Presse-toi à gauche !
Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...
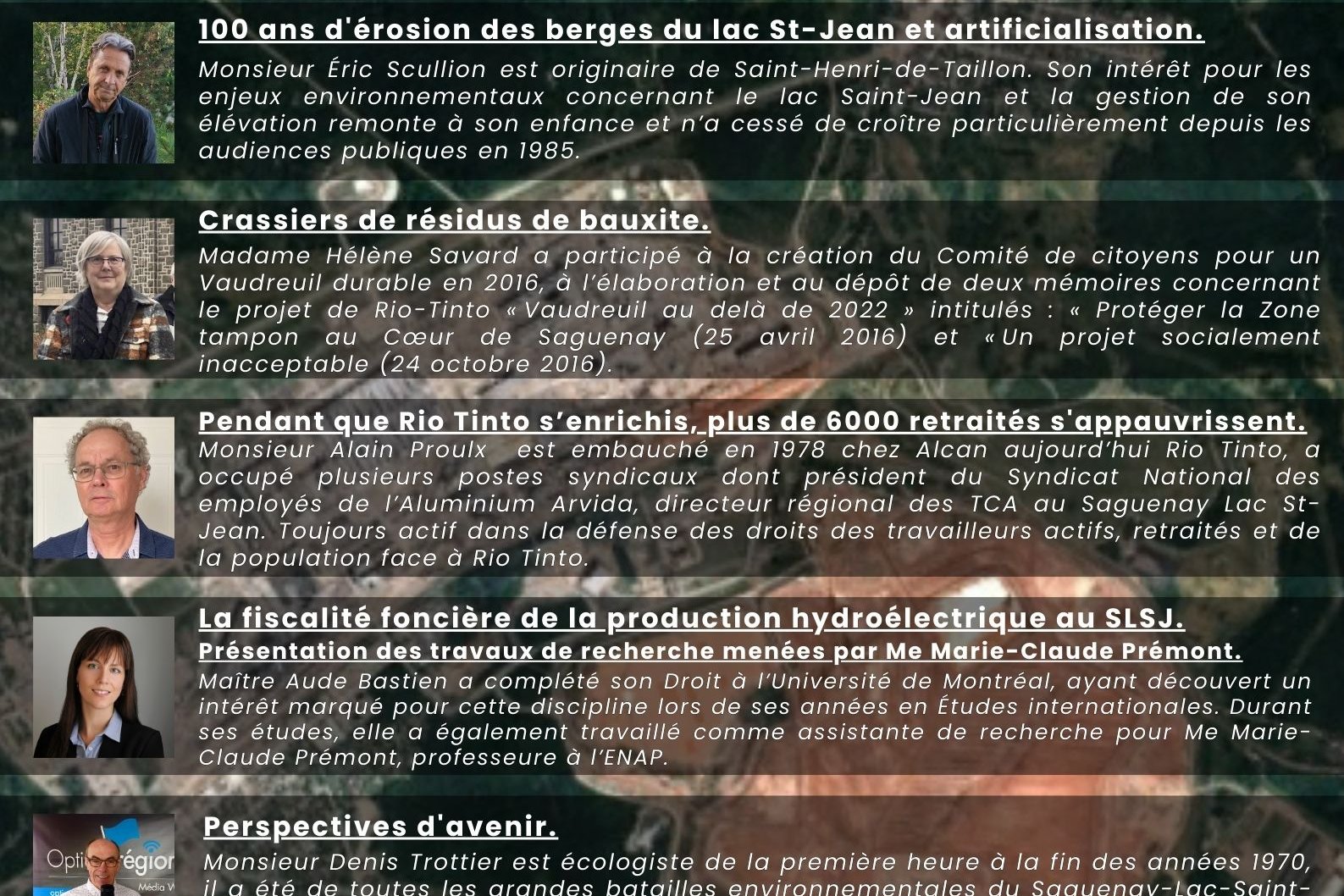
1926-2026, cent ans d’occupation par Alcan et Rio Tinto : Le bilan s’impose !

Saguenay, Québec – 8 octobre 2024 – Martine Ouellet, cheffe de Climat Québec, en collaboration avec l'Association des retraités syndiqués de Rio Tinto Alcan et d'autres partenaires annoncent la tenue d'un colloque à l'hôtel Delta à Jonquière, mardi le 22 octobre 2024 intitulé : 1926-2026, cent ans d'occupation par Alcan et Rio Tinto : le bilan s'impose !
Ce colloque sera l'occasion de faire un bilan des impacts et des retombés de la présence de Alcan/Rio Tinto depuis près de 100 ans au Saguenay et Lac St-Jean. Plusieurs personnalités tant du milieu régional comme Marc-Urbain Proulx, Denis Trottier, Alain Proulx que national comme Martine Ouellet et Robert Laplante, viendront présenter un aspect du bilan de 100 ans d'occupation.
L'année 2026 marquera le centième anniversaire de la fermeture des vannes du barrage d'Isles Malignes au Lac St-Jean et le début de l'aventure de l'aluminium dans une région qui est passée de grenier du Québec à vallée de l'aluminium Après cent ans, il est temps de regarder les choses du point de vue des résidents du Saguenay – Lac St-Jean et d'amorcer un bilan ainsi qu'une réflexion. Ces résidents étaient là avant et ils le seront après.
Berges, crassier de résidus, électricité, transformation
Si ce bilan comporte un actif important représenté par les milliers d'emplois qui ont façonné la région, il comporte également un important passif sur lequel il existe une forme d'omerta. On pense en particulier à l'artificialisation des berges du Lac Saint-Jean ou encore les gigantesques crassiers de résidus de bauxite sans parler de la pollution de l'air ou celle de l'eau qui affecte toujours les bélugas à l'embouchure du Saguenay.
Il est aussi temps d'analyser les retombés versus les privilèges consentis à Alcan lors de la nationalisation de l'électricité en contrepartie d'un contrat social pour la création d'emploi et la transformation d'aluminium. De 12 000 qu'il était au début des années 60, le nombre d'employés n'a fait que diminuer et est maintenant que de 2 700. Alors que l'électricité privé représente un équivalent de subvention d'environ 700 millions de $ par année, sans parler des passe-droits au niveau de l'impôt et des GES. Est-ce toujours aussi pertinent ? Il y aurait-il d'autres avenues pour la région ?
Que nous réserve l'avenir pour les installations de Rio Tinto ?
Est-ce que l'implantation de la nouvelle usine d'AP-60 promise à de multiple reprise verra un jour le jour ? Est-ce que la nouvelle technologie Élysis qui ressemble de plus en plus à une chimère va rencontrer ses promesses ? Comment le PL 69 risque de changer le portrait du tout au tout avec des méga parcs éoliens et la privatisation de l'électricité ?
Compte tenu de ces différents éléments, les jeannois et saguenayens ont matière à réflexion. C'est dans le but d'amorcer ce bilan et cette réflexion dans une perspective globale que se tiendra ce colloque.
SOURCE :
climat.quebec
communications@climat.quebec
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
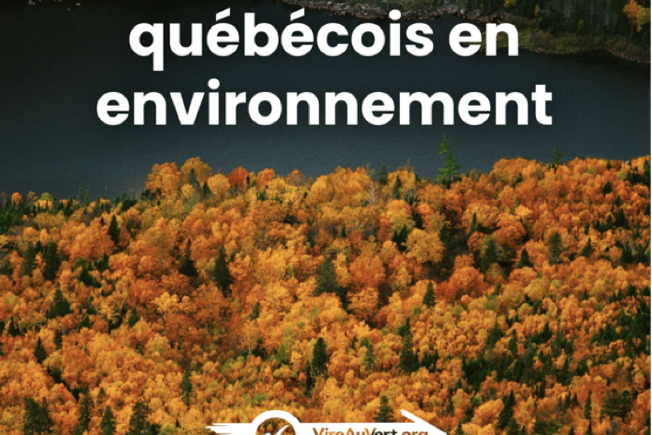
Le consensus québécois en environnement

À travers le pays, depuis maintenant des décennies, le Québec s'est démarqué en intégrant des principes environnementaux forts dans son développement économique et social. Notre nation a fait des choix ambitieux, a adopté des lois, s'est dotée de plans, a eu de grands débats de société, a mené des luttes, a bâti des infrastructures collectives et a mené des chantiers importants pour bâtir un avenir viable. Pour nous, l'aboutissement de tout ce travail représente aujourd'hui le consensus au Québec en matière d'environnement.
Ces choix représentent des acquis sur lesquels nous ne pouvons pas reculer.
C'est pourquoi nous demandons aux partis politiques fédéraux de s'engager à respecter le Consensus québécois en environnement.
Si pour vous aussi, il est non-négociable que les partis fédéraux respectent ce que le Québec a bâti et choisi depuis des années, appuyez le consensus. Demandons aux partis de s'engager formellement à respecter nos valeurs et nos acquis en matière d'environnement s'ils souhaitent se faire élire aux prochaines élections !
Notre consensus, en bref
– Nous sommes fiers d'être de grands producteurs d'énergies renouvelables et nous croyons qu'elles sont la voie de l'avenir.
Pour l'affirmer, le Québec a interdit la production d'énergies fossiles sur son territoire et fait partie d'une alliance Beyond Oil and Gas (BOGA).
– Nous croyons que les changements climatiques sont un enjeu prioritaire et nous sommes engagés à agir pour réduire les émissions de GES de notre province.
Pour y arriver, le Québec a adhéré à l'accord de Paris, s'est donné des cibles pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050, a mis en place un marché du carbone et un prix sur la pollution.
– Nous voulons réduire les déchets et le gaspillage dans notre province.
Pour y arriver, le Québec a voté une loi contre l'obsolescence programmée, pour forcer les producteurs à faire des biens plus durables et réparables. Plusieurs villes interdisent aussi les produits en plastique jetable pour diminuer les déchets.
– Nous voulons habiter des milieux de vie sains et vivants, où nous avons accès à des services de proximité et où nous pouvons profiter de la nature.
Pour y arriver, le Québec s'est doté d'une politique d'architecture et d'aménagement du territoire (PNAAT) qui cherche à concentrer la croissance urbaine près des services et infrastructures existantes et à limiter l'étalement urbain pour protéger les milieux naturels.
– Nos terres agricoles sont précieuses et cruciales pour notre résilience alimentaire. Nous voulons les protéger et les garder en bonne santé.
Pour y arriver, nous avons adopté au Québec un plan d'agriculture durable (PAD), qui prévoit des pratiques agroenvironnementales, la réduction des engrais azotés et des mesures de protection de la santé des sols. Notre politique d'architecture et d'aménagement du territoire (PNAAT) vise aussi la protection de nos terres en limitant l'étalement urbain.
– Nous aimons profondément notre territoire et nous voulons agir pour prendre soin de nos milieux naturels et de notre biodiversité.
Pour y arriver, nous nous sommes engagés à protéger 30% de notre territoire d'ici 2030, nous avons adhéré au Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal pour inverser la tendance de la perte de biodiversité et plusieurs villes interdisent l'utilisation de pesticides sur leur territoire.
– Notre eau, nos lacs, nos rivières, notre fleuve, nos milieux humides, sont des richesses collectives précieuses que nous voulons protéger contre la pollution et la destruction.
Pour y arriver, nous avons adopté une loi pour garantir “zéro perte nette” de milieux humides et hydriques.
– Nous voulons nous déplacer de manière plus durable et avoir accès à des options de transport moins polluantes, efficaces et abordables.
Pour y arriver, le Québec a adopté une loi pour cesser la vente de véhicules à essence à partir de 2035, a adopté sa norme VZE pour encourager la transition vers des véhicules plus propres et a choisi de bâtir de nouvelles infrastructures de transports en commun, comme le tramway de Québec.
Pour consulter le document complet du Consensus québécois en environnement, cliquez ici.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Quand Christian Rioux appelle à la « guerre totale » au Proche orient !
Petites « mises au point » suite à la chronique intitulée : « Pogrom »
Le Devoir, 7 octobre, 2024
Mario Charland
« On peut bien sûr avoir de bonnes raisons de penser que le coût humain payé par les Gazaouis est démesuré. [...] Mais cela ne nous explique pas comment il est possible d'éviter une guerre totale face à un ennemi qui ne veut ni vous vaincre ni vous faire reculer, mais vous exterminer et vous faire disparaître “du fleuve à la mer” ? » Je souligne.
On pourrait renverser les protagonistes du conflit israélo-palestinien dans cette citation tirée de la chronique ci-haut mentionnée du polémiste en résidence du journal Le Devoir, Christian Rioux, et on aurait le même résultat : une fraction extrémiste qui veut éradiquer la présence de l'« Autre » sur ce qu'elle considère comme étant son pré-carré et sa prérogative absolue, offert par son Dieu Tout puissant et bienveillant envers ses fidèles, ce qui leur donne le droit, et même le devoir, d'en finir avec ces « étrangers » qui souillent la Terre sacrée du Peuple élu (« Juif » dans ce cas-ci).
Mais Rioux n'en dit mot. Il n'y a que le Hamas ou le Hezbollah (ou même l'Iran) qui porte le fardeau de la faute dans cet engrenage de violence, Nétanyahou, Ben-Gvir, Smotrich, Joe Biden n'y sont pour rien car Israël a le « droit de se défendre » contre les femmes, les enfants et les journalistes palestiniens, les travailleurs humanitaires, les médecins, les chirurgiens, tous ligués contre les Juifs, tous antisémites, même les membres de l'ONU et les Cours de Justice Internationale. Comme le dit si bien notre philo-sémite : « Ce jour-là [le 7 octobre], ils [les Israéliens] ont compris qu'ils étaient seuls au monde, [...] »
On aurait envie de pleurer, ne serait-ce le fait que, en Palestine, plusieurs aimeraient bien vivre ce genre de « solitude » : L'armée la plus puissante du monde qui assure ses arrières, lui fournissant armes, munitions, renseignements, logistique, lui donnant le feu vert pour effectuer ses opérations militaires dans la région comme bon lui semble, au mépris du droit international, sans égard à la souveraineté des pays tiers, bloquant régulièrement à l'ONU toute proposition de cessez-le-feu, confondant délibérément, en toute connaissance de cause, antisionisme et antisémitisme dans le but explicite de justifier les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité perpétrés par Tsahal.
C'est sans parler de la grande majorité des pays occidentaux, alignée bien sagement derrière l'Oncle Sam, n'osant le contredire, opinant de la tête à toute déclaration aussi dénuée de sens humanitaire, d'attitude conciliatrice, d'empathie pour les populations civiles (prises pour cibles par l'armée israélienne) puissent-elles être de la part du Président de cette Superpuissance sur le déclin, en pleine décomposition socio-politique, moralement décadente, économiquement dépendante (donc parasitaire) du reste du monde, les États-Unis d'Amérique. Malheureusement (ou heureusement, dépendamment de quelle solitude on parle), l'éventuelle prochaine Présidente compte bien demeurée aveugle sur le déséquilibre évident des rapports de force entre Israël et le monde arabe.
Cela non plus, Rioux n'en fait mention nulle part. Il préfère nous partager sa contribution théorique à la science historique (qui va sûrement intéresser les historiens du monde entier) : Un Peuple qui a été victime d'un génocide ne peut pas, à son tour, devenir génocidaire envers un autre Peuple. Ce n'est pas possible ou si ce l'est, c'est sûrement pour de bonnes raisons, justifié par des circonstances atténuantes (toute critique d'Israël étant, au fond, un déni du droit aux Juifs d'exister politiquement). Pour mieux comprendre la pertinence de la découverte de M. Rioux, faisons un parallèle avec la psychologie sociale : Un enfant victime de violence parentale ne pourra pas devenir, à son tour, violent envers ses futurs enfants ; c'est impossible et impensable ; il est trop « conscient » des conséquences néfastes pour l'être humain de tels traitements traumatisants. Tous les pédopsychiatres savent cela !
La solution est donc simple et limpide : Pour que les Occidentaux (USA en tête) considèrent comme « légitime » l'aspiration des Palestiniens à former un État, ils doivent se débarrasser du Hamas, laissant ainsi toute latitude à l'extrême-droite israélienne d'accomplir son projet « sioniste » d'un Grand Israël au Proche-Orient, dans lequel seuls les « Juifs » seront considérés comme des citoyens à part entière, les autres confessions, populations, ethnies devant accepter leur statut d'infériorité congénitale dont la destinée sera dictée par le Peuple élu de Dieu. En d'autres termes, c'est le Troisième Reich, version israélite...
Bref, si comme l'
affirme Christian Rioux : « Le 7 octobre aura donc été le premier pogrom du XXIe siècle. », Gaza sera, pour sa part, le premier génocide... et non le dernier...
Mario Charland
Shawinigan
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
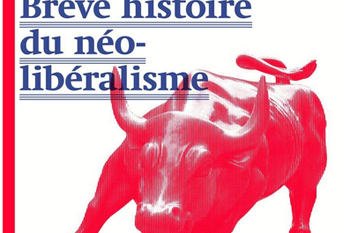
David Harvey, « Brève histoire du néolibéralisme »

Il faut féliciter les éditions Amsterdam pour leur réédition de cet ouvrage de David Harvey, initialement paru en 2005. L'auteur est un géographe et économiste marxiste de renommée internationale dont la revue L'Anticapitalistea déjà traite des travaux, en juin 2023 [1]. Harvey résume ainsi l'objet de ce livre : fournir une « histoire politico-économique des origines du néolibéralisme et de sa prolifération généralisée sur la scène mondiale ».
9 octobre 2024 | tiré du alencontre.org
https://alencontre.org/economie/david-harvey-breve-histoire-du-neoliberalisme.html
Avant la déferlante néolibérale fonctionnait ce que l'auteur qualifie de « libéralisme intégré » basé sur un « compromis de classe » entre le capital et le travail. Il est à regretter que Harvey ne dise pratiquement rien sur les raisons et facteurs de développement de ces politiques. Toutefois, il signale à juste titre que les bénéfices du libéralisme intégré furent en fait limités aux pays capitalistes les plus développés.
A la fin des années 60, le modèle commença à s'effondrer tant au niveau national qu'à l'échelle internationale : suraccumulation du capital, croissance en berne, « stagflation » (chômage et inflation simultanés), déficits budgétaires, impuissance des politiques keynésiennes, crise du système monétaire international issu de Bretton Woods. A partir de là, se présentaient deux possibilités. La première, exprimée confusément par Harvey, était la radicalisation des politiques antérieures. L'auteur explique que cela a été plus ou moins tenté dans divers pays mais que cela s'est avéré incompatible avec l'accumulation du capital et que la gauche s'est montrée incapable d'aller au-delà des solutions sociales-démocrates (il faut regretter que cette question essentielle soir traitée de manière allusive et peu claire, sans aucune allusion au principal élément socio-politique de la question : l'affrontement avec la classe dominante). Ce fut donc l'heure du néolibéralisme dont les pères fondateurs avaient brandi l'idéal de la liberté individuelle (ce qui a un attrait quasiment irrésistible aux yeux de larges secteurs des populations) et ont affirmé que les libertés individuelles supposaient la liberté du marché et des échanges. Sous cet habillage, le projet politique du néolibéralisme était en fait le rétablissement des conditions d'accumulation du capital et la restauration du pouvoir des élites économiques
Après l'expérimentation consécutive au coup d'Etat au Chili, le tournant majeur intervient en 1979-1980 avec l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher et la hausse drastique des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine dirigée par Paul Volcker qui vise à réduire l'inflation quel qu'en soit le coût pour l'emploi. En 1980, Reagan est élu président des Etats-Unis. Ensuite, le néolibéralisme s'est généralisé et imposé mais de manière différenciée en fonction des caractéristiques des différents Etats.
Les années qui suivent sont marquées par le développement de l'endettement international. Sous prétexte de faire face aux crises de la dette, FMI et Banque mondiale se font les relais internationaux des politiques néolibérales. Avec le « consensus de Washington », dans les années 90, les Etats-Unis épaulés par le FMI et la Banque mondiale ont fait de leur modèle la réponse aux problèmes du monde. Il s'agissait en fait d'ouvrir la majeure partie des Etats à la libre circulation des capitaux. Des dynamiques internes et des forces externes ont joué en ce sens mais Harvey souligne à juste titre que « parfois tout se passe même comme si le FMI ne faisait que prendre la responsabilité des réformes voulues de toute façon par la classe dirigeante de tel ou tel pays ».
Le néolibéralisme a renforcé le pouvoir de la classe dominante tout en favorisant sa reconfiguration : aux dirigeants des grandes entreprises et entités financières se sont ajoutés les détenteurs des fortunes rapides réalisées dans les nouveaux secteurs-phares, notamment les NTIC. Pratiquement partout, on a assisté à une énorme concentration des richesses.
Le fossé entre le capital industriel ou marchand et le capital financier a disparu, le pouvoir du monde de la finance s'est accru tandis que la stabilité du système financier est devenue le principal souci des Etats néolibéraux. Cette classe dirigeante est internationalisée tout en restant liée à des appareils d'Etat nationaux pour les avantages et la protection qu'elle en retire.
Après cette description de la montée et des différentes facettes du néolibéralisme, Harvey cherche à montrer comment, hors le cas du Chili où le néolibéralisme s'est imposé par la répression militaire, il a su créer un consensus qui a permis à des politiciens de gagner des élections et de mettre en œuvre leurs orientations.
Harvey développe en premier lieu les cas des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne (les brefs éléments concernant la France sont approximatifs et discutables). Aux Etats-Unis, on a assisté à la combinaison d'une offensive idéologique multiforme grassement financée par les milliardaires, d'une agression antisyndicale menée avec acharnement par Reagan, d'une capacité à accentuer les divisions entre salariés et du ralliement des deux grands partis, républicain (avec dans ce cas une alliance entre big business et chrétiens conservateurs) et démocrate, aux logiques néolibérales. Un chapitre entier est consacré à la Chine : Harvey y voit une marche particulière vers la libéralisation et la reconstitution d'un pouvoir de classe, « un néolibéralisme à caractéristiques chinoises » qui a permis la croissance économique et panache autoritarisme, nationalisme et certaines formes d'impérialisme rejoignant, selon lui, la vague néo-conservatrice américaine
Le rôle de l'Etat dans la théorie néolibérale est relativement simple : garantir le fonctionnement du marché. Le libre jeu de la concurrence est la meilleure solution, quitte à inventer des mécanismes de marché face à des problèmes nouveaux : comme le marché des droits à polluer. Pour se protéger des menaces que les processus électoraux pourraient faire peser sur la stabilité du marché, les gouvernements néo-libéraux donnent des pouvoirs à des institutions « indépendantes », comme les banques centrales, les cours de justice (on pourrait y ajouter l'édifice des traités européens : « Il ne peut pas y avoir de choix démocratique contre les traités européens » avait déclaré le président de la Commission en janvier 2015 après la victoire électorale de Syriza en Grèce). En fait, malgré son discours, l'Etat néolibéral se méfie de la démocratie et ses résultats économiques et sociaux sont en décalage par rapport à ses proclamations.
Cependant, on constate des pratiques souvent disparates entre les Etats néolibéraux, certaines renvoient à des considérations pragmatiques ou opportunistes, d'autres aux contextes socio-politiques. Tandis que, aussi bien les Etats nationaux que les institutions internationales comme le FMI, font des entorses aux principes pour sauver des institutions financières qui se sont mises elles-mêmes en difficulté.
Harvey souligne que l'Etat néolibéral est instable. Il est de plus en plus paradoxal de vanter les vertus de la concurrence quand la monopolisation de l'économie se renforce, que les scandales financiers se multiplient, que les travailleurs font les frais de la flexibilité, que les inégalités explosent et que les solidarités se désagrègent. Pour faire face aux mécontentements, l'autoritarisme et les méthodes policières se renforcent tandis que l'Etat néolibéral en appelle de plus en plus au nationalisme face aux désordres internes et à la compétition internationale. Harvey souligne que les contradictions du néolibéralisme peuvent être porteuses de dérives encore plus dangereuses, centrées sur les valeurs morales, le racisme, etc.
Dans un chapitre intitulé « le néolibéralisme en procès », Harvey revient sur les résultats de la néolibéralisation. Il souligne leurs limites : les politiques néolibérales n'ont pas réussi à impulser une nouvelle phase de croissance mondiale. L'Asie de l'Est (avec la Chine) et l'Inde semblent infirmer ce diagnostic mais il s'agit d'Etats poursuivant des politiques spécifiques et non alignées sur le « consensus de Washington ». Le seul succès du néolibéralisme est en fait le contrôle de l'inflation. L'auteur relativise l'impact du développement des technologies de l'information (ce qui pourrait déboucher sur des débats essentiels qu'il n'aborde pas).
Selon Harvey, ce qui marque en fait la phase actuelle du capitalisme c'est ce qu'il qualifie d'« accumulation par dépossession » : une extension généralisée de la sphère marchande qui transforme en marchandises tout une série de biens et d'activités qui bénéficiaient antérieurement à la masse des populations. C'est un point essentiel dont il souligne la continuité avec l'accumulation primitive décrite par Marx.
Harvey conclut son livre en évoquant les crises dont est porteur le néolibéralisme. Des crises financières violentes sont inévitables. La classe dominante en est consciente mais ne fait pratiquement rien pour les prévenir. Un des fondements de cette attitude est sa confiance à pouvoir s'en tirer sans trop de mal. Mais ce scenario pourrait s'avérer fallacieux : une crise financière majeure pourrait accentuer un basculement accentué de l'état du monde au profit de l'Asie ou bien rogner malgré tout les capacités de contrôle de la société par les dominants. Par ailleurs, la néolibéralisation génère de nombreux mouvements contestataires dont une grande partie se distingue des mouvements à base ouvrière autrefois dominants. Ce qui ne signifie pas, souligne Harvey, la mort des mouvements ouvriers, ni dans les vieux pays industriels, ni dans les nouveaux. Les luttes contre l'accumulation par dépossession font naître de nouveaux mouvements enracinés dans le quotidien et le local. Ils ont certes produit ou favorisé la production d'une pléthore d'idées alternatives mais ont, souligne justement l'auteur, souvent du mal à aller au-delà de la question sur laquelle chacun d'entre eux s'est constitué pour appréhender la nature de classe des politiques auxquelles ils se heurtent.
Comme on l'a signalé plus haut, certains développements de Harvey apparaissent parfois confus, voire discutables. Par ailleurs, il semble inutile d'essayer de comprendre les graphiques joints au texte étant donné leur faible lisibilité mais cela est de la responsabilité de l'éditeur. Mais cela ne réduit pas l'intérêt d'un livre extrêmement utile pour comprendre le néolibéralisme dans sa globalité.
[1] VoirThierry Labica, « Petite invitation au marxisme de David Harvey », Revue L'anticapitaliste, Numéro 146, mai 2023 | L'Anticapitaliste (lanticapitaliste.org)
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
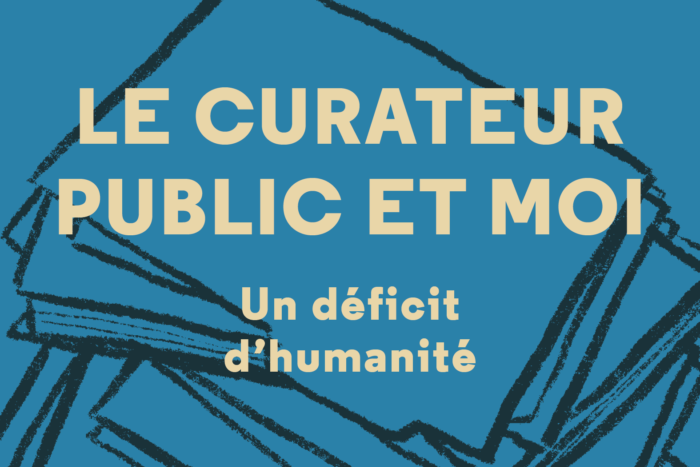
Livre Le Curateur public et moi - Parution le 29 oct.
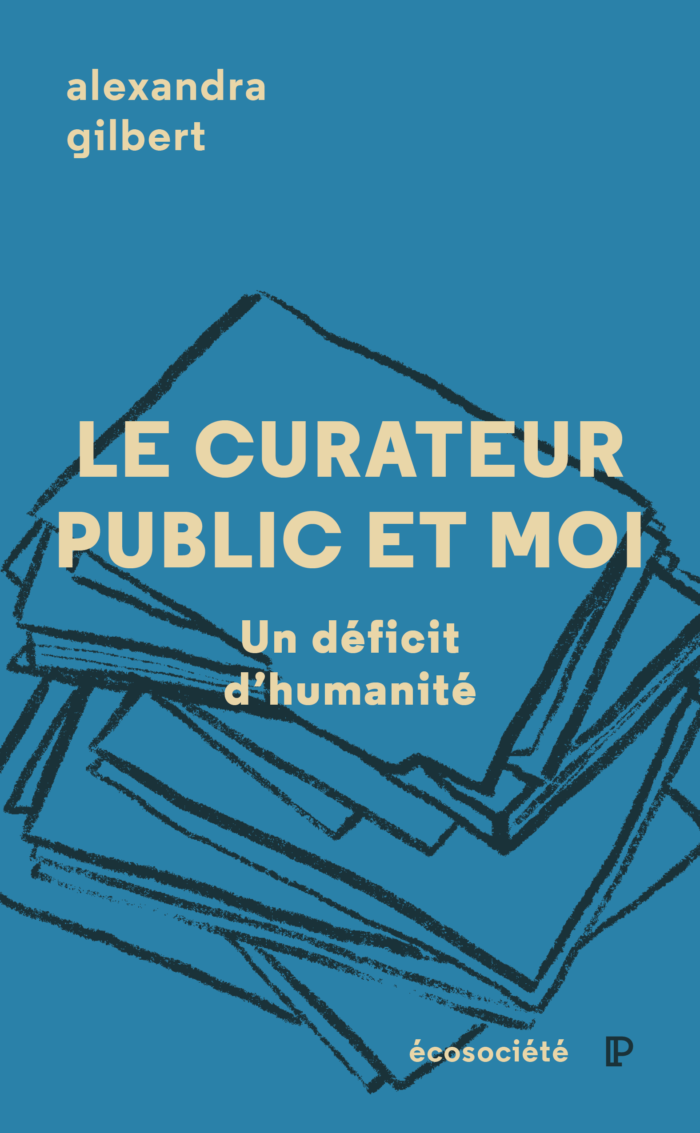
| Une représentante légale dénonce les pratiques du Curateur public
*Alors que le Protecteur du citoyen constatait, en septembre dernier, une «
déshumanisation » des services offerts par l'État québécois, une
représentante légale dénonce les pratiques opaques et étouffantes d'une
institution publique essentielle, mais méconnue : le Curateur public du
Québec.*
Le livre *Le Curateur public et moi - Un déficit d'humanité*, de
l'autrice Alexandra Gilbert, paraîtra *en librairie le 29 octobre prochain.*
*En bref* : On parle beaucoup, avec raison, de maltraitance envers les
personnes vulnérables, mais il faut aussi parler de *surveillance excessive*
et de *déshumanisation des proches aidants et représentants légaux*. Une
représentante légale lève ainsi le voile sur les pratiques étouffantes et
opaques d'une institution nécessaire, mais méconnue : le Curateur public.
*À propos du livre*
« “Ma blonde, elle aide son père handicapé et le Curateur public la traite
comme un bandit.” Cette phrase délicieusement franche de mon amoureux a
fait son chemin dans ma prise de parole. […] J'ai réfléchi. Aux années de
demandes incessantes du Curateur public qui avaient contribué à me
maintenir dans un stress constant, dans une sorte d'état d'hypervigilance.
Au manque de transparence et de professionnalisme de l'institution. Aux
règles obscures et froides qui régissent la fonction de représentant légal.
J'ai décidé que c'en était assez. »
*Le Curateur public et moi* est le récit sans concession d'une citoyenne
dévouée qui assume depuis 25 ans le rôle de représentante légale de son
père victime d'un AVC. Si la réalité de « proche aidant·e » nous est
maintenant familière, il en va tout autrement de celle de « tuteur ou
tutrice » d'un proche adulte déclaré inapte, alors qu'elle est vécue par
près de 10 000 personnes au Québec. Alexandra Gilbert lève ainsi le voile
sur les répercussions concrètes de ce rôle au quotidien, à commencer par
l'expérience de la bureaucratie opaque, étouffante et rigide du Curateur
public du Québec.
Bien que la mission du Curateur public de « veiller à la protection des
personnes inaptes, à la sauvegarde de leur autonomie et au respect de leurs
droits » soit essentielle, l'essai met plutôt en lumière le stress,
l'incompréhension et le sentiment d'isolement et de solitude qui
accompagnent bien souvent le vécu des représentants légaux, alors que le
Curateur prétend soutenir les familles et les proches dans leur fonction.
L'organisme Proche aidance Québec a d'ailleurs développé le concept de «
maltraitance organisationnelle », qui « [...] réfère, entre autres, à une
négation des compétences apportées par la personne proche aidante à la
personne aidée, à l'absence de transmission d'informations pour l'aider
dans son rôle, tout en la laissant se débrouiller seule. » Ce concept
pourrait-il également s'appliquer aux représentants légaux ?
Dans un contexte de vieillissement de la population, où le nombre de
personnes sous tutelle risque de croître, *Le Curateur public et moi* est
un vibrant plaidoyer pour que le rôle fondamental que jouent les
représentants légaux dans notre société soit enfin soutenu et reconnu à sa
juste valeur. Faute de quoi des familles et des proches de personnes
vulnérables pourraient, à l'avenir, craindre de prendre soin d'elles…
Est-ce ce que nous voulons comme société ?
*À propos de l'autrice*
Alexandra Gilbert a travaillé pendant 20 ans en développement
international. Auteure de deux romans (*Gourganes*, 2017 et *Obsolète*,
2022, tous deux chez Stanké), elle œuvre désormais comme rédactrice et
gestionnaire de projets. Représentante légale de son père handicapé depuis
25 ans, *Le Curateur public et moi* est son premier essai.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
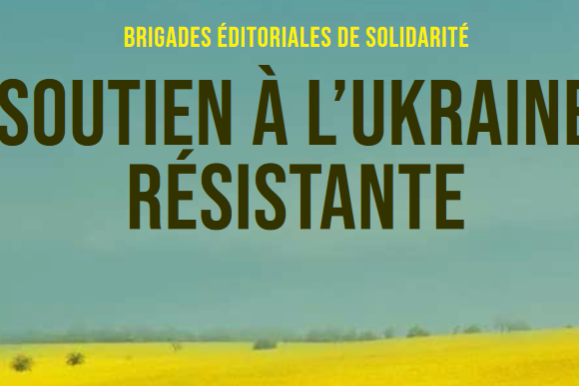
Soutien à la résistance ukrainienne
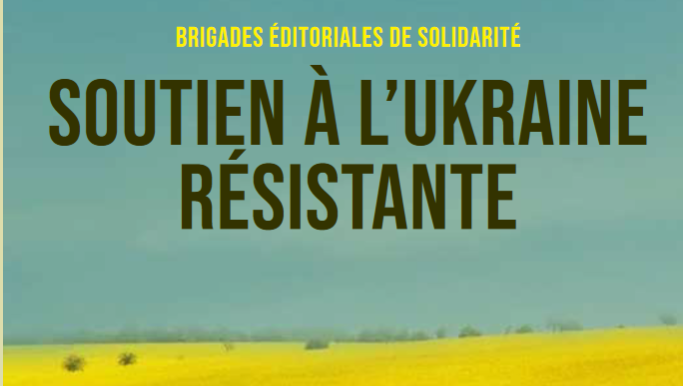
Le ficher PDF du livre à télécharger
3
Table des matières
CE N'EST QU'UN DÉBUT CONTINUEZ À TERGIVERSER
CHRISTIAN MAHIEUX
5
CARNET DE BORD DE LA GUERRE EN UKRAINE
Menace nucléaire russe, batailles de Koursk et de Vuhledar…
ANTOINE RABADAN
8
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Des syndicalistes ukrainiens en tournée dans l'État espagnol
ALFONS BECH
32
Intercepted : salle comble pour la projection en avant-première au Louxor
SOPHIE BOUCHET-PETERSEN
40
Déportation, adoption, russification des enfants ukrainiens
ROBI MORDER ET MARIANA SANCHEZ
42
Carnet de voyage
MANON BOLTANSKY ET NICO DIX
44
Deuxième assemblée générale du Comité français du Réseau européen de solidarité avec l'Ukraine
BERNARD DREANO, ROBI MORDER, MARIANA SANCHEZ
54
FÉMINISMES
Travail des femmes : comment la guerre a changé le marché du travail en Ukraine
ALIONA TKALITCH
59
Une perspective féministe
L'ATELIER FÉMINISTE
62
Le dilemme de la violence domestique en Ukraine
RUCHI KUMAR
63
Féministes en lutte contre l'impérialisme russe
UNE VIDÉO PRODUITE PAR FRIEDA AFARY ET L'ATELIER FÉMINISTE DE
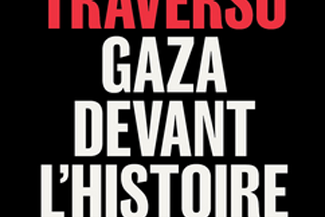
Enzo Traverso : « Le concept de génocide à Gaza apparaît clairement justifié »
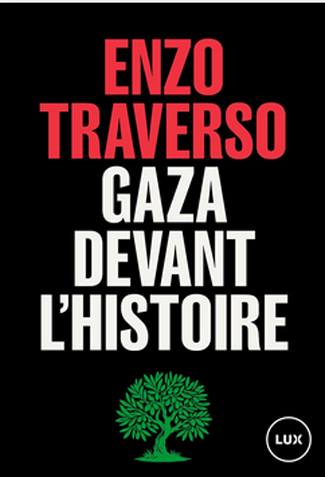
Auteur d'un grand nombre d'ouvrages sur le nazisme, l'antisémitisme ou « la guerre civile européenne de 1914 à 1945 », l'historien s'interroge dans son nouvel essai sur la signification – et les supposées justifications – de la violence israélienne contre Gaza et les Palestiniens aujourd'hui.
2 octobre 2024 | tiré de lettre de Lux éditeur
https://luxediteur.com/catalogue/gaza-devant-lhistoire/
Enzo Traverso, Italien, né en 1957, est venu enseigner l'histoire dans les universités parisiennes dans les années 1980, se spécialisant sur l'antisémitisme, le nazisme et la violence de la première moitié du XXe siècle. Professeur à Cornell University (New York), spécialiste de l'histoire du judaïsme, du sionisme et de l'antisémitisme, il est l'auteur de nombreux ouvrages traduits à travers le monde. Son regard sur la guerre qui fait rage aujourd'hui en Palestine – et désormais au Liban – en fait donc un observateur particulièrement pertinent sur l'évolution de la tragédie en cours.
Au début de votre nouveau livre, Gaza devant l'histoire, vous citez les propos d'un gradé israélien : « Rien n'arrive par hasard ; tout est intentionnel. Et s'il est nécessaire de tuer une petite fille de 3 ans dans une maison de Gaza, c'est parce que quelqu'un dans l'armée a décidé qu'il n'était pas grave qu'elle meure, que c'était le prix à payer pour atteindre [une autre] cible. Nous savons exactement combien de dommages collatéraux il y a dans chaque maison. » Il y a donc bien une « intention génocidaire » ?
Enzo Traverso : Vous avez raison de souligner qu'il y a eu des déclarations – multiples – de hauts gradés mais aussi des principaux ministres du gouvernement israélien, qui ont clairement affiché l'objectif de cette guerre. Même si ce terme de « guerre » ne me semble pas très approprié, puisqu'il ne s'agit pas d'une guerre au sens classique du terme, dans le sens où nous n'assistons pas à un affrontement entre deux armées, mais bien plutôt à la destruction planifiée et systématique d'un territoire encerclé par une armée faisant face à une résistance militaire de groupes dont l'armement n'est en rien comparable à celui de l'armée israélienne.
[…]
Voir la suite dans Politis.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Un franc succès pour la première Grande Marche lavalloise contre les violences sexuelles

Laval, 9 octobre 2024 — La Table de concertation en violence conjugale et agressions à caractère sexuel de Laval (TCVCASL) et le projet Laval alliée contre les violences sexuelles (LACVS), une initiative possible grâce à la Politique régionale de développement social de Laval (PRDS), sont fiers d'annoncer le grand succès de la première Grande Marche lavalloise contre les violences sexuelles, s'étant tenue le 5 octobre dernier.
« Cette première grande marche contre les violences sexuelles marque un tournant pour la communauté lavalloise, démontrant une mobilisation collective et une volonté forte de lutter contre ce fléau. L'organisation exemplaire et la participation de nombreuses personnalités montrent l'importance accordée à cette cause essentielle pour le bien-être de tous » a déclaré Alberto Georgian Mihut, rédacteur en chef du Média Communautaire Lavallois.
Une initiative locale qui mobilise à l'échelle transrégionale
Des organismes et des citoyen.ne.s venu.e.s de régions aussi éloignées que Joliette et Saint-Ours, et d'autres de Terrebonne, Boucherville et Montréal se sont joints par centaines à cette marche. Des élu.e.s, des organisations spécialisées en violence sexuelle ou conjugale, ainsi que des représentant.e.s de divers secteurs (scolaire, pauvreté, itinérance, etc.) ont répondu à l'appel, rassemblant des participants âgés de 7 à 77 ans.
« Je viens de Boucherville. C'est la première fois que je participe à une manifestation de toute ma vie. Ma fille ne pouvait pas venir […] je suis venue toute seule […] c'était trop important pour moi » a partagé une marcheuse.
TABLE DE CONCERTATION EN VIOLENCE CONJUGALE ET
LAVAL ALLIÉE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES AGRESSION À CARACTÈRE SEXUEL DE LAVAL
Une première Grande Marche en bonne compagnie L'animateur et chroniqueur Jordan Dupuis a eu l'honneur d'animer l'évènement. Les discours inauguraux de Sandra El-Helou, conseillère municipale de Souvenir-Labelle et responsable des dossiers de la condition féminine, en remplacement du maire Stéphane Boyer, ainsi que et de Christopher
Skeete, ministre responsable de la région de Laval, ont marqué le début des activités. Ils ont exprimé leurs félicitations aux organisateur.trice.s et aux participant.e.s, mettant de l'avant l'importance cruciale de cette mobilisation pour la communauté.
L'invitée d'honneur, Manon Massé, et la porte-parole officielle, Léa Clermont-Dion, ont également contribué à l'enthousiasme ambiant, scandant des slogans tout au long de la marche. Leurs discours ont été réservés pour la clôture de l'évènement.
« Laval. Tous allié.e.s », l'un des slogans solidaires scandés pendant la marche
Présences notables
Parmi les personnalités présentes, on retrouvait l'invitée d'honneur, Manon Massé, députée de Sainte-Marie–Saint-Jacques et ancienne travailleuse du Centre des Femmes de Laval ; Léa Clermont-Dion, autrice et militante reconnue, porte-parole officielle
de l'évènement ; Christopher Skeete, député de Sainte-Rose et ministre responsable de la région de Laval ; Sandra El-Helou, conseillère municipale de Souvenir-Labelle et responsable des dossiers de la condition féminine, en remplacement du
maire Stéphane Boyer ; Ruba Ghazal, députée de Québec solidaire dans Mercier et porte-parole parlementaire du deuxième groupe d'opposition en matière de condition féminine ; Virginie Dufour, députée de Mille-Îles ; Valérie Schamltz députée de Vimont ; Cecilia Macedo, conseillère municipale de Marigot ; Christine Poirier, conseillère municipale de Duvernay-Pont-Viau ; Silvio Manfredi, Adjoint au directeur de la Santé publique de Laval ; ainsi que, Martin Camiré, directeur Santé mentale et dépendance du CISSS de Laval.
Leur présence a amplifié le message de solidarité et d'engagement dans la lutte contre les violences sexuelles.
Les discours d'ouverture ont été prononcés sur la plateforme du Boombox, un haut-parleur géant et mobile, qui a ouvert la voie au contingent de la Grande Marche lavalloise
À la rencontre de la communauté : une lutte universelle
La Grande Marche lavalloise a été conçue pour rassembler tous les membres de la communauté. Le parcours, court et accessible, était adapté aux familles et aux personnes à mobilité réduite. Des interprètes de la langue des signes du Québec (LSQ) du Service d'Interprétation Visuel et Tactile (SIVET) étaient présents pour garantir l'inclusivité. Escortés par le Service de police de Laval, les marcheuses et marcheurs ont atteint le Parc Bernard-Landry, où ils ont pu visiter des kiosques de sensibilisation, renforçant ainsi le message contre les violences sexuelles.
Moments forts
La journée a été ponctuée de plusieurs moments marquants, notamment les discours inspirants de Manon Massé et Léa Clermont-Dion. Le duo n'a pas manqué de revenir sur les évènements entourant les déclarations misogynes de Stéphane Venne à l'égard de Clermont-Dion, survenu quelques jours avant la Grande Marche lavalloise, soulignant ainsi toute la pertinence de poursuivre les luttes contre toutes les formes de violence faites aux femmes. Elles ont également félicité les organisateur.trice.s pour leur initiative remarquable en matière de prévention et de sensibilisation, exprimant leur fierté de participer à un tel mouvement.
Jordan Dupuis a souligné la surreprésentation des personnes LGBTQ+ parmi les personnes victimes et survivantes de violences sexuelles. La directrice de la TCVCASL, Genevieve Dionne, Travailleuse sociale, a également fait allusion à l'affaire Pelicot, plaidant que la lutte aux violences sexuelles continue d'être un enjeu social, politique et de santé publique réel, urgent et contemporain.
Plusieurs enfants ont monté sur scène pour dévoiler une œuvre collective réalisée sur place : une banderole intitulée Les petit.e.s allié.e.s. Juliette Bélanger-Charpentier, Chargée de projet à la mobilisation et aux communications de la TCVCASL, a expliqué : « Il s'agit d'une activité toute simple, mais nous espérons qu'elle servira de levier pour aider les
parents à aborder avec leurs enfants des sujets essentiels tels que la santé sexuelle, l'égalité entre les genres et le consentement. »
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Mobilisation contre les féminicides : La 21e est encore en vie !

Québec, 10 octobre 2024 - Des groupes de femmes et des féministes se sont rassemblés jeudi midi à l'Assemblée nationale pour répondre à l'appel à la mobilisation du Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale. Face au 20e féminicide survenu dans la province, elles souhaitaient alerter la population et dénoncer l'inaction et le silence du gouvernement face à l'ampleur des féminicides.

Violences banalisées
Les manifestantes réunies déplorent la banalisation des violences faites aux femmes. « Les féminicides sont la pointe de l'iceberg des violences faites aux femmes. Vingt féminicides ont eu lieu cette année, et combien de milliers d'autres femmes ont été victimes de violence conjugale ou sexiste ? Comment le gouvernement pense s'y prendre pour empêcher le 21e féminicide ? » alerte Alexandra Beale, de la Maison Marie-Rollet. Les organisatrices du rassemblement soutiennent que les solutions pour mettre fin aux violences sont multiples : augmentation du financement en prévention, en accompagnement et en hébergement des femmes victimes de violences conjugales et sexuelles, formations obligatoires et continues sur la violence conjugale et le contrôle coercitif pour toutes les personnes intervenant auprès des femmes et des enfants, éducation à des modèles de relations basés sur l'égalité, déconstruction des discours qui banalisent les violences et adoption d'approches qui reposent sur la responsabilisation des agresseurs.
Contexte social difficile
Lors du rassemblement, les militantes ont aussi fait des liens entre le contexte actuel d'augmentation du coût de la vie et les violences faites aux femmes. Elles déplorent que la réforme de l'aide sociale précarise et appauvrisse les femmes victimes de violence conjugale notamment en abolissant les prestations additionnelles pour les femmes hébergées en maison d'hébergement. Les femmes se retrouvent prises au piège dans des relations violentes, une situation complexifiée par l'inflation, la crise du logement, le sous-financement des services publics et des groupes communautaires. « Depuis le début de l'année, 20 femmes ont été assassinées. Pourtant, au printemps dernier, la ministre responsable de l'Habitation bloquait les projets de maisons d'hébergement parce qu'ils coûtent trop cher. Nous sommes ici parce qu'il est urgent que nous retissions un filet de sécurité autour des victimes et nous exigeons du gouvernement qu'il prenne des engagements clairs pour lutter contre les violences faites aux femmes » explique Élise Landriault-Dupont, du Regroupement des groupes de femmes de la Capitale-Nationale.
Regroupement des groupes de femmes de la Capitale-Nationale
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Lettre à un ancien acheteur de services sexuels

Depuis un an et demi, je partage la vie d'un survivant de la prostitution. J'ai découvert ce monde, qui m'était inconnu auparavant, à travers lui et son projet d'exposition sur le sujet, que je l'ai aidé à mettre en œuvre. L'exposition Force de vivre (expoforcedevivre.com) a été présentée en avril dernier au Centre communautaire et résidentiel Jacques-Cartier à Québec, et sera affichée à nouveau le mois prochain au Théâtre Périscope.
En constatant les séquelles que leur passage dans l'industrie du sexe laisse sur les personnes qui se prostituent, la lutte contre l'exploitation sexuelle est rapidement devenue une cause chère à mon cœur.
Récemment, j'ai croisé le chemin d'un ancien acheteur de services sexuels. Il disait de sa conjointe, qu'il a rencontrée la première fois pour une transaction de cette nature, que c'était son choix si elle avait commencé à consommer à l'adolescence et en était venue à se prostituer pour payer sa drogue. Son propos m'a fait réagir fortement. Pour bien lui expliquer mon point de vue sur le sujet et pourquoi je suis en total désaccord avec lui, je lui ai écrit une lettre. Je la partage ici :
« Mon cher,
J'ai décidé d'écrire un texte, pour t'expliquer les raisons profondes derrière ma vision du choix…
Figure-toi que j'ai déjà eu une vision du choix assez semblable à la tienne, mais ma pensée a beaucoup évolué à travers mes études en santé communautaire et mes expériences de vie des dernières années.
Je t'amène donc à adopter une vision plus globale de la société, que de focaliser sur des individus comme mon conjoint ou ta conjointe. Je t'amène aussi à regarder plus globalement les habitudes de vie des gens, et non pas parler seulement de drogue ou de prostitution.
On peut s'entendre pour dire que les situations dans lesquelles les individus se retrouvent (état de santé, dépendance, pauvreté, etc.) dépendent en partie des habitudes de vie qu'ils adoptent (ex. : faire du diabète si on a de mauvaises habitudes alimentaires, avoir un cancer du poumon si on fume, être pauvre si on dépense tout son argent en drogue…). À tes yeux, selon ce que j'ai compris, ce que les individus mangent, boivent, s'ils font de l'exercice ou pas, s'ils fument ou pas, s'ils prennent de la drogue ou pas, ce sont leurs choix.
Si je te dis maintenant que selon un rapport de la santé publique de la Capitale-Nationale de 2018, il y a environ 8 ans de différence d'espérance de vie entre la population des quartiers de la Haute-Ville et celle des quartiers de la Basse-Ville à Québec : les gens de la Haute-Ville (quartiers les plus riches) vivent en moyenne 8 ans de plus que les gens de la Basse-Ville (quartiers les plus pauvres).i Est-ce que cela veut dire que les gens de la Basse-Ville sont tellement niais qu'ils font des choix qui vont les mener à mourir 8 ans plus tôt que ceux de la Haute-Ville ?
Je ne pense pas que les gens de la Basse-Ville sont niais. Je pense juste qu'ils vivent dans des conditions qui font en sorte qu'ils n'ont pas la possibilité de faire les mêmes choix que les gens de la Haute-Ville. Ils sont plus nombreux à avoir grandi dans des environnements familiaux dysfonctionnels, à avoir vécu de la violence et des abus, à ne pas avoir eu le soutien dont ils auraient eu besoin pour développer leur plein potentiel, etc. Ils se retrouvent donc à l'âge adulte avec des problèmes de santé mentale, avec un niveau d'éducation plus faible, à ne pas pouvoir accéder à des emplois bien rémunérés, etc. Donc les choix qu'ils font ne sont pas réellement des choix, puisque s'ils avaient les mêmes possibilités que les gens de la Haute-Ville, ils feraient fort probablement les mêmes choix qu'eux et vivraient aussi longtemps qu'eux. Ils font les choix qu'ils peuvent avec les possibilités qu'ils ont.
Donc dire des individus qui adoptent des habitudes de vie néfastes pour leur santé et leur bien-être (habitudes alimentaires, sédentarité, tabagisme, consommation de drogues, etc.), que ce sont uniquement leurs choix, c'est nier tous ces facteurs sociaux. C'est faire reposer sur les épaules des individus l'entière responsabilité des situations difficiles dans lesquelles ils se retrouvent, alors qu'ils sont loin d'en être entièrement responsables.
Pourquoi certaines personnes défendent-elles si ardemment cette idée de choix et de responsabilités individuels ? Qui sont ces personnes qui défendent le plus ardemment ces idées ? Ce sont celles qui ont le plus à gagner à défendre ces idées et le plus à perdre si l'idée de responsabilité collective fait sa place dans la société. Ce sont les personnes mieux nanties pour qui la pauvreté d'une partie de la société est très profitable. Parce que oui, le fait qu'il y ait des personnes moins éduquées, qui ne sont pas bien outillées pour défendre leurs droits, qui sont incapables d'accéder à des emplois avec de bonnes conditions de travail, qui ne sont parfois même pas capables d'accéder à de vrais emplois (pour différentes raisons, comme des problèmes de santé mentale ou de dépendance), ça profite à bien du monde. Ceux qui se remplissent les poches et assouvissent leurs envies en sous-payant leurs employés, en vendant de la drogue à des personnes dépendantes, en vendant ou en achetant les services sexuels d'autres personnes, etc., ils n'ont aucun intérêt à reconnaître la responsabilité de la société et leur propre responsabilité dans les conditions dans lesquelles vivent ces personnes dont ils profitent. En disant que les habitudes de vie de ces personnes (habitudes alimentaires, sédentarité, tabagisme, toxicomanie, prostitution…) sont leurs choix uniquement, ils s'en lavent les mains et peuvent continuer d'exploiter la vulnérabilité de ces personnes à leur guise, en disant que si leurs conditions de vie ne leur plaisent pas, elles n'ont qu'à faire des choix différents.
Prendre conscience qu'on n'est pas l'unique responsable des conditions de misère dans lesquelles on se trouve, c'est le premier pas vers la guérison. Arrêter de s'autoflageller en se disant qu'on a été stupide de faire ces mauvais choix et reconnaître qu'on n'avait pas toutes les possibilités pour faire de meilleurs choix, ça enlève un gros poids. Ça aide à sortir la tête de l'eau, à devenir plus bienveillant envers soi-même, à se construire une estime, qui nous permettra d'aller chercher des outils pour nous aider à prendre réellement du pouvoir sur notre vie et à faire des choix différents.
Voilà pourquoi je ne peux pas tolérer qu'on dise d'une personne qui est tombée dans la dépendance à l'adolescence, puis dans la prostitution, que c'était son choix. »
Note
1. Milieu de vie et santé dans la Capitale-Nationale (gouv.qc.ca)
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.












