Presse-toi à gauche !
Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

L’intelligence artificielle contre la syndicalisation d’Uber ?

Si les travailleurs et travailleuses à la demande (gig workers) d'Uber et consort ne semblent pas s'organiser au Québec, il n'en est pas de même à Toronto. Au Québec, la saga de l'implantation d'Uber a plutôt valu une défaite du moins partielle des chauffeurs de taxi traditionnel qui ont vu fondre la valeur de leurs permis leur servant de fonds de pension. En avril 2024, plus de dix ans après l'implantation d'Uber, ces chauffeurs, en grande partie sinon majoritairement racisés, poursuivaient le gouvernement du Québec pour obtenir la valeur marchande de leurs permis, soit environ 1.2 G$, et non leur valeur d'acquisition d'environ 800 M$. Il ne semble pas non plus que le gouvernement du Québec veuille légiférer, comme en Colombie britannique, pour accorder un salaire minimum aux chauffeurs d'Uber et consort payés bien en-dessous du salaire minimum officiel. Il en est de même à Toronto où cependant la Coalition Ridefair réclame « au moins un revenu de 37 $ par heure active pour qu'un chauffeur puisse espérer gagner le salaire minimum. » Estce la raison pour laquelle Uber recourt à l'intelligence artificielle pour abaisser leur rémunération comme le suggère cet article du Globe and Mail ?
Introduction et traduction, Marc Bonhomme, 10/10324
–
…Uber vient d'annoncer un changement majeur dans le mode de rémunération de ses chauffeurs en Ontario. À partir de cette semaine, le salaire des chauffeurs Uber sera entièrement déterminé par un algorithme, dans le cadre d'un changement de rémunération que l'entreprise appelle « upfront pricing ». Mon collègue Vanmala Subramaniam, reporter du Globe sur l'avenir du travail, a expliqué comment les revenus étaient calculés auparavant : « Un chauffeur recevait un salaire assez prévisible en fonction du nombre de kilomètres parcourus, du temps passé dans la voiture et des déductions de taxes et de frais de service », m'a-t-elle expliqué. « Après un trajet, il recevrait un reçu indiquant comment il a été payé. Dans le cadre de ce nouveau modèle, l'application se passe complètement de cette ventilation et indique simplement aux chauffeurs, d'emblée, le salaire qu'ils recevront pour un trajet. » Ils choisissent de l'accepter ou non.
Uber affirme que la fixation d'un prix à l'avance permettra de « mieux équilibrer le marché » et de s'assurer qu'il y a suffisamment de chauffeurs sur la route pour répondre à la demande des utilisateurs. Mais les experts avec lesquels
Subramaniam s'est entretenu insistent sur le fait que cela supprime la prévisibilité de la rémunération des chauffeurs et pourrait réduire le montant de leur salaire. Et comme c'est souvent le cas lorsque c'est l'IA [Intelligence artificielle] qui mène la danse, ces algorithmes opaques offrent de nombreuses possibilités de discrimination.
Un prix mystère
Les passagers d'Uber connaissent déjà la tarification dynamique : c'est la raison pour laquelle les coûts augmentent lorsque la demande de transport est particulièrement élevée, par exemple après une panne de métro ou la fin d'un match de hockey. Mais en général, la rémunération des chauffeurs fonctionne comme un compteur de taxi, c'est-à-dire qu'elle est calculée en fonction du temps, de la distance et du tarif de base, avec des primes pour les trajets fréquents ou les périodes d'affluence. Si un chauffeur emmenait quelqu'un de l'aéroport au quartier financier en pleine heure de pointe, il savait à peu près combien il allait gagner et pouvait organiser sa journée en conséquence.
La tarification initiale introduit de l'opacité et de la variabilité dans ces revenus. « Maintenant, les chauffeurs peuvent faire le même trajet trois fois et être payés trois fois différemment - 6, 10 ou 12 dollars, ils ne le savent tout simplement pas », m'a dit M. Subramaniam. « Ils sont vraiment à la merci de l'entreprise et de l'algorithme en ce qui concerne leur salaire. »
Une entreprise comme Uber - ou Lyft, DoorDash ou Amazon - recueille une multitude de données sur le comportement des travailleurs indépendants qui utilisent sa plateforme. Il s'agit notamment de savoir combien de temps les chauffeurs sont prêts à attendre entre deux courses (temps pour lequel ils ne sont pas payés), quel type de tarif ils sont prêts à accepter et quel est leur objectif de gain journalier. Armé de ces informations, un algorithme peut adapter les salaires à chaque chauffeur. L'application peut abaisser le tarif proposé à une personne qui semble plus encline à l'accepter. Elle peut aussi réduire de quelques dollars les tarifs proposés à un conducteur qui souhaite gagner 250 dollars ce jour-là, afin qu'il soit plus enclin à rester sur la route.
« La gestion algorithmique des salaires permet en fin de compte au travailleur de travailler pour l'entreprise le plus longtemps possible et pour le moins cher possible » a expliqué Veena Dubal, professeur de droit à l'université de Californie, au journal The Globe. Elle a même inventé un terme pour décrire ce système de rémunération variable pour un travail identique : la discrimination salariale algorithmique. « Et l'algorithme travaille toujours sur la base des dernières données disponibles », m'a dit M. Subramaniam. « C'est donc un système en constante évolution qui détermine le salaire final d'un chauffeur. »
Une solution législative ?
C'est ici que je note qu'Uber nie personnaliser les salaires sur la base des données collectées. Mais il est peut-être utile de mentionner que lors d'une conférence téléphonique sur les résultats au début de l'année, le PDG d'Uber, Dara Khosrowshahi, a dit ceci aux investisseurs : « Ce que nous pouvons faire de mieux, c'est cibler différents trajets pour différents chauffeurs en fonction de leurs préférences ou des modèles de comportement qu'ils nous montrent. » Il convient également de mentionner qu'il a été démontré que la tarification initiale fait baisser les salaires des chauffeurs. Selon une analyse de la Columbia Business School, la rémunération moyenne par trajet a diminué d'environ 12 % au premier trimestre 2023, peu après qu'Uber a introduit la tarification initiale aux États-Unis.
Que pouvons-nous faire à ce sujet ? Le 1er juillet 2025, la loi sur les droits des travailleurs des plateformes numériques entrera en vigueur en Ontario, avec une clause stipulant que les plateformes numériques comme Uber doivent être transparentes dans le calcul de leur rémunération. La loi stipule également que les travailleurs itinérants doivent recevoir un salaire minimum par mission. « Mais ce que signifie cette mission, ou comment garantir la transparence, ou qui va appliquer ces réglementations - rien de tout cela n'est encore clair », a déclaré M. Subramaniam. « Je ne suis pas sûr que l'on sache comment la législation fonctionnera avant qu'elle n'entre en vigueur l'été prochain. » D'ici là, si vous prenez un Uber en Ontario, je vous suggère humblement de donner un bon pourboire à votre chauffeur.
Source :Danielle Groen, Morning Update, Globe and Mail , 9/10/24
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Selon le CPJ (Comité pour la protection des journalistes), Israël a tué plus de journalistes à Gaza que dans n’importe quel conflit depuis 30 ans

En 12 mois, plus de journalistes ont été tué.e.s dans des attaques israéliennes à Gaza et au Liban que dans n'importe quelle période similaire enregistrée depuis 1992, selon le CPJ. La guerre israélienne contre Gaza a tué plus de journalistes au cours de l'année écoulée que n'importe quel autre conflit au cours des trois dernières décennies, selon les données du Comité pour la protection des journalistes (CPJ).
Tiré de Agence médias Palestine.
Selon le CPJ, un groupe basé aux États-Unis qui surveille les violations des droits de l'homme dont sont victimes les journalistes du monde entier, au moins 128 travailleurs et travailleuses des médias ont été tué.e.s dans le conflit entre le 7 octobre 2023 et le 4 octobre 2024. L'organisation enquête également sur 130 autres cas présumés de meurtres, de détentions ou de blessures.
Le groupe a déclaré qu'il s'agissait de la période la plus meurtrière pour les journalistes depuis qu'il a commencé ses activités activités de documentation en 1992.
Les données sont sujettes à caution eu égard du nombre de journalistes tué.e.s rapporté par le ministère palestinien de la santé, qui a estimé qu'au moins 175 journalistes ont été tué.e.s entre le 7 octobre 2023 et le 6 octobre 2024.
Le CPJ a fait remarquer que les journalistes ont travaillé au cours des 12 derniers mois dans les mêmes conditions humanitaires désastreuses que tous les civils à Gaza : le bombardement dévastateur de l'enclave densément peuplée qui a détruit la plupart de ses bâtiments, le siège israélien qui a conduit à la famine, et le déplacement constant de la population.
« Depuis le début de la guerre à Gaza, les journalistes paient le prix le plus élevé- leurs vies – pour produire leurs reportages. Sans protection, sans équipement, sans présence internationale, sans moyens de communication, sans eau ni nourriture, ils et elles continuent à faire leur travail indispensable pour dire la vérité au monde », a déclaré Carlos Martinez de la Serna, du CPJ.
« Chaque fois qu'un.e journaliste est tué.e, blessé.e, arrêté.e ou contraint.e à l'exil, nous perdons des fragments de vérité. Les responsables de ces pertes doivent rendre compte devant deux tribunaux : l'un en vertu du droit international, l'autre devant le regard impitoyable de l'histoire ».
La prise pour cible de journalistes pendant les conflits est un crime au regard du droit international.
Israël est actuellement jugé devant la Cour internationale de justice (CIJ), dans le cadre d'une plainte déposée par l'Afrique du Sud en décembre, pour violation présumée de la Convention de 1948 sur le génocide. La requête de l'Afrique du Sud cite parmi les preuves le ciblage de journalistes palestinien.ne.s.
« Les journalistes palestinien.ne.s sont tué.e.s à un rythme nettement plus élevé que celui que l'on trouve dans tout autre conflit au cours des 100 dernières années. Au cours des seuls deux mois qui ont suivi le 7 octobre 2023, le nombre de journalistes tué.e.s a déjà dépassé celui de toute la Seconde Guerre mondiale », indique le document.
Dans un rapport de 2022, l'organisation de défense des droits de l'homme, Euro-Med Monitor, a recensé plus de 700 journalistes et professionnel.le.s des médias tué.e.s dans la guerre syrienne entre 2011 et 2022, soit une moyenne de plus de 63 journalistes tué.e.s par an. Il s'agit du bilan le plus lourd de toutes les guerres de ce siècle.
Reporters sans frontières a recensé au moins 300 journalistes professionnel.le.s et non professionnel.le.s tué.e.s sur une période de dix ans alors qu'ils et elles couvraient le conflit syrien.
Euro-Med a déclaré que la guerre en Irak a vu la mort de 61 journalistes, soit une moyenne de six journalistes par an, tandis que la guerre au Yémen a vu la mort de 42 journalistes depuis 2014, soit une moyenne de plus de cinq journalistes par an.
Avant le 7 octobre 2023, le CPJ avait déjà documenté que 20 journalistes palestiniens et palestiniennes ont été tué.e.s par des tirs de l'armée israélienne en 22 ans, mais personne n'a été tenu responsable de ces décès.
Israël nie cibler délibérément les journalistes.
Source : Middle East Eye
Traduction BM pour Agence média Palestine
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Dossier de presse – Couverture médiatique après un an de génocide

Ce dossier de presse vise à fournir aux salles de presse, aux rédacteur·ices en chef et aux journalistes une compilation de ressources, de faits et de conseils essentiels pour couvrir l'année écoulée depuis le 7 octobre et le génocide en cours à Gaza. Ceci est d'autant plus important qu'Israël continue d'interdire l'accès à Gaza à tout journaliste international et que les journalistes locales·aux de Gaza sont pris·es pour cible sans relâche.
Tiré de France Palestine solidarité.
Il est également important de souligner, alors qu'Israël a commencé à envahir le Liban, que le génocide israélien en cours à Gaza, l'escalade de l'annexion et de la violence en Cisjordanie, et l'agression contre le Liban, la Syrie et la région ne sont pas des événements isolés ou des développements soudains, mais plutôt des symptômes des ambitions d'Israël de consolider sa domination et de remodeler la région en fonction de ses intérêts coloniaux.NB : Le document original étant en anglais, les sources et hyperliens sont en anglais
1. Faits marquants et actes génocidaires israéliens à Gaza
A. Nombre de morts, massacres, charniers et familles rayées des registresEn un an, Israël a tué plus de 41 615 Palestiniens, dont 17 000 enfants. Les massacres sont devenus une norme tragique, avec des familles entières rayées des registres d'état civil, des corps brûlés, démembrés et des enfants décapité·es.
Nombre de morts et de personnes tuées : Selon The Lancet, le nombre de morts directes et indirectes à Gaza pourrait s'élever à 186 000 personnes.
Massacres documentés :
Massacre de la farine en février, ici et ici.
Massacre de l'hôpital Al-Shifa en avril, ici.
Massacre des tentes de Rafah en mai, ici.
Massacre de Nuseirat en juin, ici, ici et ici.
Massacre des camps d'Al-Mawasi et d'Al-Shati le 13 juillet, ici.
Infographie montrant 30 fosses communes, avec 3 000 corps de Palestiniens tués dans le génocide israélien.
Pour des comptes rendus détaillés de tous les événements, jour par jour, avec des données, voir la base de données Airwars database.
Ressource clé pour retrouver des faits chronologiquement : The Palestine Chronology — événements jour par jour
Une poignée d'histoires parmi les centaines de milliers d'histoires de Palestinien·nes dont la vie a été détruite, même s'ils sont en vie.
– Hind Rajab, 6 ans
– Refat Al Areer, poète et intellectuel
– Mohamad Abu Alqumosan, dont la femme et les jumeaux ont été tué-es
– La famille Abu Salem, entièrement exterminée
– Ismail Al- Ghoul, jeune journaliste
Voir aussi : Gaza : des visages, pas que des nombres
B. Israël bat des records historiques mondiaux en matière de crimes et d'atrocités
Les Nations unies ont déclaré que Gaza était l'endroit le plus dangereux au monde pour les enfants.
Plus de 75 % des journalistes tué·es dans le monde en 2023 l'ont été pendant le génocide israélien à Gaza.
Le nombre de travailleur-euses humanitaires tué·es à Gaza au cours de l'année écoulée est le plus élevé jamais enregistré en une seule crise.
Israël a largué 70 000 tonnes de bombes sur Gaza, soit plus que les bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale de Dresde, Hambourg et Londres réunis.
C. Blessés
Plus de 96 350 Palestinien·nes ont été blessé·es à Gaza. Selon l'OMS, au moins 25 % d'entre eux risquent d'avoir des blessures qui changeront leur vie, dont plus de 15 000 cas de blessures aux extrémités et environ 3 500 amputations.
Un nouvel acronyme a été inventé : WCNSF – Wounded Child No Surviving Family (enfant blessé sans famille survivante), soulignant la situation tragique de milliers d'enfants orphelin·es et blessé·es.
D. Destruction des infrastructures
Santé : Plate-forme documentant la destruction du secteur de la santé de manière très détaillée.
Maison, eau et routes : 67% des installations et infrastructures d'eau et d'assainissement, ainsi que le réseau routier, ont été détruits ou endommagés.
En mai, l'ONU a estimé que la reconstruction des maisons de Gaza pourrait prendre jusqu'à 2040.
Écoles et universités : Israël a détruit 90 % des écoles de Gaza. La dernière université de Gaza a été détruite en janvier 2024. Les experts de l'ONU ont qualifié la destruction systématique du système éducatif palestinien d' « éducide ». Rapport UNRWA/Université de Cambridge.
Évaluation de la destruction des établissements d'enseignement supérieur par l'Agence française de développement.
Culture et patrimoine : les bombardements incessants d'Israël ont anéanti le patrimoine culturel et historique de Gaza, connue comme l'une des plus anciennes villes du monde, avec 195 sites du patrimoine, 227 mosquées et trois églises endommagés ou détruits, y compris les archives centrales de Gaza, qui contiennent 150 ans d'histoire.
E. Déplacement forcé
Neuf Palestinien·nes sur dix à Gaza sont aujourd'hui déplacé·es à l'intérieur de leur propre pays, souvent à plusieurs reprises (certain·es jusqu'à dix fois). Rapport d'Oxfam sur les cycles de déplacement
86 % de la bande de Gaza est toujours sous le coup d'ordres d'évacuation émis par Israël.
Israël a réoccupé Gaza, prenant le contrôle de 26 % de la bande, voir le site web interactif ici.
F. La famine
En juillet, les expert-es des Nations unies ont déclaré que la famine s'était répandue dans la bande de Gaza. Cette déclaration fait suite à des mois d'évaluation par la classification intégrée de la phase de sécurité alimentaire sur le risque élevé de famine.
Les Nations unies ont signalé 32 décès dus à la malnutrition, dont 28 parmi les enfants de moins de cinq ans. Environ 200 patient·es ont été admis·es pour malnutrition aiguë sévère et on estime que 50 000 enfants ont besoin d'un traitement contre la malnutrition aiguë.
G. Situation sanitaire
En onze mois, 512 attaques ont été lancées contre les personnels, équipements et infrastructures de santé à Gaza, entraînant la mort de 759 Palestinien·nes, la détention et l'arrestation de 128 travailleur·euses de la santé, tout en affectant 110 établissements de santé et 115 ambulances.
90 % de l'approvisionnement en eau de Gaza est impropre à la consommation.
La destruction des infrastructures, le manque d'assainissement, l'effondrement du système de santé et la surpopulation des sites de déplacement créent un terrain propice aux épidémies.
Les attaques israéliennes contre la santé ont créé une « biosphère de guerre », avec le retour du virus de la polio à Gaza, parmi de nombreuses autres conséquences sanitaires catastrophiques du génocide.
H. Obstruction de l'aide humanitaire
Israël a entravé l'aide humanitaire à Gaza en renforçant son blocus, en créant des points de contrôle militaires à travers Gaza, en attaquant les agences humanitaires et les travailleurs humanitaires, ainsi qu'en s'en prenant à l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) et à son personnel. Lire la déclaration d'Al-Haq.
7 façons dont Israël a délibérément bloqué l'aide humanitaire par Oxfam.
Les agences humanitaires américaines ont même confirmé l'existence d'une obstruction délibérée, en envoyant leurs conclusions au département d'État, et il a été révélé que l'administration Biden a menti au Congrès et enterré les conclusions.
15 ONG internationales ont publié collectivement un appel détaillant comment le siège d'Israël bloque 83 % de l'aide alimentaire parvenant à Gaza.
Analyse de la gouvernance de l'aide par l'Institut de recherche sur la politique économique de la Palestine.
I. Intention génocidaire
Le génocide se produit également sur fond d'intention génocidaire manifeste de la part des responsables et des décideurs israéliens. Dès le départ, il était clair qu'il ne s'agissait pas d'une guerre, mais d'une intention délibérée d'éliminer, d'effacer et de détruire l'ensemble de la population et du territoire. En annonçant un siège total et l'intention de couper l'électricité et l'eau, en utilisant des métaphores animales et d'autres étiquettes déshumanisantes, l'intention génocidaire d'Israël a été claire.
→ Law4Palestine a compilé une base de données de plus de 500 incitations au génocide et à la violence de masse par des responsables israélien·nes et des personnalités publiques.
Exemples :« Il n'y aura pas d'électricité, pas de nourriture, pas d'eau, pas de carburant, tout sera fermé. Nous nous battons contre des animaux humains et nous agirons en conséquence ». Y. Gallant (ministre de la Défense)
« Vous devez vous souvenir de ce qu'Amalik vous a fait », Benjamin Netayahu
« Brûlez Gaza maintenant, rien de moins ! » vice-président de la Knesset sur X
2. L'assaut sur la Cisjordanie
Il ne s'agit pas d'une guerre « Israël-Hamas ». Les derniers bombardements sur le Liban l'ont confirmé. Les médias ne doivent pas non plus présenter cette guerre comme « débordant » sur la Cisjordanie. La Cisjordanie a toujours été au cœur du projet de domination mis en place par Israël sur l'ensemble du territoire. Israël a pris l'opération du 7 octobre comme prétexte pour étendre son projet colonial en Cisjordanie, où les Palestinien·nes sont encore plus assiégés et font face à un nettoyage ethnique imminent.
– L'année dernière a été la plus meurtrière pour les Palestinien·nes en Cisjordanie depuis des décennies, avec plus de 693 morts. Mises à jour de l'Ocha : pour des faits et des chiffres sur les meurtres, les blessures, les démolitions et d'autres formes de violence systémique.
– Un enfant tous les deux jours a été tué en Cisjordanie depuis le 7 octobre – rapport de DCI.
– Entre le 7 octobre 2023 et le 23 septembre 2024, les autorités israéliennes ont démoli, détruit ou confisqué 1 725 structures palestiniennes en Cisjordanie, déplaçant plus de 4 450 Palestinien·nes, dont environ 1 875 enfants. Cela représente plus du double du nombre de Palestinien·nes déplacé·es au cours de la même période avant le 7 octobre.
– Le gouvernement israélien a étendu la colonisation et l'accaparement des terres. En mai 2024, les autorités israéliennes ont transféré les pouvoirs relatifs à la terre et aux colonies de l'armée au contrôle civil israélien, poursuivant ainsi l'annexion de la Cisjordanie. Depuis le 7 octobre, les colons ont établi 25 nouveaux avant-postes coloniaux, le gouvernement a rétroactivement « légalisé » trois avant-postes coloniaux et déclaré 24 193 dunams (environ 2 420 hectares, NLDT) en Cisjordanie comme « terre d'État ».
– Entre le 7 octobre 2023 et le 23 septembre 2024, l'OCHA a enregistré 1 390 attaques de colons israéliens contre des Palestiniens, dont environ 135 ont fait des morts et des blessés palestiniens. Entre octobre 2023 et août 2024, 261 ménages comprenant 1 566 Palestiniens ont été déplacés à la suite d'attaques de colons.
– Briefing sur la violence des colons par UAWC.
3. Désinformation et mensonges israéliens depuis le 7 octobre
Vous trouverez ci-dessous les principales fausses affirmations, fake news et récits fallacieux qui ont été diffusés et promus de manière proactive par les autorités israéliennes et/ou des groupes affiliés. L'utilisation généralisée de la propagande par les responsables israélien·nes et la mauvaise foi flagrante de certains médias ont créé une arme de guerre dangereuse qui déshumanise encore plus les hommes palestiniens et le Hamas. Les autorités israéliennes ont dépensé plus de 7 millions de dollars en publicités et en contenus de propagande au niveau international.
Ressources générales : Decolonize Palestine, Base de données des mythes / Pali Answers / October 7 Fact Check
A. Affirmation : « le Hamas a commis un viol de masse le 7 octobre »
Echo médiatique : ces affirmations ont été rapidement reprises, de nombreux médias grand public et organisations internationales s'en faisant l'écho.
Démenti : Au fil du temps, aucune preuve crédible n'est venue étayer les allégations de viols massifs. De nombreuses enquêtes ont démenti ces accusations. De nombreux rapports accusant les Palestiniens de commettre des violences sexuelles systématiques à l'encontre des Israéliennes s'appuient sur des témoignages de volontaires de ZAKA, une organisation de secours israélienne qui ne fait pas de travail médico-légal. Un article de l'Associated Press a réfuté deux accusations de viol et de violence sexuelle formulées par des bénévoles de ZAKA. La bénévole a déclaré à AP : « Ce n'est pas que j'ai inventé une histoire… À la fin, il s'est avéré que c'était différent, alors je me suis corrigée ». En outre, la crédibilité et les méthodes des rapports des Nations unies et des organisations internationales de défense des droits de l'homme, qui ont réitéré les allégations de violence systémique fondée sur le sexe et de viol, ont été remises en question par la société civile palestinienne et les réseaux de solidarité internationale.
Impact sur l'opinion publique : La diffusion de ces allégations joue à ce jour un rôle important dans la diabolisation de la résistance palestinienne et la déshumanisation des Palestinien·nes en général.
Ressources clés :
— Feminist Solidarity Network for Palestine, Here's what Pramila Patten's UN report on Oct 7 sexual violence actually said (« Voici ce que dit réellement le rapport de Pramila Patten sur les violences sexuelles du 7 octobre »)
— AP, How 2 debunked accounts of sexual violence on Oct. 7 fueled a global dispute over Israel-Hamas war (« Comment deux récits de violence sexuelle démentis le 7 octobre ont alimenté un conflit mondial sur la guerre entre Israël et le Hamas »)
— Mondoweiss, ZAKA is not a trustworthy source for allegations of sexual violence on October 7 (« ZAKA n'est pas une source fiable pour les allégations de violence sexuelle du 7 octobre »)
— Al Jazeera, The unravelling of the New York Times “Hamas rape” story (« Le démêlage de l'histoire du viol du Hamas du New York Times »)
B. Affirmation : « le Hamas utilise des civil·es comme boucliers humains et des hôpitaux comme bases militaires »
Écho médiatique : Ces affirmations ont été amplifiées par divers organes de presse internationaux, dont beaucoup se réfèrent à des sources militaires et à des porte-parole israélien·nes. La même tactique de désinformation a été utilisée par Israël pour bombarder le Liban.
Démenti :
Les civils comme boucliers humains : Les organisations de défense des droits de l'homme, telles qu'Amnesty International, et les Nations unies n'ont trouvé aucune preuve concrète de l'utilisation de boucliers humains par le Hamas. Gaza est l'une des régions les plus densément peuplées au monde, ce qui complique naturellement la distinction entre zones civiles et zones militaires. Les agressions militaires successives d'Israël sur Gaza sont documentées, y compris le génocide le plus récent, avec des bombardements généralisés, systématiques et aveugles et par le ciblage de civils et d'infrastructures civiles. D'autre part, des enquêtes ont révélé que les forces israéliennes elles-mêmes ont utilisé des Palestinien·nes comme boucliers humains, renversant ainsi le mythe.
Les hôpitaux comme bases militaires : Des enquêtes indépendantes n'ont trouvé aucune preuve concrète à l'appui de cette affirmation. L'analyse par le Washington Post de documents visuels de source ouverte, d'images satellite et de tous les documents militaires israéliens rendus publics a démenti l'affirmation selon laquelle le Hamas aurait utilisé l'hôpital Al-Shifa comme centre de commandement. Une autre affirmation israélienne selon laquelle un calendrier affiché sur les murs d'un hôpital serait une « liste de gardes du Hamas » a été facilement démentie par les utilisateurs arabophones des médias sociaux. Une autreenquête d'Al Jazeera a réfuté l'affirmation israélienne selon laquelle il y aurait un tunnel du Hamas sous l'hôpital Qatari, en montrant que « la trappe qu'Israël prétendait être un tunnel du Hamas n'est qu'un réservoir d'eau pour l'hôpital ». L'Organisation mondiale de la santé a condamné les attaques israéliennes contre les établissements de santé et Human Rights Watch a déclaré qu'elle ne pouvait pas corroborer les allégations israéliennes selon lesquelles le Hamas utilisait l'hôpital Al-Shifa comme base militaire, et que les attaques contre les établissements de santé « devraient faire l'objet d'une enquête en tant que crimes de guerre ».
Impact sur l'opinion publique : Ces allégations créent une perception qui justifie et normalise les bombardements israéliens sur les hôpitaux, les abris et d'autres zones remplies de Palestinien·nes déplacé·es, de blessé·es et de patient·es. Elles rejettent également la responsabilité sur le Hamas au lieu de reconnaître la responsabilité de l'armée israélienne.
Ressources clés :
— Mondoweiss, Every accusation a confession : Israel and the double lie of ‘human shields (Israël et le double mensonge des ‘boucliers humains') (traduction française ici)
— DecolonizePalestine – Mythe : les Palestiniens utilisent des boucliers humains
— Al Jazeera – La fausseté des allégations d'Israël concernant les boucliers humains à Gaza
— B'Tselem – Boucliers humains
— Enquête du Washington Post sur l'hôpital Al-Shifa
— Enquête d'Al Jazeera sur l'hôpital qatari
— Rapport de The Intercept sur l'hôpital Al-Shifa
— Guardian, Rapport sur l'hôpital Al-Shifa
— Euro-Med Human Rights Monitor, Rapport sur le massacre israélien à Al-ShifaC.
Affirmation : Le Hamas a décapité des enfants le 7 octobre
Echo des médias : Cette affirmation est partie d'une correspondante israélienne qui a rapporté les affirmations de soldat·es israélien·nes selon lesquelles elles et ils avaient trouvé des bébés décapités dans le kibboutz de Kufr Azza. Elle a rapporté : « Des bébés, la tête coupée, c'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit ». Cette histoire, qui n'a pas été contestée, a été largement diffusée dans les médias internationaux et par des hommes politiques, ce qui a contribué à sa propagation rapide.
Démenti : Dès le début de l'enquête, les responsables israélien·nes se sont rétracté·es. Les enquêtes ont conclu que les allégations manquaient de preuves crédibles.
Impact sur l'opinion publique : Ce récit, bien que démenti, a enflammé le sentiment public à l'égard des Palestinien·nes, les déshumanisant davantage et justifiant les crimes israéliens à leur encontre. Les efforts déployés pour rétracter l'histoire après qu'elle a été démentie ont été minimes, et le mal était déjà fait. Les affirmations et cette histoire sont toujours en circulation à ce jour.
D. Affirmation : le Hamas vole l'aide humanitaire
Echo médiatique : Cette affirmation a été diffusée à plusieurs reprises par des responsables israélien·nes et des médias internationaux, alléguant que le Hamas détournerait l'aide humanitaire destinée aux Palestinien·nes de Gaza à des fins militaires, ou affirmant que l'envoi d'aide à Gaza reviendrait à aider le Hamas.
Démenti : Israël impose un blocus aérien, terrestre et maritime à Gaza depuis 17 ans, qui n'a été renforcé que depuis octobre 2023. Chaque entrée d'aide est soumise à des protocoles stricts et arbitraires par les autorités d'occupation israéliennes. Une fois que l'aide se trouve à l'intérieur de Gaza, elle relève de la responsabilité des Nations unies et des agences humanitaires. Des déclarations consécutives ont nié tout détournement de l'aide humanitaire par le Hamas, y compris par des responsables américains et des agences de l'ONU. Au contraire, Israël est le principal responsable de la famine et de la crise humanitaire en raison de son régime de blocus et de l'obstruction systématique de l'acheminement de l'aide à Gaza.
Impact sur l'opinion publique : l'image du Hamas qui exploite l'aide humanitaire alimente l'image négative du Hamas en tant qu'organe gouvernemental indigne de confiance dans la bande de Gaza, ce qui déshumanise encore plus les Palestinien·nes. Elle remet en question et conditionne la nécessité de l'acheminement de l'aide à Gaza, alors qu'Israël poursuit son blocus illégal, son génocide et sa guerre de famine.
4. Captifs et captives israélien·nes et palestinien·nes — Distinguer les faits des mythes
A. Otages israélien·nes
– Le 7 octobre, Israël a ordonné l'utilisation de la directive Hannibal. Cette doctrine, rédigée en 1986 en réponse à l'enlèvement de soldats israéliens au Liban, autorise les forces israéliennes à tirer sur des « ennemis retenant leurs camarades en otage », au risque de tuer les otages. L'armée israélienne a donné l'ordre de tirer sur les troupes capturées par le Hamas. Résumé ABC. Parmi les personnes tuées ce jour-là, de nombreux Israélien·nes ont été tué·es par leurs propres tirs.
– Les apparitions des captif·ves israélien·nes libéré·es dans les médias ont été étroitement contrôlées et limitées. Jusqu'à présent, peu de témoignages directs.
– Les otages se sont exprimés par l'intermédiaire de leurs familles, qui ont décrit leurs conditions de détention comme des mauvais traitements, avec des choses comme « être obligé de chuchoter », « être recouvert de couvertures » ou « recevoir des mensonges ». D'autres ont dit avoir été bien traités.
– En décembre 2023, l'armée israélienne a abattu trois otages israéliens. Cet incident a révélé que les soldat·es israélien·nes n'avaient pas reçu l'ordre d'être « prudent·es » avec les personnes qu'ils et elles rencontraient en général.
– Le 8 juin 2024, Israël a massacré des Palestinien·es — 270 Palestinien·nes ont été tués et 698 autres blessés — « pour sauver » quatre otages. Suite à l'indignation suscitée par la couverture médiatique extrêmement partiale de cette journée, de nombreux médias ont par la suite couvert ce qui était réellement arrivé aux Palestinien·es qui avaient été complètement déshumanisé·es.
– 3 des 6 otages israélien·nes retrouvé·es mort·es en août 2024 devaient être libéré·es dans le cadre de l'accord conclu entre le Hamas et les États-Unis, que le gouvernement israélien a rejeté. Article CNN
– Interview du négociateur thaïlandais qui a négocié la libération des otages thaïlandais avec le Hamas.
B. Otages palestinien·nes
Israël a massivement kidnappé, détenu et fait disparaître de force des Palestinien·nes, avec des documents et des preuves d'abus, de torture et de viols, qui ont également entraîné la mort de détenu·es par Israël.
– Depuis octobre, au moins 53 captif·ves palestinien·nes sont mort·es dans les prisons israéliennes des suites de tortures et de conditions inhumaines.
– Le camp de Sde Teiman – un camp de torture (dans le Néguev) où des prisonniers de Gaza ont été emmenés et systématiquement maltraités, torturés, battus et, pour l'un d'entre eux, violé — révélations d'un lanceur d'alerte.
– Le principal stade de football de Gaza a été transformé en camp de détention où des Palestinien-nes ont été systématiquement maltraité-es, déshabillé-es et torturé-es.
– Des enfants ont également été enlevé·es et maltraité·es – rapport de la DCI
– Les captif·ves palestinien·es libéré·es présentaient systématiquement une perte de poids massive, des marques d'abus physiques et de torture, de coups, d'attaques de chiens et bien d'autres choses encore.
– Des viols et des abus sexuels ont également été signalés — Un soldat israélien accusé de viol a été invité à plusieurs reprises sur les chaînes israéliennes pour se défendre et a été acclamé. Il a été défendu par des dirigeant·es israélien·nes.
– Al-Mezan, un groupe de défense des droits de l'homme, a recueilli des témoignages directs sur l'utilisation par l'armée israélienne de Palestinien·nes kidnappé·es à Gaza comme boucliers humains.
– B'Tselem a fait état des tortures et des abus systématiques auxquels les Palestinien·nes sont confronté·es dans les prisons israéliennes de Cisjordanie et de Gaza : Bienvenue en enfer
– La population des prisonnier·es politiques palestiniens dans les prisons israéliennes a presque doublé depuis le 7 octobre. 9 900 prisonnier·es palestinien·nes contre 5 200 avant octobre 2023.
Ressources clés :
— Témoignages ici, ici, ici, ici et ici
— Enquêtes et rapports ici, ici, ici, ici, et ici
— Déclaration des experts de l'ONU
5. Obstruction israélienne aux pourparlers et aux accords de cessez-le-feu
Voici la chronologie et les faits concernant les accords de cessez-le-feu et d'échange d'otages. Il apparait clairement qu'à partir d'octobre, la stratégie du Hamas a été d'accepter de libérer tous les otages en échange de captif·ves palestinien·nes et d'un cessez-le-feu permanent. Le gouvernement Netanyahou a toujours rejeté cette demande, refusant un cessez-le-feu permanent et le retrait des troupes israéliennes de Gaza.
Principaux événements survenus :
→ En octobre déjà, les familles des otages demandaient à Netanyahou d'accepter les accords sur la table, elles ont été écartées.
→ 22 novembre : après des pourparlers, un premier cessez-le-feu de quatre jours est instauré. Le Hamas libère 50 prisonnier·es israélien·nes en échange de 150 femmes et enfants palestinien·nes détenu·es dans les prisons israéliennes. Netanyahou refuse un cessez-le-feu permanent, insistant sur le fait que l'objectif d'Israël est de « démanteler complètement le Hamas ». La « trêve » n'a été prolongée que d'une semaine.
→ En novembre, Al Jazeera a analysé des centaines de discours prononcés à l'ONU et a constaté que 55 % des nations qui se sont exprimées sur la question de la situation à Gaza ont appelé à un cessez-le-feu, tandis que 23 % ont appelé à une « pause » et que 22 % n'ont appelé ni à une pause ni à un cessez-le-feu
→ 2 décembre : le Hamas exige la libération de tou·tes les prisonnier·es palestinien·nes en échange de la libération d'otages. Israël refuse.
→ 10 décembre : le Hamas étudie un plan de trêve en trois phasesproposé par les négociateur·ices égyptiens, qataris, israéliens et américains à Paris. Netanyahou le rejette, ses allié·es menaçant de faire éclater la coalition s'il accepte l'accord.
→ 20 février : pour la troisième fois, les États-Unis opposent leur veto à une résolution de l'ONU en faveur d'un cessez-le-feu. Israël se félicite de cette décision.
→ 5 mars : À la suite de l'accord d'échange de prisonnier·es conclu entre Israël et le Hamas en novembre 2023, Israël viole les principes de l'accord et arrête à nouveau onze Palestinien·nes parmi celles et ceux qui ont été libéré·es dans le cadre de l'accord.
→ 7 mai : le Hamas accepte un cessez-le-feu proposé par le Qatar et l'Égypte qui suit le cadre en trois phases. Il stipule que tou·tes les prisonnier·es israélien·nes seront libéré·es en échange d'un nombre non précisé de prisonnier·es palestinien·nes. Il demande à Israël d'augmenter son aide, de se retirer progressivement de Gaza et de permettre la reconstruction, ainsi que de lever le siège qu'il impose à l'enclave depuis 2007. Deux jours plus tard, Israël lance l'offensive et le massacre de Rafah où 1,4 million de Palestinien·nes déplacé·es cherchaient refuge.
→ 31 juillet : Israël assassine Haniyeh, principal négociateur d'un cessez-le-feu.
Depuis octobre, Israël procède à des arrestations massives [voir point 4 ci-dessus], doublant presque le nombre de prisonnier·es palestinien·nes dans les prisons israéliennes, y compris des femmes et des enfants, afin de les compter dans les négociations sur l'échange de prisonnier·es.
Ressources clés :
— Résumé de l'IPS sur les appels au cessez-le-feu et les pourparlers.
— Chronologie des pourparlers de cessez-le-feu sur Al Jazeera.
— L'ancien porte-parole des familles de captif-ves israélien-nes s'exprimant sur le blocage des accords par Netanyahou.
— Al-Shabaka, « The Enduring and Racist Trope of Palestinian Rejectionism »
6. Comment éviter les formulations et les pratiques problématiques dans le travail journalistique
Le langage, les cadres, les angles choisis, les récits, le choix des sources et d'autres pratiques sont très puissants dans les reportages sur le génocide actuel et la situation de crise. Ils ont été utilisés pour obtenir le consentement à l'oppression et à la violence de masse, et pour déshumaniser les victimes. Pour une couverture précise et critique de l'actualité, voici quelques lignes directrices sur les pièges et les écueils.
A. Décontextualisation
Problème : crée un cadrage bilatéral, efface le contexte de décennies de colonialisme et d'occupation illégale, d'apartheid et de blocus, et présente les choses comme ayant commencé le 7 octobre.
Exemple : La « guerre Israël-Hamas » au lieu du « génocide israélien à Gaza ».
B. Le prétendu « droit à l'autodéfense d'Israël »
Problème : Pour reprendre les termes d'un spécialiste du droit international : « aborder l'action militaire actuelle d'Israël à Gaza comme s'il s'agissait d'un incident isolé de recours à la force et se demander si Israël a un droit à l'autodéfense justifiant cette action en droit international, c'est fondamentalement mal caractériser la situation. L'action actuelle d'Israël est en fait une reconfiguration de l'usage de la force qu'il exerçait déjà, sous la forme du blocus (avec des bombardements épisodiques et des incursions terrestres) et avant cela dans sa manifestation originale de bottes-sur-le-terrain et de colonies, en ajoutant de nouveaux moyens et de nouvelles méthodes ».
Exemple : La plupart des déclarations officielles européennes et américaines, ainsi que les encadrements des médias grand public.
C. Utilisation de la voix passive
Problème : l'utilisation de la voix passive exonère l'apartheid israélien de ses responsabilités et dissimule ses crimes.
Exemple : « 40 000 Palestinien·nes sont morts » au lieu de “Les forces d'occupation israéliennes ont tué 40 000 Palestinien·nes”.
D. Délégitimer les sources palestiniennes
Problème : mettre en doute les sources et les témoignages palestiniens et sources palestiniens en les jugeant peu fiables et en ajoutant des qualifications par ouï-dire, ce qui déshumanise les Palestinien·nes et sape leur crédibilité.
Exemples : Attribution des chiffres des martyrs palestiniens au « ministère de la santé dirigé par le Hamas » / « Le Hamas affirme que les frappes israéliennes ont tué 40 personnes dans la zone de sécurité de Gaza » / « Un médecin chevronné de Gaza affirme avoir subi de “graves tortures” après avoir été libéré d'une détention israélienne » / « Israël a tué 40 Palestinien·nes, selon des responsables/témoins ». Depuis l'année dernière, l'un des principaux exemples a été de délégitimer et de remettre en question les chiffres provenant du ministère de la santé de Gaza et de qualifier tout fait provenant de Gaza d'allégations du « Hamas ». C'est absurde si l'on considère que lors de toutes les campagnes de guerre menées à Gaza depuis 2009, le nombre de mort·es n'a jamais été remis en question, que l'ONU utilise toujours les données, que le ministère de la santé est également administré par des employés de l'Autorité palestinienne, que les données proviennent de tous les établissements de Gaza, y compris des hôpitaux chrétiens, que l'ONU utilise toujours ces données et que le nombre de mort·es est très largement sous-estimé et probable.
E. Présomption de culpabilité pour les Palestinien·nes et présomption de légitimité pour la violence israélienne
Problème : utiliser les justifications de l'armée israélienne à leur juste valeur ; adhérer aux arguments israéliens pour obtenir le consentement à la violence ; déshumaniser les Palestiniens en les qualifiant de « non civils » ou d'« innocents » ou présumer que si Israël a bombardé un endroit, c'était pour atteindre une cible légitime spécifique. Les Palestiniens sont contraints de justifier leur humanité.
Exemples :
– appeler cela des « frappes ciblées » alors que des dizaines de civil·es palestinien·nes ont été tué·es et que des bâtiments entiers ont été détruits.
– « Commandement du Hamas détruit » alors qu'une zone entière a été anéantie.
– « L'armée israélienne enquête sur les soldat·es » comme titre alors qu'il existe des preuves vidéo des crimes commis par les soldat·es, et nous savons que le système israélien ne s'oblige jamais à rendre des comptes.
– Insister sur le fait que les habitant·es de Gaza ont été « prévenu·es » (sms/ prospectus) d'évacuer avant les bombardements, alors qu'elles et ils n'ont aucun endroit sûr où aller et perdront de toute façon leurs maisons.
F. La victime idéale
Problème : le reportage sélectif sur certaines victimes est une pratique déshumanisante qui suppose que certaines méritent plus de sympathie et de justice que d'autres.
Exemples : l'accent mis sur les femmes et les enfants et l'ignorance des hommes palestiniens en tant que victimes / l'exclusion des combattant·es de la résistance palestinienne de la couverture ou, lorsqu'ils et elles sont inclu·es, la criminalisation et la diabolisation de ces dernier·es.
G. Utilisation du concept de « terrorisme »
Problème : qualifier la résistance palestinienne de terrorisme et criminaliser le droit des Palestinien·nes à résister au colonialisme et à l'occupation.
Exemple : Qualifier les groupes et les individu·es de la résistance palestinienne de terroristes.
H. Censure
Problème : Interdire l'utilisation de certains termes pour masquer la réalité de l'apartheid israélien.
Exemple : Des médias imposent des politiques visant à interdire l'utilisation de termes qui reflètent la réalité, tels que « génocide », « nettoyage ethnique » ou « territoires occupés »
I. Minimisation et exceptionnalisation de la violence israélienne
Problème : Utiliser un langage aseptisé et réducteur pour minimiser l'oppression israélienne. Décrire la violence israélienne comme étant sans précédent ou inhabituelle, en minimisant le projet colonial centenaire mené par l'État, l'armée et les colons.
Exemples :
– « Israël a tué des dizaines de personnes » au lieu de rendre compte de l'ampleur des massacres israéliens.
– Qualifier les attaques des colons illégaux soutenus par l'État d'attaques « extrémistes », comme s'il ne s'agissait que de quelques pommes pourries.
– Mettre trop l'accent sur le « gouvernement de droite » ou pointer du doigt Netanyahou en suggérant que ses politiques sont exceptionnelles par rapport à des gouvernements plus centristes qui ont néanmoins bombardé Gaza et construit des colonies. Israël « envoie des troupes » au Liban vs. Israël « envahit » le Liban.
J. Légitimation institutionnelle
Problème : renforcement des récits sionistes par le biais d'un langage légitimant.
Exemple : Se référer à l'armée israélienne en tant que « Forces de défenses israéliennes » ou « Tsahal » plutôt que « armée d'occupation israélienne ou « armée israélienne »
7. Conseils pour une couverture journalistique éthique
1) Contextualisez votre reportage : Le colonialisme israélien n'a pas commencé le 7 octobre et la situation n'est pas un conflit entre deux camps symétriques et égaux. Pendant huit décennies, le régime colonial israélien a imposé l'apartheid et l'occupation au peuple autochtone de Palestine. Inscrivez vos reportages dans ce contexte.
2) Rejetez la qualification de terrorisme : rejetez ce concept, qui n'a pas de définition en droit international et a été exploité politiquement par les grandes puissances afin de blanchir leurs agressions illégales, particulièrement au moyen-orient.
3) Contrez la désinformation sur le droit à l'autodéfense d'une puissance occupante : de telles affirmations sont non seulement moralement indéfendables, mais elles n'ont pas non plus de valeur juridique en vertu du droit international. (Voir le point ci-dessus sur l'autodéfense). Au lieu de cela, rappelez que le droit des opprimé·es à résister pour exercer leur droit à l'autodétermination est bien inscrit en droit international.
4) Soulignez la criminalisation : mettre en lumière la suppression systémique et la criminalisation par Israël de toutes les formes de résistance des Palestinien·nes au cours du siècle dernier, y compris les manifestations, les grèves, les boycotts, l'organisation politique et le travail juridique et de plaidoyer.
5) N'utilisez pas la forme passive ou un langage euphémisant : rejetez l'utilisation d'un langage léger ou dépolitisé dans votre travail sur la Palestine. Évitez de filtrer les termes, ou le langage passif qui minimisent ou édulcorent les crimes israéliens.
6) Ne prenez pas les sources des officiels israéliens pour argent comptant : la désinformation fait partie intégrante des tactiques du régime israélien. Il faut toujours évaluer de manière critique et remettre en question la crédibilité des sources officielles israéliennes, rechercher des vérifications indépendantes et vérifier les faits.
7) Cessez de présumer immédiatement de la culpabilité des Palestinien·nes : reconnaître la déshumanisation inhérente au fait d'obliger les Palestinien·nes à prouver leur humanité et mettre fin à toute question ou formulation décontextualisée, de faux-fuyant ou de fausse équivalence qui traite les Palestinien·nes comme s'ils et elles étaient soumis·es à un interrogatoire.
8) Faites entendre les voix palestiniennes et respectez la capacité des palestiniens à parler pour eux-même : donnez le micro aux Palestinien·nes en tant qu'agents actif·ves et veillez à ce qu'ils et elles aient leur mot à dire sur la manière dont leurs propres histoires sont racontées. Faites confiance aux sources palestiniennes et valorisez les, sans scepticisme mal placé. Inclure les Palestinien·nes en tant qu'analystes, expert·es et représentant·es crédibles de leurs propres réalités.
9) Ne cherchez pas la victime parfaite : évitez de créer une hiérarchie de la victimisation en fonction de ce qui correspond le mieux à vos attentes. N'exceptionalisez pas les femmes et ne mettez pas toujours l'accent sur les enfants dans votre couverture en oubliant les autres. Toutes les victimes palestiniennes méritent que leur histoire soit entendue et couverte.
10) Ne vous laissez pas intimider ou (auto)censurer par les lobbys pro-apartheid et la peur des représailles par des groupes de diffamation : ne cédez pas aux intimidations et à la diffamation du régime israélien et des pro-apartheid, car il s'agit d'outils intentionnels pour faire taire et discréditer les reportages véridiques.
Ressources clés :
— PIPD, '10 things to remember when reporting on Palestine' (10 choses à garder à l'esprit lors d'un reportage sur la Palestine)
— IMEU, Guidance for Reporting on Palestine/Israel
— Guide de reportage de l'AMEJA pour les médias
— AJ+, « Pourquoi ce n'est pas la “guerre Israël-Hamas” ».
— AJ +, « Les Palestiniens “meurent-ils” ? Ou sont-ils « tués » ?
— Comment l'AFP utilise le mot terroriste
— Mohammed El-Kurd, « Le droit de parler pour nous-mêmes ».
— Corrections de titres par Assal Rad.
— Détection par NewsCord de la partialité des médias et de leur complicité dans le génocide israélien.
— Commentaire d'Al-Shabaka sur la complicité des médias occidentaux.
— Teach in by Jaddaliya with Sana Saeed on US Media Complicity in Israel's Genocide.
8. Analyses, étayées par des données, de la partialité des médias à l'égard du génocide israélien
Médias américains : par The Intercept
Médias britanniques : par le Centre for Media Monitoring
Médias français : par Acrimed et Arret sur Image (TV)
Sur la partialité du New York Times
9. Contacts clés
Pour toute question, demande de renseignements, interview avec les médias et demande de contacts palestiniens :
Inès Abdel Razek, ines.abdelrazek@thepipd.com
Traduction : Agence Média Palestine
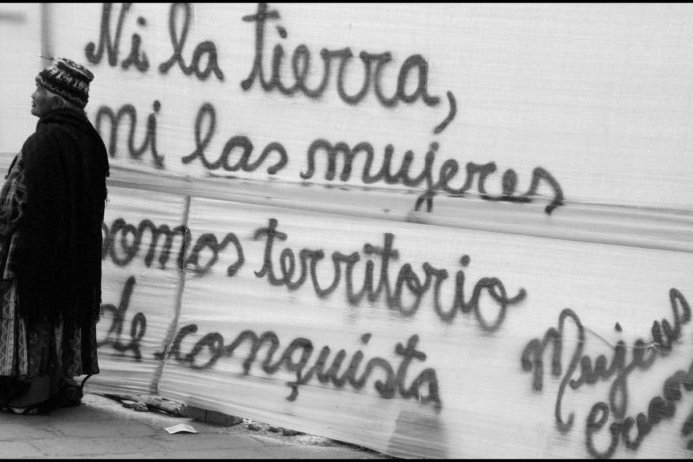
La farce de la « prise en compte du genre » : une grille de lecture féministe des politiques de la Banque mondiale
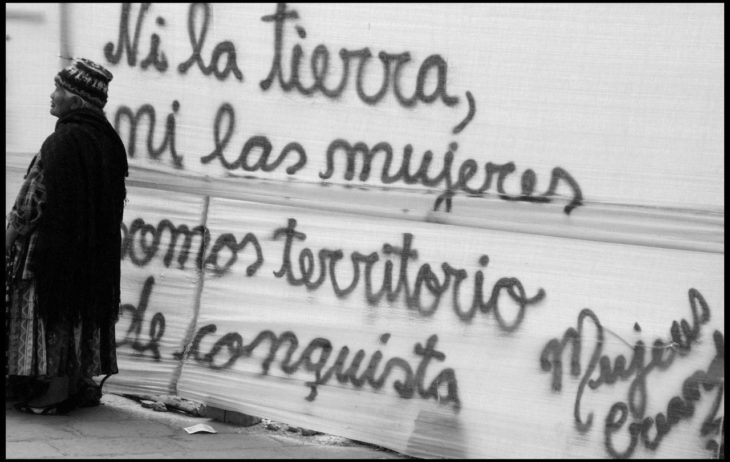
La Banque mondiale et le FMI ont 80 ans. 80 ans de néocolonialisme financier et d'imposition de politique d'austérité au nom du remboursement de la dette. 80 ans ça suffit ! Les institutions de Bretton Woods doivent être abolies et remplacées par des institutions démocratiques au service d'une bifurcation écologique, féministe et antiraciste.
Tiré de CADTM infolettre , le 2024-09-26
25 septembre par Camille Bruneau
Il n'est pas possible de s'intéresser aux politiques de la Banque mondiale ou à l'émancipation des peuples sans prendre en compte les enjeux de genre, eux-mêmes imbriqués avec d'autres systèmes d'oppression et rapports sociaux inégalitaires.
Si officiellement la Banque mondiale s'approprie « l'égalité de genre » en faisant presque de l'« empowerment » une obligation pour les pays débiteurs, la pratique révèle trop peu de véritable préoccupation pour cet enjeu. Comme avec les questions environnementales, le décalage entre les beaux discours et les changements réels est énorme.
Cette apparente inclusion est problématique à bien des égards : les conséquences concrètes des projets menés et les recommandations macro-économiques sont contraires à toute perspective d'émancipation. En plus, sa conception même de l'(in)égalité de genre s'inscrit dans un agenda néolibéral affiché qu'elle ne prend même pas la peine de dissimuler.
Cette étude poursuit deux objectifs. D'une part, démontrer comment ces « stratégies genrées » continuent d'asseoir la domination occidentale et, souvent, renforcent le patriarcat plutôt que de le combattre. Ceci s'observe de trois manières principales :
– Cette prétendue inclusion s'apparente à du « genderwashing », en d'autres termes, à une opération de communication ;
– Les discours de la Banque mondiale renforcent certains aspects de la domination patriarcale ;
– Les projets et politiques prescrit.es ont des conséquences néfastes.
D'autre part, il s'agit de donner quelques clefs d'analyse pour quiconque voulant s'intéresser aux Institutions financières internationales sans fermer les yeux sur des mécanismes d'oppression centraux.
Pourquoi une analyse féministe des Institutions financières internationales ?
On sait que « les prêts de la Banque mondiale, loin d'être des gestes désintéressés, sont au contraire un moyen de soumettre le pays politiquement et économiquement à l'ordre international des puissants, de le ‘modeler' selon leurs besoins et ceux de la classe dominante locale, pour en tirer un bénéfice maximal » [1]. Autrement dit, la dette est un des mécanismes centraux dans le maintien des rapports de pouvoir, elle est indispensable à la reproduction du capitalisme néolibéral et participe de manière fondamentale aux oppressions patriarcales, néocoloniales, racistes, extractivistes, …
On sait aussi que les politiques liées à ces prêts impactent profondément et durablement les populations les plus vulnérables (alors que la « mission première » de la Banque est officiellement de leur venir en aide), dont une grande partie sont des femmes [2].
Il est dès lors certain que les femmes sont impactées directement (c'est-à-dire en tant que « femmes » dans un système patriarcal) et indirectement (par l'accroissement général des inégalités).
La dette n'est pas « aveugle » et doit être pensée au sein de rapports sociaux
Le patriarcat - qui légitime les violences sexistes et les discriminations quotidiennes - se base sur la séparation entre les activités dites « productives » et celles dites « non-productives » ou « reproductives ». Ces dernières - pourtant essentielles à la reproduction de la vie sur terre et des sociétés - sont socialement dévalorisées et assignées aux femmes. Le système économique dominant repose tout autant sur cette séparation : l'accumulation du capital (bénéficiant principalement à des hommes riches) est entretenue grâce à du travail sous-payé ou gratuit effectué par une écrasante majorité de femmes, « naturellement » vouées aux tâches de soins, de soutien, de services : le travail de « care » [3].
En cas de crise économique (en général liée aux dettes), leur statut marginal sur le marché du travail signifie qu'elles sont les premières concernées par les licenciements ou la précarisation des emplois. Elles sont aussi les premières à pallier le retrait de l'État social, vu leur assignation prioritaire au travail domestique. Ces inégalités socioprofessionnelles ont des conséquences durables : sur leur pension, leur sécurité sociale (si elle existe), etc. Comme elles sont moins bien placées pour faire face aux crises, elles sont d'autant plus sujettes à l'exploitation. Rappelons ici que dans de nombreux pays, les puissances coloniales ont propagé les normes et inégalités de genre européennes.
Depuis les années 1990, on assiste à un processus de réorganisation et de réappropriation du travail (re)productif à l'échelle mondiale, notamment autour de critères de genre, de classe et de « race », dessinant les contours d'un nouveau capitalisme patriarcal et raciste globalisé. Un outil de prédilection de sa mise en place est la dette publique ou celles des ménages des classes populaires, qui accélèrent cette division sexuelle et raciale du travail ainsi que les violences sexistes via la demande de travailleurs et travailleuses sous-payées et la dépendance aux revenus. Les femmes non-blanches et migrantes sont ainsi encore une fois les principales « perdantes » [4].
Évidemment, certaines femmes (souvent issues de classes sociales supérieures) échappent à cette assignation, tout comme certains hommes (surtout non-blancs, migrants et précarisés) rentrent dans la catégorie des personnes effectuant du travail de care dévalorisé et invisibilisé [5]. C'est pour cela qu'il faut privilégier une approche imbricationniste [6] et en termes de rapports sociaux - qui nous concernent toutes et tous - plutôt que de discriminations ou privilèges individuels.
Il apparaît alors comme une évidence que la structure genrée et raciste de l'économie dominante doit être prise en compte dans nos analyses.
Principalement à partir des années 1990, des études de tous bords ont critiqué les impacts genrés des politiques de la Banque mondiale et des plans d'ajustement structurel ce qui a forcé les IFI à « réagir ». L'une des caractéristiques de la Banque mondiale est sa capacité à se réapproprier les critiques afin d'essayer de renouveler son image et ainsi renforcer son emprise sur une multitude d'acteurs politiques, sociaux, économiques et scientifiques [7].
De nombreuses féministes dénoncent pourtant depuis longtemps cette récupération par les IFI et les programmes de « développement » (notion problématique en soi [8]), qui occultent les voix féministes radicales et anti-impérialistes et ré-légitiment certaines formes d'exploitation des femmes.
Après le greenwashing, place au pink ou genderwashing, où une nouvelle conditionnalité des prêts, le « budget sensible au genre », prétend prendre en compte la réduction des inégalités de genre dans les politiques budgétaires et fiscales.
Chronologie de la prise en compte des inégalités et du genre
Les années 1980 et les PAS sont synonymes de destruction de la protection sociale et des moyens de subsistance pour les peuples des Suds. Ces phénomènes contribuent à l'accroissement de diverses inégalités et impactent particulièrement les femmes.
Les inégalités, dont la Banque mondiale ne se souciait guère, étaient vues comme un mal nécessaire à la croissance qui seraient un jour amoindries par « l'effet de ruissellement ». En plus d'être complètement erroné, ce point de vue ne s'intéresse pas à ce qu'il y a derrière les « inégalités », résumées à l'écart de revenus entre les « riches » et les « pauvres ». Il aura fallu longtemps avant qu'apparaisse la question de savoir « qui est pauvre et pourquoi ? ». Parmi les textes fondamentaux de la Banque mondiale sur l'inégalité, citons celui de S. Kuznets paru en 1955 [9], où le mot « femmes » apparaît, sans surprise… zéro fois (voir encadré sur Kuznets rédigé par Éric Toussaint). Ce n'est finalement qu'en 1982 qu'on commence à parler des « femmes », et cela, principalement de deux manières : des paysannes improductives ou des arriérées ayant trop d'enfants. Les « PED » auraient tout à gagner à les inclure dans les efforts d'augmentation de la productivité agricole [10] (notamment en utilisant des engrais chimiques et des semences extérieures). Et cette vision est encore présente dans de nombreuses déclarations.
Simon Kuznetz et la justification de l'augmentation des inégalités (Éric Toussaint)
Simon Kuznets a élaboré dans les années 1950 une théorie selon laquelle un pays dont l'économie décolle et progresse doit nécessairement passer par une phase d'augmentation des inégalités. Selon ce dogme, les inégalités commenceront à baisser dès que le pays aura atteint un seuil supérieur de développement. C'est un peu la promesse du paradis après la mort qui est utilisée par les classes dominantes pour faire accepter une vie faite de souffrances et de reculs. La nécessité de voir monter les inégalités est très ancrée à la Banque mondiale. Pour preuve, les paroles du président de la BM, Eugene Black, en avril 1961 : “Les inégalités de revenus découlent nécessairement de la croissance économique (qui) donne la possibilité aux gens d'échapper à une existence dans la pauvreté » [11]. Pourtant, les études empiriques réalisées par la Banque Mondiale du temps de Hollis Chenery, économiste en chef de cette institution dans les années 1970 ont infirmé les affirmations de Kuznets.
Dans son livre Le capital au XXIe siècle [12], Thomas Piketty a présenté une critique très intéressante de la théorie de Kuznets. Piketty rappelle qu'au départ Kuznets doutait lui-même du bien-fondé de sa courbe, cela ne l'a pas empêché d'en faire une théorie qui a la vie longue. Entre temps les inégalités ont atteint un niveau inédit dans l'histoire de l'humanité. C'est le produit de la dynamique du capitalisme globalisé soutenue par les politiques des institutions internationales en charge du « développement » et des gouvernements qui favorisent le 1 % le plus riche au détriment de l'écrasante majorité de la population tant au Nord qu'au sud de la planète.
En 2021, la Banque mondiale est revenue sur le printemps arabe de 2011 en affirmant, contre toute évidence, que le niveau d'inégalité était faible dans toute la région arabe et cela l'a beaucoup inquiété car selon elle c'est le symptôme que quelque chose ne fonctionne pas suffisamment dans le supposé succès économique de la région. En fidèles adeptes de la théorie de Kuznets, Vladimir Hlasny et Paolo Verme affirment dans un document publié par la Banque mondiale qu' « une faible inégalité n'est pas un indicateur d'une économie saine » [13].
Au cours des années 1990, alors que de nombreux pays subissent de plein fouet les conséquences des PAS et que les femmes en portent spécifiquement certains « dommages collatéraux », la question de la « réduction des inégalités hommes-femmes » fait son apparition. La conférence de Beijing de 1995 met à l'agenda international les « droits des femmes » et la « réduction des inégalités », notamment via la « participation à l'économie » [14]. Mais la question ne devient vraiment prégnante qu'à partir des années 2000.
Si la Banque mondiale adopte en 2001 sa première gender mainstreaming strategy qui servira de base pour ses futurs plans d'actions et évaluations et que la question de la « condition des femmes » est mentionnée dans le rapport annuel de 2003 et quelques autres documents, la notion de genre reste largement absente des textes fondamentaux de la Banque mondiale sur la réduction des inégalités. A titre d'exemple, en 2004, le fameux « Triangle pauvreté-croissance-inégalité » [15] de l'économiste en chef de la Banque mondiale, François Bourguignon, un des socles de la pensée développementaliste de la décennie, ignore complètement les enjeux de genre.
La phrase d'accueil actuelle de la page « égalité des genres » de l'Association internationale de développement en dit long : Faute d'exploiter le potentiel productif des femmes, on passe à côté d'une opportunité de premier plan, avec de lourdes conséquences au niveau des individus, des familles et des économies
Dans le rapport annuel de 2006, par contre, on trouve quelques réflexions sur les inégalités et discriminations de genre et la nécessité de s'y intéresser. La Banque mondiale évoque même qu'il serait possible de les réduire en investissant dans la protection sociale, la santé reproductive, l'éducation des filles, l'accès à l'eau, mais aussi et surtout en encourageant la propriété privée et la productivité.
Année après année, les propositions « progressistes » sont invariablement contrebalancées par d'autres « intérêts antagonistes ». Il serait par exemple nécessaire de trouver un juste milieu entre la protection sociale des travailleuses et la rentabilité des entreprises.
« La combinaison des moyens d'action doit être évaluée de façon à établir un équilibre entre la protection (de tous les salariés) et la possibilité pour les entreprises de se restructurer, ce qui est d'une importance capitale pour dynamiser la croissance et créer des emplois. »
« La sécurité des salariés est souvent assurée par divers textes législatifs excessivement rigoureux sur la protection de l'emploi, qui rendent le recrutement coûteux en général et, dans certains cas, plus coûteux encore lorsqu'il s'agit de recruter des travailleurs non qualifiés, des jeunes et des femmes. » [16]
La sécurité sociale, essentielle pour les plus précaires, dont les femmes font partie, serait donc un obstacle à la rentabilité des entreprises. Quand des propositions positives concernant les femmes ne sont pas contrebalancées de la sorte, elles sont alors justifiées par le fait que cela incite la prise de risque et donc la rentabilité, ou que cela contribue à la compétitivité, la productivité, la croissance, l'esprit d'entreprise, … Quand des discriminations sont attaquées en tant que telles, comme la violence domestique, c'est pour permettre une meilleure intégration des femmes sur le marché du travail ! Ce ne sont donc pas des fins en soi.
2007 est l'année du Gender Action Plan (plan d'action genre), intitulé : « L'égalité des sexes, un atout économique ». Il établit la centralité des questions de genre et reste depuis lors une base régulièrement mise à jour.
Il s'appuie sur une évaluation indépendante et très critique de la stratégie de 2001, pointant du doigt la non-prise en compte de cette dimension dans les programmes dès 2003.
Soupçonnant la faille dans l'absence de mécanismes de contrôle et d'évaluation, la nouvelle stratégie pour 2007 met l'accent sur des secteurs « prioritaires » pour l'émancipation des femmes : « la terre et l'agriculture, le travail, le développement du secteur privé, la finance et l'infrastructure » [17]. Il semblerait qu'en 2007, les femmes n'étaient pas concernées par les questions de reproduction sociale, les services publics, les violences, etc. !
Le rapport sur le développement dans le monde 2012 : L'égalité des sexes et le développement devient à son tour le cadre conceptuel pour les prochaines stratégies.
Malgré une reconnaissance de plus en plus prégnante des normes de genres et de la division sexuelle du travail au fil des années [18], la recette reste l'augmentation des revenus par la participation au travail rémunéré.
Dans la même logique, la Banque mondiale lance en 2015 sa stratégie pour 2016-2023 sous l'étendard de la « croissance inclusive ». Si dans la partie « progrès depuis 2000 », le rapport constate que « l'inégalité entre les sexes dans le monde s'est obstinément maintenue dans de multiples dimensions » même si les femmes se sont engagées dans des activités économiques, la partie « leçons apprises » ne contient aucune remise en question de ses propres politiques [19]. A la fin, elle se félicite même de montrer le chemin en matière de progrès dans l'égalité de genre dans plusieurs domaines.
Enfin, en 2016, toute une série de nouveaux indicateurs sont proposés pour l'évaluation. Ceux-ci sont, dans leur quasi-totalité, en lien avec le travail salarié, j'y reviens plus tard dans cette étude.
En bref :
La question du genre est présente dans les rapports depuis un peu plus de 20 ans, mais sans faire partie des stratégies centrales avant 2006, alors que récemment la BM y a consacré une multitude de rapports et projets.
Cette évolution récente n'exprime pas une prise de conscience féministe ou une volonté d'en finir avec l'exploitation. Elle doit être comprise comme :
– Une action de communication en réponse aux critiques et à d'importants mouvements de contestation ;
– Une tentative « d'incorporer les femmes et le mouvement féministe dans le processus de mondialisation néolibérale » [20].
L'émancipation n'est jamais traitée comme une fin en soi mais bien comme un outil dans l'intérêt de l'économie capitaliste. Les femmes sont des ressources, un investissement, un facteur de production sous-utilisé, et il faut les amener dans la sphère productive.
La phrase d'accueil actuelle de la page « égalité des genres » de l'Association internationale de développement (IDA) en dit long : « Faute d'exploiter le potentiel productif des femmes, on passe à côté d'une opportunité de premier plan, avec de lourdes conséquences au niveau des individus, des familles et des économies. » [21]
Tous ces discours ont par ailleurs alimenté une forme de féminisme institutionnel et impérialiste, une nouvelle carte à jouer pour le néolibéralisme, agissant maintenant fallacieusement par « souci du droit des femmes ».
La Banque mondiale continue de prescrire des politiques qui portent préjudices aux femmes en pleine connaissance de cause, en donnant, avec le FMI, la priorité au remboursement de la dette par rapport aux dépenses sociales. Au centre de ces stratégies figurent les marchés et non des humains ; ce sont là des discours aux allures progressistes qui ne remettent jamais en question la position néolibérale de base. On assiste donc ni plus ni moins à un ambitieux projet de genderwashing.
L'approche « genre » de la Banque mondiale : un discours au service du capital, pas de la majorité des femmes !
Depuis la reconnaissance des impacts négatifs des projets de « réduction de la pauvreté », indifférents aux genres et adressés aux « chefs de familles », on l'a vu, de nombreux programmes de « développement » ont commencé à mettre l'accent sur la réduction des inégalités professionnelles, les « stratégies genrées » et l'empowerment. Les droits des femmes comme partie intégrante du développement sont devenus l'objectif affiché des institutions internationales et des ONG. Et le gender budgeting, devenu obligatoire, est la continuité d'une démarche tournée vers les besoins des investisseurs, en utilisant l'argument de ce miraculeux « effet cascade » censé être favorable aux femmes et aux pauvres.
Pourtant, en plus du genderwashing exposé plus haut, le discours dominant de la Banque mondiale et ses alliés renforce certains biais genrés, réaffirmant ainsi une forme de domination patriarcale, pour deux raisons.
Premièrement, en prétendant « décider à la place des femmes - surtout non-occidentales- ce qui est bon pour elles », la Banque prend le rôle du papa ou professeur de l'économie mondiale qui agit pour le bien d'êtres incapables de savoir ce dont elles ont besoin.
En effet, il est bien plus courant de lire et entendre ce que la Banque mondiale considère être une femme « émancipée », que les voix de ces mêmes femmes. Les discours s'appuient systématiquement sur une norme de genre ou l'autre qu'ils renforcent pour servir des intérêts spécifiques. Cela confisque aux femmes des Suds leur capacité à décider des moyens de leurs émancipation en les plaçant dans des cases préfabriquées et homogènes, -aveugles à l'intersectionnalité [22] ou aux réalités multiples et variées des femmes - et utiles aux théories économiques et conjonctures du moment : l'actrice économique dont l'esprit d'entreprise est entravé par la culture locale ; la pourvoyeuse des besoins du foyer, centrale à l'économie familiale et à la résilience face aux crises ; l'ouvrière aux petites mains, indispensable à la croissance économique ; ou encore la pauvre victime vulnérable…
Ces discours se perpétuent, comme on le voit dans un rapport du FMI qualifiant les femmes « d'un des actifs les plus sous utilisé de l'économie » [23].
Deuxièmement, l'empowerment, processus émancipatoire multidimensionnel qui devrait inclure de nombreux facteurs, est mesuré principalement via la « participation à la vie économique et politique » des femmes, ce qui est tout à fait insuffisant [24]. Ce discours de l'émancipation par le travail est problématique et dangereux pour plusieurs raisons :
En prônant l'augmentation de la participation des femmes à la vie économique, ce discours occulte complètement la réalité du fonctionnement actuel de la plupart des sociétés humaines, comme si les femmes ne participaient pas à la vie économique quand elles n'ont pas un emploi salarié déclaré ! Quid du travail gratuit colossal effectué pour prendre soin des êtres chers, des communautés et des écosystèmes, sans lequel « l'économie productive » s'effondrerait tout simplement ? Non pas que la Banque mondiale ignore leur existence, mais ces réalités n'entrent pas dans ses considérations. Ce sont au mieux des « obstacles » au travail salarié des femmes : une redistribution qui ne reproduirait pas des relations d'exploitation, une prise en charge publique ou collective, ou encore une remise en question des normes de genre, ne sont pas au programme ;
La négation de l'importance du travail de care, alors que le travail salarié est valorisé, peut contribuer à augmenter les inégalités de genre (en augmentant le temps de travail total), mais aussi entre femmes car ce sont les femmes des classes populaires qui prennent en charge le travail de care dans une grande partie des ménages riches (délaissé par les femmes qui accèdent à des emplois à temps plein correctement rémunérés et que ni les hommes ni la collectivité ne prennent en charge) ;
Cette vision simpliste de l'émancipation comme synonyme uniquement d'autonomie économique via le travail salarié ignore le fait que l'augmentation du nombre de femmes sur le marché de l'emploi va en général de pair avec une augmentation du nombre d'emplois ultra-précaires. Dans de nombreux pays, cette entrée sur le marché du travail s'est concrétisée dans les zones franches, faisant du travail dévalorisé des femmes un outil privilégié pour augmenter la rentabilité. Au Cambodge, par exemple, le début des années 2000 est marqué par une forte croissance économique, nourrie par les exportations de l'industrie du textile qui emploie quasi-exclusivement des femmes. Dans le même temps, de 2004 à 2009, l'écart salarial a plus que doublé [25]. À moins de s'attaquer simultanément à toute forme d'exploitation, une expansion du marché du travail ira toujours de pair avec une augmentation de l'exploitation de certain.es.
L'approche est de surcroît insuffisamment fondée. Bien que des arguments semblent indiquer une corrélation entre croissance économique et diminution des inégalités de genre, d'autres démontrent également que l'inégalité économique augmente avec certaines formes de croissance ;
Elle ignore qu'il existe d'autres possibilités pour subvenir à ses besoins : économie informelle, autosuffisance, etc. Les principaux indicateurs étant « taux de participation » et « revenus », l'émancipation est mesurée en termes monétaires et non en termes de qualité de vie. Signalons que l'entrée sur le marché de l'emploi des femmes s'accompagne souvent de la destruction des précédents moyens de subsistance et lieux de vie, provoquant la migration massive vers les villes pour rejoindre le rang des travailleuses précaires (domesticité, travail industriel, prostitution, services, …). Dans de nombreux cas, si la « pauvreté monétaire » diminue, la pauvreté matérielle et la pénibilité quotidienne augmentent !
Ce discours est celui d'une mise au travail des femmes au service des intérêts financiers, tout à fait assumé et à peine maquillé d'un prétendu féminisme institutionnel et occidental aux relents impérialistes et néolibéraux. Il enlève aux femmes des Suds leur autodétermination et réprime les voix radicales qui mettent plutôt l'accent sur la fin de la surexploitation du Sud par le Nord comme condition à l'émancipation des femmes dans leurs diversités.
Bien qu'au fil des années elle ait intégré des critiques dans son discours, la Banque mondiale continue de parler des femmes en termes quasi-exclusivement économiques, fermant la voie d'une réelle émancipation, qui ne peut être réduite à une seule dimension économique.
Cette intégration ne témoigne pas d'une volonté d'en finir avec les logiques de domination, ou d'assurer des droits humains fondamentaux, mais bien d'assurer la rentabilité. Selon la Banque mondiale, il ne faut donc pas trop insister sur les notions de patriarcat et de rapports sociaux inégalitaires car cela risquerait de fragiliser le socle de travail exploité sur lequel repose le système en place.
Les prêts, les projets et les politiques de la Banque mondiale : des impacts spécifiques et néfastes
Bien que plusieurs programmes de la Banque mondiale améliorent sûrement l'accès des femmes au travail et leur condition en général (le recul de l'âge de la maternité, l'accès à l'école, l'égalité formelle, les programmes d'insertion professionnelle et d'économies solidaires, etc.), des critiques s'imposent.
Au nom de la stabilité macro-économique, l'institution impose la rigueur budgétaire et favorise la rentabilité des entreprises. Les mécanismes qui ont creusé les inégalités sont à nouveau prescrits comme solution.
Suite à l'application des recommandations macro-économiques de la Banque mondiale, des ressources tout à fait insuffisantes sont allouées aux services publics et à la protection sociale, qui profitent principalement aux populations vulnérables dont les femmes font globalement partie.
A titre d'exemple, dans les années 1990, alors que les pays africains allouent entre 15 et 50 % de leur budget au service de la dette, systématiquement moins de 20 % le sont pour les services sociaux. En 2013 en Amérique latine, il s'agit souvent de moins de 10 % pour l'éducation, moins de 5 % pour la santé, contre entre 10 et 40 pour la dette [26].
De manière non exhaustive, rappelons certaines des mesures phares prônées par la Banque mondiale et le FMI : dévaluation de la monnaie, suppression de barrières tarifaires et douanières, démantèlement du contrôle des prix et des subventions publiques, assouplissement des lois sur le travail, privatisations, diminution des taxes pour les entreprises et des impôts sur le capital, augmentation de la TVA, encouragement des exportations afin de faire entrer des devises étrangères, diminution des dépenses publiques, gel des salaires et coupes budgétaires dans les services sociaux et publics comme l'éducation, la santé, la protection sociale, l'associatif, les transports, les infrastructures de base, etc.
Ces ajustements de variables macro-économiques, qui visent à garantir le remboursement rapide des créanciers, se traduisent par des conséquences très concrètes sur la vie des populations les plus précaires. Une perspective sensible au genre permet de décliner comment les femmes sont spécifiquement [27] impactées en six axes différents mais pouvant agir simultanément et à des dégrées variés selon les contextes et régions.
– Les femmes sont les principales travailleuses des secteurs concernés ;
– Les femmes sont les principales usagères et bénéficiaires des services et secteurs concernés ;
– Ce sont les mères, épouses, sœurs, etc., c'est-à-dire les femmes, qui compensent les chocs économiques et le retrait de l'état social par une augmentation de leur travail gratuit ;
– Les femmes sont les premières productrices et agricultrices mondiales, notamment dans l'économie informelle, dont les moyens de subsistance et de production sont détruits ;
– Les femmes sont les premières victimes des violences sexistes qui augmentent à cause des méga-projets et de la précarisation de larges franges de la population ;
– Ce sont les cheffes de foyers et petites entrepreneuses qui contractent des microcrédits et crédits à la consommation pour subvenir à leurs besoins et ceux de leurs proches.
Cette grille de lecture peut être appliquée de manière systématique aux analyses de la dette et de l'austérité. Intéressons-nous ici à quatre types de mesures mises en avant par la Banque mondiale.
Politiques agricoles et projets extractivistes : impact sur les femmes
Loin de s'intéresser à la préservation des écosystèmes, de nombreux projets et stratégies de la Banque mondiale suivent une logique extractiviste : le « développement » et la croissance par l'exploitation et la destruction des ressources naturelles [28]. Je citerai les « éléphants blancs », ces mégaprojets nuisibles et souvent imposés : projets de production énergétiques, projets miniers, d'infrastructure ou logistiques, dont le barrage INGA en République démocratique du Congo est emblématique. Je pense également aux réformes qui s'inscrivent dans le sillon de la « révolution verte » [29] et aux politiques d'exportation qui contribuent à détruire le vivant, les communautés et la souveraineté alimentaire : monocultures, OGM, pollution et épuisement des sols, biopiraterie via la propriété intellectuelle et l'accaparement des terres, etc.
Ces projets ont en commun un caractère écocide évident mais aussi le fait qu'ils contribuent très souvent à la destruction des moyens de subsistance, des territoires et des savoirs des communautés, dont la préservation repose principalement sur les femmes. Ces destructions (déforestation, pollutions des sols, inondations) les poussent à la migration forcée, à la recherche d'alternatives dans ces « nouveaux » emplois réputés typiquement féminins : domesticité, production en zones franches, soins aux autres, ou encore la prostitution subie. C'est notamment de cette « entrée » des femmes dans « l'économie productive » que se félicite la Banque mondiale. D'après le consortium international des journalistes d'investigation, 3,4 millions de personnes ont été déplacées en conséquence des projets de la Banque mondiale, et se retrouvent dans des camps de déplacés internes [30]. Ce sont les personnes que la Banque mondiale est censée « aider » qui sont en réalité les plus impactées.
En plus de cela, ce type de projet implique souvent la présence de groupes armés, qu'ils soient chargés de « protéger » les projets en question, ou qu'ils cherchent à contrôler les territoires où se trouvent les matières premières. Cela aggrave les violences, notamment sexuelles, auxquelles les femmes sont confrontées. La violence répressive et meurtrière augmente également, notamment envers celles qui s'opposent à ces projets en défendant l'environnement, leurs terres, leur culture et leurs pratiques.
Les politiques agricoles de la Banque mondiale, quant à elles, aggravent certaines inégalités. L'agriculture est à l'échelle mondiale une des activités principales des femmes. Or, l'implantation de monocultures pour l'exportation (ce qui augmente le PIB et les devises pour rembourser la dette) signifie que l'agriculture vivrière, essentielle pour de nombreuses familles, est déplacée vers des terres toujours plus éloignées et moins fertiles. Cela augmente les temps de trajet, le risque d'agressions sur celui-ci et la pénibilité du travail, alors que les récoltes se réduisent en quantité et en qualité. Cela impacte directement les revenus, mais aussi la santé et la sécurité alimentaire des femmes, dont des filles qui sont les premières victimes de la malnutrition. Enfin cela porte aussi atteinte à la souveraineté alimentaire nationale. Dans certaines régions, les emplois dans les cultures de rente sont offerts aux hommes en priorité, poussant les femmes vers des activités encore plus précaires. Si globalement la proportion de l'emploi des femmes dans le secteur agricole a baissé depuis 20 ans (augmentation dans le secteur des services), il reste leur première source d'emploi dans les pays à faible ou à moyen revenu où elles exercent les activités les plus pénibles, les plus chronophages et mal-rémunérées. Les politiques agraires promues par la Banque mondiale impactent donc particulièrement les femmes [31].
Parmi les mesures imposées figurent la fin des subsides sur les intrants agricoles alors que les produits européens, eux subventionnés par la Politique agricole commune européenne (PAC), inondent les marchés : une concurrence tout à fait déloyale qui affectent directement les moyens de subsistance et de production des femmes.
Destruction des services publics
Comme expliqué par Éric Toussaint : « [les PAS], fruit d'une politique consciemment élaborée et appliquée par les responsables du FMI et de la Banque mondiale, ont eu des conséquences extrêmement négatives sur les droits économiques sociaux et culturels, spécialement en ce qui concerne la santé, l'éducation, l'accès à l'eau potable, la sécurité alimentaire, etc. » (voir « Le FMI et la Banque mondiale au temps du coronavirus : La quête ratée d'une nouvelle image », https://www.cadtm.org/Le-FMI-et-la-Banque-mondiale-au-temps-du-coronavirus-La-quete-ratee-d-une ).
La casse de ces secteurs, que l'on peut qualifier de biens communs, a de très lourdes conséquences sur les femmes. Premièrement, en tant que travailleuses et fonctionnaires qui perdent leur emploi ou voient leur salaire baisser sans compensations. Deuxièmement en tant qu'usagères, pour elles-mêmes ou celles et ceux dont elles ont la charge. La privatisation et les coupes budgétaires dans la santé en réduisent l'accessibilité pour les femmes les plus pauvres, affectant gravement les suivis gynécologiques, les maternités et tout ce qui est lié à la santé sexuelle et reproductive. Ces questions sont trop souvent ignorées par les décideurs, bien souvent des hommes.
Troisièmement en étant celles qui compensent par leur travail gratuit les changements imposés par la Banque mondiale. Cette dernière préconise en effet le retrait de l'État social moyennant la privatisation des services publics ou mise en place de partenariats publics privés (PPP). La gestion privée serait plus « compétitive » et donc efficace selon le dogme libéral. Une demande explicite et régulièrement formulée par la Banque est de privatiser la distribution de l'eau, ce qui a eu de nombreuses conséquences, notamment dans les cas de la Bolivie ou de la Tanzanie, se traduisant, en plus de l'inefficacité, par une hausse des prix, la fermeture de puits publics, avec des conséquences désastreuses sur l'agriculture. Aller chercher l'eau est une tâche qui incombe généralement aux femmes et aux filles. Pour elles, la réduction de l'accès à l'eau signifie une augmentation du temps dévolu à cette tâche, de risques pour leur santé, en particulier des problèmes de dos, et d'exposition à des agressions sur les trajets désormais plus longs [32]. Les PPP, vantés pour leur meilleure gestion, sont en réalités moins efficaces : ils coûtent jusqu'à six fois plus pour le contribuable et offrent des emplois plus précaires [33].
Les réformes fiscales
La Banque mondiale préconise des réformes fiscales en réalité favorables au grand capital : la suppression de barrières douanières, une baisse des impôts sur les sociétés, le patrimoine et les revenus les plus élevés. En contrepartie de ces pertes de revenus, l'augmentation de la TVA est la mesure phare des IFI. C'est ce qu'on appelle une fiscalité régressive car elle impacte proportionnellement plus les personnes aux plus petits revenus. Les « efforts budgétaires » demandés par la Banque mondiale sont en vérité assumés par ces personnes-là ! Les femmes, responsables de nombreuses dépenses pour le ménage, tout en ayant souvent un revenu inférieur, sont particulièrement confrontées à cet enfer quotidien. Le fait que des produits essentiels, comme les protections menstruelles, ne soient pas inclus parmi les « produits de base » avec une TVA réduite [34], entraîne des difficultés supplémentaires. Ainsi, une adolescente sur dix en Afrique rate une semaine d'école par mois en conséquence [35].
Un autre aspect concerne leur activité principale au niveau mondial : l'agriculture informelle et les activités informelles en général. Alors que le prix des intrants augmente, alors qu'elles dépensent de plus en plus pour l'activité dont elles dépendent, elles ne bénéficient pas des mêmes avantages fiscaux que les entrepreneurs de l'économie formelle. Pour le Bretton Woods Project, les femmes qui travaillent dans le secteur informel et se ravitaillent dans le secteur formel sont sans aucun doute les plus affectées par ces mesures. Dans une enquête menée par l'OIT, les femmes mettent explicitement « les taxes » parmi les obstacles à rejoindre l'économie formelle.
Ces mesures fiscales seront toujours inefficaces dans les pays à plus faibles revenus où la majorité de l'économie est informelle. Elles ne peuvent que conduire à l'adoption de nouvelles mesures restrictives, bien souvent des coupes dans la protection sociale… Un cercle vicieux bien rodé ! Ces ajustements imposés sont d'ailleurs une violation directe et répétitive du principe fondamental selon lequel le régime fiscal est la base de la souveraineté et de l'autonomie des États. Les dettes, contractées pour la mise en place de ces mesures, sont donc, de ce point de vue, totalement odieuses et illégitimes.
L'accès au microcrédit
Le microcrédit a été favorisé par les « soft loans » (les prêts doux) de la Banque mondiale et largement félicité par la communauté internationale. Le microcrédit consiste en l'attribution de prêts de faibles montants à des entrepreneurs/euses ou à des artisan·es qui ne peuvent pas accéder aux prêts bancaires « classiques ». Il s'est développé surtout dans les pays du Sud et vise les personnes hors du système bancaire et donc souvent les plus pauvres.
Les femmes représentent, au niveau mondial, environ 70 % de la clientèle des instruments de microfinance [36]. Sous couvert d'autonomisation économique, les femmes sont directement ciblées, entre autres à cause des stéréotypes quant à leur docilité de remboursement [37]. Ces micro-crédits se caractérisent par des taux d'intérêts bien plus élevés que dans les banques « normales », et certainement que le taux zéro qui est la norme dans la plupart des circuits de circulation monétaire traditionnels comme les tontines.
Jules Falquet souligne qu'« il ne s'agit pas d'autre chose que du droit, ou du ‘devoir' des femmes à s'endetter, en même temps que d'une manière de faire entrer dans les circuits bancaires du Nord les immenses ‘gisements d'épargne', souvent organisés par les femmes, qui existent dans le Sud » [38]. Cet appauvrissement des femmes par la dette consolide la logique de transfert de richesses des pauvres vers les riches.
Ce processus de bancarisation des pauvres et de création de nouvelles opportunités d'investissement est une manière de perpétuer les dommages causés par la croissance néolibérale qui continue d'exclure des solutions collectives et macro-économiques pour favoriser des réponses financières et individuelles.
Quelle autocritique au milieu d'une crise multidimensionnelle globale ?
Malgré tout cela, la Banque ne semble toujours pas effectuer de réelle autocritique. Par exemple, l'évaluation sur trois ans du plan d'action de 2007 ne répond pas aux critiques formulées par la société civile. Elizabeth Arend le montre en cinq axes : la non-considération des droits humains (qui incluent aussi les femmes !), l'attention insuffisante à la santé reproductive, le manque de données sérieuses quant au genre, la vision restreinte de l'émancipation comme l'autonomisation économique, et le manque de capacité d'action des bureaux nationaux [39].
En 2012, elle finit par reconnaître que la diminution des inégalités ne peut pas être réduite à « la croissance », et un imposant rapport reconnaît avoir trop misé sur la réduction des inégalités comme facteur contribuant à la croissance plutôt que comme fin en soi. Mais ne saluons pas trop vite un supposé « changement de paradigme » : l'analyse reste centrée sur l'économie et la recherche de « certaines sortes de croissances » avant tout [40].
Encore en 2014, les critiques continuent à pointer du doigt que la Banque mondiale néglige le travail de care. Une étude constate que sur une trentaine de projets, 92 % ne tiennent pas explicitement compte de l'existence du travail de soin non-rémunéré dans leur conception [41].
En 2016, tout en disant vouloir mieux appréhender le droit à la parole et la capacité d'action, elle s'obstine à « se baser sur ce qui a déjà été accompli » et « remédier aux obstacles spécifiques auxquels se heurtent les femmes dans l'accès aux opportunités économiques » [42]. Elle met aussi en place un groupe de travail pour s'attaquer aux violences sexistes, initiative critiquée pour son mandat extrêmement limité et son silence sur les violences engendrées précisément par les projets de la Banque mondiale.
Alors, à quoi bon les Analyses des Impacts sur la Pauvreté et le Social (AIPS) mises en œuvre par les pays débiteurs ? Bien que des guides contenant des pistes pour l'inclusion du genre existent, aucune mesure n'est contraignante [43]. Par exemple, le programme de « meilleure gestion » et « rationalisation » des secteurs publics en Serbie, imposé en contrepartie d'un prêt octroyé en 2016, a signifié une perte de presque 30.000 emplois et un gel des salaires dans les secteurs publics, où les femmes sont la majorité des travailleuses. L'AIPS ne rapporte aucun effet social sur la pauvreté ou la distribution des richesses.
Bien que l'analyse multidimensionnelle semble progresser, les années 2020 et 2021 confirment que les mesures macro-économiques prônées continuent à dégrader la situation des populations défavorisées. Après plusieurs décennies de politiques antisociales, les systèmes de santé se retrouvent particulièrement affaiblis dans un contexte de crise globale imminente fin 2019.
Alors que la part du budget alloué au service de la dette doublait dans les pays à bas et moyens revenus entre 2010 et 2018, des mesures d'austérité, qui se sont avérées inefficaces en plus d'être inégalitaires, continuent à être inlassablement appliquées. Les ressources allouées aux services publics diminuaient de 18 % en Amérique latine et aux Caraïbes, et de 15 % en Afrique sub-saharienne de 2014 à 2018, ce qui pourrait constituer un record d'ici quelques années si cela continue. Dans au moins 21 pays à bas et moyens revenus les budgets d'éducation baissent depuis 2015 alors que le service de la dette augmente. En ce qui concerne la santé, c'est le cas pour 39 pays [44], avec de lourdes conséquences sur la santé publique, le personnel soignant, les soins de proximité, les capacités d'hospitalisation, etc. À cela on peut ajouter la réduction de l'accès à l'eau potable dans de nombreuses régions. Dans ce contexte, comment faire face à la crise sanitaire qui éclate en 2020 ?
Il est immédiatement évident que le poids des choix politiques souvent incohérents retombe principalement sur les femmes. Elles sont particulièrement nombreuses dans les secteurs « essentiels » et donc en première ligne de l'épuisement et du danger de contamination. Elles sont aussi majoritaires dans l'impossibilité de télé-travailler, et dans de nombreuses régions c'est le cas des groupes ethniques défavorisés [45]. A l'inverse, elles sont aussi très nombreuses à exercer des métiers et occupations désormais interdites et sans compensations car informelles (domesticité, travail du sexe, commerce de rue…). Cela aggrave les inégalités économiques. Comme si cela ne suffisait pas, leur rôle de soin au sein des familles les expose plus au virus et augmente leur travail gratuit (enfants déscolarisés, confection de masques, …). Pour couronner le tout, les violences domestiques et les risques dus à la complète mise de côté de la santé reproductive et mentale montent en flèche. Un constat non seulement dramatique, mais prévisible [46].
L'annonce du moratoire de la Banque mondiale, des « aides » du FMI, ou encore des possibles restructurations du G20 sont, dans ce contexte, au mieux, des mauvaises blagues qui ne prêtent même pas à rire jaune pour les laissées pour compte du néolibéralisme. Sans structurellement remettre en question l'organisation du soin dans nos sociétés, cela ne fait que reporter un fardeau de la dette augmenté, qui impactera durement les femmes. La priorité de la Banque reste la stabilité macro-économique et des secteurs financiers, justifiant à nouveau politiques d'austérité et d'exportation.
Cette crise n'est pas seulement le résultat de facteurs économiques ou sanitaires, mais de notre rapport au vivant et aux activités essentielles, au « prendre soin » de ce qui nous entoure. Le rapport dominant, prôné dans les idéologies de la Banque mondiale, est à mille lieux de toute conception d'équilibre écologique et de bien-être collectif qui pourrait permettre de faire face à de telles crises sans sacrifier toujours les mêmes et en faire ainsi des crises sociales sans précédent.
Conclusion
Dans son fameux rapport de 2007, la Banque mondiale résume son « objectif fondamental » dans ces termes : Donner aux femmes les moyens de rivaliser sur :
– Les marchés de produits ;
– Les marchés financiers ;
– Les marchés fonciers ;
– Les marchés du travail [47].
Que signifie donc cette vision de l'égalité ? Comme les féministes anticapitalistes le disent depuis longtemps, le discours de l'égalité n'aide pas à combattre les oppressions mais ne fait que les déplacer. On nous parle ici de l'égalité des chances de rivaliser, de dominer. D'exceller dans les domaines jusqu'ici considérés comme masculins, de s'en approprier les codes, d'exploser le plafond de verre (et rendre le plancher encore plus collant), et devenir actrices des mécanismes de l'accumulation capitaliste.
Cette vision du « féminisme » est dangereuse. Plutôt que de parler de l'accès aux structures de pouvoir, c'est de la remise en question radicale des structures de pouvoir qu'il faudrait se soucier. Plutôt que de réduire les obstacles économiques individuels, c'est de créer des dynamiques collectives, solidaires, une force politique qui est nécessaire. La Banque ne soutient pas les revendications féministes, elle entretient et nourrit la finance patriarcale, extractiviste et raciste.
La question, in fine, n'est donc pas de savoir si oui ou non certains projets locaux ont soutenu des femmes, ni de simplement clamer que la Banque mondiale n'a pas réussi à assez réduire les inégalités. La question est plutôt de savoir si oui ou non sa ligne politique contribue à les aggraver. La réponse est oui. La Banque mondiale s'obstine à prescrire des politiques macro-économiques qui impactent négativement l'égalité de genre et renforcent les oppressions structurelles, comme l'illustre sa stratégie de 2016 à 2023.
En 2016, Elisabeth Prügl qualifiait de Neoliberalism with a feminist face [48] le nouvel agenda de la Banque mondiale. Un nouveau discours où l'analyse des inégalités de genre est de plus en plus poussée, mais également de plus en plus au service des marchés : autrement dit, les revendications féministes sont de plus en plus instrumentalisées ; cooptées et traduites en termes marchands. Pour Prügl, si les nombreuses « avancées » et remises en question sont condamnables par leurs intentions (par exemple pousser les gouvernements à investir dans les crèches pour que les femmes puissent travailler plus), elles ouvrent aussi des brèches dont il serait intéressant de se saisir pour formuler des demandes et alternatives véritablement féministes.
Tous ces constats sont une raison de plus d'annuler la majeure partie des dettes, qui n'ont pas servi les populations, et ce en connaissance de cause. C'est pourquoi, comme le prône le CADTM entre autres, c'est d'un changement radical que nous avons besoin, et pas de reformes au sein de ces institutions, qui, qu'il s'agisse du G20, du FMI, de la Banque mondiale ou encore de l'ONU, entretiennent l'institutionnalisation des féminismes aux dépens des premières concernées.
Une perspective féministe, et même éco-féministe, amène aussi à se poser plus généralement la question de qui doit quoi à qui ? Si on prend en compte tout le travail invisible effectué et les ressources pillées et ravagées sans scrupule, ni compensations ou efforts de conserver un équilibre, alors la donne change [49]. Une bonne partie des populations et en particulier des classes dominantes de la planète sont en vérité redevables d'une immense dette, écologique, mais aussi reproductive, envers les femmes.
Critique féministe du développement
La sociologue Jules Falquet rappelle que les cinq dimensions centrales du développement impactent nécessairement les femmes [50].
Préférer les monocultures intensives à l'agriculture familiale prive les femmes de leurs activités et condamne un grand nombre de personnes à dépendre de produits industriels chers ;
Mettre à profit les matières premières disponibles en sous-sol génère des conflits qui détruisent les communautés autochtones et l'environnement ;
La création de zones de libre-échange encourage l'implantation de multinationales à la recherche de main d'œuvre peu qualifiée, bon marché et essentiellement féminine ;
Faire rentrer des devises via l'exportation de main d'œuvre féminine autorisée à travailler à l'étranger renforce leur exploitation ;
Le tourisme, fortement encouragé, engendre une augmentation des activités dégradantes des femmes dont la « beauté exotique » fait partie des atouts mis en avant par les destinations.
Le « développement » doit être vu pour ce qu'il est : non pas le synonyme d'un « progrès » déclaré comme tel tout à fait arbitrairement, mais un attirail idéologique déployé afin d'aider à la généralisation des modes de production capitalistes, normes culturelles occidentales, et ainsi continuer des dynamiques néocoloniales de pillage organisé, ayant invariablement de nombreux impacts sur la vie des femmes.
mailfacebookprintertwitter
Notes
[1] Éric Toussaint, « Équateur : Les résistances aux politiques voulues par la Banque mondiale, le FMI et les autres créanciers entre 2007 et 2011 », 2021, https://cadtm.org/Equateur-Les-resistances-aux-politiques-voulues-par-la-Banque-mondiale-le-FMI
[2] Camille Bruneau, l'auteure de cette étude, utilise ici le terme « femmes » dans une perspective plurielle et non–essentialiste : toute personne se reconnaissant dans ou étant assignée au genre et/ou sexe « féminin » et subissant ainsi une série d'oppressions sexistes et hétéropatriarcales (femmes cisgenres, personnes transgenres, personnes non-binaires, a-genres, aux genres fluides…). Elle utilise cette « catégorie » dans une perspective politique, c'est-à-dire utile pour analyser des rapports sociaux de domination.
[3] Le concept de « care work » (travail de soin) fait référence à un ensemble de pratiques matérielles et psychologiques destinées à apporter une réponse concrète aux besoins des autres et d'une communauté (dont des écosystèmes). On préfère le concept de care à celui de travail « domestique » ou de « reproduction » car il intègre les dimensions émotionnelles et psychologiques (charge mentale, affection, soutien), et, pour moi et comme utilisé ici, ne se limite pas aux aspects « privés » et gratuits en englobant également les activités rémunérées nécessaires à la reproduction de la vie humaine.
[4] Camille Bruneau : « La dette : une arme patriarcale déployée dans les pays du Sud », AVP Dettes aux Suds, n°77, 2019, https://cadtm.org/La-dette-une-arme-patriarcale-deployee-dans-les-pays-du-Sud
[5] Jules Falquet : « Le capitalisme néolibéral, allié des femmes ? Perspectives féministes matérialistes et imbricationnistes », dans Verschuur, C., Guérin, I., et Guétat-Bernard ? H. (ed.). 2015. Sous le développement, le genre, pp. 365-387. Cynzia Arruzza, Tithi Bhattacharya et Nancy Fraser, Féminisme pour les 99 %, La Découverte, Paris, 2019
[6] Jules Falquet. 2019. Imbrication : Femmes, race et classe dans les mouvements sociaux, Éditions du croquant, 304 p.
[7] Voir également l'analyse de Michael Goldman, notamment autour des questions environnementales. Il s'intéresse aussi à comment la Banque mondiale s'est historiquement imposée comme détentrice de savoirs, ce qui lui permet de consolider son hégémonie. Michael Goldman (2005) : The World Bank and Struggles for Social Justice in the Age of Globalization, Yale University Press.
[8] La notion de développement est problématique à bien des égards, autant le concept en tant que tel - normatif et façonné par une idéologie occidentale et eurocentrique- que ses origines historiques, ses intentions politiques, ainsi que ses conséquences sociales, économiques, environnementales et culturelles. En résumé, il s'agit d'un outil du néocolonialisme et du pillage organisé mis en place après les indépendances pour continuer à contrôler l'organisation mondiale de la production et de la consommation, et donc, de la répartition des richesses. Il est clair que le contrôle des capacités productives et reproductives des femmes (leurs corps, leur fertilité) en est une dimension importante et parfois assumée. En plus des théories dites du « post-développement » ou des nombreuses critiques décoloniales ou anti-impérialistes, voir Éric Toussaint, « Les mensonges théoriques de la Banque mondiale » https://www.cadtm.org/Les-mensonges-theoriques-de-la-Banque-mondiale ainsi que quelques articles amenant une lecture féministe de la notion de développement : Denise Comanne, « Quelle vision du développement pour les féministes », 2005, https://www.cadtm.org/Quelle-vision-du-developpement-pour-les-feministes ; Jules Falquet, « Femmes, féminisme et “développement” : une analyse critique des politiques des institutions internationales », dans Bisilliat, Jeanne (dir.) 2003. Regards de femmes sur la globalisation. Approches critiques, Paris, Karthala, pp 75-112 ; Roger Herla, « Du Sud au Nord, impacts de mondialisation néolibérale sur le travail des femmes », CVFE - Publications, 2018, http://www.cvfe.be/sites/default/files/doc/ep-2018-6-du_sud_au_nord._impacts_de_la_mondialisation.pdf
[9] Simon Kuznets, « Economic Growth and Income Inequality », American Economic Review, n°49, mars 1955, p.1-28.
[10] World Bank, World Development Report, 1982, World Development Indicators Washington, D.C. http://documents.worldbank.org/curated/en/948041468152100530/World-development-report-1982 En français : http://documents1.worldbank.org/curated/en/680161468336317883/pdf/108870WBAR0FRENCH0Box35453B01PUBLIC1.pdf consulté le 18 avril 2021
[11] Cité par DEVESH KAPUR, JOHN P. LEWIS, RICHARD WEBB. 1997. The World Bank, Its First Half Century, Volume 1, p. 171.
[12] Le capital au XXIe siècle, Le Seuil, 2013, 970 p.
[13] « low inequality was not an indicator of a healthy economy » Vladimir Hlasny et Paolo Verme, « On the ‘Arab Inequality Puzzle' : A Comment », publié en janvier 2021 dans la Revue Development and Change de l'Institut des Etudes sociales de La Haye, p. 4.
[14] Pour une analyse historique et critique de « l'inclusion » des femmes dans le « développement » par les grandes institutions internationales notamment l'ONU, voir Jules Falquet (2002), Op.cit. et Denise Comanne (2005), Op. cit.
[15] François Bourguignon, The Poverty-Growth-Inequality Triangle, 2004, https://www.researchgate.net/publication/5127146_The_Poverty-Growth-Inequality_Triangle
[16] Banque Mondiale, Rapport sur le développement dans le monde, Equité et développement, 2006, https://www.genreenaction.net/IMG/pdf/WDR2006overview-fr.pdf
[17] Banque Mondiale, « L'égalité des sexes, un atout économique », 2006, http://documents1.worldbank.org/curated/en/482921468315359005/pdf/370080FRENCH0G10Box032734201PUBLIC1.pdf
[18] Banque Mondiale, 2014, Gender at Work : A Companion to the World Development Report on Jobs, https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Gender/GenderAtWork_ExecutiveSummary.pdf
[19] World Bank Group Gender Strategy (2015) : Gender Equality, Poverty Reduction and Inclusive Growth., https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986
[20] Christine Vanden Daelen, « Féminismes et Banque mondiale : un mariage ‘contre-nature' », 2020, https://www.cadtm.org/Feminismes-et-Banque-mondiale-un-mariage-contre-nature
[21] http://ida.banquemondiale.org/theme/genre-et-egalite-des-sexes
[22] L'intersectionnalité est un concept issu du black féminism et forgé par la juriste américaine Kimberlé Crenshaw pour rendre raison de l'existence de discriminations multiples jusque-là invisibilisées dans le cadre d'une approche segmentée et hiérarchisée des discriminations au sein du droit. Selon le Mouvement européen de lutte contre le racisme (ENAR), l'approche intersectionnelle permet de prendre en compte que des personnes qui se trouvent à l'intersection de plusieurs sources de discriminations (ex : être une femme, être de religion musulmane, être d'origine étrangère,..) subissent souvent une nouvelle forme de discrimination résultant du cumul de plusieurs caractéristiques. Finalement, « C'est un outil pour lutter contre les discriminations à l'intérieur des discriminations, protéger les minorités au sein des minorités et combattre les inégalités au cœur des inégalités » (Emilia Roig, Centrer for Intersectional Justice : https://www.intersectionaljustice.org/). Des féministes décoloniales comme Françoise Vergès rappellent que cette notion était déjà bien intégrée avant la reconnaissance du concept, par exemple au sein des luttes contre l'esclavage. Voir Françoise Vergès. 2019. Un féminisme décolonial, éditions La Fabrique, 208 p.
[23] Lovisa Moller et Rachel Sharpe pour ActionAid, « Women as ‘underutilized assets'– A critical review of IMF advice on female labour force participation and fiscal consolidation », 2017, https://actionaid.org/publications/2017/women-underutilized-assets
[24] Agnès Adjamagbo et Anne-Emmanuèle Calvès, L'émancipation féminine sous contrainte », Presses Science Po / Autrepart, N° 61, 2012, pp. 3 -21.
[25] Jua

L’Azerbaïdjan, cette dictature qui accueille la COP29 et réprime les écologistes

Un rapport dénonce la répression des activistes écologistes en Azerbaïdjan, pays des hydrocarbures. De quoi inquiéter, à quelques semaines de la COP29 qui se déroulera dans la capitale.
8 octobre 2024 | tiré de reporterre.net
https://reporterre.net/Prison-et-faux-proces-avant-la-COP29-l-Azerbaidjan-fait-taire-ses-ecologistes
Cela n'augure rien de bon. Alors que la COP29 — la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques — doit se tenir en novembre à Bakou, en Azerbaïdjan, deux ONG ont publié le 8 octobre un rapport sur la répression dans le pays. Human Rights Watch et Freedom Now accusent les autorités azerbaïdjanaises d'arrêter des dizaines de militants, notamment écologistes, pour les réduire au silence.
Parmi les personnes emprisonnées, se trouve par exemple Anar Mammadli, un défenseur des droits humains. Il a été arrêté en avril dernier, deux mois après avoir cofondé une association pour défendre les libertés civiques et la justice environnementale en Azerbaïdjan en amont de la COP29. Le motif d'inculpation ? Contrebande. « L'Azerbaïdjan restreint l'accès aux financements proposés par des bailleurs internationaux, détaille Myrto Tilianaki, chargée de plaidoyer chez Human Rights Watch. Financer une association indépendante de l'État devient dès lors quasi impossible. Et si les autorités s'aperçoivent qu'un activiste a malgré tout reçu de l'argent de l'étranger… alors il se voit accuser de contrebande. » Une stratégie bien rodée visant à dissuader quiconque de s'aventurer dans la création de contre-pouvoir.
Aujourd'hui, Anar Mammadli attend encore d'être jugé. Il risque jusqu'à huit ans de prison. Avec cette accusation, que les ONG qualifient de « fausse », « les autorités azerbaïdjanaises ont envoyé un avertissement clair aux militants qui pourraient envisager l'activisme climatique », estiment-elles. Dans un mois environ, des représentants de 197 États et de l'Union européenne assisteront au sommet mondial pour le climat : une occasion pour les militants locaux de porter leur voix.
Sauf que le gouvernement de Bakou ne l'entend pas de cette oreille. Un autre exemple : le professeur Gubad Ibadoglu, arrêté en juillet 2023. Cet économiste travaillait, entre autres, sur la transparence des recettes et sur la corruption dans le secteur pétrogazier de l'Azerbaïdjan. Il avait aussi étudié l'accord de coopération énergétique entre l'Union européenne et Bakou. Il est désormais assigné à résidence, après avoir passé neuf mois en détention provisoire. Il est accusé de produire de la fausse monnaie — une accusation là encore réfutée par les ONG — et risque jusqu'à dix-sept ans de prison.
Or, se défendre des mains des autorités n'est pas chose aisée dans ce pays du Caucase. « Il ne faut pas s'imaginer un pays où il serait facile d'avoir recours à une décision de justice, déplore Myrto Tilianaki. Et encore moins de pouvoir la renverser. Parmi les journalistes arrêtés, certains n'ont même pas eu le droit de parler à un avocat. »
Selon les organisations, ces arrestations ne seraient qu'un « prétexte » pour museler et punir ces activistes. « Human Rights Watch et Freedom Now sont convaincues [...] que toutes les affaires examinées dans ce rapport sont des attaques à motivation politique, contre l'exercice légitime du droit à la liberté d'association et d'expression », affirment-elles.
Une terre d'hydrocarbures
S'il y a un pays où il ne fait pas bon être militant pour le climat, c'est bien l'Azerbaïdjan. L'industrie des hydrocarbures représente 90 % des recettes d'exportation du pays, et 51,5 % des recettes budgétaires de l'État. En critiquant cette filière climaticide, les activistes écologistes mettent en péril les intérêts financiers du gouvernement — et se mettent donc en danger eux-mêmes. « Les enquêtes sur les méfaits de l'industrie fossile en Azerbaïdjan, ou le plaidoyer en faveur d'une élimination progressive des énergies fossiles, sont interdits », rappellent Human Rights Watch et Freedom Now.
Cette répression provoque la crainte. Selon le rapport, toutes ces arrestations et ces condamnations de militants écologistes — mais aussi de défenseurs des droits humains et de journalistes de médias indépendants — auraient incité des activistes à quitter le pays. Ce qui a « encore réduit la diversité des organisations et des activistes à oser défier le gouvernement azerbaïdjanais ».
« Il est difficile d'imaginer comment des associations ou des journalistes azerbaïdjanais pourraient ouvertement critiquer les politiques climatiques du gouvernement et exiger [lors de la COP29] des mesures pour respecter les engagements de l'Azerbaïdjan dans le cadre de l'Accord de Paris de 2015 », prévoit le rapport. Selon ses auteurs, la répression du gouvernement aura forcément un « impact négatif » sur la participation des militants et des scientifiques lors de la COP.
Les ONG demandent donc au gouvernement azerbaïdjanais de « libérer immédiatement et sans condition » les militants et les journalistes emprisonnés à tort, et d'abandonner les accusations portées contre eux. Elles pointent en outre la grande responsabilité des Nations unies, ayant décidé pour la troisième fois consécutive d'organiser une COP dans un pays réprimant fortement les droits humains. Les deux précédents raouts du climat s'étant tenus à Dubaï et en Égypte.
Quant aux États membres de l'Union européenne, ceux-ci doivent « veiller à ce que les liens économiques et politiques avec l'Azerbaïdjan, y compris la coopération énergétique, contiennent des engagements concrets en matière de droits de l'Homme », ponctue le rapport. À plusieurs reprises, la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a déjà condamné le pays hôte pour violation du droit à la liberté d'association. « Malheureusement, force est de constater que ça ne dissuade pas les autorités azerbaïdjanaises, conclut Myrto Tilianaki. Celles-ci ont beau promettre une COP29 inclusive sur le papier, les remontées du terrain nous montrent d'ores et déjà qu'il n'en sera rien. »
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Actualité L’écologie, au centre d’un programme de rupture

Le capitalisme exploite et asservit les humains, aggrave la crise écologique qui revêt des formes multiples : réchauffement climatique, détérioration de l'air, de l'eau, des sols, acidification des mers, fonte des glaces, déforestation massive...
9 octobre 2024 à 12h00 | Revue L'Anticapitaliste n°159 (septembre 2024) | Photo : Crédit Photo
Photothèque Rouge / Copyright : JMB
Cette crise écologique surdétermine la situation sociale et politique : elle impose des mesures immédiates de rupture (comme un moratoire sur les grands projets d'infrastructures autoroutières ou sur les mégabassines, présent dans le programme du NFP) et une planification des objectifs à tenir à terme. Cet impératif est à relier nécessairement à une nouvelle organisation de la société qui passe par la démocratie à la base et l'auto-organisation. La ligne de classe est à réaffirmer car il faut supprimer de toute urgence l'emprise des riches sur nos vies et nos corps, sur le monde.
Les mesures à prendre doivent être radicales et rapides
La sortie des énergies fossiles et l'arrêt du nucléaire imposent une réduction drastique de la production matérielle globale, donc de la consommation globale et des transports. Il importe de socialiser les secteurs clés de l'économie (banques, transports, énergie, santé, éducation...), de supprimer la propriété privée qui concerne les « communs », ces biens indispensables et utiles à la population qui doivent échapper à la marchandisation. Aussi, financer la gratuité des besoins vitaux (énergie, transports du quotidiens, école, santé...) doit guider les politiques publiques.
La planification écosocialiste permettra d'organiser par en bas, démocratiquement, les projets globaux, à partir des besoins et demandes exprimés par les consommateur·es producteur·es réuni·es dans des structures locales, guidé·es par une ingénierie publique de personnes-ressources.
Transports
L'urgente et massive diminution de la production matérielle globale s'accompagnera d'une réduction en proportion des marchandises transportées. Priorité au fret ferroviaire et fluvial. La priorité donnée aux transports collectifs gratuits fera perdre à la voiture sa place centrale dans la mobilité des personnes. Le vélo pourra jouer un rôle non négligeable et la marche retrouver sa place. Hors des villes, les services publics et les nouveaux usages de la voiture seront au centre. Le développement du ferroviaire permettra la nécessaire diminution du transport aérien.
Agriculture et alimentation
L'agriculture industrielle, responsable de 20 % des émissions de GES en France, a provoqué une perte immense en biodiversité, porte atteinte à notre santé et fournit une alimentation de qualité médiocre. Le basculement vers une agriculture paysanne, sans chimie et moins mécanisée, vers une production 100 % bio, vers une réduction importante de la consommation de viande, aussi s'impose. Cette mutation nécessitera des financements pérennes et sera créatrice d'emplois. Une « Sécurité sociale de l'alimentation », branche de la Sécu, doit être défendue.
Logement, urbanisme et artificialisation des terres
Un programme de mise à disposition de logements à prix abordables bien isolés, y compris par la réquisition de millions de logements vides est nécessaire. Autres priorités : financer l'isolation des « passoires thermiques », stopper l'étalement urbain, les zones commerciales et les projets routiers destructeurs qui grignotent les terres agricoles.
Énergie
La rupture, c'est obtenir 100 % d'énergies renouvelables en 2050, qui combine l'arrêt du nucléaire, possible en dix ans, l'arrêt de l'EPR de Flamanville, la fermeture de tous les réacteurs de plus de 30 ans, l'abandon des projets d'enfouissement des déchets radioactifs de haute activité et la sortie des énergies fossiles.
Le secteur de l'énergie socialisé sous contrôle des salarié·es et des usager·es favorisera un débat démocratique sur les besoins réels, sur les choix sur les énergies renouvelables et leurs conditions de production, sur la nécessité afin de supprimer la publicité et certaines productions inutiles.
La rupture contre l'adaptation
L'alternative « socialisme ou barbarie », décrite par Rosa Luxemburg n'a jamais été aussi actuelle. Si le capitalisme vert et son cortège de mesures bidons est disqualifié, il est nécessaire de refonder le socialisme autour de ses valeurs historiques : la pratique démocratique réunissant la démocratie directe, la démocratie représentative et la pratique référendaire, l'égalité par la mise en place d'un revenu maximal acceptable ; la justice et la fraternité-sororité.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Les Teamsters et le fascisme, hier et aujourd’hui

Jusqu'à récemment, le terme « nationaliste chrétien » n'était pas une étiquette que les femmes et les hommes politiques étasuniens s'attribuaient. Il s'agissait plutôt d'un terme appliqué par dérision par les opposant·es à celles et ceux qui voulaient abattre le mur de séparation entre l'Église et l'État. Ce n'est pas pour rien que les femmes et les hommes politiques ne faisaient pas la queue pour s'appeler « nationalistes chrétiens ».
Tiré de Entre les lignes et les mots
Le nationalisme chrétien était une tentative consciente d'envelopper le fascisme dans la croix et le drapeau afin de le rendre plus acceptable pour le public américain. Le premier mouvement de ce pays à s'identifier comme tel était dirigé par le révérend Gerald L.K. Smith, un antisémite, un sympathisant fasciste et un ségrégationniste. La croisade nationaliste chrétienne de Smith a existé des années 40 jusqu'à sa mort en 1976, tout en s'attaquant aux Noir·es, aux Juifs/Juives, aux socialistes et aux syndicats.
Aujourd'hui, certains hommes politiques de droite choisissent l'étiquette de « nationaliste chrétien ». Parmi eux, le sénateur du Missouri Josh Hawley et le sénateur de l'Ohio (et candidat de Donald Trump à la vice-présidence) J.D. Vance. Ces deux hommes politiques ont le bilan anti-ouvrier que l'on peut attendre de ceux qui suivent les traces de Smith. Smith a été payé par des magnats de l'automobile comme Henry Ford et Horace Dodge pour rallier les travailleurs et les travailleuses contre la formation d'un syndicat. Hawley a obtenu à vie un score de 11% auprès de l'AFL-CIO. Vance est au plus bas avec 0%. La principale législation du travail qu'il a parrainée est la proposition du sénateur Marco Rubio de légaliser les syndicats d'entreprises pro-patronales. Pourtant, ces deux hommes politiques ont été vantés par Sean O'Brien, le président de la Fraternité internationale des Teamsters, l'un des plus grands syndicats du pays. M. O'Brien est allé jusqu'à dire que M. Vance « a été à nos côtés sur toutes nos questions », bien que le sénateur ait voté contre les syndicats chaque fois qu'il en a eu l'occasion. Il s'agit d'un changement radical par rapport à la façon dont les Teamsters parlaient des politiciens d'extrême droite pendant la poussée de l'extrême droite dans les années 1930 et 1940.
Lorsque les Chemises d'argent pro-fascistes, un groupe explicitement modelé sur les Chemises brunes nazies, ont menacé d'écraser le syndicat Teamsters 544 dans les années 1930, on n'a pas parlé du fait que les fascistes avaient été à leurs côtés sur toutes les questions qui les concernaient. Au contraire, le syndicat a organisé une garde de défense syndicale, a pratiqué des exercices et a réussi à empêcher les Chemises d'argent d'organiser un rassemblement à Minneapolis, et encore moins de détruire le syndicat lors d'une attaque d'autodéfense. Les Teamsters 544 ont eu l'avantage d'être dirigés par des socialistes militants et révolutionnaires comme Farrell Dobbs, qui savaient exactement ce qu'une victoire fasciste signifierait pour le mouvement ouvrier.
Même le syndicat international, dirigé par le démocrate conservateur Dan Tobin, était conscient des dangers du fascisme et sensibilisait ses membres à ce danger. Un numéro de l'International Teamster recommandait le livre Under Cover de John Roy Carlson, qui dénonçait les fascistes américains. La publication exhortait les Teamsters : « Si vous voulez savoir qui se glisse derrière vous avec un couteau, lisez Under Cover ». Dans son livre, Carlson explique en détail comment le nationalisme chrétien de Smith a été financé par les super riches. L'un des lieutenants de Smith déclare : « J'ai vu beaucoup d'argent arriver. J'ai vu des chèques de 2 000 et 3 000 dollars. Ce ne sont pas les travailleurs ou les travailleuses qui les envoient. Non, monsieur, c'était les fabricants. »
Un autre numéro contenait des citations d'individus et de publications pro-fascistes aux États-Unis, extraites de l'ouvrage de Michael Sayers et Albert Kahn, Sabotage ! The Secret War Against America de Michael Sayers et Albert Kahn. Parmi les personnes citées figuraient Gerald L.K. Smith, le « prêtre de la radio » anti-ouvrier, le père Charles Coughlin, et Parker Sage, chef de l'organisation pro-nazie des « travailleurs », la National Workers League (Ligue nationale des travailleurs). La Ligue ne faisait rien pour les travailleurs ou les travailleuses. Son véritable objectif était d'attiser le racisme et l'antisémitisme dans les usines automobiles de Détroit. Toutes ces personnes étaient fermement opposées à tout syndicat militant et indépendant. Les organisations syndicales qu'elles et ils voulaient étaient calquées sur celles de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste. Elles seraient douces, complaisantes et totalement dominées par les fascistes et les nazis.
Enfin, les Teamsters étaient fiers de s'opposer au membre du Congrès de l'Illinois Stephen A. Day dans un article intitulé « Labor Fights Friends of Fascism » (Le travail combat les amis du fascisme) de Lester Hunt. Day était un membre particulièrement répréhensible de la Chambre des représentants qui a envoyé un télégramme de félicitations à Adolf Hitler lorsque le Führer a pris le pouvoir en 1933. Day a également collaboré en toute connaissance de cause avec l'agent allemand nazi George Sylvester Viereck pour publier le livre scabreux We Must Save The Republic (Nous devons sauver la République). L'article paru dans l'International Teamster établit un lien direct entre les sympathies de Day pour le fascisme et sa politique antisyndicale. « Il ne fait aucun doute que Day savait qu'Hitler était arrivé au pouvoir sur les cadavres de syndicalistes », écrit M. Hunt. « Il ne fait aucun doute qu'il savait également que la première action d'Hitler avait été de dissoudre les syndicats d'Allemagne et d'emprisonner leurs dirigeant·es ».
Le fait que les Teamsters se soient complètement retirés de cette première opposition au fascisme en dit long. Sean O'Brien s'est prosterné à la Convention nationale républicaine devant Trump, un homme qui a promis d'être « un dictateur dès le premier jour ». Des hommes politiques comme Vance et Hawley considèrent l'autocratie hongroise, de l'autre côté de l'Atlantique, comme un modèle pour le type de société qu'ils veulent construire chez eux. Pour M. O'Brien, tout cela fait d'eux des « durs à cuire » qui « ont été à nos côtés sur toutes nos questions ». Ils seront durs, c'est vrai. Mais ils le seront au nom des grands hommes d'affaires et des grandes entreprises qui leur envoient des chèques de campagne, et non au nom des dirigeants syndicaux comme Sean O'Brien, et certainement pas au nom des membres des syndicats de base.
« Un homme peut-il être à la fois l'ami d'Hitler et l'ami des travailleurs et des travailleuses ? » C'est ce qu'a demandé Lester Hunt en 1944. La réponse était alors négative. On ne peut pas servir deux maîtres, surtout lorsqu'ils sont si irrémédiablement opposés. Il est toujours vrai que personne ne peut être l'ami du fascisme, de la dictature réactionnaire et des syndicats. Les Teamsters connaissaient la bonne réponse à l'époque. Il semble qu'ils l'aient oubliée aujourd'hui.
Hank Kennedy
Hank Kennedy est un éducateur et un socialiste de la région de Détroit
https://newpol.org/teamsters-and-fascism-then-and-now/
Traduit avec DeepL.com (version gratuite)
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Trahies de tous les côtés

Les talibans ont interdit aux filles et aux femmes d'aller à l'école au-delà de la sixième
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/10/14/trahies-de-tous-les-cotes/
Nous avonsdéjà abordé la répression brutale des femmes par les talibans en Afghanistan dans le Brief du Jour. Nos lecteurs réguliers connaissent donc les grandes lignes de la crise des droits des femmes la plus grave au monde.
Les talibans ont interdit aux filles et aux femmes d'aller à l'école au-delà de la sixième, les ont empêchées d'accéder à de nombreuses formes d'emploi et ont limité leurs déplacements en public. Une femme ne peut quitter sa maison sans être chaperonnée par un membre masculin de sa famille. Les talibans ont également déclaré que les femmes ne devaient pas être entendues en train de parler ou chanter en public.
Mais en plus de ces restrictions générales, certaines catégories de femmes ont été particulièrement ciblées par les talibans. Un nouveau rapport de HRW montre comment les autorités talibanes ont menacé d'anciennes policières, c'est-à-dire des femmes qui avaient servi dans la police sous le gouvernement précédent. Face à ces menaces, nombre d'entre elles ont dû se cacher.
Il convient toutefois de rappeler que de nombreuses policières afghanes ont également souffert sous l'ancien gouvernement. Des centaines d'entre elles ont été victimes de harcèlement sexuel et d'agressions, y compris de viols, de la part de collègues et de supérieurs masculins. Les auteurs de ces actes n'ont jamais eu à répondre de leurs actes, ni par les anciennes autorités, ni par les talibans.
Les femmes qui ont survécu à ces abus continuent de subir des traumatismes psychologiques et n'ont que peu ou pas accès à une aide psychosociale appropriée. Elles vivent également dans la crainte de représailles non seulement de la part des talibans, mais aussi de la part de leurs propres proches, dont certains pensent que leur travail a fait « honte » à la famille.
Pour ne rien arranger, les gouvernements étrangers qui, par le passé, ont soutenu des programmes de formation et d'embauche de femmes dans les forces de police afghanes tentent aujourd'hui, semble-t-il, de s'en laver les mains. Ils ont ignoré les abus lorsqu'ils se sont produits et n'ont généralement pas accordé l'asile à ces femmes qui ont besoin de sécurité et de soutien.
Les gouvernements des États-Unis, du Canada, du Japon et de l'Allemagne, ainsi que d'autres pays de l'Union européenne, devraient soutenir les femmes afghanes qui demandent l'asile et accorder la priorité à la réinstallation de ces femmes.
L'espoir réside dans le fait que ces gouvernements étrangers reconnaissent leur part de responsabilité et prennent les mesures qui s'imposent.
Andrew Stroehlein
Directeur des relations médias en Europe
https://www.hrw.org/fr/news/2024/10/10/trahies-de-tous-les-cotes
******
Les autorités talibanes ont menacé des femmes afghanes ayant servi dans la police
Tiré de Entre les lignes et les mots
Les autorités talibanes ont menacé des femmes afghanes ayant servi dans la police sous le gouvernement précédent, les exposant à un risque supplémentaire, celles-ci étant déjà sous la menace de leurs familles opposées à leur travail.
Les policières ont été doublement trahies : une première fois par l'ancien gouvernement, dont certains agents étaient responsables d'abus sexuels généralisés, ensuite par les pays qui ont ignoré ces abus lorsqu'ils étaient commis et refusé l'asile à ces femmes.
Les pays qui ont soutenu les programmes de formation et d'embauche des femmes dans la police afghane, à savoir, les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, le Japon et les pays de l'UE, devraient apporter leur soutien aux Afghanes qui demandent l'asile et donner la priorité à leur réinstallation.
(New York) – Les autorités talibanes ont menacé des femmesafghanes qui avaient servi dans la police sous le gouvernement précédent, les exposant à des risques, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd'hui.
Ce rapport de 26 pages, intitulé « Double Betrayal : Abuses against Afghan Policewomen Past and Present » (« Double trahison : Abus présents et passés contre les policières afghanes ») documente les menaces que les autorités talibanes font peser sur d'anciennes policières depuis août 2021, contraignant nombre d'entre elles à se cacher de peur d'être identifiées.
Alors qu'elles étaient employées par l'ancien gouvernement, des centaines de policières afghanes ont précédemment été victimes de harcèlement et d'agressions sexuelles, notamment de viols, commis par leurs collègues et superviseurs masculins, qui n'ont jamais eu à répondre de leurs actes. D'anciennes et d'actuelles policières vivant en Afghanistan, ou dans la clandestinité dans d'autres pays où elles ont demandé l'asile, ont décrit la détresse psychologique et le traumatisme permanents découlant de ces abus commis par le passé, ainsi que leur crainte de représailles de la part des talibans ou même de leurs propres familles.
« Les policières afghanes ont été doublement trahies, une première fois par le gouvernement afghan précédent, qui a permis que de graves abus sexuels se poursuivent sans être réprimés, et ensuite par les pays qui ont ignoré ces abus et ont refusé de réinstaller ou d'accorder l'asile à ces femmes qui demandaient leur protection », a déclaré Fereshta Abbasi, chercheuse sur l'Afghanistan à Human Rights Watch. « Depuis le retour au pouvoir des talibans, d'anciennes policières ont dû fuir, ayant été la cible de menaces de la part des autorités et de violences accrues de la part de leurs familles, qui s'opposaient à leur travail dans la police. »
Le rapport s'appuie principalement sur 24 entretiens avec des femmes qui étaient policières sous le gouvernement précédent : dix entretiens en personne et neuf à distance avec des femmes vivant dans cinq provinces d'Afghanistan, et cinq entretiens à distance avec des femmes vivant aux États-Unis, en Suède, en Italie, en Iran et au Pakistan. Human Rights Watch a également interrogé d'anciens et d'actuels représentants des Nations Unies et des activistes de la société civile au fait de ces questions.
D'anciennes policières ont déclaré avoir reçu des appels téléphoniques intimidants de responsables talibans leur intimant de se présenter pour un interrogatoire et les avertissant qu'elles auraient à subir des conséquences liées à leur ancien emploi, sans autre précision. Plusieurs anciennes policières et femmes fonctionnaires de l'administration pénitentiaire ont été tuées, apparemment par des proches qui estimaient que leur travail « faisait honte » à la famille. Les talibans n'ont pas mené d'enquêtes crédibles sur ces meurtres. Des femmes ont décrit les perquisitions abusives de leur domicile par les forces talibanes qui ont parfois agressé leurs proches et endommagé leurs biens personnels.
Les femmes interrogées ont déclaré que sous le gouvernement précédent, elles avaient été fréquemment victimes de harcèlement et d'agressions sexuelles, notamment des viols et d'autres formes de violence sexuelle, et que leurs supérieurs leur demandaient des relations sexuelles en échange d'une promotion ou de la garantie de ne pas être licenciées. La nature généralisée de ces abus était connue depuis au moins 2013, notamment par les pays qui soutenaient le gouvernement précédent, mais les policiers responsables de ces abus n'ont pas eu à répondre de leurs actes.
Les femmes employées comme fonctionnaires par l'ancien gouvernement, notamment dans la police, ont perdu leur emploi lorsque les talibans ont repris le pouvoir. Alors que ceux-ci ont ordonné à certaines policières de reprendre leur travail pour exécuter certaines tâches, notamment la fouille des femmes aux points de contrôle et la garde des prisonnières, la majorité a eu du mal à trouver une autre source de revenus. L'effondrement économique de l'Afghanistan a frappé particulièrement durement les anciennes policières.
Beaucoup ont fui vers l'Iran ou le Pakistan voisins ou ont essayé de se rendre dans d'autres pays pour obtenir l'asile. La plupart des femmes interrogées ont relaté une détresse psychologique et un traumatisme persistants dus aux abus subis, mais n'ont pas pu trouver de soutien psychosocial adapté ou n'avaient pas les moyens d'y recourir.
Les talibans devraient mettre fin à tout harcèlement et aux menaces contre les anciennes policières et les autres femmes qui ont travaillé pour le gouvernement précédent et mener des enquêtes crédibles sur les incidents de violence. Les pays qui ont soutenu par le passé les programmes de formation et d'embauche des femmes dans la police afghane, notamment les États-Unis, devraient apporter maintenant leur soutien aux Afghanes qui demandent l'asile et donner la priorité à leur réinstallation.
Les États-Unis devraient veiller à ce que les policières restées en Afghanistan ou se trouvant temporairement dans des pays tiers en quête d'une protection américaine puissent bénéficier d'une réinstallation d'un niveau au moins égal à celui des autres catégories vulnérables. Le Royaume-Uni, l'Union européenne et ses États membres, le Canada et le Japon devraient augmenter le nombre de places de réinstallation destinées aux réfugiées afghanes, en accordant la priorité aux femmes en danger.
« L'oppression des femmes et des jeunes filles par les talibans frappe doublement les anciennes policières », a conclu Fereshta Abbasi. « Les gouvernements qui ont financé et assuré la formation des femmes dans les forces de police devraient également faire pression sur les talibans pour qu'ils mettent fin à tous les abus contre ces femmes. »
Quelques citations d'ex-policières afghanes
Sous le gouvernement précédent
« Le chef de police du district est venu chez elle la nuit et l'a violée. Son mari était absent ce jour-là. Elle a pleuré devant moi. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas porter plainte, parce qu'elle craignait que son mari ne demande le divorce et qu'elle ne perde la garde de ses enfants. »
– Une ancienne policière décrivant un incident survenu sous le gouvernement précédent
« Tout semblait correct, vu de l'extérieur. Mais pour celles qui ont travaillé à l'intérieur, c'était différent. J'ai vu des gardes du corps harceler des femmes, les arrêter et même les toucher… Le chef des renseignements de ma station m'a vraiment harcelée. Il m'a dit qu'il pouvait me faire ce qu'il voulait. »
– Une ancienne policière de Khost décrivant une situation sous l'ancien gouvernement
Depuis la prise de pouvoir par les talibans
« J'ai reçu un appel des talibans me disant de revenir travailler. Je leur ai donné un faux nom, mais ils m'ont accusée de mentir et m'ont dit que je devais me présenter à tout prix à mon travail. J'ai eu peur et j'ai raccroché. J'ai de nouveau reçu un appel et cette fois, ils m'ont dit : “Vas-tu venir par toi-même, ou faut-il que nous venions te tirer par les cheveux pour t'emmener ?” »
– Une ancienne policière alors en fuite
« Au téléphone, on m'a menacée et chaque seconde est une menace… Quand je vais au bazar, je porte un masque et des lunettes pour que personne ne puisse me reconnaître. Si les gens l'apprennent, ils risquent de me dénoncer aux talibans en disant que j'ai travaillé pour la police ».
– Une ancienne policière alors en fuite
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

France - L’éducation à l’égalité des sexes et des sexualités : le cœur de la contre-offensive réactionnaire

Tandis que de nouveaux programmes relatifs à l'Éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle (EVARS) sont élaborés, l'offensive réactionnaire s'est reconfigurée depuis La manif pour tous (LMPT) qui avait obtenu le retrait des ABCD de l'égalité en 2013-2014. Fanny Gallot et Cécile Ropiteaux font le point sur les éléments de langage, modalités d'action et la portée de ces groupes pour mieux les combattre [1].
Tiré de la revue Contretemps
10 octobre 2024
Par Fanny Gallot et Cécile Ropiteaux
***
Introduction
Au printemps 2024, l'Éducation nationale a fait connaître son projet de nouveaux programmes pour l'Éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle (EVARS) et le 10 septembre, le Conseil économique, social et environnemental (Cese) a publié un rapportpour alerter sur le manque de cours d'éducation à la sexualité dans les établissements scolaires [2].
Dans le même temps, une myriade de groupes conservateurs voire d'extrême droite s'insurge par voie de tracts distribués devant des écoles, de lettres de mise en demeure, de mails envoyés aux directeur·trices des écoles ou aux chef·fes d'établissements : SOS éducation a lancé une pétition intitulée « A l'école, enseignez-moi les divisions, pas l'éjaculation » qui a recueilli plus de 70 000 signatures. Selon les informations de la FSU-SNUipp, dans un tract distribué dans plusieurs départements (16, 33, 39, 44, 64, 72, 90), l'arrêt immédiat du projet d'élaboration d'un programme est demandé [3] :
« Plusieurs collectifs et associations se regroupent pour vous informer du programme EVARS (Éducation à la vie Affective, Relationnelle et Sexuelle dès la maternelle) ; de très nombreux signalements d'enfants et adolescents gravement choqués, traumatisés par les informations à caractère sexuel et pornographique nous sont parvenus. […] Ce programme imposé par l'Éducation Nationale ne protège pas les enfants, au contraire il les expose et les fragilise. […] Nous demandons l'arrêt immédiat de ce programme ! »
Depuis la rentrée 2023, la pression de ses groupes s'intensifie du moins via les réseaux sociaux. Plus tout à fait les mêmes qu'en 2013-2014, ils s'inscrivent néanmoins dans leur continuité. L'ambition de cette contribution est de revenir sur la séquence 2013-2014 avant de préciser les éléments de langage actuels de ces groupes ainsi que leurs modes opératoires pour mieux les combattre et empêcher le retrait du programme EVARS, ou sa réécriture qui viserait à fermer le champ des possibles dans une approche naturalisante hétérocentrée.
2013-2014 : contre la dite « Théorie du genre » : « Touche pas à mes stéréotypes »
Fin 2013, après la défaite de sa mobilisation contre la loi ouvrant le mariage à tous les couples, la (mal nommée) Manif pour tous a pris pour cible l'école publique, et plus précisément les ABCD de l'égalité. Ce dispositif, destiné à lutter contre les stéréotypes de genre à l'école primaire, avait été mis en place dans 600 classes à titre expérimental, à l'initiative du Ministère des Droits des Femmes et du Ministère de l'Éducation nationale. Dès la rentrée de septembre, dans plusieurs départements, des tracts ont commencé à circuler, dénonçant les méfaits de la prétendue « théorie du genre ». Ces tracts étaient distribués par des collectifs de parents auto-proclamés, des associations catholiques traditionalistes, ou des groupuscules de type « veilleurs » ou « vigi-gender », issus de La Manif Pour Tous (LMPT).
La rhétorique de ces tracts est un mélange de mensonges, d'exagérations, de glissements de sens, de détournements, de phrases extraites de leur contexte… Les groupes à l'œuvre se posent en défenseurs de « la complémentarité des sexes », dans une posture essentialiste. Ceci va être symbolisé par les couleurs rose et bleu, déclinées jusqu'à la nausée ! Ils évoquent « l'être » et la « nature » (implicitement divine) des femmes et des hommes, comme si l'individu·e n'était pas une construction sociale.
Ils amalgament volontairement les ABCD, dispositif institutionnel, avec un travail syndical mené par la FSU-SNUipp « Éduquer contre l'homophobie dès l'école primaire », qui va plus loin dans la déconstruction des stéréotypes et souhaite mettre en œuvre une nécessaire banalisation de l'homosexualité : ils tentent ainsi de jeter le discrédit sur toutes les actions d'éducation à l'égalité et de lutte contre les discriminations que l'école peut mener, et remettent en cause l'éducation à la sexualité. Ils dénoncent les méthodes qualifiées de « totalitaires » de l'Éducation nationale, le fait que les parents seraient tenus à l'écart, et revendiquent que l'école ne s'occupe que d'instruction. Il est même clairement précisé qu'elle n'est pas là pour lutter contre les inégalités !
Certains discours, plus subtils, semblent faire des concessions au constructivisme « On ne naît pas femme, on le devient », et prétendent s'opposer aux discriminations. C'est en fait pour exprimer alors une homophobie plus feutrée, moins outrancière, qui considère les personnes LGBT comme inférieures [4]. L'hétérosexualité est présentée comme la seule sexualité « naturelle » et épanouissante, car féconde. Dans l'ensemble de ces tracts, les revendications d'égalité sont associées, négativement, à de l'individualisme. Il est par ailleurs question de « contrôle totalitaire des cerveaux », d'« enseignant·es gauchistes aux mœurs dépravées voulant corrompre la jeunesse ».
Les convergences de vocabulaire et d'arguments fallacieux montrent que, derrière la multiplicité des appellations, même si les relais sont divers et variés, on est dans la plus pure tradition des discours de l'extrême-droite contre l'école publique et laïque ! On a bien affaire à un réseau, alliant droite traditionaliste et extrêmes droites. LMPT a été l'occasion d'établir des passerelles, des rapprochements, comme entre l'UNI [5] et les Identitaires, allant de fanatiques religieux de tous bords, jusqu'à la droite plus traditionnelle, depuis les convaincu·es de l'essentialisme, pour qui « LA » femme doit rester à « sa » place, jusqu'aux élu·es embrayant par opportunisme électoraliste.
À cela viennent s'ajouter les ennemi·es de l'école publique et les tenant·es de l'anti-pédagogisme. L'emploi du mot « gender » dans les argumentaires réactionnaires relève du sexisme et des LGBTphobies, mais aussi de l'anti-américanisme et l'anti-intellectualisme. On retrouve très souvent aussi une dimension complotiste : des « lobbies » œuvreraient à la promotion d'une supposée « théorie du genre ». Derrière la défense de la mythique complémentarité des sexes se cache le refus de l'égalité. En effet, dans la vision binaire du monde de ces groupes, le masculin est assimilé au principe actif et à la sphère publique ; aux femmes la passivité et la sphère domestique. Répartition ô combien hiérarchique, qui est à la source même des inégalités, et nourrit la domination patriarcale.
Ce sont les mêmes qui s'opposent à l'avortement, au partage du congé parental, etc. Leur crainte de « l'indifférenciation » masque leur refus de la diversité, ils prônent en fait l'uniformité à l'intérieur de chaque catégorie de sexe, exprimant homophobie et transphobie, et nient la réalité et la diversité des familles. Quant aux attaques contre l'éducation à la sexualité, elles relèvent bien évidemment de l'ordre moral, qui s'oppose à l'émancipation des femmes et des filles.
Dans le même temps, en janvier 2014 les Journées de Retrait de l'École (JRE) sont lancées par Farida Belghoul et relayées par Égalité et réconciliation et les réseaux liés à la mouvance Dieudonné-Soral. Le sociologue Simon Massei souligne les « inégalités de ressources et de capitaux détenus par les militantes VigiGender et les JRE ». Les premières sont issues de la « grande bourgeoisie économique catholique, fortement diplômées et résidant dans les arrondissements centraux de Paris » quand les secondes sont « d'origine populaire, plus faiblement diplômées, déclassées pour certaines, et résidant dans des communes moyennes ou populaires de la banlieue parisienne. » [6]
Clairement, si les aspirations de l'un et l'autre groupe se rejoignent ici ponctuellement, les enjeux sont différents. Comme l'écrit Joëlle Magar-Brauner à partir d'une étude de cas, « si l'objet au cœur du rapport de force concerne l'éducation à la sexualité, avec en filigrane une possible déstabilisation de l'hétéronormativité, il s'y superpose la tension entre les rôles éducatifs respectifs de l'école et de la famille, greffée sur la question de la citoyenneté dans un contexte de racialisation [notamment du sexisme] . » [7]
Finalement, les ABCD sont enterrés en juillet 2014 et le Plan d'éducation à l'égalité, présenté par le ministère de l'Éducation nationale comme une généralisation des actions en faveur de l'égalité des sexes, ne tiendra pas ses promesses faute de moyens et de choix cohérents. Les attaques réactionnaires se poursuivent néanmoins, avec par exemple, en 2016, la brochure Le genre en images (50 pages sur papier glacé !), envoyée à des centaines d'écoles, et dans laquelle l'éducation à l'égalité et la lutte contre les discriminations sont discréditées [8].
Quelles reconfigurations des discours et des pratiques depuis 2023 ?
Sur le modèle des Moms for Liberty (M4L), une organisation conservatrice étatsunienne menant une véritable « guerre culturelle » autour des écoles à partir de « campagnes agressives » pour dénoncer le « wokisme à l'école » [9], Eric Zemmour a lancé les « Parents vigilants » à la rentrée 2023 : il s'agit de se présenter aux élections de parents d'élèves pour lutter contre ce qui est qualifié de « wokisme » et de « prosélytisme trans ». Le contexte est différent : il est marqué par une forte contestation féministe qui s'exprime également médiatiquement. Les violences sexistes et sexuelles sont dénoncées, de même que la culture du viol, tandis que, malgré les obstacles, les appels à la grève féministe du 8 mars sont davantage relayés. Les savoirs et les idées féministes et LGBTQIA+ semblent en outre davantage appropriées par les plus jeunes [10].
Devant la lame de fond ouvrant le champ des possibles, la panique morale s'accroit. Il n'est plus question de « gender », mais de « wokisme ». LMPT s'est muée en Syndicat de la famille tandis que des groupes d'abord constitués dans les mouvances antivax réactionnaires se reconvertissent, à l'image des Mamans Louves qui a fait son apparition au moment du Covid. Les discours diffusés sont mensongers : « Non à l'apprentissage de la masturbation à 4 ans, du changement de sexe à 6 ans, de la fellation et de la sodomie à 9 ans, de l'excitation sexuelle à 12 » ; « Non à l'incitation au consentement sexuel précoce et au transgenrisme, non à la transgression » ; « stop sexualité ». Des deepfake circulent de façon virale semant le doute chez de nombreux parents.
Certains groupes proposent mêmeen ligne des courriers de refus pour justifier l'absence des enfants aux séances EVARS arguant que la sexualité relève de la vie privée et familiale. Ces courriers multiplient les références juridiques afin d'effrayer les chef·fes d'établissements et les directeur·ices d'école, les menaçant d'actions en justice au prétexte que l'éducation à la vie affective et sexuelle ne respecterait ni la Convention Européenne des Droits de l'Homme, ni la Convention Internationale des Droits de l'Enfant, ni le Code pénal, ni même le Code de l'éducation. On imagine mal un ministère établir un programme qui contreviendrait aux lois nationales et supranationales ! Et si on regarde d'un peu plus près les articles cités, la baudruche se dégonfle aisément.
Outre le fait que certaines références sont plus qu'approximatives, voire douteuses, tout l'argumentaire est basé sur l'idée que l'EVARS serait une incitation à avoir des pratiques sexuelles, que les enfants seraient exposé·es à des contenus pornographiques et à une « exaltation » de la sexualité, bref qu'il s'agirait de corruption de mineur·es et même de harcèlement sexuel. L'EVARS est également qualifiée d'idéologie et relèverait alors d'un « endoctrinement des enfants ». Cette présentation déformée de l'EVARS ne correspond ni au contenu des programmes, ni à la réalité de ce qui se passe dans les classes.
Ces discours se fondent sur la tension existante entre ce qui relève de l'École et ce qui relève des familles : l'éducation à la sexualité relèverait de la sphère privée et non de choix politiques et donc éducatifs. Tout d'abord, l'historien Yves Verneuil montre bien que cette tension n'est pas propre au XXIe siècle. A partir d'un corpus varié d'archives, il souligne que l'éducation sexuelle constitue « une question chaude », dès le début du XXe siècle : les polémiques se rapportent généralement à la « perversion » à laquelle ces cours d'éducation sexuelle pourraient conduire les enfants et les adolescent·es [11].
Ensuite, le positionnement adéquat de l'institution ne consiste pas à porter des jugements sur ce qui se fait dans les familles, ni même à aller à l'encontre des choix des parents. Mais l'école, comme les espaces où les enfants sont accueillis en dehors de l'école ou sur les temps méridiens dans le cadre d'une délégation de service public, doit porter une parole propre en restant sur son terrain.
Nommer les choses, éduquer à la vie sexuelle, relationnelle et affective de manière égalitaire, ouvrir le champ des possibles, donner confiance aux élèves fait partie des missions de l'école et de l'ensemble des éducateurs et éducatrices dans le cadre de l'apprentissage à la citoyenneté. Revoir nos pratiques enseignantes ou d'animation participe de la fabrication d'une société plus égalitaire. L'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle est donc bien une des missions de l'école : elle participe à la construction de l'estime de soi et à la prévention des agressions et violences sexuelles, pour une sexualité épanouie et égalitaire pour toutes et tous.
Si le nouveau programme présenté n'est pas parfait, il donne des outils aux enseignant·es pour s'emparer de la question car les trois séances par ans d'éducation à la sexualité instaurées depuis 2001 ne sont toujours pas mises en œuvre. Jusqu'à récemment, selon les chiffres de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, moins de 15% des jeunes accèdent finalement à cette information et à cette éducation.
Les collègues se sentent en effet désarmé·es, insuffisamment formé·es pour répondre à l'ensemble des questions alors même que les enjeux sont importants : le sexisme reste prégnant notamment chez les jeunes, comme le révèle le rapport du Haut conseil à l'égalité(HCE) de janvier 2024 ; les jeunes LGBT sont sujets à des dépressions et un risque de sur-suicidalité(harcèlement, homophobie et/ou transphobie intériorisées, haine de soi) ; [Entre 2017 et 2022], plus de la moitié des infractions à caractère sexuel ont été commises sur des mineur·es (53%). Par ailleurs, 36% des viols sur mineur·es et 30% des agressions sexuelles sur mineur·es sont commis par des personnes mineures [12].
Conclusion
L'ampleur de cette offensive réactionnaire est méconnue. Cependant, si ces groupes sont probablement numériquement peu importants, ils ont un pouvoir de nuisance qui pourrait s'étendre dans les semaines à venir. Ils peuvent rencontrer un écho chez des parents, déstabiliser les personnels engagés autour de l'éducation à la sexualité et refroidir celles qui voudraient s'y engager. Des remontées éparses – notamment via la FSU-SNUipp qui rassemble l'ensemble des informations et réalise une intervention sur le sujet depuis la rentrée 2023 – révèlent une structuration en cours et des actions plus coordonnées que le contexte politique favorise, mais il est nécessaire :
1) d'échanger et de rassurer les parents que ces discours réactionnaires font douter ;
2) de ne pas être dupes des chiffres annoncés par des personnalités comme Eric Zemmour : ils ne reposent sur rien de tangible mais participent au contraire à construire un mouvement réactionnaire. Aucune enquête quantitative ne peut à notre connaissance accréditer les chiffres annoncés ;
3) de vérifier les sources : les arguments donnés déforment la réalité. Le mode opératoire s'appuie sur des rumeurs relayées par les réseaux sociaux sans qu'aucune preuve ne soit apportée à aucun moment.
*
Illustration : Wikimedia Commons.
Notes
[1] Nous remercions Sophie Abraham, Julien Cristofoli, Gaël Pasquier et Céline Sierra pour leur relectures et/ou informations diverses.
[2] Déjà en 2021, l'IGESR avait publié un rapport, enterré par Jean-Michel Blanquer, pour alerter sur ce point. Un autre rapport pointait déjà ces questions en rapport avec la formation des enseignant·es en 2019.
[3] Voir l'ensemble des associations et collectifs concernés : https://linktr.ee/stopevars
[4] Voir l'Association des Familles Catholiques.
[5] Union Nationale Inter-universitaire : https://www.uni.asso.fr/
[6] Simon Massei, « S'engager contre l'enseignement de la « théorie du genre ». Trajectoires sociales et carrières militantes dans les mouvements anti-« ABCD de l'égalité » », Genre, sexualité & société [En ligne], 18 | Automne 2017, mis en ligne le 01 décembre 2017
[7] Joëlle Magar-Braeuner, « La mésentente à l'école des Tilleuls : Des effets et de quelques enjeux de l'appel à la Journée de retrait de l'école dans une école primaire », Cahiers du Genre, 2018/2 n°65, 2018. p.59-79.
[8] Suite à des interventions syndicales, le ministère avait envoyé aux académies la consigne de bloquer ces envois.
[9] Piotr Smolar, « Aux États-Unis, la voix influente des Moms for Liberty », Le Monde, 30 novembre 2023 ; Hélène Vissière, « États-Unis : quand les mamans trumpistes réécrivent les programmes scolaires », L'Express, 27 août 2023.
[10] Oscar Taupas, « Les réseaux sociaux rendent-ils woke ? Les conditions de l'appropriation ordinaire par des lycéen·nes des idées et savoirs féministes et LGBTQIA+ », mémoire de master 2, EHESS, 2024.
[11] Yves Verneuil, Une question « chaude », Histoire de l'éducation sexuelle à l'école (France, XXe-XXIe siècle), Peter Lang, 2023.
[12] https://www.justice.gouv.fr › sites › default › files › 2023-11 › Infos_Rapides_Justice_n9_Violences sexuelles.pdf
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Non au projet de rapport de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe, comité sur l’égalité et la non-discrimination relatif au « travailleur.euses du sexe »

14 coalitions, représentant plus de 2000 ONG féministes, organisations de terrain et/ou fondées par des survivante, dont l'Amicale du Nid, défendent collectivement le modèle abolitionniste en matière de prostitution, modèle qui décriminalise toutes les personnes en situation de prostitution, garantit des parcours de sortie de la prostitution et en pénalise les auteurs.
Tiré de Entre les lignes et les mots
Ce modèle abolitionniste a récemment été salué par la Cour Européenne des Droits de l'Homme.
Nos ONG expriment leurs plus vives inquiétudes sur ce rapport qui reposent sur une procédure opaque et biaisée n'ayant consulté que des organisations connues pour leur plaidoyer en faveur de la légalisation de tous les aspects du système de la prostitution, y compris le proxénétisme et l'achat d'actes sexuels. Cette procédure a notamment exclut les voix des survivantes de la prostitution, des organisations de terrain et féministes.
Ce rapport qui sera voté probablement cette semaine est dangereux pour les personnes en situation de prostitution et les droits des femmes pour plusieurs raisons :
La promotion du « modèle belge » qui est récemment allé encore plus loin dans la dépénalisation des clients.
Le rapport ne reconnaît pas que la demande masculine pour l'achat d'actes sexuels est la racine de la prostitution et de la traite à des fins d'exploitation sexuelle.
L'utilisation de l'expression « travail du sexe » va à l'encontre du langage agréé par les Nations unies et l'Union européenne, qui utilisent le terme neutre de « prostitution ».
Le rapport ne respecte pas les normes les plus élevées de protection des droits humains internationaux et européens en matière de prostitution et de traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle ;
La convention des Nations unies de 1949, considère que la prostitution est incompatible avec la dignité humaine. Elle oblige les États membres à sanctionner le proxénétisme sous toutes ses formes, y compris la tenue d'une maison close, et le fait de tirer profit de la prostitution d'autrui, même avec le consentement de cette personne.
Le protocole de Palerme des Nations unies appelle les États à décourager la demande qui favorise toutes les formes d'exploitation.
La convention pour l'élimination de toutes les discriminations à l'égard des femmes (CEDAW) appelle les États à supprimer l'exploitation prostitutionnelle des femmes.
Le Parlement européen reconnaît que la prostitution est une « atteinte à la dignité humaine » et « un obstacle à l'égalité entre les femmes et les hommes, contraire à la Charte des droits fondamentaux de l'UE ». En 2023, il réaffirme que la prostitution est une violence et demande aux États membres de dépénaliser les personnes en situation de prostitution, de leur offrir des parcours de sortie, de pénaliser l'achat d'actes sexuels et les proxénètes conformément au modèle abolitionniste.
La Rapporteuse Spéciale des Nations unies sur la Violence à l'égard des Femmes souligne que « la légalisation de la prostitution accroît la demande, favorise la violence à l'égard des femmes et des filles et affaiblit les outils nécessaires aux forces de l'ordre pour surveiller, cibler et poursuivre les auteurs, y compris les trafiquants et les autres tiers exploiteurs ». La rapporteuse invite les États membres à adopter les cinq piliers du modèle abolitionniste.
Le rapport relate des informations non-étayées et fausses sur les soi-disant effets négatifs du modèle abolitionniste, effets que la Cour Européenne des Droits de l'Homme réfute elle-même dans l'arrêt de juillet 2024.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.












