Presse-toi à gauche !
Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...
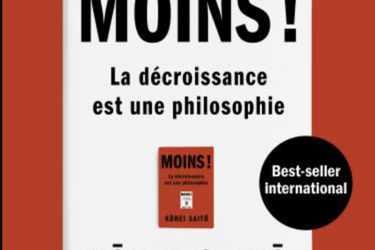
Décroissance : Socialisme ou communisme ?

Le livre à grand succès de Kohei Saito « Moins ! », paru au Seuil en septembre 2024, montre de façon convaincante que le capitalisme est la cause des principaux maux qui accablent la planète. C'est entretenir notre combat pour le vaincre que de nommer l'alternative que nous lui préparons : socialisme ou communisme.
Tiré du blogue de l'auteur.
Les mots sont pour chacun chargé de mémoire et peuvent, de ce fait, perdre la simplicité de leur première signification à laquelle vient s'ajouter toute une histoire qui éloigne jusqu'à les opposer des utilisateurs en manque de réflexion.
La compréhension de l'être nous situant dans l'infini (v. dernier billet) nous sommes assurés de vivre, dans un temps qui s'éloigne tant que nous nous refusons de rendre vrai notre regard, l'époque où l'humanité aura retrouvé la voie de son accomplissement. A cette époque sera donné un nom. Mon grand âge me porte vers ces noms peut-être du passé, socialisme et communisme. Il me revient le souvenir d'une velléité de répondre à Daniel Bensaïd qui venait d'écrire un texte à la gloire du terme communisme pour défendre le mot socialisme. Je le défendrais encore aujourd'hui.
Le livre à grand succès de Kohei Saito « MOINS », Seuil, septembre 2024, cité KS, démontre que le capitalisme est la cause principale de tous les maux qui accablent la planète. Il nous invite à abandonner ce mantra qui nous paralyse : « qu'il n'y a pas d'alternative, alors que ce capitalisme commence à se fissurer » (p.125). L'auteur est marxiste et a pour horizon le communisme. Sa critique, très riche en informations sur les faits, s'appuie sur les dernières réflexions de Marx. Le discours est empirique et abandonne le recours à des principes qui en fonderaient la vérité en raison. Ainsi en était-il du matérialisme historique considéré un temps comme ayant valeur scientifique. Il nous assurait que l'état des forces productives constituait une infrastructure qui gouvernait nos institutions sociales, superstructures dépourvues de véritable autonomie. Les faits, même les plus évidents, pouvant toujours être contestés et la cécité de certains pour refuser d'y consentir étant grande, mieux vaut établir quelques principes avant d'en connaître.
Principes
Principe de vérité
La vérité est partout bafouée et le mensonge est roi. La revendiquer comme seule lieu où échanger des paroles a encore un sens est dérisoire. Les clientèles qui consolident un pouvoir sont manipulées grâce à l'usage immodéré qui est fait de la fausse information. Il est au moins une imposture, une tricherie intellectuelle à la base de l'institution qui permet aux fauves qui peuplent notre jungle de saccager le jardin que de pacifiques travailleurs tentent d'aménager pour le bonheur de vivre ensemble. Cette institution est la propriété privée et le capitalisme. Avoir fait de cette propriété un droit est le coup de force le mieux réussie de l'histoire des hommes, la force s'y étant déguisée en juste (v.billet du 1er avril 2024), au point que ce dimanche 13 octobre, sur LCP, dans un débat qui posait encore la question de savoir si l'écologie pouvait être de droite, personne n'a osé prononcer le mot capitalisme pour désigner l'institution qui, au travers de la recherche frénétique du profit, constitue le facteur le plus contraire à l'objectif que tous les interlocuteurs désignaient comme le leur : maîtriser la croissance.
Les appellations gauche/droite, purement géographiques, n'ont plus guère de sens dans notre pays sans vérité. L'écologie ne peut qu'être anticapitaliste, et l'être constitue même à mon sens la condition pour se dire de gauche. Seule la prétention nulle part justifiée du capitalisme à constituer la norme peut situer l'anticapitalisme dans une zone qualifiée « extrême », c'est-à-dire privée de légitimité par ceux qui ont établi la norme qui fonde leur domination.
Principe d'universalité
La disqualification du prétendu droit de propriété est sans appel possible. Un système juridique qui reconnaît ce droit ne peut se recommander du Droit, un Droit qui, sortie de l'emprise d'un déterminisme matérialiste de l'histoire a retrouvé son autonomie et dont Hans Kelsen a décrit ce qu'il a appelé sa pureté et dont Jacques Bouveresse a tenté de dire la vérité (v.billet précité).
Le principe d'universalité se déduit d'une option. A chacun d'adhérer à l'une ou à l'autre, à la condition, cette option tenant d'un chois de raison, de conduire sa rationalité jusqu'au bout. Je vais énoncer la première, celle que je propose. Je dirai ensuite un mot de la seconde. Ne pas choisir est, selon moi, emprunter la seconde.
La première option repose sur le refus qu'il puisse y avoir une génération spontanée. Il y a quelque chose, de l'existant, un ou des univers. Il n'y a donc pas « Rien ». Quelque chose ne pouvant sortir de rien, il y a donc toujours eu quelque chose. « Être », qui représente l'objet philosophique par excellence, exprime ce toujours. Ce qui est n'est pas précédé, ne peut disparaître, peut varier dans ses modalité, ses modes d'existence, nous situe dans un infini, lequel ne nous est pas étranger et que nous sommes invités à vivre, l'ayant pensé et disposant d'une liberté pour édifier un monde pouvant l'accueillir. Tout cela fait l'objet de la méditation qu'est ce blog, méditation jamais terminée et qui ne peut s'accomplir qu'en multitude.
Être nous invite à chaque jour croître en être et en liberté. Aucun humain ne doit être exclu de cette croissance. Là est le lieu de l'universalité.
La seconde option admet la génération spontanée. Sa définition appartient à ceux qui la prennent. Je ne pense pas trop la trahir en la résumant : dans un monde qui surgit de rien il appartient à l'entreprise des malins de fixer un cap, pour bien qu'assoiffés d'infinitude, il faille vivre la finitude inscrite dans le hasard d'un surgissement.
Malins, c'est un compliment, ils sont intelligents, entreprenants et leur mégalomanie nourrit l'admiration et la soumission. C'est aussi une crainte de démonisme, nature de celui qu'on a nommé le Malin.
Principe de liberté
De la liberté il a beaucoup été question dans ce blog. La liberté y est consubstantielle à l'être. La liberté ici diffère sans doute beaucoup de celle dont les malins parlent, la capturant chacun à leur profit, la refusant le plus possible à l'autre. J'ai condensé l'idée de liberté en adhérant pleinement au cri de Franz Fanon : « Ma liberté m'a été donnée pour édifier le monde du toi ».
Je me limite ici à me réjouir que K. Saito ait une conception de la liberté très proche. Notre auteur ne s'embarrasse pas de nuance. La liberté du capitaliste est de choisir la voie de l'autodestruction, c'est une « mauvaise liberté » (p. 239). C'est la vision de Marx à la fin de sa vie, d'un Marx revenu à cet humanisme qui était le sien avant 1845. Le regard qu'il porte sur les choses est immensément humain et bénéficie de l'autorité d'un homme de génie, qui s'est lourdement trompé mais dont l'erreur a été terriblement amplifiée par des hommes qui portaient déjà en eux de la malignité, d'un homme qui a élevé très haut sa préoccupation pour l'homme. Il convient de souligner que Marx dans le Capital a déjà amorcé un tournant écologique et perçu les perturbations de l'environnement causées par le capitalisme (p. 138/140) et qu'il est à la recherche d'une nouvelle rationalité mettant l'accent sur la durabilité et l'égalité (p. 160 et s.).
Faits
Le regard est subjectif, les faits sont réels. Les relier à des principes a paru leur donner une petite chance supplémentaire pour acquérir de l'objectivité , être entendus. Le sens de l'humain a été atrophié, anesthésié par des décennies, voire des siècles, d'une culture encensant un certain type d'homme, caricature du véritable. De même que l'on naît poète et que l'on devient orateur, le sens de l'humain tient à l'inné, la raison peut être éduquée.
En grand accusateur du capitalisme, K. Saito s'appuie essentiellement sur une lecture des faits qui me paraît avoir la vérité de l'évidence. Certaines pages cependant devraient être plus rigoureusement renseignées pour emporter l'adhésion. Si l'essor du capitalisme réalisé « sur le démantèlement des communs » peut apparaître aujourd'hui appauvrir davantage qu'il n'enrichit il a pu un temps être regardé comme une voie, nécessairement couteuse, pour libérer certaines couches de la population de modes de vie oppressives. Ce temps a malheureusement était prolongé par les malins qui font tout pour empêcher les oreilles naïves d'entendre les voix raisonnables. Si le démantèlement des communs a bien permis « l'accumulation primitive » du capital, lieu de la tricherie fondatrice, reste à chiffrer « l'augmentation artificielle de la rareté » que cela a provoquée (p.209/210).
Saito rend compte tout d'abord du lien quasi inhérent au triste génie du capitalisme qui conduit celui-ci à saccager notre environnement et à bouleverser notre climat. Il montre ensuite qu'un certain type de décroissance est nécessaire. Le phénomène migratoire étant devenu le prétexte d'une alliance mortifère entre un peuple abusé et le capitalisme, où plutôt d'une capture du premier par le second, je me limiterai à ce que l'auteur dit à son sujet.
Dès le début de son ouvrage le « pillage de l'environnement » se révèle accompagné d'un « pillage de l'humanité » (p. 51). « La dégradation des conditions de vie des populations du Sud a permis le capitalisme » (p. 24). « L'externalisation » des coûts du Nord vers le Sud sera par la suite richement informée. Le lien avec la tolérance d'inégalités astronomiques, destructrices de toute unité du genre humain est établi. « En refusant de limiter les injustices, le capitalisme réduit la probabilité de survie de l'humanité » (p. 99). Le capitalisme et le train de vie qu'il a permis à une parie de l'humanité conduit inexorablement une autre partie à l'exode. Au mouvement d'hospitalité que la reconnaissance de leur égale humanité devrait faire naître s'ajoute une dette que nous ne pourrons jamais solder. Si l'hospitalité a pour limite nos « possibilités » et la satisfaction que nous devons également aux marginaux du Nord, ces possibilités sont à apprécier à l'aune d'une justice aussi réparatrice que reconnaissante.
De façon purement anecdotique me revient le mot de l'expert qui en cette soirée du 13 octobre évoquée ci-dessus, était invité à donner une opinion informée. Pensant dire un mot qui à la fois préservait la bienveillance et la rigueur, il appelait à ne pas confondre migrants et immigrants. J'ai, malveillant, entendu que les migrants étaient des gens très biens, sauf quand ils nous demandaient un partage.
La restauration des communs
« Le communisme, c'est restaurer les communs » écrit Saito (p. 228). Le socialisme doit également restaurer les communs, à grande échelle. Mais il ne fait pas de ceux-ci l'unique univers de l'homme. Le communisme peut également préserver cette part inaliénable qui doit permettre le déploiement des subjectivités dans leurs singularités les plus amples, le mot socialisme me paraît simplement convenir mieux. Est social ce qui donne une part juste à tous, ce qui permet au regard de se détourner de la contemplation de soi-même pour envelopper le monde dans sa préoccupation.
La propriété de nos codes emporte les droits de disposer, d'user, de bénéficier des fruits, l'abusus, l'usus et le fructus. Le fructus peut être rattaché à l'abusus (exemple des loyers) et disparaître avec lui, ou à l'usus, au droit subjectif d'usage.
Tous les penseurs soucieux de vérité ont vu en l'usage le mode par excellence permettant d'avoir avec les choses que les juristes alors nomment des « biens » un rapport humain. Humain et ne fermant pas à tout avenir comme le fait le capitalisme. C'est pourquoi la référence s'impose au petit livre de Gaël Giraud et Felwine Sarr, lequel insiste sur l'usage, et a pour titre : « L'économie à venir ».
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

À Mayotte, une schizophrénie collective

Le 18 octobre, Rémi Carayol publie Mayotte. Département colonie aux éditions La Fabrique. Dans cet ouvrage, le journaliste déconstruit notamment le récit (français) d'une île dont l'histoire est plus complexe qu'il n'y paraît. Afrique XXI en publie des extraits.
Tiré d'Afrique XXI.
« Dans ce livre, je prends le parti d'employer les noms comoriens des quatre îles de l'archipel des Comores et non leurs versions « francisées » issues de l'histoire coloniale : Mayotte est Maore ; la Grande Comore, Ngazidja ; Anjouan, Ndzuani ; et Mohéli, Mwali. » Rémi Carayol (membre du comité éditorial d'Afrique XXI) pose le décor dès la première page de son dernier livre, Mayotte. Département colonie, qui paraît le 18 octobre aux éditions La fabrique.

Car le propos est bien celui-ci : déconstruire un récit colonial véhiculé depuis un siècle et demi pour justifier une colonisation qui ne dit (presque) plus son nom. Maore n'a pas, comme ses « sœurs » comoriennes, accédé à l'indépendance en 1975. Pourtant, « aucune de ces îles ne va sans les autres », rappelle d'emblée le journaliste. En cinquante ans, l'ONU a plusieurs fois condamné la France en vertu du principe selon lequel une décolonisation doit s'effectuer dans le cadre des anciennes frontières pour ne pas atteindre à l'intégrité territoriale d'un pays. En vain.
Pour que la France reste sur place, la réécriture historique est permanente, qu'elle soit du fait de Paris ou de certains Mahorais. Première intox démontée : Maore serait devenue « française » bien avant Nice et la Savoie. En réalité, si les dates semblent donner raison à cette affirmation (l'une des « expression-marteau » qui ancrent durablement une idée dans la tête du public), puisque l'île est « cédée » à la France en 1841, Maore ne devient pas française. Les habitants sont demeurés des indigènes jusqu'en 1946, comme ceux des autres colonies d'Afrique.
Injonctions contradictoires
Au fil des 220 pages, Rémi Carayol s'attache à proposer une lecture le plus juste possible de l'histoire de cette île devenue un département français en 2011 après bien des manipulations. Comment un peuple colonisé en arrive-t-il à revendiquer son attachement à la « métropole » au point d'épouser les thèses racistes de l'extrême droite française, comme celle du « grand remplacement », dont il serait victime à cause des arrivées de Comoriens et, depuis peu, d'Africains du continent ?
Cette particularité mène à une « schizophrénie collective » des Mahorais qui doivent jongler entre les injonctions contradictoires de l'administration coloniale et leurs coutumes séculaires… En définitive, qu'y a-t-il de français à Maore à part les mzungu, qui vivent pour beaucoup dans des « ghettos de Blancs » et qui tentent de maintenir le statu quo ? Cette question devient obsédante quand on referme l'ouvrage.
Afrique XXI publie ci-dessous une partie du chapitre VI intitulé « Peau comorienne, masques français » avec l'autorisation de La Fabrique et de l'auteur.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
L'histoire d'un malentendu
« L'HISTOIRE DE « MAYOTTE FRANÇAISE » EST NÉE D'UN MALENTENDU, ou du moins d'un non-dit. Les drapeaux bleu-blanc-rouge qui volent au vent en permanence sur l'île n'ont pas la valeur que les nostalgiques de l'Empire veulent lui donner. Cette revendication « ne procède pas d'une émotion patriotique pro-française », comme le soulève dès 1976 le journaliste Jean-Claude Guillebaud dans un ouvrage consacré aux « confettis de l'Empire » (1), mais bien d'une volonté, pour les dirigeants du mouvement séparatiste, de rompre avec les autres îles de l'archipel avec l'appui d'une puissance présentée comme protectrice. C'est précisément ce que dit le slogan préféré des partisans de la séparation : « Nous voulons rester français pour être libres. » Ce qui revient à Maoré à vouloir rester colonisés pour être libres.
On ne peut comprendre cette contradiction que si l'on considère que l'attachement à la France, ici, n'est pas le but du projet séparatiste mais le moyen. C'est pourquoi les leaders politiques mahorais se sont battus pendant des années pour obtenir le statut de département. Il ne s'agissait pas de devenir « aussi français que les Français » (le but), mais bien de se munir d'un bouclier institutionnel face aux revendications territoriales de l'État comorien (le moyen), puis, lorsque cette menace s'est éloignée, d'en tirer les bénéfices en matière économique notamment. On ne voulait plus seulement rester français, on voulait désormais devenir département. Sauf que personne, parmi les leaders du mouvement séparatiste, n'a jamais osé dire aux Mahorais ce que signifiait concrètement la départementalisation, ni à quoi elle aboutirait. À force de ressasser le « mot-marteau », on en a fait un dogme incompris. Si bien qu'au fil des ans, le moyen est devenu le but, contribuant à plonger la société mahoraise dans une profonde schizophrénie que l'histoire des « vieilles » colonies et les écrits de Frantz Fanon et d'Albert Memmi aident à comprendre. [...]
La lecture de Fanon est utile lorsqu'on vit dans l'archipel des Comores. Le psychiatre et révolutionnaire martiniquais n'a probablement jamais mis les pieds aux Comores mais certaines lignes qu'il couche sur le papier dans Peau noire, masques blancs (1952) et Les Damnés de la terre (1961) semblent décrire ce qu'il s'y joue aujourd'hui. « Face à l'arrangement colonial le colonisé se trouve dans un état de tension permanente. Le monde du colon est un monde hostile, qui rejette, mais dans le même temps c'est un monde qui fait envie. » Mais il arrive un moment où, « après des années d'irréalisme », le colonisé « prend une conscience très aiguë de ce qu'il ne possède pas », de l'aliénation mentale, de l'inégalité matérielle, et alors il se révolte contre « les seules forces qui lui contestaient son être », les forces du colonialisme. On n'en est pas encore là à Maore, où la remise en cause du système colonial n'est jamais frontale. Mais la multiplication des mouvements sociaux et des grèves générales montre qu'on s'en approche.
Des « contradictions de toutes sortes »
Dans Peau noire, masques blancs, Fanon fait la démonstration que le destin du Noir français (en l'occurrence antillais) est de devenir blanc, que c'est le seul moyen pour lui d'être reconnu en tant qu'être humain, mais que cela relève de l'impossible car cette blancheur restera à jamais hors d'atteinte. Pour Fanon, cette impasse explique les troubles individuels et collectifs qui frappent la société antillaise. Ces troubles, une lointaine consœur de Fanon les a étudiés à Maore. Patricia Janody a exercé la psychiatrie durant plusieurs courts séjours dans l'île entre 2004 et 2011. Et elle en a tiré un très beau récit, L'Odeur de Mayotte. Une clinique des frontières (Epel, 2022).
Elle raconte avoir été confrontée durant ses missions à la difficulté d'exercer dans un tel milieu, « empêtrée dans des contradictions de toutes sortes » (2), à commencer par sa méconnaissance de la langue, un sérieux obstacle dans son travail. Elle décrit et contextualise les troubles qu'elle a rencontrés et aboutit à la conclusion que certains d'entre eux sont directement liés à la situation politique. Elle narre notamment le cas d'une patiente dépressive, dénommée « Ahmed ».
Janody est surprise qu'une femme porte le prénom d'un homme. Grâce à l'aide de l'interprète, elle découvre l'ingénierie proprement coloniale qui a abouti à cette situation. « Ahmed » et l'interprète lui expliquent que jusqu'à récemment, un nouveau-né mahorais recevait son nom d'après trois degrés de filiation : le nom du nouveau-né + le nom du père + le nom du grand-père paternel. Ainsi dans le système comorien, à chaque génération, le nom du père vient s'ajouter à celui du fils. Abdou Madi signifie « Abdou, fils de Madi ». Mais ce modèle ancestral, considéré comme fiable et cohérent par les Comoriens, ne correspond pas à celui en vigueur en France : prénom + patronyme.
Durant toute la période coloniale et même après, les autorités l'ont toléré d'autant plus aisément que la plupart des Comoriens avaient peu de rapports avec l'administration. Mais au milieu des années 1990, lorsque la « marche vers le droit commun » a été engagée à Maore [le nom comorien de Mayotte, NDLR], accentuant le contrôle étatique des populations, l'administration a entrepris de tout remettre à plat, à sa convenance, ce que Janody appelle une « opération de substitution radicale ». Un immense chantier a été lancé pour renommer les gens. Une commission spéciale « relative aux noms patronymiques » a été mise sur pied en 1996. L'année suivante, une brochure intitulée « Le Livre des noms et prénoms mahorais », diffusée par la préfecture, proposait une liste de « prénoms susceptibles de devenir des noms patronymiques » – dont très peu de noms d'origine arabe et de signification religieuse musulmane, comme l'a constaté en 1999 un trio de chercheurs (3).
« Le village et la religion restent au centre de nos vies »
Un an plus tard, une ordonnance fixe les nouvelles règles qui prévoient que « les Mahorais de statut personnel doivent choisir un nom patronymique parmi une liste établie par une commission du nom patronymique créée en 1997 ». Une commission de révision de l'état civil, la CREC, est chargée d'effacer le nom des Mahorais et de leur en attribuer un nouveau, suivant des critères qui échappent bien souvent aux principaux concernés. En dix ans, elle a rendu 85 000 décisions ayant conduit à l'édition de 240 000 actes d'état civil. Du jour au lendemain, on peut ainsi changer de nom ou de prénom. La plupart en rient mais d'autres le vivent mal. « Quand le contexte social soutient le processus, il y a moyen de s'identifier à son nom en souplesse, en laissant glisser ailleurs qu'en soi ses effets de dérobement », constate Patricia Janody.
Mais quand « le contexte social n'est pas cohérent [...] il ne reste guère qu'à en endosser la faille à titre individuel, c'est-à-dire à produire un symptôme ». C'est ce qui est arrivé à « Ahmed », qui a hérité d'un nom masculin bien malgré elle. « Les modalités sont, dans la situation qui nous occupe, littéralement stupéfiantes, poursuit la psychiatre. [...] Elles ne sont pas issues de changements de place au sein d'une société, mais bien de l'imposition d'un autre système de nomination ». Cette dépossession abrupte, « Ahmed » ne l'a pas acceptée... « Mais d'où provient donc la folie ? se demande la psychiatre. D'une faille propre au sujet qui délire, ou bien des sociétés qui désarticulent, sans préavis, les règles d'inscription, d'usage et de transmission du nom ? »
Bien sûr, « Ahmed » a continué de se faire appeler par son vrai nom dans son village, comme tous les Mahorais ou presque. La vie au village n'est pas la même qu'en ville et dans la société comorienne, elle reste cardinale. « On peut faire toutes les réformes qu'on veut, le village et la religion restent au centre de nos vies », m'a un jour expliqué l'actuel sénateur Saïd Omar Oili. De nombreux travaux de recherche l'ont documenté, comme ceux de Nicolas Roinsard : « Sous les eaux agitées de la départementalisation et de ses mesures assimilationnistes, la vie sociale demeure en partie régie selon des logiques d'intégration et d'obligations fondées sur l'appartenance villageoise et familiale, l'ethos musulman, les rapports de genre, etc. » (4).
Une société à deux facettes
C'est ainsi qu'une société à deux facettes s'est constituée : côté pile, ce que l'on veut bien montrer aux Blancs ; côté face, la vie telle qu'on l'entend. D'un côté, la société de la départementalisation et du droit commun : l'école laïque, l'économie marchande déclarée, le français comme langue officielle, etc. De l'autre, la société mahoraise et donc comorienne : les mariages religieux, le travail non déclaré, la prédominance des langues vernaculaires, etc. Un chiffre illustre cette résistance selon Roinsard : 98 % des mariages demeurent coutumiers. « Chassez le culturel, il revient au galop », ironisait Lou Bellétan en 1993 (5).
Ainsi, la polygamie est interdite, mais toujours pratiquée : selon une étude de l'Insee, un homme sur dix était polygame à Maore en 2017, soit à peu près le même taux qu'en 1991 (13 %), lorsque cette pratique était autorisée (6). En 2024, la polygamie est encore très courante, y compris chez les jeunes. Ce serait même « redevenu à la mode », estime Saïd Omar Oili, et pour cause : par l'effet des flux migratoires, il y a plus de femmes que d'hommes sur l'île (12 000 de plus, selon l'Insee), et le fossé est particulièrement important chez les 20-40 ans (7) . Or la pression familiale et au village est telle sur les femmes célibataires qui ont passé la trentaine qu'elles finissent par épouser le premier venu, ou que leurs parents le leur imposent, même s'il a déjà une (ou plusieurs) épouse(s) et même si c'est un « Comorien » venu des autres îles. [...]
Cette cohabitation entre deux mondes qui s'évitent, s'ignorent et entre lesquels les passerelles sont assez rares se reflète dans la pratique de la langue. Roinsard rappelle qu'en 2012 le français était la langue maternelle d'un habitant de Maore sur dix seulement et que plus de la moitié (58 %) de la population en âge de travailler ne maîtrisait pas le français écrit – un véritable obstacle à l'accès au travail salarié. En 2019, seuls 55 % des habitants de Maore déclaraient maîtriser le français (75 % parmi les natifs de l'île (8)). Cette dichotomie entre la langue officielle, indispensable mais peu ou mal maîtrisée, et la langue officieuse parlée par l'immense majorité de la population, y compris les « étrangers », mais incomprise de la petite minorité venue de « métropole » qui détient le pouvoir, est un des marqueurs les plus saisissants de la colonialité mahoraise.
Résistance passive
« Muni de sa seule langue, le colonisé est un étranger dans son propre pays », écrivait en 1957 Albert Memmi dans son Portrait du colonisé. « La possession de deux langues n'est pas seulement celle de deux outils, c'est la participation à deux royaumes psychiques et culturels. Or ici, deux univers symbolisés, portés par les deux langues, sont en conflit. Ce sont ceux du colonisateur et du colonisé. En outre, la langue maternelle du colonisé, celle qui est nourrie de ses sensations, ses passions et ses rêves [...], celle enfin qui recèle la plus grande charge affective, celle-là précisément est la moins valorisée [...] Dans le conflit linguistique qui habite le colonisé, sa langue maternelle est l'humiliée, l'écrasée » (9).
Comme Fanon, Memmi a lui aussi proposé une critique radicale du système colonial. La lecture de ses deux courts essais, Portrait du colonisé et Portrait du colonisateur, publiés en 1957 et fondés sur ses observations sous la colonisation française en Tunisie, offre parfois un miroir déconcertant : c'est comme si les portraits qu'il dresse étaient tirés de la situation à Maore. Le colonisé, écrit-il, « tente soit de devenir autre, soit de reconquérir toutes ses dimensions, dont l'a amputé la colonisation ». Sa première tentative est de changer de peau, de tenter de copier le « modèle tentateur » tout proche du colonisateur qui, lui, « a tous les droits, jouit de tous les biens et bénéficie de tous les prestiges ». Il s'arrache de lui-même et « pour se libérer, du moins le croit-il, il accepte de se détruire ». Mais lorsqu'il se rend compte que l'assimilation est une quête impossible, il se révolte et entreprend de se libérer « par la reconquête de soi ».
Cette reconquête ne prend pas forcément les contours que l'on attend. À Maore, où la revendication frontale de l'indépendance est pour l'heure inenvisageable, elle s'exprime par la résistance passive décrite plus haut, mais aussi par la multiplication des mouvements sociaux depuis le milieu des années 2000. Les Mahorais ne sont plus prêts à faire des efforts inconsidérés sans en recevoir quelques bénéfices. Les instituteurs réclament l'indexation des salaires, les chômeurs une indemnité digne de ce nom, les travailleurs du privé exigent un salaire minimum aligné sur celui en vigueur dans l'Hexagone... Il s'agit de « monnayer l'acculturation », selon le sociologue David Guyot. [...] »
Notes
1- Jean-Claude Guillebaud, Les Confettis de l'Empire. Djibouti, Martinique, Guadeloupe, Réunion, Tahiti, Nouvelle-Calédonie, Guyane, Paris, Seuil, 1976
2- Mohamed Anssoufouddine, Patricia Janody, Les maux/les mots n'appartiennent à personne. Rejouer les frontières d'aujourd'hui, KomEDIT, 2023
3- Mohamed M'Trengoueni, Soilihi Moukhtar, Noël Gueunier, « “NOM, Prénom” : une étape vers l'uniformisation culturelle ? Identité et statut juridique à Mayotte (Océan Indien Occidental) », Revue des sciences sociales, n° 26, 1999.
4- Nicolas Roinsard, Une situation postcoloniale. Mayotte ou le gouvernement des marges, CNRS éditions, 2022.
5- Lou Bellétan, La Guerre de la salive, autoédition, 1993.
6- « Migrations, natalité et solidarités familiales », Insee Analyses Mayotte, n° 12, mars 2017.
7- « Les femmes à Mayotte. Une situation souvent précaire, mais des progrès en matière de formation et d'emploi », Insee Dossier Mayotte n° 3, juillet 2022.
8- Marylise Dehon, Amandine Louguet, « Mayotte, un territoire riche de ses langues et de ses traditions. Enquête Pratiques culturelles à Mayotte en 2019 », Insee Analyses Mayotte n 33, juillet 2022.
9- Albert Memmi, Portrait du colonisateur, Portrait du colonisé, Gallimard, 1985.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
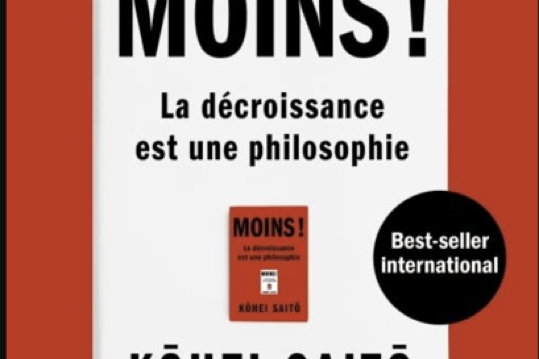
Marx, le communisme et la décroissance — A propos du nouveau livre de Kohei Saito : « Moins ! La décroissance est une philosophie »

Kohei Saito remet le couvert. Dans La nature contre le capital. L'écologie de Marx dans sa critique inachevée du capital (Ed. Syllepse, Page2, et M, 2021), le marxologue japonais montrait comment le Marx de la maturité, conscientisé à l'impasse écologique capitaliste par les travaux de Liebig et de Frass, avait rompu avec le productivisme [1]. Son nouvel ouvrage, Moins ! La décroissance est une philosophie (Ed. Seuil, septembre 2024), prolonge la réflexion [2].
Tiré d'À l'encontre.
Ce livre est remarquable et utile en particulier sur quatre points : la nature de classe, foncièrement destructive, des forces productives capitalistes ; la supériorité sociale et écologique des sociétés (dites) « primitives », sans classes ; le débat sur nature et culture avec Bruno Latour et Jason Moore, notamment ; la grosse erreur, enfin, des « accélérationnistes » qui se réclament de Marx pour nier l'impérieuse nécessité d'une décroissance. Ces quatre points sont d'une importance politique majeure aujourd'hui, non seulement pour les marxistes soucieux d'être à la hauteur du défi écosocial lancé par la crise systémique du capitalisme, mais aussi pour les activistes écologiques. Le livre a les mêmes qualités que le précédent : il est érudit, bien construit, subtil et éclairant dans la présentation de l'évolution intellectuelle de Marx après 1868. Il a malheureusement aussi le même défaut : il présente pour acquis ce qui n'est qu'hypothèse. Une fois encore, Saito force le trait à vouloir trouver chez Marx la parfaite anticipation théorique des combats d'aujourd'hui. [3]
Au commencement était la « faille métabolique »
La première partie de « Marx in the Anthropocene » approfondit l'exploration du concept marxien de « faille métabolique » (« hiatus métabolique » dans la version française du Capital). [4] Saito se place ici dans le sillage de John B. Foster et de Paul Burkett, qui ont montré l'immense importance de cette notion. [5] Saito enrichit le propos en mettant en évidence trois manifestations du phénomène – perturbation des processus naturels, faille spatiale, hiatus entre les temporalités de la nature et du capital – auxquelles correspondent trois stratégies capitalistes d'évitement – les pseudo-solutions technologiques, la délocalisation des catastrophes dans les pays dominés, et le report de leurs conséquences sur les générations futures (p.29 et sq.).
Le chapitre 1 se penche plus particulièrement sur la contribution au débat du marxiste hongrois István Mészáros, que Saito estime décisive dans la réappropriation du concept de métabolisme à la fin du 20e siècle. Le chapitre 2 est focalisé sur la responsabilité d'Engels qui, en éditant les Livres II et III du Capital, aurait diffusé une définition du « hiatus métabolique » tronquée, sensiblement différente de celle de Marx. Pour Saito, ce glissement, loin d'être fortuit, traduirait une divergence entre la vision écologique d'Engels – limitée à la crainte des « revanches de la nature » – et celle de Marx – centrée sur la nécessaire « gestion rationnelle du métabolisme » par la réduction du temps de travail. Le chapitre 3, tout en rappelant les ambiguïtés de György Lukács, rend hommage à sa vision du développement historique du métabolisme humain-nature à la fois comme continuité et comme rupture. Pour Saito, cette dialectique, inspirée de Hegel (« identité entre l'identité et la non-identité ») est indispensable pour se différencier à la fois du dualisme cartésien – qui exagère la discontinuité entre nature et société – et du constructivisme social – qui exagère la continuité (l'identité) entre ces deux pôles et ne peut, du coup, « révéler le caractère unique de la manière capitaliste d'organiser le métabolisme humain avec l'environnement » (p. 91).
Dualisme, constructivisme et dialectique
La deuxième partie de l'ouvrage jette un regard très (trop ?) critique sur d'autres écologies d'inspiration marxiste. Saito se démarque de David Harvey dont il épingle la « réaction négative surprenante face au tournant écologique dans le marxisme ». De fait, « Marx in the Anthropocene » rapporte quelques citations « surprenantes » du géographe étasunien : Harvey semble convaincu de « la capacité du capital à transformer toute limite naturelle en barrière surmontable » ; il confesse que « l'invocation des limites et de la rareté écologique (…) (le) rend aussi nerveux politiquement que soupçonneux théoriquement » ; « les politiques socialistes basées sur l'idée qu'une catastrophe environnementale est imminente » seraient pour lui « un signe de faiblesse ». Géographe comme Harvey, Neil Smith « montrerait la même hésitation face à l'environnementalisme », qu'il qualifie de « apocalypsisme ». Smith est connu pour sa théorie de « la production sociale de nature ». Saito la récuse en estimant qu'elle incite à nier l'existence de la nature comme entité autonome, indépendante des humains : c'est ce qu'il déduit de l'affirmation de Smith que « la nature n'est rien si elle n'est pas sociale » (p. 111). D'une manière générale, Saito traque les conceptions constructivistes en posant que « la nature est une présupposition objective de la production ». Il ne fait aucun doute que cette vision était aussi celle de Marx. Le fait incontestable que l'humanité fait partie de la nature ne signifie ni que tout ce qu'elle fait serait dicté par sa « nature », ni que tout ce que la nature fait serait construit par « la société ».
Destruction écologique : les « actants » ou le profit ?
Dans le cadre de cette polémique, l'auteur consacre quelques pages très fortes à Jason Moore. Il admet que la notion de Capitalocène « marque une avancée par rapport au concept de ‘production sociale de nature' », car elle met l'accent sur les interactions humanité/environnement. Il reproche cependant à Moore d'épouser que les humains et les non-humains seraient des « actants » travaillant en réseau à produire un ensemble intriqué – « hybride » comme dit Bruno Latour. C'est un point important. En effet, Moore estime que distinguer une « faille métabolique » au sein de l'ensemble-réseau est un contresens, le produit d'une vision dualiste. Or, la notion de « métabolisme » désigne la manière dont les organes différents d'un même organisme contribuent spécifiquement au fonctionnement du tout. Elle est donc aux antipodes du dualisme (comme du monisme d'ailleurs) et on en revient à la formule de Hegel : il y a « identité de l'identité et de la non-identité ». « Marx in the Anthropocene » s'attaque aussi aux thèses de Moore par un autre biais – celui du travail. Pour Moore, en effet, le capitalisme est mû par l'obsession de la « Cheap Nature » (nature bon marché) qui englobe selon lui la force de travail, l'énergie, les biens alimentaires et les matières premières. Moore se réclame de Marx, mais il est clair que sa « Cheap nature » escamote le rôle exclusif du travail abstrait dans la création de (sur)valeur, ainsi que le rôle clé de la course à la survaleur dans la destruction écologique. Or, la valeur n'est pas un « actant hybride » parmi d'autres. Comme dit Saito, elle est « purement sociale » et c'est par son truchement que le capitalisme « domine les processus métaboliques de la nature » (pp. 121-122).
Il est clair en effet que c'est bien la course au profit qui creuse la faille métabolique, notamment en exigeant toujours plus d'énergie, de force de travail, de produits agricoles et de matières premières « bon marché ». De toutes les ressources naturelles que le capital transforme en marchandises, la force de travail « anthropique » est évidemment la seule capable de créer un indice aussi purement « anthropique » que la valeur abstraite. Comme le dit Saito : c'est « précisément parce que la nature existe indépendamment de et préalablement à toutes les catégories sociales, et continue à maintenir sa non-identité avec la logique de la valeur, (que) la maximisation du profit produit une série de disharmonies au sein du métabolisme naturel ». Par conséquent, la « faille n'est pas une métaphore, comme Moore le prétend. La faille existe bel et bien entre le métabolisme social des marchandises ainsi que de la monnaie, et le métabolisme universel de la nature » (ibid). « Ce n'est pas par dualisme cartésien que Marx a décrit d'une manière dualiste la faille entre le métabolisme social et le métabolisme naturel – de même que la faille entre le travail productif et le travail improductif. Il l'a fait consciemment, parce que les relations uniquement sociales du capitalisme exercent un pouvoir extranaturel (alien power) dans la réalité ; une analyse critique de cette puissance sociale requiert inévitablement de séparer le social et le naturel en tant que domaines d'investigation indépendants et d'analyser ensuite leur emboîtement. » (p. 123) Imparable. Il ne fait aucun doute, encore une fois, que cette vision de « l'emboîtement » du social dans l'environnemental était celle de Marx.
Accélérationnisme vs. anti-productivisme
Le chapitre 5 polémique avec une autre variété de marxistes : les « accélérationnistes de gauche ». Selon ces auteurs, les défis écologiques ne peuvent être relevés qu'en démultipliant le développement technologique, l'automation, etc. Cette stratégie, pour eux, est conforme au projet marxien : il faut abattre les entraves capitalistes à la croissance des forces productives pour possibiliser une société de l'abondance. Cette partie de l'ouvrage est particulièrement intéressante car elle éclaire la rupture avec le productivisme et le prométhéisme des années de jeunesse. La rupture n'est probablement pas aussi nette que Saito le prétend [6], mais il y a incontestablement un tournant. Dans Le Manifeste communiste, Marx et Engels expliquent que le prolétariat doit « prendre le pouvoir pour arracher petit à petit tout le capital à la bourgeoisie, centraliser tous les moyens de production aux mains de l'Etat et augmenter au plus vite la quantité des forces productives ». [7] Il est frappant que la perspective de ce texte est résolument étatiste et que les forces productives y sont considérées comme neutres socialement ; elles forment un ensemble de choses qui doit changer de mains (être « arraché petit à petit à la bourgeoisie ») pour grandir quantitativement.
Les accélérationistes sont-ils pour autant fondés à se réclamer de Marx ? Non, car Marx a abandonné la conception exposée dans le Manifeste. Kohei Saito attire l'attention sur le fait que son œuvre majeure, Le Capital, ne traite plus des « forces productives » en général (anhistoriques), mais de forces productives historiquement déterminées – les forces productives capitalistes. Le long chapitre XV du Livre 1 (« Machinisme et grande industrie ») décortique les effets destructeurs de ces forces, à la fois sur le plan social et sur le plan environnemental. On pourrait ajouter ceci : il n'est pas fortuit que ce soit précisément ce chapitre qui s'achève sur la phrase suivante, digne d'un manifeste écosocialiste moderne : « La production capitaliste ne développe la technique et la combinaison du procès de production sociale qu'en épuisant en même temps les deux sources d'où jaillit toute richesse : la terre et le travailleur ». [8] Il n'est plus question ici de neutralité des technologies. Le capital n'est plus saisi comme une chose mais comme un rapport social d'exploitation et de destruction, qui doit être détruit (« négation de la négation »). Notons que Marx, après la Commune de Paris, précisera que rompre avec le productivisme nécessite aussi de rompre avec l'étatisme.
Il est étonnant que Kohei Saito ne rappelle pas la phrase du Manifeste citée ci-dessus, où le prolétariat est exhorté à prendre le pouvoir pour « augmenter au plus vite la quantité des forces productives ». Cela aurait donné plus de relief encore à sa mise en évidence du changement ultérieur. Mais peu importe : le fait est que le tournant est réel et débouche au Livre III du Capital sur une magnifique perspective de révolution en permanence, résolument anti-productiviste et anti-technocratique : « La seule liberté possible est que l'homme social, les producteurs associés règlent rationnellement leur métabolisme avec la nature et qu'ils accomplissent ces échanges en dépensant le minimum de force, dans les conditions les plus dignes de la nature humaine. La condition essentielle de cet épanouissement est la réduction de la journée de travail. » [9] L'évolution est nette. Le paradigme de l'émancipation humaine a changé : il ne consiste plus en la croissance des forces productives mais en la gestion rationnelle des échanges avec la nature et entre les humains.
Subsomption formelle et subsomption réelle du travail
Les pages les plus riches de « Marx in the Anhropocene », à mon avis, sont celles où Saito montre que le nouveau paradigme marxien de l'émancipation résulte d'un ample effort de critique des formes successives que le capital a imposées au travail. Bien qu'elle fasse partie des travaux préparatoires au Capital, cette critique ne sera publiée que plus tard (« Manuscrits économiques de 1861-1863 »). Sa clé de voûte est l'importante notion de subsomption du travail au capital. Insistons-y en passant : la subsomption est plus que de la soumission : subsumer implique intégrer ce qui est soumis à ce qui soumet. Le capital subsume le salariat puisqu'il intègre la force de travail comme capital variable. Mais, pour Marx, il y a subsomption et subsomption : le passage de la manufacture au machinisme et à la grande industrie implique le passage de la « subsomption formelle » à la « subsomption réelle ». La première signifie simplement que le capital prend le contrôle du procès de travail qui existait auparavant, sans apporter de changement ni à son organisation ni à son caractère technologique. La seconde s'installe à partir du moment où le capital révolutionne complètement et sans arrêt le procès de production – non seulement sur le plan technologique mais aussi sur le plan de la coopération – c'est-à-dire des relations productives entre travailleurs.euses et entre travailleurs.euses et capitalistes. Se crée ainsi un mode de production spécifique, sans précédent, entièrement adapté aux impératifs de l'accumulation du capital. Un mode dans lequel, contrairement au précédent, « le commandement par le capitaliste devient indispensable à la réalisation du procès de travail lui-même » (p. 148).
Saito n'est pas le premier à pointer le caractère de classe des technologies. Daniel Bensaïd soulignait la nécessité que « les forces productives elles-mêmes soient soumises à un examen critique ». [10] Michaël Löwy défend qu'il ne suffit pas de détruire l'appareil d'Etat bourgeois – l'appareil productif capitaliste aussi doit être démantelé. [11] Cependant, on saura gré à Saito de coller au plus près du texte de Marx pour résumer les implications en cascade de la subsomption réelle du travail : celle-ci « augmente considérablement la dépendance des travailleurs vis-à-vis du capital » ; « les conditions objectives pour que les travailleurs réalisent leurs capacités leur apparaissent de plus en plus comme une puissance étrangère, indépendante » ; « du fait que le capital en tant que travail objectivé – moyens de production – emploie du travail vivant, la relation du sujet et de l'objet est inversée dans le processus de travail » ; « le travail étant incarné dans le capital, le rôle du travailleur est réduit à celui de simple porteur de la chose réifiée – les moyens de préserver et de valoriser le capital à côté des machines – tandis que la chose réifiée acquiert l'apparence de la subjectivité, puissance étrangère qui contrôle le comportement et la volonté de la personne » ; « l'augmentation des forces productives étant possible seulement à l'initiative du capital et sous sa responsabilité, les nouvelles forces productives du travail social n'apparaissent pas comme les forces productives des travailleurs eux-mêmes mais comme les forces productives du capital » ; « le travail vivant devient (ainsi) un pouvoir du capital, tout développement des forces productives du travail est un développement des forces productives du capital ». Deux conclusions non productivistes et non technocratiques s'imposent alors avec force : 1°) « le développement des forces productives sous le capitalisme ne fait qu'augmenter le pouvoir extérieur du capital en dépouillant les travailleurs de leurs compétences subjectives, de leur savoir et de leur vision, il n'ouvre donc pas automatiquement la possibilité d'un avenir radieux » ; 2°) le concept marxien de forces productives est plus large que celui de forces productives capitalistes – il inclut des capacités humaines telles que les compétences, l'autonomie, la liberté et l'indépendance et est donc à la fois quantitatif et qualitatif » (p. 149-150).
Quel matérialisme historique ? Quelle abondance ?
Ces développements amènent Kohei Saito à réinterroger le matérialisme historique. On sait que la Préface à la critique de l'économie politique contient le seul résumé que Marx ait fait de sa théorie. On y lit ceci : « A un certain stade de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en contradiction avec les rapports de production existants ou, ce qui n'en est que l'expression juridique, avec les rapports de propriété au sein desquels elles s'étaient mues jusqu'alors. De formes de développement des forces productives qu'ils étaient, ces rapports en deviennent des entraves. Alors s'ouvre une période de révolution sociale ». [12] Il semble clair que Marx ne pouvait plus adhérer littéralement à cette formulation – et encore moins à celle du Manifeste sur l'augmentation quantitative des forces productives – dès lors que son analyse l'amenait à conclure que le développement des dites forces renforce l'emprise du capital et mutile l'agentivité de celleux qu'il exploite. Comme le dit Saito : « On ne peut plus assumer qu'une révolution socialiste pourrait simplement remplacer les relations de production par d'autres une fois atteint un certain niveau de forces productives. Puisque les forces productives du capital engendrées par la subsomption réelle sont matérialisées et cristallisées dans le mode capitaliste de production, elles disparaissent en même temps que le mode de production ». Transférer la propriété du capital à l'Etat ne changerait pas le problème : les forces productives restant inchangées, 1°) les tâches de conception devraient être assurées par une « classe bureaucratique », 2°) la destruction écologique continuerait. L'auteur en conclut que « la subsumption réelle pose un problème difficile de ‘gestion socialiste libre'. La vision traditionnelle du matérialisme historique, synthétisée dans la Préface, n'indique aucune piste de solution » et « Marx n'a pas été à même d'apporter une réponse définitive à ces questions, même dans Le Capital, de sorte que nous devons aller au-delà » (pp. 157-158).
« Aller au-delà » est ce qui est proposé dans la troisième partie de son ouvrage, et c'est elle qui soulève le plus de polémiques. La question de départ est simple : si l'émancipation ne passe pas par la libre croissance des forces productives, donc par ce que Daniel Bensaid appelait le « joker de l'abondance » [13] par où pourrait-elle passer ? Par « la réduction d'échelle et le ralentissement de la production », répond Saito (p. 166). Pour l'auteur, en substance, l'abondance doit s'entendre non comme pléthore de biens matériels privés – sur le modèle à la fois consumériste et excluant de l'accumulation de marchandises accessibles uniquement à la seule demande solvable – mais comme profusion de richesses sociales et naturelles communes. Sans cela, « l'option restante devient le contrôle bureaucratique de la production sociale, qui a causé l'échec de la voie soviétique » (p. 166).
Décroissance, économie stationnaire et transition
« Marx in the Anthropocene » entend donc plaider pour un « communisme de la décroissance », profondément égalitaire, axé sur la satisfaction des besoins réels. Selon Saito, ce communisme était celui des communautés dites « archaïques », dont certains traits ont subsisté longtemps sous des formes plus ou moins dégradées dans des systèmes agraires basés sur la propriété collective de la terre, en Russie notamment. Pour le Marx de la maturité, il s'agit de beaucoup plus que des survivances d'un passé révolu : ces communautés indiquent qu'après avoir « exproprié les expropriateurs », la société, pour abolir toute domination, devra progresser vers une forme plus élevée de la communauté « archaïque ». J'adhère pleinement à cette perspective, mais avec un bémol : Saito force gravement le trait en prétendant que « 14 années d'étude sérieuse des sciences naturelles et des sociétés précapitalistes » auraient amené Marx en 1881 à avancer « son idée du communisme décroissant » (p. 242) Cette affirmation est excessive. Prise littéralement, elle ne repose sur aucun document connu. Du coup, pour qu'elle ait malgré tout une once de plausibilité (et encore : à condition de la formuler comme une hypothèse, pas comme une certitude !) Saito est obligé de recourir à une succession d'amalgames : faire comme si la critique radicale de l'accumulation capitaliste par Marx était la même chose que l'économie stationnaire, comme si les communautés « archaïques » étaient stationnaires, et comme si l'économie stationnaire était la même chose que la décroissance. Cela fait beaucoup de « si », néglige des différences essentielles… et ne nous fait pas avancer dans le débat sur les enjeux de la décroissance au sens où elle se discute aujourd'hui entre anticapitalistes, c'est-à-dire au sens littéral de la réduction de la production imposée objectivement par la contrainte climatique. Voyons cela de plus près.
Laissons le PIB de côté et considérons uniquement la production matérielle : une société post-capitaliste dans un pays très pauvre romprait avec la croissance capitaliste mais devrait accroître la production pendant une certaine période pour répondre à l'énorme masse de besoins réels insatisfaits ; une économie stationnaire utiliserait chaque année la même quantité de ressources naturelles pour produire la même quantité de valeurs d'usage avec les mêmes forces productives ; quant à une économie décroissante, elle réduirait les prélèvements et la production. En mettant un signe d'égalité entre ces formes, Kohei Saito entretient une confusion regrettable. « Il devrait maintenant être clair, écrit-il, que le socialisme promeut une transition sociale vers une économie de décroissance » (p.242). C'est fort mal formulé, car la décroissance n'est pas un projet de société, juste une contrainte qui pèse sur la transition. Une « économie de décroissance », en tant que telle, cela ne veut rien dire. Certaines productions doivent croître et d'autres décroître au sein d‘une enveloppe globale décroissante. Pour coller au diagnostic scientifique sur le basculement climatique, il faut dire à peu près ceci : planifier démocratiquement une décroissance juste est le seul moyen de transiter rationnellement vers l'écosocialisme. En effet, étant donné qu'un nouveau système énergétique 100% renouvelables doit forcément être construit avec l'énergie du système actuel (qui est fossile à 80%, donc source de CO2), il n'y a en gros que deux stratégies possibles pour supprimer les émissions : soit on réduit radicalement la consommation finale d'énergie (ce qui implique de produire et transporter globalement moins) en prenant des mesures anticapitalistes fortes (contre les 10%, et surtout le 1% le plus riche) ; soit on mise sur la compensation carbone et sur le déploiement massif à l'avenir d'hypothétiques technologies de capture-séquestration du carbone, de capture-utilisation ou de géoingénierie, c'est-à-dire sur des solutions d'apprentis-sorciers entraînant encore plus de dépossessions, d'inégalités sociales et de destructions écologiques. Nous proposons l'expression « décroissance juste » comme axe stratégique des marxistes antiproductivistes d'aujourd'hui. Faire de la décroissance un synonyme de l'économie stationnaire n'est pas une option car cela équivaut à baisser le volume de l'alarme incendie.
La commune rurale russe, la révolution et l'écologie
La perspective d'une décroissance juste doit beaucoup à l'énorme travail pionnier de Marx, mais il n'y a pas de sens à affirmer qu'il en est le concepteur, car Marx n'a jamais plaidé explicitement pour une diminution nette de la production. Pour en faire le père du « communisme décroissant », Saito se base quasi exclusivement sur un texte célèbre et d'une importance exceptionnelle : la lettre à Vera Zasoulitch. [14] En 1881, la populiste russe avait demandé à Marx, par courrier, son avis sur la possibilité, en Russie, de s'appuyer sur la commune paysanne pour construire le socialisme directement – sans passer par le capitalisme. La traduction russe du Capital avait déclenché un débat sur cette question parmi les opposants au tsarisme. Marx rédigea trois brouillons de réponse. Ils attestent sa rupture profonde avec la vision linéaire du développement historique, donc aussi avec l'idée que les pays capitalistes les plus avancés seraient les plus proches du socialisme. A ce sujet, la dernière phrase est claire comme de l'eau de roche : « Si la révolution se fait en temps opportun, si elle concentre toutes ses forces pour assurer l'essor libre de la commune rurale, celle-ci se développera bientôt comme un élément régénérateur de la société russe et comme élément de supériorité sur les pays asservis par le régime capitaliste ».
Pour Saito, ce texte signifie que la dégradation capitaliste de l'environnement avait conduit Marx, après 1868, à « abandonner son schéma de matérialisme historique antérieur. Ce ne fut pas une tâche aisée pour lui, dit-il. Sa vision du monde était en crise. En ce sens, (ses) recherches intensives au cours de ses dernières années (sur les sciences naturelles et les sociétés précapitalistes, D.T.) étaient une tentative désespérée de reconsidérer et de reformuler sa conception matérialiste de l'histoire à partir d'une perspective entièrement nouvelle, découlant d'une conception radicalement nouvelle de la société alternative » (p. 173). « Quatorze années de recherches » avaient amené Marx « à conclure que la soutenabilité et l'égalité basées sur une économie stationnaire sont la source de la capacité (power) de résistance au capitalisme ». Il aurait donc saisi « l'opportunité de formuler une nouvelle forme de régulation rationnelle du métabolisme humain avec la nature en Europe occidentale et aux Etats-Unis » : « l'économie stationnaire et circulaire sans croissance économique, qu'il avait rejetée auparavant comme stabilité régressive des sociétés primitives sans histoire » (pp. 206-207).
Que penser de cette reconstruction du cheminement de la pensée marxienne à la sauce écolo ? Le narratif a beaucoup pour plaire dans certains milieux, c'est évident. Mais pourquoi Marx a-t-il attendu 1881 pour s'exprimer sur ce point clé ? Pourquoi l'a-t-il fait seulement à la faveur d'une lettre ? Pourquoi cette lettre a-t-elle demandé trois brouillons successifs ? Si vraiment Marx avait commencé à « réviser son schéma théorique en 1860 par suite de la dégradation écologique » (p.204), et si vraiment le concept de faille métabolique avait servi de « médiation » dans ses efforts de rupture avec l'eurocentrisme et le productivisme (p. 200), comment expliquer que la supériorité écologique de la commune rurale ne soit pas évoquée une seule fois dans la réponse à Zasoulitch ? Last but not least : si on peut ne pas exclure que la dernière phrase de cette réponse projette la vision d'une économie post-capitaliste stationnaire pour l'Europe occidentale et les Etats-Unis, ce n'est pas le cas pour la Russie ; Marx insiste fortement sur le fait que c'est seulement en bénéficiant du niveau de développement des pays capitalistes développés que le socialisme en Russie pourra « assurer le libre essor de la commune rurale ». Au final, l'intervention de Marx dans le débat russe semble découler bien plus de son admiration pour la supériorité des rapports sociaux dans les sociétés « archaïques » [15] et de son engagement militant pour l'internationalisation de la révolution que de la centralité de la crise écologique et de l'idée du « communisme décroissant ».
« Offrir quelque chose de positif »
L'affirmation catégorique que Marx aurait inventé ce « communisme décroissant » pour réparer la « faille métabolique » est à ce point excessive qu'on se demande pourquoi Kohei Saito la formule en conclusion d'un ouvrage qui comporte tant d'excellentes choses. La réponse est donnée dans les premières pages du chapitre 6. Face à l'urgence écologique, l'auteur pose la nécessité d'une réponse anticapitaliste, juge que les interprétations productivistes du marxisme sont « intenables », constate que le matérialisme historique est « impopulaire aujourd'hui » parmi les environnementalistes, et estime que c'est dommage (a pity) car ceux-ci ont « un intérêt commun à critiquer l'insatiable désir d'accumulation du capital, même si c'est à partir de points de vue différents » (p. 172). Pour Saito, les travaux qui montrent que Marx s'est détourné des conceptions linéaires du progrès historique, ou s'est intéressé à l'écologie, « ne suffisent pas à démontrer pourquoi des non-marxistes, aujourd'hui, doivent encore prêter attention à l'intérêt de Marx pour l'écologie. Il faut « prendre en compte à la fois les problèmes de l'eurocentrisme et du productivisme pour qu'une interprétation complètement nouvelle du Marx de la maturité devienne convaincante » (p. 199). « Les chercheurs doivent offrir ici quelque chose de positif », « élaborer sur sa vision positive de la société post-capitaliste » (p. 173). Est-ce donc pour donner de façon convaincante cette interprétation « complètement nouvelle » que Saito décrit un Marx fondant successivement et à quelques années de distance « l'écosocialisme » puis le « communisme de la décroissance » ? Il me semble plus proche de la vérité, et par conséquent plus convaincant, de considérer que Marx n'était ni écosocialiste ni décroissant au sens contemporain de ces termes. , Cela n'enlève rien au fait que sa critique pénétrante du productivisme capitaliste et son concept de « hiatus métabolique » sont décisifs pour saisir l'urgente nécessité actuelle d'une « décroissance juste ».
Vouloir à toute force faire entrer la décroissance dans la pensée de Marx est anachronique. Ce n'est d'ailleurs pas nécessaire. Certes, on ne peut pas défendre la décroissance juste et maintenir en parallèle la version productiviste quantitativiste du matérialisme historique. Par contre, la décroissance juste s'intègre sans difficulté à un matérialisme historique qui considère les forces productives dans leurs dimensions quantitatives et qualitatives. Quoiqu'il en soit, nous n'avons pas besoin de la caution de Marx, ni pour admettre la nécessité d'une décroissance juste, ni plus généralement pour élargir et approfondir sa « critique inachevée de l'économie politique ».
Le problème de l'apologie
On peut se demander l'utilité d'une critique des exagérations de Saito. On peut dire : l'essentiel est que « (ce) livre fournit une alimentation utile aux socialistes et aux activistes environnementaux, indépendamment des avis (ou de l'intérêt même d'avoir un avis) sur la question de savoir si Marx était vraiment un communiste décroissant ou pas » [16]. C'est l'essentiel, en effet, et il faut le répéter : « Marx in the Anthropocene » est un ouvrage excellent, notamment parce que ses développements sur les quatre points mentionnés en introduction de cet article sont d'une actualité et d'une importance majeure. Pour autant, le débat sur ce que Marx a dit ou pas n'est pas à sous-estimer car il porte sur la méthodologie à pratiquer dans l'élaboration des outils intellectuels nécessaires à la lutte écosocialiste. Or, cette question-là concerne aussi les activistes non-marxistes.
La méthode de Kohei Saito présente un défaut : elle est apologétique. Ce trait était déjà perceptible dans « Marx's ecosocialism » : alors que le sous-titre de l'ouvrage pointait la « critique inachevée de l'économie politique », l'auteur consacrait paradoxalement tout un chapitre à faire comme si Marx, après Le Capital, avait développé un projet écosocialiste complet. « Marx in the Anthropocene » suit le même chemin, mais de façon encore plus nette. Pris ensemble, les deux ouvrages donnent l'impression que Marx, dans les années 70, aurait fini par considérer la perturbation du métabolisme humanité-nature comme la contradiction centrale du capitalisme, qu'il en aurait d'abord déduit un projet de croissance écosocialiste des forces productives, puis qu'il aurait abandonné celui-ci vers 1880-81 pour tracer une nouvelle voie : le « communisme décroissant ». J'ai tenté de montrer que ce narratif est fort contestable.
Un des problèmes de l'apologie est de surestimer fortement l'importance des textes. Par exemple, Saito donne une importance disproportionnée à la modification par Engels du passage du Capital, Livre III, où Marx parle de la « faille métabolique ». La domination des interprétations productivistes du matérialisme historique au cours du 20e siècle ne s'explique pas avant tout par cette modification : elle découle principalement du réformisme des grandes organisations et de la subsomption du prolétariat au capital. Lutter contre cette situation, articuler les résistances sociales pour mettre l'idéologie du progrès en crise au sein même du monde du travail est aujourd'hui la tâche stratégique majeure des écosocialistes. Les réponses sont à chercher dans les luttes et dans l'analyse des luttes beaucoup plus que dans les Notebooks de Marx.
Plus fondamentalement, l'apologie tend à flirter avec le dogmatisme. « Marx l'a dit » devient trop facilement le mantra qui empêche de voir et de penser en marxistes au sujet de ce que Marx n'a pas dit. Car il n'a évidemment pas tout dit. S'il est une leçon méthodologique à tirer de son œuvre monumentale, c'est que la critique est fertile et que le dogme est stérile. La capacité de l'écosocialisme de relever les défis formidables de la catastrophe écologiques capitaliste dépendra non seulement de sa fidélité mais aussi de sa créativité et de sa capacité à rompre, y compris avec ses propres idées antérieures comme Marx le fit quand c'était nécessaire. Il ne s'agit pas seulement de polir soigneusement l'écologie de Marx mais aussi et surtout de la développer et de la radicaliser. (Publié dans Actuel Marx, 2024 numéro 76. Reproduit avec autorisation de l'auteur)
Voir de même à propos de l'ouvrage de Kohei Saïto, La Nature contre le capital, l'article, édité en deux parties, d'Alain Bihr « L'écologie de Marx à la lumière de la MEGA 2 », publié sur le site alencontre.org en date du 23 novembre 2021.
Notes
[1] Marx's ecosocialism. An unfinished critique of the political economy. Trad. française La nature contre le capital. L'écologie de Marx dans sa critique inachevée du capital, Syllepse, 2021.
[2] Marx in the Anthropocene. Towards the Idea of Degrowth Communism. Cambridge University Press, 2022.
[3] Voir mon article « Marx était-il écosocialiste ? Une réponse à Kohei Saito »,gaucheanticapitaliste.org
[4] Karl Marx, Le Capital, Livre III, Moscou, éditions du Progrès, 1984, Chapitre 47, p. 848
[5] Lire en particulier Paul Burkett, Marx and Nature. A Red and Green Perspective. Palgrave Macmillan, 1999. John Bellamy Foster, Marx's Ecology. Materialism and Nature, Monthly Review Press, 2000
[6] On lit déjà dans L'Idéologie allemande (1845-46) : « il arrive un stade dans le développement où naissent des forces productives et des moyens de circulation […] qui ne sont plus des forces productives mais des forces destructrices (le machinisme et l'argent) ». Karl Marx et Friedrich Engels, L'Idéologie allemande, Éditions sociales, 1971, p. 68.
[7] Karl Marx et Friedrich Engels, Manifeste du Parti communiste, in Œuvres choisies, ed. De Moscou, tome 1, p.130.
[8] Le Capital, Livre I, Garnier-Flammarion, 1969, p. 363.
[9] Le Capital, Livre III, ed. De Moscou, chapitre 48, p. 855.
[10] Daniel Bensaïd, Introduction critique à ‘l'Introduction au marxisme' d'Ernest Mandel, 2e édition, ed. Formation Lesoil, en ligne sur contretemps.eu
[11] Michael Löwy, Ecosocialisme. L'alternative radicale à la catastrophe écologique capitaliste, Mille et une nuits, 2011, p. 39
[12] Marx-Engels, Œuvres choisies, Tome 1, p.525.
[13] D. Bensaïd, op. cit
[14] Marx et Engels, Œuvres choisies, op. cit. tome 3, p. 156.
[15] Une opinion partagée par Engels : cf. notamment son admiration pour les Zoulous face aux Anglais, dans L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'Etat.
[16] Diana O'Dwyer, « Was Marx a Degrowth Communist », https://rupture.ie
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
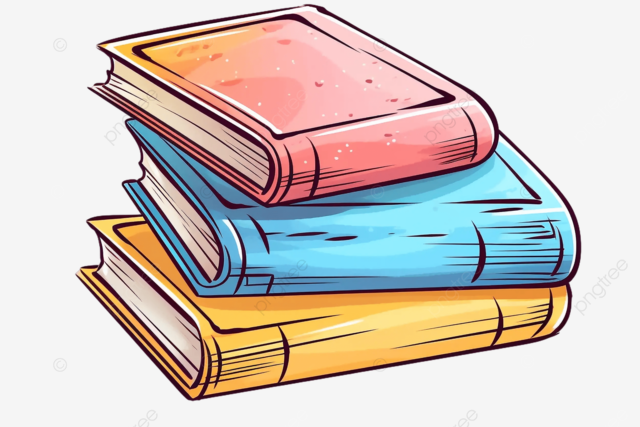
Compte rendu du 22 octobre 2024


Détruire la Palestine
Tanya Reinhart
Traduit de l'anglais
Cet essai au titre évocateur est paru il y a une vingtaine d'années. Il nous permet de nous rappeler que le génocide en cours en Palestine n'est que la poursuite de la politique à long terme de l'État d'Israël en vue de détruire la Palestine et les Palestiniens. Parmi toutes les politiques et mesures mises en place pour arriver à cette fin relevées dans ce livre, celle qui m'a le plus répugné est l'emploi de tireurs cachés pour blesser gravement par balle des citoyens palestiniens et les rendre invalides et à la charge d'une population déjà paupérisée - les statistiques sur les personnes blessées par balle ayant un impact beaucoup moins grand sur l'opinion publique mondiale que celles sur les personnes tuées. Le commencement de ce qui se poursuit de façon encore plus grave aujourd'hui avec le consentement et le soutien abjects de l'Occident. Un bouquin qui nous décrit l'état des choses lorsque l'inhumanité dépasse l'entendement...
Extrait :
Depuis l'occupation de 1967, les responsables politiques et militaires israéliens débattent de la meilleure façon de conserver le maximum de terres avec le minimum de Palestiniens.

Hiroshima mon amour
Marguerite Duras
Marguerite Duras a écrit ce scénario pour le film franco-japonais du même nom d'Alain Resnais. C'est un texte d'une grande poésie, fait de souvenirs, qui présente la rencontre d'une Française et d'un Japonais. Il porte surtout, en filigrane, non tant sur la souffrance des Japonais que sur la réconciliation des peuples et la paix. Un article de l'Agence France-Presse, paru dans les pages du Devoir en mars, nous rappelle toutefois que le très beau film tiré de ce scénario « fut présenté au Festival de Cannes en 1959, mais écarté de la compétition en raison de pressions américaines. »
Extrait :
J'ai regardé les gens. J'ai regardé moi-même pensivement, le fer. Le fer brûlé. Le fer brisé, le fer devenu vulnérable comme la chair. J'ai vu des capsules en bouquet : qui y aurait pensé ? Des peaux humaines flottantes, survivantes, encore dans la fraîcheur de leurs souffrances. Des pierres. Des pierres brûlées. Des pierres éclatées. Des chevelures anonymes que les femmes de Hiroshima retrouvaient tout entières tombées le matin, au réveil.

Le retrait
Noam Chomsky et Vijay Prashad
Traduit de l'anglais
C'est mon huit-centième compte rendu de lecture. Il porte sur un autre captivant bouquin de Noam Chomsky, cette fois avec des échanges sur la politique internationale avec le journaliste et historien indien Vijay Prashad. Les deux hommes y abordent la question de la fragilité grandissante de la puissance états-unienne avec la monté en force de l'économie de la Chine, mais également d'autres pays dans le monde ; ils y discutent aussi de tout ce que les États-Unis ont fait au cours des dernières décennies et sont prêts à faire – sans égard aux coûts humains et environnementaux – pour maintenir leur hégémonie dans le monde. Un très bon livre ! Encore une fois, je ne saurais trop vous recommander de lire Chomsky !
Extrait :
Ensuite la Chine et la Russie vont multiplier leurs relations institutionnelles et commerciales avec l'extérieur. Elles renforceront d'abord leurs liens mutuels, dans la lignée du rapprochement amorcé au cours de la dernière décennie. Mas ces deux pays s'ouvriront également à de nouvelles régions afin de répondre aux demandes croissantes de multipolarité et de non-alignement du Sud mondialisé. On l'a déjà constaté lors du premier vote de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la guerre en Ukraine, où de nombreux pays du Sud se sont abstenus de toute condamnation.

Le nucléaire à la dérive
Marie-Hélène Labbé
Marie-Hélène Labbé est l'auteure de nombreuses publications sur la prolifération des armes et de l'énergie nucléaires. Cet intéressant bouquin nous expose l'historique, la dangerosité et la perte de contrôle progressive du nucléaire à mesure qu'augmente le nombre de pays en possession de ces armes destructrices et qu'augmente le nombre de centrales nucléaires dans le monde. Tout pour nous convaincre de mettre un terme à notre fuite en avant avec l'atome.
Extrait :
Cette demande de nucléaire, que ce soient des armes ou des centrales, rencontre une offre qui est suscitée voir nourrie par les vendeurs eux-mêmes. À une revendication nucléaire globale répond en effet une offre tous azimuts de technologies et de composants nucléaires qui se joue des contrôles à l'exportation et des cartels d'exportateurs. Trois phénomènes se conjuguent pour mettre le nucléaire à la portée de tous : des vendeurs de plus en plus dynamiques, des progrès technologiques avec la victoire de la centrifugeuse et des contrôles toujours inadéquats.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
Nétanyajou : bon pour la taule !
Plusieurs responsables gazaouis du Hamas et du Hezbollah au Liban ont été tués par des attaques israéliennes ces dernières semaines, notamment Yahya Sinouar, l'architecte de l'offensive du 7 octobre 2023 depuis Gaza.
Les responsables gouvernementaux israéliens et même occidentaux ont utilisé le terme "éliminés" pour qualifier l'assassinat de ces gens ; ils s'en réjouissent ouvertement, affectant d'y voir un pas vers la "paix". À observer le qualificatif employé par tout ce monde, on ressent l'irrésistible impression d'assister à une guerre entre bandes rivales de la pègre ; le clan dominant israélien qui supprime ses opposants, ce qui rappelle d'ailleurs les origines terroristes de l'État hébreu.
Les classes politiques dans leur ensemble, en particulier l'américaine et bien entendu celle d'Israël située à l'extrême-droite du spectre politique, se félicitent sans vergogne du meurtre en série de résistants palestiniens, un phénomène qui n'a rien de nouveau. Sans souhaiter ouvertement la suppression de responsables de la résistance palestinienne par le Mossad, les politiciens occidentaux la dénoncent rarement, sauf en ce qui concerne les "victimes collatérales" de ces opérations, c'est—à-dire les proches des gens assassinés. Mais pas question pour autant de remettre en question leur appui inconditionnel à l'État hébreu.
On ne peut donc qu'en tirer une conclusion : à leurs yeux, une vie israélienne vaut bien plus que son équivalente palestinienne.
Il n'y a rien d'original à le faire remarquer, beaucoup d'autres observateurs l'ont déjà fait. Mais dans le cas de la guerre Gaza-Israël, cette constatation devient aussi frappante que choquante vu le nombre très élevé de victimes civiles et l'ampleur des destructions matérielles.
La riposte israélienne à l'offensive du Hamas a fait au moins 41,800 décès, dont une forte majorité de civils. La délégation américaine à l'Onu a opposé à deux reprises son véto à une résolution contraignante du Conseil de sécurité qui, en cas d'adoption, aurait obligé le gouvernement Netanyahou à respecter un cessez-le-feu permanent. Les États-Unis sont donc aussi responsables de la tuerie à Gaza qu'Israël.
La situation dans ce conflit ressemble à celle de responsables policiers qui soutiennent pour divers mobiles une organisation criminelle dominante (Israël en l'occurrence) au détriment d'un groupe non criminalisé dont les membres, victimes du clan dominant se défendent comme elles peuvent. Il y a quelque chose de choquant à voir la plupart des dirigeants occidentaux se réjouir ou même ne pas condamner l'assassinat de plusieurs responsables du Hamas et du Hezbollah en même temps qu'un criminel de guerre comme Benyamin Netanyahou ne fait l'objet d'aucune accusation. Non qu'il faille approuver à priori toutes les initiatives militaires du Hamas et du Hezbollah, mais l'indulgence des dirigeants américains, canadiens, français, britanniques et allemands à l'endroit d'Israël est condamnable. Si Netanyahou était zigouillé par un commando palestinien, ces mêmes politiciens se livreraient à des dénonciations agressives vis—vis de cet "acte terroriste".
Rappelons que jusqu'à présent, les succès militaires israéliens sur le terrain n'ont procuré à l'État hébreu aucune victoire stratégique décisive. Tout sera donc à recommencer tant que les motifs qui animent la résistance palestinienne demeureront en place. En ce sens, c'est rendre un mauvais service à Israël que de le couvrir contre vents et marées.
La meilleure manière de pacifier les relations entre Israël et la Palestine consiste au contraire à intégrer dans toute la mesure du possible les organisations palestiniennes vues comme "terroristes" au sein des futures négociations de paix et non à maintenir leur boycott. On fait la paix avec des ennemis, non avec des alliés. Quant aux irréductibles, ils s'en trouveraient isolés et assez neutralisés.
Il importe donc de mettre un terme à la coupable complaisance des gouvernements occidentaux envers l'État hébreu. Pourquoi alors ne pas débuter par l'émission d'un mandat d'arrêt international contre Benyamin Netanyahou et certains membres de son cabinet ?
Jean-François Delisle
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Israël contre l’ONU, une si longue histoire

Aussi impuissante soit-elle, l'Organisation des Nations unies est la cible de Benyamin Nétanyahou car elle représente le droit international. Ses agences, ses Casques bleus au Liban sont, verbalement et physiquement, attaqués. Même Emmanuel Macron, bien timoré face aux massacres dans la bande de Gaza, s'est fait tancer pour avoir pointé son rôle dans la création d'Israël. Or, ces attaques systématiques contre l'ONU ne datent pas d'aujourd'hui.
Tiré d'Orient XXI.
Dès le début de son offensive à Gaza, le 8 octobre 2023, l'État d'Israël lance une campagne de dénigrement de l'Organisation des Nations unies (ONU). Il présente celle-ci comme un organisme dévoyé qui l'empêche d'assouvir ses objectifs en protégeant indûment ses ennemis, le Hamas à Gaza et le Hezbollah au Liban, deux entités « terroristes » aux contours indéfinis qu'il entend « éradiquer en totalité ». Du haut de la tribune de l'Assemblée générale, le 27 septembre 2024, le premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, traite l'ONU de « cloaque de bile antisémite à assécher ». Si elle n'obtempère pas, dit-il, elle restera « considérée comme rien d'autre qu'une méprisable farce ». Les trois-quarts des présents quittent la salle.
Il en fallait plus pour émouvoir Nétanyahou. Son offensive n'a fait que croître contre toutes les organisations onusiennes sur le terrain, qu'elles soient militaires (les Casques bleus) ou civiles (l'office des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, UNRWA). Israël taxe d'« antisémite » toute critique de ses crimes à Gaza — les pires commis depuis le début de ce siècle, comme répètent les organisations humanitaires. Le 8 octobre 2024, alors que le premier ministre israélien menace explicitement les Libanais de leur faire subir « les mêmes destructions et les mêmes souffrances qu'à Gaza (1) », s'ils ne se soumettent pas à ses exigences, c'est-à-dire « éradiquer le Hezbollah », ses forces armées frappent délibérément trois sites de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul). Huit jours plus tard, on comptait au moins cinq attaques israéliennes contre cette organisation, créée en 1978, après une lourde opération militaire israélienne au Sud-Liban contre l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) pour surveiller le comportement des belligérants et protéger les populations civiles.
Comme chaque fois qu'Israël se comporte ainsi, l'ONU et de très nombreux pays émettent de vives critiques. L'armée, elle, poursuit sa campagne : le 13 octobre 2024, deux de ses chars entraient de force dans une position de la Finul, pour bien montrer que les pressions internationales l'indiffèrent. À Gaza, au 14 mars 2024, l'UNRWA dénombrait « au moins 165 membres tués dans l'exercice de leurs fonctions » depuis octobre. Quatre jours après le massacre de masse perpétré par le Hamas et d'autres milices palestiniennes, le 7 octobre 2023, le secrétaire général des Nations unies, le Portugais António Guterres rappelait que, selon le droit international, « les locaux de l'ONU et tous les hôpitaux, écoles et cliniques ne doivent jamais être pris pour cible ». Comme s'il savait d'expérience les mesures de rétorsion de l'état-major israélien. Depuis, la vindicte israélienne envers l'Organisation n'a jamais cessé.
L'UNRWA au cœur de l'offensive israélienne
Le ministre des affaires étrangères, Yisraël Katz, a déclaré Guterres « persona non grata » dans son pays, le 1er octobre 2024. À plusieurs reprises, depuis un an, Israël a exigé que l'UNRWA quitte les Territoires palestiniens occupés — l'accusant de servir de protection aux « terroristes ». Cet organisme est le seul à fournir une aide humanitaire permanente, sanitaire et éducationnelle, dans ce qui reste des camps de réfugiés palestiniens, à Gaza et en Cisjordanie, ainsi qu'au Liban, en Syrie et en Jordanie. L'armée bombarde non seulement ses écoles et ses hôpitaux dans la bande de Gaza, mais Israël bloque aussi l'entrée des fonds qui servent à le financer et mène une campagne de dénigrement à son encontre.
Le Parlement israélien a entamé, en juillet 2024, un débat sur un projet de loi pour caractériser l'UNWRA d'« organisation terroriste » ; il doit se conclure à la fin octobre et il pourrait déboucher sur la mise sous séquestre de ses bâtiments et avoirs (2). Le 9 octobre, Katz a aussi laissé entendre que le quartier général de l'organisation à Jérusalem-Est pourrait être confisqué (afin d'y implanter des logements pour les Israéliens).
Parallèlement, sans l'ombre d'une preuve, Israël a mené une propagande active visant à présenter l'UNRWA comme un « repaire de terroristes ». Le 26 janvier 2024, Nétanyahou indiquait que 12 employés avaient participé à l'attaque du Hamas du 7 octobre précédent. Comme par hasard, l'annonce tombait précisément le jour où la Cour internationale de Justice (CIJ) ouvrait une enquête pour un « risque plausible de génocide » à Gaza. Bientôt, Israël obtenait son premier succès d'envergure : le 23 mars 2024, le Congrès américain votait l'arrêt du financement de l'UNRWA par les États-Unis jusqu'en mars 2025. Une attitude finalement peu suivie dans le monde.
Les allégations du gouvernement israélien n'ont eu aucune suite juridique, car il ne présentait aucune preuve convaincante les corroborant, selon le rapport de la commission indépendante Colonna (3). Mais l'essentiel a été atteint : le doute sur l'organisme onusien s'est étendu.
Le risque d'épidémie, un cas d'école
Étonnamment, cependant, la campagne d'Israël s'est un temps interrompue. L'affaire mérite d'être contée, tant elle est édifiante. Fin août 2024, un début d'épidémie de poliomyélite menace la bande de Gaza. Au vu du risque d'extension à des soldats engagés sur le terrain et, par leur biais, à toute la population israélienne non vaccinée — les militaires revenant périodiquement en permission dans leurs foyers —, le rôle de l'UNRWA redevient primordial. Les Israéliens négocient alors avec l'organisme onusien. Un mois après, 560 000 enfants palestiniens ont été vaccinés. L'armée israélienne a dû admettre que, sans la logistique unique de l'UNRWA, « la campagne de vaccination n'aurait jamais pu être menée à bien », explique Jonathan Adler, journaliste au quotidien en ligne Local Call (+972 dans la version internationale) (4).
Le gouvernement a ainsi montré toute sa duplicité. Pendant qu'il laissait passer 1,2 million de vaccins à Gaza pour enrayer le risque d'épidémie, il continuait de restreindre l'entrée des autres médicaments de première urgence, de l'eau et de la nourriture nécessaires aux Gazaouis. Une fois le risque d'épidémie enrayé, la campagne anti-UNRWA a pu reprendre. Le vice-maire de Jérusalem, Nir Barkat (Likoud), a organisé des manifestations permanentes devant le QG de l'UNRWA, pour le pousser à se déplacer à Amman, la capitale jordanienne. À la fin de ce mois, un vote en première lecture est prévu à la Knesset (le Parlement) sur deux propositions de loi : l'une vise à rompre les liens de toute autorité publique israélienne avec l'UNRWA, l'autre à interdire d'activité cet organisme sur le territoire. En attendant, Israël continue de bloquer ses comptes dans les banques israéliennes et les visas d'entrée pour ses nouveaux personnels.
Bilan : entre le 8 octobre 2023 et le 27 septembre 2024, les bâtiments de l'UNRWA — écoles, hôpitaux, foyers, bureaux — ont subi 464 attaques israéliennes à Gaza (5). Plus d'une par jour. Elles ont fait 226 morts parmi ses équipes, et 563 parmi les civils qui s'y trouvaient. Comme l'écrit Jonathan Adler, « l'offensive législative visant à faire partir l'UNRWA des Territoires occupés palestiniens n'est qu'une inscription dans la loi de la pratique militaire existante (6) ». Toutefois, l'armée israélienne est aussi pragmatique. Certains hauts gradés, explique encore Adler, s'inquiètent de ces lois. Leur argument : « Si l'UNRWA quitte Gaza, une nouvelle pandémie potentielle pourrait empêcher l'armée israélienne d'y poursuivre sa chasse au Hamas. »
De Bernadotte à l'OCHA
Bien qu'elle atteigne aujourd'hui des sommets, l'hostilité d'Israël à l'ONU et à la légitimité de toute critique extérieure de sa politique, surtout en temps de guerre, remonte à loin, quasiment à ses origines. La liste serait longue et l'on se contentera de rappeler quelques exemples. Le 17 septembre 1948, quatre mois après la création de l'État d'Israël, et alors que la première guerre israélo-arabe éclate, le comte suédois Folke Bernadotte, médiateur de l'ONU depuis mai 1948, est assassiné à Jérusalem. Bernadotte contrarie les ambitions israéliennes avec un « plan de paix » dont Israël ne veut pas. Il est abattu par quatre hommes portant l'uniforme militaire, mais appartenant au groupe Stern, un mouvement ultranationaliste. Comme le rappelle Jean-Pierre Filiu, ce groupe armé dispose aujourd'hui d'une place éminente au Musée de l'Armée israélienne (7).
Plus près de nous, en 1996, lors d'une opération contre le Hezbollah, l'aviation israélienne bombarde un camp des Casques bleus dans la bourgade de Cana où la population s'est réfugiée : 106 morts parmi les civils. En 46 ans, de tous les organismes onusiens identiques, la Finul est celui qui a connu le plus de pertes : en avril, elle comptabilisait 334 de ses membres tués, le plus souvent lors de raids israéliens. Autre organisme subissant les contraintes permanentes de Tel-Aviv depuis de très longues années : le Bureau des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), seule agence neutre qui recense les actes illégaux (crimes, expulsions, occupation, destructions, etc.) perpétrés dans les Territoires palestiniens occupés.
Quand le président français Emmanuel Macron assure que « M. Nétanyahou ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l'ONU », en référence à la résolution 181 partageant la Palestine en deux États, l'un « juif » et l'autre « arabe », adoptée le 29 novembre 1947, il se fait tancer par le chef du gouvernement israélien : « ce n'est pas la résolution de l'ONU qui a établi l'État d'Israël, mais la victoire obtenue dans la guerre d'indépendance [de 1948 contre les Palestiniens et les États arabes] . » Exit l'ONU.
Le retour du néoconservatisme
Ce rejet des autorités onusiennes s'accompagne d'un discours récurrent. En hébreu, l'acronyme ONU se dit « Oum ». Le fondateur de l'État d'Israël, David Ben Gourion, disait par dérision : « Oum, Schmoum », que l'on pourrait traduire par « l'ONU, on s'en fiche ». Une attitude qui s'insère dans une vision politique. Tout comme aux États-Unis, où l'Organisation des Nations unies est vilipendée par une fraction notoire de la classe politique, en particulier les nationalistes. Ces derniers estiment qu'aucun organisme international ne peut imposer à leur pays de se soumettre à une loi générale contraire à la politique choisie — loi universelle que seules les Nations unies peuvent adopter. Israël entend pareillement s'y soustraire, c'est quasiment une doctrine d'État, même si elle reste non dite.
En 2004, j'interviewais Carmi Gilon, un ex-chef du Shin Bet, les forces de sécurité intérieure. L'affaire Abou Ghraib (8) avait éclaté peu avant en Irak. Ma première question était la suivante : « Dans la lutte contre des adversaires qui usent du terrorisme, peut-on respecter le droit humanitaire international, ou y déroger est-il dans la logique des choses ? » Sa réponse fut limpide : « Je ne suis pas un spécialiste du droit international. Je ne peux que me prononcer en fonction du droit israélien (9). » En d'autres termes, le patron des services spéciaux s'assoit sur le droit international et le dit. Cette attitude ne lui est pas propre. Elle incarne une philosophie que les édiles israéliens ont, de tout temps, adoptée : justifier de mille manières possibles le refus de se soumettre au droit international.
Le contourner au nom de la souveraineté est une philosophie que de nombreux régimes entendent aujourd'hui imposer.
Dans ce domaine, Israël a fait figure de précurseur. Le cas le plus explicite est le rapport à la « guerre préventive ». Le rejet de cette notion a été inséré dans le codex onusien par les Conventions de Genève relatives « au droit de la guerre et de l'utilisation des armes pour régler les conflits ». C'est en leur nom qu'en 1967, par exemple, le général de Gaulle déclarait : dans le conflit entre Israël et l'Égypte sur le blocage de l'accès des navires israéliens à la mer Rouge, le premier qui ouvrira le feu enfreindra le droit de la guerre et, de ce fait, il ne bénéficiera pas du soutien de la France. Depuis 1949, cette interdiction à déclencher une guerre ou une opération armée « préventivement » a été de facto ignorée à de nombreuses reprises de grandes comme de petites puissances.
Mais la particularité d'Israël est d'avoir constamment récusé, quasiment depuis sa naissance, l'interdiction du droit à la guerre préventive. Dès le début des années 1950, le général israélien Yigal Alon, devenu chef de la frange la plus militante du parti travailliste alors au pouvoir, se fit le chantre de la « guerre préventive ». Auparavant, la stratégie de l'armée était basée sur une conception dite « défensive-offensive » (privilégier la défense à l'attaque). À partir de 1953, elle devient « offensive-défensive », selon la terminologie militaire israélienne. Une stratégie qui « perdure en grande partie jusqu'à ce jour », écrivait le chercheur israélien Oren Barak en 2013 (10). Pour Barak :
- [Israël a] depuis des décennies, de facto, adhéré à une politique étrangère reposant fortement sur une doctrine (qui) prévoyait le lancement de frappes et de guerres préventives contre les voisins d'Israël en cas de menaces existentielles avant qu'elles ne se matérialisent.
Cette politique, ajoutait-il, est devenue « routinière ». Tel-Aviv adoptant systématiquement l'argument de la « menace existentielle » en toute occasion.
En 1982, lorsque l'armée israélienne envahit le Liban pour en chasser les forces de l'OLP et y changer le gouvernement du pays, le premier ministre de l'époque, Menahem Begin, expliqua qu'il lançait cette guerre parce que « nous avons décidé qu'un nouveau Treblinka n'adviendra pas ». Identiquement, dès le lendemain de l'attaque du Hamas, le 7 octobre 2023, Benyamin Nétanyahou invoqua « le plus grand crime contre des Juifs depuis la Shoah ». Cette référence « existentielle » permet dès lors de se soustraire à toutes les remontrances onusiennes — qualifiées, comme on l'a vu, d'« antisémites ».
Cette réhabilitation de la « guerre préventive » fut installée en majesté par la conseillère américaine à la sécurité, Condoleezza Rice, dans le document annuel de la « stratégie nationale » américaine, en septembre 2002. Aujourd'hui, cette même doxa préside au comportement israélien, de manière plus radicale encore. Dans une posture de défi, Israël affiche sa volonté de ne respecter aucune des normes du droit de la guerre, bien plus encore que ne le firent les Américains en Irak il y a vingt ans. On le sait trop peu, mais Benyamin Nétanyahou, dans les années 1980-1990, fut un des idéologues majeurs de la montée en puissance du néoconservatisme aux États-Unis.
Notes
1- Lire Vincent Lemire : « Le jusqu'au-boutisme en ligne de mire », Libération, 9 octobre 2024.
2- « Lourdes menaces d'Israël sur UNRWA et l'aide aux Palestiniens », unric.org, 10 octobre 2024.
3- Cf. « Independant review of mechanism and procedure to ensure adherence by UNRWA to humanitarian principle of neutrality », ONU, 22 avril 2024.
4- Jonathan Adler : « Israel paradoxical crusade against UNRWA », Local Call, 10 octobre 2024.
5- « UNRWA Situation Report #140 on the situation in the Gaza Strip and the West Bank, including East Jerusalem », unrwa.org, 27 septembre 2024.
6- op.cit.
7- Jean-Pierre Filiu : « L'assassinat par Israël du médiateur de l'ONU en Palestine », Le Monde, 14 octobre 2018.
8- Du nom de la prison où l'armée américaine et la CIA torturaient des prisonniers durant la guerre d'Irak en 2003-2004.
9- Sylvain Cypel, « Carmi Gilon : La notion de pression modérée est sérieuse, pas hypocrite », Le Monde, 29 juin 2004.
10- Oren Barak, avec Amiram Oren et Assaf Shapira : « “How The Mouse Got His Roar” : The Shift to an 'Offensive-Defensive' Military Strategy in Israel in 1953 and its Implications », The International History Review (35-2) : 356-376, avril 2013.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Crimes de l’industrie pornographique : les faits doivent être jugés dans leur intégralité

Le 17 octobre, la cour d'appel de Paris rendra une décision importante dans l'affaire dite « French Bukkake ». Les dizaines de victimes des crimes de l'industrie pornographique devront-elles se contenter d'une justice au rabais ?
Tiré de Entre les lignes et les mots
Quatre ans. Cela fait plus de quatre ans que les 42 victimes qui se sont portées parties civiles dans l'affaire dite « French Bukkake » attendent le procès des hommes qui les ont exploitées sexuellement. Dans cette affaire dévoilant les rouages criminels de l'industrie pornographique française, 17 hommes ont été mis en examen pour viols en réunion, traite d'êtres humains en bande organisée et proxénétisme aggravé.
Les violences que ces femmes ont subies sont insoutenables. Manipulées et prises au piège par un rabatteur, elles ont été violées à de multiples reprises. Le dossier d'instruction contient des centaines d'heures d'images de violences sexuelles extrêmes.
L'une des victimes associe les multiples viols qu'elle a subis à de la torture : « J'ai été violée 240 fois, ce n'est pas de la torture ça ? Quatre-vingt-huit fois sur le bukkake, quarante-quatre fois en une heure. Je sais que j'ai été violée, ce n'est pas ça le sujet, le sujet c'est la torture. Aucun humain n'est capable d'absorber quarante-quatre pénétrations en une heure », témoigne l'une des victimes.
Ces femmes ont été soumises à des mises en scène et des actes sadiques, volontairement déshumanisants, à des souffrances aiguës, des étouffements prolongés, des pénétrations multiples et simultanées (vagins, anus, bouche), ces femmes ont été torturées.
Pourtant, la circonstance aggravante d'actes de tortures n'a pas été retenue par le juge d'instruction dans son ordonnance de mise en accusation en 2023. Les circonstances aggravantes de sexisme et de racisme non plus, alors même que les insultes racistes et misogynes pullulent dans les vidéos. La plupart des parties civiles ont donc fait appel de cette décision.
L'abandon de ces circonstances aggravantes est un déni de justice pour les victimes. Au passage, la justice laisse impunie la dimension la plus anti-sociale de ces crimes, leur dimension déshumanisante, raciste et sexiste, ce qui profite aux accusés qui n'auront pas à répondre de l'intégralité de leurs actes. Encourant une peine de 20 ans de réclusion criminelle tout au plus, ils peuvent alors être renvoyés devant une cour criminelle départementale, au lieu de comparaître devant une cour d'assises et de faire face à une peine de 30 ans, voire à la perpétuité.
Cette déqualification inacceptable des violences est rendue possible par la généralisation récente des cours criminelles départementales. Censées répondre à l'engorgement des cours d'assises et améliorer la réponse judiciaire – notamment en matière de viols – ces cours ont en réalité permis l'apparition d'une nouvelle forme de minimisation des viols : les juges d'instruction et les parquets peuvent être tentés d'écarter certaines circonstances aggravantes ayant accompagné les crimes, afin de pouvoir les renvoyer devant une cour criminelle plutôt qu'une cour d'assises. L'affaire French Bukkake en est un exemple flagrant.
Nous, associations féministes, syndicats et organisations de la société civile, attendons beaucoup de la décision que prendra la chambre de l'instruction le 17 octobre.
Sept ans après le début du mouvement #MeToo, en plein procès des violeurs de Mazan, nous ne pouvons accepter que les viols soient encore minimisés par l'institution judiciaire et des victimes sacrifiées pour des motifs budgétaires.
https://mouvementdunid.org/blog/actus-mdn/communiques-presse/crimes-de-lindustrie-pornographique-les-faits-doivent-etre-juges-dans-leur-integralite/
https://scenesdelavisquotidien.com/2024/10/15/communique-de-presse-crimes-de-lindustrie-pornographique-les-faits-doivent-etre-juges-dans-leur-integralite/
https://www.egalite-professionnelle.cgt.fr/crimes-de-lindustrie-pornographique-les-faits-doivent-etre-juges-dans-leur-integralite/
https://cfcv.asso.fr/relais-osez-le-feminisme-crimes-de-l-industrie-pornographique-les-faits-doivent-etre-juges-dans-leur-integralite/
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Pour vaincre l’extrême droite, il faut prendre le racisme (et l’antiracisme) au sérieux

Les éditions Amsterdam ont récemment publié le premier ouvrage collectif d'une nouvelle collection dédiée aux travaux de l'Institut La Boétie : Extrême droite, la résistible ascension. À l'occasion de cette parution, une conférence a été organisée (que l'on peut visionner ici) dans laquelle sont intervenu·es notamment plusieurs membres de la rédaction de Contretemps, sur le thème : « comment battre l'extrême droite ? ».
Le texte que nous publions ici constitue ainsi une version légèrement approfondie de l'intervention d'Ugo Palheta, coordinateur de l'ouvrage, autour d'une dimension spécifique mais centrale de cette question : la lutte contre le racisme.
15 octobre 2024 | tiré de contretemps.eu
https://www.contretemps.eu/vaincre-extreme-droite-rn-xenophobie-racisme-antiracisme/
***
Je voudrais aborder le sujet de mon chapitre du livre que nous présentons ce soir, à savoir la question des rapports entre le racisme et l'extrême droite, qui sont évidemment très étroits. Comme l'ont montré de nombreux travaux, basés sur des enquêtes de terrain (notamment celle qui est au cœur du livre publié en 2024 par le sociologue Félicien Faury, qui a d'ailleurs contribué à notre livre) ou sur des enquêtes d'opinion (par exemple l'enquête réalisée pour le rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie), la dimension raciale et raciste est centrale dans le vote pour l'extrême droite.
Elle l'est également dans les orientations programmatiques et stratégiques des organisations d'extrême droite, sous une forme particulièrement évidente et explicite chez Zemmour (qui n'a cessé de faire de la surenchère raciste ces dernières années afin d'exister), et d'une manière à peine plus feutrée chez Le Pen et Bardella. L'extrême droite continue de placer au centre de sa vision du monde et de ses discours la nécessaire « mise au pas » (comme ils le disent de manière euphémisée) de groupes considérés comme des ennemis de l'intérieur, sorte de « cinquième colonne » qui serait soutenue par la gauche (elle-même vue comme « parti de l'étranger »). Tous ceux et toutes celles qui sont perpétuellement soupçonné·es de ne pas être ou se sentir suffisamment français, sont présentés comme inévitablement extérieurs et hostiles à la nation, éternellement « allogènes » même s'ils ou elles sont né·es en France, considérés comme « refusant de s'intégrer » et de toute façon « inassimilables ».
Avant tout autre chose, la bataille de l'extrême droite actuelle est identitaire, mais ce mot mérite une rapide explication. Il importe de rappeler que, dans le langage des extrêmes droites actuelles, le terme d'identité – devenu central dans presque toutes les mouvances de cette famille politique, des néonazis aux identitaires en passant par le FN/RN ou Reconquête – a été introduit dès les années 70 par des idéologues racialistes rassemblés dans ce qu'on a appelé alors la « Nouvelle Droite ». Le concept d' « identité » visait, dans le cadre d'une stratégie élaborée alors et mise en œuvre depuis, à remplacer celui de « race », devenu en grande partie imprononçable après le judéocide, et en tout cas beaucoup trop encombrant pour ces héritiers du fascisme qui aspiraient à sortir de la marginalité politique dans laquelle la défaite politico-militaire du nazifascisme en 1945 les avait confinés.
Ils ont donc travaillé à remodeler le vieux langage de l'extrême droite afin de culturaliser le racisme. Il ne s'agissait plus d'affirmer la hiérarchie des races mais de proclamer l'incompatibilité des cultures et la nécessité de préserver ou sauver, « quoi qu'il en coûte », une identité française ou européenne : une identité dont ces mouvances ont une conception non pas politique, mais culturaliste (fondée sur une essentialisation de la culture) et pseudo-biologique. Cette conception spécifique n'a d'ailleurs généralement pas besoin d'être précisée car les extrêmes droites font le pari que, pour la plupart des gens auxquels ils destinent leurs discours, la défense de l'identité française ou européenne sera immédiatement comprise comme la défense d'une France et d'une Europe blanches, d'une France et d'une Europe où la domination blanche doit impérativement continuer à s'exercer, où les personnes identifiées comme blanches devraient continuer à compter plus que les autres et à passer avant les autres.
Cette identité française ou européenne dont parle tant l'extrême droite est donc le produit d'un bricolage idéologique dont la seule cohérence se trouve dans sa finalité : stigmatiser, marginaliser, isoler, discriminer et in fine exclure, voire déporter (« remigrer » disent les identitaires et Zemmour), en ciblant des groupes qui peuvent être variables historiquement mais qui sont principalement, aujourd'hui en France, les populations noires, musulmanes, arabes, rroms, et l'ensemble des immigrés extra-européens.
Bien sûr, les juifs ont longtemps constitué la cible par excellence des extrêmes droites, mais la plupart de ses courants – notamment le FN/RN, Reconquête et les identitaires –, sans jamais avoir rompu en réalité avec l'antisémitisme (ce qui n'est pas difficile à démontrer), ont adopté une tactique nouvelle (en continuité avec le personnel politique dominant mais aussi une partie des organisations qui prétendent parler au nom des populations juives, en particulier le CRIF) : détourner et instrumentaliser la lutte ô combien nécessaire contre l'antisémitisme pour mieux traîner dans la boue des groupes qui en auraient à présent le monopole, à savoir les musulman·es et les immigrés postcoloniaux, pour des raisons prétendument culturelles qui seraient liées à l'islam ou au soutien à la Palestine occupée et colonisée.
Toutes les enquêtes démentent cette vision[1], sans parler du fait qu'elle absout l'Europe catholique de l'antijudaïsme endémique qui s'y développa pendant des siècles et des pires formes – génocidaires – de l'antisémitisme qui y émergèrent au 19e siècle, dont la conséquence fut précisément le génocide des juifs d'Europe durant la Seconde Guerre mondiale. Ce détournement de la lutte contre l'antisémitisme permet de mettre en accusation l'ensemble de celles et ceux qui pleurent les innombrables morts en Palestine et qui protestent contre la guerre génocidaire menée par l'État colonial d'Israël contre les Palestinien·nes de Gaza, qui sont accusé·es d'antisémitisme. Double infamie ici : passer sous silence le massacre voulu et planifié des Palestinien·nes, et vilipender celles et ceux qui s'y opposent en marquant leur solidarité avec un peuple colonisé et persécuté.
*
Quand on aborde la question du racisme dans l'optique de vaincre l'extrême droite, il faut prendre la question en grand, dans toute sa profondeur historique et dans toute sa consistance sociale.
Le racisme n'est pas un venin que Jean-Marie Le Pen et l'extrême droite auraient inoculé à la société française depuis 40 ans. Bien sûr, les néofascistes ont joué leur rôle, en tant que composante la plus brutale et la plus brutalement raciste du nationalisme français. Pour autant, le racisme dans la société française a un ancrage beaucoup plus profond, une histoire beaucoup plus ancienne et un déploiement beaucoup plus transversal, si bien que – sous une forme bien évidemment déniée, occultée – il est inscrit dans le fonctionnement routinier des institutions de ce pays, y compris bien entendu dans le fonctionnement de l'État (la police, la justice ou la prison par exemple. Il s'exprime également sur le marché du travail ou du logement, dans l'institution scolaire et le système de santé, sous des formes à chaque fois spécifiques, qui soulignent la dimension institutionnelle du racisme.
En outre, en raison non pas d'on ne sait quelle « nature humaine » mais de toute une trajectoire historique qui remonte à l'histoire esclavagiste et coloniale de la France (et plus largement de l'Occident), le racisme est inscrit aussi dans les cerveaux, les représentations, les affects, les désirs sociopolitiques d'une bonne partie de la population, pour ne pas dire l'ensemble de la population. Dans une société façonnée par des siècles d'impérialisme, de suprémacisme blanc, de racisme colonial mais aussi d'antisémitisme, tout le monde est, à des degrés très divers et sous des formes variées, imprégné par le racisme. C'est bien sûr le cas quand on en subit les conséquences (discriminations, spoliations, humiliations, violences, etc.), mais aussi et surtout quand on peut en tirer divers avantages.
Ces avantages n'ont à l'évidence nullement disparu avec l'affirmation dans la loi de l'égalité de tou·tes quelle que soit l'origine, la religion, la couleur de peau, etc., et encore moins parce que le terme « race » a été ôté de la Constitution, mesure cosmétique qui a sans doute comme principal effet de renforcer l'aveuglement face au racisme.
Dans une société marquée par des concurrences de plus en plus intenses – au sein du système scolaire, sur le marché du travail, ou pour accéder aux territoires les plus prisés –, les discriminations raciales construisent des formes d'entre-soi blanc et des intérêts, pour les personnes reconnues comme blanches, à la conservation d'un système qui leur octroie de tels avantages relatifs. Dans la mesure où ces avantages se cumulent, à la fois de génération en génération mais aussi entre les différentes sphères sociales (marché du travail, logement, école, santé, etc.), ils font bien souvent de grandes différences dans les parcours sociaux.
Il y a donc bien un ancrage matériel du racisme, y compris du côté de personnes et de couches sociales qui, d'un point de vue de classe, ne sont pas à proprement parler des privilégié·es. Ilfaut signaler sur ce point que le niveau de discrimination raciale se situe en France à un niveau exceptionnellement élevé. Une recherche quantitative comparée, publiée en 2019 dans la prestigieuse revue Sociological Science par certain-es des meilleures spécialistes de ce champ de recherche, a montré que parmi 9 pays occidentaux (dont les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède, etc.), le niveau le plus élevé de discrimination raciale à l'embauche dont sont l'objet les personnes nées dans les pays en question mais identifiées comme non-blanches, a été observée en France.
De même, dans un article publié récemment, Mathieu Ichou et moi-même avons démontré statistiquement l'ampleur des inégalités raciales de salaires en France : des différentiels de plusieurs centaines d'euros par mois, toutes choses égales par ailleurs, au détriment des descendants d'immigrés d'Afrique subsaharienne et du Maghreb mais aussi des Outre-mer.
Si on prend tout cela en compte, l'enjeu pour nous, dans la bataille contre les forces fascistes ou fascisantes, ce n'est pas simplement une échéance électorale particulière, même si cela s'avère primordial dans la mesure où on ne doit laisser aucune instance ou parcelle de pouvoir aux mains de l'extrême droite néofasciste ou de la droite fascisée. C'est toute la structure racialisée de la société française qu'il nous faut combattre durablement, en étant aux côtés des collectifs et de tou·tes celles et ceux qui, d'ores et déjà, mènent cette bataille à partir de questions spécifiques (violences policières, contrôles au faciès, discriminations de toutes sortes, islamophobie, etc.), ou dans sa globalité.
Notre objectif c'est bien sûr de défaire toutes les politiques racistes, anti-immigrés, islamophobes ou rromophobes, qui ont été menées ces dernières décennies, mais c'est plus largement et plus profondément de déracialiser la société française. Et c'est là toute l'hypocrisie des attaques qui s'abattent régulièrement sur le mouvement antiraciste et à présent sur la gauche de rupture, de la part de presque tout le spectre politique, à savoir les accusations de « communautarisme », de « racisme anti-blanc », de « racisme à l'envers » ou encore d' « obsession de la race ».
Nous sommes au contraire celles et ceux, ou nous devons être celles et ceux, qui prenons au sérieux politiquement la manière dont le racisme s'abat quotidiennement sur une partie de la population et fracture la société tout entière, qui ne font pas l'autruche par rapport à la question des inégalités raciales et de la domination blanche : celles et ceux qui ne veulent pas laisser les choses en l'état, qui veulent transformer radicalement les institutions, la culture et l'ensemble de la société de telle manière qu'on ne se pose précisément plus la question raciale, de telle manière que l' « universalisme » ne soit plus un mot creux ou, pire, une couverture pour dissimuler le refus de lutter contre les inégalités et les structures de domination.
Mais pour déracialiser, il faut commencer par affronter la question raciale, autrement dit les catégorisations et hiérarchisations raciales que le racisme produit et reproduit sans cesse, sous des formes d'ailleurs évolutives. Affronter la race pour mieux déracialiser n'est d'ailleurs un paradoxe que pour ceux qui ne veulent pas comprendre, ou qui ont trop intérêt à ne pas comprendre, précisément parce que le statu quo racial et raciste leur profite, ou du moins ne pèse en rien sur leurs existences quotidiennes, et qui font bien souvent tout pour occulter la réalité et les effets du racisme.
Déracialiser suppose bien sûr de renforcer et de populariser un récit antiraciste, de l'opposer en permanence aux discours identitaires et racistes qui ont envahi le débat public, de mener une lutte sans trêve et assumée sur ce terrain de l'antiracisme, pour briser notamment les consensus xénophobe et islamophobe qui se sont imposés au cours des quatre dernières décennies, y compris avec la complicité d'une partie de la gauche, et pour retourner la polarité dans la construction des « problèmes publics » : le problème ce n'est ni l'immigration ni l'islam, ce sont les politiques anti-migratoires (qui tuent chaque jour), l'islamophobie et plus largement le racisme sous toutes ses formes et dans toutes ses variétés.
Mais prendre au sérieux la question raciale, c'est aussi défendre et avancer un programme. Parce que si la question du pouvoir et du gouvernement nous importe, si elle est même cruciale pour nous, c'est en raison de ce que pourrait et devrait faire un gouvernement de rupture, non seulement avec le néolibéralisme et le productivisme, mais aussi avec le racisme et l'impérialisme. Difficile de ne pas en dire quelques mots ici. Un tel programme devrait comporter au minimum :
- – des politiques de régularisation des sans-papiers ;
- – des politiques de lutte réelle contre les discriminations raciales (lutte qui n'existe pas véritablement à l'heure actuelle, quoi qu'on en dise) ;
- – des politiques de déségrégation des territoires, du marché du travail ou de l'institution scolaire ;
- – des politiques de réparation à l'égard des minorités racialisées et des peuples colonisés ;
- – des politiques visant à mettre un terme au profilage racial dans l'activité de la police et engageant par ailleurs la dissolution des brigades – comme la Brigade anti-criminalité (BAC) – les plus activement et brutalement au service du maintien de l'ordre socio-racial ;
- – des politiques éducatives visant la connaissance par tou·tes des processus historiques à travers lesquels les puissances occidentales ont colonisé le monde entier, installé leur domination et imposé des classifications et des hiérarchisations raciales, qui ont eu un rôle central dans la construction d'un capitalisme mondialisé et prédateur.
– mais aussi une rupture nette avec les politiques impérialistes, ce qui passe notamment par la fin du pillage néocolonial de l'Afrique, le boycott d'Israël et l'autodétermination du peuple kanak.
C'est seulement à ce prix politique que l'on parviendrait – au terme d'une longue bataille politique, sociale et culturelle – à déracialiser véritablement les institutions et les consciences. Vaincre l'extrême droite suppose évidemment de battre électoralement des forces politiques organisées mais cela va beaucoup plus loin : il s'agit de transformer radicalement les conditions sociales, politiques, institutionnelles et culturelles, dans lesquelles ces forces naissent, se développent et prospèrent, donc notamment de bâtir une société en rupture complète avec un ordre racial qui organise des concurrences multiples, entretient la division sur le fondement de l'origine, de la religion ou de la couleur de peau, et reproduit tout un ordre inégalitaire socio-racial qui est solidaire et constitutif d'un système capitaliste fondé sur l'exploitation de la grande majorité par une petite minorité.
Cette bataille n'est évidemment pas notre seule tâche dans le combat contre l'extrême droite. Elle n'est pas exclusive d'autres luttes (syndicales, féministes ou écologistes par exemple), mais elle est une tâche absolument centrale pour quiconque prend au sérieux l'objectif de la libération et d'une humanité émancipée.
*
Illustration : Photographie de Martin Noda / Hans Lucas / Photothèque rouge.
Note
[1] Voir là encore le dernier rapport de la CNCDH ou, il y a déjà une vingtaine d'années, cet article de Nonna Mayer.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Soudan : Au-delà de l’aide humanitaire

Le Soudan est confronté non seulement à des tirs de balles, mais aussi à l'absence étouffante d'infrastructures de communication, une ressource vitale souvent négligée mais aussi essentielle que la nourriture ou les médicaments. Alors que le pays est aux prises avec une grave crise de sécurité alimentaire, les initiatives locales, telles que les groupes d'entraide et les cuisines d'urgence, sont les seules sources fiables de survie pour des millions de personnes . Pourtant, ces réseaux de soutien fragiles dépendent d'un accès stable à Internet, un outil vital aujourd'hui étouffé par la guerre. Alors que les Forces de soutien rapide (RSF) resserrent leur emprise sur les communications dans les territoires qu'elles contrôlent et utilisent des appareils Starlink de contrebande pour surveiller et contrôler l'accès, les acteurs internationaux restent étrangement silencieux sur cette obstruction critique.
Tiré d'Afrique en lutte.
Les enjeux sont clairs : sans le rétablissement de l'accès à Internet, l'avenir humanitaire et politique du Soudan risque de s'effondrer. L'infrastructure même qui mobilisait autrefois la résistance, renversait les dictateurs et permettait une coordination vitale est désormais à la merci des seigneurs de guerre et de l'indifférence étrangère.
La crise alimentaire au Soudan est grave et ne cesse de s'aggraver . L'aide internationale devenant de plus en plus inaccessible en raison du conflit, les communautés les plus vulnérables dépendent des groupes d'entraide, du soutien de la diaspora soudanaise et des cuisines centrales gérées par des services d'urgence bénévoles. Ces initiatives locales ne se contentent pas de combler les lacunes laissées par les efforts humanitaires internationaux ; dans de nombreux cas, elles constituent la seule bouée de sauvetage des populations. « Les Soudanais s'entraident à peine, avec un soutien ou une protection internationale minime », a déclaré William Carter, directeur du Conseil norvégien pour les réfugiés au Soudan. Pour beaucoup, ce réseau local fait la différence entre un repas quotidien et des jours de famine.
Cependant, ces efforts pour sauver des vies dépendent entièrement d'une communication stable et d'un accès à Internet. Les familles qui envoient des fonds, les groupes d'entraide qui identifient les communautés dans le besoin et les cuisines d'urgence qui coordonnent les approvisionnements ont tous besoin d'Internet pour fonctionner. Sans Internet, ce système de soutien déjà fragile, poussé à bout, s'effondrera.
Dans les zones contrôlées par les RSF, les communications reposent uniquement sur des dispositifs Starlink de contrebande, qui fonctionnent de manière non officielle et à un coût élevé. L'accès est rare, dangereux et étroitement surveillé, car nombre de ces appareils sont contrôlés par les soldats des RSF. Il est scandaleux que, malgré l'obstruction continue de l'aide humanitaire par les RSF, les acteurs internationaux restent silencieux sur leur incapacité à entretenir les infrastructures de communication. Ce manque de responsabilité aggrave encore la crise humanitaire et porte atteinte aux réseaux vitaux dont dépendent les communautés soudanaises pour leur survie.
Mais les enjeux vont bien au-delà des besoins humanitaires immédiats : Internet est crucial pour l'avenir politique du Soudan. La guerre en cours remodèle le paysage politique et l'espace civique du pays. Bien avant le déclenchement du conflit le 15 avril, Internet était un élément essentiel de l'infrastructure de l'engagement civique. C'était le champ de bataille où les mouvements populaires soudanais s'organisaient, affrontaient les discours conflictuels et dirigeaient l'opposition qui a renversé une dictature de 30 ans en 2019. Les mêmes réseaux numériques ont soutenu la résistance au coup d'État de 2021 et ont suscité les remarquables réponses locales d'urgence que nous observons aujourd'hui. Leur activisme a été essentiel. Pourtant, la guerre en cours a considérablement perturbé cette dynamique, menaçant l'infrastructure même qui a autrefois donné du pouvoir à une génération de militants et transformé le paysage civique du Soudan.
Les déplacements provoqués par le conflit ont forcé d'innombrables militants, responsables politiques et dirigeants de la société civile à fuir les grandes villes ciblées par les RSF, et nombre d'entre eux n'ont pas pu revenir en raison de la dégradation de la situation sécuritaire. Dans les États relativement sûrs du nord et de l'est du Soudan, les Forces armées soudanaises (FAS) imposent de sévères restrictions, et de plus en plus de militants et de responsables politiques sont pris pour cible. En conséquence, les rassemblements politiques et de la société civile se sont largement déplacés hors du Soudan, ce qui a gravement compromis l'espace civique interne du pays. Les comités de résistance, autrefois l'épine dorsale de la résistance civile, ont été dévastés par ces déplacements. Leur capacité à se réunir et à s'organiser au Soudan a été encore plus entravée par les coupures de communication.
Malgré les promesses répétées de l'envoyé spécial des États-Unis de donner la priorité aux voix des citoyens soudanais dans le processus de négociation, la conception de ces processus reste floue. De plus, les exigences imposées aux factions belligérantes n'ont pas permis de rétablir l'action des civils. Au contraire, le cadre de médiation a encore davantage militarisé les acteurs civils, érodant l'action des citoyens, car de nombreux Soudanais attendent désormais le résultat des élections américaines. Une demande essentielle et immédiate – rétablir et maintenir l'accès à Internet – ne peut attendre un cessez-le-feu. Il s'agit d'un droit fondamental qui doit être garanti sans délai.
Pendant ce temps, RSF continue d'exploiter les plateformes humanitaires, ne répondant que de façade aux médiateurs et aux acteurs internationaux. Une exigence simple et exécutoire – qu'ils assurent un système de communication fonctionnel dans toutes les zones sous leur contrôle – serait une étape vitale, à la fois facile à surveiller et essentielle à la survie des efforts de terrain.
Tahany Maalla est analyste politique et directeur de Mubasara (un centre de recherche soudanais).
Source : https://africasacountry.com/
Traduction automatique de l'anglais
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Mali, les colonels de la junte soudain promus généraux

Ce 16 octobre, les cinq colonels auteusr du coup d'Etat d'août 2020 ont, à titre exceptionnel, obtenu le grade de général de corps d'armée. Si cette promotion n'est pas surprenante, le timing, en revanche interroge.
Tiré de MondAfrique.
Il faudra s'y faire et désormais appeler général aussi bien Assimi, Goïta, président d'une transition qui dure, Sadio Camara, ministre de la Défense, Ismaël Wagué ministre de la réconciliation, Modibo Koné puissant patron du renseignement, Malik Diaw, président du Conseil National de transition. Quatre ans et demi après leur coup d'Etat qui a renversé Ibrahim Boubacar Keïta, ils auront donc pris du temps pour s'octroyer cette promotion.
Le Guinéen Mamadi Doumbouya n'a pas pris autant de précautions, il est passé de lieutenant-colonel à général en moins de trois ans.
Pourquoi maintenant ?
Cette promotion aurait été plus comprise si elle avait été annoncée après un succès militaire comme la reprise de Kidal en novembre 2023. Or, elle intervient précisément dans un moment où les autorités maliennes traversent une très mauvaise passe. Après la défaite cuisante à Tinzawaten en juillet 2024 où nombre de soldats et de mercenaires de Wagner ont été tués, blessés ou fait prisonniers, les militaires sont repartis à l'assaut de cette ville située aux portes de l'Algérie. Après avoir essayé pendant près de deux semaines de rejoindre la localité, en vain, l'armée a rebroussé chemin. Ce nouveau galon est-il destiné à faire diversion pour passer cet échec sous silence ?
Pour le site de l'Alliance des Etats du Sahel, ces changements « s'inscrivent dans un contexte de réorganisation de l'appareil sécuritaire malien », peut-être mais comme les désormais cinq généraux restent tous à leur poste, difficile d'imaginer de grands bouleversements à venir. Ou bien faut-il voir la volonté pour les bénéficiaires de ces promotions de se sécuriser avant d'organiser l'élection présidentielle ? Dans ce dernier cas, ces galons supplémentaires seraient une très bonne nouvelle.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :












