Presse-toi à gauche !
Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...
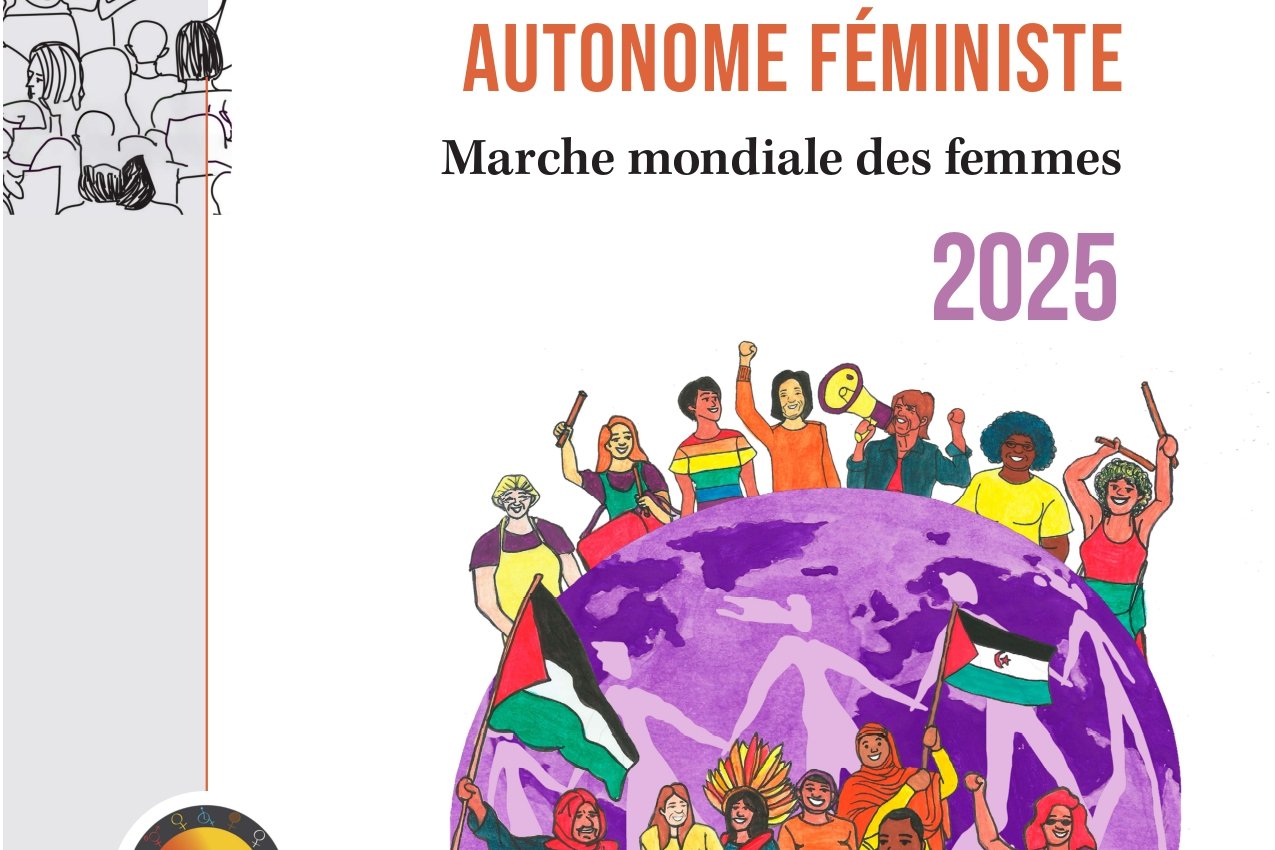
Contexte international

Nous vous présentons ici notre analyse de la conjoncture internationale, qui met en lumière les multiples crises et bouleversements façonnant notre réalité actuelle, qui nous appelle à se mobiliser pour la 6e édition de l'action de la Marche
mondiale des femmes. Les inégalités grandissantes, les conflits, les reculs démocratiques, les crises économiques et environnementales révèlent l'ampleur des injustices systémiques et renforcent la nécessité de notre mobilisation. Face à ces
défis, notre engagement collectif s'impose comme une réponse essentielle pour défendre les droits, la justice sociale et l'égalité, affirmant ainsi la pertinence d'un mouvement de solidarité féministe transnational.
Tiré du GUIDE D'OUTILS D'ÉDUCATION POPULAIRE AUTONOME FÉMINISTE
Marche mondiale des femmes 2025
file :///C :/Users/coord/Downloads/CQMMF_Guide_EPAF_NUM.pdf
La situation internationale en 2025 : un monde en grand bouleversement dans un immense cycle de la violence.
1. Concentration de la richesse et inégalités
La mondialisation économique néolibérale a permis l'accumulation de richesses d'un cercle restreint d'individus : pour chaque dollar gagné par les 90 % les plus pauvres, les milliardaires ont gagné 1,7 million de dollars2. Ils accumulent leur fortune grâce aux actifs des marchés financiers, et profitent également d'un système fiscal qui leur
est favorable.
De plus en plus d'éléments indiquent que les entreprises contribuent à l'inflation3. Nous le voyons autant dans le prix des aliments que dans celui de l'énergie. Le droit à un logement adéquat est aussi soumis à la spéculation. Dans ce système économique donnant priorité au marché, les impacts négatifs sur la vie des populations s'en font sentir, notamment par la hausse de la pauvreté des femmes, bien que ce soient encore elles qui s'occupent le plus fréquemment de nourrir, éduquer
et soigner les membres de leur famille. Les personnes migrantes veulent se soustraire à la pauvreté, à la violence et aux bouleversements climatiques, mais sont exposées à des risques dans leur migration et dans leur intégration sur leur nouvelle terre d'accueil4.
2. Concentration du pouvoir et violences
Non seulement les milliardaires à la tête de transnationales possèdent des ressources et une influence pour façonner le cours des économies, mais ils sont en mesure d'influencer les paysages politiques en prônant une réduction du rôle de l'État. Des gouverne ments de droite et d'extrême droite sont arrivés au pouvoir dans plusieurs pays (Italie, Autriche, Suède, Argentine, États-Unis) et la tendance en vogue est de libéraliser les marchés, de s'attaquer aux programmes sociaux et de privatiser les services publics, empêchant ainsi une juste redistribution de la richesse5.
Le tout à la croissance économique domine sur la démocratie. De plus en plus, les règles démocratiques sont détournées pour imposer une vision ou un projet économique. Cela favorise les entreprises, et ce, au mépris du respect des droits et libertés des collectivités et de la population. Parfois, on outrepasse même le pouvoir judiciaire6 (désinformation, manque de transparence dans les projets en développement, manipulation des médias sociaux, corruption, etc.).
Des valeurs conservatrices sont prônées par des extrémistes et idéologues religieux, renforcées par le courant des masculinistes, qui condamnent la diversité sexuelle et de genre, et préconisent le retour des rôles traditionnels des femmes et des hommes, notamment par le contrôle de la vie et du corps des femmes. Les violences envers les femmes passent non seulement par la hausse du nombre de féminicides, mais par toutes formes de déshumanisation et d'invisibilisation des femmes, jusqu'à l'extrême comme dans le cas des femmes afghanes.
3. L'exploitation de la planète et destruction du vivant
L'accaparement des richesses passe par l'exploitation de la nature, et ces richesses sont convoitées par les principaux pays impérialistes7 (États-Unis, Chine, Russie). Des tensions, des violences politiques et des guerres sévissent partout (Moyen-Orient, Afrique, Ukraine et plusieurs pays) et impliquent souvent des acteurs non étatiques et des sociétés militaires privées. Les conflits armés renforcent le modèle patriarcal, et font augmenter la violence domestique, le viol et la traite des femmes8. Les rapports colonialistes9 persistent avec l'appropriation des territoires des pays du Sud et ceux des populations autochtones.
La production d'énergie avec les combustibles fossiles et certains secteurs d'activités comme le transport et la construction ont fait augmenter le taux d'émission de gaz à effet de serre, ce qui contribue entre autres aux dérèglements climatiques actuels.10 De plus, la déforestation pour libérer des espaces agricoles modifie les habitats des animaux, mettant ceux-ci en péril. Les conséquences de ces changements climatiques alourdissent davantage la charge mentale des femmes liée à l'organisation de la famille pour les soins qu'elles prodiguent à leurs proches dans les cas de catastrophes naturelles
ou d'épidémies11, et peuvent générer une surcharge dans leur milieu de travail.
Même si les études scientifiques crient au danger pour l'avenir de la vie humaine, le mode de développement économique capitaliste12 prend toujours de l'expansion en poursuivant la marchandisation de la nature, incluant les êtres humains qui y habitent13.
4. Soulèvements et luttes des femmes
Ce portrait mondial est à la fois alarmant et redoutable, mais il nous exige d'avancer pour imposer notre volonté et exprimer notre résistance. Soyons réalistes : la lutte n'est pas terminée et sera longue et difficile. Les femmes ont déjà réalisé de grandes avancées après de longues luttes : le droit de voter et de se présenter aux élections, le droit de travailler et de faire une carrière dans plusieurs domaines autrefois interdits aux femmes, le droit de décider de sa maternité, le droit de décider de sa sexualité, le droit de prendre des congés parentaux, et biens d'autres encore. En effet, ces progrès ont été possibles grâce aux mobilisations, et c'est pour cette raison qu'il est essentiel de les maintenir. Cependant, il est important de
nuancer que ces avancées n'ont pas profité à toutes les femmes de manière égale. Nous devons continuer de lutter pour que ces droits soient étendus à TOUTES les femmes, sans exception.
Le mouvement des femmes a fait tomber des barrières immenses pour l'obtention de lois forçant l'égalité des droits pour toutes et tous – même si d'immenses pas restent à faire. Au cours des dernières années, une multitude de mouvements ont pris forme : #moiaussi pour dénoncer les violences sexuelles faites aux femmes ; celui contre les féminicides ; « Femme, vie, liberté » en Iran qui aspire à un changement pour éliminer la discrimination et la violence fondées sur le genre ; les luttes de plusieurs communautés contre l'exploitation des ressources naturelles et énergétiques qui dévaste leurs territoires ; les mobilisations des travailleuses en milieux majoritairement féminins pour la défense des réseaux publics, accessibles et de qualité de l'éducation et de la santé et services sociaux, etc.
Les protestations contre les inégalités, le racisme, les violences envers les femmes ou contre la destruction de l'environnement ne sont pas épargnées par la répression policière ou militaire, ni par l'augmentation de la surveillance et de la criminalisation de ces mouvements sociaux14.
C'est pourquoi les actions de la CQMMF en 2025, inspirées par les valeurs de la Charte mondiale des femmes pour l'humanité, sont si importantes et demeurent pertinentes encore aujourd'hui !
Travaillons à unir nos forces, à rassembler les différentes générations et à regrouper les luttes multiples afin de sortir les femmes et les familles de la pauvreté et leur donner la possibilité de vivre et travailler dans un milieu exempt de violence. Assurons-nous que nos choix de vie respectent l'environnement, notre « bien vivre » ; Sortons de nos chemins et revendications spécifiques pour faire en sorte de créer un mouvement de résistance uni pour le maintien de nos acquis si chèrement gagnés, et progresser dans nos trois grandes orientations.
Avec cette force collective qui se déploie dans toutes les régions du Québec, chacune de nos actions est une pierre pour ériger notre édifice de la résistance en 2025. Rassemblons-nous le 18 octobre prochain et démontrons la force de notre mouvement et de notre unité pour construire et défendre nos choix de société pour la durabilité de la vie.
Notre colère est notre moteur pour résister, pour dénoncer la privatisation de notre société et pour exiger le respect de nos droits collectifs. Ce slogan résume fort bien notre engagement et notre volonté d'agir :
Encore en marche pour transformer le monde !
Notes
2.OXFAM International. « Chapitre 1 : La loi du plus riche ou l'explosion des inégalités » dans La loi du plus riche :
pourquoi et comment taxer les plus riches pour lutter contre les inégalités, Royaume-Uni, OXFAM International,
janvier 2023, p.17. https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621477/bp-survival-of
the-richest-160123-fr.pdf
3.HARVEY, Pierre-Antoine. Le rôle potentiel des profits dans l'inflation élevée se confirme, Institut de recherche
et d'informations socioéconomiques, 1er septembre 2022. https://iris-recherche.qc.ca/blogue/economie-et
capitalisme/le-role-potentiel-des-profits-dans-linflation-elevee-se-confirme/
4.United Nations High Commissioner for Refugees. Global Trends Forced Displacement, Édition 2020,
Denmark, United Nations High Commissioner for Refugees, 72p. https://www.unhcr.org/statistics/
unhcrstats/60b638e37/global-trends-forced-displacement-2020.html
5.DIAZ MAHEUX, Alexandre. « Pourquoi nos démocraties sont-elles à risque ? », Le Devoir, 12 novembre 2024.
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/823485/idees-pourquoi-democraties-sont-elles-risque
6.Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec. Pour en finir avec les inégalités,
sortons du capitalisme, Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec, mai
2024. https://mepacq.qc.ca/wp-content/uploads/2024/05/Pour-en-finir-avec-les-inegalites-sortons-du
capitalisme.pdf
7. Impérialisme : caractérise toute politique de conquête qui vise à construire un empire.
8.Amnesty international. Les crimes commis contre les femmes lors des conflits armés, Londres, 8 décembre
2004, 83 p. https://www.amnesty.org/fr/wp-content/uploads/sites/8/2021/06/act770752004fr.pdf
9.Voir Annexe II-b du présent document.
10.Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Réchauffement planétaire de 1,5 °C : rapport
spécial du GIEC sur les conséquences d'un réchauffement planétaire de 1,5 °C par rapport aux niveaux
préindustriels et les trajectoires associées d'émissions mondiales de gaz à effet de serre, dans le contexte
du renforcement de la parade mondiale au changement climatique, du développement durable et de la lutte
contre la pauvreté, 2019, 94 p. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/SR15_Summary_
Volume_french.pdf
11.COUTURIER, Eve-Lyne et Julia POSCA. L'impact des crises sur les femmes : Inégales dans la tourmente,
Montréal, Institut de recherche et d'informations socioéconomiques, mars 2021, 68 p. https://iris-recherche.
qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/Femmes_et_crises_WEB1.pdf
12.Voir Annexe II-b du présent document.
13.Programme des Nations Unies pour le développement. Rapport sur le développement humain 2020 : La
prochaine frontière : Le développement humain et l'Anthropocène, New York, Programme des Nations Unies
pour le développement, 2020, 445 p. https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdr2020fr.pdf
14.DORAN, Marie-Christine. « Criminalisation », Antropen, 19 décembre 2020, 7 p. https://revues.ulaval.ca/ojs/
index.php/anthropen/article/view/40949/218

17 mai, journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie

En cette journée du 17 mai, journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, nous vous écrivons toutes les deux pour élever notre voix au nom de nos communautés LGBTQIA2S+.
Chères solidaires, chers solidaires,
Les gens de nos communautés font encore beaucoup trop souvent face à la haine, à l'intimidation et à la violence. Partout à travers la planète, la droite conservatrice remet en question l'égalité des genres et la diversité sexuelle. Au sud comme à l'est et l'ouest du Québec, les personnes non-binaires et fluides dans le genre sont effacées de l'histoire et des institutions, alors que ces personnes existent depuis des millénaires dans plusieurs sociétés à travers le monde.
Le terme « gay » est de plus en plus utilisé dans nos écoles québécoises de façon péjorative, nuisant à la santé mentale et physique des plus jeunes d'entre nous.
L'augmentation des crimes haineux ciblant une orientation sexuelle a augmenté de 69% au Canada entre 2022 et 2023 selon Statistique Canada. Ceux contre les personnes trans ont doublé depuis 2020.
Nos communautés sont inquiètes.
La Coalition Avenir Québec n'a pas de position claire et assumée. Le Parti Québécois utilise les petites avancées de nos communautés, comme les toilettes mixtes, pour diviser les Québécoises et les Québécois.
Sous peu, le Comité des « sages », créé pour conseiller le gouvernement dans sa prise de position sur les enjeux d'identité de genre, déposera son rapport qui pourrait ébranler profondément les droits des membres de nos communautés.
Soyons vigilantes et vigilants. Nous aurons besoin de vous.
Aujourd'hui comme toujours, nous faisons un appel à l'empathie. Un appel à l'introspection, sur l'ensemble de nos paroles et nos gestes. Un appel vibrant à toutes les personnes alliées.
Nous aurons besoin de chacune et de chacun d'entre vous, pour éviter la dégradation de nos droits, pour éviter la stigmatisation, pour éviter de perdre nos acquis si durement gagnés.
Résistons à la haine, qu'elle se trouve dans nos écoles, dans nos institutions, dans nos rues.
Soyons libres, soyons fier⋅es, soyons solidaires. ✊
Manon Massé
Députée de Sainte-Marie–Saint-Jacques
Roxane Milot
Présidente de Québec solidaire
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Belgique - Fier·es mais pas dupes : l’Arizona doit tomber

Nous publions ci-dessous la version longue du tract que nous distribuerons lors de la Pride bruxelloise et européenne, qui aura lieu le samedi 17 mai, au départ du Mont des Arts. Le tract est également téléchargeable en version courte au format PDF en cliquant ici.
Tiré de Gauche anticapitaliste
7 mai 2025
Par Gauche anticapitaliste
Communiqués, LGBTQI+
Bain de sang social contre les LGBTI+
Le gouvernement Arizona et ses homologues régionaux organisent une véritable boucherie sociale et les personnes LGBTI+ seront parmi les premières impactées par les mesures austéritaires ! Au niveau fédéral, c'est presque 22 milliards d'euros qui vont nous être arrachés.
Après un bilan de la Vivaldi essentiellement symbolique et non accompagné de budgets suffisants malgré quelques mesures concrètes (la fin des thérapies de conversion, la fin des mutilations des enfants intersexes), la précarité reste forte et aucune des racines matérielles des difficultés rencontrées par les personnes LGBTI+ n'a été éliminée.
Les attaques contre le droit au chômage et les CPAS n'ont rien d'anodin pour notre communauté quand nous savons à quel point les personnes transgenres sont surreprésentées dans les statistiques du chômage. De la même manière, s'attaquer aux CPAS, c'est mettre en danger les jeunes LGBTI+ ne pouvant pas compter sur leur famille pour avoir la moindre aide matérielle, précarité accentuée par la limitation des allocations d'insertion à un an ! L'offensive contre le monde médical (avec le flicage des médecins qui mettraient “trop” de certificats) met aussi en danger les personnes LGBTI+ qui sont en moins bonne santé, notamment avec plus de problèmes d'addiction et de santé mentale.
L'associatif n'est pas épargné non plus dans ce dépeçage en règle : suppression de subventions, gel voire suppression pure et simple de l'indexation des subventions de plusieurs dispositifs réglementaires, baisses de financement atteignant jusqu'à 25 % dans certains secteurs, réduction de la déductibilité fiscale des dons aux ASBL, etc. Les personnes LGBTI+ dépendent fortement de la vie associative pour socialiser et avoir accès à certains mécanismes de solidarité littéralement vitaux, on comprend bien les effets extrêmement négatifs sur notre communauté de ces attaques.
L'Arizona déteste aussi la lutte contre les discriminations, puisqu'elle coupe un quart des subsides d'UNIA, organe de lutte contre les discriminations : c'est la même logique d'austérité qui est à l'œuvre et qui touche forcément les plus précaires.
Des transphobes au gouvernement
À un mois de la Pride, le ministre de l'intérieur MR Bernard Quintin débarque avec une proposition d'optionnalité de l'enregistrement du genre sur la carte d'identité. Une mesure qui risque de créer deux régimes d'enregistrement qui mettrait les LGBTI+ en danger au sein de pays LGBTI+phobes, et qui est complètement en décalage avec les consultations faites avec le secteur associatif. De son côté, Vooruit surfe également sur le mois des Fiertés en proposant la constitutionnalisation du mariage homosexuel, ce que personne n'avait demandé. Les homos exclu·es du chômage par l'Arizona lui seront probablement reconnaissant·es pour ce bel exercice de pinkwashing ! L'Arizona n'a aucune volonté de se concerter avec qui que ce soit, le monde du travail comme la communauté LGBTI+.
Certains de ces partis contribuent même avec enthousiasme à la dégradation de la santé mentale des personnes LGBTI+, comme la N-VA et le MR qui mettent des personnes clairement LGBTI+phobes à des postes de ministres et défendent leurs sorties haineuses. On n'oubliera pas la promotion du pamphlet transphobe “Transmania” par David Clarinval, vice-premier ministre, qui sera défendu à l'époque par un Georges-Louis Bouchez qui assimilait alors les critiques de son protégé à du nazisme, purement et simplement. Sans parler du Premier Ministre De Wever et de son sbire Francken (qui écrivait en 2007 : « Le mouvement arc-en-ciel a tout gagné (…) Que veulent-ils de plus ? »), dont la campagne électorale de 2024 basée sur « l'antiwokisme » contribue clairement à l'aggravation d'un climat déjà dangereux pour les LGBTI+.
Nous l'avons défendu des années durant : la N-VA n'a pas sa place à la Pride et aujourd'hui, le MR a lui aussi clairement franchi certaines lignes rouges de la discrimination LGBTI+phobe, récemment en collaborant sur la question de l'EVRAS avec l'institut Thomas More (financé par le milliardaire français Pierre-Edouard Stérin, architecte du plan PERICLES dont l'objectif est de faire advenir une alliance gouvernementale de la droite et de l'extrême-droite).
Nous ne célébrerons rien avec nos bourreaux ! La Pride DOIT expulser ces partis du cortège.
Solidarité contre l'internationale réactionnaire
L'actualité internationale est plus qu'inquiétante, tant la recrudescence des attaques LGBTI+phobes est forte tout autour du globe : Russie, USA, Hongrie, Géorgie, Afghanistan, Iran, Royaume-Uni, Brésil, … Récemment, la décision de la Cour Suprême britannique, qui fait reposer la définition d'une femme sur la seule biologie (excluant également les femmes intersexes), crée un dangereux précédent dont les transphobes s'empareront pour justifier les exclusions des femmes trans, par exemple des dispositifs de soutien aux femmes, notamment les violences sexistes et sexuelles.
Nous sommes solidaires de nos adelphes partout et seule l'ouverture des frontières permettra de les accueillir dans la dignité sans avoir à violer l'intimité de qui que ce soit pour savoir s'iel est “vraiment” queer. Pour rappel, une personne qui reste au placard dans son pays d'origine est une personne qui ne peut prouver qu'elle est en danger selon le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA).
L'Arizona, avec ses politiques anti-migrant·es, va dans la direction inverse en sortant encore plus explicitement le statut de réfugié·e de l'état de droit : la Vivaldi s'était déjà illustrée par son refus à appliquer les décisions de justice concernant ce statut, l'Arizona vient maintenant réduire fortement les recours judiciaires possibles. Limiter le droit d'asile à une époque de montée des guerres, des génocides et du fascisme, c'est être complice de la brutalité qui touchera les personnes LGBTI+ qui seront dans les premières lignes.
En même temps, la Belgique jouit d'une réputation de paradis pour les LGBTI+ : ce n'est vrai qu'en théorie (les “classements” se basent sur la législation, non sur les faits) et en comparant à la situation catastrophique des personnes queers à travers le globe. Derrière les premières places dans les classements internationaux se cachent l'augmentation des discriminations LGBTI+phobes, les hauts taux de suicide et la précarité. Nous ne sommes pas dupes des états qui jouent aux bons élèves avec une stratégie de pinkwashing tout en étant indifférents à notre sort ou au respect des droits humains les plus élémentaires, que ce soit en Belgique, aux Pays-Bas ou en Israël.
Face à une situation aussi catastrophique au plan national et international, une seule solution : s'organiser !
Résistance unie contre l'Arizona
Le mouvement LGBTI+ en Belgique s'illusionne encore trop sur des relais politiques au gouvernement : face à l'Arizona, aucune concertation n'est envisageable et le mouvement LGBTI+ doit former un front de résistance et mobiliser ses militant·es au-delà de la seule entraide matérielle. Nous défendons la nécessité de construire un mouvement LGBTI+ massif, autonome et international, qui s'allie aux autres mouvements sociaux pour imposer un véritable rapport de force, seul à même d'aboutir à la libération de toutes les personnes LGBTI+ ! Notre nombre n'est pas à notre avantage, il est donc nécessaire d'unir les différentes communautés queers derrière une grande bannière sans pour autant chercher à dissimuler les différences entre nous.
Face à l'Arizona, un important mouvement de contestation prend forme depuis plusieurs mois. Si le plan d'action syndical échoue encore à trouver le chemin de la victoire, il est crucial de continuer à l'amplifier, pour dégager le gouvernement De Wever/Bouchez. En s'en prenant à tout le monde, la coalition fédérale ouvre une brèche pour une riposte collective des opprimé·es et des exploité·es. Alors que la droite et l'extrême-droite accélèrent leurs attaques contre les LGBTI+, notre place est au cœur de cette lutte, pour faire valoir nos revendications, et contribuer à la construction d'un front uni des résistances contre la guerre sociale organisée par les capitalistes.
Le retour en force de l'extrême-droite sur le globe doit nous mettre en alerte maximale : face à la N-VA, au MR et au Vlaams Belang, le pire est possible et il faut nous tenir prêt·es face aux attaques présentes et futures. L'Arizona ne cédera rien, sa légitimité démocratique ne repose que sur le mensonge et il faudra lutter jusqu'à sa chute.
Face à ces attaques sociales qui touchent les LGBTI+ de plein fouet, nous défendons :
. Un logement pour tous·tes ! Réquisition des logements vides, plus de logements sociaux et de refuges ;
. La fin du statut de cohabitant·e qui précarise les personnes LGBTI+, et l'individualisation des droits sociaux ;
. L'égalité pour le don de sang pour les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes (HSH) : pour l'instant, les HSH doivent être abstinents pendant 4 mois là où les autres n'ont pas cette restriction ;
. Des investissements massifs dans le secteur de la santé et la sécurité sociale, notamment pour rembourser les soins spécifiques des personnes LGBTI+ ;
. La reconnaissance immédiate du droit d'asile aux personnes LGBTI+ et la régularisation de toutes les personnes sans-papiers ;
. La fin de la répression policière et de l'instrumentalisation de nos luttes à des fins racistes par la droite et l'extrême-droite ;
. Le développement de politiques publiques d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS), non cishétéro-centré, obligatoire à l'école, avec les moyens nécessaires, par divers centres et associations pluriels de promotion des droits sexuels et reproductifs et anti-violences ;
. Un véritable plan d'action syndical, crescendo, discuté de la base au sommet, vers une vraie grève générale au finish, avec pour objectif la chute du gouvernement !
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

30 ans de luttes contre la pauvreté, pour l’égalité et la dignité – Marchons pour Du pain et des roses, encore et plus que jamais !

Du 26 mai au 4 juin, des dizaines de marches locales, organisées par des organisations féministes, syndicales et du mouvement communautaire, mixtes et non-mixtes, auront lieu dans la plupart des régions. Des citoyen·nes en réaliseront aussi dans leurs milieux respectifs. Le point culminant de cette mobilisation consistera en une marche à Québec le 7 juin.
« En ces temps troublés et inquiétants, les femmes ressentent plus que jamais le désir de se mobiliser avec tous ceux qui les appuient dans le combat pour leurs droits. Les actions de mai et juin 2025 seront des moments de retrouvailles mais aussi de réaffirmation de la nécessité de revendiquer ensemble un Québec juste et égalitaire. Un prélude au grand rassemblement du 18 octobre prochain, organisé par la Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes ! » souligne Françoise David, présidente de la FFQ au moment de la marche de 1995 et co-porte-parole des actions de « Marchons pour Du pain et des roses, encore et plus que jamais ».
Des marraines de 1995 seront également présentes à différents moments, parfois accompagnées de comarraines illustrant ensemble la force, la diversité et la persistance du mouvement féministe. Les informations sur les événements seront progressivement annoncées sur le site web de la FFQ et sur Facebook. En hommage au trajet de 1995, le total des kilomètres parcourus y sera répertorié. La population est invitée à se vêtir de mauve durant les événements.
« Marchons pour Du pain et des roses, encore et plus que jamais » est organisé par la FFQ, en collaboration avec la Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes. Les marches locales du 26 mai au 4 juin sont réalisées par des organisations autonomes et celle du 7 juin à Québec est organisée grâce à la contribution du Regroupement des groupes de femmes de la Capitale-Nationale.
Source : FFQ, 13.05.2025
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le retour du ministère des Femmes et de l’Égalité des genres : une victoire de la mobilisation féministe

Nous saluons le retour du poste de ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, aboli sans explication en mars dernier lors du remaniement ministériel de Mark Carney, alors nouvellement nommé premier ministre du Canada. Grâce à la mobilisation rapide et soutenue de groupes féministes pancanadiens, ce ministère crucial est de nouveau en place, tel qu'annoncé le 13 mai dernier. L'honorable Rechie Valdez a été nommée ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, ainsi que secrétaire d'État aux petites entreprises et au tourisme.
Nous sommes heureuses de cette nomination et prêtes à collaborer avec la ministre Valdez pour faire avancer la justice de genre et les politiques publiques féministes. En l'absence d'un engagement politique clair, sa présence est l'un des seuls remparts pour éviter que les enjeux de genre soient écartés des décisions gouvernementales.
Cependant, nous demeurons consternées par l'absence d'une nomination à la Diversité, à l'Inclusion et aux Personnes en situation de handicap. Ce silence envoie un message inquiétant. Plus d'un quart de la population vivant au Canada vit avec un handicap – et ce chiffre grimpe à un tiers lorsqu'on parle des femmes. Pourtant, aucune personne ministre ne porte désormais cette réalité dans le Conseil des ministres.
Nous rappelons que, sans voix officielle au sein du gouvernement, ce sont les groupes de la société civile, les femmes, les personnes en situation de handicap et les communautés marginalisées elles-mêmes qui continueront à porter ces enjeux et à revendiquer des changements concrets. Nous continuerons notre plaidoyer politique pour que personne ne soit laissé derrière !
Merci à toutes celles et ceux qui se sont mobilisé·es. La vigilance reste de mise.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
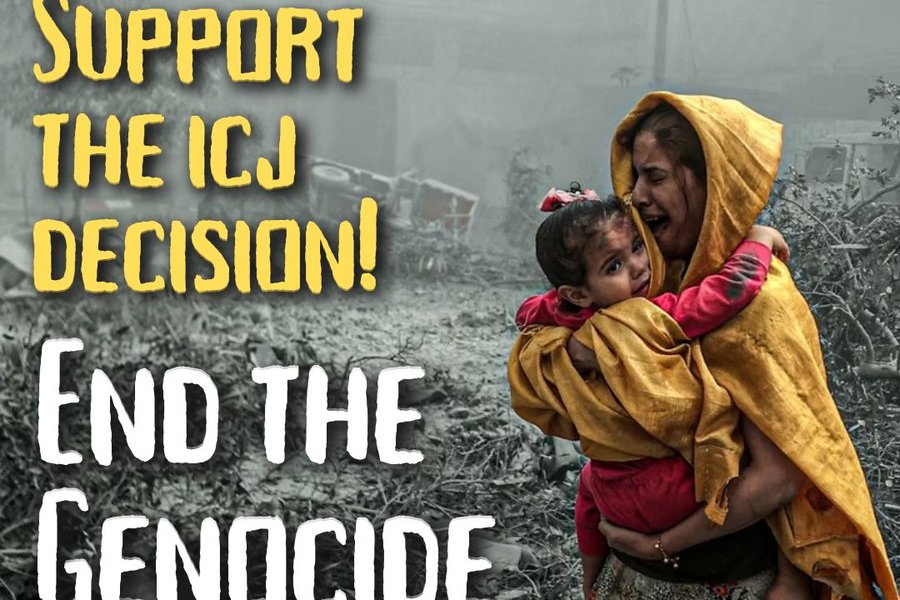
La Nakba à 77 ans

Le 15 mai, nous commémorons la Nakba, la catastrophe infligée au peuple palestinien par les milices sionistes et l'armée israélienne naissante. Plus de 750 000 personnes ont été violemment expulsées et forcées de fuir leurs terres, plus de 530 villages ont été détruits et des communautés entières ont été massacrées et détruites par les sionistes.
Tiré de Voix juives indépendantes
Cette année, nous célébrons l'anniversaire de cette catastrophe, qui s'est traduite par 77 ans de nettoyage ethnique, de dépossession et de déshumanisation, et maintenant par 19 mois de génocide.
Depuis sa création, le sionisme est un projet de colonisation fondé sur l'effacement des Palestinien.ne.s.
En 1937, David Ben-Gourion, qui deviendra plus tard le premier Premier ministre d'Israël, écrivait : « Nous devons expulser les Arabes et prendre leur place ». Trois ans plus tard, Yosef Weitz, du Fonds national juif, déclarait : « Il n'y a pas de place pour les deux peuples dans ce pays… il ne faut laisser aucun village, aucune tribu. »
Ces déclarations reflètent une croyance fondamentale de l'idéologie sioniste : les Palestiniens doivent être expulsés de leurs terres ancestrales pour faire place à l'occupation coloniale.
La violence qui a commencé en 1948 n'a jamais cessé. Elle se poursuit par la famine de masse et le bombardement de Gaza. Dans la violence armée des colons et les incursions militaires en Cisjordanie.
Depuis octobre 2023, au moins 62 600 Palestinien.ne.s ont été tués, dont plus de 17 800 enfants. Un demi-million de personnes sont aujourd'hui confrontées à ce que l'Organisation mondiale de la santé appelle « la faim catastrophique, la malnutrition aiguë, la famine, la maladie et la mort ». Depuis qu'Israël a commencé à bloquer l'aide à Gaza en mars, au moins 57 enfants sont morts de faim, un chiffre qui devrait continuer à augmenter.
Dans ce contexte, le Canada refuse de prendre des mesures significatives et maintient son soutien commercial, militaire et diplomatique à Israël.
Alors qu'Israël commet un génocide au vu et au su du monde entier, la complicité du Canada est indéniable et impardonnable.
Pourtant, la résistance perdure. Depuis 77 ans, les Palestinien.ne.s refusent d'être effacés par le sionisme.
Face à la violence des colons et aux déplacements forcés, la Palestine survit. Elle vit avec ceux qui survivent au génocide à Gaza, qui résistent à l'empiétement des colons en Cisjordanie, dans le défi des étudiant.es.s qui réclament justice, dans l'organisation sans relâche des communautés diasporiques, dans le déchirement et l'espoir de chaque réfugié qui se souvient du nom de son village.
En ce jour de la Nakba, alors qu'Israël célèbre son « indépendance », nous nous souvenons de la vérité : l'existence d'Israël est née d'une dépossession violente et est maintenue aujourd'hui par une violence militaire écrasante. Qu'un mensonge sur « une terre sans peuple pour un peuple sans terre » a été utilisé pour justifier une catastrophe qui n'a jamais pris fin.
En ce jour de la Nakba, nous nous souvenons. Nous pleurons et nous résistons. Nous exigeons la fin du génocide, de l'apartheid et des catastrophes continues du sionisme.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

À voix égales félicite le Premier ministre Carney et appelle à poursuivre les progrès en matière d’équité entre les genres

À voix égales félicite le Premier ministre Mark Carney pour sa victoire électorale et la formation du prochain gouvernement du Canada. En tant qu'organisation multipartite dédiée à l'avancement de l'équité des genres en politique canadienne, À voix égales souligne l'importance de maintenir des actions concrètes afin que le Canada continue de progresser vers une représentation politique équitable des genres.
À la suite des élections fédérales de 2025, la représentation des femmes et des personnes de la diversité des genres parmi les députés, selon leur affiliation politique, est la suivante :
• Parti libéral : 67 sur 169 députés (39,6 %)
• Parti conservateur : 26 sur 144 députés (18,1 %)
• Bloc québécois : 5 sur 22 députés (22,7 %)
• Nouveau Parti démocratique : 4 sur 7 députés (57,1 %)
• Parti vert : 1 sur 1 député (100 %)
Ces résultats portent la proportion totale de femmes et de personnes de la diversité des genres à la Chambre des communes à 30,03%, ce qui représente une légère baisse par rapport à 30,5% en 2021.
Lors de l'élection fédérale précédente (2021) :
• Parti libéral : 57 sur 160 députés (35,6 %)
• Parti conservateur : 22 sur 119 députés (18,5 %)
• Bloc québécois : 12 sur 32 députés (37,5 %)
• Nouveau Parti démocratique : 11 sur 25 députés (44,0 %)
• Parti vert : 1 sur 2 députés (50 %)
« Cette élection démontre clairement que les progrès sont fragiles », a déclaré Lindsay Brumwell, directrice générale par intérim d'À voix égales. « Nous ne pouvons pas considérer la représentation comme acquise — l'équité des genres en politique exige un engagement soutenu et des actions de la part de tous les partis. Les Canadiens méritent un Parlement qui reflète pleinement la diversité de notre pays. »
Le changement systémique et sociétal commence par un leadership fort. Un siège réservé aux femmes à la table du Cabinet démontre que les politiques inclusives comptent. Nous encourageons tous les chefs de partis à reconnaître les compétences et l'expertise des femmes comme étant essentielles pour élaborer les solutions dont le Canada a besoin, aujourd'hui et pour l'avenir. À voix égales exhorte le Premier ministre et l'ensemble du Parlement à faire en sorte que les contributions des femmes soient valorisées au plus haut niveau des décisions, dans toutes les priorités et occasions gouvernementales.
À voix égales s'engage à faire en sorte que les femmes et les personnes de la diversité des genres soient non seulement élues, mais aussi placées en position de diriger et de s'épanouir. Par l'éducation, le mentorat, la recherche et le développement de réseaux, l'organisation soutient un changement durable du paysage politique canadien.
À propos d'À voix égales :
À Voix Égales est un organisme de bienfaisance enregistré dédié à l'amélioration de la représentation des genres en politique canadienne par la recherche et l'éducation. Depuis 2001, À Voix Égales est à l'avant-garde de la promotion d'une représentation équitable des femmes et des personnes de diversité de genre au Parlement du Canada, dans les législatures provinciales et territoriales ainsi que dans les conseils municipaux et autochtones. Par l'éducation, la formation et le développement du leadership, À Voix Égales travaille à créer un système politique équitable et inclusif à tous les niveaux de gouvernement.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Nomination du Conseil des ministres : « Est-ce que le tandem Carney Hajdu sera celui qui réformera l’assurance-emploi ? »

Montréal, le 13 mai 2025 – Le Conseil national des chômeurs et chômeuses (CNC) souhaite réagir à la nomination de Patty Hajdu comme ministre de l'Emploi et des Familles, responsable du programme d'assurance-emploi.
« Nous allons travailler avec la nouvelle ministre, qui chapeaute maintenant le plus important programme social canadien », ont déclaré Selma Lavoie et Milan Bernard, co-porte-paroles du CNC.
« Au cours des derniers jours, on a vu les conséquences réelles de l'affaiblissement de l'économie canadienne par les politiques de Donald Trump, avec l'augmentation du chômage et l'incertitude économique. Il faut des signaux clairs et des actions concrètes pour améliorer de manière durable le programme d'assurance-emploi pour soutenir les travailleurs et les travailleuses dans le contexte actuel et face aux prochaines crises. Il faut absolument agir, rien n'est réglé dans la guerre commerciale ! En campagne électorale, Mark Carney et les Libéraux se sont engagé à « renforcer le filet social » et à
« travailler pour que l'assurance-emploi soit mieux adapté aux réalités modernes du travail en offrant un soutien flexible et fiable ». Ils conservent donc leur orientation des dernières années : ils devront rapidement clarifier cet engagement et surtout le mettre en œuvre », a déclaré Selma Lavoie, co-porteparole du CNC
« Parce qu'au cours du dernier mandat libéral, ce fut un processus pour le moins agonisant : malgré deux lettres de mandat bien claires, le seul résultat de tout cela fut l'organisation d'une longue série de consultations. La réforme a été constamment retardée, remise à demain, et au surlendemain. Elle devait finalement être annoncée à l'été 2022, il y a trois ans, pour être mise de côté jusqu'à maintenant. Cela explique notre scepticisme. Enfin, les exclusions du cabinet de Jean-Yves Duclos, qui connaissait bien le programme et était connu pour son penchant progressiste, et de Karina Gould, qui a proposé l'amélioration du programme d'assurance-emploi lors de la course à la chefferie, font également sourciller. Avec le certain virage conservateur de Carney, ce sont des sources d'inquiétude », a pour sa part affirmé Milan Bernard, co-porte-parole du CNC.
À propos du CNC :
Fondé en 2005, le Conseil national des chômeurs et chômeuses (CNC) est la force organisée de défense et de promotion des droits des chômeurs et chômeuses, et plus largement des travailleurs et travailleuses. Il rassemble une dizaine d'organismes locaux et régionaux se voulant des acteurs proactifs pour une réforme globale du programme de l'assurance-emploi.
Þ Pour en savoir plus : www.lecnc.com
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
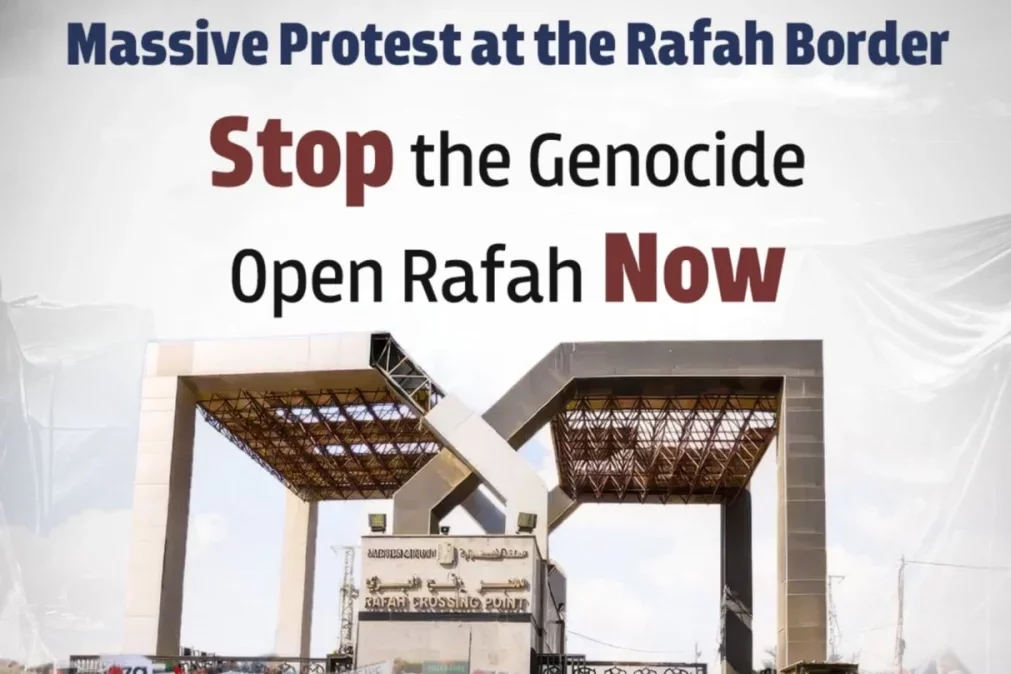
Pourquoi une délégation canadienne à la Global March to Gaza ?

Parce que le Canada a joué un rôle central dans le génocide du peuple de Gaza, par son soutien actif à Israël et sa couverture politique et diplomatique constante à l'État sioniste. Depuis qu'Israël a imposé le blocus de la bande de Gaza en 2007, le Canada — aux côtés des États-Unis et de l'Union européenne — a facilité, par son inaction, la situation catastrophique que nous vivons aujourd'hui.
Depuis toutes ces années, Israël contrôle la vie des habitants de Gaza, décidant ce qui peut y entrer, quand et comment — en imposant un blocus terrestre, maritime et aérien qui a asphyxié plus de deux millions de personnes. Bien que ce blocus ait été déclaré illégal par les Nations Unies, les alliés d'Israël non seulement l'ont toléré, mais n'ont rien fait pour l'atténuer. Le résultat : une famine sans précédent, des dizaines de milliers de morts civils, et une campagne de nettoyage ethnique ouvertement assumée au XXIe siècle.
Le Canada est complice de cette situation. Mais le gouvernement canadien ne représente pas la volonté de nombreux citoyens.
Une grande partie de la société canadienne est profondément sensibilisée à la souffrance du peuple palestinien et rejette avec force le génocide en cours à Gaza. D'un bout à l'autre du pays, des initiatives de solidarité se multiplient : mobilisations, lettres ouvertes, actes de désobéissance civile, campagnes de soutien. De ce rejet du génocide, et de l'indignation face à l'inaction gouvernementale, est née la délégation canadienne à la Global March to Gaza.
Il est des moments dans l'histoire où les citoyens doivent devenir les garants de l'humanité lorsque leurs gouvernements les trahissent. Nous croyons que nous vivons l'un de ces moments.
Le Canada a le pouvoir d'imposer un embargo sur les armes à destination d'Israël. Il peut rappeler l'ambassadeur israélien et adopter une position claire et ferme contre le génocide. Il dispose de tous les moyens nécessaires pour montrer son respect du droit international et, face à une intention génocidaire déclarée, il peut — et doit — agir.
Mais il ne l'a pas fait. Depuis des mois, le gouvernement canadien — d'abord sous Justin Trudeau, aujourd'hui sous Mark Carney — a choisi la lâcheté et la complicité. Loin d'assumer ses responsabilités, il s'est déclaré sioniste, a soutenu sans réserve le gouvernement de Netanyahu et s'est opposé à toute initiative internationale visant à exiger des comptes à Israël.
Il a même renoncé à enquêter sur les citoyens canado-israéliens impliqués dans des crimes de guerre, abandonnant délibérément ses engagements en matière de droits humains.
La délégation canadienne à la Global March to Gaza envoie un message clair : la population canadienne, en ce qui concerne la défense des droits du peuple palestinien, se trouve du bon côté de l'histoire. Et nous continuerons à participer à des initiatives courageuses pour attirer l'attention du monde sur des crimes qui ne doivent, en aucune circonstance, être tolérés par un gouvernement prétendant nous représenter.
Comité Canadien de Coordination pour la Marche Mondiale vers Gaza
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

TES Canada – Où est la vérité ?*

Nul besoin d'être un grand visionnaire pour comprendre ce qui se trame autour du projet TES Canada. Depuis le début, le promoteur multiplie les déclarations floues, les zones grises, et les intentions changeantes. Il est temps que la population se pose les vraies questions et que nos dirigeants exigent des réponses claires.
*Possibilité 1 : Un projet vidé de sa substance, sans preuve d'efficacité*
La première possibilité, bien réelle, serait que TES Canada abandonne l'idée de produire de l'hydrogène pour le transport lourd, ne conservant que le volet de méthanisation de l'hydrogène pour injection dans le réseau d'Énergir. Problème : aucune étude ne confirme les bénéfices de cette approche pour la décarbonation. On parle ici de 80 000 tonnes de gaz naturel renouvelable (GNR) de 3e génération, accompagnées de 220 000 tonnes de CO₂ biogénique injectés dans le réseau — mais sans qu'aucun contrat formel ne lie Énergir à l'achat de ce gaz de synthèse. Pire encore, aucune entente ne semble conclue pour l'approvisionnement de ce CO₂, pourtant essentiel au procédé.
Et même si l'on continue à croire que TES Canada souhaite réellement produire de l'hydrogène vert, on peut se demander comment la ministre de l'Énergie, Christine Fréchette, peut fermer les yeux sur les inefficacités flagrantes du procédé. Des experts et scientifiques de partout dans le monde dénoncent déjà l'aberration énergétique du projet : d'énormes pertes
d'énergie pour un rendement minimal.
La ministre envisagerait même de *subventionner* ce gaz pour compenser l'écart de prix avec le gaz naturel fossile. Est-ce là le rôle de l'État ? De tous les experts, aucun ne croit que ce type de projet puisse devenir viable sans injection massive de fonds publics. Les coûts de conversion sont bien trop élevés. Et tout ça pour quoi ? Injecter une goutte d'hydrogène dans un océan de gaz naturel polluant. Une illusion de progrès à fort coût collectif.
*Possibilité 2 : Un projet qui lorgne l'exportation*
Deuxième scénario : TES Canada viserait en réalité l'exportation de son hydrogène. On nous a toujours dit que le projet était destiné au marché québécois. C'est d'ailleurs ce qui est écrit noir sur blanc dans l'Avis de projet. Pourtant, aucun contrat d'achat ne lie le promoteur à des clients québécois. Alors, on produit pour qui ? Pourquoi ?
La seule conséquence, selon la ministre, en cas de non-respect des engagements ? Retirer le bloc d'énergie octroyé. Une simple tape sur les doigts. Aucune véritable pénalité. Aucune obligation de résultats. Si TES ne réussit pas à trouver d'acheteurs, il pourrait simplement tout abandonner — sans conséquence majeure.
*Possibilité 3 : Une privatisation déguisée de nos ressources*
Et si le véritable objectif était ailleurs ? Sans contrat local, sans projet exportateur viable, TES pourrait très bien se contenter… de produire de l'électricité. Une production assurée, sans appel d'offres, et surtout, extrêmement rentable — grâce à l'énergie publique fournie par Hydro-Québec. Ce serait alors une *privatisation déguisée* de notre accès à l'énergie. Un
précédent grave.
On permettrait ainsi à un promoteur étranger de s'implanter en territoire québécois, avec toute la latitude pour exploiter nos ressources, occuper nos terres et imposer ses conditions. Le tout, avec une *opacité jamais vue* et un discours marketing bien huilé, promettant espoir et développement durable à l'échelle planétaire… alors que les fondements mêmes du projet
sont loin d'être clairs.
Pendant ce temps, nos élus — municipaux, provinciaux et fédéraux — préfèrent jouer à l'autruche. Ils ferment les yeux sur les contradictions, refusent de poser les vraies questions et laissent le promoteur avancer, sans jamais devoir rendre de comptes à la population.
Il est temps de *demander des réponses*. Il est temps de *voir clair* dans ce projet qui prétend sauver la planète, mais qui pourrait bien, au contraire, devenir un cheval de Troie de la privatisation et du greenwashing énergétique.
La vérité, elle, attend toujours.
Pierre Pouliot
Citoyen préoccupé
Notre-Dame-du-Mont-Carmel
Merci à monsieur Haroun Bouazzi d'avoir posé les bonnes questions à la ministre de l'Énergie, madame Christine Fréchette, lors de l'une des dernières séances en commission parlementaire de l'assemblé nationale.
https://www.youtube.com/watch?v=dEx1_YzO9rs
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :












