Presse-toi à gauche !
Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

La France au cœur d’une guerre d’intérêts stratégiques

La Guerre en Ukraine pourrait entrer dans les prochaines heures dans une spirale d'affrontements dramatiques, suite à l'attaque russe, hier lundi 9 juin, sur la Pologne. Un contexte dont profite le constructeur automobile français Renault pour lancer opportunément sa chaine de production de drones.
De Paris, Omar HADDADOU
Couver la guerre biaisée et sauver ses intérêts !
Profit, matoiserie, prédation ! Autant de substantifs qui agitent les pulsions des grandes puissances industrielles, compromettant morale et équilibre géopolitique. L'Europe et les Etats-Unis se livrent à des conquêtes territoriales et énergétiques qui ne reculent devant aucune indignité. Cuirassé de sa puissance de feu, Donald Trump donne le ton dès son 2ème Investiture, le 20 janvier 2025, et dicte sa feuille de route inepte et surréaliste : Conquête du Groenland, récupération du canal de Panama et du Golfe du Mexique, provocation annexionniste envers le Canada, taxes douanières, expulsions massives des immigrés (es) qui se sont soldées par des troubles, ce dimanche 8 juin, à Downtown.
Le géant chinois, lui, ne se laisse pas dévorer par son rival, acculé à trouver un compromis dans une guerre commerciale sans merci.
Le Président américain n'ira pas de main morte à l'égard du protégé de Van der Leyen et ses largesses pécuniaires en millions de dollars. Zelensky, le choyé des Européens, doit payer ! Sa disgrâce est un choc ! La France de Macron en subira pour sa part des contrecoups accablants. Début mai 2025, le Président ukrainien, laminé par son créancier Trump, cède au deal du natif du Queens qui lui fait payer la dette de 500 milliards de dollars (aide militaire) par l'exploitation des minerais stratégiques. Trump part avec un « accord historique ! ».
Oui, il y a à boire et à manger en Ukraine !
Certains Industriels français, mus par l'opportunisme charognard, ne s'offusquent nullement de promouvoir une filière de circonstance pour leur chiffre d'affaires sur des cadavres. Aussi, selon une source d'une radio française, ce lundi 9 juin, le constructeur Automobiles Renault dont l'Etat est actionnaire, réfléchirait à l'opportunité d'installer une usine de fabrication de drones militaires en Ukraine en collaboration avec une PME française.
C'est dire la soif inextinguible du capitalisme français et ses appétits tentaculaires sous les bourrasques apocalyptiques : « Cela peut correspondre à une logique capitalistique. L'Etat français a un pouvoir d'action à l'ancienne régie, comme on dit. Les drones valent 15 ou 20 000 euros. L'idée est peut-être de ramener leur prix 5 000 ou 10 000 euros. Cela fait un effet de rattrapage pour l'industrie française » fait observer Marc Chassillan, Ingénieur militaire de formation. Et d'ajouter : « Il y a une logique industrielle. Les constructeurs automobiles sont les Rois de la production à très grande cadence et à coûts maîtrisés d'objets complexes. C'est exactement ce que cherchent les Ministères de la Défense européens ». Voilà une belle illustration des motivations réelles des engagements de Renault en Ukraine. Purement financières. Une reconversion au grès de l'évolution de la tragédie, savamment entretenue par le succès illusoire.
De grâce ! Pourquoi autant d'enfumage sur l'issue d'une guerre dont on connait l'issue ? N'est-ce pas pervers de bercer Zelensky par des chimères triomphalistes dont l'unique dessein est de s'en mettre plein les poches ? Pourquoi autant d'hypocrisie occidentale, au moment où le front ukrainien fait office de manne providentielle mal dissimulée ?
C'est maintenant ou jamais ! Vendre, vendre ! En priant avec ferveur que le conflit ne connaisse pas de répit. Pauvre Ukraine ! Comment écrire ton histoire ? Toi qui croyait en ta victoire ? Hier, Odessa et Kiev ont subi des attaques massives aériennes russes. Renault a toutes les chances de voir son marché de drones se matérialiser, les doigts dans le nez.
La Pologne ayant réagit, ce lundi, aux attaques intenses de la Fédération de Russie, se porterait certainement comme cliente potentielle pour en faire acquisition. Il va sans dire que l'escalade du conflit conforte formidablement la conquête de ce marché juteux. Des chaines de production sous la houlette du Ministère de la Défense français, seraient bientôt opérationnelles. Les drones FPV pourraient incessamment investir le front et provoquer une autre dynamique, celle de l'enlisement et de l'explosion du carnet de commandes des Industriels et Start-up opportunistes !
O.H
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Grèves féministes et syndicalisme au Pays Basque

Onintza Irureta Azkune et Aiala Elorrieta Agirre 4 juin 20252025-06-04T08:28:08+01:00
Alors que dans de nombreux pays, le syndicalisme connait un certain essoufflement et peine à se renouveler, au Pays Basque, la confédération syndicale Eusko Langileen Alkartasuna (ELA) née il y a plus d'un siècle, est parvenue à se transformer pour s'adapter aux évolutions du salariat et aux exigences des travailleur·ses.
Avec Borrokan !, les Éditions syndicalistes montrent comment ce renouvellement a pu permettre des victoires dans des grèves féministes. Le livre, coordonné par la journaliste Onintza Irureta Azkune et l'économiste Aiala Elorrieta Agirre rejoint le catalogue de la collection Féministes qui veut « contribuer à la féminisation de nos syndicats et à la syndicalisation du féminisme ».
Nous publions ici un extrait qui explique les transformations opérées par le syndicat et revient sur sa structuration, reflétant ses orientations de lutte et démocratiques. Borrokan. Comment gagner une grève féministe, Editions Syndicales, 2025
ELA, un modèle syndical original et efficace
Borrokan ! En lutte ! C'est le mot d'ordre d'ELA, principal syndicat en Euskal Herria (le Pays basque). Mais ce qui fait la force et l'originalité de ce syndicat, c'est qu'il a su faire de cette formule bien plus qu'un slogan. Les militant·es de cette organisation ont su se donner les moyens de mener réellement des luttes et de les gagner, quitte à devoir pour cela bousculer beaucoup d'évidences syndicales solidement ancrées : le poids accordé au dialogue social, la conception masculine de l'action militante, la structuration autour d'une multitude de fédérations de branche, ou encore la focalisation sur le salariat stable. Grâce à cette remise en question permanente, ELA est le syndicat majoritaire en Euskal Herria, avec plus de 40 % de représentativité sur les trois provinces de la Communauté autonome du Pays basque, plus de 100 000 adhérent·es, dont presque la moitié de femmes, soit 10 % du salariat du territoire (c'est environ le taux de syndicalisation en France pour l'ensemble des syndicats)… et une lutte gagnée tous les trois jours.
Mais d'où vient ce modèle syndical qui semble si efficace ? La confédération syndicale ELA, Eusko Langileen Alkartasuna (Solidarité des travailleurs et travailleuses basques), a été fondée en 1911. Elle plonge ses racines dans le courant du syndicalisme chrétien, mais la longue période de la dictature franquiste, la répression et la clandestinité ont changé la donne. En 1976, à son 3e congrès, ELA affirme ses valeurs de base : un projet de construction nationale pour le peuple basque ; un syndicalisme de classe et socialiste. On peut y ajouter une très forte culture d'organisation, notamment interprofessionnelle, ainsi que son indépendance politique et financière.
Grâce à ces appuis solides, ELA a su évoluer peu à peu vers un syndicalisme de contre-pouvoir, délaissant l'intégration institutionnelle pour miser sur l'implantation auprès des travailleurs et des travailleuses, à la base. Cette stratégie porte rapidement ses fruits, et ELA devient le premier syndicat du Pays basque, sans pour autant se reposer sur ses lauriers. Malgré un dynamisme à faire pâlir d'envie la plupart des autres syndicats d'Europe, le congrès de 1990 pose ainsi un constat sans appel : « ELA est refermé sur lui-même, coupé de la société, dénué de capacité d'initiative et incapable de riposter ». ELA anticipe ainsi les transformations en cours du salariat, l'augmentation de la précarité et la destructuration des bastions ouvriers. Pour survivre, la confédération doit sortir de ses viviers de militant·es historiques, et aller au-devant de ces salarié·es plus précaires et fragiles.
Un projet confédéral global
Le cas de cette confédération est particulièrement intéressant sur un aspect : elle a su aller au-delà des constats, et mettre en œuvre les transformations requises dans son organisation et son fonctionnement pour répondre aux évolutions du salariat. Le cadre de ces transformations est l'idée, héritée de la génération issue de la fin du franquisme, que la seule structure qui doit perdurer est la confédération. À l'intérieur, les fédérations comme les unions interprofessionnelles sont des organes fonctionnels, reposant sur les sections syndicales sur les lieux de travail : elles doivent évoluer selon les réalités du salariat et les orientations stratégiques et revendicatives adoptées en congrès. L'organisation interne, adaptée à un moment donné du capitalisme, ne doit pas rester figée pour être en mesure de répondre aux transformations du système productif.
Ainsi, à partir de 1993, les 12 fédérations existantes sont peu à peu regroupées en 3 fédérations : services publics, services privés, et industrie-construction. Chaque fédération correspond à des formes d'organisation du travail, et donc à des manières d'organiser les salarié·es, plutôt qu'à des secteurs bien définis : une pour toute la fonction publique, industrie pour les concentrations d'emploi et les lieux où il y a un collectif de travail stable, et services privés pour les lieux d'emplois éclatés, sans communauté de travail cohérente. Un rôle central – et des moyens importants – sont conférés aux structures interprofessionnelles, les 12 comarcas (qui sont des sortes d'unions interprofessionnelles de bassin d'emploi, se rapprochant des Unions départementales françaises) qui rassemblent les 42 Unions locales. Ces comarcas ne correspondent volontairement pas à un découpage administratif, notamment pour éviter la formation de « baronnies » territoriales.
Les fédérations ont perdu leur rôle identitaire, au profit de la confédération : on est d'abord adhérent·es à ELA, qui collecte les cotisations, avant de l'être à une fédération particulière. Plus encore, c'est la distinction même entre les niveaux professionnels et interprofessionels qui s'efface : les fédérations sont représentées dans chaque comarca, les permanent·es ne sont pas cantonné·es à une structure mais sont amené·es à circuler (un·e permanent·e d'une fédération est ainsi amené·e à devenir permanent·e d'une comarca, puis d'une autre fédération, par exemple). Les élu·es du personnel dans les entreprises sont incité·es à mutualiser une partie de leurs heures de délégation pour appuyer les secteurs moins organisés – car ces heures sont dûes à tout le syndicat, et non aux seul·es salarié·es d'une entreprise donnée. On obtient ainsi un modèle confédéral « compact », véritablement décloisonné et au service des salarié·es, capables d'organiser avec succès le salariat précaire. Le fonctionnement n'est pour autant pas dirigiste, avec une forte culture démocratique et des assemblées générales fréquentes dans les entreprises et les territoires, pour favoriser en permanence l'implication des militant·es.
Les champs professionnel et interprofessionnel ne sont pas isolés l'un de l'autre, mais travaillés ensemble au quotidien : activité permanente vers les petites et moyennes entreprises, élections professionnelles, syndicalisation, tournées des boîtes, luttes locales et négociations, services juridiques, mise en œuvre des orientations stratégiques, alliances avec le mouvement social et associatif (notamment dans le collectif Charte des droits sociaux de Euskal Herria ; mais aussi avec le collectif confédéral d'Action sociale, décliné dans les comarcas, et qui permet aux militant·es de ELA d'allier leur militantisme dans le syndicat et dans le mouvement social), etc. C'est ce que ELA appelle la comarca integral : un outil de mise en œuvre des orientations confédérales, adaptées au niveau du territoire, en concevant le syndicat comme une organisation ouverte sur la société, et non pas enfermée sur le seul lieu de travail.
Une véritable autonomie financière
Une clé de ces transformations est l'autonomie du syndicat : les orientations doivent être définies de l'intérieur, et non pour se couler dans les institutions de dialogue social qui financent le syndicalisme. Une autonomie politique donc, mais qui doit être une autonomie financière pour être réelle. ELA s'est désengagée des institutions du paritarisme, se coupant ainsi des financements qui les accompagnaient, et a misé sur une hausse des cotisations mensuelles : 26 € pour un·e salarié·e à temps plein, 20 € pour un·e salarié·e à mi-temps, chômeur·e ou retraité·e, et 13 € pour les plus précaires (très faible temps de travail, retraité·e ou chômeur·e non indemnisé·e…) [1]. Bilan : aujourd'hui, ELA est financé à plus de 90 % par ses ressources propres – les cotisations de ses membres. Le syndicat est ainsi matériellement autonome de tout support extérieur.
À quoi servent ces cotisations ? Un quart sert à alimenter la « caisse de résistance », caisse de grève confédérale qui permet à ELA de tenir et de remporter des conflits très longs et très durs, de plusieurs mois, voire plusieurs années. La caisse permet de verser une indemnité de 1400 € (par mois et par gréviste), supérieure au salaire minimum, qui peut être renforcée à hauteur de 1600 € si l'entreprise compte suffisamment de syndiqué·es ELA ; voire, si la grève présente un intérêt stratégique pour la confédération, de plus de 2200 € (l'indemnité de grève ne peut pas dépasser le salaire perçu en temps normal). Des dizaines de millions d'euros ont déjà été versés par la caisse, avec à la clé de nombreuses victoires, de meilleurs salaires et plus de syndiqué·es… et donc plus d'argent pour la caisse de grève.
Une partie finance également les services juridiques d'ELA, qui comptent une centaine de personnes, et ont monté des milliers de dossiers chaque année. La présence de juristes permanent·es dans chaque comarca permet de développer la syndicalisation, en particulier des salarié·es les plus précaires, qui viennent souvent pour une assistance juridique immédiate.
Assistance juridique individuelle et collective, accès à la caisse de grève : avec de tels arguments, pas besoin de débattre longtemps des taux de cotisation trop élevés : les syndiqué·es voient bien où va leur argent, et les salarié·es sont prêt·es à adhérer.
Le résultat parle de lui-même : une lutte victorieuse tous les 3 jours en 2023, un niveau de grève au Pays basque qui est le plus élevé d'Europe, des salaires largement supérieurs à ceux du reste de l'Espagne dans de nombreux secteurs… et une marginalisation des syndicats qui ont joué le jeu du dialogue social (CCOO et UGT), en perte de vitesse depuis des années.
Un syndicat en expérimentation permanente
L'autonomie véritable de ELA permet à son fonctionnement et à ses valeurs cardinales de se concrétiser et d'évoluer en fonction des débats, des analyses et des bilans sur la situation politique et socio-économique et les évolutions du salariat.
Par exemple, après avoir appuyé le statut de la Communauté autonome du Pays basque (qui regroupe trois provinces situées sur la partie espagnole), comme cadre pour avancer vers la construction de relations professionnelles et sociales propres au Pays basque, ELA se rend compte que ce statut n'est plus un moyen adapté pour y arriver. Lors de son dernier congrès confédéral en novembre 2021, la confédération adopte la revendication d'une République basque indépendante. Le statut d'autonomie est un cadre épuisé.
On n'entrera pas ici dans les détails des orientations de ELA sur les questions socio-économiques, écologiques, internationales, etc. Elles sont proches de celles que l'on retrouve en France à la CGT, Solidaires ou la FSU. ELA a notamment mis l'accent sur le rôle clé du syndicat dans la transition écologique, et pose « la nécessité d'un changement de système de production, de distribution et de consommation permettant de répondre à la nécessité de faire décroître l'utilisation des ressources ». Cette transition devra faire le passage du « système capitaliste actuel, hétéropatriarcal, raciste, colonialiste et écocide, à un modèle social, féministe, antiraciste et éco-socialiste qui place en son cœur la vie et le soin » [2].
Vers un syndicalisme féministe
Le travail de questionnement et d'évolution permanente de la confédération s'est matérialisé sur un autre thème : celui du genre. ELA s'est donné pour objectif de devenir un syndicat féministe, et après un travail de diagnostic et de réflexion commencé en 2014, le syndicat a adopté un plan d'équité de genre en 2021. Ce plan fait l'objet de bilans d'étapes réguliers, et prévoit des évolutions sur le plan revendicatif comme sur celui du fonctionnement interne du syndicat. Il vise à faire adopter une grille d'analyse en termes de genre à chaque échelon de l'organisation : dans les négociations, la conduite des grèves, le travail juridique, les élections, la formation…
Ce plan ambitieux a pu être effectivement mis en œuvre grâce à la mise en place d'une « architecture de genre » au sein du syndicat : celle-ci consiste en un réseau de militant·es, les Irule, chargé·es de faire le lien entre ce que prévoit le plan d'équité de genre et chaque domaine d'action du syndicat (juridique, formation, négociation collective, bureau d'études, etc.). Grâce à un temps de décharge dédié à cette tâche, iels apportent une perspective de genre à tous les niveaux, et sont aussi chargé·es de collecter des informations et de partager les expériences, via différents lieux de coordination sur le sujet. Cette démarche interroge également le fonctionnement de la confédération, et veut « démanteler le modèle du syndicaliste idéal » en s'attaquant aux obstacles concrets au militantisme des femmes, notamment pour celles qui doivent s'occuper de leurs enfants et ne peuvent militer sur leur temps libre.
Un aspect central de la démarche d'ELA sur le sujet est la stratégie volontariste en direction des secteurs les plus féminisés et les plus précaires. L'organisation du syndicat, avec des services juridiques efficaces et surtout une caisse de grève solide, se sont révélés être des outils très efficaces pour y mener des grèves, dont plusieurs ont été très longues et sont devenues emblématiques. Ces conflits, pas forcément vécus comme féministes au départ par les salariées qui se battent notamment pour des augmentations de salaire, sont devenus des occasions de politisation féministe.
Ce livre raconte deux de ces luttes, étalées sur plusieurs années : celle des maisons de retraite de Bizkaia d'abord, qui totalise des milliers de jours de grève au fil des négociations des conventions collectives successives [3]. On y voit la construction par étapes d'une mobilisation puissante, qui a su sortir des frontières de l'entreprise et mettre en mouvements des milliers de salariées éparpillées dans des établissements répartis sur toute la province… et la naissance d'une véritable conscience de classe sans besoin de regrouper ces salariées dans une fédération propre à leur secteur.
Le deuxième texte relate la lutte des travailleuses du nettoyage, menée sur une base originale[4] : elles ne se sont pas contentées de pointer les écarts de salaire au sein d'une même entreprise ou d'une même branche, mais ont mis en avant l'écart de salaire entre des secteurs dont les salarié·es présentent des qualifications proches. D'un côté, le nettoyage urbain, très masculin, de l'autre, le nettoyage des bureaux, très féminisé. La dimension territoriale de la lutte touche des travailleuses d'employeurs différents, du secteur public comme du secteur privé ; une manière d'adapter nos combats aux évolutions du système capitaliste et l'organisation du travail qui en découle.
Cet ouvrage rend compte de la puissance de l'organisation collective à la base quand elle dépasse les frontières habituelles du syndicalisme. Ce récit de conscientisation, organisation et mobilisation, ce récit de grève, est une leçon d'émancipation dont nous avons tou·tes à apprendre si nous voulons construire un syndicalisme qui soit réellement de lutte de classes.
Aux Éditions syndicalistes comme au sein du collectif Syndicalistes !, les pratiques d'ELA et les victoires rapportées ici nous enthousiasment et nous inspirent. Il est urgent que nos syndicats se transforment à leur tour en profondeur pour aligner les discours et les pratiques. Nous voulons rendre nos luttes plus efficaces et fédératrices au-delà des cercles militants déjà convaincus. Nous voulons nous aussi que multiplier les victoires et unir les classes laborieuses.
Bibliographie en français sur ELA
Christian Dufour & Adelheid Hege, « 12e congrès de ELA, confédération syndicale basque », Chroniques internationales de l'IRES, no 117, 2009, p. 27-36 [en ligne].
— , « Congrès de ELA : redéfinir les priorités syndicales en temps de crise », Chroniques internationales de l'IRES, no 140, 2013, p. 41-54 [en ligne].
— , « À son 14e congrès, la confédération ELA présente un projet “plus politique que jamais” », Chroniques internationales de l'IRES vol. 2, no 158, 2017, p. 27-39 [en ligne].
« Vers une métamorphose féministe », Enbata, 2022 [en ligne].
Jon Las Heras & Lluis Rodriguez, « Un peu de réalisme stratégique. Ou comment faire une caisse de grève efficace », Syndicalistes !, 2023 [en ligne].
« 30 novembre : grève féministe générale en Euskadi » [en ligne] et « Euskadi : succès de la grève générale féministe ! », Syndicalistes !, 2023 [en ligne].
Leire Gallego, « Un bilan de la grève générale féministe du 30 novembre 2023 », Syndicalistes !, 2024 [en ligne].
SDR Amazon : une brèche dans le colosse, Manu Robles-Arangiz Fundazioa, 2025 [en ligne].
*
Traduction, prologue et notes par Baptiste, Laura et Michel, qui participent au site syndicalistes.org
Illustration : Célébration de la victoire le vendredi 27 octobre 2017 après plus de 2 ans de luttes des maisons de retraite privatisées de Biscaye.
Notes
[1]Pour comparaison, le niveau moyen de cotisation à la CGT est inférieur à 13 € par mois, alors même que les salaires sont largement supérieurs en France, et que la cotisation syndicale est ensuite remboursée aux 2/3 par les impôts…).
[2]Résolution au 15e congrès confédéral de ELA.
[3]Cette partie est la traduction d'un ouvrage de Onintza Irureta Azkune (journaliste au média Argia), Berdea da more berria. Bizkaiko egoitzetako grebalarien testigantzak (Le vert [couleur de ELA] est le nouveau violet [couleur de nombreux mouvements féministes] : témoignages de grévistes des résidences de Bizkaia), paru en 2019 chez Argia.
[4]Cette seconde partie est la traduction d'une brochure de Aiala Elorrieta Agirre (économiste à la fondation Manu Robles-Arangiz), Nola garbitu soldata arrakala (Comment combler l'écart salarial), publiée en 2023 par la fondation Manu Robles-Arangiz.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Ukraine : Solidarité avec les millions de personnes déplacées

De la protection temporaire….
Immédiatement après l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, le 24 février 2022, un statut de « protection temporaire » a été activé et défini par une décision du Conseil de l'Union européenne (UE) du 3 mars 2022 pour les personnes déplacées d'Ukraine. Il résulte de la mise en exécution d'une directive européenne de 2001. Les pays de l'UE, à l'exception du Danemark, ont transposé cette directive au niveau national.
2 juin 2025 | tiré du site Entre les lignes entre les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/06/02/ukraine-solidarite-avec-les-millions-de-personnes-deplacees/
En France, sa mise en œuvre a été remodelée à plusieurs reprises dans un sens plus favorable, notamment au niveau des droits sociaux. Son champ d'application a été précisé par la circulaire interministérielle du 10 mars 2022 puis par l'instruction du 22 mars 2022, relative à l'hébergement et au logement.
Le droit au séjour :
Les personnes éligibles à la PT sont :
➤ les ressortissant•es ukrainien•es ayant quitté l'Ukraine à partir du 24 février 2022 ;
➤ les ressortissant•es ukrainien•nes se trouvant en court séjour (moins de 90 jours) sur le territoire de l'UE à la date du 24 février 2022, mais pouvant établir qu'ils ont une résidence permanente en Ukraine ;
➤ les non-Ukrainien•nes bénéficiant en Ukraine du statut de réfugié•e ou apatride ;
➤ les non-Ukrainien•nes qui étaient titulaires d'un titre de séjour en Ukraine avant le 24 février 2022 et qui ne peuvent rentrer dans leur pays dans des conditions « sûres et durables », conditions qui sont appréciée par les préfectures après un entretien individuel ;
➤ les membres des familles des personnes précitées, y compris des ressortissant•es de pays tiers sans que ne leur soit opposable la possibilité de rentrer dans leur pays dans des conditions « sûres et durables ».
Sont exclu.e.s du bénéfice de la PT :
➤ les Ukrainien•nes présent•es en France avant le 24 février 2022 et en situation irrégulière ;
➤ les personnes non-ukrainiennes arrivées en France après le 24 février et dont la préfecture aura estimé qu'elles peuvent retourner dans leur pays d'origine ;
➤ les personnes ayant demandé l'asile en Ukraine (mais qui pourront demander l'asile en Europe, sans que le « règlement de Dublin » ne s'applique).
La revendication d'inclure ces groupes de personnes dans les ayants droit à la PT s'est faite jour en 2022 en France. Cela revenait à appliquer l'article L581-7du CESSE : « Dans les conditions fixées à l'article 7 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, peuvent bénéficier de la protection temporaire des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil prévue à l'article 5 de cette même directive, lorsqu'elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d'origine. » La France a ignoré cette possibilité légale, à la différence de l'Espagne ou des Pays-Bas, qui en ont fait une interprétation plus généreuse.
En février 2025, 4 219 975 personnes bénéficiaient de la PT en Europe (Source : Statista), dont 98% d'Ukrainien•nes – la minorité étant composée de Russes (12 381), de Nigérians (4 988) et d'Azéris (4 235). En France, ils et elles étaient 55 680 (source : Statista). Ce sont les préfectures qui délivrent en France les autorisations provisoires de séjour (APS) de six mois renouvelées automatiquement. L'UE a reconduit la PT jusqu'en mars 2026.
Les droits sociaux
Cette APS ouvre automatiquement le droit à l'exercice d'une activité professionnelle, de s'inscrire à Pôle emploi/ France Travail et de percevoir des indemnités chômage.
La PT ouvre le droit à l'allocation pour demandeur•euse d'asile, à l'assurance maladie sans délai de carence ainsi qu'à une complémentaire santé sans examen des ressources, ainsi qu'aux allocations familiales et à l'APL.
Toute personne déplacée d'Ukraine a eu droit à un premier accueil d'urgence, puis un hébergement transitoire a été offert aux personnes bénéficiaires de la PT. Cet hébergement a été souvent le fait d'associations, grâce surtout à l'hébergement citoyen, encouragé. Cette seconde phase, qui a pris fin avec l'absence de budget dédié en 2025, devrait déboucher à terme sur la mise à disposition de logements pérennes par des acteurs publics ou privés. Les bénéficiaires de la PT peuvent demander un logement social.
Le droit aux études
Les étudiant•es bénéficiaires d'une PT inscrit•es pour des études supérieures peuvent obtenir une bourse selon des critères sociaux.
L'apprentissage du français est offert dans le cadre de l'intégration républicaine sans que les personnes aient à signer ledit contrat. Une formation linguistique est prévue dont le contenu a été précisé le 3 mai 2022. Les enfants sont scolarisés obligatoirement jusqu'à 16 ans. L'accueil en crèche est gratuit.
Le droit de vivre en famille
Les bénéficiaires de la PT ont le droit d'être rejoints par les membres de leur famille (conjoint•e, partenaire dans une relation stable, enfant mineur, personne à charge) qu'il soit bénéficiaire de la protection dans un autre État ou qu'il soit hors UE.
Accès au droit d'asile
Les personnes sous PT et les demandeurs d'asile en Ukraine peuvent demander l'asile sans être placées sous procédure Dublin. En cas de rejet, les premières ne perdent pas la PT.
L'accès à la protection temporaire
La personne désirant être protégée doit, dans un délai de 90 jours après son entrée en France, se présenter en préfecture ou via des guichets internet de cette dernière. Ce premier accueil doit informer les personnes, quelle que soit leur nationalité, sur leurs droits au séjour, y compris les personnes en transit, recenser celles présentant des vulnérabilités, évaluer les besoins en hébergement, et prendre en charge les besoins essentiels (alimentation, hygiène, habillement).
… à la demande d'asile
La mise en œuvre de la directive, si elle a eu l'inconvénient de créer une nouvelle catégorie d'exilé•es avec des droits différents, a eu le mérite d'avoir offert aux personnes déplacées d'Ukraine des droits inédits. L'Europe forteresse ne serait donc pas une fatalité. Et la mise à disposition de moyens, quoi qu'il en coûte, s'est révélée une question de volonté politique. Par ailleurs, la mise en œuvre de la directive a révélé que le règlement de Dublin est une fois de plus inapplicable et est passée outre ce dernier.
L'impossibilité de retourner en Ukraine pour beaucoup, le caractère temporaire de cette protection, sa reconduction, incertaine d'année en année, ajoutés à l'exclusion des bénéficiaires de la PT d'un certain nombre de droits – allocation de rentrée scolaire, allocation adultes handicapés, revenu de solidarité active, prime d'activité, allocation personnes âgées, etc., – poussent de plus en plus de bénéficiaires de la PT à demander l'asile en France. En 2024, la demande d'asile des Ukrainien•nes a été multipliée par 4, portant leur nombre à plus de 11 800, ce qui en a fait la deuxième nationalité après les Afghans. Elle concerne des femmes, d'âge mûr, et bénéficiaires de la PT. Deux types de réponses peuvent être apportés :
– le bénéfice du statut de réfugié•e en France, ouvrant le droit à un titre de séjour de dix ans, extrêmement rare en ce qui concerne les Ukrainien•es, du fait des critères définissant le-la « réfugié•e », une personne craignant des persécutions du fait de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions ;
– le bénéfice de la protection subsidiaire (en raison de menace grave et individuelle contre la vie ou la personne du demandeur•euse, en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international) ouvrant le droit à un titre de séjour de quatre ans. Ces critères ont permis d'accorder le bénéfice de cette protection aux Ukrainien•nes venu•es des régions orientales et méridionales de l'Ukraine. Pour les autres, ce sera un refus et leur maintien dans le statut de la PT.
L'après-mars 2026 se prépare en Europe : la Pologne, la République tchèque et l'Italie ont pris des mesures permettant aux personnes de sortir de la PT par l'octroi de permis de séjour basés sur l'emploi, ce que semblait préconiser aussi Michel Barnier : « Accélérer l'accès au séjour des bénéficiaires de la protection temporaire les mieux insérés » (4 décembre 2024)
Télécharger le document complet au format PdF :
4-pages-REFUGIESV6-LB-MS
****
Pour une paix juste et durable en Ukraine plus que jamais renforcer le soutien à la résistance du peuple ukrainien
Télécharger le document complet au format PdF :
resu_4-pages-ukraine_mai-2025
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Qu’est-ce qui empêche la fin de la guerre en Ukraine ? Deux problèmes principaux

9 juin 2025 | Lettre de Vitaly Dudin
Malgré certaines attentes, la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine se poursuit et s'intensifie. Chaque jour, je vois des images terribles de destructions massives dans ma ville natale de Kyiv, à Kharkiv et dans d'autres belles villes, et qui sont difficiles à imaginer. Des scènes dignes d'un film catastrophe font désormais partie de notre quotidien. Les endroits où nous avions l'habitude de nous promener sont réduits à un tas de cendres et de ruines. Pendant ce temps, les envahisseurs russes lancent de nouvelles attaques, non seulement à l'est et au sud, mais aussi au nord, dans la région de Soumy. Ici, en Ukraine, cette guerre a véritablement le caractère d'une guerre populaire en raison de l'ampleur de la participation de la population à l'effort de guerre : plus d'un million de personnes servent dans l'armée, un peu plus sont engagées dans les secteurs critiques des infrastructures et beaucoup d'autres participent à des activités bénévoles.
Les négociations d'Istanbul cachent les plans expansionnistes de Moscou et ont peu de chances d'aboutir.
Même ma vie de civil et de militant pour les droits du travail a radicalement changé. Je reçois des messages de cheminots qui ont besoin d'argent pour acheter des drones et d'autres équipements ; des proches de travailleurs morts lors de frappes de missiles sur leur lieu de travail m'informent des problèmes liés à l'aide sociale ; des infirmières près de la ligne de front se plaignent de ne pas recevoir les primes auxquelles elles ont droit. Nous parvenons parfois à surmonter ces difficultés, mais nous voulons tous que la guerre se termine le plus rapidement possible.
Bien sûr, la résistance héroïque des défenseurs ukrainiens et les opérations spéciales remarquables menées sur le territoire russe ont largement contribué à démilitariser la machine de guerre du Kremlin. Mais après avoir perdu le soutien militaire des États-Unis, les chances de victoire stratégique de l'Ukraine se sont amenuisées.
Les négociations d'Istanbul ont clairement démontré que la position ukrainienne était devenue beaucoup plus flexible et visait une solution pacifique (un cessez-le-feu de 30 jours, par exemple). Au contraire, les exigences russes semblent encore plus offensives et agressives. Grâce à Donald Trump, la Russie a pris l'initiative sur le champ de bataille, ce qui reflète la réalité objective. L'impossibilité de mettre fin à la guerre découle de la faiblesse de la position de négociation de l'Ukraine et ne peut être surmontée par une mobilisation plus sévère des hommes.
Alors, quels sont les facteurs qui affaiblissent l'Ukraine ?
Problème n° 1 – Le pseudo-pacifisme des forces progressistes occidentales
Le premier problème est particulièrement douloureux à admettre pour moi. Beaucoup de personnes au sein du mouvement socia7liste refusent traditionnellement d'aborder des questions telles que la violence, l'État et la souveraineté. Cela les conduit à une mauvaise compréhension de la situation ukrainienne. Certaines d'entre elles ne reconnaissent pas la nature décoloniale et anti-impérialiste de la lutte ukrainienne. Cette analyse repose sur une vision dépassée du système international, où les États-Unis sont considérés comme le seul impérialiste et la Russie comme sa victime. Même Donald Trump, qui « comprend » chaleureusement le sentiment impérialiste de Poutine, n'a pas changé les conclusions des personnes qui se disent intellectuels de gauche. Les régimes les plus réactionnaires de l'histoire américaine et russe exercent une pression énorme sur l'Ukraine, tandis que certains cherchent des arguments pour expliquer pourquoi la nation attaquée ne mérite pas le soutien international. Je me demande comment les protagonistes de la théorie de la « guerre par procuration » vivent avec le fait que l'Ukraine poursuit son combat sans l'aide directe des États-Unis et malgré leur opposition.
Beaucoup de militants de gauche s'opposent au soutien militaire en raison de leur éthique antimilitariste. Fournir une motivation philosophique sophistiquée pour ne pas envoyer d'armes à un pays envahi conduit à davantage de souffrances pour des innocents. Le caractère contradictoire de cette affirmation devient particulièrement absurde lorsqu'elle est défendue par ceux qui se prétendent révolutionnaires ou radicaux... Pour moi, il est clair que ces rêveurs veulent mener une vie prospère au sein du système capitaliste sans avoir de réelles perspectives de le renverser. Être contre l'armement, c'est se réconcilier avec le mal de l'esclavage.
Vivre sous la protection de l'OTAN et craindre une « militarisation excessive » de l'Ukraine semble hypocrite.
Et l'inverse : si les travailleurs ukrainiens gagnent la guerre, ils seront suffisamment inspirés pour poursuivre leur lutte émancipatrice pour la justice sociale. Leur énergie renforcera le mouvement ouvrier international. L'expérience de la résistance armée et de l'action collective est une condition préalable essentielle à l'émergence de véritables mouvements sociaux qui remettront en cause le système.
Problème n° 2 : l'incapacité de l'État ukrainien à faire passer l'intérêt public avant les intérêts du marché
Les élites au pouvoir en Ukraine promeuvent le libre marché et le système axé sur le profit comme seul mode d'organisation possible de l'économie. Toute idée de planification étatique ou de nationalisation des entreprises peut être rejetée comme un héritage soviétique. Le problème est que la version ukrainienne du capitalisme est totalement périphérique et incompatible avec la mobilisation des ressources nécessaires à l'effort de guerre.
Le dogmatisme idéologique dominant place l'Ukraine dans le piège de la privatisation économique et d'une grande dépendance à l'aide étrangère.
Nous vivons dans un pays où les hommes d'État sont riches et l'État pauvre. Le gouvernement tente de réduire sa responsabilité dans la gestion du processus économique et d'éviter d'imposer une taxe progressive élevée aux riches et aux entreprises. Cela conduit à une situation où le fardeau de la guerre est supporté par les citoyens ordinaires qui paient des impôts sur leurs maigres salaires, qui servent dans l'armée, qui perdent leur maison...
Il est impossible d'imaginer un chômage en période de guerre totale. Mais en Ukraine, il existe parallèlement à un niveau extrêmement élevé d'inactivité économique de la population et à une pénurie incroyable de main-d'œuvre. Ces lacunes s'expliquent par la réticence de l'État à créer des emplois et par l'absence de stratégie visant à impliquer massivement la population dans l'économie par le biais des agences pour l'emploi. Nos politiciens pensent que les déséquilibres historiques sur le marché du travail peuvent être résolus sans intervention active de l'État ! Malheureusement, les réformes de déréglementation mises en place pendant la guerre ont créé de nombreux facteurs dissuasifs qui découragent les Ukrainiens de trouver un emploi salarié. C'est pourquoi la qualité de l'emploi doit être améliorée par une augmentation des salaires, des inspections du travail rigoureuses et un large espace pour la démocratie sur le lieu de travail.
Seule une politique socialiste démocratique peut ouvrir la voie à un avenir durable pour l'Ukraine, où toutes les forces productives travailleront pour la défense nationale et une protection socialement juste.
Nous devons maintenant aller droit au but. Sans un soutien militaire et humanitaire complet, l'Ukraine ne sera pas en mesure de protéger sa démocratie et sa défaite aura des répercussions sur le niveau de liberté politique dans le monde entier. Mais d'un autre côté, nous devons critiquer les responsables gouvernementaux ukrainiens et leur incapacité à mettre fin au consensus néolibéral qui sape l'effort de guerre. Il serait particulièrement difficile de gagner une guerre contre un envahisseur étranger alors que le pays est confronté à de nombreux problèmes internes, liés à une économie capitaliste dysfonctionnelle.
9 juin 2025
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les élections législatives mises en perspective. Les défis du Bloco de Esquerda

4 juin 2025 | tiré du site alencontre.org | Photo : Mariana Mortágua en conférence de presse.
https://alencontre.org/europe/portugal/portugal-dossier-les-elections-legislatives-mises-en-perspective-les-defis-du-bloco-de-esquerda.htmlOnintza Irureta Azkune et Aiala Elorrieta Agirre

Les résultats électoraux portugais définitifs des législatives du 18 mai (voir article publié le 21 mai) sont tombés suite à l'enregistrement des résultats recueillis dans les deux circonscriptions de l'émigration (« des expatrié·e·s »). Quatre députés sont élus dans ces circonscriptions. Fin mai, les résultats sont les suivants : 2 élus pour Chega (extrême droite « ça suffit ») et 2 pour l'Alliance démocratique (coalition de droite formée par le Parti social-démocrate (PPD/PSD), le CDS – Parti populaire-CDS-PP et le Parti populaire monarchiste-PPM). Dès lors, la droite AD détient 91 sièges (89 du PSD et 2 du CDS-PP) et Chega devient le deuxième parti en termes de députés, avec 60 élu·e·s. Le PS se retrouve déplacé au troisième rang avec 58 sièges.
Le quotidien Publico du 28 mai souligne que « dans la circonscription européenne, Chega remporte une victoire confortable avec 28,2% des voix, soit 10 points de pourcentage de plus qu'en 2024. L'AD n'a pas dépassé 14,7% et le PS, qui recule de la deuxième à la troisième place en Europe, a obtenu 13,5%. » Chega a obtenu ce résultat en recueillant particulièrement les voix des émigrant·e·s portugais vivant en France, en Suisse, en Belgique et aux Luxembourg. C'est la première fois, depuis 1976, que le PS n'élit pas de députés parmi les émigré·e·s, alors que la circonscription européenne était considérée comme « un bastion social-démocrate ».
Le graphique ci-dessous illustre la situation politique en termes parlementaires, à ce jour, 3 juin, où s'ouvre la XVIIe législature. Nous publions ci-dessous un premier bilan établi par le Bloco de Esquerda et diverses contributions. (Rédaction A l'Encontre)
*****
Le Bloco veut « résister » et « se relever », mais aussi « élargir ses alliances » pour continuer à se battre avec détermination
Par Bloco de Esquerda
Dans sa résolution, la direction du Bloco de Esquerda (Bloc de gauche) tire le bilan des élections législatives du 18 mai, au regard de la conjoncture et de la campagne du parti afin de trouver des réponses pour l'avenir.
Le Bloco de Esquerda a obtenu le pire résultat de son histoire à des élections à l'Assemblée de la République. Le Bloco regarde ces résultats avec préoccupation et entend dresser un bilan qui permette de corriger les erreurs commises, d'écouter l'ensemble de ses militant·e·s ainsi que des personnes qui ne sont pas membres du parti, et de faire porter à maturation une orientation qui assure la pérennité de ce projet politique, de sa présence dans les luttes sociales et de son offre alternative. Ce processus ne peut se faire dans la précipitation ni en cherchant une explication unique. Il exige du temps, de l'humilité, de l'ouverture et la volonté de trouver des voies que nous ne découvrirons qu'ensemble.
Le total des voix des partis à la gauche du PS est le plus bas jamais enregistré, et il en va de même lorsque l'on inclut le PS dans ce total. Ces défaites – de l'ensemble de la gauche et du Bloco – exposent le pays à de graves risques. Pour que nous puissions les comprendre, il faut étudier les facteurs qui ont déterminé ce désastre électoral, ainsi que les spécificités de chaque force politique. Cette résolution examine certaines conditions politiques nationales et internationales et leur impact, en particulier la manœuvre du Premier ministre [Luis Montenegro du PSD], l'effet de la place de l'immigration au cœur du débat politique et encore la peur de la guerre. Elle engage également une réflexion sur notre campagne.
Le contexte des élections
La crise politique créée par le Premier ministre Montenegro à la suite de la violation de son obligation de se consacrer exclusivement à sa tâche [conflit d'intérêts lié au maintien de la gestion de sa société immobilière par sa famille] s'est transformée une manœuvre sans précédent dans l'histoire récente du gouvernement, qui a contribué à la dégradation du climat politique. Elle s'est avérée être un succès pour Montenegro, en lui permettant de retrouver sa capacité d'initiative. Sa première déclaration, en faveur d'une révision constitutionnelle avec le soutien de l'Initiative libérale (IL-Iniciativa Liberal) et Chega (extrême droite), même si elle était enrobée dans une déclaration d'ouverture, est une menace flagrante et très grave contre certains des piliers des acquis démocratiques de la Révolution des Œillets [voir ci-après la contribution de Maria J. Paixão – réd.].
La place centrale prise par la question de l'immigration dans le débat politique a été un facteur important dans la défaite de la gauche. Le Portugal connaît l'une des transformations les plus profondes de sa composition sociale et du profil de sa classe laborieuse. En quelques années, le nombre de travailleurs étrangers a été multiplié par dix et représente aujourd'hui environ un tiers de la population active. Une partie importante de cette nouvelle classe ouvrière ne vient pas des pays lusophones. Dans ce contexte, la défaillance des services d'accueil et de régularisation et le manque de moyens consacrés à des réponses d'ensemble en matière de logement, de services publics et d'accès à la langue ont renforcé le discours de l'extrême droite. Ce discours a été repris par le gouvernement pour justifier la nouvelle législation et légitimé, par ailleurs, par le recul du PS sur cette question. Ce discours a été relayé par le sensationnalisme de certains médias et surtout par la manipulation des masses à travers les réseaux sociaux [1]. En effet, l'extrême droite a réussi à faire de l'immigration l'explication de toutes les difficultés de la population, du logement au système de santé.
Le Bloco et d'autres partis ont été pénalisés dans les urnes en raison de cette situation. La leçon à en tirer est que différents éléments restent essentiels : l'action militante antiraciste et antifasciste, la création d'espaces communs et unitaires, l'intervention dans les quartiers populaires où il faut affronter l'autoritarisme et les discours de haine. Il est indispensable de trouver les moyens d'ouvrir les syndicats aux travailleurs étrangers, de créer des mécanismes d'inclusion, d'empêcher l'exploitation des différences qui nourrissent le ressentiment social. La lutte contre la division de la classe laborieuse est essentielle aujourd'hui comme demain.
La réélection de Trump a des conséquences multiples en matière de politique internationale, qui favorisent l'extrême droite : premièrement, elle encourage le génocide à Gaza et place Netanyahou à l'abri des pressions internationales, en s'en prenant aux gouvernements qui ont dénoncé le génocide des Palestinien·nes, comme celui de l'Afrique du Sud ; deuxièmement, elle recherche une alliance avec Poutine ; troisièmement, elle met en place une internationale réactionnaire qui implique directement l'administration états-unienne dans les élections en Allemagne [soutien de JD Vance à l'AfD] et dans d'autres pays européens ; quatrièmement, elle utilise les droits de douane comme un instrument de politique économique visant à soumettre ses alliés et partenaires et à s'opposer à la Chine.
Dans ce contexte international, le Bloco de Esquerda a bien identifié le risque d'accentuation du virage à droite observé depuis un an, en particulier sous l'effet de la montée de la pression militariste dans ce nouveau contexte. Cette pression suscite la peur et fait basculer la politique vers la droite, amenant les partis du centre à accepter la course aux armements en Europe et la soumission à l'OTAN.
Ces trois facteurs – la stratégie de l'Aliança Democrática (coalition de la droite), qui a repris le discours sur la stabilité qui a donné la majorité absolue au PS en 2022 ; la centralité de la question de l'immigration, déterminante pour toute la politique nationale ; et la peur face à la propagande militariste – ont été déterminants dans le contexte général des élections.
La réponse immédiate à la menace qui pèse sur la Constitution
La plus forte évolution observée le 18 mai a été la progression de Chega. Ce résultat démontre sa capacité à conserver l'électorat qu'il avait récupéré parmi les abstentionnistes en 2024, tout en l'augmentant sur l'ensemble du territoire, en particulier dans les zones les plus défavorisées socialement, à l'intérieur du pays et dans les anciennes ceintures industrielles. Devenu, comme prévu, le deuxième parti en nombre de député·e·s (une fois le dépouillement des votes des circonscriptions électorales de l'émigration terminé), Chega entre désormais bel et bien dans la course pour le gouvernement. Cette nouvelle situation se traduira par une dégradation générale des conditions d'exercice de la démocratie, tant au parlement (où Chega mène depuis plusieurs années une stratégie de sape des conditions de débat et d'expression) que dans la société, avec la banalisation de la violence raciste, machiste, transphobe, homophobe et, plus généralement, fasciste. En devenant majoritaire dans le sud du pays et à Setúbal [à 40 km au sud de Lisbonne], et en renforçant son résultat dans tous les districts, l'extrême droite gagne des voix populaires, y compris de nombreuses voix qui étaient auparavant gagnées par les forces de gauche. Fort de cette représentation, Chega va aggraver sa campagne xénophobe et antidémocratique, en coordination avec les groupes criminels qui gravitent autour de lui (voir la récente attaque contre la manifestation du 25 avril par une bande néonazie, immédiatement applaudie par Chega).
Dans la nouvelle configuration parlementaire, aucun des trois principaux partis ne peut former une majorité avec des partis plus petits. Cependant, pour la première fois, les partis à droite du PS dépassent le seuil des deux tiers qui leur permet de modifier la Constitution. Ce fait prend une importance capitale dans la situation politique actuelle et représente un risque réel de modification régressive du système constitutionnel, compte tenu des antécédents du PSD en la matière, qu'il s'agisse de l'attaque contre les retraites menée dans le cadre du plan d'austérité imposé par la troïka, des propositions de révision de la loi électorale ou encore des récentes déclarations sur le droit de grève. Iniciativa Liberal (IL) et Chega ont déjà annoncé leurs intentions. Le Bloco de Esquerda considère qu'il est essentiel que toutes les voix et toutes les forces politiques qui se reconnaissent dans les valeurs et le texte de la Constitution du 25 avril [1976] s'expriment de manière unie, afin de défendre les libertés et les garanties qu'elle consacre.
Pour le Bloco, l'objectif n'est pas seulement de résister à la vague fasciste et xénophobe ou aux alliances possibles et dangereuses entre la droite et l'extrême droite, ou encore au soutien du PS au gouvernement de Montenegro. L'objectif du Bloco est de se relever, de se reconstruire, de créer et d'élargir des alliances et de lutter avec détermination pour notre peuple.
La campagne du Bloco
Dans le nouveau contexte politique, nous avons revu notre modèle de campagne. Nous avons donc décidé de nous concentrer sur quelques thèmes essentiels auxquels nous avons accordé la plus grande importance, en cherchant à les placer au centre du débat public : plafonnement des loyers, droits des travailleurs par équipes [3×8]] et impôt sur la fortune. Nous n'avons pas abandonné les autres combats programmatiques qui font l'identité du Bloco, tels que les services publics, l'égalité, le rejet de la xénophobie ou l'opposition à la guerre, mais nous nous sommes concentrés sur ces thèmes afin qu'ils deviennent notre marque distinctive. C'est également ainsi que nous avons évité un débat stérile sur la gouvernabilité, en mettant en avant les mesures qui permettraient d'améliorer la vie d'une partie importante de la population et que notre représentation parlementaire défendrait en toutes circonstances. Cette politique a porté ses fruits : la question du plafonnement des loyers a occupé une place importante dans le débat politique, elle a obligé tous nos adversaires à se prononcer, a été renforcée par les nouvelles de plus en plus alarmantes sur la crise du logement et a été identifiée par la population comme une solution crédible. Elle continuera d'être l'un des combats les plus importants pour la vie de notre peuple – même la majorité des familles de travailleur·ses, qui achètent leur propre maison, savent que leurs enfants ne pourront pas en faire autant et ne parviennent déjà pas à louer un logement. La deuxième proposition, sur le travail par équipes, a été soutenue par des milliers de travailleur·ses. Cependant, aucune de ces propositions n'a permis de relancer la dynamique électorale dans le contexte décrit ci-dessus.
Deuxièmement, notre campagne a favorisé les initiatives décentralisées de contact direct, par le porte-à-porte. Nous avons frappé à plus de vingt mille portes et lancé une forme d'action politique qui sera fondamentale à l'avenir. Nous l'avons fait de manière différenciée dans le pays, en mobilisant des jeunes militant·e·s, des adhérent·e·s récents et plus anciens, qui ont constaté qu'ils pouvaient intervenir directement et non pas en tant que spectateurs de la campagne électorale. Pour la même raison, nous avons remplacé les traditionnels meetings par des « cafés-débats », ouverts au dialogue avec tout le monde, et par des fêtes et des réunions publiques créatives et animées.
Troisièmement, nous avons mobilisé toutes nos forces, y compris avec les candidatures des fondateurs du parti. Ces candidatures n'ont pas eu d'effet électoral, mais elles ont eu un effet militant, dynamisant les campagnes dans les grands districts.
Ces choix n'ont pas permis d'inverser la tendance électorale et le Bloco a subi sa pire défaite. Et sachant que la discussion sur le bilan des élections permettra d'identifier les erreurs et d'évaluer, au-delà des questions mentionnées, les modèles de communication, les formes d'organisation, la pédagogie de la campagne, l'adéquation des réponses aux campagnes diffamatoires, ou d'autres aspects de cette bataille, le Bloco affirme qu'il ne cessera de lutter pour ce que nous avons mis en avant lors de ces élections : pour une politique populaire du logement, pour les droits de qui travaille, contre les inégalités et pour la qualité et le maintien des services publics, contre les menaces fascistes et pour l'unité dans la défense de la vie démocratique et des règles constitutionnelles qui la protègent.
Délibérations
Les 13 et 14 juin, à Porto, le Bloco de Esquerda accueille le congrès fondateur de l'Alliance de la gauche européenne pour les peuples et la planète, un nouveau parti politique européen qui réunit le Bloco de Esquerda (Portugal), La France Insoumise (France), l'Alliance de gauche (Finlande), Podemos (Espagne), l'Alliance verte et rouge (Danemark), Razem (Pologne) et le Parti de gauche (Suède). La montée des forces d'extrême droite et les crises sociales, environnementales et internationales exigent une coopération plus efficace de la gauche verte, féministe et antiraciste européenne. Le Bloco de Esquerda s'engage dans cette nouvelle alliance et invite ses adhérent·e·s et sympathisant·e·s à participer activement à ce temps de débat et d'apprentissage. Lors de ce congrès, ouvert à la participation d'autres forces de gauche, européennes et internationales, ainsi qu'aux mouvements sociaux et militants, nous souhaitons créer de nouvelles formes de travail solidaire et préparer des actions concrètes de mobilisation contre le capitalisme et la guerre, de résistance à l'extrême droite et de reconquête de majorités sociales à gauche.
Le Bloco de Esquerda continuera à préparer ses candidatures aux élections municipales, réaffirmant son engagement en faveur d'accords programmatiques pour une convergence à gauche, que ce soit avec le PS à Lisbonne pour battre Carlos Moedas [maire de Lisbonne depuis 2021, membre du PSD], ou pour affirmer des alternatives municipales à gauche. Même dans les communes où le Bloco a déjà présenté sa liste, il reste ouvert à des rapprochements, dans la mesure du possible, avec le PCP, Livre (les Verts), le PAN [Personnes-Animaux-Nature] et les mouvements citoyens.
Au vu des nombreuses adhésions de jeunes enregistrées tout au long de la campagne électorale et dans les jours qui ont suivi les élections, le Bureau national réitère son appel à participer au « Campement Liberté » qui se tiendra dans le centre du pays du 24 au 27 juillet. Cette rencontre, ainsi que d'autres rencontres élargies de formation et de débat politique, comme « Socialisme 2025 », qui se tiendra du 29 au 31 août, sont essentielles dans cette nouvelle phase de la vie du pays.
Face à la nouvelle situation politique et à la lourde défaite électorale du Bloco, le Bureau national décide de convoquer une nouvelle Convention nationale les 29 et 30 novembre. Il ne s'agit pas de reprendre le processus qui avait été suspendu en raison des élections, car le changement de la situation politique nationale, la nécessité d'une réflexion approfondie et de la définition d'une orientation pour les années à venir ne pouvaient être traités comme la simple conclusion d'un processus entamé en janvier 2025, alors que la convocation d'élections législatives n'était même pas envisagée et que Trump n'avait pas encore pris ses fonctions. Avec cette décision s'ouvre une nouvelle période pour la présentation de motions d'orientation avec une mise à jour de la liste des adhérent·e·s ayant le droit d'élire et d'être élu·e·s délégué·e·s. – 24 mai 2025 (Traduction par Pierre Vandevoorde – ESSF ; édition rédaction A l'Encontre)
[1] Le quotidien Publico, en date du 29 mai, titre « La désinformation augmente au Portugal et Chega est le parti qui y contribue le plus ». L'auteure de cet article, Barabara Baltarejo, cite une étude du MediaLab qui indique que, « parallèlement, André Ventura [chef de Chega] a été le leader politique qui a le plus dominé les réseaux sociaux, tant en termes de portée que de production de contenu. Il a atteint neuf millions de followers sur Facebook et 5,4 millions sur Instagram en seulement une semaine. Il convient de noter que les neuf millions de vues du leader de Chega sur Facebook sont plus de neuf fois supérieures au nombre de vues de tous les autres leaders politiques analysés par MediaLab. Les leaders du PSD, du PS, du BE, du Livre, du CDS et du PAN ont totalisé 724 079 vues. » (Réd. A l'Encontre)
*****
La démocratie et l'Etat social « sont en danger » avec la révision constitutionnelle de la droite
Par Bloco de Esquerda
Une délégation du Bloco de Esquerda composée de la coordinatrice du parti Mariana Mortágua et des dirigeants Fabian Figueiredo et Jorge Costa a été reçue ce jeudi 22 mai au palais de Belém [par le président de la République Marcelo Rebelo de Sousa. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des consultations menées par le président de la République au sujet des résultats électoraux, qui ne seront définitifs qu'après le dépouillement des votes des expatriés [voir résultats en introduction de ce dossier].
A l'issue de l'audience, Mariana Mortágua a souligné que « la droite n'a pas tardé à dire ce qu'elle pensait », dès les premières déclarations d'intention de l'Initiative libérale [IL] de profiter de la majorité parlementaire avec l'extrême droite [Chega] pour ouvrir un processus de révision constitutionnelle lors de la prochaine législature [voir article ci-après de Maria J. Paixão]. Selon Mariana Mortágua , c'est « la plus importante portée de ce virage à droite » dans le pays. Cette radicalisation « n'est possible que parce que le PSD s'est radicalisé », ouvrant la porte à la discussion du projet de l'IL « qui veut mettre fin aux services publics qui ont construit la démocratie ou de Chega qui veut mettre fin aux libertés individuelles ».
« Toute notre démocratie, l'Etat social, l'éducation, des acquis que nous considérons comme allant de soi, tels que l'accès à la santé, existent parce qu'elles sont inscrites dans la Constitution. Et c'est précisément cette Constitution qui est aujourd'hui menacée et que la droite veut attaquer », a souligné la coordinatrice du Bloco.
Mariana Mortágua a également défendu la nécessité « que toutes les forces de la démocratie et de l'Etat social s'unissent autour d'un objectif qui est d'empêcher la révision de la Constitution du 25 avril [1976] et de la démocratie portugaise ».
Interrogée par les journalistes sur la possibilité d'alliances entre les partis de gauche lors des prochaines élections municipales [septembre/octobre 2025], Mariana Mortágua a révélé que les réunions entre les partis organisées par le Bloco après les élections législatives de l'année dernière [10 mars 2024] « ont donné lieu à des discussions avec Livre (Verts) et le PAN [Personnes-Animaux-Nature] pour des projets de convergence lors des élections municipales ». Mortágua a réitéré son souhait que tous les partis de gauche, y compris le PS, s'unissent à Lisbonne pour battre Carlos Moedas (membre du PSD).
Quant à la perspective d'une stabilité gouvernementale actuellement en discussion, Mariana Mortágua a rappelé que « la dernière période de stabilité que ce pays a connue est celle où le Bloco de Esquerda a déterminé la solution gouvernementale et la majorité parlementaire » [suite aux législatives de 2015].
« A mesure que la politique se rapproche de la droite, ce pays ne connaîtra que l'instabilité. C'est pourquoi nous nous battons pour que la Constitution et la vie des gens soient marquées par la sécurité », a-t-elle conclu. (Article publié sur le site du Bloco le 22 mai ; traduction rédaction A l'Encontre)
*****
« Une Constitution peut-elle survivre à son esprit ? »
Journal de l'Assemblée constituante lors de sa session inaugurale du 2 juin 1975.
Par Maria J. Paixão

La commotion suscitée par les résultats électoraux du 18 mai 2025 était encore palpable lorsque l'Initiative libérale (IL) a attisé le feu en promettant d'entamer un processus de révision constitutionnelle. Ce sera, dans l'histoire de la démocratie portugaise, la première révision constitutionnelle dont l'approbation ne dépend pas de l'accord entre les deux partis du centre traditionnel – le PS et le PSD. En effet, la Constitution de 1976 prévoit que les modifications de son texte doivent être approuvées par une majorité des deux tiers des député·e·s en exercice, majorité détenue, après dimanche 18 mai, par le PSD, Chega et IL.
La Constitution approuvée le 2 avril 1976 constitue, comme toutes ses congénères, un pacte social. Le texte de la loi fondamentale est le fruit des tensions entre les forces politico-sociales qui se sont affirmées au cours des deux années qui ont séparé la révolution d'avril 1974 et la fin des travaux de l'Assemblée constituante [en avril 1975 sont élus 250 députés à une Assemblée constituante pour un mandat d'un an : le PS de Mario Soares obtient 116 députés, le PCP d'Alvaro Cunhal 30, le Mouvement démocratique portugais-MDP 5 ; le PPD-Parti populaire démocratique 81].
Il s'agit donc d'un projet de société issu des concessions mutuelles des mouvements et des idéologies en présence durant un long avril [d'avril 1974 à avril 1976, avec un tournant en novembre 1975 qui modifie les rapports de force socio-politico-militaires]. Ce projet reconnaît la propriété privée aux côtés du droit à l'autogestion et à la constitution de coopératives, ainsi que la propriété publique. Il consacre un large catalogue de droits civils et politiques, à tendance libérale, mais aussi un catalogue ambitieux de droits économiques, sociaux et culturels. Les partis politiques se voient reconnaître la fonction d'organiser et d'exprimer la volonté populaire, mais la mission de réaliser la démocratie économique, sociale et culturelle est également assumée par la mise en œuvre de mécanismes de démocratie participative. Tout au long du texte constitutionnel, on trouve donc des traces et des fragments d'une pluralité de visions du monde et de projets d'organisation sociale. La Constitution, en tant qu'ensemble unitaire, est le produit des confluences et des antinomies entre ces différentes conceptions [et rapports de forces socio-politiques entre classes].
Ainsi, la Constitution est plus qu'un instrument juridique de valeur paramétrique supérieure : c'est un document historique, un projet utopique, un artefact de l'esprit national. Cela ne signifie pas pour autant, soulignons-le, que cette constitution ou tout autre mérite d'être sacralisée. D'ailleurs, les exemples ne manquent pas pour montrer à quel point le fétichisme constitutionnel peut être pernicieux. Il suffit de considérer l'exemple des Etats-Unis, dont la Constitution, vieille de plus de 200 ans, continue d'être canonisée. Il est toujours déconcertant d'observer les acrobaties intellectuelles auxquelles se livrent les Américains pour extraire d'un texte du XIXe siècle [en fait fin du XVIIIe] des réponses aux problèmes du XXIe siècle. Pour toute société qui a connu les tumultes de l'histoire, il est évident qu'aucun texte ne doit lier ad eternum les générations présentes aux choix des générations passées.
Il est toutefois important de reconnaître la nature spécifique de la Loi fondamentale. Il ne s'agit pas d'un simple texte normatif, mais plutôt du symbole du type de société que nous voulons construire un jour, traversée, comme il se doit, par l'histoire des conflits sociaux et politiques qui ont permis d'aboutir au pacte consigné dans le texte.
C'est dans cette optique qu'il convient d'examiner le processus de révision constitutionnelle annoncé par l'IL. Nous pouvons nous faire une idée des propositions qui seront avancées par les partis à partir des projets présentés en 2022, dans le cadre du processus de révision alors ouvert par Chega. Les projets soumis par les partis qui constituent désormais la majorité de droite (PSD, IL et Chega) constituent une modification substantielle du texte fondamental, qui ne se limite pas à de simples arrangements esthétiques. En effet, les modifications proposées, en particulier par l'IL et Chega, impliquent, dans une certaine mesure, une subversion du projet de société et du pacte social inscrits dans la Constitution de 1976. Au vu de ce qui précède, il n'y a rien de fondamentalement mauvais à cela ; les textes constitutionnels ne sont pas immuables. Cependant, il convient d'être clair sur ce que représente cette révision constitutionnelle (contrairement à la plupart des précédentes) : une modification profonde du projet de société que les Portugais ont choisi pour eux-mêmes, ainsi que le rejet d'une certaine histoire de la lutte sociale qui a construit le Portugal que nous connaissons aujourd'hui.
L'obsession quasi frénétique des partis de droite pour la suppression de la référence à la « voie vers une société socialiste » dans le préambule de la Constitution dénote, à deux niveaux, le mépris et le rejet de l'histoire « d'en bas », des mouvements sociopolitiques qui ont donné naissance à la démocratie portugaise. Comme indiqué ci-dessus, la Constitution est également un document historique, notamment en ce qui concerne le préambule, qui n'a pas d'effet juridiquement contraignant. Cette référence n'a jamais fait obstacle (depuis l'adoption de la loi fondamentale) à la reconnaissance de la propriété privée et de l'initiative économique. Elle constitue donc, comme elle l'a toujours fait, un élément symbolique et historique qui ne justifie pas la fixation particulière sur ce thème de l'Initiative libérale, à moins que l'objectif de cette fixation ne soit d'effacer l'histoire de notre démocratie et de refonder le régime.
En ce qui concerne les modifications matérielles du texte constitutionnel, tant le projet de l'IL que celui de Chega présentent une particularité intéressante : tous deux visent à rendre possibles des mesures que les partis défendent tout en sachant qu'elles sont inconstitutionnelles. On pense tout d'abord à la proposition de modification des dispositions qui qualifient le système national de santé et le système éducatif comme des services publics universels. La Constitution a toujours reconnu les services de santé et les établissements d'enseignement comme relevant du secteur public et aussi du secteur privé. Il s'agit donc de supprimer le caractère universel des services publics. En outre, il convient de prendre en considération la proposition visant à supprimer la référence à la fonction de réduction des inégalités sociales exercée par les impôts sur le revenu. Enfin, rappelons les propositions visant à introduire dans le texte constitutionnel la castration chimique et la prison à perpétuité.
La révision constitutionnelle annoncée ne doit donc pas être prise à la légère. C'est peut-être le moment où le projet d'avril rendra enfin son dernier souffle. (Article publié dans l'hebodmadaire Sabado le 25 mai 2025, repris par le site du Bloco ; traduction rédaction A l'Encontre)
Maria J. Paixão est assistante invitée à la Faculté de droit de l'Université de Coimbra et chercheuse dans le domaine du droit climatique. Militante pour la justice climatique au sein de divers mouvements sociaux.
*****
« La solution est à gauche »
Par Fernando Rosas
Dans cette situation grave, nous devons peut-être chercher avec lucidité et courage à réinventer l'antifascisme. Autrement dit, promouvoir une solution de gauche, pluraliste, qui rassemble tout ce qui peut l'être.
Je sais bien que le titre de cet article peut sembler insensé, surtout après la défaite électorale significative de la gauche lors des élections du 18 mai, mais mon point de départ est le suivant : la crise institutionnelle de la démocratie que connaît également notre pays et qui s'est traduite par le résultat des élections trouve son origine dans le discrédit et l'impopularité du monopole alterné PS-PSD au gouvernement. En adoptant des politiques fondamentalement identiques dans des domaines essentiels, il a permis la dégradation des principaux services publics, aggravé les inégalités sociales et les conditions de vie. Cela a semé le mécontentement, l'insécurité, le désespoir et la colère dans de larges secteurs de la population contre le bloc central informel au pouvoir et l'inefficacité socialement injuste de ses gouvernements.
Comme dans d'autres pays, l'extrême droite a également profité et exploité au Portugal, grâce à un large soutien financier et médiatique et à de nouveaux instruments de manipulation algorithmique, ce malaise des couches importantes de la classe moyenne et salariée. Elle a sans vergogne fait appel à la peur et aux instincts primitifs, exploité la désinformation et l'ignorance généralisée, menti tous les jours, manipulé, toujours encouragée par une couverture médiatique dominante généreuse et complice. Et face à l'incapacité de la gauche à s'affirmer comme alternative, elle l'a écrasée et s'est mise en position de prendre le pouvoir, contre tout ce que la démocratie a conquis politiquement et socialement depuis le 25 avril.
La victoire électorale du PSD est donc plus apparente et éphémère que réelle et stabilisatrice pour le régime.
A mon avis, trois solutions s'offrent à la droite classique, formellement victorieuse sans majorité absolue. Premièrement : s'appuyer parlementairement et politiquement sur un accord informel et ponctuel avec le PS – comme celui-ci est disposé à le faire –, en plaçant l'extrême droite dans une position satellite.
Il s'agirait d'une « contention » purement apparente et transitoire : c'est précisément l'épuisement du « situationnisme rotatif » du centre-droit qui a fait croître l'extrême droite. Sa continuité sera probablement le prélude à la prise du pouvoir par l'extrême droite lors des prochaines élections, à court ou moyen terme.
Deuxièmement : le PSD peut jouer sur l'équilibre instable. C'est-à-dire en pêchant délibérément des soutiens dans le camp du PS et en acceptant d'intégrer davantage les politiques de l'extrême droite (sécuritarisme, anti-immigration, restrictions des libertés publiques et des droits du travail…). Le résultat serait le même que dans la première solution, mais en plus rapide : un continuisme plus proche de l'extrême droite précipiterait l'avènement de cette dernière.
Troisièmement : la droite traditionnelle pourrait progressivement abandonner le « non c'est non » [face à Chega : déclaration de Montenegro] et renoncer à son apparence de « cordon sanitaire », comme le réclame une large partie du PSD et comme cela se produit déjà dans toute l'Europe, et ailleurs. Dans ce cas, nous aurions une alliance parlementaire entre la vieille droite et la nouvelle extrême droite, sur la voie d'un nouveau type de régime autoritaire : une sorte de néofascisme adapté au régime historique et aux conditions sociales de l'époque actuelle. Avec tout ce que cela implique.
En réalité, à la lumière de l'avancée démocratique conquise en avril 1974, les solutions apparemment prévisibles pour la droite débouchent sur une voie de régression civique et civilisationnelle à court ou moyen terme. Face à la gravité de la situation, la solution, du point de vue de la liberté et de la justice sociale, doit être recherchée, construite, avec un nouveau cours de politiques alternatives, c'est-à-dire à gauche. En changeant de paradigme. Dans cette situation grave, nous devons peut-être chercher avec lucidité et courage à réinventer l'antifascisme. En d'autres termes, promouvoir une solution de gauche, pluraliste, qui rassemble tout ce qui peut l'être autour d'un double objectif général : défendre la démocratie et la liberté, d'une part, et préserver et approfondir la justice sociale et distributive, d'autre part. Pour cela, en luttant pour des politiques concrètes et urgentes qui répondent à la crise du logement ; pour la défense et l'amélioration du système de santé publique, de l'école publique et des salaires et pensions ; pour la lutte contre le racisme et toutes les formes d'exclusion et de discrimination fondées sur le genre ou l'orientation sexuelle. Un antifascisme qui s'oppose à la guerre et à la folie militariste [dépenses d'armement] qui la promeut et qui se prononce sans tiédeur dégradante contre le massacre génocidaire à Gaza et pour les droits du peuple palestinien.
Ce n'est certainement pas une voie facile dans la foulée d'un revers électoral difficile. Cela exige un dialogue et la conclusion d'accords entre les forces politiques, les mouvements sociaux et la citoyenneté. Mais la dispersion et la division ne sont certainement pas une réponse digne de notre engagement envers le passé et l'avenir. Malgré tout, avril mérite bien qu'on s'entende. Et la tête haute. (Article publié dans le journal Publico le 31 mai 2025 et publié le 1er juin sur le site du Bloco ; traduction rédaction A l'Encontre)
Fernando Rosas est historien, professeur émérite de l'Université de Lisbonne, un des fondateurs du Bloco de Esquerda en 1999.
*****
« Le Bloco fera opposition aux nouvelles politiques de coupes sociales »
Lors de la conférence de presse marquant le début de l'année parlementaire, le Bloco de Esquerda (Bloc de gauche) a présenté ses premières initiatives pour la législature et a commenté la proposition de révision constitutionnelle que la droite libérale et l'extrême droite tentent de faire avancer.
A ce sujet, Mariana Mortágua note que le Premier ministre s'est contenté de dire « qu'il ne s'agirait pas d'un projet immédiat », laissant ainsi planer la « menace » d'une révision constitutionnelle à droite qui suscite des inquiétudes « pour l'Etat social et les libertés collectives et individuelles dans notre pays ».
Mais le Bloco sait qu'au-delà de cela, « des risques se concrétiseront déjà dans le prochain budget de l'Etat » et qu'ils sont indépendants d'une modification constitutionnelle : même sans celle-ci, « il a été possible de privatiser des services publics, de privatiser d'importantes entreprises publiques », de « sabrer dans les retraites, les salaires » et d'« affaiblir l'Etat social ». Le Bloco entend par là qu'il prévoit « de nouvelles politiques de coupes sociales » qui s'ajouteront aux engagements du gouvernement en matière de dépenses militaires.
La coordinatrice du Bloco a également présenté les trois projets déposés le premier jour de la nouvelle législature. Tout d'abord, le viol comme crime public, importante à un moment « où la violence contre les femmes et la violence sexuelle augmentent » et qui répond « au tollé et à la pétition qui a rassemblé plus de 100 000 personnes » en ce sens.
Deuxièmement, la reconnaissance de l'Etat palestinien à un moment où « le génocide à Gaza se poursuit » et où la crise humanitaire qui y règne est reconnue. Pour la députée, « il n'y a aucune raison pour que le gouvernement portugais et l'Etat portugais ne reconnaissent pas l'Etat palestinien », ce qui « est avant tout un acte de respect du droit international, mais aussi un acte symbolique qui déclare le soutien du Portugal au peuple palestinien et la solidarité portugaise avec ce peuple victime d'un génocide qui continue de bénéficier de la complicité des plus grands Etats du monde ».
En troisième lieu, le Bloco insiste sur la réduction du temps de travail, considérant que « le Portugal est l'un des pays où l'on travaille le plus pour un salaire inférieur » [1]. En outre, on estime qu'« il y a eu quelques expériences réussies avec la semaine de quatre jours, un projet pilote qui a donné de bons résultats en termes de productivité et qui a été bien accueilli tant par les entreprises qui y ont participé que par les travailleurs et travailleuses, et que cette expérience doit donc se poursuivre ». Cela n'implique aucune perte de salaire et les projets pilotes doivent se poursuivre dans le secteur privé, dans l'administration publique et dans le secteur public.
Concernant la position générale du Bloco vis-à-vis du gouvernement PSD/CDS, Mariana Mortágua a souligné le « rôle d'opposition », en rappelant ce qui s'est passé l'année dernière : « une politique gouvernementale qui a montré des signes d'incompétence, notamment dans le domaine de la santé » et le projet politique de la droite en matière de logement, de travail, de retraites, de sécurité sociale et de services publics, que le Bloco rejette. (Communiqué du Bloco publié sur son site le 30 mai ; traduction rédaction A l'Encontre)
[1] La limite de la pauvreté au Portugal est située à un revenu effectif de 632 euros mensuels. En 2023, 1,7 millions de personnes disposaient d'un revenu effectif inférieur à 632 euros mensuels. Toutefois, dans une enquête publiée pour la région du Grand Lisbonne et de Setubal, un revenu de 746 euros, étant donné les différences régionales, aboutit à être statistiquement sur la ligne de passage dans la pauvreté. L'enquête (telle que rapportée par Publico le 4 juin 2025) démontre que dans le Grand Lisbonne le taux de pauvreté se situé à 19,2% de la population et à 20% dans la région de Setubal, si la référence est celle de 632 euros. De plus, les 10% des travailleurs les plus pauvres subissent des horaires de travail de plus de 45 heures hebdomadaires. (Réd. A l'Encontre)
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Marine Le Pen célèbre l’Internationale facho

10 juin 2025 |Tiré de la lettre de Regards.fr
06:10 (il y a 3 heures)
Finito la dédiabolisation, la cheffe de l'extrême droite française se « trumpise » avec ses semblables européens autour d'un adversaire commun : l'UE.
Un an après les élections européennes de juin 2024, Marine Le Pen s'est offert, en plein Loiret, un jubilé de victoire (relative) des extrêmes droites du continent. Dans une mise en scène soigneusement orchestrée, entre drapeaux nationaux et accents martiaux, elle a célébré le premier anniversaire de la création de son groupe au Parlement européen en compagnie de ses alliés : le premier ministre hongrois Viktor Orbán, le néo-franquiste espagnol Santiago Abascal (Vox), le nazillon autrichien Herbert Kickl (FPÖ), le fasciste italien Mateo Salvini (Ligue du Nord) et Jordan Bardella, désormais président de groupe et dauphin désigné. Une Europe des nations, contre Bruxelles. Une Internationale des nationalistes, contre la gauche, les juges, les immigrés et les minorités. Une scène. Et derrière, un virage stratégique majeur.
Marine Le Pen, depuis 2017, s'était appliquée à lisser sa rhétorique sur l'Europe. Finie la sortie de l'euro, oubliée la tentation du Frexit, elle s'était faite gestionnaire de la souveraineté. Mais à Mormant-sur-Vernisson, elle est redevenue ce qu'elle n'a jamais cessé d'être : une adversaire frontale de l'Union européenne. Elle l'a qualifiée de « tombeau de promesses politiques non tenues », de machine « woke et ultra-libérale », jugeant que l'heure n'était plus à la réforme de l'intérieur mais à la reconquête : « Nous ne voulons pas quitter la table. Nous voulons terminer la partie et gagner. »
La formule résume une stratégie : renverser Bruxelles de l'intérieur. Affaiblir la Commission. Asphyxier le Parlement. Coaliser les forces identitaires, climatosceptiques, autoritaires. Et redonner à chaque capitale le droit de s'opposer à la solidarité européenne. L'Union n'est plus un cadre de négociation : c'est un ennemi. Et elle entend le diriger depuis Strasbourg.
Cette offensive est menée avec Viktor Orbán, dont Marine Le Pen se rapproche plus que jamais. Le chef du gouvernement hongrois, mis au ban par Bruxelles pour atteinte à l'État de droit, trônait à ses côtés. Plus qu'un allié, un frère d'armes. Avec lui, Le Pen ne partage pas seulement une alliance stratégique : elle épouse une vision du pouvoir. Répression des ONG, contrôle des médias, priorité nationale à l'économie, rejet de l'immigration et mise au pas des contre-pouvoirs. Ce n'est plus l'extrême droite marginale : c'est un projet d'alternative civilisationnelle.
Ce tournant s'était déjà amorcé le 1er mai 2025 : pour la première fois, Marine Le Pen avait publiquement adopté le lexique anti-« wokisme », jusqu'ici manié avec prudence. Loin de sa rhétorique souverainiste classique, elle a accusé la gauche, les féministes, les antiracistes d'« imposer leur vision du monde », reprenant les codes sémantiques forgés par la droite américaine. L'héritière du FN, longtemps méfiante à l'égard des guerres culturelles, est désormais pleinement engagée dans la bataille culturelle — et idéologique.
Et puis il y a Trump. Longtemps, Marine Le Pen avait tenu à distance le président américain. Trop instable, trop provocateur, trop dangereux. Elle s'en distinguait pour mieux rassurer les électeurs français. Mais voilà qu'aujourd'hui, elle en mime sa posture et adopte son récit de persécution. Après sa récente condamnation judiciaire pour détournement de fonds, elle enfile le costume de la martyre politique, persécutée par l'establishment. Une stratégie directement calquée sur celle du milliardaire américain, devenu modèle plus qu'inspiration. Et si elle y fait référence, ce n'est pas un hasard. C'est qu'elle pense que cela peut marcher. Trump n'est plus, pour son électorat, un épouvantail à moineaux. Il est une force. Il est la revanche des humiliés, des « vrais gens » contre les élites mondialisées. En s'alignant sur lui, Le Pen entend galvaniser sa base : elle veut faire croire que l'Histoire est de son côté. Qu'elle aussi, bientôt, passera de l'opposition au pouvoir. Comme Trump en 2016. Comme Orbán depuis 2010.
Ce repositionnement dur n'est pas qu'européen. Il vise aussi à affirmer son hégémonie sur la droite française. En ligne de mire : Bruno Retailleau. Le président des LR tente, du haut de son magistère de Beauvau, de se positionner comme tête de proue d'une droite ultraconservatrice et autoritaire. Mais il demeure symbole d'un vieux monde politique, asséché, solitaire. En s'affichant avec des chefs d'État et de parti d'envergure continentale, Marine Le Pen se pose en figure d'autorité : elle organise des sommets avec des puissants et prépare l'OPA mondiale des extrêmes droites.
Ce tournant idéologique, stratégique et symbolique n'est pas un simple glissement. C'est une offensive. Marine Le Pen a digéré sa dédiabolisation. Elle veut incarner le pouvoir, la victoire, la force. La gauche ne peut plus se contenter de la renvoyer à son passé familial ou à son programme économique vide. Elle doit comprendre ce que ce discours produit : un sentiment d'ordre, de virilité politique, d'unité culturelle. Si Le Pen se met à parler comme Trump, ce n'est pas une erreur de communication. C'est un calcul : pour le RN, la France aussi est mûre pour l'extrême droite populiste. Pour gouverner avec Orbán. Avec Trump. Et sûrement aussi avec Poutine.
Pablo Pillaud-Vivien
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Notre perspective ne peut être qu’un changement radical de société

Le Conseil national des 7 et 8 juin a porté de façon centrale sur les perspectives avancées par Ruba Ghazal. Le Manifeste était au cœur des discussions et la table ronde qu'elle animait portait sur le thème d'un gouvernement des travailleuses et des travailleurs. Dans cette mesure Ruba a gagné son pari.
Le panel, animé par Ruba Ghazal, a été l'occasion d'aborder entre autres les attaques du gouvernement Legault contre les droits des travailleuses et travailleurs et faisait des comparaisons avec le PL 5 en Ontario. L'annexe 9 de ce projet de loi omnibus, actuellement en deuxième lecture à l'Assemblée législative de l'Ontario, accorderait au gouvernement le pouvoir élargi de désigner, n'importe où dans la province, des « zones économiques spéciales ». Dans ces zones, le gouvernement provincial peut suspendre ou annuler toutes les lois et réglementations existantes concernant les conditions de travail, la santé et la sécurité, et les protections environnementales, ainsi que les règlements municipaux.
Les orientations politiques
La partie cruciale, la crise environnementale, ne faisant pas partie du Manifeste ni de la discussion de ce Conseil national. Plusieurs associations et Comités d'Action Politique (CAP) ont apporté des propositions pour y remédier. L'asso de Maurice-Richard proposait l'amendement suivant concernant le logement :
Il le fera en promouvant un modèle de développement écoresponsable à l'opposé des politiques d'étalement urbain et de gentrification qui exclut les classes populaires et participe à leur appauvrissement. Il n'hésitera pas à légiférer dans ce sens afin de bloquer les projets d'un marché débridé.
Cette proposition a été battue au profit d'une résolution appuyée par un membre du CCN, qui proposait à la place : « en priorisant les projets de développement durable », un concept plutôt sans saveur.
L'ajout d'un texte indiquant que les investissements requis pour rebâtir les services publics devraient être financés par l'augmentation des taxes sur les milliardaires, les surprofits des grandes pétrolières, les surprofits des grandes chaînes d'épicerie, les surprofits des multinationales de la haute technologie telles qu'Amazon, Apple, Meta, et Google a été référé.
En ce qui concerne la Proposition 5 Droits des travailleurs et travailleuses, la résolution du CAP indépendance a été adoptée presque dans sa totalité : Un gouvernement solidaire mettra en œuvre des réformes structurelles pour renforcer la démocratie dans les institutions publiques et les milieux de travail, en favorisant la participation directe des travailleuses et des travailleurs aux décisions, et la transparence dans la gestion.
Un débat très intéressant concernant la transition juste a conduit à l'adoption du texte suivant : un gouvernement de Québec solidaire s'engagera dans une transition sociale et écologique juste, équitable et transformatrice. Il investira massivement dans le transport collectif électrifié et urbain, régional et interrégional, travaillera à la sortie des hydrocarbures et des industries ultrapolluantes et au développement massif des énergies renouvelables, le tout sous contrôle public et démocratique.
Il travaillera de concert avec les mouvements sociaux et syndicaux, les populations vulnérables et les Peuples autochtones afin d'obtenir leur consentement dans la construction d'un mouvement unitaire pour cette transition. Celle-ci doit se faire en planifiant l'avenir avec les travailleurs et travailleuses, pas contre elles et eux. La division entre travailleuses et travailleurs fait le jeu du système capitaliste et des véritables responsables de la crise climatique, dont les grandes entreprises polluantes. En pleine crise du coût de la vie, la culpabilisation des individus est une impasse.
Une position sans équivoque concernant la lutte contre le racisme et les discriminations systémiques,
Pour que les travailleuses et les travailleurs puissent se défendre et conquérir de nouveaux droits, un gouvernement solidaire interdira les lockout, inscrira le droit de grève dans la Charte des droits et libertés de la personne et s'assurera de faire respecter la Charte des droits et libertés et la Loi sur les normes du travail pour toutes les travailleuses et travailleurs, y compris évidemment celles et ceux provenant de minorités ou au statut temporaire.
Il abrogera également toute loi établissant une forme de discrimination ou de racisme systémique contrevenant à l'esprit de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, notamment les articles de loi visant les personnes portant des signes d'appartenance religieuse.
Quatre résolutions d'urgence adoptées
Concernant le 30e anniversaire de la marche Du pain et des roses, le soutien à la Palestine et la dénonciation de la complicité de la Caisse de dépôt et placement du Québec, l'opposition de QS à la réforme énergétique de la loi 69 et à la réforme du régime forestier de la loi 97.
Quelles seront les suites ?
Le congrès de l'automne prochain doit réviser le programme, ce qui est en soi une nécessité afin de mieux répondre à la situation politique actuelle et à la montée du conservatisme et de la droite. Cependant, lors du Conseil national de Saguenay tenu en mai 2024, nous avons adopté la position suivante : [1]
Qu'en prévision de la campagne électorale de 2026, le parti s'engage dans un processus d'actualisation de son programme, qui sera suivi par l'adoption de la plateforme électorale.
Que la Commission politique, le Comité de coordination national et les commissions thématiques soient responsables de coordonner le processus d'actualisation du programme, pour adoption lors d'un Congrès spécial en 2025. Que le processus soit guidé par les balises suivantes :
a. Que le programme prenne la forme d'un document présentant la vision politique de Québec solidaire ainsi que sa philosophie gouvernementale générale et sa vision de la transformation sociale et notre projet visant à renverser le statu quo politique au Québec, afin d'encadrer notamment l'élaboration des plateformes électorales du parti ;
b. Le programme de Québec solidaire ne se limite pas à définir les orientations d'un éventuel gouvernement solidaire, mais aussi les axes de transformations sociales et politiques nécessaires à l'atteinte d'un Québec écologiste, égalitaire, démocratique, féministe, altermondialiste et souverain.
c. Que le programme soit exempt d'engagements politiques trop spécifiques ;
d. Que le programme respecte l'esprit de la « Déclaration de principes » adoptée à la fondation de Québec solidaire ainsi que l'entente de fusion entre Québec solidaire et Option nationale ;
e. Que le programme soit le résultat d'une réflexion impliquant l'ensemble du parti et portant notamment sur les grandes orientations politiques du parti, en dehors des réflexions conjoncturelles ;
f. Que le processus se fasse de façon démocratique, mobilisatrice et en impliquant l'ensemble des membres et des instances statutaires de Québec solidaire ;
g. Qu'au cours du processus de consultation des membres et des instances statutaires de Québec solidaire, ces personnes et ces instances soient invitées à échanger en ateliers autour des grandes orientations du programme.
Avec des paramètres semblables, il sera difficile de faire une campagne politique qui permettra de contrer le discours dominant de droite concernant la culpabilisation des personnes immigrantes qui seraient responsables de la crise du logement, le nationalisme identitaire, l'augmentation du budget militaire. Comment pourrons-nous dans un cadre de débat aussi court et restreint, répondre à une problématique politique de plus en plus intense et complexe ?
De plus, en limitant les changements possibles aux programems et les paramètres de la plateforme à quelques engagements électoraux, nous confinons nos perspectives à une voie parlementariste et non de combat de changement do société.
Voilà nos défis, notre perspective ne peut être qu'un changement radical de société, pour y arriver nous devons élargir le processus de débat, la crise environnementale à elle seule le réclame !
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
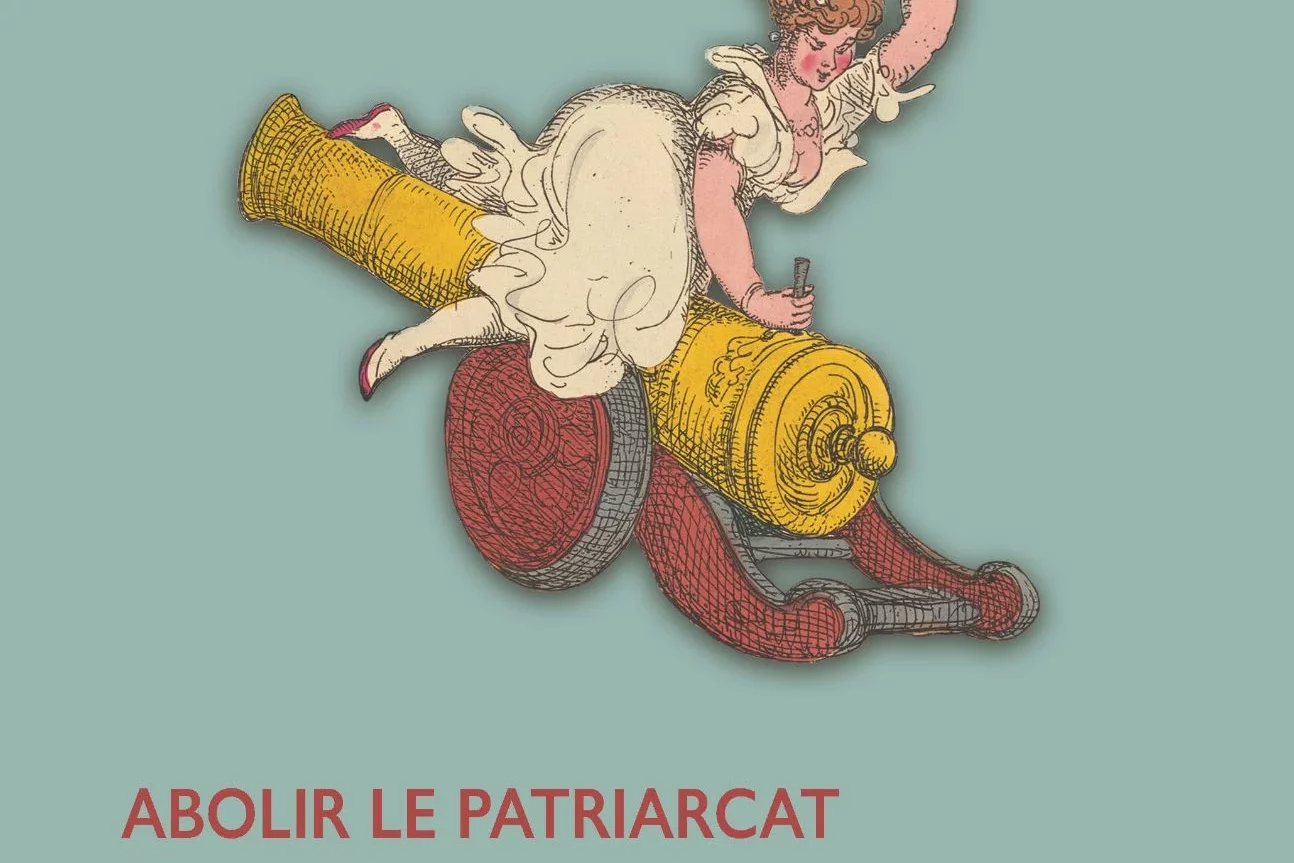
Abolir le patriarcat. L’utopie féministe de James Henry Lawrence (1773-1840) » par Anne Verjus

« Abolir le patriarcat. L'utopie féministe de James Henry Lawrence (1773-1840) » par Anne Verjus, Presses universitaires de Saint-Étienne, collection "Le Genre en toutes lettres", Saint-Étienne, 2025. https://presses.univ-st-etienne.fr/fr/index.html
Se souvient-on encore de James Henry Lawrence et de son roman « L'Empire des Nairs », un rêve d'un monde où les femmes sont libérées de la dépendance des hommes ? À contre-courant des mœurs et des lois de son époque, Lawrence invente un équilibre inédit entre les rôles de genre : il imagine un monde où les femmes transmettent la propriété et le nom de famille, et assument seules l'éducation des enfants.
Comment est né ce livre ? Quelle a été sa destinée ? Quels échos a-t-il suscités à l'époque, et dans quelles traditions intellectuelles peut-on le situer ? Cet essai répond à ces questions et présente une étude inédite de l'auteur.
*Par sa critique du patriarcat et des violences de genre, et par les moyens qu'il met en œuvre pour répondre aux enjeux de la liberté pour les deux sexes, Lawrence se révèle d'une étonnante modernité.*
*Anne Verjus, *directrice de recherche au CNRS, spécialiste de la Révolution française, explore les logiques du patriarcat à travers ses deux piliers : le mariage et la paternité. Depuis ses premiers travaux, elle considère la recherche comme un levier de transformation sociale.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
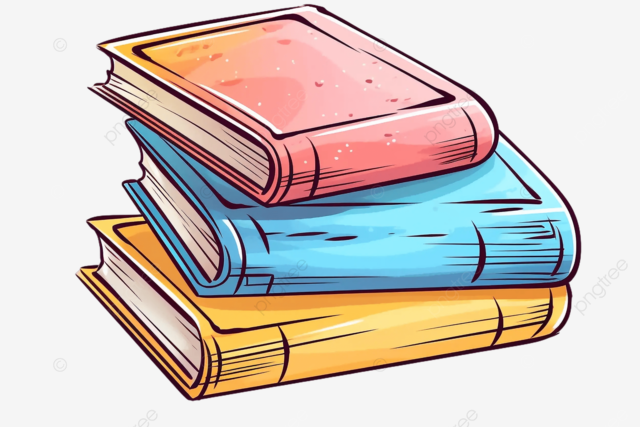
Comptes rendus de lecture du mardi 10 juin 2025

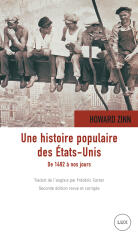
Une histoire populaire des États-Unis
Howard Zinn
Traduit de l'anglais
Ce fut un cadeau de ma femme et c'est un livre que tout le monde devrait lire. Cette histoire des États-Unis nous présente le point de vue des sans voix, de ceux dont les manuels d'histoire parlent peu et au sort desquels on s'intéresse encore moins dans l'actualité. Howard Zinn y confronte la version officielle et héroïque de l'histoire à la réalité et aux témoignages des acteurs les plus modestes : les Indiens, les esclaves en fuite, les soldats déserteurs, les jeunes ouvrières du textile, les syndicalistes, les GI du Vietnam, les activistes et les victimes contemporaines de la politique intérieure et étrangère américaine. « Une histoire populaire des États-Unis » est un livre de référence incontournable.
Extrait :
Deux mois plus tard à Charleston, dans le sud de l'État, il [Abraham Lincoln] déclarait : « Je dirai, donc, que je ne suis pas - et n'ai jamais été - pour l'instauration sur quelque mode que ce soit d'une égalité sociale et politique des races blanche et noire (applaudissements). Je ne suis pas non plus - et n'ai jamais été - pour que l'on accorde aux Noirs le droit de vote ou celui d'être juré ; pas plus que pour autoriser leur accession aux postes administratifs ou les mariages interraciaux. [...] Aussi, comme tout cela leur est interdit et qu'ils doivent rester entre eux, il en découle qu'il doit nécessairement y avoir des supérieurs et des inférieurs. En ce qui me concerne, comme tout le monde, je suis favorable à ce que les Blancs jouissent de ce statut de supériorité. »

La Chine contemporaine
Alain Roux
Alain Roux est l'un de nos plus éminents sinologues. Il a publié sur le sujet de très nombreux ouvrages et de nombreux articles dans Le Monde diplomatique et Manière de voir. Cette sixième édition de son ouvrage « La Chine contemporaine » nous permet de mieux comprendre l'histoire de ce pays depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à nous jours, depuis la chute de l'empire Qing, en passant par l'instauration de la République de Chine en 1912 sous Sun Yat-sen, par la création de la République populaire de Chine en 1949 sous Mao Zedong, par le grand bond en avant et par la révolution culturelle. Il nous explique les luttes et les avancées, les tiraillements, les erreurs coûteuses en vies humaines, les importants jalons aussi, qui ont permis à ce pays longtemps le plus populeux de la planète de lentement émerger d'un siècle de dominations et de misères, d'importants retards technologiques, pour devenir l'une des principales puissances économiques et industrielles de la planète. Une analyse honnête et sans compromis de la Chine, du chemin qu'elle a parcouru et de celui qu'il lui reste à faire.
Extrait :
À la fin du XIXe siècle, à partir des guerres de l'Opium (1840-1860),la Chine des Mandchous paraît vouée à l'éclatement. Les grandes puissances y découpent des zones d'influence, imposent l'humiliation des Traités inégaux à un État incapable de défendre sa souveraineté, tandis que le retard entre l'immense pays et le niveau de développement atteint par les nations les plus dynamiques s'accroît sans cesse. Jadis centre civilisateur rayonnant sur toute l'Asie orientale, l'Empire du Milieu a raté le rendez-vous de la révolution industrielle et n'est plus qu'une province déshéritée du monde moderne.

Sur ma mère
Tahar Ben Jelloun
Tahar Ben Jelloun est reconnu comme l'un des écrivains les plus traduits au monde. Son livre "Sur ma mère" se situe à la frontière entre le roman et le récit. Il porte sur sa mère, atteinte de la maladie d'Alzheimer. Pendant des journées entières, alors qu'il vient passer du temps à ses côtés et la veiller, l'auteur l'écoute dans ses moments de lucidité comme dans ceux où elle perd pied et où la réalité n'a plus de prise sur elle. Malgré sa souffrance face à sa propre impuissance, il découvre celle qui lui a donné la vie. Les souvenirs qu'elle lui offre au fur et à mesure de ces longues heures douloureuses permettent à l'écrivain de reconstituer sa vie dans la ville de Fès des années trente et quarante et de plonger dans les ressentis de la fille, de l'épouse et de la mère qu'elle a été. Tahar Ben Jelloun nous dit que ce récit est celui d'une vie dont il ne connaissait rien, ou presque rien. Une œuvre vraiment touchante.
Extrait :
Depuis qu'elle est malade, ma mère est devenue une petite chose à la mémoire vacillante. Elle convoque les membres de la famille morts il y a longtemps. Elle leur parle, s'étonne que sa mère ne lui rende pas visite, fait l'éloge de son petit frère qui, dit-elle, lui apporte toujours des cadeaux. Ils défilent à son chevet et passent de longs moments ensemble. Je ne la contrarie pas. Je ne les dérange pas. Sa femme de compagnie, Keltoum, se lamente : « Elle croit que nous sommes à Fès l'année de ta naissance. »
La condition humaine
André Malraux
Ce fut le premier et seul roman que ma mère m'empêcha momentanément de lire. J'étais assez jeune et c'est l'enthousiasme créé par l'ouverture de notre nouvelle bibliothèque municipale avec ses livres neufs qui sentaient si bon qui m'avait fait choisir ce roman parmi une foule d'autres. Je me suis repris plus tard et plus tard encore. Ce grand roman, le plus connu de Malraux, relate le parcours d'un groupe de révolutionnaires communistes chinois préparant le soulèvement de la ville de Shanghai. Au moment où commence le récit, le 21 mars 1927, communistes et nationalistes préparent une insurrection contre le gouvernement...
Extrait :
Tchen tenterait-il de lever la moustiquaire ? Frapperait-il au travers ? L'angoisse lui tordait l'estomac ; il connaissait sa propre fermeté, mais n'était capable en cet instant que d'y songer avec hébétude, fasciné par ce tas de mousseline blanche qui tombait du plafond sur un corps moins visible qu'une ombre, et d'où sortait seulement ce pied à demi incliné par le sommeil, vivant quand même — de la chair d'homme. La seule lumière venait du building voisin : un grand rectangle d'électricité pâle, coupé par les barreaux de la fenêtre dont l'un rayait le lit juste au-dessous du pied comme pour en accentuer le volume et la vie. Quatre ou cinq klaxons grincèrent à la fois. Découvert ? Combattre, combattre des ennemis qui se défendent, des ennemis éveillés !
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Bangladesh : Journée internationale de commémoration des luttes des travailleurs

Aujourd'hui, le 1er mai 2025, la Bangladesh Sangjukto Building and Wood Workers Federation [Fédération des travailleurs du bâtiment et du bois du Bangladesh] (BSBWWF) a organisé une réunion-débat pour commémorer le grand 1er mai, Journée internationale de la solidarité des travailleurs, dans ses locaux de Dhaka. Présidée par le président par intérim de la BSBWWF, le camarade Badrul Alam, la réunion a été animée par le secrétaire général de la BSBWWF, AKM Shadul Alam Faruq, et le coordinateur du Progotisheel Krishok Sangram Parishad, Sultan Ahmed Biswas, entre autres.
1er mai 2025 - BSBWWF (Bangladesh)
https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article75253
Au début de la réunion, les dirigeants se sont levés pour rendre hommage à toutes les travailleuses et tous les travailleurs au Bangladesh et partout dans le monde qui sont mort.e.s au travail et ont observé une minute de silence à leur mémoire. Ils ont également exprimé leur respect et leurs vœux de rétablissement aux personnes blessées. Leurs familles doivent recevoir une indemnisation. Les orateurs ont également demandé avec force la ratification de la Convention 102 de l'OIT et la mise en œuvre des Conventions 87 et 98 de l'OIT. Ils ont ajouté qu'ils exigeaient la mise en œuvre de tous les droits des travailleurs mentionnés dans la loi sur les syndicats, y compris la protection de la santé au travail et la sécurité sociale dans le secteur de la construction.
Les intervenants ont insisté sur la question de l'augmentation du salaire minimum des travailleurs, de la réouverture des usines qui ont licencié leurs employé.e.s, du paiement des arriérés de salaire, de la mise en œuvre des recommandations des organisations syndicales à la Commission de réforme du travail, de la mise en œuvre des conventions de l'OIT relatives au travail, à la sécurité au travail, de la déclaration d'un salaire minimum de 30 000 Tk, etc.
Bangladesh Sangjukto Building and Wood Workers Federation [Fédération des travailleurs du bâtiment et du bois du Bangladesh] (BSBWWF)













