Derniers articles
La télévision québécoise : miroir et moteur d’une culture en mouvement
Témoignages et colère dans une manifestation massive contre la CAQ
Ruba, le visage d’un pays qui se réinvente !
« Il est exactement quelqu'un comme Ruba Ghazal ». C'est ainsi qu'un internaute a fini par me qualifier.
Je l'ignorais, que j'étais comme Ruba, que je pouvais refléter un fragment de sa personnalité ou de sa façon d'exister. La personne ignore peut-être qu'avec une telle association, il me fait plaisir. Je la remercie. Le commentaire voulait sûrement laisser entendre que j'étais un admirateur de Ruba Ghazal. Je dois dire que ce n'est pas la première fois que je sois amusé de lire des opinions que l'on formule sur moi. Positives ou négatives, elles m'amusent au même degré, et d'ailleurs, il m'arrive de penser que ceux qui me critiquent n'ont pas toujours tout à fait tort, et ceux qui me complimentent n'ont pas entièrement tout à fait raison. Mais ça, c'est un autre chapitre dans le grand roman de mes contradictions.
Revenons à Ruba, c'est d'elle qu'il s'agit. Comment a t'on deviné que j'en étais admirateur ? Je reconnais, je n'ai jamais été doué pour dissimuler mes sympathies. Je l'avoue donc sans emphase mais avec certitude, je suis un admirateur de Ruba Ghazal. Je ne le dis pas par solidarité de circonstance ou pour répondre à ses détracteurs, elle n'a nul besoin d'escorte, elle se défend seule, avec cette élégance que possèdent les convictions profondément ancrées.
Je l'ai suivie dès son apparition dans la vie publique, dès que son nom a commencé à circuler, comme une rumeur bienveillante, avant de devenir une présence affirmée. Le fait qu'elle soit d'origine palestinienne n'est pas étranger à mon attachement, je porte en moi une tendresse particulière pour ce peuple, pour sa résilience presque surnaturelle. Mais au delà des affinités personnelles, elle incarne ce que la politique peut encore offrir de plus noble.
Ruba est de ces êtres droits. Solidaire jusqu'au cœur, loyale, constante, incapable de renier ses idéaux. Les tumultes internes de son parti n'ont jamais entamé sa droiture, ni son découragement. Elle a cette manière, cet art de tenir tête au cynisme comme on oppose le regard à la tempête. Elle conjugue la fermeté et la tendresse, la lucidité et la compassion. C'est une femme politique qui ne se contente pas d'être présente dans l'arène, elle en modifie la forme, elle en déplace les frontières. Même quand elle critique sévèrement l'adversaire politique en face, c'est toujours dans le but de construire des ponts et ce pourquoi elle a été élue, s'opposer au pouvoir quand ce dernier vacille.
Son parcours s'est construit à même les pierres du réel. Députée de Mercier, membre fondatrice de Québec solidaire, militante avant d'être élue, engagée dans la défense de l'environnement, des droits humains, des enjeux sociaux. Elle aurait pu suivre la route toute tracée que son diplôme d'ingénieure ouvrait devant elle, mais elle a préféré les chemins escarpés de la chose publique. Et c'est ainsi qu'elle est entrée dans la vie politique, non pas façonnée par une machine, mais forgée par la réalité, les idées et les luttes. Elle a apporté ses valeurs, ses cicatrices, ses colères et ses espoirs.
Comme moi, Ruba est souverainiste. Par sa qualité de porte-parole de son parti, elle sera appelée à jouer un grand rôle au prochain rendez-vous du Québec avec l'histoire. Ceux, parmi les identitaires, qui s'attaquent à elle personnellement, rendent-ils service à la cause souverainiste ? Rendent-ils service au Québec ? S'ils continuent dans cette manoeuvre, ils se tirent dans les pieds. Je recommande vivement à tous les souverainistes de faire de Ruba et ce qu'elle représente, un formidable atout pour le prochain grand rendez-vous.
Comme moi, Ruba est issue de l'immigration. Comme moi, elle sait que l'appartenance ne se mesure pas seulement à la langue d'origine, ni au lieu de naissance, mais au geste d'habiter une société en l'enrichissant. Sa présence à l'Assemblée nationale porte la preuve d'un pays qui se redéfinit et se réinvente. Ceux qui l'observent savent que son regard sur le monde est traversé d'ouverture et de lucidité. Comme citoyen et comme élue, elle a toujours joué un rôle positif dans une société francophone moderne, accueillante, confiante. Et ceux qui s'en prennent à elle personnellement se trompent d'époque, de cible et d'histoire. Ils semblent ne pas voir en elle une richesse, un trésor national.
Je ne suis pas membre de Québec solidaire, mais j'ai toujours voté QS depuis sa fondation. Parfois, j'ai reproché à ce parti d'être réfractaire au vernis, de négliger l'emballage, de manquer de stratégie d'image. J'ai souvent pensé qu'un peu de mise en scène ne ferait pas de tort. Et puis j'ai observé Manon. Puis Ruba. Et j'ai compris que leur style, c'était précisément de ne pas en avoir trop. Les éléments de langage ce n'est pas le style de ces deux femmes admirables. Leur langage est fidèle à la substance de leur message. Leur discours n'est pas une esthétique, mais une vérité. Une authenticité. Québec solidaire ne joue pas la politique, il la pense, il l'ancre, il la défend.
Depuis ses débuts, j'ai suivi avec respect ce parti, cette maison politique où se croisent des héritages de courage. J'ai gardé une admiration intacte pour Amir, Françoise et Manon. Ruba s'inscrit dans cette continuité, avec sa signature propre. Québec solidaire est devenu un espace singulier dans notre paysage démocratique, un contrepoids, une voix qui défend le bien commun. Il tient lieu de mémoire et de conscience.
Ruba Ghazal et Québec solidaire forment, à mes yeux, une même respiration. Ils rappellent qu'il existe encore des femmes et des hommes capables de faire de la politique avec humanité, avec profondeur, avec fidélité à une certaine idée du monde. Un monde où les très riches partagent un peu plus leurs richesses, un monde ou l'égalité est un principe sacrée et une action constante.
Je rends hommage à Ruba aujourd'hui parce qu'on ne rend plus hommage aux politiciens qui tiennent bon malgré les insultes. La politique, malgré ses déceptions, peut rester un lieu vivant, un lieu vrai, un lieu de sens, à condition de lui apporter notre soutien, notre voix et à l'occasion, un hommage.
Mohamed Lotfi
1 Décembre 2025
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
20 ans de culture collective : la Coop Paradis se projette vers l’avenir

Lancement de la Campagne nationale 2026 pour un transport adapté digne, juste et équitable

Une mobilisation historique pour la défense du transport adapté au Québec
Alliance des Regroupements des usagers du transport adapté du Québec (ARUTAQ)
01 déc, 2025,
MONTRÉAL, le 1er déc. 2025 /CNW/ - À la veille de la Journée internationale des personnes handicapées qui se tiendra le 3 décembre sous le thème québécois "comprendre, agir, bâtir", trois grandes organisations québécoises de portée provinciale, l'ARUTAQ, l'AQRIPH et la COPHAN unissent leurs voix au sein de la nouvelle Coalition transport adapté. Ensemble, elles lancent le Manifeste pour un transport adapté digne, juste et équitable.
Le transport adapté : clé d'une participation citoyenne pleine et entière (Groupe CNW/Alliance des Regroupements des usagers du transport adapté du Québec (ARUTAQ))
Le transport adapté : clé d'une participation citoyenne pleine et entière (Groupe CNW/Alliance des Regroupements des usagers du transport adapté du Québec (ARUTAQ))
– Parce que se déplacer, c'est vivre.
– Parce que l'inclusion sans mobilité n'est qu'un concept.
– Parce que le droit au transport adapté, inscrit dans nos lois, n'est pas appliqué de manière équitable à travers tout le Québec.
Un cri d'alarme collectif
Chaque jour, des milliers de personnes admises au service public de transport adapté et leurs proches se heurtent à un réseau de transport fragmenté et inégal. Manque de véhicules, pénurie de chauffeurs formés, temps d'attente déraisonnables, compressions de service : la réalité du terrain met en péril la participation sociale, économique et citoyenne de milliers de Québécoises et Québécois.
« Nous refusons un Québec à deux vitesses où l'accès à la mobilité dépend du code postal. Le transport adapté est un droit, pas un privilège », déclare Annie Des Rosiers, présidente du conseil d'administration de l'ARUTAQ.
« En 2026, il est inacceptable que des citoyens admissibles à un service public voient leurs déplacements essentiels compromis. »
Des revendications claires avant les élections provinciales
À moins d'un an des élections provinciales de 2026, la Coalition transport adapté réclame des engagements fermes de tous les partis politiques afin d'assurer un service équitable et durable partout au Québec.
Elle demande notamment :
– Un financement récurrent, indexé et prévisible, aligné sur la croissance des besoins.
– Des programmes structurés de recrutement et de formation de chauffeurs en transport adapté.
– Un fonds dédié spécifiquement à l'acquisition de véhicules adaptés et sécuritaires.
La reconnaissance politique du transport adapté comme service essentiel.
– Des normes uniformes de sécurité et un mécanisme indépendant pour le traitement des plaintes.
« Nos régions vivent une iniquité criante. D'une ville à l'autre, l'accès à un déplacement peut faire toute la différence entre la participation et l'exclusion », souligne Patrick Paulin, président de l'AQRIPH. « Il est temps que le gouvernement fasse du transport adapté une véritable priorité nationale. »
Une campagne portée par et pour les personnes concernées
Cette mobilisation s'inscrit dans un mouvement mondial visant à renforcer le leadership des personnes handicapées.
Le Manifeste pour un transport adapté digne, juste et équitable, cœur de la campagne, est maintenant en ligne.
La Coalition transport adapté invite l'ensemble de la population, des organismes et des élus à le lire et à le signer dès aujourd'hui sur le site officiel :https://arutaq.org/campagne-nationale-2026/
« Le transport adapté est au cœur de l'inclusion sociale. Sans lui, impossible de travailler, d'étudier, de se soigner ou de participer à la vie communautaire », déclare Michel Gaudet, président de la COPHAN. « Ensemble, nous appelons à un Québec, où la mobilité est un droit fondamental garanti à toutes et tous. »
À propos de la Coalition transport adapté
La Campagne 2026 pour un transport adapté digne, juste et équitable est pilotée par l'Alliance des regroupements d'usagers du transport adapté du Québec (ARUTAQ) et menée en coalition avec l'Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l'intégration des personnes handicapées (AQRIPH) et la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec (COPHAN)
Ensemble, elles représentent des milliers d'usagers, de familles, d'organismes et de partenaires mobilisés pour défendre le droit fondamental à la mobilité et à la participation citoyenne.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La tentation pragmatique de Vincent

Je n'écris pas ces lignes pour accabler Vincent Marissal. J'écris ces lignes pour m'adresser à la cheffe de QS et aux radicaux de la base militante.
Je n'écris pas ces lignes pour accabler Vincent Marissal. J'écris ces lignes pour m'adresser à la cheffe de QS et aux radicaux de la base militante.
Mais avant, quelques mots pour clarifier mes propos dans les médias. J'aurais souhaité que Vincent ne quitte pas le navire QS pendant que QS traverse une période houleuse. Je suis certain que s'il en avait eu la force, Vincent aurait aussi voulu pouvoir faire preuve de ténacité et de conviction comme Pascal Bérubé qui est demeuré à la barre du PQ durant les années de la traversée du désert. Mais les convictions changent parfois et les siennes ont bougé, ce qui est humain et légitime. Dans cette circonstance je suppose aussi qu'il aurait souhaité un départ digne et serein comme Gabriel ; comme celui de Lionel Carmant qui a quitté la CAQ sans insulter les militant-es de la base, celles et ceux-là même qui ont œuvré sans compter leurs heures et leur énergie pour le faire élire. Hélas, ça ne s'est pas passé comme ça, et je crois que Vincent est le premier à le regretter. C'est une nuance qui importe.
À la cheffe de QS
La plupart des député-es qui quittent leurs partis le font parce qu'ils sont en désaccord avec leurs chefs. Vincent Marissal a fait la même chose : il s'est plaint de la base militante parce qu'il avait compris que la base militante est la véritable et seule cheffe de QS.
Ruba et Sol – et d'autres porte-paroles avant eux comme Françoise, Manon, Émilise, André Frappier, Andres Fontecilla et moi-même je crois bien, avons bien assimilé cette réalité et l'avons intégrée tant bien que mal dans nos pratiques. Gab a sans doute tenté de le faire aussi, mais avec quelques difficultés. Vincent toutefois, comme quelques-autres d'entre nous les Solidaires- n'a finalement pas pu accepter que la ''base militante'' soit la cheffe. Et ça donne ce départ.
Je dis quelques autres d'entre nous en me rappelant par exemple d'une des membres du comité de coordination nationale de l'UFP et qui était parmi les fondatrices de QS en 2006. Elle ne cessait de s'en plaindre en privé et me voulait comme chef. Mais dans la réflexion qui a mené à la fondation de QS on a préféré rompre avec cette structure hiérarchique politique, celle de chef, héritée de la nuit des temps. QS a choisi de faire de la délibération de ses membres son unique cheffe. Comment un assemblage de gens en délibération peut remplir le rôle de chef ? Tout chef est en constante délibération avec lui-même et son entourage. Rien de différent à ce chapitre si ce n'est un mécanique plus compliqué, mais pas tant à l'ère moderne des moyens de communication en continue.
La structure hiérarchique novatrice que QS s'est donnée à sa fondation ne vise ni à étouffer personne ni à embrigader quiconque contre son gré. Elle est connue de toutes et tous à l'admission dans nos rangs. C'est une vision démocratique qui correspond selon nous à l'évolution des sociétés démocratiques et à l'approfondissement de la démocratie en faveur de structures de représentation et de délégation de pouvoir décentralisées.
La chefferie traditionnelle qui s'incarne dans une personne est la pierre angulaire des organisations et sociétés autoritaires primitives ou traditionnelles. Il est cependant navrant de constater qu'à l'ère de la littératie universelle et la démocratisation du savoir et des droits, nos structures de pouvoir contemporaines soient encore aussi lourdement imprégnées de ce schéma archaïque.
Renoncer à une organisation du pouvoir centrée sur un-e chef-fe est de mon point de vue une autre étape dans le long parcours d'un idéal démocratique qui a émergé il y a trois ou quatre siècles avec le renversement des monarchies despotiques. Diminuer, voire abolir les pouvoirs confiés au chef a pour objectif ultime de diminuer le plus possible l'inégalité inhérente qui existe dans la relation entre gouvernants et gouvernés. Car cette inégalité est un obstacle à l'idéal démocratique qui vise la pleine souveraineté des peuples et des citoyens.
Qui dit idéal se pose la question de son accessibilité. Évidemment on peut douter que cet idéal soit réalisable dans un avenir prévisible. Mais rien n'empêche les organisations qui tendent vers une plus grande autonomie et souveraineté des citoyens à diminuer cette inégalité en innovant. Ce qui requiert d'abord le dépassement des structures anciennes, dont celles dominées par la figure du chef.
Ceci ne se fera pas par génération spontanée. Ce dépassement nécessite des tentatives comme la nôtre de faire évoluer la culture démocratique qui tarde à accoucher de la démocratie participative. C'est dans cette perspective que QS a choisi de renoncer à se donner un-e chef-fe en confiant le rôle de le représenter à des porte-paroles. QS a voulu dès le départ en 2006 mettre en pratique plusieurs des innovations déjà pratiquées par des formations politiques ailleurs dans le monde qui étaient en rupture avec la démocratie libérale bourgeoise. Si en 2006 cela était moins apparent, ça crève maintenant les yeux que nos démocraties libérales (qui en portent de moins en moins bien le nom) sont de plus en plus en proie à l'influence sinon au contrôle total d'une poignée de riches et de puissants oligarques qui veulent nous dicter la marche du monde. Ces élites ultra-minoritaires se sont dotées d'un contrôle étendu des appareils médiatiques et politiques de toutes sortes de manières directes et détournées. Mais cette usurpation des pouvoirs au sein des démocraties représentatives n'a été rendue possible que par la collusion au sommet par des individus qui se sont hissés au pouvoir pour ensuite utiliser les prérogatives du ‘'chef politique'' pour avancer les intérêts de cette ultra-minorité.
Cet exercice corrompu des prérogatives du chef s'est effectué en toute ‘'légitimité institutionnelle'', au mépris de la base politique (base militante des partis) qui les a placés en position de décider, et au détriment du plus grand nombre. Trump en est une illustration extrême. Mais presque toutes les démocraties occidentales en offrent des exemples.
Macron est un exemple différent de Trump par ‘'sa saveur'' mais identique en substance : corruption de la démocratie représentative au profit d'une minorité de nantis par l'exercice sans partage du pouvoir rendu possible par les prérogatives qu'imposent la place hiérarchique du chef. Les deux illustrent de manière extrême à quel point les pouvoirs confiés aux ‘'chefs'' d'organisations politiques peuvent faire le lit de cette usurpation du pouvoir par la classe économique archi-minoritaire mais dominante des ultra-riches. C'est un élément facilitateur déterminant dans les nombreux exemples de la corruption de l'exercice de la démocratie représentative qu'on pourrait facilement répertorier.
Toute l'architecture de ces modèles de structuration et de distribution centralisée du pouvoir alentour du chef dans les partis est donc à revoir, car elle est partie prenante – comme le rôle du lobby professionnel au service d'entités à but lucratif - dans cette immense corruption.
Aux radicaux qui veulent changer les choses à la racine du problème
Marissal s'est plaint des ‘'radicaux''. Il s'est plaint de vous les militants-tes de la base, la ‘'gang'' qu'il n'était ‘'plus capable d'endurer''.
Je voudrais vous confier ici pourquoi je le comprends. Je comprends pourquoi ça pouvait être difficile pour lui d'accepter les orientations de son ‘'cheffe'', étant donné son positionnement que j'expliquerai plus loin. On peut être fâché de la manière, mais je pense qu'il ne faut pas porter un jugement moral sur sa décision mais plutôt un jugement politique sur son orientation soi-disant ‘'pragmatique''. Aucun « pragmatique » au sens commun donné dans nos démocraties parlementaires, ne serait capable de vous ‘'endurer'' pendant deux mandats !
Vincent a dû faire le même constat que moi : vous êtes une ‘'gang'' de gens demeurés « radicalement », obstinément Solidaires malgré les obstacles et la rigidité des habitudes politiques ; malgré l'opposition des plus fortunés et des plus puissants ; malgré les injonctions et les campagnes d'intimidation médiatique.
Pour ces médias qui préfèrent garder le débat à la surface des controverses et des petites joutes politiques, vous êtes des radicaux par opposition aux pragmatiques. Vous êtes des ?????????? par opposition aux Lucides. Vous êtes têtus et obstinés, vraiment inconscients de l'ordre ‘'naturel'' des choses en démocratie bourgeoise.
Je caricature un peu, mais la réalité est que ce dilemme entre radicaux et pragmatiques est vieux comme le monde. En tout cas aussi vieux que la politique qui s'exerce depuis des temps immémoriaux. Vivre ce dilemme n'a rien de honteux et d'inadmissible. La tentation pragmatique a toujours existé et a été explorée par les plus admirables des personnes, aux motivations les plus nobles.
Dans cette perspective, la tentation pragmatique de Vincent n'a rien de honteux ni d'illégitime. Bien au contraire elle s'impose dans nos débats publics et ailleurs de multiples façons et de manière récurrente.
Il y a 20 ans exactement, en novembre 2005, nous étions une trentaine de signataires à lancer un manifeste pour un Québec solidaire (d'où notre parti tire son nom) qui a amassé plus de 20 000 signatures dans le but de réfuter les thèses d'un groupe de notables et de puissants avec à leur tête Lucien Bouchard, ex-premier ministre du PQ, qui deux semaines plus tôt avait lancé un manifeste pour un Québec lucide. (Voir le manifeste des solidaires sur le site des Classiques de l'UQAM – manifeste pour un Québec solidaire) :
Les Solidaires étaient dépeints par les commentateurs médiatiques habituels ainsi : au mieux comme des rêveurs désintéressés du pouvoir et aveugles aux réalités dépeintes en toute lucidité et pragmatisme par les signataires du manifeste de Lucien Bouchard ; au pire nous étions des gauchistes radicaux bloqués dans notre idéologie obsédée d'égalité qui était considérée dépassée.
Pour d'autres commentateurs médiatiques qui s'intéressaient au sens véritable des mots, sans partisannerie coutumière… nous étions des « radicaux » parce que nous voulions des changements plus en profondeur que ceux promis par les partis réformistes. Des partis ‘'pragmatiques'' toujours appelés par la classe politique et économique dominante à se montrer raisonnables et lucides, à faire des concessions pour ‘'prendre le pouvoir''. Alors que nous, nous disions : non, merci !
Aujourd'hui, comme il y a 20 ans, ce n'est pas plus compliqué que ça : vous êtes radicaux, parce que vous dites non merci.
Vous dites non, parce que pour que ça vaille la peine, pour pouvoir appeler ça prendre le pouvoir, il faut vraiment pouvoir changer les choses à la racine des problèmes.
Or, si pour prendre le pouvoir il faut être à ce point « raisonnable et pragmatique » qu'il faut éviter de nommer ces problèmes – comme le fait que dans une société juste et démocratique on ne doit pas empêcher les travailleurs de s'organiser librement et utiliser des moyens légaux pour faire pression (ça s'appelle la grève) – comment est-il possible de régler ces problèmes ?
Si par pragmatisme il faut même éviter complètement d'identifier la cause fondamentale, la racine de ces problèmes, c'est-à-dire le système économique capitaliste qui occasionne ces problèmes, comment sommes-nous supposés remédier à tout cela ? Comment peut-on alors se permettre d'offrir des solutions ? Si on s'accorde à dire que le système actuel détruit et nous condamne à des catastrophes écologiques, économiques et sociales, comment sommes-nous supposés dépasser le capitalisme sans aujourd'hui mettre l'accent sur l'écologie et l'égalité ; sans réfléchir à voix haute de pistes de solutions comme le socialisme démocratique, l'écosocialisme, la décroissance conviviale ou toute autre innovation politique ou économique capable de nous sortir de ce pétrin immense dans lequel le capitalisme nous a plongés ?
Donc, comme on le voit, le dilemme que vit Vincent Marissal est un déchirement entre les mêmes lignes de faille. D'une part la ligne des tenants d'une accession rapide au pouvoir dans l'espoir d'y accéder aux moyens étatiques de changer des choses ; mais ce faisant accepter un certain degré de soumission à l'ordre ‘'naturel'', aux contraintes du système en place – l'appareil économique capitaliste. À l'époque du Manifeste pour un Québec solidaire les principales contraintes du moment étaient dictées par l'agenda néo-libéral du libre-échange et de la liberté totale du capital sans contrainte étatique ou tarifaire. D'autre part, la ligne des Solidaires, tenants d'une accession au pouvoir porté par les classes populaires organisées et mobilisées par des mouvements sociaux, pour permettre à l'État de conduire les réformes profondes que nécessite un monde plus juste, solidaire et responsable. Nous étions soi-disant des rêveurs radicaux, incapables de compromis avec les exigences du système.
Aujourd'hui la ligne de faille qui sépare ‘'radicaux'' et ‘'pragmatiques'' est dictée par la montée de l'extrême droite dont les éléments de langage et de discours débordent et parfois inondent tout l'espace politique, y compris le positionnement de partis autrefois considérés de centre gauche, comme la ‘'social-démocratie » européenne ou québécoise. Cette inondation a un visage caricatural en celui de Donald Trump, qui n'est que l'exemple le plus abouti des dérives de la droite montante qui a graduellement imposé sur 3 décennies ses lignes de démarcation : rejet de la diversité et de l'inclusion, mise à l'index des immigrants et de l'étranger comme principales sources des maux sociaux, mise à l'écart de toute considération qui vaille sur le plan environnemental sous prétexte des exigences économiques, repli identitaire sur une définition ethnique sinon raciale du nationalisme, rejet des institutions internationales qui participaient à des garanties minimales de la primauté du droit sur la force dans des rapports par ailleurs très inégalitaires.
Alors voilà : vous la gang de ‘'radicaux de la base de QS'' Vous refusez d'accepter les contraintes du système - notre système économique appelé capitalisme qui ne veut pas qu'on le dérange trop fondamentalement. Le système n'aime pas du tout les gens qui le remettent trop radicalement en question pendant qu'il exploite les humains, appauvrit les gens au profit des élites ultra-riches, fomente des guerres, pille les ressources, détruit et pollue l'environnement et perturbe le climat irrémédiablement.
Remettre tout cela en question est déraisonnable, donc pas pragmatique si on veut être pris au sérieux. Oui, car trop d'intérêts en dépendent. Et vous voudriez que dans ces circonstances, on soit tendre avec vous dans les journaux et les médias alors que vous refusez d'en tenir compte de manière « pragmatique et raisonnable ». Vous semblez en apparence être indifférents au fait qu'en apparence c'est votre obstination à refuser de taire un peu vos idéaux d'égalité, de justice et d'écologie qui vous empêcherait de prendre le pouvoir. Ce pouvoir étatique par lequel pourraient arriver les changements. Quels changements ? Ceux acceptables par le système sans remise en question fondamentale.
On vous reproche essentiellement de ne pas être intéressés par une accession plus rapide au pouvoir qui serait assortie de la garantie de ne pas trop déranger le système sur sa base… Vous seriez déraisonnable de ne pas vouloir jouer dans ce jeu. Ce serait pragmatique de prendre des moyens pour arriver au pouvoir qui ensuite vous empêche d'agir de manière raisonnablement cohérente pour mettre en œuvre vos objectifs. Et on appelle cela pragmatisme ! Cherchez l'erreur.
Ce serait même pire, si l'on en croit certains commentateurs qui poussent plus loin une certaine logique et tentent de vous opposer vous les Solidaires à Vincent – voire GND – les qualifiants de pragmatiques. Vous seriez Solidaires par inconscience ou aveuglement fanatique. Votre constance indomptable aurait vaincu la patience de Vincent ou GND. Etc, etc.
Cette mise en opposition fantasmée par les suspects médiatiques habituels est une duperie. Je crois pouvoir l'affirmer sans hésiter pour GND – avec un peu moins de certitude pour Vincent : la différence perçue entre les différentes sensibilités prédominantes au sein des Solidaires, traduit des divergences sur les moyens objectifs immédiats pour sortir des contraintes. Pas sur l'acceptation des contraintes. Et le débat reste ouvert sur ces moyens.
Comment s'en sortir
La question qui se pose à la cheffe de QS, la base militante, est donc : comment se sortir de ces contraintes ?
Je nai pas de réponse bien réfléchie et en plus j'ai déjà trop écrit. Donc j'ai pensé céder ici la parole à
Bhaskar Sunkara, éditeur du magazine américain The Jacobin, une revue de gauche socialiste. The Jacobin a été un vecteur important d'une décennie d'organisation et de mobilisations de l'initiative socialiste au sein du Parti Démocrate américain qui a pris naissance alentour de la candidature de Bernie Sanders en 2016 et s'est soldée récemment par la victoire de Zohran Mamdani à la mairie de NY.
Dans un éditorial intitulé ‘'The Goal of Socialism Is Everything'' il écrit ceci :
« …fondamentalement, toute forme de gouvernance sociale-démocrate est soumise à des contraintes. Tout comme sous le capitalisme, les travailleurs dépendent de la profitabilité des entreprises pour avoir des emplois. Les villes dépendent des grandes entreprises et des personnes riches pour leurs recettes fiscales… Ces préoccupations ne sont pas nouvelles. C'est le dilemme de la social-démocratie. C'est la tension entre nos objectifs à court et à long terme qui existe dans le mouvement socialiste depuis 150 ans.
À court terme, nos élus doivent gérer le capitalisme dans l'intérêt des travailleurs, tandis que notre mouvement a aussi un objectif à long terme : construire un nouveau système grâce à l'auto-émancipation de ces mêmes travailleurs.
Nous devons comprendre les contraintes auxquelles Zohran sera confronté en ces termes structurels, plutôt que moraux. Mais avoir de la patience et le soutenir ne répond pas à la question de savoir comment concilier le court et le long terme – la social-démocratie et le socialisme.À tout le moins, il est important de se souvenir de l'objectif final. Le grand théoricien du réformisme, Eduard Bernstein, a dit un jour que « le but final n'est rien, le mouvement est tout ». Je pense que ce n'est pas tout à fait juste. Si nous ne parlons pas du socialisme après le capitalisme, personne d'autre ne le fera. Le rêve historique de notre mouvement, un monde sans exploitation ni oppression, sera perdu.
Mais nous ne devrions pas éviter le réformisme simplement pour nous sentir purs en tant que « vrais socialistes » ou par pur exercice intellectuel. Nous devrions éviter le réformisme et nous souvenir de l'objectif de rupture avec le capitalisme parce qu'il peut offrir une vision convaincante du monde à ceux que nous essayons de toucher.
Le socialisme n'est pas la « Suède », comme Bernie [Sanders] le dit parfois. Le socialisme n'est même pas seulement, comme l'a dit Martin Luther King Jr et comme Zohran l'a si bien invoqué, « une meilleure répartition des richesses pour tous les enfants de Dieu ».Le socialisme signifie une meilleure répartition, mais aussi un contrôle démocratique sur les choses dont nous dépendons tous les travailleurs qui tiennent les leviers de la production et de l'investissement, et l'État qui garantit les bases de la vie comme des droits sociaux.
Le socialisme signifie ne plus mendier auprès des entreprises pour qu'elles investissent dans nos communautés, ou auprès des riches pour qu'ils restent et paient leurs impôts.Le socialisme signifie surmonter la dialectique travail-capital par le triomphe du travail lui-même, et non par un compromis de classe plus favorable.
Le socialisme signifie que les personnes qui ont maintenu ce monde en vie – les aidants, les chauffeurs, les machinistes, les ouvriers agricoles, les agents d'entretien – cessent d'être une toile de fond invisible et deviennent les auteurs de leur propre avenir.
Le socialisme signifie une société où ceux qui ont toujours donné sans avoir leur mot à dire montrent enfin leurs véritables capacités. Où, comme l'a dit C. L. R. James, toute cuisinière peut gouverner.
Le socialisme signifie remplacer une économie basée sur la hiérarchie et l'exclusion par une économie bâtie sur l'intelligence et la créativité des travailleurs eux-mêmes.
C'est l'objectif que nous maintenons en vie. Non pas parce qu'il est utopique, mais parce qu'il est le seul horizon à la hauteur de la dignité et du potentiel des gens ordinaires. » (source : site de Jacobin numéro de nov 2025 et cherchez socialism-mamdani-dsa-organizing-leadership)
Je relis cet article et ma conviction se renforce : c'est là un pragmatisme digne du sens véritable de pragma : action, accomplissement !
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Conflits de travail – Entrée en vigueur de la Loi n° 14, contestations déposées par les organisations syndicales

À peine entrée en vigueur le 30 novembre 2025, la Loi no 14, Loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out qui a été adoptée par le gouvernement de François Legault le printemps dernier, est déjà contestée devant les tribunaux. La FTQ, la CSN, la CSQ, la CSD et l'APTS, qui représentent ensemble plus d'un million de travailleuses et de travailleurs, annoncent le dépôt de contestations juridiques coordonnées.
« La Loi no 14 brime le droit de grève des travailleuses et des travailleurs, brise l'équilibre des relations de travail et remet trop de pouvoirs entre les mains du ministre du Travail. Dès le départ, nous avions prévenu que la Loi no 14 conforterait les employeurs à laisser traîner les négociations dans l'attente de l'intervention du ministre, qu'elle envenimerait les relations de travail et aurait une incidence importante sur les conflits de travail. Non seulement la Loi no 14 compromet gravement, à notre avis, les droits des travailleuses et des travailleurs, mais elle est aussi inconstitutionnelle, en plus d'être un élément toxique pour le climat social au Québec, dénoncent d'une voix commune les porte-paroles syndicaux Magali Picard (FTQ), Caroline Senneville (CSN), Éric Gingras (CSQ), Luc Vachon (CSD) et Robert Comeau (APTS).
« Nous l'avons signifié à maintes reprises : la Loi no 14 est une atteinte à l'action collective des travailleuses et des travailleurs. Elle modifie les règles du jeu unilatéralement sur de fausses prémisses. À vouloir faire taire, ce gouvernement attise la grogne. La voix que nous portons, c'est celle des membres que nous représentons. Et que le gouvernement se le tienne pour dit : ça fait pas mal de monde ! »
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Manifester contre le virage à droite de la CAQ : Ok, mais les autres ?

La manifestation organisée par les principales organisations syndicales québecoises a eu lieu ce samedi et elle fut importante. Depuis les récentes négos dans les secteurs public et para-public, nous n'avions pas vu de mobilisation aussi massive. Elle a eu lieu dans un contexte où la CAQ au pouvoir montre ses vraies couleurs de parti des élites, incompétent et revanchard. Un parti qui tente par tous les moyens de détourner l'attention de la population suite aux échecs retentissants de ses politiques (Northvolt, régime forestier, crise du logement, 3e lien à Québec, etc.).
Après avoir blâmé l'immigration, les médecins et la guerre tarifaire de Donald Trump, voilà que les caquistes déclarent la guerre aux syndicats. « Encadrement » du droit de grève avec la loi 14 et maintenant la loi 3 qui contraint les centrales et leurs syndicats affiliés à une série de mesures administratives qui visent à affaiblir leur pouvoir de contester hors des négos de conventions collectives, voilà les défis que pose la CAQ au mouvement ouvrier.
Les organisations syndicales préparent la riposte. Tout d'abord, elles contestent la loi 14 devant les tribunaux. Elles affirment avec raison que les lois 3 et 14 briment le droit de grève et qu'elle remet trop de pouvoir entre les mains du ministre. Le Barreau du Québec partage cet avis. Puis la manif du 29 novembre dernier se tenait la grande manifestation afin d'« affirmer que la justice sociale n'est pas négociable et qu'on ne bâtit pas une société forte en rétrécissant le débat. Ensemble, faisons entendre la voix d'un Québec fier, solidaire et résolument tourné vers l'avenir ». Les centrales rappellent l'état lamentable du réseau de la santé et des écoles délabrées.
La CAQ adopte en effet l'approche actuelle des partis de droite partout en occident, stratégie qui consiste à marcher sur les pas des partis de l'extrême-droite qui ont le vent dans les voiles, à adopter en partie son langage, ses politiques notamment en matière d'immigration pensant ainsi gruger des appuis électoraux acquis à ces partis. Ici c'est la base électorale des conservateurs qui est visée. Couper l'herbe sous le pied du parti d'Eric Duhaime est le but de la CAQ. Le PQ emboîte le pas dans ce sens, sa position de tête dans les sondages le poussant à mettre ses cartes programmatiques sur la table, et le PLQ compte demeurer le parti du grand capital pan-canadien malgré les crises qui le traverse.
Dans ce contexte, la mobilisation des centrales doit s'appuyer non seulement sur la volonté de bloquer le virage à droite de la CAQ mais aussi celui de l'ensemble des partis qui se situent dans l'axe néo-libéral. Or le mot d'ordre pourrait porter à croire que, comme dans de trop nombreuses élections tant fédérales que québécoises, les centrales adoptent la politique du « moins pire ». Celle-ci consiste à identifier le parti qu'elle considère le plus dangereux pour le « modèle québecois » et à appeler à voter pour le partis le plus en mesure de bloquer l'élection de cet indésirable. Mais ce faisant, on ne fait qu'encourager un système d'alternance entre deux partis qui s'opposent en apparence mais qui comportent davantage de ressemblance que de différences en matière d'orientation politique. Le PQ et le PLQ en sont des exemples probants alors qu'ils s'échangeaient le pouvoir et adoptaient des politiques plutôt similaires et surtout une hostilité commune envers les syndicats.
Paul St-Pierre-Plamondon a montré ses vraies couleurs suite au passage de la présidente de la FTQ Magalie Picard à la commission parlementaire étudiant le projet de loi 3. Celle-ci a refuser de serrer la main du ministre Boulet et l'a notamment qualifié d'« innocent ». Elle a aussi menacé le gouvernement caquiste d'une grève sociale ce qui a permis de montrer les vraies couleurs des partis CAQ-PQ-PLQ-PCQ au Québec, tous unis contre le mouvement syndical. PSPP a même refusé de se présenter au congrès de la FTQ, la plus importante centrale au Québec. Personne ne pourra prétendre parmi ces formations politiques avoir un préjugés favorable aux travailleurs comme le laissait entendre le PQ à une certaine époque. Ce qui laisse une seule option aux mouvement ouvrier pour construire un mouvement qui non seulement s'oppose aux politiques anti-syndicales mais qui construit une alternative capable d'imposer une autre logique.
Québec solidaire représente la seule option qui partage avec le mouvement syndical, féministe et communautaire l'orientation commune vers une société compatible avec les objectifs du mouvement ouvrier. Une coalition qui regrouperait les organisations des classes populaires et le parti de gauche pourrait imposer une dynamique profitable à toutes les parties, les organisations s'assurant de l'application de politiques qui leur sont favorables et QS recompose sa base électorale de façon plus organique avec les organisations que se sont donnés les populations. Une telle union aurait alors le potentiel d'imposer une toute autre logique à la politique québécoise, vers une indépendance véritable au service des classes populaires.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Jean Boulet : Ministre du travail ou du patronat ?

Mais d'où vient cet intérêt du Ministre du travail, M. Jean Boulet, pour la démocratie et la transparence financière, des syndicats exclusivement ? D'où peut donc provenir cette étonnante aspiration pour la démocratie et la transparence de la part d'un Gouvernement critiqué de toute part, y compris par la Commission des droits de la personne ou le très peu militant Barreau du Québec, pour ses « dérives » autoritaires et son manque de transparence financière ?
Le ministre ne cesse de le répéter, comme un disque orwellien rayé. Contrairement à ce dont on l'accuse, le nouveau système de "cotisations facultatives" et de reddition de compte, n'est pas contre les syndicats mais pour les syndiqué·es ; pour qu'ils et elles puissent enfin s'exprimer, de manière démocratique et transparente.
Pourtant, à notre connaissance, jamais un seul syndicat de travailleurs et de travailleuses ne lui a demandé de s'occuper de démocratie syndicale. Nous n'avons même pas trouvé une pétition en ce sens, ni même un mémoire d'une quelconque association de travailleurs et de travailleuses.
On nous explique alors que c'est précisément parce que les syndiqué·es ne peuvent pas s'exprimer, que le ministre a dû prendre ses responsabilités et régler un problème démocratique majeur. Lui, l'ancien avocat patronal (Lavery), lui l'ancien président de la Chambre de commerce et d'industries de Trois-rivières (CCITR), qui connait bien les attentes des syndiqué·es.
Et en ce sens, il serait d'ailleurs vraiment ingrat d'oublier qu'il s'agit également d'une revendication de longue date du très démocratique et très transparent syndicat des patrons, le Conseil du patronat du Québec (CPQ) [1].
Ainsi, en 2011 le CPQ demandait déjà :
« que la portion [des] cotisations utilisée pour financer d'autres mandats que la représentation au chapitre des relations du travail (notamment les campagnes d'affaires publiques) puisse être versée sur une base volontaire par les travailleurs ».
En 2025, le Projet de loi 3 déposé par le Ministre du travail prévoit :
« que seules les cotisations facultatives peuvent être utilisées pour financer certaines activités déterminées lorsque ces activités sont financées au moyen de cotisations syndicales ».
Mais que ferait donc la classe ouvrière sans Jean Boulet et le Conseil du patronat ?
On ne sait pas. En revanche, les 50 000 travailleurs et travailleuses qui ont manifesté le 29 novembre 2025 contre l'ensemble de l'œuvre du Gouvernement Legault, aimeraient bien le savoir.
En attendant, il faut être bien "innocent" pour ne pas voir que, à la différence de Magali Picard, la présidente "hystérique" de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, le gouvernement Legault travaille, "dans le dialogue et la collaboration", sans "hausser le ton" et très "respectueusement", tout à la fois pour les patrons et pour la CPQ.
Martin Gallié
Délégué du syndicat des professeurs et professeurs de l'Université du Québec à Montréal (SPUQ-UQAM) au Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN)
Illustration : Georges Rouault, Laquais, 1917
(merci à Laurence pour le mémoire)
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Étude parlementaire sur la loi C-12 : les organismes communautaires et les associations des avocats se sentent complètement ignorés

Si, au soir du 8 octobre 2025, les Canadiens avaient les yeux rivés à leurs écrans pour assister à la victoire des Blues Jays contre les Yankees de New York, peu avaient suivi le dépôt du projet de loi C-12, qui avait été effectué le matin même par le ministère de la Sécurité publique, l'honorable Gary Anandasangaree.
Un mois et demi plus tard, La Loi visant à renforcer le système d'immigration et la frontière du Canada n'a encore fait aucune vague. Elle passe ni vu ni connu, comme ces balles flottantes qui déjouent si souvent les batteurs au baseball.
Malgré tout, son absence dans les médias ne fait que camoufler les changements radicaux du système d'immigration que celle-ci propose. La nouvelle loi modifierait le processus de traitement des réfugiés, et permettrait aux fonctionnaires de l'État de suspendre des demandes d'asile ou des permis de travail pour des raisons « d'intérêt de l'État ». Les organismes communautaires et les groupes d'avocats en immigration sonnent l'alarme, mais personne ne semble vouloir les écouter.
Des avocats atterrés
La loi C-12 prend sa source dans le projet de loi C-2, qui avait été retiré en juillet dernier suite à une forte contestation populaire, notamment en raison de ses amendements permettant aux services de police d'accéder à des renseignements privés sur les Canadiens sans mandat.
Déjà, en juillet, l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration (AQAADI) avait déposé un mémoire auprès du gouvernement fédéral au sujet de la loi C-2. Celle-ci n'avait pas demandé le retrait du projet de loi, l'association n'avait que proposé des ajustements :
« On a tenté de mettre à l'avant que le système était déjà sécuritaire, déjà efficace d'une certaine façon, et que ça n'allait pas le rendre plus sécuritaire ni plus efficace. Au contraire, ça allait vraiment l'alourdir, »
Explique Julie-Anne Desnoyer, une avocate en immigration spécialisée en droits des réfugiés qui a contribué à la rédaction du mémoire. Si la loi est censée augmenter « la rapidité » et la « convivialité » du système de traitement des demandes, le rapport de l'AQAADI explique que le transfert de plusieurs demandes d'asile à l'agence des services frontaliers (ASFC), plutôt qu'à la commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR) comme c'est le cas en ce moment, ne va que transférer la responsabilité du traitement des demandes à d'autres fonctionnaires moins efficaces et moins bien formés.
Le Canada a reçu plus de deux fois plus de demandeurs d'asile entre 2023 et 2025, mais la nouvelle loi n'allègerait pas le processus de traitement des réfugiés :
“Ce qu'on disait c'était que ce n'était pas une solution au problème de surcharge … la loi C-2 ne faisait que déplacer les demandes d'un système qui est préparé à les accueillir à un autre qui ne l'était pas, »
Rajoute l'avocate Gwendolyn Muir de la Clinique pour la justice migrant. S'attendant à ce que le projet de loi C-12 comprenne au moins certaines modifications, celle-ci fut surprise quand elle remarqua que rien n'avait vraiment été changé dans le nouveau projet de loi déposé au début du mois d'octobre. En entrevue, Gwendaline s'inquiète de voir que non seulement la nouvelle loi n'a pas été changée, mais que la commission parlementaire qui étudie le projet de loi, qu'elle suit régulièrement à la télévision, n'a consulté aucun parti concerné :
« Il n'y a aucun intérêt, dans ce que je peux voir au parlement, de vraiment écouter les gens qui vont être impactés par cette loi … Tu peux voir les témoins qui ont été invités par le ministère de la Sécurité publique : des gens en cybersécurité, des agents des services frontaliers, des représentants de la police - pas une seule organisation communautaire ou un groupe d'avocats. Ils invitent juste des gens qui ne connaissent rien au processus ! »
Le processus de traitement des demandes d'asile est complexe et peu compris par ceux qui n'en sont pas des spécialistes. Gwendalin, qui travaille depuis des années dans le milieu, est furieuse de savoir que son métier va être transformé par des fonctionnaires qui ne connaissaient rien au droit des réfugiés. « Ils ne comprennent même pas le système dont ils discutent, et ils ne font même pas l'effort pour le faire », me dit-elle, complètement dépassée.
Des mois difficiles à l'horizon
Plus tôt cette semaine, une coalition de groupes communautaires a lancé un appel pour le retrait de la loi C-12 à une conférence de presse à Ottawa. Leur plaidoyer, lu par Gauri Sreenivasan, du Conseil canadien pour les réfugiés, affirmait que la loi était discriminatoire, et qu'elle allait contre la Charte canadienne des droits et libertés.
Malgré tout, plusieurs partis de l'opposition semblent être peu investis dans la lutte contre loi C-12. L'opposition la plus vive vient des conservateurs, dont certains membres prétendent qu'elle n'est pas assez stricte. Avec le NPD en restructuration, et le Bloc qui refuse de s'y prononcer, les groupes communautaires opposés à la loi peinent à trouver des appuis forts au sein de la classe politique. Rushdia Mehreen, membre active de Solidarité sans frontières basée à Montréal, affirme même que la communauté journalistique ne s'y intéresse peu.
De son côté, le public, qui se laisse graduellement emporter par les discours anti-immigratoire de la droite canadienne, semble tout aussi passif. Lors d'une manifestation que Rushdia et d'autres membres de SSF ont organisée à Montréal le 13 octobre, moins de vingt personnes se sont présentées.
Une lueur d'espoir : il semble tout de même que la loi ne va pas passer avant l'année prochaine. Cela donnera aux groupes de pression plus de temps pour réveiller l'opinion publique et, en attendant que la saison de baseball reprenne, peut-être capter l'attention des Canadiens sur autre chose que du sport. « Du pain et des jeux », disaient-ils…
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Projet de loi 9 et prières collectives en public – Une atteinte claire à la liberté de religion,

La Ligue des droits et libertés et l'Association canadienne des libertés civiles s'opposent au projet de loi 9 déposé le 27 novembre 2025. Ce projet de loi ne bafoue pas uniquement les droits des minorités religieuses. Ce sont tous les Québécois·es – croyant·es et non-croyant·es – qui doivent s'alarmer de cette nouvelle limite à l'expression en public.
27 novembre 2025 | tiré du site de la Ligue des droits et libertés
Le gouvernement du Québec a déposé ce 27 novembre un projet de loi interdisant, sauf exception, les pratiques religieuses collectives sur les voies publiques et dans les parcs, élargissant les interdictions de port de signes religieux des CPE à l'université et restreignant les accommodements religieux. La Ligue des droits et libertés et l'Association canadienne des libertés civiles, ainsi que de nombreuses voix de la société civile, dénoncent à nouveau l'instrumentalisation de la notion de laïcité de l'État pour justifier une violation de la liberté de religion. Nous décrions également l'approche du gouvernement, que nous considérons comme discriminatoire.
Soulignons que ce projet de loi ne bafoue pas uniquement les droits des minorités religieuses. Ce sont tous les Québécois et Québécoises – croyants et non-croyants – qui doivent s'alarmer de cette nouvelle limite à l'expression en public.
D'entrée de jeu, rappelons que la laïcité de l'État signifie de séparer le politique et le religieux, et d'assurer la neutralité de l'État face aux croyances et non-croyances de la population. Ce principe ne signifie aucunement d'effacer le religieux de l'espace public.
Non seulement les prières collectives publiques sont loin de constituer un réel enjeu au Québec, mais qui plus est, elles ont tout à fait leur place dans une société libre et démocratique.
On ne peut d'ailleurs passer outre au fait que cette offensive du gouvernement fait suite à des prières publiques spécifiques qui ont fait les manchettes récemment. Les rares exemples évoqués s'inscrivaient dans le contexte de manifestations en soutien au peuple palestinien, qui subit ce qu'une commission d'enquête de l'ONU et des experts internationaux en la matière qualifient explicitement de génocide. Le contexte de ces moments de recueillement collectif observés à Montréal ne peut être ignoré – tout comme le danger, pour une démocratie, que pareille expression soit censurée par l'État.
Climat d'intolérance
Une quasi-interdiction de prières collectives dans l'espace public ne répond à aucune lacune juridique. Elle entrave plutôt les libertés civiles et alimente un climat d'intolérance et de délation entre concitoyens et concitoyennes. En effet, la législation canadienne et québécoise encadre déjà les rassemblements publics, qu'ils soient ou non de nature religieuse. Advenant qu'un rassemblement soulève des enjeux de sécurité, les autorités disposent déjà de leviers et normes en matière d'ordre public et de sécurité routière leur permettant d'intervenir. La société civile doit d'ailleurs exercer une vigilance constante pour s'assurer que les lois et règlements en la matière, et leur application, respectent la liberté de réunion pacifique, la liberté d'expression et les autres libertés civiles protégées par nos chartes et essentielles à l'exercice de la démocratie.
Censurer l'expression en public sur la base de son caractère religieux est aussi dommageable pour une démocratie que ne le serait de censurer l'expression d'activistes féministes, syndicalistes, indépendantistes, étudiants ou climatiques au motif que leurs propos ou actions offensent, déplaisent ou dérangent.
Le Québec d'aujourd'hui, dans toute sa richesse et sa diversité, est le fruit de nombreuses luttes socio-économiques et politiques menées sur la place publique. Le mouvement féministe des années 1960 et le plus récent mouvement d'action climatique, tout comme les mouvements syndicalistes, indépendantistes et étudiants, ont tous un point en commun : ils ont eu recours aux manifestations pour sensibiliser la population à leur cause et critiquer le statu quo, dans l'espoir d'être entendus par le gouvernement et de provoquer un changement.
L'expression critique génère forcément des réactions variées. Les manifestations pacifiques perturbatrices peuvent aussi créer de l'inconfort, tout comme le fait de voir des concitoyens méditer ou prier dans un espace public.
Cela ne justifie pas pour autant une approche qui est à nos yeux répressive, arbitraire et autoritaire. Au contraire, un inconfort passager fait partie de la vie dans une démocratie, dont une des pierres angulaires est ce droit fondamental qu'a chacun d'exprimer librement en public ses croyances et opinions.
Contrairement à ce que le premier ministre du Québec a laissé entendre, il n'en revient pas à son gouvernement d'être l'arbitre de « ce qu'on veut voir – ou pas – au Québec ». Sous le couvert de protéger la population contre le prétendu fléau des prières de rue, le gouvernement du Québec s'attaque en réalité à notre droit fondamental d'exercer notre liberté de réunion pacifique et de nous exprimer d'une manière qui déplaît à certains, y compris au gouvernement.
Le gouvernement du Québec a déjà porté atteinte de manière éhontée à la liberté de religion de certains employés de l'État. Mais pour la première fois, il annonce son intention d'élargir cette violation de droits à l'ensemble de la population ; c'est un énorme pas qu'il entend franchir. En interdisant les prières collectives dans l'espace public au motif qu'elles importunent certains, le gouvernement du Québec s'avance davantage sur une pente glissante à laquelle tous les Québécois et Québécoises devraient s'opposer.
Anaïs Bussières McNicoll, Directrice du programme des Libertés fondamentales, Association canadienne des libertés civiles
Laurence Guénette, coordonnatrice et porte-parole, Ligue des droits et libertés
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’Ukraine face à un choix insupportable

Il est important d'entendre la voix des Ukrainien·nes, des militant.es progressistes d'abord. Comme dit l'auteur : « Si les mots seuls pouvaient mettre fin à l'oppression, les grèves et les révolutions auraient été remplacées par des concours d'éloquence. » De plus, il permet une réflexion plus globale introduite par la députée européenne finlan- daise Li Andersson qui s'adresse à ceux qui se réclame de la gauche émancipatrice : « Il est grand temps de proposer une alternative crédible dans les débats sur la sécurité, qui ne cède pas au néolibéralisme militarisé et ne fétichise pas la pureté. »
1. Oleksandr Kyselov est militant de Sotsialnyi Rukh. Ukrainien originaire de Donetsk, il est assistant de recherche à l'université d'Uppsala. Article publié par Jacobin, le 22 novembre 2025. Traduction française par Michel Lanson et publié sur le site du Réseau Bastille.
Michel Lanson
Épuisés par plus de trois ans d'attaques russes, les Ukrainiens sont de plus en plus prêts à accepter des compromis politiques injustes et des concessions territoriales sévères pour mettre fin à la guerre. Pourtant, il est loin d'être certain que ce choix difficile apportera réelle- ment une paix durable.
Alors que les spéculations vont bon train au sujet d'un autre plan de paix négocié par Trump pour l'Ukraine, une grande partie du débat ac- tuel donne une impression de déjà-vu. On re- trouve les mêmes dénonciations des « intérêts particuliers » dans le conflit, les condamnations des bellicistes et les appels à des « pourparlers urgents ». En Ukraine, nous n'avons pas seule- ment entendu ces arguments. Nous les avons nous-mêmes formulés.
À l'été 2014, après l'annexion de la Crimée par la Russie et alors que la guerre dans le Don- bass faisait déjà rage, des militants ukrainiens, russes et biélorusses ont publié une déclara- tion « New Zimmerwald » critiquant la montée
du chauvinisme et de la xénophobie dans leurs pays. Ils ont appelé à un vaste mouvement an- tiguerre, à un cessez-le-feu immédiat et à un désarmement mutuel. Le mouvement ukrainien Sotsialnyi Rukh, nouvellement formé, s'est fait l'écho de cet esprit en 2015, préconisant des négociations directes impliquant des syndica- listes et des défenseurs des droits humains des deux côtés, ainsi que la dissolution des agences de sécurité. Il s'agissait d'une véritable tentative de paix internationaliste — qui a échoué. Rien de tout cela n'a empêché l'agression russe en 2022. Pourtant, à l'exception d'une cou- rageuse minorité, les gauchistes russes se sont à nouveau retranchés derrière des formules pa- cifistes, rejetant la responsabilité de la guerre sur les deux camps et pointant du doigt l'OTAN, Boris Johnson et le « régime oligarchique néo- nazi de Kiev ». Les Ukrainiens, sous le feu des bombardements, n'avaient pas ce luxe. Ils ont résisté aux troupes d'occupation, et trop nom- breux sont ceux qui ont déjà perdu la vie.
Au niveau international, lorsque la gauche ne se limite pas à de brèves déclarations sté- réotypées, elle oscille largement entre une ré- pulsion instinctive face à l'injustice et un appel désespéré à la paix. Mais l'un ou l'autre peut-il servir de guide pour l'action ?
Le prix de la justice
Nombreux sont ceux qui dénoncent tout compromis avec le Kremlin comme une trahi- son pure et simple qui créerait un précédent en récompensant l'agression. En termes absolus, ils ont raison. Pourtant, la justice a toujours un prix : si ce n'est pour les militants qui la récla- ment, c'est pour quelqu'un d'autre.
Les ressources de l'Ukraine sont poussées à leur limite. Les dépenses de défense en 2025 ont atteint les 70 milliards de dollars, dépassant les recettes fiscales nationales. Le déficit bud- gétaire oscille autour de 40 milliards de dollars, et la poursuite de l'aide étrangère n'est pas ac- quise. Le coût de la reconstruction a déjà grim- pé à plus d'un demi-billion de dollars. La dette publique s'élève à 186 milliards de dollars et continue d'augmenter.
Près des deux tiers des Ukrainiens s'attendent à ce que la guerre dure plus d'un an, et les ex- perts partagent cet avis. Le président Volodymyr Zelensky souligne que son pays aura besoin de tout le soutien possible pour combattre l'armée russe pendant encore deux à trois ans. Dans le même temps, les forces armées ukrainiennes sont mises à rude épreuve non seulement par le manque d'armes et de munitions, mais aussi par la diminution des effectifs.
Plus de 310000 cas de désertion et d'ab- sence sans permission ont été enregistrés de- puis 2022, dont plus de la moitié en 2025. De nombreux soldats qui ont quitté l'armée in- voquent l'épuisement, le manque de prépara- tion psychologique à l'intensité extrême des combats, les déploiements sans fin et la corrup- tion des commandants qui les traitent comme des pions jetables. Certains sont prêts à reve- nir dès que les conditions s'amélioreront, mais seule une fraction d'entre eux l'ont fait dans le cadre de l'amnistie.
Plus de la moitié des hommes ukrainiens se disent prêts à se battre, mais un million et demi d'entre eux n'ont toujours pas mis à jour leur dossier militaire. Après l'introduction du re- crutement en 2024, seuls 8500 se sont portés volontaires en un an. Même l'offre d'une prime d'inscription de 24000 dollars pour les contrats d'un an aux jeunes n'a pas réussi à en atti- rer beaucoup. Une fois que les restrictions de voyage pour les 18-22 ans ont été assouplies, près de 100000 hommes ont traversé la fron- tière au cours des deux premiers mois, beau- coup pour partir définitivement.
La triste réalité est que la résistance ukrai- nienne repose sur la « busification », c'est-à-dire le fait de saisir de force des hommes dans la ru ou sur leur lieu de travail et de les enrôler de force dans l'armée. Le médiateur a recon- nu que ces abus sont désormais systémiques.
Malgré cela, la Cour suprême ukrainienne a jugé que la mobilisation restait juridiquement irréversible, même lorsqu'elle était effectuée de manière illégale. Pendant ce temps, les réseaux sociaux font de plus en plus souvent état d'af- frontements violents avec les agents chargés de la conscription.
L'opinion publique reflète cette lassitude, et les récents scandales de corruption impliquant les plus proches collaborateurs du président n'arrangent rien. Les sondages montrent que 69 % des Ukrainiens sont désormais favorables à une fin négociée de la guerre et près des trois quarts sont prêts à accepter le gel de la ligne de front, même si ce n'est pas selon les conditions de la Russie. Les Ukrainiens continuent d'insis- ter sur des garanties de sécurité, qui pour eux incluent des livraisons d'armes et l'intégration à l'UE.
Le rêve de « se battre jusqu'à la victoire », quoi qu'il arrive, ignore ces limites. À moins que le « soutien indéfectible » de l'Occident n'inclue la volonté d'ouvrir un deuxième front, à quoi devons-nous nous attendre ? La logique du dé- sespoir conduit à abaisser l'âge de la conscrip- tion, à étendre le service militaire aux femmes, à expulser les réfugiés ukrainiens en âge d'être appelés depuis l'étranger pour remplir les tran- chées, puis à mettre en place des troupes de barrage et des exécutions sur le terrain pour empêcher les désertions.
L'illusion pacifiste
Cette situation sombre n'est pas seulement un échec national. Elle reflète l'épuisement de porter seul le fardeau le plus lourd et de se battre bec et ongles pour obtenir le soutien matériel de ceux qui pensent que des condamnations fermes et une aide humanitaire suffisent pour mettre fin à l'invasion russe. Plus la situation de- vient difficile, plus il est tentant pour certains à l'étranger d'imaginer que la lutte elle-même est le problème.
Si les mots seuls pouvaient mettre fin à l'op- pression, les grèves et les révolutions auraient été remplacées par des concours d'éloquence. D'où l'idée que les armes occidentales ne font que « prolonger les souffrances » et que couper cette bouée de sauvetage à l'Ukraine la pousserait à accepter les « concessions néces- saires ». C'est une illusion réconfortante fondée sur un raisonnement erroné. Si les mots seuls pouvaient mettre fin à l'oppression, les grèves et les révolutions auraient été remplacées par des concours d'éloquence.
Les livraisons d'armes n'entravent pas la di- plomatie, mais permettent à l'Ukraine de parti- ciper aux négociations. Le président Zelensky a fait part de son ouverture à des discussions et même à des décisions difficiles. Mais seule une partie capable de tenir bon peut négocier sur un pied d'égalité. Désarmer l'Ukraine reviendrait à la forcer à céder. Moscou le sait et exploite les contradictions pour semer la confusion et divi- ser les rangs.
Le Kremlin a rejeté à plusieurs reprises un cessez-le-feu, indiquant clairement qu'il ne s'intéressait qu'à la capitulation effective de l'Ukraine. Même si le maximalisme de la Rus- sie est en partie un bluff, un conflit « gelé » ou même la cession du Donbass par l'Ukraine ne « s'attaquerait pas aux causes profondes » de la guerre, comme l'affirme Vladimir Poutine. Mos- cou a sécurisé son pont terrestre vers la Crimée, mais manque de ressources pour s'emparer du reste des oblasts de Kherson et de Zaporijjia, qu'elle revendique également. L'Ukraine ne re- connaîtra jamais ses pertes, même si elle y est officiellement contrainte. Le ressentiment fera de la Russie un ennemi éternel, créant ainsi le risque d'une nouvelle flambée de conflit.
La maxime de Poutine lui-même — « Si le com- bat est inévitable, frappe le premier » — rend la prochaine étape prévisible, à en juger par la carte. Une poussée vers l'avant-poste russe en Transnistrie piégerait la Moldavie, sécuriserait le corridor de la mer Noire et étranglerait ce qui reste du commerce maritime ukrainien, tout en livrant Odessa, autrefois joyau de l'empire russe, au cœur de la mythologie du « printemps russe ».
L'abandon de l'Ukraine par les États euro- péens n'apporterait aucune détente. Les nou- veaux membres de l'OTAN, la Finlande et la Suède, ont abandonné leur neutralité préci- sément en raison de la nouvelle manière dont la Russie « résout les différends ». Cinq pays se sont retirés de l'interdiction des mines terrestres prévue par le traité d'Ottawa en 2025 pour la même raison. Les dépenses militaires de la Po- logne sont en passe de tripler depuis 2022, et les pays baltes se précipitent vers un niveau de dépenses de défense représentant 5 % du PIB.
Voir un voisin démembré par un ancien suzerain ne les apaiserait pas, mais les pousserait à s'ar- mer davantage.
Angle mort
L'ultimatum lancé par Moscou en dé- cembre 2021 a clairement affiché ses ambi- tions : l'OTAN doit se retirer aux frontières de 1997 et reconnaître la sphère d'influence russe en Europe centrale et orientale. Cette exigence semblait absurde jusqu'à ce que les coups de feu éclatent en février 2022. Mais la guerre éclair de Poutine contre l'Ukraine a échoué, et il en tient les « élites dirigeantes européennes » pour responsables.
Personne ne s'attend à ce que les chars russes atteignent Berlin. Mais les États baltes, coincés entre la Russie et son enclave militarisée de Kaliningrad, correspondent au schéma. Les anciennes provinces impériales, qui séparent Moscou de son territoire côtier, constituent une cible tentante. La rhétorique sur les « nations non historiques » en proie à la russophobie est déjà en place.
Si le Kremlin décidait de combler le fossé de Suwalki — l'étroite bande de territoire polonais et lituanien entre Kaliningrad et la Biélorussie, alliée de la Russie — alors que l'Occident est à nouveau en proie à des querelles internes sur les sanctions, la politique énergétique ou la stratégie de défense commune, qui prendrait le risque d'une troisième guerre mondiale ?
À un moment donné, une partie de la gauche a perdu la capacité de distinguer la résistance du militarisme. En considérant l'expansion de l'OTAN comme la cause de la guerre – et en trouvant ainsi une solution dans son simple recul – les antimilitaristes concèdent discrète- ment que de vastes régions au-delà de la Russie appartiennent à son domaine « naturel ».
La question centrale est la suivante : si la Rus- sie peut régler ses griefs historiques et répondre à ses « préoccupations légitimes en matière de sécurité » par la force, pourquoi les autres ne le pourraient-ils pas ? La véritable victoire pour le complexe militaro-industriel ne serait pas les livraisons à l'Ukraine ni même les programmes de réarmement, mais une Europe en crise per- manente, où chaque frontière devient contes- table et où les dépenses de défense augmen- tent sans fin.
Révisionnisme rancunier
La véritable menace n'est pas le nationalisme ukrainien. Il n'est ni plus sinistre ni plus chauvin que celui de n'importe quel petit État assiégé. Même les personnes les plus touchées par la guerre se soucient plus souvent de survivre aux frappes de missiles et aux attaques de drones.
Cela ne signifie pas pour autant que l'on ap- prouve la création de mythes nationalistes. Mais se focaliser sur les excès de la politique cultu- relle de l'Ukraine est une distraction commode, une excuse pour relativiser l'agression et se dis- tancier de ce qui est réellement en jeu.
Nous sommes aujourd'hui confrontés à un empire pétrolier militarisé et expansionniste qui dissimule son ressentiment derrière des dis- cours sur la « justice historique », drapant sa re- naissance néotraditionnelle contre « l'Occident décadent » et prêt à utiliser tous les moyens pour revendiquer sa « place légitime dans le monde ». Cette politique de révisionnisme ran- cunier n'est pas propre à Moscou, mais trouve un écho de Washington à Pékin, et doit être combattue avant que tout discours sur le désar- mement ne prenne tout son sens.
Il est grand temps de proposer une alterna- tive crédible dans les débats sur la sécurité, qui ne cède pas au néolibéralisme militarisé et ne fétichise pas la pureté.
Li Andersson, ancienne présidente de l'Al- liance de gauche finlandaise, a déjà appelé à une politique de sécurité et étrangère antifas- ciste. Elle rejette l'illusion selon laquelle on peut raisonner le fascisme, accepte le renforcement des capacités de défense et de l'autonomie stratégique des États membres de l'UE comme condition préalable à la paix, et défend le droit international comme mécanisme de prévention contre la subversion autoritaire.
L'extrême droite progresse dans les son- dages, les budgets de défense gonflent tandis que les dépenses sociales, l'adaptation au chan- gement climatique et l'aide au développement sont réduites. Pourtant, le problème ici, ce sont les élites qui exploitent cette crise pour faire avancer leur programme, et non les Ukrainiens qui refusent de se plier à la volonté de Poutine.
Pour résister à cette tendance, il faut insister sur deux points. Premièrement, des institutions sociales résilientes et des infrastructures pu- bliques solides sont essentielles pour résis- ter aux chocs et à ceux qui peuvent les uti- liser comme des armes. Deuxièmement, la démocratie économique, l'inclusion politique et le contrôle public rendent toute cause digne d'être défendue. Comme le montrent les leçons tirées de l'Ukraine, sans cela, tout discours sur la solidarité est une imposture.
Pas de solution toute faite
Tout le monde souhaite la fin de la guerre, mais personne n'a de solution toute faite — peut-être n'y en a-t-il pas. Nous nous devons mutuellement l'honnêteté que ce moment exige. Tout ce qui n'est pas le retrait complet de la Russie d'Ukraine est profondément injuste et carrément dangereux, mais la recherche intran- sigeante de la justice peut également nous me- ner à un point de non-retour.
La survie elle-même — perdurer en tant que nation indépendante malgré les leçons d'his- toire de Poutine — est déjà une victoire pour l'Ukraine. Mais l'histoire ne s'arrêtera pas là. Les États cupides attaquent non pas parce qu'ils sont provoqués, mais parce qu'ils en ont la pos- sibilité. Il faudra plus que la force morale pour les arrêter.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Trump : Heurs et surtout malheurs d’un pacificateur pyromane !

La rencontre Trump-Mamdani à la Maison Blanche n'a pas été seulement « étrange » et « surprenante » vu tout ce qui l'avait précédé. Elle a été surtout pleine d'enseignements pour la suite des évènements tant pour l'un que pour l'autre de ses protagonistes. Et le premier de ces enseignements est que Mamdani en sort clairement renforcé ! Pourquoi ? Mais, parce que les effusions d'amitié auxquelles s'est adonné Trump à son égard, se traduisent en désarroi des dirigeants et supporters newyorkais de Trump, qui ne savent plus quoi penser de Mamdani.
Tiré du blogue de l'auteur.
Ce qui contribue à éloigner la mise en exécution des menaces trumpiennes au moins jusqu'à la prise de fonction de Mamdani en janvier prochain, et probablement pour les 4-5 mois suivants. Et évidemment, ce n'est pas du tout un hasard que Trump s'est empressé de déclarer qu'à la suite de l'échange qu'il a eu avec Mamdani, il ne compte pas envoyer ICE et ses autres milices a New York sauf si…Mamdani le lui demande ! En somme, Mamdani gagne un temps précieux pour s'enraciner et organiser sa défense et surtout son mouvement populaire…
Évidemment, ce succès de Mamdani doit beaucoup non pas à son incontestable « charme » personnel, comme le prétendent nos bons médias, mais plutôt à sa fermeté et détermination qui impressionnent et déstabilisent Trump, ainsi qu'à la très méticuleuse préparation de la rencontre de sa part. Cependant, tout ça est secondaire comparé à l'état d'infériorité où se trouvait Trump au moment de sa rencontre avec Mamdani. Tout d'abord, il affrontait celui qui venait de triompher en traduisant en programme d'action le mot « affordability » (abordabilité), qu'un Trump dans le besoin s'est empressé d'adopter donnant même l'ordre à ses ministres d'en faire autant. Et il est dans le besoin parce qu'il est en train de cumuler les déceptions dont la plus importante concerne ses accomplissements économiques : selon une enquête d'opinion de la très trumpienne chaine de télévision FOX publiée le jour de la rencontre Trump-Mamdani, 76% des citoyens américains désapprouvent sa politique économique !
Mais, les malheurs de Trump ne se limitent pas à ces sondages catastrophiques. Son parti Républicain est dans la tourmente depuis qu'un jeune neonazi, antisemite, homophobe, misogyne, négationniste et supremaciste de 27 ans appelé Nick Fuentes a été interviewé sur Youtube par la star des chaines d'extreme-droite -et intervieweur habituel de Trump et de Poutine- Tucker Carlson. Le fait que Carlson ait offert une tribune a un tel individu qui était déjà en train de prendre la place du regretté Charlie Kirk dans le cœur des jeunes Républicains, a soulevé une véritable tempête dans les milieux trumpistes. D'abord, en défendant le choix de Carlson, le président du bastion américain et internationale du conservatisme le plus réactionnaire qu'est la vénérable Heritage Foundation, a provoqué un tollé et la démission de plusieurs de ses dirigeants, tandis qu'une majorité des milliardaires qui financent la Fondation annonçaient qu'ils arrêtaient de la soutenir !
Mais, ce n'était pas tout. Trump lui-même non seulement prenait la défense de son ami Carlson mais se déclarait aussi d'accord avec certaines thèses de Fuentes, sans expliciter lesquelles. C'en était trop, d'autant plus qu'Israel et son lobby américain demandaient les têtes des responsables en sentant monter l'influence néonazie et antisémite dans les rangs d'un mouvement Maga désormais en crise et divisé, tandis que le grand admirateur de Hitler mais aussi de…Staline et accessoirement de Poutine qu'est ce Nick Fuentes voyait son emprise sur le parti du président Trump monter en flèche…
Devant cette multiplication d'échecs et de malheurs, Trump a tenté de redorer son blason en se mettant de nouveau en scène comme pacificateur (1). D'abord, à Gaza et ensuite en Ukraine. Mais, malgré le tapage triomphaliste médiatique, les résultats sont pour le moins plus que médiocres pour lui et tragiques pour les peuples intéressés. A Gaza, le tant célébré cessez-le-feu trumpien a été mort-né dès le départ. Pour tout dire, dès son premier jour, il n'a été qu'une blague macabre, l'apothéose du cynisme meurtrier du tandem Trump-Netanyahou. C'est ainsi que pendant que les médias et nos gouvernants persistent à louer le « cessez-le-feu globalement respecté » à Gaza, l'armée israélienne tue jour après jour, 30, 35 ou 40 civils Palestiniens dans l'indifférence générale. Comme si tuer 30 ou 35 Palestiniens de Gaza par jour est quelque chose de « normal », dans l'ordre des choses, qui n'a rien a voir avec le cessez-le-feu et son fameux… « respect ». D'ailleurs, ce tant célébré cessez-le-feu assassin, ne vaut que pour Gaza, laissant Israël, son armée et ses bandes de colons libres d'agir, de tuer, de saccager, bruler, démolir, déraciner (des dizaines de milliers d'oliviers) et terroriser en Cisjordanie occupée. Ainsi qu'au sud Liban, à Beyrouth et en Syrie !
Alors, fort de son succès à Gaza, Trump a voulu parfaire sa mission (divine ?) de pacification proposant ses services à l'Ukraine. Sauf que, selon son ministre des affaires étrangères Marco Rubio, son plan de paix a été rédigé par le bras droit de…Poutine. Ce qui a fait sensation même dans son propre parti aux Etats-Unis. Mais, ce ne sont pas de tels « détails » qui peuvent faire reculer Trump. « Things happen », ce sont des choses qui arrivent, comme il a dit de l'assassinat, du démembrement et de la dissolution dans l'acide du pauvre journaliste saoudien Khashoggi, en présence de son bourreau MBS dans la Maison Blanche.
Et la gauche européenne dans tout ca ? Qu'en pense-t-elle et surtout que fait-elle en ce moment si critique pour le présent et l'avenir de l'humanité ? Malheureusement, pas grand-chose. Quand évidemment, elle ne fait l'opposé de ce qu'elle devrait faire. Comme par exemple, ce parti de Sarah Wagenknecht en Allemagne, qui a ambitionné de devenir le bateau amiral de cette gauche internationale qui flirte ouvertement avec Poutine, soutient sa « dénazification » de l'Ukraine et trouve tout à fait fréquentables des « antiimpérialistes » comme Assad ou Orban. Malheureusement pour ce parti au nom de sa fondatrice et leader incontestable, Sarah Wagenknecht vient d'annoncer son départ de sa direction, après une série de résultats électoraux catastrophiques. Mais le pire est le - tres didactique- aboutissement actuel de ces échecs à répétition : une fraction du BSW et Sarah Wagenknecht elle-même déclarent maintenant vouloir faire quelque chose que même le partis bourgeois les plus droitiers comme la CDU et la CSU refusent de faire : vouloir s'allier aux néonazis de l'AFD, avec l'ambition de co-gouverner des Länder en Allemagne de l'est où les deux partis pourraient avoir une majorité de députés locaux ! Triste et pitoyable aboutissement d'un parcours qui a commencé à l'extreme gauche gauche et semble vouloir se conclure à l'extrême droite. Que ceux qui suivent des parcours analogues y réfléchissent et en tiennent compte…
Note
1. Voir aussi Trump le « pacificateur » comme Hitler le « chancelier de la paix » ! : https://www.cadtm.org/Trump-le-pacificateur-comme-Hitler-le-chancelier-de-la-paix?debut_tous_articles_auteur=90
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Propositions de points saillants pour la plateforme électorale 2026 de Québec solidaire

Québec solidaire, après s'être doté d'un programme à son dernier congrès de l'automne 2025, a enclenché un processus de construction de sa plateforme électorale pour l'élection de l'automne 2026 laquelle plateforme sera adoptée au congrès du printemps 2026. Le processus procède de bas en haut sur un mode consultatif avant de s'achever sur un mode décisionnel allant du haut vers le bas.
On aurait aimé qu'il soit décisionnel dès sa première étape. Mais passons. Examinons plutôt quelle conjoncture enrobera la confection de la plateforme
Dans les sondages, Québec solidaire s'est maintenu à ±15% depuis les élections de 2018 et non pas 2022 jusqu'à l'automne 2024 où il commence à dégringoler. Pourquoi ? À cause de la contestation de la gauche ? Avant l'automne 2024, il y a eu plusieurs moments de contestation surtout à propos de « l'alliance » avec le PQ mais aussi sur le « voile » mais aussi à propos de la « démocratie interne ». Aucune baisse dans les sondages ne s'est produit du fait que sa militance de gauche ait empêché le parti de glisser vers la droite. Pourquoi alors cette baisse à partir de l'automne 2024 ? La gauche a été cette fois-ci incapable d'empêcher le recentrage marqué par la Déclaration de Saguenay poussée par la direction de Gabriel Nadeau-Dubois (GND).
Notons que ce recentrage avait auparavant provoqué la démissions fracassante d'une porte-parole femme non-élue qui avait perdu sa circonscription alors que le recentrage privilégie les affaires parlementaires et les élections. Notons aussi la condamnation de l'aile parlementaire du député de Maurice-Richard qui avait souligné le racisme en langage codé de maints débats parlementaires. La partie la plus fragile de son électorat a alors déserté les Solidaires vers des partis centriste ou droitiste plus authentiques. Quand GND a compris l'échec électoraliste de son recentrage, il a laissé sa place à une nouvelle direction pour réparer les pots cassés.
Depuis lors, le parti tente une approche pro travailleuses et travailleurs dont la campagne électorale réussie du nouveau maire de New-York est certainement un exemple à suivre. Zohran Mamdani a gagné contre le candidat de l'establishment Démocrate parce qu'une organisation militante, Democratic Socialist of America, sur la base d'une plateforme à gauche toute (Freeze the rent, Fast fare free buses, No cost child care, Raising the minimum wage to $30 by 2030, Taxing corporations and the 1%) a mobilisé près de 100 000 personnes pour la campagne électorale.
Aux Solidaires de se doter d'une plateforme en dehors de la boîte capable de mobiliser la pluraliste jeunesse du Québec qui intuitionne l'indépendance non seulement comme une libération nationale mais aussi comme une émancipation sociale. Ce tournant socio-économique n'est pas cependant une raison de déserter le wokisme. Comme Mamdani est un immigré africain d'origine musulmane, Québec solidaire a la chance d'avoir une porte-parole issue de l'immigration en plus d'être d'origine palestinienne. Il est impérieux de continuer à souligner ce génocide qui se poursuit. Sa famille a été victime de la Nakba. Pour cette raison et aussi parce qu'elle est une femme, elle se fait tomber dessus sur les réseaux sociaux. Cet atout doit stimuler à faire du wokisme une partie intégrante de notre pré-campagne et de notre campagne électorale.
Voici ci-bas ce que pourrait être une plateforme dans l'actuelle conjoncture. Il s'agit d'un point de départ, car une telle entreprise ne saurait que se construire collectivement. Mais il faut une partance qui donne la direction et le ton. Le défi est de taille car il doit réconcilier la perspective écosocialiste avec la définition Solidaire d'engagements à accomplir durant le mandat. Il y a toutefois moyen de tirer l'élastique. En plus, le parti a prescrit « que la plateforme électorale de 2026 soit conçue comme un ensemble court et cohérent d'engagements électoraux. Qu'elle contienne de 5 à 6 enjeux électoraux au maximum ». La gageure est ici à peu près tenue mais pas tout à fait quoiqu'elle se cristallise dans les slogans finaux dussent-ils être très sélectifs. Le modèle est bien sûr la brillante campagne électorale de Zohran Mamdani ce qui suppose que la mobilisation en grande du peuple-travailleur croisse géométriquement après l'élection de sorte à se rapprocher du soulèvement.
&&&&&&&&&&&
Pour un Québec indépendant, français et doté de sa monnaie Vers une société du soin et du lien libérée des énergies fossiles
A. Logement :
1. La construction de 100 000 logements sociaux autogérés à consommation énergétique nulle
2. Réduction d'au moins 50% de la consommation d'énergie et restauration de
50% de tous les existants bâtiments récupérables
3. Gel des loyers
4. Interdiction de la construction de maisons individuelles et en rangées en faveur de la construction de logements collectifs à consommation énergétique nulle
5. Taxe doublant l'impôt foncier tant pour les terrains et les édifices à l'abandon que les logements vides et confiscation au bout d'un an si rien n'est fait
B. Transport :
1. Utilisation de la moitié des voies de toutes les routes et rues de quatre voies et plus pour la circulation d'autobus et de tramways à haute fréquence et gratuit
2. Transport en commun public et fréquent entre tous les villes et villages du Québec
3. Doublement du réseau de pistes cyclables urbain et interurbain accommodant les personnes âgées et handicapées
C. Agriculture, pêche et foresterie
1. Abolition de (l'intérêt sur ?) la dette des très petites entreprises (TPE) agricoles, forestières et de pêche en retour de l'obligation de transiter vers des pratiques écologiques et une agriculture non carnée et non laitière*
2. Prix contrôlés, par le gouvernement et par des comités citoyens, et subventionnés des fruits et légumes frais, des aliments à grains entiers, des légumineuses, du tofu, des noix mais non des produits carnés et laitiers et surtout pas des produits ultratransformés à soumettre à la taxe de vente
3. Taxe pénalisante sur les aliments périmés et jetés par les entreprises à moins de les donner
4. Même droits aux travailleurs agricoles qu'aux autres travailleurs et accès à la citoyenneté
5. Soutien de la conversion des gazons en jardins et des toits verts
6. Cogestion de la forêt avec les nations autochtones y compris leur consentement libre et éclairé, c'est-à-dire leur droit de veto, au sujet de tout projet ayant des incidences sur leurs terres et ressources.
*L'éléphant ou plutôt le monstre dans la pièce pour les très petites entreprises de l'agriculture, de la foresterie et de la pêche, comme le trop oublié rapport Pronovost le soulignait pour l'agriculture, est le fardeau de l'endettement ce qui est le cauchemar de la relève et la contrainte restreignant le passage à une pratique écologique.
D. Industrie et commerce
1. Obligation d'appliquer sans délai et à leur frais, à la satisfaction du gouvernement et d'un comité de travailleurs-citoyennes à cet effet, les technologies les moins énergivores, les moins polluantes et les moins productrices de GES, sous peine de doublement de leur imposition globale et au bout d'un an sans rien faire d'une expropriation sans compensation
2. Obligation pour les industries et commerces militaires de produire un plan de reconversion civile, en tenant compte de l'input de leurs travailleurs, à moins d'être sollicitées par l'État québécois pour son armée ou pour le soutien à un peuple luttant contre une menace ou une invasion impérialiste
3. Interdiction de toute publicité commerciale
4. Obligation de garantir leurs produits pour réparation ou remplacement selon des normes imposées par une organisation d'experts, de travailleurs et de citoyennes
5. Interdiction de nuire à l'établissement d'un syndicat, salaires indexés à l'inflation, garantis d'emploi et normes de sécurité sous contrôle syndical
E. Les services publics
1. Abolition de toutes les organisations privées (cliniques, GMF, écoles, collèges, garderies…) et leur intégration dans le réseau public y compris de leurs employées.
2. Augmentation moyenne de 25% des budgets de tous les services publics
3. Gratuité des garderies répondant à tous les besoins
4. Logements-refuges en nombre suffisant pour les femmes violentées
5. Salarisation des médecins et leur intégration dans les CLSC ouverts 24/7
6. Une école publique mur-à-mur avec projets particuliers ouverts à toustes sans sélection et sans frais
7. Décentralisation des services publics avec des conseils d'administration élus et représentatifs y compris le retour des commissions scolaires
8. Soutien de dernier recours égal au revenu viable de l'IRIS et un salaire minimum de 1.5 fois ce revenu viable pour une personne seule
F. Immigration
1. L'immigrant-e temporaire aura les mêmes droits que les citoyen-ne-s et accès à la pleine citoyenneté au bout d'un cumul de trois ans de résidence
2. Accueil annuel égal à 1% de la population québécoise sans compter les personnes réfugiées suite à leur persécution due à leur identité, aux guerres et aux catastrophes dont celles climatiques
3. Un soutien pour survivre si nécessaire dont un logement accessible le temps d'un accueil d'intégration dont la francisation minimum puis un soutien pour intégrer le monde du travail ou scolaire
G. Le financement
1. Création d'une banque d'État qui contrôlera l'ensemble des institutions financières et les flux internationaux de capitaux
2. Abolition des paradis fiscaux, des entreprises individuelles et doublement du personnel affecté à la fraude fiscale priorisant les personnes à hauts revenus et les grandes entreprises
3. Rétablir l'échelle de progression des taux d'imposition combiné (fédéral et provincial) des particuliers à ce qu'elle était en 1971 où le taux marginal supérieur était de 82.4% à partir d'un revenu de 3 millions en dollars d'aujourd'hui
4. Imposition à 100% des gains de capitaux réalisés dont la succession
5. Sauf pour la ferme familiale, taxe progressive sur le patrimoine des ménages excédant 2 millions de dollars doublant les taux proposés par l'IRIS soit 0,4 % pour les actifs d'une valeur de 2 à 5 millions de dollars, de 1.0 % pour les actifs allant de 5 à 25 millions de dollars, de 1,5 % sur les actifs de 25 à 100 millions de dollars et de 2,5 % sur les actifs supérieurs à 100 millions de dollars
6. Abolition du gel successoral et évaluation de patrimoine immobilier par un organisme d'experts et de citoyennes et non par des firmes comptables
La campagne électorale exige une poignée de slogans qui traduisent l'essence de son orientation politique, ce qu'avait magistralement saisi la campagne Mamdani.
Ce pourrait être :
a. Un Québec indépendant, français et doté de sa monnaie
b. 100 000 logements sociaux autogérés à consommation nulle d'énergie
c. Gel des loyers
d. Autobus et tramways fréquents et gratuits dans des corridors exclusifs sur toutes les rues et routes à 4 voies
e. Prix contrôlés et subventionnés des fruits, légumes, grains entiers, légumineuses et noix
f. Interdiction de toute publicité commerciale
g. Garderies gratuites et publiques répondant à tous les besoins
h. Salaire minimum de 30$ l'heure de 2024 indexé au coût de la vie
i. Imposition du patrimoine du 1 % à un taux de 2.5 % et hausse des taux d'imposition et des seuils (ajustés à l'inflation) au niveau de 1971
&&&&&&&&&&&&&
Le succès du Grand rassemblement intersyndical contre le gouvernement de la CAQ, en autant qu'il n'est pas un coup d'épée dans l'eau, permet tous les espoirs. Les manifestants et manifestantes étaient des dizaines de milliers comme l'avancent Radio-Canada et La Presse, peut-être 50 000 comme le prétend la CSN. Je me suis posté au début du cortège pendant une bonne heure et j'en n'avais pas encore vu la fin. Les contingents FTQ (SCFP, Métallos, Unifor…) dominaient nettement mais j'ai pu voir ceux de l'APTS, de la CSQ, de la FAE, de la FIQ, du SCFP, du SPGQ, de la CDS mois nombreux. Étonnamment, les cortèges CSN étaient moins visibles. Où était le cortège FSSS ? Peut-être l'ais-je raté en fin de manifestation. Le secteur communautaire s'était regroupé en un seul nombreux cortège. Mais on pouvait voir de nombreux petits cortèges séparés comme celui des travailleuses accidentées ou d'Équiterre. À noter celui de Québec solidaire d'une cinquantaine de personnes. À signaler un très nombreux cortège militant de personnes immigrées temporaires et alliées réclamant le maintien du PEQ, scandant des slogans et distribuant des tracts aux passants.
Voilà du pain béni pour pousser dans le dos d'une campagne électorale Solidaire en autant justement que le parti n'attende pas les élections. Il faut se hâter pour publiciser une telle plateforme pour en faire une longue pré-campagne qui, l'espère-t-on, entrera en dialectique avec la lutte sociale. Celle-ci pourrait se transformer en grève sociale comme le laisse entendre la présidente de la FTQ… en autant qu'elle la prépare.
Marc Bonhomme, 30 novembre 2025
www.marcbonhomme.com ; bonmarc@videotron.ca
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Plus de 50 000 personnes en colère contre le gouvernement de la CAQ

Nous présentons ci-dessous les interventions des dirigeante·s des neuf organisations syndicales, qui ont toustes souligné le caractère profondément politique de cette mobilisation historique, rassemblant l'ensemble de la société civile québécoise. Les 9 représentant·es des organisations syndicales sont intervenu·es dans l'ordre suivant : 1. Magali Picard de la FTQ, 2. Guillaume Bouvrette du SPGQ ; 3. Luc Vachon de la CSD ; 4. Christian Daigle du SFPQ ; 5. Éric Gingras de la CSQ ; 6. Mélanie Hubert de la FAE ; 7. Robert Comeau de l'APTS ; 8. Robert Bombara de la FIQ ; 9. Caroline Senneville de la CSN.
et l'audio
Plus de 50 000 manifestant·es venu·es de l'Abitibi, de la Gaspésie, du Saguenay, de Québec, de la Montérégie, de la région de Montréal et de toutes les régions du Québec ont convergé vers la métropole. Ces personnes sont descendues dans la rue pour exprimer leur colère contre le gouvernement de la CAQ.
De vastes contingents de la CSN, de la FTQ, de la CSQ, de la CSD, de la FAE, du SPGQ, du SCFP, de l'APTS et de la FIQ ont marché côte à côte pour dénoncer les attaques contre les libertés syndicales, les politiques de privatisation en santé, les coupures dans les programmes sociaux, les mesures anti-immigration et, plus largement, l'orientation toujours plus conservatrice et réactionnaire du gouvernement. Québec solidaire avait mobilisé un contingent de ses membres pour manifester son soutien à la volonté de riposte aux attaques de la CAQ contre la majorité populaire.
La société civile était également au rendez-vous : groupes communautaires, organisations écologistes, associations étudiantes et féministes ont rempli les rues. Les pancartes, nombreuses et variées, donnaient la mesure du ras-le-bol populaire face à un gouvernement de plus en plus anti-social et anti-populaire.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Projet de loi 1 : une menace à la démocratie, à l’État de droit et aux droits humains

Avec le PL1, l'Assemblée nationale aurait le pouvoir d'empêcher plus d'une centaine d'organismes – voire davantage – recevant des fonds publics de l'État d'utiliser ces sommes pour contester la validité constitutionnelle de certaines lois ou de contribuer à de telles contestations.
Tiré du site web de la LDL
0 Avant-propos
Le dépôt du projet de loi n° 1 – Loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec (PL1) n'est pas un acte législatif isolé. Il s'inscrit dans la continuité d'une série d'actions gouvernementales qui témoignent d'une dérive centralisatrice et autoritaire visant à renforcer les pouvoirs du gouvernement et à affaiblir les contre-pouvoirs, en particulier ceux des tribunaux et de la société civile.
Cette tendance se manifeste entre autres par une concentration croissante des pouvoirs entre les mains de l'exécutif, un mépris affiché pour les institutions et les processus démocratiques, ainsi que des atteintes répétées aux droits humains et aux chartes qui les protègent.
Dans ce contexte, notre opposition au projet de loi n° 1 fait partie d'un combat plus large pour la défense de la démocratie, de l'État de droit et du régime de protection des droits humains – trois piliers majeurs de la société québécoise.
1 Un processus illégitime et antidémocratique
Le projet de loi n° 1 a été élaboré derrière des portes closes et sans consultations publiques en amont. Or, les critères établis par le droit international prévoient que la rédaction d'une constitution doit se faire dans le cadre d'un processus ouvert, permettant la pleine participation de la société civile et de l'ensemble de la population. L'absence de consultations larges et inclusives pour la préparation de ce projet de loi fait en sorte que celui-ci n'a aucune légitimité politique et démocratique. C'est pourquoi il doit être rejeté en bloc.
***
La rédaction et l'adoption d'une constitution sont un acte juridique majeur dans la vie d'une collectivité, qui doit impliquer la participation pleine et entière de la société civile et de l'ensemble de la population.
Or, aucun des critères reconnus en droit international pour l'adoption d'une constitution légitime, notamment ceux établis par le Haut-Commissariat des droits de l'Homme des Nations unies, n'a été respecté par le gouvernement dans le contexte de l'élaboration et du dépôt du PL1. Ce projet de constitution a été rédigé derrière des portes closes sans consultations publiques préalables. Un projet de loi aussi décisif pour l'avenir social et politique du Québec ne devrait en aucun cas être élaboré de manière opaque ni émaner d'un simple acte unilatéral de l'exécutif.
Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme explique que « le lien entre les droits de l'homme et l'ordre constitutionnel démocratique se crée dès le processus conduisant à l'adoption d'une constitution ou à une réforme constitutionnelle. Un tel processus promet des résultats valables, s'il est fondé sur une large participation de tous les segments de la société. Les participants doivent pouvoir formuler leurs opinions librement et communiquer entre eux sans que le pouvoir en place les en empêche. Il est important que leurs opinions [soient] prises en considération dans le cadre de procédures clairement définies… » (Droits de l'homme et élaboration d'une Constitution, HCDH, 2018).
Ce sont ainsi, notamment, les défenseurs des droits, les associations de juristes, les médias et autres organisations de la société civile, y compris celles qui représentent les femmes, les enfants, les minorités, les peuples autochtones, les réfugiés, les apatrides, les personnes déplacées, les travailleurs et les entrepreneurs, qui doivent se prononcer au moment d'élaborer une Constitution (Secrétaire général sur l'assistance des Nations Unies à l'élaboration de constitutions, 2009).
L'élaboration d'un tel projet de loi aurait dû être précédée de vastes consultations auprès d'expert·es de différents domaines, des membres de la société civile et du grand public.
De surcroit, un projet de loi de cette nature ne saurait être légitimement adopté uniquement par un vote à majorité simple de l'Assemblée nationale. Dans le contexte actuel, cela reviendrait à confier au parti majoritaire la destinée politique à long terme de l'État québécois. Rappelons qu'en raison du mode de scrutin au Québec, ce parti n'a été appuyé que par environ le quart des électeurs-trices lors des élections de 2022. L'électorat n'a d'ailleurs pas mandaté le gouvernement pour qu'il crée une Constitution du Québec, puisque ce projet ne figurait pas dans sa plateforme électorale.
Ne serait-ce qu'au regard de ce processus lacunaire et antidémocratique, voire partisan et électoraliste, le PL1 est un acte législatif illégitime. Pour ces raisons, ce projet de loi ne saurait être discuté article par article. Il doit être rejeté en bloc au nom de la sauvegarde des principes fondamentaux de la démocratie.
2 Musellement des contre-pouvoirs : restrictions à l'autonomie d'action politique et judiciaire de la société civile
Avec le PL1, l'Assemblée nationale aurait le pouvoir d'empêcher plus d'une centaine d'organismes – voire davantage – recevant des fonds publics de l'État d'utiliser ces sommes pour contester la validité constitutionnelle de certaines lois ou de contribuer à de telles contestations. Il s'agit là d'une tentative de priver la société civile de son autonomie d'action et de priver la population de la protection des tribunaux contre les actions gouvernementales abusives, arbitraires, discriminatoires ou attentatoires aux droits et libertés.
***
Le PL1 permettrait à l'Assemblée nationale de désigner toute loi (ou l'une de ses dispositions) comme protégeant « la nation québécoise ainsi que l'autonomie constitutionnelle et les caractéristiques fondamentales du Québec » (art. 5, Loi sur l'autonomie constitutionnelle du Québec – ci-après Loi autonomie). L'impact de cette désignation est que plus d'une centaine d'organismes – voire davantage selon les critères établis par le gouvernement – recevant des fonds de l'État se verraient alors interdits d'utiliser ces sommes pour contester la validité constitutionnelle de ces lois ou contribuer à une telle contestation (art. 4 et Annexe I, Loi autonomie).
La portée de cette disposition est très large. Selon les termes du PL1, la liste actuelle inclut des organismes gouvernementaux et paragouvernementaux, des sociétés d'État, des organismes du réseau public d'éducation et du domaine de la santé et des services sociaux, ainsi que des organismes municipaux et professionnels. Il s'agit là d'une atteinte grave, non seulement à l'autonomie de ces organismes, mais aux fondements mêmes de notre démocratie sociale.
Concrètement, cette disposition limiterait la capacité de participer à des contestations de la constitutionnalité de lois québécoises à des organismes tels que la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, le Protecteur du citoyen, le directeur général des élections, l'Autorité des marchés financiers, le Conseil du statut de la femme, l'Office de la protection du consommateur, le Protecteur national de l'élève, Santé Québec, les collèges d'enseignement et universités, les municipalités et communautés métropolitaines, ainsi que les ordres professionnels.
Le projet de loi prévoit aussi que les membres ou administrateurs des organismes visés seraient personnellement imputables du respect de cette interdiction et tenus solidairement responsables du remboursement de tout financement étatique utilisé d'une façon prohibée.
Il est particulièrement important de souligner que cette disposition pourrait également s'appliquer à toutes les autres « catégories d'organismes que le gouvernement détermine », à son entière discrétion (art. 4, Loi autonomie). Cela ouvre toute grande la porte à ce que le gouvernement applique éventuellement ce verrou constitutionnel aux syndicats, aux groupes de défense collective des droits, aux organismes communautaires ou à tout autre groupe, association ou institution de la société civile.
Le PL1 élargirait également d'autres façons l'emprise du gouvernement sur les organismes étatiques, paragouvernementaux, institutionnels et de la société civile. Notamment, s'il est d'avis qu'une initiative fédérale a pour effet que l'État fédéral « s'immisce dans un domaine (…) préjudiciant au Québec, de quelque manière que ce soit », le gouvernement québécois pourrait ordonner aux organismes mentionnés ci-haut de refuser du financement fédéral, de résilier une entente avec une institution fédérale, ou d'adopter « toute autre conduite [que le gouvernement québécois] juge appropriée ». (art.17, Loi autonomie)
Le gouvernement québécois imposerait en outre aux organismes visés, dans leurs négociations de quelque entente que ce soit avec un autre gouvernement au Canada, de veiller à protéger et promouvoir la conception qu'a le gouvernement québécois des « caractéristiques fondamentales du Québec », des « droits collectifs de la nation québécoise » et des « revendications historiques du Québec » (art. 14, Loi autonomie).
En définitive, la volonté du gouvernement de bâillonner la société civile et de se soustraire au regard des tribunaux est profondément préoccupante, car elle menace de priver le Québec des remparts qui le protègent contre les dérives autoritaires. En affaiblissant la capacité des instances judiciaires d'agir comme gardiennes des droits et libertés, le gouvernement québécois s'attaque aux fondements mêmes de notre démocratie. Or, cette démocratie repose justement sur la possibilité pour les organismes de la société civile d'avoir accès aux tribunaux afin de contester des actions gouvernementales qui pourraient s'avérer arbitraires, abusives, discriminatoires ou attentatoires aux droits humains. Préserver cet accès n'est donc pas seulement souhaitable : c'est une condition essentielle au maintien de l'État de droit.
Lire la suite ici
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Trois fois rien pour les personnes les plus pauvres

Québec, le 25 novembre 2025 — Le Collectif pour un Québec sans pauvreté constate avec amertume que, fidèle à son habitude, le gouvernement de François Legault fait le choix politique d'abandonner à leur sort les Québécois et les Québécoises en situation de pauvreté.
Le Collectif se désole également de le voir chercher à brouiller les cartes en faisant passer un simple mécanisme de rattrapage pour une mesure d'amélioration du revenu ; et l'annulation d'une mesure fiscale qui aurait pu rapporter 2 milliards $ au Trésor public, pour un gain pour l'ensemble des citoyen∙nes.
« Rien pour les personnes âgées, rien pour les personnes qui reçoivent de l'assistance sociale, rien pour les étudiant∙es… Bref, trois fois rien pour les personnes les plus pauvres, trois fois rien pour s'attaquer à la crise sociale qui frappe le Québec. C'est un euphémisme que de dire que ce gouvernement a des œillères », de s'exclamer Serge Petitclerc, porte-parole du Collectif pour un Québec sans pauvreté.
« Le ministre Girard devait trouver des moyens de ''soulager le portefeuille des Québécois qui souffrent actuellement''. Que faut-il alors comprendre de son dernier exercice comptable, que les travailleurs et travailleuses pauvres et les personnes à l'assistance sociale ne souffrent pas encore assez ?
« Les réductions de cotisation au RRQ et au RQAP ne feront aucune différence dans la vie des travailleurs et travailleuses au bas de l'échelle. On parle d'une économie de 137 $ par an au maximum pour une personne salariée, et de 79 $ pour un travailleur avec un revenu de 50 000 $. De plus, ces réductions laissent intactes les difficultés financières des personnes sans emploi, notamment les personnes âgées et les personnes qui reçoivent de l'assistance sociale.
« Le ministre Girard a le culot de présenter le mécanisme d'indexation du régime fiscal et des prestations d'assistance sociale comme une mesure d'amélioration du revenu. D'abord, en procédant à leur indexation, le ministre ne fait rien d'autre qu'appliquer la loi ! Ensuite, il est pour le moins contradictoire, sinon volontairement trompeur, de présenter un mécanisme qui sert à maintenir le pouvoir d'achat des ménages, en compensant l'augmentation du coût de la vie au cours de la dernière année, comme une mesure d'amélioration du revenu. Une indexation ne bonifie rien, ça ne fait que maintenir les choses à un même niveau », de poursuivre M. Petitclerc.
Un gain pour qui ?
« L'annulation de la hausse du taux d'inclusion des gains en capital illustre à merveille le double standard de ce gouvernement, avec qui les plus pauvres ont droit à des miettes ponctuelles et les plus riches à des cadeaux fiscaux permanents.
« Cette mesure qui touchait uniquement les mieux nanti∙es aurait permis au gouvernement d'augmenter ses revenus de plus de 2 milliards de dollars sur 5 ans. Une somme qui aurait été utile pour le financement de notre filet social, qui en a bien besoin. Le pire, c'est que le ministre Girard va jusqu'à présenter cette annulation comme un ''gain''. Mais un gain pour qui exactement, pour le 1 % ou pour les ménages qui tirent le diable par la queue semaine après semaine ? », de s'interroger M. Petitclerc.
« Combien de temps encore le gouvernement va-t-il prétendre vouloir aider les personnes les plus mal prises d'un côté et, de l'autre, faire à peu près tout ce qui est possible pour produire l'effet inverse ?
« S'il veut véritablement améliorer les conditions de vie des personnes en situation de pauvreté, qu'il commence par bonifier le crédit d'impôt pour solidarité comme le Collectif le lui suggère depuis des années. Ce serait pour lui la manière la plus simple, efficace et durable d'aider les ménages à faible revenu. Il pourrait aussi adopter toute une série de mesures fortes, structurantes pour paver le chemin vers un Québec sans pauvreté et riche de tout son monde. Le Collectif l'invite à s'inspirer des pistes de solution qu'il met de l'avant dans son manifeste, pour son ultime budget en mars », de conclure le porte parole.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Une mise à jour économique qui oublie encore les groupes communautaires

Montréal, le 25 novembre 2025 Dans le contexte où les besoins des groupes communautaires ne font que s'accroître, la Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles [1] est déçue de constater que, fidèle à son habitude, la mise à jour économique ne tient pas compte de cette réalité. D'un même souffle,
elle exprime ses attentes envers le gouvernement et le ministère de la Santé et des Services sociaux en particulier pour le dernier budget du présent mandat de la Coalition Avenir Québec.
Par sa mise à jour économique le gouvernement accorde, encore une fois, sa faveur aux entreprises et laisse pour compte les groupes communautaires.
« Les groupes communautaires contribuent pourtant aussi à faire rouler l'économie, notamment en employant au moins 54 000 personnes et en en soutenant plus de 2,25 millions », souligne Mercédez Roberge, coordonnatrice de la Table.
Le 21 octobre dernier, le Conseil du trésor a demandé à chaque ministère de faire le point. Cet exercice a permis au gouvernement de disposer du portrait des subventions qu'il accorde.
« En conséquence, l'absence de rehaussement pour les groupes communautaires dans la présente mise à jour économique signifie que le gouvernement considère que 255 000$[1] par année, c'est suffisant pour des organismes comme des maisons des jeunes ou des centres de femmes, pour ne donner que deux exemples », déplore Karine Robinette, membre du comité de coordination de la campagne _CA$$$H (Communautaire autonome en santé et services sociaux – Haussez le financement !)_. [2]
Depuis plusieurs années, les organismes communautaires autonomes du domaine de la santé et des services sociaux (OCASSS) revendiquent l'ajout de 1,7G$ à l'intention de plus de 3000 groupes [3] pour rehausser l'enveloppe pour la mission globale du Programme de soutien aux
organismes communautaires (PSOC). Pour l'année 2024-2025, celle-ci n'était que de 924 M$. Ils demandent également que la valeur du programme soit maintenue par l'application d'une indexation basée sur l'Indice des coûts de fonctionnement du communautaire (ICFC). [4]
« En prévision du budget de 2026, la Table et ses membres demandent à la ministre responsable des Services sociaux, Madame Sonia Bélanger, de convaincre son collègue du Ministère des Finances qu'un montant substantiel est requis. Ces deux dernières années, son gouvernement n'a ajouté que 9M$ suivi de 10M$. Pire encore, pour que ce maigre montant soit totalement distribué selon les règles du PSOC, il a fallu mettre en demeure son ministère, ainsi que le Conseil du trésor, [5] ce qui est aberrant », s'insurge Stéphanie Vallée, présidente de la Table.
Les OCASSS attendent depuis trop longtemps que le financement à la mission globale du PSOC soit rehaussé. Le budget 2026 sera l'opportunité de véritablement répondre aux besoins des groupes afin que ceux-ci continuent de soutenir la population du Québec comme ils le font si bien.
Le gouvernement doit à tout prix injecter des sommes significatives. C'est son ultime occasion de démontrer, avant le test des prochaines élections, son humanité envers des ressources dont il vante les bienfaits.
SOURCE Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et
bénévoles (TRPOCB)
À propos
● Stéphanie Vallée est co-coordonnatrice de l'R des Centres de femmes du Québec [6] et présidente de la Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles
● Karine Robinette, directrice générale du Regroupement des popotes roulantes du Québec [7] et membre du comité de coordination de la campagne _CA$$$H_.
● Mercédez Roberge est coordonnatrice de la Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles [1]
Fondée en 1995, la Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles (TRPOCB) est formée de 47 regroupements nationaux [8], rejoignant plus de 3 000 groupes communautaires autonomes à travers le Québec. Ce sont, par exemple, des maisons de jeunes, des centres de femmes, des cuisines collectives, des maisons d'hébergement,
des groupes d'entraide, des centres communautaires, des groupes qui luttent contre des injustices ayant des répercussions sur la santé.
Ceux-ci représentent les ¾ des organismes communautaires autonomes du Québec et abordent la santé et les services sociaux sous différentes perspectives (femmes, jeunes, hébergement, famille, personnes handicapées, communautés ethnoculturelles, sécurité alimentaire, santé mentale, violence, périnatalité, toxicomanie, etc.).
La Table coordonne de plus la campagne _CA$$$H_ (_Communautaire autonome en santé et services sociaux — Haussez le financement_). [2] Lancée le 17 octobre 2017, cette campagne vise l'amélioration substantielle du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), au bénéfice de plus de 3 000
organismes communautaires autonomes subventionnés par le MSSS. Les revendications de la campagne _CA$$$H_ [9] sont : l'atteinte de l'équité de financement et de traitement partout au Québec, notamment par l'application de seuils planchers communs et adaptés aux OCASSS, l'indexation annuelle des subventions en fonction de l'Indice des coûts de fonctionnement du communautaire (ICFC) et l'ajout de 1,7 G$ à l'enveloppe annuelle du PSOC (mission globale).
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Projet de loi 7 : Une nouvelle attaque à l’autonomie des organismes et à la démocratie !

Le Regroupement des organismes en défense collective des droits (RODCD) tient à manifester sa vive opposition face au projet de loi 7 (Loi visant à réduire la bureaucratie et à accroître l'efficacité de l'État) déposé par la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État, Mme France-Élaine Duranceau.
Montréal, 7 novembre 2025
En plus de rejoindre plusieurs des commentaires exprimés par d'autres acteurs sociaux, le RODCD tient particulièrement à dénoncer le projet d'intégration du Fonds d'aide à l'action ommunautaire autonome (FAACA) au Fonds québécois d'initiatives sociales (FQIS), qui sont ous deux sous la responsabilité du Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS), lui-même sous l'égide du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale.
Cette mesure, si elle est adoptée, pourra ouvrir la voie à une attaque sans précédent contre les quelques 350 groupes communautaires reconnus actuellement comme organismes de défense collective des droits (DCD). Rappelons que le FAACA a été créé lors de l'adoption de la Politique de reconnaissance de l'action communautaire (PRAC) en 2001 pour être « le véhicule de financement pour l'ensemble des organismes en DCD ». Le gouvernement ajoutait que « non seulement cette orientation vient-elle marquer la reconnaissance gouvernementale pour la DCD, mais elle permet aussi aux organismes visés d'être soutenus financièrement par une instance totalement indépendante des ministères ou organismes gouvernementaux avec lesquels ces organismes sont parfois susceptibles d'entretenir des relations conflictuelles. » Finalement, le gouvernement annonçait son intention de maintenir le financement au palier national « afin de bénéficier d'une marge de manœuvre leur permettant de maintenir une vision globale de leur priorité d'action ».
Depuis près de 25 ans, le FAACA est le véhicule par lequel les organismes en DCD reçoivent un financement à la mission, mode le plus à même de protéger leur autonomie et qui est réservé aux organismes d'action communautaire autonome. Dans ce contexte, l'absence du mot autonome dans le nom du nouveau Fonds n'a rien de rassurant.
Quant au FQIS, c'est un fonds d'une tout autre nature. Il finance essentiellement des projets et est associé au Plan de lutte contre la pauvreté du gouvernement du Québec. Il est géré régionalement, soit par des municipalités, des tables régionales d'élu-e-s ou des tables d'organismes communautaires. Depuis plusieurs années, la tendance valorisée est à la priorisation des projets pensés, portés et développés par les organismes communautaires autonomes qui se voient fortement inciter à travailler en partenariat avec les institutions gouvernementales ou même le secteur privé. Ce partenariat est parfois conditionnel à l'obtention de financement.
Comme on le voit, les deux fonds poursuivent des objectifs différents. Au mieux, le financement des organismes en DCD sera dilué dans un ensemble plus vaste dans lequel les subventions par projet seront prépondérantes ! Au pire, cela pourrait signifier une réorientation qui fragiliserait encore plus nos organismes qui subissent déjà un sous-financement chronique.
Il faut aussi replacer le projet de loi 7 dans un contexte plus général dans lequel les attaques du gouvernement envers les droits fondamentaux et les contre-pouvoirs de la société civile se
multiplient. Ces attaques avaient déjà débuté dans la dernière année, avec par exemple le projet de loi 98 sur la modification de la loi électorale, mais elles ont pris un tournant accéléré
ces dernières semaines. Pensons, entre autres, au projet de loi 1 sur la constitution et qui vise à limiter la portée de la Charte des droits et libertés et le droit de contestation par les organisations de la société civile, et au projet de loi 3, qui veut limiter la capacité d'action des syndicats.
« Il est plutôt ironique de penser que ce gouvernement, qui pour la première fois dans l'histoire a créé un poste de ministre responsable à l'action communautaire, soit l'instigateur d'une attaque sans précédent contre l'autonomie de nos organismes », lance Sylvain Lafrenière, coordonnateur du RODCD. Avec le projet de loi 7, la porte est maintenant ouverte à s'attaquer directement au financement de nos membres.
Le RODCD refuse d'accepter cette fusion imposée et demande le maintien du FAACA ou à tout le moins des garanties écrites indiquant que les engagements du gouvernement inscrits dans la PRAC soient maintenus. Le projet de loi 7, dans sa forme actuelle, nous apparaît plutôt comme une attaque contre les organismes qui représentent des populations socio
économiquement précaires qu'une réelle tentative de faire des économies. La démocratie, pour être vraiment vivante, ne peut se limiter à l'Assemblée nationale. Le gouvernement devrait plutôt faciliter et encourager la participation de la population et des organismes de la société civile. Le RODCD demeure fermement en soutien à toutes les organisations qui ne cesseront jamais de parler de justice sociale, une justice qui passe par le respect des droits fondamentaux. Cessons le saccage !
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Hydro Québec veut vous faire payer 1.40 $ par facture envoyée par la poste

L'ACEF du Nord lance une campagne de lettres pour s'opposer à la volonté d'Hydro-Québec d'imposer des frais de 1,40$ par facture papier envoyée par la poste (demande faite à la Régie de l'énergie). Cette proposition est inacceptable et désavantagera particulièrement les ménages vulnérables et à faible revenu.
Avec d'autres associations de consommateurs partout au Québec, on se mobilise pour dénoncer cette demande.
– une lettre que tu peux signer comme organisme
– une lettre (en français et en anglais) que les personnes peuvent signer (si vous voulez partager à vos membres, ce serait super !) un visuel pour l'infolettre au besoin
– Le matériel est disponible sur notre site Internet :https://www.acefnord.org/mob-energie/
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
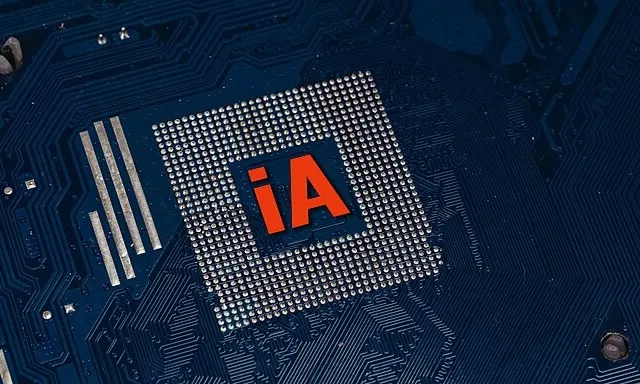
La bulle de l’intelligence artificielle est sur le point d’éclater.
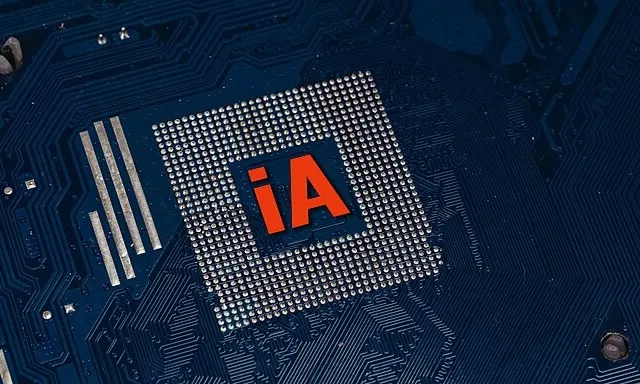
Alors que les politiciens.nes canadiens.nes sont encore embourbés.es dans leur histoire d'amour avec l'intelligence artificielle, (IA), la panique est prise dans cette industrie ; la bulle boursière est sur le point d'éclater. Les conséquences seront massivement dommageables pour le Canada.
Jim Thomas, The Breach, 18 novembre 2025
Traduction, Alexandra Cyr
Les multimillionnaires font confiance à l'IA. Mais même les géants de la technologie se préparent pour une correction (à la bourse) qui pourrait ébranler les marchés et les fonds de pension publics et privés.
La fin de semaine dernière, on a su que Peter Thiel, le multimillionnaire fondateur de la firme de logiciel Palentir a retiré tous ses investissements dans Nvidia, le fabricant de puces dont les produits pourraient rendre possible l'IA générative.
En misant tellement sur les ventes de puces de cette compagnie à Google, Meta, Amazon et OpenAI, les investisseurs ont rendu Nvidia le seul responsable de plus du quart de tous les gains de ce marché depuis plus de trois ans.
Nvidia est maintenant la première compagnie dans le monde à être cotée d'une valeur de cinq milliards de dollars. C'est une surévaluation stupéfiante qui annonce une correction boursière probablement dramatique.
La nouvelle que P. Thiel, qui a été qualifié d'homme de l'ombre de la Silicone Valley, ait décidé de se débarrasser de la totalité de ses actions Nvidia qui constituaient probablement 40% de son portefeuille, peut être un des indices qu'une correction est maintenant inévitable.
Ce geste de P. Thiel arrive quelques jours seulement après que le géant japonais Softbank annonce publiquement qu'il a retiré tous ses investissements dans Nvidia soit 5 milliards 83 millions de dollars. Il y a environ deux semaines, le charismatiques investisseur Michael Burry a déplacé ses propres milliards de dollars investis dans Nividia et Palentir. Il est connu pour avoir fait 800 millions de dollars en misant contre le marché immobilier durant la récession de 2008. C'est ce qui a inspiré l'intrigue du film The Big Short. Il est maintenant silencieux en attendant le crash.
Deutch Bank qui semble aussi examiner de possibles ventes d'actions d'IA, signale que sans les masses de fonds dépensés par les compagnies de ce secteur pour construire des centres de données pleins des puces très chères de la compagnie Nvidia, l'économie américaine serait déjà en récession.
En fait, quelques géants de la technologie investissant dans les centres de données, l'électricité et les puces, dépensent plus que toute la population américaine qui consomme.
Malheureusement, pour nous les Canadiens.nes qui n'avons pas de société d'investissement lourdes de milliards de dollars et plus pour jouer le jeu des achats et ventes en bourse, la perspective d'une énorme implosion du marché de l'IA pourrait avoir de profondes conséquences.
Ottawa en remet plutôt que se retirer
Fin septembre, le Conseil d'administration du Fonds de pension canadien auquel tous les Canadiens.nes contribuent hors Québec, possédait 8 milliards de dollars d'actions de Nvidia, son plus important investissement. C'était son huitième plus important blocs d'actions dans tout ce secteur. Avec 33 milliards de valeur combinée, ces investissements représentent le quart de toute la valeur de ce fond de pension.
Le fond de pension le plus important de Québec, la Caisse de dépôts et placements du Québe, affichait aussi ses investissements les plus importants chez Nvidia à la fin septembre. Les actions de Nvidia et d'autres entreprises du secteur de l'IA dominent complètement les investissements de presque tous les huit plus grands fonds de pension canadiens. Il arrive aussi qu'ils soient actionnaires de fonds indiciels qui sont chargés en actions de Nvidia et d'autres compagnies du secteur.
Qu'en est-il alors de la sécurité financière de tout un chacun si la valeur de ces actions s'effondre du jour au lendemain ? Selon Deutch Bank, il n'existe pas de mode d'emploi pour faire face à une possible implosion du marché de l'IA. La Banque du Canada de son côté déclare ne pas savoir ce que pourraient être les impacts plus larges d'une telle correction.
Malheureusement, le gouvernement libéral, obnubilé par le battage médiatique de l'IA, se dirige du mauvais côté. Dans le récent budget fédéral du Premier ministre Carney, un million de dollars seront affectés à l'expansion des infrastructures de l'IA. Et les ministères ont instruction comme n'importe qui d'autre de s'engager à fond dans l'IA générative.
Et c'est sans compter les fonds supplémentaires injectés dans les industries fossiles et nucléaires pour fournir l'électricité aux centres de données. Il y a aussi des fonds dédiés à l'extraction de minéraux critiques nécessaires à la fabrication des puces et des lignes de transmission pour assurer le fonctionnement de ces centres.
Notre Premier ministre et les géants de la technologie
On connait M. Carny comme un ancien banquier. Ce qui est moins connu, c'est qu'il était aussi un dirigeant de grandes industries technologiques. Il agit encore comme s'il y était. À titre de vice- président de Brookfield Asset Management, il a aidé cette compagnie à devenir un investisseur majeur dans les centres de données de l'IA. La compagnie a doublé sa valeur depuis, avec des dizaines de millions de dollars investit dans de nouvelles infrastructures pour l'IA en plus de ce qu'elle possédait déjà.
L'appétit vorace des centres de données en énergie, eau et minéraux soulève la résistance des communautés et groupes environnementaux partout dans le monde. Cela provoque déjà des difficultés économiques même avant que la bulle de l'IA menace nos fonds de pension. La plupart des centres de données sont installés près des grandes villes. Plusieurs devraient mobiliser des centaines de mégawatts d'électricité ; les fournisseurs tentent d'augmenter leur production tout en offrant des prix compétitifs aux opérateurs.
Il en résulte une hausse des prix pour les ménages qui finissent pas subventionner certaines des plus riches compagnies de la technologie du monde. Comme le note Daily Kos, quand il est question du coût de la vie, « nous détestons tous et toutes les centres de données ». En Alberta, au Québec, dans le grand Toronto et en Colombie Britannique, qui sont les endroits qui subissent le plus de pressions agressives, (de la part des compagnies IA), nous devrions être en alerte maximales.
Dans son rôle avec les compagnies technologiques, M. Carney a aussi siégé au conseil d'administration du géant des paiements électroniques, Stripe. Cette compagnie est proche du leadership de P. Thiel qui l'a fondée. P. Thiel et Patrick Collison, fondateur de Stripe, sont tous les deux attachés à un concept connu sous le vocable de : « capacité libertarienne étatique » qui plaide pour que les gouvernements assument le coût des infrastructures nécessaires aux technologies émergentes de façon à ce que les entreprises spécialistes des prises de risques soient moins embarrassées quand vient le temps de spéculer en vue de profits, privés, bien sûr. Autrement dit, on socialise les risques et privatise les profits.
Au cours des quelques dernières semaines, plusieurs dirigeants.es de l'IA dont le P.D.G. de OpenAi, Sam Altaman, ont commencé à dire s'attendre à ce que les gouvernements s'impliquent en les soutenant financièrement si et quand la bulle éclatera. Est-ce que le gouvernement américain n'a pas fait cela en mars 2023 quand P. Thiel avec son dernier gros retrait de fonds de la Silicon Valley Bank a précipité une série de faillite de banques ?
Avec autant d'argent des fonds de pension et d'autres fonds publics investit dans l'IA, M. Carney pourrait aussi décider de soutenir financièrement les géants du secteur et les constructeurs de centres de données avec l'argent public. (Il devrait) plutôt prendre quelques précautions tactiques et retirer des investissements des entreprises de l'IA gonflées à bloc.
Protéger la population canadienne du crash de l'IA
Si le gouvernement se précipite pour sauver les compagnies de l'IA, ce serait manquer l'essentiel et punir la classe travailleuse du pays. Toute la foi aveugle et parfois l'excitation enfantine que M. Carney et d'autres politciens.nes vouent à l'IA générative ne tient qu'à l'illusion de gains financiers en même temps qu'au malentendu grossier à l'effet que l'IA serait en quelque sorte « intelligente » et donc socialement valable. M. Evan Solomon, le ministre de l'IA et de l'innovation technologique, est un de ceux-là.
Les remous financiers qui secouent les fondations de la bulle de l'IA est un signal d'alarme fort qui s'adresse à la stabilité de l'économie canadienne et à la sécurité du gros de la population canadienne. En se laissant séduire sans sens critique par le battage publicitaire (autour de l'IA), nos législateurs.trices s'avancent comme des somnambules dans la dangereuse fragilité du secteur, une vulnérabilité qui dépasse de loin nos fonds de pension et se rend au cœur de notre économie, de notre environnement et de nos services publics.
Ignorer cette menace financière imminente et ce qu'elle entraine de pressions sur l'énergie, l'eau et le contrat social, n'est plus une option. Le premier point à l'ordre du jour doit être une mobilisation nationale pour protéger notre pays de la probabilité qui se prépare d'un effondrement boursier tôt ou tard. Et cela passe par une bonne évaluation des valeurs et de mesures de leur isolement.
Pour passer du déni à la défense, le gouvernement doit immédiatement introduire et défendre des législations pour protéger nos fonds de pension, les fonds et les services publics des risques systémiques (en cours). Il doit aussi inviter la Banque du Canada et les gestionnaires de fonds à se préparer à un crash du secteur économique rattaché à l'IA.
Dès maintenant il doit commencer une évaluation nationale en commençant par les cinq secteurs les plus fragiles, soit, la finance, l'économie, l'environnement, la démocratie et le bien-être psychologique. Il devrait aussi immédiatement introduire une pause dans les dépenses dans les infrastructures, retarder l'approbation de construction de nouveaux centres de données et faire cesser les dépenses des ministères en matière d'IA tant que les évaluations ne seront pas complétées et leurs recommandations présentées.
Les enjeux sont si importants qu'ils commandent des délais de précaution. Nos dirigeants.es doivent cesser d'agir comme les promoteurs des spéculateurs.trices de la grande industrie technologique et prendre des positions protectrices immédiates envers la sécurité financière de plus de 40 millions de Canadiens.nes face aux retombées d'un éclatement de la bulle boursière spéculative.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Embargo sur les armes maintenant !

Ce rapport révèle l'existence d'un vaste réseau de trafic de pièces détachées d'avions militaires et d'explosifs entre le Canada et Israël via les États-Unis, facilité par une faille mortelle dans la législation canadienne.

Le rapport est publié par le Mouvement de la jeunesse palestinienne (PYM), World Beyond War, Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient (CJPMO), et la campagne
« Embargo sur les armes maintenant ».
Il nous interpelle particulièrement concernant la complicité du Québec avec le génocide puisqu'il met notamment en lumière...
➡️ 150 expéditions d'explosifs et de matières inflammables provenant des installations de General Dynamics à Valleyfield et Repentigny,au Québec, vers les usines étasuniennes de production de munitions qui fabriquent les bombes MK-84 de 2000 livres, les obus d'artillerie de 155 mm et les obus de char de 120 mm exportées vers Israël.
➡️ 433 expéditions de TNT fabriqué en Pologne, transitant par le port Saguenay, au Québec, entre octobre 2023 et novembre 2025.
Les expéditions sont ensuite transportées par camion sur des autoroutes au Canada et aux États-Unis vers des usines étasuniennes de production de munitions, où le TNT est utilisé pour produire les bombes MK-84 de 2000 livres et les bombes pénétrantes I-2000 larguées sur Gaza par Israël.
📖 Pour lire le rapport en français
📢 POUR PROTESTER AUPRÈS DE VOTRE DÉPUTÉ·E au moyen d'un courriel déjà préparé, prêt à l'envoi
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Déclaration du coprésident de Retroussons-nous les manches pour le climat

La coalition Retroussons-nous les manches pour le climat [1] est profondément préoccupée par l'annonce faite hier par le premier ministre.
Le 28 novembre 2025
Cet été a été l'un des pires étés de l'histoire canadienne en matière de catastrophes liées aux changements climatiques. Plus de 220 communautés d'un océan à l'autre ont été brûlées, évacuées, inondées ou autrement touchées directement par le dérèglement climatique. Il est profondément troublant que le premier ministre ait choisi de prioriser les subventions à des projets de combustibles fossiles au profit de certaines des entreprises les plus riches au monde et d'augmenter leurs profits déjà considérables, aux dépens de nos collectivités. Le protocole d'entente signé aujourd'hui garantit pratiquement que davantage de nos résidents souffriront de catastrophes climatiques, à un moment où les gouvernements locaux sont déjà
profondément préoccupés par la protection des citoyens qu'ils servent.
Le premier ministre et son gouvernement devraient plutôt se concentrer sur des solutions sérieuses qui bâtissent notre nation, et non continuer de la détruire.
Le gouvernement doit concentrer ses efforts et ses investissements sur des projets sérieux et structurants qui créeront de bons emplois partout au pays et bâtiront des communautés fortes et résilientes, aujourd'hui comme dans l'avenir. Des projets comme un réseau électrique propre est-ouest-nord, un réseau ferroviaire à grande vitesse national, des millions de logements abordables et écoénergétiques hors marché, l'installation massive de thermopompes et la rénovation énergétique d'un bout à l'autre du pays, ainsi qu'une stratégie nationale de résilience et de relèvement entièrement financée permettraient de répondre à la
fois à la crise climatique et aux menaces économiques de Trump envers notre économie.
David Miller
Coprésident, Retroussons-nous les manches pour le climat
David Miller est l'ancien maire de Toronto et coprésident de Retroussons-nous les manches pour le climat, une coalition de 250 maires et conseillers municipaux de partout au Canada représentant plus de 10 millions de Canadiens qui croient que le Canada peut – et doit –
s'attaquer conjointement aux deux crises que sont les changements climatiques et les menaces économiques des États-Unis.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’autoritaire Doug Ford privatise notre eau

Le gouvernement de Doug Ford vient d'adopter le projet de loi 60, intitulé « Fighting delays, Building Faster Act, 2025 » (Loi de 2025 visant à lutter contre les retards et à accélérer la construction), un gigantesque projet de loi omnibus qui donne aux propriétaires fonciers plus de pouvoir pour expulser leurs locataires.
Tiré de Rabble
26 novembre 2025
Il a été adopté sans consultation publique et sans transparence législative. Ce projet de loi comporte certains aspects très préoccupants, notamment la prise de contrôle de l'Exhibition Place, et ce n'est là qu'un des aspects cachés du projet de loi omnibus du premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, qui profitera aux entreprises privées.
Les gens seront très inquiets d'apprendre que le projet de loi omnibus 60 cache une nouvelle loi appelée « Water and Waste Water Public Corporations Act » (loi sur les sociétés publiques d'eau et d'égouts). Cette loi permettra la privatisation de l'eau. En cette période de crise du pouvoir d'achat, ce projet de loi permettra aux entreprises privées de contrôler les tarifs de l'eau afin de maximiser leurs profits. La sécurité publique sera-t-elle une préoccupation lorsque des profits seront en jeu ?
Le gouvernement conservateur n'a pas tiré les leçons de Walkerton, où en 1996, après la privatisation des analyses de l'eau, au moins sept personnes sont décédées. Plus de
2 300 personnes sont tombées gravement malades, beaucoup ont été hospitalisées et beaucoup ont dû subir une dialyse pour le reste de leur vie. Pire encore, Ford a déjà adopté le projet de loi 56 qui a supprimé l'autonomie locale des réseaux d'approvisionnement en eau et a donné au ministre responsable le pouvoir d'apporter des modifications sans consultation publique ni contrôle.
Le premier projet de loi présenté par Harris était le projet de loi omnibus 26 en 1996, qui comptait 200 pages. Ce projet de loi cachait la suppression d'une loi exigeant un référendum public contraignant chaque fois qu'un bien public devait être vendu.
Nous avons déjà vu ce qui est arrivé à un autre bien de première nécessité lorsque l'électricité a été déréglementée et privatisée : en 2018, les tarifs avaient quadruplé. Ford vient d'augmenter les tarifs de l'électricité de 29 % et a augmenté la subvention financée par les contribuables pour l'électricité à 23,5 % afin de le dissimuler. La privatisation de l'électricité a été une terrible erreur dont les Ontarien·ne paient encore le prix fort. La privatisation de l'eau est une erreur bien pire. Cacher des informations au public et à la surveillance démocratique est la procédure habituelle de Ford.
La quête de pouvoir autoritaire de Ford se manifeste par la concentration du pouvoir au sein du bureau du premier ministre. Depuis 2018, Ford a considérablement réduit le contrôle parlementaire grâce à une gigantesque loi omnibus, en tentant de submerger l'opposition, en réduisant le temps alloué, en invoquant la clôture permettant au gouvernement de conclure le débat et de forcer un vote sur n'importe quelle question.
Depuis sa première élection, Ford a poursuivi un transfert de pouvoir sans précédent vers le bureau du premier ministre.
Le nombre de personnes sans-abri a augmenté en raison du projet de loi 184 de Ford, intitulé « Loi sur la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire ». Il a été qualifié de « projet de loi sur les expulsions » car il a donné aux sociétés d'investissement plus de pouvoir pour expulser les locataires afin qu'elles puissent augmenter les loyers.
À la suite de la législation de Ford, la pauvreté infantile, qui devait être éliminée d'ici l'an 2000, a augmenté.
Le démantèlement de la démocratie par Ford a commencé discrètement lors de son premier mandat et s'accélère. À chaque occasion, Ford a éliminé les audiences publiques et toute participation du public.
Ford a marginalisé les réglementations dans tous les domaines de la politique publique, de la protection du public à l'environnement, en les qualifiant de « formalités administratives » et s'est efforcé de les supprimer.
Le projet de loi omnibus 57 de Ford a modifié 56 lois existantes touchant presque tous les ministères. Le projet de loi 57 a également supprimé trois bureaux de la législature, soit le défenseur des enfants de l'Ontario, le commissaire à l'environnement de l'Ontario et les services en français.
Ford privatise les soins de santé avec les projets de loi 74, 175 et 60, qui donnent au ministre le pouvoir de privatiser les soins de santé en Ontario.
Nous ne devons pas oublier que pendant la pandémie, en avril 2022, Ford a tenté d'ordonner à la police de toute la province d'arrêter les automobilistes et les piéton·nes pour leur demander de présenter une pièce d'identité et de dire où ils et elles allaient. Toutes les forces de police de la province ont refusé.
La privatisation de l'eau au Royaume-Uni a contraint les personnes pauvres et marginalisées à s'approvisionner en eau dans les toilettes publiques, ce qui a entraîné des problèmes de santé. La privatisation autoritaire de l'eau par Ford ne profite qu'aux riches entreprises.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Yves Engler est candidat à la direction du NPD

Jeudi, le NPD se prépare à exclure le seul candidat québécois et francophone du débat à la chefferie du parti à Montréal. Il s'agit là d'une insulte envers le Québec, les francophones et les membres du parti.
Après que le caucus socialiste du NPD m'ait demandé de me présenter, j'ai annoncé ma candidature à la chefferie du parti en juillet. Avec plus d'un millier de bénévoles, ma campagne rebelle a organisé deux douzaines d'événements à travers le pays, a largement dépassé le nombre requis de signatures pour l'investiture du NPD et a récolté plus de 100 000 dollars. La campagne a également rédigé une plateforme complète intitulée « Le capitalisme <> ne peut être réparé – en avant vers un avenir socialiste ». Rédigé par 50 militant·es dans le cadre d'un processus démocratique, ce programme s'inscrit dans la volonté de la campagne de raviver la pensée anticapitaliste et l'énergie militante qui ont mené à la création du NPD.
Les partisan·es du génocide perpétré par Israël à Gaza ayant appelé le parti à rejeter ma candidature et les responsables ayant refusé ma participation au congrès du NPD de l'Ontario, nous avons retardé la soumission officielle de ma candidature au comité de sélection composé, de trois personnes. Selon les règles de la course à la chefferie du NPD, une candidature potentielle peut être exclue si elle ne respecte pas « les principes et les valeurs fondamentales du parti ». Mais n'est-ce pas dans le cadre de la course à la chefferie (et des congrès politiques) que les « valeurs fondamentales » du NPD sont déterminées ?
Craignant que certain·es membres du parti ne bloquent purement et simplement notre campagne insurrectionnelle de gauche avant même qu'elle ne démarre, nous avons décidé de créer une dynamique et de publier notre programme avant de le soumettre à l'examen. Nous avons également cherché à discréditer ce processus d'examen antidémocratique.
Le 10 novembre, nous avons officiellement soumis notre candidature à l'examen du NPD. Même s'ils sont au courant de la campagne depuis des mois et que mes écrits et mon activisme « controversés » sont publics, le comité d'examen, composé de trois personnes, mandatées par le parti mais non-élues, fait traîner le processus. Le parti a laissé entendre qu'il ne se prononcerait pas sur ma candidature avant le débat à la chefferie du 27 novembre. C'est inacceptable.
De nombreuses personnalités du NPD et analystes médiatiques ont souligné l'importance pour le chef du parti de parler français, mais la plupart des autres candidatures à la direction peuvent à peine converser, et encore moins débattre, en français. Lors d'un forum organisé le mois dernier par le Congrès du travail du Canada, les questions prévues en français ont été annulées en raison des faibles compétences linguistiques des candidatures.
Le français n'est pas ma langue maternelle. J'ai grandi à Vancouver, mais ma mère est Fransaskoise et j'ai fréquenté une école d'immersion française. J'ai déménagé à Montréal pour fréquenter l'université Concordia ; j'y suis resté même après avoir été expulsé de l'université en tant que vice-président du syndicat étudiant à la suite d'une manifestation contre Benjamin Netanyahu en 2002. Je parle français à mes enfants de trois et huit ans.
En tant que seul Québécois dans la course, j'aurais plus de chances de recréer la vague orange de Jack Layton en 2011. En fait, ma stratégie au Québec consisterait à remettre en question le soutien, ce « confort et indifférence » des libéraux et du Bloc québécois envers le militarisme et le génocide perpétré par Israël à Gaza. Le Québec a une tradition pacifiste et internationaliste qui offre au NPD une certaine marge de manœuvre pour gagner du terrain. À mesure que les coupes budgétaires imposées par le militarisme radical de Mark Carney prendront effet, la question gagnera en importance. Si Carney entre en guerre, le sujet deviendra encore plus controversé.
Avec un seul siège au Québec, le potentiel de croissance est considérable. Mais surtout, le NPD doit devenir un lieu où les gens peuvent discuter du capitalisme, du militarisme et de l'impérialisme.
Dans les deux langues officielles du Canada.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Projet de loi constitutionnelle : dérive autoritaire et menaces pour la démocratie

Le PL1 vise à adopter une Constitution du Québec, mais il le fait sans véritable débat public, en concentrant davantage les pouvoirs entre les mains du gouvernement.
Tiré de l'Infolettre de l'R des centres de femmes
Le Nouvel'R 26 novembre 2025
En affaiblissant le rôle des tribunaux, en banalisant la suspension des droits fondamentaux et en limitant la capacité des organismes et de la société civile à contester les décisions de l'État, ce projet représente un recul majeur pour la démocratie et les droits humains. Il soulève des enjeux sérieux quant à la laïcité, à la liberté de conscience et à l'égalité réelle, particulièrement pour les groupes déjà marginalisés.
Le RQ-ACA rejette fermement le PL1 et demande son retrait complet et immédiat. Servez-vous de son mémoire-type et faites-vous entendre ! Des consultations générales auront lieu à compter du 4 décembre en Commission des institutions. Pour envoyer un mémoire SANS être entendue en commission, la date limite sera la dernière journée des consultations. Envoyez votre mémoire et/ou demande via ci@assnat.qc.ca
Pour en savoir plus, visionnez cerécent paneldu RQ-ACA et de la Ligue des droits et libertés (LDL). Cet outil-napperon (dont voici la version texte) vulgarise les enjeux, tandis que la LDL rassemble des ressources pour comprendre et combattre le PL1.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Transit Secours Québec (TSQ) voit le jour pour étendre son service à travers la province

Montréal, le 25 novembre 2025 — Transit Secours région de Montréal fait place à Transit Secours Québec (TSQ), un changement de structure visant à pérenniser la mission de l'organisme et à étendre ses services à travers la province. Il s'agit du seul organisme au Québec à offrir un service de déménagement et d'entreposage gratuit et sécuritaire aux survivant·es de violence conjugale et à leurs enfants.
TSQ reçoit en moyenne une quarantaine de demandes par mois. Il peine pourtant à répondre à la demande, faute de financement. Derrière chaque refus, ce sont des femmes – souvent de jeunes mères de 18 à 29 ans – et leurs enfants qui doivent improviser un départ dans la peur, parfois un sac de poubelle à la main. « Le moment où une femme et ses enfants quittent un milieu violent est statistiquement le plus dangereux. Il ne s'agit pas d'une simple logistique, mais d'une question de vie ou de mort. Lorsque des organismes essentiels comme TSQ sont sous-financés, c'est tout le réseau d'hébergement et de protection qui s'effrite — et avec lui, la sécurité des femmes et des enfants », met en lumière Anathalie Jean-Charles, présidente et fondatrice de TSQ.
En collaborant étroitement avec les maisons d'hébergement, les services sociaux et les corps policiers, TSQ contribue à diminuer les risques de représailles d'un partenaire envers l'autre au moment de quitter la relation. Le service de TSQ est particulièrement crucial pour les enfants et adolescents. « Des études estiment que 40% des enfants qui subissent des violences familiales développent un trouble de stress post-traumatique, explique Anathalie Jean-Charles. Notre service permet de briser le cycle de la peur et de leur offrir un environnement stable dès leur arrivée au refuge. »
À l'occasion des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes, TSQ fait circuler cette pétition <https://jappuietsq.ca/> pour demander au Gouvernement du Québec de financer la mission de l'organisme à la hauteur des besoins. « Rappelons que 9 féminicides intrafamiliaux sont déjà recensés au Québec en 2025. Signer la pétition, c'est poser un geste concret contribuant à sécuriser leur transition et à sauver les vies » conclut la présidente et fondatrice de TSQ.
Témoignage
Une mère, qui a dû fuir avec ses deux jeunes enfants (âgés de 2 et 4 ans) après un acte criminel commis par leur père, raconte : « J'ai dû partir presque sur le coup avec mes deux jeunes enfants qui avaient été témoins d'actes criminels graves. Plus tard, au printemps, j'ai pu enfin aménager mes choses de la maison familiale, grâce à Transit Secours. Leurs services furent absolument essentiels. Sans cette aide, mon histoire aurait pu très bien finir en homicide ou en féminicide. Transit Secours y a été pour beaucoup dans mon processus de libération et d'émancipation. Aujourd'hui, ma vie se replace tranquillement en milieu d'hébergement. »
Lien vers la pétition : https://jappuietsq.ca/
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

PL1 : Quand un projet de « constitution » menace nos droits

Le 9 octobre 2025, le ministre de la Justice a déposé le projet de loi no 1 (PL1), Loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec (ci-après « PL1 »), présenté comme une « constitution » québécoise. Ce projet de loi incarne à la fois une initiative autoritaire et une dérive antidémocratique, et représente une grave atteinte aux droits humains, ainsi qu'à l'égalité entre les genres au Québec. Or, malgré sa prétention fondatrice, il s'agit d'une coquille largement vide sur le plan législatif dans le contexte constitutionnel canadien, dont l'impact réel en matière d'émancipation ou de transformation juridique serait minimal.
– Autoritaire, car le PL1 privilégie la vision caquiste et non transpartisane d'un projet de constitution fondateur. Autoritaire, car le PL1 affaiblit la Charte des droits et libertés de la personne. Autoritaire, car le PL1 limite la contestation des contre-pouvoirs et renforce les pouvoirs exécutifs.
– Antidémocratique, car le PL1 s'est élaboré en vase clos, sans mandat ni discussion publique préalable, sans consultation préalable à son dépôt et sans transparence. Antidémocratique, car le PL1 s'est rédigé dans un processus précipité, et en contradiction avec les standards internationaux en matière de constitutionnalisation.
– Attentatoire aux droits humains, car le PL1 constitutionnalise une « laïcité » qui exclut des pans de la population et impose de force un « modèle d'intégration nationale ».
– Attentatoire à l'égalité entre les genres, car le PL1 impose une définition régressive et binaire de l'égalité en plus de fragiliser les droits sexuels et reproductifs en légiférant sur la liberté d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse.
Plus encore, le PL1 reproduit une logique coloniale majeure : les Premières Nations et Inuit n'ont pas fait partie du processus de conception. Or, une constitution véritablement bien réfléchie et inclusive n'est pas une loi ordinaire pour laquelle on peut se contenter d'une simple majorité des votes à l'Assemblée nationale. Puisqu'elle détermine la structure même du pouvoir politique, encadre l'existence et l'exercice des droits et libertés et définit les mécanismes essentiels qui permettent la justice sociale et la justice de genre, la rédaction d'un tel texte constitutionnel requiert un processus politique rigoureux, transparent, transpartisan, participatif, et surtout, conforme aux standards internationaux.
Aucune de ces conditions n'a été respectée.
Plutôt que de permettre à la population québécoise de débattre de la pertinence même d'adopter une constitution, ou encore de discuter des bases sur lesquelles devrait reposer celle-ci, le gouvernement caquiste impose un texte déjà rédigé, qui encadre, limite et prédétermine les discussions publiques et le processus de consultations générales. Les consultations générales et auditions publiques annoncées à la Commission des institutions porteront donc non pas sur le principe d'une constitution québécoise, mais sur un projet de constitution caquiste, enfermant d'emblée le débat public dans une perspective partisane. Les groupes de la société civile seront tentés de proposer des amendements à la pièce, de manière sectorielle.
Si une constitution a pour ambition de rassembler, la démarche envisagée pour l'adopter risque, paradoxalement, de susciter davantage de dissensions. Ainsi, le gouvernement ne possède ni l'autorité morale ni le mandat populaire pour imposer un changement d'une telle ampleur, touchant les droits fondamentaux et l'organisation des pouvoirs.
La Fédération des femmes du Québec (ci-après « FFQ ») conclut donc que ce projet est irrémédiablement vicié, tant dans son élaboration que dans son contenu. En cherchant à imposer en fin de mandat un texte de nature « constitutionnelle » sans participation réelle et en affaiblissant les contre-pouvoirs, le gouvernement compromet l'avenir démocratique du Québec et l'égalité réelle entre les genres.
Pour toutes ces raisons, la FFQ demande le retrait complet du PL1 et l'ouverture d'un véritable processus constituant, conforme aux normes internationales encadrant la constitutionnalisation et la protection des droits humains. Un tel processus doit être fondé sur la participation pleine et entière de l'ensemble de la population québécoise, en accordant une place particulière aux groupes marginalisés, et reposer sur une conception inclusive, intersectionnelle et non régressive des droits humains.
En date du 27 novembre, voici les organisations et personnes qui endossent le mémoire.
Endossement organisationnel
– Action cancer du sein du Québec
– Action Chômage Kamouraska
– Afrique au féminin
– Bureau d'animation et information logement du Québec Métro
– CALACS de Charlevoix
– Centre Communautaire des Femmes Sud-Asiatique
– Centre de solidarité lesbienne
– Centre des femmes de Longueuil
– Centre des femmes Ô Pays
– CIAFT
– Co-Savoir
– DAWN Canada
– Divergenres
– EX AEQUO
– La Marie Debout
– L'R des centres de femmes du Québec
– Mouvement Action-Chômage de Montréal
– Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi (MASSE)
– Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale (RGF-CN)
-Syndicat Industriel des Travailleurs et Travailleuses (SITT-IWW)
– Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes
– Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec
Endossement individuel
Silvie Lemelin
Vous voulez endosser le mémoire de la FFQ ? Voici un gabarit que vous pouvez utiliser !

Réaction de Greenpeace Canada au Protocole d’entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Alberta

Montréal – « C'est un jour sombre pour le Canada et tous ceux et celles qui entretiennent l'espoir de maintenir une planète habitable. Non seulement Carney et Smith tentent d'imposer un nouveau méga-projet pipelinier malgré l'opposition farouche de la Colombie-Britannique et des Premières Nations concernées, mais le gouvernement fédéral élimine aussi le plafonnement des émissions sur le pétrole et le gaz ainsi que la réglementation sur l'électricité propre. Il retarde également de 5 ans la réglementation sur le méthane et autorise l'utilisation du captage de carbone pour extraire davantage de pétrole, ce qui annule tout bénéfice potentiel. » – Louis Couillard, responsable de la campagne climat-énergie chez Greenpeace Canada
Tiré de Greenpeace Canada.
« Il s'agit d'une trahison pour l'ensemble des Québécois·es qui ont voté pour Mark Carney en pensant qu'il ferait de la lutte aux changements climatiques l'une de ses priorités ainsi d'une grave atteinte à l'égard de notre engagement en faveur de la réconciliation avec les peuples autochtones » affirme Louis Couillard, responsable de la campagne Climat et Énergie chez Greenpeace Canada.
Voici un extrait d'une déclaration commune de 41 organisations de la société civile sur le protocole d'entente entre Carney et l'Alberta :
« Il n'est pas dans l'intérêt national de poursuivre un projet qui oppose les provinces les unes aux autres, bafoue les droits des peuples autochtones et met en péril les économies locales ainsi que les écosystèmes côtiers et marins du Pacifique Nord.
Il y a dix ans, le Canada a tenté de conclure un accord ambitieux avec l'Alberta. Le gouvernement a racheté le projet d'expansion de Trans Mountain en échange du système inefficace de tarification du carbone de l'Alberta, que la première ministre Smith a récemment affaibli. Il n'y a aucune raison de croire que ce nouvel accord donnera de meilleurs résultats. »
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Voici pourquoi plus de 40 organisations s’opposent au projet d’oléoduc et de pétroliers sur la côte nord-ouest

Déclaration conjointe de 41 organisations de la société civile œuvrant pour un système climatique sûr, la protection des milieux marins et d'eau douce et le respect des droits et de la souveraineté des peuples autochtones.
Nous soutenons les Premières Nations côtières qui s'opposent au projet d'oléoduc et de pétroliers sur la côte nord-ouest. L'écosystème côtier du Pacifique Nord est d'une importance mondiale et un moteur économique majeur pour la région. Les eaux que les pétroliers emprunteraient sont dangereuses et les conséquences d'une marée noire catastrophique seraient inacceptables. La Loi sur le moratoire concernant les pétroliers est le fruit de décennies de travail mené par les communautés autochtones et non autochtones pour protéger le milieu marin et constitue un symbole juridique de la réconciliation entre la Couronne et les Autochtones.
Il n'est pas dans l'intérêt national de poursuivre un projet qui oppose les provinces les unes aux autres, bafoue les droits des Autochtones et met en péril les économies locales ainsi que les écosystèmes côtiers et marins du Pacifique Nord.
Un oléoduc et le trafic de pétroliers sur la côte nord auraient les conséquences suivantes :
– Un déversement de pétrole catastrophique risquerait d'entraîner des conséquences dévastatrices pour l'économie, les collectivités, les pêches et la faune de la Colombie-Britannique.
– Il bafouerait l'engagement du Canada envers la réconciliation.
– Il rendrait les objectifs du Canada en matière de climat et de nature encore plus inaccessibles.
– Il détournerait le Canada de la transition énergétique et des investissements dans une véritable compétitivité climatique.
– Un oléoduc n'a aucun sens : il n'y a ni promoteur, ni marché, ni plan, ni consentement des Premières Nations concernées.
Il y a dix ans, le Canada a tenté une grande entente avec l'Alberta. Le gouvernement a acquis le projet d'expansion de Trans Mountain en échange du système inefficace de tarification du carbone de l'Alberta, que le premier ministre Smith a récemment affaibli. Rien ne permet de croire qu'une nouvelle grande entente serait plus avantageuse.
Nous rejetons catégoriquement l'idée que cela représente une entente, quelle qu'elle soit.
Le projet Pathways CCUS ne compenserait pas les émissions liées à l'augmentation de la production nécessaire pour alimenter un nouvel oléoduc ou l'agrandissement d'un oléoduc de bitume.
Un renforcement de la tarification du carbone industriel est nécessaire, mais il ne compenserait pas l'augmentation des émissions due à l'accroissement de la production de pétrole et de gaz. Les contribuables ont investi 40 milliards de dollars dans l'achat et la construction de TMX. Nous refusons toute nouvelle subvention des contribuables pour les installations pétrolières et gazières ou pour la capture du carbone.
Ce n'est pas bâtir notre nation, c'est la trahir : trahir l'avenir de nos enfants, trahir les peuples autochtones et trahir les Canadiens qui, dans leur immense majorité, appuient la lutte contre les changements climatiques.
Les Canadiens veulent de l'énergie propre, des logements abordables et des transports propres. Pas un autre pipeline.
Signataires
Calgary Climate Hub, Canada's Clean50, Canadian Association Of Physicians For The Environment, Canadian Environmental Law Association, Canadian Voice Of Women For Peace, Change Course, Climate Action Network Canada, Climate Action Partnership, Climate Emergency Unit, Climatefast, Climate Justice Saskatoon, Coalition For Responsible Energy Development In New Brunswick (Cred-NB), Decolonial Solidarity, East Coast Environmental Law, Ecology Action Centre, Ecojustice, Environmental Defence, For Our Kids, For Our Kids Burnaby, Friends Of The Earth Canada, Gasp (Grandmothers Act To Save The Planet), Green 13, Greenpeace Canada, LeadNow, Ontario Clean Air Alliance, Ontario Climate Emergency Campaign, Re•generation, Sacred Earth, Seniors For Climate Action Now !, Shift : Action, Sierra Club Canada, Stand.Earth, The Climate Reality Project Canada, West Coast Climate Action Network, West Coast Environmental Law Association, West Kootenay Climate Club, Wilderness Committee, Windfall Ecology Centre, Youth Climate Save Canada, Zero Waste BC
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.











