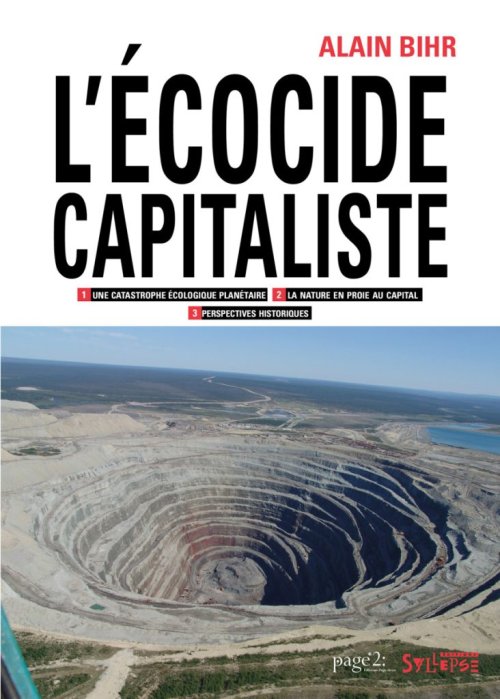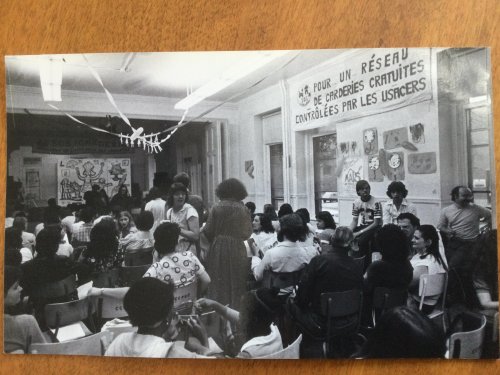Derniers articles
Des militants écologistes privés d’un procès avec jury

Salade, tomate, pognon !

( Au Resto, « Les Milords », du 16ème, une nouvelle formule dédiée à la bourgeoisie parisienne séduit par sa touche excentriquement suave )
- Arrange ta cravate, mon chéri, elle est de travers, enjoint Madame Troflouze, à son époux.
– J't'avais dit que les nœuds papillons, c'est pas mon truc, grogne François, un Industriel replet et trapu qui pèse lourd dans le CAC 40.
– Moi, je te trouve très élégant, avec !
- Bon, entrons maintenant !
( Le couple Troflouze retrouve sa table parmi le beau monde venu savourer la curiosité gastronomique dédiée à la bourgeoisie, sur la Place de Paris )
- Alors ? Tu le trouves comment, le cadre du restaurant ? Jade.
– Somptueux !
- J'aime les ambiances qui répondent aux allants et aspirations des acteurs de l'entreprenariat, pas toi ?
- Si ! Regarde les tentures imprimées avec des motifs de billets de banque en euro et en dollar, c'est vraiment bien contextualisé.
– T'as pas regardé les dalles, sous tes pieds ?
- Oh, j'avais les yeux où, moi ? Comme c'est sympa ! Des lingots d'or qui scintillent dès qu'on bouge les pieds.
– Et le plafond ? fait François.
– Mon Dieu comme c'est magnifique. Un revêtement en Labradorites ! De l'iridescence plein la vue !
- Eh, Jade, oublie l'effet Schiller ! Et regarde qui arrive, tu ne croirais pas tes yeux.
– Oh ! Le prince de Monaco et juste derrière, les grosses fortunes en cordon d'oignon qui font la fierté de la France.
– Voilà notre ami Bolloré, lance François d'un ton enthousiaste, dont le Groupe est en guerre avec l'Audiovisuel public.
- Depuis hier, il défraie la chronique. Observe Jade.
– Pourquoi ?
– Il parait qu'il a fait exploser les revenus du président du Rassemblement national (RN).
– Jade ! Tourne-toi discrètement ! Tu vas tomber des nues, dit François.
– Le Président de la République !
- En chair et en os !
- Je savais qu'il allait venir, mais avec un certain doute, reprend Jade.
– Il a une capacité d'adaptation à donner le tournis aux Caméléons, pointe François.
– Plutôt d'ubiquité déroutante : Près du Peuple et du Fric ! atteste Jade.
( Les commandes arrivent enfin. Dans la salle, le Gotha découvre et savoure la nouvelle formule )
– Alors qu'est-ce t'en penses, Jade ?
- Exquis !
- Moi, dit François, je n'en reviens pas. Cette saveur gustative, du Bonheur aux papilles.
– Dorénavant, on mangera au moins deux fois par semaine « Salade, Tomate, Pognon ! », insiste Jade.
- T'as pris quelle sauce, mon lapin ?
- Sauce Capital mixée Dividendes caramélisées et toi ?
- Capitalisation avec Actions. C'est bourratif, mais intensément bon !
- C'est curieux, cette sensation succulente : Plus on mange, plus on brûle d'envie de faire du fric ! remarque Jade.
– C'est vrai, consent François, j'éprouve le même effet : Oseille ! Encore oseille ! Toujours oseille !
- J'ai vu, dit Jade, un des serveurs apporter au chef de l'Etat une sauce Plus-Value, cela doit être bon ?
– Lui aussi, il a fini son plat « Salade, Tomate, Pognon ! »
- Il a visiblement bien apprécié le nouveau concept culinaire ?
- Il s'y connait pour avoir fréquenté les Rothschild.
( Jade reste un long moment silencieuse )
– Qu'est-ce qu'il t'arrive Jade ?
- Attends ! Je me suis fait mal à la dent en croquant sur un débris dur.
– Tu veux de l'eau ?
- Non !
- C'est certainement un fragment d'os.
– Ça y est je l'ai ! C'est pas un os, Monsieur Troflouze !
– Fais voir ? s'impatiente François.
- (…)
- Eh, tu veux qu'te dise ? s'écrie l'époux. Ton intrus indésirable, c'est un DIAMANT !
- On n'a pas commandé la Galette du Roi, pourtant ?
- Chuut, Mund zu ! Ça s'passe comme ça chez « Salade, Tomate Pognon ! »
- Demain, à la première heure, le p'tit déj' chez qui, ma Chérie ?
- « Salade, Tomate Pognoooon ! »
Texte et illustration : Omar HADDADOU
(Le récit reste fictif)
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les femmes sont les premières cibles des attaques de la CAQ

Voici le tract du comité des femmes du Conseil Central de Québec Chaudière-Appalaches (CSN) distribué le 6 décembre 2025 durant la manifestation contre les violences faites aux femmes.
Après 7 ans au pouvoir, l'appui au gouvernement de la CAQ est en chute libre et tout indique que si des élections avaient lieu aujourd'hui, il serait rayé de la carte. C'est dans ce contexte qu'il tente de détourner l'attention de son bilan désastreux en attaquant les syndicats et les personnes immigrantes.
Les compressions et le sous-financement chronique, notamment des réseaux de l'éducation, de la santé et des services sociaux, touchent principalement les femmes d'abord comme travailleuses, mais aussi comme utilisatrices. Le retrait de réseaux de l'éducation et de la santé et des services sociaux des mécanismes de protection de la Loi sur la santé et la sécurité au travail qui s'appliquent à l'ensemble des entreprises québécoises touche surtout des travailleuses.
Le durcissement des lois sur la « laïcité », notamment dans les CPE et les écoles primaires et secondaires, touche surtout des femmes et attaque de front leur droit au travail en pleine pénurie de personnel.
Même les attaques antisyndicales visent surtout les femmes.
Déjà, on l'oublie souvent, mais les femmes sont majoritaires dans le mouvement syndical québécois. Ce sont majoritairement des femmes qui ont fait la grève et pris la rue dans les dernières années (Front commun du secteur public, grève des enseignantes, CPE, hôtellerie, etc.).
On pourrait continuer longtemps. Les attaques contre les médecins coïncident avec la féminisation de la profession. Les stages non-rémunérés ? Surtout concentrés dans les milieux à forte prédominance féminine.
FAIRE FRONT POUR LES FEMMES
Face à une conjoncture politique particulièrement hostile, la CSN a choisi de faire front et d'organiser la résistance. Le gouvernement caquiste favorise le privé, réorientant l'État social pour qu'il serve d'abord les intérêts des patrons et de l'élite économique plutôt que la population. Le tout dans un contexte d'austérité et de coupures sauvages.
Notre objectif est de contrer les attaques de la CAQ et de mettre en lumière les vrais besoins de la population et nos solutions. Il faudra frapper assez fort pour s'assurer que, peu importe le parti qui remportera les prochaines élections, l'on change d'orientation pour remettre l'État social au service de la population et que l'on reprenne le chemin de la justice climatique et sociale.
Le mouvement syndical donnera de la voix et multipliera les mobilisations dans les prochains mois. Et ça a commencé par un grand rassemblement qui a réuni plus de 50 000 personnes le 29 novembre dernier, à Montréal. Joignez-vous à nous pour la suite !
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Projet de loi 1 sur la Constitution du Québec - Plus de 300 organisations réclament son retrait

MONTRÉAL, le 4 déc. 2025 - Une vaste coalition d'organisations de la société civile québécoise, dont la Ligue des droits et libertés (LDL), le Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA), le Centre québécois du droit de l'environnement (CQDE), l'Association canadienne des libertés civiles (ACLC), la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI), le Conseil central du Montréal métropolitain CSN (CCMM-CSN) et le Conseil régional FTQ Montréal métropolitain (CRMM-FTQ), dénonce le projet de loi n° 1, Loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec. Selon ces groupes, ce projet de loi constitue une menace pour la démocratie, l'État de droit et le régime québécois de protection des droits et libertés.
Rassemblés en conférence de presse au moment où débutent les consultations devant la Commission des Institutions, ils portent la voix de plus de 300 organisations* qui ont endossé une déclaration commune réclamant le retrait complet du projet de loi :
« Le projet de loi No 1, Loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec, est une attaque contre la démocratie et les droits humains. La démarche est unilatérale et précipitée et elle ne respecte pas les critères démocratiques pour l'élaboration d'une constitution légitime. En outre, elle perpétue une logique coloniale en niant le droit des peuples autochtones à l'autodétermination.
Au lieu d'affronter les questions qui préoccupent les citoyen•nes (la santé, l'éducation, le logement, l'environnement, l'égalité des genres, le coût de la vie, etc.), le gouvernement québécois s'attaque aux droits et libertés, aux contre-pouvoirs et à l'État de droit. Par conséquent, les groupes soussignés exigent le retrait complet du PL1. »
Cette coalition dénonce le processus entourant l'élaboration et le dépôt de ce projet de loi, tout comme les nombreux reculs que prévoit le PL1 en matière de droits et libertés. Considérant l'importance juridique d'une constitution, celle-ci aurait dû être élaborée dans le cadre d'un processus ouvert, permettant la pleine participation de la société civile et de l'ensemble de la population. Or, dans le cas du projet de loi n° 1, le gouvernement a choisi d'agir en vase clos, sans consultations publiques préalables et sans tenir compte des critères établis en droit international, qui recommandent des processus élargis, participatifs et respectueux des droits de toutes et tous. Les groupes dénoncent aussi le fait que ce projet de loi a été préparé sans la participation des peuples autochtones, niant leur droit à l'autodétermination et outrepassant le principe de dialogue de nation à nations.
La coalition appelle la population, les mouvements sociaux et tous les groupes de la société préoccupés par la démocratie, l'État de droit et les droits humains à se mobiliser pour exiger que le gouvernement retire le projet de loi no1.
* La liste des organisations exigeant le retrait du PL1 est disponible ici.
Citations
« Pour une rare fois dans sa longue histoire, la LDL a refusé de participer aux consultations sur un projet de loi qui menace les droits et libertés, et ce même si le projet de loi no 1 constitue une attaque délibérée au régime québécois de protection des droits humains. Par cette décision, la LDL dénonce le processus opaque, autoritaire et antidémocratique utilisé par le gouvernement pour préparer et présenter son projet de constitution. Le gouvernement n'a respecté aucun des critères établis par l'ONU pour l'adoption d'une constitution démocratique et légitime. C'est pourquoi nous appelons l'ensemble de la société québécoise à le rejeter en bloc. »
– Paul-Étienne Rainville, responsable de dossiers politiques à la Ligue des droits et libertés (LDL)
« Le PL1 réduit considérablement l'espace démocratique, fragilise l'indépendance des mouvements sociaux et menace directement le modèle québécois d'action communautaire autonome (ACA), fondé sur la défense des droits, la participation citoyenne et la transformation sociale. Le retrait complet et immédiat du projet de loi no 1 est la seule voie responsable et raisonnable. »
– Claudia Fiore-Leduc, chargée de campagnes au Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA).
« Ce projet de loi constitutionnelle s'inscrit dans une tendance préoccupante d'affaiblissement de l'État de droit. Une Constitution ne peut être légitime que si elle repose sur l'exercice du droit à la participation publique, ce qui exige un processus participatif élargi. C'est d'autant plus important alors que certaines dispositions fragilisent des mécanismes essentiels de contre-pouvoir et restreignent indûment le contrôle judiciaire. »
– Geneviève Paul, directrice générale, Centre québécois du droit de l'environnement (CQDE)
« Le projet de constitution s'inscrit dans la série d'initiatives législatives que le gouvernement présente comme autant de démarches d'affirmation nationale, tel que le modèle d'intégration à la nation québécoise (PL 84), adopté en mai 2025. Comme dans ce dernier cas, on propose des changements drastiques, attentatoires aux droits humains et propres à alimenter l'exclusion, le tout à l'issue de processus de consultations bâclés. Nous refusons de jouer dans ce mauvais film. »
– Louis-Philippe Jannard, coordonnateur du volet protection de la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes
« Le PL1 est une attaque directe aux droits démocratiques et politiques de l'ensemble de la population du Québec. Les attaques contre les syndicats ne doivent pas cacher le fait que c'est toute la société civile que le gouvernement cherche à affaiblir. Nous ne pouvons accepter que le gouvernement du Québec se mette à l'abri d'éventuelles contestations judiciaires ou politiques. Une constitution doit non seulement être élaborée par et pour le peuple, elle doit aussi avoir pour objectif de protéger la population contre d'éventuels abus de pouvoir de l'État, et non pas défendre la "souveraineté parlementaire" des gouvernants. Le PL 1 est inamendable et doit être retiré, purement et simplement. »
– Bertrand Guibord, président, CCMM-CSN
« Pour être légitime, une constitution doit être le fruit de consultations en amont de l'ensemble de la population, incluant les groupes marginalisés. Ce type de texte doit tendre à garantir les droits fondamentaux du peuple et à faire obstacle à d'éventuelles tentatives visant à introduire un régime autoritaire. Le Projet de loi 1 échoue sur tous les plans. »
– Anaïs Bussières McNicoll, directrice du programme des libertés fondamentales, Association canadienne des libertés civiles
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Lancement du rapport "Femmes sans statut en action : conditions de travail et santé" dans le cadre des 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes

Montréal, le 3 décembre 2025 – Le Centre des travailleurs et travailleuses immigrant݀݀݀·e݀݀݀·s (CTTI) lutte pour l'amélioration des conditions de travail et de vie travailleuses migrantes et immigrantes depuis l'an 2000.
Conscient des défis, des risques et de la violence accrus auxquels sont confrontées les femmes sans statut d'immigrant régulier, le Comité des femmes a été créé. En raison de ces difficultés, le comité a men݀é une recherche de cinq ans pour documenter l'expérience des femmes sans statut d'immigrante au Québec. Le Comité femmes du présente les résultats de sa recherche intitulée Femmes sans statut en action : conditions de travail et santé dans le cadre des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. Après un long parcours de plus de cinq ans de travail acharné, nous pouvons enfin divulguer le rapport de notre recherche-action participative qui nous permettra de sensibiliser la population aux réalités vécues par les femmes sans statut régulier au Québec.
Les femmes sans statut sont exposées à un risque supplémentaire de violence en raison de leur statut. Elles subissent malheureusement différents types de violence, dont la violence institutionnelle. Elles sont ignorées, discriminées et invisibles, abandonnées face à un système qui les utilise et les rejette. C'est dans ce cadre des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes, nous avons décidé de faire entendre notre voix.
Nous avons travaillé pendant longtemps et nous sommes aujourd'hui en mesure de démontrer que nous ne sommes pas une ou deux femmes qui se trouvent dans cette situation d'extrême précarité et d'abandon.
Des salaires impayés, victimes d'abus psychologiques et sexuels. Elles sont exposées à et développent des maladies chroniques en raison du stress auquel elles sont confrontées chaque jour. Condamnées à être loin de leurs familles, de leurs enfants, parce qu'elles sont le pilier économique de leurs familles, mais aussi de ce pays qui les nient. Elles sont
indispensables, mais invisibles.
Statistiques de notre report de recherche
Selon nos recherches, 42% de femmes sans statut vivent de l'harcèlement sexuel et 25% ont été touchées de facon inappropriée au travail.
Seulement 25 % des femmes sans statut ont toujours été payées au moins le salaire minimum.
Plus de 50% des femmes sans statut expérience le vol de salaire.
La grande majorité des femmes (73 %) ayant vécu tristesse, déprime ou désespoir tous les jours ou presque dans les six derniers mois.
QUELQUE CITATIONS DU COMITÉ FEMMES
« Le statut d'immigrant avant tout ! Nous ne sommes pas humains, nous ne sommes pas des femmes ! Le travail et l'économie en detriment de nous vie. »
« Ce projet n'est pas seulement un document, c'est la voix d'un mouvement. »
« On porte le Québec sur nos épaules, mais personne ne porte notre sécurité. »
« Invisibles au gouvernement, indispensables dans la réalité. »
« On prend soin de tout, sauf de nous. »
« Nous ne cherchons pas la pitié, seulement la dignité. »
« Toutes les femmes devraient avoir les mêmes droits. »
-
Comité femmes de CTTI
Source : Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (CTTI)
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La Fédération du travail de l’Ontario adopte une résolution « Hot Cargo » contre Israël

La Fédération du travail de l'Ontario (FTO) est devenue la quatrième fédération syndicale canadienne à adopter une résolution contre les marchandises israéliennes la semaine dernière. La résolution déclare que les relations commerciales et les services avec Israël sont considérés comme des « marchandises chaudes » que les travailleurs et travailleuses ne toucheront pas.
28 novembre 2025
Le terme « marchandises chaudes » est utilisé pour définir les marchandises que les travailleurs et travailleuses ne manipuleront pas en raison de leur association avec l'exploitation ou l'oppression.
La Fédération du travail du Nouveau-Brunswick a été la première à adopter une résolution soutenant le boycott d'Israël lorsqu'elle a voté en mai une résolution contre la manutention d'armes destinées à Israël. Depuis lors, trois autres fédérations provinciales du travail ont pris des mesures similaires en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve-et-Labrador et en Ontario.
Kevin Levangie, membre du comité directeur national de Travailleurs pour la Palestine Canada, a déclaré que les travailleurs et travailleuses sont peut-être habitué·es à voir le terme « cargaison brûlante » utilisé pour décrire les marchandises fabriquées par des briseurs de grève, mais que cette tactique de pression peut être utilisée de manière plus large.
À St. John's, au Nouveau-Brunswick, la ville natale de M. Levangie, les travailleurs et travailleuses ont une longue tradition de refus de manipuler des marchandises associées à des violations des droits humains. En juillet 1979, les dockers de St. John's ont refusé d'expédier des conteneurs d'eau lourde destinés à être utilisés par le gouvernement argentin dans un réacteur nucléaire. À l'époque, l'Argentine était dirigée par une dictature militaire connue pour faire disparaître ses citoyen·nes.
Plus récemment, les travailleurs et travailleuses du même port ont refusé de transporter des cargaisons militaires à destination de l'Irak lors de l'invasion américaine de 2003.
« L'isolement international de tout pays qui commet des violations des droits humains est un outil très puissant dont nous disposons », a déclaré Levangie. « Je pense qu'il faudra une pression venant de la base, une pression des travailleurs et travailleuses, pour imposer cet isolement international. »
En octobre 2023, le gouvernement israélien a déclaré la guerre au Hamas à Gaza après que plus de 1 300 Israélien·nes ont été tué·es lors d'une attaque terrestre. La riposte des Forces de défense israéliennes a entraîné la mort de plus de 67 000 Gazaoui·es, selon les autorités sanitaires palestiniennes.
« L'attaque terroriste perpétrée par le Hamas le 7 octobre était une atrocité », a écrit Danny Kavanaugh, président récemment retraité de la Fédération du travail de la Nouvelle-Écosse, dans une lettre signée par Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada, et envoyée au premier ministre Mark Carney. « La punition collective infligée à des millions de Palestinien·nes en réponse à cette attaque est un crime d'une ampleur historique. »
Selon l'opinion publique, la pression pour qu'Israël soit tenu responsable de ses crimes à Gaza s'intensifie au Canada. En août, un rapport de l'Institut Angus Reid a révélé que la sympathie des Canadien·nes pour les Palestinien·nes avait doublé depuis qu'Israël avait déclaré la guerre en 2023.
En août, la ministre des Affaires étrangères, Anita Anand, a annoncé que le Canada « gèlerait en 2024 tous les permis existants qui auraient pu permettre l'utilisation de composants militaires à Gaza ». Malgré cela, des rapports réalisés par World Beyond War, le Mouvement de la jeunesse palestinienne, Canadians for Justice and Peace in the Middle East et la coalition Arms Embargo Now ont montré que des armes continuaient d'arriver en Israël via les États-Unis. M. Levangie a déclaré que c'était l'une des nombreuses raisons pour lesquelles les Canadien·nes devaient continuer à agir en solidarité avec la Palestine.
« Les Canadien·nes sont complices de ce génocide en cours, et il existe des moyens de résister et de s'opposer au génocide et à l'apartheid », a-t-il déclaré. Labour For Palestine, qui a poussé les organisations syndicales à adopter des résolutions « hot cargo » à l'égard d'Israël, prévoit de continuer à renforcer la dynamique contre la manutention des biens et services à destination de ce pays. L'organisation espère que le Congrès du travail du Canada, qui représente plus de trois millions de travailleurs et travailleuses, soutiendra la campagne « Arms Embargo Now » (Embargo sur les armes maintenant) et adoptera une résolution « hot cargo » à l'échelle nationale lors de son congrès qui se tiendra l'année prochaine.
« Nous continuerons à faire ce que nous avons fait jusqu'à présent », a déclaré M. Levangie. « Cela signifie continuer à demander à nos syndicats de signer la campagne BDS, continuer à travailler avec les membres de la base pour coordonner le refus de traiter les marchandises et les services liés à Israël, et nous poursuivrons également nos efforts de sensibilisation. »
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La COP30 entre palabres officielles et mobilisation populaire

La COP30 [1] s'est tenue à Belém, capitale de l'Etat brésilien du Pará, du 10 au 22 novembre. Elle avait la redoutable tâche de faire oublier les pitoyables résultats auxquels étaient parvenues les précédentes éditions de cette conférence annuelle.
Tiré de A l'Encontre
2 décembre 2025
COP30, le marketing et la réalité.
Pour rappel : la COP21 qui s'était tenue à Paris en 2015 avait abouti à un accord prévoyant une réduction de l'émission des gaz à effet de serre (GES) capable de contenir « l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels [tout] en poursuivant l'action menée pour limiter l'élévation de la température à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels » [2]. Mais, depuis, en dépit d'engagements répétés de COP en COP, aucun effort sérieux n'a été accompli dans cette voie. Entre 1990 et 2023, la part des combustibles fossiles (charbon, pétrole et gaz naturel) dans le mix énergétique mondial, dont la combustion est le principal responsable des émissions des GES facteurs du changement climatique, est restée pratiquement constante : elle continue à se payer la part du lion (elle n'a régressé que de 81,8 à 80,7 %) alors que la production d'énergie primaire mondiale s'est accrue de 74 % entre-temps, en passant de quelque 364 millions à 633 millions de terajoules [3]. De la sorte, il ne faut pas s'étonner que l'Organisation météorologique mondiale (OMM) ait dû constater qu'en 2024 la hausse de la température moyenne du globe s'est située entre 1,34 et 1,41°C par rapport aux niveaux préindustriels et que, dans ces conditions, il y a 70 % de chances que le seuil des 1,5°C soit franchi par la moyenne quinquennale entre 2015 et 2034 [4].
Présidée par le sultan Ahmed Al-Jaber, patron de la compagnie pétrolière émiratie Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), la COP28 (2023) a lancé une véritable OPA des industries productrices de combustibles fossiles destinée à reporter aux calendes grecques l'abandon définitif de l'extraction et de la consommation de ces combustibles, le tout au nom du droit au développement des États « en voie de développement » et en pratiquant un déni cynique des données scientifiques. Opération largement réussie : si la résolution finale a fait allusion aux énergies fossiles, c'est pour simplement demander aux parties de « s'éloigner des combustibles fossiles [transitioning away from fossile fuels] de manière à atteindre le zéro net en 2050 » sans cependant fixer aucun calendrier, aucune contrainte ni aucune sanction a fortiori en cas de non-respect des engagements, les États et les compagnies charbonnières, pétrolières et gazières (dont les projets de mise en exploitation de nouveaux sites dans les prochaines années se comptent par dizaines) restant les seuls maîtres en la matière [5]. L'essentiel est acquis : il n'est pas question de sortir des énergies fossiles car l'on sait que les transitions peuvent durer longtemps…voire éternellement.
Siégeant à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, la COP29 (2024) aura été la troisième à se tenir successivement dans un État producteur de pétrole, les représentants de grands groupes pétroliers (Exxon Mobil, Shell, Chevron, BP, TotalEnergie, etc.) et leurs lobbyistes faisant désormais partie des délégations officielles [6], de manière à pouvoir encore mieux verrouiller ou orienter les négociations et les décisions. Si bien qu'« au moment où António Guterres, à Bakou, indiqu[ait] qu'il faut réduire de 30 % la production d'hydrocarbures d'ici à 2030, l'hôte de la COP29, l'Azerbaïdjan, selon le rapport de l'ONG Oil Change International, [avait] pour objectif d'augmenter sa production d'hydrocarbures de 14 % d'ici à 2035. Et le futur hôte de la COP30, le Brésil [désormais huitième producteur mondial de pétrole], tabl[ait] sur une croissance de 36 % » [7].
Et le bilan de ces COP n'aura été guère plus fameux ou moins douteux sur d'autres points en discussion dans le cadre de la CCNUCC (Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, traité datant de 1992). Ainsi les États du Nord global ont-ils persisté à se montrer peu disposés à prendre en charge les dommages et les pertes infligés par le changement climatique aux États du Sud global. Le Fonds vert créé en 2009 lors de la COP19 (Copenhague) était destiné à permettre à ces derniers de financer leur lutte contre le réchauffement climatique, tout en faisant payer aux premiers leur responsabilité historique dans la production de celui-ci. La COP21 (Paris) avait décidé de porter l'abondement à ce fonds à hauteur de 100 milliards de dollars par an d'ici à 2020. Or, il n'a atteint à cette date qu'à peine les quatre cinquièmes de cette somme. Et réellement beaucoup moins, à peine le cinquième. Car les pays du Nord global ont souvent « confondu » leur contribution à ce Fonds avec leur aide publique au développement, alors qu'il était prévu que la première vienne en sus de la seconde. Ou encore, ils ont avancé les fonds dus non pas sous forme de dons mais de prêts !
Et l'accord sur lequel s'est conclue la CP29 a constitué un véritable camouflet pour le Sud global, notamment les « pays les moins avancés » qui sont les plus menacés par les effets du changement climatique. Alors qu'un groupe d'experts international avait estimé nécessaire de porter les transferts annuels destinés à leur permettre d'entamer leur « transition énergétique » à la hauteur de 1 000 à 1 300 milliards de dollars d'ici à 2035, les pays du Nord ne se sont engagés que sur le montant de 300 milliards de dollars, sans d'ailleurs préciser s'il s'agirait de dons ou de prêts [8].
Nouvelle COP, nouveau fiasco !
Héritière d'un tel du bilan désastreux, la COP30 a de surcroît été placée sous de mauvais auspices. Le 20 octobre, à trois semaines de son ouverture, l'Institut brésilien de l'environnement et des ressources naturelles renouvelables (Ibama) a approuvé… un projet d'exploration pétrolière au large de l'Amazonie. Or sa réalisation menacerait directement cette dernière en cas de marée noire provoquée par un accident survenant sur les forages pétroliers ; et, plus largement, elle contribuerait à son dépérissement par le changement climatique qu'elle accélérerait [9] ! Ce qui n'a pas empêché le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, dit Lula, puissance invitante de la COP, de déclarer en ouverture de celle-ci, qu'elle serait « la COP de la vérité » et qu'« accélérer la transition énergétique et protéger la nature sont les deux moyens les plus efficaces de lutter contre le réchauffement climatique », en proposant même que soit élaborée « une feuille de route pour, de manière juste et planifiée, inverser la déforestation, surmonter la dépendance aux combustibles fossiles et mobiliser les ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs » [10]. On ne peut imaginer meilleur exemple du double langage, digne d'Orwell, que tiennent tous les pays producteurs d'hydrocarbures dont le Brésil fait partie. Double langage doublé de schizophrénie : on concède d'un côté qu'il faut de toute urgence diminuer autant que possible les émissions de GES tandis que, de l'autre, on étend le champ des extractions pétrolières qui alimentent la principale source de ces émissions.
De plus, selon l'Accord de Paris, tous les cinq ans, les Etats signataires doivent présenter des engagements de réduction de leurs émissions de GES (appelés « contributions déterminées au niveau national » ou CDN) impliquant en principe une diminution de ces dernières par rapport à celles autorisées au cours du quinquennat précédent. Ce devait donc être le cas à Belém. Or, à l'ouverture de la COP, seuls 98 des 194 Etats parties prenantes, représentant 72,7 % des émissions mondiales, avaient remis leurs CDN. Plusieurs « poids lourds » (dont l'Inde et les Etats-Unis, ces derniers s'étant à nouveau retirés de la CCNUCC après la réélection de Donald Trump) faisaient défaut. Seules les CDN de la Norvège et du Royaume-Uni étaient conformes aux exigences de l'Accord de Paris. Le tout, largement insuffisant, devait conduire droit à une élévation de la température moyenne du globe comprise entre 2,3 et 2,5°C d'ici à la fin du siècle selon une étude de l'ONU [11].
Si les participants à la COP30 sont rapidement tombés d'accord sur son ordre du jour, c'est parce que celui-ci a délibérément écarté les sujets principaux, ceux qui fâchent : la demande d'intensification de la réduction des émissions de GES et celle d'une transparence accrue des efforts consentis en la matière (soutenues par l'Union européenne), la demande de suppression des barrières douanières liées au climat (du type de la taxe carbone instituée par l'Union européenne) soutenue par la Chine et l'Inde et la demande d'une augmentation des transferts financiers du Nord global vers le Sud global, tous sujets renvoyés à des discussions non plénières menées en coulisse, dans l'espoir qu'elles aboutissent avant la fin de la tenue de la COP [12]. Espoir en définitive largement déçu.
En effet, la déclaration finale, adoptée sans l'approbation de l'Union européenne, de la Suisse, de la Colombie et du Panama, ne comprend aucune feuille de route planifiant la sortie des énergies fossiles ni même aucun engagement d'ouvrir ultérieurement des négociations à ce sujet. Elle se contente de renvoyer à l'accord conclu deux ans plus tôt à Dubaï, demandant aux parties prenantes de s'engager dans une transition en vue de la sortie des énergies fossiles – autrement dit de se hâter lentement, sans prendre aucun engagement ni quant au rythme ni quant au terme du processus. Et la déclaration finale fait de même complètement silence sur la planification de la fin de la déforestation, qui joue un rôle tout aussi important dans le processus de changement climatique. Autrement dit, elle est muette sur les deux principaux moteurs de ce dernier. En d'autres termes, elle ne dit rien sur ce qui devrait pourtant constituer son centre de préoccupations principal voire exclusif. Les lobbyistes des compagnies pétrolières et gazières et les principaux pays producteurs d'hydrocarbures présents (soit la Russie, l'Arabie saoudite, le Canada, l'Irak, la Chine, l'Iran et les Emirats arabes unis) ont une fois de plus bien œuvré. Tandis que la Chine aura obtenu l'ouverture d'un « dialogue » sur le commerce mondial qui prélude au démantèlement des taxes carbone frappant les importations notamment au sein de l'Union européenne.
Au titre des seules maigres avancées du texte, on peut compter, d'une part, le triplement des fonds consacrés à l'adaptation au changement climatique, pour faire face aux canicules et aux inondations, qui devrait passer de 40 à 120 milliards de dollars d'ici 2035 ; bien que les besoins actuels soient déjà évalués à quelque 310 à 365 milliards de dollars et que seuls 26 milliards aient été versés en 2023 [13]. Et on en reste toujours aux seuls 300 milliards par an promis à Bakou d'ici à 2035 pour permettre au Sud global d'entamer sa « transition énergétique », du fait notamment d'un blocage de l'Union européenne sur la question. S'y ajoute, d'autre part, l'instauration à l'initiative du Brésil d'un Tropical Forest Forever Facility (TFFF : Fonds pour des forêts tropicales éternelles), un fonds d'investissement destiné à rémunérer les pays préservant leurs écosystèmes forestiers, qu'il s'agira encore d'abonder à hauteur de 125 milliards de dollars en faisant appel à des contributions publiques, privées et philanthropiques [14]. Dans les deux cas, il s'agit de nouvelles promesses dont seul demain nous dira si et dans quelle mesure elles auront été tenues.
Au terme de ce nouveau fiasco diplomatique, on peut se demander à quoi servent en définitive les COP. Réponse : à permettre aux (ir)reponsables qui nous gouvernent de « s'agiter » et de « discourir » devant les médias du monde entier pour faire semblant d'avancer… tout en restant sur place, voire en régressant. C'est ce qu'avait déjà constaté Greta Thunberg à la veille de la COP26 (Glasgow) : « Blabla. C'est tout ce que nous entendons de la part de nos soi-disant dirigeants. Des mots qui semblent géniaux mais qui n'ont mené à aucune action jusqu'à présent » [15]. C'est à une conclusion similaire qu'est parvenu le Réseau Action Climat-International, qui rassemble plus de 2000 organisations de la société civile, au terme de la COP30 : « Les gouvernements n'ont pas présenté de plan de réponse mondial concret pour combler le déficit d'ambition et se sont seulement engagés à mettre en place des processus supplémentaires pour y remédier »[16]. Donc aucune solution concrète mais la multiplication de procédures promettant de parvenir à des solutions. Autant dire : « Pour l'instant, on ne bouge pas mais on vous promet de mettre en place des mécanismes qui nous permettront sans doute de bouger demain »…
Or les conséquences de cette inaction et procrastination seront dramatiques et se font sentir d'ores et déjà. Les émissions de GES vont continuer à augmenter et la teneur de l'atmosphère en dioxyde de carbone va s'accroître : en 2024, elle a déjà atteint le niveau de 424 ppm (particules par million) alors qu'il aurait fallu les maintenir au niveau de 350 ppm (son niveau en 1990) pour être assuré que la température moyenne du globe ne s'élève pas de plus de 1,5°C par rapport à celle de l'ère préindustrielle (la « révolution industrielle » marquant le parachèvement des rapports capitalistes de production). La température moyenne du globe va continuer à augmenter : les dix années depuis 2015 ont déjà été les plus chaudes jamais enregistrées depuis 1850. Avec toute une série de conséquences plus désastreuses les unes que les autres : réchauffement des océans et dégradation des forêts (donc affaiblissement des deux principaux puits naturels de carbone) ; augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements atmosphériques extrêmes ; feux de forêts immaîtrisables augmentant encore les rejets de dioxyde de carbone ; accroissement du nombre des décès prématurés dus à la chaleur et à l'humidité de l'air mais aussi à la pollution atmosphérique par les particules dont sont chargés les GES [17] ; diminution des rendements agricoles synonymes d'augmentation de la précarité alimentaire des populations déjà les plus victimes de la malnutrition et de la disette, donc augmentation de la famine dans le monde ; etc. [18].
Belém, une préfiguration de l'immonde de demain… et des luttes contre son avènement
Au demeurant, si les participants à la COP30 avaient voulu se convaincre de la nécessité de changer de cap immédiatement, il leur aurait subi de mettre le nez dehors. C'est que le changement climatique et ses effets sont déjà très nettement sensibles à Belém même. Ses maxima de température se sont accrus de 1,9°C au cours des cinquante dernières années. Une étude conjointe de l'ONG The Carbon Plan et du Washington Post prévoit qu'en 2050 Belém risque de connaître 222 jours de chaleur extrême par an – de quoi la rendre largement inhabitable. D'ores et déjà, le changement climatique s'y traduit aussi par des épisodes de précipitations extrêmes plus fréquents et plus intenses : 40 % des épisodes de pluie intense dans la région de Belem enregistrés entre 1980 et 2020 ont eu lieu depuis 2011. Ils affectent notamment les habitats précaires des bidonvilles qui constituent la périphérie de l'agglomération, où s'entasse une population paupérisée laissée à l'abandon par les pouvoirs publics locaux. Et, bien qu'elle se soit tenue loin de ces quartiers déshérités en plein cœur de l'agglomération, la COP30 n'aura pas échappé à cette dégradation environnementale : dans le Parque da Cidade, spécialement construit à son effet, la température s'élève jusqu'à 40°, si bien que personne ne pouvait s'y tenir une journée entière. Pourtant, dans une région riche de 16 000 espèces différentes d'arbre, les organisateurs locaux de la COP n'ont rien trouvé de mieux pour tenter de rafraîchir le lieu en le végétalisant que d'y installer… des arbres métalliques couverts de plantes [19 ! Un parfait exemple de cette civilisation minéralisée dont ils sont parties prenantes, qui ne fait qu'accroître encore les effets désastreux du changement climatique dont ils sont responsables.
Bien que grosse de 1 300 000 habitants, Belém est entourée par la forêt amazonienne qui, comme toutes les autres forêts tropicales, joue un rôle fondamental dans l'établissement et le maintien des équilibres climatiques globaux et se trouve néanmoins directement menacée par le changement climatique. Sous l'effet de ce dernier et de la poursuite de la déforestation à l'initiative de l'agrobusiness et d'autres projets de mise en valeur capitaliste (activités minières, ouvertures de routes, de voies ferrées et de voies navigables, etc.), l'Amazonie risque en effet de se transformer de forêt tropicale en savane, privant ainsi la Terre d'un de ses principaux « poumons », capable d'absorber le dioxyde de carbone atmosphérique et d'émettre de l'oxygène. Une mutation catastrophique à terme pour la planète mais qui menace immédiatement les populations autochtones, regroupant quelque 34 millions de personnes, vivant souvent de manière ancestrale en Amazonie des ressources renouvelables de cette dernière selon des modes de production respectueux du milieu et par conséquent durables.
Manifestation du MST opposant à l'orientation officielle de la COP.
C'est ce dont a voulu témoigner le 11 novembre la Marche pour la santé et le climat, organisée par des membres de ces populations autochtones. Elle s'est achevée devant le site de la COP, où ses participants se sont heurtés aux forces d'insécurité chargées de « protéger » cette dernière contre de pareils « intrus » ayant cependant tout lieu de se considérer comme directement concernés par ses enjeux. Cependant, une partie est parvenue finalement à forcer ce barrage pour s'exprimer dans l'enceinte même de la COP [20]. Ainsi, alors que les lobbyistes des principales compagnies pétrolières et gazières, intégrés aux délégations officielles (ils étaient encore plus nombreux qu'à Bakou, la seule délégation française en comptait vingt-deux, dont le PGG de TotalEnergie lui-même !) ont eu leur place assurée au sein de la COP et ont pu participer pleinement aux débats de manière à les bloquer ou à les faire dévier dans le sens de leurs intérêts, les représentants des peuples autochtones, qui comptent parmi les principales victimes directes des activités des précédents, ont dû affronter la répression policière pour ne s'y exprimer qu'un court moment. Et cela en dépit de l'engagement pris par Lula lors de l'ouverture de cette COP : « Nous serons inspirés par les peuples autochtones et les communautés traditionnelles, pour qui la durabilité a toujours été synonyme de vie »[21].
Le seul signe d'espoir est d'ailleurs venu des mobilisations populaires à l'extérieur de la COP et contre celle-ci. Car, contrairement aux trois COP précédentes au cours desquelles les autorités égyptiennes, émiraties et azerbaïdjanaises avaient interdit toute protestation publique, à Belém les manifestations se sont succédé jour après jour. Celle du 15 novembre, particulièrement importante, grosse de 50 000 à 70 000 personnes, a réuni autour de représentants de peuples autochtones de l'Etat de Para, exigeant la protection de leurs terres, des militants venus du monde entier : des paysans du Manipur, un Etat du Nord-Est de l'Inde, en proie à des projets d'exploitation pétrolière et d'huile de palme, mais aussi des Australiens venus protester contre l'inaction climatique de leur gouvernement, pourtant censé coparticiper à l'organisation de la prochaine COP qui se tiendra à Antalya en Turquie. Et le cortège a porté en terre les trois cercueils du charbon, du pétrole et du gaz naturel [22]. S'il faudra bien plus que des actes symboliques de ce genre pour en venir à bout, du moins cette manifestation aura-t-elle indiqué la seule voie pour y parvenir : celui de la plus large mobilisation possible des peuples sur le plan international pour mettre fin à l'activité des industries promotrices des énergies fossiles et, plus largement, de tout l'écocide capitaliste.
Cette manifestation a été en fait un des hauts moments d'un Sommet des peuples qui s'est tenu une semaine durant en marge de la COP. Il aura réuni quelque 70 000 participants, très divers : en plus des délégations de peuples autochtones amazoniens, des délégué-es du Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) brésilien à côté de ceux et celles de la Fédération de tous les paysans du Népal (ANPFa), des petits agriculteurs africains et des pêcheurs asiatiques pratiquant une pêche artisanale, des membres de mouvements se battant pour la justice environnementale ou la souveraineté alimentaire, etc. Un rassemblement à forte proportion de femmes et de jeunes ; les premières parce qu'elles portent le plus souvent le fardeau de la gestion de l'eau, de la terre et de l'alimentation ; les seconds parce qu'ils sont les principaux concernés par la détérioration de l'œcumène qui se profile dans les décennies à venir. Se sont ainsi succédé, en sus des manifestations de rues, prises de paroles et débats, mais aussi cérémonies culturelles autochtones, marchés paysans, espaces d'agro-écologie, moments conviviaux autour de cuisines populaires, etc. Finalement, « le Sommet a produit des résultats concrets et de grande portée : un appel renouvelé à la reconnaissance de la dette climatique et aux réparations ; un front uni des peuples contre les marchés du carbone et la géo ?ingénierie ; le renforcement des alliances entre mouvements paysans, peuples autochtones, jeunes, féministes et syndicaux ; des propositions claires pour des systèmes alimentaires publics, la démocratie énergétique, la réforme agraire et les droits territoriaux ; ainsi que des plans coordonnés pour des mobilisations dans le Sud global » [23]. Gageons que ce Sommet sera en mesure d'inaugurer un nouveau cycle de résistance mondiale contre les effets désastreux du changement climatique, une résistance destinée à fédérer tous ceux et celles qui défendent la vie contre la dictature mortifère du capital. (2 décembre 2025)
Alain Bihr
auteur de L'écocide capitaliste,
Editions Page 2 & Syllepse
à paraître en février 2026
[1] COP, acronyme de l'anglais Conference of Parties, désigne en l'occurrence la conférence annuelle, qui se tient généralement courant novembre, réunissant l'ensemble des parties signataires de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) adoptée lors du Sommet de la Terre de Rio en juin 1992. La COP30 est la trentième conférence de ce type organisée depuis 1995.
[2] ONU, Accord de Paris, https://unfccc.int/sites/default/files/french_paris_agreement.pdf, 2015, page 3.
[3] Agence internationale de l'énergie (AIE), https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/energy-statistics-data-browser?country=WORLD&fuel=Energy%20supply&indicator=TESbySource consulté le 28 novembre 2024.
[5] Daniel Tanuro, « Ahmed al-Jaber inscrit son nom dans l'histoire de l'enfumage capitaliste », https://alencontre.org, 15 décembre 2023.
[6] Emmanuel Clevenot, « La COP29 parasitée par plus de 1 770 lobbyistes fossiles », https://reporterre.net, 15 novembre 2024.
[7] A l'Encontre, « COP 29 : un don de la Trinité », https://alencontre.org, 13 novembre 2024.
[8] Emmanuel Clevenot, « Fin de COP29 : les pays riches imposent un accord “néocolonialiste” », https://reporterre.net, 24 novembre 2024 ; Jeanne Cassard, « L'accord pour le climat attribue “une somme ridicule” aux pays du Sud », https://reporterre.net, 25 novembre 2024.
[9] Raphaël Bernard, « Avant la COP, le Brésil autorise de nouvelles explorations pétrolières », https://reporterre.net, 21 octobre 2025.
[10] Paula Gosselin, « “La COP de la vérité” : au Brésil, Lula lance les négociations climat », https://reporterre.net, 7 novembre 2025.
[11] Paula Gosselin, « La COP démarre ; tout comprendre en 5 points », https://reporterre.net, 10 novembre 2025.
[12] Paula Gosselin, « A mi-chemin de la COP30, le grand réveil tarde à se manifester », https://reporterre.net, 15 novembre 2025.
[13] Audrey Garic, « “Nous pesons moins de 1 % des émissions et pourtant nous souffrons le plus” : à la COP30, les pays du Sud veulent plus d'argent pour s'adapter au réchauffement », Le Monde, 21 novembre 2025.
[14] Emmanuel Clevenot et Paula Gosselin, « Coup de force à la COP30 : énergies fossiles et déforestation exclues d'un accord décavant », https://reporterre.net, 22 novembre 2025.
[15] Cité par Ian Angus, « Emission reductions : Promises, promises, promises », https://climateandcapitalism.com, 8 novembre 2025.
[16] Cité par Audrey Garic et Perrine Mouterde, « Avec un accord sans ambition, la COP30 sauve le multilatéralisme mais néglige l'urgence climatique », Le Monde, 22 novembre 2025.
[17] Cf. « Climate change costs millions of lives each year », climateandcapitalism.com, 3 novembre 2025.
[18] Pour des données détaillées sur tous ces phénomènes, cf. Michael Roberts, « COP 30 : it's no joke », https://thenextrecession.wordpress.com/2025/11/23/cop-30-its-no-joke.
[19] Raphaël Bernard, « Le chaos climatique sévit déjà à Belém, ville hôte de la COP30 », https://reporterre.net, 10 novembre 2025.
[20] Raphaël Bernard, « Des militants autochtones forcent l'entrée de la COP30 : “On a le droit d'être entendus” », https://reporterre.net, 13 novembre 2025.
[21] Paula Gosselin et Raphaël Bernard, « En dépit des promesses, la COP30 prise d'assaut par les lobbies du pétrole », https://reporterre.net, 14 novembre 2025.
[22] Raphaël Bernard, « “Quel désastre !” : les peuples autochtones vent debout contre le COP30 des lobbies », https://reporterre.net, 17 novembre 2025.
[23] Pramesh Pokharel, « COP 30 : Plus de 70 000 personnes participent au Sommet des Peuples à Belém et rejettent 30 ans de greenwashing ! », https://viacampesina.org/fr/cop30-plus-de-70-000-personnes-participent-au-sommet-des-peuples-a-belem-et-rejettent-30-ans-de-greenwashing/#:~:text=climatique%20et%20environnementale-,COP%2030%20%3A%20Plus%20de%2070%20000%20personnes%20participent%20au%20Sommet,rejettent%2030%20ans%20de%20greenwashing%20!&text=Ce%20mois%20de%20novembre%2C%20les,battant%20de%20la%20r%C3%A9sistance%20mondiale, 19 novembre 2025.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« C’est une ville syndicale » : Zohran Mamdani et Bernie Sanders rejoignent les grévistes de Starbucks sur la ligne de piquetage

Le maire élu de New York, Zohran Mamdani, et le sénateur indépendant du Vermont, Bernie Sanders, ont rejoint lundi les travailleurs de Starbucks en grève sur leur ligne de piquetage afin d'exiger que le géant du café conclue enfin une convention collective équitable avec son personnel syndiqué, après des années de tactiques de retardement.
S'exprimant devant une succursale à Brooklyn, Mamdani a déclaré que New York était une « ville syndicale » et a promis de continuer à se joindre aux lignes de piquetage même après son entrée en fonction le 1er janvier. En réponse à une question de Democracy Now !, Sanders a affirmé que la campagne victorieuse de Mamdani pour la mairie constituait un modèle pour le Parti démocrate, en mettant au cœur de son programme le coût de la vie et les droits des travailleurs. « Nous avons la base populaire de l'Amérique derrière nous », a-t-il déclaré.
Les travailleurs syndiqués de Starbucks à travers les États-Unis ont lancé une grève générale illimitée le 13 novembre, accusant l'entreprise de pratiques antisyndicales illégales. Starbucks Workers United négocie un contrat avec la compagnie depuis le début de l'an dernier. La ligne de piquetage de lundi s'est tenue quelques heures après que Starbucks a conclu un règlement de 38 millions de dollars avec la Ville de New York pour des violations du droit du travail, notamment le refus de fournir aux employés des horaires stables et prévisibles.
New York, le 2 décembre 2025. | tiré de democracy now !
https://www.democracynow.org/2025/12/2/starbucks
AMY GOODMAN : C'est Democracy Now !, democracynow.org, The War and Peace Report. Je suis Amy Goodman, avec Juan González.
Lundi, le maire élu de New York, Zohran Mamdani, et le sénateur indépendant du Vermont Bernie Sanders ont rejoint des travailleurs en grève sur une ligne de piquetage devant un Starbucks à Brooklyn. Le rassemblement a eu lieu peu après que la ville de New York a annoncé que Starbucks avait accepté de verser plus de 35 millions de dollars à quelque 15 000 travailleurs, dans ce qui est considéré comme le plus important règlement de protection des travailleurs de l'histoire de New York.
Voici Zohran Mamdani, qui sera assermenté comme maire le 1er janvier.
MAIRE ÉLU ZOHRAN MAMDANI : Bonjour à toutes et à tous.
LA FOULE : Bonjour !
MAIRE ÉLU ZOHRAN MAMDANI : C'est un plaisir d'être ici sur une ligne de piquetage avec les travailleurs de Starbucks, comme ceux à ma droite et à ma gauche, des travailleurs qui affrontent le froid de décembre et le froid bien plus mordant encore des pratiques antisyndicales dans cette ville et à travers ce pays, ainsi que la peur qui accompagne ces tactiques de bris d'union, alors qu'ils exigent les meilleures conditions de travail qu'ils méritent, comme tant de travailleurs à travers cette ville. Ce ne sont pas des demandes de cupidité. Ce sont des demandes de décence. Ce sont des travailleurs qui demandent simplement d'être traités avec le respect qu'ils méritent. Ils demandent que leur travail soit compensé d'une manière qui leur permette de construire une vie digne. Et je les rejoins parce que je veux faire tout ce que je peux pour montrer ma solidarité, mais aussi parce que je sais que trop souvent les voix des travailleurs ordinaires ne sont pas amplifiées avec le volume dont bénéficie si facilement la direction. Je veux partager quelques chiffres avec vous cet après-midi, des chiffres qui, je l'espère, mettront cette lutte en perspective. 36,2 milliards. C'est le montant des revenus que Starbucks a générés l'an dernier. 95,8 millions. C'est le montant du salaire total reçu par le PDG de Starbucks, Brian Niccol, pour quatre mois de travail l'an passé. 6 666. C'est combien de fois son salaire dépasse celui du barista moyen de Starbucks. 400. C'est le nombre de violations des lois du travail que le NLRB a constatées chez Starbucks.
LA FOULE : Honte !
MAIRE ÉLU ZOHRAN MAMDANI : 120. C'est le nombre de magasins actuellement en grève, et 85 le nombre de villes dans lesquelles ces grèves se déroulent. Ces chiffres nous montrent une réalité à deux volets : d'un côté, l'avidité et l'enrichissement corporatifs au détriment de leurs propres travailleurs, et de l'autre, une solidarité remarquable de la part de ces mêmes travailleurs, exploités et maltraités encore et encore.
La solidarité, autant que nous en parlons, n'est pas un concept abstrait. Elle se mesure dans les piquets tenus sous la pluie et le verglas. Elle se mesure dans les loyers que les travailleurs ne savent pas s'ils pourront payer, dans les frais de garde d'enfants qu'ils ne savent pas s'ils pourront assumer. Et elle se mesure dans ces inconnus qui, sans jamais s'être rencontrés, se donnent la main pour lutter pour un objectif commun et un avenir juste.
Je suis fier d'être ici aux côtés d'élus exceptionnels, au niveau municipal, au niveau de l'État, et aussi — à ma gauche — du sénateur Bernie Sanders du Vermont, parce que nous sommes tous unis dans la conviction que nous devons construire un New York où chaque travailleur peut mener une vie décente. Nous devons construire un New York où nos paroles ne sonnent pas creux lorsque nous disons que cette ville est une ville syndicale. Et nous devons construire un New York où les travailleurs qui la font vivre peuvent se permettre d'y vivre. Merci beaucoup. Et maintenant, le sénateur Bernie Sanders.
SÉN. BERNIE SANDERS : C'est un honneur pour ma femme et moi d'être ici avec vous pour soutenir les travailleurs de Starbucks en grève, qui disent clairement à cette entreprise qu'ils en ont assez de la cupidité corporative et assez du bris d'union.
Ce que le maire élu vient de souligner, c'est que ce qui se passe ici sur cette ligne de piquetage se passe partout dans ce pays. Nous vivons dans une économie où les plus riches n'ont jamais été aussi riches. Un seul homme possède plus de richesse que les 52 % des ménages américains les plus pauvres.
LA FOULE : Honte ! Honte !
SÉN. BERNIE SANDERS : Et pendant que les PDG se gavent de salaires inimaginables, 60 % de notre population, au Vermont, à New York, partout dans ce pays, vit d'un chèque de paie à l'autre, en luttant pour payer le loyer, les soins de santé, ou pour mettre de la nourriture sur la table. Et Zohran et moi sommes déterminés à bâtir une nation et une économie qui fonctionnent pour nous tous, pas seulement pour le 1 %.
Je veux remercier les travailleurs de Starbucks pour leur courage ici et partout dans le pays. Nous allons gagner. Merci beaucoup.
MAIRE ÉLU ZOHRAN MAMDANI : En arrivant, Bernadette m'a demandé : « Quand vas-tu arrêter d'aller à des manifestations et devenir maire ? » Et j'ai répondu : « Techniquement, le 1er janvier, je serai le maire. » Mais je veux aussi dire une chose : quand je deviendrai maire de cette ville, je continuerai à marcher sur les lignes de piquetage avec les travailleurs dans les cinq arrondissements.
Je l'ai dit à plusieurs syndicats présents aujourd'hui : nous voulons créer une administration qui se caractérise par un soutien constant aux travailleurs à chaque étape. Et parfois, dans la lutte pour la décence et la dignité, la voix des travailleurs est étouffée. Et quand vous êtes le maire de New York, vous avez une plateforme — une plateforme pour dénoncer les centaines de violations des lois du travail commises par Starbucks, une plateforme pour dire que oui, nous célébrons le règlement historique de 28 millions obtenu par le DCWP, mais que nous nous engageons aussi à continuer de financer et de fournir la volonté politique nécessaire pour tenir ces entreprises responsables.
Avant de prendre une question, j'aimerais qu'on applaudisse les travailleurs de Starbucks eux-mêmes.
LA FOULE : [acclamations]
MAIRE ÉLU ZOHRAN MAMDANI : Nous avons Kai Fritz à ma gauche, Noor Hayat à ma droite, et tant d'autres travailleurs qui nous inspirent chaque jour. Merci, avant même de commencer la période de questions.
AMY GOODMAN : Zohran, puis-je poser une question — beaucoup de travailleurs de cette ville sont des immigrants. Lorsque vous avez rencontré le président Trump, avez-vous obtenu une concession concernant les descentes d'ICE et leur non-intervention dans cette ville ? Puis j'ai une question pour Bernie Sanders : pensez-vous que si votre « Fight Club » réussit, avec d'autres sénateurs qui soutiennent votre mission pour remplacer le chef de la minorité Chuck Schumer, cela ouvrirait un espace pour des candidats progressistes qui représentent ce que vous défendez aujourd'hui ?
MAIRE ÉLU ZOHRAN MAMDANI : Lorsque j'ai rencontré le président, j'ai été très clair : ces descentes sont cruelles et inhumaines. Elles ne servent en rien la sécurité publique. Ma responsabilité est d'être le maire de chaque personne qui considère cette ville comme son foyer — et cela inclut des millions d'immigrants, dont je fais partie. Je suis fier d'être le premier maire immigrant de cette ville depuis des générations, et plus fier encore de vivre selon les idéaux symbolisés par la statue que nous avons dans notre port et par les valeurs que nous proclamons depuis longtemps, mais que nous avons trop souvent négligé d'enraciner dans nos pratiques quotidiennes. Voilà le maire que je serai.
SÉN. BERNIE SANDERS : Concernant ce que nous essayons de faire au Sénat, il n'est pas secret qu'il existe des divergences d'opinion au sein du caucus démocrate. Je suis indépendant, mais je caucuse avec les démocrates. Et cette différence s'est manifestée ici même, dans la récente élection municipale à New York.
À mes yeux, Zohran Mamdani a mené l'une des plus grandes campagnes de l'histoire moderne de ce pays. Il a commencé à 1 %, et il a gagné. Et comment a-t-il gagné ? Il a gagné en rassemblant des dizaines de milliers de bénévoles qui ont frappé aux portes. Il a gagné parce qu'il a eu le courage de parler des oligarques et de dire que lorsqu'il deviendrait maire, il se tiendrait aux côtés des travailleurs de Starbucks et de tous les travailleurs de cette ville.
Et ce que nous voyons aujourd'hui aux États-Unis, dans les courses au Congrès et au Sénat, c'est un nombre croissant de candidats qui se lèvent exactement comme Zohran l'a fait. Ils affirment que nous avons besoin d'une économie qui fonctionne pour tous ; que nous n'allons pas permettre aux milliardaires d'obtenir des cadeaux fiscaux tandis que des gens perdent leur assurance maladie ; que nous allons augmenter le salaire minimum pour en faire un salaire décent et non un salaire de misère ; que nous ne resterons pas le seul grand pays au monde à ne pas garantir la santé comme un droit humain. Et cela continue d'évoluer — et c'est une bonne chose. Nous avons l'appui de la base populaire du pays. Ce que Zohran a accompli inspire des gens partout aux États-Unis et dans le monde, et nous allons continuer dans cette direction.
AMY GOODMAN : C'était donc le sénateur Bernie Sanders et le maire élu de New York Zohran Mamdani, lundi, alors qu'ils rejoignaient les travailleurs de Starbucks en grève sur une ligne de piquetage à Brooklyn. Au rassemblement, je leur ai posé des questions, mais j'ai aussi parlé aux travailleurs et aux organisateurs sur la ligne.
GABRIEL PIERRE : Je m'appelle Gabriel Pierre. Je suis superviseur de quart à Bellmore, Long Island. Chez Starbucks, je supervise le plancher et je m'assure que les clients comme mes collègues sont bien servis. Nous sommes ici aujourd'hui pour lutter contre les pratiques de travail déloyales de l'entreprise, ainsi que pour les ramener à la table des négociations afin d'obtenir une convention collective juste.
AMY GOODMAN : Et ça ressemblerait à quoi ?
GABRIEL PIERRE : Cela voudrait dire mettre fin à leurs pratiques déloyales. Nous avons actuellement 400 poursuites ouvertes concernant des violations du travail, ainsi que 650 en attente, comprenant, entre autres, les horaires non garantis, la mauvaise gestion, la maltraitance de travailleurs trans et homosexuels, des salaires injustes et des heures non assurées. Starbucks n'a reconnu aucun syndicat dans aucun magasin en quatre ans d'organisation. C'est effrayant que cela n'ait toujours pas été fait, et nous espérons que cette mobilisation les ramènera à la table.
MELANIE KRUVELIS : Je m'appelle Melanie Kruvelis. Je suis organisatrice avec la DSA de New York. Je pense que c'est extrêmement fort d'avoir le maire ici aujourd'hui. Aujourd'hui même, les services municipaux ont récupéré des dizaines de millions de dollars pour des travailleurs de Starbucks à qui on avait refusé une rémunération équitable. Et dans un moment où les gens luttent pour nourrir leur famille ou acheter des cadeaux pour les fêtes, cela signifie beaucoup de reconnaître que ces travailleurs se battent tous les jours.
AMY GOODMAN : Vous pensez que les 104 000 bénévoles continueront à s'organiser ? Et que feront-ils ?
MELANIE KRUVELIS : Absolument. Le mouvement qui a mené Zohran à la victoire en novembre est puissant, et j'ai confiance que nous allons l'entretenir. Le fait qu'il y ait eu tant de monde ici aujourd'hui devant Starbucks est significatif. Il a mobilisé des gens à travers la ville et le pays. Je pense que cela nourrit l'espoir de beaucoup de gens qui en avaient peu cette année.
GABRIEL PIERRE : Je pense qu'avoir Zoran Mamdani augmente beaucoup nos chances. Il est très progressiste et j'ai hâte de voir ce qu'il fera lors de son premier jour comme maire.
AMY GOODMAN : Des travailleurs et organisateurs de Starbucks sur la ligne de piquetage à Brooklyn lundi, où ils ont été rejoints par le sénateur Bernie Sanders et le maire élu de New York Zohran Mamdani.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« La gauche britannique ne doit pas tout miser sur le parlementarisme » -

La politique britannique semble être à un tournant. La première année du gouvernement de Keir Starmer a montré à quel point le Parti travailliste est revenu à un programme blairiste, dont les politiques néolibérales et répressives sont de plus en plus rejetées. Dans le même temps, le Reform Party de Nigel Farage a fait un bond dans les sondages et semble en passe de remporter les prochaines élections. Mais les choses bougent enfin à gauche, avec le renouveau des Verts depuis l'élection de Zack Polanski à sa tête et le lancement de « Your Party » par Jeremy Corbyn et Zahra Sultana.
Pour James Schneider, ancien conseiller de Jeremy Corbyn et auteur de Our Bloc : How we win (Verso, 2022), qui travaille désormais pour la Progressive International, les leçons de l'ère Corbyn doivent être tirées : pour que la gauche réussisse en Grande-Bretagne, elle ne doit pas se contenter de participer aux élections, mais aussi reconstruire un parti de masse, liés à des clubs sociaux locaux, des syndicats et d'autres organisations. Selon lui, cette voie difficile vers un parti de masse est la seule option pour éviter les divisions culturelles encouragées par la classe dirigeante afin de fracturer la majorité populaire, comme elle l'a fait avec le Brexit.
31 octobre 2025 | Photo : James Schneider sur le plateau de GBNews. © Capture d'écran Youtube William Bouchardon
https://lvsl.fr/la-gauche-britannique-ne-doit-pas-tout-miser-sur-le-parlementarisme-entretien-avec-james-schneider/
LVSL – L'année dernière, le Parti travailliste a remporté une large majorité de sièges à Westminster, mais il a également perdu un demi-million de voix par rapport aux élections précédentes de 2019. Depuis lors, Keir Starmer a continué à appliquer des mesures d'austérité et est de plus en plus impopulaire. Comment résumeriez-vous cette première année du gouvernement travailliste ? Et quelles sont vos perspectives pour son avenir jusqu'aux prochaines élections ?
James Schneider – Comme on pouvait s'y attendre, cela a été catastrophique. Quiconque ayant une connaissance élémentaire de la politique et de la société pouvait voir que ce gouvernement allait très vite devenir profondément impopulaire.
En Grande-Bretagne, comme dans la plupart des pays du Nord, le niveau de vie de la plupart des gens est en baisse depuis près de deux décennies. Dans le même temps, les prestations sociales fournies par les services publics, les services sociaux et les droits sociaux ont été réduites. Les infrastructures du pays sont partout en mauvais état, car les gouvernements conservateurs précédents n'ont pas investi pendant des années, alors que les taux d'intérêt étaient proches de zéro. En plus de tout cela, la Grande-Bretagne, très intégrée dans l'économie mondiale, est confrontée à des risques géopolitiques croissants et aux effets inflationnistes des chocs climatiques.
Le Parti travailliste n'a proposé aucune mesure significative pour remédier à ces problèmes. L'approche de Keir Starmer est globalement la même que celle de Rishi Sunak (Premier ministre britannique conservateur d'octobre 2022 à juillet 2024, ndlr) : la poursuite d'une gestion technocratique qui part du principe qu'une administration compétente restaurera la confiance du public dans le système politique. Cette stratégie a échoué sous Sunak, et elle échoue à nouveau sous Starmer.
« Quand il était dans l'opposition, Starmer a été ménagé par la presse britannique, qui considérait que son rôle était de tourner la page de la politique de gauche de Jeremy Corbyn et de réduire les attentes du public en matière de progrès social. Mais une fois que le Parti travailliste est arrivé au pouvoir, ce soutien médiatique a disparu. »
Le déclin du Parti travailliste s'explique également par des raisons politiques. Pendant son mandat dans l'opposition, Starmer a été ménagé par la presse britannique de droite, majoritairement détenue par des milliardaires, qui considérait que son rôle était de tourner la page de la politique de gauche de Jeremy Corbyn et de réduire les attentes du public en matière de progrès social. Mais une fois que le Parti travailliste est arrivé au pouvoir comme plan B du capital, ce soutien médiatique a disparu. Les mêmes médias qui le toléraient se sont rapidement retournés contre lui, amplifiant les échecs du gouvernement.
En fin de compte, le Parti travailliste dirige un gouvernement incohérent. Il a eu cinq ans pour se préparer à ce que serait son mandat et il n'a pas de plan ! Starmer n'a pas de vision cohérente du monde. Quelles que soient leurs différences, et elles sont nombreuses, les précédents dirigeants du Parti travailliste – Tony Blair, Gordon Brown, Ed Miliband ou Jeremy Corbyn – avaient tous une théorie de la société et une vision du changement, ce qui n'est pas le cas de Starmer. Il en résulte un gouvernement à la dérive, confronté à de graves difficultés économiques, à la pression hostile des médias et à la montée en puissance de Reform UK, un parti d'extrême droite qui bénéficie du soutien à la fois des conservateurs mécontents et des électeurs de la classe ouvrière aliénés par la classe politique.
Les sondages reflètent cette division : le Parti travailliste est en tête parmi ceux qui se sentent financièrement en sécurité, tandis que Reform domine parmi les personnes qui ont du mal à joindre les deux bouts. Cela résume bien l'état actuel de la politique britannique.
LVSL – Vous avez mentionné Reform UK. D'un côté, Nigel Farage radicalise certaines franges de la société britannique autour de questions de droite, principalement l'immigration. Nous avons assisté à des émeutes racistes l'été dernier et à une manifestation massive d'extrême droite à Londres récemment. Dans le même temps, Reform a amélioré ses résultats dans les sondages et remporté les élections locales en mai. Si la plupart de ses partisans sont d'anciens électeurs conservateurs, certains viennent du Labour. Pour ceux qui sont passés du Labour à Reform, pensez-vous que les efforts de Nigel Farage pour se présenter comme un « homme du peuple » – par exemple, en appelant à la nationalisation des aciéries de British Steel – ont joué un rôle dans son ascension ?
JS – Cela a certainement joué un rôle. Farage est un entrepreneur politique habile qui sait comment exploiter les frustrations populaires. Cependant, je considère cela comme un facteur secondaire, voire tertiaire. Les causes profondes sont économiques et sociales.
Le message central de Reform UK est surtout économique. Il dit aux électeurs : « Vous avez raison d'être en colère. Vos salaires stagnent, vous n'arrivez pas à obtenir de rendez-vous au NHS (le National Health Service est l'équivalent britannique de la Sécurité sociale, ndlr), vos enfants n'ont pas les moyens de se loger, les transports publics et l'industrie s'effondrent, et nous pouvons régler tout cela si nous nous occupons des migrants, des musulmans et des minorités ». Ce discours combine des griefs légitimes et la désignation de boucs émissaires, ce qui fonctionne pour une petite minorité ayant de forts préjugés, mais aussi pour d'autres qui cherchent une explication à leurs difficultés économiques. Pendant ce temps, le Labour et l'establishment au sens large n'offrent aucune alternative convaincante. Leur message se résume à dire : « La situation est difficile, mais nous la gérons bien, faites-nous confiance. » Sans surprise, cela n'inspire personne.
« Quand Farage parle de la propriété publique de l'eau, de l'acier et d'autres industries, il dépasse même parfois le Parti travailliste sur sa gauche. »
Reform UK tente également de se réinventer de deux manières. Premièrement, en utilisant des références qui rappellent la social-démocratie traditionnelle : quand Farage parle de la propriété publique de l'eau, de l'acier et d'autres industries, il dépasse même parfois le Parti travailliste sur sa gauche. Deuxièmement, en adoptant une attitude populiste à l'américaine : une esthétique « Make Britain Great Again » divertissante, qui ne se prend pas trop au sérieux et anti-élite. Ce style leur permet de paraître plus accessibles.
Plus récemment, Reform UK a même commencé à s'organiser localement, en reprenant d'anciens clubs ouvriers et des espaces sociaux conservateurs. Au premier abord, cela peut sembler insignifiant – des gens qui se réunissent pour boire un verre –, mais ces espaces peuvent facilement devenir des centres d'organisation politique. Si la gauche faisait de même, nous y verrions une avancée stratégique majeure. La capacité de Reform UK à maintenir et à approfondir cette organisation déterminera si elle restera une force durable après un mandat au gouvernement, ce qui semble tout à fait possible à ce stade.
LVSL – Comme vous l'avez mentionné, il y a un énorme manque d'alternative de gauche. Récemment, le Parti vert a gagné en popularité. Zack Polanski est devenu son leader avec 85 % des voix grâce à un programme « éco-populiste » qui s'est avéré très populaire. Le nombre d'adhérents a augmenté, dépassant même celui des Conservateurs, et les sondages sont en hausse. Mais les Verts peuvent-ils vraiment devenir plus qu'un parti de CSP+ concentrés dans les grandes villes ? Peuvent-ils toucher d'autres territoires et la classe ouvrière ?
JS – Un parti politique peut être compris à trois niveaux, chacun étant plus difficile à changer à mesure que l'on approfondit. Le premier niveau est le positionnement : le message public, la stratégie de communication et les questions sur lesquelles il met l'accent. C'est le plus facile à ajuster, et les Verts l'ont fait efficacement. Polanski a attiré plus l'attention des médias sur le parti que quiconque avant lui, en grande partie en adoptant des positions audacieuses et populaires qui avaient été écartées du débat mainstream. Par exemple, les Verts réclament désormais haut et fort un impôt sur la fortune, massivement soutenu par la population. En ce sens, ils parviennent à former un pôle de gauche au niveau national.
Le deuxième niveau concerne le personnel politique et la base sociale : qui compose le parti, sa composition de classe et la manière dont il gouverne au niveau local. Ce niveau est beaucoup plus difficile à modifier. Seules 24.000 personnes ont voté lors interne pour le leader du Green Party, ce qui suggère que la plupart des membres étaient passifs. Aujourd'hui, le parti compte 140.000 membres, dont la plupart ont adhéré explicitement en raison du message éco-populiste.
Cependant, cette présentation éco-populiste n'est généralement pas présentée en termes de classe et les membres des Verts sont plus jeunes, urbains et diplômés que la moyenne. Historiquement, ils ont eu du mal à attirer les personnes racisées et les électeurs de la classe ouvrière non diplômés. Que cela change ou non dépendra de la manière dont leurs nouveaux membres et organisateurs développeront l'orientation du parti. Certains groupes émergents, comme Greens Organise, qui copient ce que nous avons fait avec Momentum (Momentum était une organisation de gauche cofondée par James Schneider en 2015 pour soutenir le leadership de Jeremy Corbyn et l'aider à réformer le parti travailliste, ndlr), tentent de pousser le parti dans cette direction, en le reliant plus étroitement à l'activisme de base. Beaucoup de personnes qui se sentent orphelins politiquement depuis l'ère Corbyn sont prêtes à faire évoluer le Parti vert dans cette direction.
« L'approche parlementariste peut permettre de réaliser certains progrès, mais elle ne modifie pas fondamentalement les rapports de force. »
Enfin, le troisième niveau, le plus profond, est celui de la stratégie : quelle est la théorie du parti en matière de changement social ? Sur ce point, les Verts restent similaires à la plupart des autres partis. Leur modèle de base est parlementaire : rassembler des membres, des donateurs et des sympathisants, remporter des sièges et faire pression pour obtenir des réformes par le biais des institutions existantes. Les Verts disent en substance : si vous élisez davantage de députés verts, ceux-ci pourront soit faire basculer le Parti travailliste vers la gauche, soit obtenir certaines réformes par le biais des institutions existantes. Cette approche peut permettre de réaliser certains progrès, mais elle ne modifie pas fondamentalement les rapports de force. Pour aller plus loin, le parti devrait repenser son rôle dans son ensemble, non seulement « comment gagner les élections », mais aussi comment renforcer son pouvoir au sein de la société elle-même, en combinant le travail électoral avec une organisation sociale plus large.
Néanmoins, même si je ne suis pas membre du Parti vert, je connais et respecte Zack Polanski et je pense qu'il fait du bon travail. Je ne dis pas que les élections n'ont pas d'importance, mais qu'elles ne devraient être qu'une partie d'une stratégie, et non la stratégie dans son ensemble. Il faut une vision plus profonde du changement, qui ne repose pas entièrement sur le parlementarisme. Néanmoins, compte tenu de l'absence actuelle de voix et d'organisations de gauche en Grande-Bretagne, la transformation du Parti vert est une évolution bienvenue.
LVSL – Ce vide des organisations de gauche en Grande-Bretagne est en effet comblé par les Verts, mais aussi par le nouveau parti de Jeremy Corbyn et Zahra Sultana (députée de Coventry, élue sous l'étiquette Labour, désormais indépendante et figure de la gauche britannique, ndlr), actuellement appelé « Your Party ». Dans une interview pour la New Left Review, vous avez décrit la base sociale qu'un nouveau parti de gauche en Grande-Bretagne devrait chercher à organiser : la « classe ouvrière pauvre en actifs », les « diplômés déclassés » (qui penchent désormais vers les Verts) et les « communautés racisées ». Pourriez-vous expliquer comment ces groupes pourraient être attirés par un tel parti ? Par ailleurs, dans une certaine mesure, ces groupes faisaient déjà partie de la coalition travailliste de Jeremy Corbyn, alors que feriez-vous différemment cette fois-ci ?
JS – Il existe bien sûr un chevauchement important entre ces trois groupes, qui ne doivent pas être considérés comme exclusifs, car les personnes issues d'autres milieux sociaux sont également les bienvenues. Mais ces trois groupes constituent le noyau dur des électeurs dont les intérêts communs pourraient, s'ils étaient politiquement unis, représenter une majorité dans la société. L'objectif n'est pas d'exclure les autres, mais de commencer par renforcer le pouvoir de ceux qui ont le plus à gagner de la transformation de la société. Ces groupes étaient en effet au cœur de la coalition travailliste de Corbyn, qui était un projet majoritaire : « For the many, not the few » (slogan de campagne officiel en 2017, ndlr).
Lorsque j'aborde ce sujet, je reçois parfois des critiques selon lesquelles le public cible d'un parti de gauche doit être « la classe ouvrière ». Je suis d'accord, mais la classe sociale n'est pas une identité figée, elle est continuellement façonnée par des processus sociaux, économiques et politiques. Après près de 50 ans de contre-révolution extrêmement efficace, à travers le néolibéralisme et la désindustrialisation, la conscience de classe est très faible. Cela signifie que nous devons reconstruire un nouveau bloc populaire à partir de plusieurs fractions de la classe ouvrière qui ont des intérêts communs. La construction d'une telle coalition nécessite plus qu'une simple unité électorale ; elle nécessite une construction politique active, c'est-à-dire la création d'alliances entre des groupes dont les conditions matérielles sont similaires, même si leurs identités culturelles ou leurs positions sociales diffèrent. Cette approche est courante dans les mouvements de gauche latino-américains, où l'objectif est d'unir des communautés diverses autour d'intérêts sociaux communs.
« La classe dirigeante avait autrefois une stratégie hégémonique qui procurait certains avantages privés à certains groupes du bloc populaire. Aujourd'hui elle n'a plus qu'une seule arme, celle de la division. »
Cette unité populaire est particulièrement importante aujourd'hui, car la classe dirigeante n'a plus qu'une seule arme, celle de la division. La classe dirigeante avait autrefois une stratégie hégémonique qui procurait certains avantages privés à certains groupes du bloc populaire. Dans les années d'après-guerre, le niveau de vie augmentait parce que les salaires augmentaient parallèlement à la productivité. Aujourd'hui, la productivité et les salaires n'augmentent plus, donc cela ne fonctionne plus.
On a alors procédé à la cession d'actifs, par exemple avec le Right to Buy (programme lancé par Margaret Thatcher permettant aux millions de Britanniques vivant alors dans des logements publics d'en devenir propriétaires et a abouti à la quasi-disparition du logement public et à la concentration de l'immobilier aux mains de grandes entreprises, ndlr), ce qui explique pourquoi Thatcher bénéficiait du soutien d'une partie de la classe ouvrière. Mais l'État a déjà cédé presque tout ce qu'il pouvait.
La dernière stratégie consistait donc à gonfler la valeur des actifs, mais cela ne fonctionne que pour les personnes qui possèdent déjà des actifs, et ce groupe est en train de se réduire, d'où la crise de gouvernance. De plus, la crise financière a révélé la stupidité et la vénalité de notre classe dirigeante, et en particulier de son bras financier. Aujourd'hui, la classe dirigeante n'a plus aucun moyen d'améliorer le niveau de vie de la population. Sa seule stratégie restante consiste à diviser les gens, par leur appartenance ethnique, leur culture ou leur identité.
Il est donc encore plus urgent de construire l'unité populaire qu'à l'époque de Corbyn. Le message économique clé de la droite, qui consiste à blâmer les migrants, les musulmans et les minorités pour le déclin social, est un effort délibéré pour fragmenter cette majorité potentielle. Pour surmonter cela, il faut organiser les gens au-delà de ces divisions, construire une identité politique commune autour de la solidarité et de la transformation sociale. Notre tâche consiste à reconstruire la conscience de classe sur de nouvelles bases, en reliant l'insécurité économique, la justice raciale et les inégalités générationnelles dans un seul et même projet politique. C'est ce qui peut transformer une majorité sociologique en une majorité sociale et, à terme, politique. Sinon, les clivages culturels peuvent être utilisés contre nous, et c'est ce qui a fait échouer le projet porté par Corbyn avec le Brexit en 2019.
LVSL – Le Brexit a en effet été le clivage qui a fracturé la coalition sociale réunie par Corbyn. Bien qu'il ait fini par avoir lieu, les divisions politiques qu'il a créées continuent de façonner la politique britannique. Comment expliquez-vous la position incohérente du Parti travailliste sur le Brexit entre 2017 et 2019, lorsque son message politique est passé de « nous respecterons le résultat du référendum et quitterons l'UE » à « nous organiserons un nouveau référendum, avec le maintien dans l'UE comme option » ? Plus précisément, pourquoi l'argument de gauche en faveur du Brexit, qui mettait l'accent sur l'opportunité qu'il représente pour mener une politique industrielle, pour des nationalisations, etc. n'a-t-il jamais été promu par le Labour ? Comment les futurs mouvements de gauche pourraient-ils éviter de répéter cette erreur, surtout si la question du retour dans l'UE se pose à nouveau ?
JS – Il est possible que la question du retour dans l'UE revienne, d'ailleurs Zack Polanski, des Verts, a déjà déclaré que le Royaume-Uni devrait réintégrer l'Union européenne. Pour comprendre ce qui s'est passé sous Jeremy Corbyn, il faut garder deux faits à l'esprit. Premièrement, la direction du Parti travailliste n'avait pas toute latitude pour décider de sa position. Nous dirigions un parti qui comptait de nombreux centres de pouvoir concurrents – syndicats, députés, militants et membres – avec des points de vue très différents. Deuxièmement, dans cette structure, un argumentaire de gauche totalement en faveur du Brexit, malgré les arguments que vous avez mentionnés, n'était tout simplement pas viable. La plupart des syndicats affiliés au parti et des membres, ainsi que la grande majorité des députés, étaient fortement favorables au maintien dans l'UE.
« Même si l'on pensait que le Brexit était une erreur, il était logique d'y chercher des opportunités : politique industrielle, expansion des services publics, réforme des marchés publics, investissements dans les infrastructures… Mais politiquement, cette position était impossible à maintenir au sein du Parti travailliste. »
Lorsque John McDonnell (alors ministre « fantôme » des Finances pour le Labour, nldr) a prononcé un discours fin 2016 suggérant que le Parti travailliste devrait « saisir les opportunités du Brexit », il avait raison. Même si l'on pensait que le Brexit était une erreur, il était logique d'y chercher des opportunités : politique industrielle, expansion des services publics, réforme des marchés publics [pour favoriser les entreprises nationales], investissements dans les infrastructures… Mais politiquement, cette position était impossible à maintenir au sein du Parti travailliste. La gauche libérale était tout simplement trop puissante au sein de la gauche.
En 2017, comme le référendum sur le Brexit ne datait que d'un an, il était naturel que le Parti travailliste promette de quitter l'UE, et tous les membres du front bench (soit le gouvernement proposé par l'opposition travailliste, ndlr) respectaient cette position. Mais dans les deux années suivantes, la campagne pour un second référendum a gagné du terrain, tandis que les conservateurs étaient incapables de mener à bien le Brexit. Et le Parti travailliste était tellement divisé sur la question que cela nous a conduits à un compromis ambigu. Sous la pression, le parti a changé de position, proposant un second référendum et s'alignant finalement sur le camp du « Remain », ce qui a aliéné de nombreux partisans. Nous n'avions pas de principe fort de souveraineté populaire, c'est-à-dire l'idée que le changement politique doit être mené par et pour les citoyens ordinaires.
Avec le recul, l'erreur du Parti travailliste a été de ne pas avoir su construire un discours démocratique plus large autour du Brexit. Nous aurions pu l'inscrire dans un projet plus vaste de transformation sociale : reprendre le pouvoir (« Take Back Control » était le slogan des pro-Brexit, ndlr) non seulement à Bruxelles, mais aussi à l'OMC, à Westminster, aux banques et aux élites non élues. Si nous l'avions fait, nous aurions pu éviter d'être réduits à un choix entre nationalisme et libéralisme. Au final, nous nous sommes retrouvés piégés dans un discours qui se résumait à « le Brexit est mauvais parce qu'il est soutenu par les conservateurs libertariens de droite qui veulent nous faire sortir de l'UE pour de très mauvaises raisons, et par les racistes, alors soyons les gentils et opposons-nous au Brexit », même si les gens avaient voté pour et que cette stratégie était un suicide électoral.
La leçon clé à retenir ici est que l'unité ne peut pas être simplement maintenue par des compromis. Elle doit être activement construite autour d'une vision claire et positive qui donne aux gens un objectif commun. Sans cela, on se contente de réagir aux événements et on se laisse entraîner dans toutes les directions, ce qui est exactement ce qui est arrivé au Parti travailliste avec le Brexit.
LVSL – Parlons maintenant plus en détail de « Your Party ». Jeremy Corbyn et Zahra Sultana ont annoncé son lancement cet été, après une première année désastreuse du gouvernement travailliste. Corbyn est une figure très reconnue et Sultana représente la jeune génération. Initialement, leur annonce a suscité un énorme enthousiasme, avec plus de 800.000 personnes qui se sont inscrites en ligne. Mais depuis, Zahra Sultana a lancé son propre portail d'adhésion, ce qui a conduit à une dispute publique entre elle et Corbyn. Bien qu'ils affirment que ce différend est désormais résolu et qu'ils soient apparus ensemble lors de plusieurs événements, cela a inquiété leurs soutiens. Vous avez participé à la création de ce nouveau parti, pourriez-vous nous en dire plus sur votre rôle et les raisons qui vous ont finalement poussé à vous en retirer ?
JS – Je suis revenu l'année dernière pour diriger la campagne de Jeremy Corbyn à Islington North (circonscription au Nord de Londres, ndlr), et j'ai ensuite participé aux discussions sur la création d'un nouveau parti. J'avais une idée claire du type d'organisation que je souhaitais voir le jour, mais je ne pensais pas qu'il était réaliste de la lancer avant les élections générales (organisées en juillet 2024, ndlr). Elle a finalement vu le jour cet été, mais cela s'est avéré plus difficile que prévu.
La principale difficulté dans la création du nouveau parti a été de mettre en place une structure de décision légitime. C'est essentiel pour toute organisation, et très difficile à créer sans l'une des trois conditions suivantes. Soit vous avez un leader fort, quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, qui peut dire « nous formons un nouveau parti » et tout le monde le suit ; soit vous disposez d'organisations préexistantes, comme les syndicats, qui fournissent une base institutionnelle ; soit vous avez un petit groupe fondateur idéologiquement unifié, comme dans de nombreux partis communistes à leurs débuts.
Nous n'avions rien de tout cela. La gauche britannique est aujourd'hui hétérogène, avec de nombreuses orientations stratégiques différentes. Tout au long du processus, la question principale était de savoir si nous pouvions mettre en place une structure capable de prendre des décisions contraignantes de manière collective. Mon espoir initial était de lancer le parti avec une direction collective – comprenant Jeremy et des personnalités d'autres mouvements – unie autour d'une stratégie claire et publiée. Ce groupe agirait comme direction provisoire pendant un an environ, jusqu'à ce que le parti soit suffisamment grand pour organiser des élections démocratiques internes afin de mettre en place une structure permanente.
« L'espace politique est largement ouvert : des millions de personnes ont vu leurs espoirs grandir pendant les années Corbyn et se sentent aujourd'hui complètement délaissées. »
Mais pour cela, il faut d'abord que tout le monde s'accorde sur l'existence et l'autorité d'une telle direction. Cela ne s'est jamais vraiment produit, c'est pourquoi le processus s'oriente désormais vers une conférence fondatrice, au cours de laquelle les membres eux-mêmes débattront et décideront du cadre, et c'est pourquoi j'ai pris du recul en septembre.
Malgré ces défis, je continue de penser que le potentiel est réel. L'espace politique est largement ouvert : des millions de personnes ont vu leurs espoirs grandir pendant les années Corbyn et se sentent aujourd'hui complètement délaissées. La demande est là : des centaines de milliers de personnes se sont inscrites en ligne, le soutien au Parti travailliste s'effondre et même dans ses bastions, il perd des élections, comme récemment au Pays de Galles. Ce qui manque, c'est une organisation capable de canaliser cette énergie en quelque chose de cohérent et de démocratique.
LVSL – En effet, le potentiel de « Your Party » est énorme, mais pour réussir, il faudra construire une organisation solide. Vous avez souligné que nous ne devrions pas nous concentrer uniquement sur les élections, mais aussi sur l'amélioration de la vie des gens « ici et maintenant », en tissant des liens avec les syndicats, les associations de défense des locataires, les coopératives alimentaires, les associations d'entraide pour régler les factures ou les groupes de santé mentale. Cela semble très ambitieux. Comment cela peut-il se faire concrètement, surtout compte tenu du faible niveau de vie civique en Grande-Bretagne aujourd'hui ?
JS – Au niveau local, l'organisation doit partir de l'échelle et des capacités. Si une section locale compte moins d'une centaine de membres, sa seule véritable tâche devrait être d'atteindre ce nombre. Bien sûr, ce nombre est un peu arbitraire, mais si vous n'avez pas 100 membres, vous n'avez pas 10 personnes super actives. Sans cette base minimale, il n'y aura pas assez d'organisateurs actifs pour soutenir un travail local significatif. Pour ces petites sections, le parti central ne devrait fournir que des tracts, des affiches et d'autres outils pour recruter de nouveaux membres.
Une fois qu'une section atteint cette taille critique, l'étape suivante devrait être d'organiser une grande réunion publique, ouverte à l'ensemble de la communauté locale, et pas seulement aux membres. La section choisirait l'une des nombreuses initiatives d'organisation possibles adaptées à son contexte local : campagne pour la rénovation des logements, création d'une association de locataires, revitalisation d'une zone commerciale négligée, création d'un espace communautaire, organisation des travailleurs locaux…
Le parti national devrait élaborer des modèles pour ces formes d'organisation locale, avec des exemples pratiques provenant d'autres régions. Par exemple, si un groupe local a réussi à organiser les locataires, cette expérience devrait être partagée afin que d'autres puissent en tirer les leçons. Les sections pourraient alors adapter ces modèles à leur propre situation, parfois en collaborant avec des syndicats ou des associations existantes, parfois en créant de nouvelles initiatives à partir de zéro.
À mesure que les sections se développent, elles devraient recevoir des ressources supplémentaires en fonction de leur activité, par exemple l'accès à des organisateurs d'autres régions, à des programmes de formation, à des fonds ou à des conseils stratégiques. Cela crée une boucle de rétroaction : plus une section renforce son pouvoir au niveau local, plus elle est soutenue. Cela renforce également les liens horizontaux entre les militants qui font un travail similaire, comme l'organisation dans le domaine du logement ou du travail, de sorte que les connaissances circulent sans que tout dépende d'en haut.
Le travail électoral ne devrait intervenir qu'une fois ces bases établies. Il est important de remporter des sièges, mais le véritable enjeu est de savoir si un mouvement a obtenu la majorité sociale, s'il dispose d'une force organisée suffisante dans un domaine donné pour façonner la vie publique et résister au pouvoir des élites. Les élections doivent servir ce processus plus large, et non le remplacer.
Vous avez probablement entendu parler de la notion du « Red Wall » (circonscriptions des Midlands et du nord de l'Angleterre où le Parti travailliste a toujours remporté une grande partie des voix, ndlr). Pour moi, c'est un phénomène intéressant pour la raison exactement opposée à celle présentée par les médias lorsqu'ils affirment que « la classe ouvrière a abandonné le Parti travailliste » : je pense que cela montre que le pouvoir social a toujours une représentation électorale, des années, voire des décennies après sa disparition. Dans les petites et moyennes villes qui comptaient autrefois une ou deux industries majeures et un taux de syndicalisation élevé, les gens votaient encore pour le Parti travailliste il y a dix ans, sur la base d'un pouvoir qui avait été en grande partie détruit il y a trente ans. C'est ce type de pouvoir populaire à long terme que le nouveau parti devrait chercher à reconstruire.
LVSL – Vous avez été l'un des cofondateurs de Momentum et un proche conseiller de Jeremy Corbyn lorsqu'il était à la tête du Parti travailliste. À cette époque, le nombre d'adhérents a explosé, mais il semblait que l'action se concentrait principalement sur la compétition électorale. Avec le recul, pensez-vous qu'il y ait eu une occasion manquée de reconstruire le pouvoir populaire ?
JS – Pendant les années Corbyn, l'une de mes plus grandes frustrations était que nous n'avons jamais redéfini ce que signifiait être membre du parti. Avec 600.000 membres, nous aurions pu construire un véritable pouvoir local, mais l'activisme s'est largement réduit à un engagement en ligne. Cette période a coïncidé avec l'essor des réseaux sociaux, et beaucoup pensaient que les campagnes numériques pouvaient remplacer le face à face. Mais ce n'est pas le cas.
« Pendant les années Corbyn, l'une de mes plus grandes frustrations était que nous n'avons jamais redéfini ce que signifiait être membre du parti. Avec 600.000 membres, nous aurions pu construire un véritable pouvoir local, mais l'activisme s'est largement réduit à un engagement en ligne. »
Si nous voulons nous remettre de 50 ans de contre-révolution féroce et d'atomisation néolibérale, si nous voulons construire un pouvoir, ce ne sera pas seulement par le biais de publications sur les réseaux sociaux. Cela doit se faire dans le monde réel. La politique doit revenir dans les espaces réels, dans les quartiers, sur les lieux de travail et dans la vie sociale. Même la socialisation elle-même peut être politique : créer des espaces où les gens se rencontrent, discutent et s'organisent ensemble fait partie de la construction d'un nouveau type de communauté humaine. La vie sociale-démocrate en Europe occidentale, en Grande-Bretagne et en Scandinavie était autrefois centrée sur les bibliothèques ouvrières, les clubs de travailleurs, les fanfares, les équipes de football, etc.
Si nous ne reconstruisons pas ces fondations, nous serons peut-être au gouvernement à un moment donné, mais nous ne serons pas réellement au pouvoir. Lorsque nous accédons à des fonctions officielles, la classe dirigeante lance toute une série d'attaques contre nous. Si nous ne disposons pas de forces populaires progressistes suffisantes pour former un contrepoids, nous finissons par capituler. C'est ce qui est arrivé à Mitterrand en France, par exemple. Gagner plus de sièges aux prochaines élections n'est qu'une étape, cela ne doit pas être notre objectif ultime. Notre objectif est de socialiser l'économie, de démocratiser l'État et de rompre nos liens avec l'impérialisme. La construction de l'unité populaire est donc une condition préalable à la construction d'un pouvoir populaire significatif.
Bien sûr, ce sont des objectifs ambitieux. Mais nous avons également besoin de cette perspective pour nous lever chaque jour et mener des actions politiques. 99,99 % des actions politiques quotidiennes sont très loin de cet objectif : il s'agit d'installer les chaises pour une réunion, de sortir les poubelles, de répondre aux e-mails, de passer des coups de fil… Mais pour faire tout ce travail, il faut être imprégné de l'idée que nous le faisons dans un but plus large, et même si cela signifie simplement prendre un verre dans un pub local avec d'autres membres du parti, cela permet de rester motivé. C'est le genre de parti dont nous avons besoin : un parti qui ne se contente pas de participer aux élections, mais qui crée de nouvelles formes de pouvoir social, transformant à la fois la société et ses propres membres dans le processus.
LVSL – Pensez-vous que c'est la direction que prend actuellement « Your Party » ?
JS – Il est beaucoup trop tôt pour le dire. La première conférence du parti approche à grands pas (elle se tiendra à Liverpool les 29 et 30 novembre 2025, ndlr) et il y a encore beaucoup d'incertitudes. Mais il y a à la fois des signes encourageants et des obstacles évidents. Le principal défi est que les gens de gauche savent qu'ils doivent faire de la politique différemment, mais très peu savent ce que cela signifie réellement. Il y a un sentiment croissant que les anciennes méthodes ne fonctionnent plus – des réunions qui semblent sans vie, des partis déconnectés de la vie quotidienne – mais la suite reste encore à définir. Même de petites choses, comme un meilleur graphisme ou l'ajout de musique et de culture aux réunions politiques, peuvent beaucoup aider.
Le plus grand défi est le temps. Il faut des années, voire des décennies, pour construire un véritable pouvoir. La dernière période où les gens ordinaires ont collectivement gagné du terrain – que ce soit grâce à la social-démocratie d'après-guerre dans le Nord ou aux luttes anticoloniales dans le Sud – a été le résultat d'une organisation à long terme, parfois sur plusieurs générations, souvent accélérée par des événements mondiaux majeurs comme la guerre.
En revanche, les trente-cinq dernières années ont été marquées par une croissance quasi nulle des revenus réels pour la moitié la plus pauvre de l'humanité, à l'exception notable de la Chine. La stagnation économique a érodé l'espoir et les horizons politiques se sont rétrécis. Les mouvements antérieurs avaient des objectifs clairs à long terme : le socialisme, le communisme ou la libération nationale. Aujourd'hui, cette vision commune nous manque.
Il est essentiel de reconstruire cet horizon stratégique. Sans cela, la politique se résume à réagir à des événements de court terme, axés sur les prochaines élections plutôt que sur la prochaine ère. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'une orientation suffisamment large pour guider tous nos efforts individuels : la conviction qu'ensemble, nous pouvons transformer la société, et pas seulement gérer son déclin ou résister à sa destruction.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Santé Québec a un an, et le sabotage de notre système de santé est bien engagé

Près de 500 organisations dénoncent la réforme Dubé, dont les effets sont appelés à s'amplifier. Les autrices sont respectivement coordonnatrice de la Ligue des droits et libertés ; coordonnatrice de la Coalition Solidarité santé ; membre de la Coalition Main rouge ; première vice-présidente de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) ; coordonnatrice à la Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires&bénévoles (TRPOCB). Elles cosignent ce texte au nom du Collectif Tout sauf santé.
Les autrices sont respectivement coordonnatrice de la Ligue des droits et libertés ; coordonnatrice de la Coalition Solidarité santé ; membre de la Coalition Main rouge ; première vice-présidente de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) ; coordonnatrice à la Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires&bénévoles (TRPOCB). Elles cosignent ce texte au nom du Collectif Tout sauf santé.
Printemps 2022. Nous sommes au lendemain de la pandémie. Le rapport de la coroner Géhane Kamel est dévastateur. Le mammouth de la santé a échoué à protéger les plus vulnérables. Dans le privé, le pire n'a pu être évité. Les conséquences ont été dramatiques.
La pandémie est terminée, et les listes d'attente sont plus longues que jamais. L'accès aux services fait défaut partout. Des milliers de personnes attendent une opération. On ne répond qu'à environ 10 % des besoins en soins à domicile. Il manque des milliers de places en CHSLD. Les hôpitaux tombent en ruine. Plusieurs centaines de médecins se sont désengagés du réseau public. Les services sociaux et la prévention sont négligés. Jeunes et moins jeunes sont abandonnés à leur sort. Il faut se rendre à l'évidence : rien ne va plus en santé. Et ce, en dépit des belles promesses politiques avancées lors des deux dernières réformes centralisatrices successives de Philippe Couillard, en 2003, et de Gaétan Barrette, en 2015.
Dans l'urgence d'agir, le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) répond avec le Plan pour mettre en œuvre les changements nécessaires en santé, déposé par le ministre de la Santé, Christian Dubé. Sur papier, ce plan met en avant deux grandes priorités : rendre le réseau plus humain et plus performant. Parmi les intentions avancées, on retrouve l'augmentation de la formation, la rétention du personnel, un recrutement important de nouvelles ressources, l'ajout de nouveaux lits dans le réseau et le virage massif vers les soins à domicile. Le ministre promet aussi de consulter davantage le terrain et les experts, évoque la nécessité de décentraliser le réseau et se défaire de la dépendance aux agences privées. Ces mesures ont-elles réellement été mises en place ?
Il y a deux ans, malgré les nombreux avis défavorables et au terme d'une consultation de façade, la CAQ adoptait sous bâillon le projet de loi 15, Loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace. Une énième réforme de structure bureaucratique et hypercentralisée qui ouvrait encore plus grande la porte à la privatisation accélérée du réseau. Un an plus tard naissait le plus gros employeur au Canada : Santé Québec.
Le mammouth devenu dinosaure
En créant cette nouvelle mégastructure bureaucratique, le ministre se dotait habilement d'un paravent derrière lequel il pouvait dorénavant se cacher afin d'effectuer ses basses œuvres. Négligeant de s'attaquer au manque criant de ressources et de mettre fin à la privatisation rampante, il poussait à l'extrême la logique mise en avant lors des dernières réformes, menant notre système de santé encore plus proche de l'implosion. Avec pour résultat la situation que l'on connaît actuellement, qui ressemble plus à un sabotage qu'à la remise sur pied promise.
Ce sont près de 500 organisations ont signé la déclaration « La réforme Dubé : tout sauf santé » pour dire haut et fort : « Assez, c'est assez ! » La réforme Dubé ne réglera pas les problèmes du système de santé et la situation risque seulement de se détériorer davantage.
Plus grave encore, on nous dépossède de nos moyens de contrôle sur notre avenir collectif en santé. Avec Santé Québec, la transparence est réduite au minimum. Il sera de plus en plus difficile pour chaque citoyen d'avoir l'heure juste et d'influer sur les prises de décisions.
La situation est grave. Le gouvernement donne les pleins pouvoirs à une agence gouvernementale, lui permettant de transformer les fondements mêmes de notre système de santé. Pour qu'une population entière puisse demeurer en santé, on doit mutualiser le risque et on doit pouvoir compter sur un système public au service de l'ensemble de la population. Comment est-ce possible qu'une agence créée sous bâillon puisse avoir l'autorité de remettre cela en question ?
Est-ce normal que le gouvernement préfère agir à coups de bâillons et de réformes, rendant le système public de plus en plus déficient, et ce, malgré les nombreuses oppositions ? Et alors que la société civile et les acteurs du milieu apportent des solutions concrètes ? Est-ce normal qu'à peu près tous les espaces de participation démocratique qui permettaient à la population et aux gens sur le terrain d'organiser leurs soins et leurs services de santé aient été éliminés ? Est-ce normal qu'on soit en train de nous imposer un retour à un système de santé à plusieurs vitesses, dont seuls quelques privilégiés pourront bénéficier, avec l'affaiblissement social comme conséquence ?
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
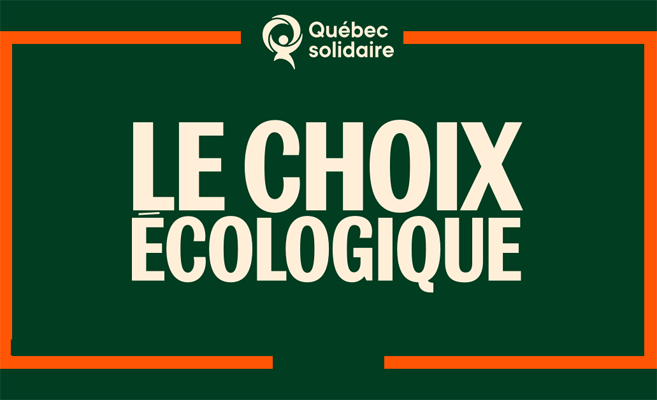
Plateforme électorale 2026 - Mémoire sur la conjoncture et nos six enjeux
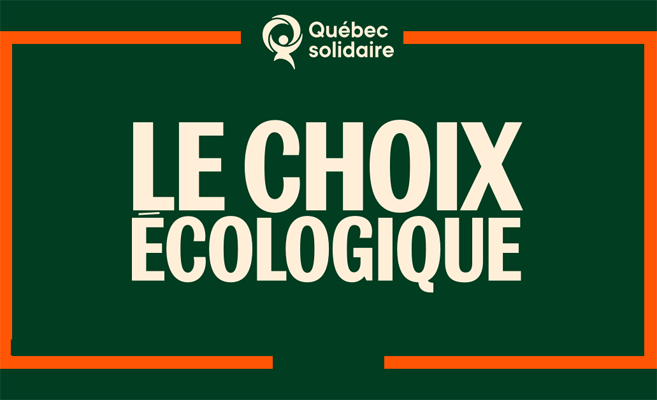
Nous publions ci-dessous le mémoire du Comité d'action politique de Québec solidaire, soumis dans le cadre de la consultation préparatoire à l'élaboration de la plate-forme de Québec solidaire pour les prochaines élections . (PTAG)
Préambule
Le CAP écologiste présente ce mémoire sur la conjoncture et les perspectives d'une campagne électorale centrée sur la mobilisation populaire pour la justice sociale, pour la lutte contre les changements climatiques et pour l'indépendance du Québec.
La période politique ouverte par le retour du trumpisme au pouvoir aux États-Unis marque une recomposition profonde des rapports de force à l'échelle nord-américaine. Elle révèle brutalement la nature structurelle du capitalisme contemporain : un système en crise permanente, traversé par des contradictions écologiques, économiques, sociales et politiques qui atteignent un point de non-retour. Dans ce contexte, continuer de concevoir la stratégie politique comme un simple travail électoral – lever des fonds, installer des pancartes, produire des slogans – revient à se condamner à l'impuissance.
Une véritable stratégie électorale de gauche implique de mettre en lien analyse de la conjoncture (par exemple, identifier les points forts du gouvernement et ses faiblesses, attentes et revendications de la population, états de mobilisation des mouvements sociaux, etc.), construction de rapports de force sociaux (par exemple, convergence et unification des luttes sociales, actions concertées, etc.) et orientation vers une transformation radicale des rapports sociaux au Québec.
1. La conjoncture nord-américaine, canadienne et québécoise : crise du capitalisme et offensive de la classe dominante
La domination trumpiste en Amérique du Nord constitue aujourd'hui le centre de gravité du bloc bourgeois continental. Sa fonction n'est pas idéologique, mais structurelle : restaurer le taux de profit par la guerre commerciale, la dérégulation, la destruction des droits sociaux et la reconfiguration autoritaire de l'État. Les tarifs douaniers imposés au Canada et au Québec ne sont pas des dérapages nationalistes : ils prolongent une stratégie impériale visant à imposer aux peuples voisins les coûts de la crise du capitalisme états-unien. Ils accélèrent la hausse du coût de la vie, fragilisent les secteurs productifs et accroissent la dépendance du Canada aux États-Unis.
Le gouvernement Carney s'inscrit parfaitement dans cette dynamique. Sous couvert de modernisation, il mène une politique de classe classique : abolition des taxes sur le capital, abandon de la taxe carbone, cadeaux massifs aux pétrolières, alignement militaire sur Washington, aplaventrisme diplomatique et adhésion au programme trumpiste. Il accepte implicitement la restructuration néolibérale voulue par la Maison-Blanche et déplace le poids de la crise vers les classes ouvrières et populaires, en particulier les femmes, particulièrement touchées par l'appauvrissement, la précarité et l'effondrement des services publics.
Au Québec, la CAQ remplit un rôle complémentaire : affaiblir les syndicats, criminaliser la résistance sociale, renforcer l'extractivisme, détruire les services publics, multiplier les attaques contre les droits démocratiques, et imposer une vision réactionnaire de la nation qui divise les travailleurs selon l'origine, la couleur de peau et le statut migratoire. La montée du nationalisme conservateur alimente un climat propice à la diffusion du suprémacisme blanc – importé des États-Unis mais désormais enraciné ici – et renforce un masculinisme toxique qui se traduit par une recrudescence de la violence faite aux femmes. Cette dynamique réactionnaire fragilise le « nous » populaire, divise les classes laborieuses et détourne la colère sociale vers les personnes immigrantes, racisées et marginalisées.
La crise écologique accélère toutes ces tendances. L'effondrement de la biodiversité, la déstabilisation climatique, la dépendance aux énergies fossiles et l'épuisement des ressources annoncent non seulement une crise de reproduction sociale, mais une crise de civilisation. Les femmes, particulièrement présentes dans les secteurs du care et déjà victimes de pauvreté structurelle, se retrouvent au premier front de cette crise. La bourgeoisie, consciente de l'insoutenabilité de son modèle, tente de s'enrichir avant le choc tout en s'appuyant sur la répression et la montée de l'extrême droite.
Les classes populaires subissent cette offensive de plein fouet : explosion du coût des loyers et des aliments, stagnation des salaires, endettement massif, épuisement généralisé du personnel de la santé et des services sociaux – composé majoritairement de femmes –, désorganisation du système éducatif, insécurité économique et climatique. La polarisation politique qui en résulte ouvre deux voies : un basculement réactionnaire ou la recomposition d'un bloc populaire de rupture, féministe, antiraciste, écosocialiste et autochtone-allié.
2. Les revendications que doit porter QS : une plateforme d'affrontement avec le capital
L'actualisation du Programme, telle qu'adoptée par le Congrès de novembre 2025 affirme « [...] notre volonté de nous attaquer aux grands intérêts financiers, qui sacrifient l'avenir du Québec pour assurer leurs profits. Cette position dérange, mais nous savons pour qui nous nous battons. »
Dans ce contexte, un parti de gauche comme Québec solidaire ne peut se contenter d'un réformisme gestionnaire. Il doit assumer une orientation de lutte, centrée sur la défense des intérêts matériels de la classe ouvrière et des classes populaires, en intégrant explicitement la lutte contre la pauvreté des femmes, contre les violences conjugales et patriarcales, et contre les discriminations racistes et xénophobes. Cette plateforme doit renforcer l'unité populaire en s'opposant aux tentatives de division fondées sur le sexisme, le racisme ou le nationalisme conservateur.
En adoptant la décroissance comme stratégie pour réaliser la transition, la plateforme ciblera les secteurs économiques les plus importants et impliquera démocratiquement la population touchée par ces secteurs. De plus, la décentralisation des pouvoirs de l'État vers les régions et les collectivités locales (par exemple, les villes, les villages, les arrondissements municipaux) leur donnera un pouvoir décisionnel sur tous les aspects de la vie quotidienne.
Les revendications doivent jouer un double rôle : améliorer immédiatement les conditions de vie et ouvrir une dynamique de confrontation avec la classe dominante.
3. Nos six enjeux :
(Ébauche de synthèse de nos six enjeux sans ordre de priorité) :
1. Transition écologique, décroissance et lutte aux changements climatiques.
2. Économie, coût de la vie, transport et logement.
3. Santé, éducation et services sociaux
4. Indépendance et autodétermination autochtone.
5. Immigration, inclusion et culture.
6. Démocratie, institutions et territoire.
Revendications essentielles (enjeu Transition écologique, décroissance et lutte aux changements climatiques)
• Une loi climat ambitieuse prévoyant une réduction d'au moins 55 % des GES d'ici 2030 et la carboneutralité en 2040, appuyée par un budget carbone et des plans de transition régionaux.
• Une sortie accélérée du pétrole et du gaz grâce au développement d'un réseau public de chemin de fer électrifié (voyageurs et marchandises) et l'interdiction des véhicules neufs à essence dès 2030, portée par des entreprises publiques de production de matériel roulant.
• Une planification publique de l'énergie : interdiction de tout nouveau pipeline, nationalisation sous contrôle populaire des filières renouvelables (éolien, solaire) et orientation de la production énergétique vers les besoins collectifs plutôt que les grands projets industriels ou Big Tech.
• Une économie sobre en ressources : lutte contre l'obsolescence programmée, fin des produits à usage unique, réduction du gaspillage alimentaire et droit garanti à la réparation.
• La protection de la biodiversité : 30 % du territoire protégé d'ici 2030, contre l'expansion actuelle des industries minières, forestières et énergétiques qui dégradent les milieux naturels et menacent des espèces.
• Une stratégie d'adaptation aux effets déjà présents de la crise climatique.
Revendications essentielles (enjeu Économie, coût de la vie et logement)
• Gel immédiat des loyers, construction massive de 100 000 logements publics et sociaux, lutte ouverte contre les propriétaires spéculatifs.
• Lutte contre la pauvreté des femmes : hausse majeure du financement des maisons d'hébergement, revenu minimal garanti, protection accrue des travailleuses précaires.
• Gratuité de l'éducation, du transport collectif, des cantines scolaires.
• Lancement du projet Pharma-Québec et réduction drastique du coût des médicaments.
• Augmentation du salaire minimum à 25 $, reconnaissance du travail du care, réduction massive du temps de travail.
• Taxation radicalement progressive du capital, des profits, de la richesse et notamment des géants du numérique et des pollueurs.
Revendications essentielles (enjeu Santé, éducation et services sociaux)
• Réinvestissement massif (10 milliards) dans la santé, l'éducation, les soins de longue durée et la transition écologique.
• Fin de l'expansion du privé en santé, reconstruction du réseau public sous contrôle démocratique.
• Redistribution du capital : fonds publics d'investissement, pôle bancaire public, contrôle social sur les secteurs stratégiques.
Revendications essentielles (enjeu Indépendance et autodétermination autochtone)
L'indépendance comme libération nationale et sociale doit être :
• un instrument pour une transition écologique radicale et pour refuser la tutelle du Canada en tant qu'état extractiviste (pétrole, mines, forêts) ;
• une rupture avec l'État canadien, ses appareils répressifs et sa tutelle constitutionnelle et le refus de sa course aux armements et de sa préparation de la guerre ;
• un outil pour redistribuer la richesse, contrôler les secteurs stratégiques et reconstruire le commun ;
• un cadre pour une démocratie populaire, féministe, plurinationaliste et antiraciste ;
• un projet internationaliste reliant les luttes autochtones, les mouvements ouvriers et les forces progressistes du Canada et du continent.
Revendications essentielles (enjeu Immigration, inclusion et culture)
• Nouvelle politique d'accueil et d'inclusion ;
• Lutte contre les discriminations, les exploitations et les oppressions ;
• Légalisation des personnes sans-papier ;
• Accessibilité et diffusion du contenu québécois ;
• Statut des travailleuses et travailleurs de la culture.
Revendications essentielles (enjeu Démocratie, institutions et territoire)
• Luttes contre les féminicides
• Soutien aux victimes des actes criminels
• Décentralisation des pouvoirs étatiques vers les régions et les municipalités
• Réforme du mode de scrutin
Conclusion
La plateforme électorale doit offrir une alternative politique clairement différente de celles de nos adversaires. Elle contiendra des mesures de transformation structurantes pour une planification démocratique de l'économie et pour un contrôle public des ressources stratégiques nécessaires pour la transition écologique.
Les enjeux et les propositions concrètes de la plateforme identifieront les luttes sociales à mener, même si le parti ne forme pas le gouvernement en 2026. La plateforme mettra de l'avant les éléments d'une abondance solidaire pour fédérer les mouvements sociaux. Comme parti des travailleuses et travailleurs, nous utiliserons la plateforme pour changer fondamentalement leurs conditions de travail et pour soutenir leur souveraineté sur la production, la distribution et l'utilisation des richesses.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Parc-Extension : des groupes communautaires dénoncent l’ouverture d’un magasin Village des Valeurs et la gentrification du quartier

Montréal, le 5 décembre 2025 –
Le Regroupement en aménagement de Parc-Extension (RAMPE) regrette l'ouverture ce jeudi 4 décembre 2025 d'une succursale de Village des Valeurs au cœur du quartier, dans l'emblématique bâtiment de l'ancienne gare Jean-Talon.
Pour les organismes communautaires membres du RAMPE, cette implantation constitue une occasion manquée pour répondre aux besoins criants en locaux communautaires, et risque d'accélérer l'embourgeoisement d'un des quartiers les plus pauvres du Québec.
L'ouverture de ce commerce survient quelques mois seulement après l'éviction d'une quinzaine d'organismes communautaires du Complexe William-Hingston. Ces groupes, qui offraient des services essentiels à la population – dépannage alimentaire, soutien aux locataires, cours de français et bien plus encore – se retrouvent aujourd'hui dispersés dans le
quartier, faute de locaux adéquats. Le bâtiment historique de la gare Jean-Talon aurait pu accueillir une partie de ces organismes et contribuer à combler une pénurie majeure d'espaces communautaires.
De plus, lorsque la Ville a vendu l'immeuble de la gare au groupe Loblaws, le contrat réservait une part des espaces intérieurs de l'ancienne gare à des fonctions sociocommunautaires, une condition qui ne fut jamais remplie.
Pour les organismes réunis au sein du RAMPE, cette installation confirme l'urgence d'un engagement ferme de tous les paliers de gouvernement afin de financer un nouveau centre communautaire pour Parc-Extension, un projet porté de longue date par la Table de quartier de Parc-Extension et plus que jamais nécessaire.
Le RAMPE rappelle que Village des Valeurs est une entreprise américaine à but lucratif, qui revend des articles usagés à des prix souvent plus élevés que ceux d'autres friperies locales ou organismes à vocation sociale. Son arrivée pourrait également renforcer la gentrification déjà bien entamée à Parc-Extension. En transformant l'offre commerciale et en attirant une
nouvelle clientèle en quête de « bonnes affaires », ce type de commerce tend à déséquilibrer la dynamique sociale du quartier, ajoutant une pression supplémentaire sur les résidents historiques. Les exemples ne manquent pas à Montréal : nombre d'artères commerciales tendances ont eu pour conséquence un regain d'intérêt de promoteurs immobiliers et une
hausse significative des prix des loyers.
L'arrivée de Village des Valeurs dans un bâtiment aussi symbolique que la gare Jean-Talon révèle un manque de vision dans la planification urbaine du quartier. Alors que Parc-Extension traverse une crise d'accès aux espaces communautaires et un processus de gentrification rapide, le RAMPE exhorte les paliers gouvernementaux à prioriser les besoins de la communauté plutôt que ceux d'entreprises à but lucratif. La gare Jean-Talon aurait pu être
notre patrimoine commun et le cœur vivant de Parc-Extension : elle servira finalement à l'enrichissement de quelques-uns.
A propos du RAMPE
Le Regroupement en aménagement de Parc-Extension (RAMPE) rassemble les organismes mobilisés autour des enjeux d'aménagement et de logement dans le quartier de Parc-Extension.
Source :
Regroupement en aménagement de Parc-Extension (RAMPE)
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le gel des subventions du MRIF persiste : les organismes québécois de coopération internationale dans l’impasse

Montréal, le 2 décembre 2025 — Malgré l'annonce du dégel des subventions par le Conseil du Trésor, le ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) maintient la suspension du versement des aides financières, mettant en péril les activités de dizaines d'organismes québécois de coopération internationale (OCI) et compromettant leurs engagements auprès de partenaires à travers le monde.
Un dégel qui exclut le MRIF
Une directive ministérielle suspend pour une durée indéterminée le versement des aides financières dans tous les secteurs d'activité du MRIF. Cette mesure compromet directement le décaissement de la deuxième tranche des subventions du programme Québec sans frontières (QSF) 2025-2026 pour les organismes ayant déjà soumis leur reddition de compte complète et conforme.
Des dizaines d'organismes menacés, des milliers de personnes privées de services Cette suspension entraîne des répercussions directes :
• sur les projets en cours dans des domaines essentiels comme les droits humains, le développement économique et social, le renforcement du pouvoir des femmes et des jeunes, la protection de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques, l'agriculture et la souveraineté alimentaire, ainsi que la santé et l'éducation ;
• pour les partenaires locaux et les volontaires dont la situation est également directement concernée par cette décision.
Cette décision, prise sans préavis par le ministère, met en péril près de 80 emplois au Québec et 200 postes chez les partenaires internationaux, tout en affectant plus de 34 400 personnes qui pourraient être privées de services essentiels.
« Cette situation est inacceptable. Les organismes financés par le programme QSF ont engagé des fonds pour la réalisation de leurs projets en fonction des conventions signées avec le MRIF. Ce gel, s'il est prolongé, compromet non seulement des projets en cours, mais aussi le maintien d'emplois et la crédibilité de nos organismes auprès de leurs partenaires internationaux », déclare Michèle Asselin, directrice générale de l'AQOCI.
« La suspension de ce soutien met directement en danger notre capacité à poursuivre nos activités. Elle menace aussi la continuité de notre mission, qui repose sur 25 ans d'expertise dans la lutte contre l'exploitation des enfants. Sans ce pilier essentiel, c'est toute notre organisation qui se fragilise, avec des répercussions humaines, sociales et organisationnelles importantes », explique l'organisme Aide internationale pour l'enfance.
Un appel urgent
L'AQOCI demande au gouvernement du Québec de :
– Procéder immédiatement au décaissement de la deuxième tranche des subventions QSF 2025-2026 pour les organismes ayant soumis leur reddition de compte conforme.
– Honorer les engagements contractuels en garantissant le remboursement des montants déjà avancés par les OCI dans le cadre de leurs projets. Cette garantie est essentielle compte tenu de la précarité financière de plusieurs partenaires locaux et du fait que de nombreux organismes dépendent de ce financement pour équilibrer leur budget annuel.
« Le gel prolongé des subventions envoie un message préoccupant sur l'engagement du Québec envers la solidarité internationale. Nos organismes sont des acteurs essentiels de la politique internationale du Québec et méritent d'être traités avec respect et prévisibilité. Nous demandons au ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christopher Skeete, d'agir rapidement pour résoudre cette crise », conclut Michèle Asselin.
À propos de l'AQOCI
L'Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) regroupe plus de 70 organismes de 14 régions du Québec actifs dans 86 pays en collaboration avec 1300 partenaires du Sud global. Ensemble, ils œuvrent, à l'étranger et localement, pour un développement durable et humain. En s'appuyant sur la force de son réseau, l'AQOCI œuvre à l'éradication de la pauvreté et à la construction d'un monde de justice, d'inclusion et d'égalité. L'AQOCI priorise la promotion des droits des femmes et de l'égalité des genres, des droits humains, de la paix et de la protection de l'environnement. www.aqoci.qc.ca
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Nick Kakeeway : une histoire de survie autochtone

Après avoir lutté contre une santé déclinante, Nick Kakeeway est décédé le 16 octobre à St. Catharines, en Ontario. Peu importe ce qui figure sur son certificat de décès, Nick a été victime des relations coloniales abusives que le Canada entretient depuis toujours avec les peuples autochtones qu'il a dépossédés et poussés en marge de la société. Il n'a vécu que jusqu'au début de la soixantaine, mais cela reste remarquable compte tenu de la violence et des épreuves qu'il a subies au cours de sa vie.
https://canadiandimension.com/articles/view/nick-kakeeway-a-story-of-indigenous-survival
19 novembre 2025
Je connaissais Nick depuis plus de 30 ans. Nous nous sommes rencontrés et sommes devenus amis parce qu'il était un membre actif de la Coalition ontarienne contre la pauvreté (OCAP). Malgré le racisme, la pauvreté, l'itinérance, la violence, les abus et l'emprisonnement auxquels il a été confronté, c'était un être humain profondément honnête que j'admirais et respectais énormément.
Pas de monuments
Après avoir appris la mort de Nick, je me suis demandé si je devais lui rendre hommage par écrit. Puis, je me suis promené dans un petit bois près de chez moi qui porte le nom d'un membre décédé de la classe politique de Toronto. Je sais que Nick ne sera pas honoré de cette manière, mais ce serait une injustice criante si sa vie et ses combats n'étaient connus que de sa famille et de ses ami·es.
J'écris donc cet article en hommage personnel à Nick, tout en réfléchissant à ce que son combat pour la survie devrait signifier pour les personnes qui luttent contre l'oppression partout dans le monde. Je veillerai à ne pas empiéter sur la vie privée des membres de sa famille qu'il chérissait, mais j'espère que son chat, Maverick, ne m'en voudra pas de le mentionner.
Ma première rencontre avec Nick a eu lieu au début des années 1990, lors d'une action de l'OCAP au cours de laquelle nous avons pénétré par effraction dans un bâtiment abandonné dans le cadre d'une campagne qui a finalement abouti à sa transformation en logements sociaux. Prendre des risques et faire face à des policiers hostiles n'avait rien de nouveau pour Nick, donc occuper les lieux et être emmené menotté étaient des choses qu'il prenait avec philosophie.
La police est intervenue très rapidement, je n'ai donc pas eu beaucoup l'occasion de parler à Nick, mais je me souviens qu'il a mentionné le refuge où il séjournait et a souligné qu'il était membre de la nation Ojibwe et qu'il avait été rendu sans abri par ceux qui avaient volé les terres de son peuple. C'était un point qu'il soulevait très souvent, à juste titre.
Après nous avoir emmenés, les policiers nous ont informés que nous serions libérés sur-le-champ, après avoir reçu des contraventions pour intrusion. Ils ont fait la queue pour rédiger les contraventions. Quand ils sont arrivés à Nick, il a froissé la sienne et l'a jetée au visage du policier. Il connaissait très bien les conséquences potentielles d'un tel acte, mais pour lui, la défiance était une question très pratique, plutôt qu'un principe abstrait.
Nick est rapidement devenu un participant régulier aux actions de l'OCAP et a commencé à prendre une part active à certaines de nos activités quotidiennes, en aidant à faire connaître nos actions et nos événements et en jouant le rôle d'ambassadeur pour nous dans les rues. La lutte pour les droits des autochtones l'a toujours inspiré et il ressentait une certaine fierté chaque fois que les structures du colonialisme canadien étaient ébranlées.
Nick est né dans une réserve au nord de Thunder Bay, l'un des centres d'accueil profondément inadéquats créés par la Loi sur les Indiens pour les nations autochtones dépossédées. Dans l'espoir d'une vie meilleure, sa famille a déménagé en ville alors qu'il était encore enfant.
Thunder Bay est un creuset notoire de racisme anti-autochtone, et Nick en a fait l'expérience à sa manière. Confronté à la discrimination et à l'exclusion sociale, il a eu des démêlés avec la « justice » et a été incarcéré avant d'atteindre l'âge adulte. Pour Nick, comme pour tant d'autres, l'alcool, malgré tous les problèmes qu'il entraînait, lui apportait un certain soulagement à la douleur qu'il devait endurer. Il s'est rendu à Toronto et a fini par vivre dans la rue pendant de nombreuses années.
Au cours de mon mandat d'organisateur de l'OCAP, Nick semblait toujours être dans les parages. C'était un homme très grand, très costaud et assez intrépide lorsqu'il s'agissait d'affrontements physiques. Il m'a dit que le système informatique de la police le considérait comme « violent lorsqu'il était en état d'ébriété ». Malgré sa réputation féroce, il pouvait être gentil et généreux, et il ne s'en prenait pas aux plus faibles que lui. Lorsqu'il a été élu au comité exécutif de l'OCAP, j'ai été surpris de le voir essuyer des larmes ; il m'a dit que cela signifiait beaucoup pour lui d'avoir gagné cette confiance.
La police avait Nick dans le collimateur et son association avec l'OCAP la rendait encore plus hostile à son égard. Il leur tenait toujours tête, souvent au prix fort. Une fois, alors qu'il était en prison et devait comparaître devant le tribunal, il m'a demandé de lui apporter des vêtements de rechange. Il m'a dit que les vêtements qu'il portait lors de son arrestation n'étaient pas en bon état, car les policiers l'avaient malmené. J'ai ouvert le sac qui les contenait et j'ai été choquée de constater qu'ils étaient imprégnés de sang.
Il y avait des moments où la douleur que Nick portait en lui devenait très évidente. Un jour, il est venu au bureau de l'OCAP, très ivre et bouleversé, et m'a raconté en détail les terribles épreuves que lui et sa famille avaient endurées. Il s'est levé et a donné un coup de poing dans le mur du bureau en criant : « Je déteste tous ces enfoirés de Blancs. » Puis, il a marqué une pause avant de se retourner et de dire : « Désolé, John. Sans vouloir t'offenser. »
Je pourrais raconter de nombreuses anecdotes sur l'activisme de Nick, mais celle qui m'a le plus marqué est son rôle dans une « collecte massive » organisée par l'OCAP à l'extérieur du Festival du film de Toronto pour dénoncer le rôle de la ville qui abandonne les gens à la rue, alors même qu'elle se présente comme un centre de culture et d'éveil. Nick a récolté beaucoup de petite monnaie dont il avait grand besoin, mais c'est l'audace de défier la structure du pouvoir dans le processus qui l'a motivé.
Une leçon de survie
Après avoir quitté mon poste d'organisateur à l'OCAP, j'ai donné quelques cours sur la justice sociale à l'université York. Je voulais inviter un conférencier pour parler des luttes des Autochtones et j'ai pensé à Nick. Il n'était pas un porte-parole ou un leader reconnu, mais j'avais le sentiment qu'il avait quelque chose à dire, alors je l'ai invité.
Je savais que Nick n'avait pas l'habitude de donner des conférences, alors j'ai présenté cela comme une séance de questions-réponses. Je pensais que le cadre universitaire pourrait l'intimider, mais je me trompais complètement. Il était spirituel et sociable, même lorsqu'il présentait une critique du colonialisme canadien à travers le prisme de sa propre vie. Il a commencé par rire et dire aux étudiant·es : « Je n'arrive pas à croire qu'ils laissent John enseigner ici ! »
Au fil du cours, Nick a humanisé le colonialisme et la résistance autochtone. Il a raconté comment, à l'âge de 16 ans, il s'était évadé d'un centre de détention, pour être ensuite arrêté dans les rues de Toronto alors qu'il tentait de voler un vélo. Il a été maintenu à l'isolement pendant des mois. L'une des élèves, très choquée par cette histoire, a demandé comment les autorités pouvaient faire cela à un jeune garçon. Nick a haussé les épaules et lui a répondu : « Pour eux, c'était juste un Indien de moins dans les rues. »
Plus tard, Nick a pu obtenir une allocation d'invalidité et un logement à St. Catharines. Il est devenu un amoureux des chats, a animé une page Facebook très active et s'est entouré de personnes qu'il aimait et qui l'aimaient. Il a profité au maximum de cette période, même si les épreuves de sa vie l'ont inévitablement conduit à une mort prématurée.
Lorsque nous pensons à la résistance autochtone, nous évoquons des images de luttes et de campagnes clés qui ont été menées. Toutes ces luttes sont essentielles, mais nous ne devons pas négliger un autre aspect important.
La résistance des peuples autochtones se manifeste dans leur lutte quotidienne pour survivre. Cela était vrai pendant la phase initiale de la spoliation coloniale, dans les pensionnats et dans le cas des enfants volés par les agences de « protection de l'enfance ». Cela reste vrai aujourd'hui dans les réserves et dans les rues des villes canadiennes. Elle est au cœur de la vie des femmes autochtones, qui sont confrontées à des niveaux de violence génocidaires. La vie de Nick a été l'une de ces luttes pour la survie. Elle a connu des moments de joie, mais ce fut un combat difficile et amer du début à la fin.
J'ai souvent repensé à cette remarque mémorable de Stephen Jay Gould : « Je suis, d'une certaine manière, moins intéressé par le poids et les circonvolutions du cerveau d'Einstein que par la quasi-certitude que des personnes tout aussi talentueuses ont vécu et sont mortes dans les champs de coton et les ateliers clandestins. » Cela sonne juste quand on pense à la vie de Nick.
Nick Kakeeway était un être humain remarquable qui avait beaucoup à offrir à une société trop raciste et injuste pour faire autre chose que l'enfermer et tenter de l'écraser. Ses qualités et ses capacités considérables ont dû être mises à profit dans une lutte quotidienne pour surmonter les épreuves et la douleur qui lui ont été infligées. Il n'y aura pas d'hommage officiel à Nick, mais celleux d'entre nous qui l'ont connu honorent sa vie, chérissent sa mémoire et poursuivent la lutte dans laquelle il a joué un rôle très précieux.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La nouvelle agence immobilière de Mark Carney a pour mission de protéger la bulle immobilière

Les groupes de défense du logement ont exprimé divers degrés d'optimisme à propos des 13 milliards de dollars que le gouvernement fédéral a alloués à Build Canada Homes (BCH) dans son premier budget depuis son entrée en fonction. C'est une nouvelle que beaucoup dans le monde de la politique du logement attendaient. Après avoir fait campagne avec acharnement au printemps dernier sur le projet BCH, alors mal défini, Mark Carney a maintenant donné une certaine ampleur au projet et permis à la nouvelle initiative de construction de logements de prendre forme.
20 novembre 2025 | tiré du site de Canadian dimension
https://canadiandimension.com/articles/view/mark-carneys-new-housing-agency-is-built-to-protect-the-bubble
Le mandat de l'agence a enfin été défini. Sa mission est de « contribuer à créer les conditions » d'un « secteur du logement non commercial » moins « dépendant des subventions gouvernementales permanentes ». C'est un début, mais avec si peu de détails, il est difficile d'évaluer l'efficacité du programme BCH pour résoudre le problème de l'accessibilité au logement. Le gouvernement n'a encore publié aucun objectif précis, il n'y a pas de nombre prévu de logements non marchands à construire, pas de coût de location prévu par logement, pas de définition claire de l'accessibilité, pas de pourcentage cible de logements non marchands dans les zones à loyer élevé, et aucune garantie que les logements du BCH seront détenus par des acteurs non marchands.
Nous pouvons toutefois déduire l'orientation générale de la nouvelle agence à partir de ses publications destinées au public et des références de la personne qui a été choisie pour la diriger. Il s'agit de l'ancienne conseillère municipale de Toronto et ancienne candidate à la mairie, Ana Bailão. Au cours de ses dix années au service de la ville de Toronto, Bailão s'est forgé une réputation de fervente défenseure des intérêts immobiliers. Elle a réduit les taxes municipales imposées aux promoteurs immobiliers, cédé de vastes étendues de terrains publics à des propriétaires privés et applaudi la stratégie nationale du logement, qui consistait à brader massivement les richesses publiques. Si son travail sur les questions de logement à Toronto n'a pas beaucoup contribué à rétablir l'accessibilité financière, il lui a valu d'être acclamée par le secteur. Bailão était considérée comme une alliée si célèbre qu'après avoir perdu la course à la mairie de 2023 face à Olivia Chow, elle s'est vu offrir un poste de haut niveau chez Dream Unlimited Corporation, l'une des plus grandes sociétés de développement immobilier de la ville.
Bailão a passé deux ans à travailler comme cadre pour ce promoteur immobilier dont les filiales comprennent les sociétés d'investissement immobilier cotées (REIT) Dream Residential et Dream Industrial, qui contrôlent ensemble 15 milliards de dollars d'actifs. Quelques mois avant qu'elle ne rejoigne l'équipe Dream, la société s'est associée à un fonds souverain pour acheter 1,5 milliard de dollars de biens immobiliers dans la région du Grand Toronto. Cette accumulation de biens immobiliers par les sociétés d'investissement est l'essence même de la financiarisation, et c'est peut-être le facteur le plus important à l'origine de la crise du logement abordable au Canada.
Le fait que les politiques pro-entreprises ratées de Mme Bailão ne l'aient pas immédiatement disqualifiée pour le poste de directrice générale de la BCH démontre clairement les priorités de M. Carney. En plaçant une experte du secteur à la tête de sa nouvelle agence pour le logement abordable, le Premier ministre a donné la priorité aux intérêts des promoteurs immobiliers et des propriétaires.
Dans ses nouvelles fonctions, Mme Bailão sera chargée de créer des opportunités lucratives pour les grandes sociétés d'investissement immobilier grâce à des prêts bon marché, des transactions foncières, des contrats de construction et des frais de gestion. Cela fait partie intégrante de la mission de la BCH qui, comme indiqué sur son propre site web, consiste à « financer des logements abordables ». La BCH ne mettra pas la main à la pâte, mais sous-traitera au secteur privé la construction de logements non marchands.
L'agence promet d'utiliser ces logements développés par le secteur privé pour « accroître l'offre de logements abordables et communautaires gérés par des organisations à vocation sociale ». Il convient de noter que le projet consiste à construire des logements qui seront gérés par des organisations à vocation sociale, et non détenus par celles-ci. Cette formulation ambiguë crée une importante faille : les logements de la BCH sont destinés à être détenus par des propriétaires privés et gérés par des ONG.
J'ai discuté avec un travailleur social d'Edmonton qui travaillait dans un site de logements sociaux fonctionnant selon ce modèle. L'immeuble de 20 logements appartient à une société d'investissement immobilier cotée en bourse appelée Mainstreet Equity et est géré par une ONG. Même si les locataires paient des loyers proches de ceux du marché et que Mainstreet engrange d'énormes profits, l'immeuble est classé par les autorités provinciales et municipales comme « logement non commercial ».
Une autre alerte concerne le langage utilisé par BCH pour décrire son mandat. Les logements sociaux financés par l'agence doivent « réduire leur dépendance vis-à-vis des subventions publiques permanentes ». Dans la pratique, cela signifie deux choses : soit les loyers seront fixés à un niveau qui exclura les plus vulnérables, soit les opérateurs seront condamnés à l'échec. Sans subventions au loyer ni aides financières accrues, les logements construits par la BCH seront soit inabordables pour les personnes qui en ont le plus besoin, soit laissés à l'abandon, devenant ainsi un futur prétexte politique pour affirmer que les logements non marchands ne fonctionnent pas.
Dans l'ensemble, la nouvelle agence pour le logement mise en place par les libéraux marque un retour au modèle de partenariat public-privé (PPP). Nous avons déjà vu ce scénario se dérouler. Le plan « Building Canada » de Stephen Harper a canalisé les fonds publics vers des projets d'infrastructure PPP qui ont systématiquement donné moins pour plus, privilégiant les profits des entreprises au détriment de l'intérêt public. En nommant Bailão à la tête de la BCH, Carney importe le même modèle axé sur le profit.
La conclusion est évidente : la BCH est conçue pour créer un petit portefeuille de logements privés géré par des ONG, un modèle beaucoup trop faible pour stabiliser les prix ou contester le pouvoir des propriétaires.
Lorsque l'Autriche, la Finlande et la France ont utilisé des logements non marchands pour améliorer l'accessibilité financière dans leurs villes, elles ont veillé à ce que 20 à 30 % de l'ensemble du parc immobilier soit détenu (et souvent construit) par des acteurs non marchands. La nouvelle agence fédérale canadienne du logement n'est ni financièrement équipée ni philosophiquement encline à construire quoi que ce soit qui ressemble à ce système.
La situation est claire : le BCH est conçu pour créer un petit portefeuille immobilier privé géré par des ONG, un modèle bien trop faible pour stabiliser les prix ou contester le pouvoir des propriétaires.
Nous pourrions faire les choses différemment. Nous pourrions nous efforcer de mettre fin à la financiarisation de nos logements. Nous pourrions suivre l'exemple européen et construire un système de logement démarchandisé capable de fournir des logements abordables et dignes pour toustes. Mais il semble que le gouvernement Carney n'ait pas le courage de le faire. Le premier ministre a montré qu'Ottawa suivait toujours le mantra de Trudeau selon lequel « le logement doit conserver sa valeur ».
Les raisons de cette situation sont peut-être compréhensibles. Le Canada est devenu l'otage de sa propre bulle immobilière. Nos retraites, notre système bancaire et nos principaux indicateurs économiques dépendent de la hausse constante de la valeur des biens immobiliers. Un programme de logement non marchand véritablement ambitieux qui réussirait à stabiliser les prix déclencherait une vague importante de désendettement, obligeant une large partie de l'économie à se restructurer.
Plutôt que d'affronter cette réalité et de proposer une vision pour une économie canadienne fondée sur autre chose que la spéculation immobilière, Carney a choisi de soutenir les intérêts immobiliers. Le programme Build Canada Homes est conçu pour donner l'impression d'agir en faveur de l'accessibilité au logement, tout en veillant soigneusement à ce que ses résultats soient conformes aux intérêts des propriétaires et des promoteurs immobiliers que Bailão représente si habilement.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’industrie canadienne de l’armement sous la dépendance de l’armée américaine

Une usine de Brampton s'apprête à livrer 20 véhicules blindés à l'ICE (Immigration and Customs Enforcement, service américain chargé de l'immigration et des douanes).
Des systèmes de caméras canadiens ont été utilisés lors de récentes frappes américaines contre des bateaux vénézuéliens. Le Pentagone a commandé des propulseurs d'artillerie et des balles fabriquées à Montréal pour aider Israël dans son génocide.
Chaque année, le Canada vend pour plus d'un milliard de dollars d'armes aux États-Unis. Il est difficile de savoir exactement combien de milliards de dollars d'armes sont envoyés au sud, car le gouvernement ne comptabilise pas les ventes aux États-Unis. En raison d'un accord bilatéral unique vieux de 70 ans, la plupart des expéditions d'armes vers les États-Unis ne nécessitent pas de permis.
En réponse à la pression exercée par les militantes et les militants contre les livraisons d'armes à Israël via les États-Unis, la députée néo-démocrate Jenny Kwan a récemment proposé le projet de loi C-233 (« Loi visant à éliminer les lacunes »). Ce projet de loi d'initiative parlementaire empêcherait les exemptions accordées à certains pays en matière d'autorisation et introduirait des mesures de déclaration plus strictes pour les exportations militaires.
Jeudi, The Maple a rendu compte de la réponse du Parti libéral à l'important projet de loi de Kwan. Selon une note d'information préparée pour le caucus libéral, le projet de loi C-233 est « malavisé » et « affaiblirait nos alliances et décimerait notre industrie de la défense ». La note indiquait : « Notre exemption générale avec les États-Unis n'est pas une faille — elle reflète une relation géopolitique unique fondée sur des engagements communs en matière de sécurité, la défense continentale et des décennies d'intégration militaire. Imposer les formalités administratives prévues par cette législation compromettrait ces efforts et rendrait les deux pays moins sûrs face aux menaces qui pèsent sur leur souveraineté et leur stabilité. »
La note ajoute également que les États-Unis pourraient riposter.
Si le fait d'armer Israël dans son génocide et de voir l'armée américaine faire exploser des navires dans les Caraïbes est odieux, la vente d'armes non autorisées trouve son origine dans un accord unique et de longue date. En 1956, le Canada et les États-Unis ont signé l'Accord de partage de la production de défense (DPSA), qui permettait aux entreprises canadiennes de soumissionner pour des contrats militaires américains. En effet, le DPSA intègre les entreprises canadiennes à la base industrielle de défense américaine et, grâce à lui, la plupart des articles militaires expédiés aux États-Unis ne nécessitent pas de permis.
L'Accord sur la défense et la sécurité (DPSA) a amélioré l'accès des entreprises canadiennes au marché mondial des armes, qui est le plus lucratif au monde. De plus, il leur a donné accès à une technologie militaire de pointe et a facilité leur participation aux chaînes de valeur mondiales des entreprises américaines. Pour chaque dollar que les entreprises canadiennes ont exporté vers l'armée américaine dans le cadre du DPSA, elles ont généralement vendu environ 50 cents supplémentaires de ce produit à un autre pays.
La DPSA a fait appel au Pentagone parce que les entreprises canadiennes étaient des fournisseurs relativement sophistiqués. Mais la DPSA comportait également un élément politique. Le Pentagone voulait lier les entreprises canadiennes au complexe militaro-industriel américain dans l'espoir que cela les inciterait à défendre une politique militaire pro-américaine. Un document américain de 1958 sur la sécurité nationale décrivait l'importance de maintenir une « industrie de défense canadienne » « saine » pour que les États-Unis puissent « bénéficier de la même excellente coopération dans le cadre de l'effort de défense commun qui a prévalu dans le passé ».
Signe du succès de la DPSA, le président de Canadian Marconi (aujourd'hui CMC), John H. Simmons, a souligné l'importance pour Ottawa de s'aligner sur la politique militaire américaine lors d'un examen du NORAD par le comité de la défense. Dans un discours prononcé en 1987 et qualifié de « résumé du sentiment général parmi les représentants de l'industrie », M. Simmons a déclaré : « Il est vital pour le Canada que la base industrielle de défense survive et se développe, et il est vital pour l'industrie de la défense qu'elle conserve son accès au marché américain de la défense et continue d'être considérée comme faisant partie de la base industrielle de défense américaine. Pour atteindre ces deux objectifs, il est donc essentiel que le Canada continue de coopérer avec les États-Unis dans le domaine de la défense en général, et au sein du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD) en particulier. »
En d'autres termes, les capitalistes canadiens en général, et ceux qui investissent dans l'industrie de l'armement en particulier, sont sous la dépendance de nos voisins du sud. L'industrie canadienne de l'armement est liée au Pentagone et à la politique militaire américaine. Le projet de loi C-233 contribue utilement à rompre ces liens, mais il est important de comprendre à quoi nous sommes confronté·es.
Yves Engler est candidat à la direction du NPD et auteur de 13 livres.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Oxfam-Québec demande aux gouvernements d’interdire les liens d’affaires avec les colonies israéliennes

Montréal, le 2 décembre 2025 — Des acteurs économiques québécois de premier plan alimentent la politique de colonisation israélienne en entretenant des relations commerciales ou d'affaires dans les colonies en Cisjordanie et dans le Golan syrien occupé, démontre Oxfam-Québec dans une nouvelle analyse.
Le rapport, intitulé Commerce avec les colonies : comment des acteurs économiques du Québec permettent à Israël de déployer sa politique d'occupation illicite, montre comment le Canada et le Québec permettent à des entreprises et des investisseurs québécois de contribuer au maintien de l'occupation israélienne.
L'étude met en lumière trois exemples concrets de liens économiques entre le Canada et les colonies israéliennes. La Société des alcools du Québec, par exemple, permet l'importation et la commercialisation de produits issus de vignobles situés en territoires occupés, ou produits à partir de raisins qui y sont cultivés. En continuant de les vendre comme s'il s'agissait de produits d'Israël, la SAQ légitime et soutient indirectement le régime de colonisation, estime Oxfam-Québec.
« Le gouvernement du Québec a su faire interdire la vente par la SAQ de produits provenant des États-Unis. Il est donc en mesure de faire interdire les vins provenant des territoires occupés, conformément au droit international », fait valoir Béatrice Vaugrante, directrice générale d'Oxfam-Québec.
De son côté, WSP, l'une des plus grandes firmes de services professionnels au monde établie à Montréal, a été impliquée dans le développement d'un système de transport public – au seul bénéfice des Israéliens – permettant de connecter et de consolider les colonies israéliennes à Jérusalem-Est et en Cisjordanie avec le reste du territoire d'Israël. La Caisse de dépôt et placement est l'actionnaire principal de WSP.
La position officielle du Canada stipule que les colonies israéliennes sont illégales et constituent un « obstacle à la paix ». Malgré cela, le Canada continue de soutenir l'économie des colonies en n'interdisant pas à des entreprises domiciliées sur son territoire d'entretenir des relations commerciales avec les colonies israéliennes ou des entreprises qui y sont implantées.
Oxfam constate chaque jour les conséquences désastreuses de la colonisation sur les droits et les moyens de subsistance des communautés palestiniennes et syriennes de Cisjordanie et du Golan syrien occupé. Le projet de colonisation israélien, qui s'étend de façon de plus en plus violente depuis le 7 octobre 2023, fragmente la Cisjordanie, détruit l'économie palestinienne et crée de profondes inégalités. Dans le Golan syrien occupé, les communautés sont également dépossédées de leurs terres et des ressources en eau, au profit du développement économique et de l'expansion des colonies.
« Tout échange commercial avec les colonies israéliennes légitime leur présence sur des territoires occupés illégalement, entrave la viabilité d'un futur État palestinien et aggrave la précarité économique de la population palestinienne. Nous demandons aux gouvernements fédéral et provincial d'interdire toute forme de commerce avec les entreprises qui sont implantées ou opèrent dans les colonies israéliennes illégales en Cisjordanie, notamment à Jérusalem-Est, et dans le plateau du Golan », plaide Mme Vaugrante.
Des mesures doivent être mises en place par les gouvernements pour identifier et prévenir toute forme de soutien au projet de colonisation israélien. Oxfam-Québec demande aux gouvernements du Québec et du Canada d'interdire explicitement les relations commerciales avec les colonies israéliennes, y compris la prestation de services et les investissements. Les gouvernements devraient aussi exiger des exportateurs israéliens qu'ils démontrent clairement que leurs marchandises n'ont pas été produites, en tout ou en partie, dans des territoires occupés.
« Les colonies illégales sont l'une des principales causes de la pauvreté et des violations des droits en Cisjordanie et dans le Golan syrien occupé. Nos équipes et nos partenaires le confirment : l'expansion des colonies provoque le déplacement forcé de familles, le pillage des ressources naturelles et des élevages, la privation de terre et d'eau, la démolition de maisons et la perte de moyens de subsistance », illustre la directrice générale d'Oxfam-Québec.
« Il est urgent d'interdire le commerce avec les colonies israéliennes pour protéger les droits, la dignité et la survie des communautés palestiniennes et syriennes concernées, et de ne pas participer à l'expansion des colonies. Cela relève du plein contrôle de nos gouvernements. »
Notes
* Le rapport Commerce avec les colonies : comment des acteurs économiques du Québec permettent à Israël de déployer sa politique d'occupation illicite est disponible sur demande. La méthodologie est incluse dans le rapport.
* Les entreprises retenues pour ce rapport – la SAQ, La Caisse et WSP – ont été choisies sur la base de la disponibilité d'informations publiques, crédibles et vérifiées. Ces quelques entreprises ne constituent pas une liste exhaustive des entités corporatives québécoises concernées, mais elles ont été sélectionnées pour montrer la diversité des mécanismes par lesquels des institutions et des entreprises d'ici peuvent se retrouver impliquées dans une situation reconnue comme illégale en droit international, et pour illustrer les risques et obligations qui en découlent.
* Le rapport réalisé par Oxfam-Québec se veut un complément au rapport international Commerce avec les colonies illégales : comment les États et entreprises étrangères permettent à Israël de mettre en œuvre sa politique de colonisation illégale,<https:/oxfam.qc.ca/wp-content/uplo...>'><https://oxfam.qc.ca/wp-content/uplo...> appuyé par plus de 80 organisations de la société civile, dont Oxfam. Ce rapport, publié en septembre 2025, est axé sur l'Union européenne et ses États membres. Il s'inscrit aussi dans la campagne mondiale « Stop au commerce avec les colonies ».
* Le Canada ne reconnaît pas le contrôle permanent exercé par Israël sur les territoires occupés, incluant le plateau du Golan, depuis 1967. Pourtant, l'Accord de libre-échange Canada–Israël (ALECI)<https://www.international.gc.ca/tra...>'><https://www.international.gc.ca/tra...> ne fait aucune distinction entre les biens et services produits à l'intérieur des frontières internationalement reconnues d'Israël et ceux issus des territoires occupés illégalement. L'ALECI autorise donc l'apposition de la mention « fabriqué en Israël » ou « produit d'Israël » sur les produits provenant de régions où les lois douanières israéliennes s'appliquent, ce qui inclut la Cisjordanie, la bande de Gaza et le plateau du Golan.
* Pour être conformes au droit international, les accords bilatéraux et multilatéraux conclus avec Israël doivent clairement distinguer entre les frontières reconnues d'Israël et les territoires qu'il occupe illégalement. Les accords qui ne font pas cette distinction de manière adéquate, comme l'ALECI, doivent être suspendus ou révisés.https://apidiakoniase.cdn.triggerfi...>
"><https://apidiakoniase.cdn.triggerfi...>
* Dans un avis consultatif de juillet 2024<https:/www.icj-cij.org/sites/defau...>'><https://www.icj-cij.org/sites/defau...> , la Cour internationale de justice a reconnu que l'occupation prolongée par Israël du territoire palestinien était illégale. La Cour indique que les États tiers sont dans l'obligation de ne pas reconnaître comme licite la situation découlant de la présence de l'État d'Israël dans le Territoire palestinien occupé et de ne pas prêter « aide ou assistance au maintien » de cette situation.
* Oxfam-Québec lance une pétition<https:/oxfam.qc.ca/commerce-avec-l...>'><https://oxfam.qc.ca/commerce-avec-l...> exigeant des gouvernements canadien et québécois qu'ils mettent fin au commerce avec les colonies illégales israéliennes.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Canada-Émirats arabes unis : Quelle belle alliance !

Notre cher Premier ministre M. Carney est tout fier de nous annoncer qu'il a conclu un contrat avec les dirigeants des Émirats arabes unis qui va nous gratifier d'investissements à hauteur de plus de 70 milliards de dollars dans les prochaines années.
Alexandra Cyr
M. Carney n'est ni un idiot ni un ignorant, surtout pas en matière de rapports avec les pays étrangers. Donc il doit savoir à qui il a affaire en faisant des ententes avec ce pays. Dire que ce n'est pas un enfant de cœur, c'est peu dire.
En ce moment même, ses dirigeants sont impliqués à fond dans la guerre au Soudan. Ils vendent des armes et d'autres fournitures aux Forces de soutien rapide, anciennement Janjawids déclarées par les instances internationales, comme les auteurs du génocide au Darfour (province au nord-ouest du Soudan) en 2013. Elles poursuivent les mêmes objectifs aujourd'hui et utilisent les mêmes moyens : massacres de masses, destructions des biens collectifs et privés, comme à l'époque. L'ONU a déclaré que la prise récente de la plus grande ville du Darfour, El-Fasher, qui s'est conclu par des massacres sans nom de la part des FSR, est la pire crise humanitaire sur terre actuellement. En plus des tués.es et blessés.es des millions ont fuit vers le Tchad petit pays africain déjà en difficulté et débordé par cet afflux de réfugiés.es.
Et dans la situation complexe et conflictuelle de cette partie du monde, les Émirats aussi mêlés dans d'autres conflits armés avec les mêmes objectifs.
Donc, l'argent qui sera éventuellement investit ici, aura été gagné en bonne partie grâce à ce commerce d'armes que je qualifie d'horrible et dégoûtant. Nous sommes proches, me semble-t-il du blanchiment d'argent. Ah ! La belle alliance.
Il est consternant, que ce cher Trump ayant passé par là, nos dirigeants.es, dûment élus.es dans nos sociétés démocratiques, s'emploient comme si de rien n'était, à faire des affaires, en notre nom en plus, au lieu de gouverner. Il y a un niveau de considération politique, morale et humaine qui se dissout dans l'encre des billets de banques. Nous savons que D. Trump fait des affaires pour lui-même et sa famille en se servant du pouvoir américain, mais les autres, tous les autres ou presque comme M. Carney, comment peuvent-ils s'accrocher à des cordes aussi minées et honteuses ?
Note : pour comprendre plus à fond les liens des Émirats arabes unis dans la guerre au Soudan, je vous invite à écouter l'émission Affaires étrangères de samedi le 22 novembre 2025 sur franceculture.fr
Et pour toute la complexité de cette guerre dite civile, voir l'article sur Wikipedia.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Journée de commémoration et d’actions contre les violences faites aux femmes

Le 6 décembre dernier à Québec, une centaines de femmes ont manifesté contre les violences faites aux femems dans le cadre des 12 jours contre les violences faites aux femmes. Vous trouverez le communiqué de presse émis par le Regroupement des groupes de femmes de de la région de la Capitale nationale (RGF) et le texte de discours prononcés à cette occasion.
Québec, le 6 décembre 2025 - Aujourd'hui, le Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale (RGF-CN) a organisé une marche dans le quartier Limoilou dans le cadre de la Journée de commémoration et d'actions contre les violences faites aux femmes. Rappelant l'horreur du plus grand féminicide vécu au Québec, soit la tuerie de Polytechnique en décembre 1989, le RGF-CN a dénoncé toutes les violences vécues par les femmes et interpellé les gouvernements sur leur responsabilité face à la lutte contre les violences.
La manifestation a permis de dénoncer les féminicides, ainsi que les violences sexuelles et conjugales. 16 féminicides connus ont eu lieu cette année au Québec. Rappelons que les féminicides sont la pointe de l'iceberg des violences vécues par les femmes. Près de la moitié des femmes (44%) ont subi au moins une forme de violence entre partenaires intimes (violence psychologique, physique et sexuelle) au courant de leur vie. La violence conjugale, tout comme les violences sexuelles, touche particulièrement les femmes autochtones, les personnes de la diversité sexuelle et de genre, les personnes ayant une problématique de santé mentale ou un handicap.
Mêmes luttes, mêmes espoirs
C'est sous le thématique « Même monde, mêmes luttes, mêmes espoirs » qu'a eu lieu la campagne annuelle 2025 des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes, qui s'étend du 25 novembre, Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, au 6 décembre.
« Le contexte politique nous amène à dénoncer avec force les violences institutionnelles et systémiques. L'État contribue aux violences genrées, notamment en banalisant la crise du logement, qui accentue la précarité des femmes et les met à risque de vivre plus de violences, et en sous-finançant les maisons d'hébergement et de deuxième étape. Comment sortir d'une relation violente lorsqu'il n'y a pas de logement abordable et accessible ? », s'indigne Claire Murati du RGF-CN.
Le RGF-CN dénonce les récentes coupures, autant au provincial qu'au fédéral, dans l'aide et les services aux victimes. Au Québec, une partie du programme Rebâtir qui permettait aux victimes d'agressions à caractère sexuel d'être représentées par des avocat.e.s spécialisé.e.s devant les tribunaux a pris fin ; des maisons de deuxième étape accusent toujours des retards dans la livraison ; l'allégement des tâches des agent.e.s de probation auprès des contrevenants et des victimes de violence conjugale est inquiétante. Les récentes coupures dans le budget du ministère Femmes et Égalité des genres Canada, sont tout aussi alarmantes.
La manifestation a permis de dénoncer les violences systémiques auxquelles font face les femmes racisées et en situation d'immigration au Québec. Le gouvernement québécois contribue, par ses lois et discours, à la discrimination envers les femmes immigrantes. La fin du Programme de l'expérience québécoise (PEQ), le renvoi possible de milliers de personnes immigrantes, les coupures dans différents programmes visant les personnes réfugiées ou à statut migratoire précaire précarise les femmes racisées ou en situation d'immigration ou de refuge a un impact négatif sur toute la société québécoise !
S'unir contre les violences
« Dans un contexte où les droits des femmes et des personnes de la diversité de genre sont attaqués partout dans le monde, où la droite prend de plus en plus de place dans les décisions politiques, l'omniprésence des discours haineux et misogynes dans l'espace public, il est impératif de prendre aujourd'hui les mesures pour lutter contre la montée du masculinisme, pour éliminer et prévenir les violences genrées et racistes, les violences sexuelles et les féminicides », revendique Claire Murati, du RGF-CN.
Le RGF interpelle les gouvernements de remettre la lutte contre les violences au premier rang de ses priorités.
Ces 12 jours d'action ont pris place quelques semaines après la Marche mondiale des femmes 2025, où près de 20 000 femmes et alliés se sont rassemblées à Québec afin de dénoncer les violences, la pauvreté et la crise climatique. « La solidarité continue ! Nous serons en marche tant que toutes les violences ne seront pas éliminées. Pour cela, nous avons besoin de solidarité et politiques sociales inclusives, justes et féministes. Et nous le répéterons tant et aussi longtemps que ce sera nécessaire », ajoute Cynthia Laura Petit-Maître de la Maison pour femmes immigrantes de Québec.
Le RGF-CN regroupe des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale et travaille la défense des droits et des intérêts de toutes les femmes, l'égalité des femmes entre elles, l'amélioration des conditions de vie.
**********
Projet L.U.N.E. – Gabrielle Vaudry
6 décembre
Aujourd'hui, on se réunit pour souligner le triste 36e anniversaire du 6 décembre 1989, la tuerie de la Polytechnique.
Trente-six ans plus tard, on est encore ici. On marche encore. Pas par habitude, mais parce que les violences faites aux femmes et aux personnes de la diversité de genre continuent. Parce que, malgré les promesses, malgré les plans d'action, malgré les discours… la réalité, c'est que la violence persiste et qu'elle coûte des vies.
On nous répète trop souvent que « ça coûte cher » d'accompagner les victimes, d'offrir des services, des refuges, du soutien. Mais la vérité, c'est que ce ne sont pas les victimes qui coûtent cher au système…
Ce sont les partenaires violents.
Ce sont les agresseurs.
Et dans l'immense majorité des cas, ce sont des hommes.
Les données sont sont claires :
Au Québec, environ 77 % des auteurs présumés de violence conjugale sont des hommes.
Pour les agressions sexuelles, 96 % des auteurs sont des hommes.
À l'échelle du Canada, pour les féminicides, la quasi-totalité des auteurs sont des hommes.
Et aujourd'hui, les violences se vivent aussi en ligne : la cyberviolence, majoritairement commise par des hommes, frappe de plus en plus fort et vise surtout les femmes, les filles et les personnes marginalisées.
Aujourd'hui, on se souvient aussi des quatorze jeunes femmes tuées lors de la tuerie de la Polytechnique. Quatorze femmes qui ont été ciblées parce qu'elles étaient des femmes.
On les nomme, pour qu'elles restent présentes avec nous, dans notre mémoire collective et dans notre lutte :
Geneviève Bergeron
Hélène Colgan
Nathalie Croteau
Barbara Daigneault
Anne-Marie Edward
Maud Haviernick
Maryse Laganière
Maryse Leclair
Anne-Marie Lemay
Sonia Pelletier
Michèle Richard
Annie St-Arneault
Annie Turcotte
Barbara Klucznik-Widajewicz
Solidarité internationale
En 2025, au Québec seulement, nous sommes déjà à 16 féminicides.
Seize vies volées.
Seize de trop.
– Une femme dont l'identité est inconnue a été assassinée le 11 novembre 2025 à Ste-Julienne.
– Une femme dont l'identité est inconnue a été assassinée le 1er octobre à Saint-Charles-sur-Richelieu.
– Nathalie Côté, tuée le 22 septembre à Normétal.
– Gabie Renaud, tuée le 7 septembre à St-Jérôme.
– Mylène Masson-Bessette, tuée le 30 mai à Sherbrooke.
– Jeanine Durocher, tuée le 22 mai à Québec.
– Patricia Lynda Thériault, tuée le 16 mai à Lachute.
– Simone Mahan, 45 ans, tuée le 14 mai à Châteauguay.
– Lyne Fournel, 62 ans, tuée le 7 mai à Granby.
– Nellie Tullaugak-Wilson, 79 ans, tuée le 21 avril à Puvirnituq
– Denise Wagner, 79 ans, tuée le 16 mars à Longueuil.
– Luuku Luukku, 38 ans, tuée le 13 février à Puvirnituq.
– Ginette Bélanger, 71 ans, tuée le 13 février à Boucherville.
– Lisa Marie Rytar, 42 ans, tuée le 23 janvier à Québec.
Je vous invite maintenant à prendre une minute de silence en mémoire des 16 féminicides survenus cette année, et en solidarité avec toutes les victimes de violences.
Pensée pour toutes les femmes qui vivent en zone de conflit — celles qui fuient, celles qui restent, celles qui protègent leurs enfants avec presque rien, celles qui enterrent leurs proches, celles qui continuent de résister alors que tout s'effondre autour d'elles. Leur courage nous rappelle la force des femmes, et c'est cette force qui continue d'alimenter nos luttes, nos solidarités et notre refus collectif de baisser les yeux.
Notre lutte ne s'arrête pas aux frontières du Québec. La violence patriarcale est mondiale, et notre solidarité l'est aussi.
Aujourd'hui, on tient à souligner particulièrement la résistance des femmes du mouvement Femmes, Vie, Liberté, qui continuent de se battre avec un courage immense pour leurs droits, leur dignité et leur liberté. Leur lutte résonne ici, avec nous, et nous marchons avec elles, symboliquement et politiquement.
*********
Mélanie Pelletier
Resposable de la condition féminine
Conseil Central de Québec Chaudière Appalaches (CSN)
Aujourd'hui, on dénonce les violences que subissent les femmes. On ne se le cachera pas, la violence est partout et de plus en plus présente. Nous avons qu'à regarder sur les réseaux sociaux, c'est tellement violent ce qui s'y dit. Et les femmes sont en grande partie ciblées, imaginez les femmes syndicalistes. Voici un exemple de commentaire haineux envers des femmes syndicalistes qui prennent la parole « couché tapis la vagin pis retourne dans tes chaudrons, une vraie dépravée sans classe, folles. » Ce sont des exemples très récents. Pis pour vrai, c'est le reflet de la société qui va mal. Et pourquoi ça va mal ? Ben en grande partie parce que le gouvernement de la CAQ fait des choix politiques qui sont violents et qui touchent principalement les femmes. Je ne suis pas gênée de le dire : la CAQ n'aime pas les femmes.
Pourquoi je me permets de dire cela :
1- Les compressions et le sous-financement chronique, notamment des réseaux de l'éducation, de la santé et des services sociaux, touchent principalement les femmes d'abord comme travailleuses, mais aussi comme utilisatrices.
2- Le durcissement des lois sur la « laïcité », surtout dans les CPE et les écoles primaires et secondaires, touche surtout des femmes et attaque de front leur droit au travail en pleine pénurie de personnel.
3- Les attaques antisyndicales qui visent surtout les femmes. Déjà, on l'oublie souvent, mais les femmes sont majoritaires dans le mouvement syndical québécois. Ce sont majoritairement des femmes qui ont fait la grève et pris la rue dans les dernières années (Front commun du secteur public, grève des enseignantes, CPE, hôtellerie, etc.).
Le système est tellement violent envers les femmes qu'elle les amène tranquillement à ne plus pouvoir faire de choix.
Prenez les places en CPE : présentement 63 % des femmes doivent allonger le congé parental, faute de places, elles sont obligées de rester à la maison. Elles sont devant un non-choix. Prenons le PL3 en lien avec les cotisations syndicales, et la loi 14, celle qui restreint le droit de grève : c'est carrément une façon de nous faire taire et de nous faire disparaitre, de ne plus écouter ce que nous avons à dire. Bref on n'aura pas le choix de se conformer, sans avoir le droit de revendiquer et de lutter.
Aujourd'hui, le conseil central est ici en appui au RGF, avec le camion ainsi que le système de son. Si la CAQ réussit à faire passer les projets de loi antisyndicaux, à long terme ça ne sera plus possible qu'on soit là en appui et avec vous dans la rue. C'est inacceptable et c'est tout le mouvement féministe qui va en écoper. Aujourd'hui, on fait front contre les violences systémiques que le gouvernement inflige aux femmes !
En terminant, je veux souligner l'arrivée d'un nouveau syndicat à la CSN. C'est un milieu de travail où des femmes travaillent pour aider d'autres femmes et présentement, elles ne l'ont pas facile. Donc à toutes les travailleuses du Centre femmes aux 3A de Québec, nous sommes avec vous. Ne lâchez pas !
Sororité !
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les minables

Chaque jour pour des milliers de femmes dans le monde c'est l'horreur, c'est le 6 décembre, date où l'on se souvient de 14 étudiantes québécoises assassinées par un homme parce qu'elles étaient femmes. Une date gravée dans la chair de nos mémoires.
Chaque jour dans le monde, des femmes sont tuées, violées, excisées, brûlées, lapidées, génocidées, battues, vendues, réduites, niées. Des femmes privées de leurs enfants à jamais. Des femmes traitées comme butin de guerre, comme ressources reproductives, comme corps disponibles, consommables, effaçables. Des femmes que l'on ne pleure même plus, que l'on compte.
Et quand on compte, la vérité fait trembler. 840 millions de femmes. Oui. Huit-cent-quarante millions. C'est le nombre estimé de femmes ayant subi des violences physiques ou sexuelles au cours de leur vie. Presque une sur trois. Un continent entier de souffrance.
316 millions de femmes violentées rien que l'an dernier. Des coups, des viols, des menaces, des cicatrices qu'aucun tribunal ne verra jamais. 316 millions. Presque l'équivalent de la population des États-Unis.
Environ 50 000 femmes tuées par un conjoint, un père, un frère, un fils, en un an. 137 par jour. Une toutes les 10 minutes. Dix minutes, le temps de lire ce texte, une femme aura été tuée par quelqu'un qui disait l'aimer. Parfois même par quelqu'un que la société lui ordonnait d'honorer.
Et pourtant, on s'émeut un jour, on oublie le suivant. On accuse individuellement, on pathologise, on psychologise. On dit, c'est un monstre, un minable. Non. Ce serait trop facile.
Ces hommes ne tombent pas du ciel ni des enfers. Ils poussent sur un sol. Ils germent dans des mentalités. Ils se nourrissent d'un système, d'une culture, d'un silence. Ils apprennent très tôt que leur colère vaut plus que la vie d'une femme. Et tant que l'on refuse de nommer ce sol, de labourer ce terrain, l'horreur repoussera. Encore.
Ce ne sont pas seulement des hommes minables. Ce sont des sociétés minables qui fabriquent les minables. Des éducations minables. Des excuses minables. Des lois minables. Des interventions minables. Des préventions minables. On condamne l'individu pour se rassurer, mais rarement, pour ne pas dire jamais le terreau qui l'a produit.
Parce que les morts ne tombent pas du ciel. Parce que les coups ne surgissent pas de nulle part. Parce que la haine se construit. Alors oui, indignons-nous. Pas pour un jour. Pas pour un hashtag. Pour chaque femme déjà tombée, et pour celles qui tomberont demain si nous restons confortablement silencieux.
Parce qu'on n'a pas besoin de pleurer les femmes. On doit les protéger, les croire, les entendre, les défendre, les libérer. On doit cesser de traiter l'horreur comme une fatalité. On doit cesser de croire que l'indignation est un excès, elle est un devoir.
À la mémoire des 14 femmes québécoises tuées le 6 décembre 1989.
À la mémoire des 50 000 femmes tuées chaque année. À la mémoire de toutes celles qu'on n'a pas su compter.
Pour que cesse enfin l'ère des minables !
Mohamed Lotfi
6 Décembre 2025
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« Je hais les féministes » : Retour sur le massacre de l’École Polytechnique de Montréal le 6 décembre 1989

Le 6 décembre 1989 vers 16h, un homme entre à l'École Polytechnique de Montréal. Dehors, il neige à gros flocons. C'est la fin de session. Il s'installe dans un bureau au 2e étage de l'institution universitaire. Une heure plus tard, il entre dans une classe de génie mécanique. Fait sortir la cinquantaine d'hommes présents et demande aux neuf femmes qui restent si elles savent pourquoi elles sont là.
Tiré de campagnerosa.quebec
Alix Parent
Elles ne le savent pas. Il rétorque « je combats le féminisme ». Une étudiante, Nathalie Provost répond « Écoutez, nous sommes juste des femmes étudiant l'ingénierie, pas forcément des féministes prêtes à marcher dans les rues criant que nous sommes contre les hommes, juste des étudiantes cherchant à mener une vie normale. » La réponse n'est pas satisfaisante. Il réplique : « Vous êtes des femmes, vous allez devenir des ingénieures. Vous n'êtes toutes qu'un tas de féministes, je hais les féministes. » Il ouvre le feu.
Avant de se suicider, une vingtaine de minutes plus tard, il tue quatorze personnes. Toutes des femmes. Parce qu'elles étaient des femmes.
Suite à la tuerie de Polytechnique, on cherche à comprendre ce qui s'est passé. On critique l'intervention policière – en fait, la police n'est entrée dans l'École qu'après le suicide du tireur. Encore une fois, on psychanalyse post-mortem le tueur. Plusieurs groupes féministes tentent de faire valoir qu'il s'agit clairement d'un geste anti-féministe. Le tueur l'a dit lui-même avant de tirer. Il l'a écrit dans lalettre qu'on a retrouvé sur lui. Celle-ci était assortie d'une liste de 19 femmes qu'il voulait tuer – parce qu'elles étaient – et sont encore – féministes.
Au Québec, il y a eu de nombreux débats sur la nature du massacre de Polytechnique. Selon Hélène Charron, historienne, trois thèses principales sont débattues. Premièrement, il s'agit d'un geste isolé, perpétré par un fou. Un crime isolé qui n'a aucune portée politique. Une seconde mouvance reconnait qu'il s'agit d'un attentat féministe, lui accordant la portée politique et symbolique qu'un tel geste porte. Et, enfin, la dernière thèse blâme les femmes qui ont osé bouleverser l'ordre normal des choses et les rôles traditionnels selon le genre. Les bouleversements sociaux engendrés par les avancées menées par les femmes de la classe ouvrière auraient créé une crise de la masculinité et – selon cette théorie clairement masculiniste – les vraies victimes seraient les hommes qui ont perdu tous leurs repères.
Il aura fallu trente ans pour qu'on reconnaisse enfin qu'il s'agissait bel et bien d'un féminicide, ancré politiquement et socialement dans une mouvance masculiniste qui a pris de l'ampleur depuis 1989. Trente-cinq ans plus tard, la thèse masculiniste reste donc bien présente dans la société. Certains groupes masculinistes ont fait du tireur un héros, qui a osé faire valoir la place des hommes dans une société soit-disant matriarcale. Il va sans dire que le 6 décembre 1989 a marqué les esprits au Québec.
Polytechnique aujourd'hui
Les discours antiféministes liés à Polytechnique sont en corrélation avec une montée de la droite idéologique au Canada. Dès 2012, le gouvernement conservateur de Stephen Harper a détruit le registre des armes à feu créé en 1995 suite aux revendications des survivantes et des proches de la tuerie de Polytechnique. Les attaques contre la classe ouvrière se multiplient : le droit à l'avortement est constament remis en question ; les femmes et filles autochtones sont encore les plus discriminées dans l'État canadien.
On constate d'ailleurs la montée d'un pseudo-féminisme de droite au Québec, incarnée par une organisation islamophobe et transphobe. Ce groupe est financé en grande partie par la Coalition Avenir Québec (CAQ) , le parti au pouvoir. Ces discours, faits sous le voile de la bienveillance, s'inscrivent dans une logique du contrôle du corps des femmes et de leur place dans la société. En effet, sous prétexte de protéger les femmes et les enfants, certains groupes veulent interdire les toilettes non-genrées et limiter les droits des personnes trans. Leurs positions politiques sont empruntes de sexisme, d'homophobie, de racisme et d'islamophobie.
L'attentat de Polytechnique a été analysé, décortiqué et disséqué depuis trente-cinq ans. La société québécoise cherche à donner du sens à cette tuerie, sans jamais vouloir s'attaquer aux sources fondamentales de l'antiféminisme. Les discours de droite ont une forte tendance à blâmer un autre groupe minorisé pour les problèmes qui affectent la classe ouvrière. Le laïus antiféministe n'échappe pas à cette logique bien ancrée dans le capitalisme.
Le 25 novembre, Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, s'ouvrent les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. Au Québec, de nombreuses activités sont organisées par différentes organisations et groupes, des plus réactionnaires aux plus radicaux. Pourtant, selon un rapport de L'Observatoire canadien du fémicide pour la justice et la responsabilisation (OCFJR), de 2019 et 2022, le nombre de féminicides au Canada a augmenté de 20%. 36% des victimes sont des femmes autochtones alors qu'elles ne représentent que 5% de la population canadienne. Force est de constater que la pandémie de COVID-19 a exacerbé les inégalités déjà bien présentes dans l'État canadien. Les pouvoirs publics ont lancé un plan d'action qui vise, principalement, à venir en aide aux victimes. C'est essentiel de mettre tout en œuvre pour que les femmes puissent avoir accès aux ressources qui leur permettront de s'en sortir. En effet, depuis la pandémie, les refuges débordent et le sous-financement des ressources d'aide reste un problème structurel.
Le constat s'impose : malgré cette apparente volonté de régler une fois pour toutes la violence genrée, la situation ne s'améliore pas. La violence faite aux femmes est rendue possible parce que, dans le système capitaliste, les femmes sont perçues comme inférieure. En effet, le mythe bien ancré de la famille « traditionnelle » encourage les femmes à se consacrer à des tâches non rémunérées – ou moins bien rémunérées – et liées au soin des autres. Pour les féministes socialistes, le combat contre la violence faite aux femmes est étroitement imbriqué dans la lutte de classe.
La classe ouvrière ne peut tolérer ni les violences de genre ni les autres oppressions inhérentes au système capitaliste – que ce soit la misogynie, la transphobie, les lgbtphobies, le racisme… Ces différentes attaques sont nécessaires aux puissants et servent à nous diviser pour détourner notre attention de nos véritables ennemis communs : le capitalisme, le patriarcat, le colonialisme… L'instrumentalisation de ces violences par la droite doit donc être dénoncée avec force.
Combattre ces idées réactionnaires et revendiquer des solutions pour permettre de paver le chemin vers l'émancipation des femmes de la classe ouvrière fait partie intégrante de notre lutte.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Cible de réduction des GES : 13 organisations exigent une feuille de route à Québec

Québec, 4 décembre 2025 – Après que le ministre Bernard Drainville a reconnu mardi l'existence d'un « consensus » en faveur du maintien de l'ambition climatique du Québec, une coalition regroupant 13 organisations lance un message clair au gouvernement : il est temps de passer à l'action.
- « Le ministre a raison : le consensus existe. Nous saluons sa lucidité. Maintenant, le Québec a besoin de savoir comment il compte l'honorer concrètement. L'incertitude coûte cher à l'économie et au climat. Nous avons besoin d'une décision claire quant à notre trajectoire d'ici la fin de l'année. »
Au terme des auditions publiques sur la révision de la cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre, un constat s'impose : reculer n'est pas une option. Si le niveau d'ambition recommandé varie entre les différentes parties prenantes, aucune ne propose de le diminuer. Au contraire, elles s'entendent sur le besoin de planifier le plus tôt possible la transition souhaitée de manière concertée.
« Si le Québec veut demeurer un acteur fiable, cohérent et engagé sur la scène internationale, il ne peut tout simplement pas reculer. Chaque jour sans trajectoire claire, ce sont des entreprises qui hésitent, des investissements reportés, des emplois qui risquent d'être perdus ou qu'on ne crée pas, des projets qui stagnent », rappellent les organisations signataires.
Une ambition partagée, une transition juste à bâtir
« Une cible n'est pas grand-chose sans plan pour l'atteindre, et on reconnaît que la mise en œuvre est la partie la plus difficile. C'est précisément pour ça qu'il faut faire cette transition avec les travailleurs et travailleuses, ainsi qu'avec les communautés. Atteindre notre cible de 2030 restera une utopie tant que notre approche ne sera pas ancrée dans les principes de la transition juste. Heureusement, les gens sont prêts », ajoutent les organisations.
Il y a à peine quelques semaines, dans le contexte des élections municipales, 81 % des gens ont estimé qu'il est important que leur municipalité agisse pour lutter contre les changements climatiques.
L'inaction coûte plus cher que l'action
Pour les organisations signataires, le discours alarmiste sur les coûts de l'action climatique, mis de l'avant par le ministre Drainville lors des audiences, manque de fondement.
« Ses propres fonctionnaires ont démontré, dans le document de consultation, que maintenir la cible actuelle représenterait un effort collectif de 9 milliards de dollars d'ici 2030, soit seulement 1,4 % du PIB québécois », avancent-elles.
En comparaison, les pertes économiques liées aux impacts climatiques au Canada devraient atteindre 25 milliards de dollars par année dès 2025, pour dépasser 100 milliards d'ici 2055, sans compter la disparition potentielle de 500 000 emplois. Au Québec, l'année 2024 a été la plus coûteuse de son histoire en termes de pertes assurables liées aux phénomènes météorologiques extrêmes ; la tempête Debby a entraîné, à elle seule, des dommages de 2,7 milliards de dollars.
« Ce n'est plus un secret : la crise climatique nous coûte cher, et ce n'est que le début. L'équation est simple : on peut investir dès maintenant dans la transition ou subir des pertes catastrophiques. Les moyens existent, mais on décide de s'en passer en détournant plus de 1,8 milliard du FECC qui n'attendent qu'à être investis », concluent les organisations.
Pour rappel, en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement et au terme de sa démarche de consultation, le gouvernement doit annoncer si les cibles actuelles de 2030 et de 2050 sont maintenues, renforcées ou affaiblies d'ici la fin de l'année.
Organisations signataires
Alliance TRANSIT ; Association québécoise des médecins pour l'environnement (AQME) ; Centre d'études et de recherches intersectorielles en économie circulaire (CERIEC) ; Équiterre ; Fédération des travailleuses et travailleurs du Québec ; Mobilité Électrique Canada ; Nature Québec ; Pierre-Olivier Pineau, professeur titulaire, Chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC Montréal ; Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec (RNCREQ), Réseau action climat Canada ; Réseau Environnement ; Réseau de recherche en économie circulaire du Québec (RRECQ) ; Vivre en Ville
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Bilan environnemental 2025 : une dérive autoritaire est-elle en marche ?

Montréal, le 8 décembre 2025 – Des organisations et groupes environnementaux font front commun pour tirer la sonnette d'alarme : l'année qui vient de s'écouler marque un tournant inquiétant pour la démocratie environnementale au Québec et au Canada. Sous prétexte « d'accélération économique », les gouvernements multiplient les mesures législatives qui affaiblissent les lois et les contre-pouvoirs, marginalisent la science et réduisent la participation citoyenne.
Un recul démocratique préoccupant au Québec
Au cours de la dernière année, une accumulation inédite de projets de loi fragilisant l'État de droit a été constatée, notamment par l'utilisation du bâillon, le dépôt d'omnibus et l'élargissement du pouvoir discrétionnaire du gouvernement. Parmi les exemples les plus préoccupants, on peut citer le projet de loi 69 (énergie), le projet de loi 97 (régime forestier), le projet de loi omnibus 81, le projet de loi 93 (Stablex), le projet de loi 7, et le récent projet de loi constitutionnelle.
Mis ensemble, ces textes traduisent une tendance lourde d'effritement de l'État de droit et d'affaiblissement des garde-fous démocratiques.
« Quand un gouvernement limite les débats, contourne ses propres lois, s'attaque à la légitimité scientifique, réduit les contre-pouvoirs et renforce la concentration de pouvoir entre les mains de quelques personnes, ce sont les fondements même de notre démocratie qui sont attaqués ».
L'environnement également mis sur le banc des sacrifiés par le fédéral
Les organisations dénoncent une rhétorique gouvernementale qui oppose constamment l'environnement au développement économique et qui sous-entend que les normes environnementales sont un “fardeau”, un même fil rouge qui se dessine au niveau fédéral, notamment avec l'adoption du projet de loi C-5 et le dépôt du projet de loi C-15 (loi budgétaire), actuellement discuté au Parlement canadien.
Les organisations rappellent que la démocratie, la science et les lois environnementales ne sont pas des obstacles pour le Québec, mais bien des fondations essentielles pour le bien-être collectif et pour une économie qui soit véritablement résiliente et soutenable. Lorsque les lois deviennent optionnelles, les atteintes à l'environnement et plus largement à la protection des droits de la population et des premiers peuples deviennent inévitables.
Les organisations appellent les gouvernements du Québec et du Canada à suspendre les mesures législatives qui affaiblissent le droit environnemental, à respecter les droits des peuples autochtones, à rétablir la place de la science dans les processus décisionnels, à encourager la participation citoyenne et démocratique, et à protéger les principes qui sous-tendent le respect de l'État de droit.
Les organisations environnementales invitent la population, les élu·es, les médias et les institutions à se mobiliser pour préserver la démocratie, la protection de l'environnement et le respect des savoirs et de la science, devenus des parties intégrantes de nos valeurs sociétales fondamentales.
« L'environnement, c'est le canari dans la mine. Si nous ne travaillons pas tous et toutes ensemble pour contrer cette dérive autoritaire, elle continuera de faire d'autres victimes au nom de la sacro-sainte croissance économique. »
Liste des signataires
Alain Branchaud, directeur général, Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec)
Geneviève Paul, directrice générale, Centre québécois du droit de l'environnement (CQDE)
Alice-Anne Simard, directrice générale, Nature Québec
Thibault Rehn, coordonnateur, Vigilance OGM
André Bélanger, directeur général, Fondation Rivières
Sabaa Khan, directrice générale, Fondation David Suzuki (Québec)
Karel Ménard, directeur général, Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets
Martin Vaillancourt, directeur général, Regroupement national des Conseils régionaux de l'environnement du Québec (RNCREQ)
Rébecca Pétrin, directrice générale, Eau Secours
Marc-André Viau, directeur des relations gouvernementales, Équiterre
Chantal Levert, coordonnatrice générale, Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE)
Chloé Tremblay Cloutier, coordonnatrice développement et partenariats, Réseau Demain le Québec
Louis Couillard, responsable de la campagne climat-énergie, Greenpeace Canada
Gabrielle Spenard-Bernier, co-directrice, Mères au front
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Climat Québec dépose un mémoire audacieux :une Constitution initiale et transitoire pour fonder la République du Québec

Montréal, le mercredi 3 décembre 2025 – Dans la foulée du début des consultations générales sur le PL 1 concernant une constitution pour la province de Québec, Martine Ouellet cheffe de Climat Québec rend public le mémoire de Climat Québec.
Le parti y met en lumière les limites inhérentes à toute constitution provinciale subordonnée à la Constitution canadienne et propose une voie résolument indépendantiste : l'adoption d'une Constitution initiale et transitoire de la République du Québec, véritable acte fondateur d'un Québec souverain.
« Le Québec n'a pas besoin d'une constitution provinciale qui nous rattache encore au cadre canadien et même s'y soumet. Il a besoin d'un outil d'émancipation. Avec la publication du projet de Constitution initiale et transitoire de la République du Québec, nous posons le premier geste concret vers la création de la République du Québec, un geste ancré dans la démocratie, la justice climatique et la volonté du peuple. » Martine Ouellet, cheffe de Climat Québec
Cette Constitution initiale et transitoire, inspirée du projet présenté en 2016 alors préparé en collaboration avec des experts reconnus : le constitutionnaliste André Binette, l'ancien secrétaire général Louis Bernard et l'ancien ministre Gilbert Paquette a été adaptée à l'urgence climatique ainsi qu'à la démarche d'accession à l'indépendance de Climat Québec, qui s'appuie sur la légitimité électorale et parlementaire pour déclarer l'indépendance. Elle serait suivie d'un vaste processus participatif menant à la rédaction et à l'adoption, par référendum, d'une Constitution permanente.
Une proposition structurante et démocratique
Dans son mémoire, Climat Québec démontre que toute constitution provinciale demeure limitée par la Constitution canadienne et qu'elle revient, de fait, à en reconnaître la suprématie. Pour sortir de cette impasse, le parti propose une démarche claire, cohérente et démocratique pour établir un véritable État républicain, structuré autour de :
Une Constitution initiale et transitoire de la République du Québec, adoptée par l'Assemblée nationale à majorité des députés qui constitut une déclaration d'indépendance ;
Une Assemblée constituante indépendante parcourant toutes les régions du Québec pour élaborer la Constitution définitive et permanente de la République du Québec ;
Une Constitution définitive et permanente de la République du Québec, soumise au peuple par référendum.
Un exercice pour le peuple, pas pour l'image
Climat Québec critique également le caractère fermé et partisan du processus constitutionnel proposé par le gouvernement de la CAQ. Le parti insiste sur l'importance d'un véritable exercice démocratique impliquant la population de toutes les régions et fondé sur l'équité, la transparence et la participation citoyenne.
À propos de Climat Québec : Climat Québec est un parti politique indépendantiste dédié à la justice climatique qui propose que l'État de la République du Québec prenne toutes ses décisions à travers le prisme du climat dans une perspective d'équité sociale et économique.
Mémoire de Climat Québec sur le PL1 sur la Constitution de la province du Québec soumis à la Commission des institutions.
CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU MÉMOIRE (VERSION PDF)
SOURCE :
climat.quebec
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Censurer les syndicats : ce que cela aurait donné pour le réseau des garderies

Le réseau québécois de services de garde n'existerait pas si une loi semblable à la « loi Boulet » avait été en vigueur durant les années 1970-1980. À tout le moins, si ce réseau avait réussi à se développer, il serait passablement moins progressiste qu'il ne l'est devenu. Voilà l'essentiel de ce que ce petit texte souhaiterait ajouter aux nombreuses voix visant à empêcher que cette loi entre un jour en vigueur, dont les milliers de personnes ayant manifesté la semaine dernière. 1
D'abord un peu d'histoire pour situer le sujet.
Contrairement à la rengaine continuellement tenue dans les grands médias, Pauline Marois n'est pas la mère du réseau québécois de garderies : ce serait comme dire qu'un gynécologue est le père de tous les nouveaux nés dont il a coupé le cordon ombilical ! Ce projet social a été initié par une coalition informelle de groupes populaires, de groupes féministes, de personnes du milieu de l'éducation, mais également, aussi surprenant cela soit-il pour messieurs Boulet et Legault de l'apprendre, par des centrales syndicales dont aucune cotisation n'avait été votée expressément à cet effet, ni par référendum ni autrement. Si une pareille obligation avait alors existé, ainsi que veulent aujourd'hui l'imposer ces deux bouffons, non seulement cela aurait-il énormément compliqué la tâche des syndiquées qui promouvaient ce projet social, mais il est fort probable qu'une bonne partie de leurs collègues (surtout parmi les hommes, bien sûr) auraient refusé qu'une partie de leurs cotisations serve à en faire la promotion, à une époque où le modèle « mères à la maison » prévalait encore. C'est donc un tout petit nombre de personnes sensibles à cet enjeu (des femmes surtout, bien sûr) qui ont progressivement réussi à le faire cheminer de bas en haut dans les structures syndicales de l'époque, principalement via leurs comités de condition féminine. Ceux-ci se sont mis à organiser des activités d'information auprès des autres syndiquées, auprès de la population en général et auprès des politiciens, pour faire connaître ce surprenant projet qu'avaient initié des groupes populaires dans certains quartiers dits « défavorisés » d'une quinzaine de villes de la province : mettre sur pied un réseau de garderies financées par l'État mais contrôlées par les usagers. En 1972, cette idée a été endossée par le congrès de FTQ, puis par celui de la CEQ en 1973 et par celui de la CSN l'année suivante.
Les gestes combinés de tous ces organismes ont réussi à forcer le gouvernement québécois de mettre en place, en 1974, le premier programme destiné à financer en partie les services de garde : cela s'appellera le plan Bacon, du nom de la ministre des « affaires sociales » à ce moment-là.
Durant les décennies qui suivront, d'autres organisations naîtront dans ce réseau ou en appui à son développement. Des travailleuses d'un tout petit nombre de garderies sans but lucratif vont par exemple se constituer elles-mêmes en syndicats régionaux, là encore pour faire des pressions de nature ouvertement politique et non principalement pour négocier des conventions collectives puisque leurs employeurs légaux, en l'occurrence leurs conseils d'administration formés de parents, n'avaient tout simplement pas les moyens d'améliorer leurs salaires et autres conditions de travail monétaires, seul le gouvernement pouvant le faire.
Les moyens de pression variés de tout ce beau monde, parfois exercés de manière indépendante et parfois de manière concertée, forceront les gouvernements successifs, libéraux et péquistes, à construire le réseau de services de garde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Avec ses imperfections mais à tout le moins avec des bases relativement solides, du moins plus solides qu'elles ne l'étaient en 1970.
Cet exemple démontre bien que des cotisations syndicales peuvent servir à autre chose qu'à négocier des conventions collectives avec des patrons. Qu'elles peuvent même contribuer à améliorer les conditions de vie de gens qui ne paient aucune cotisation syndicale, par exemple celles de ces milliers de parents non syndiqués qui ont bénéficié des services à la petite enfance durant les cinquante dernières années. Et surtout, il démontre que si les gouvernements se mettent aujourd'hui à décréter de quoi devraient se mêler les organismes autonomes tels que les syndicats et les groupes populaires, nous ne sommes pas sortis du bois, comme disaient nos ancêtres. Les membres de tous ces organismes sont suffisamment matures pour décider de leur fonctionnement ainsi que de leurs priorités d'action. Si une situation particulière leur apparaît non démocratique, elles et ils vont trouver moyen de la corriger et ce n'est pas une nouvelle « loi du cadenas » qui va les y aider.
De la même manière, sur un autre enjeu social m'apparaissant personnellement majeur par les temps qui courent, il serait grand temps de faire comprendre à ce gouvernement, par des gestes concrets de solidarité à leur égard, que les éducatrices des CPE, ainsi que celles des garderies privées et du milieu familial, sont suffisamment matures pour savoir comment s'habiller lorsqu'elles vont travailler ! Lui faire savoir qu'elles n'ont pas besoin d'une loi quelconque pour les obliger à suivre les préférences du ministre Roberge en la matière. D'autant plus que celui-ci n'a absolument aucune preuve à l'effet qu'un seul enfant, ni au Québec ni ailleurs dans le monde, aurait demandé à ses parents de se rendre à la mosquée et encore moins de devenir membre d'un présumé Hamas international après avoir constaté que son éducatrice avait la chevelure recouverte d'un morceau de tissu. Avec de telles élucubrations, si ça continue, la CAQ et ses bouffons du roi, médias de Québecor en tête, vont décréter que la terre est plate… en invoquant que seuls les immigrants s'acharnent à l'arrondir.
S'cusez-là…
Yves Rochon, Montréal, décembre 2025
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Un an de Santé Québec : il est grand temps de mettre l’accès aux soins au cœur du réseau

Le 1er décembre 2025 marque le premier anniversaire de Santé Québec, la société d'État créée pour moderniser le réseau de santé et de services sociaux du Québec. Un an plus tard, je constate que si les bases de la nouvelle organisation sont désormais en place, l'enjeu principal consiste maintenant à centrer l'action sur ce qui fait réellement vivre le réseau : les professionnelles en soins, ainsi que la qualité, l'accessibilité et la continuité des services offerts à la population. L'objectif doit rester clair : permettre à chaque personne d'obtenir les soins dont elle a besoin, au bon moment et au bon endroit.
Lors de la création de Santé Québec, le gouvernement avait identifié quatre objectifs principaux : revenir à une gestion de proximité, améliorer l'accès aux services, être à l'écoute des usager-ère-s et mettre sur pied la nouvelle société d'État. Un an plus tard, même si la structure organisationnelle est maintenant déployée, je note comme vous que les autres objectifs exigeront encore des efforts soutenus pour se matérialiser pleinement sur le terrain.
La décentralisation promise demeure incomplète : plusieurs décisions continuent d'être prises loin du quotidien des équipes, et la multiplication des instances administratives alourdit votre travail plutôt que de le faciliter. Et pendant ce temps, les patient-e-s subissent les conséquences de cette transition. Dans plusieurs régions, l'accès aux services reste difficile : certaines chirurgies sont reportées ou annulées, et des maternités ou unités d'obstétrique doivent fermer temporairement.
Je suis aussi préoccupée de voir que, malgré sa volonté affichée de soutenir le réseau public, la privatisation continue de gagner du terrain. À la FIQ, nous le répétons avec conviction : le réseau public demeure le meilleur moyen d'assurer des soins de qualité, accessibles et à coût moindre pour la population québécoise.
La confiance des usager-ère-s et des équipes reste à bâtir. Pour y parvenir, Santé Québec devra aligner réellement ses actions sur ses missions fondamentales : vous soutenir dans votre pratique et garantir l'accessibilité de services publics de qualité.
Votre quotidien est exigeant. Vous travaillez au sein d'équipes parfois instables, avec des charges de travail lourdes et une reconnaissance qui n'est pas à la hauteur de votre expertise. Moderniser le réseau ne peut pas se résumer à centraliser le pouvoir ou à multiplier les organigrammes. Cela doit passer d'abord par la reconnaissance de votre profession, par des conditions de travail et d'exercice sécuritaires et humaines, par la stabilisation des équipes et par votre pleine participation aux décisions qui influencent la qualité des soins.
Un an après sa création, Santé Québec a l'occasion de consolider ses acquis et de progresser dans la bonne direction. Les professionnelles en soins, fortes de leur expertise du terrain, souhaitent contribuer à des solutions concrètes pour améliorer l'accès, la continuité et la qualité des soins et services.
De notre côté, à la FIQ, nous réaffirmons notre ouverture au dialogue et notre volonté de travailler avec Santé Québec. Il est grand temps d'ajuster la trajectoire, de consolider les structures mises en place et de focaliser l'action sur ce qui compte vraiment : vos équipes, les soins de proximité, l'accès universel, le refus de la privatisation et la reconnaissance de votre expertise professionnelle.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Réformer la santé : mission sociale ou logique comptable ?

Depuis la mise sur pied du RSSS au tournant des années 70, les réformes et orientations ont systématiquement été présentées sous l'angle de l'amélioration de l'accès aux soins. Pourtant, les mêmes problématiques ne cessent d'être décriées : pénurie de main-d'œuvre, attente aux urgences et difficultés d'accès à la première ligne. Qu'est-ce qui explique cette stagnation des enjeux ?
Cet article a été publié dans la première édition du magazine La Résonance
Depuis la mise sur pied du RSSS au tournant des années 70, les réformes et orientations ont systématiquement été présentées sous l'angle de l'amélioration de l'accès aux soins. Pourtant, les mêmes problématiques ne cessent d'être décriées : pénurie de main-d'œuvre, attente aux urgences et difficultés d'accès à la première ligne. Qu'est-ce qui explique cette stagnation des enjeux ?
Pour répondre à cette question, il faut en poser une autre : qu'ont en commun le virage ambulatoire du ministre Rochon et les réformes Couillard, Barrette et Dubé ? Des objectifs économiques camouflés sous des promesses d'amélioration des services à la population. L'ensemble des réformes récentes dans le RSSS se sont déployées en parallèle de grandes vagues de compressions budgétaires, qui compromettent l'atteinte des objectifs d'amélioration du réseau.
En prônant la réduction du rôle de l'État au profit de l'entreprise privée et de la recherche de rentabilité, les gouvernements peinent à honorer leurs promesses d'accessibilité et d'universalité des soins. Miser sur la performance du privé en santé, c'est accepter que le profit guide les choix et les priorités ce qui, en plus de faire des laissés-pour-compte, implique une augmentation de la charge de travail qui s'accentue depuis des décennies.
Les réformes dans le RSSS seront inefficaces tant et aussi longtemps que des objectifs économiques guideront les choix de nos décideurs. Pour qu'une réforme soit bénéfique, le seul et unique objectif doit être l'accessibilité des soins.
Centralisation
La réforme Dubé est la plus grande opération de centralisation de l'histoire du RSSS. Le gouvernement prétend mettre la gestion de proximité de l'avant en embauchant des centaines de gestionnaires de proximité et en les rendant plus imputables et accessibles.
La superstructure de Santé Québec et la révision des rôles et des pouvoirs des conseils d'administration d'établissement (CAE) ont plutôt l'effet contraire. On constate un éloignement des soins par rapport à la gestion, ce qui est très préoccupant. Il est essentiel que les besoins et les enjeux du terrain soient entendus et que les instances locales aient un réel pouvoir de décision. C'est un incontournable pour que les spécificités locales soient prises en compte, mais aussi pour assurer la qualité et la sécurité des soins offerts à la population.
Privatisation
La réforme Dubé prévoit que les services soient dorénavant fournis à la population par les établissements publics et privés, sans distinction. Le gouvernement a refusé de prioriser le réseau public et de stipuler que Santé Québec est un organisme à but non lucratif.
Une évidence s'impose : la rentabilité du secteur privé dépend du piètre état du réseau public de santé et services sociaux. En effet, plus le réseau public dépérit en raison des réformes et des compressions budgétaires, plus la population et le gouvernement recourent au privé, qui apparaît alors comme un mal nécessaire. Cependant, l'imbrication du privé dans le réseau public est extrêmement coûteuse pour l'État et pour la population qui finance les services publics par les taxes et impôts. Les entreprises privées chargent plus cher pour les mêmes services, en plus d'accaparer les ressources limitées du réseau public. La solution au problème empire donc la situation initiale. C'est un cercle vicieux.
Déprofessionnalisation
Le gouvernement de la Coalition Avenir Québec (CAQ) mise sur ce qu'on appelle la « déprofessionnalisation » afin d'élargir le bassin de personnes disponibles pour offrir certains soins ou services. En assouplissant des règlements professionnels, le gouvernement relègue certaines activités réservées à du personnel moins formé ou même aux proches des patient-e-s.
La déprofessionnalisation des soins, c'est d'abord une dévaluation de professions à prédominance féminine. Elle entraîne une perte de sens dans l'exercice professionnel, une diminution de l'autonomie et une surcharge de travail, puisque ce sont souvent les professionnelles en soins qui doivent assumer la responsabilité des activités réalisées par ce personnel.
En misant sur la déprofessionnalisation, le gouvernement fait peser le fardeau de l'accessibilité aux soins sur les épaules des professionnelles en soins et des proches. Ainsi, il se déresponsabilise de ses obligations et cela a inévitablement des impacts sur les soins et les services offerts aux patient-e-s.
Efficacité
Le gouvernement cherche à rendre le réseau public plus « performant ». Cette vision managériale des soins repose sur des indicateurs de performance décidés par le MSSS et par Santé Québec, qui sont bien loin des préoccupations des professionnelles en soins et des patient-es. L'atteinte de ces cibles se fait d'ailleurs difficilement sans affecter la qualité et la sécurité des soins.
Ce type de gestion engendre une charge de travail additionnelle pour les professionnelles en soins, qui doivent dorénavant effectuer encore plus de tâches administratives pour satisfaire les tableaux Excel des hauts dirigeants. Occupées à montrer leur performance, elles sont alors moins disponibles pour offrir des soins.
Mais quels indicateurs permettent de mesurer le réconfort, l'écoute ou l'empathie nécessaires à une prise en charge humaine et complète ? En misant sur la performance, les gouvernements invisibilisent une grande part du travail qui est pourtant essentiel au rétablissement des patientes.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Attaque au droit de grève : la FAE conteste la loi 14 devant la Cour supérieure

La Fédération et ses syndicats affiliés a déposé la semaine dernière à la Cour supérieure du Québec un recours pour contester la Loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out ou Loi 14 (avant sa sanction, il s'agissait du projet de loi numéro 89).
Selon nous, certains aspects de cette Loi sont inconstitutionnelles puisqu'ils constituent une attaque notamment à la liberté d'association protégée par la Charte des droits et libertés de la personne québécoise et la Charte canadienne des droits et libertés ainsi qu'à la liberté d'expression.
En élargissant la notion de services essentiels pour restreindre le droit de grève afin de préserver le « bien-être de la population », le gouvernement de François Legault cherche à modifier unilatéralement le rapport de force entre les personnes enseignantes et l'État, soit le patron avec qui nous négocions nos conditions de travail.
Au fil des négociations, les tribunaux ont interdit plusieurs moyens de pression puisque ceux-ci étaient susceptibles de priver les élèves et leurs parents des services auxquels ils ont droit. Au final, il ne reste que le recours à la grève comme moyen efficace pour nous permettre d'exprimer nos revendications lors de la négociation collective.
Avec cette Loi, le gouvernement cherche donc à limiter de façon significative et importante l'impact de l'exercice du droit de grève pour tous les enseignantes et enseignants du secteur public et concentre le pouvoir entre les mains du ministre du Travail. Ce dernier oublie que nos revendications concernant nos conditions de travail sont intrinsèquement liées aux conditions d'apprentissage de nos élèves. Les services d'enseignement n'ont jamais été considérés comme étant des services essentiels en droit québécois, canadien et international et cette Loi vient entraver de façon importante le droit de grève des travailleuses et travailleurs.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Entrée en vigueur de la Loi no 14 – Contestations déposées par les organisations syndicales

La FTQ, la CSN, la CSQ, la CSD et l'APTS, qui représentent ensemble plus d'un million de travailleuses et de travailleurs, annoncent le dépôt de contestations juridiques coordonnées.
TIré de l'infolettre de la CSN En Mouvement
1 décembre 2025
À peine entrée en vigueur le 30 novembre 2025, la Loi no 14, Loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out qui a été adoptée par le gouvernement de François Legault le printemps dernier, est déjà contestée devant les tribunaux. La FTQ, la CSN, la CSQ, la CSD et l'APTS, qui représentent ensemble plus d'un million de travailleuses et de travailleurs, annoncent le dépôt de contestations juridiques coordonnées.
« La Loi no 14 brime le droit de grève des travailleuses et des travailleurs, brise l'équilibre des relations de travail et remet trop de pouvoirs entre les mains du ministre du Travail. Dès le départ, nous avions prévenu que la Loi no 14 conforterait les employeurs à laisser traîner les négociations dans l'attente de l'intervention du ministre, qu'elle envenimerait les relations de travail et aurait une incidence importante sur les conflits de travail. Non seulement la Loi no 14 compromet gravement, à notre avis, les droits des travailleuses et des travailleurs, mais elle est aussi inconstitutionnelle, en plus d'être un élément toxique pour le climat social au Québec, dénoncent d'une voix commune les porte-paroles syndicaux Magali Picard (FTQ), Caroline Senneville (CSN), Éric Gingras (CSQ), Luc Vachon (CSD) et Robert Comeau (APTS).
« Nous l'avons signifié à maintes reprises : la Loi no 14 est une atteinte à l'action collective des travailleuses et des travailleurs. Elle modifie les règles du jeu unilatéralement sur de fausses prémisses. À vouloir faire taire, ce gouvernement attise la grogne. La voix que nous portons, c'est celle des membres que nous représentons. Et que le gouvernement se le tienne pour dit : ça fait pas mal de monde ! »
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Enjoindre les victimes à porter plainte et les abandonner ensuite : Le gouvernement du Québec asphyxie le CALACS Longueuil

À l'occasion de la manifestation du 20 novembre et dans diverses interventions médiatiques tenues au fil des dernières semaines, la coordonnatrice du Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) de Longueuil a lancé un signal d'alarme : il ne reçoit que 98 000 $ par année pour desservir une population d'environ 273 000 femmes et adolescentes de 14 ans et plus. Pour assurer sa mission, l'organisme aurait besoin d'au moins 450 000 $, car on ne combat pas la violence sexuelle avec des fonds de tiroirs.
par Sandrine Ricci (UQAM) et Carole Boulebsol (UQO), chercheuses spécialisées en violence sexuelle, appuyées par une centaine de collègues, intervenantes et citoyennes
Photo : S. Ricci, manifestation du 20 nov. 2025
Ce sous-financement chronique du gouvernement provincial n'a rien d'une anomalie : il témoigne plutôt du manque persistant de reconnaissance accordé au travail des femmes, et à ces organismes communautaires majoritairement portés par des femmes.
Au CALACS Longueuil, le manque de moyens engendre des conséquences lourdes, anciennes et immédiates : intervenantes débordées, heures d'ouverture réduites, services fragilisés et 64 survivantes inscrites sur des listes d'attente depuis presque 11 mois… après avoir trouvé le courage de briser le silence.
Faute de fonds, deux intervenantes ne verront pas leur contrat renouvelé et la coordonnatrice se retrouvera seule en poste dès le 1er avril, épaulée uniquement d'une intervenante chargée pour quelques semaines des ateliers de prévention dans les écoles. Ces ateliers sont essentiels pour parler de consentement et de sexualité respectueuse, mais ils ne remplacent pas l'accompagnement dont ont besoin les femmes et les adolescentes aux prises avec la violence.
Un financement dérisoire qui met en péril un service indispensable
Selon les responsables, le CALACS devra fermer ses portes s'il ne reçoit pas de nouveau financement d'ici le 31 mars 2026. Depuis les années 1970, les CALACS jouent un rôle essentiel au Québec : soutien psychosocial, accompagnement judiciaire, défense des droits, prévention et contribution à l'avancement des connaissances scientifiques. Leur existence est un pilier de la lutte contre la violence sexuelle, construit à force de mobilisation féministe.
Le rapport Rebâtir la confiance (2020), produit par un comité mandaté par le gouvernement, constatait déjà un manque de services, menant à de longues listes d'attente et, dans certaines régions, une absence pure et simple de CALACS. C'est pour répondre à cette lacune structurelle que le CALACS Longueuil a enfin été créé en 2022, grâce au travail de militantes et de bénévoles. La recommandation 3 du rapport était sans équivoque, mais cinq ans plus tard, elle demeure largement ignorée :
« Accorder aux organismes d'aide aux personnes victimes le financement nécessaire à la réduction des listes d'attente et à la bonification des services d'accompagnement psychosocial/judiciaire, et ce, dans toutes les régions du Québec. » (p. 49)
Le ministre Jolin-Barrette doit aligner ses paroles et ses actions
Depuis quelques années, Simon Jolin-Barrette se présente comme un défenseur des victimes de violence sexuelle. En 2017, en plein #MeToo/#Moiaussi, alors porte-parole de la Coalition Avenir Québec (CAQ) en matière de justice, il déclarait :
« La CAQ appuie ces victimes dans leur dénonciation. […] La société est là pour vous soutenir. [...] J'encourage les victimes à demander du support aux CALACS. »
(Point de presse, 19 octobre 2017)
Le message était clair : dénoncer est important et les CALACS sont essentiels. Mais encourager les victimes à porter plainte tout en laissant mourir les organismes censés les soutenir, c'est une incohérence politique majeure.
Encore plus troublant : inviter les victimes à se tourner vers un CALACS au seuil du bris de service revient à leur tendre une main vide. Quand les moyens ne suivent pas, les promesses deviennent des mensonges et le cynisme, la norme.
Le modèle du Programme de soutien aux organismes communautaires du Québec (PSOC), fondé sur l'« ancienneté » des organismes, place les CALACS récents tout en bas de l'échelle de ce financement public, même lorsqu'ils répondent à un besoin urgent identifié par un comité mandaté par le gouvernement. L'existence du CALACS Longueuil est menacée par ce système inéquitable, incompatible avec l'ambition de mieux soutenir, défendre et informer les femmes victimes.
Le financement du CALACS Longueuil, un test de crédibilité pour la CAQ
Si le gouvernement veut réellement :
– être cohérent avec son propre discours,
– respecter les recommandations de Rebâtir la confiance,
– mieux soutenir les personnes survivantes,
– réduire les listes d'attente dans les CALACS,
– permettre des conditions de travail décentes aux intervenantes en première ligne,
– reconnaissant la valeur, l'expertise et le rôle essentiel du travail qu'elles accomplissent,
alors il doit augmenter immédiatement et substantiellement le financement du CALACS Longueuil.
Ne pas agir, c'est renoncer à construire un Québec où la violence sexuelle est réellement combattue.
Pour ajouter votre signature à cette tribune, remplissez le registreICI
Nous vous invitons aussi à signer une pétition initiée par Diane G, une survivante : https://www.change.org/.../soutenir-la-survie-du-calacs...
#SauvonsLeCALACSLongueuil
#justicepourlessurvivantes
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.