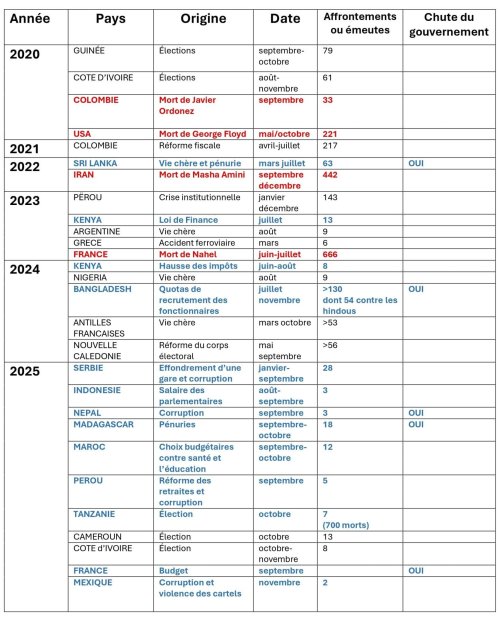Derniers articles

Los Angeles : une population migrante persécutée

Retour à la table des matières Droits et libertés, automne 2025/hiver 2026
Los Angeles : une population migrante persécutée
Johannes Prins et Mélisande Séguin, militant·es Les années 1950 évoquent souvent la montée de l’American way of life aux États-Unis, une période marquée par la prospérité économique des entreprises et une présence militaire à l’échelle mondiale. Pourtant, derrière l’image idyllique des familles blanches souriantes à la télévision, les communautés noires, hispaniques et autochtones étaient largement invisibles et traitées comme des populations excédentaires ne bénéficiant que du strict minimum en matière de droits, et souvent encore privées du droit de vote[1]. Alors que les banlieues se développaient pour incarner le soi-disant rêve américain, des communautés entières ont été déplacées et leurs maisons rasées. À l’époque, Los Angeles, une ville souvent décrite comme une terre où tout est possible (« land of opportunity »), connaissait une transformation rapide, mais cette croissance s’accompagnait de profondes contradictions et inégalités. [caption id="attachment_22309" align="alignnone" width="731"] Crédit : Mélisande Séguin[/caption]
Bien que les États-Unis aient envahi et annexé la moitié nord du Mexique en 1848, cette histoire a été rapidement effacée de la conscience nationale. Les populations hispanophones, qui faisaient autrefois partie intégrante de ces terres, ont soudainement été considérées comme étrangères dans leurs propres villes. Elles ont été reléguées au rang de main-d’œuvre bon marché et, dans de nombreux cas, contraintes de quitter leurs chez-soi. Les personnes immigrantes mexicaines et le Mexique lui-même ont été présentés comme des envahisseurs dans un nouveau récit, perpétué par Hollywood qui, à l’époque, produisait des films comme Davy Crockett at the Alamo (Disney, 1955) pour aider à façonner l’opinion publique.
Cet effacement historique a jeté les bases de la construction du Dodger Stadium à Los Angeles en 1959, symbole à la fois de la croissance de la ville et de ses injustices profondément enracinées. Ce stade a été construit sur le terrain de Chavez Ravine, qui abritait 1800 familles hispanophones[2]. D’abord attirées par des offres manipulatrices visant à leur faire vendre leurs propriétés, elles furent finalement expulsées de force par les adjoints du shérif.
Cet épisode continue de résonner aujourd’hui, s’inscrivant dans un long historique de violences, de détentions et de déportations visant certaines communautés depuis longtemps, comme on le sait. Reste que le deuxième mandat de Trump à la présidence du pays constitue une étape alarmante. En juin 2025, le Dodger Stadium est devenu un centre d’opérations de ICE. Son personnel, lourdement armé, a utilisé ce site comme point de départ pour des raids visant les communautés latino-américaines, une brutale démonstration de la marginalisation continue, de l’expulsion et de la criminalisation qui affectent ces communautés dans la région.
Nos esprits étaient empreints de cette histoire douloureuse lorsque nous sommes allé·es à Los Angeles en juin dernier. Poussé·es par un sentiment d’urgence et de colère, nous avons participé à des rassemblements contre l’ICE et avons cherché à mieux comprendre la situation. Dès notre arrivée, nous avons été frappé·es par le silence écrasant qui régnait. Une courte promenade dans le centre-ville nous a permis de découvrir des fenêtres recouvertes de contreplaqué et un calme inquiétant dans les rues. Nous avons reçu une alerte sur nos téléphones nous informant d’un couvre-feu en vigueur à 22 heures. Pour nous, qui n’avions vu Los Angeles que dans les films, la réalité qui s’offrait à nous était à mille lieues de nos attentes.
Crédit : Mélisande Séguin[/caption]
Bien que les États-Unis aient envahi et annexé la moitié nord du Mexique en 1848, cette histoire a été rapidement effacée de la conscience nationale. Les populations hispanophones, qui faisaient autrefois partie intégrante de ces terres, ont soudainement été considérées comme étrangères dans leurs propres villes. Elles ont été reléguées au rang de main-d’œuvre bon marché et, dans de nombreux cas, contraintes de quitter leurs chez-soi. Les personnes immigrantes mexicaines et le Mexique lui-même ont été présentés comme des envahisseurs dans un nouveau récit, perpétué par Hollywood qui, à l’époque, produisait des films comme Davy Crockett at the Alamo (Disney, 1955) pour aider à façonner l’opinion publique.
Cet effacement historique a jeté les bases de la construction du Dodger Stadium à Los Angeles en 1959, symbole à la fois de la croissance de la ville et de ses injustices profondément enracinées. Ce stade a été construit sur le terrain de Chavez Ravine, qui abritait 1800 familles hispanophones[2]. D’abord attirées par des offres manipulatrices visant à leur faire vendre leurs propriétés, elles furent finalement expulsées de force par les adjoints du shérif.
Cet épisode continue de résonner aujourd’hui, s’inscrivant dans un long historique de violences, de détentions et de déportations visant certaines communautés depuis longtemps, comme on le sait. Reste que le deuxième mandat de Trump à la présidence du pays constitue une étape alarmante. En juin 2025, le Dodger Stadium est devenu un centre d’opérations de ICE. Son personnel, lourdement armé, a utilisé ce site comme point de départ pour des raids visant les communautés latino-américaines, une brutale démonstration de la marginalisation continue, de l’expulsion et de la criminalisation qui affectent ces communautés dans la région.
Nos esprits étaient empreints de cette histoire douloureuse lorsque nous sommes allé·es à Los Angeles en juin dernier. Poussé·es par un sentiment d’urgence et de colère, nous avons participé à des rassemblements contre l’ICE et avons cherché à mieux comprendre la situation. Dès notre arrivée, nous avons été frappé·es par le silence écrasant qui régnait. Une courte promenade dans le centre-ville nous a permis de découvrir des fenêtres recouvertes de contreplaqué et un calme inquiétant dans les rues. Nous avons reçu une alerte sur nos téléphones nous informant d’un couvre-feu en vigueur à 22 heures. Pour nous, qui n’avions vu Los Angeles que dans les films, la réalité qui s’offrait à nous était à mille lieues de nos attentes.
La manière Trump
S’il y a la « manière Trump », cela ne date pas d’hier que l’on parle « d’étrangers illégaux » (illegal aliens) dans la législation américaine sur l’immigration pour désigner qui vient de l’étranger et n’est pas admis·e officiellement. Cela inclut les personnes entrées au pays sans avoir été contrôlées à un point d’entrée ou celles entrées légalement, mais qui ont dépassé la durée de validité de leur visa ou enfreint les conditions de leur statut légal et se trouvent donc sans papiers, non autorisé·es. L’administration Trump s’est fixé comme objectif d’expulser 3000 personnes par jour à l’échelle du pays[3], consacrant d’énormes ressources à la militarisation des services de contrôle de l’immigration et démonisant à tort et à travers ses cibles. Six mois après son élection, l’impact de ses politiques s’est fait sentir à Los Angeles. Les agent·es de l’ICE ont commencé à arrêter des personnes en fonction de leur couleur de peau et de leur langue, souvent dans la précipitation et sans vérifier leur statut migratoire, générant un climat d’incertitude et de peur parmi la population chicana et latino-américaine naturalisée. Depuis le début de la campagne de déportation de Trump, plusieurs personnes détenant un statut conforme à la loi de l’immigration américaine ont été détenues et, dans certains cas, déportées[4]. Le National Immigration Law Centre a d’ailleurs publié un article encourageant les migrant·es ayant la résidence permanente (la fameuse « Green Card ») à s’informer sur leurs droits. Entre autres, le groupe indique que les gens ayant des affiliations politiques ou des propos contraires aux positions du gouvernement pourraient être ciblés par l’administration Trump[5]. Alors que l’ICE intensifiait ses raids, la communauté latino-américaine, qui compose près du tiers de la population de Los Angeles, était en proie à la panique et vivait dans un climat de peur. Les entreprises employant du personnel migrant étaient ciblées et les quartiers devenaient des lieux de surveillance constante. Des manifestations ont éclaté dans toute la ville, rassemblant des milliers de personnes qui réclamaient le départ de l’ICE. En représailles, le gouvernement américain a déployé 4000 membres de la Garde nationale et 700 Marines pour intimider les gens, remettant ainsi en cause l’autonomie de la Californie sur son propre territoire. Le tollé que cela a suscité l’a toutefois contraint de réduire cette présence un mois plus tard[6]. Plusieurs des politiques de Trump sont contestées devant les tribunaux par des juges progressistes qui les estiment inconstitutionnelles. Malgré ces efforts pour limiter la violence envers la population, les effets de la répression sur le terrain sont dévastateurs. De nombreuses personnes ont été contraintes de se cacher chez elles, et de nombreux lieux de travail, en particulier ceux dépendant d’une main-d’œuvre latino-américaine, se sont retrouvés vides, aggravant une précarité déjà grande, les plus vulnérables étant les plus touché·es. Rappelons que les forces policières qui patrouillent à Los Angeles sont déjà fortement militarisées. Leur présence est très visible. Alors que nous étions dans le métro en direction du centre-ville, six agents de police ont fait irruption dans notre wagon à Crenshaw en annonçant de manière agressive « This is the LAPD! » ; ils ont ensuite exigé de voir les billets de jeunes hommes de couleur tout en ignorant les autres personnes. À un autre moment, à bord d’un autobus en direction d’un rassemblement dans le quartier Paramount, nous avons été témoins de l’arrestation d’un jeune homme noir devant un café par plusieurs agents. Immédiatement, les passager·es ont commencé à demander en espagnol s’il s’agissait de l’ICE ou du département du shérif. Lorsqu’il est devenu évident qu’il s’agissait « seulement » de la police, mais une police portant ses uniformes ainsi que des vêtements civils et des équipements militaires, les gens ont repris leur trajet, en silence. Partout dans la ville, les bâtiments du gouvernement fédéral étaient encerclés par des militaires portant des armes d’assaut.Une vague de résistance
[caption id="attachment_22478" align="alignright" width="350"] Crédit : Mélisande Séguin[/caption]
Malgré le climat oppressant, cette démonstration abusive de pouvoir a déclenché une vague de solidarité locale et internationale. Alors que des familles migrantes sont contraintes de rester chez elles, des réseaux d’entraide se créent et leur permettent d’accéder à de la nourriture et à d’autres produits de première nécessité sans risquer l’arrestation. Des collectes de fonds ont été organisées pour soutenir les familles qui ne peuvent se permettre de rester sans travail pendant de longues périodes. Dans les quartiers à majorité latino-américaine, les actions vont des fêtes de quartier au travail de plaidoyer dans les conseils municipaux, créant ainsi un front uni dans la lutte contre cette déshumanisation et cette violence d’État. Comme nous l’a confié une organisatrice locale, l’entraide est une bouée de sauvetage qui permet de sauver des vies en cette période critique.
Crédit : Mélisande Séguin[/caption]
Malgré le climat oppressant, cette démonstration abusive de pouvoir a déclenché une vague de solidarité locale et internationale. Alors que des familles migrantes sont contraintes de rester chez elles, des réseaux d’entraide se créent et leur permettent d’accéder à de la nourriture et à d’autres produits de première nécessité sans risquer l’arrestation. Des collectes de fonds ont été organisées pour soutenir les familles qui ne peuvent se permettre de rester sans travail pendant de longues périodes. Dans les quartiers à majorité latino-américaine, les actions vont des fêtes de quartier au travail de plaidoyer dans les conseils municipaux, créant ainsi un front uni dans la lutte contre cette déshumanisation et cette violence d’État. Comme nous l’a confié une organisatrice locale, l’entraide est une bouée de sauvetage qui permet de sauver des vies en cette période critique.
Alors que des familles migrantes sont contraintes de rester chez elles, des réseaux d’entraide se créent.Ailleurs dans la ville, des groupes locaux ont lancé diverses initiatives pour résister à la présence de l’ICE. L’Unión del Barrio, un groupe militant de base, aide à identifier des agent·es de l’ICE et partage leur description sur les réseaux sociaux afin de prévenir la population migrante. Leur objectif est de les intercepter avant les raids. Devant les hôtels où séjournent les forces de l’ICE, des militant·es font du bruit pour perturber leur repos et sensibiliser le public à leurs actions. Aux quatre coins de Los Angeles et au-delà, les gens se rassemblent avec un message clair : « ICE, vous n’êtes pas les bienvenus ici ».
Leçons tirées de Los Angeles
Nous avons passé cinq jours à Los Angeles, où nous avons rencontré des organisateur·ices locaux, participé à des rassemblements et travaillé à la création de réseaux de solidarité pour soutenir les groupes communautaires. Nous avons cherché à comprendre la situation complexe qui se déroulait sous nos yeux. Ce que nous avons vu aux États-Unis nous a profondément inquiété·es quant à ce qui pourrait nous attendre chez nous. Même si le Québec et le Canada ne sont pas encore confrontés à des politiques aussi agressives que celles de l’administration Trump, des dynamiques d’exclusion, de dépossession et de violence sanctionnée par l’État à l’encontre des communautés marginalisées existent et sont troublantes de similitude. Les mesures en matière de laïcité qui limitent les droits des minorités au travail et à l’éducation, celles visant à réduire l’immigration, la montée de la rhétorique xénophobe dans les médias grand public, démontrent que le racisme et la xénophobie ne se limitent pas aux États-Unis. Les luttes des communautés migrantes partout dans le monde doivent être considérées comme faisant partie d’un combat plus large et mondial.[1] « History of Voting : Latinx Community and Voting » [en ligne]. [2] Sur ce sujet, lire Jovanni Perez, « The Los Angeles Freeway and the History of Community Displacement », The Toro Historical Review, 2017, vol. 3, no 1, [en ligne]. [3] Lire American Immigration Council, « Mass Deportation : Analyzing the Trump Administration’s Attacks on Immigrants, Democracy, and America », 2025, [en ligne]. [4] Leila Jackson, « Migrants in U.S. legally and with no criminal history caught up in Trump crackdown », PBS News, 28 mars 2025, [en ligne]. [5] National Immigration Law Center, « Green Card Holders : Know Your Rights & Risks During the Second Trump Administration », 16 septembre 2025, [en ligne]. [6] Thomson Reuters, « Pentagon ends weeks-long deployment of U.S. Marines to Los Angeles », CBC News, 21 juillet 2025, [en ligne].
L’article Los Angeles : une population migrante persécutée est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.
Chronique du gars en mots dits : Deuils nationaux

Fiertés et résistances – présentation du dossier

Retour à la table des matières
Droits et libertés, automne 2025/hiver 2026
Fiertés et résistances
Delphine Gauthier-Boiteau et Stéphanie Mayer,
membres du CA de la Ligue des droits et libertés
Ce dossier paraît dans un contexte de précarisation des droits humains des personnes qui dérogent à l’ordre hétérocisnormatif. Ce terme, issu des études queers, éclaire la manière dont les rapports de pouvoir normant les sexualités, les genres et les corps des personnes s’imbriquent avec d’autres systèmes de domination – notamment le patriarcat, le colonialisme et le capitalisme racial. Autrement dit, l’« hétérocisnormativité » correspond à un système reposant sur un ensemble normatif qui se rattache à l’expression du sexe, du genre et des désirs. Les règles de conduite implicites ou explicites qui en découlent, en ce qu’elles fixent les contours du normal et de l’anormal, sont intimement liées aux structures sociales, aux institutions ainsi qu’aux rapports de domination et aux régimes de pouvoir qui les traversent. C’est à partir de ce cadre que ce dossier aborde l’existence, la réalisation et la mise à mal des droits des personnes qui dérogent à ces normes, se prenant en plein visage, dans leur corps et leur cœur, le ressac actuel.
Vous constaterez la diversité des termes employés dans les textes – «queer», «gais et lesbiennes», «LGBTQ+», «LGBTQIA2S+» – pour aborder ces enjeux de droits. Notre comité éditorial a choisi de respecter la volonté des auteur·ices à cet égard et de conserver ces expressions auto-identificatrices variées, même si elles ne sont pas interchangeables.
Au Québec, évoquer un ressac contre les droits humains LGBTQ+ n’a rien d’exagéré. Malgré des avancées aussi imparfaites que significatives, les droits obtenus ont permis aux personnes dissidentes des normes hétérocisnormatives de gagner en dignité, de se sentir respecté·es et même d’exister avec fierté, peut-être, l’espace d’un moment. Nous assistons à une montée de l’extrême droite et à un glissement faisant en sorte que des idées fascisantes deviennent ou redeviennent plus acceptables au sein de la population. Les personnes LGBTQ+ figurent parmi les premières cibles des discours ultraconservateurs, nationalistes et masculinistes produisant des paniques morales dont les personnes migrantes, racisées, pauvres, vivant avec des enjeux de santé mentale ou un handicap font aussi les frais.
Le cadre hétérocisnormatif proposé plus haut est utile pour comprendre comment la précarisation des droits des personnes LGBTQ+ se déploie dans un contexte plus large de politiques autoritaires qui font reculer les droits des minorités, quelles qu’elles soient. En filigrane de cette droitisation se profilent les désastres amorcés et à venir liés à une crise écologique reposant sur la «colonialité du pouvoir», comme le conceptualise le sociologue péruvien Aníbal Quijano, c’est-à-dire sur l’imposition d’un pouvoir voulant toujours aller au-delà et en dehors de lui-même. Notre cadrage hétérocisnormatif rappelle ainsi l’imbrication de l’impérialisme, de la suprématie blanche, du patriarcat, du capitalisme racial et une organisation sociale dont les logiques extractives, expansives et binaires sont reproduites.
Des droits humains à défendre
On constate au Québec, ces dernières années, l’adoption de lois bafouant les principes des droits humains et les protections prévues dans les chartes canadienne et québécoise. L’importante dégradation des conditions socio-économiques de vie des personnes menace directement les droits humains qu’il faut toujours concevoir comme étant indivisibles et interdépendants. Sous la gouverne de François Legault, soulignons l’adoption de dispositions législatives – trop souvent sous bâillon – attentant directement aux droits, en plus du recours répété aux clauses dérogatoires. Cette approche culmine avec le projet de loi 1 (PL1), déposé le 9 octobre 2025, qui prétend imposer une « Constitution » du Québec sans processus constituant et qui affaiblit les droits et libertés sous prétexte de souveraineté parlementaire. Le PL1 constitue une attaque frontale des contre-pouvoirs (judiciaires, communautaires, syndicaux, organismes indépendants, etc.) qui permettent de se prémunir des dérives autoritaires.
Au regard de l’État québécois, l’article de Léo Lecomte explique bien que la réponse caquiste au « jugement Moore » n’est pas si positive qu’on l’imagine et que le gouvernement actuel continue de prendre des décisions à l’encontre des droits des personnes trans. Les possibilités pour les personnes queers de faire famille autrement sont entravées par la non-reconnaissance de la pluriparenté, affirment pour leur part Sophie Parent et Kévin Lavoie. Les politiques menées ont des conséquences bien concrètes sur les corps et la sécurité des personnes, qu’il s’agisse des personnes trans incarcérées, comme l’aborde Samuel Bernard, ou de celles luttant pour l’accès aux soins de santé, la démédicalisation et le respect de l’autonomie corporelle, comme en traite Judith Lefebvre.
Certains textes du dossier adoptent le cadre des droits LGBTQ+ pour réfléchir sur les appropriations libérales de certaines revendications, de même que sur la mobilisation et l’instrumentalisation de discours féministes et queers par des groupes nationalistes. Zev Saltiel discute du pinkwashing qui tapisse la propagande de l’État d’Israël dans le contexte du génocide du peuple palestinien. Diane Lamoureux montre comment l’homo et le fémo nationalismes entraînent d’importantes dérives au sein des mouvements LGBTQ+, tandis que Laurence Gauvin-Joyal et Djemila Carron rompent avec la rhétorique libérale canadienne, en dévoilant ce qui se cache sous le couvert du libéralisme et conduit à la reproduction d’un État straight.
Dans le contexte de droitisation actuel, Céleste Trianon décrit une partie de la nébuleuse des groupes actifs contre les personnes trans au Canada ainsi que leurs allié·es, documentant les attaques et les luttes menées sur le front juridique. En ce qui concerne les jeunes, prenant appui sur un récent rapport du Groupe de recherche en intervention sociale de Montréal, Alexis Graindorge, Amélie Charbonneau et Olivier Vallerand apportent une compréhension empirique de ce qui se joue dans les écoles et décrivent les effets du déplacement à droite des discours sur les diversités de genre et les sexualités.
Dans un entretien, Josu Otaegi Alcaide met en exergue les réalités de personnes migrantes au Québec, plusieurs fuyant les persécutions subies dans leur pays d’origine en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Christian Djoko Kamgain témoigne de la criminalisation et de la stigmatisation des personnes appartenant à la diversité sexuelle en Afrique de l’Ouest et du Centre, qui compromettent l’efficacité des réponses à l’épidémie de VIH/sida. L’article de Fabrice Nguena brosse un portrait des personnes queers d’origine africaine ou afro-descendantes, proposant un devenir afroqueer.
D’ailleurs, nombre de textes du dossier font écho à la nécessité de se rassembler pour créer des présents et des devenirs autres. Des espaces physiques sont mis en place autour du besoin de (re)connaître la mémoire militante, les résistances passées et les personnes qui les ont portées. Les textes d’Iain Blair des Archives gaies du Québec et d’Antoine Vogler de la librairie Mes Pants de Queer témoignent de la puissance des solidarités émergeant dans ces lieux grâce aux personnes qui leur donnent vie et qui y participent, établissant des ponts entre le passé et l’avenir. De manière similaire, le projet précurseur de la Maison des RebElles, dont nous parle Lise Moisan en entrevue, montre comment les solidarités lesbiennes et entre femmes permettent d’éviter le risque de retours dans le placard aux personnes vieil-lissantes devant changer de résidence. Puis, relatant l’expérience qu’a constituée l’organisation de la conférence « Toward Trans Joy and Justice », Belen Blizzard et Mar Ibrahim réfléchissent aux espaces éphémères contribuant à l’émergence de savoirs non académiques et à l’expression d’un pouvoir de création, de résistance et de libération.
Souhaits de solidarités à incarner
Nous chérissons le souhait que les sujets abordés dans les différents textes instruisent sur des enjeux peut-être méconnus et sensibilisent à des réalités nouvelles présentées dans toute leur complexité. Nous espérons aussi qu’ils toucheront les cœurs, incitant à faire un pas de côté, pour accueillir les différences et la pluralité, pour aimer véritablement. Mais aussi, qu’ils témoigneront de la nécessité d’une convergence, de l’impératif de ne pas penser en vase clos (ce qui s’observe sur divers fronts) et de l’étendue des solidarités à bâtir, à incarner et à porter. Voilà le socle de nos aspirations solidaires, actuelles et à venir. En dépit des multiples luttes à mener et des menaces de toutes parts, nous sommes convaincues que les solidarités politiques contre les forces réactionnaires – et la fierté d’agir collectivement qu’elles procurent – sont les seules voies d’avenir pouvant nous conduire vers des mondes de demain plus vivables.
L’article Fiertés et résistances – présentation du dossier est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

Nouveau numéro : Fiertés et résistances

[caption id="attachment_22313" align="alignleft" width="394"] Illustration : Isadora-Ayesha Lima[/caption]
Illustration : Isadora-Ayesha Lima[/caption]
Nouveau numéro!
Hiver 2025 / Printemps 2026
Au Québec comme ailleurs, dans un contexte de montée de l'extrême droite, les attaques contre les droits des personnes queer et LGBTQ+ se multiplient - menaçant parfois leur existence même. Elles s'intriquent à d'autres formes d'oppression, entraînant des expériences particulières de stigmatisation, notamment pour les personnes migrantes et/ou racisées.
Ainsi, sur plusieurs fronts, des luttes se poursuivent. Un regard critique s'impose sur de prétendues avancées des droits LGBTQ+, qui n'en sont pas toujours. L'homo ou le fémo nationalisme et le pinkwashing doivent être compris à l'aune des logiques impérialiste, raciale et capitaliste qui se trouvent à leur racine, pour être contrés. En dépit de l'instrumentalisation à des fins politiques des luttes et revendications des mouvements, joie et inspiration émergent dans des espaces de mémoire, de partage, de création et de libération.
Le recul des droits des un·es étant toujours le recul des droits des tous·tes, nous espérons que ce dossier non seulement vous informe sur ces enjeux, mais surtout qu'il nourrisse de nouvelles solidarités.
Bonne lecture !
Procurez-vous la revue Droits et libertés!
MembreDevenez membre de la LDL et recevez les deux numéros de Droits et libertés gratuitement chaque année! Achat
Numérique (PDF) : 8 $
Imprimée incluant livraison : 11 $ incluant les frais de poste Abonnement
Abonnez-vous à deux numéros : 15 $ pour un abonnement individu ou 30 $ pour un abonnement organisation.
* Les articles sont mis en ligne de façon régulière. *
Dans ce numéro
Éditorial
La stigmatisation des immigrant·es, une déshumanisation à combattreAurélie Lanctôt
Laurence Guénette
Chroniques
Un monde sous surveillance
À Ottawa, un empilage inquiétant de projets de loisAnne Pineau
Le monde de l'environnement
Loi C-5 : quelles conséquences pour la démocratie, l'État de droit et l'environnement ?Me Ann Ellefsen
Ailleurs dans le monde
Los Angeles : une population migrante persécutéeJohannes Prins
Mélisande Séguin
Un monde de lecture
Incursion en Iran au cœur d'un mouvement féministeCatherine Guindon
Dossier principal
Fiertés et résistances
Présentation
Fiertés et résistancesDelphine Gauthier-Boiteau
Stéphanie Mayer
Dossier
Défendre les droits LGBTQ+ comme droits humainsDiane Lamoureux Pinkwashing : pas de quoi être fièr·es !
Entretien avec Zev Saltiel
Propos recueillis par Charlotte Vallée Gagnon Brève histoire de la construction juridico-politique d'un État straight
Djemila Carron
Laurence Gauvin-Joyal Droits des personnes trans : quelles avancées ?
Léo Lecomte Trans sous attaque
Céleste Trianon La libération transféministe commence là où le pouvoir des médecins finit
Judith Lefebvre Enjeux LGBTQ+ : une panique morale qui se sent dans les écoles
Alexis Graindorge
Amélie Charbonneau
Olivier Vallerand En prison, où devraient aller les personnes transgenres ?
Samuel Bernard À quand la reconnaissance des familles pluriparentales au Québec ?
Sophie Parent
Kévin Lavoie Au service des personnes LGBTQ+ migrantes
Entretien avec Josu Otaegi Alcaide
Propos recueillis par Catherine Caron Réalités afroqueers au Québec
Fabrice Nguena Épidémie de VIH/sida et homophobie en Afrique de l'Ouest et du Centre
Christian Djoko Kamgain Pour ne pas retourner dans le placard
Entretien avec Lise Moisan
Propos recueillis par Diane Lamoureux Archives gaies du Québec : le désir d'évoluer avec son temps
Iain Blair Mes Pants de Queer : un espace de mobilisation et de mémoire
Antoine Vogler Regard sur la conférence « Towards Trans Joy and Justice »
Belen Blizzard
Mar Ibrahim
Reproduction de la revue
L'objectif premier de la revue Droits et libertés est d'alimenter la réflexion sur différents enjeux de droits humains. Ainsi, la reproduction totale ou partielle de la revue est non seulement permise, mais encouragée, à condition de mentionner la source.
L’article Nouveau numéro : Fiertés et résistances est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

Éditorial – La stigmatisation des immigrant·es, une déshumanisation à combattre

Retour à la table des matières Droits et libertés, automne 2025/hiver 2026
Aurélie Lanctôt et Laurence Guénette, respectivement membre du CA et coordonnatrice de la Ligue des droits et libertés Au début du mois d’octobre, on apprenait que le ministre québécois de l’Immigration, Jean-François Roberge, songeait à limiter les prestations d’aide sociale aux demandeur·euses d’asile à une durée de neuf mois, en plus de sabrer l’aide aux familles et aux mineur·es non accompagné·es. Un mémoire présenté au Conseil des ministres détaillait d’autres économies de bouts de chandelle que l’on envisageait de réaliser sur le dos des demandeur·euses d’asile : accès réduit à l’aide juridique, aux titres de transport en commun, aux services de francisation. Des broutilles, en somme, à l’échelle du budget de l’État, mais qui procurent un soutien essentiel aux personnes qui s’installent ici, ce type de mesures contribuant directement à l’exercice de plusieurs de leurs droits et libertés. Le gouvernement Legault menace depuis plus d’un an de réduire progressivement le « panier de services » offert aux demandeur·euses d’asile, sous prétexte que le Québec ferait déjà plus que sa part en matière d’accueil. La stratégie est simple : on annonce des coupes dans les services pour envoyer un message à Ottawa et exiger une répartition soi-disant plus équitable des demandeur·euses d’asile à travers le Canada. De plus, on diminue les seuils d’immigration sur la base de la « capacité d’accueil », un concept flou, purement arbitraire et dépourvu d’assise empirique. Les mesures mises de l’avant par le ministre de l’Immigration repoussent les limites de la mesquinerie, d’autant plus que l’empressement à réduire le soutien offert aux personnes en demande d’asile survient à un moment singulier. En effet, pour les premiers mois de l’année 2025, on constate une baisse générale de leur nombre à l’échelle canadienne (données du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale) et une diminution de 60 % des demandes d’aide sociale déposées par ces personnes. Qu’à cela ne tienne, on suggère de couper à la fois dans les mesures de soutien de première ligne et dans l’aide de dernier recours – ce qui représente un montant dérisoire pour l’État. Ces propositions, avant tout idéologiques, s’inscrivent en droite ligne avec la prolifération des discours anti-immigration, qui se sont intensifiés de manière frappante tout au long du dernier cycle électoral. Depuis 2022, les personnes immigrantes et demandeuses d’asile ont été blâmées sans relâche pour tous les maux de la société québécoise par le gouvernement Legault. L’idée que le Québec serait « trop généreux » envers elles a le dos large. On enfonce le clou à chaque occasion. On les a blâmées pour le manque de places en garderie, pour le « poids » qu’iels exercent sur l’ensemble des services publics, pour la pénurie de logements (en dépit de données démontrant que le manque de logements abordables est avant tout le résultat de décennies de politiques sur le logement indifférentes à la condition des ménages locataires), pour le recul du français, pour la hausse des signalements à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ). On a poussé la note jusqu’à les pointer du doigt pour leur contribution aux accidents de la route! En somme, on a dépeint ces personnes comme représentant une menace tant pour la prospérité et le bien-être de la population que pour les « valeurs québécoises », en particulier l’égalité et la laïcité. Il suffit d’un peu de recul historique pour constater que la stratégie n’est pas neuve. L’idée que les personnes immigrantes constituent une menace pour la paix et l’ordre social, pour les valeurs ou pour l’économie traverse l’histoire des politiques migratoires au Canada. Des immigrant·es « voleurs de jobs » d’hier aux familles immigrantes d’aujourd’hui qui « surchargent les services publics » et s’accaparent des logements, la continuité d’une même idéologie – marquée par le racisme et le sentiment de supériorité des sociétés occidentales – est claire. Or, ces discours sont d’une dangerosité extrême, parce qu’ils alimentent le racisme systémique – l’islamophobie en particulier – et banalisent ses manifestations, des plus frontales aux plus subtiles. Plus largement, ces discours accélèrent les reculs sur le plan des droits : on s’attaque d’abord aux plus vulnérables, puis on élargit – en invoquant la nécessité de défendre le « Nous » face à une menace extérieure (largement fantasmée et fabriquée). Les entorses aux droits des individus prennent alors des airs de vertu. À ce sujet, le tout récent projet de loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec (Projet de loi 1) est un cas d’école. Élaboré en l’absence de toute démarche démocratique, ce projet mal nommé prétend renforcer l’autonomie du Québec et affirmer les droits collectifs de la nation québécoise. Dans les faits, il a pour effet principal d’ébranler l’édifice des droits et libertés au Québec. Dans sa mouture actuelle, il subordonne les droits fondamentaux protégés par la Charte québécoise au principe de « souveraineté parlementaire » alimentant le détournement idéologique qui consiste à faire croire que les droits des individus sont un obstacle à l'exercice démocratique, alors qu'ils constituent en réalité un rempart contre les dérives autoritaires. En plus de limiter la portée de la Charte québécoise et de la déclasser dans la hiérarchie des lois du Québec, le projet entend confisquer un pouvoir considérable à la société civile, en empêchant une série d’organisations recevant des fonds publics de contester la constitutionnalité des lois portant sur les « caractéristiques fondamentales » du Québec. Ces dernières demeurent abstraites, à définir, selon le bon vouloir du législateur. En soi, c'est inquiétant, mais on devine aussi la teneur de ces « caractéristiques fondamentales » : elles se définissent surtout en opposition à un·e « Autre » dont il faudrait se protéger. En arrière-plan, ce discours est alimenté par une nouvelle vague d’austérité : puisque l'ensemble des ressources et des services se raréfient, peut-on vraiment se permettre de partager ? Là encore, la stratégie n'est pas neuve. Elle détourne l'attention des vraies causes des problèmes qui minent les conditions de vie de la population : le manque de logements abordables, la vie chère, l’érosion dramatique de l’égalité des chances dans l’éducation scolaire publique, le manque d’accès aux soins de santé publics de première ligne, l’insuffisance chronique et délibérée de l’aide de dernier recours… Au chapitre des attaques mesquines lancées contre les personnes immigrantes par la Coalition Avenir Québec (CAQ), plus rien n’étonne. En fait, il s’agit d’une stratégie éculée qui permet au parti de faire un maximum de gains politiques auprès de sa base pour un minimum de coûts, sans égard aux dommages causés. Le gouvernement de la CAQ stigmatise les personnes qui se trouvent souvent en situation de précarité – en nourrissant au passage la xénophobie, le racisme ordinaire et systémique, la discrimination – sans avoir trop à craindre une riposte par les urnes. La montée de la rhétorique anti-immigration, alimentée par le gouvernement actuel, s’inscrit dans un discours plus large qui tend à déshumaniser des personnes vulnérables et marginalisées. On parle des personnes immigrantes comme on parle des personnes en situation d’itinérance, ou de celles qui vivent avec des problèmes de santé mentale : avec un manque de considération pour leur dignité humaine et un mépris pour leurs droits. Or cela concerne chacun·e d’entre nous, car cette tendance à la déshumanisation est un symptôme de la dégradation des droits et libertés de tous·tes.L’article Éditorial – La stigmatisation des immigrant·es, une déshumanisation à combattre est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

Éditorial – La stigmatisation des immigrant·es, une déshumanisation à combattre

Retour à la table des matières Droits et libertés, automne 2025/hiver 2026
Aurélie Lanctôt et Laurence Guénette, respectivement membre du CA et coordonnatrice de la Ligue des droits et libertés Au début du mois d’octobre, on apprenait que le ministre québécois de l’Immigration, Jean-François Roberge, songeait à limiter les prestations d’aide sociale aux demandeur·euses d’asile à une durée de neuf mois, en plus de sabrer l’aide aux familles et aux mineur·es non accompagné·es. Un mémoire présenté au Conseil des ministres détaillait d’autres économies de bouts de chandelle que l’on envisageait de réaliser sur le dos des demandeur·euses d’asile : accès réduit à l’aide juridique, aux titres de transport en commun, aux services de francisation. Des broutilles, en somme, à l’échelle du budget de l’État, mais qui procurent un soutien essentiel aux personnes qui s’installent ici, ce type de mesures contribuant directement à l’exercice de plusieurs de leurs droits et libertés. Le gouvernement Legault menace depuis plus d’un an de réduire progressivement le « panier de services » offert aux demandeur·euses d’asile, sous prétexte que le Québec ferait déjà plus que sa part en matière d’accueil. La stratégie est simple : on annonce des coupes dans les services pour envoyer un message à Ottawa et exiger une répartition soi-disant plus équitable des demandeur·euses d’asile à travers le Canada. De plus, on diminue les seuils d’immigration sur la base de la « capacité d’accueil », un concept flou, purement arbitraire et dépourvu d’assise empirique. Les mesures mises de l’avant par le ministre de l’Immigration repoussent les limites de la mesquinerie, d’autant plus que l’empressement à réduire le soutien offert aux personnes en demande d’asile survient à un moment singulier. En effet, pour les premiers mois de l’année 2025, on constate une baisse générale de leur nombre à l’échelle canadienne (données du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale) et une diminution de 60 % des demandes d’aide sociale déposées par ces personnes. Qu’à cela ne tienne, on suggère de couper à la fois dans les mesures de soutien de première ligne et dans l’aide de dernier recours – ce qui représente un montant dérisoire pour l’État. Ces propositions, avant tout idéologiques, s’inscrivent en droite ligne avec la prolifération des discours anti-immigration, qui se sont intensifiés de manière frappante tout au long du dernier cycle électoral. Depuis 2022, les personnes immigrantes et demandeuses d’asile ont été blâmées sans relâche pour tous les maux de la société québécoise par le gouvernement Legault. L’idée que le Québec serait « trop généreux » envers elles a le dos large. On enfonce le clou à chaque occasion. On les a blâmées pour le manque de places en garderie, pour le « poids » qu’iels exercent sur l’ensemble des services publics, pour la pénurie de logements (en dépit de données démontrant que le manque de logements abordables est avant tout le résultat de décennies de politiques sur le logement indifférentes à la condition des ménages locataires), pour le recul du français, pour la hausse des signalements à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ). On a poussé la note jusqu’à les pointer du doigt pour leur contribution aux accidents de la route! En somme, on a dépeint ces personnes comme représentant une menace tant pour la prospérité et le bien-être de la population que pour les « valeurs québécoises », en particulier l’égalité et la laïcité. Il suffit d’un peu de recul historique pour constater que la stratégie n’est pas neuve. L’idée que les personnes immigrantes constituent une menace pour la paix et l’ordre social, pour les valeurs ou pour l’économie traverse l’histoire des politiques migratoires au Canada. Des immigrant·es « voleurs de jobs » d’hier aux familles immigrantes d’aujourd’hui qui « surchargent les services publics » et s’accaparent des logements, la continuité d’une même idéologie – marquée par le racisme et le sentiment de supériorité des sociétés occidentales – est claire. Or, ces discours sont d’une dangerosité extrême, parce qu’ils alimentent le racisme systémique – l’islamophobie en particulier – et banalisent ses manifestations, des plus frontales aux plus subtiles. Plus largement, ces discours accélèrent les reculs sur le plan des droits : on s’attaque d’abord aux plus vulnérables, puis on élargit – en invoquant la nécessité de défendre le « Nous » face à une menace extérieure (largement fantasmée et fabriquée). Les entorses aux droits des individus prennent alors des airs de vertu. À ce sujet, le tout récent projet de loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec (Projet de loi 1) est un cas d’école. Élaboré en l’absence de toute démarche démocratique, ce projet mal nommé prétend renforcer l’autonomie du Québec et affirmer les droits collectifs de la nation québécoise. Dans les faits, il a pour effet principal d’ébranler l’édifice des droits et libertés au Québec. Dans sa mouture actuelle, il subordonne les droits fondamentaux protégés par la Charte québécoise au principe de « souveraineté parlementaire » alimentant le détournement idéologique qui consiste à faire croire que les droits des individus sont un obstacle à l'exercice démocratique, alors qu'ils constituent en réalité un rempart contre les dérives autoritaires. En plus de limiter la portée de la Charte québécoise et de la déclasser dans la hiérarchie des lois du Québec, le projet entend confisquer un pouvoir considérable à la société civile, en empêchant une série d’organisations recevant des fonds publics de contester la constitutionnalité des lois portant sur les « caractéristiques fondamentales » du Québec. Ces dernières demeurent abstraites, à définir, selon le bon vouloir du législateur. En soi, c'est inquiétant, mais on devine aussi la teneur de ces « caractéristiques fondamentales » : elles se définissent surtout en opposition à un·e « Autre » dont il faudrait se protéger. En arrière-plan, ce discours est alimenté par une nouvelle vague d’austérité : puisque l'ensemble des ressources et des services se raréfient, peut-on vraiment se permettre de partager ? Là encore, la stratégie n'est pas neuve. Elle détourne l'attention des vraies causes des problèmes qui minent les conditions de vie de la population : le manque de logements abordables, la vie chère, l’érosion dramatique de l’égalité des chances dans l’éducation scolaire publique, le manque d’accès aux soins de santé publics de première ligne, l’insuffisance chronique et délibérée de l’aide de dernier recours… Au chapitre des attaques mesquines lancées contre les personnes immigrantes par la Coalition Avenir Québec (CAQ), plus rien n’étonne. En fait, il s’agit d’une stratégie éculée qui permet au parti de faire un maximum de gains politiques auprès de sa base pour un minimum de coûts, sans égard aux dommages causés. Le gouvernement de la CAQ stigmatise les personnes qui se trouvent souvent en situation de précarité – en nourrissant au passage la xénophobie, le racisme ordinaire et systémique, la discrimination – sans avoir trop à craindre une riposte par les urnes. La montée de la rhétorique anti-immigration, alimentée par le gouvernement actuel, s’inscrit dans un discours plus large qui tend à déshumaniser des personnes vulnérables et marginalisées. On parle des personnes immigrantes comme on parle des personnes en situation d’itinérance, ou de celles qui vivent avec des problèmes de santé mentale : avec un manque de considération pour leur dignité humaine et un mépris pour leurs droits. Or cela concerne chacun·e d’entre nous, car cette tendance à la déshumanisation est un symptôme de la dégradation des droits et libertés de tous·tes.L’article Éditorial – La stigmatisation des immigrant·es, une déshumanisation à combattre est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

Québec solidaire peut devenir l’alternative politique face aux attaques du gouvernement Legault contre la majorité populaire

Les attaques du gouvernement Legault contre la majorité populaire ne sont ni isolées ni conjoncturelles. Elles s'inscrivent dans un réalignement politique plus large, structuré par le durcissement autoritaire et impérial de la politique américaine sous Trump et par la vassalisation croissante du Canada à cette orientation.
1. Le cours prédateur et la volonté hégémonique de l'actuelle administration américaine
La nouvelle stratégie de sécurité nationale des États-Unis, fondée sur la militarisation accrue, la domination économique, le contrôle autoritaire des frontières et la défense agressive des intérêts extractifs, exerce une pression directe sur les gouvernements canadien et québécois. Ceux-ci répercutent cette orientation par un virage combinant déréglementation environnementale, répression migratoire, alignement militaire et subordination aux vœux de l'administration américaine.
La nouvelle stratégie du gouvernement américain vise : a) à « recruter, former, équiper et déployer l'armée la plus puissante, la plus redoutable et technologiquement la plus avancée » ; b) à obtenir « la dissuasion nucléaire la plus robuste, la plus crédible et la plus moderne au monde » ; c) à assurer « un contrôle total des frontières et du système d'immigration » ; d) à « veiller à ce que les économies alliées ne soient pas subordonnées à une puissance concurrente » ; e) à assurer la prospérité de la nation, ce « qui ne peut être réalisé sans un nombre croissant de familles traditionnelles et unies, qui contribuent à la naissance d'enfants en bonne santé ». [1]
2. Les conséquences sur le Québec du processus d'inféodation du Canada aux États-Unis
Au Canada, le gouvernement Carney accompagne le nouveau cours du gouvernement américain. Il a, dans un premier temps, répondu aux demandes du président Trump de durcir le contrôle des frontières et de restreindre les possibilités d'immigration sur le territoire canadien. Il a aboli la taxe carbone pour les consommateurs. Il a abandonné le plafond sur les émissions du secteur pétrolier et gazier. Il a adopté un projet de pipeline vers la côte Pacifique, torpillant les objectifs nationaux de réduction de 40 à 45 % des émissions d'ici 2030. Il a supprimé le quota minimal de véhicules électriques imposé aux constructeurs. Il a adopté le projet de loi C-5, qui permet de soustraire tout projet « d'intérêt national » aux normes environnementales. Il a planifié une augmentation massive des dépenses militaires et l'alignement de sa politique commerciale et diplomatique sur Washington, notamment dans la rivalité avec la Chine. Il a entrepris de réduire le nombre de fonctionnaires fédéraux. Ce choix transfère les coûts sociaux et écologiques vers les classes populaires, les femmes, les communautés autochtones et les territoires, tout en consolidant le pouvoir des secteurs extractifs et financiers.
3. Le gouvernement de la CAQ s'inscrit dans une orientation économique et politique marquée par le mépris des droits démocratiques et des conditions d'existence de la majorité populaire
Le gouvernement de la CAQ mène une offensive systématique contre la démocratie et les conditions de vie de la majorité populaire. Son projet de loi no 1 sur la Constitution du Québec, qu'il veut faire adopter, constitue une attaque frontale contre l'État de droit : imposé de manière unilatérale et antidémocratique, il piétine les libertés fondamentales, affaiblit les contre-pouvoirs et perpétue une logique coloniale en escamotant la reconnaissance du droit à l'autodétermination des peuples autochtones. Pendant que la population fait face à une profonde détérioration des services publics, à la crise du logement, à la hausse du coût de la vie et au creusement des inégalités sociales, le gouvernement choisit délibérément de s'en prendre aux droits plutôt que de répondre aux besoins urgents.
Cette orientation autoritaire s'accompagne d'un sabotage conscient de la transition écologique. En niant l'urgence climatique, en démantelant les protections environnementales, en contournant les garde-fous et en se proposant d'abaisser les cibles de réduction des GES, la CAQ sacrifie l'avenir collectif aux intérêts du capital. Les fonds destinés à la lutte contre les changements climatiques sont détournés pour réduire la dette, pendant que la privatisation de l'énergie est encouragée et que le gouvernement a proposé l'accaparement des territoires forestiers par les grandes entreprises, au mépris des droits autochtones. Ces derniers sont parvenus à faire reculer le gouvernement sur ce point.
Fidèle à son rôle de gouvernement au service de la classe dominante, la CAQ distribue des milliards aux multinationales et aux grands groupes industriels sans garanties ni retombées sociales ou créations d'emplois, tout en prétendant manquer de ressources pour les hôpitaux, les écoles, le logement social et la francisation. Cette logique de classe s'étend désormais à la militarisation de l'économie : en voulant faire du Québec un acteur majeur de l'industrie militaire, le gouvernement Legault veut détourner des ressources vitales de la justice sociale et de la transition écologique pour les consacrer à la production d'armes et à l'escalade militaire.
Dans le même temps, la CAQ criminalise les mouvements sociaux, attaque le droit de grève, cherche à réduire l'action syndicale à une simple gestion technocratique des conventions collectives et restreint l'accès à l'immigration et aux programmes d'intégration.
Incapable d'assumer la responsabilité de ses politiques néolibérales, d'austérité et de privatisation, le gouvernement désigne les personnes immigrantes comme boucs émissaires des crises du logement, de la santé et de l'itinérance. Sous couvert de « protection du français » et de « laïcité », il attise les divisions, normalise la discrimination — en particulier envers les personnes racisées, arabes et musulmanes — et tente de reconstruire sa base électorale sur la peur et le repli identitaire. Cette stratégie vise à masquer une réalité fondamentale : ce ne sont ni l'immigration ni la diversité qui détruisent le Québec, mais bien un projet politique autoritaire, néolibéral et antisocial qu'il est urgent de combattre collectivement.
4. La nécessaire construction d'un front commun de résistance… et la discussion sur les stratégies pour bloquer l'offensive caquiste
a) Participer à la construction d'un front uni contre les attaques du gouvernement Legault
Face à cette convergence des droites — fédérale, provinciale, économique et idéologique — aucune lutte sectorielle isolée ne peut suffire. La riposte doit prendre la forme d'un front uni des mouvements sociaux, rassemblant syndicats, groupes communautaires, mouvements féministes, écologistes, autochtones, étudiant·es et organisations de défense des droits. Ce front ne peut se limiter à une coordination ponctuelle : il doit se structurer autour d'un diagnostic commun, d'un programme de rupture et d'une stratégie visant à construire un rapport de forces capable de bloquer politiquement et socialement l'offensive en cours.
Dans ce contexte, la « grève sociale contre les politiques du gouvernement Legault » apparaît comme un outil central. La grève sociale ne doit pas être conçue comme un simple arrêt de travail, mais comme une mobilisation collective élargie qui articule le travail salarié, le travail du care, les services communautaires, les groupes féministes, les artisan·es de la culture, les minorités immigrantes et les peuples autochtones. Une grève sociale commune permet de rendre visible ce que l'État et le capital invisibilisent : sans le travail des travailleuses et travailleurs, sans les femmes, sans les communautés et sans les services publics, ni l'économie ni la société ne peuvent fonctionner. Elle permet aussi d'inscrire la lutte sur le terrain politique et démocratique.
Cette grève sociale doit porter des exigences claires : arrêt de la déréglementation environnementale, réinvestissement massif dans une transition écologique juste, défense des droits sociaux et du logement, refus de la militarisation de l'économie, respect de l'autonomie des communautés et reconnaissance des droits des peuples autochtones. Elle doit également affirmer que la crise climatique et sociale est incompatible avec le modèle extractiviste et néolibéral actuellement imposé.
Dans cette perspective, Québec solidaire a une responsabilité politique particulière. Parce qu'il est issu des mouvements sociaux, parce qu'il articule lutte contre les changements climatiques, justice sociale et démocratie, et parce qu'il refuse l'alignement sur les droites économiques et sécuritaires, Québec solidaire peut et doit se définir comme le défenseur, sur le terrain politique, de ce front uni. Non pas pour se substituer aux mouvements, mais pour amplifier leurs revendications, leur offrir une traduction institutionnelle et préparer une alternative électorale crédible face à la CAQ, au Parti libéral, au Parti québécois et à l'ensemble des forces de droite.
Cette orientation stratégique souligne que Québec solidaire ne saurait négliger l'impact de son insertion dans les mobilisations sociales pour la construction de sa crédibilité politique. Préparer les prochaines élections ne peut donc se faire indépendamment de la mobilisation sociale. Québec solidaire doit chercher à enraciner son projet de société en devenant un parti au cœur des luttes, pour participer à la construction de la grève sociale et de l'unité populaire contre les projets de la classe dominante et des gouvernements à son service.
b) Québec solidaire doit se poser comme le débouché politique incontournable de ce front uni
Si les luttes sur la scène extraparlementaire sont essentielles pour faire reculer le gouvernement Legault et les autres partis liés à la bourgeoisie, il n'en demeure pas moins qu'il faut que le camp populaire pose la question de qui doit diriger cette société s'il veut réellement en finir avec l'offensive actuelle contre ses intérêts.
Relever le défi de défendre activement le projet d'un Québec égalitaire, solidaire, féministe et inclusif ne peut se faire en laissant le pouvoir politique aux mains des partis liés à la classe dominante. S'il faut assumer une défense militante et unitaire contre « les effets dévastateurs de l'austérité caquiste, les politiques antiécologistes et les attaques contre les droits de la majorité populaire », il est tout à fait insuffisant de se contenter « d'interpeller les partis politiques et les candidat·es sur la base des propositions syndicales ou communautaires », vieille stratégie qui a démontré à maintes reprises son inefficacité.
Pour passer à l'offensive, le camp populaire doit se porter candidat au pouvoir politique. Pour parvenir à « sécuriser le revenu tout au long de la vie, à développer l'économie et à créer des emplois de qualité, à consolider les services publics, à lutter contre les changements climatiques et à renforcer la démocratie », c'est l'ordre politique lui-même qui doit être bouleversé.
Si le mouvement syndical québécois et les autres mouvements sociaux veulent assumer leur pleine liberté vis-à-vis des partis politiques liés à la classe capitaliste, nous ne pouvons pas abandonner la lutte pour le pouvoir politique à nos adversaires de classe. Ce serait s'enfermer dans une position défensive qu'il faut à tout prix dépasser pour faire face aux défis posés par l'offensive actuelle de la classe dominante.
Des militantes et militants du mouvement syndical, du mouvement des femmes et des mouvements populaires et étudiants ont lancé Québec solidaire pour défendre un projet de société visant à définir le Québec que nous voulons.
Le mouvement syndical et les mouvements sociaux peuvent, tout en préservant leur autonomie politique et organisationnelle la plus complète, dans le respect de leurs mandats démocratiques, appuyer un parti construit à partir du camp populaire pour en finir avec le pouvoir de la classe dominante et de l'oligarchie politique à son service. Mettre tous les partis politiques dans le même sac, sans discuter de la pertinence d'appuyer un parti au service de la majorité populaire, revient à esquiver des débats essentiels.
Face à l'autoritarisme, à l'extractivisme et à la militarisation, l'enjeu n'est rien de moins que la reconquête démocratique du Québec, la défense des conditions de vie de la population et l'imposition d'un projet écologique et social à la hauteur de la crise historique que nous traversons. Québec solidaire peut et doit être le débouché politique de la résistance aux politiques réactionnaires du gouvernement Legault.
c) Une plate-forme revendicative qui répond aux défis de la majorité populaire
La Commission politique a déterminé les principaux enjeux auxquels devra répondre la plate-forme électorale de Québec solidaire : « coût de la vie et redistribution de la richesse ; logement et habitation ;environnement, transition socioécologique et transports ;santé et services sociaux ;éducation ;indépendance inclusive, féminisme, vivre-ensemble et amour du Québec ; démocratie et droit du travail (lutte contre la dérive autoritaire et défense du syndicalisme) ».
Les débats autour de ces enjeux doivent viser non seulement à définir des revendications précises capables de marquer des ruptures avec les politiques du gouvernement et des partis néolibéraux, mais aussi à établir un ordre de priorité tenant compte du vécu de la majorité et de ses aspirations à améliorer ses conditions d'existence.
La plate-forme électorale devra donc assumer une orientation de lutte, centrée sur la défense des intérêts matériels de la classe ouvrière et des classes populaires, en intégrant explicitement la lutte contre la pauvreté — particulièrement celle des femmes —, la défense des services publics et la lutte contre les discriminations racistes et xénophobes. Cette plate-forme doit renforcer l'unité populaire en s'opposant aux tentatives de division fondées sur le sexisme, le racisme ou le nationalisme conservateur. Les revendications doivent jouer un double rôle : améliorer immédiatement les conditions de vie et ouvrir une dynamique de confrontation avec la classe dominante.
En adoptant la décroissance comme stratégie pour réaliser la transition, la plate-forme ciblera les secteurs économiques les plus polluants et impliquera démocratiquement les populations concernées. De plus, la décentralisation des pouvoirs de l'État vers les régions et les collectivités locales (villes, villages, arrondissements municipaux) leur donnera un véritable pouvoir décisionnel sur les aspects essentiels de la vie quotidienne.
Enfin, la défense des droits démocratiques du mouvement syndical et des organisations de la société civile impliquera d'exiger l'abrogation des lois antidémocratiques et divisives adoptées par le gouvernement de la CAQ au cours de la dernière année, et surtout le retrait du projet de loi no 1 sur la Constitution du Québec, qui vise à limiter les libertés démocratiques et à contourner une véritable démarche de souveraineté populaire.
d) Comment rallier la majorité populaire au projet d'indépendance mis de l'avant ?
Face au carcan que constitue l'État canadien pour la majorité populaire, il n'existe pas de demi-mesures. L'indépendance ne peut se réduire à une dimension identitaire ou culturelle : elle est la condition matérielle d'une rupture réelle avec un État canadien qui sacrifie le territoire, l'environnement, les services publics, les droits démocratiques et les conditions de vie des classes populaires. Sans indépendance, le Québec restera prisonnier d'un régime qui protège les profits des pétrolières, impose des politiques anti-immigration racistes, intensifie la surveillance militarisée et bloque toute transition écologique digne de ce nom.
L'indépendance proposée par PSPP n'est pas une véritable indépendance : le Québec demeurerait assujetti aux politiques de l'empire américain. « Un Québec indépendant devra aligner ses politiques économiques et militaires sur celles des États-Unis, malgré la guerre tarifaire menée par Donald Trump », affirme Paul St-Pierre Plamondon. « Il y a un contexte géopolitique et nos intérêts, au Québec, sont alignés sur ceux des États-Unis », a-t-il déclaré en dévoilant les premiers éléments de son Livre bleu sur un Québec souverain.
Cette vision de l'indépendance implique le refus de remettre en question la société néolibérale, la politique militariste imposée par Washington et le déni de la réalité des changements climatiques. Si le projet d'indépendance accepte l'alignement des politiques économiques et militaires d'un Québec souverain sur celles des États-Unis (adhésion à l'OTAN et au NORAD), il s'agit d'une indépendance néocoloniale, où la souveraineté du peuple est sacrifiée sur l'autel de l'impérialisme américain. L'indépendance du Québec devra être anti-impérialiste, ou elle ne sera pas.
Ce projet du PQ ne permettra pas de rallier une majorité de la population, car il défend un nationalisme identitaire qui divise le Québec entre un « nous » canadien-français et un « eux » étranger. Seule la perspective d'un Québec inclusif, plurinational et intégrant pleinement les Premières Nations dans la démarche indépendantiste peut jeter les bases de la construction d'une majorité pour l'indépendance. Définir l'indépendance comme un avenir indéterminé, comme le propose le PQ, prive la mobilisation indépendantiste d'un ressort essentiel : celui d'un projet de société écologiste, féministe, redistributif et véritablement égalitaire, promettant une amélioration réelle des conditions d'existence et un avenir meilleur pour la majorité populaire. Il ne s'agit pas de poser des conditions à l'indépendance, mais d'identifier les ressorts qui en font une force propulsive.
Des débats importants sont devant nous. Ils ne doivent pas se limiter aux discussions sur le contenu de la plate-forme, aussi importantes soient-elles. Ils doivent aussi porter sur les chemins que devra emprunter la résistance populaire pour bloquer les attaques contre les droits et les conditions d'existence de la majorité, faire face aux politiques de division du camp populaire et identifier les conditions de la construction d'une majorité pour l'indépendance du Québec.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

À propos du livre : Le fascisme tranquille, affronter la nouvelle vague autoritaire

Nous publions ci-dessous un intéressant échange entre Pierre Dubuc, rédacteur de l'Aut'journal et Jonathan Durand Folco à propos du livre de ce dernier, Fascisme tranquille, affronter la nouvelle vague autoritaire, livre publié aux éditions Écosociété.
À propos du livre Le Fascisme Tranquille, Pierre Dubuc
2025/11/11 | https://www.lautjournal.info/20251111/le-fascisme-tranquille
L'Autjournal
En 1977, le cinéaste Chris Maker produisait « Le fond de l'air est rouge », un film sur l'émergence d'une nouvelle gauche. Aujourd'hui, la gouvernance de Donald Trump et la montée des partis d'extrême droite inciteraient plutôt à dire que « le fond de l'air est brun ». Aussi, il faut saluer le fait que de plus en plus de livres traitent de la question du fascisme, dont celui de Jonathan Durand Folco, Fascisme tranquille. Affronter la nouvelle vague autoritaire (écosociété, 2025).
Folco soutient « l'étrange hypothèse du fascisme tranquille », qui caractériserait la société québécoise. Le Québec serait rendu à la phase 2 du « niveau émotionnel et idéologique » de « la radicalisation du complexe autoritaire », une typologie qu'il emprunte au politologue américain Robert O. Paxton. Le Québec aurait quitté la phase 1 (Le nationalisme conservateur), et le processus de radicalisation l'entraînerait vers la phase 3 (Régime autoritaire) et la phase 4 (Terreur fasciste).
L'auteur accorde beaucoup d'importance à l'aspect psychologique de la fascisation (77 pages) et énumère différents classements (les 14 signes du fascisme ; les 15 définitions de l'extrême droite ; les 6 racines de l'extrême droite ; les 4 émotions du populisme) avant de se rabattre sur la classification de Paxton.
Le Québec, seul au banc des accusés
La partie la plus intéressante du livre est celle consacrée au technofascisme aux États-Unis. Folco présente une brillante synthèse du passage des géants du web d'une idéologie libertarienne « progressiste » à une alliance avec les représentants des secteurs industriels les plus à droite dans le cadre du trumpisme (63 pages).
Mais le cœur de son livre est consacré au Québec (87 pages). Au départ, soulignons l'absence totale de chapitre sur le Canada. À peine quelques mentions dans cet ouvrage de 415 pages ! Les intellectuels anglophones nous ont habitués à des livres sur le Canada sans mention du Québec, voici un livre sur le fascisme au Canada avec seulement deux petites mentions du Convoi de la « liberté », qui a occupé Ottawa pendant la pandémie, et le nom de Pierre Poilièvre, l'émule de Trump, qui n'apparaît que trois fois ! Faut le faire !
Le Québec est seul au banc des accusés de fascisme – bien que « tranquille » – alors qu'il a bloqué, lors des dernières élections fédérales, l'arrivée de Poilièvre au pouvoir. Le Parti conservateur n'a recueilli que 23,5% des suffrages au Québec contre 44,3% en Ontario et 64,8% en Alberta. À Québec, le gouvernement Legault est certes conservateur, mais il a été élu avec une minorité de votes (40,9%) et ne recueille aujourd'hui que 16% des intentions de vote.
Le gouvernement Carney n'est mentionné que 11 fois, alors que c'est lui qui contrôle les « vrais » pouvoirs, les pouvoirs régaliens (la sécurité, la politique étrangère, la diplomatie, la défense, l'armée, la monnaie, etc.), ces pouvoirs les plus susceptibles de conduire le Canada vers les stades 3 et 4 de la grille de Paxton. Folco n'y porte aucune attention, même si le gouvernement Carney est en train de transformer l'économie du pays en économie de guerre.
L'obsession Bock-Côté
Pour Folco, le danger du fascisme vient du Québec et il cible plus particulièrement Mathieu Bock-Côté (198 occurrences), auquel il consacre un chapitre complet (33 pages). Avec raison, il présente MBC comme le chef de file de la nébuleuse conservatrice québécoise. Il décrit son cheminement politique du conservatisme de jeunesse au « populisme de droite décomplexé », lui faisant jouer le rôle d'un « pont » entre la droite et l'extrême droite, particulièrement en France.
En fait, la « pensée » de MBC n'a pas évolué. Dès 2001, il citait Charles Maurras de l'Action française dans une publication du Forum Jeunesse du Bloc Québécois, s'attirant les foudres du parti. Il a alors compris, comme il l'écrit dans Le Nouveau régime (Boréal, 2017), que, plutôt qu'une « opposition frontale », il valait mieux une « contestation dans les limites du système, en se permettant d'en repousser chaque fois les marges ». MBC a toujours campé du même côté du « pont ». Lors de l'élection présidentielle française de 2022, il a appuyé Éric Zemmour – le plus à droite sur le spectre de l'extrême droite française – dont il est toujours un des proches.
Bien sûr, il faut combattre les idées de MBC et de son entourage – et nous le faisons à L'aut'journal – mais il ne pas laisser croire que l'ensemble du Québec est sous sa coupe.
La nation
Notre divergence principale avec Folco concerne le concept de nation. Au « nationalisme ethnique », il oppose le « nationalisme civique », en faisant référence au débat, qui a lieu après la déclaration malheureuse de Parizeau. Dans ce débat, nous avons démontré dans un texte paru dans le livre Les grands textes indépendantistes (tome 2, Hexagone 2004) et dans un dossier intitulé « Sans nous qui est québécois » publié de la revue L'Apostrophe de L'aut'journal, que ce « nationalisme civique » était le cheval de Troie de la mondialisation.
Il était basé sur les Chartes des droits individuels, réduisant la nation à une simple agrégation d'individus, la coupant de ses racines historiques, de sa langue, de sa culture, de son économie spécifique, pour l'engager dans la libéralisation des échanges sans mesures de protection. André Boisclair, promoteur de ce concept dans les années post-référendaires, et que Folco salue positivement, était un néolibéral dont la source d'inspiration était Tony Blair.
Dans la présentation des objectifs politiques de Folco, le cadre national est totalement absent. Il propose, au plan économique, une société post-capitaliste fondée sur des coopératives autogérées, des systèmes d'échange non monétaires, des communautés de soin et d'entraide, des réseaux de production et de distribution autogérées, le tout dans un système politique postnational basé sur la décentralisation politique. Ce n'est là qu'une reprise du discours anarchiste classique, véhiculé par les tenants de l'altermondialisme, qui n'était que l'envers par effet miroir du néolibéralisme, avec comme caractéristique commune l'oblitération de la nation.
Les termes « classe ouvrière » et « peuple » rebutent Folco. Il propose plutôt comme sujet politique « la multitude » (un concept plus inclusif, à ses yeux) pour affronter « l'oligarchie », un terme plus « accessible » à la grande masse de la population que « capitalisme ». Ce n'est là qu'une réactualisation de la lutte contre le 1% d'Occupy.
Notre position
Pour notre part, nous croyons que le cadre national est le plus approprié pour mener la lutte contre l'extrême droite et le fascisme. Nous nous réclamons, au-delà du nationalisme ethnique ou civique, de la tradition du « nationalisme révolutionnaire » québécois, qui inclut toutes celles et ceux qui veulent participer à notre lutte de libération nationale. Nous développons cette orientation, et notre critique de thèses proches de celles de Folco, dans le carnet Cap sur l'indépendance, que nous venons de publier. Nous y soutenons que la menace de guerre sera l'enjeu principal des prochaines années et que le meilleur moyen de s'y opposer est d'affaiblir le tandem Trump-Carney en visant comme objectif l'indépendance du Québec.
Ceci étant dit, malgré nos divergences, nous sommes prêts à collaborer avec Jonathan Durand Folco et avec tous ceux qui partagent ses vues. Dans cette perspective, nous accueillons avec plaisir sa proposition d'une « gauche transversale » et trouvons fort pertinente sa critique du sectarisme de la gauche intersectionnelle. Nous devons nous unir pour faire barrage à l'extrême droite et au fascisme.
La réponse de Jonathan Durand Folco
3 décembre 2025 | Dernier texte sur Métapolitiques : Critique du fascisme tranquille
https://www.facebook.com/jonathan.durand.folco/posts/dernier-texte-sur-m%C3%A9tapolitiques-critique-du-fascisme-tranquilleje-suis-ravi-pie/26492608413672746/
Je suis ravi : Pierre Dubuc, syndicaliste et rédacteur en chef de L'Aut'Journal, a récemment publié une recension critique de mon ouvrage Fascisme tranquille. Il est en désaccord avec plusieurs de mes analyses, mais il semble saluer mon travail et manifester des points de convergence.
Cela contraste avec la plupart des réactions vis-à-vis mon livre que j'ai reçues jusqu'à maintenant, lesquelles sont souvent tranchées. D'un côté, beaucoup de gens issus de la nébuleuse conservatrice, identitaire et/ou anti-woke s'en donnent à cœur joie en dénigrant le livre simplement en raison du titre, de telle image, citation ou de ma simple présence, me qualifiant de gauchiste extrémiste ou d'autres anathèmes, et ce sans avoir lu une ligne du livre. D'un autre côté, je reçois aussi beaucoup d'éloges du camp progressiste, libéral, socialiste ou antifasciste, qui saluent mon courage, la qualité de mon ouvrage, mes prises de parole sur les médias sociaux, mais sans avoir lu le livre…
J'ai également reçu des échos très positifs de personnes sérieuses ayant lu une bonne partie ou la totalité de l'ouvrage. C'est très flatteur, et je suis heureux de voir que mes réflexions résonnent chez plusieurs personnes qui partagent le même horizon politique que moi.
Cela dit, ça me semble essentiel de recevoir des commentaires critiques sur les angles morts de mon livre, que ce soit par des gens de mon propre camp ou mes adversaires, afin de pousser la réflexion plus loin, apporter des nuances, et rectifier le tir au besoin. Dans sa recension, Dubuc salue l'importance de mon livre, tout en exprimant des critiques qui visent parfois juste. Par exemple, il écrit :
"Mais le cœur de son livre est consacré au Québec (87 pages). Au départ, soulignons l'absence totale de chapitre sur le Canada. À peine quelques mentions dans cet ouvrage de 415 pages ! Les intellectuels anglophones nous ont habitués à des livres sur le Canada sans mention du Québec, voici un livre sur le fascisme au Canada avec seulement deux petites mentions du Convoi de la « liberté », qui a occupé Ottawa pendant la pandémie, et le nom de Pierre Poilièvre, l'émule de Trump, qui n'apparaît que trois fois ! Faut le faire !"
En effet, mon livre n'aborde pas l'émergence du "fascisme tranquille" au Canada, et il aurait été utile d'ajouter un chapitre à cet effet pour éviter de donner l'impression que ce phénomène se limitait seulement au Québec. Les chefs Pierre Poilièvre et Maxime Bernier jouent un rôle clé en ce sens, et l'analyse du contexte québécois doit être liée à celle plus large du Canada et des États-Unis. Je mentionne certes le virage autoritaire de Carney qui épouse les diktats du trumpisme avec un visage libéral, mais mon analyse reste plutôt sommaire.
Cela dit, Dubuc affirme que le Québec serait "seul au banc des accusés", alors que mon introduction affirme le contraire. En fait, la montée de l'autoritarisme et de l'extrême droite affecte la vaste majorité des sociétés à travers le monde, les pays occidentaux et ceux du Sud global. Je spécifie d'emblée que j'analyse les conditions générales du néofascisme à notre époque, tout en me concentrant sur deux "études de cas" : le Québec et les États-Unis. Je ne pouvais pas aborder le cas français dans mon ouvrage, comme la plupart des pays proches de nous, faute d'espace et d'expertise. J'aurais pu certes parler de l'extrême droite au Canada, mais cela m'apparaissait comme un phénomène connexe face à la montée de la droite identitaire au Québec.
Ensuite, Dubuc me reproche de faire une "obsession" sur la figure de Mathieu Bock-Côté. Je dédie en effet un chapitre de mon livre sur son œuvre et sa trajectoire, mais cela représente à peine 33 pages sur 418, soit environ 8% du livre. Je le cite longuement ici :
"Pour Folco, le danger du fascisme vient du Québec et il cible plus particulièrement Mathieu Bock-Côté (198 occurrences), auquel il consacre un chapitre complet (33 pages). Avec raison, il présente MBC comme le chef de file de la nébuleuse conservatrice québécoise. Il décrit son cheminement politique du conservatisme de jeunesse au « populisme de droite décomplexé », lui faisant jouer le rôle d'un « pont » entre la droite et l'extrême droite, particulièrement en France. En fait, la « pensée » de MBC n'a pas évolué. Dès 2001, il citait Charles Maurras de l'Action française dans une publication du Forum Jeunesse du Bloc Québécois, s'attirant les foudres du parti. Il a alors compris, comme il l'écrit dans Le Nouveau régime (Boréal, 2017), que, plutôt qu'une « opposition frontale », il valait mieux une « contestation dans les limites du système, en se permettant d'en repousser chaque fois les marges ». MBC a toujours campé du même côté du « pont ». Lors de l'élection présidentielle française de 2022, il a appuyé Éric Zemmour – le plus à droite sur le spectre de l'extrême droite française – dont il est toujours un des proches. Bien sûr, il faut combattre les idées de MBC et de son entourage – et nous le faisons à L'aut'journal – mais il ne pas laisser croire que l'ensemble du Québec est sous sa coupe.
Je partage ici l'analyse de Dubuc, et je mentionne à la page 202 que MBC défendait déjà en 1998 "la nécessité d'une alliance entre la droite conservatrice et l'extrême droite en France, « la collaboration avec le Front national permettrait de réintégrer dans le giron républicain 15 % de l'électorat de l'Hexagone »."
Mais je souligne aussitôt dans mon livre : "Selon cette grille de lecture, Bock-Côté plaiderait depuis ses débuts pour une « union de toutes les droites », en faisant sauter le cordon sanitaire entre le conservatisme et l'extrême droite. Le ver était déjà dans la pomme, en quelque sorte. Cela dit, à la suite de cette prise de position controversée, Mathieu Bock-Côté fut marginalisé au sein des cercles souverainistes, et il dut prendre un détour pour réhabiliter progressivement un nationalisme conservateur qui allait à contre-courant de la doxa de l'époque. Autrement dit, la thèse selon laquelle Bock-Côté flirtait avec l'extrême droite française au départ n'est pas incompatible avec l'idée d'une radicalisation progressive de sa philosophie et de ses écrits, qui deviennent de plus en plus décomplexés avec le temps."
Enfin, voici un dernier point de divergence avec Pierre Dubuc qui me reproche de délaisser le cadre national au profit d'une vision altermondialiste. Il est vrai que mon livre n'adopte pas une posture nationaliste, bien que je considère que les nationalistes de gauche peuvent faire partie d'un front populaire large opposé à l'extrême droite. Mais pour Dubuc, mon projet de société visant une démocratie économique néglige complètement la question nationale. Il écrit :
"Dans la présentation des objectifs politiques de Folco, le cadre national est totalement absent. Il propose, au plan économique, une société post-capitaliste fondée sur des coopératives autogérées, des systèmes d'échange non monétaires, des communautés de soin et d'entraide, des réseaux de production et de distribution autogérées, le tout dans un système politique postnational basé sur la décentralisation politique. Ce n'est là qu'une reprise du discours anarchiste classique, véhiculé par les tenants de l'altermondialisme, qui n'était que l'envers par effet miroir du néolibéralisme, avec comme caractéristique commune l'oblitération de la nation. [...] Les "termes « classe ouvrière » et « peuple » rebutent Folco. Il propose plutôt comme sujet politique « la multitude » (un concept plus inclusif, à ses yeux) pour affronter « l'oligarchie », un terme plus « accessible » à la grande masse de la population que « capitalisme ». Ce n'est là qu'une réactualisation de la lutte contre le 1% d'Occupy."
Il est vrai que les pistes de solution vers la fin de mon livre ne tournent pas autour de la réhabilitation de la nation comme figure centrale de l'émancipation. Cela dit, il est faux d'affirmer que les termes "classe ouvrière" et "peuple" me rebutent. En réalité, je dis qu'il faut essayer de renouveler notre imaginaire politique en dépassant les idées reçues à l'endroit de la classe ouvrière, du peuple et de la nation, sans répudier ces mots pour autant. On peut par exemple réinterpréter la notion de peuple de manière processuelle et dynamique.
Le peuple peut être vu comme une "multitude" se déployant à travers l'histoire, comme lorsqu'on dit "un peuple ce n'est pas des gens tous pareils, mais des gens tous ensemble". Il faut délaisser l'idée d'un peuple ethnique homogène, au profit d'une conception large d'un peuple en mouvement, qui se redéfinit à travers l'histoire, et dont les intérêts s'opposent directement aux élites et à la concentration du pouvoir.
Outre ces divergences sur la question nationale, je salue tout de même l'ouverture de Pierre Dubuc qui souhaite converger en créant un front plus large contre l'extrême droite. Il termine son texte en disant :
"Ceci étant dit, malgré nos divergences, nous sommes prêts à collaborer avec Jonathan Durand Folco et avec tous ceux qui partagent ses vues. Dans cette perspective, nous accueillons avec plaisir sa proposition d'une « gauche transversale » et trouvons fort pertinente sa critique du sectarisme de la gauche intersectionnelle. Nous devons nous unir pour faire barrage à l'extrême droite et au fascisme."
Je critique effectivement certains excès de la "gauche intersectionnelle" et de la "gauche universaliste" dans mon livre, mais dans l'espoir de trouver des voies de passage et des points de convergence face à la droite décomplexée qui domine le paysage politique, idéologique et médiatique actuel. Malgré les divergences et les querelles de chapelles, il est temps d'élargir le front antifasciste au-delà des cercles des personnes convaincues.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le côté autoritaire du conservatisme albertain

La question de l'avancée de l'extrême droite au Canada a pris un caractère d'urgence après que la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, ait invoqué pour la quatrième fois en seulement cinq semaines la clause dérogatoire (NWC). Cette clause, qui figure à l'article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés, permet aux gouvernements fédéral ou provinciaux de suspendre temporairement certains droits garantis par la Charte. Elle a été introduite en 1982 dans le cadre d'un compromis politique visant à protéger l'autonomie des provinces, mais elle est depuis devenue un outil permettant aux gouvernements de soustraire des lois controversées à l'examen judiciaire.
https://canadiandimension.com/articles/view/the-authoritarian-edge-of-alberta-conservatism
1er décembre 2025
Au-delà de la simple lutte contre le populisme de droite et la politique réactionnaire, nous devons désormais faire face à l'utilisation de plus en plus autoritaire des outils constitutionnels pour protéger les projets politiques d'extrême droite de la critique et du contrôle des autres branches du gouvernement.
Si de nombreuses analyses institutionnelles et libérales ont été publiées dans les quotidiens et les grands médias concernant l'utilisation répétée de la NWC par Mme Smith, elles ne parviennent généralement pas à appréhender la politique régressive et réactionnaire qui est au cœur de son projet idéologique. Ce n'est pas une coïncidence – ni même une spécificité provinciale – si Mme Smith a utilisé la NWC contre les travailleurs, les travailleuses et les personnes LGBTQ+ ; en dehors du Québec, ces groupes ont été les principales cibles de cette clause.
En octobre, le gouvernement de l'Alberta a utilisé la NWC, combinée à une loi de retour au travail, pour mettre fin à la grève des enseignant·es de l'Alberta, une grève soutenue par un vote de rejet à 90 % en réponse au refus de la province et des commissions scolaires de négocier de bonne foi. La loi sur la rentrée scolaire (Back to School Act) a imposé une convention collective de quatre ans qui limitait les augmentations salariales à 3 % par an et restreignait les nouvelles embauches dans le secteur public, reflétant essentiellement l'offre que les travailleuses et travailleurs avaient déjà rejetée. Il s'agissait d'une attaque délibérée contre un syndicat spécifique, mais cela correspond également à la manière dont la NWC a été utilisée par d'autres gouvernements de droite contre le mouvement syndical dans son ensemble.
Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a utilisé la NWC pour imposer un contrat aux travailleuses et travailleurs de l'éducation du SCFP en grève à l'automne 2022, ne reculant que face à une large alliance syndicale intersectorielle et à une résistance publique généralisée. Smith et Ford ont toustes deux invoqué la nécessité de défendre les étudiant·es contre les syndicats et d'empêcher les dépenses publiques incontrôlées, revendiquant une responsabilité démocratique pour protéger leurs programmes d'austérité contre les juges et les tribunaux « interventionnistes ». Cela s'inscrit parfaitement dans la longue histoire de l'utilisation de la NWC comme arme contre les travailleuses et les travailleurs : en 1986, la Saskatchewan est devenue le premier gouvernement hors Québec à invoquer cette clause, passant outre la décision de la Cour d'appel provinciale selon laquelle la législation de retour au travail violait la liberté d'association des travailleuses et des travailleurs. Ce fut un moment charnière dans la stratégie juridique antisyndicale de l'État néolibéral.
Au-delà de ses positions politiques anti-syndicales et libertaires, Smith participe depuis longtemps aux campagnes culturelles de la droite, allant de la rhétorique sur les « droits des parents » à une politique réactionnaire plus large contre le mouvement woke. Il était presque inévitable qu'elle cherche à apaiser les mouvements sociaux conservateurs et chrétiens d'extrême droite influents de l'Alberta. Pourtant, elle a initialement affirmé qu'elle n'aurait pas besoin de recourir au NWC pour protéger sa législation anti-trans. Comme dans la plupart des gouvernements d'extrême droite, l'autoritarisme est toujours prêt à être déployé dès que cela est politiquement opportun.
Les trois projets de loi qu'elle a choisi de soumettre au NWC le mois dernier modifient la loi sur l'éducation, la loi sur l'équité dans le sport et la loi sur les professions de santé. Ensemble, ils constituent un ensemble radical de mesures d'extrême droite visant à afficher une vertu hypocrite et à attaquer directement l'existence même des personnes transgenres en Alberta.
Le premier projet de loi exige que les enfants de moins de 16 ans obtiennent le consentement de leurs parents pour changer leur nom ou leur pronom à l'école, avec une notification obligatoire des parents pour les élèves de plus de 16 ans. Il habilite également le ministère provincial de l'Éducation à interdire effectivement l'enseignement de l'identité de genre et de l'orientation sexuelle, remplace l'éducation sexuelle par un système parental optionnel et exige l'approbation du gouvernement pour tout matériel pédagogique provenant de tiers.
Le deuxième projet de loi reflète la législation anti-transgenres aux États-Unis en interdisant aux athlètes transgenres de participer à des sports amateurs féminins et en introduisant un système officiel de signalement des plaintes dans les écoles et les organisations sportives.
Le troisième projet de loi restreint les soins d'affirmation du genre exclusivement aux personnes transgenres, interdisant à toute personne de moins de 16 ans l'accès aux bloqueurs de puberté, à l'hormonothérapie et à la chirurgie du haut ou du bas du corps.
Ces politiques reflètent non seulement la ferveur anti-transgenres qui balaye la droite nord-américaine, mais aussi l'utilisation stratégique de la NWC pour protéger des mesures manifestement inconstitutionnelles et discriminatoires. Elles s'inscrivent dans une tendance régionale plus large : le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a invoqué cette clause en 2023 pour faire adopter une « charte des droits des parents » similaire qui, loin d'être un simple débat sur les pronoms, obligeait en fait à révéler l'identité transgenre des enfants à leurs parents, les exposant ainsi au risque de discrimination et d'abus. Le refus supplémentaire de soins en Alberta pourrait entraîner une augmentation des taux d'automutilation et de suicide chez les jeunes transgenres. Smith a tenté de justifier ces mesures en comparant les soins d'affirmation du genre à la prescription trop permissive d'opioïdes, affirmant que l'État doit imposer des « garde-fous ».
La rhétorique « Sauvez les enfants » a une longue histoire et reste fondamentale pour le mouvement réactionnaire et peu structuré des droits des parents, dont Smith et Moe sont toustes deux des partisan·es éminent·es.
Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, s'est également rallié à ce mouvement, affirmant dans la biographie flatteuse d'Andrew Lawton que « les droits des parents priment sur ceux des gouvernements » et que les parents devraient avoir le dernier mot sur « les valeurs [...] enseignées aux enfants ». Ce programme s'inscrit dans le droit fil de la politique anti-État providence et des revendications en faveur de la privatisation de l'école, en lien avec le mouvement historique en faveur des chèques-éducation en Alberta et les dépenses record de Smith pour les écoles à charte – près de 10 milliards de dollars –, qui font de l'Alberta le plus grand réseau d'écoles privées et à charte du Canada.
Les mouvements en faveur des bons scolaires et des droits des parents sont de plus en plus fusionnés, car certains stratèges populistes de droite les considèrent comme deux fronts dans une lutte plus large visant à limiter l'autorité de l'État : soit en réduisant le financement public, soit en le redirigeant vers des institutions choisies par les parents. L'utilisation de la NWC contre la soi-disant « idéologie du genre » est justifiée par un discours populiste dans lequel les gouvernements prétendent défendre le « bon sens » contre « l'idéologie gouvernementale » ou les juges activistes socialement libéraux.
Ces développements s'inscrivent également dans la longue histoire de l'Alberta en matière d'utilisation de la NWC contre les personnes LGBTQ+. Après la décision rendue en 1998 par la Cour suprême dans l'affaire Vriend c. Alberta, les groupes chrétiens de droite ont exigé que la province utilise cette clause pour passer outre les protections anti-discrimination dont bénéficient les personnes LGBTQ+ dans le domaine de l'emploi. Menés par la Family Life Coalition et des politiciens tels que Jason Kenney et Stockwell Day, leurs arguments faisaient écho à la même rhétorique sectaire qui refait surface aujourd'hui. Le premier ministre Ralph Klein s'est opposé à l'invocation de cette clause pour des raisons d'autoprotection politique, mais a ensuite adopté une loi menaçant de l'utiliser si le gouvernement fédéral redéfinissait le mariage pour inclure autre chose qu'un homme et une femme (la Cour suprême a finalement déclaré cette loi inconstitutionnelle).
Pour comprendre l'idéologie de Smith, il faut la replacer dans le contexte d'une longue tradition politique anti-planification centrale et anti-État providence qui caractérise le conservatisme albertain depuis plus de 60 ans.
La montée de la rhétorique populiste de droite pour justifier l'utilisation autoritaire de la NWC s'inscrit dans un projet idéologique plus large, auquel il faut opposer une résistance. L'utilisation abusive de cette clause par Ford a été contrée par une mobilisation massive, qui a réussi à convaincre le public que la NWC est un outil autoritaire donnant carte blanche à des gouvernements antidémocratiques pour agir de manière anticonstitutionnelle. Comme je l'ai fait valoir dans Canadian Dimension en 2022, les victoires juridiques sont importantes, mais elles ne peuvent se substituer à une résistance collective soutenue contre les gouvernements régressifs.
Historiquement, la NWC a été utilisée presque exclusivement pour attaquer les travailleurs, les travailleuses et les personnes LGBTQ+, sous prétexte de limiter l'intervention et les dépenses de l'État. En réalité, elle permet une forme d'interventionnisme étatique ancré dans la politique d'extrême droite, se faisant passer pour du populisme alors qu'elle ne sert que des intérêts socialement régressifs. C'est un moyen de contester la judiciarisation des droits dans un pays où les tribunaux ont souvent été plus disposés que les partis politiques à défendre les droits des minorités.
Pour contester cette politique, nous devons nous appuyer à la fois sur l'histoire plus longue de l'utilisation de la NWC et sur son application contemporaine par un gouvernement Smith déterminé à réorienter l'État vers un néolibéralisme plus profond et un conservatisme social réactionnaire.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Menace fasciste, boucs émissaires et défense des personnes migrantes

Trump n’était pas encore élu, mais à l’été 2024, le gouvernement fédéral de Justin Trudeau a pris une série de mesures rendant très difficile la vie des personnes migrantes au Canada. Prolongeant la décision du gouvernement québécois de François Legault de geler dans la région de Montréal les autorisations données aux entreprises pour recruter ou garder à leur emploi des travailleuses ou travailleurs migrants temporaires (TMT) sur des postes dits à bas salaires[1], le gouvernement fédéral libéral l’a étendue à toutes les zones métropolitaines où le taux de chômage atteint ou dépasse 6 %[2]. Parallèlement, rien n’a été prévu pour protéger les travailleuses et travailleurs migrants déjà présents sur le territoire et qui y font leur vie – car les entreprises comblent ainsi des besoins permanents – du risque d’avoir à plier bagage ou de continuer de vivre au Canada, mais sans statut.
Pourtant les ministres qui gèrent ces programmes et ces autorisations savent que les personnes entrant au Canada par le programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) et même, pour certaines, par le programme de mobilité internationale (PMI), n’ont pas de permis à proprement parler : c’est leur employeur qui a une autorisation pour les recruter[3]. Si celui-ci rompt le contrat ou n’obtient pas de réponse positive à sa demande de renouvellement d’une EIMT (voir la note 2), la travailleuse ou le travailleur doit quitter le Canada dans les 90 jours après la période initialement prévue, à moins qu’elle ou il trouve immédiatement un autre employeur ayant obtenu une EIMT et souhaitant le recruter. Voilà pourquoi on parle de « permis fermé ». Faute de droits qui leur soient attachés en propre, les travailleurs et travailleuses du PTET n’ont presque pas de voie administrative d’accès à un permis ouvert, à moins de s’être fait abuser ou violenter par son employeur[4]. Quant aux démarches menant à la résidence permanente, elles sont complexes et très restreintes, en particulier pour les travailleuses et travailleurs migrants à bas salaire au Québec, car le gouvernement caquiste de François Legault, qui se plaint que le champ de compétence du Québec en immigration n’est jamais assez grand, les en a exclus, à quelques exceptions près (notamment en agroalimentaire et chez les préposé·e·s aux bénéficiaires).
D’autres mesures prises réduisent l’accueil de réfugié·e·s et le regroupement familial. Une partie pénalise les étudiantes et étudiants internationaux – dont les frais de scolarité apportent une part de financement non négligeable aux universités ; par exemple, de nouvelles exigences sont ajoutées pour obtenir un permis de travail postdiplôme tandis que les possibilités de regroupement familial ont été restreintes.
Pourquoi le gouvernement libéral a-t-il adopté de telles mesures ? L’objectif officiel est pour réduire le nombre d’entrées de personnes migrantes temporaires au Canada et au Québec, qui s’est accru dans l’après-pandémie, contrairement au nombre d’entrées de résidentes et résidents permanents – une tendance dont les responsables politiques ne peuvent ignorer qu’elle est à l’œuvre depuis deux décennies puisque depuis 2008, les entrées au Canada avec un statut temporaire surpassent les entrées par la voie de la résidence permanente[5].
Mais comment expliquer que les politiques adoptées récemment ne s’embarrassent guère des conséquences pour les travailleuses, travailleurs, étudiantes et étudiants concernés ? Preuve en est de l’abandon du programme de régularisation promis par Justin Trudeau après sa réélection en septembre 2021, à la sortie de la pandémie; on oublie ainsi les anges gardiens et tous ceux et celles qui avaient continué à travailler pendant la pandémie au risque de leur vie.
C’est que depuis la fin de 2023, le débat public a commencé à être rythmé par la perspective d’une élection fédérale où les conservateurs menés par Pierre Poilièvre avaient le vent en poupe, du moins jusqu’à l’arrivée au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis. Le succès des conservateurs a été analysé par les libéraux comme résultant du fait que Poilièvre se montrait résolu à contrôler une immigration qu’il rendait responsable de tous les maux sociaux et qu’il criminalisait dans ses discours, comme le fait le gouvernement Legault au Québec. En réalité, si des électrices et électeurs semblaient se détourner du Parti libéral, c’est sans doute qu’elles et ils sont affectés par la montée des inégalités, pris en tenaille entre l’inflation et la montée des taux d’intérêt.
Mais le gouvernement Trudeau ne s’est pas attaqué aux inégalités croissantes et aux racines de la crise du logement. Il n’a pas adopté de politique de soutien au logement social ou vraiment abordable dans un contexte de marchandisation du logement et de spéculation immobilière. Il a reproduit les mêmes stratégies de fuite en avant que celles adoptées par des partis équivalents en Europe : croyant récupérer des voix, il a mis en œuvre des politiques banalisant la criminalisation de l’immigration, en brossant dans le sens du poil les discours qui transforment les personnes migrantes ou demandeuses d’asile[6] en boucs émissaires des problèmes sociaux. L’illustrent le renforcement de la surveillance de la frontière entre le Canada et les États-Unis avec force démonstration publique et les déclarations de Marc Miller, ministre de l’Immigration de l’époque, préférant cibler les personnes migrantes plutôt que les nombreux employeurs, recruteurs et agences de placement qui en abusent en contrevenant à la loi[7]. Il n’y a dès lors rien d’étonnant à ce que ces personnes migrantes soient traitées comme des dommages collatéraux de choix politiques et non comme des êtres humains dont la dignité et les droits doivent être prioritairement respectés et protégés, comme le prévoient d’ailleurs les conventions internationales signées par le Canada.
Au Québec, le ciblage des immigrantes et immigrants comme boucs émissaires reste minoritaire. Contrairement aux autres provinces du Canada, pour lesquelles, en moyenne, 62 % des habitants déclarent qu’il y a trop d’immigrants, ce sont 46 % des Québécois qui cochent cette réponse. Cependant, pour ces derniers, comme pour les autres Canadiens, à force de l’entendre, ils finissent par croire qu’il y a trop d’immigrants par rapport au nombre de logements disponibles[8]. Les personnes sondées sont sensibles aussi à l’augmentation de la présence de personnes migrantes, travailleuses ou étudiantes, avec un statut temporaire, et doutent que ces personnes puissent s’intégrer aussi bien que des personnes résidentes permanentes, ou s’inquiètent que trop d’immigrants n’adoptent pas les valeurs canadiennes – une rhétorique largement développée par les conservateurs au Canada et par le gouvernement caquiste au Québec. Cette croyance est pourtant loin des faits, en tout cas au Québec, où les candidates et candidats à l’immigration permanente réussissent à un taux de quasi 100 % le test des valeurs imposé par le gouvernement Legault depuis 2020[9] !
On peut penser que les Québécoises et les Québécois se démarquent dans les résultats du sondage par rapport aux habitants des autres provinces en raison de leur attachement à un modèle d’État social, l’État-providence, plus développé, ce qui les rendrait plus sceptiques face à un discours désignant les personnes migrantes comme responsables des problèmes sociaux. On y maitrise sans doute mieux le lien entre fiscalité progressive et financement des services publics, ou le rôle qu’a l’État dans le développement de logements abordables.
Mais à ce jour, le Québec est aussi la seule province où il existe une large coalition regroupant 45 organismes : des organisations au service des personnes migrantes ou les organisant, comme le Centre des travailleurs et travailleuses migrants (CTTI); des organismes de défense des droits, telles Amnistie internationale Canada francophone, la Ligue des droits et libertés; toutes les centrales syndicales ainsi que l’APTS et la FIQ[10]; la Fédération des femmes du Québec et nombre de regroupements ou de tables pour les droits des femmes qui sont conscients des abus spécifiques que subissent les femmes migrantes avec un statut temporaire ou sans statut; de nombreux organismes à Québec et en région, dont le Bas-Saint-Laurent et l’Estrie, confrontés là aussi aux cas d’abus de travailleuses et travailleurs migrants temporaires. Enfin, on compte aussi dans la coalition québécoise des organismes qui souhaitent d’autant plus vivement déconstruire les discours anti-immigrants qu’ils sont bien placés pour pointer les causes des problèmes sociaux, tel le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) qui se bat de longue date pour le droit au logement.
Créée en 2022 à partir de quelques organisations et sous la poussée de la mobilisation des premières et premiers concernés, cette coalition baptisée Campagne québécoise pour la régularisation et pour la justice migrante[11] a multiplié les interventions sous forme de communiqués, lettres ouvertes et rassemblements ou manifestations, pour réclamer un programme de régularisation large et inclusif, et aussi pour dénoncer les discours anti-immigrants ainsi que le système d’immigration à deux vitesses[12] – avec la création à partir de 1966 des programmes de travail temporaire, qui visent essentiellement la main-d’œuvre provenant des pays du Sud dont le Guatemala, le Mexique, et les Philippines. À l’automne 2024, la coalition a permis de mobiliser largement autour d’une position de dénonciation des mesures prises à l’encontre des travailleuses et travailleurs migrants temporaires, en dégageant un consensus non pas pour réclamer leur annulation – puisque parallèlement, la coalition demande de prioriser les entrées par la résidence permanente – mais pour obtenir que ces mesures ne soient pas appliquées à celles et ceux déjà présents sur le territoire et pour lesquels est réclamé l’accès à la résidence permanente. Elle a ainsi contribué à légitimer des actions concrètes des organisations membres pour accompagner les personnes migrantes temporaires affectées, qui se voient privées de statut ou à la recherche d’un employeur.
La capacité de la coalition à prendre rapidement position d’une manière cohérente et satisfaisante pour ses nombreux membres tient à la qualité des débats et au fait d’avoir su anticiper qu’il serait nécessaire de mener une campagne publique pour relier les revendications – un programme de régularisation large et inclusif, l’abolition du permis fermé, le moratoire sur les détentions et déportations et la priorisation du statut de résident permanent – à la déconstruction du discours anti-immigrant. La coalition a ainsi organisé une semaine d’action du 2 au 9 novembre 2024 qui a rassemblé plusieurs centaines de personnes et permis de faire converger ses actions en tant que coalition[13] avec les différentes initiatives de ses membres, comme une conférence de la Ligue des droits et libertés[14] ou le lancement de vidéos réalisées par l’Observatoire pour la justice migrante présentant une dénonciation humoristique des discours contre les personnes migrantes temporaires ou demandeuses d’asile[15].
Dans sa pratique, la coalition est aussi une chambre d’écho des initiatives des différents membres, par exemple de la campagne pour l’abolition du permis fermé lancé à l’automne 2024 par Amnistie internationale Canada francophone en collaboration avec, notamment, l’Association pour les droits des travailleurs ses de maison et de ferme (DTMF-RHFW)[16]. Elle a aussi relayé la mobilisation des travailleuses et travailleurs migrants temporaires ou sans papier le 18 décembre 2024, qui s’organisait avec le CTTI, Migrante Québec et Migrante Canada ainsi que l’Alliance internationale des migrants au Canada, pour mener des actions autour des lieux de travail dans tout le Canada, pour protester contre la trahison des promesses, les resserrements des permis temporaires sans abolition du permis fermé ni accès à la résidence permanente et pour montrer que « rien ne bouge sans nous ». Une mobilisation qui a eu un important succès médiatique et reçu un appui significatif des centrales syndicales.
Enfin, ce qui soude sans doute les membres lors des réunions de la coalition, c’est la reconnaissance du rôle primordial que doivent jouer les personnes migrantes dans la définition des actions de la coalition (avec l’appui de leurs organisations qui participent à la coalition) et le fait de partager des analyses sur la période actuelle, comme lors de la seconde rencontre stratégique de la coalition en février 2025. Une sorte de consensus se dégage sur le fait que la montée des discours anti-immigrants s’inscrit dans une période mondiale de durcissement des politiques envers les travailleuses et travailleurs et d’une répression ouverte et violente des conflits sociaux, y compris dans l’Union européenne, pourtant longtemps considérée comme un modèle social. Les réorientations des politiques migratoires au Canada participent d’une dynamique mondiale s’appuyant sur un recours accru à l’autoritarisme et sur l’abandon par les États-nations de la recherche d’intérêts communs au profit d’intérêts privés – ce qu’illustre entre autres l’accélération de la privatisation de services publics, en particulier de la santé.
Ce durcissement des politiques sociales et migratoires des États-nations s’accompagne aussi d’un repli sur ce qui est considéré comme la « majorité » de la population, à laquelle on associe des valeurs et une culture que ne partageraient pas les personnes migrantes ou immigrantes. Au Québec, l’illustration en est donnée par la décision du gouvernement Legault de revenir à la charge, après la Loi sur la laïcité (loi 21) toujours contestée, avec le projet de loi 84 (PL 84) sur l’intégration nationale en février 2025. Ajoutons que récemment, en mars, le gouvernement a déposé un autre projet de loi, le PL 94[17], une relecture caquiste des événements de l’école Bedford[18] qui aboutit sur des interdictions étendues de port de signes religieux et sur une forme d’encadrement des pratiques pédagogiques.
Les attaques sur les dimensions culturelle ou idéologique ont leur raison d’être : celle de justifier un traitement de deuxième ou troisième zone des personnes migrantes racisées, au prétexte qu’elles ne partageraient pas les valeurs majoritaires et qu’il ne serait plus d’actualité de défendre les droits des minorités, comme le prétend le PL84 (voir l’encadré). Dans la compétition que se mènent les États, et en particulier dans la guerre économique que se livrent les grandes puissances européennes ou nord-américaines et les puissances montantes (comme la Chine, l’Inde, le Brésil), la gestion contrôlée des flux migratoires, c’est-à-dire la vassalisation d’une partie de la main-d’œuvre, celle qui vient des Suds et souvent des anciennes colonies, devient une sorte d’avantage compétitif, en tout cas pour les pays du Nord. Car, ainsi, ils réintroduisent les Suds au sein même de leur pays, au profit notamment des secteurs d’activité qui ne peuvent se délocaliser, et modernisent les dominations pour accumuler du capital non seulement par un processus de dépossession (ou de vol, nommons-le, dans le cadre de l’extractivisme), mais aussi par un processus de reproduction élargie.
Articuler luttes contre l’austérité et luttes contre la transformation des personnes migrantes en boucs émissaires
Dans ce contexte, et même si le sentiment anti-Trump au Canada ne fait guère de doute – en témoigne la baisse des conservateurs dans les sondages à la mi-mars –, il peut paraitre inquiétant de constater, toujours selon le sondage sur les perceptions à l’égard de l’immigration[19], la croissance du pourcentage de personnes qui associent l’immigration à une montée de la criminalité (de 14 % en 2019 à 35 % en 2024) ou qui pensent que le Canada accepte trop d’immigrants venant des minorités racisées (de 24 % en 2022 à 39 % en 2024). C’est une évolution vers un racisme décomplexé que l’on doit mettre en relation avec la montée des discours anti-immigrants, et que l’on est tenté de comparer à la montée de l’antisémitisme au cours des années 1930 en Europe, et au-delà, pendant que les nazis asseyaient par la force leur pouvoir en Allemagne – ce que l’on souhaite ne pas voir arriver aux États-Unis, mais ce qui n’est pas exclu, et qui pourrait prendre la forme d’une loi martiale ou de l’annulation des élections de mi-mandat : Trump n’a-t-il pas fait référence à la mi-mars à une loi datant de 1798 et qui n’a été utilisée qu’en période de guerre pour justifier le renvoi forcé de Vénézuéliens, malgré un jugement contraire, considérant que les États-Unis étaient en guerre[20] ?
Au Québec comme au Canada, les mois qui viennent seront importants notamment pour les mouvements sociaux et les syndicats, pour montrer leur capacité à se solidariser avec les personnes immigrantes contre la montée du fascisme et contre les politiques d’extrême droite, et aussi contre les politiques d’austérité mises en œuvre en douce par le gouvernement Legault. Il est important de développer un contre-discours qui associe la lutte contre l’austérité, la lutte contre le racisme et la transformation des immigrantes et immigrants en boucs émissaires, sans hiérarchiser les attaques qui, en réalité, s’articulent et tirent profit l’une de l’autre. Le 1er mai 2025 sera l’occasion de manifester une vision inclusive de la société québécoise, loin du PL84 dénoncé tant par les organisations de défense des droits que par les centrales syndicales.
De minorités « ethniques » à minorités « culturelles »: les mots autorisés et ceux bannis du projet de loi 84 sur l’intégration nationaleComme une façon de brasser les peurs face à l’idée d’un « grand remplacement[21] », la décision du gouvernement Legault de proposer un projet de loi sur l’intégration nationale va surtout accentuer la polarisation, comme Trump a su si bien le faire aux États-Unis pour gagner les élections, tout en étouffant les droits des minorités. Heureusement, à l’initiative de la Ligue des droits et libertés, 87 organisations, parmi lesquelles les groupes de femmes, les associations de chômeuses et chômeurs, les centrales syndicales, ont d’une seule voix, dans un communiqué de presse, dénoncé ce projet de loi qui alimente « une rhétorique dangereuse », et propose « plusieurs modifications inadmissibles à la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, en plus de constituer une menace directe à plusieurs droits humains, dont la liberté de conscience et le droit à l’égalité[22] ». Il faut mettre sur pause le processus d’étude de ce projet de loi. Les organisations, au nombre de presque une centaine maintenant, dénoncent aussi le fait que le gouvernement s’arroge le droit de définir lui-même les modalités d’un « contrat social » que ce projet de loi-cadre prétend poursuivre. De là à dire que l’on va nous imposer comment il faut dire les choses et quelles représentations sociales sont autorisées ou bannies – à l’instar de Trump qui, par décret, a défini les mots acceptables ou interdits pour obtenir des subventions en recherche –, il n’y a quasiment qu’un pas que l’on serait tenté de franchir. Par exemple, lorsqu’on voit que le projet de loi se propose de modifier l’article 43 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne en remplaçant « ethniques » par « culturelles » dans la façon de caractériser les minorités[23]. On ne parlerait plus ainsi de minorités ethniques, terme distinguant ethnicité et tradition culturelle, mais de minorités culturelles. Le projet de loi ne mentionne d’ailleurs que l’intégration des « personnes immigrantes et des personnes s’identifiant à des minorités culturelles ». Cela revient à transformer un signe – la langue parlée, le pays d’origine, la religion, etc. – en marqueur d’une caractéristique distinctive et homogène, puisqu’on considère ainsi que toute personne membre d’un groupe ethnique partage nécessairement la même culture avec ce groupe. Or, prenons un seul contre-exemple pour montrer que cette équation ne tient pas : les Juifs forment un groupe ethnique; pourtant, il est évident que les membres de ce groupe ne sont pas tous religieux, n’habitent pas le même pays, ne parlent pas la même langue, n’ont pas les mêmes valeurs, n’adoptent pas nécessairement une position de dénonciation du génocide à Gaza. Bref, on ne peut confondre ethnicité et culture, à moins de vouloir réduire une population à des caractéristiques que lui prête un groupe dominant ou majoritaire. S’agit-il ainsi de rétablir une forme de racisation en utilisant la culture plutôt que la race comme marqueur ? |
Par Carole Yerochewski, sociologue
- C’est-à-dire sur des postes dont le salaire horaire est inférieur à 120 % du salaire médian, qui est à 27,47 $/h en 2024. ↑
- Certains secteurs d’activité ont été exclus de ces resserrements, notamment ceux de la construction et de la santé, où le pourcentage maximum de TMT a été réduit à 20 % de la main-d’œuvre totale. ↑
- L’autorisation est accordée à la suite d’une demande d’Évaluation de l’impact sur le marché du travail (EIMT) déposée par une entreprise. Pour un aperçu des réformes prises à l’été 2024, voir : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travailleurs-etrangers.html. ↑
- Pressés notamment par les organismes d’accompagnement ou de défense des droits des personnes migrantes, qui dénoncent au sujet du « permis fermé » le risque de livrer pieds et poings liés ces personnes aux employeurs – ce que le rapporteur spécial de l’ONU a conforté en 2024 en disant que le programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) alimente des formes contemporaines d’esclavage –, le ministère Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a créé un « permis ouvert pour travailleurs vulnérables », comme s’il s’agissait de protéger quelques cas individuels. Cette mesure, prise pour répondre aux abus sans abolir le système du permis fermé, ne répond pas à l’ampleur des abus et discriminations systémiques ainsi engendrés à l’égard essentiellement des travailleurs et travailleuses des Suds. Les démarches pour obtenir ce permis ouvert sont complexes et les temps d’attente longs en raison de la multiplication des demandes, ce qui veut dire continuer à subir ou quitter l’employeur et vivre sans statut pendant ce temps, car sa durée d’un an est souvent trop courte pour faire aboutir des démarches, notamment de recherche d’emploi. ↑
- Avant le gouvernement Harper, les agentes et agents des services ministériels étudiaient les demandes d’EIMT, notamment pour vérifier qu’il n’y avait pas de candidates ou de candidats potentiels sur le marché du travail local. Depuis Harper et par la suite, les démarches ont été simplifiées et les seuils d’embauche par entreprise augmentés. Les universités se sont tournées vers les étudiantes et étudiants internationaux. En outre, au Québec, le gouvernement Legault a demandé en fin de pandémie de faciliter l’accès aux EIMT pour les entreprises québécoises. ↑
- Dans les mesures prises depuis l’été 2024, il faut aussi souligner l’abaissement des seuils d’accueil, notamment dans le cadre des programmes de parrainage collectif (dont les demandes ont été suspendues en 2025) et pour d’autres programmes ainsi que pour l’immigration permanente (retour à 400 000 entrées par an au lieu des 500 000 annoncées à l’automne 2023). ↑
- Marc Miller déclarait ainsi : « Le discours qu’on entend aux États-Unis est malheureux. Je n’y adhère pas, mais nous avons besoin d’un système d’immigration qui ne donne pas l’impression qu’il est fraudé par des gens qui tentent d’en profiter. Nous constatons une augmentation du nombre de fausses demandes en provenance de certains pays ». La Presse canadienne, « Immigration : le système fédéral manque de discipline, reconnaît Marc Miller », Radio-Canada, 21 décembre 2024. ↑
- Institut Environics, Opinion publique canadienne sur l’immigration et les réfugiés, Toronto, automne 2024. ↑
- Voir Sarah R. Champagne, « Les immigrants décrochent une note presque parfaite au test des valeurs », Le Devoir, 10 mars 2025. ↑
- APTS, Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux; FIQ, Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. ↑
- Elle a un site web (https://cqrjm.org/) et un courriel (régulariser.qc.ca@gmail.com). On pourra aussi consulter l’article de Cheolki Yoon, « Campagne pour la régularisation des sans-papiers», Nouveaux Cahiers du socialisme, n° 29, printemps 2023, sur la place des personnes migrantes dans la conduite de la lutte pour la régularisation. ↑
- Plusieurs articles publiés à ce sujet dans les Nouveaux Cahiers du socialisme, notamment dans le dossier immigration du n° 27, hiver 2022, et l’article « Nommer et combattre un système d’immigration colonialiste et raciste », Nouveaux Cahiers du socialisme, n° 31, printemps 2024 par Carole Yerochewski. ↑
- Voir par exemple le webinaire du 28 octobre 2024 intitulé Évolution des politiques d’immigration et statut migratoire précaire. ↑
- Voir la conférence hybride du 5 novembre 2024 : On remet les pendules à l’heure! Crise du logement et personnes migrantes. Rétablir les faits. ↑
- Campagne On s’fera pas porter l’chapeau, novembre 2024 et un exemple de vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=JcZn3EFfkiA. ↑
- Voir les deux webinaires à ce sujet : Travail migrant et formes contemporaines d’esclavage au Canada, avec une conférence de Tomoya Obokata, rapporteur spécial de l’ONU sur le sujet, 17 septembre 2024 et Permis de travail sectoriels et droits des travailleuses et travailleurs migrants : perspectives internationales, 3 octobre 2024. ↑
- Voir le PL94 : https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-94-43-1.html. ↑
- Direction des enquêtes, Administration, organisation et fonctionnement du Centre de services scolaire de Montréal et de l’école Bedford, rapport d’enquête, Ministère de l’Éducation du Québec, juin 2024. Ce rapport met en garde contre la présentation faite dans les médias : « Il serait fautif de croire qu’un individu d’origine maghrébine, enseignant à l’école Bedford, soit nécessairement associé au clan dominant » (p. 5) et « En somme, bien qu’il y ait effectivement présence de clans à l’école Bedford composés d’individus de différentes origines, les enquêteurs ont surtout observé une opposition entre des idéologies » (p. 6). ↑
- Institut Environics, automne 2024, op. cit. ↑
- Nicholas Riccardi, « L’administration Trump expulse des centaines d’immigrants malgré l’ordre d’un juge », Le Devoir, 16 mars 2025. ↑
- Théorie complotiste, promue par l’écrivain français Renaud Camus, qui a imaginé qu’il y avait une volonté politique de substituer à la population européenne « de souche » une population des pays du Maghreb et de l’Afrique subsaharienne, soit une population provenant notamment des pays anciennement colonisés par la France. ↑
- Consultations sur le projet de loi n° 84 sur l’intégration nationale – Plusieurs dizaines d’organisations expriment leurs vives inquiétudes, communiqué de presse, 25 février 2025. ↑
- Voir la page 11 du PL84: https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-84-43-1.html. ↑

La culture québécoise a un impérieux besoin de critique matérialiste

La récente nomination de Marc Miller au ministère de l'identité et de la culture a suscité l'enthousiasme de certain·es acteur·ices d'importance du milieu culturel québécois. Ceux-ci se réjouissent de ce qu'un fin connaisseur des arcanes du pouvoir canadien puisse se pencher sur les dossiers du remplacement de certain·es travailleur·euses de la culture par l'intelligence artificielle, du maintien de l'exemption culturelle canadienne dans l'Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) et du renforcement d'un filet social pour les artistes.
La culture, dans ces trois dossiers apparemment prioritaires, est perçue dans sa dimension économique, intégrée dans un marché compétitif mondialisé dont il faut réguler les méfaits, mais qui n'est jamais lui-même remis en cause. Ce que l'on nomme « milieu culturel » désigne ainsi un ensemble d'institutions, de pratiques et de discours qui adhère aux manières de faire, aux structures et à la vision du monde du capitalisme néolibéral, sans qu'il soit mentionné que ce dont on cherche à protéger la culture et ses travailleur·euses est causé en grande partie par la logique de dévoration d'un capitalisme sous-entendu comme normal, neutre et indépassable. Or toute défense des travailleur·euses sans critique des conditions d'exercice et de production de leur pratique est vouée à la stérilité intellectuelle et à l'inefficacité. Ce « milieu culturel » est tout entier acquis à la compétition néolibérale qui le ronge.
Dans ce cadre précaire et dans la dépendance de subventionnaires qui pensent en termes de progrès, de carrière et de développement, à quel point les plus vulnérables, mal logé·es, mal nourri·es, mal soigné·es, mal éduqué·es, violenté·es, peuvent-iels prétendre à une agentivité culturelle ? Comment dans ce contexte, peut-on avoir autre chose qu'une culture reconduisant un ensemble de dominations, connaissant d'instinct les limites à ne pas dépasser dans ses analyses critiques, aveugle à tout ce qui n'apparaît pas au sein des institutions traditionnelles, plus encline à défendre l'auto-entrepreneuriat de ses travailleur·euses que le financement de l'éducation populaire et de l'alphabétisation ?
La culture est célébrée avec ferveur par les médias dominants de tout bord au Québec. Elle raconte « nos histoires », dit « la diversité », « invente de nouvelles formes », célèbre « les saveurs d'ici ». Son approche est idéaliste, la culture est une belle idée, l'expression d'identités plurielles, de sensibilités multiples, de « voix fortes » et « nécessaires », l'émerveillement et le pas de côté. Si la belle idée de la culture se concrétise, c'est sous la forme d'un protectionnisme commercial. Consommons de la culture québécoise, explique-t-on, pour soutenir nos artistes, ces entrepreneur·euses d'iels-mêmes. Car la culture est un bien consommable sur un marché compétitif de capitaux économiques (et symboliques). Que la culture soit un marché subventionné et encadré par l'état, voilà l'horizon d'espérance du Québec. Là où aussi s'arrête trop souvent la réflexion. Comme si chaque artiste et travailleur·euse culturel·le pourrait tirer son épingle du jeu, comme si la compétition ne faisait que des gagnant·es, ce qui est une reconduction pure et simple d'un des mensonges premiers du libéralisme économique.
En réduisant la culture à un ensemble de savoir-faire professionnels, à une poïésis en situation de marché, en en excluant sa dimension transversale, son intime présence dans chaque existence, son rôle dans la vie collective, en lui niant sa dimension de praxis, d'engagement éthique, le néolibéralisme s'assure que celle-ci ne puisse pas se mettre en travers de son chemin, une route menant chaque jour à plus d'inégalités sociales, au péril même du vivre ensemble.
Il ne s'agit pas de dire ici que tout ce qui a été fait en matière de politique culturelle au Canada et au Québec était inadéquat et n'a eu que des effets néfastes. Que l'on subventionne et protège n'est pas un mal en soi, mais encore faut-il réarticuler la culture à des promesses d'avenir démocratique. Et pour cela, il est impératif de contrer l'idéalisme sur lequel repose l'idéologie culturelle néolibérale et de promouvoir des outils essentiels pour la poursuite des débats concernant les politiques culturelles : des analyses matérialistes, prenant en compte les situations très concrètes des divers rapports de forces matériels. Depuis Marx, des intellectuel·les et des militant·es ont produit et produisent à travers le monde des analyses matérialistes des politiques culturelles, que l'on pense à l'école de Francfort, aux théories décoloniales ou encore au féminisme matérialiste. Le débat culturel québécois est-il devenu tel qu'il se privera de ces perspectives ? Que l'on soit ici clair : appeler à des analyses matérialistes ne revient pas à en exclure d'autres, ni à promouvoir un marxisme orthodoxe. Il reste que la critique matérialiste – marxiste ou non – apparaît indispensable à toute critique efficace en contexte capitaliste qui ne souhaite pas se leurrer de belles histoires.
Que ce soit au niveau fédéral ou provincial, quelle culture subventionne, structure et, in fine, propose un état néolibéral extractiviste fondé sur un génocide colonial quand celle-ci n'inclut pas sa propre analyse matérialiste ? Une fois cette question posée, et toutes celles qui en découlent, pourront alors commencer des débats au sujet des politiques culturelles canadiennes et québécoises ouvrant sur de véritables perspectives d'avenir, inclusives et démocratiques.
L'idéalisme culturel prend les choses par le haut, et impose un point de vue informé par les desiderata des classes dominantes. D'un point de vue matérialiste, la culture ne peut être qu'une praxis, un engagement en situation dans le monde, et aucune réflexion intellectuelle, si pertinente soit-elle, ne pourra dégager d'analyse efficace si elle n'est secondée et redoublée par l'expérience de terrain, qu'elle soit syndicale, communautaire ou militante, les trois piliers de la défense des droits.
Si la culture demeure l'affaire d'une défense de professionnel·les, alors iels resteront des millions que l'on gave de mauvaise télé, de mauvaise radio, de malbouffe, que l'on enrôle dans des travails abrutissants sous-payés, que l'on séquestre dans la culture du char, avec sucre, sel, alcool et pétrole pour espérance, à qui ont intime d'admirer les artistes, à qui on laisse entendre que la culture est à mille lieues de leurs possibles à eux et elles, tout au mieux ce sera le concert gratuit sur la place publique cet été, financé par une banque, bien sûr.
Peut doit nous chaloir, ceci posé, qu'un gouvernement qui a pour horizon l'écocide et l'armement – c'est-à-dire la guerre, que ce soit à Gaza, au Darfour ou ailleurs, il ne faut pas se leurrer – mette en poste un « quelqu'un d'envergure » au ministère de l'identité et de la culture. Les institutions culturelles en place jouent le jeu du néolibéralisme, c'est pour cela qu'elles ont été créées, on ne les changera pas demain. Cela ne doit pas empêcher les cultures populaires, les pôles intellectuels et les bases militantes de revendiquer leur rôle majeur, premier et essentiel, dans le débat concernant les politiques culturelles, au même titre que les institutions culturelles. Le « milieu culturel » ne doit pas faire le hold-up d'un débat démocratique sur le droit général à la culture en contexte néolibéral.
Pour une culture solidaire et émancipatrice, que les artistes ne soient pas des travailleur·euses comme les autres, mais que chacun·e, travailleur·euse ou non, devienne un·e artiste comme les autres. Toute perte sur le front social est une perte pour la culture. Toute lutte un progrès. La culture ne doit être pas une reconduite du suicide sociétal néolibéral.
Travailleur·euses culturel·les et/ou artistes, politisons notre position au sein d'une analyse matérialiste générale de la situation néolibérale, ouvrons-nous aux luttes pour les droits (logements, santé, éducation, papiers…) de celles et ceux qui ont en retour leur part dans le débat culturel. Que l'inertie des institutions culturelles dominantes ne nous prive pas de cultiver des devenirs alternatifs.
Paul Kawczak
Auteur
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Presse-toi à gauche prend une pause en cette fin d’année

Presse-toi à gauche prend une pause en cette fin d'année. Nous serons de retour le 20 janvier pour reprendre le fil de l'actualité à gauche. D'ici là, nous vous souhaitons à tous et toutes, collaborateurs et collaboratrices, lecteurs et lectrices, une bonne fin d'année. Nous la souhaitons reposante afin de reprendre des forces et puis reprendre les luttes afin de résister aux assauts de la droite et ouvrir les perspectives pour une transformation solidaire de la société.

Priorisons les solutions climatiques plutôt que les énergies fossiles

Le gouvernement fédéral nouvellement élu, dirigé par le premier ministre Carney, vient d'adopter le projet de loi C-5 qui permet d'accélérer la réalisation de mégaprojets pétroliers et gaziers en ouvrant explicitement la porte à des exemptions dans l'application de normes environnementales.
Avec la Loi visant à bâtir le Canada, les mégaprojets choisis et considérés comme étant d'« intérêt national » passeront par un « processus d'évaluation accéléré » qui demeure flou et inquiétant. Pendant ce temps, les solutions d'énergie renouvelable, comme les centrales solaires et les réseaux verts, sont reléguées au second plan.
Nous ne pouvons pas tolérer un affaiblissement des mesures de protection environnementale existantes.
Au Québec, le BAPE (Bureau d'audiences publiques sur l'environnement) est essentiel : il permet aux citoyen·nes de se faire entendre et de freiner des projets destructeurs. Il permet de défendre notre territoire et notre avenir – soumettre un projet au BAPE est une étape clé pour la démocratie et la protection de l'environnement. Au fédéral, la loi sur l'évaluation d'impact est complémentaire au BAPE, elle doit être préservée !
Le processus d'approbation accéléré de Carney n'est pas qu'un simple changement de politique – c'est un cadeau aux lobbyistes des énergies fossiles. Les grandes compagnies pétrolières et gazières en tireront profit, tandis que les peuples autochtones risquent de voir leurs droits bafoués. Cette proposition législative ne garantit pas un consentement libre, préalable et éclairé, ce qui compromet la réconciliation et la souveraineté autochtone.
C'est la mise en œuvre de solutions climatiques que nous devons accélérer, et non la destruction du climat.
Nous n'avons pas le loisir d'attendre à plus tard. Rejoignez-nous pour rappeler au premier ministre Carney que le Canada doit protéger la nature, respecter les droits des peuples autochtones et investir non pas dans de nouveaux pipelines, mais dans un avenir qui carbure aux énergies renouvelables.
Pour signer la pétition.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le sermon de Amir !

À la veille de la diffusion officielle du documentaire Le serment d'Hippocrate de Nadia Zouaoui le 12 décembre, puis sur Ici Télé le 8 janvier prochain, une question lourde d'enjeux politiques et humains s'impose avec une acuité douloureuse. Comment une société qui se dit ouverte et soucieuse du bien commun peut-elle accepter que des médecins formés ailleurs et déjà prêts à soigner soient tenus à l'écart d'un système de santé qui manque cruellement de bras et d'esprits compétents ?
Le Québec accepte 8% de médecins formés à l'étranger alors que l'Ontario en accueille 31%. Au Canada, le Québec est la province qui intègre le moins ces médecins venus d'ailleurs. Ce contraste n'est pas seulement un chiffre. Il est le révélateur d'une attitude institutionnelle qui entretient l'impression d'une discrimination systémique vécue par des praticiens pourtant qualifiés et désireux de contribuer. Ces femmes et ces hommes arrivent avec des années d'expérience, souvent dans des contextes médicaux exigeants, mais ici leur parcours est suspendu. Leurs diplômes sont reconnus, puis on leur impose un nouveau passage par des formations, des périodes d'adaptation et une quantité d'étapes qui s'allongent jusqu'à devenir décourageantes.
Le documentaire de Nadia Zouaoui suit quatre de ces médecins. Deux d'entre eux ouvrent les portes de leur vie quotidienne et montrent sans fard les effets de cette situation sur leurs familles. On y voit l'attente, le doute, mais aussi une incroyable persévérance. Le film fait tomber les masques administratifs et rappelle que derrière chaque dossier il y a un être humain en suspens et des citoyens privés de soins.
Au cœur du récit, les interventions du Dr Amir Khadir frappent par leur lucidité. Médecin, ancien député, ancien porte-parole de Québec Solidaire, figure de l'engagement social, il met des mots précis sur un malaise que l'on appréhendait sans toujours oser le nommer. Pour lui, la racine du problème n'est pas strictement technique. Elle n'est pas seulement dans les formulaires ni dans les examens à repasser. Elle se trouve dans la volonté politique. Une volonté absente, hésitante ou fragmentée. Les gouvernements successifs auraient pu simplifier l'accès à la pratique médicale, alléger des processus qui n'en finissent plus, réformer un système de sélection devenu trop lourd. Ils auraient pu, mais ils ne l'ont pas fait.
Le réseau québécois souffre. Les urgences débordent. Les listes d'attente s'allongent. Les régions éloignées cherchent encore désespérément des médecins de famille. On répète depuis des années qu'il faut attendre que les cohortes d'étudiants finissent leur parcours. Mais le temps d'attente pèse lourd sur la population déjà fragilisée. Et ce paradoxe demeure. Des
médecins formés à l'étranger vivent ici, prêts à contribuer, parfois installés depuis des années, mais ils ne peuvent pas exercer.
Il faut préciser une idée qui apporte nuance et crédibilité au débat. Employer davantage de médecins formés ailleurs et viser au moins le taux de l'Ontario ne réglera pas tous les problèmes du système de santé. Personne ne croit qu'une seule mesure peut tout transformer. Mais cette décision ferait partie d'un ensemble de gestes nécessaires pour améliorer l'accès
aux soins et offrir à la population un réseau plus fluide et plus humain. On ne résout pas un système entier avec un seul levier. On amorce cependant un changement réel en actionnant les leviers qui sont disponibles maintenant.
On ressort du documentaire avec une sensation persistante, presque amère. Pourquoi choisir la complexité quand la simplicité est possible. Pourquoi maintenir des labyrinthes institutionnels alors que l'urgence de soigner saute aux yeux. La question devient une sorte de refrain intérieur, une interrogation qui dépasse la technique et touche au sens même de la gouvernance.
Autrefois, les médecins, les guérisseurs parcouraient montagnes et vallées, d'une contrée à l'autre, pour offrir leurs services à ceux qui en avaient besoin. Aujourd'hui les médecins traversent des océans pour offrir leur savoir. Ce ne sont plus les distances qui les freinent, mais une architecture de règles qui se referme sur eux, tantôt trop prudente, tantôt trop rigide, souvent marquée d'un corporatisme qui ne dit pas son nom. La médecine n'est pas seulement une discipline. Elle est devenue un espace qu'on protège comme un territoire privé. Un gâteau qu'on ne veut pas trop partager.
Dans le film, Amir Khadir lance une phrase qui expose à elle seule un malaise profond. « * À quoi bon gagner quatre cent mille dollars par année, et parfois jusqu'à un million pour certains médecins, si l'on n'a même pas le temps d'en profiter ?* ». Dans cette interrogation se trouvent le praticien, le citoyen et l'homme solidaire. On y entend aussi un sermon que toute la corporation médicale gagnerait à méditer et si possible, incarner.
En sortant de l'avant première du film de Nadia Zouaoui, je revoyais défiler certains moments marquants, notamment cette première scène où un médecin algérien lit la lettre du Collège des médecins. Les premières lignes laissaient croire à une bonne nouvelle, puis les dernières qu'il n'avait pas besoin de lire pour comprendre qu'elles refermaient brutalement la porte à une carrière en médecine au Québec. Karim Laribi, aurait pu être devenir un excellent comédien tant son visage exprime à la fois la retenue, le désarroi et l'absurdité de la situation de tous ces médecins déçus.
Le Dr Karim Laribi a fini par devenir enseignant au cégep après avoir consacré plus de cinq années à tenter de franchir les étapes imposées par le Collège des médecins du Québec. Il a passé les examens, cherché en vain un stage de résidence, multiplié les démarches sans jamais obtenir la porte d'entrée qu'il espérait. La Dre Daniela Pujol, anesthésiste d'Argentine
forte de quinze ans d'expérience, a dû prendre une tout autre direction.
Faute de pouvoir exercer ici, elle s'est engagée avec Médecins sans frontières Canada, acceptant des missions dans des régions à haut risque et menant une vie loin de son mari québécois. Le Dr Gilles Carruel, médecin français cumulant trois décennies de pratique, a lui aussi fini par renoncer aux longues attentes et aux embûches administratives qui se
succédaient. Il exerce désormais en Martinique, bien qu'il conserve un pied à terre au Québec où il aurait souhaité poursuivre sa carrière. Quant à la Dre Fernanda Pérez Gay Juarez, médecin d'origine mexicaine et détentrice d'un doctorat en neurosciences de l'Université McGill, elle a réussi à devenir psychiatre. Forte de son parcours, elle a choisi de soutenir d'autres médecins issus de l'immigration et de les accompagner dans ce labyrinthe de procédures qui empêche trop souvent des talents essentiels de rejoindre le réseau québécois.
Mais ce sont les toutes dernières images du film qui ont fait naître en moi une question insistante. Pourquoi un homme de l'envergure d'Amir Khadir, dont les interventions donnent au documentaire sa force et sa cohérence, pourquoi cet homme n'est il pas notre ministre de la Santé. Pourquoi ne pas confier cette responsabilité à quelqu'un qui possède une vision politique comparable à celle des premiers artisans du système de santé solidaire et universel, quelqu'un qui connaît le réseau de l'intérieur, qui perçoit ses failles, ses besoins et l'épuisement de ceux qu'il devrait soutenir.
Aucune réforme profonde ne peut naître sans volonté politique. Cette volonté se manifeste souvent lorsque l'opinion publique s'éveille et refuse de rester silencieuse. Le documentaire ne se limite pas à informer. Il met en lumière une évidence que l'on ne peut plus repousser. Rien ne changera si nous n'exigeons pas que cela change. Rien ne s'améliorera tant que nous accepterons une complexité inutile qui bloque des médecins compétents et prive des citoyens de soins dont ils ont besoin maintenant.
Le film se termine sur l'appel d'Amir Khadir adressé au ministre de la Santé Christian Dubé. Même s'ils ne partagent pas la même famille politique, Amir le décrit comme un homme honnête. Mais l'honnêteté en politique, si elle ne repose pas sur du courage et une réelle volonté d'agir, elle n'a aucun sens.
*Mohamed Lotfi*
11 décembre 2025
PS : Comme aujourd'hui, un 11 décembre, il y a exactement 36 ans, j'ai fait mon entrée en prison pour tendre un micro de radio. Cela m'a permis, pendant 35 ans, de voler une quantité phénoménale de temps au profit de ceux qui en étaient prisonniers. J'avais l'intention d'accoucher d'un texte pour souligner cette date anniversaire. Mais la projection du film de Nadia m'a accaparé. Je vous laisse sur ce lien. C'est la toute dernière émission Souverains anonymes, tournée en mars 2025. https://www.youtube.com/watch?v=bmCKc9ryXlg
Et ce court document réalisé par Nadia Zouaoui, il y a 14 ans, sur Souverains anonymes : https://youtu.be/GkNzgpta8xw
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Cri du cœur au Mont-Sainte-Anne

On se rappelle aisément de 2020, avec l'arrêt brusque des télécabines ayant fait 21 blessés. D'une télécabine tombée en 2022. Et aujourd'hui, d'une panne électrique majeure forçant la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) à fermer les remontées mécaniques pour des enjeux de sécurité. Depuis 1994, les événements au Mont-Sainte-Anne se succèdent et démontrent l'incapacité de RCR à agir comme un gestionnaire responsable et un véritable citoyen corporatif.
Cependant, le problème est plus profond encore. Oui, on peut affirmer que RCR a cherché pendant des décennies à siphonner l'argent des contribuables québécois tout en sous-traitant ses obligations. Mais une question demeure : pourquoi aura-t-il fallu près de 30 ans avant d'oser sérieusement envisager leur éviction ? Cette situation ne s'est pas créée par hasard. Elle prend racine bien au-delà de la montagne.
Un premier élément majeur est l'absence historique d'un réseau médiatique local fort, indépendant et soutenu sur la Côte-de-Beaupré. Il y a bien eu L'Autre Voix, et il nous reste La Télé d'ici, mais jamais cela n'a été une priorité pour nos décideurs locaux. Il est toujours plus facile de gérer ses petites affaires sans le regard du quatrième pouvoir.
Pendant ce temps, les médias régionaux et nationaux ont — légitimement — d'autres enjeux à couvrir que ceux de notre territoire. On ne peut demander à La Télé d'ici d'être partout, tout le temps. Mais cette absence profite à qui, au juste ?
Deuxième élément : le morcellement politique de la Côte-de-Beaupré. Huit municipalités qui peinent à travailler ensemble, sans oublier la présence du Séminaire à la table du conseil de la MRC. Le comté provincial s'étend de la rivière Montmorency à la rivière Saguenay, incluant l'Île d'Orléans : 27 municipalités, 4 MRC, des TNO, des terres institutionnelles inaccessibles.
Au fédéral, on ajoute le sud et le nord de Beauport ainsi qu'une partie de la MRC de La Jacques-Cartier. Résultat ? Aucun leadership clair. Aucune voix forte pour la Côte.
Ce vide ouvre la porte à un troisième phénomène : les pouvoirs informels. Des gens tirent les ficelles. Les situations précédentes ont créé un terreau fertile permettant à certaines fortunes locales d'influencer nos élu·e·s : comment agir, quelles décisions prendre, et surtout, quand fermer les yeux. Cette recette se répète ensuite dans les associations influentes, les associations d'affaires, les organismes publics et parapublics. Quand vient le temps de défendre réellement les besoins de notre région auprès des paliers supérieurs, tous les leviers sont déjà occupés — souvent au service de copinages et d'intérêts personnels.
Un dernier élément, trop souvent passé sous silence : la Côte-de-Beaupré est l'un des territoires colonisés les plus anciens du Québec. Nous n'avons jamais réellement été les décideurs chez nous. Les réflexes judéo-chrétiens du « être né pour un petit pain » demeurent profondément ancrés. Il est temps que cela change.
Non, le Mont-Sainte-Anne ne devrait pas être confié à un autre acteur privé.
Il devrait être géré par nous, par la MRC, avec l'appui du Québec pour le relancer.
Non, notre arrière-pays ne devrait pas être sous la gouvernance d'une institution archaïque.
Il devrait être administré collectivement, par et pour le territoire.
Non, le développement immobilier sauvage ne devrait pas être la norme.
Non, l'étalement urbain de la Ville de Québec ne devrait pas se faire sans vision régionale.
Notre territoire est magnifique.
Notre collectivité l'est tout autant.
Des solutions existent. Sortons RCR et reprenons le contrôle de notre montagne, de notre arrière-pays, de nos rivières et de notre fleuve. Bonifions et coordonnons nos réseaux de transport collectif : le quai, le chemin de fer, la PluMobile. Lançons un média local fort, indépendant et multiplateforme.
Revisitons notre démocratie locale : un préfet élu au suffrage universel, des budgets participatifs, des regroupements municipaux intelligents respectant la représentativité locale, et un véritable appui à nos organismes communautaires.
Le Mont-Sainte-Anne n'est pas un accident.
Il est le symptôme.
À nous maintenant d'agir sur la cause.
Jonathan Tremblay, citoyen engagé
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La « Gen Z » face à la corruption du monde

Avez-vous remarqué ce drapeau de pirate qui flotte aux quatre coins du monde et sert d'étendard aux peuples en révolte ? Madagascar, Maroc, Népal, Pérou… Alors que l'impuissance domine en Europe occidentale, la vitalité des insurrections récentes de la “Génération Z” élargit l'horizon. Cartographie et analyse de révoltes qui font vaciller les pouvoirs.
Tiré de Terrestres
La revue des écologies radicales
9 décembre 2025
Par Alain Bertho
Une tête de mort coiffée d'un chapeau de paille : ce curieux drapeau « Jolly Roger », emprunté au manga One piece, flotte désormais sur des foules en colère (1). En octobre 2025, il est devenu le symbole de la « Génération Z », autoproclamée Gen Z, dans les rues de Lima, Antanarivo, Jakarta, Mexico, Manille, Katmandou, Marrakech et … Paris le 18 octobre.
Symbole générationnel, il est le premier drapeau international à être ainsi brandi depuis 20 ans. Le drapeau arc en ciel, symbole de paix apparu au début du siècle au sein du mouvement altermondialiste, avait été depuis longtemps troqué pour le drapeau national lors des soulèvements du printemps arabe (2011) et des places occupées (2011-2014), comme lors des soulèvements de 2018-2019 – à commencer par celui des Gilets Jaunes en France. Le drapeau national, toujours présent, est aujourd'hui complété par ce trait d'union planétaire qui proclame des exigences communes.
Enfants pirates de la Matrice
Le nom de Génération Z n'est pas né dans la rue mais trouve son origine dans la sphère médiatico-managériale (2). Suivant les « génération X et Y » et précédant la « génération Alpha », démographiquement définie comme née entre 1997 et 2010, elle serait la première génération « nativement digitale », née et élevée dans un monde numérique infiniment plus prégnant qu'il y a seulement quinze ans (3).
Ce constat est factuellement juste. Rappelons que depuis la naissance du World Wide Web en 1991, du SMS en 1992, du smartphone Ibm en 1994 et de l'IPhone en 2007, la croissance de la toile a été exponentielle. Nous sommes passés de 1 million d'ordinateurs connectés en 1992 à 36 millions en 1996, 370 millions au tournant du siècle, et plus de 5 milliards aujourd'hui.
Durant ces 25 années, alors le nombre d'ordinateurs connectés est multiplié par 15, le téléphone portable a supplanté ces derniers dans les usages personnels d'Internet… et dans le nombre d'appareils. Les estimations sur le parc mondial actuel oscillent entre 8,5 milliards et 7,1 milliards, contre 3,7 milliards en 2016. Ils représentent plus de 60 % du trafic Web mondial, allant jusqu'à 90 % dans des pays sous équipés comme le Soudan, la Libye, la Syrie ou le Tchad (4).
La « Matrice », née dans l'imagination de deux réalisatrices visionnaires en 1999 (5), semble devenue réalité. Ne sommes-nous pas aujourd'hui confronté·es à un univers numérique qui capte les flux financiers comme nos rêves, nos désirs de résistance comme la surveillance policière, machine globale d'information et de désinformation, de promotion de soi manipulée par des algorithmes, de production d'images irréelles dans un monde où les ruines progressent, notamment en raison des besoins énergétiques exponentiels de la gestion des données ? L'Agence internationale de l'énergie prévoit un doublement des besoins d'électricité des Data Centers avec la progression de l'IA. Comme dans le film de 1999, la Matrice se nourrit de la destruction de la planète et de son humanité.
L'une des spécificités démographiques de la Génération Z est bien d'être née dans un monde déjà dominé par la Matrice et d'avoir été biberonnée par les portails offerts à chacune et chacun que sont les déjà vieux Facebook (2004), YouTube (2005), X (ex-Twitter 2006), mais aussi des portails plus récents comme Instagram (2010), Snapchat (2011), Tiktok, Telegram (2014) et Discord (2015).
Animation Matrix. Wikimedia.

Mais ce constat ne nous dit rien du rapport de cette génération au monde social et à son avenir. Pourquoi imaginer qu'elle serait plus prisonnière de la Matrice que celles qui l'ont précédée ? Comme dans le film de 1999, et depuis vingt ans au moins, la résistance articule l'action au sein du monde numérique et l'action rematérialisée, celle des corps eux-mêmes libérés de la toile digitale. Le développement des liaisons numériques a accompagné toutes les grandes révoltes du siècle. Les photos des voitures brulées circulaient comme des trophées sur Skyrock en 2005 (6). En 2008, Twitter a été mis en vedette pour son usage au sein de la contestation de masse des élections présidentielles de juin en Iran. En 2011, les jeunes Tunisien·es ont prouvé comment la censure d'Internet par Ben Ali avait fait d'eux des experts en cyber-résistance. Le partage des images a été un élément de poids dans le printemps arabe (7). Depuis lors, quelle mobilisation peut se passer d'une présence en ligne, de compte Facebook ou Instagram ? (8)
À cette longue antériorité s'ajoute une expérience biographique. Voici une génération entrée dans la vie adulte dans la confrontation à une pandémie universelle, à un retour dramatique de la matérialité vitale de l'humanité et de sa fragilité. Cette génération COVID a fait l'expérience du contrôle policier universel des corps, des relations sociales enfermées dans les écrans.
Comment s'étonner, dans ces conditions, que la marque politique brandie par la Gen Z soit le Jolly Roger de One Piece ? C'est peut-être l'indice de sa capacité universelle de détourner ces portails numériques au profit d'une résistance qui prend corps dans la rue, dans l'espace public matériel de la politique.
Philippines, septembre 2025. Wikimedia.
Comment penser qu'une telle génération connectée n'aurait pas vent de ce qu'on dit ou écrit sur elle ? La voici donc qui, d'un continent à l'autre, s'approprie le vocabulaire objectivant des commentaires de celles et ceux qui l'observent comme des entomologistes observent des insectes en laboratoire. Tels les révoltés des Pays Bas en 1566 traités de « Gueux » par la royauté espagnole, elle retourne le stigmate et revendique l'étiquette qu'on lui a accolée. La voici qui brandit son nom comme une subjectivité politique pirate symbolisée par le manga le plus lu au monde, apologie universelle d'une piraterie de justice sociale. Nous y reviendrons.
➤ Lire aussi |L'effondrement a commencé. Il est politique・Alain Bertho (2019)
Le message singulier des révoltes
Les mobilisations de l'auto-nommée Gen Z marquent une étape singulière dans le message que portent les révoltes des peuples depuis 25 ans9. Elle s'affirme comme un acteur politique apartisan et exigeant, promoteur de mobilisations, porteur de principes de vie commune. La Génération Z émerge comme symbole d'un nouveau cycle de confrontation des peuples et des pouvoirs.
Elle se pense comme telle : l'adoption du nom et de la bannière affirme une culture et une subjectivité commune, une communauté de révolte. La circulation des informations, des images et des symboles construit une dynamique de propagation. Les jeunes Marocain·es de 2025 ont l'exemple du Népal en tête comme Aminatou, Bewdo et Khouma me faisaient part à Dakar en 2011 de leur souhait de faire aussi bien que les jeunes Tunisien·nes (10). De la même façon, en 2019, le port du Gilet jaune avait fait école en Belgique, au Royaume Uni, en Allemagne, en Afrique du Sud, au Canada, en Irak, dans une trentaine de pays au total. Sauf en Égypte ou le gouvernement avait interdit préventivement la vente de gilets aux particuliers.
Caractérisée par ses modes d'organisation numériques et horizontaux et l'usage notamment de la plateforme Discord, la Gen Z ne se mobilise pas prioritairement en réaction à des évènements tels que ceux qui ont déclenché émeutes et soulèvements depuis 20 ans comme la mort d'un jeune ou la hausse des prix des transports ou du carburant. Ses mobilisations portent sur des principes de gouvernement et ce qu'elle perçoit comme des entorses fondamentales au bien commun : la corruption, l'austérité budgétaire qui ravage les services publics, la désinvolture démocratique, l'effondrement des états face aux mafias et à la corruption généralisée du Capital. Peu porteuse, dans l'état actuel des choses, d'une alternative constituante, elle se manifeste d'abord par la soudaineté des révoltes et par son efficacité dégagiste.
Népal, septembre 2025. Wikimedia.
Sri Lanka, Bangladesh, Népal, Madagascar : un dégagisme expéditif
Depuis 20 ans, combien de soulèvements ont mis à bas le pouvoir en place ? Trois en 2011 (Tunisie, Égypte et Libye), un en 2014 (Ukraine), deux en 2019 (Chili et Soudan). En trois ans, depuis 2022, quatre cheffes et chefs de gouvernement ont dû prendre la fuite en urgence face à la mobilisation de la rue : le président srilankais, la première ministre bengali, le premier ministre népalais et le président malgache.
Il n'a fallu que quelques semaines aux manifestations de « l'Aragalaya » (la lutte), pour mettre en fuite le président du Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa. La lourde répression des premières manifestations contre les pénuries n'a fait que renforcer la révolte. Le blocage des réseaux sociaux a été contourné par une jeunesse virtuose d'une technologie dans laquelle elle a grandi et notamment de l'usage de VPN. Le 9 juillet 2022, l'occupation du palais présidentiel à Colombo signe la fin de la domination de la famille Rajapaksa.
Car les pénuries, la dette publique qui ont fait suite à la gestion du Covid sont entièrement mis au compte d'une dynastie dominant la vie politique du pays depuis la fin de la guerre civile en 2009. Le président Gotabya Rajapaska est le frère d'un ancien président, Mahinda, devenu son premier ministre. Leur autre frère, Basil, était ministre des finances. À l'accaparement du pouvoir politique s'ajoutent les pratiques de corruption massive d'une famille qui a mis les intérêts de l'État au service de ses intérêts patrimoniaux. La crise met en avant la coalition de gauche National People's Power (NPP), créée en 2019, qui gagne haut la main les législatives de 2024.
La Gen Z se mobilise contre ce qu'elle perçoit comme des entorses fondamentales au bien commun : la corruption, l'austérité budgétaire qui ravage les services publics, la désinvolture démocratique, l'effondrement des états face aux mafias et à la corruption généralisée du Capital.
Deux ans plus tard, ce n'est pas la corruption mafieuse qui met le feu au Bangladesh, mais la mise en place d'un système préférentiel de recrutement de la fonction publique au profit de ce qui apparaît comme un clan. Le système des quotas instauré au profit des vétérans de la guerre d'indépendance et de leurs descendants avait été aboli en 2018. Sa restauration par décision de la Cour suprême le 5 juin 2024 génère immédiatement une mobilisation étudiante.
Le « Mouvement étudiant anti-discrimination » lance alors le « blocus du Bangladesh ». La suspension provisoire de la réforme par la Cour d'Appel le 10 juillet ne fait que renforcer la détermination du mouvement. Dans les jours qui suivent, la répression est violente, faisant une centaine de morts. Internet est coupé. La prise d'assaut du palais gouvernemental provoque la fuite en Inde de la première ministre Sheikh Hasina en poste depuis 15 ans et le basculement de l'armée du côté du soulèvement. La « Révolution de la mousson » met ainsi fin au règne de la Ligue Awami, cheville ouvrière de l'indépendance. Le prix Nobel de la paix Muhammad Yunus est nommé Premier ministre par intérim.
Bangladesh, 2024. Wikimedia.
En 2025 vient le tour du Népal, où Khadga Prasad Shama Oli, dirigeant du Parti Communiste du Népal, est premier ministre pour la troisième fois. La jeunesse se mobilise sur Internet contre la corruption du gouvernement et des administrations, le népotisme et l'opulence affichée sur les réseaux sociaux par la classe politique. Pour y répondre, le 4 septembre 2025, le gouvernement ferme 26 réseaux sociaux non légalement déclarés en vertu d'une décision de la Cour suprême datant de 2023, dont Facebook, YouTube, LinkedIn, Signal et Snapchat. Mais il n'empêche pas pas Tiktok, ni la possibilité de recourir à un VPN. La Gen Z, qui constitue 40 % de la population du pays, se soulève le 8 septembre. Le drapeau Jolly Roger surgit quand la foule tente d'investir le Parlement fédéral. L'affrontement est violent. Human Rights Watch parle de 76 morts (11). Dans la soirée, le blocage des réseaux est levé. Trop tard : le 9 septembre, les résidences du premier ministre et celles de membres du gouvernement et du Parlement sont prises d'assaut et incendiées, ainsi que les locaux du Parti Communiste. Le premier ministre prend la fuite. L'armée investit la rue. Le 11 septembre, des pourparlers s'engagent entre l'armée et les représentants de la Gen Z. Soutenue par ces derniers, l'ancienne juge en chef de la Cour Suprême, Sushila Karki, est nommée première ministre par intérim.
À Madagascar, comme au Sri Lanka, pénuries structurelles et corruption étatique sont aux racines de la colère. Et comme au Népal, le Jolly Roger surgit dans les manifestations. Comme au Bangladesh, l'armée rejoint le mouvement. Quatre jours suffisent pour mettre en fuite le président. La Haute Cour Constitutionnelle confie le pouvoir au colonel Michael Randrianirina qui dissout les institutions en attendant d'éventuelles élections dans un délai de deux ans.
Dans ces quatre cas, la corruption politique, l'accaparement de l'institution publique au profit de quelques un·es, famille, clan, parti, ont été les moteurs de la révolte. À l'instar des mouvements tunisien et égyptien en 2011, les soulèvements qui ne portaient pas d'alternative laissent gérer leur victoire par d'autres : les militaires au Népal et à Madagascar, une figure symbolique au Bangladesh.
Image ©GenZ Madagascar
La corruption comme effondrement du commun
D'autres pays sont secoués par la Gen Z sans que la mobilisation ne provoque l'effondrement immédiat du pouvoir. La corruption, et parfois l'insécurité mafieuse, sont les moteurs d'une mobilisation contre l'effondrement de l'esprit public.
En Indonésie, le Jolly Roger a été brandi par la mobilisation lancée à l'initiative de l'Union des étudiants Indonésiens contre des coupes budgétaires massives, puis contre l'augmentation des frais de fonction des députés en août. Du 25 août 2025 au 1er septembre, la répression est violente. Internet est coupé.
Aux Philippines, depuis 2024, une controverse grossit sur les milliards de pesosalloués à la gestion des inondations, les constructions au rabais et l'accaparement des contrats par un petit groupe d'entrepreneurs. Le Jolly Roger flotte à Manille le 21 septembre 2025 lors d'une violente manifestation contre la corruption. Au même moment, au Timor oriental, la décision d'acheter des SUV aux députés (pour 4 millions de dollars) mobilise victorieusement durant trois jours les étudiants à Dili, la capitale.
Au Pérou, en octobre 2025, le mouvement lancé sur les réseaux sociaux exprime l'épuisement populaire face à l'instabilité institutionnelle (huit présidents en dix ans), l'insécurité et la corruption. Le remplacement de la présidente destituée Dina Boluarte par son vice-président José Jeri, accusé de corruption et de viol, met le feu à Lima, Arequipa, Cusco et Puno. Le vieux slogan « que se vayan todos » (qu'ils s'en aillent tous) côtoie le Jolly Roger.
Pérou, octobre 2025. Wikimedia.
En novembre, des mobilisations massives emplissent les rues du Mexique contre la corruption et la violence des cartels à l'appel de la Gen Z. Le Jolly Roger flotte sur le Zocalo lors de l'assaut symbolique contre le Palais National. Si la manifestation n'a pas conduit à un soulèvement, la Gen Z fait maintenant partie du débat politique national.
En Serbie, tout est parti de l'effondrement meurtrier du portail flambant neuf de la gare de Novi Sad le 1er novembre 2024. Le drame devient le symbole de la corruption de l'État pour la jeunesse. Malgré la répression, la mobilisation sur l'ensemble du pays ne faiblit pas. Sept mois après le drame, des barricades sont encore érigées à Belgrade.
➤ Lire aussi | Pour que la dignité devienne une habitude・Omar Felipe Giraldo (2022)
La démocratie comme puissance populaire
Reste la démocratie. La politique au sens institutionnel du terme s'invite ici de deux façons : par la contestation brutale des dynasties électorales et des scores obscurs qui font des urnes une farce quasi officielle, mais aussi par la volonté de peser directement sur les grands choix du pays, notamment budgétaires.
La contestation brutale des processus électoraux est devenue un classique dans certains pays d'Afrique. Les émeutes de Guinée en 2020, de Côte d'Ivoire en 2020 et 2025, du Cameroun en 2025, ne sont pas une surprise. Quant à la crise institutionnelle du Pérou en 2023, conséquence de la destitution du président Pedro Castillo, elle a mobilisé beaucoup plus largement que la génération Z.
En 2024, il n'en est pas de même en Tanzanie où la domination trentenaire du Chama cha Mapinduzi (Parti de la Révolution) est personnifiée par Samia Suluhu, la présidente sortante et candidate à sa réélection. L'élection est précédée d'une répression systématique des opposants (parti Chadema), des journalistes et de la société civile, qualifiée de « vague de terreur » par Amnesty international. Les candidats d'opposition sont disqualifiés. L'élection de Samia Suluhu avec 97.95 % des voix provoque un soulèvement à Dar Es Salaam et dans toutes les grandes villes du pays. La jeunesse, qui s'est massivement abstenue, affronte une répression féroce. On compte au moins 700 morts.
En 2024, au Kenya, c'était la même jeunesse, connectée, informée mais sans illusion sur les processus électoraux, qui avait décidé de s'opposer à une nouvelle loi fiscale et s'en est donné les moyens en ligne : #OccupyParliament et #RejectFinanceBill2024, crowdfunding pour financer le voyage vers Nairobi le jour des manifestations. Des numéros de téléphone des dirigeants politiques sont divulgués pour les spammer avec des SMS et des messages WhatsApp. Sur le Web, un « mur de la honte » dresse la liste des hommes politiques qui soutiennent le projet de loi de finance (12). Le 18 juin 2024, la rue donne corps à la mobilisation à Nairobi. Le 19 juin, le Parlement amende le texte sans le retirer, provoquant une mobilisation violente dans tout le pays. Le 25, le Parlement lui-même est pris d'assaut. Le 26 juin, le projet de loi est annulé. Comme la loi de finance de l'année précédente, annulée par la justice après une mobilisation massive en dépit de la répression. Cette puissance démocratique directe s'installe dans la durée et la Gen Z est encore dans la rue en juin 2025 pour l'anniversaire de sa victoire, et encore le 7 juillet pour les 35 ans du soulèvement de 1990 (13).
Cette puissance est autant dans l'air du temps que dans l'ADN de la Gen Z. En Colombie, en 2021, une mobilisation populaire majoritaire et intergénérationnelle, très violemment réprimée (47 morts) s'oppose aux coupes budgétaires et aux hausses massives d'impôt prévues par la réforme fiscale. La réforme est finalement abandonnée.
Maroc, octobre 2025. Wikimedia.
Au Maroc, alors qu'on annonce depuis janvier un budget de 200 milliards d'euros pour financer la Coupe d'Afrique des Nations, mi-septembre, huit femmes enceintes meurent à l'hôpital d'Agadir lors de césariennes. Ce sacrifice meurtrier des budgets de la Santé et de tous les services publics, notamment de l'éducation, est au cœur de la mobilisation de la « Gen Z 212 » (212 est le code téléphonique du pays), qui commence le 27 septembre 2025 à Rabat, Casablanca, Marrakech, Agadir et Tanger, puis se répand à Salé Didi, Bibi, Kelaât M'Gouna, Inzegane, Témara, Beni Mellal, Aït Amira, Oujda et Lqliaâ. Plus de 1 500 personnes font l'objet de poursuites judiciaires. En octobre, la cour d'Appel d'Agadir prononce des peines de prison lourdes allant jusqu'à quinze ans de prison ferme pour trois accusés.
Plus modeste, le mouvement « Bloquons tout », lancé en mai 2025, appartient à la même galaxie. Certes, en France, les réserves démographiques de la Gen Z sont sans commune mesure avec le Kenya ou la Tanzanie. Mais on trouve ici aussi dans le viseur un budget particulièrement austéritaire. Les modes opératoires sont les mêmes : organisation horizontale, usage systématique de la messagerie Telegram. La fréquentation des assemblées locales préparatoires ne fait pas de doute sur la dynamique générationnelle. Si le mouvement n'a pas vraiment bloqué le pays le 10 septembre, il a néanmoins eu deux conséquences historiques : la chute volontaire du gouvernement Bayrou dès le 8 septembre et l'appel à la grève générale de tous les syndicats le 18. Jamais un gouvernement n'avait décidé de se faire harakiri devant le Parlement à la seule annonce d'une mobilisation. Jamais le mouvement syndical unanime n'avait appelé à la grève contre un projet de budget ! Et le « Jolly Roger » est sporadiquement apparu sur les défilés…
Tableau des mobilisations, par Alain Bertho.
2019-2020, universalisation de la lutte, défaillance des États
Partout donc, la corruption, le népotisme et la prévarication symbolisent l'effondrement de l'esprit public, de l'État comme garant de l'avenir commun au profit d'intérêt de clans à l'heure où l'avenir même de l'humanité semble compromis. C'est un élément nouveau dans les 25 années de mobilisation et de répression violente qui ont ouvert le XXIème siècle. Ce tournant s'enracine visiblement dans l'expérience de la pandémie et la multiplication des catastrophes climatiques et écologiques vécues auxquelles les pouvoirs ne font pas face.
Inaugurée par les émeutes de Seattle à l'occasion d'une conférence de l'Organisation Mondiale du Commerce (29-30 novembre 1999) et de Gènes lors de la réunion du G8 (19 juillet 2001), la longue période de brutalisation mondiale des rapports politiques trouve donc un nouveau souffle. La mondialisation (et la financiarisation) du capitalisme et de sa gouvernance politique, engagée depuis un demi-siècle a mis à distance systématique des hommes et des femmes tant des lieux stratégiques de production du profit que des lieux de décision politique. Dans des situations nationales très diverses, les peuples ont fait l'expérience de l'impuissance politique face aux choix néolibéraux. En désarticulant les sociétés, les pouvoirs étatiques et financiers désarticulent et désarment le Demos. Les souffrances n'ont plus d'expression politique ni les revendications d'interlocuteurs. Dans ces conditions, chaque conflit court le risque de s'exprimer dans ce que Martin Luther King nommait « le langage de ceux qui ne sont pas entendus » : l'émeute. Et les émeutes se sont en effet multipliées contre la vie chère (2008 par exemple) comme face la mort de jeunes tués par la police (France 2005 et 2023, USA 2012-2014 et 2020, Iran 2022), contre la hausse du prix du carburant ou du métro (soulèvements de 2019).
Le plus souvent ponctuelles et sans lendemains visibles, prenant parfois au contraire la forme brusque d'un soulèvement national voire d'une insurrection, les émeutes, par leur récurrence peuvent aussi installer une sorte de dissidence populaire durable, de soulèvement à bas bruit. Elles cimentent alors une méfiance structurelle entre les peuples et les pouvoirs, entre le Demos et le kratos.
Ces émeutes ont une histoire que j'ai rappelée à grands traits dans un précédent article de Terrestres (14). Les soulèvements de 2019 dans le monde marquent une étape cruciale. Après le lancement du mouvement des Gilets jaunes le 17 novembre 2018, de proche en proche plus de vingt pays dans le monde ont connu des soulèvements concomitants. C'est plus, en extension géographique et en durée, que les mobilisations de 2011 nommées alors « printemps arabe ».
Mexique, novembre 2025. Wikimedia.
En 2019, le déclencheur fut toujours très concret, lié à une décision ou à des pratiques gouvernementales mettant en danger la survie matérielle ou la liberté des personnes et des familles. Partout la colère englobe toute la classe politique. Mais là où le dégagisme de 2011 avait laissé de vieux chevaux de retour ramasser le pouvoir abandonné par des dictateurs en déroute comme en Tunisie ou en Égypte, les révoltés de 2019 n'ont laissé personne parler et décider à leur place. Les soulèvements devenus insurrection au Chili et au Soudan, ont engagé un processus constituant remarquable, quelle qu'en soit l'issue finale (coup d'État militaire au Soudan, référendum négatif au Chili sur la Constitution). Si le bilan global de l'année est une défaite des peuples face à la répression, celle-ci ne signe pas pour autant une victoire politique des pouvoirs en place qui perdent en légitimité ce qu'ils ont gagné par la violence d'État.
Après le lancement du mouvement des Gilets jaunes le 17 novembre 2018, de proche en proche plus de vingt pays dans le monde ont connu des soulèvements concomitants.
Immédiatement après, en 2020, la pandémie a enfoncé le clou. Avec son lot de peurs, de dénis complotistes, de solidarité, d'obéissance et de révoltes, elle a été un choc pour les peuples mais aussi pour les États. Ces derniers ont camouflé par un contrôle autoritaire des populations la révélation universelle de leur défaillance biopolitique, de leur lien privilégié avec des puissances financières – qui font même de la mort une source de profit.
2020 a été une année record p (our le nombre d'émeutes et d'affrontements civils. Un cinquième des affrontements a concerné les politiques sanitaires et un cinquième les mobilisations contre la police et les violences policières. Si on ajoute les émeutes et affrontements liés aux élections, à la corruption des États et aux attaques contre les libertés, plus de 60 % des situations d'affrontement ont été générées par une remise en cause fondamentale de l'autorité publique, de sa légitimité et de sa police (15).
➤ Lire aussi | Quand le néolibéralisme enfante le néofascisme : aux sources d'une révolution idéologique・Haud Guéguen (2025)
2021-2025 : un nouveau cycle
Quand la défaillance biopolitique des États devient clairement universelle, la physionomie et la géométrie des révoltes se transforme. En 2021, la brutalisation se maintient de façon diffuse. Le monde, hormis la Colombie (16), ne connaît pas de grands mouvements nationaux. Puis, dans les années qui suivent, l'expression violente et localisée des révoltes marque le pas au profit de soulèvements plus larges à la fois plus fréquents et plus directement motivés par la remise en cause globale de la gouvernance néolibérale autoritaire : la violence d'État, la corruption, les choix budgétaires, le trompe l'œil démocratique des institutions électorales.
Références sur la page personnelle de l'auteur : https://berthoalain.com/documents/
Ainsi émergent d'abord trois soulèvements nationaux : aux USA après l'assassinat de George Floyd (25 mai 2020), en Iran après celui de Masha Amini (16 septembre 2022) et en France après celui de Nahel Merzouk (27 juin 2023). Dans les trois cas, la répression est à la hauteur de la puissance de la colère populaire. Dans deux cas au moins, ces soulèvements ont une résonnance mondiale, jamais vue jusqu'à présent, dont témoigne alors la viralité soudaine et mondiale de deux mots d'ordre : « I can't breathe » et « Femmes Vie Liberté ».
Ainsi s'ouvre donc le cycle de la Génération Z. Dans un monde aux prises avec le néolibéralisme autoritaire et une financiarisation écocidaire, depuis le début du siècle, émeutes et soulèvements sont un signe incontestable de vie des peuples et de l'humanité tout entière. Ces mobilisations ont été les véritables pulsations du siècle, portant lumière et exigences sur tous les fronts de souffrance et de résistance collective. En 25 ans, six pulsations ont ainsi secoué le monde : l'égale dignité de toutes les vies, la volonté collective de survie, la défiance démocratique, la décolonisation, la lutte contre le patriarcat et la défense du vivant (17).
La Génération Z les rassemble toutes en contestant aux États le monopole de la compétence publique et celui de la légitimité démocratique, en portant le fer sur le cœur de l'époque : le sacrifice de tout intérêt public ou collectif au profit de quelques puissants. La corruption comme les budgets austéritaires sont le nom de cette mainmise universelle des logiques de profit financier sur les décisions collectives. L'exigence démocratique n'est pas qu'une question institutionnelle. Elle est une exigence de reconstitution de la puissance du Démos.
Photo Unsplash.
One Piece n'est pas qu'un drapeau : c'est la revendication d'une trame subjective commune, un combat contre la corruption du gouvernement du monde.
Le commun, le demos et l'ethnos
Dans ces conditions, quelques questions politiques se posent. La Gen Z a-t-elle un projet ? La référence à One Piece n'est pas indifférente, ni le succès planétaire de ce manga au propos fortement politique : un héros issu de quartiers pauvres et marginalisés, une confrontation à un gouvernement mondial corrompu…. Pour certains militants plus âgés, comme Youcef Brakni, un des animateurs du comité Vérité et Justice pour Adama Traoré, ou Fatima Ouassak, politologue et fondatrice du Front de mères, c'est clairement une leçon d'engagement qui les a formé.es dès leur enfance (18).
One Piece n'est pas qu'un drapeau : c'est la revendication d'une trame subjective commune, un combat contre la corruption du gouvernement du monde. Cet ancrage culturel fait la différence entre la Gén Z autoproclamée, mobilisée et pirate, et la « Génération Z » telle qu'elle est définie démographiquement. On ne peut pas affirmer que ses « idéaux » seraient « ambivalents » au titre de la diversité politique de la génération (19). Si la génération démographique est très diverse, la Gen Z mobilisée porte quelques grands principes communs et une aspiration affirmée à la défense du commun, à l'instar de Luffy le pirate. D'autre part, en comparaison avec les soulèvements de 2019, on ne peut pas dire que la Gen Z est purement pragmatique (20).
Pour autant, elle n'est pas encore porteuse d'une aspiration démocratique incarnée dans un peuple politique, un Demos. Quels sont aujourd'hui les enjeux de sa constitution et de sa puissance du Demos ? Il y en a deux : la rematérialisation politique par l'assemblée et l'ancrage national du Démos politique contre la tentation de l'Ethnos identitaire.
Avec des moments forts comme « ¡Democracia Real ya ! » en Espagne, les printemps arabes en 2011, la révolution ukrainienne en 2014, les mobilisations de 2019 et notamment les Gilets Jaunes, voire la mobilisation contre la réforme des retraites en France en 2023 (21), cette question s'affirme de façon de plus en plus explicite. Elle est bien sûr une dimension incontournable des mobilisations écologiques lorsqu'elles veulent opposer une expertise populaire au monopole de la compétence revendiqué par les pouvoirs publics.
Népal, septembre 2025. Wikimedia.
Cette affirmation d'un corps politique commun passe par l'incarnation corporelle, physique de l'exigence démocratique dans l'espace public alors que le monde économique, social, informationnel et gouvernemental veut par tous les moyens se protéger de la démocratie notamment par une numérisation galopante. Dès son origine antique, la démocratie s'est fondée dans les assemblées que la démocratie représentative a voulu ensuite éloigner du pouvoir. Les assemblées resurgissent obstinément lors de la Commune de Paris, de la révolution russe et dans tous les grands moments de soulèvement populaire. On les voit renaitre au XXIème siècle avec les places occupées de Tunisie, d'Égypte, d'Espagne et de Grèce en 2011, suivies d'Istanbul et Kiev, Nuit Debout à Paris en 2016, les ronds-points et les assemblées de Gilets Jaunes de 2018-2019.
Cette dimension est encore embryonnaire dans la Gen Z. L'installation dans la durée nécessite organisation, débat, réflexion collective sur les objectifs du mouvement. Une mention spéciale doit être accordée à la situation serbe (22). Les zborovi, assemblées citoyennes, se forment au mois de mars dans les villages ou les quartiers des grandes villes (23). Des revendications sont adoptées par le mouvement dès le mois de mars, débordant largement la colère initiale. « Liberté, justice, dignité, État, jeunesse, solidarité, savoir et avenir » structurent la plateforme d'un mouvement apartisan bien décidé à affirmer sa puissance citoyenne. Une véritable dissidence populaire prend racine.
En 2024, la chute de la fièvre émeutière et des affrontements civils dans le monde a été spectaculaire. La violence s'est pour une part déplacée : dans la guerre civile, dans la guerre faite aux civils jusqu'au génocide, dans des déchainements xénophobes d'une ampleur inédite.
Reste à éviter la tentation identitaire de l'Ethnos, très présente aujourd'hui. L'année 2024 fut à cet égard critique (24). La chute de la fièvre émeutière et des affrontements civils dans le monde a été spectaculaire. La violence s'est pour une part déplacée : dans la guerre civile, dans la guerre faite aux civils jusqu'au génocide, dans des déchainements xénophobes d'une ampleur inédite. Il n'y a pas qu'en Cisjordanie que la logique de guerre civile et de guerre coloniale mobilise les civils. Le nombre d'affrontements directs entre les populations a augmenté de 50 % et leur poids dans la totalité des émeutes et affrontements civils est passé de 7 % à 18 %.
Nous en avons vu une manifestation terrifiante en Angleterre durant l'été 2024 quand, dans 26 villes, des foules populaires s'en sont pris physiquement aux mosquées et aux hôtels de demandeurs d'asile (25). L'été 2025 a vu la peste s'étendre : en Irlande du Nord contre les Rroms, en Espagne contre les Marocains, en Angleterre enfin où les manifestations anti migrants se sont multipliées.
La Gen Z n'est pas à l'abri de cette dérive du Démos politique à l'Ethnos identitaire. Le Bangladesh en a été le théâtre dans les jours qui ont suivi la chute de la première ministre Sheikh Hasina en août 2024. Du 8 au 13 août, dans 53 districts du pays, les Hindous, stigmatisés comme partisans de l'ancien gouvernement, sont victimes de violences de masse (26).
Il reste donc de ces derniers mois un sentiment d'inachèvement politique. La critique que porte en acte la Gen Z sur le gouvernement du monde est d'une grande acuité. Ni idéologie ni pragmatisme mais exigence impatiente d'un État soucieux du commun, de solidarité institutionnalisée (dans des services publics et des choix budgétaires), d'honnêteté publique. Cette impatience est expéditive, mais sans lendemains convaincants, là où les pouvoirs sont faibles. Ailleurs, elle fait l'expérience de leur résistance violente. Elle ne réalisera vraiment ses exigences en puissance d'alternative durable que dans sa capacité à redevenir, jusqu'au bout, obstinément terrestre.
Image d'accueil : Mexique, novembre 2025. Wikimedia.
Notes
1. One Piece, manga de Eiichiro Oda, est sorti pour la première fois en 1997. En 2025, 113 tomes sont publiés au Japon. Avec plus de 530 millions d'exemplaires, c'est la série la plus vendue au monde, dessinée par un seul auteur. Son jeune héros, Luffy, cherche à devenir le roi des pirates.[↩]
2. Elisabeth Soulié, La génération Z aux rayons X, Cerf, 2020.[↩]
3. La caractérisation alphabétique des générations est née dans les années 1960 : Jane Deverson et Charles Hamblett, Generation X, 1964 ; Jean Louis Lavallard, « Génération y les millenials », Raison Présente n°11, 2019/3[↩]
4. Sources https://wearesocial.com/fr/ et https://statcounter.com/web-analytics/[↩]
5. Matrix, 1999, réalisé par Larry et Andrew Wachowski, devenues depuis Lana et Lilly Wachowski.[↩]
6. Réseau social créé en 2002 et fermé en 2023. Il permettait la création de blogs individuels (Skyblog).[↩]
7. C'est l'objet de la thèse de Ulrike Riboni « Juste un peu de vidéo » : la vidéo partagée comme langage vernaculaire de la contestation – Tunisie 2008-2014, Université de Paris 8, 2016. Cf. Ulrike Lune Riboni, Vidéoactivismes. Contestation audiovisuelle et politisation des images, Amsterdam, 2023.[↩]
8. Alain Bertho :« Énoncés visuels des mobilisations : autoportraits des peuples », in Anthropologie et sociétés, « Reconnaissances et stratégies médiatiques », 2016/40/1, pages 31-50 ; Alain Bertho « Soulèvements contemporains et mobilisations visuelles », Socion°2 , pages 217-228 ; Alain Bertho, « Émeutes sur Internet : montrer l'indicible ? », Journal des anthropologues, 126-127 2011, pages 435-452.[↩]
9. Alain Bertho, De l'émeute à la démocratie, La dispute, 2024.[↩]
10. Ibid., page 33.[↩]
12. Job Mwaura, « Manifestation au Kenya : la génération Z montre le pouvoir de l'activisme numérique faire passer le changement de l'écran à la rue », The Conversation, 25 juin 2024[↩]
13. Robert Amalemba, « Kenya. Soutenue et organisée, la Gen Z résiste malgré la censure », AfriqueXXI, 22 juillet 2025.[↩]
14. Alain Bertho : « L'effondrement a commencé, il est politique », novembre 2019.[↩]
15. Alain Bertho, « Bilan 2020 : les peuples ne peuvent plus respirer », Médiapart, 30 janvier 2021[↩]
16. D'avril à mai 2021, la grève contre la réforme fiscale et des manifestations violentes touchent toutes les villes de Colombie.[↩]
17. Ces six « pulsations » du cœur battant du monde sont documentées dans le deuxième chapitre de mon livre De l'émeute à la démocratie, la Dispute, 2024.[↩]
18. Voir la vidéo : ONE PIECE : Un manga POLITIQUE ??? – Fatima Ouassak, YouTube, Histoires crépues, 21 mars 2023[↩]
19. Jean-François Bayart, sociologue : « Les idéaux politiques de la génération Z sont très ambivalents, et facilement récupérables », Le Monde, 9 novembre 2025[↩]
20. Cécile Van de Velde, « La colère de la génération Z est très pragmatique », Le Monde, 31 octobre 2025, propos recueillis par Yasmine Khiat.[↩]
21. Alain Bertho, « Et maintenant quel ordre de bataille ? », Regards, 24 avril 2023 et « Faire peuple sans populisme », Regards, 20 juin 2023.[↩]
22. Pauline Soulier, « Serbie : la révolte des étudiants va-t-elle tout renverser ? », The Conversation, 10 mars 2025.[↩]
23. Milica Cubrilo Filipovic et Jean Arnault Dérens, « Zbor : quand la Serbie réinvente la démocratie directe », Le Courrier des Balkans, 24 mars 2025.[↩]
25. https://blogs.mediapart.fr/alain-bertho/blog/110924/face-l-ombre-du-pogrom-ordinaire[↩]
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Depuis l’Amérique de Trump, une vague masculiniste est en train de s’abattre sur le monde.

Il faut en prendre pleinement la mesure : l'internationale réactionnaire et autoritaire a fait le choix d'une confrontation sur la question du genre. La campagne de Donald Trump en 2024 avait de ce point de vue marqué un tournant avec un mot d'ordre clair : redonner aux hommes blancs chrétiens une suprématie mondiale — jusqu'à la conquête de Mars.
28 octobre 2025 | Le grand continent | Illustration : Vue d'artiste d'une casquette qui n'existe pas. © Tundra Studio
https://legrandcontinent.eu/fr/2025/10/28/male-america-great-again/
L'alliage accélérationniste et réactionnaire trumpien intègre de plus en plus explicitement une nouvelle dimension : le masculinisme.
C'est là qu'est la véritable bascule : ce n'est plus « Make America Great Again » mais « Male America Great Again ».
Les masculinistes qui forment cette alliance — composite, dans les Amériques et en Europe — défendent haut et fort le retour à « l'ordre éternel » des sexes et des sexualités ; pour hâter un tel retour, ils ne reculent pas non plus devant la violence.
Les symboles agités disent leurs obsessions virilistes et leur imaginaire sexiste.
Lors du débat télévisé du second tour de la présidentielle brésilienne en 2022, Jair Bolsonaro a demandé à Lula da Silva s'il prenait du Viagra.
Parmi ses cinq priorités de programme, Donald Trump a mis en avant une mesure contre les personnes transgenres.
Giorgia Meloni a trouvé son slogan : « sono una madre, sono una donna, sono Cristiana » 1, mêlant un programme politique aux parfums des tradwives et de la guerre des civilisations.
On pourrait multiplier les exemples à l'envi. L'un d'entre eux résume mieux que d'autres leur programme : à Davos, Javier Milei, a résumé le parti pris masculiniste. Pour le président argentin, le « féminisme radical » serait une « distorsion du concept d'égalité », une « recherche de privilèges » qui opposerait « une moitié de la population à l'autre ». Cette inversion des rôles entre dominants et dominés est au fondement du masculinisme.
Une internationale réactionnaire contemporaine marquée par une esthétique viriliste s'adosse au mouvement masculiniste qui se développe fortement, en réaction — au sens fort de ce mot — à la popularisation des idéaux féministes et à la déferlante #MeToo.
Cette progression est manifeste : le féminisme avance et convainc, notamment chez les jeunes générations. Mais en abaissant les privilèges des hommes et en troublant les repères traditionnels, ces victoires génèrent des crispations et une contre-offensive. C'est le fameux backlash 2 analysé par Susan Faludi 3.
Le masculinisme d'aujourd'hui dépasse pourtant ce seul phénomène par son imbrication avec la réaction : les deux se nourrissent et s'imbriquent.
De Trump à Poutine, de la Hongrie à la Corée du Sud, des discours d'Erdogan à ceux de Modi, toutes les nuances de l'internationale autoritaire et réactionnaire s'appuient sur la valorisation de la différence et de la hiérarchie entre les sexes.
S'appuyant sur des collectifs militants, la « manosphère » 4 et des figures de l'oligarchie finançant de grands médias, ce masculinisme postule que les problèmes et la souffrance des hommes seraient causés par l'influence indue des femmes en général, et des féministes en particulier. En portant des revendications proprement masculines et conservatrices, il légitime et assoit une organisation sociale reposant sur les hiérarchies, les dominations et les prédations.
Penser qu'on pourrait gagner contre le trumpisme en faisant l'impasse sur la question du genre relève de la faute morale et stratégique. Clémentine Autain
Une internationale réactionnaire
Partout dans le monde, l'extrême droite a pour projet fondamental de valoriser la tradition, la religion, les distributions inégalitaires, la jouissance capitaliste et consumériste.
Elle a aussi pour cible la science et les arts.
La percée de l'extrême droite aux États-Unis et en Europe s'agrippe au « déclin de l'Occident », qui aurait été considérablement ébranlé par le recul du religieux et le progrès des Lumières, le mélange des cultures, la décolonisation, le mouvement des femmes, les conquêtes sociales, l'écologie politique, l'essor des pays du Sud. Le retour aux « valeurs occidentales » passe par un combat en faveur de la supériorité des Blancs, de la culture chrétienne, du masculin et de l'hétérosexualité ; il orchestre la chasse aux migrants, l'obscurantisme et la destruction de l'État social.
C'est à cette échelle que la confrontation se situe.
Ce que veulent les trumpistes et leurs avatars, c'est anéantir le mouvement d'émancipation et d'individuation ouvert au XVIIIe siècle, dont l'égalité femmes/hommes est l'une des principales dimensions.
Javier Milei proclame en toute occasion : « Vive la liberté, bordel ! », détournant ce principe de son sens pour le mettre au service des dominants. Pour lui, pour eux, la liberté, c'est la liberté des hommes d'opprimer les femmes, la liberté des marchés financiers, la liberté de détruire la planète, la liberté d'être raciste, la liberté d'expression de la haine — en somme, tout ce qui fait reculer les capacités des individus à devenir libres.
La nature de la réponse progressiste doit donc être à la hauteur de l'offensive.
Aujourd'hui, chez celles et ceux qui défendent l'émancipation, beaucoup s'interrogent.
Face au procès en « wokisme », faudrait-il parler d'autre chose ?
En ferait-on trop sur le terrain du genre ?
Le féminisme serait-il devenu trop consensuel, rebattu, achevé ?
Faudrait-il en finir, à gauche, avec le sociétal pour en revenir au pur social ?
Ces questions sont souvent l'occasion de proposer la mise au placard de la défense des femmes et des minorités ; pas toujours cependant. À l'heure où l'extrême droite a le vent en poupe, nous aurions tort de les balayer d'un revers de la main : il y a de la gravité et de la complexité dans ces questionnements.
Mais penser qu'on peut gagner contre le trumpisme en faisant l'impasse sur la question du genre relève de la faute morale et stratégique. L'égalité femmes/hommes — aujourd'hui très loin d'être achevée — est non seulement une cause juste, elle est incontournable. Et le combat contre l'extrême droite suppose de déminer le masculinisme qui façonne son programme.
Pour gagner, il faut entraîner cette énergie féministe.
Le féminisme contre l'extrême droite
Contre la vague brune, le féminisme est une clef.
Aucun autre mouvement mondial n'est davantage à la mesure de la progression fasciste.
La mobilisation féministe a embrassé les États-Unis et Hollywood, mais aussi les femmes chiliennes, les Espagnoles, les Iraniennes ; elle se répand tout autour du monde.
Cette mobilisation invente ses formes et ses chants ; elle renouvelle ses mots d'ordre. Elle affirme sa force grâce à son caractère intergénérationnel et supra-occidental. Elle a ses icônes — de Gisèle Pélicot à Mahsa Amini. Faisant sien le slogan des combattantes kurdes, « Femmes, Vie, Liberté », elle sait relier trois mots qui opposent un non radical aux idées brunes, mutilantes et mortifères.
La vitalité féministe contre la restauration d'un ordre injuste est pour la gauche un puissant point d'appui. Pour autant, les théories féministes sont plurielles 5 — comme sont diverses les possibilités de les articuler à un projet de transformation sociale et écologiste.
Le féminisme, c'est la défense de toutes les femmes, et pas seulement des privilégiées. Une femme victime de viol est une femme victime de viol, qu'elle soit au RSA ou cadre supérieure, qu'elle habite Versailles ou Tarbes, qu'elle soit blanche ou noire.
Le féminisme que je défends est celui qui parle, qui interpelle, qui défend la majorité des femmes 6 : les caissières et les infirmières, les employées à temps partiel — qui signifie salaire partiel, chômage partiel, retraite partielle — et celles, parfois les mêmes, qui se démènent seules pour élever leurs enfants ; les femmes qui, par millions, souffrent dans l'indifférence de l'endométriose et celles qui n'ont même plus les moyens de s'acheter des protections périodiques ; les jeunes filles qui subissent le harcèlement sexiste sur les réseaux sociaux et les femmes ménopausées que l'on dit périmées sur le « marché de la séduction ».
Détourner les hommes du vote brun
La polarisation dans les votes l'indique clairement : le repli masculiniste actuel conduit de plus en plus d'hommes à se tourner vers l'extrême droite — quand les suffrages féminins se portent de plus en plus à gauche 7.
Cette captation du vote des femmes montre que le féminisme est un élément de dynamique pour la gauche et les écologistes ; il montre aussi que, pour atteindre la majorité, et sans en rabattre sur l'exigence d'égalité, il faut faire mieux pour parler à l'électorat masculin.
Les hommes ont vu leurs privilèges remis en cause — et ce n'est que justice. Mais dans une société où les régressions s'accumulent, où l'air du temps est au « c'était mieux avant », le ressentiment est un dangereux carburant. Les mutations dans l'emploi, le déclin des territoires ruraux et industriels, l'atomisation du salariat et des espaces de sociabilité sont le terreau d'un mal-être dans les classes populaires.
Alors que tout rime avec déclassement aujourd'hui, que l'injonction à être du côté des winners fait partie du décor dans notre régime capitaliste de concurrence et de compétition, comment ne pas regretter, quand on est un homme, ces temps anciens où le patriarcat sans entraves garantissait au moins un domaine où l'on était toujours gagnant ?
Par ce biais, l'extrême droite détourne l'attention des solutions reposant sur le partage des richesses, au profit de celles restaurant des hiérarchies.
Or si les hommes ont des privilèges à perdre dans une société égalitaire, ils ont aussi de la liberté à gagner.
Les injonctions à se conformer aux stéréotypes masculins ne sont pas que joie et bonheur. Se montrer toujours fort, ne pas pleurer, ne pas partager l'intime, se voir attribuer a priori le rôle de l'actif dans la séduction et la sexualité, sont autant de moules dans lesquels le virilisme enferme. La hiérarchie entre les sexes a un corollaire qui touche aussi les hommes : l'assignation à des rôles imposés. Face aux difficultés sociales qui s'accumulent, les hommes se réfugiant dans la mythologie viriliste n'ont-ils pas besoin que l'on prenne le mal à la racine ?
Notre réponse doit être un projet global fort, cohérent, offrant à toutes et tous une projection valorisante, une vie meilleure. Un projet qui protège et apaise, qui vise des services publics accessibles partout et de qualité, un environnement vivable, des salaires permettant de vivre dignement, de la démocratie dans l'entreprise, une sécurité alimentaire, des logements dignes, la réindustrialisation, un soutien à l'économie de proximité et le développement de lieux de soins, de liens, de convivialité. C'est un projet qui place en son cœur l'éducation et la culture.
Le repli masculiniste actuel conduit de plus en plus d'hommes à se tourner vers l'extrême droite — quand les suffrages féminins se portent de plus en plus à gauche. Clémentine Autain
Répondre à l'intersectionnalité des haines
En un mot : ce projet est celui de la société des communs, contre la marchandisation et la déshumanisation ; il propose de s'arracher au déclassement et de se projeter positivement dans l'avenir.
Le jeu de balancier qui a d'abord consisté à ignorer les questions féministes puis à s'en préoccuper pour porter les combats des femmes et des minorités — tout en laissant de côté la défense des classes populaires — doit cesser. Choisir entre le social et le sociétal est une impasse — parce que le prétendu sociétal est en réalité profondément social.
Les individus ne se découpent pas en morceaux, et les femmes sont majoritaires dans les catégories sociales les plus exploitées et les plus précaires. Les conditions de l'émancipation des ouvrières et des employées dépendent de nos victoires contre le capitalisme et le consumérisme.
Quand on est ouvrière dans une conserverie ou employée dans un hôtel, on est à la fois opprimée par le rapport de classe et en tant que femme. Et si l'on est noire ou musulmane — réelle ou supposée —, on subit aussi le racisme. Les oppressions ne s'additionnent pas, elles s'articulent entre elles. L'internationale réactionnaire et autoritaire l'a d'ailleurs très bien compris, elle qui prône l'intersectionnalité des haines. 8
Il faut donc éviter ce double écueil : ni l'économico-social pour solde de tout compte, ni les thèses autrefois promues par le think tank Terra Nova qui proposait de cibler, pour gagner à gauche, les femmes et les immigrés ; c'était là un consternant adieu au prolétariat.
Défendre à la fois le monde du travail et la liberté des femmes, une politique industrielle et les droits des minorités, ce n'est pas associer des choses qui s'opposent : en vérité, celles-ci se complètent. Cet assemblage n'est pas simple, ni exempt de tensions voire de contradictions, mais tous les raccourcis qui ne voient les mécanismes d'oppression que dans un seul rouage ratent la cible.
Pour un nouvel imaginaire du genre
Il n'est pas sérieux de croire que l'on pourrait affronter l'extrême droite sans avoir quelque chose à dire de clairement différent sur les thèmes qui sont au centre de sa propagande.
Il n'est pas sérieux non plus de croire que l'on peut gagner face à l'internationale réactionnaire avec pour seuls messages audibles les droits des femmes ou la lutte contre l'islamophobie.
Le salut viendra de l'articulation des combats émancipateurs.
C'est pourquoi l'égalité doit être portée comme une valeur contre l'essentialisme et l'enfermement identitaire. La conflictualité avec l'extrême droite se situe en grande partie sur ce terrain. L'identité fige et enferme ; l'égalité permet la dynamique émancipatrice.
La confusion s'installe souvent quand on oppose la différence à l'égalité : les hommes et les femmes sont en effet différents par leur corps, leur histoire, leur quotidien — et il y a d'ailleurs une historicité de cette différence 9, dont les concepts suivent l'évolution des rapports sociaux. Je refuse pourtant de valoriser et d'essentialiser cette différence : si le féminisme assigne lui aussi le féminin et le masculin, et/ou inverse la hiérarchie pour faire primer le féminin sur le masculin, nous voici à nouveau dans l'impasse.
La revendication d'égalité postule, elle, que chacune et chacun ne doit pas être voué à un destin préétabli en raison de son appartenance de genre. Quand on parle le langage de l'ennemi, la partie est déjà perdue. Face à ceux que l'identité obsède, soyons clairs sur notre mantra de l'égalité.
Nous avons à créer un autre imaginaire que celui d'une binarité figée, masculin/féminin. Nous touchons ici à l'intime et à des représentations profondément ancrées : nous n'aurons pas de nouveau mythe prêt à l'usage pour les remplacer. Le mouvement de la société dira ce qu'il restera de cette différence, ce que nous décidons d'en faire ; en attendant, l'égalité est le moteur de la libération.
Enfin, le féminisme est aussi fécond pour repenser notre rapport au pouvoir et à la politique.
Revendiquer le droit à l'avortement, l'égalité des salaires et des moyens pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, est essentiel.
Comprendre également que le féminisme vient contester le virilisme tel qu'il s'observe dans la façon de gouverner, de choisir les thèmes politiques ou de faire des discours — le mot tribun n'a d'ailleurs pas d'équivalent féminin —, c'est encore mieux.
Le vocabulaire « militant » en dit long : nous parlons de « camp », de « combat », de « lutte » et de « rapports de force », donnant à voir combien la forme guerrière, masculine, est constitutive de la politique elle-même. Pendant que les Trump et les Poutine radicalisent cet exercice masculin du pouvoir, nous devrions travailler à sa refondation et la donner à voir, pour promouvoir la coopération et approfondir la démocratie — qui reste la condition première de notre victoire.
Sources
1. « Je suis une mère, je suis une femme, je suis chrétienne ».
2. Terme anglais pour « retour de bâton ».
3. Susan Faludi, Backlash, Paris, trad. Lise-Éliane Pommier, Évelyne Châtelain et Thérèse Réveillé, Éditions des femmes, 1991.
4. Le terme « manosphère » (construit de la même manière que « fachosphère ») désigne l'ensemble des communautés en ligne — forums et réseaux sociaux — entretenant une forme de culture viriliste et misogyne.
5. Comme le montre l'ouvrage collectif qui vient de paraître sous la direction de Camille Froidevaux-Metterie, Théories féministes, Paris, Seuil, 2025.
6. Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya, Nancy Fraser, Féminisme pour les 99 %, trad. Valentine Dervaux, Paris, La Découverte, 2019.
7. La sociologie des votes de la dernière présidentielle aux États-Unis ou des élections législatives en Allemagne est de ce point de vue édifiante.
8. Expression empruntée à l'historienne Christine Bard. Voir Christine Bard, Mélissa Blais et Francis Dupuis-Déri (dir.), Antiféminismes et masculinismes d'hier à aujourd'hui, Paris, PUF, 2019.
9. Je renvoie notamment ici aux travaux de Geneviève Fraisse, notamment Les Femmes et leur histoire, Paris, Gallimard, 1998.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Venezuela : la menace impérialiste et les issues possibles du conflit

Comme s'il s'agissait de scénarios écrits par Warren Ellis —The Authority, Transmetropolitan, Planetary—, dans lesquels abondent les arguments exagérés, nous avons assisté au cours des quatre derniers mois à une offensive médiatique et militaire disproportionnée contre la souveraineté vénézuélienne. La double morale de l'administration américaine est passée de l'achat de pétrole vénézuélien — dans des conditions commerciales néocoloniales, résultat des sanctions qu'elle a elle-même imposées et de l'attitude servile du gouvernement Maduro — à la présentation des dirigeants de l'État vénézuélien comme un cartel criminel se livrant au trafic de drogue, dans le but de justifier un déploiement et une éventuelle attaque militaire.
https://vientosur.info/venezuela-la-amenaza-imperialista-y-los-posibles-cursos-del-conflicto/
2 décembre 2025
Elle le fait en toute connaissance de cause, sachant que le gouvernement Maduro est discrédité tant au niveau national qu'international, marqué par un déficit démocratique évident — en particulier depuis les élections présidentielles de 2024 —, un virage autoritaire et néolibéral qui conserve la rhétorique de gauche, et la détérioration de la qualité de vie du peuple et de la classe ouvrière, qui survit avec un salaire minimum mensuel inférieur à un dollar, dans un contexte d'inflation à trois chiffres et de prix des produits de consommation de base deux fois plus élevés que la moyenne régionale. La migration forcée, pour des raisons économiques et politiques, de millions de Vénézuéliens a fracturé les familles et érodé la popularité du gouvernement, au point que le gouvernement Maduro n'a pas réussi à articuler un front national anti-impérialiste face à l'offensive américaine qui inclurait tous les secteurs du pays. La droite cipaya s'est constituée en une sorte de phalange locale qui justifie l'invasion par des arguments aussi farfelus que celui de placer la souveraineté populaire électorale au-dessus de la souveraineté territoriale, alléguant que le manque de transparence des élections du 28 juillet 2024 justifie l'intervention américaine.
Mais rien de tout cela ne suffirait à lui seul à convaincre l'opinion publique américaine, latino-américaine et mondiale d'accepter une attaque militaire disproportionnée contre la patrie de Bolívar. C'est pourquoi on construit une image criminelle du gouvernement lui-même qui, de manière soumise, a livré du pétrole aux États-Unis depuis le début de la guerre en Ukraine ; une opération de propagande qui semble inspirée des monstres créés par le regretté John Cassaday.
Cependant, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait clair dans cette offensive militaire et médiatique américaine, qui un jour attaque de petits bateaux, le lendemain durcit le ton des agressions verbales, puis publie des communiqués grandiloquents contre le gouvernement vénézuélien et donne l'impression d'actions imminentes, pour ensuite laisser le silence et l'inaction alimenter une clinique de rumeurs et de spéculations. Pour couronner le tout, un week-end, il qualifie le gouvernement vénézuélien de « criminel » et le week-end suivant, il annonce l'ouverture de pourparlers directs entre Miraflores et la Maison Blanche.
La question initiale
Le gouvernement de Nicolás Maduro n'est pas une continuation du chavisme, il a ses propres caractéristiques qui produisent un étrange mélange entre une rhétorique socialiste dépassée - à la manière de Staline ou de Mao - pour maintenir un champ international de solidarité, tout en attaquant toute la gauche créole - en s'en prenant judiciairement à ses représentants naturels -, il mène une offensive antipopulaire contre les syndicats et les associations de travailleurs qui tentent d'organiser des luttes pour des salaires équitables et des conditions de vie dignes, il concrétise la suppression des libertés démocratiques minimales, tout en appliquant un programme néolibéral avec un discours sui generis de gauche, sans que cela l'empêche d'attaquer verbalement l'impérialisme américain - pour satisfaire sa base sociale - tout en livrant le pétrole aux gringos dans des conditions terriblement néocoloniales.
Une partie importante de la gauche vénézuélienne dénonçait lors des élections de 2024 que le candidat idéal pour les États-Unis était Nicolás Maduro, car il avait mis en place un gouvernement à l'efficacité autoritaire - non pas économique, politique et sociale - qui livrait sans vergogne les richesses du pays en échange de son maintien au pouvoir, ce que même le duo María Corina Machado (MCM) et Edmundo González Urrutia (EGU) ne pourrait pas faire en toute impunité, car sa propre base sociale le lui reprocherait.
En fait, ceux qui considèrent que Nicolás Maduro est un dirigeant timoré se trompent. Au contraire, il est extrêmement habile pour se maintenir au pouvoir malgré un mécontentement populaire croissant, sans précédent dans l'histoire nationale. Le dictateur Juan Vicente Gómez a gouverné au début du XXe siècle sans causer autant de dommages collatéraux, et la dictature de Pérez Jiménez, dépourvue de libertés démocratiques, a stabilisé l'économie grâce à un programme de développement capitaliste, mais dans lequel la classe ouvrière n'a pas connu la misère actuelle. Le fait que Maduro se maintienne au pouvoir dans ces conditions implique une capacité singulière à gérer et à contrôler les rapports de force, ce qu'il faut prendre en compte dans l'équation de l'analyse.
Mais si Maduro était déjà en négociations ouvertes avec les États-Unis depuis la guerre en Ukraine, faisant à nouveau du Venezuela un fournisseur sûr de pétrole pour le nord, alors pourquoi ce déploiement militaire inhabituel contre le Venezuela ? Les explications simplistes, qui indiquent qu'il s'agit uniquement de garantir le contrôle absolu des réserves pétrolières vénézuéliennes, ne sont pas suffisamment satisfaisantes. Si la richesse du Venezuela en fait la cible de la voracité capitaliste mondiale, et en particulier de l'impérialisme américain, ce déploiement disproportionné semble indiquer d'autres éléments supplémentaires. Nous sommes invités à nous poser cette question afin d'évaluer ce qui n'apparaît pas de manière aussi évidente.
Les faits
À la mi-août 2025, un déploiement naval, amphibie et de troupes a commencé dans les Caraïbes, en particulier autour du périmètre des côtes vénézuéliennes, sans précédent depuis 1902-1903, lorsque le président Cipriano Castro avait refusé de reconnaître la dette extérieure du Venezuela. Dans un premier temps, les États-Unis ont annoncé la mobilisation de 4 000 militaires, dont des éléments de l'Iwo Jima Amphibious Ready Group (ARG) ainsi que la 22e Marine Expeditionary Unit (MEU), des destroyers de classe Arleigh-Burke, un croiseur lance-missiles guidés - comme l'USS Gettysburg , le sous-marin nucléaire USS Newport News (SSN-750), des avions de patrouille maritime P-8 Poseidon et des hélicoptères du Corps des Marines. Le groupe armé a quitté Norfolk, en Virginie, le 15 août 2025, après une longue période sans déploiement dans la région. La presse internationale a rapporté que, par la suite, le 27 août, l'USS Newport News, ainsi que d'autres destroyers et unités de soutien, se sont joints à l'opération de surveillance et de dissuasion dans le sud des Caraïbes, près de la frontière maritime du Venezuela.
Le gouvernement vénézuélien a lancé une offensive médiatique - accusant initialement Marcos Rubio et présentant Trump comme ayant été trompé par ce dernier -, politique, en mobilisant ses bases sociales affaiblies, les miliciens, et en appelant à l'unité nationale. Il refuse toutefois de libérer tous les prisonniers politiques, de restituer la personnalité juridique des partis de gauche à leurs militants légitimes et ne renonce pas à son modèle d'accumulation néo-bourgeoise. Il a également lancé une offensive militaire, en concevant une stratégie de résistance prolongée qui nécessiterait un front social plus large, et une offensive diplomatique dans les différentes instances multilatérales, de l'ONU à la CELAC. Après avoir tenté de manière presque enfantine de créer une division au sein de l'administration Trump, il a attaqué l'offensive en la qualifiant d'impérialiste, tout en prenant soin de ne pas fermer la porte au dialogue avec le locataire de la Maison Blanche.
Les gouvernements progressistes ont réagi de différentes manières : tandis que Boric (Chili) insiste sur le caractère autoritaire et non socialiste du gouvernement Maduro, Petro met l'accent sur le déficit démocratique au Venezuela, qui ne justifierait pas une invasion militaire du pays, Lula souligne qu'il s'agit d'une préoccupation pour la souveraineté de tout le continent et la présidente du Mexique se montre plus proche du discours anti-impérialiste comme priorité.
Le 2 septembre, l'opération Southern Spear a été annoncée, visant à éradiquer ce qu'ils appellent les narcoterroristes liés au Venezuela. Le 2 septembre, une première attaque a détruit un petit bateau - présumé dédié au trafic de drogue - faisant 11 morts dans les eaux internationales des Caraïbes. À la mi-septembre, ces attaques se sont poursuivies, faisant 3 morts supplémentaires.
Le 1er septembre, le gouvernement Maduro avait déclaré que le Venezuela était en état d'alerte maximale, avertissant qu'il riposterait si les forces américaines tentaient de violer la souveraineté nationale. De plus, Nicolás Maduro a menacé de déclarer la République en état d'alerte si l'agression étrangère se concrétisait.
Le 10 octobre, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth a annoncé la création de la Joint Task Force (JTF) anti-Narcotics (Force opérationnelle interarmées anti-stupéfiants) dans le but de coordonner les opérations maritimes, aériennes et de renseignement contre les réseaux de trafic de drogue. Cette JTF est dirigée par la II Marine Expeditionary Force (II MEF). À partir du 11 octobre, les patrouilles maritimes s'intensifient, avec des avions de soutien logistique et des hélicoptères des Marines, auxquels s'ajoute la coordination avec des pays tels que la République dominicaine et Trinité-et-Tobago. Plus de 10 attaques supplémentaires contre de petits bateaux sont perpétrées, portant le nombre de morts à 43.
En octobre, le gouvernement vénézuélien a organisé des exercices militaires, mobilisant ses forces aériennes et ses défenses antiaériennes pour répondre à d'éventuelles provocations. Entre-temps, un sentiment anti-impérialiste précaire se développe parmi la population, résultat d'un épuisement social terrible après onze années de crise économique sans précédent qui a fait chuter le salaire minimum mensuel à moins d'un dollar américain, avec une inflation soutenue et des produits de consommation de base dont les prix ont doublé par rapport à la moyenne régionale. Il ne s'agit pas qu'une partie importante de la population - de droite, sans affiliation politique et même de gauche - soit d'accord avec une agression contre le pays, mais plutôt qu'il existe un terrible ras-le-bol à l'égard du gouvernement national. Face à cela, une partie de la population semble préférer « le mal inconnu » comme illusion qu'il est possible de sortir de la situation actuelle, caractérisée par des revenus moyens inférieurs au seuil de pauvreté, comme si l'histoire ne démontrait pas que là où les gringos envahissent, ce qui suit, c'est la misère, le chaos et la destruction.
Le 16 novembre, bien que cela ait été annoncé auparavant, la mission a été élargie avec l'incorporation du porte-avions USS Gerald R. Ford (CVN 78) et de son groupe d'attaque, ainsi que de bombardiers à longue portée et de patrouilles aériennes et maritimes supplémentaires, portant la présence à environ 15 000 soldats. À ce jour, le nombre de morts liées aux opérations militaires s'élève à 83 personnes. Il s'agit de morts extrajudiciaires, d'êtres humains qui auraient pu être neutralisés, capturés et jugés dans le cadre d'une procédure régulière, ce qui a été dénoncé par des organisations de défense des droits humains.
À l'annonce de l'arrivée de l'USS Ford, le Venezuela a mobilisé près de 200 000 soldats dans le cadre d'une opération de préparation à l'éventualité d'une escalade des hostilités. Cela s'accompagne d'une intensification de la propagande sur la nécessité de l'unité nationale et de la défense de la souveraineté, qui a certainement réussi à souder la base sociale du madurisme, mais qui s'avère insuffisante pour une résistance anti-impérialiste efficace.
Le 21 novembre 2025, le Cartel des Soleils est déclaré organisation criminelle, dont l'existence n'a pas été prouvée, mais qui serait composée d'éléments de la haute hiérarchie militaire et politique du gouvernement vénézuélien, y compris le président Nicolás Maduro lui-même. Fin novembre, les spéculations s'intensifient et des annonces sont faites sur la possibilité que les États-Unis lancent des opérations terrestres contre le trafic de drogue - euphémisme pour désigner une éventuelle attaque militaire sur le territoire vénézuélien - tandis que le président Trump lui-même évoque la possibilité d'une rencontre avec le président Maduro. Au moment où nous écrivons ces lignes, le New York Times signale qu'un premier entretien téléphonique a eu lieu, sans qu'aucun accord de non-agression n'ait été conclu.
Ce n'est pas une aberration de Trump, c'est la politique néocoloniale de l'impérialisme américain
Trump n'est pas un « fou furieux » à la tête de l'administration de la plus importante nation impérialiste, au contraire, il exprime des politiques structurelles, bien qu'appliquées à sa manière excentrique et tapageuse, propre aux illibéraux. Ce qui se passe dans le sud des Caraïbes s'inscrit en réalité dans un contexte plus général lié à la restructuration du système de gouvernance capitaliste mondial issu de la Seconde Guerre mondiale. L'émergence de la Chine en tant que puissance économique, de la Russie en tant que géant militaire nucléaire, la relocalisation d'un puissant pôle d'innovation entre la Chine et l'Inde, et la perte croissante d'influence géostratégique et militaire de l'Europe ne sont que les signes d'une transformation radicale de l'ordre capitaliste.
Comme toujours, le nouvel ordre émergera par la négociation ou par la guerre – dans ce dernier cas, ce serait apocalyptique pour l'humanité et le capitalisme lui-même – mais les pièces commencent à bouger. Les États-Unis agissent comme une nation impérialiste, et une grande partie de ce qui est aujourd'hui en jeu a commencé avec Biden, c'est-à-dire que pour les démocrates et les républicains, le véritable intérêt réside dans la géopolitique américaine. Les États-Unis doivent montrer au monde qu'ils restent la nation la plus puissante en matière d'armement, avec une capacité de destruction à grande échelle et une présence militaire extraterritoriale dans de nombreux pays.
La « politique économique intérieure », officiellement connue sous le nom d'approche « Trade and Economic Security » (TES), promue par le département de la Sécurité intérieure (DHS) sous l'administration Biden, a été annoncée en 2021 dans le cadre d'une stratégie globale visant à intégrer la sécurité économique dans l'agenda de la sécurité nationale. Sa principale publication, le rapport TES, s'appuie sur des évaluations annuelles telles que l'Economic Security Annual Assessment de 2020, publiée le 11 janvier 2021, et le DHS Strategic Action Plan to Counter the Threat Posed by the People's Republic of China (12 janvier 2021).
L'objectif principal était de reconnaître que la prospérité économique des États-Unis dépend du flux ininterrompu de biens, de services, de personnes, de capitaux, d'informations et de technologies à travers les frontières. Il s'agit donc d'atténuer les risques pour la sécurité économique intérieure par des actions coordonnées à l'échelle du gouvernement, sur les plans politique, financier et militaire, qui actualisent de manière bilatérale les liens historiques des pays avec l'empire. Cela comprenait le renforcement de la présence militaire dans d'autres pays et le lancement d'opérations de coopération dans ce domaine dans d'autres nations.
Les principaux objectifs visaient à renforcer la position économique mondiale des États-Unis. Promouvoir des politiques visant à protéger les chaînes d'approvisionnement critiques, en réduisant les vulnérabilités face à des menaces telles que les perturbations commerciales, les cyberattaques ou la concurrence déloyale (par exemple, de la part de la Chine) ; Intégrer la sécurité économique à la sécurité nationale et utiliser le « Homeland Security Enterprise » pour répondre aux risques qui affectent la stabilité économique, tels que les fluctuations du commerce international ou la dépendance vis-à-vis des importations essentielles.
Les actions pratiques du TES visaient à réaliser des évaluations annuelles pour éclairer les politiques, promouvoir le commerce sécurisé et collaborer avec les alliés afin de diversifier les chaînes d'approvisionnement. Elles mettaient l'accent sur des secteurs tels que l'industrie manufacturière, la technologie et les ressources naturelles, en se concentrant sur la réduction des risques économiques « d'origine étrangère ». Le revirement de la politique de sécurité, présenté sous le couvert d'une carotte et d'un bâton dissimulé, est naturalisé. Cette politique représentait un tournant vers une vision « pangouvernementale » (whole-of-government), combinant diplomatie économique, réglementations commerciales et coopération internationale, contrairement aux approches plus isolationnistes précédentes.
La politique TES reste en vigueur en tant que cadre étatique sous l'administration Trump (qui a débuté en janvier 2025). Bien que certaines directives spécifiques de Biden aient été abrogées, notamment dans les domaines de l'immigration et de l'application de la loi dans les zones sensibles (par exemple, la directive du 24 janvier 2025, formulée par le secrétaire par intérim du DHS, Benjamine Huffman), le rapport TES reste une référence active dans les publications du DHS jusqu'au 24 novembre 2025.
D'autres documents connexes, tels que le plan de développement de la main-d'œuvre ICE Pact et les déclarations d'intention conjointes, s'étendent jusqu'en 2026, indiquant une continuité. Elle n'a pas été officiellement remplacée, mais intégrée dans des initiatives plus larges de l'ère Trump.
La politique Homeland Economic/TES fournit le cadre conceptuel du déploiement militaire actuel dans les Caraïbes, mais marque une évolution des approches : de la diplomatie économique avec un éventuel soutien militaire sous Biden, à la centralité de l'action militaire offensive sous Trump. L'argument de l'administration Trump est que le trafic transnational de drogue, qui est au centre de l'opération Southern Spear - lancée en septembre 2025, avec des antécédents en août -, menace directement les objectifs du TES en créant les conditions d'une interruption potentielle des chaînes d'approvisionnement et du commerce, car les cartels - en l'occurrence le Cartel des Soleils - contrôlent les routes maritimes dans les Caraïbes, affectant le flux de marchandises légales - par exemple, le pétrole, l'agriculture - ce qui augmente les coûts logistiques et sape la « prospérité économique dépendante des flux transfrontaliers », éléments mis en avant dans la TES.
D'autre part, le trafic de drogue génère une instabilité régionale, notamment en raison de ses « liens » avec les migrations massives, comme c'est le cas lors des crises économiques dans des pays tels que le Venezuela. En outre, le trafic de drogue favorise la dépendance vis-à-vis des importations illicites et réduit la coopération commerciale avec les alliés des Caraïbes, ce qui va à l'encontre de l'accent mis par la TES sur les alliances visant à diversifier les approvisionnements. Pour l'administration Trump, tout cela a un impact sur la sécurité économique intérieure, car le fentanyl et d'autres drogues inondent les États-Unis, coûtant des milliards de dollars en santé publique et en productivité, ce que la TES identifie comme un risque « intérieur » nécessitant une réponse intégrée.
Sous Biden, la TES donnait la priorité à des mesures non létales telles que les sanctions économiques, le partage de renseignements et l'aide aux partenaires régionaux pour démanteler les réseaux financiers des cartels. Dans le cas du Venezuela, Biden a privilégié la mise en place de conditions néocoloniales dans l'approvisionnement en pétrole vénézuélien de l'Amérique du Nord. En 2025, sous l'administration Trump, cela a dégénéré en un déploiement massif - depuis août - qui semble être une adaptation de la TES, dans ce cas pour « protéger la stabilité économique » par la contention militaire.
Marché pétrolier
Les estimations de l'OPEP et de l'AIE évaluent les réserves pétrolières vénézuéliennes à 303 milliards de barils, ce qui fait du pays celui qui possède les plus grandes réserves prouvées de pétrole brut au monde, devant l'Arabie saoudite et l'Iran. Dans la stratégie du TES, cela constitue un domaine stratégique pour l'avenir économique des États-Unis, raison pour laquelle une stratégie non dévoilée ouvertement, consistant à installer des bases militaires américaines sur le sol vénézuélien, semble cohérente. Les États-Unis, dans la concurrence acharnée avec la Chine et la Russie pour les marchés pétroliers, veulent s'assurer la plus importante réserve mondiale, située dans leur zone d'influence la plus proche, ce qu'ils ne peuvent faire que par un contrôle militaire direct. Les annonces du début des opérations d'exploitation et de commerce du pétrole vénézuélien par des entreprises chinoises et russes ont inquiété Washington, qui semble rechercher des mécanismes coercitifs pour éviter la perte potentielle d'influence directe sur cette importante réserve énergétique. En d'autres termes, le déploiement militaire dans le sud des Caraïbes ne vise pas seulement à changer le gouvernement pour s'assurer l'approvisionnement en pétrole, mais aussi à créer les conditions politico-militaires d'un contrôle militaire direct, ce qui constituerait une violation de la souveraineté nationale plus grave encore que celle commise pendant la guerre froide et la quatrième République.
Contrairement à ce qui s'est produit sur les marchés pétroliers lors des offensives américaines contre un pays producteur, dans le cas présent, la nervosité n'a pas affecté les indicateurs de prix. Au cours de l'année 2025, les fluctuations des prix du pétrole ont été à la baisse (78 dollars en janvier 2025 - 64 dollars en novembre de la même année), ce qui montre que, plutôt qu'une opération militaire directe, le marché s'attend à un accord entre les gouvernements Maduro-Trump, qui dans ce cas serait la négociation d'une présence militaire américaine permanente sur le sol vénézuélien. Depuis le début du déploiement militaire américain dans le sud des Caraïbes, en août, les prix du pétrole, bien qu'ils aient connu de légères variations lorsque les tensions entre la Maison Blanche et Miraflores se sont intensifiées, n'ont pas cessé de baisser. Ce comportement du marché est un élément à prendre en compte lorsqu'on examine le calendrier et les scénarios de ces tensions. En résumé, alors que le marché pétrolier ne semble pas anticiper d'offensive militaire contre le Venezuela à court terme et ne réagit donc pas de manière nerveuse en augmentant les prix du baril, une hausse du coût de l'or noir favoriserait les affaires des négociants en pétrole brut, parmi lesquels figure le président Trump lui-même.
Trump et le renforcement de la présence militaire en Amérique latine et dans les Caraïbes
Depuis son arrivée au pouvoir, Trump a concentré une grande partie de ses efforts, au cours de son deuxième mandat en 2025, sur la présence militaire américaine en Amérique latine et dans les Caraïbes. En d'autres termes, il s'agit d'une continuité du TES, avec une importance accrue accordée à l'expansion des forces militaires dans les pays dépendants. Certaines des initiatives les plus importantes à cet égard sont énoncées dans le protocole d'accord accepté par le président Mulino (Panama) et annoncé par le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth pour l'« utilisation rotationnelle » des anciennes bases, aérodromes et stations navales que les États-Unis possédaient au Panama avant la cession du canal ; dans le cas de Porto Rico, la base de Roselvet Roads a été rouverte et renforcée sur le plan opérationnel, et des exercices ont été lancés à Vieques ; en Équateur, le parlement a approuvé une réforme constitutionnelle ouvrant la possibilité d'étendre la présence militaire américaine sur son territoire, mais cette mesure a été rejetée par référendum populaire ; plus récemment, en novembre 2025, la République dominicaine a autorisé l'utilisation de bases locales (la base aérienne d'Isidro et l'aéroport international des Amériques) pour des opérations logistiques de lutte contre le trafic de drogue. L'administration Trump a encouragé l'utilisation intensifiée des CSL (Cooperative Security Locations) au Salvador, à Curaçao, à Palenque/Apiay/Malambo et dans d'autres aérodromes (Colombie), c'est-à-dire qu'en quelques mois seulement, elle a travaillé à un repositionnement militaire américain dans la région.
Le Venezuela est l'un des pays où les États-Unis ont toujours souhaité installer des bases militaires. Dans les années 1960, ils ont tenté de le faire, mais ils se sont heurtés à l'opposition du gouvernement social-démocrate de Rómulo Betancourt, qui a accepté une coopération militaire sans troupes stationnées en permanence. Les États-Unis semblent vouloir renverser cette situation, paradoxalement alors que le gouvernement est dirigé par Maduro, considéré comme l'antithèse de Betancourt. En ce sens, la pression militaire sur le Venezuela semble viser, outre le contrôle du pétrole, à vaincre la résistance betancouriste au déploiement militaire sur le territoire, que ce soit par un accord avec le madurisme ou dans le cadre d'une éventuelle succession dirigée par María Corina Machado, qui a laissé entrevoir cette possibilité dans un passé récent. Cela expliquerait en partie pourquoi, malgré la livraison du pétrole vénézuélien aux États-Unis dans des conditions néocoloniales ces dernières années, une offensive militaire disproportionnée est menée contre le pays et l'administration vénézuélienne.
Régime prédictif et contrôle impérial
La lutte des classes est le moteur de l'histoire, disait le vieux Marx. C'est pourquoi la formation impériale - l'impérialisme aujourd'hui - fait partie intégrante de la lutte des classes, en l'occurrence en faveur de la bourgeoisie en tant que classe sociale à l'échelle mondiale. L'oppression de classe s'exerce par le biais de l'État bourgeois et de ses institutions, sous diverses formes, notamment la biopolitique (Foucault) et la psychopolitique (Chul-Han) pendant les périodes libérale et néolibérale.
Le développement des technologies constitutives de la quatrième révolution industrielle, en particulier l'internet, la collecte de données, l'analyse de métadonnées, l'intelligence artificielle et les systèmes de gestion à grande échelle d'informations multiniveaux, ont donné naissance au régime prédictif de contrôle impérial. À cet égard, la collecte massive de données suscite un intérêt particulier afin de connaître les comportements, de les segmenter, de les localiser et de pouvoir construire des scénarios futurs, qui permettent précisément de faire entrer le futur dans le présent. Cela revêt une importance particulière dans les nouvelles formes d'oppression et de contrôle impérial sur les territoires.
C'est ce que nous avons observé au cours de ces quatre derniers mois, pendant lesquels nous avons semblé être en permanence au bord d'une action militaire à grande échelle contre le Venezuela, ce qui a suscité des réactions de sympathie ou de rejet, d'incrédulité ou d'optimisme, de soutien ou d'opposition de la part de la population, non seulement du pays, mais aussi de la région et du monde entier. Cela a généré un volume gigantesque d'informations, d'un intérêt prédictif particulier, qui, en raison de l'impunité avec laquelle elles ont été exécutées, constituent une victoire très importante pour les objectifs de l'impérialisme américain. Les États-Unis disposent désormais de davantage d'éléments pour évaluer les comportements éventuels de la population et des représentants politiques face à de futures interventions potentielles dans la région, les probabilités réelles d'obtenir des soutiens, mais aussi les résistances auxquelles il faut s'attendre. Tout cela est traité à l'aide de méthodes de renseignement ouvert automatisé.
OSINT
Les opérations militaires ont commencé dès l'annonce du déploiement de la flotte américaine dans le sud des Caraïbes. Il ne s'agit pas de tirs de missiles comme dans les guerres conventionnelles, mais du lancement d'une phase des nouvelles guerres hybrides, qui ne semblent pas si évidentes pour l'observateur ordinaire. C'est le résultat de l'utilisation militaire de multiples technologies, parmi lesquelles nous analyserons l'OSINT.
Le renseignement ouvert automatisé (OSINT) est né dans le renseignement militaire dans les années 40-50 (radio, presse) du XXe siècle. Avec l'émergence d'Internet (années 1990), il devient massif. De 2015 à 2025, avec l'intelligence artificielle (IA) et le big data, l'OSINT entre dans son ère automatisée, avec des analyses en temps quasi réel.
L'OSINT automatisé est une méthode de collecte et d'analyse d'informations publiques (actualités, réseaux sociaux, images satellites, documents officiels, trafic maritime/aérien, forums, bases de données ouvertes, etc.), où un logiciel spécialisé effectue automatiquement des tâches qui nécessitaient auparavant des heures de travail humain.
L'automatisation permet de parcourir (scraping) des milliers de pages et de sources ouvertes, de générer un classement automatique à l'aide de modèles d'IA (par thème, géographie, sentiment, pertinence), de détecter des tendances en temps réel (mouvements militaires, campagnes médiatiques, changements économiques), de produire des alertes basées sur des événements clés (déploiements navals, discours, annonces de sanctions) et de générer des rapports intégrés à partir de multiples sources.
Par exemple, grâce à des systèmes qui surveillent les routes maritimes et détectent les mouvements inhabituels des navires, des plateformes qui analysent les images satellites pour identifier l'activité militaire, des outils qui capturent et corrèlent les discours officiels, les sanctions et les mouvements logistiques, des moteurs qui traquent les actualités dans des dizaines de langues et produisent des résumés automatiques, des robots qui suivent les hashtags ou les récits politiques sur les réseaux sociaux.
L'OSINT est utilisé pour évaluer les risques de conflit ou d'escalade militaire, surveiller le trafic de drogue, la contrebande ou le crime organisé, anticiper les crises politiques ou économiques, analyser les campagnes de désinformation, mesurer l'impact des sanctions ou des tensions diplomatiques.
Dans le contexte de l'escalade des tensions dans le sud des Caraïbes, l'OSINT semble être utilisé à quatre niveaux principaux. Le premier consiste à suivre le trafic maritime (AIS + OSINT satellite), en surveillant les navires militaires, commerciaux et de pêche à l'aide du système d'identification automatique (AIS), en précisant les itinéraires anormaux près de Porto Rico - où la présence militaire a été réactivée à Vieques et dans d'autres endroits -, Curaçao, Trinité, La Guaira et le golfe du Venezuela, en détectant les schémas logistiques de ravitaillement, les approches des zones d'exclusion, les comportements face aux restrictions, les patrouilles répétitives, entre autres ; en outre, des travaux sont menés sur d'éventuelles coupures de l'AIS pour des opérations secrètes, en optimisant l'utilisation de la technologie militaire disponible dans la région.
Le second consiste à utiliser des images satellites automatisées. Grâce à des systèmes de détection automatique (vision artificielle), on obtient des informations sur le déploiement de destroyers ou de porte-avions, les activités dans les bases américaines (en particulier Rooselvet, Roads, Mayport, Key West), les mouvements inhabituels dans les bases vénézuéliennes (La Orchila, Punto Fijo, Sucre, Puerto Cabello, Guárico, Maracay et les zones frontalières) qui, ensemble, permettent d'augmenter le nombre de vols de surveillance P-8 Poseidon ou d'hélicoptères MH-60. Ces images satellites permettent de détecter en temps réel les changements de « pixels » et d'alerter lorsque de nouveaux navires, des ombres thermiques, des colonnes logistiques, des stocks de carburant ou des équipements radar actifs apparaissent, informations particulièrement utiles au moment d'intensifier les opérations militaires.
Le troisième consiste en la surveillance automatique des discours, des mesures coercitives et des déclarations officielles. Dans ce cas, des robots formés au traitement du langage naturel analysent les communiqués, les directives du DHS, du commandement sud et du département d'État, ainsi que les réactions des pouvoirs publics et des forces armées vénézuéliennes, en détectant des mots clés tels que « menace inhabituelle », « réponse stratégique », « violation des eaux territoriales », « activation des milices ». Ils calculent ensuite le risque implicite et explicite à partir du ton du discours, de la fréquence, des précédents historiques d'escalade et de la véracité des affirmations lors d'occasions précédentes, ainsi que des acteurs impliqués et de leur présence dans différents scénarios.
Le quatrième volet concerne la surveillance automatique des réseaux sociaux et des signaux faibles. Les algorithmes traquent les vidéos de mouvements militaires mises en ligne par des civils, les rapports de pêcheurs, les publications de communautés de pêcheurs, les critiques ou les sympathies postées ou envoyées par SMS, les vols non identifiés (OSINT aéronautique), ainsi que les fuites du personnel militaire, ce qui permet de détecter les mouvements avant qu'ils ne se produisent ou ne soient annoncés.
La combinaison de l'OSINT et des modèles prédictifs pour les risques géopolitiques permet de mesurer les probabilités d'escalade - bien qu'ils ne prédisent pas d'événements concrets - à l'aide de trois techniques principales : les modèles de corrélation et les séries chronologiques (ARIMA, VAR, Granger), les modèles de risque de type « odds ratios » et probabilités logistiques, et les modèles de simulation (Monte Carlo + analyse des jeux géopolitiques).
Les modèles de corrélation et de séries chronologiques intègrent la fréquence des mouvements navals, la fréquence des annonces officielles, les prix du pétrole, les tensions internes dans le pays, les activités sur les routes (dans ce cas, le trafic de drogue) et l'intensité potentielle et réelle des sanctions, en pondérant chacun d'entre eux et en évaluant leurs interactions. Ces modèles cherchent à déterminer si un facteur en anticipe un autre selon les principes de causalité de Granger.
Dans les modèles de risque et de probabilité logistique, la régression estime le risque d'incursions, de confrontation et d'escalade militaire par erreur de calcul. Ils ne disent pas quel événement se produira, mais quelle est la probabilité qu'il se produise.
Les modèles de simulation élaborent des scénarios basés sur la distance entre les équipements militaires, l'intensité de l'hostilité dans les discours, le chevauchement avec des périodes électorales qui rendent prévisibles les exagérations, la production pétrolière et les actions d'acteurs non étatiques, en particulier les cartels. Chaque scénario montre les probabilités que les incidents débouchent sur des affrontements directs, des attaques chirurgicales, des escalades ou des sanctions.
L'OSINT a besoin de beaucoup d'informations pour être plus efficace, c'est pourquoi le déplacement dans le sud des Caraïbes, depuis plus de trois mois, n'a pas donné lieu à des attaques concrètes sur le territoire, avec une surcharge de stimuli pour susciter des réactions de la population et des gouvernements. L'offensive communicationnelle de l'opération militaire se caractérise par des jours où les attaques contre les navires sont plus fréquentes (le lundi) et par des déclarations musclées (le mercredi) afin de mesurer les jours suivants les comportements qui se produisent, de recueillir des informations massives et d'alimenter les scénarios.
La guerre a déjà commencé, même si aucun missile n'a été tiré sur le territoire vénézuélien. Un élément essentiel dans la collecte d'informations est la position de la population locale à l'égard de l'offensive en cours, de la présence militaire américaine et de son évolution. Les sympathies et les résistances sont détectées et traitées.
NOTAM
Les NOTAM (Notice to Air Missions), anciennement Notice to Airmen, sont des avis officiels et obligatoires émis par l'autorité aéronautique d'un pays. Dans le cas des États-Unis, ils sont générés par la Federal Aviation Administration (FAA) dans le but d'informer les pilotes, les contrôleurs aériens, les compagnies aériennes et les services de navigation aérienne des conditions ou restrictions susceptibles d'affecter la sécurité d'un vol.
Dans le cas du Venezuela, la FAA a publié le 21 novembre 2025 un NOTAM (A0012/25) signalant l'augmentation de l'activité militaire et recommandant la plus grande prudence face aux risques potentiels liés au survol du Venezuela. Cela inclut les phases de vol, de survol, de décollage, d'atterrissage et de mouvement au sol des aéronefs.
Le 29 novembre, le président Trump lui-même a annoncé la fermeture totale de l'espace aérien vénézuélien, bien qu'il ne soit pas l'autorité compétente pour le faire, ce qui a eu un impact particulier sur l'opinion publique. Des compagnies aériennes telles qu'Iberia, Tap et d'autres ont temporairement suspendu leurs vols, bien qu'à la date de clôture de cet article (30-11-2025), des compagnies aériennes telles que COPA, Laser et Wingo volaient normalement à destination de Caracas.
Dans le contexte des tensions croissantes entre Caracas et Washington, le NOTAM et l'annonce ultérieure de Trump doivent être considérés dans leurs trois dimensions réelles. La première consiste à renforcer le blocus et l'encerclement du Venezuela afin d'avoir un impact encore plus important sur l'économie locale, dans le but d'accélérer un changement de régime. La deuxième consiste à continuer à faire pression sur la table des négociations qui est ouverte. La troisième consiste à produire des volumes supplémentaires d'informations pour l'OSINT, les systèmes Odds et d'autres mécanismes du régime de contrôle prédictif.
ODDS
Les Odds[2] sont des systèmes ou des méthodologies probabilistes pour la construction de scénarios, très utilisés par le secteur des entreprises et les agences de presse. Même si le contexte présente un risque élevé d'intervention militaire, avec des discours belliqueux et des alertes de part et d'autre, aucune action directe ne semble se profiler, si l'on se base sur l'ensemble des informations disponibles.
Bien qu'il n'existe pas d'Odss officiels, en utilisant leur technique de construction, on peut déduire que les probabilités d'une intervention militaire américaine au Venezuela à court terme (24 à 160 heures) ne sont que de 5 à 12 %. En d'autres termes, il faut s'attendre à ce que plusieurs jours ou semaines s'écoulent avant que les probabilités d'une intervention militaire ne s'accroissent ou ne se dissipent.
Le madurisme dans son labyrinthe
Nous insistons. Ceux qui sous-estiment les capacités politiques de Maduro se trompent. Maduro n'est certes pas un homme cultivé, mais c'est un homme politique doté d'une capacité exceptionnelle à se maintenir au pouvoir, notamment parce qu'il est pragmatique plutôt qu'idéologisé.
Maduro n'est pas Chávez, et le madurisme n'est pas similaire au chavisme. Chávez était un hyper-leader, qui ne partageait pas son leadership - il n'a jamais fonctionné avec une direction collective, pas même avec le MVR ou le PSUV -, doté d'un immense sens de l'empathie envers le peuple, conscient que son maintien au pouvoir dépendait de son accord avec la majorité du peuple, qui a utilisé la polarisation comme stratégie pour construire un pôle autour du projet qu'il incarnait ; Chávez a commis de nombreuses erreurs – qu'il n'appartient pas d'analyser dans ce texte –, mais il s'est engagé pleinement dans la création d'un nouveau pluralisme – qui dépasserait celui de la Quatrième République – en orientant son action selon sa conception de la justice sociale.
Contrairement au chavisme, le madurisme est le résultat d'un passage abrupt du pouvoir, de Chávez - à partir de sa maladie et de sa mort - à Maduro, qui ne jouissait ni du charisme ni du contrôle des rapports de force qui caractérisaient le chavisme. Le madurisme est une alliance de dirigeants et de groupes mineurs (Diosdado Cabello, les frères Rodríguez et d'autres), qui s'élargit pour pallier le manque d'expérience militaire de Maduro (Padrino López et la nouvelle direction militaire et policière post-chaviste) qui acceptent le leadership de Maduro, mais qui ont leurs propres intérêts économiques et politiques.
Alors que le chavisme prônait une alliance civico-militaire, le madurisme, dans son virage autoritaire, l'élargit à une alliance civico-militaire-policière.
Dans sa construction d'identité et de rapports de force pour se maintenir au pouvoir, le madurisme s'est démarqué des alliés de la période chaviste, ce qui a créé une opposition chaviste au madurisme - encore faible - ainsi qu'un affrontement avec l'ensemble de la gauche authentique (PCV, PPT et autres) dont les représentations juridiques ont été attaquées par des décisions judiciaires, ce qui a suscité une opposition de la gauche. La coordination entre le chavisme dissident et la gauche critique en termes organiques est encore très faible.
Par conséquent, toute négociation pour la transition ne se fait pas seulement avec Maduro, mais avec le madurisme, et ne peut ignorer l'opposition chaviste et de gauche qui est anti-maduriste. C'est l'erreur stratégique de la droite la plus radicale et des dirigeants du MCM-EGU, qui proposent un changement radical avec le passé et unifient le chavisme avec le madurisme.
Comme je l'explique dans le livre « Venezuela y el Chavismo » (2025), le madurisme est une rupture avec le projet polyclassiste incarné par Chávez et un pari sur la consolidation d'une nouvelle bourgeoisie, née dans le sillage des affaires et de la corruption des vingt-cinq dernières années, opposée de manière conjoncturelle aux intérêts de l'ancienne bourgeoisie, mais avec laquelle elle partage un horizon stratégique.
Ce qui reste au madurisme de son tronc d'origine, le chavisme, c'est la rhétorique socialiste et populaire-communautaire, qu'il maintient pour conserver la cohésion de sa base sociale qui, bien que réduite – et incapable de remporter des élections libres, justes et transparentes à court terme –, peut encore compter environ quatre millions d'électeurs, ce qui n'est pas négligeable lorsqu'on parle de transition démocratique.
Le madurisme a connu jusqu'à présent quatre étapes. La première, entre 2014 et 2017, a été marquée par l'écrasement et l'intervention des représentations politiques de la droite et de la bourgeoisie classique, ainsi que par la récupération d'une partie importante des dirigeants qui continuent d'apparaître comme des opposants et que l'on qualifie en vénézuélien d'« alacranes » (capables d'agir contre les leurs). La deuxième, entre 2018 et 2024, a été marquée par l'intervention et la réduction à sa plus simple expression de la gauche politique qui avait accompagné Chávez, la destruction des libertés syndicales d'organisation, de grève et de mobilisation, et le début de négociations avec les États-Unis pour rétablir les relations bilatérales, ce qui a été particulièrement favorisé par la guerre en Ukraine, qui a fait du Venezuela un fournisseur fiable pour les Américains, même dans des conditions de dépendance néocoloniale supérieures à celles connues avant Chávez, ouvertement dépouillées de toute velléité nationaliste. J'insiste sur le fait que le Venezuela et les États-Unis, indépendamment des déclarations grandiloquentes propres au spectre politique interne de chaque pays, avaient sensiblement amélioré leurs relations entre 2020 et 2025 (avant le début du déploiement militaire américain dans les Caraïbes). La troisième, entre 2024 et 2025, consiste à passer d'un régime démocratique formel à l'annulation de facto de la voie démocratique - même si les élections, le Conseil national électoral (CNE) et la rhétorique participative sont maintenus - avec une escalade de la répression sélective qui s'est traduite par l'arrestation de centaines de membres du mouvement social, ce qui l'a placé dans une position défensive, tant au niveau national qu'international. La quatrième, qui commence par le siège militaire (2025 - ), période durant laquelle tout est permis et où la survie au pouvoir est le leitmotiv.
L'impossibilité de rendre crédible le résultat des élections du 28 juillet 2024 a plongé le madurisme dans une crise internationale sans précédent, dont l'escalade la plus importante est l'offensive militaire américaine dans le sud des Caraïbes. Les États-Unis utilisent cette situation, sous le prétexte de la lutte contre le trafic de drogue, pour faire avancer leur stratégie TES dans la région, avec l'intention claire de positionner des sites militaires sur le territoire vénézuélien, dans le cadre de la reconfiguration politique mondiale.
Cela crée un défi inhabituel pour le madurisme. Négocier maintenant avec les États-Unis implique non seulement de parler de transition - qui pourrait attendre quelques années s'il cède à leurs intentions stratégiques : installer des bases militaires - mais aussi d'accepter une épée de Damoclès au-dessus de leur tête, tout en réapprenant à maintenir un équilibre minimal avec les Américains. Il serait plus facile pour les États-Unis d'intervenir dans les affaires politiques locales s'ils disposaient d'une force militaire sur le territoire, ce qui est la face cachée de la lune trumpiste.
En d'autres termes, l'assurance-vie politique pour le madurisme serait une sorte de « roulette russe ». Le prolongement de son séjour au pouvoir, dans un scénario comme celui-ci, impliquerait l'abandon définitif de son discours idéologique et la mutation vers de nouveaux récits plus proches des gringos. En d'autres termes, une édition créole d'Ahmed al Sharaa, ancien terroriste recherché, aujourd'hui allié des Américains, reçu par Trump après avoir rompu avec son passé djihadiste.
L'autre alternative consiste à radicaliser sa rhétorique pseudo-idéologique, dans l'espoir de reproduire l'expérience de Cuba, qui est resté au pouvoir pendant des décennies. Mais ce n'est pas le cas du madurisme, ni dans la structure de classes du gouvernement vénézuélien, étant donné son désir de consolider une nouvelle bourgeoisie, qu'il ne représente pas seulement, mais dont il fait partie intégrante. Cet intérêt de la classe néo-bourgeoise exige la construction d'un avenir où elle pourra utiliser et profiter de la richesse accumulée (par le madurisme), continuer à accumuler et faire partie du modèle d'accumulation rentière de l'économie vénézuélienne.
Le madurisme n'a pas de vocation suicidaire, mais un attachement au pouvoir pour continuer à accumuler des richesses. Ce qui semble ne pas avoir encore été réalisé, c'est la mise en place d'une formule de transition qui inspire confiance et rassure les Américains. Si le processus de construction de cette mutation n'est pas suffisamment rapide, cela pourrait précipiter une agression militaire américaine sous toutes ses formes et dans toutes ses possibilités réelles.
Pour couronner le tout, ces dernières semaines ont été marquées par des changements dans la géopolitique maduriste. Le Nouveau Parti démocratique (NDP) de Saint-Vincent-et-les-Grenadines vient de battre le Parti travailliste uni (ULP) de Ralph Gonsalves, allié du madurisme. Au Honduras, tout indique que la candidate du zeyalisme, Rixi Ramona Moncada Godoy, perdra les élections qui se tiendront le dimanche 30 novembre : c'est un revers pour le madurisme. Le MAS bolivien, autre allié du madurisme, a été pratiquement pulvérisé lors des dernières élections. D'autre part, le spectre des identités gouvernementales avec le madurisme se reconfigure. Lula et Petro restent distants, réclamant plus de démocratie pour le Venezuela, tandis que la candidate progressiste au Chili, Jannette Jara (du Parti communiste), qualifie le madurisme de dictature.
Pour couronner le tout, le maire nouvellement élu de New York, Mamdani, a déclaré que Maduro était un dictateur et que sa vision du socialisme était radicalement différente d'expériences telles que celle-ci.
Mais le labyrinthe du madurisme n'est pas idéologique, mais pragmatique. La question est de savoir s'il parviendra à trouver la formule qui lui permettra de se maintenir au pouvoir, avec l'accord tacite des États-Unis.
MCM-EGU : le leadership n'est pas synonyme de capacité à gouverner
Le leadership de María Corina Machado (MCM) est indéniable, tout comme celui dont bénéficie Edmundo González Urrutia (EGU), un personnage absolument opaque et secondaire. Il est incontestable que MCM a réussi, lors des élections présidentielles de 2024, à rassembler des voix qui dépassent l'influence classique de l'opposition de droite au chavisme et au madurisme. Même une partie importante de ceux qui continuent à revendiquer le chavisme, ainsi que des secteurs de gauche lassés de la dérive autoritaire de Maduro, ont fini par voter pour EGU, non pas parce qu'ils étaient devenus des électeurs de droite, mais comme un moyen de permettre le changement face au désastre maduriste. La gauche qui a conservé son indépendance vis-à-vis du madurisme et du maricorinisme était minoritaire, et je le souligne non pas parce que cela rend ce secteur moralement supérieur, mais pour mettre en évidence la tragédie politique du moment.
Le problème est que MCM-EGU envisage une transition à la manière de Tomas de Torquemada, en lançant une inquisition politique contre ceux qui ont participé dans un passé récent au chavisme - qu'il ne distingue pas du madurisme -, le mouvement social qui revendique la Constitution de 1999 et toute la hiérarchie militaire. Cela est impossible à réaliser sans une guerre civile interne. D'autre part, son programme illibéral – tel qu'il l'a exprimé dans son programme gouvernemental de 2023[3] – prévoit la poursuite des politiques anti-ouvrières initiées par Maduro, en y ajoutant des processus d'intégration du capital local dans la dynamique de financiarisation, sans qu'aucun signe ne laisse présager une période de reprise des conditions de vie matérielles de la population. Sa recette du libre marché part du principe que cela rendra tout le monde prospère. Dans une éventuelle situation post-maduriste, cela générerait une terrible frustration sociale, qui se traduirait par une instabilité et une gouvernance précaire de sa part.
Cela est tellement évident que cela semble s'inscrire dans la ligne des intérêts américains de consolidation de leur influence politico-militaire dans le pays, avec la formation de dirigeants et de représentants parfaitement alignés sur leurs objectifs stratégiques. Le chaos post-maduriste que générerait MCM-EGu est tout à fait fonctionnel à la logique néocoloniale américaine au Venezuela.
Combien de temps durera la transition qui permettra d'atteindre une stabilité minimale dans le pays, en rétablissant les conditions matérielles de vie de la classe ouvrière et les libertés politiques pour son organisation ? Telle est la question qui nous intéresse. Mais cela ne se fera pas de manière passive, mais avec organisation, en abandonnant les illusions sur la bourgeoisie post-maduriste et les troupes américaines, en nous préparant à la lutte.
Scénarios simplifiés
Tout ce qui précède configure plusieurs scénarios que nous aborderons de manière simplifiée.
Scénario 1 : les États-Unis lancent une invasion classique à court terme (moins de trois mois). Le nombre de militaires disponibles à l'heure actuelle est insuffisant pour mener une opération de ce type dans un pays au relief si accidenté, aux frontières si étendues et où la résistance organisée est possible. Une opération de ce type serait longue, épuiserait l'administration Trump et susciterait le rejet en Amérique latine et aux États-Unis mêmes. Les risques de défaite américaine seraient très élevés. Hautement improbable.
Scénario 2 : Les États-Unis attaquent par voie aérienne les infrastructures de pouvoir au Venezuela, qu'ils accusent de servir de soutien au trafic de drogue. Cela inclurait certaines installations militaires. Objectif : semer la terreur parmi la population, diviser les forces armées et provoquer un changement interne à la tête du régime politique, ce qui faciliterait le début d'une transition négociée, supervisée politiquement et militairement par les États-Unis. Le leadership de María Corina Machado (MCM) et Edmundo González Urrutia (EGU) n'aurait qu'une utilité transitoire. Objectif final : installer des bases militaires au Venezuela, garantir militairement le contrôle du pétrole vénézuélien, de la production d'or et de terres rares, et mettre en place une façade militaire américaine dans cette région du sud des Caraïbes. Ce scénario serait hautement improbable car le madurisme est un système de relations hiérarchiques fortement soudé par des intérêts communs, et tous savent qu'une division finirait par les anéantir tous.
Scénario 3 : les États-Unis combinent opérations psychologiques, manipulation médiatique et opérations militaires ciblées pour provoquer une révolte populaire anti-Maduro qui justifierait une opération militaire américaine à grande échelle en « soutien à la démocratie ». Il pourrait par exemple signaler que Maduro a transféré son centre de commandement dans un quartier populaire (Petare, La Vega, El Valle, ou autre) et mener des actions militaires ciblées dans ce secteur, causant des pertes civiles. l'objectif serait que la population, lassée de la situation économique, de la précarité du système de santé, du problème salarial et de l'impact de la forte migration sur le noyau familial, descende dans la rue pour demander la démission de Maduro, avec pour slogan « nous avons assez souffert et maintenant vous nous tuez : démissionnez ! ». Le chaos prolongé servirait ses objectifs (modèle Haïti), la transition démocratique sous la direction du MCM-EGU n'étant qu'un prétexte et sa durée serait brève en raison des problèmes de gouvernance. L'objectif final resterait le même : installer des bases militaires sur le sol vénézuélien, contrôler directement la production pétrolière et disposer d'une présence militaire stratégique dans le sud des Caraïbes. Probabilité moyenne.
Scénario 4 : Les États-Unis lancent des attaques ciblées contre des objectifs militaires et politiques au Venezuela, à l'instar des récentes attaques en Iran. L'objectif est d'éliminer une partie des dirigeants maduristes afin de provoquer la capitulation de l'alliance civico-militaire-policière du madurisme ou le début certain d'une transition à court terme. Cela risquerait d'être rejeté par l'opinion publique américaine et mondiale en raison des dommages collatéraux en vies humaines et de la possibilité que le régime ne se rende pas. La transition serait précédée du déploiement de forces militaires américaines sur le territoire (ce qui ouvrirait le chapitre des bases militaires) sous prétexte de garantir le retour à la démocratie, mais dans le but de contrôler l'accès et l'utilisation des richesses naturelles vénézuéliennes (pétrole, or, terres rares) et de consolider leur présence géostratégique dans le sud des Caraïbes. La probabilité à court terme (avant 3 mois) est moyenne, mais possible dans plus de trois mois car elle devrait s'accompagner d'une décision politique unifiée au Congrès américain, ce qui ne semble pas envisageable à court terme.
Scénario 5 : Déstabilisation interne par l'activation des services de renseignement américains sur le territoire vénézuélien ; générer des mobilisations et le chaos pour favoriser une version latino-américaine du printemps arabe. Cela justifierait une intervention militaire directe – ultérieure – pour soutenir le rétablissement de la démocratie. L'objectif final est le même : déployer des forces militaires permanentes sur le territoire vénézuélien. Le problème pour ce scénario est que l'alliance civico-militaire-policière du madurisme a mis en place un appareil et un réseau de contrôle et de répression sociale efficaces, qui ont instauré la peur dans la population afin qu'elle ne soit pas emprisonnée, ce qui limite la disposition de la population à descendre dans la rue : en outre, le secteur le plus rebelle de l'opposition et la jeunesse qui protesterait dans les rues se trouvent actuellement en situation de migrants, hors du pays. Efficacité impossible à prévoir. Probabilité faible.
Scénario 6 : Négociation réussie entre l'administration Trump et le gouvernement Maduro qui évite les actions militaires sur le territoire vénézuélien. Dans ce cas, le madurisme décide d'autoriser l'installation de bases militaires américaines au Venezuela, sous la forme d'un mémorandum de collaboration pour la lutte commune contre le trafic de drogue, tout en s'engageant à une transition démocratique ordonnée dans les deux à trois prochaines années. Le point d'honneur pour les États-Unis est l'autorisation du déploiement militaire américain au Venezuela. L'effet secondaire serait le dépassement du duo MCM-EGU à la tête de la transition, avec la construction d'un nouvel axe d'ouverture démocratique dans l'opposition (un leadership construit à partir de l'opposition qui dialogue avec le gouvernement, appelée « alacranes »), garantissant au madurisme qu'il n'y aura pas de persécutions. Le problème dans ce cas serait pour le madurisme, qui devrait accepter que son éviction du pouvoir soit désormais sérieuse, ce qui impliquerait une réorganisation des rapports de force (au sein du madurisme et avec les oppositions) pour rendre l'accord possible. Probabilité élevée.
Scénario 7 : La combinaison des scénarios précédents, pour produire un changement de régime politique en 2026. Ce scénario nécessiterait au moins trois mois pour être viable, son lancement serait donc prévu à partir de février-mars 2026. Pour ce scénario, le moment idéal serait après les élections en Colombie, où l'on aspire à évincer le progressisme, créant ainsi les conditions pour la création d'une force multinationale qui interviendrait depuis la frontière néogranadine avec le soutien aérien et balistique des États-Unis. L'objectif final serait de déployer des forces militaires américaines permanentes sur le sol vénézuélien. La probabilité à court terme est faible à moyenne. Scénario 8 : une attaque sous faux pavillon contre des cibles militaires ou civiles américaines, qui unifierait le bloc politique américain, pour le lancement d'opérations ciblées à court terme. Dans ce cas, l'objectif serait de favoriser la chute rapide du madurisme, afin de gagner du temps pour préparer les conditions d'une intervention avec une force multinationale à moyen terme. Probabilité moyenne.
Scénario 9 : maintenir le siège pendant les trois prochains mois, avec une escalade de la guerre psychologique et technologique, afin d'épuiser le madurisme et d'amorcer une transition négociée, incluant le déploiement de forces militaires sur le territoire vénézuélien. Probabilité moyenne.
Scénario 10 : maintien de la situation actuelle pendant quelques mois supplémentaires, dans le but de créer les conditions politiques (consensus au Congrès américain), militaires (constitution d'une force multinationale) et économiques (asphyxie totale de l'économie vénézuélienne) permettant le développement d'opérations à plusieurs niveaux pour le déplacement du madurisme. MCM et son prix Nobel joueraient un rôle central de transition dans cette stratégie, bien que remplaçables à moyen terme. Scénario très probable.
Scénario 11 : Trump se retire sans gloire. Dans ce scénario, les États-Unis démobilisent l'infrastructure militaire déployée depuis août, sous n'importe quel prétexte. Cela serait interprété comme une victoire du madurisme qui lui permettrait de consolider son pouvoir. Probabilité très faible.
Scénario 12 : Les États-Unis interviennent au Venezuela et se heurtent à une résistance armée, consciente de la nécessité d'une lutte populaire prolongée. Ce scénario serait irréalisable car la majorité de la population attribue la responsabilité de sa situation matérielle aux erreurs du gouvernement maduriste. Cette possibilité est très faible.
Ces douze scénarios sont hypothétiques et ont été élaborés à partir d'informations multi-référencées existantes. Un facteur peut évoluer dans une autre direction, modifiant ainsi les possibilités de chaque scénario. C'est pourquoi le suivi des scénarios doit être quotidien.
Anti-impérialisme et culture de la paix
On peut avoir de multiples divergences de différentes natures avec le gouvernement de Nicolas Maduro et le madurisme, mais ces divergences ne peuvent servir à justifier une intervention américaine sur le sol vénézuélien. En ce sens, les forces progressistes, démocratiques, nationalistes, populaires et socialistes du continent et du monde doivent dénoncer les tentatives de l'administration Trump de violer la souveraineté. Une attaque militaire contre le Venezuela est une attaque contre la souveraineté de toute l'Amérique latine.
Nous devons combiner cela avec la dénonciation du caractère antidémocratique, anti-ouvrier et néolibéral du gouvernement Maduro, qui tient un discours de gauche. Le madurisme et Maduro ne sont ni socialistes ni révolutionnaires, ils so

Pour soutenir le docteur Amir Khadir

Pourquoi donc le docteur Amir Khadir vient-il d'être radié par le conseil de discipline du collège de médecins du Québec, en écopant d'une interdiction de pratiquer la médecine de 6 mois ? Officiellement, c'est parce qu'il n'a pas respecté son engagement de ne pas prescrire d'antibiotiques pour plus de 28 jours à des patients atteints de la maladie de Lyme sauf si c'est dans le cadre d'un projet de recherche. Mais n'y a t-il pas autre chose ?
En fait, plutôt que de juger cette sanction comme sévère, ne devrait-on pas la considérer comme tout à la fois déplacée et injuste ? Et cela, en raison du soutien décidé et quasi inconditionnel de ses patients et de l'Association qui les défend, mais aussi au regard du nécessaire appui que les patients atteints de la forme chronique de la maladie de Lyme devraient recevoir des institutions de santé et du gouvernement du Québec.
Il est vrai qu'il y a quelque chose de difficile à comprendre dans cette histoire, à moins d'oser aller sur le fond.
Aller sur le fond
Aussi faut-il d'abord partir du contexte dans lequel toute cette histoire se déroule, et tenir compte du personnage même du docteur Khadir. On le sait : au nom des valeurs d'égalité sociale qui lui sont chères, l'homme va de l'avant et n'a jamais hésité dans le passé à prendre des risques pour courageusement les défendre, suscitant bien souvent des réactions frileuses ou conservatrices à son égard. À preuve, son rôle particulièrement remarqué comme porte-parole à QS entre 2010 et 2018, puis à partir de 2018, son engagement corps et âme, à la demande de l'Association québécoise des patients de la maladie de Lyme, auprès des malades atteints de cette maladie peu connue.
Et puis pour vraiment comprendre, il faut aussi tenir compte des avancées des sciences médicales. Comme toute entreprise rationnelle digne de ce nom, ces sciences ne sont au bout du compte qu'une série d'erreurs rigoureusement rectifiées, ce qui veut dire qu'elles évoluent, elles aussi, et que leurs vérités d'hier peuvent se muer en faussetés pour l'aujourd'hui.
L'existence d'un syndrome de la maladie persistant
Ce n'est que depuis une quinzaine d'années —et notamment suite à des pressions d'associations de malades— que des institutions médicales états-uniennes reconnues ont admis qu'il pouvait exister « un syndrome de la maladie de Lyme persistant », tout comme des traitements longs par antibiotiques pour la soigner ou pour le moins en atténuer certains symptômes ; informations confirmées depuis par le guide de l'institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) de 2021 [1] . Il est vrai que cela allait à l'encontre d'études et d'un guide de référence états-unien célèbre élaboré il y a 20 ans (celui de la Infectious Desease society of America), qui néanmoins rappelait déjà à l'époque –la nuance est importante— que les données dont la science disposait ne permettaient pas de « statuer » dans le sens ou non de la chronicité de cette maladie. Ce qui, dans les faits, permettait à un médecin, et avec l'accord acquis du patient traité, certaines ouvertures. Ce dont s'est servi le docteur Khadir, en ne manquant pas d'en décider avec ses patients et de s'appuyer sur les dernières avancées en la matière, avec à la clé, et depuis 2020, des résultats vérifiés extrêmement encourageants selon tous les barèmes médicaux en vigueur.
Le sensationalisme médiatique
Il n'en fallut pas plus cependant pour que certains —mal informés— aient opté pour le sensationnalisme médiatique et tenté de lui faire un mauvais procès. En surfant un peu trop rapidement sur ces données à la fois complexes et en évolution constante, ils ont voulu insinuer qu'il y avait là un soi-disant manquement flagrant à l'éthique médicale, en écornant au passage la figure publique progressiste qu'il représentait.
C'est tout au moins ainsi qu'on pourrait interpréter l'utilisation médiatique du balado d'Olivier Bernard (reposant sur des données scientifiques dépassées), ou encore les articles dans la Presse d'Isabelle Hachey qui en reprend la substance, sans même parler de la prestation si étonnamment hargneuse de Marie-Louise Arsenault sur Radio-Canada quand elle l'a interviewé.
Cela évidemment n'invalide en rien le fait qu'Amir Khadir n'ait pas respecté un accord qu'il avait signé avec le Collège des médecins et qu'il concevait comme conjoncturel, justement –oh ironie— dans le but de se protéger de telles incompréhensions. Pourrait-on néanmoins dans cette affaire aller sur le fond, et mettre plutôt de l'avant le formidable travail d'avant-garde médical qu'il a accompli pour aider les personnes atteintes de la maladie de Lyme à affronter, non sans succès, les affres de cette maladie ? N'est-ce pas cela qui devrait avant tout compter ?
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’indépendance sans le PQ : mission impossible ?

Les propos de Michel David reflètent bien l'ambiguïté (sciemment entretenue par certains souverainistes) qui règne concernant la question nationale chez QS et, de façon plus large, à l'intérieur des rangs d'une gauche assumée comme telle, en particulier quant aux conditions de possibilité et sa vision d'un Québec Indépendant.
Le chroniqueur lance un ultimatum aux indépendantistes de toute allégeance : la souveraineté se fera avec le PQ ou ne se fera pas ! Conséquemment, peu importe la teneur socio-politique, économique et culturelle derrière ce projet, il faut y adhérer sous peine d'être accusé de jouer le jeu des fédéralistes qui, comme on le sait, prennent un malin plaisir à mettre les batons dans les roues à tout projet émancipateur du Peuple québécois, qu'il soit interne ou externe aux structures actuelles du fédéralisme !
De fait, cette attitude rigide, voire « sectaire » réduit d'emblée les alternatives possibles au programme du PQ pour les prochaines élections et la tenue d'un éventuel référendum. David (comme bien d'autres souverainistes plus ou moins à droite) opère un strict clivage entre la question nationale et la question sociale, ce que refuse de faire la gauche (tout comme plusieurs Solidaires) pour des raisons à la fois politiques et éthiques. L'indépendance, comme tout projet d'envergure de cet ordre, peut être instrumentalisée à des fins moins vertueuses, en l'occurrence « identitaires », « chauvines » et parfaitement « réactionnaires ». Les propos de PSPP sur les immigrants et un futur Québec soi-disant « prospère » ont eu l'effet d'une douche froide sur bien des citoyens qui seraient favorables à la souveraineté mais pas à n'importe quelle condition. Et il ne s'agit aucunement d'une phobie, d'un sabotage ou d'une quelconque hostilité nourrie délibérément envers le PQ comme l'affirme gratuitement Michel David ; tout simplement, la manifestation d'un esprit « critique » qui s'avère tout à fait nécessaire en ces temps de xénophobie péquiste et caquiste parfaitement revendiquée.
Les indépendantistes non-péquistes ont raison de se méfier d'un projet de souveraineté mené de l'avant par un politicien comme PSPP (qui rappelle un peu Marissal par son côté un tantinet « opportuniste »), non pas par aversion innée pour l'aspiration du Québec à sa pleine autonomie (politique, sociale et économique) mais compte-tenu du fait que le chef actuel du PQ s'inscrit d'emblée dans la mouvance « nationaliste identitaire » qui a pris son envol à la faveur de la crise des accommodements raisonnables en 2006. Déjà en 1995, Parizeau (un « bonze » du souverainisme rationnel, économique, libéral) s'est évertué à s'aliéner (lui et les leaders péquistes à lui succéder) pour de bon les Québécois issus de l'immigration avec son constat pour le moins « maladroit » sur les causes de la défaite référendaire. Marois en a rajouté une couche avec sa Charte des valeurs et J.-F. Lysée a couronné le tout en mettant en garde les Québécois (les « vrais », les Québécois « de souche ») contre la menace que représenterait un environnement constitué de femmes voilées autour de nos écoles publiques !
Il faut faire preuve d'un aveuglement volontaire pour continuer à sous-estimer, comme le fait Michel David, cette dimension identitaire devenue centrale au PQ et qui explique les réticences « justifiées » de la base militante de QS quant à une éventuelle collaboration avec le parti de PSPP aux prochaines élections ou pour lutter à ses côtés dans le camp du « Oui », advenant la tenue d'un troisième référendum (ce qui n'est pas encore fait). Tout comme il est parfaitement démagogique d'affirmer que : « Si le PQ et la CAQ persistent à miser sur l'insécurité des Québécois en présentant les immigrants comme une menace pour le français et comme un poids insupportable sur les services publics, c'est que cela trouve un écho dans l'électorat. »1
Il s'agit là de l'argument préféré des populistes d'extrême-droite : « Ce n'est pas nous qui sommes xénophobes ou inquiets des retombées de l'immigration, c'est le Peuple. En bons démocrates que nous sommes, on ne fait que répondre à la demande de sécurité des citoyens ! » Comme si l'« offre » politique ne jouait aucun rôle dans l'opinion publique, comme si les manœuvres politiciennes qui consistent à détourner le regard de l'électorat des vrais enjeux (sous-financement des programmes sociaux, allégements fiscaux des plus riches, gaspillage d'argent public dans des projets « broche-à-foin », déni de diverses crises dont les gouvernements sont en bonne partie responsables : crise du logement, crise de l'environnement, perte de confiance populaire dans les Institutions parlementaires et la démocratie libérale, survalorisation du privé au détriment du public, relations incestueuses entre le Québec inc et les élus) vers de faux enjeux (immigration soi-disant « massive », « capacité » d'accueil jamais exactement chiffrée, incompatibilité naturelle, voire « génétique », entre les différentes cultures, prosélytisme volontaire et malveillant des immigrés arabo-musulmans) ne contribuaient pas à maintenir au pouvoir une caste de dirigeants dont l'incompétence et la partisanerie ne s'étaient jamais observées de façon aussi éclatante depuis les plus belles heures de l'Union Nationale à l'époque de Maurice Duplessis.
« L'Indépendance à tous prix » semble scander les chroniqueurs du Devoir, en phase avec les souverainistes qui tournent autour du PQ comme la lune autour de la terre, ne pouvant résister à sa force gravitationnelle : « Faire du Québec un pays est sans doute le meilleur moyen — et même le seul — d'[e] parvenir [à dissiper cette insécurité]. »2 Est-ce si sûr ?
N'y a-t-il pas une part de pensée magique dans cette affirmation tellement de fois répétée qu'elle en devient redondante ? Avons-nous la capacité, en tant que Québécois « de souche », de nous mettre, ne serait-ce qu'un instant, dans la peau d'un Québécois issu de l'immigration (récente ou moins récente) qui observe la scène politique et voit les Legault, Boulet, Roberge, PSPP faire des amalgames (plutôt obscènes) entre problèmes sociaux « chroniques » et immigration qu'on dit « incontrôlée » (ce qui est évidemment faux — ce sont des choix politiques qui ont été faits, entre autre, pour accommoder les patrons d'entreprises en manque de main d'œuvre, ce qui n'est pas, en soi, une mauvaise raison) ?
Qu'adviendrait-il de ce Québec « inclusif » qu'aurait déjà défendu PSPP s'il s'avérait qu'un polémiste xénophobe et réactionnaire comme Mathieu Bock-Côté (MBC) devenait un jour Ministre de l'Immigration (des Communautés culturelles et de l'« Inclusion ») dans un éventuel gouvernement péquiste ? MBC qui appuie ouvertement la candidature d'Éric Zemmour à la présidentielle française, dont un des projets les plus délirants consiste à renvoyer dans leur bled respectif les « citoyens » de la République issus de l'immigration (non seulement les nouveaux arrivants mais aussi ceux des deuxième et troisième générations — donc des « citoyens » français à part entière puisque nés sur le sol français).
Ce n'est pas de la science-fiction mais simplement l'éventail des possibles advenant une souveraineté administrée par des nationalistes qui se croiraient autorisés à passer outre tout ce qu'ils associeraient, de près ou de loin, à tort ou à raison, à du multiculturalisme dont le Québec se serait débarrassé en quittant le Canada et sa Charte des droits et libertés qui aurait entravé l'aspiration des Québécois à leur pleine émancipation. N'en déplaise aux journalistes qui attendent avec impatience un nouveau référendum, le PQ n'a pas le monopole de l'idée, de la mouvance et du processus politiques qui mèneraient à l'Indépendance, d'autant plus qu'il n'a jamais été un parti « indépendantiste » (au sens fort) mais un parti « souverainiste » qui tient à garder un lien économique fort et étroit avec le reste du Canada (ROC) afin de rassurer les marchés, le milieu des affaires et la classe capitaliste en général. Reste à savoir si le ROC acceptera de jouer le jeu dans lequel il pourrait avoir l'impression d'être le dindon de la farce.
Mario Charland
Shawinigan
Notes
1. Le Devoir, jeudi 11 novembre, 20205. C'est moi qui souligne.
2. Ibid.C'est moi qui souligne.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Une autre victime évitable ?

MONTRÉAL - 11 décembre 2025 - Le 10 décembre 2025, nous avons appris qu'une femme a été tuée dans le cadre d'une intervention policière à fort déploiement à Saint-Hyacinthe. Selon les informations disponibles, la femme était connue des services policiers et vivait d'importants enjeux de santé mentale et de toxicomanie.
Une autre victime évitable ?
Le Collectif de défense des droits de la Montérégie (CDDM) et l'Association des groupes d'intervention en défense des droits en santé mentale (AGIDD-SMQ) soulèvent des enjeux relativement au décès d'une femme, tuée dans le cadre d'une intervention de crise, à Saint-Hyacinthe.
Bien que les détails complets de l'intervention demeurent pour le moment limités, tout indique qu'elle se trouvait en situation de crise au moment de l'arrivée des policiers et qu'elle brandissait un couteau. Dans un tel contexte, le CDDM reconnaît qu'une intervention rapide des agents de la paix, responsables de la sécurité de toutes les personnes présentes, était légitime.
Néanmoins, David-Alexandre Grisé, coordonnateur du CDDM, questionne les dispositifs et les pratiques accomplies dans le cadre de ce type d'intervention : « Quelles sont les pratiques et les modalités d'interventions policières devant un cas de figure manifestement profilé « santé mentale » ? Est-ce que le profilage de la dame a teinté ou biaisé l'intervention des agents impliqués ? Est-ce que des intervenants de crise ont été mobilisés dans ce cadre et ce contexte d'urgence ? Est-ce que des organisations en intervention de crise existent ou sont suffisamment financées pour y participer dans la région maskoutaine ? Est-ce que des équipes mixtes ou des pratiques de collaborations sont établies entre des services d'aide en situation de crise (SASC) et les forces de la Sûreté du Québec à Saint-Hyacinthe et dans les environs ? »
« Si la mort de la sergente Maureen Breau et d'Isaac Lessard-Brouillard a suscité le désarroi en 2023, ce énième décès doit nous servir de catalyseur et nous sensibiliser sur le besoin de bonifier des pratiques d'interventions alternatives à la présence des forces de l'ordre, ou du moins, minimalement différenciées et complémentaires entre les forces policières et les services d'intervention de crise au Québec » clame Nancy Melanson de l'AGIDD-SMQ.
Comme en témoigne la récente étude de l'Institut québécois de réforme du droit et de la justice (IQRDJ), « la collaboration des policiers et des intervenants SASC est centrale dans l'application de la P-38. Bien que leurs fonctions diffèrent, les deux groupes se retrouvent
à l'avant-plan des interventions en situation de crise, souvent en collaboration. Les policiers insistent sur leur mandat de sécurisation et expriment, pour plusieurs, un malaise face à des interventions qu'ils considèrent en marge de leur rôle traditionnel. À l'inverse, les intervenants SASC affirment leur compétence spécifique en matière de désescalade et d'évaluation psychosociale, tout en reconnaissant l'importance du soutien policier en contexte de dangerosité ».[1]
« Étant donné les multiples témoignages des personnes premières concernées, il est donc pressant de tenir compte des malaises et doléances qu'elles ont émis maintes fois en rapport avec les interventions de crise. Si cette loi et ces interventions sont appelées à se réformer, souhaitons que cette transformation soit aussi muée par l'écoute de la parole concertée et le vécu traumatique commun de ceux et celles qu'elle doit servir et protéger » réclament d'un commun accord M. Grisé et Mme Melanson.
[1] Source :
https://iqrdj.ca/wp-content/uploads/2025/10/Rapport-4.-P-38-Enquete-qualitative.pdf
[1]
[2] www.cddm.qc.ca [2]
[3] www.agidd.org [3]
Les opinions exprimées dans ce communiqué de presse sont uniquement celles de l'expéditeur et ne reflètent pas nécessairement celles d'Cision.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Hausse record de 25 % du loyer moyen dans Limoilou

Québec, le 12 décembre 2025 : Un rapport de la SCHL nous apprend cette semaine que le taux d'inoccupation des logements augmente au Québec, indiquant pour plusieurs un indice de « sortie de crise ».
À Québec, le taux d'inoccupation tous logements confondus a atteint 2,4%, nouvelle qui a été hautement saluée par l'administration Marchand, se félicitant d'avoir construit un nombre « record » d'unités de logements cette année. Or, on constate sur le terrain des hausses fulgurantes du prix des loyers, malgré cette augmentation du taux d'inoccupation. La Table citoyenne Littoral Est et le FRAPRU mettent en garde la population et les élu.es : la crise vécue par les locataires n'est pas terminée et celle de l'inabordabilité empire.
Portrait de la situation
Dans le secteur de Limoilou, toutes typologies confondues, le loyer moyen a augmenté de
24,6% en 1 an seulement. C'est plus du double de la hausse du loyer moyen à l'échelle de
la ville déjà énorme. Le loyer moyen pour un 4 et demi a atteint 1124$ par mois cette année, ce qui représente une hausse record de 28,3% depuis l'an dernier, malgré que le taux
d'inoccupation ait atteint 3% pour le secteur. Ce taux élevé ne doit pas invisibiliser la crise de l'inabordabilité des logements avertissent les groupes. En effet, à l'échelle de la région
métropolitaine de Québec, on constate que le taux d'inoccupation des logements les moins chers (premier quartile) est autour du 1% alors qu'il s'élève à 4,9% pour les logements les
plus coûteux (quatrième quartile). La Table citoyenne Littoral Est est catégorique : « le
problème c'est que les constructions neuves et inabordables influent à la hausse sur les prix du marché, ce qui accélère la cherté des logements et la gentrification de nos quartiers » dénonce Azélie Rocray, coordonnatrice du groupe.
À l'heure actuelle, l'augmentation du prix des loyers dépasse largement l'augmentation des revenus de la majorité des locataires, qui doivent se rabattre sur des logements toujours
plus inabordables pour se loger, déplorent les groupes de défense du droit au logement. «
Lors du dernier recensement, un ménage locataire sur 5 dans Limoilou payait plus de 30% de ses revenus pour se loger. Avec le phénomène de gentrification et de raréfaction
incessante des logements correspondant à leur capacité de paiement, on craint que la situation se soit considérablement empirée depuis » déplore Azélie Rocray.
Une Crise de l'inabordabilité
La construction massive de logements privés inabordables ne garantit pas une éventuelle
sortie de la crise du logement, dans le contexte actuel de marchandisation accrue de
l'immobilier. Pour assurer une sortie de crise, les gouvernements doivent mettre en place un mécanisme rigoureux de contrôle du prix des loyers et investir massivement dans le
logement social. « Aucune autre formule que le logement social ne permet de répondre à la fois à l'inabordabilité des loyers et aux besoins réels des locataires comme des
communautés. Ce n'est pas une dépense, mais bien un investissement collectif », rappelle
Véronique Laflamme.
Concrètement, la Tables citoyenne et le FRAPRU demandent au gouvernement québécois :
● De nouveaux investissements substantiels et récurrents, permettant le financement
pluriannuel d'au moins 10 000 logements sociaux et communautaires par année.
● La mise en place de véritables programmes de logement social capables de
répondre à la crise de l'inabordabilité.
La Table citoyenne, comme les autres membres du FRAPRU à Québec, demandent à la
Ville de Québec de doubler son objectif annuel et de réaliser au moins 1 000 logements
sociaux et communautaires par année. Que les terrains et les fonds publics municipaux
destinés à la réalisation de logements sociaux « et abordables » ne servent qu'à des projets sans but lucratif et que l'octroi de tous fonds publics municipaux destinés à la réalisation de logements qualifiés d' « abordables » soient conditionnels à ce que le prix des logements ne dépassent pas les seuils établis dans le Programme d'habitation abordable Québec (PHAQ), avec des loyers moins chers que le loyer médian du marché. Dans le contexte où le gouvernement Legault impose de plus en plus aux projets sans but lucratif d'inclure des logements plus chers, les groupes demandent à l'administration Marchand de refuser les pressions de Québec en ce sens et de défendre plutôt le droit des locataires de Québec d'avoir accès à un logement décent.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

CISO a 50 ans – Quel avenir pour la solidarité internationale ?

Dans un contexte mondial marqué par le repli sur soi, il est légitime de s'interroger sur la place et l'avenir de la solidarité ouvrière internationale. Comment préserver, mais surtout renforcer ces liens à une époque où les dynamiques de fragmentation se multiplient ? C'est dans cette perspective qu'a été organisée une journée de réflexion par le CISO — retour sur un événement riche en idées et en échanges.
9 décembre 2025 | https://alter.quebec/quel-avenir-pour-la-solidarite-internationale/
Depuis près d'un demi-siècle, le Centre international de solidarité ouvrière (CISO) œuvre à sensibiliser et à éduquer les travailleuses et travailleurs sur les réalités internationales qui façonnent leurs luttes.

Cette journée a rassemblé une centaine de personnes issues de divers milieux. Parmi celles-ci figuraient notamment Louise Harel, une figure politique marquante du Québec, et Haroun Bouazzi, député à l'Assemblée nationale. Plusieurs invité.es et panélistes étaient également présents, dont Geneviève Dorais, professeure au Département d'histoire de l'UQAM ; Benedicto Martínez Orozco, représentant du Frente Auténtico del Trabajo (FAT) au Mexique ; Chris Dols du Federal Unionists Network (FUN) aux États-Unis ; ainsi que Yvel Admettre, secrétaire général de la Confédération des travailleuses et travailleurs des secteurs publics et privés (CTSP) en Haïti.
Un laboratoire de solidarités ouvrières
Fort de ses cinq décennies d'expérience, le CISO est devenu un véritable « laboratoire » de solidarités ouvrières. Ses pratiques et ses démarches permettent aujourd'hui de mieux comprendre les mécanismes favorisant l'émergence et la consolidation de solidarités internationales.

Selon Geneviève Dorais, les pratiques du CISO éclairent une vision fondée sur des responsabilités partagées et sur l'interdépendance entre solidarité internationale et avancement des droits. De son analyse émergent trois axes fondamentaux pour soutenir une solidarité ouvrière internationale durable :
L'éducation à la citoyenneté mondiale ;
La création de coopérations par le dialogue
Le développement durable d'actions concrètes par et pour les travailleurs/travailleuses.
Axe 1 – Éduquer pour comprendre, la base d'une solidarité
L'éducation constitue la première étape incontournable. Pour qu'une personne s'intéresse à l'internationalisme ou s'y investisse, elle doit d'abord comprendre les raisons qui rendent cet engagement nécessaire.
Faire connaître les enjeux internationaux liés à chaque secteur d'activité permet aux travailleuses et travailleurs de saisir les liens qui les unissent à leurs homologues ailleurs dans le monde. Dans un contexte de mondialisation des entreprises, cette compréhension globale devient essentielle : elle permet d'échanger des connaissances, de reconnaître des problèmes communs et de comprendre pourquoi la création de liens internationaux renforce les luttes, mais aussi permettent le maintien ou l'avancement des conditions et des droits, ici comme ailleurs.
Axe 2 – Le dialogue l'ingrédient créateur de coopération
Comment créer ces liens et faire naître cette solidarité ? Par le dialogue. La coopération ne peut exister sans échanges, sans écoute, sans compréhension mutuelle.
Les occasions sont multiples : conférences, ateliers, observatoires, webinaires, assemblées générales, rencontres militantes, etc. Ces espaces ne sont pas que syndicaux ou communautaires : ce sont de véritables lieux d'éveil politique où l'on vit des émotions fortes. Ils sont essentiels pour tisser des liens, susciter l'ouverture et éveiller la conscience sociale.
En nourrissant ce dialogue, on fait naître l'engouement pour la solidarité internationale. Chaque échange devient une pierre ajoutée à la construction d'une coopération durable.
Axe 3 – Développer du concrets, le présage d'un engagement durable
Vient ensuite le troisième axe : la mise en œuvre d'actions concrètes par et pour les personnes qui font vivre cette solidarité. Ces initiatives permettent non seulement de cultiver l'ouverture, mais aussi de renforcer le rapport de force des travailleuses et travailleurs à l'échelle internationale.
Ce succès repose sur deux éléments :
- La multiplication du sens de la solidarité par l'éducation et la politisation, un milieu de travail à la fois ;
- La possibilité d'effectuer des stages internationaux, où l'expérience vécue — l'émotion — devient un puissant moteur d'engagement.
La convergence des luttes : l'illustration de cette journée
Au cours de la journée, les panélistes ont présenté des luttes internationales au seindesquelles des solidarités se sont créées, transformées ou renforcées. Ces témoignages ont illustré concrètement la portée de la solidarité ouvrière : ses défis, ses victoires, ses apprentissages, et surtout les avenues de possibles qu'elle ouvre dans les milieux de travail et dans les communautés.

Les incontournables
Peu importe le panel, l'atelier ou la discussion, un constat s'est imposé : l'éducation demeure le premier axe permettant la création d'une solidarité durable. Mais ce n'est pas le seul enseignement de la journée. Les échanges ont permis d'approfondir la réflexion et d'alimenter un engagement renouvelé envers le développement de la solidarité locale et internationale.
Réfléchir ensemble, confronter les idées, laisser émerger de nouvelles observations : c'est toute la richesse de ces espaces de dialogue. Les émotions y jouent un rôle central. On ne peut s'engager si l'on ne comprend pas pourquoi — et l'émotion, l'indignation, la compassion ou l'espoir sont souvent les moteurs de cet engagement.

La solidarité trop souvent définie selon une vision judéo-chrétienne — celle d'une aide unilatérale — doit être repensée comme une solidarité de classe, fondée non pas sur la vulnérabilité, mais sur la recherche du bien-être collectif. La convergence des luttes renforce les mouvements sociaux, syndicaux, environnementaux, politiques et humains, car nos enjeux et nos intérêts sont profondément liés.
La solidarité comme vecteur de changement
Dans un contexte de polarisation croissante, l'isolement favorise la division, au bénéfice des classes dominantes. L'appel à la solidarité, au contraire, nous invite à nous concentrer sur ce qui nous unit. De faire collectivement un choix lucide vers un monde plus juste et plus consciencieux des autres. Et il s'agit là d'un véritable vecteur de changement.
Se doter d'une culture internationale forte, c'est se donner les moyens d'atteindre des objectifs communs, de travailler en coopération et d'innover dans une perspective de bien commun.
Pour plus d'informations :
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Stratégie de QS pour 2026

Une stratégie politique de construction de la gauche, c'est établir une orientation générale cohérente tenant compte du rapport de force actuel qui permet de construire la gauche politique et les mouvements sociaux afin de transformer les rapports sociaux en faveur du peuple. Nous proposons ici une stratégie à court terme pour QS, d'ici aux élections de l'automne 2026
Analyse de la période
– Crise écologique existentielle qui s'accélère, notamment par l'effondrement de la vie sauvage et la biodiversité, l'épuisement des ressources et les dérèglements climatiques.
– Hausse du coût de la vie des classes populaires, dans un contexte de polarisation de la richesse, expliqué notamment par un ralentissement structurel de la croissance économique qui favorise ceux qui ont déjà du capital au détriment de ceux qui travaillent (Voir Piketty, Capital du XXIe s.).
– Polarisation politique avec montée de la droite radicale, déclin du centre et de la gauche malgré quelques exceptions.
Analyse de la conjoncture
– La droite radicale est en croissance partout et au pouvoir dans plusieurs des principaux pays dominant la planète (États-Unis, Inde, Russie, Argentine, dictatures du Golfe, Italie) et en croissance dans de nombreux pays.
– Trump organise des attaques historiques contre les droits à l'interne et, à l'externe, se lance dans une guerre commerciale mondiale avec des tarifs qui touchent notamment le Canada et le Québec et augmente le cout de la vie.
– La gauche modérée est au pouvoir dans certains pays importants (Mexique, Brésil, Colombie, Chili, Espagne). La gauche assumée est minoritaire dans certains pays tout en représentant une force notable, notamment aux États-Unis (DSA, Mairie de New York et Seattle) et en France.
– Les tarifs de Trump, la bulle techno et la crise écologique nous poussent vers une crise économique à court ou moyen terme.
– Le gouvernement Carney applique le programme conservateur : abolition des taxes sur le capital, sur le carbone, priorité au pétrolières, au militaire, aplaventrisme devant Trump…
– Les gouvernements canadiens et québécois ont un déficit notable qui s'accentuera avec la prochaine crise économique. On doit s'attendre à l'augmentation des luttes sociales contre les coupures dans les prochaines années.
– Les mobilisations sont modérées du syndical (rattrapage salarial), étudiant (stages rémunérés), des groupes populaires (financement autonome), féministe (avortement), écologiste (mines, rivières, démantèlement du ministère de l'environnement) et indépendantiste (notamment chez les jeunes)
– Les attaques de la CAQ sur les droits en général et contre les syndicats en particulier ont provoqué une grande manifestation unitaire le 29 novembre, mais sans lendemain conséquent. Il y a ici un potentiel d'unification et de radicalisation des luttes qui demandera une remise en question des orientations de l'attentisme.
– Les appuis de QS ont 5 caractéristiques sociales : jeunes, urbains, pauvres, éduqués et femmes.
– QS est en période de crise et de déclin. Le débat porte notamment sur le virage à droite, la centralisation et le rôle des femmes. Les fondements politique et organisationnel du parti restent en place, mais sont fragilisés.
Stratégies possibles dans ce contexte
Mettre en place des politiques progressistes de transformation sociale et d'indépendance du Québec est possible seulement avec une mobilisation populaire massive et organisée. La stratégie de Québec solidaire doit contribuer à cette mobilisation. Dans ce sens, nous proposons une stratégie en deux axes : construire la mobilisation contre la CAQ et établir la priorité de QS d'ici les élections.
Axe 1) Construire la mobilisation contre la CAQ
Depuis un an, la CAQ mène une offensive brutale et radicale contre les droits, en particulier ceux des travailleuses et des travailleurs. Comme l'a souligné le Barreau du Québec, ces attaques fragilisent l'État de droit, les contre-pouvoirs, l'indépendance judiciaire et les droits fondamentaux, notamment par des tentatives visant à empêcher certains organismes de contester des lois devant les tribunaux. Le mouvement syndical est lui aussi ciblé : ses capacités d'intervention sur les enjeux sociopolitiques sont restreintes, ce qui freine ses alliances avec les autres mouvements sociaux [1]
Ce virage autoritaire cherche également à neutraliser toute contestation des lois racistes qui excluent les femmes voilées des emplois en éducation, dans un contexte où l'abolition du PEQ plonge de nombreuses personnes immigrantes dans une grande précarité. De son côté, le PQ, actuellement en tête des sondages, surenchérit sur ces politiques racistes tout en se limitant à une défense de la « liberté d'expression », allant jusqu'à condamner les propos de la présidente de la FTQ sur les projets de loi. Aucun de ces deux partis n'ose par ailleurs s'opposer frontalement ni à Trump ni à Carney, et tous deux appuient un virage économique militariste, extractiviste et profondément anti-environnemental.
Dans ce contexte, la grande manifestation unitaire du 29 novembre 2025 a marqué une étape importante, mais la question de la suite demeure entière. Faut-il aller vers des actions de perturbation économique — blocages de ports, de ponts ou de routes — ou vers une grève sociale intersectorielle ? L'exemple récent des médecins démontre qu'un véritable rapport de force est le seul moyen de faire reculer ce gouvernement. Quelle que soit la forme qu'elles prendront, seule une escalade des moyens de pression permettra d'obtenir le retrait des projets de loi. Le Printemps érable (transcroissance d'une grève étudiante illimitée en une désobéissance civile citoyenne contre la loi spéciale) constitue à cet égard un modèle inspirant. Ce débat doit être ouvert sans tarder, et Québec solidaire doit appuyer toute initiative allant dans ce sens.
Axe 2) Établir la priorité de QS d'ici les élections
Voici 4 stratégies possibles pour QS d'ici les prochaines élections. Toutes comportent une articulation entre les 3 fondements de QS : justice sociale, écologie et indépendance.
Centre notre discours, nos alliances et notre travail terrain sur :
1- Cout de la vie
2- Réinvestissement dans les services publics
3- Indépendance du Québec
4- Transition écologiste
Nous ne proposerons pas une stratégie centrée sur l'indépendance ou sur l'écologie, mais plutôt sur la justice sociale. Nous détaillerons donc 2 propositions : une première centrée sur le cout de la vie et une 2e sur le réinvestissement.
Notre orientation sur la justice sociale sera présentée comme la meilleure pour mobiliser le peuple et les mouvements sociaux vers l'indépendance (les politiques antisociales empêchant l'indépendance).
Les grandes propositions de transition écologiste, notamment en transport (principal émetteur de GES au Québec), seront couplées au cout de la vie (gratuité) ou au réinvestissement.
Plan A : Une stratégie centrée sur le cout de la vie
Dans un contexte de croissance des inégalités sociales, si l'on veut améliorer la qualité de vie, il faut s'attaquer au cout de la vie par la baisse des couts des loyers et des médicaments, la gratuité de l'éducation et du transport collectif et la hausse des bas salaires, le tout financé par la taxation de la richesse et Pharma-Québec.
Secteurs de la société ciblés :
● Personnes à plus faible revenu : Sans-emploi, étudiantE, retraitéEs, travailleurs pauvres, femmes, jeunes, immigrantEs, et leurs associations et syndicats
● Locataires et les groupes en logements
● Notons que ces secteurs sont ceux qui vont le moins voter
● Vise en partie la classe moyenne
● Les locataires et le transport collectif sont des enjeux plus urbains
Revendications phares
● Gel des loyers et construction de logements sociaux (et abordables ?)
● Instauration de la gratuité : de l'éducation supérieure, du transport collectif, les cantine dans le réseau scolaire, financé par une taxation du capital
● Baisse des couts des médicaments (et des assurances) avec Pharma-Québec
● Augmentation du salaire minimum et soutien aux luttes syndicales pour l'augmentation des salaires
● Indépendance pour reprendre le contrôle de notre budget, notre État, nos priorités. Sortir du pétro-État canadien militariste, conservateur et à genou devant Trump.
Voici ce qui le site web de QS propose pour l'instant :
Pour aider les familles à arrondir les fins de mois, Québec solidaire va :
● Instaurer un Programme universel d'alimentation scolaire ;
● Abolir la TVQ sur les produits usagés et sur les services de réparation ;
● Augmenter le salaire minimum à 20$ de l'heure.
Pour aider les locataires et les premiers acheteurs, Québec solidaire va :
● Instaurer un registre des loyers et interdire les hausses abusives ;
● Mettre fin aux enchères à l'aveugle pour les offres d'achat ;
● Lancer une nouvelle Corvée d'habitation : un grand chantier pour que l'État construise rapidement des logements abordables, collectifs et sociaux ;
● Rembourser la TVQ sur les constructions neuves pour favoriser la construction de nouvelles maisons abordables.
Pour réussir la transition écologique, Québec solidaire va :
● Investir massivement en transport en commun en priorisant les régions les moins bien desservies ;
● Financer un fonds d'adaptation climatique pour mieux se préparer aux évènements météorologiques extrêmes en rapatriant les subventions fédérales aux pétrolières ;
● Mettre en place un fonds d'urgence pour aider nos producteurs et productrices agricoles partout au Québec.
Pour la majorité de la société, la question du cout de la vie est un enjeu important
● Notamment la hausse des couts du logement et de l'alimentation
-
- o Mais aussi les soins et l'éducation privée ou tarifée
● Les tarifs de Trump n'aident pas
● Mais les mesures en mettre en place ne sont pas évidentes
● Pour la droite, c'est par les baisses d'impôt et la libéralisation qu'on fera baisser les prix. Elle favorisera aussi l'accès à la propriété.
- o Mais aussi les soins et l'éducation privée ou tarifée
QS est le seul parti à soutenir que :
– Les écarts entre riches et pauvre augmentent depuis 50 ans
– La hausse des salaires et une solution à la hausse du cout de la vie
– La taxation des riches, des grandes entreprises et de la pollution est nécessaire pour instaurer la gratuité
– Pharma-Québec permet de réduire les couts des médicaments (et de se protéger de Trump)
– La crise écologique augmentera le cout de la vie et menace nos emplois
– La crise économique à venir va réduire les emplois et faire baisser les salaires
– Pour faire l'indépendance (35 à 55% dans les appuis), il faut améliorer de leurs conditions de vie. Le PQ, comme d'habitude, va se lancer dans une campagne de déficit 0 et entrer en confrontation avec les mouvements sociaux et plusieurs secteurs de la population. QS au contraire souhaite réinvestir et travailler avec les mouvements sociaux, qui sont nécessaires à la mobilisation pour l'indépendance.
Plan B : Une stratégie centrée sur le réinvestissement dans les services publics
Dans un contexte de déficit qui sera aggravé par une crise économique, si l'on veut améliorer les conditions de vie de la majorité et faire l'indépendance, on doit participer à la mobilisation des mouvements sociaux afin de taxer les riches pour réinvestir dans les services publics.
Secteurs de la société ciblés :
● Travailleur-se-s du secteur public, majoritairement des femmes, et leur syndicat
● Usagé-ère-s des services publics : étudiants, malades, parents, vieux, pauvres, femmes et leurs associations
● Bénéficiaires du financement public : villes, écolo, milieu culturel,
● toutes les régions (pas de priorisation)
Revendications phares
● Réinvestissement de 10 milliards dans les services publics et la transition écologique (avec multiple déclinaison dans tous les secteurs)
● La taxation des riches, des grandes entreprises et de la pollution (et mise en place de Pharma-Québec qui réduira les couts des médicaments)
● Indépendance pour reprendre le contrôle de notre budget, notre État, nos priorités. Sortir du pétro-État canadien militariste, conservateur et à genou devant Trump.
Voici ce que dit le site web de QS propose pour l'instant :
Pour donner aux Québécois⋅es des services qui marchent, Québec solidaire va :
● Assurer l'égalité des chances des enfants dans nos écoles en rendant les projets particuliers accessibles à toutes et tous ;
● Garantir un accès équitable aux services publics au Québec : que vous habitiez en ville, en région ou en banlieue, vous devriez avoir droit à des services publics qui marchent ;
● Mettre fin à l'expansion du privé en santé et renforcer la qualité des soins offerts gratuitement dans le réseau de santé publique.
Pour la majorité de la société, la question des services publics est prioritaire
● La santé est l'enjeu le plus important pour les élections, l'éducation n'est pas loin derrière
● Une partie de la population adhère à la vision de la droite :
-
- o Le déficit, de la dette, des cotes de crédits d'un côté, la baisse des impôts de l'autre est une priorité
- o Réduire dans l'État, la bureaucratie est la solution
- o Privatiser est une autre solution
QS est le seul parti à soutenir que :
● Les écarts entre riches et pauvre augmentent depuis 50 ans
● Le déficit sera aggravé par une crise économique (et écologique) et les dépenses militaires
● Il est possible de réinvestir si on taxe la richesse
● Il est possible de taxer la richesse sans faire fuir les capitaux
● La crise écologique augmentera les déficits et menace nos services publics
● Pour faire l'indépendance (35 à 55% dans les appuis), il faut améliorer les conditions de vie. Le PQ, comme d'habitude, va se lancer dans une campagne de déficit 0 et entrer en confrontation avec les mouvements sociaux et plusieurs secteurs de la population. QS au contraire souhaite réinvestir et travailler avec les mouvements sociaux, qui sont nécessaires à la mobilisation pour l'indépendance.
● La nation québécoise veut survivre, nous avons le choix entre un nationalisme conservateur basé sur la peur des immigrantEs ou l'indépendantisme de gauche inclusif. Ne pas construire un c'est laisser l'autre prendre la place.
Autres éléments à prendre en considération dans les tactiques à développer
● Importance de garder le cap sur nos valeurs, qu'il soit clair pour la population qu'on ne pliera pas sur nos principes : justice sociale, écologie, indépendance et la dénonciation des riches qui contrôle l'économie, de la droite qui s'attaque aux droits sociaux et aux droits des minorités.
● Construire un « nous » solidaire basé sur le peuple québécois dans sa diversité, fier de son modèle social et des luttes qui l'ont permis, qui oppose le 1% vs 99% nommer les réalités vécues à partir du point de vue des gens qui le subissent : hausse du cout de la vie, logement inaccessible, services publics fragilisés. Démontrer le rôle parasitaire et destructeur des milliardaires qui nous dirigent. Mettre en relief l'apport des femmes et des personnes issues de l'immigration dans la construction du Québec et des luttes qui nous unissent et soutenir activement leurs luttes spécifiques.
● Associer les propositions de notre plateforme aux pays qui les appliquent et où il y a les meilleures conditions de vie. Rappeler que ces pays reposent sur 3 choses : l'état social très développé, forte taxation de la richesse, taux de syndicalisation très élevé et qu'il n'y a que QS qui va dans ce sens.
● Positionner QS comme le meilleur rempart et le projet le plus cohérent contre Trump et ses valeurs. Critiquer l'aplaventrisme de la CAQ, du PQ, et du gouvernement fédéral face à Washington et positionner QS comme le seul projet politique souverain, écologique et solidaire qui réduit notre dépendance aux États-Unis. Établir des liens visibles avec la gauche américaine, notamment les DSA.
● Positionner QS comme l'opposition la plus cohérente au programme conservateur, pétrolier et fédéraliste mis en place par Carney
● Positionner QS comme le parti qui s'engage, auprès des mouvements sociaux, à mettre fin aux politiques de la CAQ, notamment ses derniers projets de loi (voir axe 1).
● Clarifier que le PQ n'est pas un parti de gauche, mais une coalition droite-gauche qui a mis en place une grande partie des politiques de droite Québec, notamment avec Bouchard, Landry, Legault et autres.
● Il faut ouvrir des espaces de politisation, de rassemblement pour accueillir les nouveaux-elles militantEs
● La nation québécoise veut survivre, nous avons le choix entre un nationalisme conservateur basé sur la peur des immigrantEs ou l'indépendantisme de gauche inclusif. Ne pas construire un c'est laisser l'autre prendre la place.
ANNEXE 1
Résumé des 5 priorités stratégiques de la gauche selon Piketty & Cagé dans leur livre "Une histoire du conflit politique, Élections et inégalités sociales en France, 1789-2022"
1. Reconquérir les classes populaires en mettant la réduction des inégalités au cœur du projet.
2. Proposer une vision économique forte : fiscalité progressive, services publics, redistribution du capital.
3. Réconcilier diplômés urbains et non-diplômés ruraux avec un programme commun.
4. Investir massivement dans les territoires périphériques pour contrer le vote extrême droite.
5. Combattre l'abstention populaire, qui est devenue l'expression politique dominante des précaires.
Pour poursuivre vos réflexions, quelques textes sur la politique au Québec
Manifester contre le virage à droite de la CAQ : Ok, mais les autres ?
Yves Bergeron - 2 décembre 2025
Propositions de points saillants pour la plateforme électorale 2026 de Québec solidaire-
Marc Bonhomme - 2 décembre 2025
Déclaration de solidarité et appel à la mobilisation - L'hiver sera chaud : la CAQ a déclaré la guerre à la société civile
Collectif d'organisations et de militant·es - 25 novembre 2025
La partie n'est pas jouée
Benoit Renaud - 18 novembre 2025
La conjoncture qui se dessine et les conditions d'un rebond pour Québec solidaire
Bernard Rioux - 18 novembre 2025
Construire la majorité pour un Québec indépendant, égalitaire, féministe et décolonial
Bernard Rioux et André Frappier - 4 novembre 2025
L'instrumentalisation politique de l'immigration par le gouvernement Legault
Bernard Rioux - 22 octobre 2025
Leur laïcité et la nôtre
Benoît Renaud - 9 septembre 2025
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le débat sur la stratégie pour l’indépendance ne saurait attendre

Dans sa chronique du Devoir « Les saboteurs », Michel David rend compte que tant Québec solidaire, aujourd'hui, et hier sauf sa direction, que le PQ dont son chef d'aujourd'hui, hier, admet-admettait noir sur blanc que le PQ est un parti « noninclusif » c'est-à-dire « identitaire ». Ce sont là des mots codés signifiant antiimmigrant autrement dit des mots référant à la xénophobie pour ne pas dire au racisme étant donné la composition majoritairement non-blanche de l'actuelle immigration et même islamophobe étant donné son importante composante dite musulmane.
Côté PQ, le chroniqueur pro-PQ admet carrément la crue vérité de son identitarisme électoraliste : « Si le PQ et la CAQ persistent à miser sur l'insécurité des Québécois en présentant les immigrants comme une menace pour le français et comme un poids insupportable sur les services publics, c'est que cela trouve un écho dans l'électorat. »
Un clash sociétal irréconciliable qui ouvre la porte à un clash socio-économique
La base militante Solidaire est depuis toujours allergique à l'identitarisme tout comme aujourd'hui l'est devenue sa direction, avec une porte-parole principale d'origine palestinienne dont une grand-mère victime de la Naqba de 1948 et un porte-parole aux racines italiennes. C'est un tournant clarificateur et bienvenu depuis la pénible affaire des chinois qui se seraient accaparés des terres agricoles au Téminscamingue, de l'appui au rapport Bouchard-Taylor à propos du voile et du refus de soutenir les Anishinabeg de la Réserve faunique La Vérendrye à propos de la chasse à l'orignal à l'encontre du « consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause » de la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des peuples autochtones.
Ce clash entre le PQ et Québec solidaire est crucial et irréconciliable. Il est au cœur de la contradiction majeure du monde contemporain. Aucune alliance formelle ou tacite ne saurait en naître. D'un côté les forces fascisantes et fascistes en progression rapide « nous montent […] les un·es contre les autres. Elles pointent du doigt les personnes immigrantes. Les personnes qui ne sont pas blanches. Les socialistes. Les personnes à faible revenu. Les femmes. Les personnes LGBTQ+. Tout groupe fait l'affaire, tant que cela nous empêche de regarder vers le haut, là où la richesse continue de s'accumuler » (Greenpeace-Canada, lettre du 12/12/25). De l'autre, la majorité des forces de gauche s'adapte à cette dérive sous prétexte qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde alors que l'imposition des riches et ultra-riches n'a jamais été aussi basse depuis la Deuxième guerre mondiale sans compter que l'épargne nationale et les quelques deux cent transnationales majeures sont devenues, depuis lors, totalement sous le contrôle de la grande bourgeoisie oligarchique.
Les exceptions à la règle, sans être des modèles stratégiques, montre la voie
Mais il y a des exceptions à la règle telles Die Linke allemand et le chapitre de la cité de New-York du Democratic Socialist of America (DSA), aile gauche du parti Démocrate, qui avec succès ont lutté à contre-courant d'un torrent fascisant qui s'est par ailleurs imposé à leurs nations respectives. On a noté avec raison que Die Linke et Mamdani ont assis leur campagne électorale sur d'incisives, concrètes, irrécupérables revendications-clefs vérifiables en fin de mandat. Celles-ci, reflétant les majeures préoccupations de l'heure du peuple-travailleur, notamment liés au coût de la vie, ont eu la capacité de mobiliser en masse particulièrement la jeunesse angoissée par ce capitalisme « austoritaire » gros d'anti-woke guerres sociales et internationales afin de nier par la diversion cette fin du monde qui pend au bout du nez de l'humanité.
On a moins noté, cependant, leur parti-pris woke les démarquant clairement tant des forces fascisantes que de celles de centre-gauche glissant vers un point de vue anti-immigrant tels les partis social-démocrate et vert allemands, et encore plus de la scission rouge-brune — les programmes sociaux et les services publics pour les natifs seulement — issue de Die Linke, que les Démocrates centristes. C'est cette caractéristique qui les a rendu attrayants aux progressistes, en particulier la jeunesse. Ensuite, a fait le reste leur plateforme répondant concrètement aux besoins impérieux sociaux-économiques du peuple-travailleur.
Certes ces succès électoraux ne sont nullement gages d'une modification durable des rapports de forces, notamment aux ÉU. Le vainqueur, au lieu de remobiliser ses 100 000 militantes électorales pour le combat acharné afin de réaliser son programme, cherche plutôt, en vain, à se reconnecter aux Démocrates centristes et même à Trump, l'incarnation de la fascisation du monde. Mais cette indépendance de classe qui manque à Mamdani ne devrait pas normalement être un problème pour les Solidaires. Au Québec, l'équivalent de la tentation de se lier au parti Démocrate est celle de l'alliance avec le PQ, à laquelle la base Solidaire a toujours résisté, afin de réaliser l'indépendance nationale dont se réclament Solidaires et PQ.
Le défi de l'indépendance de classe se pose non pas un de ces jours en vue des Calendes grecques mais aujourd'hui en vue des élections de 2026 étant donné que les deux partis se sont engagés pour un référendum dans le premier mandat, post processus constitutionnel pour le premier mais non pour le second. Les sondages du jour laissent voir, en plus d'un Québec solidaire au soutien électoral effondré, un gouvernement péquiste minoritaire mais peut-être majoritaire étant donné les bizarres déformations du scrutin nominal à un tour en présence des cinq partis en lice. Les dilemmes ne manquent pas au parti de gauche afin de se situer envers le PQ par rapport tant à l'élection qu'au référendum et ceci sans plus tarder.
Puissant est le dilemme PQ fort / Solidaires faibles alors qu'il y a une porte de sortie
Que PQ et Solidaires appartiennent, comme on l'a vu, aux deux camps s'opposant mondialement et ne pouvant s'allier stratégiquement. Le premier représente une indépendance nationale de droite masquée en « ni droite ni gauche mais en avant » et le deuxième une indépendance woke de gauche. Ils ne sauraient s'allier électoralement mais pour le référendum ils pourraient tactiquement « marcher séparément mais frapper ensemble ». C'est ce qu'avait fait le petit Parti de la démocratie socialiste (PDS), ancêtre de Québec solidaire, en 1995. Mais il y a loin de la coupe aux lèvres.
Qu'en serait-il si un PQ vainqueur majoritaire continuait son tournant de droite vers l'extrême droite ? Le rapport de forces Solidaire — rallier sa base non indépendantiste pour combler l'écart au 50% — en serait drôlement amoindri pour faire valoir son point de vue dans la campagne référendaire, s'il y a campagne. Il le serait d'autant plus pour imposer un préalable démocratique processus constitutionnel qui presque automatiquement tendrait à gauche comme l'a démontré durant l'hiver 1995 la consultation populaire des « Commissions régionales sur l'avenir du Québec. »
Évidemment, un PQ au gouvernement mais minoritaire et une députation Solidaire plus nombreuse ouvrirait une plus grande possibilité d'imposer au PQ des compromis et surtout une consultation populaire de type constitutionnel en dehors de son contrôle. En filigrane de ce rapport de forces politique se profile un rapport de forces social qu'annonçait peut-être le Grand rassemblement intersyndical des 50 000 contre le gouvernement de la CAQ en autant qu'il n'est pas été qu'un coup d'épée dans l'eau à la mode bureaucratique des grandes centrales syndicales.
On ne voit pas comment le ‘oui' référendaire puisse vaincre sans une remobilisation sociale qu'invite le mitraillage des lois réactionnaires de la CAQ tant antisyndicales qu'antiécologiques si ce n'est antidémocratiques dont une fédéraliste Constitution affaiblissant jusqu'aux droits individuels fondamentaux au nom de la nation, ce qui n'est pas sans obscurcir son droit fondamental à l'autodétermination. (Quant aux Libéraux, ils sont en train encore une fois de prouver qu'ils ne sont que le parti de l'Argent corrupteur mais sans pouvoir s'en remettre au prestige d'un dirigeant banquier pillant les platebandes plus modérées des Conservateurs fédéraux.)
La porte de sortie exige de liquider le recentrage par une plateforme à la Mamdani
C'est cette remobilisation qui permet d'envisager un retour en force de Québec solidaire y compris aux dépens du PQ comme c'était le cas encore électoralement en 2022. C'est dire l'ampleur des dégâts du recentrage à la GND — la démissiondénigrement de Marissal en est le dernier soubresaut — préparé par la direction précédente dont la tactique préférée parlementaire était de tendre la main à la CAQ. La nouvelle direction du parti en plus de son net souverainisme a opté pour un discours affirmé pour les travailleurs et travailleuses dans un manifeste accouchant de cependant piteuses revendications. Le nouveau programme Solidaire plus lissé et court conserve le « dépassement du capitalisme » du discours du dimanche mais il est sans stratégie pour stopper la débandade vers la terre-étuve. Reste l'étape cruciale de la plateforme électorale capable d'inspirer la possible remobilisation sociale et de recruter dans sa foulée cette militance électorale de 100 000 personnes afin de gagner.
Le Comité d'action politique (CAP) écologie du parti, pendant que le collectif « Parti de la rue » lambine, propose à ses membre les options style mini-programme de sa coordination, dans le sillage de la plate thématique proposée par la Commission politique du parti, et ma perfectible proposition à la Mamdanien mesure de soulever la militance et d'être comprise par le peuple-travailleur. À suivre.
Marc Bonhomme, 14 décembre 2025
www.marcbonhomme.com ; bonmarc@videotron.ca
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« Je viens de la base » : Rob Ashton veut reconstruire le NPD à partir de la classe ouvrière

Depuis des années, des critiques tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Nouveau Parti démocratique avertissent que le parti s'éloigne de sa base historique. Élection après élection, le NPD a du mal à établir le contact avec les électeurs et électrices qu'il a été créé pour représenter : les personnes qui travaillent dans les entrepôts, les écoles, les docks, les bureaux, les hôpitaux et les usines du Canada, et qui se sentent de plus en plus abandonnées par une classe politique qui ne tient pas compte de leur opinion.
Tiré de Canadian dimension
10 décembre 2025
C'est dans ce contexte que Rob Ashton, docker et dirigeant syndical, a lancé sa candidature à la direction du NPD. Nouveau venu en politique au sens traditionnel du terme, M. Ashton n'a jamais occupé de fonction élective. Mais il a passé plus de trois décennies sur les quais et dans les salles syndicales, gravissant les échelons jusqu'à devenir président national de l'International Longshore and Warehouse Union (ILWU). À une époque où le Parlement canadien est dominé par des avocat·es, des consultant·es et des gestionnaires professionnel·es, Ashton représente quelque chose de de plus en plus rare dans la politique fédérale : un leader issu directement de la base.
La candidature d'Ashton est un pari sur le fait que le parti ne pourra renouer avec les électeurs et électrices de la classe ouvrière que s'il est dirigé par quelqu'un qui parle leur langage, non pas comme une tactique rhétorique, mais comme une expérience vécue. Il soutient que le NPD doit à nouveau nommer le conflit de classe pour ce qu'il est et se battre sans complexe pour les personnes écrasées par le pouvoir des entreprises et la complaisance politique.
Lorsque nous nous sommes assis pour discuter, Ashton a été catégorique : le NPD a perdu la confiance des électeurs et des électrices, non pas parce que ses valeurs ont changé, mais parce qu'il n'a pas su les communiquer clairement et de manière cohérente. Il estime pouvoir regagner ces électeurices (celleux qui se sont tourné·es vers les libéraux par peur ou vers les conservateurs par frustration) en proposant une politique ancrée dans les luttes quotidiennes plutôt que dans les calculs d'initiés.
Voici notre conversation sur l'avenir du NPD, les échecs de la classe politique canadienne et la tentative d'Ashton de reconstruire le parti à partir de la base.
Christo Aivalis : Une question que se posent de nombreux partisan·es du NPD est de savoir comment chacun des candidats à la direction va convaincre les électeurices de voter pour le NPD. Pourquoi pensez-vous être le mieux placé pour regagner l'électorat ?
Rob Ashton : Je viens de la base, Christo. J'ai vécu cette vie pendant 32 ans en tant que docker, et j'ai représenté les dockers pendant les dix dernières années en tant que président national. Je sais ce dont ils ont besoin et ce qu'ils veulent. Cette fois-ci, certain·es électeurices du NPD ont voté pour les conservateurs, d'autres pour les libéraux, inquièt·es de voir ce roi autoproclamé au sud et Pierre Poilievre prendre le pouvoir. Sous la direction du NPD, je peux ramener ces électeurices qui ont voté bleu, car je parle leur langue. Je connais les difficultés auxquelles ils et elles sont confronté·es. Dans le même temps, les partisan·es du NPD qui ont voté libéral, ainsi que d'autres libéraux, verront que Carney n'est pas celui qu'il prétendait être pendant la campagne électorale. Il est en fait plus conservateur, oserais-je dire, que Brian Mulroney. Ces électeurs et électices verront que le NPD est le parti auquel ils et elles appartiennent, celui qui représente véritablement la classe ouvrière. Je suis le candidat qui peut ramener tout le monde au NPD.
Les Canadien·nes sont de plus en plus préoccupé·es par le Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) et, bien que certain·es politicien·nes l'aient critiqué, peu ont appelé à son abolition comme vous l'avez fait. Pourquoi est-il temps de mettre fin au programme des TET ?
Le programme des TET est conçu pour la classe dirigeante. Il permet de faire venir des gens dans le pays uniquement pour les forcer à accepter des emplois moins bien rémunérés et plus précaires. Vous n'avez pas la possibilité de vous syndiquer, ni de refuser un travail dangereux. Car si un travailleur ou une travailleuses ose s'exprimer, les employeurs ont le droit de le ou larenvoyer dans son pays d'origine. Nous devons nous débarrasser de ce programme. Nous devons créer un système qui fonctionne pour tous les travailleurs et toutes les travailleuses, qu'ils et elles soient citoyen·nes canadien·nes ou résident·es temporaires, car c'est ainsi que ce pays devrait fonctionner. Et c'est ce que défend le NPD : améliorer la situation de toutes les travailleuses et tous les travailleurs et leur offrir un lieu de travail sûr.
Il y a eu récemment de nombreux exemples d'entreprises qui ont quitté le Canada et délocalisé des emplois à l'étranger, même après avoir reçu des subventions du gouvernement spécifiquement destinées à préserver ces emplois. En tant que chef, comment comptez-vous mettre fin à cette situation ?
Prenez l'exemple de l'industrie automobile et d'Aloma Steel, qui vient de recevoir 400 millions de dollars du gouvernement fédéral et 100 millions de dollars du gouvernement provincial, et qui prévoit de se séparer de plus de la moitié de ses employé·es. Ou encore, dans le cas du secteur automobile, ils partent tout simplement au sud de la frontière. Le problème sous-jacent est que l'on distribue l'argent public pour rien. Sous un gouvernement néo-démocrate dirigé par moi-même, il y aurait des conditions à respecter. Si nous vous donnons de l'argent, la première chose à faire est de vous assurer que les Canadien·nes continuent à travailler. Pas d'externalisation, pas de suppression d'emplois, pas de fermeture et pas de départ. Si vous prenez l'argent et que vous partez, vous devrez le rembourser avec des intérêts. C'est la promesse que nous faisons aux Canadien·nes : nous protégerons vos emplois et l'argent public que nous donnons pour soutenir ces entreprises.
Êtes-vous favorable à la propriété publique et des travailleuses et des travailleurs comme moyen de prévenir ce type de pratiques d'externalisation ?
Bien sûr. L'une de nos politiques consiste à faire siéger des travailleurs et travailleuses au conseil d'administration des entreprises de ce pays afin que nous ayons véritablement notre mot à dire sur leur gestion. Lorsque les travailleurs et travailleuses contribuent à orienter une entreprise, celle-ci se développe d'une manière qui profite réellement à ceux et celles qui la font fonctionner. Nous l'avons déjà constaté en Colombie-Britannique, où une usine qui était sur le point de fermer a été sauvée grâce à l'intervention conjointe des travailleurs et des travailleuses, de leur syndicat et du gouvernement. Cette usine est toujours en activité aujourd'hui. Donc oui, la propriété publique et des travailleuses et des travailleurs est une option tout à fait viable.
Une chose que j'ai remarquée dans votre campagne, c'est que vous n'hésitez pas à parler en termes de conflit de classes. Les politicien·nes libéraux et conservateurs sont clairement d'un côté de cette guerre des classes contre les travailleurs et travailleuses canadien·nes, mais même le NPD a parfois hésité à nommer cette réalité directement. Pourquoi est-il important pour vous de rompre avec cela et de le dire clairement ?
Le message de la guerre des classes correspond à la façon dont j'ai vécu toute ma vie, non seulement en tant que leader, mais aussi en tant que docker. C'est une guerre des classes, pure et simple. Tout ce qui s'est passé dans ce pays depuis la colonisation relève de la guerre des classes. Même les questions environnementales en font partie, car la classe dirigeante les utilise pour diviser les travailleurs et les travailleuses en opposant les militant·es écologistes à ceux et celles qui font le travail. Une fois que nous aurons commencé à communiquer clairement ce message et que les travailleurs et travailleuses auront compris qu'ils et elles font partie de cette guerre des classes, nous sommes convaincu·es qu'ils et elles reviendront vers le parti. Car le gouvernement Trump au sud, le gouvernement Carney ici et l'opposition Poilievre feront tout leur possible pour enrichir leurs ami·es tout en maintenant la classe ouvrière sous l'eau. Ce sont des messages que nous continuerons à diffuser, jusqu'à ce que nous en ayons assez de les répéter, et ensuite nous les diffuserons encore plus fort.
Dans le même ordre d'idées, vous avez mentionné dans des interviews précédentes que les Canadien·nes sont en colère contre le statu quo, et à juste titre. Mais nous avons également vu cette colère se manifester de manière déplaisante, souvent à l'encontre des éléments vulnérables de la société. Considérez-vous qu'une campagne axée sur les conflits de classe est un moyen utile de canaliser cette colère ?
Tout à fait. La colère que nous observons dans la société canadienne est en grande partie liée à la lutte des classes qui fait rage actuellement. Écoutez, lorsque les gouvernements ou les partis politiques sont dirigés par des gens comme Donald Trump – et d'autres comme lui, oserais-je dire, presque fascistes –, ils mènent leur campagne avec haine et vous disent de blâmer votre voisin·e pour vos problèmes. Mais ce n'est pas votre voisin·e qui vous empêche de payer votre loyer ou d'acheter vos provisions ; il ou elle n'a aucun contrôle là-dessus. Il faut plutôt se tourner vers les gouvernements et les entreprises qui ont mis en place ce système, un système créé par la classe dirigeante pour la classe dirigeante, afin que les riches s'enrichissent et que les travailleurs et travailleuses restent dans leur condition. Et quand je parle de travailleurs et travailleuses, je parle de toutes les personnes qui sont exploitées : les personnes handicapées, les bénéficiaires de la sécurité de la vieillesse et toutes celles qui essaient de joindre les deux bouts.
Comme la plupart des candidats à cette élection, vous ne siégez pas actuellement au Parlement. Si vous devenez chef du NPD, quel est votre plan pour entrer à la Chambre, où envisageriez-vous de vous présenter et envisageriez-vous une élection partielle pour y parvenir ?
Je n'ai pas de siège au Parlement, et ce n'est pas une mauvaise chose. À l'heure actuelle, nous avons sept député·es solides qui défendent les travailleurs et les travailleuses et s'opposent à la législation dépassée de la classe dirigeante, comme Leah Gazan qui œuvre à l'abrogation de l'article 107 et Alexandre Boulerice qui se bat pour un meilleur programme d'assurance-emploi. Le fait de ne pas avoir de siège me donne la liberté de voyager à travers le pays, de parler aux gens et de me rendre dans des endroits où le NPD n'a pas été vu depuis des années, qu'il s'agisse de communautés rurales ou de nations autochtones, afin d'écouter leurs préoccupations et d'expliquer comment notre parti compte y remédier. En ce qui concerne un siège à la Chambre, je vis dans la vallée du Bas-Fraser, en Colombie-Britannique, et je compte donc me présenter quelque part dans cette région. Mais si une élection partielle est organisée, je ne vais pas simplement me présenter et accepter le siège. Nous discuterons avec l'association locale de la circonscription pour voir si elle a déjà un·e candidat·e, si elle est d'accord pour que je me présente et si je peux vraiment représenter la communauté. Tout cela doit être pris en considération.
Enfin, de nombreux observateurs et observatrices ont soulevé la question du bilinguisme dans cette course à la direction, et votre nom a été mentionné aux côtés d'autres candidat·es. Quelles mesures concrètes prenez-vous pour vous assurer de pouvoir communiquer efficacement votre vision en français ?
Oh oui, j'ai fini par participer à l'émission This Hour Has 22 Minutes à cause de mon français épouvantable [rires]. Blague à part, le français est vraiment important pour moi. Je ne me suis engagé pleinement dans cette course qu'il y a environ deux mois et demi, et je n'aurais jamais imaginé me présenter à la direction du parti. Je vis en Colombie-Britannique et je n'ai pas beaucoup d'ami·es francophones ici, mais j'ai commencé à prendre des cours et à parler avec les francophones de mon équipe de campagne, qui m'aident à apprendre. Si je suis élu le 29 mars, j'ai l'intention de m'immerger dans la langue et la culture françaises au Québec.
Hier soir, j'étais à un événement à Saguenay, où j'ai discuté avec des gens qui m'ont expliqué l'importance de la langue française. Dans les années 1950, la classe dirigeante du Québec parlait anglais tandis que la classe ouvrière parlait français, puis vint la Révolution tranquille dans les années 1960, lorsque les Québécois·es commencèrent à revendiquer leur identité et leur pouvoir. C'est dire à quel point la langue française est importante, non seulement pour les Québécois·es, mais aussi pour les francophones de tout le Canada. Il ne s'agit donc pas seulement d'apprendre la langue, mais aussi de comprendre les identités des différentes communautés, qu'elles soient francophones ou autochtones. En tant que dirigeant du Canada, vous devriez toujours chercher à en savoir plus sur la société que vous servez.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Au-delà de la propriété publique : l’heure de l’écosocialisme

En 2021, James Meadowcroft, professeur à l'université Carleton, déclarait : « Il n'est pas vrai que les gouvernements ne peuvent pas choisir les gagnants : ils le font tout le temps, partout dans le monde. »
Tiré de Rabble. 1er décembre 2025
Meadowcroft a ajouté que les gouvernements canadiens devraient voir plus loin que les pipelines à cet égard. Il s'agissait là d'une observation prémonitoire, étant donné que le premier ministre Mark Carney et la première ministre de l'Alberta Danielle Smith ont convenu d'accorder « des exemptions spéciales aux lois environnementales fédérales et d'offrir un soutien politique à un nouvel oléoduc ».
Réfléchissons attentivement à la question suivante : « Qui choisit les gagnant·es ? »
Les politicien·nes ? Un article du Globe and Mail indique que le personnel politique du ministre du Travail de l'Ontario, David Piccini, « a rejeté les évaluations de fonctionnaires non partisan·es et a distribué des centaines de millions de dollars à des organisations ayant obtenu des notes inférieures » dans le cadre des demandes adressées au Fonds de développement des compétences. L'article ajoute que « les candidat·es retenu·es pour bénéficier des fonds du programme avaient engagé des consultants pour faire pression sur M. Piccini ».
Il semble que les gouvernements canadiens ne choisissent pas les gagnant·es. Ils laissent les lobbyistes le faire à leur place. Pas étonnant que « la productivité du Canada soit à la traîne par rapport à celle de ses pairs depuis de nombreuses années ».
Les gouvernements peuvent et doivent « investir ». Mais la manière dont ils investissent est très importante.
Les trois candidats à la direction du NPD qui ont assisté au gala Mouseland de la Fondation Douglas Coldwell Layton le 28 octobre ont tous abordé ce sujet.
Rob Ashton a critiqué les employeurs qui reçoivent des aides gouvernementales puis ferment leurs portes.
« Chaque budget prévoit des aides financières pour les employeurs, ce qui est acceptable, à condition qu'elles soient assorties de sanctions. S'ils partent et laissent les Canadien·nes dans l'embarras, ils devront rembourser la totalité des fonds », a-t-il déclaré.
Heather McPherson a déclaré : « En tant que Canadien·nes, nous étions autrefois propriétaires de certaines choses. Vous savez, pendant la pandémie de COVID-19, je me suis constamment rappelé que nous avions autrefois les laboratoires Connaught. Notre pays avait autrefois la capacité de créer des vaccins. Nous possédions autrefois ce dont nous avions besoin pour fabriquer dans ce pays, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. »
Avi Lewis a poursuivi en déclarant : « Il est passionnant d'entendre un consensus émerger autour de la propriété publique. Je pense que c'est une idée populaire en période de défaillance du marché. Et je pense que les libéraux et les conservateurs n'ont qu'une seule idée pour stimuler l'économie : donner l'argent public à des intérêts privés. »
Lewis a ensuite évoqué la campagne du NPD contre les « parasites de l'aide sociale aux entreprises », menée par son grand-père David Lewis dans les années 1970.
Angella MacEwan, économiste principale du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), décrit « Le pouvoir de la propriété publique » dans une vidéo de neuf minutes. Elle souligne l'importance de fabriquer et d'acheter des produits au Canada. Acheter canadien et privilégier la propriété publique est tout à fait logique. Mais la gauche a besoin d'une vision plus large de l'écosocialisme, combinant la propriété publique avec une planification démocratique et des normes environnementales progressistes.
Yves Engler, qui s'est porté candidat à la direction du NPD le 10 novembre, est très critique à l'égard du statu quo.
« Il est remarquable de constater à quel point notre système économique, qui concentre les richesses et détruit l'environnement, a été peu discuté dans les cercles du NPD », ajoutant que « remettre en question le capitalisme est plus important que jamais », a-t-il déclaré dans un éditorial publié sur rabble.ca.
Les économistes, qui s'intéressent à des questions telles que l'innovation et la productivité, analysent rarement la propriété publique sous l'angle environnemental. Une étude universitaire récente a révélé que les entreprises publiques peuvent être « plus innovantes que le secteur privé » et « n'ont pas d'effet négatif significatif en termes d'efficacité opérationnelle et de performance ». Un exemple : la société de télécommunications publique de la Saskatchewan (SaskTel) rivalise avec succès avec les opérateurs privés en louant ses antennes-relais et ses réseaux de fibre optique.
Dans l'ensemble, cependant, le Canada est loin derrière la plupart des pays en matière d'utilisation créative des investissements publics, par exemple en permettant à nos fonctionnaires de diriger des entreprises qui sont en concurrence sur le marché. Une adhésion obstinée au dogme néolibéral (déréglementation, privatisation, libre-échange) contribue à la baisse de notre productivité.
De nombreuses sociétés d'État fédérales prospères ont disparu lors de la vague de privatisations des années 1980 : Air Canada, Petro-Canada, Canadair, de Havilland Canada, Teleglobe, Connaught Labs, etc. Les gouvernements provinciaux ont également vendu des sociétés publiques rentables. La Saskatchewan a privatisé SaskOil and Gas et PotashCorp dans les années 1980. L'Alberta a privatisé les magasins d'alcool en 1993, la Saskatchewan en 2023. L'Ontario procède de manière fragmentaire.
Pour inverser cette tendance, il faut une vision à long terme du contrôle public majoritaire de secteurs clés tels que le logement, l'alimentation, l'exploitation minière, l'énergie, la sylviculture, la pêche et les transports.
Outre le contrôle public majoritaire, une société écosocialiste confierait le pouvoir décisionnel sur les activités économiques aux communautés locales et autochtones. Les projets devraient être écologiquement durables pour bénéficier d'un soutien.
Avec la durabilité écologique comme moteur de la prise de décision, des changements majeurs auraient lieu, en particulier dans les secteurs de l'agriculture et de l'énergie. Par exemple, l'agriculture industrielle serait remplacée par l'agriculture régénérative, les combustibles fossiles et nucléaires seraient progressivement éliminés, les énergies renouvelables seraient développées et des normes strictes en matière d'efficacité énergétique et de conservation seraient mises en place.
Enfin, on ne saurait trop insister sur l'importance des terres publiques. La fin du programme fédéral des pâturages communautaires en 2012 a été une grande perte. Malheureusement, les parcs nationaux urbains semblent progresser lentement. Une société saine doit protéger et préserver des espaces naturels sains, des lieux où toutes les espèces, et pas seulement les humains, peuvent s'épanouir.
La nature est un élément clé de notre identité en tant que Canadien·nes. Nous devrions tous être fièr·es d'être les gardien·nes de nos terres et de nos eaux, en partenariat avec les peuples autochtones qui en prennent soin depuis des temps immémoriaux. La gestion responsable de la nature peut aller de pair avec de solides principes socialistes.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Bloc québécois, Gaza, demi solidaire ?

Dans le fracas d'une guerre qui ravage Gaza depuis plus de deux ans, alors que les bilans humains atteignent des sommets effroyables, la présence du Bloc au sein du groupe interparlementaire Canada Israël laisse une empreinte lourde, bien plus lourde que ce que ses dirigeants semblent vouloir admettre. À force de ménager la chèvre et le chou, le Bloc québécois s'installe dans une zone trouble où le malaise devient plus que palpable.
Il s'agit pourtant d'une évidence. Les chiffres s'accumulent, les ruines s'étendent, les vies palestiniennes disparaissent dans un silence qui glace la conscience. Les organisations internationales parlent de crimes de guerre, plusieurs chercheurs et juristes évoquent un génocide, et les témoignages venus du terrain décrivent un peuple écrasé sous les bombes et la faim. Dans un tel contexte, on peine à comprendre ce qui pousse un parti qui se veut humaniste à demeurer présent dans un groupe interparlementaire dont l'objet même est lié à un gouvernement responsable de cette situation.
La difficulté devient choquante quand on observe l'ampleur de cette participation. Entre 19 et 21 députés bloquistes sur 22 figurent parmi les membres de ce groupe. Presque tout le Bloc. Une telle proportion entretient inévitablement l'impression d'un appui tacite, même si le parti se défend de toute adhésion aux actions de l'État israélien. En politique, les impressions sont parfois plus fortes que les faits, et il est impossible de balayer cette réalité d'un simple revers de main.
Il serait injuste de prétendre que le Bloque soutient les bombardements ou ferme les yeux sur la tragédie palestinienne. Ses déclarations publiques réclament un cessez le feu, dénoncent les violations du droit international et appellent à la création d'un État palestinien. Ces prises de position sont claires et importantes. Pourtant, elles se heurtent à cette contradiction silencieuse mais tenace. Comment concilier une condamnation des crimes commis à Gaza avec une participation active à un groupe parlementaire dédié à des liens d'amitié avec le pays qui en porte la responsabilité. Parmi les députés israéliens qui font partie du groupe, combien font-ils partie de l'actuel gouvernement d'Israël que l'histoire jugera comme génocidaire ?
Cette contradiction nourrit un trouble profond. L'opinion publique la perçoit. Les militants pro palestiniens la dénoncent. Les citoyens qui attendent du Bloc une voix ferme et cohérente en matière de droits humains ne comprennent pas ce double mouvement qui ouvre la porte à toutes les interprétations.
La question se pose alors avec une gravité nouvelle. Que cherche le Bloc québécois en maintenant sa présence dans ce groupe ? Veut-il préserver une image auprès de certaines communautés juives du Canada ? Tente t-il d'éviter les foudres du lobby sioniste bien implanté dans les cercles politiques d'Ottawa ? Ou alors présume t-il que sa position ambigüe reflète celle de l'opinion publique québécois ? Mais surtout, pourquoi autant de députés du Bloc sentent-ils le besoin de faire partie de ce groupe ?
Lorsque j'ai posé la question directement au chef du Bloc, il n'a pas répondu directement. J'ai senti plutôt un malaise, « Je suis hostile tant aux terroristes qu'aux criminels de guerre », une phrase qui rappelle tristement les discours prudents et interchangeables des dirigeants occidentaux qui, depuis deux ans, refusent de prendre la pleine mesure de la catastrophe humanitaire à Gaza. Certains états comme le Canada, continuaient à autoriser les livraisons d'armes à Israël en plein génocide. Cette réponse ne ressemble pas à Yves François Blanchet. Elle manque de souffle, de conviction, de cette netteté morale qui devrait guider tout chef politique face à l'injustice.
C'est dommage. Je fais partie de ces Québécois qui ont vu en lui un dirigeant mûri par l'expérience, capable de finesse politique et surtout de courage. Je crois encore qu'il peut assumer une position forte, claire, sans équivoque. Une position qui ne craint ni les pressions ni les tensions, ni les diatribes que provoque la dénonciation d'un pays allié du Canada. En tant que souverainiste, je m'attends de lui et de son parti plus de courage, de cohérence et un sens de l'histoire.
Le courage politique ne consiste pas à répéter les formules convenues, mais à dire ce que tant redoutent de dire. Les victimes palestiniennes n'attendent pas des nuances diplomatiques. Elles attendent une parole nette. Une solidarité sans détours. Elles attendent de nous un geste de dignité humaine. Elles attendent de nous d'être des souverains déclarés de nos positions en solidarité entière avec les peuples qui aspirent aussi à leur souveraineté. Laissons les demi solidarités aux demis politiciens.
Courage Yves François. Le moment exige plus que des équilibres. Il exige une voix sans aucune ambiguïté. Une voix qui reconnaît la souffrance où elle se trouve et qui refuse de la voir à moitié.
Mohamed Lotfi
12 Décembre 2025
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Nature Québec demande le retrait du projet de loi 5

Nature Québec demande le retrait du projet de loi no 5, Loi visant à accélérer l'octroi des autorisations requises pour la réalisation des projets prioritaires et d'envergure nationale. Selon l'organisation environnementale, la « loi Q-5 » est une atteinte directe aux principes démocratiques du Québec et prive la population québécoise de son droit de participer aux décisions cruciales pour son avenir collectif.
« Ce projet de loi est l'aboutissement d'une année marquée par un recul démocratique inédit au Québec. Il s'ajoute à une liste alarmante de mesures législatives qui fragilisent l'État de droit et qui écartent nos garde-fous de protection de l'environnement et de la population. Il donne des pouvoirs démesurés au ministre des Finances au détriment de nos institutions démocratiques essentielles », affirme Alice-Anne Simard, directrice générale de Nature Québec.
Nature Québec déplore particulièrement que les promoteurs pourront réaliser des travaux préparatoires qui risquent de détruire des milieux naturels avant même de recevoir les autorisations nécessaires. L'organisme s'inquiète aussi de voir le BAPE muselé, alors qu'il ne pourra pas recommander la non-réalisation du projet même si les impacts sociaux et environnementaux sont majeurs pour le milieu d'accueil.
« Ce n'est pas dans la paperasse qu'on coupe, mais dans la protection légale de la population et du territoire québécois. Cette tentative d'accélérer le développement industriel et d'infrastructures risque d'aboutir à des projets mal ficelés, sans acceptabilité sociale, et dont les impacts sur la santé de la population et des écosystèmes ne seront connus que trop tard. Personne n'en sortira gagnant », conclut Mme Simard.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.