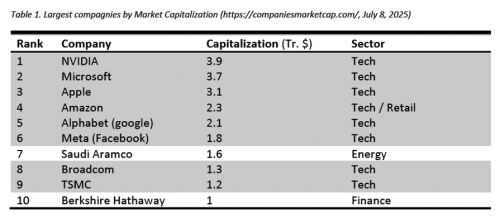Derniers articles

Un an après la chute de Bachar Al-Assad, la Syrie dans l’ombre d’un nouveau pouvoir

Près d'un an après la fuite de Bachar Al-Assad et l'effondrement de son régime, la population syrienne espérait voir naître un État démocratique et apaisé. Mais les violences persistantes, les divisions profondes et l'opacité des nouvelles autorités nourrissent aujourd'hui de sérieux doutes.
Tiré du Journal des alternatives.
« Ce que je vois est accablant… Parfois on perd presque espoir », souffle Hanan Halima, lorsqu'elle dresse le bilan de ces presque 12 mois sans Bachar Al-Assad, avant de se rectifier aussitôt : « Mais aussi, nous ne sommes pas aussi pessimistes. Le problème est peut-être que nous voulons que tout change immédiatement et que le changement arrive à tous les niveaux… »
La pensée de cette activiste des droits humains résume dans les grandes lignes le sentiment de nombreux Syriens. Cette dernière est revenue en Syrie dès la chute du régime, après avoir vécu en exil en Turquie pendant de nombreuses années, et y avoir travaillé dans des organisations de la société civile qui venaient en aide aux Syrien.nes, réfugiés à l'étranger ou restés au pays. Comme la majorité de ces compatriotes, elle a été surprise par la chute du régime de Bachar Al-Assad.
Personne n'aurait imaginé, il y a un an, que Bachar Al-Assad abandonnerait Damas dans la précipitation. L'offensive éclair d'une coalition de groupes rebelles, menée par Hayat Tahrir al-Cham (HTC), a mis fin à plus d'un demi-siècle de pouvoir autoritaire des Al-Assad. Dans les mois qui ont suivi le renversement du régime, une constitution provisoire a été adoptée en instituant un régime présidentiel.
Les postes clés du pouvoir comme la défense, les affaires étrangères et le renseignement ont été attribués majoritairement à des alliés du nouveau président. Ce gouvernement de transition se retrouve face à des défis importants : des destructions massives, des services publics affaiblis, une économie en ruine et des risques sécuritaires importants avec un territoire encore morcelé et des zones instables.
Deux massacres et de nombreuses violences
Dans l'euphorie de décembre 2024, beaucoup rêvaient d'un pays libéré et d'une transition démocratique. Un an plus tard, l'enthousiasme a viré, parfois, à la désillusion. « Chaque jour, il y a quelque chose de nouveau qui se passe qui nous fait nous éloigner du but principal, souligne Nidal Jojak, membre du Mouvement politique des femmes syriennes, qui vit en Finlande. Nous n'avons pas encore atteint notre rêve de construire un état démocratique. » Depuis un an, les violences demeurent endémiques : assassinats, enlèvements, affrontements locaux. Sur la côte, entre 1 400 et 1 700 civils ont été tués en mars. À Soueida, des luttes entre tribus bédouines et milices druzes ont fait près de 1 700 morts cet été.
Depuis Strasbourg, en France, Bassam Alahmad, co-directeur de Syrians for Truth and Justice, parle d'une « année noire ». Ses équipes, souvent contraintes à l'anonymat, documentent violations et abus commis dans les zones contrôlées par les nouvelles autorités. « Il y a eu deux massacres de masse pour cette première année de soi-disant transition », lâche-t-il.
Le politologue syro-suisse Joseph Daher estime que ces massacres sont avant tout des messages politiques qui ont brisé les espaces de dialogues qui s'étaient rouverts dès la chute du régime. « Le confessionnalisme reste un outil. En début d'année, les fonctionnaires de l'État se mobilisaient ; or, les massacres ont servi d'avertissement, mettant fin aux protestations par peur de représailles », observe-t-il.
Déjà plus l'ancien régime, mais pas encore un État démocratique
En octobre dernier, le gouvernement de transition a organisé ce qu'il appelle des élections à travers le pays, mais celles-ci ont suscité de nombreuses critiques en raison de leur organisation sans cadre démocratique, sans sécurité, sans inclusion, et dans un pays encore fracturé. Elles ont été perçues non pas comme une étape vers la transition, mais comme un moyen pour les nouvelles autorités d'asseoir leur pouvoir. « Des élections sont impossibles aujourd'hui, mais un conseil national représentatif de tout le pays serait faisable », tance Bassam Alahmad.
Beaucoup avaient cru à un renouveau social. Nidal Jojak et Hanan Halima déplorent le recul du rôle des femmes, qui avait dû jouer un rôle plus conséquent sous le régime d'Assad en raison des circonscriptions et disparitions forcées, qui ont concerné majoritairement des hommes. « Il est très clair qu'il y a une exclusion des femmes de la sphère politique et des centres de décision… Et quand ils acceptent les femmes, celles-ci sont de leur bord », tranche Nidal Jojak.
Pour nombre d'analystes, les défis à relever — reconstruction, justice transitionnelle, refonte économique — sont immenses. Mais l'essentiel manque encore : des bases nécessaires pour une véritable reprise économique qui bénéficiera à toute la population et pour un futur État démocratique.
Amélie David, correspondante basée à Beyrouth
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les manifestations révèlent les fractures du mouvement anti-corruption philippin

Plus de 140 000 manifestants anti-corruption se sont mobilisés dans plus de 30 villes le 30 novembre — une expansion géographique depuis l'émergence du mouvement en septembre, bien qu'en deçà des 300 000 espérés par les organisateurs. [1] Mais si les manifestants étaient de bonne humeur, chacun comprend désormais que trois courants politiques se disputent ouvertement la direction du mouvement.
Tiré d'Europe solidaire sans frontière.
Participation : géographie élargie, chiffres contestés
Les organisateurs à Manille ont estimé à plus de 50 000 les participants au Monument du People Power sur l'avenue EDSA [2] et à 20 000 ceux du parc Rizal. Plus de 10 000 personnes se sont rassemblées à Cebu. [3] Les manifestations se sont étendues à Iloilo, Bacolod, Tacloban, Cagayan de Oro et — fait significatif — Davao City, fief du clan Duterte. [4]
Même les estimations de la police, qui sous-évaluent systématiquement les foules, montrent une augmentation de 46 % par rapport à septembre : 90 000 le 30 novembre contre 61 605 le 21 septembre. [5] Quand les chiffres officiels eux-mêmes montrent une croissance de la participation, quelque chose doit se passer.
L'attitude de la police elle-même témoigne de la reconnaissance de la puissance croissante du mouvement. Les manifestations de septembre avaient vu 224 arrestations dont 91 mineurs, des actes de torture documentés par Amnesty International, et un mort — Eric Saber, ouvrier du bâtiment abattu par la police. [6] Le 30 novembre, malgré 17 500 policiers déployés, seules trois personnes ont été brièvement interpellées. Le ministre de l'Intérieur Jonvic Remulla a qualifié cela de « meilleur résultat possible ». Un mouvement soutenu par le cardinal David et 86 des 87 diocèses catholiques est plus difficile à brutaliser qu'un mouvement présenté comme une jeunesse radicale.
Le courant de médiation ecclésiastique
Les bonnes nouvelles concernant la participation de l'Église s'arrêtent là. Le discours de 27 minutes du cardinal David lors de la principale manifestation de Manille a rendu explicite la position de la hiérarchie catholique. Il a rejeté la revendication « Resign All » (démission générale), affirmant que les responsables ne démissionneraient « que sous la menace des armes » si l'armée faisait défection. Il a mis en garde contre les conseils de transition et les juntes civilo-militaires : « Nous ne serons jamais tentés de devenir des Talibans », a-t-il déclaré. [7]
Mgr Jose Colin Bagaforo de Caritas Philippines a rapporté que lui-même et le cardinal David avaient été approchés par des groupes cherchant le soutien de l'Église pour une junte.
Les Églises traditionnelles soutiennent l'aile Trillion Peso March Movement du mouvement anti-corruption. Celui-ci a cinq revendications — transparence, recouvrement des avoirs, condamnations, respect de la Constitution et loi anti-dynasties. Ces revendications excluent tout appel à la démission des principaux responsables politiques. [8]
Les tentatives de la hiérarchie ecclésiastique de limiter le mouvement de masse en attendant que l'élite politique du pays fasse le ménage ont consterné de nombreux catholiques ordinaires, y compris des religieuses et des prêtres. [9]
Le courant de la démission
Au parc Rizal, un rassemblement plus radical incluant BAYAN (Bagong Alyansang Makabayan) [10] et la coalition Makabayan s'est réuni sous la bannière « Baha sa Luneta 2.0 ». [11] Là où le courant ecclésiastique considère la démission comme impossible sans intervention militaire, le bloc national-démocratique la considère comme l'exigence minimale : le président Marcos et la vice-présidente Sara Duterte (qui sont des rivaux acharnés) doivent tous deux partir.
Le président de BAYAN, Teddy Casiño, a cadré la journée de protestation autour du « pagpapanagot » (reddition de comptes), avertissant que quiconque viendrait défendre Marcos ou protéger Sara Duterte se sentirait « très mal à l'aise ». [12] Le secrétaire général du Kilusang Manggagawang Pilipino, Jerome Adonis, a été explicite : « Pour les travailleurs, la première étape vers la responsabilisation est d'évincer Marcos Jr. et Sara Duterte de leurs fonctions. »
Le courant de la transformation
En dehors du bloc aligné sur le PCP et de la coalition ecclésiastique, des formations socialistes indépendantes ont avancé l'analyse la plus radicale : le problème n'est pas les individus mais le système politique lui-même.
Sanlakas (Solidarité du travail nationaliste et démocratique), une fédération syndicale et mouvement social distinct du bloc PCP-NDF, a émis une réponse cinglante au cardinal David. Le secrétaire général Aaron Pedrosa a accusé le cardinal d'« alarmisme et désinformation ». Il a exhorté l'Église à « avoir foi dans le peuple », citant des résultats concrets : la pression des manifestations avait déjà contraint à la démission certains des plus corrompus parmi les riches et les puissants [13] — sans intervention militaire. « Il n'a pas fallu une junte militaire pour que le président de la Chambre Romualdez... démissionne. Ce sont les gens inondant les rues qui ont contraint leurs démissions. » [14]
Leody de Guzman [15], s'exprimant au rassemblement MANLABAN près de Malacañang, a souligné que le pays « ne pouvait pas résoudre ses problèmes de gouvernance en mettant le blâme sur une seule anomalie ou un seul responsable ». [16] Le système politique était l'ennemi — exigeant non seulement des démissions mais une rupture structurelle.
Le président du Partido Lakas ng Masa, Sonny Melencio, a qualifié les remarques du cardinal David de « à la fois attristantes et alarmantes ». Il a défendu la proposition de Conseil de transition populaire comme « une proposition démocratique conçue pour garantir des élections propres, authentiques et crédibles qui démantèleront enfin les dynasties politiques », citant le Népal et le Bangladesh comme précédents récents où des mobilisations menées par la jeunesse ont contraint des gouvernements à démissionner et établi des administrations intérimaires. [17] [18]
Ce que signifie la fracture
Le mouvement a démontré qu'il peut se mobiliser séparément à travers trois courants. La question stratégique est de savoir s'il peut converger à la base malgré la prudence et la modération de la hiérarchie de l'Église catholique. [19]
Le porte-parole du TPMM, Kiko Aquino Dee, a annoncé qu'une troisième Trillion Peso March est « définitivement » possible « si le rythme actuel de l'enquête reste hésitant concernant les hauts responsables ». [20] La police a confirmé le 2 décembre qu'elle était « prête à assurer la sécurité d'une autre manifestation majeure ». [21]
L'Église insiste sur le processus constitutionnel ; la gauche exige le départ des dynasties ; le courant socialiste affirme que ni l'un ni l'autre ne suffit sans transformation systémique. Sanlakas rappelle au cardinal David que le gouvernement révolutionnaire de Cory Aquino après 1986 a prouvé « comment l'apparemment impossible a été rendu possible grâce au pouvoir du peuple ». Que cette génération trouve l'unité au-delà du dégoût partagé — ou se fragmente en mobilisations concurrentes que les factions de l'élite peuvent surpasser en manœuvres — voilà désormais la question qui compte.
Mark Johnson
Notes
[1] Sur les origines du mouvement, voir Mark Johnson, « Ni Marcos ni Duterte : l'Église et la gauche face aux dynasties philippines », Europe Solidaire Sans Frontières, 30 novembre 2025. Disponible sur : https://europe-solidaire.org/spip.php?article77169
[2] Le Monument du People Power sur l'avenue EDSA marque le lieu de la révolution de 1986 qui renversa la dictature de Marcos père.
[3] Inquirer, « LIVE UPDATES : November 30 rallies against corruption », 30 novembre 2025. Disponible sur : https://www.inquirer.net/461913/live-updates-november-30-rallies-against-corruption/
[4] Sur le développement des coalitions régionales, voir Mark Johnson, « Philippines. Corruption drowned the Visayas : regional protest movements rise from typhoon wreckage », Europe Solidaire Sans Frontières, 27 novembre 2025. Disponible sur : https://europe-solidaire.org/spip.php?article77148
[5] Philstar, « PNP : 90,000 joined Bonifacio Day anti-corruption rallies nationwide », 1er décembre 2025. Disponible sur : https://www.philstar.com/headlines/2025/12/01/2491140/pnp-90000-joined-nov-30-anti-corruption-rallies-nationwide
[6] Voir Mark Johnson, « Philippine massive anti-corruption protests hijacked by evangelical sect », Europe Solidaire Sans Frontières, 20 novembre 2025. Disponible sur : https://europe-solidaire.org/spip.php?article77071
[7] Rappler, « Why Cardinal David rejects Marcos-Duterte resignation call », 30 novembre 2025. Disponible sur : https://www.rappler.com/philippines/why-cardinal-pablo-virgilio-david-rejects-marcos-duterte-resignation-call/
[8] Philstar, « Third Trillion Peso March eyed amid 'tentative' corruption probes », 1er décembre 2025. Disponible sur : https://www.philstar.com/headlines/2025/12/01/2491131/third-trillion-peso-march-eyed-amid-tentative-corruption-probes
[9] Rappler, « 'Nanlumo ako' : Luneta protesters call out Cardinal David over EDSA speech », 1er décembre 2025. Disponible sur : https://www.rappler.com/philippines/luneta-protesters-reaction-cardinal-ambo-david-edsa-speech/
[10] BAYAN (Nouvelle Alliance patriotique) est la plus grande coalition multi-sectorielle des Philippines, fondée en 1985 et étroitement associée au mouvement national-démocratique.
[11] Sur la distinction entre le mouvement national-démocratique aligné sur le PCP et la gauche socialiste indépendante, voir Nathan Quimpo, « The War Is Over – The Communist Party of the Philippines », Europe Solidaire Sans Frontières, août 2015. Disponible sur : http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article35654
[12] Bulatlat, « Anti-corruption calls draw thousands to Luneta on Bonifacio Day », 30 novembre 2025. Disponible sur : https://www.bulatlat.com/2025/11/30/anti-corruption-calls-draw-thousands-to-luneta-on-bonifacio-day/
[13] Le président de la Chambre Martin Romualdez, l'entrepreneur en fuite Zaldy Co, la secrétaire au Budget Amenah Pangandaman et le secrétaire exécutif Lucas Bersamin.
[14] Déclaration Facebook de Sanlakas, 30 novembre 2025.
[15] Leody de Guzman, connu sous le nom de « Ka Leody », est un dirigeant syndical chevronné qui s'est présenté à l'élection présidentielle de 2022 sur une plateforme socialiste.
[16] Manila Times, « Labor group set to mount Nov 30 rally for sweeping reforms to dismantle 'structural corruption' », 28 novembre 2025. Disponible sur : https://www.manilatimes.net/2025/11/28/news/national/labor-group-set-to-mount-nov-30-rally-for-sweeping-reforms-to-dismantle-structural-corruption/2233001
[17] Business Mirror, « Labor leader calls out David for choice of protest venue », 1er décembre 2025. Disponible sur : https://businessmirror.com.ph/2025/12/01/labor-leader-calls-out-david-for-choice-of-protest-venue/
[18] Voir « Philippines : Socialist party calls for people's transition council to break with post-Marcos order », Europe Solidaire Sans Frontières, novembre 2025. Disponible sur : https://europe-solidaire.org/spip.php?article77039
[19] Sur le schéma historique des mouvements anti-corruption philippins et les conditions pour le briser, voir Walden Bello, « Filipinos' ineffective protest cycle », Europe Solidaire Sans Frontières, octobre 2025. Disponible sur : https://europe-solidaire.org/spip.php?article76488
[20] Philstar, « Third Trillion Peso March eyed amid 'tentative' corruption probes », 1er décembre 2025.
[21] Philstar, « PNP prepared to secure another major protest », 2 décembre 2025. Disponible sur : https://www.philstar.com/headlines/2025/12/02/2491268/pnp-prepared-secure-another-major-protest
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Sur les campus israéliens, l’État désigne un nouvel ennemi intérieur

Alors que les mécanismes de contrôle de l'occupation gagnent la sphère civile, les dissidents juifs se retrouvent dans le collimateur, sans que la liberté académique ne leur offre aucune protection.
Tiré de Agence Média Palestine
2 décembre 2025
Par Yael Berda, le 21 novembre 2025
L'ancien député Otzma Yehudit Almog Cohen et des militants de droite organisent une contre-manifestation tandis que des étudiants et militants palestiniens protestent contre l'opération de l'armée israélienne à Jénine, à l'université de Tel Aviv, le 30 janvier 2023. (Tomer Neuberg/Flash90)
En Israël, en 2025, les frontières entre les sphères de pouvoir du régime tendent à s'estomper. Les mécanismes de domination sur les Palestiniens dans la Cisjordanie occupée et à Gaza – la loi martiale parallèlement au droit civil, le pouvoir sans limite adossé aux institutions officielles – se propagent à l'intérieur du pays et affectent les citoyens palestiniens d'Israël et, de plus en plus, les dissidents juifs israéliens qui refusent de se conformer à la politique de l'État.
Il ne s'agit pas d'un changement soudain, mais plutôt d'un processus cumulatif. Au fil des décennies, le régime d'occupation a développé des technologies de contrôle, de surveillance et de classification pour soumettre les Palestinien·ne·s. Ces technologies se sont progressivement transformées en instruments de gouvernance au sein de la société civile israélienne
Le mécanisme de ciblage des ennemis en est un élément central. Il ne s'agit pas seulement d'une pratique de contrôle militaire, mais d'un outil politique général qui redéfinit les limites de la légitimité. À cet égard, les deux récentes attaques contre la liberté d'expression sur les campus universitaires israéliens ne sont donc pas des exceptions ; elles s'inscrivent dans la continuité logique de schémas établis de longue date.
Le 6 novembre, Alec Yefremov, qui enseigne l'éducation civique dans un lycée de Tel Aviv, a assisté à la cérémonie de remise de diplôme de sa sœur à l'Université hébraïque de Jérusalem. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, était également présent pour célébrer le diplôme de son épouse.
Lorsque Yefremov a aperçu le chef du parti Otzma Yehudit (Force juive), il lui a crié qu'il était raciste, kahaniste et un adorateur de Baruch Goldstein, qui a abattu 29 Palestiniens dans la mosquée d'Ibrahim à Hébron en 1994.
Yefremov a été expulsé de la cérémonie par les agents de sécurité de l'université avant d'être menotté par la police et emmené pour être interrogé pour « insulte à un fonctionnaire » et « trouble à l'ordre public ». Il a été fouillé à nu au poste de police, puis relâché avec une interdiction de 15 jours de se rendre sur le campus universitaire.
L'université hébraïque a publié une déclaration condamnant l'arrestation de Yefremov, et la police israélienne, sous la pression des politiciens de l'opposition, a lancé une enquête internesur l'arrestation et la fouille à nu. (De telles enquêtes n'aboutissent généralement pas.)
Une semaine plus tard, Almog Cohen, vice-ministre au cabinet du Premier ministre israélien, a fait irruption dans une conférence à l'université Ben-Gourion du Néguev, dans la ville méridionale de Beer-Sheva. Fort de son immunité et de son sentiment de propriétaire des lieux, Cohen, accompagné de militants du mouvement d'extrême droite Im Tirtzu qui l'ont filmé et ont mis la vidéo en ligne, est venu perturber une conférence sur l'informatique donnée par Sebastian Ben Daniel, critique régulier de la politique israélienne (et contributeur de longue date à +972 sous le pseudonyme de John Brown).
« Je me suis rendu ce matin à l'université Ben-Gourion en raison des propos antisémites tenus par le professeur Sebastian Ben Daniel, qui a qualifié les soldats héroïques de l'armée israélienne de “meurtriers d'enfants, criminels de guerre et néonazis”, a déclaré Cohen dans un communiqué publié ultérieurement. « Je ne tolérerai pas qu'une personne rémunérée par des fonds publics s'exprime de cette manière alors que bon nombre de ses étudiants, qu'ils soient de droite ou de gauche, sont eux-mêmes réservistes. »
L'université a porté plainte contre Cohen auprès de la police et a déclaré dans un communiqué : « Nos campus doivent rester des lieux sûrs pour les études, l'enseignement, la recherche et l'échange d'idées, [et être] des lieux où les étudiants peuvent apprendre et être éduqués, où les professeurs peuvent enseigner et où les chercheurs peuvent mener leurs recherches sans craindre de violences physiques ou verbales. »
Sans être en rien identiques, ces deux incidents sont l'expression d'un même phénomène. Ils illustrent l'érosion de la frontière entre autorité légitime et pouvoir brut, même à l'intérieur de la Ligne verte, et même à l'encontre des Juifs.
L'autorité mise à nue
Dans un article universitaire que j'ai écrit il y a dix ans, intitulé « On the Objective Enemy and the Political Void » (Sur l'ennemi objectif et le vide politique), j'ai montré comment fonctionne en Israël le mécanisme de dénonciation selon lequel une menace est définie non pas sur la base d'une action ou d'une preuve, mais simplement en la qualifiant comme telle. Une allusion, un mot, une story Instagram, voire parfois le silence suffisent pour classer quelqu'un dans la catégorie des « ennemis », uniquement sur la base d'images, de perceptions et des émotions qu'ils suscitent, sans qu'il soit nécessaire d'apporter des preuves.
C'est depuis longtemps une réalité dans les territoires occupés : les Palestinien·nes sont considéré·es comme naturellement suspect·es, et la loi est élaborée en conséquence. Mais dès lors que le marquage de l'ennemi devient un outil central de gouvernance, il cherche sans cesse de nouvelles cibles.
Ces dernières années, les citoyens palestiniens d'Israël ont été progressivement intégrés à cette définition, faisant l'objet de poursuites judiciaires pour des publications sur les réseaux sociaux, de restrictions à la liberté d'expression et d'interrogatoires policiers pour des déclarations publiques. Aujourd'hui, les opposants juifs au régime, notamment les enseignants critiques et les étudiants politiquement actifs, sont victimes du même mécanisme.
Cette situation peut également être comprise à travers ce que le politologue juif allemand Ernst Fraenkel a appelé le concept d'« État double », une situation dans laquelle l'État fait fonctionner deux systèmes simultanément : un système normatif qui s'exprime à travers les lois, les procédures et les réglementations, et parallèlement à celui-ci, un système de prérogatives, qui agit avec une autorité absolue au nom de la « sécurité », de « l'intérêt national » ou de « l'ordre public ».
L'arrestation de Yefremov et l'interruption de la conférence de Ben Daniel sont des allégories qui illustrent ce mécanisme : si la première est dissimulée sous une façade de légalité et de procédure administrative, la seconde expose la force brute, immédiate et disproportionnée du régime.
Le monde universitaire est censé être protégé par le principe de la liberté de la recherche intellectuelle, qui a déjà été gravement érodé, mais le bras impérieux du pouvoir politique y pénètre sans entrave. Le modèle utilisé depuis longtemps dans les territoires occupés – la loi martiale parallèlement au droit civil, le pouvoir sans limite adossé aux institutions officielles – se propagent à l'intérieur du pays presque sans résistance. Et lorsque les deux systèmes fonctionnent en tandem, la distinction entre « légal » et « permis » s'effondre.
Lorsque le contrôle, la surveillance et la rhétorique de « l'ennemi intérieur » deviennent des outils de gestion civile, il n'y a plus de limite : l'ennemi extérieur d'hier devient l'ennemi intérieur de demain. Une fois cette logique intériorisée par la police, les politiciens et les membres des institutions universitaires eux-mêmes, ce à quoi nous assistons sur les campus n'est pas une « escalade », mais une démonstration directe du fonctionnement du système.
Quand l'ordre est le problème
Les réactions à ces deux incidents s'expriment dans le même langage codé. La déclaration de l'Association des recteurs d'université, qui a condamné l'intrusion de Cohen dans l'amphithéâtre de l'université Ben-Gourion et appelé à préserver la sécurité des espaces d'apprentissage, a pu sembler sévère, mais elle a éludé la question du mécanisme qui produit la violence.
La déclaration invoque la « tolérance zéro pour le désordre », comme si le problème résidait dans un comportement indiscipliné plutôt que dans un régime politique exerçant un pouvoir illimité sur les espaces de connaissance. Elle enjoint le gouvernement à condamner cet acte, comme si ce n'était pas ce même gouvernement qui considérait les enseignants comme des ennemis et permettait l'intrusion du pouvoir exécutif dans la sphère universitaire. Ainsi, la capacité des institutions à fixer des limites est érodée : elles adoptent le langage du régime plutôt que de le remettre en question.
La réponse des anciens présidents d'université et des lauréats du prix Nobel est plus incisive et plus précise, mais elle demeure confinée dans un paradigme libéral qui appelle les institutions affaiblies à se défendre. Elle exprime une profonde préoccupation pour la liberté d'expression et la résilience civique, mais ne reconnaît pas que le système normatif lui-même ne peut plus contenir la portée du pouvoir exécutif. Elle appelle également à un « rétablissement de l'ordre », une demande futile lorsqu'une institution doit se défendre contre une force politique qui détient le mécanisme de désignation des ennemis. L'ordre lui-même est le problème.
Ce qui s'est donc déroulé sur les campus israéliens n'est pas simplement une « atteinte à la liberté académique », mais la mise à nu de ce mécanisme. La police n'a pas dévié de sa ligne de conduite en utilisant une force disproportionnée contre Yefremov ; elle a agi selon un modèle éprouvé depuis longtemps sur les Palestinien·nes. Cohen n'a pas fait irruption dans un amphithéâtre parce qu'il était « incontrôlable » ; il l'a fait parce que le régime israélien lui a fait comprendre que la sphère universitaire n'était plus protégée.
Lorsque le monde universitaire lui-même adopte le langage de l'ordre, de la sécurité et du patriotisme, il ne peut plus articuler une opposition efficace au pouvoir de l'État et cède au contraire son autorité et sa légitimité à l'État. Et il est inutile de demander au régime de cesser de nous considérer comme des ennemis, car un mécanisme qui produit des ennemis a besoin d'eux pour justifier son existence.
La seule réponse possible est politique : ramener au centre les discours sur le pouvoir, le contrôle, la race et le régime ; reconstruire des espaces de connaissance et de communauté indépendants de l'autorisation de l'État ; dénoncer le mécanisme de désignation de l'ennemi ; et former des partenariats judéo-palestiniens qui démantèlent les conditions mêmes nécessaires au fonctionnement de ce mécanisme.
Une version de cet article a été publiée pour la première fois en hébreu sur Local Call, disponible ici.
Yael Berda est professeure agrégée de sociologie et d'anthropologie à l'Université hébraïque et membre de la Middle East Initiative de la Harvard Kennedy School. Elle est l'auteure de Colonial Bureaucracy and Contemporary Citizenship, The Bureaucracy of the Occupation, et Living Emergency : Israel's Permit Regime in the Occupied West Bank.
Traduction : JC pour l'Agence Média Palestine
Source : +972 Magazine
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Légiférer l’apartheid : comment Israël a renforcé les inégalités pendant la guerre à Gaza

Selon un nouveau rapport, les législateurs israéliens ont adopté en deux ans plus de trente lois restreignant les droits des Palestiniens et punissant toute dissidence.
Tiré de Association France Palestine Solidarité
3 décembre 2025
+972 Magazine par Orly Noy
Photo : Les ministres d'extrême droite israéliens Itamar Ben Gvir et Bezalel Smotrich © X
Depuis plus de deux ans, la vie publique israélienne est enveloppée d'un brouillard épais et désorientant. Les crises, les conflits et les inquiétudes se succèdent sans fin, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays : le choc de l'attaque du Hamas du 7 octobre et la campagne génocidaire de représailles menée par Israël contre Gaza, la lutte pour ramener les otages et contre la diffamation de leurs familles par l'État, les confrontations imprudentes avec l'Iran. Tout cela a plongé la société israélienne dans une torpeur collective, occultant la profondeur de l'abîme dans lequel nous sombrons rapidement.
Mais on ne peut pas en dire autant de nos parlementaires. Comme le montre un nouveau rapport inquiétant du centre juridique Adalah, basé à Haïfa, ils ont profité du chaos des deux dernières années pour faire adopter plus de 30 nouvelles lois renforçant l'apartheid et la suprématie juive, qui viennent s'ajouter à la liste existante d'Adalah qui compte désormais plus de 100 lois israéliennes discriminatoires à l'égard des citoyens palestiniens.
L'une des principales conclusions du rapport est une attaque généralisée contre la liberté d'expression, de pensée et de protestation dans un large éventail de domaines. Il s'agit notamment de lois interdisant la publication de contenus qui incluent « la négation des événements du 7 octobre », tels que déterminés par la Knesset, et restreignant la diffusion des médias critiques qui « nuisent à la sécurité de l'État ».
Une autre loi autorise le ministère de l'Éducation à licencier des enseignants et à retirer le financement des établissements d'enseignement sur la base d'opinions qu'il considère comme un soutien ou une incitation à un acte ou à une organisation terroriste. Parallèlement à une campagne menée par l'État pour expulser les militants de la solidarité internationale, une troisième loi interdit aux ressortissants étrangers d'entrer dans le pays s'ils ont tenu des propos critiques à l'égard d'Israël ou ont demandé aux tribunaux internationaux de prendre des mesures contre l'État et ses représentants.
Mais le projet de loi le plus dangereux est peut-être celui qui vise les citoyens qui cherchent simplement à consommer des informations provenant de sources que l'État n'apprécie pas. Un mois seulement après le 7 octobre, la Knesset a adopté une ordonnance temporaire de deux ans – renouvelée la semaine dernière pour deux années supplémentaires – qui interdit la « consommation systématique et continue de publications d'une organisation terroriste », sous peine d'une année d'emprisonnement. En d'autres termes, le législateur criminalise désormais des comportements qui se déroulent entièrement dans l'espace privé d'une personne.
Selon les notes explicatives du projet de loi, la législation repose sur l'affirmation selon laquelle « une exposition intensive aux publications terroristes de certaines organisations peut créer un processus d'endoctrinement — une forme d'« endoctrinement » auto-infligé — qui peut accroître le désir et la motivation de commettre un acte terroriste à un niveau très élevé de préparation ». Mais la loi ne précise pas ce qui constitue une « exposition intensive » ou une « consommation continue », laissant la durée et le seuil totalement indéfinis.
Elle ne précise pas non plus les outils que les autorités peuvent utiliser pour établir qu'un individu a consommé du contenu interdit. Comment, dans la pratique, les fonctionnaires sauront-ils ce que quelqu'un regarde en privé ? Comme le note le rapport Adalah, la localisation des suspects potentiels nécessiterait en soi des opérations d'espionnage, une surveillance de l'ensemble de la population et un contrôle de l'activité sur Internet.
Si les « publications terroristes » interdites ne comprennent actuellement que les documents du Hamas et de l'État islamique – une liste que le ministre de la Justice a déjà exprimé son intention d'élargir –, les législateurs ont également cherché à couper l'accès à d'autres sources d'information qui pourraient, Dieu nous en préserve, exposer les citoyens israéliens à toute l'étendue des crimes contre l'humanité que leur armée a commis et continue de commettre à Gaza. D'où l'adoption de la loi dite « loi Al Jazeera », qui a privé le public israélien de l'une des sources d'information les plus fiables au monde sur les événements à Gaza.
De même, la loi contre la « négation des événements du 7 octobre » non seulement élève les attaques au rang de crime comparable à l'Holocauste, mais va bien au-delà du domaine des actions pour s'étendre à celui de la pensée et de l'expression. Elle ne fait aucune distinction entre, d'une part, les appels directs à la violence ou au terrorisme, qui sont déjà interdits, et, d'autre part, la simple expression d'une position politique, d'un discours critique ou d'un scepticisme à l'égard du récit officiel de l'État.
« La loi est conçue pour cultiver la peur, étouffer le débat public et supprimer toute discussion sur une question d'intérêt public », note Adalah. « On ne sait toujours pas clairement quelles actions constituent l'acte de « déni » que la loi interdit, d'autant plus qu'à ce jour, l'État n'a pas nommé de commission d'enquête officielle sur les attaques du 7 octobre, ni publié [...] un « récit officiel » des événements de cette journée. »
Le rapport d'Adalah donne une bonne indication de la direction que prend Israël. Même si nous semblons déjà avoir atteint le fond du gouffre, il y a toujours un abîme au-delà de l'abîme, un abîme qui invite à de nouvelles atrocités et vers lequel nous nous précipitons à toute vitesse.
Ces lois méprisables n'ont pas fait descendre des centaines de milliers de personnes dans la rue, même parmi ceux qui prétendaient autrefois craindre pour le sort de la « démocratie israélienne ». En fait, certaines de ces lois ont été adoptées avec le soutien des partis d'opposition juifs à la Knesset. L'illusion d'une démocratie réservée aux seuls Juifs n'a jamais semblé aussi grotesque, ni aussi dangereuse.
L'abîme au-delà de l'abîme
Dès les premiers jours de la guerre, le régime israélien a gravement violé les droits fondamentaux à la liberté d'opinion et de manifestation. Le 17 octobre 2023, le commissaire de police de l'époque, Yaakov Shabtai, a annoncé une politique de « tolérance zéro » envers « l'incitation » et les manifestations, et pendant des mois, toute tentative de manifester contre la destruction de Gaza par l'armée israélienne a été réprimée avec une main de fer.
Mais la vague de nouvelles lois draconiennes va encore plus loin. En plus d'établir l'infrastructure juridique nécessaire à la persécution systématique des dissidents, tant juifs que palestiniens, elle comprend des mesures qui visent explicitement les citoyens palestiniens, comme la loi dite « loi sur l'expulsion des familles de terroristes ».
En vertu de cette loi, la définition du terme « terroriste » – une étiquette appliquée presque exclusivement aux Palestiniens en Israël – a été élargie pour inclure non seulement les personnes condamnées pour terrorisme dans le cadre d'une procédure pénale, mais aussi les personnes détenues pour suspicion de telles infractions, y compris celles placées en détention administrative. En d'autres termes, des personnes qui n'ont été ni inculpées, ni condamnées pour quoi que ce soit.
Dans le même temps, la Knesset a renforcé l'interdiction déjà draconienne du « regroupement familial » afin d'empêcher les citoyens palestiniens de se marier avec des Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza, et a alourdi les sanctions contre les Palestiniens qui « séjournent illégalement » en Israël. En effet, les législateurs ont exploité le génocide de Gaza pour intensifier leur guerre démographique de longue date contre les Palestiniens, y compris ceux qui vivent à l'intérieur des frontières de 1948.
Un chapitre distinct du rapport d'Adalah documente les graves violations des droits des prisonniers et détenus palestiniens depuis le 7 octobre, qui, selon des témoignages et d'autres rapports, ont été détenus dans des camps de torture. La même vague législative a également gravement porté atteinte aux droits des enfants, en supprimant « la distinction juridique de longue date entre adultes et mineurs » pour les infractions liées au terrorisme. En outre, le rapport détaille la législation qui porte délibérément préjudice aux citoyens palestiniens en élargissant le recours au service militaire comme critère d'accès aux prestations sociales et aux ressources publiques, et aux réfugiés palestiniens dans les territoires occupés en interdisant les organisations d'aide telles que l'UNRWA.
En tant que personne familière depuis longtemps avec l'argument selon lequel il est utile de « lever le voile » et de dévoiler la véritable nature du régime israélien – antidémocratique, raciste et fondé sur l'apartheid –, je ne trouve aucune raison d'être optimiste à cet égard. Dans la course effrénée des dirigeants israéliens vers le fascisme, non seulement ce sont les plus exposés et les plus vulnérables qui paieront le prix le plus lourd, mais c'est précisément l'écart entre l'image que la société a d'elle-même et la réalité qui rend possible le changement politique. Lorsque cet écart se comble et que la société commence à accepter l'image qui lui renvoie le miroir, l'espace politique pour une transformation significative se réduit considérablement.
Ces dernières années, des centaines de milliers d'Israéliens sont descendus dans la rue pour protester contre la « réforme judiciaire » du gouvernement Netanyahu, affirmant que son véritable objectif était de « détruire la démocratie israélienne ». Pourtant, le mouvement de protestation s'est largement concentré sur les mécanismes procéduraux de la démocratie : les freins et contrepoids, l'indépendance judiciaire, les démêlés judiciaires du Premier ministre et son aptitude à exercer ses fonctions. Trop peu d'attention, voire aucune, a été accordée à l'érosion des fondements substantiels de la démocratie : la liberté d'expression et de manifestation, l'égalité devant la loi et les garanties contre la discrimination institutionnalisée.
Ces tendances ne datent pas des deux dernières années, mais ce n'est pas un hasard si elles se sont accélérées à un rythme effrayant parallèlement au génocide perpétré par Israël à Gaza. La dévastation de la bande de Gaza et la législation fasciste qui progresse à la Knesset fonctionnent comme deux forces coordonnées qui s'efforcent de démanteler les dernières contraintes qui pèsent encore sur le pouvoir israélien.
Et tout comme le mouvement de protestation israélien ne peut ignorer le génocide à Gaza et la question de la suprématie juive s'il espère résister efficacement à la refonte judiciaire, le mouvement mondial qui s'oppose au génocide ne peut ignorer la législation promue par la Knesset la plus extrême de l'histoire d'Israël. Il ne s'agit plus seulement d'une affaire interne à Israël, mais d'une attaque plus large contre l'existence même du peuple palestinien.
Traduction : AFPS
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les entreprises de surveillance basées sur l’IA se bousculent pour obtenir une part du butin de Gaza

La présence de Palantir et Dataminr dans le nouveau complexe militaire américain en Israël donne un aperçu de la manière dont les entreprises technologiques tirent profit du génocide.
Tiré de France Palestine Solidarité. Photo : Pavillon de Palantir au Forum de Davos © Cory Doctorow
Depuis la mi-octobre, quelque 200 militaires américains travaillent dans un vaste entrepôt situé dans le sud d'Israël, à environ 20 kilomètres de la pointe nord de la bande de Gaza. Le Centre de coordination civilo-militaire (CMCC) a été officiellement créé pour faciliter la mise en œuvre du « plan de paix » en 20 points du président Donald Trump, dont les objectifs déclarés sont de « désarmer le Hamas », « reconstruire Gaza » et jeter les bases de « l'autodétermination et de la création d'un État palestinien », qui a reçu la semaine dernière l'aval du Conseil de sécurité des Nations unies.
Cependant, alors qu'aucun organisme palestinien n'a été associé aux discussions sur l'avenir de Gaza, au moins deux sociétés privées américaines de surveillance ont trouvé le moyen de s'immiscer dans les projets d'après-guerre de la Maison Blanche pour la bande de Gaza.
Selon un plan de table consulté par le magazine +972, un « représentant du service Maven Field » était présent au CMCC. Créé par la société technologique américaine Palantir, dont le logo était visible dans les présentations données au sein du Centre, Maven collecte et analyse les données de surveillance provenant des zones de guerre afin d'accélérer les opérations militaires américaines, y compris les frappes aériennes meurtrières. La plateforme aspire des informations provenant de satellites, d'avions espions, de drones, de télécommunications interceptées et d'Internet, et « les regroupe dans une application commune et consultable par les commandants et les groupes de soutien », selon les médias américains spécialisés dans la défense.
L'armée américaine qualifie Maven de « plateforme de combat alimentée par l'IA ». Elle a déjà été déployée pour guider les frappes aériennes américaines à travers le Moyen-Orient, notamment au Yémen, en Syrie et en Irak. Palantir a commercialisé sa technologie en affirmant qu'elle permettait de raccourcir le processus d'identification et de bombardement des cibles militaires, ce que le directeur technique de l'entreprise a récemment décrit comme « l'optimisation de la chaîne de destruction ». Au cours de l'été, Palantir a remporté un contrat de 10 milliards de dollars pour mettre à jour et perfectionner la plateforme Maven pour les forces armées américaines.
Palantir travaille également en étroite collaboration avec l'armée israélienne depuis janvier 2024, date à laquelle les deux parties ont conclu un « partenariat stratégique » pour des « missions liées à la guerre ». L'entreprise a recruté de manière agressive des employés pour son bureau de Tel Aviv, qui a ouvert ses portes en 2015 et s'est considérablement développé au cours des deux dernières années. Justifiant son engagement indéfectible envers Israël malgré les accusations croissantes de crimes de guerre et de génocide, le PDG de Palantir, Alex Karp, a récemment déclaré que son entreprise était la première à être « complètement anti-woke ».
Outre Maven de Palantir, le nom d'une autre société de surveillance basée aux États-Unis est apparu lors de récentes présentations au CMCC : Dataminr. Cette start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle tire parti de ses liens étroits avec des plateformes de réseaux sociaux telles que X (anciennement Twitter) pour permettre aux États et aux entreprises de surveiller les internautes : « Informations en temps réel sur les événements, les menaces et les risques », voilà comment la société vante ses services.
Dataminr a fait ses débuts au milieu des années 2010 en offrant au FBI l'accès à l'ensemble des données des utilisateurs de Twitter afin de surveiller et d'alerter les forces de l'ordre en cas d'« activités criminelles et terroristes ». Bien que vendu comme un outil permettant de surveiller en temps réel les incidents violents dans les grandes villes, l'entreprise offrait aux forces de l'ordre et aux gouvernements la possibilité de surveiller « l'activité numérique passée » de tout utilisateur de réseaux sociaux et de « découvrir l'interconnectivité et les interactions d'un individu avec d'autres personnes sur les réseaux sociaux ». Twitter considérait alors Dataminr comme un « partenaire officiel » et détenait 5 % des parts de l'entreprise. Le fonds de capital-risque de la CIA, In-Q-Tel, a également été l'un des premiers investisseurs.
Au cours de la décennie qui a suivi, Dataminr a travaillé en étroite collaboration avec l'armée américaine et les forces de l'ordre à travers le pays. Au cours du premier mandat de Donald Trump, Dataminr s'est associé aux forces de police locales pour suivre les manifestations du mouvement Black Lives Matter, tandis que sous la présidence de Joe Biden, les marshals américains ont utilisé les services de l'entreprise pour surveiller les militants protestant contre le recul des protections en matière d'avortement. Et en mars dernier, le département de police de Los Angeles a utilisé Dataminr pour surveiller les manifestants appelant à un cessez-le-feu à Gaza et pour signaler les discours pro-palestiniens en ligne.
La présence de Palantir et Dataminr au CMCC suggère que, malgré la vague mention de l'autodétermination palestinienne dans le plan de Trump, le contrôle d'Israël sur Gaza restera profondément ancré, avec des systèmes de surveillance et d'armement basés sur l'IA au cœur de l'architecture de sécurité d'après-guerre.
Pour les Palestiniens sur le terrain, les six premières semaines du soi-disant cessez-le-feu offrent un aperçu de ce qui les attend. Les responsables militaires américains du vaste CMCC surveillent les troupes israéliennes en temps réel. Pourtant, selon le ministère de la Santé de Gaza, les soldats israéliens ont tué plus de 340 Palestiniens depuis l'entrée en vigueur de l'accord le 10 octobre — certains écrasés lors de frappes aériennes et d'autres abattus par les troupes israéliennes pour s'être approchés de la « ligne jaune », le périmètre fluctuant des 58 % de la bande de Gaza encore sous occupation directe israélienne.
« Il n'y a pas beaucoup de différence par rapport à la période précédant le cessez-le-feu », a déclaré Mohammed Saqr, directeur des soins infirmiers à l'hôpital Nasser de Khan Younis, au Guardian en début de semaine. « Malheureusement, les bombardements se poursuivent. »
Régime de surveillance régi par l'IA
Dans le cadre du plan de Trump, les États-Unis superviseront la création d'une force internationale de stabilisation (ISF) composée de soldats provenant de divers pays non identifiés. L'utilisation du système Maven de Palantir et des plateformes de Dataminr fournira aux États-Unis et à l'ISF des capacités comparables à celles des éléments clés de l'arsenal israélien.
Maven reflète les systèmes de ciblage assistés par l'IA sur lesquels Israël s'est appuyé pour guider ses frappes aériennes et ses opérations terrestres à Gaza depuis le début de la guerre. Les outils de collecte de données sur les réseaux sociaux alimentés par l'IA de Dataminr ressemblent aux plateformes déployées par les agences de renseignement israéliennes pour surveiller les internautes palestiniens depuis une dizaine d'années. Et compte tenu de l'histoire des États-Unis en matière de partage et de renforcement des efforts de surveillance israéliens dans les territoires palestiniens, il est peu probable que les données compilées par Palantir et Dataminr restent sous la seule responsabilité de Washington.
En 2013, le lanceur d'alerte américain Edward Snowden a publié une série de documents révélant comment la NSA avait transféré des renseignements bruts aux services de renseignement israéliens, notamment « des transcriptions, des résumés, des télécopies, des télex, des enregistrements vocaux et des métadonnées et contenus du Digital Network Intelligence non évalués et non minimisés » concernant des civils palestiniens. Sous la première administration Trump, les deux agences de renseignement ont opéré « en parfaite synchronisation » à travers le Moyen-Orient, selon le New York Times.
Cette collaboration s'est encore intensifiée depuis le 7 octobre, les États-Unis partageant avec les forces israéliennes une quantité considérable de leurs propres renseignements sur les activités du Hamas à Gaza, notamment « des images prises par des drones, des images satellites, des communications interceptées et des analyses de données [alimentées par l'IA] ». Ces mesures de surveillance intrusives devraient se poursuivre dans le cadre du plan de paix de Trump, car les technologies fabriquées aux États-Unis, telles que Maven, renforceront la capacité des forces soutenues par les États-Unis à mener des opérations de surveillance et de reconnaissance dans toute la bande de Gaza.
Au-delà de faciliter la coopération en matière de renseignement, Palantir et Dataminr pourraient également jouer un rôle dans la coordination sécuritaire entre les États-Unis et Israël à Gaza. En effet, l'une des recommandations clés du plan Trump consiste à transférer massivement les Palestiniens des zones de Gaza contrôlées par le Hamas vers des complexes situés dans les enclaves occupées par Israël, et à collaborer avec les troupes et les agences de renseignement israéliennes pour les gérer.
Selon certaines informations, ces « communautés alternatives sûres » accueilleraient environ 25 000 Gazaouis. Chaque enclave serait entourée de routes de patrouille, de clôtures, de caméras de surveillance et de postes militaires gérés par les ISF, qui coordonneraient avec les forces israéliennes pour déterminer qui entre dans chaque complexe. Une fois admis, les Palestiniens ne devraient pas pouvoir en sortir, selon la proposition des responsables israéliens.
Israël souhaite en outre que l'entrée soit soumise à l'approbation du Shin Bet (l'agence de sécurité intérieure israélienne), et le critère principal sera de savoir si une personne ou ses proches ont des liens avec le Hamas, selon un responsable israélien cité dans The Atlantic. Mais comme le Hamas gouverne Gaza depuis 2007, des centaines de milliers de Palestiniens ont des liens avec l'organisation du fait qu'ils travaillent dans le secteur public, que ce soit dans les domaines de la santé, de l'éducation ou de la police.
Israël s'appuie déjà sur un outil de surveillance assisté par l'IA appelé Lavender pour identifier toutes les personnes connues ou présumées affiliées au Hamas comme cibles d'assassinat, y compris les fonctionnaires tels que les policiers, comme l'a précédemment rapporté le magazine +972. Lavender utilise l'analyse prédictive pour classer les Palestiniens en fonction de leur probabilité d'être liés au Hamas et à d'autres groupes militants, sur la base d'un ensemble de critères opaques. Les nouveaux plans incitent les agences de renseignement israéliennes à continuer d'accumuler ces informations, et les entreprises et plateformes américaines pourraient encore renforcer ces efforts.
Maven et Dataminr permettront aux forces américaines de mener des opérations de surveillance pour le compte des autorités israéliennes, à l'intérieur et à l'extérieur des complexes contrôlés par la communauté internationale. Les produits de ces entreprises permettent de cartographier les liens entre les civils et les groupes militants, de dresser des listes de personnes à arrêter ou à tuer lors d'opérations militaires, et de surveiller les déplacements et les communications des Palestiniens en masse. L'utilisation de technologies similaires par les forces israéliennes au cours des deux dernières années a transformé Gaza en un lieu d'horreur incessante, accentuée par des bombardements aériens sans fin et une surveillance systématique.
Un nouveau type d'occupation
Un point du plan de Trump qui a suscité la colère du gouvernement d'extrême droite israélien est la vague promesse de supprimer progressivement le contrôle militaire israélien sur la bande de Gaza et de faciliter la création d'un État palestinien. Il convient toutefois de considérer cette promesse avec scepticisme, non seulement en raison de l'absence de tout engagement réel en faveur de l'autodétermination palestinienne, mais aussi parce que les plans passés qui visaient ostensiblement à renforcer la souveraineté palestinienne n'ont fait que renforcer la domination d'Israël sur les territoires occupés.
Les accords d'Oslo des années 1990 ont consacré le contrôle israélien sur les infrastructures de télécommunications palestiniennes, garantissant aux services de renseignement israéliens des pouvoirs de surveillance quasi illimités sur la Cisjordanie et Gaza. Le « désengagement » israélien de Gaza en 2005 a permis à l'armée israélienne de maintenir son contrôle grâce à la surveillance aérienne et à une politique d'assassinats ciblés — ce que les responsables de l'armée de l'air appelaient à l'époque une « occupation imposée par les airs ».
Les responsables du CMCC sont en train d'élaborer un nouveau paradigme de contrôle israélien sur Gaza, qui pourrait externaliser cette tâche aux forces militaires américaines et à leurs partenaires du secteur privé. Il s'agit d'une relation mutuellement bénéfique : des entreprises telles que Palantir et Dataminr sont désireuses d'accumuler des données et de perfectionner de nouvelles technologies militaires grâce à des tests en conditions réelles. L'armée israélienne souhaite se décharger du travail d'occupation aérienne et terrestre de ses réservistes, dont les effectifs sont en baisse et en déclin, tout en conservant le contrôle de vastes portions de la bande de Gaza grâce au partage de renseignements et à la coordination en matière de sécurité.
Au cours de la dernière décennie, et certainement depuis le 7 octobre, des entreprises américaines telles que Palantir et Dataminr, ainsi que Microsoft, Google et Amazon, ont saisi l'occasion offerte par la catastrophe de la guerre pour investir et se développer. Le pouvoir incontrôlé d'Israël sur Gaza en a fait l'incubateur idéal pour une industrie de l'IA de plus en plus militarisée. L'ampleur sans précédent des destructions infligées par Israël au cours des deux dernières années dépendait en grande partie de l'approvisionnement régulier en armes et en puissance de calcul provenant des États-Unis et de leurs géants technologiques.
Il est clair que cet esprit d'innovation persiste malgré le cessez-le-feu ; les responsables américains décrivent le CMCC comme une « start-up chaotique ». Pendant ce temps, les intérêts commerciaux de l'industrie technologique militaire — à savoir l'extraction illimitée de données et les expérimentations meurtrières — resteront à jamais gravés dans la réalité politique de la région.
Palantir et Dataminr n'ont pas répondu à nos demandes de commentaires.
Sophia Goodfriend est une anthropologue qui écrit sur la cyberguerre en Israël et en Palestine. Elle est chercheuse sur la violence au Pembroke College de l'université de Cambridge.
Traduction : AFPS

L’amnésie collective d’Israël

Alors même qu'Israël continue de tuer des Gazaouis, ses libéraux sont prêts à oublier le génocide.
Tiré de Agence média Palestine
25 novembre 2025
Par Lee Mordechai
Des enfants palestiniens dans les décombres suite à une frappe israélienne dans la ville de Gaza, le 20 novembre 2025 (photographie Yousef Zaanoun)
LE 13 OCTOBRE, trois jours après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, l'actuel chef de l'opposition israélienne, le libéral centriste Yair Lapid, a prononcé un discours dans lequel il a déclaré que « tous ceux qui ont manifesté contre Israël ces deux dernières années […] ont été trompés ». Devant ses collègues de la Knesset et le président américain Donald Trump en visite, il a déclaré : « Il n'y a pas eu de génocide, ni de famine intentionnelle. » Les faits bien documentés – à savoir qu'Israël a mené une politique de famine implacable, notamment en bloquant totalement l'aide humanitaire à destination de Gaza pendant 11 semaines consécutives – ont ainsi été réécrits en direct à la télévision. Cette révision de la réalité a préparé le terrain pour ce qui allait bientôt se produire : un acte collectif et discret d'oubli, visant à faire disparaître de la mémoire israélienne le massacre des Palestiniens à Gaza.
Alors même qu'Israël continue de tuer des Gazaouis, cette amnésie volontaire a commencé à prendre forme de diverses manières dans la société israélienne libérale, précisément là où l'on pourrait espérer voir un examen honnête de la situation. Les partisans de la brutalité ont été accueillis sans critique. Yair Golan, étoile montante de la gauche sioniste, a invité le général à la retraite Giora Eiland – qui a conçu le tristement célèbre Plan des généraux, proposant d'affamer les Gazaouis qui refuseraient de quitter leurs maisons, et a défendu l'utilité des épidémies pour tuer les Palestiniens – à prendre la parole lors de l'événement organisé par son parti en l'honneur d'Yitzhak Rabin. Pendant ce temps, les institutions et les personnalités publiques ont entrepris de fixer les limites de la mémoire acceptable en rendant inavouables certains récits sur les deux dernières années. Haaretz, le principal journal de gauche israélien, a publié une tribune d'un psychiatre travaillant dans le système de santé publique, rejetant les accusations de génocide portées par les Juifs en Israël et ailleurs comme un « fantasme moral » illusoire, une forme pathologique d'automutilation équivalant à du « masochisme moral ». Cette logique de déni s'est également exprimée dans la vie publique, sous prétexte d'un retour à la normale. À la rentrée universitaire israélienne, les deux principales universités du pays ont publié des messages de joie, soulignant avec soulagement le retour des otages israéliens et réitérant leur soutien aux étudiants qui ont servi comme réservistes dans l'armée, mais sans mentionner les pertes subies par les étudiants palestiniens dont les familles se trouvent à Gaza.
Cette consolidation de l'oubli s'appuie sur l'indifférence généralisée des Israéliens à l'égard des souffrances palestiniennes au cours des deux dernières années. De nombreux libéraux israéliens ont passé ce temps à essayer de détourner le regard des conséquences dévastatrices des actions d'Israël : un sondage réalisé en juin 2025 a révélé que deux tiers des Israéliens, dont 44 % des électeurs de l'opposition, pensaient que les médias israéliens n'avaient pas besoin de couvrir la crise humanitaire à Gaza. (Le sondage a également révélé qu'environ deux tiers des Israéliens, dont 67 % de ceux qui se déclarent centristes et 30 % de ceux qui se déclarent de gauche, pensaient qu'il n'y avait pas d'innocents à Gaza, légitimant ainsi leur ciblage dans la guerre ; d'autres sondages ont montré que 47 % des Israéliens juifs soutiennent le massacre généralisé et intentionnel de civils à Gaza et que 82 % sont favorables au nettoyage ethnique des Gazaouis, 56 % soutenant le même sort pour les citoyens palestiniens d'Israël). En effet, les médias israéliens n'ont jamais accordé beaucoup d'attention à la destruction de Gaza, qui a servi de bruit de fond tandis que d'autres sujets – les nombreux récits du 7 octobre, la crise des otages, l'antisémitisme mondial – ont pris le dessus.
En fin de compte, la tentative libérale israélienne d'oublier ce qu'Israël a fait subir aux Palestiniens de Gaza est une tentative de revenir au statu quo qui régnait depuis la prise de contrôle de Gaza par le Hamas en 2007 jusqu'au 7 octobre. Pendant la grande majorité de cette période, Gaza et sa population sont restés commodément invisibles pour les Israéliens, faisant périodiquement irruption dans l'actualité dans le contexte de brefs mais de plus en plus horribles accès de violence, pour disparaître à nouveau de la conscience israélienne. En ce sens, l'oubli collectif concernant Gaza n'est pas nouveau ; c'est un processus qui dure depuis près de deux décennies. Les deux dernières années de violence continue ont rendu Gaza impossible à ignorer, nécessitant des modes d'oubli plus actifs – et maintenant un effort concerté pour consolider un discours national édulcoré qui disculpe Israël de ses fautes. Mais c'est précisément cette négligence passive et normalisée des droits des Gazaouis, voire de leur existence, qui a conduit à la tragédie du 7 octobre et aux violences qui ont suivi. Dans leur empressement à oublier, les Israéliens sèment les graines de la prochaine catastrophe, les laissant germer à la vue de tous, mais loin de leur esprit.
AU COURS DE LA GUERRE, les institutions étatiques et médiatiques ont mis au point une stratégie efficace pour faciliter l'amnésie collective concernant les atrocités israéliennes en temps réel. Chaque fois qu'un cas de brutalité israélienne suscitait une controverse publique, le même schéma de base se reproduisait : la nouvelle était révélée ; l'État attendait qu'elle disparaisse ; si ce n'était pas le cas, l'État mettait en place un processus de responsabilisation symbolique et totalement insuffisant qui visait tout au plus quelques soldats ; les médias ne donnaient pas suite, ou ne le faisaient qu'après que les Israéliens étaient passés à autre chose, et finalement, l'affaire était classée.
Par exemple, au début de l'année 2025, l'armée israélienne a cédé à la pression internationale et a commencé à enquêter sur six cas de « procédure moustique », dans lesquels les troupes israéliennes traitaient les Palestiniens comme des boucliers humains, les envoyant sans armes, parfois vêtus d'uniformes de l'armée israélienne, dans des tunnels et des bâtiments de la bande de Gaza. Cette pratique était suffisamment régulière pour qu'un officier supérieur la décrive dans une lettre anonyme comme créant une véritable classe d'esclaves. Une poignée de soldats ont été interrogés par la police militaire, les résultats des enquêtes n'ont jamais été publiés, et l'affaire – ainsi que la pratique – ont disparu de l'attention publique. En mars 2025, des soldats israéliens ont tué 15 ambulanciers et secouristes à Rafah ; l'armée a d'abord nié toute implication, puis a tenté de dissimuler ses crimes à l'aide d'une série de mensonges qui ont été démentis dans les semaines et mois suivants. Les médias israéliens se sont abstenus d'enquêter sérieusement sur l'incident, laissant aux médias internationaux le soin de révéler les aspects essentiels de ce qui s'était passé. Personne n'a subi de conséquences significatives : finalement, un commandant a été réprimandé et un seul réserviste a été renvoyé de l'armée, davantage pour ses mensonges lors d'une enquête militaire interne que pour les meurtres eux-mêmes.
Une dynamique similaire s'est produite dans l'affaire notoire de Sde Teiman, où des détenus ont été victimes d'abus physiques et sexuels et où l'infirmerie locale gardait les patients constamment les yeux bandés, en couches et enchaînés à leur lit. Bien que les abus aient été généralisés, seule une poignée de soldats ont été interrogés sur l'un des nombreux cas de mauvais traitements commis dans la base militaire : des abus sexuels filmés et divulgués aux médias l'été dernier. Même cette réponse limitée était tellement contraire aux normes israéliennes que des foules de droite, parmi lesquelles se trouvaient des membres de la Knesset, ont envahi les deux bases militaires où les interrogatoires avaient eu lieu. L'enquête sur l'intrusion dans les bases, dans laquelle les personnes identifiées par la police n'ont pas été interrogées pendant des mois, avance à un rythme glacial, sans qu'aucun procès ne soit en vue. Et près d'un an et demi après les premières révélations, seuls cinq soldats ont été jugés pour les abus commis, dans une affaire qui est toujours en cours. (Un sondage récent révèle que plus de 60 % des Israéliens juifs s'opposent à l'enquête sur les soldats israéliens accusés d'avoir maltraité des détenus ou des prisonniers palestiniens). Toute cette affaire était généralement tombée dans l'oubli en Israël jusqu'à ce qu'il soit révélé fin octobre que c'était le procureur général militaire qui avait divulgué la vidéo incriminante. Même si l'affaire a refait la une des journaux nationaux, l'attention du public s'est concentrée sur les méfaits de cette fonctionnaire et sa spectaculaire chute du pouvoir, certaines publications présentant les soldats comme les victimes de ses actions.
Ces cas de responsabilité insuffisante et d'attention éphémère sont l'exception ; le plus souvent, les auteurs israéliens de violences contre les Palestiniens n'ont fait l'objet d'aucun processus de responsabilisation, leurs crimes n'entrant jamais dans la conscience publique. Je l'ai clairement constaté dans mes propres efforts pour synthétiser les preuves des crimes de guerre israéliens depuis le 7 octobre — en étant confronté à d'innombrables incidents de violence dont la plupart des Israéliens n'ont jamais entendu parler — et à travers le travail de professionnels qui ont systématiquement répertorié ces violences. En août dernier, le principal groupe israélien de défense des droits humains, B'Tselem, a publié un rapport détaillé sur les abus commis contre les Palestiniens dans le système carcéral israélien, intitulé « Welcome to Hell » (Bienvenue en enfer) ; un an plus tard, le groupe a conclu qu'Israël commettait un génocide à Gaza et a publié un autre rapport complet. Aucune de ces informations n'a fait l'objet d'une couverture médiatique significative en Israël. Même dans le journal Haaretz, ces conclusions ont rapidement disparu de la une, permettant aux lecteurs libéraux de traiter ces rapports comme des événements médiatiques passagers plutôt que de les assimiler comme des révélations durables sur Israël et son comportement. Il en résulte une culture omniprésente de permissivité et d'impunité, dans laquelle la souffrance des Palestiniens est presque totalement ignorée.
Cette éthique a même été encouragée par la Cour suprême, l'institution même que les libéraux israéliens sont descendus dans la rue pour défendre, comme l'un des derniers bastions de la démocratie israélienne, dans les mois qui ont précédé le 7 octobre. La Cour s'est abstenue d'examiner les allégations croissantes d'abus généralisés à l'encontre des Palestiniens détenus et d'étudier la possibilité de préjudices généralisés à l'encontre des civils palestiniens à Gaza, a évité de mener des enquêtes sur les milliers de cas où de tels préjudices ont été enregistrés et a permis à l'État de poursuivre sa campagne de famine. Ce manque de contrôle de la part de l'institution chargée de contrôler le pouvoir a contribué à maintenir cette violence hors de la vue du public au fur et à mesure qu'elle se déroulait, ouvrant la voie à l'oubli de ce moment par le public.
Les mécanismes nationaux d'amnésie sont désormais soutenus et encouragés par des mécanismes internationaux. Malgré les violations immédiates et continues de la part d'Israël, le cessez-le-feu a suffi à convaincre trop d'organismes et d'États de passer à autre chose. Presque immédiatement après l'annonce de la trêve, l'Union européenne de radio-télévision a reporté un vote sur la participation d'Israël au concours Eurovision de la chanson, symbole du lien entre Israël et la culture européenne et de son acceptation au sein de celle-ci. L'Allemagne, qui avait déclaré en août qu'elle cesserait de vendre des armes offensives à Israël, a signalé qu'elle lèverait son embargo quelques jours seulement après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, et a récemment mis sa décision à exécution. (Une semaine après le cessez-le-feu, elle avait déjà signé un contrat de deux milliards d'euros pour l'acquisition de missiles Spike israéliens). Et le président français Emmanuel Macron est revenu sur son engagement d'exclure les entreprises israéliennes d'un important salon de l'armement. Si ces efforts visant à tenir Israël responsable continuent de s'effondrer, les Israéliens comprendront que les horreurs des deux dernières années peuvent être oubliées sans risque, une compréhension renforcée par les médias israéliens, qui ont mis l'accent sur ces revirements tout en minimisant l'impact global des interdictions d'armes, rassurant ainsi le public sur le fait que le monde a tourné la page et que tout impact durable sera insignifiant.
Ensemble, ces forces aident Israël à refuser de faire face à la réalité de ses actes et à maintenir ainsi les mythes nationaux fondamentaux que les deux dernières années ont clairement réfutés, comme l'indépendance militaire, économique et diplomatique d'Israël, ou l'idée que l'armée israélienne est « l'armée la plus morale au monde ». Une fois cette violence définitivement oubliée, les Israéliens seront libres de revenir à un mode plus confortable et passif de négligence de la vie palestinienne. Pour les critiques tant nationaux qu'internationaux, il sera extrêmement difficile de briser cette amnésie. Après tout, Israël a laissé perdurer le statu quo d'avant le 7 octobre avec Gaza, car cela lui assurait de nombreux avantages et ne lui coûtait pas grand-chose. Et bien sûr, la tradition israélienne de l'oubli est profondément enracinée, remontant aux origines mêmes d'Israël : Depuis 1948, l'État et la société se sont rigoureusement efforcés d'oublier la violence fondatrice de la Nakba par des moyens allant de l'adoption de lois spécifiques à la destruction physique. Pour obtenir justice pour les Palestiniens – et la sécurité durable que les Israéliens juifs prétendent vouloir – il faudra tenir compte de cette éthique nationale profondément enracinée du déni. Tant que nous ne serons pas enfin prêts à nous souvenir des horreurs que nous avons déjà commises, d'autres suivront certainement.
Lee Mordechai est maître de conférences au département d'histoire de l'université hébraïque.
Traduction : Thierry Tyler Durden
Source : Jewish Currents
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La crise climatique a déraciné 250 millions de personnes en une décennie ; dans le même temps, les États-Unis et d’autres pays pollueurs fermaient leurs frontières

Transcription d'une entrevue de DEMOCRACY NOW !
Tiré de Democracy Now
20 novembre 2025
https://www.democracynow.org/2025/11/20/climate_refugees
Traduction Johan Wallengren
Invités
• Edwin Josué Castellanos López
Vice-ministre des Ressources naturelles et du Changement climatique du Guatemala
• Nikki Reisch
Directrice du programme Climat et Énergie au Center for International Environmental Law (CIEL) — Centre pour le droit international de l'environnement
Notre émission se déroule en direct du sommet COP30 sur le climat à Belém, au Brésil, alors que de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer une protection renforcée des réfugiés et des migrants déplacés de force par les catastrophes climatiques. Les Nations unies estiment qu'environ 250 millions de personnes ont été contraintes d'abandonner leur foyer au cours de la dernière décennie en raison de sécheresses, de tempêtes, d'inondations et de chaleurs extrêmes meurtrières, principalement dans les pays du Sud, où de nombreux groupes de population ont également été forcés de fuir, par vagues, délogés par des conflits armés et des situations d'extrême pauvreté. Dans le même temps, les pays riches du Nord, émetteurs d'une part disproportionnée des gaz à effet de serre qui alimentent le réchauffement climatique, intensifient leur répression contre les migrants et les réfugiés climatiques qui fuient les crises humanitaires en cascade.
« Le problème principal est toujours la pauvreté, le manque d'opportunités — et le changement climatique ne fait fondamentalement qu'exacerber ce problème », a déclaré à Democracy Now ! Edwin Josué Castellanos López, vice-ministre des Ressources naturelles et du Changement climatique du Guatemala.
« Cela n'a rien d'abstrait », renchérit Nikki Reisch, directrice du programme Climat et Énergie du Centre pour le droit international de l'environnement, à propos des migrations induites par le climat. « Il s'agit de vies réelles. Il s'agit de survie. Il s'agit de droits humains et de dignité, et, en fin de compte, de justice. »
Madame Reisch fait également le point sur l'état d'avancement des négociations de la COP30, soulignant que les « points importants » à l'ordre du jour sont le financement de la transition et de l'adaptation, l'abandon graduel des combustibles fossiles et la préservation des forêts. « Les grands pollueurs doivent obtempérer et passer à la caisse », martèle Mme Reisch.
Transcription
Résultat d'une transcription rapide, ce texte peut ne pas être dans sa forme définitive.
NERMEEN SHAIKH : Nous commençons l'émission d'aujourd'hui alors que de plus en plus de voix s'élèvent aux Nations unies pour réclamer une protection renforcée des réfugiés et des migrants déplacés de force par les catastrophes climatiques. Dans un nouveau rapport, le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés estime qu'environ 250 millions de personnes, principalement dans les pays du Sud, ont été forcées, au cours de la dernière décennie, de fuir des sécheresses, des tempêtes, des inondations et des chaleurs extrêmes meurtrières, ce qui représente en moyenne plus de 67 000 personnes par jour ! Des conflits armés et des situations d'extrême pauvreté ont également provoqué un exode après l'autre. Selon les experts de l'ONU, trois personnes déracinées sur quatre vivent désormais dans des pays où les communautés humaines sont vulnérables, étant, je cite, « exposées à un degré élevé à extrême aux dangers liés au climat ». Dans des pays comme le Tchad, les camps de réfugiés risquent de devenir inhabitables d'ici 2050 en raison des conditions météorologiques de plus en plus extrêmes, selon l'ONU.
Dans le même temps, les pays riches du Nord, émetteurs d'une part disproportionnée de gaz à effet de serre qui alimentent le réchauffement climatique, intensifient leur répression contre les migrants et les réfugiés climatiques qui fuient les crises humanitaires en cascade. À la frontière entre les États-Unis et le Mexique, bon nombre de ces migrants viennent de régions dévastées par la crise climatique et les industries destructrices déployées par des puissances étrangères, telles que l'exploitation minière notamment.
AMY GOODMAN : Mercredi, Democracy Now ! s'est entretenu avec Edwin Josué Castellanos López, vice-ministre des Ressources naturelles et du Changement climatique du Guatemala, au sujet du rôle que peut jouer son pays pour garantir que les États-Unis respectent les droits humains des communautés migrantes.
EDWIN JOSUÉ CASTELLANOS LÓPEZ : La situation est définitivement très complexe, et nous essayons simplement de travailler autant que possible avec le gouvernement américain pour nous assurer qu'il traite nos citoyens de la meilleure façon possible. C'est difficile, parce que, bien évidemment, ils tiennent à s'assurer que plus personne ne se rende aux États-Unis. Mais nous devons trouver une solution intermédiaire. Nous devons nous assurer que notre population dispose des opportunités dont elle a besoin. Beaucoup, beaucoup de ces migrants sont probablement des victimes de la crise climatique. Mais, bien sûr, le problème principal reste la pauvreté, le manque d'opportunités — et le changement climatique n'a fondamentalement fait qu'exacerber ce problème.
AMY GOODMAN : C'était le vice-ministre des Ressources naturelles et du Changement climatique du Guatemala, qui s'adressait à María Inés Taracena, de Democracy Now !
Pour continuer la discussion, Nikki Reisch, directrice du programme Climat et Énergie au Centre pour le droit international de l'environnement, se joint à nous.
Nous voulons aborder le sort des réfugiés climatiques de partout dans le monde. Mais tout d'abord, vous êtes une figure de proue de ces négociations et vous comprenez bien ce qui se passe. Pouvez-vous nous expliquer quels sont les points d'achoppement à ce stade ? Que Lula, le président du pays, revienne aussi précocement au sommet sur le climat n'est pas ordinaire. Sur quoi portent les négociations ? Et qu'est-ce qui les empêche d'avancer ? Que certains pays soulèvent la question des personnes transgenres lors d'un sommet sur le climat a de quoi choquer. Quel est le rapport avec le changement climatique ? Faites-nous voir un topo général.
NIKKI REISCH : Oui, pas de problème. Merci beaucoup de m'avoir invitée, et merci d'une manière générale pour votre engagement en faveur du journalisme indépendant, qui a une importance si critique en ce moment.
Je dirais qu'au cours des dernières 24 heures, nous avons assisté à une intensification des négociations entre les États, en grande partie à huis clos, autour des questions qui comptent vraiment énormément ici — et qui comptent sans doute énormément à chaque COP : les questions des finances, des combustibles fossiles et des forêts. Cela veut dire qu'on parle des facteurs qui produisent la crise climatique et des ressources et des finances nécessaires non seulement pour atténuer ces facteurs, mais aussi pour répondre aux besoins d'adaptation en vue d'aider les communautés qui souffrent de manière disproportionnée de cette crise et offrir des réparations pour les pertes et les dommages subis.
Donc, ces questions sont au centre des négociations et suscitent de vifs débats, car ce qui se transige ici, c'est tout un programme pour assurer une certaine justice. Une transition juste ne peut pas avancer sans un financement de source publique adéquat, sans créer de nouvelles dettes pour les pays qui sont vraiment en première ligne face à cette crise. Alors, il s'agit que les grands pollueurs s'exécutent et sortent leur portefeuille. Voilà le genre de questions qui sont au centre des débats actuels.
AMY GOODMAN : Et le fait qu'on soulève la question de savoir ce qui fait qu'on est homme ou femme lors d'un sommet sur le climat, est-ce simplement pour semer la confusion et empêcher l'adoption d'une résolution finale ?
NIKKI REISCH : Nous avons assisté à un interminable déluge de tactiques procédurales utilisées par certains pays pour faire dérailler les négociations et éviter de fermer les vannes des combustibles fossiles, afin de soustraire les grands pollueurs — et les plus grands producteurs de combustibles fossiles — à leurs responsabilités dans cette crise. Et nous assistons à un piégeage des questions débattues, à des attaques contre les droits humains portant notamment atteinte à la notion même de genre, au rejet d'arguments invoquant le droit et les obligations juridiques, qui sont autant de tendances vraiment choquantes mais faisant partie intégrante d'une orientation générale régressive au plan mondial qui s'écarte de la dignité fondamentale et du respect des droits humains des communautés du monde entier, et notamment des peuples autochtones, qui ont vraiment pris leur place à cette COP en Amazonie.
NERMEEN SHAIKH : Eh bien, Nikki, comme vous l'avez mentionné, l'une des questions clés ici, comme d'ailleurs à chaque COP, est celle des combustibles fossiles. Et à l'heure actuelle, plus de 80 pays font pression pour élaborer une feuille de route en vue d'aboutir à l'élimination des combustibles fossiles. Parmi ces pays figurent l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Suède, l'Irlande et le Kenya. Bien sûr, l'Arabie saoudite et la Russie se sont année après année opposées avec constance à l'élaboration d'une telle feuille de route, et les États-Unis manquent tout simplement à l'appel. Pourriez-vous nous donner votre avis sur l'absence des États-Unis et sur la signification de cette initiative de plus de 80 pays ?
NIKKI REISCH : Bien sûr. Eh bien, je pense que le fait que 80 pays joignent leurs voix pour clamer la nécessité d'une feuille de route conçue pour s'éloigner des énergies fossiles montre que les données scientifiques et les principes du droit sont convaincants et que la pression politique et le mouvement pour la justice climatique sont efficaces. Cette question est au centre des préoccupations et il est indéniable que nous ne saurions résoudre la crise climatique sans mettre fin à l'ère des énergies fossiles, sans nous attaquer aux causes profondes de cette crise.
Nous voyons donc des pays prendre position verbalement, mais nous devons aller au-delà des déclarations politiques. Et c'est pourquoi il est si important qu'il y ait des pays comme la Colombie, un pays producteur de combustibles fossiles du Sud, qui montre la voie en s'engageant à accueillir la première conférence internationale sur la mise au rancart des combustibles fossiles, en dehors de ces salles, précisément parce que nous constatons un obstructionnisme procédural continu de la part des pays qui ont un intérêt direct à maintenir le statu quo actuel et notre dépendance par rapport aux combustibles fossiles. Nous les avons vus mettre en œuvre tous les moyens procéduraux possibles pour faire réellement dérailler les négociations ici, comme vous l'avez dit.
AMY GOODMAN : Et, bien sûr, c'est le Brésil. Cela se passe au Brésil, un autre pays riche en pétrole. C'est quand même remarquable et puis il y a ce que le président, Lula — Lula et Petro sont tous deux la cible du président Trump — ce que Lula est prêt à prendre comme engagements, ce qu'il est prêt à faire et à ne pas faire…
NIKKI REISCH : C'est un excellent point, car nous avons vu, quelques semaines seulement avant l'ouverture de cette COP, que de nouvelles licences pour l'exploitation pétrolière et gazière offshore avaient été approuvées à l'embouchure de l'Amazone, juste au large des côtes. Alors, on relève ici des contradictions. Si nous ne veillons pas à arrêter l'extraction de pétrole et de gaz, comment pouvons-nous lutter contre cette crise ? Mais nous voyons des pays comme la Colombie, entre autres, prendre le mors aux dents et s'engager, au-delà des simples déclarations, à vraiment agir et mettre en œuvre des solutions concrètes et en branle un train de mesures visant à atteindre l'objectif de 1,5 °C, le tout dans un souci d'équité, en commençant par stopper l'expansion des énergies fossiles puis en traçant la voie pour mobiliser les ressources nécessaires en vue de permettre au reste du monde de suivre le mouvement.
NERMEEN SHAIKH : J'en viens à la question cruciale, que je vois comme ceci : quand des pays aussi puissants et, en fait, les plus grands émetteurs historiques, comme les États-Unis...
NIKKI REISCH : Exactement.
NERMEEN SHAIKH : ... sont absents, sans compter le plus grand exportateur de pétrole au monde, l'Arabie saoudite, et le plus grand émetteur actuel, la Chine...
NIKKI REISCH : Oui.
NERMEEN SHAIKH : ... si ces pays ne sont pas disposés à s'engager et à accepter les conditions de négociation d'une feuille de route, qui n'est même pas un document final...
NIKKI REISCH : En effet.
NERMEEN SHAIKH : … une feuille de route pour mettre fin à l'exploitation des combustibles fossiles, qu'est-ce qui peut motiver les autres pays à signer ?
NIKKI REISCH : Eh bien, ces pays ont une bonne raison de souscrire au projet et c'est que la fossilisation ne constitue pas une voie d'avenir. Ils le savent… par exemple, la Colombie, qui est pourtant un pays producteur de combustibles fossiles, reconnaît que ses propres intérêts économiques, et ceux de sa population… ne résident pas dans les combustibles fossiles. Partant, ces acteurs ont des possibilités de contourner le problème et de se mettre à l'écart du processus par lequel toujours les mêmes pays obstructionnistes bloquent les progrès, décennie après décennie. Alors, c'est dans cet esprit qu'ils organisent une conférence et soutiennent avec ardeur des initiatives telles que le Traité de non-prolifération des combustibles fossiles, un traité sur les combustibles fossiles qui pourrait en fait rassembler une coalition de pays volontaires et lancer et développer une dynamique à partir de cette plateforme, car la transition effective vers l'abandon des combustibles fossiles et le fait de reprendre la main sont dans l'intérêt de ces pays et de leurs populations. C'est en fait une évolution positive.
AMY GOODMAN : Venons-en aux réfugiés climatiques. C'est votre domaine de spécialité. Parlez-nous de la crise mondiale actuelle, des centaines de millions de personnes qui fuient leur pays en raison de catastrophes liées au climat, et des pays vers lesquels elles fuient – qui ont une bien plus grande part de responsabilité dans le changement climatique, mais qui ferment leurs écoutilles.
NIKKI REISCH : Oui, bon, je pense que les statistiques sur le nombre de personnes déplacées par des catastrophes climatiques sont l'un des rappels les plus visibles et les plus viscéraux de la réalité et de la gravité de la crise climatique, et que ce dont il s'agit… ce n'est pas une question abstraite. Il s'agit de vies réelles. Il s'agit de survie. Il s'agit de droits humains et de dignité, et, au bout du compte, de justice.
Ce qui nous renvoie à deux réalités : d'entrée de jeu, nous ne pouvons pas lutter contre le changement climatique sans nous attaquer à ses causes profondes, et nous devons absolument fournir un financement aux pays qui souffrent de manière disproportionnée des effets du changement climatique sans y avoir contribué. Aussi les pays développés doivent-ils passer à la caisse, fournir des fonds d'adaptation à ces pays et aider les communautés à renforcer leur résilience et à rester chez elles, et le jour où il y aura lieu de migrer en raison d'inondations, de sécheresses, de conditions météorologiques extrêmes ou de vagues de chaleur, ces gens devront être accueillis avec dignité et leurs droits humains devront être respectés. C'est absolument critique, et la loi l'exige. La Cour internationale de justice, la plus haute juridiction au monde, l'a établi. Le principe de non-refoulement a force de loi et doit s'appliquer. Cela signifie que les pays ne peuvent pas renvoyer des personnes dans des endroits où elles courraient un grave danger, ce qui vaut notamment pour les risques liés aux effets néfastes du changement climatique.
Ce qui nous renvoie à la constatation que la voie militaire n'est pas une option. Nous savons que les impacts du changement climatique peuvent exacerber les difficultés et problèmes engendrés par les conflits et autres crises violentes. Alors, au lieu de mobiliser des troupes, nous devons renforcer le respect des droits et diriger des fonds vers les pays qui en ont besoin pour pouvoir renforcer leur résilience et les armer pour résister aux effets du changement climatique où qu'ils soient dans le monde.
NERMEEN SHAIKH : Et en fait, ce rapport ne parle que des réfugiés – n'est-ce pas le cas ? – et non des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, qui sont, j'imagine, plus nombreuses.
NIKKI REISCH : Oui, d'après ce que je sais, la plupart de ces migrants climatiques sont en fait des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, et donc les conséquences... c'est à bien des égards un mythe de dire que les conséquences touchent avant tout les pays développés, car en réalité, la majeure partie de ces mouvements migratoires se produisent à l'intérieur des pays et entre les pays en développement qui doivent déjà faire face à de nombreuses difficultés, comme l'existence de conflits et la rareté de ressources. Nous devons donc renforcer nos engagements à soutenir ceux dont le nombre ne fera qu'augmenter à mesure que la crise climatique s'aggravera, à moins que des mesures concrètes ne soient prises pour s'attaquer aux causes profondes, à savoir les combustibles fossiles et la déforestation. Nous devons nous éloigner des combustibles fossiles, cesser d'abattre des arbres et prendre des engagements financiers concrets pour lutter contre les problèmes à la source. Sinon, nous ne ferons qu'assister à davantage de dévastation et de dégâts.
NERMEEN SHAIKH : Alors, Nikki, avant de conclure, juste un autre sujet : la décision historique prise en juillet par la Cour internationale de justice sur la nature des obligations des États en vertu du droit international en matière de changement climatique.
NIKKI REISCH : Cette COP est la première depuis cette décision historique, selon vos propres mots, puisqu'elle a été prise par la plus haute juridiction mondiale compétente en matière d'obligations climatiques des pays, une décision définitive qui rend caduc tout argument selon lequel les plus grands pollueurs n'auraient pas d'obligation juridique. L'action climatique n'est pas une opinion. C'est une obligation juridique pour les pays, qui ont le devoir — qui découle de multiples sources du droit (non seulement les dispositions des conventions sur le climat, mais aussi le droit coutumier, les principes des droits de l'homme…) — de prévenir les dommages climatiques et d'intensifier les mesures visant à protéger les droits de l'homme face aux impacts climatiques, et les progrès dans ce domaine doivent être jugés à l'aune de l'obligation ainsi fondée, et non de ce qui a été promis l'année dernière ou l'année précédente. Leurs efforts seront évalués selon l'étalon de leurs obligations juridiques. Et nous voyons cela prendre forme, se concrétiser : un nouveau cadre de discussion a été établi. Il est grand temps de combler le déficit de responsabilité. Revoir les ambitions à la hausse pour se conformer à cette norme fermement établie ne consiste pas seulement à annoncer des promesses et des engagements plus ambitieux, mais à prendre des mesures concrètes de manière à respecter le droit et à se conformer à la science.
AMY GOODMAN : Nikki Reisch est directrice du programme Climat et Énergie au Centre pour le droit international de l'environnement. Merci beaucoup, Nikki, de vous être jointe à nous.
NIKKI REISCH : Merci beaucoup.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Pourquoi l’eau est devenue un enjeu de pouvoir et de sécurité en Afrique

L'eau est souvent considérée comme allant de soi, lorsque l'on a la chance de la voir couler au robinet. Pourtant, elle est au cœur de la sécurité nationale. Contrôler l'eau signifie contrôler une ressource essentielle qui permet à l'économie de fonctionner et de rester stable. L'eau soutient l'emploi, les entreprises et les moyens de subsistance. Lorsqu'elle est bien gérée, l'économie des pays est plus forte et plus sûre.
Photo et article tirées de NPA 29 2 décembre 2025
Je suis un universitaire spécialisé dans l'étude des fleuves transfrontaliers et les questions de sécurité nationale. Ce domaine de recherche étudie le conflit entre le concept juridique d'égalité souveraine (selon lequel tous les pays sont égaux en droit international) et les droits associés aux cours d'eau et aux délimitations frontalières.
Les conflits autour des fleuves, du Chobe et de l'Orange en Afrique australe au Nil dans le nord, montrent que l'accès à l'eau et le contrôle des sources d'eau peuvent déterminer la stabilité sociale, les migrations, les investissements et même les relations internationales.
Comment les changements fluviaux créent des conflits frontaliers
Un bon exemple est celui de la petite île située sur le fleuve Chobe, entre le Botswana et la Namibie. Cette île est appelée Kasikili au Botswana et Sedudu en Namibie. La question de la propriété de l'île est devenue importante après l'indépendance de la Namibie, qui a porté l'affaire devant la Cour internationale de justice en 1996, affirmant que l'île était son territoire depuis toujours.
La Cour a statué contre la Namibie, invoquant la norme internationale qui reconnaît le thalweg du fleuve comme véritable frontière.
Le thalweg est la partie la plus profonde du lit d'un fleuve. Mais dans les cours d'eau qui évoluent rapidement, ce point le plus profond peut se déplacer au fil du temps, parfois après une seule grande crue. Dans ce cas, l'île se trouvait du côté botswanais du thalweg et appartenait donc au Botswana.
Cette délimitation juridique peut être très contestée, en particulier lorsqu'il s'agit de déterminer quel pays a accès aux ressources minérales des fleuves et de la mer (la délimitation des frontières s'étend jusqu'aux océans au niveau des estuaires).
Un autre exemple est le fleuve Orange, long de 2 200 kilomètres, et plus grand fleuve d'Afrique du Sud. Il traverse quatre pays – le Lesotho, l'Afrique du Sud, le Botswana et la Namibie – et en 1890, la frontière entre la Namibie et l'Afrique du Sud a été définie comme suivant la rive namibienne du fleuve (la ligne des hautes eaux) plutôt que le thalweg (ligne médiane).
La raison pour laquelle cette délimitation frontalière particulière ignore la norme juridique internationale consistant à utiliser le thalweg remonte à l'époque coloniale. À cette époque, des hostilités existaient entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Les autorités britanniques de la colonie du Cap estimaient qu'il était possible d'empêcher l'installation permanente des Allemands en refusant à l'Afrique du Sud-Ouest allemande l'accès à l'approvisionnement fiable en eau du fleuve Orange.
Cette décision était motivée par la sécurité nationale et la perception d'une menace. Dans mes recherches, j'ai souvent observé ce type de situation.
Comment les frontières hydrauliques affectent la sécurité d'un pays
Le contrôle de l'eau est source de sécurité, qui peut prendre de nombreuses formes. Le contrôle des eaux de crue permet de se prémunir contre les inondations et les noyades. La lutte contre les inondations implique généralement la construction d'un ou plusieurs barrages afin de réduire l'ampleur des crues les plus importantes.
Contrôler l'eau stockée dans les barrages signifie que pendant les périodes de sécheresse, la société disposera toujours d'un approvisionnement en eau et pourra continuer à fonctionner normalement. Le contrôle de l'eau génère donc une sécurité qui permet à la société de prospérer.
C'est également une question très controversée, comme on le voit dans le cas du fleuve Nil. Long de 6 650 km, c'est l'un des plus longs fleuves du monde, qui draine 10 % de l'ensemble du continent africain. Onze États riverains – Burundi, République démocratique du Congo, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Rwanda, Soudan du Sud, Soudan, Tanzanie et Ouganda – se partagent le Nil. Le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne est le dernier en date des nombreux points de discorde.
L'Égypte revendique des droits souverains sur le Nil. Mais cela entre en conflit avec les droits souverains de l'Éthiopie, qui a construit le barrage. L'Égypte a accusé l'Éthiopie d'avoir accaparécette ressource. La question est complexe sur le plan juridique et délicate sur le plan politique.
L'eau peut également renforcer la sécurité d'un pays, d'une ville ou d'une village. En 2018, Le Cap, en Afrique du Sud, a frôlé une crise du Day Zero (Jour Zéro) qui a fait la une des journaux internationaux. La ville faisait face à la perspective de se retrouver littéralement à court d'eau. Cela s'est produit parce que l'eau de plusieurs cours d'eaux locaux avait été détournée grâce à des transferts entre bassins versants. Ce qui, combiné à la sécheresse, a rendu la ville vulnérable.
Aujourd'hui, la ville a adopté une stratégie durable qui repose sur deux piliers : le recyclage des eaux usées et le développement d'unités de dessalement de l'eau de mer à l'échelle industrielle.
La sécurité nationale dépend de la sécurité de l'approvisionnement en eau
Les êtres humains sont des migrants par nature, ils se déplaceront donc naturellement des zones peu sûres vers des zones plus sûres. Les migrants apportent avec eux du capital : des compétences humaines et des ressources financières.
La gestion de l'eau doit être basée sur les flux naturels des populations. Les mouvements internes de population en Afrique du Sud étaient autrefois contrôlés par une politique appelée « contrôle des flux migratoires ». Cette politique, considérée comme une violation des droits humains, a été rejetée. Elle était au cœur de la lutte armée pour la libération.
Au cours des quarante dernières années, la population a presque triplé, entraînant une migration incontrôlée des zones rurales vers les villes. Ces migrations ont submergé les infrastructures. L'approvisionnement en eau et l'assainissement n'ont pas suivi le rythme, créant une nouvelle forme de crise de sécurité nationale.
Des capitaux sont nécessaires pour créer des emplois et assurer la stabilité sociale d'une population marquée par les migrations. Mais les investisseurs sont de moins en moins disposés à s'implanter dans des régions submergées par des migrations qui dépassent les capacités des services d'approvisionnement en eau et d'assainissement.
Nous pouvons ainsi constater que la sécurité nationale dépend de la sécurité de l'approvisionnement en eau, car la stabilité sociale et le bien-être économique sont directement liés aux flux de personnes possédant des compétences et des capitaux. Il est essentiel de considérer l'eau comme un risque pour la sécurité nationale afin de mettre en place les réformes politiques nécessaires pour créer les conditions propices à l'épanouissement des êtres humains. Les capitaux affluent toujours vers les endroits où les gens peuvent s'épanouir. La politique de l'eau soit s'aligner sur cette simple réalité.
The Conversation
2 décembre 2025 Anthony Turton
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

COP30 : la question de l’écocide

Les résultats de la COP30 amènent un haut fonctionnaire des Nations unies à se demander s'ils pourraient être considérés comme un écocide, même un crime contre l'humanité, si des actions plus fortes ne sont pas rapidement prises.
Volker Türk, haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, a commenté les faibles résultats de la 30e conférence des Nations unies sur le climat à Belem au Brésil (COP30). Cet accord a minima dans une situation d'urgence climatique illustrerait, selon lui, les déséquilibres existant entre l'industrie des combustibles fossiles qui génère des profits colossaux et des certaines de communautés et pays victimes de préjudices causés par le dérèglement climatique.
Il n'est pas le seul à se questionner sur la situation climatique de la planète. Cette année, des travaux scientifiques sur les risques systémiques soulignaient une aggravation des tendances. Le Stockholm Resilience Centre affirme que sept des neuf limites planétaires seraient déjà franchies, ce qui accroîtrait les risques d'effondrement de la biodiversité, d'instabilité climatique et de perturbations hydriques.
L'année dernière, le Rapport Planète Vivante du WWF exposait un déclin de 73 % des populations d'animaux sauvages depuis 1970. L'équipe internationale de climatologues, sous la direction du Global Carbon Project, publiait dans la revue scientifique Environmental Research Letters, le 3 septembre 2024, que la concentration dans l'atmosphère de méthane (CH4) à l'origine d'un tiers du réchauffement climatique global augmenterait plus rapidement que tout autre gaz à effet de serre majeur. Il n'y a jamais eu autant de méthane dans l'atmosphère, affirme-t-il. Ceci menacerait gravement l'habitabilité de la planète.
Le dérèglement climatique a aussi été souligné à l'occasion de la COP28 en décembre 2023 par le Global Systems Institute de l'université d'Exeter au Royaume-Uni dans son rapport Global Tipping Points. Il identifie 25 points de bascule dans le système terrestre dont 16 sont dans la biosphère telle la disparition du corail, six dans la cryosphère telle la fonte des calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique, et quatre dans les circulations atmosphériques et océaniques comme l'Amoc et les moussons ouest-africaines. La co-auteure de ce rapport, Sonia Kéfi, affirmait à ce sujet que nous sommes au seuil de points de bascule en cascade du système Terre. Pour ce groupe de scientifiques internationaux, le changement climatique constitue désormais une menace existentielle directe pour la vie sur terre.
Qu'est-ce qu'un écocide ?
Est considéré comme un écocide l'endommagement irrémédiable ou la destruction d'un écosystème par un processus qui entraîne sa surexploitation, intentionnelle ou non. De nombreux événements passés ont été considérés par plusieurs organismes comme des écocides. L'utilisation de l'agent orange pendant la guerre du Vietnam, l'explosion d'un réacteur atomique à Tchernobyl, la déforestation en Amazonie et en Indonésie, l'invasion de l'Ukraine par la Russie et dernièrement la guerre à Gaza.
Le concept de crime d'écocide est débattu depuis 1947 au sein de la Commission du droit international pour l'inclure dans le Code des crimes contre la paix et la sécurité de l'Humanité. Dans les années 1970, il a été proposé de l'inclure dans la Convention sur le génocide de 1948. Mais il a été retiré en 1995 du projet de Code et n'a pas été inclus au Statut de Rome. Depuis la fin des années 1990, diverses tentatives de le réintégrer dans le droit international ont été faites sans succès.
S'il n'y a donc pas de loi internationale qui criminalise l'écocide en temps de paix. Le Statut de Rome en fait cependant un crime en temps de guerre sous certaines conditions. Une quinzaine de pays ont déjà criminalisé l'écocide sur leur territoire. Le Viêtnam a été le premier en 1990. En décembre 2020, la Belgique a demandé d'inscrire le crime d'écocide dans le droit international.
L'urgence de régler cette situation
Pour Sébastien Treyer, le directeur général de l'Institut du développement durable et des relations internationales, il serait nécessaire pour accélérer la transition écologique d'utiliser d'autres instances que les conférences onusiennes.
En ce sens, le président de la COP30, André Corrêa do Lago, a aussi reconnu que plusieurs pays et organismes attendaient davantage d'ambition et a annoncé le lancement d'une feuille de route, pour surmonter la dépendance aux énergies fossiles, qui devrait être discutée avec les États volontaires en parallèle du processus officiel.
Le bilan médiocre de la COP30 a conduit le ministre adjoint de l'Environnement des Maldives, Thybian Ibrahim, à affirmer qu'il faut voir le problème dans son ensemble. Pour nous, aux Maldives, ça veut aussi dire de devoir faire face à une rupture de nos produits alimentaires s'il y a une sécheresse ou des inondations en Inde, commente-t-il.
La négociatrice pour les Comores, Loubna Hamidi, a demandé de récompenser les pays qui préservent leurs écosystèmes côtiers. Dans mon pays, protéger les mangroves est le meilleur moyen de s'adapter aux changements climatiques, affirme-t-elle.
Le haut-commissaire des Nations unies s'interrogeait après la COP30 quant à cette inaction, parlant du récent arrêt de la Cour internationale de Justice qui affirmait que les gouvernements doivent prévenir toute atteinte grave au climat. Le jugement imposait aux entreprises le devoir de diligence et à prévoir des réparations pour les préjudices liés au climat. Il s'est même demandé publiquement, au sujet de l'opinion des générations futures, si cette réponse inadéquate pouvait être considérée comme un écocide, peut-être même un crime contre l'humanité.
Michel Gourd
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Violence et mort sur le sol américain et à l’étranger

Le 26 novembre, Rahmanullah Lakanwal, un immigrant afghan, s'est approché de deux membres de la Garde nationale de Virginie stationnés à Washington, D.C. et leur a tiré dessus à bout portant.
Hebdo L'Anticapitaliste - 778 (04/12/2025)
Par Dan La Botz
Traduction Henri Wilno
L'une d'entre eux, Sarah Beckstrom, 20 ans, est décédée des suites de ses blessures, tandis que l'autre, Andrew Wolfe, 24 ans, reste dans un état critique. Lakanwal a également été grièvement blessé et a été inculpé pour meurtre. À la suite de cette fusillade, Trump a immédiatement suspendu l'immigration en provenance d'Afghanistan et de 19 autres « pays du tiers monde » d'Afrique et d'Asie. Il jette ainsi de l'huile sur le feu de la xénophobie.
Comment Lakanwal a-t-il perdu la tête ?
Trump a déclaré à propos du tireur : « Il est devenu fou, il a perdu la tête. Et cela arrive, cela arrive trop souvent avec ces gens-là. » Mais qui sont « ces gens » ? Comment Lakanwal a-t-il perdu la tête ? La guerre des États-Unis en Afghanistan a commencé en 2001, lorsque Lakanwal avait cinq ans. À l'âge adulte, il a rejoint une « unité zéro » dirigée par la CIA (Agence centrale de renseignement américaine). Ces unités ont été décrites par des diplomates et des organisations de défense des droits humains comme des « escadrons de la mort » qui ont procédé à des exécutions extrajudiciaires.
Lorsque la guerre a pris fin en 2021 avec la victoire des talibans et le retrait des troupes américaines, des dizaines de milliers d'Afghans, dont Lakanwal et sa famille, ont trouvé refuge aux États-Unis. Il s'est installé à Bellingham, dans l'État de Washington. Ses expériences de guerre, au cours desquelles il a assassiné des personnes pour le compte de la CIA dans son pays natal, lui ont manifestement laissé un syndrome de stress post-traumatique. Un jour, il a perdu la tête, a traversé 3 000 miles jusqu'à Washington, D.C., s'est approché d'une unité de la Garde nationale et a tiré sur Beckstrom et Wolfe.
Les escadrons de la mort de la CIA ont rendu Lakanwal fou, et c'est Trump qui, dans le cadre de sa campagne contre les maires du Parti démocrate, a envoyé la Garde nationale à Washington. La CIA et Trump peuvent être tenus responsables du meurtre de Sarah Beckstrom.
Les États-Unis s'engagent dans une nouvelle guerre aux Caraïbes
En ce moment, dans les Caraïbes, les États-Unis s'engagent dans une nouvelle guerre qui verra également intervenir la CIA et les escadrons de la mort de l'« Unité Zéro », entraînant davantage de traumatismes et de violence non seulement à l'étranger, mais aussi chez nous. Trump poursuit ses meurtres en haute mer, ayant fait exploser 22 bateaux et tué 83 personnes. Il affirme que ces bateaux transportent des drogues qui nuisent aux Américains, ce qui, selon lui, constitue une guerre contre les États-Unis et lui donne donc le droit de mener une guerre contre les trafiquants de drogue. L'administration Trump n'a fourni aucune preuve que les bateaux et les personnes qui s'y trouvaient étaient des trafiquants de drogue, mais même si c'était le cas, le gouvernement américain n'aurait pas le droit de les tuer.
Le Washington Post rapporte que, selon deux témoins, Pete Hegseth, secrétaire à la Défense, a donné un ordre verbal pendant une attaque : « L'ordre était de tuer tout le monde. » Lorsqu'au cours d'une attaque, deux survivants se sont retrouvés accrochés à des débris dans la mer, suivant les ordres de Hegseth, ils ont été réduits en morceaux. Hegseth est un criminel de guerre pour avoir ordonné le meurtre de civils non armés. C'est précisément la raison pour laquelle six membres du Congrès américain, tous issus du milieu militaire, ont récemment publié une vidéo affirmant que les militaires devraient et doivent refuser les ordres illégaux (cf. L'Anticapitaliste de la semaine dernière). Trump a qualifié ces législateurs de traîtres.
Les attaques contre les bateaux s'inscrivent dans le cadre de la campagne croissante de Trump contre le Venezuela, qui pourrait déboucher sur une guerre à tout moment. L'administration Trump, qui ne reconnaît pas le gouvernement du président vénézuélien Nicolás Maduro, l'a accusé d'être à la tête du « Cartel de Los Soles », un cartel de la drogue prétendument dirigé par le gouvernement, et a offert une récompense de 50 millions de dollars pour la capture de Maduro. Trump a envoyé un groupe aéronaval américain au large des côtes vénézuéliennes et dispose de 15 000 soldats dans la région. Il a également annoncé la fermeture de l'espace aérien vénézuélien et menacé d'attaquer bientôt le Venezuela par voie terrestre.
La guerre des États-Unis en Afghanistan a duré vingt ans et une guerre contre le Venezuela pourrait également devenir un conflit prolongé. Trump et Hegseth seront responsables non seulement de la guerre, mais aussi de la longue série d'événements qui s'ensuivront, avec davantage de traumatismes et de violence.
Dan La Botz
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La victoire de Mamdani et les perspectives socialistes

La victoire de Zohran Mamdani à l'élection municipale de New York a dynamisé la gauche, exaspéré Trump (qui semble vouloir le coopter après l'avoir qualifié de « communiste » et avoir menacé de couper les fonds fédéraux destinés à New York) et stimulé le débat au sein de la gauche sur l'action politique indépendante et l'utilisation du bulletin de vote du Parti démocrate.
Tiré de Inprecor 739 - décembre 2025
3 décembre 2025
Mamdani a remporté la victoire grâce à un programme de réformes radicales comportant une dynamique anticapitaliste, qui abordait directement les questions du logement abordable, des transports et de la protection de l'enfance, et se présentait ouvertement comme socialiste démocratique, musulman, pro-Palestinien, immigrant et défenseur des immigrant·es dans une période marquée par les raids terroristes de l'ICE mais aussi du déclin du soutien public à Trump.
Un mouvement populaire
La campagne a suscité un enthousiasme considérable dans les quartiers populaires et immigrés, mobilisant 104 000 bénévoles, dont 11 000 membres de DSA de New York. Le caractère populaire et pro-immigré·es de la campagne l'a inscrite dans le vaste mouvement anti-Trump qui a vu trois grandes mobilisations à l'échelle nationale au cours des derniers mois. La dernière manifestation, le 18 octobre, a rassemblé sept millions de personnes.
Mamdani s'est présenté comme candidat du Parti démocrate après avoir battu deux politiciens discrédités lors des primaires du PD, l'ancien gouverneur Andrew Cuomo, contraint de démissionner à la suite de révélations de harcèlement sexuel, et l'actuel maire démocrate Eric Adams, accusé de corruption et finalement sauvé politiquement par Trump. Lors de l'élection générale, il a affronté Cuomo et le candidat républicain Curtis Sliwa, un milicien bien connu qui avait fait campagne sur la promesse d'embaucher 7 000 policiers supplémentaires. La victoire de Mamdani s'inscrit dans une vague de victoires démocrates à travers le pays, dont plusieurs membres de DSA, à un moment où le soutien à Trump est en baisse dans les sondages.
Si certains ont présenté la victoire de Mamdani comme une surprise, tous les sondages le donnaient favori. La surprise est venue lorsqu'il a remporté les primaires du PD. Bien qu'il ait dû faire face à l'opposition de nombreux dirigeant·es du Parti démocrate (le leader démocrate au Sénat Chuck Shumer et l'ancien président Barack Obama ne l'ont pas réellement soutenu), il a bénéficié du soutien de certains démocrates, notamment de Kathy Hochul, la gouverneure centriste de New York, et des ressources matérielles du PD.
Paradoxes de la victoire
La campagne de Mamdani, sa victoire et les perspectives de mise en œuvre de son programme se heurtent à une contradiction fondamentale. Il a remporté l'élection grâce à son programme progressiste. Ayant été élu sous la bannière du PD avec les ressources du parti et certains soutiens, il sera soumis à une pression énorme de sa part pour modérer son programme. Ainsi, la gouverneure Kathy Hochul a déjà indiqué qu'elle s'opposerait à la forte augmentation des impôts pour les super-riches que Mamdani estime nécessaire pour mettre en œuvre son programme.
Une opposition considérable viendra de l'establishment du PD, du secteur immobilier et des milliardaires que Mamdani entend taxer pour financer son programme. Cela souligne la nécessité d'un mouvement de masse pour pousser à sa mise en œuvre, et la dimension populaire de la campagne montre le potentiel pour construire un tel mouvement de masse. Mais au lieu de cela, Mamdani s'est entouré de conseiller·es issu·es d'organisations non gouvernementales (ONG) et semble mettre en place une organisation hiérarchisée plutôt qu'un mouvement démocratiquement contrôlé.
Action politique indépendante pour la classe ouvrière et ses alliés
L'élection de Mamdani va relancer le débat au sein de DSA et de toute la gauche américaine sur l'efficacité de l'utilisation du bulletin démocrate pour remporter des sièges, ce qu'on appelle la « rupture sale » par opposition à la « rupture propre » qui consiste à mener des campagnes socialistes indépendantes en dehors du Parti démocrate.
Les partisans de la rupture propre affirment que le Parti démocrate est un parti des élites, contrôlé par des milliardaires et qu'il ne peut être transformé en outil au service du socialisme. Ils s'opposent à la candidature ou au soutien de candidats démocrates et appellent à mener des campagnes socialistes indépendantes lorsque cela est possible. La plupart des partisans de la « rupture sale » s'accordent à dire que le PD est irréformable et considèrent l'utilisation du vote démocrate comme une tactique. Si DSA et d'autres candidat·es socialistes ont remporté des élections, comme Mamdani, il est difficile d'imaginer qu'une organisation socialiste indépendante puisse être construite avec une telle orientation.
La situation politique actuelle aux États-Unis, notamment la résistance croissante contre Trump – qui s'est manifestée lors d'au moins trois manifestations massives No Kings ! depuis le 5 avril –, les sondages montrant la perte de soutien de Trump parmi sa propre base et les campagnes réussies comme celle de Mamdani, tout cela indique la possibilité de construire un mouvement socialiste de masse indépendant aux États-Unis. Mais cette énergie sera absorbée et gaspillée si les socialistes se présentent sous la bannière démocrate.
Une orientation socialiste indépendante est possible
Il est prouvé que des campagnes socialistes indépendantes ancrées dans le mouvement de masse peuvent aujourd'hui remporter des élections. En avril dernier, Alex Brower, coprésident du DSA de Milwaukee, a remporté une élection partielle pour un siège au conseil municipal avec le soutien de DSA et de l'organisation socialiste révolutionnaire Solidarity. Il a mené une campagne énergique en tant que socialiste assumé, avec un programme radical comprenant la municipalisation de la compagnie d'électricité locale, et le soutien d'une petite armée de bénévoles de DSA et d'autres organisations, pour battre de manière décisive un démocrate progressiste. Bien qu'il s'agisse d'une élection qui se déroule en dehors du cadre des partis, la victoire de Brower en tant que socialiste assumé et le caractère démocratique et populaire de sa campagne montrent qu'il est possible de mener et de remporter des campagnes socialistes populaires. Brower a également fondé et dirige une organisation populaire appelée Power to the People, appuyée sur DSA, qui vise à municipaliser la compagnie d'électricité locale. Bien que Milwaukee ne soit pas New York et qu'un siège au conseil municipal ne soit pas la mairie, cette combinaison de la politique socialiste anticapitaliste populaire et électorale observée dans la campagne de Brower représente la voie à suivre pour le socialisme aux États-Unis.
À leur manière, les campagnes de Mamdami et Brower et les mouvements anti-Trump et anti-ICE en pleine expansion montrent que les socialistes ont la capacité d'attirer le soutien enthousiaste de la classe ouvrière et des communautés opprimées pour disputer et remporter des élections et construire un mouvement socialiste de masse vigoureux capable de proposer une alternative socialiste au néofascisme de Trump et au néolibéralisme des démocrates. n
Le 22 novembre 2025
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Ce que représente Trump concrètement pour les Afro-Américain·es

Les Afro-Américain·nes sont sous les feux des critiques du régime Trump sur tous les fronts. Le président Trump affirme que la population noire bénéficie d'avantages injustes par rapport à la plupart des Blancs, en particulier les jeunes hommes blancs. Ces attaques sont dirigées contre tout ce qui touche au « wokisme » (qui désignait à l'origine la prise de conscience des réalités de l'oppression) et à la DEI (diversité, équité, inclusion). Il s'agit purement et simplement d'une offensive raciste visant à réduire à néant tous les acquis socio-économiques et politiques obtenus par cette partie opprimée de la population.
Tiré de Inprecor
7 décembre 2025
Par Malik Miah
L'administration Trump a licencié Carla Hayden, première Afro-Américaine et première femme bibliothécaire du Congrès, par SMS.
Et lorsque Trump, entouré de ses sous-fifres, déclare vouloir s'attaquer à la « gauche radicale », ce sont les organisations de défense des droits civiques qui figurent en tête de sa liste.
Capitalisme, oppression nationale, sexisme
À la source de ces attaques, on trouve la nature même du système capitaliste, où les milliardaires occupent la première place et les travailleurs la dernière. Le capitalisme américain est profondément ancré dans une structure de classes historiquement fondée sur la race. Avant l'indépendance obtenue face à l'Angleterre coloniale, les fondateurs percevaient les peuples autochtones qui les avaient accueillis comme des êtres inférieurs.
Les colons européens blancs considéraient les esclaves africain·es comme des êtres moins que civilisés. Ils voyaient les Mexicain·es et les autres futurs immigrant·es latino-américain·es à la peau mate comme des envahisseurs.
Les Noir·es, le groupe opprimé le plus important, ont été considérés comme « inférieurs » dès la constitution d'un pays indépendant. Il a fallu une guerre civile (la deuxième révolution américaine) pour mettre fin à l'esclavage et permettre aux ancien·nes esclaves de devenir des citoyen·nes.
Bien qu'ils aient débattu de l'esclavage, les fondateurs n'ont jamais été favorables à l'égalité pour les personnes non blanches. Les tribus autochtones ont été victimes d'un génocide.
Il n'est pas surprenant que les futurs dirigeants blancs des deux grands partis capitalistes aient imposé un système de suprématie blanche fondé sur la ségrégation forcée, l'exclusion et le principe « dernier embauché, premier licencié » pour les Afro-Américain·es.
Les femmes ont bien sûr subi une double ou triple exploitation : le racisme, l'oppression sexuelle et les actuelles menaces de l'extrême droite de restreindre davantage le droit à l'avortement et même à la contraception.
Le « secrétaire à la Guerre » Pete Hegseth, idéologue patriarcal et suprémaciste chrétien, a même émis des doutes quant au fait que les femmes devraient continuer à avoir le droit de vote. Les personnes transgenres sont confrontées à des menaces pour leur existence physique.
Hausse du chômage et coupes budgétaires
Une étude des chiffres de l'emploi publiés en août 2025 par le Bureau of Labor Statistics (BLS) révèle la véritable nature du capitalisme et de l'oppression des Noirs.
Le taux de chômage des Noir·es, qui s'élève à 7,5 % (contre 6,1 % en juillet 2024), reste nettement supérieur à la moyenne nationale de 4,3 %.
Les travailleur·ses noir·es sont confronté·es à des disparités persistantes dues à de nombreux facteurs, notamment la concentration géographique dans les zones urbaines à fort taux de chômage et les barrières structurelles en matière d'embauche et de promotion.
Les taux de chômage les plus récents par race et origine ethnique en août 2025, d'après les données du Bureau of Labor Statistics :
Blanc·hes 3,7 %
Noir·es/Afro-Américain·es 7,5 %
Asiatiques 3,6 %
Latin@s 5,3 %
Moyenne nationale 4,3 %
En bref, ces données montrent que les Afro-Américain·es continuent d'afficher le taux de chômage le plus élevé, près du double de celui des Blanc·hes et des Asiatiques. Elles ne permettent toutefois pas de constater l'augmentation du nombre de sans-abri parmi les travailleur·ses licencié·es, incapables de payer leur loyer et de conserver leur logement.
Les plus touché·es sont les hommes et les femmes noir·es, y compris celles et ceux qui ont des enfants scolarisés et qui n'ont pas d'adresse fixe. Les coupes dans le programme SNAP (coupons alimentaires) et la diminution des repas gratuits dans les écoles publiques entraînent une sous-alimentation des familles, en particulier dans les communautés noires et latino-américaines.
Les Américain·es d'origine asiatique affichent systématiquement le taux de chômage le plus bas, ce qui est souvent imputé à leur niveau d'éducation plus élevé et à leur concentration dans des secteurs à forte demande.
Les travailleur·ses latino-américain·es se situent entre les deux, avec des taux supérieurs à ceux des Blanc·hes et des Asiatiques, mais inférieurs à ceux des Afro-Américain·es.
Ces disparités se retrouvent dans toutes les tranches d'âge, mais elles sont particulièrement marquées chez les jeunes travailleur·ses (âgés de 16 à 24 ans), où le chômage des jeunes Noir·es peut dépasser 19 %.
Les femmes noires durement touchées
Les femmes noires sont parmi les plus touchées par les suppressions d'emplois fédéraux décidées par Trump. Il a supprimé des centaines de milliers d'emplois dans la fonction publique fédérale, ce qui affecte de manière disproportionnée les employé·es noir·es, en particulier les femmes qui y ont obtenu des emplois et des avantages sociaux auxquels elles n'auraient pas eu accès dans le secteur privé.
Ainsi, lorsque Trump a commencé à démanteler les agences fédérales et à licencier des fonctionnaires de rang modeste, Peggy Carr, statisticienne en chef au ministère de l'Éducation, s'est immédiatement livrée à des estimations chiffrées.
Elle avait été la première personne noire et la première femme à occuper le poste prestigieux de commissaire du Centre national des statistiques du secteur de l'éducation. Désignée à ce poste par le pouvoir politique, elle savait qu'elle risquait d'être prise pour cible.
Mais ses trente-cinq années de carrière au sein de ce ministère, qui se sont étalées sur six mandats présidentiels, dont le premier mandat de Donald Trump, lui avaient valu le respect des responsables politiques des deux partis.
Elle pensait certainement que le bureau chargé de suivre les résultats scolaires des élèves du pays ne pouvait pas être considéré par le président comme « diviseur et nuisible » ou « woke ».
Un après-midi de février, un agent de sécurité s'est présenté à son bureau alors qu'elle s'apprêtait à tenir une réunion avec son équipe. Quinze minutes plus tard, ses collaborateurs l'ont vue, en larmes et incrédules, sortir du bâtiment sous escorte. Le Dr Carr a déclaré dans une interview : « C'était comme être poursuivie en justice devant ma famille, ma famille professionnelle. C'était comme si on me jetait comme un kleenex, à la seule différence que j'étais accompagnée jusqu'à la porte d'entrée plutôt que celle de derrière. »
Alors que des dizaines de milliers d'employé·es comme Carr ont perdu leur emploi dans le cadre de la politique de réduction drastique des effectifs fédéraux menée par le président Trump, les experts en matière d'emploi affirment que ces coupes touchent de manière disproportionnée les femmes noires.
Les femmes noires représentent 12 % des effectifs fédéraux, soit près du double de leur part dans la population active globale. Cependant, elles représentent 25 % des effectifs dans des agences telles que l'Internal Revenue Service et le ministère de l'Éducation, où les coupes ont été les plus importantes.
Le ministère de l'Éducation était un cas particulier, avec plus d'un quart de ses effectifs composé de femmes noires, et il a suspendu des dizaines de personnes dont les titres et les fonctions officielles n'avaient aucun lien avec la DEI.
Leur seul contact évident avec les activités de la DEI s'était limité à des formations dispensées à l'initiative de leurs supérieurs hiérarchiques. Pour Trump, le fait d'être noir·e dans un emploi est la preuve que vous avez été embauché grâce au « wokisme » et à la DEI.
Pourquoi défendre la DEI
Depuis des générations, l'emploi fédéral sert d'échelle sociale à la classe moyenne qui était exclue du marché du travail en raison de la discrimination. Le secteur public a toujours offert une plus grande stabilité de l'emploi, une plus grande équité salariale et de meilleures perspectives de carrière que le secteur privé.
Depuis l'adoption de la loi sur les droits civiques de 1964, le gouvernement fédéral a appliqué de façon vigoureuse la discrimination positive dans le recrutement ainsi que les dispositions anti-discrimination. Trump qualifie ces programmes de « racisme inversé ».
La droite, qui contrôle la majorité au Congrès et à la Maison Blanche, soutient la restructuration du gouvernement fédéral menée par Trump. En juillet, la majorité de la Cour suprême a décrété que le président pouvait poursuivre ses licenciements racistes au sein du gouvernement fédéral.
Dans une déclaration, Harrison Fields, porte-parole de la Maison Blanche, a déclaré que Trump « ouvrait la voie à une économie qui donnerait plus de poids à tous les Américains, comme il l'avait fait lors de son premier mandat ».
Il a ajouté que « cette obsession à vouloir mettre en place des mesures de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI) qui divisent la population annule des années de progrès vers une véritable égalité ».
C'est précisément pour cette raison que la DEI doit être au cœur de la résistance contre les mesures prises par Trump pour instaurer un système présidentiel sans contrôle de ses pouvoirs (le Shutdown – arrêt des activités gouvernementales – donne à Trump et au Bureau de la gestion et du budget un précieux prétexte pour multiplier les abus).
Au cours des 200 premiers jours de la présidence Trump, sur les 98 personnes qu'il a nommées aux postes les plus élevés de l'administration, seules deux étaient afro-américaines. Il s'agissait de Scott Turner, secrétaire au Logement et au Développement urbain, et d'Earl G. Mathews, avocat général du nouveau département de la Guerre. Dans la première administration Trump, sur les 70 nominations, Ben Carson, qui est devenu secrétaire au Logement, était le seul fonctionnaire noir confirmé.
Purges
Les statistiques compilées par Kathryn Dunn Tenpas pour la Brookings Institution dévoilent à quel point cette administration est blanche. En comparaison avec ce taux de 2 % après 200 jours, les responsables noirs représentaient 21 % des candidats confirmés par le Sénat sous Joseph Biden, 13 % sous Barack Obama et 8 % sous George W. Bush.
Au cours de la même période, l'administration Trump a licencié des haut·es fonctionnaires noir·es qui avaient été précédemment confirmé·es par le Sénat. Parmi eux figurent Alvin Brown, membre du National Transportation Safety Board (Bureau national de la sécurité des transports) ; le général Charles Q. Brown, chef d'état-major interarmées ; Carla Hayden, bibliothécaire du Congrès ; Robert E. Primus, président du conseil d'administration de la Federal Energy Regulatory Commission (Commission fédérale de réglementation de l'énergie) et Gwynne Wilcox, membre du National Labor Relations Board (NLRB, Conseil national des relations du travail). (Voir « Trump Fires Black Officials From an Overwhelmingly White Administration », Elisabeth Bumiller et Erica L. Green, New York Times, mis à jour le 10/10/25)
La plupart ont été licencié·es par courriel ou par SMS, sans explication. Plusieurs ont trouvé leurs téléphones et ordinateurs professionnels éteints et ont été escorté·es hors des locaux fédéraux peu après. Mais le général Brown a clairement compris la raison pour laquelle on lui a montré la porte. Pete Hegseth avait demandé son licenciement, affirmant qu'il nuisait à l'armée parce qu'il mettait en œuvre des programmes D.E.I.
Le général Brown, ainsi que Primus et Wilcox, ont intenté un procès pour être réintégrés. La Cour suprême des États-Unis a statué que l'administration pouvait temporairement démettre de ses fonctions Gwynne Wilcox, la première femme noire à siéger au NLRB, pendant que son procès suit son cours.
Mme Wilcox s'inquiète pour l'agence, car celle-ci n'a plus le quorum et ses activités sont au point mort.
D'autres ont été contraints de démissionner plutôt que d'affronter l'humiliation d'un licenciement brutal et d'une campagne de dénigrement. Willie L. Phillips, le premier président afro-américain de la Commission fédérale de régulation de l'énergie, a démissionné au printemps dernier à la demande de la Maison Blanche.
La tentative de Trump de licencier Lisa D. Cook, la première femme noire gouverneur du Conseil de la Réserve fédérale, a jusqu'à présent échoué. Contrairement à ce qui s'est passé dans l'affaire Wilcox, la Cour suprême a statué que Cook pouvait continuer à exercer ses fonctions pendant que l'administration fait avancer la procédure.
Bien que Trump ait initialement visé le président du conseil, Jerome Powell, pour le destituer, les règles stipulent qu'un membre ne peut être destitué que pour un motif valable. L'administration a ensuite accusé Cook d'avoir menti dans une demande de prêt hypothécaire. Même si cela était vrai, cet incident n'aurait rien à voir avec ses qualifications ou ses performances au sein du conseil d'administration, et se serait produit avant son investiture. (Les médias affirment que cette accusation est fallacieuse.)
Cook est une ancienne professeure d'économie dont les recherches portaient sur les disparités raciales, l'histoire des institutions financières, les crises des marchés financiers et l'innovation.
La militante LaTosha Brown a expliqué au Guardian pourquoi Trump avait retenu Lisa Cook : « Il l'a choisie parce qu'il parie que, dans un secteur où 90 % ou plus des employé·es sont des hommes blancs, ses chances de la destituer sont plus grandes que celles de destituer d'autres membres du conseil d'administration. Cela s'explique par l'histoire et par la manière insidieuse dont le racisme est ancré dans la façon dont nous percevons les personnes de couleur dans ce pays ».
Jusqu'à présent, Lisa Cook a combattu cette tentative de licenciement jusqu'à la Cour suprême, qui a estimé qu'elle pouvait continuer à exercer ses fonctions de gouverneure pendant que son affaire suivait son cours. Celle-ci a été inscrite au rôle début 2026.
Beaucoup de ces personnes ont été les premiers Afro-Américain·es à être nommé·es, confirmé·es et à travailler au poste qu'ils ou elles occupent. C'est le cas d'Alvin Brown, Lisa Cook, Carla Hayden, Willie Phillips, Robert Primus et Gwynne Wilcox. Le général Brown a été le deuxième président noir des chefs d'état-major interarmées.
Ces purges démontrent clairement pourquoi la défense de la DEI doit être au cœur de la lutte contre l'autoritarisme de Trump et ses politiques suprémacistes blanches. L'unité de la classe ouvrière, essentielle pour vaincre l'extrême droite, n'est pas possible sans cela.
Jeudi 13 novembre 2025, Against The Current n°239, traduit par Pierre Vandevoorde.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le capitalisme beaucoup trop tardif. Ernest Mandel à l’ère Trump*

Dans Late Capitalism, le magnum opus d'Ernest Mandel, publié pour la première fois au début des années 1970, le penseur marxiste militant soulignait que cette phase du capitalisme « loin de représenter une société post-industrielle, apparaît donc comme la période durant laquelle toutes les branches de l'économie sont pleinement industrialisées pour la première fois » 1. Selon lui, l'industrialisation complète ne désigne pas le développement de l'industrie manufacturière au sens strict, mais la généralisation de la logique industrielle à toutes les branches de la production et à la société dans son ensemble. Cette logique industrielle est la logique du travail abstrait : la comparabilité universelle des processus concrets de travail par l'échange de marchandises, qui découle de la dynamique de valorisation et de son expansion constante en portée et en profondeur. Sous la menace de l'élimination, la concurrence entre capitaux implique « une pression permanente pour accélérer l'innovation technologique, (...) une recherche constante de rentes technologiques qui ne peuvent être obtenues que par un renouvellement technologique permanent » 2.
12 mars 2025 | Vientosur nº 198
https://vientosur.info/el-capitalismo-demasiado-tardio-ernest-mandel-en-la-era-trump/
En conséquence de cette lutte pour la survie entre capitaux, l'économie et la société se remodelent sans relâche. Ces transformations structurelles ne s'arrêtent pas aux frontières nationales, mais, au contraire, déclenchent une métamorphose historique à l'échelle mondiale. Dans le capitalisme tardif, aucun coin du monde social n'est à l'abri de l'influence de la valorisation, ce qui signifie que les indicateurs de performance sont propagés à travers la matrice économique sous forme de normes technologiques et organisationnelles. En même temps, les liens sont densifiés à travers l'espace social mondial. Comme le dit Mandel, « la socialisation du travail atteint son extrême à mesure que le résultat cumulatif total du développement scientifique et technique de toute la société et de l'humanité devient de plus en plus la condition immédiate de chaque processus particulier de production dans chaque sphère de production. Avec la réalisation d'une automatisation complète, cela se réaliserait au sens littéral. » 3pp. 315, 316.
Près de cinq décennies plus tard, alors que les outils d'IA générative colonisent chaque centimètre du tissu social, la vision de Mandel d'une interdépendance mondiale permanente et d'une automatisation généralisée du travail intellectuel devient réalité. Il prévoyait avec précision la transformation qualitative du capitalisme, son omniprésentité. Il a compris très tôt que le changement technologique et l'intensification de la dépendance au travail intellectuel ne se matérialisent pas automatiquement dans une nouvelle vague d'expansion. Il fondait également son optimisme sur l'intensification des contradictions systémiques. Il vaut la peine de le citer ici en entier :
L'appropriation privée de cette production socialisée conduit à la contradiction flagrante selon laquelle ce vaste capital scientifique et technique à la disposition de l'humanité est subordonné aux conditions de valorisation du capital et, par conséquent, est refusé à des millions de personnes ou ne leur est accessible que sous une forme déformée et fragmentaire. Ce n'est que lorsque les forces productives brisent la coquille de l'appropriation privée qui les emprisonne que les forces révolutionnaires, qui pour la plupart dorment encore dans la science contemporaine, pourront pleinement servir la libération de l'homme et du travail..
Mandel avait raison, et il l'a encore plus aujourd'hui, en ce qui concerne le mouvement structurel du système. Cependant, l'idée que le développement de ses contradictions ouvrirait la voie à un avenir socialiste n'a jamais semblé aussi éloignée d'être politiquement envisageable. Le pouvoir systémique de la socialisation pourrait-il contribuer à un tournant réactionnaire systémique ?
Le but de ce texte est de tenter de concilier la vision de Mandel du capitalisme tardif comme voie vers l'émancipation post-socialiste avec la politique économique du régime d'extrême droite aux États-Unis, pays leader du capitalisme mondial. Après avoir présenté quelques paramètres de base du contexte économique, je me souviendrai de l'argument classique de Kalecki sur la macroéconomie politique fasciste et montrerai comment il s'accorde parfaitement avec le conte de fées des milliardaires réactionnaires raconté après la deuxième victoire électorale de Trump. Ensuite, je me concentrerai sur deux processus qui se sont accélérés sous cette administration : la désintégration du capitalisme mondial construite après la Seconde Guerre mondiale et l'avancée du secteur technologique vers des capacités semblables à celles de l'État.
Mon principal argument est que, bien que l'agenda de Trump ait des caractéristiques néofascistes indéniables, ce régime ne se dirige pas vers la résurgence d'une modernisation autoritaire menée par l'État, mais vers le démantèlement du terrain de jeu mondial pour les capitalistes du monde entier et l'expansion du pouvoir politico-administratif des grandes entreprises technologiques au détriment du pouvoir étatique. Si la position confrontante avec la Chine est réelle et dangereuse, la direction prise conduit à une plus grande autonomie des grandes entreprises technologiques américaines en tant qu'agents hybrides post-étatiques du pouvoir politico-économique, plutôt qu'à une renaissance de l'impérialisme américain à l'ancienne.
1. Paramètres de base
Pour comprendre le panorama structurel dans lequel évolue l'administration Trump II, il est essentiel de se souvenir des paramètres économiques fondamentaux de la situation historique. Ils peuvent se résumer en cinq points principaux.
Premièrement, on observe un déclin relatif des principales économies à revenu élevé par rapport au reste du monde (graphique 1), tandis que la Chine et, dans une moindre mesure, l'Inde ont considérablement augmenté leur part du PIB mondial (graphique 2). Mesurée en parité du pouvoir d'achat (PPA), qui est un indicateur plus fiable de la puissance productive effective d'un pays que le PIB nominal, cette évolution est frappante. En 2023, la France et l'Allemagne représentaient 5,3 % de l'économie mondiale, soit la moitié de leur part de 10,6 % en 1980. La baisse aux États-Unis est moins spectaculaire, passant de 21,3 % en 1980 à 15,5 % en 2023, mais très significative. Surtout comparé à l'augmentation de la part de la Chine, passant de 2,2 % à 18,7 %, bien au-dessus des États-Unis. L'Inde augmente son poids de 3 % à 7,6 %, dépassant la France et l'Allemagne réunies.

Figure 1. Parts des principales économies à revenu élevé dans le PIB mondial (PPA, part du total mondial – 1980-2023 – FMI-OMO)

Figure 2. Parts de la Chine et de l'Inde dans le PIB mondial (PPA, part du total mondial – 1980-2023 – FMI-WEO)
L'équipe économique de Trump relie ce déclin relatif des États-Unis vis-à-vis de la Chine à la financiarisation. La compréhension de cette malédiction des dirigeants sur la voie du développement capitaliste remonte à William Playfair (1759-1823). Cet économiste britannique a identifié les tendances du capital à concentrer la richesse entre quelques mains, la disparition de la classe moyenne et la nécessité d'exporter le capital. Il soulignait déjà en 1805 que, lorsque le stade de la surabondance du capital est atteint, lorsqu'une nation industrielle devient une nation créancière ou investisseur, « cela signifie la fin de l'industrialisation progressive et de l'expansion, c'est-à-dire une tendance à un état stable et le début de la désintégration et du déclin ». Giovanni Arrighi a développé cet argument dans sa théorie du cycle spatio-temporel systémique d'accumulation, définie comme une « phase d'expansion matérielle suivie d'une phase d'expansion financière promue et organisée par la même agence ou groupe d'agences » 6. Dans ce cadre, l'histoire du capitalisme mondial est une succession de quatre cycles systémiques : génois, néerlandais, britannique et américain, chacun s'étendant à partir d'une base territoriale plus large que son prédécesseur. Pour Arrighi, l'expansion de la Chine, compte tenu de l'immense taille du pays et de la profondeur de son articulation historique avec toute la région d'Asie de l'Est, en fait une puissante « force subversive pour la hiérarchie mondiale de la richesse » et le principal prétendant à la succession de l'économie mondiale dirigée par les États-Unis.
Cette entrelacement de finance et de déclin est ce que Braudel appelait « le signe de l'automne », lorsque des pays entiers « sont transformés en une société d'investisseurs rentiers à la recherche de tout ce qui leur garantira une vie tranquille et privilégiée » 7. Ce braudelisme sombre rôde l'administration Trump actuelle. Le secrétaire d'État Marco Rubio et le secrétaire au Trésor Scott Bessent ont tous deux adopté l'accent braudélien, liant une orientation de valeur pour les actionnaires et un levier excessif à l'affaiblissement des capacités entrepreneuriales à long terme et à l'insoutenable des dépenses militaires impériales.8. Stephen Miran, actuel président du Conseil des conseillers économiques, souligne le rôle du dollar, qui sous-tend tout l'édifice de la finance mondiale, lorsqu'il affirme qu'« il devient de plus en plus lourd pour les États-Unis de financer la fourniture d'actifs de réserve et de l'ombrière de la défense, car les secteurs manufacturier et négociable supportent la majeure partie des coûts »9 .
Ce pessimisme financier au sommet de l'élite politique américaine contraste fortement avec la fièvre financière de l'ère Clinton, lorsque, sous l'égide de Lawrence Summers à la Banque mondiale et au Trésor, la libéralisation financière totale a été adoptée. Ce furent les années d'or d'une expansion de quatre décennies du supercycle minskien, qui devint de plus en plus difficile à maintenir après la Grande Crise Financière (Figure 3) 10. L'intervention croissante des banques centrales et l'explosion de l'inflation après la COVID ont révélé les tensions croissantes entre le ralentissement de l'économie productive et la poursuite de l'expansion des actifs financiers. Cette suraccumulation de capital fictif est donc le deuxième point qui caractérise la conjoncture.

Figure 3. Poids des formes fondamentales du capital fictif aux États-Unis (1980-2024)
Le troisième point concerne l'hégémonie du secteur technologique. La quête d'augmenter la capitalisation boursière n'est pas un phénomène répandu, mais résulte d'une concentration historiquement extrême de l'indice boursier, les dix plus grandes entreprises du S&P représentant plus d'un tiers de la capitalisation totale à la fin de 2024, contre moins de 20 % pour la majeure partie des dernières décennies (Graphique 4). Parmi les dix principales entreprises par capitalisation boursière, seules deux ne sont pas liées au secteur technologique à la fin de l'été 2025 (tableau 1). L'importance de ce boom dans le secteur technologique dépend de l'évaluation de ce type d'activité : qu'il s'agisse simplement d'une nouvelle transition sectorielle ou d'une profonde modification du mode de production. Cependant, la réalisation de cette révolution industrielle est sans aucun doute un élément crucial de la situation.

Figure 4. Capitalisation boursière des dix plus grandes entreprises du S&P 500 ( % de l'indice total, Goldman Sachs, novembre 2024)11
Tableau 1. Entreprises majoritaires selon la capitalisation boursière
Le quatrième point concerne la mondialisation. L'accélération du commerce a été une force majeure du milieu des années 1980 jusqu'à la grande crise financière, mais a depuis fortement reculé (Graphique 5). La part du commerce des biens par rapport au PIB a atteint un pic en 2007 (graphique 6), tandis que les flux financiers internationaux ne se sont jamais remis de leur forte baisse après la Grande Crise financière, mais ont été proportionnellement de plus en plus redirigés vers les économies émergentes 12. En général, comme le déclare le FMI, « l'économie mondiale pourrait être au bord d'un renversement de la tendance à l'augmentation constante de l'intégration qui caractérisait la seconde moitié du XXe siècle » 13.

Figure 5. Commerce des biens et services (volume, variation en pourcentage, 1980-2025, FMI-OMO)

Figure 6. Commerce des marchandises ( % du PIB mondial, 1988-2021, FMI-OMO)
Le cinquième et dernier point est une récession mondiale. Cette conjoncture se caractérise par un déclin relatif marqué de l'hégémonie américaine, avec une rivalité systémique avec la Chine à l'horizon après une longue phase de financiarisation, une restructuration sectorielle de l'économie mondiale où le secteur technologique est le pôle dominant et l'épuisement des forces dynamiques de la mondialisation. Une transformation systémique est en cours, mais ce n'est pas un renouveau du capitalisme qui ouvre la voie à une nouvelle phase d'expansion. La longue récession des économies à hauts revenus 14 elle fut compensée, pendant un temps, par la reprise rapide de la Chine. Cependant, depuis la crise financière mondiale, la croissance a également ralenti en Chine. Il y a eu un ralentissement séculaire de l'économie mondiale, alors que la Chine rejoint la longue récession des économies occidentales (Figures 7 et 8).
Figure 7. Croissance du PIB mondial (évolution et tendance annuelles, 1980-2024, FMI-WEO)

Figure 8. Croissance du PIB en Chine et dans le G7 (évolution et tendance annuelles, 1980-2024, FMI-OMO)
En résumé, le capitalisme tardif d'aujourd'hui est un capitalisme en décélération. Les forces de la financiarisation et de la mondialisation qui l'ont soutenu jusqu'à la grande crise financière s'épuisent, alors que nous assistons à un virage tectonique de la puissance productive mondiale vers la Chine et à une réorganisation des entreprises américaines autour du secteur technologique. Ce sont les paramètres de base sur lesquels le facteur Trump évolue.
2. Un conte de fées pour milliardaires réactionnaires
Avec l'enracinement de l'extrême droite au sommet de la plus grande puissance mondiale, nous sommes condamnés à relire ce que ceux qui ont vécu l'ère fasciste du XXe siècle en ont écrit. Cela nous rappelle immédiatement le nom du grand économiste polonais Michal Kalecki. Son célèbre article de 1943, « The Political Aspects of Full Employment », soutient que « la résistance à la politique de dépenses publiques en tant que telle est surmontée sous le fascisme par le fait que l'appareil d'État est sous le contrôle direct d'une combinaison de grandes entreprises et de carriéristes fascistes. » Ce régime politique spécifique implique que les principaux obstacles politiques aux profits futurs des capitalistes disparaissent. Premièrement, il n'y a plus la menace d'incertitude d'un futur gouvernement démocratiquement élu et hostile aux entreprises, puisque « sous le fascisme, il n'y a pas de gouvernement à proximité ». Deuxièmement, il n'y a aucune raison de craindre que l'armée de réserve de main-d'œuvre en déclin favorise un trouble ouvrier massif, puisque la « discipline dans les usines » et la « stabilité politique » sous plein emploi sont maintenues par le « nouvel ordre »., et que la répression politique remplace la pression économique du chômage.
Ce cadre solide aide à comprendre pourquoi les marchés se sont réjouis après l'élection de Trump et restent, au moment de la rédaction, à des niveaux records malgré des sommets d'incertitude dans la plupart des régions 16. À première vue, les investisseurs ne semblent pas particulièrement préoccupés par l'aggravation du déficit budgétaire, qui atteint des niveaux de guerre. Ils parient que les baisses d'impôts, la privatisation et l'assouplissement réglementaire augmenteront les profits tant du côté de la demande que de l'offre, tandis que les obstacles politiques posés par les syndicats et les mouvements sociaux seront contenus et que la gauche sera éliminée de façon durable – Trump n'a-t-il pas promis pendant la campagne électorale de « chasser les communistes et les marxistes »17– ? De plus, la dureté impériale et la diplomatie transactionnelle pouvaient encercler les concurrents étrangers et forcer l'ouverture de nouveaux champs d'accumulation pour le capital américain.
Dans la mesure où cet enthousiasme néo-fasciste reflète une défaite de la gauche et un élan impérial rajeuni, il repose sur une base rationnelle. Selon l'une des figures les plus en vue de la Silicon Valley, Marc Andreesen, le virage à droite des entreprises était une réaction à ce que certains chefs d'entreprise percevaient comme un puissant mouvement anticapitaliste de la Nouvelle Gauche qui s'est propagé depuis les campus universitaires à la suite de la guerre en Irak et de la Grande Crise Financière et a radicalisé la main-d'œuvre à l'ère post-COVID-18.
Puis, pendant la pandémie, l'État a accordé d'importants transferts aux travailleurs, dont certains se sont sentis habilités à exprimer de nouvelles revendications. Puis, l'administration Biden a pris une série de mesures progressistes ; parmi elles, une application stricte des lois antitrust sous la direction de Lina Khan à la FTC, une tentative de coordination internationale de la fiscalité des sociétés, et un certain soutien à la remobilisation syndicale et à l'action climatique, alors que la politique industrielle était de retour en vigueur avec l'IRA [Inflation Reduction Act]. Depuis la gauche, cette avancée timide n'était pas une source de joie, mais elle suffisait à la droite capitaliste américaine, habituée à une domestication complète des forces sociales, pour se sentir menacée par la pression populaire croissante et abandonner les principes démocratiques, humanitaires, écologiques et progressistes qu'elle avait formellement défendus jusque-là.
La mesure dans laquelle les capitalistes peuvent supporter des contraintes plus substantielles sur leur autonomie décisionnelle dépend, dépendant de l'équilibre des forces entre les classes et des attentes des différentes fractions. L'élection de Trump et la précipitation à soutenir le nouveau président au sein du monde des affaires suggèrent que beaucoup de membres de la classe capitaliste peuvent accepter un autoritarisme accru.
3. L'effondrement du capitalisme mondial
L'une des caractéristiques les plus notables de la nouvelle administration est sa position ouvertement nationaliste, tant dans sa politique anti-immigration sur le plan intérieur que dans ses attaques ouvertes contre le système multilatéral sur le plan international, avec un accent particulier sur le commerce.
Le vaste paquet de tarifs à l'importation annoncé par le président américain Donald Trump le 2 avril 2025, jour de la libération, a été un moment charnière pour cet agenda, comportant deux volets principaux. Le premier est un tarif global de 10 % sur les importations de tous les pays. La seconde est le soi-disant tarif réciproque. Les niveaux initialement annoncés résultent de la formule suivante : la moitié du déficit par rapport au total des importations d'un pays donné, exprimé en pourcentage, où le déficit commercial et les importations ne concernent que les biens, et non les biens et services.
Comment évaluer cette mesure ? La saga des tarifs se poursuit, avec des retards, des dérogations et des négociations sur les accords bilatéraux, il n'est donc pas tout à fait clair quel sera le point d'arrivée. Au départ, cette approche franche et indiscriminée a effrayé les investisseurs, mais à la mi-juillet 2025, les marchés boursiers ont largement récupéré leurs pertes. Après l'accord avec la Chine et l'accumulation d'exemptions, ils semblent croire que Trump reculera toujours si les dégâts pour l'économie américaine sont suffisamment importants, une stratégie connue sur les marchés sous le nom de Taco, acronyme de Trump Always Chickens Out. Si les tarifs élevés étaient mis en œuvre, les finances et les entreprises réagiraient sévèrement, mais la route est longue entre le bruit des tarifs et leur mise en œuvre efficace.
Nous ne devons pas non plus exagérer la nature perturbatrice de la position de cette administration sur le commerce, puisque le départ des États-Unis du libre-échange se préparait depuis des années. La guerre commerciale avec la Chine a commencé sous la première administration Trump et ne s'est pas calmée sous celle de Biden. De plus, les États-Unis expriment leur mécontentement envers l'OMC depuis le tournant du millénaire, car leur capacité à obtenir des résultats souhaités a été drastiquement réduite par la montée de la Chine et d'autres puissances émergentes. En conséquence, il a saboté l'institution. Comme l'a expliqué Kristen Hopewell,
Les États-Unis ont commencé à bloquer toutes les nouvelles nominations à l'Organe d'appel (AB) à l'expiration des mandats de ses juges (membres). Depuis décembre 2019, avec six de ses sept sièges vacants, l'OA n'a pas eu suffisamment de juges pour trancher les différends. Depuis décembre 2020, les sept postes sont vacants. En bloquant les nominations à l'OA, les États-Unis ont rendu le mécanisme d'application de l'OMC inutile 19.
Et cela a laissé tout l'opérateur de régulation commerciale impuissant.
Enfin, les sanctions économiques ont contribué à ralentir la dynamique commerciale, fragmentant progressivement l'économie mondiale, car le nombre de sanctions et la diversité de leurs sources ont augmenté de façon spectaculaire au cours des 15 dernières années 20.
Cependant, même après ces mises en garde, on peut dire que la politique commerciale américaine durant le premier semestre 2025 a été le coup de grâce à ce que Panitch et Gindis ont qualifié de capitalisme mondial 21.
L'horizon réglementaire de ce projet, déployé dans la seconde moitié du XXe siècle, était l'indifférence entre capital étranger et capital, c'est-à-dire l'utopie d'un traitement égal pour tous les capitalistes. Cette idée, qui a été un facteur puissant dans la mobilisation mondiale des classes dirigeantes autour de ce projet mené par les États-Unis, est ouvertement rejetée par l'administration actuelle au profit d'une approche à somme nulle de l'économie politique internationale. Sous cette administration, comme l'affirme Vivian Balakrishnan, ministre des Affaires étrangères de Singapour, le déplacement vers l'intérieur des États-Unis a bouleversé le système commercial mondial existant : « L'architecte, le planificateur principal, le développeur du système multilatéral d'intégration économique fondé sur des règles a décidé qu'il était désormais nécessaire d'entreprendre la démolition totale du système qu'il a créé. ». En conséquence, la plupart des pays d'Asie, d'Europe, du Golfe et d'autres régions intensifient leurs efforts diplomatiques pour construire un système commercial moins dépendant des États-Unis.
Les objectifs explicites des tarifs sont de stimuler la production intérieure, de créer des emplois et de générer des recettes pour le budget fédéral 23. Selon cet argument, l'économie américaine aurait été affaiblie par la concurrence mondiale, en raison d'une large gamme de pratiques commerciales déloyales d'autres pays, mais, d'un point de vue plus structurel, en raison de la surévaluation du dollar en raison de sa large demande issue de son statut spécial de monnaie de réserve 24. Il existe de nombreux problèmes qui ne peuvent être abordés dans l'espace limité de ce document. Mentionnons simplement que le commerce des biens ne représente qu'une partie des différents types d'activités commerciales au XXIe siècle, tandis que le commerce des biens immatériels est extrêmement bénéfique pour les États-Unis, de sorte qu'en général, le tableau global est moins déséquilibré 25.
Cependant, les conséquences de ce mode d'intégration commerciale ont été particulièrement néfastes, tant pour la classe ouvrière américaine que pour le secteur du développement des pays les plus pauvres, tout en profitant à une poignée d'entreprises spécialisées dans les activités intellectuelles et protégées par des dispositions spéciales dans le cadre des soi-disant accords de libre-échange 26.
Un autre problème concerne la méprise du fonctionnement du dollar mondial. Le déficit commercial américain n'est pas nécessaire pour soutenir l'offre de dollars requise mondialement à des fins de précaution, ni simplement pour financer des activités commerciales et d'investissement libellées en dollars sans équivalent résident aux États-Unis. Premièrement, l'achat de bons du Trésor très liquides par des investisseurs étrangers peut être compensé par l'achat d'actions et d'autres actifs à haut rendement à l'étranger par des investisseurs américains, qui générent ensemble des rendements positifs pour l'économie américaine 27. Deuxièmement, la liquidité mondiale du dollar est également maintenue par les eurodollars – passifs libellés en dollars échangés par des entités non américaines – sans lien direct avec le compte courant américain 28.
En fin de compte, la raison d'être d'une politique commerciale américaine agressive est de tenter d'apaiser les tensions sociales intérieures en imposant des coûts plus élevés aux autres économies, même à court terme, grâce aux recettes issues des tarifs commerciaux. Il vise également à empêcher la Chine de prendre la tête à long terme en matière de capacité productive, en accordant une attention particulière aux technologies avancées et à la solidité de la base matérielle plus large de l'économie, y compris les industries lourdes et l'accès aux ressources naturelles. Pendant des décennies, les deux pays ont été largement complémentaires, ce qui a généralement profité à leurs capitalistes respectifs, mais le resserrement de l'écart par l'économie chinoise les a mis sur une voie dangereuse de confrontation 29, dont la dynamique se rapproche davantage des rivalités impérialistes à l'ancienne que de l'esprit coopératif de l'empire informel de Panitch et Gindins. L'augmentation de 150 milliards de dollars des dépenses de défense – une hausse de 13 % entre 2025 et 2026– est un signe inquiétant de cette tendance. Enfin, les tarifs sont aussi un outil punitif utilisé pour forcer l'assouplissement de la régulation des entreprises technologiques, un problème persistant avec l'UE. C'est aussi le cas dans le Brésil de Lula, mais là-bas la question de la régulation des plateformes s'ajoute à l'ingérence politique directe. Les tarifs de 50 % sont principalement motivés par le soutien à l'ancien président Bolsonaro 31. Dans ce contexte, ils ne sont rien d'autre qu'une forme de sanction économique pour affronter politiquement d'autres nations.
4. Le technoféodalisme sur la scène
Dans un article récent avec Benjamin Braun 32, nous avons détaillé les nombreuses antinomies qui traversent la coalition de Trump, parmi lesquelles la polarité entre nationalisme et internationalisme se distingue. Une grande partie des entreprises américaines, y compris les plus grandes transnationales, les détaillants, la finance traditionnelle et les grandes entreprises technologiques, se méfient de toute forme d'obstacle à leurs opérations mondiales. Plus généralement, il y a un manque de médiation politique entre la faction MAGA et les différentes factions du capital. En conséquence, le processus décisionnel de l'administration est très erratique et la situation globale est politiquement instable. Pour éviter que des conflits trop importants ne s'ouvrent ou pour raviver le soutien populaire, il existe une probabilité non négligeable d'une radicalisation à droite du régime américain ou d'une agression extérieure ouverte contre un voisin ou contre la Chine pour provoquer une mobilisation autour du drapeau, quelque chose de terriblement proche du fascisme ou d'une guerre à grande échelle au sens littéral.
Mais la perspective du capitalisme tardif nous invite à regarder les événements actuels à travers le prisme des relations entre le changement technologique et les relations de production. Plus précisément, en suivant l'intuition de Mandel, nous devrions explorer le caractère troublant de la tendance à l'hypersocialisation et à l'automatisation des relations capitalistes. Compte tenu du manque de perspectives immédiates pour le socialisme, nous devons faire face à la possibilité d'une régression régressive du capitalisme, ce que j'ai appelé l'hypothèse techno-féodale..
Le principal symptôme d'une telle métamorphose serait une déstabilisation de l'autonomie politique relative de l'État sous la domination du capital numérique. La tendance générale est la suivante : 1) la monopolisation du savoir va de pair avec la centralisation des moyens algorithmiques de coordination des activités humaines, c'est-à-dire l'hypersocialisation ; 2) en l'absence de contrepoids de la part du pouvoir public, cela entraîne le déplacement du pouvoir d'organiser la société entre les mains des grandes entreprises technologiques ; 3) Le corollaire est la capacité extraordinaire et croissante de ces acteurs privés à influencer le comportement individuel et collectif et, par conséquent, à remplacer les relations de marché par des relations néo-fiscales.
Cette section suit cette hypothèse pour interpréter l'empreinte toujours croissante du secteur technologique qui existe déjà aux États-Unis. Avec le démantèlement de la mondialisation évoqué ci-dessus, il s'agit du changement le plus significatif qui a lieu, car le secteur technologique acquiert des attributs cruciaux du pouvoir de l'État et remplace la finance comme structure dominante.
Carte blanche pour l'IA
Un indice spectaculaire de cette tendance a déjà été donné le 20 janvier 2025, jour de l'inauguration 34. Après une cérémonie à laquelle assistaient les hauts dirigeants du secteur technologique, Trump a signé une série de décrets exécutifs, dont la révocation d'un mandat de l'ère Biden qui exigeait que « les développeurs de systèmes d'IA présentant un risque pour la sécurité nationale, l'économie, la santé ou la sécurité publique des États-Unis communiquent les résultats des tests de sécurité avec le gouvernement américain » 35. Alors que les autorités publiques avaient auparavant une certaine influence sur les développements à la frontière de l'IA, cette supervision minimale a désormais été supprimée. La philosophie de l'administration sur cette question est sans équivoque, comme l'a précisé le vice-président J. D. Vance : « Nous pensons qu'une régulation excessive du secteur de l'IA pourrait anéantir une industrie transformatrice alors qu'elle décolle, et nous ferons tout notre possible pour encourager des politiques d'IA favorables à la croissance. ». Le spectre de la Chine à la tête de la course est généralement cité comme justification. Dans ce contexte, les entreprises technologiques ont tenté d'obtenir un moratoire de dix ans sur la régulation de l'IA au niveau des États grâce au projet de loi One Big Beautiful. Ils n'ont pas réussi, mais ils poussent pour des mesures fédérales visant à établir des normes les protégeant de la surveillance publique au niveau de l'État 37.
Au-delà des vicissitudes, l'élément décisif est que l'administration présidentielle et la majorité républicaine sont convaincues que la technologie la plus perturbatrice de notre époque n'a pas besoin d'une régulation stricte, malgré les nombreux avertissements sur l'impact qu'elle peut avoir sur la sphère publique, sur les marchés du travail, sur la santé, etc. en créativité et en sécurité en général. La véritable menace n'est pas la fantaisie d'une intelligence artificielle générale (AGI), mais plutôt une prédation généralisée et une instrumentalisation généralisée de l'intellect général 38. Si l'automatisation du travail intellectuel entraînerait une grande disqualification de la main-d'œuvre et de la population en général, poursuivre sur la voie actuelle de la monopolisation du savoir et du contrôle privé des moyens automatisés de coordination sociale conduirait à une concentration massive de richesse et de pouvoir politique. similaire à celle de l'État, dans une poignée de mégacorporations technologiques.
Contrôle de la gestion
À ce sujet, l'annonce de la création du Département de l'Efficacité Gouvernementale (DOGE), dirigé par Elon Musk, était une seconde indication de l'expérimentation d'une nouvelle forme d'articulation entre la technologie et l'État. La première initiative reposait sur une réorganisation des services numériques américains, créée sous Obama pour intégrer les systèmes d'information entre les différentes branches du gouvernement fédéral. Cela a permis au DOGE d'avoir un accès quasi illimité aux données non classifiées de toutes les agences gouvernementales. Sa première mission était de « réformer le processus de contrat fédéral et de restaurer le mérite dans la fonction publique », en veillant à ce que les employés de l'État aient « un engagement envers les idéaux, valeurs et intérêts américains » et « servent loyalement le pouvoir exécutif ».. En affirmant que ce plan « intégrerait les technologies modernes », cet ordre encourageait l'intégration de machines pour la supervision politique des responsables fédéraux. Le départ d'Elon Musk après sa confrontation publique avec le président des États-Unis n'a pas mis fin à l'attaque contre les organismes publics. La Cour suprême a autorisé les licenciements massifs initiés par le DOGE, et les technologues inexpérimentés continuent d'opérer dans tous les organismes gouvernementaux et de pousser pour un déploiement maladroit des outils d'IA 40.
Il n'existe pas de tour magique technologique pour simplifier le processus administratif, et beaucoup de personnes aux États-Unis considèrent que les mesures prises sont très préjudiciables aux capacités de l'État américain. Il est encore trop tôt pour évaluer l'étendue de l'empreinte technologique privée dans les opérations gouvernementales et dans quelle mesure elle affecte l'intégrité du processus administratif. Cependant, les premiers signes suggèrent qu'il est très profond et que le risque de violations de données n'est pas négligeable. Selon le New York Times, suite à la mise en œuvre de DOGE, des entreprises technologiques telles que Palantir ont remporté plusieurs contrats, notamment avec l'IRS, qui est responsable de la collecte des impôts, de la Sécurité sociale et de l'ICE. Les outils mis en œuvre dans ces différentes branches du gouvernement peuvent facilement être utilisés pour consolider les données et être utilisés contre les droits humains et politiques fondamentaux 41.
D'autres informations suggèrent que le DOGE n'est pas un cas isolé. La nomination de quatre cadres supérieurs de Meta, Palantir, Open AI et Thinking Machines Lab en tant que commandants supérieurs de l'Armée est une décision très inhabituelle à l'ère moderne, car ils ont reçu des uniformes pour des cadres supérieurs du secteur privé. Selon Military.com, un site spécialisé, l'initiative « s'annonce comme un point chaud, le dernier signe de la relation croissante de l'armée avec la Silicon Valley, un lien qui s'intensifie rapidement et devient une préoccupation croissante pour les législateurs préoccupés par l'influence et le lobbying des grandes entreprises technologiques. ». Le développement de l'IA aux États-Unis est étroitement lié à l'appareil de sécurité nationale américain, mais les capacités de planification des grandes entreprises technologiques semblent prendre l'avantage 43.
Le pouvoir monétaire émergent de la technologie
L'assouplissement de la supervision administrative sur l'IA et l'empreinte croissante des entreprises technologiques dans le processus administratif américain sont deux signes partiels d'un processus émergent de colonisation privée du pouvoir étatique. Cependant, ces éléments, bien que significatifs, sont trop préliminaires et partiaux pour être décisifs. On peut dire que le changement le plus significatif se produit dans le domaine monétaire.
Au cours du premier semestre 2025, le statut du dollar américain en tant que devise de réserve mondiale incontestée, ce que les marxistes appelaient la monnaie mondiale 44, a été gravement endommagé. En février dernier, le directeur des investissements du gestionnaire d'actifs français Amundi a déclaré : « De plus en plus de choses sont prises et pourraient commencer à éroder la confiance. Et, au final, le statut du dollar américain est aussi lié à ceci : la confiance dans le système américain, dans la Réserve fédérale, dans l'économie américaine. » . Dans les semaines qui suivirent, cette menace à peine voilée commença à se matérialiser avec plusieurs épisodes de tensions sur les marchés boursiers et obligataires ainsi qu'un recul du dollar.
Puisque l'administration entend affaiblir la valeur du dollar, c'est une caractéristique de sa politique, pas une erreur. Pendant ce temps, elle mise sur ce qu'Eric Monnet a qualifié de cryptomercantilisme 46 pour préserver la centralité du système du dollar. La loi GENIUS crée un cadre réglementaire pour remplacer le système traditionnel du dollar par des stablecoins indexés au dollar. Pour Scott Bessent, secrétaire au Trésor des États-Unis, « les cryptomonnaies ne représentent pas une menace pour le dollar. En fait, les stablecoins peuvent renforcer la suprématie du dollar », car ils pourraient devenir l'un des plus grands acheteurs de Treasuries américains 47. L'objectif est de préserver la centralité du dollar et de soutenir la demande pour les obligations d'État américaines sans renforcer le dollar.
Cependant, il n'est pas certain que ce plan réussira, et il n'existe pas de substitut évident au dollar comme monnaie de réserve mondiale ; Ni l'euro, ni le renminbi, ni l'or, ni les cryptomonnaies ne sont à la hauteur pour l'instant. Cela suggère que nous nous dirigeons vers un monde sans actif sûr à l'échelle mondiale, une configuration qui augmentera l'instabilité financière, tant au niveau national qu'international, ainsi que la fragmentation du système financier mondial 48.
Certains indices indiquent que le nouveau système monétaire international émergent conduira probablement à la « montée des zones de monnaie numérique structurées autour de l'interconnexion technologique ». Dans ce contexte, les plateformes sociales et commerciales dominantes sont bien équipées pour contester le pouvoir monétaire de l'autorité publique et contourner les frontières nationales. En fait, puisque le degré de liquidité est le facteur le plus important de la monétarité, les entités dont l'infrastructure numérique peut transmettre plus de transactions deviendraient les grands gagnants ; Les devises proposées par les plateformes transnationales pourraient devenir de plus en plus attractives, les plaçant au sommet de la hiérarchie monétaire mondiale. Des entreprises comme Amazon, Wal-Mart, Facebook et X élaborent des plans pour développer leurs propres stablecoins, et il n'est pas difficile d'imaginer comment une augmentation des participations dans ces portefeuilles d'entreprises pourrait entraîner une substitution de la monnaie, entraînant une perte de contrôle par de nombreuses banques centrales et régulateurs à travers le monde sur leur système financier et, En fin de compte, sur leurs économies.
Dès 2021, Benoît Coeuré, alors membre de la Banque des règlements internationaux, l'a dit franchement : en matière de monnaie numérique, « la mère de toutes les questions politiques n'est pas la concurrence internationale, mais l'équilibre des pouvoirs entre gouvernements et les grandes entreprises technologiques dans la définition de l'avenir des paiements et des droits et du contrôle des données » 50. Avec sa stratégie crypto, l'administration américaine souhaite que l'État puisse gagner la concurrence internationale en promouvant les stablecoins des grandes entreprises technologiques sans perdre son pouvoir monétaire ultime au profit d'acteurs privés. Il reste à voir si l'État américain sera capable de contrôler les futures bêtes monétaires. Mais il ne fait aucun doute que les entreprises technologiques privées sont sur le point d'ajouter une nouvelle couche de pouvoir souverain à leurs capacités déjà bien dotées de type étatique.
5. Ouvertures
Les orientations prises par l'administration Trump et la manière dont elles influencent la configuration capitaliste ont été examinées en trois aspects. Premièrement, les classes dirigeantes américaines profitent de cette occasion pour consolider leur pouvoir de classe avec d'énormes gains fiscaux, la répression de la gauche et la compression de la revendication ouvrière. Deuxièmement, l'agenda nationaliste a désavantagé de nombreuses factions du capital, en particulier celles dont les opérations et les profits dépendent des chaînes d'approvisionnement mondiales, de la main-d'œuvre migrante, des opérations en Chine ou du rôle du dollar comme atout refuge. Cependant, alors que l'administration semble ajuster son agenda pour répondre à ces demandes commerciales, la vision nationaliste globale qu'elle exprime et sa position confrontante avec la Chine sont incompatibles avec la perspective mondiale du capital et conduisent à un remaniement majeur des relations internationales. Cependant, il est clair que certains segments, dans le secteur de la défense et la finance privée, se positionnent pour en tirer profit. Enfin, la technologie accélère leur différenciation entre les capitaux et leur appropriation des attributs de l'État, créant et déployant des capacités sur lesquelles les gouvernements en général dépendent de plus en plus. Sur ce point, les développements actuels aux États-Unis suggèrent que, contrairement à la Chine, il n'y a aucune volonté de freiner ce pouvoir par une surveillance publique stricte. Bien au contraire, en fait.
Du point de vue de Late Capitalism d'Ernest Mandel, la signification de Trump est profondément ambivalente. D'une part, cela confirme que le capitalisme ne se régénère pas, mais, comme Mandel l'avait anticipé, il vieillit, ce qui signifie une perte systémique de dynamisme qui accélère les tensions de multiples façons. La brutalité est le symptôme d'une impasse : l'échec à faire avancer les promesses des bénéfices partagés de la modernisation, alimentant un tournant vers un dangereux jeu à somme nulle. À une époque où les catastrophes climatiques s'accélèrent, le déni de la perturbation écologique doit être interprété comme un simple renonciement à l'avenir capitaliste. En fait, comme l'indique un membre du conseil d'administration d'Allianz, « une fois que nous atteignons 3°C de réchauffement (...) Le risque ne peut pas être transféré (il n'y aura pas d'assurance), il ne peut pas être absorbé (il n'y aura pas de capacité publique) et il ne peut pas être adapté (les limites physiques seront dépassées (...). Le secteur financier tel que nous le connaissons cessera de fonctionner. Et avec lui, le capitalisme tel que nous le connaissons cessera d'être viable » 51.
Cet agenda réactionnaire est un accélérateur de catastrophes qui non seulement s'oppose brutalement aux intérêts immédiats de la classe ouvrière, mais constitue aussi une attaque contre la dignité humaine. On peut en dire autant du groupe social ultra-restreint des capitalistes technologiques qui, avec la finance privée, constituent la faction la plus active du capital soutenant l'agenda de Trump et bénéficiant le plus des mesures structurelles de cette administration. Encore plus dangereux, cependant, cette partie de l'expérience de Trump n'est pas strictement réactionnaire, mais plutôt visionnaire au sens dystopique. Son féodalisme technologique est une réponse à la conclusion de Mandel sur la contradiction au sein du capitalisme qui découle de l'hypersocialisation dans le capitalisme tardif. Il espérait de nouvelles relations émancipatrices de production, mais celles-ci évoluent vers une déplacement du marché mondial mené par les entreprises vers des fiefs numériques privés hautement intégrés en interne.
Stratégiquement, cette nouvelle situation constitue une défaite majeure pour les libéraux mondiaux, dont le triomphe des dernières décennies a donné naissance à cette terrible situation politique. Au contraire, c'est un grand succès pour la gauche socialiste dans sa version du Parti communiste chinois. Cette organisation est le seul organisme politique, avec l'Église catholique, à articuler, d'une part, une vision à long terme pour un plus grand épanouissement humain et, d'autre part, une réelle capacité à influencer le cours de l'histoire. Pour la gauche démocrate occidentale, les implications sont claires. D'abord, elle doit initier ou soutenir des fronts contre la réaction de Trump et ses vicissitudes ailleurs, contribuant à la construction de blocs sociaux nationaux qui articulent la défense des intérêts des classes populaires, ainsi que des droits démocratiques et l'engagement envers une civilisation écologique. Ce dernier représente une affinité politique sur laquelle se construire en faveur d'une position coopérative avec la Chine. Et c'est la deuxième tâche, qui vise à la fois à désamorcer immédiatement les tensions géopolitiques et à poser les bases d'une coopération sur des questions urgentes d'écologie, de santé et de développement au niveau mondial. Enfin, mais avec beaucoup de chevauchement, la gauche doit retrouver les capacités de l'État en défendant le principe de souveraineté numérique pour les peuples et la planète 52. Si elles ne sont pas rapidement contrées, la monopolisation des capacités de savoir et de coordination par les grandes entreprises technologiques privera bientôt les institutions politiques de toute pertinence.
Comme l'indiquent ces éléments brèfs, le capitalisme est allé trop loin. Il est trop tard pour leur revitalisation. Le paradoxe est que, bien que les forces socialistes subjectives en Occident soient historiquement faibles, la radicalisation à droite, la trajectoire des libéraux et le succès de la Chine ouvrent un immense espace à la politique socialiste.
Juillet 2025
Cédric Durand est économiste, professeur à l'Université de Paris XIII et auteur de Techno-féodalisme. Critique de l'économie numérique.
*Nous remercions Socialist Register de nous avoir permis de co-publier cet article qui paraîtra dans son magazine de novembre.
Notes
1. Ernest Mandel (2023) El capitalismo tardío, Verso, Sylone, viento sur, p. 226,
2. Idem., p. 228.
3. Idem., pp. 315, 316
4. Idem., p. 316.
5. Grossman, Henryk “W. Playfair, the Earliest Theorist of Capitalist Development,” The Economic History Review 18, no. 1/2 (1948) : 70, https://doi.org/10.2307/2590263.
6. Arrighi, Giovanni (2010) The Long Twentieth Century : Money, Power, and the Origins of Our Times. Londres : Nueva York : Verso, p. 89.
7. Braudel, Fernand (1984) Civilization and Capitalism, 15th-18th Century. Berkeley : University of California Press, pp. 246 y 266–67.
8. Braun, Benjamin y Durand, Cédric (2025) “America´s Braudelien automn”, in https://www.phenomenalworld.org/analysis/americas-braudelian-autumn/, mayo de 2025.
9. Miran, Stephen (2024) “A User's Guide to Restructuring the Global Trading System,” Hudson Bay Capital, 11 de diciembre, https://www.hudsonbaycapital.com/our_research.
10. Durand, Cédric, Alfageme, Ayoze y Grothe, Simon (2025) “How a Minskyan Supercycle Ends” UNIGE Political Economy WP, núm. 2/2025 (8 de julio), https://archive-ouverte.unige.ch/unige:186122.
11. Goldman Sachs (2024) “Market Concentration : How Big a Worry ?” Top of Mind, 25 de noviembre, 8. https://www.goldmansachs.com/insights/top-of-mind/market-concentration-how-big-a-worry
12. Garcia López, Gerardo Israel ; Stracca, Livio y Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, eds., (2021) Changing Patterns of Capital Flows, CGFS Papers, no 66 (Basel : Bank for International Settlements)
13. Aiyar, Shekhar et al. (2023) Geoeconomic Fragmentation and the Future of Multilateralism, Staff Discussion Notes (Washington, D.C : International Monetary Fund,), 6, https://doi.org/10.5089/9798400229046.006.
14. Brenner, Robert (2006) The Economics of Global Turbulence, Londres : Verso.
15. Michal Kalecki (1943), “Aspectos politicos del pleno empleo” http://www.olafinanciera.unam.mx/new_web/21/pdfs/KaleckiOlaFinanciera21.pdf.
16. Nangle, Toby (2025) “Where Have All the Risk Premia Gone ?”, Financial Times, 8 de julio, sec. FT Alphaville, https://www.ft.com/content/89fb657c-3829-4c32-b6ea-310d4f288b8e.
17. Trump, Donald (2024) “Discourse to the NRA Leadership Forum in Dallas” Roll Call Factba.Se (blog), 18 de mayo, https://rollcall.com/factbase/trump/transcript/donald-trump-speech-nra-leadership-forum-dallas-may-18-2024
18. Douthat, Ross y Andreessen, Marc (2025) “How Democrats Drove Silicon Valley Into Trump's Arms” The New York Times, 17 de enero, sec. Opinion, https://www.nytimes.com/2025/01/17/opinion/marc-andreessentrump-silicon-valley.html.
19. Hopewell, Kristen (2024) “The (Surprise) Return of Development Policy Space in the Multilateral Trading System : What the WTO Appellate Body Blockage Means for the Developmental State”, Review of International Political Economy 31, no. 4, p. : 1246.
20. Yalcin, Erdal et al. (2025) “The Global Sanctions Data Base-Release 4 : The Heterogeneous Effects of the Sanctions on Russia” The World Economy, 2025.
21. Gindin, Sam y Panitch, Leo (2012) The Making of Global Capitalism : The Political Economy of American Empire, Londres : Brooklyn, NY : Verso).
22. Borrett, Amy et al. (2025) ‘The End of an Era' What next for Global Trade ?” Financial Times, 11 de abril, sec. The Big Read, https://www.ft.com/content/b28f93fa-cdc7-4830-bd36-21e66d824335.
23. Trump, Donald (2025) “Transcript of President Trump Remarks at Liberation Day Event (2 de abril),” The Singju Post (blog), 3 de abril, https://singjupost.com/transcript-of-president-trump-remarks-at-liberation-dayevent-april-2-2025/.
24. Miran, “A User's Guide to Restructuring the Global Trading System”
25. Fu, Xiaolan y Ghauri, Pervez (2021) “Trade in Intangibles and the Global Trade Imbalance” The World Economy 44, no. 5, pp) : 1448–69.
26. Rodrik, Dani (2018) “What Do Trade Agreements Really Do ?” National Bureau of Economic Research ; Durand, Cédrid y Milberg, William (2020) “Intellectual Monopoly in Global Value Chains” Review of International Political Economy 27, no. 2, 3 de marzo, pp. 404–29, https://doi.org/10.1080/09692290.2019.1660703.
27. Ali, Mona (2016) “Global Imbalances and Asymmetric Returns to US Foreign Assets : Fitting the Missing Pieces of the US Balance of Payments Puzzle” International Review of Applied Economics 30, no. 2, 3 de marzo, pp. 167–87, https://doi.org/10.1080/02692171.2015.1085002.
28. Rey, Hélène (2025) “How Europe Should Respond to the Erosion of the Dollar's Status” Financial Times, 7 de mayo, sec. Markets Insight, https://www.ft.com/content/5bc02699-3eda-465b-bd73-f5e8b9573ae8.
29. Bürbaumer, Benjamin (2024) Chine/États-Unis. Le Capitalisme Contre La Mondialisation, Paris : La Découverte.
30. US Department of Defense (2025) “Background Briefing on FY 2026 Defense Budget”, U.S. Department of Defense, 26 de junio, https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/4228828/backgroundbriefing-on-fy-2026-defensebudget/ https%3A%2F%2Fwww.defense.gov%2FNews%2FTranscripts%2FTranscript%2FArticle%2F4228828%2Fbackground-briefing-on-fy-2026-defense-budget%2F ; Valerie Insinna, “Congress Passes Trump's Reconciliation Megabill with $150B for Defense”, Breaking Defense (blog), 3 de julio, 2025, https://breakingdefense.com/2025/07/congress-passes-trumps-reconciliation-megabill-with-150b-for-defense/.
31. Bade, Gavin (2025) “Trump to Impose 50% Brazil Tariff, Citing Bolsonaro Trial-WSJ”, 9 de julio, https://www.wsj.com/world/americas/trump-threatens-50-brazil-tariff-citing-bolsonaro-trial-93a95e7b.
32. Braun, Benjamin y Durand, Cédric (2025) “America's Braudelian Autumn” Phenomenal World (blog), 29 de mayo, https://www.phenomenalworld.org/analysis/americas-braudelian-autumn
33. Durand, Cédric (2024) How Silicon Valley Unleashed Technofeudalism, Londres y Nueva-York : Verso.
34. Durand, Cédric (2025) “Fragile Leviathan ?,” NLR/Sidecar, 30 de enero, https://newleftreview.org/sidecar/posts/fragile-leviathan.
35. Mason, Jeff et al. (2023) “Biden Administration Aims to Cut AI Risks with Executive Order” Reuters, 30 de octubre, sec. Technology, https://www.reuters.com/technology/white-house-unveils-wide-ranging-action-mitigateai-risks-2023-10-30/.
36. Levy, Steven (2025) “How the Loudest Voices in AI Went From Regulate Us to Unleash Us” Wired, 30 de mayo, https://www.wired.com/story/plaintext-sam-altman-ai-regulation-trump/.
37. Loten, Angus (2025) “After Setback, Tech Firms Renew Push for Federal AI Regulation” Wall Street Journal, 9 de julio, sec. WSJ Pro, https://www.wsj.com/articles/after-setback-tech-firms-renew-push-for-federal-airegulation-cc2b26d5.
38. Pasquinelli, Matteo ; Alaimo, Cristina y Gandini, Alessandro (2024)“AI at Work : Automation, Distributed Cognition, and Cultural Embeddedness” Tecnoscienza 15, no. 1, 15 de julio, pp. 99–131, https://doi.org/10.6092/ISSN.2038-3460/20010.
39. US President Donald Trump (2025) “Reforming The Federal Hiring Process And Restoring Merit To Government Service”, https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/reforming-the-federal-hiring-processand-restoring-merit-to-government-service/.
40. Kelly, Makena (2025) “This Is DOGE 2.0”, Wired, 10 de julio, https://www.wired.com/story/next-stage-dogeelon-musk/ ; Palma, Stefania y Chazan, Guy (2025) “Supreme Court Allows Donald Trump's Plan for Mass Government Lay-Offs to Proceed”, Financial Times, 8 de julio, sec. US politics & policy, https://www.ft.com/content/e2f268f6-e3ac-47fc-94c7-16ee6e40d18a.
41. Frenkel , Sheera et al. (2025), “Trump Taps Palantir to Compile Data on Americans”, The New York Times, 30 de mayo, sec. Technology, https://www.nytimes.com/2025/05/30/technology/trump-palantir-data-americans.html ; Emily Badger, Emily y Frenkel, Sheera (2025) “Trump Wants to Merge Government Data. Here Are 314 Things It Might Know About You”, The New York Times, 9 de abril, sec. U.S.,

Russie. Le capital contre les sanctions

Pourquoi les technologies occidentales continuent-elles d'alimenter la machine de guerre russe malgré des sanctions radicales ? S'agit-il d'une question de failles — ou de la preuve que le capital mondial lui-même échappe à l'emprise des gouvernements ? Pourquoi le système économique mondial est-il devenu, bien que involontairement, l'allié le plus fiable de l'agresseur ?
29 novembre 2025 | tiré du site Entre les lignes entre les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/11/29/russie-le-capital-contre-les-sanctions/
Des sanctions radicales étaient censées paralyser la machine de guerre russe. Mais la logique du capital s'est révélée plus forte que la volonté des États, tissant des réseaux invisibles qui contournent les restrictions. Ce faisant, la coalition occidentale a involontairement conçu un système opérationnel quasi parfait pour ses ennemis.
Lorsqu'un missile de croisière Kalibr [1] russe frappe une ville ukrainienne, les enquêteurs qui fouillent les décombres trouvent souvent des puces électroniques de guidage fabriquées à Austin, au Texas, ou à Munich, en Allemagne. Ces composants de haute technologie étaient destinés à des contrôleurs industriels et à l'électronique grand public et n'étaient jamais censés finir à l'intérieur d'armes russes. Pourtant, ils y sont.
Ces puces ont parcouru un long chemin — des chaînes d'assemblage américaines aux restes carbonisés de missiles tombés sur Mykolaïv, Kyïv ou Kharkiv. Leur trajectoire raconte une histoire plus large : comment le régime de sanctions le « plus complet » de l'histoire moderne n'a pas réussi à arrêter la machine de guerre russe. Au contraire, il a forcé l'adaptation, le regroupement et un tournant vers les zones grises de la mondialisation. C'est une histoire sur la façon dont la géopolitique étatique entre en collision avec la règle fondamentale du système même qu'elle a créé. Dans la logique du capital, il n'y a pas de patrie, et le profit est le seul impératif.
Depuis février 2022, la coalition occidentale a cherché à couper la Russie de l'architecture financière mondiale. L'idée, née dans les think tanks de Washington et de Bruxelles, était à la fois simple et élégante. En contrôlant les « centres nerveux » de la mondialisation — systèmes de paiement internationaux, marchés de l'assurance et chaînes d'approvisionnement de haute technologie — l'Occident pourrait déclencher un effondrement économique rapide en Russie et mettre fin à la guerre.
C'était un choix pragmatique : frapper l'économie de l'agresseur demeurait la seule alternative puissante à l'intervention militaire directe. Pourtant, la stratégie reposait sur une foi technocratique selon laquelle un monde construit sur le libre-échange pourrait être mis en pause d'une simple pression sur un bouton. La croyance que les gouvernements conduisent encore les flux du commerce mondial comme un chef d'orchestre dirige une symphonie était, au fond, une illusion néolibérale.
La stratégie a échoué à cause du système même que l'Occident lui-même a passé un demi-siècle à construire — un système optimisé pour échapper aux réglementations nationales, minimiser la fiscalité et dissimuler les bénéficiaires ultimes. Au fil des décennies, l'accumulation de capital est devenue inséparable d'un abandon systématique de l'identité nationale. Une société transnationale dont le siège est dans la Silicon Valley paie des impôts en Irlande, fabrique ses produits en Chine à partir de composants taïwanais et les vend dans le monde entier. Son allégeance ne va pas à un drapeau, mais à ses actionnaires ; sa seule mission est le profit.
Les sanctions ne sont pas un interrupteur marche/arrêt qui arrête le flux du commerce. Elles ressemblent davantage à un barrage : l'eau s'accumule, cherchant de nouveaux canaux à travers lesquels elle peut se déverser — en l'occurrence, vers des profits extraordinaires. Il y aura toujours un acteur économique — une entreprise dans un pays tiers, un négociant transnational ou un intermédiaire financier — pour qui la prime de risque en vaut la peine. Il ne s'agit pas nécessairement de malveillance ou d'alignement idéologique. D'un point de vue commercial, il s'agit simplement d'exploiter une opportunité de marché. Le régime de sanctions a, involontairement, engendré son propre reflet inversé — une économie parallèle spécialisée dans le contournement des restrictions.
Au lieu de parler de « failles », il est plus productif de considérer ce phénomène comme un réseau d'opportunités d'arbitrage — des profits extraits des différences de prix, d'accès et de conditions créées artificiellement par les sanctions. Cette adaptation se déploie selon trois axes principaux : le déplacement de juridictions, la construction de logistiques alternatives et la manipulation du statut juridique des marchandises.
La géographie du profit
Au cœur de la plupart des systèmes de contournement des sanctions se trouve l'arbitrage juridictionnel, une pratique particulièrement répandue dans des pays comme le Kazakhstan, l'Arménie et le Kirghizistan, qui apparaissent désormais à l'Occident comme les « complices » de la Russie. Leur comportement reflète un mélange complexe de nécessité économique, de peur de Moscou, d'inquiétude face aux sanctions secondaires occidentales et d'un désir de capitaliser sur un moment historique pour s'enrichir.
Pour de nombreux entrepreneurs de ces régions, opérer dans la « zone grise » est depuis longtemps une pratique courante ; les sanctions ont simplement créé un nouveau marché lucratif pour ces compétences familières. L'exemple le plus clair est la réexportation d'électronique. Selon un rapport de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) [2], les exportations de l'UE et des États-Unis vers l'Arménie et le Kirghizistan ont augmenté de 80 à 100 pour cent en 2022-2023. Cette hausse correspond presque parfaitement à l'augmentation des exportations des mêmes catégories de produits de ces pays vers la Russie.
Lorsque le Kazakhstan, un pays sans industrie d'appareils électroménagers, commence soudainement à expédier des centaines de milliers de machines à laver vers la Russie, comme l'a documenté Bloomberg, il est évident qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle obsession nationale pour la propreté. Ce qui se passe réellement est une forme de « cannibalisme de composants » — l'extraction massive de micropuces occidentales de biens de consommation pour les réutiliser dans des applications militaires.
La même logique s'applique aux symboles de statut convoités par l'élite russe. Après que Mercedes-Benz, BMW et Audi ont officiellement quitté le marché russe, les salles d'exposition de luxe de Moscou ne sont pas restées vides. Les routes d'approvisionnement directes ont été rapidement remplacées par des circuits tortueux passant par Bichkek, Erevan et Dubaï. Selon l'Office fédéral allemand de la statistique, les exportations de voitures d'Allemagne vers le Kirghizistan ont bondi de près de 5 500 pour cent en 2022 par rapport à l'année précédente. Pour les consommateurs finaux à Moscou, seules deux choses ont changé : les prix ont augmenté de 50 à 100 pour cent et les garanties officielles ont disparu. Mais pour la clientèle aisée déterminée à préserver son mode de vie d'avant-guerre, c'était un prix acceptable à payer. Le système de marché ne peut ignorer une telle demande solvable ; des intermédiaires apparaissent inévitablement, pavant des routes alternatives, même si elles sont plus coûteuses.
Le commerce nécessite à la fois de l'argent et des entités juridiques. La réponse à l'isolement financier de la Russie a été une migration massive d'entreprises vers des juridictions offrant une combinaison rare : une infrastructure financière développée et une neutralité politique. Le principal bénéficiaire a été les Émirats arabes unis (EAU). Le commerce bilatéral entre la Russie et les EAU a grimpé de 68 pour cent en 2022, atteignant un record de 9 milliards de dollars (environ 8,5 milliards d'euros).
Typiquement, une société intermédiaire basée à Dubaï et enregistrée dans l'une des zones économiques franches de l'émirat agit à la fois comme « blanchisseur » financier et juridique. Elle reçoit des paiements de Russie (souvent en roubles ou en yuans), les convertit en dirhams puis en euros, et règle les factures avec des fournisseurs européens en son propre nom. Pour le système financier occidental, qui ne voit qu'une transaction provenant d'une contrepartie émiratie légitime, tout semble parfaitement légal.
La flotte fantôme
Lorsque la politique ferme les routes traditionnelles, le capital ne se contente pas de trouver des détours ; il construit sa propre infrastructure parallèle. L'exemple le plus clair de cela est apparu en réponse au « plafonnement des prix » [3] du G7 sur le pétrole russe. Le mécanisme était conçu pour couper Moscou du marché mondial de l'assurance maritime, largement contrôlé par des entreprises à Londres et dans l'Union européenne. L'hypothèse était simple : sans assurance, aucun port réputé n'accepterait un pétrolier, et le pétrole russe serait bloqué.
Au lieu de cela, une « flotte fantôme » est née. Il ne s'agit pas d'une poignée de navires pirates, mais d'un écosystème entier. À partir de 2022, le marché mondial des navires d'occasion s'est emballé. Des dizaines, puis des centaines de pétroliers vieillissants — des navires habituellement destinés à la démolition — ont été rachetés par des sociétés nouvellement créées, souvent anonymes, enregistrées à Dubaï ou à Hong Kong. Selon les estimations du Conseil de l'Atlantique [4], cette flotte compte désormais plus de six cents navires.
Ces pétroliers opèrent selon leurs propres règles, loin de toute surveillance réglementaire. Ils désactivent régulièrement leurs systèmes d'identification automatique pendant des semaines pour obscurcir leurs routes et effectuent des transferts de pétrole de navire à navire en eaux internationales, transformant certaines zones des océans du monde en vastes dépôts flottants. Durant ces transferts, le brut russe est mélangé à d'autres qualités de pétrole, blanchissant effectivement ses origines. Le résultat est un produit anonyme, « mélange letton » ou « mélange méditerranéen », qui peut être vendu librement dans les ports du monde entier.
Tout comme la flotte fantôme a émergé, un système financier parallèle est également apparu. La déconnexion des principales banques russes de SWIFT [5] était censée déclencher un effondrement financier. Mais SWIFT n'est qu'une plateforme de messagerie, pas un système de paiement en soi. Les flux financiers ont rapidement creusé de nouveaux canaux. Le yuan chinois est rapidement devenu le principal instrument de la Russie pour les règlements du commerce extérieur, dépassant le dollar en volume de transactions sur la Bourse de Moscou dans l'année suivant l'invasion.
Pour les transactions avec l'Occident, la Russie s'appuie sur un réseau tentaculaire de banques intermédiaires dans des juridictions amies. Un importateur russe envoie des roubles à une banque au, disons, Kirghizistan. Cette banque, toujours connectée à SWIFT, convertit les fonds et transfère des euros à un fournisseur allemand. Chaque participant à cette chaîne prend une commission ; le coût augmente, mais le paiement passe.
La double vie des choses
Le type de contournement des sanctions le plus insaisissable est l'arbitrage de marchandises. Il n'exploite pas les frontières géographiques ou juridiques, mais la nature même des biens modernes dans une économie mondialisée. Il manipule la réponse à une question apparemment simple : « Qu'est-ce que nous vendons exactement ? »
C'est ainsi que la microélectronique occidentale continue d'alimenter l'industrie de défense russe. Des analystes du Royal United Services Institute [6] ont examiné 27 systèmes d'armes russes capturés en Ukraine. Leur rapport a documenté plus de 450 composants étrangers uniques trouvés dans des missiles de croisière Kalibr, des drones Orlan-10 [7] et des systèmes de guerre électronique — la plupart produits par des entreprises américaines telles que Texas Instruments, Analog Devices et Altera.
Cela ne signifie pas que ces entreprises violent sciemment les sanctions. Cela révèle plutôt une vulnérabilité fondamentale du système commercial mondial lui-même — un système optimisé pour l'efficacité, pas pour la transparence. Cette structure permet aux risques juridiques et de réputation de passer d'un maillon de la chaîne à l'autre jusqu'à ce qu'ils se dissipent entièrement dans un réseau d'intermédiaires anonymes.
Un fabricant au Texas vend légalement des millions de puces à usage général à un distributeur mondial comme Mouser Electronics. Ce distributeur, à son tour, les vend, également légalement, à des centaines d'intermédiaires régionaux, y compris en Asie. L'un de ces distributeurs régionaux vend un lot de puces à une petite entreprise récemment créée à Hong Kong, qui les inscrit dans les documents douaniers comme « composants pour l'électronique grand public ». Ce n'est qu'à l'étape finale que la puce civile traverse en Russie et finit intégrée dans du matériel militaire. L'arbitrage réside dans l'exploitation de la double nature du produit lui-même : le même composant peut faire fonctionner à la fois une machine à laver et un système de guidage de missile.
Un mécanisme similaire fonctionne dans l'aviation civile, un autre domaine essentiel à la sécurité nationale et à la connectivité économique dans un pays aussi vaste que la Russie. Lorsque Boeing et Airbus ont arrêté la maintenance officielle des avions en 2022, on s'attendait à ce que la flotte russe soit bientôt clouée au sol. Ce ne fut pas le cas. Une enquête de Reuters, basée sur des données douanières, a révélé qu'entre mai 2022 et juin 2023, les compagnies aériennes russes ont importé au moins 1,2 milliard de dollars (environ 1,1 milliard d'euros) de pièces détachées pour leurs avions de fabrication occidentale. Les expéditions transitaient par des sociétés écrans au Tadjikistan, aux EAU, en Turquie, en Chine et au Kirghizistan.
Le marché mondial des pièces détachées d'avions est vaste et fragmenté, et les pénuries créées par les sanctions ont alimenté une volonté de payer presque n'importe quel prix. Cela, à son tour, a attiré un essaim d'intermédiaires du monde entier pour qui les risques politiques sont plus que compensés par des marges bénéficiaires extraordinaires.
Le vrai prix
Bien que le contournement des sanctions démontre la remarquable adaptabilité du capital, il serait faux de conclure que les mesures n'ont eu aucun effet réel sur l'économie russe. Les sanctions fonctionnent — mais leur impact n'est pas l'effondrement immédiat de l'économie russe ; il apparaît plutôt comme une pression graduelle sur les revenus, une inflation systémique des coûts et un déclin technologique qui s'accélère.
Entre 2023 et 2024, les sanctions, y compris le plafonnement des prix du G7, ont à peu près réduit de moitié les revenus pétroliers de la Russie, forçant le Kremlin vers une « économie de guerre » avec des risques croissants d'inflation et de stagflation. Aux moments les plus critiques, les déficits de revenus pétroliers ont atteint jusqu'à 30 pour cent, sapant la capacité du budget à financer le conflit.
Chaque intermédiaire dans une chaîne d'approvisionnement illicite ajoute une majoration supplémentaire. La « prime de risque » et les commissions facturées par les entreprises en Turquie, aux EAU et au Kazakhstan imposent un lourd fardeau à l'économie russe, siphonnant des ressources qui auraient pu être allouées à d'autres priorités.
Une autre conséquence est la dégradation technologique. L'accès aux technologies de pointe est devenu contraint. La pratique de récupération de puces de machines à laver n'est pas tant un triomphe qu'une preuve de dégradation forcée. La production de Lada en 2022 sans airbags ni systèmes de freinage antiblocage n'était qu'une des nombreuses manifestations de ce processus. De nouvelles dépendances émergent également. En se détachant de l'Occident, la Russie est tombée dans de nouveaux liens, tout aussi rigides, avec des États intermédiaires. La Turquie, la Chine et l'Inde peuvent désormais dicter les termes et les prix, sachant à quel point ils sont devenus cruciaux pour la survie de l'économie russe. En bref, le système n'a pas effondré — mais son fonctionnement est devenu plus coûteux et moins efficace.
Contre-mesures
À l'automne 2025, l'efficacité pure de ces contournements — et la prise de conscience qu'ils permettaient à la Russie de continuer à financer sa guerre — ont poussé les stratèges occidentaux à rechercher des instruments de pression plus radicaux. Les architectes des sanctions sont passés de la pression sur la Russie, le producteur, au ciblage du réseau mondial d'intermédiaires et d'utilisateurs finaux qui facilitent le contournement. Cette évolution a été exprimée par Bill Browder [8], critique de longue date du Kremlin, qui a soutenu qu'il était temps d'adresser un ultimatum aux grands raffineurs dans des pays comme l'Inde et la Turquie : arrêtez de traiter le brut russe ou faites face à une exclusion complète des services financiers, d'assurance et de transport maritime occidentaux.
Il ne s'agit plus d'un appel à des sanctions plus sévères en soi ; c'est une tentative de rendre économiquement impossible la participation au blanchiment des revenus de guerre russes. Cette logique a déjà commencé à informer la politique : les nouvelles restrictions de l'UE introduites en 2025 visent à interdire les importations de produits pétroliers raffinés à partir de brut russe, quel que soit le lieu de mélange.
L'objectif de cette phase de la guerre économique est d'acculer la Russie — de la pousser hors du marché « ami » à prix réduit et vers un véritable marché noir avec des remises de 20 à 30 dollars par baril (environ 18-28 euros). En substance, c'est le prochain chapitre de la lutte entre le pouvoir étatique et le capital : un effort direct pour augmenter la prime de risque à un niveau tel que les opportunités d'arbitrage qui ont soutenu l'économie russe deviennent non rentables.
Même ainsi, ces mesures n'arrêteront pas entièrement le pétrole russe d'atteindre les marchés de l'UE. Si des produits raffinés sont importés de pays qui sont eux-mêmes de grands producteurs de pétrole, comme l'Arabie saoudite, l'Irak, les EAU, le Kazakhstan, entre autres, ils seront généralement traités comme d'origine locale, et non comme russes. Cela crée des failles potentielles à travers lesquelles les hydrocarbures russes peuvent encore pénétrer les marchés de l'UE. Ainsi, alors que les sanctions resserrent les contrôles et exigent une documentation d'origine plus rigoureuse, un certain contournement via les pays producteurs peut persister.
Pourtant, les sanctions étatiques ne représentent qu'un front. Une campagne plus silencieuse et moins formelle se déploie : une guerre pour la transparence. Cette lutte n'est pas menée par des gouvernements mais par un réseau décentralisé de journalistes d'investigation, d'activistes anti-corruption et de spécialistes de la finance forensique. Ils n'écrivent pas de lois, mais ils modifient la variable clé du système — le risque de réputation et juridique. En publiant les noms des entreprises intermédiaires, en traçant les routes de la flotte fantôme et en exposant les bénéficiaires ultimes, ils peuvent transformer une affaire lucrative en catastrophe de réputation. Leur travail n'arrête pas directement les flux de capitaux ; il augmente plutôt fortement la prime de risque, rendant de nombreux systèmes d'arbitrage toxiques et économiquement non viables.
Un monde fracturé
Le régime de sanctions mondial est, paradoxalement, devenu un puissant catalyseur de marché, engendrant de nouvelles niches à forte marge pour le capital. Le phénomène du contournement des sanctions a révélé une vérité plus profonde : le système du capitalisme mondial, construit sur l'intégration transnationale, est structurellement incapable d'isoler l'un de ses propres nœuds majeurs. La tentative d'amputation politique d'une économie de la taille de celle de la Russie n'a pas conduit à sa décomposition, mais à l'émergence de « réseaux vasculaires » parallèles.
L'infrastructure construite pour contourner les sanctions — la « flotte fantôme », les corridors financiers via le yuan et le dirham, et les réseaux de sociétés commerciales écrans — n'est pas une solution temporaire. Ce qui prend forme sous nos yeux n'est pas un nouvel ordre mondial au sens classique, mais plutôt un système alternatif durable, dont le cœur économique et technologique est de plus en plus centré en Chine, et qui pourrait, avec le temps, déplacer l'équilibre du pouvoir mondial.
Les sanctions étaient un outil conçu à une époque où les économies étaient plus liées nationalement. Dans la crise actuelle, les États occidentaux ont tenté d'actionner les leviers d'un système qu'ils considéraient autrefois comme le leur, pour découvrir qu'il a depuis longtemps développé sa propre logique, largement indifférente aux objectifs politiques pour lesquels ses mécanismes sont déployés.
C'est précisément cette vulnérabilité structurelle que l'État russe a exploitée. Il n'opère pas comme un empire classique mais comme un acteur hybride dont l'élite dirigeante pense moins en termes d'intérêt national qu'en termes de marges bénéficiaires et de survie du régime. Il a maîtrisé le langage du capital mondial — arbitrage, anonymat offshore et logistique parallèle — et est devenu l'un de ses praticiens les plus cyniques et les plus efficaces, soutenant sa machine de guerre, aussi coûteuse soit-elle, à travers le système même conçu pour la contenir.
Sofron Bliznakov
https://www.posle.media/article/capital-vs-sanctions
Traduit pour ESSF par Adam Novak
https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article77061
Notes
[1] Le Kalibr est une famille de missiles de croisière russes lancés depuis des navires, des sous-marins ou des plateformes terrestres, utilisés notamment pour frapper des cibles en Ukraine.
[2] La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) est une institution financière internationale créée en 1991 pour soutenir le développement économique des pays post-communistes.
[3] Le plafonnement des prix (price cap) est un mécanisme mis en place par le G7 et l'UE en décembre 2022 visant à limiter le prix du pétrole russe à 60 dollars le baril afin de réduire les revenus russes tout en maintenant l'approvisionnement mondial.
[4] Le Conseil de l'Atlantique (Atlantic Council) est un think tank américain de Washington, D.C., axé sur les relations internationales et la politique de sécurité.
[5] SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) est le réseau de messagerie interbancaire mondial qui facilite les transactions financières transfrontalières. La déconnexion des banques russes de SWIFT faisait partie du paquet de sanctions post-février 2022.
[6] Le Royal United Services Institute (RUSI) est un think tank britannique fondé en 1831, spécialisé dans la défense et la sécurité internationale.
[7] L'Orlan-10 est un drone de reconnaissance russe utilisé pour la surveillance et le guidage d'artillerie.
[8] Bill Browder est un financier américano-britannique et activiste des droits de l'homme, devenu un critique virulent du régime de Poutine après la mort de son avocat Sergueï Magnitski en détention en Russie en 2009.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Bloquer le projet de loi maintenant
Le PL1 est présenté comme une loi constitutionnelle pour le Québec dont l'objectif apparent serait une affirmation de l'autonomie de la Nation et de sa souveraineté constitutionnelle. Mais derrière ce récit de souveraineté se cache un coup de massue dans les fondations de l'État de droit et des mécanismes de contre-pouvoirs dont le Québec s'est doté ces 50 dernières années.
Dans cette capsule, nous analysons les principaux enjeux du PL1 et mettons en lumière les risques concrets qu'il fait peser sur l'État de droit, les droits fondamentaux et l'équilibre démocratique au Québec.
Réalisation : Ky Vy Leduc
Recherche et idéation : Amel Zaazaa
Scénarisation : Amel Zaazaa et Manal Drissi
Protagonistes : Amel Zaazaa (OPLJM), Karine Millaire (Projets Autochtones du Québec), Alexandre Petitclerc (LDL), Sara Arsenault (FFQ) et Ramatoulaye Diallo (CCMM-CSN)
Pour lire notre article sur le projet de loi 1, c'est par ici : opljm.org
Cette capsule a été réalisée grâce aux soutiens de :
La ligue des droits et libertés (LDL)
La Fédération des femmes du Québec (FFQ)
Le Conseil central du Montréal métropolitain CSN (CCMM-CSN)
Le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ)
Fédération de la Santé et des Services Sociaux - CSN (FSSS-CSN)
© 2025 Observatoire pour la justice migrante (OPLJM). Tous droits réservés.
Toute reproduction, diffusion, réutilisation, téléchargement, réédition, découpage, adaptation ou traduction de ce contenu, en tout ou en partie, est interdite sans autorisation écrite préalable de l'OPLJM, sauf dans les limites des exceptions prévues par la Loi sur le droit d'auteur (Canada).
Les travailleurs de Maple Leaf à Winnipeg résistent à l’intimidation
Le combat de l’internationalisme contre le campisme : le cas de l’Ukraine
Chili : l’extrême droite obtient 58 % des voix, alors que la gauche récolte 42 %
Un LOUPerivois dans la bergerie : La poésie m’a sauvé la vie
Vers le FSM 2026 – Afrique de l’Ouest : 20 ans de néolibéralisme en agriculture
Le gel des subventions du MRIF persiste : les organismes québécois de coopération internationale dans l’impasse
Niger : Moussa Tchangari toujours en prison un an après
« Je rêvais d’un Soudan libre, je rêve d’un Soudan calme »
Les cols bleus pas fautifs pour le campement démantelé à Montréal-Nord
L’exploitation minière en eaux profondes menace la vie sous-marine et terrestre
Des cadeaux pour les entreprises, avec 25% du Québec dans la pauvreté
La télévision québécoise : miroir et moteur d’une culture en mouvement
Témoignages et colère dans une manifestation massive contre la CAQ
Ruba, le visage d’un pays qui se réinvente !
« Il est exactement quelqu'un comme Ruba Ghazal ». C'est ainsi qu'un internaute a fini par me qualifier.
Je l'ignorais, que j'étais comme Ruba, que je pouvais refléter un fragment de sa personnalité ou de sa façon d'exister. La personne ignore peut-être qu'avec une telle association, il me fait plaisir. Je la remercie. Le commentaire voulait sûrement laisser entendre que j'étais un admirateur de Ruba Ghazal. Je dois dire que ce n'est pas la première fois que je sois amusé de lire des opinions que l'on formule sur moi. Positives ou négatives, elles m'amusent au même degré, et d'ailleurs, il m'arrive de penser que ceux qui me critiquent n'ont pas toujours tout à fait tort, et ceux qui me complimentent n'ont pas entièrement tout à fait raison. Mais ça, c'est un autre chapitre dans le grand roman de mes contradictions.
Revenons à Ruba, c'est d'elle qu'il s'agit. Comment a t'on deviné que j'en étais admirateur ? Je reconnais, je n'ai jamais été doué pour dissimuler mes sympathies. Je l'avoue donc sans emphase mais avec certitude, je suis un admirateur de Ruba Ghazal. Je ne le dis pas par solidarité de circonstance ou pour répondre à ses détracteurs, elle n'a nul besoin d'escorte, elle se défend seule, avec cette élégance que possèdent les convictions profondément ancrées.
Je l'ai suivie dès son apparition dans la vie publique, dès que son nom a commencé à circuler, comme une rumeur bienveillante, avant de devenir une présence affirmée. Le fait qu'elle soit d'origine palestinienne n'est pas étranger à mon attachement, je porte en moi une tendresse particulière pour ce peuple, pour sa résilience presque surnaturelle. Mais au delà des affinités personnelles, elle incarne ce que la politique peut encore offrir de plus noble.
Ruba est de ces êtres droits. Solidaire jusqu'au cœur, loyale, constante, incapable de renier ses idéaux. Les tumultes internes de son parti n'ont jamais entamé sa droiture, ni son découragement. Elle a cette manière, cet art de tenir tête au cynisme comme on oppose le regard à la tempête. Elle conjugue la fermeté et la tendresse, la lucidité et la compassion. C'est une femme politique qui ne se contente pas d'être présente dans l'arène, elle en modifie la forme, elle en déplace les frontières. Même quand elle critique sévèrement l'adversaire politique en face, c'est toujours dans le but de construire des ponts et ce pourquoi elle a été élue, s'opposer au pouvoir quand ce dernier vacille.
Son parcours s'est construit à même les pierres du réel. Députée de Mercier, membre fondatrice de Québec solidaire, militante avant d'être élue, engagée dans la défense de l'environnement, des droits humains, des enjeux sociaux. Elle aurait pu suivre la route toute tracée que son diplôme d'ingénieure ouvrait devant elle, mais elle a préféré les chemins escarpés de la chose publique. Et c'est ainsi qu'elle est entrée dans la vie politique, non pas façonnée par une machine, mais forgée par la réalité, les idées et les luttes. Elle a apporté ses valeurs, ses cicatrices, ses colères et ses espoirs.
Comme moi, Ruba est souverainiste. Par sa qualité de porte-parole de son parti, elle sera appelée à jouer un grand rôle au prochain rendez-vous du Québec avec l'histoire. Ceux, parmi les identitaires, qui s'attaquent à elle personnellement, rendent-ils service à la cause souverainiste ? Rendent-ils service au Québec ? S'ils continuent dans cette manoeuvre, ils se tirent dans les pieds. Je recommande vivement à tous les souverainistes de faire de Ruba et ce qu'elle représente, un formidable atout pour le prochain grand rendez-vous.
Comme moi, Ruba est issue de l'immigration. Comme moi, elle sait que l'appartenance ne se mesure pas seulement à la langue d'origine, ni au lieu de naissance, mais au geste d'habiter une société en l'enrichissant. Sa présence à l'Assemblée nationale porte la preuve d'un pays qui se redéfinit et se réinvente. Ceux qui l'observent savent que son regard sur le monde est traversé d'ouverture et de lucidité. Comme citoyen et comme élue, elle a toujours joué un rôle positif dans une société francophone moderne, accueillante, confiante. Et ceux qui s'en prennent à elle personnellement se trompent d'époque, de cible et d'histoire. Ils semblent ne pas voir en elle une richesse, un trésor national.
Je ne suis pas membre de Québec solidaire, mais j'ai toujours voté QS depuis sa fondation. Parfois, j'ai reproché à ce parti d'être réfractaire au vernis, de négliger l'emballage, de manquer de stratégie d'image. J'ai souvent pensé qu'un peu de mise en scène ne ferait pas de tort. Et puis j'ai observé Manon. Puis Ruba. Et j'ai compris que leur style, c'était précisément de ne pas en avoir trop. Les éléments de langage ce n'est pas le style de ces deux femmes admirables. Leur langage est fidèle à la substance de leur message. Leur discours n'est pas une esthétique, mais une vérité. Une authenticité. Québec solidaire ne joue pas la politique, il la pense, il l'ancre, il la défend.
Depuis ses débuts, j'ai suivi avec respect ce parti, cette maison politique où se croisent des héritages de courage. J'ai gardé une admiration intacte pour Amir, Françoise et Manon. Ruba s'inscrit dans cette continuité, avec sa signature propre. Québec solidaire est devenu un espace singulier dans notre paysage démocratique, un contrepoids, une voix qui défend le bien commun. Il tient lieu de mémoire et de conscience.
Ruba Ghazal et Québec solidaire forment, à mes yeux, une même respiration. Ils rappellent qu'il existe encore des femmes et des hommes capables de faire de la politique avec humanité, avec profondeur, avec fidélité à une certaine idée du monde. Un monde où les très riches partagent un peu plus leurs richesses, un monde ou l'égalité est un principe sacrée et une action constante.
Je rends hommage à Ruba aujourd'hui parce qu'on ne rend plus hommage aux politiciens qui tiennent bon malgré les insultes. La politique, malgré ses déceptions, peut rester un lieu vivant, un lieu vrai, un lieu de sens, à condition de lui apporter notre soutien, notre voix et à l'occasion, un hommage.
Mohamed Lotfi
1 Décembre 2025
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.