Derniers articles

De l’État pour le bien-être à l’État pour la guerre : le keynésianisme militaire

Le bellicisme a atteint son paroxysme en Europe. Tout a commencé lorsque les États-Unis de Trump ont considéré qu'il ne valait plus la peine de payer pour la « protection » militaire des capitales européennes contre des ennemis potentiels. Trump veut arrêter de financer l'essentiel de l'OTAN et de lui fournir sa puissance militaire, et il veut mettre fin au conflit entre l'Ukraine et la Russie afin de pouvoir concentrer la stratégie impérialiste américaine sur l'« hémisphère occidental » et le Pacifique, dans le but de « contenir » et d'affaiblir l'essor économique de la Chine.
24 mars 2025 | tiré du site du CADTM
De l'État pour le bien-être à l'État pour la guerre : le keynésianisme militaire
La stratégie de Trump a fait paniquer les élites dirigeantes européennes. Elles s'inquiètent soudain de la défaite de l'Ukraine face aux forces russes et, avant longtemps, de la présence de Poutine aux frontières de l'Allemagne ou, comme l'affirment le premier ministre travailliste britannique Keir Starmer et un ancien chef du MI5, « dans les rues britanniques ».
Quelle que soit la validité de ce danger supposé, l'occasion a été créée pour les militaires et les services secrets européens de « faire monter les enchères » et d'appeler à la fin des soi-disant « dividendes de la paix » qui ont commencé après la chute de la « redoutable » Union soviétique et d'entamer maintenant le processus de réarmement. La responsable de la politique étrangère de l'UE, Kaja Kallas, a présenté la politique étrangère de l'UE telle qu'elle la conçoit : « Si, ensemble, nous ne sommes pas en mesure d'exercer une pression suffisante sur Moscou, comment pouvons-nous prétendre vaincre la Chine ?
Plusieurs arguments sont avancés pour réarmer le capitalisme européen. Bronwen Maddox, directrice de Chatham House, le groupe de réflexion sur les relations internationales, qui présente principalement les points de vue de l'État militaire britannique, a donné le coup d'envoi en affirmant que « les dépenses de “défense” “sont le plus grand bien public de tous” car elles sont nécessaires à la survie de la “démocratie” face aux forces autoritaires. Mais la défense de la démocratie a un prix :
« le Royaume-Uni pourrait devoir emprunter davantage pour financer les dépenses de défense dont il a si urgemment besoin. Au cours de l'année prochaine et au-delà, les hommes politiques devront se préparer à récupérer de l'argent en réduisant les allocations de maladie, les pensions et les soins de santé ».
Elle poursuit :
« S'il a fallu des décennies pour accumuler ces dépenses, il faudra peut-être des décennies pour les inverser ». « M. Starmer devra bientôt fixer une date à laquelle le Royaume-Uni atteindra les 2,5 % du PIB consacrés aux dépenses militaires - et un chœur de voix s'élève déjà pour dire que ce chiffre devrait être plus élevé. En fin de compte, les hommes politiques devront persuader les électeurs de renoncer à certains de leurs avantages pour financer la défense. »
Martin Wolf, le gourou de l'économie libérale keynésienne du Financial Times, s'est lancé dans l'aventure :
« les dépenses de défense devront augmenter de manière substantielle. Rappelons qu'elles représentaient 5 % du PIB britannique, voire plus, dans les années 1970 et 1980. Il ne sera peut-être pas nécessaire de maintenir ces niveaux à long terme : la Russie moderne n'est pas l'Union soviétique. Toutefois, il pourrait être nécessaire d'atteindre ce niveau pendant la phase de préparation, en particulier si les États-Unis se retirent. »
Comment financer cela ?
« Si les dépenses de défense doivent être augmentées en permanence, les impôts doivent augmenter, à moins que le gouvernement ne parvienne à réduire suffisamment les dépenses, ce qui est peu probable. »
Mais ne vous inquiétez pas, les dépenses en chars, en troupes et en missiles sont en fait bénéfiques pour l'économie, affirme M. Wolf.
« Le Royaume-Uni peut aussi raisonnablement s'attendre à des retours économiques sur ses investissements en matière de défense. Historiquement, les guerres ont été la mère de l'innovation ».
Il cite ensuite les merveilleux exemples des gains qu'Israël et l'Ukraine ont tirés de leurs guerres :
« La “start up economy” d'Israël a commencé dans son armée. Les Ukrainiens ont révolutionné la guerre des drones ».
Il ne mentionne pas le coût humain de l'innovation par la guerre. Wolf poursuit :
« Le point crucial, cependant, est que la nécessité de dépenser beaucoup plus pour la défense devrait être considérée comme plus qu'une simple nécessité et aussi plus qu'un simple coût, bien que les deux soient vrais. Si l'on s'y prend bien, il s'agit également d'une opportunité économique ».
La guerre est donc le moyen de sortir de la stagnation économique.
Wolf s'écrie que la Grande-Bretagne doit s'y mettre :
« Si les États-Unis ne sont plus les promoteurs et les défenseurs de la démocratie libérale, la seule force potentiellement assez puissante pour combler le vide est l'Europe. Si les Européens veulent réussir cette lourde tâche, ils doivent commencer par sécuriser leur territoire. Leur capacité à le faire dépendra à son tour des ressources, du temps, de la volonté et de la cohésion ..... Il ne fait aucun doute que l'Europe peut augmenter considérablement ses dépenses en matière de défense ».
M. Wolf a affirmé que nous devions défendre les « valeurs européennes » vantées que sont la liberté individuelle et la démocratie libérale.
« Ce sera économiquement coûteux et même dangereux, mais nécessaire, car l'Europe a des « cinquièmes colonnes » presque partout. Il conclut : « Si l'Europe ne se mobilise pas rapidement pour sa propre défense, la démocratie libérale risque de disparaître complètement. Aujourd'hui, on se croirait un peu dans les années 1930. Cette fois, hélas, les Etats-Unis semblent être du mauvais côté ».
Considéré comme « conservateur progressiste », l'éditorialiste du Financial Times Janan Ganesh l'a exprimé sans ambages :
« L'Europe doit réduire son État-providence pour construire un État de guerre. Il n'y a aucun moyen de défendre le continent sans réduire les dépenses sociales ».
Il a clairement indiqué que les gains obtenus par les travailleurs après la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais qui ont été progressivement réduits au cours des 40 dernières années, doivent maintenant être totalement supprimés.
"Selon Janan Ganesh du Financial Times les gains obtenus par les travailleurs après la fin de la Seconde Guerre mondiale doivent être totalement supprimés"
« La mission consiste désormais à défendre la vie de l'Europe. Comment financer
un continent mieux armé, si ce n'est en réduisant l'État-providence ? »
L'âge d'or de l'État-providence de l'après-guerre n'est plus possible.
« Toute personne de moins de 80 ans ayant passé sa vie en Europe peut être excusée de considérer un État-providence géant (sic - MR) comme la voie naturelle des choses. En réalité, c'était le produit de circonstances historiques étranges, qui ont prévalu dans la seconde moitié du 20e siècle et qui ne prévalent plus. »
"Ganesh du Financial Times écrit : « L'Europe doit réduire son État-providence pour construire un État de guerre. Il n'y a aucun moyen de défendre le continent sans réduire les dépenses sociales »"
Oui, c'est exact, les gains obtenus par les travailleurs à l'âge d'or étaient l'exception par rapport à la norme du capitalisme (« circonstances historiques étranges »).
Mais maintenant,
« les engagements en matière de pensions et de soins de santé allaient être suffisamment difficiles à assumer pour la population active, même avant le choc actuel en matière de défense...
Les gouvernements vont devoir se montrer plus pingres avec les personnes âgées. Dans tous les cas, l'État-providence tel que nous l'avons connu doit reculer quelque peu : pas suffisamment pour que nous ne l'appelions plus par ce nom, mais suffisamment pour que cela fasse mal ».
Ganesh, le vrai conservateur, voit dans le réarmement l'occasion pour le capital de procéder aux réductions nécessaires de la protection sociale et des services publics.
« Il est plus facile de faire accepter des réductions de dépenses au nom de la défense qu'au nom d'une notion généralisée d'efficacité. .... Pourtant, ce n'est pas l'objectif de la défense, et les hommes politiques doivent insister sur ce point. L'objectif est la survie ».
Le soi-disant « capitalisme libéral » doit donc survivre, ce qui signifie réduire le niveau de vie des plus pauvres et dépenser de l'argent pour faire la guerre. De l'État providence à l'État de guerre.
Le Premier ministre polonais, Donald Tusk, a fait monter d'un cran le bellicisme. Il a déclaré que la Pologne
« doit se tourner vers les possibilités les plus modernes, y compris les armes nucléaires et les armes modernes non conventionnelles ».
Nous pouvons supposer que le terme « non conventionnel » désigne les armes chimiques ?
Tusk :
« Je le dis en toute responsabilité, il ne suffit pas d'acheter des armes conventionnelles, les plus traditionnelles ».
Ainsi, presque partout en Europe, l'appel est lancé en faveur d'une augmentation des dépenses de « défense » et d'un réarmement. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a proposé un plan Rearm Europe qui vise à mobiliser jusqu'à 800 milliards d'euros pour financer une augmentation massive des dépenses de défense.
« Nous sommes à l'ère du réarmement et l'Europe est prête à augmenter massivement ses dépenses de défense, à la fois pour répondre à l'urgence à court terme d'agir et de soutenir l'Ukraine, mais aussi pour répondre à la nécessité à long terme d'assumer davantage de responsabilités pour notre propre sécurité européenne », a-t-elle déclaré.
"L'objectif des dépenses de défense éclipsera les dépenses de déficit disponibles pour la lutte contre le changement climatique et pour les infrastructures qui font cruellement défaut"
En vertu d'une « clause de sauvegarde », la Commission européenne demandera une augmentation des dépenses d'armement même si elle enfreint les règles budgétaires en vigueur. Les fonds COVID non utilisés (90 milliards d'euros) et davantage d'emprunts par le biais d'un « nouvel instrument » suivront, afin de fournir 150 milliards d'euros de prêts aux États membres pour financer des investissements de défense conjoints dans des capacités paneuropéennes, y compris la défense aérienne et antimissile, les systèmes d'artillerie, les missiles et les munitions, les drones et les systèmes anti-drones. Mme Von der Leyen a affirmé que si les pays de l'UE augmentaient leurs dépenses de défense de 1,5 % du PIB en moyenne, 650 milliards d'euros pourraient être libérés au cours des quatre prochaines années. Mais il n'y aurait pas de financement supplémentaire pour les investissements, les projets d'infrastructure ou les services publics, car l'Europe doit consacrer ses ressources à la préparation à la guerre.
Dans le même temps, comme le souligne le FT, le gouvernement britannique
« effectue une transition rapide du vert au gris cuirassé en plaçant désormais la défense au cœur de son approche de la technologie et de la fabrication ».
M. Starmer a annoncé une augmentation des dépenses de défense à 2,5 % du PIB d'ici 2027 et l'ambition d'atteindre 3 % dans les années 2030. La ministre britannique des finances, Rachel Reeves, qui n'a cessé de réduire les dépenses consacrées aux allocations familiales, aux allocations d'hiver pour les personnes âgées et aux prestations d'invalidité, a annoncé que les attributions du nouveau Fonds national de richesse du gouvernement travailliste seraient modifiées afin de lui permettre d'investir dans la défense. Les fabricants d'armes britanniques sont dans l'embarras. « Si l'on fait abstraction de l'éthique de la production d'armes, qui décourage certains investisseurs, la défense en tant que stratégie industrielle a beaucoup à offrir », a déclaré un PDG.
Il existe un groupe clair de bénéficiaires du programme de dépenses massives : l'industrie de la défense de l'UE
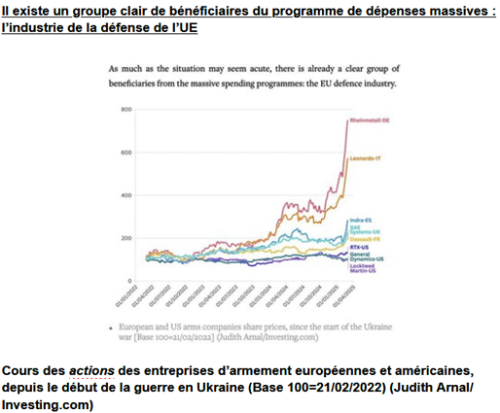
Cours des actions des entreprises d'armement européennes et américaines, depuis le début de la guerre en Ukraine (Base 100=21/02/2022) (Judith Arnal/Investing.com)
En Allemagne, le chancelier élu du nouveau gouvernement de coalition, le Chrétien démocrate Friedrich Merz, a fait adopter par le parlement allemand une loi mettant fin au « frein fiscal », qui interdisait aux gouvernements allemands d'emprunter au-delà d'une limite stricte ou d'augmenter la dette pour financer les dépenses publiques. Mais aujourd'hui, les dépenses militaires déficitaires ont la priorité sur tout le reste, c'est le seul budget qui n'est pas limité. L'objectif des dépenses de défense éclipsera les dépenses de déficit disponibles pour la lutte contre le changement climatique et pour les infrastructures qui font cruellement défaut.
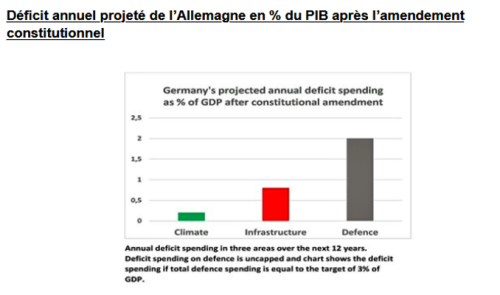
Dépenses annuelles déficitaires dans trois domaines au cours des 12 prochaines années. Le déficit des dépenses de défense n'est pas plafonné et le graphique montre que le déficit des dépenses totales de défense est égal à l'objectif de 3 % du PIB
Les dépenses publiques annuelles dues au nouveau paquet fiscal allemand seront plus importantes que le boom des dépenses qui a suivi le plan Marshall d'après-guerre et la réunification de l'Allemagne au début des années 1990.
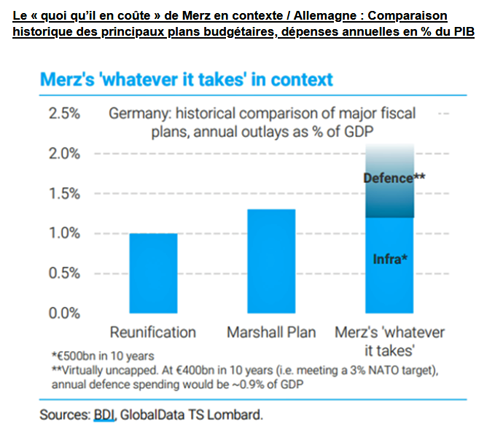
Traduction du graphique :
Reunification : Réunification
Marshall Plan : Plan Marshall
Merz's 'whatever it takes : Le « quoi qu'il en coûte » de Merz
€500bn in 10 years : 500 milliards de dollars en 10 ans
Virtually uncapped. At €400bn in 10 years (i.e. meetinf a 3% NATO target), annual defense spending would be around 0,9% of GDP : Pratiquement sans plafond. À 400 milliards d'euros en 10 ans (c'est-à-dire pour atteindre l'objectif de 3 % fixé par l'OTAN), les dépenses de défense annuelles représenteraient environ 0,9 % du PIB.
Cela m'amène à parler des arguments économiques en faveur des dépenses militaires. Les dépenses militaires peuvent-elles relancer une économie en proie à la dépression, comme c'est le cas dans une grande partie de l'Europe depuis la fin de la grande récession en 2009 ? Certains keynésiens le pensent. Le fabricant d'armes allemand Rheinmetall affirme que l'usine d'Osnabrück de Volkswagen, laissée à l'abandon, pourrait être un candidat de choix pour une reconversion dans la production militaire. L'économiste keynésien Matthew Klein, coauteur avec Michael Pettis de Trade Wars are Class Wars, a salué cette nouvelle :
« L'Allemagne construit déjà des chars d'assaut. Je l'encourage à en construire beaucoup plus ».
La théorie du « keynésianisme militaire » a une histoire. Une de ses variantes était le concept d'« économie d'armement permanente », adopté par certains marxistes pour expliquer pourquoi les principales économies ne sont pas entrées en dépression après la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais ont au contraire connu une longue période d'expansion, avec seulement de légères récessions, qui a duré jusqu'à l'effondrement international de 1974-1955. Cet « âge d'or » ne pouvait s'expliquer, selon eux, que par des dépenses militaires permanentes destinées à maintenir la demande globale et le plein emploi.
Mais cette théorie du boom de l'après-guerre n'est pas étayée. Les dépenses militaires du gouvernement britannique sont passées de plus de 12 % du PIB en 1952 à environ 7 % en 1960 et ont diminué tout au long des années 1960 pour atteindre environ 5 % à la fin de la décennie. Pourtant, l'économie britannique n'a jamais été aussi florissante depuis lors. Dans tous les pays capitalistes avancés, les dépenses de défense représentaient à la fin des années 1960 une fraction nettement plus faible de la production totale qu'au début des années 1950 : de 10,2 % du PIB en 1952-1953, au plus fort de la guerre de Corée, elles n'atteignaient plus que 6,5 % en 1967. Pourtant, la croissance économique s'est maintenue pratiquement tout au long des années 1960 et au début des années 1970.
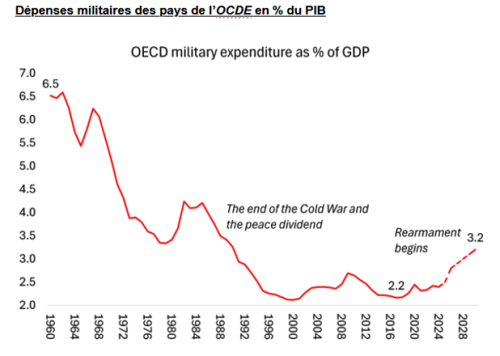
Traduction du graphique :
The end of the cold war and the peace dividend : La fin de la Guerre froide et le dividende de la paix
Rearmament begins : Début du réarmement
Le boom de l'après-guerre n'a pas été le résultat de dépenses publiques d'armement de type keynésien, mais s'explique par le taux élevé de rentabilité du capital investi par les grandes économies après la guerre. C'est plutôt l'inverse qui s'est produit. Parce que les grandes économies connaissaient une croissance relativement rapide et que la rentabilité était élevée, les gouvernements pouvaient se permettre de maintenir les dépenses militaires dans le cadre de leur objectif géopolitique de « guerre froide » visant à affaiblir et à écraser l'Union soviétique - le principal ennemi de l'impérialisme à l'époque.
Par-dessus tout, le keynésianisme militaire est contraire aux intérêts des travailleurs et de l'humanité. Sommes-nous favorables à la fabrication d'armes pour tuer des gens afin de créer des emplois ? Cet argument, souvent défendu par certains dirigeants syndicaux, fait passer l'argent avant la vie.
Keynes a dit un jour :
« Le gouvernement devrait payer les gens pour qu'ils creusent des trous dans le sol et les remplissent ensuite. »
Les gens répondaient :
« C'est stupide, pourquoi ne pas payer les gens pour construire des routes et des écoles ».
Keynes répondrait :
« Très bien, payez-les pour construire des écoles. Le fait est que ce qu'ils font n'a pas d'importance tant que le gouvernement crée des emplois ».
Keynes avait tort. C'est important. Le keynésianisme préconise de creuser des trous et de les remplir pour créer des emplois. Le keynésianisme militaire préconise de creuser des tombes et de les remplir de cadavres pour créer des emplois. Si la manière dont les emplois sont créés n'a pas d'importance, pourquoi ne pas augmenter considérablement la production de tabac et promouvoir la dépendance pour créer des emplois ? À l'heure actuelle, la plupart des gens s'opposeraient à une telle mesure, qu'ils considèrent comme directement nuisible à la santé. La fabrication d'armes (conventionnelles et non conventionnelles) est également directement nuisible. Et il existe de nombreux autres produits et services socialement utiles qui pourraient créer des emplois et des salaires pour les travailleurs (comme les écoles et les logements).
Le ministre de la défense du gouvernement britannique, John Healey, a récemment insisté sur le fait que l'augmentation du budget de l'armement
« ferait de notre industrie de la défense le moteur de la croissance économique dans ce pays »
.
C'est une excellente nouvelle. Malheureusement pour M. Healey, l'association commerciale de l'industrie de l'armement britannique (ADS) estime que le Royaume-Uni compte environ 55 000 emplois dans le secteur de l'exportation d'armes et 115 000 autres au sein du ministère de la défense. Même si l'on inclut ce dernier, cela ne représente que 0,5 % de la main-d'œuvre britannique (pour plus de détails, voir le document Arms to Renewables de CAAT). Même aux États-Unis, le ratio est à peu près le même.
Une question théorique est souvent débattue dans l'économie politique marxiste. Il s'agit de savoir si la production d'armes est productive de valeur dans une économie capitaliste. La réponse est oui, pour les producteurs d'armes. Les fournisseurs d'armes livrent des marchandises (armes) qui sont payées par le gouvernement. Le travail qui les produit est donc productif de valeur et de plus-value. Mais au niveau de l'ensemble de l'économie, la production d'armes est improductive de valeur future, de la même manière que le sont les « produits de luxe » destinés à la seule consommation capitaliste. La production d'armes et les produits de luxe ne réintègrent pas le processus de production suivant, que ce soit en tant que moyens de production ou en tant que moyens de subsistance pour la classe ouvrière. Tout en étant productive de plus-value pour les capitalistes de l'armement, la production d'armes n'est pas reproductive et menace donc la reproduction du capital. Par conséquent, si l'augmentation de la production globale de plus-value dans une économie ralentit et que la rentabilité du capital productif commence à chuter, la réduction de la plus-value disponible pour l'investissement productif en vue d'investir dans les dépenses militaires peut nuire à la « santé » du processus d'accumulation capitaliste.
Le résultat dépend de l'effet sur la rentabilité du capital. Le secteur militaire a généralement une composition organique du capital plus élevée que la moyenne de l'économie, car il incorpore des technologies de pointe. Le secteur de l'armement aurait donc tendance à faire baisser le taux de profit moyen. D'un autre côté, si les impôts perçus par l'État (ou les réductions des dépenses civiles) pour financer la fabrication d'armes sont élevés, la richesse qui irait autrement au travail peut être distribuée au capital et peut donc augmenter la plus-value disponible. Les dépenses militaires peuvent avoir un effet légèrement positif sur les taux de profit dans les pays exportateurs d'armes, mais pas dans les pays importateurs d'armes. Dans ces derniers, les dépenses militaires sont une déduction des profits disponibles pour l'investissement productif.
Dans l'ensemble, les dépenses d'armement ne peuvent pas être décisives pour la santé de l'économie capitaliste. En revanche, une guerre totale peut aider le capitalisme à sortir de la dépression et du marasme. L'un des principaux arguments de l'économie marxiste (du moins dans ma version) est que les économies capitalistes ne peuvent se redresser durablement que si la rentabilité moyenne des secteurs productifs de l'économie augmente de manière significative. Et cela nécessite une destruction suffisante de la valeur du « capital mort » (accumulation passée) qu'il n'est plus rentable d'employer.
La Grande Dépression des années 1930 dans l'économie américaine a duré si longtemps parce que la rentabilité ne s'est pas redressée tout au long de la décennie. En 1938, le taux de profit des entreprises américaines était encore inférieur à la moitié du taux de 1929. La rentabilité ne s'est redressée qu'une fois l'économie de guerre en marche, à partir de 1940.

Ce n'est donc pas le « keynésianisme militaire » qui a sorti l'économie américaine de la Grande Dépression, comme certains keynésiens aiment à le penser. La reprise de l'économie américaine après la Grande Dépression n'a pas commencé avant le début de la guerre mondiale. L'investissement n'a décollé qu'à partir de 1941 (Pearl Harbor) pour atteindre, en pourcentage du PIB, plus du double du niveau atteint en 1940. Comment cela se fait-il ? Ce n'est pas le résultat d'une reprise des investissements du secteur privé. Ce qui s'est produit, c'est une augmentation massive des investissements et des dépenses publiques. En 1940, les investissements du secteur privé étaient encore inférieurs au niveau de 1929 et ont même continué à baisser pendant la guerre. Le secteur public a pris en charge la quasi-totalité des investissements, les ressources (valeur) étant détournées vers la production d'armes et d'autres mesures de sécurité dans une économie de guerre totale.
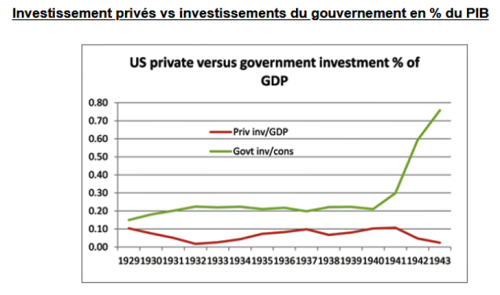
Priv inv/GDP : Investissements privés / PIB
Govt inv / GDP : Investissements du gouvernement / PIB
Mais l'augmentation de l'investissement et de la consommation publics n'est-elle pas une forme de relance keynésienne, mais à un niveau plus élevé ? Eh bien, non. La différence se révèle dans l'effondrement continu de la consommation. L'économie de guerre a été financée en limitant les possibilités pour les travailleurs de dépenser les revenus qu'ils tiraient de leur emploi en temps de guerre. L'épargne a été forcée par l'achat d'obligations de guerre, le rationnement et l'augmentation des impôts pour financer la guerre. L'investissement public signifiait la direction et la planification de la production par décret gouvernemental. L'économie de guerre n'a pas stimulé le secteur privé, elle a remplacé le « marché libre » et l'investissement capitaliste à des fins de profit. La consommation n'a pas rétabli la croissance économique comme l'auraient espéré les keynésiens (et ceux qui voient la cause de la crise dans la sous-consommation) ; au lieu de cela, elle a été investie principalement dans des armes de destruction massive.
La guerre a mis fin de manière décisive à la dépression. L'industrie américaine a été revitalisée par la guerre et de nombreux secteurs ont été orientés vers la production de défense (par exemple, l'aérospatiale et l'électronique) ou en ont été complètement dépendants (énergie atomique). Les changements scientifiques et technologiques rapides de la guerre ont poursuivi et intensifié les tendances amorcées pendant la Grande Dépression. La guerre ayant gravement endommagé toutes les grandes économies du monde, à l'exception des États-Unis, le capitalisme américain a acquis une hégémonie économique et politique après 1945.
Guiglelmo Carchedi explique : « Pourquoi la guerre a-t-elle entraîné un tel bond de la rentabilité au cours de la période 1940-1945 ? Non seulement le dénominateur du taux n'a pas augmenté, mais il a baissé parce que la dépréciation physique des moyens de production a été supérieure aux nouveaux investissements. Dans le même temps, le chômage a pratiquement disparu. La baisse du chômage a permis d'augmenter les salaires. Mais l'augmentation des salaires n'a pas entamé la rentabilité. En fait, la conversion des industries civiles en industries militaires a réduit l'offre de biens civils. L'augmentation des salaires et la production limitée de biens de consommation signifient que le pouvoir d'achat des travailleurs doit être fortement comprimé afin d'éviter l'inflation. Pour ce faire, on institue le premier impôt général sur le revenu, on décourage les dépenses de consommation (le crédit à la consommation est interdit) et on stimule l'épargne des consommateurs, principalement par le biais d'investissements dans des obligations de guerre. En conséquence, les travailleurs ont été contraints de reporter la dépense d'une partie importante de leurs salaires. Dans le même temps, le taux d'exploitation des travailleurs a augmenté. En substance, l'effort de guerre était une production massive de moyens de destruction financée par le travail ».
Laissons Keynes résumer la situation : « Il est, semble-t-il, politiquement impossible pour une démocratie capitaliste d'organiser les dépenses à l'échelle nécessaire pour faire les grandes expériences qui prouveraient mon point de vue - sauf dans des conditions de guerre », extrait de The New Republic (cité par P. Renshaw, Journal of Contemporary History 1999 vol. 34 (3) p. 377 -364).
Traduction : Éric Toussaint avec l'aide de Deepl
Source : Michael Roberts Blog
Auteur.e
Michael Roberts a travaillé à la City de Londres en tant qu'économiste pendant plus de 40 ans. Il a observé de près les machinations du capitalisme mondial depuis l'antre du dragon. Parallèlement, il a été un militant politique du mouvement syndical pendant des décennies. Depuis qu'il a pris sa retraite, il a écrit plusieurs livres. The Great Recession - a Marxist view (2009) ; The Long Depression (2016) ; Marx 200 : a review of Marx's economics (2018), et conjointement avec Guglielmo Carchedi ils ont édité World in Crisis (2018). Il a publié de nombreux articles dans diverses revues économiques universitaires et des articles dans des publications de gauche.
Il tient également un blog : thenextrecession.wordpress.com
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Enlèvements, dissolution : la répression s’abat sur les journalistes au Burkina Faso

Après l'organisation d'un congrès sur l'état de la presse dans le pays, l'Association des journalistes du Burkina a été dissoute, et deux de ses dirigeants enlevés. Reporters sans frontières dénonce une pratique “extrême” et “répressive” pour museler les journalistes.
Tiré de Courrier international.
Cinq cent mille francs CFA d'amende (762 euros), une suspension pour deux semaines… Telles sont les sanctions prises par le Conseil supérieur de la communication (CSC) contre le journaliste Luc Pagbelguem, relate Le Faso. Son tort ? Avoir filmé pour la chaîne privée BF1 le congrès extraordinaire de l'Association des journalistes du Burkina (AJB).
Le 21 mars, ce congrès avait dressé un état des lieux du secteur de la presse dans ce pays sahélien dirigé, depuis le coup d'État du 30 septembre 2022, par le capitaine Ibrahim Traoré. Les membres du bureau de l'AJB avaient dénoncé la répression contre la presse et la propagande des médias d'État.
Ce 26 mars, BF1 a également publié un communiqué expliquant que la chaîne a envoyé “des lettres d'excuses officielles à la RTB et l'AIB [radiotélédiffusion du Burkina et agence d'information du Burkina, les médias qualifiés de relais de la propagande officielle], et supprimé le reportage sur ce congrès. Le communiqué indique aussi que le CSC souhaite que les excuses de BF1 soient “[étendues] aux autorités nationales”, selon le communiqué relayé par le site d'information Wakat Séra.
L'AJB en ligne de mire
Le messager se retrouve condamné, et contraint à la contrition publique, tandis que l'AJB a été dissoute par les autorités le 25 mars, au lendemain de l'enlèvement de deux de ses principaux responsables.
“Guezouma Sanogo, président de l'AJB, et Boukari Ouoba, vice-président de l'AJB, viennent d'être amenés par des individus se présentant comme des policiers du service des renseignements au CNP-NZ [Centre national de presse Norbert-Zongo] vers une destination inconnue. Le président était en entretien avec Gildas Ouédraogo [à] qui il avait donné rendez-vous à 10 heures”, indique le communiqué de l'association, publié sur sa page Facebook.
Guezouma Sanogo était journaliste à la radio publique. Boukari Ouoba a produit de nombreuses enquêtes et reportages pour le bimensuel d'investigation Le Reporter.
Le 21 mars, “les congressistes [avaient] vivement dénoncé les enlèvements et disparitions de journalistes, ainsi que les atteintes répétées à la liberté d'expression et de presse dans un contexte sécuritaire préoccupant”, souligne L'Observateur Paalga.
Série d'enlèvements
Tout en dénonçant la “mainmise de l'État” sur les médias, le président de l'association, Guezouma Sanogo, avait appelé la corporation à la solidarité afin que le métier “survive à toutes les répressions”. L'AJB avait également réclamé la libération des sept journalistes et chroniqueurs enlevés par des agents de l'État.
Le plus récemment enlevé, Idrissa Barry, a été kidnappé à la mairie de Saaba, en périphérie de Ouagadougou, le 19 mars.
Ces nouveaux enlèvements ont “suscité une vive réaction de Reporters sans frontières (RSF), qui a dénoncé une pratique ‘extrême' et ‘répressive' visant à faire taire les journalistes critiques du pouvoir”, indique Ouestaf, dans un article consacré au durcissement de la répression contre la presse.
Ce 26 mars, le chef de l'État, Ibrahim Traoré, a déploré que “certains Burkinabè n'[aient] pas encore pris le train de la révolution en marche, préférant se soustraire à l'ordre et à la discipline”, cite Le Faso.
Courrier international
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’isolationnisme de gauche : un chemin vers l’insignifiance politique dans le débat sur la défense européenne

Le Parlement européen a voté une résolution qui définit la ligne en matière de défense et de réarmement. Les critiques les plus sévères à l'égard de la résolution de la Commission européenne sur la défense et le réarmement proviennent du groupe politique de gauche. Parmi eux, Manon Aubry (France Insoumise), qui dénonce : « Vous trouvez de l'argent pour les chars mais pas pour les hôpitaux. » Elle a remarqué avec sarcasme : « C'est comme si, tout d'un coup, il n'y avait plus de réchauffement climatique ni de pauvreté, et que la seule priorité était les véhicules blindés. » De même, Benedetta Scuderi des Verts soutient que « cette course aux armements » mine la croissance et les finances publiques. D'autres voix se sont jointes au chœur, notamment le coprésident de la Gauche Martin Schirdewan et Danilo Della Valle du Mouvement Cinq Étoiles. Pendant le discours de Della Valle, un groupe de représentants du Mouvement Cinq Étoiles a manifesté en agitant des pancartes telles que « Plus d'armes » ou « Plus d'emplois, moins d'armes ».
24 mars 2025 | tiré du site Entre les lignes entre les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/03/24/justice-sociale-defense-europeenne-securite-nationale-quatre-textes/
Au fond, la position de ces politiciens se résume à ceci : laissons le monde qui nous entoure s'effondrer, laissons les pays être envahis – ce n'est pas notre affaire. Ils déclarent vouloir préserver leur modèle social en augmentant le budget du bien-être tout en limitant les dépenses de sécurité – un idéal que partagerait tout politique de gauche. Ce qu'ils ignorent commodément, c'est que le modèle social qu'ils cherchent à protéger a été rendu possible précisément parce que la sécurité a été externalisée à d'autres acteurs – notamment aux États-Unis. Mais que se passe-t-il lorsque la sécurité n'est plus garantie par ces derniers ? C'est une question qu'ils n'abordent jamais, avançant des slogans simples à la place. Les réalités de la compétition internationale pour le pouvoir – désormais à l'un de ses moments les plus intenses depuis des décennies – sont simplement écartées.
Si la France, l'Espagne, l'Italie ou l'Allemagne ne font pas face à une menace militaire immédiate, pour la Pologne, les États baltes et les pays nordiques, le danger est direct. Lorsque votre voisin est l'une des plus grandes puissances militaires du monde, un pays qui a violé tous les principaux accords internationaux au cours de la dernière décennie, bombarde quotidiennement les villes ukrainiennes et dépasse tous les pays européens en dépenses militaires, la capacité à se défendre n'est pas une « course aux armements » – c'est une condition préalable à la survie.
Au cœur de cette question se trouve un refus de voir l'Europe comme un projet commun. Ironiquement, cette forme d'opposition de gauche à la défense européenne est une forme de nationalisme déguisé. Mais le nationalisme, dans sa forme historique, est précisément ce qui a alimenté des siècles de guerre, de destruction et de division sur le continent européen. L'Union européenne n'a jamais été simplement un projet économique – c'était un projet politique et de sécurité conçu pour prévenir la guerre, une leçon tirée des catastrophes répétées du passé.
Ce qui rend cette position particulièrement contre-productive pour la gauche, c'est qu'elle reflète l'isolationnisme des partis souverainistes de droite. Cela est clairement illustré par la façon dont l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) a voté aux côtés de la Gauche. Cependant, contrairement à la gauche, la droite est constamment isolationniste. Leur position est simple : ils rejettent les engagements militaires externes et s'opposent aux migrants, renforçant une vision du monde dans laquelle seuls les intérêts de leur nation comptent, et rien au-delà de leurs frontières ne mérite d'attention. Cette position a au moins l'avantage de la cohérence, ce qui la rend plus attrayante pour les électeurs qui croient à l'intérêt personnel absolu.
En revanche, l'isolationnisme sélectif de la gauche – où les menaces de sécurité sont ignorées, mais où les appels à la solidarité internationale sur les questions sociales et environnementales persistent – manque de cohérence et ne trouve pas d'écho auprès du grand public. En attisant des sentiments isolationnistes et égoïstes, la gauche populiste cultive un terrain émotionnel qui, en fin de compte, profite à la droite. Après tout, si l'humeur politique dominante est celle de l'égocentrisme national, c'est la droite – et non la gauche – qui offre une vision plus claire.
Cependant, il faut reconnaître que les critiques de gauche et écologiques des plans de réarmement de l'Europe ont raison de souligner que ni la crise écologique ni l'inégalité systémique n'ont disparu. Ce sont en effet des menaces existentielles pour l'humanité. Mais sont-ils justifiés de présenter la préparation militaire et le soutien à l'Ukraine comme étant en opposition avec la lutte contre ces défis mondiaux ?
En réalité, la lutte pour la sécurité et la lutte contre le changement climatique sont profondément interconnectées.
Prenez la consommation de combustibles fossiles comme exemple. La dépendance de l'Europe – et particulièrement de l'Allemagne – aux combustibles fossiles russes bon marché n'a pas seulement été une catastrophe environnementale, mais aussi une grave responsabilité géopolitique. La dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie a donné au Kremlin l'un de ses outils les plus efficaces de levier politique sur l'Europe. Elle a financé la machine de guerre russe tout en rendant simultanément les nations européennes vulnérables au chantage énergétique. Ainsi, le développement rapide de sources d'énergie alternatives n'est pas seulement un impératif environnemental – c'est une nécessité géopolitique. C'est précisément ce que les Ukrainiens et d'autres États menacés par l'expansionnisme russe demandent. Les démocraties qui se rendent dépendantes des régimes autoritaires pour quelque chose d'aussi critique que l'énergie sabotent leur souveraineté et leur sécurité. Comme l'a justement dit Li Andersson, également membre du groupe de la Gauche, l'UE devrait se fixer un objectif stratégique de réduction de nos dépendances vis-à-vis d'acteurs externes, y compris dans les domaines de l'énergie et du numérique. Cependant, à ce moment précis, selon iStories, les autorités allemandes, russes et américaines discutent de la reprise des livraisons de pétrole et de gaz russes à l'Allemagne – une décision qui contredit directement la sécurité à long terme de l'Europe et son indépendance énergétique.
Résoudre des défis mondiaux tels que le changement climatique et les inégalités est sans aucun doute une priorité, mais le faire dans un cadre isolationniste et souverainiste est une contradiction. Dans un monde où le concept de bien commun disparaît et où la politique est dictée uniquement par la maximisation des intérêts nationaux, les forces qui en bénéficient ne sont pas celles qui défendent la justice climatique ou l'équité sociale. Au contraire, un tel monde est précisément ce que Trump et Poutine promeuvent ouvertement – un monde dans lequel la nature et la vie humaine sont des ressources dispensables dans la poursuite du pouvoir d'État, au service des autocrates au pouvoir. Cela ne signifie pas que les démocraties libérales privilégient automatiquement la nature et la vie humaine. La différence, cependant, est que dans les systèmes démocratiques, il y a de l'espace pour l'opposition et la possibilité d'imposer des visions alternatives. Il suffit de demander aux éco-activistes et aux syndicalistes russes et chinois leur capacité à lutter pour la justice sociale et climatique. Et aux États-Unis, la présidence Trump a démontré avec quelle rapidité les projets environnementaux et sociaux pouvaient être démantelés et leurs valeurs réduites au silence et criminalisées.
Ni la vie humaine ni l'environnement ne peuvent être protégés dans un État qui tombe dans la « zone d'intérêt » des puissances impériales autocratiques. L'ironie de la gauche isolationniste est qu'en rejetant la coopération en matière de sécurité, elle accélère sa propre insignifiance politique. Dans un monde dominé par une politique de grandes puissances sans contrôle, eux et leurs valeurs seront poussés à la marge – d'abord politiquement, puis physiquement.
Le contrat social dans nos sociétés est construit sur l'idée que l'État existe pour protéger les droits et les libertés de ses citoyens, et non pour les sacrifier à des ambitions expansionnistes. Les régimes autoritaires considèrent la vie humaine comme une ressource dispensable à utiliser dans la poursuite d'objectifs géopolitiques. Les démocraties sont contraintes par des considérations éthiques et politiques. Les États autoritaires possèdent un contrôle centralisé sur les médias et une répression efficace, ce qui leur permet de mener des guerres sans tenir compte de l'opinion publique. Les politiciens des démocraties, concentrés sur les cycles électoraux, privilégient les résultats à court terme par rapport aux stratégies à long terme.
Ainsi, les sociétés démocratiques font face à une vulnérabilité stratégique inhérente lorsqu'elles sont confrontées à des États autoritaires agressifs. Pourtant, de nombreuses personnes préfèrent s'accrocher à la croyance que la diplomatie, l'interdépendance économique ou la supériorité morale seule nous préserveront d'une éventuelle agression militaire. Cette pensée naïve conduit à l'inaction et à une vulnérabilité encore plus grande que les régimes autoritaires exploitent efficacement, en présentant une résistance aux puissances autocratiques comme impossible à gagner et inutile.
Les slogans abstraits sur « l'abolition de la guerre » révèlent non seulement un manque de solutions pratiques, mais aussi une réticence à prendre des responsabilités. Au lieu de cela, ils permettent de se sentir juste sans s'engager dans le travail difficile de gouvernance et de stratégie. En refusant de confronter les réalités militaires, ces mouvements deviennent des spectateurs plutôt que des acteurs, commentant les événements plutôt que de les façonner. Ce faisant, ils abandonnent finalement les tâches critiques de sécurité et de défense à ceux auxquels ils s'opposent idéologiquement.
Au lieu de se réfugier dans une rhétorique vide, la gauche doit façonner de manière proactive les solutions. La gauche doit s'unir pour promouvoir une stratégie de défense où la sécurité n'est pas financée par la réduction des programmes sociaux mais par l'augmentation des impôts sur les ultra-riches. Comme Li Andersson le soutient à juste titre, « Ce serait une erreur historique de financer cela en réduisant le bien-être social », car une telle démarche ne ferait qu'alimenter la montée de l'extrême droite. La mesure la plus immédiate et la plus efficace serait la confiscation des actifs russes gelés et leur réinvestissement rapide dans l'aide militaire à l'Ukraine. Pourtant, La France Insoumise, le parti que Manon Aubry représente au Parlement européen, a voté contre la confiscation des actifs russes dans son parlement national. De plus, le Mouvement 5 Étoiles a un historique de positions pro-Kremlin, qui comprennent l'opposition aux sanctions avant l'invasion à grande échelle de l'Ukraine.
Si la gauche ne prend pas de mesures concrètes face à l'agression, elle ne perdra pas seulement sa crédibilité mais renoncera également à son rôle dans la formation de l'avenir de l'Europe.
Hanna Perekhoda, 18 mars 2025
https://www.valigiablu.it/left-wing-rearm-europe/
Traduit pour ESSF par Adam Novak
https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article74145
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La gauche doit rejeter le faux dilemme entre justice sociale et sécurité nationale

L'armement militaire et l'armement social ne doivent pas être opposés, mais il faut que la gauche présente des revendications offensives pour la production d'armes à la demande, l'abolition des paradis fiscaux et l'obligation pour les milliardaires de payer.
24 mars 2025 | tiré du site Entre les lignes entre les mots
Suite à la décision américaine d'abandonner l'Ukraine un pays qui constitue désormais la dernière ligne de défense pour la sécurité de l'Europe – l'UE n'a pas d'autre choix que d'agir de manière décisive. Assurer notre propre protection n'est plus un sujet de débat, mais une nécessité indéniable.
Pour la gauche, la question est de savoir si elle dispose d'un programme concret pour faire face à cette crise. Si elle continue à se plaindre de la militarisation – sans même proposer de solutions aux véritables menaces sécuritaires auxquelles nous sommes tous et toutes confrontées – la gauche sera complètement mise à l'écart, laissant le monde à lui-même tout en cultivant avec suffisance sa propre pureté idéologique.
Trois solutions différentes
Réduire les dépenses sociales pour augmenter le budget militaire est à la fois dangereux et réactionnaire. C'est exactement ce que les néolibéraux font déjà aujourd'hui : réduire les fonds alloués à la santé, à l'éducation, aux pensions et à la protection sociale – pour ensuite donner plus de ressources à la défense.
Il est clair que l'affaiblissement de la sécurité sociale exacerbera les inégalités, créera des troubles sociaux et finira par déstabiliser les démocraties. À l'heure où le populisme de droite se développe, les politiques d'austérité ne feront que renforcer les forces antidémocratiques. Étant donné le soutien évident que la Russie et les États-Unis apportent à ces forces, c'est exactement ce que Trump et Poutine espèrent.
Une autre solution consiste à augmenter les impôts des ultra-riches et des multinationales. Celles et ceux qui ont le plus bénéficié de la démocratie devraient contribuer le plus à sa défense. L'introduction d'impôts progressifs sur la fortune, de taxes sur l'énergie et de règles fiscales plus strictes pour les entreprises peut générer des revenus sans frapper l'ensemble de la population.
Toutefois, une telle stratégie nécessite une coordination internationale pour empêcher la fuite des capitaux, car les milliardaires et les entreprises chercheront sans aucun doute à transférer leurs actifs dans des paradis fiscaux. L'annonce récente par Trump de visas dorés pour les ultra-riches montre qu'il se prépare déjà à un tel scénario en renforçant les États-Unis en tant que havre de paix pour les fraudeurs fiscaux. La Suisse se trouve dans une position similaire puisqu'elle ne fait pas partie de l'UE… précisément pour conserver son statut de paradis fiscal.
Ce n'est pas nouveau. Au siècle dernier, alors que d'autres pays augmentaient les impôts pour financer leurs efforts de guerre, la Suisse a accueilli des milliardaires et s'est enrichie de manière éhontée. Elle pourrait très bien répéter la même stratégie opportuniste.
Une troisième option consiste à confisquer les 300 milliards d'euros de fonds russes gelés et à les utiliser pour financer la défense de l'Ukraine et renforcer la sécurité de l'Europe. De cette manière, la Russie serait tenue financièrement responsable de ses crimes de guerre tout en évitant de faire peser des charges supplémentaires sur les citoyens européens.
Toutefois, les autorités de l'UE craignent qu'une telle décision ne crée un précédent susceptible de saper la confiance dans leurs systèmes financiers, ne serait-ce que pour ceux qui envahissent des États souverains et commettent des crimes de guerre. Toutefois, la justice peut constituer un précédent dangereux dans un système fondé sur la protection des intérêts des riches et des puissants.
La reconnaissance de normes morales dans les décisions économiques et politiques risque d'ébranler les fondements du capitalisme. Une idée impensable pour celles et ceux qui profitent de ses injustices.
Les Verts et les Rouges doivent présenter leurs propres propositions
Si la gauche veut rester pertinente, elle doit développer une stratégie claire en matière de politique de défense. Ignorer la sécurité militaire ne fera que permettre à la droite de monopoliser le débat et de dépeindre la gauche comme naïve ou faible – et si c'était le cas, ce ne serait pas une accusation injuste.
La gauche doit rejeter le faux dilemme entre justice sociale et sécurité nationale. La sécurité ne doit pas être financée en réduisant les pensions ou les soins de santé, mais en veillant à ce que les milliardaires et les multinationales contribuent à leur juste part.
La gauche doit lutter pour une fiscalité équitable, supprimer les niches fiscales qui permettent aux entreprises d'échapper à l'impôt et sévir contre les paradis fiscaux, y compris la Suisse.
Aucun pays européen ne peut se défendre seul. Au lieu d'augmenter massivement les budgets militaires nationaux, l'UE devrait renforcer les mécanismes de sécurité collective. La sécurité énergétique doit également être considérée comme une partie intégrante de la stratégie militaire : en réduisant la dépendance à l'égard des combustibles fossiles russes, nous pouvons empêcher un futur chantage économique.
Surtout, la gauche doit agir rapidement pour obtenir la confiscation des biens de l'État russe. Retarder cette décision pour protéger les intérêts de l'élite financière ne fait qu'enhardir les attaquants.
Hanna Perekhoda
Hanna Perekhoda est historienne et chercheuse à l'Université de Lausanne et activiste au sein de l'ONG ukrainienne « Sotsialnyi Rukh ».
https://solidaritet.dk/venstrefloejen-maa-afvise-det-falske-dilemma-mellem-social-retfaerdighed-og-national-sikkerhed/
Traduit avec DeepL.com (version gratuite)
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Comment gérer les dilemmes de défense de l’Europe ?

Le partage imminent de l'Ukraine entre Trump et Poutine a divisé l'opinion publique européenne, y compris parmi les amis de l'Ukraine. Ici, Chris Zeller conteste l'analyse récente de Hanna Perekhoda sur la défense et la solidarité européennes..
Chère Hanna,
Je comprends tes arguments. Je partage ta position selon laquelle nous avons besoin d'une perspective de solidarité pour l'ensemble du continent européen. Cette perspective inclut un soutien massif à la résistance ukrainienne. Cependant, le fait que les pays d'Europe et les États-Unis aient jusqu'à présent accordé trop peu de soutien à l'Ukraine n'est pas dû à une infériorité militaire vis-à-vis de la Russie, mais à des raisons politiques et économiques. Au moins certains secteurs importants du capital ont toujours visé à reprendre des « relations économiques raisonnables » avec la Russie.
Il est juste d'exiger que les États européens garantissent que l'Ukraine puisse se défendre. Je suppose que les stocks d'armes de défense aérienne de tous les États européens suffiraient à eux seuls à protéger la population des grandes villes ukrainiennes.
Néanmoins, l'appel à un armement général est erroné. Nous devons considérer le contexte global et planétaire. Et à cet égard, nous sommes confrontés à d'énormes dilemmes qui semblent presque insolubles.
L'attaque de la Russie contre l'Ukraine a contribué à ce que le réchauffement climatique soit largement écarté du débat public. Le réchauffement climatique s'accélère et dans environ cinq à sept décennies, cela signifiera que de grandes parties des zones peuplées ne seront plus habitables de façon permanente. 3 milliards de personnes ne vivront plus dans la niche de température qui a prévalu ces 6 000 dernières années. La rivalité impérialiste et la consommation matérielle des armements feront augmenter massivement les émissions de gaz à effet de serre. La vague d'armement qui s'annonce rendra improbable une réduction substantielle du réchauffement climatique et mettra ainsi directement en péril la reproduction physique non pas de millions, mais de milliards de personnes en quelques décennies.
Le système terrestre change brusquement et marquera tous les conflits sociaux.
Nous ne pouvons pas approuver un réarmement général des puissances impérialistes européennes. Elles utiliseront leur force militaire pour faire valoir leurs revendications par la force dans le contexte d'une rivalité accrue pour les minerais rares et coûteux, les terres rares, les terres agricoles et même l'eau, que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe ou ailleurs. Leur méthode d'adaptation au réchauffement climatique est la militarisation de la société et des frontières et l'exclusion du nombre toujours croissant de personnes superflues. Cela signifie que les puissances européennes voudront également utiliser leur force militaire pour affirmer leurs ambitions coloniales. Après tout, ce n'est rien de nouveau.
Le réarmement conduira à une distribution encore plus inégale des ressources sociales et à l'enrichissement des secteurs les plus pervers du capital.
Comment pouvons-nous faire face à ces dilemmes ?
1.) Les États européens doivent être contraints de livrer un maximum de leurs stocks d'armes (notamment de défense aérienne), y compris des informations de renseignement, à l'Ukraine.
2.) Nous devons exiger la socialisation de l'industrie de l'armement. Cette industrie doit orienter sa production vers les besoins actuels de l'Ukraine. Les livraisons d'armes à d'autres pays, notamment Israël, l'Arabie saoudite et l'Égypte, doivent être arrêtées. Le réarmement au service d'intérêts néo-coloniaux et impérialistes doit être rejeté. Mais nous devons admettre que cette différenciation est difficile à faire dans la réalité.
3.) Nous devons immédiatement entamer une discussion continentale approfondie sur un système de sécurité paneuropéen. Une attention particulière doit être accordée aux besoins des États baltes potentiellement menacés et de la Moldavie. Nous devons empêcher que la sécurité sociale et écologique ne soit compromise. Une compréhension continentale globale de la sécurité combine la sécurité sociale, écologique et physique. Cela n'est possible qu'au niveau continental.
4.) Nous devons également développer une politique qui aide à convaincre la population générale et particulièrement la classe ouvrière en Russie (et ailleurs) de rompre avec leurs dirigeants. Si les gens perçoivent le réarmement européen comme étant dirigé contre eux, cette préoccupation deviendra impossible.
5.) Nous devons maintenir la perspective d'une rupture mondiale avec le pouvoir capitaliste, une restructuration mondiale et le démantèlement de l'industrie de l'armement, et enfin un bouleversement éco-socialiste, et la remplir d'autant de vie concrète que possible dans les luttes quotidiennes.
Christian Zeller ,20 mars 2025
Christian Zeller est un militant du Réseau européen de solidarité avec l'Ukraine (RESU-ENSU).
https://ukraine-solidarity.eu/
Il est professeur de géographie économique et membre du comité de rédaction de la revue germanophone « emancipation – Journal for Ecosocialist Strategy ».
La note de Chris Zeller, publiée sur Facebook, est adressée à Hanna Perekhoda : Comment financer la défense européenne (et comment ne pas le faire)
https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article73898
Traduit pour ESSF par Adam Novak
https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article74144
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’escalade de la violence à l’égard des femmes en Iran : Augmentation du nombre de cas et absence de protection juridique

Plus de 28 000 femmes victimes de violences demandent des rapports médicaux légaux à Téhéran
L'escalade de la violence à l'égard des femmes en Iran : Au cours des 8 premiers mois de 2024, plus de 28 000 femmes à Téhéran ont demandé des rapports médicaux dans des centres médico-légaux en raison de blessures subies lors d'altercations physiques, dont une part importante est attribuée par les experts à la violence domestique.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/03/26/la-mission-denquete-sur-liran-met-en-evidence-la-persecution-systematique-des-femmes-et-des-filles-autres-textes/?jetpack_skip_subscription_popup
Selon Omidreza Kargar-Bideh, directeur de l'organisation de médecine légale de Téhéran, 74 845 personnes se sont rendues dans ces centres à la suite d'incidents violents, ce qui représente une augmentation de 2,5% par rapport à la même période de l'année précédente.
Parmi les personnes ayant demandé une évaluation médico-légale, 46 528 étaient des hommes et 28 317 des femmes. L'augmentation du nombre de cas impliquant des femmes met en évidence le problème persistant de la violence sexiste en Iran. Bien qu'elles puissent obtenir des rapports médicaux médico-légaux à titre de preuve, les victimes de violences domestiques se heurtent à d'importants obstacles juridiques, car les tribunaux iraniens ne criminalisent pas les violences domestiques à l'encontre des femmes en raison de lacunes juridiques dans le système judiciaire du pays.
Cette situation survient alors que la commission des affaires sociales du parlement iranien examine un projet de loi intitulé « Protection de la dignité et soutien aux femmes contre la violence », qui est dans les limbes de la législation depuis des années. Introduit à l'origine sous la présidence de Hassan Rouhani dans les années 2010, le projet de loi visait à lutter contre la violence à l'égard des femmes, mais il a depuis fait l'objet de révisions approfondies favorisant l'interprétation de la loi islamique par le régime. Les défenseurs des droits des femmes ont critiqué la version modifiée, arguant qu'elle ne fournissait pas de protections significatives aux victimes de violences basées sur le genre.
Absence de refuges sûrs pour les victimes d'abus domestiques
Outre les obstacles juridiques, les femmes victimes de violences domestiques en Iran sont confrontées à une grave insuffisance de refuges sûrs. Selon Fatemeh Babakhani, directrice du refuge Mehr Shams-Afarid, il n'y a actuellement que 17 refuges opérationnels pour les femmes dans tout le pays, ce qui signifie que la moitié des provinces iraniennes ne disposent d'aucun refuge pour les victimes de violences domestiques.
Mme Babakhani a souligné le rôle essentiel que jouent ces refuges en fournissant un hébergement temporaire et des services de soutien, notamment des conseils psychologiques, une assistance juridique et une formation professionnelle. L'âge moyen des femmes qui cherchent un refuge se situe entre 18 et 34 ans, mais il y a aussi des mineurs parmi les victimes. Elle a raconté le cas d'une jeune fille de 13 ans qui avait été forcée à se marier, était tombée enceinte et avait accouché pendant son séjour au refuge.
Les causes profondes de la violence domestique et l'inaction du régime iranien
Hassan Ahmadi, expert juridique au sein du système judiciaire iranien, a identifié les principaux facteurs contribuant à la violence domestique, notamment les attitudes culturelles qui traitent les femmes comme des biens, les difficultés économiques, les troubles psychologiques et le manque d'éducation juridique. Il a souligné que la pauvreté, le chômage et le stress financier exacerbent les tensions familiales, tandis que les troubles mentaux non traités, tels que la dépression et la mauvaise gestion de la colère, alimentent la violence domestique.
M. Ahmadi a également mis en évidence le rôle des normes culturelles qui tolèrent la violence comme méthode de contrôle, en particulier en l'absence de répercussions juridiques. Il a exhorté le régime iranien à mettre en œuvre des lois plus strictes contre la violence domestique et à faciliter l'accès des victimes aux services judiciaires et de soutien.
Conclusion
Le nombre croissant de femmes cherchant à obtenir un rapport médico-légal à Téhéran souligne le besoin urgent de protections juridiques et de systèmes de soutien pour les victimes de violences domestiques. Cependant, la réticence du régime iranien à criminaliser la violence domestique et le manque de refuges sûrs laissent d'innombrables femmes vulnérables à la violence continue. Bien que les organisations locales et les refuges apportent une aide essentielle, un changement systémique reste impossible tant que les réformes juridiques sont entravées par le programme misogyne du régime. Sans changement de régime, le cycle de la violence à l'égard des femmes en Iran persistera, laissant de nombreuses femmes sans recours ni refuge.
https://wncri.org/fr/2025/03/25/violence-a-legard-des-femmes-en-iran/
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Guatemala : mobilisation des femmes autochtones pour la vie, la terre et le territoire

Dans le cadre du 8 mars, les femmes paysannes et autochtones sont descendues dans la rue pour commémorer leur lutte et leur résistance à travers le pays. Elles ont également mené des actions de formation et d'incidence dans leurs territoires.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/03/30/guatemala-mobilisation-des-femmes-autochtones-pour-la-vie-la-terre-et-le-territoire/?jetpack_skip_subscription_popup
La Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (Conavigua), membre de la CLOC – La Via Campesina, s'est mobilisée à Tegucigalpa et, dans un communiqué, a salué toutes les femmes. Elle a rendu hommage à la mémoire et à l'histoire des aïeules qui ont tracé la voie, en exprimant sa gratitude pour leur exemple de lutte et de résistance, ainsi que pour la transmission des savoirs de génération en génération.
Elles ont également souligné et reconnu les efforts et l'engagement des femmes paysannes et autochtones pour éradiquer toutes les formes de violence, le patriarcat et la criminalisation des luttes sociales. Enfin, elles ont insisté sur l'importance de dénoncer toute forme de discrimination raciale qui affecte leur vie.
Extrait de leur communiqué :
Nous encourageons et exprimons notre solidarité avec nos sœurs de la communauté linguistique Achí, engagées dans une lutte intense pour exiger justice face aux graves violations de leurs droits humains subies durant la guerre, en particulier les violences sexuelles. Aujourd'hui, les tribunaux de justice cherchent à instaurer l'impunité, mais nous saluons le courage de ces femmes et les encourageons à poursuivre la consolidation de leurs luttes. Nous appelons à renforcer les alliances, les coordinations et les réseaux aux niveaux national et international, car ce n'est qu'ainsi que nous pourrons garantir une vie digne et épanouie pour toutes les femmes.
Nous soutenons et encourageons les femmes, en particulier les femmes mayas, qui occupent des postes publics. Elles doivent continuer à exercer leur leadership, faire valoir leur talent et leurs compétences pour soutenir et accompagner les revendications des femmes en faveur de l'autonomie économique. Celle-ci est essentielle pour nourrir leur indépendance et leur aspiration à une vie pleine et entière.
Les femmes Q'eqchí commémorent leur lutte pour la terre et le territoire dans la vallée du Polochic
Les femmes Q'eqchí, membres du Comité d'Unité Paysanne (CUC), ont commémoré leur lutte pour la terre et le territoire à travers un acte de résistance et d'unité, réaffirmant leur rôle de gardiennes de leur territoire ancestral.
Lors de l'événement, Claudia, l'une des dirigeantes de la communauté, a adressé un message de bienvenue soulignant l'importance de la persévérance et de la sororité dans la lutte pour les droits collectifs. « Embrassons nos chemins de lutte avec force. Nous sommes les gardiennes de la terre. Ne laissons rien nous arrêter et unissons nos forces, de femme à femme, de communauté à communauté, pour obtenir les changements que nous désirons », a-t-elle déclaré.
Matilde, de la communauté de San Esteban, a insisté sur la nécessité pour le système judiciaire de protéger les femmes contre toutes les formes de violence, dénonçant l'absence de justice dans les communautés rurales, où de nombreux cas de violences sexuelles restent impunis. Elle a également exprimé son rejet de l'augmentation de salaire des députés, affirmant que « ce n'est pas juste d'augmenter leur salaire alors qu'ils n'ont rien fait pour le peuple. Nous refusons aussi les spoliations causées par les grands propriétaires terriens, car elles nous causent beaucoup de souffrance ».
Cette rencontre a été une occasion de renforcer l'organisation communautaire et de rendre visible la lutte des femmes autochtones pour la défense de leurs droits fonciers. Dans un contexte marqué par des conflits territoriaux, elles ont réaffirmé leur engagement à protéger leurs ressources naturelles et leur identité culturelle, diffusant un message d'unité et de résistance.
Cette publication est également disponible en Español.
https://viacampesina.org/fr/guatemala-mobilisation-des-femmes-autochtones-pour-la-vie-la-terre-et-le-territoire/
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La résistance secrète des femmes afghanes face au patriarcat religieux

Depuis 2021, les femmes afghanes subissent une pression brutal sous les talibans. Privées d'éducation et de libertés, elles résistent en secret par des écoles clandestines et les réseaux sociaux. Malgré les menaces, leur lutte pour la justice et l'égalité persiste.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/03/16/etre-femme-en-afghanistan-ou-quand-chanter-en-public-devient-un-crime/?jetpack_skip_subscription_popup
Il est évident que les talibans ont systématiquement exclu les femmes afghanes de la vie sociale et politique, menant une guerre inégale contre elles.
Les dirigeants talibans, dans leur volonté de réduire le rôle des femmes dans la société, tentent de justifier cette répression par des arguments religieux et idéologiques. Dans cette analyse, nous examinerons comment ces politiques patriarcales, justifiées par des interprétations religieuses, sont utilisées pour légitimer la répression, et comment les femmes afghanes résistent à cette idéologie misogyne.
Le patriarcat religieux comme outil de domination des femmes
Les femmes afghanes ont toujours fait face à de vastes défis en matière de violations de leurs droits humains. Après la chute du régime taliban en 2001 et l'instauration d'un gouvernement démocratique, certaines tentatives ont été faites pour inclure les femmes dans les sphères sociales et politiques, mais la réalité est que ces changements étaient superficiels et instables. Au sein de la société afghane, dominée par des idéologies patriarcales et religieuses, ces changements limités n'ont pas conduit à une transformation réelle.
La catastrophe est survenue lorsque les talibans ont repris le pouvoir en 2021. À ce moment-là, tous les efforts visant à améliorer la situation des femmes ont été anéantis. Avec le retour des talibans, les femmes afghanes ont non seulement été privées de leurs acquis passés, mais elles se sont retrouvées engagées dans une guerre inégale contre leurs droits fondamentaux.
Les talibans, en abusant d'interprétations extrémistes de l'islam, ont sévèrement limité les droits des femmes, les excluant systématiquement des activités sociales et politiques. Cette tragédie humaine et ce scandale moral et politique sont généralement justifiés par des interprétations rigides et extrémistes de l'islam. Lorsqu'une société patriarcale affirme « les hommes sont les protecteurs des femmes en raison de la préférence de Dieu », un combattant taliban, formé dans des écoles religieuses, trouve une légitimation de son pouvoir sur les femmes dans ce que lui enseignent les prédicateurs : les hommes ont une position supérieure aux femmes dans tous les domaines, de la maison à la société.
C'est ainsi que la présence des femmes dans une société patriarcale est considérée comme inacceptable par les hommes détenant le pouvoir politique. Lors du retour au pouvoir des talibans, leur première mesure a été d'interdire l'éducation des filles au-delà du niveau primaire. En se basant sur leur propre interprétation de l'islam, ils ont systématiquement privé les femmes d'accès à l'éducation.
Selon Richard Bennett, rapporteur spécial de l'ONU, entre septembre 2021 et mai 2023, plus de 50 décrets ont été émis par les talibans restreignant les droits des femmes et des filles, notamment leurs droits à la circulation, à l'habillement, à la conduite, à l'accès à l'éducation, à l'emploi, à la santé et à la justice. (Richard Bennett, 2023) Tous ces décrets sont appliqués par une structure appelée « la promotion de la vertu et la prévention du vice », et toute personne désobéissant à leurs ordres s'expose à l'arrestation et à l'emprisonnement.
D'autre part, le patriarcat religieux en Afghanistan, par l'utilisation d'interprétations extrémistes de l'islam, rend la violence contre les femmes légitime. Les talibans ont non seulement privé les femmes de leurs droits fondamentaux, mais ils justifient également la violence domestique sous les enseignements déformés de la religion.
Dans les zones rurales, la violence domestique est courante et de nombreuses femmes, par peur des représailles ou en raison de problèmes sociaux, ne peuvent pas la signaler. Selon Amnesty International, 85% des femmes afghanes ont subi des violences domestiques, mais en raison du manque de soutien juridique et de la peur des conséquences sociales, elles restent majoritairement silencieuses. (Amnesty International, 2021)
La résistance secrète des femmes afghanes contre l'oppression des talibans :
Bien que les manifestations des femmes afghanes contre les politiques des talibans soient durement réprimées, et que celles-ci soient systématiquement arrêtées et torturées sous prétexte de « contravention à la charia », les femmes afghanes continuent de résister par des actions secrètes et sociales. En particulier dans le domaine de l'éducation, les femmes afghanes ont organisé des classes secrètes et utilisé les nouvelles technologies pour étudier clandestinement.
Selon le rapport de l'UNESCO (2022), les femmes afghanes ont organisé des classes secrètes dans certaines régions où des filles de différents villages se rassemblent pour recevoir une éducation. Cette résistance à la répression éducative est un exemple de résistance à l'injustice, salué non seulement en Afghanistan, mais aussi au niveau mondial. En outre, les femmes afghanes ont également résisté dans les luttes sociales et culturelles pour préserver leurs droits.
Elles utilisent les médias sociaux, notamment en dehors de l'Afghanistan, pour partager leurs récits avec le monde. Ces actions, malgré les menaces de sécurité et les pressions des talibans, continuent. Selon les Reporters sans frontières (RSF, 2021), de nombreuses femmes afghanes ont utilisé les réseaux sociaux pour diffuser des informations sur les violations des droits humains et, malgré les menaces graves des talibans, elles poursuivent leur lutte.
À cet égard, les femmes afghanes ont résisté non seulement aux répressions physiques et psychologiques, mais elles ont aussi utilisé le retrait du voile obligatoire comme moyen de protester contre l'injustice des talibans. Cette résistance n'est pas seulement une tentative de sauver les femmes individuellement, mais aussi de sauver la société dans laquelle elles vivent, et elle témoigne de la force de leur volonté face à un gouvernement patriarcal.
La résistance des femmes afghanes contre les talibans est un exemple de lutte secrète et de résistance silencieuse qui, dans de nombreux cas, est restée cachée aux yeux des médias. Malgré les menaces graves, les attaques violentes et les restrictions sévères imposées par la société sous le régime taliban, les femmes afghanes continuent de lutter pour leurs droits et pour le progrès social. Cette résistance n'est pas seulement une réaction aux oppressions, mais aussi un outil de changement et d'accès à la justice sociale et aux droits humains.
À mon avis, la solidarité mondiale avec la résistance des femmes afghanes contre l'oppression des talibans, en tant que mesure essentielle pour lutter contre le patriarcat religieux et la violence envers les femmes, pourrait avoir des effets significatifs. Malgré les menaces et les répressions sévères, les femmes afghanes restent debout pour défendre leurs droits, et leurs luttes sont non seulement admirées en Afghanistan, mais aussi au niveau mondial.
Le soutien et la solidarité internationale avec ces résistances pourraient remettre en cause la légitimité des régimes patriarcaux et extrémistes tels que les talibans et, en fin de compte, conduire à des changements culturels et sociaux qui aideraient à mettre fin à la discrimination fondée sur le sexe et à la violence contre les femmes. Par conséquent, en poursuivant le soutien aux droits des femmes et en élargissant la sensibilisation mondiale à cet égard, nous pouvons faire un grand pas vers l'égalité des sexes et la justice sociale.
Amnesty International. (2021). Afghanistan : Violence Against Women.
(2022). Tamana Zaryab Priyani's Arrest and Torture.
Richard Bennett, Special Rapporteur of the United Nations, « Report on the Situation of Women in Afghanistan », September 2021 – May 2023.
UNESCO, « Education under Taliban Rule », 2022.
Reporters Without Borders (RSF), « Women Journalists in Afghanistan », 2021.
Rohullah Taheri, journaliste
https://blogs.mediapart.fr/rohullahtaheri/blog/110325/la-resistance-secrete-des-femmes-afghanistanes-face-au-patriarcat-religieux
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

¡ Vivas nos queremos !

Ce que le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes, ne doit pas être pour Yolanda Becerra Vega, c'est une date instrumentalisée par et pour les grandes entreprises pour s'enrichir sur le dos de l'appauvrissement social et économique des femmes. Le 8 mars doit servir à la commémoration des luttes des femmes pour le respect de leurs droits, offrir un espace politique pour réfléchir aux enjeux féministes et permettre aux militant.es de se retrouver et s'organiser.
Tiré du Journal des Alternatives : Alter- Québec
Crédit photo : site de l'Organisation populaire des femmes de Colombie
Vivantes, nous voulons être !
La militante féministe colombienne et défenseuse de droits humains était l'invitée d'un webinaire initié par la section québécoise de l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC-Québec) le 6 mars dernier, en collaboration avec le Centre international de solidarité ouvrière (CISO) et le Projet Accompagnement Solidarité Colombie (PASC).
À l'origine de l'Organisation populaire des femmes
Après avoir rejoint l'Organisation populaire des femmes (Organización Feminina Popular — OFP) en 1980, soit huit ans après sa création, Yolanda Becerra Vega a fondé sa direction nationale. L'OFP est un organisme à but non lucratif qui œuvre pour la défense des droits fondamentaux des femmes et la justice sociale en Colombie. Elle se positionne activement contre le conflit armé colombien et promeut des méthodes non violentes pour favoriser l'émancipation et l'autonomisation globale des femmes.
L'ADN politique de l'OFP a été forgé par le contexte géopolitique lors de la formation de l'organisation. Barrancabermeja, capitale de la région du Magdalena Medio et ville où est née l'OFP, est le principal moteur de l'industrie pétrolière en Colombie et abrite la plus grande raffinerie du pays. Cette réalité a transformé la ville en point stratégique dans le contexte du conflit armé, engendrant ainsi de nombreuses violences affectant particulièrement les femmes.
Assurer un soutien à ces femmes a été au cœur de l'action de l'OFP depuis ses débuts. Il s'agissait notamment de leur paver un chemin vers de plus amples possibilités, et faire face aux protagonistes dans le conflit.
Parmi les nombreuses initiatives menées par l'OFP, Yolanda Becerra Vega a évoqué l'inauguration du musée Casa Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de las Mujeres en 2019. Il s'agit du seul espace en Colombie qui traite le conflit armé dans une perspective du genre et qui met en lumière les luttes populaires menées par les femmes. La dirigeante colombienne mentionnait l'inscription de ce projet dans un effort de développement de méthodologies de résistance pour les femmes. Elle évoquait également le choix d'une esthétique muséal qui rappelle la vie, alors que la mort rôde et guette de manière disproportionnée celles qui osent lever le ton quant à leur sort.
Le triomphe du nécrocapitalisme
Le thème de la mort a été répété à maintes reprises lors du webinaire. En mars 2025, selon l'Observatorio Colombiano de Feminicidios, 79 féminicides ont déjà été commis depuis le début de l'année. Les femmes colombiennes sont de plus en plus appauvries, et ce jusqu'à être dépourvues de la vie. Ici, la mort — ou la vie dans des conditions pratiquement invivables — devient un outil qui bénéficie économiquement à ses responsables en permettant l'accumulation de moyens de production et de profits. C'est ce que le sociologue Subhabrata Bobby Banerjee définit comme le nécrocapitalisme.
Selon Yolanda Becerra Vega, les économies antérieures ont apporté la mort et la précarité en Colombie, et ont laissé les femmes pauvres, seules, et exclues. Si elles survivaient aux persécutions des grandes entreprises pétrolières et des différents groupes armés, les femmes étaient souvent sous l'emprise d'un mode de vie restreint par les rôles genrés.
Bien qu'elles soient diplômées tout autant que les hommes, les femmes demeurent sous-représentées dans le marché du travail en Colombie. C'est entre autres pour cette raison que l'OFP et sa représentante militent avec autant d'ardeur pour le droit à la vie et pour les droits ouvriers des femmes colombiennes.
Pas de Paz Total sans les femmes
L'arrivée du gouvernement de Gustavo Petro au pouvoir en Colombie, il y a de cela bientôt trois ans, s'est accompagnée de l'instauration d'une politique de paix dite Paz Total. Celle-ci vise le renforcement des accords de paix signés en 2016 par l'ancien président Iván Duque et les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), et ce par l'emploi de la négociation et d'autres stratégies politiques et légales. L'objectif ultime est l'aboutissement de la transition d'un état de conflit armé vers une paix effective dans le pays.
Alors que les violences liées au conflit ont récemment augmenté de manière significative en Colombie, notamment dans le Catatumbo où la guerre entre des groupes dissidents des FARC et l'Armée de libération nationale a engendré le déplacement forcé de plus de 50 000 personnes, Yolanda Becerra Vega insiste sur le fait que la transition vers la paix ne peut se faire sans la prise en compte des revendications des femmes et l'application transversale de la perspective du genre.
Les femmes ont historiquement été exclues du processus de paix colombien. Les organisations de femmes continuent ainsi d'être d'une grande utilité, et la nécessité du travail qu'elles réalisent est d'autant plus criante en Colombie. Dans un contexte de répression et d'absence de l'État dans de nombreuses régions du pays, l'OFP et ses collègues permettent aux femmes de manger, de travailler, de penser, de lutter et de survivre, tout en offrant aux jeunes filles des espaces pour grandir et se définir au-delà de la pauvreté.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le travail invisible du clic : une exploitation systématique à l’échelle mondiale

Plusieurs personnes ont déjà eu recours à l'intelligence artificielle (IA) pour obtenir des réponses instantanées ou pour recevoir un service rapide. Pourtant, derrière ces systèmes, présentés comme des actions technologiques autonomes, se cache un travail invisible, effectué par des humains. Ce travail, largement méconnu, soulève des enjeux majeurs liés aux droits humains, où cette main-d'œuvre est invisibilisée, mal rémunérée et exploitée.
Tiré du journal Alter Québec
https://alter.quebec/le-travail-invisible-du-clic-une-exploitation-systematique-a-lechelle-mondiale/
Par Maîka Desjardins Communications CISO -21 janvier 2025
Un travail précaire et déshumanisant
Le travail du clic consiste à diviser des tâches simples et répétitives comme du tri de données, de la reconnaissance d'image ou des évaluations de produits accomplies par plusieurs personnes, le plus souvent pour une rémunération indécente. À l'échelle mondiale, entre 45 et 90 millions de personnes réalisent ce type de travail dans des conditions précaires. Sans statut juridique clair auprès de l'État, elles sont privées de leurs droits fondamentaux : elles n'ont ni contrat de travail défini, ni protection sociale, ni recours en cas de licenciement déraisonnable. Elles sont connectées en permanence, prêtes à accomplir des tâches mécaniques et déshumanisantes, en plus d'être constamment exposées à des images violentes, pour un salaire très bas. Ces facteurs engendrent une perte de sens du travail, pouvant mener à de l'épuisement psychologique.
Ce travail, dans sa forme actuelle, est un exemple criant d'exploitation systématique dans l'ère numérique, qui pèse sur des millions de vies. L'invisibilité du travail du clic est essentielle à son efficacité. C'est l'une des raisons pour lesquelles ce travail reste largement ignoré du grand public : l'illusion d'une IA autonome masque la réalité d'une exploitation humaine et fait taire les critiques.
Le cas de MTurk
Laplateforme numérique Amazon Mechanical Turk (MTurk), qui distribue des microtâches à des travailleur.se. s à l'échelle mondial en est un exemple. En 2018, seulement 2676 « Turkers » ont réalisé 3,8 millions de tâches à un rythme effréné du travail à la demande. À tout moment, une alerte HIT (Human Intelligence Tasks) surgit pour indiquer une nouvelle « offre d'emploi ». Les travailleur.se. s ont un temps limité pour réaliser la microtâche et la soumettre pour ne gagner qu'entre 2 $ et 7,25 $ de l'heure. Toutefois, seuls les Turkers américains et indiens sont rémunérés en argent, les autres doivent se contenter de bons d'achat Amazon ! Également, la rémunération n'inclut pas tout travail lié à la recherche de tâches, celles rejetées par l'employeur et celles qui n'ont jamais été envoyées.
Un nouveau modèle économique : le « cyber prolétariat »
Ce modèle de travail abusif, le « cyber-prolétariat », permet aux géants technologiques de se déresponsabiliser en sous-traitant des microtâches, créant des conditions d'exploitation invisibles, et ce, à l'échelle mondiale. Des travailleur.se. s sont privé.es de droits et de protections, vivant dans l'incertitude permanente et soumise à des rythmes de travail épuisants et déshumanisants. Il ne s'agit pas uniquement de conditions de travail précaires, mais d'un véritable système qui structure et renforce les rapports de force dans une économie numérique qui échappe à tout contrôle social. Le danger réside dans l'illusion entretenue par les géants du numérique que ce modèle est non seulement inévitable, mais qu'il s'agit d'une forme de « liberté » pour les travailleur.ses qui peuvent choisir leurs tâches et leurs horaires. Ce discours de l'autonomie individuelle dissimule un système fondé sur l'exploitation, où chaque travailleur.ses est responsable de sa propre précarité, sans recours possible ni pouvoir de négociation. Leur isolement et leur absence de liens formels avec l'employeur rendent extrêmement difficile leur organisation collective.
Des initiatives de résistance pour l'éthique et la dignité de travail
Face à cette réalité, diverses initiatives tentent d'inverser la tendance et de proposer des solutions pour améliorer les conditions de travail des travailleur.se. s du clic.
L'Organisation internationale du Travail (OIT), dans son rapport de 2018, dresse 18 critères pour garantir un travail décent avec une reconnaissance des droits fondamentaux dans le secteur du numérique, notamment par l'instauration d'un salaire minimum en fonction du pays de résidence des travailleur.ses et un encadrement juridique du travail du clic.
Des plateformes alternatives telles que Daemo souhaitent concurrencer MTurk en offrant un espace de travail décent et respectueux des travailleur.ses. Parallèlement, des extensions ont été développées servant à trier les tâches plus efficacement, à créer des alertes lors d'apparition de tâches mieux rémunérées. Des plateformes comme Turkopticon et FairCrowdWork permettent aux travailleur.se. s de noter les plateformes de microtâches, leurs employeurs et leurs collègues pour améliorer la transparence des plateformes. Finalement, un guide de bonnes pratiques, The Dynamo Guideline, a été élaboré pour les recherches universitaires utilisant le travail du clic afin d'assurer une éthique dans l'utilisation des données.
Malgré tout, ces initiatives, bien qu'essentielles, restent marginales et ne suffisent pas à contrer l'ampleur du phénomène en s'attaquant aux racines structurelles de l'exploitation. Les géants du secteur, tels qu'Amazon, restent largement dominants et les efforts pour créer une véritable régulation des plateformes numériques se heurtent à des résistances politiques et économiques importantes.
Pour véritablement changer la donne, il est urgent de repenser le modèle économique des plateformes numériques. Cela implique notamment une régulation forte, une reconnaissance des travailleur.ses du clic comme salarié.es, avec tous les droits associés à ce statut, ainsi qu'un engagement à faire respecter des normes sociales et éthiques dans l'économie numérique.
Il faut repenser l'avenir de l'IA en termes d'impacts technologiques, humains, environnementaux et sociaux. Le fait de construire une société plus juste et plus démocratique doit demeurer une priorité et ce, peu importe les tendances technologiques actuelles.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Exilé·es et emprisonné·es, les syndicalistes biélorusses poursuivent leur combat

Adapté d'un exposé présenté lors du webinaire « Labour Movements Under Authoritarian Regimes » organisé par Global Labour Column, Salidarnast e.V., Industrial Workers Federation of Myanmar, et Hong Kong Labour Rights Monitor, février 2025.
Tiré de Entre les lignes et les mots
Le Belarus est l'un des dix pires pays pour les travailleurs et les travailleuses selon l'indice mondial des droits de la Confédération syndicale internationale. Il se classe parmi les champions du monde des violations des droits des êtres humains, y compris des droits syndicaux. Depuis 2022, il est classé parmi les pays où la liberté d'association n'existe pas. Comment un pays situé au centre géographique de l'Europe a-t-il pu devenir une dictature comptant plus de 1 500 prisonnier·es politiques ?
Tout a commencé il y a plus de 30 ans avec l'élection d'Alexandre Loukachenko, qui est resté président du Belarus depuis 1994. Il a fait campagne en promettant de maintenir les emplois, de préserver les liens économiques avec la Russie post-soviétique et de s'assurer des ressources moins chères. M. Loukachenko a habilement joué sur l'incertitude, la pauvreté et la peur des travailleurs et des travailleuses face à une économie de marché déréglementée en promettant un retour aux « meilleures pratiques » du passé soviétique.
Pendant trois décennies, Loukachenko a maintenu sa main de fer sur le pouvoir en organisant des élections frauduleuses, en kidnappant les opposant·es politiques et en transformant la Fédération des syndicats du Belarus (FTUB) en un instrument de l'appareil idéologique de l'État. Depuis les années 1990, le régime a sévèrement limité l'espace de la société civile démocratique au Belarus.
Néanmoins, cette société civile démocratique, y compris les syndicats indépendants, a réussi à se développer contre la volonté de l'État. Grâce à la protection des institutions internationales de défense des droits des êtres humains, de l'Organisation internationale du travail et de la Confédération syndicale internationale, le mouvement ouvrier a conservé une certaine marge de manœuvre.
Les médias indépendants, les organisations non gouvernementales et les syndicats démocratiques – réunis au sein du Congrès biélorusse des syndicats démocratiques –- ont offert une voie alternative aux Biélorusses. Cet écosystème fragile a été fortement perturbé en 2020.
Le réveil de 2020
La pandémie mondiale de COVID-19 a entraîné des changements spectaculaires au Belarus. Après des décennies de survie passive, les biélorusses se sont finalement réveillé·es face à une pandémie pour laquelle l'État n'assurait pratiquement aucune protection de la santé publique. Les citoyen·nes ont été contraint·es de s'organiser au niveau local pour simplement survivre.
Le mouvement de protestation, alimenté par la méfiance à l'égard des autorités, est apparu entre les échecs du gouvernement face à la pandémie et les élections présidentielles qui se sont révélées frauduleuses. Lorsque les électeurs et les électrices ont réalisé que leurs bulletins de vote contre Loukachenko avaient été volés, elles et ils sont descendu·es dans la rue en nombre sans précédent. Des centaines de milliers de personnes ont manifesté pendant des mois.
Les travailleurs et les travailleuses ont adhéré à des syndicats démocratiques et ont défié les autorités par une grève générale. Des structures démocratiques ont commencé à se mettre en place dans presque toutes les entreprises publiques. Pour la première fois, les travailleurs et les travailleuses des secteurs de l'éducation et de la santé ont commencé à former des syndicats de leur choix, au lieu d'être contraint·es de s'affilier à la FTUB, contrôlée par l'État.
Notre stratégie en tant que syndicats démocratiques était simple : organiser, organiser et organiser. Notre objectif était d'offrir aux travailleurs et des travailleuses de différentes professions l'expérience de l'action collective, qui leur avait été systématiquement refusée sous le régime de Loukachenko.
La répression
La force disproportionnée utilisée contre les manifestant·es pacifiques, l'ingérence de la Russie et le rôle de la FTUB, contrôlée par l'État, ont finalement eu raison de ce mouvement démocratique. Les travailleurs et les travailleuses ont manqué de confiance les un·es envers les autres en raison de leur manque d'expérience en matière d'action collective – un déficit provoqué à la fois par le régime de Loukachenko et par le caractère compromis de la FTUB.
Des centaines de milliers de familles biélorusses ont fui le pays. Tous les médias indépendants ont été fermés, les journalistes réduit·es au silence et presque tous les points de vue alternatifs qualifiés d'« extrémisme ». Aujourd'hui, environ 1 500 prisonnier·es politiques croupissent dans les prisons biélorusses, dont de nombreux syndicalistes et le président de la BCDTU.
C'est Alexandre Yaroshuk qui a annoncé l'opposition claire du BCDTU à la guerre en Ukraine. Suite à la déclaration anti-guerre du BCDTU, des arrestations massives de syndicalistes ont eu lieu le 19 avril 2022. Par la suite, tous les syndicats démocratiques ont été dissous sur décision de la Cour suprême du Belarus.
À ce jour, plus de 30 de nos frères et sœurs sont toujours détenu·es dans des colonies pénitentiaires et des prisons avec des libertés restreintes. Qualifiés d'extrémistes et de terroristes, elles et ils portent des étiquettes jaunes sur leurs uniformes de prison pour les distinguer des « criminels ordinaires », ce qui les désigne comme des ennemi·es du régime autoritaire.
Les arrestations se poursuivent quotidiennement sur les lieux de travail en Biélorussie pour des infractions allant de l'abonnement à des chaînes d'information indépendantes à l'apparition sur des photographies des manifestations de 2020, en passant par des dons à des initiatives de la société civile, le soutien à des défenseur·es des droits des êtres humains ou l'aide à la famille d'un·e prisonnier·e politique.
Résistance en exil
Lors des récentes élections en Biélorussie, la FSB a organisé la campagne électorale de Loukachenko et a tenu des bureaux de vote, ce qui prouve une fois de plus qu'elle est un appareil d'État plutôt qu'une organisation de travailleurs et de travailleuses.
Maintenant en exil, nous avons dû adapter notre stratégie. Nous ne pouvons plus nous organiser sur les lieux de travail au Belarus. Les syndicats démocratiques ayant été éliminés, il n'y a plus de liberté d'association dans le pays.
Celles et ceux d'entre nous qui ont fui la Biélorussie poursuivent les activités internationales du BCDTU, en documentant les violations des droits des travailleurs et des travailleuses et en les signalant à l'Organisation internationale du travail et à la Confédération syndicale internationale. L'une de nos principales tâches consiste à soutenir nos camarades restés au Belarus.
Nous nous efforçons également de présenter aux travailleurs et travailleuses biélorusses des alternatives à la dictature. Nous pensons que le principe selon lequel un syndicat fort doit être indépendant et démocratique ne doit pas être oublié par les travailleurs et les travailleuses de n'importe quel pays, en particulier le Belarus. Nous promouvons cette idée par le biais de nos canaux médiatiques et d'un cours en ligne pour les réseaux de travailleurs et de travailleuses que nous lancerons bientôt.
Construire la solidarité internationale
Il est essentiel de nouer des alliances solides avec les syndicats fraternels du monde entier. Nous tendons la main aux camarades du monde entier, en particulier à celles et ceux qui pourraient être trompé·es par la logique « l'ennemi de mon ennemi est mon ami ».
Les dictateurs collaborent et apprennent les uns des autres. Loukachenko et son syndicat d'État jaune recherchent la sympathie du Sud, obtenant souvent un soutien non critique pour s'opposer aux politiques des États-Unis, tout en restant profondément autoritaires et hostiles à nos valeurs communes.
Aujourd'hui, aucun acte de protestation n'est possible au Belarus. La conscience populaire se concentre sur la sécurité, en évitant les arrestations et l'étiquette d'extrémiste. Nous, les travailleurs et les travailleuse, n'avons pas d'armes. Les outils dont nous avons besoin pour construire une société juste basée sur les principes du travail décent et de la liberté d'association doivent être fournis par la solidarité internationale.
Notre tâche, en tant que mouvement de travailleurs et de travailleuses, est maintenant de protéger les mécanismes restants qui peuvent être utilisés contre les violations de la liberté d'association, en particulier l'article 33 de la Constitution de l'Organisation internationale du travail. J'invite les syndicalistes d'Europe, d'Amérique, d'Afrique et d'Asie à reconnaître que la Fédération des syndicats du Belarus n'est pas un véritable syndicat, mais un instrument de la dictature.
À Salidarnast e.V., nous lançons une campagne intitulée « L'activité syndicale n'est pas de l'extrémisme ! » Le 19 avril, nous marquerons le troisième anniversaire des arrestations massives de dirigeant·es syndicaux clés en Biélorussie, dont Alexandre Yarochuk. La Confédération syndicale internationale organisera une campagne et je vous demande, au nom des syndicats indépendants de Biélorussie, d'y participer.
Lizaveta Merliak
Lizaveta Merliak est présidente de Salidarnast e.V. et ancienne dirigeante du syndicat indépendant biélorusse des mineurs et des travailleurs/travailleuses de la chimie. Suite à la répression de 2020 (2022), elle vit aujourd'hui en exil en Allemagne où elle continue de plaider pour un syndicalisme indépendant au Belarus.
https://globallabourcolumn.org/2025/03/13/exiled-and-imprisoned-belarusian-trade-unionists-fight-on/
Traduit avec DeepL.com (version gratuite)
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Quelque chose est en train de changer

Soudain, quelque chose a commencé à bouger. Un appel inattendu de supporters de football a déclenché une mobilisation hétérogène et massive. Ce 24M a dépassé toutes les attentes. Une nouvelle subjectivité est-elle en train de naître ?
28 mars 2025 | tiré de Viento sur | Photo : Marche pour la mémoire, Argentine, 24 mars 2025 – Página12
https://vientosur.info/algo-esta-cambiando/
Les plaques techno-sociales semblent avoir commencé à bouger. Cela ne signifie pas que nous sommes déjà face à une possible éruption sociale – comme cela se produit dans la lithosphère terrestre lorsque commencent les frictions interplaques (bien que, chez nous, on ne sache jamais) –, mais si les plaques sociales, jusqu'ici rigides, commencent à frictionner en surface, c'est bien qu'il se passe quelque chose en leur sein.
Rapide et furieux
C'est ainsi que l'on pourrait nommer la trajectoire descendante qu'ont empruntée le président et son gouvernement depuis le début de l'année. Depuis son discours à Davos, attaquant toute forme de progressisme et proférant des absurdités telles que l'idée que les couples de même sexe ont une tendance à la pédophilie. Puis est venu le cryptogate, qui a laissé le président soit comme complice nécessaire d'une escroquerie pyramidale, soit comme un économiste aspirant au prix Nobel, mais qui s'est fait avoir par plus rusé que lui. Enfin, les Décrets de Nécessité et d'Urgence (DNU), pour nommer des juges ou soutenir un nouvel accord avec le FMI, un accord dont personne ne connaît les détails et dont la concrétisation est sans cesse repoussée. Entre-temps, son principal conseiller a orchestré une interview du président, manifestement arrangée, révélant ainsi qui sont les journalistes corrompus.
La rue
Les mobilisations et les batailles parlementaires ont pris de l'ampleur, nourries par l'ensemble des « erreurs non forcées » du gouvernement, par une situation économique qui alarme aussi bien les gourous de la finance que le patronat, et par la décomposition du système des partis (principal capital politique du gouvernement face à une opposition désorientée, sans leadership ni programme).
Les marches du mercredi, initiées par une centaine de retraités et systématiquement réprimées, étaient devenues une routine. Jusqu'à ce qu'un groupe de supporters décide de soutenir l'un des leurs, gazé lors de la manifestation précédente. L'appel s'est rapidement répandu à d'autres groupes de supporters, aboutissant à un résultat plus symbolique qu'effectif, mais permettant d'amplifier la voix des retraités. Ce fut également une véritable gifle pour le péronisme, qui s'est senti interpellé et est sorti de sa léthargie. (Un militant expérimenté a récemment confié qu'un groupe de supporters de football avait su mobiliser plus de monde que la plupart des dirigeants politiques).
Des centaines de militants ont envahi les rues, rejoints par des membres d'assemblées de quartier, de centres culturels et d'innombrables formes d'organisations sociopolitiques et solidaires. Ainsi, l'un des succès politiques du gouvernement – avoir repris le contrôle de la rue en écartant les piqueteros – a été neutralisé par une foule auto-organisée, manifestant hors des structures partisanes, sans hiérarchie ni commandement.
Ce mercredi 12 mars, la concentration a été massive, et la ministre de la Sécurité n'a eu d'autre réponse qu'une répression encore plus brutale que les précédentes. Les gaz lacrymogènes ont été tirés avant même le début de la manifestation, sans nécessité, sinon pour dissuader la foule en approche. En réponse, les manifestants ont adopté une tactique de violence défensive. Tout s'est terminé avec plus d'une centaine d'arrestations, des blessés en nombre et un photographe touché à la tête par un tir, qui l'a laissé entre la vie et la mort et qui lutte encore aujourd'hui pour sa survie.
Le mercredi 19, la manifestation a été encore plus massive, cette fois avec de nombreux secteurs organisés, mais sans direction politique claire. Le ministère de la Sécurité a été pratiquement mis sous tutelle, et la ministre Patricia Bullrich (dont l'avenir politique est désormais incertain) a été écartée de la préparation d'une stratégie répressive. Cette dernière a inclus le bouclage militaire du Congrès, la diffusion de messages menaçants dans les gares et des contrôles stricts aux entrées de la ville. Certaines sources indiquent que la SIDE aurait été chargée de mener des opérations d'espionnage interne, avec un transfert préalable de 1,6 milliard de pesos. Pendant quelques heures, on a vécu une sorte d'état de guerre. Le slogan « Qu'ils s'en aillent tous ! » a retenti avec force.
Le parlement
Pendant ce temps, le parlement était le théâtre de luttes interpartisanes et de négociations de plus en plus opaques, alors que le gouvernement cherchait à faire approuver par les députés son DNU pour un nouvel accord avec le FMI. Cette approbation a eu un coût politique élevé. Le gouvernement espérait 140 votes favorables, mais n'en a obtenu que 129, et a dû manœuvrer et concéder pour que les abstentions empêchent le rejet d'atteindre les 108 votes requis. Il a cédé la présidence de la commission de contrôle des DNU à un allié peu fiable et a dû allouer des fonds considérables à plusieurs provinces en échange de votes et d'abstentions.
La réponse
La réponse sociale a été variée, marquée par une grande hétérogénéité et sans leadership politique clair. La gauche accompagne et encourage ces mobilisations, mais à chaque fois, de nouveaux secteurs populaires s'y joignent, donnant naissance à une nouvelle dynamique de confrontation avec le gouvernement, peut-être même à une nouvelle perspective politique.
Rien n'est encore consolidé, mais il est clair que l'air du temps change. La marche du 1er février, en réaction aux propos tenus à Davos, a inscrit l'antifascisme et l'antiracisme comme enjeux politiques centraux. L'autorisation du nouvel accord avec le FMI, le même jour qu'une manifestation des retraités, a mis en lumière le lien entre la précarisation des pensions et salaires, la fin du moratoire prévoyant des aides aux retraités et la politique d'austérité permanente dictée par le Fonds. Le 24M a réaffirmé avec force le « Plus jamais ça », face au négationnisme du gouvernement et à sa vision des « deux démons ».
La dynamique des mobilisations a fini par contraindre la CGT à annoncer un plan d'action incluant sa participation au 24M, le soutien aux manifestations des retraités, un possible arrêt de travail général de 36 heures le 10 avril, et une grande marche syndicale pour la Journée internationale des travailleurs et travailleuses.
Rien n'est gratuit
Le cryptogate, les accusations de monnayer des interviews avec le président, ainsi que les concessions pour faire passer le DNU, sapent la prétendue intégrité du gouvernement et le rapprochent de la « caste » qu'il prétend combattre. L'escalade de la violence institutionnelle révèle, quant à elle, ses tendances autoritaires.
La crise économique sous-jacente alimente l'incertitude, la dévaluation et la résurgence de l'inflation, pourtant principal succès politique du gouvernement.
Les élections de mi-mandat seront cruciales : soit le gouvernement consolide son projet en faveur du capital, soit il est freiné, voire renversé, par la réaction populaire dans la rue et dans les urnes.
La lutte des classes est imprévisible, mais il ne faut pas compter sur la spontanéité. Il faut s'y préparer.
Depuis le début de l'année, l'image présidentielle s'est ternie et des doutes grandissent sur sa capacité à gouverner. Oui, quelque chose est en train de changer.
Eduardo Lucita est membre d'EDI (Économistes de gauche).
26/03/2025
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Résistances syndicales dans l’Argentine de Milei

Malgré l'autoritarisme et le massacre à tronçonneuse auquel se livre Javier Milei face aux classes populaires, à l'État social et aux services publics, les travailleur·ses argentin·es ne restent pas l'arme aux pieds. Les derniers mois ont donné lieu à nombre de conflits sociaux, et tout autant de répression, qui appellent d'autant plus un débat profond dans le syndicalisme argentin : accepter un dialogue avec le pouvoir de Milei ou être un vecteur essentiel des résistances sociales ?
31 mars 2025 Résistances syndicales dans l'Argentine de Milei2025-03-
https://www.contretemps.eu/resistances-syndicats-argentine-milei-fascisme/
***
11 février 2025, autoroute panaméricaine, au niveau de la route 197 : un piquete réunissant un large nombre d'organisations syndicales et militantes perturbe l'accès nord de Buenos Aires, sous la surveillance d'un important dispositif policier. Devenue une figure ordinaire des conflits sociaux dans les années 2000 et 2010, cette scène détonne aujourd'hui davantage dans l'Argentine de Javier Milei, dont l'une des premières mesures à son arrivée au pouvoir a été l'adoption d'un « protocole anti-piquete », qui criminalise ce type d'actions collectives et prévoit notamment la possibilité de peines de prison pour les organisateurs.
Ce jour-là, le rassemblement est organisé à l'appel des salariés et des délégués syndicaux de Linde-Praxair, géant mondial de la fabrication de gaz industriels et médicinaux. Dans l'usine située à quelques encablures, un conflit dure depuis plusieurs semaines. Invoquant des difficultés économiques liées à l'atonie du marché interne, la direction de l'entreprise a annoncé le 5 décembre le licenciement de dix salariés. Dans les jours qui suivent, une grève coordonnée des cinq sites de production de Buenos Aires est organisée, soutenue par la fédération syndicale de la chimie. Le 20 décembre, à la suite de plusieurs réunions entre représentants syndicaux et patronaux, le ministère du Travail décrète une période de « conciliation obligatoire », qui suspend temporairement les licenciements et force les parties à négocier. Les concessions octroyées par Linde-Praxair se révèlent toutefois bien maigres. Mi-janvier, la direction de l'entreprise présente au ministère un projet d'accord : en échange de la réintégration de quatre salariés, elle maintient le licenciement des six autres, tout en annonçant sa volonté de supprimer une prime de production et d'accroître la polyvalence des tâches demandées aux ouvriers. En plus de rogner sur les droits salariaux, ces annonces comportent une tonalité antisyndicale à peine voilée : les six salariés restant sur le carreau ont pour caractéristique commune d'avoir été délégués syndicaux au cours des dernières années. La mobilisation reprend alors de plus belle. Outre le piquete sur l'autoroute panaméricaine, une nouvelle grève coordonnée de quatre jours a lieu et des rassemblements de soutiens réunissent des dizaines de militants syndicaux et associatifs locaux, d'habitants des quartiers voisins, de représentants de fédérations nationales et internationales ou encore de personnalités politiques. Début mars, le conflit se poursuivait toujours, après que le ministère du Travail de la province de Buenos Aires, dominé par le péronisme, ait ordonné l'ouverture d'une nouvelle période de conciliation obligatoire.
Une conflictualité du travail en augmentation
Singulière par son audience médiatique et l'ampleur de ses réseaux de soutien, la mobilisation des salariés de Linde-Praxair n'en constitue pas moins la pointe émergée d'une conflictualité du travail en augmentation dans l'Argentine de Javier Milei. Le gouvernement voudrait certes faire croire le contraire : il y a quelques semaines encore, l'entourage du ministre du Travail se félicitait d'une conflictualité au travail au plus bas depuis deux décennies, invoquant un « dialogue réel et très fructueux [mis en place] avec les syndicats »[1]. D'autres indicateurs universitaires dressent pourtant un tableau bien différent. Selon les relevés mensuels de l'Observatoire du Travail et des Droits Humains (OTDH), de l'Université de Buenos Aires, l'année 2024 a été marquée par 1637 conflits du travail à travers le pays, soit une moyenne mensuelle de 136 conflits, un chiffre plus de dix fois supérieur à celui avancé par le gouvernement.
Ces conflits touchent une large diversité d'entreprises de premier plan comme Linde-Praxair (Shell, Bridgestone, Granja Tres Arroyos, etc.), mais aussi des secteurs d'activité entiers. Le 30 octobre dernier, une grève a paralysé l'ensemble des moyens de transport du pays. Plus récemment, le syndicat de la métallurgie (UOM) a annoncé un « plan national de lutte », incluant six journées de grève dans le courant du mois de mars 2025, pour protester contre le blocage des salaires. Pour des motifs similaires, une grève de 24 heures a eu lieu dans l'ensemble des entreprises du secteur des huileries (aceiteros) le 12 mars dernier. Les administrations publiques, particulièrement ciblées par Javier Milei, ne sont pas en reste. Dans l'enseignement supérieur et la recherche, par exemple, plusieurs journées d'action nationale de grande envergure ont eu lieu en avril puis en octobre 2024 pour protester contre les coupes budgétaires et les réductions d'effectifs.
Thérapie de choc et remise en cause des droits sociaux
Principalement centrés autour des questions de salaires et de licenciements, ces conflits esquissent les contours d'une résistance diffuse du monde du travail aux politiques régressives du pouvoir en place. Sitôt son arrivée à la présidence, Javier Milei s'est en effet employé à opérer un ajustement brutal de l'économie. La dévaluation du peso de 50 %, actée dès décembre 2023, mais aussi les coupes drastiques dans les subventions publiques (énergie, transport), ont provoqué en 2024 une baisse de plus de 27 % du niveau réel global des salaires et une explosion de la pauvreté[2]. Dans le même temps, le taux de chômage a fortement progressé et les licenciements se sont multipliés. Selon un rapport publié par le Centre d'Économie Politique Argentine (CEPA) pour 2024, ce sont plus de 12 000 entreprises qui ont fermé leurs portes et plus de 240 000 emplois salariés qui ont été supprimés au cours de l'année écoulée, principalement dans les secteurs de la construction, des transports et de l'industrie, mais aussi dans celui des administrations publiques (culture, éducation, santé, recherche, politiques sociales, etc.), durement touchées par les restrictions budgétaires.
A l'origine d'une forte pression sur les niveaux de vie et sur l'emploi des salariés, cette stratégie du choc a aussi pris la forme d'attaques sur une large série de droits sociaux. Fin avril, l'adoption de la loi dite « Bases et points de départs pour la Liberté des Argentins » (« Bases y puntos de partida para la Libertad de los Argentinos ») a ouvert la voie à des privatisations d'entreprises publiques, introduit des mesures dites de « flexibilisation » du travail (allongement des périodes d'essai, réduction des indemnités de licenciement, etc.) et procédé à une réforme du système des retraites, incluant notamment un report de l'âge légal de départ et une modification des règles de calcul des annuités défavorable aux travailleurs informels (une situation très fréquente en Argentine).
Ces mesures sont allées de pair avec une criminalisation des protestations sociales, qui n'a pas épargné le monde du travail : en plus du « protocole anti-piquete » déjà mentionné, le « méga-décret » adopté par Milei dix jours après son arrivée au pouvoir comportait initialement d'importantes restrictions au droit de grève, finalement déclarées inconstitutionnelles par le pouvoir judiciaire : introduction d'un service « minimum » de 75 % de l'activité normale dans une très large diversité de secteurs définis comme « essentiels », interdiction de toutes formes d'action portant atteinte à la « liberté du travail » ou « à la propriété entrepreneuriale ».
Offensives patronales contre le monde du travail
Cette posture hostile du gouvernement vis-à-vis des mobilisations du monde du travail, et plus largement vis-à-vis de toute forme de contestation sociale, a directement contribué à légitimer et à banaliser des stratégies patronales qui remettent en cause les droits sociaux des salariés et leurs structures de représentation.
Depuis plusieurs semaines, on assiste à la multiplication de « procédures préventives de crises » (PPC), un dispositif légal qui permet aux entreprises en difficultés économiques d'acter des licenciements, de revenir sur des droits existants (indemnités de licenciement, primes), d'imposer des régressions en matière de conditions de travail ou encore d'entériner un gel ou une baisse des salaires. Alors que l'activation d'une PPC suppose d'apporter la preuve de trois exercices consécutifs négatifs et d'obtenir l'approbation du ministère du Travail, l'attitude conciliante du gouvernement offre aujourd'hui des marges de manœuvre décuplées aux directions d'entreprise. Représentant de l'Association d'avocats et avocates du travail, Guillermo Pérez Crespo tirait il y a peu la sonnette d'alarme : « les PPC ont augmenté de façon alarmante. (…) Plus que pour licencier, les directions d'entreprise les utilisent actuellement pour pousser à une modification substantielle des conditions de travail, par exemple pour intensifier les rythmes de travail, augmenter la durée du travail ou supprimer des primes ou des compléments de salaires »[3].
Le renforcement du pouvoir des employeurs passe aussi par des pratiques antisyndicales plus assumées. Le cas de Linde-Praxair incarne bien ici le retour au premier plan de telles pratiques. Dans les années 2000, l'usine mentionnée plus haut s'était en effet imposée comme une figure emblématique des combats pour les libertés syndicales. Alors que la direction de Linde-Praxair menait depuis les années 1990 une politique répressive empêchant toute présence syndicale, une longue lutte entre 2004 et 2007 avait débouché sur une décision de la Cour Suprême étendant les protections des activistes syndicaux sur les lieux de travail. Elle avait aussi abouti à l'élection de la première « commission interne » (l'organe de représentation des travailleurs au sein de l'espace de travail, émanation dans l'entreprise du syndicat de branche) de l'histoire de l'entreprise, point de départ d'une décennie marquée par une inversion du rapport de forces en faveur des salariés et de leurs représentants[4]. Vingt ans plus tard, plusieurs d'entre eux sont à nouveau menacés de licenciement.
Les fondements historiques et institutionnels des résistances syndicales
Dans ce contexte hostile, la capacité de résistance du monde du travail argentin puise sa source dans une histoire de plus long terme. En dépit de la brutalité des politiques néolibérales et de la forte progression du travail informel depuis les années 1990, les syndicats argentins ont conservé jusqu'à aujourd'hui un ancrage social relativement étendu. Celle-ci est sans commune mesure avec la situation qui prédomine dans la plupart des pays latinoaméricains. Par rapport aux standards internationaux, le pays présente en effet des niveaux de syndicalisation relativement élevés, estimés autour de 35 % pour le secteur privé et de 46 % pour le secteur public[5]. Dans les entreprises et les administrations, un dense maillage syndical persiste à travers les « commissions internes », dont l'existence est garantie par la loi et les conventions collectives. Sous les premiers gouvernements péronistes au milieu du vingtième siècle, ces organes de représentation des salariés ont pu être pensés comme des outils du contrôle corporatiste et des courroies de transmission entre l'organisation syndicale de branche et les travailleurs[6]. Directement élues par les salariés, elles ont toutefois toujours bénéficié d'une autonomie relative et ont été associées lors de différentes périodes historiques à l'émergence d'un syndicalisme contestataire, comme par exemple dans les années « d'insubordination ouvrière » qui ont précédées le coup d'État de 1976.
Sous les gouvernements des époux Kirchner (2003-2015), ces commissions internes ont notamment été le support d'une revitalisation « par le bas » du syndicalisme en Argentine[7]. Dans bon nombre d'entreprises et d'administrations de différents secteurs (transports, éducation, commerce, etc.), cette période a été marquée par un renouvellement de ces structures syndicales et par l'engagement de nouvelles générations militantes politisées au gré des luttes sociales qui ont secoué le pays au tournant des années 2000. Ces recompositions de moyen terme contribuent à expliquer la vigueur des résistances salariales qui s'expriment aujourd'hui face aux politiques brutales de Javier Milei, qu'illustre le cas de Linde-Praxair évoqué plus haut.
Les atermoiements et le dialoguismo de la CGT
Malgré tout, ces résistances ont jusqu'à présent peiné à se cristalliser et à converger autour d'une stratégie de confrontation claire avec le gouvernement. Les débuts du mandat de Javier Milei pouvaient pourtant laisser présager un scénario différent. Dès décembre 2023, la CGT, la principale confédération syndicale du pays, déposait un recours devant les tribunaux pour demander une déclaration d'inconstitutionnalité du “méga-décret” de Javier Milei. Ce recours était associé à une première manifestation d'envergure, qui a rassemblé des organisations syndicales, mais aussi les organisations piqueteras et de l'économie informelle et populaire, des organisations de droits humains et du mouvement féministe, ou encore des groupes de supporters opposés à la privatisation des clubs de football (en Argentine, les clubs sont des organisations à but non lucratif, qui appartiennent à leurs adhérents).
Quelques semaines plus tard, le 24 janvier 2024, la CGT lançait un premier appel pour une grève générale, aux côtés de la CTA-A et de la CTA-T, les deux principales confédérations implantées dans le secteur public, mais aussi d'organisations sociales, féministes et de défense des droits humains. Remarquable par sa précocité (jamais la CGT n'avait appelé à une grève générale à peine plus d'un mois après l'élection présidentielle), par son ampleur (plus d'un million de manifestants sont recensés à travers le pays) mais aussi par son caractère unitaire, ce premier épisode n'a toutefois pas constitué le point de départ d'une stratégie d'opposition coordonnée au pouvoir en place. Jusqu'à présent, la plupart des puissantes fédérations de branche autour duquel s'organise le syndicalisme argentin[8] ont privilégié un certain « dialoguisme » (dialoguismo), une stratégie historique consistant à négocier le contenu des réformes en échange d'un maintien de leurs prérogatives institutionnelles ; une posture similaire à celle déjà observée dans les années 1990, au moment du tournant néolibéral engagé par le péroniste Carlos Menem.
De son côté, Javier Milei s'est montré prudent à l'heure d'engager une révision plus frontale des fondements du système de relations professionnelles. Si les attaques sur le droit de grève ont été frontales au début de son mandat, la loi « Bases » adoptée au milieu de l'année 2024 a laissé de côté les mesures affectant plus spécifiquement le droit et les structures syndicales. Jusqu'ici, le pouvoir exécutif s'est notamment refusé à engager une réforme de la loi d'Associations syndicales, qui constitue le socle du droit syndical en Argentine et qui n'a plus été touchée depuis 1988dans le sillage du retour à la démocratie, et ce malgré les velléités et les projets formulés par des députés de la coalition gouvernementale au cours de l'année 2024[9].
Des perspectives incertaines : fuite en avant répressive et multiplication des conflits sociaux
En ce début d'année 2025, c'est donc un panorama incertain se dessine. Le discours de Javier Milei au forum de Davos – qui pointait notamment du doigt le « cancer woke » –, son implication et celle de son entourage dans une arnaque liée à une cryptomonnaie, mais aussi l'augmentation des prix des produits de première nécessité et les controverses autour de la manipulation des statistiques de l'inflation, nourrissent une défiance croissante à l'égard du pouvoir. A la suite des déclarations du président à Davos, une marche de la « fierté antiraciste et antifasciste », à l'appel d'une très large coalition d'organisations LGBTQIA+, féministes, étudiantes, syndicales et politiques, a rassemblé des dizaines de milliers de manifestants à travers le pays.
Début mars, les mobilisations hebdomadaires des retraités contre la faiblesse de leurs pensions, rejointes par des collectifs antifascistes et des groupes de supporters, ont par ailleurs été le point de départ d'une escalade répressive. Le 12 mars, la manifestation dans le centre de Buenos Aires a donné lieu à une forte répression de la part des forces de l'ordre, entraînant des centaines d'arrestations et des dizaines de blessés (le pronostic vital de l'un d'entre eux est encore engagé à ce jour). Loin de calmer le jeu, le pouvoir exécutif a vu dans cet épisode une tentative de déstabilisation, voire de « coup d'État ». C'est dans ce contexte de tension sociale croissante que la CGT a décidé d'appeler le 8 avril prochain à une nouvelle grève générale – la troisième depuis décembre 2023 – et à rejoindre les manifestations du 24 mars, qui commémorent chaque année le putsch de 1976.
La situation d'aujourd'hui est donc complexe. D'un côté, le gouvernement, qui rencontre des difficultés croissantes pour maintenir le taux de change du peso, se montre soucieux de donner des gages de la viabilité de sa politique (dans la perspective d'un nouvel accord de financement avec le FMI) et pourrait dès lors être tenté par une dérive encore plus répressive. De l'autre, la recrudescence des manifestations et la multiplication des foyers de conflits suggèrent une base de résistance croissante aux politiques néolibérales. Le rôle que jouera la CGT dans ce front d'opposition dépendra de la capacité de mobilisation et d'organisation des syndicats argentins à tous les étages, au niveau sectoriel et sur les lieux de travail.
*
Pierre Rouxel, est chercheur à l'Université Rennes 2, Julia Soul chercheuse au CONICET en Argentine, iels mènent depuis plusieurs années des recherches sur le syndicalisme argentin.
Notes
[1]“Según un relevamiento del Gobierno, la conflictividad laboral en 2024 fue la más baja de las últimas dos décadas”, Infobae, 05/02/2025, URL : https://www.infobae.com/politica/2025/02/06/segun-un-relevamiento-del-gobierno-la-conflictividad-laboral-en-2024-fue-la-mas-baja-de-las-ultimas-dos-decadas/
[2]“Le choc Milei, violent, inégalitaire et écologiquement désastreux”, Mediapart, 10/12/2024.
[3]“Aluvión de preventivos de crisis : extorsión para vulnerar los convenios”, Tiempo Argentino, 02/03/2025.
[4]P. Rouxel, “Mettre en débat la représentation syndicale. La transmission d'un sens syndical alternatif dans un Bachillerato Popular en Argentine”, Actes de la recherche en sciences sociales, n°248, 2023, p. 32-45.
[5]C. Tomado, D. Schleser, M. Maito, Radiografia de la sindicalizacion en Argentina, IDAES y Universidad Nacional de San Martin, 2018.
[6]Héritage des premiers gouvernements péronistes, les relations professionnelles en Argentine s'organisent autour du principe d'un monopole de la représentation : dans chaque branche d'activité, le syndicat qui dispose du plus grand nombre d'adhérents obtient de l'État le statut d'organisation représentative (appelée personeria gremial), qui lui confère le pouvoir de représenter les travailleurs lors des conflits et des négociations.
[7]Pierre Rouxel, Le syndicalisme en restructurations. Engagements et pratiques de délégués d'entreprises multinationales en Argentine et en France, Paris, L'Harmattan, 2022.
[8]En lien avec la personeria gremial dont elles disposent (qui, dans les faits, constitue une propriété quasi inaliénable), ces fédérations disposent de pouvoirs et de ressources étendues : elles sont les seules habilitées à collecter des cotisations salariales et patronales et jouent aussi un rôle central dans la mise en œuvre de la protection sociale
[9]En août 2024, des députés PRO et UCR ont présenté un projet de loi visant à réviser des principes fondamentaux de la loi comme le prélèvement automatique de cotisations aux syndiqués ou le principe d'ultra-activité (selon lequel des droits contenus dans des accords passés ne peuvent être remis en cause sans accord mutuel des parties) et à introduire une limitation du renouvellement des mandats des dirigeants syndicaux.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Admission de l’Indonésie aux BRICS : nouveau pas vers un « capitalisme multipolaire »

L'admission éclair de l'Indonésie au groupe BRICS a renouvelé les interrogations autour de son expansion. L'attractivité de la coalition repose sur son potentiel économique et l'ambivalence de son horizon géopolitique, mais la cooptation de nouveaux membres dépend de critères « larges » dont l'application fait la part belle aux intérêts des premiers membres. Alors que la réélection de Donald Trump pourrait temporairement casser l'élan « pro-BRICS » de ces dernières années, l'adhésion de l'Indonésie au groupe constitue une nouvelle brique dans l'édification d'un monde capitaliste multipolaire. Par François Polet, docteur en sociologie et chargé d'étude au Centre tricontinental (CETRI).
4 février 2025 | tiré d'Europe solidaire sans frontières
Longue marche vers un capitalisme multipolaire
Faut-il le rappeler, les BRICS ont été créés en 2009 (par la Russie, la Chine, l'Inde et le Brésil) en vue de réformer un système international dominé par les pays occidentaux et intensifier la coopération économique entre ses membres. Il s'agissait en quelque sorte du pendant non occidental du G7, ce club des pays riches s'employant à coordonner leurs vues sur les grands enjeux économiques et financiers mondiaux. Pour autant, comme le rappellent les auteurs et autrices d'une livraison récente d'Alternatives Sud, en dépit du maniement d'une rhétorique progressiste, les BRICS ne visent pas la transformation du modèle de développement dominant promu par le G7, mais oeuvrent plutôt à l'avènement d'un « capitalisme multipolaire ». [1]
Ce forum intergouvernemental n'a pas été formé en 2009 par hasard. Ses membres ont connu une croissance telle durant les années 2000 (et les années 1990 pour ce qui est de la Chine) que leur influence sur les institutions de la gouvernance mondiale était en décalage de plus en plus flagrant avec leur poids réel dans l'économie mondiale. Une situation de moins en moins supportable pour les pays concernés. Ce, d'autant plus que la récession de 2007-2008 venait de démontrer que l'architecture internationale n'était pas seulement inéquitable, mais aussi incapable de prévenir l'apparition de crises systémiques aux effets dévastateurs pour les pays en développement. Les futurs membres se sont très tôt accordés sur la nécessité « d'une nouvelle monnaie internationale de réserve, susceptible de faire contrepoids au dollar et de stabiliser le système financier global ». [2]
« L'attraction magnétique des BRICS » repose sur la force de son idée centrale – la promesse d'un monde plus équilibré – mais aussi sur son ambivalence
Les BRICS ont poursuivi une double stratégie consistant à accroître leur influence au sein des institutions existantes et à mettre en place des structures alternatives, en particulier la Nouvelle banque de développement et l'Accord de réserve contingente (un fonds de réserve de devises) créés en 2014. Les tensions croissantes entre pays occidentaux, Chine et Russie à partir de la deuxième moitié des années 2010, avec l'annexion de la Crimée, l'affirmation des ambitions de Pékin de Xi Jinping, la guerre commerciale initiée par Donald Trump, l'invasion de l'Ukraine par la Russie et enfin les sanctions occidentales contre la Russie, ont graduellement accru la dimension géopolitique des BRICS – que Pékin et Moscou s'efforcent désormais explicitement de transformer en plateforme anti-occidentale d'une « majorité globale ». Voire en embryon d'un ordre international alternatif.
Treize années séparent le premier élargissement des BRICS, avec l'admission de l'Afrique du Sud en 2010, du deuxième, en août 2023, lors du sommet de Johannesburg, où six pays ont été invités à rejoindre le groupe – Iran, Arabie saoudite, Émirats Arabes Unis, Argentine, Égypte et Éthiopie. Cette même année 2023 a aussi mis en évidence l'attractivité de la coalition parmi les pays du « Sud global » : pas moins d'une quarantaine de pays ont exprimé un intérêt à rejoindre ce forum. Plus de la moitié ont officiellement formulé une demande d'adhésion. Une nouvelle catégorie de pays « partenaires » des BRICS a été créée lors du Sommet suivant, en octobre 2024 à Kazan, à laquelle treize pays aspirants ont été invités. Parmi eux l'Indonésie, cooptée deux mois plus tard, janvier 2025, pour devenir le dixième membre effectif de la coalition [3]. L'intégration du pays le plus peuplé d'Asie du Sud-Est et du monde musulman donne une nouvelle envergure à la coalition, qui représente désormais la moitié de l'humanité et plus de 40% de l'économie mondiale.
Ressorts d'une attraction magnétique
Dans un texte rédigé pour l'Africa Policy Research Initiative, Mihaela Papa revient sur les ressorts de cette expansion récente de la coalition. [4] « L'attraction magnétique des BRICS » repose sur la force de son idée centrale – la promesse de marchés émergents dans un monde plus équilibré – et la multiplicité des interprétations auxquelles cette idée se prête, notamment quant aux objectifs et moyens de la réforme du système international. Une force de gravité renforcée par la proactivité croissante de ses membres, Chine et Russie en tête, dans la perspective de constitution d'un bloc contre-hégémonique.
L'ambiguïté du projet contribue à son attractivité en ce qu'il permet la coexistence de motivations hétérogènes chez les candidats. La participation aux BRICS peut d'abord apparaître comme un moyen de renforcer les liens avec des économies et des institutions financières en pleine expansion : promesse d'investissements étrangers, de partenariats, d'accès à des marchés, à des crédits, à des ressources énergétiques, à des technologies… potentiellement sans passer par le dollar. Cet enjeu pragmatique est la principale motivation de la majorité des nouveaux membres effectifs et « partenaires ». Ensuite, la participation à la coalition peut être motivée par le renforcement de l'autonomie stratégique d'un pays, via la diversification de ses relations diplomatiques et commerciales – réduisant sa perméabilité aux pressions occidentales.
Enfin la participation aux BRICS porte en elle la promesse de contribuer à l'avènement d'un monde multipolaire. Celui-ci est tantôt entendu dans un sens « réformiste » d'une démocratisation de la gouvernance mondiale, offrant davantage d'espace au « Sud global ». Tantôt en un sens « radical » ou « révisionniste » de lutte contre les principes et pratiques associés à l'Occident, que l'on parle d'une géopolitique impérialiste ou d'une conception universelle de la démocratie et des droits humains (plus rarement du libre-échange, ardemment défendu par la coalition face aux velléités protectionnistes des États-Unis…). En d'autres termes, si la majorité des pays envisagent leur participation aux BRICS sous l'angle de la concrétisation du principe de « non-alignement actif » ou de « multi-alignement », incarnés par l'Inde et le Brésil [5], d'autres y voient d'abord l'expression de leur alignement sur le camp anti-occidental – cas de l'Iran, du Venezuela, de Cuba…
Critères partagés, intérêts contingents
Si ces considérations renseignent quant aux motivations, elles en disent peu sur le processus de sélection des nombreux candidats. La décision d'inviter un nouveau membre est théoriquement prise par consensus. Le pays candidat doit avoir démontré son adhésion aux principes des BRICS (dont la réforme de la gouvernance globale ou le rejet des sanctions non validées par l'ONU), avoir une influence régionale, entretenir de bonnes relations avec les membres et contribuer au renforcement du groupe. La formalisation des critères a fait l'objet de tensions entre les membres initiaux, de même que le rythme de l'élargissement du groupe. Si la Chine et la Russie poussent à l'expansion rapide de la coalition, l'Inde et surtout le Brésil craignent la dilution de leur influence et de leur statut. [6] En-deçà des principes, le processus de cooptation paraît surtout guidé par « un mélange de considérations pragmatiques, d'intérêts contingents et de souverainisme sourcilleux » souligne Laurent Delcourt. [7]
L'adhésion de l'Arabie saoudite et des Émirats Arabes Unis se sont imposées du fait du poids financier et de la puissance énergétique qu'ils apporteraient au groupe. La candidature de l'Argentine a été poussée par la diplomatie brésilienne, en vue de renforcer le pôle latino-américain de l'attelage, mais surtout pour éviter qu'il devienne « une source de risques en devenant un club de régimes autoritaires ayant des positions anti-occidentales ». [8] Des enjeux diplomatiques du même ordre ont contribué à ce que le Brésil bloque l'entrée du Venezuela lors du Sommet de Kazan. [9] La candidature du Pakistan est entravée par l'Inde pour des raisons de rivalité régionale. [10] Et la non-sélection de l'Algérie est officiellement motivée par des critères économiques, mais Alger y voit la main des Émirats, avec lesquels ses rapports sont tendus, qui auraient convaincu l'Inde de mettre son veto [11].
Equations politiques internes et coûts géopolitiques
Le retrait de l'Argentine décidé par le président Javier Milei rappelle que les logiques d'adhésion aux BRICS sont aussi tributaires d'équations politiques internes. De même, l'inclusion accélérée de l'Indonésie aux BRICS résulte également d'une alternance politique. Le président Subianto, personnalité autoritaire réputée pro-russe, a sorti son pays de la posture attentiste qui le caractérisait auparavant, dictée par l'espoir de ne pas gâcher sa demande d'adhésion à l'OCDE. Le « non-alignement » invoqué par Jakarta pour justifier ce changement d'optique devrait pencher nettement dans le sens des intérêts de Moscou [12].Un tournant qui explique vraisemblablement l'insistance de Vladimir Poutine à précipiter l'accession de l'Indonésie… ignorant le moratoire sur l'élargissement du groupe annoncé par son propre ministre des Affaires étrangères six semaines plus tôt. [13]
Les tergiversations de l'Arabie Saoudite, invitée à rejoindre le groupe à Johannesburg, mais qui n'avait toujours pas répondu formellement à l'invitation au début de l'année 2025, illustrent les craintes des coûts géopolitiques de la participation à une coalition dominée par des puissances hostiles à l'Occident. Les menaces de Donald Trump, un mois avant sa prise de fonction, d'imposer des droits de douane de 100% aux pays contribuant à la dédollarisation des échanges accentuent ces craintes [14]. Cette diplomatie coercitive pourrait casser temporairement l'élan « pro-BRICS » d'une série de pays fortement dépendants des États-Unis sur les plans sécuritaire et économique. Mais sur le plus long terme, elle a toutes les chances d'aboutir au résultat inverse – et à renforcer l'attractivité du club pour les pays en développement, en quête d'un monde plus respectueux des souverainetés et des intérêts du « Sud global ».
François Polet
LVSL
Notes :
1 CETRI, BRICS+ : une alternative pour le Sud global ?, Syllepse – CETRI, Paris – Louvain-la-Neuve, 2024.
2 Laurent Delcourt, « BRICS+ : une perspective critique », in CETRI, Ibid.
3 L'Argentine a décliné l'invitation début 2024, tandis que l'Arabie saoudite n'a ni accepté, ni rejeté la sienne en janvier 2024.
4 Mihaela Papa, « The magnetic pull of BRICS », Africa Policy Research Insitute – APRI, 3 décembre 2024.
5 Notons que les deux nouveaux membres africains – l'Égypte et l'Éthiopie – sont les premiers bénéficiaires de l'aide états-unienne du continent.
6 Ces critères ont été précisés lors du Sommet de Johannesburg d'août 2023.
7 Dès 2017, les velléités chinoises d'élargir les BRICS ont fait craindre une tentative de mettre la dynamique au service du projet des Nouvelles routes de la soie, grande priorité diplomatique de Xi Jinping. Voir Evandro Menezes de Carvalho, « Les risques liés à l'élargissement des BRICS », Hermès, La Revue, n° 79(3), 2017.
8 Editorial d'un journal économique brésilien (Valôr Econômico) cité par Oliver Stuenkel, « Brazil's BRICS Balancing Act Is Getting Harder », America's Quarterly, 21 octobre 2024.
9 Dans un contexte de dégradation des relations entre les présidents brésilien et vénézuélien liée aux conditions de la réélection de ce dernier en juillet 2024.
10 Mirza Abdul Aleem Baig, « Why Did Pakistan Fail To Secure BRICS Membership At 2024 Summit ? – OpEd », Eurasia review, 27 octobre 2024.
11 El Moudjahid, 28 septembre 2024. L'Algérie a néanmoins intégré la catégorie des pays partenaires et rejoint la Nouvelle banque de développement.
12 Notons que ce même principe de non-alignement motivait la présidence précédente à… ne pas rejoindre les BRICS, craignant que cela soit interprété en Occident comme un rapprochement avec l'axe Pékin-Moscou. Juergen Rueland, « Why Indonesia chose autonomy over BRICS membership », East Asia Forum, 25 octobre 2023.
13 Saahil Menon, « Why Was Indonesia's BRICS Membership Short-Circuited ? », Modern Diplomacy, 14 janvier 2025.
https://lvsl.fr/admission-de-lindonesie-aux-brics-nouveau-pas-vers-un-capitalisme-multipolaire/
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Enquête. L’aide internationale survivra-t-elle au bouleversement de l’ordre mondial ?

Quand l'administration Trump a fermé l'USAID, la déflagration a été ressentie dans le monde entier : ses financements, alloués dans 158 pays, représentaient près du tiers de l'aide planétaire en 2024. Le système de l'aide internationale, tel qu'il est né au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pourra-t-il s'en remettre ? Le “Financial Times” semble en douter et entrevoit l'émergence de nouveaux modèles.
tiré du Courrier international
https://www.courrierinternational.com/article/enquete-l-aide-internationale-survivra-t-elle-au-bouleversement-de-l-ordre-mondial_228829
Soixante ans avant que, aux États-Unis, Elon Musk ne décide de passer à la “broyeuse” l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et que, au Royaume-Uni, le Premier ministre [travailliste], Keir Starmer, n'annonce de profondes coupes dans le budget d'aide internationale déjà exsangue, les pays riches remettaient déjà en question l'efficacité – et tout bonnement l'intérêt – de l'aide internationale.
Lire aussi : Géopolitique. L'aide américaine gelée et menacée : une carte pour comprendre la crise
En 1961, selon un rapport de l'USAID, la Corée du Sud, qui constitue aujourd'hui une des économies les plus développées au monde, était un “trou à rats”, un “puits sans fond” engloutissant les aides internationales. Quelques années plus tard, en 1968, un grand rapport commandé par la Banque mondiale, dont le premier chapitre s'intitulait “L'aide en temps de crise”, arrivait à cette conclusion : le soutien entre donateurs et bénéficiaires va s'amenuisant. Plus récemment, en 2009, l'économiste zambienne Dambisa Moyo expliquait dans son livre Dead Aid [“Aide morte”, inédit en français] que l'Afrique était “accro aux aides” et que “l'idée selon laquelle ces aides permettent de lutter contre la pauvreté systémique est un mythe”.
De nos jours, les États-Unis de Donald Trump rechignent à donner ne serait-ce qu'un petit coup de pouce à d'autres pays. Et avant même que l'administration Trump ne décide de liquider l'USAID, le vice-président américain, J. D. Vance, déclarait à Fox News :
“Nous devons d'abord aimer notre famille, puis nos voisins, puis notre communauté, puis notre pays, et seulement après prendre en compte les intérêts du reste du monde.”
Puisant dans le langage des guerres culturelles, Musk attaque l'USAID sans faire dans la dentelle : c'est à ses yeux un “nœud de vipères de marxistes de la gauche radicale”, un nœud de vipères qui œuvre contre les intérêts américains.
Désengagement occidental
Du côté de l'Europe, qui compte parmi les autres donateurs avec une poignée de pays riches de l'OCDE, l'aide internationale est également sous pression. Comprimés par le ralentissement de la croissance, les budgets d'aide européens sont alloués à des priorités locales, telles que l'hébergement des demandeurs d'asile et l'aide humanitaire à l'Ukraine.

Avant même que Keir Starmer ne ratatine le budget britannique à 0,3 % du PIB, le précédent gouvernement conservateur avait renoncé, malgré ses engagements, à maintenir le budget de l'aide internationale à 0,7 % du PIB. En 2020, il avait même fermé le renommé ministère du Développement international pour regrouper ses activités au sein du ministère des Affaires étrangères.
Ce désengagement occidental soulève plusieurs questions, en premier lieu sur ses répercussions pour les populations les plus pauvres de la planète, mais aussi sur ses conséquences pour la santé et la sécurité mondiale, notamment en cas de pandémie.
Lire aussi : Royaume-Uni. Keir Starmer promet de porter le budget de la Défense à 2,5 % du PIB
“J'espère qu'il ne s'agit pas d'un tournant définitif”, commente Abhijit Banerjee, professeur au MIT et corécipiendaire du prix Nobel d'économie [avec son épouse, Esther Duflo, et l'Américain Michael Kremer] pour ses travaux sur la pauvreté. Même si toutes les aides ne sont pas efficaces, dit-il, “de multiples exemples montrent que de petites sommes d'argent permettent d'accomplir de grandes choses. Si les pays les plus riches du monde suppriment leurs aides, cela ne fera qu'exacerber la misère dans le monde.”
Réimaginer l'aide au XXIe siècle
Qui plus est, l'influence occidentale dans le “Sud global” pourrait prendre un rude coup dans l'aile, en particulier si la Chine, la Russie et d'autres pays cherchent à combler le vide laissé par l'Occident. D'une manière générale, la question se pose également de savoir quelle forme prendra cette aide, alors que les gouvernements revoient leurs priorités et risquent de vouloir avant tout défendre leurs intérêts commerciaux et géopolitiques.

SOURCES : USAID, FOREIGNASSISTANCE.GOV, OCDE, “THE NEW YORK TIMES”.
Comme le rappelle Stefan Dercon, ancien économiste en chef du ministère du Développement international britannique, au lendemain de la chute du mur de Berlin, l'aide a cessé d'être un instrument géopolitique. Aujourd'hui, il pense au contraire qu'elle le devient de plus en plus :
“On supprime de l'aide la notion de générosité.”
D'aucuns espèrent pourtant que le démantèlement de nos vieilles structures d'aide au développement pourrait être l'occasion de réimaginer l'aide internationale au XXIe siècle. “Trump est en train de mettre en pièces quelque chose d'essentiel pour certaines des populations les plus vulnérables du monde”, déplore Ylva Lindberg, vice-présidente exécutive de Norfund, le fonds norvégien d'investissement destiné aux pays en développement. “Cela dit, l'organisation et le financement de l'aide internationale doivent impérativement être repensés. Tout le chaos que sème Trump nous poussera peut-être à revoir notre conception de l'aide internationale.”
Lire aussi : L'aide au développement est une pure arnaque
Depuis toujours, l'aide internationale est un équilibre entre trois éléments : l'aide humanitaire, le développement à long terme et l'influence. C'est d'ailleurs ce qui la rend difficile à accepter d'un côté par les contribuables, de l'autre par les pays bénéficiaires, qui contestent souvent l'idée selon laquelle ces aides sont fondamentalement altruistes. Aux États-Unis, selon un récent sondage réalisé par l'institut Public First pour le Financial Times, les Américains sont 60 % à penser que l'aide américaine n'arrive jamais aux personnes à qui elle est destinée.
Des progrès à mettre au crédit de l'aide
L'actuel désengagement occidental inquiète évidemment ceux qui sont convaincus que l'aide internationale fait beaucoup plus de bien que de mal. Selon la Banque mondiale, la part de la population mondiale vivant dans un état d'extrême pauvreté – sous le seuil de 2,15 dollars par jour – est passée de 38 % en 1990 à 8,5 % en 2024. Approximativement au cours de la même période, le nombre d'enfants mourant avant leur cinquième anniversaire a chuté de 12,5 à 4,9 millions.
Ces progrès sont notamment dus à la croissance rapide de la Chine, de l'Inde et d'autres économies émergentes. Mais aussi à l'aide internationale, soulignent les experts, en particulier en Afrique, en Asie du Sud et dans les zones les plus pauvres de l'Amérique latine.
Lire aussi : Géopolitique. Cataclysme sanitaire, “guerre idéologique” : que signifie le gel de l'USAID en Afrique ?
D'après Bright Simons, directeur de recherche au groupe de réflexion Imani, à Accra, au Ghana, rares sont en effet les pays à être sortis de la pauvreté sans l'aide d'autres pays. La Chine, souligne-t-il, a elle-même bénéficié de milliards de dollars de prêts japonais à des conditions préférentielles, prêts qui lui ont permis de construire des infrastructures, de stimuler sa croissance et de sortir de la pauvreté.
Pour Jeffrey Sachs, directeur du Centre pour le développement durable à l'université Columbia, le problème de l'aide internationale n'est pas qu'il y en a trop, mais pas assez : les pays pauvres reçoivent “des aides au compte-gouttes, si minimes qu'elles ne peuvent pas véritablement faire décoller leur économie”. “Pourquoi choisir entre la lutte contre le paludisme et l'éducation des enfants ?” s'interroge-t-il. “Il serait très facile de financer ces deux causes à la fois si les autorités américaines, britanniques, européennes et autres le voulaient vraiment. Malheureusement, elles s'en contrefichent.”
Par la force des choses, l'aide internationale évolue en même temps que les réalités géopolitiques. Dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis consacraient 3 % de leur PIB à l'aide internationale, soit plus de dix fois plus qu'aujourd'hui. Une grande partie de ces fonds a alors été injectée dans le plan Marshall [1948], qui a permis de reconstruire le Japon, ainsi que l'industrie et les infrastructures d'Europe.
44 milliards de dollars par an
Dans les années 1980 et 1990, les pays occidentaux se sont servi de l'aide internationale pour inciter les pays en développement, en particulier les pays d'Afrique qui s'étaient convertis au socialisme, à adopter des réformes pour ouvrir leurs marchés. Après l'effondrement du communisme, cette politique a été élargie à l'Europe de l'Est.
Au XXIe siècle, la guerre froide étant derrière nous, les grandes priorités sont devenues la lutte contre la pauvreté et la défense des droits des populations les plus pauvres de la planète. C'est ce que reflètent notamment les objectifs du millénaire pour le développement [2000] et les objectifs de développement durable [2015] des Nations unies.
Lire aussi : Géopolitique. Le Sud global veut sa place sur le grand échiquier mondial
La fermeture de l'USAID en février, du jour au lendemain, a des retentissements dans le monde entier. Avec un budget de 44 milliards de dollars par an, l'agence gérait plus de la moitié des quelque 70 milliards de dollars que les États-Unis consacrent au développement international, notamment sous la forme d'aide militaire.
En 2023, l'aide américaine représentait près de 30 % de l'aide internationale mondiale versée par 24 pays membres de l'OCDE, laquelle s'élève à quelque 223,3 milliards de dollars. À noter que l'aide de la Chine, apportée principalement sous la forme de prêts destinés à la construction de routes, de ports et d'aéroports dans le cadre de son programme des nouvelles routes de la soie, n'est pas prise en compte dans les chiffres de l'OCDE.

Dans les rues de Cap-Haïtien, en Haïti, le 10 juillet 2024. Photo Corentin Fohlen/Divergence
Une dépendance exacerbée à l'aide
Samedi 1er février, lorsque le site Internet de l'USAID a été désactivé, les travailleurs de l'aide internationale, qu'ils distribuent de la nourriture dans le Soudan ravagé par la guerre, assurent l'éducation des filles dans l'Afghanistan des talibans ou luttent contre les ravages de la drogue en Colombie, se sont préparés au pire. Et même quand le secrétaire d'État, Marco Rubio, a émis une dérogation pour les programmes qui fournissent une assistance vitale, bon nombre d'organisations sont restées fermées.
L'USAID taillée en pièces
“Il est temps qu'elle disparaisse”, a déclaré Elon Musk. Qualifiée de “nid de vipères” par le milliardaire, l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) est devenue l'une des premières cibles de son “département de l'efficacité gouvernementale” (Doge). Début février, son siège a été abruptement fermé, l'accès à la boîte e-mail coupé pour une grande partie du personnel, tandis que le secrétaire d'État, Marco Rubio, mettait sous tutelle l'agence indépendante. En quelques jours, la plupart des contractuels et employés ont été placés en congé administratif. Et ce alors que Donald Trump avait ordonné dès janvier un gel de toute l'aide à l'étranger – même si des initiatives “sauvant des vies” ont finalement été préservées.
Le 18 mars, un tribunal fédéral a estimé que le démantèlement de l'agence par Musk et son Doge avait “probablement violé la Constitution”. Le juge Theodore Chuang a ordonné de rétablir l'accès du personnel aux courriels et aux locaux, “même si ce répit ne sera sans doute que provisoire” selon The New York Times.
Après avoir passé en revue les activités de l'USAID, le gouvernement Trump a déclaré éliminer 83 % de ses programmes. Le reste pourrait faire l'objet d'une profonde réorganisation ; c'est du moins ce que propose une note interne obtenue par Politico. Il y est question de transformer l'USAID en une “agence pour l'assistance humanitaire internationale” sous la houlette du département d'État. Celui-ci gérerait directement tous les programmes “politiquement orientés”. De quoi servir davantage les intérêts géopolitiques de Washington. Courrier International
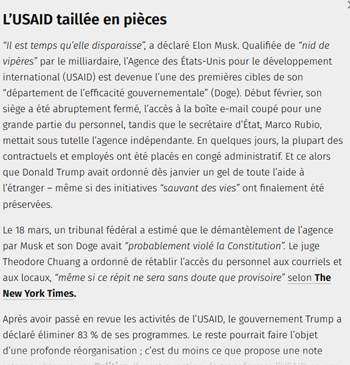
Les coupes budgétaires actuelles mettent en évidence à quel point certains pays dépendent des aides, notamment dans le domaine de la santé. Francisca Mutapi, spécialiste de santé mondiale à l'université d'Édimbourg, rapporte qu'en 2021 un tiers du budget de la santé de la moitié des pays africains dépendait de financements externes. Chris Coons, sénateur démocrate du Delaware et ancien président du sous-comité sur l'Afrique de la commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, explique que certains républicains sont choqués par l'ampleur des réductions budgétaires :
“Ils voulaient en finir avec le côté woke. Remanier un peu les choses, mais certainement pas laisser mourir de faim des enfants.”
Les réactions des pays bénéficiaires de ces aides se font pour l'heure plus discrètes. “Les gens pleurent, ils se plaignent que Trump ne nous donne plus d'argent”, commentait Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya, lors d'un sommet régional sur la santé à Mombasa en janvier. “Mais au lieu de pleurer, nous devons nous demander : ‘Que pouvons-nous faire pour subvenir à nos besoins ?'” Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, abonde en son sens : “En Afrique, nous devons changer de mentalité. L'aide internationale ? Nous devons y penser comme à quelque chose qui appartient au passé.”
Reste que les pays concernés ne pourront pas s'adapter en un claquement de doigts, réagit Ken Opalo, professeur associé à l'université de Georgetown, à Washington. “Jusqu'à présent, les gouvernements africains ne semblent pas avoir élaboré de plan sérieux en cas d'urgence. Ils sont purement et simplement dépendants des aides.”
Des coupes budgétaires qui vont alimenter les migrations
Pour évaluer les répercussions de la suppression des aides, il faut commencer par déterminer leur utilité réelle. Or, selon Bright Simons, du groupe de réflexion Imani, elles avaient de moins en moins d'effets. Alors qu'auparavant les pays riches cherchaient à stimuler la croissance des pays pauvres jusqu'à ce qu'elle atteigne un niveau qui leur permette de se transformer, ces derniers temps, estime-t-il, leurs objectifs ont été dilués. La bureaucratie qui se trouve derrière l'aide internationale – pensons aux 17 objectifs de développement durable des Nations unies, déclinés en 169 cibles – “s'affaisse sous son propre poids et se perd dans sa propre complexité”.
James Robinson, coauteur du livre Why Nations Fail [“Pourquoi les nations échouent”, inédit en français, 2012] et corécipiendaire du prix Nobel d'économie 2024, rejette ces critiques. “Je ne pense pas que l'aide internationale soit le problème, ni même la solution, dit-il. Si un puits est creusé dans une région rurale de Madagascar, c'est magnifique. Si un toit est installé sur une école de Sierra Leone, ce n'est pas un problème : c'est utile aux gens.” Les coupes actuelles, ajoute-t-il, ne feront qu'aggraver la pauvreté et l'insécurité, et alimenter les migrations. “Que risque-t-il de se passer si on coupe les vivres à des populations pauvres ? Elles seront encore plus désespérées et enclines à partir.”
Lire aussi : Géopolitique. Le gel de l'USAID, une occasion pour repenser le modèle de développement
L'Occident pourrait par ailleurs perdre de son influence, avertissent les experts. Lorsqu'il a créé l'USAID, en 1961, en pleine guerre froide, le président John F. Kennedy y voyait ouvertement un précieux outil diplomatique. “C'est une puissante source de pouvoir pour nous, avait-il déclaré au personnel recruté pour l'agence. Quand nous ne voulons pas envoyer de troupes américaines dans les nombreuses zones où la liberté se trouve menacée, c'est vous que nous envoyons.”
Même si ces aides ne suffisent pas toujours à conquérir les cœurs et les esprits, le fait est qu'elles y parviennent parfois. Le Pepfar, le plan d'aide d'urgence à la lutte contre le sida à l'étranger lancé par George W. Bush en 2003, a sauvé la vie de pas moins de 26 millions de personnes, ce qui lui a valu d'être couvert d'éloges.
L'image et la sécurité des États-Unis menacées
Pour le sénateur Chris Coons, supprimer de tels programmes et “ôter des milliards de dollars de la bouche de bébés du monde entier” est indubitablement immoral, mais c'est aussi une mesure qui, en fin de compte, nuit à l'image et à la sécurité des États-Unis.
Dans le domaine de la santé mondiale, explique-t-il, les programmes financés par les États-Unis aident les pays les plus pauvres du monde à gérer des épidémies de maladies infectieuses comme Ebola, Marburg ou la variole du singe [mpox], et évitent qu'elles ne se propagent dans le monde entier. Chris Coons ajoute que le travail d'ONG financées par les États-Unis contribue par ailleurs à dissuader les hommes jeunes avec peu de perspectives économiques de rejoindre des groupes terroristes ou des organisations de trafic d'êtres humains. En les supprimant, redoute-t-il, on risque de “créer un grand vide” qui laissera la voie libre “à la Chine, à la Russie, aux trafiquants et aux terroristes”.
Lire aussi : Géopolitique. Le Sud global veut sa place sur le grand échiquier mondial
Du reste, l'Occident ne peut tout simplement pas se couper des problèmes du monde, estime Ayoade Alakija, spécialiste nigériane de la santé mondiale. Qui cite un proverbe yoruba :
“Quand on lance une pierre sur un marché, il faut être prudent, car on risque de frapper un parent.”
Dorénavant, les aides ont de plus en plus de chances d'être soumises à des conditions, dans le cadre de négociations commerciales ou autres, prévoit Stefan Dercon, cet ancien membre du ministère du Développement international britannique qui enseigne à présent à l'école d'administration Blavatnik, à l'université d'Oxford. Le monde en a eu un avant-goût pendant la pandémie de Covid-19, lorsque la Chine, la Russie, les États-Unis et l'Europe ont cherché, souvent en vain, à se faire des amis dans les pays en développement avec ce que l'on a alors appelé la “diplomatie du vaccin”.
Des investissements à but lucratif
Cela fait longtemps que les réseaux sociaux sont inondés de thèses complotistes sur les supposés véritables motifs qui se cachent derrière les aides – depuis l'exploitation des ressources jusqu'à des missions d'espionnage – et que les rivaux de Washington reprennent allègrement ces thèses. “De nombreux éléments suggèrent que l'USAID a travaillé en étroite collaboration avec le département d'État américain et la CIA lors de diverses opérations secrètes visant à déstabiliser des gouvernements étrangers”, écrivait récemment le chroniqueur Chen Weihua dans le quotidien China Daily.
Mais Bright Simons trouve “naïf” d'imaginer que les pays pauvres pourront se tourner vers la Chine ou d'autres puissances pour combler le vide laissé par l'Occident. “Les puissances géopolitiques montantes, comme les Brics, ne voient pas l'intérêt de soutenir le système d'aide internationale classique, souligne-t-il. La Russie n'a que faire de renforcer la justice en Afrique ou de savoir si les écolières du Soudan disposent de protections hygiéniques.”
Lire aussi : Brésil. Des milliards pour une favela, ou l'aide au développement selon les Émirats
Ylva Lindberg, de Norfund, prédit un autre scénario : les subventions vont laisser place à des investissements à but lucratif dans des entreprises. Chaque année, Norfund investit déjà quelque 7,7 milliards de couronnes (soit 670 millions d'euros) dans des entreprises étrangères – depuis une ferme solaire en Inde jusqu'à une exploitation laitière au Malawi, en passant par une banque au Honduras. Comme ses homologues au Royaume-Uni, en France ou en Allemagne, ce fonds injecte des capitaux dans des entreprises qui peinent autrement à accéder à des financements. Si ces investissements représentent aujourd'hui moins de 2 % des aides des pays de l'OCDE, selon Ylva Lindberg, ce chiffre pourrait bien doubler, voire tripler.
“Une solution gagnant-gagnant”
Les États-Unis aussi semblent être en train de prendre cette direction. Lors de son premier mandat, Trump a créé l'US International Development Finance Corporation (DFC), dotée d'un budget de 60 milliards de dollars pour investir dans divers projets menés dans des pays avec des revenus intermédiaires à faibles. Même si le démarrage de la DFC a été lent, sous le mandat Biden, elle a financé un consortium de télécommunication en Éthiopie, une mine de graphite au Mozambique et un complexe plan de refinancement de la dette en Équateur.
Soulignons que la DFC a également approuvé un prêt de 553 millions de dollars au corridor de Lobito, une initiative majeure, menée par les Américains, pour construire une voie ferrée reliant les mines de Zambie et du Congo avec le port angolais de Lobito, sur la côte atlantique. Aux yeux des responsables américains, ce gigantesque chantier constitue un exemple de ce nouveau type d'assistance qui combine les intérêts stratégiques américains – en l'occurrence la lutte contre la mainmise chinoise sur des minéraux critiques – et le développement des pays bénéficiaires.
Lire aussi : Reportage. En Angola, un chemin de fer qui attise les convoitises : “Les Américains, on vous aime !”
“Plutôt que d'exporter des matières premières vers la Chine, qui peut profiter de sa place dans la chaîne d'approvisionnement mondiale pour faire chanter les autres pays, c'est une solution gagnant-gagnant pour les Africains et les Américains”, résume Peter Pham, un spécialiste de l'Afrique qui travaille actuellement à l'Atlantic Council, à Washington, et qui, selon certains, pourrait prochainement jouer un rôle de premier plan dans la nouvelle administration Trump.
En février, Trump a signé un décret présidentiel pour créer un fonds souverain, laissant spéculer que la DFC pourrait être intégrée à cette nouvelle organisation. “Au lieu d'être une institution de financement du développement, il s'agira sans doute davantage d'un instrument géopolitique”, présume Ylva Lindberg. Les investissements commerciaux, ajoute-t-elle, ne remplaceront jamais les projets purement humanitaires comme la gestion d'urgence des catastrophes naturelles ou des crises migratoires. Aussi les choses vont-elles se durcir dans le domaine de l'aide internationale. “Je ne dirais pas que l'altruisme est mort, conclut-elle. Mais en règle générale, les intérêts nationaux occuperont beaucoup plus de place.”
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Vers un désordre mondial militariste

Le retour de Donald Trump au pouvoir s'accompagne d'une profonde réorientation de l'impérialisme étasunien, notamment par un rapprochement avec la Russie. En réaction, l'Europe adopte une rhétorique militariste. Celle-ci n'ouvre pas de nouvelles perspectives au peuple ukrainien dans sa lutte contre l'agresseur russe. Entretien avec Jaime Pastor, membre de la rédaction de Viento Sur et militant d'Anticapitalistas.
21 mars 2025 | tiré du site Solidarités | Photo : Ursula von der Leyen et J. D. VanceLa Présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le vice-président étasunien J. D. Vance lors d'un sommet sur l'IA à Paris, 11 février 2025 Dati Bendo / European Commission
https://solidarites.ch/journal/447-2/usa-russie-europe-ukraine-vers-un-desordre-mondial-militariste/
Comment définiriez-vous la situation internationale actuelle ?
En partant du tournant radical que représente le retour de Trump au gouvernement des États-Unis, on pourrait dire que nous sommes au début d'une nouvelle ère de désordre mondial qui s'inscrit dans un contexte que l'on qualifie généralement de « polycrise ». Ce terme désigne une conjonction de crises simultanées et interconnectées, dont la plus marquante est la crise écosociale mondiale, qui se produit dans le cadre d'une stagnation prolongée du capitalisme et de la fin de la « mondialisation heureuse ».
L'une des principales conséquences de cette polycrise est l'aggravation de la compétition et des tensions entre les grandes puissances. Pour y répondre, le tandem Trump-Musk – qui incarne la mainmise directe d'une fraction du grand capital étasunien sur l'État – mise sur un nationalisme oligarchique et protectionniste visant à « rendre sa grandeur » aux États-Unis (le slogan MAGA, « Make America Great Again ») et ainsi freiner leur déclin impérial.
D'un point de vue géopolitique, ce projet étasunien se traduit par une redéfinition des relations avec les autres grandes puissances, afin d'atteindre plusieurs objectifs. Le premier consiste à conclure un pacte avec Poutine en reconnaissant leurs sphères d'influence respectives, restaurant ainsi un partage colonial des pays voisins et de leurs ressources. Le second objectif réside dans la limitation du rôle des États-Unis en tant que « protecteur » militaire de l'Europe, en poussant les États membres de l'Union Européenne à accroître leurs dépenses de défense et en les traitant comme des concurrents économiques. Enfin, à moyen et long terme, un troisième objectif consiste à donner la priorité à l'interventionnisme en Asie-Pacifique et surtout à la rivalité avec la Chine, qui est la principale puissance montante à laquelle s'opposent les États-Unis.
Cette tentative de réorganisation de la hiérarchie internationale intervient alors que l'extrême droite progresse dans le monde entier. Le trumpisme, qui associe une conception libertarienne de l'économie, un autoritarisme sur le plan politique et une orientation réactionnaire sur le plan idéologique, est devenu la principale référence de ces forces cherchant à imposer un « changement de régime ». Cela a été explicitement affirmé par le vice-président J. D. Vance lors du sommet de Munich, qui a laissé entendre que l'objectif est pratiquement de mettre fin à la démocratie libérale et d'instaurer de véritables autocraties électorales, voire des régimes néofascistes.
Toutefois, ce projet rencontre déjà des résistances et contradictions, tant aux États-Unis qu'ailleurs, ce qui pourrait accentuer l'instabilité géopolitique et approfondir la polycrise, notamment dans sa dimension écosociale, avec des issues incertaines.
Que se passe-t-il en Europe dans cette reconfiguration mondiale ? Et que pensez-vous de la course effrénée à l'armement et du climat de « pré-guerre » qui se crée ?
L'Europe est aujourd'hui en plein désarroi face au virage radical imposé par Trump, notamment en ce qui concerne la guerre en Ukraine, qui a en effet entrepris de réhabiliter Poutine, au point de vouloir partager avec lui l'exploitation des ressources naturelles ukrainiennes. Par ailleurs, la nouvelle politique commerciale protectionniste des États-Unis, via l'augmentation des droits de douane, intensifie la rivalité économique avec l'Union européenne.
Depuis quelques temps, l'UE tente d'endiguer sa perte d'influence sur la scène mondiale en renforçant son « autonomie stratégique », comme l'ont recommandé les récents rapports de Draghi et Letta. Ce projet prend aujourd'hui une dimension principalement militaire, avec l'adoption d'un budget de 800 milliards d'euros destiné à un programme de réarmement qui alimentera inévitablement une nouvelle phase dans la course aux armements à l'échelle mondiale.
Pour justifier cette montée en puissance militaire, les élites européennes cherchent à imposer l'idée que la Russie de Poutine constitue une « menace existentielle » pour l'Europe. Conscientes que ce discours peine à convaincre au-delà des pays voisins de la Russie, elles l'associent à une rhétorique de défense de la « démocratie et du bien-être » contre le « totalitarisme ». Pourtant, cette posture contraste avec les politiques répressives menées en Europe contre les migrant·es, les restrictions des libertés politiques et sociales, et surtout, la complicité occidentale avec le génocide perpétré par l'État colonial israélien contre le peuple palestinien.
De plus, ce réarmement n'a aucune justification rationnelle : comme l'a souligné la députée portugaise Mariana Mortágua, « les pays de l'UE disposent de plus de personnel militaire en activité que les États-Unis ou la Russie, et leur budget de défense cumulé est supérieur à celui de la Russie et proche de celui de la Chine ». Il faut également tenir compte du fait que l'Europe pourrait disposer, s'il le fallait, de l'arsenal nucléaire français et britannique.
Il ne s'agit donc pas d'un projet défensif, mais bien d'une militarisation accrue des sociétés européennes, au service d'une stratégie offensive visant à protéger les intérêts d'une Europe qui veut relancer un plan industriel militaire au service d'un capitalisme toujours plus prédateur et autoritaire.
Certains secteurs de la gauche, y compris radicale, appellent à soutenir le réarmement militaire européen. Quelle devrait être notre position sur la guerre en Ukraine ?
Il est gravement erroné que des secteurs de la gauche soutiennent le réarmement militaire européen. Cela revient à s'aligner sur un projet agressif et offensif qui ne profitera qu'à l'industrie de l'armement étasunienne et européenne. Malgré les discours officiels, cette orientation se fera au détriment des investissements sociaux et de la lutte contre le réchauffement climatique.
Une gauche internationaliste doit s'opposer à tous les impérialismes et à la logique des sphères d'influence. Elle doit exprimer sa solidarité avec le peuple ukrainien dans sa résistance – armée ou non – contre l'occupation russe et dans sa demande d'aide militaire et matérielle à autres pays. Cela implique de dénoncer tout accord entre Trump et Poutine négocié sans le peuple ukrainien, d'exiger le respect de la souveraineté de l'Ukraine, l'annulation de sa dette de guerre et le soutien à une reconstruction écosociale juste.
Il est également essentiel de renforcer les liens avec les forces de gauche en Ukraine qui s'opposent aux politiques néolibérales et pro-atlantistes du gouvernement Zelensky, ainsi qu'avec les militant·es anti-guerre en Russie qui luttent dans des conditions répressives extrêmes.
Poutine est aujourd'hui en position de force. Est-il possible d'inverser ce rapport de forces sur le plan militaire ou est-ce inutile ?
Après trois ans de guerre, il semble évident que le rapport de forces militaire est difficilement réversible et que le coût humain et matériel de la prolongation du conflit est immense. Cependant, l'insistance de Poutine à revendiquer l'Ukraine comme partie intégrante de son imaginaire nationaliste grand-russe laisse craindre qu'il soit impossible d'obtenir une paix juste et durable pour le peuple ukrainien comme pour le peuple russe.
Il faudra rechercher une solution politique, mais il ne revient pas à nous de dire au peuple ukrainien quand il doit arrêter de résister face à l'envahisseur. Nous devons continuer à soutenir leur lutte, armée ou non armée et, en son sein, les organisations sociales et populaires qui aspirent à une Ukraine souveraine et libérée des ingérences des grandes puissances, qu'elles soient occidentales ou russes.
Certains courants pacifistes étaient par le passé contre l'exportation d'armes à l'Ukraine. Penses-tu que cette position est toujours défendable ?
Je crois que si nous partons du fait indéniable que l'invasion russe est injuste et que, par conséquent, le peuple ukrainien a le droit de résister à cette invasion par les armes, il a également le droit de demander l'aide militaire inconditionnelle d'autres pays, même si leurs gouvernements le font motivés par d'autres intérêts ou faisant preuve d'un double standard par rapport à autres peuples, comme c'est le cas de Gaza. Une fois que la majorité du peuple ukrainien a décidé de résister, s'opposer à cette aide maintiendrait une position équidistante entre agresseur et agressé, ce qui est totalement contraire à la lutte pour une paix juste.
Compte tenu de la volonté de Trump de contraindre l'Ukraine à accepter l'accord qu'il pourrait conclure avec Poutine, je considère qu'une aide militaire à la résistance ukrainienne pour sa défense est d'autant plus nécessaire aujourd'hui que dans le passé, et cela peut se faire sans avoir à augmenter les budgets militaires des pays européens.
Telle a été la position traditionnelle d'une gauche internationaliste solidaire des peuples attaqués, que ce soit par d'autres États ou par la menace nazie ou fasciste, comme cela s'est produit pendant la guerre civile espagnole, même lorsque la résistance au fascisme était dirigée par un gouvernement qui avait fait échouer le processus révolutionnaire dans la zone républicaine.
Quelles doivent être nos tâches et revendications dans la période actuelle ?
Nos tâches devraient se concentrer sur la construction de fronts unitaires pour une lutte commune contre le projet de réarmement de l'UE, en exigeant une réduction substantielle des dépenses militaires afin de les consacrer à la transition écosociale juste, qui est nécessaire et urgente, ainsi qu'au désarmement nucléaire de la France, du Royaume-Uni et de la Russie.
Ces tâches doivent être accompagnées, comme ce fut le cas dans les années 1980 face à l'installation des euromissiles à l'Ouest et à l'Est, d'une lutte pour la dissolution de l'OTAN et le démantèlement de toutes les bases militaires américaines en Europe, ainsi que d'autres blocs militaires régionaux, tels que l'Organisation du traité de sécurité collective (OTSC), dirigée par la Russie et impliquant d'autres pays de l'ex-espace soviétique.
Tout cela devrait s'accompagner d'une remise en cause du concept militariste de « sécurité » employé aussi bien par l'UE que par la Russie, pour lui opposer une culture de paix, de résistance non-violente active contre toutes les agressions et de solidarité avec tous les peuples, dans le but d'avancer vers une dénucléarisation et une démilitarisation progressive de l'Europe, de l'Atlantique jusqu'à l'Oural.
C'est cette Europe-là qu'il faudra défendre si nous voulons construire une autre Europe écosocialiste.
Propos recueillis par Juan Tortosa
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

ReArm Europe et la militarisation des esprits

Le rapport sur les dépenses militaires de l'OTAN pour 2024 fait état d'une augmentation de 17,9% des dépenses de défense en Europe et au Canada (ces chiffres sont toujours agrégés) cette année-là par rapport à la précédente. Et en 2023, elle faisait déjà état d'une augmentation de 9,3% des dépenses militaires par rapport à 2022. En fait, l'augmentation des dépenses dans ce domaine est constante depuis 2015, avec de fortes hausses en 2023 et 2024.
24 mars 2025 | tiré du site Entre les lignes entre les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/03/24/justice-sociale-defense-europeenne-securite-nationale-quatre-textes/
L'investissement proposé ne sera pas non plus nécessaire, comme cela a été souligné, pour combler les lacunes de l'industrie européenne de l'armement, qui est très concentrée. Les données du SIPRI entre 2020 et 2024 montrent que parmi les 9 pays qui exportent le plus d'armes dans le monde, 4 appartiennent à l'Union européenne (France, Allemagne, Italie et Espagne) et 5 à des pays européens membres de l'OTAN (le Royaume-Uni s'ajoute aux 4 précédents).
En outre, dans les principales catégories de production d'équipements militaires répertoriées, l'industrie européenne ne présente aucune lacune. En d'autres termes, il n'y a pas de grands domaines où l'industrie européenne est déficiente. La France, l'Italie et le Royaume-Uni abritent des entreprises qui produisent et exportent des avions de combat, et la France et l'Italie font de même avec les hélicoptères de combat. Pour les grands navires de guerre, il y a vraiment cinq pays européens, et tous, sauf le Royaume-Uni, exportent des véhicules blindés. L'Allemagne et l'Italie exportent des chars de combat, la France et l'Allemagne de l'artillerie. Même les missiles sol-air les plus complexes (systèmes SAM) sont exportés par l'Allemagne et le Royaume-Uni.
Parallèlement à une industrie militaire robuste destinée à l'exportation, les pays européens ont considérablement augmenté leurs dépenses en équipements militaires au cours des dernières années. Il ne s'agit pas seulement d'achats, mais aussi d'investissements dans des projets de recherche et de développement. C'est ce qu'indique le rapport de l'OTAN. En 2024, les dépenses en armement des pays européens et du Canada ont augmenté de 36,9%, alors qu'en 2023, l'augmentation était déjà de 16,4%. Une fois de plus, les pays européens et le Canada ont connu des augmentations constantes des dépenses en équipement militaire depuis 2015, avec des pics en 2017, 2021, 2023 et 2024.
En Albanie, en République tchèque, en Finlande, en Hongrie, en Lettonie, au Luxembourg, en Pologne et au Royaume-Uni, la majeure partie du budget militaire est déjà consacrée à l'équipement militaire, allant de 36,9% en Lettonie à 51,1% en Pologne. Entre 2014 et 2024, 27 pays européens ont augmenté le pourcentage de leur budget de défense alloué aux équipements. Il s'agit de tous les pays européens membres de l'OTAN (y compris la Turquie), à l'exception de la Suède. De plus, dans 17 de ces pays, l'augmentation du pourcentage du budget de la défense consacré aux équipements a augmenté de manière plus ou moins régulière, et dans tous ces pays, on observe une tendance à l'accélération de l'augmentation au cours des deux dernières années.
Le complexe militaro-industriel transatlantique
L'augmentation des dépenses militaires s'est accrue et le pourcentage de ces budgets consacré à l'équipement et à l'armement a également augmenté. Pourquoi les dirigeants européens veulent-ils augmenter encore les dépenses militaires et quels en sont les enjeux ?
Dans son discours d'adieu de 1961, Dwight D. Eisenhower, ancien général et président des États-Unis d'Amérique pour le parti républicain, a lancé un avertissement à sa nation : « Dans les conseils de gouvernement, nous devons nous prémunir contre l'acquisition d'une influence injustifiée, qu'elle soit recherchée ou non, du complexe militaro-industriel ».
« La conjonction d'un immense complexe militaire et d'une vaste industrie de l'armement est une nouveauté dans l'expérience américaine. L'influence totale – économique, politique et même spirituelle – se fait sentir dans chaque ville, dans chaque État, dans chaque bureau du gouvernement fédéral », a-t-il ajouté.
Néanmoins, selon les données de la Banque mondiale, les dépenses militaires sont passées de 47,3 milliards de dollars à 876 milliards de dollars (environ 839 milliards d'euros, comme indiqué ci-dessus). Même corrigée de l'inflation, il s'agit d'une augmentation réelle d'environ 332 milliards de dollars en soixante ans.
Les entreprises d'équipement militaire des États-Unis d'Amérique ont acquis une taille considérable et une capacité d'influence sur la sphère politique et sociale, comme l'avait prédit Eisenhower. Et cette influence a atteint l'Europe.
Une enquête menée par Investigate Europe a montré que la stratégie de financement du programme européen de développement industriel de la défense est dominée par cinq entreprises : Airbus, Leonardo, Thales, Dassault Aviation et Indra Sistemas. Ces entreprises sont en partie détenues par des États européens, mais aussi par des fonds américains qui sont actionnaires de sociétés militaires américaines.
En pratique, les grandes entreprises d'armement européennes et les grandes entreprises d'armement américaines sont détenues par les mêmes fonds, ce qui signifierait un processus de concentration horizontale de la propriété sur le marché. Les fonds qui détiennent des intérêts dans ces cinq entreprises détiennent également des intérêts dans Boeing, Lockheed Martin, Raytheon Technologies, General Dynamics et Northrop Grumman. Le complexe militaro-industriel dont parlait Einsenhower a traversé l'océan Atlantique.
L'un des groupes les plus visibles est BlackRock, qui détient des participations dans Airbus, Leonardo, Thales, Indra Sistemas, Dassault en Europe, et Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, Northrop et General Dynamics aux États-Unis.
De plus, ces entreprises ont plusieurs représentants au sein du Groupe des personnalités de la recherche en matière de défense (GoP), un groupe créé par la Commission européenne en 2015 (année où les investissements militaires ont commencé à augmenter de façon constante) pour orienter la politique de sécurité et de défense en Europe.
Preuve en est l'augmentation des dépenses consacrées au lobbying auprès des institutions européennes par les 10 plus grandes entreprises de défense des pays de l'UE au cours des dernières années. Entre 2022 et 2023, les chiffres publics montrent une augmentation de 40%.
Ceux qui profitent du génocide en Palestine et de la guerre en Ukraine préparent le terrain pour bénéficier également des réductions de l'État-providence en Europe, augmentant ainsi leur taux de profit.
Miguel Urbán
https://www.publico.es/opinion/rearm-europe-militarizacion-espiritus.html
Transmis et traduit par JB
https://www.reseau-bastille.org/2025/03/21/rearm-europe-et-la-militarisation-des-esprits/
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

RDC, l’avancée inexorable de la rébellion

Les derniers évènements en RDC montrent que le M23/AFC entend contrôler durablement les territoires conquis tout en continuant son avancée, acculant le président congolais à chercher désespérément des soutiens militaires.
Tiré d'Afrique en lutte.
Le mouvement du 23 Mars et l'Alliance du Fleuve Congo (M23/AFC) soutenu par le Rwanda continue sa progression vers Kindu, chef-lieu de la province de Maniema et vers Uvira située sur le bord du lac Tanganyika. Dans le même temps, le M23/AFC conforte sa position et tente d'administrer les deux grandes villes du Nord et Sud Kivu, Goma et Bukavu.
S'installer dans la durée
Il ne faut pas se fier aux foules saluant les « libérateurs » dans les villes conquises. Il s'agit avant tout d'une stratégie des habitantEs tentant de se concilier les bonnes grâces des nouveaux maîtres des lieux. Quant au grand meeting organisé par Corneille Nangaa le dirigeant du M23/AFC au stade de l'Unité à Goma, les habitantEs ont été invitéEs à y participer sous la menace des kalachnikovs relativisant fortement la spontanéité de leur ferveur.
La situation humanitaire et sociale est catastrophique. Les miliciens ont expulsé les populations des camps de réfugiéEs vers leurs villages, indépendamment des conditions sécuritaires. Les citadinEs de Goma et de Bukavu sont confrontéEs à la pénurie de liquidités car les banques ne sont plus approvisionnées par Kinshasa. Beaucoup ont perdu leur emploi ou leurs biens à cause de pillages mais tous doivent participer gratuitement aux travaux communautaires appelés « Salongo » chaque samedi.
Les autorités du M23/AFC traquent opposantEs, journalistEs et toutes voix critiques et tentent d'étouffer la société civile. C'est le cas avec « La Lucha » dont les militantEs subissent la répression. Si avant la situation était loin d'être parfaite, elle s'est maintenant considérablement détériorée. Le remplacement systématique des chefs coutumiers – certains sont même exécutés – permet ainsi de conforter les propriétés foncières des partisans des miliciens voire d'accéder à de nouvelles terres, car traditionnellement leur distribution est assurée par les chefs des villages.
Un président congolais affaibli
Félix Tshisekedi, le président de RDC, se trouve acculé. La conférence de la SADC, regroupant les pays de l'Afrique australe, a acté le retrait de leurs troupes. Il s'est tourné vers le Tchad en vain. En interne, ses oppositions haussent le ton à l'image de Joseph Kabila, l'ancien président, qui l'accuse de dictature avec ses velléités de modifier la constitution lui permettant de briguer un troisième mandat.
Le dirigeant congolais joue une nouvelle carte, celle des USA. En échange d'une protection de la RDC, les États-Unis auraient accès aux nombreux minerais du pays. Cette offre, si elle correspond bien au logiciel du « First America » de Trump fait fi de la réalité, le contrôle par la Chine de près de 70 % à 80 % des mines obligeant les USA à mener des prospections géologiques considérées comme coûteuses, chronophages et aléatoires. Cependant, Washington s'est dit intéressé par la proposition.
Négociations contraintes
Aux dires du médiateur pour la paix, le président angolais João Lourenço, Félix Tshisekedi n'exclurait plus de franchir la ligne rouge qu'il avait lui-même édicté à savoir le refus de toutes négociations directes avec le M23/AFC, considéré comme des pantins du Rwanda. Depuis plusieurs semaines, les autorités religieuses congolaises très écoutées par la population défendaient cette option.
Isolé politiquement en RDC, ne pouvant plus compter sur une aide militaire d'un quelconque pays et conscient de la déliquescence de son armée et des milices alliées – les wazalendo dont certains ont changé de camps en rejoignant le M23/AFC – Félix Tshisekedi n'a plus beaucoup de choix. Mais accepter les négociations s'avèrera un jeu périlleux. En effet, trop céder aux exigences du Rwanda, risque non seulement d'être un suicide politique mais pourrait aussi susciter une opposition d'un autre pays voisin l'Ouganda qui verrait d'un mauvais œil l'hégémonie économique voire politique du président rwandais Paul Kagamé sur la partie Est de la RDC.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Au Mali, l’impasse de la guerre à outrance

Dans le pays se dessine une alliance entre force djihadiste et force indépendantiste au nord du Mali, ce qui améliorerait leur rapport de forces dans le conflit en cours.
Tiré d'Afrique en lutte.
En février a eu lieu dans la région de Sikasso une attaque contre le convoi du ministre de l'Enseignement supérieur, puis une seconde une semaine plus tard sur l'axe Kati-Soribougou. Cette fois-ci c'était le ministre de l'Assainissement qui était visé. Deux raids revendiqués par les islamistes qui ne cessent de gagner du terrain, au point que l'État ne contrôle plus que la moitié du territoire.
Une volonté de paix
Dans cette situation difficile pour la junte militaire, l'annonce de pourparlers entre le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM) affilié à Al-Qaïda et le Front de libération de l'Azawad (FLA) regroupant l'ensemble des organisations indépendantistes ou autonomistes du nord du Mali, est une nouvelle source d'inquiétude.
Un premier pacte de non-agression avait été signé au printemps 2024 entre les deux organisations aux agendas très différents. Les islamistes veulent instituer un État sur la base de la charia, alors le FLA milite, au moins pour les plus radicaux en son sein, pour une sécession du pays.
Ces pourparlers sont une réponse au désir des populations souhaitant la paix. Une volonté affichée depuis des années et renouvelée lors du dialogue national organisé par les putschistes. Le FLA s'y est dit sensible d'autant que cette idée est aussi largement partagée par les membres des communautés où il est implanté. Il y a aussi l'idée que le GSIM pourrait abandonner une partie de son programme et de ses méthodes les plus radicales à l'image de l'évolution du Front al-Nosra participant à la création de Hayat Tahrir al-Cham en Syrie qui a pris les rênes du gouvernement en Syrie.
Négociations en cours
Il semble que le GSIM ait accepté la proposition du FLA sur les modalités d'exercice de la charia qui serait appliquée de manière moins brutale et sous la responsabilité des notables religieux reconnus par les communautés indépendamment de leur affiliation ou non au GSIM. Pour ce dernier, la désaffiliation d'Al-Qaïda pourrait même être envisagée si des ruptures importantes se produisaient à l'intérieur du pays comme la chute du pouvoir, ou l'indépendance de l'Azawad. Bien que le GSIM considère que la communauté internationale accepterait plus facilement un État fondé sur la charia que la partition du Mali. Enfin, si la situation se présente, le GSIM n'exclut pas la possibilité d'une administration commune de villes ou de territoires avec le FLA.
Ce rapprochement des deux organisations est aussi la conséquence de l'attitude de la junte, appuyée par les mercenaires russes de Wagner/Africa Corps, qui se refuse à envisager une solution politique à cette crise qui s'ancre pourtant dans des problèmes économiques, sociaux et communautaires.
Les populations paient le prix fort de cette fuite en avant sécuritaire des putschistes. Ainsi les forces armées maliennes et leurs supplétifs russes ont fait en 2024 trois fois plus de victimes parmi les civilEs que les islamistes. Même si ces derniers, par leur politique d'encerclement des villes, approfondissent la paupérisation des populations et mènent des actions violentes de représailles.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Contrat du siècle ou piège du siècle ? La RDC face à la Chine

Le 17 septembre 2007, la République Démocratique du Congo (RDC) signait avec un consortium d'entreprises publiques chinoises un accord économique d'une ampleur sans précédent en Afrique. Surnommé le « contrat du siècle », ce partenariat, impliquant principalement l'EXIM Bank of China, Sinohydro Corporation et la China Railway Engineering Corporation (CREC), repose sur un échange « ressources contre infrastructures » [1]. En effet, en contrepartie du financement et de la construction de routes, d'hôpitaux et de voies ferrées, la Chine obtient un accès privilégié aux richesses minières congolaises, notamment le cuivre et le cobalt, ressources stratégiques indispensables pour son développement industriel [2].
Tiré du site du CADTM.
Fondé sur le principe de coopération mutuellement bénéfique, ce contrat représente-t-il une réelle opportunité pour le développement de la RDC, ou marque-t-il une nouvelle étape du néocolonialisme économique sous influence chinoise ? Derrière les promesses d'infrastructures se cache un système qui pourrait bien hypothéquer l'avenir du pays en le liant durablement aux intérêts chinois.
Un partenariat économique présenté comme gagnant-gagnant
Le contrat sino-congolais repose sur un échange de type « ressources contre infrastructures », où la Chine finance et construit des infrastructures en échange de l'exploitation de vastes ressources minières congolaises. Ce « contrat du siècle », engage des acteurs majeurs : China Railway Group Ltd. (China Railways) et Sinohydro Corporation, avec un financement assuré par la China Exim Bank. Côté congolais, la Gécamines, entreprise minière publique, joue un rôle clé via la joint-venture Sicomines, majoritairement chinoise (68%), chargée de l'exploitation des gisements stratégiques de Dikuluwe, Mashamba Ouest et Synclinal Dik Colline, entre autres [3].
L'accord initial prévoyait un investissement de 9 milliards de dollars pour la construction de 3.500 km de routes, 3.500 km de chemins de fer, 31 hôpitaux, 145 centres de santé et 5.000 logements, ainsi que pour des investissements miniers [4].
Sous la pression du FMI, préoccupé par la viabilité de la dette et par les termes de l'accord, les investissements dans les infrastructures ont été réduits de moitié, passant à 3 milliards de dollars. Ceux-ci sont financés uniquement par des prêts chinois à des taux fixes de 4,4 % et 6,1 % [5]. Par ailleurs, 3,2 milliards de dollars ont été alloués au développement minier, garantissant aux entreprises chinoises un accès privilégié aux ressources stratégiques du pays [6].
En échange de ces investissements, la Gécamine, concède plusieurs gisements contenant jusqu'à 10,6 millions de tonnes de cuivre, dont environ 6,8 millions de tonnes de réserves confirmées. En outre, l'accord stipule que la RDC s'engage à livrer 202 000 tonnes de cobalt et 372 tonnes d'or à Sicomines. La RDC a également accordé une exonération totale de taxes, impôts et droits douaniers jusqu'au remboursement des infrastructures.
Le pays renonce à plusieurs milliards de dollars de recettes fiscales et s'endette à des taux élevés, limitant ses marges de manœuvre économiques pour plusieurs décennies.
La dette comme outil de domination : vers une dépendance structurelle ?
L'engagement économique de la Chine en Afrique repose sur une approche singulière, fondée sur des prêts massifs, des investissements stratégiques et une absence de conditionnalités politiques. Ce modèle, mis en œuvre à travers des institutions comme China Exim Bank, se matérialise souvent par des contrats intégrés liant infrastructures et exploitations des ressources naturelles.
Officiellement “gagnant-gagnant”, le contrat pose en pratique plusieurs enjeux majeurs.
D'abord, la nature même des prêts accordés par la Chine soulève des interrogations sur la viabilité financière de ces accords. Les investissements chinois sont financés par des prêts à taux d'intérêt fixes et remboursés par l'exploitation des mines de cuivre et de cobalt. Le remboursement est directement assuré par 85 % des bénéfices de Sicomines, réduisant d'autant plus les ressources disponibles pour l'État congolais [7]. Cette structuration exclut tout contrôle démocratique sur la gestion des revenus miniers, rendant le pays dépendant des prévisions de production et des fluctuations du marché des matières premières.
Ensuite, cet accord, censé incarner une coopération équitable, est marqué par une opacité totale. Contrairement aux annonces officielles, l'accord a été négocié à huis clos, et les conditions de fixation des prix des minerais ne sont pas clairement établies, ouvrant la porte à une évaluation biaisée en faveur des entreprises chinoises et à de la corruption.
En effet, l'enquête menée par The Sentry a révélé des preuves manifestes de corruption, suggérant que des sociétés chinoises se sont entendues avec des acteurs puissants en RDC pour accéder à des milliards de dollars de ressources naturelles. La Congo Construction Company (CCC) est au centre de ces allégations, ayant apparemment versé des millions de dollars à des proches du président Kabila via des transactions financières douteuses transitant par des banques internationales [8]. Ces opérations présentent les caractéristiques d'un système de corruption de grande ampleur, avec des fonds mal justifiés, des sociétés à la propriété obscure et des conflits d'intérêts. Le paiement d'un « pas-de-porte » (prime à la signature) de 350 millions de dollars par les entreprises chinoises a également soulevé des questions [9]. Des enquêtes ont mis en lumière des transactions suspectes impliquant une partie de ces fonds, soulevant des doutes quant à leur destination et à leur gestion.
Enfin, la clause de stabilisation inscrite dans la convention de 2008 verrouille encore davantage la position chinoise en stipulant que toute nouvelle réglementation défavorable aux entreprises chinoises ne leur sera pas appliquée. En d'autres termes, la RDC s'engage pour plusieurs décennies sans possibilité de renégociation des termes du contrat.
Au-delà de son impact économique, cette approche favorise une dépendance structurelle.
Le contrôle chinois sur des secteurs clés, notamment l'exploitation minière et les infrastructures, empêche l'émergence d'une industrie locale indépendante en RDC.
De plus, l'accord initial prévoyait que si la RDC ne parvient pas à rembourser les prêts chinois dans les 25 ans, elle devait attribuer d'autres concessions minières à la Chine comme compensation. Bien que cette clause ait été supprimée sous la pression du FMI, la durée totale du remboursement s'étend sur 34 ans, maintenant le pays dans une relation de créancier à débiteur sur le long terme [10]. Passé ce délai, la RDC devra payer les financements chinois et leurs intérêts cumulés par toute autre voie, intégrant ainsi les prêts chinois à la dette publique externe de la RDC.
Un néocolonialisme économique sous couvert de coopération ?
L'accord sino-congolais repose sur l'exploitation des immenses richesses minières de la RDC, qui représentent un enjeu économique crucial pour la Chine.
La transition écologique et le développement des technologies numériques sont aujourd'hui au cœur des transformations économiques mondiales. En effet, en tant que puissance industrielle, la Chine est un acteur majeur dans cette course aux ressources, ayant connu des pénuries qui l'ont poussée à sécuriser son accès aux matières premières congolaises. Le cobalt, étant un élément essentiel des batteries utilisées dans les voitures électriques, les téléphones et les ordinateurs, sa demande a fortement augmenté avec la transition énergétique. Ainsi, la transition écologique, bien que essentielle pour l'avenir de la planète, s'accompagne d'un paradoxe : elle repose sur une exploitation accrue de ressources qui perpétue des dynamiques néocoloniales.
Selon les estimations, les gisements généreraient entre 40 et 120 milliards de dollars de recettes, soit bien plus que l'investissement chinois initial de 6,5 milliards de dollars [11]. En d'autres termes, la valeur réelle des minerais extraits dépasse largement le financement des infrastructures, marquant clairement un échange déséquilibré entre la RDC et la Chine.
En théorie, cet accord devrait améliorer les conditions de vie des congolais⸱es en construisant des infrastructures essentielles (routes, hôpitaux, écoles). Cependant, les réalisations concrètes ne répondent pas aux besoins prioritaires de la population. Une grande partie des infrastructures financées par la Chine se concentrent dans des zones stratégiques liées à l'exploitation minière, notamment dans le Katanga, plutôt que dans les régions où les besoins sociaux sont les plus urgents.
Par ailleurs, l'entretien de ces infrastructures n'a pas été pris en compte dans l'accord, ce qui risque de les rendre inutilisables à long terme faute de financements pour leur maintenance.
L'impact sur l'emploi local est également limité. La majorité des chantiers d'infrastructures sont réalisés par des entreprises chinoises, qui emploient principalement de la main-d'œuvre chinoise plutôt que de former et embaucher des ouvrier⸱ères congolais⸱es. Cela signifie que, malgré l'ampleur du projet, les bénéfices économiques directs pour la population congolaise restent marginaux, tandis que la Chine s'assure un accès sécurisé aux ressources minières du pays sans véritable transfert de compétences ou développement local durable.
Ce modèle de prêts garantis par des ressources naturelles n'est pas propre à la RDC : il a été déjà observé ailleurs en Afrique, notamment en Angola, où des accords similaires sur le pétrole ont permis à la Chine de prendre le contrôle de vastes secteurs économiques. Dans plusieurs pays, ces investissements massifs ont été suivis d'une prise de contrôle par des entreprises chinoises, transformant ce qui était présenté comme un partenariat en une domination économique à long terme.
Ainsi, loin d'être une simple coopération économique, l'accord sino-congolais s'inscrit dans une stratégie où la Chine sécurise l'accès aux ressources stratégiques tout en enfermant la RDC dans une dépendance durable, rendant tout redressement économique autonome extrêmement difficile.
“Gagnant-gagnant” perdu
Loin du récit officiel d'un partenariat « gagnant-gagnant », le contrat sino-congolais sert avant tout les intérêts économiques et stratégiques de la Chine, au détriment du peuple congolais. Plutôt qu'une souveraineté économique renforcée, la RDC s'enferme dans un modèle de dépendance où ses ressources financent son propre endettement, au bénéfice exclusif d'un partenaire étranger. Cet accord soulève ainsi une question fondamentale : la RDC construit-elle réellement son avenir avec ce partenariat, ou est-elle en train de céder son indépendance économique à une nouvelle puissance étrangère ?
Bibliographie
– Global Witness. (2011). La Chine et le Congo : Des amis dans le besoin. Global Witness.
– Ibanda Kabaka, P. (2018). La Chine en RD Congo : Relecture du contrat infrastructures contre minerais. HAL.
– Marysse, S., Geenen S. (2008),“Les contrats chinois en RDC : L'impérialisme rouge en marche ?”, L'Afrique des Grands Lacs, Annuaire 2007-2008, pp. 287-313.
– Marysse, S. (2010). “Le bras de fer entre la Chine, la RDC et le FMI : La révision des contrats chinois en RDC”, L'Afrique des Grands Lacs. Annuaire 2009-2010, pp. 131-150
– The Sentry. (2021). Trafic d'influence : Mainmise sur l'État et pots-de-vin derrière le contrat du siècle au Congo. The Sentry.
– Umpula Mkumba, E. (2021). Convention de la Sino-Congolaise des Mines : Qui perd, qui gagne entre l'État congolais et la Chine ? Évaluation de l'exécution des obligations des parties à la convention de collaboration de 2008. AFREWATCH.
Notes
[1] Marysse , S., Geenen S. (2008),“Les contrats chinois en RDC : L'impérialisme rouge en marche ?”, L'Afrique des Grands Lacs, Annuaire 2007-2008, pp.287-313.
[2] Global Witness. (2011). La Chine et le Congo : Des amis dans le besoin. Global Witness.
[3] Ibidem.
[4] Marysse , S., Geenen S. (2008),“Les contrats chinois en RDC : L'impérialisme rouge en marche ?”, L'Afrique des Grands Lacs, Annuaire 2007-2008, pp.287-313.
[5] Global Witness. (2011). La Chine et le Congo : Des amis dans le besoin. Global Witness.
[6] Ibidem.
[7] Global Witness. (2011). La Chine et le Congo : Des amis dans le besoin. Global Witness.
[8] The Sentry. (2021). Trafic d'influence : Mainmise sur l'État et pots-de-vin derrière le contrat du siècle au Congo. The Sentry.
[9] Ibidem.
[10] Umpula Mkumba, E. (2021). Convention de la Sino-Congolaise des Mines : Qui perd, qui gagne entre l'État congolais et la Chine ? Évaluation de l'exécution des obligations des parties à la convention de collaboration de 2008. AFREWATCH.
[11] Global Witness. (2011). La Chine et le Congo : Des amis dans le besoin. Global Witness.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Soudan : l’armée affirme avoir pris le contrôle total de Khartoum

La guerre, qui a éclaté le 15 avril 2023 entre l'armée du général Burhane et les FSR commandées par son ancien adjoint, le général Mohamed Hamdane Daglo, a fait des dizaines de milliers de morts et a déraciné plus de 12 millions d'habitants
Tiré d'El Watan.
L'armée soudanaise a annoncé avoir pris le contrôle complet de Khartoum, une semaine après avoir repris le palais présidentiel aux paramilitaires lors d'une offensive majeure. Cette déclaration intervient alors que la guerre dure depuis près de deux ans dans ce pays d'Afrique de l'Est. Selon le porte-parole de l'armée, Nabil Abdoullah, les forces armées ont réussi à éliminer les dernières poches de résistance des Forces de soutien rapide, qualifiées de milice terroriste et dirigées par le commandant Hamdane Daglo.
La veille, le général Abdel Fattah al-Burhane, commandant de l'armée, avait déjà proclamé la libération de Khartoum depuis le palais présidentiel, où il s'était rendu après l'offensive de ses troupes pour reprendre la capitale. Une source militaire a rapporté que les combattants des Forces de soutien rapide fuyaient par le pont de Jebel Aouliya, leur unique voie de repli hors de l'agglomération. En réponse, les paramilitaires ont affirmé leur détermination à poursuivre la lutte et ont exclu toute possibilité de retraite ou de reddition.
Depuis le début du conflit le 15 avril 2023, l'affrontement entre l'armée dirigée par le général Burhane et les Forces de soutien rapide menées par son ancien adjoint, le général Mohamed Hamdane Daglo, a causé la mort de dizaines de milliers de personnes selon les Nations unies. Plus de douze millions d'habitants ont été déplacés, aggravant une crise humanitaire de grande ampleur. Le pays, troisième plus vaste d'Afrique, est désormais scindé en deux, l'armée contrôlant le nord et l'est tandis que les paramilitaires dominent une partie du sud ainsi que la majeure partie de la région du Darfour, à l'ouest, frontalière du Tchad.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

En France, les gauches antimilitaristes changent leur fusil d’épaule

Si des partis de gauche radicale cherchent un chemin pour « stopper la marche à la guerre », les traditions antimilitaristes et pacifistes sont largement éclipsées par l'actualité internationale. En partie sidérées, parfois inaudibles, ces formations se recomposent à bas bruit.
23 mars 2025 | tiré d'Europe solidaire sans frontières | Photo : Un rassemblement de solidarité avec la résistance du peuple ukrainien à Lyon, en France, le 23 février 2025. © Photo Elsa Biyick / Hans Lucas via AFP
https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article74174
Une ambiance de mutinerie studieuse règne au 87 rue du Faubourg-Saint-Denis, dans le Xe arrondissement de Paris, mercredi 19 mars. Le local du Parti ouvrier indépendant (POI), d'obédience trotskiste lambertiste, accueille une conférence publique du Cercle d'études Pierre-Lambert sur le thème : « Marche à la guerre : comment la stopper ? »
À la tribune, face à une centaine de militant·es, Jérôme Legavre, membre du POI et député siégeant dans le groupe de La France insoumise (LFI), dénonce la « propagande guerrière » et le « climat de bourrage de crâne » en faveur de l'effort de réarmement.
Depuis le clash entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, une majorité du spectre politique est acquise à cet effort en France. Même si elles se différencient sur l'échelon de la défense à construire et préviennent contre la stratégie du choc néolibéral, les gauches se sont ralliées à un principe de réalité face aux menaces impérialistes et guerrières que Trump et Poutine font peser. À quelques exceptions près.
« On n'accumule pas de telles montagnes de munitions, de missiles, d'armement sans courir le risque que ça ne débouche sur une catastrophe », prévient Jérôme Legavre, qui fait reposer sur « les déserteurs ukrainiens et russes » une bonne part de l'issue du conflit. Cette posture antiguerre stricte n'est pas commune dans le paysage politique.
Depuis le début de la guerre en Ukraine, le député s'oppose aux livraisons d'armes – toutes les armes, à la différence de LFI. Jérôme Legavre avait aussi été le seul à voter contre une résolution de l'Assemblée nationale en soutien à l'Ukraine en décembre 2022. On l'a accusé de fermer les yeux devant l'impérialisme russe par « campisme ». Lui se dit internationaliste et anti-impérialiste. « Cette guerre oppose l'oligarchie mafieuse autour du régime pourri et tyrannique de Poutine et des États occidentaux qui servent les multinationales de l'armement », affirme-t-il aujourd'hui.
Des mémoires réactivées
Il rappelle que sa formation politique, jadis baptisée l'Organisation communiste internationaliste (OCI), n'est pas « pacifiste » pour autant : elle avait par exemple soutenu le Mouvement national algérien de Messali Hadj pendant la guerre d'Algérie. Sa position, singulière, évoque le « défaitisme révolutionnaire » professé par Lénine lors de la Première Guerre mondiale et l'antimilitarisme des socialistes réunis lors de la conférence de Zimmerwald, en 1915. Une vision que d'autres composantes de la gauche antiguerre rejettent pour son anachronisme.
« Cette théorie date d'avant le fascisme, elle ne correspond plus à la réalité d'une société civile devant résister à un tel pouvoir et aux crimes de guerre poutiniens », pointe Christian Varquat, membre de la commission internationale du Nouveau Parti anticapitaliste (NPA). Entre-temps, la Seconde Guerre mondiale et la trajectoire de certains pacifistes intégraux comme Louis Lecoin ou René Dumont – restés pacifistes sous l'Occupation – ont rendu cette grille de lecture difficilement audible. En juin 1944, le journal La Vérité écrivait que « la libération de Roosevelt valait tout autant que le socialisme de Hitler ».
« Après 1945, c'est plutôt la Résistance, qui est un mouvement d'indépendance nationale armé, qui a pris le dessus dans l'imaginaire de la gauche dans de nombreux pays », analyse l'historien Gilles Candar – même si le pacifisme incarné en 1914 par Jean Jaurès a repris de la vigueur au moment des guerres coloniales, notamment celle du Vietnam.
Du point de vue antimilitariste, il y a une forme de sidération et d'attentisme.
Éric Fournier, historien
De manière générale, le retour des conflits et la rupture nette provoquée par Donald Trump sur l'Ukraine amènent des recompositions inédites, dans un champ où les positions avait été figées par l'éloignement des guerres hors du continent européen.
« L'invasion russe de l'Ukraine a reconfiguré les lignes, constate l'historien Éric Fournier, qui a codirigé le livre À bas l'armée ! L'antimilitarisme en France du XIXe siècle à nos jours (Éditions de la Sorbonne, 2023). Du point de vue antimilitariste, il y a une forme de sidération et d'attentisme, même si la mémoire de l'anarchiste Makhno a été réactivée par des libertaires européens. Ce qui était acquis – le refus de la guerre qui ne profite qu'aux grands groupes de l'armement, le mépris des officiers – change avec l'Ukraine. Il était plus facile de s'intéresser à des milices kurdes en Syrie qu'à un groupe de combattants étatique. »
Engagé dans le Réseau européen de solidarité avec l'Ukraine et contre la guerre, le NPA soutient Sotsialnyi rukh (le « Mouvement social », une organisation de la gauche ukrainienne qui a des militants dans l'armée) et assume son engagement auprès de la résistance ukrainienne à l'invasion russe, « en toute indépendance du gouvernement néolibéral ukrainien et des grandes puissances occidentales », précise Christian Varquat.
« L'aide armée n'est pas demandée seulement par le gouvernement Zelensky, mais par toutes les composantes de la société qui résistent à l'agression russe », rappelait l'économiste Catherine Samary, membre d'Attac et du NPA, dans un entretien à Mediapart. « Insister sur la nécessité de disposer des moyens de se défendre n'est pas du bellicisme. Sans cela, la diplomatie se résume à un appel à la pitié », affirme ainsi Oleksandr Kyselov, membre du conseil de Sotsialnyi rukh dans le journal L'Anticapitaliste. C'est sur cette ligne de crête, sans angélisme ni bellicisme, que les gauches antiguerre se recomposent.
Les nuances entre antimilitarisme et pacifisme
Historiquement, l'antimilitarisme n'est d'ailleurs pas contradictoire avec le soutien armé aux peuples qui résistent. « L'antimilitariste se distingue du pacifisme par son hostilité systématique à l'institution militaire et notamment à la chaîne de commandement, les officiers de carrière étant facilement assimilés à des aristocrates réactionnaires. Mais cette hostilité qui vise la caserne et l'uniforme, assimilé à une tenue d'esclave, ne s'accompagne pas du tout d'un refus de la prise d'armes civique ou populaire », rappelle l'historien Éric Fournier.
Avant le renversement d'alliance et le deal Trump-Poutine fait dans le dos de l'Ukraine, les Soulèvements de la Terre avaient ravivé cette mémoire de l'antimilitarisme en rejoignant la coalition « Guerre à la guerre », appelant à « désarmer le militarisme ». Cette coalition visait à s'ériger contre l'« interventionnisme militaire [de la France] au Sahel, en Kanaky, en Martinique, à Mayotte », et contre la « guerre intérieure, menée par une police aux moyens militarisés, qui cible en premier lieu les non-Blancs et les minorités ».
La cause du refus absolu du fait militaire et de la logique guerrière est condamnée à rester une protestation morale.
Gilles Candar, historien
Mais les bouleversements géopolitiques autour de l'Ukraine ont changé la donne. Désormais, la coalition cherche une ligne qui convienne à toutes ses composantes. La gauche antiguerre, en partie marquée par une vision purement anti-atlantiste des relations internationales jusqu'à récemment, est prise par surprise et doit rapidement se réarmer intellectuellement. « Le rapprochement Trump-Poutine plonge dans un hébètement idéologique tous ceux qui s'opposaient à l'alliance atlantique. Des années de discours doivent être reconsidérées », observe Éric Fournier.
Les Écologistes, qui avaient déjà fortement nuancé leur héritage pacifiste au fil des années, ont confirmé cette évolution depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Même si des nuances existent en leur sein, l'époque où la candidate écologiste à la présidentielle Éva Joly proposait la suppression du défilé militaire du 14-Juillet semble bien loin. « Refuser le campisme, c'est analyser le conflit tel qu'il est et non pas tel qu'il est fantasmé. Il ne faut pas se contenter de saluer l'héroïsme des Ukrainiens, il faut les soutenir »,explique Jérôme Gleizes, vice-président du groupe écologiste à la mairie de Paris, auteur d'un billet de blog à ce sujet.
Alors que les grandes puissances adversaires des démocraties libérales et aux velléités expansionnistes grandissent, de Poutine à Trump, en passant par Xi Jinping et Narendra Modi, l'espace du pacifisme se réduit d'autant. « La cause du refus absolu du fait militaire et de la logique guerrière est condamnée à rester une protestation morale de forces très minoritaires qui ont valeur de témoignage », analyse Gilles Candar. L'antimilitarisme, qui articule critique du militarisme et soutien aux peuples qui se battent pour leur autodétermination, a plus de chances de se faire entendre face à l'escalade militaire qui se dessine.
Mathieu Dejean
P.-S.
• Mediapart. 23 mars 2025 à 14h54 :
https://www.mediapart.fr/journal/politique/230325/en-france-les-gauches-antimilitaristes-changent-leur-fusil-d-epaule
Les articles de Mathieu Dejean sur Mediapart :
https://www.mediapart.fr/biographie/mathieu-dejean-0
ESSF invite lectrices et lecteurs à s'abonner à Mediapart.
POURQUOI S'ABONNER A MEDIAPART ?
• Site d'information indépendant
• Sans subventions ni publicité sur le site
• Journal participatif
• Financé uniquement par ses abonnements
https://www.mediapart.fr/abonnement
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La situation en France, le NFP et les tâches des révolutionnaires

La situation en France est marquée par la crise générale du capitalisme et par celle de sa place dans les rapports de forces internationaux. Elle est aujourd'hui en équilibre très instable et pourrait basculer, comme bien d'autres pays, sous la domination de l'extrême droite.
Tiré de Inprecor 730 - mars 2025
24 mars 2025
Par Antoine Larrache
Manifestation contre la réforme des retraites, 7 février 2023. Photothèque Rouge, Martin Nada, Hans Lucas
Le capitalisme français est percuté par la crise économique mondiale. Le pays est en quasi-récession, son déficit budgétaire est croissant (6 % du PIB en 2024), à tel point que la note de la dette de la France a été dégradée à plusieurs reprises par les agences de notation (elle est passée de AAA à Aa2 entre 2012-2015 puis à Aa3 en 2024). L'un de ses secteurs historiques, l'automobile, est en crise, incapable notamment de prendre le tournant de l'électrique. Le secteur du commerce supprime des postes par milliers (notamment chez Auchan et Casino). Globalement, sur la période de juillet à novembre 2024, la CGT a recensé 120 plans de licenciements, représentant, depuis septembre 2023, entre 130 000 et 200 000 emplois. Il est possible que les chiffres réels soient très supérieurs, en comptant les emplois induits. Ces suppressions de postes comprennent des licenciements secs et des départs en retraite non remplacés qui conduisent à une augmentation de la charge de travail. Par ailleurs, la pauvreté est en hausse, avec 8,1 % de pauvres (moins de 1 000 euros par mois, ou 1 500 pour un couple sans enfant).
Les gouvernements Barnier et Bayrou ont mis en place des coupes budgétaires drastiques dans les dépenses publiques, de 60 milliards d'euros, et diverses fonctions publiques sont en grande difficulté. C'est le cas dans l'Éducation, même si les suppressions de postes prévues au budget 2025 ont été reportées, dans la santé (plusieurs morts ont été comptées dans les hôpitaux en raison de la lenteur des prises en charge ou du manque de personnels), dans la fonction publique territoriale où les suppressions de postes rendent la gestion des collectivités locales de plus en plus difficile, dans universités, etc. Sans parler de la privatisation rampante de la SNCF et de la RATP, qui se met en place petit à petit, avec l'ouverture à la concurrence puis la vente de lignes.
La réaction impérialiste aux difficultés
La tendance est donc à un déclin très prononcé sur le plan économique. Dans le même temps, l'impérialisme français est mis en déroute dans la plupart des pays d'Afrique qu'il dominait dans sa forme moderne d'impérialisme, la Françafrique. Au Mali (février 2022), au Burkina Faso (février 2023), au Niger (fin 2023), en Côte d'Ivoire (février 2025), au Tchad (décembre 2024) et au Sénégal (septembre 2025), la France a dû retirer ses troupes, et ses intérêts économiques et politiques sont remis en cause. Ces retraits ont eu lieu à l'initiative des régimes, soit en raison du mécontentement des populations, soit de l'émergence d'influences concurrentes, en particulier de la Russie et de la Chine.
En réponse, la France poursuit voire renforce sa domination sur ses colonies restantes. Ainsi Macron tente d'arrêter le processus de décolonisation de la Kanaky en ayant tenu en 2021, le troisième référendum malgré le Covid, essayé de dégeler le corps électoral et en déportant des militants en métropole. Il a répondu par la répression aux revendications sociales en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, tandis que Mayotte sert désormais de test grandeur nature pour les politiques racistes, avec la suppression du droit du sol qui permettait à toute personne née en France d'obtenir la nationalité française.
Plus globalement, la 7e puissance militaire mondiale cherche à construire une « défense européenne » autour d'elle. Ainsi, la prochaine loi de programmation militaire du pays devrait atteindre 413 milliards d'euros sur 5 ans, soit un doublement en 10 ans, tandis que Macron déclare souhaiter « un financement européen commun massif pour acheter et produire plus ».
L'usure des partis gestionnaires
La crise est donc généralisée et les gouvernements bourgeois classiques sont en grande difficulté pour la résoudre. Depuis une vingtaine d'années, les partis de droite issus du gaullisme et la social-démocratie ont connu une alternance au pouvoir, mais avec des difficultés croissantes à se reproduire. Le Parti socialiste a opéré un tournant particulièrement droitier sous la présidence de François Hollande (2012-2017), ajoutant au libéralisme économique déjà amorcé par Lionel Jospin, à la fin des années 1990, un développement de la répression et des politiques racistes, une poursuite de la destruction de la Sécurité sociale, notamment par les réformes des retraites et contre les chômeurs, des attaques contre le droit du travail et la représentation syndicale. Mais les scores électoraux du parti de droite, Les Républicains, et du PS se sont petit à petit réduits, avec la chute en 3e position de François Fillon en 2017 et le très faible score (4,78 %) de Valérie Pécresse en 2022 pour ce qui concerne les premiers, et les scores encore plus réduits des candidats du PS Benoît Hamon (6 %) et Anne Hidalgo (1,75 %). Pendant que Marine Le Pen atteignait 21 % en 2017 et 23 % en 2022 ; et Jean-Luc Mélenchon 20 % en 2017 et 22 % en 2022.
Le personnel bourgeois classique a donc été profondément bouleversé : Macron, ancien ministre sous Hollande, a réussi à rassembler les électeur·trices modéré·es de la droite classique et ceux les plus à droite du Parti socialiste, et à sortir gagnant des deux dernières présidentielles. Mais son assise est cependant très limitée, avec 18 et 20 % des voix des inscrit·es sur les listes électorales au premier tour en 2017 et 2022. Et elle tend à se réduire toujours plus : lors des dernières élections législatives, l'alliance construite autour de Macron n'a obtenu que 26 % des voix, 43 % des député·es en 2022, puis 22 % des voix et 29 % des député·es en 2024. De fait, son assise sociale est essentiellement constituée des couches très supérieures du salariat (cadres), et de la classe dominante. Les secteurs réactionnaires se tournent de plus en plus vers la droite, vers Éric Zemmour, Éric Ciotti et bien sûr le RN, tandis que l'union de la gauche lors des dernières élections législatives lui a fait perdre les couches intermédiaires qui votaient traditionnellement PS, retournées au bercail.
En 2017 comme en 2022, Macron a été élu au second tour de la présidentielle contre Marine Le Pen et a donc fait jouer pleinement le « front républicain », qui consiste à ce que les partis appellent à voter contre l'extrême droite. Macron est donc à chaque fois apparu aux couches intermédiaires comme le meilleur outil, dès le premier tour, pour empêcher l'arrivée au pouvoir de Le Pen. Il a d'ailleurs mené une grande partie de ses campagnes sur cette thématique, promettant de faire reculer l'extrême droite. Mais cette promesse a été de courte durée, les classes populaires abandonnant de plus en plus le vote Macron pour se concentrer, pour ce qui concerne les couches conscientes et/ou racisées, sur le vote Mélenchon, et pour les couches craignant un déclassement, vers Le Pen.
Un danger fasciste toujours plus concret
Ainsi, le « centre » se réduit, au bénéfice d'une gauche en mutation et de l'extrême droite. C'est cette dernière qui connaît une progression particulièrement spectaculaire, car le « front républicain » ne suffit plus à arrêter son développement : dans 39 circonscriptions (sur 577), aux législatives de 2024, les candidat·es du RN ont même été élu·es dès le premier tour.
De plus, on voit une augmentation effrayante du soutien au RN dans la police et dans l'armée. Le soutien dans la police est passé de 51 % en 2015 à 67 % dans les échelons inférieurs de la hiérarchie en 2022, et dans l'armée, il aurait dépassé les 50 %. Elles constituent, de fait, des bandes armées favorables à l'extrême droite. Un élément qui doit être mis en relation avec la tribune de 20 généraux publiée un 21 avril 2021 – en référence à la tentative de putsch des généraux de 1961 – dans la revue d'extrême droite Valeurs actuelles indiquant que « Oui, si une guerre civile éclate, l'armée maintiendra l'ordre sur son propre sol » (1). Et avec le fait que des franges importantes de la bourgeoisie française ont basculé vers l'extrême droite. Ainsi « Le patron de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), François Asselin, s'appuie sur un sondage commandé par son organisation pour affirmer que “le Rassemblement national fait moins peur aux entrepreneurs que le Nouveau Front populaire”. Tandis que Michel Picon, président de l'Union des entreprises de proximité (U2P), considère de son côté que les petits patrons “expriment un fort besoin d'ordre, de fermeté, de remise en place de hiérarchie des valeurs” » (2). Les Bolloré et Progli se multiplient, tandis que le Financial Times a noté que « les patrons des grandes entreprises françaises se précipitent pour nouer des contacts avec l'extrême droite de Marine Le Pen ».
Les agressions par des groupes fascistes se développent, petit à petit, contre les personnes racisé·es, les LGBTI, des piquets de grève, des réunions militantes. En février, un militant de gauche a été poignardé, heureusement sans dommage grave. Et l'extrême droite a pris une place importante dans certaines mobilisations sociales comme celle des Gilets jaunes et les mobilisations paysannes, par l'intermédiaire notamment de la Coordination rurale, qui connaît une progression importante (passant de 3 à 14 présidences de chambre d'agriculture entre 2019 et 2025, avec des scores supérieurs à 30 % dans de nombreux départements).
Une grande partie des caractéristiques du fascisme sont donc déjà en place dans le pays. Il manque un point essentiel : l'existence d'un parti fasciste de masse. Mais cet élément peut hélas être réalisé, quand on voit les files d'attente impressionnantes lors de signatures du livre de Jordan Bardella (3) ou la présence dans les meetings du RN.
Une gauche en pleine reconfiguration
En face, la gauche évolue fortement. Comme nous l'avons vu, le Parti socialiste, hégémonique à gauche pendant trente ans, est très affaibli et travaillé par de fortes contradictions. Il revendique 50 000 adhérent·es mais moins de 20 000 personnes votent lors de ses congrès. Et il est traversé par des désaccords très importants entre une frange complètement intégrée aux institutions et qui cherche à se rapprocher de Macron (autour de Carole Delga, Anne Hidalgo et Michael Delafosse…) et une autre qui reste sensible à l'histoire du mouvement ouvrier, notamment par l'intermédiaire des élu·es des quartiers populaires ou des syndicalistes de la CFDT ou l'UNSA ou de FO.
L'unité de la gauche, lors des élections législatives de 2022 et 2024, s'est imposée à ses organisations car, divisées, elles auraient eu très peu d'élu·es. Mais on ne peut pas ignorer la corrélation entre, d'une part, l'unité réalisée avec la NUPES en 2022 et le NFP en 2024, et, d'autre part, l'unité syndicale face à la casse des retraites en 2023, qui a rassemblé toutes les forces, de Solidaires à la CFDT en passant par la FSU et la principale, la CGT. On peut considérer que, sous le coup des attaques antisociales dans un cas, de la menace de la droite et de l'extrême droite dans le second, les organisations du prolétariat se sont rassemblées, dans le même temps que celui-ci tentait de s'organiser et d'agir, exerçant une pression pour ce rassemblement.
Sous cette pression, le PS, comme ça avait déjà été le cas lors de la désignation de Benoît Hamon en 2017, a adopté une orientation relativement combative, et accepté le programme du Nouveau Front populaire, qui est sur la plupart des points une reprise de celui de La France insoumise, lui-même inspiré par les revendications des grands mouvements sociaux, formulées par des militants des principales organisations dans tous les domaines (syndicats, associations pédagogiques, groupes d'économistes, etc.). De même, Les Écologistes et le Parti communiste ont participé à l'alliance. Ces deux organisations, n'ayant pas été à la direction des gouvernementaux sociaux-libéraux, ont une plus grande faculté d'adaptation programmatique que le PS, et les négociations ont été rapides.
Le cœur de l'accord politique entre les quatre grandes formations de gauche a été le mot d'ordre du retrait de la réforme des retraites de 2023 et qu'en cas de victoire, le NFP choisirait quel·le Premier·e ministre il proposerait à Macron, et voterait des motions de censure contre tout Premier ministre de droite. Cet accord fragile, que le PS a remis en cause ces derniers mois, a été imposé à la droite du parti en échange d'une part importante des circonscriptions pour les élections législatives… l'une d'elles étant même accordé à l'ancien président François Hollande.
Un front unique original
De l'autre côté de la gauche, le NPA-L'Anticapitaliste (NPA-A) a participé au Nouveau Front populaire, obtenant « sur le quota de LFI », une circonscription ingagnable pour Philippe Poutou4. L'entrée du NPA-A dans le NFP a eu pour seule condition l'engagement à voter pour le programme du NFP à l'Assemblée si Philippe était élu ; il a été clairement spécifié par le NPA-A qu'il ne participerait pas au gouvernement du NFP. En effet, la nature du NFP, cette alliance « de Philippe Poutou à François Hollande », ne permet pas une participation des révolutionnaires, laquelle ne peut relever que de circonstances exceptionnelles.
Le NFP se réclame d'un programme de rupture qui intègre des propositions assez radicales : bloquer « les prix des biens de première nécessité dans l'alimentation, l'énergie et les carburants », taxer « les super profits », augmenter les salaires, « un moratoire sur les grands projets d'infrastructures autoroutières », « passer à une 6e République par la convocation d'une assemblée constituante citoyenne élue », des mesures plus favorables à l'immigration, le refus du « pacte de stabilité budgétaire » européen, de très nombreuses mesures qui, sans être révolutionnaires, constituent une rupture réelle avec les politiques bourgeoises menées depuis des décennies et supposent un affrontement avec la bourgeoisie.
Un tel programme est précisément totalement inacceptable et la classe dominante, par ses médias, ses représentant·es politiques ou de grands dirigeants d'entreprises, a exprimé sa totale opposition à ce programme et à La France insoumise. Une partie a même repris à son compte des formules proches de l'historique « mieux vaut Hitler que le Front populaire ». Cependant, les objectifs d'un gouvernement issu du NFP s'inscriraient dans le cadre du système et associeraient des courants ayant participé loyalement à la gestion du capitalisme français, notamment les membres du PS, du PCF et des Écologistes. Le programme, s'il ne comprend pas vraiment de mesure erronée, n'aborde ni les licenciements ni la dette publique, et n'introduit aucune incursion dans la propriété privée des moyens de production. Il y a fort à parier qu'un gouvernement issu de ce programme serait mis sous pression et discipliné encore plus rapidement que l'a été le gouvernement Syriza en Grèce et, même si LFI répète à l'envi vouloir s'appuyer sur les mobilisations – à défaut de s'employer à les construire –, la faible auto-activité actuelle des classes populaires rendrait le débordement du gouvernement par sa gauche assez improbable.
Contenir le recul, préparer la contre-offensive
Tout cela reste assez hypothétique car, justement, le rapport de forces entre les classes ne permet pas, à ce stade, d'espérer une victoire électorale de la gauche. En effet, le mouvement ouvrier connaît une phase de recul de ses capacités à peser sur la situation. La mobilisation sur les retraites de 2023 s'est soldée par une défaite, tandis que les droits des chômeurs et des étrangers ont été dégradés sans que les grandes organisations s'y opposent réellement. La casse ou la privatisation des services publics se poursuit avec des réactions pour l'instant très limitées et locales. Les déserts syndicaux s'agrandissent, et les perspectives d'une unification – à moyen terme – entre la CGT et la FSU (voire Solidaires) serviraient plutôt à contenir le recul qu'à espérer une reconstruction.
Cependant, des points d'appui existent. Le mouvement sur les retraites a montré, avec des records de participation aux manifestations (au plus fort, un million de manifestant·es selon la police, 3,5 millions selon la CGT), qui ont eu lieu dans plusieurs centaines de villes, montrant ainsi la profondeur du mouvement. À l'instar des mouvements précédents, ou de la mobilisation des Gilets jaunes en 2018-2019, on a pu observer que le potentiel de mobilisation de la classe ouvrière reste très important même si, en termes de rapport de forces relatif à celui imposé par la classe dominante, il est insuffisant.
D'autres mobilisations ont eu lieu, montrant des capacités variées : par exemple le mouvement contre les violences policières et racistes, suite à l'assassinat d'un jeune par la police, Nahel, en juin 2023, qui a mobilisé pendant plusieurs jours les quartiers populaires, malgré les interdictions de manifester et la répression policière (3 651 personnes arrêtées et 380 peines de prison fermes, et deux morts). Ce mouvement a d'ailleurs, contrairement aux révoltes de 2005, globalement été soutenu par la gauche. La mobilisation pour la Palestine, bien que confrontée à la répression et à une offensive idéologique de grande ampleur, a réussi à tenir sur la longue durée et à mobiliser pendant un moment plusieurs dizaines de milliers de personnes, notamment des quartiers populaires et racisées. Il a représenté le plus important mouvement internationaliste de la jeunesse – notamment des quartiers populaires – depuis plusieurs décennies. Des actions ont été menées contre les licenciements et les suppressions de postes, notamment dans l'automobile et le commerce, en novembre 2024 et, si elles n'ont pas obtenu de victoire, elles ont contribué à déstabiliser le gouvernement Barnier et à ce que la tentative d'adoption du budget par l'article 49-3 de la Constitution conduise à la censure et à la démission du gouvernement. Les mobilisations féministes, régulières notamment depuis Metoo, avec notamment le développement de la grève féministe, et les mobilisations écologiques (notamment contre les Grands projet inutiles comme les autoroutes, les méga-bassines, etc.), contribuent aussi à la contestation sociale globale. Aujourd'hui, on observe des actions syndicales contre la pénurie budgétaire dans les administrations territoriales, dans les universités (avec plusieurs centaines de personnes dans quelques assemblées générales, à ce jour), les hôpitaux, les écoles…
Une unité militante
Il y a donc une crise et des mobilisations quasi permanentes en réaction aux attaques du gouvernement et, de façon similaire, une partie de la gauche – en réaction à la montée de l'extrême droite et face à Macron – s'est mobilisée pour construire la campagne du NFP, dans des comités locaux regroupant chacun plusieurs dizaines de personnes – voire des centaines à certaines occasions. Dans de nombreuses circonscriptions, tout·es les militant·es de gauche se sont retrouvé·es pour organiser des diffusions de tracts, des collages d'affiches, des tournées d'immeubles et des réunions publiques. Pas seulement les militant·es politiques, aussi les syndicalistes et membres d'associations de gauche.
Cette dynamique possède des qualités indiscutables. En effet, la seule présence dans des actions communes pendant plusieurs semaines sécrète quasi mécaniquement une capacité d'action décuplée – qui a permis non seulement que le RN ne gagne pas les élections, mais aussi que le NFP soit la force disposant du plus grand nombre de député·es à l'Assemblée nationale ! – et exerce une pression pour continuer cette unité dans les luttes. En effet, il est évident pour tout·e militant·e de base qu'il y a un lien entre les éléments de programme et les luttes à la base, entre les préoccupations des classes populaires et les actions à mener, même si une grande partie des militant·es les conçoivent dans leurs aspects les moins combatifs (rendez-vous avec les élu·es, pétitions, etc.), et il était absolument essentiel, pour des militant·es révolutionnaires, d'accompagner cette dynamique globale, malgré la combativité limitée de ces cadres.
Ce dernier point est lié à la faiblesse majeure du NFP, sa nature essentiellement institutionnelle, dans le sens où elle est liée aux institutions du capitalisme, de la base au sommet. Son combat est en effet essentiellement une lutte à l'intérieur du système, pour en modifier les équilibres et « mener une politique de gauche ». Le NFP a ainsi mené campagne pour obtenir le poste de Premier ministre et gouverner, bien qu'il n'ait obtenu qu'un gros tiers des député·es. La France insoumise, pourtant la force la plus radicale des quatre organisations principales du NFP, a engagé une procédure de destitution de Macron qui n'avait aucune chance d'aboutir et ne participait aucunement à un mouvement de masse, alors que le président est pourtant détesté par une grande partie de la population. Le PS, dans la dernière séquence de vote du budget (5), n'a pas voté la censure, contrairement aux engagements initiaux du NFP. Ce choix, répondant aux préoccupations d'une partie la population qui craignait une nouvelle déstabilisation du pays en cas de non-adoption du budget, a permis au Rassemblement national, qui ne souhaitait pas non plus censurer le gouvernement, de se positionner de façon favorable. En effet, le RN joue un jeu complexe : il tente d'un côté de se présenter comme le principal opposant à Macron et de l'autre d'apparaître comme une force crédible pour gérer le système à sa place. Cette orientation est pleine de contradictions, et la gauche pourrait, en votant systématiquement la censure et en se positionnant comme la principale force militante anti-Macron, faire la démonstration que le RN n'est pas au service des classes populaires.
Mais, pour cela, il faudrait que la gauche entreprenne des campagnes militantes combatives, à la base, ce qu'elle n'est pas disposée à faire, car elle se laisse absorber par le travail parlementaire, les divisions et en particulier celles liées à la préparation des élections municipales qui auront lieu en 2026. Pour les partis de gauche les plus intégrés au système, c'est une échéance fondamentale pour garder ses positions, qui lui permettent – comme ses positions dans les conseils régionaux et départementaux – de construire leurs appareils et de maintenir un rapport de forces vis-à-vis de LFI, qui reste bien plus faible sur ce terrain. De plus, chaque organisation de gauche garde en tête la préparation de la prochaine échéance présidentielle, en 2027, en espérant y jouer un rôle central. LFI par le biais de Jean-Luc Mélenchon, qui se présentera vraisemblablement, les autres forces voulant à tout prix éviter que l'ancien sénateur soit le candidat unique de la gauche, car cela contribuerait à diminuer leur rapport de forces vis-à-vis de LFI. Chaque force étant sous une pression énorme : la nécessité, pour gagner, et peut-être même pour empêcher Le Pen d'être élue, de présenter une candidature unique, commune. À ce puzzle il faut ajouter la possibilité, si le gouvernement Bayrou ne tient pas dans le temps, notamment s'il est censuré par la gauche et le RN, de nouvelles élections législatives dès juin 2025. Autant dire que la gauche est tétanisée par ces enjeux, qui la divisent tout en nécessitant son unité.
Articuler unité et radicalités
Il est difficile de peser dans une telle situation, car tant sur le terrain politique que social, les choses semblent bloquées. Les mobilisations sociales sont pour l'instant peu puissantes malgré l'ampleur des attaques, et les organisations politiques sont engluées dans des négociations et confrontations locales délétères. Cependant, les périodes où existe un fort décalage entre les nécessités et les actions concrètes peuvent constituer des moments où un espace politique existe pour exprimer une orientation alternative, où les nécessités doivent être, par le travail politique, transformées en possibilités.
Pour cela, il nous faut tenter d'analyser les enjeux précis et de mettre en mouvement les forces disponibles pour peser dessus. Cette tentative conduit à distinguer les nécessités politiques selon trois niveaux.
Le premier est le besoin de l'unité de toute la gauche pour répondre à la menace fasciste, pour construire le rapport de forces et pour tracer des perspectives alternatives à la domination bourgeoise. C'est pour cette raison que, malgré les limites du NFP, il était correct d'y participer et de faire le lien entre cette alliance et les luttes concrètes. Il semble aussi correct de continuer à construire ce cadre à la base, notamment en encourageant les dizaines de collectifs qui se maintiennent localement. Des alliés (Nouvelle donne, Égalités, l'Après, Copernic, Peps…) existent pour une telle orientation, qui travaillent à construire une réunion nationale des collectifs, là où les quatre organisations principales (LFI, PS, PCF, écologistes) privilégient leurs intérêts. Le moment venu, cette politique pourrait jouer un rôle important car il s'agit d'un embryon de cadres démocratiques unitaires de base, dont tout mouvement de masse a besoin pour agir, se construire et poser la question du pouvoir par en bas.
Ces collectifs de base peuvent mettre en place les campagnes unitaires nécessaires dans la période : contre les politiques racistes, contre les licenciements, pour l'augmentation des salaires, pour la défense des services publics, pour la Palestine, la Kanaky… De premières discussions ont eu lieu, à l'initiative du NPA-A, sur les licenciements pendant la vague de suppressions de postes de novembre-décembre 2023 et des initiatives pour les services publics sont discutées. Ils pourraient aussi intervenir dans les débats politiques plus généraux, par exemple celui sur le budget et la censure, et contester le gouvernement.
De plus, une nouvelle discussion va s'engager sur les retraites et il sera indispensable de construire un front intersyndical et une campagne unitaire du NFP et du mouvement social pour les défendre.
La défense de l'unité de la base au sommet pourrait aussi passer, ce n'est pas à exclure, par la défense d'une candidature unique de la gauche à la présidentielle. En effet, dans le cadre de la Ve République, qui est particulièrement antidémocratique et donne des pouvoirs immenses au président, éviter une victoire de Le Pen pourrait nécessiter une candidature unique à gauche. Mais les jeux sont loin d'être faits. La séquence des élections municipales de 2026 constitue une étape difficile à anticiper pour l'instant : on ne sait pas si la division de la gauche provoquera un nouveau progrès de l'extrême droite, ou si une unité de la gauche sera réalisée et dans quelles conditions et quels rapports de forces.
La place particulière de LFI
Le second niveau découle de l'analyse des différentes organisations de gauche. Il est apparu, ces dernières années, que LFI joue un rôle particulier parmi celles-ci : sa relativement faible intégration dans le cadre des institutions (elle n'a pas de conseiller·e régional·e, et a 6 conseiller·es départementaux, à comparer aux 40 du PCF, qui en a perdu 81 aux dernières élections, et aux 332 du PS, qui en a perdu 622…) induit une position partiellement critique par rapport à l'ordre établi. Sa stratégie électorale est également de s'appuyer sur les quartiers populaires, notamment racisé·es, et elle combat plus frontalement le racisme, l'islamophobie et le RN que les autres forces de gauche. Sur la Palestine, elle a tenu, notamment à l'Assemblée, un discours de solidarité avec le peuple palestinien qui tranchait avec les positions du reste de la gauche (deux député·es ont brandi un drapeau palestinien, d'autres ont dessiné ce drapeau en se positionnant selon la couleur de leurs vêtements). Elle est aussi la force la plus jeune et la plus dynamique du NFP.
Les critiques à formuler vis-à-vis de LFI ne manquent pas, sur son manque de démocratie interne, son sectarisme vis-à-vis des autres forces politiques comme syndicales, ses traditions chauvines, son prisme très étatique et la faiblesse de ses propositions en termes d'incursion dans la propriété privée. De plus, sa volonté de devenir hégémonique à gauche s'accompagne de tendances très sectaires vis-à-vis des autres organisations. Mais il est évident que cette force constitue un immense point d'appui à gauche, sur le plan programmatique et militant.
Construire une gauche unitaire et révolutionnaire
Le troisième niveau est la nécessité de regrouper les forces révolutionnaires unitaires. Dans la séquence qui a duré de la présidentielle 2022 à la chute du gouvernement Barnier, en passant par la grève sur les retraites, les discussions se sont multipliées à gauche. De ces discussions s'est dégagé un pôle composé de différents groupes défendant des orientations générales similaires sur de nombreux points : la nécessité de l'unité de la gauche, de la construction des collectifs NFP à la base, mais aussi d'une orientation indépendante, notamment sur les luttes sociales et l'Ukraine. Des discussions multiples ont eu lieu entre le NPA-A, Ensemble !, la Gauche écosocialiste, le collectif de quartiers « On s'en mêle », le collectif militant Égalités… Ces échanges n'ont pas conduit à la construction d'une nouvelle organisation, notamment en raison des divergences sur comment articuler unité et indépendance, même si les relations restent régulières.
Cependant, l'émergence d'une gauche révolutionnaire unitaire est une nécessité dans la prochaine période. Il est en effet très probable que de nouvelles confrontations sociales de masse aient lieu, dans les luttes sociales et dans les élections. Dans ces chocs, une orientation réellement unitaire, qui ne soit donc pas prisonnière d'intérêts d'appareils, devra être mise en avant, comme devra l'être une orientation dont le centre de gravité se situe dans les luttes sociales extra-parlementaires pour renverser le pouvoir de la bourgeoisie.
Pour y parvenir, il faudra impérativement intervenir dans les luttes, mais aussi dans les débats à gauche, même les plus difficiles. En effet, c'est sur sa capacité de répondre aux questions que l'on se pose dans les classes populaires face aux grands problèmes politiques nationaux qu'une organisation est jugée par les masses, et c'est par la possibilité d'y répondre ensemble que se testent les perspectives de rassemblement militants.
Le 25 février 2025
1. « La tribune des généraux, l'armée et la Cinquième République », Claude Serfati, Contretemps, mai 2021.
2. « Le patronat passe-t-il à l'extrême droite ? », Maxime Combes, Basta, 5 juillet 2024.
3. À raison de deux dates par semaine, il sillonne la France. L'eurodéputé s'est déjà arrêté à Tonneins, Perpignan, Beaucaire, Marseille, Sète, Strasbourg. « À chaque fois, il reste près de six heures et salue près de 1 000 personnes », rapporte-t-on du côté de la maison d'édition.
4. En France, les militant·es de la IVe Internationale militent au NPA-A, au NPA-Révolutionnaires (qui s'est opposé au NFP et a présenté ses propres candidat·es), à la Gauche écosocialiste (courant de La France insoumise, dont un grand nombre de militant·es se font exclure ou l'ont quittée depuis les dernières législatives), à l'Après (organisation créée par les député·es Hendrik Davi, Clémentine Autain, Alexis Corbière après leur exclusion de La France insoumise avec François Ruffin et Raquel Garrido) et à Ensemble !.
5. Cette discussion s'est étendue entre novembre 2024 – moment où Barnier a été contraint de démissionner suite à l'utilisation de l'article 49-3 de la Constitution, qui a conduit à une censure par les députés de la gauche et du RN – et février 2025, où le nouveau Premier ministre François Bayrou a réussi à faire passer un budget par le 49-3, résistant à la censure grâce aux abstentions du PS et du RN.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Marine Le Pen a été condamnée à l’inéligibilité et ne sera pas candidate à la présidentielle. C’est un coup de tonnerre

Marine Le Pen a donc été condamnée à 4 ans de prison, dont deux ans ferme, aménageables avec un bracelet électronique, 100 000 euros d'amende et une peine d'inéligibilité de 5 ans assortie d'une exécution immédiate. En clair, Marine Le Pen se voit dans l'incapacité de se présenter à la prochaine élection présidentielle.
0N CHERCHE ENCORE
31 mars 2025 | tiré de la Lettre de Regards.fr
C'est donc un jugement sans « laxisme » : les prévenus du procès en détournement de fonds européens ont tous été déclarés coupables, la plupart avec des peines de prison ferme. Les juges ont appliqué la loi votée par les députés en 2016, lesquels ont rendu obligatoire – et non automatique – la peine d'inéligibilité et l'exécution immédiate en cas de détournement de fonds.
Sitôt le verdict tombé, le leader Hongrois Viktor Orban tweete « Je suis Marine », le Kremlin déplore « une violation des normes démocratiques ». Dans le monde entier, l'ultra-droite marque son soutien au RN. Le jugement a un écho national et international.
Avant même le prononcé des peines, Marine Le Pen avait rejoint le siège du parti et son président Jordan Bardella. Les dirigeants du RN vont contester ce jugement, le déclarant partisan. Ils alimenteront la campagne planétaire contre la justice, son autonomie et sa fonction de garant du droit et des institutions.
Ce jugement est un tremblement de terre pour le RN, mais il l'est pour tout l'espace politique. Il est un peu l'équivalent de l'affaire Strauss-Kahn qui redistribua les cartes pour 2012.
Le RN va bien sûr mettre en selle un candidat. Il y a fort à parier que ce sera Jordan Bardella. Mais son très jeune âge (29 ans) et son positionnement à la croisée du RN, de Reconquête et des LR modifient la donne. Bardella a peu convaincu lors des législatives, pas plus qu'il ne s'impose parmi les cadres du RN. Il n'occupe pas exactement le même espace politique que Marine Le Pen. Mis en place pour rallier la bourgeoisie réactionnaire et les électeurs âgés, il devait bloquer Marion Maréchal. Le voilà en première ligne : les équilibres sont modifiés. La force de Marine Le Pen était du côté des catégories populaires, les plus nombreuses. Avec un tout autre profil, Bardella ne part pas avec les mêmes chances de victoire. Malgré une cote de popularité équivalente à celle de Marine Le Pen, son élection est loin d'être aussi crédible.
Bien des prétendants à l'Élysée vont se sentir rassérénés. Chassant sur les mêmes terres, Retailleau et Zemmour vont disputer la place au jeune homme au nom de l'expérience. Sur cette base, l'alliance du « bloc central » va en prendre un coup. La lutte entre Philippe et Retailleau prend corps.
À gauche, ceux qui ne veulent pas d'une candidature de rassemblement vont y trouver arguments. La droite divisée, la crédibilité de Bardella incertaine, le niveau à atteindre pour accéder au second tour s'abaisse et la perspective de victoire paraît moins bouchée. Jean-Luc Mélenchon en tirera argument. Raphaël Glucksmann aussi. Les forces d'entropie à gauche vont pouvoir se libérer. Audacieux et dangereux calculs : Marine Le Pen sort du jeu alors que l'extrême droite est en ascension, en Amérique comme partout en Europe. En France, ils sont nombreux à pouvoir et vouloir reprendre ces idées, au-delà du RN.
Catherine Tricot
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

J. D. Vance, l’arrogant vice-président qui gêne de Washington au Groenland

Éconduit au Groenland et pris en faute sur Signal, le vice-président de Donald Trump enchaîne les moments embarrassants, souligne “The Observer”. S'il avait plus de décence, il envisagerait de démissionner, juge ce titre britannique de gauche.
Tiré de Courrier international. Éditorial du médias britannique The Observer sur le site de The Guardian.
Le vice-président américain, J. D. Vance, dont on commence à connaître la brusquerie, vient de se ridiculiser publiquement, et ce n'est pas une première. Il a fallu qu'il se rende au Groenland [le 28 mars], au mépris des dirigeants du territoire arctique et du gouvernement danois, qui martelaient qu'il n'était pas invité et qu'il n'était pas le bienvenu. Vance a ainsi été cantonné à la visite d'une base militaire perdue dans l'immensité glacée, où il n'a pu s'exprimer que devant des Américains. Il entendait se rendre sur d'autres sites du territoire danois et parler aux Groenlandais, mais ses projets ont été annulés – les Groenlandais, eux, ne voulaient pas lui parler.
Une hostilité parfaitement compréhensible étant donné les déclarations provocatrices, irrespectueuses et répétées du patron de Vance, Donald Trump, sur la volonté des États-Unis d'annexer le Groenland, si nécessaire par la force et en toute illégalité. Le Groenland est un territoire semi-autonome qui fait partie du royaume du Danemark. Les élections qui s'y sont tenues mi-mars ont montré que les Groenlandais dans leur grande majorité sont favorables à un approfondissement de l'autonomie ou à l'indépendance – ils n'ont aucune envie d'être américains.
Digne de Poutine
De ce projet digne de Poutine, puisqu'il s'agit de s'emparer d'un territoire souverain, Vance a tenté une piètre justification et clamé que le Danemark avait manqué à ses obligations en ne protégeant pas le Groenland des menaces chinoise et russe – ce dont il n'a pas avancé la moindre preuve. Le vice-président américain n'a pas non plus expliqué pourquoi, si de tels dangers existent bien, les États-Unis, membres de l'Otan aux côtés du Danemark, n'honorent pas l'obligation qui leur revient d'accroître “leur capacité […] collective de résistance à une attaque armée” [article 3 du traité de l'Atlantique Nord] en vertu de l'accord américano-danois de 1951 sur la défense du Groenland.
On a beaucoup entendu Trump, aussi, pérorer sur l'importance du Groenland pour la “paix dans le monde”. Il est vrai que l'Arctique est la cible d'une compétition internationale accrue, notamment en raison du changement climatique qui rend la région plus accessible. Mais dans un autre écho à ce que vit l'Ukraine, Trump cherche surtout, manifestement, à mettre la main sur les richesses minières inexploitées du Groenland. Comme à Gaza ou au Panama, sa préoccupation principale n'est ni la sécurité ni la justice, mais des intérêts géopolitiques, financiers et commerciaux. Avec ses intentions insultantes de faire du Canada le 51e État des États-Unis, Trump affiche aussi une autre volonté : relancer son pays dans un expansionnisme territorial agressif d'un autre temps.
Au Groenland, Vance avait certes préféré le bonnet de laine au casque colonial, mais il portait ses menées impérialistes en étendard. Malgré l'accueil glacial qui lui a été réservé, sans doute était-il content de pouvoir s'échapper de Washington, où lui et son compagnon de voyage arctique, le conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz, étaient sous le feu des critiques après une autre énormité : l'affaire des fuites du groupe de discussion Signal. Un journaliste de premier plan s'était retrouvé inclus par erreur dans une boucle où Vance, Waltz et d'autres hauts responsables échangeaient en temps réel sur les bombardements menés contre les rebelles houthistes au Yémen.
“Immense hypocrisie”
Cette faille de sécurité est, en soi, gravissime. Mais le contenu de ces discussions, publiées in extenso, a aussi révélé des remarques insultantes, de la part de Vance et du ministre de la Défense, Pete Hegseth, à l'égard des alliés européens. Ces propos stupides et humiliants sont une illustration spectaculaire et particulièrement néfaste de la rapide détérioration des liens transatlantiques depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche.
Comme le séjour indésirable de Vance au Groenland, les réactions officielles au scandale de la fuite Signal en disent long sur la nature profonde du gouvernement Trump. Le premier et vil élan du président a consisté à nier toute responsabilité, à minimiser la gravité des faits, à dénigrer le journaliste et même à clamer que toute l'affaire n'était qu'un canular. De leur côté, Waltz, Vance et Hegseth font preuve d'une immense hypocrisie en se refusant à ne serait-ce qu'envisager la démission, après une bourde qui aurait valu à tout responsable de moins haut rang d'être viré sans ménagement.
Les deux épisodes sont révélateurs d'un orgueil, d'une arrogance, d'une incompétence et d'une irresponsabilité proprement sidérants – et sont pour le monde autant d'avertissements qui font froid dans le dos.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
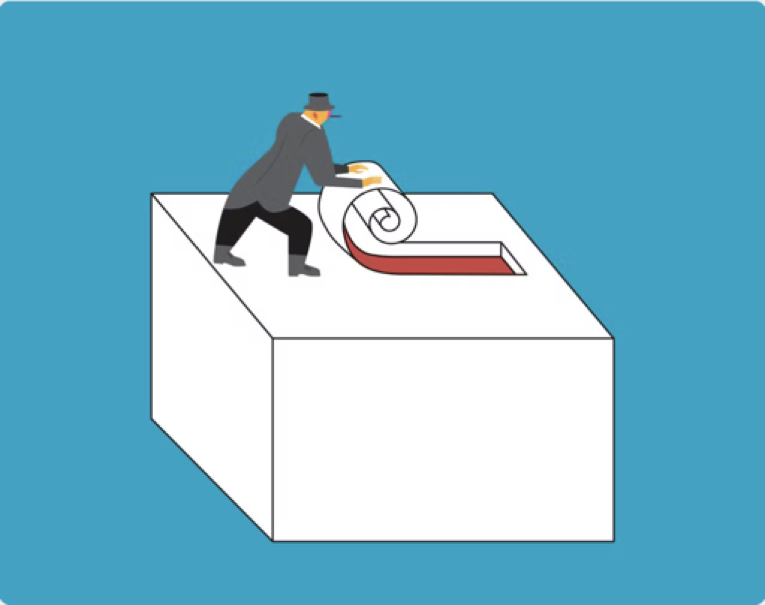
En Roumanie, malgré l’exclusion de Calin Georgescu, l’esprit de revanche n’a pas disparu
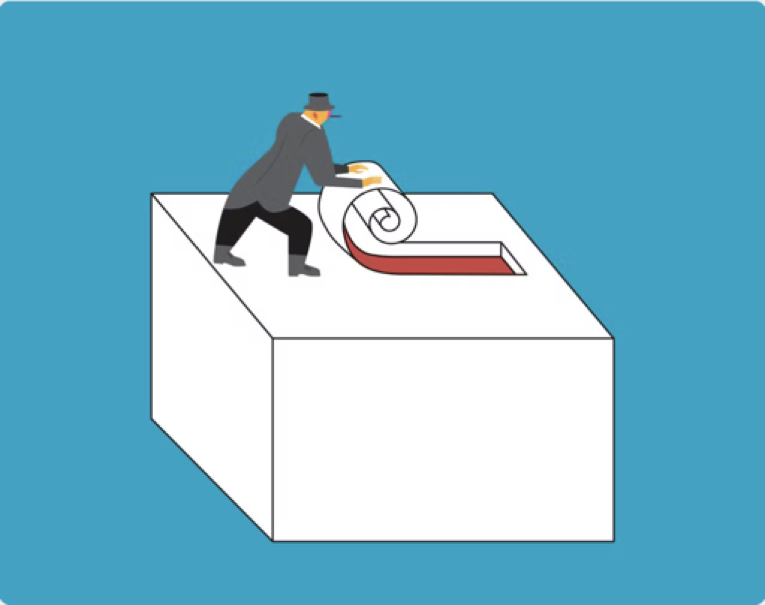
Le candidat d'extrême droite a été écarté avec la double décision de la Cour constitutionnelle et de la Commission électorale. Mais dans le quotidien “Libertatea”, l'écrivain Vasile Ernu craint que le pays ne soit proche de l'implosion : la population est déjà radicalisée et polarisée.
Tiré de Courrier international. Dessin d'Ajubel paru dans El Mundo, Madrid.
Mais pourquoi les Roumains sont-ils toujours mécontents ? Espérons que nous ne perdrons pas la tête d'ici à la présidentielle de mai 2025. La confiance dans les institutions de l'État est à un minimum historique, tout ce qui émane des autorités est remis en question. La plupart des décisions et le cirque des mandats d'arrêt paraissent également douteux et parfois ridicules. Or les décisions importantes à ce niveau devraient être expliquées de telle manière que même les commères du marché puissent les comprendre. Sous peine d'obtenir la réaction inverse à celle souhaitée.
La presse et les ONG suscitent tout autant la méfiance. Même les institutions européennes n'ont plus le soutien sans faille de la population. Pourquoi ? Les dernières décisions politiques ont détruit le peu de confiance qui restait. Ce n'est pas Calin Georgescu, le problème, mais les causes qui ont engendré le “phénomène Georgescu”. Est-ce que ce ne sont pas les décisions des grands partis et des institutions de l'État qui ont fait grimper ses chiffres de 10 % à 40 % lors de l'élection annulée de 2024 ?*
Pourquoi les gens votent comme ils votent ? L'électorat n'a pas le cerveau si “lavé” qu'on le croit, il a le droit de voter comme bon lui semble.
En fait, de quoi est composé l'électorat du “phénomène Georgescu” ? Et surtout, quelles sont les causes qui lui ont donné naissance ? Parce qu'il est beaucoup plus diversifié qu'il n'y paraît à première vue : il rassemble des gens abandonnés, des gens non représentés et des gens en colère à cause de toutes sortes de raisons. Certaines causes ont des racines très profondes. Et ces griefs ne peuvent pas être apaisés par des sermons intellectuels et journalistiques moralistes et abstraits.
Vaste électorat endormi mal représenté
Aux yeux de la grande majorité de la population, l'élite de la presse, les ONG, les intellectuels font partie du pouvoir, même s'ils veulent son bien. Il y a certes beaucoup de propagande nocive, mais ce n'est pas elle qui est à la base de la réaction populaire. Par conséquent, la mise à l'écart de Georgescu ne résout pas le problème : elle ne fait que le reporter tout en l'exacerbant. Nous sommes entrés dans une ère de politique revancharde – et cela n'est pas de bon augure. Or nous parlons là de près de la moitié de l'électorat de ce pays – je crains même que ce ne soit encore plus. Quelles sont les raisons fondamentales de sa colère ?
Si je devais énumérer les principales causes, elles seraient les suivantes : une trop grande partie de la population s'estime perdante. Cette impression d'abandon politique, social et économique remonte aux années 1990. Et, au fil du temps, ce sentiment s'est amplifié. D'où un désir de vengeance contre ceux que cette portion de l'électorat considère comme les responsables et les coupables : l'élite politique officielle. Il existe aussi un vaste électorat endormi qui se sent lui aussi mal représenté. Après être resté passif pendant des années, en partant du principe que personne ne se souciait de ses aspirations, il votera pour le premier candidat excentrique qui fera mine de s'intéresser à lui.
Un prix trop élevé
Plus généralement, un public assez large, affecté sur le plan social et économique, attribue la grande injustice des inégalités sociales à l'establishment politique. Les causes économiques jouent un rôle essentiel dans cette affaire. À cela s'ajoute un public instruit, qui dispose de moyens financiers relatifs, mais qui est indigné : il a le sentiment d'avoir trop longtemps payé un prix trop élevé pour ce qu'il a obtenu en retour. Et lui aussi tient à avoir sa revanche. Enfin, il y a un jeune public très insatisfait. La plupart de ces facteurs sont liés à des causes économiques : la misère, la mauvaise répartition des richesses, les inégalités, trop de gens qui ont trop peu.
Pour être dignes, les gens ont besoin d'une position sociale, économique et politique minimale : ils veulent être respectés. Un tant soit peu. Et attention, à tout cela viennent encore s'ajouter la crise pandémique et la guerre en Ukraine. Les gens n'ont pas oublié la période du Covid, au cours de laquelle le pouvoir, la presse, les ONG et les élites ont montré un visage plutôt sans merci – que les gens ont vu comme une force autoritaire, injuste et abusive.
Quant à la guerre, elle est perçue avec une grande crainte, et la tendance est d'adhérer au “parti de la paix” et non à celui de l'armement. Cela peut se vérifier par les chiffres des sondages. On retrouve la même tendance dans toute l'Europe. Et, ultime facteur, les États-Unis, avec leur nouvelle politique, laquelle est très proche de ce tournant conservateur. Tout cela ne peut que laisser des traces. Mais alors, que faire ? Je dirais qu'il faut commencer par nous attaquer aux causes.
L'extrême droite toujours favorite (Courrier international)
Le Bureau électoral central (BEC) de Bucarest a rejeté le 9 mars la candidature à la présidentielle de mai prochain du candidat souverainiste Calin Georgescu. Arrivé en tête du premier tour de l'élection de novembre, finalement annulée, Georgescu, maintenu en résidence surveillée, fait l'objet d'une enquête du parquet pour avoir créé une organisation aux “caractéristiques fascistes, racistes ou xénophobes”. Il serait également soupçonné d'une tentative d'“incitation à des actions contre l'ordre constitutionnel”. Plusieurs dizaines de personnes et associations proches de Georgescu sont aussi sous le coup d'une enquête.
Malgré l'exclusion du candidat, accusé de sympathies prorusses, l'extrême droite a toujours le vent en poupe. Selon un sondage effectué le 22 mars, cité par Romania libera, parmi les onze candidats validés, George Simion, le dirigeant de l'Alliance pour l'unité des Roumains (AUR), un autre parti d'extrême droite, est donné comme favori, devant Crin Antonescu, le candidat de la coalition centriste au pouvoir. Simion, qui soutenait la candidature de Georgescu fin 2024, a d'ailleurs qualifié la décision du BEC de “nouvel épisode du coup d'État de décembre 2024”, en référence à l'annulation de la présidentielle, relaie Romania libera.
* Selon le site d'enquête Snoop en janvier, l'Agence nationale de l'administration fiscale a découvert que les libéraux au pouvoir avaient financé une campagne de promotion massive de Georgescu sur TikTok, dans le but de contrer l'Alliance pour l'unité des Roumains (AUR), un autre parti d'extrême droite.
L'auteur Vasile Ernu
Écrivain, analyste politique et éditeur roumain, Vasile Ernu est né en 1971 dans ce qui était alors la République socialiste soviétique d'Ukraine. Il a vécu à Odessa puis à Chisinau, aujourd'hui la capitale de la Moldavie, avant de s'installer à Bucarest en 1990. Son premier livre, Nascut in URSS (“Né en URSS”), une œuvre autobiographique dans laquelle il raconte ses expériences en Union soviétique, a été traduit en plusieurs langues, mais reste inédit en français.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les nouvelles attaques LGBTIphobes d’Orbán

Le 16 mars dernier, le parlement hongrois, dominé par le parti de Viktor Orbán, a voté un amendement interdisant la tenue de la Marche des Fiertés de Budapest.
Hebdo L'Anticapitaliste - 747 (27/03/2025)
Par Hor et Manue Mallet
Déjà, en 2021, sous prétexte de « protection de l'enfance », toute propagande de l'homosexualité (qui peut être le fait de se tenir la main pour un couple, ou d'avoir une « allure » identifiée comme queer) a été interdite et punie de 500 euros d'amende.
LGBTI cibléEs, Orbán vacille
La Hongrie était le pays le plus libéral de la région et avait dépénalisé l'homosexualité en 1961. Aujourd'hui, renforcés par l'élection de Trump, les fascistes du gouvernement attaquent frontalement la communauté LGBTI pour s'en servir de « bouc émissaire » afin de voiler un système oligarchique et népotique ultra-corrompu.
Le parti Momentum, seul parti démocratique d'opposition qui défend le droit des LGBTI, a été chassé du Parlement et puni de 10 millions de florins d'amendes.
Orbán est menacé par un score secondaire aux élections de 2026, son gouvernement n'ayant ni enrayé la crise ni relancé le pouvoir d'achat, et tente par tous les moyens d'éliminer ses adversaires.
Selon des militantes, interviewées à Paris le dimanche 23 mars lors d'un rassemblement de solidarité en défense de la Pride et de la liberté de réunion en Hongrie, le seul moyen de faire tomber Orbán lors des élections est de manifester (1).
La communauté LGBTI ne désarme pas et s'organise pour résister et tenir la Belgrade Pride le 28 juin. Les diasporas LGBTI hongroises d'Europe appellent les eurodéputéEs à s'y rendre, ainsi que les organisations communautaires ou des droits humains comme Amnesty International. Le Conseil de Paris a promis un vœu pour que la ville soutienne les militantEs LGBTI hongroisEs.
Antifascistes extradéEs, Macron complice
Nous avons pu noter l'hypocrisie de Macron, qui devant le Parlement européen a dit apporter son soutien aux LGBTI menacéEs et en France fait arrêter, par sa police antiterroriste, un militant antifasciste condamné par contumace en Hongrie (2), menacé d'extradition et qui risque plus de 15 ans de prison.
C'est également ce qui est arrivé à Maja, militante antifasciste non binaire, extradéE par les autorités allemandes (3). Lors de son audience devant le tribunal de Budapest le 21 février, iel a rejeté l'accord qui lui était proposé et a dénoncé les violations du droit européen par la Hongrie ainsi que les conditions inhumaines qu'iel vit depuis plus de huit mois en prison. Iel est réveilléE la nuit, sa chambre est infectée de cafards et de punaises de lit, sans parler du manque d'intimité dans la prison. L'État hongrois lui reproche la même chose qu'à Gino : être antifasciste. Contre le fascisme, il y a urgence à une riposte internationale.
Hor et Manue Mallet
1. Cecilia F. et Dora, étudiantes et militantes pour la Pride de Budapest.
2. https://blogs.mediapart…
3. https://blogs.mediapart…-
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le soutien internationaliste à l’Ukraine qui résiste : une urgence antifasciste

La fin des renseignements militaires fournis par les USA à l'armée ukrainienne et le blocage temporaire des livraisons d'armes ont eu pour conséquences immédiates une poussée décisive russe dans la région de Koursk, une multiplication de bombardements mortels sur les infrastructures civiles partout en Ukraine et un regain d'assurance côté russe, les incitant à pousser leur avantage toujours plus loin.
25 mars 2025 | tiré d'Europe solidaires sans frontières
https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article74182
En reprenant les éléments de langage du Kremlin, Trump a par ailleurs opéré un renversement de sens majeur : c'est l'agresseur russe qui serait une victime, c'est aussi lui qui serait le plus fervent soutien de la paix. Ce cadeau offert sur un plateau à son camarade « incompris » Vladimir, doit néanmoins s'inscrire en retour dans l'agenda médiatique de Trump : une proposition de cessez-le-feu de 30 jours, acceptée par les UkrainienNEs, comme une preuve supplémentaire du génie de Trump pour obtenir rapidement de bons deals.
La paix selon Poutine : écraser l'Ukraine libre et indépendante
La réponse tardive de Poutine a été particulièrement évasive, laissant entendre qu'il y avait besoin de plus de discussions avec son partenaire américain. Ainsi le cessez-le-feu n'est-il plus un préalable à une négociation, mais l'occasion pour Moscou de poser des prérequis maximalistes conditionnant tout cessez-le-feu. Voici, d'après le Washington Post, les conditions imposées par Poutine : la reconnaisse formelle par l'Ukraine de la souveraineté russe non seulement sur la Crimée mais aussi sur les quatre régions partiellement occupées par l'armée russe (de 20 % de territoires actuellement occupés par l'armée russe, on passerait à 30 % du territoire ukrainien…) ; l'éviction de Zelensky par de nouvelles élections, accompagnée de l'obligation pour Kiev de renoncer à son adhésion à l'Otan et l'arrêt immédiat de l'aide militaire occidentale à l'Ukraine ; l'interdiction de déployer des forces européennes de maintien de la paix en Ukraine et la réduction drastique des effectifs de l'armée ukrainienne, d'environ un million de soldats à quelques dizaines de milliers.
C'est bel et bien une façon de préparer la voie pour d'autres invasions à venir. La paix pour Poutine consiste à en finir de façon pure et simple avec une Ukraine libre et indépendante.
Soutien concret à l'Ukraine
Il y a plus que jamais urgence à soutenir politiquement — et, c'est indissociable, militairement — la résistance ukrainienne. Plutôt que les plans de réarmement nationaux promus par les gouvernements européens, passant la transition écologique et les droits sociaux à la trappe, c'est d'un soutien concret qu'a besoin l'Ukraine pour continuer de résister : investissements immédiats dans les industries ukrainiennes qui manquent cruellement de ressources, fourniture de la production militaire en lieu et place des exportations massives aux dictatures des pays du Golfe, annulation de la dette ukrainienne et saisie des 200 milliards d'avoirs russes qui reviennent légitimement aux UkrainienNEs.
Les réponses nationalistes de la gauche
S'il y a peu d'espoirs de voir cette politique internationaliste appliquée par des gouvernements libéraux et conservateurs, on devrait s'attendre à autre chose de la propagande de la gauche radicale européenne. On la trouve en pratique dans la gauche finlandaise, polonaise ou encore danoise. Mais au cœur de l'impérialisme occidental, comme en France, ce sont les réponses nationalistes, marquées par le mépris pour les UkrainienNEs et les peuples d'Europe de l'Est, qui prédominent dans la gauche dite radicale. La défense de « l'agriculture française », des « intérêts des Français » ou des « relations historiques avec la Russie » est un crachat aux principes cardinaux de l'internationalisme ouvrier.
C'est aussi une façon de préparer les défaites de demain. La dynamique du néofascisme international est inextricablement liée à celles du néofascisme français. On ne peut combattre l'un sans combattre l'autre. Les UkrainienNEs sont en première ligne face à la violence néofasciste ; mettre en contradiction les intérêts des UkrainienNEs et les intérêts des travailleurEs français est une erreur historique aux potentielles conséquences dramatiques.
Elias Vola et Gin Vola
P.-S.
• Hebdo L'Anticapitaliste - 746 (20/03/2025). Publié le Jeudi 20 mars 2025 à 18h00 :
https://lanticapitaliste.org/actualite/politique/le-soutien-internationaliste-lukraine-qui-resiste-une-urgence-antifasciste
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Lettre posthume du journaliste Palestinien Hossam Shabat

Nous republions la lettre d'Hossam Shabat, un journaliste palestinien qui a été assassiné le 24 mars dernier, ainsi que son collègue Mohammed Mansour. Hossam a été ciblé dans sa voiture. Selon le syndicat des journalistes palestiniens, 206 journalistes palestiniens ont été assassinés à Gaza depuis octobre 2023.
Tiré d'Agence médias Palestine.
Si vous lisez ceci, cela signifie que j'ai été tué – très probablement ciblé – par les forces d'occupation israéliennes.
Quand tout cela a commencé, j'avais seulement 21 ans, j'étais un étudiant avec des rêves comme tout le monde.
Au cours des dix-huit derniers mois, j'ai consacré chaque instant de ma vie à mon peuple, documentant les horreurs dans le nord de Gaza minute par minute, déterminé à montrer au monde la vérité qu'ils ont essayé d'enterrer.
J'ai dormi sur les trottoirs, dans les écoles, dans des tentes – partout où je pouvais. Chaque jour était un combat pour la survie. J'ai enduré la faim pendant des mois, mais je n'ai jamais quitté mon peuple.
Par Dieu, j'ai fait mon devoir de journaliste. J'ai tout risqué pour dire la vérité, et maintenant je me repose enfin – quelque chose que je n'ai pas connu au cours des dix-huit derniers mois.
J'ai fait tout cela par conviction en la cause palestinienne. Je crois que cette terre est à nous et ce fut le plus grand honneur de ma vie de mourir pour la défendre, elle et son service familial.
Je vous le demande maintenant : n'arrêtez pas de parler de Gaza, ne laissez pas le monde détourner le regard d'elle, et continuez la lutte et continuez à raconter nos histoires jusqu'à ce que la Palestine soit libre.
Pour la dernière fois,
Hossam Shabat, du nord de Gaza.
Source : Twitter d' Hossam Shabat
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Turquie : la contagion néofasciste

La bataille en cours en Turquie est devenue de plus en plus importante pour le monde entier. Si le mouvement populaire turc gagne, sa victoire aura un impact important sur la galvanisation de la résistance à la montée du néofascisme dans le monde.
Gilbert Achcar
Professeur émérite, SOAS, Université de Londres
Abonné·e de Mediapart
Ce blog est personnel, la rédaction n'est pas à l'origine de ses contenus.
https://blogs.mediapart.fr/gilbert-achcar/blog/260325/turquie-la-contagion-neofasciste
Les événements qui se déroulent en Turquie depuis mercredi dernier sont extrêmement graves : ils constituent une nouvelle étape très dangereuse dans le glissement du pays vers l'étranglement de la démocratie. L'arrestation d'Ekrem Imamoglu – le populaire maire d'Istanbul et candidat de son parti, le Parti républicain du peuple (CHP), à la prochaine élection présidentielle prévue en 2028 – et l'arrestation de près de 100 de ses collaborateurs dans la municipalité de la plus grande ville de Turquie, en vertu d'accusations qui combinent corruption (la justice turque aurait mieux fait d'enquêter sur la corruption dans l'entourage d'Erdogan, à commencer par son gendre) et liens avec le « terrorisme », c'est-à-dire contacts avec le Parti des travailleurs du Kurdistan-PKK (au moment où le gouvernement négocie avec ce parti en vue d'un règlement pacifique), est un comportement tout droit sorti du manuel bien connu des dictatures.
Si quelqu'un doutait que les accusations aient été fabriquées de toutes pièces et que l'intention était d'éliminer la figure la plus forte de l'opposition au régime de Recep Tayyip Erdogan, qui semble déterminé à diriger son pays à vie comme d'autres dirigeants autocratiques, la décision de l'Université d'Istanbul d'invalider le diplôme d'Imamoglu à la veille de son arrestation ne laisse aucune place au doute. Un diplôme universitaire est l'une des conditions requises pour se présenter à la présidence de la Turquie, et la décision de l'université se fonde sur un prétexte complètement fallacieux, d'autant plus qu'Imamoglu a obtenu son diplôme il y a trente ans !
Il y a près d'un an, au lendemain des dernières élections municipales en Turquie, j'ai rappelé le rôle d'Erdogan dans l'établissement de la démocratie dans son pays au cours de la première décennie de son règne. En dépit de sa dérive autocratique ultérieure, y compris par le limogeage de dirigeants de son propre parti perçus comme des rivaux, j'ai loué sa reconnaissance de la défaite de son parti aux municipales, qui le distinguait de nombre de néofascistes qui refusent d'accepter la défaite, y compris Donald Trump qui avait tenté de renverser le processus électoral de l'automne 2020, et refuse toujours de reconnaître sa défaite, affirmant que la présidence lui a été volée » (« Deux leçons précieuses des élections turques », 2 avril 2024 – en arabe uniquement).
La morale de cette histoire est que le même homme qui a commencé sa carrière politique par une lutte courageuse contre un régime dictatorial, et a subi pendant son mandat de maire d'Istanbul ce qui ressemble beaucoup à ce qu'il inflige maintenant à son adversaire, le maire actuel – cet homme, qui a joué un rôle louable dans l'établissement de la démocratie dans son pays, a été conduit par l'ivresse du pouvoir et la jouissance d'une grande popularité, à vouloir perpétuer cette condition, même en l'imposant par la force aux dépens de la démocratie.
Et pourtant, jusqu'à l'année dernière, Erdogan n'avait pas franchi la ligne rouge qualitative qui sépare la préservation d'une marge de liberté permettant à la démocratie de survivre, bien qu'avec de plus en plus de difficulté, et l'empiétement sur cette marge de manière dictatoriale.
C'était en dépit du fait qu'Erdogan présente certaines caractéristiques néofascistes, en s'appuyant sur une « mobilisation agressive et militante de [sa] base populaire » sur un terrain idéologique qui intègre certains des éléments clés de l'idéologie d'extrême droite, y compris le fanatisme nationaliste et ethnique contre les Kurdes (en particulier), le sexisme et l'hostilité, au nom de la religion ou autrement, à diverses valeurs libérales (voir « L'ère du néofascisme et ses particularités », 5 février 2025).
Sa dérive actuelle suggère qu'il rejoint désormais les rangs des régimes néofascistes quant à leur attitude à l'égard de la démocratie. Dans l'article susmentionné, j'ai décrit cette attitude comme suit : « Le néofascisme prétend respecter les règles fondamentales de la démocratie au lieu d'établir une dictature pure et simple comme l'a fait son prédécesseur, même lorsqu'il vide la démocratie de son contenu en érodant les libertés politiques réelles à des degrés divers, selon le niveau de popularité réel de chaque dirigeant néofasciste (et donc de son besoin ou non de truquer les élections) et du rapport des forces entre lui et ses adversaires. »
Il y a deux facteurs principaux derrière la dérive d'Erdogan vers le néofascisme. Le premier est que la tentation néofasciste augmente chaque fois qu'un dirigeant autoritaire fait face à une opposition croissante et craint de perdre le pouvoir par le biais de la démocratie.
Vladimir Poutine en fournit un exemple dans la mesure où sa dérive s'est intensifiée lorsqu'il a fait face à une opposition populaire croissante lors de son retour à la présidence en 2012 (après une mascarade consistant à passer au poste de Premier ministre, conformément à la constitution, qui à l'époque interdisait plus de deux mandats présidentiels consécutifs). En même temps, Poutine a eu recours à l'incitation du sentiment nationaliste à l'égard de l'Ukraine (en particulier), tout comme Erdogan l'a fait plus tard à l'égard des Kurdes.
Le deuxième facteur, crucial, est l'arrivée du néofascisme au pouvoir aux États-Unis, représenté par Donald Trump. Cela a donné une puissante impulsion au renforcement de diverses formes de néofascisme réel ou latent, comme nous le voyons clairement en Israël, Hongrie et Serbie, par exemple, et comme nous le verrons de plus en plus à l'échelle mondiale.
La force de la contagion néofasciste est proportionnelle à la force du principal pôle néofasciste : la contagion fasciste s'est considérablement renforcée, en particulier sur le continent européen, lorsque la puissance de l'Allemagne nazie s'est accrue dans les années 1930. La contagion néofasciste est devenue encore plus forte aujourd'hui, les États-Unis passant d'un rôle de dissuasion contre l'érosion de la démocratie, bien que dans des limites évidentes, à l'encouragement de cette érosion, directement ou indirectement. L'érosion est déjà en cours et s'accélère aux États-Unis mêmes.
Ce n'est donc pas une coïncidence si l'offensive d'Erdogan contre l'opposition a commencé à la suite d'un appel téléphonique entre lui et Trump, que Steve Witkoff, ami proche du président américain et son envoyé à diverses négociations, a qualifié vendredi dernier d'« excellent » et de « vraiment transformateur ». Witkoff a ajouté que « le président [Trump] a une relation avec Erdogan et cela va être important. Et il y a du bon à venir – juste beaucoup de bonnes nouvelles positives en provenance de Turquie en ce moment à la suite de cet appel. Je pense donc que vous le verrez dans les reportages dans les prochains jours. » (La déclaration de Witkoff a été faite deux jours après l'arrestation d'Imamoglu, même s'il ne faisait pas nécessairement référence à cette arrestation.)
En outre, Erdogan croyait avoir réussi à neutraliser le mouvement kurde grâce à de récents compromis, bénis par ses alliés de l'extrême droite nationaliste turque eux-mêmes (il s'est trompé : le mouvement kurde soutient l'opposition et la protestation populaire). Il croit également que les Européens ont besoin de lui, et de son potentiel militaire en particulier, en ce moment critique pour eux, de sorte qu'ils n'exerceront aucune pression réelle sur lui.
Ce qui reste une source d'espoir dans le cas turc, c'est qu'Erdogan est confronté à une réaction populaire bien au-delà de ce qu'il avait apparemment anticipé. Cette réaction de masse est bien plus importante que ce à quoi Poutine a été confronté en Russie, où le mouvement populaire avait été atrophié après des décennies de régime totalitaire. Elle est bien plus grande que ce à quoi la plupart des pionniers du néofascisme ont été confrontés, y compris Trump, qui n'a rencontré qu'une très faible opposition de la part du Parti démocrate depuis sa victoire électorale.
Erdogan tente d'écraser le mouvement populaire en intensifiant la répression (le nombre de détenus approche les 1500 dans un pays qui compte 400 000 prisonniers, dont un pourcentage élevé de prisonniers politiques et de nombreux journalistes) au détriment de la sécurité, de la stabilité et de l'économie turques (la Banque centrale a été contrainte de dépenser 14 milliards de dollars pour éviter un effondrement complet de la livre turque et le marché boursier a connu une forte baisse).
La bataille en cours en Turquie est devenue de plus en plus importante pour le monde entier. Soit Erdogan réussit à éliminer l'opposition, ce qui pourrait nécessiter une répression sanglante similaire à la répression du soulèvement populaire syrien par Bachar el-Assad en 2011, risquant ainsi de faire glisser le pays dans la guerre civile, soit le mouvement populaire l'emporte, le faisant reculer ou tomber d'une manière ou d'une autre. Si le mouvement populaire turc gagne, sa victoire aura un impact important sur la galvanisation de la résistance à la montée du néofascisme dans le monde.
Traduit de ma chronique hebdomadaire dans le quotidien de langue arabe, Al-Quds al-Arabi, basé à Londres. Cet article est d'abord paru en ligne le 25 mars. Vous pouvez librement le reproduire en indiquant la source avec le lien correspondant.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.













