Derniers articles

Un journaliste palestinien brûlé vif lors d’une attaque israélienne contre un camp de journalistes à Gaza

La mort du journaliste porte à au moins 210 le nombre total de journalistes tués dans la guerre de Gaza, l'horrible attaque rappelant une frappe aérienne d'octobre.
Tiré d'Agence médias Palestine.
Un journaliste palestinien a été brûlé vif et au moins dix autres personnes ont été blessées lors d'une frappe aérienne israélienne dimanche soir qui visait une tente abritant des journalistes dans le sud de la bande de Gaza.
Des vidéos partagées en ligne montrent le journaliste Hilmi Al-Faqaawi en feu après que la tente dans laquelle il se trouvait à Khan Younis ait été frappée par l'armée israélienne, alors que ses collègues tentaient de le secourir, mais en vain.
Une autre vidéo montre son corps calciné enveloppé dans une couverture et transporté par des personnes.
Neuf autres journalistes et une autre personne ont été blessés et soignés à l'hôpital Nasser, situé à proximité, qui a été la cible d'une frappe aérienne le mois dernier.
L'un des journalistes a été identifié comme étant Ahmed Mansour. Des journalistes et des militants palestiniens ont partagé son image sur les réseaux sociaux et ont déclaré qu'il était toujours dans un état « critique ».
Ces scènes horribles rappellent une frappe aérienne israélienne en octobre dernier, qui a frappé un campement à côté de l'hôpital Al-Aqsa, où des dizaines de civils ont été brûlés vifs.
La mort d'Al-Faqaawi porte à au moins 210 le nombre de journalistes palestiniens tués à Gaza depuis le début de la guerre en octobre 2023.
Le fait de prendre délibérément pour cible des journalistes ou de ne pas faire la distinction entre civils et combattants dans une zone de conflit peut constituer un crime de guerre au regard du droit international humanitaire.
Selon un récent rapport publié par le projet Costs of War de l'Institut Watson pour les affaires internationales et publiques, la guerre à Gaza est le conflit le plus meurtrier jamais connu pour les journalistes. Les conclusions indiquent que plus de journalistes ont été tués dans le territoire palestinien que pendant les deux guerres mondiales, la guerre du Vietnam, les guerres en Yougoslavie et la guerre des États-Unis en Afghanistan réunies.
Israël a repris ses attaques sur Gaza à la mi-mars, après que la guerre se soit largement calmée en janvier grâce à un cessez-le-feu avec le Hamas.
La trêve a vu le Hamas libérer des dizaines de prisonniers israéliens et étrangers en échange de milliers de détenus palestiniens dans les prisons israéliennes.
Plus de 1 330 personnes ont été tuées et près de 3 300 autres blessées depuis la reprise de la guerre. Au total, plus de 50 000 personnes ont été tuées depuis 2023, pour la plupart des civils.
Dimanche soir, le Hamas a déclaré avoir tiré des roquettes sur la ville israélienne d'Ashdod en réponse aux massacres en cours à Gaza. Au moins un projectile aurait atterri, causant des dégâts matériels mais aucune victime.
Traduction : AMP
Source : The New Arab
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Point sur la situation en Cisjordanie occupée le 2 avril 2025

Nos sources : ces informations sont collectées et compilées par une militante anticolonialiste israélienne, et reprises en Israël par des sites contre l'occupation et par des médias palestiniens. En raison des circonstances actuelles, les sources pour ce rapport sont un petit peu plus limitées qu'auparavant, mais les voici : l'Autorité palestinienne de la santé pour la Cisjordanie ; le Croissant Rouge ; l'Office des Nations Unies pour les affaires humanitaires (OCHA) ; WAFA.
Tiré d'Agence médias Palestine.
Toujours en raison des circonstances actuelles, nous peinons à recevoir en temps réel les actualités village par village en Cisjordanie, nous actualiserons donc cet article au fil des informations que nous recevrons de nos correspondant-e-s sur place.
Tués
1. Hamza Muhammad Saeed Khammash, 33 ans, de Naplouse.
2. Omar Zuyoud, 15 ans, de Silat al-Harithiya.
Raids et arrestations
Pendant la nuit, les forces israéliennes ont effectué des raids dans le camp de réfugiés et la ville de Jénine (72e jour consécutif), le camp de réfugiés et la ville de Tulkarem (66e jour consécutif), le camp de réfugiés de Nur Shams (53e jour consécutif), les camps de réfugiés de Sa'ir, Al Shuyukh, Burka, ad-Dhahiriya, Naplouse et Shuafat. Au cours de la journée, ils ont attaqué Anata, Deir Sammit, Kafr Qallil, Issawiya, Bethléem, le camp de réfugiés de Dheisheh, Ramallah, Huwara, Silat al-Harithiya, Azzun, Shuqba et Sanur. Au moins cinq Palestiniens ont été arrêtés.
Camp de réfugiés de Dheisheh
Attaques de l'armée contre les Palestiniens
1. Sa'ir, au nord d'Hébron – raid nocturne. Dommages causés à un véhicule militaire.
2. Al Shuyukh, au nord d'Hébron – raid nocturne. Arrestations.
3. Camp de réfugiés et ville de Tulkarem, camp de réfugiés de Nur Shams – raid nocturne. Pendant la journée, déploiement des forces, affrontements, grenades assourdissantes. Les familles sont empêchées de rentrer chez elles. Un homme de 54 ans est blessé et hospitalisé.
Bilan des victimes dans les camps de réfugiés de Tulkarem et de Nur Shams depuis le début de l'opération il y a 66 jours :
– 13 personnes tuées, dont un enfant et deux femmes, dont une enceinte de huit mois ;
– plus de 4 000 familles déplacées, plus des dizaines de personnes du quartier nord de Tulkarem ;
‣ 396 maisons totalement détruites, 2 573 autres maisons touchées et inhabitables ;
‣ Entrée des camps de réfugiés bloquée par des digues de terre.
4. Camp de réfugiés et ville de Jénine – les bulldozers continuent de détruire les structures et les infrastructures. Affrontements, gaz lacrymogènes. Bilan depuis le début de l'opération
il y a 72 jours :
‣ 36 personnes tuées ;
‣ Plus de 600 maisons totalement détruites, 3 250 autres maisons touchées et inhabitables ;
‣ Des centaines de personnes arrêtées ;
‣ Plus de 21 000 personnes déplacées.
5. Naplouse. Raid qui a commencé la nuit dans la vieille ville. Véhicules endommagés. Tirs à balles réelles, une personne blessée, morte d'une hémorragie en raison du blocage de l'aide médicale. En outre, une autre personne a été blessée par un véhicule militaire qui l'a renversée.
6. Camp de réfugiés de Dheisheh – déploiement des forces autour de l'entrée du camp. Raid à l'intérieur du camp. Forces auxiliaires, affrontements, tirs à balles réelles et gaz lacrymogènes.
Deux garçons blessés après avoir été violemment battus par des soldats. Trois journalistes agressés, le portefeuille de l'un d'entre eux a été volé, le téléphone portable d'un autre a été cassé. Vandalisme et destruction de biens. Détention et interrogatoires au sol. Arrestations.
7. Silat al-Harithiya, à l'ouest de Jénine – affrontements. Tirs à balles réelles, un mort. Charges explosives activées contre les blindés de l'armée. Quatre Palestiniens blessés.
8. Anata, au nord-ouest de Jérusalem – démolitions le matin, raid le soir.
9. Shuqba, à l'ouest de Ramallah – raid. Fermeture des magasins ordonnée.
10. Sanur, au sud de Jénine – raid et affrontements. Tirs de gaz lacrymogènes.
Attaques palestiniennes contre l'armée
1. Silat al-Harithiya, à l'ouest de Jénine – plusieurs charges explosives activées contre des véhicules militaires blindés.
2. Tubas – Les forces de sécurité de l'Autorité palestinienne ont exposé et fait exploser une charge explosive dans des conditions contrôlées.
Démolitions, confiscations et blocages
1. Anata, au nord-est de Jérusalem – Maison et camp agricole détruits. Tirs à balles réelles sur un journaliste qui couvrait l'événement. Le journaliste s'est échappé, sa voiture a été endommagée.
2. Kafr Qallil, au sud-est de Naplouse – Ordonnances de démolition émises pour plusieurs structures.
3. Issawiya, Jérusalem – démolition de cabanes et d'une grotte près de la Colline française.
4. Huwara, au sud de Naplouse – confiscation de voitures.
Attaques de colons contre des Palestiniens
1. Mosquée Al-Aqsa, Jérusalem – Itamar Ben Gvir, ministre israélien de la Sécurité intérieure, arrive au Mont du Temple et fait le tour de l'enceinte d'Al-Aqsa.
2. À Salfit, les colons poursuivent les travaux sur deux routes menant à des avant-postes à l'ouest de la ville. Des drapeaux israéliens sont suspendus au-dessus d'une maison et menacent le propriétaire de ne pas oser les retirer.
3. À Dura, au sud-ouest d'Hébron, les colons travaillent sur une route menant à un avant-poste sur des terres palestiniennes privées.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Point sur la situation à Gaza le 2 avril 2025

Nos sources : ces informations sont collectées et compilées par une militante anticolonialiste israélienne, et reprises en Israël par des sites contre l'occupation et par des médias palestiniens. En raison des circonstances actuelles, les sources pour ce rapport sont un petit peu plus limitées qu'auparavant, mais les voici : l'Autorité palestinienne de la santé pour la Cisjordanie ; le Croissant Rouge ; l'Office des Nations Unies pour les affaires humanitaires (OCHA) ; WAFA.
Tiré d'Agence médias Palestine.
Toujours en raison des circonstances actuelles, nous peinons à recevoir en temps réel les actualités à Gaza, nous actualiserons donc cet article au fil des informations que nous recevrons de nos correspondant-e-s sur place.
Général
– Au cours des dernières 24 heures – 100 personnes tuées et 138 blessées ;
– Depuis le 18 mars 2025 – 1 163 personnes tuées et 2 735 blessées ;
– Depuis le 7 octobre 2023 – 50 523 personnes tuées et 11 776 blessées.
‣ Du lever au coucher du soleil, 77 personnes ont été tuées aujourd'hui dans toute la bande de Gaza.
‣ Les boulangeries de la bande de Gaza ont cessé de fonctionner en raison du manque de carburant et du blocage du passage pour l'importation de farine.
Attaques contre Israël
1. Kissufim – sirènes d'alarme craignant l'entrée de drones.
2. 2 roquettes tirées sur Sderot, interceptées.
Bande de Gaza
1. Camp de réfugiés et ville de Jabalia :
– Attaque aérienne de la clinique de l'UNRWA qui abrite environ 700 personnes déplacées. 22 personnes tuées, dont 16 enfants, et blessées. Le ministère palestinien de la Santé signale des corps non identifiables et des parties de corps.
– Une autre attaque contre le camp dans la soirée.
– Jabalia Al Balad – tirs d'artillerie.
2. Beit Lahia :
‣ Bombardement de la rue Al Manshiya. 2 personnes tuées, plusieurs blessées.
‣ Atatra – bombardement, une personne tuée.
Ville de Gaza
1. Attaque aérienne à l'est de la ville.
2. Shuja'iya – une personne tuée alors qu'elle ramassait du bois de chauffage.
3. Bâtiments résidentiels détruits dans la partie sud de la ville.
Bande centrale
1. Deir al-Balah :
– Attaque aérienne dans la nuit du camp de personnes déplacées à l'ouest.
– Une autre attaque à midi.
– Maison bombardée dans le quartier d'Al Bshara.
– Personnel de la police palestinienne bombardé près de la mosquée Al Nassar dans l'après-midi. Quatre personnes tuées, dont un enfant, et d'autres blessées.
2. Camp de réfugiés de Nuseirat – Des drones attaquent une maison à l'est du camp. Des personnes sont tuées et blessées.
3. Camp de réfugiés d'Al Bureij :
– Des drones attaquent la partie est du camp. 3 personnes tuées, d'autres blessées.
– Tirs d'artillerie, personnes blessées.
4. Al Mughraqa – coups de feu. 2 personnes tuées.
District de Khan Yunis
1. Attaque aérienne dans la nuit à l'est de la ville.
2. Ma'an, à l'est de Khan Yunis – des avions de chasse ont de nouveau bombardé la mosquée indonésienne, qui avait été détruite lors d'une attaque précédente.
3. Maison bombardée près d'un garage dans le centre-ville, 13 personnes tuées, blessées et disparues.
4. Al Fukhari – tirs d'artillerie sur des terres agricoles.
5. Al Salem – un groupe de Palestiniens a été bombardé. Huit personnes ont été tuées, dont un enfant.
6. Abasan Al Jadida – bombardement près de l'école Abu Nuara. Une personne tuée, une autre blessée.
7. Bani Suheila – bombardement du quartier Abu Nasira. Une personne blessée.
District de Rafah
1. Attaques aériennes répétées pendant la nuit.
2. Raid des forces armées sur des véhicules, appuyé par des tirs d'artillerie et d'hélicoptères massifs dans le centre de la ville.
3. Al Mawasi :
– Attaque d'un camp de personnes déplacées, une personne tuée, d'autres blessées ;
– Autre attaque au crépuscule. Une femme tuée, des personnes blessées.
– Mirage, au nord de la ville – bombardement, 2 personnes tuées.
– Khirbet Al Adas, au nord de la ville – attaque aérienne, 2 personnes tuées.
– Al Nassar – tirs d'artillerie. 9 personnes tuées, dont 5 enfants.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

États-Unis - Les attaques contre nous tou·tes

Une attaque sur plusieurs fronts est en cours, non seulement contre les partisans de la libération de la Palestine, mais aussi contre le Premier Amendement et les droits civiques. L'enlèvement de Mahmoud Khalil, l'expulsion péremptoire du Dr Rasha Alawieh du groupe Brown Medicine, la tentative de détention et d'expulsion de Ranjani Srinivasan, étudiante en doctorat à l'Université de Columbia qui a fui pour demander l'asile au Canada, et la capture de Badar Khan Suri, universitaire à l'Université de Georgetown - aucun de ces cas, et beaucoup d'autres qui n'ont pas attiré l'attention du public, ne se produisent de manière isolée.
Tiré de Inprecor
4 avril 2025
Par Solidarity
Les mêmes décrets de Trump qui ont supprimé 400 millions de dollars de subventions fédérales à l'université de Columbia - dont la réponse de l'administration restera à jamais dans les chroniques de la lâcheté cynique - retirent maintenant également 175 millions de dollars à l'université de Pennsylvanie pour un délit sans rapport qui consiste à permettre à des athlètes transgenres de participer à des compétitions sportives masculines.
Il ne s'agit pas de questions distinctes ou de cas individuels à analyser juridiquement chacun de leur côté. L'intention ouverte du régime Trump et du groupe de milliardaires, d'idéologues d'extrême droite et de nationalistes chrétiens suprémacistes blancs qui le soutiennent, est de détruire, d'intimider et de convertir les universités et les collèges américains en agences totalement obéissantes du pouvoir des entreprises et de la réaction politique.
Le même programme est évident dans la volonté de criminaliser les programmes de diversité, d'égalité et d'inclusion (DEI) dans les secteurs public et privé, de paralyser la sécurité sociale et Medicaid, de pulvériser la main-d'œuvre fédérale et d'anéantir les agences qui aident les vétérans militaires, les enfants des écoles et les droits des travailleurs à organiser des syndicats et à survivre sur le lieu de travail.
L'attaque contre le courageux et puissant mouvement de solidarité avec la Palestine sur les campus et dans les communautés des États-Unis est un moyen de poursuivre cette offensive de la droite. La Palestine en tant que telle, bien sûr, est une question mondiale absolument centrale puisque le génocide à grande échelle mené conjointement par Israël et les États-Unis à Gaza a repris, le ministre israélien de la Défense promettant la « destruction totale » de ce qui reste de ce territoire et de ses 2,2 millions d'habitants.
Rappelons quelques faits essentiels : Mahmoud Khalil, le diplômé de Columbia détenteur d'une carte verte et son épouse Noor Abdalla, enceinte de huit mois, a été appréhendé le 8 mars par des agents en civil du ministère de la sécurité intérieure, alors que le couple rentrait dans la résidence universitaire qu'il occupait. Columbia avait ignoré les demandes de protection de Khalil, qui avait le sentiment d'être suivi.
Activiste de premier plan lors des occupations de l'année dernière et négociateur pour la résolution pacifique de l'occupation, Khalil n'a jamais été accusé d'un quelconque délit ou d'une quelconque mesure disciplinaire de la part de l'université. Après avoir appris que son « visa d'étudiant » (inexistant) puis sa carte verte avaient été « révoqués », Mahmoud a été emmené dans le New Jersey et transféré dans un centre de détention isolé de Louisiane avant que les tribunaux ne puissent intervenir. Un juge fédéral a ordonné que l'affaire soit renvoyée dans le New Jersey. Aujourd'hui, il reste à voir si le régime Trump obtempérera.
Yunseo Chung, 20 ans, étudiant à Columbia, est un résident permanent qui vit aux États-Unis depuis l'âge de 7 ans. Aujourd'hui dans un lieu non divulgué, elle intente un procès pour éviter d'être expulsée après que des agents de l'Immigration and Customs Enforcement ont effectué des descentes et des fouilles dans les résidences de Columbia sous prétexte que l'école ou ses résidences « hébergent et cachent des étrangers en situation irrégulière sur son campus ». Sa participation à des manifestations pro-palestiniennes ferait d'elle un « obstacle aux objectifs de la politique étrangère des États-Unis », selon les termes d'une loi de 1952 datant de l'ère McCarthy et autorisant l'expulsion pour ce motif.
Le Dr Alawieh, spécialiste des reins, chirurgien et professeur adjoint à l'université Brown, de retour d'un voyage au Liban, a été détenue pendant 36 heures, puis mise sur un vol de retour - en violation flagrante d'une décision de justice d'urgence interdisant son expulsion. Les prétendus « motifs d'expulsion » étaient sa participation aux funérailles de Hasan Nasrallah, le chef du Hezbollah assassiné par Israël, auxquelles assistaient des dizaines de milliers de Libanais·es.
Ces cas sont loin d'être les seuls dans lesquels les agents de Trump ont ignoré une décision de justice, comme l'illustre le renvoi massif de « membres de gangs » vénézuéliens présumés - sans aucune preuve ni l'ombre d'une procédure légale - vers une prison tristement célèbre et mortelle au Salvador.
Ranjani Srinivasan, dont le doctorat en urbanisme est presque achevé, a été « désinscrite » par Columbia après que des agents de l'ICE se sont présentés à son appartement et, ne parvenant pas à entrer pour la détenir, ont déclaré que son visa était annulé et l'ont informée qu'elle avait 15 jours pour quitter le pays. Elle a déclaré à CBC News qu'elle n'avait pas participé aux manifestations sur le campus (elle a apparemment été aperçue dans la foule au printemps dernier, à un moment où sa résidence sur le campus avait été bloquée).
Le comportement méprisable de Columbia, qui a supprimé et expulsé des étudiant-es l'année dernière, est maintenant aggravé par sa lâcheté à se plier à une série de demandes draconiennes de la Maison Blanche trumpiste, incluant non seulement l'interdiction des masques - notamment, Mahmoud Khalil a été facilement ciblé parce qu'il ne portait pas de masque - et la mise sous « tutelle externe » de son centre d'études sur le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie.
Badar Khan Suri est professeur à Georgetown et chercheur postdoctoral sur la religion et les processus de paix au Moyen-Orient et en Asie du Sud. Il séjourne légalement aux États-Unis avec un visa de chercheur et de professeur. De nationalité indienne, il vit avec sa femme, citoyenne américaine, et ses trois enfants à Rosslyn, en Virginie. Lorsqu'il est rentré chez lui le 17 mars après un repas d'iftar du Ramadan, Suri a été placé en garde à vue par des agents fédéraux masqués sans être accusé d'aucun crime.
En un peu plus de 72 heures, il a été transféré dans plusieurs centres de détention pour immigrés, puis dans un centre de transit de l'ICE à Alexandria, en Louisiane. (Ses collègues soupçonnent que la véritable cible du gouvernement est sa femme américaine d'origine palestinienne, Mapheze Saleh, qui, en tant que citoyenne, ne peut être expulsée).
Au moment où vous lirez cette déclaration, les outrages perpétrés par le régime gangréné de Trump auront encore proliféré.
Ce qui est en jeu
En deux mois à peine, le régime de Trump est devenu un cancer métastatique sur le corps déjà affaibli des droits démocratiques aux États-Unis. En fait, au cours des années qui ont précédé le règne actuel de la terreur, Trump, l'aile droite et leur majorité empilée à la Cour suprême ont obtenu des résultats significatifs - notamment en transformant la loi historique sur le droit de vote en lettre morte, en supprimant les lois sur le financement des campagnes électorales afin que des parasites milliardaires comme Elon Musk et les Adelson puissent acheter le gouvernement, et bien sûr en abolissant le droit fédéral à l'avortement.
L'orientation actuelle - sur de nombreux fronts, allant de la gouvernance par décrets exécutifs à la terrorisation des communautés d'immigrés et des militants pro-palestiniens, en passant par l'abolition de la citoyenneté de naissance - mène à la destruction substantielle du gouvernement constitutionnel aux États-Unis. Seul un papier peint décoratif sera laissé en place pour dissimuler la pourriture.
Les organisations de défense des libertés civiles et les avocats des personnes visées par l'expulsion interviennent énergiquement dans les affaires judiciaires et tirent la sonnette d'alarme dans les médias. Mais les dirigeants du Parti démocrate gardent un silence assourdissant sur la destruction de Gaza et le nettoyage ethnique rampant en Cisjordanie occupée. Alors que des dizaines de membres démocrates du Congrès ont publié une lettre contestant la détention de Mahmoud Khalil, le nom du chef de la minorité, Hakeem Jeffries, brille par son absence. Du côté du Sénat, Chuck Schumer semble être en hibernation profonde après son vote en faveur de la « résolution de continuation » budgétaire des Républicains de la Chambre des représentants.
La résistance émerge sur de multiples fronts, de l'appel à l'action du syndicat étudiant de Columbia CSW-UAW 2710 sur le cas de Mahmoud Khalil, aux syndicats de travailleurs postaux qui organisent des manifestations pour protester contre les plans de dévastation puis de privatisation du service postal, en passant par les piquets de grève dans les salles d'exposition Tesla contre l'empire commercial du milliardaire Elon Musk. Nous sommes ravis de voir des drapeaux palestiniens et ukrainiens flotter ensemble lors de manifestations de solidarité - alors que Trump donne son feu vert à la volonté d'Israël de détruire définitivement Gaza et se prépare à découper l'Ukraine en collaboration avec Vladimir Poutine.
Toute illusion consistant à penser que le différentes mesures – terroriser l'activisme palestinien et les communautés d'immigrés, s'attaquer aux droits des transgenres, des queers et des féministes, vider les agences gouvernementales de leur substance et abolir les syndicats de travailleurs fédéraux, la sécurité sociale et Medicaid – sont des questions « distinctes » est fatale. La protection de nos droits nécessite un effort gigantesque et unifié de la part de la résistance populaire, des libertés civiles et des forces du mouvement populaire.
Le cas scandaleux de Mahmoud Khalil, en particulier, a attiré l'attention des masses, et sa lettre de prisonnier politique est un puissant appel à la mobilisation. Des manifestations ont eu lieu dans tout le pays, notamment l'occupation du hall de la Trump Tower par Jewish Voice for Peace - New York.
Il s'agit d'un combat à mener sur plusieurs fronts. Bien entendu, tout partisan des droits fondamentaux du premier amendement devrait exiger la libération immédiate de Mahmoud Khalil, indépendamment de ce qu'il pense de son activisme en faveur de la Palestine - et personne ne devrait être idéologiquement exclu de cette lutte juridique et pour les libertés civiles, quelles que soient ses opinions politiques.
En même temps, l'agitation et l'activisme pour la libération de la Palestine et contre le génocide continueront et doivent continuer, inspirés par l'exemple et le courage de Khalil. Le sort du peuple palestinien, sacrifié sur l'autel du cynisme politique, de l'impérialisme et du colonialisme de peuplement, n'est pas une question isolée. Il est inextricablement lié à notre avenir à tous.
Comité national de Solidarity
Quelques sources
Lettre de Mahmoud Khalil datée du 18 mars et dictée depuis son centre de détention en Louisiane : https://www.aclu.org/news/free-speech/a-letter-from-palestinian-activist-mahmoud-khalil
Pétition de soutien à Badar Khan Suri : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfznp-mVhvKXv0mxUMgwLMAuvjP7Z9wnwz3cIvcGehjy3tfTA/viewform
Requête d'urgence pour empêcher l'expulsion péremptoire du Dr. Suri : https://www.acluva.org/en/press-releases/aclu-virginia-files-emergency-motion-stop-trump-administrations-illegal-deportation
En soutien au professeur Steven Thrasher, ciblé pour son activisme pro-palestinien à l'université de Northwestern : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfXeE0eClMlnBZD8djSblYWVl4Alhq_DknTqFAy16_tJh35g/viewform?fbzx=3017609832160450586
Manifestation de soutien au Dr Alawieh : https://www.youtube.com/watch?v=9PpcsSAVGGk
Parmi les nombreuses réactions de la gauche, nous recommandons tout particulièrement cette excellente déclaration du Tempest Collective : https://tempestmag.org/2025/03/free-free-mahmoud-khalil/
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Des milliers de manifestants s’opposent à Trump

Le samedi 6 avril, des milliers de manifestant-es ont défilé à travers les États-Unis dans le cadre des plus grandes manifestations organisées contre la présidence de Donald Trump depuis son arrivée au pouvoir.
Rédaction d'Africanews | tiré de znetwork.org
Sous le slogan "Bas les pattes !", ces rassemblements ont réuni plus de 1 200 sites de protestation à travers tous les États du pays, rassemblant des groupes aussi variés que des militant-es des droits civiques, des défenseurs des droits des LGBTQ+, des syndicalistes, des vétérans et des militant-es pour la justice sociale. Le but de ces manifestations : dénoncer les politiques de Trump, jugées néfastes pour la démocratie, les droits sociaux et l'inclusion.
Des manifestations se sont tenues dans des villes de toute l'Amérique, allant de Midtown Manhattan à New York jusqu'à Anchorage en Alaska, et se sont même étendues à plusieurs États. Parmi les revendications principales, la défense de la sécurité sociale, l'opposition aux coupes dans les effectifs du gouvernement fédéral et la lutte contre la réduction des protections pour les personnes transgenres.
À Seattle, sous l'ombre du Space Needle, les manifestant-es ont brandi des pancartes scandant des messages comme "Combattez l'oligarchie". À Los Angeles, des centaines de personnes ont défilé de Pershing Square à l'hôtel de ville, criant leur mécontentement contre les politiques économiques et sociales de l'administration Trump. Aucune arrestation n'a été signalée durant les manifestations, et l'ambiance est restée globalement pacifique.
Des revendications diverses mais toutes visant Trump
Les manifestant-es ont exprimé leur colère face contre plusieurs politiques clés du président Trump, notamment la réduction des effectifs du gouvernement fédéral, la fermeture de bureaux locaux de la sécurité sociale et des coupes dans les financements des programmes de santé. Les attaques contre la communauté LGBTQ+, notamment la restriction des droits des personnes transgenres, ont également été largement dénoncées.
L'un des objectifs majeurs des manifestant-es est de maintenir la pression contre une administration perçue comme déconnectée des réalités sociales. Des slogans comme "Bas les pattes de notre démocratie" et "Bas les pattes de notre sécurité sociale" ont résonné dans de nombreuses rues.
Parmi les figures les plus controversées du gouvernement Trump figure Elon Musk, à la tête du département de l'efficacité gouvernementale(DOGE). L'homme d'affaires, responsable de la réduction des effectifs dans plusieurs agences fédérales, a été pris pour cible par les manifestant-es qui l'accusent de compromettre les services publics essentielsafin d'"économiser de l'argent" au détriment des citoyen-nes les plus vulnérables. Musk, pour sa part, défend ses actions, affirmant qu'elles permettent d'économiser des milliards de dollars pour les contribuables.
Les réactions politiques
Le président Trump, quant à lui, a répondu par le biais d'un communiqué de la Maison Blanche, soulignant que ses priorités étaient de protéger les programmes de sécurité sociale, de Medicare et de Medicaid pour les bénéficiaires légitimes. Le porte-parole de la Maison Blanche a cependant mis en garde contre les propositions des Démocrates, qui selon lui, risqueraient de mener ces programmes à la faillite en élargissant leur accès à des étrangers en situation irrégulière.
À Washington, la présidente de la Human Rights Campaign, Kelley Robinson, a vivement critiqué les politiques de l'administration Trump, estimant que ces mesures étaient des attaques directes contre la dignité des minorités et des personnes LGBTQ+.
Bien que ces manifestations ne représentent pas encore une mobilisation aussi massive que celle de la Marche des femmes de 2017 ou les protestations de Black Lives Matter de 2020, elles témoignent d'un mécontentement croissant. Des militant-es, des citoyen-nes ordinaires et même des républicains déçus par Trump, comme Roger Broom, un retraité de l'Ohio, ont rejoint les rangs de l'opposition.
Britt Castillo, une manifestante de Charlotte, a déclaré : "Peu importe votre parti, peu importe pour qui vous avez voté, ce qui se passe aujourd'hui est inacceptable. C'est dégoûtant."
Alors que Donald Trump continue de défendre ses réformes et ses priorités, la mobilisation contre son administration semble loin d'être terminée. Le mouvement "Bas les pattes !" est un signal fort que l'opposition à ses politiques reste bien vivante à travers le pays. Les manifestations de ce week-end n'ont peut-être pas encore l'ampleur de celles des premières années de son mandat, mais elles témoignent d'une résistance qui pourrait s'intensifier à mesure que le climat politique évolue aux États-Unis.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Des salles de classe à la prison : trump intensifie les coupes budgétaires, les arrestations et la censure dans sa croisade contre la protestation universitaire.

L'administration de Donald Trump a intensifié son offensive contre le droit de manifester sur les campus universitaires aux États-Unis. Dans une lettre envoyée à 60 établissements d'enseignement supérieur, le gouvernement a averti qu'ils risquaient de perdre des financements fédéraux s'ils ne garantissaient pas la sécurité des étudiants juifs.
Par : Isabel Cortés
Cette mesure s'inscrit dans un modèle d'actions répressives suite aux manifestations pro-palestiniennes de 2024, qui ont mené à l'annulation de subventions multimillionnaires et à l'arrestation d'activistes.
L'ombre de Columbia et la répression de la protestation
Le précédent le plus immédiat de cette escalade a été la sanction contre l'Université de Columbia, qui a perdu 400 millions de dollars en subventions fédérales après avoir été accusée de permettre un environnement hostile pour les étudiants juifs. De plus, l'étudiant palestinien Mahmoud Khalil a été arrêté par des agents de l'immigration sous l'accusation d'avoir dirigé des manifestations pro-palestiniennes sur le campus. Bien qu'il réside légalement aux États-Unis, Khalil fait face à un processus de déportation qui a suscité des protestations de la part des organisations de défense des droits humains.
Selon le Bureau des droits civils du Département de l'éducation, dirigé par Linda McMahon, les universités doivent garantir l'accès ininterrompu à leurs installations et protéger les étudiants juifs contre ce que l'administration décrit comme du "harcèlement et de la discrimination".
Des secteurs progressistes et des organisations de défense des droits civils estiment qu'il s'agit d'une attaque directe contre la dissidence politique et la défense des droits des Palestiniens. "Nous assistons à une criminalisation sans précédent de la protestation", a déclaré un porte-parole de l'American Civil Liberties Union (ACLU).
Harvard et la menace de coupes budgétaires massives
L'offensive du gouvernement a également mis dans sa ligne de mire l'Université de Harvard, dont le financement de 9 milliards de dollars est actuellement sous révision en raison d'accusations d'« antisémitisme ». Le secrétaire d'État, Marco Rubio, a annoncé que plus de 300 étudiants ont vu leur visa révoqué pour avoir participé aux manifestations pro-palestiniennes.
La secrétaire à l'Éducation, Linda McMahon, a justifié la possible suspension des fonds en affirmant qu'Harvard "a échoué à protéger ses étudiants". En réponse, le recteur de l'université, Alan Garner, a mis en garde contre les conséquences graves de ces mesures : "Si ces financements sont suspendus, des recherches vitales seront paralysées et l'innovation scientifique sera mise en danger".
Dans un courriel adressé aux étudiants et aux professeurs, Garber a insisté sur le fait que, "bien qu'Harvard ait travaillé pour combattre l'antisémitisme grâce à des initiatives de sensibilisation et des règles plus strictes, toute réduction budgétaire affecterait des domaines clés de la recherche et de l'innovation". Ses déclarations interviennent à un moment critique, alors que le gouvernement fédéral durcit sa position contre les institutions qui permettent ou encouragent les manifestations pro-palestiniennes sur leurs campus, ce qui a engendré un débat intense sur les limites de la liberté académique et l'autonomie universitaire.
L'annonce de garber coïncide avec une lettre signée par 94 professeurs de la faculté de droit de harvard, qui dénoncent ce qu'ils considèrent une érosion de l'état de droit sous l'administration Trump "Nous sommes unis dans notre condamnation des tactiques d'intimidation, de la discrimination basée sur les opinions et des tentatives de l'administration d'utiliser l'exécutif comme une arme contre l'État de droit. Nous ne fermons pas les yeux sur le fait qu'elle attaque des professions et des groupes dont l'existence et l'indépendance sont vitales pour toute forme de démocratie américaine."
Ce conflit met en lumière une tendance inquiétante : l'utilisation de mesures punitives pour réprimer des expressions légitimes de protestation, un phénomène qui ne touche pas seulement les États-Unis, mais résonne également dans les institutions éducatives à travers le monde.
Voici la lettre qui dénonce et s'oppose à "l'attaque frontale visant à démanteler les normes de l'État de droit" : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7B2GVhBZRjEsZYeJVz6vL3hkXheu9LmuFRx38JQ0RkXPveA/viewform
Un panorama incertain pour l'éducation supérieure aux états-unis
La pression du gouvernement fédéral pour réprimer les protestations pro-palestiniennes a créé un climat de peur parmi les étudiants et les universitaires, en particulier ceux ayant un statut migratoire vulnérable.
L'affaire Mahmoud Khalil a servi d'avertissement à d'autres activistes, dont certains ont choisi de suivre des cours en ligne pour éviter d'éventuelles arrestations. Pendant ce temps, les universités tentent de trouver un équilibre entre la protection de la liberté d'expression et le respect des exigences gouvernementales.
Arrestations et tentatives de déportations
Ces derniers jours, le gouvernement Trump a recours à des mesures violentes contre les étudiants ayant manifesté en soutien à la Palestine dans plusieurs universités aux États-Unis.
Yunseo Chung, une étudiante sud-coréenne de l'Université de Columbia, qui vivait aux États-Unis depuis l'âge de sept ans et était résidente légale, a dénoncé le 24 mars dernier que la police de l'immigration était intervenue à son domicile ainsi qu'à celui de ses parents. Les autorités affirmaient que son statut migratoire avait été révoqué, un argument fréquent dans de tels cas.
Deux jours plus tard, une juge de New York a empêché la déportation de Chung, estimant qu'il n'y avait "aucune preuve qu'elle puisse constituer une menace pour la communauté".
Mahmoud Khalil, un étudiant palestinien qui avait aussi dirigé des manifestations à Columbia, n'a pas eu la même chance et demeure détenu. L'administration Trump l'accuse d'avoir des liens avec le Hamas, ce qui n'a pas encore été prouvé.
Rumeysa Ozturk, une étudiante turque qui faisait son doctorat à l'Université Tufts (Massachusetts), a également été arrêtée pour avoir coécrit un article publié dans le journal de l'université en 2024. Dans cet article, elle appelait l'institution à cesser de financer des entreprises ayant des liens avec Israël. Cette arrestation a provoqué une forte réaction des organisations de défense des droits humains, qui y voient une attaque directe à la liberté d'expression et une tentative de criminaliser la dissidence académique.
La gouverneure du Massachusetts, Maura Healey, a exigé des explications de l'administration Trump, dénonçant que le cas d'Ozturk illustre l'utilisation arbitraire du pouvoir migratoire pour réprimer ceux qui exercent leur droit à l'opinion. "Donald Trump a dit qu'il allait poursuivre les criminels et les sortir des rues ; mais de plus en plus, ce que nous voyons, c'est le contraire", a déclaré Healey. La juge Denise Casper, de la Cour de district des États-Unis du Massachusetts, a émis un ordre pour empêcher sa déportation pendant que son cas est examiné, soulignant qu'"aucune preuve n'a été présentée pour démontrer que Ozturk représente une menace".
Le cas d'Ozturk souligne la préoccupation croissante concernant la criminalisation de la dissidence académique aux États-Unis. Des organisations internationales ont averti que ce type d'arrestation crée un précédent dangereux pour la liberté d'expression et le droit de manifester. La persécution des étudiants internationaux qui critiquent la politique étrangère américaine ou les actions d'Israël à Gaza soulève de sérieuses interrogations sur le respect des principes démocratiques et des droits humains par les États-Unis.
Face à cette offensive grandissante contre la liberté académique et le droit à la protestation, la communauté internationale ne peut rester indifférente. Les universités, les organismes de défense des droits humains et les citoyens du monde entier doivent élever la voix pour rejeter toute tentative de censure sous des prétextes politiques. La défense de l'éducation en tant qu'espace de pensée critique et de débat libre est un pilier fondamental des sociétés démocratiques. L'histoire a prouvé que lorsqu'on attaque le savoir, on mine les valeurs de justice et de liberté ; empêcher cela est une responsabilité mondiale.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Mahmoud Khalil doit être libéré !

Mahmoud Khalil, qui a le statut légal de résident permanent aux États-Unis, a été arrêté par les services de l'immigration pour avoir exercé son droit à la liberté d'expression. Envoyez un message à Kristi Noem, secrétaire à la Sécurité intérieure des États-Unis et demandez sa libération immédiate.
Quel est le problème ?
https://www.amnesty.org/fr/petition/release-mahmoud-khalil/
Le 8 mars 2025, les services de l'immigration des États-Unis ont arrêté illégalement et placé arbitrairement en détention Mahmoud Khalil, militant palestinien et organisateur de manifestations étudiantes qui a récemment obtenu son diplôme à l'université Columbia, aux États-Unis.
Il a le statut légal de résident permanent aux États-Unis. Mahmoud a été pris pour cible en raison de son rôle dans les manifestations étudiantes à l'université Columbia, lors desquelles il exerçait son droit à la liberté d'expression et de réunion pacifique en soutenant les droits du peuple palestinien. Il n'a été inculpé d'aucune infraction.
Mahmoud est enfermé dans un centre de détention et les autorités l'ont informé qu'elles avaient « révoqué » sa résidence permanente et engagé une procédure d'expulsion contre lui.
Ce que vous pouvez faire
Appelez les autorités à libérer Mahmoud immédiatement et à respecter ses droits à la liberté d'expression et de réunion pacifique et à une procédure régulière.
************
Envoyez un message aux autorités des États-Unis maintenant
Mahmoud Khalil doit être libéré !
Secrétaire à la Sécurité intérieure des États-Unis : Kristi Noem
Madame la Secrétaire,
Dans la soirée du 8 mars, des agents du département de la Sécurité intérieure (DHS) ont interpellé Mahmoud Khalil, militant étudiant palestinien récemment diplômé de l'université Columbia, alors qu'il venait de rentrer d'un repas de rupture du jeûne du ramadan avec son épouse enceinte de huit mois, avant de l'arrêter illégalement.
Mahmoud Khalil a le statut légal de résident permanent et a été informé par des fonctionnaires fédéraux que ses papiers d'immigration allaient être révoqués. Il n'a été inculpé d'aucune infraction. Il a participé activement aux manifestations et aux campements organisés à l'université Columbia pour soutenir les droits du peuple palestinien et protester contre le génocide en cours dans la bande de Gaza occupée.
Personne ne devrait être séparé de sa famille et envoyé en détention pour avoir simplement exercé son droit de manifester, et personne ne doit être expulsé pour avoir défendu les droits humains.
L'arrestation de Mahmoud Khalil et son maintien en détention arbitraire sont une attaque de plus contre les droits humains de la part du gouvernement de Donald Trump. L'exercice du droit à la liberté d'expression et de réunion pacifique est un droit fondamental, et non pas un motif d'expulsion.
S'en prendre à des manifestant·e·s pacifiques et menacer leur statut migratoire en raison du contenu de leur manifestation, comme la défense des droits humains des Palestinien·ne·s, est une violation des droits humains. Ce ciblage envoie un signal inquiétant à toutes les personnes dans ce pays, sur les campus et ailleurs, en laissant entendre que quiconque exerce ses droits pourra faire l'objet d'une répression, d'une détention et potentiellement d'une expulsion. Il pousse par ailleurs les populations immigrées qui vivent déjà dans la peur aux États-Unis à se cacher encore davantage, de crainte d'être expulsées si elles s'expriment.
Mahmoud Khalil doit être libéré immédiatement. Je vous prie instamment d'annuler la révocation de son statut légal de résident permanent et d'utiliser vos prérogatives pour veiller à ce que le gouvernement de Donald Trump respecte les droits fondamentaux de Mahmoud Khalil, notamment son droit à une procédure régulière, et le libère afin qu'il puisse rentrer chez lui à New York auprès de sa famille.
Veuillez agréer, Madame la Secrétaire, l'expression de ma haute considération.
Prénom :
Nom :
Courriel :
Pays :
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les attaques de Trump contre la liberté d’expression

Quiconque aux États-Unis aime penser qu'il vit dans un pays libre devrait être indigné par le cas de Rumeysa Ozturk. La vidéo de l'étudiante en doctorat de l'université Tufts, arrêtée sur le trottoir près de chez elle dans une banlieue de Boston, est effrayante. On y voit une demi-douzaine d'individus au visage couvert entourer Ozturk, l'attraper, puis l'emmener.
3 avril 2025 | tiré du site d'Human Rights Watch | photo : Des étudiants pro-palestiniens manifestent à l'université de Columbia lors du troisième jour du « Gaza Solidarity Encampment » à New York (États-Unis), le 19 avril 2024. © 2024 Selcuk Acar/Anadolu via Getty Images
https://www.hrw.org/fr/news/2025/04/03/les-attaques-de-trump-contre-la-liberte-dexpression
Le seul « crime » d'Ozturk - la raison apparente pour laquelle des agents fédéraux masqués l'ont enlevée dans la rue - était qu'elle avait écrit quelque chose qui déplaisait au gouvernement. Plus précisément, quelque chose qui déplaisait à l'administration Trump.
Ozturk a co-écrit un article d'opinion dans un journal étudiant. Elle y mettait en évidence des accusations crédibles d'atrocités commises par le gouvernement israélien à Gaza, et faisait référence à des rapports de l'ONU et d'Amnesty International. L'article appelait également l'université de Tufts à « reconnaître le génocide palestinien » et à retirer leurs investissements liés à Israël.
L'article était-il controversé ? Peut-être selon votre opinion sur les allégations crédibles d'atrocités commises par le gouvernement israélien à Gaza. L'article était-il criminel ? C'est évident que non.
Le Département américain de la Sécurité Intérieure (Department of Homeland Security - DHS) affirme qu'Ozturk « s'est engagée dans des activités de soutien au Hamas ». Le mot « Hamas » n'apparaît même pas une seule fois dans l'article qu'elle a co-signé. Encore une fois, il y est question des politiques universitaires, vis-à-vis d'allégations crédibles selon lesquelles le gouvernement israélien commet des atrocités.
Le cas d'Ozturk n'est pas isolé. Il s'agit d'un incident qui s'inscrit dans une politique plus large du gouvernement américain cherchant à arrêter et expulser arbitrairement des étudiants et des universitaires internationaux en représailles à leurs opinions politiques et à leur activisme en faveur de la Palestine.
Ozturk est originaire de Turquie. Elle est aux États-Unis avec un visa étudiant.
Cela ne signifie pas qu'elle perd de quelque manière que ce soit son droit à la liberté d'expression, soit dit en passant. En vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, que les États-Unis ont ratifié en 1992, les non-citoyens ont le droit d'avoir des opinions et de les exprimer.
Punir des personnes pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression constitue une violation du droit international des droits humains.
L'administration Trump poursuit sans relâche sa vaste répression contre des étudiants et des universitaires non citoyens qui ont des opinions que le gouvernement n'apprécie pas. Les cas de Mahmoud Khalil et Yunseo Chung ont également attiré l'attention des médias, à juste titre, tout comme celui d'Ozturk, mais ce qui se passe va bien au-delà de quelques individus.
L'administration affirme avoir déjà révoqué des centaines de visas d'étudiants.
Ce qui se passe actuellement aux États-Unis est déjà suffisamment choquant. Mais où cela va-t-il nous mener ? Quelles opinions politiques le gouvernement ciblera-t-il ensuite ? Qui sera le prochain à être enlevé dans la rue par des voyous masqués pour avoir simplement exprimé une opinion qui déplaît au gouvernement ?
Comme le dit John Raphling de HRW : « Les actions de l'administration Trump constituent une attaque contre la liberté d'expression et menacent les fondements mêmes d'une société libre. »
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

POUR UNE RIPOSTE UNITAIRE AU VENT DE DROITE

Le panel sera composé de :
Amir Khadir, ex-député et ancien porte-parole de Québec solidaire
Chantal Ide, vice-présidente du Conseil central du Montréal-Métropolitain CSN
Karine Cliche, initiatrice de QS-Parti de la rue
Roger Rashi, Intersyndical de QS et membre de Révolution écosocialiste
Animation : Josée Chevalier, militante syndicale FNEEQ-CSNCSN
Face à la montée du vent de droite ici et ailleurs, la résistance s'organise. Comment unir ces résistances multiples en un front uni ? Quel rapport entre la déferlante Trumpiste au sud et les attaques anti-syndicales ici ? Comment renforcer la gauche sociale et politique dans ce nouveau cycle politique ?
En personne au Centre St-Pierre, salle 303, 1212 Panet, Montréal (Métro Beaudry)
ainsi qu'en diffusion virtuelle :
https://us02web.zoom.us/j/5657718675?omn=82879551711
L'activité est gratuite, mais n'hésitez pas à faire une contribution monétaire ! On accepte les virements bancaires (info@ecosocialisme.ca) ! Sur place, il y aura aussi des personnes mandatées pour recueillir vos dons. Merci !
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Photographies Devant le Paysage

"Nouveau monde, nouvelle humanité, nouvelles révolutions".

Viens écouter Jean-Luc Mélenchon lors de la conférence organisée par la LFI-NUPES Montréal
Mardi 15 avril 2025
de 19:00 à 21:30
Où : Université McGill - Pavillon Leacock
855 Rue Sherbrooke Ouest Montréal, QC H3A 2T7

Black like Mao. Chine rouge et révolution noire (Partie II)
L’article qui suit est la deuxième partie de l’article de Robin Kelly et Betsy Esch, Black like Mao. Chine rouge et révolution noire, publié pour la première fois en 1999 dans la revue Souls. Le texte explore l’impact de la Révolution chinoise sur les mouvements radicaux afro-américains du 20e siècle, des groupes d’autodéfense armée de Robert Williams à la poésie marxiste-léniniste d’Amiri Baraka. La traduction originale de l’article provient de la revue Période. On peut lire la première partie de l’article ici : Black like Mao. Chine rouge et révolution noire (Partie I)
The Black Nation
Sur la question de la libération des Noirs, cependant, la plupart des organisations maoïstes américaines fondées entre le début et le milieu des années 1970 furent influencées par Staline plutôt que par Mao. Les Noirs aux États-Unis n’étaient pas simplement des prolétaires à la peau noire, ils formaient une nation, ou, comme l’a dit Staline, « une communauté constante créée historiquement sur la base des communautés de langue, de territoire, de vie économique et psychique et qui s’exprime par une culture commune[1]. » Les groupes anti-révisionnistes qui adoptaient la définition de la nation de Staline, tels que le Communist Labor Party (CLP) et la October League, firent revivre la position du vieux Parti communiste selon laquelle les Africains-Américains des États de la Black Belt du Sud constituaient une nation et avaient le droit de se séparer s’ils le souhaitaient. D’autre part, des groupes comme le Progressive Labor – qui avait auparavant défendu le « nationalisme révolutionnaire » – se rapprochèrent d’une position rejetant toute forme de nationalisme au moment de la Révolution culturelle.
Parmi les mouvements anti-révisionnistes, Le CLP était peut-être le partisan le plus constant de l’autodétermination des Noirs. Fondé en 1968, en grande partie par des Africains-Américains et des Latinos, les racines du CLP remontent au Provisional Organizing Committee (POC). Cette organisation était elle-même un produit de la division de 1956 dans le CPUSA qui avait conduit à la création de Hammer Steel et du Progressive Labor Movement. Ravagé par une décennie de divisions internes, le POC était devenu une organisation constituée essentiellement de Noirs et de Portoricains divisée entre New York et Los Angeles. En 1968, les dirigeants de New York exclurent leurs camarades de Los Angeles pour avoir, entre autres, refusé de dénoncer Staline et Mao. Le groupe de Los Angeles, en grande partie sous l’influence du marxiste noir chevronné Nelson Peery, fonda la même année la California Communist League et commença à recruter de jeunes ouvriers et des intellectuels radicaux noirs et hispaniques. La maison de Peery au sud du centre de Los Angeles était déjà devenue une sorte de lieu de rassemblement pour les jeunes radicaux noirs après le soulèvement de Watts ; Peery forma de petits groupes informels pour étudier l’histoire, l’économie politique et les œuvres classiques de la pensée marxiste-léniniste-maoïste et accueillit des militants de tout bord, allant des Black Panthers aux étudiants militants de la California State University à Los Angeles et du L.A. Community College. La California Communist League fusionna par la suite avec un groupe de militants du SDS qui se faisaient appeler la Marxist-Leninist Workers Association et fonda la Communist League en 1970. Deux ans plus tard, le groupe changea une nouvelle fois de nom pour devenir le Communist Labor Party[2].
À l’exception peut-être du long essai de Harry Haywood « Towards a Revolutionary Position on the Negro Question » (publié pour la première fois en 1957 et qui circula jusque dans les années 1960-1970)[3], aucun plaidoyer pour l’autodétermination ne fut plus lu dans les milieux marxistes-léninistes-maoïstes de l’époque que la brochure de Nelson Peery The Negro National Colonial Question (1972). Peery fut vivement critiqué pour avoir défendu l’usage du terme « Negro », une position difficile à tenir au sein du mouvement du Black Power. Mais Peery avait un bon argument : l’identité nationale n’était pas une question de couleur. Selon lui, la nation noire (Negro Nation) était une communauté constante créée historiquement et ayant sa propre culture, sa propre langue (ou plutôt dialecte), son propre territoire – les États de la Black Belt et les régions environnantes, c’est-à-dire essentiellement les treize États confédérés. Dans la mesure où les sudistes blancs partageaient un territoire commun avec les Africain-Américains, et, selon lui, une langue et une culture communes, ils étaient également considérés comme faisant partie de la nation noire. Plus précisément, les sudistes blancs constituaient la « minorité anglo-américaine » à l’intérieur de cette nation noire. Comme en témoignaient la musique soul, les negro-spirituals et le rock-and-roll, le Sud avait été le lieu d’émergence d’une culture hybride ayant de fortes racines africaines que les contes populaires sur les esclaves et les turbans des femmes rendaient manifestes. Peery citait Jimi Hendrix et Sly and the Family Stone, ainsi que les imitateurs blancs Al Jolson, Elvis Presley et Tom Jones, comme des exemples d’une culture partagée. Il percevait même la présence de la culture « soul » dans « la coutume de manger des pieds de cochon, des os du collier, divers types de haricots et des boyaux [qui] sont tous associés à la région du Sud, en particulier avec la nation noire[4] ».
L’intégration par Peery des Blancs du Sud dans la nation noire fut un coup de génie, d’autant plus que l’un de de ses objectifs était de déstabiliser les catégories raciales. Sa confiance dans la définition stalinienne de la nation affaiblissait cependant son argument. Au moment même où la migration de masse et l’urbanisation rétrécissait la part de la population noire dans le Sud rural, Peery insistait sur le fait que la terre natale des Noirs était la Black Belt. Il essaya même de prouver qu’il existait encore dans la Black Belt une paysannerie noire et un prolétariat rural stable. Dans la mesure où la question de la terre était la base sur laquelle s’était construite sa compréhension de l’autodétermination, il finit par en dire très peu sur la nationalisation de l’industrie et la production socialisée. Il pouvait ainsi écrire en 1972 que « la question coloniale et nationale noire ne peut être résolue qu’en redonnant la terre à ceux qui l’ont travaillé depuis des siècles. Dans la nation noire, cette redistribution des terres exigera une combinaison de fermes d’État et d’entreprises coopératives afin de répondre au mieux aux besoins de la population dans les conditions de l’agriculture moderne mécanisée[5] ».

Le parti communiste (marxiste-léniniste) (CP[ML]) promut également une version de la thèse de la Black Belt héritée de son incarnation passée au sein de l’October League. Le CP(ML) fut le fruit de la fusion en 1972 de l’October League[6], principalement basée à Los Angeles, et la Georgia Communist League. Nombre de ses membres fondateurs venaient du Revolutionary Youth Movement (une fraction au sein du SDS), dont quelques reliquats de la Vieille gauche comme Harry Haywood et Otis Hyde. La présence de Haywood dans le CP(ML) est significative car il est considéré comme l’un des premiers architectes de la thèse de la Black Belt, formulée lors du Sixième Congrès de l’Internationale communiste en 1928. Dans sa formulation actualisée par le CP(ML), les Africains-Américains avaient le droit de se séparer de « leur patrie historique dans la Black Belt du Sud[7]. » Mais les membres du CP(ML) ajoutèrent que la reconnaissance du droit à l’autodétermination ne signifiait pas que la séparation était la solution la plus appropriée. Ils introduisirent également l’idée de l’autonomie régionale (c’est-à-dire que les concentrations urbaines d’Afro-Américains pouvaient également exercer l’autodétermination dans leurs propres communautés) et élargirent le slogan de l’autodétermination aux Chicanos, Portoricains, Américains d’origine asiatique, Autochtones et populations indigènes dans les colonies des États-Unis (dans les îles du Pacifique, à Hawaii et en Alaska, etc.). Ils sélectionnaient scrupuleusement les types de mouvements nationalistes qu’ils étaient prêts à soutenir, ne promettant de donner leur appui qu’au nationalisme révolutionnaire et non au nationalisme réactionnaire.
La Revolutionary Union, une émanation de la Bay Area Revolutionary Union (BARU) fondée en 1969 avec le soutien d’anciens membres du CPUSA qui avaient visité la Chine, adopta la position selon laquelle les Noirs constituaient « une nation opprimée d’un type nouveau[8]. » Dans la mesure où les Noirs étaient principalement des ouvriers concentrés dans les zones industrielles urbaines (ce que la BARU appelait une « structure déformée de classe »), le groupe pensait que l’autodétermination ne devait pas prendre la forme de la séparation, mais devait plutôt être réalisée à travers la lutte contre la discrimination, l’exploitation et les répressions policières dans les centres urbains. En 1975, lorsque la Revolutionary Union devint le Revolutionary Communist Party (RCP), elle continua à soutenir l’idée que les Noirs constituaient une nation d’un nouveau type, mais commença également à défendre « le droit des Noirs à rejoindre et à revendiquer leur territoire d’origine[9]. » Il n’est pas étonnant que ces deux lignes contradictoires aient été sources de confusion, ce qui contraignit les dirigeants de la RCP à adopter une position intenable en défendant le droit à l’autodétermination sans le prôner. Deux ans plus tard, ils abandonnèrent complètement le droit à l’autodétermination et, comme le PLP, firent la guerre à toute forme de nationalisme « étroit ».
Contrairement aux organisations à tendance maoïste mentionnées ci-dessus, la Revolutionary Communist League (RCL) – fondée et dirigée par Amiri Baraka – émana directement des mouvements nationalistes-culturels de la fin des années 1960. Pour comprendre les positions changeantes de la RCL (et de ses précurseurs) à l’égard de la libération des Noirs, il faut en revenir à 1966, l’année où Baraka fonda la Spirit House à Newark, dans le New Jersey, avec l’aide de militants locaux et d’autres avec lesquels il avait travaillé au Black Arts Repertory Theater de Harlem. Si les artistes de la Spirit House étaient dès le début impliqués dans la politique locale, les violences policières contre Baraka et d’autres militants pendant le soulèvement de Newark de 1967 les politisa plus encore. Après le soulèvement, ils participèrent à l’organisation d’une conférence du Black Power à Newark qui attira plusieurs dirigeants nationaux noirs, dont Stokely Carmichael, H. Rap Brown et Huey P. Newton du Black Panther Party, ainsi qu’Imari Obadele de la Republic of New Africa (en partie une émanation du Revolutionary Action Movement). Peu de temps après, la Spirit House forma la base du Committee for a Unified Newark (CFUN), une nouvelle organisation composée des United Brothers, de la Black Community Defense and Development, et des Sisters of Black Culture. Outre le fait qu’il put attirer des nationalistes noirs, des Noirs musulmans et même quelques Marxistes-Léninistes-Maoïstes, le CFUN portait la marque de la US Organization de Ron Karenga. En effet, le CFUN adopta la version du nationalisme culturel de Karenga et travailla en étroite collaboration avec lui. Même si des tensions apparurent entre Karenga et certains des militants de Newark en raison de son attitude envers les femmes et de la structure de direction trop centralisée que le CFUN avait emprunté à la US Organization, le mouvement continua à se développer. En 1970, Baraka renomma le CFUN le Congress of African Peoples (CAP) ; il le transforma en une organisation nationale, et, lors du congrès inaugural, rompit avec Karenga. Les dirigeants du CAP critiquèrent vivement le nationalisme culturel de Karenga et firent adopter des résolutions qui reflétaient un virage à gauche – dont une proposition visant à lever des fonds pour aider à construire le chemin de fer entre la Tanzanie et la Zambie[10].
Plusieurs facteurs contribuèrent au virage à gauche de Baraka pendant cette période. L’un d’eux est lié à la douloureuse expérience qu’il fit des limites des politiciens noirs de la « petite bourgeoisie ». Après avoir joué un rôle central dans l’élection de Kenneth Gibson en 1970, le premier maire noir de Newark, Baraka fut le témoin de l’augmentation des répressions policières (incluant des agressions contre les manifestants du CAP) et de l’incapacité de Gibson à tenir la promesse qu’il avait faite à la communauté africaine-américaine. Se sentant trahi et désabusé, Baraka se sépara de Gibson en 1974, sans pour autant abandonner entièrement l’idée d’un processus électoral. Le rôle qu’il joua dans l’organisation de la première National Black Political Assembly en 1972 lui redonna foi dans le pouvoir des politiques noires indépendantes et dans la force potentielle d’un front noir uni[11].

Le coordinateur régional de la côte Est du CLP, William Watkins, exerça une influence importante sur Baraka. Né et élevé à Harlem, Watkins faisait partie d’un groupe d’étudiants radicaux noirs de la California State University à Los Angeles qui contribua à la fondation de la Communist League. En 1974, il fit la connaissance de Baraka. « On passait des heures dans son bureau, se rappelle Watkins, à débattre des fondamentaux – comme la plus-value ». Pendant environ trois mois, Baraka rencontra régulièrement Watkins qui lui enseignait les fondamentaux de l’économie politique et tâchait de lui montrer les limites du nationalisme culturel. Ces rencontres jouèrent certainement un rôle dans le changement de cap à gauche de Baraka. Mais quand Watkins et Nelson Perry demandèrent à Baraka de rejoindre le CLP, il refusa. Bien qu’il devînt sensible à la pensée marxiste-léniniste-maoïste, il n’était pas prêt à rejoindre une organisation multiraciale. La lutte noire était prioritaire[12].
L’origine la plus évidente de la radicalisation de Baraka se situait en Afrique. Tout comme son premier tournant à gauche après 1960 avait été suscité par la révolution cubaine, la lutte dans le Sud de l’Afrique suscita son second tournant à gauche post-1970. L’événement clé fut la création du African Liberation Support Committee en 1971. Celui-ci émanait d’un groupe de nationalistes noirs dirigé par Owusu Sadaukai, directeur de la Malcom X Liberation University à Greensboro, en Caroline du Nord, qui se rendit au Mozambique sous l’égide du Front de Libération du Mozambique (FRELIMO). Le président du FRELIMO, Samora Machel (qui était par pure coïncidence en Chine au même moment que Huey Newton) et d’autres militants convainquirent Sadaukai et ses collègues que le rôle le plus utile que les Africains-Américains pouvaient jouer en soutien à l’anticolonialisme était de défier le capitalisme américain de l’intérieur et de faire connaître la vérité au sujet de la guerre juste du FRELIMO contre la domination portugaise.
L’African Liberation Support Committee (ALSC) reflétait l’orientation radicale des mouvements de libération en Afrique lusophone. Le 27 mai 1972 (date anniversaire de la fondation de l’Organisation of African Unity), l’ALSC participa à la première manifestation du African Liberation Day (ALD), réunissant environ 30 000 manifestants rien qu’à Washington, D.C., et environ 30 000 de plus à travers le reste des États-Unis. Le comité de coordination du ALD comptait des représentants de plusieurs organisations noires de gauche, y compris la Youth Organization for Black Unity (YOBU), le All-African people’s Revolutionary Party (AAPRP), mené par Stokely Carmichael [Kwame Toure], la Pan-African People’s organization, et le Black Workers Congress à tendance maoïste[13]. L’ALSC réunit un si large éventail de militants noirs qu’il devint l’arène de débats portant sur la création d’un programme noir radical. Bien que la plupart des organisateurs de l’ALSC fussent profondément anti-impérialistes, le nombre de marxistes noirs aux postes de direction devint un point de discorde. Outre Sadaukai, qui allait continuer à jouer un rôle majeur dans Revolutionary Workers League (MWL) d’orientation maoïste, les principaux dirigeants de l’ALSC étaient Nelson Johnson (futur dirigeant du Communist Workers Party) et Abdul Alkalimat (un brillant écrivain et membre fondateur de la Revolutionary Union).
Dès 1973, des divisions se créèrent au sein de l’ALSC. Les querelles internes et le sectarisme s’avérèrent trop difficile à gérer pour l’ALSC et la politique étrangère chinoise le mit en crise pour de bon. Le soutien de la Chine à UNITA lors de la guerre civile angolaise de 1975, de même que l’argument du premier ministre adjoint Li Xian-Nian selon lequel le dialogue avec l’Afrique du Sud valait mieux que l’insurrection armée, placèrent les maoïstes noirs de l’ALSC dans une position délicate. En l’espace de trois ans, l’ALSC s’effondra complètement, mettant malencontreusement un terme à l’organisation anti-impérialiste sans doute la plus dynamique de la décennie.
Néanmoins, l’expérience de Baraka au sein de l’ALSC modifia profondément ses perspectives. Comme il le rappelle dans son autobiographie, au moment de la première manifestation du Africain Liberation Day en 1972, il était en train de « faire un tournant de gauche et lisait Nkrumah, Cabral et Mao. » Dans les deux années qui suivirent, il en appela les membres du CAP à examiner « l’expérience révolutionnaire internationale [à savoir les révolutions russe et chinoise] et à l’appliquer à la révolution africaine[14]. » Leurs programmes de cours s’élargirentpour inclure des œuvres telles que les Quatre essais de philosophie de Mao et les Fondements du léninisme et l’Histoire du Parti communiste bolchevik de l’URSS de Staline[15]. En 1976, le CAP s’était défait de tous les vestiges de nationalisme ; il changea son nom en Revolutionary Communist League (RCL), et chercha à se refondre en un mouvement multiracial marxiste-léniniste-maoïste. Afin sans doute d’atteindre une stabilité idéologique en tant que mouvement anti-révisionniste, le RCL s’engagea dans la noble voie de la résurrection de la thèse de la Black Belt. En 1977, le RCL publia un article intitulé « The Black Nation[16] » qui analysait les mouvements de libération noire d’un point de vue marxiste-léniniste-maoïste et concluait que le peuple noir dans le Sud et dans les grandes villes composaient une nation disposant d’un droit fondamental à l’autodétermination. Bien que rejetant « l’intégration bourgeoise », l’essai affirmait que la lutte pour le pouvoir politique noir était un élément majeur dans le combat pour l’autodétermination.
En tant qu’artiste profondément ancré dans le mouvement artistique noir, Baraka a constamment construit sa vision de la culture et de la politique à partir des contradictions de la vie noire dans un contexte capitaliste, impérialiste et raciste. Pour Baraka, comme pour beaucoup de ceux que l’on a évoqués ici, ce n’était pas simplement une question de nationalisme étroit. Au contraire, comprendre la place de l’oppression raciale et de la révolution noire dans le contexte capitaliste et impérialiste était essentiel pour le futur de l’humanité. Dans la tradition de Du Bois, Fanon et Cruse, Baraka insistait sur le fait que le prolétariat noir (donc colonial) était l’avant-garde de la révolution mondiale, « non en raison d’un quelconque chauvinisme mystique mais à cause de notre place dans l’histoire objective […]. Nous sommes l’avant garde parce que nous sommes les bas-fonds et quand nous nous lèverons, tout ce qui sera au-dessus de nous s’effondrera[17] . » De plus, malgré son immersion dans la littérature marxiste-léniniste-maoïste, son propre travail culturel suggère qu’il avait conscience, comme la plupart des radicaux noirs, que la question de savoir si le peuple noir constituait ou pas une nation ne serait pas résolue par la lecture de Lénine ou Staline, ni par la résurrection de M. N. Roy. Si jamais elle pouvait l’être, la bataille aurait lieu, pour le meilleur ou pour le pire, sur le terrain de la culture. Bien que le mouvement artistique noir ait été le moteur essentiel de la révolution culturelle noire aux États-Unis, il est difficile d’imaginer à quoi aurait ressemblé cette révolution sans la Chine. Les radicaux noirs prirent par les cornes la Grande Révolution culturelle prolétarienne et la remodelèrent à leur image.


La Grande Révolution culturelle prolétarienne (noire)
Il n’existe pas, dans la réalité, d’art pour l’art, d’art au-dessus des classes, ni d’art qui se développe en dehors de la politique ou indépendamment d’elle.
Mao Zedong, « Interventions aux causeries sur la littérature et l’art à Yen’an », (Mai 1942)[18]
Moins d’un an après le début de la Révolution culturelle, Robert Williams publia un article dans le Crusader intitulé « Reconstitute Afro-American Art to Remold Black Souls » (Reconstruire l’art africain-américain pour remodeler les âmes noires). Tandis que l’appel de Mao pour une révolution culturelle impliquait de se débarrasser des vestiges (culturels et autres) de l’ancien ordre, Williams – à l’instar du mouvement artistique noir aux États-Unis – parlait de purger la culture noire de la « mentalité d’esclave ». Bien qu’il ait adopté quelques éléments de langage du manifeste du Parti communiste chinois (CCP) (la « Décision du Comité central du Parti communiste chinois sur la Grande Révolution culturelle prolétarienne », publiée le 12 août 1966, dans la Peking Review), Williams chercha dans son article à s’inspirer de l’idée plutôt que de l’idéologie de la Révolution culturelle. Comme Mao, il appela les artistes noirs à se débarrasser des chaînes des anciennes traditions et à mettre l’art au service de la révolution et d’elle seule :
L’artiste africain-américain doit faire un effort conscient et résolu pour reconstruire nos représentations artistiques, pour remodeler une âme noire et révolutionnaire, fière d’elle-même. […] Il doit créer une théorie et une direction nouvelles pour préparer notre peuple à une lutte acharnée, sanglante et prolongée contre la tyrannie et l’exploitation racistes. L’art noir doit servir au mieux le peuple noir. Il doit devenir une puissante arme dans l’arsenal de la révolution noire[19].
Les dirigeants du RAM se mirent d’accord. En 1967, circula un document interne du RAM, intitulé Some questions concerning the present period, qui en appelait à une révolution culturelle noire totale aux États-Unis, dont l’objectif était de détruire les mœurs, les attitudes, les manières, les coutumes, les modes de vie et les habitudes de l’oppression blanche. Cela impliquait la formation d’une nouvelle culture révolutionnaire. Cela signifiait également la fin des cheveux traités, du blanchiment de la peau et autres vestiges de la culture dominante. En effet, la révolution n’avait pas seulement pour cible les bourgeois noirs intégrés mais aussi les barbiers et les esthéticiennes.
La promotion consciente de l’art comme arme de la libération noire n’a rien de nouveau : elle remonte au moins à la frange de gauche de la Harlem Renaissance, si ce n’est plus tôt. Le mouvement des arts noirs aux États-Unis – tout comme pratiquement tous les mouvements de libération nationale contemporains – prit cette idée très au sérieux. Fanon n’a pas manqué d’évoquer cette dimension dans Les Damnés de la Terre dont la traduction anglaise s’est répandue comme une trainée de poudre à son époque[20]. Mais c’est la Révolution culturelle chinoise qui joua le rôle le plus important. Après tout, beaucoup sinon la majorité des nationalistes noirs connaissaient bien la Chine et avaient lu Mao. Même s’ils ne reconnaissaient pas de manière explicite l’influence des idées maoïstes sur la nécessité d’un art révolutionnaire et sur celle de la nature prolongée de la révolution culturelle, les parallèles sont frappants. Considérons le manifeste de 1968 de Ron [Maulana] Karenga « Black Cultural Nationalism ». D’abord publié dans Negro Digest, l’essai tire plusieurs de ses idées des « Interventions aux causeries sur la littérature et l’art à Yen’an » de Mao. Comme Mao, Karenga insistait sur le fait que tout art doit être jugé selon deux critères – « artistique » et « social » (« politique »); que l’art révolutionnaire doit être destiné aux masses et qu’il « doit être fonctionnel, c’est-à-dire utile, puisque nous ne pouvons pas accepter la fausse doctrine de “l’art pour l’art” » comme le dit Karenga lui-même. L’influence du maoïsme directement perceptible à travers les efforts de Karenga pour façonner une culture révolutionnaire alternative. En effet, les sept principes de Kwanzaa (la fête africaine-américaine inventée par Karenga et célébrée pour la première fois en 1967), à savoir l’unité, l’autodétermination, la responsabilité et le travail collectifs, l’économie collective (socialisme), la créativité, le but, et même la foi sont tout aussi compatibles avec les idées de Mao qu’avec la culture « traditionnelle » africaine[21]. Ce n’est sans doute pas une coïncidence si ces sept principes furent le fondement de la célèbre Déclaration d’Arusha de 1964 en Tanzanie sous la présidence de Julius Nyerere – la Tanzanie étant l’allié le plus précoce et le plus important de la Chine en Afrique.
Bien que la dette de Karenga envers Mao soit passée inaperçue, le Progressive Labor Party en prit note. Le journal du PLP, The Challenge, se livra à une virulente critique de l’ensemble du mouvement des arts noirs et de ses théoriciens intitulée « [LeRoi] Jones-Karenga Hustle: Cultural “Rebels” Foul Us Up », qui caractérisait Karenga de « pseudo-intellectuel » qui a « minutieusement lu les interventions sur la littérature et l’art de Mao ». « Le nationalisme culturel », poursuit l’article, « ne vénère pas seulement les aspects les plus réactionnaires de l’histoire africaine. Il va même jusqu’à mesurer l’engagement révolutionnaire de tel ou tel par sa tenue vestimentaire ! Cela fait partie de la “conscience noire”[22]. »
Bien sûr, la révolution est devenue une sorte d’art, ou plus précisément un style bien défini. Qu’ils s’habillent en Afro et en dashiki ou en veste en cuir et béret, la plupart des révolutionnaires noirs des États-Unis développèrent leurs propres critères esthétiques. Dans le monde de l’édition, le « Petit Livre rouge » de Mao eut un impact phénoménal sur les styles littéraires dans les cercles radicaux noirs. L’idée qu’un livre de format poche de citations concises et d’aphorismes pouvaient couvrir un si large éventail de sujets, incluant le comportement éthique, la pensée et la pratique révolutionnaires, le développement économique et la philosophie, attira beaucoup de militants noirs indépendamment de leurs allégeances politiques. Le « Petit Livre rouge » engendra une industrie artisanale de livres miniatures de citations expressément adressés aux militants noirs. The Black Book, publié par Earl Ofari Hutchinson (avec l’aide de Judy Davis) en est un parfait exemple[23]. Publié par le Radical Education Project (aux alentours de 1970), The Black Book comprend une compilation de courtes citations de W.E.B Dubois, Malcom X, et Franz Fanon qui couvrent un large éventail de questions relatives à la révolution nationale et mondiale. Les similitudes avec les Citations du Président Mao Tsé-Toung sont frappantes. Les chapitres ont notamment pour titre « La culture et l’art noir », « La politique », « L’impérialisme », « Le socialisme », « Le capitalisme », « La jeunesse », « Le Tiers-Monde », « L’Afrique », « Au sujet de l’Amérique » et « L’unité noire ». L’introduction d’Ofari place la lutte noire dans un contexte global et revendique une éthique révolutionnaire et « l’unification spirituelle et physique du Tiers-Monde ». Ofari ajoute que « la vraie Blackness est un style de vie collectif, un ensemble de valeurs collectives et une perspective commune sur le monde » qui va au-delà de nos différentes expériences en Occident. The Black Book n’était pas conçu comme une défense nationalisme noir contre les incursions du maoïsme. Au contraire, Ofari conclut en disant que « partout les combattants de la liberté continuent de lire le livre rouge, mais placent à ses côtés le LIVRE NOIR de la révolution. Pour gagner la bataille à venir, les deux sont nécessaires ».
Un autre texte populaire dans cette tradition était Axioms of Kwame Nkrumah: Freedom Figthers Edition, qui parut en 1969 – un an après que les Chinese Foreign Languages Press eurent publié la version anglaise des Citations du Président Mao Tsé-Toung[24]. Relié en cuir noir et couvert de dorures, il débute par une phrase inscrite sur le frontispice qui souligne l’importance de la volonté révolutionnaire : « le secret de la vie est de n’avoir peur de rien ». Si l’on fait abstraction du fait qu’ils se concentrent sur l’Afrique, les chapitres sont pratiquement impossibles à distinguer du « Petit Livre rouge ». Les sujets abordés incluent « La révolution africaine », « L’armée », « Le Black Power », « Le capitalisme », « L’impérialisme », « La milice populaire », « Le peuple », « La propagande », « Le socialisme » et « Les femmes ». La plupart des citations sont vagues ou échouent à être autre chose que des slogans (« La bêtise intellectuelle la plus ignoble jamais inventée par l’homme est celle de l’infériorité et de la supériorité raciales », ou encore : « un révolutionnaire n’échoue que s’il renonce »)[25]. Un grand nombre des idées de Nkrumah auraient cependant pu être celles de Mao, en particulier les citations traitant de l’utilité de la mobilisation populaire, de la relation dialectique entre la pensée et l’action et les questions relatives à la guerre, à la paix et à l’impérialisme.



En ce qui concerne la question de la culture, la plupart des groupes maoïstes et antirévisionnistes aux États-Unis étaient moins concernés par la création d’une nouvelle culture révolutionnaire que par la destruction des vestiges de l’ancienne et le combat contre ce qu’ils considéraient être une culture commerciale bourgeoise rétrograde. À cet égard, ils allaient dans le sens de la Grande Révolution culturelle prolétarienne. Dans une passionnante critique du film Superfly publié par le journal du CP(ML) The Call, l’auteur saisit l’opportunité de critiquer le rôle de la contre-culture ainsi que celui des capitalistes dans la promotion de la prise de drogues au sein de la communauté noire. « Quand je regarde toutes les personnes qui meurent d’overdose autour de moi, se font tuer dans des fusillades qui les opposent, sont broyés par des accidents de travail alors qu’ils sont déjà écrasés par le labeur, il devient évident que la dope fait autant de ravages que n’importe quel policier armé. » Pourquoi un film destiné à la population noire glorifie-t-il la culture de la drogue ? Parce que « les impérialistes connaissent la dure réalité – si tu planes à cause de la drogue, tu n’auras pas le temps de penser à la révolution – tu es trop préoccupé par le lieu où tu pourras te procurer la prochaine dose ! » La critique introduit également un peu d’histoire de la Chine :
Les Britanniques ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour faire en sorte que les chinois soient dépendants [de l’opium]. Il était habituel que les ouvriers se voient verser une partie de leur salaire en opium, provoquant une addiction encore plus rapide. Il n’y avait que la révolution qui pût mettre fin à cette misère. Afin de se réapproprier leur pays et transformer leur société en une autre qui serait véritablement au service du peuple, il fallait cesser de trouver un échappatoire dans la drogue[26].
Les critiques maoïstes ne se limitaient pas aux aspects les plus réactionnaires de la culture commerciale de masse. Le mouvement des arts noirs – un mouvement qui, ironiquement, incluait des personnalités très inspirées par les événements en Chine et à Cuba – fut scruté à la loupe par la gauche antirévisionniste. Des groupes tels que le PLP et le CP(ML), malgré leurs nombreuses divergences au sujet de la question nationale, s’accordaient sur le fait que le mouvement des arts noirs, par son attirance pour la culture africaine était malavisé, pour ne pas dire contre-révolutionnaire. Le PLP rejetait les nationalistes culturels noirs comme étant de petits hommes d’affaires bourgeois qui vendaient les aspects les plus rétrogrades de la culture africaine au peuple et « exploit[ai]ent les femmes noires – tout cela au nom de la “culture africaine” et de la “révolution”. » Ce même éditorialiste du PLP reprocha au mouvement des arts noirs d’ « enseigner les reines, les rois et les “empires” africains. Il n’y a pas d’approche de classe – aucune indication sur le fait que ces rois, etc., s’opposaient au peuple africain[27]. » De la même façon, un éditorial de 1973 de The Call critiquait le mouvement des arts noirs parce qu’il « délégitimait les aspirations nationales authentiques de la population noire aux États-Unis et […] et substituait une contre-culture africaine à la lutte anti-impérialiste[28]».
Bien que ces attaques fussent excessives, notamment parce qu’elles mettaient dans un même panier toute un ensemble d’artistes aux projets très différents, une poignée d’artistes noirs en était venue aux mêmes conclusions au sujet de la direction du mouvement des arts noirs. Pour le romancier John Oliver Killens, la révolution culturelle chinoise avait offert un modèle pour transformer le nationalisme culturel noir en une force révolutionnaire. À la suite de ses voyages en Chine dans les années 1970, Killens publia un essai important dans The Black World louant la révolution culturelle qui avait, selon lui, connu un succès retentissant. En fait, il s’était clairement rendu en Chine pour découvrir pourquoi la révolution chinoise avait réussi « alors que [leur] propre révolution culturelle noire, si ardente dans les années 1960, semblait dépérir[29]» Au moment où il était prêt à rentrer aux États-Unis, il parvint à plusieurs conclusions relatives aux limites de la révolution culturelle noire et à la force du modèle maoïste. Premièrement, il reconnut que toutes les révolutions couronnées de succès sont continues – permanentes et prolongées. Deuxièmement, le militantisme culturel et le militantisme politique ne sont pas pour lui des stratégies de libération différentes mais deux faces d’une même pièce. La révolution culturelle et la révolution politique vont de pair. Troisièmement, un mouvement révolutionnaire doit être indépendant, il doit créer des institutions culturelles autonomes. Bien sûr, la plupart des nationalistes radicaux noirs dans le mouvement des arts noirs s’en étaient rendu compte par eux-mêmes et l’article de Killens renforça seulement ces enseignements. Toutefois, la Chine apprit également à Killens quelque chose à laquelle peu de militants masculins du mouvement faisaient attention à l’époque: « Les femmes portent la moitié du ciel. » Dans certaines fractions militantes centrales de la révolution culturelle noire, il était littéralement demandé aux femmes de « rester assises à l’arrière du bus. […] C’est une pensée rétrograde qui a produit des divisions. De nombreuses femmes allèrent battre le pavé et rejoignirent le mouvement de libération des femmes. Certains des frères semblaient contrariés et surpris, mais c’est nous qui les avons conduites à cela[30]. »
Amiri Baraka représenta l’autre principale critique noire et inspirée par le maoïsme du mouvement des arts noirs, alors qu’il était lui-même une figure essentielle de la révolution culturelle noire et l’une des premières cibles des critiques maoïstes. En tant que fondateur et dirigeant du CAP et plus tard de la RCL, Baraka fit davantage qu’une critique, il bâtit un mouvement qui tentait de faire la synthèse entre les innovations stylistiques et esthétiques du mouvement des arts noirs et la pensée marxiste-léniniste-maoïste. Tout comme sa trajectoire du monde des beatniks à la conférence de Bandung, la transformation de Baraka de nationaliste culturel en communiste engagé donne un aperçu de l’impact de Mao sur le radicalisme noir aux États-Unis. Plus que tout autre maoïste ou antirévisionniste, Baraka et les membres de la RCL symbolisaient l’effort le plus conscient et le plus soutenu pour transférer la Grande révolution culturelle prolétarienne dans les quartiers défavorisés des États-Unis et la transformer de telle manière qu’elle touche la classe ouvrière.

Battre les droites

Alors que la droite et l'extrême droite gagnent du terrain ici comme ailleurs, la solidarité internationale entre les forces progressistes s'avère plus essentielle que jamais.
Pour en discuter, Ruba Ghazal, porte-parole de Québec solidaire, et Jean-Luc Mélenchon, fondateur de La France insoumise et président de l'Institut La Boétie, tiendront une conférence publique le 16 avril prochain à la Maison Théâtre.
Cette rencontre unique sera l'occasion d'échanger sur les stratégies de résistance à la montée des droites, des deux côtés de l'Atlantique.
Mercredi 16 avril, 18h30 Maison Théâtre (245 Rue Ontario E, Montréal)
Ouverture des portes à 18h
Je m'inscris
Le PL94 en éducation enlèverait du pouvoir aux parents et aux professeurs
Dsputio : le nouveau média social québécois qui réinvente le débat en ligne
Des étudiants en grève parce que leur cégep s’effondre
Alain Deneault et Claude Vaillancourt lèvent le voile sur le pouvoir incandescent des multinationales
Un pour tous, et tous contre Amazon : la solidarité internationale face à la crise

Les poubelles... débordent !

En supplément du dossier de notre revue papier, Ramon Vitesse nous fait quelques recommandations ordurières.
Musique
Guérilla Poubelle : Power trio DIY punk rock français de puis 2003. Parmi leur enregistrements on trouve Punk= existentialisme et La nausée (Guérilla Asso).
The Cramps : Le provocateur groupe psychobilly punk (1975-2009) joue notamment l'emblématique Garbageman !
Les Ordures Ioniques : Groupe punk québécois qui… Se saoûlage.
BD
Derf Backderf : Trashed et L'Année des ordures (Ça et Là – 2015 et 2021) Un style robuste et un humour tordu pour narrer un emploi étudiant de vidangeur.
André-Philippe Côté : Baptiste le clochard (Station T, 2022) Mémorables comics trips d'un clochard philosophe vivant dans une poubelle…
Album jeunesse
Pierre Grosz et Rémi Saillard : La bonne idée de monsieur Johnson (La Cabane Bleue, 2022) Le gardien d'une décharge publique entreprend de reverdir les montagnes de déchets accumulés tout près de New-York. Inspiré d'une histoire vraie et d'un parc qui lui survit !
Joan Sénéchal et Yves Dumont : Opération mange-gardiens – non au gaspillage alimentaire (Isatis, 2023) Un bouquin pour les activistes de tout âges !
Essai
Lucie Taïeb : Freshkills (Édition Varia, 2019) Une réflexion critique à partir du parc « écologique » qui escamote la décharge Fresh Kills (1948-2001) sur Staten Island N-Y.
Olivier Linot et Daniel Simon : Le cheval au service de la ville (Écosociété, 2014) L'expérience d'hippomobilité initiée à Trouville-sur-Mer (France) ; d'abord pour la collecte sélective des déchets.
Estelle Richard : Pour en finir avec le gaspillage alimentaire (Écosociété, 2021)
Simon Paré-Poupart : Ordures ! Journal d'un vidangeur (Lux Éditeur, 2024) Tout ce que nous souhaiterions ignorer quant à notre production pléthorique de déchets - directement du camion par un vidangeur !
Illustration : Ramon Vitesse
Des salles de classe à la prison : Trump intensifie sa croisade contre la protestation universitaire
Le cynisme ma bouée

Les travailleuses contre l’État néolibéral : entrevue avec Camille Robert
Camille Robert est historienne, chercheuse postdoctorale à l’Université Concordia et chargée de cours à l’Université du Québec à Montréal. Depuis plusieurs années, ses recherches portent sur l’histoire syndicale, les luttes des travailleuses du secteur public et les mobilisations féministes. Elle a notamment publié le livre Toutes les femmes sont d’abord ménagères. Histoire d’un combat féministe pour la reconnaissance du travail ménager (Éditions Somme toute, 2017) et codirigé l’ouvrage Travail invisible. Portraits d’une lutte féministe inachevée (Éditions du Remue-ménage, 2018). Camille Robert est aussi membre des comités de rédaction des revues Labour / Le travail et Histoire engagée. Sa thèse s’intitule Les travailleuses de l’éducation et de la santé face au tournant néolibéral de l’État québécois (1980-1989). Le collectif Archives Révolutionnaires s’est entretenu avec elle afin de mieux saisir la restructuration économique des années 1980 et son impact sur les travailleuses du secteur public, ainsi que sur leurs courageuses luttes. Alors que l’austérité fait son retour au Québec et que la droite radicale s’impose un peu partout, il est essentiel d’étudier les résistances passées au néolibéralisme pour s’en inspirer et développer une stratégie ouvrière victorieuse.
Entrevue réalisée par Alexis Lafleur-Paiement



Alexis Lafleur-Paiement : D’abord, voudrais-tu me parler de la manière dont le néolibéralisme s’est imposé mondialement au tournant des années 1970-1980, et présenter ses caractéristiques principales ?
Camille Robert : Pour une introduction sur le sujet, je recommanderais le livre de David Harvey, un géographe marxiste qui a écrit une Brève histoire du néolibéralisme. C’est un bon ouvrage pour comprendre comment s’est déployé le néolibéralisme à l’échelle internationale. En fait, les idées néolibérales émergent dès les années 1940, avec la formation de la Société du Mont-Pèlerin qui a regroupé les penseurs néolibéraux à partir de 1947. Mais c’est surtout dans les années 1970 qu’on voit leurs idées s’imposer davantage, dans la foulée de critiques du modèle de l’État-providence et d’une reconfiguration majeure des rapports de force.
Harvey souligne qu’il y a eu de premières expériences néolibérales, par exemple au Chili après le coup d’État du 11 septembre 1973. Celui-ci est à inscrire dans une restructuration néolibérale mondiale, où on voit des gouvernements socialistes ou défendant les intérêts des travailleuses et des travailleurs être remplacés de force par des régimes autoritaires qui mettent en place des programmes antisociaux. Quand on réfléchit aux débuts du néolibéralisme, il faut aussi considérer ces événements, et pas seulement regarder l’Angleterre de Margaret Thatcher ou les États-Unis de Ronald Reagan.
Plus concrètement, je dirais que le néolibéralisme se présente d’abord comme une remise en question de l’État-providence. Rappelons que ce dernier s’était mis en place dans le cadre d’un régime d’accumulation fordiste, caractérisé par une croissance de la productivité, une augmentation de la consommation et par l’intervention de l’État comme régulateur des tensions entre le capital et le travail. L’État-providence a émergé à partir des années 1930-1940 et s’est consolidé après la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis, au Canada, en Angleterre et en France, notamment. L’après-guerre correspond aussi à une période d’avancées importantes pour le mouvement syndical qui obtient généralement des rehaussements salariaux et de meilleures conditions d’emploi. En parallèle, l’État met en place divers services publics et des programmes sociaux universels qui visent à combler, en partie, les revendications ouvrières et à réduire les conflits de travail. Il y a un certain apaisement des tensions entre capital et travail, mais ça ne veut pas dire qu’il n’y a plus de conflits et que tout va bien ! Il y a tout de même plusieurs grèves et d’importants mouvements de revendications.
Dès les années 1960-1970, on commence toutefois à voir un essoufflement du régime d’accumulation fordiste et une baisse du taux de profit des entreprises. La productivité stagne et le secteur industriel connaît des difficultés importantes, ce qui entraîne de premières fermetures et délocalisations d’usines. Puis arrivent des périodes de forte inflation consécutives aux chocs pétroliers des années 1970, entraînant une instabilité économique. Les mesures de protection sociale qui étaient offertes par les États – comme l’assurance-chômage – ou les protections garanties par les conventions collectives – notamment l’indexation des salaires pour protéger le pouvoir d’achat des syndiqué·es pendant les périodes d’inflation –, tout ça commence à être considéré comme trop coûteux par les élites politiques et économiques. Le modèle de l’emploi permanent à temps complet, avec des mesures de protection garanties, représente désormais une contrainte du point de vue patronal.
Progressivement, les mesures keynésiennes liées à l’État-providence sont jugées inefficaces pour redresser l’économie. En contrepartie, les « solutions » néolibérales gagnent en importance, particulièrement à partir des années 1980. David Harvey présente la « néolibéralisation », ou la transition néolibérale, comme un projet politique qui vise à recréer des conditions propices à l’accumulation du capital et à rétablir le pouvoir des élites économiques. Entre les années 1940 et 1970, il y a eu un très relatif (et bref) équilibre dans les rapports de force entre le patronat et les syndicats ; le tournant néolibéral cherche donc à remettre en question ce compromis, au profit des élites politiques et économiques.
Dans leur excellent livre La nouvelle raison du monde, les chercheurs Pierre Dardot et Christian Laval mentionnent que le néolibéralisme n’est pas nécessairement un projet concerté, mais plutôt une série de réactions qui se sont progressivement imposées comme nouvelle norme. Ces actions ne sont pas le fait d’un seul groupe, mais de plusieurs acteurs. Ainsi, le patronat, les autorités financières, les politiciens, les actionnaires ont peu à peu consolidé la rationalité néolibérale, notamment à travers des dynamiques d’affrontement et de répression. On constate d’ailleurs que les dispositifs disciplinaires ont contribué au renforcement des politiques néolibérales, que ce soit par l’autorité des marchés financiers qui ont poussé les États à réduire leurs dépenses sociales, ou avec les lois spéciales contre les syndicats, réduisant leur rapport de force et leur capacité de revendication. On voit finalement que le néolibéralisme, ce n’est pas un processus naturel, mais plutôt un nouveau paradigme qui a été imposé de façon brutale à plusieurs moments. Ce processus a été long et parfois violent, pour éventuellement faire advenir une nouvelle norme… ou une nouvelle rationalité qui s’impose tant aux individus qu’aux institutions et aux États, comme l’avancent Dardot et Laval.


Pour continuer dans le même sens, pourrais-tu me parler de la manière dont le néolibéralisme s’est implanté au Canada, surtout au Québec ?
Au Québec, ça s’est fait assez progressivement. C’est difficile de fixer un moment ou une année qui marquerait le début du tournant néolibéral. Après avoir consulté plusieurs livres et articles sur le sujet, je dirais qu’il n’y a pas vraiment de consensus sur quand le néolibéralisme aurait « débuté » au Québec. Certains auteurs affirment que ça commence avec le deuxième mandat de Robert Bourassa en 1985, alors que circulent des discours ouvertement en faveur de la privatisation et de la déréglementation. Pour d’autres personnes, le néolibéralisme arrive dans les années 1990 avec le projet de « déficit zéro » de Lucien Bouchard. Mais avec mes recherches en archives, je peux dire qu’on voit des signes de l’arrivée du néolibéralisme dès la fin des années 1970. À l’époque, le gouvernement péquiste commence à tenir un discours en faveur d’un « dégraissage de l’État ». Certains services publics sont considérés comme étant inefficaces et coûtant trop cher.
Dans le secteur hospitalier, il y a d’importantes vagues de compressions budgétaires à ce moment. Le ministère des Affaires sociales (aujourd’hui le ministère de la Santé et des Services sociaux) impose par exemple des plans de redressement budgétaire à partir de 1977-1978. Chaque hôpital doit soumettre au ministère un plan détaillé pour se conformer aux compressions demandées. En pratique, ça implique des coupures de milliers de postes, des réductions de services et des déplacements de patientèle, puisque des départements sont fermés dans certains hôpitaux et transférés ailleurs. Évidemment, les syndicats s’y opposent de façon assez vigoureuse. Il y a même certains gestionnaires d’hôpitaux qui refusent carrément de mettre en application les compressions budgétaires – et qui sont éventuellement menacés de congédiement par le ministre des Affaires sociales. On voit qu’à la fin des années 1970, il y a des tensions concernant les ressources qui sont allouées aux soins de santé, et qu’il y a déjà des affrontements.
Au même moment, on voit aussi une volonté du gouvernement de réduire les salaires des employé·es du secteur public pour les ramener au même niveau que ceux du secteur privé. Il faut rappeler que dans les années 1970, il y avait une volonté, de la part des syndicats, que le secteur public serve de « locomotive » pour améliorer globalement les conditions de toutes les travailleuses et de tous les travailleurs. L’idée, c’était qu’en rehaussant les salaires et les conditions dans le secteur public, ça aurait un effet d’entraînement sur le secteur privé, que ça créerait une pression à la hausse sur le plan salarial. Certains gains issus des grèves du front commun ont eu des retombées positives sur d’autres catégories de travailleuses et de travailleurs, par exemple en matière de congés de maternité. Mais à la fin des années 1970, le gouvernement péquiste veut renverser cette tendance ; il soutient que les employé·es du secteur public gagnent trop cher et qu’il faudrait ramener leur salaire au niveau du secteur privé. Cette posture vise à la fois à réduire l’engagement de l’État-employeur et à limiter, dans le secteur privé, les pressions en vue d’une amélioration des conditions d’emploi.
En 1978, le Conseil du trésor publie deux études où les salaires du secteur public sont comparés à ceux du secteur privé, prétendument pour montrer comment les employé·es de l’État sont privilégié·es. Déjà à l’époque, certaines lacunes surgissent puisque 60 % des emplois dans le secteur public n’ont pas d’équivalent dans le secteur privé, surtout en santé et en éducation. Finalement, le gouvernement compare une minorité d’emplois pour affirmer que tous les salarié·es du secteur public gagneraient 16 % de plus que dans le secteur privé. Cet argumentaire gouvernemental, qui mise sur l’antagonisme public / privé, se construit à partir de la fin des années 1970 et s’amplifie au début des années 1980, dans un contexte de crise des finances publiques. Le gouvernement continue dans la même lignée en prétendant que les employé·es du secteur public sont des « gras dur », des privilégié·es, des gens qui conservent une sécurité d’emploi et qui bénéficient de bonnes conditions de travail en pleine crise économique… alors qu’en pratique, il y a beaucoup de précarité dans le secteur public. Mais le gouvernement cherche quand même à créer une opposition entre les travailleuses et travailleurs du secteur public, et ceux du secteur privé.
Au cours de la période 1981-1983, ces tensions se consolident de manière très évidente. À ce moment, il y a une récession économique globale et le Québec traverse une crise des finances publiques. Le chômage, l’inflation et les taux d’intérêt augmentent considérablement. Ce contexte représente un terreau fertile pour le déploiement du néolibéralisme. Si certains signes étaient présents auparavant, on constate une intensification des réformes, des discours et des mesures disciplinaires à caractère néolibéral au début des années 1980.
Sur le plan budgétaire, le secteur public est soumis à une « opération austérité » en 1981, qui vise à retrancher un milliard de dollars dans l’ensemble des ministères. Au même moment, la fiscalité des particuliers et des entreprises est allégée. Le sommet économique de 1982 représente un autre moment marquant : René Lévesque, devant un important déficit budgétaire, envisage ouvertement de réduire les salaires dans le secteur public… ce qui sera ensuite fait par une loi spéciale. Les représentants du gouvernement insistent sur la nécessité d’améliorer la productivité, la mobilité et la flexibilité des salarié·es de l’État. Les négociations du front commun de 1982-1983 seront donc assez difficiles. Alors que le gouvernement doit négocier avec ses employé·es, il mène une importante campagne médiatique contre les syndicats, avant d’imposer les conditions de travail par décret. La répression de la grève du personnel enseignant sera aussi très dure, mais on y reviendra. En résumé, le gouvernement péquiste, de façon assez claire, tente de « résoudre » la crise par l’imposition de mesures néolibérales. On peut donc avancer que le néolibéralisme émerge à la fin des années 1970, mais se consolide au cours des années 1980.

Avant qu’on parle plus en détail du conflit de 1982-1983, pourrais-tu me dire un mot sur la réaction des syndicats face aux premières mesures néolibérales, parce que les centrales syndicales étaient alors très proches du Parti québécois au pouvoir. Comment les syndicats ont réagi en 1980, 1981, 1982, avant qu’il y ait un conflit ouvert ?
Effectivement, il y avait des liens assez étroits entre le Parti québécois et les syndicats. Le PQ, lorsqu’il s’est fait élire, affirmait avoir un préjugé favorable envers les travailleurs. Et c’est vrai qu’il y a eu quelques mesures progressistes lors du premier mandat, comme la loi anti-scabs, mais la lune de miel n’a pas duré longtemps. Les choses se sont compliquées lors du front commun de 1979, où les syndicats du secteur public avaient mis beaucoup de pression sur le gouvernement. En vue du référendum sur la souveraineté, le gouvernement péquiste ne voulait pas qu’il y ait une crise sociale, alors il a offert quelques concessions pour maintenir la paix sociale. Mais il y a une rancœur qui est restée à l’endroit des syndicats, et le gouvernement tentera ensuite de revenir sur les conditions négociées pour la convention collective de 1979-1982.
Selon mes recherches en archives et les entrevues que j’ai menées, je dirais que de 1981 à 1983, il y a eu une cassure par rapport aux liens qu’il y avait entre le PQ et les syndiqué·es. Beaucoup de péquistes qui étaient dans les rangs des syndicats, qui occupaient des fonctions syndicales, ont vécu une grande désillusion politique. Plusieurs d’entre eux ont quitté le milieu syndical, surtout après la répression de la grève de 1983. Cette rupture, ce bris de confiance, a eu un effet très déstabilisateur sur la vie militante à l’interne. Pour les personnes qui étaient plus marxistes ou socialistes, qui avaient déjà une approche plus critique à l’égard du Parti québécois, ce n’était pas une surprise, le choc n’était pas si grand. Mais pour les gens qui étaient péquistes, ça été extrêmement difficile, particulièrement pour ceux qui venaient des rangs de l’enseignement, où la grève a été le plus durement réprimée. Il y a vraiment une… cassure. Quarante ans plus tard, les gens s’en souviennent très clairement. Beaucoup d’enseignantes et d’enseignants n’ont plus jamais voté pour le Parti québécois et ont déchiré leur carte de membre. Ça vraiment été une rupture entre le Parti québécois et les syndicats.

Parlant de cette cassure, peux-tu me décrire le conflit de travail dans le secteur public en 1982-1983, et me parler de la répression qu’ont subie les travailleuses ?
Pour commencer, il y a un élément que j’aimerais partager, je pense que ça vaut la peine de le souligner. Au départ, je voulais centrer mon projet de thèse sur les grèves. Puis, en faisant des entrevues, je me suis rendu compte qu’à part pour les femmes qui avaient été très impliquées syndicalement, les grèves n’avaient pas été aussi marquantes que je l’avais anticipé. C’est-à-dire que plusieurs travailleuses n’en gardaient pas nécessairement beaucoup de souvenirs. C’est surtout la dégradation de leurs conditions d’emploi au quotidien qui les avait marquées. J’ai donc revu la structure de mon projet. Les grèves sont importantes, mais peut-être pas autant que ce que l’historiographie syndicale a laissé croire. Ça m’a motivée à remettre en question le narratif de l’époque, notamment en relativisant l’idée selon laquelle les années 1980 étaient essentiellement marquées par des défaites, par des reculs et par la perte de combativité du mouvement syndical. On en reparlera.
Pour répondre plus directement à ta question, au sujet du conflit de 1982-1983, je reviens à ce que je mentionnais un peu plus tôt. En avril 1982, il y a un sommet économique à Québec où les centrales syndicales sont conviées. Des représentants du patronat sont aussi présents. À ce moment, le gouvernement annonce qu’il y a un manque à gagner de 700 millions de dollars dans les finances publiques et « consulte », entre guillemets, différents acteurs pour trouver comment résoudre cette crise des finances. Évidemment, la réduction des salaires dans le secteur public est l’une des solutions évoquées, à laquelle s’opposent assez fermement les syndicats. Mais ceux-ci sont prêts à négocier, et même à rouvrir les conventions collectives à certaines conditions, notamment que le gouvernement s’engage à ne pas décréter de façon unilatérale les conditions de travail, ni à modifier les régimes de retraite.
En juin 1982, quelques semaines après le sommet économique, le gouvernement adopte trois lois spéciales. D’abord, le projet de loi 68 modifie unilatéralement les régimes de retraite, ce qui a pour effet de réduire la contribution du gouvernement. Ensuite, il y a le projet de loi 70 qui prolonge la durée des conventions collectives durant trois mois, soit les trois premiers mois de 1983, et qui impose des réductions salariales pouvant atteindre 20 % durant cette période. C’est donc un cinquième du salaire de milliers d’employé·es du secteur public qui est coupé au début de l’année 1983, dans un contexte économique extrêmement difficile pour les ménages. Enfin, le projet de loi 72 remplace le Conseil sur le maintien des services de santé et des services sociaux par le Conseil des services essentiels. En pratique, le gouvernement s’octroie un pouvoir discrétionnaire pour déterminer les services à maintenir en cas de grève, ce qui va avoir des effets sur la portée des conflits dans le secteur hospitalier. Et ces trois lois spéciales sont adoptées pendant les négociations avec les employé·es du secteur public, laissant donc très peu de marge de manœuvre pour les syndicats.
Le 10 novembre 1982, il y a une première journée de grève « illégale » du front commun et le gouvernement réplique avec de nombreuses sanctions. Puis, le 11 décembre 1982, il adopte le projet de loi 105 qui met fin aux négociations et fixe par décret les conditions d’emploi des salarié·es de l’État jusqu’en décembre 1985. Les décrets prévoient plusieurs reculs dans les conditions de travail non seulement sur le plan salarial, mais aussi par rapport à la tâche et à l’autonomie professionnelle. Par exemple, dans le milieu scolaire, il a un alourdissement de la charge de travail avec l’augmentation du nombre d’heures d’enseignement, ou encore le retrait de l’encadrement en matière de ratio enseignante / élèves. Dans le secteur de la santé, plusieurs mesures des décrets facilitent les abolitions et la flexibilisation des postes. La structure de l’emploi est considérablement fragilisée.
C’est évidemment un choc pour le front commun. Malgré la suspension du droit de grève, le personnel enseignant des cégeps et des écoles entre en grève générale illimitée les 26 et 27 janvier 1983. Certains syndicats de la santé et des services sociaux concluent quelques ententes sectorielles, ce qui évite des grèves dans le secteur hospitalier. Assez rapidement, les enseignantes et les enseignants se trouvent donc isolé·es et dans une posture de désobéissance qui est difficile à tenir. Le contexte social et politique est extrêmement tendu. En comparaison, si on regarde la dernière grève des enseignantes en 2023 au Québec, la population appuyait en majorité les revendications des syndicats. Mais pendant la grève de 1983, tout le discours gouvernemental contre les employé·es du secteur public soi-disant privilégié·es, et l’opposition avec le secteur privé, ça fonctionne. Il n’y a pas de mouvement d’appui large derrière les syndicats qui désobéissent. Donc c’est loin d’être évident. Il y a des gens qui essaient de rentrer au travail et de franchir les lignes de piquetage, il y a des affrontements devant les écoles.
Après trois semaines de grève, le 16 février 1983, le gouvernement adopte la loi 111 qui force la reprise du travail sous peine de sanctions extrêmement sévères. Les travailleuses et les travailleurs risquent une perte de trois années d’ancienneté et de deux jours de salaire pour chaque jour de grève. La loi suspend aussi la présomption d’innocence et inverse le fardeau de la preuve en cas de désobéissance. C’est une répression majeure, qui est inédite à l’époque. Pendant quelques jours, les syndicats tentent de la défier, ce qui expose les grévistes à des amendes et à des congédiements.
Finalement, les syndicats de l’enseignement décident de rentrer au travail le lundi 21 février 1983. Par cette trêve, ils espèrent renégocier et renverser certaines dispositions des décrets. Après une conciliation, quelques aménagements mineurs sont apportés, mais dans l’ensemble, les conditions de travail sont imposées de façon unilatérale par le gouvernement. Comme je t’expliquais, c’est un coup extrêmement difficile pour les centrales syndicales et pour le front commun en général. D’ailleurs, lors des grèves suivantes, il n’y aura pas de front commun et les centrales syndicales négocient de façon séparée. Ce n’est donc pas un « happy ending », mais les syndiqué·es n’arrêteront pas pour autant de se battre. Il y a plusieurs luttes très importantes au cours des années suivantes.

Maintenant qu’on a parlé des restructurations économiques du néolibéralisme et de son imposition par le pouvoir politique au Québec, j’aimerais qu’on discute de la manière dont ces mesures ont affecté les travailleuses et les travailleurs. Dans ta thèse, tu parles d’une taylorisation du travail dans le secteur public, j’ai trouvé que c’était une manière intéressante d’aborder la question. À l’aide de ce terme ou d’autres qui te semblent pertinents, voudrais-tu décrire comment l’imposition du néolibéralisme se réalise concrètement, notamment en éducation et dans la santé ?
Dans le secteur de l’éducation, plusieurs choses se passent en même temps. Au-delà d’une taylorisation, je dirais qu’on assiste surtout à une précarisation de l’emploi, à un alourdissement de la charge de travail, à une complexification de la tâche et à des attaques contre l’autonomie professionnelle. Dès la fin des années 1970, il y a une baisse démographique qui fait en sorte qu’il y a moins d’élèves, et donc, qu’on a besoin de moins d’enseignantes. Une certaine précarité commence à s’installer, mais elle sera ensuite surtout le résultat de l’alourdissement de la tâche qui vient avec les décrets, imposés à partir de 1983. C’est-à-dire que si on augmente le nombre d’élèves par classe, ou encore le nombre de groupes des enseignantes du secondaire, ça crée un « surplus » de personnel qui se trouve ensuite réaffecté à d’autres tâches, ou encore maintenu dans une situation de précarité. Les enseignantes ou les professionnel·les qui commencent leur carrière pendant cette période peuvent connaître une dizaine d’années de précarité, avec des remplacements de plus ou moins longue durée, avant d’avoir une certaine stabilité.
Au début des années 1980, c’est aussi la mise en œuvre des premières politiques d’intégration des élèves en difficulté d’adaptation et d’apprentissage. Les fondements sont légitimes, c’est-à-dire qu’on ne veut plus que les élèves en difficulté soient marginalisés, exclus ou connaissent un parcours scolaire à part ; on veut qu’ils aient un parcours scolaire le plus « normal » possible. Par contre, c’est implanté en pleine vague de compressions budgétaires. Certains groupes d’adaptation scolaire sont fermés de façon précipitée pour faire des économies. Évidemment, pour les commissions scolaires, ça coûte moins cher que les élèves en difficulté soient dans une classe régulière, avec des ratios de 26 ou 27 élèves par classe, plutôt que dans un groupe spécial où ils sont environ 12 ou 13. Cette intégration entraîne une complexification de la tâche pour les enseignantes qui, au début des années 1980, ne reçoivent pas, ou très peu, de formation pour accompagner les élèves en difficulté. Au même moment, des ressources se font couper, par exemple en orthopédagogie. C’est donc une situation difficile, autant pour les enseignantes que pour les élèves et leurs parents.
À partir de 1982, il y a aussi une refonte des programmes pédagogiques et des méthodes d’évaluation. La pédagogie par objectifs, qui est imposée par le ministère de l’Éducation, vise une évaluation qui est beaucoup plus serrée, plus précise, et qui est donc plus exigeante pour les enseignantes. Les décrets retirent également certaines clauses qui garantissaient une consultation et une autonomie des enseignantes en matière d’outils d’évaluation et de méthodes pédagogiques. C’est certain que l’intégration des élèves en difficulté ou le nouveau régime pédagogique, ce ne sont pas des mesures néolibérales en soi, mais si on les situe dans leur contexte plus large – compressions budgétaires, précarisation, réduction des ressources, décret des conditions d’emploi –, on constate que ça complexifie et ça alourdit la charge de travail de façon importante. D’une certaine façon, l’État peut forcer une plus grande « productivité » chez les enseignantes en leur imposant un plus grand nombre d’élèves – dont les besoins sont plus complexes – et plus d’heures d’enseignement.
Dans le secteur de la santé, il y a aussi une précarisation de l’emploi assez majeure. Beaucoup de postes à temps plein sont abolis au profit de postes à temps partiel, occasionnels ou sur appel. Alors qu’au début des années 1980, on avait une majorité de postes à temps complet dans le secteur hospitalier, à la fin de la décennie, on a une majorité de postes à temps partiel ou occasionnels. Il y a vraiment un basculement. Les équipes soignantes sont de plus en plus instables parce qu’il y a plus de roulement et plus de remplacements, et il y a moins de gens qui sont là de façon permanente. Sur le plan de la charge de travail au quotidien, ça devient beaucoup plus complexe parce qu’il y a moins de stabilité et de prévisibilité. Quand il y a des patients avec des problèmes qui sont plus lourds, le personnel expérimenté doit les prendre en charge, alors que les infirmières ou les préposées qui sont là en remplacement ne peuvent pas nécessairement assurer ce travail complexe.
Dans les hôpitaux, on observe plusieurs mesures de privatisation, de sous-traitance, de taylorisation et de rationalisation du travail. Les services auxiliaires comme la buanderie, l’entretien ménager ou les services alimentaires, sont particulièrement touchés. À partir des années 1980, il y a beaucoup de sous-traitance dans les buanderies. Plutôt que le linge d’hôpital soit nettoyé dans chaque établissement, des appels d’offre sont lancés et ce travail est désormais réalisé dans des centres externes, par des entreprises privées ou par d’autres hôpitaux. On met en compétition les fournisseurs pour réduire les coûts, quitte à diminuer la qualité du travail et les conditions des employé·es. Dans certains cas, ce sont même des prisons qui reçoivent des contrats de buanderie, et donc les prisonniers font ce travail à moindre coût et avec peu d’équipement et de protection face aux risques de contact avec le linge d’hôpital contaminé.
Du côté de l’entretien ménager, certaines administrations hospitalières engagent des firmes externes pour observer et évaluer les préposé·es à l’entretien, puis leur imposer une séquence de gestes pour accélérer leur cadence et nettoyer plus d’espace en moins de temps. Certains outils de travail plus lourds ou plus difficiles à manier sont imposés pour accroître le rythme de travail et la productivité. Dans les services alimentaires, plus d’aliments sont préparés à l’externe, congelés, puis envoyés à l’hôpital, plutôt que d’être apprêtés sur place. Quelques hôpitaux décident d’octroyer des contrats de sous-traitance pour les services de cafétéria ou de casse-croûte. On assume que les hôpitaux sont restés des établissements publics, mais à l’interne, il y a beaucoup de privatisation et de sous-traitance qui s’est faite depuis les années 1980. Il y a même un hôpital qui a été acheté par la firme Lavalin en 1986, c’est toute une histoire.
Certaines techniques « taylorisantes » ont été imposées, par exemple ce que les préposé·es aux bénéficiaires appelaient le système « car wash ». Avec ce système, les patient·es qui avaient besoin d’être lavé·es, par exemple des personnes non autonomes ou en hôpital psychiatrique, passaient par une espèce de « chaîne de montage ». Plutôt que ce soit une seule personne préposée qui lave le patient du début à la fin, il y avait un préposé qui déshabillait, l’autre qui lavait, l’autre qui séchait, l’autre qui rhabillait. C’était comme une chaîne de montage, amenant une déshumanisation dans les services auprès des bénéficiaires. Dans les hôpitaux psychiatriques, les gens qui étaient déjà vulnérables, qui avaient déjà un lien fragile avec les préposé·es, ont vécu ça très durement. C’est déshumanisant, ça brise la confiance et ça ne donne pas un soin de qualité. Cette pratique a évidemment été dénoncée et contestée par les syndicats. Comme je disais plus tôt, on connaît relativement bien les grèves et les lois spéciales des années 1980, mais c’est fondamental de voir ce qui se passe à l’intérieur des écoles et à l’intérieur des hôpitaux. C’est ça qui permet de comprendre l’impact et la violence des réformes néolibérales dans le quotidien des gens, et de voir leurs résistances aussi.
« Dans les années 1980, il y a une crise de la reproduction sociale qui découle de la transition néolibérale. C’est-à-dire que face à un désengagement de l’État dans la prise en charge de certaines responsabilités sociales, les individus, les familles et les communautés sont de moins en moins aptes à répondre à leurs besoins en matière de soins, d’éducation et de soutien.
Les femmes, en particulier, se retrouvent prises en étau entre la nécessité économique de travailler à temps plein, l’absence de sécurité d’emploi, l’accroissement de leurs responsabilités et le manque de services pour les décharger de leur fardeau domestique. Mais cette situation de crise met encore plus de l’avant la nécessité de lutter pour avoir accès à des garderies et à des congés de maternité ou des congés parentaux ; de lutter pour que le travail des femmes cesse d’être dévalué. Les contradictions amènent des luttes, c’est important de le souligner. »

Je pense que tu as raison, parce que même si les grèves sont des moments révélateurs, c’est dans le quotidien qu’on saisit les restructurations et leur portée. En ce sens, je voulais te demander, comme tu as procédé à beaucoup d’entrevues, qu’est-ce que les travailleuses enseignantes ou infirmières se rappellent de la décennie ? Comment elles ont vécu cette restructuration du travail ? Puis comment elles y ont résisté ?
C’est sûr que ça été des années extrêmement difficiles. Dans la mémoire syndicale et dans les publications sur le sujet, il y a cette idée que les luttes des années 1960-1970 avaient réussi à amener une certaine stabilité d’emploi et des conditions salariales plus intéressantes, et que dans les années 1980, finalement, il y a vraiment un ressac antisyndical. Il y a effectivement un « backclash ». Le gouvernement du Parti québécois se retourne contre les travailleuses et les travailleurs, mais c’est aussi tout le climat social qui se transforme. Le modèle de l’État-providence est remis en question. La propagande contre les syndicats et contre les employé·es du secteur public est très présente. C’était des années extrêmement difficiles. Pour les femmes qui travaillaient ou luttaient déjà, elles ont vécu les années 1980 comme un recul. Celles qui ont commencé leur carrière pendant cette période ont connu des années de précarité avant d’aspirer à une certaine sécurité d’emploi.
Mais ce que j’ai constaté aussi, c’est que les années 1980 ont été assez déterminantes pour les femmes dans le mouvement syndical. Et ça, c’est quelque chose dont les historiens du syndicalisme, comme Jacques Rouillard, ne parlent pas beaucoup. Dans plusieurs publications, les années 1970 sont souvent idéalisées comme une sorte d’âge d’or du syndicalisme, avec les fronts communs et des grèves majeures. Mais les femmes sont pratiquement absentes des directions syndicales. Quand on pense au front commun de 1972, on voit surtout les trois chefs syndicaux, Marcel Pepin, Louis Laberge et Yvon Charbonneau. On connaît bien certaines figures comme Michel Chartrand ou Norbert Rodrigue, mais les femmes qui forment la majorité des employé·es du secteur public, elles sont pratiquement invisibles. Certes, il y a des comités syndicaux de condition féminine qui sont créés à partir de 1973, mais c’est surtout dans les années 1980 que les revendications des femmes auront plus de visibilité dans le mouvement syndical. Comme une participante à mon étude a expliqué, durant cette période, il fallait non seulement lutter pour conserver des acquis, mais il fallait aussi se battre pour aller chercher de nouveaux gains pour les femmes, comme des congés de maternité, l’accès aux garderies ou l’équité salariale.
La décennie 1980 n’apporte pas que des reculs dans le mouvement syndical ; c’est aussi un moment crucial pour l’entrée des femmes dans certains postes de pouvoir syndicaux et pour l’avancement des revendications féministes. Par exemple, la négociation de 1989 a été très importante en ce qui concerne l’équité salariale. C’est aussi pendant cette période que l’accès aux congés de maternité est élargi, notamment pour les employées à statut précaire. Le leadership syndical se transforme également. L’arrivée de Monique Simard comme vice-présidente de la CSN, en 1983, est assez déterminante. En 1987, les trois fédérations d’infirmières fusionnent pour créer la FIIQ et la nouvelle présidente, Diane Lavallée, va jouer un rôle important dans les négociations suivantes. En 1988, Lorraine Pagé est élue à la tête de la CEQ et devient la première femme présidente d’une centrale syndicale au Québec. C’est donc un changement significatif par rapport aux années 1970, où les chefs syndicaux étaient tous des hommes. À la fin des années 1980, on voit au contraire des femmes qui tiennent tête au gouvernement et qui dénoncent les réformes néolibérales et leur impact sur les femmes. Et il y a beaucoup à dénoncer, car les conséquences sont nombreuses ; pas seulement pour les travailleuses du secteur public, mais aussi pour toutes les femmes en tant qu’utilisatrices des services publics et comme principales bénéficiaires des politiques sociales de l’État.
Par exemple, si le gouvernement coupe les soins à domicile, ce sont des femmes qui s’occupent des personnes vulnérables à la maison. Si le gouvernement n’investit pas dans les garderies, ce sont encore les femmes qui se retrouvent avec des services de mauvaise qualité ou qui sont inaccessibles. Quand on observe les luttes des femmes durant cette décennie, on se rend compte que c’est vraiment une période intéressante pour ça. C’est une période où les femmes ont été très combatives, très mobilisées. Si on regarde la grève des infirmières en 1989, ça prenait du courage pour défier la loi 160 [Loi assurant le maintien des services essentiels dans le secteur de la santé et des services sociaux] qui était en vigueur : les grévistes s’exposaient à la perte de deux ans d’ancienneté par jour de grève. Pour que les infirmières s’engagent dans un conflit comme ça, il leur fallait de la combativité. Autrement dit, c’est vrai que les années 1980 sont marquées par les attaques du patronat et de l’État, mais c’est aussi une période de luttes et de courage des femmes, une époque de revendications féministes très fortes.

La tension monte entre les travailleuses en CPE et le gouvernement

Des perspectives de la gauche écosocialiste et écoféministe

La nouvelle période est caractérisée par la prise du pouvoir par des partis d'extrême droite dans différentes parties du monde, dont celle du parti de Donald Trump aux États-Unis. Cette situation pose une série de défis à la gauche écosocialiste et écofémiste et à l'ensemble de la gauche politique et sociale dans le monde, au Canada et au Québec. Québec solidaire est également confronté à ces défis et doit élaborer un programme, des stratégies et des actions pour y faire face. Pour ce faire, il est important que s'ouvre un large débat dans la gauche politique et sociale, et plus particulièrement au sein de Québec solidaire.
A. La nouvelle situation politique et les fondements de la nécessité d'une orientation écosocialiste
Notre projet politique doit s'inscrire dans une situation politique singulière. Un des éléments essentiels de la conjoncture politique est la victoire de Trump et les nouvelles orientations qu'il met de l'avant : a) des menaces de s'approprier le Groenland et le canal de Panama par une intervention militaire ; b) la multiplication des tarifs contre la Chine et contre des alliés, comme l'Europe et le Canada ; c) la défense des énergies fossiles contribuant à approfondir la crise climatique ; d) une offensive généralisée contre l'État social et les classes ouvrières et populaires des États-Unis et de l'ensemble des pays impérialistes ; e) des mesures favorisant la concentration de la richesse et le démantèlement des services publics ; f) le soutien aux partis d'extrême droite du monde ; g) la consolidation des politiques de prédation des ressources naturelles jusqu'à la remise en cause radicale des relations internationales marquées par le droit ; h) la militarisation des économies et la préparation à des guerres avec les puissances impérialistes concurrentes.
Comme l'écrit Romaric Godin : « Soyons clairs : les États-Unis ne deviennent pas impérialistes avec Trump, mais cet impérialisme change de nature. Il ne laisse plus la place à l'illusion de la souveraineté, il ne s'embarrasse pas de contreparties. Ce que cherche la nouvelle administration, c'est une vassalisation complète où les intérêts économiques des États-Unis seraient sanctuarisés. C'est un impérialisme de prédation. »(Le monde diplomatique, janvier 2025)
La présence d'un parti néofasciste à la tête de la plus grande puissance impérialiste, voisine du Canada, va avoir un impact majeur sur la politique canadienne et sur la politique québécoise. Déjà, les élections fédérales sont déterminées par la question de ce qui rendra possible une résistance aux politiques et aux pressions de Trump sur la politique canadienne. Son gouvernement menace le Canada de tarifs douaniers importants. Il pousse le Canada à fermer hermétiquement ses frontières et à adopter une politique migratoire d'expulsion des migrant-es et des sans-papiers. Il cherche à amener le gouvernement canadien à augmenter son budget militaire. Il a déjà amené le gouvernement libéral à promettre de lever toute restriction au développement de l'industrie pétrolière et gazière. Toutes ces pressions visent à soumettre les politiques du Canada aux intérêts du capital américain.
La politique québécoise sera également impactée par ces politiques et ces pressions. Legault se dit déjà d'accord pour se rendre aux demandes de Trump en ce qui concerne la politique migratoire. La politique de croissance de la production d'énergie et d'extraction minière du gouvernement de la CAQ ne pourra que renforcer la crise climatique. La perspective de souveraineté sera également impactée par les positions que prendra l'administration Trump à cet égard. Où mènera la volonté du PQ de ne pas heurter l'impérialisme de son voisin ? Comment sera posée la perspective de la souveraineté et d'un éventuel référendum dans un tel contexte ? Nous devons approfondir nos discussions à ce niveau.
B. Pour une stratégie écosocialiste et écoféministe de rupture avec la domination capitaliste
La stratégie que la gauche écosocialiste et écoféministe doit défendre s'oppose à une stratégie électoraliste pour la construction d'un parti de gouvernement se voulant réaliste. La stratégie écosocialiste vise à construire le pouvoir dans la société par le renforcement de l'expression démocratique, de la combativité et de l'unité des différents mouvements sociaux antisystémiques.
La ligne de rupture que nous proposons, tant à la gauche sociale qu'à Québec solidaire, vise à rallier une majorité populaire. C'est celle de la lutte pour la mise en route d'un Québec indépendant qui nécessitera :
• la remise en question de l'exploitation de nos ressources naturelles et de notre énergie par des multinationales étrangères ;
• la planification démocratique de nos choix d'investissements pour une transition écologique juste et véritable qui s'oppose au capitalisme vert des gouvernements en place, favorise une décroissance dans l'utilisation des énergies et des ressources et une production centrée sur les besoins et le bien-vivre ;
• la mise en place d'institutions politiques d'un Québec indépendant dépassant la démocratie représentative, ce qui se fera dans le cadre de l'élection d'une constituante visant l'établissement d'une république sociale ;
• la lutte pour une société écoféministe assurant la fin de la domination patriarcale ;
• le développement de nos services publics contrôlés par les usagers et les usagères et les personnes qui y travaillent ;
• le refus de laisser dans la marge des secteurs de la société privés de droits, comme ceux des travailleurs et travailleuses temporaires et des sans-papiers ;
• la liberté de circulation et d'installation de toutes les personnes migrantes ;
• l'éradication du racisme systémique qui touche tant les peuples autochtones que les autres secteurs racisés de la population ;
• une politique linguistique qui défend l'usage du français comme langue commune, mais qui refuse de faire des personnes immigrantes la cause du manque d'attractivité de la langue française ;
• le rejet d'une laïcité identitaire qui essentialise la réalité de la nation et
• la promotion d'un altermondialisme anti-impérialiste et antimilitariste visant l'émancipation des peuples.
C. Pour concrétiser ces perspectives stratégiques
Afin de rendre concrètes ces perspectives, nous devons travailler à l'atteinte d'objectifs politiques centraux s'articulant comme suit :
• Donner la priorité à l'intervention dans les mouvements sociaux comme forces essentielles de transformation sociale et d'émancipation.
• Construire une gauche écosocialiste dans les mouvements sociaux – des ailes gauches des mouvements autour de perspectives précises – mouvement syndical, mouvement écologiste, mouvement féministe et mouvement des jeunes.
• Proposer des orientations précises dans les débats au sein de Québec solidaire pour contrer les perspectives de recentrage du parti, ce qui implique l'élaboration de tout un éventail de propositions (au niveau du programme, de la plate-forme, de campagnes et d'initiatives militantes).
En mettant le cap sur cette orientation et pour atteindre ces objectifs, les médiations organisationnelles qui s'imposent sont les suivantes :
• Appuyer résolument les mobilisations sociales en cours et favoriser leur convergence dans un front uni des luttes contre l'antisyndicalisme, notamment le projet de loi 89, l'austérité et l'extrême droite (voir la résolution du Comité d'action politique provisoire intersyndical au 22e Conseil national de Québec solidaire).
• Faire connaître publiquement les débats qui traversent la gauche politique en tenant des assemblées publiques tenues sur une base régulière en collaboration avec des militant-es de la gauche sociale.
• Regrouper la gauche radicale au sein de Québec solidaire autour de cette lutte programmatique et de la défense de différentes initiatives.
La gauche écosocialiste et écoféministe vise à construire un regroupement de la gauche politique et de la gauche sociale des différents mouvements sociaux. Elle va également proposer une telle orientation à Québec solidaire. Ces perspectives visent à répondre aux défis de la nouvelle période.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Élections canadiennes : quand les partis parlent dans le vide

J'avoue ma frustration : dans cette campagne électorale, aucun parti ne s'adresse à moi.
Leurs messages se perdent dans une masse éthérée, impersonnels, enfermés dans des slogans stériles et un langage qui fuit la réalité de la rue. Autour de moi, les gens répètent comme un mantra : "Ils se ressemblent tous". Et ils n'ont pas tort. Mêmes costumes, mêmes gestes de courtoisie vide, même défense du système. Les différences sont minimes, comme si le jeu politique consistait à se fondre dans le décor et à laisser les couleurs parler à leur place : bleu, rouge, orange, vert.
Les oranges et les verts - soi-disant progressistes - ont opté pour un ton poli, presque complaisant.
Cette obsession de préserver les apparences m'inquiète quand le monde brûle :
Gaza : plus d'un an et demi de génocide, avec des familles entières qui voient mourir les leurs jour après jour.
Trump : une guerre économique qui menace de laisser des milliers de Canadiens sans emploi.
La crise : emplois précaires, salaires insuffisants, expulsions, vies brisées par un système qui rejette les gens.
Face à la peur et à la frustration populaire, les partis de gauche (orange et vert) persistent à céder du terrain aux rouges libéraux, comme si le respect des élites valait plus que la justice.
Je parle avec mes voisins, avec des travailleurs, avec ceux qui souffrent : ils fuient les partis comme la peste. Pourquoi ? Parce qu'ici règne un consensus tacite de paix sociale, une fiction où le conflit est balayé sous le tapis. Les rues pourraient brûler par nécessité, mais eux continueraient à parler d'"unité" et de "dialogue".
Nous - ceux qui vivons au quotidien dans le conflit - n'avons pas notre place dans ce récit. Ceux qui craignent l'expulsion, qui pleurent les morts de Gaza, du Soudan ou du Congo, qui survivent avec trois jobs et n'arrivent toujours pas à joindre les deux bouts. Pour nous, il n'y a pas de discours.
S'ils voulaient vraiment nous parler, les partis devraient :
Descendre dans la rue : soutenir nos luttes par des actes, pas par des prospectus.
Apprendre notre langage : abandonner le jargon politique et parler clairement, sans filtre.
Se salir les mains : faire partie de notre réalité, pas être des touristes de la souffrance d'autrui.
Un jour, les oranges et les verts comprendront pourquoi ils ne gagnent jamais : nous avons besoin de souris qui défendent les souris, pas de chats déguisés. Je voterai orange, oui, mais mes voisins - crevés et dégoûtés - ne feront même pas l'effort de les distinguer. Et qui pourrait leur en vouloir, quand même les couleurs semblent se dissoudre dans le même brouillard.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
La dimension humaine oubliée

La politique sexuelle de la viande

« Les batteurs de femmes ont souvent employé l'absence de viande comme prétexte pour leurs gestes brutaux. Ce n'est pas le fait que les femmes ne servent pas de chair qui constitue le motif de la violence perpétrée à leur endroit. Les hommes dominateurs l'utilisent, comme ils le font d'autres facteurs, à titre d'excuse pour leur violence. Mais puisque les « vrais » hommes mangent de la viande, les agresseurs disposent d'un symbole culturel duquel tirer parti afin de détourner l'attention de leur besoin de contrôle. »
La politique sexuelle de la viande
Parution le 1 avril 2025 au Québec
Dans ce livre culte publié en 1990 aux États-Unis, Carol J. Adams propose une analyse percutante de l'intersection entre virilité et exploitation animale. Elle montre que la domination patriarcale repose autant sur le massacre des animaux que sur le contrôle et l'objectivation du corps des femmes.
Ses analyses littéraires, sociologiques, historiques et médiatiques permettent d'élaborer la thèse du « référent absent » et de révéler les structures communes du sexisme, du racisme et du spécisme. Insistant sans détour sur la nécessité de la convergence des luttes, l'autrice nous rappelle qu'il est « plus que temps de nous pencher sur la politique sexuelle de la viande, car elle n'est pas séparée des autres questions urgentes de notre époque ».
Comment combattre l'oppression des femmes et des groupes minorisés si nous sommes incapables d'admettre la violence du régime carné ? Trente-cinq après sa parution originale, ce classique est toujours aussi pertinent.
« Le lien entre domination et consommation de chair ne relève pas du hasard. Depuis des décennies, toute avancée féministe s'accompagne d'une résistance cherchant à réaffirmer un ordre hiérarchique traditionnel – et la viande n'en est qu'un symbole parmi d'autres. »
Extrait de la préface par Élise Desaulniers
CAROL J. ADAMS est militante féministe végane, chercheuse indépendantes et autrices de nombreux essais et articles. Son ouvrage le plus célèbre est sans contredit La politique sexuelle de la viande. Traduit dans plusieurs langues et maintes fois réédité, l'essai célèbre cette année, son 35ᵉ anniversaire.
ÉLISE DESAULNIERS est directrice générale de la Fondation Dépendances Montréal. De 2017 à 2022, elle a été directrice générale de la SPCA de Montréal. Elle est également chercheuse indépendante et l'autrice des essais Je mange avec ma tête (Stanké, 2011), Vache à lait (Stanké, 2013) et Le défi végane 21 jours (Trécarré, 2016) traduits en plusieurs langues et adaptés pour la France. En 2019, elle a publié avec Patricia Martin Tables véganes (Trécarré) qui s'est mérité le Taste Awards d'or du meilleur livre de recettes au Canada (cuisine régionale et culturelle).
Pour marquer la parution des nouvelles éditions francophones de La politique sexuelle de la viande, Élise Desaulniers, éditrice à L'Amorce et préfacière de l'édition québécoise, a pris l'initiative d'inviter Carol J. Adams, autrice de l'ouvrage, et Nora Bouazzouni, préfacière de l'édition française, à partager leurs perspectives. Ces trois voix féministes et véganes, issues de différents horizons, explorent les interconnexions entre patriarcat, carnisme et contrôle des corps. Dans cet échange informel, nourri par une actualité brûlante, elles abordent les stratégies réactionnaires visant à restreindre les droits des femmes et les luttes antispécistes, ainsi que la montée des discours masculinistes et carnistes, et envisagent ensemble des pistes de résistance.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
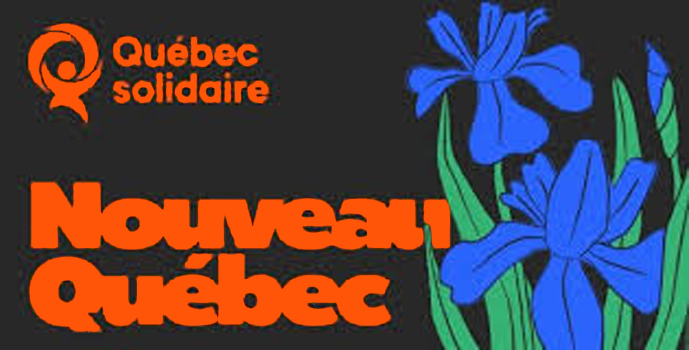
Québec solidaire doit refuser de se taire durant la campagne électorale fédérale
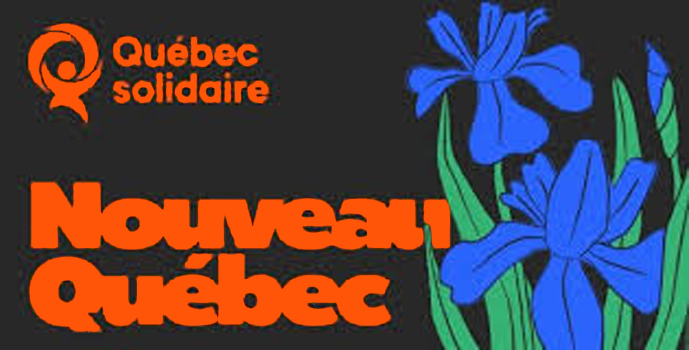
Le Cahier de propositions en direction du 22e Conseil national devant se tenir les 5 et 6 avril 2025, rappelait la posture traditionnelle du parti : Il est proposé qu'en prévision des prochaines sélections fédérales et des élections générales qui se tiendront à l'automne :
a) Les instances de Québec solidaire (Comité de coordination national, comités de coordination régionaux et locaux, Aile parlementaire, etc.) n'appuient directement ou indirectement aucun parti ou candidature ;
b) Que ce devoir d'impartialité s'applique également aux personnes élues des instances nationales de Québec solidaire ainsi qu'aux porte-parole des instances locales et régionales ;
c) Qu'aucune ressource humaine, logistique, informationnelle ou financière de Québec solidaire et de ses instances ne soit mise à la disposition d'un parti politique fédéral ;
d) Que les autres membres de Québec solidaire, sur une base individuelle, soient invités à soutenir le parti qui représente le mieux leurs valeurs en s'engageant à y défendre les principes et le projet de société de Québec solidaire ;
e) Que Québec solidaire et ses instances profitent de la campagne fédérale pour inviter les partis fédéraux à se positionner sur différents enjeux en accord avec le programme de Québec solidaire.
Le document ajoutait également : « Il est à noter que, si les élections fédérales sont déclenchées avant le 5 avril 2025, le Comité de coordination national reconduira la posture choisie en 2019 et la communiquera aux associations. » Comme les élections fédérales ont été déclenchées avant le 5 avril 2025, le Cahier de synthèse, publié le 25 mars 2025, faisait remarquer que « la posture du parti relative aux élections fédérales ne figure plus à l'ordre du jour ».
Pourtant, il aurait été utile de discuter des élections fédérales et de discuter et de préciser les nécessaires positionnements sur les différents enjeux dans le cadre de cette campagne électorale, comme l'invité le point e) de la proposition traditionnelle du parti. Au lieu de cela, on a mis de côté ces importantes discussions politiques et Québec solidaire se cantonnant dans son rôle de parti provincial gardant le silence sur l'action de l'État fédéral au Québec. Mais, il n'est pas trop tard pour sortir de cet apolitisme et pour préparer des interventions d'un parti indépendantiste véritable dans le cadre de la campagne électorale actuelle.
Sans remettre en question la posture visant à ne pas prendre position envers un parti lors des prochaines élections fédérales, il apparaît nécessaire que Québec solidaire se prononce sur des enjeux essentiels. Ces prises de position se situent dans le cadre de la défense de l'indépendance du Québec et en solidarité avec la classe ouvrière du Reste du Canada et avec les Premières Nations.
Pour actualiser le point e) et agir politiquement comme un parti indépendantiste dans le cadre de cette campagne, Québec solidaire devrait intervenir pour défendre les principes suivants :
• L'opposition au développement des énergies fossiles et le refus de la construction de pipelines ou de gazoducs.
• Le refus d'abolir les privilèges fiscaux des plus riches et l'affirmation de la nécessité de réformer la fiscalité pour la rendre plus juste et plus redistributive.
• L'opposition à l'augmentation de l'inflation et la revendication d'un contrôle des prix des aliments et des logements.
• La dénonciation de toute remise en question du droit à l'avortement.
• L'exigence de l'éradication des discriminations raciales et la proclamation du droit à l'autodétermination du Québec et des Premières Nations.
• Le refus de l'augmentation des budgets militaires aux dépens des dépenses sociales
• La fin de toute collaboration avec l'administration Trump sur le contrôle des frontières et l'ouverture à la circulation et à l'installation des personnes migrantes.
• La proclamation que c'est par l'indépendance articulée à un projet de société égalitaire que le Québec pourra le mieux défendre les intérêts de la majorité populaire, sa culture et la langue française contre les projets impérialistes de domination économique, politique et culturelle.
• La nécessaire alliance de la majorité populaire du Québec avec les classes ouvrières et populaires du ROC et les nations autochtones.
En intervenant sur ses propres bases, Québec solidaire ferait la preuve qu'il est un véritable parti indépendantiste qui sait lier son projet national d'en finir avec le fédéralisme oppresseur à son projet d'émancipation sociale.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Une comparaison qui ne trompe pas : Le trumpisme en nazisme de notre temps !

Malheureusement, la triste réalité est que, grâce surtout à Trump et ses plus proches collaborateurs*, le spectre de Hitler plane de nouveau sur l'Europe et le monde !* L'évènement est de taille car imprévu et n'entrant pas dans les calculs de tous ceux (médias, gouvernants, experts et autres « politologues ») qui nous assuraient que leur système avait appris la leçon et était désormais immunisé contre de telles… « folies ».
Cependant, le fait est que même les plus hésitants et incrédules d'eux commencent -enfin- à admettre cette triste réalité et à en parler. On ne peut que s'écrier mieux vaut tard que jamais. Toutefois, la confusion persiste : Trump est-il fasciste seulement parce qu'il prend des poses qui rappellent Mussolini ? Et Musk parce qu'il fait le salut nazi ? Évidemment, tous ces comportements ne sont pas à négliger, mais qualifier quelqu'un de fasciste ou de néonazi est une chose pleine d'implications trop importantes, et demande beaucoup plus que des références aux comportements et aux signes extérieurs de l'intéressé.
Alors, force est de constater que la meilleure preuve du fascisme de Trump et de ses amis, est celle offerte par leurs actes, par ce qu'ils sont en train de faire depuis qu'ils se sont installés à la Maison Blanche. Car, on s'empresse de dire que ce que le triumvirat de Trump, Musk et Vance fait depuis deux mois fait penser à ce qu'ont fait… Hitler, Goering et Goebbels durant leurs deux premiers mois au pouvoir. Et voilà tout de suite de quoi il s'agit à l'aide de l'excellent et tellement utile livre *« Le monde nazi 1919-1945 »(1)* dont les auteurs Johann Chapoutot, Christian Ingrao et Nicolas Patin nous avertissent opportunément que les nazis de 1933 ne sont pas encore les nazis génocidaires qu'ils sont devenus pas la suite, ils ne sont pas encore * « les ordonnateurs de Treblinka et de Birkenau, les concepteurs de Auschwitz…Ce sont des gens fréquentables ».* Alors, ayant cet avertissement préalable bien en tête, comparons ce qui est comparable, les deux premiers mois au pouvoir de Trump et de Hitler.
Tout d'abord, il y a cet extrême empressement, commun à Trump et à Hitler, à frapper simultanément vite et fort sur tous les fronts, afin de créer des faits accomplis et ne pas laisser aux adversaires le temps de s'organiser.
Chez Trump on a une avalanche (plusieurs centaines) des décrets signés et exhibés fièrement par lui-même. Dans le cas de Hitler, on a « *une pluie de décrets-lois qui s'abat sur l'Allemagne* ». Dans les deux cas, on constate le même souci des autocrates de « *mettre au pas* » leurs sociétés, de ne pas leur laisser le temps de comprendre ce qui leur arrive. Et également dans les deux cas, on a ces avalanches de décrets qui transforment déjà radicalement les deux pays au temps record de deux mois (!), à l'initiative du seul chef, et sans que le conseil de ministres se réunisse plus d'une fois en 60 jours ! Et tout ça en violant souvent allégrement toute légalité y inclue celle des constitutions…
Mais, qui sont ceux qui, en toute priorité, se trouvent dans le viseur de ces centaines de décrets-lois tant de Trump que de Hitler ? C'est l'État et ses fonctionnaires qu'il faut purger en masse, par centaines de milliers ! Pourquoi ? Mais, pour éliminer ceux qui sont des « ennemis", les juifs et les « marxistes » et autres gens de gauche pour les nazis. Ou ceux dont l'objet de leur activité professionnelle (changement climatique, genre, droits et libertés démocratiques, sécurité sociale, minorités, humanitaire, …) est jugé incompatible avec le trumpisme. Et aussi, pour mettre au pas les restants, et surtout pour terroriser et paralyser tous les autres, en créant et en propageant un climat de peur et d'insécurité générale !
Si cette véritable purge des fonctionnaires occupe une place de choix dans le projet plus qu'autoritaire des deux autocrates, il faut avouer que Trump et ses fidèles « innovent » et ne suivent pas à la lettre l'exemple des nazis allemands quand ils n'attaquent pas seulement les enseignants mais aussi l'éducation en tant que telle, allant jusqu'à faire disparaître le ministère de l'éducation ! De même avec la recherche et les sciences en général, qui ne sont pas du goût du trumpisme, lequel leur préfère ostensiblement les références…bibliques. *C'est le côté obscurantiste, rustre, inculte et aussi religieux intégriste du trumpisme (et aussi, de Trump lui-même)* qui le différencie des nazis lesquels préféraient endoctriner et embrigader plutôt que licencier les universitaires. C'est d'ailleurs pourquoi les rangs des SS étaient pleins, au moins jusqu'en 1943, de jeunes avocats, juristes, diplômés en sciences et même d'universitaires…
Si Trump se montre tout autant que Hitler empressé de « normaliser » l'armée, les services et les polices, force est de constater qu'il le fait beaucoup plus brutalement que le dictateur allemand. Là où le Führer allemand choisit d'amadouer ses généraux, se limitant à destituer ceux dans la police qui sont très marqués à gauche, Trump préfère purger tout de suite tout l'état-major et l'ensemble des directions des services secrets et du FBI !
D'autre part, à distance de 90 ans, tant le trumpisme que le national-socialisme ont attaqué, en toute priorité et avec la même brutalité, les juges et la justice de leurs pays, foulant aux pieds la séparation des pouvoirs. Mais, là où Hitler a procédé à une grande purge éliminant d'un coup les juges « non-aryens », Trump se limite pour l'instant à attaquer verbalement, mais avec une rare violence, les juges qui lui résistent, toute en destituant ou contraignant à démissionner des dizaines de procureurs et offrant à des milliers d'employés du département de justice des compensations s'ils se décident de démissionner.
Une autre priorité de ces deux régimes liberticides est leur empressement de se retirer des organisations internationales. Hitler l'a fait tout de suite en faisant sortir l'Allemagne nazie de la Société des Nations, tandis que, pour l'instant, Trump préfère retirer son pays de plusieurs traités et organisations internationales (climat, santé, droits humains…), pendant que son bras droit Elon Musk annonce que les Etats-Unis attendent le moment propice pour se retirer de l'ONU et de l'OTAN…
Mais, encore plus révélatrice des affinités électives de deux régimes, est leur *commune haine viscérale pour les droits et les libertés démocratiques* les plus élémentaires, dont la liberté d'expression. C'est ainsi qu'une fois au pouvoir, Trump et Hitler ont attaqué frontalement et en toute priorité les médias, Hitler en occupant leurs locaux, en saisissant leurs rotatives et en licenciant leurs journalistes, et Trump en interdisant à plusieurs d'entre eux l'accès à l'information et en menaçant ouvertement de faire disparaître les autres s'ils ne se soumettent pas à ses désirs.
Tout cela étant dit, *ce qui unit le plus Hitler, Trump et leurs acolytes est leur commun délire raciste ! *Le racisme principalement anti-juif et « accessoirement » anti-gitan et anti-homosexuel pour Hitler, et le racisme principalement anti-migrant et « accessoirement » anti-homosexuel, anti-trans et misogyne pour Trump. C'est ainsi que les juifs pour l'un et les migrants pour l'autre servent de parfaits boucs émissaires pour tous les maux, vrais ou imaginaires, de nos sociétés. Et cela afin de dédouaner d'avance les chefs et leurs régimes de leurs échecs et de leurs responsabilités, mais aussi afin d'offrir les victimes juifs ou migrants de ce racisme d'État en pâture à la base raciste et suprématiste de ces deux régimes. Détail éloquent : Nos gouvernants pourfendeurs du racisme de Trump et de Hitler, refusent d'accueillir les juifs chassés par l'un et les migrants chassés par l'autre. Évidemment, à la grande satisfaction de deux tyrans qui, tout en dénonçant, pour une fois à juste titre, l'hypocrisie de nos libéraux occidentaux…se sentent avoir les mains libres pour déporter et enfermer dans des camps jadis les juifs, et maintenant les migrants.
Et pour terminer, comment ne pas penser que Trump s'inspire de l'exemple hitlérien quand on le voit faire du Canada son… Autriche auquel il veut imposer son…Anschluss, pour l'annexer et le transformer, « par tous les moyens », en 51e état des Etats-Unis d'Amérique ? Ou aussi, quand il remplace le tristement célèbre *lebensraum* (espace vital) hitlérien par ses propres « besoins de la sécurité nationale » des Etats-Unis pour « justifier » ses prétentions sur le Panama ou le Groenland, lesquelles d'ailleurs n'ont rien à envier à celles de Hitler sur la Tchécoslovaquie ou la Pologne ?
Et enfin, que dire du véritable guet-apens tendu à la Maison Blanche au Président Ukrainien Volodymyr Zelensky par Trump et Vance, lequel ressemble comme deux gouttes d'eau à celui tendu en 1939, à la chancellerie de Berlin, au Président de la Tchécoslovaquie *Emil Hacha *par Hitler et Goering ? La seule différence est que tandis que *Zelensky* a résisté aux menaces et à l'humiliation, le pauvre Hacha terrorisé et au bord de la crise cardiaque, a cédé, signant la fin de son pays…
Conclusion : depuis deux mois, tout se fait à la Maison Blanche comme si Trump suivait presque à la lettre les conseils d'un manuel d'action qu'aurait ecrit Hitler lui-meme. C'est d'ailleurs pourquoi ceux qui persistent à nier que Trump, Vance, Musk et leurs amis sont des fascistes pur-sang, font penser de plus en plus à tous ceux qui en 1939, persistaient à dire que « son Excellence le Chancelier Hitler » était peut-être un peu trop remuant mais qu'il allait se calmer, parce qu'en réalité, il ne voulait que la paix. On connaît la suite…
*Notes*
*1.**Le Monde nazi 1919-1945*, p.626, edit.Tallandier
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La gauche approuve l’impartialité de la justice !

Les Politiques véreux ont un faible pour l'abus du Pouvoir et ses mannes étourdissantes. Comme Sarkozy, Marine le Pen a succombé à la force de sa position et mangé dans le râtelier des « Ripoux » sur le dos des Européens (es). La figure de proue de l'Extrême Droite a été condamnée à 5 ans d'inéligibilité pour détournement de fonds publics.
De Paris, Omar HADDADOU
Des élus (es) du Peuple se figurant au-dessus de la Loi, se calent les joues jusqu'à l'asphyxie, par la magouille !
La torgnole infligée par la Juge Bénédicte de Pertuis, 63 ans, menacée de mort, selon l'AFP, par des Ultras de l'Extrême Droite, a fait le tour du monde. L'Eurodéputée et ancienne cheffe du Parti, Marine le Pen, n'a pas dérogé au cérémonial des Politiques hors caste, imbus (es) de leur Pouvoir et leur Liberté à extorquer l'argent du contribuable.
Piquer dans la caisse est devenu une Religion pour certains Députés (es) improbes ! La République avance avec ses panaches surfaits et ses souillures aspergées à l'eau bénite. La Gauche et ses Elus (es) en lutte contre les inconduites indécentes et gloutonneries financières de l'extrême Droite, ont contribué à la mise à nu de ces dérives politicofinancière. Des témoignages relayés par les médias publics et privés n'ont cessé de débusquer le train de vie fastueux de Marine le Pen, son entourage et sa famille politique.
Epaulée par la Bourgeoisie, les magnats de l'Industrie française et les médias, Marine le Pen, à l'instar de Sarkozy ( 2 avocats véreux ) est convaincue de ne pas y laisser ses plumes dans ce procès.
C'est avec condescendance qu'elle a quitté la salle d'audience du Tribunal Correctionnel de Paris, ce lundi 31 mars 2025, après l'annonce du jugement. La Cheffe de file du Rassemblement national a été condamnée à une peine de 4 ans de prison dont 2 fermes et 5 ans d'inéligibilité avec application immédiate, ainsi que 100 000 euros d'amende, au procès des assistants parlementaires du Front national.
L'immédiateté de l'application l'empêche de se présenter pour la quatrième fois au Elections présidentielles de 2027. Le Parti est condamné pour avoir profité de plusieurs millions d'euros du Parlement européen en vue de financer son parti le Rassemblement National (RN).
Il est de tradition que les partis politiques français piochent dans la caisse. Mais au niveau européen les dépenses sont très encadrées. D'où la sentence à l'encontre de l'élue qui doit se battre en faisant appel au plus tôt (trop tard selon les Juristes) pour la suspension de l'exécution. Sonnée, Marine le Pen ne s'avoue toutefois pas vaincue et s'en prend à la Justice : « Il tentent d'empêcher par tous les moyens mon accession à l'Elysée. C'est un jour funeste. Je ne vais pas me laisser éliminer. L'Etat de Droit a totalement été violé par la décision judiciaire dans des pratiques réservées aux régimes autoritaires », a-t-elle déclaré. Et le Président du RN, Jordan Bardella, de lui emboiter le pas, se dit « sous le choc d'une décision brutale et antidémocratique ».
Selon un sondage, 57% des Français (es) jugent cette décision normale au vu des faits reprochés. La Gauche a rappelé à ce titre la souveraineté de la Justice. Pour le Député socialiste, Emmanuel Grégoire, l'institution n'a fait qu'appliquer la loi : « Il y a un principe de séparation des pouvoirs. Les Juges sont formés (es) pour porter un jugement et à aucun moment on ne peut s'exonérer du respect de la Loi sous prétexte de légitimité démocratique. Ça n'existe pas ! » Puis son collègue Jérôme Guedj de préciser : « Le problème démocratique, ça a commencé par un détournement de Fonds publics et le non-respect d'une Loi ». Dans la même trajectoire, Alexis Corbière, Député écologiste et social, pointe : « Je rappelle que le RN est une force politique qui se fait connaître dans tous les débats pour que la Loi soit sévère. La Loi est appliquée et s'appliquera à tous et toutes ».
Jean Luc Mélenchon, voyant l'horizon de la Gauche se dégager à pas comptés, reste droit dans ses bottes en déclarant humblement : « LFI battra dans les urnes, le Rassemblement National ! »
Le Pouvoir politique opère des morales et des magies, celles de se nourrir de ses infamies !
O.H
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.











