Revue Droits et libertés
Publiée deux fois par année, la revue Droits et libertés permet d’approfondir la réflexion sur différents enjeux de droits humains. Réalisée en partenariat avec la Fondation Léo-Cormier, la revue poursuit un objectif d’éducation aux droits.
Chaque numéro comporte un éditorial, les chroniques Un monde sous surveillance, Ailleurs dans le monde, Un monde de lecture, Le monde de l’environnement, Le monde de Québec, un dossier portant sur un thème spécifique (droits et handicaps, droits des personnes aînées, police, culture, droit à l’eau, profilage, mutations du travail, laïcité, etc.) ainsi qu’un ou plusieurs articles hors-dossiers qui permettent de creuser des questions d’actualité. Les articles sont rédigés principalement par des militant-e-s, des représentant-e-s de groupes sociaux ou des chercheuses ou chercheurs.
Créée il y a 40 ans, la revue était d’abord diffusée aux membres de la Ligue des droits et libertés. Depuis, son public s’est considérablement élargi et elle est distribuée dans plusieurs librairies et disponible dans certaines bibliothèques publiques.
Bonne lecture !

Regards critiques sur l’incarcération

[caption id="attachment_19730" align="alignleft" width="336"] Artiste : Eve[/caption]
Artiste : Eve[/caption]
La Ligue des droits et libertés consacre son nouveau numéro de Droits et libertés aux enjeux liés à l'incarcération au Québec.
Disponible dès juin 2024, ce numéro rassemble des perspectives critiques sur plusieurs facettes de l'incarcération à travers unevingtaine d'articles.
Page après page, le fil des logiques carcérales se déroule. Ces logiques ont beau constituer la norme, elles révèlent leurs noeuds et leurs failles en matière de réparation envers les victimes, de réinsertion sociale, de dissuasion et de la diminution de la violence. L'incarcération produit et reproduit des violations de droits, de la détresse et des discriminations que les réformes du système carcéral ne peuvent pas enrayer.
Dans bien des cas, le recours à l'enfermement est une réponse punitive et restrictive de liberté à des enjeux sociaux, résultat d'un désengagement de l'État quant à ses obligations en matière de droits économiques et sociaux. Le dossier se termine en dégageant de nouvelles avenues, plaçant les victimes d'actes criminels au coeur de la justice transformatrice.
Bonne lecture!
Procurez-vous la revue Droits et libertés!
- Devenez membre de la LDL pour recevoir deux numéros de Droits et libertés par année!
- Numérique (PDF) : 8 $
- Imprimée incluant livraison* : 11 $ incluant les frais de poste
- Abonnez-vous à deux numéros : 15 $ pour un abonnement individu ou 30 $ pour un abonnement organisation.
Dans ce numéro
Éditorial
Les services publics et les droits humains : deux faces d'une même médailleAlexandre Petitclerc
Chroniques
Ailleurs dans le monde
La Palestine, un test pour l'humanitéZahia El-Masri
Un monde sous surveillance
Un trio législatif… accommodant pour l'industrieAnne Pineau
Le monde de l'environnement
Fonderie Horne : une allégorie de l'opacitéLaurence Guénette
Un monde de lecture
Un autre soi-mêmeCatherine Guindon
Dossier principal
Regards critiques sur l'incarcération
Présentation
Dérouler le fil des logiques carcéralesDelphine Gauthier-Boiteau
Aurélie Lanctôt Un portrait de la population carcérale
Aurélie Lanctôt
Violations de droits
Rien ne change pour les femmes incarcéréesJoane Martel Prison et déficience intellectuelle, ça ne va pas!
Samuel Ragot
Guillaume Ouellet
Jean-François Rancourt Portes tournantes : une spirale sans fin
Philippe Miquel Quand la prison fait mourir
Catherine Chesnay
Mathilde Chabot-Martin Être en prison dans une prison
Lynda Khelil
Me Nadia Golmier Contre vents et marées : liens avec un proche incarcéré
Sophie Maury Le Protecteur du citoyen, un pouvoir limité
Daniel Poulin-Gallant Le politique, le Code criminel et la prison
Jean Claude Bernheim
D'autres formes d'enfermement
La prison, l'antichambre de la déportationPropos recueillis par Laurence Lallier-Roussin L'enfermement en centre jeunesse
Ursy Ledrich Pinel : Les cas complexes crient au secours !
Jean-François Plouffe
Remise en question de l'incarcération
La prison comme institution colonialeEntretien avec Cyndy Wylde
Propos recueillis par Alexia Leclerc Qu'en est-il des systèmes carcéraux et des abolitionnismes?
Entretien avec Marlihan Lopez
Propos recueillis par Delphine Gauthier-Boiteau Nouvelles prisons, mêmes enjeux?
Mathilde Chabot-Martin
Karl Beaulieu Courtes peines ou recours excessif à l'incarcération
Jean Claude Bernheim Comparutions virtuelles, droits virtuels ?
Me Khalid M'Seffar
Me Nicolas Lemelin
Me Ludovick Whear-Charrette Coup d'oeil sur la justice alternative à Kahnawà:ke
Entrevue avec Dale Dione
Propos recueillis par Nelly Marcoux Luttes abolitionnistes et féminisme carcéral
Entretien avec Marlihan Lopez
Propos recueillis par Delphine Gauthier-Boiteau La justice transformatrice, s'organiser pour guérir
Propos recueillis par Laurence Lallier-Roussin
Reproduction de la revue
L'objectif premier de la revue Droits et libertés est d'alimenter la réflexion sur différents enjeux de droits humains. Ainsi, la reproduction totale ou partielle de la revue est non seulement permise, mais encouragée, à condition de mentionner la source.
L’article Regards critiques sur l’incarcération est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

L’éducation à la citoyenneté, au cœur de la mission éducative
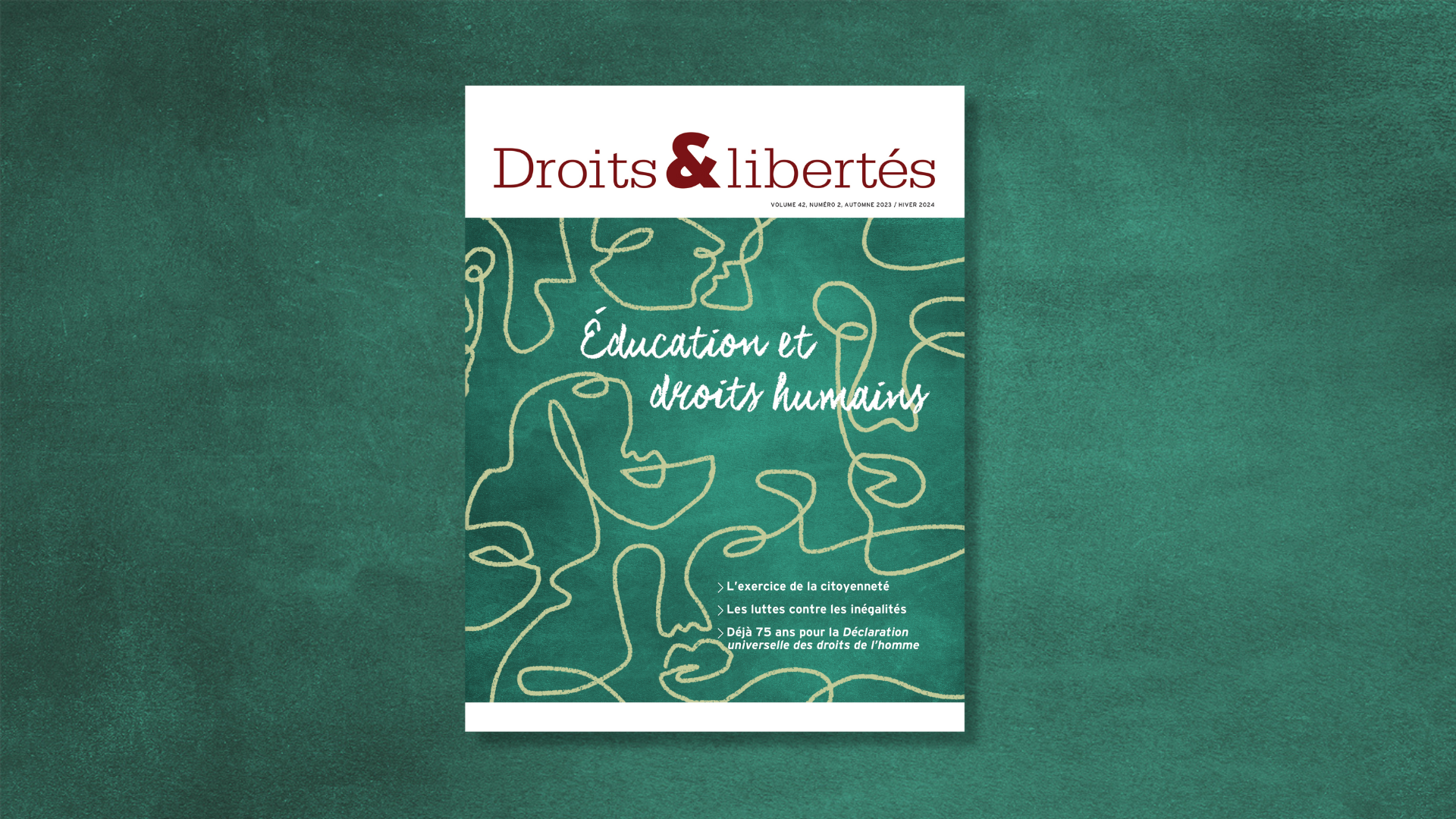
Retour à la table des matières Droits et libertés, automne 2023 / hiver 2024
L’éducation à la citoyenneté, au cœur de la mission éducative
Alexis Legault, étudiant-chercheur en éducation à l’Université de Sherbrooke Ronald Cameron, enseignant à la retraite Les mandats de l’éducation se résument traditionnellement à trois mots clés : instruire, socialiser et qualifier. Ce sont là les grandes missions qui visent à concrétiser que « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits1». C’est suivant cette mission que les jeunes des pays occidentaux, mais aussi de plus en plus des pays des Suds sont aujourd’hui scolarisés, comme le souhaitait la Déclaration universelle des droits de l’homme. La valorisation du droit à l’éducation et à son accessibilité universelle a favorisé une participation citoyenne accrue des jeunes générations aux transformations sociales dans la deuxième moitié du XXe siècle. Néanmoins, progressons-nous vers une société plus égalitaire et plus juste ? L’égalité des chances permet-elle la mobilité sociale ? En dépit d’un certain recul de l’extrême pauvreté dans le monde au cours des années précédant la pandémie, le XXIe siècle est globalement synonyme d’accroissement des inégalités dans des proportions inouïes. Par ailleurs, les capacités des populations adultes de pays pourtant pleinement scolarisées demeurent insuffisantes pour relever les défis contemporains d’une ampleur inédite. Le dernier rapport du Programme pour l’évaluation interna tionale des compétences des adultes (PEICA)2 révélait que la moitié de la population adulte du Québec présente un niveau de littératie ne leur permettant pas de comprendre et d’intégrer des textes denses. Aussi une personne sur cinq présente des niveaux si faibles que leur capacité de participer à la vie en société est entravée. Il s’agit d’une forme d’exclusion au cœur du respect de leurs droits.La faute au système scolaire ?
Beaucoup s’en prennent au système scolaire. Et il est vrai qu’il présente d’énormes travers. Entre instruire et qualifier, la fonction de socialiser peine à trouver sa place à l’école. Le développement de l’agir citoyen y occupe un espace limité, coincé entre les matières dites prioritaires, considérées plus neutres et évaluées par des examens ministériels. Les apprentissages sociaux (ex. citoyenneté, environnement, médias), devant en principe s’intégrer dans chacune des matières, ne se retrouvent finalement nulle part, quand ils ne sont pas le théâtre de controverses. Le débat public autour du cours Culture et citoyenneté québécoise, qui a remplacé l’Éthique et culture religieuse, en est un exemple. Il constitue d’ailleurs l’un des seuls refuges pour ces types d’apprentissage citoyen, dans un contexte où la neutralité éducative sert trop souvent d’argument pour limiter l’espace à la réflexion critique, ce qui contribue à favoriser le choix du statu quo du système en place. Cependant, le travers le plus lourd dans un projet d’école émancipatrice et dans la perspective de l’égalité en droit est le choix décomplexé d’un système à trois vitesses. L’écart au sein du système public se creuse entre le niveau scolaire des personnes les plus favorisées et celui des plus vulnérables. La persistance des écoles privées assure encore et toujours l’avantage aux familles qui ont les moyens. Au Québec, on constate d’ailleurs une tendance à l’accroissement de la place du privé3. L’école à trois vitesses ramène un système foncièrement discriminatoire. Il s’agit d’un obstacle majeur au respect du droit à une éducation de qualité pour toutes et tous. Ce droit est concrètement mis en péril par les nombreuses inégalités d’accès offertes aux élèves selon la vitesse à laquelle ils ont accès : services psychosociaux ; personnel de soutien ; installations sportives ; maté riel pédagogique ; sorties culturelles ; activités parascolaires ; etc.Comme quoi l’école n’est pas neutre. Il est alors impératif de s’assurer que chacun puisse bénéficier d’une éducation citoyenne de qualité, laquelle vise à permettre à toutes et tous d’agir socialement et politiquement dans leur communauté.En ce sens, ce système constitue un recul majeur, à l’instar de l’accroissement des inégalités sociales auxquelles il contribue. Comme quoi l’école n’est pas neutre. Il est alors impératif de s’assurer que chacun puisse bénéficier d’une éducation citoyenne de qualité, laquelle vise à permettre à toutes et tous d’agir socialement et politiquement dans leur communauté.
Pour transformer la société
Même si l’éducation à la citoyenneté devait prendre l’espace qu’elle mérite dans les écoles et qu’elle porte à conséquence sur la jeunesse scolarisée, devons-nous attendre que ces jeunes atteignent l’âge adulte pour changer la société ? Pour relever les défis auxquels font face les populations – enjeux écologiques et climatiques, de justice sociale, de discriminations, de pauvreté, de conditions de vie et de logement, de compétences numériques, d’accès à l’information, de santé publique – pouvons-nous attendre que ces jeunes soient en position d’agir ? L’urgence est maintenant ! Nous avons besoin de mobiliser les jeunes et les adultes dans un projet de transformation sociale. Or, le droit à l’éducation tout au long de la vie subit les mêmes pressions sociales que l’école publique. L’éducation populaire occupe la fonction de socialisation en éducation des adultes. Or, cette mission peine cependant à trouver sa place entre celle d’instruire en formation de base et celle de qualifier en formation liée à l’emploi. Force est de constater que l’éducation populaire est à l’éducation des adultes, ce que cette dernière est au système éducatif : parent pauvre, puisque lentement définancé et invariablement sous-considéré dans les politiques éducatives gouvernementales ! Dans un monde dominé par la diplomation, les compétences et la performance, les parcours non formels en éducation populaire sont perçus comme peu utiles.L’éducation à la citoyenneté en mouvements
Il est vrai que l’explosion des mécanismes d’éducation informelle, surtout avec la révolution technologique, élargit l’accessibilité à des connaissances et favorise le développement des capacités des individus pour agir sur leur vie quotidienne. Toutefois, au-delà du développement culturel personnel, l’éducation populaire de transformation sociale, plus particulièrement dans sa forme contemporaine d’éducation à la citoyenneté, est indissociable de ses dimensions collectives et communautaires.En amont du désengagement de l’État, on constate aussi le retrait du financement public des activités de formation syndicale, qui pourtant font partie intégrante du champ de l’éducation populaire.Les mouvements sociaux et les réseaux qui les réalisent sont des milieux présentant un riche potentiel éducatif, mais dont le sous-financement et la marginalisation restreignent la portée. Le milieu communautaire, mais aussi de nombreuses personnes chercheuses en éducation, appelle depuis des décennies à une meilleure reconnaissance financière et symbolique de ces groupes systématiquement sousfinancés et sous sollicités4. Ce sont ces mouvements qui favorisent le respect des droits humains. En amont du désengagement de l’État, on constate aussi le retrait du financement public des activités de formation syndicale, qui pourtant font partie intégrante du champ de l’éducation populaire5. C’est un exemple du refus du système de soutenir le développement des apprentissages de contestation. C’est aussi le cas des organismes environnementaux, malgré les tentatives de l’école à fournir une éducation environnementale et écocitoyenne. Ils sont très peu mis à contribution, alors que leurs aptitudes éducatives ne sont plus à démontrer6.
Pour qu’un autre monde soit possible
Parmi les écrits les plus célèbres de Paulo Freire, on retrouve ce passage dans La pédagogie des opprimé.es, qui résume bien sa pensée : « Personne n’éduque personne, personne ne s’éduque seul », les êtres humains s’éduquent ensemble7. La pédagogie de l’éducation populaire de conscientisation ne se réalise pas dans un rapport d’extériorité avec la réalité des personnes apprenantes. La connaissance des faits sert à démontrer l’évidence, mais, dissociée des réalités sociales, elle est impuissante à transformer le monde ! Dans l’optique de contrer la montée de l’intolérance et de l’autoritarisme et pour développer un projet social plus égalitaire et inclusif, la contestation sociale s’impose comme nécessaire à l’exercice d’une démocratie susceptible de permettre aux collectivités de transformer la société. Finalement, si l’éducation est émancipatrice, c’est parce qu’elle constitue un terreau à l’exercice de la citoyenneté. Pour Freire, l’éducation populaire de conscientisation permet justement une prise de conscience citoyenne qui fait corps avec l’agir collectif. Elle offre aux personnes les plus démunies des moyens de comprendre le monde pour pouvoir le transformer.- Organisation des Nations unies, Déclaration universelle des droits de l’homme, article premier, 1948.
- Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Perspectives de l’OCDE sur les compétences : premiers résultats de l’Évaluation des compétences des adultes, Éditions OCDE,
- Anne Plourde, Où en est l’école à trois vitesses au Québec ?. IRIS , Collectif Debout pour l’école !, Une autre école est possible et nécessaire, Del busso éditeur, 2022.
- Réseau québécois de l’action communautaire autonome, L’action communautaire autonome,
- Conseil supérieur de l’Éducation, L’éducation populaire : mise en lumière d’une approche éducative incontournable tout au long et au large de la vie,
- Sauvé, H. Asselin, C. Marcoux et J. Robitaille, Stratégie québécoise d’éducation en matière d’environnement et d’écocitoyenneté. Les Éditions du Centr’ERE, 2018.
- Freire, La pédagogie des opprimé·es. Éditions de la rue Dorion, 2021.
L’article L’éducation à la citoyenneté, au cœur de la mission éducative est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

Pour une éducation émancipatrice, équitable et de qualité
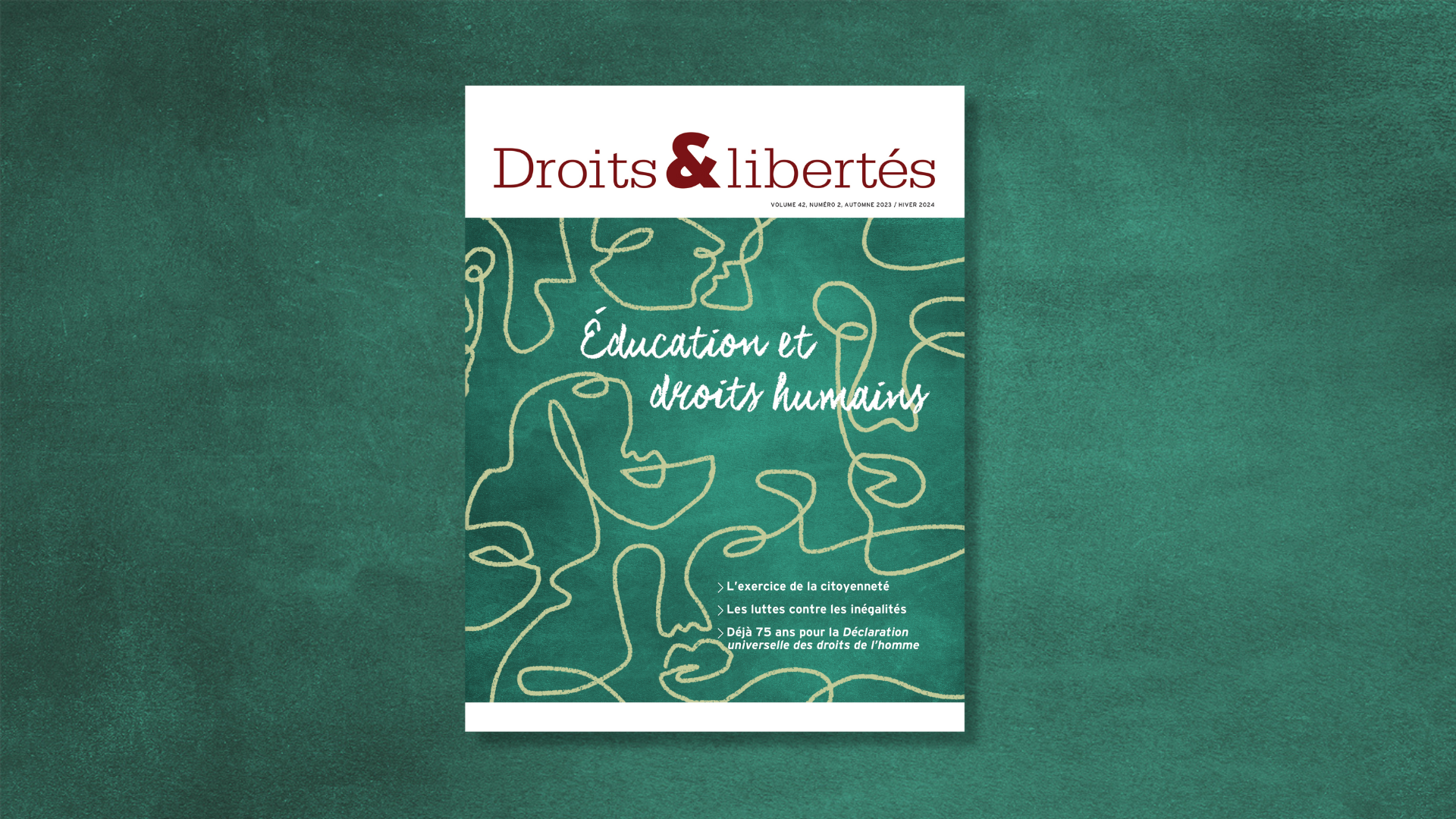
Retour à la table des matières Droits et libertés, automne 2023 / hiver 2024
Pour une éducation émancipatrice, équitable et de qualité
Suzanne-G. Chartrand, retraitée de l’enseignement secondaire et universitaire, et porte-parole de Debout pour l’école Jean Trudelle, retraité de l’enseignement collégial et président de Debout pour l’école 1948, une année qui connaît deux évènements majeurs de l’après-guerre : c’est l’année où le peuple de Palestine se voit dépossédé de sa terre par la création de l’État d’Israël sur son territoire. C’est également l’année de l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme dont l’article 26 stipule : « Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire… L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ».L’obligation de la fréquentation scolaire au Québec
C’est en 1943 que l’Assemblée législative de la province de Québec adopte l’obligation de fréquentation scolaire pour les enfants de 6 à 14 ans, une question débattue par les parlementaires depuis 1901. La loi abolit alors les frais de scolarité à l’élémentaire et instaure la gratuité des manuels. Malgré l’instauration de l’école obligatoire et la multiplication d’établissements scolaires à travers la province, cette mesure reste insuffisante pour assurer l’égalité de l’accès à l’école à tous et à toutes. Les années 1960 annoncent une époque de bouleversements sur le plan éducatif au Québec avec le rapport Parent, issu de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement, qui propose une vision de l’égalité des chances, entendue comme la possibilité pour toutes et tous d’acquérir les outils nécessaires pour s’émanciper, peu importe leur origine culturelle, sociale et économique.Dans les forums, on a donc exprimé la nécessité de se mobiliser pour obtenir à court et à moyen terme des changements substantiels du système d’éducation afin qu’advienne une école émancipatrice, inclusive, équitable et de qualité pour tous et toutes.Depuis le rapport Parent, l’éducation scolaire est non seulement un droit, mais elle est une obligation jusqu’à 16 ans1. Le rapport Parent avait bien saisi la portée du droit à l’éducation. L’éducation dans l’institution scolaire implique l’instruction qui se réfère à l’acquisition de connaissances et de compétences comme la lecture, l’écriture, la numératie et la capacité à débattre. Elle implique la socialisation des enfants qui doivent apprendre à apprendre et à vivre ensemble. Ce rapport favoriserait ce qu’il nommait l’égalité des chances entendue comme la possibilité pour toutes et tous d’acquérir les outils nécessaires pour s’émanciper, peu importe leur origine culturelle, sociale et économique.
Une ségrégation scolaire inacceptable
Force est de constater que soixante plus tard, ce souhait n’est pas devenu réalité. Le système scolaire québécois est fortement ségrégé. Il marginalise les élèves des milieux modestes ou pauvres et les condamne souvent à l’échec et au décrochage. Que l’on pense aux élèves des Premières Nations et inuits, dont 50 % sont scolarisés dans le système québécois et dont les cultures ne sont prises en compte ni dans le programme d’études ni dans la vie scolaire ; aux élèves récemment arrivés qui ne reçoivent pas toujours l’accueil et le soutien nécessaire à leur intégration et scolarisation ; aux élèves vivant avec un handicap ou en difficulté dont les besoins ne sont pas comblés et, enfin, à trop de jeunes qui se retrouvent par défaut à la formation générale des adultes. L’école québécoise n’est ni inclusive ni équitable. Selon notre collectif, l’éducation scolaire doit viser l’émancipation, à savoir la capacité des élèves à s’affranchir de la dépendance intellectuelle et morale aux idées toutes faites et aux préjugés, grâce aux connaissances acquises et aux valeurs partagées dans l’institution scolaire. L’instruction vue ainsi implique la socialisation des élèves qui, ensemble, apprennent et se développent à travers les échanges avec leurs condisciples. L’école privée subventionnée et les projets particuliers sélectifs offerts dans les écoles publiques sont réservés aux élèves performants et, sauf quelques rares exceptions, aux élèves dont les parents ont la capacité de payer les frais ou acceptent de s’endetter : tout concourt à segmenter les effectifs scolaires. Les élèves qui présentent de meilleures chances de réussite se retrouvent dans les mêmes écoles, ce qui concentre dans les mêmes classes celles et ceux qui éprouvent davantage de difficulté et qui sont privés du même coup de toute forme d’émulation, plus encore du soutien pédagogique et psychologique nécessaire. Fréquenter l’école publique ordinaire est devenu une étiquette négative. L’iniquité du système scolaire est donc bien réelle, feu l’égalité des chances ! L’institution scolaire est de plus en plus pervertie, depuis les années 1990, par la gestion axée sur les résultats dans le cadre de la Nouvelle gestion publique (NGP) où domine l’objectif d’efficience (l’efficacité à moindre cout) qui se traduit par les critères de réussite chiffrée et de diplomation, quelle qu’en soit la qualité de l’éducation2. Les indices de performance des systèmes scolaires, par exemple les résultats de PISA, études réalisées par l’OCDE, ne sont pas sans faille et trop de facteurs entrent en compte pour qu’on puisse les considérer comme une valeur absolue3.Libérer la parole citoyenne : du jamais vu depuis les États généraux de 1995 !
Rappelons que la démarche de la Commission des États généraux sur l’éducation (ÉGÉ) a connu deux périodes. Des consultations populaires ont été menées pour faire état de la situation de l’éducation au Québec et en analyser les principaux éléments. Aussi, il y a-t-il eu des audiences citoyennes dans toutes les régions du Québec qui ont été marquées par une mobilisation exemplaire. La deuxième phase est celle des assises nationales, tenues en septembre 1996. Elles ont porté sur un nombre limité de questions soit pour tenter de mieux éclairer des zones d’ombre, soit pour tenter de dénouer des impasses qui subsistaient. Pour beaucoup des participants à la première phase, le Rapport final de la Commission des ÉG a édulcoré plusieurs revendications débattues dans les audiences citoyennes. Debout pour l’école a retenu des ÉGÉ qu’il est essentiel de donner la parole aux citoyennes et aux citoyennes et non seulement aux représentants des institutions lorsqu’il s’agit d’éducation, assise d’une société. Debout pour l’école a été, avec d’autres, à l’origine de Parlons éducation qui a tenu 20 forums dans 19 villes du Québec au printemps 2023 et une cinquantaine d’ateliers réunissant près de 650 jeunes d’écoles secondaires, de cégeps, de centres d’éducation aux adultes, de centres de formation professionnelle, de maisons des jeunes, de centres communautaires, d’équipes sportives et de maisons d’hébergement. Cette démarche était soutenue par une cinquantaine d’organisations communautaires, syndicales ou citoyennes. Les forums de Parlons éducation (PÉ) ont libéré la parole de plus 1 500 citoyens, jeunes et moins jeunes pour s’exprimer sur plusieurs thèmes, dont la mission de l’école, son iniquité, les conditions de travail des personnels et le piètre état de la démocratie scolaire. Partout, la qualité de l’accueil reçu et l’intérêt profond pour l’éducation montré par les participants ont confirmé la pertinence de ces rencontres. Les interventions ont confirmé le piètre état de l’école québécoise, colorant par de nombreux exemples le portrait proposé dans le Document de participation4 et avançant plusieurs pistes de solutions. Tout en exprimant un vif désir que leur parole soit entendue par les pouvoirs publics, bien que les participants aient bien peu d’espoir dans le niveau d’écoute de ces derniers. Le Document de participation brossait un état des lieux alarmants du système scolaire actuel. Du flou entourant la mission de l’école jusqu’aux effets délétères d’une ségrégation des effectifs que le ministère s’obstine à nier, en passant par le constat d’une démocratie scolaire étiolée, tous les constats présentés ont été avérés par le regard engagé des personnes venues contribuer à l’exercice. Faute de temps, certains sujets n’ont pas pu être approfondis, bien que soulevant un vif intérêt. Ainsi en est-il des pratiques actuelles d’intégration des élèves handicapés ou des élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, de la tendance actuelle au surdiagnostic et à la médication ou du rôle des projets particuliers dans les écoles. Ces derniers se développent actuellement sans balises et sans moyens, ce qui crée un véritable marché scolaire axé sur la performance individuelle. Est-ce bien là ce que l’on veut comme système d’éducation ? Dans les forums, on a donc exprimé la nécessité de se mobiliser pour obtenir à court et à moyen terme des changements substantiels du système d’éducation afin qu’advienne une école émancipatrice, inclusive, équitable et de qualité pour tous et toutes. En filigrane des milliers de prises de paroles qu’ont permis les forums, il y a un vibrant appel pour une école, disposant de plus de moyens pour offrir aux élèves un milieu de vie serein, convivial et un parcours éducatif de qualité pour tous. Dans une société où s’effritent les repères, n’est-ce pas une nécessité ? Pour ce que cela se réalise, il est primordial que les compétences professionnelles de tous les personnels scolaires soient respectées, que leurs conditions de travail s’améliorent grandement et, enfin, que l’institution scolaire soit réellement démocratique, c’est-à-dire, d’une part, qu’elle permette que tous les acteurs, des élèves au personnel de direction, de débattre et de prendre des décisions sur ce qui les concerne et, d’autre part, que la communauté environnante de l’école et la société en général puissent faire partie des délibérations, car l’éducation scolaire est un bien collectif qui joue un rôle déterminant dans une société.Vers un Rendez-vous national sur l’éducation, début 2025
C’est pour toutes ces raisons que Debout pour l’école travaillera dans les prochains mois à coaliser le plus grand nombre d’organisations de la société civile organisée et des milliers de citoyennes et citoyens afin qu’ensemble ils dégagent des revendications prioritaires à adresser aux pouvoirs publics qui, s’ils ont un tant soit peu le respect de la démocratie, devront les mettre en œuvre. Un Rendez-vous national sur l’éducation est prévu au début 2025 pour obtenir des transformations structurantes en éducation. Ensemble, mettons-nous debout pour l’école !- Pour un aperçu historique, voir https://www.journaldemontreal.com/2023/08/27/vous-savez-au-quebec-lecole-na-pas-toujours-ete-obligatoire
- Voir les chapitres 1 et 2 de l’ouvrage du collectif Debout pour l’école : Une autre école est possible et nécessaire, Del Busso, éditeur, 2022.
- Lire Daniel Bart, Bertrand Daunay, Les problèmes de traduction dans le PISA : les limites de la standardisation des tests de compréhension. En ligne : https://liseo.france-education-international.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=9889
- Voir l’onglet Parlons éducation sur le site de Debout pour l’école. En ligne : https://deboutpourlecole.org
L’article Pour une éducation émancipatrice, équitable et de qualité est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

La DUDH : genèse de l’édifice universel des droits humains

La DUDH : genèse de l'édifice universel des droits humains
Retour à la table des matières Droits et libertés, automne 2023 / hiver 2024
Edouard De Guise, Étudiant à l’Institut d’études politiques de Paris et militant à la LDL La Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), adoptée le 10 décembre 1948, constituait à la fois une avancée remarquable dans l’internationalisation de la protection des droits humains et une déception pour celles et ceux qui espéraient y voir un outil juridiquement contraignant pour les États. La DUDH, à son adoption, innovait quant à sa portée et à son envergure. D’abord, sur la forme, aucun texte n’avait prétendu à l’universalité sur la scène internationale avant la DUDH. Il existait alors déjà, dans quelques pays, des déclarations des droits rédigées à la suite des grandes révolutions des XVIIe et XVIIIe siècles. Ces déclarations avaient une prétention à l’universalité mais ne concernaient que les rapports de l’État à l’individu en droit interne. Elles n’étaient souvent pas respectées pour toutes et tous, comme ce fut le cas des personnes autochtones, des femmes, des personnes noires, et de plusieurs autres minorités; elles n’avaient qu’une portée circonscrite à la nation. Il existait également, du côté des organisations civiles, des documents privés qui tentaient de codifier le droit international des droits humains. Ce fut le cas notamment des codifications de l’Institut de droit international en 1929 et de la Ligue des droits de l’Homme en 1936. Ces documents n’étaient cependant pas reconnus par la communauté internationale et ils n’ont pas progressé vers un ordre international de protection des droits humains. Par ailleurs, il y avait des documents qui avaient la forme de la Déclaration sans en avoir l’envergure sur le fond. C’est le cas de la Déclaration du 8 février 1815 du Concert de l’Europe sur l’abolition de la traite esclavagiste. C’est également le cas du Traité de Berlin de 1878, qui contenait une disposition pour protéger les minorités chrétiennes dans l’Empire ottoman. Ces traités, bien qu’ayant une forme juridique ou déclaratoire, étaient bien loin de déclarer des droits pour toutes et tous, ne s’en tenant qu’à un seul enjeu.La genèse
L’idée d’une charte mondiale de protection des droits humains était promue et revendiquée depuis la Crise des années 1930 par des figures intellectuelles de différents milieux, comme les groupes syndicaux, pacifistes, féministes, juifs, chrétiens et libéraux. Dans son discours au Congrès des États-Unis du 6 janvier 1941, le président Franklin Delano Roosevelt lançait le débat sur la protection des droits dans le nouveau régime international qui serait établi à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il espérait alors pousser les États-Unis hors de leur isolationnisme pour soutenir les alliés qui vivaient alors, pour la plupart, sous l’occupation nazie. Il formulait dans ce discours son souhait que soient protégées quatre libertés : la liberté d’expression, la liberté de religion, la liberté de vivre à l’abri du besoin et de la tyrannie. Ces libertés préfigurent l’esprit de la DUDH dans son inclusion au sein d’un même texte de droits civils, politiques, sociaux et économiques.L’échec de la Société des Nations
Un deuxième fait historique a inspiré la forme et le fond de la DUDH : l’échec de la Société des Nations. Malgré sa structure et ses objectifs d’abord politiques et diplomatiques, l’action de la Société des Nations couvrait quatre orientations qui relevaient du droit international des droits humains : le respect des droits des minorités, la protection des réfugiées, l’amélioration des conditions des travailleuses et travailleurs et une justice pénale internationale. Outre ces grandes orientations, on y affirme le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, toile de fond de l’organisation pensée par le président Woodrow Wilson. L’action de la Société n’a pas été vaine, puisqu’elle a, notamment, créé le poste de haut commissaire aux réfugiés, qui avait instauré le passeport Nansen, un docu ment de voyage destiné aux apatrides. Il a d’abord servi, en 1922, aux réfugié-e-s du bolchévisme, « contre-révolutionnaires » qui avaient été déclarés apatrides. En 1924, il a ensuite permis aux Arménien-ne-s de fuir le génocide. La Société des Nations a donc joué un rôle important dans la protection de certains groupes et classes de la société.La création de l’Organisation internationale du travail
En matière de protection des travailleuses et travailleurs, la Société avait entre autres présidé à la création de l’Organisation internationale du travail (OIT), plus tard intégrée à l’Organisation des Nations unies (ONU). L’OIT a adopté une série de conventions portant sur les droits des travailleuses et travailleurs, des femmes, des enfants, des migrant-e-s et plus encore. La Déclaration de Philadelphie de 1944, document concernant les buts et objectifs de l’OIT, a même été décrite par plusieurs comme la première déclaration de droits à vocation universelle. Cependant, la Société n’avait pas de régime unique de protection des droits humains, ce que tenteront d’accomplir les architectes du système des Nations unies à l’aune des conséquences des tragédies humaines de la Seconde Guerre mondiale.La rédaction
L’ONU a été créée en 1945 par l’adoption de la Charte des Nations unies à la clôture de la conférence de San Francisco. La Charte faisait suite à la Déclaration des Nations unies, un texte signé par 26 pays alliés en 1942. Cette déclaration constituait alors le premier document international faisant explicitement appel à la protection des droits humains dans leur intégralité à l’échelle internationale. Un comité de rédaction de la DUDH, présidé par Eleanor Roosevelt, a été formé en 1947. Des juristes d’origines diverses avaient été appelés à former ce comité pour poser la première brique dans l’édification d’un nouveau système de protection des droits de la personne. Le comité était épaulé par John Peters Humphrey, professeur de droit à l’Université McGill et premier directeur de la Division des droits de l’homme du Secrétariat général des Nations unies.Un travail collectif
Contrairement aux croyances populaires alimentées par la littérature nationaliste et patriotique, en vogue surtout en France, aux États-Unis et au Canada, la rédaction de la DUDH n’était pas le fruit du travail d’une seule femme ou d’un seul homme extraordinaire. Humphrey avait rédigé la première ébauche du document dans le cadre de ses fonctions au Secrétariat général. Son travail a été repris par René Cassin, juriste français et membre du gouvernement de la France libre pendant l’occupation allemande, qui a notamment milité pour remplacer le terme « international » par le terme « universel » pour que la DUDH ne relève pas exclusivement du champ de compétence étatique. Il a également donné un style déclaratif « à la française » au document. Peng-Chun Chang, universitaire et militant des droits humains en Chine, a insisté pour que la DUDH soit exempte de références religieuses au « Créateur » ou à la « nature », pour qu’elle soit plus inclusive. Les autres membres du Comité de rédaction ont également apporté des précisions et des améliorations au projet de DUDH pour en faire un document qui soit de portée réellement internationale, avec la participation consultative des gouvernements et des ONG. Grâce, entre autres, au soutien des Soviétiques, la DUDH signifiait également, dès son adoption, un élargissement considérable du domaine traditionnel des droits humains aux droits économiques et sociaux, revendication portée principalement par les groupes syndicaux. Ces droits faisaient alors leur toute première apparition dans les textes juridiques internationaux sur un pied d’égalité avec les droits civils et politiques. Toutefois, la balance du pouvoir à l’Assemblée générale de l’ONU était alors favorable aux pays occidentaux, dont certains avaient encore des colonies. On ne retrouve donc pas dans la DUDH le plus important des droits collectifs ; il figure pourtant au premier article des deux Pactes de 19661 mettant en œuvre le projet de la DUDH : le droit des peuples à l’autodétermination.La différence entre le texte de la DUDH et celui des Pactes de 1966 témoigne certainement d’un déplacement du poids diplomatique aux Nations unies depuis l’Occident vers ses anciennes colonies, fruit du mouvement de décolonisation entre la fin des années 1940 et les années 1960.
Vers les Pactes
La forme juridique du texte a créé un litige dès le début de la rédaction de la DUDH, et ce n’était pas leur statut colonial qui alignait les pays. Finalement, certains pays ont préféré que la DUDH ne soit pas contraignante. Au Canada par exemple, le gouvernement a hésité à voter l’adoption de la DUDH, craignant devoir respecter la liberté d’expression ou de religion de certains groupes comme les communistes ou les Témoins de Jéhovah. Humphrey n’aurait convaincu le Cabinet de voter en faveur de l’adoption qu’au dernier vote. Certains pays souhaitaient que la DUDH soit juridiquement contraignante, craignant qu’elle soit adoptée facilement, mais que les Pactes, contraignants, ne le soient pas. Bien que l’histoire n’ait pas matérialisé leurs craintes, le contexte de guerre froide ainsi que les tensions liées à la décolonisation leur ont presque donné raison. Il a donc fallu attendre 18 ans — 28 ans si l’on considère la date de l’entrée en vigueur — pour que soient adoptés des instruments juridiques qui pouvaient assurer la mise en œuvre des objectifs de la DUDH.Les Pactes
Entre la DUDH et les Pactes, plusieurs vagues de décolonisation se sont succédé, marquant un élargissement considérable du nombre de pays à l’Assemblée générale de l’ONU. Cet élargissement a entraîné un changement dans la balance du pouvoir au sein de cette assemblée : les pays en développement avaient maintenant la majorité. L’époque était également marquée par la guerre froide, polarisant la politique mondiale. Ces deux grandes divisions : décolonisation et guerre froide étaient la toile de fond de la création et de la rédaction de l’instrument juridique contraignant qui manquait à la DUDH. C’est dans ces conditions qu’a été déterminée la forme de ce nouvel outil, composé de deux pactes : l’un concernerait les droits civils et politiques, favorisés par l’Occident ; l’autre concernerait les droits sociaux et économiques, promus par le bloc soviétique et les pays en développement. En 1966, la rédaction des Pactes était terminée et la période de ratification pouvait débuter. Les Pactes ne sont entrés en vigueur qu’en 1976. Ils ont par la suite été complétés de protocoles facultatifs d’application ou de précision. Le plus célèbre d’entre eux était celui portant sur l’abolition de la peine de mort, en 1989. Il résultait de plusieurs années de travail militant sur les scènes nationale et internationale. La Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que les deux Pactes constituent ensemble la fondation du régime international de protection des droits humains. On appelle ce corpus de textes la Charte internationale des droits de l’homme. Si les Pactes identifient les obligations des États de respecter, de protéger et de mettre en œuvre les droits humains, les dernières décennies nous démontrent que les gouvernements prennent rarement les devants pour les assumer, et quand ils le font, il s’avère que ce sont bien souvent les crises ou les urgences qui dictent leurs actions.- Pacte international sur les droits civils et politiques (PIDCP) et le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC).
L’article La DUDH : genèse de l’édifice universel des droits humains est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

La participation des parents, un incontournable pour la création d’écoles inclusives
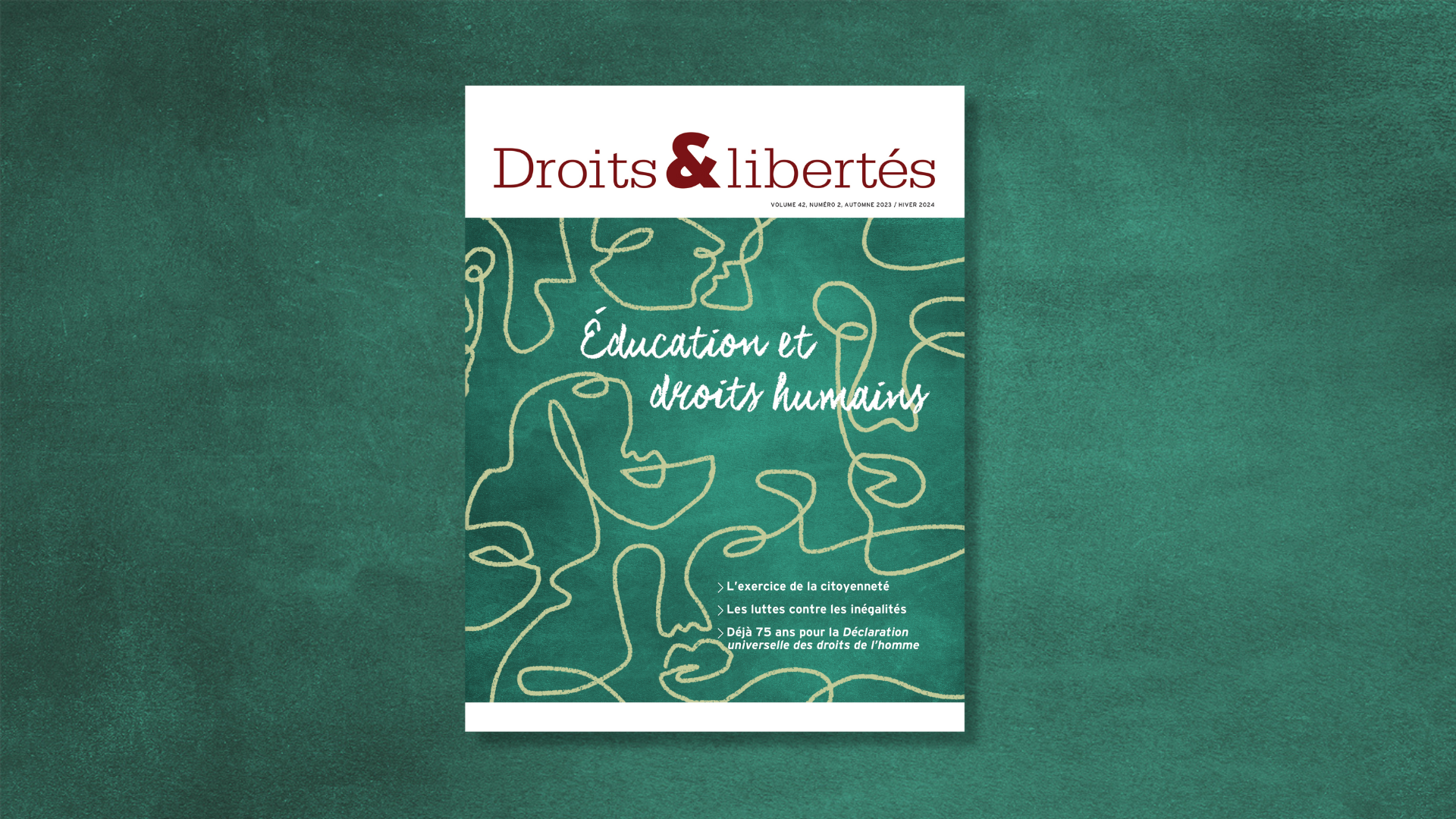
La participation des parents, un incontournable pour la création d’écoles inclusives
Retour à la table des matières Droits et libertés, automne 2023 / hiver 2024
Jacinthe Jacques Safa Chebbi Coordonnatrices générales à La Troisième Avenue L’école est avant tout le premier palier de la démocratie, où les jeunes acquièrent leurs premières connaissances, compétences et valeurs essentielles pour devenir des citoyens informés et actifs. Elle offre l’occasion de mettre en pratique les principes fondamentaux de la démocratie. Participer activement à la vie démocratique de l’école, étant parent ou jeune élève, peut être un puissant moteur de changement social positif. En s’engageant ainsi, les personnes ont davantage la capacité d’influencer les pratiques contribuant ainsi à façonner une société plus équitable et respectueuse des droits humains. Selon le Code civil du Québec et la Loi sur l’instruction publique1, l’école a le devoir d’instruire, de socialiser et de qualifier les enfants, tout en les rendant aptes à entreprendre et à réussir leurs parcours scolaires. L’école est tenue aussi de réaliser son projet éducatif, en collaboration avec divers acteurs, dont les parents, en siégeant dans des instances décisionnelles comme les conseils d’établissements pour exprimer leurs besoins et participer activement à la vie scolaire. Cette coopération entre l’école et les parents est cruciale pour garantir l’épanouissement éducatif des enfants. Néanmoins, la réalité sur le terrain s’avère souvent plus complexe. Les lieux d’implication et de participation des parents ne sont pas toujours clairement compris pour être accessibles, que ce soit du côté de l’école ou des familles. Pourtant, il est toujours bénéfique pour l’enfant lorsque l’école tient compte de l’expérience des parents dans ses démarches d’intervention. Cette approche favorise un mode de fonctionnement démocratique qui conduit au développement d’une citoyenneté allant au-delà du simple droit à des services de qualité.Les obstacles à la participation des parents à l’école
Selon nos différentes consultations auprès de nos membres parents, les obstacles sont nombreux à la participation au sein de l’école. D’une part, ceux-ci ont souvent l’impression qu’ils ont de la difficulté à entrer en contact avec l’école que ce soit concernant l’accès à l’information ou encore aux personnels scolaires. Dans certains cas, ils ne peuvent même pas accéder physiquement au bâtiment. Pour un parent, la transition de l’espace de la petite enfance (0-5 ans) à l’école primaire représente un changement radical en termes d’accessibilité physique et de relation avec l’institution et son personnel. Souvent, les parents éprouvent des difficultés pour aller au-delà du secrétariat ou de la porte du service de garde, transformant ainsi l’espace-école en un simple comptoir de services qui limite au maximum toute interaction externe. D’autre part, les parents sont souvent confrontés à de nombreux préjugés provenant de l’école, particulièrement lorsqu’il est question d’un parent immigrant. À titre d’exemple, on entend souvent les idées préconçues selon lesquelles les parents seraient peu intéressés par l’éducation de leurs enfants, trop occupés pour s’engager dans la démocratie scolaire de leur école, ou que leur culture les empêcherait de mieux comprendre les valeurs de l’école d’ici, renforçant ainsi une vision biaisée de leurs enfants. Ces préjugés remettent indirectement en question leur capacité à être de bons parents ou simplement de potentiels alliés pour l’école. Bien trop souvent, les interventions des parents à l’école prennent diverses formes, certaines pouvant même revêtir un caractère confrontant. On observe maintes fois des négociations pour définir la répartition des territoires symboliques liés à l’exercice du pouvoir. Les parents se sentent privés d’un sentiment d’appartenance envers l’institution qu’est l’école.| « Je suis tout à fait disposée à m’impliquer à l’école, mais il est difficile d’y pénétrer. Les seules invitations semblent limitées à des tâches spécifiques telles que ranger les livres de la bibliothèque ou contribuer à la logistique d’événements ponctuels. Notre implication se réduit alors à des tâches mécaniques simples qui ne demandent pas beaucoup de réflexion, et notre pouvoir est limité à une simple exécution de ces tâches. Dès que nous tentons de nous impliquer dans des rôles où notre champ d’action est plus étendu, les choses deviennent rapidement compliquées, et notre contribution semble soudainement être perçue comme une menace. Je suis convaincue que mes compétences peuvent être mises à contribution de manière plus significative pour aider l’école, audelà de ces tâches ». Diana (nom fictif), parent et membre de nos programmes dans le quartier Montréal-Nord |
Pour des écoles inclusives
La pleine participation des parents à l’école devient d’autant plus importante pour les familles immigrantes, qui représente la plus grande proportion de notre public et une part significative de la population montréalaise ces dernières années. Notons par ailleurs un nombre record d’inscriptions d’élèves issus de l’immigration à Montréal en 20232. Le succès du projet migratoire de ces parents est souvent mesuré par la bonne intégration de leurs enfants et leur réussite scolaire. Toutefois, l’école a de la difficulté à accueillir ces familles et elle a souvent tendance à les garder encore plus à l’écart que celles issues de la société d’accueil. Pourtant, la pleine participation des parents et des jeunes issus des groupes racisés au sein des structures démocratiques de l’école permettrait de construire des ponts entre les différentes cultures et par le fait même contribuer à créer un climat plus inclusif, harmonieux et bienveillant.| « Je me souviens d’une occasion où j’ai participé à un événement de chocolat chaud à l’école. Notre mission était de remplir les tasses pour les enfants pendant la pause. Lorsque mes propres enfants m’ont vue là, leurs yeux brillaient d’admiration, et ils étaient ravis de me présenter aux autres enfants. Même les enfants qui se reconnaissaient en moi, voyant en moi une figure de leurs familles, étaient également heureux de voir une personne qui leur ressemblait à l’intérieur de l’école. Ils venaient me parler et me demandaient si j’étais la maman de X ou de quel pays je venais. » Najat (nom fictif), parent et membre de nos programmes dans le quartier Saint-Léonard |
Ouvrir des espaces de dialogue
Dans ce contexte, une intervention spécifique et structurée est nécessaire pour favoriser les liens entre les parents et l’école, deux groupes indispensables. C’est d’ailleurs à la lumière de ces enjeux que notre organisation, La Troisième Avenue, a été fondée en 1974 à l’initiative de parents, devenant ainsi un centre d’expertise en participation citoyenne à l’école au Québec. Notre programme Parents en action pour l’éducation, l’un de nos principaux axes d’action, a été lancé en 1999 dans trois secteurs montréalais à forte population immigrante, soit Cartierville, Petite-Bourgogne et Villeray. Ce programme a été conçu pour renforcer la capacité des mères issues de groupes marginalisés sur le plan économique et social à jouer un rôle actif dans les écoles. Il vise notamment à les aider à exprimer leurs préoccupations face aux réformes majeures du système scolaire des années 19981999 et aux réductions budgétaires qui ont un impact sur les chances de réussite égales pour leurs enfants. À ses débuts, ce projet proposait des visites guidées en autobus scolaire en partenariat avec l’organisme l’Autre Montréal. Ces visites, d’une durée de plusieurs heures, permettaient au groupe de parcourir la ville en se focalisant sur des institutions, des thèmes et des événements de l’histoire de l’éducation à Montréal, avec une perspective critique visant à éclairer le présent en examinant le passé. À travers ces visites et les ateliers qui ont suivi, il est apparu que des discriminations systémiques existaient en termes d’accès à l’éducation et de réussite scolaire, malgré les efforts déployés pour rendre l’enseignement plus démocratique et garantir une plus grande égalité des chances en milieu scolaire. Avec le groupe de 25 mères participantes, une prise de conscience collective s’est développée, conduisant à une volonté de participer activement au sein de ces institutions pour améliorer des situations sociales inégalitaires. Ces femmes ont créé leurs propres espaces pour transformer leur sentiment d’impuissance en une force d’action visant à améliorer les écoles publiques en fonction de leurs préoccupations spécifiques. Au fil des années, elles ont organisé des discussions sur ces enjeux et ont progressivement développé des ressources plus adaptées à leurs besoins en collaboration avec notre organisation pour relever ces défis. Le projet s’est poursuivi ensuite pendant 2 à 3 ans en collaboration avec des organismes communautaires locaux pour promouvoir les visites et les ateliers. Bien que l’activité ait initialement ciblé les parents, elle a également été ouverte au personnel scolaire, aux travailleurs et travailleuses communautaires, ainsi qu’aux résidents et résidentes des quartiers. Au total, environ 400 personnes ont participé dans les quartiers suivants : Cartierville, Côte-des-Neiges, Parc-Extension, Pointe Saint-Charles, Saint-Henri, Saint-Michel, Villeray et Saint-Laurent. Les résultats de ces divers ateliers et conversations ont été analysés en collaboration avec l’Université McGill pour créer, avec la participation des parents, un guide d’éducation populaire intitulé À qui appartient l’école ? Vers un sentiment d’appartenance des parents à l’école3. Cette série d’ateliers se poursuit encore aujourd’hui, avec la participation continue de milliers de parents, soulignant la persistance de la demande et du besoin pour ces activités.En conclusion
Nous sommes convaincues qu’il est précieux, vital et avantageux d’établir la participation des parents à l’école pour avoir une vision intégrée de celle-ci. Cela implique de considérer l’école comme une communauté éducative où tous les acteurs sont des partenaires engagés pour la réussite et l’épanouissement des enfants, nos futurs citoyens, qui leur sont confiés. Cette finalité nécessite une alliance harmonieuse entre les parents et l’école. Cependant, pour permettre cette cohabitation, l’école a également un rôle majeur à jouer. Il est important que l’école informe les parents de leurs droits et responsabilités tout en favorisant un dialogue ouvert avec eux. L’école doit être résolument inclusive et fière de sa diversité pour garantir une éducation inclusive pour l’ensemble des enfants qui la fréquentent. C’est seulement de cette manière que nous pouvons aspirer à une plus grande justice sociale à l’école.- Chapitre III, section 1, article En ligne : https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/I-13.3/20010701?langCont=fr#se:36
- En ligne : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2005534/record-inscriptions-eleves-immigration-montreal
- En ligne : https://troisiemeavenue.org/appuyer-les-parents/
L’article La participation des parents, un incontournable pour la création d’écoles inclusives est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

Mettre en œuvre des droits : complexification et marginalisation
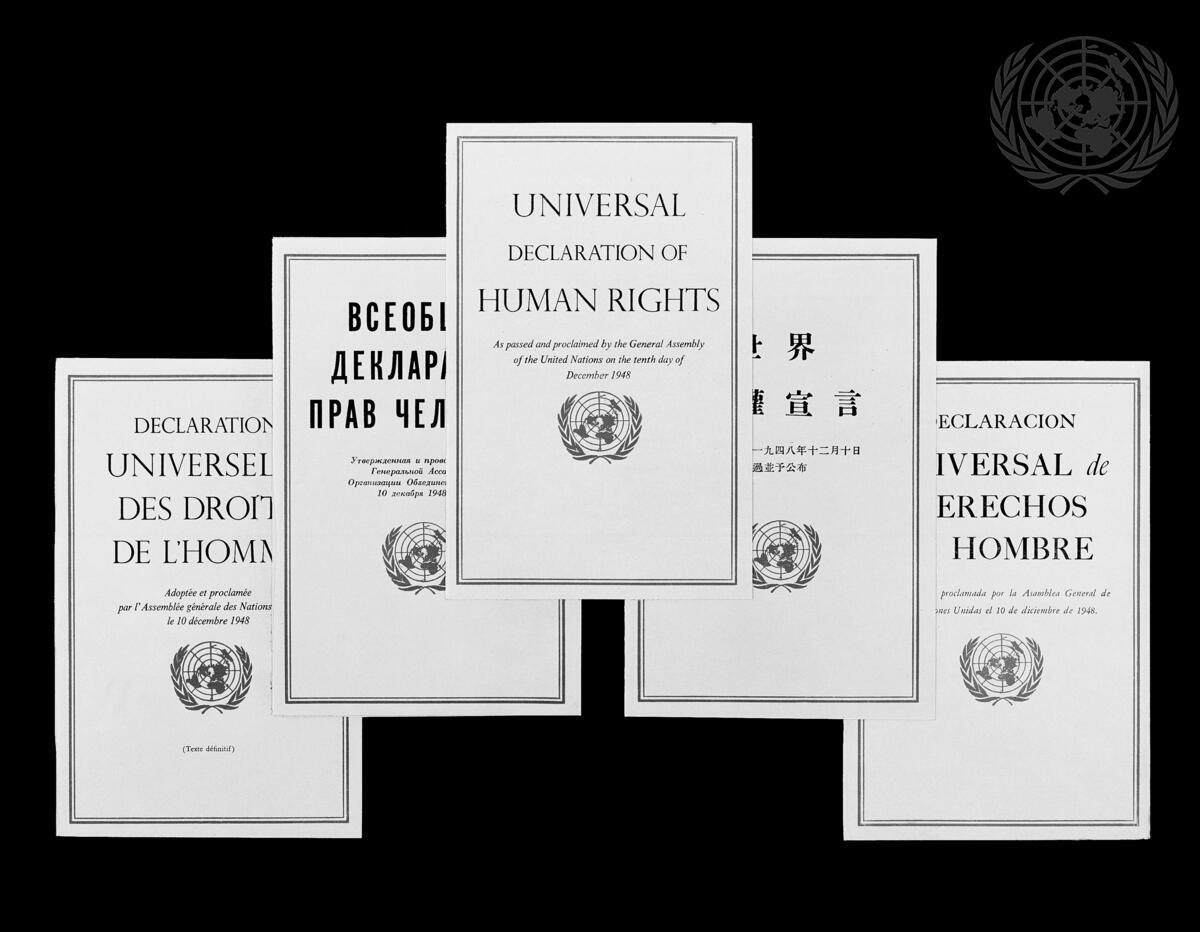
Mettre en œuvre des droits : complexification et marginalisation
Retour à la table des matières Droits et libertés, automne 2023 / hiver 2024
Sylvie Paquerot, Professeure retraitée, École d’études politiques, Université d’Ottawa, membre du CA de la Fondation Danielle Mitterrand Si la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), en 1948, établit un catalogue des droits humains que la communauté des États est prête à reconnaitre, ce sont les deux Pactes1 entrés en vigueur en 1976 qui introduiront des obligations claires pour les États : respecter, protéger et mettre en œuvre ces droits. Le développement du cadre juridique international des droits humains s’est toutefois fortement complexifié depuis, comme leur mise en œuvre à travers des politiques publiques effectives…Un édifice juridique complexe
D’abord, on s’apercevra très tôt que les obligations générales prévues aux Pactes ne peuvent suffire à la mise en œuvre concrète de l’égalité de personnes appartenant à des groupes ou des catégories historiquement exclues, discriminées ou marginalisées. Parallèlement à l’adoption et à la ratification des deux Pactes, le système onusien amorcera donc un processus de définition et de codification d’obligations plus précises, répondant aux situations spécifiques de ces groupes, qu’il s’agisse de s’attaquer à la discrimination en emploi vécue par les femmes, aux droits des personnes handicapées ou aux conditions particulières des travailleurs migrants, etc. Ces conventions, traités ou mécanismes (rapporteurs spéciaux par exemple) se sont multipliés depuis l’adoption de la DUDH, non seulement à l’échelle internationale mais également au sein des différents systèmes régionaux de protection des droits. Or, cette multiplication des instruments, essentielle à la précision des obligations des États, aura aussi pour effet de rendre plus complexe la compréhension même de la logique des droits humains, universels, inhérents et interdépendants, comme l’a rappelé la conférence de Vienne en 1993. On peut illustrer les conséquences de cette complexité avec le traitement de la question de la violence faite aux femmes, particulièrement la violence conjugale, dont les États ont mis du temps à se sentir responsables, dans la mesure où cette violence n’était pas de leur fait. Il aura fallu la mise en place d’un mécanisme de Rapporteuse spéciale sur la violence faite aux femmes, ses causes et ses conséquences pour que cet enjeu soit considéré comme relevant des droits humains et donc de la responsabilité de l’État de protéger les femmes contre la violence de tiers. Encore aujourd’hui, beaucoup interprètent les instruments visant des groupes ciblés comme donnant des droits spécifiques à ces groupes. Pourtant, il s’agit chaque fois essentiellement, de créer des obligations précises pour les États responsables de la mise en œuvre effective des mêmes droits, ceux du catalogue que constitue la DUDH, auprès des groupes plus vulnérables qui nécessitent des mesures particulières pour atteindre l’égalité. L’exemple le plus récent d’une telle confusion est sans doute le référendum australien, en octobre 2023, visant à inscrire dans la constitution les droits des peuples autochtones dans ce pays, qui a été rejeté. Un argument central des opposants était précisément que cela donnerait « plus de droits » aux Autochtones qu’aux autres citoyen-ne-s. Malheureusement, devant la complexité plus grande d’un système de protection plus développé et mieux précisé, les États ont en quelque sorte « oublié » leur obligation de promotion et négligé l’importance de l’éducation aux droits. En effet, combien, parmi les personnes qui liront ce texte, peuvent dire qu’elles ont bénéficié d’une formation aux droits humains dans leur parcours scolaire obligatoire ? Comment peut-on sérieusement penser « promouvoir le respect universel des droits » tel que le stipule la Charte des Nations unies, sans savoir et comprendre vraiment ce qu’ils sont ?De la société de droit à la société de marché
Mais si l’édifice juridique des droits humains s’est complexifié, leur mise en œuvre, elle, est devenue de plus en plus aléatoire sur le plan politique avec l’évolution des fondements et des valeurs de nos sociétés. C’est ici une contradiction fondamentale à laquelle nous faisons face : pour être revendiqués et mis en œuvre, les droits ont besoin d’une société de droit où le droit régule les rapports sociaux, et non la force ou la violence… et nos sociétés, à bien des égards, n’en ont plus que le nom. La société de marché, mise de l’avant dans les années 1980 par Ronald Reagan (États Unis) et Margaret Thatcher (Grande Bretagne), s’est déployée largement, jusqu’à imprimer dans nos têtes l’idée que le marché, et non le droit, allait assurer des rapports sociaux apaisés. Dans cette logique, l’objectif principal de l’État néolibéral n’est plus d’assurer l’égalité et les droits de ses citoyen-ne-s, mais de garantir les conditions de bon fonctionnement du marché et de pallier occasionnellement ses déficiences. L’État n’intervient plus alors qu’en situation de crise ou d’urgence. Pourtant, la mise en œuvre des droits humains exige plutôt des politiques ancrées dans une perspective globale et de long terme. La crise actuelle du logement nous offre une caricature de cette logique. On sait depuis plusieurs années que la situation se dégrade en matière de logement, que nos lois et nos règles ne suffisent plus à assurer l’accès de toutes les personnes à un logement convenable. Cette situation touche une part de plus en plus importante de la population. Elle revêt plusieurs dimensions imbriquées qui ne sont pas apparues du jour au lendemain : entretien du parc locatif, écart coût/revenus, répartition territoriale, accès à la propriété, contenu de l’offre, etc. Pour assurer le droit au logement, l’État devrait donc adopter des politiques structurantes et revoir ses règles en prenant en compte ces différentes facettes du problème, mais sa réponse, pour l’heure, demeure celle d’une société de marché : il manque de logement, augmentons l’offre. Il ne s’agit en aucun cas d’assurer le droit au logement mais bien d’assurer l’équilibre du marché de l’habitation. Les conséquences sur les droits de cette gouvernance par les crises et l’urgence vouée à la protection de la société de marché se donne à voir avec le plus de brutalité dans le domaine des libertés publiques. On assiste en effet à un retour en force de la violence politique et des restrictions aux libertés, y compris dans les pays que l’on considérait jusqu’ici démocratiques : un ministre de l’Intérieur français qui se vante de contrevenir à la Convention européenne de sauvegarde, des manifestations faisant face à une violence policière disproportionnée, ou carrément interdites, etc. ; de plus en plus d’atteintes à ces libertés publiques se voient normalisées et légitimées dans les discours de nos dirigeants. Si la faillite du droit humanitaire est de plus en plus évidente dans les conflits en cours, il faut aussi constater que les États prennent de moins en moins au sérieux leurs obligations en matière de droits humains en temps de paix. Le respect des droits humains n’est plus ni le critère, ni l’objectif de leur action. Ils ont oublié que la DUDH, en son article 28, leur faisait obligation de maintenir « un ordre tel que les droits et libertés puissent y trouver plein effet ». En terminant, il apparait essentiel de relever un troisième aspect à ces deux dimensions, complexité juridique et contradictions politiques, même si l’espace ne permet pas d’élaborer beaucoup ici : l’enjeu des nouveaux droits. Le droit à l’eau ou le droit à un environnement sain par exemple, dont le statut juridique demeure incertain sur le plan du droit international, obligent à poser la question de l’incomplétude du catalogue originel de la DUDH. Il fut beaucoup question, dans les années 1970, d’une troisième génération de droits et une conférence internationale a même eu lieu au Mexique, à l’initiative de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), pour réfléchir sur le sujet. Le droit à la paix, le droit au développement, le droit au patrimoine de l’humanité, le droit à l’environnement, entre autres, y ont été abondamment discutés. Ces enjeux, fondamentaux, doivent-ils être considérés au titre des droits humains, ou en tant que conditions nécessaires à la réalisation des droits ? Tout en reconnaissant l'importance de ces enjeux pour la réalisation des droits humains, plusieurs considèrent que les reconnaitre en tant que droits entrainerait une complexité encore plus grande puisqu’on ne peut leur appliquer la logique à la base de tout droit qui exige en miroir l’identification d’un détenteur de l’obligation : right holder/duty holder. Or en matière de droit au développement, de droit à un environnement sain, de paix, etc., qui est le détenteur du droit ? Qui est le détenteur de l’obligation ? C’est peut être encore ici dans l’article 28 de la DUDH que nous pourrions trouver l’amorce d’un raisonnement propre à intégrer ces enjeux dans l’agenda des droits humains : un ordre tel que les droits et libertés puissent trouver plein effet exige un environnement sain, le développement, la paix, etc. Les droits de l’homme ne sont pas une politique écrivait en son temps Marcel Gauchet. Mais les droits humains doivent impérativement servir de boussole et d’horizon politique puisque seule la communauté politique est à même de garantir des droits.1) Les deux Pactes sont : le Pacte international des droits civils et politiques (PIDCP) avec le Comité des droits de l’homme chargé de son application et le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) avec le Comité des droits économiques, sociaux et culturels.
L’article Mettre en œuvre des droits : complexification et marginalisation est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

Des tiers-lieux engagés à créer un avenir différent ?
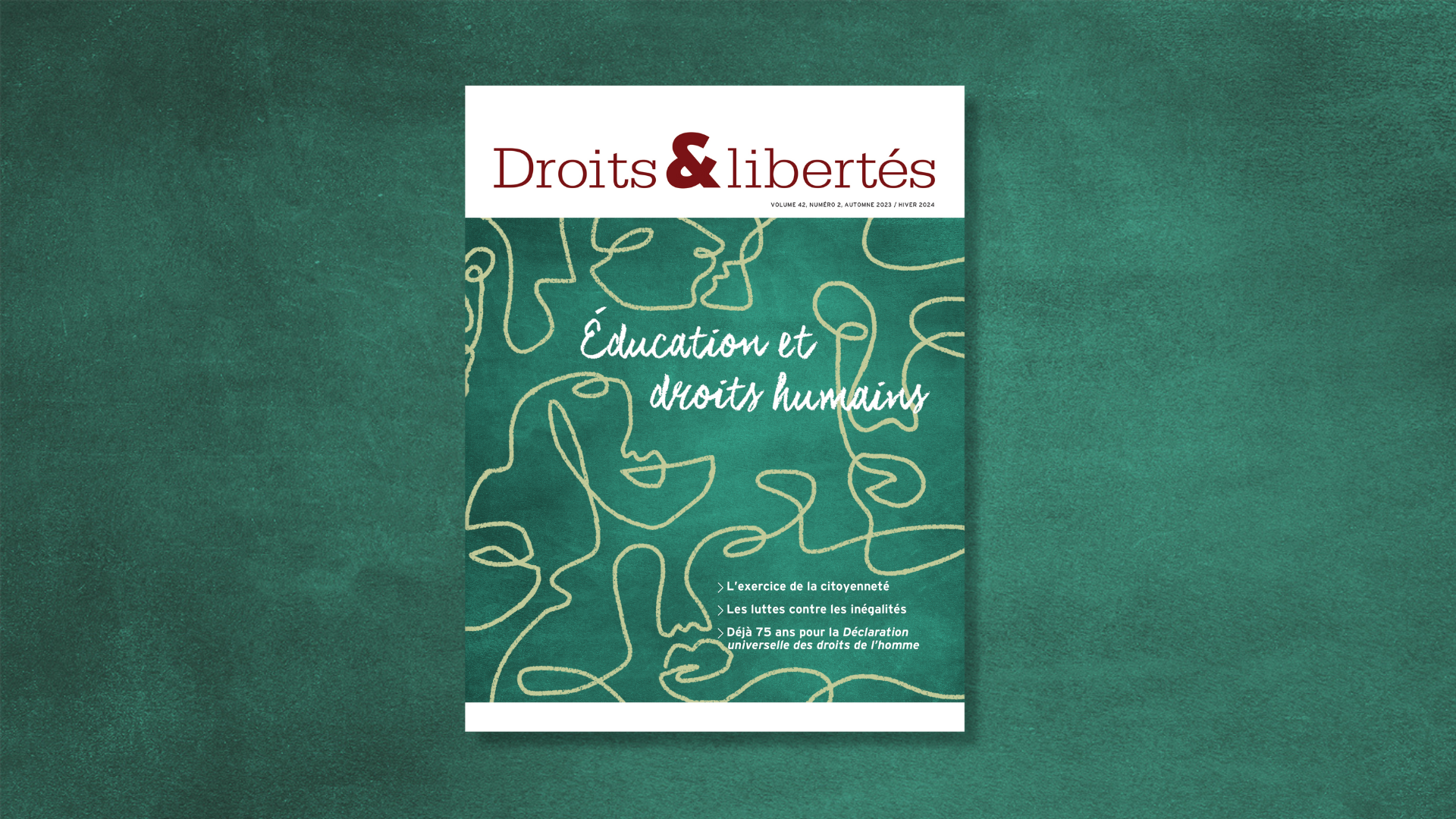
Retour à la table des matières Droits et libertés, automne 2023 / hiver 2024
Des tiers-lieux engagés à créer un avenir différent?
Pascale Félizat, bibliothécaire et observatrice des mouvements écocitoyens À la question « Avec le temps limité que nous avons désormais, où mettez-vous le plus d’espoir de changement, dans le milieu de l’éducation formelle ou informelle ? », deux jeunes québécois répondaient récemment que transformer à partir de l’éducation informelle leur semblait plus facile. Une autre étudiante précisait : « L’école peut apprendre les principes de base pour comprendre le monde mais elle n’apprendra pas à s’activer pour changer le monde ». Ces échanges se sont déroulés durant la table ronde Enjeux éducatifs de la mouvance jeunesse et étudiante pour la justice socio-écologique organisée par le Centr’ERE de l’UQAM en octobre 2023. Aujourd’hui, il n’est plus vraiment nécessaire d’expliquer pourquoi un changement sociétal profond est nécessaire. Tout le monde le sait et le vit. Trouverons-nous le chemin de cette métamorphose sociétale, qui exige, selon le philosophe Aurélien Barrau, « que nous redessinions l’ossature du réel1 »? À la lumière de ce que nous avons observé au cœur de Montréal, une voie semble possible. Elle associe trois groupes d’acteurs : tiers-lieux, groupes citoyens engagés et concepteurs et conceptrices d’activités permettant la reconnexion au milieu de vie et au pouvoir d’agir.Une éducation en évolution
De plus en plus documentés par la recherche, les apprentissages via la mobilisation citoyenne sont nombreux : exercice de la démocratie, politique, enjeux socio-écologiques, impact de l’extractivisme, existence de différentes sortes de rapports au monde, autres revendications (autochtones, décoloniale, antiraciste, féministe, pour la diversité de genre, etc.). S’y ajoutent des apprentissages d’ordre plus instrumental : communication, prise de parole, rédaction, évaluation, mobilisation, travail en équipe, gestion des tensions internes, innovation… Avec l’engagement citoyen, on fait aussi et surtout l’expérience d’une sorte de foi, celle qui pousse à continuer à affronter ces crises d’une gravité sans précédent. C’est l’espoir dont parle Vaclav Havel : la certitude que quelque chose fait sens quelle que soit l’issue finale. À cette même table ronde organisée par le Centr’ERE, une militante indiquait qu’elle aimerait que ces trois aspects particuliers de l’éducation retrouvent toute leur place : la responsabilité partagée de l’éducation « Pourquoi avons-nous arrêté de vouloir aussi éduquer l’enfant de la voisine ? » ; le savoir expérientiel : toutes les activités d’apprentissage basées sur l’observation, l’expérimentation dans son propre territoire, avec tous ses sens, dans l’émerveillement et la curiosité ; la capacité à continuer à se questionner sans cesse pour mieux construire le monde de demain y compris en se demandant « Qu’ai-je fait moimême pour contribuer à ce dont je me plains ou que je veux changer ? ». Ces trois modalités éducatives sont présentes au sein des collectifs citoyens et des tiers-lieux qui fleurissent ces dernières années dans les quartiers centraux de Montréal. On y renoue avec une certaine curiosité pour son milieu de vie, établissant de nouvelles relations avec celui-ci. On y exerce aussi un pouvoir d’agir, limité mais réel, tout en s’adaptant en continu aux nombreux imprévus qui ne manquent pas de se présenter. Vivre et apprécier sa codépendance, en même temps que l’exercice de son pouvoir d’agir tout en acceptant la prise de risques : il s’agit donc d’expérimenter un mode de relation au monde bien différent de celui privilégié par nos sociétés modernes centrées sur l’individualisme, le prêt à consommer et la recherche d’une sécurité maximale. Ces tendances observées au cœur de Montréal vont dans le sens de bien de nos textes fondateurs en éducation y compris l’article 13 du Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels ratifié par le Canada et le Québec : « [l’] éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre2 ».Avec l’engagement citoyen, on fait aussi et surtout l’expérience d’une sorte de foi, celle qui pousse à continuer à affronter ces crises d’une gravité sans précédent.
Des collectifs à connaître
Ces collectifs sont militants (Mères au front, Collectif Antigone…) ou non (Mémoires de Petite-Patrie). Ils sont parfois engagés dans la défense d’un commun menacé (Mobilisation 6600 Parc Nature MHM, À nous la Malting…). Ils sont parfois rassemblés sous la bannière d’une intention rassembleuse (Prenons la Ville) ou d’un manifeste (Gardiens et gardiennes du vivant). Ils sont centrés autour d’un quartier ou d’un territoire donné (Petite Famiglia, Petite Plaza ! À nous le Plateau, Angus s’amuse, Effervescence citoyenne…) ou d’une activité particulière (Super Boat people, Les fruits défendus, Cyclistes solidaires…).| Le terme tiers-lieu, traduit de l’anglais The Third Place, a été introduit en 1989 par le sociologue Ray Oldenburg dans son ouvrage The Great Good Place. Il fait référence aux environnements sociaux qui ne sont ni la maison ni le travail ou l’école. Un tiers-lieu ne se décrète pas mais se constate par la coexistence de plusieurs critères dont le caractère vivant, la capacité à générer de nouveaux liens d’amitié, l’absence de barrières à l’accès des lieux, le caractère fédérateur ou niveleur des conditions et croyances politiques, religieuses ou autres. L’adoption de ce lieu par une communauté distincte qui y imprime sa marque et invite les nouveaux venus à y participer librement est indispensable. Les tiers-lieux se déclinent en plusieurs formes et peuvent être aussi des lieux d’innovation et de faire-ensemble sous leurs formes laboratoires de création (makerspace, medialab, laboratoire de fabrication numérique, living lab, ruche d’art…). |
Les tiers-lieux
Les tiers-lieux pourraient-ils leur servir de caisse de résonnance ? À Montréal, on observe en effet parallèlement un renouveau de ces tiers-lieux : lieux d’un nouveau genre comme Brique par Brique, L’Espace des possibles Petite Patrie, Lespacemaker ; lieux d’éducation alternative ouverts sur la communauté (Fabrique familiale la Cabane) ; lieux d’éducation populaire (Ateliers d’éducation populaire du Plateau ; lieux communautaires (Chez Émilie, La Place) et autres centres sociaux (L’Achoppe)… Tous ces lieux présents au cœur de Montréal se positionnent de plus en plus clairement comme transformationnels. Depuis une quinzaine d’années, les bibliothèques aussi se réclament mondialement du concept de tierslieux et soulignent leur rôle en éducation relative à l’environnement. Véritable « infrastructure liquide qui hybride social, culturel et économique », l‘ensemble de ces lieux quadrillent le territoire dans une belle diversité décrite par la littérature4. Ils ont des armes spécifiques pour conforter les transformations socio-environnementales en cours: ressources partagées (documents mais aussi outils, grainothèques, accès à des experts), programmation régulière d’activités et de services (ateliers de réparation par exemple), formations à la maîtrise des technologies mais aussi « pédagogie du lieu ». Ce dernier volet est particulièrement fécond5 6. Fait intéressant, ces tiers-lieux hébergent régulièrement des artistes (comme la Ruche d’Art Yéléma présente depuis plusieurs années à la bibliothèque Marc Favreau) qui invitent leurs membres à sortir de la pensée rationnelle et à explorer de nouvelles pratiques. Aujourd’hui, toutefois, ces tiers-lieux et les prestataires d’activités éducatives non formelles du cœur de Montréal ne semblent pas se percevoir encore comme un même écosystème d’éducation non formelle. En réponse à ce constat, une poignée de citoyennes visent maintenant à leur proposer des micro-projets pour leur donner des occasions de travailler ensemble autour d’enjeux socio-environnementaux propres à leur territoire : faciliter l’accès de tous les Montréalaises au plein air en ajoutant, conjointement, des informations utiles à une carte de prêt d’accès Sépaq proposée par la BAnQ ; augmenter le pouvoir d’agir citoyen sur la question du logement en abritant des séances d’un jeu cocréé localement par les citoyens eux-mêmes ; contribuer à un répertoire conjoint des modalités de soutien aux projets citoyens pour l’activité Soupe locale, un exercice de démocratie participative qui vise à propulser des initiatives locales. Ces micro-projets sont autant de tentatives de tester, par l’expérimentation, la capacité collective des tiers-lieux à soutenir réelle ment et de façon plus constante et organisée les forces régénératrices portées par ces collectifs écocitoyens. À suivre!- Conférence d’Aurélien Barrau, Rencontres internationales de Genève, Catastrophe écologique : état du monde et perspectives, 26 septembre 2023. En ligne : https://www.youtube.com/watch?v=a5RQYI89plY
- Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 3 janvier 1976. En ligne : https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights
- Les membres de Promenade arboricole collective explorent des moyens de se relier autrement aux arbres Ce collectif a été mis en place à l’initiative de la fondatrice de l’OBNL Cœur d’Épinette.
- Voir Pascal Desfarges, Processus des tiers-lieux des infrastructures civiques de résilience, 2020. En ligne : https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2020-09/ARTICLE-TIERS-LIEU-DEFINITIF.pdf
- Le bibliothécaire David Lankes, dans son ouvrage Expect More, demanding better libraries for today’s complex world, incite les citoyens à réclamer davantage à leurs bibliothèques. En ligne : https://davidlankes.org/new-librarianship/expect-more-demanding-better-libraries-for-todays-complex-world/
- À sa suite, les bibliothèques parlent de leur lieu d’accueil comme un possible « symbole des aspirations de la communauté » mais bien d’autres aspects seraient à examiner pour davantage d’impact Voir par exemple : Pascale Félizat, Convialité/Convivialisme, 2022.En ligne : https://praxis.encommun.io/n/F4ZV1PMTKXLBPgOKtIh435qcWUc/
L’article Des tiers-lieux engagés à créer un avenir différent? est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme

75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme
Retour à la table des matières Droits et libertés, automne 2023 / hiver 2024
À l’occasion du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) adoptée le 10 décembre 1948, la revue Droits et libertés consacre quelques pages à la genèse de la Charte internationale des droits de l’homme et à quelques perspectives critiques des engagements des États envers les droits humains. Plus que jamais le respect, la protection et la mise en œuvre de tous les droits humains, politiques, civils, économiques, sociaux et culturels, sont des obligations auxquelles les États doivent répondre. Les militant-e-s des organisations de défense des droits au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde, jouent un rôle essentiel pour le respect des droits humains. Ils et elles ne cessent de porter à bout de bras, au bout de leurs pancartes, de leurs porte-voix et de leurs claviers, un projet de société basé sur les droits humains et de rappeler aux gouvernements leurs obligations. Dans la foulée de l’adoption de la DUDH, des militant-e-s de la première heure qui avaient réclamé l’adoption d’une charte des droits dès les années 1950 et en 1963, ont contribué à fonder la Ligue des droits et libertés, appelée alors la Ligue des droits de l’homme. Lors de l’exposition Droits en mouvements, soulignant les 60 ans de la Ligue des droits et libertés, qui s’est tenue à l’été 2023, des commentaires de visiteur-euse-s ont été recueillis dans un espace de cocréation aménagé à l’Écomusée du fier monde. Il était important de connaître leur point de vue sur les grands enjeux de l’avenir pour les droits humains. Une sélection de ces commentaires vous sont partagés dans l'article L'avenir des droits humains. Vous aussi pouvez partager votre point de vue! Nous aimerions vous entendre à propos des grands enjeux de l’avenir pour les droits humains. Écrivez-nous !L’article 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

Ce qui se joue à travers le voile des Iraniennes
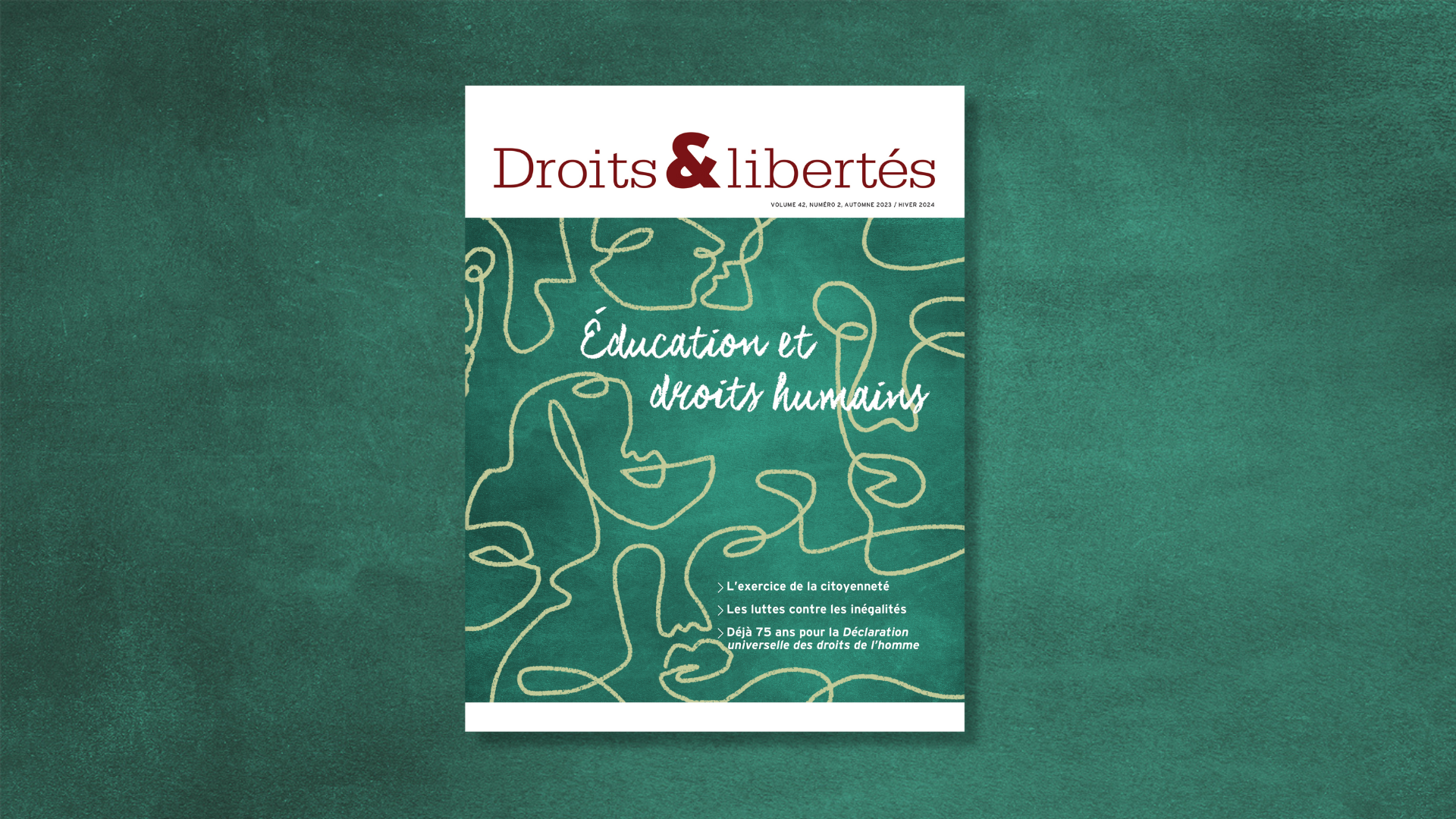
Ce qui se joue à travers le voile des Iraniennes
Retour à la table des matières Droits et libertés, automne 2023 / hiver 2024
Yalda Machouf Khadir, Avocate et militante iranienne Le 6 octobre dernier Nargess Mohammadi, militante féministe iranienne, se voyait octroyer le prix Nobel de la paix pour son combat en faveur des droits humains et contre l’oppression des femmes en Iran. Puis ce fut le tour de Jîna (Mahsa) Amini et le mouvement Femme, Vie, Liberté de recevoir le Prix Sakharov, soulignant leur contribution à la lutte pour la défense des droits de la personne et des libertés fondamentales. Si cette double distinction est l’expression d’un soutien important de la part de la communauté internationale, cette dernière peine toujours à sortir du symbolisme et à offrir une aide concrète à la population iranienne. Le voile des Iraniennes et leur revendication au droit à l’autodétermination de leur corps ont été le point focal de cette révolution inachevée : le voile imposé a embrasé la poudrière iranienne, et femmes et filles sont devenues les porte étendards du mouvement de contestation. Mais lorsque les femmes prennent les rues et brûlent leur voile, symbole de la ségrégation de genre et pilier de la théocratie iranienne, c’est l’ensemble du système politique en place qu’elles défient. Les revendications du mouvement porté par le slogan Jîn Jian Azadi (Femme, Vie, Liberté) dépassent ainsi largement cette question. Il s’agit d’un mouvement d’émancipation qui s’inscrit dans un cycle de soulèvements que connaît l’Iran depuis 2009 et qui porte en lui des revendications multiples, dont la liberté politique, la justice sociale et environnementale, la laïcisation et la démocratisation de l’État, ainsi que la pleine reconnaissance des minorités ethniques et de genres.Brutalité de la violence étatique
Le mouvement Femme, Vie, Liberté a donné lieu à une unité historique au sein de la société civile iranienne, notamment entre les courants féministes, ouvriers et les groupes de défense des droits des minorités ethniques. Une coalition de vingt organisations féministes, syndicales et de la société civile iranienne publiait ainsi, dès février 2023, une déclaration commune visant à jeter les bases d’un nouveau contrat social fondé sur douze principes minimaux, commençant par la libération inconditionnelle immédiate de tou-te-s les prisonnier-ière-s politiques et l’imputabilité des responsables de la répression étatique actuelle et passée1. C’est ainsi qu’en l’espace de quatre mois, 165 villes des quatre coins du pays ont été le théâtre de mobilisations massives, réunissant des manifestant-e-s de tous âges et de toutes conditions sociales. La réponse du gouvernement iranien face à l’embrasement du pays a été des plus brutales. Selon le Human Rights Activists News Agency, organe de presse d’une organisation indépendante de défense des droits de la personne opérant depuis l’Iran, cette répression féroce a fait en quatre mois plus de 530 morts et conduit à 19 763 arrestations, dont celle de 181 enfants2. Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de la personne en Iran, Javaid Rehman, décrivait dans son rapport rendu public en février 2023 une situation très alarmante faisant notamment état de torture et de mauvais traitements, y compris des violences sexuelles, à l’endroit des manifestant-e-s, d’emploi illégal de la force létale et d’exécutions d’enfants3. Face à la brutalité de la violence étatique, le mouvement de contestation qui défiait ouvertement le pouvoir dans la rue, a battu en retraite. Reste à voir si ce repli tactique lui permettra de trouver de nouvelles façons de se déployer. Car si dans les faits aucun changement structurel ne s’est encore opéré en Iran, la dynamique sociale a irrémédiablement changé et paraît nettement favorable aux Iraniennes qui s’octroient plus de libertés en dépit de toutes les tentatives du pouvoir religieux d’imposer des restrictions par de nombreuses mesures de rétorsion et de répression.Crise persistante
Mais plus important encore, la crise sociale et économique qui a instigué ce mouvement est loin d’être résolue et atteint des sommets inégalés. Un taux d’inflation vertigineux frisant les 50 %4, couplé à un taux de chômage de 11 % en 2022 — le taux de chômage chez les femmes étant supérieur de 7 points de pourcentage à celui des hommes5, accentuant ainsi la fracture sexuelle systémique — rend le quotidien des Iranien-ne-s insoutenable. Tout cela s’inscrit sur fond de corruption endémique et de dévastation environnementale qui sévit d’autant plus fort que le pouvoir est dopé par la rente des ressources premières. La théocratie iranienne qui a longtemps bénéficié d’un appui populaire reposant sur la ferveur religieuse doit, face au déclin de sa base historique, compenser par un clientélisme politique de plus en plus marqué. La vision extractiviste des ressources environnementales du pays, couplée à la nécessité de l’État de financer un appareil de répression coûteux, accentue la crise environnementale à laquelle l’Iran fait face. De plus, la construction intensive de barrages et le détournement des ressources hydrauliques du pays pour alimenter ses industries agricoles et pétrolières dévastent champs et campagnes, en plus de causer des pénuries d’eau importantes au pays. L’assèchement des lacs, rivières et marais perturbe l’ensemble de l’écosystème et représente aujourd’hui une dimension particulièrement aiguë de cette crise environnementale. La pollution urbaine est également une préoccupation importante, alors que l’Iran affiche parmi les pires indices de qualité de l’air au monde6. Nulle surprise de voir l’environnement comme terrain de mobilisation de la contestation du pouvoir. L’horizon n’est guère plus positif sur le plan social. De nouvelles dispositions législatives visant à contraindre le port du voile sont à l’étude. Elles prévoient de nouvelles formes de surveillance dans l’espace virtuel, un durcissement des sanctions en cas de non-respect du port du voile, un élargissement des mesures pénales aux entreprises, en plus d’encourager la délation au sein de la population7. La répression se fait aussi sentir au sein de l’appareil judiciaire. Le 17 octobre dernier, l’avocat de la famille de Jîna Amini, Saleh Nibakht, se voyait infliger un an de détention pour propagande contre l’État8. Moins d’une semaine plus tard, le 23 octobre, Niloofar Hamedi et Elahe Mohammadi, les deux journalistes ayant couvert la mort en détention de Jîna Amini recevaient des peines respectives de 13 et 12 ans de détention au terme de procès iniques où on leur reprochait d’avoir « collaboré avec un état ennemi, à savoir les États-Unis », de « rassemblement et collusion contre la sécurité nationale » et d’avoir fait de la « propagande contre l’État »9.Intensification de la peine de mort
On observe également depuis le début du mouvement une intensification du recours à la peine de mort par le système judiciaire. Les contestataires, inculpés pour des infractions vagues et imprécises comme moharabe (inimitié avec Dieu) et efsad-e fil-arz (corruption sur Terre), en sont une cible évidente10. Les plus grandes victimes de cette pratique proscrite par le droit international restent cependant les personnes condamnées pour des infractions liées au trafic de stupéfiants, des personnes provenant majoritairement de minorités ethniques cibles de discriminations systémiques et de communautés défavorisées sur le plan socioéconomique. Selon le plus récent recensement d’Amnistie internationale, au moins 282 personnes ont été exécutées en Iran en 2023, tous crimes confondus11. Au lendemain du décès de la jeune Armita Garavand, cette adolescente de 17 ans décédée le 29 octobre dans des circonstances qui rappellent douloureusement celui de Jîna Mahsa Amini, force est de constater que la marche vers la révolution politique et sociale initiée par les Iranien-ne-s sera plus longue qu’anticipé. Malgré les contrecoups et le fort prix payé par les opposant-e-s du régime, la population iranienne est déterminée à la mener à terme. Il peut sembler périlleux d’articuler son soutien à la lutte des Iranien-ne-s dans un contexte politique marqué par une montée du nationalisme identitaire et de l’islamophobie. C’est sans doute ce qui explique le manque d’enthousiasme des courants féministes québécois face à ce mouvement qui l’est pourtant résolument, tant par ses revendications que par sa forme. Pour sortir de cette impasse et tisser des liens de solidarité, il faut comprendre la multiplicité des revendications du mouvement Femme, Vie, Liberté et se rappeler que le voile n’est que le symbole de la structure politique que l’on cherche à renverser. Quelques pistes d’actions ont été dégagées par les initiatives de luttes qui ont pris origine dans la diaspora iranienne en appui au mouvement, dont le Collectif Femme Vie Liberté de Montréal :- Isoler le gouvernement iranien et le priver de ses liquidités : depuis octobre 2022, le gouvernement canadien s’est mis à la tâche en amendant les dispositions réglementaires régissant les sanctions économiques imposées au pays, pour élargir son champ d’application à des entités et personnes ayant participé à des violations graves et systémiques des droits de la personne en Iran12.
- Empêcher l’établissement au Canada et ailleurs des membres de l’appareil d’État iranien, de même que des oligarques iraniens et de toutes les personnes responsables de violations de droits de la personne en
- Contribuer à traduire en justice les auteurs de ces violations en appliquant le principe de compétence universelle13.
- Aider les Iranien-ne-s fuyant la persécution politique à trouver un refuge durable, notamment par la mise en place de programmes spéciaux de parrainage.
- Le Club Mediapart, Femme, Vie, Liberté ! Les organisations indépendantes syndicales et civiles, 20 février 2023. En ligne : https://blogs.mediapart.fr/patricio-paris/blog/200223/iran-femme-vie-liberte-les-organisations-independantes-syndicales-et-civiles
- Human Rights Activists News Agency, Iran Nationwide Protests after 157 Days: a Preliminary Summary of the Mass Releases, 21 février 2023. En ligne : https://www.en-hrana.org/iran-nationwide-protests-after-157-days-a-preliminary-summary-of-the-mass-releases/
- Javaid Rehman, Situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran – Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran, 7 février 2023. En ligne : https://www.ohchr.org/fr/documents/country-reports/ahrc5267-situation-human-rights-islamic-republic-iran-report-special
- International Monetary Fund, Country Data – Islamic Republic of Iran, octobre 2023. En ligne : https://www.imf.org/en/Countries/IRN#
- Groupe Banque mondiale, Data – Chômage, femmes (% de la population active féminine) (estimation modélisée OIT) - Iran, Islamic et Chômage, hommes (% de la population active masculine) (estimation modélisée OIT) - Iran, Islamic Rep. En ligne : https://donnees.banquemondiale.org/pays/iran-republique-islamique-d
- IQAir, 2022 World Air Quality Report - Region & City 5 Ranking, 47 pages.
- Al Jazeera Media Network, Iran’s parliament approves ‘hijab bill’; harsh punishments for violations, 20 septembre 2023. En ligne: https://www.aljazeera.com/news/2023/9/20/irans-parliament-approves-hijab-bill-harsh-punishments-for-violations
- Center for Human Rights in Iran, Blind Human Rights Lawyer Disappears in Iran, 19 octobre 2023. En ligne : https://iranhumanrights.org/2023/10/blind-human-rights-lawyer-disappears-in-iran/
- Human Rights Activists News Agency, Journalists Niloofar Hamedi and Elahe Mohammadi Sentenced to a Combined 25 Years in Prison, 23 octobre 2023. En ligne : https://www.en-hrana.org/journalists-niloofar-hamedi-and-elahe-mohammadi-sentenced-to-a-combined-25-years-in-prison/
- Javaid Rehman, op.é cit., p.15.
- Amnesty International, Frénésie d’exécutions dans les prisons pour des infractions liées aux stupéfiants : les chiffres ont quasiment triplé cette année, 2 juin 2023. En ligne : https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2023/06/iran-prisons-turned-into-killing-fields-as-drug-related-executions-almost-triple-this-year/
- Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran, DORS/2010-165, art. 2, par a.1).
- En ligne : https://www.amnesty.fr/focus/competence-universelle
L’article Ce qui se joue à travers le voile des Iraniennes est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

Quel respect des droits humains avec l’identité numérique ?
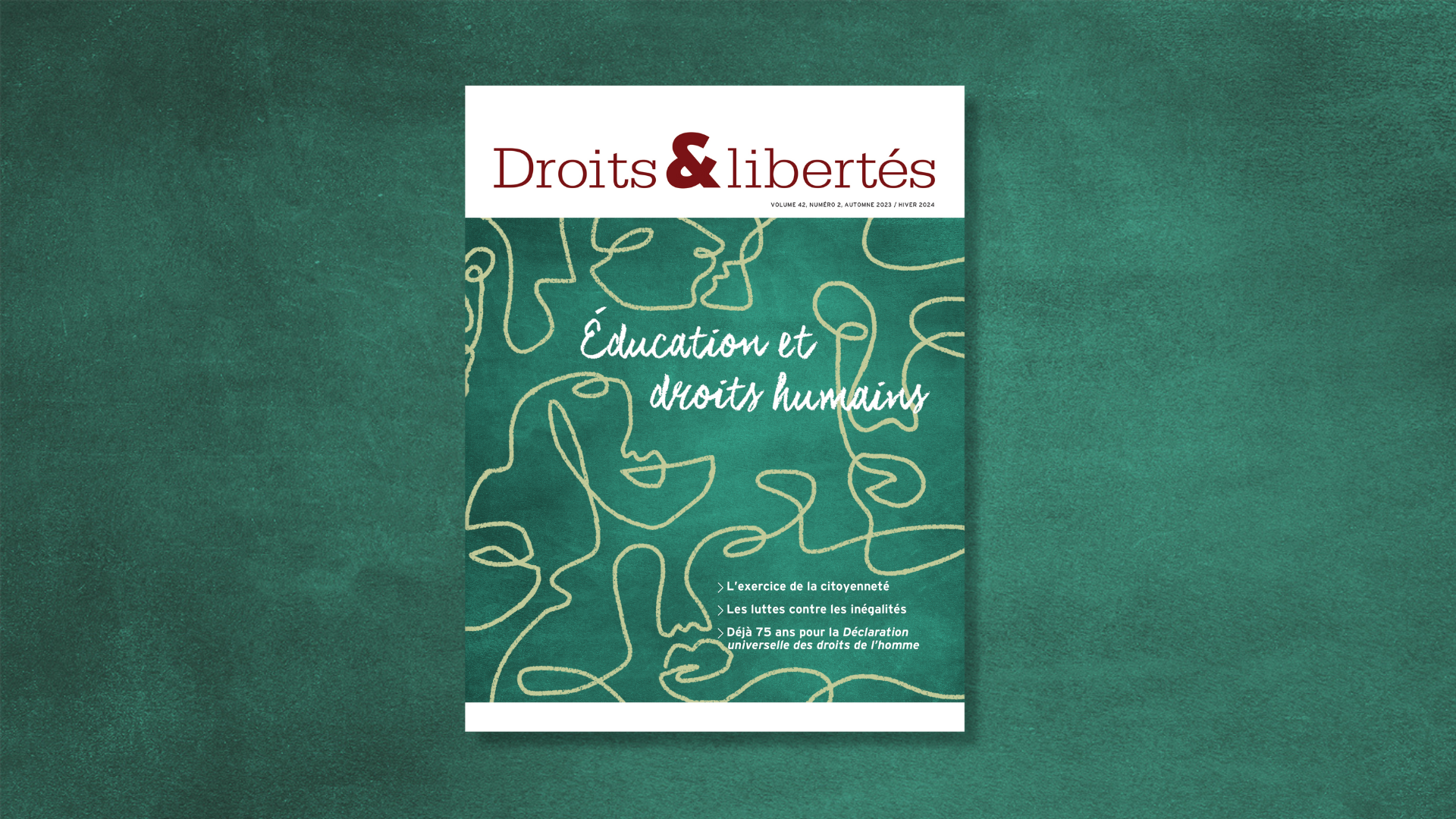
Quel respect des droits humains avec l’identité numérique?
Retour à la table des matières Droits et libertés, automne 2023 / hiver 2024
Anne Pineau, Membre du comité Surveillance des populations, intelligence artificielle et droits humains Selon une enquête réalisée par l’Académie de la transformation numérique (Université Laval) « moins de la moitié des internautes québécois connaissent les concepts d’identité numérique (44 %) et de portefeuille numérique gouvernemental (45 %)1 ». Et seulement 40 % des adultes internautes affichent de l’intérêt « pour installer une carte d’identité numérique sur leur téléphone intelligent ». Malgré ce désintérêt ou cette méconnaissance, le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Caire, avance à marche forcée dans son projet d’identité numérique (IN).Manque de transparence
Il y a un an, le 24 octobre 2022, les commissaires à la protection de la vie privée de tout le Canada publiaient une résolution concernant les systèmes d’identité numérique2. Elle énonce les exigences que devraient respecter les gouvernements en la matière3. Au Québec, la Commission d’accès à l’information, signataire de la résolution commune, précisait dans un communiqué que « le gouvernement doit faire preuve de transparence à toutes les étapes de la réalisation du projet d’identité numérique en sollicitant la participation citoyenne par des consultations élargies, comme l’ont fait certaines provinces »4. Or, force est de constater que le projet de Service québécois d’identifiant numérique (SQIN) se développe actuellement sans débat, et qu’à plusieurs égards, il ne respecte pas les exigences de la résolution : éventuelle utilisation de la biométrie, manque de consultation, absence d’encadrement légal précis.Service québécois d’identité numérique (SQIN)
Un mémoire déposé au Conseil des ministres sur le SQIN en décembre 20215 apporte certaines informations : la « solution d’affaires » vise l’élaboration d’un document d’identité numérique gouvernemental faisant autorité auprès des tiers (public ou privé). Cette identité serait supportée par un portefeuille numérique (application mobile) permet tant de conserver des cartes, permis et attestations d’identité diverses. Une vérification d’identité « bonifiée » par l’utilisation potentielle de la biométrie, par exemple la reconnaissance faciale, est prévue. Le système aurait un registre doté d’un processus de vérification d’identité de toutes les personnes résidant au Québec.En trois volets
Le Service d’authentification gouverne mentale (SAG), l’étape 1 du projet SQIN, est une « solution d’authentification » qui permettra aux individus d’accéder en ligne à des services gouvernementaux et de consulter à distance leurs dossiers personnels (santé, SAAQ, Revenu Québec etc.). Comme le mentionne le mémoire au Conseil des ministres, le SAG « met en place les fondements d’une identité numérique » pour les fins gouvernementales. Ce service a été inauguré dans le cadre de la transformation numérique de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), avec les résultats discutables que l’on sait. L’étape 2 du SQIN vise l’authentification des entreprises faisant affaire avec le gouvernement. L’étape 3 concerne l’ajout d’un portefeuille numérique, c’est-à-dire un « document d’identité numérique gouvernementale, sur un support numérique, faisant autorité et sur lequel peuvent se fier les tiers dans le cadre de programmes, de services ou d’autres activités ». Le mémoire précise que « les consommateurs de l’identité numérique disposeront d’un moyen simple, fiable et légalement reconnu de valider l’identité d’un résident du Québec avec lequel ils souhaitent faire affaire […] ». Pour mettre au point ce volet « des entreprises couvrant plusieurs domaines d’affaires (finances, télécommunications, assurances) ont été consultées » dans le but « de recueillir ou valider les besoins qui font partie intégrante de la solution proposée ». Le portefeuille s’articule donc autour des besoins des entreprises. Cette dernière phase du projet SQIN est prévue pour 2025. Le projet SQIN, dans son ensemble, soulève de nombreuses questions.Respect des droits humains et encadrement légal
L’élaboration d’un identifiant numérique fiable et sécuritaire doit d’abord respecter le droit à la vie privée et les autres droits humains.Le système ne devrait pas permettre la surveillance et aucun détournement de finalités ne doit être possible, ce qui implique l’adoption d’un cadre légal robuste et précis, allant bien au-delà des lois générales de protection des renseignements personnels. Or, aucune loi particulière n’encadre le SQIN. Les commissaires à la vie privée indiquent pourtant que les nombreuses conditions qu’ils posent à l’établissement d’un tel système d’IN devraient « être intégrées à un cadre législatif applicable à la création et à la gestion des identités numériques », et assorti d’interdictions, de sanctions et de recours. Le SQIN devrait aussi faire l’objet d’une évaluation et d’une surveillance par un organisme indépendant.
Sécurité et conception des systèmes : une forte dépendance au privé
Les questions de sécurité et de confidentialité des données sont cruciales. En cas de panne, de piratage ou d’attaques par rançongiciels du système d’identifiants, on peut craindre une paralysie des services gouvernementaux. Et qu’en sera-t-il en cas de vol d’identité ? Les appréhensions sont d’autant plus importantes que le gouvernement peine à recruter des experts en cybersécurité, ce qui l’amène à dépendre fortement du secteur privé. La proportion de sous traitants en informatique au sein du gouvernement atteignait 34,3 % en 20226, en forte hausse. L’utilisation de ressources externes augmente les coûts de même que les risques sur le plan de la confidentialité (plus de joueurs extérieurs). Le recours aux géants américains du Web, tels que Google, Amazon et Microsoft, pour l’hébergement des données ajoute aux inquiétudes, le Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act (Cloud Act) permettant aux autorités américaines d’accéder aux données hébergées (en infonuagique) par un fournisseur américain, peu importe où elles sont stockées7.Biométrie
Selon ce que le ministre Caire a maintes fois indiqué aux médias, l’identifiant pourrait être activé par reconnaissance faciale mais au choix de l’utilisatrice ou de l’utilisateur8. Il a aussi laissé entendre que les photos du permis de conduire ou de la carte d’assurance maladie pourraient éventuellement être utilisées9. Plus récemment, dans le cadre de l’étude des crédits budgétaires de son ministère, le ministre déclarait qu’une consultation aurait lieu sur cette question : « Mais, pour la reconnaissance faciale, dans le SQIN, ce que je vous avais dit et ce que je vous redis, c’est qu’il y aura consultation publique. Mais, si on veut amener notre service d’identité à ce qu’on appelle un niveau trois, donc c’est un niveau supérieur au niveau de la sécurité, c’est le genre d’élément (…) qu’on devra déployer, donc, l’identification par la biométrie. Et, si on ne souhaite pas ça, évidemment, si les citoyen-ne-s ne souhaitent pas aller là, bien, on n’ira pas10 ». Fonder un système d’identifiant gouvernemental sur l’utilisation de la biométrie mènerait à une banalisation insidieuse de cette technologie très invasive. Et ce même si son usage demeurait facultatif. Le critère retenu par les commissaires à la vie privée dans leur résolution n’est pas celui de la volonté mais de la nécessité11. Quant à l’argument de la sécurité, les commissaires à la vie privée notent dans un autre document : « Il ne suffit pas de s’appuyer sur des objectifs généraux de sécurité publique pour justifier l’utilisation d’une technologie aussi intrusive que la reconnaissance faciale12 ». L’usage de la biométrie semble se répandre au sein du gouvernement québécois. En 2020, la Sûreté du Québec concluait un contrat avec la société Idemia pour une « solution d’empreintes digitales et de reconnaissance faciale en mode infonuagique privé ». En 2022, la SAAQ annonçait adopter elle aussi cette technologie, apparemment pour « faire le ménage » de sa banque de photos13. Si le chaos généré par la transition numérique de l’organisme a mené la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, à suspendre ce projet, tout indique qu’il ne s’agit que d’une pause14. L’extension projetée de cette technologie à l’identifiant numérique démontre l’insouciance du gouvernement quant aux risques que fait planer cette technologie sur la vie privée et la démocratie. Comme le signalent encore les commissaires à la vie privée : « Si elle est utilisée de manière inappropriée, la technologie de reconnaissance faciale peut donc avoir des effets durables et sérieux sur la vie privée et sur d’autres droits fondamentaux. Cela inclut des préjudices subis par certaines personnes dont les renseignements personnels peuvent être recueillis, utilisés ou communiqués, mais aussi des préjudices pour les groupes et les communautés et des préjudices sociétaux plus généraux qui découlent de la plus grande capacité des autorités à surveiller les espaces physiques et numériques dans lesquels les citoyen-ne-s interagissent. Il peut être difficile de limiter cette plus grande capacité de surveillance une fois qu’elle est enclenchée15 ».Fracture numérique
Comment, enfin, garantir que l’identifiant numérique n’accentuera pas la fracture numérique d’une partie de la population ? Que le passage au gouvernement en ligne ne sera pas l’occasion de coupes sévères dans les services téléphoniques ou en personne ? Que les exclu-e-s du numérique ne seront pas laissés pour compte dans l’accès aux services gouvernementaux. Cet écart est déjà très préoccupant comme le signale le Protecteur du citoyen dans son dernier rapport : « (…) il existe un véritable fossé entre, d’une part, les services mis en ligne et, d’autre part, les personnes qui éprouvent des problèmes d’accès à ces modes de communication16 ».Ailleurs dans le monde
La course à l’identifiant numérique dépasse les frontières québécoises. Le ministre Caire collabore depuis quelques années avec le fédéral et les provinces de l’Ontario et de la Colombie-Britannique pour assurer l’interopérabilité (compatibilité) des services d’IN de chaque gouvernement17. En France, une application gouvernementale (France Identité Numérique) a été lancée en septembre 2023. Le gouvernement vise une généralisation de l’IN (80 % d’utilisateurs) en 2027. L’IN n’est toutefois pas obligatoire et, fait important, l’État, devant la grogne et des avis défavorables de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, l’équivalent de la CAI pour le Québec, a dû renoncer à l’utilisation de la reconnaissance faciale18. Une IN européenne est aussi en cours d’élaboration. En février 2017, la Banque Mondiale, et d’autres entités, publiaient les Principes généraux sur l’identification pour un développement durable : vers l’ère numérique19. L’objectif officiel : offrir une forme légale d’identification permet tant l’accès aux services publics, aux programmes sociaux et au marché en ligne. À cela s’ajoute une initiative de la Banque mondiale (ID4D) pour fournir une gamme complète de soutiens financiers et techniques aux niveaux national et régional en Afrique. Mais l’IN ne crée, en soi, aucun droit et l’accès à des programmes sociaux peut demeurer bien théorique, même avec un tel outil. Dans ce contexte, l’IN s’avère surtout un catalyseur de l’économie numérique, une identité « transactionnelle » comme la décrit le Center for Human Rights & Global Justice dans un texte de juin 2022. L’organisme reproche aussi à la Banque Mondiale de soutenir des projets d’IN fondés sur la biométrie. « La Banque prend soin de préciser que les données biométriques ne sont pas exigées. Mais en insistant autant sur leurs avantages dans toute sa documentation, l’initiative ID4D a contribué à normaliser l’utilisation extensive de la biométrie dans les systèmes d’identification numérique20 ». [Traduction libre] Coïncidence ? Secure Identity Alliance (SIA), qui compte parmi ses membres les principales entreprises de biométrie, endosse les Principes généraux sur l’identification établis par la Banque Mondiale.Conclusion
L’identité numérique soulève nombre d’enjeux de droits humains : vie privée, protection des données, anonymat, surveillance, cybersécurité, inégalités, démocratie, relation des citoyen-ne-s avec l’État, accès aux programmes sociaux, etc. Autant de défis qui justifient amplement la tenue d’un débat public, démocratique et éclairé sur l’ensemble du projet d’identifiant numérique, comme le réclament de nombreux experts et organisations, dont la Ligue des droits et libertés.- Académie de la transformation numérique. Les services gouvernementaux en ligne et l’identité numérique (2021). 27 avril 2022. En ligne : https://transformation-numerique.ulaval.ca/enquetes-et-mesures/netendances/les-services-gouvernementaux-en-ligne-et-lidentite-numerique-2021
- Assurer le droit à la vie privée et la transparence dans l’écosystème d’identité numérique au CanadaRésolution des commissaires à la protection de la vie privée fédéral, provinciaux et territoriaux et des ombudsmans qui assument une fonction de surveillance dans le domaine. En ligne : https://www.priv.gc.ca/fr/a-propos-du-commissariat/ce-que-nous-faisons/collaboration-avec-les-provinces-et-les-territoires/resolutions-conjointes-avec-les-provinces-et-territoires/res_220921_02
- Notamment : participation volontaire des individus; contrôle des personnes sur leurs renseignements; ne pas utiliser de données biométriques sauf nécessité; le système ne devrait pas permettre le traçage ni créer de bases de données centralisées; transparence et encadrement légal du système d’IN incluant des droits de recours pour les citoyen-ne-s.
- En ligne : https://www.cai.gouv.qc.ca/identite-numerique-canada-organismes-de-surveillance-demandent-aux-gouvernements-dassurer-le-droit-a-la-vie-privee-et-la-transparence-dans-leurs-projets-et-systemes
- En ligne : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/gouvernement/MCE/dossiers-soumis-conseil-ministres/2021-0227_memoire.pdf
- Nicolas Lachance, Une transformation numérique sans expertise et sans effectifs pour Éric Caire, Journal de Montréal, 25 avril 2023. En ligne : https://www.journaldemontreal.com/2023/04/25/une-transformation-numerique-sans-expertise-et-sans-effectifs-pour-eric-caire
- Rousseau, La souveraineté numérique en agroalimentaire au Canada et au Québec, CIRANO, 16 février 2021. En ligne : https://cirano.qc.ca/files/publications/2021PE-03.pdf
- Nicolas Lachance, Identité numérique des Québécois: la reconnaissance faciale ne sera pas obligatoire, Journal de Québec, 25 février 2022. En ligne : https://www.journaldequebec.com/2022/02/25/identite-numerique-des-quebecois-la-reconnaissance-faciale-ne-sera-pas-obligatoire
- Stéphane Rolland, La Presse canadienne, Des documents financiers seront-ils associés à nos futures identités numériques au Québec?, Le Devoir, 7 janvier 2022. En ligne : https://www.ledevoir.com/politique/quebec/658875/des-documents-financiers-seront-ils-associes-a-nos-futures-identites-numeriques-au-quebec?
- Journal des débats de la Commission des finances publiques, Vol. 47 N° 21, Étude des crédits budgétaires du ministère de la Cybersécurité et du Numérique, 26 avril 2023. En ligne : https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/cfp-43-1/journal-debats/CFP-230426.html
- « La collecte ou l’utilisation de renseignements particulièrement intimes, sensibles et permanents, comme les données biométriques, ne devraient être envisagées que s’il est démontré que d’autres moyens moins intrusifs ne permettent pas d’atteindre l’objectif poursuivi; »
- Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, Document d’orientation sur la protection de la vie privée à l’intention des services de police relativement au recours à la reconnaissance faciale, mai 2022, 62.
- Nicolas Lachance, Après ses ratés informatiques, la SAAQ se lance dans la reconnaissance faciale, Journal de Québec, 4 avril 2023. En ligne : https://www.journaldequebec.com/2023/04/04/la-saaq-utilisera-la-reconnaissance-faciale-pour-prevenir-les-fraudes
- Nicolas Lachance, Reconnaissance faciale à la SAAQ: Guilbault demande la suspension du projet, Journal de Québec, 4 avril 2023. En ligne : https://www.journaldequebec.com/2023/04/04/reconnaissance-faciale-a-la-saaq-guilbault-demande-la-suspension-du-projet
- Document d’orientation sur la protection de la vie privée à l’intention des services de police relativement au recours à la reconnaissance faciale. Précité. par. 14
- Rapport annuel 2022-2023, page 13. En ligne : https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/2023-09/rapport_annuel-2022-2023-protecteur-citoyen.pdf
- En ligne : https://www.newswire.ca/fr/news-releases/avancees-importantes-en-matiere-d-identite-numerique-pour-le-quebec-rencontre-des-ministres-federal-provinciaux-et-territoriaux-sur-la-confiance-numerique-et-la-cybersecurite-869739478.html
- Louis Adam, France Identité numérique veut faire oublier ZDNET, 2 mai 2022.En ligne : https://www.zdnet.fr/actualites/france-identite-numerique-veut-faire-oublier-alicem-39941353.htm
- En ligne : https://thedocs.worldbank.org/en/doc/423151517850357901-0190022018/original/webFrenchID4DIdentificationPrinciples.pdf
- Center for Human Rights and Global Justice, NYU School of Law, Paving a Digital Road to Hell? A Primer on the Role of the World Bank and Global Networks in Promoting Digital ID, juin 2022. En ligne : https://chrgj.org/wp-content/uploads/2022/06/Report_Paving-a-Digital-Road-to-Hell.pdf
L’article Quel respect des droits humains avec l’identité numérique? est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.












