Revue Droits et libertés
Publiée deux fois par année, la revue Droits et libertés permet d’approfondir la réflexion sur différents enjeux de droits humains. Réalisée en partenariat avec la Fondation Léo-Cormier, la revue poursuit un objectif d’éducation aux droits.
Chaque numéro comporte un éditorial, les chroniques Un monde sous surveillance, Ailleurs dans le monde, Un monde de lecture, Le monde de l’environnement, Le monde de Québec, un dossier portant sur un thème spécifique (droits et handicaps, droits des personnes aînées, police, culture, droit à l’eau, profilage, mutations du travail, laïcité, etc.) ainsi qu’un ou plusieurs articles hors-dossiers qui permettent de creuser des questions d’actualité. Les articles sont rédigés principalement par des militant-e-s, des représentant-e-s de groupes sociaux ou des chercheuses ou chercheurs.
Créée il y a 40 ans, la revue était d’abord diffusée aux membres de la Ligue des droits et libertés. Depuis, son public s’est considérablement élargi et elle est distribuée dans plusieurs librairies et disponible dans certaines bibliothèques publiques.
Bonne lecture !

C-27 | Un trio législatif… accommodant pour l’industrie

Retour à la table des matières Droits et libertés, printemps / été 2024
Un trio législatif… accommodant pour l’industrie
Anne Pineau, membre du comité Surveillance des populations, intelligence artificielle et droits humains de la Ligue des droits et libertés Le lancement du robot conversationnel ChatGPT-4 au printemps 2023 a créé une véritable onde de choc, au point d’amener des experts et industriels du secteur de l’intelligence artificielle (IA) à réclamer une pause de six mois dans le développement de systèmes plus puissants1. Comme si les experts n’avaient pas vu venir le train ; et comme si l’encadrement sécuritaire de tels outils pouvait se résoudre en 6 mois ! Le besoin pressant d’un cadre législatif solide en matière d’IA coule de source. Mal conçue ou mal utilisée, cette technologie peut être dommageable : hameçonnage, cyberharcèlement, discrimination, désinformation, manipulation, surveillance, atteinte à la vie privée et au droit d’auteur, impacts sur l’emploi et l’environnement, etc. Mais l’urgence ne saurait justifier l’adoption d’une loi au rabais.
La Charte du numérique
Depuis quatre ans, Ottawa tente de moderniser le régime fédéral de protection des renseignements personnels (RP) dans le secteur privé. Le projet de loi C-11, déposé en 2020, est mort au feuilleton en 2021. Il a été remplacé en juin 2022 par le C-27. Alors que C-11 ne concernait que les RP et la création d’un Tribunal des données, C-27 ajoute en catimini un troisième volet sur l’intelligence artificielle. C-27 vise donc l’édiction de trois lois : partie 1 : Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs (LPVPC) ; partie 2 : Loi sur le Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données (Loi sur le Tribunal) ; partie 3 : Loi sur l’intelligence artificielle et les données (LIAD). C’est le ministre de l’Industrie (Innovation, Science, ISDE) qui pilote le projet, ce qui en dit déjà long sur l’orientation donnée au dossier. Le C-27 est en examen devant le Comité permanent de l’industrie et de la technologie (INDU) depuis septembre 2023. Plus de 100 mémoires ont été soumis2 plusieurs critiquant vivement l’ensemble de l’œuvre. Nous faisons un survol des principaux reproches formulés à l’endroit de ce projet de loi omnibus.1. LOI SUR LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DES CONSOMMATEURS
La Loi fédérale qui encadre actuellement les renseignements personnels dans le secteur privé a été adoptée en 20003. Une modernisation tenant compte des avancées technologiques s’impose. C’est ce que tente de faire la LPVPC, la partie 1 de C-27. Notons que dans les provinces disposant d’une loi essentiellement semblable à la LPVPC, c’est la loi provinciale qui s’applique. Ainsi, la LPVPC n’aura pas d’application au Québec.Droit à la vie privée
La LPVPC vise, selon son titre, à promouvoir le commerce électronique au moyen de la protection des renseignements personnels utilisés dans le cadre d’activités commerciales. Son objet est défini à l’article 5 : dans un contexte où « une part importante de l’activité économique repose sur l’analyse, la circulation et l’échange de renseignements personnels », la loi vient fixer des « règles régissant la protection des renseignements personnels d’une manière qui tient compte, à la fois, du droit fondamental4 à la vie privée des individus […] et du besoin des organisations de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels […] ». On mise donc sur un équilibre entre droit humain et activité économique, comme si les deux éléments pouvaient s’équivaloir ! De plus, cet équilibre n’est que façade car plusieurs autres dispositions de la loi font en réalité primer les besoins commerciaux de l’entreprise — ou organisation — sur le droit des individus. Comme le souligne le Centre pour la défense de l’intérêt public dans son mémoire : « Les récentes modifications apportées par le ministre dans le but d’ajouter la vie privée comme droit fondamental au préambule et à l’objet du projet de loi sont inutiles, car rien d’autre dans le projet de loi et, plus largement dans le cadre juridique, ne protège la vie privée en tant que droit de la personne ».Sans consentement
En principe, le consentement est nécessaire pour recueillir, utiliser ou communiquer des RP. Mais en réalité le C-27 établit une multitude d’exceptions (art. 18 à 52). Certaines sont reprises de la loi actuelle. Mais plusieurs sont nouvelles. Il sera notamment possible de faire usage de RP à l’insu et sans le consentement de la personne concernée (voir encadré ci-dessous).| Exceptions prévues dans la Loi pour l’usage sans consentement des renseignements personnels :
• pour des activités d’affaires art. 18 (1) • en vue d’une activité dans laquelle l’organisation a un intérêt légitime qui l’emporte (selon elle !) sur tout effet négatif que la collecte ou l’utilisation peut avoir pour l’individu art. 18 (3) • à des fins de recherche, d’analyse et de développement internes, si les RP sont d’abord dépersonnalisés art. 21 • communication à des fins de statistiques ou d’étude ou de recherche lorsque le consentement est pratiquement impossible à obtenir art. 35 • entre organisations en vue de la détection d’une fraude art. 27 • à une institution gouvernementale pour une fin socialement bénéfique (si les RP sont d’abord dépersonnalisés) art. 39 • pour l’application de la loi art. 43 à 46 et 49 • à une institution gouvernementale (à sa demande ou de la propre initiative de l’organisation en cas de soupçons que les RP concernent la sécurité nationale, la défense du Canada ou la conduite des affaires internationales) art. 47-48 |
On mise donc sur un équilibre entre droit humain et activité économique, comme si les deux éléments pouvaient s’équivaloir! De plus, cet équilibre n’est que façade car plusieurs autres dispositions de la loi font en réalité primer les besoins commerciaux de l’entreprise — ou organisation — sur le droit des individus.Il sera aussi permis d’utiliser les RP sans contrainte en les anonymisant puisqu’ils se trouvent alors exclus de la loi. Or, on sait que l’anonymisation est un procédé faillible et qu’un risque de réidentification demeure toujours possible. De plus, même anonymisés, les RP sont porteurs d’informations qui devraient faire l’objet d’un contrôle, comme le constate Brenda McPhail : « Considérant que même l’anonymisation des renseignements personnels est inefficace contre les pratiques de tri social, qui sont à l’intersection de la vie privée et de l’égalité, toutes les données dérivées de renseignements personnels, qu’elles soient identifiables, non personnalisées ou anonymisées, devraient faire l’objet d’une surveillance proportionnelle par le commissaire à la vie privée6 ».
Système décisionnel automatisé
L’organisation qui utilise un système décisionnel automatisé (SDA) pour faire une recommandation ou prendre une décision ayant une incidence importante sur une personne doit, à sa demande, lui fournir une explication (renseignements utilisés, principaux facteurs ayant mené à la décision). Ce droit à l’explication est fort restreint. Le CPVP note que « le fait de limiter cette obligation aux décisions qui pourraient avoir une incidence importante ne permettrait pas d’assurer la transparence des algorithmes ». Qui plus est, la loi n’offre aucun recours : pas le droit de s’opposer à ce qu’une décision soit prise par SDA et aucun droit d’appel de la décision.Pouvoirs du CPVP
La loi accorde un nouveau pouvoir d’ordonnance au CPVP. Et les organisations pourraient écoper de fortes sanctions administratives en cas d’infraction à certaines dispositions de la loi. Malheureusement le commissaire ne peut que recommander et non imposer lui-même7 ces sanctions qui sont de la compétence du nouveau Tribunal des données.2. LOI SUR LE TRIBUNAL DE LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET DES DONNÉES
Cette loi (partie 2 de C-27) instituerait un nouveau Tribunal, agissant en appel des conclusions et décisions du CPVP. Ce tribunal statuera aussi sur les recommandations de sanctions administratives du commissaire. Il se compose de trois à six membres choisis par le gouverneur en conseil (gouvernement) sur recommandation du ministre. Plusieurs groupes ont condamné la création de ce Tribunal qui ne fera qu’étirer les délais et saper l’autorité du CPVP. De l’avis du CPVP dans son mémoire sur C-27 : « La création du Tribunal ajoute donc un palier de contrôle supplémentaire dans le processus causant des délais et des coûts additionnels ». Le commissaire propose plutôt de limiter les recours à un contrôle judiciaire directement en Cour d’appel fédérale.3. LOI SUR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET LES DONNÉES
La LIAD (partie 3 de C-27) n’a fait l’objet d’aucune consultation avant son dépôt, sauf peut-être auprès de l’industrie et de certains experts. De très nombreux groupes, dont la Ligue des droits et libertés (LDL), ont dénoncé ce fait et demandent le retrait de cette partie de C-27 jusqu’à la tenue de véritables consultations publiques8. On conteste également que le ministère de l’Industrie (ISDE) soit le principal voire l’unique rédacteur d’un projet de loi qui aura des impacts sur l’ensemble de la société.Exclusion du secteur public
La LIAD se limite au secteur privé ; elle ne s’applique pas aux institutions fédérales (ministères, organismes publics, sociétés d’État). Elle ne s’applique pas non plus à l’égard des produits, services ou activités relevant : a) du ministre de la Défense ; b) du SCRS ; c) du Centre de la sécurité des communications ; d) de toute autre personne désignée par règlement. L’exemption gouvernementale a été décriée par de nombreux intervenants, dont la LDL. L’utilisation de l’IA par les institutions fédérales et organismes de sécurité doit faire l’objet d’un encadrement légal assurant un contrôle indépendant et public.Objet de la loi
La LIAD vise l’établissement d’exigences canadiennes pour la conception, le développement et l’utilisation des systèmes d’intelligence artificielle (SIA) ainsi que l’interdiction de certaines conduites relativement aux SIA qui peuvent causer un préjudice sérieux aux individus (physique ou psychologique, dommages aux biens, perte économique) ou un préjudice à leurs intérêts. La loi ne prend donc en compte que le préjudice personnel et non les graves préjudices collectifs que peuvent engendrer les SIA. Cela est fortement critiqué.Système d’IA à incidence élevée
La LIAD impose diverses obligations au responsable d’un système d’IA à incidence élevée (SIÉ), obligations qui peuvent varier selon qu’il gère ou rend disponible ce système : évaluation des effets négatifs potentiels, la prise de mesures pour évaluer et atténuer les risques, la mise en place d’une surveillance humaine, le signalement d’incidents graves, la publi- cation sur un site web de la description du SIÉ et la tenue de registres pertinents. Les amendements déposés en novembre dernier étendent ces obligations aux systèmes à usage général comme ChatGPT (voir l’encadré ci-dessous).| Ces amendements établissent en outre sept classes d’activités où l’utilisation de l’IA est considérée à incidence élevée : 1. décisions concernant l’emploi (recrutement, embauche, rémunération, etc.) ; 2. décision de fournir ou non un service à un particulier (ex. : prêt, assurance) ; 3. le traitement de données biométriques relativement à : a) l’identification d’une personne (sauf consentement) ou ; b) l’évaluation du comportement ou de l’état d’esprit d’une personne physique ; 4. la modération ou la priorisation de contenu sur les plateformes en ligne ; 5. les services de santé ou d’urgence ; 6. la prise de décision par les tribunaux ou les organismes administratifs ; 7. pour assister un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions liées au contrôle d’application de la loi. |
Mécanismes non indépendants
Le ministre de l’Industrie (ISDE), rédacteur de la LIAD, serait aussi chargé de sa règlementation, de sa surveillance et de son application. Le ministre pourra aussi désigner un cadre supérieur de son ministère au poste de Commissaire à l’IA. Le conflit d’intérêts est patent. Le ministre chargé de la promotion de l’industrie de l’IA ne saurait agir en toute indépendance dans l’application de la loi ; pas plus que son subordonné, le commissaire à l’IA. Cette faille a été signalée par de nombreux groupes, dont la LDL.Conclusion
Le projet de loi C-27 a de la suite dans les idées. En multipliant les exceptions au consentement, il facilite la circulation, l’accès, l’utilisation et la communication de renseignements personnels (qu’ils soient nominatifs, dépersonnalisés ou anonymisés). Ce qui ne manquera pas de servir l’industrie de l’IA, toujours avide de données. Ce secteur économique profitera en outre d’un encadrement législatif minimal, supervisé par un ministre gagné à sa cause. Cela dit, évidemment, si C-27 est adopté dans sa forme actuelle…- En ligne : https://futureoflife.org/open-letter/stoppons-les-experimentations-sur-les-ia-une-lettre-ouverte/
- Pour accéder aux différents mémoires cités dans ce Voir : https://www.noscommunes.ca/committees/fr/INDU/StudyActivity?studyActivityId=12157763
- Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, C. 2000, ch. 5.
- Le mot fondamental a été ajouté par un amendement déposé à l’automne par le ministre. Voir : https://www.ourcommons.ca/content/Committee/441/INDU/WebDoc/WD12633023/12633023/MinisterOfInnovationScienceAndIndustry-2023-10-20-f.pdf
- En ligne : https://www.priv.gc.ca/fr/mesures-et-decisions-prises-par-le-commissariat/memoires-presentes-dans-le-cadre-de-consultations/sub_indu_c27_2304/
- Témoignage de Mme Brenda McPhail (directrice exécutive par intérim, maitresse de programme de politique publique dans la société numérique, McMaster University, à titre personnel) devant le comité INDU, le 26 octobre 2023. En ligne : https://www.ourcommons.ca/DocumentViewer/fr/44-1/INDU/reunion-92/temoignages
- Sauf si violation d’un accord de conformité.
- En ligne : https://liguedesdroits.ca/lettre-collective-c-27-reglementation_intelligence_artificielle
- En ligne : https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/441/ETHI/Reports/RP11948475/ethirp06/ethirp06-pdf
- En ligne : https://liguedesdroits.ca/lettre-collective-c-27-reglementation_intelligence_artificielle/
L’article C-27 | Un trio législatif… accommodant pour l’industrie est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

La Palestine, un test pour l’humanité

Retour à la table des matières Droits et libertés, printemps / été 2024
La Palestine, un test pour l’humanité
Zahia El-Masri, réfugiée palestinienne, militante passionnée de la justice sociale, fondatrice du collectif des femmes pour la Palestine Le tout n’a pas commencé le 7 octobre 2023. Le 7 octobre s’inscrit dans le cadre d’une série d’événements tragiques pour le peuple palestinien, un continuum commençant aussi loin que 1917 quand lord Balfour, ministre britannique des Affaires étrangères, annonça que son gouvernement soutenait l’établissement d’un « foyer national juif » en Palestine. Cet acte de guerre contre le peuple de la Palestine selon l’historien Rachid Khalidi marquait ainsi le début d’une guerre coloniale d’un siècle en Palestine, soutenue par un ensemble de puissances extérieures, notamment la Grande-Bretagne et les États-Unis, et qui se poursuit toujours aujourd’hui1. La Nakba – ou Grande catastrophe – constitue le début du nettoyage ethnique de la Palestine2. En 1948, plus de 800 000 Palestinien-ne-s ont été violemment expulsés de leurs foyers par les milices israéliennes et déplacés de force de leur maison, leurs terres, obligés de laisser derrière eux leur vie, et suivre les chemins de l’exil forcé. La clé de leur maison en main, ils ont entamé le chemin de la douleur, sans savoir que leur sort transformerait pour toujours le visage de l’humanité. Des familles déchirées, dépourvues, des amours inachevées, des enfances volées, des rêves suffoqués, se sont retrouvés malgré eux, les porteurs de la lutte contre la forteresse de l’impérialisme et du colonialisme érigée sur la terre de la Palestine, leur terre, contre leur volonté. Actuellement, nous sommes témoins d’un génocide3, et pour la première fois de l’histoire de l’humanité, ce sont les victimes de ce génocide même qui nous rapportent les évènements en direct. Gaza s’est transformé d’une prison à ciel ouvert, à un cimetière à ciel ouvert. Pourtant, au niveau des gouvernements, l’indignation, les dénonciations et les actions pour mettre fin à cette catastrophe humanitaire n’étaient pas au rendez-vous, comme elles l’étaient pour l’Ukraine. Au lieu de ça nous avons eu droit à des mots vides, de la passivité et de la résignation. Mais heureusement, les sociétés civiles dans le monde occidental et partout ailleurs se mobilisent en solidarité. Pourtant, selon l’article premier de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits ».Aujourd’hui, il faut adopter un changement drastique dans notre façon d’aborder la question de la Palestine.
Un test pour l’humanité
Chaque année des organismes de défense des droits humains, tel qu’Amnistie internationale, Oxfam, Human Rights Watch, B’Tselem, Al Dameer, ainsi que les diverses agences de l’Organisation des Nations unies (ONU) publient des données qui dénoncent le régime d’apartheid qu’exerce Israël sur la population palestinienne avec des politiques cruelles de ségrégation, de dépossession et d’exclusion. Leurs rapports décrivent les effets brutaux de l’hyper-militarisation d’Israël sur la population palestinienne. Aujourd’hui, la Palestine a démasqué l’hypocrisie. Elle nous a appris que tous les êtres humains ne sont pas égaux, elle nous démontre que la valeur d’une vie humaine est directement liée à la couleur de sa peau et à sa valeur économique. Ce qui compte en réalité pour nos gouvernements ce ne sont pas le respect des droits humains, mais les alliances stratégiques et économiques. Elle nous a appris que le colonialisme semble encore tolérable pour de nombreux États et compagnies, et qu’il est toujours au cœur des violences actuelles malgré tout le mouvement de décolonisation qui a traversé le monde dans les années 1950 à 1980. Nous vivons une crise climatique sans précédent, une crise migratoire, et un génocide en direct, et pourtant, it’s business as usual.Occupation par Israël
L’occupation est un geste violent, la colonisation est une entreprise basée sur la violence, l’expropriation de la terre, le déplacement forcé du peuple, le déracinement, le changement toponymique, le pillage des ressources naturelles, et l’installation de colonies de peuplement en violation du droit international. C’est une tentative d’effacer un peuple, sa culture, son histoire, même son existence. Selon un rapport publié par le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, l’occupation israélienne est la plus longue de l’histoire moderne4. La Quatrième Convention de Genève est claire sur le principe qu’une force occupante, comme c’est le cas d’Israël à Gaza, doit « assurer l’approvisionnement de la population en vivres et en produits médicaux ». Le recours à la famine comme méthode de guerre est interdit et constitue un crime de guerre5. Il est hypocrite de prétendre d’un côté que nous sommes signataires des conventions de droits de la personne et des droits de l’enfant, et de fournir de l’autre côté de l’armement à un pays qui pratique l’apartheid : la population non-juive de Cisjordanie est soumise au droit militaire, tandis que les colons israéliens qui occupent le territoire, sont soumis à un autre système juridique. On fournit de l’armement à un pays qui interdit l’accès à plus de 61 %6 du territoire de la Cisjordanie aux Palestinien-ne-s. Cette hypocrisie finira par faire disparaître les principes fondamentaux non seulement de toutes les conventions et de tous les traités internationaux, mais de notre humanité.Gigantesques dépenses militaires
Aujourd’hui, Israël reçoit plus que nul autre pays dans l’histoire, du financement des États-Unis chiffré à 3.3 milliards7 de dollars juste pour 2022, cette somme étant dédiée spécifiquement à l’industrie d’armement. Elle se situe parmi les pays qui allouent le plus de ressources aux dépenses militaires en proportion du produit intérieur brut (PIB), en figurant à la cinquième place du classement mondial8. Le Canada, à son tour, a exporté plus de 21 millions de dollars de matériel militaire vers Israël en 2022, ce qui place Israël parmi les 10 principales destinations des exportations d’armes canadiennes9.| Article premier de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée le 9 décembre 1948. « Les Parties contractantes confirment que le génocide, qu’il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, constitue un crime du droit des gens, qu’elles s’engagent à prévenir et à punir. » Article premier |
Plus possible d’ignorer
Dans un monde soi-disant post colonial, Israël est aujourd’hui le seul pays qui essaie d’étendre son projet colonialiste de peuplement avec des projets d’expansion. Ce projet expansionniste est réalisé par la construction des colonies de peuplement qualifiées comme illégales sous le droit international. La présence d’une panoplie de lois israéliennes racistes dont la loi du retour (1950), la loi sur la propriété des absents (1950), la loi sur l’acquisition des terres (1953) et la loi sur la Nakba (2011), chacune de ces lois constitue une discrimination contre la population palestinienne en Israël ainsi que dans les territoires palestiniens occupés. « Le fait de considérer que les colonies juives revêtent une importance nationale, comme cela est affirmé dans la Loi fondamentale susmentionnée [Loi fondamentale : Israël, État-nation du people juif, 2018], alors qu’elles sont interdites par le droit international, constitue une violation par Israël de ses obligations au titre du droit international10 ». Nous ne pouvons plus prétendre être antiraciste et en même temps soutenir un état qui a imposé au-delà de 60 lois qui discriminent les Palestinien-ne-s. Aujourd’hui, il faut adopter un changement drastique dans notre façon d’aborder la question de la Palestine. Le voile de l’ignorance s’est levé, nous ne pouvons plus plaider l’ignorance et le manque d’information. Pour contrer les tentatives de l’effacement du peuple palestinien, il faut reconnaitre son récit, il faut utiliser la terminologie qui décrit sa réalité. Il faut alors parler de la colonisation et non pas d’une guerre, il faut parler d’une famine forcée et non pas d’une famine, il faut parler du droit à la résistance et non pas de terrorisme. En parlant de Gaza, il faut parler du siège illégal, il faut parler des prisonniers et prisonnières politiques, et non pas des détenu-e-s, il faut parler des martyr-e-s abattus et non pas des personnes tuées. Il faut rappeler que la lutte du peuple palestinien s’inscrit dans un cadre légitime d’une lutte pour l’autodétermination et pour l’atteinte de sa liberté et la libération de sa terre.Changement de paradigme
Nous devons alors décoloniser notre approche. En regardant les atrocités qui se déroulent devant nos yeux, il faut enlever le prisme orientaliste, qui justifie la subordination et ainsi la colonisation des peuples du Sud et voir au-delà des faux récits pour retrouver notre propre humanité. Ce changement de paradigme est essentiel pour comprendre et pour agir. Pour mettre fin au colonialisme, à l’apartheid, il faut une reconnaissance du récit palestinien, une reconnaissance de la Nakba et de ses origines. C’est notre devoir en tant que société de lutter et de dénoncer cette colonisation, de reconnaître l’intersectorialité de nos luttes, et que personne ne sera vraiment libre, tant que nous ne le sommes pas tous. C’est notre devoir d’empêcher un gouvernement colonialiste de continuer son projet d’expansion. C’est notre devoir de lutter contre toutes les formes d’oppression en se tenant debout pour les droits humains, la justice et l’égalité pour tou-te-s. Notre résistance en tant que peuple palestinien est animée par notre désir de justice, par l’amour de notre patrie et non pas par la haine envers l’autre. Au moment où vous lisez ces mots, des familles, des personnes comme vous, essaient de répondre à une simple question, comment? Comment avons-nous permis à ces morts annoncées de se poursuivre jour après jour?- The hundred years’ war on Palestine, Rashid Khalidi,
- Le nettoyage ethnique de la Palestine, Ilan Pappé,
- En ligne : https://www.icj-org/fr/affaire/192
- En ligne : https://www.ohchr.org/fr/news/2023/07/special-rapporteur-says-israels-unlawful-carceral-practices-occupied-palestinian
- En ligne : https://www.hrw.org/fr/news/2023/10/18/israel-le-blocus-illegal-de-gaza-des-effets-fatals-pour-des-enfants
- En ligne : https://www.un.org/unispal/fr/faits-et-chiffres/#_ftn1
- En ligne : https://www.foreignassistance.gov/cd/israel/
- En ligne : https://www.chroniquepalestine.com/armes-et-droits-de-l-homme-le-cas-du-complexe-militaro-industriel-israelien/
- En ligne : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2029344/silence-canada-exportations-armes-israel
- En ligne : https://www.ohchr.org/fr/2019/12/dialogue-israel-committee-elimination-racial-discrimination-urges-greater-inclusion-and
L’article La Palestine, un test pour l’humanité est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

Les services publics et les droits humains : deux faces d’une même médaille

Retour à la table des matières Droits et libertés, printemps / été 2024
Les services publics et les droits humains : deux faces d’une même médaille
Alexandre Petitclerc, doctorant en philosophie et président du CA de la Ligue des droits et libertés Les derniers mois ont été marqués par des luttes importantes concernant les services publics québécois. La grève des enseignant-e-s et les luttes des travailleuses de la santé nous ont rappelé que la réalisation d’un projet de société respectueux des droits humains est intrinsèquement liée à des services publics accessibles et financés adéquatement. En ratifiant différents traités et accords en matière de droits humains au cours des 75 dernières années, le Canada et le Québec se sont engagés à mettre en œuvre ces droits. Un financement adéquat et pérenne des services publics permet de mettre en œuvre le droit à la santé, à l’éducation ou au logement, par exemple. Sans financement adéquat, les droits humains ne demeurent que des principes énoncés comme des vœux pieux. Alors, les services publics sont constamment menacés par la privatisation et par les désinvestissements, ces phénomènes mettent à mal la disponibilité, l’accessibilité, l’acceptabilité et la qualité des services sociaux, par exemple. Le langage des droits humains rappelle qu’investir en éducation, en santé et dans le logement n’est pas uniquement un choix politique, mais contribue aussi à ce que les États respectent les obligations auxquelles ils se sont engagés. Le financement des services publics est une affaire collective et participe au plein exercice des droits garantis à toutes et tous et à réduire les inégalités socioéconomiques. Privatiser les services publics participe d’un désaveu envers ces droits et envers, qui plus est, celles et ceux qui fournissent les soins et services au quotidien. En ce sens, il est particulier de constater la manière dont le gouvernement provincial a instrumentalisé les luttes syndicales de l’automne dernier pour expliquer le déficit du budget 2024-2025. Le parti au pouvoir n’a pas hésité à mettre la faute sur les hausses salariales des employé-e-s de l’État pour justifier que le gouvernement se retrouve à adopter un budget peu enviable face à son électorat. Or, financer les services publics convenablement, en offrant notamment des salaires décents et des conditions de travail raisonnables, peut se faire sans opposer le personnel de l’État aux contribuables. Au contraire, les travailleuses et les travailleurs et les contribuables sont tous détentrices et détenteurs de droits dont le droit à une vie décente, le droit à la santé, le droit à l’éducation, le droit d’association, etc. De plus, si les services publics constituent un des moyens de réaliser les droits humains, l’État devrait trouver des manières de financer ces services. Une des critiques les plus fortes concernant la pleine réalisation des droits humains — notamment les droits économiques, sociaux et culturels — se base précisément sur l’argument voulant que la réalisation des droits soit dépendante des ressources disponibles au sein des États. Cet argument, celui de la rareté des ressources, stipule qu’il est difficile de mobiliser le langage des droits humains pour justifier des dépenses dans certains services publics. S’il existe une limite matérielle à la réalisation des droits, diront ces critiques, alors il est inutile d’utiliser ce langage. Or, l’argument de la rareté ne doit pas être utilisé pour justifier l’abandon du cadre de référence des droits humains pour défendre les services publics. Au contraire, les engagements de l’État en matière de droits économiques, sociaux et culturels stipulent que la réalisation de ces droits doit se faire progressivement. L’État ne peut pas reculer par rapport à ces droits : il doit toujours travailler à améliorer leur réalisation. De plus, l’argument de la rareté demeure relatif. Bien qu’il soit difficile de contester que l’État dispose de ressources finies pour parvenir à remplir ses obligations en matière de droits humains, il demeure néanmoins qu’il dispose d’une multitude de moyens pour financer les services publics de sorte à favoriser la pleine réalisation des droits humains. Son outil le plus efficace, surtout dans un contexte d’accroissement significatif de la concentration des capitaux, demeure un ensemble de mesures pour limiter et éventuellement éliminer les inégalités socioéconomiques. Or, même en laissant de côté le motif électoraliste d’une telle position, il est difficile pour le gouvernement d’augmenter les revenus provenant des impôts des classes inférieures et moyennes, en raison de l’effet matériel important sur ces classes. Néanmoins, l’enrichissement des groupes les plus possédants a été presque exponentiel depuis les dernières décennies et encore plus depuis la COVID-19. Une période de ralentissement et de difficultés économiques ne justifie aucunement que l’État délaisse ses engagements en matière de droits humains. Il doit en faire plus pour s’assurer que nous puissions éventuellement vivre comme égaux au Québec. Nous le répétons, la réalisation des droits humains doit se faire de manière progressive et l’État ne peut accepter des reculs en la matière. Les grandes mobilisations syndicales, fin 2023 et début 2024, nous rappellent que le cadre de référence des droits humains doit rester au cœur des revendications pour redire à l’État de remplir ses obligations : envers tous les titulaires de droits.L’article Les services publics et les droits humains : deux faces d’une même médaille est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

Luttes abolitionnistes et féminisme carcéral

Retour à la table des matières Droits et libertés, printemps / été 2024
Luttes abolitionnistes et féminisme carcéral
Entrevue avec Marlihan Lopez, cofondatrice de Harambec et militante féministe Noire Propos recueillis par Delphine Gauthier-Boiteau, doctorante en droit et membre du comité de rédaction de la revue et du comité Enjeux carcéraux et droits des personnes en détention de la Ligue des droits et libertés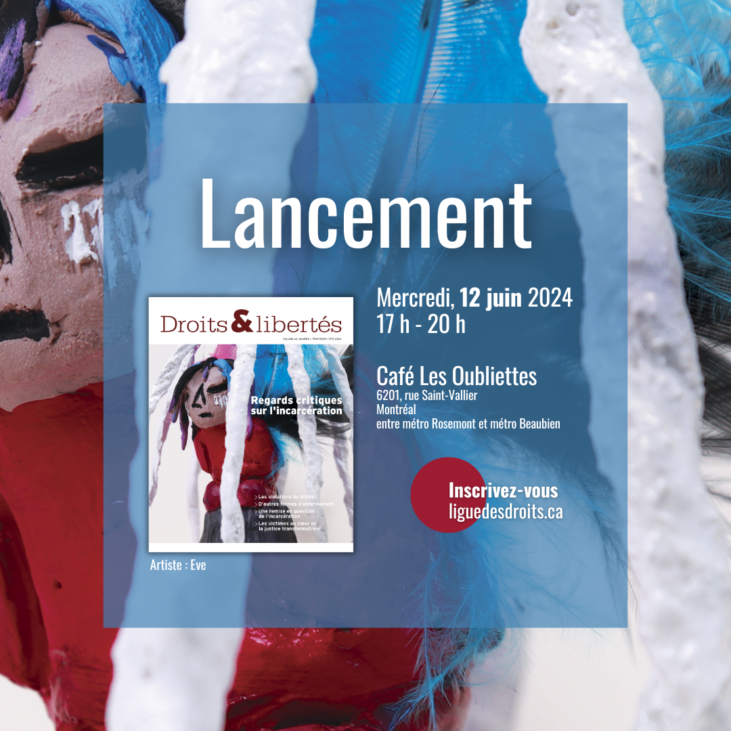
L’article Luttes abolitionnistes et féminisme carcéral est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

Qu’en est-il des systèmes carcéraux et des abolitionnismes ?

Retour à la table des matières Droits et libertés, printemps / été 2024
Qu’en est-il des systèmes carcéraux et des abolitionnismes?
Entrevue avec Marlihan Lopez, cofondatrice de Harambec et militante féministe Noire Propos recueillis par Delphine Gauthier-Boiteau, doctorante en droit et membre du comité de rédaction de la revue et du comité Enjeux carcéraux et droits des personnes en détention de la Ligue des droits et libertés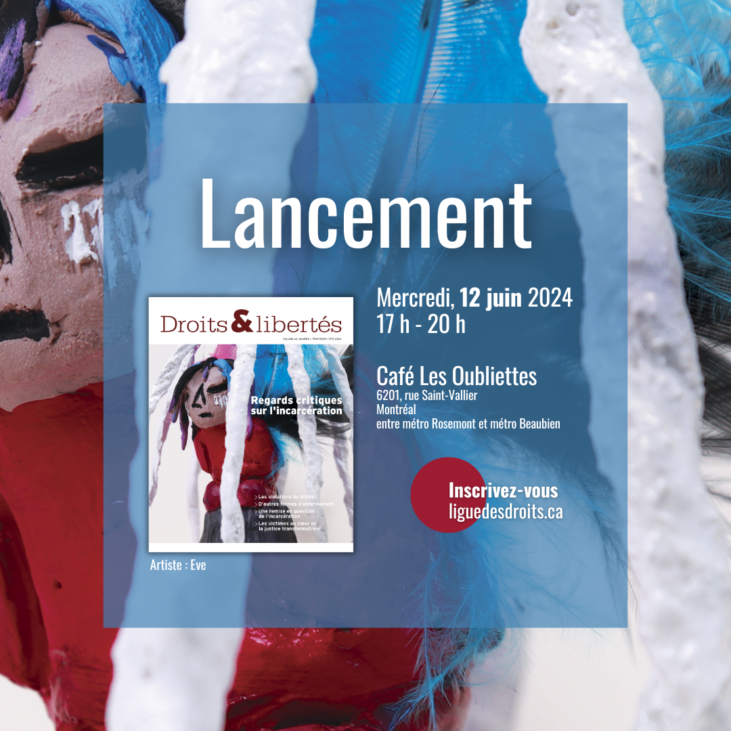
L’article Qu’en est-il des systèmes carcéraux et des abolitionnismes? est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

Coup d’oeil sur la justice alternative à Kahnawà:ke

Retour à la table des matières Droits et libertés, printemps / été 2024
Coup d'oeil sur la justice alternative à Kahnawà:ke
Entrevue avec Dale Dione, fondatrice et ex-coordonnatrice du programme de justice alternative Sken:nen A'Onsonton à Kahnawà:ke Propos recueillis par Nelly Marcoux, membre du comité Droits des peuples autochtones de la Ligue des droits et libertésComment le programme Sken:nen A’Onsonton a-t-il été créé?
Le projet est né d’un effort populaire. Les membres de notre communauté estiment que le système judiciaire n’est pas représentatif de la justice au sein de notre culture. Des recherches ont donc été menées sur les méthodes et philosophies Haudenosaunee1 pour aborder les conflits. Une vaste consultation communautaire a également eu lieu, au cours de laquelle on a demandé aux gens ce qui serait le plus utile à la communauté en matière de justice. Le programme a débuté en 2000. À l’époque, des membres de la communauté ont suivi des formations en justice réparatrice et ont endossé cette approche comme moyen de développer un programme de justice alternative à Kahnawà:ke. La justice réparatrice est une méthode autochtone de gestion des conflits, très proche de nos méthodes traditionnelles. Nous ne l’avions simplement pas utilisée pendant de nombreuses années, étant bombardés par le système judiciaire occidental.Que signifie le nom Sken:nen A’Onsonton?
En anglais, Sken:nen A’Onsonton se traduit par to become peaceful again (redevenir paisibles). Dans notre langue2, ce terme a une signification très profonde. Supposons qu’un conflit survienne entre deux personnes qui avaient une relation proche, une amitié, ou qui étaient de simples connaissances. Le conflit brise la sken:nen (la paix). Comment pouvons-nous revenir à la situation antérieure ? Il faut que les gens se réunissent et, le mieux possible, essaient d’arranger les choses. Nous avons toujours vécu dans de petites communautés. Si un problème survenait, nous devions nous réunir et apporter des changements pour pouvoir avancer en tant que communauté ou en tant que nation. C’était une question de survie.Comment le programme fonctionne-t-il? Quels en sont les principes fondamentaux?
La guérison collective est la pierre angulaire de la justice réparatrice. Cette approche encourage les gens à se parler, à assumer la responsabilité de leurs actes et à résoudre les problèmes ensemble. Le programme vise donc à rassembler les gens, à leur donner les moyens de prendre des décisions ensemble et à atteindre la paix et la guérison. Nous proposons des services non contradictoires, notamment la médiation et les cercles de justice. Le processus de médiation commence par une rencontre individuelle entre chacune des parties et les personnes facilitatrices. Les parties racontent leur histoire et expriment leurs attentes par rapport au processus. Les personnes facilitatrices analysent le conflit et identifient les points d’entente. Au cours de ces rencontres, vous entendrez souvent la douleur des parties. Lorsqu’elles se réunissent dans le cadre de la médiation, une grande partie de cette douleur s’est estompée. C’est une première étape très utile. Dans les cercles de justice, chaque partie est accompagnée d’une personne qui la soutient. Il peut s’agir d’un-e membre de la famille, d’un-e ami-e ou d’une personne affectée par la situation. Dans un premier temps, le processus est expliqué à chaque personne individuellement et des questions lui sont posées avant la tenue du cercle afin qu’elle puisse se préparer. Par exemple, on lui demande ce qui s’est passé, ou ce qu’elle pensait à ce moment-là. Chaque personne peut alors réfléchir à ce qu’elle veut communiquer au moment du cercle de justice. Pendant le déroulement des cercles, les personnes facilitatrices posent des questions et aident les participant-e-s à trouver une entente. Toutes les personnes présentes entendent ce qui s’est passé et ont leur mot à dire, ce qui est très important. Une personne n’aurait peut-être jamais imaginé l’impact de ses actions sur les autres, mais le fait d’entendre une autre personne exprimer à quel point elle a été profondément affectée peut aider à reconnaître cela. Tout est dit et entendu. À la fin, les participant-e-s sont invité-e-s à partager les suggestions qui, selon elles et eux, pourraient améliorer les choses. Tout le monde est inclus. Les deux parties reçoivent une copie de l’accord. En général, les parties elles-mêmes et les personnes accompagnatrices veillent à ce que l’accord soit respecté. En s’engageant dans ce processus, les gens assument la responsabilité de leurs actes, ce qui est une condition pour avoir accès au programme; à partir de là, l’emphase est sur la guérison collective. Il s’agit en outre d’un processus volontaire : toutes les parties doivent accepter d’y participer. Nous recevons des dossiers de notre propre cour et de la cour de Longueuil. Les gens peuvent également demander de l’aide pour vivre les situations. Le service est offert gratuitement par la communauté.Pourquoi est-ce important d’avoir un programme de justice par la communauté, pour la communauté?
J’ai toujours considéré que la justice et l’éducation sont étroitement liées. Je crois qu’un système judiciaire doit refléter la culture et les valeurs d’une société. Nos valeurs ne sont pas reconnues ou soutenues dans le système occidental, un système qui crée des gagnant-e-s (généralement celles et ceux qui ont de l’argent et du pouvoir) et des perdant-e-s. Le système dont je parle est basé sur l’égalité de toutes et tous, sur le fait que chacun-e a son mot à dire et sur la recherche de solutions sur lesquelles il est possible de s’entendre.La guérison collective est la pierre angulaire de la justice réparatrice. Cette approche encourage les gens à se parler, à assumer la responsabilité de leurs actes et à résoudre les problèmes ensemble.Dans le système judiciaire occidental, on conseille souvent aux accusé-e-s de plaider non coupable, même si elles ou ils ont en réalité participé à l’évènement. C’est un principe qui va à l’encontre des façons d’être et des valeurs autochtones, notamment le principe de dire la vérité et d’être responsable de ses actes. Cela va à l’encontre de qui nous sommes. C’est très dommageable. Dans notre processus, c’est la victime qui est la plus importante. Dans le système occidental, si un événement violent se produit, on lui demande de porter plainte, souvent au pire moment possible, alors qu’elle peut être traumatisée. Ses déclarations écrites peuvent ensuite être utilisées pour mettre en doute sa crédibilité. Je n’ai jamais pu comprendre cela. Pour donner un autre exemple : les tribunaux traditionnels ne tiennent pas compte des possibles conséquences d’une décision sur la famille d’une personne. Un juge peut imposer une amende qui pourrait nuire à la capacité d’une famille à se nourrir et à payer son loyer. Dans notre processus, nous demandons : « Cette solution est-elle acceptable pour vous? » « Pouvez-vous faire cela? », car il ne sert à rien de donner des ordres si la personne ne peut pas les appliquer! Les parties respectent généralement leur entente parce qu’elles se sont réellement engagées. Finalement, les tribunaux extérieurs ne sont pas conscients de notre culture, de l’endroit où nous vivons, de la manière dont nous vivons. Les juges sont formés sur la base des réalités caractéristiques de populations plus nombreuses. Les Autochtones vivent dans leurs communautés, dans les réserves ; elles et ils se voient tous les jours dans la rue, dans les magasins. C’est une grande différence. Dans ce contexte, le processus accusatoire favorise la division au sein des communautés.
Quels sont les plus grands défis vécus par votre équipe dans l’accomplissement de votre travail ?
Renoncer à la punition pour aller vers la guérison et revenir aux anciennes façons de faire a été un véritable changement de paradigme. Au début, c’était très nouveau et très difficile car tout le monde est formé aux processus accusatoires, autant au sein de la police, que des Peacekeepers et des tribunaux, et même dans les écoles et les lieux de travail. Les gens avaient l’impression que ce processus était une solution facile, elles et ils étaient réticent-e-s à l’idée d’avoir à parler de leurs sentiments, ce genre de choses. Il était difficile de changer les façons de penser. Mais au fil des ans, les conséquences des problèmes multigénérationnels que nous avons vécus ont été de plus en plus reconnues. La colonisation. La perte de notre langue. La perte du territoire. La perte de notre eau, de notre rivière3. Nous avons subi tant de pertes au cours de notre histoire. Aujourd’hui, les gens se rendent compte que nous devons pouvoir parler de ces choses et que nous avons le droit de trouver des solutions entre nous. Grâce à l’éducation, les gens pensent différemment et la plupart d’entre eux sont désormais disposé-e-s à parler de ces choses. Les personnes qui participent aux processus de médiation ou aux cercles de justice sont étonnées de constater à quel point les choses ont changé pour elles. Elles voient les choses différemment. Elles laissent aller l’anxiété, la colère et tout ceQuels sont vos espoirs pour l’avenir de la justice dans votre communauté ?
Lorsque j’ai commencé ce travail, je ne m’attendais pas à ce que les choses changent automatiquement. Je me suis dit que cela se produirait peut-être à la prochaine génération ou à la suivante, peut-être quand je ne serais plus là. Au moins, les semences de la paix seront plantées, il y a un processus qui peut être développé pour l’avenir. Il faut beaucoup de temps pour que les gens changent, surtout après des siècles d’imposition de ces systèmes accusatoires et punitifs dans nos communautés. Il faudra beaucoup de temps pour démanteler ces systèmes. J’espère que le programme Sken:nen A’Onsonton ramènera notre peuple à ses valeurs originelles, en travaillant ensemble pour éradiquer les divisions qui nous sont imposées. À l’heure actuelle, tout arrive du sommet de la pyramide. Nos valeurs originelles, elles, parlent d’un cercle où tout le monde est égal et où nous travaillons ensemble pour maintenir qui nous sommes pour les générations à venir. Mais aussi, pour retrouver tout ce que nous avons perdu — notre langue, notre territoire, notre culture. Je sais que c’est un grand souhait. Mais comme je l’ai dit, nous plantons des semences. J’ai des enfants, des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Je me préoccupe du monde dans lequel elles et ils vivront lorsque je ne serai plus là.- Le peuple Haudenosaunee, peuple des maisons longues communément appelé Iroquois ou Six Nations, forme une confédération de six Nations dont est membre la Nation Kanien’kehá:ka (communément appelée Mohawk), dont fait partie la communauté de Kahnawà:ke.
- Langue Kanien’kéha
- Pour en apprendre plus sur les impacts de la construction de la Voie maritime du Saint-Laurent sur la communauté de Kahnawà:ke, en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=aTRIqCgSxYQ
L’article Coup d’oeil sur la justice alternative à Kahnawà:ke est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

La prison, l’antichambre de la déportation

Retour à la table des matières Droits et libertés, printemps / été 2024
La prison, l’antichambre de la déportation
Propos recueillis par Laurence Lallier-Roussin, anthropologue et membre du comité de rédaction de la revue et du comité Enjeux carcéraux et droits des personnes en détention de la Ligue des droits et libertés La double peine est un concept utilisé pour désigner le fait de subir deux fois la conséquence d’un acte criminel : purger une peine à la suite à une condamnation criminelle, puis être expulsé du Canada après avoir purgé sa peine. Seules les personnes non citoyennes subissent cette double peine, puisqu’après avoir été déjà punies par le système judiciaire criminel, elles sont interdites de territoire et déportées. Comme en témoigne l’organisation Personne n’est illégal, les personnes qui sont renvoyées peuvent être des résident-e-s permanents depuis leur enfance, avoir une vie établie au Canada, un emploi et une famille et n’avoir peu ou pas de lien avec le pays vers lequel elles sont déportées1. Il s’agit en quelque sorte d’un système de justice à deux vitesses : en fonction de leur statut, les personnes vivant au Canada subissent des conséquences bien différentes pour un même acte criminel. La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) stipule que les résident-e-s temporaires peuvent être interdits de territoire pour criminalité, et les résident-e-s permanents pour grande criminalité. Cela dit, Mᵉ Coline Bellefleur, avocate en immigration et criminaliste, souligne :« La grande criminalité n’est pas toujours celle à laquelle on pourrait penser… Par exemple [...], conduire avec les facultés affaiblies par l’alcool ou le cannabis constitue de la grande criminalité, même si vous êtes juste condamné à payer une amende. Pourquoi? Parce qu’en théorie, il est possible d’être condamné à 10 ans de prison pour cela. La même règle s’applique pour toutes les infractions qui pourraient mener jusqu’à ce fameux 10 ans d’emprisonnement (ou plus), même si la personne concernée a dans les faits été poursuivie par procédure sommaire et n’a pas mis un seul orteil en prison2. »
Témoignage : dénoncer un système injuste
Le texte qui suit présente le témoignage d’Alexe, partenaire de Théo, un résident permanent qui a été déporté à cause de sa condamnation pour un acte criminel. Toutes les citations sont d’Alexe.« Ils ont déporté le père de mes enfants. »
Alexe est en couple avec Théo depuis 14 ans et ils élèvent ensemble trois enfants quand il est accusé au criminel. S’il est reconnu coupable, sa peine sera double : la prison, puis la déportation. Théo est arrivé au Canada à 16 ans pour rejoindre son père qui avait obtenu le statut de réfugié. À la mi-trentaine, il avait toujours le statut de résident permanent. Il aurait pu demander la citoyenneté, ce qui lui aurait permis d’éviter la déportation.« Son seul tort là-dedans, ça a été d’être procrastineux ou négligent. Si j’avais su la situation depuis day one, moi, j’aurais agi en conséquence, pour faire ses papiers pour devenir citoyen. »
Théo plaide coupable et est condamné à une sentence de deux ans moins un jour.« Il a fait sa peine au grand complet, puis la journée de la libération, ils l’ont échangé de mains, puis il est reparti pour être détenu par l’immigration. »
Séparation de la famille et intérêt des enfants
La double détention de Théo (au provincial, puis par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) au Centre de surveillance de l’immigration à Laval) suivie de sa déportation, le séparent de sa famille et de ses enfants. Cette séparation démontre le peu d’égards du système d’immigration canadien envers les droits des enfants, alors même que l’intérêt supérieur de l’enfant est un principe inscrit dans la LIPR.« C’est quoi le plan après ? On déporte les gens, mais ils ont des enfants.
« L’UNICEF, c’est juste pour ramasser des cennes noires à l’Halloween ? Qu’est qui est prévu pour nous ? Pour mes enfants ?
« Ça faisait 14 ans qu’on était en couple et qu’on habitait ensemble. On a deux filles ensemble et mon fils, il l’appelle papa et il le considère comme tel. On travaillait ensemble.
« Comment je fais pour prouver qu’il n’est pas juste un nom sur un certificat, que c’était une partie prenante de la famille ? C’est lui qui était à la première journée de prématernelle de mon fils. Tout le temps... on était toujours ensemble. »
Théo a d’ailleurs continué à soutenir sa famille durant sa détention en prison provinciale, en leur envoyant l’argent qu’il faisait en travaillant.« Il a fallu qu’ils inventent une procédure à la prison, parce que lui, quand il travaillait, il faisait sortir de l’argent. Les gars, d’habitude, demandent de l’argent, en reçoivent, mais lui, il dit, : ‘’Moi, j’ai une famille, je travaille, bien j’envoie de l’argent.’’ »
Alexe était enceinte durant la détention de Théo au provincial.« Je me souviens, c’était le jour de mon premier rendez-vous de grossesse pour notre dernière fille. Il est parti en taxi pour rentrer en prison, puis moi, je suis partie de l’autre bord à mon rendez-vous. »
Leur fille naît alors que son père est toujours détenu.
« J’ai accouché toute seule. Ils sont venus avec lui quand elle est née. Il avait les menottes aux pieds, aux mains, avec un masque dans la face. Ils ne l’ont même pas démenotté. Je lui ai mis ma fille dans les bras, mais il n’a même pas pu la toucher. Elle était juste posée. J’ai demandé si je pouvais prendre une photo. Ils m’ont dit non. Il devait avoir une sortie de plusieurs heures, mais il est resté 45 minutes. Ils l’ont fait marcher entre la maternité avec les deux agents, les menottes, les entraves. J’entendais dans le corridor : Cling, cling, cling. »
Quand Théo a pu revoir sa fille, elle avait un an. Alexe nous parle des conséquences sur ses enfants de la séparation d’avec leur père.« C’est mes enfants qui réclament leur père ; ils ne comprennent pas pourquoi il n’est pas là... Tu sais, ma petite, elle dit : ’’Papa, il est plus loin, il est plus loin comme les dinosaures.’’ C’est lui qui était très joueur avec les enfants et il est très calme. On s’équilibrait. Toute seule, je trouve ça vraiment dur de donner du temps à trois enfants. Il n’y a personne d’autre pour les garder, je les ai tout le temps. Pendant la COVID, c’était infernal.
« Je suis pas du genre à faire des promesses, mais pendant ses détentions, je croyais tellement qu’il allait revenir, on a tellement tout essayé pour qu’il ne soit pas déporté que je leur disais qu’il allait revenir. Et là, il n’est pas là ; je me sens mal.
« Toutes les procédures, les avocats, les appels, ça a pris beaucoup de temps, je les ai presque comme négligés, tu sais... Je dormais pas la nuit pour faire les papiers, pour travailler sur ses dossiers. Ça a donné un coup à la famille en général. Puis là, bien, c’est les enfants qui me voient fatiguée, c’est moi qui est plus irritable... »
Expulsé hors du pays, Théo continue de jouer son rôle parental à distance, comme il peut. « Les enfants, ils s’ennuient. Même si on est plus down ou stressé, dès qu’il sait que les enfants sont là ou que je tourne le téléphone vers un kid, il sourit, il joue avec eux. Ils jouent à la cachette au téléphone. Moi, je tiens le téléphone, les enfants se cachent et lui il me dit : ’’droite-gauche’’. Nous, on est les quatre ensembles, puis on s’ennuie, mais lui il est tout seul depuis tellement longtemps. »Connaître les conséquences
Lors de son procès, l’avocat criminaliste n’était pas certain des conséquences qu’aurait sa condamnation sur son statut au Canada.« Théo, il savait pas que s’il plaidait coupable, ça allait à l’immigration. C’est pas tous les avocats qui sont sensibles à ça, puis qui sont intéressés par ça.
« On n’était pas certains si ça allait affecter son statut d’immigration. C’est quand on a passé en cour, l’avocat m’a appelée parce que le juge lui a demandé : ‘’Est-ce que votre client préfère 2 ans moins 1 jour ou 2 ans?‘’ L’avocat, il n’y avait jamais personne qui lui avait demandé ça. On a pensé qu’au provincial ce serait mieux, que ça toucherait pas à l’immigration. Mais en fait, ça change rien. Parce que, pendant sa détention, il a reçu une lettre disant qu’ils allaient devoir l’arrêter après, puis procéder aux mesures de renvoi. »
Alexe croit que les personnes non citoyennes et les avocat-e-s devraient être mieux informés des conséquences de certaines condamnations sur le statut d’immigration. C’est aussi ce qu’écrit l’avocate en immigration et criminaliste Coline Bellefleur3. Alexe souligne également l’injustice de ce double standard.« Théo n’a eu aucun avis pendant toute sa détention en prison, ni pendant la détention par l’immigration, y compris les cinq tentatives de renvoi. Il n’a aucun truc de violence, aucun mémo, aucune note à son dossier. C’est comme, tu vois, il a fait toutes les thérapies qui étaient en son pouvoir.
« Tu sais, je comprends, t’as fait une erreur, c’est correct. Tu fais de la prison. Mais quand tu fais les thérapies, quand tu fais ton temps plein, quand t’as aucun manquement, quand t’as une famille, quand t’as une stabilité... c’est de l’acharnement.
« Les gens disent : s’ils l’ont déporté, c’est parce qu’il le méritait. Mais tu sais, les autres criminels, eux ? C’est comme si le statut surpasse la personne, ses actions, sa valeur.
« Pourquoi on te fait passer par le système carcéral si on n’a pas l’intention de toute façon de continuer ton séjour au pays ou quoi que ce soit ? »
Violations de droits en détention
Le conjoint d’Alexe est détenu par l’ASFC « mais ils n’arrivent pas à le renvoyer dans son pays d’origine, parce qu’il n’a pas de document de voyage ; l’immigration a perdu son dossier d’arrivée ». Une fois qu’il est clair que l’ASFC cherche à expulser Théo, la famille multiplie les démarches pour trouver un moyen légal de le faire rester au Canada. Ils contactent de nombreux avocat-e-s et des associations de soutien. Ils reçoivent notamment une aide précieuse de l’adjoint de circonscription de leur député fédéral, qui s’efforce de les soutenir. Durant sa détention par l’immigration, Théo collabore avec l’ASFC pour fournir son certificat de naissance et il est alors remis en liberté en attendant sa date de renvoi. À ce moment, il prend la décision désespérée de devenir sans statut afin de rester avec sa famille. Il ne se présente pas à l’aéroport pour son renvoi. Mais l’ASFC harcèle sa famille et il finit par retourner au centre de détention. « Ce n’était pas une vie, de se cacher tout le temps. » En détention, il est tellement désespéré qu’il fait une tentative de suicide.« C’est là qu’ils m’ont appelée puis qu’ils m’ont juste dit : ‘’Votre conjoint est transporté dans un centre hospitalier, je peux pas vous dire où, je peux pas vous dire son état de santé.’’ J’ai dit : ‘’Mais il est encore en vie?’’ – ‘’Je peux pas vous le dire’’, qu’ils m’ont répondu. »
Il aura fallu cinq tentatives de renvoi avant que Théo soit finalement renvoyé dans son pays d’origine. Pendant sa détention par l’immigration, Alexe raconte comment Théo est victime de violations de droits, tant pour les soins de santé que pour l’accès à son avocat et à sa famille. Il subit notamment de la violence physique de la part des agent-e-s de l’ASFC lors de ses tentatives de renvoi, pour le forcer à collaborer.« Mais ils auraient fini par le tuer ! Je suis convaincue qu’il y en a déjà, mais qu’on ne le sait pas parce qu’ils n’ont pas de personne comme moi qui est ici. Ce sont des gens qui viennent d’arriver ou qui n’ont pas de famille ou qui ne parlent pas la langue puis qui se font... Imagines-tu ceux qui n’ont même pas personne pour parler, ce qu’ils vivent? »
Cette séparation démontre le peu d’égards du système d’immigration canadien envers les droits des enfants, alors même que l’intérêt supérieur de l’enfant est un principe inscrit dans la LIPR.
L’article La prison, l’antichambre de la déportation est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

Prison et déficience intellectuelle, ça ne va pas !

Retour à la table des matières Droits et libertés, printemps / été 2024
Prison et déficience intellectuelle, ça ne va pas!
Samuel Ragot, analyste aux politiques publiques, Société québécoise de la déficience intellectuelle et candidat au doctorat en travail social à l’Université McGill Guillaume Ouellet, professeur associé, École de travail social, UQAM et chercheur au Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté (CREMIS) Jean-François Rancourt, analyste aux politiques publiques, Société québécoise de la déficience intellectuelle Dans les dernières décennies, les personnes ayant une déficience intellectuelle occupent de plus en plus leur place en société et y sont davantage incluses à part entière, que ce soit au travail, dans les activités de loisirs, ou dans leur rôle de citoyen. S’il est vrai que la déficience intellectuelle compte désormais ses ambassadrices et ses ambassadeurs en matière d’inclusion sociale, sur le terrain la situation est souvent moins rose. En effet, nos recherches et les échos qui nous parviennent des intervenant-e-s témoignent du fait qu’un nombre croissant de personnes ayant une déficience intellectuelle vivent dans des conditions d’extrême précarité (résidentielle, financière, relationnelle, judiciaire, etc.). Un profond fossé existe entre l’idéal projeté par les politiques sociales et les conditions objectives de vie dans lesquelles ces personnes évoluent.
Une société inclusive, vraiment?
Ce fossé est notamment lié à la tension entre, d’une part, la promotion de l’équité, de la diversité et de l’inclusion (EDI) dans toutes les sphères du monde social, et, d’autre part, les appels à être plus indépendant-e, plus productif, plus self-made, qui marquent nos imaginaires collectifs en lien avec ce qu’est la réussite dans une société capitaliste. En somme, l’aspiration à bâtir une société plus inclusive se heurte à un système de normes sociales qui demeure profondément capacitaire. Le capacitisme, comme le racisme, le sexisme ou l’âgisme, est un système d’oppression qui fait en sorte que bien des personnes en situation de handicap demeurent socialement stigmatisées et structurellement discriminées. Conséquemment, malgré un apparent progrès sur le plan des droits, nous vivons encore et toujours dans une société capacitiste, pensée par et pour les personnes qui ne se trouvent pas en situation de handicap. Dans ce contexte, il n’est pas étonnant qu’une part croissante de personnes ayant une déficience intellectuelle peinent à satisfaire les marqueurs de la réussite sociale. En fait, les personnes ayant une déficience intellectuelle se trouvent de plus en plus à l’intersection de systèmes d’oppression multiples qui les rendent plus susceptibles de vivre de la violence1, du sous-emploi2, de la pauvreté3 et de l’exclusion sociale4. Combinés, ces facteurs peuvent entraîner des conséquences graves pour les personnes ayant une déficience intellectuelle.| La déficience intellectuelle est un état, non une maladie, qui se manifeste avant l’âge de 18 ans. Elle se caractérise par des limitations significatives du fonctionnement intellectuel et du comportement adaptatif, notamment dans les habiletés conceptuelles, sociales et pratiques. Ces limitations peuvent, par exemple, se traduire par des difficultés à comprendre des concepts abstraits, à établir des interactions sociales ou à accomplir certaines activités quotidiennes. Ces difficultés varient d’une personne à l’autre en fonction du niveau de la déficience intellectuelle. |
| Capacitisme : Attitude ou comportement discriminatoire fondé sur la croyance que les personnes ayant une déficience, un trouble ou un trouble mental ont moins de valeur que les autres (Office québécois de la langue française). Voir aussi le texte de Laurence Parent sur le capacitisme publié dans Droits et libertés au printemps 2021. Le capacitisme permet d’aller au‑delà de ce qui est légalement reconnu comme de la discrimination fondée sur le handicap et d’approcher le handicap d’une perspective critique pour ainsi mieux s’attaquer aux sources des injustices et des inégalités vécues par les personnes handicapées. |
La double peine
Bien entendu, la prison n’est pas la solution aux échecs sociétaux. Elle ne fait souvent qu’empirer le sort des personnes. Les personnes ayant une déficience intellectuelle se trouvent de plus en plus à l’intersection de systèmes d’oppression multiples qui les rendent plus susceptibles de vivre de la violence, du sous-emploi, de la pauvreté et de l’exclusion sociale. D’abord, dans les établissements provinciaux au Québec, les personnes n’ont pas davantage accès aux services dont elles ont besoin, tant à l’intérieur des murs de la prison qu’à l’extérieur. Non seulement le personnel n’est pas formé pour intervenir auprès des personnes ayant une déficience intellectuelle, mais le fonctionnement même de la prison exacerbe la vulnérabilité des personnes concernées. Pensons ici aux requêtes que doivent rédiger à la main les détenu-e-s pour avoir accès à des soins de santé ou encore aux nombreux codes sociaux implicites qui régissent les interactions entre les détenu-e-s. De plus, contrairement au système fédéral, où les informations d’un diagnostic sont intégrées sur le plan correctionnel, qui comprend des interventions et des programmes adaptés aux besoins du détenu, il n’existe aucun programme spécialisé pour la déficience intellectuelle au Québec. L’ensemble des normes capacitaires de la société continuent également de sévir au sein même de la prison, rendant difficile, voire impossible, la réadaptation et la réinsertion sociale.[…] une meilleure prise en compte de la déficience intellectuelle au sein du système pénal […] ne viendrait toutefois pas remplacer la nécessité d’un filet social fort situé bien en amont de la filière pénale.Par ailleurs, l’incarcération mène automatiquement à la perte des prestations d’assistance sociale et à la fin des services quand il y en a. Privées de tout soutien financier et psychosocial à leur sortie de prison, les personnes retombent souvent dans la criminalité de subsistance et dans des dynamiques menant à leur exclusion sociale. Le cycle se répète donc inlassablement : pauvreté, exclusion sociale, judiciarisation, prison, pauvreté, etc.
Quelles alternatives à la prison ?
Au Québec, au cours des trois dernières décennies, les dispositifs dédiés aux personnes composant avec des enjeux de santé mentale se sont multipliés. Successivement des équipes spécialisées en intervention de crise, des patrouilles composées de policières, de policiers, et d’infirmières et d’infirmiers, des tribunaux spécialisés en santé mentale sont apparus6. Ces initiatives, associées à ce qui se présente comme un tournant thérapeutique de la justice, témoignent d’une volonté d’offrir à ces personnes un traitement judiciaire plus juste et équitable. S’il est vrai qu’à travers ces nouveaux dispositifs, la justice tend à présenter un visage plus humain, peu d’indices laissent à penser que les conditions de vie dans lesquelles évoluent les personnes concernées s’en trouvent pour autant nettement améliorées. Ainsi, bien qu’une meilleure prise en compte de la déficience intellectuelle au sein du système pénal soit souhaitable et pourrait probablement rendre certains parcours moins désastreux pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, cela ne viendrait toutefois pas remplacer la nécessité d’un filet social fort situé bien en amont de la filière pénale. Il semble clair que de simplement injecter plus d’argent dans le système pénal et carcéral n’est pas une solution pour régler les manques de services. Si les mesures d’adaptation du système de justice peuvent être utiles, elles doivent être accompagnées d’une intervention étatique cohérente et soutenue pour restaurer un vrai filet de sécurité. Ce dont bien des personnes ont besoin, ce sont des services sociaux universels et de qualité, des mesures visant à rendre réellement inclusive notre société, et des programmes d’assistance sociale qui permettent de mener une vie réellement digne. Pas de plus de répression, de judiciarisation et de prison. En somme, ce dont ces personnes ont besoin, c’est que l’on reconnaisse leur humanité et qu’on leur permette de faire partie elles aussi de la collectivité d’égal à égal. La prison n’est certainement pas la solution pour y arriver.- Codina, N. Pereda, G. Guilera. Lifetime Victimization and Poly-Victimization in a Sample of Adults With Intellectual Disabilities. Journal of Interpersonal Violence 37, no 5-6, 2022. En ligne : https://doi.org/10.1177/0886260520936372.
- Statistique Canada, Caractéristiques de l’activité sur le marché du travail des personnes ayant une incapacité et sans incapacité en 2022 : résultats de l’Enquête sur la population active, En ligne : https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/230830/dq230830a-fra.htm.
- Eric Emerson, Poverty and People with Intellectual Disabilties, Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews 13, 2007. En ligne : https://doi.org/10.1002/mrdd.20144.
- Nathan J. Wilson et al., From Social Exclusion to Supported Inclusion: Adults with Intellectual Disability Discuss Their Lived Experiences of a Structured Social Group, Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities 30, no 5, 2017. En ligne : https://doi.org/10.1111/jar.12275.
- En ligne : https://theconversation.com/au-quebec-comme-ailleurs-au-canada-les-programmes-dassistance-sociale-sont-des-trappes-a-pauvrete-211968
- G. Ouellet, E. Bernheim, D. Morin, “VU” pour vulnérable : la police thérapeutique à l’assaut des problèmes sociaux, Champ pénal, 2021. En ligne : http://dx.doi.org/https://doi. org/10.4000/champpenal.12988
L’article Prison et déficience intellectuelle, ça ne va pas! est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

Un portrait de la population carcérale

Retour à la table des matières Droits et libertés, printemps / été 2024
Dérouler le fil des logiques carcérales
Aurélie Lanctôt, doctorante en droit, membre du comité de rédaction et du comité Enjeux carcéraux et droits des personnes en détention de la Ligue des droits et libertésÉtablissements de détention au Québec
Au Québec, en 2021-2022, 19 976 personnes ont été prises en charge par les services correctionnels provinciaux, ce qui représentait une augmentation de 10 % par rapport à l’année précédente. Plus de deux tiers (68 %) des personnes admises en détention avaient entre 25 et 49 ans, une tranche d’âge qui regroupe 33 % de la population1, et seules 10 % de ces personnes étaient des femmes2. Une proportion de 11 % des personnes incarcérées avaient un problème de santé physique ou mentale, et 12 % vivaient avec un trouble de santé mentale seulement; 4 % des personnes étaient en situation d’itinérance déclarée; 4,5 % étaient des personnes autochtones et 3 % étaient Inuit, ce qui constitue une surreprésentation par rapport à leur poids dans la population totale (selon les données du recensement de 2021, les personnes autochtones représentaient 2,5 % de la population québécoise et les Inuit, 0,2%). Plus du tiers (38 %) des personnes avaient des antécédents judiciaires, et plus de la moitié (53 %) purgeaient des courtes peines (en moyenne 47 jours). Les Inuit et les personnes ayant un niveau secondaire d’études présentent les taux d’incarcération les plus élevés par rapport à leur population totale respective. Les causes d’incarcération les plus fréquentes étaient les infractions commises en contexte conjugal (16 %) – une catégorie qui a connu une augmentation de 5 % depuis 2020 –, le défaut de se conformer à une ordonnance de probation ou une omission de se conformer à un engagement, représentant 19 % des causes d’incarcération. Pour l’année 2022-2023, les peines discontinues (c’est-à-dire les peines purgées par périodes plutôt que de manière continue, parfois appelées peines de fin de semaine) constituaient la réalité d’une importante proportion des personnes incarcérées au Québec. Ces peines étaient purgées par des hommes dans 89 % des cas, et 15,75 % des personnes purgeant une peine discontinue déclaraient être en situation d’itinérance.Surreprésentation des Autochtones et Inuit
Partout au Canada, Autochtones et Inuit sont surreprésentés au sein de la population carcérale, tant dans les prisons provinciales que dans les pénitenciers fédéraux. En 2020-2021, selon les données compilées par Statistique Canada, les adultes autochtones représentaient 33 % des admissions en détention, tant dans les établissements provinciaux que fédéraux, alors qu’elles et ils représentent environ 5 % de la population canadienne. On note aussi que les mineur-e-s autochtones représentaient 50 % des placements sous garde (alors qu’elles et ils ne sont que 8 % de la population totale des jeunes)3. Les données disponibles les plus récentes sur les Autochtones des Premières Nations incarcérées dans un établissement de détention provincial au Québec remontent à 2018-20194. Cette année-là, 629 Autochtones des Premières Nations purgeaient une peine en établissement de détention (hausse de 5 % par rapport à l’année précédente), 406 purgeaient une peine dans la communauté (augmentation de 40 %) et 322 purgeaient une peine discontinue. La grande majorité (81 %) purgeaient des courtes peines, et les infractions les plus fréquentes étaient le défaut de se conformer à une ordonnance de probation ou à un engagement. Au Québec, en 2018-2019, 5,1 % des femmes incarcérées étaient Inuit et 4,5 % étaient membres d’une Première Nation5. Si cela constitue une surreprésentation par rapport à leur poids au sein de la population québécoise, c’est au sein du système correctionnel fédéral que leur surreprésentation est la plus marquée. En effet, en 2019, alors que les femmes représentaient 6 % des personnes détenues dans les établissements du Service correctionnel Canada (SCC) à travers le Canada, les femmes autochtones constituaient 42 % de la population carcérale féminine, et 27 % des femmes placées sous surveillance dans la collectivité6. En 2023, le rapport de l’Enquêteur correctionnel (Enquêteur) soulignait que la situation s’était encore aggravée, alors que les femmes autochtones constituaient désormais près de 50 % de la population pénitentiaire féminine. On remarque par ailleurs que les femmes autochtones sont largement plus susceptibles de se voir attribuer une cote de sécurité plus élevée que les autres femmes.Surreprésentation des personnes noires
Le ministère de la Sécurité publique du Québec ne transmet pas d’information quant à l’appartenance raciale des personnes détenues, outre les personnes autochtones. Les données compilées par Statistique Canada à partir des données transmises par certaines provinces esquissent cependant une tendance au sein de la population carcérale canadienne. En 2020-2021, la Nouvelle-Écosse, l’Ontario, l’Alberta et la Colombie-Britannique compilaient des renseignements sur les adultes appartenant à une minorité visible admis en détention. Les personnes appartenant à une minorité visible représentaient 17 % des admissions, et, de manière saillante, parmi ce groupe, 61 % étaient des personnes noires. Au total, 10 % des admissions d’adultes en détention dans ces provinces concernaient des personnes noires, alors qu’elles ne représentent que 4 % de la population adulte dans ces provinces7. À noter que la représentation des personnes racisées était beaucoup plus importante chez les hommes admis en détention (18 %) que chez les femmes (9 %). En 2013, l’Enquêteur a indiqué que le nombre de personnes noires incarcérées avait bondi de 80 % en une décennie, (et de 46 % chez les personnes autochtones). Les personnes noires représentaient alors 9,5 % des personnes détenues dans un pénitencier fédéral, alors qu’elles ne formaient que 2,9% de la population. Les personnes noires étaient également plus susceptibles d’être placées en établissement à sécurité maximale, réduisant ainsi leur accès à différents programmes durant leur détention, et plus nombreuses à être placées en isolement. En 2022, l’Enquêteur soulignait que la tendance s’était maintenue : la représentation des personnes noires en détention dans un établissement fédéral a peu varié (9,2 %), tout comme leur poids au sein de la population totale. De plus, les incidents de racisme et de discrimination subis par des personnes noires détenues signalés au Bureau de l’enquêteur correctionnel ont augmenté dans les dernières années. Quant aux femmes noires, si elles étaient, en 2022, moins nombreuses que dans la décennie précédente à purger une peine dans un établissement fédéral, l’Enquêteur rapportait néanmoins qu’elles subissaient de nombreuses discriminations en détention (par exemple, une suspicion et une surveillance accrues, ou encore un accès défaillant à des articles d’hygiène corporelle appropriés).- En ligne :https://statistique.quebec.ca/fr/document/population-et-structure-par-age-et-sexe-le-quebec/tableau/estimations-de-la-population-selon-lage-et-le-sexe-quebec#tri_pop=30
- Données issues du Profil de la clientèle carcérale 2021-2022, ministère de la Sécurité publique, Québec.
- Statistique Canada, Statistiques sur les services correctionnels pour les adultes et les jeunes, 2020-2021. En ligne : https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220420/dq220420c-fra.htm
- Profil des Autochtones des Premières Nations confiées aux services correctionnels en 2018-2019, ministère de la Sécurité publique, Québec.
- Profil des femmes confiées aux services correctionnels en 2018-2019, ministère de la Sécurité publique, Québec.
- Service correctionnel Canada, Statistiques et recherches sur les délinquantes. En ligne : https://www.canada.ca/fr/service-correctionnel/programmes/delinquants/femmes/statistiques-recherches-delinquantes.html
- Statistique Canada, Statistiques sur les services correctionnels pour les adultes et les jeunes 2020-2021. En ligne : https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220420/dq220420c-fra.htm
L’article Un portrait de la population carcérale est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

Dérouler le fil des logiques carcérales

Retour à la table des matières Droits et libertés, printemps / été 2024
Dérouler le fil des logiques carcérales
Delphine Gauthier-Boiteau et Aurélie Lanctôt, doctorantes en droit, membre du comité de rédaction et du comité Enjeux carcéraux et droits des personnes en détention de la Ligue des droits et libertés À l’automne 2022 se tenait le colloque De l’Office des droits des détenu-e-s (1972- 1990) à aujourd’hui : perspectives critiques sur l’incarcération au Québec, organisé par la Ligue des droits et libertés et son comité Enjeux carcéraux et droits des personnes en détention. Cet évènement a donné lieu à des discussions autour d’enjeux passés et présents en lien avec l’incarcération et les luttes anticarcérales au Québec. L’évènement, marquant à plu- sieurs égards, embrassait une définition large des systèmes et institutions que les luttes anticarcérales prennent pour objet. Il s’agissait alors de stimuler une réflexion vaste sur les transformations sociales visant à dépasser et à défaire les logiques qui produisent et reproduisent l’enfermement au sein de notre société. Ce dossier s’inscrit dans le sillon des réflexions qui ont émergé lors de cette journée. [caption id="attachment_19978" align="alignright" width="438"] Mes droits, ma charte des libertés par RVL | Projet Société Elizabeth Fry 2024.[/caption]
Ce dossier se veut une invitation. D’abord, une invitation à reconnaître les violences inhérentes à la prison et aux institutions carcérales ainsi que ce que leur existence empêche, c’est-à-dire une prise en charge des problèmes sociaux à leur racine. La proposition qui en découle est de réfléchir à partir de l’idée que la prison, tout comme le système de justice pénale, ne peuvent constituer une réponse appropriée aux problèmes sociaux parce que ces institutions sont, avant toute chose et de manière inévitable, un lieu de reproduction des systèmes qui en sont l’assise. Du point de vue des personnes victimisées, cette réponse n’est pas, non plus, appropriée, car elle individualise les torts causés, la transgression sociale ainsi que la violence, et n’a pas pour fonction d’apporter une réparation.
Ensuite, ce dossier est une invitation à poser un regard critique sur les logiques carcérales à l’œuvre au sein des institutions qui assurent une prise en charge de différents problèmes sociaux par l’État et dont le champ d’intervention repose sur des cadres juridiques distincts. Il s’agira donc de se pencher, certes, sur la prison, mais aussi les institutions psychiatriques, les systèmes d’immigration, de protection de la jeunesse ou encore d’éducation. Plutôt que de penser ces institutions en vase clos, il convient de dévoiler le fil de la carcéralité qui les traverse. Cela permet d’élargir notre compréhension des phénomènes de détention, de contrôle des corps et de surveillance des individus, au-delà des murs de la prison et de sa matérialité immédiate. Autrement dit, l’enfermement n’a pas lieu uniquement dans les prisons et les pénitenciers.
Les contributions mises de l’avant dans ce dossier tentent d’esquisser une compréhension transversale des systèmes qui produisent l’enfermement, la déshumanisation et la mise à l’écart sous des prétextes multiples, mais dont le sous-texte commun est l’idée que la vie de tous et toutes n’aurait pas la même valeur. Par exemple, il sera question de la manière dont le statut d’immigration que l’État accorde à une personne lui permet d’infliger une double peine, c’est-à-dire de procéder à l’expulsion territoriale de personnes auxquelles on a déjà infligé une peine en vertu du système de justice pénale. Plus généralement, il s’agira de mettre en évidence la notion, souvent occultée, de gestion différentielle des illégalismes en fonction de la place qu’occupe un individu dans l’espace social, et de dévoiler ainsi la teneur politique des infractions prévues au Code criminel. Il s’agira de rendre visible, par la négative, les effets de courtoisie organisés par l’État à l’égard de certains groupes ; ou ce que le juriste Dean Spade appelle la distribution inégale des chances de vivre1. Cette notion renvoie notamment aux tensions entre, d’une part, le défaut de mise en œuvre des droits économiques et sociaux par l’État et, d’autre part, les interventions étatiques découlant de logiques carcérales : cela alimente la détérioration des conditions de vie des personnes, intensifie la surveillance et les profilages (racial, social et politique) puis, en dernière instance, la criminalisation ainsi que l’incarcération disproportionnées de certains groupes.
L’expansion des logiques carcérales doit bien sûr être mise en lien avec des décennies de gouvernance néolibérale ayant laissé les services publics et communautaires dans un état de délabrement alarmant. En revanche, le présent dossier invite à ne pas voir les
Mes droits, ma charte des libertés par RVL | Projet Société Elizabeth Fry 2024.[/caption]
Ce dossier se veut une invitation. D’abord, une invitation à reconnaître les violences inhérentes à la prison et aux institutions carcérales ainsi que ce que leur existence empêche, c’est-à-dire une prise en charge des problèmes sociaux à leur racine. La proposition qui en découle est de réfléchir à partir de l’idée que la prison, tout comme le système de justice pénale, ne peuvent constituer une réponse appropriée aux problèmes sociaux parce que ces institutions sont, avant toute chose et de manière inévitable, un lieu de reproduction des systèmes qui en sont l’assise. Du point de vue des personnes victimisées, cette réponse n’est pas, non plus, appropriée, car elle individualise les torts causés, la transgression sociale ainsi que la violence, et n’a pas pour fonction d’apporter une réparation.
Ensuite, ce dossier est une invitation à poser un regard critique sur les logiques carcérales à l’œuvre au sein des institutions qui assurent une prise en charge de différents problèmes sociaux par l’État et dont le champ d’intervention repose sur des cadres juridiques distincts. Il s’agira donc de se pencher, certes, sur la prison, mais aussi les institutions psychiatriques, les systèmes d’immigration, de protection de la jeunesse ou encore d’éducation. Plutôt que de penser ces institutions en vase clos, il convient de dévoiler le fil de la carcéralité qui les traverse. Cela permet d’élargir notre compréhension des phénomènes de détention, de contrôle des corps et de surveillance des individus, au-delà des murs de la prison et de sa matérialité immédiate. Autrement dit, l’enfermement n’a pas lieu uniquement dans les prisons et les pénitenciers.
Les contributions mises de l’avant dans ce dossier tentent d’esquisser une compréhension transversale des systèmes qui produisent l’enfermement, la déshumanisation et la mise à l’écart sous des prétextes multiples, mais dont le sous-texte commun est l’idée que la vie de tous et toutes n’aurait pas la même valeur. Par exemple, il sera question de la manière dont le statut d’immigration que l’État accorde à une personne lui permet d’infliger une double peine, c’est-à-dire de procéder à l’expulsion territoriale de personnes auxquelles on a déjà infligé une peine en vertu du système de justice pénale. Plus généralement, il s’agira de mettre en évidence la notion, souvent occultée, de gestion différentielle des illégalismes en fonction de la place qu’occupe un individu dans l’espace social, et de dévoiler ainsi la teneur politique des infractions prévues au Code criminel. Il s’agira de rendre visible, par la négative, les effets de courtoisie organisés par l’État à l’égard de certains groupes ; ou ce que le juriste Dean Spade appelle la distribution inégale des chances de vivre1. Cette notion renvoie notamment aux tensions entre, d’une part, le défaut de mise en œuvre des droits économiques et sociaux par l’État et, d’autre part, les interventions étatiques découlant de logiques carcérales : cela alimente la détérioration des conditions de vie des personnes, intensifie la surveillance et les profilages (racial, social et politique) puis, en dernière instance, la criminalisation ainsi que l’incarcération disproportionnées de certains groupes.
L’expansion des logiques carcérales doit bien sûr être mise en lien avec des décennies de gouvernance néolibérale ayant laissé les services publics et communautaires dans un état de délabrement alarmant. En revanche, le présent dossier invite à ne pas voir les
[à] reconnaître les violences inhérentes à la prison et aux institutions carcérales ainsi que ce que leur existence empêche, c’est-à-dire une prise en charge des problèmes sociaux à leur racine.atteintes graves aux droits humains relatées comme les effets délétères d’un système brisé. Les contributions démontrent plutôt que ces atteintes font partie intégrante de ce système ; en d’autres mots que la prison est un lieu de violations de droits et que l’on peut et doit juger ce système avant tout à partir de ses effets. Plutôt que comme des exceptions, nous devons les concevoir comme le résultat du croisement des systèmes d’oppression sur lesquels les logiques carcérales s’érigent. Enfin, ce dossier se veut une invitation à imaginer ce que pourrait être un autre monde, un ailleurs politique qui dépasse l’horizon de la carcéralité. Il s’agit en quelque sorte d’un exercice de répétitions pour vivre2. Le dossier adopte deux temporalités : l’ici et maintenant — pour réagir aux violences infligées au présent par les logiques carcérales — et l’avenir souhaité — pour repenser notre rapport à la carcéralité et à tout ce qui la permet.
Dérouler le fil
Afin de refléter une pluralité de réflexions au sujet des tensions qui traversent la critique radicale du recours à l’enferme- ment et des logiques qui rendent cette pratique possible, nous mettons de l’avant les voix et les savoirs des personnes touchées directement par les phénomènes carcéraux, leurs proches et les personnes œuvrant à leurs côtés pour la défense des droits humains. Le premier volet a pour objectif de dévoiler les violences dont la prison est le nom, en mettant en lumière le caractère mortifère de cette institution ainsi que l’indifférence des autorités à l’égard des dénonciations pourtant continuelles des atteintes aux droits et des violences qui surviennent derrière les murs. Il sera question du caractère cyclique et de la nature carcérale de la prise en charge des personnes qui vivent avec des problèmes de santé mentale ou avec une condition de déficience intellectuelle, ainsi que des enjeux soulevés par le paradigme de l’isolement en milieu carcéral. Il sera aussi question des conditions d’incarcération des femmes dans les prisons provinciales, des expériences des proches de personnes incarcérées ainsi que des limites de l’action du Protecteur du citoyen pour assurer le respect des droits des personnes incarcérées et intervenir sur le plan systémique au Québec. Le second volet pose un regard critique sur d’autres réalités d’enfermement : de la détention administrative des personnes migrantes au système dit de protection de la jeunesse, en passant par les formes de détention en lien avec la psychiatrie. Celui-ci montre bien comment la position de certaines personnes dans l’espace social favorise, à leur encontre, l’exercice de formes de contrôle qui découlent de plusieurs systèmes, parfois de façon simultanée. Le troisième volet tente finalement d’articuler une critique plus fondamentale du recours à l’incarcération et à l’enfermement, en explorant notamment l’apport des théories et pratiques abolitionnistes carcérales et pénales. Il sera question, notamment, du rôle du capitalisme racial et de l’organisation patriarcale et coloniale de la société dans la production du caractère jetable (disposable) de certaines personnes. Le dossier se conclut par des contributions sur le thème de la justice transformatrice, pour penser une saisie non pénale et non carcérale des violences patriarcales. Ces contributions, s’appuyant sur des expériences collectives et individuelles, montrent comment le système pénal et carcéral fait défaut de réparer les torts vécus par les personnes victimisées et d’ébranler les racines structurelles des violences commises. Elles traduisent qu'il perpétue les logiques des systèmes mortifères sur lesquels il repose, et confine les personnes victimisées, ainsi que leurs besoins, à la marge.C'est là tout le paradoxe et de l'État pénal : l'architecture juridique pénale et constitutionnelle confère nécessairement aux personnes victimisées un statut de considération secondaire.Mariame Kaba, militante féministe et abolitionniste, écrit que les structures pénale et carcérale s’opposent à la responsabilisation (accountability) individuelle et collective. D’un côté, la structure de ce système décourage la reconnaissance de torts causés, puisque reconnaître sa culpabilité emporte son lot de discriminations pour les personnes accusées et leurs proches. De l’autre, l’individualisation qui prévaut contredit une compréhension systémique et une réponse commune, à portée transformatrice. Pour finir, il va sans dire que ce numéro n’a aucune prétention à l’exhaustivité. Ce dossier se veut une contribution humble, ouverte, et forcément imparfaite, aux luttes collectives pour la défense des droits des personnes incarcérées et enfermées, ainsi qu’aux luttes anticarcérales. Nous avons pensé l’ensemble de ces contributions comme une parenthèse ouverte, qui traduit une nécessité et un désir de poursuivre le travail de réflexion critique sur la carcéralité, pour mieux contribuer aux luttes collectives toujours plus nécessaires. Bonne lecture !
L’article Dérouler le fil des logiques carcérales est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.












