Presse-toi à gauche !
Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Violences faites aux femmes : vers une compréhension politique du patriarcat

La violence à l'égard des femmes et des filles peut prendre de nombreuses formes à l'échelle mondiale, de l'absence d'autonomie personnelle à la violence sexuelle et à la violence domestique.
Tiré de Entre les ligne et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/02/12/violences-faites-aux-femmes-vers-une-comprehension-politique-du-patriarcat/?jetpack_skip_subscription_popup
Pour mieux comprendre comment la violence à l'égard des femmes affecte les femmes au Moyen-Orient en particulier, cette note d'orientation aborde divers cas de violence à l'égard des femmes kurdes dans la région du Kurdistan irakien (KRI). Une attention particulière est accordée aux mariages forcés/arrangés, à la violence fondée sur l'honneur et aux mutilations génitales féminines, qui forment un « trio patriarcal » d'oppression : un phénomène que l'auteur a identifié et étudié de manière approfondie. Les recommandations de la note d'orientation éclairées par cette recherche sont pertinentes pour les décideurs politiques de la région du Kurdistan irakien et au-delà, y compris les États membres de l'Union européenne qui ont été confrontés à des cas troublants de violence à l'égard des femmes dans les communautés immigrées et qui sont confrontés à des défis similaires en matière de droits des femmes. L'examen des violations contre les femmes est pertinent pour de nombreuses régions du Moyen-Orient et, plus largement, pour les sociétés et les communautés où les valeurs et les normes patriarcales produisent un milieu social où la principale justification de la violence à l'égard des femmes est la protection d'une construction sociale de l'honneur. Cette note d'orientation s'appuie sur des travaux de terrain menés dans la région du Kurdistan irakien ; 55 entretiens qualitatifs avec des décideurs politiques, des fonctionnaires des Nations Unies, des avocats, des universitaires, des militants, des membres de la société civile, ainsi que des femmes et des hommes victimes et auteurs de violences faites aux femmes ; et une enquête quantitative menée auprès de 200 femmes et hommes pour connaître leurs opinions sur ce phénomène aux multiples facettes. L'objectif de cette note d'orientation est de donner aux institutions publiques chargées de surveiller le bien-être des femmes une meilleure idée des défis auxquels les femmes sont encore confrontées en matière d'égalité et de proposer des pistes pour relever ces défis. [1]
Les femmes et les filles subissent de nombreuses formes de violences basées sur le genre (VBG) à l'échelle mondiale. Cette note d'orientation examine des cas spécifiques de VBG contre des femmes kurdes dans la région du Kurdistan irakien (KRI) afin de mettre en lumière l'impact unique de la VBG sur les femmes du Moyen-Orient. Au cours de mes recherches, j'ai observé, défini et examiné une trinité d'oppression, que j'ai baptisée « trifecta patriarcale » (Hussain, 2024). Ce trio comprend les mariages forcés/arrangés, les mutilations génitales féminines (MGF) et les soi-disant « crimes d'honneur » / violences basées sur l'honneur (VHB) ; des phénomènes qui, selon moi, fonctionnent de manière symbiotique et méritent une attention particulière du point de vue des politiques publiques (Payton, 2019 ; Beghikhani, 2015 ; Haig et al., 2015 ; Ruba, 2010 ; Brown et Romano, 2016 ; Ahmady, 2018 ; Burrage, 2016 ; Barrett et al., 2021).
Les conclusions et recommandations de cette note d'orientation s'appuient sur des recherches menées entre 2022 et 2024. En 2023, j'ai mené des travaux de terrain dans les villes d'Erbil, Duhok, Sulaymaniyah, Kelar et Xanaqin, en menant des entretiens avec 55 femmes et hommes ayant survécu ou ayant commis des violences sexistes, des décideurs politiques, des fonctionnaires des Nations Unies (ONU), des avocats, des universitaires, des militants et des membres de la société civile. J'ai également mené une enquête quantitative auprès de 200 femmes et hommes sélectionnés au hasard, comme variable de contrôle pour connaître leur point de vue sur les différents phénomènes examinés dans cette note d'orientation.
Cette note d'orientation est importante au-delà du KRI, car la région du Moyen-Orient dans son ensemble est confrontée à des obstacles comparables en matière d'égalité des femmes. Cette question gagne également en importance dans les communautés de la diaspora en raison de la tension croissante entre les conceptions conservatrices et traditionalistes de l'islam au Moyen-Orient et les conceptions libérales modernistes « anglo-européennes » des droits des femmes inscrits dans la législation européenne. Un tel environnement idéologique partagé par le KRI et les diasporas des États d'Europe occidentale signifie que de nombreuses femmes survivantes sont ostracisées par la société et obligées de subir ces injustices en silence. Compte tenu de ces défis, cette note d'orientation comprend sept recommandations générales qui abordent les violations des droits des femmes.
Cette note d'orientation vise à offrir aux agences gouvernementales chargées de suivre le bien-être des femmes des informations supplémentaires sur la manière de mieux garantir l'égalité des femmes dans la société en proposant des stratégies cohérentes. Les recommandations de cette note d'orientation s'alignent étroitement sur l'Objectif de développement durable ODD) 5 des Nations Unies sur l'égalité des sexes et l'ODD 16 sur la paix, la justice et des institutions efficaces [2].
Mariages forcés et arrangés
Les données que j'ai recueillies au KRI ont révélé que le taux de mariage forcé parmi les filles mariées entre 14 et 17 ans et entre 18 et 24 ans était de 20% pour les deux groupes. Les mariages d'enfants et les mariages forcés découlent de divers facteurs, notamment les normes tribales et patriarcales, les pratiques culturelles, le manque d'éducation formelle, les déséquilibres de pouvoir au sein des ménages et les attentes masculines néfastes (Khan, 2020 ; Erman et al., 2021). Ces mariages ont souvent lieu dans des zones rurales régies par des coutumes qui ne respectent pas les lois de l'État.
La prévalence du mariage d'enfants au Kurdistan irakien est difficile à quantifier, mais une enquête de l'UNFPA a révélé que 20,53% des femmes âgées de 20 à 24 ans dans la région du Kurdistan et 23,02% dans l'ensemble de l'Irak étaient mariées avant l'âge de 18 ans (UNFPA, 2016). Les facteurs contributifs comprennent des coutumes désuètes, la pauvreté et un faible niveau d'éducation, qui rendent les filles vulnérables à l'exploitation et à la dépendance économique (ONU Femmes, 2018 ; 2019 ; El Ashmawy et al., 2020). Les hommes sont également touchés, car les jeunes maris sont souvent confrontés à la pression de subvenir aux besoins d'un ménage sans carrière ni revenus stables (Hussain, 2024).
Après la montée de l'État islamique (EI) en 2014, les difficultés économiques et la baisse du niveau de vie au Kurdistan irakien ont entraîné une augmentation des violences contre les femmes. De nombreuses filles ont été contraintes d'abandonner l'école et de se marier jeunes en raison de difficultés financières, de pressions familiales ou d'un contexte de travail forcé où elles étaient exposées à l'exploitation et au harcèlement sexuels.
Les familles considéraient souvent le mariage précoce comme un moyen de « protéger » leurs filles de plus grands dangers, malgré les objections de ces dernières. Les violences physiques au sein du mariage étaient normalisées par les parents, car elles considéraient que c'était une meilleure alternative que de laisser leurs filles « sans défense » et potentiellement vulnérables à de multiples abus. Les mariages arrangés étaient perçus comme des opportunités de mobilité sociale, tirant parti des structures patriarcales pour améliorer les perspectives matérielles d'une fille. Cependant, ces unions manquaient souvent d'amour et d'empathie, réduisant les mariages à des arrangements transactionnels dans lesquels les femmes étaient traitées comme des biens ou des servantes, ce qui conduisait à l'isolement et à l'enfermement.
Dans les régions rurales et tribales, la domination masculine façonnait tous les aspects de la vie. Les hommes justifiaient souvent leur contrôle par des croyances religieuses, rejetant les lois laïques protégeant les femmes comme des influences corruptrices. L'obéissance des filles et des femmes était considérée comme un impératif moral, et le fait de défier les choix parentaux en matière de mariage était considéré comme déshonorant. En fin de compte, mes recherches ont mis en évidence que les pratiques de mariage forcé étaient profondément ancrées dans les normes culturelles.
Violence fondée sur le déshonneur perçu
Les violences liées à l'honneur (VFI) demeurent courantes au Kurdistan irakien, enracinées dans les normes patriarcales et tribales ainsi que dans les perceptions culturelles du rôle « approprié » des femmes. Les données officielles montrent que 44 femmes ont été tuées pour « l'honneur » en 2022. De nombreuses autres se seraient suicidées dans des circonstances suspectes, souvent par auto-immolation, et on suppose que certains d'entre elles étaient des meurtres d'honneur mis en scène comme des suicides. Comme l'a expliqué un représentant d'ONG à Sulaymania, « il est très facile pour une femme d'être victime d'un meurtre d'honneur commis par des membres de sa famille au Kurdistan irakien ou en Irak et de s'en tirer impunément ».
Les crimes d'honneur sont commis pour des raisons diverses, notamment les relations sexuelles avant le mariage, le fait d'être victime d'un viol, le refus d'un mariage arrangé ou le fait d'épouser une personne désapprouvée par la famille. Si le meurtre est la forme la plus grave, d'autres sévices, comme les mutilations et les défigurations faciales, sont également infligés pour rendre les femmes « indésirables ».
La loi irakienne traite des crimes d'honneur mais autorise des peines réduites pour ces crimes, les considérant souvent comme des délits moins graves. Dans l'ensemble de l'Irak, les peines peuvent être aussi basses que six mois, alors que les meurtres non liés à l'honneur sont passibles de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort (AlKhateeb, 2010). Cette clémence perpétue l'idée que les crimes d'honneur sont des réactions « naturelles » à la honte ressentie par la famille. En revanche, les autorités du Kurdistan irakien ont aboli les lois autorisant de telles peines réduites en 2000.
Contrairement aux mariages forcés, les violences sexuelles touchent tous les milieux socioéconomiques. Une enquête de l'UNICEF a révélé que 59% des femmes âgées de 15 à 59 ans trouvaient acceptables les violences physiques infligées par leur mari (AlKhateeb, 2010). De nombreuses femmes intériorisent les normes patriarcales et perçoivent ces dangers comme ne concernant que les « autres ». Les entretiens ont montré que les femmes plus âgées, notamment les mères et les tantes, considéraient souvent les crimes d'honneur comme justifiés par des transgressions morales « graves », comme la promiscuité sexuelle perçue, estimant que de tels actes ternissaient l'honneur de la famille.
Recommandations politiques
Le « trio patriarcal » – mariages forcés/arrangés (Hussain, 2024), violences basées sur l'honneur (VHB) et mutilations génitales féminines (MGF) – est un problème complexe qui nécessite des solutions globales. Pour remédier à ces abus, le gouvernement du Kurdistan palestinien doit mettre en œuvre une stratégie nationale globale. Bien que des progrès aient été constatés, notamment une diminution des MGF, ces phénomènes continuent d'avoir des conséquences catastrophiques pour les femmes, les familles et les communautés.
Au niveau institutionnel, les propositions politiques prévoient notamment l'élargissement des services de réponse aux violences basées sur le genre financés par l'État, tels que les soins de santé, le soutien psychologique, l'aide au logement et les protections juridiques (Waylen, 2014 ; Piscopo, 2020). L'élimination des pratiques sexistes qui limitent l'accès des femmes au lieu de travail et aux ressources est essentielle pour renforcer leur capacité d'action économique, offrir des alternatives aux mariages arrangés et réduire le risque de crimes d'honneur (Chenoweth & Zoe, 2022 ; Hussain, 2024).
Les principaux objectifs pour atteindre ces buts sont les suivants :
– Renforcer la législation pour remettre en question les normes et croyances sexistes néfastes.
– Réduire l'acceptation sociale de la violence à l'égard des femmes (VAW) en promouvant des normes d'égalité des sexes.
– Collaborer avec des organisations dirigées par des femmes, des ONG et des dirigeants communautaires pour conduire des changements significatifs.
– Donner la priorité aux lois liées à la santé et aux mesures de responsabilisation pour atténuer la violence et favoriser l'égalité des sexes.
– Améliorer l'accès des femmes à la formation professionnelle, à l'emploi formel et aux droits du travail pour améliorer leurs opportunités économiques.
– Encourager une croissance économique inclusive en soutenant les entreprises qui privilégient le leadership et l'entrepreneuriat féminin.
– Coordonner les efforts intersectoriels pour aider les adolescents à lutter contre les mariages d'enfants, les MGF et la VHB.
Les réformes structurelles devraient inclure l'intégration de ces mesures dans le système éducatif. Une éducation complète à la santé reproductive peut informer les jeunes des dangers des MGF, tandis qu'assurer l'égalité d'accès à l'éducation obligatoire jusqu'à 18 ans peut permettre de lutter contre le désespoir économique (EGER, 2021). Les écoles pourraient également employer des administratrices et des infirmières pour répondre aux défis spécifiques des filles et fournir des conseils sur les problèmes personnels et de sécurité (World Food Program USA, 2022).
Une action législative est essentielle. Il faut interdire aux religieux d'enregistrer des mariages en dehors des tribunaux officiels, et les violences faites aux femmes et les mutilations génitales féminines devraient être sanctionnées plus sévèrement. Des unités spéciales devraient enquêter sur ces délits, et les procédures de divorce pour les femmes maltraitées doivent être simplifiées, avec l'aide de l'État pendant leur transition. Comme l'a déclaré une jeune femme du Kurdistan irakien : « Nous avons besoin que les hommes ressentent l'urgence de le faire. » Démanteler la « trilogie patriarcale » (Hussain, 2024) nécessite la participation de ceux qui en bénéficient (Levtov et al., 2015 ; Dabla-Norris et Kochhar, 2019). Les limitations des droits des femmes sont interconnectées et exigent des solutions holistiques qui s'attaquent aux causes profondes plutôt qu'à la simple atténuation des symptômes. Ces idées et recommandations sont pertinentes bien au-delà du Kurdistan irakien, et s'étendent à des contextes mondiaux.
Par Shilan Fuad Hussain
Shilan Fuad Hussain est chercheuse en études de genre et analyse culturelle. Elle a été auparavant boursière postdoctorale Marie Sklodowska-Curie (2022-2024, UKRI), chercheuse invitée au Washington Kurdish Institute (États-Unis) et boursière doctorale au Centre de politique de sécurité de Genève (Suisse). Elle est une universitaire interdisciplinaire et travaille sur une variété de sujets, parmi lesquels : la représentation, la production et les pratiques culturelles ; la violence sexiste ; les politiques étatiques favorisant l'égalité des femmes les MGF et les mariages arrangés/forcés ; les impacts sociaux de la masculinité ; et la multi-identité et la culture dans les diasporas. Ses travaux actuels se situent à l'intersection de la sociologie et de l'analyse culturelle, et de sa pertinence symbiotique pour la société moderne. De plus amples informations sont disponibles sur son site internet :
https://www.shilanfuadhussain.com/
Texte original (en anglais) à lire ici : Hussain, Shilan Fuad. (2025). “Violence Against Women : Towards a Policy Understanding of the Patriarchy.” Policy Papers. European Center for Populism Studies (ECPS). February 5, 2025.
https://doi.org/10.55271/pop0005
Références :
Ahmady, K. (2018). “The Politics of Culture-Female Genital Mutilation/Cutting in Iran.” Journal of Humanity. Vol 4(1) (March):1-022.
AlKhateeb, Basma. (2010). Persistent gender-based violence an obstacle to development and peace. Developing Programs for Women and Youth Iraqi. Al-Amal Association, Social Watch Poverty Eradication and Gender Justice. https://www.socialwatch.org/node/12087
Barrett, H. R. ; Bedri, N. & Krishnapalan, N. (2021). “The Female Genital Mutilation (FGM) – migration matrix : The case of the Arab League Region.” Health Care for Women International, 42(2), 186–212. https://doi.org/10.1080/07399332.2020.1789642
Beghikhani, N. (2015). Honour Based Violence. Gill & Hague.
Brown, L., & Romano, D. (2006). “Women in Post-Saddam Iraq : One Step Forward or Two Steps Back ?” NWSA Journal, 18(3), 51–70.
https://doi.org/10.2979/NWS.2006.18.3.51
Burrage, H. (2016). Female Mutilation : The Truth Behind the Horrifying Global Practice of Female Genital Mutilation, New Holland Publishers.
Chenoweth, Erica & Zoe, Marks. (2022, March 8). “Revenge of the Patriarchs : Why Autocrats Fear Women.” Foreign Affairs.
https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2022-02-08/women-rights-revenge-patriarchs
Dabla-Norris, E. & Kochhar, K. (2019). “Closing the Gender Gap.” IMF Paper.
https://www.imf.org/Publications/fandd/issues/2019/03/closing-the-gender-gap-dabla
EGER. (2021). Girls Education Roadmap.
https://apppack-app-eger-prod-publics3bucket-elt8wyly48zp.s3.amazonaws.com/documents/Girls_Education_Roadmap_2021_Report.pdf
El Ashmawy, Nadeen ; Muhab, Norhan and Osman, Adam. (2020). “Improving Female Labor Force Participation in MENA.” The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL). November 2, 2020.
https://www.povertyactionlab.org/blog/11-2-20/improving-female-labor-force-participation-mena
Erman, Alvina ; De Vries Robbe, Sophie Anne ; Thies, Stephan Fabian ; Kabir, Kayenat ; Maruo, Mirai. (2021). Gender Dimensions of Disaster Risk and Resilience : Existing Evidence. World Bank, Washington, DC.
http://hdl.handle.net/10986/35202
Haig, G. L. J. ; Öpengin, E. ; Hellinger, M. & Motschenbacher, H. (2015). “Gender in Kurdish : Structural and socio-cultural dimensions.” In : Gender Across Languages (Vol. 36, pp. 247–276). John Benjamins Publishing Company.
https://doi.org/10.1075/impact.36.10hai
Hussain, S. F. (2024). Protecting women's agency in the Middle East : Interventions and reforms to ensure women's rights. CWS Policy Insights No. 1. Center for War Studies.
Khan, A. R. ; Ratele, K. & Arendse, N. (2020). “Men, Suicide, and Covid-19 : Critical Masculinity Analyses and Interventions.” Postdigital Science and Education, 2(3), 651–656.
https://doi.org/10.1007/s42438-020-00152-1
Levtov, R. ; van der Gaag, N. ; Greene, M. ; Kaufman, M. & G. Barker. (2015). “State of the World's Fathers : A Men Care Advocacy Publication.” Washington, DC : Promundo, Rutgers, Save the Children, Sonke Gender Justice, and the Men Engage Alliance.
https://www.fatherhood.gov/sites/default/files/resource_files/e000003287.pdf
Payton, J. (2019). Honour and Political Economy of Marriage. Rutgers University Press.
Piscopo, Jennifer. (2020). The Impact of Women's Leadership in Public Life and Political Decision-Making. Prepared for UN Women's Expert Group Meeting for the 65th Session of the Committee on the Status of Women. New York : UN Women.
Ruba, S. (2010). Transnational Public Spheres from ‘Above' and from Below', Feminist Networks across the Middle East and Europe, Transnational Public Spheres.
UN Women. (2018). “Facts and Figures : Economic Empowerment.
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures
UN Women. (2019). Women's Full and Effective Participation and Decision-Making in Public Life, as Well as the Elimination of Violence, for Achieving Gender Equality and the Empowerment of All Women and Girls. New York : UN Women, 2019 :
https://digitallibrary.un.org/record/3898140?ln=en
UNFPA. (2016). Child Marriage in Kurdistan Region-Iraq.
https://iraq.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Child%20Marriage%20Broucher%20English%20Final%20covers%206.pdf
Waylen, Georgina. (2014). “Strengthening women's agency is crucial to underpinning representative institutions with strong foundations of participation.” Politics & Gender, 10, no. 4 : 495–523.
World Food Program USA. (2022). “Top 6 Reasons Women Are Hungrier Than Men Today.”
https://www.wfpusa.org/articles/women-in-crisis-top-ways-women-are-hungrier/
[1] Funding Details : This project was funded by UKRI, Grant Number : EP/X024857/1, carried out by Shilan Fuad Hussain at the Department of Law and Social Science, Middlesex University, United Kingdom.
[2] Geneva International Centre for Justice (GICJ), published by CEDAW – UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, ‘Shadow Report on Iraq submitted by Geneva International Centre for Justice (GICJ) to the Committee of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women ; 74th Session ; 21 October – 8 November 2019 ; Geneva, Switzerland', 10 October 2019. United Nations Population Fund, UN Children's Fund, UN Women, ‘Protecting Girls in Iraq from Female Genital Mutilation', 6 February 2019, from :
https://reliefweb.int/report/iraq/protecting-girls-iraq-female-genital-mutilation-enarku. The
United Nations have put forward multiple documents on the elimination of violence against women, including forced marriages, e.g., the 1993 Declaration on the Elimination of Violence against Women (UN Doc. A/Res/48/104). United Nations Statistics Division. United Nations Global SDG Database. Data retrieved July 2022. From :
https://unstats.un.org/sdgs/dataportal.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Mars 2025 : grève féministe !

Avec les femmes du monde entier, pour les droits des femmes, toutes en grève féministe et en manifestations !
Stop à l'extrême droite, à la droite réactionnaire, au gouvernement et à sa politique libérale et autoritaire !
7 février 2025 | tité du site Entre les lignes entre les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/02/10/8-mars-2025-greve-feministe/
Le 8 mars, journée internationale de mobilisation pour les droits des femmes, nous appelons à la grève du travail, des tâches domestiques, de la consommation. Sans les femmes, tout s'arrête ! Nous sommes déterminées à lutter, à faire entendre nos voix pour obtenir l'égalité.
Solidaires avec les femmes du monde entier !
Afghanes, Iraniennes, Palestiniennes, Soudanaises, Kurdes, Ukrainiennes, nous sommes solidaires de toutes celles qui encore aujourd'hui sont emmurées, exécutées, qui font face à des bombardements massifs, au génocide, à l'exode, sont victimes de viols de guerre, peinent à nourrir leur famille et elles-mêmes, de toutes celles qui se défendent farouchement pour recouvrer ou obtenir leur liberté et leurs droits, qui sont confrontées aux conflits armés, aux régimes fascisants, réactionnaires, théocratiques et colonialistes.
Nous sommes solidaires des femmes et des populations subissant de plein fouet les conséquences dramatiques du changement climatique, aggravé par les politiques productivistes et capitalistes.
Non à l'Extrême Droite !
Les idées d'extrême droite qui prônent la haine de l'autre, le racisme, la misogynie, les LGBTQIA+ phobies, le validisme, se banalisent, et sont aux portes du pouvoir, voire y accèdent partout dans le monde, à l'image de Trump aux États-Unis… Les femmes, les minorités de genre, les migrant·es en sont les premières cibles.
En France, nous dénonçons les propos racistes du ministre de l'intérieur, nous exigeons la régularisation et l'ouverture des guichets pour que tou·te·s les immigré·es puissent rester ici. Nous refusons l'abrogation du droit du sol à Mayotte et la remise en cause de l'Aide Médicale d'État.
Nous voulons vivre et pas survivre !
Les différents gouvernements ne font rien contre les inégalités salariales et les bas salaires qui touchent particulièrement les femmes (62% des personnes payées au SMIC sont des femmes). Quant aux mères isolées touchant le RSA, elles sont confrontées à de multiples difficultés pour trouver un emploi (problème de garde d'enfants, de transports…). Particulièrement touchées par la crise du logement cher, les femmes sont majoritaires parmi les personnes expulsables et sont de plus en plus nombreuses à vivre dans la rue. Les femmes sont majoritaires parmi les 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté !
Nous exigeons l'abandon de la réforme du RSA, qui oblige les bénéficiaires à faire 15h de travail forcé, gratuit et sans contrat !
Nous exigeons l'abrogation des réformes sur l'assurance chômage restreignant les droits des chômeur·ses.
Rémunérons le travail à sa juste valeur, à salaire égal entre femmes et hommes !
Pour l'égalité salariale, du temps pour vivre, des salaires et une retraite décente !
Le gouvernement n'a aucune volonté de réduire les inégalités salariales, de 27% en moyenne entre les femmes et les hommes. La transposition de la directive européenne sur la transparence salariale vise à renforcer l'application du principe d'une même rémunération « pour un même travail ou un travail de valeur égale ».
Nous exigeons la transposition immédiate de cette directive, la revalorisation salariale des métiers féminisés (éducation, soins, nettoyage…)., l'interdiction du temps partiel imposé, la transformation des CDD en CDI et la réduction du temps de travail avec embauches correspondantes.
Nous nous battons pour l'abrogation de la réforme Macron des retraites, et pour une réforme des retraites favorable aux femmes, la retraite à 60 ans avec une réduction du nombre d'annuités.
Des Services publics au service de nos besoins !
Malgré la paupérisation croissante et le manque crucial d'aide publique sur les territoires, le gouvernement Bayrou va continuer le démantèlement des services publics de la Santé, de l'Éducation, du Logement…. Les femmes en seront doublement pénalisées : parce qu'elles sont majoritaires dans la fonction publique, et qu'elles devront se substituer aux services de la petite enfance et de la prise en charge de la dépendance.
Nous exigeons un service public national de l'autonomie tout au long de la vie, à la hauteur des besoins, avec les moyens correspondants, sans oublier une prise en charge réelle du 4ème âge.
Nous exigeons la création d'un vrai service public de la petite enfance pour en finir avec les crèches privées à but lucratif et les maltraitances liées aux économies de personnels dans ces structures. Nous sommes opposées à la recommandation de la Cour des comptes de développer « la garde parentale, moins onéreuse pour les finances publiques » qui n'est qu'une incitation au retour des femmes à la maison.
Pour un réel partage du travail domestique !
Nous ne pouvons nous satisfaire que rien ne bouge dans la répartition des tâches au sein des couples et ce depuis des années. Cette inégalité dans la répartition du travail domestique se traduit par des inégalités dans la sphère professionnelle et est l'un des facteurs des inégalités salariales et patrimoniales. Nous dénonçons le mirage des « nouveaux pères » car les femmes en font toujours beaucoup plus que les hommes, qui de fait prennent plus souvent les tâches valorisantes, en laissant les tâches ménagères à leur compagne. C'est tout l'enjeu d'une éducation non sexiste qui puisse permettre d'en finir avec les stéréotypes de genre.
Notre corps nous appartient !
L'inscription dans la constitution de l'IVG ne doit pas masquer les obstacles liés au manque de moyens du service public de la santé pour recourir à l'IVG.
Nous réclamons la réouverture des plus de 130 centres d'interruption volontaire de grossesse fermés.
Nous dénonçons les offensives réactionnaires qui s'en prennent aux droits des personnes LGBTQIA+ qui veulent limiter le droit de vivre librement son orientation sexuelle et son identité de genre. Nous exigeons une transition libre et gratuite pour toutes et tous.
Nous dénonçons les offensives transphobes réactionnaires, notamment les propositions de loi qui remettent en cause toute possibilité de transition des mineur·es, et nous demandons la fin des mutilations et des traitements hormonaux non consentis.
Femmes handicapées, nous subissons toutes les violences. Privées de nos droits à l'autonomie, à l'éducation, à l'emploi, aux soins et à la procréation. Nous voulons notre indépendance économique, l'accessibilité universelle à l'ensemble des lieux et bâtiments.
Halte aux violences sexistes et sexuelles !
Le procès des 51 violeurs de Gisèle Pélicot a rappelé que les violeurs sont des hommes ordinaires, et que la culture du viol persiste dans les différentes strates de la société. La nomination de Darmanin mis en cause pour des violences sexistes et sexuelles comme garde des sceaux est une véritable provocation.
Nous continuons à compter nos mortes car il n'y a aucune volonté politique de lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants.
Pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, dont les violences obstétricales et gynécologiques, nous voulons une loi-cadre intégrale qui mette en avant prévention, éducation, protection, accompagnement, sanction et garantisse les moyens pour la prise en charge de l'ensemble des victimes, femmes, enfants et minorités de genre. Les plus touchées par les violences sexistes, dont les violences économiques, sont celles qui souffrent déjà de multiples oppressions : femmes victimes de racisme, migrantes, sans papiers, femmes précarisées, en situation de handicap, femmes lesbiennes et bi, femmes trans, femmes en situation de prostitution et celles victimes de l'industrie pornocriminelle. Nous demandons la mise en place d'actions concrètes pour lutter contre toutes les violences sexistes et sexuelles, protéger les victimes et combattre les réseaux de traite prostitutionnelle et de proxénétisme.
Nous exigeons les 3 milliards nécessaires pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles.
Nous refusons que les enfants violé·es, maltraité·es, incesté·es continuent le plus souvent à être abandonné·es à leur sort !
Pour l'éducation, pour les enfants, l'Éducation à la Vie Affective Relationnelle et Sexuelle pour toutes et tous maintenant !
Le dernier rapport du Haut conseil à l'égalité note que le sexisme progresse chez les adolescents et les jeunes hommes. Nous dénonçons fermement les attaques portées par le précédent gouvernement contre le projet de programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle (EVARS) reprenant les propos des associations réactionnaires de parents qui y sont farouchement opposées. Nous exigeons l'adoption et la mise en place immédiate du projet de programme EVARS, dans la continuité des lois votées pour l'éducation à la sexualité à l'école. L'EVARS aide à déconstruire les stéréotypes, à comprendre les inégalités, à comprendre l'injustice des dominations qui s'exercent par les hommes sur les femmes, à prendre conscience de son corps et de son intimité et à respecter l'autre et soi-même.
Mobilisées tous les jours contre le patriarcat, les politiques libérales et autoritaires et contre l'extrême droite.
Le 8 mars, nous manifesterons, nous serons en grève féministe.
Nous serons en grève sur nos lieux de travail (santé, commerce…), en grève du travail domestique et en grève de la consommation !
Quand les femmes s'arrêtent, tout s'arrête !
Signataires et soutiens
Premières signataires de l'appel
ActionAid France, AFRICA93, APEL-Égalité, Association Panafricaniste des Droits Civiques des femmes, Attac France, CGT, Collectif Faty KOUMBA : Association des Libertés, Collective des mères isolées, Droits de l'Homme et non-violence, FAGE, Féministes Révolutionnaires Paris, Femmes Egalité, Fondation Copernic, Force Féministe (57), FSU, Fête des 3 Quartiers ( F3Q), Genre et altermondialisme, HFE /Handi Femme Epanouie, Handi-Social, Las Rojas Paris, Le Planning familial, Le Planning Familial 94, Ligue des Femmes Iraniennes pour la Démocratie-LFID, Mouvement des Femmes Kurdes En France, Mouvement de la Paix, Organisation de Solidarité Trans (OST), Stop aux Violences Obstétricales et Gynécologiques France ( Stop-Vog ), UNEF le syndicat étudiant, Union Etudiante, Union syndicale Solidaires, Union des femmes Socialistes (SKB)
En soutien
APRES, Égalités, ENSEMBLE !, Gauche démocratique et sociale GDS, Gauche Ecosocialiste (GES), Génération.s, La France insoumise, Mouvement jeunes communistes de France, NPA-l'Anticapitaliste, NPA – Révolutionnaires, Parti Communiste Français, Parti Communiste des Ouvriers de France (PCOF), Parti de Gauche, PEPS 31, Révolution Écologique pour le Vivant (REV), Union Communiste Libertaire
Télécharger l'appel : Appel 8 mars 2025

Pourquoi le planning familial sauve des vies ?

Sakina Sania été contrainte de se marier à l'âge de 12 ans, en pleine guerre et pénurie alimentaire dans le nord du Nigéria. Elle est tombée enceinte à 15 ans, avant de faire une fausse couche, puis d'accoucher de deux enfants en peu de temps.
Tiré de Entre les lignes et les mots
« Je ne permettrai jamais à ma fille de vivre ce qui m'est arrivé », a-t-elle déclaré à l'agence des Nations Unies pour la santé sexuelle et reproductive(UNFPA).
Que se passe-t-il lorsque des conflits déplacent des dizaines de milliers de personnes dans des zones sensibles comme le Nigéria, la République démocratique du Congo (RDC) et l'Ukraine, et que des femmes meurent chaque jour en couches ou pendant leur grossesse ?
L'UNFPA apporte une aide vitale dans les camps de déplacés et au personnel médical.
Lorsqu'un tremblement de terre fait s'écrouler des quartiers entiers, des contraceptifs sont acheminés vers les convois de secours d'urgence, ainsi que des kits d'accouchement et des médicaments pour arrêter les hémorragies internes.
Lorsqu'un cyclone frappe des communautés insulaires, l'agence envoie des contraceptifs de la même manière qu'elle envoie du matériel médical stérile, notamment des préservatifs, des contraceptifs oraux et injectables, des implants contraceptifs et des dispositifs intra-utérins (DIU).
Pourquoi ? Parce que les contraceptifs font aussi partie des soins humanitaires susceptibles de sauver des vies.
Cela peut paraître contre-intuitif pour certains, mais c'est un fait établi du point de vue de la science médicale, des intervenants humanitaires et des femmes qui en bénéficient.
Même en dehors des situations d'urgence, l'accès à des contraceptifs modernes et sûrs permet aux femmes de prendre leurs propres décisions concernant leur fertilité, ce qui réduit les grossesses non désirées et les avortements à risque, améliore les résultats en matière de santé et diminue le risque de mortalité maternelle et infantile.
En bref, le planning familial sauve des millions de vies. Voici quelques éléments essentiels sur le sujet :
Les grossesses dans les situations d'urgence
On estime que plus de 60% des décès maternels surviennent dans des situations de crise humanitaire et de fragilité, où les femmes ont du mal à accéder aux soins et à la nutrition nécessaires pour mener à bien une grossesse en toute sécurité.
Même dans les meilleures circonstances, un quart des femmes n'ont pas la capacité de refuser d'avoir des rapports sexuels, selon les données les plus récentes.
En cas de crise humanitaire, les femmes sont deux fois plus exposées aux violences de genre, à l'utilisation du viol comme arme de guerre et comme instrument de génocide et au risque accru de violence conjugale.
Tout cela accroît les risques de grossesses non désirées.
Prévenir les complications mortelles
Si la contraception est parfois critiquée – à tort – comme un phénomène nouveau, elle existe en réalité depuis des millénaires.
Les préservatifs, par exemple, sont utilisés depuis des siècles.
Les formes modernes de contraception sont parmi les médicaments les plus prescrits et les mieux étudiés qui existent. Les contraceptifs ont été étudiés non seulement par des pharmacologues et des chercheurs en médecine, mais aussi par des économistes de la santé, des épidémiologistes et des décideurs politiques.
Et les résultats sont concluants : en prévenant les grossesses non désirées, les contraceptifs empêchent les femmes de mourir.
Comment ? Chaque grossesse comporte un risque, et les grossesses dans les situations de crise, où les systèmes de santé sont en ruine et les soins médicaux difficiles d'accès, sont particulièrement dangereuses.
Parce que les bébés n'attendent pas
Que se passe-t-il lorsqu'une femme est prête à accoucher après un ouragan ou dans une zone de guerre ?
En RDC, en proie à une crise actuelle, l'effondrement des infrastructures de santé a fait grimper en flèche les taux de mortalité maternelle. Trois femmes y meurent toutes les heures de complications liées à la grossesse ou à l'accouchement.
Selon le Dr Ikram Haboush, à Idlib, de nombreuses femmes dans le nord-ouest de la Syrie perdent la vie lors de leur transfert entre les hôpitaux, en l'absence de fournitures essentielles pour des conditions critiques.
Les grossesses non désirées sont également directement liées à des taux de mortalité maternelle plus élevés.
« C'est pourquoi tout programme de santé publique conçu pour réduire le nombre de décès maternels intègre la contraception comme l'un des piliers de l'action », indique les rédacteurs la publication annuelle phare de l'UNFPA, le rapport sur l'état de la population mondiale, « Comprendre l'imperceptible : Agir pour résoudre la crise oubliée des grossesses non intentionnelles ».
En prévenant les grossesses non désirées, les contraceptifs réduisent également l'incidence des blessures et des maladies maternelles, des mortinaissances et des décès néonatals.
En 2023, le partenariat dédié de l'UNFPA a permis d'acheter des contraceptifs pour un montant total de 136 millions de dollars, ce qui a permis d'éviter près de 10 millions de grossesses non désirées et plus de 200 000 décès maternels et néonatals, selon les estimations. Ces contraceptifs ont également permis d'éviter près de trois millions d'avortements à risque.
Prévenir les maladies mortelles et chroniques
Les contraceptifs, tels que les préservatifs masculins et féminins, sauvent également des vies en réduisant les risques de contracter des infections sexuellement transmissibles (IST), notamment le VIH.
Même une IST traitable peut mettre la vie du patient en danger dans des environnements où l'accès aux soins médicaux est limité, comme c'est le cas pour les femmes et les filles en Haïti, par exemple, où la violence sexuelle généraliséeet incessante a entraîné une augmentation des taux de grossesses non désirées ainsi que des IST, alors que le système de santé s'est presque effondré.
Seuls 3% des survivantes en Haïti déclarent avoir reçu un traitement post-viol dans les 72 heures suivant l'agression. Ce traitement comprend une contraception d'urgence pour éviter une grossesse et la prophylaxie post-exposition pour éviter la transmission du VIH.
Les contraceptifs permettent également de traiter des problèmes de santé sans lien avec l'activité sexuelle, comme le syndrome des ovaires polykystiques, l'endométriose, la dysménorrhée et les saignements extrêmement abondants.
Pour des femmes comme Omaira Opikuko, du Venezuela, il ne fait aucun doute que la contraception à longue durée d'action, après son sixième accouchement, lui a sauvé la vie.
Elle a souffert à la fois d'hémorragie et d'un prolapsus génital lors de son dernier accouchement.
« J'étais au bord de la mort », a-t-elle déclaré.
Le planning familial est rentable
En 2023, plus de 50 pays ayant reçu du matériel contraceptif de la part de l'UNFPA ont réalisé des économies de plus de 700 millions de dollars, au totla, grâce à la réduction des coûts de santé liés à la grossesse, l'accouchement et aux soins post-avortement.
De nombreuses études ont démontré que le planning familial est un investissement essentiel pour la société, non seulement parce qu'elle permet d'éviter les grossesses non désirées et les problèmes de santé maternelle qui les accompagnent, mais aussi parce qu'elle a un effet positif sur l'éducation et les capacités d'emploi des femmes.
Dans les situations humanitaires, les contraceptifs sont d'autant plus essentiels qu'ils aident les femmes et les familles à survivre et à se stabiliser pour mieux se redresser.
Alors que, partout,la précarité s'accroît, les catastrophes se multiplient et les déplacements augmentent, ces services représentent une lueur d'espoir pour les femmes et les filles du monde entier.
Comme l'a dit Mme Opikuko au Venezuela : « Je ne veux plus avoir peur ».
https://news.un.org/fr/story/2025/02/1152881
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Femmes kurdes : redéfinir la liberté grâce à la résilience

Quand nous parlons de lutte, nous évoquons une image aussi vieille que la civilisation humaine : la tension éternelle entre oppression et liberté, silence et voix, captivité et libération. Mais rarement dans l'histoire cette dichotomie a trouvé une expression aussi vivante que dans le voyage des femmes kurdes du Rojava (nord de la Syrie) et du Kurdistan du Sud (nord de l'Irak). Leur histoire est celle du défi, de la résilience et de la transformation, un récit qui marie poésie et résistance, et une histoire qui exige à la fois notre admiration et notre solidarité.
Tiré de Entre les liges et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/02/17/femmes-kurdes-redefinir-la-liberte-grace-a-la-resilience/?jetpack_skip_subscription_popup
Les femmes kurdes sont depuis longtemps marginalisées, non seulement par les traditions patriarcales de leurs propres communautés, mais aussi par les régimes oppressifs qui ont cherché à effacer l'identité kurde elle-même. Pourtant, de ces cendres, telles des phénix, elles sont devenues des leaders, des guerrières et des visionnaires. Elles sont les architectes d'une révolution féministe, une avant-garde dans la lutte pour l'égalité des sexes sur l'un des terrains les plus hostiles que l'on puisse imaginer. Leur lutte, bien que spécifique à leur contexte culturel et historique, résonne universellement, nous appelant tous à réimaginer les possibilités de la liberté.
Mais pour comprendre l'ampleur de leurs réalisations, il faut d'abord prendre en compte le contexte de leur oppression. Pendant des décennies, les femmes kurdes d'Irak, de Syrie, de Turquie et d'Iran ont été triplement marginalisées : en tant que Kurdes au sein d'États-nations oppressifs, en tant que femmes au sein de sociétés profondément patriarcales et en tant qu'individus au sein d'un système mondial qui ignorait souvent leur sort. Le Rojava, la région autonome du nord-est de la Syrie, et le Kurdistan irakien sont devenus des creusets de leur résistance.
Au Kurdistan du Sud et en Irak, les cicatrices de la campagne Anfal restent gravées dans la mémoire collective : une attaque génocidaire menée sous le régime de Saddam Hussein qui a coûté la vie à des dizaines de milliers de Kurdes, laissant d'innombrables femmes veuves, déplacées et vulnérables. De même, au Rojava, la guerre civile syrienne a créé un vide de gouvernance et de sécurité dans lequel la violence patriarcale, les idéologies extrémistes et la négligence systémique ont menacé d'engloutir les femmes kurdes.
Mais les femmes kurdes n'ont pas accepté le statut de victime comme leur destin. Au contraire, elles l'ont redéfini en utilisant l'oppression comme une arme de défi, en forgeant la solidarité et en créant des espaces d'autonomie, de droits et de dignité.
Nulle part cette défiance n'est plus évidente qu'au Rojava, où les femmes kurdes ont mené une révolution féministe et écologique qui remet en cause non seulement le patriarcat, mais aussi les structures mêmes de l'État et du capital. Au cœur de cette révolution se trouve le principe de la « jinéologie », une philosophie féministe kurde qui dérive du mot kurde pour « femme », jin, et qui revendique le rôle central des femmes dans la société.
La jinéologie s'éloigne radicalement des rôles traditionnels des sexes et du féminisme libéral occidental. Elle insiste sur le fait que la libération de la société dans son ensemble est impossible sans la libération des femmes. Au Rojava, cette philosophie s'est traduite par des structures de gouvernance concrètes. Les femmes occupent tous les niveaux de direction politique, des conseils locaux au commandement militaire. Le système de coprésidence impose que chaque poste de direction soit partagé par un homme et une femme, garantissant ainsi la parité des sexes dans la prise de décision.
Ce n'est pas seulement symbolique. Les femmes du Rojava ont réécrit des lois qui autrefois légitimaient les mariages forcés, les crimes d'honneur et la violence domestique. Elles ont construit des maisons pour les femmes – des centres d'éducation, de médiation et de soutien – et créé des coopératives pour promouvoir l'indépendance économique. Ce sont des actes de révolution silencieuse, qui ne reposent pas uniquement sur la théorie mais aussi sur une transformation concrète et vécue.
Le monde a pris conscience pour la première fois de la lutte des femmes kurdes lors de la bataille de Kobané en 2014, lorsque des images de jeunes femmes en treillis, armées de kalachnikovs, ont commencé à circuler dans les médias du monde entier. Ces femmes, membres des Unités de protection des femmes (YPJ), se sont retrouvées en première ligne contre l'EI, l'une des forces les plus brutales et misogynes du XXIe siècle. Leur courage et leur génie tactique ont renversé le cours de la bataille, reprenant Kobané des mains de l'EI et gagnant l'admiration du monde entier.
Mais il ne s'agit pas seulement d'une histoire de triomphe militaire. Pour les femmes du YPJ, la résistance armée est une extension de leur idéologie féministe. Elles ne se battent pas seulement pour la souveraineté territoriale, mais pour une libération plus large du patriarcat et de l'autoritarisme. À leurs yeux, l'arme n'est pas un outil de domination mais un moyen de démanteler les structures d'oppression.
Au Kurdistan irakien, la lutte pour les droits des femmes a pris une tournure différente mais tout aussi significative. Les femmes kurdes y sont apparues comme militantes, politiciennes et militantes, remettant en cause des normes culturelles bien ancrées et faisant pression pour des réformes juridiques.
Des organisations comme l'Union des femmes du Kurdistan et l'Organisation des droits des femmes du Kurdistan mènent une campagne inlassable contre la violence sexiste, le mariage des enfants et les mutilations génitales féminines. Leurs efforts ont conduit à d'importantes victoires juridiques, notamment la criminalisation des crimes d'honneur et la création de refuges pour les victimes de violences conjugales.
Mais les progrès sont fragiles. Les normes traditionnelles et l'instabilité politique continuent de poser des problèmes. Pour chaque femme qui entre au parlement ou qui mène une manifestation, il y en a d'innombrables autres dont la voix reste ignorée et dont les droits restent bafoués. Mais même ici, les femmes kurdes puisent leur force dans leur lutte collective, refusant de céder face à l'adversité. Il y a aussi la situation troublante où de nombreuses militantes kurdes sont la cible de frappes de drones ou d'assassinats par l'armée turque, comme nous l'avons vu à plusieurs reprises au cours des dernières années.
Mais les réalisations des femmes kurdes vont bien au-delà de leur contexte immédiat. Elles sont devenues un symbole de résistance et une source d'inspiration pour les mouvements féministes du monde entier. Leur lutte met au défi les féministes occidentales de reconsidérer les croisements entre genre, ethnie et colonialisme. Elle nous rappelle que la libération n'est pas un don d'en haut, mais une bataille acharnée menée d'en bas.
Les femmes kurdes ont également forgé des solidarités transnationales, en collaborant avec des organisations féministes du monde entier pour amplifier leur message. Leur travail nous a montré que le féminisme ne peut être dissocié des questions de justice économique, de durabilité écologique et d'autodétermination ethnique. Il doit être holistique, intersectionnel et sans compromis. À cet égard, l'idéologie du confédéralisme démocratique est significative, tout comme les écrits du leader kurde Abdullah Öcalan.
En réfléchissant sur la lutte des femmes kurdes, nous ne devons pas non plus négliger sa dimension poétique. Leur révolution n'est pas seulement un acte politique, c'est aussi un acte profondément culturel. À travers leurs chants, leurs danses et leurs récits, les femmes kurdes ont préservé leur héritage et imprégné leur résistance d'un profond sentiment d'identité et d'objectif.
Écoutez leurs voix et vous entendrez les échos de Mala Jin, les maisons des femmes kurdes qui sont à la fois des espaces de refuge et de révolution. Vous entendrez les chants de défi des femmes de Kobanê et les discours passionnés des militantes de Souleimaniyeh. Vous ressentirez les rythmes d'un peuple qui, même face à des souffrances inimaginables, refuse de renoncer à son espoir.
En conclusion, posons-nous la question suivante : qu'est-ce que la lutte des femmes kurdes exige de nous ? Au minimum, elle exige que nous en témoignions. Elle exige que nous racontions leurs histoires, que nous amplifiions leurs voix dans un monde qui les réduit trop souvent au silence. Mais plus encore, elle nous appelle à l'action. Elle nous met au défi de démanteler les systèmes d'oppression dans nos propres communautés, de lutter pour l'égalité des sexes non pas comme un idéal abstrait, mais comme une réalité vécue.
Les femmes kurdes nous ont montré ce qui est possible lorsque le courage rencontre la conviction, lorsque le féminisme n'est pas seulement une théorie mais une pratique, un mode de vie. Elles nous ont appris que la libération n'est pas une destination mais un voyage, un voyage qui nous oblige à marcher ensemble, main dans la main, vers un avenir où chaque femme, partout, pourra vivre libre. C'est la véritable essence du slogan kurde « Jin, Jiyan Azadi » (Femmes, vie, liberté), que l'on peut entendre scander partout dans le monde.
Shilan Fuad Hussain
Shilan Fuad Hussain est chercheuse en études de genre et analyse culturelle. Elle a été auparavant boursière postdoctorale Marie Sklodowska-Curie (2022-2024, UKRI), chercheuse invitée au Washington Kurdish Institute (États-Unis) et boursière doctorale au Centre de politique de sécurité de Genève (Suisse). Elle est une universitaire interdisciplinaire et travaille sur une variété de sujets, parmi lesquels : la représentation, la production et les pratiques culturelles ; la violence sexiste ; les politiques étatiques favorisant l'égalité des femmes ; les MGF et les mariages arrangés/forcés ; les impacts sociaux de la masculinité ; et la multi-identité et la culture dans les diasporas. Ses travaux actuels se situent à l'intersection de la sociologie et de l'analyse culturelle, et de sa pertinence symbiotique pour la société moderne. De plus amples informations sont disponibles sur son site internet :
https://www.shilanfuadhussain.com/
Texte original (en anglais) à lire sur le site de Washington Kurdish Institute : Kurdish Women : Redefining Freedom through Resilience
https://kurdistan-au-feminin.fr/2025/02/11/femmes-kurdes-redefinir-la-liberte-grace-a-la-resilience/
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Rêver ensemble. Pour un patriotisme internationaliste

À l'occasion des journées de débat sur le thème « L'alliance des tours et des bourgs ? Chiche ! », dont Contretemps a publié certaines contributions (voir ici et ici), Houria Bouteldja a prononcé une intervention, dont nous publions la version écrite. Prolongeant les thèses défendues dans son dernier ouvrage, Beaufs et barbares. Le pari du nous, elle regrette l'absence de transcendance parmi les défenseurs de l'émancipation, et défend notamment un « patriotisme internationaliste », un « Frexit décolonial » et un « communisme à visage patriote ».
Si la rédaction de Contretemps est loin d'être unanime quant à cette perspective, il nous a semblé utile de publier ce texte qui questionne le rapport de la gauche et des classes populaires à la nation, sans abandonner une perspective antiraciste et décoloniale. Nul doute que le débat sur ces enjeux, qui font écho aux propos de Jean-Luc Mélenchon sur la « Nouvelle France », nécessite d'autres contributions qui pourront être accueillies sur le site de Contretemps.
***
11 février 2025 | tiré de contretemps.eu
https://www.contretemps.eu/rever-ensemble-patriotisme-internationaliste-houria-bouteldja/
Commençons par un constat froid.
Dans la période, le rêve est d'extrême droite. Seule l'extrême droite rêve. Seule l'extrême droite désire. Seule l'extrême droite a une libido.
La meilleure des gauches au mieux est matérialiste. Ce qui n'est pas un défaut en soi car dans ce monde dystopique où la vérité historique et le réel ont été abolis, l'analyse matérialiste est une condition essentielle de l'action politique. Mais cette gauche, aussi honnête soit-elle, peine à produire du rêve notamment à cause des défauts de ses qualités : elle n'est que matérialiste. Elle ne touche aucune corde sensible. Comme le faisait déjà remarquer le psychanalyste communiste Wilhelm Reich dans l'entre-deux guerres, « le mouvement socialiste ne défend pas l'affirmation de la vie en ce qui concerne les masses laborieuses mais seulement quelques revendications économiques essentielles ». Mais mieux que Reich, Otto Strasser (de la « gauche » du parti nazi) disait en s'adressant aux communistes : « Vous commettez l'erreur fondamentale de nier l'âme et l'esprit, de vous en moquer et de ne pas comprendre que ce sont eux qui animent toute chose ».
Avec cette gauche, on peut au mieux rêver de préserver ses acquis, sa retraite, le service public ou son pouvoir d'achat. Certes, il existe une autre gauche, minoritaire mais plus romantique. Celle qui est internationaliste et communiste. Sauf que son rêve n'est partagé que par une poignée d'idéalistes, tellement elle est utopiquement déconnectée, tellement le communisme a historiquement déçu, tellement il a été dévoyé d'un côté, diabolisé et ringardisé de l'autre, tellement il échoue à répondre aux besoins immédiats tant matériels que moraux des classes populaires. En d'autres termes, si cette gauche rêve, elle rêve seule. Or le thème de cette table ronde, c'est « rêver ensemble », et j'ajouterais rêver en masse. Par conséquent la question est la suivante : comment concurrencer les rêves l'extrême droite et comment rêver plus passionnément à gauche ?
J'ai eu l'occasion dans des débat récents d'être confrontée à cette question. Une première fois avec Bernard Friot, une seconde avec Frédéric Lordon. Tous deux m'ont dit, et à juste titre, que la proposition de Frexit décolonial que je propose dans Beaufs et Barbares, même si elle est nécessaire, n'est pas « kiffante ». Je le concède tout à fait. C'est pourquoi, ils, Friot et Lordon, persistent à rêver communistes. Mais en vérité, ni ce projet ni les moyens de le réaliser ne sont plus « kiffants » que le Frexit. On ne mobilise pas en effet les masses avec l'idée de salaire à vie. Et, je le crains, pas plus avec la proposition communiste de Lordon sur laquelle je vais revenir et qui se fonde sur un postulat avec lequel je suis en parfait accord et que je résume ici : il y a au coeur des classes populaires blanches des enjeux d'identification rattachés à des enjeux de survie. Le racisme, le nationalisme et le masculinisme sont toutes des solutions identificatoires de ce type quand toutes les autres ont été détruites. Il ajoute et là aussi je suis en total accord, qu'il faut inventer des solutions identificatoires de substitution si on veut aller vers un dénouement révolutionnaire, et à ce titre, ces solutions doivent être de qualité et procurer le même niveau, sinon un niveau supérieur, de satisfactions morales et psychiques que le nationalisme, le racisme et le masculinisme. Sa proposition peut se résumer comme suit : faire un détour par 1917 où selon lui trois ressources passionnelles ont été utilisées pour nourrir le souffle révolutionnaire : 1/ la colère et la haine, 2/ l'expérimentation des puissances collectives soviétiques et 3/ l'horizon positif du mot d'ordre (la terre, la paix, le pain). Je propose de les passer en revue.
1/ La colère et la haine sont effectivement des affects puissants et il faudrait selon lui les détourner de leur cible première, les noirs est les arabes, pour les orienter vers les riches. C'est évidemment dans cette direction qu'il faut aller mais là où le bât blesse c'est qu'on ne voit pas trop par quel miracle cette pulsion passionnelle, l'hostilité envers les arabes et les noirs, se retournerait spontanément contre les riches étant donné son ancrage dans la culture populaire dont je voudrais rappeler ici qu'elle tient à des conditions matérielles liées au contrat racial. Comment opérer ce détournement, c'est ce que Lordon ne nous dit pas car la conscience triangulaire des « petits blancs », qui détestent autant la France d'en haut que la France d'en dessous la France d'en bas, ne se téléguide pas, elle est trop consistante pour espérer la balayer à coup de sermons et de prêche sur l'ennemi principal que serait la bourgeoisie.
2/ Expérimenter les puissances collectives : à l'époque celle des soviets, aujourd'hui, celle des ronds-points. Pourquoi pas ? Mais cette expérimentation pour extraordinaire et créatrice qu'elle ait pu être, ne peut pas se généraliser ni se pérenniser dans le temps comme on a pu le constater. En d'autres termes comment expérimenter les puissances collectives quand le marché du travail est à ce point éclaté, morcelé, stratifié et où la classe ouvrière beaucoup plus hétérogène et concurrentielle qu'en 17 ne dispose plus de lieux comme l'usine où se mobiliser et où s'organiser ?
3/ L'horizon positif du mot d'ordre : la terre, la paix, le pain. Lordon ne dit pas qu'il faut revendiquer ces mots d'ordre précisément mais je considère pour ma part qu'ils restent valides. Sauf que pour revendiquer la terre encore faut-il une paysannerie puissante ou défendre celle qui reste, voire lui imaginer un avenir décent, mais elle a été sacrifiée par le néolibéralisme et continue de l'être. Pour revendiquer la paix encore faut-il se sentir concerné par la guerre. Sauf que pour l'instant, ce n'est pas nous qui mourrons en masse mais les peuples qui ne comptent pas et dont la destruction effroyable est banalisée. Reste le pain ? Il se trouve que ce ne sont pas forcément les plus pauvres qui votent extrême droite. Et ceux qui très pauvres auraient toutes les raisons de revendiquer le pain, sont plutôt la frange la plus résignée de la population, qu'elle soit blanche ou non blanche. Il faut donc d'autres mots d'ordre. Mais lesquels ? Telle est la question.
Ainsi, renouer avec la proposition identificatoire du premier communisme : le pour-soi de la condition ouvrière est aujourd'hui une impasse. Comment renouer avec cette identification quand les conditions sociales de la culture ouvrière ont été détruites et que la conscience ouvrière s'est progressivement dissoute dans l'individualisme, la culture libérale, l'abstention encore la dérive droitière et raciste… ?
Malgré tout, et il faut le reconnaitre, toutes ces propositions sont justes et dignes de participer de l'élaboration d'une politique révolutionnaire mais elles ont un énorme défaut. Ce qui me frappe dans cette solution, c'est qu'elles ne salissent pas. On sort de ces propositions aussi propres qu'on y est rentrés. A aucun moment on est mis en danger alors même que Lordon affirmait je cite « qu'il n'était pas de proposition politique qui aspire à quelque succès, qui ne soit doublée d'une proposition passionnelle identificatoire forte qui s'attaque aux pulsions négatives ». Il ajoutait : « quand on soulève le capot et qu'on regarde dans la psyché des gens, on ne voit que du dégueulasse. La gauche qui refuserait de regarder ça se condamnerait. » Je ferme les guillemets.
Il a mille fois raison. Sauf que comprendre le sale, ce n'est pas encore affronter le sale et encore moins se salir. Or, le sale, dans cette proposition, est contourné. La proposition reste d'une grande pureté. Les petits blancs sont racistes ? Qu'à cela ne tienne, offrons-leur la tête des bourgeois ! Ils sont masculinistes ? Détournons leur colère contre les patrons ! Ils sont nationalistes ? Offrons-leur les joies du communisme ! Je ne veux surtout pas faire ici de mauvais procès à Lordon avec lequel j'ai beaucoup de convergences de vue car il a été l'un des premiers et des rares à prôner le retrait de l'Union européenne et a subi pour cela des attaques en souverainisme. Je ne parle bien que de cette proposition telle qu'elle a été formulée.
Je pense pour ma part, qu'on ne peut pas prétendre avoir compris la matérialité du besoin de racisme, de masculinisme ou de nationalisme sans au minimum aller tremper un orteil dans le marais de ces passions tristes, comme on ne peut pas prétendre devenir sujet d'histoire avec les classes populaires telles qu'elles sont sans partager avec elles une part du laid et sans s'enlaidir un peu soi-même. La proposition intègre et vertueuse hélas n'existe pas. Ceux qui l'espère dans un projet d'union des beaufs et des barbares sont défaits par avance. Tout projet de transformation impliquant les masses populaires des pays du centre capitaliste très fortement impliquées dans l'exploitation et le saccage du monde et ayant un fort intérêt à défendre ce train de vie est nécessairement une entreprise compromettante, dangereuse et risquée. Les forces politiques à prétention révolutionnaire seront toujours sur une ligne de crête. Car me semble-t-il, nous devons payer le prix d'être la fraction privilégiée et corrompue du prolétariat international. C'est la nature même de ce prolétariat et la tentation de la sauvegarde de ses intérêts de race garantie par l'État-nation, dans toute son ambivalence, qui rend la tâche ardue et qui fera de nous des funambules.
Alors que faire ?
Si le communisme en 1917, l'islam politique dans le monde arabe ou la théologie de la libération en Amérique latine, pour ne prendre que ces trois exemples, ont mobilisé les corps et les esprits, c'est parce qu'ils ne se contentaient pas d'être à hauteur d'hommes. Ils étaient plus grands et d'une certaine manière obligeaient à lever la tête en direction d'une utopie, ou en direction de Dieu. Si j'évoque ces exemples, c'est pour d'abord souligner une absence, une vacance, un vide de transcendance. Car oui, il nous manque une transcendance. Cette transcendance ne peut plus être le communisme pour les raisons déjà évoquées, elle ne peut plus être le christianisme car Dieu a été chassé des cœurs et des esprits par un sécularisme forcené, cette transcendance ne peut pas être l'islam (et croyez bien que je le regrette) car c'est à la fois une religion persécutée mais surtout une religion minoritaire ici en France. Or comme vous le savez, nous devons rêver ensemble. Nous devons donc nous projeter sur une transcendance collective et largement reconnue. Je m'empresse de dire que celle-ci doit être raisonnable, j'insiste sur raisonnable, car c'est l'humeur générale et le contexte qui fixent le niveau d'exaltation qui doit nous habiter, or le contexte est désenchanté. L'humeur c'est la désillusion, le sentiment d‘échec. Nous sommes tous et collectivement revenus de tout. On a tout essayé, tout expérimenté mais rien ne marche. Même pas la simple préservation des acquis. La Macronie nous dépossède tous les jours de notre puissance collective et nous nargue. C'est pourquoi, même l'idée de transcendance, il faut l'aborder de manière pondérée, c'est à dire adaptée aux conditions historiques, sociales et psychologiques du moment, soit celles des illusions perdues. Le rêve que j'imagine ne peut-être qu'un compromis entre les rêves trop grands des avant-gardes romantiques et les rêves trop petits en faveur de la retraite à 60 ans.
Pour résumer, cette transcendance doit être capable de mobiliser les affects installés et durs donc à fort potentiel identificatoire ; elle doit être saisissable immédiatement car le fascisme est à nos portes ce qui nécessite d'utiliser les affects communs à grande échelle et disponibles instantanément ; elle ne peut pas prendre la forme d'une utopie hors-sol, trop généreuse si j'ose dire, qui fantasmerait d'abord le bonheur de toute l'humanité, la fraternité humaine, sans répondre aux besoins matériels et moraux des classes populaires dont l'adhésion massive est l'une des conditions essentielles de la transformation sociale. C'est-à-dire, et au risque d'en froisser certains, en finir avec la forme éthérée de la « révolution permanente » qui est une forme abstraitement « cosmopolite » et universaliste. Enfin, elle doit compromettre notre vertu non pas parce que la souillure serait une fin en soi mais parce qu'elle est un passage obligé compte tenu de ce que j'ai dit plus haut. Nous, peuples du Nord, ne sommes pas innocents qu'on soit Blancs ou non Blancs. Nous faisons partie du problème.
Aussi, la seule transcendance que je connaisse et qui réunisse toutes ces qualités, tout le monde dans cette salle la connait intimement. Mais beaucoup la méprisent parce qu'à gauche, et dans le mouvement décolonial, pour des raisons souvent nobles, elle a été jetée avec l'eau du bain. C'est donc l'occasion pour nous, moi y compris, de faire notre auto-critique, et mener la bataille contre nous-mêmes.
Cette transcendance a un nom. Elle s'appelle France.
La France. Notre pays. Le pays dans lequel nous vivons, dans lequel nous élevons nos enfants, dans lequel nous nous projetons, auquel nous sommes plus ou moins attachés, que nous pouvons parfois aimer, parfois détester, qui nous fait et que nous faisons.
La France, qu'est-ce que c'est ? Je mets au défi quiconque dans cette salle de me donner une définition claire et précise de ce que c'est. On peut définir un État-nation, on peut définir la république, mais la France ? C'est déjà plus compliqué.
Parce que la France, c'est une idée. Une simple idée. Et d'une idée, on en fait ce qu'on veut. Notamment un devenir. Ce que je veux appeler ici le devenir France.
Dans son livre « Théorie du sujet », Alain Badiou commence avec cette phrase : « J'aime mon pays la France ». Plus tard, dans un débat contre Alain Finkielkraut avec qui il dit partager une forme de mélancolie dans son rapport à la France, il ajoute : « Il est difficile de trouver plus profondément français que moi ». Ce qui est intéressant dans cette déclaration, c'est d'abord qu'un communiste non repenti exprime son amour pour son pays, ensuite qu'il le fasse en compagnie d'un ennemi qui, lui, en sa qualité de prétendant à la blanchité (je rappelle que Finkielkraut est un juif et qu'à ce titre il est une victime historique du nationalisme européen), a sur-investi l'idée de France comme le font la plupart des non blancs au point d'être devenu au fil du temps l'une des figures majeures de la réaction. Nous avons donc ici deux figures : l'une fidèle au projet communiste et l'autre réactionnaire, toutes deux amoureuses de la France. Il n'y a là qu'une contradiction d'apparence, car comme je l'ai dit plus haut, la France c'est d'abord une idée. Mais c'est aussi une histoire. Et de France, il y en a au moins deux. Celle de la révolution et celle de la contre-révolution, celle des Communards et celle des Versaillais, celle de la résistance et celle des collabos[1], celle du mouvement ouvrier qui accouche des droits sociaux et politiques et celle de la bourgeoisie qui accouche de l'Union européenne.
Je postule ici que si la gauche est plutôt l'héritière de la première et la droite de la deuxième, le peuple blanc est lui une synthèse des deux France. Il est dans ses grands traits patriote pour de très bonnes et de très mauvaises raisons. Il sort le drapeau pour de bonnes et de mauvaises raisons. Il chante la marseillaise pour de bonnes et de mauvaises raisons. En d'autres termes, les deux France cohabitent en lui. C'est donc au creux de cette contradiction profonde que la bataille doit être menée. Notre objectif ultime étant que l'une des deux France l'emporte sur l'autre.
Comme je le disais, il faut apprendre à se salir les mains. C'est ici que ça commence. Le premier pas dans cette direction si on veut cheminer avec les petits blancs serait de se ré-approprier la France et plus exactement l'idée de patrie. C'est dans ce geste précisément qu'on va commencer non pas à rêver ensemble mais à être ensemble. J'insiste sur être. Car si les classes populaires sont attachées à la patrie, ce n'est pas seulement parce qu'elles sont mues par des sentiments primaires et chauvins mais aussi parce que la patrie sous sa forme nationale est un bien du peuple et qu'elle est comme le souligne Poulantzas un produit de la lutte des classes. Les affects blancs patriotes sont aussi liés à des intérêts de classe comme nous le montre le mouvement dialectique de la formation nationale. Le mot patrie est polysémique. Sous l'influence de la Révolution française (puis d'autres évènements fondateurs comme la Commune ou le programme de la Résistance à la Libération), la perception populaire de la patrie est d'abord rattachée à l'affirmation de principes politiques émancipateurs, universels, étrangers à toute idée de nationalité ou de nationalisme. Ici, la patrie est indissolublement liée à la souveraineté et donc à la nation.
Mais la notion bourgeoise de nationalité de l'État-nation va évidemment contrecarrer cette conception émancipatrice de la nation : le national se définit alors comme le ressortissant de l'État, tandis que l'étranger se définit comme non-national et non-citoyen, n'appartenant pas à la communauté politique constituée en État. La nationalité moderne ne définit donc pas réellement l'appartenance à une nation, mais le rattachement à un État. Comme le dit Lochak, « le lien de nationalité est devenu un lien unilatéral et non plus contractuel, dont l'État est à peu près seul maître ». C'est ainsi que sont progressivement liquidés et la volonté générale(à la source de la souveraineté et de la Nation) et le contrat social. Ainsi, le mot « patrie » qui oscille toujours entre fraternité universelle d'une part et exclusion et racisme d'autre part est tout sauf pur mais aussi tout sauf totalement condamnable.
Si sous sa part lumineuse, la Patrie-Nation est avant tout la souveraineté nationale et populaire, il devient évident que la corrosion des services publics et du principe d'égalité et de justice est immédiatement perçue comme une perte de souveraineté. C'est ce qui pousse les dépossédés, les véritables nationaux, le corps légitime de la nation, les petits blancs au chauvinisme et donc à la défense de la frontière raciale qui devient poreuse à mesure qu'ils dégringolent dans l'échelle sociale. Leur effroi est justement qu'ils refusent de devenir des indigènes. Leur salut c'est une version exclusiviste de la patrie.
C'est pourquoi, pour rétablir une version non exclusiviste de la patrie, il faut rétablir l'État social et le service public auxquelles les classes populaires blanches sont très attachées. Il faut prouver que la justice sociale (qui passe par déposséder le bloc bourgeois) est plus profitable que récupérer les miettes des noirs et des arabes, prouver que la lutte des classes est plus profitable que le racisme. Mais pour cela, il faut rétablir la souveraineté populaire. Le thème de la souveraineté nationale telle que la définit Gramsci est aujourd'hui, plus que jamais d'actualité. Mais cela implique une réforme intellectuelle et morale. Cela implique aussi de construire un rapport sentimental, affectif et idéologique avec les sacrifiés du néo-libéralisme et cela ne peut se faire que par la médiation du sentiment patriotique. C'est en tant que peuple nation que nous devons redevenir les protagonistes de l'histoire car c'est à l'échelle nationale, comme l'a dit hier Stathis Kouvelakis – l'échelle qui mobilise les affects les plus puissants – que doit s'organiser l'hégémonie et plus exactement une volonté politique collective et nationale, ce que recouvre le concept gramscien de « national-populaire ». C'est dans ce cadre que le Frexit prend toute sa dimension stratégique puisqu'il propose la reconquête de la patrie et donc du bien commun et donc de la souveraineté populaire. Et là où il y a reconquête de la souveraineté populaire, il y a rapport de force. Et là où il y a rapport de force favorable, il y a le pouvoir, il y a l'existence politique, il y a la dignité retrouvée. Ajoutons ici qu'il y a une opportunité historique qui se présente à nous et qu'il serait bête de ne pas saisir. L'extrême droite soit-disant patriote n'a la confiance des classes dirigeantes qu'à la condition de se soumettre à l'européisme et par conséquent de trahir la nation. Plus elle donnera des gages comme l'a déjà fait Meloni plus elle a des chances d'accéder au pouvoir. Or, les classes populaires blanches sont plutôt anti-européennes comme l'a montré le « non » au traité constitutionnel de 2005. C'est le moment où jamais de prouver qui est véritablement avec le peuple et qui ne l'est pas.
Mais moi qui vous parle aujourd'hui, et après avoir fait cette balade dans l'univers révolutionnaire français, je n'oublie pas un instant qui je suis ou plutôt ce que je suis : une indigène de la république. Un sujet colonial. L'objet de la discorde. La variable d'ajustement. Je n'oublie pas l'autre France. Je n'oublie pas que les « fachés pas fachos » sont organiquement liés à l'autre France. Je n'oublie pas un instant le mal qu'a semé l'autre France, dans le monde, je n'oublie pas le code noir, le code de l'indigénat, je n'oublie pas les massacres de masse, l'exploitation et la spoliation de masse, je n'oublie pas la Françafrique, la Kanaky, l'abandon de Mayotte, le soutien aux génocidaires israéliens. Bref, je n'oublie pas, comme le dit Césaire que la France est indéfendable. Je n'oublie pas le constat de Césaire :
« Le fait est que la civilisation dite » européenne », la civilisation « occidentale », telle que l'ont façonnée deux siècles de régime bourgeois, est incapable de résoudre les deux problèmes majeurs auxquels son existence a donné naissance : le problème du prolétariat et le problème colonial ; que, déférée à la barre de la « raison » comme à la barre de la « conscience », cette Europe-là est impuissante à se justifier ; et que, de plus en plus, elle se réfugie dans une hypocrisie d'autant plus odieuse qu'elle a de moins en moins de chance de tromper. »
Sauf qu'il se trouve que même les indigènes ont un besoin de patrie. D'ailleurs, la plupart du temps, ils aiment plus la France qu'elle ne les aime. Et ces manifestations d'amour, en fait, elles sont nombreuses. Et ils ne sont pas rares à brandir le drapeau bleu blanc rouge lors de victoires de coupes du monde, ou lors de manifestations contre le racisme où il leur sert d'alibi. Voyez à quel point nous sommes Français clament-ils. Car les indigènes sont privés de patrie. Ils ont perdu la leur et n'en ont retrouvée aucune. Et s'ils aspirent à cette adoption par la patrie France, c'est aussi pour des questions de survie, de protection, de sécurité. Avoir une patrie, c'est l'une des dimensions de la dignité humaine et en être privé est une blessure sinon comment expliquer le rapport névrotique au drapeau algérien ?
Les beaufs et les barbares, situés du même côté de la barrière de classe mais séparés par la division raciale, partagent donc le même rêve. Les uns revendiquent une patrie qui leur échappe (à cause de ce qu'ils appellent le mondialisme) ou qui les trahis (l'Union européenne), les autres revendiquent une patrie qui les exclut et les méprise. Mais à chacune de ces manifestations de désir patriotiques, les avant-gardes politiques, qu'elles soient d'extrême gauche ou décoloniales se bouchent le nez. La gauche parce qu'elle n'y voit que du chauvinisme, les décoloniaux parce qu'ils n'y voient que de l'intégrationisme. Je prétends pourtant ici que les avant-gardes qui se bouchent le nez dans les moments de liesses populaires comme les matchs de foot, ou devant les drapeaux de gilets jaunes, ou encore les manifestations comme celle contre l'islamophobie de 2019 dans lesquelles les indigènes ont brandi le drapeau bleu blanc rouge se transforment par ce geste en arrière-garde. Je sais que s'attribuer le qualificatif d'avant-garde est mal perçu dans certains milieux de gauche. J'assume malgré tout et sans fausse pudeur ce titre. Car je crois à l'importance et à la nécessité de directions politiques qui assument ce rôle d'impulser, de diriger, d'encadrer, d'organiser et de tracer des lignes stratégiques fondées sur une théorie, une pratique et une vision du monde. En revanche, je pense que si parfois nous sommes légitimes à prétendre guider les masses, en tant qu'avant-garde, nous rechignons à être guidés par elles. Pourtant nous devons apprendre à distinguer les moments où nous devons guider comme les moments où nous devons nous laisser guider. Se boucher le nez devant certaines manifestations de patriotisme ou devant l'intégrationisme spontané des indigènes c'est passer à côté de la finesse et de la subtilité des affects populaires. Ils savent très bien pourquoi ils ont besoin de ce drapeau, ils savent très bien ce qu'ils en attendent. Ils savent très bien que la France, c'est comme l'or, une valeur refuge. Et contrairement à nous, ils savent rêver à la mesure de leurs moyens. Et si la France incarne leur rêve, c'est que la France est à leur portée. Ni trop grande ni trop petite.
Et pourtant, malgré tout ce que je viens de dire, je ne fais confiance ni aux indigènes ni aux petits blancs. Parce que je sais que je ne peux pas me laisser entrainer par la pente nationaliste et intégrationniste. Parce qu'au fond je sais que j'ai raison de n'être ni nationaliste ni intégrationniste. Je sais qu'ils savent quelque chose, et je sais aussi que je sais quelque chose. Je sais que la solution « patriote » ne saurait se suffire à elle-même. L'indigène décoloniale que je suis se sentirait à l'étroit. Mais plus qu'à l'étroit, se sentirait incomplète, limitée dans son être. Mais pire encore, se sentirait traitre. Car il y a les autres du grand Sud. Non pas les autres comme simple altérité mais les autres comme prolongement de notre humanité. Or ces autres, nous les malmenons, nous les torturons. S'il est un impératif à devenir pragmatiques, donc patriotes, cet impératif ne peut pas constituer une fin en soi. La défense de la patrie-nation ne sera acceptable que fraternisant avec les peuples écrasés. Aussi, ce patriotisme sera internationaliste ou ne sera pas. C'est la seule manière d'échapper à l'emprise de l'État bourgeois, que je veux appeler ici État racial intégral. La communion populaire et la communion avec les peuples opprimés par les appétits impérialistes passeront nécessairement par la rupture de la collaboration de race donc par la rupture du lien organique qui lie les classes populaires blanches à l'État bourgeois et qui lie les indigènes à ce même État bourgeois par le mirage intégrationniste. Aussi la tâche des avant-gardes politiques qui auront pris le chemin de la défense de la patrie et qui auront repris langue avec les classes populaires, qui apprendront à parler la langue des petits, ne doit en aucun cas céder à la démagogie. Car les affects des petits sont aussi dangereux qu'ils sont émancipateurs. Il faut les manipuler avec une grande prudence. Notre boussole internationaliste doit donc rester intacte. Aussi de la même manière que dans le mouvement décolonial nous disons « pas de lutte de classe sans anti-impérialisme », « pas de féminisme sans anti-impérialisme », « pas de 6eme république sans anti-impérialisme », nous disons bien évidemment pas de patriotisme sans anti-impérialisme. Et pour ceux qui douteraient de la possible résolution de cet antagonisme apparent, je renvoie à cet épisode de la Révolution française où est venue à l'ordre du jour la question de l'abolition de l'esclavage. Les colons défendaient l'idée que l'intérêt national dépendait de la production coloniale, elle-même dépendante du travail forcé et gratuit. La fameuse réplique de Robespierre : « périssent les colonies plutôt qu'un principe » est l'expression d'une rationalité. Si la révolution édicte des principes, elle doit en assumer les conséquences. Il est impossible de réduire un homme en esclavage sans être un criminel. Il faut donc en assumer les conséquences, et si les conséquences, c'est la ruine des colonies, alors c'est la ruine des colonies et c'est tout. C'est pourquoi, le vote de l'abolition de l'esclavage s'est fait sans débat, ce qui était contraire aux mœurs démocratiques. Mais c'est, comme le rappelle Badiou, que les révolutionnaires ont considéré que soumettre la question du vote au débat c'était déjà en entamer la valeur. Or on ne débat pas de savoir si un humain doit être esclave ou non. On vote contre et c'est tout. C'est ainsi que l'abolition de l'esclavage a été entérinée sans débat, car en débattre était déshonorant. Ce geste fondateur, d'une esthétique et d'une beauté sublime, doit redevenir le geste des avant-gardes politiques et doit s'étendre à la conscience collective. Ce n'est pas tout à fait un hasard, si contrairement à de nombreux pays européens, nous avons encore une gauche de rupture forte. Si nous ne sommes pas complètement défaits, c'est qu'il y a des héritages historiques forts qui innervent le mouvement social au-delà de la France insoumise. Face à la transcendance, il y a l'immanence de la volonté populaire historique. Mais attention, la tâche des avant-gardes ne s'arrête pas là, elle doit aussi proposer une vision de la totalité, une explicitation du monde. Une vision qui expliciterait les mystères de notre impuissance collective dont les classes populaires ont soif et qui les poussent dans les bras du confusionnisme et du conspirationnisme. C'est pourquoi à un phénomène total, il faut opposer une vision matérialiste de la totalité.
Pour conclure, je voudrais attirer votre attention sur les soubassements de cette proposition de « patriotisme internationaliste ». Je disais plus haut que le communisme ne faisait pas rêver. Certes. Mais je n'ai jamais dit qu'il fallait y renoncer. Je vais même faire un aveu. Je pense que le communisme est la seule et unique planche de salut pour l'humanité. Quel que soit son habillage. D'abord parce qu'il est la seule alternative rationnelle à l'ensauvagement capitaliste mais aussi parce que nous n'avons aucun autre choix devant l'impératif écologique et climatique. L'option communiste est la seule option vitale. Je le dis sans la moindre ambiguïté. C'est pourquoi, il faut rendre grâce à ceux comme Friot et Lordon qui poursuivent ce rêve, c'est pourquoi je ne l'ai jamais écarté. Si vous dépliez la proposition de patriotisme internationaliste, vous constaterez que le retour à l'échelle nationale (Frexit décolonial), la reconquête de la souveraineté nationale-populaire, le combat pour l'hégémonisation d'un bloc social accompagné d'un véritable programme de rupture avec le néo-libéralisme additionné d'un internationalisme sous sa forme anti-impérialisme – je rappelle que selon Lénine l'impérialisme et le stade suprême du capitalisme et qu'à ce titre être anti-impérialiste c'est être automatiquement anticapitaliste – constituent une proposition résolument et implacablement communiste. La différence entre un communisme qui se présente devant un peuple réfractaire à visage découvert et un communisme à visage patriote c'est que le premier rate sa cible et que le deuxième a quelques chances de l'atteindre. Mais ce communisme devra être le communisme de son temps. Il devra être décolonial. Pas seulement anti-impérialiste. Il pourra être chrétien, il pourra être islamique, il pourra être kurde, palestinien, chinois, il pourra même être régionaliste. Car pour devenir une véritable transcendance, Il doit accueillir en son sein la diversité humaine, la diversité des situations, la diversité culturelle mais aussi tous les besoins de l'âme.
Comme vous pouvez le voir, ce rêve que je promettais modeste et raisonnable est tout sauf raisonnable et modeste. Il est même un peu fou. Mais comme vous le savez, heureux soient les fêlés, ils laissent passer la lumière.
Note
[1] La Résistance n'était pas qu'affaire de lutte armée contre l'occupant, mais également de réfléchir à quelle France construire à la Libération (d'où le fait que De Gaulle a méprisé la résistance intérieure de la France – dans laquelle les communistes ont joué un rôle important). Grégoire Madjarian écrit notamment : « ce qui se joue directement en France, ce n'est pas seulement la libération du territoire, mais aussi l'existence d'un régime, la nature du pouvoir politique et la direction de ce pouvoir. L'insurrection de l'été 1944 n'a pas simplement un caractère national : elle provoque l'effondrement de « l'État français » et elle est l'instrument d'une prise de pouvoir. ». D'où le fait que les Américains étaient très méfiants vis-à-vis de la Résistance intérieure. Bref : plusieurs conceptions de la France s'affrontent. En visite à Marseille à la Libération, où des maquisards défilaient la chemise ouverte, en tirant un véhicule allemand sur lequel se trouvait des filles en robes (il faisait chaud) qui criaient en agitant des drapeaux, De Gaulle aurait grommelé (selon Lucie Aubrac) « Quelle mascarade ». A Toulouse, la situation a failli dégénérer après que De Gaulle a ouvertement méprisé des maquisards. D'ailleurs, il est intéressant que l'une des premières demandes faites par De Gaulle aux alliés ait été la livraison d'uniformes militaires afin de distinguer les « réguliers » des irréguliers et faire disparaitre des forces armées auxquels ils étaient hostiles.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
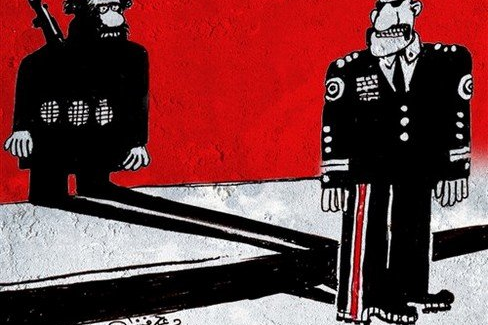
Le duo Trump-Musk : Un fascisme « nouveau genre » ?

Les spécialistes de l'histoire du nazisme nous préviennent : la situation politique actuelle, à l'échelle internationale, s'apparente, sous maints aspects, à celle qui a précédé l'arrivée au pouvoir du « Parti National-Socialiste des travailleurs » d'Adolphe Hitler dans les années 1930 en Allemagne.
Au delà du salut « hitlérien » d'Elon Musk lors de l'investiture du Président le 20 janvier dernier, qui envoie déjà un signal clair quant à l'idéologie qui sous-tend les intentions du bras droit de Donald Trump, les réactions, les comportements, les attitudes, les décisions de l'élite financière et économique mondiale depuis la victoire du Républicain en novembre 2024, et surtout depuis ses déclarations de guerre commerciale à l'échelle planétaire, sont caractéristiques d'une classe sociale qui sait plus que jamais où se situe son « intérêt ».
Le fascisme ne peut s'installer, s'imposer, prospérer et dominer une société (à l'échelle nationale, régionale ou mondiale) sans l'appui indéfectible des puissances d'argent qui, comme on le sait, ne portent pas de jugement « moral » sur la nature du pouvoir en place tant et aussi longtemps que celui-ci ne nuit pas à la bonne marche des « affaires », qui plus est lorsqu'il se porte garant d'un accroissement de richesses à venir, que ce soit par l'instauration d'une fiscalité « compétitive », d'une priorité donnée aux entreprises nationales, l'accès à une main d'œuvre docile et bon marché (ou qualifiée et loyale, si besoin est), des faibles coûts de production, des prix fixes concomitant à une situation de monopole ou d'oligopole.
L'arrivée d'Adolphe Hitler au Reichstag en 1933 a été une bénédiction pour les capitalistes allemands (exception faite, évidemment, des détenteurs de capitaux d'origine juive) ; les Nazis ont relancé l'économie du pays durement touchée par le Traité de Versailles et le krach boursier de 1929 à Wall Street, interdit les syndicats, emprisonné les communistes (ainsi que les sociaux-démocrates trop critiques envers le capitalisme) et pratiqué un interventionnisme d'État à l'image du New Deal de Roosevelt aux États-Unis, quoique avec des objectifs quelque peu différent ! Avec, en prime, une fois la guerre enclenchée, le recours à une main d'œuvre plus que servile, remplaçable à souhait, reconnaissante de pouvoir offrir gratuitement sa force de travail (du moins, temporairement) plutôt que d'être gazée et finir dans les crématoires des camps de la mort.
Jusqu'au déclenchement de la guerre, Hitler et sa « horde de criminels » faisaient l'admiration d'une bonne partie du gratin du monde occidental (politiciens, aristocrates, hommes d'affaires, intellectuels d'extrême-droite ―― même Staline était impressionné par la capacité du Führer à éliminer aussi efficacement ses opposants) : le Troisième Reich était loué pour sa discipline et son ardeur au travail (« on ne fait pas “grève” en Allemagne ! »), sa capacité à reprendre sa place dans le « Concert des Nations », sa fermeté (voire sa « cruauté ») envers les forces de gauche, menace à la précieuse liberté du monde civilisé, bref, il représentait un rempart contre la montée du communisme, système politique barbare qui ne respecte rien. On a même cru, jusqu'à la dernière minute (Accords de Munich), que le chef d'État allemand était un homme de « paix ». On connaît la suite…
Bien sûr, la situation actuelle est, à bien des égards, différente de celle des années 1930. Nous ne subissons pas les contre-coups d'une crise économique à l'échelle mondiale, propice à l'émergence de solutions radicales portées par des idéologies meurtrières et défendues par des psychopathes œuvrant en groupes organisés, nos institutions légales, juridiques, politiques sont plus fortes, mieux constituées, mieux articulées pour réagir à des phénomènes extrêmes comme celui du nazisme, nous sommes plus éduqués, mieux conscientisés des dangers que représente la prise du pouvoir par l'extrême-droite populiste et nous avons pu constater, à notre corps défendant, jusqu'où peut aller une psychose collective lorsqu'elle s'alimente de ses propres phobies, ne sachant plus distinguer le vrai du faux, le Moral de l'Immoral, l'Humain de l'Inhumain.
Il n'empêche que nous vivons, collectivement, une autre sorte de crise qui génère une forme différenciée de fascisme, adapté à notre époque technologique. Le spectacle un tantinet « surréaliste » offert par la cérémonie d'investiture du Président américain constitue un instantané de la structure politico-économique qui va dominer le Monde à partir du 20 janvier 2025. Que les géants de la « Tech » se soient agglutinés autour du Matador en cette soirée officielle ne relève pas du hasard, pas plus que le geste « symbolique » d'Elon Musk, révélateur des accointances qui vont « naturellement » se nouer dans un avenir rapproché.
En cela, le processus est semblable à celui qui a abouti à la deuxième guerre mondiale, à savoir, le mariage de Raison entre, d'une part, un pouvoir politique xénophobe, liberticide, paranoïaque et, d'autre part, le pouvoir économique le plus à même de soutenir le projet démesuré du « mâle dominant » qui cherche à impressionner par des déclarations à l'emporte-pièce, des provocations récurrentes, une stratégie du chaos assumée. Nous assistons au même scénario que celui élaboré par les Nazis concernant l'Allemagne de l'époque et qui a servi de justificatif pour adopter des politiques extrêmes qui font fi des principes fondamentaux d'une démocratie libérale et du plus élémentaire droit international : les États-Unis sont exploités par le monde entier, victimes de leur généreuse richesse, ils font plus que leur part pour protéger militairement leurs alliés (contre quels ennemis, ça reste à déterminer), leur énorme déficit commercial et leur dette abyssale sont le résultat de pratiques commerciales malveillantes et déloyales de la part des Chinois, des Européens, des Canadiens, des Mexicains et tutti quanti.
Bref, l'Amérique n'a rien à se reprocher, elle n'est pas responsable des délocalisations massives des entreprises américaines vers la Chine, l'Asie, le Mexique, l'Europe de l'Est depuis plus de trente ans et qui sont à l'origine du désert industriel qui recouvre des régions entières des États-Unis, autrefois prospères, gage de leur pouvoir économique et financier, assurant leur main-mise sur les affaires du Monde ; elle n'a rien à voir non plus avec la pauvreté endémique des pays du Sud global dont les ressortissants n'ont d'autres choix que d'émigrer vers le Nord pour améliorer leurs conditions de vie, quitte à travailler illégalement à bas salaire, sans protection sociale, sans assurance-santé, risquant à tout moment d'être expulsés vers le pays qu'ils cherchent à fuir.
Ce complexe de persécution est source de violence dirigée contre tout ce qui n'est pas américain et exacerbe les tensions géo-politiques déjà manifestes dans le monde occidental. Les Allemands ont carburé à cette victimisation à tous crins, les Juifs de Palestine en font de même et, dans tous les cas, cette impression généralisée d'être injustement traités par le reste de l'humanité donne lieu à des comportements belliqueux qui abaissent dangereusement le niveau de tolérance envers les embûches rencontrées en chemin, les contradicteurs, la diversité des points de vue, les visions du monde différentes de celle du leader charismatique. Il faut prendre acte de ce fait et agir en conséquence.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« L’IA telle qu’elle est développée alimente un système d’exploitation global »

Un collectif, parmi lesquelles Amnesty International et la Ligue des droits de l'homme, recommande, dans une tribune au « Monde », de placer les droits humains et la justice environnementale au cœur de la régulation de l'intelligence artificielle.
10 février 2025 | tiré du site entre les lignes entre les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/02/10/lappel-dune-centaine-dong-lia-telle-quelle-est-developpee-alimente-un-systeme-dexploitation-global-manifeste/
L'intelligence artificielle (IA) connaît un développement foudroyant, et nos dirigeants ne semblent pas pressés de réfléchir aux enjeux humains, sociaux et environnementaux de ces nouvelles technologies, uniquement vues sous le prisme de la croissance, des gains de productivité et des profits. L'IA telle qu'elle est développée perpétue cependant les discriminations, aggrave les inégalités, détruit la planète et alimente un système d'exploitation global. Parce que ces constats ne figureront pas au programme officiel du Sommet mondial sur l'IA [qui se tient à Paris les 10 et 11 février], nous, organisations de la société civile, vous les rappelons ici.
Se concentrer uniquement sur d'éventuels futurs risques existentiels à venir de l'IA est un leurre : ces technologies ont déjà des effets très concrets pour les populations les plus vulnérables et les plus discriminées et portent largement atteinte aux droits humains. En s'appuyant sur des bases de données biaisées et en intégrant les préjugés de ses concepteurs, l'IA perpétue les stéréotypes, renforce les inégalités sociales et limite l'accès aux ressources et opportunités. A cela s'ajoute le fait que le déploiement de ces systèmes d'IA s'inscrit dans le contexte des structures discriminatoires et inégalitaires qui existent dans les sociétés du monde entier. Le recours à ces technologies, souvent sur fond de politiques d'austérité, amplifie les discriminations dans l'accès à la santé, à l'emploi, aux services publics ou aux prestations sociales. En témoignent les scandales ayant éclaté ces dernières années : biais sexistes et racistes des algorithmes de santé, algorithme des services de l'emploi autrichien qui refuse d'orienter les femmes vers le secteur informatique, profilage et discrimination des usagers de la Caisse nationale des allocations familiales en France, au Danemark ou aux Pays-Bas.
Or les technologies sont rarement la solution à des problèmes en réalité systémiques. Il est préférable de s'attaquer à la racine de ces problèmes plutôt que de prendre le risque d'aggraver les violations des droits humains avec des systèmes d'IA. Tandis que l'on confie de plus en plus de décisions aux algorithmes, leurs biais peuvent avoir des conséquences dramatiques sur nos vies. Les IA prédictives se substituent à la justice et à la police, risquant d'amplifier le racisme systémique. Par exemple, aux Etats-Unis, une IA calculant les risques de récidive désignait deux fois plus les accusés noirs comme étant « à haut risque » que les accusés blancs. Et quand bien même on réduirait ces biais, se concentrer sur les outils prédictifs nous empêche de penser à des réformes plus globales du système carcéral.
Menaces pour l'Etat de droit
Ces systèmes sont aussi utilisés à des fins de surveillance et d'identification dans le cadre du contrôle des frontières ou de conflits, comme Lavender, cette IA qui, en désignant des cibles terroristes, a provoqué la mort de milliers de civils gazaouis. Et bien souvent, ces technologies sont développées par les pays occidentaux, comme les outils créés par des pays européens utilisés pour surveiller la population ouïghoure en Chine.
Les systèmes d'IA générative sont également instrumentalisés à des fins de désinformation et de déstabilisation par des régimes répressifs et des acteurs privés. « Bots » utilisés pour manipuler l'information sur des questions liées à la santé, désinformation à caractère raciste durant les dernières élections européennes, deepfakes audios et vidéo mettant en scène des candidats aux élections : ces technologies sont autant de menaces pour l'Etat de droit. Les montages crédibles générés par IA sont aussi un danger pour les femmes et les enfants : 96% de ces deepfakes sont des contenus non consentis à caractère sexuel [selon le rapport 2019 du cabinet de conseil en gestion de risques DeepTrace], massivement utilisés dans le but de nuire aux femmes et de générer des contenus pédocriminels.
Par ailleurs, ces effets s'inscrivent dans un système d'exploitation global. L'IA, et notamment l'IA générative, constitue un véritable désastre pour l'environnement. D'ici à 2027, l'IA générative nécessitera une alimentation en électricité équivalente à celle de pays comme l'Argentine ou les Pays-Bas [comme le rapporte un article du New York Times d'octobre 2023]. Les émissions de CO2 des « géants de la tech » ont augmenté de 30 à 50% en 2024 en raison du développement fulgurant de ces technologies. Et ce sont les pays du Sud global qui sont les premiers touchés : les data centers y pullulent, et l'extraction de minerais, comme le cobalt, utilisé entre autres dans les batteries, met en péril la santé des populations, entraîne la pollution des eaux et des terres et alimente violences et conflits armés.
L'affaire de toutes et tous
Les inégalités entre les pays du Nord et du Sud sont également aggravées par les technologies déployées pour la modération de contenus en ligne. Les géants du numérique qui allouent plus de moyens aux pays du Nord privilégient ainsi certaines langues et récits culturels, déjà dominants, au détriment des autres. Enfin, n'oublions pas que ces systèmes d'IA sont majoritairement entraînés par des travailleurs et travailleuses du Sud global, exploités et sous-payés. Selon les informations du magazine Time, la société OpenAI a ainsi rémunéré des Kényans moins de deux dollars (1,95 euro) de l'heure pour labelliser des contenus toxiques, un travail particulièrement violent et éprouvant.
Face à ces constats alarmants, le règlement européen sur l'IA, présenté comme un instrument de protection des droits et libertés, reste très imparfait, notamment sur les questions de surveillance et de police prédictive. Par ailleurs ce règlement ne s'appliquera pas hors des frontières de l'Union européenne, alors même que la menace pour les droits humains et l'environnement est globale et que l'exportation des IA de surveillance génère du profit pour les entreprises européennes.
Nos gouvernements ne cessent de parler de souveraineté de l'IA, mais les défis posés par ces systèmes transcendent les frontières. Loin d'être un sujet technologique, l'IA est l'affaire de toutes et tous. Tout le monde doit pouvoir choisir la direction de ses développements, quitte à les refuser s'ils ne correspondent pas à notre projet de société. Un cadre contraignant élaboré démocratiquement, dans une perspective de solidarité internationale et avec les communautés les plus touchées, qui place les droits humains et la justice environnementale au cœur de la régulation de l'IA, voilà le véritable progrès.
Premiers signataires : Erika Campelo, déléguée nationale de VoxPublic ; Laure Salmona, directrice et cofondatrice du collectif Féministes contre le cyberharcèlement ; Anne Savinel-Barras, présidente d'Amnesty International France ; Nathalie Tehio, présidente de la LDH (Ligue des droits de l'Homme).
Consulter la liste de l'ensemble des signataires
*******
Manifeste : L'IA contre les droits humains, sociaux et environnementaux
Ce texte est le manifeste fondateur de « Hiatus », une coalition composée d'une diversité d'organisations de la société civile française qui entendent résister au déploiement massif et généralisé de l'intelligence artificielle.
Il a été publié dans le journal Le Monde le 6 février 2025.
*-*
Tout concourt à ériger le déploiement massif de l'intelligence artificielle en priorité politique. Prolongeant les discours qui ont accompagné l'informatisation depuis plus d'un demi-siècle, les promesses abondent pour conférer à l'IA des vertus révolutionnaires et imposer l'idée que, moyennant la prise en compte de certains risques, elle serait nécessairement vecteur de progrès. C'est donc l'ensemble de la société qui est sommée de s'adapter pour se mettre à la page de ce nouveau mot d'ordre industriel et technocratique. Partout dans les services publics, l'IA est ainsi amenée à proliférer au prix d'une dépendance technologique accrue. Partout dans les entreprises, les managers appellent à recourir à l'IA pour « optimiser » le travail. Partout dans les foyers, au nom de la commodité et d'une course insensée à la productivité, nous sommes poussés à l'adopter.
Pourtant, sans préjuger de certaines applications spécifiques et de la possibilité qu'elles puissent effectivement répondre à l'intérêt général, comment ignorer que ces innovations ont été rendues possible par une formidable accumulation de données, de capitaux et de ressources sous l'égide des multinationales de la tech et du complexe militaro-industriel ? Que pour être menées à bien, elles requièrent notamment de multiplier la puissance des puces graphiques et des centres de données, avec une intensification de l'extraction de matières premières, de l'usage des ressources en eau et en énergie ?
Comment ne pas voir qu'en tant que paradigme industriel, l'IA a dores et déjà des conséquences désastreuses ? Qu'en pratique, elle se traduit par l'intensification de l'exploitation des travailleurs et travailleuses qui participent au développement et à la maintenance de ses infrastructures, notamment dans les pays du Sud global où elle prolonge des dynamiques néo-coloniales ? Qu'en aval, elle est le plus souvent imposée sans réelle prise en compte de ses impacts délétères sur les droits humains et l'exacerbation des discriminations telles que celles fondées sur le genre, la classe ou la race ? Que de l'agriculture aux métiers artistiques en passant par bien d'autres secteurs professionnels, elle amplifie le processus de déqualification et de dépossession vis-à-vis de l'outil de travail, tout en renforçant le contrôle managérial ? Que dans l'action publique, elle agit en symbiose avec les politiques d'austérité qui sapent la justice socio-économique ? Que la délégation croissante de fonctions sociales cruciales à des systèmes d'IA, par exemple dans le domaine de la santé ou l'éducation, risque d'avoir des conséquences anthropologiques, sanitaires et sociales majeures sur lesquelles nous n'avons aujourd'hui aucun recul ?
Or, au lieu d'affronter ces problèmes, les politiques publiques menées aujourd'hui en France et en Europe semblent essentiellement conçues pour conforter la fuite en avant de l'intelligence artificielle. C'est notamment le cas de l'AI Act adopté par l'Union européenne et présenté comme une réglementation efficace alors qu'elle cherche en réalité à promouvoir un marché en plein essor. Pour justifier cet aveuglement et faire taire les critiques, c'est l'argument de la compétition géopolitique qui est le plus souvent mobilisé. À longueur de rapports, l'IA apparaît ainsi comme le marchepied d'un nouveau cycle d'expansion capitaliste, et l'on propose d'inonder le secteur d'argent public pour permettre à l'Europe de se maintenir dans la course face aux États-Unis et à la Chine.
Ces politiques sont absurdes, puisque tout laisse à penser que le retard de l'Europe dans ce domaine ne pourra pas être rattrapé, et que cette course est donc perdue d'avance. Surtout, elles sont dangereuses dans la mesure où, loin de constituer la technologie salvatrice souvent mise en avant, l'IA accélère au contraire le désastre écologique, renforce les injustices et aggrave la concentration des pouvoirs. Elle est de plus en plus ouvertement mise au service de projets autoritaires et impérialistes. Non seulement le paradigme actuel nous enferme dans une course technologique insoutenable, mais il nous empêche aussi d'inventer des politiques émancipatrices en phase avec les enjeux écologiques.
La prolifération de l'IA a beau être présentée comme inéluctable, nous ne voulons pas nous résigner. Contre la stratégie du fait accompli, contre les multiples impensés qui imposent et légitiment son déploiement, nous exigeons une maîtrise démocratique de cette technologie et une limitation drastique de ses usages, afin de faire primer les droits humains, sociaux et environnementaux.
Premiers signataires :
Annick Hordille, membre du Nuage était sous nos pieds
Baptiste Hicse, membre de Stop Micro
Camille Dupuis-Morizeau, membre du conseil d'administration de Framasoft
David Maenda Kithoko, président de Génération Lumière
Denis Nicolier, co-animateur de Halte au contrôle numérique
Emmanuel Charles, co-président de ritimo
Éléonore Delatouche, fondatrice de Intérêt à agir
Judith Allenbach, présidente du Syndicat de la Magistrature
Judith Krivine, présidente du Syndicat des avocats de France (SAF)
Julie Le Mazier, co-secrétaire nationale de l'Union syndicale Solidaires
Julien Lefèvre, membre de Scientifiques en rébellion
Marc Chénais, directeur de L'Atelier Paysan
Nathalie Tehio, présidente de la LDH (Ligue des droits de l'Homme)
Olivier Petitjean, co-fondateur de L'Observatoire des multinationales
Raquel Radaut, porte-parole de La Quadrature du Net
Sandra Cossart, directrice de Sherpa
Soizic Pénicaud, membre de Féministes contre le cyberharcèlement
Sophie Venetitay, secrétaire générale du SNES-FSU
Stéphen Kerckhove, directeur général d'Agir pour l'environnement
Thomas Thibault, président du Mouton Numérique
Vincent Drezet, porte parole d'Attac France
Yves Mary, cofondateur et délégué général de Lève les yeux
David Maenda Kithoko, président de Génération Lumière ; Julie Le Mazier, co-secrétaire nationale de l'Union syndicale Solidaires ; Julien Lefèvre, membre de Scientifiques en rébellion ; Marc Chénais, directeur de L'Atelier Paysan ; Nathalie Tehio, présidente de la LDH (Ligue des droits de l'Homme) ; Raquel Radaut, porte-parole de La Quadrature du Net ; Soizic Pénicaud, membre de Féministes contre le cyberharcèlement ; Sophie Venetitay, secrétaire générale du SNES-FSU ; Stéphen Kerckhove, directeur général d'Agir pour l'environnement ; Vincent Drezet, porte parole d'Attac France.
Liste complète des organisations premières signataires à retrouver sur :
https://www.laquadrature.net/manifeste-hiatus/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2025/02/06/l-intelligence-artificielle-accelere-le-desastre-ecologique-renforce-les-injustices-et-aggrave-la-concentration-des-pouvoirs_6533885_3232.html
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Intelligence artificielle : « Nous devons combattre le fanatisme technologique »

« L'intelligence artificielle est un pur délire », résume notre chroniqueuse Celia Izoard. « Les géants de la tech sont des fondamentalistes de la religion de la technologie. » Arrêterons-nous cette folie criminelle ?
Celia Izoard est autrice et journaliste. Elle est l'autrice de La ruée minière au XXIe siècle —Enquête sur les métaux à l'ère de la transition (éd. Seuil, 2024) et d'un recueil sur les usines du numérique (La Machine est ton seigneur et ton maître Xu Lizhi, Yang, Jenny Chan, éd. Agone, 2022). Elle a traduit et préfacé 1984, de George Orwell (Agone, 2021).
7 février 2025 | tiré du site reporterre.net
Avant, pour nous vendre du maquillage, on nous montrait la photo d'un top model. Aujourd'hui, on nous montre un avatar IA (intelligence artificielle). Une critique du New Yorker, Jia Tolentino, a appelé ça le « look cyborg », ou le « visage Instagram » : impeccablement lisse, yeux en amande, regard vide. Ce nouveau standard de beauté s'est imposé à force de voir des visages retouchés par IA (les « filtres beauté ») sur Instagram ou Tiktok.
À force aussi de voir des top models et des influenceuses qui, de plus en plus... sont des robots. La haine de soi que l'industrie de la beauté inculque aux femmes depuis des générations a atteint un nouveau stade : « Ton problème, ce n'est pas seulement que tu es grosse, ou vieille, c'est que tu es humaine. »

Le top model lilmiquela, créée par intelligence artificielle, se présente comme un « robot de 21 ans vivant à Los Angeles » sur son profil. Elle est suivie par 2,4 millions d'abonnés. Instagram / lilmiquela
Le déploiement de l'IA s'accompagne d'un imaginaire qui porte en lui une dévaluation profonde de l'humanité. Sam Altman, patron d'OpenAI [l'entreprise qui a lancé ChatGPT], promet que l'intelligence artificielle va « élever l'humanité ». Mais il prend soin de rappeler que nous, les humains, sommes des êtres « limités par notre vitesse de traitement de données ». La publicité de Cruise — la branche véhicules autonomes de General Motors — affirme que « les humains sont de très mauvais conducteurs », responsables de la mort de près de 50 000 Étasuniens chaque année.
On nous inculque désormais en masse la « honte prométhéenne », selon l'expression du philosophe Günther Anders. Réfugié dans les années 1940 en Californie, il s'inquiétait de la vénération des Occidentaux pour la technologie. Ils en étaient arrivés, disait-il, à avoir honte de leur infériorité d'humains, honte de ne pas avoir été produits, fabriqués, comme des machines.
Les géants de la tech se projettent vers une humanité toute-puissante, omnisciente, démiurgique, multiplanétaire ; mais ce projet implique d'abord de boxer notre estime de nous-mêmes. C'est, en quelque sorte, ce que le marché de la cosmétique a fait aux femmes : il a fallu, pendant des décennies, nous enseigner nos laideurs pour pouvoir nous vendre des produits de beauté. Comme le décrit Thibaut Prévost dans son essai, Les Prophètes de l'IA (Lux, 2024), ChatGPT n'est qu'une « machine à bullshit ». Il faut avoir profondément atomisé et humilié les individus pour qu'ils en viennent à le considérer comme un interlocuteur valable.
La technologie comme religion
Cette manière étrange de rabaisser l'humanité tout en lui prêtant un avenir grandiose est bien plus qu'une stratégie marketing. C'est un courant religieux qui irrigue la Silicon Valley depuis ses débuts, un millénarisme technologique que l'historien étasunien David Noble a décrit dans The Religion of Technology (paru en 1997, seul un extrait a été publié en français par la revue Agone). Dans le cyberespace, un monde de purs esprits, écrit-il, ces entrepreneurs se rêvent libérés de l'enveloppe corporelle et de la finitude humaines. Ils voient l'intelligence artificielle comme une délivrance à la malédiction du travail. Et ils prévoient de monter au ciel dans les fusées de la conquête spatiale. L'humanité est maudite par la Chute ; la post-humanité sera sauvée, rendue à sa perfection par le progrès technique.
Cette religion de la technologie s'inscrit dans une tradition chrétienne que l'on peut faire remonter à la culture monastique masculine du Moyen Âge. Pour la première fois, la technique y fut constituée comme un moyen pour les hommes (et non les femmes) d'accéder au salut de leur âme et de renouer avec leur nature divine, la perfection d'Adam au jardin d'Éden. Retracer cette histoire permet de comprendre le culte des machines dans le capitalisme industriel. C'est la religion dominante (avec le fétichisme de l'argent) d'une civilisation qui s'est crue affranchie par la raison tout en plaçant ses rêves d'abondance, d'omniscience, d'immortalité et d'ascension céleste dans la technologie.
« Ces entrepreneurs se rêvent libérés de l'enveloppe corporelle »
Mais si le capitalisme industriel, depuis la fin du XVIIIe siècle, est dominé par la religion de la technologie, ce culte a toujours été pondéré, aux XIXe et XXe siècles, par d'autres forces et d'autres courants intellectuels. Les grèves et les mutuelles ont créé des rapports de force qui ont permis la redistribution et diminué les profits privés du capitalisme sauvage. Le mouvement romantique a critiqué le désenchantement et l'enlaidissement d'un monde régi par l'industrie. Le féminisme et l'écologie ont défendu le vivant face aux rêves virilistes de gratte-ciel et de missiles.
Les patrons de la tech : des gourous de sectes dangereuses
Dans la Silicon Valley, au contraire, tout se passe comme si cette religion n'avait pas connu de contre-pouvoir. Année après année, elle s'est développée sous une forme plus fanatique. Le transhumanisme, la singularité, le cosmisme — ces mystiques californiennes ne sont autres que le fondamentalisme de la religion de la technologie.
Avec la Silicon Valley et ses héritiers, le culte de la machine, dopé aux milliards de dollars, s'est radicalisé. Sam Altman veut télécharger son cerveau dans le cloud. Elon Musk (Tesla) veut coloniser Mars. Sergei Brin (Alphabet) veut nous « guérir de la mort ». Ces hommes devraient être mis hors d'état de nuire et surveillés de près, comme les gourous de sectes dangereuses.
Lire aussi : « Trump et Musk nous mènent vers un monde glacial, dominé par l'IA »
C'est bien le contraire qui se produit. Depuis le début de ce XXIe siècle, la Silicon Valley ne cesse de renforcer son hégémonie culturelle. Les géants de la tech sont les grands gagnants de cinquante ans de réformes néolibérales, cinquante ans de spoliation des peuples qui leur ont permis d'amasser une puissance et des fortunes colossales. Si les économies occidentales sont de plus en plus concurrencées par la Chine, l'Inde ou la Russie, le fanatisme technologique californien, lui, a été adopté par les élites de la quasi-totalité du globe. Ces délires technofanatiques dictent les agendas politiques de la plupart des pays.
Pourquoi essayer de nous adapter à cette folie criminelle ?
L'IA, par exemple. Déployée à grande échelle, elle sert à automatiser les tâches créatives, et n'est-ce pas la dernière chose que l'on souhaite ? Elle renforce l'arsenal des technologies de police totalitaires. C'est une machine à produire du chômage, à détruire les capacités cognitives, à manipuler les foules, à traquer les anomalies.
Quant à ses « utilisations positives », la consommation d'énergie, d'eau et de métaux de ses data centers devrait obliger quiconque à les considérer comme nulles et non avenues. L'IA est un pur délire. Alors pourquoi essayons-nous de nous adapter à cette folie criminelle, qui ne peut qu'accélérer le réchauffement climatique et les dominations ? Pourquoi les esprits critiques se contentent-ils d'imaginer une déclinaison égalitariste, ou subversive de l'IA ?
« Ne donnons aucune légitimité à ce que produit un Chatbot »
Nous devons combattre le fanatisme technologique en tant quel, et pas juste ses saluts nazis. Commençons par suivre les conseils de Thibaut Prévost, auteur des Prophètes de l'IA : « Ne donnons aucune légitimité à ce que produit un Chatbot. » Rappelons-nous que « nous sommes collectivement cette superentité intelligente et autonome ». Que « nous avons toujours été là, sous les yeux des prophètes de la superintelligence ». Et que « s'ils avaient le moindre respect pour la multitude, ils l'auraient remarqué depuis longtemps ».
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Tarifs et protectionnisme, comme entraves au marché libéral d’autrefois

Dans le contexte actuel, un chambardement affecte les marchés en raison de l'inclination du président étasunien aux tarifs, soi-disant pour renforcer l'économie de son propre pays. Or, il s'agit d'un réflexe à la fois défensif et nuisible : d'abord, parce qu'il contraint la liberté de choix des entreprises et des personnes du territoire, ensuite parce qu'il démontre une incompréhension de l'interdépendance des marchés — à moins de vouloir imposer un nouvel impérialisme accompagné d'une nouvelle division internationale des échanges.
Des tarifs contre les autres, mais aussi contre soi-même
Comme d'autres l'ont dit — notamment les journalistes Stéphanie Bérubé de La Presse ainsi que Stéphane Bordeleau et Philippe de Montigny d'ICI Radio-Canada, Clémence Pavic du journal Le Devoir, de même que Krishen Rangasamy, Directeur, Services économiques et économiste principal de Financement agricole Canada (FAC)[1] —, les tarifs imposés sur les produits extérieurs servent certes d'entraves à leur entrée, mais ont aussi comme effet pervers de limiter les choix pour la population et les entreprises intérieures. En plus, ce sont elles qui paieront les tarifs. Dans le sens moral du terme, contraindre quelqu'un suppose d'être contraint à son tour, dans une sorte de loi du Talion, quoique la logique du marché exige d'échanger des valeurs égales pour transiger. Alors, imposer 25 % d'un côté crée un déséquilibre à réajuster, et une logique simpliste pousse à trouver une mesure d'équilibre équivalente de l'autre. Mais qui est à l'origine de ces tarifs ? Il ne s'agit pas des deux populations, mais de leurs représentant.e.s qui siègent au gouvernement. Des interventions politiques interfèrent donc dans le déroulement des échanges internationaux pour diverses raisons.
Alors qu'un nouveau régime économique visait à remplacer les systèmes mercantile et physiocratique — voyant dans les métaux précieux ou l'agriculture la richesse des nations —, Adam Smith apportait certaines explications à l'acte d'entraver les importations et celles-ci peuvent encore servir de nos jours. D'abord, il peut s'agir simplement de la décision de protéger l'industrie intérieure, capable de produire certains biens. Par contre, cela revient aussi à faire d'elle un monopole et la question est de savoir si ce geste est profitable globalement pour le pays qui entrave de la sorte ses importations. Il faut se demander si les gens sont prêts à soutenir cette industrie et même à vouloir y travailler. De plus, il faut établir son niveau de santé et sa capacité à être performante sur le long terme, au point de générer suffisamment de richesses de façon à surpasser l'offre venue d'ailleurs. Smith (2009[1776], p. 145) stipule ceci : « Il n'y a pas de règlement de commerce qui soit capable d'augmenter l'industrie d'un pays au-delà de ce que le capital de ce pays peut entretenir : tout ce qu'il peut faire, c'est de faire prendre à une portion de cette industrie une direction autre que celle qu'elle aurait prise sans cela, et il n'est pas certain que cette direction artificielle promette d'être plus avantageuse à la société que celle que l'industrie aurait suivie de son plein gré ». Autrement dit, protéger une industrie suppose d'accepter d'utiliser des richesses intérieures pour la conserver, au détriment peut-être d'autres. Pour revenir aux États-Unis actuels, la présidence semble reconnaître cette particularité et, pour remédier aux frais de maintien ou de valorisation de certaines industries, a choisi de sabrer dans la fonction publique et l'aide internationale notamment. De là, des économies compensatoires.
Au fond, cette manoeuvre diverge à première vue de l'intérêt général, afin de satisfaire un besoin de sûreté. Car une économie accueille normalement les achats à moindre coût, ce que Smith 2009[1776], p. 147) répète en ces termes : « Si un pays étranger peut nous fournir une marchandise à meilleur marché que nous ne sommes en état de l'établir nous-mêmes, il vaut bien mieux que nous la lui achetions avec quelque partie du produit de notre propre industrie, employée dans le genre dans lequel nous avons quelque avantage. L'industrie générale du pays étant toujours en proportion du capital qui la met en oeuvre, elle ne sera pas diminuée pour cela […] ; seulement, ce sera à elle à chercher la manière dont elle peut être employée à son plus grand avantage ». Néanmoins, il reconnaît des cas où imposer une entrave aux produits étrangers peut s'avérer avantageux, notamment lorsque l'industrie génère ce qui est nécessaire à la défense du pays. À noter présentement des tarifs de 25 % sur l'aluminium et l'acier, pouvant être revendiqués pour des raisons de sécurité nationale par les États-Unis. Doit-on y voir une préparation à la guerre ou une autre manoeuvre protectionniste ? Car il faut considérer l'avenue selon laquelle le président Trump met en branle un plan visant à mieux contrôler tout ce qui entre au pays : matières premières, capitaux, marchandises et personnes. Mais il y a surtout cette utopie caractéristique voulant que le marché étasunien soit exceptionnel, soit un privilège. Autrement dit, entraver les importations et, du coup, les exportations des autres, semble insinuer le désir de créer un marché intérieur à ce point extraordinaire que l'extérieur sera prêt à payer chèrement pour y avoir accès. S'expose en parallèle cette ambition de devenir le coeur des échanges internationaux à partir du marché intérieur étasunien ; pour ne pas dire, dominer le marché ou représenter le maître d'oeuvre du marché mondial. Par ambition, le stratagème consiste à créer un « effet d'impasse » pour forcer l'adhésion, d'une manière ou d'une autre, des pays étrangers.
Cela dit, un État fort possède une monnaie forte, ce qui le désavantage pour exporter. En revanche, il peut profiter plus largement de l'offre internationale, surtout si ses entreprises ont été en mesure de s'implanter dans des marchés à faible coût. Par le fait même, cette circonstance doit profiter à sa population, à moins de concentrer la richesse dans les mains de quelques-uns seulement. Si sur le plan global ledit pays semble effectivement s'enrichir, cette perversion par l'accumulation de quelques-uns suppose des inégalités socioéconomiques qui peuvent devenir des problèmes intérieurs. Vouloir alors imposer des tarifs sur des biens importés à moindre frais et qui satisfont les besoins généraux, risque de provoquer des frustrations internes, surtout en provenance de la population moins nantie. En ce sens, entraver les importations aux profits de quelques-uns devient une forme d'esclavagisme de la consommation au détriment même de la population nationale.
Pourquoi encore la présidence étasunienne décrète-t-elle des tarifs de 25 % ? Une hypothèse serait de déduire, par exemple, l'avantage canadien en termes de taux de change, puisqu'à un certain moment, un dollar canadien équivalait à 75 cents étasuniens. Si une logique simpliste suppose un besoin de ramener les monnaies à l'équivalence, un tarif de 25 % sur les biens canadiens importés serait justifié. Encore là, se focaliser sur la plus faible valeur de l'un par rapport à l'autre minore l'analyse, au point de devoir rappeler les avantages d'une monnaie forte. Et l'idée de l'échange consiste dans un rapport gagnant-gagnant, où les partenaires profitent de l'expertise ou des marchandises de l'un ou de l'autre, parce que cela fait leur affaire. Ainsi, imposer des tarifs sur cette base peu convaincante ramène à nouveau les explications soit sur un sentiment faussé de perte, soit sur l'ambition impérialiste dans une version 2.0.
Un empire protectionniste
Lorsque la Grande-Bretagne du XIXe siècle commença à cesser ses tarifs préférentiels envers ses colonies, en privilégiant tout autant un protectionnisme, l'idée derrière était d'assurer le renforcement de son empire. Mais au-delà des difficultés économiques rencontrées, du chômage, des luttes sociales — internes et externes —, des pressions sur l'échange et des rivalités impérialistes, comme le mentionne Karl Polanyi (1983[1944], p. 292), le siècle était plutôt occupé « à construire l'utopie libérale ». D'ailleurs, l'impérialisme avait ses limites et les colonies devenaient des boulets politiques et financiers ; autrement dit, parler de colonies était dépassé. En passant donc du régime impérial au régime libéral (et bourgeois), des tensions se firent entre l'adaptation des populations au régime industriel et à la mise en place d'un marché international autorégulateur. C'est à ce moment-là que l'interdépendance des marchés entre la métropole britannique et les colonies a été la plus affectée, d'où des frustrations qui ont mené aux indépendances.
On a vite compris toutefois qu'un marché totalement libre créait de nombreux remous. Une intervention s'avérait requise, au point de favoriser des mesures protectionnistes. Or, libéralisme et protectionnisme ne vont pas si facilement de pair, voire même semblent être contradictoires. Mais comment expliquer ce renversement ? À cause notamment de la mauvaise tendance à regarder les balances commerciales. Une analyse réductrice voudra seulement voir les gains et les déficits entre deux États, sans comprendre l'apport bénéfique de l'interdépendance de leur marché. À son époque, Smith (2009[1776], pp. 152 et 153) justifiait les entraves « à l'importation des pays avec lesquels on suppose la balance du commerce défavorable » sur la base de « préjugés » et de « haines nationales ». Selon lui, juger une balance égalitaire comme l'absence de gain et une autre déficitaire comme un rapport perdant constitue une absurdité, parce que si les échanges ont été entretenus naturellement, sans contraintes, ils sont avantageux pour les deux parties en cause. Par exemple, si l'une offre des matières premières à l'autre qui s'en sert pour sa production (et donc aussi sa consommation et/ou ses exportations), cela implique de considérer ce que la première reçoit de valable en retour et ce que les matières permettront de réaliser en richesses pour la seconde. Cette analyse exige de voir au-delà des chiffres de la balance, afin de tenir compte d'un plan global d'enrichissement. Smith (2009[1776], p. 161) poursuit son apologie du marché libre comme suit : « […] à mesure qu'un pays, qu'une ville a ouvert ses ports aux autres nations, au lieu de trouver sa ruine dans cette liberté de commerce, comme on devait le craindre d'après les principes du système, elle y a trouvé une source de richesses […] ». Et la balance qui mérite une réelle attention est plutôt celle qui fixe le rapport entre la production et la consommation annuelles, donc en lien avec l'enrichissement intérieur.
Ainsi, l'argument actuel chez la présidence étasunienne d'une balance commerciale déficitaire avec le Canada devient certes un moyen de justifier des mesures tarifaires à l'importation, mais d'autres raisons que la jalousie ou la haine doivent entrer en ligne de compte. En effet, il n'y a pas d'animosité entre le Canada et les États-Unis, ce qui signifie autre chose aux tarifs impliqués. Cependant, le Canada a aussi ses mesures d'entrave venant interférer dans les échanges avec les États-Unis. Cela justifie-t-il des tarifs élevés à titre de représailles et en plus de vouloir l'annexer ? Car annexer le Canada met en lumière un esprit de conquête et les entraves aux échanges visent à mieux faire reconnaître les avantages du marché étasunien et, en contrepartie, le prix d'entrée à devoir désormais supporter en choisissant de rester souverain. Apparaît alors une guerre économique qui sous-entend de revoir les ententes pour rétablir la paix dans le marché. Sinon, on revient à l'esprit de conquête. Vouloir agrandir le territoire étasunien devient une réponse mimétique à d'autres grandes Puissances qui cherchent également à s'imposer dans la marche du Monde. Il s'agit alors de créer un « bloc Amérique » en privilégiant un mouvement impérialiste au lieu d'alliances. Une idéologie anti-démocratie et anti-libre-marché semble être préconisée par la présidence étasunienne : la force sert donc de moyen afin de soumettre les adversaires (autrefois alliés).
Pour revenir avec l'utopie libérale du XIXe siècle, un facteur majeur entre en ligne de compte. Plus tôt, il a été question de la distinction entre une monnaie forte et une autre faible, mais à l'époque en cause, les monnaies des différents pays ou États avaient un rapport avec l'étalon-or. Selon Polanyi (1983[1944]), ce facteur a suscité l'avènement d'institutions protectionnistes —tarifs douaniers, lois sur les fabriques et politique coloniale renouvelée — dans le but de stabiliser la monnaie extérieure, voire encore d'intégrer les pays et autres territoires à la stabilité des changes. Certes, ces mesures se destinaient à encadrer l'économie de marché, mais surtout à favoriser les grands joueurs, car « [l]à où ces méthodes furent imposées, en l'absence de toute mesure protectrice, à un peuple sans défense, […] elles entraînèrent des souffrances indicibles » (Polanyi, 1983[1944], p. 297). Actuellement, comment expliquer le protectionnisme étasunien sur la base des changes ? On n'est plus au XIXe siècle et la stabilité désirée semble être chose faite. Peut-être faudrait-il regarder du côté de la cryptomonnaie, à savoir une nouveauté extrêmement spéculative et l'homme derrière la présidence étasunienne possède même la sienne. Serait-il possible, en vertu des opérations marchandes de plus en plus effectuées via les plateformes virtuelles, d'envisager un tour de force pour faire intégrer la cryptomonnaie dans le système monétaire international. Pourtant déjà, la monnaie américaine sert en quelque sorte d'étalon-or depuis plusieurs décennies. Il n'y aurait donc pas seulement la promotion des États-Unis en jeu.
Par ailleurs, si aux XIXe et XXe siècles, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et les États-Unis, en considérant sur un autre plateau l'URSS, formaient les grandes puissances du moment, désormais il faut considérer la Chine, la Russie, l'Inde, les États-Unis, mais aussi des blocs politico-économiques comme l'Union européenne, alors qu'il y en a aussi d'autres. Et Polanyi (1983[1944], pp. 300 et 301) fait remarquer ceci :
Que la protection fût justifiée ou non, les effets des interventions firent apparaître une faiblesse du système de marché mondial. Les droits de douane à l'importation d'un certain pays entravaient les exportations d'un autre pays et les forçaient à chercher des marchés dans des régions qui n'étaient pas protégées politiquement. L'impérialisme économique était d'abord une lutte entre les Puissances pour avoir le privilège d'étendre leur commerce dans des marchés sans protection politique. La pression de l'exportation était renforcée par la ruée vers des réserves de matières premières, causée par la fièvre manufacturière. […] Le protectionnisme contribuait à transformer des marchés concurrentiels en marchés monopolistiques. On pouvait de moins en moins décrire des marchés comme étant des mécanismes autonomes et automatiques d'atomes en concurrence.
De nos jours, les pays se sont armés, de façon générale, d'outils de protection en ce sens. Par contre, la corruption des gouvernements dans certaines régions du monde rappelle en quelque sorte les propos de Polanyi. Par ailleurs, les visées de la présidence étasunienne s'inscrivent dans une ambition de « puissance », face à des leaders actifs sur la scène mondiale et pouvant être perçus comme ayant à leur tour des aspirations impérialistes. Et comme avant la Première Guerre mondiale, chaque État lorgne l'autre et réagit au mouvement en vogue. Comme préambule, le fascisme est apparu dans la première moitié du XXe siècle, démontrant à quel point l'économie de marché s'était politisée et subissait toutes sortes d'intervention. Ce qui se passe actuellement semble en être la suite, alors que des régimes autoritaires apparaissent même dans des pays dits démocratiques. En même temps, des mesures protectionnistes surviennent, ce qui n'a rien de surprenant. Le marché mondial est en train de subir une refonte, voire un repartage, comme cela s'est toujours produit. Parce que les grands joueurs évoluent, n'étant pas tout à fait les mêmes ; l'arrivée de la Chine a d'ailleurs changé la donne. Avec la présence de telles Puissances, le marché ne peut être totalement libre.
En réalité, le néolibéralisme arrive à son tour à un tournant, comme l'utopie libérale qui, elle, a été ratée par la civilisation du XIXe siècle, car au fond elle était encore impérialiste et craignait le marché autorégulateur, comme le mentionne avec assurance Polanyi (1983[1944]). Présentement, cette crainte demeure au même titre que le besoin d'affirmer sa puissance, laissant présager un nouvel épisode des empires qui a goûté au fascisme. Ainsi, les entraves au marché ou les manoeuvres tarifaires du président étasunien constituent l'apothéose d'une étape inédite de la mondialisation des marchés, alors que d'autres grandes Puissances aspirent à remporter la plus grande part.
Conclusion
Un pays puissant profite de plusieurs marchés, afin de bénéficier d'économies et de faire croître la consommation/richesse intérieure. Et ses interventions à l'international visent alors à limiter les contraintes dans les échanges. Mais en imposant soi-même des tarifs, un piège se présente, malgré le désir de vouloir réduire des balances commerciales jugées déficitaires. Faire monter les prix à l'entrée exige en contrepartie une réelle capacité de pouvoir produire ce qui est en quelque sorte refusé de l'extérieur, et ce, idéalement à moindre coût. Être incapable d'atteindre ce niveau ou encore d'y consacrer le temps et l'argent nécessaires occasionnera une baisse de régime susceptible de causer des pertes difficilement réversibles. Certain.e.s verront cette période comme une opportunité d'investissement, dont le rendement sera visible à moyen et long terme. Or, il s'agit d'un espoir, sans aucune certitude, alors que les économies étaient déjà connues et en main en faisant affaire avec un pays exportateur fiable.
Lorsqu'il est question de tarifs, apparaît non loin une idéologie de protectionnisme, visant à satisfaire des intérêts intérieurs. Mais la véritable analyse exige de reconnaître les forces et les faiblesses du pays, de statuer sur les types d'industries qui méritent un support et celles qui devraient être réorganisées. Même si chaque pays peut être en mesure de produire tout ce qui existe, il y aura toujours, pour diverses raisons (législatives, géographiques, climatiques, culturelles, esprit d'innovation, etc.), des plus performants dans un domaine comparativement aux autres. De là s'entrevoit la théorie des avantages comparatifs de David Ricardo, à la base des échanges internationaux. L'intention est de favoriser des rapports gagnant-gagnant entre les pays. À l'inverse, imposer des tarifs détruit ce rapport et insinue une crainte même envers l'échange. Sinon, il s'agit de vouloir créer un rapport gagnant-perdant, ce qui n'a aucun sens. Pour justifier cette crainte, il faut alors regarder non pas le marché, mais les idées préconçues ou la façon de se le représenter par les dirigeant.e.s des pays. De là s'expose un nationalisme, un chauvinisme, voire même une aspiration impérialiste qui n'a pas lieu d'être en contexte de libre marché.
Imposer des tarifs, c'est employer une mesure protectionniste qui n'a peut-être rien à voir avec la défense d'industries intérieures. Entraver le marché revient aussi à vouloir y soutirer quelque chose de plus, si ce n'est de prendre le contrôler de l'échange. Au XIXe siècle, l'utopie libérale n'a pu se réaliser, parce que le régime impérialiste devait être réformé et ajusté aux réalités plus actuelles, alors que la bourgeoisie prenait finalement son élan, tout en faisant face aux préoccupations sociales qui ont calmé les ardeurs. Mais ça prenait aussi une politique monétaire forte, une entente entre les pays pour stabiliser la monnaie. Plusieurs avancées ont eu lieu depuis. Face au retour de l'autorité impériale désormais « embourgeoisée », les régimes démocratiques subissent des contrecoups qui apparaissent sous formes d'entraves au marché par des mesures protectionnistes. Encore faut-il se demander si elles visent réellement à protéger le territoire de son auteur ou à mener une nouvelle conquête en réponse aux autres Puissances.
Quoi faire alors ? Imposer à son tour des tarifs, de façon à entrer dans la guerre économique ? Ou choisir d'aller en sens inverse, c'est-à-dire en incitant les consommateurs (personnes et entreprises) à continuer de profiter des biens importés, malgré l'état d'âme de leurs dirigeant.e.s ? Pourquoi ne pas les inciter à venir s'établir chez nous, en leur faisant éviter ce tournant vers l'autoritarisme afin de bénéficier d'une véritable liberté dans un régime démocratique ? De s'unir avec d'autres pays dans la même situation, afin de créer une nouvelle force de marché qui tient compte du rapport gagnant-gagnant ? Sinon de miser sur son propre marché intérieur et à l'attachement de la population à son pays ? Face à des mesures d'entraves, tous les moyens sont bons pour se défendre et pour reprendre en main sa propre puissance. En ce sens, il ne faut jamais renoncer à compter d'abord sur soi-même.
Guylain Bernier
Yvan Perrier
16 février 2025
13h30
Références
Polanyi, K. (1983). La Grande Transformation. Aux origines politiques et économiques de notre temps [1944]. Paris, France : Gallimard.
Smith, A. (2009). La richesse des nations [1776]. Paris, France : Flammarion.
[1] Bérubé, Stéphanie (2025, 1er février). Tarifs et boycottage | Vers un regain d'intérêt pour les produits locaux ? La Presse. Repéré à https://www.lapresse.ca/affaires/2025-02-01/tarifs-et-boycottage/vers-un-regain-d-interet-pour-les-produits-locaux.php ; Bordeleau, Stéphane (2025, 31 janvier). Comprendre | Petit guide en vue d'une guerre commerciale avec les États-Unis. ICI Radio-Canada. Repéré à https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2136854/guerre-tarifaire-mode-emploi-trump-canada?depuisRecherche=true ; Montigny, Philippe de (2025, 30 janvier). Comprendre | Le Canada peut-il tirer son épingle du jeu face aux menaces de tarifs de Trump ? ICI Radio-Canada. Repéré à https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2136081/economie-investissement-commerce-interieur-trump-tarifs ; Pavic, Clémence (2025, 3 février). Voici ce qu'il faut savoir concernant les tarifs douaniers. Le Devoir. Repéré à https://www.ledevoir.com/economie/838312/voici-ce-il-faut-savoir-concernant-tarifs-douaniers ? ; Rangasamy, Krishen (2025, 4 février). Que sont les tarifs et pourquoi est-il difficile d'en mesurer les impacts ? FAC. Repéré à https://www.fcc-fac.ca/fr/savoir/services-economiques/que-sont-tarif
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Haro sur l’aide internationale

L'aide internationale est actuellement la cible d'attaques et de remises en cause. Gelée temporairement par la nouvelle administration Trump aux États-Unis, elle fait l'objet d'importantes coupures budgétaires du côté européen, notamment en France et en Belgique. Cela témoigne tout à la fois du recul moral et des contradictions de l'aide.
CETRI - Centre tricontinental
Le Centre tricontinental est un centre d'étude, de publication et de formation sur le développement, les rapports Nord-Sud, les enjeux de la mondialisation et les mouvements sociaux en Afrique, Asie et Amérique latine.
Frédéric Thomas est chargé d'étude au CETRI - Centre tricontinental.
11 février 2025 | tiré de mediapart.fr
https://blogs.mediapart.fr/cetri-centre-tricontinental/blog/110225/haro-sur-l-aide-internationale
Elon Musk, en charge de « l'efficacité gouvernementale » (DOGE), vient d'annoncer la fermeture de l'agence américaine d'aide au développement, USAID, qu'il a qualifiée sur son réseau X d'« organisation criminelle » qui « devait mourir » [1]. Cet arrêt brutal suit la décision abrupte du 20 janvier dernier de geler pendant 90 jours le financement de l'aide internationale [2]. Ces diktats témoignent de la nouvelle donne politique aux États-Unis, mais ils sont également les marqueurs, au-delà des frontières nord-américaines, des contradictions de l'aide internationale et d'un repli éthique au niveau mondial.
Politique spectacle
Dès son investiture, Trump a montré qu'il entendait être le nouvel homme fort du pays, sinon du monde, gouvernant par effets d'annonce et coups de force : volonté de s'approprier le Groenland et le canal de Panama, hausse des tarifs douaniers (sur laquelle il est revenu), expulsions massives, etc. Il convient de prendre au sérieux ce virage à droite et cette politique spectacle, tout en ne se méprenant pas sur son caractère exceptionnel.
Les institutions et contre-pouvoirs auxquels Trump s'attaque avaient déjà été mis à mal par le néolibéralisme, les inégalités et les avantages accordés aux grands acteurs de la tech. Il ne s'agit pas de minimiser la violence du nouveau président, mais plutôt de prendre acte du fait que le trumpisme n'est pas hors-sol, qu'il ne constitue pas un corps étranger à la démocratie américaine. Comme l'écrit Mesrine Malik, « le rêve américain de prospérité à l'intérieur et de suprématie à l'étranger a longtemps masqué un ordre beaucoup plus cynique et transactionnel - un ordre que Trump est à la fois en train d'exposer et d'enraciner » [3].
En fin de compte, le président américain met en scène, tout en la poussant à l'extrême, une politique qui a été largement mise en œuvre par ses prédécesseurs, mais sous une forme plus diplomatique. Au niveau international, la stratégie impériale à visage humain de Biden a ainsi fait place à la stratégie sans masque de Trump. Dans les deux cas, c'est America first [4].
Failles de l'aide internationale
La décision de Trump se répercute directement et lourdement au niveau mondial, mettant en évidence l'architecture de l'aide internationale dont les États-Unis représentent plus de 40% du financement [5]. Outre qu'elle entretient le flou et la confusion quant aux exemptions actuelles – tout ce qui concerne l'aide vitale à court terme – et sur la suite, cette politique hypothèque toute idée de partenariat avec les organisations locales du Sud, dont les programmes financés par la coopération états-unienne ont dû s'arrêter du jour au lendemain, et qui sont traitées comme de vulgaires sous-traitants [6].
Apparaît de la sorte une double dépendance : celle du système de l'aide internationale et des acteurs humanitaires et de développement américains envers la Maison blanche. Dépendance d'autant plus problématique au vu de l'instrumentalisation récurrente de l'aide par Washington. Ainsi, les trois éléments essentiels mis ouvertement en avant par les gouvernements successifs pour légitimer l'aide internationale fournie par les États-Unis sont : la sécurité nationale, les intérêts commerciaux et le reflet des valeurs et du leadership global [7].
Ce qui, jusqu'à présent, était plus ou moins implicitement accepté, à savoir que l'aide sert aussi les intérêts américains, est désormais affirmé avec force comme prioritaire. Chaque dollar dépensé doit être justifié en répondant à trois simples questions, déclare ainsi Marco Rubio, le nouveau secrétaire d'État : cela rend-il les États-Unis plus sûrs, plus forts, plus prospères [8] ?
Désorientation éthique
Sale temps pour l'aide internationale, car ce n'est pas seulement de l'autre côté de l'Atlantique qu'elle est confrontée à des coupes budgétaires drastiques. De l'Allemagne à la Belgique, en passant par les Pays-Bas, le repli européen est évident, et c'est en France que la baisse, de 35%, est la plus importante. Du côté belge, le gouvernement Arizona réduira le budget de la coopération d'un quart. Si les réactions ne se sont pas fait attendre, force est de reconnaître qu'elles prennent souvent un tour défensif.
Ainsi, aux États-Unis, la majorité des ONG internationales (ONGI) ont adopté un profil bas, préférant tenter de négocier avec l'administration Trump, voire de l'amadouer. En témoigne la déclaration d'Interaction, le plus grand réseau d'ONGI, selon laquelle les organisations d'aide et de développement états-uniennes travaillaient sans relâche pour faire avancer les intérêts des États-Unis au niveau mondial et que la suspension des programmes créerait un vacuum que « la Chine et nos adversaires allaient rapidement remplir » [9]. Bien que contesté par nombre d'ONG, le positionnement d'Interaction n'en est pas moins révélateur de la confusion qui règne.
Sous un mode mineur, la ligne de défense tend à être la même du côté belge (et européen) : mise en avant du soft power, de « l'investissement stratégique », de la stabilité internationale et de la « gestion migratoire ». Il faudrait valider et s'approprier l'instrumentalisation de l'aide pour mieux la légitimer. Simple tactique ou narratif assumé, cela trahit la dépolitisation des acteurs de l'aide et du développement [10], ayant de plus en plus de mal à penser les conditions de leur fonctionnement dans un monde marqué par les inégalités, les relents réactionnaires, la montée en puissance du Sud et les rapports de force. Au risque de devenir les complices du pouvoir plutôt que des contrepouvoirs.
À défaut de réinventer l'aide en pariant sur l'intelligence sensible des gens ordinaires, qui trouvent tout simplement injuste et révoltant que des hommes, des femmes et des enfants meurent de faim ou faute de soins, sous les coups ou sous les bombes, leurs droits et leur dignité bafoués, on s'autocensure et on s'aligne sur la politique du plus fort. À l'automne 2004, Gustavo Gutiérrez (1928-2024), le « père » de la théologie de la libération, s'appuyant sur le grand philosophe et penseur juif Emmanuel Lévinas (1906-1995), affirmait la nécessité d'une « éthique de la solidarité » [11]. C'est aussi, d'abandonner ce terrain-là, déclaré perdu d'avance, en cédant sur les principes et sur les mots, au nom de la crise économique et de la realpolitik, que l'on condamne l'aide au faux dilemme du gaspillage ou de l'utilité géopolitique.
Notes
[1] Lauren Irwin, « Musk calls USAID a ‘criminal organization' that should ‘die' », The Hill, 2 février 2025, https://thehill.com/homenews/administration/5122128-musk-calls-usaid-a-criminal-organization-that-should-die/.
[2] Laurence Caramel, Philippe Ricard, Ghazal Golshiri, Piotr Smolar, Jean-Michel Hauteville, Jacques Follorou, Florence Miettaux, Bruno Meyerfel, Faustine Vincent et Laure Stephan, « Pourquoi le gel par Trump de l'aide internationale sidère le monde et provoque déjà des dégâts dévastateurs », Le Monde, 3 février 2025, https://www.lemonde.fr/international/article/2025/02/01/donald-trump-seme-le-chaos-et-la-panique-en-gelant-l-aide-etrangere_6526177_3210.html.
[3] Nesrine Malik, « Trump 2.0 is exposing American exceptionalism for what it is – and has always been », The Guardian, 3 février 2025, https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/feb/03/donald-trump-american-exceptionalism-guantanamo-bay-imperialism-billionaires.
[4] Bernard Duterme, « L'Amérique latine selon Trump : des menaces aux réalités », Cetri, 31 janvier 2025. Lire aussi Frédéric Thomas, « Joe Biden : un impérialisme à visage humain ? », Cetri, 16 novembre 2020.
[5] OCHA, Total reported funding 2024, https://fts.unocha.org/global-funding/overview/2024.
[6] Irwin Loy, « Trump stop-work orders hit local aid and frontline communities », The New humanitarian, 31 janvier 2025, https://www.thenewhumanitarian.org/news/2025/01/31/trump-stop-work-orders-hit-local-aid-and-frontline-communities ; Irwin Loy, « Inklings | What to make of the Trump aid freeze chaos ? », The New humanitarian, 29 janvier 2025, https://www.thenewhumanitarian.org/newsletter/2025/01/29/inklings-what-make-trump-aid-freeze-chaos.
[7] Congressional Research Service, U.S. Foreign Assistance, 1er novembre 2024, https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF10183.
[8] « Chaque dollar que nous dépensons, chaque programme que nous finançons et chaque politique que nous poursuivons doivent être justifiés par la réponse à trois questions simples :
Cela rend-il l'Amérique plus sûre ?
Cela rend-il l'Amérique plus forte ?
Cela rend-il l'Amérique plus prospère ?
Sous la présidence Trump, les dollars des contribuables américains qui travaillent dur seront toujours dépensés avec sagesse et notre pouvoir sera toujours cédé avec prudence — et vers ce qui est le mieux pour l'Amérique et les Américains avant tout », Marco Rubio, audition devant le Sénat américain. « Révisionnisme et désinhibition : l'Empire de Trump dans la doctrine Marco Rubio », Le Grand continent, 15 janvier 2025, https://legrandcontinent.eu/fr/2025/01/18/revisionnisme-et-desinhibition-lempire-de-trump-dans-la-doctrine-marco-rubio/.
[9] Cité dans Irwin Loy, Ibidem.
[10] Julie Godin, « ONG : dépolitisation de la résistance au néolibéralisme ? », Cetri, 13 juin 2017.
[11] Et de poursuivre : « Lévinas parle par exemple par exemple, d'une ‘éthique asymétrique', il l'appelle ainsi car pour lui, l'autre est premier. C'est une façon de parler de solidarité, mais je dirais qu'elle va plus loin. C'est une perspective éthique profonde et féconde ». Anthropia, « Solidaridad y tolerancia : Entrevista a Gustavo Gutiérrez”, 2004, https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/anthropia/article/view/11202.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :












