Presse-toi à gauche !
Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Bolsonaro et 33 autres personnes sont dénoncées par la PGR pour tentative de coup d’État
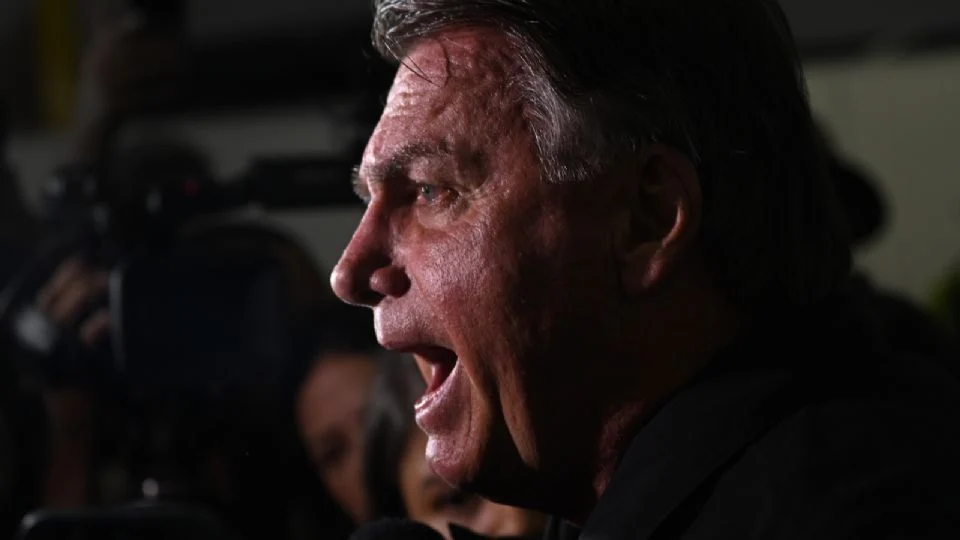
Le bureau du procureur général (PGR) a dénoncé l'ancien président Jair Bolsonaro (PL) devant la Cour suprême fédérale (STF), mardi (18 février), pour les crimes de formation d'une organisation criminelle, d'abolition violente de l'État de droit démocratique et de tentative de coup d'État, pour sa participation aux événements survenus entre la fin de son mandat, en décembre 2022, et le fatidique 8 janvier 2023.
18 février 2025
Après une grande appréhension et une grande anxiété de la part d'une grande partie des Brésiliens, le PGR Paulo Gonet a présenté la plainte au STF, près de trois mois après que l'ancien occupant du Palais du Planalto et 39 autres personnes enquêtées aient été inculpés dans le cadre d'une enquête détaillée de la police fédérale composée de 884 pages et pleine de preuves recueillies par les agents.
Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira et Walter Souza Braga Netto ont également été inculpés.
Les principaux points de l'acte d'accusation contre Jair Bolsonaro
Le MPF (Ministère Public Fédéral) dénonce une tentative de coup d'État et une structure criminelle visant à délégitimer les élections et à empêcher la transition du gouvernement.
Le ministère public fédéral (MPF) a déposé une plainte formelle contre Jair Bolsonaro et plusieurs membres de son gouvernement, les accusant de faire partie d'une organisation criminelle qui a tenté d'empêcher Luiz Inácio Lula da Silva d'accéder au pouvoir après les élections de 2022. Le document, signé par le procureur général de la République, Paulo Gonet, a été envoyé à la Cour suprême fédérale (STF) et est sous le rapport du juge Alexandre de Moraes.
À la tête d'une organisation criminelle
L'acte d'accusation affirme que M. Bolsonaro, ainsi que son colistier à la vice-présidence pour 2022, le général Braga Netto, ont coordonné et encouragé des actions visant à empêcher la transition du gouvernement. L'acte d'accusation décrit l'organisation comme étant structurée, hiérarchisée et avec une division des tâches entre ses membres. Parmi les personnes impliquées figurent des ministres, du personnel militaire et des conseillers directs, tous supposés être alignés sur le projet de maintenir Bolsonaro au pouvoir, quel que soit le résultat électoral. Les documents saisis indiquent que des réunions ont été organisées pour définir les stratégies du groupe.
Délégitimer les élections
Depuis 2021, Bolsonaro aurait promu un discours de méfiance à l'égard des urnes électroniques et du Tribunal supérieur électoral (TSE), préparant le terrain pour remettre en cause les résultats de l'élection de 2022. La stratégie comprenait des déclarations publiques, des émissions en direct et des réunions avec des autorités nationales et internationales pour répandre des soupçons infondés sur l'équité du processus électoral. Selon la plainte, ce discours a été méticuleusement planifié dans le cadre de la narration qui soutiendrait un coup d'État.
Utilisation de structures gouvernementales
L'ancien président aurait utilisé des organismes gouvernementaux, tels que la Police fédérale des routes (PRF) et le Bureau de la sécurité institutionnelle (GSI), pour entraver l'élection de son adversaire et créer une instabilité institutionnelle. Lors du second tour des élections, la PRF a mené des opérations dans des régions où Lula avait obtenu un nombre important de voix au premier tour, rendant difficile l'accès des électeurs aux bureaux de vote. En outre, les enquêtes montrent que Bolsonaro et ses alliés ont discuté de stratégies visant à instrumentaliser les forces armées et l'Abin (Agence brésilienne de renseignement) en faveur du plan de coup d'État.
Tentative de coup d'État
La plainte indique que Bolsonaro et ses alliés ont envisagé des mesures telles que la déclaration de l'état de siège, l'arrestation des ministres du STF et du TSE et l'annulation des élections sous des prétextes frauduleux. La police fédérale a identifié des projets de décrets prévoyant une intervention militaire et la suspension des institutions démocratiques, ainsi que l'emprisonnement éventuel d'opposants politiques et de membres du pouvoir judiciaire. Les documents saisis montrent que des réunions ont eu lieu pour discuter de ces plans, avec la participation de militaires d'active et de réserve.
Plan de violence et d'intimidation
L'un des aspects les plus graves de l'acte d'accusation mentionne l'existence de plans prévoyant la possibilité d'assassiner des autorités, telles que le ministre Alexandre de Moraes et le président élu lui-même, Luiz Inácio Lula da Silva. Parmi les documents saisis, des notes mentionnent une opération appelée « Poignard vert et jaune », qui prévoyait des attaques contre des personnalités du pouvoir judiciaire et de l'exécutif. La plainte indique que Bolsonaro a été informé de ces conspirations et qu'il a non seulement donné son accord, mais qu'il aurait également encouragé des groupes extrémistes à s'y joindre.
Mobilisation militaire et désobéissance à la Cour suprême
L'organisation aurait tenté de coopter les militaires pour qu'ils se joignent à un coup d'État, en faisant pression sur le haut commandement de l'armée et en utilisant les réseaux sociaux pour attaquer les généraux qui ne soutenaient pas la rupture démocratique. Selon les enquêtes, Bolsonaro et ses alliés ont cherché à obtenir le soutien d'officiers de haut rang, tandis que des personnalités militaires alignées sur le gouvernement ont fomenté une atmosphère de désobéissance au sein des forces armées. Malgré la résistance d'une partie du haut commandement, des secteurs des forces spéciales se seraient organisés pour rendre possible la tentative de coup d'État.
Lien avec les manifestations du 8 janvier
La plainte souligne que Bolsonaro et ses alliés ont encouragé et facilité la mobilisation des partisans, qui a culminé avec l'invasion et la destruction du siège des trois branches du gouvernement. Des messages interceptés révèlent que des membres de l'organisation criminelle ont maintenu un contact direct avec des manifestants qui campaient devant des casernes, les encourageant à faire pression sur les militaires pour qu'ils agissent. Le 8 janvier, l'action violente a été facilitée avec la connivence de secteurs de la sécurité publique du district fédéral. Les messages enregistrés révèlent que les organisateurs attendaient le feu vert de l'armée pour agir de manière plus incisive.
Preuves documentaires
Des manuscrits, des messages et des fichiers numériques ont été trouvés, détaillant le plan pour maintenir Bolsonaro au pouvoir, ainsi que des instructions pour discréditer les sondages et créer un environnement d'instabilité. Parmi les documents saisis figurent des projets de décrets de coup d'État, des comptes rendus de réunions de conspirateurs et des notes qui démontrent la planification méticuleuse de l'invalidation de l'élection de 2022. Les preuves recueillies par la police fédérale et le MPF renforcent la thèse selon laquelle les actes criminels n'ont pas été improvisés, mais sont le résultat d'une conspiration à long terme visant à saper la démocratie brésilienne.
Implications et développements
La plainte, désormais entre les mains du STF, pourrait conduire à l'ouverture d'une procédure pénale contre Bolsonaro et ses alliés, consolidant ainsi l'une des plus grandes affaires pénales de l'histoire politique du Brésil. Si elle est acceptée, la plainte pourrait donner lieu à des sanctions sévères, y compris de longues périodes d'emprisonnement pour les personnes impliquées. Le jugement rendu dans cette affaire pourrait constituer un précédent important en ce qui concerne l'obligation pour les anciens dirigeants de rendre compte des crimes commis contre la démocratie.
La défense de Bolsonaro nie les accusations, affirmant qu'il n'y a pas de preuves concrètes contre l'ancien président. Toutefois, la solidité des preuves présentées par le MPF renforce la possibilité de demander des comptes à l'ancien chef de gouvernement et à ses plus proches alliés.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Personnes traumatisées craniocérébrales : Très vulnérables à la crise du logement, selon une étude

Québec, le 19 février 2025 – Le Regroupement des associations de personnes traumatisées craniocérébrales du Québec (Connexion TCC.QC <https://www.connexiontccqc.ca/> ) tient aujourd'hui une conférence de presse pour dévoiler les résultats préliminaires d'une récente étude sur les conditions d'habitation des personnes traumatisées craniocérébrales (TCC)
Cette étude est menée en collaboration avec l'équipe de recherche Participation sociale et ville inclusive du Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale (CIRRIS <https://www.cirris.ulaval.ca/> ) de l'Université Laval.
Les résultats préliminaires de l'étude mettent en lumière que :
● Plus du 1/4 des participant·es ont mentionné que ce n'était pas leur décision de vivre dans leur milieu actuel ;
● 1/6 des participant·es prévoit déménager à moyen terme (2-3 prochaines années) ;
● près du 1/10 des participant·es ont déjà été ou pourraient être actuellement dans une situation d'instabilité résidentielle ;
● 2/3 des participant·es sont non-propriétaires et donc à risque d'être touché·es de plein fouet par la crise du logement.
« Le TCC survient de façon soudaine, ce qui a un impact considérable la capacité des personnes qui le subissent à continuer à travailler au même rythme qu'avant. Elles se retrouvent du jour au lendemain avec un revenu moindre et une dépendance accrue au soutien de leurs proches, les exposant ainsi à un risque d'instabilité résidentielle » explique Marie-Ève Lamontagne, chercheure au CIRRIS.
Depuis leur TCC, les participant·es ont en moyenne déménagé 2,8 fois, ce qui illustre le grand besoin de trouver un milieu de vie mieux adapté à leur nouvelle réalité. Les compressions budgétaires d'1,5 milliard en santé annoncées par Christian Dubé le mois dernier alertent le Regroupement, qui trouve la situation déjà préoccupante sur le terrain : manque ou absence de services spécifiques pour les personnes TCC dans de nombreuses régions, manque de logements adaptés et listes d'attente, etc. « Nous demandons au gouvernement que le prochain budget investisse dans le PSOC à la hauteur des besoins, afin que chaque personne subissant un TCC soit accompagnée dans son milieu de vie », affirme Marjolaine Tapin, directrice générale de Connexion TCC.QC.
Les données présentées ont été recueillies auprès de 175 membres participant aux activités des associations membres du Regroupement dans 12 régions du Québec. Les répondant·es sont des adultes avec un TCC modéré ou grave depuis au moins 5 ans.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’embuscade néo-fasciste au Brésil

Concernant l'extrême droite en Amérique Latine, nous avons les yeux rivés sur l'Argentine. C'est oublier un peu vite la situation dans le pays voisin, le Brésil. Bien que Jair Bolsonaro a été écarté du pouvoir depuis 2023, l'extrême droite demeure un danger très présent.
À travers une analyse de la trajectoire politique du Lula et du lulisme, resitué dans une perspective historique de plus long terme, Valerio Arcary, historien et militant du PSOL, propose une analyse éclairante sur l'ampleur des risques politiques que traverse le pays.
18 février 2025 | tiré du site contretemps.eu
https://www.contretemps.eu/embuscade-neo-fasciste-bresil/
***
Si le Brésil est aujourd'hui moins pauvre et mieux instruit qu'il y a quarante ans, il demeure néanmoins profondément injuste. Le constat historique est accablant. Certes, les inégalités sociales ont diminué, mais les changements restent minimes. Tout évolue à un rythme désespérément lent. Pire encore, ce qui ne progresse pas régresse. La direction luliste s'est retrouvée prise en otage par l'opération Lavajato, a démoralisé de larges secteurs de la classe travailleuse et de la jeunesse et a livré les classes moyennes exaspérées (par les accusations de corruption, l'inflation des services, les augmentations d'impôts, etc.) aux mains du pouvoir de l'« Avenida Paulista » (siège des grandes banques et entreprises), ouvrant la voie au gouvernement ultra-réactionnaire de Temer. Et Temer l'a remis entre les mains de l'extrême droite et de Bolsonaro.
Ce n'est pas pour cela qu'une génération s'est tant battue. Entre 1978 et 1989, Lula a gagné la confiance de la grande majorité de l'avant-garde ouvrière et populaire. Le rôle de premier plan de Lula était à la fois le reflet de la force sociale du prolétariat brésilien et, paradoxalement, de sa naïveté politique. Une classe ouvrière jeune et peu instruite, récemment issue des régions les plus défavorisées, sans expérience préalable de la lutte syndicale, sans tradition d'organisation politique indépendante, mais concentrée dans les grandes régions métropolitaines du nord au sud et, dans les secteurs les plus organisés, avec une volonté indomptable de se battre. L'illusion réformiste selon laquelle il serait possible de changer la société sans conflit majeur, sans rupture avec la classe dirigeante, était l'opinion majoritaire et la stratégie du « Lula là » a engourdi les attentes d'une génération. Cette expérience historique n'a pas encore été surmontée. Cependant, le gouvernement Lula III ne bénéficie pas du contexte exceptionnel d'il y a vingt ans, et les différences sont nombreuses. L'élément central est la présence d'un mouvement d'extrême droite, piloté par des néo-fascistes déterminés à reconquérir le pouvoir.
La stratégie du troisième mandat de Lula
Le projet du gouvernement Lula est de profiter du contexte international de relative reprise économique, après l'impact de la pandémie, en espérant que cette dynamique se poursuivra sous l'impulsion, à nouveau, de la Chine. Il entend maintenir un pacte avec la fraction bourgeoise qui l'a soutenu au second tour de 2022 contre Bolsonaro et a intégré le gouvernement, ainsi qu'avec la gouvernabilité au Congrès à travers le centrão, afin de garantir la continuité de la croissance et la mise en œuvre des réformes. Au cours de la première année de son mandat, la transition PEC a permis une croissance proche de 3 % et une augmentation de 12 % des revenus du travail, l'expansion du programme Bolsa Família, qui, dans 13 des 27 États, bénéficie à un plus grand nombre de personnes que celles disposant d'un contrat formel. Par ailleurs, le gouvernement a rétabli le salaire minimum, restructuré l'IBAMA et la FUNAI, lancé le programme Pé de Meia pour les élèves du secondaire, remis en place le plan national de vaccination et renforcé le soutien des banques publiques au projet Desenrola, pour aider les familles endettées. L'accès au crédit a été facilité par une baisse des taux d'intérêt et 100 nouvelles unités des Instituts Fédéraux d'enseignement techniques ont été créés, parmi d'autres initiatives visant à améliorer les conditions de vie des masses.
L'objectif était de maintenir une croissance du PIB supérieure à 3 % en 2024, de contenir l'inflation sous les 5 %, de poursuivre un ajustement fiscal progressif et de stimuler les investissements privés, tant nationaux qu'étrangers par le biais du cadre fiscal qui a remplacé le « Teto de Gastos », le plafond des dépenses (« Amendement constitutionnel sur le plafond des dépenses publiques en vigueur de 2003 à 2011 »). En bref, un engagement en faveur d'un réformisme « faible », mais avec une amélioration lente et régulière des conditions de vie et la garantie de préserver la démocratie. Au Brésil, si de petites réformes peuvent transformer la vie de millions de personnes, remporter une élection demeure impossible sans le soutien majoritaire de la classe travailleuse.
De bons indicateurs économiques ne suffiront pas. Il y a un conflit idéologique incessant et ininterrompu. Le lulisme conserve la confiance des plus pauvres, mais le bolsonarisme a gagné du terrain parmi les travailleurs « aisés » qui gagnent plus de deux salaires minimums et accumule des forces dans la « guerre culturelle » fort du soutien des églises néo-pentecôtistes. La population demeure profondément divisée, laissant planer une grande incertitude sur l'issue de 2026.
Cette stratégie s'inscrit dans la continuité du projet élaboré après la victoire électorale de 2002, qui a conduit aux succès de 2006, 2010, 2014, et plus dangereusement, celui de 2022.
Trois hypothèses sous-tendent cette approche.
Premièrement, le pari que le risque d'une nouvelle conspiration similaire au coup d'État institutionnel qui a renversé Dilma Rousseff en 2016 a été écarté temporairement.
Deuxièmement, l'idée que l'inéligibilité de Bolsonaro diminue fortement la probabilité qu'un de ses héritiers politiques l'emporte en 2026 face à Lula.
Troisièmement, la prévision selon laquelle la division de la bourgeoisie sur la nécessité de préserver le régime démocratique et électoral est devenue irréversible. Ainsi, en 2026, la faction capitaliste représentée par Geraldo Alckmin et Simone Tebet pourrait à nouveau soutenir Lula, refusant le risque d'une nouvelle présidence d'extrême droite.
Ces trois calculs contiennent plus qu'un simple « grain de vérité », mais ils sous-estiment gravement les risques encourus. Ils oublient les leçons du coup d'État de 2016 contre Dilma Rousseff. Les plus importantes sont au nombre de cinq :
1/ La première est la sous-estimation du courant néofasciste – l'erreur la plus catastrophique des sept dernières années – de son audace, de son implantation sociale et culturelle, de sa volonté de confrontation directe, de la confiance dans le leadership politique de Bolsonaro, et donc de la résilience du soutien social de l'extrême droite. Cela révèle que l'affrontement ne se limite pas à la perception d'une amélioration des conditions de vie, mais qu'il repose également sur une lutte politique, idéologique et même culturelle féroce portée par une vision du monde réactionnaire.
2/ La deuxième est le fantasme selon lequel il serait possible de maintenir indéfiniment une gouvernabilité « froide » et l'idéalisation du Frente Amplio, en croyant que les dirigeants bourgeois intégrés au ministère resteront loyaux. Cette vision oublie le rôle de Michel Temer et exagère la confiance dans la stabilité du gouvernement, qui repose sur des accords fragiles avec le Centrão au Congrès National, ignorant le danger d'un chantage inacceptable.
3/ La troisième est la sous-estimation personnelle de Bolsonaro en tant que leader de l'opposition et pré-candidat, même dans sa condition d'inéligibilité. Si nécessaire, ils peuvent le remplacer par un autre candidat – Tarcísio de Freitas, Michelle Bolsonaro, ou même un autre « personnage » – avec la conviction que le transfert de son capital électoral reste possible.
4/ La quatrième est la sous-estimation de l'émergence des revendications populaires, noires, féministes, LGBT, environnementales et culturelles, une erreur qui a été fatale au péronisme en Argentine. La confiance excessive dans la poursuite de de la croissance économique comme condition de la mise en œuvre de réformes progressives, peut être démentie, car la structure fiscale limite le rôle de l'investissement public et le marché international des matières premières reste imprévisible.
5/ La cinquième est l'élection de Trump aux États-Unis, qui a eu un effet catalyseur mondial, y compris au Brésil, et les victoires annoncées de l'extrême droite lors des prochaines élections en Europe, ainsi qu'une aggravation des conflits dans le système international avec la Chine.
L'émergence du néofascisme : un danger latent
Comment expliquer la force de l'extrême droite ? Le marxisme ne devrait pas être un déterminisme strictement économique. Mais l'économie joue un rôle clé.
Une mutation structurelle s'est opérée au cours de la dernière décennie. Entre 2013 et 2023, nous avons connu la première décennie régressive depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale :
(a) Pendant les trente « années glorieuses », l'Europe et le Japon ont reconstruit leurs infrastructures et mené à bien les réformes qui ont garanti le plein emploi et des concessions à la classe travailleuse. L'économie brésilienne en a bénéficié en tant que première destinataire des investissements étatsuniens dans la périphérie.
(b) dans les années 1980, un « mini-boom » sous Reagan a vu le Brésil sombrer dans une crise sociale, bien qu'il ait continué à croître.
(c) dans les années 1990, le « mini-boom » sous Clinton a permis la stabilisation de la monnaie brésilienne et du régime libéral-démocratique, facilitée également par la fin de l'URSS.
(d) dans la première décennie du 21e siècle, un « mini-boom » sous George W. Bush a vu le Brésil accumuler des réserves de centaines de milliards de dollars, grâce à l'appréciation exceptionnelle des matières premières stimulée par la croissance chinoise, un phénomène seulement comparable à l'inversion des termes de termes de l'échange durant les guerres mondiales.
La deuxième décennie du XXIe siècle a marqué, pour la première fois dans l'histoire, une période de stagnation. Rien de tel ne s'était jamais produit au Brésil. Le Brexit et Donald Trump, Jair Bolsonaro et Javier Milei sont l'expression électorale d'une stratégie visant à maintenir le leadership étatsunien dans le monde.
Une fraction de la bourgeoisie mondiale, insatisfaite du gradualisme néolibéral, a recours à une stratégie de choc hyper-libérale visant à démanteler les droits sociaux : elle prône la « latino-américanisation » des pays du centre, et l'« asiatisation » de l'Amérique latine afin d'égaliser les coûts de production avec la Chine. Elle veut imposer une défaite historique qui garantira la stabilité des régimes pour une génération.
Cependant, l'extrême droite ne se limite pas seulement à une stratégie économique pour maintenir son leadership sur le marché mondial. Il ne s'agit pas seulement d'un alignement politique sur les États-Unis au sein du système international. Le courant néo-fasciste présente des hétérogénéités internes, et des programmes différents selon les pays, mais repose sur un socle idéologique commun : nationalisme exalté, misogynie sexiste, racisme suprématiste blanc, homophobie pathologique, négationnisme climatique, militarisation de la sécurité, anti-intellectualisme, mépris de la culture et de l'art, méfiance à l'égard de la science.
Ce choc ne peut se concrétiser sans une restriction des libertés démocratiques, voire une destruction des libertés politiques L'extrême droite nourrit une soif de pouvoir et vise à renverser le régime libéral-démocratique. Elle ne cherche pas à « copier » le totalitarisme nazi-fasciste des années 1930 mais aspire à des régimes autoritaires. Elle admire Erdogan en Turquie, Bukele au Salvador et Duterte aux Philippines. Seule une lutte acharnée peut les arrêter.
Par des dénonciations incessantes, un mouvement sociopolitique d'extrême droite, dirigé par des néo-fascistes, s'est consolidé. Les néo-fascistes ont construit un narratif où ils prétendent qu'il existe « trop de droits » pour les travailleurs. Jair Bolsonaro a inventé la menace : « l'emploi ou les droits ? ». Ce qui est menacé par l'extrême droite au Brésil, ce sont toutes les conquêtes sociales, petites mais précieuses, obtenues depuis la fin de la dictature.
Les avancées de tous les mouvements sociaux, qu'ils soient populaires, liés au logement, aux droits des femmes, des Noirs, à la culture, aux étudiants, aux syndicats, aux paysans, aux LGBT, aux écologistes ou aux peuples autochtones. Le bolsonarisme n'est pas une réaction à une menace révolutionnaire, ni une tentative de lutte pour le pouvoir dans le système international des États, comme l'a été le nazifascisme dans l'Europe des années 1920, après la victoire de la révolution d'Octobre. Il n'existe aucun risque, même lointain, de révolution au Brésil.
Les néofascistes ont acquis une base de masse, parce qu'une fraction de la bourgeoisie s'est radicalisée et mène une offensive contre les travailleurs, soutenue par une majorité de la classe moyenne, entraînant avec elle certains secteurs populaires sous le prétexte qu'un choc de capitalisme « sauvage » est nécessaire.
L'extrême droite s'est développée en réaction à la crise de 2008-2009, qui a plongé le capitalisme occidental, y compris le Brésil, dans une décennie de stagnation tandis que la Chine poursuivait sa croissance. Son programme repose sur un néolibéralisme à la « fièvre de 40 degrés », un alignement inconditionnel sur Trump aux États-Unis et un régime autoritaire empreint de nostalgie pour la dictature militaire.
L'objectif du néofascisme est d'imposer une défaite historique en démantelant les réformes sociales progressistes : l'aide sociale qui protège 50 millions de personnes de l'extrême pauvreté, à travers le programme Bolsa Família ; l'accès à une pension vieillesse pour 38 millions de personnes âgées ; les soins de santé publics universels et gratuits à travers le SUS (Système Unifié de Santé) ; l'école publique universelle jusqu'à la fin de l'enseignement secondaire et l'élargissement des universités publiques avec des quotas pour les Noirs et les peuples autochtones ; l'augmentation du salaire minimum au-dessus de l'inflation, etc.
L'« exceptionnalité » brésilienne
Toutes les nations possèdent leurs singularités, leurs grandeurs et leurs misères. Le Brésil, bien que dépendant, est la plus grande puissance à la périphérie du capitalisme. Doté de dimensions continentales, il s'étend de l'Amazonie à la Pampa et concentre à lui seul la moitié de la population sud-américaine. Un peu plus de la moitié de ses habitants sont noirs, et son image internationale, façonnée au cours de la seconde moitié du XXᵉ siècle, repose sur la beauté naturelle des tropiques, le carnaval et le football.
Mais c'est peut-être sur le plan politique que le Brésil se distingue le plus, à travers trois particularités majeures :
(a) une inégalité sociale d'une ampleur extrême, qui demeure presque intacte.
(b) une classe dirigeante historiquement habile à négocier des compromis pour résoudre les conflits sociaux et politiques.
(c) l ‘existence d'une énorme classe ouvrière et de l'un des partis de gauche les plus influents au monde.
Marqué par la domination impérialiste, le pays fut successivement colonie portugaise pendant trois siècles, semi-colonie britannique durant un siècle et, depuis le milieu du XXᵉ siècle, une zone d'influence étatsunienne. Mais son « exceptionnalité » réside dans ces dynamiques internes, qui produisent un paradoxe frappant : une lenteur sidérante des transformations sociales, incapables d'endiguer la profonde injustice qui accable le peuple.
L'histoire politique brésilienne est marquée par des transitions initiées d'en haut et par des compromis entre factions bourgeoises. Les conflits au sein de la classe dirigeante se résolvent par des négociations laborieuses, faites de concessions mutuelles et d'arrangements. Le pays n'a connu qu'une guerre civile limitée, au Rio Grande do Sul il y a un siècle et, pendant quelques mois, lors du soulèvement de São Paulo en 1932. La seule véritable rupture fut le coup d'État militaire de 1964.
Pourtant, au cours des dix dernières années, le Brésil est devenu un véritable « laboratoire » politique. Après tout, en 2018, Bolsonaro, un ancien militaire néofasciste, a remporté l'élection présidentielle après treize ans de gouvernements dirigés par le PT, le plus grand parti de gauche apparu à la fin du XXᵉ siècle, tandis que Lula était en prison. Pourquoi ? Bolsonaro a perdu sa réélection en 2022 face à Lula, a tenté un coup d'État militaire, a été déclaré inéligible par la justice en 2023, mais menace de se présenter aux prochaines élections présidentielles de 2026, avec des taux de popularité très élevés, dans un contexte imprévisible. Les raisons de cette « exceptionnalité » sont multiples.
Le paradoxe brésilien : des tensions sociales sans bouleversements violents
Il existe des facteurs objectifs et subjectifs qui permettent de comprendre ce résultat. C'est un paradoxe, car l'inégalité sociale chronique dans un pays qui possède le PIB le plus élevé du monde périphérique, tout en concentrant proportionnellement la plus grande classe ouvrière, de gigantesques centres urbains et plus de vingt villes de plus d'un million d'habitants, devrait entraîner un niveau de tension sociale extrêmement élevé. Or, ce ne sont que les luttes sociales qui favorisent le changement, qu'il passe par la réforme ou la révolution. Mais ce n'est pas le cas. Le Brésil était, aux côtés de l'Afrique du Sud, le champion mondial des grèves dans les années 1980. Ce n'est plus le cas aujourd'hui.
Tous les principaux voisins du Brésil – l'Argentine (2001-2002), le Venezuela (2002), le Chili (2019), ainsi que le Pérou, l'Équateur et la Bolivie – ont connu des situations pré-révolutionnaires au cours de ce siècle. Ce n'est pas le cas du Brésil. Ce qui y a prévalu, c'est l'expérience du lulisme. Le PT a remporté cinq des six élections présidentielles depuis 2002. Il a fallu un renversement « institutionnel » du gouvernement de Dilma Rousseff pour ouvrir la voie à l'élection d'un néofasciste comme Bolsonaro. Il ne s'agit cependant pas d'un coup d'État « froid ». Les mobilisations entre 2015 et 2016 ont fait descendre des millions de personnes dans les rues en faveur de la destitution de Roussef et ont galvanisé une ultra-droite puissante, dont l'influence est intacte à ce jour.
Cette séquence a précipité un tournant réactionnaire, modifiant durablement le rapport de forces au sein de la société brésilienne, et ce, malgré la courte victoire de Lula en 2022. Et la situation pourrait empirer en 2026. Dans la principale ville du pays, un bouffon histrionique et néofasciste, Pablo Marçal, vient de s'imposer en 2024 comme une figure montante de l'extrême droite, porté par une ascension fulgurante. Une confirmation que le danger est bien réel et imminent. Personne ne peut sous-estimer la menace de son retour au pouvoir national.
Différentes hypothèses ont émergé pour expliquer ce paradoxe. Deux d'entre elles se distinguent par leur importance et contiennent chacune une part de vérité :
(a) la théorie ultra-objectiviste qui met en avant la puissance de la bourgeoisie brésilienne ;
(b) la théorie ultra-subjectiviste qui insiste symétriquement sur la fragilité de la conscience populaire.
Toutefois, cette approche est circulaire et donc insuffisante. Il est indéniable que la richesse et le pouvoir colossaux de la bourgeoisie brésilienne, alliés à son extrême conservatisme et à une remarquable intelligence stratégique, ont joué un rôle clé dans le maintien du statu quo et la neutralisation de la pression sociale en faveur du changement. Parallèlement, la classe ouvrière brésilienne, très hétérogène, souffre d'une faiblesse subjective qui limite ses capacités d'auto-organisation et d'unité. Cela explique à la fois son étonnante patience politique et ses illusions persistantes quant aux solutions concertées.
Mais un troisième facteur mérite d'être pris en compte : le rôle des classes moyennes.
Historiquement, la classe moyenne brésilienne est restée plus restreinte que son équivalente argentine. Pourtant, comme dans tous les pays urbanisés, elle constitue un rempart essentiel à la stabilité de la domination de la bourgeoisie. Elle se compose principalement des couches salariées supérieures qui ont bénéficié d'un accès à l'éducation plus élevé et qui partagent un mode de vie distinctif. Au Brésil, il n'y a pas de Noirs dans la classe dirigeante et très peu dans la classe moyenne. Le pays est profondément fracturé sur le plan racial, et la blancheur y confère un statut privilégié. C'est important.
De la dictature au premier gouvernement Lula
Le Brésil d'aujourd'hui a qualitativement changé par rapport à la fin des années 1970, mais son évolution a suivi une trajectoire distincte de celle de ses voisins. Tout au long de ce cycle historique, les rapports de force entre les classes ont connu de nombreuses oscillations, parfois favorables aux travailleurs et à leurs alliés, parfois défavorables. Pourtant, jamais une situation véritablement révolutionnaire ne s'est ouverte.
Voici un aperçu de la période qui a précédé la première élection de Lula. Ce qui importe ici, c'est qu'à chaque moment où une rupture semblait possible, elle a été évitée :
(a) 1978-1981 : Une montée des luttes ouvrières et étudiantes culmine avec les grandes grèves de l'ABC, mais la défaite du mouvement en 1981 conduit à une stabilisation fragile jusqu'en 1983. L'échec du plan de relance économique de Delfim Neto, qui devait stimuler les exportations par la dévaluation monétaire, aggrave l'inflation sans relancer la croissance.
(b) 1984 : Une nouvelle vague de mobilisation secoue le pays avec lacampagne Diretas Já, qui marque la fin de la dictature militaire. Pourtant, le gouvernement de João Figueiredo ne tombe pas.
(c) 1985-1986 : La prise de pouvoir par le tandem Tancredo/Sarney et le lancement du Plan Cruzado, permettent une brève stabilisation avant qu' un nouveau pic de mobilisation populaire contre l'hyperinflation, ne s'amorce, culminant avec l'élection présidentielle de 1989, où Lula atteint le second tour.
(d) 1992 : Après un court répit avec le plan Collor, le pays replonge dans la crise avec la montée du chômage et la persistance de l'hyperinflation. La contestation culmine avec la campagne Fora Collor (« dehors Collor ! »), qui entraîne sa destitution.
(e) 1994-1995 : L'investiture d'Itamar Franco et l'adoption du Plan Real ouvrent une période de stabilisation plus durable. Mais la défaite de la grève des travailleurs du pétrole en 1995 marque un tournant défavorable et le début d'une phase défensive pour les mouvements sociaux.
(f) 1995-1999 : Les luttes de résistance reprennent progressivement, atteignant un point culminant en août 1999 avec une manifestation de 100 000 personnes scandant « FHC dehors ! contre le gouvernement de Fernando Henrique Cardoso. Pourtant, l'attentisme des dirigeants du PT et de la CUT freine la radicalisation, leur priorité étant de construire une coalition électorale en vue de 2002, jugée incompatible avec un climat de confrontation sociale.
Durant tout cette période, le pays connait régulièrement des chocs ou des virages au sein du champ politique : en 1985, la dictature militaire prend fin mais ne s'effondre pas. Le premier président élu au suffrage universel en 1989, Fernando Collor, est destitué en 1992 après un jugement politique, mais sans élections anticipées. En 2011, Dilma Rousseff devient la première femme élue présidente par un parti de gauche, mais elle est renversée en 2016 sans que le PT ne soit interdit. Lula est emprisonné en 2018. La même année, le néofasciste Bolsonaro accède au pouvoir par les urnes, plongeant le pays dans une régression historique face à la pandémie, mais il ne tombe pas sous le coup d'une destitution.
Entre-temps, en juin 2013, une « explosion » sociale soudaine et imprévue secoue le pays. Mais cela n'a rien à voir avec le renversement de De La Rúa en Argentine en 2001-2002. De 2003 à juin 2013, sous les gouvernements de Lula et Dilma, le Brésil connaît une relative stabilisation sociale, portée par une croissance économique soutenue d'environ 4 % par an et la consolidation d'un filet de sécurité sociale. Jusqu'à ce qu'une vague de protestations populaires, aussi soudaine qu'intense, déferle sur tout le pays, rassemblant des millions de manifestants.
Ce soulèvement, comparable à une éruption volcanique, est pourtant stoppé dès le premier semestre 2014, avant la réélection de Dilma Rousseff. La véritable rupture survient entre mars 2015 et mars 2016, lorsque d'immenses mobilisations réactionnaires, majoritairement issues des classes moyennes et attisées par les accusations de corruption de l'opération Lava Jato, prennent une ampleur sans précédent. En quelques mois, des millions de Brésiliens descendent dans la rue pour soutenir un coup d'État juridico-parlementaire aboutissant à la destitution de Dilma Rousseff.
À ce moment-là, le cycle politique semble définitivement clos. Pourtant, il n'en est rien : le Brésil avance, lentement.
Ce cycle a représenté la dernière phase de la transformation tardive mais accélérée du Brésil agraire en une société urbaine ; la transition de la dictature militaire vers un régime démocratique-électoral ; et l'histoire de la genèse, de l'essor et de l'apogée de l'influence du pétisme, ensuite transfiguré en lulisme, sur les travailleurs. La classe dominante a réussi, à grands pas, à empêcher l'émergence d'une situation révolutionnaire au Brésil, comme celles vécues en Argentine, au Venezuela et en Bolivie, bien que, à plusieurs reprises, des circonstances propices aient vu le jour et auraient pu évoluer dans cette direction, mais ont été interrompues.
Une perspective historique peut nous aider à comprendre cela. L'élection en 2002 d'un président ouvrier dans un pays capitaliste semi-périphérique comme le Brésil a été un événement atypique. Du point de vue de la bourgeoisie, il s'agissait d'une anomalie, mais pas d'une surprise. Le PT n'inquiétait plus la classe dirigeante comme en 1989. Un bilan des treize années de gouvernement du PT semble irréfutable : le capitalisme brésilien n'a jamais été menacé par les gouvernements du PT. Mais cela n'a pas empêché l'ensemble de la classe dirigeante de s'unir en 2016 pour renverser Dilma Rousseff avec des accusations ridicules. Cette opération politique, une conspiration menée par le vice-président Michel Temer, révèle quelque chose d'importance stratégique sur la classe dirigeante brésilienne.
Les gouvernements du Parti des Travailleurs (PT) se sont inscrits dans une logique de collaboration de classe. S'ils ont mis en place certaines réformes progressistes, comme la réduction du chômage, l'augmentation du salaire minimum, le programme Bolsa Família ou encore l'expansion des universités et des instituts fédéraux, leur politique a surtout bénéficié aux plus riches. Jusqu'en 2011, ils ont maintenu intact le triptyque macroéconomique libéral, reposant sur un excédent primaire supérieur à 3 % du PIB, un taux de change flottant autour de 2 réais pour un dollar et un objectif de maîtrise de l'inflation sous la barre des 6,5 % par an. Dans un contexte international favorable, le silence de l'opposition bourgeoise et le soutien explicite des banquiers, des industriels, des grands propriétaires terriens et des investisseurs étrangers ne sauraient surprendre.
Lorsque l'impact de la crise internationale déclenchée en 2008 a frappé le Brésil en 2011-2012, le soutien inconditionnel de la classe dirigeante aux gouvernements du PT s'est effondré. La défaite d'Aécio Neves en 2014 ne laissa plus aucun doute : l'élite économique et politique choisit la voie du coup d'État. La dénonciation du « petrolão » par l'opération Lava Jato ne fut qu'un prétexte, un instrument au service de cette offensive. « L'œuf de serpent » du néofascisme était déjà là.
La manifestation dirigée par Jair Bolsonaro sur l'avenue Paulista le 7 septembre 2024 fut une nouvelle démonstration de force du néofascisme. Ce ne fut ni un fiasco, ni un simple faux pas. Pendant trois heures, sous un soleil accablant, environ 50 000 personnes ont scandé leur soutien à l'amnistie des auteurs du coup d'État et réclamé la destitution d'Alexandre de Moraes. Ils ont également acclamé Pablo Marçal, porté en triomphe par la foule.
Le marxisme est un réalisme révolutionnaire : il serait naïf et dangereux de minimiser l'ampleur de la radicalisation de l'extrême droite, une erreur récurrente et fatale de la majeure partie de la gauche brésilienne – qu'elle soit modérée ou radicale – depuis 2016. L'argument selon lequel il ne faut ni sous-estimer ni surestimer cette menace est une formule « élégante », mais fondamentalement escapiste. L'escapisme est une forme de déni. L'état de déni est une attitude défensive qui permet d'éviter d'affronter de front un danger immense. Il ne sert qu'à perdre du temps, en nourrissant l'illusion que l'on est en train de « gagner » du temps. Il existe un public de masse pour le discours du « contre tout ».
La radicalisation antisystème est d'extrême droite. Mais cet extrémisme n'est pas neutre, il est réactionnaire. L'attrait de l'hystérie antisystème de l'extrême droite ne peut pas être contesté par la gauche au Brésil. Un tel discours impliquerait de rompre avec le gouvernement Lula III et de passer dans l'opposition. Or, l'échec de cette stratégie est manifeste : les organisations qui ont tenté de radicaliser leur discours contre Lula sont restées invisibles.
Cet espace est inexistant parce que le rapport de forces social s'est profondément inversé. Nous sommes dans une situation de repli extrême, où la confiance des travailleurs dans leurs organisations et leur propre capacité de lutte est au plus bas. Les attentes se sont effondrées, et même parmi les secteurs les plus conscients et militants de la classe travailleuse, c'est l'appréhension qui domine. Nous sommes dans un rapport de forces défavorable.
Il ne s'agit pas d'une véritable polarisation sociale et politique. La polarisation n'existe que lorsque les deux camps principaux – le capital et le travail – disposent de forces relativement équivalentes. Le Brésil est fragmenté, mais croire que la victoire électorale de Lula, avec une marge de deux millions de voix sur 120 millions de votes valides, refléterait une équivalence des positions sociales de force relève d'une illusion dangereuse. Nous sommes sur la défensive, et dans ce contexte, l'unité de la gauche dans les luttes, y compris sur le plan électoral, est plus que jamais indispensable.
La situation reste défavorable
La gauche modérée a traversé une crise mondiale face à l'offensive de l'extrême droite : le travaillisme, le PS portugais et français, le PSOE, le Pasok, voire Syriza, le PT et le péronisme. Mais ce fut un processus partiel et conjoncturel, dont elle s'est relevée. Les masses s'appuient sur les outils dont elles disposent pour se défendre. Dans ce contexte, la gauche radicale peut occuper un espace, mais elle n'a pas à se replier sur le propagandisme. Elle peut démontrer son utilité en tant qu'instrument de lutte efficace dans le cadre du Front Unique, à condition d'accompagner, avec une patience révolutionnaire, le mouvement réel de résistance au néofascisme. L'unité de la gauche ne doit pas servir à museler les critiques légitimes sur les hésitations inutiles, les accords erronés, les décisions mal avisées ou les capitulations inexcusables. Cependant, l'ennemi central demeure le néofascisme.
Une stratégie d'opposition de gauche au gouvernement de Lula serait une erreur grave, à la fois dangereuse et stérile. La victoire électorale de Lula en 2022 fut un événement majeur, précisément parce qu'elle masquait une réalité bien plus inquiétante que ce que le résultat des urnes laissait entrevoir. D'ailleurs, cette victoire n'a été possible qu'avec le soutien d'une dissidence bourgeoise.
De nombreux facteurs expliquent le caractère réactionnaire de la situation. Parmi eux, la défaite historique de la restauration capitaliste entre 1989 et 1991 façonne le contexte actuel, car il n'existe plus de référence à une alternative utopique, comme le socialisme l'a été pendant trois générations.
La restructuration productive a progressivement imposé une accumulation de défaites et a également creusé des divisions au sein de la classe travailleuse. Les gouvernements dirigés par le PT entre 2003 et 2016 ne sont pas exempts de responsabilité, en raison d'une stratégie de collaboration de classe qui a limité les transformations à des réformes si minimalistes qu'il n'a pas été possible de mobiliser les masses pour défendre Dilma Rousseff au moment de sa destitution. Les défaites accumulées pèsent lourd. Nos adversaires sont à l'offensive.
Il est inutile de débattre de la question de savoir si la défaite électorale de Jair Bolsonaro aurait été possible sans Lula. Rappelons que la stratégie gagnante reposait sur un Lula « paix et amour » opposé au cabinet de la haine, tout en étant soutenu par Geraldo Alckmin. La victoire a été obtenue grâce à des tactiques ultra modérées. Cette évidence devrait nous guider dans l'évaluation réaliste des rapports de forces politiques.
Après deux ans de gouvernement, Lula est toujours au pouvoir, mais le pays demeure profondément fragmenté. Cela confirme que, si le rapport de forces s'est amélioré sur le plan politique depuis son élection, il n'y a pas encore eu de renversement sur le plan social :
(a) Les différentes enquêtes d'opinion confirment qu'environ la moitié de la population approuve le gouvernement, tandis que l'autre moitié le désapprouve, avec de légères variations. Les fluctuations sur le long terme restent dans les marges d'erreur. Il existe des divergences entre le soutien à Lula, qui atteint 47,4 % contre 45,9 %, et les 40 % qui déclarent désapprouver le gouvernement (contre 39 % en janvier). Ceux qui approuvent représentent 38 % (soit une baisse de 4 points de pourcentage par rapport au sondage précédent),tandis que plus de 18 % considèrent la gestion comme « passable ».
(b) L'action du gouvernement n'a pas réussi jusqu'à présent à diminuer l'influence de l'extrême droite, qui conserve une audience d'environ un tiers de la population.
(c) Le clivage socioculturel demeure inchangé.
Le bolsonarisme conserve une influence prépondérante parmi les classes moyennes gagnant plus de deux salaires minimums, dans le Sud et le Sud-Est du pays, ainsi que chez les évangéliques. À l'inverse, le lulisme reste dominant parmi les classes populaires, aux deux extrémités du spectre éducatif – chez les moins éduqués et les diplômés de l'enseignement supérieur –, ainsi que parmi les catholiques et dans le Nordeste. En somme, il n'y a que peu d'évolutions qualitatives.
Toutefois, ce constat ne saurait être interprété comme rassurant. Le gouvernement n'est pas plus solide, malgré le contraste abyssal avec l'ère Bolsonaro. Après un an de mandat, les fluctuations du soutien ou du rejet de Lula restent minimes, mais une tendance baissière plus marquée se profile en 2024. Ces évolutions ne découlent jamais d'un seul facteur. Dans un pays aussi inégalitaire, la conscience politique de dizaines de millions de personnes est influencée par de multiples dynamiques. Il n'est donc pas surprenant que les résultats les plus négatifs pour le gouvernement se concentrent – et de loin – parmi les personnes gagnant plus de trois fois le salaire minimum, ayant un niveau d'éducation intermédiaire, les hommes plus âgés, ainsi que dans les régions du Sud-Est et du Sud, et chez les évangéliques. En d'autres termes, l'électorat de Bolsonaro.
Par ailleurs, la force bolsonariste est redescendue dans la rue, avec des manifestations massives réclamant l'amnistie des putschistes, telles une avalanche néo-fasciste. Cette mobilisation pose un défi majeur. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas exclu que Bolsonaro soit arrêté en 2025.
La stratégie de Lula III
La voie de la lutte politique est sinueuse, parfois labyrinthique, jalonnée de virages, de hauts et de bas, sans jamais suivre une ligne droite. La plupart des dirigeants du PT ont misé sur l'usure du gouvernement d'extrême droite, convaincus que l'exaspération et la lassitude suffiraient à assurer la victoire de Lula en 2022. Ils ont fait le pari d'une patience stratégique. Lula a gagné, mais de justesse. Aujourd'hui, son gouvernement repose sur une autre hypothèse : celle que la « bonne gouvernance », en répondant à une partie des besoins urgents de la population à travers des « livraisons » et des réalisations concrètes, qui suffira pour consolider un second mandat en 2026.
Bolsonaro, lui, ne misera pas sur une tactique d'attente passive. Le bolsonarisme est un mouvement combatif. L'extrême droite comprend la « pathologie » de sa base sociale. Dans une société aussi inégalitaire, les privilèges matériels et sociaux ne se maintiennent que parce que ceux qui en bénéficient se battent avec acharnement pour les défendre. Elle sait exploiter l'arrogance d'une nouvelle génération bourgeoise à la tête de l'agro-industrie, nourrie d'un ressentiment socioculturel à l'égard des élites urbaines cosmopolites, qui les méprisent comme des brutes machistes et des négationnistes du changement climatique. Elle instrumentalise également l'amertume d'une partie des classes moyennes, gangrenée par le racisme, l'homophobie et le sentiment de déclassement. Elle s'appuie sur la méfiance anti-intellectuelle, savamment entretenue par les églises-entreprises néo-pentecôtistes.
Sans transformations profondes et tangibles dans la vie quotidienne – des salaires plus élevés, des emplois dignes, une éducation de qualité, un SUS (le régime brésilien de sécurité sociale) renforcé et un véritable accès à la propriété –, il est illusoire de croire que l'on pourra diviser cette base sociale. Vaincre le bolsonarisme exige une volonté de lutte, une capacité de manœuvre tactique, de l'audace pour opérer des virages stratégiques, une volonté de confrontations, ainsi qu'une constance et une patience calculée pour gagner du temps, avant d'opérer un nouveau tournant et d'évaluer les rapports de force. Mais jusqu'à présent, le gouvernement a surtout temporisé. Il a misé sur la « pacification » : un pas en avant, puis plusieurs pas en arrière. N'avons-nous rien appris de la défaite du péronisme en Argentine et du recul de Kamala Harris aux États-Unis ?
Radicalisation à droite sans polarisation
De nombreux observateurs à gauche décrivent cette évolution comme une tendance à la polarisation. L'idée est séduisante, mais elle est dangereusement trompeuse, car les deux pôles de la lutte des classes n'occupent pas des positions équivalentes. Dans le camp réactionnaire, ce sont les éléments les plus radicaux qui dirigent. Dans le camp de la gauche, ce sont les plus modérés qui gouvernent. L'extrême droite a absorbé l'influence des partis traditionnels de centre-droit (MDB, PSDB, União Brasil), mais le gouvernement de Lula n'est pas un gouvernement de gauche, puisqu'il a accepté un pacte avec la fraction libérale dirigée par Tebet/Alckmin.
Dans un contexte de stabilité du régime libéral-démocratique, la majorité de la population se positionne généralement au centre de l'échiquier politique, soutenant alternativement le centre-droit ou le centre-gauche, qui se succèdent à la tête de l'État. C'est ce qui s'est produit au Brésil depuis la fin de la dictature, avec trois gouvernements de centre-droit, suivis de quatre gouvernements du PT. C'est cette dynamique qui a assuré la plus longue période de stabilité du régime démocratique libéral, soit trente ans (1986-2016).
Cette période, que le marxisme considérait comme une hypothèse improbable dans les pays périphériques mais qui est devenue possible après la fin de l'URSS, est désormais révolue. L'un des plus grands défis pour la gauche est d'admettre cette réalité. Cependant, ce qui a suivi ne peut être expliqué par une polarisation. La polarisation suppose un renforcement simultané des extrêmes, or ce n'est pas ce que nous vivons au Brésil depuis 2016. Depuis le coup d'État institutionnel et l'inversion du rapport de forces social, seule l'extrême droite s'est radicalisée, exerçant une attraction gravitationnelle qui a entraîné avec elle l'influence historique des conservateurs traditionnels, à la manière d'un filet dérivant. Ce phénomène n'est pas une polarisation, mais un glissement unilatéral. L'idée de « polarisation asymétrique » peut sembler plus élégante, mais elle reste inexacte. À gauche, les positions sont restées stables et il n'y a pas eu de radicalisation. Au contraire, le gouvernement Lula se déplace vers le centre, abandonne toute mobilisation populaire et élargit sa coalition avec des partis de droite pour préserver sa majorité au Congrès. Cela crée une vulnérabilité critique : il suffirait d'une crise avec ses alliés pour que la menace néofasciste et son projet de subversion bonapartiste du régime deviennent une réalité imminente.
La clé de l'analyse est que la gauche est en position défensive. De nombreux facteurs expliquent la perplexité, la baisse des attentes et le climat d'insécurité au sein de sa base sociale. L'autorité de Lula reste forte, mais elle coexiste avec la peur et le découragement dans le mouvement ouvrier et syndical, après des années de revers et de défaites. La volonté de lutte est faible parmi les forces de gauche, voire inexistante.
La situation n'est guère différente dans les mouvements sociaux populaires. Depuis la campagne électorale de 2022, la capacité de mobilisation est restée faible. Ce phénomène s'explique en grande partie par la fragmentation des classes populaires. L'ascension sociale par l'éducation n'est plus garantie. Les travailleurs de la classe moyenne – plus éduqués, souvent d'origine européenne, avec des revenus légèrement plus élevés – voient leurs conditions de vie stagner, voire se détériorer, ce qui nourrit un ressentiment croissant envers ceux qui bénéficient des programmes de transfert monétaire.
Les tensions sociales et culturelles aggravent cette situation. Une partie des jeunes hommes perçoit les avancées féministes comme une menace directe. Par ailleurs, la phobie anti-LGBT+ s'est intensifiée dans les secteurs les plus conservateurs, attisée par la guerre idéologique et culturelle menée par les églises évangéliques. Dans ce contexte, les néo-fascistes exploitent un nationalisme exacerbé et accusent les mouvements écologistes qui défendent l'Amazonie d'être les instruments d'un complot international.
Les divisions ont des conséquences paralysantes. Le militantisme a transféré à Alexandre de Moraes la responsabilité de juger les auteurs du coup d'État, à commencer par Bolsonaro. Cependant, il serait injuste de ne pas souligner le rôle du gouvernement et de Lula lui-même dans la démobilisation. L'avant-garde cherche un point d'appui pour favoriser une issue politique plus avancée. Parmi tous les compromis concédés depuis l'investiture – et ils ont été nombreux –, aucun n'a été plus grave que l'attitude adoptée envers les Forces armées, même après que leur complicité avec le coup d'État ait été clairement établie.
La décision de ne pas saisir l'occasion du 60ᵉ anniversaire du coup d'État militaire de 1964 pour organiser une initiative de mobilisation et d'éducation politique de masse a été profondément démoralisante. L'erreur la plus grave que pourrait commettre la gauche serait de sous-estimer l'impact de cette contre-offensive des néofascistes. Si on ne les arrête pas, ils avanceront.
Réfléchir à l'avenir n'est possible que si nous comprenons d'où nous venons et ce que l'histoire nous a appris. Depuis 2016, lorsque le rapport de forces social a été structurellement bouleversé, cinq enseignements sont cruciaux :
(a) Après la victoire serrée contre Aécio Neves en 2014, le PT a fait le pari de la « gouvernabilité » en s'alliant avec une fraction de la classe dirigeante, notamment à travers la nomination de Joaquim Levy, au ministère des Finances. Ce choix a échoué et a abouti au coup d'État institutionnel de 2016, porté par d'immenses mobilisations réactionnaires. Le pari selon lequel les Tribunaux suprêmes ne valideraient pas le coup institutionnel orchestré via le Congrès national s'est également avéré vain.
(b) L'accumulation ininterrompue de défaites jusqu'à 2022 a laissé des séquelles profondes, encore non surmontées, sur le moral de la classe travailleuse et l'état d'esprit de la gauche militante. Parmi ces défaites : la démoralisation de l'opération Lava Jato, l'incarcération de Lula, la réforme du droit du travail, l'élection de Bolsonaro, une nouvelle réforme des retraites, la catastrophe humanitaire pendant la pandémie, ainsi que la recrudescence des incendies en Amazonie et dans le Cerrado.
(c) Minimiser le danger de l'extrême droite a été une erreur impardonnable. Le néofascisme n'est pas seulement un courant électoral, mais un mouvement socio-politique et culturel de masse, avec une dimension internationale. Il a conquis près de la moitié du pays non seulement par les urnes, mais aussi par l'occupation militante de l'espace public. De plus, il a déjà prouvé que Bolsonaro peut transférer ses votes à d'autres figures politiques.
(d) Une analyse complexe de la défaite électorale de Bolsonaro en 2022 doit prendre en compte de multiples facteurs. Cependant, il serait illusoire de nier que le rôle personnel de Lula a été décisif et qualitativement déterminant dans ce résultat.
(e) La victoire de Lula a modifié le rapport de forces politique, mais elle n'a pas suffi à inverser le rapport de forces social. C'est là le défi central qui reste à relever.
Contradictions sociales et politiques dans le Brésil de Lula
Cependant, ce cadre reste insuffisant pour analyser les divergences entre le rapport de forces social et politique. Trois questions fondamentales doivent être posées :
1/ La capacité d'initiative politique ne se limite pas aux mécanismes institutionnels de la lutte politique « professionnelle » au sein des instances du pouvoir. Le bolsonarisme conserve une force de mobilisation sociale bien plus importante que le lulisme dans la rue.
2/ Dans les sondages et lors des élections, chaque vote a le même poids, mais dans la lutte sociale et politique, ce qui prévaut, c'est la défense des intérêts des classes et des fractions de classes les plus organisées. Ce n'est pas la même chose que la gauche soit forte parmi la majorité du semi-prolétariat le plus pauvre, les jeunes, les Noirs et les femmes, alors que le bolsonarisme s'impose dans l'agro-industrie, parmi les couches moyennes des grands propriétaires terriens, les salariés gagnant entre 5 et 10 salaires minimums et les églises évangéliques. De même, il y a une différence entre le fait que la gauche soit bien implantée dans le Nordeste et que le bolsonarisme soit majoritaire dans le Sud-Est et le Sud du pays.
3/ Les principaux « bataillons » de la classe travailleuse organisée, notamment les travailleurs sous contrat formel dans le secteur privé et dans l'administration publique, restent profondément divisés. L'extrême droite a réussi à gagner du terrain au sein de certaines fractions de la classe ouvrière, ce qui fragilise le potentiel de mobilisation de la gauche.
Dans l'analyse de la situation, il est crucial de rappeler que la lutte des classes ne se réduit pas à une simple opposition entre le capital et le travail. Ni le capital ni le travail ne sont des classes homogènes ; il est impératif de considérer leurs fractions de classe.
La bourgeoisie se compose de plusieurs factions aux intérêts propres (agricoles, industriels, financiers), bien que fortement concentrés.
Le monde du travail, quant à lui, est marqué par des réalités distinctes : prolétariat, semi-prolétariat, salariés avec ou sans contrat, travailleurs du Sud ou du Nordeste. Les classes moyennes jouent un rôle crucial : la petite bourgeoisie et la nouvelle classe moyenne urbaine. La lutte des classes ne se limite pas uniquement à la « structure » de la vie économique et sociale. Elle se déroule également dans la superstructure de l'État, sous la forme d'affrontements entre les institutions du pouvoir : le gouvernement, le pouvoir législatif, la justice et les forces armées. Il existe un conflit permanent entre les Tribunaux suprêmes et l'armée, et dans une large mesure, contre le Congrès. Sous-estimer ces affrontements serait une grave erreur.
Tout comme une partie de la gauche modérée exagère l'importance des affrontements au sommet amplifiés par les organes de presse de la bourgeoisie, une frange de la gauche radicale sous-estime la lutte politique entre les représentants des différentes fractions de la classe dominante dans l'arène institutionnelle. C'est précisément le rôle du régime libéral-démocratique : permettre que ces divergences s'expriment et se résolvent publiquement. Le pari du gouvernement Lula sur une gouvernabilité “froide”, sans mobilisation active d'une base sociale, repose sur cette dynamique et répond à un calcul clair : éviter à tout prix une “vénézuélisation” du Brésil.
Aujourd'hui, sous la direction d'Arthur Lira, la Chambre des députés contrôle une part du budget plus importante que la plupart des ministères. Toutefois, ceux qui accordent une confiance excessive à l'issue de ces différends se trompent. Le sort de Bolsonaro ne dépend pas uniquement d'un jugement « technique ». Il se dirige vers une défaite juridique, mais il peut survivre politiquement tant que 40 % de la population estime qu'il est persécuté. Après le 8 janvier 2023, la question politique centrale est de savoir si Bolsonaro et les généraux seront condamnés et emprisonnés.
Une analyse marxiste doit commencer par l'étude des évolutions économiques. Depuis le début du mandat de Lula, trois variables majeures ont façonné la situation :
– La confirmation du maintien d'importantes entrées de capitaux étrangers, permettant une réduction du déficit de la balance des paiements et consolidant les attentes positives des investisseurs internationaux.
– Un excédent commercial atteignant des records historiques, entraînant une augmentation du niveau des réserves ainsi que des recettes fiscales.
– La poursuite de la croissance amorcée après la pandémie, qui s'est traduite par une baisse rapide du chômage, une hausse des salaires et une réduction de l'inflation, autant d'indicateurs positifs
Cependant, ces avancées restent insuffisantes pour réduire l'audience de l'extrême droite parmi les salariés diplômés de l'enseignement supérieur du Sud-Est et du Sud, qui gagnent entre 3 et 5 salaires minimums.
Les divisions au sein de la classe travailleuse n'ont donc pas été surmontées.
L'évaluation des fluctuations économiques doit suivre une méthode rigoureuse : tout ne peut être expliqué uniquement par l'économie. Quelles sont les conséquences des événements mondiaux, en particulier dans les pays ayant le plus d'impact sur la situation brésilienne ?
Parmi ces événements, certains ont fortement renforcé le moral du bolsonarisme : la victoire de Trump aux États-Unis ; l'élection de Javier Milei en Argentine ; l'ascension fulgurante de l'extrême droite au Portugal.
Quelles ont été les répercussions de ces évènements majeurs ? Le massacre israélien à Gaza et la dénonciation du génocide par Lula ; la sympathie pour la cause palestinienne qui semble avoir augmenté chez les partisans de Lula, mais le soutien au sionisme qui s'est également renforcé parmi les bolsonaristes ; l'épidémie de dengue la plus importante de l'histoire du Brésil ; les incendies criminels dans le Cerrado et l'Amazonie ; la recrudescence des féminicides ;L'opération criminelle de la Police militaire de São Paulo dans la Baixada Santista ; l'évasion de dirigeants du Comando Vermelho d'une prison de haute sécurité.
Tout aussi important : quel a été l'impact des « livraisons » du gouvernement Lula, le grand pari du Palais du Planalto ?
Trois scénarios possibles pour le Brésil
En ce début d'année 2025, l'avenir du gouvernement de coalition dirigé par Lula demeure incertain Mais la formule indéterminée selon laquelle « tout peut arriver » n'est pas raisonnable. Même si le gouvernement se trouve à la croisée des chemins, il est possible d'établir des projections probables.
Après l'échec du soulèvement du 8 janvier 2023 et le resserrement de l'étau autour du noyau dur de Bolsonaro, y compris l'état-major militaire, un nouveau coup de force insurrectionnel semble impensable. L'extrême droite a choisi une stratégie de repositionnement, visant à disputer l'élection présidentielle de 2026. Le calendrier électoral structure désormais la lutte politique.
Trois grands scénarios se dessinent pour le Brésil, même s'il est encore impossible de trancher :
1/ Le gouvernement pourrait arriver en 2026 avec une popularité suffisante, comme Lula en 2006 et 2010, et remporter la réélection.
2/ Le gouvernement pourrait arriver en 2026 dans une position incertaine, comme Dilma Rousseff en 2014, rendant l'issue électorale imprévisible.
3/ La gauche pourrait atteindre 2026 usée, rejetée par une grande partie de l'opinion, comme ce fut le cas pour Fernando Haddad en 2018, ouvrant la voie à la victoire de l'extrême droite.
Bien entendu, le facteur Forrest Gump – “shit happens” – doit toujours être pris en compte. L'aléatoire, l'accidentel et l'inattendu font partie de l'histoire. Deux ans, c'est long : demain ne sera pas forcément une simple continuation d'aujourd'hui.
Nous ne pouvons pas prédire les transformations de la situation mondiale d'ici 2026, ni les fluctuations économiques, ni les luttes idéologiques et culturelles, ni les dynamiques de mobilisation des différentes classes sociales et fractions de classe. Sans parler des trahisons, des scandales, des manœuvres politiques et des revirements des partis et des dirigeants qui jalonneront inévitablement les prochains mois.
Cela étant dit, le scénario le plus probable reste le déroulement normal du calendrier électoral.
1/ Premier scénario : Lula est réélu.
2/ Deuxième scénario : Bolsonaro revient au pouvoir par les urnes.
3/ Troisième scénario : une alternative imprévisible émerge.
Ce troisième scénario est le plus incertain et déstabilisant. Que se passe-t-il si ni Bolsonaro ni Lula ne peuvent se présenter ?
Si, finalement et malheureusement, Lula ne peut pas se présenter, le candidat le plus probable serait Haddad. Il ne fait aucun doute que sa popularité est nettement inférieure à celle de Lula.
Réfléchir à l'avenir implique de s'interroger sur le rôle des individus dans l'histoire. Les trois scénarios envisagés – Lula favori, une élection disputée ou un retour en force de l'extrême droite – dépendent d'un tel nombre de facteurs qu'il est impossible de calculer des probabilités précises à l'avance.
Une analyse marxiste ne doit pas perdre de vue le sens de la mesure. Les dirigeants représentent des forces sociales. Cependant, minimiser le rôle spécifique de Bolsonaro serait une superficialité impardonnable : sa présence change la donne.
L'extrême droite serait-elle devenue un mouvement politique, social et culturel avec une influence de masse, même sans Bolsonaro, après 2016 ? Il s'agit d'une conjecture contrefactuelle, mais l'hypothèse la plus probable est que oui.
Le néofascisme est un courant international. C'est une dynamique internationale qui a porté Donald Trump aux États-Unis, Marine Le Pen en France, Giorgia Meloni en Italie, Santiago Abascal en Espagne, André Ventura au Portugal et Javier Milei en Argentine Leur ascension simultanée n'est pas une coïncidence.
Les conditions objectives ont poussé une fraction de la classe dirigeante à adopter une stratégie libérale de choc frontal. Mais la forme concrète qu'a prise le néofascisme dépendait beaucoup du charisme de Bolsonaro. Bolsonaro est grossier, brutal et intempestif, mais ce n'est pas un imbécile. Un imbécile ne devient pas président dans un pays complexe comme le Brésil. Bolsonaro n'a pas beaucoup d'éducation ou de répertoire intellectuel, mais il est intelligent, rusé, manipulateur et sournois. Aucun autre énergumène n'aurait pu atteindre et conserver une position de leadership aussi centrale, malgré les innombrables accusations qui pèsent contre lui : mépris pour la vie de millions de personnes pendant la pandémie, appropriation illégale de bijoux présidentiels, complot militaire en vue d'un coup d'État, etc.
La clé de son influence réside dans son charisme déroutant, capable de susciter une identification passionnée chez ses partisans. Il a su fédérer des intérêts de la fraction bourgeoise de l'agro-industrie, des négationnistes du réchauffement climatique, avec le ressentiment des militaires et de la police ; le ressentiment des classes moyennes avec la méfiance populaire manipulée par les églises-entreprises néo-pentecôtistes ; la nostalgie réactionnaire de la dictature militaire avec le sexisme, le racisme et l'homophobie.
Il n'avait pas besoin de la chevelure en bataille et de la rhétorique anarcho-capitalisme anti-caste de Milei, ni du national-impérialisme xénophobe de Trump, ni de la rage islamophobe de Le Pen.
S'il était condamné et emprisonné, son autorité serait diminuée.
Cela devrait être au cœur de la tactique de la gauche :
– Aucune amnistie.
– Sanctions pour tous les putschistes.
– Prison pour Bolsonaro.
*
Valerio Arcary est historien

Brésil : Élections 2026

L'étude qui a mis les financiers en émoi a été réalisée par un gestionnaire de fonds qui compte parmi ses partenaires un membre du conseil d'administration d'Equatorial, le groupe qui a racheté Sabesp* lors de la privatisation douteuse menée par Tarcísio.
Faria Lima aposta em evangélicos para derrotar Lula : voto conservador e à direita | Revista Fórum
18 février 2025
Tout en alimentant le jeu spéculatif sur le marché, banquiers et cadres du système financier parient sur le fait que l'électorat évangélique battra Lula et portera au pouvoir un gouvernement de droite - excluant totalement l'usé Jair Bolsonaro (PL) - en 2026.
Ce pronostic, qui a fait bondir Faria Lima (l'équivalent de "Wall Street" pour le Brésil), a été émis par le gestionnaire de fonds Mar Asset, dirigé par Bruno Coutinho (ex-BTG Pacutal, propriété de Paulo Guedes, Ministre de l'économie de Bolsonaro.), Philippe Perdigão (ex-Oportunitty, propriété de Daniel Dantas) et Luis Moura (ex-3G Capital, propriété du groupe Lemman).
« Notre perception repose sur deux piliers. Nous voyons une inflexion cyclique de l'économie, résultat d'un cycle économique épuisé et la perspective d'une détérioration dans les années à venir. En même temps, nous identifions un changement structurel dans la société brésilienne, marqué par la croissance de la population évangélique, qui a influencé un changement dans le profil du vote moyen vers le conservatisme et a déplacé le pendule politique brésilien vers la droite », indique l'analyse.
Ensuite, les financiers admettent que, sous Lula, « la croissance du PIB a surpris les marchés de manière significative, le chômage a atteint des niveaux historiquement bas et l'inflation s'est maintenue à un niveau historiquement bas ».
« Le tableau de la fin 2024, bien résumé par le fameux indice de misère - qui est la somme de l'inflation et du taux de chômage - aux niveaux les plus bas de notre histoire, reflète exactement ce que le gouvernement a voulu réaliser », ajoute-t-il, soulignant toutefois que le problème est structurel »puisque, bien que l'indice de misère soit au niveau le plus bas de son histoire, son effet positif sur la popularité présidentielle a été décevant. »
Coopté par l'ultra-droite
Le problème « structurel » évoqué par les financiers est précisément le créneau électoral évangélique.
Une étude Latam Pulse, réalisée en partenariat avec Atlas et Bloomberg et publiée la semaine dernière, révèle que la chute du taux d'approbation de Lula est directement liée au rejet de l'électorat évangélique, qui a été coopté par l'ultra-droite et désapprouve actuellement à 80,1 % le travail du président, selon l'étude.
« Nous pensons que l'idée évangélique qui représente le mieux le moment social du Brésil est la Théologie de la Prospérité. Elle associe la foi en Dieu à la réussite matérielle, à la santé et au bien-être physique et émotionnel. Cette idée souligne que le succès professionnel fait partie du voyage spirituel et que sa progression est une bénédiction de Dieu pour le bon croyant, ce qui affaiblit le lien entre l'amélioration de la vie personnelle et le gouvernement actuel », indique l'analyse de Mar Asset.
Dans la pratique, cette thèse est illustrée par l'alliance entre Pablo Marçal (PRTB) et sa méritocratie de « coaching » avec l'électorat évangélique et la théologie de la prospérité. L'« ex-entraîneur » a mené une grande partie de la course à la mairie de São Paulo parmi les évangéliques et n'a perdu son soutien qu'après l'entrée en lice de Silas Malafaia, qui a dirigé un bataillon de pasteurs pour faire passer les votes à Ricardo Nunes (MDB).
Dans son étude, Mar Asset montre une détérioration du vote évangélique à gauche, tant au niveau municipal qu'aux élections présidentielles, en particulier depuis 2014, lorsque Dilma Rousseff (PT) a battu Aécio Neves (PSDB) « avec environ 55 % du vote non évangélique et 50 % du vote évangélique ».
« Lors des élections présidentielles de 2018, qui ont vu la victoire de Bolsonaro, le PT, par l'intermédiaire de Fernando Haddad, a obtenu encore plus de voix parmi les non-évangéliques, mais seulement 31 % des voix parmi les évangéliques. Lors des élections de 2022, qui ont scellé la victoire de Lula avec la plus petite marge de notre histoire, la conversion de l'électorat évangélique au candidat du PT s'est maintenue aux mêmes 31 % obtenus par Fernando Haddad en 2018. Cependant, parmi les non-évangéliques, Lula a obtenu un impressionnant 60 % des voix, ce qui a été décisif pour garantir sa courte victoire », indique le texte.
« Les élections présidentielles de 2022 ont été marquées par un fort rejet du président Bolsonaro. Malgré cela, nous avons vu l'inclinaison à droite de l'électorat s'exprimer lors des élections des gouverneurs et des mandats législatifs tels que les députés fédéraux et les députés d'État. Les récentes élections municipales de 2024 ont approfondi le mouvement de droite observé depuis 2016, indiquant une fois de plus la tendance à la victoire d'un candidat présidentiel conservateur en 2026 », ajoute-t-il.
Dans leur analyse, les économistes affirment que « le meilleur moment économique du mandat actuel est passé » et que le facteur évangélique pèsera en faveur de la droite dans le balancier électoral en 2026.
« En résumé, la situation économique est un facteur de difficulté important pour les perspectives politiques du gouvernement actuel. Parallèlement, la croissance forte et continue de la population évangélique produit un mouvement structurel de droite dans la société brésilienne. Il s'agit de deux vecteurs puissants qui convergent dans la même direction politique : une plus grande difficulté pour une candidature du PT en 2026 », affirment les financiers.
« Cette combinaison, à notre avis, rend la probabilité de la réélection du président Lula minoritaire, ce qui devrait être anticipé par les marchés à un moment donné en 2025 », dit le texte, appelant à la guerre des banquiers contre Lula dès 2025.
Enfin, les FariaLimer signalent que les paris sur Tarcísio sont ouverts, étant donné qu'ils ont déjà mis Bolsonaro sur la touche et qu'ils veulent « saigner » Lula plus tard cette année.
« Dans le scénario idéal, l'anticipation d'une amélioration passerait par l'indication que ni Lula ni Bolsonaro ne participeraient aux prochaines élections. Un renouvellement générationnel en politique, avec des candidats plus modérés des deux côtés du spectre, aurait un énorme potentiel pour l'évolution institutionnelle du pays », conclut l'étude.
*NDLR : La Sabesp est la compagnie privée à laquelle le gouverneur de l'État de Sao Paulo, le bolsonariste Tarcisio Gomes de Freitas, a confié le traitement des eaux de l'État. Depuis, les tarifs ont monté et le service a diminué, ce qui a eu des conséquences désastreuses à plusieurs occasions.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La réaction du président colombien Gustavo Petro à Trump : gaffe monumentale ou exemple à suivre ?

Nous assistons, de jour en jour, à une déclaration fracassante après l'autre de Trump. Faire du Canada le 51ième état de son pays, prendre de force le Canal de Panama et le Groenland, imposer des droits de douane chocs à ses principaux partenaires commerciaux, expulser les immigrants, perçus comme violeurs et criminels, et les renvoyer, souvent mains menottés et pieds attachés, à leur pays d'origine, etc.
Le rythme de ses sorties et gestes est étourdissant !
Le 18 février, Trump organise une rencontre en Arabie Saoudite de hauts placés de son administration et de celle de la Russie pour discuter d'un plan de paix possible en Ukraine.
Ni l'Ukraine ni l'Union européenne ne sont invités, ce qui, peu étonnamment, les indisposent carrément. Lorsqu'ils dénoncent cela, Trump réagit selon son style habituel – au diable les faits, j'invente un récit pour me justifier !
Aujourd'hui, je les ai entendu se plaindre... Nous n'avons pas été invités. Eh bien, cela fait trois ans que vous êtes là, vous auriez dû y mettre fin... Vous n'auriez jamais dû commencer la guerre. Vous auriez pu conclure un accord.
Zelenski réagit en affirmant que le président américain, qu'il respecte, adhère à la bulle de désinformation que lui transmet la Russie.
Zelenski, dont la cote de popularité ne dépasse pas 4 %, est un dictateur qui refuse d'organiser des élections, riposte l'empereur froissé qu'est Trump. La seule chose que Zelenski sait faire, c'est manipuler habilement Biden pour que l'argent américain coule à flot vers l'Ukraine !
Face à ce comportement d'intimidation constante de Trump, qui provoque des bouleversements internationaux géopolitiques tectoniques, de nombreux dirigeants en Europe en ce moment, voire dans de nombreuses parties du monde, se demandent comment réagir. Doivent-ils se contenter de constamment faire une génuflexion devant l'empire, ou doivent-ils, comme le faisait le président colombien Gustavo Petro le 26 janvier dernier, réagir rapidement et de manière percutante ?
Lettre à Donald Trump posté sur X, anciennement Twitter, par le président colombien Gustavo Petro
En pleine campagne d'expulsion, Trump envoie à Colombie, le 26 janvier dernier, deux avions militaires américains remplis d'immigrants colombiens.
Ces derniers sont qualifiés de violeurs, criminels, etc., et sont traités comme du bétail, plusieurs ayant pieds et mains menottés.
Carrément indigné devant autant de racisme flagrant, le président colombien Gustavo Petro pose un geste inédit : il refuse de permettre aux deux avions militaires d'atterrir dans son pays.
Froissé par ce manque de respect envers l'empereur, Trump réagit en menaçant d'imposer des droits de douane de 25% à tout produit provenant de la Colombie, et d'augmenter ces droits à 50% une semaine plus tard si nécessaire.
Le président colombien Gustavo Petro, ancien guérillero et ex-maire de Bogota, prend sa plume et écrit une lettre percutante à Trump dans laquelle il dénonce le racisme et l'impérialisme du président américain, et annonce qu'il va riposter du tic au tac en imposant aux produits provenant des Etats-Unis des droits de douane similaires.
On sait que Petro, dans les heures qui suivirent, a vite fait volte-face et est arrivé à un accord avec Trump. Et on sait aussi que de nombreux observateurs estiment que sa lettre, rédigée de façon spontanée et avec colère, fut une gaffe diplomatique monumentale qui ne pouvait que nuire aux intérêts de la Colombie.
Cependant, cette lettre a néanmoins eu un énorme succès en Colombie et dans toute l'Amérique Latine.
Lectrices et lecteurs pourront juger si, à leur avis, cette lettre de Petro, que je reproduis ci-dessous, représente une gaffe diplomatique monumentale ou ne représente pas plutôt un exemple que pourraient et devraient suivre d'autres leaders lorsqu'ils se voient grossièrement intimidés par Trump.
Trump, je n'aime pas trop voyager aux États-Unis, c'est un peu ennuyeux. Mais j'avoue qu'il y a des choses louables. J'aime aller dans les quartiers noirs de Washington, où j'ai vu une bagarre entre noirs et latinos avec des barricades. Ce qui me semblait absurde, parce qu'ils devraient s'unir ensemble.
J'avoue que j'aime bien Walt Whitman, Paul Simon, Noam Chomsky et Henry Miller.
J'avoue que Sacco et Vanzetti, qui ont mon sang, sont mémorables dans l'histoire des USA et je les suis. Ils ont été condamnés à la chaise électrique, assassinés par les dirigeants fascistes qu'il y a aux USA, comme d'ailleurs dans mon pays.
Je n'aime pas votre pétrole, Trump. Vous allez anéantir l'espèce humaine à cause de votre avidité. Peut-être qu'un jour, autour d'un verre de whisky, que j'accepterais malgré ma gastrite, on pourra en parler franchement. Mais c'est difficile car vous me considérez comme étant d'une race inférieure. Ce que je ne suis pas, ni aucun colombien.
Si vous voulez faire affaire avec quelqu'un qui est têtu, c'est bel et bien moi. Point final. Vous pouvez essayer de réaliser un coup d'État contre moi, avec votre force économique et votre arrogance. Comme vous l'avez fait avec Salvador Allende au Chili. Mais je mourrai sans peur. J'ai déjà résisté à la torture et je vous résisterai.
Je ne veux pas d'esclavagistes comme voisins de la Colombie. On en a eu beaucoup et on s'en est libérés. Ce que je veux, comme voisins de la Colombie, ce sont des amoureux de la liberté. Si vous ne pouvez pas m'accompagner dans cette voie, nous vous laisserons tomber.
La Colombie est le cœur du monde et vous n'avez pas compris que, c'est la terre des papillons jaunes, de la beauté des Remedios, mais aussi des Aureliano Buendía (résistant du roman de "Cent ans de solitude" de Federico Garcia Marquez, figurant un personnage qui se lève contre l'oppression), dont je suis l'un des représentants, comme tous les colombiens.
Vous allez peut-être me tuer, mais je survivrai dans mon peuple, qui existait avant le vôtre, en Amérique. Nous sommes des peuples des vents, des montagnes, de la mer des Caraïbes et de la liberté.
Vous n'aimez pas notre liberté ?! OK, je ne vous serre pas la main car je ne serre pas la main des esclavagistes blancs. Je serre la main des héritiers libertaires blancs d'Abraham Lincoln et des fermiers noirs et blancs des États-Unis. Sur les tombes desquels j'ai pleuré et prié, sur un champ de bataille que j'ai atteint après avoir parcouru les montagnes de la Toscane italienne et après avoir été sauvé du Covid.
Ce sont eux, les vrais représentants des États-Unis et devant eux je m'agenouille, mais devant personne d'autre.
Renversez-moi, Président Trump. Les Amériques, toutes entières, et l'humanité vous répondront.
La Colombie arrête maintenant de regarder vers le nord (ndr/ Les États-Unis), et regardera vers le monde.
Notre sang vient de loin avec une longue histoire, du sang du califat de Cordoue, des latins romains, de la méditerranée, de la civilisation de cette époque, qui a fondé la République, la Démocratie à Athènes. Notre sang vient de la Résistance des noirs. Ces combattants sont devenus esclaves de votre fait. Mais la Colombie a été le premier territoire libre de l'Amérique, bien avant George Washington, de toute l'Amérique. Je me réfugie dans ses chants africains.
Ma terre est composée d'orfèvres qui travaillaient au temps des pharaons égyptiens et des premiers artistes au monde à Chiribiquete.
Vous ne nous gouvernerez jamais.
Le guerrier qui a chevauché nos terres en clamant la Liberté s'appelle Bolivar et s'oppose à vous.
Notre peuple est un peu craintif, un peu timide. Il est naïf et gentil, aimant, mais il saura comment gagner le Canal de Panama, que vous nous avez pris avec violence. Deux cents héros de toute l'Amérique latine se trouvent à Bocas del Toro, le Panama d'aujourd'hui, anciennement Colombie, que vous avez assassiné.
Je lève un drapeau. Et, comme l'a dit Jorge Eliécer Gaitán, même s'il reste seul, il continuera d'être hissé avec la dignité latino-américaine qui est la dignité de l'Amérique. Ce que votre arrière-grand-père ne connaissait pas, le mien le connaissait, monsieur le président.
Votre blocus ne me fait pas peur, car la Colombie, en plus d'être le pays de la beauté, est le cœur du monde. Je sais que vous aimez la beauté comme moi. Ne lui manquez pas de respect et donnez-lui votre douceur.
A partir d'aujourd'hui, la Colombie est ouverte au monde entier, avec les bras ouverts. Nous sommes des bâtisseurs de liberté, de vie et d'humain.
On m'informe que vous imposez un tarif de 50% sur les fruits de notre travail humain pour entrer aux États-Unis. Je fais de même : 50% sur tous vos produits.
Notre peuple plantera du maïs en Colombie et nous nourrirons le monde.
Gustavo Petro, président de la République de Colombie
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
Sans virus.www.avast.com

Les deux gauches chiliennes

Commentaire du traducteur, Ovide Bastien, auteur de Chili : le coup divin (1974)
Dans La montée de la droite, le Canada, le Québec et la classe ouvrière, André Frappier décrit la conjoncture actuelle au Canada, marquée par la crise que nous vivons à la suite de la guerre commerciale que vient de déclencher le nouvel élu à la Maison Blanche Donald Trump. Tous les partis politiques au fédéral, sauf le NPD, adoptent diverses versions du néolibéralisme, ce qui ne peut que nuire à la classe ouvrière et accentuer la crise environnementale, dit-il. Et voter pour le NPD revêt peu d'importance, l'urgence politique du moment, comme le rappelait récemment Françoise David, étant de déclencher une vaste mobilisation anticapitaliste, en étroite collaboration avec la gauche anticapitaliste à travers le monde.
Le Chilien Juan Pablo Cárdenas*, renommé journalise et professeur d'université, décrit la conjoncture actuelle au Chili. Comme Frappier, il souligne qu'aucun parti politique se consacre aux intérêts concrets et quotidiens de la majorité de la population, même, selon lui, les deux gauches chiliennes.
Une première gauche, affirme Cárdenas, n'hésite pas, dans sa soif du pouvoir, à épouser le néolibéralisme qu'imposait, pendant presque 17 ans, la dictature Pinochet. Elle ne perçoit plus les Etats-Unis comme pouvoir impérialiste, et fait comme si le néolibéralisme, amélioré ici et là grâce à quelques petites retouches, pourrait mener à un Chili plus juste et égalitaire.
Une deuxième gauche plus radicale, celle-ci non au pouvoir, n'hésite pas à appuyer un régime aussi dégueulasse que celui de Daniel Ortega et Rosario Murillo au Nicaragua, poursuit Cárdenas. Elle a tendance à se diviser en factions différentes, et passe son temps à faire des déclarations fracassantes au sujet de toutes sortes de causes de solidarité internationale, profitant des sous que lui fournit d'hypocrites entités mondiales du progressisme pour séjourner souvent à l'étranger.
Ce que ces deux gauches ont en commun, affirme Cárdenas, c'est qu'elles constituent une caste politique. Une caste qui s'inquiète davantage que Donald Trump ne l'empêche de continuer à prendre des vacances à Miami, que d'aider Chiliens et Chiliennes à prendre conscience des racines des injustices dont ils et elles souffrent dans leur vie quotidienne, et à se mobiliser pour éliminer celles-ci.
Les deux gauches chiliennes
Article paru dans Pressenza, le 17 février 2025
IL EXISTE DEUX TYPES DE GAUCHE AU CHILI : la gauche qui a une vocation au pouvoir et la gauche qui n'en a pas. Cette dichotomie a été particulièrement évidente au cours des dernières décennies. Salvador Allende, certainement le principal leader du progressisme chilien, était un mélange de ces deux expressions. Il ne fait aucun doute qu'il a eu très tôt (comme il l'avait promis à sa mère) la volonté de fer de devenir président de la République, mais tout indique qu'il a été l'un de ces gauchistes qui n'ont jamais accommodé leurs positions, et encore moins les ont-ils abandonnées lorsqu'ils sont arrivés à La Moneda.
On peut dire beaucoup de choses sur Allende et pas mal d'entre elles ont été utilisées pour l'étiqueter. Cependant, depuis sa formation universitaire jusqu'à sa mort, il a témoigné de sa fidélité à ses idées et s'est efforcé d'apporter des changements dans l'esprit d'une véritable révolution. Un mot qui n'a suscité ni scandale ni étonnement à l'époque, mais qui a fait peur à la droite et aux éclectiques habituels qui se sont unis et mobilisés pour le renverser.
Il existe une forme de gauchisme pour laquelle le plus important est d'arriver au pouvoir. Quel qu'en soit le prix, même si c'est aux mains de ceux qui les ont combattus, emprisonnés ou exilés. Désertant les convictions qu'ils ont proclamées dans la rue, au sein de leurs partis, de leurs syndicats ou au cœur des organisations populaires.
Faisant toujours appel au « réalisme », même pour cogouverner avec la droite, pour être en paix avec les milieux d'affaires et, dans les affaires internationales, pour abjurer les régimes mis hors la loi par les Etats-Unis, pays qu'ils ne qualifient plus d'impérialiste. Des gens vraiment soucieux d'obtenir un spot télévisé, un espace dans la presse, oubliant d'avoir accroché, par le passé, sur la façade de la Pontificia Universidad Católica une immense banderole où l'on pouvait lire « Chileno, El Mercurio Miente » (Chilien, El Mercurio ment).
Dans leur soif de pouvoir défilent le Mapu, les gauches chrétiennes et d'autres confessions, composées de ceux qui ont poussé Allende à prendre des mesures plus radicales que celles qu'il a pu entreprendre. Ivres de leurs querelles personnelles, ils ont même divisé le parti du président défunt en quatorze factions. Ils ont ensuite proclamé un socialisme « renouvelé », le PPD instrumental, ou l'adhésion à la Concertación Democrática avec leurs anciens adversaires.
Pour l'essentiel, leur intention était désormais d'estomper leurs propositions les plus radicales et, bien entendu, de convaincre la droite, les hommes d'affaires et le Département d'État américain qu'ils étaient « recyclés » et qu'ils pouvaient parfaitement prendre la relève de Patricio Aylwin et d'Eduardo Frei Ruiz Tagle en tant que ministres. Ils sont même parvenus à désigner Ricardo Lagos et Michelle Bachelet comme des figures progressistes, alors que selon plusieurs, comme l'ancien sénateur socialiste Carlos Altamirano, ces deux gouvernements se sont révélés être les meilleures administrations de la droite.
Au pouvoir, ils ne doutaient plus que le régime néolibéral, la création des AFP (Note du traducteur : Système de pension privé), des ISAPRES (Note du traducteur : Système de santé privatisé), des Universités privées à but lucratif, et autres absurdités pouvaient nous conduire à une société plus égalitaire, plus juste et à une politique de probité. Car parmi les nouvelles générations qui ont porté Boric au pouvoir, il y avait supposément des gens de « « supériorité morale », sans inclinaison à se remplir les poches en ayant recours à la fraude fiscale. Même si, quelques mois plus tard, le plus grand scandale de fraude fiscale des gouvernements post-dictature a été mis au jour, comme l'affaire des « convenios », qui fait actuellement l'objet d'une enquête judiciaire. Peu étonnamment, une enquête qui se réalise avec une lenteur telle que ses conclusions inévitables ne puissent affecter négativement leurs chances d'être réélu lors des prochaines élections.
Pendant ce temps, l'autre gauche, celle qui évite le pouvoir, continue dans son constant élan à la division, à se peupler de références et à adopter les causes les plus répugnantes, comme la défense de la dynastie sandiniste, et à peupler le Chili de toutes sortes de déclarations en faveur de causes mondiales si éloignées qu'elles ne peuvent guère donner lieu à une véritable solidarité nationale. Ceci, alors que les gens au Chili, aujourd'hui, connaissent peu de géographie, de mouvements de libération et de tout l'attirail inventé par ceux et celles qui veulent continuer à parcourir le monde grâce aux sous que leur donnent des entités mondiales hypocrites du progressisme. Cette gauche assiste, le poing serré, à tous les événements internationaux et, au Chili, elle ne fait rien ou presque pour que le peuple, ce peuple qu'elle dit tant aimé, prenne conscience de la manière dont il est trompé et désenchanté au quotidien. Au lieu de l'encourager à se rebeller contre l'injustice et l'iniquité flagrantes sur l'ensemble de notre long et étroit territoire chilien.
Pour la même raison, il est déjà à craindre qu'une fois de plus, tout ce nombre profus de gauchistes sans vocation pour le pouvoir n'aura pas le temps et l'unité nécessaires pour concourir aux prochaines élections présidentielles et parlementaires. Même après le jeu de rôle du Frente Amplio et de Boric dans La Moneda. Après avoir averti avec tant de colère le président Piñera qu'il serait traduit en justice pour les crimes commis lors du dernier soulèvement social.
Renoncer à une véritable réforme des retraites, trembler devant la possibilité que Trump supprime le visa leur permettant de séjourner à Miami, ainsi que dans d'autres grandes villes. C'est là que beaucoup de nos hauts fonctionnaires passent leurs vacances.
Ils sont désespérément prêts à faire l'impossible pour que Mme Bachelet se présente pour un troisième mandat présidentiel et ne laisse pas transparaître le chaos et l'absence d'alternatives et de leadership de la gauche au pouvoir. Se moquant une fois de plus de notre pauvre démocratie, dont l'alternance tant vantée reste réservée à la seule caste politique.
*Juan Pablo Cárdenas Squella est un journaliste et professeur d'université de grande expérience. En 2005, il a reçu le Prix national du journalisme et, auparavant, la Pluma de Oro de la libertad, décernée par la Fédération mondiale de la presse. Il a également reçu le Prix du journalisme latino-américain, la Houten Camara de Hollande (1989) et de nombreuses autres distinctions nationales et étrangères. Il est l'un des soixante journalistes au monde considérés comme des Héros de la liberté d'expression, un prix décerné par la Fédération internationale des journalistes. Il a été directeur et chroniqueur des revues Debate Universitario, Análisis et Los Tiempos, ainsi que du journal électronique primeralínea.cl. Il a également été directeur de Radio Universidad de Chile et de son journal numérique pendant plus de 18 ans. Il a enseigné dans plusieurs écoles de journalisme à Santiago et à Valparaíso et a été professeur titulaire et sénateur à l'Université du Chili.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Les projets d’énergies fossiles au Québec constituent « des mirages », selon 100 organisations et représentant-e-s

100 organisations et intervenant-e-s de la société civile rappellent que le contexte ne s'est jamais aussi mal prêté à des projets de transport d'énergies fossiles, une proposition qui est revenue dans l'actualité dans la foulée du conflit économique avec les États-Unis. Ils soulignent que la transition socioécologique est la voie à suivre, tant pour assurer la prospérité économique du Québec que pour lutter contre les changements climatiques.
En conférence de presse, ils ont qualifié de « mirages » et de « bulle politique et médiatique » les récentes discussions proposant de relancer des projets liés au transport d'énergies fossiles sur le territoire québécois.
« Ce genre de projets, que ce soit GNL Québec ou Énergie Est, étaient déjà dépassés lors de leur rejet en 2015 et 2021. Imaginez maintenant ! La demande pour le gaz fossile en Europe chute et les investisseurs ne sont pas au rendez-vous. Et même si ces projets étaient levés de terre dans plusieurs années, la transition énergétique se serait poursuivie et on se retrouverait avec des infrastructures superflues et coûteuses », affirment les signataires.
« Le Québec n'a pas à compromettre l'intégrité de son territoire, la santé de son environnement et de ses habitant·es pour permettre à l'industrie pétrogazière d'écouler ses hydrocarbures… tout ça pour tenter de répondre à un enjeu économique temporaire. Ici, au Québec, nous avons embrassé fièrement la transition écologique, la production d'énergies propres et l'économie de demain. On ne reviendra pas en arrière », ont-ils ajouté.
Aucune acceptabilité sociale
En matière d'acceptabilité sociale, les groupes ont par ailleurs rappelé le long historique de victoires de la population québécoise au cours des quinze dernières années sur l'industrie des énergies fossiles : des combats qui se sont soldés par l'adoption d'une loi contre l'exploitation et l'exploration de ces ressources en 2022.
Dans la foulée de ces victoires citoyennes, l'argumentaire entourant la sécurité énergétique du Québec a toujours été instrumentalisé pour tenter de vendre à la population des projets inacceptables.
« On a vraiment fait peur aux gens avec la sécurité énergétique, mais la réalité demeure la suivante : la majorité du pétrole que le Québec consomme nous provient déjà de l'Ouest canadien et la demande pour le gaz naturel est déjà à la baisse en Europe, notamment en Allemagne. Non seulement ces projets d'infrastructure fossile ne correspondent pas à nos objectifs environnementaux, mais en plus, les clients potentiels ne sont et ne seront pas au rendez-vous », affirment les organisations et les expert-e-s signataires.
Les crises ne prennent pas de pause
Les membres de la société civile tiennent finalement à souligner que la crise actuelle avec les États-Unis est majeure et qu'elle provoque, à juste titre, de l'anxiété et de la peur chez les familles du Québec. Il faut s'en occuper. Cette crise ne doit toutefois pas nous faire oublier celles encore plus fondamentales qui nous frappent déjà au niveau social, du climat et de la biodiversité.
Les risques liés aux projets qui ont fait un retour dans l'actualité seraient les mêmes qu'à l'époque de leur rejet : dangers d'accidents et de déversements, menaces pour les populations de bélugas, risques pour la faune et la flore du fleuve Saint-Laurent de même que des enjeux graves liés à la santé humaine.
« Les crises environnementales ne prennent pas congé parce que Donald Trump a des sautes d'humeur. On ne peut pas faire face à une crise en en ignorant une autre, au contraire. La meilleure façon de les affronter toutes, c'est d'embrasser la transition écologique et sociale », concluent les signataires.
Liste des organisations signataires
Équiterre
Fondation David Suzuki
Nature Québec
Eau Secours
Les AmiEs de la Terre de Québec
Coule pas chez nous
Action climat Outaouais (ACO)
Front étudiant d'action climatique – FÉDAC
Solidarité Environnement Sutton
Regroupement vigilance énergie Québec (RVÉQ)
Association québécoise des médecins pour l'environnement (AQME)
Pour Nos Enfants/For Our Kids – Montréal
Front commun pour la transition énergétique (FCTÉ)
Réalité Climatique Canada
Greenpeace Canada
Réseau action climat Canada
Société pour vaincre la pollution
Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA)
Mouvement écocitoyen UNEplanète
Collectif scientifique sur les enjeux énergétiques au Québec
L'Assomption en transition
Coalition Alerte à l'Enfouissement Rivière-du-Nord (CAER)
Travailleuses et travailleurs pour la justice climatique
Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ)
Amnistie internationale Canada francophone
Le vivant se défend – fermons le pipeline 9b
Transition Manicouagan
Mères au front – Baie-Comeau
Énergie Côte-Nord
Collectif Antigone
Attac Québec
Mères au front
NON à une marée noire dans le Saint-Laurent
Prospérité Sans Pétrole
GMob (GroupMobilisation)
Comité citoyens et citoyennes pour la protection de l'environnement maskoutain
Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale
Ateliers pour la biodiversité
Collectif pour un transport abordable et accessible à Québec
Mobilisation environnement Ahuntsic-Cartierville
Villeray en transition
Coalition Terrains de golf en transition
Comité Maskoutain Vigilance Éolienne
Écologie populaire
Vigie citoyenne port de Contrecoeur
Réseau écocitoyen de Saint-Lambert
Mouvement ACTES-CSQ
Fondation Rivières
Réseau québécois des groupes écologistes
Familles pour l'air pur
Mères au front Vaudreuil-Soulanges
Action environnement Tingwick
Comité citoyen Vers un Val Vert
Le Carrefour d'animation et participation à un monde ouvert (CAPMO)
Mouvement pour une ville Zéro déchet
Fédération autonome de l'enseignement (FAE)
Vivre en Ville
Regroupement des éco-quartiers
Coalition Sortons la Caisse du Carbone
Mobilisation 6600 Parc-Nature MHM
Association pour la santé publique du Québec
Les Ami.e.s des boisés de Granby
Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec (RNCREQ)
Coalition Mobilisations Citoyennes Environnementales de Laval (CMCEL)
Centre québécois du droit de l'environnement (CQDE)
Mères au front Saguenay
Action Climat Rimouski
Rimouski en transition
Collectif Sauvetage
Protec-Terre
Mères au front de Laval
SNAP Québec
À nous le Plateau
Coalition anti-pipeline Rouyn-Noranda
La marche des Peuples pour la Terre Mère
Le pont de la 20 ça tient pas Debout
Vigile citoyenne Cacouna
Transition écologique La Pêche Coalition for a Green New Deal
Mères au front Trois-Pistoles
Mouvement Zéro Déchet Longueuil
Convergence populaire
Comité action/mobilisation Sauvons la sablière d'Arthabaska
Boisés et écologie – Châteauguay
350 Montréal
Table citoyenne Littoral Est
Action environnement Basses-Laurentides
Conseil régional de l'environnement de Montréal
Liste des personnes expertes signataires
– Annie Chaloux, professeure agrégée en politiques climatiques, Université de Sherbrooke
– Éric Pineault, professeur spécialisé en économie et transition énergétique, Université du Québec à Montréal (UQÀM)
– Pierre-Antoine Harvey, économiste à la Centrale des syndicats du Québec.
– Isabelle Arseneau, professeure en éducation, titulaire de la chaire de recherche en éducation transformatrice pour l'engagement climatique, Université du Québec à Rimouski (UQAR)
– Charles-Antoine Bachand, professeur en fondements de l'éducation spécialisé dans le domaine de l'éducation à l'écocitoyenneté, Université du Québec en Outaouais (UQO)
– Dominique Bernier, conseillère Environnement et transition juste à la Centrale des syndicats du Québec
– Dany Dumont, professeur en océanographie physique, Institut des sciences de la mer, Université du Québec à Rimouski (UQAR), Directeur scientifique associé du programme Transformer l'action pour le climat
– Mélanie Lemire, professeure titulaire en santé environnementale, Département de médecine sociale et préventive, Université Laval et Centre de recherche du CHU de Québec
– Isabelle Goupil-Sormany, spécialiste en santé publique et médecine préventive, professeure adjointe en santé environnementale, Département de médecine sociale et préventive, Université Laval et Centre de recherche du CHU de Québec
– Laure Waridel, écosociologue PhD, professeure associée à l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM.
– Émilie Morin, professeure en psychopédagogie, spécialisée en éducation en contexte de changements climatiques, Unité départementale des sciences de l'éducation, Université du Québec à Rimouski
– René Lachapelle, Ph.D. Chercheur – Centre de recherche et de consultation en organisation communautaire – UQO
– Mathieu Charron, Phd en études urbaines, professeur en décarbonation et quantification des GES, Université du Québec en Outaouais
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Comprendre la situation politique de Milei après le scandale des crypto-monnaies

Le scandale des crypto-monnaies mené par le président argentin Javier Milei a déclenché la première crise majeure au sein du gouvernement d'extrême-droite. Des dizaines d'accusations ont été portées contre Milei et d'autres personnes impliquées, tant en Argentine qu'aux États-Unis, et les membres du congrès de l'opposition ont déclaré qu'ils lanceraient une procédure de destitution pour "cryptofraude".
18 février 2025
Lundi soir (17 février), Milei a donné une interview désastreuse au radiodiffuseur argentin TN, dans laquelle il a été interrompu par son conseiller, Santiago Caputo, pour éviter des problèmes juridiques dans le scandale de la crypto-monnaie. Le président argentin fait l'objet d'une enquête du tribunal fédéral du pays pour avoir promu sur ses réseaux sociaux la crypto-monnaie $Libre, qui s'est effondrée quelques heures après son lancement vendredi dernier (14 février).
Milei a supprimé le message peu de temps après la publication, essayant de se dissocier de l'initiative. Entre-temps, la valeur de la pièce a augmenté de manière exponentielle et les investisseurs initiaux l'ont vendue pour un profit millionnaire. Puis, la valeur de la cryptomonnaie a chuté.
La devise a évolué, au cours de cet intervalle, de plus de 4,5 milliards de dollars américains (25,6 milliards de R$). On estime que les investisseurs ont perdu environ 250 millions de dollars américains (1,42 milliard de R$) dans ce va-et-vient.
La $Libre cryptomonnaie, promue par le président, s'est avérée être « une fraude », explique l'économiste argentin Ramon Fernandez, professeur au Centre d'ingénierie et de sciences sociales (CECS) de l'Université fédérale d'ABC (UFABC).
« Un petit groupe de propriétaires initiaux de cet actif a gagné entre 100 et 200 millions de dollars en quelques heures, et un plus grand nombre de personnes, la grande majorité des partisans de Milei, ont perdu ce montant. Il y a eu un transfert de revenus entre ses partisans et beaucoup ont été ridiculisés parce qu'ils avaient confiance dans le président », a-t-il expliqué à Brasil de Fato.
Bien qu'il s'agisse d'un scandale sans précédent « même selon les normes incroyables de Milei », Fernandez estime qu'il n'aura pas d'effets politiques ou même judiciaires graves pour le président. « Les élites argentines sont convaincues que Milei a la capacité de mener une série de réformes néolibérales avec un soutien que personne d'autre ne pourrait obtenir. Par conséquent, malgré sa folie, il continue de compter sur le soutien pour toutes les choses pertinentes ; même dans ce cas, la punition sera une petite 'réprimande', mais sans penser à des choses comme la destitution, un procès sérieux, etc. », selon son analyse.
Fernandez croit que les principaux dommages de ce scandale pour Milei seront dans le domaine économique, car l'Argentine a besoin de ressources internationales, en particulier du Fonds monétaire international (FMI), pour maintenir son programme économique et contrôler l'inflation, la principale promesse de sa campagne. « Au FMI, il y avait déjà une sérieuse réticence de la bureaucratie à prêter de l'argent qui ne servira qu'à maintenir le dollar bon marché jusqu'aux élections, brûlant ces réserves. » Milei espère que Trump acceptera ce combat.
Scénario politique
Les députés de la coalition d'opposition Union pour la patrie (péronisme) ont annoncé qu'ils mèneraient un processus de destitution contre le président, bien qu'ils soient loin d'avoir les votes nécessaires pour que l'initiative aille de l'avant. Le principal garant politique de Milei reste l'ancien président néolibéral Mauricio Macri (2015-2019), qui soutient la base gouvernementale au Congrès argentin avec son parti PRO.
Le parti de Macri a qualifié l'affaire de « très grave » et a estimé qu'elle « avait un impact sur la crédibilité du pays ». Cependant, il a refusé de soutenir la destitution « dans ce cas ». De toute évidence, le président était au milieu d'une fraude pour de nombreuses personnes et cela mérite une enquête très sérieuse », a déclaré Macri.
« Il suffit de regarder la déclaration du PRO, le parti de Macri, et le ton des critiques de [journaux comme] Clarin ou La Nación : rien ne peut faire obstacle au démantèlement de l'État et aux réformes que Milei est en train de mener. Rappelez-vous que le pouvoir judiciaire argentin est totalement contrôlé par ce groupe, c'est le « bras armé » du macrisme. Moro serait apprenti en Argentine », dit Fernandez.
Le président du bloc des députés de l'Assemblée fédérale, Miguel Ángel Pichetto, a déclaré mardi (18 février) que le cas de la crypto-monnaie est $Libre un « dommage auto-infligé » par le gouvernement lui-même et a fait valoir que, pour surmonter ce fait, certains collaborateurs de Javier Milei « doivent démissionner » pour « préserver l'image du président lui-même ».
« Le temps est venu où il est essentiel de jeter du lest par-dessus bord. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un collaborateur important du président doit quitter le gouvernement, il doit assumer les responsabilités de préserver l'image du président lui-même. Il doit démissionner », a souligné le législateur.
Recherche
La Cour fédérale 1, sous la responsabilité de la magistrate María Servini, a été chargée lundi (17 février) de centraliser les plaintes qui demandent d'enquêter sur la question de savoir si Milei a commis une association criminelle, une fraude et une violation des devoirs d'un agent public, entre autres crimes. Pour Fernandez, bien qu'un groupe de personnes proches du président, ayant un accès fréquent à la Casa Rosada, soit à l'origine du lancement de cette cryptomonnaie, « il est difficile de savoir si le président a gagné quelque chose personnellement, ou si seulement ses amis ont remporté ce jackpot ».
" On sait que le président, avant d'entrer en fonction, a donné des cours et des conseils dans des activités liées à ce groupe, faisant de bons profits. Il y a également eu une plainte selon laquelle des conseillers très proches de lui ont vendu des entrevues avec le président pour de petites fortunes à des entrepreneurs dans les secteurs de l'informatique, de l'IA, des cryptoactifs, etc.”
Entrevue désastreuse
Dans une entrevue accordée à la chaîne argentine TN, publiée lundi soir (17 février), Milei a déclaré avoir agi « de bonne foi » lors de la publicité de la cryptomonnaie. « Je ne l'ai pas promue, je l'ai communiquée », a-t-il déclaré.
Le président a déclaré que les gens qui investissent dans des actifs cryptographiques « connaissaient très bien le risque de ce qu'ils faisaient », comme quelqu'un qui va « au casino ». « Un casino où les machines sont manipulées par le propriétaire », a plaisanté Smaldone à propos de la métaphore.
Un extrait édité de l'entrevue est devenu viral sur les médias sociaux et a suscité plus de controverse, car le président et le journaliste commentent ironiquement que les questions ont été préparées à l'avance. Peu de temps après, le journaliste a modifié une question à la demande des conseillers de Milei, après avoir noté que l'interrogatoire pourrait générer un « problème judiciaire » pour le président.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le mirage du Projet Mauricie, ou l’art du greenwashing industriel

Le texte d'Éric Gauthier, président et chef de la direction de TES Canada, est une parfaite démonstration du greenwashing industriel : un habillage vert pour masquer un projet fondamentalement nuisible à l'environnement, à l'économie locale et à notre autonomie énergétique réelle. Décryptons ensemble cette tentative grossière de vendre aux Québécois un projet conçu avant tout pour enrichir des multinationales.
Un projet profondément québécois… ou profondément opportuniste ?
M. Gauthier affirme que le Projet Mauricie est « profondément québécois ». Pourtant, TES Canada n'est qu'une filiale d'une entreprise dont le siège social est situé à Schiphol, aux Pays-Bas, et qui cherche avant tout à exploiter nos ressources pour alimenter un marché international. Ce projet ne vise en rien à renforcer notre autonomie énergétique, mais plutôt à exporter de l'hydrogène vert, une technologie dont l'efficacité et la viabilité restent largement contestées.
Ironie du sort, une multinationale étrangère tente de nous vendre son projet en usurpant le nom de notre collectif : « C'est une occasion d'être toujours plus maîtres chez nous ». On aura tout vu !
Pire encore, TES Canada tente de brouiller encore davantage les cartes en changeant son nom : d'abord TES Canada, puis TES Mauricie, ou simplement « Projet Mauricie ». Une tentative grossière pour masquer ses véritables intentions. Projet Mauricie ? Plutôt « Projet d'assaut sur la Mauricie »
Des chiffres gonflés et un modèle économique douteux
Les chiffres avancés par TES Canada relèvent davantage du marketing que de la réalité économique. 5,6 milliards de dollars en retombées économiques ? Plus de 4 300 emplois ? Ces projections ne sont basées sur aucune étude indépendante et omettent surtout les coûts environnementaux et sociaux majeurs.
M. Gauthier prétend enrichir le Québec, mais en réalité, il propose de privatiser notre électricité et d'envoyer les profits à des dirigeants milliardaires, plutôt que de faire bénéficier Hydro-Québec, notre véritable levier économique collectif. Au lieu d'engraisser les coffres d'Hydro-Québec, qui redistribue ses revenus aux Québécois et finance nos infrastructures publiques, ce projet siphonnerait nos ressources naturelles pour maximiser les rendements d'intérêts privés.
De plus, il est naïf de croire que ce projet pourrait être un rempart économique contre la guerre tarifaire américaine. TES Canada prétend que l'incertitude économique des États-Unis justifie de nous lancer dans une filière hasardeuse et coûteuse, alors même que l'hydrogène vert n'a pas encore prouvé sa rentabilité sans subventions massives. On tente ici de faire croire aux Québécois qu'ils doivent se lancer dans l'inconnu pour compenser l'instabilité d'un partenaire commercial de longue date.
Un projet qui menace l'environnement et les communautés locales
Si ce projet était réellement conçu pour le bien du Québec, pourquoi est-il rejeté par tant de citoyens et d'experts en environnement ? L'hydrogène vert est loin d'être la panacée qu'on nous vend. Sa production nécessite d'énormes quantités d'électricité et d'eau, ce qui engendre des pressions sur nos ressources naturelles et un impact environnemental sous-estimé.
De plus, les MRC de Mékinac et des Chenaux risquent de payer un lourd tribut : expropriations, destruction de terres agricoles, industrialisation forcée de milieux naturels. TES Canada parle de 240 millions de dollars en compensations sur 20 ans, mais ces sommes ne suffisent pas à réparer les dégâts irréversibles qu'un tel projet engendrerait sur l'écosystème et la qualité de vie des résidents. Un « dynamisme économique » basé sur la destruction de notre territoire est un leurre.
Un avenir collectif ? Non, un cadeau aux multinationales
Enfin, TES Canada tente de nous faire croire que ce projet est un investissement pour notre avenir collectif. En réalité, il s'agit d'une opération massive de privatisation des ressources québécoises, au bénéfice d'intérêts étrangers. Un véritable développement économique durable passerait par des investissements dans les énergies réellement propres et adaptées à notre contexte, comme l'efficacité énergétique, l'éolien ou la biomasse locale.
Dire non au Projet Mauricie, c'est refuser de tomber dans le piège des grandes promesses sans fondement. C'est protéger notre territoire, notre eau et notre autonomie énergétique contre un modèle qui profite aux multinationales bien plus qu'aux citoyens du Québec.
Dany Janvier, citoyen de St-Adelphe dans Mékinac,
Contre la Privatisation du vent et du soleil dans Mékinac Des Chenaux, RVÉQ
Toujours Maîtres Chez Nous,
(Réponse à la lettre d'opinion d'Éric Gauthier parue dans Le Nouvelliste le 13 février dernier)
https://www.lenouvelliste.ca/opinions/point-de-vue/2025/02/13/projet-mauricie-un-projet-profondement-quebecois-ULKT63AZ4BFQ5NXMNQZ7RJ2FMY/
https://lobbycanada.gc.ca/app/secure/ocl/lrs/do/rgstrnLbbystsEmplyd?regId=957464&lang=fra
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le Canal de Panama et la présence chinoise en Amérique Latine

La présence chinoise en Amérique Latine, y compris en Amérique centrale, connaît ces dernières années une progression saisissante qui illustre les progrès fulgurants de l'influence politique et économique de la République Populaire de Chine dans ce qui était autrefois considéré comme « l'arrière-cour » des Etats-Unis.
Tiré de Asialyst
15 février 205
Par Hubiquitus
Un porte-conteneurs chinois emprunte le Canal de Panama. DR.
Sitôt confirmé par le Sénat, le nouveau Secrétaire d'Etat Marco Rubio prenait l'avion pour une tournée régionale ces petites Républiques d'Amérique centrale, autrefois appelées « bananières », le « backyard » nord-américain.
Si ce qualificatif est un peu passé de mode, l'Isthme de Panama, terrain des rivalités avec les puissances européennes (France et surtout Grande-Bretagne au mitan du XIXème siècle) est, cent-soixante ans plus tard, l'objet d'une concurrence féroce entre les Etats-Unis et la Chine.
Le 20 janvier, date de son investiture, le 47è président des Etats-Unis Donald Trump fait comme s'il découvrait que depuis la rétrocession de Hong-Kong par les Britanniques à la Chine en 1997, c'est une entreprise chinoise, Hutchison, qui opère deux des cinq ports aux deux extrémités du Canal de Panama, Balboa et Cristobal, ainsi que la voie ferrée qui traverse l'isthme.
C'était une entreprise Anglo-hongkongaise qui remporta l'appel d'offre privatisant la gestion portuaire (reconduit en 2021 pour une nouvelle période de 25 ans)*
*Cf. Sabina Nicholls
. La rétrocession en fit une entreprise nettement moins britannique et beaucoup plus sous influence du Parti communiste chinois (PCC). L'actionnaire majoritaire, Li Ka-Shing et son fils Victor Li, l'actuel PDG, sont proches depuis longtemps du président chinois Xi Jinping, avant même qu'il n'accède au pouvoir suprême en 2012.
Mais d'un autre côté, un autre de ces ports, le CCT – pour Colon Containers Terminal – est exploité par l'entreprise Evergreen, ce géant du transport maritime international basé lui à… Taïwan !
Le Canal de Panama a vu passer 373 000 navires de 1998 à 2024, dont la majorité (52%) allait vers ou provenaient de ports des Etats-Unis. Les trois-quarts des marchandises transitant par le canal (76%) étaient destinés ou provenaient du marché nord-américain.
Le fait que la République Populaire de Chine (RPC) ait été l'origine ou la destination de ces marchandises n'est pas nouveau et ne lui permet pas pour autant de contrôler le canal.
La compétition entre les « deux Chines »
De fait, les petits pays qui composent l'Amérique Centrale ont longtemps été en première ligne dans la concurrence entre Pékin et Taipei. Les régimes militaires, instaurés avec l'appui des Etats-Unis avant ou après l'après-deuxième guerre mondiale, avaient clairement choisi leur camp tout au long de la guerre froide : celui du Guomindang, le parti nationaliste au pouvoir à Pékin jusqu'à ce qui l'en soit chassé par le PCC en 1949, et ne juraient que par Taipei.
Le voyage historique de Richard Nixon à Pékin en 1972 et la reconnaissance de la Chine communiste qui s'ensuivit n'eurent strictement aucune incidence sur les relations des pays Centraméricains avec la Chine continentale, superbement ignorée.
Il fallut attendre 2007 pour que le Costa Rica, sous la pression de l'entreprise américaine Intel pour l'installation d'une usine de microprocesseurs, franchisse le pas de la reconnaissance diplomatique de la RPC facilitant le commerce entre les deux pays. Il faut rappeler que Taipei arrosait généreusement les petits Etats centraméricains en échange du maintien de leurs relations diplomatiques, notamment avec des conditions discrétionnaires fort intéressantes pour le chef d'Etat en place.
A la fin des années 1980 et plus encore dans les années 1990, la crise économique et financière met en faillite la plupart des Etats centraméricains, qui n'ont d'issue que dans la guerre – pas vraiment civile – (Nicaragua, El Salvador, Guatémala), des dévaluations et une émigration massives (les mêmes, plus le Honduras) et la création de multiples zones franches, proches des aéroports pour ceux qui n'ont pas de port sur le littoral atlantique (El Salvador, Nicaragua) ou des ports (Puerto Cortés au Honduras, Puerto Santo Tomas au Guatemala).
Il s'agit avant tout d'attirer les investissements étrangers au titre d'une main d'œuvre non qualifiée bon marché et d'un accès libre au marché nord-américain, mis en place à partir de l'Administration Reagan, avec la Caribbean Basin Initiative. Beaucoup d'entreprises chinoises, établies à Taïwan en grande majorité, viennent s'installer dans ces zones franches.
Ceci principalement dans le secteur de la confection textile, les « maquiladoras » : les pièces de tissu arrivent toutes taillées d'Asie, il suffit d'opérateurs de machines à coudre pour les assembler, et de fixer une étiquette indiquant la provenance pour bénéficier de l'exportation en franchise sur le marché nord-américain.
Au début des années 2000, les pays d'Amérique centrale consolident le système avec la négociation d'un accord régional de libre-échange avec les Etats-Unis, qui culmine en 2004. De fait, le Central American Free-Trade Agreement (CAFTA, élargi par la suite en CAFTA-DR lorsque la République dominicaine rejoint le processus de négociation) ne fait que consolider un régime commercial qui avait fait ses preuves.
Le Salvador
Grâce aux enquêtes des magistrats et aux alternances politiques, on a fini par savoir que Taipei arrosait généreusement l'Alliance Républicaine Nationaliste ARENA, le parti d'extrême-droite au pouvoir à San Salvador. De 1989 à 2009, 20 millions de dollars ont été mis à disposition du parti, lui permettant de financer la campagne de son candidat à la présidence tous les 5 ans, acheter les voix de députés d'un petit parti susceptible d'appuyer tel ou tel projet de loi, et autres généreux subsides.
Le fait que Francisco Flores, Président du Salvador de 1999 à 2004, conserva pour lui-même l'essentiel de la subvention taïwanaise lui valut des poursuites judiciaires et une condamnation à de la prison ferme lorsque son parti perdit les élections de 2009 en faveur de l'ancienne guérilla du FMLN.
L'arrivée de la gauche au pouvoir ne changea pas grand-chose, car Taïwan continua à verser son subside annuel que le gouvernement de Mauricio Funes utilisa comme caisse noire pour ses ministres et hauts fonctionnaires. La subvention annuelle des 20 millions de dollars n'était toutefois plus jugée suffisante : à la fin de son mandat en 2014, Mauricio Funes fut accusé de corruption pour des centaines de millions de dollars et échappa à la justice en se réfugiant au Nicaragua voisin.
Son successeur, du même parti de l'ancienne guérilla, le FMLN, Salvador Sanchez Ceren (2014-2019), connut le même sort, mais avant de perdre les élections de 2019, décida de changer soudainement de camp : en août 2018, El Salvador établit brusquement des relations avec la République Populaire de Chine, au grand dam de l'administration Trump 1 qui dénonça les visées expansionnistes consistant à y construire une base navale.
Le nouveau Président, Nayib Bukele, accepta cette situation laissée par l'administration sortante, essentiellement parce que les liens avec Taïwan s'étaient considérablement délités et que la Chine continentale était devenue l'un des principaux partenaires commerciaux. Coutumière du fait, celle-ci sut gratifier le changement de bord de El Salvador en offrant une superbe Bibliothèque Nationale en plein cœur de la capitale.
Le cas du Nicaragua
Après le triomphe de la Révolution Sandiniste en 1979, le gouvernement dénouera le lien qui existait entre Taïwan et la dictature de Somoza pour établir en 1985 une relation politique avec Pékin, qui ne dépassera guère un niveau symbolique.
La défaite électorale de Daniel Ortega à l'élection présidentielle de 1990 permet au nouveau gouvernement libéral de Doña Violeta Barrios de Chamorro de revenir aux liens traditionnels avec Taipei, à la faveur sans doute du recours de nouveau aux généreux subsides pour le parti de gouvernement décrit précédemment avec El Salvador.
Lorsque Daniel Ortega revient aux affaires en 2007, il s'intéresse d'abord à capter à son profit la manne provenant de Taïwan au lieu de revenir à la relation bilatérale existante durant son premier mandat. Puis en 2012, il évoque en public un projet de canal interocéanique qui intéresse un groupe d'investisseurs chinois de Hong Kong, maintenant une ambigüité sur les liens avec Pékin. Le projet est approuvé à marche forcée, Ortega étant maître de tous les pouvoirs, législatif et judiciaire en sus de l'exécutif, par la loi 840 du 14 juin 2013, suivie de l'accord de concession signé avec le HKND Group, d'un certain Wang Jing*
*Voir LOPEZ BALTODANO, Umanzor & Monica. Ruta Mafiosa : quienes controlan la concesión canalera en Nicaragua ? Ed. Popol Na, San José, Costa Rica, 2023, 164 pp. (version électronique), inconnu de tout le monde ou presque.
Si ce n'est qu'il semble avoir fait fortune en 2009, en s'emparant du Groupe Xinwei, spécialisé dans les télécommunications et des « technologies » que la CIA identifie rapidement comme une entreprise liée au complexe militaro-industriel de l'Armée populaire de libération chinoise (APL).
Wang Jing a été approché par le fils du couple Ortega-Murillo, Laureano, et viendra une seule fois au Nicaragua pour lancer des études de faisabilité et d'impact environnemental dont la qualité laisse pour le moins à désirer. L'analyse de l'accord de concession est implacable : les investisseurs peuvent faire à peu près ce qui leur passe par la tête dans l'ensemble du territoire du Nicaragua, et les organisations de la société civile et le mouvement paysan, craignant des expropriations massives de terres, se mobilisent. Par chance pour le Nicaragua, l'affaire se dégonfle assez vite, le HKND Group souffre de pertes très élevées lors d'un krach de la bourse de Shanghai survenu en 2015, l'entreprise elle-même fait faillite et est expulsée de la bourse en 2021.
L'étude des frères Lopez Baltodano conclue d'ailleurs « que la Chine peut voir dans un projet de canal situé dans la sphère d'influence immédiate des Etats-Unis un élément qui pourrait servir à négocier des positions dans sa propre zone d'influence », et font explicitement référence à Taïwan*
*Ibid, p. 19
.
Dans ce registre, un rapprochement s'impose avec le projet de canal à travers l'Isthme de Kra, en Thaïlande, promu dans ces années-là (2012-13) par la RPC, qui suscite l'opposition des Américains ainsi que des militaires thaïlandais jusqu'à leur coup d'Etat en 2014. Il reste que l'intérêt stratégique pour la Chine d'un tel projet est infiniment plus grand qu'un canal au Nicaragua, puisqu'il permettrait d'éviter le détroit de Malacca, seul point de passage de la Mer de Chine du Sud vers l'Océan Indien.
Côté nicaraguayen, Ortega se rallie officiellement à la politique d'une seule Chine en 2021, rompant toutes relations avec Taïwan.
Au Panama : l'effritement des promesses des BRI
Le Panama avait réussi, tout comme le Nicaragua, à maintenir des relations simultanées avec les « deux Chines », la RPC, disposant des bénéfices d'une vraie reconnaissance diplomatique tandis que Taïwan devait se satisfaire d'un bureau de représentation commerciale.
Si Panama se vante d'avoir été le premier pays centraméricain à souscrire, en 2017, au programme pharaonique des Nouvelles Routes de la Soie, il pourra aussi arguer du fait qu'il est le premier à en sortir, sous la pression des Etats-Unis, inaugurant ce que Tabita Rosendal*appelle joliment le « BRI-xit », inspiré de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.
*ROSENDAL, Tabita. Could US forcing Panama to exit China's Belt and Road set pattern ? Asia Times, February 8, 2025.
Reste que le Panama viendrait juste derrière le Pérou en termes de concentration des intérêts chinois en Amérique Latine, avec 40 entreprises présentes dans le pays, mais évidemment surtout dans les zones franches qui sont essentiellement des centres de redistribution des marchandises à l'échelle du continent nord et sud-américain, ainsi par exemple pour l'entreprise de télécommunications Huawei.
Le gigantesque projet d'élargissement du Canal de Panama, dont les travaux avaient duré 10 ans, s'était achevé en 2016 et le tirage au sort avait favorisé le porte-conteneurs Andronikos, de l'armateur chinois COSCO. En juin 2017, survenait l'annonce surprise de la reconnaissance du principe d'une seule Chine. En décembre 2018, le président Xi Jinping faisait lui-même escale à Panama lors d'une tournée latino-américaine. C'est aussi en 2017 que commencent les travaux d'aménagement du port de l'île Margarita, dans la zone libre de Colon, estimés en un milliard de dollars apportés par le consortium chinois Landbridge, avec la construction du Panama-Colon Containers Port (PCCP).
Les projets se succèdent à une vitesse effrénée pour des montants colossaux : 4 milliards de dollars pour une ligne de TGV reliant Panama et David, un milliard pour une centrale électrique au gaz, un terminal pour les navires de croisière à l'entrée pacifique du Canal, un centre de conférences, un nouveau bâtiment pour l'ambassade de Chine et enfin 1,4 milliard de dollars pour un quatrième pont traversant le canal.
En dehors de ce dernier projet, récemment relancé, le terminal de l'île Margarita et l'absurde TGV ont été abandonnés, ainsi que l'idée d'un accord bilatéral de libre-échange. C'est un projet minier, mené par First Quantum Minerals (FQM), une soi-disante entreprise canadienne, en réalité filiale de la Jiangxi Copper Co Ltd., qui a provoqué un rejet massif de la population et des institutions panaméennes. La Cour Suprême du Panama a rejeté, en novembre 2023, ce méga-projet d'une mine de cuivre à ciel ouvert, comme contraire à la Constitution.
Autant Taïwan avait explicitement accepté le traité proclamant la neutralité du canal, l'un des deux traités signés en 1977 par Jimmy Carter et le Général Omar Torrijos, en souscrivant un addendum déposé au siège de l'Organisation des Etats Américains (OEA) à Washington, dont elle était observatrice à l'époque, autant la RPC évite soigneusement de se prononcer sur ce délicat sujet, depuis qu'elle l'a remplacé dans son statut d'observateur extrarégional.
Bénéficier d'un port à chaque bout permet évidemment une surveillance constante des navires empruntant le canal, notamment des flottes militaires. De fait, c'est l'un des rares endroits au monde où l'on peut observer un sous-marin nécessairement émergé, quels que soient son mode de propulsion et sa nationalité.
Carte du Canal de Panama (crédit : Shutterstock)
Au Guatémala et dans l'ensemble de la région
Le Guatémala est le seul pays d'Amérique Centrale à maintenir la reconnaissance diplomatique de la République de Chine (Taïwan aujourd'hui), ceci depuis sa fondation et leur reconnaissance mutuelle en 1912 ! Il ne semble pas y avoir de raison particulière à cela.
Si la diplomatie guatémaltèque ne semble pas envisager à court ou moyen terme de couper les liens, faibles, avec Taïwan, cela n'empêche pas un commerce normal avec la Chine, avec un fort excédent en faveur de celle-ci. Simplement, il n'y a pas d'investissements ou de lignes de crédits des banques de la RPC.
Paradoxalement, c'est peut-être le Costa Rica, premier pays de la région à choisir la RPC contre Taïwan en 2007, qui en a le moins bénéficié. Le niveau de développement du pays est certes supérieur au reste de la région, et il réalise des projets de développement d'infrastructures de transports financés par des prêts concessionnels chinois : ainsi la route reliant la capitale, San José, au principal port sur l'océan Atlantique, Puerto Limón, est aménagée grâce à un prêt à long terme de 400 millions de dollars mis en œuvre par la China Harbour Engineering Company (CHEC), dont le respect des délais, des normes environnementales et l'absence de corruption des fonctionnaires nationaux n'est pas une caractéristique reconnue, bien au contraire.
Le Honduras est le dernier en date à avoir rompu avec Taipei pour reconnaître la RPC début 2023. En dehors d'un voyage de la présidente Xiomara Castro, on est bien en peine de savoir quels miroirs aux alouettes ont déployé les responsables politiques chinois pour la convaincre.
L'Isthme centraméricain et la problématique migratoire
En définitive, l'urgence politique pour les Etats-Unis et l'Administration Trump 2 est d'affronter l'immigration sur leur marge sud et non pas d'affronter la Chine dans son « arrière-cour », où Taïwan a perdu l'essentiel de ses appuis et où la RPC a ancré sa présence politique et économique, mais où la primauté nord-américaine n'est pas pour autant actuellement menacée.
Tout autant que le Canal de Panama, est important pour les Etats-Unis le bouchon, le « Tapón » du Darién, déterminant pour contrôler en amont les flux migratoires, et tout spécialement ceux qui proviennent du Venezuela, d'Haïti et de Cuba. Trump 2 a appris la leçon de Trump 1 : la construction d'un mur le long du Rio Grande, quelle qu'en soit la hauteur ou le pays qui le finance, est loin d'être suffisant pour stopper les flux. Il faut remettre en place le bouchon qui voit passer, par dizaines de milliers, des migrants provenant des Etats faillis de l'Amérique du Sud et des Caraïbes, puis convaincre les petits Etats centraméricains de reprendre des milliers d'émigrants clandestins. Les « déporter », selon le terme nord-américain, doit se faire de façon suffisamment massive et violente pour assurer un minimum de dissuasion.
Le Panama et le Costa Rica ne connaissent guère l'émigration, mais les deux pays n'ont pas voulu ou pu stopper le flux migratoire passant par le Darién. Le calcul de l'administration Trump 2 est probablement qu'il faut faire peur à l'Etat panaméen, en menaçant sa principale activité économique, le canal, pour qu'il se résolve à resserrer le bouchon.
Nayib Bukele, le Président salvadorien, n'a pas hésité à proposer à Marco Rubio d'héberger dans sa gigantesque prison de 40 000 places, tous les délinquants latinos dont les Etats-Unis souhaitaient purger leurs prisons en échange de frais d'hébergements modiques, à discuter entre les deux pays. Pour sa part, le Président du Guatémala, Bernardo Arévalo, a fait preuve de bonne volonté pour accueillir les migrants illégaux qui seraient « déportés » des Etats-Unis, et n'a pas écarté l'idée de servir de pays tiers pour en héberger d'autres nationalités.
Ainsi, la critique de l'omniprésence chinoise et la préoccupation nord-américaine pour la sécurité du Canal a servi de levier pour prendre à la gorge le gouvernement panaméen sur le rebouchage du Darién, tandis que plusieurs autres pays sont allés à la rencontre des souhaits de l'Administration Trump 2 en matière d'accueil des immigrants illégaux. Le seul pays véritablement à problèmes, le Nicaragua, perçu par Rubio et l'Administration Trump 2 comme faisant partie de « l'Axe du mal » avec Cuba et le Venezuela, est à la fois trafiquant de migrants et fricote avec la Chine sur un projet de canal concurrent de Panama, mais bien hypothétique…
Par Hubiquitus
A propos de l'auteur Hubiquitus
Ancien universitaire puis diplomate, présent dans la région durant un quart de siècle, Hubiquitus a également été en poste à Pékin.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :















