Presse-toi à gauche !
Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Allemagne - Après les élections législatives : refuser de se conformer !

20 % de racistes au Parlement + des manifestations de masse et Die Linke avec une nouvelle force !
« Les élections sont des événements qui se déroulent en surface. Elles entérinent soit des choix de société fondamentaux qui avaient déjà été faits, soit elles indiquent que le moment n'en est pas encore venu. » (Georg Fülberth)
24 février 2025 | tiré d'Europe solidaire sans frontières
https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article73738
La campagne électorale et le résultat des élections législatives nous montrent que :
• L'AfD, avec son racisme qui méprise et menace directement la dignité de l'être humain, a réussi à s'incruster jusqu'au « centre démocratique ». Les mobilisations de masse contre l'extrême droite sont remarquables et porteuses d'espoir, mais elles n'ont pas encore suffi pour réussir à influencer de manière significative ceux et celles qui veulent voter pour l'AfD et la CDU/CSU. Le fait que les Verts et le SPD se soient mis au diapason dans leur discours et leur politique gouvernementale ne leur a pas servi.
• Le « tournant historique » annoncé avec emphase par Olaf Scholz est lui aussi susceptible de rallier une majorité dans ce pays. L'escalade militaire et le bellicisme sont largement acceptés sans contestation. Seuls les votes en faveur du BSW et de Die Linke peuvent être interprétés comme un rejet fondamental de la militarisation de la société.
• L'administration américaine de Donald Trump et Mike Pence plonge aussi les responsables politiques allemands dans la confusion.
• Le doublement des voix pour l'AfD par rapport à 2021 n'est pas seulement une source d'inquiétude, de menace et de danger immédiat pour les migrant.e.s, les militant.e.s de gauche, les syndicalistes et les minorités. Il est aussi révélateur de l'absence d'une résistance digne de ce nom de la part de la gauche et des syndicats contre le racisme et la politique de redistribution du bas vers le haut, qui a entraîné un glissement vers la droite de la société et de la représentation parlementaire.
• Il est apparu clairement, si tant est que cela ait été le sujet de la campagne électorale, que les partis pro-capitalistes qui veulent constituer le gouvernement n'ont pas de projet crédible pour résoudre la crise conjoncturelle ni les problèmes structurels de l'industrie en Allemagne. Les intérêts de la majorité de la population ne jouent de toute façon qu'un rôle secondaire pour ces partis, si tant est qu'ils en jouent un.
• La remontée de Die Linke, que ce soit dans les urnes ou avec l'arrivée de dizaines de milliers de nouveaux membres, majoritairement jeunes, est plus qu'une lueur d'espoir dans cette situation. Cela crée une réelle possibilité de construire un projet qui s'oppose à la poussée de la droite dans les mois et les années à venir. Cela est dû à la fois à la polarisation politique accrue par le coup de force de Merz au Bundestag et à la mobilisation antifasciste massive qui s'en est suivie dans la société. C'est le moment pour beaucoup d' « annoncer leur couleur », de s'engager, de s'impliquer activement et de manière organisée. Le grand défi sera de transformer cet élan en un travail politique continu dans tous les domaines de la société : dans les quartiers, sur les lieux de travail, dans les écoles et les universités, mais aussi dans les syndicats et les autres mouvements sociaux, ainsi que dans la rue, en organisant la résistance. C'est la résistance extra-parlementaire qui est à l'ordre du jour, et non l'espoir d'un « mur coupe-feu » parlementaire.
• Ce mur coupe-feu extra-parlementaire, il faudra le construire contre le racisme, le nationalisme, le bellicisme et pour la justice sociale, et pas seulement « contre l'AfD ».
Nous ne sommes pas seuls
Le monde tourne – c'est bien l'impression que ça donne – de plus en plus vite. Ce n'est pas en Allemagne que la roue tourne, car ici nous ne sommes qu'une partie du monde. L'invasion de l'Ukraine par la Russie et le génocide en Palestine ne sont lointains qu'en apparence ; la concurrence économique mondiale peut sembler une abstraction, mais tout cela a une influence sur notre situation et constitue le fondement des choix politiques que font les dirigeants de ce pays.
L'Ukraine
Un terme va être mis à la guerre par procuration en Ukraine. L'Ukraine, sa population et ses ressources naturelles se trouvent tout simplement dans l'impossibilité de financer l'achat de nouvelles armes et de munitions. La Russie semble durablement affaiblie ; la poursuite de la guerre n'aura qu'un faible effet supplémentaire sur son affaiblissement. Il est donc temps de conclure un « accord ». Pour les Européens non préparés, la tâche consiste à garantir et à financer « la nouvelle paix ».
Gaza : nettoyage ethnique
L'expulsion de millions de Palestiniens n'est malheureusement pas une chimère. Les États-Unis comptent sur la peur de tous les régimes de la péninsule arabique et d'Afrique du Nord face à un nouveau « printemps arabe ». Si les régimes dictatoriaux locaux ne veulent pas participer à l'expulsion, ils devront payer pour une autre « solution ». Et l'appareil militaire israélien, renforcé après le génocide impuni de Gaza, est prêt à étendre l'ordre et son contrôle sur la région.
Les représentants de la « raison d'État » allemande sont unanimes
Les représentants de la « raison d'État » allemande, c'est-à-dire les partis dominants en Allemagne, s'accordent à soutenir inconditionnellement Israël et sa politique génocidaire. Cela inclut également la répression croissante contre toute forme de solidarité pro-palestinienne.
La fidélité inconditionnelle à l'impérialisme américain en matière de politique étrangère était au sens propre du terme « bon marché » tant que l'on pouvait participer au pillage mondial moyennant une modeste participation à l'OTAN.
Points de discorde pour la nouvelle coalition
Un élément important dans les marchandages autour d'une nouvelle coalition sera donc de savoir combien l'armement doit et peut coûter. Quelle part sera financée par l'endettement ? Quelle part sera financée par des coupes budgétaires ? Quels pans de l'État social seront encore davantage vidés de leur substance ? Quels investissements seront réalisés dans les infrastructures (réseaux électriques, réduction des coûts de l'énergie, transports ferroviaires, éducation et santé) et dans les secteurs dits d'avenir et la protection du climat, et quels investissements ne le seront pas ? De plus, on ne voit pas quelle stratégie sera mise en place pour restaurer la compétitivité internationale de l'industrie. Les cadeaux fiscaux et la redistribution aux entreprises et aux riches ne suffisent pas.
Le racisme s'aggrave encore
En ce qui concerne la « politique migratoire », tous les partis représentés au Bundestag, à l'exception de Die Linke, se sont mis d'accord pendant la campagne électorale pour durcir encore la répression contre les réfugié.e.s et renforcer le système de contrôle aux frontières. Pour les individus menacés d'expulsion et de harcèlement, c'est déjà une catastrophe qui met leur vie en danger. Le grand succès électoral de l'AfD laisse présager une nouvelle montée de la violence raciste de la part de hordes fascistes.
Mobilisation de masse contre l'extrême droite
Depuis quelques semaines, nous assistons à une mobilisation de masse antiraciste et antifasciste d'une ampleur sans précédent, et en même temps au choix de s'organiser de la part de dizaines de milliers de jeunes. Le slogan « Ensemble contre le fascisme » ne portera ses fruits que s'il est associé à une perspective sociale porteuse d'espoir.
Son contenu social doit être axé sur les intérêts de la grande majorité de la population. Les besoins sociaux de la grande majorité de la population sont avant tout l'augmentation des salaires et des retraites, des loyers et des prix abordables, le maintien et la création d'emplois et de places dans le système de formation, un système de santé et d'éducation efficace, le maintien et le développement des équipements et des services publics ainsi qu'une protection efficace du climat, financée par les riches bénéficiaires du capitalisme.
En parler ensemble, se mettre d'accord sur des revendications, agir collectivement pour les faire valoir, cela peut permettre de faire un pas de plus. Die Linke a misé sur ces thèmes et c'est ce qui lui a permis de se renforcer de la sorte. Ce qui montre bien que c'est la question sociale qui fait la politique de gauche.
Dans la durée, partout, ensemble
Des groupes et des comités qui travaillent dans la durée peuvent transformer des manifestations ponctuelles en un mouvement durable et présent partout. Au-delà de cela, il est important que ce mouvement essaie d'agir de manière ciblée partout où se déroule la vie sociale. À long terme, notre objectif est de susciter un soutien massif aux actions antifascistes, allant jusqu'à des grèves sur le lieu de travail et des grèves générales.
Pour peser dans la rue, nous contribuons à la formation de coordinations les plus larges possibles avec des formes d'action qui touchent le plus grand nombre, afin que le slogan « Pas de place pour les fascistes » s'applique littéralement.
Le fait que des millions de personnes descendent maintenant dans la rue pour s'opposer à la montée de l'extrême droite et au fascisme, que des dizaines de milliers de personnes rejoignent le parti Die Linke, voilà une lueur d'espoir malgré la montée de l'extrême droite. Le défi consiste maintenant à mettre en place une pratique quotidienne commune avec ces personnes qui se politisent. Cela ne fera pas disparaître les 20 % de racistes et de partisan.e.s de l'extrême droite au sein de la population. Mais cela peut encourager ceux et celles qui descendent aujourd'hui dans la rue pour s'opposer à la montée de l'extrême droite, leur donner la force de tenir bon et de continuer, ainsi qu'une perspective d'action commune et solidaire.
J. H. Wassermann
P.-S.
• Traduit pour ESSF par Pierre Vandevoorde avec l'aide de DeepLpro.
Source : Intersoz (ISO), 24/02/2025 :
https://intersoz.org/nach-den-bundestagswahlen-widerstand-statt-anpassung/
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La « submersion » étrangère : un fantasme raciste français récurrent

La hantise d'une submersion imaginaire du pays par les étrangers a une longue histoire en France. François Bayrou ne fait que reprendre un stéréotype colonial.
Thème fétiche de l'extrême droite raciste, variante de la théorie délirante du « grand remplacement », la hantise d'une « submersion » imaginaire par les étrangers vient d'être à nouveau brandie par le premier ministre François Bayrou. Elle est également exploitée de façon éhontée par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Un « débat » sur « l'identité française », rappelant furieusement les errements xénophobes et racistes de la présidence Sarkozy, est annoncé. De même qu'une remise en cause du droit du sol non seulement à Mayotte mais aussi en France. L'historien Alain Ruscio montre ici que le fantasme politique ainsi agité est aussi ancien que récurrent dans notre histoire.
15 février 2025 | tiré d'Europe solidaire sans frontières Alain Ruscio
https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article73677
Une identité nationale submergée ? Une idée vieille comme… la France
La France est-elle une personne, comme le pensait Michelet ? Y a-t-il une identité propre à ce pays, à la fois comparable et opposable à d'autres ? Si oui, quelle est son essence ? Chrétienne ? Blanche ? Quand enfonça-t-elle ses racines dans l'hexagone ? « La population de notre pays est restée homogène depuis ses origines » (Front National, Programme de gouvernement, 1993)[1]. Origines ? Du temps des Gaulois, comme l'école de la IIIe République tenta de le faire croire ? Sous les Mérovingiens ? Les Carolingiens ? Les Bourbon ? Sous la Révolution ? Les Français éprouvent un « sentiment de submersion » vient d'affirmer François Bayrou en précisant : « Les apports étrangers sont positifs pour un peuple, à condition qu'ils ne dépassent pas une proportion »[2]. C'est la vieille théorie du seuil de tolérance.
Ou, a contrario, cette essence n'est-elle qu'une invention ? L'identité n'est-elle pas plutôt une construction permanente, dont aucune définition ne pourrait être figée ?
Ces interrogations n'ont cessé de susciter polémiques et mises au point des politiques et des intellectuels.
Premiers débats
On peut être surpris de constater que la sensation d'une menace sourde sur l'identité nationale par une présence d'éléments autres a plusieurs siècles d'existence.
Au XVIIIe siècle, où les esclaves noirs, emmenés en métropole par leurs maîtres, et parfois abandonnés, n'étaient que quelques milliers, le Procureur du Roi à la Cour de l'Amirauté de France jugea la figure de la France menacée : « L'introduction d'une trop grande quantité de Negres en France (…) est d'une dangereuse conséquence. Nous verrons bientôt la nation Françoise défigurée si un pareil abus est toléré » (Guillaume Poncet de la Grave, Ordonnance, 31 mars 1762)[3].
En 1802, telle était l'opinion d'un ancien avocat-colon du Cap français (Saint-Domingue), exilé en métropole, dans un chapitre intitulé « L'inconvénient du Nègre en France » : « Depuis la révolution, le sang Africain ne coule que trop abondamment dans les veines des Parisiennes mêmes. Il est vrai que l'espèce de femmes qui s'allient aux Noirs est la plus vile de Paris et des départemens. Mais il en naît de gros mulâtres renforcés, plus bronzés même que dans les Colonies. Ces mulâtres épouseront eux-mêmes quelques-unes de ces femmes, et leur troisième ou quatrième génération peut se mêler à des femmes plus relevées. Si cet abus subsistoit plus longtemps, il attaqueroit donc jusqu'au cœur de la nation, en en déformant les traits, et en en brunissant le teint. Le moral prendroit alors la teinte du physique, et la dégénération entière du peuple Français ne tarderoit pas à se faire appercevoir » (Louis-Narcisse Deslozières, Les égaremens du nigrophilisme, 1802)[4].
La présence même en métropole d'un seul homme de couleur, le député de Saint-Domingue Belley, amènera des incidents significatifs. Pour beaucoup de Français, alors, on ne pouvait vraiment pas être nègre et Français. Le 5 thermidor an III (23 juillet 1795) eut lieu à la Convention un débat houleux. Évoquant la grande île, un député Girondin, Jean Serres, adjura ses collègues de cesser de « faire couler le sang français par torrents (…) pour faire triompher les Africains ». La formule méprisante provoqua une réaction indignée de Belley[5], qui s'exclama : « Est-ce que je suis un chien ? », ce qui lui attira cette réponse définitive de la salle : « Non, mais tu n'es pas Français ». À ce même Belley sera à une autre occasion dénié le droit d'être Français, puisqu'il était d'ailleurs « de nation afriquaine-bambara »[6].
La période coloniale
Que ce fût pour les besoins de l'appareil productif ou pour assurer la défense du territoire national, l'appel à des indigènes à venir sur le territoire de l'hexagone traverse l'histoire coloniale française. Avec le revers de ce phénomène : la présence d'immigrés colonisés fut souvent vécue comme une invasion et, donc, assimilée à une perte d'identité.
L'un des grands théoriciens de la question des races, Georges Vacher de Lapouge, écrivit en 1899 un essai au titre qui prendra par la suite une dimension tragique : L'Aryen. Il déclarait y constater que l'invasion était un processus irréversible : « L'immigration a introduit depuis un demi-siècle plus d'éléments étrangers que toutes les invasions barbares. Les éléments franchement exotiques deviennent nombreux. On ne rencontre pas encore à Paris autant de jaunes et de noirs qu'à Londres, mais il ne faut se faire la moindre illusion. Avant un siècle, l'Occident sera inondé de travailleurs exotiques (…). Arrive un peu de sang jaune pour achever le travail, et la population française serait un peuple de vrais Mongols. “Quod Dii omen avertant !“[7] » (L'Aryen, 1899)[8]. En 1923, pour lui, le processus était presque achevé : la France était un pays envahi, la « fin du monde civilisé » se profilait à l'horizon[9]. Il vécut encore 13 années. Nul doute qu'il vît l'évolution de la société française d'un œil plus sombre encore…
Un tiers de siècle plus tard, le démographe Georges Mauco, même s'il n'utilisa pas le mot d'identité, émit les mêmes craintes : « L'accroissement continu de la masse des étrangers qui rend plus lente et plus difficile depuis la guerre leur assimilation, développe, par ailleurs, le redoutable problème de la saturation. Certes, la France est merveilleusement douée pour absorber les apports étrangers et il n'est pas au-dessus de ses écoles, de ses élites, d'encadrer, de diriger, d'éduquer l'énorme armée des mercenaires du travail qu'il lui a fallu recruter. Mais l'augmentation à prévoir de la masse des étrangers ne risque-t-elle pas de dépasser sa faculté d'absorption ? La France ne court-elle pas le risque de voir l'immigration facteur de renouvellement devenir une force de substitution ? L'immigration apporte des éléments humains peu évolués, frustes en général, parfois inférieurs. Tant que le rythme des arrivées permet d'éduquer, il y a enrichissement et atténuation de notre pénurie d'hommes. Mais quel danger du jour où la diminution des cadres et le gonflement des troupes rendraient difficile l'assimilation de celle-ci ! » (La Revue de Paris, 15 février 1933).
C'est l'époque où une partie de la presse, beaucoup d'hommes politiques, d'intellectuels, mènent une campagne contre les indésirables, les métèques, une masse indistincte englobant tous ceux qui ne correspondaient pas à certains critères, « qui n'ont ni le parler ni la figure des gens de chez nous » (Henri Béraud, 1936)[10]. Un grand écrivain reprit alors à son compte ces thèses : « Qu'importe si les frontières du pays soient intactes si les frontières de la race se rétrécissent et si la peau de chagrin française est le Français ! » (Jean Giraudoux, Pleins pouvoirs, 1937)[11]. Un essayiste, Raymond Millet, s'effraya qu'il y ait « trois millions d'étrangers en France » (c'était le titre de son essai) et proposa aux autorités d'opérer un tri entre les « bienvenus » (une minorité) et les « indésirables » (la masse), « nos facultés d'assimilation et d'absorption (restant) considérables quand le pourcentage d'étrangers ne dépass(ait) par une certaine limite » (1938)[12]/
Après-guerre, les expressions indésirables et métèques étant devenues sulfureuses, c'est contre « l'ethnie nord-africaine » que se tournèrent les interrogations : « Jusqu'à quel point et dans quelles limites numériques et même géographiques une assimilation est-elle possible ? Les facteurs à considérer sont d'ordre physique et d'ordre ethnique. Au point de vue physique, il s'agit de savoir si cette immigration risque de bouleverser les composantes physiques constatées en France et exprimées par une certaine répartition de caractères aussi évidents que la stature, la pigmentation, l'indice céphalique. Au point de vue ethnique, il s'agit de savoir si l'ethnie nord-africaine affirmée par une certaine civilisation, c'est-à-dire une langue, des mœurs, une religion, un comportement général et jusqu'à une mentalité, oppose un refus absolu, un antagonisme total à ce que l'on peut considérer comme l'ethnie française » (Louis Chevalier, Le problème démographique nord-africain, 1947)[13].
Plus tard, parmi les causes du désengagement gaulliste de l'Algérie, il y avait la crainte du Général de voir, en cas d'assimilation totale, le « peuple européen de race blanche » se dissoudre : « C'est très bien qu'il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns. Ils montrent que la France est ouverte à toutes les races et qu'elle a une vocation universelle. Mais à condition qu'ils restent une petite minorité. Sinon, la France ne serait plus la France. Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. Qu'on ne nous raconte pas des histoires ! » (Propos, 5 mars 1959)[14].
Ces propos ont certes été tenus en privé. Mais, manifestement, le Général tenait à ce qu'ils soient rapportés (Alain Peyrefitte était un fidèle et un proche).
Avec le temps, la notion de seuil de tolérance explosa dans le vocabulaire de bien des hommes politiques, journalistes et intellectuels. Un jeune chercheur, Mathieu Rigouste, en décela une première trace dans un article de 1969 de Maurice Schuman, alors ministre d'État chargé des affaires sociales[15]. À la même époque, deux circulaires gouvernementales (70-27 et 70-88 du 4 mars 1970) fixèrent à 15 % le maximum de population étrangère dans les HLM[16].
Le 25 août 1973, à Marseille, l'assassinat d'un conducteur de bus – français –, Émile Gerlach, par un malade mental – arabe –, Salah Bougrine, suscita un vif débat. Le ministre chargé des relations avec le Parlement considéra que c‘était l'installation d'une communauté étrangère qui était la cause de la tension, égratignant au passage la municipalité socialiste dirigée par Gaston Defferre (Joseph Comiti, Déclaration, 30 août 1973)[17]. Avec plus de finesse, le président Pompidou ne dit pas autre chose, lors de la conférence de presse qui suit immédiatement ces crimes : « Il faut bien voir qu'il y a un problème (…) : les Nord-Africains, et particulièrement les Algériens, sont concentrés dans quelques agglomérations : Marseille et sa banlieue, la banlieue lyonnaise, Paris et sa banlieue » (Conférence de presse, Paris, 27 septembre 1973)[18].
En 1983, Michel Debré, en fin de carrière politique, mais dont l'autorité reste grande dans les milieux conservateurs, participe à la 36e session du très officiel Institut des hautes études de la Défense nationale. Il y fait une contribution significativement intitulée L'immigration est-elle une invasion ? Réponse : « Désormais, les travailleurs d'origine étrangère occupent souvent, en rangs serrés, certains quartiers de nos villes. Il s'est développé un “quart monde“ sur notre propre territoire »[19].
Le plus grave sans doute est le ton de l'évidence, adopté par des familles politiques par ailleurs opposées : « Le seuil de tolérance est dépassé dans certains quartiers, et cela risque de provoquer des réactions de racisme » (Jacques Chirac, 13 juillet 1983)[20]… « Je ne souhaite pas aggraver le chômage en France en laissant la porte ouverte aux travailleurs immigrés (…). Le gouvernement français sera très ferme : la France ne peut plus accueillir des travailleurs étrangers » (Georgina Dufoix, PS, 23 février 1984)[21]… « Il faut partir d'une évidence : on ne peut pas prendre le risque de laisser augmenter encore le nombre d'immigrés en France » (Jean-Claude Gaudin, Figaro Magazine, 1er juin 1985)[22]… Que dire, alors, de la caution étatique, dans la bouche de François Mitterrand, lors d'un entretien avec Christine Ockrent : « Le seuil de tolérance a été atteint dès les années 70, où il y avait déjà 4,1 à 4,2 millions de cartes de séjour, à partir de 1982 (…). Il ne faut pas dépasser ce chiffre, mais on s'y tient depuis des années et des années » (Antenne 2, 10 décembre 1989)[23]. C'est exactement au même moment (3 décembre 1989) que son Premier ministre, Michel Rocard, prononce une phrase restée célèbre : « La France ne peut pas recevoir toute la misère du monde »[24].
1989 : c'est l'année dite des foulards de Creil… Le terrain était prêt pour une offensive plus spécifiquement dirigée contre la population la plus présente dans cette immigration : les Maghrébins, décrétés tous musulmans.
Alain Ruscio
Notes
[1] 300 mesures pour la renaissance de la France. Programme de gouvernement, Programme rédigé par Bruno Mégret, Brochure Front national, Paris
[2] Interview à LCI, 27 janvier 2025.
[3] Cité par Pierre H. Boulle, Race et esclavage dans la France de l'Ancien Régime, Paris, Perrin, 2007.
[4] À Paris, Chez Migneret, Imprimeur (Gallica).
[5] Le nom n'est pas cité dans le compte-rendu. Mais, d'après Claude Wanquet, qui cite cette anecdote, il s'agit bien de Belley (La France et la première abolition de l'esclavage, 1794-1802. Le cas des îles orientales Ile-de-France (Maurice) et la Réunion, Paris, Karthala, 1998).
[6] Pétition de colons contre Belley, citée par Vertus Saint-Louis, « Le surgissement du terme “africain“ pendant la révolution de Saint-Domingue », Revue Ethnologies, Vol. XXVIII, n° 1, 2006 (Persée).
[7] « Puissent les dieux démentir ce présage ! »
[8] L'Aryen, son rôle social, Cours libre de science politique, professé à l'Université de Montpellier (1889-1890), Paris, A. Fontemoing Éd., 1899.
[9] « Dies Irae. La fin du monde civilisé », Europe, 1 er octobre 1923.
[10] Gringoire, 7 août 1936, cité par Ralph Schor, « L'extrême droite française et les immigrés en temps de crise. Années trente-années quatre vingts », Revue européenne des migrations internationales, Vol. XII, n° 2, 1996 (Persée).
[11] Paris, Gallimard, NRF
[12] Trois millions d'étrangers en France. Les bienvenus, les indésirables, Paris, Libr. de Médicis.
[13] Cahiers de l'INED, Coll. Travaux et Documents, n° 6, Paris, PUF.
[14] Propos tenus à Alain Peyrefitte, rapportés in C'était de Gaulle, Vol. I, La France redevient la France, Paris, Ed. de Falois / Fayard, 1994.
[15] L'ennemi intérieur. La généalogie coloniale et militaire de l'ordre sécuritaire dans la France contemporaine, Paris, Éd. La Découverte, Coll. Cahiers libres, 2009.
[16] José Rodrigues Dos Santos & ; Michel Marie, « L'immigration et la ville », Espaces & ; sociétés. Revue critique internationale de l'aménagement, de l'architecture et de l'urbanisation, n° 8, février 1973.
[17] Le Monde, 1 er septembre
[18] Le Monde, 29 septembre
[19] IHEDN, Dossier L'Environnement national, 1983-1984, cité par Mathieu Rigouste, L'ennemi intérieur. La généalogie coloniale et militaire de l'ordre sécuritaire dans la France contemporaine, Paris, Ed. La Découverte, Coll. Cahiers libres, 2009
[20] Le Monde, 15 juillet.
[21] « La France ne peut plus accueillir de travailleurs étrangers », Les Échos, 24 février.
[22] « Qu'ils commencent d'abord par nous accepter, nous ».
[23] Cité par Christine Barats, L'intégration et le discours présidentiel sur l'immigration, 1981-1991, Thèse pour l'obtention du titre de Docteur en science politique, Université de Paris-Dauphine, UER Sciences des organisations, janvier 1994.
[24] Cette formule, souvent citée, a été effectivement prononcée, sous des formes différentes, toutes en 1989 : lors d'un débat à l'Assemblée nationale (6 juin), lors d'une assemblée de la CIMADE (28 novembre), émission Sept sur sept, avec Anne Sinclair (décembre).
P.-S.
• Histoire coloniale et postcoloniale. 15/02/2025 :
https://histoirecoloniale.net/la-submersion-etrangere-un-fantasme-raciste-francais-recurrent-par-alain-ruscio/
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le Canada pour Trump et Musk ? L’Ukraine pour Poutine et Abramovitch ?

Le 24 février 2025, cela fera trois ans que Vladimir Poutine a lancé une invasion militaire à grande échelle de l'Ukraine pour, officiellement, la dézanifier. Depuis, des centaines de milliers de personnes sont mortes, Trump a été élu président États-Unis, il revendique le Canada, le Groenland, le canal de Panama comme son "lebensraum", son secrétaire à La Défense exhibe des tatouage nazis sur son torse, Musk fait des saluts nazis à la face du monde et tous s'entendent avec Poutine et oligarques, comme larrons en foire, pour "purifier leur territoire" de la vermine Woke, se partager et piller l'Ukraine, procéder à un nettoyage ethnique de la Palestine.
La gauche canadienne
Dans ce contexte, la majorité des dirigeant·es de la classe ouvrière ou qui s'en revendiquent soit se taisent (pour la majorité) soit se félicitent : enfin la paix !
Contrat - USA
https://legrandcontinent.eu/fr/2025/02/18/trump-exige-la-vassalisation-economique-de-lukraine/
Bulletin syndical
https://drive.google.com/file/d/1m2nHfzVYqRKMUD3z72KKtb2GB0poO0VP/view
Brigades
https://www.syllepse.net/syllepse_images/soutien-a---lukraine-re--sistante-n-deg-36-2_compressed.pdf
Vidéo du président du FTU
https://mail.fpsu.org.ua/www/20250224/video_20250224_for_int_v3.mp4

Un auteur arrêté pour des publications sur les réseaux sociaux critiquant Israël et emprisonné pour avoir écrit sur les accusations portées contre lui

À 9 h 30 jeudi, la police de Montréal prévoit d'arrêter l'auteur Yves Engler pour avoir publié des messages sur les réseaux sociaux dénonçant la violence d'Israël à Gaza. Après qu'Engler a écrit sur les accusations douteuses portées contre lui pour avoir critiqué Israël, la police a ajouté quatre nouvelles accusations, affirmant qu'il harcelait la police.
Engler devait initialement être arrêté après une plainte pour harcèlement déposée contre lui par la personnalité médiatique raciste Dahlia Kurtz. Kurtz, qui accuse le premier ministre Justin Trudeau d'être antisémite et de soutenir le terrorisme, a engagé une candidate du Parti conservateur et avocate pour faire pression sur la police de Montréal afin qu'elle porte plainte contre Engler. Ce dernier ne nie pas avoir qualifié Kurtz de « partisane du génocide » et de « fasciste » sur Twitter. Étrangement, Kurtz n'a jamais bloqué Engler sur X, malgré ses affirmations selon lesquelles elle se sentirait intimidée.
« En tant que père d'un enfant de deux ans et d'un autre de sept ans, et auteur de 13 livres, il est absurde de prétendre que je représente une menace pour Dahlia Kurtz », souligne Engler. « Je n'ai jamais rencontré Kurtz. Je ne lui ai jamais envoyé de message ni de courriel. Je ne l'ai jamais menacée. Je ne la suis même pas sur X. »
En moins de 24 heures, 2 500 personnes ont envoyé un courriel à la police de Montréal pour exiger l'abandon des poursuites contre Engler.
Furieuse de recevoir des courriels et de faire face à une forte critique publique, la police prétend maintenant qu'Engler les harcèle en écrivant sur les accusations portées contre lui. La police de Montréal l'accuse désormais d'intimidation, de harcèlement, de communication harcelante et d'« entrave » envers un agent de police.
Pour en savoir plus sur ces accusations, lisez cet article ainsi que ce document de référence.
Des personnes accompagneront Engler à 9 h 30 lorsqu'il sera emprisonné au 980, rue Guy, Montréal.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La société ukrainienne dans la troisième année de résistance à l’invasion russe : points d’unité et de division
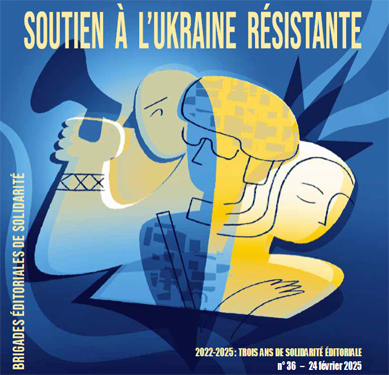
Nous sommes en février 2025 et de nom- breux Ukrainiens ont oublié à quoi ressemblait leur vie avant l'invasion russe. Le sentiment d'in- sécurité, les pertes douloureuses et la séparation d'avec les membres de la famille sont des attributs inhérents à la vie de nos citoyens, qu'ils vivent en Ukraine ou même à l'étranger. La longueur de la ligne de front en Ukraine dépasse désormais les 3 000 kilomètres. La population de l'Ukraine s'est réduite à environ 30 millions d'habitants. Les autorités font-elles assez pour réduire la menace militaire et préserver un espace de vie ? Telles sont quelques-unes des questions clés qui préoccupent les Ukrainiens et qui définissent leur attitude à l'égard de l'État en pleine guerre. La vie politique s'anime peu à peu, même si la situation autour de nous ne semble pas s'y prêter, avec la poursuite de l'offensive russe dans le Donbass et le risque de bombardements sur toutes les villes.
Vitaliy Dudin est avocat du travail, membre de l'organisation socialiste Sotsialnyi Rukh. Kyiv, 12 février 2025.
Février 2025 | tiré de Soutien à l'Ukraine résistance (Volume 36)
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/wp-content/uploads/2025/02/soutien-a-lukraine-resistante-nc2b036.pdf
Pour lire ce bulletin Cliquez sur l'icône :
Face à l'impérialisme le plus agressif de notre époque – l'impérialisme russe – le peuple ukrainien a choisi la voie de la lutte. Notre so- ciété a montré un élan d'auto-organisation sans précédent, a pardonné à l'État ses imperfec- tions et la solidarité internationale est devenue tangible. L'Ukraine tient bon, le poutinisme n'a pas atteint ses objectifs mais l'issue semble loin- taine.
L'État ukrainien a peu changé depuis, mais le contexte dans lequel il opère a changé. Il n'y a pas de solution facile pour sortir de l'état de guerre. Que devrions-nous faire – mettre fin à la guerre contre l'impérialisme russe ou la pour- suivre, tout en devenant dépendants du président américain Donald Trump ?
Bien sûr, les changements dans la situation internationale auront un impact sur la façon dont les transformations au sein de l'Ukraine auront lieu. J'aimerais faire le point sur ce que les trois années de guerre ont apporté et si la dynamique actuelle ouvre des perspectives pour une politique plus progressiste.
Le capitalisme ukrainien, une usine à problèmes
Rares sont les analystes politiques qui, lorsqu'ils étudient le système politique ukrainien, ne soulèvent pas la question de la légitimité du président Zelensky. Mais la question mérite d'être posée plus profondément : tout le discours dominant fondé sur les valeurs libérales et la confiance en l'Occident est-il en train de perdre sa légitimité ? Il est en train d'échouer. Au début de la guerre, tout semblait plus simple : nous voulions un capitalisme à l'américaine et une intégration dans l'OTAN. Depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, les choses se compliquent et les objectifs précédents sont remis en cause. Le consensus de droite s'effondre progressivement. Les attitudes à l'égard de l'extrême droite ont changé. Les événements récents ont montré la proximité de leurs idées avec les idées conservatrices de l'extrême droite européenne, adepte de Vladimir Poutine.
La plupart des forces politiques ne vont toujours pas au-delà du consensus droite-libéral. Bien sûr, les idées réactionnaires d'ethnonationalisme et d'autoritarisme sont largement représentées en Ukraine, mais heureusement pas autant que le voudrait la propagande de Poutine. Par ailleurs, la revendication de justice sociale des masses est de plus en plus prononcée : les mineurs, les infirmières et les cheminots ukrainiens souffrent tellement des abus des classes dirigeantes que la lutte contre ces abus n'a pas cessé, même au milieu de la guerre. Dans le chaos de la guerre, l'inégalité sociale est encore plus douloureuse qu'auparavant : si vous êtes riche, vous avez beaucoup plus de chances de sauver votre vie ! En même temps, l'incapacité de l'appareil d'État à être au service les gens a été prouvée par des exemples tragiques.
Si l'on ne résout pas la question sociale, c'est-à-dire la redistribution des biens et du pouvoir en faveur de la majorité de la population, l'Ukraine est condamnée à se trouver dans une situation extrêmement précaire. Cependant, la mise en œuvre d'une ligne de conduite de la gauche n'est pas si simple. Nous sommes en fait le seul pays européen où la gauche est absente de la « grande scène » politique en tant que phénomène, et presque toutes les forces politiques jugent nécessaire de proférer la haine de la gauche, en manipulant habilement les traumatismes du passé soviétique. L'Olympe politique existera encore longtemps sans la gauche, il faut l'accepter. Toutefois, au niveau local, un champ de pratique politique de gauche s'ouvre. J'associe mon optimisme à l'activisme des représentants des régions relativement industrialisées de l'est et du sud de l'Ukraine, proches de la ligne de front actuelle. Pourquoi ? Parce que pendant la guerre, ces régions ont connu une transformation significative. Tout d'abord, elles ont bénéficié d'un grand coup de fouet moral, car leurs compétences se sont révélées extrêmement utiles pendant la guerre – à la fois dans la production et, surtout, sur la ligne de front. Deuxièmement, ces villes ont enfin affirmé leur identité nationale face à la terreur impitoyable de la Russie. Troisièmement, de nombreuses personnes (en particulier des femmes) sont parties vers l'Union européenne, et ont fait l'expérience de l'efficacité des politiques de l'État-providence. C'est donc dans cet environnement que les partisans des idées de gauche devront chercher leur base sociale (même si, bien sûr, les oligarques voudront aussi jouer sur le mécontentement des masses). À mon avis, la principale caractéristique de la société n'est pas tant la lassitude des gens face à la guerre que leur déception fac à l'inadaptation du capitalisme ukrainien aux conditions de la guerre. La dépendance de l'élite à l'égard des instruments libéraux l'a empêchée de prendre des décisions qui auraient pu sauver des vies :
1) le développement du complexe militaro-industriel a échoué en raison de la dépendance à l'égard des importations d'équipements militaires ;
2) nous n'avons pas réussi à introduire l'impôt progressif en rai son de l'attrait des prêts [occidentaux] ;
3) la fin du contrôle de la protection du travail a entraîné la mort de nombreux et précieux spécialistes ;
4) l'austérité dans le secteur public a entraîné une détérioration de la qualité du potentiel humain, rendant de plus en plus difficile pour les Ukrainiens d'étudier et d'éduquer leurs enfants, de suivre un traitement médical et de se réadapter ;
5) les restrictions des droits des travailleurs ont profité aux oligarques, et ont découragé les gens de travailler.
La volonté de maintenir le capitalisme intact nous a coûté cher. Je reste persuadé que l'Ukraine est capable de résister à Poutine, mais à quel prix ? Les rumeurs persistent selon lesquelles l'Ukraine céderait ses richesses naturelles pour continuer à recevoir de l'aide et que ce serait le prix naturel à payer pour ne pas à démanteler le système de capitalisme libéral qui a freiné notre potentiel. Sans parler des problèmes de corruption et de conditions de vie déplorables.
La mobilisation
La question de la mobilisation est devenue l'un des sujets qui divisent le plus la société. Cependant, l'Ukraine n'avait guère d'autre moyen de résister à l'armée russe pendant trois ans et sans être membre de l'OTAN. Au sein de Sotsialnyi Rukh, il y a à la fois des personnes qui sont allées volontairement au front et d'autres qui ont été mobilisées. Toutes méritent un respect sans bornes car elles permettent à notre organisation de remplir sa véritable mission. C'est difficile à admettre, mais arrêter la mobilisation dans ces conditions, c'est alourdir le fardeau de ceux qui sont déjà mobilisés et qui se sentent le plus mal. Bien sûr, la procédure peut être améliorée : pour prévenir des événements particulièrement honteux, des « groupes d'alerte » devraient être composés de représentants des structures des droits humains qui enregistreraient les violations des droits élémentaires. Cela aurait peut-être permis de décourager le recours à des méthodes violentes.
Le plus grand problème, cependant, est que la mobilisation du peuple n'est pas accompagnée par des mesures de mobilisation équivalente contre le capital (voire la confiscation des biens des groupes oligarchiques). Le fait que la société ukrainienne ait fait preuve d'une forte unité contre l'idée d'une réserve [exemption] économique (« seuls les pauvres se battent ») est une victoire évidente, car autrement le désespoir aurait pu être total. Il ne fait aucun doute que l'Ukraine doit rechercher un équilibre entre les besoins de mobilisation et le fonctionnement de l'économie. Il est indéniable qu'un nombre important d'hommes échappent à la mobilisation et viennent grossir les rangs de la population économiquement inactive. Toutefois, il est possible de parvenir à cet équilibre grâce à des outils socialement acceptables : des réserves temporaires pour les hommes qui commencent à travailler après une longue interruption, des réserves pour le personnel clé dans les infrastructures critiques et l'adaptation de la sphère sociale et de l'emploi aux besoins des femmes. Pourquoi les gens vont-ils au front ? Ce n'est pas seulement par amour abstrait de l'Ukraine (même si, croyez-moi, cette raison suffit à beaucoup). Le fait est que la plupart des Ukrainiens croient en la capacité de l'Ukraine à changer.
C'est ce qui nous différencie des pays voisins comme la Russie et le Bélarus, où toutes les décisions dépendent depuis longtemps de la volonté d'une personne en place. De nombreux Ukrainiens rêvent de voir l'État lutter contre la concentration excessive des richesses, où l'économie commencera à fournir aux Ukrainiens tout ce dont ils ont besoin pour une vie prospère et où les conditions de travail seront influencées par les organisations syndicales pour rendre les gens heureux. Nous régnerons alors véritablement sur notre pays, nous n'aurons plus peur des ennemis extérieurs et nous cesserons de les chercher à l'intérieur. Lutte sociale : qui défend les travailleurs ? Pendant la guerre, la gauche ukrainienne et Sotsialnyi Rukh, ont été contraints de se réinventer dans de nouvelles conditions. Nos militants combattent l'occupant les armes à la main, répondent bénévolement aux besoins humanitaires et militaires, fournissent une assistance juridique aux travailleurs des infrastructures critiques touchés par les agresseurs russes et apportent un soutien psychologique aux groupes affectés par la guerre. Nous sommes des membres à part entière de la société civile, même si nous sommes porteurs de valeurs particulières : nous croyons à la démocratie socialiste, à la solidarité internationale et à la primauté de la dignité humaine. Et notre position claire contre les politiques néolibérales n'a jamais été aussi pertinente.
Dans le contexte actuel d'aggravation de la crise, le gouvernement cherche un moyen facile de stabiliser l'économie aux dépens des citoyens : en introduisant un système de retraite par capitalisation, en adoptant un nouveau Code du travail pour remplacer celui de 1971 et en privatisant les banques ou les chemins de fer appartenant à l'État. Aucune de ces réformes n'est nouvelle – tous les gouvernements ukrainiens ont voulu les mettre en œuvre depuis la crise financière de 2008. La survie du mouvement syndical organisé dépend de la capacité des syndicats ukrainiens à trouver la force de s'unir et de lutter contre ces réformes exorbitantes. Bien sûr, les syndicats ukrainiens sont depuis longtemps un instrument de lutte 9 collective, mais pendant l'invasion, ils sont devenus plus conscients de leur responsabilité envers les travailleurs, car ils restent la voix la plus forte des intérêts des travailleurs. Malgré l'interdiction officielle des rassemblements, des manifestations de rue contre les fermetures d'hôpitaux et des fusions d'universités ont lieu en Ukraine. Car rien ne nous fera accepter les mauvaises conditions de vie. Dans la plupart des cas, l'optimisation du secteur public est réalisée d'une manière qui arrange les fonctionnaires, et non pour améliorer la qualité du service ou pour dégager des fonds pour la victoire. Par ailleurs, les Ukrainiens contestent de plus en plus les violations de leurs droits du travail devant les tribunaux, et chaque succès dans ces affaires est la victoire du peuple qui lui donne la force pour aller de l'avant et de remporter une grande victoire pour l'Ukraine. Je veux croire qu'à l'avenir la classe ouvrière jouera un rôle beaucoup plus important dans la vie du pays. Si elle a joué un rôle si important dans le maintien de la ligne de front et de la stabilité économique, serait-il démocratique de la priver de sa voix dans la sphère politique ? L'absence de forces politiques de gauche est le plus grand problème de la démocratie ukrainienne. Mais malgré toutes les pertes et la privation de droits actuelle, la classe ouvrière a une chance de devenir forte à long terme.
Des élections qui bousculent la démocratie
L'Ukraine est aujourd'hui confrontée à un choix difficile : comment préserver notre dignité et protéger notre démocratie ? Nous pouvons tous constater que la société se politise à grande échelle et cherche des idées pour changer le pays. Quelle sera la solution aux contradictions accumulées ? En dehors d'une révolution (dont la perspective n'est jamais à exclure en Ukraine), la seule option est l'organisation d'élections. Cependant, l'ensemble de la société est convaincue que la tenue d'élections pendant la guerre pourrait être l'une des épreuves les plus difficiles pour notre démocratie.
De nombreuses questions angoissantes se posent. Comment les élections peuvent-elles se dérouler en toute sécurité ? Les forces prorusses ne gagneront-elles pas ? Si les élections ont lieu, changeront-elles le paysage idéologique ? Je pense que nous ne devons pas céder à la peur panique. Nous devons réfléchir davantage aux dommages qui seront causés si les élections ont lieu demain et qu'elles se déroulent sans notre influence. Nous, la gauche ukrainienne, devons enfin donner aux travailleurs ukrainiens le droit de choisir. Si nous ratons les prochaines élections parce que nous ne sommes pas prêts, rien ne dit que l'histoire nous donnera une nouvelle chance de faire nos preuves. Malheureusement, la guerre nous a rappelé que le temps est limité et que nous ne sommes pas éternels. Si nous ne saisissons pas cette chance, nous serons condamnés à continuer à tourner en rond dans la lutte contre les conséquences du capitalisme à l'agonie – réduction des droits du travail, fermeture d'hôpitaux, etc. Tout d'abord, je voudrais commenter les craintes qui existent d'une vengeance prorusse. Comment la Russie peut-elle espérer un 10 quelconque succès alors qu'elle a causé des dommages irréparables à l'Ukraine et qu'elle s'est dressée elle-même contre les habitants des régions russophones qui lui sont proches ? Par ailleurs, l'Ukraine a déjà neutralisé les forces prorusses, notamment en interdisant les partis susceptibles d'avoir des liens avec la Russie. Les prochaines élections ne seront manifestement pas l'occasion d'une revanche prorusse.
Celle-ci pourrait survenir bien plus tard, si de plus en plus de personnes sont déçues par la démocratie ukrainienne et sa capacité à traiter les questions urgentes. Le plus grand danger est d'affronter seul ses propres problèmes et de s'y noyer. Lorsque l'agression de Poutine ne sera plus une excuse et que l'aide des partenaires internationaux disparaîtra. En d'autres termes, je pense que nous devons réfléchir ensemble à la manière de rendre notre démocratie durable, et que personne ne puisse la démanteler.
Je voudrais vous rappeler que les élections dans la République populaire d'Ukraine il y a plus d'un siècle n'ont pas pu empêcher l'effondrement de l'État ukrainien, bien qu'elles n'aient pas été une victoire pour les forces russes. Je pense que l'Ukraine est beaucoup plus forte aujourd'hui.
Malgré la perspective des élections, nous devrions réfléchir à la manière d'adapter le régime juridique de la loi martiale aux besoins de la démocratie ukrainienne (et non l'inverse). D'autant plus que la guerre va durer longtemps. Nous devons lever les restrictions sur le droit de grève et de manifestation, et étendre les formes de contrôle public ! Car dans le contexte ukrainien, la démocratie n'empêche pas les victoires militaires. En revanche, sa disparition provoque la panique, la peur et la méfiance. Au cours des trois dernières années, nous avons eu beaucoup de preuves de la première proposition et, malheureusement, de la seconde.
Solidarité mondiale et reconstruction
En conclusion, on ne saurait trop insister sur le fait que la question ukrainienne est une question mondiale. Je suis sincèrement convaincu que cette guerre montrera la capacité du monde à s'unir contre la barbarie. Les camarades des mouvements de gauche du monde entier ont encore une chance d'empêcher la plus grande catastrophe du 21e siècle – la défaite de l'Ukraine dans la guerre contre l'oppresseur impérialiste russe. Le succès des Ukrainiens servira d'exemple aux autres nations du monde qui osent aller à l'encontre des plans de l'envahisseur.
Je tiens à exprimer une fois de plus mon mépris pour ceux qui, depuis la pseudo-gauche, ont oublié l'essence de la véritable solidarité et cherchent n'importe quelle excuse pour refuser à l'Ukraine le droit de se défendre. Dans leurs analyses géopolitiques, ils ignorent le peuple ukrainien, qui est la clé de la résistance et de la prévention des réformes néfastes.
Enfin, je voudrais dire quelques mots sur la reconstruction. Malheureusement, les mots « reconstruction juste » perdent leur sens, tout comme les mots « paix juste ». Nous devons donner un sens réel à ce concept.
Pour moi, la paix et la reconstruction seront justes dans les conditions suivantes :
1) Garantir l'indépendance
L'annulation de la dette extérieure de l'Ukraine est une condition préalable. L'économie doit être socialisée : les entreprises stratégiques doivent être détenues par l'État sous la direction de collectifs de travailleurs. L'accent doit être mis sur le développement de l'énergie verte et de l'industrie afin que nous puissions produire des biens technologiques chez nous et ne pas dépendre des maîtres étrangers.
Les sociétés transnationales devraient adhérer à des normes sociales qui ne soient pas pires que celles de leur pays d'origine. Les ressources naturelles et la main-d'œuvre ukrainiennes doivent alimenter notre économie, et non assurer la prospérité de quelqu'un à l'étranger. Une perspective stratégique consisterait à conclure des alliances de défense avec les pays qui se sentent menacés par la Russie (notamment la Pologne, les États baltes et la Scandinavie). L'ensemble de la population devrait suivre une formation militaire et l'État devrait créer des garanties sociales appropriées à cet effet (maintien du salaire moyen pendant la formation). Dans ces conditions, l'Ukraine pourra surmonter sa position périphérique et mettre son indépendance au service des intérêts de la population.
2) Le pouvoir des travailleurs
La population active de l'Ukraine a payé un lourd tribut à l'indépendance et elle mérite donc le pouvoir. Les travailleurs doivent avoir une influence sur l'état des choses en Ukraine, en particulier à travers les partis ouvriers de gauche. Les lois ne devraient pas être adoptées sans l'accord des syndicats. Les travailleurs doivent être représentés dans la gestion des entreprises afin de garantir une répartition équitable des résultats de l'activité économique. Tous les accords d'investissement doivent être soumis à des audits syndicaux pour s'assurer qu'ils vont dans l'intérêt à long terme de la classe ouvrière et qu'ils favorisent l'emploi productif. Un ministère du travail devrait être créé pour veiller à ce que les intérêts des travailleurs soient pris en compte de manière optimale, pour déterminer la charge de travail la meilleure et pour coordonner les inspections du travail et les services de l'emploi, avec une direction nommée par les syndicats. C'est la seule façon de restaurer la confiance des travailleurs dans l'État et de promouvoir l'inclusion des citoyens dans la politique.
3) Une politique sociale pour tous
Égaliser les salaires entre les femmes et les hommes en établissant des salaires minimums fixes pour les secteurs les plus féminisés – éducation, santé et soins (ces salaires ne devraient pas être inférieurs à la moyenne nationale). Les appels d'offres pour la reconstruction devraient inclure des clauses sociales – le gagnant devrait être le candidat qui offre les meilleures conditions de travail et garantit la participation des employés à la gestion. L'accent doit être mis sur le soutien des programmes d'emploi par le biais de projets de construction d'infrastructures à grande échelle (y compris d'infrastructures sociales). Le syndicat peut obliger le propriétaire à augmenter les effectifs si la charge de travail maximale est dépassée. Les mères, les vétérans de guerre et les personnes handicapées devraient avoir un droit prioritaire à l'emploi. Il doit devenir économiquement non rentable de maintenir des normes sociales trop peu élevées !
Tous ces changements ne couvrent certainement pas tout ce dont l'Ukraine a besoin. Mais ils peuvent contribuer à ouvrir la voie à une politique plus inclusive, pluraliste et démocratique. Je voudrais également exprimer ma gratitude à tous nos amis internationaux qui ont fait leurs nos difficultés et nos triomphes, qui ont collecté des fonds et envoyé des fournitures précieuses à l'Ukraine, qui ont fait circuler de vraies informations malgré la crainte de faire l'objet de fausses accusations dans leur propre pays. Ensemble, nous avons déjà réalisé l'impossible : l'Ukraine a résisté et son avenir sera sans aucun doute beaucoup plus lié à celui du monde entier.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Comment se porte la démocratie à Victoriaville ?

Bien que citoyenne de Victoriaville depuis 30 ans, j'avais rarement fréquenté ses assemblées municipales. La lecture régulière du journal local suffisait à me tenir informée de l'actualité sylvifranche. Retraitée de l'enseignement collégial et désirant continuer à m'impliquer dans ma communauté, j'ai décidé, dans la dernière année, d'assister mensuellement aux séances du conseil de ville. J'y ai même pris la parole, pour exprimer mes préoccupations ou encore celles du groupe Sauvons la sablière d'Arthabaska auquel je me suis jointe.
Une lutte écocitoyenne
Je ne présenterai pas tous les motifs de notre opposition au projet d'un promoteur local qui, appuyé par la ville, veut construire sur le site de la sablière d'Arthabaska un quartier résidentiel haut de gamme d'environ 300 logements. Avec nos quelques 1500 sympathisant.es, nous voulions convaincre le maire Antoine Tardif et son conseil de sauver de la destruction cet écosystème fragile, l'un des derniers milieux naturels de notre territoire urbain. C'est un site paisible situé entre un boisé, des marécages et la rivière Nicolet. Il nous semblait urgent de protéger les espèces menacées qui le fréquentent, qu'il s'agisse des hirondelles du rivage, des tortues serpentines ou même des humains qui y trouvent refuge quand le stress devient anxiogène. Autoriser ce développement sous prétexte de contrer la crise du logement nous semblait malhonnête : des logements luxueux, on en a déjà ; c'est de logements abordables dont a besoin la population de Victoriaville. À nos arguments écologiques et sociaux, s'ajoutaient d'autres préoccupations, notamment patrimoniales. Mais surtout, durant cette lutte qui n'est pas encore finie, nous avons fait des constats inquiétants sur l'état de santé de notre démocratie municipale. Des constats peut-être partagés par d'autres citoyen.nes ailleurs en région.
Aucun effort de pédagogie
Imaginez un cours offert le lundi soir, à l'heure du souper, de 18 h à 19 h. Seriez-vous surpris de n'y voir que quelques rares élèves ? C'est d'ordinaire ce qui se passe aux séances du conseil de Victoriaville, quasi-désertes sauf peut-être une fois par décennie, lorsqu'un dossier particulier attire un public plus nombreux.
Que penseriez-vous d'un professeur qui, sachant qu'en cette occasion particulière son cours risque d'être très populaire, prévoit un nombre insuffisant de chaises, obligeant des élèves à s'asseoir par terre durant toute la séance ? C'est ainsi qu'on est accueilli dans la salle du conseil, où l'aménagement des lieux est pensé pour mettre en valeur les élu.es à la télévision, sans trop se soucier du confort de la population.
Entassé derrière la caméra, après le « mot du maire » qui présente d'abord ses récents bons coups au bénéfice des personnes qui n'auraient pas suivi ses nombreux selfies et autres publications d'auto-promotion sur les médias sociaux, le public doit ensuite l'écouter débiter les points de l'ordre du jour. Se succèdent alors des titres aussi passionnants que « Autorisation de dépenser dans le Règlement d'emprunt numéro 1486-2022 (parapluie) » ou que « Adoption d'un projet de résolution PPH 2025-01 concernant un projet particulier d'habitation pour les immeubles situés aux numéros 805-807 et 809, boulevard des Bois-Francs Sud » (titre réel de la résolution qui nous concerne). Comment être intéressé par un menu aussi peu comestible ? Car dans la grande majorité des cas, personne au conseil de ville ne prend la peine d'expliquer de quoi il retourne. Ou alors la greffière murmure qu'il s'agit d'une dépense de 10 385 293 $, et hop ! le sujet est clos. Il semble que la population, chez nous, n'a pas besoin de comprendre les raisons de telle dépense ou de telle décision ; après tout, elle a voté pour ce conseil et doit donc lui faire confiance ! (Quoique plusieurs élu.es, dont le maire lui-même, ont été élu.es sans opposition…) S'il advient, à ce stade-ci, qu'une personne dans l'assistance ait les yeux fermés, c'est qu'elle se sera malencontreusement endormie… Comme il arrive parfois aux étudiant.es durant un interminable cours magistral débité d'un ton monotone.
Absence de transparence et de débat public
Arrive enfin la période de questions ! Et avec elle, espérons-le, un peu d'action ! La population peut s'adresser à son conseil municipal, en fin de séance, à la condition d'avoir préalablement donné à l'agente de sécurité son nom, son adresse et le sujet de son intervention. Pas question d'improviser, de réagir séance tenante aux propos d'un.e élu.e, ni d'émettre un commentaire à saveur éditoriale. Ça prend une question. Courte et claire. Sinon on vous coupe la parole. Vous habitez le quartier no. 3 et voudriez que votre conseiller municipal vous réponde ? N'y pensez même pas. C'est uniquement le maire qui parle. Est-il présumé omniscient ? Le reste du conseil n'a-t-il jamais rien à dire ? On ne veut pas risquer que tel conseiller contredise publiquement le maire ? Allez savoir.
Voilà une citoyenne toute tremblante qui ose courageusement se présenter au micro et à la caméra pour poser sa question soigneusement préparée. Le maire peut l'interrompre à plusieurs reprises. S'il est embêté par la question, s'il n'en approuve pas les sous-entendus ou s'il ne connaît tout simplement pas la réponse, notre maire, jadis joueur de hockey, peut patiner longuement. Il peut aussi lever la séance sur un coup de tête, privant ainsi les citoyen.nes de la seule période où la parole leur est donnée. Ça s'est vu. Chez nous, à Victo. Récemment.
Après cela, notre citoyenne est-elle mieux informée ? Pas nécessairement. A-t-elle pu s'exprimer ? Si peu. Mais HEUREUSEMENT, lorsqu'un sujet est susceptible d'être contesté, la municipalité tient une séance de CONSULTATION PUBLIQUE ! Prenons l'exemple de la dernière en date, à Victoriaville, un lundi à l'heure du souper, bien sûr. Les gens concernés s'y sont présentés et se sont exprimés une heure durant. La greffière a dressé un procès-verbal résumant en une demi-page les propos tenus et l'a transmis au conseil de ville. Car les membres du conseil n'ont pas l'obligation de se présenter à la séance pour écouter le peuple. Ni le maire. A-t-il jugé que LE débat de la décennie dans notre petite ville n'était pas assez important pour qu'il se présente en personne ? Il semble qu'il ait préféré se fier au procès-verbal et aux commentaires qu'ont dû lui faire les deux conseillers présents ainsi que son attaché politique.
On se serait attendu, avant que la décision finale se prenne, à ce que les résultats de cette consultation soient présentés au conseil de ville suivant. À ce qu'on explique pourquoi, malgré une forte opposition citoyenne, les élu.es persistaient à vouloir aller de l'avant. Ou même à ce que le maire sorte de son chapeau un avis favorable du scientifique en chef ou de la directrice du développement durable qui, étrangement, ne se sont jamais prononcés sur le projet. Rien de tout cela ne s'est produit.
La décision finale a été prise à l'assemblée municipale du 3 février. Au point 10.4.1 de l'ordre du jour, le maire a lu le titre de la proposition, que quasi-personne dans l'assistance n'a reconnu (voir le texte du 2e exemple cité plus haut). Aucune proposition n'a été lue. Aucune explication, aucune justification n'a été donnée. Un conseiller a levé le doigt pour proposer. Un autre a levé le sien pour appuyer. Et le maire est passé au point suivant.
Il faut croire que le sujet avait été discuté entre élu.es, en catimini, avant l'assemblée. Aucun débat n'a eu lieu publiquement entre les membres du conseil. Personne n'a demandé le vote puisque personne n'a voulu voter contre. Conséquemment, la décision a été prise à l'unanimité : projet autorisé. Comme ce fut le cas pour TOUTES les décisions prises à Victoriaville dans TOUTES les assemblées des huit derniers mois. On s'y attendait, malheureusement. C'est pourquoi les opposant.es ont quitté sur le champ (et en silence) la salle du conseil.
C'est ça, la démocratie, à Victo ?
Lorsque des citoyen.nes écrivent des lettres d'opinion dans les médias locaux, adressent une pétition au conseil de ville, tiennent une conférence de presse et posent des questions aux séances du conseil ; lorsqu'ils organisent un spectacle de sensibilisation puis manifestent pacifiquement leur opposition en chantant aux élu.es quatre lignes de « Frère Jacques » leur demandant de VOTER, pour une fois, et de voter NON ; lorsqu'ils s'expriment aux assemblées de consultation publique, participent à une manifestation pacifique devant l'hôtel de ville suivie d'une marche au centre-ville, n'ont-ils pas rempli tous leurs devoirs citoyens ? Et quand, malgré tout cela, leurs supposé.es représentant.es les ignorent, peut-on parler de démocratie ? D'autres, en de telles circonstances, auraient envisagé la désobéissance civile…
Vers un parti d'opposition ?
Existe-t-il d'autres villes sans parti d'opposition où se tiennent des débats sains et publics entre les membres du conseil ? Ou alors faut-il, pour redonner de la vigueur à notre démocratie municipale, espérer qu'un parti d'opposition se crée à Victo ? Ne faudrait-il pas encourager la formation d'un parti écocitoyen ayant l'ambition de secouer un peu le « berceau du développement durable » ? Nous faut-il aller jusqu'à susciter des candidatures et mettre les personnes intéressées en contact les un.es avec les autres ? Nous y réfléchissons. Que la population de notre chère Victoriaville y songe aussi.
Sincèrement préoccupé.es, (1501 mots incluant le titre)
Silvie Lemelin. Ont appuyé ce texte :
Gilles Labrosse
Luce Michaud
France Labrecque
Gaël Deguire
Geneviève Doucet
Sophie Harvey
France Martin
Noémie Caron
Gaétan St-Arnaud
Stéphanie Déziel
Luc Couture
Chantale Marcotte
Sophie Beauregard
Manon Leclerc
Marie-Claude Chouinard
Maude Campeau
Nancy Hubert
Bastienne Duncan Châtelain
Juliette Houde
Lucie Cormier
Renaud Vimond
Marie-Soleil Drouin
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Ukraine : Sotsialnyi Rukh : « La défense de notre pays fait partie de la lutte pour la justice sociale »

Depuis le début de la guerre à grande échelle, de nombreux membres du Sotsialnyi Rukh se sont engagé·es dans la défense armée de l'Ukraine contre l'agression impérialiste de la Russie. Le 21 novembre 2024, le Sotsialnyi Rukh déclarait qu'« environ un million de défenseurs ukrainiens et des millions de membres de leurs familles sont malheureusement souvent confrontés à des violations de leurs droits fondamentaux. Nous avons donc décidé de nous joindre à leur protection… un protocole de coopération a été signé entre le Sotsialnyi Rukh et l'ONG Fonds pour le soutien social et juridique des participants aux opérations de combat.
Yana Bondareva, membre du Sotsialnyi Rukh (Kryvyï Rih), qui est particulièrement en charge d'une ligne téléphonique de soutien aux soldat·es et leurs familles, a bien voulu répondre à nos questions sur le sens de l'engagement militaire de son organisation.
Patrick Le Tréhondat
20 février 2025 |tiré du site entre les lignes entre les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/02/20/ukraine-sotsialnyi-rukh-la-defense-de-notre-pays-fait-partie-de-la-lutte-pour-la-justice-sociale/#more-90926
Le Sotsialnyi Rukh a créé une ligne téléphonique pour soutenir les soldat·es et leurs familles. Pourquoi cette initiative ?
Cette initiative vise à soutenir les militaires et leurs familles confrontés à des difficultés sociales et juridiques. La guerre met à rude épreuve non seulement les soldat·es, mais aussi leurs proches, qui peuvent avoir besoin d'aide pour les démarches administratives, les questions sociales, etc.
La ligne téléphonique du Sotsialnyi Rukh peut y répondre. Nous apportons :
* des conseils juridiques sur les garanties sociales, les prestations, le statut de combattant·e et les droits du travail.
* un soutien social en matière de réadaptation, d'adaptation à la vie civile et d'interaction avec les organismes gouvernementaux.
Un tel projet est important car de nombreux vétérans et leurs familles sont confrontés à des problèmes bureaucratiques, et une ligne téléphonique gratuite peut s'avérer une ressource vitale pour eux et elles.
Recevez-vous beaucoup d'appels et quelles sont les questions ou les demandes d'aide ?
La ligne d'assistance téléphonique reçoit beaucoup d'appels, ce qui confirme la forte demande de soutien de la part des militaires et de leurs familles. Toutefois, une campagne d'information encore plus importante permettrait d'élargir considérablement la portée de ce service. Une publicité supplémentaire dans les médias sociaux, les médias de masse, les organisations partenaires et les communautés locales permettrait d'atteindre les personnes qui ont réellement besoin d'aide mais qui ne sont pas encore au courant de cette initiative.
On nous demande souvent :
Questions juridiques
Comment obtenir le statut de combattant·e et quelles sont les prestations offertes ?
Est-il possible de faire appel d'un refus de paiement [de prestation sociale] aux militaires ou à leurs familles ?
Problèmes liés aux droits du travail : licenciement, maintien de l'emploi, paiement [du salaire] pendant le service.
Comment préparer correctement les documents après une blessure ou un handicap ?
Soutien social et réinsertion
Où puis-je trouver un centre de réadaptation pour les militaires ou leurs familles ?
Existe-t-il des programmes de reconversion et d'éducation pour les ancien·nes combattant·es ?
Comment puis-je obtenir une aide financière pour les familles des militaires décédés ?
Quels sont les programmes de soutien pour les enfants de militaires ?
Recevez-vous des appels téléphoniques de femmes soldats et quels sont leurs problèmes ?
Oui, nous recevons des appels téléphoniques de femmes soldat·es qui soulèvent un large éventail de questions.
Questions juridiques
Congé pour les femmes en service : comment exercer ses droits légaux ?
Prise de congé de maternité pour les femmes en service : qu'est-ce qui est prévu par la loi ?
Questions sociales et domestiques
Où trouver des soins médicaux spécialisés (gynécologue, psychologue pour les femmes militaires) ?
Comment retourner à la vie civile après le service et trouver un emploi ?
Existe-t-il des programmes de soutien pour les femmes vétérans ?
Des membres du Sotsialnyi Rukh se sont engagé·es dans l'armée. Pourquoi ce choix ?
Les membres du Sotsialnyi Rukh se sont engagé·es dans l'armée parce qu'ils et elles considèrent que la défense du pays fait partie de la lutte pour la justice sociale. Elles et ils ont toujours défendu les droits des travailleurs et des citoyens, et la guerre menace tous ces acquis. Certain·es ont d'abord fait du bénévolat, mais ont finalement décidé personnellement de se battre. En première ligne, elles et ils ne défendent pas seulement le pays, mais aident aussi leurs camarades à résoudre des problèmes sociaux et juridiques. Pour eux, c'est la poursuite du combat pour la liberté, l'égalité et la dignité.
Récemment, nous avons appris que le directeur de l'académie militaire de Lviv avait été élu. Nous savons qu'il existe une association de soldat·es LGBT+ dans l'armée ukrainienne. Il existe également une association de femmes soldates appelée Veteranka. Des soldats se disent publiquement anarchistes ou socialistes. Les militaires ukrainien·nes restent toujours en contact avec leurs syndicats, qui les soutiennent. Telle est la situation dans l'armée ukrainienne. Comment expliquez-vous ce que j'appelle « l'énigme de l'armée ukrainienne » ?
L'« énigme de l'armée ukrainienne » est une combinaison de phénomènes apparemment contradictoires : hiérarchie militaire traditionnelle et initiatives autonomes, discipline et diversité idéologique, institution étatique et rôle actif des organisations de base.
Dans le même temps, les militaires ukrainien·nes font partie de la structure de l'armée etfaçonnent activement leurs environnements en fonction des intérêts, des idéologies et desgroupes sociaux. Cela est possible parce que la société ukrainienne a historiquement développédes liens horizontaux et une tradition d'auto–organisation, qui s'est également manifestée dans l'armée.
Le soutien des syndicats et des organisations de la société civile montre que l'armée n'est pas isolée de la société, mais qu'elle interagit avec elle et défend ses droits. Il est également important de noter que de nombreux soldat·es étaient des activistes dans la vie civile et qu'elles et ils apportent donc leurs valeurs et leurs réseaux de soutien mutuel à l'armée.
Ainsi, l'armée ukrainienne n'est pas seulement un mécanisme étatique, mais une communauté vivante et socialement active qui reflète le pluralisme et les tendances démocratiques de l'ensemble de la société.
La question de la création de syndicats pour le personnel militaire a été débattue à de nombreuses reprises. Qu'en pensez-vous ?
La création de syndicats pour le personnel militaire est un pas important vers la protection de ses droits et de ses garanties sociales. Les militaires ont le droit d'être représenté·es en matière de salaires, de conditions de service et de soins médicaux. Cependant, il est important que les syndicats ne violent pas la discipline et la subordination militaires. Dans l'ensemble, les syndicats peuvent être un outil efficace pour améliorer la situation des militaires s'ils sont correctement organisés.
En Occident, beaucoup de militaires commentent la situation militaire. Leurs informations viennent souvent des Américains. Comment vous analysez la situation militaire. Avez-vous vos propres sources d'information ukrainiennes ?
Pour analyser la situation militaire, il est important d'utiliser différentes sources, notamment les agences de presse officielles ukrainiennes et les données provenant de la ligne de front. Les commentaires des responsables militaires occidentaux sont souvent importants, mais ils ne reflètent pas toujours la réalité des événements.
J'ai accès aux informations et aux ressources officielles, et je peux m'y référer pour recueillir des faits afin d'effectuer une analyse objective. Cependant, il est important de se rappeler que les informations peuvent être différentes [selon les sources] en temps de guerre et qu'il est toujours utile de comparer les sources pour obtenir des analyses plus précises.
Nous sommes aussi surpris de voir que les soldats s'expriment publiquement dans les journaux par exemple. C'est un droit d'expression important, particulièrement en temps de guerre. Comme la guerre a transformé l'armée ukrainienne ?
La guerre a considérablement changé l'armée ukrainienne, la rendant plus flexible et adaptée aux réalités modernes. Pendant le conflit, les militaires ont commencé à exprimer activement leurs pensées et leurs sentiments, ce qui est devenu une partie importante de leur expression personnelle. Ce droit à l'expression publique permet aux soldat·es de partager leurs expériences, d'impliquer le public civil sur des questions importantes et de remonter le moral des troupes. Dans le même temps, ces déclarations soulignent le changement d'attitude à l'égard des militaires : ils et elles ne sont pas seulement des exécutant·es, mais aussi des participant·es actif·ves à la vie sociale et politique du pays.
Quelles sont les conséquences politiques pour le Sotsialnyi Rukh de cet engagement dans les questions militaires ? Selon moi, le Sotsialnyi Rukh a acquis des compétences dans le domaine militaire (comparé à la gauche occidentale). Peut-on parler de la construction du début d'une alternative sur la question militaire de votre sur la base de votre expérience concrète ?
L'engagement du Sotsialnyi Rukh dans les questions militaires a des implications politiques. Cela permet à l'organisation non seulement de participer à des initiatives sociales et de défense des droits humains, mais aussi d'influencer des questions importantes liées à la guerre et à la sécurité. Par rapport à la gauche occidentale, qui se concentre souvent sur des initiatives pacifiques et la critique des structures militaires, le Sotsialnyi Rukh démontre une volonté de travailler avec l'armée en temps de guerre, tout en maintenant des idées de justice sociale, des positions anti-guerre et le soutien aux droits des militaires.
Sur la base de l'expérience du mouvement, nous pouvons parler de la construction d'un modèle alternatif pour aborder les questions militaires qui combine les aspects sociaux, humanitaires et des droits humains. Il s'agit de créer un environnement dans lequel les soldats peuvent défendre leurs droits et leurs intérêts sans enfreindre la discipline et les normes militaires. De cette manière, le Sotsialnyi Rukh développe un modèle qui pourrait devenir une alternative importante à l'approche traditionnelle des questions militaires, en combinant les intérêts sociaux et militaires.
Enfin, il y a la question du système de sécurité collective en Europe, la question de l'OTAN. Comment voyez-vous ces questions complexes concernant l'avenir de l'Ukraine et de l'Europe ?
L'Ukraine, compte tenu de sa situation géopolitique et de son expérience des conflits armés, a un intérêt stratégique à renforcer sa sécurité par le biais d'alliances internationales. L'OTAN peut devenir un puissant garant de la sécurité pour l'Ukraine, car elle lui permettra de s'intégrer dans un système commun de défense collective, de réduire les menaces de voisins agressifs et d'assurer la stabilité dans la région.
Toutefois, cette question est complexe et nécessite la prise en compte de facteurs internes et externes. Dans le même temps, l'élargissement de l'OTAN à l'Est peut être perçu de manière ambiguë dans certains pays, ce qui entraîne des risques politiques et stratégiques. Pour l'Ukraine, il est important non seulement de préserver son droit à choisir ses alliances de sécurité, mais aussi de veiller à renforcer ses propres capacités de défense et de soutenir ses partenaires européens dans le renforcement de la stabilité dans la région.
À long terme, la clé pour l'Ukraine et l'Europe est d'équilibrer l'intégration dans les organisations internationales et de préserver une sécurité commune interne, compte tenu de l'évolution de l'environnement géopolitique.
19 février 2025
Ucrania. Entrevista con Yana Bondareva
https://satorzulogorria.org/ucrania-entrevista-con-yana-bondareva/
Yana Bondareva
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Si les riches derrière les Fondations privées veulent nous soutenir, qu’ils paient leurs impôts !

Lettre ouverte
Les regroupements d'organismes communautaires signataires de cette lettre se préoccupent depuis longtemps des impacts de la philanthropie sur le filet social, la démocratie et les organismes communautaires. Depuis un certain temps, les ententes de financement entre des regroupements d'organismes communautaires et diverses fondations privées se multiplient. Ce n'est pas un soudain intérêt des fondations pour la transformation sociale qui guide cet élan de « générosité », mais bien une loi fédérale qui les force à hausser leur pourcentage d'investissement. Si nous comprenons le grave besoin de financement qui pousse les regroupements à signer avec les fondations, nous ne pouvons pas passer sous silence notre malaise grandissant, puisque ces choix ne sont pas sans conséquences.
Les fondations privées c'est de l'évitement fiscal
Les fondations ont été pensées afin de permettre à des multimillionnaires de sauver de l'impôt. Ces pratiques nous privent collectivement de millions de dollars qui pourraient être réinvestis dans le filet social, c'est-à-dire les programmes sociaux, les services publics et les organismes communautaires. La philanthropie n'est rien de moins que la privatisation de notre filet social. Une tendance qui sert à justifier le désengagement de l'État.
Au tournant des années 2000, le milieu communautaire dénonçait farouchement ces pratiques. La situation est tout autre aujourd'hui, car plusieurs acteurs du communautaire se tournent vers les fondations. Notre mouvement semble frappé par des vagues d'amnésie, alors que l'opposition aux PPP sociaux, la lutte contre l'évitement fiscal et le rejet de la privatisation font encore partie de nos argumentaires pour régler le sous-financement du communautaire, des programmes sociaux et des services publics. Qu'est-ce qu'on envoie comme message ? Évitez de payer vos impôts, privatisez notre filet social, c'est correct tant qu'on ramasse notre part du gâteau au passage.
Quelle autonomie nous reste-t-il ?
Les impacts du financement privé sur l'autonomie du communautaire sont déjà tangibles : réajustement du discours et des pratiques, détournement des organismes de leur mission, ralentissement de la lutte pour le financement à la mission, etc. L'Observatoire de l'ACA (action communautaire autonome) qui travaille sur l'autonomie est lui-même financé par des fondations. Quelle lunette d'analyse cela nous laisse face à ce phénomène ? Quand les liens de dépendance financière se seront grandement resserrés, le milieu communautaire osera-t-il encore dénoncer l'évitement fiscal alors qu'il en profite allègrement ? Osera-t-il dénoncer les pratiques de plus en plus intrusives des fondations si des emplois en dépendent ? Est-ce que ses pratiques démocratiques s'adapteront pour plaire aux investisseurs privés qui préfèrent certains modes de gouvernance plus proches de leurs propres pratiques ? Sera-t-il toujours en action contre la privatisation du filet social ? Quelle place restera-t-il aux revendications qui émanent de la population si les discours sont aseptisés pour plaire aux bailleurs de fonds privés ?
Le communautaire a toujours défendu un filet social fort. Pour soutenir ce filet social, l'autonomie et la pérennité des groupes et regroupements sont essentielles. Celles-ci passent nécessairement par un financement stable à la mission provenant de source publique. En cédant devant la manne privée, sommes-nous en train de creuser notre propre tombe ? Quelles conclusions pourrait tirer le gouvernement de ce mouvement vers le financement privé, lui qui nous dirige vers une nouvelle période d'austérité budgétaire ? N'y verra-t-il pas une occasion rêvée de se déresponsabiliser davantage face au filet social et de se désengager de plus en plus du financement des groupes d'ACA ?
Le sous-financement chronique du milieu communautaire est intenable et il affecte gravement nos missions. La richesse du communautaire a toujours été son autonomie, sa proximité avec la population et ses pratiques de mobilisation. Ce sont des acquis fragiles qu'il faut préserver à tout prix !
Dans ce contexte, plus que jamais, nous nous opposons à la privatisation du financement de l'ACA. Notre autonomie n'est pas à vendre ! Exigeons des gouvernements qu'ils s'assurent du bien commun ! Pour un financement à la mission public, indexé, et pérenne !
Signataires :
• Julie Robillard, Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec (MÉPACQ)
• Danielle Gill, Coalition des organismes communautaires autonomes de formation (COCAF)
• Daniel Cayley-Daoust, Coalition des Tables Régionales d'Organismes Communautaires (CTROC)
• Steve Baird, Front commun des personnes assistées sociales du Québec (FCPASQ)
• Stéphane Handfield, Groupe de recherche et de formation sur la pauvreté au Québec (GRFPQ)
• Michel Dubé, Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi (MASSE)
• Marie-Andrée Painchaud-Mathieu, Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM)

« La Constitution brésilienne est en train d’être réécrite », déclare Maurício Terena à propos de la conciliation du “cadre temporel” du STF (Tribunal fédéral suprême)

Le juge de la Cour suprême Gilmar Mendes a présenté, lundi 17, une proposition de conciliation sur le “cadre temporel”, qui fait l'objet de cinq actions en justice devant la Cour. Sept propositions de modification de la “loi du cadre temporel” (loi 14.701/2023), approuvée par le Congrès en décembre 2023, ont été incorporées.
Le 17 février 2025
Selon le projet, la thèse du cadre temporel, selon laquelle seules les terres indigènes occupées par leurs peuples d'origine en octobre 1988, date de la promulgation de la Constitution, peuvent être délimitées, a été surmontée. Le STF lui-même avait déjà déclaré le paramètre inconstitutionnel en septembre 2023, quelques mois avant l'adoption de la nouvelle loi. Cependant, le magistrat a décidé d'innover et a rédigé une sorte de substitut à la loi 14.701, dans lequel il inclut la possibilité d'exploration minière sur les terres indigènes, modifie les processus de démarcation et affaiblit le processus de consultation préalable avec les populations d'origine.
Dans une entrevue exclusive accordée à Brasil de Fato, Maurício Terena, coordinateur juridique de l'Articulation des peuples indigènes du Brésil (Apib), évoque le processus de mise en place de la table de conciliation et commente les propositions contenues dans le projet de Mendes. « Le chapitre indigène de la Constitution fédérale est en cours de réécriture », explique l'avocat. « Cette initiative du ministre Gilmar pourrait entrer dans l'histoire comme l'une des plus violentes dans la lutte pour les droits des indigènes au Brésil », ajoute-t-il. En août 2024, l'Apib s'est retirée de la commission, estimant qu'il s'agissait d'une tentative de « conciliation forcée et obligatoire ».
Lire l'entrevue :
Brasil de Fato :
– Dr Maurício, dans cette proposition présentée par le ministre Gilmar Mendes, la thèse du cadre temporel a-t-elle été surmontée ?
Maurício Terena :
– Oui, en fait, le cadre temporel est un problème qui a été surmonté dans cette proposition. Mais nous avions déjà compris que le délai serait un problème mineur, étant donné que la Cour suprême l'a déjà déclaré inconstitutionnel. Le juge Gilmar Mendes n'aurait aucun moyen de rendre constitutionnel ce qui est inconstitutionnel par le biais de cette chambre de conciliation.
– Néanmoins, l'Apib a exprimé des inquiétudes sur d'autres points de cette proposition. Quels sont ceux sur lesquels vous insisteriez ?
– Cette proposition a un fort contenu économique et ce qui nous préoccupe le plus, c'est la possibilité d'activités économiques sur les terres indigènes. Je voudrais souligner l'exploitation minière sur les terres indigènes, une proposition qui a été insérée dans le texte et qui ne faisait pas partie du projet initial de la loi historique. Elle ne figurait nulle part. Le ministre a donc élargi son champ d'application avec cette proposition. Il y a également une modification radicale du rite de démarcation des terres indigènes, qui ouvre la voie à davantage de questions et permet à de nouvelles organisations de prendre part au processus de démarcation.
Un autre point qui nous préoccupe est l'affaiblissement de la consultation libre, préalable et informée. La proposition du ministre permet aux tiers intéressés par les terres indigènes de mener un processus de consultation simplifié. La consultation est nécessaire car elle concerne la convention 169 [de l'Organisation internationale du travail]. Et dans la même loi qui ouvre les terres indigènes à l'exploitation économique, on veut aussi réglementer cette consultation libre, préalable et informée. Nous sommes donc très préoccupés par cette simplification de la consultation libre, préalable et informée.
Enfin, une autre préoccupation concerne l'autorisation donnée à la police militaire d'agir dans les conflits fonciers impliquant des territoires indigènes. La Constitution fédérale est très claire sur le fait que la compétence d'agir sur les terres indigènes revient aux entités fédérales, en l'occurrence la police fédérale, pour traiter les questions liées aux droits des indigènes. Or, la proposition présentée prévoit que la police militaire agisse dans les conflits autochtones, ce qui pourrait accroître la violence policière dans les territoires.
– Selon votre analyse, outre la fin de la thèse du cadre temporel, la proposition issue de la prétendue conciliation, en plus de ne pas concilier, exacerbe encore les conflits liés aux terres indigènes ?
– Il n'y a certainement pas eu de conciliation. J'ai dit que le chapitre autochtone de la Constitution fédérale, l'article 231, est en train d'être réécrit. Nous sommes très préoccupés par ce mouvement. Parce que les questions proposées dans cette loi reviennent sur une période très nébuleuse de notre histoire récente, lorsque les droits des peuples autochtones étaient soumis au pouvoir économique.
Cette tentative de modifier ces droits par le biais de la proposition présentée par le ministre Gilmar Mendes revient en fait à réécrire ce chapitre constitutionnel qui a été le fruit d'une lutte acharnée et qui est en train de disparaître à la suite d'une décision de la Cour suprême.
– Comment les organisations autochtones doivent-elles réagir à cette proposition, étant donné qu'elles ne participent pas à la table de conciliation de la Cour suprême ?
– Nous nous mobilisons déjà, cherchons à faire une mobilisation interne, dans le mouvement, pour qu'il y ait une mobilisation à Brasília pendant ce procès. Cette initiative du ministre Gilmar est peut-être passée à l'histoire comme l'une des plus violentes en ce qui concerne la lutte pour les droits des autochtones au Brésil. Il y aura donc beaucoup de lutte, il y aura de la résistance, on va probablement aggraver la décision, mais c'est le moment d'appeler les peuples autochtones de tout le pays et les organisations partenaires à se mobiliser rapidement contre cette proposition.
– En août, l'Apib s'est retirée de cette table de conciliation parce qu'elle n'était pas d'accord avec ce qui lui était négocié. Comment évaluez-vous ce processus jusqu'à ce que vous arriviez à cette ébauche, présentée par le ministre Gilmar Mendes ?
– Il s'agissait d'un processus marqué par la violence symbolique en matière d'accès à la justice. Apib a trois appels en attente d'examen et, jusqu'à présent, il n'y a eu aucun signe d'appréciation de ces appels. Tout ce qui a été décidé au sein de cette chambre de conciliation est une procédure obscure, avec un manque de méthodologie, avec un manque de transparence. En ce qui concerne ce qui est négocié, c'est une tentative de forcer la conciliation, c'est une conciliation forcée.
Lorsque l'Apib se retire de l'acte de conciliation, le ministre Gilmar demande la nomination d'autres autochtones pour composer la tentative de conciliation, ce qui est absurde. Nous sommes le demandeur dans la poursuite, et le ministre a remplacé le demandeur. C'est comme si un parti, comme le PT [Parti des travailleurs], avait intenté une action en justice, et face à l'impossibilité de la conciliation, le rapporteur a déterminé que le PL [Parti Lieral] a remplacé le PT dans le procès. Cela n'a pas de sens.
Donc, si la Cour suprême veut investir davantage dans des procédures de conciliation comme celle-ci, elle doit avant tout investir dans la formation de professionnels pour qu'ils prennent soin adéquatement de ces procédures.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Des regroupements s’unissent pour réclamer la reconnaissance de tous les organismes d’action communautaire autonome de la Ville de Québec

Québec, 18 février 2025- Le Regroupement des organismes communautaires de la région 03 (ROC-03), le Regroupement d'éducation populaire en action communautaire des régions de Québec et Chaudière-Appalaches (RÉPAC 03-12) et le Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale (RGF-CN) ont revendiqué d'une même voix, lors de la séance du conseil municipal, la reconnaissance de tous les organismes d'action communautaire autonome de la Ville de Québec.
En effet, les différents regroupements demandent à la Ville de Québec, via sa Politique de reconnaissance des organismes à but non lucratif, de reconnaître tous les organismes d'action communautaire autonome (ACA) dont le siège social est situé sur le territoire, en leur donnant accès à des services de base tels que le prêt de salle, de matériel et d'équipement et l'accès aux assurances de l'UMQ. Or, un nombre grandissant de ces organismes se voient refuser cette reconnaissance par la Ville sous prétexte que leur mission ne correspond pas avec les compétences et obligations du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire.
« Comment la Ville de Québec peut-elle ne pas reconnaître des organismes fondés sur la participation des citoyennes et citoyens ? Ils encouragent l'implication des individus dans la prise de décision et l'élaboration des actions. Cette approche vise à renforcer le pouvoir d'agir des personnes sur leur propre vie et à favoriser l'autonomisation des communautés. En ce sens, ils contribuent tous au développement social et à la participation active des citoyennes et citoyens », souligne Karine Verreault du ROC 03.
Cette décision est un non-sens pour les organismes d'ACA qui contribuent au développement social de la Ville de Québec et au maintien d'un filet social pour l'ensemble de la population, particulièrement pour les personnes marginalisées.
« On s'attendait vraiment à mieux du maire Marchand qui s'était engagé à soutenir davantage le milieu communautaire. Au lieu de cela, on constate que plusieurs organismes, notamment des organismes de défenses collectives des droits, se voient refuser ou retirer la reconnaissance de la ville. On s'explique mal le mépris de la Ville de Québec envers des groupes solidement ancrés dans le milieu et reconnus par le gouvernement du Québec », dénonce Vania Wright-Larin du RÉPAC 03-12.
« L'importance pour un organisme communautaire d'être reconnu par sa ville est majeur. Le manque d'ouverture du Maire Marchand et, de surcroît, de la Ville de Québec de reconnaître les organismes d'ACA démontre le manque d'empathie envers les difficultés financières de ces organismes qui peinent à rejoindre les deux bouts », souligne Catherine Gauthier du RGF-CN.
Notons que tous ces groupes se soumettent à un processus de reddition de compte auprès du gouvernement du Québec qui démontre l'étendue de leur mission, la rigueur de leur fonctionnement et l'importance qu'ils représentent pour la population de la Ville de Québec.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :



















