Presse-toi à gauche !
Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Déclaration finale du séminaire de renforcement des capacités des femmes de la coordination de luttes féministes du réseau CADTM Afrique

La Coordination des Luttes Féministes du CADTM Afrique en partenariat avec la Plateforme d'Information et d'Action sur la Dette (PFIAD), Womin, fondation pour une Société Juste (FJS), CNCD Belgique, CS-Funds, Entraide et Fraternité Belgique a organisé un séminaire de renforcement des capacités des femmes de la Coordination et des membres de la société civile camerounaise composée des associations de femmes, de jeunes, pour le développement durable ainsi que les femmes de médias et les syndicats. Ce séminaire avait pour thème central « Femmes, leadership féminin, dettes, changements climatiques et extractivisme : enjeux et perspectives ».
Tiré de l'Infolettre CADTM
https://www.cadtm.org/Declaration-finale-du-seminaire-de-renforcement-des-capacites-des-femmes-de-la
21 février par CADTM Afrique , Coordination des Luttes Féministes du CADTM Afrique
A cette occasion, se sont réunies à Yaoundé au Cameroun du 12 au 15 février 2024, 38 participantes venant du Bénin, du Burkina Faso, du Mali, du Niger, de la République Démocratique du Congo, du Congo Brazzaville, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Gabon, du Togo, du Sénégal et de la Belgique.
Le contenu des modules abordés au cours du séminaire se structure autour de quatre axes, à savoir :
• Femmes, leadership féminin et Dettes
• Changement Climatique
• Extractivisme
• Enjeux et perspectives des luttes féministes
Animés principalement par les femmes de la Coordination des Luttes Féministes du Réseau CADTM Afrique et les militantes et actrices de la société civile camerounaise, ces thématiques ont suscité des échanges, des débats, des réflexions, des partages d'expériences qui ont conduit à l'adoption des résolutions et recommandations suivantes :

Résolutions
Les femmes de la Coordination des Luttes Féministes du Réseau CADTM Afrique ainsi que les militantes et actrices de la société civile camerounaise présentes au séminaire :
• Réaffirment leur engagement à se mobiliser davantage, à s'organiser et à fédérer leurs énergies dans la lutte contre les impacts des dettes, des changements climatiques et de l'extractivisme en général et sur les femmes en particulier.
• S'engagent à intensifier les actions, les campagnes d'information, de sensibilisation et d'éducation contre les facteurs de féminisation de la pauvreté en Afrique.
• Réaffirment leur volonté à poursuivre les processus de renforcement des capacités des femmes en vue de développer leur leadership.
• S'engagent à mettre en place un Comité restreint pour finaliser et capitaliser les productions et les données récoltées par pays sur les thématiques du séminaire en vue d'une part de produire un article pour le diffuser et d'autre part, en vue de mener des actions de plaidoyer auprès des Etats pour la prise en compte des préoccupations majeures des femmes.
• S'engagent à élaborer une note de plaidoyer qui recense les projets financés par la BAD par pays et qui fait ressortir les impacts négatifs de ces projets sur les conditions de vie des populations notamment les femmes et les filles.
• S'engagent à faire des recherches-actions sur les impacts et les dérives des microcrédits dans tous les pays membres du Réseau CADTM Afrique.
• Réaffirment leur engagement à lutter contre les impacts de l'endettement au niveau macro sur la vie des populations notamment dans le domaine de la santé maternelle et infantile.
• S'engagent à promouvoir les innovations issues des femmes pour lutter contre toutes les formes d'injustices (sociales, environnementales, économiques, politiques etc.) qui impactent leurs conditions de vie.

Recommandations
Les femmes de la Coordination des Luttes Féministes du Réseau CADTM Afrique ainsi que les militantes et actrices de la société civile camerounaise présentes au séminaire recommandent :
AUX ETATS AFRICAINS
• Que soient menées des politiques de désendettement renonçant aux formes de dette qui ne répondent pas aux aspirations profondes des populations en général, et des femmes en particulier.
• Que les projets de développement et les plans d'actions communaux soient directement issus des communautés locales et garantissent la participation effective des femmes.
• De promouvoir les alternatives locales de financement en révisant la loi de 2012 sur la règlementation des Services Financiers Décentralisés en Afrique de l'Ouest.
• De veiller à la vulgarisation et à l'application des lois qui concourent à la promotion des droits des femmes à tous les niveaux.
• D'adopter des lois impliquant la participation de la société civile dans les prises de décisions en vue de favoriser le développement des dynamiques et solutions endogènes.
AUX ETATS AFRICAINS, A LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT ET AUX INSTITUTIONS FINANCIERES INTERNATIONALES
• De prendre en compte les besoins réels des communautés à la base en impliquant les femmes dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques, projets et programmes de développement.
• La réparation des dommages causés aux populations et aux femmes en particulier et leur indemnisation suite à l'implantation des projets de développement qui ont eu un impact négatif sur les conditions de vie des communautés locales.
• De repenser les politiques et projets qui accaparent et exproprient les moyens de subsistance des femmes ainsi que leurs ressources (naturelles, économiques, culturelles, etc.).
AUX ETATS AFRICAINS ET A LA SOCIETE CIVILE AFRICAINE
• Le développement d'alternatives au profit des femmes et des filles face à l'endettement, aux changements climatiques et à l'extractivisme.
• De mettre en place une commission de suivi évaluation de la mise en œuvre des projets et programmes au profit des femmes dans les différents pays (Etat, représentants de la société, représentant régionaux ou locaux…).
• De mettre en place des dynamiques sociales nationales, continentales et internationales pour promouvoir l'autonomisation et l'émancipation économique et sociale des femmes et des filles en Afrique.
A LA SOCIETE CIVILE AFRICAINE
• De s'investir dans la réalisation des audits citoyens des mégas projets financés par les institutions financières internationales pour plus de transparence et de redevabilité.
• De contester et dénoncer le système du microcrédit qui accentue la pauvreté et le harcèlement des institutions de la microfinance envers les femmes.
• D'exiger la création d'un mécanisme d'attribution de crédits sans intérêt ou à taux bas destiné aux populations marginalisées.
• D'inciter la société civile africaine à sensibiliser et à former les communautés locales afin que les populations soient les acteurs de leur propre développement.
• D'inciter la création d'une charte éthique par des cellules communautaires pour garantir le respect des droits des femmes et de l'environnement dans le cadre des politiques, des projets et programmes de développement.
Fait à Yaoundé
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

26 février : Journée internationale pour les journalistes palestiniens

Quatre mois après le début de la guerre à Gaza en Palestine, le 7 octobre, 100 journalistes ont été tués. Ce massacre est sans précédent et inacceptable. Rejoignez la Fédération internationale des journalistes (FIJ), la Fédération arabe des journalistes (FAJ) et ses affiliés, ce 26 février, pour une journée mondiale en soutien aux journalistes palestiniens.
19 February 2024
Quatre mois après le début de la guerre à Gaza, la FIJ, la Fédération arabe des journalistes (FAJ) et ses affiliés partout dans le monde continuent leur mobilisation et soutiennent à travers des actions publiques les journalistes et travailleur.euse.s des médias en Palestine, notamment ses membres du Palestinian Journalists' Syndicate (PJS).
100 journalistes ont été tués en quatre mois, l'équivalent de 7 par semaine. Ce massacre est sans précédent et inacceptable.
Les besoins de nos collègues travaillant à Gaza sont devenus vitaux. En plein hiver, nos consœurs et confrères et leurs familles manquent de tout et surtout de l'essentiel : vêtements, couvertures, tentes, nourriture, eau... Le manque de ces produits de première nécessité dans ce petit territoire de 40 km de long et 5 km de large se traduit par une envolée des prix. Et ils ne peuvent plus y faire face.
La FIJ s'alarme également de la faible couverture internationale du conflit, liée au fait que les médias internationaux ne sont pas autorisés par Israël à entrer dans l'enclave et à y réaliser des reportages pour rendre compte de la réalité. C'est le droit des citoyens de connaître la réalité du conflit à Gaza qui a été violé, tant dans la région que dans le reste du monde.
En consultation avec le PJS, nous vous invitons à mobiliser vos membres, les journalistes dans les rédactions, mais aussi les organisations nationales des travailleurs et travailleuses le lundi 26 février, pour ce qui sera la journée mondiale pour les journalistes palestiniens.
Téléchargez le visuel de campagne (en anglais, français et espagnol) et l'annonce ici
Suggestions d'activités pour marquer la journée : rassemblements, discours, séances publiques, fils de discussion sur les réseaux, toutes les occasions sont bonnes pour rappeler à tous les citoyens et citoyennes que la liberté d'informer a un prix, à Gaza plus qu'ailleurs. N'oublions jamais que, pendant quatre mois, ce sont des journalistes de Gaza qui ont informé le monde parce que cette zone de quelques kilomètres carrés a été complètement fermée.
Rejoignez-nous pour une minute de silence à midice lundi 26 février pour commémorer les journalistes qui ont été tués depuis le 7 octobre.
Envoyez vos photos, vidéos, documents, messages de solidarité publiés durant la journée au Secrétariat général à Bruxelles, nous les partagerons largement : communication@ifj.org
Taguez-nous sur les réseaux pour que l'on relaie vos actions :
X @IFJGlobal
Facebook @InternationalFederationofJournalists
Instagram @ifj_journalists
LinkedIn @InternationalFederationofJournalists
Utilisez #SupportPalestinianJournalists sur vos réseaux sociaux
Faites un don au Fonds de sécurité de la FIJ avec "PJS" en communication pour soutenir les consoeurs et confrères à Gaza et offrez-leur de la nourriture, des vêtements chauds, des batteries externes et des équipements pour travailler.
Lisez les messages de solidarité des affiliés de la FIJ aux journalistes palestiniens :ici
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’écoféminisme

L'écoféminisme est la mise en commun des forces de l'écologie et du féminisme, mais aussi de l'économie et de l'écosocialisme. Dans cet article, un survol de l'histoire et des termes relatifs à l'écoféminisme, pour se repérer.
La destruction de la planète est due à l'appât du gain inhérent au pouvoir masculin.
– Françoise d'Eaubonne, 1972 in Adams, 1993
Mise en bouche
« Pollution », « destruction de l'environnement », « démographie galopante » sont des mots d'hommes, correspondant à des problèmes d'hommes : ceux d'une culture mâle. Ces mots n'auraient pas eu lieu dans une culture femelle, reliée directement à l'ascendance antique des Grandes Mères. Cette culture-là aurait pu n'être qu'un misérable chaos, comme celles d'un Orient qui, tout phallocratique qu'il soit, relève bien plus d'« Anima » que d'« Animus » ; il semble qu'aucune de ces deux cultures n'aurait pu être satisfaisante, dans la mesure où elle aussi aurait été sexiste ; mais la négativité finale d'une culture de femmes n'aurait jamais été ceci, cette extermination de la nature, cette destruction systématique, en vue du profit maximum, de toutes les ressources nourricières.
– Françoise d'Eaubonne, 1974 (p.36)
Comme membres de Québec solidaire (Qs), nous savons toutes et tous que le parti est, ou tend vers le féminisme. Pour plusieurs, c'est même une des raisons primordiales pour lesquelles iels sont devenu.es membres. Nous avons dans nos instances la volonté de toujours agir avec bienveillance envers l'Autre. Nous nous sommes même donné.es une Commission nationale des femmes (CNF), une forme de garde du vécu, du senti, des idées et des réflexions féministes.
Alors que nous jetons les bases d'un nouveau collectif au sein de Québec solidaire (Qs), il nous paraît utile de faire un survol de ce qu'est l'écoféminisme dans sa constitution et son histoire. À nous de nous approprier la langue pour faire avancer les causes.
Lorsque l'écoféminisme parle de « pouvoir masculin » et attribue au genre masculin son lot de problèmes, il ne s'agit pas d'accuser « les hommes », mais bien de distinguer des visions et des pratiques différentes selon les genres. Rappelons-nous que les genres ont toujours une certaine fluidité.
Il semble que les écoféministes qui sont nos contemporain.es aient un discours qui vise moins généralement le « masculin », au profit de termes plus spécifiques. En effet, il est maintenant préférable de parler du colonialisme, du patriarcat et du capitalisme, pour ne nommer que ces problèmes. Ainsi, Corrie Scott nous dit :
La subjugation de la femme à l'homme fait alors partie de l'héritage colonial qui continue d'avoir un impact sur les femmes aujourd'hui comme en témoigne, entre autres, le nombre de femmes autochtones disparues ou assassinées. [...] La violence patriarcale est également intrinsèquement liée à la création et à l'établissement du Québec.
– Corrie Scott, 2024, en attente de publication
Or, la violence patriarcale n'affecte pas que les femmes, mais l'ensemble de la population, sans distinction.
Dans son article à paraître, Scott cite aussi Leanne Betasamosake Simpson, qui relie les violences faites aux femmes au patriarcat et au colonialisme. De là, il n'y a qu'un court pas à franchir pour comprendre que la création et l'établissement du Canada n'ont été possibles que par la motivation capitaliste de posséder, de posséder toujours plus, sans égard à la Terre et celleux qui la peuplent.
Je pense qu'il ne suffit pas de simplement reconnaître que la violence faite aux femmes existe, mais qu'elle est intrinsèquement liée à la création et à l'établissement du Canada. La violence sexiste est au cœur de notre dépossession, occupation et effacement continus et les familles et les communautés autochtones ont toujours résisté à cela. Nous avons toujours riposté et organisé contre cela – nos grands-parents ont résisté à la violence de genre, nos jeunes s'organisent et résistent à la violence de genre parce que nous n'avons pas d'autre choix (Betasamosake Simpson 2014 : s.p.).
– Leanne Betasamosake Simpson
Environnement et écologie, deux concepts relatifs aux deux genres dominants
Alors que les activités anthropiques (humaines) sont les principales responsables des changements climatiques, il existe pourtant un clivage selon le genre pour l'apport de solutions aux crises qui sont déjà actives. Ainsi, dans la lutte pour l'écologie, il importe peu d'être homme ou femme ; la tâche est lourde et les ouvri.ères peu nombreuses, a dit un certain Palestinien, il y a plus de deux-mille ans. Pour les besoins de cet argumentaire, les termes homme et femme font référence à des manières d'agir générales, l'animus et l'anima.
Chez les hommes (animus) qui s'intéressent aux changements climatiques, comme Elon Musk et Richard Branson, on voit une forte tendance à se limiter à chercher des solutions pour pérenniser les conforts du système capitaliste comme en fait foi ce rapport du Comité Environnement et Développement durable [!] de la CSN, où l'on peut lire au sujet des dommages causés à l'écologie qu'ils « découlent de plusieurs décennies de décisions prises dans une logique de recherche de profits à tout prix et de surconsommation » ; les femmes (anima), elles, avec les moyens qui leur sont impartis, cherchent à réduire les causes de la dégradation de l'environnement, en agissant plutôt sur l'écologie, dont font partie les questions d'alimentation, de la qualité des sols, etc. Tout ça, en étant les moins payées, à travail égal et en assurant en plus, la majorité des tâches non-rémunérées reliées à l'éducation des enfants et la tenue de la maison. Les hommes s'intéressent aux technologies environnementales qui faciliteront le maintien d'une forme ou l'autre du capitalisme, tandis que les femmes veillent à la préservation et à l'amélioration de l'écologie, ce système même qui, loin du capitalisme, voit à soutenir la vie sur Terre.
J'exploiterai votre territoire et je le détruirai. Aujourd'hui, vous voyez, il est encore très propre et, vous le savez, toutes les sortes d'animaux que vous avez, les animaux indiens sont encore propres. Tous sont encore bons à manger. Plus tard, je gaspillerai et je salirai vos animaux, toutes les espèces d'animaux indiens. À l'avenir, votre territoire ne sera pas aussi propre que maintenant et vos animaux ne seront pas aussi propres que maintenant. Qu'en pensez-vous ? Après que j'aurai gaspillé et sali vos animaux, est-ce que vous, les Indiens, aimerez les manger même s'ils ne sont pas propres ? Par exemple, c'est dans les égouts que vous prendrez toutes les sortes de poissons que vous avez, si à l'avenir vous voulez les tuer pour votre nourriture.
(Kapesh, 2022 : 19)
Les hommes veulent continuer de transporter personnes et marchandises afin de faire fructifier certains domaines économiques ; les femmes, elles, se demandent comment nourrir leur communauté lorsque les abeilles auront complètement disparu à force de pesticides et autres biocides encore trop largement employés, que les terres, épuisées de leurs ressources ne produiront plus d'aliments nutritifs et que les guerres et la cupidité auront détruit la Vie et toutes les possibilités qu'elle offre, il faut le dire, gratuitement. Les uns parlent encore de développement durable alors que les autres, à la suite de Françoise d'Eaubonne et de multiples autres, parlent, elles, de modes de vie durable. Et elles s'y engagent.
S'engager sur le terrain en tant que citoyen.ne ordinaire, c'est devenir membre d'un petit équipage épars qui a un combat en commun. Un équipage lié par cette conviction partagée : la situation est désespérée, changer le monde est difficile, mais il faut néanmoins essayer. C'est ce ciment qui nous fait tenir, bien plus que la certitude de voir les choses changer dans l'immédiat ou même de notre vivant. Il s'agit de refuser, ensemble, cette idée supposément raisonnable et pragmatique selon laquelle améliorer notre monde est absolument impossible. De refuser de croire que ce qui est, est immuable.
– Mélikah Abdelmoumen, 2023
Le mouvement écoféministe fait des petits
L'asservissement des femmes et celui de l'environnement sont étroitement liés. Les premiers écrits écoféministes, par exemple, le livre qui a lancé le mouvement environnemental aux États-Unis, Silent Spring, de Rachel L. Carson, ont célébré une perspective dans laquelle les femmes sont reconnues comme ayant des liens plus étroits avec la nature. En France, c'est Françoise d'Eaubonne qui donne le ton et le nom à cette nouvelle vague, l'écoféminisme. C'est elle qui, en français, identifie la théorie du genre en écoféminisme. C'est aussi grâce à sa relève, par exemple, Vandana Shiva ou Wangari Maathai du Kenya, que l'on peut maintenant dire que le genre et l'environnement ont été articulés ensemble de manière plus puissante et ont eu plus d'influence dans le monde majoritaire.
Et la planète mise au féminin reverdirait pour [toustes] !
– Françoise d'Eaubonne (1920-2005)
Le travail d'une femme n'est jamais terminé.
Il vaut mieux avoir rendez-vous avec les femmes qu'avec l'Apocalypse.
– Françoise d'Eaubonne, dans Goldblum, p.58
Ainsi, au Québec par exemple, plusieurs groupes écologistes, tout comme plusieurs groupes environnementaux, sont coordonnés par des femmes, sans budget, ou ceux, minimes, accordés par le gouvernement provincial, au moyen de maigres enveloppes très convoitées. Il faut savoir que seulement 6% des groupes écologistes sont subventionnés et qu'il est toujours plus difficile de faire comprendre au gouvernement que l'expression « groupes écologistes » est une entité différente du terme « lobbyistes ». Des femmes au Front commun pour la transition énergétique (FCTÉ) ; au Réseau québécois des femmes en environnement (RQFE) ; au Réseau québécois des groupes écologistes RQGE ; dans de petits groupes dits grassroots, de la base, comme Action-Environnement Basses-Laurentides (AEBL), et tant, tant d'autres qui se donnent corps et âme dans une lutte à finir avec les gouvernements majoritairement masculins et tous capitalistes, afin d'arracher ici et là quelques améliorations à l'environnement et l'assainissement de l'écologie. Des femmes qui briguent des postes de députées dans l'espoir non seulement d'atteindre la parité de représentation femmes-hommes, mais aussi dans le souci de porter la cause de l'écologie dans les sphères décisionnelles. Des femmes comme cette maraîchère de la région de Lanaudière, qui accompagne sa communauté à la recherche d'une meilleure alimentation et cette autre, qui veille au fonctionnement du modèle coopératif de sa ferme à Mont-Tremblant : des écoféministes qui travaillent d'arrache-pied afin de nourrir leur monde tout en prenant soin de la Terre.
Il y a aussi ces femmes autochtones, dont les Aînées, qui vouent à la Terre le respect qui lui est dû ; elles tentent aussi de préserver leur culture de nourriture et de soins par les herbes, fleurs et fruits qui sont à disposition de toustes, même si ces traditions ont été muselées au profit de l'avancement de la colonie. Certains Inuit et certaines Innues ont publié quelques ouvrages qui nous éduquent sur les sujets chers à leurs communautés. Les écrits des Innues Natacha Kanapé-Fontaine, Naomie Fontaine et Joséphine Bacon, pour ne nommer que celles-là, sont des écrits forts qui font le plus souvent abstraction des détails pour aller à l'essentiel : Pour survivre, il faut travailler ensemble. Mais pour y arriver, il faut s'éduquer, connaître et comprendre pour ensuite partager avec l'Autre, peu importe qui iel est. Nous sommes passagères et passagers sur le même vaisseau, il faudra apprendre à connaître son voisin, tôt ou tard et, dans plusieurs cas, faire la paix.
An Antane Kapesh, la première écrivaine Innue, mère de huit enfants, dénonce en 1975, dans son livre Eukuan Nin Matshi-Manitu Innushkueu traduit par José Mailhot (Je suis une maudite sauvagesse), que lorsque le Blanc est arrivé sur les terres innues, qu'il les a envahies à escient d'exploiter et de détruire le territoire, « il n'a demandé de permission à personne, il n'a pas demandé aux Indiens s'ils étaient d'accord. Quand le Blanc a voulu exploiter et détruire notre territoire, il n'a fait signer aux Indiens aucun document disant qu'ils acceptaient qu'il exploite et qu'il détruise tout notre territoire afin que lui seul y gagne sa vie indéfiniment. Quand le Blanc a voulu que les Indiens vivent comme les Blancs, il ne leur a pas demandé leur avis et il ne leur a rien fait signer disant qu'ils acceptaient de renoncer à leur culture pour le reste de leurs jours. » (Kapesh, 2022 : 15)
Ce sont ces paroles fortes qui, bien qu'avec des mots différents de ceux des Blancs, expriment très bien ce qu'est le colonialisme (l'arrivée du Blanc exploiteur), le capitalisme (le Blanc exploiteur et destructeur au seul nom du profit) et ainsi, inscrit An Antane Kapesh comme écoféministe dans sa dénonciation et dans son fait d'écriture.
[…] l'écoféminisme peut être vu comme une proposition théorique et politique de décroissance, formulée à partir d'une critique sexiste du système économique capitaliste et des modes de gouvernance politique et institutionnelle. Ces rapports mettent en vis-à-vis les inégalités entre dominants et dominés et l'exploitation des ressources. Le péril écologique va jusqu'à rendre visible les limites du système patriarcal parce que, comme l'affirme d'Eaubonne : « Lorenz a raison : aucune société (mâle) ne peut prendre la relève. » Le système mâle vient de faire la preuve de son incapacité à répondre aux enjeux que pose la crise écologique globale.
Françoise d'Eaubonne, 1974, 2020, p. 73
Les gouvernements et la résistance
It was expected that Newspeak would have finally superseded Oldspeak [standard English] by about the year 2050. Meanwhile, it gained ground steadily. All party members tended to use Newspeak words and grammatical constructions more and more in their everyday speech.
– George Orwell, 1984 (1948)
(On s'attendait à ce que la novlangue supplante finalement les anciennes formes de l'anglais usuel autour de l'année 2050. Entre-temps, elle a gagné du terrain petit à petit. Tous les membres du parti utilisaient la novlangue en mots et constructions grammaticales au fur et à mesure de leurs adresses quotidiennes [Ma traduction].)
Pendant ce temps, les hommes du gouvernement, messieurs Benoit Charette au Québec et Steven Guilbault au fédéral, ressassent, d'un côté, un vocabulaire vidé de son sens et fabriquent, assistés d'attachés politiques bien éduqués aux usages corporatistes, des constructions syntagmatiques dénuées de sémantisme (économie verte, capitalisme vert, développement durable, etc.) et de l'autre, parlent de mesures insensées, comme le 3è lien, le développement du Nord, les oléoducs (Coastal Gaslink) qui tentent d'en finir avec le peuple Wet'suwet'en de l'Ouest de l'Île-de-la-Tortue en mettant sous les verrous l'anima de ce peuple qui dénonce son génocide et celui de la Terre, sans s'étendre sur l'éco-blanchiment (greenwashing), l'utilisation du nucléaire ou même, de l'explosif hydrogène (qu'il soit gris ou vert), sans même parler de la militarisation des forces de l'ordre et les subventions canadiennes et américaines, entre autres, consenties aux guerres. Tout cela afin de passer pour, de Paraître, comme des défenseurs de l'environnement, alors que ce qui importe, merci Michel de Montaigne, n'est pas le Paraître, mais l'Être. Le temps que ces sbires font perdre à la société, particulièrement aux femmes, mais aussi à la planète, aux générations qui, peut-être, suivront, est incalculable.
Avant le capitalisme, dernier venu vieillissant et résistant, avant le féodalisme, avant le phallocratisme, le pouvoir féminin, qui n'atteignit jamais la dimension ni le statut de matriarcat, se fondait sur la possession de l'agriculture ; mais c'était une possession autonome, accompagnée d'une ségrégation sexuelle, selon toute vraisemblance ; et voilà pourquoi il n'y eut jamais de véritable matriarcat. Aux hommes le pastorat et la chasse, aux femmes l'agriculture ; chacun des deux groupes armés affrontait l'autre ; telle est l'origine de la prétendue « légende » des Amazones. Quand pointa la famille, la femme pouvait encore traiter de puissance à puissance, tant que les fonctions agricoles continuaient à la sacraliser ; la découverte du processus de fécondation – celle du ventre comme celle du sol – sonna le glas de sa fin. Ainsi commença l'âge de fer du deuxième sexe. Il n'est certes pas terminé aujourd'hui. Mais la terre, elle, symbole et ancien fief du ventre des Grandes Mères, a eu la vie plus dure et a résisté davantage ; aujourd'hui, son vainqueur l'a réduite à l'agonie. Voici le bilan du phallocratisme.
Françoise d'Eaubonne, 1974 (p.37)
Tandis que le ministre Charette et son cabinet envoient des missives aux activistes, jurant, entre autres, que « l'asphalte est durable », les femmes se démènent, organisent des manifestations, des sit-in, des pétitions et des élections. Oh ! Bien sûr que plusieurs hommes sont alliés ! Chez Vigilance OGM, à la Fondation Rivières, à Greenpeace, et au Centre de ressources sur la non-violence, à L'Union paysanne, se trouvent de magnifiques exemples d'hommes alliés. N'oublions pas les collègues de Révolution Écosocialiste qui, pour certain.e.s, sont actifs et actives en journalisme citoyen auprès de Presse-toi à gauche ou encore, aux Nouveaux Cahiers du Socialisme, qui, individuellement et collectivement, livrent des batailles pour l'écologie. Pourtant, ce sont bien les femmes qui sont beaucoup plus nombreuses que les hommes à souffrir d'épuisement, qu'il se nomme burn-out, éco-anxiété ou fatigue de compassion. Ce n'est pas un concours, mais un simple constat.
Il ne s'agit plus de tenter d'améliorer ou de changer le monde, « mais d'agir pour qu'il puisse y avoir encore un monde. »
Goldblum 2019, p.99
Comme mentionné précédemment, les femmes autochtones du Canada allient toutes leurs luttes, sans relâche. « On constate une puissante composante féminine qui touche non seulement le mouvement social, mais l'évolution actuelle de l'art autochtone au Kanata et au Kébec. Ensemble, ces femmes au front prônent un art de guérison individuel et un art de protection écologique de la Mère-Terre, donc un art universel. » (Guy Sioui Durand, 2016, p. 6)
Prétendre que seul l'engagement qui modifie les structures à long terme vaut la peine, nous autorise à ne pas agir.
– Mélikah Abdelmoumen, 2023
Quelques termes
Tout d'abord, s'entendre sur quelques définitions. Voyons la petite mise au point terminologique qui suit.
Selon le Dictionnaire Le Robert, l'environnement est « l'ensemble des conditions naturelles et culturelles qui peuvent agir sur les organismes vivants et les activités humaines », tandis que l'écologie, elle, est « une doctrine visant à un meilleur équilibre entre l'homme et son environnement naturel ainsi qu'à la protection de ce dernier. C'est aussi le courant politique défendant ce mouvement ». En d'autres mots, le domaine de l'environnement est général, alors que celui de l'écologie est spécifique. Comme pour la dichotomie de genre, ces deux termes ont des activités reliées qui sont différentes. Au plan sémantique, l'environnement a un vocabulaire maintenant dilué, après plus de 60 ans de luttes et de récupération par l'industrie et les gouvernements, tandis que la militance écologique tente, en plus de ses autres batailles, de préserver le plus possible l'intégrité de son vocabulaire associé.
Sous Écologie, une définition et une observation : « Science qui étudie les milieux où vivent et se reproduisent les êtres vivants, ainsi que les rapports de ces êtres avec le milieu ». « L'écologie se subdivise en plusieurs branches : l'autoécologie, la synécologie, mais aussi la bioclimatologie, l'écophysiologie, la biocénotique, la dynamique des populations, l'écogénétique, la biogéographie et bien des aspects étudiés traditionnellement en agronomie ». On note que cette nomenclature n'inclut pas l'écoféminisme. On retrouvera le terme sous sa propre entrée, plus loin sur le site.
L'écosocialisme, lui, n'existe pas sur les plateformes qui viennent en aide aux langagier.ères. Ni Termium, ni le Grand dictionnaire terminologique n'offrent d'explication. J'en ai trouvé une : L'écosocialisme (également connu sous le nom de socialisme vert ou d'écologie socialiste) est une idéologie fusionnant des aspects du socialisme avec ceux de la politique verte, de l'écologie et de l'altermondialisation ou de l'anti-mondialisation.
Pour l'écoféminisme, « Cette construction de l'esprit s'oppose à la fois à l'environnementalisme et au féminisme humaniste pour lier l'oppression de la femme (plus « naturelle » que celle de l'homme) à celle de la nature. Paradoxalement l'écoféminisme risque de revamper des thèmes chers à l'extrême-droite : ‘ À insister sur la naturalité de la femme, on risque tout simplement de reconduire les clichés les plus éculés sur l'intuition féminine, la vocation à la maternité et l'irrationalisme de ce qui pourrait bien, dès lors, passer pour le deuxième sexe ‘. »
N'en déplaise aux auteurices de Termium, il est maintenant de mise d'adopter une approche plus intersectionnelle à l'écologie qui, comme définie d'abord pour les luttes féministes, s'adapte facilement pour décrire les circonstances nouvelles créées par les crises climatiques. Selon Wikipedia, l'intersectionnalité « désigne la situation de personnes subissant simultanément plusieurs formes de stratification, domination ou de discrimination dans une société. Ainsi, dans l'exemple d'une [femme] appartenant à une minorité ethnique et issue d'un milieu pauvre, celle-ci pourra être à la fois victime [de sexisme,] de racisme et de mépris de classe ». Ajoutons donc à ce portrait les effets de la menace des guerres et des crises climatiques, issues des guerres ou, de manière presque plus banale, du capitalisme, les effets de l'âgisme, du capacitisme et du fait que les femmes sont toujours, globalement, sous-représentées dans les sphères décisionnelles. On comprendra maintenant que ces « détails » s'ajoutent au portrait de l'écoféminisme, en incluant les gains de la troisième vague du féminisme. Comme le définit la FAE : « Le féminisme intersectionnel permet de mettre en lumière les multiples discriminations qui peuvent toucher les femmes et surtout l'indissociabilité de ces discriminations. »
L'écosocialisme [et donc, l'écoféminisme] peut se concrétiser en une pratique qui permet d'allier la lutte des classes à la lutte contre tous les systèmes de domination qui menacent la vie sur Terre.
– Jenny-Laure Sully, www.cahiersdusocialisme.org
Pour terminer
Les genres masculin (animus) et féminin (anima) de l'espèce humaine ont une perception différente de l'environnement et de l'écologie, complémentaire, la plupart du temps. Pourtant, rares sont les mâles qui dénoncent le plus grand contributeur de gaz à effet de serre : le complexe militaro-industriel américain et sa franchise canadienne, qui passerait même devant l'exploitation industrielle des animaux pour la consommation humaine, pourtant très néfaste, dans le décompte des pollueurs. Car Il ne faut pas oublier que dans les chiffres terrifiants des apports délétères du transport, où l'on propose la solution mitoyenne des transports individuels électrifiés, il y a ceux des émanations du plus grand pollueur au monde, l'armée américaine, cachées au vu et au su de toustes. Les avions dont les moteurs roulent 24 heures sur 24, sur le pied de guerre, tout autour des côtes étatsuniennes, les camions aussi, les armes en joue, les guerres perpétuelles sur le terrain ou par procuration (Ukraine et Palestine à l'heure d'écrire cet article) n'en sont que quelques exemples.
Le jour où leurs options mâles de macho-gauchistes seront anéanties par la conscience d'une urgence, d'une nécessité brûlante : faire sauter le cycle de consommation-production au lieu de lui aménager une nouvelle forme vouée au même échec et conduisant à la même mort, le féminisme aura vaincu, car le féminisme aura triomphé.
Françoise d'Eaubonne, 1977 (p.47)
Or, qui sont ces voix qui s'élèvent contre la guerre et l'utilisation d'armes de destruction massive, traditionnelles et maintenant bactériologiques ? Au-delà des Medea Benjamin, Cindy Sheehan et Naomi Klein, ces femmes autochtones de l'Inde, d'Afrique et d'Amérique du Sud, anonymes pour la plupart, qui luttent sans relâche pour que cessent les agressions tant sur les femmes que sur l'écologie, mais aussi, plus précisément, exhortent les nations, somment même directement les pays guerriers comme les États-Unis et le Canada, de mettre fin à leur barbarie séculaire. Nous savons toustes que l'énergie nucléaire n'est pas une bonne solution, mais qu'en est-il de tout cet armement nucléaire, dans des mains moins que rassurantes ? Quelles menaces, quels dommages sommes-nous encore disposé.es à tolérer ?
S'engager, c'est aussi s'intégrer. C'est échapper aux assignations culturelles, religieuses ou familiales liées à l'origine pour embrasser et construire une histoire en mouvement.
– Edwy Plenel, cité par Abdelmoumen, 2023
Donc, oui, mettons en place des capteurs solaires et des éoliennes, qui peuvent aider à nourrir le parc énergétique de manière saine, peu coûteuse et sécuritaire. Roulons en Tesla usagée, mais au moins en Prius 2005 ; elles sont encore très en forme pour la plupart. Mieux, prenez les transports publics si votre région vous en propose et militez pour leur gratuité ! Il faut agir vite et bien. Surtout, cessons l'exploitation des animaux, que ceux-ci soient bipèdes ou quadrupèdes, qu'ils parlent en mots ou en onomatopées. Encourageons la cessation des « produits alimentaires » génétiquement modifiés au profit d'une agriculture qui soit saine pour les écosystèmes, dont nous, en tant qu'humain.es, faisons partie au même titre que les autres animaux. Et, de grâce, faisons cesser les guerres. Immédiatement.
Or, l'armée est reconnue pour être l'une des institutions les plus polluantes en raison de sa consommation vorace de matières premières et de ressources énergétiques (dont les hydrocarbures) et de tous les déchets toxiques qu'elle laisse sur son passage. Or, même avec une armée de dimension modeste, comme on peut imaginer celle envisagée ici, on voit mal comment cet écueil peut être surmonté.
– Beaudet, Constantin, Mayer, 2021
Chris Hedges, le journaliste américain, reprend, à peu de choses près, les idées de l'écoféminisme lorsqu'il dit que :
« L'avidité du capitalisme devra être contenue ou détruite. Nous devrons retrouver notre admiration pour le sacré […] pour que nous puissions enfin voir la Terre et chacun de nous, non comme des objets à exploiter, mais bien comme des êtres vivants devant être respectés et protégés. Cette régénération nécessitera cependant une vision bien différente de la société humaine. »
Mettons les verbes de la citation au présent, « que l'on détruise dès à présent l'avidité du capitalisme, afin de retrouver notre sens inné du sacré en faisant d'abord cesser les guerres, nous pourrons, peut-être, enfin voir la Terre et chacun.e de nous comme des êtres vivants respectés et protégés. Sinon, nous faisons fausse route et notre race, la race animale, sera disparue de la Terre dans moins de 100 ans.
Comme mentionné au début de l'article, l'écoféminisme est la mise en commun des forces de l'écologie et du féminisme, mais aussi de l'économie et de l'écosocialisme. Il est plus que temps de mettre les sinistres rabougris à la retraite et de laisser la place à des femmes, des femmes de tête et de coeur, soucieuses, appuyées par les hommes qui sont leurs alliés, de réparer la Terre et de la laisser aux générations futures encore probables dans un meilleur état que celui où elle nous a été prêtée. Laissons-nous inspirer par la sagesse et la compassion des auteurices autochtones dont la vocation de protection de la Terre et de tout ce qu'il l'habite perdure depuis la nuit des temps.
Laissons enfin la place à l'anima, celle qui lui revient d'intelligence naturelle axée sur la vie et laissons l'animus se « pencher sur sa vie comme sur un cahier à composer des rimes pour ses vieux péchés au lieu d'en inventer » de nouveaux, pour ajouter à la destruction déjà fort bien entamée.
Il est cependant clair que la crise climatique ne peut être résolue sans changer notre système économique de façon radicale. On ne peut ignorer les liens entre le capitalisme, le néolibéralisme et la destruction écologique. Il est urgent de repolitiser la question climatique et environnementale.
– Achard et Bernard, NCS automne 2023, p.13
L'autrice, Lucie Mayer, est artiste lyrique, enseignante de musique et de pose de voix, traductrice et réviseure candidate à la Maîtrise à l'UQTR et, à cette même université, poursuit ses études au microprogramme en Études autochtones. Cet article est le résultat d'une édition de son dernier travail au DESS qui portait sur l'écoféminisme. Elle a été candidate à deux élections provinciales sous la bannière de Québec solidaire (2014 et 2018). En 2016, après une chute, elle développe une mobilité différente ; son slogan pré-électoral de 2018 était « Même assise elle est debout ». Elle a tenu plusieurs responsabilités militantes au sein de Qs et milite maintenant auprès de Révolution écosocialiste, d'Action Environnement Basses-Laurentides, au sein du CA du RQGE en plus d'autres occupations dans des domaines variés. Et, malgré les mauvais pronostics, elle est toujours debout, vit dans les Laurentides avec chéri et le chat du voisin.
Bibliographie
Abdelmoumen, Mélikah, Les engagements ordinaires, UQAM 25, 2023
Achard, Flavie et Bernard, Milan, Des gouvernements irresponsables face à l'urgence climatique et à la détérioration de notre environnement, Nouveaux Cahiers du Socialisme, Éditorial, No. 30, automne 2023
Adams, Carol J. (editor), Ecofeminism and the Sacred, Continuum, 1993
Beaudet, Normand, Constantin, Louise et Mayer, Lucie, Relations 811, Québec solidaire en faveur d'une armée : un choix contre nature, Hiver 2020-2021. https://cjf.qc.ca/revue-relations/publication/article/quebec-solidaire-en-faveur-dune-armee-un-choix-contre-nature/ et https://www.erudit.org/fr/revues/rel/2020-n811-rel05684/94423ac/
Brisson, Pierre-Luc, L'âge des démagogues. Entretiens avec Chris Hedges, Montréal, Lux, coll. « Futur proche », 2016, cité par Dorion, Catherine, Les têtes brûlées, Carnets d'espoir punk, Lux, 2023
Buckingham, Susan, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (2è édition), 2015
Conseil central du Montréal métropolitain (CSN), Pandémie COVID-19, Pour une sortie de crise verte, sociale et démocratique, 2021
D'Eaubonne, Françoise, Le féminisme ou la Mort, Paris 1974 ; réédition Paris, 2020
Dupuy, Alexandra, Lessard, Michaël et Zaccour, Suzanne, Grammaire pour un français inclusif Nouvelle édition revue et augmentée, Somme Toute, 2023
Guy Sioui Durand, 2016, p. 6
Goldblum, Caroline, Françoise d'Eaubonne et l'écoféminisme, Le passager clandestin, 2019
Kapesh, An Antane, Eukuan Nin Matshi-Manitu Innushkueu traduit par José Mailhot : Je suis une maudite sauvagesse, édité et préfacé par Naomi Fontaine, Mémoire D'encrier, 2022.
Katan, David and Taibi, Mohamed, Translating Cultures, An Introduction for Translators, Interpreters and Mediators, Third Edition, Routledge 2021
Larousse.fr
Lerobert.com
Lefebvre-Faucher, Valérie, Promenade sur Marx, micro r-m, 2020
Sully, Jenny-Laure, L'écosocialisme contre toutes les guerres de domination, Nouveaux Cahiers du Socialisme, No. 28, L'écosocialisme, une stratégie pour notre temps, NCS, 2022
Un autre jour arrive en ville, Tout va bien, Beau Dommage, Capitol ST-70.048, 1977
Viennot, Éliane, En finir avec l'homme, Éditions iXe, 2021
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

En 142 jours de massacres, la population palestinienne a subi les pires atrocités : 30 000 morts et 70 000 blessés à Ghaza

Alors que les massacres des Palestiniens se poursuivent à raison d'une centaine au moins de morts par jour, les négociations semblent repartir du bon pied en vue de parvenir à une trêve. Jake Sullivan, conseiller de Joe Biden, a déclaré hier à CNN qu'un « terrain d'entente » a été trouvé lors des récentes discussions qui ont eu lieu à Paris.
Tiré d'El Watan.
Au 142e jour de la guerre contre Ghaza, le bilan des victimes palestiniennes est sur le point de franchir le seuil symbolique des 30 000 morts et 70 000 blessés. En effet, le ministère de la Santé de Ghaza a indiqué, hier, que 29 692 personnes ont été tuées et 69 879 blessées depuis le début de cette campagne dévastatrice. Mais ces chiffres sont à revoir à la hausse, si l'on tient compte du fait que des dizaines de victimes sont encore ensevelies sous les décombres.
Pas moins de huit massacres ont été perpétrés en vingt-quatre heures, soit entre samedi soir et dimanche matin, faisant 92 morts et 123 blessés, rapporte un communiqué du ministère de la Santé de Ghaza. Les derniers développements sur le terrain font état de nouvelles séries de bombardements concentrés sur les villes de Ghaza, de Khan Younès, de Rafah, ainsi que sur le camp de réfugiés de Beit Lahia, au nord.
D'après l'agence d'information palestinienne Wafa, plus de 10 civils ont été tués et plus de 50 autres ont été blessés suite à une série de bombardements qui ont visé ce dimanche des zones d'habitation à Haï Al Zaytoun et Al Sabra, dans la ville de Ghaza. A Khan Younès, 8 dépouilles ont été évacuées par les équipes de la Protection civile dans la région d'Al Satar, à l'est de la ville.
L'agence palestinienne, qui cite des sources locales, fait état par ailleurs de « bombardements intenses sur les zones orientales du gouvernorat de Khan Younès », ajoutant qu'« un citoyen a été tué dans un raid qui a ciblé des citoyens de la ville d'Al Qarara, au nord du gouvernorat ».
« 13 patients enterrés dans l'hôpital Al Nasser »
D'après Al Jazeera, les forces d'occupation se sont retirées du complexe médical Al Nasser de Khan Younès après des assauts répétés sur cet hôpital. L'agence Wafa note, toutefois, que l'armée sioniste reste « stationnée à proximité de l'hôpital ». « Le personnel et les patients du complexe médical Al Nasser se trouvent sans eau, sans nourriture, sans électricité, sans oxygène et sans composants thérapeutiques », informe Wafa en citant des sources médicales.
Ces dernières affirment que « 13 patients ont été enterrés dans l'enceinte de l'hôpital Al Nasser ». Ces 13 malades sont décédés par manque d'oxygène lui-même causé par des coupures de courant et l'arrêt des générateurs électriques.
Le centre palestinien d'information fait état de son côté de « violents affrontements qui ont éclaté au milieu de tirs d'artillerie et de bombardements intenses d'hélicoptères dans la ville d'Abasan, à l'est du gouvernorat de Khan Younès ». La même source cite deux frères, Salim Bashir Barbakh et Ahmed Nidal Barbakh, tous deux tués hier « dans un bombardement israélien contre un groupe de citoyens dans la région d'Al Sikka, dans le centre de Khan Younès ».
Dans la même ville, le centre palestinien d'information mentionne cette effroyable boucherie qui a coûté la vie à sept membres d'une même famille, en l'occurrence la famille Al Agha. Ils ont péri dans une frappe meurtrière qui les a surpris samedi soir, alors qu'ils étaient regroupés dans la demeure familiale.
A Khan Younès toujours, Al Jazeera a indiqué hier qu'une dizaine de civils ont été exécutés par des snipers à la rue Al Ibara, au cœur de la ville. Le média qatari ajoute que 8 civils ont été tués et de nombreux autres ont été blessés dans un bombardement ayant ciblé une habitation à Rafah, hier après-midi.
Dans la ville de Ghaza, l'occupant continue de mener une vaste opération militaire dans le quartier Al Zaytoun, au sud de la ville de Ghaza où des combats féroces font rage. « Des tirs d'artillerie et des raids aériens s'acharnent sur le quartier d'Al Zaytoun, coïncidant avec de violents affrontements avec la résistance, alors que les forces d'occupation poursuivaient leur incursion dans le sud-est du quartier », détaille le centre palestinien d'information. « Parallèlement aux tirs d'artillerie, des hélicoptères et des drones se sont attaqués aux quartiers est de la ville de Ghaza », poursuit le CPI. Cette offensive a fait au moins quatre morts parmi les civils.
Dans la ville de Ghaza toujours, cette fois dans le quartier d'Al Sabra, trois personnes ont été tuées dans une frappe contre la maison de la famille Kali, révèle le centre palestinien d'information. Par ailleurs, une autre personne a péri dans un raid mené sur le quartier d'Al Shaaf, à l'est de la ville de Ghaza.
A Beit Lahia, au nord, « des avions de l'occupant ont bombardé un site résidentiel de la rue Al Shaymaa, faisant de nombreux martyrs », rapporte le CPI. Dans la même région, des frappes aériennes « ont détruit un entrepôt de produits agricoles et d'appareils électriques, et un incendie s'est déclaré sur place ».
Le centre palestinien d'information a documenté également la mort atroce, ce samedi, d'un jeune infirmier avec plusieurs membres de sa famille dans une attaque à Beit Lahia, au nord de la Bande de Ghaza. « Le docteur Muhammad Saber Qashqash a été tué dans un bombardement sioniste après avoir passé plus de 140 jours à servir les malades dans le nord de la Bande de Ghaza », écrit le CPI.
« Terrain d'entente »
Sur le front diplomatique, les discussions repartent visiblement du bon pied dans l'espoir d'arracher une trêve avant le début de l'opération d'envergure que projette de lancer Netanyahu sur Rafah au début du mois de Ramadhan.
Selon l'AFP, le cabinet de guerre israélien a « donné son feu vert à l'envoi sous peu d'une délégation au Qatar afin de poursuivre les discussions des derniers jours à Paris en vue d'un nouvel accord de trêve », assure l'agence française.
Et de préciser que « le chef du Mossad, David Barnea, s'est rendu vendredi dans la capitale française à la tête d'une délégation israélienne ». L'objet de cette visite était de peaufiner le projet d'accord discuté fin janvier avec les médiateurs américain, égyptien et qatari.
Selon des sources médiatiques égyptiennes, des responsables qataris, égyptiens, et américains se sont réunis hier à Doha avec des cadres du Hamas et des responsables israéliens.
« Ces discussions entre technocrates seront suivies de réunions au Caire », affirme la chaîne Al Qahera News citée par l'AFP. Sur ces entrefaites, Jake Sullivan, le conseiller à la Sécurité nationale du président américain Joe Biden, a déclaré ce dimanche à CNN qu'un « terrain d'entente » a été trouvé lors des récentes discussions qui ont eu lieu à Paris.
« Il est vrai que les représentants d'Israël, des Etats-Unis, de l'Egypte et du Qatar se sont rencontrés à Paris et sont parvenus à un terrain d'entente entre eux quatre à propos des contours d'un possible accord », a soutenu le haut responsable américain.
L'accord devait principalement porter sur la libération des otages et sur un « cessez-le-feu temporaire ». « Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'ils sont toujours en train d'être négociés.
(…) Il faudrait qu'il y ait des discussions indirectes du Qatar et de l'Egypte avec le Hamas, parce qu'au final, ils devront donner leur accord à la libération des otages. Ce travail est en cours », a précisé le conseiller de Joe Biden selon des propos rapportés par l'AFP, avant de souligner : « Nous espérons que, dans les prochains jours, nous pourrons parvenir à un point où il y a effectivement un accord solide et final sur cette question. » -
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le féminisme construit des ponts pour l’intégration des peuples

Alejandra Angriman parle du rôle du féminisme dans les processus d'intégration régionale des peuples des Amériques
L'Amérique latine et les Caraïbes sont un territoire de dispute matérielle et symbolique. L'avancée de la puissance et de la cupidité de l'empire au cours des dernières décennies est stupéfiante, et s'est accélérée et est implacable. Il s'agit d'une expansion sans précédent de la violence et du pillage. Cela se reflète au niveau institutionnel, économique et productif, à travers les politiques néolibérales mises en œuvre par les représentants corporatifs du pouvoir concentré, qui mettent en pratique des stratégies pour détruire les conditions de vie de nos peuples.
Cette réalité implique, pour nous, la construction de conditions d'organisation populaire pour contester tous les espaces dans lesquels se déroule la lutte pour surmonter les inégalités et les asymétries de nos sociétés. Nous devons mener une lutte émancipatrice qui nous permette de définir une autre façon de reproduire la vie en commun. En ce sens, les contributions du féminisme — et en particulier la Marche Mondiale des Femmes — et tous les débats tenus lors de la Journée continentale pour la démocratie et contre le néolibéralisme ont été très importants pour notre organisation.
L'expérience de la formation de nos pays a montré que l'administration des États ne suffit pas, car la matrice coloniale et néolibérale a profondément infiltré les structures et limité le développement et la transformation dont nos sociétés ont besoin. En ce sens, il est fondamental pour la classe ouvrière de revendiquer la lutte pour le pouvoir et la représentation politique des peuples. Cela doit nous unir, pas nécessairement avec un parti politique, mais avec un projet politique émancipateur.
Les féminismes latino-américains ont une vertu : ils ont créé une identité politique capable de placer dans le scénario régional la remise en question radicale des systèmes de connaissance et d'organisation de la société. Surtout depuis les années 1990, la construction de la citoyenneté et la nécessité d'approfondir la démocratie dans les pays de notre région ont commencé à être à l'ordre du jour, et la relation entre les mouvements et les États, ainsi que le développement de stratégies pour influencer ces processus démocratiques, ont commencé à être au centre du débat. Le féminisme populaire développé sur notre continent a contribué de manière fondamentale à exposer ces tensions.
Aujourd'hui, en ce qui concerne l'agenda, une question centrale se pose :
quelle place faut-il accorder aux efforts d'institutionnalisation de la politique des droits dans des contextes d'aggravation de l'exclusion et des inégalités sociales ? Les réalisations de ces dernières années ont été importantes, mais elles semblent très modestes face aux défis de l'intégration de l'égalité et des droits dans le débat démocratique. L'objectif de la construction démocratique devrait être la création d'une vie digne d'être vécue. La lutte pour les droits des femmes nécessite le développement d'une vision stratégique de l'avenir, dans laquelle les agendas féministes ne sont pas seulement basés sur la défense discursive et la revendication de leur propre espace, mais sur l'articulation des revendications démocratiques de la société. Que des espaces de contestation et d'alternatives soient garantis en termes de réflexion, mais aussi — comme le disait Nalu Faria — en termes d'action.
« Puissions-nous être en mesure d'élaborer non seulement ce qui est possible, mais aussi ce qui est souhaitable ». Alejandra Angriman
À la Confédération Syndicale des Amériques (CSA) et dans ma propre organisation, la Centrale de travailleurs et travailleuses d'Argentine – Autonome (Central de Trabajadores y Trabajadoras de Argentina – Autónoma – CTA), nous avons un agenda fortement lié à la lutte du mouvement féministe populaire. Nous faisons une réflexion sur les débats qui se construisent sur notre continent. Nous ne parlons pas seulement d'un féminisme populaire, nous parlons également des apports des féminismes décoloniaux sur notre continent, qui nous permettent d'aborder différents aspects de l'intégration sous un angle différent.
La pensée décoloniale approfondit notre féminisme, nos perspectives sur les conflits Nord-Sud, la dimension mondiale et les liens locaux, pour dénoncer la colonialité qui persiste dans nos territoires et nos corps. Il nous permet d'analyser des questions allant de la géopolitique à la dépendance économique et culturelle et à l'injustice sociale dans la région. Cela nous permet également de chercher des réponses à travers la résistance, qui est liée à la tentative de décolonisation du savoir et du pouvoir. Ce féminisme décolonial qui a émergé dans les années 1980 comme une révision critique des féminismes hégémoniques doit être récupéré.
Le féminisme hégémonique continue d'être présent dans notre région et établit une vision unique et universelle, basée sur les préoccupations des femmes blanches, occidentales, européennes ou nord-américaines. Il est important de revenir sur les féminismes noirs, qui ont été les premiers à se positionner par rapport à ces féminismes occidentaux. Nous devons revenir à la tradition de la pensée critique latino-américaine, y compris la critique de la cooptation internationale du féminisme. Une partie du féminisme qui a émergé dans les années 1990 a été cooptée par des organisations non gouvernementales et des organisations financières internationales qui tentent de nous insérer dans un agenda lié à la défense des droits individuels, niant ou mettant les droits collectifs en veilleuse.
Il faut revaloriser les savoirs situés et horizontaux, sans prétention d'universalisme ni vérités indiscutables, afin d'obtenir des réponses plus précises et plus alignées sur les problèmes de notre région. Notre féminisme populaire, dans ses différents courants, a eu la capacité de repenser le concept de pouvoir et les luttes pour le pouvoir, en mettant l'accent sur les différentes formes d'oppression. À partir de la promotion de l'horizontalité des relations, nous devons continuer à contribuer à la critique de l'ordre international, en désarticulant les relations structurées autour de la masculinité.
De cette façon, nous pouvons continuer à réfléchir et à poser de nouvelles questions : quels sont les rôles sociaux construits et assignés aux hommes et aux femmes dans les processus d'intégration régionale ? Quelles autres inégalités sont liées aux inégalités entre les sexes ? Comment ces relations se cristallisent-elles dans la construction de l'institutionnalité ? Comment les processus d'intégration ont-ils un impact sur nos affections, nos émotions et notre corps ? Où et comment les espaces des femmes et de la diversité sont-ils inclus dans ces processus ? Toutes ces questions ont aussi à voir avec nos contributions déjà faites, et avec celles que nous devons continuer à faire pour construire un agenda qui tienne compte des enjeux des femmes.
Les enjeux n'ont pas seulement à voir avec la visibilité de ces multiples inégalités, subalternités et hiérarchies qui traversent tous les sujets qui sont dans ces espaces politiques. Analyser l'intégration régionale dans une perspective féministe populaire et décoloniale ne signifie pas s'en tenir à une perspective d'expérience, mais faire un effort indispensable pour formuler de nouvelles questions qui interrogent ces processus d'intégration. Nous avons fait beaucoup, mais nous avons encore beaucoup à faire. Qu'y avait-il en arrière-plan ? Nous devons articuler l'ensemble des connaissances que nous avons construites, ainsi que les luttes sociales qui restent segmentées par la logique patriarcale. À partir du féminisme, nous pouvons créer des vases communicants pour analyser et réfléchir à des stratégies régionales difficiles et articulées avec la mobilisation sociale actuelle. Le féminisme construit des ponts et comble les lacunes.
Alejandra Angriman
Alejandra Angriman est une militante de la Marche Mondiale des Femmes en Argentine, membre de la Central de Travailleurs d'Argentine – Autonome (CTA-Autonome) et est actuellement présidente du Comité des femmes de la Confédération Syndicale des Amériques (CSA). Ce texte est une édition de sa présentation lors du webinaire « Féminisme et intégration régionale », organisé par la MMF Amériques le 30 novembre 2023.
Langue originale : espagnol
Traduit du portugais par Andréia Manfrin Alves
Édition par Helena Zelic
https://capiremov.org/fr/analyse/le-feminisme-construit-des-ponts-pour-lintegration-des-peuples/
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Succès du séminaire de renforcement des capacités des femmes de la Coordination des Luttes Féministes du CADTM Afrique à Yaoundé

La Coordination des Luttes Féministes du CADTM Afrique en partenariat avec la Plateforme d'Information et d'Action sur la Dette (PFIAD) a organisé un séminaire de renforcement des capacités des femmes de la Coordination et des membres de la société civile camerounaise représentant diverses associations de femmes, de jeunes, pour le développement durable ainsi que des syndicalistes et des journalistes.
Tiré de l'Infolettre du CADtM
https://www.cadtm.org/Succes-du-seminaire-de-renforcement-des-capacites-des-femmes-de-la-Coordination
21 février par CADTM Afrique , Sarah Coppé , Coordination des Luttes Féministes du CADTM Afrique
38 participantes venant du Bénin, du Burkina Faso, du Mali, du Niger, de la République Démocratique du Congo, du Congo Brazzaville, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Gabon, du Togo, du Sénégal et de la Belgique se sont réunies à Yaoundé au Cameroun du 12 au 16 février 2024 pour échanger autour du thème central : « Femmes, leadership féminin, dettes, changements climatiques et extractivisme : enjeux et perspectives ».
Introduction

Après l'accueil, la présentation et le recueil des attentes de toutes les participantes, ce fut l'occasion de rappeler qu'en plus d'avoir pour objectif le renforcement des capacités, ce séminaire veut également dessiner les lignes directrices des actions à venir de la Coordination des Luttes Féministes du CADTM Afrique ainsi que son plan opérationnel. Les textes fondateurs du CADTM ont été présentés en mettant en exergue le fonctionnement et les parties spécifiques à la Coordination des Luttes Féministes.
Lors de cette première journée, les participantes ont chacune partagé la situation économique, politique, sociale et environnementale de leurs pays en mettant en avant les spécificités liées aux femmes ainsi que les différentes luttes et mouvements féministes qui ont eu lieu. Force est d'affirmer que les problématiques se ressemblent et que si les contextes en changent les détails, les systèmes et moyens d'oppression sont les mêmes. Malgré ce constat affligeant, c'est la solidarité et la détermination à s'unir pour changer les choses que les participantes ont emportées avec elles en fin de journée.
Axe 1 : Femmes, leadership féminin et Dette

La deuxième journée s'est déroulée autour de 4 présentations :
– Femmes et Leadership féminin
Ce premier atelier est revenu sur les point qui font d'une personne un.e leadeur.euse. Chacune a pu se questionner sur ses forces et faiblesses afin de garder ses forces en tête et de travailler sur les points à améliorer. L'écoute, l'analyse et l'action sont les points que nous retiendrons.
– Dette et problématique du Financement des projets de Développement en Afrique : cas spécifique de l'autonomisation des femmes
Cet atelier fut l'occasion de revenir sur des concepts clés du CADTM tels que la dette illégitime, la dette odieuse ou insoutenable, ainsi que l'autonomisation des femmes repris dans les ODD (objectifs de développement durable). Les mesures d'austérité́ mises en place pour le remboursement de la dette publique touchent en premier lieu les secteurs considérés comme « non productifs » : ceux de la santé, de l'enseignement, etc., et donc touchent spécifiquement les femmes, en tant que travailleuses majoritaires et usagères principales.
Un des objectifs du CADTM est d'expliquer l'endettement au niveau local et pas seulement macro pour que chacune puisse comprendre les implications sur leur quotidien et ainsi, faire des connexions pour améliorer leur cadre de vie. En effet, la question de la dette est transversale à la question de la santé, de l'eau, de l'extractivisme, etc.
Quant aux programmes de développement, il ne tiennent pas compte des réalités des personnes, et ne sont pas du tout adaptés aux femmes en région rurale. Les échanges sont clairs, selon les participantes, la problématique est transversale, le problème n'est pas seulement du côté financier mais aussi social. Il faut donner aux femmes rurales la capacité d'avoir confiance en elles au travers d'accompagnement et de formations.
– Le microcrédit dans le système dette en Afrique : Pratiques et dérives
Cette présentation a permis de comparer la définition des Instituts de Microfinance (IMF) et les impacts dans la réalité quotidienne des femmes, usagères majoritaires des microcrédits. Cet outil déconnecté de la réalité, s'avère être au profit des institutions de microcrédit et non un outil de lutte contre la pauvreté, bien au contraire. Ses impacts sur les femmes sont nombreux : surendettement, soucis social, divorce, prostitution, suicide, etc. Des conditionnalités d'accès au taux appliquée ainsi qu'au manque d'accompagnement et de formation, rien ne sert les populations pauvres et marginalisées, et cela concerne particulièrement les femmes. De plus, depuis la loi 2012 sur les Services Financiers Décentralisés (SFD) en Afrique de l'Ouest, les alternatives de financement local telle que la tontine traditionnelle ne sont plus autorisées, ce qui laisse les femmes avec pour seule option les institutions de microcrédit.
– La Banque Africaine de Développement, un instrument au service de la finance du système capitaliste en Afrique, quels impacts sur la paupérisation des femmes : cas des financements des mégas projets en faveur de l'élite bourgeoise locale
Les actionnaires de la BAD représentent 54 pays africains et 27 pays non régionaux. Malgré son nom qui nous fait croire que les états africains soient souverains dans la prise de décisions, les 27 membres non régionaux ont le droit de refuser ou d'accepter de financer les projets, les modifier, approuver des politiques et des procédures, augmenter le capital de la banque. De plus, le droit de vote se fait en fonction du montant d'argent versé par un pays.
Quel type de développement la BAD prétend-elle soutenir ? Des projets censé viser la création d'emplois, améliorer l'accès aux services de base, fournir des soins de santé et une éducation de qualité.
Mais quelle est la réalité ? Quels projets ont réellement abouti ? Ceux-ci n'améliorent pas les conditions de vie dans les pays et au contraire, appauvris les terres et les populations.
« La BAD a abandonné sa mission pour nous enfoncer dans le sous-développement, la BAD n'emprunte pas pour aider les pays africains mais pour s'enrichir. Pas besoin d'aller prendre des experts, vous êtes les experts de votre communauté à vous. Avec les outils actuels vous pouvez réaliser les impacts des gros projets dans votre localité et vous savez ce dont vous avez besoin pour y améliorer les conditions de vie ». sont les mots partagés lors de cet atelier. Renforcer les capacités des participantes permet de remettre les décisions entre les mains des populations en les sensibilisant et en leur donnant les outils clés pour leur propre développement.
Cette première journée s'est terminée sur le partage d'expérience des manifestations des politiques d'endettement et sur les conditions de vie des femmes par pays. Les programmes d'ajustement structurel, les projets non aboutis, les fausses solutions imposées par les Institutions financières internationales ont dans chaque pays des conséquences directes sur les populations : licenciement, privatisation des entreprises, augmentation des dépenses privées (augmentation du coût de la vie) et diminution des dépenses publiques (accès aux soins de santé et à l'éducation), tant de facteur impactant les conditions de vie des populations et particulièrement des personnes à charge de la famille, généralement les femmes.
Axe 2 : Changement Climatique

La troisième journée s'est déroulée autour de 2 axes : changement climatique et extractivisme. Pour le premier, l'atelier s'intitulait :
– Crise climatique et paupérisation : quand les femmes en Afrique paient le plus lourd tribut
L'occasion de revenir sur la définition de la crise climatique qui engendre d'autres crises sociales, économiques et agricoles ainsi que le concept de paupérisation, l'appauvrissement continuel de celleux qui ne peuvent suivre cette perpétuelle augmentation du coût de la vie. Bien que les populations du Sud Global ne participent qu'à une infime partie des causes du changement climatiques, elles subissent les conséquences les plus directes : diminution de la biodiversité, appauvrissement des sols, dérèglement du cycle saisonnier et des cultures, dégradation des écosystèmes, augmentation des maladies cancérigènes, crise migratoire, crise économique mondiale, désertification, érosion côtière, etc.
Alors que les femmes jouent un rôle clé dans la production alimentaire mondiale (50-80%), elles sont détentrices de moins de 10% des terres
Plus de 60% des personnes vivant dans l'extrême pauvreté sont des femmes, en région urbaine 40% des ménages les plus pauvres ont une femme pour cheffe de famille et alors que les femmes jouent un rôle clé dans la production alimentaire mondiale (50-80%), elles sont détentrices de moins de 10% des terres. De plus, traditionnellement, elles sont responsable d'amener la nourriture à la maison et dépendent des ressources naturelles locales pour garantir les moyens de subsistance.
Ainsi, les femmes en tant que public plus précaire subissent les effets du changement climatique plus directement et plus intensément. Leurs voix et celles des populations rurales doivent urgemment être prises en compte dans les décisions concernant les ressources et les initiatives liées aux changement climatique.
Pour rappel, les 1% les plus riches sont responsables de la production d'émission à hauteur de 2x plus que 50% de la population mondiale et le Nord Global est responsable de 92% du changement climatique contre 8% pour le Sud Global. Le CADTM ainsi que Debt for Climate demandent la suppression totale et inconditionnelle de la dette des pays des Suds comme un point de départ pour que les pays du Nord Global paient leur dette climatique.
Axe 3 : Extractivisme


– Les industries extractives et désastres écologiques, quelle incidence sur la vie des femmes dans les zones minières en Afrique ?
En République démocratique du Congo, depuis la libéralisation du secteur minier à travers l'adoption du code minier de 2002, plusieurs multinationales ont afflué dans les principales régions minières du pays, riche en minerais de cuivre et cobalt, éléments nécessaires à la fabrication des batteries et voitures électriques pour la transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique. Aux alentours, se sont installées des exploitations artisanales où travaillent beaucoup de femmes et d'enfants. Dans les deux cas, le situation des femmes y est inhumaine et les violations des droits humains nombreux : droits civils et sociaux absents des sites, pauvreté extrêmes, violations des droits à la santé y compris reproductive, manque d'accès à l'eau potable, à l'alimentation et à l'éducation, insécurité, et cette situation déjà insoutenable est augmentée par les discriminations basée sur le genre. Parmi les femmes interrogées, 73% subissent des violences sexuelles tandis que les autres d'abstiennent de répondre.
Au cours des partages d'expériences, cette situation se révèle semblable à toutes les zones minières en Afrique. L'extractivisme entraine d'innombrables désastres écologiques et sur la vie des femmes :
Expropriation de champs, évictions des logements, pollution de l'environnement (air, eau et sol) avec de graves impactes sur la santé sans indemnisation ni réparation équitable.
L'impunité, la corruption, la faiblesse et la complicité des États sont tant de facteur dont tirent profit les entreprises minières pour continuer à violer les droits des femmes sans être tenus responsables de leurs actes. L'ITIE (initiative pour la transparence des industries extractives) travaille pour que la norme de travail dans ces industries comprenne des règles tels que la RSE, le respect du principe d'égalité, la prise en compte des normes internationales de comportement, le respect des droits humains.
– Luttes féministes et réparations ciblant les industries extractives et l'exploitation forestière : cas du Mali, Cameroun et Gabon
Perte des activités génératrices de revenus, indemnisations insuffisantes et tardives, perte de la pharmacopée et des produits forestiers, accroissement du conflit homme faune, aggravation des fléaux sociaux (consommation des stupéfiants, prostitution des jeunes filles, vol, etc.), exposition aux risques climatiques (sécheresses, inondations), … les impacts des industries extractives et de l'exploitation forestière sur les conditions de vies des populations ne se comptent plus. Face à ce constat, des associations telles que la GDA au Cameroun, la CAD au Mali ou Brainforest au Gabon s'organisent pour informer les communautés sur les sauvegardes des projets extractivistes. Lors des réunions d'information, les femmes sont rarement prises en compte. Ces associations ont ainsi vu la nécessité de réunir les femmes entres elles pour qu'elles puissent porter leur voix et faire entendre leur droit de dire non, de se lever et de s'assembler.
– Les enjeux et les défis du droit de dire non à l'exploitation destructrice des ressources naturelles
Cet atelier remet au centre la problématique : les entreprises d'exploitation des ressources naturelles visent directement les intérêts du marché international plutôt que ceux de la population. Les exploitations industrielles ou minières partagent les caractéristiques d'une entreprise coloniale en ce qu'elles veulent dominer les territoires et populations au profit des pays développés.
Il est grand temps de remettre en question la pensée dominante selon laquelle le « vrai » développement s'organise autour de l'exploitation à grande échelle des ressources naturelles et d'une main d'œuvre bon marché ou non rémunérée.
Les projets de développement doivent être un choix venant de la population, les communautés peuvent avoir leurs propres alternatives au développement, elles doivent exprimer leur points de vue et apporter leur propre vision du développement en utilisant leur propre processus de prise de décision.
Le droit de dire NON des populations revient à revendiquer leur souveraineté en matière de développement afin de donner ou de refuser leur consentement à des projets de grande envergure. C'est un acte profondément politique car il remet en cause les systèmes de pouvoir et affirme le droit des communautés à définir leurs propre intérêts et avenir.
Axe 4 : Enjeux et perspectives des luttes féministes

– A l'heure du bilan des conférences internationales de la femme, pourquoi les femmes en Afrique continuent de subir ?
– La Coordination des Luttes Féministes du CADTM, Womin et FJS (Foundation for a Just Society) : trois organisations, un combat unique pour l'émancipation des femmes.
Dans tous les pays, une politique de genre existe mais ces politiques genre ne sont pas appliquées. Les discours politiques doivent être traduit en discours d'action locale mais ce n'est toujours pas le cas.
Pour cause, les institutions qui adoptent ces texte pour les droits femmes sont les mêmes qui implantent les projets qui détruisent les conditions de vie des femmes et qui les exproprient de leur terre. Les politiques et programmes de développement ne sont d'une part pas matérialisables en action et d'autre part, ne permettent pas l'autonomie des communautés et des minorités car ils ne prennent pas en compte l'avis de celles qui vivent ces préoccupations au quotidien.
C'est pourquoi, la Coordination des Luttes Féministes du CADTM, Womin et FJS partagent un objectif commun : que les femmes urbaines et rurales prennent leur destin en main pour qu'elles construisent elles-mêmes leur développement et celui de leur famille. C'est un combat contre les politiques qui ne descendent pas à la base. C'est un combat pour l'émancipation des femmes.
– Identification des enjeux de la Coordination des Luttes Féministes
– Réflexion sur le plan stratégique, élaboration de la feuille de route, mise en œuvre des recommandations du séminaire
Les rencontres et partages avec les actrices de terrain ont permis à la Coordination d'élaborer un plan stratégique d'action. Chacune des participantes a pu valoriser ses connaissances et apprentissages lors de la réalisation de la feuille de route, de l'analyse SWOT, des orientations stratégiques et des axes d'interventions pour la suite des actions de la Coordinations des Luttes Féministes du CADTM Afrique.
Outre la richesse des présentations, ce sont les partages d'expériences et les débats qui ont suivi qui ont réellement fait en sorte que chacune puisse s'approprier les informations afin d'en faire un outil pratique dans leurs vies quotidiennes et professionnelles.
Ce séminaire s'est clôturé sur les voix des femmes scandant des cris de luttes pour la solidarité : « So-so-so solidarité, avec les femmes du monde entier », pour l'engagement, « Toutes les femmes engagées pour lutter », pour la justice « Justice pour toustes, justice sociale ».
Enfin, ce séminaire a été l'occasion d'alimenter la croyance en la possibilité de se rassembler entre femmes pour partager les problématiques spécifiques qui les entourent et organiser ensemble un moyen de sortie. La lutte continue.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les filles du Mozambique privées de leur droit à l’éducation

Le Mozambique est confronté à d'énormes difficultés pour scolariser les jeunes femmes et les filles enceintes, ou celles qui ont des enfants en bas âge, selon un nouveau rapport de HRW.
Photo et article tirées de NPA 29
Ces femmes et ces filles ont besoin d'un soutien fort de la part des écoles, en particulier pendant l'une des périodes les plus vulnérables de leur vie.
Pourquoi les jeunes femmes et filles enceintes ou mères abandonnent-elles l'école ? Les raisons varient : elles sont confrontées à la discrimination, à la violence sexiste et à la pauvreté. Pour beaucoup d'entre elles, il est impossible de jongler entre l'école et les responsabilités liées à la garde des enfants. Et l'absence d'éducation gratuite pousse de nombreuses filles issues des ménages les plus pauvres à quitter l'école. La plupart d'entre elles n'ont aucune possibilité de garde d'enfants.
L'ampleur du défi est considérable :
Selon une étude, 70 % des filles enceintes au Mozambique quittent l'école.
Le pays a le cinquième taux de mariage d'enfants le plus élevé au monde. Le taux de grossesse des adolescentes au Mozambique est l'un des plus élevés d'Afrique. Selon les Nations unies, au moins une fille sur dix a eu un enfant avant l'âge de 15 ans.
En 2022, seulement 41 % des filles ont terminé le premier cycle de l'enseignement secondaire.
En 2020, seules 4 % des filles ont terminé le deuxième cycle de l'enseignement secondaire.
En 2003, le gouvernement a demandé aux responsables scolaires de transférer les filles enceintes et les mères adolescentes des écoles de jour vers les écoles de nuit. Ce décret a de fait autorisé et consolidé la discrimination à l'encontre de ces élèves dans le système éducatif national.
Par la suite, des groupes de la société mozambicaine ont mené une campagne qui a permis de faire pression sur le ministère de l'éducation pour qu'il abroge le décret en 2018. Mais bien qu'il ait fait preuve d'une volonté politique de changement, le gouvernement a eu du mal à s'attaquer aux énormes obstacles systémiques et sociaux auxquels les filles sont confrontées pour rester à l'école.
Dans le cadre de nos recherches, Human Rights Watch a constaté que certains enseignants et autorités scolaires continuaient d'orienter automatiquement les élèves vers les écoles de nuit en raison de la stigmatisation, des pratiques discriminatoires existantes, ou d'un manque de consignes des responsables. Heureusement, d'autres enseignants soutiennent les étudiantes pour qu'elles restent à l'école.
Le Mozambique devrait adopter des réglementations juridiquement applicables pour garantir le droit des filles à l'éducation pendant la grossesse et la parentalité. Le gouvernement devrait également veiller à ce que tous les élèves aient accès à une éducation sexuelle complète et à des services de santé reproductive adéquats.
Les filles du Mozambique – comme les filles du monde entier – ont un droit fondamental à l'éducation, quelles que soient les circonstances dans lesquelles elles se trouvent – et ce droit doit être garanti.
21 février 2024 Human Rights Watch
https://www.afriquesenlutte.org/
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le mariage forcé en Inde et au Népal

Le mariage forcé est encore très fréquent en Inde et au Népal, distordant les réalités des jeunes filles. Un phénomène qui a été mis en avant au cours du panel « Youth-led to dismantling Child, Early, Forced Marriage and Union » organisé par Girls Not Brides. Selon l'ONG, douze millions de filles sont mariées avant l'âge de 18 ans, ce qui équivaut à vingt-trois filles par minute.
Tiré de Entre lesl ignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/02/23/le-mariage-force-en-inde-et-au-nepal/
Lorsqu'elles sont forcées dans un mariage, les filles arrêtent leurs études et prennent le rôle de femme au foyer, ce qui les isole de leur entourage. L'organisme Girls Not Brides insiste sur le fait que lorsqu'un mariage est fait, il doit automatiquement être avec une femme majeure et non une fille puisque celles-ci pensent souvent que la violence est normale au sein d'un couple. En effet, se disputer en présence des enfants est très commun pour les parents, ce qui altère la réalité de ce qui fait une relation de couple saine. Ainsi, il faut insister et éduquer les parents sur le modèle qu'ils transmettent à leurs enfants. Les panélistes proposent donc de mettre en place des programmes pour apprendre aux parents les risques d'un mariage forcé et leur transmettre les clefs pour diminuer ces risques.
Selon les statistiques de l'organisme, un tiers des filles forcées dans un mariage ont un enfant avant 18 ans et deux tiers d'entre elles ont un enfant avant 20 ans. Cela veut dire que 100% des filles forcées d'entrer dans ce genre d'arrangement ont un enfant avant 20 ans. Toutefois, devenir mère précocement n'est pas le seul qui accompagne les mariages forcés. En effet, l'enlèvement d'enfants est fréquent au Népal. Certaines personnes enlèvent des filles dans la rue pour les obliger à se marier, propageant une peur généralisée chez les filles du pays et diminuant leur liberté de pouvoir adopter des précautions de sécurité. Il a été demandé plusieurs fois que les filles puissent sortir et non se barricader chez elles par peur.
De plus, pour embellir le mariage forcé, les populations ont adopté un nouveau terme pour le décrire : une union. Cette union ne veut pas nécessairement dire que le consentement est présent. Ce n'est qu'un terme utilisé pour enjoliver la situation. Les causes de ses arrangements trouvent ainsi leur cause dans l'inégalité des genres, les normes sociales, la pauvreté et l'ignorance des parents. En effet, il est commun de penser qu'une fille jouira d'une plus grande sécurité financière en étant rattachée à un mari qu'en restant dans sa famille. Il est également possible que la famille de la fille reçoive une dot lorsqu'elle se trouve en situation de pauvreté. Au contraire, si c'est la famille de la fille qui doit payer une dot pour marier sa fille, le montant est souvent moins élevé si elle est jeune et peu éduquée.
Ainsi, le mariage forcé demeure une réalité préoccupante en Inde et au Népal, avec des conséquences dommageables pour les jeunes filles, qui voient leurs droits bafoués et leur avenir compromis. Les efforts de sensibilisation et d'éducation menés par l'ONG Girls Not Brides sont donc essentiels pour lutter contre les mariages d'enfant. Pour les panélistes, il est impératif de s'attaquer aux racines profondes de ce phénomène, notamment l'inégalité des genres, les normes sociales préjudiciables et la pauvreté, tout en garantissant la protection et l'autonomie des jeunes filles népalaises.
Julia Hayward, participante au FSM 2024 avec le Collectif québécois
Témoignage sur la conférence « Youth-led to dismantling Child, Early, Forced Marriage and Union » présentée par Girls Not Brides Népal au FSM 2024.
https://alter.quebec/le-mariage-force-en-inde-et-au-nepal/
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Extraire des métaux pour sauver la planète ?
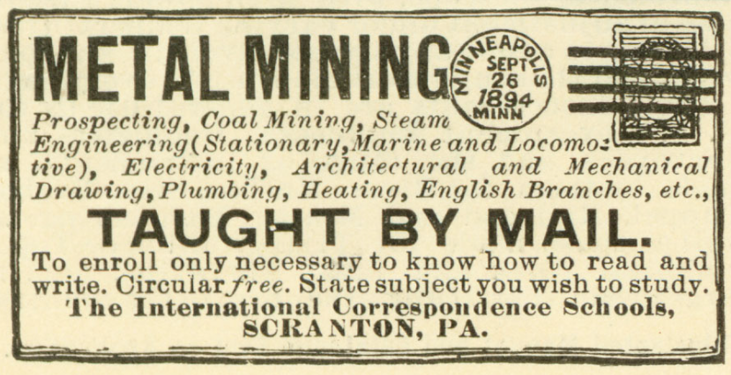
Journaliste et traductrice (notamment du Mille neuf cent quatre-vingt-quatre de George Orwell) formée à la philosophie, Celia Izoard a notamment fait profiter de sa plume laRevue Z et Reporterre. AprèsMerci de changer de métier, série de « lettres aux humains qui robotisent le monde » en 2020, elle vient de publier La Ruée minière au XXIe siècle, dans lequel elle démonte pièce par pièce un paradoxe pseudo-écologique : « extraire des métaux pour sauver la planète ».
19 février 2024 | tiré de contretemps.eu
https://www.contretemps.eu/entretien-celia-izoard-ruee-miniere/
Contretemps (CT) : Ton nom est avant tout attaché à la critique de la technologie et notamment de la domination numérique, y compris dans des cadres collectifs comme celui du groupe Marcuse ou au sein des éditions L'Échappée. D'où te vient cette sensibilité politique ? Quand et comment s'est-elle formée ?
Celia Izoard (CI) : Pendant mon adolescence, je lisais des romans sur la Résistance, j'avais hérité d'une histoire familiale violemment liée à l'Occupation et à la persécution des Juifs, puis joyeusement ancrée dans les aventures de Mai 68 – et je ne comprenais pas où était passée l'Histoire. À la fin des années 1990, au début des années 2000, j'avais l'impression que la politique avait été remplacée par la simple succession des technologies : l'époque du baladeur et du Macintosh, l'époque du Tatoo et du CD, l'époque du portable et du mp3 et demain celle des voitures volantes…
C'est en lisant Hannah Arendt puis plus tard Guy Debord que j'ai réussi à mettre des mots sur cette impression : la technique avait englouti le politique. Nous étions devenus de simples figurants dans l'histoire de la production industrielle, des utilisateurs de machines, nostalgiques de celles de notre enfance, enthousiasmés d'avance par celles de l'avenir. En ce sens Francis Fukuyama avait raison : c'était bel et bien la « fin de l'Histoire », non pas parce que le capitalisme mondialisé avait définitivement mis tout le monde d'accord comme il le prétendait, mais parce que nous avions été séquestrés par la marchandise, nous étions prisonniers d'un spectacle dans lequel les progrès de la technologie s'étaient en quelque sorte substitués à l'histoire. Si nous n'avions pas été prisonniers de ce spectacle, nous aurions pu voir que pendant ce temps, la majeure partie du globe, le Tiers Monde d'alors connaissait d'immenses bouleversements, des putschs néocoloniaux, des faillites orchestrées par le FMI et la Banque mondiale, des famines, des révoltes contre la violence du néolibéralisme.
L'autre sentiment qui m'a obligée à m'intéresser à la technologie, c'est la stupéfaction que j'ai ressentie, que nous avons ressentie avec mes ami.es et camarades, en voyant l'espace public se recouvrir de nouveaux objets tout droit sortis d'un film de science-fiction : les caméras de surveillance, les écrans publicitaires géants, les téléphones dans toutes les mains. Je me disais : on est en train de construire le cauchemar d'Orwell, la dystopie de la société de surveillance déshumanisée, on y va tout droit. Ce qui est incompréhensible, c'est que personne ne désire cette société et que pourtant personne ne fait rien. Pour des raisons mystérieuses, il est interdit de porter un jugement sur ces machines.
Avec d'autres (le groupe Marcuse, l'Échappée, la Lenteur…), nous avons voulu éclaircir ce mystère : d'où viennent ces tabous autour de la technologie ? Quelle est leur histoire ? Par exemple l'extrême violence de la répression des mouvements luddites marque le moment où les objets technologiques de l'industrie sont devenus intouchables, en même temps que la propriété bourgeoise est consacrée et sacralisée. Autre exemple : le stigmate infamant qu'on renvoie à celui qui contesterait une technologie date de l'instauration de la religion du Progrès au XIXe siècle, mais c'est aussi, dans les milieux de gauche, un héritage du stalinisme qui a terrorisé toute personne critique de la grande industrie en la suspectant d'être réactionnaire.
CT : Dans ce livre, tu « descends » pour ainsi dire au niveau de l'infrastructure physique qui soutient la numérisation généralisée, prétendument « immatérielle ». Comment as-tu entrepris non seulement de t'intéresser davantage à ces « bas-fonds », mais d'enquêter sur le sujet ? La conscience de ce « soubassement » rendu plus ou moins invisible par le discours dominant est-elle intervenue tôt dans ta réflexion, ou bien peut-on dire que celle-ci s'est peu à peu déplacée des effets jusqu'aux causes ?
CI : J'ai toujours été fascinée par le fait que notre rapport mystique à la technologie implique de faire disparaître des données matérielles de base dont l'enjeu est déterminant, qui devraient nous obliger à tout arrêter. Avant que je m'intéresse à l'informatisation, comprendre le fonctionnement de l'industrie nucléaire a été un choc pour moi. Vous voulez dire qu'en cas d'accident une seule de ces centrales peut rendre une région inhabitable pour des siècles, et qu'en plus, ça s'est déjà produit, et qu'on a quand même décidé de continuer à les utiliser ? Et que face à la pollution radioactive on n'a pas d'autre solution que d'enterrer la terre, enterrer les arbres, enterrer les maisons, comme à Tchernobyl ? C'est dément. En lisant par exemple La Supplication, de Svetlana Alexievitch, j'ai compris que la fascination de la société industrielle pour sa propre puissance impliquait un déni de son impuissance. Cette société, sous couvert de créer des instruments de puissance, ne cesse de créer des phénomènes face auxquels nous sommes radicalement impuissants : le réchauffement climatique, la pénurie d'eau potable…
Depuis, c'est resté mon principal sujet d'étude : tout ce que recouvre ce déni. Je l'étudie pour donner une légitimité au sentiment d'incrédulité que je ressens. Et bien sûr ce déni s'exerce le plus fortement là où la vénération pour la technologie est la plus forte : donc, aujourd'hui, dans le domaine du numérique, le monde des écrans et de l'intelligence artificielle (IA), les fétiches des fétiches. Dans ce domaine, ce n'est pas seulement que la technocratie a gommé une série de problèmes techniques insolubles, comme dans le nucléaire, c'est qu'elle a carrément réussi à créer une hallucination collective, à faire disparaître pendant des décennies les objets en tant qu'objets, en tant qu'ils existent matériellement, en tant qu'ils ont été produits et qu'ils seront jetés. L'électronique, terme qui renvoie à des machines et des composants, a été refoulé au profit de l'informatique puis du numérique, les termes qui renvoient à l'existence mathématique, abstraite de ces technologies. Alors que, bien sûr, le numérique s'incarne dans des objets électroniques.
C'est pour faire face à ce déni que j'ai édité en 2015 La Machine est ton seigneur et ton maître, où des ouvrières et ouvriers chinois des usines d'électronique Foxconn racontent leur quotidien, leur exploitation. C'est une exploration des bas fonds du capitalisme numérique, que j'ai conclue par un texte intitulé « Les ombres chinoises de la Silicon Valley ». Ce qui m'a le plus frappée est que le géant Foxconn a produit l'essentiel de tout ce que recouvre le terme de numérique depuis 40 ans, des premières consoles Atari aux iphones, qu'il est le premier employeur en Chine, et qu'il a néanmoins fallu attendre 2010, une épidémie de suicides d'ouvriers dans une des usines, pour que le nom de cette entreprise apparaisse dans les médias occidentaux. En trois décennies, le public n'a jamais été amené à associer le numérique à la moindre usine. Le paradoxe est que c'est le secteur de l'économie qui en nécessite le plus. Un smartphone est un concentré d'industries : minière, pétrolière, chimique, auxquelles s'ajoute l'industrie du data mining, de l'extraction de données. Comme je l'indique dans mon livre, selon les données de Fairphone, il faut des composants issus de plus de mille usines différentes pour permettre produire un seul « smartphone ».
CT : Tu parlais de paradoxe : ton livre en soulève un autre, temporel ou chronologique : l'extraction minière passe volontiers pour un phénomène du passé et dépassé, une sorte de vestige historique qui serait en tous points opposé aux « innovations techniques » d'aujourd'hui, alors qu'en réalité celles-ci reposent sur une exploitation intensive des sous-sols. Comment expliquer la persistance de ce décalage ?
CI : J'analyse dans La Ruée minière comment la mine a disparu de l'imaginaire dominant dans les pays riches alors que leurs industries, notre mode de vie, n'ont jamais cessé de consommer plus de métaux, d'être plus dépendants du secteur minier. La mystique du Progrès suppose qu'il y ait un dépassement de l'ancien, en particulier de l'ancien qui pose problème, et à partir des années 1980 ce dépassement a été consacré par le mythe de la société post-industrielle, la société de la communication, une société dite tertiaire qui s'est affranchie de ses secteurs primaires et secondaires et qui ne produisait plus que l'information, des idées ou des services.
Mais au fond, ce décalage entre l'absence de la mine et son omniprésence réelle est le résultat de l'histoire flatteuse que l'Occident se raconte depuis des siècles, une civilisation sortie de la caverne pour se projeter dans le ciel des idées.
C'est aussi l'effet d'une reprise en mains idéologique et politique des élites après la décennie 1968. En réponse aux mouvements de contestation qui dénonçaient l'aliénation technique dans les usines et la destruction des milieux causés par la production industrielle, les élites ont déménagé et invisibilisé la production minière, métallurgique (entre autres), elles l'ont à la fois sortie du pays et sortie du récit. En fait, le néo-libéralisme a toujours été follement extractiviste : il a obligé par des putschs ou par la dette des dizaines de pays à livrer leurs sous-sols, il a balayé au profit des multinationales les acquis de la décolonisation des pays miniers du Sud, qui avaient socialisé les richesses issues de l'extraction. C'est l'impérialisme, l'amplification d'un mode de vie impérial que l'on a appelé à cette période la mondialisation, qui a permis de mettre en scène la fiction des sociétés « tertiarisées ».
Tant que le flot de minéraux importés arrivait paisiblement dans les pays occidentaux ou dans leurs usines outremer, on a pu continuer à ignorer la nature fondamentalement extractiviste du capital, allant jusqu'à ignorer des conflits de grande ampleur des populations indigènes contre des multinationales de la mine, dans tout l'Est de l'Inde, contre Rio Tinto à Bougainville ou BHP en Papouasie, etc. (Elles sont racontées par Stuart Kirsch dans Mining Capitalism pour les années 1990, notamment en Papouasie.) Ce n'est qu'au début des années 2000, à partir du moment où l'arrivage de minéraux s'est enrayé, du fait de la concurrence de la Chine, que la mine a réapparu dans l'espace public, parce que les dirigeants ont été sommés par les grands groupes industriels d'inventer à la fois des politiques pour assurer leur approvisionnement et des discours publics pour les justifier.
CT : Autre paradoxe, et même « l'un des grands paradoxes de notre temps », comme tu l'écris : « Pour sauver la planète, un coup d'accélérateur historique a été donné à l'une des industries les plus énergivores et toxiques que l'on connaisse ». Peux-tu revenir sur cet extractivisme paradoxal, d'autant plus redoutable qu'il se prétend mû par des intentions écologiques ?
CI : Le pari des élites capitalistes consiste à décarboner les économies sans renoncer à la croissance, sans renoncer, donc, à l'urbanisation, à la vitesse, au béton, aux avions, à la conquête spatiale, au numérique, etc. En gros, il s'agit de continuer à alimenter la mégamachine tout en s'engageant à baisser les émissions de CO2. Ce pari repose presque entièrement sur la production minière et métallurgique qui est censée permettre cette électrification : batteries des voitures électriques, électrolyseurs pour la production d'hydrogène vert, uranium pour le nucléaire, giga-projets éoliens et photovoltaïques. Le paradoxe incroyable, donc, c'est de favoriser l'industrie la plus destructrice en prétendant ainsi sauver la planète. L'extraction minière est l'un des principaux agents du réchauffement climatique (8 % des émissions) et de la déforestation. C'est la première productrice de déchets au monde. Elle est à l'origine d'une contamination des milieux qui menace la santé de 23 millions de personnesdans le monde. On ne peut pas extraire entre cinq et dix fois plus de minéraux qu'aujourd'hui, comme il est prévu de le faire, sans exercer une violence inouïe contre les peuples.
Ce projet est d'autant plus absurde que les quantités de métaux nécessaires, ne serait-ce qu'aux batteries des véhicules électriques, sont colossales et rendent le projet irréaliste. Par exemple, pour disposer de 39 millions de voitures électriques en France, soit le parc actuel, il faudrait plus d'un an de production mondiale de cobalt, et près de deux ans de production mondiale de lithium. On voit bien que la France ne pourrait donc décarboner ses transports qu'au détriment d'un autre pays : du point de vue de la lutte contre le réchauffement, c'est un non-sens, puisque l'atmosphère se fiche de la nationalité des émissions carbone, l'important est qu'elles baissent partout.
CT : Se concentrer sur la question des métaux, est-ce une manière de rouvrir une perspective excessivement focalisée sur l'« empreinte écologique » et plus encore sur l'« empreinte carbone » au détriment d'autres concepts ou indicateurs ?
CI : Bien sûr : la question des métaux permet de réintroduire la violence sociale et coloniale dans la pensée écologiste, car la mine est indissociable de la conquête. Comme le dit un vieux proverbe impérialiste, « le commerce suit le drapeau, mais le drapeau suit le pic du mineur ». C'est toujours vrai. De la Centrafrique aux forêts indiennes, des Andes aux steppes d'Asie centrale, les fronts pionniers du capitalisme aujourd'hui, ce sont principalement les mines.
Dès lors qu'on s'intéresse aux mines et à la chaîne d'approvisionnement métallique de nos objets, on voit réapparaître les peuples, leurs mondes, l'accaparement des ressources, tout ce que les outils de quantification des émissions et de l'énergie font disparaître. Si ces indicateurs ont servi à mettre en évidence la voracité de la production dans un langage compréhensible par les bureaucraties, ces outils ont une affinité structurelle avec le capitalisme dans la mesure où ils introduisent de la commensurabilité. C'est ainsi qu'on arrive à la conclusion, par exemple, que détruire telle forêt pour installer des panneaux photovoltaïques est légitime puisque cela permettrait d'éviter tant d'émissions carbone par ailleurs. Dans la vraie vie, la forêt en question est aimée et habitée, elle donne de l'ombre et de l'humidité, elle abrite des usages collectifs parfois ancestraux : en réalité, rien, absolument rien ne saurait justifier ni compenser sa destruction. C'est exactement ce qui se passe à Prospérité, en Guyane, où les Kali'na se battent contre la destruction de la forêt tropicale de leur village pour installer une centrale photovoltaïque.
Ce sont ces indicateurs qui ont produit l'aberration qu'est la voiture électrique telle qu'elle est promue : l'idée qu'il serait légitime de détruire tels et tels endroits du monde en toute connaissance de cause dans le but de faire baisser les émissions carbone. On le voit, le principal problème de ces indicateurs est qu'ils font d'une question politique une question purement technique : ils évacuent la justice sociale, la domination coloniale, néo-coloniale. Le fait qu'on va créer des mines de lithium sur les terres collectives des peuples autochtones d'Argentine ou de Bolivie, le fait qu'on va construire des usines de batteries chez les pauvres du Nord de la France…
D'autre part ces indicateurs devraient servir à objectiver des coûts environnementaux et des pollutions ; mais ils ne font que refléter des rapports de force. Je constate que les analyses de cycle de vie ne prennent que très peu en compte les pénuries et les pollutions de l'eau créées par les mines : c'est lié à la capacité des populations qui les subissent de les dénoncer. À l'exception de celles qui sont soutenues par des ONG internationales, la majorité vit des drames qui n'arrivent jamais jusqu'aux bureaux d'études européens. C'est le cas par exemple au Maroc où j'ai enquêté sur l'extraction de cobalt destiné principalement aux batteries des véhicules électriques. La catastrophe qui se déroule autour de cette mine n'a jamais été intégrée au moindre indicateur.
CT : Le livre de Guillaume Pitron La guerre des métaux rares a bénéficié d'une couverture médiatique aussi large que positive, y compris dans le secteur indépendant ou alternatif du champ médiatique. Rares sont les voix qui, comme Ysé dans un article pour le site du collectif d'enquêtes militantes Strike, ont souligné les ambiguïtés politiques du livre et critiqué la perspective de l'auteur, en particulier du point de vue de la critique du capitalisme et du colonialisme. Quelle est ta position à cet égard ?
CI : Guillaume Pitron a fourni un argumentaire précieux aux dirigeants et aux industriels pour imposer de nouveaux projets miniers et métallurgiques en Europe. Il semble considérer qu'il y aurait d'une part des métaux sales, produits par la Chine ou par des pays pauvres, mais qu'ailleurs, comme en France, de meilleures normes environnementales permettraient d'obtenir des métaux propres. J'ai montré, au contraire, les impacts de la mine industrielle en tant que système et l'incompatibilité de ce système avec la préservation du vivant et de l'eau, a fortiori quand la sécheresse et la pénurie d'eau potable se généralisent.
Il a donc promu la mine responsable, mais il a aussi contribué à façonner une seconde créature mythique : la mine relocalisée, l'idée selon laquelle la relance minière européenne permettrait de rapatrier les mines et d'alléger notre dette écologique. En réalité, pour que l'Europe puisse fournir ne serait-ce qu'un tantième des métaux de l'industrie européenne, il faudrait diviser la production industrielle par dix, revoir notre mode de vie drastiquement à la baisse. Exit Airbus, Thalès, Stellantis et Volkswagen…. Tant qu'on ne met pas en avant la nécessité impérieuse d'un sevrage minéral, d'une décroissance de la consommation des métaux, les mines ouvertes sur le vieux continent s'additionneront aux mines qui existent ailleurs. Mais parler de relocaliser les mines est surtout un argument massue pour imposer un projet face à une contestation locale : la culpabilisation (des victimes) est devenu un mode de gouvernement.
Je m'étonne depuis la parution de ce livre du succès qu'il a connu dans les milieux pourtant conscients des enjeux écologiques et antiracistes, alors qu'il défend surtout les intérêts de la grande industrie européenne et s'ingénie à résoudre ses problèmes d'approvisionnement en métaux critiques. Je montre essentiellement l'inverse : la priorité est de contester les besoins de ces entreprises et de libérer la technique de son emprise minière, sans quoi la démesure extractiviste ne pourra que progresser.
CT : Comme l'indique son sous-titre, le livre est une réflexion sur la « transition », en théorie et en pratique. Coïncidence : il sort en même temps que celui de Jean-Baptiste Fressoz, justement intitulé Sans transition. Pourrais-tu revenir sur cet aspect et notamment sur ta caractérisation de ladite transition comme « état d'exception » ?
CI : L'impératif de produire des métaux pour la transition sert de prétexte à l'ensemble des politiques visant à sécuriser l'approvisionnement en matières premières pour les entreprises occidentales, face aux monopoles chinois et russes. Réaliser la transition devient la justification des nouvelles frontières extractives qui s'ouvrent un peu partout, c'est un motif d'intérêt supérieur qui permet de faire tomber les barrières réglementaires et politiques auxquelles faisaient face les entreprises minières. En ce sens, la transition crée les conditions d'un état d'exception, que reflète la nouvelle loi européenne sur les matières premières : il faut se donner les moyens d'ouvrir des mines le plus vite possible même dans des zones protégées.
Plus largement, je montre dans ce livre que la transition est devenu le mot d'ordre qui permet de justifier la poursuite du développement industriel et de l'accumulation, alors même que le désastre actuel devrait l'interdire. Finalement, si le réchauffement climatique est un obstacle à la poursuite de la croissance, la « transition » permet de contourner cet obstacle en justifiant l'ouverture de nouveaux marchés, la production de nouvelles marchandises et de nouvelles infrastructures.
La Transition est l'idéologie qui accompagne la poursuite de l'extractivisme de la même manière qu'il avait été légitimé il y a quelques décennies en Occident par l'impératif du Développement, il y a deux siècles par celui du Progrès, et il y a cinq siècles par l'avancée de la Civilisation. C'est encore une mission salvatrice qui justifie l'accaparement de ressources.
CT : Les phénomènes que tu analyses se déploient à une échelle de temps considérable, jusqu'à entraîner parfois des effets quasi irréversibles. « L'après-mine se prolonge indéfiniment dans le futur », écris-tu, avant d'évoquer une gestion « au pire désespérante, au mieux acrobatique », que le « chaos climatique » pourrait rapidement rendre « totalement inopérante »… Dans ces conditions, comment ne pas désespérer ? Quelles voies de sortie restent envisageables ?
CI : Des voies de sortie, des gens en inventent en permanence, des coopératives de maraîchage, des collectifs de charpentières, des ateliers textiles de laine locale, des mairies en autogestion, des salles de quartier pour s'entraider, des recycleries, des brasseries… Je pense qu'il faut à la fois cultiver ces initiatives autogérées et les relier pour former une sorte de filet de sécurité coopératif, solidaire, qui puisse enrayer un minimum l'exploitation économique ; tout en réinvestissant d'urgence la démocratie représentative, aussi impuissante et épuisante soit-elle. Il faut essayer de faire les deux à la fois pour faire face au chaos qui s'annonce : une tempête climatique et probablement fasciste.
À mes yeux, la désertion par les mouvements anticapitalistes et la jeunesse de la démocratie représentative se paie très cher. L'ensemble du paysage politique s'est déplacé vers l'extrême droite. Les partis en sont devenus incultes, totalement en décalage par rapport aux forces les plus clairvoyantes et les plus à même de créer de réelles alternatives, comme les mouvements antiracistes des quartiers populaires et les Soulèvements de la terre (à l'exception des mouvements féministes qui ont plutôt mieux réussi à faire passer leurs revendications vers la politique mainstream). Les industriels ont toujours des solutions et des projets de société clés en main à glisser aux élus. Les mouvements sociaux doivent eux aussi mettre en avant leurs imaginaires et leurs programmes, ne serait-ce que pour exiger autre chose que cette transition extractiviste. Nous avons besoin de constituer des assemblées territoriales pour planifier la décroissance et l'usage des ressources, notamment minérales – nous pourrions nous appuyer sur des partis pour le faire si la situation était différente.
Quant au désespoir, se battre pour faire de belles choses et des choses qui ont du sens sera longtemps possible. Certes la pollution est généralisée, mais prendre soin des mondes qui nous entourent, même abîmés, appauvris, ça n'a rien de déprimant. Tisser des liens communautaires et améliorer ensemble nos conditions de vie, c'est joyeux. Faire preuve de solidarité envers ceux et celles qui souffrent, c'est réparateur. Ce n'est pas parce que la mégamachine semble inarrêtable que nous devrions cesser de prendre plaisir aux cycles de la vie, de jouir d'être ces animaux terrestres, au contraire ; profitons de tout ce qui nous lie à un monde qui existait bien avant les multinationales de la mine. Quand le printemps arrive, je repense à cette formule de George Orwell : « Les bombes atomiques s'accumulent dans les usines, la police rôde dans les villes, les mensonges sont déversés par les haut-parleurs, mais la terre continue de tourner autour du soleil, et ni les bureaucrates ni les dictateurs ne peuvent rien contre cela. »
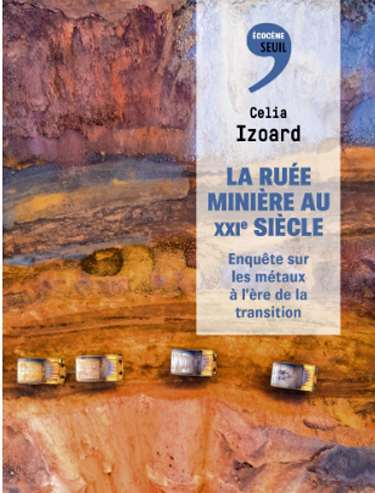
*
Celia Izoard, La Ruée minière au XXIe siècle. Enquête sur la transition à l'ère de la transition, Paris, Seuil, 2024, 352 p., 23 €. « Bonnes feuilles » disponibles sur le site de Terrestres.
Signalons aussi la parution de L'Or et l'Arsenic, de Nicolas Rouillé, sous-titré Histoire orale d'une vallée minière, aux (excellentes) éditions Anacharsis.
Québec solidaire, par l'entremise de Ruba Ghazal et d'Haroun Bouazzi, a réagit à l'offensive criminelle d'Israël à Gaza en demandant au gouvernement Legault d'exiger un cessez-le-feu. Les représentant.e.s de la formation de gauche ont aussi exigé la fermeture du bureau du Québec à Tel-Aviv en déposant une pétition de plus de 12 000 signataires. Rien n'y fit. La CAQ et ses ministres se positionnent ainsi comme les complices d'Israël et de ses exactions.
Pour toute réponse, le premier ministre a réitéré le suspect « droit d'Israël de se défendre », songe à interdire les manifestations de soutien à la cause palestinienne et vote contre la motion présentée par QS. Il avait auparavant fait fi d'une initiative du gouvernement Trudeau d'exiger un cessez-le-feu immédiat à Gaza et s'aligne sur la position du gouvernement d'extrême-droite qui dirige Israël et sa guerre.
La ministre des relations internationales Martine Biron, ex-journaliste à Radio-Canada, plaide en faveur d'une présence québécoise en Israël et que le Québec « doit avoir une porte d'entrée sur la région du Moyen-Orient ». Cette parade est suspecte puisque le site web de l'organisme ne mentionne aucunement l'intérêt pour les pays voisins d'Israël et présente la mission du « Bureau du Québec à Tel-Aviv représente le Québec en Israël auprès de partenaires gouvernementaux, institutionnels, économiques, culturels et universitaires. » Rien sur la mission de l'organisme dans la région du Proche-Orient. Bref, la ministre Biron nous mène en bateau. L'ouverture du bureau du Québec a été repoussée en raison du conflit.
Le premier ministre a déjà qualifié les manif de soutien au peuple palestinien de « honteuses et inqualifiables ». Justin Trudeau est sur la même longueur d'onde lorsqu'il est temps du 2 poids 2 mesures entre Israël qui a droit de se défendre et le la Palestine qui est mené par une organisation dite « terroriste ». Selon Legault , la manifestation pro-Palestine visait à « célébrer ou supposément justifier l'assassinat de civils ». Par contre, toute la sympathie des élu.e.s caquistes va à Israël. Le ministre François-Philippe Champagne était présent à la manifestation d'appui à Israël le 10 octobre dernier. La ministre de l'enseignement supérieur Pascale Dery se disait « fière que mon gouvernement soit aux côtés de la communauté juive et des israéliens ». Le lobby sioniste comme le Centre consultatif des relations juives et israéliennes (CIJA) et le B'nai Brith s'en réjouit, condamne Québec solidaire et refuse de qualifier l'opération militaire à Gaza de génocide.
Voix juives indépendantes, un organisme qui s'oppose au sionisme, a déjà dénoncé François Legault et son gouvernement lors du débat sur la controversée définition de l'anti-sémitisme de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'holocauste (IHRA) selon laquelle toute critique d'Israël et/ou du sionisme représente des actes antisémites. Or, le ministre du développement durable et de l'environnement Benoit Charette est auréolé par le lobby sioniste lorsqu'il accepte la définition de l'antisémitisme de l'IHRA à titre de ministre responsable de la lutte au racisme. On constate donc de nombreux liens et la proximité politique entre le gouvernement Legault et la mouvance sioniste. De droites de plus en plus dures pour ne pas dire extrêmes dans le cas de plusieurs ministres du gouvernement Netanyahou. Des droites qui ont en commun la capacité de nier l'évidence, qu'un génocide est en cours à Gaza, que le but d'Israël est de « nettoyer » la Palestine et d'en prendre le contrôle total.
Les gouvernements des pays impérialistes s'entendent pour un soutien presqu'inconditionnel à Israël. En 2015, la campagne BDS a été interdite en France. Au Canada, on refuse (simplement de se joindre à la campagne. À l'époque (février 2016) Stephane Dion (Libéral) qualifiait « le BDS de forme de discrimination tout comme les boycotts qui ont ciblé les juifs au cours de l'histoire ». Le ministre des affaires étrangères de l'époque affirmait aussi que « le monde ne gagnera rien avec le boycott d'Israël mais se privera des talents de son inventivité ». Le Canada suivait ainsi l'exemple de plusieurs Etats américains (New York, Pennsylvanie, Floride, Alabama, Tennessee et l'Indiana ont adopté des résolutions anti- BDS) et européens qui interdisent les tentatives de boycott d'Israël. Et l'accueil de réfugié.e.s palestiniens se fait au compte-goutte alors que les réfugiés ukrainien.ne.s entrent par milliers. Un autre exemple du deux poids deux mesures dans ce dossier.
Le gouvernement Netanyahou peut ainsi commettre les pires exactions sans craindre la moindre conséquence grâce au silence complice de gouvernement comme celui de François Legault. Les récentes décisions de la Cour internationale de justice en sont une illustration. Malgré ses recommandations, Israël maintient ses opérations génocidaires. Plusieurs gouvernements. Sous la pression populaire, demandent du bout des lèvres de tempérer les opérations, de permettre aux civils de se mettre à l'abri. Rien n'y fait, le gouvernement Netanyahou fait la sourde oreille et ira jusqu'au bout.
L'appui à la lutte des Palestinien.ne.s s'annonce difficile dans ce contexte. Mais l'appui populaire contre le génocide à Gaza demeure important. Le mouvement de solidarité se poursuit. Québec solidaire et les autres partis d'opposition doivent maintenir la pression sur le gouvernement Legault pour la fermeture du bureau du Québec à Tel-Aviv et exiger un cessez-le-feu immédiat.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
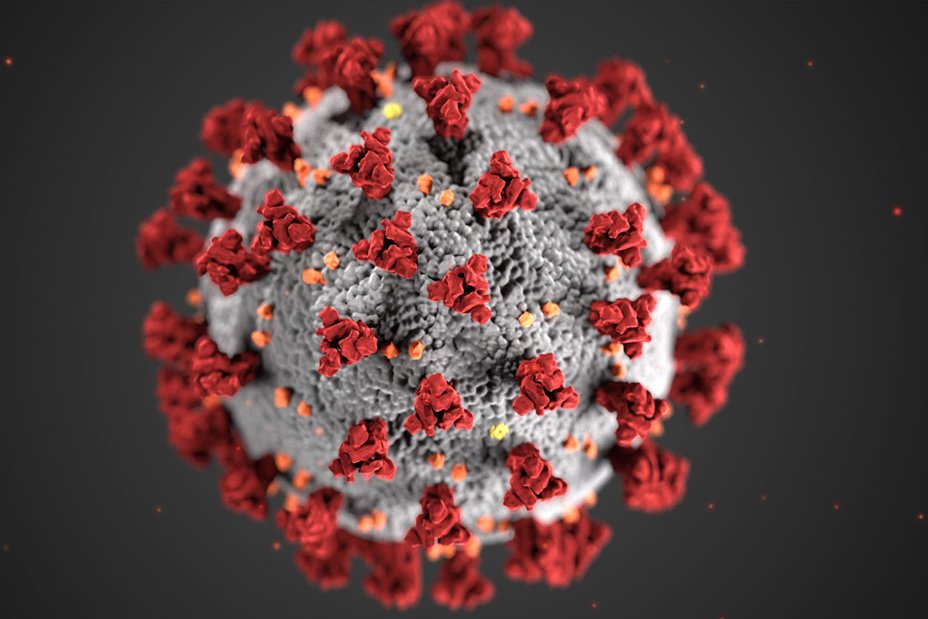
La vaccination réduit considérablement le risque de COVID Long

Un consensus de plus en plus large se dégage sur le fait que recevoir plusieurs doses de vaccin COVID peut réduire considérablement le risque de symptômes persistants. Une étude du JAMA a notamment constaté que la prévalence du COVID Long chez les travailleur·euses de la santé est passée de 41,8% chez les participant·es non vacciné·es à 30% chez celleux ayant reçu une seule dose, 17,4% avec deux doses et 16% avec trois doses.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/02/24/la-vaccination-reduit-considerablement-le-risque-de-covid-long/
Note de Cabrioles : en raison de l'échappement immunitaire des variants émergents et de la baisse importante de la protection vaccinale au bout de six mois, un rappel doit être fait régulièrement pour une protection optimale. Par ailleurs, bien que réduit par la vaccination le risque de COVID Long reste élevé. Défendre une prévention combinée (Vaccination + FPP2 gratuits + Assainissement de l'air intérieur) demeure un impératif.
Au moins 200 millions de personnes dans le monde ont été affectées par un COVID Long : une série de symptômes qui peuvent persister pendant des mois, voire des années, après une infection par le SARS-CoV-2, le virus qui provoque le COVID. Mais les recherches montrent que ce nombre serait probablement beaucoup plus élevé sans les vaccins.
Un consensus de plus en plus large se dégage sur le fait que recevoir plusieurs doses de vaccin COVID avant une première infection peut réduire considérablement le risque de symptômes persistants. Si les études ne s'accordent pas sur le degré exact de protection, elles montrent une tendance claire : plus vous recevez de doses avant une première infection par le COVID, moins vous risquez de contracter un COVID Long. Une méta-analyse de 24 études publiée en octobre, par exemple, montre que les personnes ayant reçu trois doses de vaccin COVID avaient 68,7% de risques en moins de développer un COVID Long par rapport à celles qui n'avaient pas été vaccinées. Alexandre Marra, chercheur médical à l'hôpital israélite Albert Einstein au Brésil et auteur principal de l'étude commente : « C'est vraiment impressionnant. Les doses de rappel font une différence pour le COVID Long ».
Il s'agit également d'une avancée bienvenue par rapport aux études précédentes, qui montraient que les vaccins offraient qu'une protection plus modeste face au COVID Long. En 2022, l'équipe de Marra avait publié une méta-analyse de six études inqiquant qu'une seule dose du vaccin COVID réduisait de 30% la probabilité d'un COVID Long. Aujourd'hui, cette protection apparait beaucoup plus importante.
Une étude publiée en novembre dans le BMJ a montré qu'une seule dose de vaccin COVID réduit le risque de COVID Long de 21%, deux doses de 59% et trois doses ou plus le réduisent de 73%. L'efficacité du vaccin augmente clairement à chaque nouvelle dose. Fredrik Nyberg, épidémiologiste à l'université de Göteborg, en Suède, l'un des coauteurs de l'étude déclare : « J'ai été surpris de constater une réaction aussi nette à chaque dose. Plus le nombre de doses présentes dans l'organisme avant la première infection est élevé, mieux c'est ». Ces résultats concordent avec ceux de plusieurs nouvelles études, qui montrent de la même manière un effet bénéfique en cascade. La méta-analyse d'octobre 2023 de Marra a montré que deux doses réduisaient la probabilité de COVID Long de 36,9% et que trois doses la réduisaient de 68,7%. Et dans une étude publiée l'année dernière dans le Journal of the American Medical Association, d'autres chercheur·euses ont constaté que la prévalence du COVID Long chez les travailleur·euses de la santé est passée de 41,8% chez les participant·es non vacciné·es à 30% chez celleux ayant reçu une seule dose, 17,4% avec deux doses et 16% avec trois doses.
Ces études ont été menées dans plusieurs pays dont les systèmes de santé, la démographie, le taux de vaccination contre le COVID et la prévalence du COVID diffèrent. Marra note donc que l'efficacité des vaccins COVID contre le COVID Long varie et ne peut être généralisée à d'autres contextes. Néanmoins, la cohérence des résultats des études est éloquente : quel que soit le contexte, de nombreuses études s'accordent à dire que les rappels offrent une protection efficace contre le COVID Long. La récente méta-analyse de Marra, par exemple, a montré que la prévalence du COVID Long dans les premières années de la pandémie était constamment supérieure à 20%. Aujourd'hui, les taux de COVID Long ont chuté, probablement grâce à une immunité accrue, à l'évolution des variants et à l'amélioration des traitements. Cependant, il existe toujours un fossé important entre les personnes non vaccinées et les personnes vaccinées. La prévalence du COVID Long est actuellement de 11% chez les personnes non vaccinées et de 5% chez celles qui ont reçu au moins deux doses de vaccin. « Il s'agit d'une différence significative pour les personnes qui ne veulent pas prendre le risque », dit-il.
La question reste de savoir pourquoi. C'est peut-être parce que ces vaccins aident à prévenir le COVID sévère lui-même, qui est un facteur de risque pour le COVID Long. Mais cela ne semble pas tout expliquer, notamment parce qu'il a également été démontré que les rappels protégeaient les personnes qui n'avaient eu qu'une infection bénigne par le COVID. Malheureusement, les mécanismes précis en jeu sont difficiles à démêler, car la cause du COVID Long elle-même est encore imprécise. L'une des possibilités est que le virus reste dans l'organisme, se cachant dans divers organes, tels que l'intestin ou le cerveau, et provoque une inflammation chronique. Une autre hypothèse est que le COVID Long est une maladie auto-immune dans laquelle la réponse immunitaire déclenchée par l'infection initiale mène une guerre prolongée contre l'organisme, provoquant des symptômes longtemps après la disparition de l'infection initiale.
Dans les deux cas, les rappels offrent un avantage, selon Akiko Iwasaki, immunologiste à l'université de Yale, qui codirige un essai clinique sur le COVID Long. En effet, les rappels renforcent les anticorps, augmentant à la fois leur nombre et leur capacité à se fixer au virus, ainsi que les cellules immunitaires T et B qui aident à combattre le virus. Grâce à ces deux éléments « les personnes qui reçoivent les injections de rappel ont une meilleure capacité à lutter contre l'infection » explique Iwasaki. Il s'agit là d'un élément clé, qui permet au rappel d'enrayer une infection croissante avant qu'elle ne devienne incontrôlable. « Plus on empêche la réplication et la propagation du virus dans l'organisme, moins le virus a de chances d'ensemencer une niche, d'établir des réservoirs ou de provoquer une inflammation excessive qui conduit à l'auto-immunité », explique-t-elle.
Bien qu'il faille du temps pour déterminer la raison exacte de l'effet protecteur des vaccins contre le COVID Long, de nombreu·ses spécialistes médicale·aux espèrent que les nouvelles études contribueront à lutter contre la diffusion de fausses informations et de désinformations sur la vaccination contre le COVID, qui a nourri la suspicion à leur égard. Mais les spécialistes notent également que si les vaccins réduisent le risque de COVID Long, ils ne l'éradiquent pas, et la protection peut s'estomper avec le temps. « Des vagues d'infections peuvent encore se produire, et la dynamique du virus, y compris l'émergence de nouveaux variants, ajoute de la complexité à la situation », explique Marra. Il est donc important de continuer à suivre les directives de santé publique pour minimiser l'impact du COVID Long, y compris le risque de symptômes persistants.
Shannon Hall
Shannon Hallest une journaliste scientifique indépendante et primée. Elle est spécialisée dans l'astronomie, la géologie et l'environnement. Elle écrit pour Scientific American, The New York Times, Nature, National Geographic et d'autres.
https://cabrioles.substack.com/p/la-vaccination-reduit-considerablement
Publication originale (03/01/2024) :
Scientific American
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :















