Presse-toi à gauche !
Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Fondation Humanitaire de Gaza : le nouveau modèle israélien d’aide humanitaire militarisée

‘De tels programmes ne font guère plus que maintenir l'illusion d'une préoccupation humanitaire au milieu des violences génocidaires et du nettoyage ethnique qui se poursuivent.‘
Tiré d'Agence médias Palestine.
En mars 2024, la principale initiative mondiale de surveillance de la sécurité alimentaire, l'IPC (Integrated Food Security Phase Classification) a averti que la famine était imminente à Gaza.
Aujourd'hui, près d'un demi-million de Palestiniens sont confrontés à une famine catastrophique, le reste de la population du territoire se trouvant en état de crise ou d'urgence.Des enfants, des personnes âgées et des malades, mais aussi des personnes qui étaient autrefois en bonne santé, meurent chaque jour de malnutrition, de déshydratation et de maladies qui pourraient être évitées.
Les bébés naissent dans un monde de précarité et de famine.
Il ne s'agit pas d'une catastrophe naturelle. C'est le résultat brutal de la violence orchestrée et de l'apathie collective mondiale. La famine à Gaza n'est pas un dommage collatéral, mais plutôt la conséquence intentionnelle des politiques conçues par le gouvernement israélien pour maximiser la souffrance et la mort.
L'utilisation de la nourriture et de l'aide humanitaire comme arme est depuis longtemps un pilier de la stratégie militaire d'Israël à Gaza et dans toute la Palestine occupée.
Depuis qu'Israël a imposé son blocus sur Gaza il y a 17 ans, les Palestiniens vivent sous un régime de contrôle total qui étouffe leur économie, paralyse leurs infrastructures et restreint la circulation des personnes et des biens.
En 2012, le gouvernement israélien a dû rendre public un document rédigé en 2008, qui révélait que son ministère de la Défense avait calculé l'apport calorique minimum nécessaire pour éviter la malnutrition tout en continuant à restreindre autant que possible l'accès à la nourriture. Comme l'a déclaré un haut responsable israélien en 2006, Gaza devait être maintenue « au régime ».
Des restrictions opaques
Depuis plus d'une décennie, les organisations de défense des droits humains et les experts indépendants de l'ONU ont condamné à plusieurs reprises ce blocus, le qualifiant de punition collective. Mais en l'absence de répercussions concrètes, les gouvernements israéliens successifs ont continué à renforcer et à étendre cette pratique de privation orchestrée.
Le refus systématique, le retard et la destruction de l'eau, de la nourriture, des fournitures médicales et des abris sont devenus les caractéristiques déterminantes de cette politique ; même les équipements de purification de l'eau, les béquilles et l'insuline ont été bloqués en raison des restrictions injustifiables et opaques d'Israël en matière de « double usage ».
Les prestataires de services publics palestiniens, les réseaux de la société civile et les organisations humanitaires se trouvent dans l'incapacité de répondre aux besoins les plus élémentaires des Palestiniens vivant à Gaza. Ces derniers mois, alors qu'Israël intensifiait son offensive, ce blocus s'est transformé en un siège à part entière.
Les conséquences inévitables de cette stratégie délibérée ont été catastrophiques. Des experts indépendants de l'ONU ont déclaré à la mi-2024 que la famine s'était propagée dans toute la bande de Gaza.
Des enfants et des personnes âgées meurent de faim et de déshydratation, tandis que l'Organisation mondiale de la santé a averti que la famine à Gaza menace de freiner de manière permanente la croissance et le développement cognitif de toute une génération d'enfants.
Au milieu de cette crise qui s'aggrave, la manipulation de l'aide dite humanitaire s'accélère. Au printemps 2024, les États-Unis ont construit un « quai humanitaire » au large des côtes de Gaza. Les Palestiniens ont exprimé leur scepticisme, craignant que ce quai ne serve à masquer des opérations militaires, tandis que les organisations humanitaires ont fait valoir que sa construction ne faisait que détourner l'attention de l'obstruction délibérée par Israël de tous les points de passage terrestres existants.
Au mois de juin, la zone entourant ce quai a été utilisée lors d'un raid israélien contre le camp de réfugiés de Nuseirat, déguisé en mission humanitaire. Près de 300 Palestiniens ont été tués et près de 700 autres blessés.
Les experts des droits de l'homme de l'ONU ont qualifié cette attaque d'exemple de barbarie sans précédent. Pourtant, aucune répercussion significative n'a été dirigée contre Israël ou son allié américain.
Les acteurs humanitaires établis ont été maintes fois discrédités, notamment l'Office de secours et de travaux des Nations unies (UNRWA), ce qui constitue une autre tactique dans cette guerre d'usure.
L'UNRWA joue depuis longtemps un rôle central dans la distribution de l'aide et la fourniture de services essentiels dans toute la bande de Gaza. Mais ces derniers mois, elle a fait l'objet d'une campagne de désinformation intensifiée, qui a conduit à des attaques directes contre son personnel, au retrait de financements et à une interdiction imposée par la Knesset israélienne, une mesure à la fois illégale et sans précédent dans l'histoire de l'ONU.
« Affamer pour soumettre »
Cet affaiblissement des infrastructures civiles et humanitaires à un moment où les besoins sont extrêmement élevés a encore isolé la population palestinienne de Gaza, renforçant sa dépendance à l'égard de programmes d'aide contrôlés de l'extérieur et largement irresponsables.
Le dernier programme en date d'Israël est la Gaza Humanitarian Foundation (GHF), nouvellement créée et soutenue par Tel-Aviv et Washington. La GHF a été créée pour superviser la distribution de l'aide dans toute la bande de Gaza, dans le but de mettre à l'écart toutes les structures existantes, y compris l'ONU. Un ancien porte-parole de l'UNRWA a condamné cette initiative, la qualifiant d'« aide humanitaire de façade », une stratégie visant à masquer la réalité, à savoir « affamer la population pour la soumettre ».
Selon la proposition de la GHF, les plus de deux millions d'habitants de Gaza seraient contraints de se procurer de la nourriture dans l'un des quatre « sites de distribution sécurisés ». Aucun des sites proposés n'est situé dans le nord de Gaza, une région qu'Israël a attaquée et occupée dans le but de procéder à un nettoyage ethnique, ce qui signifie que les personnes qui y vivent encore seront contraintes de fuir vers le sud pour accéder à l'aide vitale. La privation de l'aide humanitaire comme moyen de transfert forcé d'une population est reconnue comme un crime contre l'humanité.
L'annonce officielle du GHF ne fait aucune mention des attaques répétées d'Israël contre des centres de distribution alimentaire, des boulangeries et des convois humanitaires, qui ont causé la mort de centaines de Palestiniens qui tentaient de nourrir leur famille, ni de l'obstruction délibérée par Israël du système humanitaire existant.
Cette forme de contrôle de l'aide renforce le siège plutôt que de l'alléger. Des solutions inhumaines et inadéquates, telles que les largages aériens de vivres ou les colis alimentaires conditionnés, ne font guère plus que maintenir l'illusion d'une préoccupation humanitaire, tandis que la violence génocidaire et le nettoyage ethnique se poursuivent. Les auteurs de ces privations se posent en sauveurs, tout en continuant à affamer une population pour la pousser au déplacement et à la soumission.
Il ne s'agit pas d'une critique marginale : le coordinateur des secours d'urgence de l'ONU, Tom Fletcher, a qualifié les plans présentés par le GHF de « feuille de vigne pour justifier davantage de violence et de déplacements ».
Malgré la décision rendue en janvier 2024 par la Cour internationale de justice, qui exigeait la protection immédiate des civils à Gaza et la fourniture généralisée d'une aide humanitaire, la situation a continué de se détériorer rapidement. Une enquête menée en janvier 2025 auprès de 35 organisations humanitaires travaillant à Gaza a révélé un consensus écrasant : 100 % d'entre elles ont déclaré que l'approche adoptée par Israël était inefficace, inadéquate ou avait systématiquement entravé l'acheminement de l'aide.
L'incapacité de la communauté internationale à agir de manière décisive a permis cette crise prévisible – non pas une crise humanitaire, mais une crise politique marquée par l'apathie, l'indifférence et l'impunité. Les avertissements concernant la malnutrition massive et l'effondrement des infrastructures sanitaires et sociales de Gaza ont été ignorés pendant des années. Que la famine frappe aujourd'hui une population qui a été systématiquement privée de nourriture ne devrait surprendre personne.
L'utilisation de l'aide et de la nourriture comme armes à Gaza n'est pas un accident tragique. C'est le résultat prévisible – et prévu – d'un siège destiné à contrôler et à déplacer la population. L'incapacité des États et des organismes multinationaux à mettre fin à ce processus n'est pas simplement le résultat d'un environnement politique complexe, c'est un échec de la volonté, de la responsabilité et de la gouvernance mondiale.
Les détracteurs du GHF et des derniers plans d'Israël visant à mener un nettoyage ethnique sous couvert d'aide humanitaire doivent reconnaître la longue histoire de l'occupant en matière d'instrumentalisation et de militarisation de l'aide. Nous pourrons ainsi nous détourner des efforts réformistes visant à garantir une apparence de conduite humanitaire prétendument éthique et dénoncer l'ensemble des moyens utilisés par Israël pour créer une dépendance à l'aide depuis des décennies, dans le seul but de manipuler le système humanitaire comme pilier central de ses ambitions coloniales plus larges.
Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement la politique éditoriale de Middle East Eye.
Amira Nimerawi est PDG de Health Workers 4 Palestine (HW4P) et spécialiste de l'impact des programmes au sein de la Palestinian Medical Relief Society (PMRS), spécialisée dans les programmes de soins d'urgence et de santé sexuelle en Palestine.
Sara el-Solh est médecin et anthropologue. Elle travaille à l'échelle nationale et internationale sur diverses questions de santé publique, notamment la migration, la justice climatique et l'accès aux soins de santé.
James Smith est maître de conférences en politique et pratique humanitaires à l'UCL et médecin urgentiste basé à Londres. Il a travaillé à Gaza entre décembre 2023 et janvier 2024, puis d'avril à juin 2024.
Mads Gilbert est un médecin urgentiste norvégien qui se rend régulièrement dans les camps de réfugiés palestiniens au Liban, en Cisjordanie occupée et à Gaza depuis 1982.
Traduction : JB pour l'Agence Média Palestine
Source : Middle East Eye
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’évolution du mouvement syndical en Ukraine

Oleksandr Skiba est membre du syndicat VPZU (Syndicat libre des cheminots d'Ukraine – KVPU) au dépôt ferroviaire de Darnytsa et président de la Fondation pour le développement de l'Union.
Tiré de Entre les lignes et les mots
1. Introduction
Le mouvement syndical ukrainien est né dans le cadre du système soviétique, où les syndicats jouaient principalement un rôle décoratif, se concentrant sur la distribution des avantages sociaux plutôt que sur la défense des droits des travailleurs. L'effondrement de l'Union soviétique a marqué le début d'un nouveau chapitre. Dès 1990, des organisations syndicales indépendantes ont commencé à émerger, remettant en cause les institutions de l'« ancien système ». Au fil du temps, un nombre important de ces organisations se sont regroupées au sein de la Confédération des syndicats libres d'Ukraine (KVPU).
Parallèlement, la Fédération des syndicats d'Ukraine (FPU) – la plus grande coalition de syndicats dits « traditionnels » ou « jaunes » – a poursuivi ses activités. Cette entité a hérité d'actifs et de positions institutionnelles considérables de l'ère soviétique. Bien qu'elle ait conservé une structure organisationnelle formelle, comprenant des rapports, des comités et des divisions de jeunes, ses opérations étaient largement symboliques et manquaient d'engagement substantiel. En particulier, la participation des jeunes au sein de ces organisations était nominale, sans véritable implication dans les processus de prise de décision ou de défense des droits du travail.
Au début de la guerre à grande échelle en 2022, le mouvement syndical s'est retrouvé dans une situation de crise profonde. Les principaux défis à relever ont été les suivants :
– Faiblesse institutionnelle : Les syndicats ont exercé une influence minimale sur les processus législatifs et l'élaboration de la politique économique ;
– Isolement politique : Les questions relatives au travail ont été marginalisées et les syndicats ne disposent pas d'une plate-forme politique spécifique ;
– Stagnation organisationnelle : La vision stratégique était absente, les cadres juridiques étaient sous-développés et les progrès en matière de transformation numérique restaient insuffisants.
2. Contexte juridique et politique en temps de guerre
Le déclenchement d'une invasion à grande échelle en Ukraine a entraîné des transformations radicales dans le cadre juridique des relations de travail. La loi n°2136, adoptée en 2022, a considérablement restreint les droits des employés : les grèves ont été interdites, les garanties sociales ont été réduites et des dispositions clés des conventions collectives ont été annulées. En conséquence, les syndicats ont été privés de leurs mécanismes d'influence légaux et publics.
Les centres de recrutement territoriaux (TCC) sont devenus un instrument de pression supplémentaire. Des cas ont été documentés où la mobilisation aurait été utilisée pour cibler des militants syndicaux et des employés ayant une position fermement pro-ouvrière. Les employeurs, quant à eux, ont acquis un nouveau pouvoir discrétionnaire, à savoir la capacité de déterminer quels employés seraient mobilisés et lesquels seraient exemptés de la mobilisation, souvent sur la base de la loyauté personnelle ou de l'implication dans des activités syndicales. Ces développements ont eu un impact significatif sur les représentants des syndicats indépendants, qui sont généralement plus virulents dans leurs critiques à l'égard des employeurs et des autorités de l'État.
En outre, un nombre important de personnes ayant une position civique active, y compris des dirigeants et des militants, se sont portées volontaires pour le service militaire au début de 2022. Cela a considérablement affaibli le capital humain et le leadership intellectuel du mouvement syndical, aggravant les crises existantes de gouvernance et de résilience institutionnelle.
Simultanément, la suspension effective des activités du Service national du travail – en particulier des inspections de protection du travail – a entraîné des violations impunies des normes de sécurité et des conditions de travail. La suspension des inspections programmées a créé un environnement propice aux abus, en particulier dans les secteurs dangereux et à bas salaires.
Ainsi, le mouvement syndical a été soumis à une double pression : celle de l'État, qui a imposé des mesures restrictives en temps de guerre, et celle des employeurs, qui ont exploité la guerre comme moyen de contrôle. Dans un tel contexte, la défense des droits des travailleurs exige non seulement une expertise juridique, mais aussi un courage personnel exceptionnel.
Les éléments clés de ce contexte sont les suivants
– La loi n°2136 et les restrictions qu'elle impose aux droits des travailleurs, notamment l'interdiction des grèves et la réduction des garanties sociales ;
– La loi martiale et la pression des centres de recrutement territoriaux (TCC) ;
– La mobilisation des militants syndicaux, qui a conduit à l'affaiblissement des structures organisationnelles ;
– La suspension de facto des inspections de la protection du travail, ce qui entraîne des violations sur le lieu de travail non contrôlées.
3. La réponse des syndicats aux défis de la guerre
En réponse aux défis sans précédent posés par l'invasion à grande échelle, les syndicats ukrainiens ont mobilisé un large éventail d'initiatives visant à soutenir les travailleurs et à défendre la cohésion sociale. Malgré les limites institutionnelles et les contraintes politiques, les syndicats ont fait preuve de résilience, d'adaptabilité et d'un engagement fort en faveur de la solidarité.
Activités bénévoles et aide humanitaire : Les organisations syndicales ont joué un rôle actif dans les efforts de volontariat, apportant un soutien essentiel aux personnes déplacées à l'intérieur du pays et aux populations vulnérables. Ces initiatives comprennent la distribution de nourriture, de vêtements, de médicaments et d'abris, ainsi que la coordination du soutien logistique en coopération avec les communautés locales et les partenaires internationaux.
– Soutien aux travailleurs des infrastructures essentielles et du secteur de la défense : Les syndicats ont apporté une aide ciblée aux employés travaillant dans les services essentiels, en particulier dans les secteurs de l'énergie, des transports, des soins de santé et de la défense.
– Protection des droits des travailleurs mobilisés
Engagement dans des initiatives syndicales internationale : Les syndicats ukrainiens ont participé activement aux réseaux mondiaux de solidarité et aux forums internationaux du travail. Ces engagements ont permis de faciliter l'échange de bonnes pratiques, d'obtenir une aide matérielle et de sensibiliser la communauté internationale aux luttes du mouvement syndical ukrainien.
4. L'impasse stratégique et la perte d'influence
Dans le contexte de la guerre, le mouvement syndical ukrainien s'est retrouvé non seulement dans une situation d'adversité extérieure, mais aussi dans une profonde crise stratégique interne. Nous avons été confrontés à l'absence d'une stratégie cohérente, tournée vers l'avenir et proactive, capable de relever les défis contemporains et de façonner l'avenir des relations de travail dans le pays. La crise s'est traduite de la manière la plus visible par la passivité organisationnelle, l'incapacité à influencer les processus législatifs, un éloignement du discours public national et, surtout, la perte de la voix politique des syndicats.
Un nombre important de syndicats ukrainiens ont, par inertie, préservé la tradition de comportement apolitique de l'ère soviétique. Toutefois, dans le contexte de la transformation profonde de l'État et de la société ukrainiens, cette position a cessé d'être neutre. Au contraire, elle est devenue destructrice. Rester apolitique lorsque des décisions fondamentales affectant les droits des travailleurs sont prises est en fait une forme de complicité dans la violation de ces droits. En conséquence, les syndicats ne sont pas seulement absents de la sphère politique, ils perdent l'influence limitée qu'ils détenaient auparavant.
Le contraste avec les pays européens est frappant. Sur tout le continent, les forces politiques de gauche se concentrent de plus en plus sur les questions liées au travail : répartition équitable des revenus, sécurité sociale, gestion des effets de l'automatisation et de la numérisation. Les syndicats européens s'engagent activement auprès des partis politiques progressistes, participent aux débats parlementaires et font pression pour défendre les intérêts des travailleurs aux niveaux national et supranational. En Ukraine, en revanche, cette synergie stratégique est pratiquement inexistante. Les syndicats et leurs alliés politiques potentiels opèrent de manière isolée, sans plateformes, stratégies ou alignement idéologique communs. Il en résulte une marginalisation – les syndicats sont aujourd'hui largement sans alliés et sans influence.
Les implications de l'automatisation et de l'essor de l'intelligence artificielle sont particulièrement cruciales. Dans d'autres pays, les syndicats sont en première ligne pour défendre la reconnaissance du travail numérique, lutter pour la préservation des emplois, assurer la protection des données et garantir l'accès à l'amélioration des compétences et à la reconversion. En Ukraine, cependant, ces domaines critiques restent presque entièrement négligés. Il existe un réel danger que le pays prenne du retard dans sa réponse à la quatrième révolution industrielle, donnant ainsi l'initiative aux sociétés transnationales et aux structures oligarchiques locales.
L'impasse stratégique dans laquelle se trouvent actuellement les syndicats ukrainiens se manifeste dans de multiples dimensions :
– L'absence de partenariats politiques et d'engagement significatif avec les mouvements de gauche ;
– L'incapacité à façonner des agendas législatifs en défense des droits des travailleurs ;
– Une méconnaissance de la transformation numérique de l'économie ;
– Le refus de constituer un socle idéologique cohérent et fondé sur des valeurs.
Cette impasse ne peut être surmontée que par une réévaluation fondamentale des principes et des pratiques. Les syndicats doivent retrouver leur rôle historique d'acteurs politiques, d'agents du changement sociétal et de participants actifs au dialogue public. Sans cette transformation, le mouvement restera inaudible, n'inspirera pas confiance et, en fin de compte, ne sera pas pertinent.
5. Le problème des syndicats jaunes et des faux syndicats
L'un des problèmes les plus urgents et les plus préjudiciables auxquels est confronté le mouvement syndical ukrainien est la persistance de ce que l'on appelle les « syndicats jaunes » ou faux syndicats. Il s'agit d'organisations qui ressemblent extérieurement à des syndicats légitimes mais qui, dans la pratique, servent les intérêts des employeurs, des fonctionnaires ou d'autres structures de pouvoir. Leur fonction première est de simuler un partenariat social et de remplacer la véritable défense des droits des travailleurs par des activités superficielles adaptées à l'avantage du capital et de l'autorité.
Les racines de ces formations remontent à l'ère soviétique, lorsque les syndicats étaient intégrés à l'appareil d'État et fonctionnaient davantage comme des organisateurs d'activités de loisirs et d'événements cérémoniels, des distributeurs de chèques vacances que comme des défenseurs des droits du travail. Aujourd'hui encore, pour de nombreux Ukrainiens, le concept de « syndicat » reste synonyme de « cadeaux et de célébrations » plutôt que de lutte, de solidarité et d'action collective.
Les employeurs utilisent activement de faux syndicats pour faire pression sur les travailleurs et discréditer le mouvement syndical indépendant. Dans plusieurs secteurs – notamment l'administration publique, les transports et l'énergie – les employés sont souvent contraints d'adhérer à de tels syndicats sous la menace d'un licenciement, d'une perte d'avantages sociaux ou comme condition d'emploi de facto. Cette pratique constitue une violation directe du droit fondamental à la liberté d'association. Pourtant, en raison de la capacité limitée des inspections du travail et de l'absence de contrôle public efficace, ces violations restent souvent impunies.
Ces pseudo-syndicats bénéficient souvent d'un accès privilégié au dialogue officiel avec l'État et les employeurs. Ils participent aux commissions tripartites, signent des conventions collectives et contribuent ainsi à légitimer la détérioration des conditions de travail. Pendant ce temps, les syndicats authentiques, indépendants et actifs sont relégués aux marges du paysage institutionnel.
La présence de syndicats « jaunes » constitue une menace plus profonde et plus insidieuse : elle sape la confiance du public dans le mouvement syndical dans son ensemble. Les travailleurs qui ont été confrontés à ces faux syndicats sont plus susceptibles d'être désillusionnés et de perdre confiance dans la possibilité d'une représentation collective efficace. Il en résulte une apathie généralisée et une réticence à s'engager dans l'auto-organisation ou la protestation. Sans confiance et sans croyance dans le pouvoir de l'action collective, l'essence même du syndicalisme est vidée de sa substance.
La question des faux syndicats nécessite une réponse globale et systémique, notamment :
– Reconnaissance officielle du problème au niveau de l'État et de la société ;
– Mise en place d'un registre national transparent des organisations syndicales, avec des critères d'authenticité clairement définis ;
– Campagnes de sensibilisation du public visant à informer les travailleurs des différences entre les syndicats authentiques et les syndicats « jaunes » ;
– L'inclusion institutionnelle directe de représentants de syndicats indépendants dans les processus de négociation et les commissions consultatives dirigés par l'État ;
– Des mécanismes stricts de responsabilisation pour sanctionner les employeurs qui contraignent les travailleurs à adhérer à des syndicats conformes ou contrôlés par l'employeur.
Il ne s'agit pas d'une question secondaire ou technique, mais d'un impératif stratégique. Sans affronter et résoudre cette question, le développement d'un mouvement syndical fort, démocratique et solidaire en Ukraine restera impossible.
Si nous aspirons à être des voix respectées au sein de la communauté mondiale du travail, si nous cherchons à participer sur un pied d'égalité au dialogue international de la gauche, nous devons d'abord déblayer le terrain institutionnel. Nous devons restaurer l'intégrité du concept de syndicat. Ce n'est qu'à cette condition qu'une nouvelle ère de solidarité sera possible.
6. L'avenir des syndicats dans l'Ukraine de l'après-guerre
Une croyance largement répandue, mais erronée, persiste au sein de la société ukrainienne : l'idée que tout recommencera « après la guerre ». Cependant, la réalité est beaucoup plus complexe. La période d'après-guerre exigera non seulement la reconstruction matérielle des infrastructures, mais aussi la résolution de déséquilibres socio-économiques profondément enracinés que la guerre a à la fois révélés et exacerbés.
L'Ukraine est déjà confrontée à un paradoxe : malgré la guerre en cours, les secteurs des services et du commerce continuent de dominer la production industrielle. Dans de nombreuses régions, il existe un déficit critique d'emplois manufacturiers, le capital et la main-d'œuvre étant largement concentrés dans le secteur des services et de la consommation. Un exemple frappant est que dans les grands centres urbains, les complexes commerciaux et de loisirs emploient plus de personnes que les grandes entreprises industrielles. Ce modèle économique n'est pas viable – surtout si l'on tient compte du retour prévu de centaines de milliers de vétérans et de la vague d'émigration en cours.
Le temps de guerre a partiellement atténué les effets du chômage en intégrant de larges segments de la population dans l'économie de la défense et du volontariat. Des activités telles que la fabrication de drones FPV, la réparation d'équipements militaires, le soutien logistique de l'armée et le développement de systèmes civils de guerre électronique ont créé des opportunités d'emploi à court terme. Pour de nombreux ménages, cet engagement constitue la principale source de revenus. Toutefois, ces solutions ne sont que temporaires et se transformeront ou nécessiteront une restructuration fondamentale une fois que la phase active de la guerre aura pris fin.
L'une des menaces les plus graves dans le contexte de l'après-guerre est la criminalisation potentielle des relations de travail. L'Ukraine d'après-guerre pourrait être confrontée à une augmentation de l'emploi non réglementé (travail « gris » et « noir »), à une économie souterraine croissante, au pillage des entreprises et à des programmes d'externalisation du travail forcé sans garanties sociales. Les groupes vulnérables – notamment les anciens combattants, les personnes handicapées, les jeunes et les résidents des territoires anciennement occupés – sont particulièrement exposés au risque d'exploitation et de marginalisation.
Si l'État et la société ne sont pas en mesure d'offrir des possibilités d'emplois sûrs, dignes et tournés vers l'avenir, une partie importante de la main-d'œuvre continuera à chercher des moyens de subsistance à l'étranger. L'émigration de la main-d'œuvre est déjà devenue l'une des principales stratégies de survie. Avec l'ouverture des frontières de l'UE et l'instabilité intérieure persistante, cette tendance est susceptible de s'intensifier.
La réponse appropriée à ces nouveaux défis n'est pas la préservation des structures syndicales existantes, mais leur transformation complète. Les syndicats doivent devenir des institutions modernes et dynamiques, capables de façonner l'ordre socio-économique de l'après-guerre. Les domaines clés de la réforme sont les suivants :
– Transformation numérique : Transition vers des moyens de communication modernes, des mécanismes numériques pour la transparence et la protection des droits ;
– Défense juridique : Expansion des fonctions de soutien juridique au sein des syndicats, y compris l'amélioration de la formation des militants et une plus grande implication des juristes syndicaux ;
– Réflexion stratégique : Planification à long terme basée sur les tendances démographiques, économiques et géopolitiques ;
– Subjectivité politique : Développement de la capacité institutionnelle à influencer la législation, à s'engager dans des négociations avec le gouvernement et à former des coalitions avec d'autres institutions sociales.
– Les syndicats de l'avenir ne doivent pas seulement jouer leur rôle traditionnel de défenseurs des salaires et des conditions de travail. Ils doivent devenir des institutions stratégiques capables d'articuler et de mettre en œuvre une vision nationale de la stratégie de développement du travail, empêchant ainsi la société ukrainienne de sombrer dans le chaos socio-économique et le désespoir de l'après-guerre.
7. Conclusion : Le choix entre extinction et modernisation
Le mouvement syndical ukrainien se trouve à un carrefour historique. Continuer à fonctionner avec des modèles et des méthodes dépassés, c'est s'engager sur la voie de l'insignifiance et du déclin. Face à la profonde transformation de la société et à la reconstruction d'après-guerre, les syndicats doivent choisir : l'extinction ou la modernisation.
La modernisation doit être comprise non pas comme un ajustement cosmétique, mais comme une transformation globale. Elle signifie la consolidation de toutes les actions de protestation et de grève dans le cadre d'une vision stratégique cohérente. Elle signifie la politisation des syndicats et leur représentation active au sein des organes législatifs à tous les niveaux de gouvernement.
Aujourd'hui, les syndicats ukrainiens reflètent en partie un modèle plus large d'infantilisme social et politique. Trop de dirigeants syndicaux restent enfermés dans une conception étroite de leur mission – isolés dans les limites techniques de la représentation des travailleurs et dédaigneux de l'engagement politique, qu'ils considèrent comme le domaine des opportunistes ou des adversaires.
Mais cette attitude a un coût. Dans les sociétés démocratiques modernes, s'abstenir de participer à la vie politique n'est pas une marque de vertu, mais un abandon de pouvoir. Ceux qui se désengagent de la politique abandonnent inévitablement leur avenir à ceux qui agissent sans se soucier du bien public. Le résultat n'est pas la neutralité, mais la vulnérabilité.
Le mouvement syndical doit retrouver sa voix et sa pertinence. Le slogan du 21e siècle doit être clair : de la défense à l'attaque !
25 mai 2025
Publié par le Réseau syndical international de solidarité et de luttes.
Traduction Patrick Le Tréhondat.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
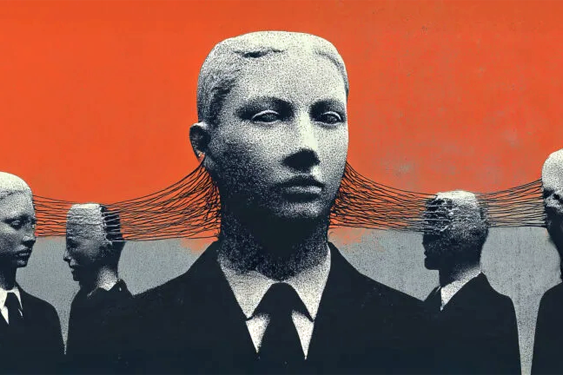
Les « unionistes » cherchent la stratégie gagnante pour « éteindre » la candidature Mélenchon

Après « La meute », les partisans d'une candidature unique à gauche en 2027, sans le candidat de LFI, oscillent entre inquiétude et espoir avant le congrès du PS.
23 mai 2025 | tiré de Regards.fr
https://regards.fr/les-unionistes-cherchent-la-strategie-gagnante-pour-eteindre-la-candidature-melenchon/
Promis, juré, ils ne sont « pas obsédés » par Jean-Luc Mélenchon. Les « unionistes », cette petite bande d'élus qui a contribué à former la Nouvelle Union du Front Populaire (NFP) aux dernières élections législatives, n'ont pas renoncé à faire émerger une candidature commune en 2027… sans le candidat de LFI, faut-il le préciser. C'est pourtant le nom du tribun de la gauche qui est sur toutes les lèvres et dont l'ombre plane sur toutes les discussions. Avec les anciens insoumis comme Clémentine Autain, François Ruffin, Alexis Corbière, qui siègent désormais sur les bancs des écolos, mais aussi leur cheffe Marine Tondelier, la haute fonctionnaire Lucie Castet, la députée PCF Elsa Faucillon ou encore la maire socialiste de Nantes et numéro 2 du PS, Johanna Rolland, ils ne se parlent pas « tous les quatre matins » et toujours avec une « grande prudence », voire « un brin de parano », confie l'un d'eux. Échaudés par les sarcasmes de presse – Libérationavait révélé que certains d'entre eux se retrouvaient autour d'une salade de pommes de terre portugaises – et de leurs adversaires, le groupe réfléchit à une autre stratégie après la parution de « La Meute », ce livre choc qui accable Jean-Luc Mélenchon et la direction de LFI. Officiellement, ils n'ont plus de contact avec leurs anciens camarades. « C'est silence radio », soupire Clémentine Autain. Mais les ponts ne sont pas totalement rompus avec tous les insoumis, selon nos informations. « Il y en a, en dehors des trentenaires qui ont été promus suite à la dernière purge, qui gardent le sens de l'amitié », observe un rescapé sous le sceau de l'anonymat.
« Le sujet, ce n'est pas Jean-Luc mais de se demander comment on créé les conditions d'une candidature commune pour battre le RN »
Alexis Corbière, député ex-LFI
« Le sujet, ce n'est pas de se positionner par rapport à Jean-Luc mais de se demander comment on créé les conditions d'une candidature commune pour battre le Rassemblement national en 2027 », affirme à PolitisAlexis Corbière. Son discours semble pourtant empreint d'un soupçon de nostalgie : « Avant, Jean-Luc avait le verbe vif, mais ça l'empêchait pas d'entretenir une certaine souplesse avec le reste de la gauche et de bâtir des ponts », se remémore l'ancien compagnon de route de l'Insoumis en chef. La déferlante médiatique autour de l'ouvrage a laissé des traces. « J'ai passé ces deux dernières semaines loin des réseaux sociaux face au shitstorm provoqué par cette enquête », s'épanche l'un de ses camarades. Dit autrement, cela donne : « L'hypothèse d'une candidature de Jean-Luc Mélenchon en 2027 ne peut être éteinte qu'avec un candidat unitaire ». Même s'ils ne veulent pas hurler avec la meute, les anciens « purgés », comme ils se surnomment entre eux, ont conscience que ce livre donne de la résonance à leurs revendications. « Le réel, ce sont les élections et ce qui va peut-être faire bouger LFI, ce sera peut-être les municipales. Ils vont découvrir que c'est une élection avec une grammaire différente des législatives », ajoute Alexis Corbière. « Notre responsabilité ultime, c'est de tout faire pour que le RN ne gagne pas en France et donc que la gauche doit être au 2e tour de la présidentielle. C'est notre matrice », répète à son tour Johanna Rolland, comme un mantra.
C'est pour cette raison que Lucie Castet a lancé l'appel du 2 juillet. L'ancienne candidate du NFP au poste de première ministre invite les chefs de partis à se rassembler pour la « primaire des gauches la plus large qu'on n'ait jamais proposée ». Le tout après le congrès des écolos et des socialistes et la fin des élections municipales. Une nouvelle tentative après son initiative « Gagnons ensemble », lancée avec Marine Tondelieret peu appréciée par les Insoumis, jusqu'alors plutôt conciliants avec elle. Clémentine Autain plaide en tous cas pour « ne pas perdre de temps » face à « la menace de l'extrême-droite. Il faut sortir des conciliabules, on ne va pas y arriver en additionnant les petits partis. La condition pour gagner, c'est de créer une dynamique comme on l'avait fait pour le NFP », affirme la députée.
Contradictions et maladresse
Reste une inconnue, le congrès du Parti socialiste, qui aura lieu du 13 au 15 juin. L'actuel premier secrétaire Olivier Faure a réussi à bâtir des relations de confiance à l'Assemblée avec ses partenaires de la défunte Nupes. « Si Olivier n'est pas reconduit, ça va être compliqué », s'inquiète Clémentine Autain. « Si c'est Nicolas Mayer-Rossignol qui est désigné, c'est terminé, autant donner les clefs du camion à Raphaël Glucksmann », résume l'un de ses camarades. C'est pourquoi Olivier Faure porte l'idée d'une plate-forme commune, sans LFI, à ce stade. « Olivier dit une chose simple, c'est que Mélenchon sera coûte que coûte candidat à la présidentielle et il n'attendra personne. Donc, l'objectif, c'est de ramener autour de nous des électeurs insoumis et même des cadres LFI en créant une dynamique », assume l'un des lieutenants du patron du PS.« On a réussi deux fois à créer les conditions de l'union », rappelle fièrement Alexis Corbière. « Les électorats ont fusionné même s'il y a eu de l'irritation, il faut maintenir l'acquis du NFP », martèle l'élu de Seine-Saint-Denis.
Reste que les membres de ce groupe devront d'abord s'affranchir de leurs propres contradictions. En dehors d'Alexis Corbière, de François Ruffin et de Marine Tondelier, les autres ne semblent pas chauds pour s'allier avec LFI pour tenter de remporter l'Elysée en 2027. S'il répète que la gauche « est plus forte ensemble », le député de la Somme a, une fois de plus, crispé ses petits camarades en annonçant dans Libération le 20 mai qu'il voulait une primaire à gauche… pour la gagner. « Ça a été mal pris, François est souvent maladroit », s'agace l'un d'eux. « Il a voulu dire qu'il ne voulait pas d'une primaire pour se ranger derrière un social mou », démine l'un de ses soutiens. Le député de la Somme, réputé pour faire cavalier seul, avait pourtant donné des gages en acceptant le rassemblement du 2 juillet. Même tentation du côté de Marine Tondelier. « Perdu pour perdu, autant qu'on mette un troisième candidat écologiste entre Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann », mettait en garde la patronne des écolos en conférence de presse le 6 mai. Avant de reconstruire l'union à gauche, les « unionistes » devront la maintenir dans leurs propres rangs.
Nils Wilcke
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Une initiative législative populaire oblige le gouvernement espagnol à régulariser exceptionnellement les migrants

700 000 personnes ont signé le document qui a poussé le gouvernement espagnol à présenter une proposition. Les modalités précises qui permettront d'assurer son adoption sont encore en cours de négociation.
27 mai 2025 | tiré d'Inprecor.fr
https://inprecor.fr/node/4773
Le gouvernement espagnol négocie avec ses partenaires un processus de régularisation extraordinaire pour les immigrant·es. Les tenants et aboutissants de ce processus ont été révélés par El País, qui rapporte que la secrétaire d'État aux Migrations, Pilar Cancela, a rencontré mercredi différents groupes parlementaires pour leur présenter les grandes lignes de la proposition.
Selon cette source, la question à l'ordre du jour est de régulariser les immigré·es qui peuvent prouver qu'ils sont dans le pays depuis au moins un an, qui retirent leur demande s'ils sont demandeurs d'asile, qui n'ont pas de casier judiciaire, qui ne font pas l'objet d'une mesure d'expulsion et qui ne représentent pas un risque pour la sécurité nationale. Ils se verront attribuer un permis de séjour et de travail d'un an sans obligation de contrat préalable, à condition qu'ils puissent ensuite se mettre en conformité avec les règles de régularisation ordinaires en vigueur. Cela contraste, par exemple, avec la procedure de régularisation de 2005, lancée par José Luis Rodríguez Zapatero, qui exigeait dès le départ un contrat de travail.
Toutefois, toutes ces conditions devront encore être négociées afin d'obtenir une majorité parlementaire suffisante pour être approuvées. Le problème sera la position des Catalans de Junts et des Basques du PNV. Les premiers veulent en échange au moins la mise en œuvre de la délégation de compétence en matière d'immigration. Et les seconds ont jusqu'à présent défendu une régularisation subordonnée à l'existence de contrats de travail, conformément à la position du patronat basque.
La droite dans l'opposition, le Parti populaire, avait elle aussi déjà préconisé une procédure de régularisation des immigré.e.s, mais elle souhaite également la subordonner à l'existence de contrats de travail et raccourcir le délai proposé par le gouvernement. Selon El País, en dépit de ses déclarations défavorables, « le gouvernement compte sur une abstention sous la pression de l'Église et, surtout, des chefs d'entreprise (représentés par la Confédération espagnole des organisations patronales), principaux intéressés par la régularisation de travailleurs potentiels ».
Une nouvelle réglementation sur les étrangers est entrée en vigueur mardi
Cette mise en avant de la proposition de régularisation extraordinaire est considérée comme un contrepoids à l'entrée en vigueur, mardi, de la nouvelle réglementation sur les étrangers qui, selon le même journal, place « des milliers de travailleurs au bord de l'illégalité ».
Ce règlement réduit la durée nécessaire pour obtenir un permis de séjour de trois à deux ans, rendant celui-ci valable dans un premier temps pour un an, puis renouvelable pour quatre ans supplémentaires. Il instaure une « deuxième chance » pour les personnes qui ont déjà obtenu un permis de séjour mais l'ont perdu pour une raison quelconque, comme la perte de leur emploi, et ouvre de nouvelles possibilités de regroupement familial pour les proches de ressortissants espagnols.
D'autre part, les demandeurs d'asile qui souhaitent accéder à la régularisation par cette voie devront renoncer à leur demande d'asile ou avoir reçu une réponse négative, se retrouvant ainsi en situation irrégulière. Ils devront se trouver dans cette situation pendant les six mois précédant immédiatement la demande de régularisation et ne pourront recourir à cette option de légalisation que dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur du texte. Selon les experts, cela pourrait automatiquement mettre des milliers de personnes en situation irrégulière et affaiblir le statut de l'asile.
Sont également critiquées les restrictions du regroupement familial des ascendant.e.s (parents et beaux-parents) qui viennent d'entrer en vigueur. Ces personnes, si elles ont entre 65 et 80 ans, devront prouver qu'elles sont financièrement dépendantes du citoyen espagnol.
Les étudiant·e·s étranger·e·s pourront également travailler à temps partiel, jusqu'à 30 heures par semaine. Mais les emplois dans la recherche leurs sont interdits. Les mineur·e·s perdent également le droit d'obtenir un permis de séjour pour étudier.
Les aspects négatifs de la réglementation ont conduit les organisations Association pour les droits de l'homme en Espagne, la Coordination des quartiers et le réseau Extranjeristas en Red, une association d'avocats spécialisés dans le droit de l'immigration, à porter l'affaire devant la Cour suprême.
Elles souhaitent obtenir l'annulation des modifications concernant les demandeurs d'asile, la partie relative aux mineurs, et contestent la discrimination à l'égard des parents étrangers de ressortissants espagnols qui sont ressortissants de pays tiers.
Une deuxième procédure devant la même instance a été engagée par d'autres organisations, Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, Red Acoge et Servicio Jea, qui mettent l'accent sur l'incompatibilité entre la procédure de protection internationale et ce qui est désormais exigé des demandeurs d'asile.
L'Initiative législative populaire fait pression pour que des changements soient apportés
Une régularisation extraordinaire des immigrant·e·s ne figurait pas à l'ordre du jour des principaux partis espagnols, qui estimaient qu'elle n'était pas nécessaire, voire qu'elle violerait les règles en vigueur dans l'Union européenne. Ce qui a conduit à ce changement, c'est l'existence d'une Initiative législative populaire qui a recueilli près de 700 000 signatures et le soutien de 900 organisations et mouvements sociaux.
La force de la pétition à travers tout l'État espagnol a été telle que, à l'exception de Vox qui a maintenu son programme anti-immigration, tous les autres partis parlementaires l'ont acceptée. Sans grand enthousiasme dans la plupart des cas. La droite espagnole ne s'est pas laissée entraîner par l'extrême droite, non pas par mérite propre, mais parce que la Conférence épiscopale catholique s'est rangée du côté de l'ILP, affirmant que son adoption était un signe de « maturité démocratique » et soulignant que les immigrés « travaillent pour le bien commun ».
Les militants en première ligne pour l'ILP insistent désormais pour que la régularisation extraordinaire se concrétise immédiatement « afin de régler une fois pour toutes la situation des personnes qui vivent et travaillent dans ce pays », comme l'affirme à El Salto Edith Espínola, porte-parole de Regularización Ya, qui réclame également davantage de techniciens et d'infrastructures pour mener à bien ce processus.
Elle souligne toutefois : « Nous ne savons pas s'il s'agit d'une opération de marketing médiatique ou si le Congrès va réellement dans la bonne direction ».
La gauche face au processus
Pour sa part, la gauche extra-gouvernementale considère également avec prudence la proposition de régularisation extraordinaire du gouvernement. Le quotidien espagnol Público s'est entretenu avec des membres de la Gauche républicaine de Catalogne qui participent aux négociations et qui reconnaissent qu'il y a une « opportunité », mais qui restent « quelque peu sceptiques », indique le journal, ajoutant que le parti ne signera un accord que si les organisations promotrices de l'ILP sont d'accord.
Podemos est encore plus sceptique, rappelant que la forme choisie par l'exécutif implique que la loi passe devant le Parlement et risque d'être rejetée, alors qu'elle aurait pu être facilement adoptée par décret gouvernemental. C'est ce qu'a défendu la secrétaire générale de cette formation, Ione Belarra, lors d'une conférence de presse, où elle a exprimé sa crainte qu'il s'agisse davantage d'une mise en scène que d'une véritable volonté de changement, utilisant Junts et le PNV « comme excuse pour ne pas faire ce qu'ils ne veulent pas faire ». En effet, si le PSOE avait voulu changer la loi, a-t-elle insisté, il aurait pu le faire « dès le lendemain ».
Le parti a également précisé qu'il n'y avait aucune négociation en cours avec le gouvernement, mais qu'il était « grand temps » que celui-ci « réfléchisse à l'importance de ne pas maintenir dans cette situation d'exception démocratique des millions de personnes en Espagne, ce qui, en outre, constitue un terreau idéal pour l'exploitation du travail et toutes sortes de violations des droits humains ».
Publié le 23 mai 2025 par Esquerda.net (Portugal). Traduit pour ESSF par Pierre Vandevoorde avec l'aide de DeepLpro
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La normalisation du fascisme en Italie

Alors que le pays commémore chaque 25 avril la fin du fascisme, l'Italie navigue dans une ambiguïté. À la croisée des chemins entre mémoire et révisionnisme, le pays se confronte à un passé qu'il n'a jamais complètement refoulé après avoir marginalisé, voire effacé, les mouvements antifascistes.
23 mai 2025 | tiré du site Frustrations
https://frustrationmagazine.fr/la-normalisation-du-fascisme-en-italie
Aux abords de la Piazzale Gorini située dans l'est de Milan, loin du tumulte du centre-ville, trois femmes voilées marchent paisiblement. Leur pas ralentit lorsqu'elles aperçoivent, à une centaine de mètres, un groupe d'hommes aux crânes rasés. Regards appuyés, silence pesant : les femmes traversent la rue. Une heure plus tard près de 2000 militants néofascistes, essentiellement masculins, se réunissent pour commémorer la mémoire de Sergio Ramelli, militant fasciste tué en 1975 par des membres de l'Avant-garde ouvrière (une organisation d'inspiration maoïste-léniniste active dans les années 1970 en Italie). Le cortège silencieux s'achève sur trois “Presente !” – une formule rituelle héritée du fascisme italien, scandée bras tendu pour affirmer la présence symbolique des morts dans le combat politique – dans ce quartier pourtant cosmopolite. « Les groupes d'extrême droite, adorateurs de Mussolini, comme Veneto Skinhead Front, Forza Nuova, Casa Pound, Do.Ra ont toujours opéré dans les rues avec des actions violentes sans jamais provoquer de véritable indignation nationale, ou de la part de nos gouvernements. Aujourd'hui ils n'ont plus besoin d'agir avec autant de violence dans les rues. Ils ont pu répandre et normaliser leur idéologie. On retrouve désormais des politiques élus qui écoutent, défendent et/ou comprennent certaines de leurs revendications » indique Vincenzo Scalia, docteur en sociologie de la déviance du département des sciences politiques et sociales de l'université de Florence.

Photo : Rémi Guyot
Le fascisme dépénalisé, l'antifascisme étouffé par le droit
L'antifascisme du quotidien, tel que l'explique Mark Bray – historien américain, auteur de l'ouvrage de référence Antifa : The Anti-Fascist Handbook – repose sur la nécessité d'ériger des tabous sociaux qui rendent les idées fascistes et les comportements discriminatoires socialement inacceptables. Ce type de lutte nécessite une vigilance constante à l'échelle individuelle et collective, mais aussi un cadre légal robuste et ferme. En Italie, bien que la Constitution interdise explicitement la reconstitution de partis fascistes, les lois Scelba (1952) et Mancino (1993) n'ont pas permis son application en raison de formulations juridiques floues et de critères restrictifs pour qualifier un acte de reconstitution fasciste. Le Mouvement social italien (MSI) a donc pu être créé en 1946, reprenant largement l'idéologie fasciste, mais sans volonté officielle de rétablir son régime dictatorial, passant ainsi entre les mailles législatives. Sans grand procès national permettant une « défascisation », le pays a pu réintégrer d'anciens fonctionnaires fascistes à la vie politique nationale.
Dès lors, le fascisme est progressivement dissocié de son caractère illégal, ce qui a permis à des groupes d'extrême droite de s'immiscer dans la sphère politique et de normaliser leurs idées. Son idéologie a donc pu continuer d'infuser dans la société italienne, abaissant la garde morale de ses citoyens, faisant sauter les digues qui le protégeaient d'un retour des mouvances d'extrême droite. Désormais, le glissement à droite et à l'extrême droite de la société italienne renforce la création d'un « extrême centre » qui banalise l'agenda politique et médiatique néo-fasciste. « Les groupuscules d'extrême droite sont largement minoritaires. Au niveau des élections, ils ne représentent que très peu d'électeurs. Ils font du bruit, mais restent en marge de la société » déclare Federico Benini, élu du Parti Démocrate (PD) à la mairie de Vérone. Une analyse qui occulte des mécanismes politiques fondamentaux, comme la fenêtre d'Overton – un concept politique qui décrit les limites du discours acceptable dans l'espace public, et comment elles peuvent être déplacées pour normaliser des idées auparavant jugées extrêmes.
L'exemple du décret DDL 1660 et comment le centre gauche se droitise
« Le décret DDL 1660 est passé en avril 2025. Il vise à criminaliser les manifestants et les activistes. Une personne qui bloque une route avec son corps, comme cela peut être fait dans les mouvements écologistes et anticapitalistes, peut être soumise à des peines d'emprisonnement en fonction des « circonstances et de la gravité de l'infraction ». L'achat d'une carte SIM nécessitera un contrôle strict d'identité, excluant de facto les personnes en situation irrégulière. Ce décret vise à réduire les libertés fondamentales. C'est un virage autoritaire » déclare Chiara Pedrocchi, journaliste indépendante qui a couvert l'évolution de la loi pour Voice Over Foundation. Pour Federico Benini (PD), la perception est différente : « Il y a du positif dans cette loi, même si nous devons encore travailler dessus, car nous devons permettre la liberté de manifestation, sans qu'elle empiète sur les libertés des autres usagers de l'espace public. » « Cette rhétorique est typique. Elle relève des justifications données par les partis de droite et d'extrême droite », affirme Leonardo Bianchi, journaliste indépendant qui couvre l'extrême droite en Italie et en Europe. « Alors que l'antifascisme de rue est en crise, le cadre légal et médiatique restreint de plus en plus son expression » poursuit l'auteur de la newsletter « Complotti ! »
Une opposition radicale essoufflée
Dans le quartier ouvrier de Sant'Eustacchio à Brescia, le président du Parti communiste italien (PCI) en Lombardie, Lamberto Lombardi, et ses camarades tous âgés de plus de 60 ans se confient sur l'émiettement du parti communiste. « Avant les néofascistes se cachaient pour répandre leurs idées, désormais ils opèrent au grand jour sans être inquiétés. C'est une des conséquences de notre défaite. » Dans les dernières semaines, la tête « d'un nord-africain » a été mise à prix sur les murs de la gare de Varese par Casa Pound. A Padoue, les militants de la même organisation ont tracté devant un centre social de la ville en faveur de la « re-migration », nouveau terme à la mode dans les groupes d'extrême droite pour demander l'expulsion des « étrangers ». Les antifascistes sont intervenus violemment pour mettre fin à l'action. Une vingtaine d'entre eux ont été conduits au commissariat. « Les personnes sans papiers victimes de violences des groupuscules d'extrême droite ne sont pas crues, et craignent de se rendre au commissariat en raison de leur situation irrégulière. Elles se retrouvent sans défense. Depuis que Maroni (Ligue du Nord) a pris le rôle de ministre de l'Intérieur, la culture de la violence policière s'est accentuée et leur proximité avec les mouvances d'extrême droite s'est resserrée. Le mouvement antifasciste se retrouve à être considéré dans l'illégalité face à des groupes néo-fascistes » affirme Vincenzo Scalia.
La bourgeoisie aux manettes du système médiatique et de l'affaiblissement de l'Etat de droit
La situation actuelle est la conséquence d'une longue histoire qui a détruit la cause communiste et antifasciste, autrefois capable d'enrayer le retour du fascisme. Les « Arditi del popolo », premier groupe antifasciste d'Italie dans les années 1920, a échoué face au soutien matériel et financier des élites économiques envers les fascistes, à la destruction des infrastructures et l'unité de la gauche afin de coopérer face à un ennemi commun. Malheureusement, l'histoire semble de nouveau se répéter. Aujourd'hui, au niveau régional, du PD au PCI en passant par les mouvements antifascistes, les désaccords empêchent toute avancée. « Au sein de la gauche, nous restons en désaccord sur la stratégie à adopter, et sur la lecture des évènements » confie Ricardo, militant communiste. « Il est possible de travailler ensemble si on met l'européisme et la défense de la méritocratie au centre de notre stratégie. Sur la question des droits individuels, nous n'avons pas tant de désaccords » affirme Federico Benini du Parti démocrate. « Il y a une fracture entre l'ancienne et la nouvelle génération. Les plus vieux n'intègrent pas suffisamment les logiques d'intersectionnalités dans la lutte antifasciste » indique Chiara Pedrocchi. « Il y a eu une réécriture de l'histoire, qui permet de promouvoir l'idéologie d'extrême droite, et exclure la nôtre », assure Lamberto Lombardi. « Je participe aux manifestations et à la défense de centres sociaux, mais il est vrai que nous manquons d'initiatives et de représentants de la cause antifasciste au niveau national, en dehors d'Ilaria Salis au Parlement européen » reconnaît Antonello, militant antifasciste. « Au niveau médiatique, Silvio Berlusconi a été l'un des précurseurs du contrôle médiatique et de son articulation à des fins politiques. Désormais, même sur la Rai (ndlr : service public de radio-télévision en Italie), des intellectuels se font exclure pour leur position, comme Antonio Scurati par exemple » déclare Leonardo Bianchi. En effet, l'écrivain et essayiste italien célèbre pour sa trilogie sur Mussolini a été écarté en raison de ses critiques sur la ligne éditoriale de la chaîne et la normalisation croissante de l'extrême droite à laquelle elle contribue.
« La France vit ce que l'Italie a vécu ces dernières années »
Depuis 2022, l'Italie connaît un tournant politique majeur avec l'arrivée au pouvoir de Giorgia Meloni et de son parti Fratelli d'Italia, héritier idéologique des mouvements néo-fascistes. Ce gouvernement s'inscrit dans une coalition comprenant également la Lega, parti d'extrême droite aux positions populistes et souverainistes. Cette alliance a marqué un renforcement des discours nationalistes, conservateurs et identitaires au cœur de la politique italienne, faisant de l'Italie un terrain d'observation essentiel pour comprendre la montée des droites radicales en Europe.« Malgré ses spécificités et ses différences, il y a de nombreux points de convergence entre ce que vit la France actuellement et ce qu'a vécu l'Italie ces dernières années. Matteo Renzi (anciennement PD) a eu une approche très similaire à celle d'Emmanuel Macron de par ses mesures sociales et économiques, tout comme son rapprochement avec l'idéologie d'extrême droite. Cela a conduit deux ans plus tard à sa victoire » souligne Leonardo Bianchi. « En Italie comme en France, il y a un anticommunisme latent, et une disqualification du discours antifasciste, qui le rend de plus en plus inaudible et inaccessible pour de nombreuses personnes. Désormais quand on parle de marxisme ou d'anticapitalisme, les auditeurs manquent de repères pour juger de la proposition, tant ces discours sont devenus minoritaires dans l'espace médiatique, et dans les discours de gauche influencés par des décennies de domination néolibérale, de dépolitisation du réel et de diabolisation de la gauche radicale » déclare Chiara Pedrocchi. Alors que Bruno Retailleau a entrepris la dissolution des groupes de résistance comme la Jeune Garde et Urgence Palestine, en les mettant sur le même plan que Lyon Populaire, groupuscule d'extrême droite très violent, le ministre de l'Intérieur français démontre sa volonté de diaboliser les mouvements progressistes radicaux. Cette situation laisse donc libre court à un virage identitaire radical du centre et de la droite, inspiré des mouvements néo-fascistes, afin d'exploiter la désillusion créée par les promesses non-tenues du système capitaliste qui règne en Italie, en France et au-delà. Ce repli pourrait toutefois être interprété comme le symptôme d'une avancée des idées progressistes, désormais suffisamment menaçantes pour inquiéter les élites bourgeoises, soucieuses de préserver leurs privilèges. Pour que cette dynamique s'inverse, l'internationalisation de la lutte antifasciste pourrait bien être la clé face à celle des mouvements néo-fascistes libéraux.
Photos de Rémi Guyot
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Une perspective socialiste dans une Ukraine en guerre

On publie ci-dessous, l'article introduction au numéro spécial des Brigades éditoriales de solidarité avec Sotsialnyi Rukh. On peut télécharger ce numéro en cliquant sur ce lien. Patrick Le Tréhondat est membre des Brigades éditoriales de solidarité et du Comité français du Réseau européen de soutien à l'Ukraine. 1er mai 2025.
26 mai 2025 | Lettre des Brigades éditoriale de solidarité
Huit mois après le début de la guerre à grande échelle, Sotsialnyi Rukh (Mouvement social) réunissait ses militant·es en conférence nationale à Kyiv. Cet événement, qui s'est tenu le 17 septembre 2022, dans des conditions très difficiles, se devait de faire le point de la situation et fixer la feuille de route de l'organisation.
Tirant le bilan des mois passés depuis le 24 février 2022, Sotsialnyi Rukh soulignait que « la société civile avait été contrainte de remplir le rôle de l'État et, au lieu d'attendre une assistance de sa part, d'assumer presque toutes ses fonctions sociales ».
La guerre, poursuivait la déclaration, avait « conduit à de nou velles formes d'auto-organisation et de politique populaire » : La mobilisation du peuple sur la base de la guerre de libéra tion nationale a renforcé le sentiment d'implication populaire dans une cause commune et la conscience que c'est grâce aux gens ordinaires, et non aux oligarques ou aux entreprises, que ce pays existe. La guerre a radicalement changé la vie sociale et politique en Ukraine, et nous ne devons pas permettre la destruction de ces nouvelles formes d'organisation sociale, mais les développer.
Parmi les revendications mises en avant, Sotsialnyi Rukh insistait sur la nécessité de « la nationalisation des entreprises clés sous contrôle ouvrier » et de « l'ouverture des livres de compte dans toutes les entreprises, quelle que soit la forme de propriété et l'im plication des salariés dans leur gestion, création d'organes et de comités élus séparés pour la réalisation de ce droit ».
L'organisation fixait ainsi une orientation politique autogestion naire pour le contrôle et la gestion de la société par la population, une nécessité face à un pouvoir oligarchique déficient dans les tâches de la défense du pays. Ainsi, dans une interview donnée, lors de son passage à Paris en novembre 2022, Katya Gritseva, membre de cette organisation, observait que « beaucoup de gens étaient volontaires » :
Ils s'engagent dans l'aide mutuelle, créent des organisations extra-étatiques pour pallier les carences d'un État peu préparé à une telle situation. Cette dynamique d'auto-organisation est contradictoire avec le retour des conservateurs, voire de l'ex trême droite. Pour la gauche, il agit d'agir en faveur de cette dynamique, d'aider les travailleurs, les gens, sans prétendre leur donner des leçons à la manière des staliniens.
Depuis, contre vents et marées, Sotsialnyi Rukh a maintenu cette orientation socialiste tout en participant de toutes ses forces à la résistance anti-impérialiste contre l'agresseur russe. Nombre de ses militant·es se sont engagé·es dans les forces armées et l'orga nisation organise en permanence des collectes de fonds pour leur apporter un soutien matériel (notamment pour l'achat de drones). Sotsialnyi Rukh apporte également une aide aux soldat·es dans la défense de leurs droits sociaux, en particulier par l'animation d'une hot-line pour répondre à leurs questions et les aider à résoudre leurs problèmes face à une hiérarchie trop souvent autoritaire.
Sotsialnyi Rukh est une petite organisation, mais ce n'est pas un groupuscule. En son sein, sensibilités marxistes et libertaires, par exemple, se mélangent. Ses militant·es sont inséré·es dans le mou vement syndical, dans les deux confédérations FPU et KVPU, mais aussi dans les syndicats indépendants comme celui du personnel soignant Soyez comme nous, le syndicat étudiant Priama Diia ou encore le syndicat des locataires.
Sotsialnyi Rukh impulse partout où il le peut l'auto-organisation démocratique des exploité·es et des dominé·es face au pouvoir ukrainien qui, au service des classes dominantes, détruit pas à pas les acquis sociaux du prolétariat ukrainien et est par trop souvent inefficace. Il revendique le contrôle et la gestion des entreprises par les salarié·es mais aussi, par exemple, celui des abris antiaé riens par la population à la suite de graves dysfonctionnements qui ont mis en danger ceux et celles qui cherchaient un refuge lors de bombardements.
Sotsialnyi Rukh prête également une attention soutenue à la for mation de ses membres et aux débats d'idées. Malgré la guerre, il apporte sa part à une vie intellectuelle vivace et critique. Il orga nise régulièrement des conférences sur des sujets les plus divers, comme la défense des droits des travailleur·euses, l'histoire du mouvement ouvrier ukrainien ou encore celle du mouvement révolutionnaire en Amérique du Sud. Tous ces forums publics sont également diffusés en ligne. Les conférencier·es viennent parfois d'autres pays, car Sotsialnyi Rukh s'affirme comme une organisa tion internationaliste qui n'oublie pas, même en période de guerre, de commémorer le massacre de Tian'anmen par la bureaucratie chinoise, de saluer une grève des travailleur·euses britanniques, de publier des informations sur les luttes ouvrières ou anticolo niales dans le monde (Géorgie, Palestine, Argentine, États-Unis…).
Dans la douloureuse lutte de libération nationale que mène l'Ukraine, malgré les trahisons et les abandons occidentaux, Sotsialnyi Rukh défend une perspective socialiste qui combine à la lutte existentielle du pays l'émancipation sociale par l'autodétermi nation et l'auto-organisation des masses ukrainiennes.
Ce recueil illustre ce combat mais aussi cette démarche concrète (et ses voies transitoires) pour un socialisme démocratique d'auto gestion. Son expérience, ses pratiques sociales et écrits politiques constituent pour les gauches internationales un acquis inestimable dans leur entreprise d'élaboration d'un programme pour l'émanci pation au 21e siècle.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Ukraine : Escalade des attaques russes contre les civils

(Kiev, 22 mai 2025) – Les attaques menées par la Russie en Ukraine depuis janvier 2025 ont tué et blessé davantage de civils que durant la même période en 2024, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Les autres gouvernements, en particulier l'administration Trump, devraient user de leur influence lors de leurs discussions avec le Kremlin pour inciter la Russie à respecter le droit international humanitaire et à mettre fin aux attaques délibérées, indiscriminées et disproportionnées contre les civils et les biens civils.
26 mai 2025 | tiré du site Entre les lignes entre les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/05/26/ukraine-escalade-des-attaques-russes-contre-les-civils/
- Les attaques menées par les forces russes en Ukraine depuis janvier 2025 ont tué et blessé davantage de civils que durant la même période en 2024.
- Ces attaques ont violé l'interdiction des attaques indiscriminées et disproportionnées imposée par le droit international. De telles attaques, lorsqu'elles sont commises délibérément ou par imprudence, constituent des crimes de guerre au regard du droit international.
- Les efforts diplomatiques devraient privilégier la protection des civils et la justice pour les violations. Cela implique un soutien continu aux enquêtes et aux poursuites pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité.
« Les attaques russes tuent et blessent un plus grand nombre de civils, y compris des femmes et des enfants, qu'auparavant, alors même que les dirigeants mondiaux impliqués dans les négociations expriment leur horreur face au nombre croissant de victimes », a déclaré Belkis Wille, directrice adjointe de la division Crises, conflits et armes à Human Rights Watch. « Les négociateurs devraient exiger la fin immédiate des attaques contre les civils et les infrastructures civiles. »
Human Rights Watch a enquêté sur quatre attaques menées par les forces russes en Ukraine entre le 1er février et le 4 avril 2025, qui ont tué au moins 47 civils et blessé plus de 18 autres personnes. Human Rights Watch a conclu que ces attaques étaient illégales car elles ont violé, au minimum, l'interdiction des attaques indiscriminées et disproportionnées en vertu du droit international. Les forces russes n'ont pas fait la distinction entre objectifs civils et militaires, ni évité les pertes civiles disproportionnées que l'on pouvait attendre de ces attaques par rapport à l'avantage militaire attendu. De telles attaques, qu'elles soient commises délibérément ou imprudemment, constituent des crimes de guerre au regard du droit international.
Le 1er février à 7h44, un missile russe a détruit une aile d'un immeuble résidentiel dans la ville de Poltava, située à 240 kilomètres de la ligne de front ; cette attaque a tué 15 civils et blessé 20 autres personnes. Une base aérienne militaire dont l'entrée est située à une distance d'environ 700 mètres du lieu de l'explosion est la seule cible militaire identifiée par Human Rights Watch dans cette zone.
Le 4 février, les forces russes ont lancé un missile sur la ville d'Izioum, située dans l'est de l'Ukraine à une distance de 42 kilomètres de la ligne de front. La frappe a touché le bâtiment du Conseil municipal dans le quartier central d'Izioum, tuant 6 civils et en blessant 57 autres, dont trois enfants. La cible militaire la plus proche identifiée par Human Rights Watch est un bureau de recrutement militaire, situé à une distance d'environ un kilomètre du Conseil municipal.
Dans la nuit du 5 mars, une munition explosive a frappé le toit de l'Hôtel Tsentralnyi, à Kryvyï Rih, dans le sud-est du pays, à 70 kilomètres de la ligne de front ; cette frappe a tué 6 civils, et blessé 31 autres personnes. La munition a touché le centre de l'hôtel, et endommagé 14 immeubles résidentiels et plusieurs autres bâtiments. Les forces russes et des blogueurs russes ont confirmé l'attaque, affirmant qu'elle avait tué 28 combattants étrangers qui se trouvaient dans l'hôtel ; toutefois, Human Rights Watch n'a trouvé aucune preuve étayant cette assertion. La cible militaire la plus proche identifiée par Human Rights Watch est un bureau de recrutement militaire, situé à une distance de 5,7 kilomètres de l'hôtel.
Karol Swiacki, fondateur et président d'Ukraine Relief, une organisation non gouvernementale fournissant une aide humanitaire aux Ukrainiens, se trouvait dans le restaurant de l'hôtel au moment de l'attaque avec six personnes, dont une femme et son fils âgé de 6 ans.
« On discutait, on riait un peu, et puis, en une milliseconde, il y a eu un bruit énorme, des bruits de verre brisé, beaucoup de poussière », a relaté Karol Swiacki. « L'endroit où nous étions assis est devenu un enfer… On était sous le choc, on cherchait une sortie [de secours]… C'était un cauchemar. L'enfant hurlait… La poussière nous empêchait de voir quoi que ce soit. J'ai dû me couvrir la tête et la bouche avec mon manteau. »
Le soir du 4 avril, les forces russes ont lancé une autre attaque contre Kryvyï Rih. Une munition a explosé au-dessus d'un parc, endommageant son aire de jeux, de nombreux bâtiments à proximité et un restaurant. Cette attaque a tué 20 civils, y compris neuf enfants, dont la plupart se trouvaient dans l'aire de jeux. La frappe a aussi blessé 73 autres personnes, dont un bébé de 3 mois.
Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a déclaré qu'il s'agissait de « l'attaque la plus meurtrière contre des enfants » enregistrée par le HCDH depuis le début de l'invasion russe en Ukraine en février 2022. La cible militaire la plus proche identifiée par Human Rights Watch était le même bureau de recrutement militaire de Kryvyï Rih mentionné ci-dessus, situé à environ 2,5 kilomètres du parc.
Les forces russes n'ont émis aucun avertissement préalable aux civils qui se trouvaient sur ces sites ou à proximité, avant ces quatre attaques meurtrières.
Entre janvier et avril 2025, le nombre de civils tués et blessés par des attaques russes en Ukraine a augmenté de 57% par rapport à la même période en 2024 ; la hausse du nombre de blessés a été particulièrement importante. Le 24 avril, la Russie a mené une attaque dévastatrice contre Kiev ; les tirs de missiles et de drones ont tué au moins 12 civils, et blessé au moins 90 autres personnes.
Le droit international humanitaire, qui rassemble les lois de la guerre, oblige les parties à un conflit à faire en tout temps la distinction entre combattants et civils. Les civils ne peuvent jamais être la cible délibérée d'attaques. Les parties belligérantes sont tenues de prendre toutes les précautions possibles pour minimiser les dommages causés aux civils et aux biens civils. Les attaques ne peuvent viser que des objectifs militaires. Les attaques ciblant des civils, qui ne font pas de distinction entre combattants et civils, ou qui sont susceptibles de causer des dommages disproportionnés à la population civile par rapport au gain militaire attendu, sont interdites.
Les violations graves du droit de la guerre, y compris les attaques indiscriminées et disproportionnées, commises avec une intention criminelle – c'est-à-dire délibérément ou par imprudence – constituent des crimes de guerre. Les individus impliqués dans ces attaques peuvent être tenus pénalement responsables de la commission d'un crime de guerre, ainsi que de l'assistance, de la facilitation, de l'aide ou de l'incitation à un crime de guerre. Les commandants et les dirigeants civils peuvent être poursuivis pour crimes de guerre au titre de la responsabilité du commandement, s'ils avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance de la commission de crimes de guerre et ont pris des mesures insuffisantes pour les prévenir ou en punir les responsables.
« Les efforts diplomatiques visant à mettre fin à la guerre menée par la Russie en Ukraine devraient privilégier la protection des civils et la justice pour les abus », a conclu Belkis Wille. « Cela signifie qu'il ne faut pas accorder d'amnistie aux auteurs de violations graves du droit international humanitaire, et qu'il faut continuer à soutenir les enquêtes et les poursuites pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. »
Suite en anglais, comprenant des informations plus détaillées sur les quatre attaques illégales russes.
https://www.hrw.org/fr/news/2025/05/22/ukraine-escalade-des-attaques-russes-contre-les-civils
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Adoption du projet de loi 89 : « Il s’agit d’une journée sombre pour les travailleuses et les travailleurs »

Le projet de loi 89, adopté aujourd'hui, aura de lourdes conséquences pour l'ensemble de la main-d'œuvre du Québec, affirment les porte-paroles des principales organisations syndicales, dont la CSQ.
« Le premier ministre et son ministre du Travail n'ont vraisemblablement pas saisi l'ampleur des dégâts qu'occasionnera sa nouvelle législation. Il s'agit d'une journée sombre pour les travailleuses et les travailleurs », dénoncent les porte-paroles Robert Comeau de l'APTS, Luc Vachon de la CSD, Caroline Senneville de la CSN, Éric Gingras de la CSQ, Mélanie Hubert de la FAE, Julie Bouchard de la FIQ, Magali Picard de la FTQ, Christian Daigle du SFPQ et Guillaume Bouvrette du SPGQ.
Des conséquences pour toutes les personnes salariées du Québec
Il ne fait aucun doute pour les organisations syndicales que les impacts du projet de loi se feront sentir bien au-delà des personnes syndiquées. « Nous le répétons, les gains obtenus par la négociation exercent une pression positive sur les milieux non syndiqués, obligeant les employeurs à s'ajuster pour demeurer compétitifs. C'est à l'ensemble de la main-d'œuvre québécoise que le gouvernement s'attaque en limitant la capacité des travailleuses et des travailleurs à défendre et à améliorer leurs conditions de travail », déplorent les porte-paroles.
Une menace à la paix industrielle
Les règles entourant le recours et l'exercice de la grève permettaient jusqu'ici de maintenir l'équilibre fragile, mais essentiel entre les travailleuses, les travailleurs et les patrons. Les organisations syndicales ne s'expliquent pas pourquoi Jean Boulet a voulu tout bouleverser, si ce n'est pour assujettir l'ensemble des personnes salariées au bon vouloir des employeurs et pour faire plaisir au patronat ainsi qu'à un conseil des ministres aux tendances antisyndicales.
« L'encadrement entourant l'exercice du droit de grève, qui était somme toute limitatif, offrait aux travailleuses et aux travailleurs la possibilité d'améliorer leurs conditions à l'intérieur de balises claires. Le ministre semble s'être trouvé des prétextes pour bafouer leurs droits et, de ce fait, il menace la paix industrielle », évoquent les représentants syndicaux. « Il nous semble clair que les limitations au droit de grève contenues dans cette législation ne passeront pas le test des tribunaux. Les constitutions, tant canadienne que québécoise, ainsi que l'arrêt Saskatchewan sont sans équivoque à ce propos. Les droits syndicaux sont aussi des droits humains. »
Des gains obtenus grâce aux luttes
Au fil des décennies, de nombreuses avancées sociales bénéficiant à l'ensemble de la société ont été obtenues grâce aux luttes menées par les travailleuses et les travailleurs syndiqués. L'équité salariale, l'implantation du réseau des CPE, le salaire minimum, les congés parentaux sont quelques-uns des gains obtenus grâce à la mobilisation syndicale. « Ce sont nos moyens de pression et nos grèves qui ont permis à des millions de Québécoises et de Québécois de bénéficier de ces droits. Priver les travailleuses et les travailleurs de leur capacité à lutter, c'est freiner les progrès de toute la société québécoise », insistent les porte-paroles.
« Le lien de confiance est rompu »
Dès l'évocation par Jean Boulet de ses intentions, à la fin 2024, les organisations syndicales ont invité le ministre du Travail à la prudence. « Nous avons rapidement saisi que le ministre ne serait pas ouvert à la discussion afin de trouver des solutions satisfaisantes pour tous. D'ailleurs, nous nous expliquons mal cette volte-face complète de la part du ministre du Travail, qui a drastiquement changé de ton à partir de ce moment : il a choisi de rompre le dialogue avec les travailleuses et les travailleurs du Québec. Le lien de confiance est rompu », concluent les porte-paroles.

Le plan d’aide d’Israël à Gaza est un élément clé de sa stratégie d’expulsion des Palestiniens

Le projet d'Israël de confier la distribution de l'aide à Gaza à une entreprise privée américaine est un élément clé de son plan de nettoyage ethnique de la population. Voici comment.
Tiré de Agence médias palestine
27 mai 2025
Par Qassam Muaddi, le 22 mai 2025
Photo : Des Palestiniens font la queue pour recevoir des pots de nourriture distribués par des organisations caritatives, à Gaza, le 21 mai 2025. (Photo : Omar Ashtawy/APA Images)
L'expulsion forcée du peuple palestinien est désormais l'objectif explicite de la guerre menée par Israël contre Gaza. Mercredi soir, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu'Israël ne mettrait fin à la guerre que si « le Hamas se rendait, Gaza était démilitarisée et que nous mettions en œuvre le plan Trump ».
Trump est revenu sur son plan de février visant à « prendre possession » de Gaza, à expulser sa population et à la transformer en « Riviera du Moyen-Orient », mais Netanyahu l'a tout de même saisi et considéré comme un feu vert pour exterminer Gaza. La dernière phase de ce plan consiste à militariser l'aide humanitaire à des fins d'extermination finale de Gaza.
Le plan est simple : affamer la population de Gaza et créer une seule zone rase où elle pourra venir chercher des rations alimentaires, acheminées par l'armée israélienne et gérées par une entreprise privée américaine. La population de Gaza sera contrainte de se rendre dans ces points de collecte, où elle sera parquée dans ce qui sera en fait un camp de concentration, situé dans l'ancienne ville de Rafah, transformée aujourd'hui en un terrain vague.
Netanyahu a clairement exprimé tout cela dans sa dernière déclaration, publiée au lendemain de l'annonce par Israël de son intention d'autoriser l'entrée d'une aide humanitaire « minimale » à Gaza pour des « raisons diplomatiques », afin d'éviter des accusations de crimes de guerre et des images de famine.
Lundi, le cabinet de guerre israélien a finalement approuvé l'entrée de l'aide, après deux mois de blocus total du territoire assiégé. Cette famine forcée a entraîné la propagation de la faim et des maladies. Le bureau des médias du gouvernement de Gaza a indiqué qu' au moins 70 000 enfants palestiniens ont été hospitalisés pour malnutrition sévère.
La décision du cabinet fait suite à d'intenses négociations avec le Hamas au Qatar, avec la médiation de cet État du Golfe et la pression de l'envoyé américain au Moyen-Orient, Steve Witkoff. Les pourparlers ont débuté après la libération par le Hamas du soldat israélo-américainEdan Alexander au début de la semaine dernière.
Les États-Unis auraient fait pression sur Israël pour qu'il envoie une équipe de négociateurs, conduisant finalement à la décision d'autoriser l'entrée de denrées alimentaires.
Les pourparlers se poursuivent sur la possibilité d'un cessez-le-feu, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu insistant sur le fait qu'Israël ne s'engagera pas à mettre fin à la guerre et conservera le contrôle de Gaza. Le Hamas insiste sur des garanties américaineset une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU stipulant qu'Israël ne reprendra pas ses attaques sur Gaza après la libération des prisonniers israéliens. Toutefois, pour l'instant, les Palestiniens de Gaza devraient bénéficier d'un certain soulagement face à la famine, Israël ayant déjà commencé à autoriser l'entrée d'un petit nombre de camions de nourriture dans la bande de Gaza.
Mardi, l'ONU a déclaré que les neuf camions autorisés à entrer la veille par Israël ne représentaient qu'une « goutte d'eau dans l'océan » par rapport aux besoins de la population dévastée. Mais la quantité de l'aide autorisée à entrer à Gaza n'est pas la seule préoccupation qui plane autour de cette question. Une crainte supplémentaire grandit que l'aide puisse être utilisée comme un outil par Israël pour atteindre son objectif principal en temps de guerre : faciliter l'expulsion des Palestiniens de Gaza.
L'objectif d'Israël : le nettoyage ethnique
Lorsque Israël a annoncé sa dernière offensive visant à contrôler l'ensemble de Gaza, baptisée « opération Gédéon », le quotidien israélien Yediot Ahronot a rapportéque l'une des phases de l'opération consisterait à transférer la majorité de la population palestinienne vers le sud de la bande de Gaza, en particulier dans la région de Rafah. Ces informations ont été publiées simultanément avec les déclarations de Netanyahu aux réservistes israéliens la semaine dernière, selon lesquelles Israël vise à chasser les Palestiniens de Gaza et que le principal obstacle est de trouver des pays prêts à les accueillir. La concentration des Palestiniens dans le sud de Gaza est considérée par la plupart des analystes comme une étape préparatoire à leur expulsion. Ce nouveau plan d'aide humanitaire à Gaza pourrait être la dernière pièce de cette stratégie.
Cette utilisation tactique de la distribution de nourriture est envisagée par le cabinet de guerre israélien depuis l'année dernière, plusieurs mois avant la conclusion du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. En septembre 2024, Netanyahu discutait déjà du meilleur mécanisme pour permettre la distribution de l'aide dans le nord de Gaza, où l'armée israélienne prévoyait alors d'étendre ses opérations terrestres. Netanyahu a déclaré lors d'une réunion du cabinet que l'armée israélienne « se chargerait » de distribuer l'aide dans les zones où elle s'efforçait également de vaincre la résistance palestinienne.
Le journal israélien Makor Rishon a rapportéà l'époque que le Premier ministre israélien suivait les suggestions de ses alliés d'extrême droite au sein du cabinet, Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich et Orit Strock, qui auraient soutenu le contrôle de l'armée israélienne sur la distribution de l'aide, dans le cadre d'un plan plus large visant à étendre l'offensive terrestre dans le nord de la bande de Gaza. Le journal citait Smotrich qui qualifiait ce plan de « changement stratégique » visant à « maximiser l'effort militaire » afin de vaincre le Hamas.
Deux mois plus tard, l'armée israélienne a bouclé tout le nord de la bande de Gaza, provoquant une baisse immédiate de la quantité de nourriture disponible et poussant quelque 400 000 Palestiniens au bord de la famine dans le cadre de ce qui a été appelé « le plan des généraux », destiné à chasser les Palestiniens du nord de Gaza. Cette opération a fait chuter la population du nord de Gaza sous la barre des 100 000 habitants, atteignant même 75 000 selon certaines sources. Israël n'a jamais été en mesure de mettre en œuvre son projet de contrôle de la distribution de l'aide, car le blocus du nord a suffi à lui seul à chasser la majeure partie de la population de la région, et un cessez-le-feu a finalement été conclu à la mi-janvier.
Le nouveau plan d'aide
Même si le cabinet de guerre israélien a approuvé lundi l'entrée des camions d'aide, la mise en œuvre effective de cette décision a été progressive. Jeudi, le bureau des médias du gouvernement de Gaza a annoncé que certains camions étaient arrivés dans la bande de Gaza pour distribution trois jours après la date prévue.
Les organisations internationales, notamment les agences des Nations unies telles que l'UNRWA et le Programme alimentaire mondial (PAM), ont traditionnellement joué un rôle clé dans la distribution de l'aide à Gaza. Mais quelques minutes après la décision du cabinet cette semaine, le Times of Israel a rapporté qu'Israël allait adopter un nouveau mécanisme pour distribuer l'aide par l'intermédiaire de l'armée israélienne, contournant ainsi les organisations internationales.
L'élément le plus important de ce nouveau dispositif est que l'aide ne serait pas distribuée dans toute la bande de Gaza, mais dans des points de distribution spécifiques où les Palestiniens seraient tenus de se rendre pour la recevoir.
Ce plan israélien avait en fait déjà été annoncé comme un plan conjoint des États-Unis et d'Israël, qui prévoyait la distribution d'une aide sous forme de rations limitées aux ménages. Dans le nouveau plan israélien, plutôt que de travailler avec les organisations humanitaires traditionnelles, la distribution serait organisée par la Gaza Humanitarian Foundation, une fondation humanitaire récemment créée aux États-Unis. Le 4 mai, les organisations internationales présentes à Gaza ont unanimement rejeté ce plan dans une déclaration commune, affirmant qu'il « contrevient aux principes humanitaires fondamentaux et semble conçu pour renforcer le contrôle sur les produits de première nécessité comme moyen de pression dans le cadre d'une stratégie militaire ».
Cette déclaration a été suivie le 6 mai par une déclaration des équipes d'aide humanitaire de l'ONU, qui ont déclaré que ce plan « semble être une tentative délibérée d'instrumentaliser l'aide ».
Un mois plus tôt, le 8 avril, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, avait rejetéle contrôle israélien sur la distribution de l'aide à Gaza, affirmant qu'il risquait « de contrôler davantage et de limiter de manière cruelle l'aide jusqu'à la dernière calorie et au dernier grain de farine ». M. Guterres avait ajouté que l'ONU « ne participerait à aucun arrangement qui ne respecterait pas pleinement les principes humanitaires : humanité, impartialité, indépendance et neutralité ».
Pendant ce temps, Gaza meurt de faim
Alors qu'Israël poursuit officiellement les négociations de cessez-le-feu avec le Hamas au Qatar, sa décision d'autoriser l'entrée de l'aide a été présentée comme un pas en avant dans les efforts visant à mettre fin à la crise humanitaire à Gaza. Cependant, si elle est mise en œuvre conformément au plan d'Israël, la livraison de l'aide pourrait devenir une nouvelle étape dans la stratégie israélienne visant à atteindre son objectif désormais explicite d'expulser la population palestinienne de la bande de Gaza.
Dans le même temps, la famine s'accentue de minute en minute dans la bande de Gaza, faisant depuis octobre 2023 au moins 57 morts parmi les Palestiniens, principalement des enfants, selon le ministère palestinien de la Santé, et provoquant 300 fausses couches dues au manque de nutriments. Le bureau des médias du gouvernement de Gaza a également déclaré qu'un nombre indéterminé de personnes âgées étaient décédées en raison du manque de médicaments au cours de la même période.
Tout cela se poursuit alors que les forces israéliennes intensifient leurs frappes aériennes sur la bande de Gaza, tuant 82 Palestiniens au cours des dernières 24 heures (mardi à mercredi), selon le ministère palestinien de la Santé. Depuis octobre 2023, l'offensive israélienne sur Gaza a officiellement tué plus de 53 000 Palestiniens, la plupart des estimations du bilan total du génocide étant beaucoup plus élevées.
Traduction : JB pour l'Agence Média Palestine
Source : Mondoweiss
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

En 2025, les Démocrates ont le vent dans les voiles ; merci à D. Trump et à la nouvelle organisation de la base

Plus de 16,000 collaborateurs.trices sont déjà sur le terrain développant ce que le Président de Parti démocrate, Ken Martin, décrit comme une infrastructure d'organisation jamais vue en période d'élection non présidentielle.
John Nichols, The Nation 20 mai 2025
Traduction, Alexandra Cyr
2025 est déjà une bonne année électorale pour les Démocrates. Il ne fait pas de doutes que le chaos, la cruauté et l'incompétence de l'administration Trump y est pour quelque chose. Elle a aidé les Démocrates à se relever des pertes de 2024 à la Chambre des représentants et au Sénat. Pourtant ils ne peuvent pas simplement s'en remettre à d'autres mauvaises politiques pour gagner les élections. Il faut vous saisir vous-mêmes des chances du moment. Il est évident que le Président du Comité central du Parti démocrate, (DNC), Ken Martin, qui n'a jamais caché son enthousiasme pour l'organisation de la base, est engagé dans ce sens.
Comme il me l'a dit cette semaine, pour ce président nouvellement élu, la notion qui veut qu'il : « n'y ait pas d'années de congé » est centrale. Avec cela en tête, K. Martin et son adjointe Libby Schneider, ont mis en place, en ces temps d'intense vie politique aux États-Unis, une stratégie peu remarquée mais efficace : il y a déjà 16,000 bénévoles sur le terrain partout dans le pays. Cela annonce aussi une augmentation significative en cette année sans élections mais qui définit celle de mi-mandat en 2026.
Mme Schneider décrit cela comme « une nouvelle organisation qui vise à impliquer les militants.es démocrates de la base à entrer en action, à demander des comptes aux Républicains.es qui ont adopté une proposition de budget désastreuse qui volent les familles ouvrières et donnent aux ultra riches ».
La direction du Parti doit faire face à de plus en plus de pressions et de mécontentement envers la stratégie dite des 50 États. Depuis plus de 20 ans on la discute dans les cercles démocrates depuis que l'ancien président du comité central, Howard Dean, qui après avoir tenté de l'implanter, l'a abandonnée. L'approche actuelle est fortement soutenue par des stratèges comme Mme Schneider qui y réfère comme : « la structure d'organisation la plus forte que la direction nationale ait jamais eue durant une année sans élections présidentielles ».
C'est ce à quoi Ken Martin, qui a longtemps été le président du Minnesota Democratic-Farmer-Labor Party avant son élection à la présidence du DNC en février dernier, réfère comme son obsession devant toutes les autres. Il semble que ça porte fruit non seulement électoralement mais aussi quand on observe l'affluence aux 100 assemblées publiques démocrates partout dans le pays. On y défie les Républicains.es sur leurs attaques contre presque tout à partir de Medicaid jusqu'à la démocratie en tant que tel.
K. Martin m'a déclaré que nous allions continuer à voir des investissements et un effort d'organisation de la part du DNC « que nous n'avons encore jamais vu ». Avec son équipe il débutait une nouvelle organisation communautaire numérique qui vise à « centraliser les opportunités de formation en communication, les événements, et les campagnes de demandes de comptes ». Il y aura aussi des programmes de formation pour outiller les bénévoles de la base qui se mobilisent pour la campagne : « Fight to Save Medicaid ». Et il ajoute : « Les principes qui nous guident pour l'organisation vont permettre au Parti de travailler à l'année longue à l'organisation des communautés, au renforcement de la base, à l'élection de candidats.es qui vont se battre pour la classe ouvrière et pour améliorer la vie des Américains.es ».
« Pas d'années de congé » est une bonne direction. La nouvelle direction du Parti démocrate parle toujours de nouvelles approches, de nouvelle stratégies. Avec les Démocrates, les débats ne manquent pas. Au cours des récentes semaines, on a entendu parler de beaucoup de drames liés au DNC spécialement quand le sous-comité des créances a recommandé une reprise de l'élection à la vice-présidence électorale suite à des plaintes sur la manière dont le vote initial avait été conduit et à des discussions à propos de la manière d'aborder les luttes pour les primaires. Bien des débats sont légitimes et importants dans un parti où l'accord sur la nécessité de changements est fort mais on observe moins de consensus sur ce qui est exactement requis.
Mais en même temps que ces débats se tiennent le Parti doit s'occuper d'un bien plus grand enjeu à court terme : les campagnes électorales à mener cette année. Comme en aucune autre année sans élections programmées, 2025 se présente un peu comme un fourretout. Il y a des élections pour les postes de gouverneurs en Virginie et au New Jersey. Des élections partielles auront lieu dans ces États et ailleurs au pays. Et des élections de juristes et de maires sont aussi au programme. Celles de mi-mandat sont dans un peu plus d'un an mais ça ne veut pas dire que les précédentes ne sont pas sans enjeux majeurs. C'est pourquoi, depuis son élection à la présidence du DNC il y a trois mois, K. Martin et son équipe ont adopté une attitude qui n'admet aucune excuse par rapport à ce cycle électoral.
Pour Mme Scheinder, l'investissement dans cette organisation précoce donne déjà des résultats.
Elle a raison. Même si les Démocrates ont débattu de la manière de se repositionner après l'amer échec de l'élection présidentielle de 2024, ils ont commencé à encaisser des records de succès en 2025. La candidate soutenue par le Parti au poste de la Cour suprême du Wisconsin a battu son adversaire à plates coutures alors qu'il était soutenu par le Parti républicain et D. Trump, qu'E. Musk y ait dépensé des sommes records et que d'autres millionnaires républicains le soutenaient aussi. Au cours des quatre premiers mois de l'année, les Démocrates ont gagné cinq élections partielles qui ont conforté leur situation à la Chambre des représentants. Ils ont profité de gains en Iowa et dans des districts de Pennsylvanie que D. Trump avait gagné haut la main en 2024. Ils ont surpassé leurs résultats de 2024 dans des élections partielles partout dans le pays. La semaine dernière les Républicains.es ont été estomaqués.es lorsque qu'un de leurs membres, maires élu dans une grande ville, a été éconduit de son poste par un Démocrate par une marge de 57 voix contre 43.
Il n'y a pas de doutes que cela soit en lien avec la manière par laquelle D. Trump et son allié multimillionnaire E. Musk qui a été « l'employé spécial du gouvernement », ont agi depuis le début de cette nouvelle administration. Ils ont été soutenus par les Républicains.es au Congrès. Leurs actions ont affaibli Social Security et l'administration des services aux anciens.nes combattants.es. Leurs menaces de coupes dans le budget de Medicaid provoquent de réelles peurs. Et tout cela avec un activisme débridé.
« Pas congés ; pas de jours de congé, par d'année de congé », répète Mme Scheinder à la suite de K. Martin. Et elle ajoute : « Le DNC est le premier comité national démocrate qui organise des liens directs avec les électeurs-trices pour les élections en 2025 et en 2026. Nous sommes témoins en temps réel de ce qu'un modèle d'organisation soutenu et couvrant toute l'année peut signifier pour les résultats électoraux. Les Démocrates surpassent leurs résultats dans les élections partout dans le pays, explicitement dans 22 élections sur 24 au cours des seuls cinq premiers mois de 2025 ».
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Comme il me l'a dit cette semaine, pour ce président nouvellement élu la notion qui veut qu'il : « n'y ait pas d'années de congé » est centrale.












