Presse-toi à gauche !
Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Une exposition présente des récits de courage et de résistance queer à Washington

Washington D.C., le 27 mai 2025 – Une exposition du Musée canadien pour les droits de la personne (MCDP) sur la purge LGBT au Canada ouvre aujourd'hui à la galerie d'art de l'ambassade du Canada à Washington, D.C. L'expo-kiosque est présentée dans le cadre de WorldPride, un événement annuel qui vise à promouvoir la visibilité et la sensibilisation aux questions 2ELGBTQI+ à l'échelle internationale.
Photo :L'expo-kiosque Amours cachés : La purge LGBT au Canada ouvre aujourd'hui à la galerie d'art de l'ambassade du Canada dans le cadre de WorldPride.
L'exposition Amours cachés :La purge LGBT au Canada relate le harcèlement et le congédiement des membres 2ELGBTQI+ des Forces armées canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la fonction publique fédérale entre les années 1950 et 1990. Cet épisode historique bien documenté, mais peu connu, est devenu connu sous le nom de « purge LGBT ».
« Le Musée canadien pour les droits de la personne, ainsi que toutes nos expositions et tous nos programmes, reposent sur la conviction que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits », a déclaré Isha Khan, directrice générale du MCDP. « Il est de notre responsabilité collective de veiller à ce que ces droits soient protégés et respectés pour tout le monde. »
L'expo-kiosque et une version complète ont été conçues dans le cadre d'un partenariat entre le Fonds Purge LGBT et le Musée canadien pour les droits de la personne. La puissante exposition présente ce chapitre douloureux de l'histoire du Canada tout en rendant hommage au courage et à la résilience des personnes qui se sont battues pour la justice et dont le militantisme a mené à des changements juridiques et sociaux durables.
« Cette exposition met en lumière la persécution tragique et injustifiée dont ont été victimes les personnes 2ELGBTQI+ qui voulaient servir leur pays », a déclaré Michelle Douglas, survivante et directrice générale du Fonds Purge LGBT. « Elle comporte des leçons importantes pour aujourd'hui et s'efforce de transmettre au public visiteur une idée de la résilience des personnes qui ont vécu la purge. Nous espérons également que cette exposition incitera les gens à réfléchir et empêchera l'histoire de se répéter. »
L'expo-kiosque d'environ 47 mètres carrés (500 pieds carrés) est l'un des volets du partenariat entre le MCDP et le Fonds Purge LGBT, qui comprend aussi une exposition complète actuellement présentée au MCDP à Winnipeg, au Manitoba. L'expo-kiosque et l'exposition complète continueront de circuler et de faire connaître ces histoires importantes.
La galerie d'art de l'ambassade du Canada, située au 501 Pennsylvania Avenue N.W. à Washington, est ouverte en semaine de 9 h à 17 h et l'entrée est gratuite.
À propos du Musée canadien pour les droits de la personne
Le Musée canadien pour les droits de la personne (MCDP) est le premier musée du monde exclusivement consacré à l'évolution des droits de la personne, à leur avenir et à leur célébration. Seul musée national du Canada dans l'Ouest canadien, le MCDP est situé sur le territoire visé par le Traité n° 1, à Winnipeg, au Manitoba, au cœur du continent. Son mandat est d'explorer les droits de la personne au Canada et ailleurs en vue d'accroître la compréhension du public à cet égard, de promouvoir le respect des autres et d'encourager la réflexion et le dialogue. Sa vision est de créer un monde où tout le monde valorise les droits de la personne et se fait le devoir de promouvoir le respect et la dignité de chaque personne.
Au sujet de la purge LGBT
Des années 1950 aux années 1990, le gouvernement du Canada a systématiquement enquêté sur des membres 2ELGBTQI+ des Forces armées canadiennes, de la GRC et de la fonction publique fédérale – plus de 9 000 personnes – puis les a harcelés et congédiés. Appelée aujourd'hui « la purge LGBT », cette politique officielle a détruit des milliers de carrières, causé des dommages psychologiques incalculables et ruiné des vies. Il s'agit de l'une des violations des droits de la personne en milieu de travail les plus vastes et les plus longues de l'histoire du Canada.
En 1992, un procès historique contre les politiques militaires discriminatoires à l'égard des membres LGBT a eu lieu et a finalement mis un terme à la purge. Un recours collectif intenté en 2018 a permis de rendre justice à des centaines de survivant·e·s de la purge, notamment grâce à un règlement de 145 millions de dollars et à des excuses officielles de la part du gouvernement canadien. Le règlement prévoyait des fonds pour des projets d'héritage, dont cette expo-kiosque, afin d'honorer les survivant·e·s ainsi que les personnes qui n'ont pas vécu assez longtemps pour recevoir une indemnisation
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’Orchestre Symphonique de Montréal résiste aussi !

Dans son chant incantatoire en langues sotho du sud et en zulu, il entraîne non seulement les musiciens de l'OSM qui l'entonnent avec lui, mais aussi le public qu'il réussit à éduquer jusqu'à des pianissimi seyant aux nombreuses répétitions soupirées de ses motifs. Gagnée par la joie subversive de l'œuvre, la salle entière s'est levée d'un bond unanime pour l'ovationner.
Par Pierre Jasmin, artiste pour la paix
Photo : Le violoncelliste sud-africain Abel Selaocoe et la cheffe chinoise Xian Zhang
Merci à Christophe Huss du DEVOIR pour ses compliments, que toute ma famille, aimerait partager car nous étions tous les quatre à la Maison symphonique de Montréal, tout en haut avec des billets à 30$, prix étudiants pour mes deux grands. « Il s'est passé comme un petit miracle avec la venue du violoncelliste et vocaliste sud-africain Abel Selaocoe aux côtés de l'OSM. L'expérience emmène le mélomane hors des sentiers battus pour un moment unique. Selaocoe est une vraie grande apparition d'une individualité artistique dans notre monde musical — la plus noble incarnation et expression de ce que peuvent apporter à l'humanité, à toutes les formes de civilisation et de cultures, certains artistes inattendus qui ont émergé récemment et ouvert nos oreilles à la découverte de répertoires ou de formes d'expressions [uniques]. (...) » Dans son chant incantatoire en langues sotho du sud et en zulu, il entraîne non seulement les musiciens de l'OSM qui l'entonnent avec lui, mais aussi le public qu'il réussit à éduquer jusqu'à des pianissimi seyant aux nombreuses répétitions soupirées de ses motifs. Gagnée par la joie subversive de l'œuvre, la salle entière s'est levée d'un bond unanime pour l'ovationner.
Xian Zhang, cheffe énigmatique chinoise quoique non inconnue du public montréalais, a maîtrisé cette œuvre complexe rythmiquement appelée Quatre Esprits, comme elle avait exploré la subtilité du Ravel de Ma mère l'Oye. Roméo et Juliette de Prokofiev concluait la soirée, la marche des Montague et Capulet, introduite par les dissonances en climax des cuivres, exploitées sans aucune retenue sonore pour bien montrer l'horreur et l'absurdité des guerres, des rivalités. L'émotion de se rappeler la pièce de Shakespeare provoque des larmes, avec sa conclusion pacifiste All are punished, si bien prononcée dans le film de Zeffirelli. Quant au compositeur, il avait a vu sa femme d'origine espagnole trop bavarde expédiée en Sibérie par le même Staline qui lui volera sa mort, puisque tous deux étant décédés à moins d'une heure d'intervalle, le parti communiste obligera la famille de Sergueï à attendre une semaine avant d'annoncer son décès pour ne pas voler le chagrin populaire dû au vainqueur des Nazis. Anecdote personnelle : ayant arrangé le voyage de ma femme chinoise pianiste au début des années 80 à Londres, une richissime Juive rescapée des camps de concentration à qui j'avais donné des leçons de piano à Vienne accepta de lui payer ses leçons auprès d'Alissa Kezeradze-Pogorelich parfois 3 fois par semaine ; Kuo-Yuan fit un soir la connaissance de la veuve de Prokofiev, admiratrice des enregistrements du pianiste Ivo de la sixième sonate pour piano de son mari, première des trois sonates de guerre enregistrée sur Deutsche Grammophon, avec mes notes musicologiques, dans leur première édition couplée avec Gaspard de la Nuit de Ravel.
Un immense merci au directeur artistique de l'OSM, le Vénézuélien élevé par el sistema, Rafael Payare, autre magicien de la musique, époux d'une violoncelliste qui l'a probablement influencé dans le recrutement d'Abel Selaocoe. Mais il est inconcevable que son génie ait pu prévoir la synchronicité de la venue de ce dernier sur le continent nord-américain avec celle, la veille, du président sud-africain Cyril Ramaphosa à la Maison Blanche, exposé à la fable raciste de Trump selon laquelle un nombre génocidaire (!!!) de fermiers blancs auraient été assassinés. Heureusement, cette fable fut vertement dénoncée par Radio-Canada grâce au témoignage concordant des journalistes Azeb Wolde-Georghis à Washington et Sophie Langlois de retour d'un voyage en Afrique du Sud, invitées à la même émission.
Ne ratez sous aucun prétexte l'un des trois concerts de mercredi à vendredi soirs, toujours à la Maison symphonique, qui mettra en scène en première partie deux courtes œuvres d'inspiration autochtone (avec entre autres Elizabeth St-Gelais que je vous avais vantée il y a un an) aux titres évocateurs : You can die properly Now d'Ana Sokolovic, dédiée aux enfants jamais revenus des pensionnats autochtones et Un cri s'élève en moi, aux paroles de Natasha Kanapé Fontaine sur une musique d'Ian Cusson. Ces deux œuvres seront suivies du chef d'œuvre absolu de la première moitié du XXième siècle occidental, l'ultime Chant de la terre de Gustav Mahler aux six parties d'autant plus bouleversantes qu'elles prophétisent les traumatismes causés à notre terre. Mais Mahler, hélas, est mort, tel Moïse, sans avoir jamais dirigé son chef d'œuvre basé sur des poèmes de la dynastie Tang pourtant écrits entre 618 et 907 : la fin, Der Abschied, erronément traduite par l'adieu, alors qu'on devrait la qualifier de déchirement ou séparation ultime plus laïcs, laisse résonner la répétition éthérée du mot ewig, éternel, le consolant sans doute de la mort cruelle de leur petite fille, à Alma et à lui. Réalité artistique de la souffrance, qui rapproche ces grands créateurs du commun des mortels en les éloignant des puissants qui se croient immortels dans leurs guerres.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Boys club

Parution le 27 mai 2025 au Québec
Parution le 22 août 2025 en Europe
Parce que le moment contemporain rend nécessaire la mise à jour du Boys club,
œuvre de Martine Delvaux désormais incontournable.
« J'avais accompli une tâche, une sorte de service public. C'était un geste de résistance, à mon sens nécessaire. Si j'avais pris plaisir en rédigeant les différents chapitres du livre, parce que j'aime enquêter, analyser et écrire, je n'ai jamais cessé de regretter devoir le faire. Et je n'ai jamais cessé d'avoir peur. »
Ils sont tournés les uns vers les autres. Ils s'observent et s'écoutent. Ils s'échangent des idées, des armes, de l'argent ou des femmes. Dans cet univers clos réservé aux hommes, le pouvoir se relaie et se perpétue à la façon d'une chorégraphie mortifère. Le boys club n'est pas une institution du passé, il est terriblement actuel et tentaculaire : État, Église, armée, université, fraternités, firmes... et la liste s'allonge.
Dans cette nouvelle édition revue et augmentée, Martine Delvaux analyse la portée historique et politique du procès de Mazan, déplore le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, la prise de pouvoir de la « broligarchie » et la montée des discours masculinistes dans l'espace public. À la manière d'une chasse à l'image, l'autrice traque aussi le boys club dans ses représentations au cinéma et à la télévision. Véritable plongée en eaux noires, ce livre nous invite à refuser coûte que coûte l'entre-soi au cœur de la domination masculine.
Écrivaine et militante féministe, MARTINE DELVAUX est professeure de littérature des femmes à l'Université du Québec à Montréal.
Le boys club fait partie de la liste des 25 nouveaux classiques de la littérature québécoise, selon La Presse.
« Avec Le boys club, Martine Delvaux, une des intellectuelles les plus influentes de ce premier quart de siècle, signait son œuvre maîtresse, celle qui contient la somme de tous ses engagements. En faisant la démonstration que même si les tavernes sont ouvertes aux dames, les lieux de pouvoir demeurent le fief des hommes, elle braquait une salutaire lumière sur une société qui préfère se gargariser du mot « égalité » que d'ouvrir les yeux sur toutes ces antichambres où elle peine à advenir. Elle offrait aussi à ses lectrices les mots pour nommer ce qu'elles avaient déjà sans doute toutes vécu dans leur chair. » — Dominic Tardif, La Presse
Près de 15 000 exemplaires vendus au Québec et en Europe. Publié en format poche chez Payot Rivages en 2021 et traduit en espagnol (Península / Planeta, 2023) et en anglais (Talonbooks, 2024)
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« Fatou Cissé » par Maurice Genevoix, préface...
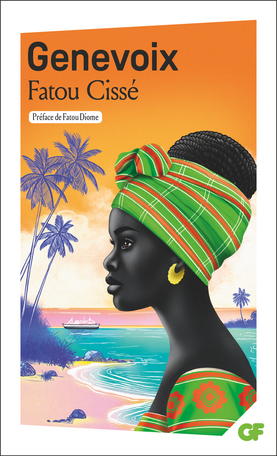
« Fatou Cissé » par Maurice Genevoix, préface de Fatou Diome, éditions Flammarion, collection "GF-Flammarion", Paris, 2025. EAN : 9782080470089. 240 pages. Prix : 10,50 euros. À paraître le 28 mai 2025. < https://editions.flammarion.com/fatou-cisse/9782080470089 >.
Information publiée le 22 mai 2025 par Marc Escola < escola[a]fabula.org > sur le site internet « Fabula : La Recherche en littérature » < www.fabula.org/actualites/127806/maurice-genevoix-fatou-cisse-pref-fatou-diome.html <http://www.fabula.org/actualites/12...> >.
*Chronologie de Mireille Sacotte*
*Préface de Fatou Diome*
Longtemps employée comme domestique dans une famille blanche, Cissé, jeune Sénégalaise, part vivre avec son mari sur une petite île de la côte guinéenne. Devenue mère, elle place en son fils Luc un espoir immense, attendant avec mélancolie le passage du bateau où il travaille comme matelot. Mais Luc n'est pas le fils parfait que Cissé s'imagine.
Avec un humanisme et une empathie rares pour son temps,/Fatou Cissé /(1954) dessine le portrait sensible d'un personnage sur qui pèsent autant le système colonial que sa condition de femme, et pose des questions qui résonnent encore aujourd'hui : comment vivre entre deux mondes ? Que valent les sentiments lorsqu'ils sont tributaires des statuts des uns et des autres ?
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Enseigner féministement la philosophie par Vanina Mozziconacci.
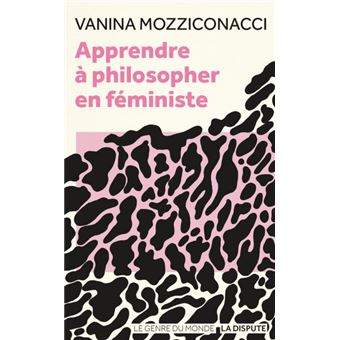
*
Tiré de : Le Café pédagogique, Paris, 26 mai 2025
https://cafepedagogique.net/2025/05/26/enseigner-feministement-la-philosophie-par-vanina-mozziconacci/
Propos recueillis par Djéhanne Gani
L'éducation à la sexualité, une pédagogie féministe pour « changer non seulement l'éducation des filles, mais aussi et surtout celle des garçons » ? À l'occasion de la sortie de son livre « Apprendre à philosopher en féministe » (1), le Café pédagogique s'entretient avec la philosophe Vanina Mozziconacci. Il est question de didactique et de pédagogie féministe : autant de résonances d'actualité et de réflexions qui traversent l'École en France, avec la libération de la parole des victimes de violences et la publication des programmes d'EVARS (2) .
*Pour commencer, pouvez-vous préciser la distinction que vous analysez entre pédagogie et didactique féministe ?*
La pédagogie, dans son sens strict, aborde directement les relations interpersonnelles dans un espace éducatif sans tenir compte de la spécificité des savoirs enseignés. La didactique, en revanche, entre dans la logique propre à une discipline : les connaissances qu'elle produit, la façon dont elle les produit et dont elle les évalue. C'est cette seconde approche qui m'intéresse pour aborder l'enseignement de la philosophie. En réalité, je distingue deux aspects qui sont souvent mêlés dans les textes que j'étudie. En effet, une partie importante de mon corpus sur les pédagogies féministes est anglophone ( bell hooks, Berenice Fisher, Kathleen Martindale, etc.). Or, la didactique, avec l'autonomie que nous lui attribuons en France, n'existe pas dans l'aire de recherche anglo-états-unienne ; c'est pourquoi ces travaux qui utilisent la catégorie de pédagogie mêlent indistinctement des considérations pédagogiques et des considérations qu'on peut qualifier de « didactiques », en intégrant ces dernières avec les réflexions sur les contenus des programmes, le curriculum.
*Vous vous intéressez à la didactique. Vous écrivez « en changeant la façon dont la philosophie se fait en s'enseignant, on change la philosophie tout court ». Pouvez-vous développer ce point ?*
Pierre Bourdieu et d'autres sociologues à sa suite ont montré à quel point le monde de la philosophie française a pour centre de gravité l'institution scolaire et l'enseignement de la philosophie. Louis Pinto avance ainsi que même si « les débats autour des méthodes et des programmes de la discipline pourraient sembler bien modestes, sinon ternes », en réalité, c'est en leur sein que se joue l'identité même de la discipline ; de là, dit-il une « continuité relative » entre le « grand intellectuel » et « le professeur inconnu de province ».
*L'enseignement de la philosophie ne serait pas féministe ? « La philosophie en féministe implique nécessairement de changer la façon d'enseigner la philosophie ». Qu'est ou serait un enseignement féministe de la philosophie ?*
On m'a déjà demandé plusieurs fois : « Pourquoi l'enseignement de la philosophie serait-il sexiste ? », ce à quoi je réponds : mais pourquoi ne le serait-il pas ? La philosophie n'existe pas en apesanteur sociale, à l'abri des dynamiques qui traversent nos sociétés… et ce, bien que cette revendication d'être « coupé du monde » soit omniprésente chez les philosophes (Bourdieu parle de « posture scolastique » pour qualifier ce positionnement ; scolastique vient de skholè, qui signifie « temps libre » et qui a donné le mot école : c'est le temps libéré des urgences du quotidien, avec un regard indifférent au contexte).
Bien sûr, la question qui se pose est celle des spécificités du sexisme tel qu'il se déploie dans le champ de la philosophie et de son enseignement. Pour prendre un exemple parmi d'autres : la figure de l'enseignant comme « maître à penser », qui peut aller jusqu'à une forme de mise sous tutelle de « ses » « disciples ». La philosophe Michèle Le Dœuff décrit bien la recherche d'une forme de dévotion que certains mandarins attendent de leurs étudiants et surtout de leurs étudiantes, et dans ces configurations, l'emprise, voire les violences sexuelles, ne sont jamais loin.
La complaisance qu'on peut avoir vis-à-vis de l'image du professeur de philosophie qui a une relation amoureuse et/ou sexuelle avec des étudiantes (voire avec des élèves) en témoigne ; pensons à tous les films qui vont jusqu'à romantiser ce genre de situations sans jamais problématiser l'abus de pouvoir qu'elles contiennent ("Noce blanche", "L'ennui", "L'homme irrationnel", "L'amant d'un jour"…).
Enseigner féministement la philosophie, cela commencerait déjà par déconstruire ces représentations, faire preuve de réflexivité et de vigilance critique vis-à-vis de ce type de relation qui, sous prétexte d'hériter de l'érotisme socratique, constitue en fait l'échec pédagogique par excellence, comme le montre très bien la philosophe Amia Srinivasan.
*Philosopher en féministe, une question de méthode, d'une manière de faire, quid des contenus ?*
Les pédagogues Margo Culley et Catherine Portuges écrivent, dans l'introduction d'un ouvrage sur l'enseignement féministe : « changer ce que nous enseignons implique de changer la façon dont nous enseignons ». En effet, on ne peut pas se contenter de rajouter au programme quelques femmes, quelques concepts féministes, quelques textes sur le genre, bien mélanger le tout, et considérer que cela suffit. Comme je le disais juste avant, la posture enseignante elle-même est en jeu, mais aussi la question des pratiques qu'on choisit de mettre en place pour apprendre à philosopher.
Par exemple, la philosophe Janice Moulton a montré la dimension genrée d'un philosopher réduit à un « duel », où l'on s'affronte à coups d'arguments jusqu'à la victoire. Plus fondamentalement, c'est aussi la définition de la discipline elle-même qui peut être questionnée, et en particulier son idéalisme ; la philosophe Kristie Dotson invite à repenser la place de la théorie à partir du moment où l'on se montre soucieuse du contexte, de la pluralité des expériences, de la praxis, etc.
*Enseignement féministe et neutralité de l'enseignant, est-ce compatible ?*
C'est une question fondamentale. Il faut commencer par se demander ce qu'on appelle neutralité. Est-ce le fait de s'abstenir de tout discours axiologique dans la salle de classe ? Si c'est bien cela, alors il sera compliqué de faire de la philosophie en cours, car c'est une discipline qui traite la question des valeurs, et même celle de la valeur des valeurs. Les perspectives évaluative et normative font partie intégrante de la discipline (il arrive qu'on considère que c'est ce qui la distingue des sciences humaines et sociales).
Si on prend acte de cela, alors la question à se poser, c'est plutôt : doit-on faire de la politique en classe (au sens de Jacques Rancière : contester un ordre établi au nom de l'égalité) ou doit-on faire la police (toujours au sens de Rancière : maintenir l'ordre établi) ? Il y a de grandes chances pour que, si l'on se considère « neutre » (ni pour, ni contre) vis-à-vis de cet ordre établi, en réalité, on le soutienne passivement, en ne le questionnant pas. Donc il ne faut pas se leurrer : si on critique l'ordre établi, il y a des valeurs en jeu ; si on le soutient, il y a des valeurs en jeu ; et si on se prétend neutre, il y a, encore et toujours, des valeurs en jeu. Nous sommes embarqué.e.s, comme dirait Pascal.
*L'EVARS pour éduquer au féminisme, en féministe ?*
Quand j'ai commencé mes recherches sur les éducations féministes, il y a plus de dix ans, j'avais pour hypothèse que l'éducation à la sexualité était probablement un point d'entrée privilégié pour aborder les questions de genre. Et quand j'ai étudié, dans ma thèse, les revendications des militantes féministes françaises de la première vague (aux alentours de 1900), j'ai constaté que la sexualité constituait l'un des rares sujets pour lesquels elles envisageaient qu'il fallait changer non seulement l'éducation des filles, mais aussi et surtout celle des garçons. L'éducation sexuelle était un cadre dans lequel elles parvenaient à penser que ce n'est pas seulement l'éducation des opprimées qui pose problème, mais également celle des oppresseurs. C'était donc un élément clef.
Toutefois, en se focalisant sur l'EVARS, le risque est de réduire les questions de genre à des questions de sexualité, comme le sens commun peut le faire, parfois en allant jusqu'à les confondre. On met alors de côté des enjeux sociaux massifs comme l'exploitation du travail domestique et du travail de /care/. La sociologue Christine Delphy le rappelle très bien : « Tout centrer sur la sexualité est une pente glissante, car on en arrive à céder facilement à l'idée que ce qui est central, c'est la sexualité et on en revient à une question individuelle, car le rapport sexuel est entre deux personnes [sic] ». Par ce biais, on est tenté.e.s de moraliser des individus, alors que le féminisme, c'est d'abord une politisation, comme le résume le fameux slogan « le personnel est politique ».
Propos recueillis par Djéhanne Gani, Le Café pédagogique, 2025-05-26.
(1) Vanina Mozziconacci, « Apprendre à philosopher en féministe ». Éditions La Dispute, avril 2025. ISBN : 9782843033476. Table des matières sur https://ladispute.fr/catalogue/apprendre-a-philosopher-en-feministe/
(2) EVARS : Éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité < https://www.education.gouv.fr/un-programme-ambitieux-eduquer-la-vie-affective-et-relationnelle-et-la-sexualite-416296 >
*Vanina Mozziconacci*
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Mobilisation : organiser la lutte des classes en milieu de travail
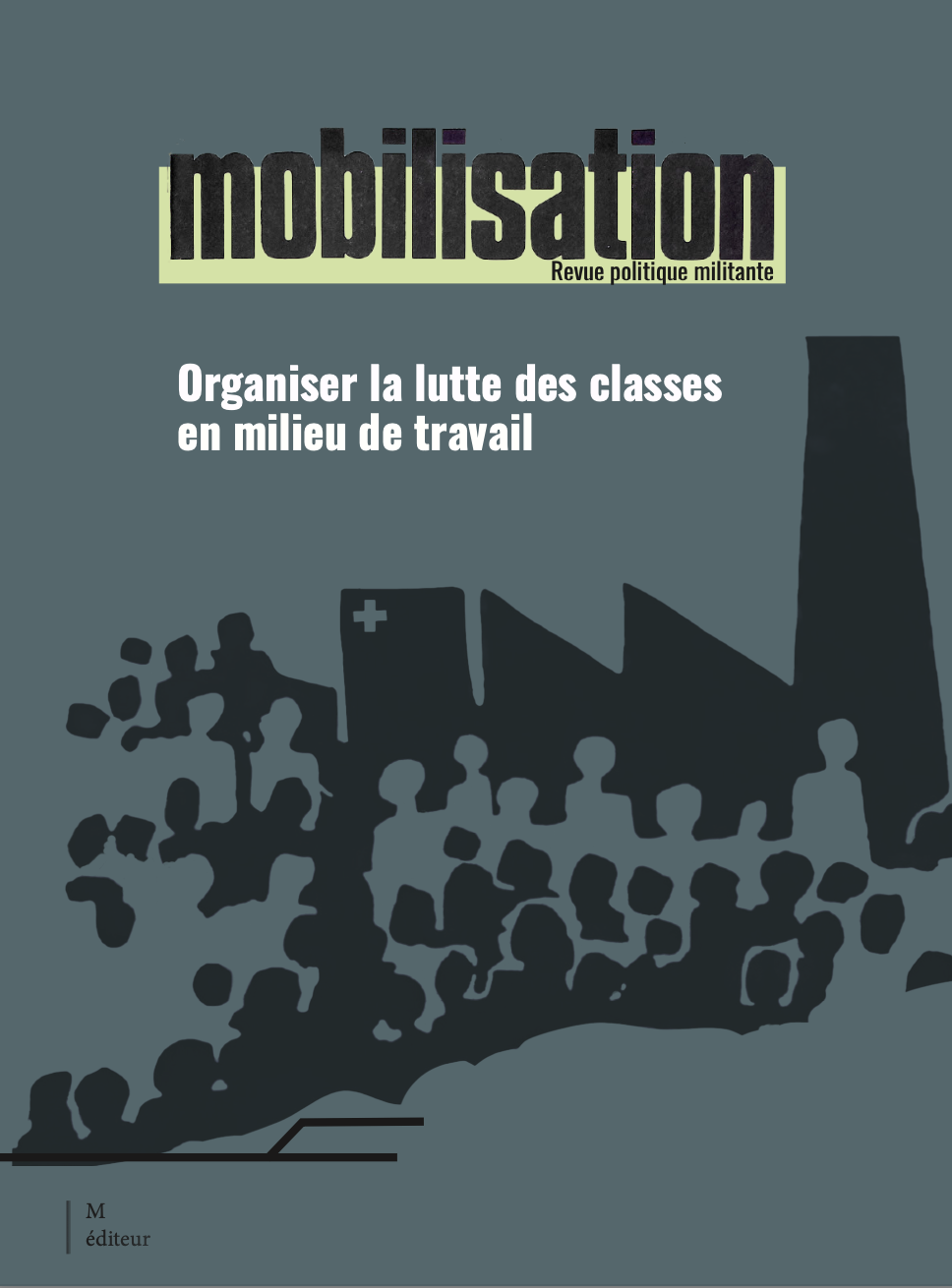
De M Éditeur
M ÉDITEUR À LA GRANDE TRANSITION !
Pour souligner la parution de Mobilisation : organiser la lutte des classes en milieu de travail, Guillaume Tremblay-Boily, auteur d'une thèse sur l'implantation marxiste-léniniste, et Roger Rashi, militant et ancien membre de la revue Mobilisation, viendront discuter des réflexions tactiques et stratégiques exposées dans la revue entre 1971 et 1974.
Des exemplaires de notre anthologie de la revue Mobilisation – en librairie dès septembre 2025 – seront disponibles en primeur à la vente de livres de la Grande transition.
À PROPOS
De 1971 à 1975, la revue Mobilisation a joué un rôle structurant dans la recomposition de la gauche québécoise. Désireuse de rompre avec un militantisme qu'elle juge désorganisé, l'équipe de la revue cherche à combler la distance idéologique et culturelle qui la sépare des travailleur·ses.
Si Mobilisation publie des textes d'analyse politique et des articles de fond sur les enjeux internationaux, l'originalité de sa contribution réside dans sa réflexion sur les différentes stratégies de liaison entre les intellectuel·les et le mouvement ouvrier et, plus particulièrement, dans ses bilans pratiques sur l'implantation dans les lieux de travail.
Au fil de leurs expériences dans les usines et les hôpitaux, les militant·es de Mobilisation ont élaboré une approche singulière de l'implantation, centrée sur la création de comités de travailleurs, et ont ainsi contribué à démocratiser – voire à radicaliser – les luttes ouvrières de l'époque.
Cinquante ans après la parution de son dernier numéro, à l'heure où la combativité du mouvement syndical souffre de la bureaucratisation des grandes centrales, cette anthologie des réflexions stratégiques de
Mobilisation éclaire les possibilités et les défis de la jonction entre les militant·es de gauche et les travailleur·euses du Québec.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

DEADLINE AMERICA
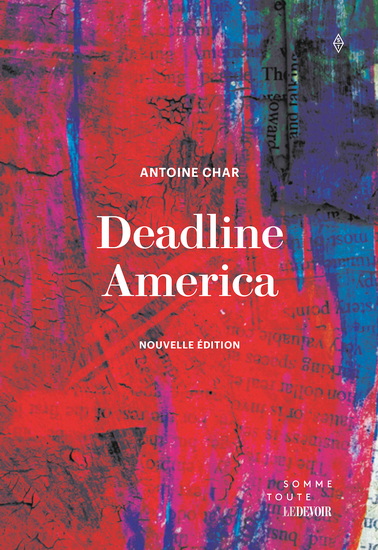
Un essai qui nous plonge dans les coulisses d'un journal américain pour comprendre l'actualité politique.. Ajout d'un long reportage du Dallas Morning News au sujet de la réélection de Donald Trump.
DEADLINE AMERICA
d'Antoine Char
En librairie le 3 juin
Un essai qui nous plonge dans les coulisses d'un journal américain pour comprendre l'actualité politique.
En 2007, le journaliste Antoine Char nous avait fait pénétrer dans les salles de rédaction de dix grands et moins grands journaux des États-Unis, assistant en direct à la confection de la « une » du journal en marge d'autant d'événements historiques. À travers l'étude de divers faits marquants de l'Histoire contemporaine américaine, allant de l'exécution de Timothy McVeigh, à l'élection très serrée de George Bush contre Al Gore, aux mariages gais au Massachusetts ou encore au
procès de Michael Jackson, l'auteur nous montrait les disparités régnant dans les valeurs des Américains.
Cette réédition de l'essai marquant _Deadline America_ offre maintenant un long reportage réalisé au _Dallas Morning New_s lors de la soirée électorale de 2024, qui a vu Donald Trump élu président.
L'auteur
Professeur à l'École des médias de l'UQAM (1995-2019), journaliste au _Jour_, à l'_Agence France-Presse_, à _La Presse canadienne_, à I_nter Press Service _et au _Devoir,_ Antoine Char a publié des essais aux Presses de l'université Québec, _Deadline America_ (Hurtubise, 2007) et _Poker Grigri_ (1961 Digital Edition, 2013), un roman policier. Il coordonne le site internet _En Retrait,_ rédigé par des journalistes retraités. En2024, il dirige le collectif _Les mille visages du populisme_
paru aux éditions Somme toute / Le Devoir.
Extrait – Deadline America
« Dans le grand bazar de l'information, les « unes » des douze quotidiens américains « disséquées » dans ce livre reflètent des moments importants d'un pays continent, insulaire à bien des égards, toujours en train de renaître, toujours en fièvre, avec ou sans la « saga Donald Trump ». […]
Chacun de ces récits représente une « journée dans la vie d'un quotidien » au moment où il confectionne sa première page en mettant toujours en évidence ses meilleurs articles pour mieux inviter le lecteur, de plus en plus happé par la « crise mondiale de l'inattention », à déambuler au milieu de ses colonnes de reportages, de faits divers, de chroniques, d'éditoriaux, de photos, d'infographies et de caricatures.
Avec un peu de chance, et surtout de temps, le promeneur de l'information s'arrêtera le temps de quelques battements de cils pour réfléchir sur le sujet du jour. » Antoine Char
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Comptes rendus de lecture du mardi 3 juin 2025


Les têtes réduites
Jean-François Nadeau
J'aime beaucoup lire Jean-François Nadeau en raison de tout ce qu'il nous apprend sur notre petite et grande histoire. Cet essai, dans la même veine que « Un peu de sang avant la guerre », « Les radicaux libres », et « Sales temps », est peut-être le meilleur d'entre eux, même si je les ai tous bien aimés. Il nous y parle de cette époque de notre histoire où une certaine élite canadienne-française valorisait la pauvreté, du Couac, mensuel satirique que j'aimais bien et qui avait à l'époque publié certains de mes textes, de l'attentat de janvier 2015 dans les locaux de Charlie Hebdo, dans lequel son grand ami le dessinateur Charb (Stéphane Charbonnier) a perdu la vie, de Serge Bouchard et de nos origines sociales, d'Anne Hébert, de René Lecavalier... Un autre de ses bouquins que j'ai dévoré et où j'ai encore appris plein de choses, qui m'a donné le goût de lire d'autres bouquins d'autres auteurs, d'en apprendre plus… Je vous en recommande la lecture !
Extrait :
La famille élargie des Hébert vivait en quasi-autarcie. Anne appartenait à un microcosme, à un monde doté d'un riche capital culturel. Dès sa prime enfance, elle a bénéficié de discussions et d'échanges érudits. Anne Hébert s'abreuvait à des sources qui n'étaient pas accessibles au commun des mortels. Elle lisait et s'instruisait, protégée par le cocon d'une classe sociale privilégiée.

Le lambeau
Philippe Lançon
C'est la lecture de l'essai « Les têtes réduites », de Jean-François Nadeau, qui m'a ramené ce livre à l'esprit. Il s'était mérité le prix Femina 2018 et j'avais alors mis beaucoup de temps à mettre la main dessus, tellement il était populaire. « Le Lambeau » ressemble plus à une autobiographie ou à un témoignage qu'à un roman. C'est surtout un livre troublant. L'auteur, chroniqueur à Charlie Hebdo, est l'un des survivants de l'attaque terroriste dans les locaux de ce journal satirique le 7 janvier 2015. Il nous décrit en longueur, jusque dans l'intimité, les moments tragiques de cette triste matinée, puis les mois d'hospitalisation dans le service de chirurgie maxillo-faciale de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et aux Invalides afin de récupérer une mâchoire fonctionnelle pour parler et manger, ainsi que les conséquences psychologiques associées au traumatisme. Une lecture attachante qui nous ouvre les yeux sur les conséquences de la violence.
Extrait :
Souvent, Gabriela m'appelait sur FaceTime depuis New York. Soit j'essayais de dormir, soit j'étais en soins, soit je recevais une visite : ce n'était jamais le bon moment, ni les bonnes paroles. Elle continuait de me prêcher l'optimisme désespéré dont elle-même croyait avoir besoin pour affronter son mari le banquier, son père malade à Copiapó, sa solitude. Elle tentait de m'enseigner des façons de guérir qui n'avaient aucun sens pour moi : je suis hermétique aux méthodes Coué et à la méditation. Elle me parlait d'un type qui s'était fait manger le bras par un requin, d'un autre qui avait été gravement brûlé dans un accident. Les deux avaient écrit des livres exemplaires, à l'américaine, pour raconter leurs « combats », célébrer la volonté, expliquer à quel point l'épreuve les avait rendus plus forts en rendant plus belle la vie. Les livres étaient bien entendu dédiés à leurs familles sans qui, etc. Les estrades et les télés américaines étaient remplies de ces survivants qui, d'un désastre surmonté, faisaient un show évangélique. Ces niaiseries volontaristes m'agaçaient d'autant plus que je pouvais à peine parler. Je regardais le sourire de Gabriela apparaître sur FaceTime, ce sourire que j'avais tant aimé, que j'aimais toujours, puis, pensant à l'homme au bras mangé par un requin, je lui substituais le sourire de Kafka ; et, tandis qu'elle me parlait de ces survivants modèles en état de résurrection prophétique, je repensais à une phrase de l'écrivain devenu compagnon de bloc : « Ce n'est que dans la mort que le vivant peut se concilier avec la nostalgie. »
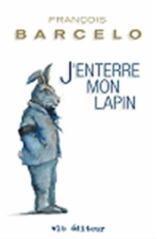
J'enterre mon lapin
François Barcelo
L'écrivain François Barcelo nous a quitté le 25 mai dernier. Je n'avais lu de lui qu'un seul de ses nombreux livres, et je l'avais bien aimé. « J'enterre mon lapin » est un petit roman drôle et intriguant, mais surtout très humain, qui vous donnera assurément le goût de lire ce bon romancier québécois trop peu connu. C'est le protagoniste Sylvain Beausoleil qui, plus d'une fois, enterre son lapin...
Extrait :
Je fais rien que des grosses lettres. Ça aussi c'est pas difficile. Je va sur Police en haut. C'est pas comme la vraie police en auto de police. C'est juste la police dans l'ordinateur. Je prends la police que j'aime le mieux. Garamond que ça s'appelle. Puis là je décide quelle grosseur que je veux sur Corps. Armand dit C'est facile de te rappeler ça fait comme Corps de police. Je prends 18. Ça se voit bien. Puis ça va me fer moins de pages pour fer mon livre.

Martin Luther King
Sylvie Laurent
C'est un article du Monde diplomatique qui m'a donné le goût de lire cette biographie de Martin Luther King, peut-être la meilleure qui ait été écrite sur cet important militant non-violent pour les droits civiques des Noirs américains, mais aussi pour la paix et contre la pauvreté. La biographe Sylvie Laurent ne partage pas les nombreux mythes qui se sont construits au cours du temps autour des États-Unis, dont celui de sa « destinée manifeste », et de nombre de ses personnages historiques. Combattant sans relâche, de façon pacifique, pour les droits des Noirs, King était détesté et vilipendé par une grande partie de l'Amérique blanche de l'époque. Agressé, emprisonné sans réel motif à plusieurs reprises, mort assassiné en 1968 à l'âge de 39 ans seulement, il était l'antithèse de la société américaine de l'époque et même de la société américaine d'aujourd'hui, demeurée raciste, malgré les avancées attribuables à King et aux siens, profondément inégalitaire aussi et peu soucieuse du bien-être commun ; si bien que c'est uniquement en l'instrumentalisant complètement que l'on en a fait, avec le temps, une figure emblématique des États-Unis d'Amérique. C'est l'une des meilleurs biographies que j'ai lues jusqu'ici.
Extrait :
Quoi de plus glorieux dans l'histoire nationale que cet homme mort en martyr pour révéler la fraternité des hommes et la bonté fondamentale de l'Amérique ? La vie de King est devenue un conte pour enfants, la chronique d'une rédemption nationale ouverte par Abraham Lincoln et refermée par le discours de 1963, « Je fais un rêve ». Ce souvenir-écran oblitère la réalité même de cet événement, une mobilisation syndicale massive organisée par des socialistes pour réclamer des emplois décents, des investissements publics et de meilleurs salaires. Les dernières années de la vie de King sont passées sous silence et le pasteur, pétrifié dans le marbre de l'amour et dans le registre du rêve patriotique, est devenu l'objet d'une consensus d'autant plus troublant qu'il fut la personnalité la plus contestée et à certains égards la plus haïe de son époque. Comme tous les mythes fondateurs, le King auquel on a consacré un jour éponyme, imposant un devoir de mémoire collective, sert à l'édification nationale et à la légitimation institutionnelle de la démocratie américaine d'après-guerre. On l'enseigne dans les écoles à des fins d'instruction civique. La légende du « grand homme » permet de taire le rôle de ses prédécesseurs, socialistes et communistes, d'effacer la contribution essentielle des dissidents du SNCC, sans lesquels la révolution n'aurait pas eu lieu, et d'établir une opposition binaire entre le bon pasteur Martin et le diabolique Malcolm X.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
La voix de son maître
Le billettiste de droite Richard Martineau a commis un autre commentaire démagogique dans sa chronique du Journal de Montréal, jeudi le 28 mai dernier.
Il a intitulé son texte : "Trump tire le monde vers le bas." Ce qui sert de base à son argumentation est une comparaison facile avec John F. Kennedy, à partir d'une biographie qu'a consacrée à l'ancien président Fredrick Logevall, lauréat d'un prix Pulitzer. Soit dit en passant, mine de rien, sous son style populiste, Martineau nous indique qu'il a des lectures ! Il faut donc le prendre au sérieux. Bien entendu, le chroniqueur se sert de l'essai de Logevall pour comparer Kennedy à Trump, au détriment de ce dernier, mais sans le moindrement tenir compte de la différence des contextes historiques qui sépare les deux présidents. Martineau tombe dans la facilité en reprenant à son compte le discours antitrumpiste dominant.
Là où les choses clochent, c'est lorsqu'il en profite pour dénigrer une fois de plus le "wokisme". Il tombe dans la démagogie la plus facile. Il en fait un dada, une fixation. Il reprend à son compte l'hostilité des conservateurs sociaux qui voient dans le wokisme une menace pour la liberté d'expression et les valeurs traditionnelles. Le wokisme se caractérise pourtant par une volonté de justice sociale et de redistribution de la richesse produite. Il prône aussi un certain multiculturalisme et une ouverture à l'autre. Examinons quels termes Martineau emploie pour aborder le wokisme.
"On dit du wokisme que c'est la gauche dans ce qu'elle a de pire. La "bienveillance/" poussée jusqu'à la niaiserie. Eh bien, le trumpisme, c'est la droite dans ce qu'elle a de pire."
Il ajoute :
"Bien sûr qu'il faut mettre un frein à l'immigration massive, à la criminalité, au communautarisme, à la dégradation des institutions d'enseignement, qui ressemblent de plus en plus à des usines destinées à former des militants extrémistes.
Mais pas comme ça.
Pas avec un batte de baseball.
Trump, c'est la pire des réponses à une excellente question."
Il ajoute :
"Les wokes nous poussent vers l'extrême gauche ? On va aller à l'autre extrême !"
Entre les lignes du texte de Richard Martineau, on discerne l'inquiétude d'une partie notable des élites économiques devant la montée de l'extrême droite dont les politiques risquent de compliquer la gestion du capitalisme "modéré" et l'accumulation du profit ; en résumé, de compromettre le bon fonctionnement du système.
Martineau n'est pas le seul billettiste du Journal à s'en prendre aux tenants et tenantes du wokisme, mais lui tombe dans la plus épaisse des démagogies. Par exemple, affirmer le plus sérieusement du monde que les institutions d'enseignement façonnent une masse de "militants extrémistes" relève d'un aveuglement volontaire, d'une mauvaise foi éclatante, ou encore des deux.
Évidemment, le courant woke ne précise guère ses objectifs dans les détails, il demeure un peu vague là-dessus tout comme les moyens à employer pour réaliser ses buts. Il est tout aussi susceptible de critique que n'importe quel autre courant idéologique. Mais il n'est pas monolithique et il existe en son sein diverses approches dans leur analyse sociale. C'est normal. Il est plus flou que ne l'était le communisme des années 1970 et tout aussi marginal en fin de compte que le marxisme-léninisme et le maoïsme l'étaient dans le temps au Québec.
Précisément, quelle aurait été la réaction de Martineau et de ses semblables devant le noyautage des plusieurs organisations étudiantes et communautaires de cette époque par des groupuscules marxistes ? Ils auraient sombré dans un anticommunisme primaire et crié au déclin de la démocratie. Ils se seraient aussi alarmés du radicalisme de certains militants syndicaux.
L'antiwokisme représente donc la forme mise au goût du jour d'un certain antigauchisme propre à des fractions influentes des classes dominantes. Martineau et ses congénères s'en font les porte-voix, on les paie pour cela. Leurs jappements sont destinés à effrayer le bon peuple.
Jean-François Delisle
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

États-Unis : De grandes entreprises violent les droits des travailleurs des plateformes numériques

(Washington) – Des grandes entreprises gérant des plateformes numériques de services (« gig companies ») aux États-Unis désignent de façon erronée des personnes travaillant pour elles comme des entrepreneurs indépendants, les privant ainsi de leurs droits de travailleurs, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd'hui.
26 mai 2025 | tiré du site Entre les lignes entre les mots
États-Unis : De grandes entreprises violent les droits des travailleurs des plateformes numériques
Ce rapport de 155 pages, intitulé « “The Gig Trap” : Algorithmic, Wage and Labor Exploitation in Platform Work in the US » (« Le piège “Gig” » : Exploitation algorithmique et violations des droits des travailleurs des plateformes numériques aux États-Unis ») examine les pratiques de sept grandes entreprises de ce type aux États-Unis : Amazon Flex, DoorDash, Favor, Instacart, Lyft, Shipt et Uber. Ces sociétés prétendent offrir la « flexibilité » aux personnes travaillant pour elles en tant que « gig workers » (terme parfois traduit comme « travailleurs à la demande » ou « travailleurs de plateformes numériques »), mais au final les rémunèrent souvent moins que le salaire minimal de l'État ou de la municipalité. Six de ces sept entreprises emploient des algorithmes aux règles opaques pour assigner les tâches et déterminer les rémunérations, ce qui fait que les travailleurs ne savent pas combien ils seront payés jusqu'à ce qu'ils aient terminé le travail.
« Les plateformes numériques de services ont créé un modèle commercial qui leur permet d'échapper aux responsabilités d'un employeur tout en maintenant les travailleurs sous un étroit contrôle algorithmique, dominé par des décisions opaques et imprévisibles », a déclaré Lena Simet, chercheuse senior sur les questions de pauvreté et d'inégalité à Human Rights Watch. « Ces entreprises promettent de la flexibilité, mais en réalité, elles laissent leurs travailleurs à la merci de rémunérations instables et inférieures au salaire minimal, avec peu de protection sociale et dans la crainte constante d'une interruption de contrat sans voie de recours. »
Les sept entreprises examinées utilisent des algorithmes pour assigner des tâches aux travailleurs, pour les superviser, pour les rémunérer, mais aussi pour terminent leurs contrats. À l'exception d'Amazon Flex, qui se fonde sur un tarif horaire fixe, toutes emploient des algorithmes opaques et variant fréquemment pour calculer la rétribution de chaque mission ou service. Les applications et les plateformes sont conçues pour maintenir les travailleurs « gig workers » en activité pendant de longues périodes de travail pour des tarifs minimes, et les algorithmes de tarification dynamique font qu'il leur est extrêmement difficile de planifier leur emploi du temps et de contrôler leurs revenus. Gérés par des algorithmes, les travailleurs ne peuvent jamais tout à fait comprendre de quelle manière on leur attribue le travail, ni comment on calcule leur rétribution. Sans aucune transparence, il leur est extrêmement difficile de remettre en question les décisions concernant leur travail ou leur rémunération.
Human Rights Watch a examiné les conditions de travail des travailleurs assurant des services de taxi informel (« ride-hailing »), de courses et de livraison de repas, notamment au Texas. Le rapport est fondé sur des entretiens semi-structurés avec 95 travailleurs de plateformes au Texas et dans douze autres États américains, ainsi que sur une enquête auprès de 127 travailleurs du Texas.
Les faibles revenus, le contrôle algorithmique et les obstacles à la syndicalisation enferment de nombreux travailleurs dans l'insécurité économique, a constaté Human Rights Watch, alors même que les entreprises multimilliardaires étendent leurs parts de marché et leurs bénéfices.
La faiblesse des règlementations autorise ces sociétés à considérer abusivement leurs travailleurs comme des entrepreneurs indépendants et non pas comme leurs employés, même si la nature de leur travail et le degré de contrôle qu'elles exercent sur eux répondent souvent aux critères juridiques du statut d'employé. Cela permet à ces sociétés de ne pas respecter les lois sur le salaire minimal, la rémunération des heures supplémentaires et la contribution aux avantages sociaux. Pour les travailleurs, cela signifie qu'ils doivent prendre à leur charge le véhicule, le carburant, l'assurance et l'entretien, mais aussi payer la part employeur des contributions à la sécurité sociale et à l'assurance maladie.
Les revenus des travailleurs texans interrogés étaient inférieurs de 30% au salaire minimum fédéral et de 70% à ce que le Massachusetts Institute of Technology considère comme un salaire permettant de vivre au Texas. Ces conclusions viennent renforcer les recherches de gouvernements locaux, d'instituts universitaires et de chercheurs en matière de politiques, qui constatent toutes que ces travailleurs ont des revenus inférieurs ou égaux au salaire minimal local et bien inférieur au seuil d'un niveau de vie décent.
Les États-Unis disposent de l'un des marchés des services de plateformes numériques (parfois appelé « gig economy » ou « économie des petits boulots ») au monde. Le nombre de personnes qui gagnent leur vie à travers le « gig work » (parfois appelé « ubérisation » en français) a explosé ces dernières années. D'après des estimations, en 2021, 16% des adultes américains avaient travaillé au moins une fois pour une plateforme numérique de services. Parmi les travailleurs des plateformes, on compte une part disproportionnée de personnes d'origine afro- ou latino-américaine.
Les travailleurs ayant répondu à l'enquête de Human Rights Watch gagnaient en moyenne 16,90 USD de l'heure (pourboires compris), mais en dépensaient près de la moitié en charges liées à leur travail. En tenant compte des avantages sociaux, que les employeurs couvrent souvent pour les autres travailleurs, leur paye effective tombait à 5,12 USD de l'heure. Certains travailleurs ont même rapporté qu'une fois déduites les charges, ils ne gagnaient rien du tout.
Trois quarts des travailleurs interrogés ont déclaré qu'ils avaient eu du mal à payer leur logement au cours de l'année écoulée et la majorité a rapporté des difficultés pour acheter à manger, faire les courses, régler l'électricité et l'eau. Plus d'un tiers d'entre eux estimaient qu'ils auraient du mal à faire face à une urgence médicale coûtant 400 USD.
Les travailleurs ont expliqué à Human Rights Watch qu'ils vivaient dans la crainte quasi-permanente de se faire « désactiver » ou renvoyer par une application, souvent sans explication ni voie de recours. Près de la moitié de ceux qui avaient ainsi été automatiquement renvoyés ont pu par la suite être acquittés de toute faute, ce qui suggère qu'il existe un taux élevé de désactivations erronées de comptes.
L'insécurité financière des travailleurs des plateformes est d'autant plus frappante que les revenus des sociétés elles-mêmes sont en forte hausse. Uber, qui détient 76% de parts du marché américain du covoiturage (« ride-sharing »), a déclaré 43,9 milliards USD de chiffre d'affaires en 2024, soit 17,96% de plus que l'année précédente, et un bénéfice net de 9,8 milliards USD. En avril 2025, Uber disposait d'une capitalisation boursière de 169,41 milliards USD. DoorDash, avec 67% de parts du marché de la livraison de repas aux États-Unis, a enregistré un chiffre d'affaires de 10,72 milliards USD en 2024 et était évaluée à 81,03 milliards USD en avril 2025.
En présentant abusivement leurs travailleurs comme des entrepreneurs indépendants, les sociétés des plateformes évitent par ailleurs de contribuer à la sécurité sociale, à l'assurance maladie et à l'assurance chômage, privant ainsi les fonds publics de ressources cruciales. Ayant consulté les données fiscales issues des statistiques sur les structures non employeuses (« Nonemployer Statistics ») du Bureau du recensement, Human Rights Watch estime que, entre 2020 et 2022, le Texas aurait pu collecter auprès des entreprises des plateformes plus de 111 millions USD de contributions à l'assurance chômage, si les travailleurs assurant les services de covoiturage, de livraison et à domicile avaient été déclarés comme employés. Le manque à gagner réel est certainement bien plus élevé si l'on tient compte des revenus non déclarés.
En réponse à la demande de commentaires adressée par Human Rights Watch, la société Lyft a déclaré : « Le travail basé sur des applications fournit à des millions d'Américains des opportunités de travail à la flexibilité unique, leur laissant ainsi la possibilité de poursuivre d'autres objectifs, d'assurer d'autres engagements ou obligations. Bien mieux qu'un emploi traditionnel aux horaires fixes, il leur permet de gérer leurs nombreux engagements réels et imprévisibles et leurs emplois du temps chargés. » Amazon a accepté de rencontrer Human Rights Watch pour parler du rapport, mais n'a pas fourni de réponse officielle. Les autres sociétés n'ont pas répondu.
Le droit international relatif aux droits humains exige des conditions de travail justes et favorables pour tous les travailleurs, y compris ceux des plateformes numériques.
Le département du Travail des États-Unis, la Commission fédérale du commerce (Federal Trade Commission), la Commission des travailleurs du Texas (Texas Workforce Commission) ainsi que les entités homologues des autres États devraient prendre des mesures immédiates pour assurer la sécurité du travail aux « gig workers » et protéger leurs droits à la syndicalisation, a déclaré Human Rights Watch.
« Les plateformes numériques de services ont créé une main-d'œuvre qui ne jouit d'aucun des droits et des protections pour lesquelles les travailleurs se sont battus pendant des décennies », a conclu Lena Simet. « Alors que de plus en plus de personnes sont attirées par le travail “gig work” pour boucler leurs fins de mois, les autorités de l'État fédéral et des États devraient passer à l'action pour leur garantir les protections auxquelles elles ont droit et œuvrer, aux côtés de l'Organisation internationale du travail, à l'établissement d'une norme mondiale contraignante pour le travail des plateformes numériques. »
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :












