Presse-toi à gauche !
Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

La justice vengeresse de Monte Cristo

Edmond Dantès/Pierre Niney semble constamment lutter afin de préserver son humanité dans ses confrontations avec la femme qu'il aime toujours et qui saura le préserver des aspects révoltants de la vengeance-machination qu'il a ourdie dans sa quête de justice.
Par Pierre Jasmin, artiste pour la paix
Affiche macho révélant les noms des sept acteurs mais seulement de deux des actrices
Séparer la vengeance haineuse de la justice
Autre adaptation réussie d'Alexandre Dumas1 confiée à Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte par le producteur Dimitri Rassam, le Comte de MonteCristo présente le fort dilemme du héros Edmond Dantès qui tente de toutes ses forces de séparer la vengeance haineuse de la justice. Quel thème explosif d'actualité à explorer, pendant qu'on déplore des massacres génocidaires à Gaza qui débordent aujourd'hui en Cisjordanie et au Liban par inaction honteuse des pays de l'OTAN : ils abandonnent l'UNRWA malgré les cris de détresse du Secrétaire général des Nations-Unies, Antonio Guterres, et en profitent en outre pour vendre honteusement leurs armes au « criminel de guerre » selon le Tribunal international de LaHaye, Nétanyahou, ivre de vengeance post 7 octobre, au point de frapper jusqu'en Iran et de risquer de provoquer une guerre mondiale ! Et ce pari sanguinaire le fait remonter dans les sondages en Israël et recevoir plus d'armes de Biden-Harris, la seule de leurs actions applaudie par Trump-Vance.
Le Devoir qualifie la vengeance de Dantès à la manière des réseaux sociaux
François Lévesque propose une interprétation du film inspirée par les réseaux sociaux fielleux en la sous-titrant « une vengeance épique » : « si Dantès complète sa vengeance, ce sera au prix de son humanité. Et il ne vaudra alors guère mieux que son ennemi. Quand on garde cela à l'esprit, la résolution douce-amère s'avère vraiment satisfaisante. »
Ce commentaire me semblerait mieux adapté au feuilleton télévisuel ayant aussi connu un immense succès il y a six ans, malgré son côté romanesque flamboyant en toc. Piloté par Josée Dayan qui n'avait que des bons mots pour son héros joué par Gérard Depardieu, il a néanmoins laissé un arrière-goût altéré par une accusation - mais pas encore condamnation - d'agression sexuelle.
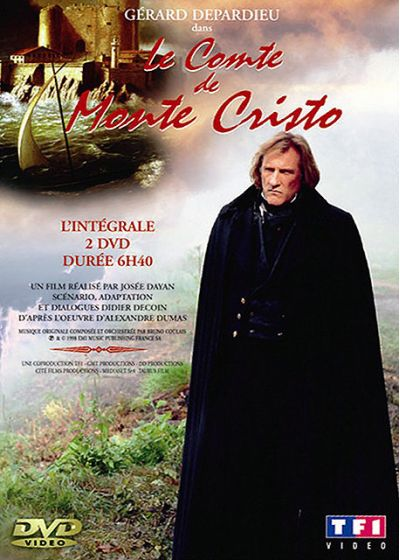
Si le film suit certaines traces du feuilleton, par exemple en aménageant un subtil suspens par de nombreuses et plausibles infidélités au roman, il joue sur un tout autre registre, prenant le temps de combler certaines invraisemblances : par exemple en nous faisant rencontrer le codétenu du château d'If, qui va équiper le jeune marin naïf de ses immenses connaissances historiques, mathématiques et sociales (secret des solidarités amicales), qui, lorsqu'il gagnera audacieusement sa liberté, égaleront en valeur l'immense trésor des Templiers de l'île de Monte-Cristo dont il révèle l'emplacement secret.
Une jeune génération féminine
Je partage néanmoins l'appréciation très positive du film par le critique du Devoir qui nous régale de sa connaissance des hauts-faits d'armes du directeur photo québécois, Nicolas Bolduc. Mais pour ma part, Edmond Dantès/Pierre Niney semble constamment lutter afin de préserver son humanité dans ses confrontations avec la femme qu'il aime toujours et qui saura le préserver des aspects révoltants de la vengeance-machination qu'il a ourdie dans sa quête de justice. Elle reçoit l'aide providentielle des trois jeunes qui entourent le héros ayant chacun, chacune, pour deux d'entre elles, leur raison personnelle de suivre aveuglément le justicier, sauf un qui le dépassera en haine dans sa mission vengeresse.
Le Devoir la percevrait-elle dévastatrice, parce qu'elle l'est pour la société royale corrompue par trois scélérats de la finance, de la justice et de la politique (qui plus est, un ex-militaire) ? Le comte de Monte-Cristo va s'appuyer sur un Britannique pour démolir d'abord la fortune de l'armateur à l'aide de compagnons solidaires ; contre le deuxième salaud, il dévoilera un « infanticide », doublé du mensonge à la mère que son bébé était mort-né. Pour le troisième coupable, son humanité préservée lui fera d'abord renoncer à se venger de son fils parce qu'il l'a (ou quoiqu'il l'ait) procréé avec son ex, bien jouée dans ses deux âges de vingt et quarante ans par Anaïs Demoustier. Elle est crédible en mère qui l'implore d'épargner ce fils très beau, joué par Vassili Schneider, le quatrième de cette mythique dynastie d'acteurs québécois. Il est l'amoureux de celle que le Comte a sauvée des griffes du sultanat, un personnage ajouté par l'imagination fertile des deux scénaristes pour établir une équation égale, jeunes générations de 3 contre les 3 vieilles crapules. Ces trois combats ne se décideront pas sans perte, ce qui contribue intelligemment au suspens tout au long des trois heures du film, altéré par une musique pompeuse qui l'alourdit : à moins que ce fût un subterfuge pour nous faire apprécier le fragile trio choral accompagnant le mariage raté des deux amants innocents du début du film et les mélopées turques émouvantes de l'ex-captive ?
Note
1. Les trois mousquetaires – d'Artagnan et Les trois mousquetaires – Milady étaient 2 reconstitutions réussies d'une époque où, par exemple, se laver était une occupation occasionnelle et facultative.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« La Belle Affaire » de Natja Brunckhorst*

1990. Début de l'été. Comment des citoyens ordinaires de l'ex-RDA vivent-ils les répercussions dans leur existence d'un événement historique considérable, la chute du mur de Berlin [ nuit du 8 au 9 novembre 1989 ] ? Pour répondre à pareille interrogation, peu abordée au cinéma, tout en s'appuyant sur des faits réels, Natja Brunckhorst, scénariste et réalisatrice allemande, née à Berlin en 1966, choisit une comédie enjouée au rythme trépidant en partant d'une intrigue à rebondissements, digne d'un thriller à la « Mélodie en sous-sol ».
Proposé par André Cloutier
Par Samra Bonvoisin, Le Café pédagogique, Paris, 28 août 2024
https://cafepedagogique.net/2024/08/28/le-film-de-la-semaine-la-belle-affaire-de-natja-brunckhorst/ <https://cafepedagogique.net/2024/08...>
Visionner la bande-annonce.
Ainsi donc, en pleine réunification des deux Allemagne, des locataires d'un même immeuble, ouvriers devenus chômeurs en un rien de temps, découvrent dans une galerie des milliers de billets de banque est-allemands et engagent une course contre la montre pour convertir leur colossal butin en Deutsche Mark avant la date fatidique du 6 juillet interdisant à la population de changer ses devises. Il reste trois jours à ce petit collectif de « voleurs » pour monter « La Belle Affaire ».
*Une fine équipe en quête d'utopie dans le chambardement de l'année 1990 *
Au cœur de cet été 90 où la RDA dans laquelle ils ont été élevés et vivent est en train de disparaître, Maren ( Sandra Hüller ), Robert ( Max Riemelt ), Volker ( Ronald Zehrfeld ), amis de toujours, s'embarquent sans coup férir dans une aventure inédite. À la faveur de la découverte des milliers de Ostmarks stockés sous terre, et bientôt obsolètes. Toute leur « éducation » formatée par le collectivisme imposé et le supposé partage égalitaire des ressources assuré par un État totalitaire, que vaut-elle désormais face aux attraits et à la loi du marché, à l'ivresse de la libre circulation des personnes et des biens, au parfum de liberté venu de l'Ouest ?
Notre trio ne se pose pas la question en ces termes mais envisage à toute allure les solutions les plus ingénieuses pour mettre en place, en y associant voisins et habitants du quartier, un système d'achats de marchandises et d'objets ( dont nous ne voyons, la plupart du temps, que les énormes emballages en cartons monumentaux transportés à toute blinde en camionnettes après bien des voies détournées ) afin de se débarrasser au plus vite de la masse de billets est-allemands, bientôt hors d'usage.
Rien n'est simple pour ceux qui font l'expérience originale de « l'argent facile » et des sentiments contradictoires qu'une telle possession engendre.
Al'heure où les repères habituels s'effondrent et que s'ouvrent des potentialités nouvelles, seront-ils capables, en dépit de retournements troublants, de surmonter la tentation du « chacun pour soi » et de préserver le sens du collectif, les bienfaits de l'amitié et le pouvoir de l'amour,tout ce qui a soudé cette folle entreprise ?
*Une fable solaire et malicieuse *
Visiblement, Natja Brunckhorst n'a pas le goût du malheur. Actrice principale à l'âge de 14 ans pour le film de Uli Edel, « Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée » [1981], elle choisit un temps l'exil en Grande-Bretagne puis en France pour se protéger du scandale. Après un retour dans son pays à la fin des années 80 où elle poursuit sa carrière de comédienne, elle devient scénariste pour la télévision et le cinéma à la fin des années 90 avant de se tourner vers la réalisation avec « L'Ordre des choses » [2021], son premier long métrage.
Aujourd'hui, « La Belle Affaire », – comédierondement menée valorisant l'humanisme et l'idéalisme de quelques héros ordinaires pris dans le tourbillon incroyable et aventureux de ce moment-charnière dans l'Histoire du XXème siècle et dans celle de l'Allemagne –, portela trace du tempérament pugnace de la cinéaste. Et de sa volonté ( étayée par des témoignages et des recherches documentaires ) de restituer l'ambivalence d'une période chaotique, les derniers mois de la RDA, sous un angle positif. Outre la dimension absurde, Natja Brunckhorst souligne : « les anciennes règles n'étaient plus valables, les nouvelles n'étaient pas encore en place. Pendant un an, beaucoup de choses étaient possibles ; il y avait de l'espoir, puis plus, des peurs, mais aussi des opportunités. Bien des gens m'ont dit : ‘'C'était la meilleure période de ma vie !'' ».
Dans la lumière chaude cet été là, magnifiée par Martin Langer, le directeur de la photographie, le trio amoureux , cher au François Truffaut de « Jules et Jim » selon le vœu de la réalisatrice,audacieuse association formée par Maren ( Sandra Hüller, rayonnante d'énergie, dans un registre nouveau ), et ses deux compagnons en tendre affection ( Max Riemelt et Ronald Zehrfeld, excellents partenaires de jeu, chacun dans un style singulier ), sans oublier le fils Janeck, traversent avec panache et humour « La Belle Affaire », modulée dans sa légèreté et sa gravité par la composition musicale « country » de Hannah von Hübbenet. Courez voir l'épopée fabuleuse d'une petite communauté humaine,inscrite dans laGrande Histoire,saisie à un moment rare de « fortune » éphémère et jubilatoire.
Samra Bonvoisin, Le Café pédagogique, 2024-08-28
« La Belle Affaire », filmde Natja Brunckhorst - sortie le 28 août 2024 (en France)
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Agence Stock Photo - Une histoire du photojournalisme au Québec

Montréal, le 28 août 2024 – Beau-livre incontournable de la rentrée, Agence Stock Photo. Une histoire du photojournalisme au Québec nous offre un condensé de l'histoire du Québec de ces 40 dernières années par les plus grand.e.s photographes québécois.es !
En 1987, trois jeunes photographes décident de fonder une agence de photographies. À l'instar des grandes agences de presse telles Reuters ou AFP, Robert Fréchette, Jean-François LeBlanc et Martin Roy créent une structure indépendante et collective encore inédite au Québec. Pendant près de quarante ans, Stock va couvrir les évènements majeurs qui ont façonné la société québécoise. Du Référendum sur la souveraineté du Québec au Printemps Érable, en passant par la résistance de Kanehsatà:ke (ou crise d'Oka) et le Sommet des Amériques, ce collectif de photographes a su apporter une diversité de regards sur les grands enjeux sociaux, politiques et culturels qui ont marqué l'Histoire du Québec.
Leurs images ont paru dans les plus grands journaux francophones nationaux et internationaux contribuant à façonner notre regard et notre mémoire collective. Qu'il s'agisse des clichés de Robert Fréchette sur le Nunavik et la communauté inuite, des portraits de la culture rave et techno à Montréal fait par Caroline Hayeur (Prix Antoine-Desilets), des explorations photographiques de Benoit Aquin (prix Pictet) sur la chasse, ou des reportages d'actualité de Normand Blouin ou Horacio Paone, les 117 photographies en couleurs et noir et blanc qui composent cet ouvrage brossent un portrait sensible et précieux de la société québécoise.
Le livre comprend une introduction de l'auteure et photographe Sophie Bertrand, un essai de l'historien de la photographie Vincent Lavoie et deux grands entretiens avec les photographes inédits Jean-François LeBlanc et Caroline Hayeur.
Agence Stock Photo est une invitation à voir ou à revoir les images qui ont fait l'histoire du Québec et qui constituent, par leur richesse humaniste, un véritable hommage au Québec et aux Québécois.es !
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Nous n’en avons pas fini avec l’anti-impérialisme des imbéciles
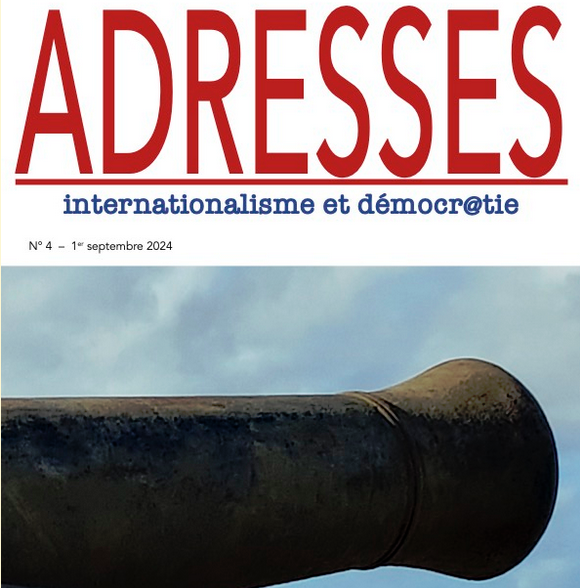
La formule de la militante syrienne Leïla Al-Shami, reprise par Pierre Madelin dans le n°2 d'Adresses ne cesse de s'imposer à nous dans l'actualité mondiale [1] : « Nous n'en avons pas fini avec l'anti-impérialisme des imbéciles ! » Pas plus que nous en avons fini avec celles et ceux qui taisent, excusent souvent, certains crimes au nom de la lutte contre d'autres crimes et criminel·les.
29 août 2024 | tiré du site entre les lignes entre les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/08/29/nous-nen-avons-pas-fini-avec-lanti-imperialisme-des-imbeciles/
Nous avons abordé dans les précédents numéros d'Adresses, certains aspects du droit international, la prévention du risque de génocide, les crimes de guerres, les crimes contre l'humanité. Il faudrait développer, encore et encore, sur les spatiocides, les domicides, les écocides, les scolasticides, sans oublier les crimes les plus répandus et les plus « banals » : les féminicides et les crimes contre les enfants. Ce numéro comporte des analyses de certains de ces crimes contre les êtres humains et leurs organisations sociales. Les possibles criminels de guerre, les plausibles criminels contre l'humanité, qu'ils soient responsables d'États ou de bandes armées, doivent être jugés dans le respect du droit, dans des procédures contradictoire et publique.
Des soldats israéliens sont soupçonnés de torture et de viols contre des prisonniers palestiniens. L'extrême droite israélienne, des ministres – avec la complicité tacite du Premier ministre – proclament que ces soldats sont des héros. Voilà qui en dit long sur les effets de la colonisation sur les colonisateurs, sur la nature du pouvoir israélien.
L'usage et la justification d'actions criminelles ne sont pas seulement contraire au droit, elles détruisent notre part commune d'humanité, elles pèsent sur les luttes émancipatrices et les futurs possibles.
La fermeture des frontières, la construction de murs (en violation du droit international) pour empêcher les êtres humains de circuler entraînent chaque année des milliers de mort·es. Dans l'histoire du 20e siècle, la fermeture de certaines frontières et le refus d'accepter les exilé·es fut aussi le prélude à des massacres de masses, des génocides.
Il ne faut pas oublier le sinistre Mur de Berlin érigé pour empêcher la population de la RDA de fuir la dictature stalinienne que certain·es considèrent encore comme « socialiste ».
Les choix démocratiques, les souverainetés des communautés, dans le respect des autres groupes humains, les possibles émancipateurs impliquent des luttes résolues contre les exclusions, les inégalités, les stigmatisations, les haines des autres.
Certaines pratiques aujourd'hui éclairent d'une lumière rayonnante les possibles. Dans cette livraison, nous avons choisi d'aborder la question de l'eau. Nécessaire à toute vie, c'est un bien commun qui suppose donc une gestion commune. Nous pouvons pour ce faire regarder du côté de Valencia (État espagnol).
Loin des représentations déformées des médias, des espaces de solidarité sont en construction, parfois peu visibles, quelques fois davantage. Il convient d'en faire la publicité : un réseau international étudiant·es-travailleur·euses, La Via Campesina, la Marche mondiale des femmes, les soutiens aux réfugié·es et aux migrant·es et des milliers d'autres pratiques qui préfigurent aujourd'hui un autre avenir…
Qu'est-ce qu'une paix juste et durable ? Une chose est sûre cela ne peut être quelques arrangements secrets imposés par un impérialisme envahisseur, un colonisateur violant les droits des êtres humains ou un voisin étatique dominant.
Juste et durable, implique de ne pas détourner les yeux des questions nationales : en Palestine, au Kurdistan, au Sahara occidental, en Kanaky, à Mayotte…
Le cadre de la revue a été expliqué dans le numéro 0
Comment élargir à d'autres sujets ? À l'occasion des élections au Parlement européen et à l'Assemblée nationale de l'État français, nous proposons un cahier, un « Parti pris ». Des prises de position engagées mais non polémiques.
D'autres « Parti pris » pourront être envisagés, en numéros spéciaux séparés et toujours téléchargeables gratuitement. Cela permettrait de regrouper des textes sur un thème, un pays, etc. Éventuellement plus ouvert aux contradictions, aux discussions mais sans insultes ni délirantes fantaisies, faut-il toujours le préciser ? N'hésitez pas à faire des suggestions.
Le refus du campisme – l'ennemi de mon ennemi rebaptisé ami –, le refus d'opposer certaines luttes à d'autres ou de taire certaines contradictions –pour ne pas « désespérer Billancourt », comme il se disait hier –, le refus de la multipolarité positive cache-sexe des régimes « autoritaires » sont au cœur d'Adresses (Syrie, invasion russe en Ukraine, place réelle des Brics, mollarchie iranienne, suprémacisme hindou, néolibéralisme et impérialisme, colonialisme français, etc.). Des positionnements réactionnaires de nature purement pavlovienne circulent aujourd'hui à propos des élections au Venezuela.
Avant de discuter du rejet des candidatures par un pouvoir en place (comment ne pas penser à la Russie, à l'Iran, sans oublier les pays où les oppositions sont interdites), des fraudes électorales, de la contestation des résultats, des proclamations antidémocratiques comme celles de Donald Trump aux États-Unis, nous tenons à rappeler que nous avons applaudi lorsque le Front sandiniste de libération nationale, au Nicaragua, a reconnu sa défaite électorale en février 1990.
Une leçon foulée aujourd'hui aux pieds par ce même Daniel Ortega et par bien d'autres, toujours plus accrochés au pouvoir qu'aux vertus vitales de la démocratie.
[1] Pierre Madelin, « Des pensées décoloniales à l'épreuve de la guerre en Ukraine », Adresses, n°2, 1er mai 2024.
Didier Epsztajn, Michel Lanson, Patrick Silberstein
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le viol - Anatomie d’un crime, de Lucrèce à #MeToo
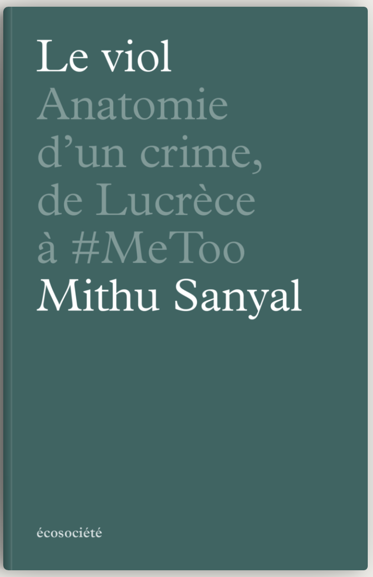
Pour la première fois traduite en français, la journaliste et autrice allemande Mithu Sanyal renverse toutes les opinions reçues sur le viol et nous offre un essai appelé à devenir un classique du féminisme.
Notre façon de parler du viol et de le penser en dit long sur nos sociétés et sur les rapports de genre. De la figure de Lucrèce dans la Rome antique à la vague #MeToo, que révèle notre façon d'aborder le viol ? Au moyen d'une analyse historique, sociale, juridique et féministe, Mithu Sanyal montre que notre regard sur ce crime est teinté de stéréotypes de genre et de racisme. En effet, quand nous pensons aux violeurs, pourquoi pensons-nous aux étrangers dans les ruelles sombres, plutôt qu'aux oncles, aux maris, aux prêtres ou aux copains ? Et qu'entendons-nous par la culture du viol ?
Plongeant dans certaines histoires médiatiquement célèbres (Weinstein, Polanski, Trump, etc.), elle déconstruit le traitement du viol dans l'espace public. Dans la lignée de Virginie Despentes et de bell hooks, Mithu Sanyal plaide pour l'autonomisation des femmes (et des hommes victimes d'agression) dans leur vécu, leurs limites et l'expression de leur consentement. Expérience émancipatrice, la lecture de ce livre, fort documenté, ne laissera personne indifférent.
Née d'une mère polonaise et d'un père indien au début des années 1970, Mithu Sanyal est une docteure en études culturelles, autrice et journaliste allemande. Militante féministe, conférencière spécialiste des questions de genre et chargée de cours dans différentes universités, elle écrit notamment pour l'hebdomadaire indépendant Der Spiegel, The Guardian et Vice. Ses livres ont été traduits en plusieurs langues, notamment en anglais et en espagnol.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les autonomes d’hier à aujourd’hui Chronologie, débats et analyse
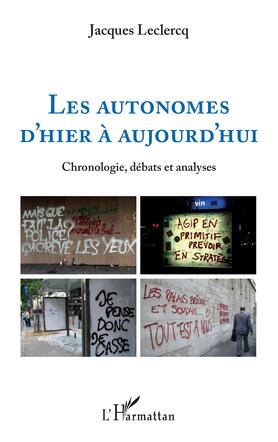
L'auteurr, chercheur indépendant spécialiste des ex-trêmes politiques, présente un document permettant de mieux appréhender la réalité d'une mouvance certes très minoritaire, mais qui a résisté à l'érosion du temps depuis près d'un demi-siècle.
Outre des repères historiques actualisés, les débats au sein de l'Autonomie sont retranscrits à l'aide de nom-breux textes, abordant notamment les thèmes de la vio-lence, des cortèges de tête, du machisme ou des rapports avec les médias.
Le lecteur découvrira également que les violences exer-cées le 1er mai 2021 contre des syndicalistes de la CGT viennent de loin.
Un ouvrage indispensable pour cerner une galaxie complexe, qui a su diversifier ses interventions au-delà de ses pratiques émeutières. Elle est présente dans les
luttes écologistes, antifascistes, contre les grands projets « inutiles » et la précarité, défendant les mal-logés, migrants et sans-papiers, active dans le courant féministe
et homosexuel ainsi que dans les luttes sociales.
Jacques Leclercq, 67 ans, est un ancien formateur. Il a publié neuf ouvrages chez L'Harmattan.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« Un jour meilleur viendra » : poésie des femmes Afghanes migrantes

Capire partage la poésie des femmes afghanes qui ont dû quitter leur patrie. L'une des premières politiques mises en œuvre par le Taliban a été l'interdiction de la poésie et des arts. La poétesse Somaia Ramish nous a parlé du paradoxe de migrer pour échapper à une guerre. Zuzanna Olszewska explique comment la poésie des personnes réfugiées des années 1980 a ouvert la voie à une poésie lyrique plus subjective.
En août 2021, le Taliban a envahi Kaboulet a repris le contrôle du gouvernement en Afghanistan. L'avancée du groupe était annoncée depuis 2015, lorsque les Talibans ont pris le contrôle de leur première province après leur défaite supposée en 2001. Actuellement, plus de 90% des Afghans souffrent d'insécurité alimentaire, de manque de liberté d'organisation et d'expression, de difficultés d'accès à l'éducation, à la santé, à l'eau potable et au travail. Pendant ce temps, chaque jour, des personnes fuient leurs maisons et, en situation de danger, traversent les frontières vers des pays voisins pour tenter d'obtenir des visas humanitaires dans différentes parties du monde ou, encore, se rendre irrégulièrement en Iran, en Turquie et, éventuellement, en Europe.
Outre le démantèlement favorisé par la politique fondamentaliste des Talibans, le peuple Afghan a également été confronté récemment à de graves catastrophes naturelles dans 33 de ses 34 provinces. Depuis le 10 janvier 2024, plus de 166 mille personnes ont été touchées par des tremblements de terre, des inondations, des sécheresses, des glissements de terrain et des avalanches, tandis que trois décennies de guerre épuisent à la fois les communautés et la nature environnante.
Les guerres rendent impossible de continuer à vivre sur le territoire, en raison de la violence, de la contamination des sols, de la pauvreté, entre autres. Comme dernière alternative, les gens se déplacent à la recherche d'une vie dans la dignité. Les personnes fuyant des conflits violents sont considérées par les gouvernements d'autres pays comme des chiffres qui doivent temporairement vivre sur leur territoire sans droits, comme une main-d'œuvre bon marché, ou qui doivent être barrées aux frontières, parfois même assassinées en essayant de les franchir. Avec la militarisation des frontières et le manque d'intégration au sein des pays d'accueil, les personnes migrantes sont privées de leur propre autonomie.
L'une des premières politiques mises en œuvre par le Taliban a été l'interdiction de la poésie et des arts. Écrire de la poésie est interdit en Afghanistan depuis que les talibans ont pris le pouvoir. Pour les femmes, la situation est encore pire : la pratique est considérée comme honteuse et peut entraîner des coups et même la mort. Les femmes ne peuvent même pas marcher librement sous le régime Taliban ; elles doivent être accompagnées d'un mahram, un membre masculin de la famille. Ainsi, la poésie est un outil important pour la justice sociale, surtout à un moment où il est nécessaire d'imaginer de nouvelles possibilités d'intégration et de coexistence.
La poésie orale reflète les expériences de vie des communautés, s'adaptant aux dynamiques locales et régionales. Il existe une histoire riche et diversifiée de la poésie parmi les Tadjiks, les Hazaras, les Ouzbeks, les Aimaq, les Turkmènes, les Baloutches, les Nuristanis, les Sadates, les Kirghizes et les Arabes, avec leurs traditions. Dans la poésie populaire Afghane, les femmes sont des écrivaines et des créatrices actives. Les femmes Afghanes ont utilisé la poésie pour se rebeller, exprimer les inégalités et aussi comme outil de communication du mouvement féministe.
Dans La Perle du Dari : Poésie et personnalité chez les jeunes Afghanes en Iran [The Pearl of Dari : Poetry and Personhood among Young Afghans in Iran] (2015), Zuzanna Olszewska explique comment la poésie des personnes réfugiées des années 1980 a ouvert la voie à une poésie lyrique plus subjective, entraînant une prolifération de formes, de genres et de styles, avec expérimentation, critique, questionnement et découverte des identités. Il existe des collectifs et des plateformes virtuelles qui rassemblent des textes de femmes afghanes, tels que Femmes Écrivaines Libres [Free Women Writers], Projet d'écriture des femmes afghanes [Afghan Women'sWriting Project], Filles de Plaza [Plaza Girls], Poésie de la Chambre Rouge [Red RommPoetry] et la Maison BaamDaad de la poésie en exil [BaamDaad House of Poetry in Exile].
La poétesse Somaia Ramish nous a parlé du paradoxe de migrer pour échapper à une guerre : « Bien que nos corps soient en dehors de la géographie de la guerre, nos âmes restent marquées par la guerre ». Somaia souligne également l'importance de la poésie populaire pour sa mère lorsqu'elle avait le mal du pays : « Ces poèmes traditionnels ont été transmis de génération en génération. Cette poésie n'est pas écrite dans les livres, mais elle existe dans le cœur de nos mères et grands-mères ». Dans le poème ci-dessous, Somaia Ramish écrit sur la « géographie de la guerre » :
Porte des poèmes comme armes
Porte des poèmes comme armes – la géographie de la guerre vous appelle pour se munir.
L'ennemi ne donne aucune alerte,
contre-alerte,
couleurs
signes
symboles ! Porte des poèmes comme armes –
chaque instant est chargé
avec des bombes
balles
explosions
sons de mort –
mort et guerre
ils ne suivent pas les règles
tu peux transformer tes pages en drapeaux blancs
mille fois
mais ravale tes mots, ne dis rien d'autre.
Porte tes poèmes –
ton corps –
tes pensées –
comme des armes.
Les écoles de guerre se lèvent
à l'intérieur de toi.Peut-être que toi
tu seras la prochaine.
Pour Somaia, son pays fait partie de son existence, et « le désir de rentrer chez elle est enraciné dans son cœur ». Selon elle, la poésie peut créer de nouvelles réalités pour une maison qui a été détruite. L'espoir de voir à nouveau l'Afghanistan comme un lieu de liberté est présent dans la poésie de différentes manières. Un poème écrit par une autre auteure,Hosnia Mohseni, expose cela. Il rend hommage à l'écrivaine du 10ème siècle Rabia Bhalki, reliant passé et futur. Rabia était la première femme poète persane enregistrée, qui a été tuée par son frère pour être tombée amoureuse et pour avoir écrit de la poésie.
Un jour meilleur viendra
Sœur, Le jour viendra où toi et moi volerons
Sur les fières montagnes de notre terre.
Il viendra un jour où les portes ne seront plus verrouillées
Et tomber amoureuse ne sera pas un crime.
Toi et moi laisserons nos cheveux voler,
Nous porterons des robes rouges,
Et enivrerons les oiseaux
De nos vastes déserts
Avec nos rires.
Nous danserons parmi les tulipes rouges de Mazar
En mémoire de Rabia,
Ce jour n'est pas loin.
Il est peut-être au coin de la rue.
Il est peut-être dans notre poésie.
Clarice Rangel Schreiner, Brésilienne vivant en Turquie, est militante de la Marche Mondiale des Femmes.
Traduit du portugais par Andréia Manfrin Alves
https://capiremov.org/fr/culture-fr/un-jour-meilleur-viendra-poesie-des-femmes-afghanes-migrantes/
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Tesla sape les conditions de travail et brise les grèves : exemple en Suède
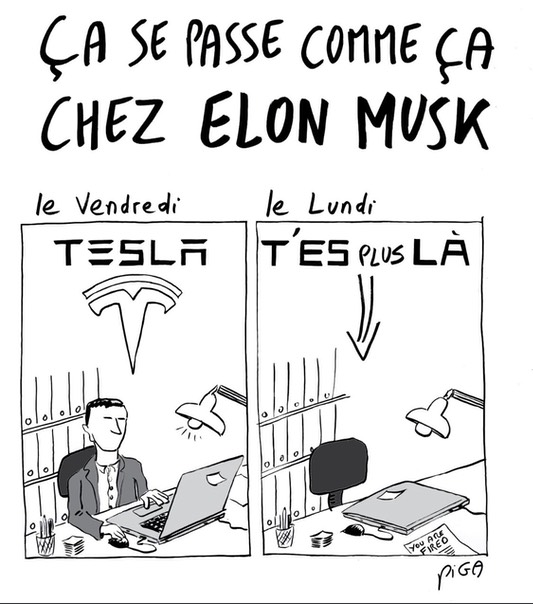
L'entreprise d'Elon Musk refuse de dialoguer avec les syndicats en Suède. C'est pourtant d'usage dans le pays. Lorsque les salariés ont fait grève, Tesla y a envoyé des employés étrangers. Cette pratique risque d'être reproduite ailleurs en Europe.
Photo et article tirés de NPA 29
Un jeune homme, assis sur le siège conducteur d'une voiture à l'arrêt, met ses mains sur le volant, le regard au loin. Puis il examine l'habitacle, touche le cuir, se penche vers le large écran de contrôle. Son ami fait le tour du véhicule bordeaux, l'observe sous chaque couture, puis revient vers le vendeur.
Les trois hommes continuent la discussion à deux pas de la Tesla Y. Ce jour-là, dans le « store », quatre conseillers sont à la disposition des curieux et futurs acheteurs. Le parking devant est rempli de voitures Tesla, et émanent de l'atelier des bruits de réparation.
Chez ce vendeur de Tesla, dans le sud de la Suède, en cette fin de mois de juin, il n'y a plus une trace du bras de fer qui oppose l'entreprise d'Elon Musk et les syndicats suédois. La banderole « conflit » accrochée aux grilles a disparu, tout comme les syndicalistes en gilets jaunes fluo du piquet de grève. Dans le magasin, on admet à demi-mot avoir eu « quelques soucis avec la réception des plaques d'immatriculation, au début ». Aucune mention explicite des grévistes, en lutte depuis le 27 octobre 2023.
Huit mois de grève
Depuis plus de huit mois, le syndicat suédois IF Metall se bat avec Tesla pour que l'entreprise états-unienne signe la convention collective du secteur. En Suède, les conventions collectives organisent le monde du travail. La loi suédoise ne prévoit pas de salaire minimum interprofessionnel. Ce sont les conventions collectives qui les définissent, par branche. Traditionnellement, chaque entreprise négocie avec les syndicats les conditions de travail et de rémunération.
« Tesla met en péril le cœur du système suédois »
Mais voilà : l'entreprise d'Elon Musk a refusé de négocier avec les représentants des salariés un accord pour ses près de 300 employés. « Le syndicat suédois IF Metall n'a eu d'autre choix que de faire grève : la position de Tesla met en péril le cœur du système suédois de négociation collective », explique l'universitaire suédois Christer Thörnqvist, spécialiste des grèves et du monde du travail.
« La principale raison pour laquelle IF Metall entreprend une action industrielle chez Tesla est de garantir à nos membres des conditions de travail décentes et sûres, lit-on sur le site du syndicat. Pendant une longue période, nous avons tenté de discuter avec Tesla de la signature d'une convention collective, mais sans succès. Aujourd'hui, nous ne voyons pas d'autre solution que de mener une action syndicale. »
- Certains salariés sont encore en grève. « Je resterai en grève pendant des mois ou bien des années pour avoir cette convention collective », témoigne une travailleuse interrogée par Equal Times dans un reportage à la rencontre des salarié·es en lutte. « IF Metall dispose de fonds de grève très importants et pourrait ainsi poursuivre la grève pendant une longue période », précise Christer Thörnqvist.
Grèves de solidarité
De son côté, concernant la situation de ses travailleurs et travailleuses, « Tesla affirme que leur salaire de départ est bien supérieur au salaire minimum prévu dans la convention collective et que leurs conditions sont globalement comparables ou meilleures que celles de l'accord de l'industrie automobile », rapporte le média suédois Dagens Arbete. IF Metall répond que tout cela est faux.
Ces « soucis » avec les plaques auxquels le vendeur Tesla fait référence sont une des conséquences des grèves de solidarité organisées par d'autres syndicats. La poste suédoise a refusé d'acheminer les plaques d'immatriculation aux ateliers Tesla dans le pays, bloquant momentanément la vente de véhicules. Des électriciens ont refusé de réparer les bornes de recharge Tesla. Des salariés d'autres secteurs, comme les éboueurs, les dockers ou transporteurs, ont pris part à des grèves dites « de sympathie ».
Des syndicats des pays voisins – Danemark, Norvège et Finlande – se sont aussi joints à la lutte, empêchant les véhicules Tesla de transiter par leurs ports. « Le fait que nous nous appuyons sur des conventions collectives et que les syndicats se soutiennent mutuellement sont des éléments essentiels du modèle de marché du travail nordique », affirmait mi-juillet Ismo Kokko, président du syndicat finlandais AKT, à Reuters.
Briseurs de grèves, un problème européen
Si, au fil des mois, les chiffres de participation à la grève ont inévitablement baissé, cette lassitude ne suffit pas à expliquer la reprise quasi-intégrale de l'activité de Tesla en Suède. « L'une des principales raisons pour lesquelles la grève n'a pas eu l'impact escompté sur Tesla est sans aucun doute le recours aux briseurs de grèves », affirme le chercheur Christer Thörnqvist.
L'entreprise a eu recours à un subterfuge, permis par la législation européenne : elle a « détaché » des travailleurs d'autres pays européens pour remplacer les grévistes. Jonas Sjöstedt, ancien leader du Parti de gauche (Vänsterpartiet) suédois et désormais eurodéputé, l'a vu de ses propres yeux dans sa ville natale, Umeå.
« Nous avons vu des gens arriver en taxi. Ils venaient de l'aéroport et parlaient polonais, néerlandais, allemand »
« En tant qu'ancien membre du syndicat, j'ai demandé à être sur le piquet de grève à Umeå à plusieurs reprises, raconte l'ancien syndicaliste de chez Volvo. Une fois, alors que nous étions devant l'atelier Tesla, nous avons vu des gens arriver en taxi. Ils venaient de l'aéroport et parlaient polonais, néerlandais ou allemand. Ils étaient venus pour travailler. Il est devenu évident que Tesla utilise systématiquement des briseurs de grève. »
« Tesla, en faisant venir des briseurs de grève d'autres pays européens, viole une règle d'or acceptée par les acteurs du marché du travail suédois depuis plus de 80 ans, retrace le chercheur Christer Thörnqvist. L'accord dit de Saltsjöbaden, conclu en décembre 1938, constitue un point de repère pour le modèle suédois. Pour garantir la paix sur le marché du travail, les syndicats ont accepté de centraliser la décision de l'utilisation de la grève et, en retour, la confédération des employeurs a accepté de ne plus avoir recours à des briseurs de grève. »
Cette lutte dépasse les frontières suédoises, et va même au-delà des pays nordiques. « Si les syndicats suédois obtiennent gain de cause, les travailleurs du monde entier pourront négocier des accords collectifs avec Tesla. C'est pourquoi ce conflit est si important », affirme Jonas Sjöstedt.
Jusqu'ici, l'entreprise n'a pas cédé aux revendications de ses employés, où que ce soit dans le monde. « Même si cela n'est pas dit haut et fort, il est clair que Tesla craint qu'un accord avec les syndicats suédois ne sape l'autorité de l'entreprise dans d'autres pays européens », complète Christer Thörnqvist, maître de conférences à l'Université de Skövde.
Une lutte vitale
« Tesla est un cas particulier car elle appartient à Elon Musk, l'une des personnes les plus riches du monde et peut-être la personne la plus égocentrique du monde. Je pense qu'il déteste les syndicats », avance le politicien de gauche Jonas Sjöstedt. L'homme a donc décidé de faire du problème des briseurs de grève son combat de la campagne pour les européennes. Aujourd'hui élu au Parlement européen, il compte bien tenir ses promesses.
Avec ses alliés de gauche finlandais et danois, son parti à envoyé le 27 juin une lettre au commissaire européen en charge du travail, Nicolas Schmit. « Nous demandons à la Commission européenne de confirmer et de clarifier que les entreprises qui font l'objet d'une action syndicale en cours ne devraient pas être autorisées à recourir à des dispositifs transnationaux ou de sous-traitance impliquant le détachement de travailleurs d'un autre État membre sur le territoire de l'État membre où l'entreprise fait l'objet d'une action syndicale », écrivent-ils dans le courrier signé du logo rouge de chacun des trois partis.
Tesla est « un exemple de violations des droits de négociation collective dans plus de la moitié des pays européens », selon la Confédération européenne des syndicats. Mais aussi une menace pour la nature : l'agrandissement de sa « gigafactory » près de Berlin menace 50 hectares de forêt. Sur place, des activistes se battent contre la déforestation, en parallèle d'une lutte syndicale pour les conditions de travail dans l'usine.
« Elon Musk agit ici comme si c'était le Far West », témoignait pour Basta ! un élu régional du parti de gauche Die Linke. La lutte suédoise ressemble à celle de son voisin européen. « Il est vital que Tesla ne s'en tire pas si facilement, conclut l'ancien syndicaliste suédois Jonas Sjöstedt. Cette lutte pose une question plus large autour des emplois de la transition écologique. Seront-ils de bons emplois protégés et syndiqués, ou des jobs sans droits ? »
Emma Bougerol 25 juillet 2024
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Uber une nouvelle fois condamné, les droits des travailleurs reconnus !

Le 22 juillet 2024, en coopération avec la Cnil, l'autorité néerlandaise de protection des données a prononcé une amende record de 290 millions d'euros à l'encontre des sociétés Uber B.V. et Uber Technologies INC. pour avoir transféré des données personnelles des chauffeurs VTC collaborant sur leur plateforme hors de l'Union européenne, et notamment vers les Etats-Unis, sans garanties suffisantes, sur le fondement de l'article 44 du RGPD.
Tiré de Entre les lignes et les mots
Parmi les données qui ont été transférées illégalement, des données de localisation, des documents d'identité et des données de santé !
Les 170 chauffeurs à l'initiative de cette plainte, ainsi que Brahim Ben Ali du syndicat INV-FO et la LDH (Ligue des droits de l'Homme), qui l'ont portée, se réjouissent de cette condamnation qui, par son montant exceptionnel, témoigne de la gravité des faits sanctionnés.
Il s'agit de la seconde plainte engagée contre Uber, la première ayant abouti à la condamnation de la plateforme à 10 millions d'euros, en janvier 2024, pour ne pas avoir suffisamment informé les chauffeurs VTC du sort de leurs données personnelles, massivement collectées sur la plateforme et de leurs droits d'accès, sur le fondement des articles 12 et 13 du RGPD. Deux autres plaintes sont encore à l'instruction, concernant notamment la déconnexion automatique des chauffeurs, sans intervention humaine, également attentatoire au RGPD.
« La LDH se félicite de cette condamnation exemplaire, après celle de janvier 2024, qui reconnait le droit des travailleurs Uber, elle souhaite qu'elle serve de « moteur » à toutes les autres victimes des « Big Tech » prouvant ainsi que le droit peut protéger les citoyens ou résidents européens » a déclaré Nathalie Tehio sa présidente. Il faut cependant préciser qu'Uber a interjeté appel de ces deux décisions.
Brahim ben Ali déclare : « En plus de violer le droit des travailleurs, sans les salarier, Uber viole leurs données personnelles aux fins de maximiser ses profits et de nourrir l'algorithme ».
Jérôme Giusti, avocat de la LDH et des plaignants, précise : « Il s'agit d'une première mondiale. A ma connaissance, aucun autre Gafam n'a été condamné pour avoir transféré les données personnelles des Européens vers les Etats-Unis ou ailleurs dans le monde alors que tout le monde sait que c'est la règle ! ».
Le syndicat INV-FO et la LDH (Ligue des droits de l'Homme) envisagent d'engager une action de groupe contre Uber pour permettre aux 40 000 à 50 000 chauffeurs en France, tous victimes de ces mêmes infractions, d'être indemnisés au regard des préjudices subis.
Paris, le 26 août 2024
https://www.ldh-france.org/uber-une-nouvelle-fois-condamne-les-droits-des-travailleurs-reconnus/
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Alerte ! Aux employeurs du privé & du public
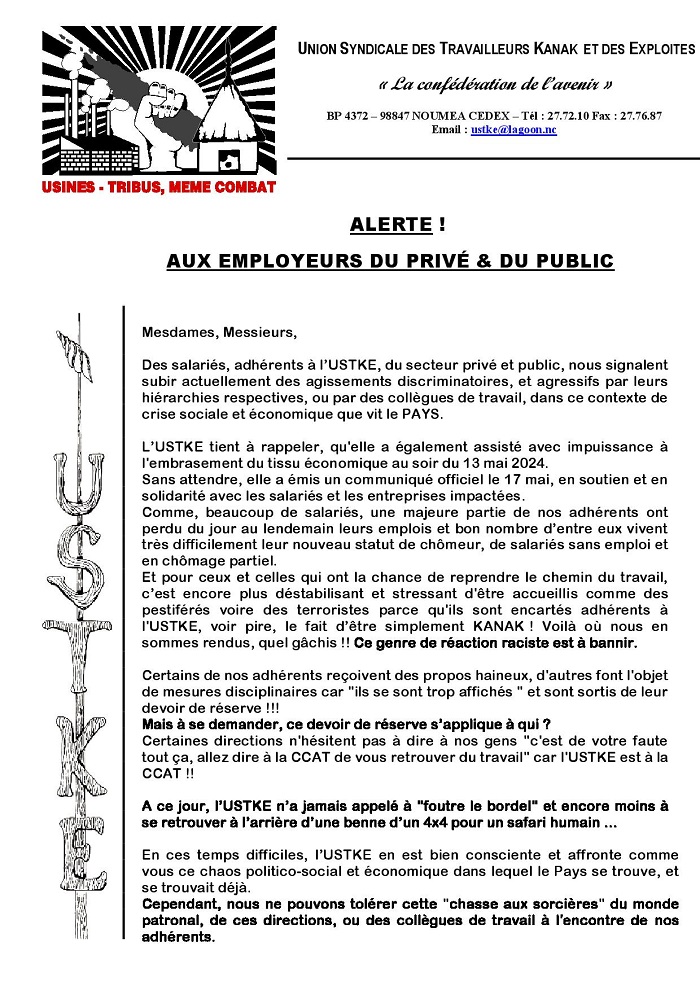
La sonnette d'alarme a été tirée sans relâche par l'USTKE depuis des années, mais par vous aussi camarades, de ces inégalités sociales criantes, de cette jeunesse marginalisée qui s'est exprimée aujourd'hui, et qui n'a pas trouvé un écho considérable, aux attentes d'une partie de la population vivant dans une grande précarité.
Tiré de Entre les lignes et les mots
Mesdames, Messieurs,
Des salariés, adherents à l'USTKE, du secteur prive et public, nous signalent subir actuellement des agissements discriminatoires, et agressifs par leurs hiérarchies respectives, ou par des collègues de travail, dans ce contexte de crise sociale et économique que vit le PAYS.
L'USTKE tient à rappeler, qu'elle a également assisté avec impuissance à l'embrasement du tissu économique au soir du 13 mai 2024. Sans attendre, elle a émis un communiqué officiel le 17 mai, en soutien et en solidarité avec les salariés et les entreprises impactées. Comme, beaucoup de salariés, une majeure partie de nos adhérents ont perdu du jour au lendemain leurs emplois et bon nombre d'entre eux vivent très difficilement leur nouveau statut de chômeur, de salariés sans emploi et en chômage partiel. Et pour ceux et celles qui ont la chance de reprendre le chemin du travail, c'est encore plus déstabilisant et stressant d'être accueillis comme des pestiférés voire des terroristes parce qu'ils sont encartés adhérents à ‘USTKE, voir pire, le fait d'être simplement KANAK ! Voilà où nous en sommes rendus, quel gâchis !! Ce genre de réaction raciste est à bannir.
Certains de nos adhérents reçoivent des propos haineux, d'autres font l'objet de mesures disciplinaires car « ils se sont trop affichés » et sont sortis de leur devoir de réserve !!!
Mais à se demander, ce devoir de réserve s'applique à qui ?
Certaines directions n'hésitent pas à dire à nos gens « c'est de votre faute tout ça, allez dire à la CCAT de vous retrouver du travail » car l'USTKE est à la ССАТ !!
A ce jour, l'USTKE n'a jamais appelé à « foutre le bordel » et encore moins à se retrouver à l'arrière d'une benne d'un 4×4 pour un safari humain …
En ces temps difficiles, l'USTKE en est bien consciente et affronte comme vous ce chaos politico-social et économique dans lequel le Pays se trouve, et se trouvait déjà.
Cependant, nous ne pouvons tolérer cette « chasse aux sorcières » du monde patronal, de ces directions, ou des collègues de travail à l'encontre de nos adhérents.
Pour certains, faire des raccourcis après notre journée de grève cadrée de 24 heures du 13 mai, en pointant l'USTKE comme être en partie responsable de ce contexte actuel, demeure un raisonnement primaire !
Aussi, c'est surtout nous méconnaître et nous dénigrer, ne pas reconnaître son sens de responsabilité, de discipline et du devoir que s'est toujours fixé notre structure syndicale, en témoigne d'ailleurs notre implication totale et sincère par notre retour au sein du dialogue social en 2012.
Par ailleurs, nous tenons à préciser que bon nombre de nos adhérents comme d'autres salariés au péril de leurs vies, se sont improvisés et mobilisés en équipe de gardiennage jour et nuit auprès des entreprises dans tout le pays et continuent aujourd'hui. Il ne faut surtout pas mésestimer la réalité dans laquelle vivent nos populations, dont tous, nous, forces vives de ce pays, politiques, et acteurs économiques avons un devoir et une responsabilité collective. La sonnette d'alarme a été tirée sans relâche par l'USTKE depuis des années, mais par vous aussi camarades, de ces inégalités sociales criantes, de cette jeunesse marginalisée qui s'est exprimée aujourd'hui, et qui n'a pas trouvé un écho considérable, aux attentes d'une partie de la population vivant dans une grande précarité.
Aujourd'hui, nous ne pouvons faire qu'ensemble et non les uns contre les autres. Ce pays et nous aussi, allons faire face et s'inscrire dans cette phase de reconstruction en ne reproduisant pas les mêmes déséquilibres, pour un avenir serein, pour une société plus juste, et pour nos générations futures.
Nous demandons que ces agissements à l'égard de nos adhérents et certainement les vôtres aussi, cessent, et nous faisons appel à une responsabilité commune, objective et bienveillante pour apaiser et désamorcer ces tensions, dont les entreprises et les établissements publics n'ont aucunement besoin en ce moment.
Nous serons très vigilants sur les relations collectives et individuelles que vivront nos adhérents et nous comptons sur tout le monde, l'ensemble des salariés, vous, employeurs et directions à plus d'indulgence.
« Préservons en priorité nos énergies pour affronter ensemble cette crise économique et sociale. »
« Inscrivons-nous dans ce pari de l'intelligence collective et humaine. »
A Nouméa, le 10 juillet 2024 Pour le Bureau Confédéral, La Présidente,
Mélanie Atapo
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :












