Presse-toi à gauche !
Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...
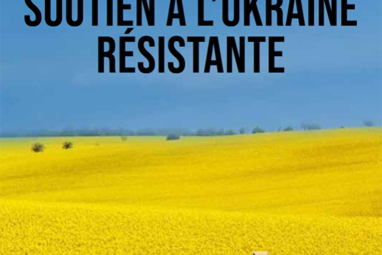
Soutien à l’Ukraine résistante

Les Brigades éditoriales de solidarité ont été créées au lendemain de l'agression de la Russie poutinienne contre l'Ukraine. Elles regroupent les éditions Syllepse (Paris), Page 2 (Lausanne), M Éditeur (Montréal), Spartacus (Paris) et Massari (Italie), les revues New Politics (New York), Les Utopiques (Paris) et ContreTemps (Paris), les sites À l'encontre (Lausanne) et Europe solidaire sans frontières, les blogs Entre les lignes entre les mots (Paris) et Utopia Rossa, ainsi que le Centre Tricontinental (Louvain-la-Neuve) et le Réseau syndical international de solidarité et de luttes.
Pour télécharger cliquer sur ce lien
Table des matières
Hasards objectifs, humeurs, divagations et nausées en 33 tours, et quelques images…
MARIANA SANCHEZ ET PATRICK SILBERSTEIN - 5
Carnet de bord sur les batailles de Koursk et de Pokrovsk, etc.
ANTOINE RABADAN - 13
Comment des conditions extrêmes ont poussé les Ukrainiens à des « transformations sociales » pour leur survie commune
ALEXANDER KITRAL - 34
PENDANT LA GUERRE LA LUTTE CONTINUE
Chronique des affaires courantes - 44
Contre les fermetures d'hôpitaux
SOIS COMME NINA - 49
Victoire sur le droit à la rémunération
SOIS COMME NINA - 50
Une médecin de l'hôpital pour enfants de Kyiv raconte
PROPOS RECUEILLIS PAR SOIS COMME NINA - 51
Mineurs de Lviv : « Nous ne sommes pas des esclaves »
ENTRETIEN AVEC TETIANA HNATIVA KARETNIKOVA POUR
TRUDOVA HALYCHYNA PAR IHOR VASYLETS ET MAKSYM CHUMAKOV - 53
Les mineurs de la région de Lviv exigent une solution à leurs problèmes urgents
CONFÉDÉRATION SYNDICALE KVPU
59
Des des actes répréhensibles dans la Légion internationale ukrainienne qui semble insensible au changement
ANNA MYRONIUK - 61
Un syndicat de travailleurs migrants russophones en Suède
VOLODYA VAGNER - 76
FÉMINISMES
Pourquoi nous fermons notre centre d'accueil pour femmes déplacées à Lviv
L'ATELIER FÉMINISTE - 82
4
Les autres sont comme nous, un nouveau zine féministe à Lviv
PATRICK LE TRÉHONDAT - 87
Enfin des gilets pare-balles pour les soldates ! - 93
RETOUR VERS LE FUTUR
Les Ukrainiens aux côtés du peuple vietnamien - 96
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Le plus important syndicat du Royaume-Uni aux côtés de l'Ukraine - 98
Le syndicat étudiant Priama Diia à l'origine d'un réseau syndical international
PATRICK LE TRÉHONDAT ET CHRISTIAN MAHIEUX - 101
Déclaration commune - 101
Indépendance année 33 Paris - 106
ÉCLAIRAGES
Pourquoi faut-il enterrer le culte de Bandera ?
BORYS OGLAVENKO ET DMYTRO MATCHNYK - 112
Stopper la main de Poutine et de ses alliés
LA CONFÉRENCE DE HANNAH PEREKHODA À L'UNIVERSITÉ D'ÉTÉ DU NPA, PRÉSENTÉE PAR ROMAIN DESCOTTES - 119
BOÎTE ALERTE
Hôpital Pavlov de Kyiv : la fondation J.R. et Ukraine CombArt joignent leurs forces pour créer une œuvre d'art participative
rendant hommage aux personnels hospitaliers
SOPHIE BOUCHET-PETERSEN - 123
Déshumanisation : leurs mots pour la dire (des soldats russes parlent sans filtre à leurs proches)
SOPHIE BOUCHET-PETERSE
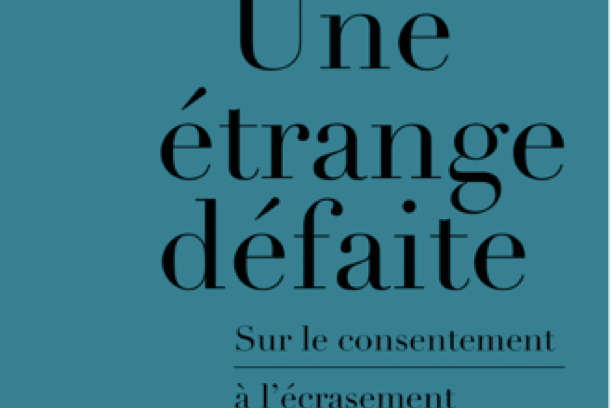
Comment on fabrique le consentement au génocide à Gaza

Chercheur en anthropologie, professeur au Collège de France et à l'université de Princeton, Didier Fassin vient de publier aux éditions La Découverte un livre salutaire et courageux sur le consentement – et dans bien des cas le soutien actif – des élites occidentales à la guerre génocidaire que mène l'État d'Israël contre les Palestinien-nes de Gaza et au nettoyage ethnique qui s'opère dans le même temps en Cisjordanie. Nous vous en proposons un extrait ici.
Le fait qui, sans doute, hantera le plus durablement les mémoires, y compris peut-être en Israël, est la manière dont l'inégalité des vies a été donnée à voir sur la scène de Gaza et dont elle a été ignorée par les uns, légitimée par les autres[1]. Que, dans le monde, cette injustice suprême – qu'une vie a moins de valeur qu'une autre – soit largement distribuée est une réalité, qui se manifeste en temps de paix comme en temps de guerre[2].
Mais il n'est guère d'exemple où les gouvernements des pays occidentaux en détournent aussi ostensiblement le regard jusqu'à lui trouver une justification et réduire au silence les voix qui la critiquent. Les interventions militaires conduites par Israël à Gaza ont pourtant donné lieu aux écarts de mortalité des populations civiles les plus élevés des conflits survenus dans le monde au XXIe siècle.
Durant l'opération « Plomb durci » de 2008, selon les données recueillies par l'organisation israélienne de droits humains B'Tselem, le ratio des victimes était de 255 pour 1 parmi les civils, tandis que 318 enfants étaient tués à Gaza et aucun en Israël[3]. Durant l'opération « Bordure protectrice » de 2014, selon les chiffres de la commission d'enquête indépendante du Conseil des droits humains des Nations unies, ce ratio était de 244 pour 1 parmi les civils, cependant que 551 enfants étaient tués à Gaza et 1 en Israël[4].
Avec l'opération « Épées de fer » en cours, le nombre absolu de victimes civiles palestiniennes sera plusieurs dizaines de fois plus élevé que durant les interventions militaires précédentes. Après six mois de guerre, on comptait déjà près de 33 000 morts identifiés à Gaza, auxquels s'ajoutaient environ 10 000 autres dans les décombres des bâtiments détruits. Les estimations du nombre de civils parmi les victimes sont controversées, les Israéliens considérant, de manière jugée non plausible par des sources neutres, que tous les hommes tués, quel que soit leur âge, sont des membres du Hamas[5].
Si l'on se réfère à des évaluations plus vraisemblables, à la date du 7 avril ont été tués approximativement 42 fois plus de civils palestiniens que de civils israéliens[6]. Pour ce qui est des enfants, le ratio s'élève déjà à 420 pour 1[7]. On peut exprimer différemment cette disparité en se référant non pas au nombre absolu de décès, mais au taux de mortalité, de façon à tenir compte de la taille des populations de référence et ainsi mieux traduire l'ampleur des pertes humaines à l'échelle des sociétés concernées.
En procédant de cette façon, on constate que, rapporté à leur démographie respective, on dénombre parmi les civils tués 185 fois plus de Palestiniens que d'Israéliens. Pour ce qui est des enfants, le taux de mortalité est de 1 850 fois supérieur parmi les Palestiniens comparés aux Israéliens. Pour prendre la mesure de l'attaque du 7 octobre en Israël, on a dit qu'en proportion du nombre d'habitants des deux pays, elle représentait l'équivalent de quinze 11 Septembre aux États-Unis[8].
Si l'on prolonge la comparaison, on peut ajouter que le total des morts à Gaza au 7 avril 2024 correspond à plus de mille sept cents 11 Septembre. Relativement à la population de la France, la mortalité observée dans la bande de Gaza au 7 avril serait de plus d'un million de victimes. Cette macabre comptabilité ne restitue cependant qu'une partie de la réalité, qu'elle tend de surcroît à rendre abstraite. We Are Not Numbers est le nom d'un projet réalisé pour les enfants de Gaza depuis 2015 au sein de l'association Euro-Mediterranean Human Rights Monitor pour faire exister la voix des Palestiniens autrement qu'à travers les statistiques, car « les nombres sont impersonnels et souvent anesthésiants »[9].
Et ce sont des statistiques de mort, comme si la vie des Palestiniens ne pouvait être pensée qu'à travers sa suppression. Or l'inégalité la plus grande est probablement celle des vies en tant qu'elles sont vécues. L'expérience de beaucoup de Palestiniens, dans leur relation avec l'État d'Israël et ses représentants, est tout au long de leur existence une expérience d'exclusion, de discrimination, de rabaissement, d'empêchement, de destruction de leurs champs et de leurs maisons, de soumission à la violence et à l'arbitraire du pouvoir.
Pour utiliser un mot anglais évocateur, ils sont disposable, au double sens d'être à disposition – on peut les arrêter n'importe quand sans donner de raison, les incarcérer sans présenter de charges contre eux et, le cas échéant, s'en servir comme monnaie d'échange dans des négociations, une pratique validée par la Cour suprême israélienne – et d'être jetables – on peut les tuer ou les mutiler, généralement en bénéficiant d'un régime d'impunité, d'autant que le gouvernement israélien menace les autorités palestiniennes de représailles si des plaintes sont déposées devant la Cour pénale internationale[10].
Le procureur général de cette institution a d'ailleurs affirmé qu'il n'hésiterait pas à poursuivre celles et ceux qui « tentent d'empêcher, d'intimider ou d'influencer de manière indue » le travail des membres de la Cour, une référence implicite aux menaces adressées à celle qui l'avait précédé dans cette fonction lorsqu'elle a engagé une enquête sur les crimes de guerre commis contre les Palestiniens, menaces sur sa sécurité et celle de sa famille formulées par le chef des services secrets israéliens lui-même[11].
Un aspect de cette expérience a été analysé par la criminologue palestinienne Nadera Shalhoub-Kevorkian dans un texte sur l'« occupation des sens » à Jérusalem-Est, c'est-à-dire la manière dont les rapports de force s'insinuent dans les cinq sens des Palestiniens à travers des micro-agressions permanentes qui « colonisent » les corps[12]. On se souvient à cet égard de la police aspergeant les murs, les rues et les écoles des quartiers arabes de la Ville sainte d'une eau putride dont l'odeur était tellement infecte et persistante que les habitants ne pouvaient plus sortir, que les élèves voyaient leur scolarité interrompue, que la souillure s'insinuait dans les corps mêmes[13].
On sait aussi qu'en permanence, depuis plusieurs années, Gaza est survolée par des drones de surveillance et d'attaque, dont le bourdonnement lancinant représente une nuisance sonore permanente rappelant aux habitants leur condition de population dominée[14]. Mais de cette réalité, la plupart des grands médias occidentaux ne parlent presque jamais. Comme l'écrit le professeur étatsunien de littérature comparée Saree Makdisi, on a commencé à faire appel à des intellectuels palestiniens le 7 octobre pour leur demander de commenter l'attaque du Hamas, mais on n'a pas voulu les entendre sur ce qui s'était passé avant et sur ce qui s'est passé après[15].
On a souvent avancé que ce silence sur ce que vivaient les résidents de Gaza était dû à des difficultés d'accès, compte tenu du fait que l'armée israélienne tuait les journalistes palestiniens, interdisait la présence de leurs collègues étrangers en ne les laissant entrer dans Gaza qu'embarqués avec elle, et interrompait sporadiquement les communications des Palestiniens avec le monde extérieur. Des reportages étaient pourtant réalisés sur place, des témoignages recueillis, des images produites, que seuls les réseaux sociaux et les médias alternatifs présentaient sur leurs sites. En réalité, le silence des grands organes de presse tenait surtout à des choix éditoriaux que certains, dans les rédactions, me disaient déplorer.
Comme l'analyse l'association Acrimed, les principaux médias français ont manifesté une « compassion sélective »[16]. Ils ont rapporté les récits des otages israéliens libérés se plaignant d'avoir souffert de la faim pendant leur captivité dans Gaza assiégée sans mentionner l'origine de la pénurie alimentaire dont ils souffraient, mais ils n'ont pas évoqué les civils palestiniens relâchés des prisons et des camps d'Israël après y avoir été humiliés et torturés.
Ils ont rendu compte des peurs des écoliers israéliens près de la frontière avec le Liban, obligés de se réfugier dans des abris lorsque retentissent les sirènes, mais n'ont pas fait état des angoisses des enfants palestiniens de Gaza, qui ne disposent d'aucun lieu où se protéger des bombes qui détruisent des quartiers entiers. Ils ont interrogé des surfeurs israéliens sur la plage de Tel Aviv expliquant que cette activité apaise leur anxiété après l'envoi de drones et de missiles par l'Iran, mais ils se sont contentés d'une phrase pour rappeler simplement le nombre des morts palestiniens à Gaza, sans faire partager l'expérience des femmes qui ne peuvent plus allaiter et des enfants qui n'ont plus à manger[17].
Nombre de médias ont ainsi choisi d'humaniser les Israéliens plutôt que les Palestiniens. Ainsi ont-ils longuement rendu compte du « succès » de l'opération militaire visant à délivrer quatre Israéliens détenus dans un camp de réfugiés, le 8 juin 2024, et des manifestations de « joie » lors de leur accueil à Tel Aviv, en mentionnant simplement en fin de reportage le coût humain de l'intervention parmi les Palestiniens : 274 morts, dont 64 enfants et 57 femmes, et 700 blessés. Dans les médias officiels, on parlait de « libération des otages » ; dans les médias indépendants, l'épisode est connu comme le « massacre de Nuseirat »[18].
Le fait n'est pas nouveau et les reportages font depuis longtemps entendre la voix des premiers à l'exclusion de celle des seconds. D'ailleurs, Meta a supprimé des comptes Facebook et Instagram les messages rédigés par des Palestiniens ou des soutiens à leur cause, notamment lorsqu'ils faisaient état de violations des droits humains par l'armée israélienne, et ce, alors même qu'ils s'accompagnaient presque toujours de propos pacifiques[19].
D'une manière générale, on ne sait presque rien de la résistance ordinaire des Palestiniens face à l'adversité et de leur demande de vivre en paix. Il est pourtant un concept arabe par lequel il est usuel de définir leur réaction face aux épreuves de l'occupation et de l'oppression israéliennes : sumud, qui, comme l'a analysé notamment l'anthropologue Livia Wick, signifie leur ténacité, leur persévérance, leur capacité de continuer à vivre dignement[20].
Depuis le 7 octobre, l'attention sélective qui les a écartés de l'information n'a guère permis de les connaître autrement que comme combattants impitoyables ou victimes impersonnelles. On n'a pas voulu faire connaître leur désespoir d'avoir été abandonnés par la communauté internationale. Dans une lettre à leur direction, des journalistes de la BBC déploraient justement le parti pris de la présentation des faits et, en particulier, de la différence dans la manière de donner une dimension humaine au deuil des familles israéliennes mais non à celui des familles palestiniennes[21].
On apprenait d'ailleurs que, dans un mémorandum distribué aux journalistes du New York Times au début de la guerre, les éditeurs leur demandaient de réduire l'usage des mots « génocide » et « nettoyage ethnique », de ne pas parler de « camps de réfugiés », d'éviter l'expression « territoires occupés », même de ne se référer que le plus rarement possible à la « Palestine », et ils leur signifiaient également que les mots « massacres » et « tueries », trop « émotionnels », devaient être remplacés par des descriptions factuelles, consigne qui ne valait toutefois pas pour qualifier l'attaque du 7 octobre[22].
De telles instructions étaient probablement communes dans les grands médias états-uniens, car, selon une étude du langage utilisé pour décrire les victimes des deux côtés dans trois des principaux quotidiens du pays, après trois mois de guerre, le mot « horrible » apparaissait neuf fois plus souvent pour parler des morts israéliennes que des morts palestiniennes, le mot « massacre » trente fois plus fréquemment, le mot « tuerie » soixante fois, quant au mot « enfants », dont les victimes, décédées ou mutilées, se comptaient en dizaines de milliers à Gaza, il n'était présent qu'à deux reprises sur 1 100 titres de journaux[23]2. Dès novembre, ils étaient plus de 750 reporters de nombreux organes de presse états-uniens à critiquer la couverture unilatéralement orientée du conflit[24].
D'une manière générale, au moins pendant les premiers mois de la guerre – car quelques corrections sont peu à peu intervenues pour un meilleur équilibre de la présentation des faits –, les grands médias, souvent à l'encontre d'une partie de leurs journalistes, ont repris les éléments de langage de la communication des autorités et des militaires israéliens, connue sous le nom de hasbara et théorisée comme arme de guerre[25].
En fait, c'est souvent dans les médias indépendants et critiques – Mediapart, Politis, Blast ou Orient XXI en France, Boston Review, The Nation, The Intercept, Mondoweiss aux États-Unis, London Review of Books et Middle East Eye en Grande-Bretagne, +972 en Israël, Al Jazeera dans le monde arabe – qu'il a été possible de s'informer de manière plus neutre sur les événements à Gaza, d'entendre les voix des Palestiniens, de disposer d'investigations s'affranchissant de la communication d'Israël, d'accéder à des analyses de journalistes et d'universitaires critiques, de lire des enquêtes produisant une documentation alternative des faits que, du reste, les principaux organes de presse finissaient souvent par reprendre.
Un indice de cette discrimination concerne le décompte des victimes. Chaque fois que les statistiques des morts palestiniennes ont été indiquées dans les médias, elles étaient accompagnées de la formule « selon le ministère de la Santé de Gaza », alors qu'aucune expression semblable ne venait relativiser les données présentées par les autorités israéliennes[26].
Ce double standard est d'autant plus remarquable que, d'une part, le gouvernement israélien exerce un contrôle extrême sur la communication, rendant le travail de vérification des faits par les journalistes particulièrement difficile, y compris sur la réalité des membres du Hamas tués ou emprisonnés, tandis que, d'autre part, les chiffres de l'administration palestinienne, qui se montre ouverte à leur récolement extérieur, ont lors des guerres précédentes correspondu précisément à ce que les enquêtes indépendantes ultérieures ont établi.
« Je n'ai aucune preuve que les Palestiniens disent la vérité au sujet du nombre de personnes tuées », déclarait le président des États-Unis le 25 octobre, reprenant l'argument d'un porte-parole de l'armée israélienne qui affirmait que ces chiffres étaient toujours gonflés, alors que son gouvernement lui-même s'en servait. Le lendemain, le ministère de la Santé de Gaza publiait la liste des 6 747 victimes avec leur nom, leur âge, leur sexe et leur numéro de carte d'identité[27].
Parallèlement, une étude publiée dans l'une des plus prestigieuses revues médicales internationales validait les données fournies par l'institution palestinienne[28]. Cette contestation des statistiques de décès est une double peine pour les victimes de la guerre. On leur a pris leur vie. On leur dénie leur mort. Une telle remise en cause s'avère particulièrement cynique dans la mesure où la mortalité à Gaza est fortement sous-estimée par l'administration palestinienne qui, d'une part, ne compte que les corps retrouvés et identifiés, ignorant donc les personnes enfouies sous les décombres dont les cadavres disparaissent dans les gravats évacués par les bulldozers israéliens, et, d'autre part, n'enregistre pas les décès dus à des causes médicales favorisées par la dénutrition, la déshydratation, l'absence de médicaments, notamment parmi les plus vulnérables, nourrissons et personnes âgées.
Seule une enquête épidémiologique dans la population pourra a posteriori permettre d'évaluer la surmortalité causée par l'opération militaire israélienne. L'étude réalisée par le Watson Institute sur les guerres conduites par les États-Unis au XXIe siècle a établi que le nombre de morts dites indirectes liées à la dégradation économique, l'insécurité alimentaire, la destruction des infrastructures, la contamination de l'environnement, le développement des épidémies et la dévastation du système sanitaire était quatre fois plus élevé que le nombre de morts directes[29].
Il est probable que la guerre de Gaza, du fait non seulement des décès causés par l'armée mais également des retombées à court et moyen terme de la malnutrition, du manque d'hygiène et de l'absence de soins aura fait au moins 100 000 victimes, dont une proportion élevée de très jeunes enfants, sans parler des traumatismes psychiques que, parmi eux, les survivants garderont.
Mais ce n'est pas seulement la quantification de leurs morts qu'on a contestée aux Palestiniens. C'est aussi leur qualification. Pour relativiser les énormes disparités du nombre de victimes de part et d'autre du conflit, on a parfois mis en cause l'équivalence de la signification de ces morts, en affirmant que les uns étaient tués en tant que juifs, et donc niés dans leur humanité, et les autres accidentellement, dans le cadre d'une opération militaire contre un ennemi[30].
C'était, d'une part, écarter la possibilité que l'attaque du Hamas ait été dirigée, comme l'affirment ses responsables, contre un ennemi qui prive de ses terres et de ses droits la population palestinienne depuis plus d'un demi-siècle, ce qui n'exclut pas la possibilité d'un sentiment antisémite, et, d'autre part, occulter les discours de dirigeants et de militaires israéliens qui, eux, nient explicitement l'humanité des Palestiniens, en les assimilant à des animaux. L'idée que l'attaque dans le sud d'Israël serait plus cruelle que la guerre dans la bande de Gaza est probablement liée au fait que, d'un côté, les assaillants et leurs victimes sont visibles dans l'acte de tuer, alors que, de l'autre, le bombardement et même le siège éloignent du regard ceux qui les ordonnent et ceux qui les exécutent.
De même, les tirs des canons contrôlés par des soldats israéliens invisibles dans la tourelle de leurs chars semblent plus impersonnels et plus désincarnés que les tirs des armes automatiques filmés par les combattants palestiniens. La distance affective que le spectateur extérieur à ces scènes développe, qu'il soit en Israël ou ailleurs dans le monde, est différente. Il n'est toutefois pas certain qu'être abattu dans un kibboutz du Néguev ou dans une rue de Gaza représente, pour les victimes civiles et pour leurs proches, une différence décisive, hormis celle qui existe entre se trouver du côté de l'oppresseur, qui a pu vivre comme un être humain libre, et se trouver du côté de l'opprimé, dont la vie captive s'est déroulée sous la menace de l'occupant.
Après l'hommage national rendu par le gouvernement aux citoyens français et israéliens morts lors de l'attaque du Hamas, un ancien président de la République a considéré qu'une cérémonie de même nature ne pourrait être envisagée pour les citoyens français et palestiniens morts au cours de la guerre à Gaza, car il fallait établir une distinction entre être tué « en tant que défenseur d'un mode de vie », dans le premier cas, et mourir comme « victime collatérale », dans le second[31].
Que le deuil palestinien puisse ainsi être minimisé en regard du deuil israélien, malgré le déséquilibre numérique formidable des pertes humaines entre les deux camps, est révélateur de l'iniquité de traitement jusque dans la mort. Il y a ainsi des vies qui méritent d'être pleurées et d'autres qui ne le méritent pas, comme l'écrit la philosophe états-unienne Judith Butler, et « la distribution différentielle de la légitimité à être pleuré a des implications » sur les conditions dans lesquelles « on ressent les affects qui en résultent politiquement, telles que l'horreur, la culpabilité, le sadisme, le manque et l'indifférence », mais aussi sur la manière dont il est possible, s'agissant des vies qui ne méritent pas d'être pleurées, de « rationaliser leur mort », puisque « la perte de ces populations est jugée nécessaire pour protéger les vies des “vivants” »[32].
Cette distinction entre ces deux formes de vie se manifeste de la manière la plus évidente et la plus douloureuse dans la différence entre la possibilité pour les familles israéliennes d'enterrer dignement et rituellement leurs morts, même dans la terrible réalité des cadavres parfois calcinés ou démembrés par les explosions, et l'impossibilité pour les familles palestiniennes d'en faire autant, soit parce que les corps pourrissent sous les éboulis avant parfois d'être éliminés par les pelleteuses, soit parce que les dépouilles trop nombreuses disparaissent dans des fosses communes faute de place dans des cimetières dévastés par les bombes, soit parce que les autorités israéliennes refusent de rendre aux familles les restes de leurs proches, ainsi que l'a montré la politiste Stéphanie Latte Abdallah[33].
Il aura ainsi fallu plus de 30 000 morts officiellement, et probablement plus de 100 000 en fait, surtout des civils, souvent des enfants, pour que les pays occidentaux commencent à trouver le châtiment collectif suffisant, pour que leurs gouvernements envisagent un cessez-le-feu tout en continuant à envoyer des armes, pour que leurs principaux médias entreprennent de corriger leur restitution partiale des événements.
Tout s'est donc passé comme si, une fois encore, une vie supprimée de civil israélien devait être payée de cent vies anéanties de civils palestiniens, comme si l'une valait cent fois plus que les autres, et même un millier de fois pour ce qui est des enfants. « L'Occident a montré un racisme pur. Il a affirmé en creux qu'une vie blanche a plus de valeur qu'une vie arabe », analyse la journaliste palestinienne Lubna Masarwa[34]. Beaucoup de celles et ceux qui ont manifesté pour exiger un cessez-le-feu exprimaient en fait leur refus de cette inégalité des vies[35].
Mais jamais le discours politique et médiatique n'a rendu compte de la mobilisation dans ces termes, à savoir pour le droit à la vie des Palestiniens et leur droit à une vie bonne. La situation a été décrite comme un nouveau « campisme », opposant un camp pro-palestinien à un autre, pro-israélien[36]. Quand on demandait l'arrêt du massacre des civils, simplement parce qu'on ne tue pas des innocents, quand on appelait à la fin du siège total, simplement parce qu'on n'affame pas des êtres humains, quand on condamnait la dévastation des hôpitaux, simplement parce qu'on ne prive pas les malades et les blessés de soins médicaux, quand on critiquait la destruction des écoles et des monuments, simplement parce qu'on n'enlève pas à un peuple sa culture et son histoire, il semblait que, pour beaucoup, parmi les commentateurs, il n'était pas possible d'imaginer un autre camp : celui de la vie.
*
Illustration : Wikimedia Commons.
Notes
[1] Ofri Ilany, « The mass killing in Gaza will poison Israeli souls forever », Haaretz, 21 mars 2024.
[2] Didier Fassin, De l'inégalité des vies, Paris, Fayard- Collège de France, 2020.
[3] Il y a eu pendant l'opération « Plomb durci » 1 398 Palestiniens, dont 1 391 à Gaza, tués par les forces israéliennes et 9 Israéliens, dont 3 civils, tués par des Palestiniens. Les statistiques concernant les civils palestiniens tués sont difficiles à établir et sujettes à discussion. Si l'on retient la définition de B'Tselem, à savoir les Palestiniens tués par l'armée israélienne alors qu'ils ne participaient pas à des activités et donc n'étaient en principe pas visés, ce sont 764 personnes, dont 318 mineurs et 108 femmes. À la différence de l'armée israélienne, qui fournit seulement des nombres sans précision, en l'occurrence 1 166 Palestiniens tués, et assimile tous les hommes adultes à des terroristes, ce qui réduit le nombre de civils tués à 295, B'Tselem indique pour chaque victime son identité, y compris le nom, l'âge et le sexe, et les circonstances de son décès.
[4] Il y a eu pendant l'opération « Bordure protectrice » 2 251 Palestiniens tués, dont 789 combattants et 1 462 civils, parmi lesquels 299 femmes et 551 enfants, et 76 Israéliens, dont 70 soldats et 6 civils. L'armée israélienne donne des chiffres proches pour le nombre total de morts, soit 2 125, mais sous-estime fortement la part des civils, dont elle établit le bilan à seulement 761.
[5] Merlyn Thomas, Jake Horton et Benedict Garman, « Israel-Gaza : Checking Israel's claim to have killed 10,000 Hamas fighters », bbc, 29 février 2024.
[6] « Contrary to Israel's claims, 9 out of 10 of those killed in Gaza are civilians », Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, 5 décembre 2023.
[7] Chiffres donnés, en ce qui concerne Gaza, par les Nations unies pour l'ensemble des décès établis, soit 32 623 le 6 avril 2024, et par l'organisation Save The Children pour les seuls enfants, soit 13 800 le 4 avril 2024 : <https://reliefweb.> et <www.savethechildren.org.uk/news/med...> .
[8] Raphael Cohen, « Why the October 7 attack was not Israel 9/11 », Lawfare, 12 novembre 2023.
[9] We Are Not Numbers, <https://wearenotnumbers.> .
[10] Eitan Barak, « Under cover of darkness : Israeli Supreme Court and the use of human lives as bargaining chips », The International Journal of Human Rights, 3 (3), 1999, et Jonathan Kuttab, « The International Criminal Court's failure to hold Israel accountable », Arab Center Washington, 12 septembre 2023.
[11] Harry Davies, Bethan McKernan, Yuval Abraham et Meron Rapoport, « Spying, hacking and intimidation :
[12] Nadera Shalhoub-Kevorkian, « The occupation of the senses : The prosthetic and aesthetic of state terror », The British Journal of Criminology, 57 (6), 2017, p. 1279-1300. L'autrice, qui est professeure à l'Université hébraïque de Jérusalem, a été suspendue par son institution en mars 2024 pour ses propos sur la guerre à Gaza, puis arrêtée et détenue par la police israélienne, avant d'être libérée et réintégrée.
[13] Haggai Matar, « Police spray putrid water on Palestinian homes, schools », +972, 15 novembre 2014.
[14] Scott Wilson, « In Gaza, lives shaped by drones », The Washington Post, 3 décembre 2011.
[15] Saree Makdisi, « No human being can exist », n+1, 25 octobre 2023.
[16] Acrimed, « Naufrage et asphyxie du débat public », 20 décembre 2023, <www.acrimed.org/Palestine-naufrage-et-> , et Blast, « Un naufrage média- tique sans précédent », 31 mars 2024, <www.youtube.com/> .
[17] Extraits de journaux quotidiens d'une radio nationale, évoqués à titre d'illustrations d'un fait général. Il est vrai que la plupart des correspondants permanents et des envoyés spéciaux se trouvent à Jérusalem ou Tel Aviv. Mais imaginerait-on un seul instant n'avoir d'information sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie et ses conséquences pour la population qu'en utilisant les seules sources officielles du régime de Moscou ?
[18] Shrouq Aïla, « Inside the Nuseirat massacre : this carnage I saw during Israel's hostage rescue », The Intercept, 10 juin 2024 ; Gideon Levy, « Why did Israel conceal hundreds of Gazans' deaths in “perfect” hostage rescue operation ? », Haaretz, 12 juin 2024. Au lendemain de l'attaque, le journal d'une radio nationale consacrait vingt-quatre fois plus de temps à l'information heureuse côté israélien qu'à la réalité tragique côté palestinien pourtant déjà connue. Parallèlement, les présidents états-unien et français se réjouissaient de la libération des quatre otages israéliens, sans un mot pour les centaines de victimes civiles palestiniennes.
[19] Human Rights Watch, Meta's Broken Promises : Systemic Censorship of Palestine Content on Instagram and Facebook, 21 décembre 2023 : <www.hrw.org/report/2023/12/21/> . Sur 1 050 contenus censurés sur Facebook et Instagram et vérifiés par Human Rights Watch, 1 049 concer- naient des éléments pacifiques en faveur de la Palestine.
[20] Livia Wick, Sumud : Birth, Oral History and Persisting in Palestine, Syracuse, Syracuse University Press, 2022.
[21] India McTaggart, « bbc reporters accuse it of favor- itism towards Israel », The Telegraph, 23 novembre 2023.
[22] Jeremy Scahill, « Leaked NYT Gaza memo tells journalists to avoid words “genocide”, “ethnic cleansing” and “occupied territories” », The Intercept, 15 avril 2024.
[23] Adam Johnson et Othman Ali, « Coverage of Gaza war in the New York Times and other major newspapers heavily favored Israel, analysis shows », The Intercept, 9 janvier 2024.
[24] Laura Wagner et Will Sommer, « Hundreds of journalists sign letter protesting coverage of Israel », The Washington Post, 9 novembre 2023.
[25] Tariq Kenney-Shawa, « Israel's disinformation apparatus : A Key weapon in its arsenal », Al-Shabaka. The Palestinian Policy Network, 12 mars 2024.
[26] Les corrections apportées début mai 2024 par les Nations unies sur la proportion de femmes et d'enfants officiellement tués à Gaza, en ne tenant compte que des données pour lesquelles existaient des informations d'état- civil, ont donné lieu à des insinuations malveillantes et des commentaires sarcastiques, qui ne faisaient pas mention du fait que, si les statistiques sont difficiles à valider, c'est que l'armée israélienne a détruit les hôpitaux qui les recueil- laient et les voies de communication qui les transmettaient : Graeme Wood, « The un's Gaza statistics make no sense », The Atlantic, 17 mai 2024.
[27] Ryan Grim et Prem Thakker, « Biden's conspiracy theory about Gaza casualty numbers unravels upon inspec- tion », The Intercept, 31 octobre 2023.
[28] Benjamin Huynh, Elizabeth Chin et Paul Spiegel, « No evidence of inflated mortality reporting from the Gaza Ministry of Health », The Lancet, 6 décembre 2023.
[29] Stephanie Savell, How Death Outlives War : The Reverberating Impact of the Post-9/11 Wars on Human Health, Watson Institute, Brown University, 15 mai 2023.
[30] William Marx, « Ce qu'Œdipe et Antigone nous disent de la crise au Proche-Orient », Le Monde, 15 novembre 2023.
[31] Selon François Hollande, interrogé le 7 février 2024, il existe une différence presque ontologique entre « les victimes du terrorisme et les victimes de guerre », ce qui justifie, selon lui, qu'on rende un hommage national aux premières, franco-israéliennes, mais non aux secondes, franco- palestiniennes : <www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/> .
[32] Judith Butler, Frames of War : When Is Life Grievable ? Londres, Verso, 2009, p. 24, 31 et 38 (traduction modifiée de la version française établie par Joëlle Mareli sous le titre Ce qui fait une vie. Essai sur la violence, la guerre et le deuil, trad. Joëlle Mareli, Paris, Zones, 2010, p. 28-29, 35).
[33] Vivian Yee, Iyad Abuheweilia, Abu Bakr Bashir et Ameera Harouda, « Gaza shadow death toll : Bodies buried beneath the rubble », The New York Times, 23 mars 2024 ; Ruth Michaelson, « un rights chief “horrified” by reports of mass graves at two Gaza hospitals », The Guardian, 23 avril 2024 ; Stéphanie Latte Abdallah, Des morts en guerre. Rétention des corps et figures du martyr en Palestine, Paris, Karthala, 2022.
[34] Louis Imbert, « Face à la guerre contre le Hamas, la crise existentielle de la gauche israélienne », Le Monde, 2 novembre 2023.
[35] Didier Fassin, « The inequality of Palestinian lives », The Berlin Review, 1 (1), 2 février 2024.
[36] Nicolas Truong, « La guerre entre Israël et le Hamas fracture le monde intellectuel », Le Monde, 8 décembre 2023.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
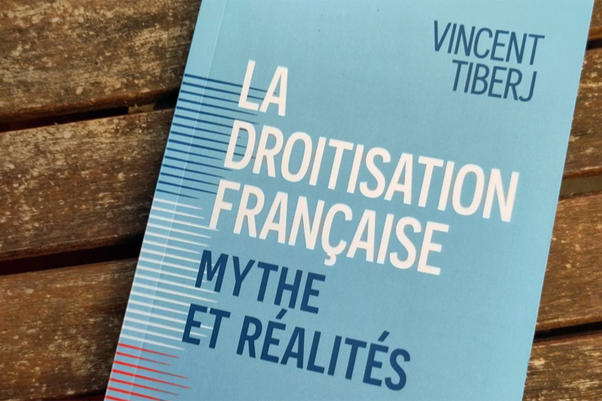
Politique française : à droite… par défaut
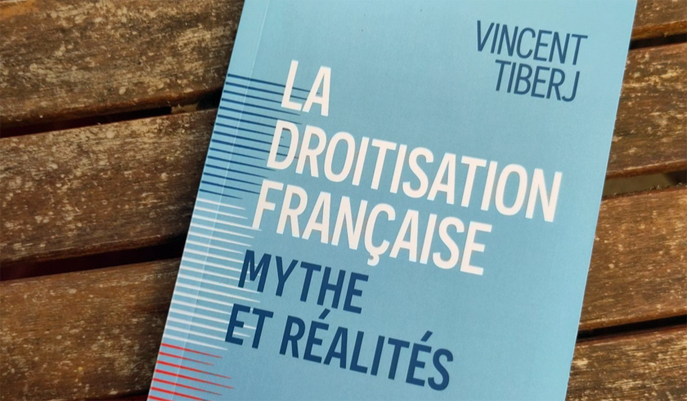
Avec la sortie de son livre La droitisation française : mythe et réalités, Vincent Tiberj jette un sacré pavé dans la mare.
5 septembre 2024 | Tiré de regards.fr
« Une victoire de la gauche aux législatives dans une France de droite » : c'est le titre retenu par Le Monde, pour un entretien avec le politiste du Cevipof, Luc Rouban1. La tonalité n'est pas la même du côté de son collègue de Bordeaux, Vincent Tiberj, qui consacre un livre entier à montrer que la droitisation est tout autant un mythe qu'une réalité2. Qui a raison ? En fait, les deux nous obligent à scruter des pans différents de la réalité…
Le paradoxe français
Tiberj connaît les données qui fondent l'appréciation de Rouban et lui-même se garde bien d'enjoliver le tableau. Les signaux électoraux sont les plus évidents tant ils convergent, quel que soit le niveau de participation aux scrutins.
Élections législatives

En scrutin législatif, l'extrême droite a gagné vingt points entre 2017 et 2024, tandis que la gauche n'en a regagné qu'un peu plus de 2,5, ne sortant pas des très basses eaux législatives atteintes en 2017. Un total gauche à moins d'un tiers et une droite aux deux tiers des suffrages exprimés… Si l'on raisonne sur la totalité du corps électoral, on a en 2024 une droite au-delà des 40% d'inscrits et une gauche à un cinquième à peine. Nul ne peut se prévaloir des électeurs potentiels, votants ou abstentionnistes, mais il est certain que la droite mobilise de 2024, deux fois plus que la gauche, ceux qui votent et que l'extrême droite y contribue pour la plus grande part.
La gauche surclasse certes l'extrême droite dans les 22 aires métropolitaines (7,5 millions d'habitants au total), mais lui laisse la première place dans toutes les tranches de communes comptant moins de 20 000 habitants (pour une population totale de près de 40 millions). L'extrême droite s'est renforcée dans les catégories supérieures et moyennes et conserve sa prépondérance chez les ouvriers et employés qui votent. Le parti de Marine Le Pen caracole en tête même chez les fonctionnaires d'État (à l'exception des enseignants) et franchirait la barre des 50% chez les salariés du privé.
Le « bruit de fond » politique, nous dit Tiberj, est conservateur alors que la société ne l'est pas de façon dominante.
Dans un article précédent, nous avions souligné les corrélations entre le vote de gauche, le vote RN et toute une série d'indicateurs socio-économiques. Elles laissaient entendre que, si la gauche n'avait pas disparu de l'univers populaire, son implantation s'était « archipélisée », concentrée dans les plus jeunes générations et au cœur des zones de peuplement dense, laissant ainsi des pans entiers du territoire et une moitié des ouvriers et des employés qui votent sous dominante de la droite la plus extrême.
En bref, la vie politique institutionnelle, celle qui est rythmée par les consultations électorales, a déplacé le curseur du vote vers la droite et vers une droite de plus en plus marquée à droite. En France, comme dans de nombreux pays européens…
Pourquoi donc Tiberj maintient-il sa critique d'une notion de droitisation qu'il juge trop excessive et par là même dangereuse ? Selon lui, la formule laisse dans l'ombre une masse de données qui suggèrent d'autres structurations de l'opinion. Avec d'autres, comme Nonna Mayer, Tiberj participe à la rédaction du « baromètre racisme » qui sert de base au rapport publié par la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH).
Ce baromètre repose sur des séries longues de sondages et regroupe des dizaines de questions. À partir des données collectées pour ce baromètre et de bien d'autres encore, il a produit avec ses collègues des indices synthétiques3, qui permettent de mesurer en longue durée le degré global de tolérance, d'ouverture culturelle et d'attentes sociales. Sans doute notera-t-on avec lui que les données disponibles ne dessinent pas des mouvements parfaitement homogènes et continus. Tout ne va pas dans le même sens et au même moment… Par exemple, l'affirmation « que l'on ne se sent plus chez soi comme avant » reste largement majoritaire et globalement stable. De même, alors que la frénésie de l'ultralibéralisme a pris du plomb dans l'aile depuis quelque temps, l'attraction de certains items libéraux (profit, confiance dans les entreprises…) reste incrustée dans tous les milieux sociaux et même – avec nuances solides – dans tous les électorats.
Pour autant, les indices soigneusement calculés par Tiberj et l'équipe du Baromètre nous livrent un constat tout aussi massif que celui qui nourrit l'idée de droitisation : si les opinions que l'on peut qualifier de droite sont bien installées, la droitisation « par en bas » n'a pas eu lieu. Contrairement à ce qui se dit parfois, « la » société ne vire pas à droite et, au contraire, la tendance globale de long terme porte un nombre croissant d'individus vers des opinions qui étaient traditionnellement considérées comme plutôt de gauche.
La réalité n'est donc pas celle d'un mouvement uniforme, mais celle d'une complexité, d'un véritable paradoxe qui vient percuter le rapport entre les représentations mentales et les votes. Alors que la société française « par en bas » est globalement plus ouverte et plus tolérante qu'il y a vingt ans, la société « par en haut » fait la part belle à des valeurs fortement droitisées. Pour l'instant, ce sont celles-là qui se mobilisent électoralement avec le plus d'intensité, comme on l'a vu au premier tour de la présidentielle 2022 et des législatives 2024 ou encore aux européennes de juin dernier. Le « bruit de fond » politique, nous dit Tiberj, est conservateur alors que la société ne l'est pas de façon dominante.
Le tableau rigoureusement dressé par Tiberj a le double avantage d'être intellectuellement convaincant et politiquement roboratif : si la société n'a pas viré à droite, il n'y a aucune fatalité à ce que la politique aille de plus en plus dans cette direction. Il reste toutefois à comprendre comment il se fait que, dans une société globalement plus tolérante, ce sont des valeurs inverses qui donnent le ton. Au fil des pages, Tiberj nous offre des pistes solides sur ce point. Il sait, avec Pierre Bourdieu, que « l'opinion publique n'existe pas », mais se construit. Elle se façonne dans un champ médiatique, éditorial et journalistique, où des forces structurent en longue durée les représentations courantes, comme s'y attache l'extrême droite depuis les années 19704. Elle le fait avec constance, usant même des conjonctures pour retourner à son profit des termes historiquement associés à la gauche, comme la république, le refus de l'antisémitisme ou la laïcité.
Par ailleurs, la poussée à droite de l'espace politique se nourrit depuis longtemps des bouleversements du tissu social, au gré des révolutions technologiques et des dérégulations financières. Le peuple sociologique n'a plus de groupe central, les représentations de classe d'hier se délitent, les mouvements sociaux, anciens ou nouveaux, se font et se défont, les discriminations s'entremêlent de façon complexe avec les inégalités. Le « nous » qui structurait l'univers populaire est concurrencé par l'affirmation de soi, la solidarité et l'autonomie s'entrelacent, s'opposent ou se complètent, selon les moments, les catégories et les individus.
En bref, la droite s'est accoutumée mieux que la gauche aux turbulences des sociétés contemporaines. Dès lors, on peut se convaincre de ce que la clé du paradoxe relevé au départ ne se trouve pas seulement dans les mouvements internes à la droite. Elle est aussi à rechercher du côté de la gauche : à sa façon, le dynamisme de la droite extrême est le contrepoint des dysfonctionnements de la gauche. La gauche n'a donc pas à choisir entre ce qui l'inquiète et ce qui la conforte. On pourrait aisément pasticher l'hôte précaire de l'Élysée en proclamant « et Rouban et Tiberj »…
La réalité, rien que la réalité, toute la réalité…
1. Vincent Tiberj a raison de nous installer dans la conviction que l'expansion des idées de la droite extrême n'est pas un fait irréversible, auquel nous devrions nous accoutumer. Accepter cette fatalité nourrit en effet une autre conviction, présente dès les premières percées du Front national, selon laquelle il suffirait de s'emparer des constats de l'extrême droite, éventuellement pour les retourner contre elle. « Le Front national pose de bonnes questions et donne de mauvaises réponses »… « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde »… Cette façon déjà ancienne de s'embourber dans les enjeux explosifs de l'identité, de la sécurité et de l'immigration a touché la droite traditionnelle, le prétendu centre et même une partie de la gauche. Le résultat est parlant : le confusionnisme qui en résulte n'enraye en rien l'expansion politique des droites extrêmes, que l'abstention s'étende ou bien qu'elle recule.
2. La puissance d'un « front républicain » au second tour a montré que l'électorat français dans sa majorité n'a pas basculé du côté des socles idéologiques travaillés par l'extrême droite depuis des décennies. Mais le premier tour a montré à l'inverse que le mouvement général des représentations stimulait un vote en faveur de l'extrême droite bien plus qu'un vote à gauche. Et si la mobilisation anti-RN du second tour a été ressentie comme un souffle d'air frais, comment ne pas constater aussi que, au fil des élections, les seconds tours voient se réduire les écarts séparant les extrêmes droites et la totalité des autres forces ? En juillet dernier, dans des dizaines de circonscriptions, l'écart s'est avéré si ténu que de légers déplacements de voix auraient pu modifier sensiblement la composition de l'Assemblée élue.
La « dédiabolisation » du RN n'est pas allée jusqu'au bout, sans avoir pour autant été contrariée de façon absolue. Rien ne dit donc que le réflexe de « front républicain » continuera de fonctionner avec la même efficacité à l'avenir. La gauche s'en est plutôt bien sortie au début de cet été, mais le vent du boulet n'est pas passé loin…
3. L'ampleur du danger obligera sans nul doute à conforter les contre-offensives visant à réduire l'effet des discours de fermeture et d'exclusion, à dénoncer les ruses, les tromperies et les mensonges du lepenisme. Cet effort déjà heureusement engagé ne devrait pas conduire à sous-estimer le fait que la force du RN n'est pas dans le détail des propositions qui sont les siennes. Elle est d'abord dans la cohérence d'un projet qui, ancré dans le tissu des inquiétudes, articule la promotion d'une protection avant tout nationale et la dénonciation de l'assistanat. C'est cette cohérence qui relie les angoisses et les attentes de larges fractions de la société et qui imprègne les territoires, avec d'autant plus de force que l'extrême droite tire parti de ce qui fut sa faiblesse, la longue marginalisation qui, à partir de 1944, l'a écartée absolument des sphères du pouvoir, national comme local. Si l'essentiel est de se protéger, pourquoi ne pas laisser le Rassemblement national aller jusqu'au bout d'une logique de fermeture ?
L'hégémonie politique se joue dans la capacité à imposer un projet global et à légitimer les regroupements capables de les faire vivre. L'extrême droite a peaufiné son projet et progressé dans sa capacité à attirer vers elles des forces qui se détournaient d'elles jusqu'alors. Pour l'instant, elle n'a pu abattre suffisamment les murailles qui l'enserrent encore. Il est donc encore temps d'opposer à ses cohérences celles d'un projet et d'une convergence fondée sur des valeurs d'émancipation. Mais les crises, propices à toutes les accélérations vers le meilleur comme vers le pire, interdisent de se dire que nous avons tout le temps devant nous. En fait, le temps nous est compté.
4. Le signal encourageant du second tour n'efface pas la préoccupation nourrie par le premier. La dynamique générale des idées diffusées dans la société stimule un vote d'extrême droite et porte beaucoup moins vers un vote de gauche. La gauche ne devrait donc pas s'en tenir à mettre en cause « les autres », quelles que soient par ailleurs leurs responsabilités, gouvernement, élites sociales, organisations et système médiatique. La critique radicale du macronisme et la hantise d'un retour en force du social-libéralisme sont évidemment bienvenues. Mais elles risquent de n'être pas plus efficaces que les mises en garde de la gauche de gauche contre les abandons du socialisme mitterrandien des années 1980.
Le problème est que, pour l'instant du moins, l'alternative au désordre existant s'identifie au projet du Rassemblement national, pas à celui de la gauche. Celle-ci, depuis la contre-offensive des « antilibéraux » après le camouflet de 2002, s'est dotée de propositions solides, dans une logique de rupture avec la pente sociale-libérale, sans être une rupture immédiate avec le seul « système » existant, qui est celui du capital financiarisé et mondialisé. La gauche rassemblée jure certes ses grands dieux que, cette fois, elle ne capitulera pas devant les difficultés et les pressions ; mais elle l'avait juré naguère, alors même qu'elle était majoritaire électoralement.
La gauche a des propositions cohérentes, qui peuvent être plus ou moins partagées par un grand nombre de ses composantes. Mais elle n'a pas encore atteint le niveau d'un projet réaliste, d'un récit capable d'agréger les inquiétudes, les colères et les attentes d'un large spectre dans une société aujourd'hui fragmentée plus que jamais. Ajoutons qu'elle n'est encore capable de raccorder ce grand récit, évident et rassurant, avec une stratégie de long souffle qui, aux discours ostentatoires de la « rupture », préfère l'invocation d'un processus cohérent de ruptures – au pluriel – au gré des majorités possibles.
5. La gauche affirmera aux yeux du plus grand nombre son utilité si elle sait répondre à quatre exigences : accompagner la mobilisation de quiconque n'accepte pas les injustices et les prédations de l'ordre dominant ; suggérer un projet rassurant à celles et ceux que ronge l'inquiétude ; aider à ce que convergent le plus grand nombre de valeurs, d'idées et de pratiques attachées à produire de l'émancipation humaine ; travailler à rassembler ce qui est aujourd'hui désuni. En bref, la gauche doit encourager la société à lutter et, pour cela, doit proposer au noyau populaire – celui d'aujourd'hui, pas celui d'hier : haro sur les nostalgies ! – un cadre attractif, mobilisateur et rassurant. Il ne suffit donc pas de « s'adresser aux abstentionnistes », si le message qui est transmis à l'ensemble du corps électoral n'a pas une cohérence suffisamment forte pour contrebalancer celle du Rassemblement national. Si la gauche ne s'interroge pas plus avant sur ce qui freine sa reconnaissance par la cohorte immense des exploités, dominés et aliénés, elle risque de voir se reproduire les mêmes mouvements qui la contraignent, même dans un contexte de participation électorale accrue.
Encore faut-il s'entendre sur ce qu'est « la » gauche. Elle existe comme un tout – l'ensemble des individus et des collectifs qui se réclament de « la gauche » et marquent leur différence à l'égard de « la droite » –, un tout pouvant et devant être rassemblé. Elle n'est pas pour autant monolithique mais plurielle, elle repose sur des partis, mais ne se limite pas à eux. Potentiellement, elle est toujours à la fois un collectif solidaire et une collection d'individus autonomes, un « nous » en construction permanente et un assemblage de « je ».
6. Les gauches ont su se rassembler à plusieurs reprises. Elles ne sont jamais parvenues à trouver un cadre pérenne à ce rassemblement, laissant ainsi la place à l'alternance des unions éphémères et des concurrences persistantes, aux tentations de l'hégémonie, au jeu des méfiances et à l'accumulation des frustrations. Sans doute parce que le désir d'union ne s'est jamais vraiment appuyé sur une culture solide de l'union. Sans doute aussi parce que les gauches dans leur ensemble n'ont pas su comprendre que la durabilité du rassemblement supposait d'œuvrer au rapprochement et à l'intercompréhension des cultures particulières, de débattre en permanence des projets et des stratégies opérationnelles pour toute la gauche et de s'accorder sur des formes pérennes permettant à chaque sensibilité de faire vivre sa pleine autonomie et sa solidarité avec toutes les autres5.
Sans doute encore parce que la gauche politique a fini par oublier que sa dynamique populaire dépendait de sa capacité à articuler les champs que la société capitaliste cloisonne, économique, social, partisan, syndical, associatif, culturel. Retisser de façon moderne ces liens, réécrire le récit d'une « Sociale » raccordée aux urgences nouvelle de l'autonomie et de l'écologie, renouer le dialogue à égalité de dignité politique entre les partis, les syndicats, le monde associatif et l'intelligentsia, réinventer les formes de la politique… Pour réussir cette alchimie redoutable, mieux vaut avoir des bases de connaissance solides et fines. Vincent Tiberj nous y aide, avec d'autres. Son travail mérite donc une appropriation collective exigeante, pas un simple coup de chapeau.
Notes
1. Luc Rouban, « Enquête électorale : une victoire de la gauche aux législatives dans une France de droite », Le Monde, 1er septembre 2024. ↩︎
2. Vincent Tiberj, La droitisation française : mythe et réalités, PUF, 4 septembre 2024). ↩︎
3. Il a lui-même élaboré ce qu'il appelle un indice longitudinal de tolérance. ↩︎
4. Par exemple sur la question de l'identité (voir Roger Martelli, L'identité c'est la guerre, Les Liens qui Libèrent, 2016). ↩︎
5. Sur la question des formes d'organisation, le collectif « Intérêt général. La fabrique de l'alternative » a récemment proposé un copieux document, truffé d'analyses et de propositions. ↩︎
Roger Martelli
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Du Labour de Corbyn à LFI de Mélenchon, les médias contre la gauche

Thierry Labica, maître de conférences au département d'études anglophones de l'université Paris-Ouest Nanterre, est l'auteur de L'hypothèse Jeremy Corbyn : Une histoire politique et sociale de la Grande Bretagne depuis Tony Blair (Demopolis, 2019) et a coordonné, avec François Cusset et Véronique Rauline, l'ouvrage Imaginaires du néolibéralisme (La Dispute, 2016).
26 août 2024 | tiré du site d'Acrimed
Acrimed : Depuis des mois, et même des années, Acrimed documente l'acharnement médiatique contre La France insoumise et singulièrement contre Jean-Luc Mélenchon. Sa volonté de rompre avec les orientations néolibérales, sécuritaires et atlantistes de la gauche de gouvernement lui valent, notamment depuis qu'il a supplanté le PS en 2017, l'hostilité de tous les médias, même « de gauche ». Avant de revenir sur les mésaventures médiatiques de Jeremy Corbyn, parvenu entre 2015 et 2020 à la tête du Labour avec un programme de rupture assez similaire à celui de LFI, pourrait-on remonter un peu dans le temps, dans les années 1980, pour voir comment les médias de gauche avaient réagi au thatchérisme ?
Thierry Labica : Dans les années 1960-1970, l'événement politique principal de l'année c'était le congrès syndical, où les responsables politiques se rendaient, où les politiques industrielles étaient négociées dans un cadre cogestionnaire, où les grandes annonces étaient faites. Une catégorie bien spécifique de journalistes couvrait ces congrès : les correspondants industriels. Et les correspondants industriels, c'était la fine fleur du journalisme politique. Or dans les années 1980, il se passe quelque chose d'assez important dans le champ de l'audiovisuel : il y a un mouvement de reflux de cette catégorie particulière de journalistes. Et ça a des conséquences très importantes dans le contexte de luttes du monde du travail contre la révolution désindustrielle thatchérienne. Le moment charnière et le mieux connu est celui de la grève des mineurs de 1984-1985, qui est vraiment un épisode seuil à tout point de vue, symbolique, économique, politique, etc. Les mineurs sont un emblème de l'histoire industrielle nationale et 1984, c'est le moment où le thatchérisme remet en question toutes les grandes institutions du compromis social d'après-guerre. Au même moment, dans les médias disparaissent les gens les plus qualifiés pour parler des conflits du monde du travail, des relations entre les syndicats et le gouvernement, avec une expertise sur la question des politiques industrielles, des négociations, des grèves, etc. Résultat : le discours désormais dominant construit la classe ouvrière désindustrialisée comme un milieu complètement relégué, voire criminel. Et cette disqualification, cette relégation symbolique des mineurs, en l'occurrence, c'est aussi quelque chose qui concerne l'ensemble du monde ouvrier, l'ensemble du monde syndical.
Cette criminalisation, elle est explicite lors de la grève de 1984, par exemple avec l'épisode d'Orgreave. Orgreave, c'est un lieu près de Sheffield où il y a eu un piquet de grève très, très important en juin 1984 qui a abouti à une bataille rangée. Or quand la BBC a montré les images de Orgreave, elle a inversé l'ordre du montage. C'est-à-dire qu'elle a montré les mineurs en train de caillasser la police, qui ensuite a chargé. Et finalement il y a eu des excuses après coup sur le mode : « On s'est trompés, on a monté la séquence à l'envers ! C'est la police qui a chargé en premier ». Les médias orientaient clairement leur couverture sur une responsabilité des mineurs dans la violence, le chaos, etc.
On sait aussi que dans la communication interne du gouvernement Thatcher, pour les ministres et leurs conseillers, les mineurs étaient régulièrement considérés comme des nazis. Il y a un conseiller important de Thatcher (David Hart) qui lui dit : « Je suis allé voir à tel endroit ce meeting avec Arthur Scargill qui était le porte-parole du syndicat des mineurs, le NUM [National Union of Mineworkers], j'avais l'impression d'être à Nuremberg. ». Chose intéressante ; dans la même période, le Sun – ce grand journal à scandales, sensationnaliste, très, très à droite, propriété de l'empire médiatique de Rupert Murdoch, et qui tire à des millions d'exemplaires – avait décidé de faire une première page pendant la grève montrant Arthur Scargill faisant apparemment un salut hitlérien, avec en gros titre : « Mine führer » (jeu de mots sur « mine/mein führer »). Or, à cette époque-là, les journalistes du Sun avaient refusé de publier cette Une – une prise de position politique et professionnelle dont je ne connais pas d'équivalent ultérieur. Dès 1984, on voit déjà une mobilisation de motifs relatifs à l'antisémitisme, au nazisme. Mais pas encore de manière complètement déployée dans le champ médiatique : en 1984-85, on était encore en temps de guerre froide et l'association avec « Moscou » restait l'accusation dominante. Le syndicat national des mineurs (NUM) fut donc prioritairement la cible de « révélations » – totalement démontées quelque temps plus tard – sur l'« argent de Moscou » ou provenant de la principale figure « terroriste » de l'époque, le dirigeant libyien, Mouammar Kadhafi.
Il y a toutes sortes d'autres choses qui sont mobilisées pour disqualifier et criminaliser. On peut citer, en 1989, l'épisode du stade de Hillsborough à Sheffield où eut lieu une rencontre de football entre Liverpool FC et Nottingham Forest. Suite à une gestion policière catastrophique de la foule se pressant à l'entrée du stade, 97 personnes périrent dans des conditions particulièrement horribles. Le lendemain, la presse à scandale, le Sun en tête, fait une page sortie du fond des enfers : des fans auraient volé des victimes, auraient uriné sur la police « courageuse », auraient agressé des policiers tentant de ranimer des personnes évanouies. Et cette couverture médiatique reçoit une validation politique de Thatcher affirmant que la police a fait de son mieux, etc. C'était tellement inqualifiable qu'il a fallu qu'un Premier ministre, 23 ans plus tard (en 2012) fasse des excuses publiques, en séance parlementaire, pour les dissimulations et mensonges de la police, la diffamation journalistique, l'acharnement de la presse et des médias contre les victimes et leurs familles. Cela dit, trente-deux ans plus tard, en 2021, aucun responsable n'avait encore été poursuivi, à l'exception du responsable de la sécurité du stade qui a reçu une amende de 6 500 livres sterling.
Au passage, le terme de « criminalisation » n'est pas le mien. C'est le nom d'une politique mise en œuvre en Irlande du Nord par les travaillistes à partir de mars 1976 et poursuivie avec une ferveur fanatique par Thatcher dans les années 1980. Les prisonniers de l'IRA, de l'INLA (autre organisation paramilitaire républicaine) incarcérés dans la grande prison de Maze voient leurs droits spécifiques de prisonniers à caractère politique retirés. « Criminalisation » fut l'appellation même de cette stratégie (qui certes n'était pas dépourvue de précédents). On ne fait plus de politique : la question républicaine en Irlande du Nord était désormais affaire de criminalité et un peu plus tard, en réponse à la grève de la faim de Bobby Sands, détenu dans la prison de Maze, Thatcher déclara : « Crime is crime is crime. It is not political. » On était donc dans une séquence de durcissement politique marqué par la réduction criminelle, dans le champ politique et dans le champ médiatique, des deux grands adversaires du pouvoir néoconservateur des années 1980, c'est-à-dire le mouvement indépendantiste irlandais en Irlande du Nord, et le mouvement syndical dans sa composante la plus combative.
Donc, c'est sous le thatchérisme que naît cette hostilité systématique des médias envers la gauche traditionnelle, attachée à la défense du monde ouvrier.
Disons qu'il y a un moment propre aux années 1980. Un exemple (avec celui de la grève de 1984) est la campagne extrêmement virulente contre la gauche du parti travailliste. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, émerge un dirigeant très à gauche : Tony Benn, une figure de premier plan, qui a évolué vers la gauche au fil de sa carrière. Ministre de l'Industrie en 1975-1976, il brigue ensuite la direction du parti. Il y a donc le risque de voir le Labour dirigé par une figure emblématique, pas juste travailliste, mais dans une tradition explicitement socialiste, avec des liens avec la gauche radicale anticapitaliste, avec des références au marxisme, aux grandes expériences de contrôle ouvrier des années 1970 en Grande-Bretagne, elles-mêmes parfois inspirées par les expériences yougoslave, portugaise ou de la jeune Algérie indépendante. Tony Benn proposait un programme : l'Alternative Economics Strategy, la stratégie économique alternative. Et il y a de bonnes raisons de penser que la formule célèbre de Margaret Thatcher, « Il n'y a pas d'alternative », n'était pas seulement une formule générale pour imposer une norme néolibérale exclusive, les privatisations, etc., mais résonnait aussi dans le contexte proprement britannique, en réponse à une certaine radicalité qui s'était exprimée au cours des années 1970 et qui se prolongeait alors dans la « stratégie économique alternative », le programme de rupture associé à Tony Benn.
Donc l'hostilité à Benn, c'est une hostilité à la gauche, une gauche qui représente vraiment une menace. D'ailleurs, les médias en prennent la mesure : on parle alors de la « loony left », de gauche cinglée, et dans les journaux, on voit Tony Benn, Ken Livingstone et une série d'autres dirigeants pris en photo au moment le plus défavorable, où ils ont l'air vraiment dingues. Il s'agit d'écarter ce danger, et ce danger va être écarté lorsque Neil Kinnock prendra la tête du parti dans les années 1980.
Il faut dire que tout ceci n'est pas sans précédent, là encore. Il faudrait parler du rôle de la jeune BBC face à la grève générale de 1926 ; à celui du Daily Mail et sa fausse « lettre de Zinoviev » aux travaillistes à la veille des élections d'octobre 1924 ; aux rumeurs d'espionnage pour le compte de l'URSS dirigées contre le Premier ministre travailliste, Harold Wilson, à la fin des années 1960.
Les années 1980 représentent un seuil dans cette histoire et dans les années 1990, on peut parler d'un basculement et d'un délitement de tout l'héritage ouvrier du XXe siècle et de cette espèce de pilier syndical de l'État britannique d'après-guerre – il y avait quand même 13 200 000 syndiqués en 1980 ! Au gré de la désindustrialisation, de la montée du chômage de masse et des lois antisyndicales, il y a un reflux de cette construction sociale et politique gigantesque, centrale dans la culture politique britannique, et ce reflux devient une véritable relégation symbolique dans des médias appliqués à célébrer la nouveauté de la fin de la guerre froide et de la disparition des bastions du monde ouvrier le plus familier.
C'est sur ce terreau que Tony Blair arrive au pouvoir.
Blair est élu avec une forte majorité absolue en 1997. Blair est soutenu médiatiquement par le principal soutien historique de la droite, c'est-à-dire Rupert Murdoch et le journal le Sun. Quand Blair est élu, le Sun fait une première page où il titre : « It's the Sun wot won it ». C'est une expression d'anglais oral un peu cockney, un peu familière, qui signifie : « C'est grâce à nous ». Donc quand on dit « Blair, c'est la droite », ce n'est pas juste des procès d'intention. Dans le succès médiatique de ce néo-travaillisme il y a une espèce de fétichisme du nouveau, c'est la nouvelle économie, le nouvel ordre post-guerre froide après la chute du Mur, etc., on est encore dans ce moment-là de triomphalisme et il y a un réalignement médiatique sur cette « gauche moderne ». Pourquoi elle est moderne ? Parce que Blair fait abolir dans un vote du Congrès la clause IV de la constitution du parti travailliste qui disait de manière vague que le parti travailliste visait la propriété commune des moyens de production. Cette formule censée représenter l'ambition « socialiste » du travaillisme faisait signe en direction de politiques de nationalisation, d'étatisation, sans que l'on puisse même parler de socialisme d'État. En tout cas, symboliquement, le renoncement formel à cette clause IV était le signal d'une « modernisation », où le marché, la libre concurrence, l'entreprise étaient maintenant mis au centre, c'est ça qui compte !
Et comment les médias de gauche réagissent-ils à ce moment-là ?
Les médias de gauche, c'est quoi, en Grande-Bretagne ? Souvent, on pense que dans la presse, le média de gauche, de centre gauche, principal serait le Guardian. Et l'Observer. Au vu des dernières années, on a du mal à se dire ça. Au Guardian, qui est une expression du centre gauche travailliste, on peut parfois trouver des travaux d'enquête très poussés, la révélation de vraies affaires, des choses magnifiques sur le plan journalistique. Après, il y a ce qui relève de la routine informationnelle qui n'est pas du tout du même ordre et qui est finalement très conformiste.
Le meilleur exemple que je peux donner c'est le magazine du parti communiste britannique. Historiquement le PC britannique a toujours été très petit mais influent, notamment dans le monde syndical. Et surtout, son magazine Marxism Today avait à la fin des années 1980 et au début des années 1990 un rayonnement énorme, jusqu'à voir des ministres conservateurs lui donner des interviews. On pouvait y lire des articles de célébrités de la gauche intellectuelle comme Eric Hobsbawm ou Stuart Hall. Eh bien, même cette revue a contribué à une espèce d'illusion blairiste. Même pour Eric Hobsbawm, le grand historien lié au PC, comme pour beaucoup de gens dans le milieu intellectuel et en lien avec la presse classée à gauche en Grande-Bretagne, il y a une espèce d'adhésion à cette nouveauté travailliste qui prend acte de la chute du Mur, qui prend acte de la désindustrialisation de l'économie britannique et surtout qui permet d'en finir avec un pouvoir conservateur détesté et continuellement au pouvoir pendant 18 ans. Donc il y a une espèce de consensus autour de l'émergence du néo-travaillisme qui veille de son côté à maîtriser son image : les dépenses de communication du gouvernement Blair sont le double de celles de Thatcher qui en faisait déjà beaucoup en la matière.
Et après la longue nuit blairiste, on arrive en 2015 avec l'accession de Jeremy Corbyn à la tête du Labour. Il est en butte à l'hostilité des médias d'emblée ?
Quand Corbyn arrive à la tête du parti en 2015, on pense d'abord que ce type-là ne sera jamais élu ; les parrainages de parlementaires travaillistes lui ont permis de briguer l'investiture pour pouvoir afficher un certain pluralisme. Mais assez rapidement, et contre toute attente, il y a un engouement énorme. Certains commencent à angoisser. Commencent à resurgir « la gauche radicale », les dangers qu'il ferait courir à l'économie, à la défense du pays et les connexions avec l'Irlande : c'est « l'ami des terroristes irlandais ». Mais ça, ça ne marche plus car pour toute une génération, c'est dépassé, c'est les années 1970, ils s'en fichent. Voire, quand ils savent des choses sur les années 1970, ils estiment que c'était pas mal sur plein de questions : de logement, de salaire, de politique sociale, etc. Et puis Gerry Adams et le Sinn Fein étaient devenus des acteurs politiques électoraux légitimes et de premier plan. Donc tout ça ne marche pas, alors on l'attaque aussi sur le fait qu'il soit soutenu par une gauche radicale, soi-disant violente, qui pratiquerait l'intimidation, avec de vraies fabrications de faux événements.
Les activistes de la Media Reform Coalition, sorte d'équivalent britannique d'Acrimed, ainsi que plusieurs études d'universitaires qui ont fait un travail quantitatif sur de gros corpus et de longues périodes ont montré que le traitement médiatique des travaillistes sous Corbyn, et de Corbyn lui-même, était quasi universellement défavorable. Dès 2015, le Guardian a été absolument complice de ce sabotage, et le restera de bout en bout. Dans la presse sérieuse, il y a le journal The Independent, qui a assez longtemps traité Corbyn et la gauche corbyniste de manière plutôt objective. Mais à un moment, ça s'arrête et on a quelque chose qui ressemble à une reprise en main et un alignement sur la campagne anti-Corbyn.
Globalement, jusqu'à 2017, on met l'accent sur l'incompétence de Corbyn, « le type qui ne saura pas faire ». Non seulement son incompétence mais comme il est issu de la circonscription londonienne de Islington, jadis quartier très populaire devenu un quartier qu'on appellerait « petit bourgeois de gauche », on lui reproche d'être élu par une jeunesse plutôt diplômée, déconnectée des « réalités » du « pays profond » – sur une variation des malheurs de la « classe ouvrière blanche ». Donc subitement, le reste de l'échiquier politique trouve que les ouvriers, c'est super, et que les jeunes diplômés sur les bancs de la fac sont dans leur bulle, ne connaissant rien à l'authenticité ouvrière. Et dans les médias infuse cette idée que Corbyn conduit à la catastrophe parce qu'il est soutenu par de petits groupes marginaux, de nantis, et notamment, au sein du parti travailliste, par Momentum qui a été fondé pour soutenir sa campagne et qui serait composé d'une jeunesse bobo, des « extrémistes » déconnectés.
Il y a un premier test électoral à la toute fin de l'année 2015 avec une élection partielle dans une circonscription du nord du pays et l'on pense que ce sera le début de la fin pour Corbyn qui est censé essuyer un revers. Le journaliste du Guardian va faire un reportage sur place : c'est le nord, il pleut, les gens sont pauvres, ils sont cons mais on les aime parce que de toute façon, ils détestent la gauche – bref, tous les clichés y passent et ces médias prédisent une grosse claque pour la gauche travailliste. Or le candidat soutenu par Corbyn est élu à une large majorité et à chaque nouvelle élection, l'échec attendu – et espéré par la grande majorité du parti travailliste parlementaire – n'arrive pas.
Quand arrivent les législatives anticipées en juin 2017, dans les sondages ça se présente mal, tout le monde est très content, pensant qu'il va se prendre une raclée et sera enfin obligé de laisser la place. Mais à mesure que l'élection approche, les travaillistes remontent, Theresa May commet des maladresses terribles, et le jour du vote le parti travailliste connaît sa plus forte progression électorale depuis 1945, en gagnant des circonscriptions qu'il n'avait jamais réussi à prendre. Et il réussit ça malgré un acharnement de tous les médias : « Corbyn l'incompétent », le « non premier ministrable », la « calamité », « l'hiver nucléaire », la « fin du débat démocratique en Grande-Bretagne », etc. Cela dit, la campagne électorale impose d'accorder un temps de parole qui permet à cette gauche de s'adresser plus directement au pays, et le programme anti-austérité, ainsi que l'engagement à respecter l'issue du référendum sur le Brexit acquièrent une très large audience.
Justement, cette série de bons résultats électoraux ne lui offre pas un certain répit sur le terrain médiatique ?
Non, ça ne cesse jamais. Non seulement Corbyn est de gauche, mais en plus il est issu d'un milieu de petite classe moyenne populaire, qui n'a pas fait les écoles classiques de l'élite politique. On est en Grande-Bretagne, et Corbyn n'est pas un produit de ce gros résidu aristocratique, nobiliaire. Tant que ces gens sont sur les arrières bancs du Parlement ça va encore, mais l'idée qu'ils puissent arriver à Downing Street… Il y a une disqualification sociale et symbolique qui est très forte. Boris Johnson a, lui, la particularité d'être tellement l'homme du sérail que ses bouffonneries et ses outrances sont acceptables, ses saillies formidablement sympathiques. Une personne jamais sérieuse, qui déconne, qui arrive décoiffée avec sa tasse de thé, une espèce de caricature de nobliau excentrique sorti d'une comédie du genre « Quatre mariages et un enterrement ». Donc ça, pas de problème ; mais Corbyn, jamais de la vie !
Mais c'est vrai qu'après cette presque victoire en 2017, la progression électorale des travaillistes est telle que personne ne songe à lui demander de quitter la tête du Labour. D'habitude c'est « tu perds, tu pars », là non. Par ailleurs, dans les mois qui vont suivre, la structure bureaucratique au service de la direction du parti qui est entièrement acquise au blairisme va être renouvelée avec l'arrivée d'une nouvelle secrétaire générale, Jenny Formby, issue du monde syndical, proche de Corbyn, et de beaucoup de gens loyaux. La direction du parti paraissait donc en bien meilleur état de marche pour permettre une victoire prochaine.
D'où, après une brève période d'accalmie post-électorale, une reprise des attaques. Par exemple, vers février-mars 2018, se répand la rumeur selon laquelle Corbyn était un agent des services de renseignement tchécoslovaques en 1986. C'est un député conservateur qui a sorti ça. Il y a eu une démarche en justice, il s'est pris une amende de 30 000 £, ça s'est réglé comme ça, mais ça a duré 15 jours. Et le truc est tellement énorme que même les médias les plus hostiles n'ont pas trop insisté dessus. Mais à peu près dans les mêmes semaines (vers mars 2018), Newsnight – un programme de commentaire politique de la BBC – utilise en arrière-plan, pendant toute la durée de l'émission, une image de Corbyn avec une casquette genre bolchévique sur fond de Kremlin rougeoyant... Mais ça, ce n'est rien en comparaison de l'extrême virulence du programme documentaire phare de BBC 1, « Panorama », diffusé à l'été 2019, sur l'antisémitisme dans le Labour quelques mois seulement avant les élections de décembre 2019. Il faut regarder l'indispensable documentaire – « The Labour File » – qu'Al Jazeera a consacré à cet épisode, entre autres.
Est-ce que les médias français s'intéressent alors à ce qui passe chez les travaillistes, et si c'est le cas est-ce qu'ils sont aussi hostiles à Corbyn que leurs confrères britanniques ? Parce qu'en France, à la même époque, Mélenchon qui a fait près de 20 % à la présidentielle, est en permanence dans le collimateur des médias.
Le parti travailliste qui avait environ 200 000 militants en 2015 se retrouve avec près de 600 000 militants deux ans plus tard, au moment où la plupart des autres partis sociaux-démocrates européens sont mal en point. Il se passe donc quelque chose d'énorme. Dans les médias français, ce phénomène n'a éveillé aucune curiosité. Compte tenu de l'état du PASOK grec, du PS en France, alors qu'à un moment, ces partis sociaux-démocrates étaient hégémoniques en Europe, la singularité britannique aurait dû susciter un intérêt certain. Mais non, rien. Il y en a qui ont quand même réussi à se distinguer dans la malfaisance, je me souviens, par exemple, des chroniques de Claude Askolovitch, d'une hargne effrayante.
Pour ce qui est de la comparaison avec Mélenchon et LFI, l'une des grandes différences c'est que Corbyn est à la tête d'un énorme parti de la social-démocratie historique, qui est là depuis près de 120 ans et qui est forcément appelé à exercer le pouvoir dans un système bipartisan. Donc en termes de structuration politique et institutionnelle, la différence est considérable avec la France. Mais globalement, on voit que les situations sont très similaires. Comme dans le cas de Corbyn, Mélenchon est construit en point de cristallisation de tous les malaises de la société française. L'autre jour, j'entends dans la matinale de France Culture le gars qui fait un petit billet politique tous les matins, qui est toujours très gentil et très agréable, mais qui reprend l'antienne selon laquelle Jean-Luc Mélenchon « a brutalisé le débat politique ». L'élément de malaise et de brutalisation du débat politique, c'est Jean-Luc Mélenchon. Les gens qui ont perdu une main ou un œil dans des manifestations de Gilets jaunes, les dirigeant politiques qui ont utilisé plus de vingt fois le 49.3, l'extrême droite qui a sa chaine d'info, tout ça, ce n'est pas une brutalisation du champ politique ! Mais que Mélenchon ait un ton polémique, c'est insupportable, c'est ça la violence… Son bilan de la semaine sur son blog, c'est une contribution au débat politique en termes de contenu, en termes d'information qui est quand même d'assez haut niveau, que l'on soit d'accord ou pas. Pourtant, le cadrage médiatique archi dominant c'est que c'est lui, Mélenchon, « l'élément toxique de la situation ». Et se greffe là-dessus un certain choix des mots qui trahirait une espèce de fond d'antisémitisme. Ça fait des années que ça dure mais depuis le 7 octobre ça a ressurgi très fort et cela participe, entre autres éléments, à l'analogie avec Corbyn entre 2017 et 2019 en particulier.
Tu peux nous expliquer comment et pourquoi ces accusations d'antisémitisme contre Corbyn ont surgi à l'époque ?
À partir de 2017, il y a ces trois facteurs : augmentation des effectifs, mise en cohérence de l'appareil et progression électorale importante. Les corbynistes semblent avoir réussi à remettre le parti en ordre de marche pour revenir au pouvoir. Et c'est là que l'on passe à un ciblage concentré et systématique sur la question de l'antisémitisme, tout le reste n'ayant pas fonctionné jusqu'ici.
En mars 2018, commencent les marches du retour à Gaza. Et il y a ces images terribles des militaires israéliens qui abattent comme des animaux des gens qui marchent avec des drapeaux jusqu'à la frontière. Il y a environ 250 morts et des dizaines de milliers de blessés sur un peu plus d'un an. Corbyn est identifié comme un pro-palestinien historique. Il n'est pas un soutien complet du mouvement BDS (Boycott, désinvestissement, sanctions) mais on le juge quand même pas mal en phase. Il faut bien avoir en tête que le Palestine Solidarity Campaign, qui est l'un des plus gros mouvements anticoloniaux au monde et qui est à l'origine des grandes manifestations qu'on a vues ces derniers mois, est identifié comme très en lien avec Corbyn. Et comme traditionnellement, historiquement, la classe politique et les médias sont très pro-israéliens en Grande-Bretagne, il va donc falloir à la fois bloquer Corbyn et neutraliser les images qui viennent de Gaza. Donc plutôt que de parler de Gaza, on va dire « Corbyn est antisémite, et toute la gauche autour de lui, élus et camarades juifs et juives inclus, sont des antisémites », et ce à tout propos. Les exemples sont sans fin, mais je peux en donner un ou deux.
L'un des premiers scandales autour du prétendu antisémitisme de Corbyn, c'est un truc qu'il faudrait toujours rappeler. En avril 2018, Corbyn est invité au repas de Pessah par une organisation juive très à gauche et religieuse : Jewdas. Jewdas est vraiment dans la tradition de la gauche radicale juive, si centrale dans l'histoire de la gauche radicale européenne, et clairement antisioniste. Et c'est rapporté ainsi : il va fêter une fête juive avec des antisémites, et des gens (des Juifs pratiquants) qui pourraient encourager l'antisémitisme. Corbyn aurait commis une terrible erreur de jugement en acceptant leur invitation « à ce moment-là » (comme si plus tôt ou plus tard y aurait changé quoi que ce soit !). Et c'est parti ! Ça a été un des épisodes marquants du scandale. Et des exemples comme ça, ridicules, on peut les multiplier.
Un des premiers axes d'attaque, dans l'été qui a suivi, fut autour de l'IHRA (l'Alliance internationale pour la mémoire de l'holocauste) et de la définition de l'antisémitisme qu'elle reprend, assortie de onze exemples. À ce stade, cette définition avait été adoptée par neuf États dans le monde, dont Israël. C'est une définition qui a été rejetée par son concepteur même, Kenneth Stern, aux États-Unis, après avoir constaté l'usage qui en était fait sur les campus américains pour empêcher les gens de débattre sur la question palestinienne, notamment parce que sur les onze exemples utilisés, sept font l'amalgame entre critique d'Israël et antisémitisme. Pourtant on assiste à une campagne pour dire que le parti travailliste doit adopter cette définition pour apporter la preuve qu'il n'est pas antisémite. Les travaillistes disent « on va regarder », la pression est super forte, c'est le feuilleton de l'été 2018. Ils disent : « on peut adopter la définition mais on ne va pas garder tous les exemples parce qu'ils posent problème, notamment en termes de liberté d'expression ». Et le seul fait qu'ils disent que ça va poser problème suscite des critiques, on entend : « le parti travailliste, la gauche travailliste, Corbyn, ne veulent pas entendre parler d'une définition de l'antisémitisme, et donc c'est qu'ils sont antisémites ». Pour vous donner une idée de la teneur et du niveau des débats, je me rappelle avoir écouté une fameuse émission de la BBC (Women's Hours, Radio 4) dans laquelle Margareth Hodge, qui est une vieille députée travailliste plutôt gauchiste dans les années 1970, mais devenue très droitière et pro-israélienne, affirme que c'est incroyable que le parti ne veuille pas adopter cette définition parce qu'elle explique qu'il y aurait « des tonnes de pays qui l'auraient déjà fait » (« tons of countries ») – alors qu'ils sont moins de dix en réalité à l'époque… C'est un mensonge caractérisé, de la pure désinformation, mais sans aucune correction d'aucune sorte de la part de l'intervieweuse.
Ce qui est intéressant, c'est que le parti libéral démocrate britannique a des élus qui sont clairement pro-palestiniens et qui ont eu un débat sur cette définition. Et il n'en a jamais été question une minute dans les médias britanniques. Le gros de la critique a porté sur les travaillistes, a été nourri de l'intérieur du parti par des composantes opposées à Corbyn et entretenu par l'inertie médiatique.
Cet épisode a cristallisé toutes ces thématiques-là. Il a permis ensuite de créer une rumeur persistante, où aucune des accusations ne tient sérieusement mais où chacune contribue à entretenir un bruit permanent. Alors je vous donne encore quelques exemples. Il y a cette élue issue de la gauche socialiste au sein du parti travailliste, Jo Bird, une femme très à gauche qui revendique sa judéité. Dans un meeting, elle fait une plaisanterie. Elle dit que les procès en antisémitisme contre le Labour sont injustes, qu'il faut que les gens aient droit à un procès équitable. Et en anglais, on dit procédure équitable, due process, c'est-à-dire un processus respectueux des règles internes du cahier des charges travailliste. Elle fait un jeu de mots : en anglais due process ça ressemble à jew process. Elle fait ce jeu de mots là, qu'on pourrait considérer tout à fait inoffensif, et tu pourrais même dire qu'elle fait appel à une éthique juive de la justice. Ce jeu de mot est devenu une nouvelle nationale ! La gauche corbyniste vient encore de faire la preuve de son antisémitisme ! Ça ne dure pas très longtemps, mais c'est une nouvelle nationale jusqu'à la suivante.
Autre exemple : Corbyn fait le débat de fin de campagne avec Boris Johnson, et à un moment, il parle de l'affaire Epstein, le pédophile ami des puissants aux États-Unis et ailleurs. En anglais, ça se prononce Epstine, et Corbyn prononce Epstaïne. Et là sur Twitter un comédien assez connu dit « Corbyn ne peut pas s'empêcher d'ostraciser les Juifs » (othering Jews). D'autres gens répondent « ben non, mon nom vient de d'Allemagne, d'Europe centrale, c'est comme ça qu'il faudrait prononcer », et donc tu as un débat là-dessus.
Dernière anecdote : dans sa circonscription, où il y a des synagogues et des organisations juives qui le soutiennent depuis toujours, il y a un type qui a longtemps organisé des commémorations du massacre qui a eu lieu dans le village palestinien de Deir Yassin en 1948, Paul Eisen. Or ce type a fini par virer négationniste. Mais Corbyn bien avant cela, et comme beaucoup d'autres, avait contribué financièrement aux commémorations avec toutes sortes de gens, dont certains rabbins, des laïques, des religieux, etc. Eh bien Corbyn est accusé d'être proche des négationnistes ! On se dit que ça ne va pas être trop difficile de voir que cette accusation ne peut pas tenir parce qu'on retrouve en ligne la lettre du cabinet de Tony Blair, au même mec, Paul Eisen, pour s'excuser de ne pas pouvoir être présent et pour le remercier de l'organisation de cet événement.
Et bien entendu, jamais un seul mot, nulle part, sur les expressions répétées de soutien à Corbyn des personnes et organisations juives, à commencer par celles de sa circonscription, en Grande-Bretagne et ailleurs dans le monde.
Voilà, je pourrais continuer quasiment à l'infini. L'analogie avec ce qui se passe pour La France Insoumise et, en particulier pour Jean-Luc Mélenchon, est évidente, la ressemblance est absolument frappante. Et on se rappelle que Sanders aux États-Unis y avait eu droit aussi…
Et finalement, c'est sur cette question qu'ils vont finir par avoir sa peau après la défaite électorale de 2019, jusqu'à l'exclure du parti travailliste.
Oui, aujourd'hui, il est député indépendant, il a été suspendu, puis réintégré par le comité exécutif national, mais Starmer a décidé de l'exclure quand même en contravention de toutes les recommandations qui avaient été faites dans le rapport que Corbyn n'a même pas contesté. Corbyn a dit bien sûr que l'antisémitisme existe, il n'est pas question de le contester, mais que son ampleur dans le parti travailliste a été vastement exagérée. Ce qui est absolument et indéniablement vrai. En dehors de Corbyn il y en a un paquet d'autres qui ont été soit rappelés à l'ordre, soit exclus. L'autre cas célèbre, c'est Ken Loach, quand l'Université libre de Bruxelles (ULB) a voulu lui remettre un titre de docteur Honoris causa, il y a même eu une campagne pour dire qu'il était négationniste. Alors il y a bien sûr des réactions contre ça de tout un tas d'organisations de gauche, par exemple tu as la Jewish Voice for Labour, ce sont des gens qui ont leur site, qui contre-argumentent en permanence et qui défendent des positions de gauche antisioniste, mais la question c'est que ça ne passe pas le seuil du reporting, ça ne perce pas dans les grands médias.
Et pour finir, est-ce que tu peux nous dire un mot de la situation actuelle ? Keir Starmer était soutenu par le Sun, le parti travailliste complètement recentré – à tel point qu'un éditorialiste célèbre du Guardian a annoncé rendre sa carte du parti –, est-ce qu'on est repartis pour vingt ans d'une resucée de blairisme ?
La réélection de Corbyn dans sa circonscription, avec une très large majorité, et contre une campagne du Labour très déterminée à l'éliminer enfin complètement de la scène politique met un peu de baume au cœur. L'élection de quatre autres indépendants pro-palestiniens positionnés contre le Labour inconditionnellement pro-Israël, est aussi un motif d'encouragement. À quoi il faut ajouter que le Labour 2024, « responsable », ouvertement repositionné à droite sur un ensemble de questions, et qui a donc fait l'objet d'un traitement médiatique tout à fait bienveillant, obtient 500 000 voix de moins qu'en 2019, défaite de Corbyn dramatisée, présentée comme la pire de l'histoire travailliste, afin de mieux justifier le réalignement droitier du parti et de préparer l'exclusion de ses composantes plus à gauche. Bref, il y a quelques leçons encourageantes à tirer de cette affaire, et malgré les apparences dues au mode de scrutin (qui induit une distorsion sans précédent entre vote et majorité parlementaire), on doit constater que manifestement, le Labour de Starmer, même après 14 ans d'agression sociale et d'extrémisme tory, ne fait pas rêver, pour dire le moins, et on est très, très loin de l'euphorie qui avait accompagné pour un temps la première élection de Blair en 1997.
Propos recueillis par Blaise Magnin et Thibault Roques, avec une retranscription collective d'adhérent·e·s d'Acrimed.
Acrimed est une association qui tient à son indépendance. Nous ne recourons ni à la publicité ni aux subventions. Vous pouvez nous soutenir en faisant un don ou en adhérant à l'association.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
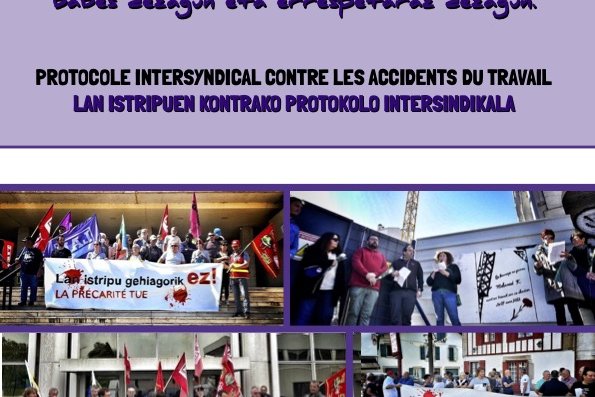
Protocole intersyndical Pays Basque contre les accidents du travail

Conférence de presse de présentation du protocole le 27/08/2024 devant le restaurant Le Prado de Saint-Jean-de-Luz, où 4 ans plus tôt trois salarié-es étaient brulé-es au travail, dont un très gravement.
Tiré de Entre les ligne et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/09/03/protocole-intersyndical-pays-basque-contre-les-accidents-du-travail/
Solidaires Pays Basque, avec les organisations USCBA CGT 64, FSU 64 et LAB IEH rend aujourd'hui public la première version du protocole d'action face aux accidents du travail.
Nos quatre organisations se sont mobilisées à plusieurs reprises ces trois dernières années face à chaque accident du travail mortel. Il est pour nous indispensable de rendre visible tous ces accidents du travail, dont quasiment personne ne parle. Qu'il soit simple, grave ou encore mortel, nous ne pouvons pas banaliser un accident du travail.
Ces dernières années, nous nous sommes mobilisé-es autour des accidents mortels mais nous sommes conscient-es que beaucoup d'autres accidents sont passés sous silence.
Par ce protocole, nous voulons créer un outil accessible au plus grand nombre des salarié-es afin de faire le maximum de pédagogie possible dans les entreprises. En automatisant les réponses à apporter en cas d'accident au travail, nous gagnerons en efficacité. En le faisant en intersyndicale, nous gagnerons du temps et serons en mesure de répondre le mieux possible face à chaque accident du travail.
En d'autres mots, ce protocole veut essayer de rendre visible tous les accidents du travail et les dénoncer notamment les plus graves et les mortels.
Il a pour but :
* de faire de la pédagogie dans les entreprises en amont aux accidents, de créer des relations entre les travailleur-ses et les organisations syndicales
* d'automatiser certaines mobilisations en cas d'accidents afin de ne plus les laisser invisibles.
Dès aujourd'hui, nos quatre syndicats commencerons à distribuer ce protocole à l'ensemble de nos représentant-es dans les entreprises et les administrations, au-delà de nos étiquettes syndicales. Nous appelons l'ensemble des salarié-es à le lire, à s'en imprégner et à prendre contact avec nous dès qu'ils et elles sont isolé-es face à un accident au travail dans leur entreprise.
Ce document reste un document ouvert à toutes les organisations syndicales qui souhaiteraient nous rejoindre. Il est encore à améliorer et à développer.
Lire le protocole
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Soutien à la grève des salarié·es d’aide à la personne Onela

Depuis février 2024, les salariéEs de l'entreprise d'aide à la personne ONELA sont en grève. Ils et elles dénoncent des conditions de travail déplorables, racontent la présence de rats et de plafonds qui tombent sur les salariéEs. Pourtant ce sont des emplois dits essentiels, des emplois du prendre soin.
Tiré de Entre les lignes et les mots
« Nous 7 salarié.es de l'entreprise de service à la personne ONELA, sommes en grève pour dénoncer les conditions de travail indignes auxquelles nous sommes confronté.es, non seulement au sein de la cellule d'astreinte d'ONELA, mais aussi et surtout dans l'ensemble du secteur de l'aide à la personne. Pourtant applaudi.es pendant la crise sanitaire, nous sommes redevenu.es des travailleurEuses invisibles et méprisé.es et l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir n'augure rien de bon en ce sens. » – réseaux sociaux – @mouvementgreviste
La mission du centre d'astreinte d'où est partie la grève est d'apporter une aide par téléphone les soirs, les week-end et les jours fériés, aux personnes âgées et handicapées et aux auxiliaires de vies pour assurer la bonne réalisation des soins, organiser les remplacements de dernière minute, soutenir les auxiliaires dans des situations qu'elles n'ont jamais vécu…
Ils et elles revendiquent de meilleures conditions de travail, un salaire décent, et du respect de la part de leur employeur qui a eu des positions racistes récemment dans les médias. Leurs requêtes n'ont pas été entendues, l'employeur a proposé une augmentation de 0,13 euros brut. [1]
La lutte pour revaloriser les fonctions du soin est une lutte anti validiste antiraciste, féministe.
Il y a énormément de femmes racisées dans les emplois d'aide à la personne. Ce sont des emplois précaires, avec de mauvaises conditions de travail. Dans un contexte de marché du travail violent et discriminant, spécialement envers les femmes racisées, le rapport de force pour exiger une amélioration des conditions de travail est difficile à mettre en œuvre.
Ces emplois du prendre soin pèsent sur les corps. Les risques musculo-squelettiques des emplois de ménage, d'auxiliaire de vie, d'aide à la personne au sens large sont des emplois handicapants. Ils produisent des douleurs chroniques, des souffrances, et du handicap. En ce sens, ils doivent être absolument revalorisés, mieux rémunérés, mieux répartis dans la société.
La Vie Autonome et la désinstitutionnalisation sont des projets politiques au cœur des luttes anti validistes. Selon les directives, la désinstitutionalisation doit viser à restaurer (redonner) l'autonomie, le choix et le contrôle aux personnes handicapées, afin qu'elles puissent décider comment, où et avec qui elles souhaitent vivre. Il est important que les personnes chargées de la gestion des institutions ne soient pas invitées à diriger le processus de désinstitutionalisation.
La désinstitutionalisation n'est pas possible sans le développement d'aides et de services de proximité qui permettent aux personnes handicapées de vivre de manière autonome et d'être intégrées dans la communauté. La désinstitutionalisation vise également à prévenir toute future institutionnalisation, en veillant à ce que les enfants puissent grandir avec leur famille, leurs voisines et leurs amies au sein de la communauté, au lieu d'être isolés dans des établissements.
La lutte des salariéEs en grève de ONELA dépasse largement la lutte au sein de l'entreprise.
Carmen Diop, Doctorante en science de l'éducation, elle étudie la subjectivité et les trajectoires de femmes noires au travail :
« Le travail c'est le lieu ou on construit son identité, sa santé mentale. Or le marché du travail est structuré par des divisions de genre, de sexe, de race de classe, d'origine, d'apparence sociale, d'âge, de handicap. Les femmes noires cumulent des désavantages. Le déni de la reconnaissance repose sur les inégalités sociales et sur la domination culture. Le racisme peut prendre des formes extrêmes de violences ou des formes plus « douces » comme le débat médiatique, l'isolement, les moqueries. Le racisme est très difficile à identifier. Et quand les micro agressions sont prises isolément on peut dire que ce n'est rien. L'accumulation de ces agressions constitue un traumatisme sociaux et émotionnel qui constitue un fardeau dont il est impossible de se défaire. Le racisme ordinaire (refus à répétition, humiliations fondées sur la culture, la couleur de peau) est un risque pour la santé physique et psychologique de l'individu. » [2]
Quatre façons de soutenir la lutte des gréviste de Onéla :
*re partager les publications et les articles. Instagram @MouvementGreviste
* signer la pétition
* remplir la caisse de grève !
* Rejoindre les rassemblements annoncés sur leurs réseaux sociaux :
Instagram @MouvementGreviste
Références
[1] Après deux mois de grève, les agents d'astreinte des auxiliaires de vie d'ONELA déterminées à poursuivre la lutte
[2] Konbit Afrofem #6 Femmes noires au travail, entre isolement et émancipation collective : perspectives (post)coloniales par Carmen Diop et Rose Ndengue
Les Dévalideuses
« Les Dévalideuses » est une association de loi 1901 visant à représenter les voix des femmes handicapées dans toute leur diversité, tout en contribuant à rendre publiques et à défendre les problématiques qui leur sont propres. Elle s'inscrit dans une démarche intersectionnelle, féministe et anti-validiste.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Aux origines de la crise écologique

Sommaire
1. Introduction
2. Quelques mots sur la (…)
3. la question des limites
4. Homo sapiens est-il une (…)
5. Pourquoi alors sommes-nous
6. le processus de civilisatio
7. En conclusion provisoire
28 août 2024 | tiré du site europe-solidaire.org
https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article71851
1. Introduction.
Réflexion : Un spectre hante le monde : le spectre de l'éco-anxiété.
Ce n'est pas un simple effet médiatique, ni un ressenti propre aux pays industrialisés et riches, ni un ressenti propre aux citoyens ayant un haut niveau d'éducation.
C'est un ressenti mondial, de plus en plus prégnant, qui signifie que la crise écologique rebat les cartes. Il ne s'agit plus seulement, pour tous les perdants du système capitaliste, de se battre pour mieux vivre, mais de se battre pour sauver l'humanité en route dans une course vers l'abîme.
L'approche très dominante est celle de la collapsologie. Or les arguments des collapsologues posent cependant questions et souffrent de défauts majeurs :
• Pas de classes sociales ni de responsables identifiés, alors qu'on pourrait être « effondriste » et cibler les responsables
• Les humains seraient du coup fondamentalement responsables en tant que tels, ce qui est contraire aux théories de l'évolution et à l'approche scientifique c'est-à-dire matérialiste, car il s'agit en l'occurrence d'une pensée essentialiste
• Le point de non retour n'est jamais clairement défini.
Mon discours n'est pas une vérité, mais l'état de mes réflexions avec la volonté d'être cohérent et de m'appuyer sur les travaux des anthropologues et archéologues mais aussi sur ceux des biologistes de l'évolution. Mon approche est similaire à celle de l'historien Jérôme Baschet : « Se placer dans la perspective historique permet d'en finir avec l'illusion de la naturalité du phénomène ». Cela suppose aussi de définir la crise écologique pour en définir l'origine.
2. Quelques mots sur la crise écologique.
La crise écologique se décline en deux dimensions qui s'interconnectent à tous les niveaux (dans leur origine, leurs conséquences, leurs interactions) :
• Une crise climatique qui s'insère dans la problématique des limites planétaires : les humains dépassent-ils les limites ? Y a-t-il des limites ?
• Une crise de biodiversité qui peut enclencher un effondrement du vivant.
Ce que nous savons (c'est un consensus scientifique), c'est que cette crise écologique est la conséquence des activités humaines. Il n'y a pas de causes extérieures.
La question se pose du nom à donner à cette période de crise : anthropocène ou capitalocène ? Si la question est pertinente, la poser telle quelle (en opposant les deux termes) l'est moins. En effet, les deux termes ont leur part d'ambiguïté.
Anthropocène peut laisser sous-entendre que cette crise est le produit de l'humanité « en tant que telle » et donc gommer les responsabilités fort différentes des classes dominantes et des classes dominées. Et poser la problématique ainsi fait l'impasse sur pourquoi et comment en est-on arrivés là, et peut nous entraîner sur la pente de la « nature humaine », donc nourrir les pensées de l'effondrement (« De toute façon, il est trop tard »). Mais le terme a toutefois une pertinence dans le sens où il interroge sur le fonctionnement des sociétés humaines, au-delà de la période récente du capitalisme.
Capitalocène peut laisser sous-entendre que l'origine de la crise est le capitalisme, quand tant d'éléments nous indiquent que le problème est antérieur au capitalisme. Et poser la problématique ainsi fait aussi l'impasse sur pourquoi et comment en est-on arrivés là. Cela peut aussi laisser croire qu'il suffirait d'un changement politique et économique pour résoudre la crise « rapidement et facilement », ce qui n'est évidemment pas le cas. Reste qu'à l'évidence, le capitalisme est un fantastique accélérateur de la crise écologique. On peut parler d'accélération exponentielle, ce qui donne une pertinence au terme. Mais le capitalisme n'est pas seulement responsable d'une accélération de la crise écologique. En effet, il engage, via la marchandisation de tout le vivant, un rapport écocidaire avec le monde.
3. la question des limites
Pour résoudre cette difficulté, il est donc indispensable de porter un regard sur les origines de la crise et la place particulière de l'espèce humaine dans le vivant. La question posée est ainsi celle des limites au développement d'une espèce. A l'évidence, les humains sont en train de dépasser les limites.
Changement climatique, acidification des océans, déséquilibre du cycle du carbone, de l'azote, du phosphore, de l'eau douce, érosion de la biodiversité : tout est interconnecté.
Cette question des limites a une histoire récente : Thomas Malthus (fin 18e, début 19e), Paul Ralph Ehrlich qu'il ne faut pas confondre avec Paul Ehrlich (La bombe P, 1968) et Dennis Meadows (Les limites à la croissance, Club de Rome, 1972).
On peut identifier trois erreurs majeures de Malthus :
• La démographie est pensée comme exponentielle (voir plus loin).
• Les ressources sont limitées. Il n'a pas vu que l'humanité fabrique ses ressources via son travail et sa technologie. La question en fait est avant tout celle des conséquences (en termes de limites planétaires) de la fabrication des ressources en exploitant à outrance la planète. Bien avant d'épuiser les ressources, l'humanité déstabilise la biosphère par les conséquences des formes d'utilisation des ressources. Au passage, c'est la raison pour laquelle l'énergie nucléaire ne peut être (même de manière transitoire) une solution à la crise énergétique, mais au contraire ne peut qu'amplifier la crise.
• Il prend le parti des classes dominantes et fait l'impasse justement sur leurs responsabilités.
On lui pardonne les deux premières erreurs, pas la dernière !
On ne pardonne pas à Ehrlich ni au couple Meadows car ils auraient dû savoir qu'il n'y aurait pas de bombe Population ! Dès 1963, des démographes alertaient sur le prochain déclin de la démographie humaine, comme l'écologiste américain Barry Commoner.
4. Homo sapiens est-il une espèce à part ?
Pourtant, il n'y a pas de différence de nature entre notre espèce, Homo sapiens, et les autres espèces vivantes, végétales ou animales, mais une différence (importante) de degré aux conséquences considérables.
Toutes les espèces, pour survivre, ont vocation à défendre leurs intérêts et donc sont en permanence en situation de dépassement des limites. Si le vivant s'est maintenu, c'est qu'il existe un mécanisme de contrôle qui permet d'éviter le « dérapage ».
Celui-ci a pourtant déjà eu lieu dans le passé. Lors de la crise du Dévonien, il y a 360 millions d'années, on a identifié qu'une des causes est climatique (refroidissement généralisé de la planète) largement amplifié (sinon créé) par le fonctionnement du vivant : la diversification des plantes terrestres ayant (sans limites !) entraîné une baisse importante du CO² dans l'atmosphère, réduisant trop l'effet de serre.
Le mécanisme de contrôle s'est mis en route un peu tard, ce qui a conduit à une perte de 75% des espèces, prélude au redémarrage de la diversification du vivant.
Ce mécanisme, c'est la sélection naturelle. Quant une espèce dépasse les limites (mouvantes et évolutives), la sanction est en général rapide.
Le « jeu », pour les espèces (en fait pour les individus dans le cadre de leur espèce) est de trouver toutes les parades possibles pour résister à la pression de sélection : résister aux changements internes de la biosphère (en particulier climatiques), résister à la pression à l'échelle individuelle (compétition intra-spécifique), résister à la compétition à l'échelle de l'espèce (compétition avec les autres espèces pour l'accès aux ressources).
Dans le cas de la crise du Dévonien, le mécanisme n'a pas fonctionné assez vite car il a été dépassé par l'emballement de la crise climatique. Cela peut nous rappeler le présent…
Et dans le « jeu » des parades face à la pression de la sélection, l'espèce humaine s'est avérée prodigieusement performante. Dans le vivant, la sélection naturelle a favorisé la naissance et le développement des instincts sociaux (empathie, entraide) qui ont permis de s'opposer à la sélection naturelle. L'erreur serait de croire que la sélection naturelle élimine les plus faibles, les moins aptes, ce qui renforce les espèces et porte leur progrès évolutif. Cela paraît une pensée logique, mais c'est en fait un lourd contre-sens.
C'est la pression de sélection qui porte sur les plus faibles et les moins aptes, mais l'espèce gagnante est celle qui réussit au contraire à conserver ses faibles et ses moins aptes, pour plusieurs raisons :
• Conserver les soi-disant faibles, inadaptés, marginaux permet de conserver la diversité génétique et culturelle qui porte la capacité de s'adapter aux changements. Le « faible » peut être porteur d'une variation génétique d'intérêt insoupçonné qui permettra la survie de l'espèce dans le cadre d'une pression nouvelle ou particulière de sélection. La population faible, marginale peut porter des connaissances culturelles qui vont être vitales dans certains contextes.
• La notion d'aptitude est discutable : apte à faire quoi ? conserver un « faible physiquement » mais qui va inventer la théorie de la relativité est fortement utile à l'espèce, qui réussit cet exploit par le développement de ses instincts sociaux.
• Conserver les soi-disant faibles augmente la cohésion sociale du groupe (le « fort » du moment va devenir un « faible » un jour) et optimise de manière exponentielle les compétences collectives de l'espèce.
• Et dans ce domaine (à plusieurs on est infiniment plus forts que tout seuls), l'espèce humaine a eu un succès évolutif inédit. On peut parler de « succès » puisque notre espèce est la seule assez puissante pour menacer tout le vivant et donc se menacer elle-même. Pour le moment on est dans le cadre d'une victoire à la Pyrrhus : nous sommes victimes de notre réussite.
Homo sapiens est fondamentalement coopératif ! Et c'est bien Kropotkine qui a raison contre Hobbes.
Chez les collapsologues, on constate une inversion de l'histoire : on invente qu'Homo sapiens est fondamentalement égoïste pour inventer que la crise écologique pourrait le rendre coopératif, alors qu'en fait il est fondamentalement coopératif et que ses réflexes égoïstes prennent le dessus dès l'instauration des sociétés de classes.
5. Pourquoi alors sommes-nous sur une voie de garage qui ressemble à une impasse ?
La question est donc d'identifier pourquoi l'espèce humaine n'a pas mis ses compétences exceptionnelles (sociales et par prolongement cognitives) au service d'un mécanisme de contrôle conscient assurant sa survie.
Nous savons que les sociétés préindustrielles et surtout celles antérieures à l'époque néolithique étaient remarquables par la variété, la diversité de leurs systèmes culturels. Ces sociétés n'étaient pas exemptes de violence (il n'y a pas le « bon sauvage » du communisme primitif), mais la constante est l'invention et le maintien durant de longues périodes de mécanismes culturels de contrôle de l'individualisme, ce qui limitait de manière drastique les possibilités d'accaparement des ressources par des individus ou des minorités.
Ces sociétés n'étaient pas non plus exemptes de dépassements des limites. Ainsi, ce sont bien les populations humaines du paléolithique qui sont responsables en (grande) partie de la disparition de la mégafaune, sur de vastes espaces.
Mais ces impacts étaient limités par le faible nombre d'humains et leurs capacités techniques limitées. Ce n'est pas une question de différence de nature entre ces sociétés anciennes et celles d'aujourd'hui, mais une différence d'échelle.
Le moment de bascule vient de l'émergence de classes sociales dominantes qui, en captant les ressources pour leurs intérêts propres, en faisant ainsi « sauter le verrou » des mécanismes de contrôle de l'individualisme, entraînent toutes les sociétés humaines dans la dérive d'un productivisme sans limites, enclenchant à terme la crise écologique que nous connaissons aujourd'hui.
Et engageant de fait l'espèce humaine dans une voie à contre sens de l'évolution, qui, à l'inverse, avait sélectionné les instincts sociaux de coopération et d'entraide. Le capitalisme n'est pas un progrès, mais le dernier avatar d'un retour en arrière évolutif.
On peut situer ce moment de bascule il y a environ (suivant les régions de la planète) entre 12 000 et 8 000 ans. En sachant que des sociétés humaines ont résisté (jusqu'à aujourd'hui) à cette dérive. Et même dans les sociétés qui se sont engagées dans cette voie sans issue (99% des humains aujourd'hui…), les comportements de coopération n'ont jamais cessé. Toute l'histoire des sociétés humaines est celle des révolutions contre les classes dominantes et plus largement encore du maintien, de la diversification, de l'adaptation de systèmes culturels coopératifs. On nous dit que le moteur économique de nos sociétés industrielles est l'appât du gain en faisant abstraction de tous les comportements et investissements individuels non marchands, moteurs d'évolution des sociétés en fait beaucoup plus importants.
Il est remarquable aussi de constater que ce moment de bascule vers des sociétés de classes est aussi celui du basculement des sociétés vers le modèle patriarcal.
Il est temps d'aborder une question majeure : pourquoi cette bascule ? Si elle a eu lieu, c'est qu'elle a malgré tout représenté un avantage évolutif pour les populations concernées. Etait-elle alors fatale, comme une conséquence déterminée du processus évolutif de l'espèce ?
Vient évidemment à l'esprit la corrélation entre ce moment de bascule vers des sociétés de classes et patriarcales et l'émergence de l'agriculture comme système économique dominant.
On a alors une explication de bons sens : agriculture = sociétés de classes= crise écologique. Bref, on aurait dû rester comme avant ! C'était mieux !
Mais souvent le « bon sens » est un contre sens…et la corrélation n'est pas une preuve.
En effet, si certains systèmes agricoles (les céréales) ont pu favoriser la dérive, celle-ci n'est pas un produit fatal de l'économie. Il faut bien avouer que l'on n'a pas (et on aura peut-être jamais) la clé du problème. Tout au plus peut-on avancer une explication qui aura au moins le mérite de stimuler les recherches : l'avantage évolutif des sociétés patriarcales contrôlées par une classe dominante est certainement militaire. Ces sociétés ont été plus performantes pour écraser et faire disparaître les autres par la force. En quelque sorte l'émergence de l'agriculture aurait créé les conditions favorables pour la dérive, mais sans être une cause obligatoire.
Un avantage évolutif peut cependant être provisoire et constituer à terme un désavantage évolutif. On estime à quelques millions d'années le temps d'existence d'une espèce. Même si ceci est un constat sur le passé du vivant et n'exclut pas la possibilité d'un temps plus long, il n'en reste pas moins que si notre espèce ne contrôle pas (vite) la crise écologique, elle risque fort d'être bien loin du temps moyen en termes de durée de vie.
Et des successeurs « intelligents » qui dans 10 millions d'années se pencheraient sur l'étude du « moment Homo sapiens » seraient contraints de dire que le faible temps d'existence des humains était le signe d'une impasse évolutive et non d'un progrès.
Si l'on prend en compte l'explication de l'avantage militaire, on doit constater que la fragilité culturelle des populations humaines pour y résister s'appuyait sur une réalité : les instincts sociaux d'entraide et de coopération restaient « cantonnés » au clan et à la tribu. L'autre n'était pas considéré comme un humain. Un autre élément à prendre en considération est que les systèmes culturels de contrôle de l'individualisme étaient aussi porteurs de formes de négation de l'individu, donc de libertés.
Or la naissance récente de l'individu ne favorise pas l'individualisme et l'égoïsme (sublimé dans la création de classes sociales dominantes), mais c'est tout le contraire !
6. le processus de civilisation
L'évolution des sociétés humaines a eu comme conséquence une réalité factuelle : les populations humaines sont passées de quelques milliers d'individus à 8 milliards aujourd'hui et 9 milliards demain, ce qui évidemment change complètement le contexte.
A ce stade il est important d'aborder la question de l'augmentation de la population. Nous l'avons abordé sous l'angle positif (la naissance de l'humanité comme unité symbolique).
N'est-elle pas aussi ou surtout le principal problème ? C'est le concept « malthusien » de la « bombe P ». La crise écologique serait due au trop grand nombre d'humains. Cela parait effectivement de bon sens et encore une fois, le bon sens conduit au contre sens.
Et ce pour deux raisons :
• Les humains ont fabriqué leurs propres ressources. S'ils sont encore restreints par les ressources fondamentales (la diminution des matières premières et les limites énergétiques), nous savons aujourd'hui que l'essentiel des problèmes ne vient pas du nombre d'humains, mais de la façon dont ceux-ci impactent la biosphère. Et en particulier nous savons que les classes dominantes (le capitalisme aujourd'hui) portent (et de loin) la principale responsabilité dans la mauvaise gestion de la biosphère. La Terre peut en fait facilement faire vivre 10 milliards d'humains…sans crise écologique, ni climatique ni de biodiversité.
• La bascule démographique rebat les cartes. Cela n'avait pas été prévu par les démographes avant les années 1970 et évidemment pas par les écologistes. Partout le taux de renouvellement des populations n'est plus assuré. Ce phénomène qui est une tendance lourde d'origine sociale est accentué fortement par la diminution des capacités reproductives des humains. La population humaine va diminuer. Elle augmente encore pour quelques décennies par effet retard, puis va diminuer drastiquement. La « bombe P » existe donc, mais dans l'autre sens. Et ceci va poser d'innombrables problèmes.
Il a fallu un long « processus de civilisation » pour que l'augmentation de la population humaine et son interconnexion économique (la mondialisation) conduisent à l'existence symbolique de l'ensemble de l'espèce comme une tribu unique, pouvant partager les comportements d'entraide, d'empathie et de soutien.
Cela pose évidemment la question du sens de l'histoire (un processus de civilisation). On peut dire qu'il existe effectivement un sens de l'histoire porté par deux données factuelles : l'augmentation de la population (on ne pense pas de la même façon à 8 milliards interconnectés ou à 200 000 en populations éclatées et se rencontrant en fait très peu) et l'augmentation des connaissances portées par les facultés d'enseignement cumulatif et permettant donc de sortir des explications non matérialistes du monde.
Ainsi, le processus de civilisation est en fait paradoxal : il est construit par l'émergence de l'humanité comme une entité potentiellement solidaire, mais ceci s'est fait au détriment de la perte des mécanismes de contrôle de l'individualisme.
La crise écologique est donc à appréhender en quatre étapes, en sachant qu'il s'agit plus d'un continuum que d'étapes séparées clairement les unes des autres et que ces étapes ne signifient pas un déroulement historique mécanique. Si rien ne vient de rien, donc si l'étape 2 est bien le produit de l'étape 1, l'étape 2 n'est pas obligatoire dans sa forme. L'espèce aurait pu ne pas s'installer dans la voie de l'étape 2 mais dans une autre étape 2 et du coup l'étape 3 n'aurait pas eu lieu ou bien sous une forme totalement différente.
Pour comprendre ce fonctionnement, on peut faire appel à l'évolution des primates. L'espèce de primate phylogénétiquement la plus proche des humains est le Bonobo. Cette espèce est coopérative, non violente, non compétitive, non hiérarchique, utilise la sexualité comme une médiation sociale alors que notre espèce humaine est (à l'heure actuelle !) compétitive, hiérarchisée, violente et patriarcale (la seule espèce de primate dont les mâles peuvent tuer les femelles !). L'ancêtre commun à ces deux espèces a évolué dans deux directions totalement opposées.
Ces quatre étapes de la crise écologique, pensée comme une crise de dépassement des limites, sont les suivantes :
• Le dépassement des limites vient de fonctionnement même du vivant. Chez les autres espèces, le dépassement (permanent) se paie cher et la sélection naturelle vient rappeler très vite à l'ordre. Faute de ressources suffisantes dues au dépassement des limites, l'espèce décline jusqu'à revenir au niveau où elle ne fait plus porter une pression trop forte sur ses ressources.
• L'évolution, chez Homo sapiens, a conduit au développement de ses instincts sociaux, et dans un processus dialectique au développement de ses compétences cognitives, développement qui, du coup s'oppose à la sélection naturelle : c'est le principe réversif de l'évolution. Le premier « verrou » est débloqué, l'espèce humaine peut fabriquer, par son travail, ses propres ressources. De « singe nu », proie des grands prédateurs, Homo sapiens est devenu dominant et super-prédateur.
Ses compétences auraient dû alors lui permettre de gérer de manière organisée et coopérative ses limites (il avait tout pour cela puisque le dépassement des limites était lui-même conduit par ses compétences sociales), mais l'installation dans des sociétés de classes, dont le fonctionnement est dépendant des intérêts des classes dominantes en lieu et place de l'intérêt collectif de ses membres, permet de passer le deuxième verrou : la crise écologique se profile, le processus n'a plus de contrôle ou en tout cas le contrôle devient de plus en plus difficile.
• Le capitalisme constitue la quatrième étape. Cette forme d'organisation a deux conséquences : par le processus d'aliénation du travail la grande masse des humains n'a plus aucun contrôle sur son lien avec la nature et le capitalisme augmente de façon exponentielle la pression sur les ressources et induit des dysfonctionnement du système terre, conduisant à la crise écologique perceptible et prégnante : crise climatique, crise de biodiversité. A ce stade, l'emballement est possible et peut porter la disparition de l'espèce humaine et de beaucoup d'autres avec elle.
Si on a l'explication du problème de la crise écologique, on a du coup aussi les clés de la porte de sortie : l'émergence de l'espèce Homo sapiens est datée d'environ 300 000 ans, sa dérive sur une voie inverse à l'intérêt collectif de ses populations d'environ 12 000 ans, c'est-à-dire 4% de son existence. Nous sommes porteurs aujourd'hui d'un capital génétique et culturel (en coévolution) qui s'est construit pendant 96% de l'existence de notre espèce. Il n'y a donc pas lieu de s'étonner de la puissance et du maintien de nos comportements et compétences sociales et coopératives !
7. En conclusion provisoire
La sortie des sociétés de classes et donc du capitalisme est possible et peut nous permettre de sortir de la crise écologique. C'est une condition nécessaire même si elle n'est pas suffisante. Car il faudra beaucoup d'efforts matériels et surtout intellectuels pour écarter le danger. Et plus c'est tard, plus ce sera difficile.
Si je ne me trompe pas, les conditions objectives n'ont jamais été aussi favorables, voire c'est seulement à l'aube du 21e siècle qu'elles deviennent favorables.
Bien sûr on fera une objection : à l'heure de la montée des fascismes à l'échelle planétaire, peut-on penser que les conditions objectives sont favorables pour sortir de la période des sociétés de classes ?
Certes, la période précédente (du 19 ème siècle au milieu du 20 ème) a connu une classe ouvrière concentrée, ce qui participe des conditions objectives favorables. Mais c'est oublier que dans cette période les sociétés sont majoritairement rurales, ce qui participe des conditions objectives défavorables. En France en 2024, il reste moins de 400 000 exploitants agricoles et les sociétés sont de plus en plus urbaines.
La montée des fascismes peut être pensée comme un phénomène réactionnaire au sens historique. Face aux mouvements telluriques qui les menacent, les classes dominantes se défendent avec acharnement et regardent de nouveau vers le fascisme comme solution d'urgence.
Mais il me semble qu'il faut penser un autre problème : l'idée du socialisme est profondément altérée par les impostures, produits de l'échec des espérances de la révolution française. Et même l'idée de république (les citoyens souverains) est altérée par l'imposture bourgeoise, induisant un déficit d'image de la démocratie.
Imposture bourgeoise qui a réduit à néant le principe « Liberté Egalité Fraternité ». On assassine Robespierre quand il dit que la révolution cours à l'échec car elle est en train de « remplacer le pouvoir du sang par le pouvoir de l'argent ».
Imposture social démocrate. Il n'y a plus de réformisme. Il est remplacée par une adhésion au capitalisme des partis issus de la classe ouvrière.
Imposture stalinienne qui représente une contre révolution au bout de 10 ans, dès la mort de Lénine. Le point de bascule est l'exil de Trotsky. Il n'y a plus de socialisme dans la société stalinienne.
Comment en sortir ?
Dans le débat entre Hans Jonas (Heuristique de la peur) et Ernst Bloch (Principe espérance) , on comprendra que je me situe du côté de Bloch.
Il me paraît nécessaire de refonder le socialisme autour de ses valeurs historiques :
• Société démocratique, plus de démocratie et non moins de démocratie : allier démocratie directe et démocratie représentative et non les opposer, intégrer les référendums ou votations.
• Société égalitaire par la mise en place du revenu maximal acceptable et du patrimoine maximal acceptable.
• Et donc société fraternelle.
La question écologique devient alors centrale. Elle est la critique absolue du capitalisme car celui-ci est dans l'incapacité structurelle de la résoudre.
Frédéric Malvaud
BIBLIOGRAPHIE
Ces sources sont celles sur lesquelles je me suis appuyé pour ce texte (en positif et en négatif). Elles sont présentées dans l'ordre chronologique de mes lectures (2014-2024).
Je remercie vivement toutes celles et tous ceux qui m'ont tant aidé par leurs réflexions et objections dans les nombreuses discussions individuelles ou en collectif !
La 6e extinction, comment l'homme détruit la vie. Elizabeth Kolbert. La librairie Vuibert. 2014
Biodiversité, l'avenir du vivant. Patrick Blandin. Albin Michel. 2010
L'archipel de la vie. Jacques Blondel. Buchet Chastel. 2012
Philosophie de la biodiversité. Virginie Maris. Buchet Chastel. 2016
Biodiversité : vers une 6e extinction de masse. Billé, Cury, Loreau, Maris. La ville brûle. 2014
Darwin et le Darwinisme. Patrick Tort. Que sais-je ? Puf
La face cachée de Darwin, l'animalité de l'homme. Pierre Jouventin. Libre et Solidaire. 2014
De Darwin à Lévi-Strauss. Pascal Picq. Odile Jacob. 2013
Une planète trop peuplée ? Angus et Butler. Ecosociété. 2014
L'entraide, un facteur de l'évolution. Pierre Kropotkine. Aden Belgique. 2015
L'évènement anthropocène. Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz. Seuil. 2016
Darwinisme et Marxisme. Anton Pannekoek et Patrick Tort. Arkhé. 2011
Sommes-nous tous voués à disparaître ? Eric Buffetaut. Le Cavalier bleu. 2012
Théorie du sacrifice. Patrick Tort. Belin. 2017
L'impossible capitalisme vert. Daniel Tanuro. La découverte. 2010
L'intelligence des limites. Patrick Tort. Gruppen. 2019
Evolution, la grande aventure du vivant. Steve Parker, Delachaud et Niestlé. 2018.
Par-delà nature et culture. Philippe Descola. Folio. 2005
L'extinction d'espèce, histoire d'un concept et enjeux éthiques. Julien Delord. MNHN 2010
Raviver les braises du vivant. Baptiste Morizot. Actes Sud 2020
Biodiversité, le pari de l'espoir. Hervé Le Guyader. Le Pommier. 2020
La symphonie inachevée de Darwin. Kevin Laland. La découverte. 2022
Trop tard pour être pessimistes ! Daniel Tanuro. Textuel. 2020
Les paradoxes de la nature. Frédéric Thomas et Michel Raymond. Humen Sciences. 2022
Une brève histoire de l'extinction en masse des espèces. Franz Broswimmer. Agone. 2010
Les harmonies de la nature à l'épreuve de la biologie. Pierre-Henri Gouyon. Quae. 2020
L'origine des espèces. Charles Darwin. Flammarion. 2008
La filiation de l'homme. Charles Darwin. Honoré Champion. 2013
Introduction à l'évolution. Carl Zimmer. De Boek. 2012
Comprendre la notion d'espèce. Philippe Lherminier. Ellipses. 2018
Lettres sur les sciences de la nature. Marx et Engels. Editions sociales. 1973
Ecosocialisme. Mickaël Löwy. Mille et une nuits. 2011
Voyage dans l'anthropocène. Claude Lorius et Laurent Carpentier. Actes Sud. 2010
Le Marxisme ouvert et écologique de Mickaël Löwy. Arno Münster. L'Harmattan. 2019
Dialectique de la nature. Friedrich Engels. Editions sociales. 1952
Guide critique de l'évolution. Guillaume Lecointre. Belin. 2021
Qu'est-ce que le matérialisme ? Patrick tort. Belin. 2007
Planète vide. Darrell Bricker et John Ibbitson. Les arènes. 2019
Une planète trop peuplée, le mythe populationniste. Ian Angus et Simon Butler. Ecosociété. 2014
L'odyssée des gènes. Evelyne Heyer. Flammarion. 2020
Au commencement était…une nouvelle histoire de l'humanité. David Graeber et David Wengrow. Les liens qui libèrent. 2021
Les dix millénaires oubliés qui ont fait l'histoire. Jean-Paul Demoule. Fayard. 2017
Et l'évolution créa la femme. Pascal Picq. Odile Jacob. 2020
Homo domesticus. James C. Scott. La Découverte. 2019
Avant l'histoire. Alain Testart. Gallimard. 2012
Evolution, la grande histoire du vivant. Steve Parker. Delachaux et Niestlé. 2018
Une histoire des civilisations. Jean-Paul Demoule, Dominique Garcia et Alain Scnapp. La Découverte. 2018
La vie large, Manifeste écosocialiste. Paul Magnette. La Découverte. 2022
Le vivant et la révolution. Bram Büscher et Robert Fletcher. Actes Sud. 2023
Ecologie et Socialisme. Mickaël Löwy et Al. Syllepse. 2005
L'homme peut-il accepter ses limites. Bœuf et Al. Quae. 2017
Rien n'est joué. Jacques Lecomte. Les arènes. 2023
Sapiens face à Sapiens. Pascal Picq. Champs. 2019
Démystifier le vivant. Guillaume Lecointre. Un monde qui change. 2023
L'homme, cet animal raté. Pierre Jouventin. Libre et solidaire.2020
La collapsologie ou l'écologie mutilée. Renaud Garcia. L'échappée. 2020
Les limites planétaires. Aurélien Boutaud et Natacha Gondran. La découverte. 2020
Gouverner la biodiversité. Vincent Devictor. Quae 2021
Pour sauver la planète, sortez du capitalisme. Hervé Kempf. Seuil. 2009
L'encerclement. Barry Commoner. Seuil. 1972
Ecofascismes. Antoine Dubiau. Grevis. 2022
Comment les riches détruisent la planète. Hervé Kempf. Seuil. 2007
La nature contre le capital. Kohei Saïto Syllepse. 2021
Les chasseurs cueilleurs ou l'origine des inégalités. Alain Testart. Gallimard 2022
Extinctions, du dinosaure à l'homme. Charles Frankel. Seuil. 2016
Comment tout peut s'effondrer. Pablo Servigne et Raphael Stevens. Points. 2021
Les européens et leurs valeurs. Pierre Bréchon. 2023
L'âge de l'empathie. Franz de Waal. 2010
Les limites planétaires. A. Boutaud et N. Gondran. 2020
P.-S.
• Intervention présentée à la 16e Université d'été du Nouveau Parti anticapitaliste (NPA) qui s'est tenue du 25 au 28 août 2024 à Port Leucate.
• Frédéric MALVAUD, né en 1956 est un militant associatif dans le domaine de l'environnement depuis plusieurs décennies. Il a eu et a encore des responsabilités nationales ou régionales dans les grandes associations environnementales (généralistes ou spécialisées dans la défense et l'étude de la biodiversité). Il a été membre du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (Haute-Normandie) et président du Conseil scientifique de la réserve de l'estuaire de la Seine. Son domaine de prédilection est l'étude de l'avifaune (ornithologie). Il est retraité de l‘enseignement. Il habite en Normandie, dans le Cotentin (département de la Manche). Il a rejoint dès sa création les « Naturalistes des terres ».
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Records de chaleur en août : L’ONU lance une alerte rouge

La hausse de la température mondiale sur le long terme est due à l'augmentation de la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, qui a atteint des niveaux record en 2022. La température moyenne à la surface de la Terre a grimpé à 1,45° Celsius de plus que les niveaux préindustriels de 1850-1900.
5 septembre 2024 | tiré du site d'El Watan | Photo : Le Dr Celeste Saulo, secrétaire générale de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), lors de la présentation du rapport sur l'état du climat mondial 2023 - Photo : D. R.
https://elwatan-dz.com/records-de-chaleur-en-aout-lonu-lance-une-alerte-rouge
Les records de chaleur en août sont synonymes d'« alerte rouge », a déclaré hier à Singapour la directrice de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), affirmant que ses services sont « inquiets mais pas paralysés ». Pour la deuxième année consécutive, la température mondiale moyenne en août a atteint des niveaux historiques, selon des données préliminaires publiques du programme d'observation de la Terre de l'Union européenne, Copernicus.
L'Australie, le Japon, plusieurs provinces de Chine ou encore le Svalbard, un archipel norvégien situé dans l'Arctique, ont connu leur mois d'août le plus chaud, selon les différents organismes météorologiques locaux. « Pour nous, c'est une alerte rouge.
Il est clair que les températures augmentent au-delà de ce que nous souhaiterions », a déclaré Celeste Saulo, directrice de l'OMM. Bien que la température moyenne mondiale exacte pour août 2024 ne soit pas encore connue, Copernicus a établi qu'elle serait supérieure au record de 16,82°C mesuré en août de l'année dernière. La directrice de l'OMM a également appelé à un meilleur suivi et à un meilleur soutien des agences météorologiques.
Août 2024 poursuit donc une série quasi ininterrompue de 15 mois où les températures moyennes du globe ont atteint une chaleur historique, synonyme de canicules, de sécheresses et de tempêtes. Aux yeux de l'OMM, « l'atténuation ne suffit pas. L'adaptation est une obligation ».
Pour beaucoup, il s'agit d'une question de vie ou de mort. Face à des défis environnementaux sans précédent, l'organisation veut dépasser le stade de simple observateur en étant plutôt appelée à être parmi les acteurs du changement.
La décennie 2014-2023 est la plus chaude jamais observée, dépassant la moyenne 1850-1900 de 1,20°C. La hausse de la température mondiale sur le long terme est due à l'augmentation de la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, qui a atteint des niveaux records en 2022.
L'arrivée du phénomène El Niño au milieu de l'année 2023 a également contribué à la montée rapide des températures, selon l'OMM. Une étude récente indique que les événements El Niño réduisent considérablement la croissance économique mondiale, « un effet qui pourrait s'intensifier à l'avenir ».
Jamais, nous n'avons été aussi proches – bien que temporairement pour le moment – de la limite inférieure fixée à 1,5°C dans l'Accord de Paris sur les changements climatiques, adopté le 12 décembre 2015 lors de la 21e session de la Conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, qui a eu lieu dans la capitale française du 30 novembre au 13 décembre 2015.
Cette limite, autrefois perçue comme un seuil à ne pas franchir, semble aujourd'hui sur le point d'être dépassée, remettant en question la capacité de la communauté internationale à contenir le réchauffement global.
L'Accord de Paris avait été salué comme un pas historique vers la protection du climat, engageant les pays signataires à limiter l'augmentation de la température mondiale bien en dessous de 2°C, avec un objectif plus ambitieux de 1,5°C.
Cependant, les efforts pour atteindre ces objectifs se révèlent insuffisants face à l'accélération des phénomènes climatiques extrêmes : vagues de chaleur record, incendies dévastateurs, inondations, sécheresses prolongées et fonte accélérée des glaces polaires.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
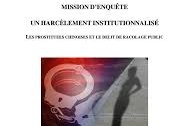
Lettre ouverte : Comment lutter contre la misogynie, les réponses erronées à la violence à l’égard des femmes et les effets traumatisants des services de police et de justice pénale

Cette lettre ouverte est adressée au gouvernement britannique, aux dirigeants des services sociaux, aux corps policiers et aux services de protection de l'enfance (SPE).
Tiré de Entre les lignes et les mots
Je vous écris ouvertement aujourd'hui pour aborder certains thèmes clés qui sont ressortis de mes cinq années de travail avec les forces de police et les SPE autour des questions de misogynie, de violences à l'égard des femmes et des jeunes filles (VFJF) et de maintien de l'ordre, en tenant compte des traumatismes constatés.
J'ai travaillé en étroite collaboration avec de nombreuses forces de police sur leur approche de la misogynie, de la violence à l'égard des femmes et du maintien de l'ordre tenant compte des traumatismes, et j'ai récemment terminé la rédaction d'une nouvelle formation tenant compte de ces traumatismes pour les SPE, qui sera déployée à l'échelle nationale. Je viens d'avoir le plaisir de mettre en place un programme d'apprentissage contre la misogynie et les traumatismes pour les experts en apprentissage et développement d'un service de police, qui devra revoir tous les intrants et matériels de formation dans l'ensemble de la force policière du pays (ce qui n'est pas une mince affaire).
(What Would Jess Say ?est une publication financée par les lecteurs. Pour recevoir de nouveaux articles et soutenir mon travail, envisagez de devenir un abonné gratuit ou payant.)
J'ai également mené des audits portant sur les attitudes et les connaissances de milliers de policiers de tous grades, et j'ai évalué l'impact de leur formation et des apports reçus. Cela fait cinq ans que je travaille sur ces enjeux et j'aimerais vous faire part de mes observations, qui pourraient être utiles à tous ceux qui participent à ce travail, d'autant plus que nous avons davantage de conversations cette semaine sur la violence à l'égard des femmes et sur des problèmes de misogynie au sein de la police et des SPE.
J'ai remarqué certains thèmes répétitifs dans plus de 15 corps policiers et au sein des SPE, et je me demandais si vous souhaiteriez en discuter ou y réfléchir dans le cadre de votre propre travail. Bien que je sois tout à fait favorable à l'évolution vers une police et une justice anti-misogynie et tenant compte des traumatismes, il reste de nombreux obstacles à franchir pour que nous puissions tous et toutes adopter cette approche. Avant de lire ce qui suit, veuillez noter que j'écris ce message dans l'espoir de vous apporter le plus grand soutien possible. J'ai rencontré et travaillé avec des centaines d'officiers, d'employés et de dirigeants brillants pendant cette période, et j'ai passé beaucoup de temps à parler honnêtement avec eux de leurs préoccupations, de certains malentendus, de leurs ressources, de leurs capacités, de leurs problèmes de formation, de leurs processus de promotion, de recrutement et de sélection, de leurs compétences en matière de gestion, de leurs normes et de leurs problèmes de comportement. Je formule les observations suivantes afin que nous puissions tous et toutes collaborer pour aller de l'avant de la meilleure façon possible. J'ai le privilège d'avoir travaillé avec des milliers d'agents au cours des cinq dernières années et d'avoir entrepris des évaluations avec eux dans des forces rurales et urbaines et dans des équipes de tailles différentes. J'ai écouté attentivement ces personnes et les schémas problématiques apparaissent clairement. J'aimerais travailler avec tout le monde pour répondre aux observations ci-dessous, dans l'intérêt de tout le monde. Le personnel en cause mérite une approche fondée sur les traumatismes pour lutter contre l'épuisement professionnel, les traumatismes indirects et la fatigue. Les victimes et les témoins méritent un meilleur service que celui offert actuellement. Le public doit en venir à faire à nouveau confiance à la police et aux SPE.
Vous trouverez ci-dessous mes observations et mes conclusions pour l'ensemble du Royaume-Uni :
Misogynie et violence à l'égard des femmes et des jeunes filles
* De nombreux services de police comprennent mal la misogynie et croient fermement que la formation sur la misogynie est une pratique de « dénigrement des hommes » – un préjugé que j'ai réussi à surmonter dans chaque corps policier – il existe une technique pour mettre fin à ce préjugé.
* Dans certains cas, des équipes de formation de leaders ou d'officiers en chef suggèrent que la misogynie et les mauvaises pratiques se situent entièrement au niveau des officiers et des sergents, et ne sont pas disposées à considérer leur propre leadership et leur rôle dans l'entretien de la misogynie et des réponses erronées à la violence à l'égard des femmes. Dans d'autres, ils sont beaucoup plus disposés à examiner leur propre rôle.
* Dans plusieurs services de police, les équipes de formation présentent des divisions, environ 40-50% de l'équipe acceptant que la misogynie existe en tant que problème systémique et personnel, et le reste niant son existence ou sa présence.
* Ce ne sont pas tous les corps policiers qui parviennent pas à comprendre ou à reconnaître la misogynie intériorisée et, pour autant que je sache, je suis la seule personne à mener un travail substantiel sur cette question – on ne peut pas s'attaquer à la misogynie dans la police sans parler de la misogynie intériorisée. Les femmes font partie de ce problème, et beaucoup d'entre nous soutenons la misogynie, la culpabilisation des victimes et le mépris des femmes et des jeunes filles. C'est dire que même lorsque des femmes constituent la majorité des équipes de direction, la misogynie n'en est pas pour autant atténuée.
* La misogynie n'est jamais isolée et les corps policiers ratent souvent des occasions cruciales d'utiliser ce temps pour inclure dans les formations certaines discriminations croisées telles que le racisme et l'homophobie, qui coexistent souvent avec la misogynie.
* Des mythes et des idées fausses sur les traumatismes, la santé mentale, les agressions, le viol et d'autres délits font surface dans le contexte d'enquêtes et de poursuites et doivent être déconstruits à la fois dans les services de police et au sein des SPE.
* Les SPE sont disposés à changer et j'élabore actuellement pour eux une ressource sur la capacité à utiliser des éléments probants pour lutter contre les mythes et les idées fausses utilisés contre les femmes et les filles dans les affaires de violence à l'égard des femmes ; je mettrai également cette ressource gratuite à la disposition de toutes les corps policiers, afin de garantir que tout le monde dispose de la même base de données.
* La culpabilisation des victimes est courante, tout comme l'auto-culpabilisation – c'est quelque chose que je peux briser avec succès et notre évaluation démontre des taux élevés de réussite.
* Plusieurs corps de police ont développé des cultures antiféministes dans lesquelles tout argument lié à la violence à l'égard des femmes est instantanément détesté et mal ressenti, et les campagnes pour le changement ne fonctionnent pas en raison de ce ressentiment croissant envers une vision déformée du féminisme – j'ai réussi à démonter ce sentiment à plusieurs reprises, mais il est parfois très ancré.
* La violence à l'égard des femmes représente aujourd'hui plus d'un cinquième des délits enregistrés, ce qui signifie que tous les agents doivent comprendre l'ampleur, les types, les cultures, les attitudes, les impacts et les mythes liés à la violence à l'égard des femmes et à la misogynie afin de pouvoir faire leur travail efficacement.
* Lorsque nous interrogeons des policières et des membres féminins du personnel, moins de 1% d'entre elles déclarent qu'elles signaleraient un viol ou une agression sexuelle si cela leur arrivait. La majorité des policières ne font pas confiance au système de justice pénale et choisissent de ne pas porter plainte lorsque cela leur arrive.
* Nous avons testé auprès de milliers d'agents la réceptivité à des énoncés tels que « Si une femme se comporte comme une traînée, elle mérite tout ce qui lui arrive ». Dans certains services, le taux d'accord sur cette question est de 20% des agents. Le taux d'accord moyen est d'environ 10%.
* La plupart des forces ont des problèmes avec les nouvelles recrues qui arrivent par le biais d'une promotion (uplift). Les nouvelles recrues sont plus susceptibles de s'envoyer des sextos, d'avoir des comportements inappropriés, et ils présentent des niveaux plus élevés d'agression sexuelle et de coercition sexuelle, ainsi que de brimades misogynes. Leur taux de rotation est plus élevé que prévu dans plusieurs corps de police et les enquêtes du Service des normes professionnelles à leur sujet sont plus nombreuses qu'à l'accoutumée.
* J'ai rencontré quelques corps policiers dans lesquels les mythes et les attitudes l'emportent sur la loi. Deux exemples datant de l'année dernière : une équipe a déclaré qu'elle pensait qu'avoir des relations sexuelles avec une femme endormie sans son consentement était légal, qu'il s'agissait d'une perversion et que cela ne relevait pas de la police. Une autre équipe a affirmé que l'étranglement des femmes lors de rapports sexuels relevait d'un choix personnel et ne constituait pas un délit – et que les femmes aimaient cela. Plusieurs équipes ne sont pas en mesure d'expliquer la Loi de 2003 sur les infractions sexuelles et ne savent pas comment définir précisément le consentement.
* Certains tribunaux se heurtent au sexisme et à la misogynie de leur région. Dans certains corps policiers, on peut prédire si une affaire de viol ou d'agression sera jugée coupable uniquement en fonction de l'endroit où le jury sera sélectionné. Cela signifie que certaines équipes de Viols et Agressions Sexuelles Graves (RASSO) se sentent démoralisées et ont l'impression qu'il est inutile d'essayer de monter un dossier de viol ou d'agression sexuelle en raison de la culture locale de la population qui fera partie du jury.
* Dans presque tous les corps de police avec lesquels j'ai travaillé, on évoque la façon dont la misogynie et le sexisme sont devenus un « mot à la mode » et on les compare à la façon dont les expressions « BLM » et « antiracisme » ont été utilisées, avant qu'elles ne tombent en désuétude et qu'on ne s'y intéresse plus comme elles le méritent. Nous n'avons jamais traité notre racisme institutionnalisé, mais l'accent a changé, et maintenant les officiers et les dirigeants se sentent blasés. Bien que je ne considère pas cela comme une excuse pour l'inaction, lorsque les agents ont vu des campagnes et des enjeux se succéder, mais sans succès, sans réel changement, il est logique qu'ils pensent que cela se produira avec la misogynie et la violence à l'égard des femmes, et qu'ils décrochent.
* Certains avocats des SPE sont misogynes, blâment les victimes et posent des problèmes bien connus dans certaines équipes RASSO. Dans d'autres régions, il y a de brillants avocats des SPE qui entretiennent d'excellentes relations avec les équipes RASSO et apportent à la police le soutien dont elle a besoin pour enquêter et obtenir des inculpations. Mais ce soutien est très disparate et peu cohérent. Certains corps policiers essaient d'éviter certaines personnes ou ont déposé en vain plusieurs recours à ce sujet.
* Il existe des commissaires de police (PCC) qui ne sont pas respectés ou auxquels leurs corps policiers respectifs ne font pas confiance. Il s'agit généralement de commissaires connus pour leur misogynie ou leur manque de respect à l'égard des femmes, et pour lesquels aucune mesure n'a été prise en vue de les démettre de leurs fonctions. Lorsque les corps policiers font l'objet d'un examen (justifié) concernant leur propre conduite et leur misogynie, il n'est ni efficace ni équitable d'avoir des PCC qui sont réputés localement ou à l'échelle nationale pour leur misogynie ou leurs comportements sexuels inappropriés.
* Il en va de même pour le leadership – dans certains corps de police, il existe une culture de « l'échec ascensionnel » dans laquelle des hommes qui se sont montrés agressifs, misogynes ou qui ont eu des comportements sexuels inappropriés ont été simplement écartés latéralement ou « congédiés vers le haut » parce que personne ne voulait travailler avec eux. Plusieurs forces armées en parlent ouvertement, mais cela signifie que certaines équipes de formation de leaders comptent en leur sein des personnes ouvertement misogynes, sans qu'aucune mesure ne soit prise pour y remédier. Cela entraîne un manque de confiance de la part du reste du corps policier, qui cesse d'écouter ces formateurs.
* Certains corps policiers sont dans le déni de leurs niveaux de misogynie et de sexisme – cependant, j'ai constaté que cela était plus courant dans les organisations situées dans les zones aisées du sud du pays. Cela se traduit parfois par une attitude du type « nous sommes meilleurs que les autres régions, nous n'avons pas de problèmes/de personnes comme ça ici ». Il existe des cultures de préservation de la réputation et de relations publiques qui passent avant la nécessité de refléter et de résoudre les problèmes de misogynie et de racisme.
Une police et une justice informées des traumatismes
* De nombreux corps policiers ne comprennent pas ce que signifie « tenir compte des traumatismes » et utilisent de nombreuses approches différentes qui ne sont ni cohérentes ni fondées sur des données probantes.
* La plupart des personnes, y compris les dirigeants et les spécialistes des forces de police, ne peuvent pas définir ce qu'est une police « informée des traumatismes » lorsque je leur pose la question.
* Les corps policiers ne considèrent pas que pour être informés des traumatismes, ils doivent également traiter les traumatismes indirects vécus par leur personnel. Les forces de police doivent de toute urgence se pencher sur de tels traumatismes, ainsi que sur l'épuisement professionnel et l'usure de la compassion de leurs propres agents et membres du personnel.
* Cela fait maintenant plusieurs années que nous proposons des modules sur le traumatisme vicariant dans les forces de police, et de nombreux problèmes nous sont signalés – l'impact psychologique du travail n'est pas suffisamment pris en compte par les équipes de santé au travail.
* L'ampleur du travail visant à mettre en place une police qui tienne compte des traumatismes est vaste et détaillée, et comprend une révision polyvalente, allant de la formation des nouvelles recrues sur les traumatismes et les agressions à la manière dont la police répond aux appels en matière de santé mentale.
* La police est invitée à recueillir et à réclamer une quantité importante de documents auprès de tierces parties, en particulier pour les infractions RASSO, et ce dans des proportions exagérées et inutiles – c'est un point que j'ai soulevé auprès des SPE et que je continuerai à encourager les officiers de police à contester avec plus d'assurance.
* Les dossiers de santé mentale sont utilisés contre les victimes et les témoins, ce qui n'est pas compatible avec une police tenant compte des traumatismes ou avec la Loi sur l'égalité de 2010.
* L'utilisation des forces de police comme service pour traiter les crises, les suicides, les automutilations et les traumatismes brouille les frontières entre leur rôle dans la criminalité et leur rôle dans la « sécurité ». Cela signifie qu'il n'est pas possible de mettre en place une police tenant compte des traumatismes, car des policiers sont envoyés auprès de personnes en détresse, qui sont ensuite encore plus traumatisées par la présence de la police, ou détenues en vertu de la Loi sur les droits de l'homme ou escortées/enlevées vers un autre endroit. Ce problème se pose également lorsque des ambulanciers ou du personnel médical se rendent à certaines adresses, où est signalé un problème de « santé mentale ». En raison de la pathologisation et de certains stéréotypes, la police est alors enrôlée pour accompagner le personnel médical, alors que ni les ambulanciers ni la police ne sont formés de manière adéquate pour répondre d'une manière respectueuse des traumatismes à une personne en détresse et traumatisée.
* Le programme du College de formation policière (College of Policing) se contredit en plusieurs endroits et applique des approches qui ne tiennent pas compte des traumatismes, tout en exigeant des forces qu'elles en tiennent davantage compte. Cette situation est due à une mauvaise compréhension de l'approche théorique d'un point de vue tenant compte des traumatismes. Il ne s'agit pas simplement d'accepter que les traumatismes existent et ont un impact sur les personnes.
* Les avocats et le personnel des SPE sont traumatisés, désensibilisés et épuisés. J'ai discuté avec nombre d'entre eux qui m'ont parlé de leur propre traumatisme vicariant et de la manière dont il n'est ni abordé ni discuté.
* Les équipes de santé au travail ne sont pas informées des traumatismes, parce qu'elles regroupent principalement des professionnels du modèle médical. On voit donc de plus en plus d'officiers de police se faire dire qu'ils ou elles souffrent de malade mentale, de TDAH ou d'autisme, au lieu que leur traumatisme et leur épuisement au travail soient validés ou soutenus. J'entends de plus en plus d'officiers de police me dire qu'ils ont récemment été évalués pour un TDAH alors qu'ils avaient consulté l'équipe de santé au travail lorsqu'ils étaient traumatisés ou affectés par un incident. Il s'agit d'une mauvaise pratique, d'une pathologisation et d'une approche inutile qui peut avoir un impact sur leur carrière et leur vie future.
* Le langage psychiatrique et les malentendus sont fréquents. J'ai travaillé avec des équipes du Département des homicides qui croient sincèrement que toutes les personnes qui commettent des homicides sont « schizophrènes » et « psychotiques ». De nombreux agents en ont conclu que tous les meurtriers sont des malades mentaux, car ils ne pourraient pas tuer quelqu'un autrement. Ce n'est pas exact, et leur travail de police et d'enquête est affecté par leur manque de connaissances.
* Des policiers orientent des femmes et des jeunes filles vers des services de santé mentale à la suite d'un crime ou d'un traumatisme grave, où on diagnostique alors à la victime un trouble mental ou un trouble de la personnalité qui est ensuite utilisé pour la discréditer en tant que personne non fiable et mentalement instable – nous constatons des impacts de cette pratique sur nos propres dossiers. Les officiers de police les renvoient à la police parce qu'il n'y a pas d'autres solutions qui tiennent compte des traumatismes vécus par ces femmes.
* Le matériel de formation sur ces sujets (lorsqu'il existe) est souvent inexact ou contient des exemples de cas ou des ressources inappropriés, traumatisants, trop descriptifs ou inutiles.
Comme vous pouvez le constater à la lecture de cette liste, il existe des domaines considérables à développer dans les services de police et les services de protection de l'enfance. Il y a beaucoup d'autres observations, mais ce sont celles qui, à mon avis, nécessitent une conversation urgente.
S'orienter vers une police et une justice anti-misogynie et tenant compte des traumatismes est la bonne chose à faire, mais ce n'est pas une mince affaire. Dans certains endroits, cela est compris et la force ou l'équipe considère cela comme un processus lent et prudent. Dans d'autres, des cours de formation d'une demi-journée sur « la prise en compte des traumatismes » ou « la misogynie et le sexisme » sont totalement inadéquats, imprécis, dépourvus de preuves ou de compréhension philosophique et compliquent le travail de la police.
Notre approche du changement culturel doit s'étendre à l'ensemble des forces de police et à l'ensemble du système judiciaire. Ce changement est possible, mais nous devons l'envisager comme une réforme et un développement à grande échelle. Cela ne se fera pas rapidement.
Je travaille aux côtés et au sein du système de justice pénale depuis l'âge de 19 ans, et il est très important pour moi que nous abordions ces questions pour le bénéfice de tout le monde. Je me réjouis de toute discussion avec des responsables, des membres du gouvernement, de la police, de la justice ou des services publics qui souhaiteraient s'atteler à la résolution des problèmes exposés dans cette lettre.
J'ai publié un article qui pourrait vous intéresser. Celui-ci se concentre sur la manière dont la psychiatrie peut être utilisée à mauvais escient en droit, en particulier dans le cadre de la lutte contre la violence à l'égard des femmes, où les femmes et les jeunes filles sont considérées comme malades mentales, peu fiables ou non crédibles alors qu'elles sont traumatisées par les crimes commis à leur encontre – le lien se trouve ici :4 ways ‘mental health' is misused in criminal and family law (substack.com)
En 2022, j'ai également publié un guide à l'intention des services statutaires afin d'étudier comment mettre en œuvre des approches de la violence à l'égard des femmes qui soient fondées sur les traumatismes dans les services de police, de santé, d'aide sociale et d'éducation. Ce document contient des listes de contrôle des changements à apporter :
https://irp.cdn-website.com/4700d0ac/files/uploaded/Implementing%20TI%20Approaches%20to%20VAWG%20-%20VictimFocus%202022.pdf
Merci de m'avoir lue aujourd'hui. Je comprends que ce document est probablement assez lourd à lire et qu'il donne beaucoup à réfléchir, que l'on soit un professionnel ou un membre du public.
Je ne voudrais pas que tant d'expérience et tant d'observations importantes au cours des cinq dernières années dans les forces de police soient gaspillées.
Avec notre nouveau gouvernement, qui a promis de s'attaquer à la violence à l'égard des femmes et à la crise croissante des traumatismes et de la santé mentale, j'ai voulu fournir des points utiles et clairs pour le changement et le développement.
N'hésitez pas à partager et à envoyer cette lettre à d'autres personnes intéressées par la lutte contre la misogynie, la violence à l'égard des femmes, les traumatismes et l'épuisement professionnel dans notre système de justice pénale.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées,
Dr Jessica Taylor
(PhD, AFBPsS, CPsychol, FRSA, PGDip)
Directrice générale de VictimFocus
Courriel : Jessica@victimfocus.org.uk
Visitez-nous : http://www.victimfocus.com
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Pourquoi les programmes de prévention des violences sexuelles ne marchent pas
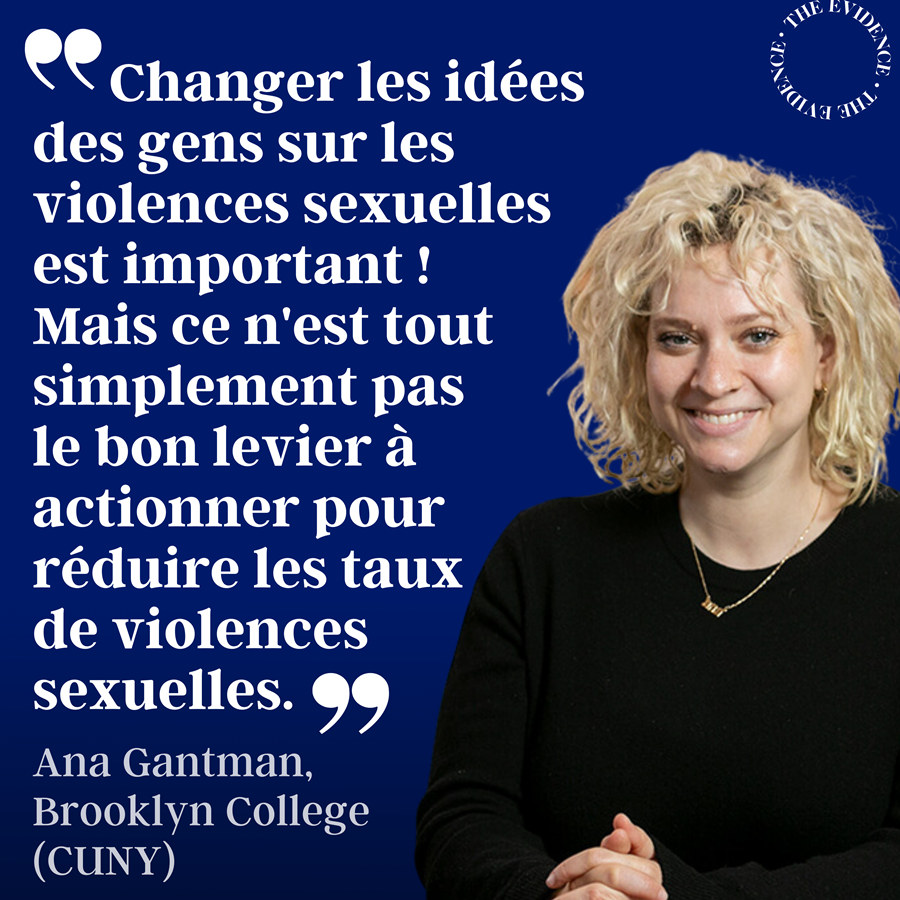
Les taux de violences sexuelles sur les campus universitaires américains n'ont pas bougé entre 1985 et 2015. Ils auraient même augmenté depuis 2015. Et ce, malgré des millions de dollars dépensés par le gouvernement américain et les universités dans des programmes de recherche et de prévention des violences sexuelles. Depuis des années, ces chiffres laissent les élu·es et les scientifiques perplexes. Comment expliquer cela ?
Photo et article tirés de NPA 29
Aujourd'hui, une nouvelle méta-analyse (une étude qui combine et analyse les résultats de nombreuses études précédentes sur un sujet), qui rassemble toutes les études publiées jusqu'alors partout dans le monde, a révélé la réponse. Il semblerait que la théorie de longue date derrière ces programmes soit fondamentalement erronée.
Pendant des décennies, les expert·es en sciences sociales sont parti·es d'un principe simple : si l'on change les attitudes ou les idées des gens sur les violences sexuelles, cela entraînera un changement de comportements, et donc une diminution de la violence.
Ainsi, la grande majorité des programmes de prévention des violences sexuelles dans le monde ont ciblé l'esprit : ce que les gens pensent et croient au sujet des violences sexuelles, de pourquoi elles se produisent, du type de personne qui les perpétue et qui en sont victimes. Une cible centrale de ces programmes sont les “mythes sur le viol”, comme l'idée que “certaines femmes méritent d'être violées” ou que “quand les femmes disent non, en fait elles veulent dire oui”.
Un grand nombre d'interventions analysées dans cette étude a réussi à contrer ces mythes sur le viol. Mais la diminution de la violence qui aurait dû suivre n'a pas été observée. Quand les équipes de recherche ont observé une réduction de la violence, elle était minime par rapport au degré de changement des manières de penser des gens. L'hypothèse selon laquelle nos pensées sont la cause principale de notre comportement a guidé les efforts de réduction des violences sexuelles depuis le début. Mais d'après cette nouvelle étude, cette hypothèse serait faussée.
D'après l'OMS, environ 1 femme sur 3 dans le monde a subi des violences sexuelles physiques. Et des chiffres de 2017 ont révélé que plus de 50 % des femmes et presque un homme sur trois sont touché·es aux États-Unis. Dans ce contexte, cette étude fait office de “signal d'alarme accablant pour le domaine de la prévention des violences sexuelles”, comme l'a observé une experte en réponse à cet article.
Voici la preuve
La méta-analyse a couvert 295 études menées dans 13 pays entre 1985 et 2018. La plupart (89 %) ont été menées aux États-Unis, et la majorité de celles-ci se sont concentrées sur les campus universitaires – où la majorité de la recherche sur la prévention des violences sexuelles a été effectuée dans le monde.
L'équipe de recherche a identifié trois périodes distinctes dans les programmes de prévention des violences sexuelles : une période initiale où les programmes se concentraient sur l'éducation des adolescent·es sur les violences dans les relations amoureuses ; une deuxième qui ciblait l'empathie des hommes envers les victimes de violences sexuelles par le biais de programmes éducatifs ; et une troisième phase (encore dominante aujourd'hui) qui, au lieu de cibler les victimes ou les coupables potentiels, vise à encourager l'action des témoins et de la communauté grâce à des programmes éducatifs qui encouragent les gens à aider les personnes en danger et à dénoncer les idées sexistes.
Bien que ces trois périodes adoptent des approches assez différentes, les chercheuses ont constaté que la théorie sous-jacente restait la même : l'hypothèse que pour changer le comportement, il faut changer les idées des gens. Elles ont découvert qu'aucune de ces approches n'avait d'effet sur les taux d'agression. Changer ce que les gens pensent des violences sexuelles ne semble tout simplement pas changer leur comportement.
J'ai parlé à deux expertes sur le sujet : Ana Gantman, professeure de psychologie au Brooklyn College (CUNY), qui a cosigné l'étude, ainsi qu'une des auteures d'un commentaire accompagnant l'article : Elise Lopez, directrice adjointe du programme de violences relationnelles à l'Université de l'Arizona. J'ai été surprise de constater que, plutôt que d'être découragé·es, les deux chercheuses étaient assez optimistes quant aux résultats.
Elise Lopez a expliqué : “Je n'ai pas été surprise par ces résultats, j'étais plus enthousiaste qu'autre chose. Ils montrent le combat que moi, et d'autres chercheuses et chercheurs, avons mené pendant des années. Si nous dépensons des millions de dollars dans la recherche et les programmes de prévention, pourquoi les chiffres n'ont-ils pas changé depuis plus de 30 ans ? Maintenant, nous avons des pistes concrètes sur le pourquoi. Quand vous identifiez un défaut fondamental, vous pouvez arrêter de tourner en rond et saisir l'opportunité de créer quelque chose de nouveau.”
Un changement radical
L'article m'en a rappelé un autre dans un domaine très différent : la crise climatique. Il y a trois ans, le neuroscientifique Kris de Meyer et ses collègues ont avancé que les personnes qui travaillent sur le climat devraient arrêter d'essayer de persuader les gens que le changement climatique est un problème, et raconter plutôt des histoires d'action. “Les croyances populaires”, ils écrivent, racontent que l'augmentation de la compréhension des gens sur le changement climatique serait un “préalable nécessaire” à l'action et au changement de comportement. Mais “dans la vraie vie, les relations entre croyances et comportement vont souvent dans la direction opposée : nos actions changent nos croyances.”
La réalisation similaire dans le domaine de la prévention des violences sexuelles fait-elle partie d'une réévaluation plus générale de l'idée que changer les attitudes des gens peut changer leur comportement ?
“Absolument”, affirme Ana Gantman. “Les psychologues savent qu'il y a un fossé entre ce que nous pensons, ce que nous voulons, ce que nous croyons et ce que nous faisons réellement.”
Cela s'explique peut-être par le fait que la relation entre les deux est purement “probabiliste”. Des obstacles nous empêchent d'agir comme nous aimerions agir dans un monde idéal. Elle me donne un exemple : une personne pourrait vouloir réagir si elle entend quelqu'un faire une blague sexiste, mais sur le moment, un autre désir, celui de maintenir la cohésion sociale, pourrait l'emporter, ou elle pourrait tout simplement ne pas savoir quoi dire.
Et, si la relation entre nos idées et nos actions peut parfois être corrélée, cela ne signifie pas nécessairement que les unes ont causé les autres. Supposons que la personne qui croit en l'importance d'intervenir lorsqu'elle entend des blagues sexistes le fasse réellement. La raison pour laquelle elle l'a fait, à ce moment-là, pourrait être n'importe quoi : peut-être qu'elle avait récemment vu quelqu'un d'autre intervenir avec succès dans une émission de télé, et qu'elle avait donc une phrase toute prête en tête. Ou peut-être qu'elle se trouvait dans un groupe où elle se sentait à l'aise et respectée, et donc elle a pris la parole parce qu'elle savait que ce serait bien accueilli. “Nous pouvons agir de manière cohérente avec nos désirs, mais cela ne signifie pas nécessairement que nos désirs en sont le mécanisme causal”, explique Ana Gantman.
Elise Lopez souligne que nous savons déjà tout cela dans le domaine de la santé. Nous savons qu'il est possible d'éduquer les gens sur l'importance de manger sain, de faire du sport ou de dormir assez, mais sans nécessairement changer leur comportement. “Cela va vraiment au-delà de changer les idées et les attitudes, bien que cela puisse être une première étape utile”, dit-elle. “Vous devez également changer la confiance en eux des gens sur leur capacité à avoir des comportements sains, leur fournir le soutien social pour le faire et penser à l'environnement dans lequel ils vivent.”
Une nouvelle approche
Alors, quels types d'interventions pourraient vraiment marcher et prévenir les violences sexuelles ? La conception de l'espace physique est un thème central.
Ana Gantman me raconte : “Les étudiant·es nous disent que souvent, les seuls espaces dans lesquels iels peuvent interagir quand les fêtes sont terminées sont leurs chambres, et que ces portes se ferment automatiquement pour des raisons de sécurité incendie – ce qui donne l'impression que personne d'autre n'est là.” Elle suggère donc que fournir plus d'espaces communs neutres pourrait permettre d'autres comportements – que si un lit n'est pas là, les gens sont moins susceptibles de penser à la possibilité de rapports sexuels.
Les chercheuses ont également insisté sur l'intégration de l'éducation à la prévention des violences sexuelles dans l'éducation générale à la santé sexuelle. “Je pense que si nous apprenions aux gens comment avoir des rapports sexuels heureux, sains, consensuels et idéalement mutuellement orgasmiques, alors peut-être que nous verrions moins de situations où les gens se trouvent dans des situations comme la consommation excessive d'alcool qui rendent le sexe plus risqué”, ajoute Elise Lopez.
Il existe également quelques indications que les cours d'autodéfense peuvent réduire les taux d'agression – même si c'est une piste controversée, car certain·es pensent que cela déplace la responsabilité des agressions sexuelles sur les victimes. Au Kenya, des transferts d'argent inconditionnels ont permis de réduire les violences sexuelles lorsqu'ils étaient donnés aux femmes. Et dans l'État de Rhode Island, les infractions déclarées de viol ont chuté de 30 % quand le travail du sexe en intérieur a été décriminalisé. Tous ces éléments montrent la multitude d'approches différentes qui pourraient être adoptées, si les attitudes et les normes de financement le permettent.
Il est important de noter que les résultats de cette étude ne signifient pas que les décennies de travail sur la prévention des violences sexuelles ont été vaines. Changer les manières de penser est toujours précieux.
“J'ai été énormément impressionnée par certaines des interventions que nous avons examinées”, dit Ana Gantman. “Changer les idées des gens sur les violences sexuelles est important ! Mais ce n'est tout simplement pas le bon levier à actionner pour réduire les taux de violences sexuelles.”
Josephine Lethbridge
https://lesglorieuses.fr/violences-sexuelles/
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :













