Presse-toi à gauche !
Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Université féministe d’été 2024

Pari réussi pour la deuxième édition de l'Université Féministe d'Été 2024 en Afrique

L'organisation féministe NÈGÈS MAWON a pris part à la deuxième édition de l'Université Féministe d'Été de l'Afrique de l'Ouest et du Centre qui s'est tenue au Sénégal, du 1er au 3 août 2024
Déroulée autour du thème “Capitaliser nos connaissances et pratiques féministes et croiser nos dynamiques d'actions collectives intersectionnelles”, cette activité a favorisé la participation de la coordonnatrice générale de NÈGÈS MAWON, Madame Pascale Solages, à titre d'intervenante au colloque d'ouverture de cet événement.
Co-organisée par JGEN SÉNÉGAL et LE COLLECTIF DES FÉMINISTES DU SÉNÉGAL, L'Université d'Été Féministe d'Afrique de l'Ouest et du Centre (UEF) 2024 se déroulera au Sénégal, du 1er au 3 août 2024.

L'édition de cette année a réuni plus de 150 participants.es, dont des chercheurs.es, militantes, universitaires, et partenaires internationaux.
Après le succès de la première édition en 2023, l'UEF 2024 continuera de renforcer les dynamiques féministes en Afrique francophone, en mettant l'accent sur l'apprentissage et la création d'outils pour démocratiser le mouvement féministe.
L' objectif Général de cette deuxième édition est de créer un laboratoire féministe pédagogique qui documente et visibilise les acquis du mouvement féministe, abordant la justice reproductive, les violences sexuelles et sexistes, la justice climatique et économique.
Qu'elles soient climatiques, géopolitiques, mais aussi sociales, la multiplication et l'imbrication des crises actuelles fragilisent les populations et exacerbent les inégalités.
Devant l'ampleur de la tâche, on maintient que les luttes féministes sont non seulement des espaces de réflexion cruciaux pour penser les crises actuelles et futures, mais également des lieux de résistances incontournables pour que les différentes solutions ne s'opèrent pas au détriment des populations les plus marginalisées.
Smith PRINVIL
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Mines de cobalt : « BMW et Renault doivent protéger les droits humains »

En grève depuis cinq mois, 254 mineurs de cobalt au Maroc sont privés de salaires. Ces « graves atteintes » doivent cesser, appellent les auteurs de cette tribune, à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron dans le pays.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/11/04/mines-de-cobalt-bmw-et-renault-doivent-proteger-les-droits-humains/
En écho à la grève des 254 mineurs en sous-traitance de la mine de Bou-Azzer, au sud du Maroc, nos organisations dénoncent les graves atteintes aux droits des travailleurs, des populations locales et à l'environnement de l'extraction de cobalt et plus largement les impacts internationaux de l'industrie automobile européenne.
Au Maroc, au Mali, au Congo comme en France, en Allemagne et partout ailleurs, le développement exponentiel des projets miniers impacte ou menace des écosystèmes entiers et des milliers de vies humaines, malgré les artifices rhétoriques des entreprises les présentant comme « responsables » ou « nécessaires à la transition énergétique ». Nous appelons les donneurs d'ordre, au premier rang desquels BMW et Renault, à prendre des mesures urgentes pour protéger les droits humains et l'environnement dans leurs chaînes d'approvisionnement.
À l'heure où nous écrivons, ces 254 mineurs n'ont pas été payés depuis cinq mois et sont en grève depuis le mois de juin. La plupart d'entre eux ont des familles et des enfants. L'entreprise marocaine Managem, groupe minier marocain international appartenant à la holding royale Al Mada, exploite la mine de cobalt de Bou-Azzer en recourant massivement à la sous-traitance. Ce sont les mineurs de l'une de ces entreprises, Top Forage, qui sont aujourd'hui privés de salaires et ont découvert que leur employeur n'avait pas versé de cotisations sociales depuis des années, se présentant comme insolvable.
En novembre dernier, nos organisations signaient déjà une tribune pour dénoncer les conditions d'extraction dans la mine de cobalt et d'arsenic de Bou-Azzer, qui se déroulent au mépris des règles les plus élémentaires de sécurité, du droit du travail, de l'environnement, du respect des populations locales et de la liberté d'association, alors même que BMW et Renault, les deux clients principaux, vantent leur politique d'approvisionnement exemplaire en métaux.
Pour les voitures des Européens
Depuis 2020, BMW est l'un des clients de Managem. Renault a également conclu avec Managem un accord pour la fourniture de 5 000 tonnes de sulfate de cobalt par an, à partir de 2025, permettant d'alimenter la production de 300 000 batteries pour véhicules électriques dans sa gigafactory du nord de la France.
Ce cobalt, qui sert à produire des alliages et les cathodes des batteries des voitures électriques européennes, est en partie extrait des galeries de Bou-Azzer dans des conditions catastrophiques. Les mineurs dénoncent leurs conditions de travail dangereuses, leur matériel vétuste et leur exposition systématique aux poussières toxiques.
Les riverains, dont une vingtaine d'enfants, respirent quotidiennement des poussières d'arsenic issues des montagnes de résidus entassés à côté de la mine. En un siècle, elle a pollué à l'arsenic les oasis de toute une vallée et épuise la nappe phréatique dans une zone désertique souffrant déjà de sécheresses qui sont devenues plus fréquentes et plus intenses ces dernières années à cause des changements climatiques.
Obligations
Nos organisations dénoncent la répression et les intimidations des militant·es syndicaux et grévistes. Nous appuyons les demandes des syndicats et salariés et nous demandons aux employeurs, aux donneurs d'ordres et à l'État marocain :
– le versement des salaires arriérés et revalorisation de ceux-ci en incluant les mois de grève ;
– le rétablissement de la couverture maladie, de la prime d'ancienneté et du camp d'été ;
– la mise en place de formations nécessaires à l'accomplissement des missions et postes en toute sécurité ;
– la dotation de matériel de sécurité adéquat pour tous les personnels ;
– la remise aux normes des dispositifs de sécurité et de protection de la mine ;
– l'arrêt du drainage et de l'épuisement de la nappe phréatique jouxtant la mine avec la fixation de seuils donnant priorité aux besoins du milieu et en eau potable des habitant·es.
Qu'il s'agisse de Renault, de BMW, de Managem, nous exigeons que les entreprises responsables de ces mauvais traitements prennent les mesures que la dignité et le droit international imposent. Ces entreprises ont une obligation d'identifier les risques d'atteintes aux droits humains et à l'environnement dans leur chaîne d'approvisionnement. La responsabilité ne peut être éternellement déléguée ni diluée dans un mécanisme de sous-traitance qui reporte les engagements vis-à-vis des travailleurs et des habitant·es sur des structures qui ne peuvent ou ne veulent pas les assumer.
Les premières organisations signataires :
Association Henri Pézerat
Association marocaine des droits humains (AMDH)
Association de défense des droits de l'homme au Maroc (ASDHOM)
Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF)
Attac France
Attac/Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde (CADTM) Maroc
Confédération générale du travail (CGT)
Fédération internationale des droits humains (FIDH),
Fondation Danielle Mitterrand
Jonction pour la défense des droits des travailleurs (Maroc)
Ligue des droits de l'Homme (LDH),
SUD Renault/Ampère Île-de-France
Union syndicale Solidaires
https://reporterre.net/Mines-de-cobalt-BMW-et-Renault-doivent-proteger-les-droits-humains
Dans les tribunes, les auteurs expriment un point de vue propre, qui n'est pas nécessairement celui de la rédaction.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Uruguay : le candidat de gauche Yamandú Orsi arrive en tête au premier tour

Le dauphin de l'ex-président José « Pepe » Mujica ( 2010-2015 ), Yamandú Orsi est arrivé en 1re position – avec 44 % des suffrages – au premier tour de la présidentielle, dimanche 27 octobre. Le second tour se tiendra le 24 novembre.
Par Luis Reygada,
Tiré de L'Humanité, France, le 28 octobre 2024.
https://www.humanite.fr/monde/jose-mujica/uruguay-le-candidat-de-gauche-yamandu-orsi-arrive-en-tete-au-premier-tour <https://www.humanite.fr/monde/jose-...>
Vers un retour de la gauche au pouvoir en Uruguay ? Le dauphin del'ex-président José « Pepe » Mujica (2010-2015) Yamandú Orsi (parti Frente Amplio) est arrivé en 1re position – avec 44 % des suffrages – au premier tour de la présidentielle, ce dimanche 27 octobre.
Alors que plus de 2,7 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour désigner le successeur<https:/www.humanite.fr/monde/urugu...>'>deLuis Lacalle Pou (droite ; Parti national), Orsi a battu de plus de 15 points Alvaro Delgado.
Ce dernier pourra toutefois compter sur le soutien des sympathisants du candidat du parti Colorado (droite), Andrés Ojeda – arrivé en troisième position avec près de 16 % des voix – lors du second tour, le 24 novembre. « /Redoublons d'efforts pour construire une nouvelle ère progressiste / », a twitté Carolina Cosse, militante communiste et candidate à la vice-présidence aux côtés d'Orsi.
photo Le candidat du parti Frente Amplio, Yamandu Orsi, le 27 octobre 2024, à Montevideo prononce un discours à l'annonce des résultats.© REUTERS/Mariana Greif
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Malcolm Ferdinand : "Le processus autour du chlordécone porte la marque d’une justice coloniale"

S'aimer la Terre. Défaire l'habiter colonial, Malcom Ferdinand, Seuil, collection « Écocène », 608 pages. Une écologie décoloniale. Penser l'écologie depuis le monde caribéen, Malcom Ferdinand, Seuil, collection « Anthropocène », 2019. Prix du livre de la Fondation d'écologie politique.
Malcom Ferdinand est ingénieur en environnement (University College, Londres), docteur en philosophie politique (Paris-Diderot), chercheur au CNRS. Il a cofondé l'Observatoire Terre-Monde. Originaire de la Martinique, il travaille depuis une quinzaine d'années sur la contamination des Antilles au chlordécone et sur une approche décoloniale de la crise environnementale. Il est partie civile dans le dossier pénal du chlordécone et a été auditionné lors de la commission d'enquête parlementaire de 2019.
30 octobre 2024 | tiré de Politis.fr
Le 22 octobre, la cour d'appel de Paris a examiné deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC). Où en sommes-nous dans le traitement judiciaire de l'affaire du chlordécone ?
Malcolm Ferdinand : Deux questions étaient posées aux juges. D'abord, l'intention d'empoisonner doit-elle être avérée pour qualifier le crime d'empoisonnement, ou est-ce que la connaissance des effets mortifères de la substance est suffisante ? La deuxième question portait sur la responsabilité pénale de l'État. Une fois qu'elles seront traitées, nous aurons une date d'audience pour aborder le fond de l'affaire. Le processus judiciaire autour du scandale du chlordécone porte la marque d'une justice coloniale.
Nous avons une justice qui se fait à l'extérieur des Antilles, sans les Antillais.
Premièrement, cette affaire qui concerne la Martinique et la Guadeloupe est traitée à Paris. Un des arguments était qu'il y a plus de moyens, mais la symbolique coloniale est forte : des tribunaux qui sont littéralement posés sur les terres contaminées se refusent à traiter de cette affaire, donc l'instruction judiciaire est menée à 8 000 kilomètres des habitant·es concerné·es. En dix-sept ans d'instruction, les juges ne se sont jamais déplacés ni en Martinique ni en Guadeloupe.
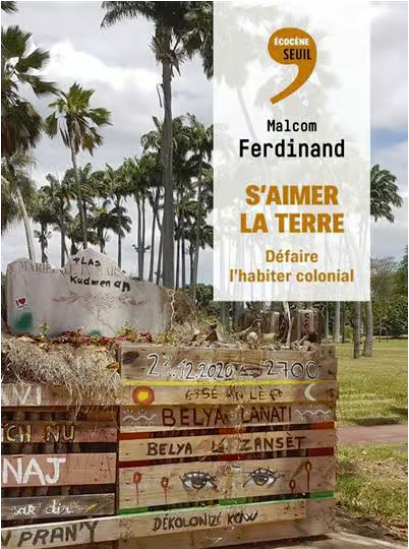
De plus, lors de l'audience de ces QPC, les parties civiles – dont je fais partie – n'ont pas pu accéder à la chambre d'instruction. Une famille avait fait le déplacement depuis la Guadeloupe et n'a pas pu assister aux débats. Nous avons donc une justice qui se fait à l'extérieur des Antilles, sans les Antillais, dans un langage relativement abscons, avec des processus qui paraissent assez opaques. Quel que soit le résultat, avoir confiance est difficile, notamment après la décision de non-lieu prononcée par la justice en janvier 2023.
Sur le même sujet : Chlordécone : non-lieu pour un « scandale sanitaire » d'État
Les juges ont reconnu le « scandale sanitaire » mais ont donné trois raisons pourjustifier le non-lieu : la prescription, les difficultés à prouver l'intentionnalité et les dommages au moment de l'utilisation du produit, et l'impossibilité de « caractériser une infraction pénale ». On demande à une population aujourd'hui contaminée à plus de 90 % au chlordécone d'accepter une justice affirmant que le crime est passé. Cette justice est coloniale et antidémocratique.
Pouvez-vous expliquer ce qu'est le chlordécone et comment il a imprégné l'histoire des Antilles ?
Il y a deux manières de penser le chlordécone. Une manière très techniciste, environnementaliste, qui est celle de l'État français, c'est-à-dire que le chlordécone ne serait qu'une petite molécule monstrueuse, très toxique. Elle a été répandue dans les bananeraies pour lutter contre le charançon du bananier de 1972 à 1993, et a contaminé les sols, les eaux, les plantes, les animaux, les corps humains. Ce récit techniciste est dépolitisant parce qu'il fait reposer toute la responsabilité de cette affaire sur cette molécule.
Sur le même sujet : Chlordécone : Du secret d'État au scandale d'État
Ainsi, l'ensemble des relations sociales, agronomiques, scientifiques, politiques, législatives, judiciaires et administratives qui ont rendu possible cette contamination sont occultées. Or on ne sortira pas de cette contamination par une dépollution miraculeuse, il faut revoir l'ensemble de ces relations qui ont causé cette molécule. C'est ce que j'appelle « l'habiter colonial », qui comprend une manière de se penser sur Terre, d'organiser les rapports de production discriminés selon des critères socio-raciaux, et avec une dimension coloniale évidente puisque les terres antillaises sont destinées à la production portée vers l'extérieur et non à l'alimentation ou aux soins portés à ceux qui y vivent.
Le mouvement pour la vie chère qui a lieu depuis septembre est un autre symptôme de cet « habiter colonial ». Les personnes demandent de pouvoir se nourrir et pourvoir à leurs besoins avec une certaine forme de dignité, et on leur envoie des CRS.
Quelles responsabilités incombent à la communauté scientifique au fil des décennies ?
Le chlordécone, tout comme la transformation des terres antillaises en terres de bananes Cavendish, a été une aventure scientifique décidée à la fin du XIXe siècle. Le but était de reproduire la « colonisation agricole ». Après la défaite de la France contre la Prusse en 1870, des administrateurs et des politiques décident que la colonisation agricole permettra à la nation française de redorer le blason de la France, de retrouver une estime de soi collective. Cela se traduit par la création d'instituts scientifiques qui ont déterminé les meilleures manières de cultiver et d'accroître les profits sur le cacao, le caoutchouc, la banane, l'industrie minière. L'utilisation du chlordécone aux Antilles s'inscrit dans ce cadre-là.
Sur le même sujet : L'écologie décoloniale au cœur de la marche contre l'agrochimie
La question de la science reste fondamentale dans cette affaire. Qui produit la science ? Qui y a accès ? Dans quelle langue ces recherches sont-elles produites ? Deux choses restent valables dans les sciences aux Antilles. Premièrement, « l'habiter colonial » est omniprésent puisque les terres antillaises sont avant tout consacrées à la monoculture d'exportation, et que cela reste le paradigme de beaucoup de productions scientifiques, notamment agronomiques. Deuxièmement, l'accès aux recherches reste inégal par la langue utilisée ou par les moyens d'accès. L'espace scientifique est lui-même traversé par cette colonialité : on maintient une situation où les Antillais sont tenus à l'écart des arènes de production de savoirs sur leur propre corps et leur propre terre.
Où en sont les recherches à propos des maladies liées au chlordécone ?
Même si les liens de causalité sont toujours très compliqués à prouver, les recherches scientifiques ont montré que cela augmente les risques de cancer de la prostate, ainsi que les récidives, retarde le développement cognitif, visuel et moteur des enfants. Il y a un ensemble de recherches en cours pour interroger les liens avec le myélome, avec l'endométriose, et avec d'autres cancers. Les scientifiques étaient des personnes d'un groupe socio-racial blanc, et majoritairement des hommes, donc cela a produit des biais de recherche. Pour le moment, nous avons plus d'informations sur les dangers liés aux pathologies masculines.
Nous sommes face à une inégalité de production de connaissances qui devient une forme d'ignorance et qui ne permet pas à tout un chacun de se saisir et d'appréhender ce sujet, sa maladie, son corps. J'appelle à une forme de souveraineté antillaise de la recherche, notamment parce que ce sujet a pris de l'ampleur médiatique et attire beaucoup de jeunes chercheurs. Ce n'est pas pour fermer la recherche, mais pour l'encadrer, l'orienter afin qu'elle soit démocratisée et coconstruite avec les acteurs et les actrices du terrain.
À quel point les pouvoirs économiques et la filière banane sont-ils encore puissants dans ce dossier ?
La colonisation a commencé par une appropriation de la terre, du foncier racialisé, c'est-à-dire que les titres de propriété étaient d'abord attribués aux hommes blancs. Cela a donné le groupe socio-racial des blancs créoles, les Békés, qui a réussi à maintenir une propriété des terres et des moyens de production. Il conserve une place dominante aujourd'hui dans l'agriculture, l'import-export, la grande distribution, la finance, les banques.
La production d'ignorance qui a entouré le chlordécone dès son introduction en 1972 a rendu difficile la mobilisation citoyenne.
Nous avons donc une structure de la production bananière basée sur quelques personnes qui ont la majorité des terres, et une pluralité de petits planteurs qui s'agrègent autour. Ces groupes dominants cultivent depuis des siècles un sentiment de toute-puissance et d'impunité. Par exemple, en 2009, une directive européenne a interdit les épandages aériens de pesticides. Aux Antilles, les producteurs de bananes ont obtenu des arrêtés préfectoraux dérogatoires afin de poursuivre ces pratiques. C'était vraiment symptomatique de leur état d'esprit colonial resté au stade de « nous sommes les maîtres ».
Sur le même sujet : « Il faut défataliser l'histoire de l'empire colonial »
Cette façon de penser découle de l'histoire, puisque l'abolition de l'esclavage en 1848 s'est faite à la condition que les anciens maîtres soient dédommagés de la prétendue injustice qui leur a été faite en perdant la propriété d'êtres humains. Elle a été faite à condition de maintenir une continuité du capital financier des anciens maîtres, ce qui leur a permis d'investir, d'acheter des usines et de maintenir leur place dominante. Ce sentiment d'impunité fait qu'aujourd'hui ils ne rendent aucun compte sur la contamination des Antilles au chlordécone.
Comment s'est organisée la mobilisation citoyenne contre le chlordécone au fil des années ?
La production d'ignorance qui a entouré le chlordécone dès son introduction en 1972 a rendu difficile la mobilisation citoyenne. Mais, en 1974, des ouvriers agricoles martiniquais qui manipulaient quotidiennement ce produit dans les bananeraies se sont révoltés. Ils n'étaient pas scientifiques mais voyaient déjà les conséquences de l'intensité aiguë de l'exposition à cette poudre blanche. Ils demandaient des congés, une pause le midi, des gants pour travailler, mais aussi le retrait du chlordécone !
Comment envisager des projets de parentalité quand on sait que le chlordécone est présent dans le lait maternel, le cordon ombilical ?
Les gendarmes ont été envoyés et ont ouvert le feu sur les grévistes, faisant deux morts et de nombreux blessés, en toute impunité. Entre 1974 et les années 2000, il y a eu une invisibilisation de ce sujet jusqu'à ce que des acteurs associatifs historiques de Martinique et de Guadeloupe déposent plainte en 2006 pour empoisonnement, mise en danger de la vie d'autrui et administration de substance nuisible. Le sujet est revenu dans le débat public lors des grèves contre la vie chère en 2009, puis lors de la mobilisation contre les épandages aériens de pesticides entre 2011 et 2014. Mais il y a eu un réel embrasement contre ce toxique à partir de 2018.
Sur le même sujet : Chlordécone : « Les autorités savaient »
L'élément déclencheur a été la déclaration de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) disant que les limites maximales de résidus (LMR) de chlordécone dans la viande étaient « suffisamment protectrices » pour la population et ne nécessitaient pas d'être abaissées. Quasiment au même moment, la commission d'enquête parlementaire – à laquelle j'ai participé – a conclu que l'État est bien le « premier responsable » du scandale du chlordécone aux Antilles.
La même année, le Collectif des ouvriers agricoles et de leurs ayants droit empoisonnés par les pesticides (Coaadep) a été créé en Martinique. C'était la première fois depuis 1974 qu'ils avaient une voix propre sur ce sujet et ils ont dénoncé le fait que les premiers concernés soient exclus des discussions.
Vous tirez un fil intéressant entre ces pratiques agro-industrielles toxiques et la méfiance développée chez les Antillais·es envers leurs propres terres. Pouvez-vous étayer ?
La gestion de l'État a mis au centre la question de la toxicité, donc les autres pratiques de ces îles – comme la pêche, la culture de certains légumes racines, l'échange, le don – n'entrent pas dans ce logiciel de pensée. Quand vous entendez à longueur de journée que le chlordécone est partout, que tout est contaminé, cela change votre rapport à la terre, aux animaux. Comme cette habitante qui a décidé de bétonner tout son jardin contaminé. Ou cet éleveur bovin qui me racontait que, pour que ses vaches soient vendues, elles doivent passer six mois dans un box de quelques mètres carrés, bétonné, afin d'être désintoxiquées.
Cette politique crée des rapports aliénants à l'environnement, au point de douter de son propre corps. Comment envisager des projets de parentalité quand on sait que le chlordécone est présent dans le lait maternel, le cordon ombilical ? Cela porte atteinte à ce que je désigne comme l'écoumène antillais. La conséquence ultime pour les Antillais est de se dire que la seule solution est de quitter cette terre. Soit littéralement pour celles et ceux qui en ont les moyens, soit symboliquement en acceptant d'acheter de l'eau en bouteille et de ne manger que des produits exportés.
Sur le même sujet : Les sacrifiés du chlordécone
Cette politique exacerbe une distanciation entre les Antillais et leur terre, déjà entamée avec la colonisation et l'esclavage, qui ont rendu compliqué l'accès à la propriété, qui ont transformé les îles en terre de monoculture pour l'exportation. Le propre de la colonisation, c'est de séparer les peuples de leur terre. Ces politiques autour du chlordécone reproduisent les mêmes schémas. Mon livre propose une autre réponse : « S'aimer la Terre », c'est-à-dire renouveler, approfondir le rapport à nos terres, quand bien même elles contiendraient des molécules dangereuses, toxiques, et retisser des liens avec les écosystèmes, avec le vivant.
Il y a d'ailleurs un passage percutant dans lequel vous appelez à penser comme un charançon.
C'est un peu contre-intuitif, car ce n'est ni le plus beau des animaux ni le plus beau des insectes. Mais le charançon a été la première victime du chlordécone, la première victime de cette relation écocidaire. Nous ne pouvons pas avoir une politique de révolte, de gestion qui ne concerne que les corps humains, qui ne reconnaît pas les connexions avec l'ensemble du vivant. Soudainement, on comprend que ce qui tue le charançon nous tue aussi car nous partageons quelque chose avec le reste du vivant.
Nous ne pouvons pas avoir une politique de révolte, de gestion qui ne concerne que les corps humains.
Il faut envisager un autre récit disant que ce n'est qu'à la condition de composer avec ce tissu vivant que nous pouvons véritablement habiter la Terre. Selon moi, c'est une réponse beaucoup plus riche, plus complexe, plus belle, qu'une seule politique centrée sur une molécule toxique.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

La leader indigène Nemonte Nenquimo parle de la lutte pour défendre l’interdit d’extraction du pétrole en Amazonie équatorienne dans le futur

Democracy now, 14 octobre 2024
Traduction, Alexandra Cyr
Note préliminaire : la parole de Mme Nenquimo est ici traduite depuis la traduction anglaise (américaine) de une langue non identifiée. A.C.
Amy Goodman : (…) Nous examinons le vote du peuple de l'Équateur qui dans un référendum a réussi à faire interdire le pompage de pétrole dans la forêt tropicale du Parc Yasuni. Mais voilà que le nouveau Président, tout juste élu, M. Daniel Noboa, a déclaré que son pays était « en guerre » contre des gangs violents qui « ne sont plus dans la même situation que celle d'il y a deux ans ». Il a aussi dit que le pétrole du Parc Yasuni pouvait aider à financer la guerre contre les cartels de la drogue. Les militants.es et les indigènes se disent préoccupés.es par cette déclaration. Leur victoire avait pourtant été citée en exemple de l'utilisation du processus démocratique pour faire en sorte que le pétrole reste dans le sol.
Pour y voir plus clair, nous sommes avec une personne qui a aidé à la direction de cette lutte pour le référendum et plus encore. Mme Nemonte Nenquimo a reçu le prix de leader Waorani de l'Amazone de l'Équateur. Elle a fondé, avec d'autres le groupe « Premières lignes de l'Amazone » et « l'Alliance Ceibo ». Elle a publié récemment un article dans The Gardian intitulé « Ecuador's president won't give up on oil drilling in the Amazon. We plan to stop him – again ».
Elle vient aussi de publier ses mémoires intitulés : « We Will Be Jaguars : A Memoir of My People », dans lequel elle écrit : « Au fond de moi-même j'ai compris qu'il existe deux mondes ; un où se trouve notre feu et sa fumée (près duquel) je tourne le manioc en miel dans ma bouche, où les perroquets répètent « Mengatowe », où ma famille m'appelle Nemonte, mon véritable nom qui signifie beaucoup d'étoiles. Et il y en a un autre où des personnes de race blanche nous surveillent du haut du ciel, le cœur du diable était noir ; il y avait quelque chose appelé « compagnie pétrolière » et les missionnaires m'appelaient Inés ».
Donc, pour creuser le sujet, Nemonte Nenquimo est ici dans nos studios de New York accompagnée de partenaire et co-auteur, Mitch Anderson qui est le fondateur et le directeur exécutif de « Amazon Frontlines. Il a longtemps travaillé avec les Premières nations de l'Amazone et défends leurs droits.
Soyez les bienvenus à Democracy Now. C'est un honneur de vous rencontrer. Nemonte, pour commencer, je voudrais que vous nous disiez votre nom. Parlez-nous aussi des nations indigènes, de vos origines, de la terre où vous avez vécu en Amazonie en Équateur.
Nemonte Nenquimo : Bonjour à vous tous et toutes.
Mon nom est Nemonte Nenquimo. Je suis une Waorani, dirigeante, mère qui vient du territoire Waorani à Pastaza en Équateur. Toutes les femmes amazoniennes en général sont sur les lignes avancées de défense. Elles donnent leur vie parce qu'elles sont plus respectées et que nous nous préoccupons pour nos fils et nos filles. Nous voulons que nos filles aient leur propre espace de vie, l'eau, la terre, les connaissances, les valeurs, les plantes, les animaux, pour que nous vivions bien libres et dans la dignité. En ce moment, tous les jours notre territoire est menacé. Pourquoi, nous les femmes devrions-nous être menacées sur notre propre territoire ?
C'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre sur la résistance, à propos de mon enfance, depuis le point de vue d'une enfant. J'ai grandi entre deux mondes. Les missionnaires nous parlaient du salut de notre âme en disant que nos croyances étaient mauvaises. Le pétrole est arrivé sur notre territoire avec le vol des hélicoptères et des promesses de développement. Ils ont fait beaucoup de dommages. Ils ont détruit notre eau. Ils ont contaminé notre population et nous ont séparé de nos savoirs et de nos valeurs. Les gouvernements et les grandes organisations sont arrivés pour nous dire qu'un parc national serait installé et en même temps, ils ont rendu les choses pires encore et ils se sont emparé de notre territoire.
La lutte que nous avons menée est très importante et je voudrais en donner le contexte. C'est une longue histoire avec tous ses détails. Mais, pour moi c'est très important. Comme le disait mon père : « Ma fille, moins les gens connaissent la jungle plus ils ont d'argent pour la détruire ». Mon histoire et notre culture sont orales. Avec mon mari Mitch j'ai voulu la livrer par écrit pour que le monde puisse comprendre comment nous vivons, nous les peuples indigènes liés à Mère Nature avec amour et respect.
Donc, c'est une histoire de résilience, de résistance pour que les autres peuples du monde puissent connaître la véritable histoire des peuples indigènes, de tous les peuples indigènes qui vivent une grande menace, une gigantesque menace parce le système d'ici atteint nos territoires jours après jours. Donc, ce message est très important. Vous pouvez lire le bouquin. Vous pouvez en être touchés.es et ouvrir vos cœurs, prendre un véritable engagement à agir.
Qu'est-ce que je tente de vous dire ? Vous ici, les communautés et la société civile vous devez ouvrir vos cœurs et condamner les compagnies qui continuent à investir dans ce qui mutile nos territoires qui les extermine comme nos connaissances et notre culture. Donc, à partir d'ici nous devons commencer à nous rééduquer à ne pas consommer ce qui détruit notre santé, à nous reconnecter à Mère Nature, nous reconnecter spirituellement, à aimer Mère Nature pour nous guérir. Voilà ce qui est important.
A.G. : Je veux que nous parlions de la bataille que vous avez menée pour faire adopter cette loi en Équateur. Mais, d'abord, le titre de votre livre qui vient juste d'être disponible est : We Will Be Jaguars : A Memoir of My People, aux États-Unis. En Europe où il vient aussi juste de sortir, ce n'est pas la même chose, c'est : We Will Not Be Saved. Pouvez-vous expliquer la différence ?
N.N. : Donc, j'ai grandi dans deux mondes différents. Les évangélistes venaient sauver nos âmes mais ils ont apporté les maladies dont la polio. Nos grands-parents, mes grands-parents et une de mes tantes en sont morts. Les compagnies pétrolières sont aussi venues disant qu'elles allaient développer nos vies dans nos communautés mais elles les ont détruites. Et encore maintenant, elles contaminent nos territoires et nous apportent des maladies. Les gouvernements et les grandes compagnies viennent avec les mêmes intentions, sans rien comprendre (à notre mode de vie).
C'est à cause de cela que j'ai tenté de dire « Nous ne serons pas sauvés.es » et cela aussi longtemps qu'ils n'écouteront pas les peuples indigènes, leur vision globale du cosmos. Parfois ils arrivent avec les structures propres à l'homme blanc pensant qu'elles sont meilleures, qu'ils ont de meilleures idées. Ils apportent des propositions de développement et causent des destructions. C'est ce que je tente de dire parce c'est ce que j'ai vécu depuis mon enfance dans la confusion et mon peuple, mon peuple était très directement lié spirituellement à la nature qui guérit. Mais les missionnaires parlent de nous sauver et disent que notre lien fort avec la nature est mauvais. C'est donc ce qu'ils sont venus faire : détruire.
C'est pour cela que j'ai choisi ce titre. Ils ne peuvent continuer à traiter les peuples indigènes comme s'ils étaient ignorants, comme si nous n'avions aucune connaissance. Pendant des milliers d'années les indigènes ont possédé leurs savoirs, ils ont respecté Mère nature, aimé la terre. Si nous les femmes somment la terre et s'il la maltraite, la détruise, comment allons-nous leur donner la vie ? Comment allons-nous les nourrir ? C'est ce que j'essaie de dire.
We Will Be Jaguars. Dans notre culture le jaguar est un dieu. Il nous aide, dans nos rêves à voir que nous devons prendre soin de notre territoire. Si nous mourrons, nous continueront à vivre spirituellement comme le jaguar qui entoure nos territoires et les défend. Donc, comme femme waoranie diriger la lutte contre le gouvernement, contre le pétrole, c'est dire : « Nous serons des Jaguars, prêts.êtes, toujours à nous défendre pour nos enfants et vos enfants et pour la planète ». Voilà pourquoi j'ai écrit que nous serons tous et toutes des jaguars.
Ce livre est très spécial. (Il espère) que tous et toutes autour du monde peuvent apprendre le respect et que nous pouvons travailler ensemble contre les changements climatiques. Pendant qu'ils parlent de changements climatiques ils n'avancent aucune solution. Ils ne font que promettre. Ce sont les mêmes politiciens.nes, les mêmes représentants.es qui prennent les décisions. Il n'y a pas de place pour que les femmes amérindiennes puissent agir, pour occuper un espace ensemble.
A.G. : Mitch Anderson, vous êtes le co-auteur de ce livre et le partenaire de Nemonte. Vous avez 2 enfants, un de 9 ans et un de 3 ans. Nemonte vient de nous expliquer ce que signifie We Will Not Be Saved e de même à propos de We Will Be Jaguars. Comme Américain, né dans la Baie de San Francisco, pouvez-vous nous expliquer pourquoi We Will Not Be Saved n'est pas le titre de ses mémoires aussi aux États-Unis ?
Mitch Anderson : Au point de départ, quand nous avons commencé à écrire ce livre Nemonte et moi, nous avons proposé We Will Not Be Saved comme titre. Nemonte, dans ce livre décrit son expérience de petite fille qui voit arriver les missionnaires qui parlent de ce Dieu blanc dans le ciel qui essaie de sauver les âmes de la population, donc ce titre nous semblait approprié. Elle décrit aussi les maux que cela a causé. Et en fait, au cours de sa vie, et elle le décrit dans le livre, elle a eu connaissance de la mentalité d'arrogance de ces étrangers.ères que le peuple Waorani appelle cowori, qui sont arrivés.es sur leur territoire en promettant de sauver leurs âmes, de le développer et qui ont fait tant de mal. Et donc, au Royaume Uni le titre est We Will Not Be Saved.
Mais quand nous avons publié le livre aux États-Unis je pense qu'ils (les éditeurs) voulaient un titre un peu moins confrontant, un peu plus optimiste je dirais. Mais We Will Be Jaguars est aussi un titre puissant parce que Nemonte décrit dans ce livre le lien de son peuple avec les esprits du jaguar. Et même si les compagnies pétrolières, les gouvernements et les missionnaires tentent de changer son peuple, de lui faire mal, il restera un jaguar dans cette vie, protégeant leur terre, et dans la vie après la mort protégera ce même territoire qu'il protège en ce moment.
A.G. : Je voulais revenir à ce qui s'est passé l'an dernier en Équateur dans la forêt tropicale où se trouvait Nemonte. Le 20 août 2023, il y a eu un vote en Équateur qui interdisait tout futur forage dans le Parc national Yasuni. En octobre, M. Daniel Noboa a été élu à la présidence, environ une année plus tard donc. Vous avez été une des leaders qui s'est battue pour que ce parc soit protégé. Décrivez-le-nous et parlez-nous du mouvement que vous avez dirigé et comment M. Noboa a changé de position.
N.N. : Le parc Yasuni est un territoire ancestral Waorani. C'est aussi un des endroits de la planète qui possède le plus de diversité. Il lui donne de l'oxygène. Pour réussir, les peuples autochtones se sont alliés entre eux puis avec des activistes, des réalisateurs.trices de cinéma et des étudiants.es. Nous avons fait comprendre aux gens des villes, à la société civile, son importance et aussi que partout où il y a eu de l'exploitation pétrolière dans notre pays, il n'y a pas eu de développement. Il y a eu plus de corruption, plus de problèmes et de morts. C'était très évident. Les sociétés ont compris que la protection était importante, qu'il fallait conserver ce territoire pour le futur. C'est pour cela que nous avons mené la bataille.
Je dirige aussi Amazon Frontlines. Avec d'autres organisations nous avons réalisé un film pour que les gens voient l'importance de la forêt tropicale du Yasuni non seulement pour le peuple Waorani mais pour tous les peuples de la terre. Et nous avons gagné le référendum ! Nous avons réussi à convaincre toute la population du pays qui a voté OUI en faveur de la vie. J'ai ressenti la puissance de ce signe : les gens des villes ont ouvert leur conscience, leur cœur et ont vu que le plus important était la vie. Nous avons gagné. Mais le Président n'est pas à la hauteur. Il devrait déjà avoir commencé à démanteler et fermer (le site). Nous les peuples indigènes, nous en avons assez.
A.G. : Laissez-moi vous interrompre un moment. Donc, d'abord vous avez fait adopter la loi ce qui a demandé une énorme mobilisation de toute la population du pays. Quelle était la position de M. Noboa durant la campagne électorale, après l'adoption de cette loi ? Elle bénéficiait d'un soutien tel que pour gagner son poste il devait la soutenir aussi n'est-ce pas ?
N.N. : Exact. Durant la campagne électorale M. Noboa s'est engagé à respecter le parc Yasuni. Mais une fois élu, il s'est désisté. Je dois dire que j'ai vu les politiciens.nes, pas seulement M. Noboa, faire de belles promesses durant les campagnes à la Présidence mais aussitôt élus.es le courage et la bravoure ne les étouffent pas et les droits des peuples autochtones, ceux de la nature, ne sont jamais pris en considération. C'est pourquoi les peuples autochtones sont unis prêts à confronter (ces politiciens.nes). Notre territoire c'est notre foyer. C'est un espace de vie pour l'avenir et pour les peuples de la terre. Notre territoire ne sera jamais à vendre.
A.G. : Donc, en ce moment, le Président dit que le pays a besoin d'argent pour combattre les cartels de la drogue qui trafiquent en Équateur. Sa façon d'avoir cet argent c'est de permettre à des compagnies étrangères d'extraire plus de ressources dans le pays. Qu'elle est votre réaction Nemonte ?
N.N. : Oui, il parle d'économie mais un jour il n'y aura plus de pétrole. Ça n'assure pas l'avenir. Le Président Noboa doit faire attention. Il doit assurer l'avenir. Il doit présenter des opportunités. Il devrait jouer un rôle plus important dans le monde pour provoquer des changements et laisser le pétrole dans le sol, présenter des alternatives, sortir de la mentalité consumériste, arriver à une autre forme de mentalité, un changement pour envisager ce qui pourrait être généré dans le futur et comment les peuples indigènes sont respectés, comment Mère nature l'est aussi pour mettre fin aux changements climatiques pour le monde. Mais souvent, les leaders ne pensent pas à ça. Ils et elles ne veulent que de l'argent et n'ont pas de solution. Ce n'est pas une solution justement pour les générations à venir. M. Noboa est favorisé ; c'est un jeune président qui pourrait changer le monde.
A.G. : Donc, comment allez-vous provoquer ce changement ? Vous êtes une leader Waoroni. Vous êtes une des leaders du mouvement qui a réussi à faire adopter cette loi mais qui a pris une autre direction. Comment allez-vous provoquer cela ?
N.N. : Je pourrais dire que n'importe quelle société doit agir. Ne laissez pas les premiers peuples mener seuls la lutte pour la vie. Ce que nous faisons, c'est la solution. Nous sommes aux premières lignes. Donc, les gens d'ici (aux États-Unis), doivent commencer par ne plus investir dans des compagnies qui endommagent le territoire, la forêt dans toute l'Amérique latine. Ensuite, n'investissez plus dans la propagande qui veut que le pétrole soit la solution, mais dans celle qui cherchent une alternative à cette énergie. Et en plus, les mentalités doivent changer, cesser de consommer de plus en plus de choses nuisibles. Par le mot changement, je veux dire d'ouvrir vraiment son cœur, de se relier de nouveau avec Mère nature, de se relier spirituellement, de guérir à nouveau. Ça c'est la solution. Les gens des villes d'ici continuent à consommer ; c'est une honte. Cela va affecter l'Amazone pendant que nous les premiers peuples somment sur les lignes de front.
Assez, c'est assez. Nous ne cesserons pas de nous battre. Nous allons continuer à nous tenir debout. Nous serons sur le front comme des combattants.es, des jaguars. Mais, ici, aussi longtemps qu'il n'y aura pas de changements, aussi longtemps que la consommation dure, l'Amazone en sera affectée. Même si les pétrolières ne viennent pas, l'effet sera là. Donc, pour moi, le travail ici, c'est de faire pression sur les hommes et les femmes politiques, sur les compagnies, de ne pas consommer ce qui fait du mal mais de soigner et guérir dans les villes.
A.G. : Vous êtes ici au beau milieu d'une campagne électorale présidentielle aux États-Unis. C'est peut-être le plus important. Il y a deux partis principaux, les Démocrates et les Républicains. À propos de l'immigration, ils rivalisent entre eux ; ils sont d'accord sur plusieurs points comme fermer la frontière aux immigrants.es venant du Mexique et des pays du sud dont l'Équateur. Pouvez-vous faire un lien direct avec la destruction environnementale, la pauvreté, la violence (dans leurs pays), qui poussent des milliers de gens de l'Équateur et de toute la région de l'Amazone à quitter leurs terres, leurs pays ?
N.N. : Je pense que cela est survenu souvent au cours des dernières années parce que le climat de crise dans le monde est très sérieux. Et nous ne devons pas laisser cela arriver. Nous devons éveiller les consciences de la population dans la ville.
Pourquoi y a-t-il des gens malheureux ? Les gens quittent leurs pays parce ce système de consommation ici, provoque des conflits armés et ce n'est pas qu'en Équateur. Ça provoque l'extraction du pétrole parce que le monde entier en a besoin pour son pillage. Le besoin d'argent est là.
C'est pourquoi nous devons y voir, équilibrer, nous reconnecter, sentir à nouveau la paix que nous voulons pour nos sociétés parce que Mère nature souffre de ces phénomènes qui nous affectent tous et toutes. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. Les politiciens.nes avec leur grand pouvoir ne s'en rendent pas compte ; ils et elles sont déconnectés.es, ne sont plus en lien avec Mère nature, ni avec leur spiritualité. Il n'y a pas d'amour dans leur cœur, absolument aucun amour.
Donc, nous les gens, la société, devons-nous rassembler, socialiser, nous unir parce que nous sommes capables de résoudre ce problème. Nous n'allons pas laisser le gouvernement prendre les décisions dans notre propre maison. Nous n'allons pas laisser le gouvernement nous diriger, diriger nos territoires. Donc cette responsabilité nous revient à tous et toutes. C'est ce que je tente de dire. La responsabilité n'est pas que celle des peuples autochtones.
Pourquoi devons-nous vivre sur notre territoire en étant chaque jour menacés.es. Le système ne s'arrête pas, les mentalités ne changent pas, le cœur n'est plus touché profondément. Donc le travail à faire est ici dans les grandes villes. Comme femme autochtone, c'est ainsi que je vois les choses, c'est ce que je tente de dire. Comme femme autochtone, je vois que le problème n'est pas dans les territoires indigènes. Le problème est ici, dans ce système que tous ensemble nous devons arrêter. C'est le message. Tant que nous ne connaissons pas vraiment la vie, ce qui est le plus important, nous allons la détruire. Mère nature ne s'attends pas à ce que nous la sauvions mais à ce que nous la respections que nous l'aimions et la guérissions. C'est la société que nous devons soigner.
A.G. : Donc, vous voici à New York. Vous y êtes à cause de la semaine sur le climat. Vous y avez été antérieurement même si vous passez l'essentiel de votre vie en Amazonie. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être avec des milliers de personnes dont des leaders mondiaux et de vous adresser aux Nations Unies ? Voyez-vous des progrès depuis que vous participez ainsi avec des milliers de militants.es venant du monde entier sur des enjeux liés au réchauffement climatique ?
N.N. : À titre de femme autochtone, je vis une vie collective dans ma communauté ; c'est ainsi dans chacune de nos communautés. Nous les femmes, somment sur les lignes de front parce que nous sommes préoccupées par le bien-être de tous et toutes. Nous sommes un collectif et nous nous assurons que tout fonctionne bien. Nous sommes les protectrices, les gardiennes, les mères.
Qu'est-ce que je vois pour ce qui est du changement climatique ? Quand j'arrive ici, en tant que femme autochtone, je regarde et je constate qu'il n'y a aucun espace pour nous les femmes autochtones où nous pourrions parler aux hommes et femmes politiques. Je vois un espace où les même politiciens.nes sont représentants.es, parlent, prennent des décisions quant au territoire, en extrayant des ressources tout en parlant de la manière de sauver l'environnement. Il n'y a aucune manière sérieuse de faire une place aux peuples indigènes à la table (de discussion), pour prendre des décisions, pour s'engager avec respect. Il n'y a rien. Les politiciens.nes créent leurs propres espaces, prennent leurs décisions. Ça n'arrêtera pas les changements climatiques.
Mais ce que j'observe aussi très sérieusement, c'est que les sociétés civiles relèvent leur conscience. Elles se réveillent. C'est bon signe. Comme je travaille avec des collectifs, la tâche nous appartient, comme le rôle. Nous devons nous unir avec les sociétés civiles. Nous devons faire pression sur les élus.es pour qu'ils et elles nous voient, pour ouvrir leurs cœurs, les rendre conscients.es des enjeux climatiques sérieusement. Pendant que nous les peuples indigènes, occupons un espace, présentons nos histoires ces élus.es prennent des décisions, signent des résolutions et des ententes. Pour moi ce n'est pas une solution. C'est triste.
A.G. : Mitch Anderson, vous avez étudié ces enjeux depuis des années. Au début 2000, vous étiez avec Amazon Watch. Vous avez passé beaucoup de temps, environ 15 ans en Amazonie. Avec votre partenaire Nemonte, vous avez fondé Amazon Frontlines. Au moment de revenir dans votre pays de naissance, les États-Unis, pouvez-vous observer quelques progrès ? Et comme personne pouvant voir l'Amazonie depuis votre pays, depuis le lieu où votre famille et votre communauté vivaient, jusqu'au lieu où vous vivez maintenant avec vos enfants, avec votre nouvelle communauté, qu'est, selon vous le plus grand malentendu que nous ayons avec l'Amazonie ?
M.A. : Je vis en Amazonie avec Nemonte et son peuple depuis 15 ans. La vaste majorité du pétrole extrait en Amazonie détruit les forêts et les rivières. Il est ensuite expédié en Californie pour y être raffiné. Il est ensuite distribué dans les stations d'essence dans tout le pays et aussi transformé en carburant pour les avions. Je ne crois pas que les Américains.es comprennent vraiment ce que Nemonte leur dit à propos de la consommation et du système de dépendance au pétrole ni comment cela détruit les cultures indigènes et leurs territoires.
Durant les années 1960, les pétrolières américaines ont découvert le pétrole de l'Amazonie en Équateur et au Pérou. Elles ont délibérément pris la décision d'en verser des barils et des barils dans les rivières, des millions de gallons ainsi que de l'eau usée pour épargner de l'argent. Il en est résulté une crise majeure de santé publique. En Équateur, le gouvernement de l'époque pensait que cette exploitation serait leur salut, que ça allait les sortir du sous-développement et de la pauvreté. Mais, au cours des 60 dernières années cela a créé des disparités économiques, des inégalités, de la corruption, une énorme contamination environnementale et de la pauvreté.
Je pense que Nemonte et son peuple, les jeunes militants.es du climat en Équateur ont fait une démonstration et élevé la conscience de toute la population du pays en lui racontant des histoires, en lui disant : « Vous voyez, nous vivons dans le développement du pétrole et où sommes-nous rendus.es en ce moment ? Il faut que le pétrole reste dans le sol. Nous devons protéger la forêt avec la plus grande biodiversité du monde. Nous devons réveiller nos imaginations, penser à des alternatives économiques, penser à la régénération ».
Et gagner dans le cas du parc Yasuni, de la forêt avec la plus grande biodiversité du monde, c'est ça. C'est ce modèle de démocratie climatique qui est une inspiration pour le monde entier. Avec Nemonte, à Amazon Frontlines, nous sommes un collectif de militants.es occidentaux et de leaders indigènes qui travaillons à mettre fin à l'industrie pétrolière, minière, du bois, à ne pas les laisser entrer dans les forêts, à créer des zones permanentes de protection, mais aussi avec les communautés indigènes à récupérer leurs territoires parce qu'essentiellement, elles sont les propriétaires ancestraux de presque la moitié de ce qui reste de la forêt amazonienne. Ils ne comptent que pour 5% de la population mondiale mais protègent 80% de la biodiversité de toute la planète. Les peuples indigènes sont les propriétaires de 40% des écosystèmes encore intacts sur terre.
Donc, nous avons vu à la semaine sur le climat que la société civile se réveille. Les peuples autochtones mènent la marche, ils partagent leurs histoires, leurs positions, ajoutent à leurs valeurs. Mais nous voyons aussi que les politiciens.nes, les dirigeants.es de compagnies sont encore accrochés.es au pompage jusqu'à la dernière goutte de pétrole dans les forêts et les océans. Nous ne pouvons permettre cela.
A.G. : Et comment a été cette collaboration entre vous pour écrire le livre ? Ce sont les mémoires de Nemonte mais vous avez écrit avec elle We Will Be Jaguars : A Memoir of My People.
M. A. : Vous savez, au cours de ces 15 dernières années, avec Nemonte et son peuple, avec Amazon Frontlines, l'Alliance Ceibo, nous avons gagné beaucoup de batailles. Nous avons fait reculer l'industrie pétrolière, protégé un demi millions d'acres de forêt, créé le précédent pour 7 millions de plus, aidé au mouvement pour sauver Yasuni et réussi à garder 726 millions de barils de pétrole dans le sol.
Nous continuons à recevoir des menaces. Les pétrolières et les minières et en ce moment le gouvernement de l'Équateur, préparent une nouvelle vente aux enchères pour la location de millions d'acres à l'industrie pétrolière internationale juste au moment où nous savons tous et toutes qu'il faut mettre fin à cette production. Il faut que le pétrole reste dans le sol.
Alors, Nemonte m'a expliqué que son père lui avait dit que le peuple Waorani avait toujours su que les étrangers détruisent ce qu'ils ne comprennent pas. Il lui a aussi dit qu'il était temps qu'elle écrive son bouquin pour y décrire l'histoire de son peuple, de sa résistance pour donner une chance au monde de connaitre les peuples indigènes, de comprendre leur conception de la forêt, de comprendre ce qui est en jeu. Elle m'a demandé d'être son collaborateur. Nous sommes partenaires de vie et dans le militantisme. Nous avons fondé ensemble Amazon Frontlines et l'Alliance Ceibo. Elle m'a donc demandé de me joindre à elle pour écrire cette histoire.
Elle vient d'une tradition orale. Nous avons passé des années ensemble à écrire aux petites heures du matin, au lever du soleil, en canot, en marchant dans la forêt. Je l'écoutais me raconter ces histoires. Certaines remontent à la nuit des temps, à des milliers d'années, à des centaines d'années, à ses premiers souvenirs d'enfant, de fillette. Ma mission était de concevoir, avec elle, une manière d'écrire cela avec l'esprit propre aux récits oraux des traditions de son peuple. Ce fut un magnifique processus. Et nous pensons ….Nemonte m'a dit qu'elle pense que ses ancêtres seraient fiers de l'histoire que nous avons produit.
A.G. : Nemonte, amenez-nous dans ce profond parcours. Vous nous faites pénétrer dans votre livre, We Will Be Jaguars. Dites-nous d'abord où vous êtes née en Équateur, en Amazonie, cet endroit où les missionnaires vous ont rejoint. Vous avez dit : « Les auteurs-es de notre destruction sont exactement ceux et celles qui nous prêchaient le salut ». Commencez par nous parler de votre visage et des images qui s'y trouvent. Il y a une teinte de rouge sur vos yeux d'une tempe à l'autre et quel est le sens de votre coiffure ?
N.N. : Durant mon enfance j'ai grandi dans deux univers, très jolis, magnifiques. Je voyais les missionnaires aller et venir autour de nous, nous apportant les paroles de Jésus et je voyais aussi nos grands-parents près de nous, soigner avec des plantes. J'étais une fillette très curieuse. Je voulais découvrir. Je voulais comprendre qui étaient ces gens, ces blancs.hes, et mes grands-parents. Qui étaient-ils ? Donc j'ai grandi en des temps très jolis, vraiment magnifiques parce que sur notre territoire nous vivions encore collectivement à ce moment-là. Nos chakras, nos rivières, notre mode de vie étaient libres dans ce lieu.
Le rocou (colorant d'un beau rouge orangé obtenu du fruit du rocouyer. N.d.t.) fait partie de notre culture. Nous nous peignons les yeux et le front pour nous protéger des mauvaises énergies. Mais aussi, pour les femmes, pour leur beauté. En peignant cette partie de notre visage nous annonçons notre identité, nos origines waoranies, de femme waorani.
La couronne est faite de plumes d'aras. Pour nous c'est un oiseau très sacré. Ils comptaient beaucoup pour nos ancêtres et nous y croyons toujours. Ils se tiennent à la cime des arbres, communiquent entre eux et ensuite ils planifient leur recherche de nourriture. Donc, porter cette couronne signifie que vous êtes une leader liée à sa famille qui protège sa maison et ses communautés.
Le collier signifie aussi que vous êtes une leader. Il représente le pouvoir, celui de la femme. Ça fait partie de notre culture. Il est fait de graines appelées pantomo. On en trouve beaucoup dans la jungle. Nous croyons qu'elles nous protègent des mauvaises énergies et mais aussi qu'elles nous envoient de bonnes vibrations, une bonne énergie. Nous portons ce collier pour aller aux cérémonies et aux réunions.
Ce n'est que depuis 50 ou 60 ans que nous avons des contacts avec l'extérieur, que notre culture est en contact avec le monde extérieur. Il y a maintenant de nouvelles générations et nous réfléchissons à la façon d'exposer nos connaissances ; nos grands-parents sont en train de mourir. Il faut donc que nous passions notre culture aux jeunes, aux jeunes leaders pour qu'ils et elles puissent continuer à protéger le territoire et conserver leur propre langage.
C'est donc très important pour nous de réapprendre, d'avoir notre propre système d'éducation, notre éducation traditionnelle mais en même temps, d'apprendre des autres systèmes comment utiliser nos connaissances pour protéger notre territoire où il y a encore des forêts. Si elles sont en santé, nous le seront nous aussi. Mais si la maladie les atteint, si elles deviennent contaminées nous commencerons à être malades et nous nous dissocieront de nous-mêmes, de nos savoirs, de notre langue, nous perdrons tout comme c'est arrivé à d'autres peuples qui sont disparus depuis 500 ans. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons continuer à être des Waoranis.es avec le savoir des deux mondes en valorisant nos principes.
A.G. : Amenez-nous avec vous depuis New York. Qu'est-ce que ce retour chez-vous, en Amazonie en Équateur, va représenter pour vous ? Combien de temps va durer ce voyage ? Vous allez d'abord vous rendre à Quito, la capitale ?
N.N. : Je peux vous en parler. Pour rejoindre mon territoire depuis ici, à New York, nous devons d'abord aller à Quito. De là, nous devons prendre un autobus et voyager pendant cinq heures jusqu'à Puyo, Pastaza. Et de là, faire encore quatre heures de routes jusqu'au bout du chemin où vivent d'autres voisins Quetchuas. Ensuite nous devons pendre un canot pour descendre la rivière jusqu'où le territoire waorani commence.
Ensuite nous nous rendrons dans les communautés de Daipare, Quenahueno et Tonampare où je suis née et où j'ai grandi. Par la suite j'ai déménagé plus bas. Mon père m'a emmenée dans la jungle profonde dans la communauté de Nemompare. J'y suis encore avec mon père. C'est un endroit très éloigné où il y a de grands arbres, des arbres magnifiques, les ceibos (Erythrica crista-galli du nom scientifique. N.d.t.). Il y a aussi beaucoup d'oiseaux des perroquets et beaucoup d'autres. On peut entendre les chants des oiseaux petits et grands. On peut aussi voir les poissons, l'anaconda, le jaguar, les singes rouges qui crient dans la montagne. C'est très, très beau. En arrivant la nuit, si vous levez les yeux, vous voyez le clair de lune, c'est vraiment très beau.
Notre territoire est grand. Il y a trois provinces : Pastaza, Napo et Orellana. Nous vivons collectivement sur ce territoire. Mais une pétrolière opère dans le parc Yasuni où nos frères et sœurs Tagaeri et Taromenane vivent en autarcie volontaire.
Nous essayons de défendre nos droits, de garder nos foyers et d'avoir un espace sans extraction, sans contamination où nous pouvons vivre dans le bonheur et dans la dignité. Et tout ce que nous faisons chez-nous pour nous protéger profite aussi aux autre tribus. Nous profitons de l'oxygène. 80% de la diversité dans les poumons de tous les humains vient de notre territoire. C'est donc mon message : même si nous sommes ici à New York où ailleurs nous nous sentons en liens avec vous.
Nous devons commencer à travailler ensemble, collectivement comme femmes. Je travaille beaucoup avec les femmes de ma communauté parce que comme femmes nous sommes aux avant-postes. Nous prenons soin de nos corps, de notre santé. Donc c'est mon message. J'apporte l'esprit des femmes de la jungle. C'est pour cette raison qu'il est dans mon livre. J'espère que vous allez tous et toutes le lire pour vous reconnecter à Mère nature, à l'amour de vous-mêmes, a la spiritualité pour vous soigner ensemble, pour faire face aux menaces qui ne vont pas s'arrêter. Je suis sûre que la menace ne s'arrêtera pas. Comme femme nous devons apprendre à bien dire les choses. Femmes indigènes et non indigènes, nous devons travailler ensemble.
A.G. : Ici aux États-Unis vous venez de gagner un prix que vous allez bientôt recevoir. Le prix humanitaire Hilton de la Fondation Conrad Hilton. Ce sont deux millions et demi de dollars pour votre groupe, Amazon Frontlines. Pouvez-vous nous dire ce que cela signifie pour vous et ce que vous prévoyez en faire ?
N.N. : Cette reconnaissance est très importante pour moi. C'est très important de montrer ce que nous faisons avec nos partenaires aussi, montrer que nous pouvons fournir des ressources aux communautés indigènes parce que nous sommes sur le front à combattre les changements climatiques. Cela va nous aider à développer notre organisation, à élaborer nos structures et à nous battre contre cette menace qui est là tous les jours.
Mais si cette reconnaissance n'est pas une solution elle va nous aider à être plus visibles, à faire valoir notre lutte et à la présenter à d'autres acteurs. La menace est très forte et le peuple indigène ne peut être le seul sur la ligne de front. Donc, le monde entier doit s'assembler et lutter pour des changements dans l'avenir.
A.G. : Mitch, vous êtes co-fondateur de Amazon Frontlines. Qu'est-ce que cela signifie pour votre organisation ?
M.A. : Amazon Frontlines est une organisation d'indigènes et d'occidentaux. Pour nous ce prix est une validation de notre modèle. C'est une validation que le leadership indigène est aux premières lignes. C'est une validation de son importance comme administrateurs.trices de leurs territoires. C'est la validation par le monde qui reconnait que pour faire face à la crise climatique les indigènes doivent être vus.es, structurés.es et soutenus.es dans leur pouvoir, qu'on doit leur fournir les ressources dont ils et elles ont besoin pour poursuivre les protections contre toutes ces menaces.
Nous allons recevoir des sommes importantes. Nous allons intervenir avec ceux et celles sur la ligne de front qui sont avec les communautés qui mènent la lutte contre les industries pétrolières et minières. Nous allons aussi nous en servir, grâce à la visibilité qu'il nous donne, pour augmenter nos ressources, pour augmenter notre travail, notre impact et nous assurer que nous pouvons protéger la totalité du Haut Amazone, une des forêts contenant le plus de biodiversité dans le monde, un lieu de capture du carbone. C'est encore un puits de carbone et c'est un des endroits avec le plus de diversité culturelle de la planète. Oui, nous sommes extrêmement fiers.es, reconnaissants.es, honorés.es et humbles. Nous allons apporter ces ressources sur la ligne de front.
A.G. : En terminant, (s'adressant à Nemonte n.d.t.), pouvez-vous regarder directement la caméra et partager votre message avec le monde ?
N.N. : Mons message est que la forêt et Mère nature sont importantes. Nous devons les aimer, nous lier à elles. Nous devons revenir aux liens, soigner nos corps parce que nous donnons la vie. Je vous apporte le message que nous les peuples indigènes sommes minoritaires mais nos territoires sont plus grands, comme notre diversité et nous allons donner vie à la planète.
La menace arrive chaque jour ; elle vient du système. Notre responsabilité est collective. Les peuples indigènes, les leaders féminines indigènes ne sont pas seuls.es a devoir porter cette responsabilité. Nous devons faire alliance avec des femmes qui ne sont pas autochtones pour nous unir et agir pour notre mieux-être et celui de nos enfants.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Elections au Brésil : la gauche a besoin de dire son nom, mais elle ne peut pas continuer à parler toute seule

Les défaites ont des effets contradictoires. Une fois absorbées, elles peuvent constituer une expérience d'apprentissage importante et favoriser la progression du mouvement. Mais cette assimilation n'est jamais automatique. C'est pourquoi le résultat immédiat des défaites est la désorganisation de la pensée, la confusion, la démoralisation et, dans les cas extrêmes, la paralysie. Face à la défaite, des explications rapides et faciles émergent, préparées à l'avance. Les ingénieurs du prêt-à-penser émergent, les prophètes du passé. Et la recherche des coupables commence.
Je souffre : quelqu'un doit bien en être coupable.
Friedrich Nietzsche
31 octobre 2024 | tiré d'Europe solidaire sans frontières | Illustration : Le diable assis, 1890. Mikhail Vrubel
https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article72431
Selon nous, il s'agit d'une victoire de l'extrême droite. La presse institutionnelle fait tout ce qu'elle peut pour la présenter comme un triomphe du centre-droit, mais il s'agit d'une analyse purement instrumentale. Son objectif est de masquer les relations du centrão avec l'extrême droite, ouvrant ainsi plus d'espace pour la formation d'un grand front anti-gauche pour 2026.
« Selon nous, il s'agit d'une victoire de l'extrême droite. La presse institutionnelle fait tout ce qu'elle peut pour la présenter comme un triomphe du centre-droit, mais il s'agit d'une analyse purement instrumentale. Son objectif est de masquer les relations du centrão avec l'extrême droite, ouvrant ainsi plus d'espace pour la formation d'un grand front anti-gauche pour 2026. »
La très forte personnalisation de la politique, résultat de la défaite historique qu'a été l'effondrement de l'Union soviétique, donne encore plus de force à ce mécanisme. On tente d'expliquer les défaites non plus par le jeu des forces entre classes et partis, mais uniquement par la subjectivité. Le volontarisme est une caractéristique de notre époque. Je peux tout faire. Et si je ne peux pas, il faut en rechercher les responsables.
L'exemple le plus flagrant de cette entreprise est l'effort déployé par les médias (qui a de grandes chances de réussir) pour présenter un personnage grossier comme Tarcísio de Freitas comme un modéré et même un démocrate, plutôt que comme ce qu'il est vraiment : un véritable produit du bolonarisme le plus torve (voir sa « révélation » sur le « Salve » du PCC le jour de l'élection) [1].
Pour commencer, analysons les conditions dans lesquelles se sont déroulées ces élections. Quelques thèmes peuvent être rapidement mentionnés :
a) Le contrôle du Congrès sur la répartition du budget dans un système (en pratique) semi-parlementaire, ce qui a conduit à un taux élevé de réélection des maires qui ont bénéficié d'amendement améliorant leur situation budgétaire alors que le gouvernement fédéral reste lié par le cadre fiscal qu'il a lui-même mis en place ;
b) La progression et la systématisation de la précarité, avec une masse gigantesque de la population jetée dans la jungle de la survie individuelle et de l'« esprit d'entreprise », ce qui a conduit à la diffusion à grande échelle de l'idéologie de la réussite individuelle et de l'idée que les droits sociaux sont nuisibles parce qu'« ils empêchent d'apprendre à pêcher » ;
c) La dégradation et la démoralisation des services publics de santé, d'éducation, de transport, d'assainissement, d'aide sociale et autres, ce qui crée dans la population le sentiment que ces services sont déjà perdus à jamais et qu'il est vain d'en attendre quoi que ce soit ou de se battre pour leur rétablissement ;
d) Le haut niveau d'engagement, de mobilisation et de motivation de l'extrême droite qui, même dans l'opposition (ou peut-être précisément à cause de cela), reste très cohérente sur les questions programmatiques essentielles, même si la personnalité de Bolsonaro est remise en question ; e) L'absence de changement réel dans la vie des gens depuis l'élection de Lula, avec des concessions permanentes au centre, une extrême timidité dans les mesures sociales et l'absence de toute lutte idéologique contre l'extrême droite ; f) Le degré de fusion entre la politique et la religion, avec la propagation (irrésistible jusqu'à présent) des cultes fondamentalistes néo-pentecôtistes qui enrégimentent politiquement leurs fidèles ; g)La campagne permanente des médias institutionnels et de la droite autour de la sécurité et de la corruption comme principaux problèmes du pays, en les associant toujours à la gauche (« qui veut le pouvoir pour voler » et « défend les escrocs ») ; h) La propagation de la panique morale autour des questions de droits reproductifs, de l'identité sexuelle et de la guerre contre la drogue ; i) La satanisation des mouvements sociaux auxquels la gauche est traditionnellement associée, tels que le Mouvement des sans-terres (MST), les syndicats, les mouvements féministes, noirs et étudiants et, plus récemment, les mouvements indigènes et environnementaux ; j) Le grand front unique anti-gauche, qui s'étend de l'extrême droite à la grande presse et qui mène des attaques frénétiques contre les candidats du camp progressiste, aussi modérés qu'ils puissent être.
Bien d'autres éléments pourraient être énumérés, mais il nous semble que ce sont les plus essentiels et les plus caractéristiques pour ce qui concerne cette élection.
Dans ce contexte, il est légitime de se demander : avons-nous commis des erreurs ? Les choses auraient-elles pu être différentes ? Nous ne sommes pas de ceux qui méprisent l'importance de l'intelligence en politique. Au contraire, dans les différents articles publiés sur ce site, nous avons insisté sur le fait que, précisément en raison des conditions difficiles dans lesquelles nous nous trouvons, la flexibilité tactique, les manœuvres, les retraites temporaires, les changements de cap, la capacité à percevoir le sentiment exact et la volonté de lutter de la classe afin de formuler la ligne correcte, tout en gardant nos principes intacts et en poursuivant la lutte à long terme pour dépasser radicalement cette société et son système, sont plus nécessaires que jamais. Il faut également faire preuve d'une capacité d'audace intelligente, en profitant des positions acquises pour attaquer sur les flancs les plus vulnérables de l'ennemi, afin de le faire reculer. Céder sans cesse des territoires (pas plus que l'offensive permanente) n'a jamais été une bonne politique.
L'histoire connaît d'innombrables exemples où l'intelligence politique a changé le cours des choses. En fait, cela arrive tout le temps. Changer le cours des événements est précisément l'essence de l'activité politique, en particulier de la politique communiste.
Mais il n'est pas vrai que cela soit toujours possible, et à n'importe quelle échelle. Cela dépend des conditions concrètes. À notre avis, la raison de la défaite de la gauche dans ces élections réside beaucoup plus dans les facteurs objectifs que sont les rapports de force que dans les erreurs subjectives liées à la tactique politique.
São Paulo : Boulos était-il trop radical ?
« La récente interview de Jilmar Tatto ne laisse aucun doute sur la stratégie qui guide la façon de voir d'une aile du PT : il faut intégrer la Mairie à tout prix. Faisant le bilan de l'élection, Tatto regrette que Nunes ait rejeté un rapprochement avec le PT et le gouvernement dans le cadre d'une alliance de centre. C'est la politique de la capitulation ».
Confrontés à la défaite de l'alliance dirigée par le PSOL à São Paulo, certains secteurs du PT ont émis l'hypothèse que, d'une manière générale, tous les arrangements politiques et accords entre les partis conclus pendant la période préélectorale étaient erronés : Boulos aurait un profil trop radical ; le PSOL aurait une implantation sociale trop faible ; le poids important accordé aux questions de race et de genre empêcherait le dialogue avec la masse de la population qui se focalise sur les « problèmes concrets ». La solution serait donc un recul encore plus grand sur le plan du programme, dans la recherche d'alliances qui dissoudraient le caractère de gauche du front pour le rapprocher d'un agrégat amorphe et centriste.
Ce type de bilan ne tient pas compte du fait qu'en 2020, Boulos est arrivé au second tour des élections avec un profil encore plus radical et une alliance encore plus clairement à gauche, tout en étant parfaitement capable de dialoguer avec la population qui était loin de le connaître aussi bien qu'aujourd'hui. Dans le même temps, le candidat du PT, Jilmar Tatto, qui incarnait exactement la conception d'une candidature plus modérée et de centre-gauche, n'avait recueilli que 8,65 % des voix, tandis que Boulos a obtenu 20,24 %, ce qui lui avait permis de se qualifier pour le second tour.
En d'autres termes, il n'existe pas de règle selon laquelle un candidat plus modéré et de centre-droit est toujours meilleur qu'un candidat avec un profil de gauche plus affirmé. C'est pourquoi la comparaison avec 2020 et la conclusion selon laquelle la candidature de Boulos était trop radicale en 2024 est erronée, car elle ignore le facteur principal : la détérioration de la situation politique.
De plus, il convient d'être concret. Boulos a mené une campagne qui parlait de logement, de transport, d'éducation et de la pénétration du crime organisé dans la mairie. Aurait-il dû renoncer à ces points fondamentaux ? En même temps, il a su établir un dialogue avec un public qui ne constitue pas un électorat traditionnel de la gauche : il s'est adressé aux conducteurs de VTC, aux livreurs, aux petits entrepreneurs, aux commerçants, aux pasteurs évangéliques. La campagne a balayé un large spectre politique et social et ne peut en aucun cas être taxée de sectaire ou d'égocentrique. La récente interview de Jilmar Tatto ne laisse aucun doute sur la stratégie qui guide l'approche d'une aile du PT : il faut intégrer l'hôtel de ville à tout prix. Faisant le bilan de l'élection, Tatto regrette que Nunes ait refusé un rapprochement avec le PT et le gouvernement dans le cadre d'une alliance au centre. C'est la politique de la capitulation.
Boulos était-il trop modéré ?
L'évaluation selon laquelle Boulos était trop radical et celle selon laquelle il était trop modéré commettent toutes deux la même erreur méthodologique : elles ignorent la réalité objective.
Boulos n'a pas été battu à São Paulo à cause d'un supposé « recul programmatique », mais parce que, face à la droitisation du processus (Nunes et Marçal ont obtenu ensemble 2/3 des voix), l'ancien leader du MTST (mouvement des travailleurs sans toit) est apparu trop radical.
Boulos n'a pas été battu à São Paulo à cause d'un prétendu « recul programmatique », mais parce que, face à la droitisation du processus (Nunes et Marçal ont obtenu ensemble 2/3 des voix), l'ancien leader du MTST est apparu trop radical, trop à gauche, trop socialiste pour une bourgeoisie qui a embrassé Bolsonaro, légitimé Marçal et rejoint Tarcísio dans un front sans principes pour empêcher la victoire du PSOL. Nous avons été vaincus en raison de ce que nous faisons le mieux : notre relation avec les mouvements sociaux, notre combativité dans les luttes pour la défense des droits, notre opposition aux privatisations, à l'incarcération massive des jeunes Noirs et pour d'autres « péchés originels » de la gauche ".
D'autres analyses affirment que le « repli programmatique » de Boulos a découragé la base militante, ce qui aurait affaibli la campagne et contribué à sa défaite. Il est vrai qu'une campagne visant à atténuer le rejet et à engager le dialogue avec un secteur qui n'est pas de gauche peut ne pas mobiliser pleinement l'avant-garde qui tient à affirmer son idéologie. À de nombreux moments, il y a eu un manque d'équilibre entre le dialogue de masse et la mobilisation de l'avant-garde. Des actions comme celle du début de la campagne sur la place Roosevelt contre Bolsonaro ou les actions de la dernière semaine auraient pu être plus nombreuses, mais cela n'aurait pas inversé le résultat, qui ne s'est pas joué sur une différence étroite. Par ailleurs, nous ne pouvons pas oublier l'énorme effort réalisé par les militant.e.s lors de ces élections : la mobilisation, les marches, les « autocollants », les « vols de nuit », la distribution de tracts, les réunions avec les communautés, etc. etc. etc. Il est vrai qu'il y a eu un moment de découragement chez les militant.e.s, mais ce n'est pas à cause de Boulos. C'est à cause du résultat du premier tour qui a ébranlé tout le monde. Ce qu'a réussi à faire la campagne de Boulos (surtout au moment le plus difficile), c'est exactement le contraire : ne pas baisser la tête, assumer ses responsabilités, relancer les découragé.e.s et mener une campagne militante, en polarisation permanente avec la droite, contre toute la machine étatique et municipale et la presse à grand tirage.
Même du point de vue du programme, bien que l'on puisse signaler des erreurs, il faut admettre qu'un combat idéologique très difficile a été mené. Quelques exemples le montrent clairement : la remise en question de la privatisation d'Eletropaulo (aujourd'hui Enel) et de SABESP ; le point sur les mouvements sociaux et la lutte pour le logement, rrepris à chaque fois que le candidat était interrogé ; l'importance de la dimension morale pour l'enseignant, à la fois comme professionnel et comme être humain ; la défense des fonctionnaires ; l'engagement à annuler la confiscation des 14% ; un traitement identique par la police municipale pour l'ouvrier d'Heliópolis et pour le médecin du quartier huppé des Jardins. La « Lettre au peuple de São Paulo » elle-même n'avait rien à voir avec la « Lettre au peuple brésilien » [de Lula] en 2002. Il s'agissait d'une recherche de dialogue non pas avec les entrepreneurs, le marché financier et la classe moyenne effrayée, mais avec les travailleurs précaires qui ne se considèrent pas comme des travailleurs et ne se sentent pas inclus dans la défense des droits en général, à la fois parce qu'ils n'ont plus rien et parce qu'ils sont sous l'emprise de l'individualisme ultra-néolibéral qui profite à l'extrême-droite.
La campagne à São Paulo a cherché à établir le dialogue avec une conscience plus à droite qu'en 2020. En ce sens, l'adaptation du discours n'a pas représenté une trahison de classe, car les questions concrètes les plus importantes sont restées à l'ordre du jour. N'oublions pas que nous sommes parvenus au second tour par une faible différence de voix et même avec l'aide d'une erreur de l'ennemi le jour du scrutin. La campagne n'a pas toujours été réussie, bien sûr. Il n'y a pas de campagne sans erreurs. Mais la rectification de ces erreurs, qui doivent être discutées ouvertement, se traduirait pas une différence qualitative dans le sens d'une amélioration.
La conclusion selon laquelle nous avons perdu parce que nous n'avons pas fait de travail dans les zones périphériques est également erronée. On ne peut pas dire que Boulos et le MTST ne sont pas dans la périphérie ou que le fait de débattre de questions concrètes dévalorise le programme. Boulos a cherché à dialoguer avec la périphérie, où il est l'une des seules forces politiques de la gauche radicale à être présente, et cela ne se fait pas en déclamant nos idées sans échanger avec les gens et ce qu'ils ont dans la tête. Des millions de travailleurs ont renoncé à être déclarés légalement et sont allés vendre quelque chose dans la rue ou sur internet. Que leur disons-nous ? Que leurs conditions de vie anciennes seront immédiatement rétablies ? C'est notre programme historique, mais dans cette situation spécifique, ce ne serait pas vrai. Il faut donc un certain nombre de médiations, et c'est ce que Boulos a cherché à trouver.
La question fondamentale ne concerne pas la tactique, le discours ou la figure de Boulos, mais le fait que la classe ouvrière est réellement gagnée à des idées qui sont étrangères à ses intérêts. Dans ces conditions, Boulos est le meilleur allié possible pour mener à bien le combat idéologique dans les zones périphériques. Boulos est une alternative au renoncement à travailler avec les mouvements sociaux de la part de la droite du PT. Et c'est une excellente nouvelle ! Mettre la campagne dans le même sac que les erreurs de la direction du PT, c'est lutter contre les faits.
Quelques leçons de 2024 et le rôle du PSOL
Le résultat des élections montre qu'il y a eu un changement négatif dans les rapports de forces depuis 2022. La diversification des candidats d'extrême droite aux élections ne reflète pas leur faiblesse et leur « division » au sens négatif du terme, mais une réorganisation considérable et une lutte pour le rôle dirigeant au sein d'un mouvement qui a pris de l'ampleur. Il y avait un grand espace pour eux, même divisés, et un espace minoritaire pour nous, même unifiés, comme à São Paulo.
Le lulisme est la seule force politique et sociale capable de disputer le pouvoir à l'extrême droite. Mais il est nécessaire de dire les choses telles qu'elles sont. Pour nous éviter une catastrophe en 2026, le PT et le gouvernement doivent changer d'attitude.
Il s'est également avéré que le lulisme est la seule force politique et sociale capable de disputer le pouvoir à l'extrême droite. Mais il faut dire les choses crûment. Pour éviter une catastrophe en 2026, le PT et le gouvernement doivent changer d'attitude : à ce stade, près de deux ans de mandat, il ne suffit pas de favoriser les améliorations économiques et sociales (même si elles sont centrales). Il est nécessaire de politiser l'espace électoral couvert par le lulisme, de transformer ce qui est actuellement une base purement électorale et profondément dépendante de la personnalité de Lula en une force politico-idéologique. Les gens votent pour Lula, mais ils ne soutiennent pas les idées de gauche. C'est aussi pour cela que nous perdons du terrain.
La conclusion selon laquelle la voie à suivre consiste à faire de plus en plus de concessions à la droite, à Faria Lima et au centre serait désastreuse pour 2026. Nous avons besoin de politiques sociales et économiques audacieuses, de préserver et d'étendre les droits, de remettre sur la table le débat sur les privatisations, sur l'autonomie de la Banque centrale, sur la crise climatique, sur la transition énergétique et sur la souveraineté nationale. Allumer une flamme d'espoir dans le cœur des gens. Le gouvernement doit être à l'avant-garde de ce mouvement.
En ce sens, la tâche de défendre le gouvernement contre l'offensive de l'extrême droite reste à l'ordre du jour, puisque Lula est le principal instrument pour battre électoralement Bolsonaro en 2026. Mais il nous faut aussi combattre pour que la gauche s'oriente dans le sens de la déclaration de Boulos : se battre pour que nos idées pénètrent dans la conscience des gens, et ne pas reculer encore plus.
Pour toutes ces raisons, le PSOL est fondamental en tant que parti porteur d'une idéologie et d'un programme résolument tourné vers la lutte contre les inégalités sociales. En s'appuyant sur l'autorité politique acquise par Boulos (mais aussi par d'autres figures du parti, nos parlementaires et nos militant.e.s), nous pouvons jouer un rôle très important dans le combat idéologique contre l'extrême droite. Cela ne dispense pas de maintenir la lutte pour le front uni de la gauche, qui devient encore plus nécessaire. Sans cela, toute lutte idéologique, aussi bien intentionnée et acharnée soit-elle, se heurtera à la violence des rapports de forces qui nous sont hostiles.
Le résultat obtenu est désolant parce qu'il montre que, malgré tous les efforts déployés, nous avons perdu des positions. Cela nous frustre, nous fatigue et nous décourage. Mais nous sommes du genre à garder la tête haute, à serrer les dents et à aller de l'avant. Nous n'avons pas commencé avec cette élection et nous allons continuer, plus conscients, plus forts, en corrigeant les trajectoires. Ce qu'il y a de beau dans la politique, c'est que, malgré les limites que nous imposent nos forces, il est possible de peser sur la réalité.
Glória Trogo et Henrique Canary
P.-S.
• Traduit pour ESSF par Pierre Vandevoorde avec l'aide de DeepL
Source : Esquerda online, site du courant « Reistencia » du PSOL
https://esquerdaonline.com.br/2024/10/31/a-esquerda-precisa-dizer-seu-nome-mas-nao-pode-ficar-falando-sozinha/
Notes
[1] Sans fournir de preuves, le gouverneur de São Paulo avait déclaré que l'organisation criminelle « Primeiro Comando da Capital » (PCC) avait appelé à voter pour le candidat du PSol en utilisant le nom de code « Salve » (ndt).
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
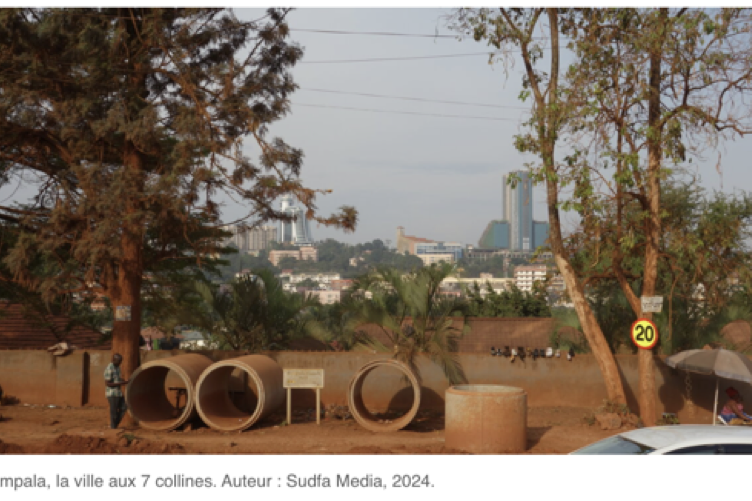
L’Ouganda, carrefour de la résistance soudanaise en exil
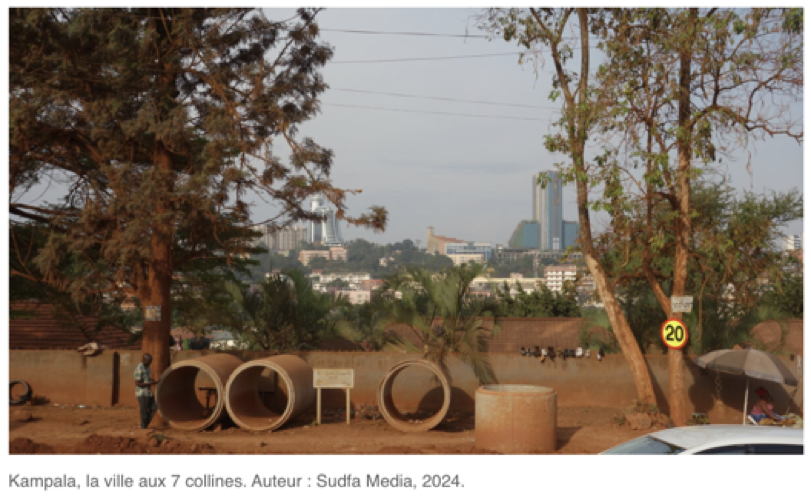
Cet été, l'équipe de Sudfa s'est rendue en Ouganda, pays frontalier du Soudan du Sud, qui est un des principaux foyers d'accueil des réfugié·es soudanais·es depuis le début de la guerre. Les politiques d'accueil ougandaises leur ont permis de faire renaître à l'étranger une véritable vie culturelle et politique soudanaise, et de poursuivre les objectifs de la révolution en exil.
Tiré du blogue de l'auteur.
L'Ouganda, foyer d'accueil des réfugiés soudanais
Depuis le début du conflit au Soudan, des millions de Soudanais·e·s ont été contraints de fuir leur pays, cherchant refuge dans les pays voisins. Parmi les destinations privilégiées, l'Ouganda s'est imposé comme l'un des principaux pays d'accueil, abritant des milliers de réfugié·e·s soudanais dès les premières heures du conflit.
Lors de notre visite à Kampala, nos échanges ont révélé que le choix de nombreux·ses Soudanais·e·s de se rendre en Ouganda n'était pas dû au hasard. En effet, l'Ouganda est perçu comme l'un des pays les plus sûrs de la région, un véritable havre de paix en comparaison avec les troubles qui affectent nombre de ses voisins. Ce pays d'Afrique de l'Est s'est bâti une solide réputation grâce à son approche généreuse et humanitaire envers les réfugiés. Contrairement à d'autres pays, l'Ouganda offre aux réfugié·e·s soudanais·e·s un accueil inconditionnel, notamment à travers la délivrance rapide de documents officiels, un fait confirmé par tou·te·s les réfugié·e·s soudanais·e·s rencontré·e·s lors de notre visite.
L'une des principales raisons pour lesquelles les Soudanais·e·s choisissent l'Ouganda réside dans la rapidité avec laquelle les autorités délivrent des cartes de résidence valables pour cinq ans. Cette mesure permet aux réfugié·e·s de se sentir rapidement intégré·e·s et de bénéficier d'une certaine stabilité dans un contexte où beaucoup ont tout perdu. Dès leur arrivée, ils et elles peuvent ainsi commencer à reconstruire leur vie.
De plus, l'Ouganda se distingue par sa politique d'accueil inclusive. Contrairement à d'autres pays, les réfugié·e·s soudanais·e·s peuvent entrer sur le territoire ougandais sans passeport valide, une situation fréquente pour de nombreux Soudanais. Les autorités ougandaises comprennent la gravité de la situation et adaptent leur approche pour faciliter l'accueil des personnes en détresse.
L'Ouganda a également été, depuis longtemps, un refuge important pour les militant·e·s soudanais·e·s. A l'époque du régime autoritaire d'Omar el-Béchir, de nombreux·ses opposant·e·s et activistes soudanais·e·s ont trouvé en Ouganda un lieu où ils et elles pouvaient s'organiser et militer sans craindre de représailles. Ainsi, Kampala (la capitale de l'Ouganda) est devenue un foyer de la résistance politique soudanaise, attirant des milliers de militant·e·s espérant, depuis cet exil, contribuer à un avenir meilleur pour leur pays.
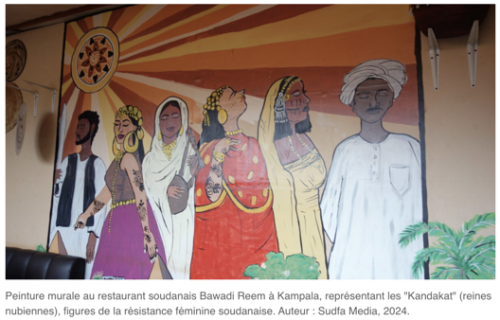
Organiser la résistance politique en exil
Depuis le début de la guerre civile en avril 2023, des milliers de militant·e·s, intellectuel·le·s et activistes soudanais·e·s se sont rassemblé·e·s à Kampala. Leur objectif est clair : « organiser la résistance, sensibiliser la communauté internationale à la crise qui ravage le Soudan, et œuvrer à une solution politique durable », comme l'a affirmé El-Mahboub, un militant arrivé à Kampala après le début de la guerre, lors d'un échange que nous avons eu sur place. En effet, Kampala abrite aujourd'hui des centaines de collectifs et associations qui militent sur des sujets variés, allant de l'aide humanitaire à la défense des droits.


L'exil à Kampala ne se limite pas à la résistance politique. La ville est également devenue un carrefour culturel où la culture soudanaise connaît une renaissance. De nombreux·ses militant·e·s ont ouvert des centres culturels, comme le groupe féministe soudanais « Les Gardiennes », qui a créé un espace de débat et de refuge pour les femmes réfugiées. Ce centre sert à la fois de lieu d'échange d'idées sur les droits des femmes et d'hébergement pour celles qui en ont besoin. Samria, une activiste féministe, a souligné que des dizaines de femmes y trouvent refuge, appelant cet espace le « Safe Space ».
Un autre exemple est l'association Hub Développement, qui vise à créer un espace de dialogue vivant entre Soudanais en exil. Ce lieu se veut une plateforme ouverte où toutes les opinions sont les bienvenues, avec l'espoir d'établir les bases d'un dialogue inclusif pour l'avenir du Soudan. Lors d'un événement auquel nous avons assisté à Kampala, Ahmed Al-Haj, coordinateur de l'association, nous a expliqué que : « Cette dynamique de réflexion reflète la volonté de la diaspora soudanaise de contribuer activement à la reconstruction politique et sociale du pays, même depuis l'étranger ».

Par ailleurs, l'association Adeela s'efforce de faire revivre la culture soudanaise en exil. À travers des événements culturels et artistiques, elle œuvre à préserver l'héritage soudanais tout en l'adaptant à la réalité des réfugiés. L'association organise des expositions d'art, des projections de films, et des débats sur l'identité culturelle soudanaise, créant un lien entre le passé et l'avenir. Lors de notre visite, nous avons assisté à une pièce de théâtre en l'honneur du centenaire de la révolte de 1924, dirigée par Ali Abdel Latif contre la colonisation britannique.
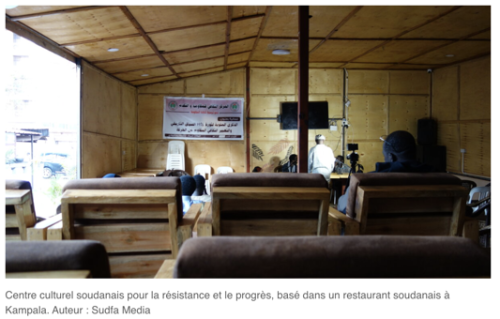
Un mini-Soudan au cœur de Kampala : recréer son monde en exil
Au centre de Kampala, un quartier particulier s'est formé, caractérisé par ses boutiques, restaurants, et ambiances qui recréent un fragment du Soudan en exil. Les habitant·e·s appellent cette zone « Down-Town ». Des centaines de réfugié·e·s et de membres de la diaspora soudanaise s'y rassemblent quotidiennement, non seulement pour faire leurs courses, mais aussi pour échanger sur la situation dans leur pays ravagé par la guerre.
Avec l'escalade récente des conflits au Soudan, ce quartier s'est transformé en un véritable « mini-Soudan ». Les vitrines des magasins portent des enseignes en arabe, rappelant leur pays d'origine. Les commerces offrent des produits typiquement soudanais, des épices aux tissus en passant par l'artisanat local.
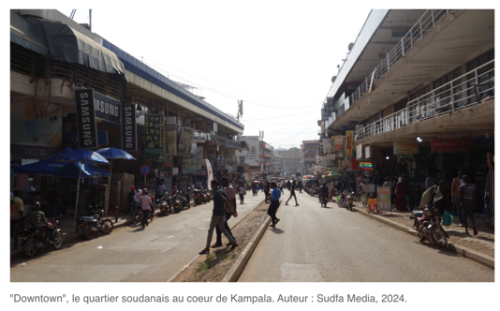
Les réfugié·e·s soudanais·e·s se retrouvent dans les cafés et restaurants pour échanger des nouvelles, partager des plats traditionnels, et renforcer leurs liens de solidarité. Ces rencontres sont un moyen de se détendre et d'échapper temporairement aux difficultés de l'exil. Ce quartier offre ainsi un soutien moral essentiel, permettant à chacun·e de se sentir un peu plus proche de son pays.
En plus d'être un espace culturel, ce mini-quartier soudanais offre des opportunités économiques pour les réfugiés. Beaucoup y trouvent du travail, que ce soit dans la vente, la restauration, ou la gestion de petites entreprises. La création d'emplois dans ce quartier est cruciale pour ces réfugié·e·s, dont beaucoup ont perdu tous leurs moyens de subsistance en quittant le Soudan. Ces commerces leur offrent une certaine stabilité économique, tout en participant à la vie de Kampala.

Là où beaucoup de médias occidentaux sont focalisés sur les migrations à destination de l'Europe, il faut rappeler, une fois de plus, que la majorité des migrations, notamment en provenance du Soudan, ne se font pas vers le Nord et vers l'Europe, mais bien dans le Sud, en Afrique, et notamment vers des pays comme le Ouganda. Pour reprendre le titre du fameux roman de l'écrivain soudanais Tayeb Saleh, « Saison d'une migration vers le Nord », la dernière guerre au Soudan a bien marqué le début d'une nouvelle « Saison d'une migration vers le Sud », vers les pays africains voisins. Bien qu'invisibles dans le champ médiatique, ces migrations sud-sud sont le point de départ, très intéressant, de nouvelles cultures hybrides, d'entraide, de renaissance culturelle et de résistance politique en diaspora.

Équipe de Sudfa Media
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Pourquoi le conflit du Sahara occidental perdure ?

Au Sahara occidental se déroule un des derniers conflits de décolonisation. En 1973, alors que ce territoire est encore occupé par l'Espagne (1884-1976), le Front Polisario, un mouvement politique et armé, est créé pour lutter contre l'Espagne, avant de s'opposer au Maroc et à la Mauritanie. Il dit agir au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et proclame la République arabe sahraouie démocratique (RASD) reconnue par l'Union africaine (UA).
Tiré d'Orient XXI.
Le Maroc revendique ce territoire de longue date. Au milieu des années 1970, et alors qu'il est confronté à la revendication indépendantiste du Front Polisario, le roi Hassan II est très affaibli par deux coups d'État perpétrés par l'armée en 1971 et 1972. Il décide de faire ce qu'il appelle la « récupération des provinces du sud », une cause nationale lui permettant l'union de tous les Marocains autour de son trône. Le pouvoir mobilise 350 000 personnes qui marchent pacifiquement sur le Sahara que les Espagnols viennent de quitter : c'est « la Marche verte » (6 novembre 1975). Grâce à elle, Hassan II fait taire son opposition, s'empare pacifiquement du territoire contesté. Il s'entend avec l'Espagne et la Mauritanie sur le partage de cette ancienne colonie, et signe les accords de Madrid (14 novembre 1975), qui seront ratifiés par le parlement espagnol, mais jamais reconnus par les Nations unies.
Une rivalité entre le Maroc et l'Algérie
En 1975, l'Algérie bouscule ces arrangements en décidant de soutenir le Front Polisario. Alger dit agir au nom du droit à l'autodétermination, mais sa rivalité avec Rabat est ancienne. Les deux pays sont divisés par la question de leur frontière tracée par la France du temps de la colonisation et qui a généreusement avantagé l'Algérie.
Dès lors, deux conflits s'enchevêtrent, un conflit de décolonisation et un autre qui oppose Alger à Rabat. Tandis que le Maroc revendique les « droits historiques » pour définir son territoire matérialisé par la carte du « Grand Maroc », dessinée en 1956, l'Algérie estime que son territoire a été obtenu par le sang des martyrs de la guerre d'indépendance. Dans leur affrontement, Alger et Rabat instrumentalisent la question du Sahara occidental.
Aujourd'hui, Rabat administre 80 % de ce territoire contesté et considéré comme non autonome par l'ONU. De son côté, Alger soutient, héberge, et finance le Front Polisario et les réfugiés sahraouis. Les deux grands États du Maghreb s'affrontent par Sahraouis interposés, contribuant à rendre inextricable la décolonisation de l'ancienne colonie espagnole.
L'Organisation des Nations unies (ONU), qui se voit confier le règlement du conflit en 1991, échoue à appliquer un règlement consistant à mettre en place un plan d'autonomie d'une durée de cinq ans, avant que les populations concernées puissent s'exprimer par voie référendaire. La difficulté consiste à définir le corps électoral, puisque Rabat a encouragé nombre de Marocains à s'installer dans le territoire.
Le Front Polisario s'est engagé récemment dans une bataille juridique contre l'exploitation et la commercialisation des ressources naturelles du Sahara par le Maroc. Tandis que Rabat a usé de son soft power pour amener le plus grand nombre d'États à reconnaître ce que le Maroc appelle la « marocanité » du Sahara. En décembre 2020, sa stratégie est couronnée de succès avec la signature d'un accord entre le Maroc et les États-Unis qui stipule que Rabat normalise ses relations avec Tel-Aviv en contrepartie de la reconnaissance par Washington de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Le pays bénéficie désormais d'un double parrainage, israélien et américain, qui lui permet de disposer de ressources stratégiques l'aidant à s'affirmer comme une puissance régionale importante. Dans la foulée, Rabat incite les capitales européennes à accepter ce que l'ONU ne lui a pas donné, c'est-à-dire sa souveraineté sur ce territoire. Il utilise tous les moyens, y compris une diplomatie du chantage, la rupture des relations diplomatiques et commerciales, le contrôle des flux migratoires, etc. Berlin et Madrid ont été les premiers à céder.
La France a longtemps hésité. L'ancienne puissance coloniale des pays du Maghreb a essayé une politique d'équilibre, inscrivant ce conflit de décolonisation dans le temps long et se référant aux options qu'offre le droit international, même si elle avait appuyé le plan d'autonomie du Sahara proposé par le Maroc en 2007.
Le changement de cap s'est opéré le 30 juillet 2024, lorsque, par une lettre adressée au roi Mohamed VI, le président Emmanuel Macron précise que « le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine ». Ce changement semble dicté par des intérêts économiques et stratégiques sur le court terme. C'est évidemment une victoire pour le soft power marocain, qui reflète aussi l'affaiblissement de l'Algérie, au plan interne et au niveau régional.
Alors qu'elle était un pays clé du mouvement des non-alignés dans les années 1970, dont la puissante diplomatie avait été capable de conduire de délicates négociations, notamment entre les États-Unis et l'Iran (1979-1981), l'Algérie se cherche aujourd'hui un rôle. En août 2023, elle échouait à rejoindre le groupe des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud). Elle peine à rajeunir une diplomatie et à freiner une perte d'influence que l'on a pu observer, notamment en Libye ou au Sahel.
Sur le Sahara occidental, l'Algérie partage avec le Maroc le fait de considérer ses interlocuteurs en fonction de leur positionnement sur ce dossier. Au fil des ans, alors que le Maroc abandonnait l'option référendaire, Alger s'est arc-boutée sur le principe d'autodétermination, rendant impossible toute négociation sur une sortie de crise. Le conflit s'en est trouvé gelé ce qui est préjudiciable aux Sahraouis d'abord, à l'ensemble des Maghrébins ensuite, dans la mesure où elle empêche l'intégration de la région. Désormais, l'Algérie perçoit la coopération entre le Maroc et Israël comme une menace, ce qui ajoute à la crispation et éloigne un peu plus le règlement de la question du Sahara occidental.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

95 morts dans des inondations à Valence : la région, le gouvernement et le patronat sont responsables !

Le Courant révolutionnaire des travailleurs (CRT), organisation révolutionnaire dans l'Etat espagnol, revient sur la catastrophe écologique qui a fait au moins 95 morts à Valence. La solidarité avec les victimes implique de dénoncer la responsabilité de ceux qui ont transformé une catastrophe naturelle en un crime social.
30 octobre 2024 | tiré du site de Révolution permanente
Nous traduisons une déclaration initialement parue en espagnol sur izquierdadiario.es.
Au cours des dernières 24 heures, la province de Valence et les régions frontalières, Albacete et Cuenca, ont connu les pluies les plus intenses du siècle. La « goutte froide » [1], a commencé mardi soir et a surpassé la précédente « goutte froide » de 2019. Les précipitations se dirigent maintenant vers la Catalogne et l'Aragon, mais aussi vers le sud-est de l'Andalousie.
A 15 heures ce mercredi, le bilan provisoire était de 70 morts et des dizaines de personnes sont toujours portées disparues [2]. Une tragédie qui va sans doute dépasser le bilan des dernières grandes inondations de 1982 et 1987, qui avaient fait respectivement 38 et 81 morts.
Mardi, des centaines de milliers de personnes ont été surprises par des torrents d'eau alors qu'ils se trouvaient à leur travail ou à leur domicile, ou bien sur la route. Des milliers de personnes ont passé la nuit sur les toits des maisons ou de leurs voitures sans aucune communication possible. Les inondations ont détruit plusieurs routes et autoroutes, tandis qu'une coupure de courant a affecté 150 000 personnes. Les réseaux téléphoniques ont été indisponibles dans une grande partie de la région et la totalité du trafic ferroviaire a dû être suspendu.
La CRT (Courant Révolutionnaire des Travailleurs et des Travailleuses, organisation sœur de Révolution Permanente dans l'État Espagnol, NdT), exprime sa solidarité avec les victimes et envoie tout son soutien aux travailleurs et travailleuses des équipes de secours qui risquent leur vie.
Une catastrophe naturelle et un crime social
Nous sommes confrontés à une catastrophe naturelle, dont l'ampleur ne peut être séparée de l'augmentation des phénomènes extrêmes produits par le réchauffement climatique, résultat de l'irrationalité capitaliste et de l'inaction absolue des États capitalistes pour y mettre un terme.
Mais en plus de ces responsabilités fondamentales, et contre ceux qui cherchent à présenter cette tragédie comme un évènement imprévu face auquel rien ne pouvait être fait, le gouvernement valencien, celui de Pedro Sánchez et le patronat ont aujourd'hui les mains tachées de sang.
Le gouvernement PP [3] à la tête de la région, dirigé par Carlos Mazón avec le soutien de Vox [4] au Parlement, a fait du démantèlement des services publics sa marque de fabrique. Ils sont donc de ceux qui ont détruit les services indispensables pour faire face à une telle situation. Peu après être arrivé au pouvoir, une de leurs premières mesures a été la dissolution de la « Unidad Valenciana de Emergencias » (Unité Valencienne des Urgences), une décision présentée comme un exemple de « restructuration du service public ».
Cette unité avait été créée lors des derniers mois du gouvernement régional du PSPV (Parti Socialiste) et Compromís (coalition de gauche et écologiste, NdT), mais n'avait en réalité jamais réellement fonctionné. Aussi, alors que les « progressistes » valenciens critiquent le PP et Vox, il est nécessaire de rappeler qu'eux non plus n'avaient pas pris de mesures efficaces pour renforcer les services d'urgence lors de leur mandat. Et cela, précisément, dans une région comme Valence sujette à des phénomènes comme les pluies torrentielles et les inondations périodiques.
Leurs profits avant nos vies
En outre, la gestion de l'inondation et l'absence de la mise en place de mesures immédiates pour protéger la population ont révélé un niveau d'incompétence qui n'est pas seulement le fait de l'inaptitude du gouvernement du PP.
Le gouvernement régional a envoyé mardi à 13 heures un message de calme et a assuré à 18 heures que le pire était passé. C'est dans ces coordonnées qu'ils ont été évacués de leurs confortables bureaux, alors que des milliers de personnes étaient déjà piégées entre des torrents d'eau dans l'attente d'un secours qui n'arrivait pas.
La raison de ces appels au calme est loin d'être innocente. Comme dans beaucoup d'autres crises, la priorité a été donnée au maintien de l'activité économique et sociale, malgré le risque que cela représentait pour des centaines de milliers de Valenciennes et de Valenciens. La bureaucratie des grands syndicats a gardé un silence complice et, à l'heure actuelle, n'a toujours pas dénoncé cette décision.
Le gouvernement central du PSOE et Sumar n'a non plus choisi de décréter des mesures d'urgence, bien qu'il contrôle directement les agences météorologiques de l'Etat qui surveillaient la situation.
Des centaines de milliers de travailleurs ont ainsi été envoyés au travail et des centaines de milliers d'enfants et de jeunes à l'école. Une répétition de la gestion de la pandémie, lorsque le gouvernement de PSOE et d'Unidas Podemos avait suspendu la fermeture des activités non essentielles au milieu de la première vague et sans même avoir fourni de masques à l'ensemble de la population.
Contre les lamentations hypocrites du gouvernement de Valence et du gouvernement national : cinq mesures d'urgence pour faire face à cette crise
Mardi, la priorité, une fois de plus, a été accordée aux profits des entreprises plutôt qu'à nos vies. Ce mercredi, tous les partis du régime se lamentent hypocritement sur la catastrophe. La droite au pouvoir à Valence veut cacher sa responsabilité directe dans la gestion de la crise. Le gouvernement Sánchez et Díaz cherchent à masquer qu'ils ont laissé faire Mazón et ses alliés.
Ensemble, ils promettent désormais « toutes les aides publiques » nécessaires à la reconstruction. Il est certain que les entreprises de la région les recevront bientôt. Pour les familles de travailleurs qui ont tout perdu, c'est moins sûr. Les victimes de la catastrophe du volcan de La Palma en 2021, attendent toujours l'indemnisation qui leur permettra de retrouver un logement.
La solidarité avec les victimes des inondations implique de dénoncer les responsables qui ont transformé cette catastrophe naturelle en un nouveau crime social. Nous exigeons des mesures urgentes et immédiates qui fassent passer nos vies avant leurs profits :
· Renforcement de tous les services d'urgence disponibles dans l'État espagnol pour garantir le sauvetage immédiat de toutes les victimes et la recherche des disparus.
· Suspension de toutes les activités non essentielles, sans réduction de salaire et à la charge des bénéfices des grandes entreprises. Les familles de travailleurs et les classes populaires doivent disposer du temps et des ressources nécessaires pour pouvoir reconstruire leur vie et se remettre de cette tragédie.
· Création d'un fonds spécial de reconstruction à la charge du budget général de l'État et alimenté par des taxes spéciales sur les grandes entreprises valenciennes et du reste de l'État.
· Des commissions d'enquête indépendantes, composées de représentants des victimes et des syndicats, afin de clarifier les responsabilités politiques et économiques dans ce qui s'est passé.
· Renforcement du corps d'urgence - santé, pompiers, équipes de secours - et nationalisation de tous les services externalisés et privatisés.
Notes
[1] une dépression de haute altitude qui provoque des pluies soudaines et extrêmement violentes, NdT
[2] A 22 h ce mercredi, le bilan est désormais de 95 morts
[3] Le Partido Popular, de centre droit
[4] Parti d'extrême droite
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

La société civile se mobilise déjà contre la future loi immigration de Bruno Retailleau

Aux premières loges face au basculement de la droite à l'extrême droite sur l'immigration, les associations s'inquiètent du sort à venir des migrants dans le pays. Avec les intellectuels engagés, elles se mobilisent contre la loi immigration et tentent d'organiser la riposte.
23 octobre 2024l| Politis - hebdo N° 1833 | Photo : Manifestation à Paris contre la loi immigration de Gérald Darmanin, en janvier 2024. © Myriam Tirler / Hans Lucas / AFP
https://www.politis.fr/articles/2024/10/asile-la-societe-civile-se-mobilise-deja-contre-la-future-loi-immigration-de-bruno-retailleau/
Michel Barnier et Bruno Retailleau main dans la main avec les ministres italiens des Affaires étrangères et de l'Intérieur, Antonio Tajani – « ami » du premier ministre français – et Matteo Piantedosi, proche de Matteo Salvani, chef de la Ligue, parti d'extrême droite. Les quatre politiciens se sont retrouvés pour lutter, selon eux, contre le « désordre migratoire », vendredi 18 octobre, à Menton, dans les Alpes-Maritimes.
Une rencontre qui n'a provoqué que de rares critiques, principalement à gauche, et une réelle inquiétude parmi les associations et les militants pour les droits des migrants. Leur constat est unanime : la répression contre les exilés s'accentue, hélas pour le pire. « Ce qui est grave, c'est que faire preuve d'humanité ne devrait pas être réservé à la gauche mais transcender les partis politiques », déclare à Politis l'agriculteur et militant Cédric Herrou.
ZOOM : Le naufrage de la France
Connu pour sa bataille acharnée contre les autorités pour faire reconnaître aux exilés leur droit à un accueil digne et faire respecter le droit d'asile à la frontière franco-italienne, Cédric Herrou était présent vendredi à un rassemblement à Menton, avec une vingtaine de militants de gauche, contre la mise en scène de l'alliance entre le gouvernement Barnier avec celui, post-fasciste, de son homologue Giorgia Meloni.
« La droite républicaine manque à l'appel. Nos politiciens n'ont plus aucune colonne vertébrale, s'insurge-t-il. Pendant qu'ils font des discours pour faire monter la peur contre les étrangers, nous, on crève de trouille face aux tempêtes qui ravagent la vallée. Les conséquences du réchauffement climatique, c'est ça notre principale préoccupation, pas l'immigration. » Il est vrai qu'à droite même des personnalités longtemps considérées comme plus modérées sur le sujet, telles que Gérard Larcher, Jean-François Copé ou encore Valérie Pécresse, semblent désormais s'aligner sur le RN.
La présidente de la région Île-de-France s'est notamment prononcée en faveur de l'instauration de quotas d'immigration et implore le gouvernement de supprimer les 50 % de réduction dans les transports pour les personnes sans-papiers. L'extrême droite voit en Bruno Retailleau le meilleur VRP de ses idées.
François Fillon a joué un rôle charnière dans le basculement de la droite à l'extrême droite.
F. Héran
Pour la députée du Rassemblement national Laure Lavalette,« quand on écoute Bruno Retailleau, on a l'impression que c'est un porte-parole du RN ». Pour un proche de Marine Le Pen, le nouveau locataire de Beauvau permet même de « changer de culture, de radicaliser tout le monde […]. Il est plus conservateur que nous ! », estime cette source auprès de Radio France.
D'ailleurs, lorsqu'on lui demande ce qui le différencie du RN, le Vendéen refuse de répondre, arguant que la question est un « vieux piège de la gauche ». Pour le professeur au Collège de France François Héran, le basculement de la droite a eu lieu lors du quinquennat de Nicolas Sarkozy (2007-2012) avec François Fillon, candidat malheureux de la droite à la présidentielle en 2017.
« C'est lui qui a joué un rôle charnière dans le basculement de la droite à l'extrême droite en s'en prenant aux juges européens qui annulaient des décisions françaises illégales sur les migrants pendant le quinquennat », précise ce spécialiste des migrations, citant les mémoires de l'ancien conseiller de Matignon Maxime Tandonnet (Au cœur du volcan, éd. Flammarion, 2014). « Comme premier ministre, il a défendu un projet de démocratie illibéral, ce même projet qui a été ensuite repris par Retailleau et Wauquiez », affirme-t-il.
« On est dans un moment d'accélération »
Emmanuel Macron n'a pas enrayé cette dérive. Au contraire, alors qu'il insistait sur la nécessité d'une intégration rapide des immigrés, avec des procédures simplifiées, le tout dans un cadre européen, lors de sa campagne en 2017, le président a trahi ses engagements une fois arrivé à l'Élysée. Il autorise la création de « hot spots » en Libye et se donne pour objectif « de n'avoir aucun migrant dans les rues d'ici fin 2017 ».
Un an plus tard, un premier projet de loi « asile et immigration » défendu par Gérard Collomb voit le jour, à la grande satisfaction de la droite. Sa majorité tire la langue et des soutiens de la première heure le lâchent. « La situation était terrible », se rappelle Pierre Henry, ancien directeur général de France Terre d'asile, qui a soutenu le candidat en 2017, avant d'en être « déçu ». « Cette première loi a été un point de bascule en rompant avec le principe d'égalité qui fonde notre république ».
Gérald Darmanin déjà se félicitait que la France soit condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme.
F. Carrey-Conte
La nouvelle loi immigration prévue par le gouvernement Barnier s'inscrit dans cette trajectoire. « On est dans un moment d'accélération mais tout cela ne vient pas de nulle part », soutient Fanélie Carrey-Conte, secrétaire générale de la Cimade. « Les remises en cause de l'État de droit ne datent pas de Bruno Retailleau, Gérald Darmanin déjà se félicitait que la France soit condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour soi-disant protéger les Français. » Mais Gérald Darmanin prenait soin de ne pas aller trop loin, en tout cas de son point de vue.
« Quand on adhère à l'UE, on adhère à la Convention européenne des droits de l'homme. Les Républicains ne sont plus dans cette logique et sont à deux doigts de défendre un Frexit », balance un proche de l'ancien ministre de l'Intérieur.
Reste que la préférence nationale, les quotas, le délit de séjour irrégulier, le renvoi des étudiants étrangers, ou encore la restriction du regroupement familial et du droit du sol – des mesures contenues dans la loi sur l'immigration adoptée fin 2023 par le Parlement et censurées par le Conseil constitutionnelavec le soutien de l'exécutif – devraient servir « de base pour le nouveau projet de loi sur l'immigration », selon le successeur de Darmanin. Ce dernier ne verrait pas d'un mauvais œil la future loi du nouveau gouvernement, selon nos informations.
Désormais, l'exécutif lorgne « le modèle albanais », qui tente de délocaliser la procédure de demande d'asile dans des entreprises italiennes installées en Albanie, pour des personnes qui ont débarqué de Méditerranée. Un système « inhumain et absurde » selon les associations interrogées, qui a déjà du plomb dans l'aile alors qu'un tribunal de Rome a invalidé la rétention des douze premiers migrants, avec un retour express sur le sol italien.
Face à ce premier revers juridique, Michel Barnier temporise. S'il a confirmé dansLe JDD, journal d'extrême droite, dimanche 20 octobre, qu'il y aurait bien un projet de loi immigration, ce dernier porterait d'abord sur « la transposition du pacte » sur la migration et l'asile voté au printemps au Parlement européen, l'actuel locataire de Matignon ne s'est pas plus avancé sur le reste : « Nous allons également avancer sur tous les abus et tous les détournements », s'est-il contenté de déclarer.
Déshumanisation
À ces initiatives politiques nauséabondes s'ajoute une dégradation brutale des conditions d'accueil et de vie des migrants au sein dans les centres de rétention administrative (CRA), en France. Tentatives de suicide, grèves de la faim, violences mais aussi absence d'hygiène : ces centres concentrenttoutes les carences actuelles de l'État en la matière. « Les conditions de travail pour les associations sont de plus en plus difficiles, l'enfermement est utilisé comme un outil d'expulsion, ce qui conduit à la maltraitance des personnes retenues », confirme Fanélie Carrey-Conte, de la Cimade, l'une des quatre associations mandatées par l'État pour accompagner les retenus dans les CRA.
En 2023, 36 % des 17 000 étrangers placés dans ces centres en métropole ont été expulsés, selon l'association. Un chiffre actuellement en baisse. En 2021, 42 % des personnes enfermées avaient été expulsées. Malgré les remontées alarmantes sur les conditions d'enfermement, Bruno Retailleau veut allonger la durée de rétention dans les CRA de 90 à 210 jours.
Le tour de vis s'observe aussi au niveau des administrations. « Auparavant, on arrivait à dialoguer avec un préfet, un secrétaire général de préfecture, un chef de service ou des fonctionnaires, maintenant tout ça, c'est terminé. On se retrouve face à un mur et des rendez-vous administratifs sur ordinateur », déplore l'ancienne présidente de la Cimade Geneviève Jacques, qui a pourtant connu le ministère Pasqua au milieu des années 1990, peu suspect de laxisme à l'égard des immigrés.
Les préfectures ne répondent plus, donc les tribunaux administratifs sont submergés de recours et les personnes sont en détresse.
P. Henry
« Les préfectures ne répondent plus, donc les tribunaux administratifs sont submergés de recours et les personnes sont en détresse », acquiesce Pierre Henry. « Il y a une déshumanisation croissante dans le regard porté sur les immigrés par certains médias et les politiciens », regrette Geneviève Jacques, qui continue de tenir des permanences au sein de la Cimade.
La vénérable association, qui œuvre depuis la Seconde Guerre mondiale pour conseiller juridiquement les étrangers en attente d'expulsion, se retrouve plus que jamais dans le viseur de la place Beauvau. Aux mauvaises conditions de travail matérielles et humaines s'ajoute en effet un « procès en sorcellerie » de la part du ministère de l'Intérieur : « Ces associations sont juges et parties », affirme Bruno Retailleau au Figaro Magazine le 2 octobre.
Le nouveau ministre n'en fait pas mystère, il aimerait les évincer des CRA pour confier leurs missions de conseil juridique à l'État, une vieille lune de la droite. « C'est une petite musique de discrédit et de remise en cause des associations qui nous affaiblit petit à petit », s'alarme Fanélie Carrey-Conte, alors que la Cimade est tout particulièrement visée par les derniers locataires de la place Beauvau.
L'association fait régulièrement l'objet de menaces, comme l'avait révélé Politis au moment du vote de la dernière loi immigration, sans aucune réaction de l'exécutif.
Le discours général sur l'immigration de l'extrême droite relayé par la droite via le gouvernement Barnier et une partie de la Macronie est d'autant plus insupportable qu'il ne correspond pas à la réalité. La France est en effet la lanterne rouge de l'Europe en matière d'asile. « Les demandes d'asile et l'immigration sont en hausse partout en Europe mais la part prise par la France est très faible. On est 15 % de la population européenne et 18 % du PIB européen et on a accueilli 5 % des réfugiés du Proche et Moyen-Orient », observe François Héran.
Bruno Retailleau prétend qu'il est pragmatique, c'est faux, c'est un dogmatique.
F. Héran
Le modèle italien, observé avec « bienveillance » par le gouvernement Barnier, semble moins répondre à une logique anti-immigration qu'à un affichage électoral : « C'est d'une hypocrisie incroyable, Meloni a diminué un peu les arrivées des petites embarcations de la Méditerranée tout en mettant en place un programme d'importation de travailleurs migrants. On évoque 500 000 personnes en trois ans, ce qui est considérable », précise François Héran.
« Bruno Retailleau affirme qu'il veut non seulement diminuer l'immigration illégale mais aussi l'immigration légale. Or le gouvernement Meloni part du principe qu'il ne pourra diminuer l'immigration illégale qu'en augmentant l'immigration légale. Bref, les mesures annoncées par Bruno Retailleau sont absurdes et inefficaces. Il prétend qu'il est pragmatique, c'est faux, c'est un dogmatique », cingle le professeur au Collège de France.
« Garder espoir »
Face à cette nouvelle donne, militants, associations et partis politiques de gauche tentent de trouver la parade. « Il faut qu'on reste très fermes sur nos principes et les valeurs que l'on défend, affirme Fanélie Carrey-Conte. L'un des leviers, ce sont les dynamiques d'alliance et de partenariat dans la société civile avec les syndicats, les associations, etc. ».
Pour Cédric Herrou, le gouvernement Barnier devrait arriver à faire passer son texte. « Ça va entraîner plus de malheurs, avec des conséquences négatives », soupire l'agriculteur. « Il y a de quoi avoir peur mais au quotidien, on rencontre aussi des initiatives individuelles ou collectives dans les villes et les villages pour accueillir dignement des réfugiés et des migrants, contre l'extrême droite. Il faut garder espoir », affirme Geneviève Jacques.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.












