Derniers articles

Il pleut des bombes !

Il pleut des bombes.
L'enfant succombe.
Quand la nuit tombe.
Il pleut des bombes.
Toujours en trombes.
Où es-tu Colombe ?
Il pleut des bombes.
Creusez les tombes !
Déluge intense.
Charniers d'hier, on recommence.
Il pleut des bombes.
Avec cratères.
C'est la Paix qu'on enterre.
Il pleut des bombes.
Signées « Puissance ».
Applaudie en haute Instance.
Il pleut des bombes
Dédicacées
Calquées d'un certain passé
Il pleut des bombes
A tout raser !
Générant des Déplacés (es).
Il pleut des bombes.
Encore intenses.
Dans tous les sens
Il pleut des bombes
Même sur la plage
Point d'orgue d'un grand carnage
Il pleut des bombes
Sur des consciences…
Armées de Résistance !
Texte : Omar HADDADOU Sep. 2024
(Hommage à Gaza)
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Guerre d’Israël contre le Liban : racisme et indécence dans le traitement médiatique occidental

En tant qu'instruments de construction d'une représentation de la réalité et de diffusion massive de cette représentation, les médias occidentaux participent plus que toute autre institution à imposer des principes de vision racistes du monde.
Tiré de la revue Contretemps
25 septembre 2024
Par Lina Mounzer
À partir de son expérience personnelle de femme libanaise qui assiste depuis le Canada à une guerre contre son pays, l'écrivaine Lina Mounzer relate la violence de ce racisme, ainsi que le gouffre entre le narratif spontanément pro-israélien qui domine les médias occidentaux et la réalité d'une guerre qui oppose les populations arabes de l'Orient à un État colonial : Israël.
Depuis sa création, celui-ci déploie une violence à tendance génocidaire visant à annihiler toute tentative de résistance à son projet d'effacement-remplacement de la Palestine.
***
Lorsque la nouvelle me parvient, je suis en train de prendre mon café du matin à Montréal.
Mon ami Rami me fait suivre un message WhatsApp. En arabe, il est écrit « Ouzai, Ghobeiri, Sfeir, Haret Hreik, Saida, les bipeurs explosent. Une brèche. Ils ont piraté des appareils et des téléphones et les ont fait exploser. Beaucoup d'informations contradictoires. Quelque 500 explosions jusqu'à présent ».
À Beyrouth, il est à peu près 15h40.
Inutile de demander qui sont ces « ils ». Ce sont les mêmes « ils » qui déciment et affament les Palestinien·nes de Gazadepuis presque une année entière, qui bombardent des hôpitaux et des camps de réfugiés, qui violent des prisonniers et qui, lorsqu'ils en sont réprimandés, font une émeute pour obtenir le droit de violer des prisonniers.
Ce sont les « ils » qui sont jugés par la Cour internationale de justice pour le summum des crimes, celui de génocide, et qui ont par ailleurs violé, devant les caméras, un certain nombre de soi-disant lignes rouges du droit humanitaire international. Après cela, je ne devrais pas être surprise par ce dont ces « ils » pourraient être capables, ni par la façon dont le monde les excusera.
Pourtant, je commence à recevoir des vidéos et je n'arrive pas à croire ce que je vois. Des images de vidéosurveillance de magasins d'alimentation avec des appareils qui explosent au niveau de la taille des gens ou dans leurs mains. Des rues bondées d'ambulances et d'individus qui hurlent. Des hommes sur des brancards, les restes déchiquetés de leurs mains dégoulinant de sang.
Quel est ce cauchemar dystopique ? Comment ont-ils piraté les appareils de ces gens ? Et quels sont les appareils à risque ? Aussitôt, j'essaie de me rappeler où j'ai acheté mon téléphone. L'ai-je acheté dans un magasin de téléphones portables à Beyrouth, le genre de magasin où les explosions se succèdent à mesure que la marchandise s'enflamme ? Ou l'ai-je commandé directement à l'étranger ? Est-il sûr ou bien risque-t-il d'être piégé ?
Peu importe : je dois décrocher mon téléphone, cette arme potentiellement meurtrière, pour joindre mes amis et ma famille, pour m'assurer qu'ils vont bien, ce qui les oblige à décrocher eux aussi leurs appareils potentiellement meurtriers pour répondre.
Les « bipeurs du Hezbollah »
Cet appareil utilisé pour nous connecter est à présent la chose même qui nous fait craindre de nous connecter. Le niveau de paranoïa est-il absurde ? Pas aussi absurde que les milliers de petites explosions qui se sont produites au Liban en une seule journée, puis les centaines d'autres le lendemain.
Avant que les détails ne deviennent plus clairs – à savoir que ces appareils, y compris les bipeurs, les talkies-walkies et les panneaux solaires qui ont explosé en deux jours, tuant 39 personnes et en blessant plus de 3 250, avaient été interceptés et chargés d'explosifs par Israël, et non piratés – la terreur de l'électronique domestique courante a atteint un tel niveau que les gens se sont précipités chez eux pour déconnecter les batteries UPS et éteindre les appareils de surveillance des bébés.
Le plus absurde, cependant, est le fait qu'aucun média occidental n'a nommé cet acte de terrorisme de masse par son nom. Au lieu de cela, les médias occidentaux ont qualifié ces plus de 4 000 explosions d'« attaques ciblées » et ces appareils – utilisés par des médecins, des livreurs et d'innombrables autres professionnels – des « bipeurs du Hezbollah ».
En l'espace de deux jours et dans tout le pays, plus de quatre mille explosions ont enflammé l'intimité vulnérable des corps de nombre de personnes, parmi lesquelles des jeunes enfants, qui se trouvaient à la maison avec des enfants, dans des épiceries ou des pharmacies, ou qui conduisaient sur les autoroutes, leur voiture devenant soudainement incontrôlable.
Les hôpitaux du pays ont été débordés, avec un afflux de blessés plus important que lors de l'explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020. Les chirurgiens traumatologues ont décrit des blessures « comme ils n'en avaient jamais vu auparavant, principalement des blessures aux yeux et aux mains, dues au fait que les patients regardaient leur téléavertisseur avant qu'il n'explose ».
Cette tactique d'un sadisme inégalé, conçue pour provoquer des blessures mortelles, a été qualifiée de « brillante » et décrite comme étant d'une « précision ciblée » [par la presse occidentale].
Des hordes brunes sans visage
Non seulement les médias occidentaux ont-ils refusé de parler de terrorisme, mais aussi ont-ils eu du mal à contenir leur enthousiasme face à ce spectacle.
Même les médias qui ont publié des articles mentionnant les souffrances des civils libanais ou l'effondrement du secteur de la santé l'ont fait à côté d'autres articles vantant l'« audace », la « sophistication » et la « démonstration spectaculaire des prouesses technologiques d'Israël ». Sur les réseaux sociaux, d'innombrables experts ont comparé cette attaque avec jubilation à un film hollywoodien. Ils ont raison. Mais ce n'est pas la « technique d'espionnage » qui la fait ressembler à un film hollywoodien. C'est plutôt le fait qu'il y ait des hordes brunes sans visage qui peuvent être fauchées, tuées en masse sous les acclamations triomphantes du public.
Les personnes assassinées ne sont pas des individus qui, comme chaque individu, sont une étoile unique dans une constellation de relations et dont le décès modifie la gravité même de la partie de l'univers qui les entoure.
Non, ce sont des « figurants », qui ne méritent même pas d'être mentionnés au générique, et dont la mort n'est pas simplement passée sous silence, mais carrément célébrée. Telle est la réalité politique que non seulement Hollywood, mais aussi les médias occidentaux, reflètent et entretiennent. Une réalité dans laquelle le terrorisme est un crime évalué non par l'acte mais par l'auteur.
Je m'efforce depuis longtemps d'expliquer aux gens qui ne connaissent pas la situation de près le sentiment vertigineux que l'on éprouve en regardant son pays dévasté de l'étranger : la façon dont le sentiment d'impuissance est aggravé par la dissonance cognitive avec votre corps à un endroit, cocooné dans la sécurité d'un monde, alors que votre conscience est obnubilée par la terreur d'un autre monde.
Des personnes bien intentionnées demandent : « N'êtes-vous pas reconnaissant de ne pas être là-bas en ce moment ? ». Une question à laquelle il m'est impossible de répondre. Après tout, j'étais là, à m'inquiéter de savoir si l'aéroport fermerait avant le départ de mon vol, à compatir avec des amis à propos de l'anxiété incessante qui se transforme parfois en terreur pure et simple avec laquelle nous vivons depuis octobre.
Un choix difficile
Je mentirais si je ne disais pas que je suis reconnaissante d'être en sécurité. Je mentirais également si je ne disais pas que j'aimerais être de retour à Beyrouth. Parce que pour la première fois dans cette guerre, j'ai été forcée de regarder les événements principalement à travers le filtre déformant des médias occidentaux. Il m'est dès lors plus facile d'exprimer ce qui est si difficile dans le fait d'être partie.
La dissonance cognitive d'être en Occident alors que l'Orient brûle n'est pas simplement le décalage entre l'endroit où se trouve le corps et l'endroit où se trouve l'esprit. Il s'agit d'être dans un endroit où toutes les institutions respectées insistent sur le fait que cet incendie est juste et bon, peu importe combien il s'avère barbare ou sauvage.
Il n'y a rien de plus dissonant que de voir le langage aseptisé des médias occidentaux s'interposer entre moi et l'expérience viscérale de savoir ce que les gens vivent là-bas. Au moins, lorsque je suis là-bas, l'humanité de personne n'est remise en question – y compris la mienne. Je ne suis étranger à aucun des sentiments que je peux éprouver, ni à la peur, ni à l'anxiété, ni même, en fait surtout, à la tristesse.
Tout cela est reflété et affirmé par le monde environnant. Personne n'est sans visage ni superflu ; personne n'est sans passé ni proches. Même les pierres endommagées ont une histoire. L'apaisement mental est tel que l'on est souvent tenté de l'échanger contre la sécurité physique.
À l'horizon, il ne se profile aucun répit à cette dissonance.
Depuis le jour où j'ai commencé à essayer de mettre des mots sur l'horreur de ces derniers événements, Israël a effectué une « frappe aérienne ciblée » dans la banlieue de Beyrouth, à Haret Hreik, faisant s'effondrer deux immeubles résidentiels, tuant 45 personnes, en blessant 66 autres et rendant la guerre régionale de plus en plus inévitable.
Lundi, nous sommes entrés dans une guerre totale, le sud et l'ouest du Liban étant particulièrement décimés. Les pertes sont énormes : déjà 274 morts et 1 000 blessés [558 morts et plus de 1800 blessés au 24 septembre]
L'État d'Israël reproduit à la lettre le scénario de Gaza : il bombarde les ambulances et les routes menant aux hôpitaux, il ordonne aux gens d'« évacuer » et il bombarde ensuite les routes qui pourraient leur permettre de le faire. Pendant ce temps, les armes continuent d'affluer.
Et les prétextes à cette guerre ont déjà été formulés – et acceptés – comme ils l'ont été pendant toute une année. De même que tous les habitant·es de Gaza sont considéré·es comme des membres du Hamas, tou·tes les habitant·es du Liban sont considéré·es comme des membres du Hezbollah et tout cela serait ainsi de bonne guerre.
Le cauchemar que nous anticipions tous depuis un an est devenu réalité. Un cauchemar que tout le monde voyait venir et qui aurait pu être arrêté à n'importe quel moment.
Je ne peux rien faire d'autre que regarder les nouvelles et j'ignore quand – ou si – je pourrai rentrer chez moi à Beyrouth. Pour celles et ceux d'entre nous qui ont la chance de l'avoir, le choix est difficile. Comme le dit un ami qui vit aux États-Unis depuis quelques années : « Soit je suis dans les flammes, soit je suis à l'endroit qui allume le feu ».
*
Lina Mounzer est une écrivaine et traductrice libanaise. Son travail a été publié dans The Paris Review, Freeman's, The Washington Post et The Baffler, ainsi que dans les anthologies Tales of Two Planets (Penguin : 2020) et Best American Essays 2022 (Harper Collins : 2022). Elle est rédactrice en chef du magazine artistique et littéraire The Markaz Review.
Cet billet est paru initialement sur le site Middle East Eye.
Illustration : Village de Zeita au Sud Liban, le 23 septembre 2024. Source : Mahmoud Zayyat, AFP.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
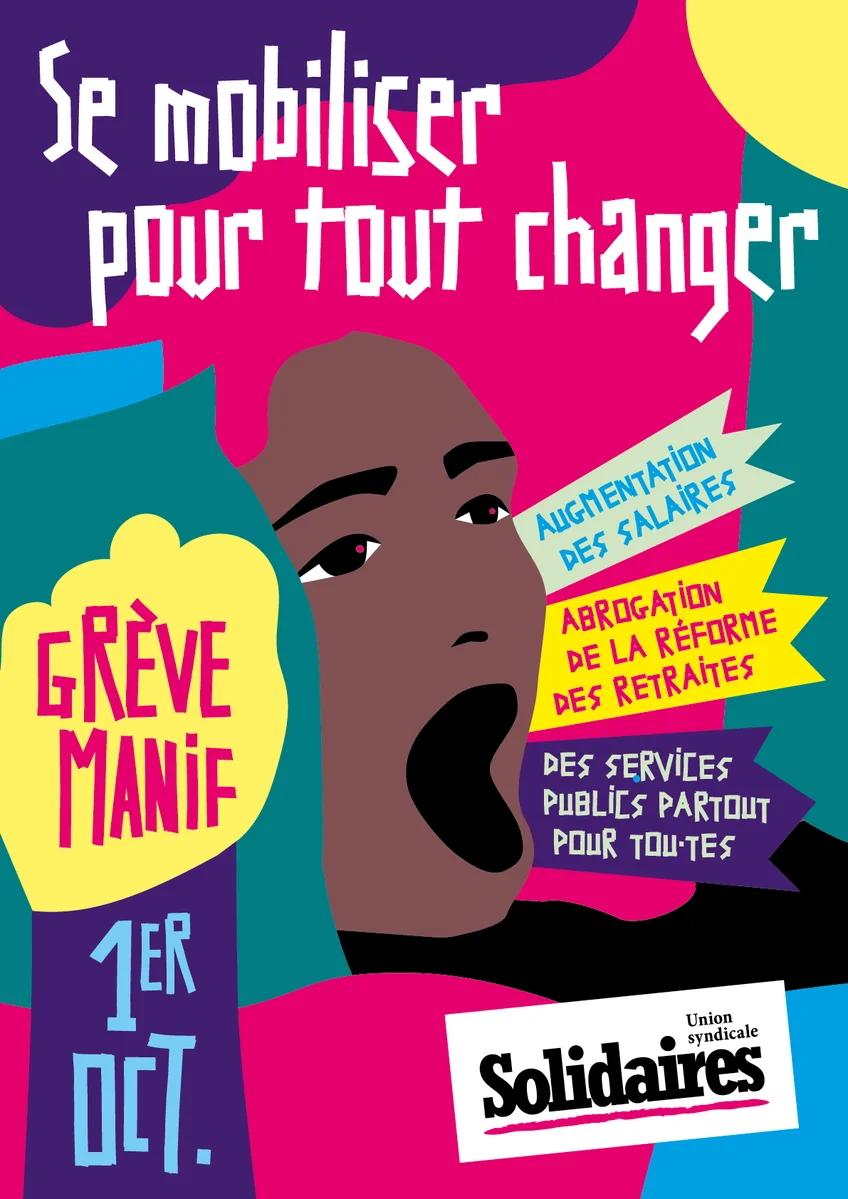
France : Communiqué intersyndical Pour les salaires, les services publics, l’abrogation de la loi retraites le 1er octobre en grève et en manifestation pour nos droits !
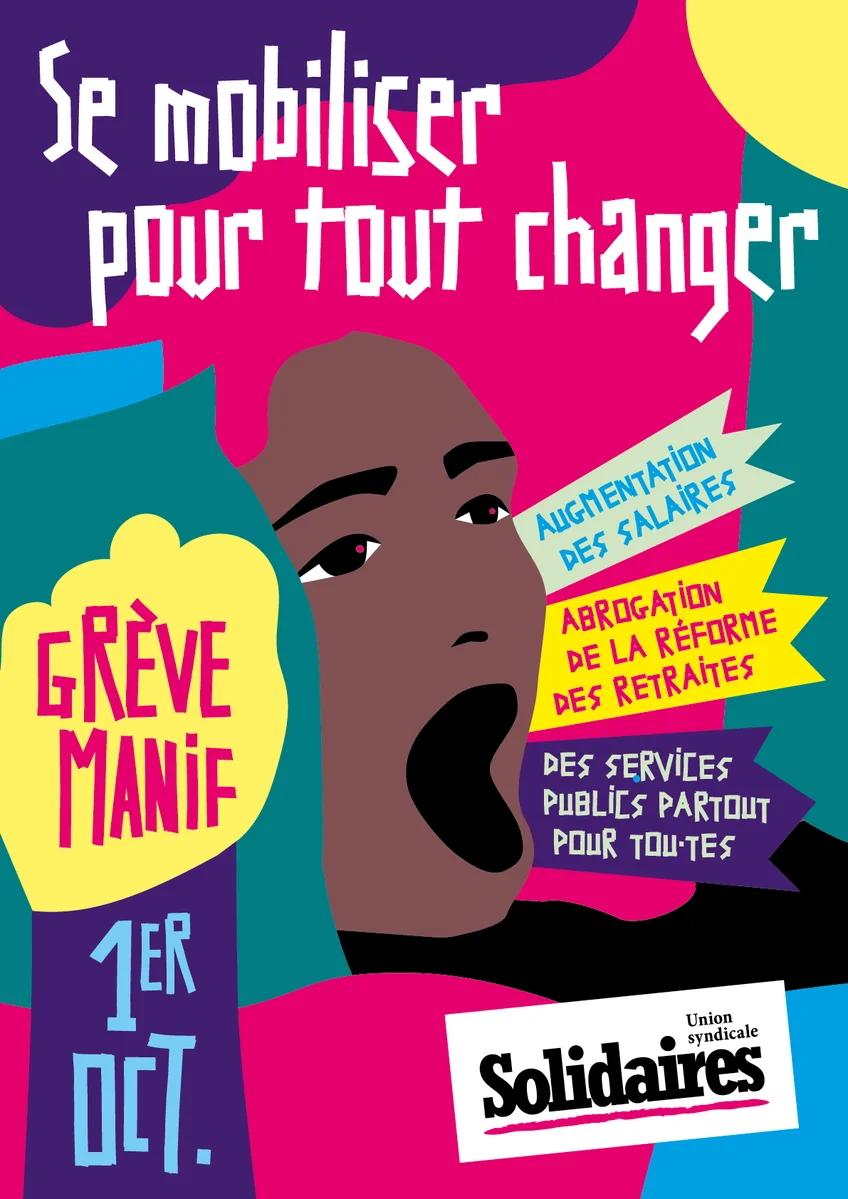
Nos organisations syndicales et de jeunesse appellent à manifester et à faire grève pour qu'enfin les urgences sociales, exprimées dans les mobilisations comme dans les urnes, soient entendues !
Tiré de Entre les lignes et les mots
Retraites, salaires, services publics, c'est sur ces sujets centraux pour la population que nous pouvons gagner et arracher des victoires au moment où le président de la République et l'alliance jusqu'à l'extrême droite cherchent à imposer contre la volonté générale le maintien du cap libéral et autoritaire.
Nous avons été des millions à nous mobiliser pendant plus de 6 mois contre la retraite à 64 ans. Emmanuel Macron a décidé de passer en force mais a été sanctionné par une lourde défaite aux élections législatives. Nous pouvons donc maintenant gagner l'abrogation de la réforme des retraites !
Nos salaires, pensions, bourses et minima sociaux ne peuvent plus régresser face à l'inflation ! C'est la raison pour laquelle nous rejoignons l'appel des organisations de retraité·es ce même 1er octobre pour exiger l'augmentation des pensions et des salaires, un Smic à 2000 euros et l'indexation des salaires sur l'inflation. Partout, dans les entreprises et les administrations, faisons grève pour obtenir l'augmentation de nos salaires et la fin des inégalités entre les femmes et les hommes !
Nos services publics sont à bout de souffle. Exigeons les moyens financiers et humains pour l'hôpital, les soins, l'éducation, l'enseignement supérieur, la recherche, l'environnement… pour permettre l'accès de tous et toutes à des services publics de qualité.
Les licenciements se multiplient dans l'industrie car les grands groupes continuent à délocaliser. Pourtant, les dividendes atteignent des records et, chaque année, 170 milliards d'euros d'aides publiques sont distribués sans contrepartie aux entreprises. Mobilisons-nous pour gagner l'arrêt immédiat de tous les licenciements, la relocalisation et la transformation environnementale de notre industrie !
Les jeunes sont parmi les premier·es à subir ces politiques de casse sociale. Il est urgent de mettre la jeunesse en protection sociale, de réformer le système des bourses et d'abolir la sélection à l'entrée de l'université.
Le 1er octobre marque le début des discussions sur le budget de l'État et de la Sécurité sociale à l'Assemblée nationale. C'est le moment de gagner qu'enfin les plus riches et les multinationales soient taxés pour financer nos services publics, la justice sociale et environnementale. C'est le moment de gagner l'abrogation de la réforme des retraites !
C'est maintenant qu'il faut peser et gagner. Ce ne sera possible que par un rapport de force clair et massif. Toutes et tous en grève le 1er octobre.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

États-Unis. Les tentatives de suicide des jeunes transgenres en hausse dans les États adoptant des lois anti-trans

Ce sont des conclusions “terrifiantes”, s'alarme them. Selon une étude, publiée cette semaine dans la revue Nature Human Behavior et relayée vendredi 27 septembre par le site d'information américain, les lois anti-transgenres entraînent “jusqu'à 72 % ” d'augmentation des tentatives de suicide chez les jeunes transgenres et non binaires.
Tiré de Courrier international
28 septembre 2024
Un manifestant agite un drapeau des fiertés LGBTQI lors d'un rassemblement de jeunes queers et transgenres près du Capitole, à Washington, le 31 mars 2023. PHOTO BRYAN OLIN DOZIER/NurPhoto/AFP
L'étude, menée par The Trevor Project, une organisation à but non lucratif de prévention du suicide de personnes LGBTQI, est la première à “établir fermement la causalité” entre la législation et les taux de tentatives de suicide chez les jeunes transgenres, explique them.
Les jeunes de 17 ans et moins particulièrement impactés
Les chercheurs ont recueilli les réponses de plus de 61 000 personnes trans et non binaires âgées de 13 à 24 ans dans le cadre d'une série d'enquêtes menées de 2018 à 2022. Ils ont constaté que dans les États qui ont adopté au cours de cette période au moins une loi restreignant ou menaçant les droits des personnes transgenres, les répondants ont signalé une augmentation “statistiquement significative” des taux de tentatives de suicide ou de suicides envisagés.
C'est parmi les jeunes trans et non binaires âgés de 13 à 17 ans que les taux de tentatives de suicide les plus élevés ont été observés, augmentant jusqu'à 72 % au cours de la deuxième année suivant l'adoption d'une loi anti-transgenre, selon l'étude, et de 52 % au cours de la troisième année.
“Ces chiffres ne signifient pas que les tentatives de suicide sont inévitables pour les jeunes trans et non binaires, mais soulignent plutôt l'importance de services de santé mentale efficaces – et les conséquences dangereuses des lois anti-trans”, commente them.
Courrier international
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Gisèle Pélicot, Taylor Swift, Lucie Castets. Un billet par VP.

Samedi 21 septembre, peut-être que ce métastasique gouvernement Macron/Barnier adviendra ce jour, peut-être pas. Mais il est bien possible que dans la durée, ce soit un autre sujet, apparemment autre, qui reste comme marque du moment présent, de cette rentrée 2024. Ce sujet autre, apparemment autre, c'est le « procès Pélicot ».
Tiré de Arguments pour la lutte sociale (aplutsoc)
21 septembre 2024
Un billet de VP
Gisèle Pélicot a été violée pendant des années par des dizaines d'hommes auxquels son mari Dominique Pélicot l'a livrée en la droguant. Inutile ici de détailler les faits, largement connus et médiatisés. Ils ont été établis suite à l'arrestation de Dominique Pélicot dans une autre affaire dite « de mœurs », son épouse, malade des traitements subis mais n'en ayant pas eu conscience, n'ayant pu porter plainte qu'une fois ceux-ci avérés sans aucun doute possible puisque ces viols ont abondamment été filmés par leur organisateur.
L'évènement important, c'est alors l'affirmation de Gisèle Pélicot voulant apparaître à visage découvert et refusant donc le huis clos, soutenue par ses enfants, appelant à ce que « la honte change de camp » et voulant combattre pour « toutes les femmes », et attirer l'attention sur le phénomène de la soumission chimique.
De leur côté, les 54 accusés, sur 83 soupçonnés, donnent l'image d'un monde masculin de prolétaires, de chômeurs et de travailleurs indépendants, parfois de militaires, le tout d'un conformisme et d'une banalité profondes.
La honte a effectivement changé de camp et la cause de Gisèle Pélicot, bien que pas tout de suite, a commencé à apparaître comme une cause féministe, le tout dans le silence assourdissant du monde officiel et politique.
Mais la dignité absolue de Gisèle Pélicot suscite l'irritation, l'énervement et les contre-attaques des tenants de l'ordre, pour qui elle devrait, au fond, se cacher et se taire, bien qu'ils n'osent le dire trop ouvertement, parce que cette dignité absolue est une menace envers leur ordre.
On a vu un avocat de la défense expliquer qu'il n'y a viol que si le violeur est conscient de violer, sinon il n'y a pas viol. On a vu cette défense tenter d'insinuer que la victime aurait aidé à susciter ce dont elle a été victime. On a vu une avocate se répandre sur les réseaux sociaux à dénoncer les « extrémistes de la pensée » qui voudraient soi-disant « museler » la défense des violeurs -lesquels, en tant qu'accusés, ont en effet droit à une défense équitable, là n'est pas la question. Sans oublier le maire de Mazan, proche du RN, s'exclamant que tout de même, ce qui s'est passé là n'est pas si grave : il n'y a pas eu « mort d'homme ou d'enfant ».
En fait, la violence dégradante de ces réactions a enfoncé le clou en couvrant de honte leurs auteurs et autrices … mais pas encore à leurs propres yeux …
En quoi la dignité absolue de Gisèle Pélicot est-elle une menace pour l'ordre établi ?
La raison est donnée par exemple par le chanteur Renaud : « Je ne sais pas si c'est juste de prendre la parole en tant qu'homme aujourd'hui et j'espère que le faire ne portera pas préjudice à cette cause, mais je souhaite apporter mon soutien total ainsi que mon admiration à Gisèle Pelicot dont la vie me bouleverse. (…) J'espère de tout mon cœur que le courage d'avoir demandé des audiences publiques fera enfin bouger cette société patriarcale, et nous les mecs, quant aux violences faites aux femmes et aux enfants. »
Ou par l'ami et camarade Michel Broué : « Ceux qui doivent réfléchir, travailler sur eux-mêmes, affronter leurs démons, ce sont les hommes. » ( La banalité du mâle ? , billet de blog du 16 septembre).
Michel Broué avait pris une initiative politique importante, le 30 avril dernier, en initiant dans le journal Elle un appel aux hommes, entendez par là les individus du genre masculin, à soutenir le mouvement #MeToo : « C'est le pouvoir et son instinct de domination qui s'acharnent, comme toujours, comme partout, sur les plus vulnérables. Nous refusons de nous reconnaître dans cette masculinité hégémonique. Devoir par exemple réserver la douceur et le soin au genre féminin est absurde : un homme ça pleure, un homme ça aime, un homme ça peut être bouleversé. »
Un homme « normal » est heurté par ce qui a été fait à Gisèle Pélicot, mais il peut aussi se sentir heurté par un supposé soupçon qui l'engloberait dans la masculinité des violeurs potentiels, étayé par le fait que les accusés sont tous des « hommes normaux ». Il est certes tout à fait légitime, c'est même sain et il serait inquiétant de ne pas ressentir cela, d'être affecté par l'éventualité d'un tel soupçon.
Mais pourquoi risquer de le ressentir aussi comme une menace, ressenti qui est exploité par les forces sociales accusant le féminisme, #MeToo, d' « exagérer » et de menacer toute liberté relationnelle dans les mœurs ?
Parce que ce qui est menacé ici est bien la masculinité et le patriarcat, qui sont des rapports sociaux fondamentaux et pas forcément des défauts individuels par essence propres aux mâles, même s'ils produisent massivement de tels défauts.
Ce rapport social, de domination masculine et dans lequel la domination est ontologiquement masculine (même lorsqu'exercée occasionnellement par des femmes, de Sémiramis à Thatcher en passant par Catherine II), donne forme aux relations affectives interindividuelles, ce pourquoi sa mise en cause est aussi une mise en cause individuelle, sans qu'il y ait lieu à culpabiliser ou à soupçonner systématiquement. D'autant que chaque individu, dans ce rapport social, en est certes, comme pour tout rapport social, un transmetteur, mais aussi une victime, les hommes compris.
Cette mise en cause arrive, semble-t-il, aujourd'hui à maturité. #MeToo en est une manifestation, loin d'être la seule. Le Chili, l'Argentine, la Pologne, ont connu des mouvements sociaux féminins de masse, bien entendu appuyés par des hommes, de toute première importance, pour la sauvegarde ou l'instauration des libertés individuelles à disposer de soi-même (droit à l'avortement). Ceci est au cœur de l'affrontement sur la question de la liberté et des droits fondamentaux qui déchire les États-Unis, pour ou contre Trump et ce qu'il représente. Les grèves et manifestations bélarusses en 2020 ont placé les femmes en situation stratégique et motrice, et la guerre en Ukraine renouvelle la lutte pour l'égalité dans la société en relation avec l'engagement militaire, de manière ouverte depuis février 2022, mais cela avait en réalité commencé dès 2014 et avait été invisibilisé, ce que souligne le syndicat de soldates Veteranka. En Iran, le mouvement « Femmes, Vie, Liberté », réprimé mais pas vaincu, place le combat des femmes contre le port du voile islamique et pour l'égalité comme pivot central de l'affrontement social contre l'État et flamme vivante de la révolution.
Ce sont là des faits massifs. Le retentissement profond du procès Pélicot s'inscrit pleinement dans cette séquence historique majeure. Mais ce rappel montre aussi que, dans la lutte des femmes comme dans la lutte des prolétaires, il y a deux camps qui s'affrontent et que le camp d'en face ne désarme pas, il contre-attaque, modernise ses méthodes (la « soumission chimique » …), frappe et tue, massivement.
Les viols de masse, cette forme extrême de terreur répressive, en Syrie, dans les zones occupées d'Ukraine, au Tigré … et les sévices exercés par toutes les polices politiques, prisons israéliennes comprises, nous le rappellent -et nous rappellent aussi que le rapport de domination physique sur les femmes et les enfants fait aussi énormément de victimes parmi les hommes adultes, que quand il y a « viols de guerre » une partie de la population masculine est elle aussi directement victime de cette forme extrême de masculinité hégémonique.
Il s'agit du plus ancien rapport de domination. Michel Broué, dans sa récente tribune, cite Françoise Héritier pour qui « Le comportement d'agression des hommes à l'égard des femmes n'est pas un effet de la nature animale et féroce de l'Homme, mais de ce qui fait sa différence, qu'on l'appelle conscience, intelligence ou culture ». J'exprimerai ici une nuance, une précision : la domination masculine n'est pas le propre d'Homo Sapiens. Elle prédomine chez une majorité (pas la totalité) de mammifères. Il s'agit donc bien d'un rapport social d'origine animale (car il y a société chez les animaux), qui reçoit dans notre espèce une forme, ou plusieurs, à travers le langage, la culture, etc., mais n'en est pas une conséquence.
Notre espècehttps://aplutsoc.org/2023/11/20/a-p... est à la fois peut-être la pire sur le plan de la violence masculine, et celle ayant la plus grande aptitude à la mise en cause et au remodelage de ses propres relations sociales, ce qui fait son histoire, et lui confère sa relative liberté. Cette variabilité augmente d'ailleurs entre les grands singes si on les compare les uns aux autres (tout près de nous, les chimpanzés robustes sont des masculinistes dominateurs qui nous ressemblent assez, alors que les bonobos ont des rapports sociaux régulés et relativement pacifiés par des groupes de femelles sexuellement complices). Cette variabilité éclate à l'intérieur même de notre espèce, dans son histoire faite de sauts qualitatifs appelés aujourd'hui des révolutions.
Bien entendu, reconnaître que le rapport de domination masculine remonte à plus loin que notre espèce et est antérieur au langage, n'en fait pas un ordre « naturel » ou « animal » essentiel ou indépassable.
Notre époque a besoin d'une révolution mettant fin à la fois au rapport de domination le plus récent et le plus anonyme et impersonnel, celui du capital qui ne veut rien d'autre que s'accumuler de manière accélérée, et au rapport le plus ancien, le rapport patriarcal ou rapport de domination masculine.
C'est le tourbillon dans lequel le capital entraîne l'espèce et toute la géobiosphère qui conduit à cette double nécessité. La dimension féminine de plus en plus affirmée des révolutions et insurrections dans le monde depuis une dizaine d'année est un signe puissant de cette maturation, et l'assumer pleinement apporte un renouveau radical de force à toutes les mobilisations. Les forces d'avant-garde de la contre-révolution l'assument à leur manière : le pouvoir chinois réprime en même temps la féministe Huang Xuebin et l'organiser d'ouvriers Wang Jianbing. Rien de fortuit.
Ce trait massif du moment actuel des révolutions et des guerres n'est souvent pas assez perçu ni compris dans les débats militants qui s'embarquent souvent sur des thématiques surdimensionnées, autour de constructions idéologiques telles que l'intersectionnalité, ou en France l'écriture inclusive, etc. Je ne crois pas utile de développer ces points ici, que j'ai déjà abordés ailleurs, mais qui me semblent de moindre importance que la saisie de la transformation principale qui a commencé, à savoir le fait que les crises sociales révolutionnaires vont de plus en plus porter aussi, directement, contre la domination patriarcale masculine, pour le plus grand bien des femmes, des enfants, des hommes, et de toutes les formes de relations affectives et sexuelles égalitaires et partagées.
Ce fait a une influence culturelle globale croissante, certes « récupérable » ou retournable par l'industrie des médias et la marchandisation des représentations, mais alimentée de manière continue par les besoins sociaux profonds.
Prenons un autre fait « sociétal » comme on dit, à l'interface du politique : le soutien de la chanteuse-compositrice-interprète Taylor Swift à Kamala Harris, contre Donald Trump, dont on sait le cri du cœur (Trump peut-il être sincère ? A mon avis, là, il l'est) : « Je déteste Taylor Swift ».
On pourrait être tenté de minimiser l'énorme signification politique d'un tel fait. Le camaradeJohn Reiman le juge très important mais trouve quand même que cela illustre la « mentalité lamentable de la plupart des Américains ». Les vedettes ont une grande importance dans l'appréhension du monde de la plupart des Américains, certainement. Est-ce lamentable ? Je n'en suis pas sûr : les peuples font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont.
Il faut lire, écouter et regarder Taylor Swift – et faire cet effort si musicalement, ce n'est pas votre tasse de thé, ce qui peut se comprendre ! On y reçoit l'image, et c'est la réalité, d'une jeune femme combattante individuelle dans un monde d'hommes et de chefs façonné par le fric, qui s'y fait sa place à la force du poignet – et du néocortex -, prend des coups et les rends, et émerge toujours, invaincue, scandant shake it off, dont la moins mauvaise traduction française serait peut-être « laisse les pisser », à l'adresse de tous les critiques, brutes, concurrents, moralistes, sales types … elle n'appelle évidemment pas à l'auto-organisation prolétarienne, mais il s'agit bien là d'un contenu, tout à fait cohérent avec l'opposition radicale à Trump.
Taylor Swift, avec quelques autres, affirme une image de « femme forte » qui, dans les séries, a eu à la fin du XX° siècle une expression frappante dans le personnage de Buffy contre les vampires , de Joss Wheedon, qu'il serait puéril de prendre pour une sous-série d'ados affrontant des vampires. Les « vampires » sont l'envers très ressemblant de l'humanité et Buffy, la jeune femme puissante, mais fragile en tant que jeune fille dans la société réellement existante, les affronte et « sors avec » plusieurs d'entre eux, et la bande de copains-copines « sauve le monde » à plusieurs reprises, tout seuls, sans aucune reconnaissance de qui que ce soit : métaphore remarquable de la situation dans laquelle est plongée la jeunesse découvrant ce monde en mode d'autodestruction, et choix culturel et médiatique clef que de mettre des filles à la tête de l'affaire, avec quelques gars qui les apprécient et les respectent.
Revenons, pour finir, au moment présent en France, moment, donc, du procès Pélicot et de la pénible gestation du pénible et pathétique exécutif Macron/Barnier. Jetons un coup d'œil sur ce spectacle de la même façon dont nous pouvons regarder Taylor Swift ou un épisode de Buffy contre les vampires. D'un côté : quelle bande de vampiriques vieux birbes respirant la vieillerie de la V° République ! Et de l'autre côté, cherchons les femmes fortes : elles sont là !
En fait, elles viennent d'arriver à visibilité : est-ce fortuit si la dernière période voit émerger successivement Sophie Binet, Marylise Léon, Marine Tondelier, Lucie Castets … et voit par ailleurs une victime âgée s'affirmer à son tour par la pure force de l'absolue dignité, Gisèle Pélicot ?
Cette observation n'implique aucun alignement a priori sur le rôle politique joué par les femmes citées ici, elle vise seulement à souligner un fait social remarquable. Bien qu'il n'y ait pas eu à ce jour, et on doit le regretter, connexion entre le combat politique pour imposer un gouvernement haussant les salaires, sauvant les services publics et abrogeant la loi retraites, et le procès Pélicot, force est de constater que l'affirmation féminine est présente dans les deux combats. Et qu'aucun des deux n'est gagné, et que la lutte va se poursuivre en s'aiguisant.
VP, le 21/09/2024.
Paru initialement sur le Club de Médiapart
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les revenus du travail en déclin : Un rapport de l’OIT alerte sur l’aggravation des inégalités et le risque pour les objectifs de développement durable

L'Organisation internationale du Travail alerte sur l'écart croissant entre les revenus du travail et ceux du capital, ainsi que sur les défis auxquels sont confrontés les jeunes sur le marché du travail.
Tiré de Entre les lignes et les mots
GENÈVE (OIT Infos) – La mise à jour dePerspectives sociales et de l'emploidans le monde : Septembre 2024 de l'Organisation internationale du Travail (OIT) révèle une pression accrue sur les inégalités alors que la part des revenus du travail diminue et qu'une grande proportion de jeunes reste sans emploi, ni éducation, ni formation. Ce rapport met en lumière les progrès insuffisants vers les Objectifs de développement durable (ODD) à l'approche de l'échéance de 2030.
Le rapport montre que la part mondiale des revenus du travail, c'est-à-dire la part du revenu total perçue par les travailleurs, a diminué de 0,6 point de pourcentage entre 2019 et 2022, et est restée stable depuis, aggravant ainsi une tendance à la baisse observée depuis des décennies. Si cette part était restée au même niveau qu'en 2004, les revenus du travail auraient été supérieurs de 2,4 trillions USD rien qu'en 2024.
L'étude souligne que la pandémie de COVID-19 a été un facteur déterminant de cette diminution, avec près de 40 pour cent de la baisse de la part des revenus du travail survenue durant les années de pandémie, de 2020 à 2022. Cette crise a exacerbé les inégalités existantes, en particulier en raison de la concentration des revenus du capital parmi les plus riches, compromettant ainsi les efforts pour atteindre l'ODD 10, qui vise à réduire les inégalités au sein des pays et entre eux.
Les avancées technologiques, notamment l'automatisation, ont également contribué à cette tendance. Bien que ces innovations aient stimulé la productivité et la croissance économique, les travailleurs n'ont pas bénéficié équitablement des gains qui en ont découlé. Le rapport avertit que, sans des politiques globales pour garantir que les avantages du progrès technologique soient partagés de manière équitable, les développements récents dans le domaine de l'intelligence artificielle risquent d'accentuer les inégalités, menaçant ainsi l'atteinte des ODD.
« Les pays doivent agir pour contrer la baisse de la part des revenus du travail. Nous avons besoin de politiques qui favorisent une répartition équitable des bénéfices économiques, incluant la liberté d'association, la négociation collective et une administration du travail efficace pour parvenir à une croissance inclusive et ouvrir la voie à un développement durable pour tous », a déclaré Celeste Drake, Directrice générale adjointe de l'OIT.
S'appuyant sur le rapport Tendances mondiales de l'emploi des jeunes (GET Youth) récemment publié par l'OIT, l'étude identifie également la part importante de jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation (NEET) comme un sujet de préoccupation persistant. Comme le montre le rapport GET Youth, le taux mondial de NEET n'a enregistré qu'une modeste diminution, passant de 21,3 pour cent en 2015 à 20,4 pour cent en 2024, et devrait rester stable au cours des deux prochaines années. Le taux de NEET chez les femmes – qui s'élèvera à 28,2% en 2024 – est plus de deux fois supérieur à celui des jeunes hommes.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

L’OIT salue l’accent mis par le Sommet de l’avenir des Nations Unies sur la justice sociale et le travail décent

Un multilatéralisme véritablement inclusif doit embrasser la diversité et placer la solidarité au cœur de la coopération internationale, a souligné le Directeur général de l'OIT.
Tiré de Entre les lignes et les mots
NEW YORK (OIT Infos) – Le Directeur général de l'Organisation internationale du Travail (OIT) s'est félicité des résultats du Sommet de l'avenir des Nations Unies, qui a mis l'accent sur le rôle central de la justice sociale et du travail décent pour relever les défis mondiaux et façonner un avenir durable.
Le Sommet, qui s'est tenu sur le thème des solutions multilatérales pour un avenir meilleur, s'est achevé par l'adoption d'un Pacte pour l'avenir. Le Pacte comprend 56 actions concrètes pour répondre aux problèmes mondiaux urgents et revitaliser le multilatéralisme.
Le directeur général de l'OIT, Gilbert F. Houngbo, a salué l'accent mis par le sommet sur la justice sociale. « La justice sociale par le biais du travail décent doit être la pierre angulaire d'un système multilatéral modernisé », a-t-il déclaré. « Les résultats du sommet constituent une base solide pour une structure de gouvernance mondiale équitable et inclusive qui aligne les objectifs économiques, sociaux et environnementaux ».
Le pacte pour l'avenir vise à revigorer le multilatéralisme et à transformer la gouvernance mondiale afin qu'elle soit en mesure de relever les défis actuels et futurs. Il s'engage à accélérer les progrès sur l'Agenda 2030 pour le développement durable, à renforcer l'action climatique, à réformer le Conseil de sécurité des Nations unies, à faire progresser les efforts de désarmement, à promouvoir l'utilisation responsable des nouvelles technologies, à autonomiser les jeunes et à réformer l'architecture financière internationale.
Lors du sommet, qui s'est tenu au siège de l'ONU les 22 et 23 septembre, les dirigeants ont également adopté une Déclaration historique sur les générations futures, s'engageant à donner la priorité au bien-être des générations futures en faisant progresser le développement durable, la paix et l'équité. Le sommet a également approuvé un Pacte mondial pour le numérique, qui présente une vision audacieuse pour un « avenir numérique inclusif, ouvert, durable, équitable, sûr et sécurisé qui profite à tous ».
« Le Pacte mondial pour le numérique offre une occasion unique d'exploiter la science et la technologie en tant que moteurs de la justice sociale et du travail décent », a déclaré M. Houngbo. « Les organisations de travailleurs et d'employeurs joueront un rôle crucial dans l'élaboration d'une gouvernance mondiale saine pour les technologies numériques ».
La récente déclaration de l'OIT sur le Sommet du Futura mis l'accent sur la nécessité de renforcer la collaboration entre les institutions multilatérales, afin de répondre aux tendances mondiales qui affectent le monde du travail. Elle a également souligné l'importance de la mobilisation des ressources pour relever les principaux défis, en particulier la réalisation des Objectifs de développement durable.
La Coalition mondiale pour la justice socialede l'OIT illustre cet engagement renouvelé en faveur de la coopération multilatérale. Avec près de 30 partenaires, issus de gouvernements, d'organisations internationales, de banques de développement, d'universités, d'organisations de travailleurs et d'employeurs, cette coalition innovante rassemble un large éventail de parties prenantes pour aborder les questions mondiales du travail et faire progresser les objectifs de développement durable.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Le mythe du dépassement : on ne peut pas continuer à brûler des combustibles fossiles et s’attendre à ce que les scientifiques du futur nous ramènent à 1,5 °C

Tiré de The Conversation
https://theconversation.com/the-overshoot-myth-you-cant-keep-burning-fossil-fuels-and-expect-scientists-of-the-future-to-get-us-back-to-1-5-c-230814
Publié : 20 août 2024 à 7 h 44 HAE
Auteurs
James Dyke
Professeur agrégé en sciences du système terrestre, Université d'Exeter
Robert Watson
Professeur émérite en sciences de l'environnement, Université d'East Anglia
Wolfgang Knorr
Chercheur principal, Géographie physique et sciences des écosystèmes, Université de Lund
Déclaration d'information
James Dyke est affilié à Faculty for a Future.
Robert Watson et Wolfgang Knorr ne travaillent pas, ne consultent pas, ne possèdent pas d'actions ou ne reçoivent pas de financement d'une entreprise ou d'une organisation qui pourrait bénéficier de cet article, et n'ont divulgué aucune affiliation pertinente au-delà de leur nomination universitaire.
Une production recordde combustibles fossiles, des émissions de gaz à effet de serre record et destempératures extrêmes. Comme la proverbiale grenouille dans la casserole d'eau chauffée, nous refusons de répondre à la crise climatique et écologique avec un sentiment d'urgence. Dans de telles circonstances, les affirmations de certains selon lesquelles le réchauffement climatique peut encore être limité à 1,5 °C prennent une tournure surréaliste.
Par exemple, au début des négociations internationales sur le climat de 2023 à Dubaï, le président de la conférence, Sultan Al Jaber, a déclaré avec audace que son objectif était de 1,5 °C et que sa présidence serait guidée par un « profond sentiment d'urgence » pour limiter les températures mondiales à 1,5 °C. Il a fait de telles promesses alors qu'il prévoyait une augmentation massivede la production de pétrole et de gazen tant que PDG de la compagnie pétrolière nationale d'Abu Dhabi.
Nous ne devrions pas être surpris de voir un tel comportement de la part du chef d'une entreprise de combustibles fossiles. Mais Al Jaber n'est pas une exception. Grattez la surface de presque tous les engagements ou politiques de zéro émission nette qui prétendent être alignés sur l'objectif de 1,5 °C de l'accord historique de Paris de 2015 et vous découvrirez le même type de raisonnement : nous pouvons éviter un changement climatique dangereux sans faire ce que cela exige – c'est-à-dire réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre de l'industrie. les transports, l'énergie (70 % du total) et les systèmes alimentaires (30 % du total), tout en renforçant l'efficacité énergétique.
Un exemple particulièrement instructif est Amazon. En 2019, l'entreprise s'est fixé un objectif de zéro émission nette pour 2040, qui a ensuite été vérifié par l'initiative Science Based Targets (SBTi)des Nations Unies, qui a mené la charge pour amener les entreprises à établir des objectifs climatiques compatibles avec l'accord de Paris. Mais au cours des quatre années suivantes,les émissions d'Amazon ont augmenté de 40 %. Compte tenu de cette performance lamentable, la SBTi a été contrainte d'agir et a retiré Amazon et plus de 200 entreprises de sa norme Corporate Net Zero.
Ce n'est pas non plus surprenant étant donné que la neutralité carbone et même l'accord de Paris ont été construits autour de la nécessité perçue de continuer à brûler des combustibles fossiles, du moins à court terme. Ne pas le faire menacerait la croissance économique, étant donné que les combustibles fossiles fournissent encore plus de 80 % de l'énergie mondiale totale. Lesmilliers de milliards de dollars d'actifs liés aux combustibles fossiles menacés par la décarbonisation rapide ont également servi de puissants freins à l'action climatique.
Déborder
La façon de comprendre cette double pensée : que nous pouvons éviter un changement climatique dangereux tout en continuant à brûler des combustibles fossiles – est qu'elle repose sur le concept de dépassement. La promesse est que nous pouvons dépasser n'importe quel réchauffement, le déploiement de l'élimination du dioxyde de carbone à l'échelle planétaire faisant baisser les températures d'ici la fin du siècle.
Non seulement cela paralyse toute tentative de limiter le réchauffement à 1,5 °C, mais cela risque d'entraîner des niveaux catastrophiques de changement climatique, car cela nous enferme dans des solutions à forte intensité énergétique et matérielle qui, pour la plupart, n'existent que sur le papier.
Affirmer que nous pouvons dépasser en toute sécurité 1,5 °C, ou n'importe quelle quantité de réchauffement, c'est dire la chose la plus silencieuse à voix haute : nous ne nous soucions tout simplement pas de la quantité croissante de souffrances et de décès qui seront causées pendant que la reconstruction est en cours.
L'élimination du dioxyde de carbone est un élément clé du dépassement. Il s'agit essentiellement d'une machine à remonter le temps – on nous dit que nous pouvons revenir en arrière de décennies de retard en aspirant le dioxyde de carbone directement de l'atmosphère. Nous n'avons pas besoin d'une décarbonisation rapide maintenant, car à l'avenir, nous serons en mesure de récupérer ces émissions de carbone. Si ou quand cela ne fonctionne pas, nous sommes amenés à croire que des approches de géo-ingénierie encore plus farfelues, telles que la pulvérisation decomposés sulfureux dans la haute atmosphère pour tenter de bloquer la lumière du soleil – ce qui équivaut à la réfrigération planétaire – nous sauveront.
L'accord de Paris de 2015 a été une réalisation étonnante. L'établissement d'un plafond de réchauffement de 1,5 °C convenu au niveau international a été un succès pour les personnes et les nations les plus exposées aux aléas climatiques. Nous savons que chaque fraction de degré compte. Mais à l'époque, croire que le réchauffement pouvait vraiment être limité à bien en dessous de 2 °C nécessitait un acte de foi lorsqu'il s'agissait de nations et d'entreprises mettant l'épaule à la roue de la décarbonisation. Ce qui s'est passé au lieu de cela, c'est que l'approche zéro émission nette de Paris se détache de la réalité car elle s'appuie de plus en plus sur des niveaux de science-fiction de technologie spéculative.
Il y a sans doute un problème encore plus important avec l'accord de Paris. En définissant le changement climatique en termes de température, il se concentre sur les symptômes, et non sur la cause. 1,5 °C ou n'importe quelle quantité de réchauffement est le résultat de la modification du bilan énergétique du climat par l'homme en augmentant la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Cela emprisonne plus de chaleur. Les changements de la température moyenne mondiale sont la façon établie de mesurer cette augmentation de la chaleur, mais personne ne connaît cette moyenne.
Le changement climatique est dangereux en raison des conditions météorologiques qui affectent des endroits particuliers à des moments particuliers. En termes simples, cette chaleur supplémentaire rend le temps plus instable. Malheureusement, le fait d'avoir des objectifs de température fait que la géo-ingénierie solaire semble être une approche raisonnable, car elle peut faire baisser les températures. Mais il le fait en ne réduisant pas, mais en augmentant notre interférence dans le système climatique. Essayer de bloquer le soleil en réponse à l'augmentation des émissions de carbone, c'est comme allumer la climatisation en réponse à un incendie de maison.
En 2021, nousavons fait valoir que la neutralité carbone était un piège dangereux. Trois ans plus tard, nous pouvons voir les mâchoires de ce piège commencer à se refermer, la politique climatique étant de plus en plus conçue en termes de dépassement. Les impacts qui en résultent sur la sécurité alimentaire et hydrique, la pauvreté, la santé humaine, la destruction de la biodiversité et des écosystèmes produiront des souffrances intolérables.
La situation exige de l'honnêteté et un changement de cap. Si cela ne se concrétise pas, les choses risquent de se détériorer, potentiellement rapidement et d'une manière qui peut êtreimpossible à contrôler.
Au revoir Paris
Le moment est venu d'accepter que la politique climatique a échoué et que l'accord historique de Paris de 2015 est mort. Nous l'avons laissé mourir en prétendant que nous pourrions à la fois continuer à brûler des combustibles fossiles et éviter un changement climatique dangereux. Plutôt que d'exiger l'élimination immédiate des combustibles fossiles, l'accord de Paris a proposé des objectifs de température du 22e siècle qui pourraient être atteints en équilibrant les sources et les puits de carbone. C'est dans cette ambiguïté que le net zéro a prospéré. Et pourtant, en dehors du choc économique de la COVID en 2020, les émissions ont augmenté chaque année depuis 2015, atteignant un niveau record en 2023.
Bien qu'il existe de nombreuses preuves que l'action climatique a du senssur le plan économique (le coût de l'inaction dépasse largement le coût de l'action), aucun pays n'a réaffirmé ses engagements lors des trois dernières COP (les réunions internationales annuelles de l'ONU), même s'il était clair que le monde était sur le point de dépasser les 2 °C, et encore moins 1,5 °C. L'accord de Paris devrait permettre de réduire de 50 % les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, mais les politiques actuelles signifient qu'elles sont en passe d'être plus élevées qu'elles ne le sont aujourd'hui.
Les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter. Catazul/Pixabay, CC BY
Nous ne nions pas que des progrès significatifs ont été réalisés avec les technologies renouvelables. Les taux de déploiement de l'éolien et du solaire ont augmenté chaque année au cours des 22 dernières années et les émissions de carbone diminuent dans certains des pays les plus riches, dont le Royaume-Uni et les États-Unis. Mais cela ne se produit pas assez vite. Un élément central de l'accord de Paris est que les pays les plus riches doivent mener les efforts de décarbonisation afin de donner aux pays à faible revenu plus de temps pour s'éloigner des combustibles fossiles. Malgré certaines affirmations contraires, la transition énergétique mondiale n'est pas en plein essor. En fait, elle n'a pas vraiment commencé parce que la transition exige une réduction de l'utilisation des combustibles fossiles. Au lieu de cela, il continue d'augmenter d'année en année.
C'est pourquoi les décideurs politiques se tournent vers le dépassement pour tenter de prétendre qu'ils ont un plan pour éviter un changement climatique dangereux. Un élément central de cette approche est que le système climatique continuera à l'avenir à fonctionner comme il le fait aujourd'hui. C'est une supposition imprudente.
Les signes avant-coureurs de 2023
Au début de l'année 2023, Berkeley Earth, la NASA, le Met Office du Royaume-Uni et Carbon Brief ont prédit que 2023 serait légèrement plus chaude que l'année précédente, mais qu'il était peu probable qu'elle établisse des records. Douze mois plus tard, les quatre organisations ont conclu que 2023 était de loin l'année la plus chaude jamais enregistrée. En effet, entre février 2023 et février 2024, le réchauffement de la température moyenne mondiale a dépassé l'objectif de Paris de 1,5 °C.
Les événements météorologiques extrêmes de 2023 nous donnent un aperçu des souffrances que produira un réchauffement climatique supplémentaire. Un rapport de 2024 du Forum économique mondial a conclu que d'ici 2050, le changement climatique pourrait avoir causé plus de 14 millions de morts et 12,5 billions de dollars américains de pertes et de dommages.
À l'heure actuelle, nous ne pouvons pas expliquer entièrement pourquoi les températures mondiales ont été si élevées au cours des 18 derniers mois. Les changements dans la poussière, la suie et d'autres aérosols sont importants, et il y a des processus naturels tels qu'El Niño qui auront un effet.
Mais il semble qu'il y ait encore quelque chose qui manque dans notre compréhension actuelle de la façon dont le climat réagit aux impacts humains. Cela inclut les changements dans le cycle naturel vital du carbone de la Terre.
Environ la moitié de tout le dioxyde de carbone que les humains ont émis dans l'atmosphère au cours de l'histoire de l'humanité est allée dans des « puits de carbone » sur terre et dans les océans. Nous obtenons cette élimination du carbone « gratuitement », et sans elle, le réchauffement serait beaucoup plus élevé. Le dioxyde de carbone de l'air se dissout dans les océans (ce qui les rend plus acides, ce qui menace les écosystèmes marins). Dans le même temps, l'augmentation du dioxyde de carbone favorise la croissance des plantes et des arbres, ce qui emprisonne le carbone dans leurs feuilles, leurs racines et leurs troncs.
Toutes les politiques et tous les scénarios climatiques supposent que ces puits de carbone naturels continueront à retirer des dizaines de milliards de tonnes de carbone de l'atmosphère chaque année.Il est prouvé que les puits de carbone terrestres, tels que les forêts, ont éliminé beaucoup moins de carbone en 2023. Si les puits naturels commencent à tomber en panne – ce qui pourrait bien se produire dans un monde plus chaud– la tâche d'abaisser les températures mondiales devient encore plus difficile. La seule façon crédible de limiter le réchauffement à une quelconque quantité est d'arrêter d'émettre des gaz à effet de serre dans l'atmosphère en premier lieu.
Solutions de science-fiction
Il est clair que les engagements pris à ce jour par les pays dans le cadre de l'accord de Paris ne protégeront pas l'humanité alors que les émissions de carbone et les températures continuent de battre des records. En effet, proposer de dépenser des milliards de dollars au cours de ce siècle pour aspirer le dioxyde de carbone de l'air, ou la myriade d'autres moyens de pirater le climat est une reconnaissance que les plus grands pollueurs du monde ne vont pas freiner la combustion des combustibles fossiles.
La capture directe dans l'air (DAC),le captage et le stockage du carbone dans la bioénergie (BECCS), l'alcalinité accrue des océans, le biochar, l'injection d'aérosols sulfatés, l'amincissement des cirrus– toutes les courses farfelues de l'élimination du dioxyde de carbone et de la géo-ingénierie n'ont de sens que dans un monde où la politique climatique a échoué.
Au cours des prochaines années, nous allons voir les impacts climatiques augmenter. Les vagues de chaleur mortelles vont devenir plus courantes. Les tempêtes et les inondations vont devenir de plus en plus destructrices. De plus en plus de personnes vont être déplacées de leurs foyers. Les récoltes nationales et régionales seront mauvaises. D'énormes sommes d'argent devront être dépensées pour s'adapter au changement climatique, et peut-être même plus pour indemniser les personnes les plus touchées. On s'attend à ce que nous croyions que, pendant que tout cela et bien d'autres choses se déroulent, de nouvelles technologies qui modifieront directement l'atmosphère terrestre et l'équilibre énergétique seront déployées avec succès.
De plus, certaines de ces technologies devront peut-être fonctionner pendanttrois cents anspour éviter les conséquences d'un dépassement. Plutôt que de ralentir rapidement les activités polluantes par le carbone et d'augmenter les chances que le système terrestre se rétablisse, nous misons plutôt sur le zéro net et le dépassement dans l'espoir de plus en plus désespéré que des solutions de science-fiction non testées nous sauveront de la dégradation du climat.
On peut voir le bord de la falaise s'approcher rapidement. Plutôt que d'appuyer sur les freins, certaines personnes poussent plutôt leur pied plus fort sur l'accélérateur. Leur justification de cette folie est que nous devons aller plus vite afin de pouvoir faire le saut et atterrir en toute sécurité de l'autre côté.
Nous pensons que beaucoup de ceux qui plaident en faveur de l'élimination du dioxyde de carbone et de la géo-ingénierie le font de bonne foi. Mais ils incluent des propositions visant à regeler l'Arctique en pompant de l'eau de mer sur les calottes glaciaires pour former de nouvelles couches de glace et de neige. Ce sont des idées intéressantes à rechercher, mais il y a très peu de preuves que cela aura un effet sur l'Arctique, sans parler du climat mondial. C'est le genre de nœuds dans lesquels les gens se nouent lorsqu'ils reconnaissent l'échec de la politique climatique, mais refusent de remettre en question les forces fondamentales derrière cet échec. Ils ralentissent involontairement la seule action efficace consistant à éliminer rapidement les combustibles fossiles.
C'est parce que les propositions visant à éliminer le dioxyde de carbone de l'air ou à faire de la géo-ingénierie pour le climat promettent une reprise après le dépassement, une reprise qui sera livrée par l'innovation, tirée par la croissance. Le fait que cette croissance soit alimentée par les mêmes combustibles fossiles qui sont à l'origine du problème ne figure pas dans leur analyse.
L'essentiel ici est que le système climatique est totalement indifférent à nos engagements et promesses. Il ne se soucie pas de la croissance économique. Et si nous continuons à brûler des combustibles fossiles, ceux-ci ne cesseront pas de changer jusqu'à ce que l'équilibre énergétique soit rétabli. D'ici là, des millions de personnes pourraient être mortes, et beaucoup d'autres seraient confrontées à des souffrances intolérables.
Principaux points de basculement climatiques
Même si nous supposons que l'élimination du carbone et même les technologies de géo-ingénierie peuvent être déployées à temps, il y a un très gros problème avec le plan de dépassement de 1,5 °C et d'abaisser les températures plus tard : les points de basculement.
La science des points de basculement progresse rapidement. À la fin de l'année dernière, l'un d'entre nous (James Dyke) et plus de 200 universitaires du monde entier ont participé à la production du Rapport mondial sur les points de basculement. Il s'agissait d'un examen des dernières données scientifiques sur l'emplacement des points de basculement dans le système climatique, ainsi que d'une exploration de la manière dont les systèmes sociaux peuvent entreprendre des changements rapides (dans la direction que nous voulons), produisant ainsi des points de basculement positifs. Les 350 pages du rapport contiennent de nombreuses preuves que l'approche du dépassement est un pari extraordinairement dangereux avec l'avenir de l'humanité. Certains points de basculement ont le potentiel de causer des ravages à l'échelle mondiale.
La fonte du pergélisol pourrait libérer des milliards de tonnes de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et aggraver le changement climatique causé par l'homme. Heureusement, cela semble peu probable dans le contexte du réchauffement actuel. Malheureusement, le risque que les courants océaniques de l'Atlantique Nord s'effondrent peut être beaucoup plus élevé qu'on ne le pensait auparavant. Si cela devait se concrétiser, les systèmes météorologiques du monde entier, mais en particulier en Europe et en Amérique du Nord, seraient plongés dans le chaos. Au-delà de 1,5°C, les récifs coralliens d'eau chaude sont en voie d'anéantissement. Les dernières données scientifiques concluent que d'ici 2°C, les récifs mondiaux seraient réduits de 99%. L'épisode dévastateur de blanchissement qui se déroule dans la Grande Barrière de corail fait suite à de multiples événements de mortalité massive. Il ne suffit pas de dire que nous assistons à la mort de l'une des plus grandes merveilles biologiques du monde. Nous le tuons sciemment.
Nous avons peut-être même déjà franchi des points de basculement climatiques majeurs. La Terre a deux grandes calottes glaciaires, l'Antarctique et le Groenland. Les deux disparaissent en raison du changement climatique. Entre 2016 et 2020, la calotte glaciaire du Groenland a perdu en moyenne 372 milliards de tonnes de glace par an.La meilleure évaluation actuelle du moment où un point de basculement pourrait être atteint pour la calotte glaciaire du Groenland se situe autour de 1,5 °C.
Cela ne signifie pas que la calotte glaciaire du Groenland s'effondrera soudainement si le réchauffement dépasse ce niveau. Il y a tellement de glace (environ 2 800 milliards de tonnes) qu'il faudrait des siècles pour qu'elle fonde, période au cours de laquelle le niveau de la mer augmenterait de sept mètres. Si les températures mondiales pouvaient être ramenées à la baisse après un point de basculement, alors peut-être que la calotte glaciaire pourrait être stabilisée. Nous ne pouvons tout simplement pas dire avec certitude qu'une telle reprise serait possible. Alors que nous nous débattons avec la science, 30 millions de tonnes de glace fondent à travers le Groenland toutes les heures en moyenne.
Le message à retenir de la recherche sur ces points de basculement et d'autres est que la poursuite du réchauffement nous accélère vers la catastrophe. C'est une science importante, mais quelqu'un écoute-t-il ?
Il est minuit moins cinq... encore
Nous savons que nous devons agir de toute urgence contre le changement climatique, car on nous répète sans cesse que le temps presse. En 2015, le professeur Jeffrey Sachs, conseiller spécial de l'ONU et directeur de l'Institut de la Terre, a déclaré :
Le moment est enfin arrivé – nous avons parlé de ces six mois pendant de nombreuses années, mais nous y sommes maintenant. C'est certainement la meilleure chance de notre génération de se mettre sur les rails.
En 2019, le prince Charles a prononcé un discours dans lequel il a déclaré : « Je suis fermement convaincu que les 18 prochains mois décideront de notre capacité à maintenir le changement climatique à des niveaux viables et à restaurer la nature à l'équilibre dont nous avons besoin pour notre survie. »
« Nous avons six mois pour sauver la planète », a exhorté le chef de l'Agence internationale de l'énergie, Fatih Birol, un an plus tard, en 2020. En avril 2024, Simon Stiell, secrétaire exécutif de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, a déclaré que les deux prochaines années étaient « essentielles pour sauver notre planète ».
Soit la crise climatique a une caractéristique très heureuse qui permet de réinitialiser sans cesse le compte à rebours de la catastrophe, soit nous nous berçons d'illusions en déclarant sans fin que le temps n'est pas tout à fait écoulé. Si vous pouvez appuyer à plusieurs reprises sur snooze sur votre réveil et vous rendormir, votre réveil ne fonctionne pas.
Ou il y a une autre possibilité. Souligner que nous avons très peu de temps pour agir vise à attirer l'attention sur les négociations climatiques. Cela fait partie d'une tentative plus large non seulement de réveiller les gens face à la crise imminente, mais aussi de générer des actions efficaces. Ceci est parfois utilisé pour expliquer comment le seuil de réchauffement de 1,5 °C a été convenu. Plutôt qu'un objectif spécifique, il doit être compris comme un objectif ambitieux. Nous pouvons très bien échouer, mais en l'atteignant, nous avançons beaucoup plus vite que nous ne l'aurions fait avec un objectif plus élevé, comme 2°C. Par exemple, considérez cette déclaration faite en 2018 :
Étirer l'objectif à 1,5 degré Celsius ne consiste pas simplement à accélérer. Au contraire, quelque chose d'autre doit se produire et la société doit trouver un autre levier à actionner à l'échelle mondiale.
Quel pourrait être ce levier ? Une nouvelle réflexion sur l'économie qui va au-delà du PIB ? Une réflexion sérieuse sur la façon dont les pays industrialisés riches pourraient aider financièrement et matériellement les pays les plus pauvres à sauter les infrastructures de combustibles fossiles ? Des approches de démocratie participative qui pourraient aider à donner naissance à la nouvelle politique radicale nécessaire à la restructuration de nos sociétés alimentées par les combustibles fossiles ? Rien de tout cela.
Le levier en question est le captage et le stockage du carbone (CSC), car la citation ci-dessus provient d'un article écrit par Shell en 2018. Dans ce publireportage, Shell affirme que nous aurons besoin des combustibles fossiles pendant de nombreuses décennies à venir. Le CSC permet de promettre que nous pouvons continuer à brûler des combustibles fossiles et éviter la pollution par le dioxyde de carbone en piégeant le gaz avant qu'il ne quitte la cheminée. En 2018, Shell faisait la promotion de son élimination du carbone et de ses compensations lourdes Sky Scenario, une approche décrite comme « un fantasme dangereux » par d'éminents universitaires sur le changement climatique, car elle supposait que les émissions massives de carbone pouvaient être compensées par la plantation d'arbres.
Depuis lors, Shell a financé la recherche sur l'élimination du carbonedans les universités britanniques, probablement dans le but de renforcer ses arguments selon lesquels elle doit être en mesure de continuer à extraire de grandes quantités de pétrole et de gaz.
Shell est loin d'être le seul à agiter des baguettes magiques de capture du carbone. Exxon fait de grandes déclarations sur le CSC comme moyen de produire de l'hydrogène net zéro à partir de gaz fossile – des affirmations qui ont fait l'objet de critiques acerbes de la part d'universitaires, des rapports récents exposant l'écoblanchiment à l'échelle de l'industrie autour du CSC.
Mais la pourriture va beaucoup plus loin. Tous les scénarios de politique climatique qui proposent de limiter le réchauffement à près de 1,5 °C reposent sur les technologies largement non éprouvées du CSC et du BECCS. BECCS semble être une bonne idée en théorie. Plutôt que de brûler du charbon dans une centrale électrique, brûlez de la biomasse telle que des copeaux de bois. Il s'agirait initialement d'un moyen neutre en carbone de produire de l'électricité si vous cultiviez autant d'arbres que vous en abattiez et en brûliez. Si vous ajoutez ensuite des épurateurs dans les cheminées des centrales électriques pour capturer le dioxyde de carbone, puis que vous enterrez ce carbone profondément sous terre, vous serez en mesure de produire de l'énergie tout en réduisant les concentrations de dioxyde de carbone dans l'atmosphère.
Malheureusement, il existe maintenant des preuves claires qu'en pratique, les BECCS à grande échelle auraient des effets très néfastes sur la biodiversité et lasécurité alimentaire et hydrique, compte tenu desgrandes quantités de terres qui seraient consacrées à des plantations d'arbres en monoculture à croissance rapide. La combustion de la biomasse peut même augmenter lesémissions de dioxyde de carbone. Drax, la plus grande centrale à biomasse du Royaume-Uni, produit désormais quatre fois plus de dioxyde de carbone que la plus grande centrale à charbon du Royaume-Uni.
Des messages de minuit moins cinq peuvent être motivés pour essayer de galvaniser l'action, pour souligner l'urgence de la situation et le fait que nous avons encore (juste) le temps. Mais le temps pour quoi faire ? La politique climatique n'offre jamais qu'un changement progressif, certainement rien qui ne menacerait la croissance économique ou la redistribution des richesses et des ressources.
Malgré les preuves de plus en plus nombreuses que le capitalisme mondialisé et industrialisé propulse l'humanité vers le désastre, cinq minutes avant minuit ne laissent ni le temps ni l'espace pour envisager sérieusement des alternatives. Au lieu de cela, les solutions proposées sont des solutions technologiques qui soutiennent le statu quo et insistent sur le fait que les entreprises de combustibles fossiles telles que Shell doivent faire partie de la solution.
Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'arguments de bonne foi pour 1,5°C. Mais être bien motivé ne change pas la réalité. Et la réalité, c'est que le réchauffement dépassera bientôt 1,5°C, et que l'accord de Paris a échoué. À la lumière de cela, demander à plusieurs reprises aux gens de ne pas perdre espoir, que nous pouvons éviter une issue désormais inévitable risque de devenir contre-productif. Parce que si vous insistez sur l'impossible (brûler des combustibles fossiles et éviter un changement climatique dangereux), alors vous devez invoquer des miracles. Et il y a toute une industrie des combustibles fossiles qui cherche désespérément à vendre de tels miracles sous la forme de CSC.
Quatre suggestions
L'humanité a assez de problèmes en ce moment, ce dont nous avons besoin, ce sont des solutions. C'est la réponse que nous obtenons parfois lorsque nous affirmons que le concept de carboneutralité et l'accord de Paris posent des problèmes fondamentaux. Cela peut se résumer par la simple question : quelle est votre suggestion ? Ci-dessous, nous en proposons quatre.
1. Laisser les combustibles fossiles dans le sol
La réalité inévitable est que nous devons rapidement arrêter de brûler des combustibles fossiles. La seule façon d'en être sûr, c'est de les laisser dans le sol. Nous devons cesser d'explorer de nouvelles réserves de combustibles fossiles et d'exploiter les réserves existantes. Cela pourrait se faire en arrêtant le financement des combustibles fossiles.
Dans le même temps, nous devons transformer le système alimentaire, en particulier le secteur de l'élevage, étant donné qu'il est responsable de près des deux tiers des émissions agricoles. Commencez par là et déterminez ensuite la meilleure façon de distribuer les biens et services des économies. Ayons des arguments à ce sujet basés sur la réalité, pas sur des vœux pieux.
2. Abandonnez les cibles de boule de cristal net zéro
L'ensemble de la définition des objectifs de zéro émission nette du milieu et de la fin du siècle devrait être mis à la poubelle. Nous sommes déjà dans la zone de danger. La situation exige des actions immédiates, et non des promesses d'équilibrer les budgets carbone dans les décennies à venir. La SBTi devrait se concentrer sur les réductions d'émissions à court terme. D'ici 2030, les émissions mondiales devront être deux fois moins élevées qu'aujourd'hui pour avoir une chance de limiter le réchauffement à 2 °C maximum.
Il est de la responsabilité de ceux qui détiennent le plus de pouvoir – les politiciens et les chefs d'entreprise – d'agir maintenant. À cette fin, nous devons exiger deux objectifs : tous les plans de neutralité carbone doivent inclure un objectif distinct de réduction réelle des émissions de gaz à effet de serre. Nous devons cesser de cacher notre inaction derrière des promesses de retraits futurs. Ce sont nos enfants et les générations futures qui devront rembourser la dette excédentaire.
3. Fonder la politique sur la crédibilité des sciences et de l'ingénierie
Toutes les politiques climatiques doivent être basées sur ce qui peut être fait dans le monde réel maintenant, ou dans un avenir très proche. S'il est établi qu'une quantité crédible de carbone peut être éliminée par une approche proposée – qui comprend le captage et son stockage permanent sûr – alors et seulement alors, cela peut être inclus dans les plans de neutralité carbone. Il en va de même pour la géo-ingénierie solaire.
Les technologies spéculatives doivent être retirées de toutes les politiques, de tous les engagements et de tous les scénarios jusqu'à ce que nous soyons sûrs de la façon dont elles fonctionneront, de la façon dont elles seront surveillées, signalées et validées, et de ce qu'elles feront non seulement au climat, mais aussi au système terrestre dans son ensemble. Cela nécessiterait probablement une très forte augmentation de la recherche. En tant qu'universitaires, nous aimons faire de la recherche. Mais les universitaires doivent se méfier du fait que la conclusion « nécessite plus de recherches » n'est pas interprétée comme « avec un peu plus de financement, cela pourrait fonctionner ».
4. Soyez réaliste
Enfin, dans le monde entier, il existe des milliers de groupes, de projets, d'initiatives et de collectifs qui œuvrent pour la justice climatique. Mais alors qu'il existe un projet de majorité climatique et un projet de réalité climatique, il n'y a pas de projet d'honnêteté climatique (bien que People Get Reals'en rapproche). En 2018, Extinction Rebellion a été formé et a exigé que les gouvernements disent la vérité sur la crise climatique et agissent en conséquence. Nous pouvons maintenant voir que lorsque les politiciens faisaient leurs promesses de zéro émission nette, ils croisaient également les doigts dans leur dos.
Nous devons reconnaître que la neutralité carbone et maintenant le dépassement sont de plus en plus utilisés pour affirmer que rien de fondamental ne doit changer dans nos sociétés énergivores. Nous devons être honnêtes au sujet de notre situation actuelle et de la direction que nous prenons. Des vérités difficiles doivent être dites. Il s'agit notamment de mettre en évidence les vastes inégalités de richesse, d'émissions de carbone et de vulnérabilité au changement climatique.
Il est temps d'agir
Nous reprochons à juste titre aux politiciens de ne pas avoir agi. Mais à certains égards, nous avons les politiciens que nous méritons. La plupart des gens, même ceux qui se soucient du changement climatique, continuent d'exiger de l'énergie et de la nourriture bon marché, ainsi qu'un approvisionnement constant en produits de consommation. Réduire la demande en rendant les choses plus chères risque de plonger les gens dans la pauvreté alimentaire et énergétique, et les politiques de réduction des émissions dues à la consommation doivent donc aller au-delà des approches fondées sur le marché. La crise du coût de la vie n'est pas distincte de la crise climatique et écologique. Ils exigent que nous repensions radicalement le fonctionnement de nos économies et de nos sociétés, et à qui elles servent.
Pour revenir à la situation difficile de la grenouille bouillante au début, il est grand temps pour nous de sauter hors de la marmite. On peut se demander pourquoi nous n'avons pas commencé il y a des décennies. C'est ici que l'analogie offre des informations précieuses sur la neutralité carbone et l'accord de Paris. Parce que l'histoire de la grenouille bouillante, telle qu'elle est généralement racontée, passe à côté d'un fait crucial. Les grenouilles ordinaires ne sont pas stupides. Bien qu'ils s'assoient joyeusement dans l'eau qui se réchauffe lentement, ils tenteront de s'échapper une fois que cela deviendra inconfortable. La parabole telle qu'elle est racontée aujourd'hui est basée sur des expériences menées à la fin du 19ème siècle qui impliquaient des grenouilles qui avaient été « piquées » – une tige de métal avait été insérée dans leur crâne qui détruisait leur fonctionnement cérébral supérieur. Ces grenouilles radicalement lobotomisées flottaient en effet inertes dans l'eau qui les cuisait vivantes.
Les promesses de zéro émission nette et de reprise après le dépassement nous empêchent de lutter pour nous mettre en sécurité. Ils nous assurent que rien de trop drastique ne doit se produire pour l'instant. Soyez patient, détendez-vous. Pendant ce temps, la planète brûle et nous voyons toute sorte d'avenir durable partir en fumée.
Admettre les échecs de la politique sur le changement climatique ne signifie pas abandonner. Cela signifie accepter les conséquences d'une erreur et de ne pas faire les mêmes erreurs. Nous devons planifier des itinéraires vers un avenir sûr et juste à partir de là où nous sommes, plutôt que là où nous aimerions être. Le moment est venu de faire un bond en avant.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Automobile. Comment la Chine est devenue championne du monde des batteries électriques

Les constructeurs chinois ont réussi à supplanter leurs concurrents sur le marché des batteries. Ils le doivent à l'accent mis depuis des années par le gouvernement sur la formation aux disciplines scientifiques et technologiques, ainsi qu'au triplement des dépenses consacrées à la recherche et développement, explique “The New York Times”.
23 septembre 2024 | tiré de Courrier international | Illustration : Xi Jinping. Technolo-Xi. Dessin de Joep Bertrams paru dans De Groene Amsterdammer, Pays-Bas.
https://www.courrierinternational.com/article/automobile-comment-la-chine-est-devenue-championne-du-monde-des-batteries-electriques_221381
La domination de la Chine sur les voitures électriques, qui menace de déclencher une guerre commerciale, trouve en réalité son origine dans certains laboratoires universitaires du Texas, où des chercheurs ont découvert, voilà plusieurs dizaines d'années, comment fabriquer des batteries à partir de minéraux bon marché et disponibles en abondance.
En exploitant cette trouvaille, des entreprises chinoises ont ensuite trouvé des solutions pour permettre aux batteries de tenir plus longtemps la charge et de supporter des recharges quotidiennes pendant plus de dix ans. Elles en fabriquent désormais en quantité, de manière fiable et bon marché. Elles produisent également la plupart des voitures électriques du parc mondial ainsi que de nombreux autres systèmes énergétiques propres.
En fait, les batteries ne sont qu'un exemple parmi d'autres de la capacité de la Chine à atteindre un niveau de sophistication technologique et industrielle lui permettant de rattraper – et même de dépasser – les démocraties industrielles développées. La liste des secteurs dans lesquels elle a effectué une percée est longue : des produits pharmaceutiques aux drones, en passant par les panneaux photovoltaïques ultra-performants.
Pour prendre la mesure du défi posé par Pékin à la suprématie technologique américaine depuis la Seconde Guerre mondiale, il suffit de se rendre dans des salles de cours en Chine ou de consulter les budgets des entreprises chinoises, ainsi que les directives émanant des plus hautes sphères du Parti communiste chinois (PCC).
Priorité aux filières scientifiques
Les étudiants chinois sont beaucoup plus nombreux qu'ailleurs à se spécialiser dans les sciences, les mathématiques et l'ingénierie. De plus, leur proportion continue d'augmenter alors que les inscriptions dans l'enseignement supérieur ont plus que décuplé depuis l'an 2000.
Par ailleurs, les dépenses consacrées à la recherche et développement ont explosé : ces dix dernières années, elles ont triplé, propulsant la Chine à la deuxième place mondiale derrière les États-Unis. Les chercheurs chinois occupent une place de premier plan : ils ont publié des articles très en vue au sujet de 52 des 64 technologies considérées comme essentielles, selon un décompte effectué récemment par l'Australian Strategic Policy Institute [ASPI, l'Institut australien de politique stratégique]. Et le mois dernier, les dirigeants chinois ont promis de faire franchir un nouveau palier à la recherche dans leur pays.
Lors d'une réunion des dirigeants du PCC qui se tient tous les dix ans, ceux-ci ont décrété que la formation et l'enseignement scientifiques devaient être l'une des principales priorités économiques du pays. La résolution finale adoptée à l'issue de cet événement a accordé à cet objectif une importance supérieure à celle de toutes les autres mesures, à l'exception de celle visant à renforcer le parti lui-même.
La Chine “va prendre des dispositions exceptionnelles pour les disciplines et les filières dont elle a besoin de façon urgente”, a déclaré Huai Jinpeng, le ministre de l'Éducation.
“Nous comptons mettre en œuvre une stratégie nationale pour cultiver les meilleurs talents.”
Selon le ministère de l'Éducation, la majorité des étudiants chinois de premier cycle se spécialisent en mathématiques, sciences, ingénierie ou agriculture. C'est aussi le cas de trois doctorants sur quatre. À titre de comparaison, aux États-Unis, ces disciplines n'attirent qu'un cinquième des étudiants de premier cycle et un doctorant sur deux. À noter cependant que ces chiffres se fondent sur une définition un peu plus stricte de ces spécialités aux États-Unis.
Des labos très bien équipés
L'avance de la Chine est particulièrement marquée dans le secteur des batteries. Selon l'ASPI, 65,5 % des articles scientifiques les plus cités sur la technologie des batteries sont le fait de chercheurs chinois, contre seulement 12 % pour les Américains. En outre, les deux plus grands fabricants mondiaux de batteries de voitures électriques, CATL et BYD, sont tous deux chinois.
La Chine propose près de 50 programmes d'études supérieures consacrés à la chimie ou à la métallurgie des batteries, tandis qu'aux États-Unis seuls quelques professeurs travaillent dans ce domaine. Selon Hillary Smith, professeure de physique des batteries au Swarthmore College [université de Swarthmore, près de Philadelphie], on constate aux États-Unis un intérêt croissant des étudiants de premier cycle pour la recherche sur les batteries. Mais “ils vont devoir jouer des coudes, car les places sont rares, et la plupart d'entre eux seront contraints de se réorienter”, ajoute-t-elle.
Pour découvrir les racines du succès de la Chine en matière de batteries, il faut se rendre à la Central South University de Changsha, une ville située dans le sud du pays qui est depuis longtemps un des bastions de l'industrie chimique chinoise. Cette université compte près de 60 000 étudiants de premier et second cycles, répartis sur un grand campus moderne. Son département de chimie, qui se trouvait autrefois dans un petit bâtiment en brique, a déménagé dans un édifice en béton de six étages, véritable labyrinthe de labos et de salles de classe.
Dans l'un de ces laboratoires, où brillent de nombreux voyants rouges, des centaines de batteries présentant de nouvelles compositions chimiques sont en train d'être testées. D'autres salles sont occupées par des microscopes électroniques et divers appareils de pointe. “Les équipements dont nous disposons pour réaliser des expériences sont suffisants à nos yeux pour répondre aux besoins de quiconque veut faire des tests”, explique le doctorant Zhu Fangjun.
Un enjeu géopolitique
Peng Wenjie, un professeur de l'université, a ouvert non loin d'ici un bureau d'études sur les batteries qui emploie une centaine de jeunes diplômés titulaires d'un doctorat ou d'une maîtrise, et plus de 200 assistants. Les assistants travaillent en relais avec les chercheurs. Ils peuvent donc tester de nouvelles compositions chimiques et des architectures de batterie vingt-quatre heures sur vingt-quatre. “Comme beaucoup de personnes sont présentes sur le site en même temps pour les essais, on est très efficaces”, souligne M. Peng.
L'expertise de plus en plus étendue de la Chine dans le secteur manufacturier est à l'origine d'un vif débat dans certains pays, notamment aux États-Unis : faut-il demander à des entreprises chinoises de venir construire des usines sur place ou vaut-il mieux essayer de reproduire ce que fait la Chine ?
“Si les États-Unis veulent mettre en place rapidement une chaîne d'approvisionnement, la meilleure solution pour eux est de solliciter des entreprises chinoises car elles la créeront en un rien de temps, en apportant avec elles leur technologie”, estime Feng An, fondateur du Centre d'innovation dans l'énergie et les transports, un organisme de recherche à but non lucratif implanté à Pékin et à Los Angeles.
L'industrie manufacturière représente 28 % du PIB de la Chine, contre seulement 11 % aux États-Unis. La Chine espère que ses investissements dans l'enseignement et la recherche scientifiques se traduiront par des gains d'efficacité qui contribueront à dynamiser l'ensemble de l'économie, nous confie Liu Qiao, directeur de l'École de gestion Guanghua de l'université de Pékin. Selon lui, “il est facile d'améliorer les niveaux de productivité, dès lors qu'on dispose d'un grand secteur manufacturier”.
Mais les prouesses de la Chine dans ce domaine posent problème sur le plan géopolitique. En effet, l'essor de l'industrie manufacturière étant alimenté en partie par des subventions et des mesures gouvernementales, de nombreux pays rechignent désormais à acheter des exportations chinoises.
Des usines chinoises aux États-Unis ?
Ainsi, l'Union européenne a décidé de taxer lourdement les véhicules électriques en provenance de Chine en leur imposant des droits de douane compensateurs. Les États-Unis ont fait de même pour stopper l'expansion des constructeurs chinois sur leur sol, tandis que les projets de coopération avec les fabricants chinois de batteries subissent des pressions politiques et commerciales qui les entravent.
Les fabricants chinois cherchent malgré tout des solutions pour produire aux États-Unis des batteries pour véhicules électriques. Mais construire et équiper ce genre d'usine aux États-Unis coûte six fois plus cher qu'en Chine, souligne Robin Zeng, président fondateur de CATL, et cela prend plus de temps – “trois fois plus”, selon lui.
Néanmoins, les États-Unis devancent toujours la Chine en ce qui concerne la dépense intérieure en recherche et développement (DIRD), en dollars mais aussi en pourcentage du PIB. L'année dernière, l'effort global de recherche, en hausse depuis plusieurs années, y a atteint 3,4 % du PIB, contre 2,6 % pour la Chine (en augmentation également).
“Que se passera-t-il lorsque la Chine, qui dispose déjà d'une solide assise manufacturière, dépassera les États-Unis en matière de R & D ?” s'interroge Craig Allen, le président de l'US-China Business Council, un organisme qui représente les entreprises américaines commerçant avec la Chine.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Manifestation du 28 septembre 2024 en défense du droit à l’avortement

Le 28 septembre défendons le droit à l'avortement partout dans le monde
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://www.bing.com/search?q=liban&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgAEEUYwgMyBwgAEEUYwgMyBwgBEEUYwgMyBwgCEEUYwgMyBwgDEEUYwgMyBwgEEEUYwgMyBwgFEEUYwgMyBwgGEEUYwgMyBwgHEEUYwgPSAQo5OTgyNTJqMGo0qAIIsAIB&FORM=ANAB01&adppc=EDGEBRV&PC=EDGEBRV
Le 28 septembre, Journée internationale pour le droit à l'avortement, nous afficherons haut et fort notre solidarité avec toutes les femmes du monde et en particulier celles des pays où est interdit totalement ou partiellement le droit à l'avortement !
Chaque année, nous manifesterons pour que ce droit soit établi, appliqué, respecté, dans le monde, en Europe et en France.
En Argentine, le Président Milei cherche à revenir sur le droit à l'avortement, acquis de haute lutte en 2020. Les conséquences de la décision de la Cour suprême état-unienne de 2022, continuent à peser sur les femmes des USA dont certaines se rendent au Mexique où la Cour suprême a dépénalisé l'avortement en septembre 2023.
Partout où l'extrême droite arrive au pouvoir elle n'a de cesse de vouloir restreindre voire interdire les droits des femmes. C'est le cas dans différents pays européens comme en Italie, en Hongrie ou en Pologne. Les femmes polonaises en paient encore le prix fort malgré un changement politique qui peine à rétablir le droit à l'avortement. Il est essentiel d'inscrire le droit à l'avortement dans la Charte Européenne des Droits Fondamentaux
En France, parmi les député.e.s du RN il y a de farouches militant.e.s anti avortement ! Le nouveau gouvernement doit pénaliser les activistes anti IVG qui notamment attaquent des locaux du Planning familial, propagent de fausses informations sur le net, dénigrent les séances d'Éducation à la vie affective et sexuelle à l'école, essaient de dissuader les femmes d'avorter. Il est urgent de dissoudre ces associations anti-IVG.
En mars 2024, la « liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse » a été inscrite dans la Constitution française, ce dont nous nous réjouissons. Cependant, cette avancée ne suffit pas. Les conditions dans lesquelles s'exercent la « liberté garantie » pourraient toujours être revues à la baisse. Rien ne garantit les moyens humains et matériels, la double clause de conscience du personnel médical existe toujours. En outre, la nomination de Michel Barnier, qui a voté en 1982 contre le remboursement de l'IVG, requiert encore plus notre vigilance.
Nous exigeons afin de garantir l'application de la loi :
– l'accès aux soins, pour toutes, sur tous les territoires, tout le long de l'année avec la réouverture des CIVG fermés, des maternités et hôpitaux de proximité, le maintien de l'offre en ville.
– la garantie pour toutes du choix des méthodes pour l'IVG et la contraception,
– une politique claire et forte impulsant des campagnes publiques d'informations sur les droits sexuels et reproductifs ainsi que les séances d'éducation à la vie affective et sexuelle en milieu scolaire prévues par la loi du 4 juillet 2001
– une politique de production publique des médicaments essentiels, incluant ceux nécessaires à l'IVG, pour éviter toute pénurie Cela passe par la création d'établissements pharmaceutiques nationaux et européens financés par des fonds publics, pour produire, diffuser et gérer les stocks de médicaments. Depuis les effets d'annonce de juin 2023, rien ne s'est concrétisé.
Nous manifesterons donc le 28 septembre 2024 pour la défense et l'application effective du droit fondamental à l'avortement partout dans le monde.
MANIF PARIS 28 SEPTEMBRE 14h30
Premières signataires : Association nationale des centres d'interruption volontaire de grossesse, Association nationale des sages femmes orthogénistes, Collectif national pour les droits des femmes, Collectif CIVG Tenon, Coordination des associations pour le droit à l'avortement et la contraception, Femmes solidaires, Planning familial, Réseau féministe “Ruptures”, Union syndicale Solidaires, Marche Mondiale des Femmes France…
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

La « tradition » n’est pas une excuse

Aizada Kanatbekova a été enlevée en plein jour à Bichkek, au Kirghizstan. Deux jours plus tard, cette jeune femme de 27 ans a été retrouvée morte étranglée à l'extérieur de la ville.
Tiré de Entre les lignes et les mots
photo Rassemblement devant le ministère de l'Intérieur du Kirghizstan demandant la démission de ses dirigeants après le meurtre de la jeune mariée kidnappée Aizada Kanatbekova et l'inaction présumée de la police, à Bishkek, le 8 avril 2021. © 2021 Vladimir Pirogov/Reuters
Elle avait été enlevée par un groupe de personnes mené par un homme qui voulait la forcer à l'épouser.
La réaction de la police a été nulle, comme c'est trop souvent le cas dans ces affaires d'« enlèvement de fiancées » au Kirghizstan. Un témoin a raconté l'enlèvement à la police, qui avait également accès aux images des caméras de surveillance de la rue. La police de la ville de Bichkek a affirmé qu'elle menait des recherches sans relâche, mais les bureaux de la police régionale en dehors de Bichkek n'en savaient rien.
Plus de trois ans plus tard, les responsables de la police continuent d'échapper à toute mise en cause pour leur inaction, qui pourrait avoir contribué à la mort de Kanatbekova aux mains de son « kidnappeur de fiancée ». La semaine dernière, le tribunal de la ville de Bichkek a confirmé l'acquittement du chef de la police de l'époque, rejetant les accusations de négligence dans la mort de Kanatbekova.
L'enlèvement de mariées – c'est-à-dire l'enlèvement de femmes en vue d'un mariage forcé – est illégal au Kirghizstan. Toutefois, à l'instar de nombreuses violences fondées sur le genre dans le pays, ce phénomène reste un problème grave, car les autorités ne le prennent pas suffisamment au sérieux.
L'agence nationale de sécurité s'est engagée à s'attaquer au problème, mais les agents des forces de l'ordre sont généralement indifférents aux appels à l'aide des femmes qui subissent d'horribles abus. Des agents de police ont ignoré des cas choquants de femmes ayant reçu des coups de pied à la tête, ayant été brûlées, ayant eu les oreilles et le nez coupés, ou ayant été poignardées à mort dans des postes de police après avoir été laissées seules avec leur kidnappeur.
Je me souviens avoir entendu parler de ces « enlèvements de mariées » lorsque je me suis rendu pour la première fois au Kirghizstan il y a 30 ans. J'ai été choqué, mais les gens m'ont dit que c'était la « tradition ». Je crains que certains raisonnent encore ainsi.
Le mot « tradition » est trop souvent utilisé pour tenter de défendre des violations des droits humains – et pas seulement en Asie centrale – et cet argument semble malheureusement convaincant pour certaines personnes.
Pour ceux qui ont été élevés dans cette culture, il renforce l'idée que les choses sont intemporelles et ne peuvent pas changer. Pour ceux qui ne sont pas issus de cette culture, la crainte est de donner l'impression de critiquer les coutumes des autres et de s'exposer à des accusations de xénophobie.
C'est pourquoi beaucoup se taisent et font semblant de croire que ce qui est manifestement inacceptable est tout à fait normal dans le contexte local. Et la référence à la « tradition » devient l'excuse standard pour commettre d'horribles abus.
Mais, comme c'est souvent le cas, c'est en écoutant les victimes que l'on commence à comprendre clairement les choses. Demandez à la personne qui a été torturée pour ses croyances. Demandez à la personne jetée en prison pour ce qu'elle est. Demandez à la famille et aux amis de la personne enlevée et assassinée.
Ils vous diront que ce n'est pas leur « tradition ». C'est un crime. Et les autorités devraient le prendre au sérieux.
Andrew Stroehlein
Directeur des relations médias en Europe
https://www.hrw.org/fr/news/2024/09/17/la-tradition-nest-pas-une-excuse
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
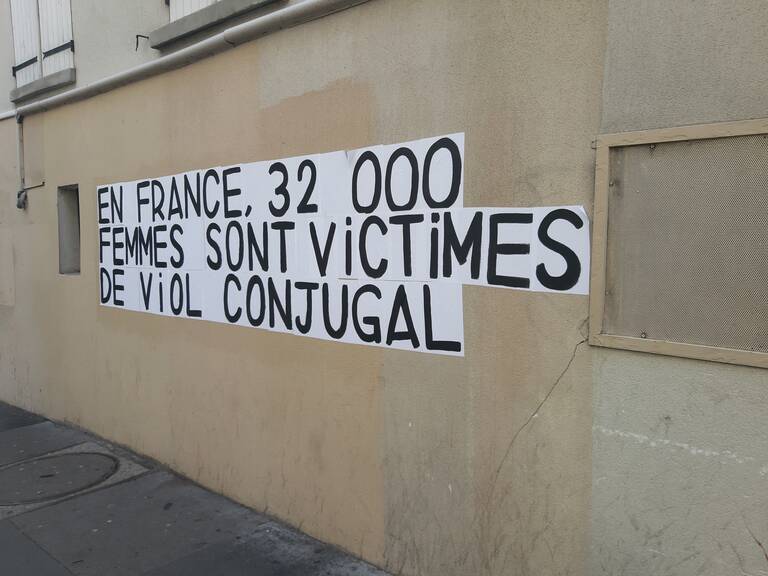
France : Réaction des associations féministes à la nomination du gouvernement
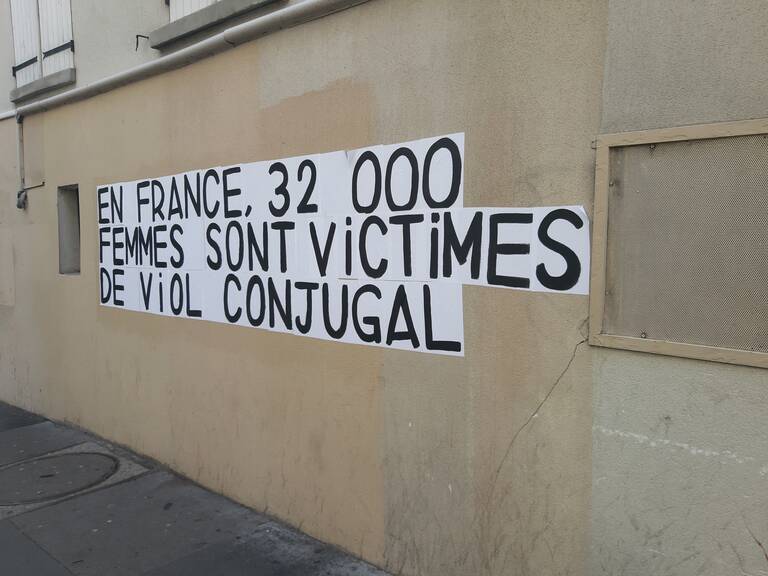
Nous, associations féministes, nous alarmons de la nomination d'un gouvernement ultra conservateur. Nous dénonçons en particulier la présence de ministres qui se sont engagé·es ou ont voté contre le droit à l'IVG dans la constitution ou contre le mariage pour tous·tes, une régression sans précédent.
Tiré de Entre les lignes et les mots
Nous sommes inquiètes du message délétère envoyé par ces nominations, qui témoigne de positions rétrogrades et réactionnaires sur les questions d'égalité et de genre, en total décalage avec les attentes de la société.
L'absence d'un Ministère de plein exercice sur les droits des femmes, avec un budget dédié, est une provocation alors que les droits des femmes sont au cœur de nombreuses mobilisations. Le procès des violeurs de Mazan suscite un émoi sans précédent. Chacun·e prend la mesure d'un besoin urgent que les victimes puissent déposer plainte sans crainte et appréhension, et de la nécessité de lutter réellement contre la culture du viol.
C'est pourquoi nos associations féministes demandent des actes forts, notamment :
* Un ministère de plein exercice pour piloter les politiques en matière de droits des femmes et assurer la coordination avec l'ensemble des ministères.
* Une loi-cadre intégrale contre les violences sexuelles qui lutte contre la culture du viol par la prévention, la sensibilisation et l'accompagnement des victimes. Cet ensemble de mesures doit inclure la mise en œuvre de procédures pénales adaptées et de véritables moyens et obligations d'enquête.
* Un budget à hauteur de 2,6 milliards d'euros par an pour se donner les moyens de lutter contre les violences faites aux femmes.
* La mise en œuvre d'une diplomatie féministe qui subordonne les relations diplomatiques et internationales au respect des droits des femmes, aux minorités de genre et aux personnes LGBTQIA+.
* L'abrogation des lois qui durcissent l'accueil des personnes exilées qui fuient les persécutions basées sur le genre ou l'orientation sexuelle et trouvent refuge en France.
Nous rappelons notre solidarité pleine et entière envers les personnes exilées, en situation de précarité, de handicap et toutes celles et ceux qui subissent des discriminations.
Alors que les victimes continuent de prendre la parole et que la demande d'action politique n'a jamais été aussi forte pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, les maigres budgets permettant d'accompagner les victimes ne sauraient souffrir de coupes et doivent au contraire être augmentés. Les associations qui œuvrent en faveur de l'égalité ne doivent en aucun cas faire les frais de l'orientation politique réactionnaire de ce gouvernement.
Les associations féministes seront vigilantes dans les semaines et mois à venir pour que les droits des femmes, des minorités de genre et des personnes LGBTQIA+ soient pleinement respectés et protégés.
Elles appellent à une mobilisation le 19 octobre en soutien aux victimes de violences sexuelles et à la grande manifestation contre les violences le 23 novembre partout en France.
Organisations et associations signataires :
Alliance des femmes pour la démocratie, Amicale du Nid, Association Française du Féminisme, Chiennes de garde, Choisir la cause des femmes, Collectif National pour les Droits des Femmes, Collectif 65 pour les Droits des Femmes, Coordination des Associations pour le Droit à l'Avortement et la Contraception, Coordination française pour le Lobby Européen des Femmes, Encore Féministes !, En avant toute(s), Equipop, Femmes avec, Femmes Solidaires, Fondation des femmes, Institut Ouïghour d'Europe (IODE), Iran justice, Le Cercle Persan, Ligue des Femmes Iraniennes pour la Démocratie-LFID, LOBA, Mouvement du Nid, Mouv'Enfants, MeTooMedia, Observatoire des Violences Sexistes et Sexuelles dans l'Enseignement Supérieur, Osez le Féminisme !, Oxfam France, Planning Familial, Quartiers du Monde, Règles Élémentaires, Réseau Féministe « Ruptures »
https://amicaledunid.org/actualites/communique-de-presse-inter-associatifreaction-des-associations-feministes-a-la-nomination-du-gouvernement/
https://osezlefeminisme.fr/reaction-des-associations-feministes-a-la-nomination-du-gouvernement/
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Les femmes, les personnes racisées et les personnes précarisées cantonné·es à la reproduction sociale et aux emplois dévalorisés

L'accès aux emplois valorisés dans les pays du Nord est le reflet d'un système raciste et patriarcal. Les personnes racisées – mais aussi les personnes blanches issues des classes populaires, précarisées – sont bien souvent cantonnées à des métiers dévalorisés sur le plan salarial et social : nettoyage des rues, des lieux publics et privés, ramassage des ordures, vigiles, livreurs Deliveroo, ouvriers qui construisent les logements, cuisiniers [1].
Tiré de CADTM infolettre, le 2024-09-26
20 septembre par Maxime Perriot
Photo : Mathias Reding, CC, Pexels, https://www.pexels.com/fr-fr/photo/homme-personne-individu-eboueur-11077610/
Un monde fait d'inégalités
1.Des richesses toujours plus concentrées et le grand écart se creuse
2.Les femmes, les personnes racisées et les personnes précarisées cantonné·es à la reproduction sociale et aux emplois dévalorisés
3.L'accès aux emplois valorisés dans les pays du Nord est le reflet d'un système raciste et patriarcal
Les femmes racisées, dont les oppressions s'imbriquent, sont cantonnées aux activités de reproduction sociale (qui permettent la reproduction de la société) : activités de soin, nettoyage, garde d'enfants. Ces personnes sont invisibilisées. Elles n'existent pas aux yeux des personnes qui profitent de leur travail et qui, sans s'en rendre compte, dépendent d'elles. Exemple : il est rare qu'un cadre ou directeur d'une grande entreprise adresse, ne serait-ce qu'un « bonjour » à la personne qui nettoie les toilettes de son entreprise. Il ne s'adresse pas à elle car elle n'existe pas à ses yeux, car, bien souvent, les femmes qui nettoient les locaux se lèvent à 4h du matin pour nettoyer avant l'arrivée des employé·es. Pourtant, sans ces femmes, dont on ne parle pas, qu'on ne rémunère pas ou très peu, et qui n'existent pas, toutes les personnes valorisées par le système ne pourraient pas travailler dans des endroits propres, profiter de toilettes propres, faire garder leurs enfants, profiter de rues propres. Elles ne pourraient pas non plus aller au restaurant (les personnes racisées et les migrant·es sont sur-représenté·es dans les cuisines), ou se loger dans des immeubles ou lotissements neufs (les personnes racisées et les migrant·es sont également massivement employé·es en tant qu'ouvriers sur les chantiers).
Cette réalité est là car rien n'est fait par l'État – ou beaucoup trop peu – pour corriger les oppressions générées par le système capitaliste, qui utilise et use les corps des femmes, des personnes racisées et précarisées pour se maintenir. Sans opprimé·es, ce système ne tient plus. Au contraire, l'État est raciste : il concentre les personnes racisées et les migrant·es dans des banlieues faites de tours bétonnées, où la nature est presque invisible. Il valorise, à l'école, une culture bourgeoise qui va légitimer l'exclusion des personnes racisées des parcours valorisés. Par exemple, un enfant noir qui a grandi en banlieue va être scolarisé dans un établissement sans moyen. Il ne va pas parvenir à avoir des bonnes notes à l'école, du fait de ses conditions de vie, de sa culture qui n'est pas la culture dominante, de l'établissement dans lequel il est scolarisé. Il va ensuite commencer à travailler tôt en rejoignant une profession citée au-dessus. L'État crée, via l'école et les programmes scolaires, une légitimation de la place de chacun·e dans la société, qui n'est autre que la reproduction des inégalités de genre et de race, dans la majorité des cas.
Quand l'État mène des politiques de discriminations positives, comme il le fait aux États-Unis, celle-ci sont remises en cause et attaquées. Ce fut le cas en juin 2023, lorsque la Cour suprême des États-Unis a interdit la discrimination positive dans les processus de sélection pour entrer à l'université.
Même s'il entretient et légitime des oppressions de classes, de genre et de race, l'État participe parfois à les estomper, via l'application de politiques sociales, via le financement de service public ou la mise en place de politiques spécifiques.
Prenons l'exemple des inégalités de genre. Précisons à nouveau que nous utiliserons le terme « femmes » comme catégorie analytique, qui permet de montrer les grandes lignes des effets genrés de l'austérité dans un monde organisé autour de dualismes de genre. Ce terme inclut les personnes qui se reconnaissent dans cette réalité sociale et politique, ou y ont été assignées, mais peut également inclure selon le sujet, les personnes queer. Son utilisation ne se veut pas essentialiste, ni invisibilisante de la pluralité de genre, des sexualités et des oppressions qui en résultent [2].
L'État est raciste : il concentre les personnes racisées et les migrant·es dans des banlieues faites de tours bétonnées, où la nature est presque invisible. Il valorise, à l'école, une culture bourgeoise qui va légitimer l'exclusion des personnes racisées des parcours valorisés
Le système capitaliste cantonne les femmes – surtout certaines comme nous l'avons vu – dans des métiers dévalorisés par la société. Elles sont largement majoritaires dans les métiers de la reproduction sociale. Elles font le ménage, s'occupent des personnes âgées, des bébés, des enfants, des malades. Elles le font dans la sphère professionnelle – en étant sous-payées – et dans la sphère privée, gratuitement. Sans elles, les dominant·es, les gagnant·es du système capitaliste, qui occupent des postes valorisés par la société, ne pourraient pas occuper leur position. Sans les personnes qui nettoient les lieux où ils passent à 5 heures du matin, qui leur font à manger à la cantine de leur entreprise, sans leur compagne qui prend soin d'eux, fait le ménage et s'occupe des enfants – quand ce n'est pas une nounou sous-payée qui fait à manger et prend soin des enfants – ces personnes ne pourraient pas vivre comme elles le font. Les hommes (et femmes) blanc·hes en haut de l'échelle et valorisé·es par la société sont dépendant·es des femmes – particulièrement des femmes racisées – qui se trouvent de l'autre côté de l'échelle et dévalorisées.
L'État, quand il mène des politiques de gauche, quand il finance les services publics, participe à réduire légèrement cette situation intolérable. Par exemple, en finançant des métiers du soin via de l'argent public, il va mieux valoriser financièrement et socialement les activités assignées aux femmes. Elles sont majoritaires dans les secteurs de la santé, de l'enseignement etc. D'autre part, en finançant des crèches, des cantines ou autres services de soins, l'État socialise une partie du travail gratuit réalisé par les femmes (le problème, c'est que ce sont souvent des femmes racisées qui occupent ces métiers (cantine, crèches), qui restent mal payés et dévalorisés socialement).
Quand l'État social est attaqué par des politiques d'austérité, au nom du remboursement de la dette publique – ce qui se passe depuis 40 ans, et ce à quoi nous assistons à nouveau depuis la fin de la pandémie en 2022 – ces maigres outils de réduction des inégalités s'effritent toujours davantage. Les coupes budgétaires génèrent une réduction du nombre de fonctionnaires des secteurs non productifs (éducation, soins, santé), où les femmes sont majoritaires. Par exemple, les services entiers de soins aux personnes ou de crèches ferment. Ces fermetures retombent sur les femmes, qui perdent leurs emplois et compensent le retrait de l'État par leur travail gratuit (elles s'occupent des enfants, font à manger, s'occupent des personnes âgées). Ce travail gratuit les empêche d'occuper des emplois stables et à temps plein, et les rend parfois dépendantes de leur compagnon.
Par ailleurs, les politiques d'austérité menée au nom du remboursement de la dette affectent de manière spécifique et disproportionnée d'autres groupes déjà marginalisés : les personnes âgées, les personnes précarisées, les personnes LGBTQUIA+ et donc, les personnes migrant·es et non blanches.
Le tableau 3 montre bien ce qui vient d'être décrit plus haut. De manière générale, dans les pays de l'Union européenne, en 2022, plus d'hommes que de femmes occupaient un emploi. Dans les ménages qui ont un ou deux enfants de moins de 6 ans, 9 hommes sur 10 occupent un emploi, contre un peu moins de 7 femmes sur 10. Quand on passe à un ménage de 3 enfants, dont au moins l'un des enfants a moins de 6 ans, le taux d'emploi masculin baisse légèrement à 84,1%. Il chute pour les femmes et passe à 50,5%. Cela signifie qu'une femme sur deux, qui a trois enfants dont un a moins de 6 ans, ne travaillent pas, et reste au foyer pour s'occuper des enfants. Ce tableau montre très bien la prise en charge différenciée de la reproduction sociale dans les ménages qui ont des enfants.
De manière générale, les femmes occupent davantage les emplois à temps partiel que les hommes. Cette réalité s'accroît dans les ménages avec enfants. Dans les pays de l'Union européenne, un quart des femmes occupent un emploi à temps partiel contre moins d'un homme sur dix. Plus les ménages ont d'enfants, et plus ils sont nombreux et jeunes, plus l'écart dans l'occupation des postes à temps partiel se creuse. Au sein des ménages avec 3 enfants, dont un a moins de 6 ans, 4 femmes sur 10 sont à temps partiel, contre 8% des hommes. De la même manière, plus d'un tiers des femmes qui ont deux enfants – peu importe leur âge – sont à temps partiel. Dans la même situation, seul un homme sur 20 occupe un emploi à temps partiel.
Ces chiffres viennent confirmer que la reproduction sociale liée à la naissance d'un ou plusieurs enfants repose bien davantage sur la femme dans le foyer. Autrement dit, ce sont elles qui s'occupent gratuitement des enfants. Cela peut être dangereux, d'une part car cette position est moins valorisée socialement que l'occupation d'un emploi. D'autre part, car cela crée une dépendance financière envers l'homme du foyer, et donc potentiellement une vulnérabilité s'il est violent. En cas de volonté de séparation, cela va également être plus compliqué pour la femme, qui peut rester – au moins quelque temps – avec son mari par dépit car dépendante financièrement.
Si l'on se penche sur l'évolution de l'occupation genrée d'un emploi à temps partiel, sur l'ensemble des pays de l'OCDE, l'écart se réduit très légèrement. Entre 2005 et 2021, le taux d'hommes employés à temps partiel est passé de 6,8% à 8,8%. Celui des femmes employées à temps partiel de 23,4% à 22,3%. Néanmoins, cette tendance ne concerne pas tous les pays. En Grèce, au Japon, au Chili, ou en Corée du Sud, l'écart se creuse. Au Japon, 4 femmes sur 10 travaillent à temps partiel.
Les pays de l'OCDE où l'écart entre le taux de femmes employées à temps partiel et le taux d'hommes employés à temps partiel est le plus haut sont la Belgique, la Colombie, l'Italie et le Japon. À l'inverse, les pays où l'écart est le plus faible sont la Roumanie et le Chili, où il y a même davantage d'hommes qui sont employés à temps partiel que de femmes.
Malgré ces légères évolutions, l'écart global entre hommes et femmes concernant l'occupation d'emplois à temps partiel reste important. Aucun changement structurel n'a encore eu lieu sur cette question.
Ce dernier tableau (tableau 6) nous apprend également que ces inégalités de genre décrites plus haut dépendent également du niveau d'étude. Plus le niveau d'études est élevé, plus l'écart entre le taux d'hommes employés et le taux de femmes employées est faible. Pour les personnes qui n'ont pas étudié davantage que jusqu'à 18 ans, deux tiers des hommes ont un emploi contre moins de la moitié des femmes qui sont dans cette situation. Si l'on regarde le même chiffre pour les personnes qui sont passées par l'enseignement supérieur, un peu moins de 9 hommes sur 10 occupent un emploi contre un peu plus de 8 femmes sur 10.
L'ensemble de ces chiffres viennent confirmer les réalités décrites précédemment. Depuis les années 1980, au nom du remboursement de la dette – qui justifie les coupes budgétaires et les politiques d'austérité – l'État a accentué – ou, à minima, n'as pas suffisamment corrigé – les inégalités d'accès à l'emploi et la dévalorisation des activités occupées par les femmes, et spécifiquement par les femmes racisées. Il accentue également leurs heures de travail gratuit pour assurer la reproduction sociale. De plus, les mesures d'austérité provoquent la fermeture de centres d'accueil et d'autres mesures du même type, augmentant les violences sexistes et sexuelles contre les femmes.
Cette dette du soin, due par la société aux femmes pour toutes les tâches gratuites et sous-rémunérées – à laquelle on peut ajouter une dette patriarcale (pour toutes les agressions, le harcèlement subi par les femmes dans l'espace public), doit être reconnue. Ces deux types de dette impliquent des réparations.
La conjonction du capitalisme néolibéral avec des systèmes patriarcaux et racistes profite donc, de manière largement majoritaire, à une minorité d'hommes blancs. Les femmes et les personnes racisées – et donc spécifiquement les femmes racisées – et plus globalement, les populations des Suds, sont les grandes perdantes de ce système. À tel point qu'une proportion importante des populations des Suds souffre de la faim et de l'extrême pauvreté. Au regard du niveau de richesses mondiales, et des richesses naturelles dont regorgent de nombreux pays des Suds, cette situation est inacceptable.
Notes
[1] Cette partie s'appuie largement sur l'article de Camille Bruneau, Sacha Gralinger, « Mais qui dépend de qui ? In(ter) dépendances et dette patriarcale », Revue Fig, décembre 2023, https://www.cadtm.org/Mais-qui-depend-de-qui-in-ter-dependances-et-dette-patriarcale.
[2] Ces deux phrases sont tirées de Camille Bruneau, Sacha Gralinger, « Mais qui dépend de qui ? In(ter) dépendances et dette patriarcale », Revue Fig, décembre 2023, https://www.cadtm.org/Mais-qui-depend-de-qui-in-ter-dependances-et-dette-patriarcale.
Auteur.e
Maxime Perrio
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Mission d’enquête de l’ONU appelle les États à poursuivre les auteurs de crimes contre les femmes et les filles en Iran

Le Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l'homme à Genève a publié un communiquéde presse le 13 septembre 2024, annonçant la publication d'unemise à jour par la Mission d'enquête indépendante de l'ONU. La Mission a déclaré : « Deux ans après le début des manifestations “Femmes, Vie, Liberté” à la suite de la mort illégale en détention de Jina Mahsa Amini, 22 ans, le gouvernement iranien a intensifié ses efforts pour réprimer les droits fondamentaux des femmes et des filles et écraser les initiatives restantes de l'activisme féminin. »
Tiré de Entre les lignes et les mots
La traduction de la déclaration officielle en anglais est la suivante :
L'Iran intensifie ses efforts pour réprimer les femmes et les filles à l'occasion du deuxième anniversaire des manifestations nationales, selon la mission d'enquête de l'ONU
GENÈVE – Deux ans après le début des manifestations « Femme, vie, liberté » qui ont suivi la mort illégale en détention deJina Mahsa Amini, 22 ans, le gouvernement iranien a intensifié ses efforts pour supprimer les droits fondamentaux des femmes et des filles et écraser les dernières initiatives de militantisme féminin, a averti la Mission internationale indépendante d'établissement des faits sur l'Iran dans une mise à jour publiée aujourd'hui.
Jina Mahsa a été arrêtée par la « police des mœurs » iranienne à Téhéran le 13 septembre 2022 pour non-respect présumé des lois iraniennes sur le hijab obligatoire. Sa mort en détention, le 16 septembre de la même année, a déclenché une vague de protestations qui s'est étendue à l'ensemble du pays.
Au cours des deux années qui ont suivi, bien que les manifestations de masse se soient calmées, le défi permanent des femmes et des jeunes filles nous rappelle sans cesse qu'elles vivent toujours dans un système qui les relègue au rang de « citoyennes de seconde zone ». Depuis avril 2024, les autorités de l'État ont « renforcé les mesures et les politiques répressives par le biais du plan dit “Noor” (noor signifiant “lumière” en persan), encourageant, sanctionnant et approuvant les violations des droits de l'homme à l'encontre des femmes et des jeunes filles qui ne respectent pas le hijab obligatoire », indique la mise à jour.
Les forces de sécurité ont encore intensifié les schémas préexistants de violence physique, notamment en frappant, en donnant des coups de pied et en giflant les femmes et les jeunes filles perçues comme ne respectant pas les lois et les règlements relatifs au hijab obligatoire, comme en témoignent des dizaines de vidéos examinées par la mission de surveillance. Parallèlement, les autorités de l'État ont renforcé la surveillance du respect du hijab dans les sphères publiques et privées, y compris dans les véhicules, en recourant de plus en plus à la surveillance, y compris par drones.
Face à cette escalade de la violence, un projet de loi sur le hijab et la chasteté est en phase finale d'approbation par le Conseil des gardiens de l'Iran et devrait être finalisé dans les plus brefs délais. Ce projet de loi prévoit des sanctions plus sévères pour les femmes qui ne portent pas le hijab obligatoire, notamment des amendes exorbitantes, des peines de prison plus longues, des restrictions en matière de travail et d'éducation et des interdictions de voyager.
La mise à jour a également fait part de sa profonde inquiétude quant à une nouvelle tendance apparente à condamner à mort des militantes, dont certaines appartiennent à des minorités ethniques et religieuses d'Iran, à la suite de leur condamnation pour atteinte à la sécurité nationale.
Au cours des deux dernières années, la peine de mort et d'autres dispositions du droit pénal national, en particulier celles relatives à la sécurité nationale, ont été utilisées pour terroriser les Iraniens et les dissuader de manifester et de s'exprimer librement. Cela a eu des répercussions sur les familles des victimes des violences liées aux manifestations, sur les journalistes, sur les défenseurs des droits de l'homme et sur d'autres personnes critiques à l'égard du gouvernement.
« Les victimes et les survivants, en particulier les femmes et les enfants, n'ont toujours pas la possibilité de demander des comptes pour les violations flagrantes des droits de l'homme et les crimes relevant du droit international, y compris les crimes contre l'humanité », indique la mise à jour.
En l'absence de mesures dissuasives de la part de l'État concernant les violations croissantes à l'encontre des femmes et des filles, il n'y a pas d'espoir réaliste que les victimes et les survivants puissent accéder pleinement et de manière significative aux droits et libertés fondamentaux auxquels ils ont droit et que la République islamique d'Iran a l'obligation de respecter et d'assurer.
La Mission a réitéré son appel au gouvernement iranien pour qu'il mette immédiatement fin à toutes les exécutions de manifestants et mette en place un moratoire sur l'application de la peine de mort, en vue de son abolition ; qu'il libère immédiatement et sans condition toutes les personnes privées arbitrairement de leur liberté dans le contexte des manifestations, en particulier les femmes et les enfants ; et qu'il mette fin à toutes les mesures politiques et institutionnelles répressives prises et conçues pour réprimer les femmes et les filles et perpétuer la violence et la discrimination à l'égard des femmes, y compris le projet de loi sur le « Hijab et la chasteté ».
Compte tenu de l'incapacité du gouvernement à demander des comptes aux auteurs de ces crimes et de l'impunité généralisée qui prévaut en Iran pour les violations flagrantes des droits de l'homme et les crimes relevant du droit international, y compris les crimes contre l'humanité, la mission d'enquête a appelé les États membres des Nations unies à redoubler d'efforts pour garantir les droits des victimes et de leurs familles à la justice, à la vérité et à des réparations.
Les États doivent continuer à faire de la situation des femmes et des filles en République islamique d'Iran une priorité de l'agenda international », indique la mise à jour. « Alors que nous célébrons le deuxième anniversaire des manifestations de septembre 2022, la Mission appelle les États à enquêter, poursuivre et punir les responsables de crimes contre les femmes et les filles commis dans le cadre du mouvement « Femme, vie, liberté », devant leurs tribunaux nationaux respectifs, y compris en vertu du principe de la compétence universelle et sans limitations procédurales ».
La mission exhorte également les États à accélérer les demandes d'asile et à fournir des visas humanitaires aux victimes de violations des droits de l'homme, en particulier à celles qui ont subi des blessures qui ont changé leur vie ou qui sont confrontées à de graves persécutions, notamment les femmes et les enfants.
FIN
Contexte : Le 24 novembre 2022, le Conseil des droits de l'homme des Nations unies a chargé la mission internationale indépendante d'établissement des faits sur la République islamique d'Iran d'enquêter sur les violations présumées des droits de l'homme en République islamique d'Iran liées aux manifestations qui y ont débuté le 16 septembre 2022, en particulier en ce qui concerne les femmes et les enfants. Le 20 décembre 2022, le président du Conseil des droits de l'homme a annoncé la nomination de Sara Hossain (Bangladesh), Shaheen Sardar Ali (Pakistan) et Viviana Krsticevic (Argentine) en tant que trois membres indépendants de la mission et a nommé Sara Hossain présidente de la mission.
https://wncri.org/fr/2024/09/18/mission-denquete-de-lonu/
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Une course aux armements plus déstabilisante que jamais

Le monde a connu des guerres meurtrières, maints conflits et surtout des vagues de dépenses militaires quantitatives et qualitatives qui ont atteint des sommets colossaux.
Tiré de La chronique de Recherches internationales
Michel Rogalski
Directeur de la revue Recherches internationales
Le modèle de référence qui s'impose fut celui de la guerre froide entre les deux Grands de l'époque - Union soviétique et États-Unis – dont la rivalité/affrontement se constitua dès 1917 pour se poursuivre après la seconde guerre mondiale sous la forme d'un conflit entre deux camps, l'URSS ayant étendu son influence. Cette guerre froide adossée sur deux grands pays s'est caractérisée par une course aux armements qui paraissait sans fin et atteint son apogée en 1988, date à laquelle elle s'arrêta pour décroitre d'environ 30 % dans les dix années qui suivirent. On appela cette période, les années des « dividendes de la paix ».
Plusieurs remarques s'imposent. Tout d'abord ce n'est pas l'effondrement du bloc soviétique (1991) qui provoque l'arrêt de la course aux armements, celle-ci ayant cessée trois ans auparavant. L'effondrement ne peut être rapportée à l'incapacité à suivre un rythme effréné de dépenses militaires. En réalité dès octobre 1986 Reagan et Gorbatchev se rencontrent à l'occasion du Sommet de Reykjavik et décident, sans l'acter dans un communiqué final, qu'ils arrêtent la course aux armements. La théorie du « linkage » qui prévalait à l'époque signifiait que tant que l'on n'était pas d'accord sur tout on n'était d'accord sur rien même si cela était faux. Compte-tenue de l'inertie des dépenses militaires le plafond fut atteint dès 1988. Chiffre élevé puisqu'il représentait un taux de militarisation d'environ 8 % (Dépenses militaires rapportées au PIB mondial). C'est dans cette période de la guerre froide qu'apparaît et se développe l'armement nucléaire et toute la technologie qui la rend opérationnelle (missiles, sous-marins, bases de lancements, …) et que le nombre d'acteurs nucléaires prolifère.
Il devient alors évident pour les deux Grands qu'ils s'épuisent mutuellement, alors que dans le même temps les « perdants » de la 2ème guerre mondiale qui se sont vus imposer des limites à leurs efforts de réarmement connaissent des « miracles économiques » (Japon, Allemagne de l'Ouest). Les études économiques se multiplient pour indiquer les pertes de compétitivité que subissent les États-Unis et l'URSS. À cela s'ajoute la certitude croissante que tout dollar ou tout rouble investi dans la course aux armements n'augmente plus la sécurité. Le moteur central de la course aux armements, la recherche de la parité, voir une marge d'avance qui se déclinera pour chaque type d'arme – en clair les conditions d'une agression réussie -, commence à questionner d'autant que certaines puissances se prévalent du concept de la dissuasion du faible au fort, de la puissance suffisante et mettent en avant le principe du pouvoir égalisateur de l'atome.
Mais ce qu'il faut retenir c'est que cette course aux armements de la guerre froide fut strictement codifiée et maîtrisée par ses acteurs. C'est par centaine que des traités et accords furent ratifiés permettant de construire une grammaire respectée par les protagonistes. Il s'agissait de brandir toute à la fois la menace mais aussi d'assurer de sa bonne foi. Dans cette perspective plusieurs types d'accords furent conclus.
D'abord s'assurer que l'arme nucléaire ne proliférerait pas. Ce fut le Traité sur la non-prolifération nucléaire (TNP). L'objectif en établissant une distinction entre États dotés et non-dotés était de promettre à ceux qui ne l'étaient pas une aide apportée par l'AIEA pour mettre sur pieds une industrie nucléaire civile en échange d'une renonciation à tout programme militaire. Le fait de ne pas s'inscrire dans l'accord revenait en fait à dévoiler ses intentions. Peu de pays refusèrent : Israël, le Pakistan, l'Inde, l'Afrique du sud qui peu à peu devinrent des puissances militaires nucléaires. Les pressions occidentales obligèrent ce dernier pays à démanteler son arsenal pour qu'il ne tombe pas entre les mains de l'ANC. La Corée du nord d'est retirée de l'accord et l'Iran est soupçonné de vouloir le contourner. Mais globalement cet accord, largement ratifié, a permis de limiter la prolifération nucléaire même si les États dotés n'ont pas respecté leurs engagements à réduire leur arsenal.
Ensuite des accords sur des plafonds de type d'armes à ne pas dépasser voire à réduire ou à interdire.
Enfin, proposer des accords qui instaurent la confiance et la bonne foi. C'est la démarche des accords Salt signés en cascade à partir des années soixante-dix. Le dernier accord signé entre les États-Unis et la Russie remonte à 2010. Les traités portèrent tout à la fois sur les missiles à moyenne portée (de 500 à 5500 km) ou sur les missiles intercontinentaux. Mais probablement l'engagement le plus fort symboliquement fut celui sur les ABM-Anti-balistic-missiles qui interdisait de protéger ses grandes villes ainsi offertes à toutes représailles de l'adversaire. C'était la preuve de sa bonne foi. Frapper l'ennemi c'était l'assurance de perdre ses grandes villes, pour autant que l'adversaire n'était pas détruit à l'aide d'une première salve.
C'est pourquoi lorsque Ronald Reagan lance en 1981 l'idée d'un bouclier spatial (plus connu sous le terme de « guerre des étoiles ») qui protégerait le territoire américain on comprend que se profile le concept déstabilisant d'une attaque qui n'aurait plus à craindre la riposte. L'espoir caressé portait également dans la certitude que les Soviétiques engagés en Afghanistan n'auraient pas la capacité de suivre. Fort heureusement sur les 17 premiers tests menés par les Américains, seuls deux aboutirent. Le projet fut donc discrètement abandonné.
Jusqu'alors, le cadre international qui s'était construit s'était polarisé autour de grandes puissances qui avaient su créer un enchevêtrement d'accords maillant la planète et qui pouvaient s'observer de plus en plus grâce au progrès des satellites. Puis depuis une quinzaine d'année une obsession bi-partisanne (Démocrate et Républicaine) s'est répandue aux États-Unis faisant de la Chine le principal adversaire, économique et militaire. Le pivot asiatique était né ainsi que les préoccupations de l'Océan indien.
La course aux armements reprenait, mais cette fois-ci entre trois protagonistes et dans des conditions qui n'étaient plus du tout codifiées. En effet la Chine n'avait souscrit à très peu des accords qui liaient les États-Unis à l'Union soviétique puis à la Russie. Elle avait l'avantage d'avoir les mains libres face à ses concurrents. Et elle ambitionna très vite de devenir non seulement une grande puissance économique et commerciale, mais également militaire et développa très vite ses dépenses dans cette direction sans négliger la dimension nucléaire. En face, les États-Unis avaient le sentiment d'affronter la Chine tout en étant contraints par les accords passés de longue date avec l'Union soviétique.
Deux solutions s'imposaient alors. Soit obliger la Chine à ratifier tous les Traités existants pour établir des règles du jeu égales pour tous. Soit sortir de tous les Traités pour avoir les mains libres. C'est ce second choix que firent les États-Unis en dénonçant ou en ne renouvelant pas certains accords. Aujourd'hui la course aux armements se déroule dans un cadre de plus en plus dérégulé et détricoté qui se traduit par l'écroulement progressif de l'architecture de maîtrise des armements héritée de la guerre froide, alors même que des foyers de tensions se développent, des armes tonnent, qu'un conflit majeur a commencé entre l'Otan et la Russie en territoire ukrainien et qu'Israël pouvant se prévaloir de l'aide occidentale met le Moyen-Orient à feu et à sang. S'ajoute à ce sinistre tableau l'apparition d'armes nouvelles comme les drones et les techniques d'observation de plus en plus fines qui permettent d'envisager des opérations plus osées.
Faut-il le rappeler, aucune guerre nucléaire n'est gagnable. La seule inconnue, c'est qui meurt en premier et qui meurt en second ?
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
Cette chronique est réalisée en partenariat rédactionnel avec la revue Recherches internationales à laquelle collaborent de nombreux universitaires ou chercheurs et qui a pour champ d'analyse les grandes questions qui bouleversent le monde aujourd'hui, les enjeux de la mondialisation, les luttes de solidarité qui se nouent et apparaissent de plus en plus indissociables de ce qui se passe dans chaque pays.
Site : http://www.recherches-internationales.fr/
https://shs.cairn.info/revue-recherches-internationales?lang=fr
Mail : recherinter@paul-langevin.fr
Abonnements 4 numéros par an : 55 Euros, Étranger 75 Euros
6, av. Mathurin Moreau ; 75167 Paris Cedex 19

Les messages contradictoires de Washington sur l’incitation à la guerre au Soudan

Le 23 septembre, la Maison Blanche a publié un communiqué résumant la dernière réunion bilatérale entre le président des Émirats arabes unis (EAU), Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, et le président Biden. Ce long document mettait l'accent sur le partenariat étroit entre les États-Unis et les Émirats arabes unis. Dans le sixième paragraphe, intitulé « Partenaires dans un Moyen-Orient et une région plus vaste stables, intégrés et prospères », le communiqué notait l'inquiétude et l'inquiétude communes des dirigeants face à la crise au Soudan, soulignait qu'« il ne peut y avoir de solution militaire » et appelait à la responsabilité des atrocités et des crimes de guerre.
Tiré d'Afrique en lutte.
Tout cela semble louable, jusqu'à ce que l'on se rappelle les preuves indiquant que les Émirats arabes unis soutiennent l'un des antagonistes du conflit soudanais : les Forces de soutien rapide (RSF). Les RSF ressemblent plus à une bande de criminels qu'à une force politique. Il n'existe aucun scénario réaliste dans lequel les RSF gouverneraient un Soudan stable. Les atrocités sont la marque de fabrique des RSF. Cette force indisciplinée et maraudeuse est responsable de violences sexuelles à grande échelle et de nettoyage ethnique. Malgré les appels lancés depuis des mois par l'Union africaine et les Nations unies, les RSF poursuivent leur assaut contre El Fasher, le dernier grand centre de population du Darfour qui n'est pas sous leur contrôle.
Et la situation s'aggrave. Comme l'a rapporté le New York Times le 21 septembre, les Émirats arabes unis ne se contentent pas de soutenir les RSF en leur fournissant des armes, des fonds et des drones. Ils le font sous couvert d'apporter une aide humanitaire au peuple soudanais, entachant la crédibilité de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et, comme le dit le Times , « en s'engageant publiquement à soulager les souffrances du Soudan tout en les attisant en secret ». Ces souffrances sont d'une ampleur presque inimaginable. Quelque douze millions de personnes ont été contraintes de fuir leur foyer. Les civils meurent de faim parce qu'aucune des parties au conflit ne prend au sérieux son obligation d'autoriser l'accès de l'aide humanitaire. Les experts en sécurité alimentaire estiment que des millions de Soudanais pourraient mourir de famine dans les mois à venir.
Pourquoi Washington se rallie-t-il à la mascarade grotesque des Émirats arabes unis en faisant une déclaration qui suggère que nous sommes des partenaires alignés pour la paix ? Comment les États-Unis comptent-ils demander des comptes aux parties au conflit pour les promesses non tenues qui ont entravé les efforts de médiation alors que notre gouvernement fait lui aussi des déclarations qui ne correspondent pas aux faits ? Comment le gouvernement américain voudrait-il que les civils soudanais, épuisés par près d'un an et demi de guerre, de déplacements massifs et de famine imminente, comprennent-ils qu'il s'associe aux Émirats arabes unis ?
On peut espérer que la réalité alternative décrite dans la déclaration de la Maison Blanche faisait partie du prix à payer pour obtenir un véritable engagement de la part des Émirats arabes unis à cesser de verser de l'huile sur le feu qui engloutit le Soudan. Le 24 septembre, un jour après sa rencontre avec Ben Zayed, le président Biden a déclaré à l'Assemblée générale des Nations unies que « le monde doit cesser d'armer les généraux, parler d'une seule voix et leur dire : arrêtez de déchirer votre pays. Arrêtez de bloquer l'aide au peuple soudanais. Mettez fin à cette guerre maintenant. » On peut espérer qu'il a fait écho à ce message au dirigeant émirati à huis clos, malgré le discours optimiste. Mais en l'absence de toute preuve que ce soit le cas, l'exhortation de Biden à l'ONU semble cynique. Lues ensemble, les deux déclarations apparaissent comme une terrible trahison et une volonté de se joindre à un riche État du Golfe pour manipuler le reste du monde.
Michelle Gavin
Source : https://www.cfr.org/blog/africa-transition
Traduction automatique de l'anglais
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Rwanda : sous la façade de la démocratie de consensus

25 ans après que le dialogue inter-rwandais a donné naissance à la « démocratie de consensus », il est désormais temps de revisiter et de renouveler le système.
Tiré d'Afrique en lutte.
À l'occasion de la Journée internationale de la démocratie, les nations se rassemblent pour célébrer les valeurs fondamentales qui définissent les véritables sociétés démocratiques : l'État de droit, la participation active des citoyens, des institutions indépendantes et un profond respect des droits de l'homme. Pourtant, au Rwanda, sous la direction du président Paul Kagame, ces principes restent largement théoriques. Malgré la rhétorique de Kagame sur une « démocratie unique » adaptée au contexte rwandais, un discours souvent repris sur les plateformes internationales comme lors du Sommet 2024 du Forum sur la coopération sino-africaine qui vient de s'achever, au cours duquel il a déclaré que « chaque pays doit tracer sa propre voie en fonction de son contexte, de son histoire et de ses aspirations uniques ». La réalité sur le terrain contraste fortement avec ces idéaux. Le Rwanda offre un exemple troublant où l'apparence de progrès et de gouvernance démocratique masque un régime profondément répressif.
Le gouvernement rwandais affirme fonctionner dans le cadre d'une « démocratie de consensus », un système convenu lors du dialogue interrwandais qui a eu lieu en 1999 et qui est censé être adapté au contexte post-génocide unique du pays. L'idée derrière ce modèle est de promouvoir l'unité et d'empêcher les politiques de division en prenant des décisions par consensus plutôt que par la règle de la majorité. Cependant, la manière dont ce modèle est mis en pratique viole la Constitution rwandaise, qui consacre les principes démocratiques tels que le pluralisme, des élections libres et équitables et le droit à la participation politique.
En réalité, la prétendue démocratie de consensus au Rwanda est un mécanisme destiné à réprimer la dissidence et à maintenir le pouvoir du parti au pouvoir. Elle réduit effectivement au silence les voix de l'opposition, laissant peu de place au véritable discours politique ou à la concurrence. Les dispositions de la Constitution relatives à la démocratie, aux droits de l'homme et aux libertés civiles sont ainsi sapées, réduisant la Constitution à un simple document sans grande incidence sur le paysage politique réel.
La véritable démocratie repose sur la participation active des citoyens. Or, au Rwanda, cette participation fait cruellement défaut et le pays se situe bien en dessous de la moyenne de l'Afrique subsaharienne en matière de « liberté d'expression et de responsabilité ». L'opposition politique au Rwanda est non seulement découragée, mais elle est souvent confrontée à de graves intimidations, harcèlements et même à des peines d'emprisonnement.
Diane Rwigara , militante et femme d'affaires, en est un exemple frappant . Après avoir annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2017, elle a été disqualifiée, soumise à une campagne de dénigrement et même emprisonnée. Elle a été acquittée une fois les élections terminées.
Un autre exemple marquant de Christopher Kayumba . En septembre 2021, peu après avoir fondé un journal en ligne appelé « The Chronicles » et créé une organisation politique, Kayumba a été accusé de viol. Il a été détenu pendant 17 mois, au cours d'une longue et éprouvante bataille juridique. Il a été acquitté de cette accusation. Mais l'expérience semble avoir eu un effet dissuasif : Kayumba ne s'est pas exprimé sur la politique depuis sa libération.
Ces cas illustrent la manière dont le gouvernement rwandais réprime systématiquement la dissidence, en utilisant le système juridique comme un outil pour étouffer l'opposition politique et décourager les autres de remettre en cause le statu quo.
Les rares partis d'opposition qui existent sont soit cooptés par le gouvernement, soit soumis à de sévères contraintes, ce qui rend la participation citoyenne quasi impossible. Ce climat étouffant est non seulement contraire à l'esprit de la démocratie, mais aussi à la lettre des garanties constitutionnelles du Rwanda.
Au Rwanda, le pouvoir judiciaire, le Parlement et l'exécutif sont étroitement liés, fonctionnant davantage comme des outils de l'élite dirigeante que comme des institutions indépendantes chargées de faire respecter l'État de droit. Plutôt que de servir de contre-pouvoirs, ils servent à renforcer l'emprise autoritaire du président Paul Kagame sur le pays.
Ceux qui osent remettre en cause ou sont perçus comme remettant en cause le discours du gouvernement sont régulièrement détenus sous des accusations vagues ou inventées. Nombre d'entre eux ne bénéficient jamais d'un procès équitable et certains sont confrontés à des conséquences désastreuses, y compris la disparition, voire la mort, pendant leur détention par les autorités. Prenons le cas de Boniface Twagirimana, un haut responsable du parti d'opposition FDU-Inkingi, qui a mystérieusement disparu d'une prison de haute sécurité en 2018, les autorités affirmant qu'il s'était évadé. À ce jour, on ignore où il se trouve et beaucoup pensent qu'il a été tué pendant sa détention. Son cas est emblématique d'un schéma plus large de détention arbitraire et de non-respect des droits humains fondamentaux.
La mort de Kizito Mihigo , un chanteur de gospel populaire, illustre une fois de plus le contrôle exercé par le régime sur le système judiciaire. Mihigo a été arrêté en 2020 pour avoir prétendument tenté de fuir le pays et a été retrouvé mort dans sa cellule de prison peu de temps après. Les autorités ont affirmé qu'il s'agissait d'un suicide, mais l'absence d'enquête approfondie et indépendante ne fait que souligner la culture de l'impunité qui prévaut au Rwanda. Comme le souligne le rapport de Human Rights Watch « Rejoignez-nous ou mourez » , les forces de sécurité du gouvernement rwandais ont systématiquement recours aux exécutions extrajudiciaires et aux disparitions pour éliminer toute menace perçue contre le régime de Kagame.
Dans certains cas, le Rwanda va jusqu'à violer ses obligations internationales. Le cas de Victoire Ingabire , une figure de proue de l'opposition, est un parfait exemple de la façon dont le Rwanda a violé le système juridique international. En 2010, Victoire Ingabire a été arrêtée et condamnée à 15 ans de prison pour des motifs politiques, de terrorisme et d'atteinte à la sécurité nationale. Le gouvernement rwandais a ignoré une décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui l'a acquittée de toutes les charges.
Outre le pouvoir judiciaire, le parlement rwandais manque également d'indépendance. Il fonctionne davantage comme une institution d'approbation automatique des politiques de Kagame que comme un organe représentant la volonté du peuple. Les débats critiques sur des questions nationales importantes, telles que les violations des droits de l'homme ou le traitement des prisonniers politiques, sont notablement absents des sessions parlementaires. Les parlementaires, dont beaucoup doivent leur position à leur loyauté envers le parti au pouvoir, s'abstiennent de contester l'exécutif, renforçant ainsi le régime autoritaire de Kagame.
Dans ce système, l'exécutif exerce un pouvoir illimité et Kagame contrôle presque tous les aspects de la gouvernance rwandaise. Cette consolidation de l'autorité ne laisse aucune place au fonctionnement indépendant des autres pouvoirs du gouvernement. Les lois sont appliquées de manière sélective pour cibler les détracteurs de Kagame tandis que ses fidèles restent à l'abri des poursuites, même lorsqu'ils sont impliqués dans de graves abus.
Le Rwanda est l'un des pays où le taux de représentation des femmes au parlement est le plus élevé, un chiffre souvent salué comme un signe de progrès. Mais ce résultat cache un problème plus profond : le parlement rwandais est loin d'être indépendant, la grande majorité de ses membres étant membres du parti au pouvoir . Il fonctionne davantage comme un organe d'approbation automatique de l'exécutif que comme un moyen de contrôle de son pouvoir.
Malgré le pourcentage élevé de femmes au parlement, leur présence ne contribue guère à promouvoir la démocratie ou les droits de l'homme. Ces parlementaires dénoncent rarement, voire jamais, les violations des droits de l'homme ou ne remettent pas en cause les actions du gouvernement. Le taux élevé de représentation féminine est donc une façade utilisée pour renforcer l'image internationale du Rwanda tout en masquant la réalité de sa gouvernance non démocratique.
Aucun des cas mentionnés ci-dessus n'a jamais été débattu au Parlement, ce qui met en évidence le manque d'indépendance du corps législatif rwandais. Cette absence de débat critique sur les questions urgentes liées aux droits de l'homme est une indication claire que les parlementaires rwandais ne sont pas libres d'agir de manière indépendante mais sont plutôt limités par les intérêts du parti au pouvoir.
Les élections de 2024 au Rwanda ont une fois de plus mis en évidence le profond déficit démocratique du pays. La victoire écrasante, presque stalinienne, revendiquée par Paul Kagame reflète les schémas des élections passées, où les résultats étaient prédéterminés et les voix de l'opposition réduites au silence. Ce résultat ne reflète pas un véritable processus démocratique, mais la continuation d'un régime qui utilise les élections comme une façade pour maintenir le contrôle, étouffant toute véritable compétition politique ou contestation.
Les leaders de l'opposition comme Victoire Ingabire, Bernard Ntaganda et Diane Rwigara se sont vu interdire de participer au scrutin. Ces trois hommes avaient auparavant été victimes de harcèlement, d'emprisonnement et de recours judiciaires destinés à les empêcher de se lancer dans une quelconque opposition politique sérieuse.
L'exclusion des véritables candidats de l'opposition garantit que les résultats des élections seront acquis d'avance, ce qui renforcera encore davantage la domination du FPR. Un tel processus ne peut être considéré comme une élection libre ou équitable, mais plutôt comme la continuation du régime dictatorial du Rwanda sous couvert de démocratie.
Les rapports d'organisations internationales comme Freedom House et Human Rights Watch dressent un sombre tableau de la démocratie rwandaise. Freedom House considère systématiquement le Rwanda comme « non libre », en raison des graves restrictions imposées aux droits politiques et aux libertés civiles. Human Rights Watch a recensé de nombreuses violations des droits humains, notamment la répression des médias, la détention arbitraire et la persécution des opposants politiques.
Ces rapports soulignent l'urgence pour la communauté internationale de réévaluer son engagement envers le Rwanda. La situation actuelle dans le pays n'est pas tenable et un soutien international continu sans obligation de rendre des comptes ne fait qu'encourager le gouvernement rwandais à persister dans ses pratiques répressives.
Une véritable démocratie, caractérisée par des élections libres et équitables, une participation politique ouverte et des médias indépendants, menace de plusieurs façons l'emprise de Paul Kagame sur le pouvoir. La démocratie implique la concurrence et la dissidence, deux éléments que le gouvernement de Kagame a historiquement réprimés. Elle incarne également la séparation des pouvoirs et pourrait révéler les violations des droits de l'homme et d'autres défauts du gouvernement de Kagame.
Alors que le monde commémore la Journée internationale de la démocratie, il est essentiel que la communauté internationale regarde au-delà de l'image soigneusement entretenue du Rwanda et affronte les dures réalités de sa gouvernance. La façade démocratique du pays ne doit pas être confondue avec de véritables pratiques démocratiques. Les dirigeants rwandais doivent rendre des comptes et la communauté internationale doit exiger des réformes significatives qui donnent la priorité à l'État de droit, aux droits de l'homme et à une véritable participation citoyenne.
Le président rwandais Paul Kagame a par le passé subi des pressions de la part des bailleurs de fonds occidentaux, notamment des États-Unis et du Royaume-Uni, pour faire avancer les réformes démocratiques. Lors de l'Examen périodique universel du Rwanda de 2021, le Royaume-Uni a publié une déclaration publique exhortant le gouvernement rwandais à renforcer la gouvernance démocratique , notamment en favorisant la liberté de la presse et en garantissant des élections plus transparentes.
De même, lors de sa visite au Rwanda en 2022, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a publiquement fait part de ses inquiétudes concernant les violations des droits de l'homme et de la nécessité pour le Rwanda d'élargir les libertés politiques, de s'attaquer à des problèmes tels que la détention de détracteurs du gouvernement comme Paul Rusesabagina. Washington a souligné l'importance de protéger la liberté d'expression et de créer davantage d'espace politique pour les partis d'opposition. Bien que ces pressions reflètent un intérêt occidental plus large pour la promotion des droits de l'homme et des normes démocratiques au Rwanda, il reste encore beaucoup à faire.
Tout comme le Rwanda a adopté une forme de démocratie de consensus par le biais du dialogue inter-rwandais en 1999, il est temps aujourd'hui de revoir et de renouveler ce système et de remédier aux faiblesses qui ont été mises en évidence au cours des 25 dernières années. Il est en effet nécessaire d'organiser un nouveau dialogue inter-rwandais réunissant des responsables gouvernementaux et des opposants politiques ainsi que des représentants de la société civile du Rwanda et de l'extérieur, afin de convenir d'un cadre politique qui aborde des questions telles que l'exclusion politique, le manque de participation des citoyens et le respect des droits de l'homme et de l'état de droit qui caractérisent la démocratie de consensus pratiquée au Rwanda depuis 25 ans.
En conclusion, l'absence de démocratie au Rwanda n'est pas seulement un problème national, mais un problème mondial qui exige une action immédiate. La communauté internationale doit soutenir le peuple rwandais dans sa lutte pour une véritable démocratie, une démocratie dans laquelle sa voix est entendue, ses droits respectés et ses dirigeants responsables. Ce n'est que par des efforts collectifs que le Rwanda pourra véritablement incarner les valeurs de la démocratie, non seulement aujourd'hui, mais pour l'avenir.
Denise Zaneza
Source : https://africanarguments.org/2024/09/rwanda-beneath-the-facade-of-consensus-democracy/
Traduit de l'anglais automatiquement
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Sahara occidental : Résister au colonialisme marocain

Face à l'oppresseur et aux multiples formes de soutien dont il dispose de la part des occidentaux et de l'Union européenne, en particulier de la France, de l'Espagne, des États-Unis et d'Israël, s'engager comme le fait le Front Polisario dans la résistance armée comme l'un des moyens à opposer à l'occupant marocain est conforme à la Charte des Nations unies et du Droit international.
Tiré du site du CADTM. Photo Dakhla, Western Sahara - cc
Car il est évident que le problème n'est pas la résistance armée du peuple sahraoui contre le colonisateur marocain mais bien l'occupation et le projet annexionniste de ce dernier.
Le peuple sahraoui est un peuple éminemment pacifiste qui a toujours témoigné de son souhait de coexistence et de coopération avec les autres nations de la région du Maghreb et de l'Union africaine. Il l'a démontré en faisant confiance, ces 25 dernières années, aux Nations unies et sa promesse de réaliser en 1990 un référendum d'autodétermination tel que prévu par la Résolution XV 14 de l'AGNU, réaffirmé chaque année par la 4e Commission de l'AG des Nations unies. C'est ainsi que fut signé par le Front Polisario et le Royaume du Maroc, sous les auspices du Secrétaire général des Nations unies à New York, l'accord de cessez-le-feu devant permettre l'identification des votants au référendum sous les auspices de la Mission des Nations unies pour l'organisation du référendum au Sahara occidental, la MINURSO.
Après dix ans de travail d'identification, malgré les nombreux obstacles voulus par le Maroc, lorsque la MINURSO remis les listes des votants, et le Maroc constatant qu'il risquait de perdre le référendum, en rejeta la mise en œuvre. Il avança alors l'alternative suggérée par l'Élysée (à l'époque de Jacques Chirac) d'un plan de large autonomie au sein de l'entité marocaine. Depuis ce temps, le Maroc, tout en revendiquant le Sahara marocain, ne cesse de s'abriter derrière ce dit plan d'autonomie. Il oublie que cette autonomie fut offerte par la plupart des ex-puissances coloniales mais fut rejetée par tous les mouvements de libération africains en lutte pour leur indépendance.
Il y a quatre ans, le président américain Donald Trump, tel un seigneur féodal, offrit le Sahara occidental au Roi du Maroc en échange de l'acceptation par ce dernier des accords d'Abraham, assujettissant le Maroc à une alliance avec Israël dans le cadre de la vision des USA du Great Middle East.
Le Maroc poursuit aujourd'hui ses tentatives d'accaparement du Sahara occidental, avec l'aide militaire et l'assistance technique d'Israël, en utilisant la répression comme la violence meurtrière. Dans le même temps, et comme Israël dans les Territoires palestiniens occupés (TPO), le Maroc colonise, prélève et exploite à son profit les ressources naturelles des Sahraouis, et ce en violation du Droit international et des arrêts tant de la Cour européenne de Justice, s'agissant des accords de partenariat U.E./ Maroc, que de la Cour africaine des Droits humains et des droits des peuples.
Depuis 1975, les Sahraouis ont connu le même sort que les Palestiniens en étant chassés de leur territoire. Les deux peuples ont été déplacés de force et survivent, pour la plupart, grâce à l'accueil qui leur est réservé par des pays frères, telle l'Algérie en ce qui concerne les Sahraouis. Dans les territoires occupés par le Maroc, les Sahraouis, parmi lesquels d'héroïques résistants et résistantes sont violemment réprimés et privés de leurs libertés les plus fondamentales.
Le drame que vivent tant les Sahraouis que les Palestiniens s'appelle le colonialisme ,dans sa forme la plus brutale et barbare. Ce colonialisme n'existe en outre que grâce à la complicité des occidentaux, en particulier de la France, de l'Espagne et des États-Unis. C'est ainsi que le Maroc, comme Israël, se croit au-dessus des lois, du droit et des grandes conventions internationales.

Aujourd'hui, dans leurs luttes de résistance contre l'envahisseur colonialiste, les Palestiniens comme les Sahraouis ne sont pas les avatars d'un colonialisme historiquement condamné et dépassé, ils sont l'avant-garde d'un monde où se produit la deuxième grande étape de l'émancipation des peuples du Grand Sud, confrontés à la domination impériale des multinationales et des grands groupes financiers.
Nombre de grands médiateurs internationaux, tels l'ambassadeur De Mistura, Francesca Albanésé ou encore Jean Ziegler, nombre de mouvements de solidarité pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, d'associations citoyennes, de syndicats et de jeunes, perçoivent cette nouvelle aspiration émancipatrice des peuples cherchant un nouveau modèle de coopération et de sécurité pour leur assurer les garanties nécessaires à la paix dans le respect de leur indépendance et la gestion de leurs ressources pour leur bien-être. L'attente des opprimés et des affamés n'a que trop duré. Il est temps de leur donner raison et de revenir aux tables de négociations pour initier un renouveau de l'Organisation des Nations unies et de leur rôle central.
Les massacres génocidaires commis par Israël à Gaza, mais aussi en Cisjordanie et à Jérusalem, ont suscité un éveil mondial et de nouvelles mobilisations qui s'inscrivent dans les grandes étapes des soutiens aux luttes d'émancipation des peuples conduites en Algérie par le FLN et Ben Bella, au Vietnam par Hô Chimin, en Afrique par A. Neto, Mondlane, GA.Nasser, Nyerere, Lumumba, Th. Sankara, S. Nujoma, Sekou Tourré, Nkummah, J. Nyerere et N. Mandela, sans oublier Gandhi, Soekarno, Moa et Gusmao en Asie ou encore F. Castro et S. Allende en Amérique latine et tant d'autres encore.
Palestiniens et Sahraouis sont aujourd'hui des maillons solides de l'histoire qui pousse les peuples à décider souverainement de la conduite de leur lutte pour imposer à la communauté des Nations ce qui est juste. Les formes multiples de rébellion légitime qu'ils adoptent pour faire respecter leurs droits les plus fondamentaux au regard du Droit international qu'ils ont contribué à créer, se fondent sur leur droit à être respectés, ce qui n'est en fait qu'une nécessité existentielle face à l'aliénation qui leur est imposée par la force brutale des armes et des marchands.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

En Martinique, l’arrivée de la CRS 8 rappelle le douloureux passé de l’île avec cette unité de police

MARTINIQUE - Une mesure tristement symbolique alors que la Martinique est confrontée à une profonde crise liée au coût de la vie. La colère de la population s'est concrétisée par plusieurs nuits de violences urbaines qui ont poussé les autorités locales à instaurer un couvre-feu et à interdire les manifestations. Et ce samedi 21 septembre, il a été annoncé que la huitième Compagnie Républicaine de Sécurité (CRS) va être déployée sur l'île.
22 septembre 2024 | tiré d'Europe solidaire sans frontières |
https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article72022
En route pour l'île depuis samedi soir selon l'AFP, confirmant une information de BFMTV, la CRS 8 va venir prêter main-forte au GAN (Groupe d'Appui de Nuit) sur place. Une décision qui est justifiée par l'importante circulation d'armes à feu sur l'île. Des policiers avaient d'ailleurs été victimes de tirs à balles réelles plus tôt dans la semaine.
Cette unité d'élite spécialisée dans la lutte contre les violences urbaines, créée en 2021 par Gérald Darmanin, avait déjà été déployée en avril 2023 à Mayotte pour renforcer les effectifs de l'opération de sécurisation de Mayotte, baptisée « Wuambushu ». Mais aujourd'hui cette décision pose question en raison du lourd passif de l'île avec les CRS.
Trois jeunes tués en 1959
Comme le rappelle justement La 1re au lendemain de cette annonce sécuritaire, les policiers de la CRS 8 « sont prioritairement engagés sur des missions de maintien et rétablissement de l'ordre, lutte contre les violences urbaines et les émeutes, assistance et renfort aux autres directions de la police nationale » lorsque la menace est « particulièrement forte ».
Cette description résonne comme un triste écho aux émeutes de décembre 1959 en Martinique, date à partir de laquelle « aucune compagnie républicaine de sécurité n'avait été autorisée à intervenir » sur l'île, souligne le média ultramarin.
Cette année-là, trois jours de soulèvement provoqués par un banal accident de la route sur fond de crise économique et sociale avaient conduit à des émeutes entre la police nationale − dont un détachement de CRS − et de jeunes manifestants martiniquais. Bilan ? Trois jeunes tués par les forces de l'ordre, provoquant un grave choc chez les responsables politiques locaux, extrêmement surpris par la brutalité des forces de l'ordre déployées.

En réaction, les élus martiniquais de tous bords politique avaient exigé « que des conversations soient entamées immédiatement entre les représentants qualifiés des Martiniquais et le Gouvernement pour modifier le statut de la Martinique en vue d'obtenir une plus grande participation à la gestion des affaires martiniquaises ». Dans un extrait de la motion du Conseil Général de Martinique le 24 décembre 1959, citée par La 1re, le « retrait de tous les CRS et des éléments racistes indésirables » avait donc été acté et respecté… jusqu'à ce samedi 21 septembre 2024.
Maxime Birken
P.-S.
• Le HuffPost. 22/09/2024 13:08 Actualisé le 22/09/2024 15:50 :
https://www.huffingtonpost.fr/france/article/en-martinique-l-arrivee-de-la-crs-8-rappelle-le-douloureux-passe-de-l-ile-avec-cette-unite-de-police_239938.html
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Un oubli impardonnable pour la gauche : la situation de la classe ouvrière

Lorsqu'un marxiste révolutionnaire est interrogé sur la situation d'un pays, il dispose de trois cadres référentiels et catégoriels pour répondre.
20 septembre 2024 | tiré du site inprecor.org
https://inprecor.fr/node/4302
Le premier cadre, basique et élémentaire, préalable et déterminant par rapport aux autres, renvoie aux conditions de la classe ouvrière, notamment à sa situation matérielle de vie et de travail (salaires, inflation, pouvoir d'achat, accès aux services de base et à la sécurité sociale) et au régime de libertés politiques dans lequel se déroule son processus de prise de conscience en tant que classe (liberté d'organisation syndicale, liberté de formuler des contrats collectifs, de présenter des revendications contradictoires, droit de grève, droit de mobilisation, possibilités de s'organiser en partis politiques révolutionnaires, liberté d'opinion et de production intellectuelle, entre autres).
Le deuxième cadre, les conditions dans lesquelles la bourgeoisie et les classes (et castes) dirigeantes s'approprient les richesses, le modèle dominant d'accumulation capitaliste, les caractéristiques du modèle de représentation politique qui exprime la domination bourgeoise et le régime de libertés politiques dont les riches disposent pour devenir de plus en plus riches.
Le troisième cadre, la relation des bourgeoisies nationales avec les nations impérialistes et les centres du capitalisme mondial, qui implique un débat actualisé sur les types d'anti-impérialisme, parmi lesquels les réarrangements des bourgeoisies nationales et de leurs systèmes de relations qui peuvent provoquer des fissures temporaires avec les liens historiques avec le centre impérialiste, et qui sont présentés comme de l'anti-impérialisme. Toute contradiction temporaire ou circonstancielle n'est pas de l'anti-impérialisme. Aujourd'hui, un anti-impérialisme cohérent et durable est un anticapitalisme.
Il est impossible de parvenir à une compréhension globale des deuxième et troisième cadres de l'analyse catégorielle sans une définition correcte du premier.
Depuis les premières heures du 29J-2024, lorsque le président du Conseil national électoral (CNE) du Venezuela, Elvis Amoroso, a annoncé les résultats des élections tenues la veille, une controverse s'est déclenchée sur la transparence et la fiabilité des données étayant l'annonce. Cette situation a généré un débat et une fissure dans la gauche internationale autour de trois grands pôles : le premier, celui de la géopolitique, le deuxième celui de la négociation pour sortir de la crise de légitimité, et le troisième celui du point de vue du monde du travail.
Le bloc majoritaire, celui de la géopolitique, pose tout en termes de « gauche au gouvernement » contre « droite et ultra-droite dans l'opposition ». Les catégories de droite et de gauche sont des signifiants vides si elles ne partent pas de la conformation et des confrontations entre classes sociales, des processus d'accumulation du capital et des rapports d'oppression ou de libération avec les classes subalternes, notamment la classe ouvrière.
Les partisans de la géopolitique ne mentionnent pas les processus de formation d'une nouvelle bourgeoisie dans le processus bolivarien, mis en évidence par des événements tels que la crise bancaire de 2009 (fermeture de banques créées avec des capitaux issus des relations avec le gouvernement) ou la révélation de la méga-corruption de l'affaire PDVSA-Cripto impliquant une centaine de dirigeants du PSUV, dont l'un des membres du bureau politique (on a parlé de 3 milliards de dollars, puis de 15 milliards de dollars et dernièrement de 23 milliards de dollars).
Il ne suffit pas de maintenir un discours de gauche pour être de gauche, si cela couvre l'incubation d'un secteur bourgeois et le maintien du modèle rentier de l'accumulation bourgeoise. Les programmes et les actions des gouvernements doivent être évalués au-delà des formalités discursives, pour cela il est important de les confronter ou de les relier à la logique d'accumulation et de distribution de la richesse nationale.
Le bloc géopolitique omet cela. Il ne consulte pas la gauche historique vénézuélienne PCV-authentique, le vrai PPT, les Tupamaros historiques, entre autres, pour savoir s'il y a cohérence et consistance entre la définition de la gauche par le gouvernement et sa pratique.
Le pire des « arguments de la gauche géopolitique » est que si le gouvernement vénézuélien « tombe », cela aura un effet désastreux sur la formation et l'avancée de la gauche dans leur pays, ignorant le discrédit social continental et mondial croissant du madurisme dans leurs pays, qui est ce qui les affecte vraiment.
Mais, de plus, dans le meilleur des cas, cette définition « géopolitique » implique une demande de sacrifice de la classe ouvrière vénézuélienne, d'acceptation soumise de ses conditions d'exploitation et d'oppression dans son propre pays, afin que les autres gauches au niveau international puissent, comme un bouchon, rester à flot. Il est terrible de penser seulement à demander ce sacrifice à la classe ouvrière vénézuélienne.
Le deuxième bloc est celui de la négociation, de l'accord pour sortir de la crise. Dans cet effort, nous trouvons les gouvernements du Brésil (Lula), de la Colombie (Petro), jusqu'à récemment du Mexique (AMLO) et, par intermittence, du Chili (Boric). Ce secteur semble être inspiré par le désir d'éviter une plus grande détérioration sociale et la possibilité de générer une atmosphère de commotion et de guerre civile dans le pays. Malgré leurs bonnes intentions louables, leurs efforts ont le défaut d'omettre deux éléments fondamentaux : 1) la situation matérielle et les libertés de la classe ouvrière vénézuélienne et 2) le fait que l'authentique gauche vénézuélienne (PCV, PPT, Tupamaros et autres groupes qui n'ont pas été autorisés à légaliser leurs partis) est hors-la-loi, n'a aucune possibilité d'obtenir une personnalité juridique ou une participation autonome dans le cadre électoral. Cette omission n'est pas un problème mineur.
Récemment, ce secteur a proposé (Lula et Petro) la tenue de nouvelles élections nationales pour sortir de l'impasse générée par le refus du gouvernement de montrer les procès-verbaux qui appuient la déclaration de triomphe de Maduro, alors que l'opposition a publié sur son propre site web plus de 81 % des copies des procès-verbaux, que le gouvernement accuse de ne pas être authentiques. Cette proposition de nouvelles élections doit être comprise comme une voie de continuité avec les politiques d'accord inter-bourgeois (ancienne et nouvelle bourgeoisie) promues par le gouvernement Maduro entre 2018-2024, qui n'ont pas réussi à se conclure en raison de la résistance d'un secteur de l'ancienne bourgeoisie dont María Corina Machado (MCM) fait partie et qu'elle représente.
De nouvelles élections ne pourraient évidemment pas être organisées à court terme, car elles déboucheraient sur une nouvelle impasse, mais devraient l'être à moyen terme (deux ans ou plus), précédées par la formation d'un gouvernement de cohabitation, de consensus ou d'intégration qui construise la viabilité d'une éventuelle transition (lois qui protègent le régime de Maduro de la prison, garanties pour la nouvelle bourgeoisie du respect de son patrimoine et des possibilités de continuer à accumuler). Le MCM s'est rapidement opposé à cette proposition parce qu'elle représente un secteur liquidationniste de la nouvelle bourgeoisie, qui va dans le sens d'un formatage de tout ce qui s'est passé – et accumulé par la nouvelle bourgeoisie – au cours des vingt-cinq dernières années.
C'est-à-dire que la question centrale aujourd'hui – sortir de l'impasse conjoncturelle de la logique du capital – est un accord inter-bourgeois, mais l'atteindre ne signifie pas la résolution de la crise du modèle d'accumulation et de représentation politique de la bourgeoisie initiée en 1983, mais il ouvre des voies dans cette direction. Les politiques de renversement de la bourgeoisie maduriste ou du secteur bourgeois représenté par Machado commencent à inquiéter la bourgeoisie latino-américaine, car cela pourrait créer une situation incontrôlable ; la médiation des présidents progressistes de la région tente de contribuer à éviter ce risque, en construisant un chemin de rencontre pour les secteurs bourgeois en conflit.
Le troisième bloc est constitué par les différentes nuances de la gauche qui s'appuient sur l'analyse de classe. Ce secteur, minoritaire dans ses relations partisanes au niveau international, a du mal à faire valoir ses arguments face au maelström médiatique qui installe l'idée d'une polarisation en deux blocs antagonistes (droite contre gauche, ignorant la lutte inter-bourgeoise et l'existence d'organisations à gauche du Madurismo).
La gauche vénézuélienne non maduriste est celle qui comprend le mieux ce qui se passe structurellement, mais elle a tendance à avoir des difficultés à proposer des analyses dans un langage compréhensible par la majorité de la population, qui parvienne à dépasser l'aspect pamphlétaire, le sectarisme ou l'ultra-gauchisme et même la « politique du foie ». Ce secteur a besoin de renouveler son discours pour peser davantage dans le débat et contribuer à clarifier la situation des organisations sociales et politiques de la classe ouvrière internationale.
Les discours qui présentent ce qui existe au Venezuela comme une contradiction entre la droite et la gauche, ou qui, même face aux erreurs du Madurismo, privilégient son « indépendance » vis-à-vis de l'impérialisme américain, constituent un large spectre connu sous le nom de « campisme », sont prépondérants.
L'oubli impardonnable de la gauche campiste (qui pose tout en termes de noir et de blanc) est que son lieu d'énonciation, de communication et de prise de position n'est pas la situation matérielle de la classe ouvrière vénézuélienne et les causes multiples de cette situation, qui incluent l'effet du blocus américain, mais aussi les politiques néolibérales et anti-ouvrières du gouvernement Maduro.
15/09/2024
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Pacte asile et migration : un pas de plus dans la nécropolitique européenne

L'adoption par les instances de l'Union européenne du « Nouveau Pacte sur la Migration et l'Asile », en avril de cette année, s'est faite à bas bruit. Ce nouveau durcissement des politiques migratoires de l'UE s'explique en partie par la pression croissante des droites radicales, xénophobes et racistes. Mais il renvoie aussi à des facteurs d'ordre structurels, inscrits dans la logique même de l'intégration européenne et de la conception de la « liberté de circulation » qui y est à l'œuvre. C'est ce que montre Emmanuelle Carton dans cet article.
24 septembre 2024 | tiré de contretemps.eu
https://www.contretemps.eu/pacte-asile-migration-necropolitique-europeenne/
***
En cette année 2024, les politiques migratoires en Europe offrent un tableau bien sombre. La Méditerranée demeure un chemin mortifère pour les milliers de personnes qui empruntent la voie maritime pour atteindre les côtes européennes, tandis que la Manche représente toujours un passage mortel pour rejoindre le Royaume-Uni. De même, l'Atlantique est quotidiennement traversé par des candidat·es à la migration et à l'asile, qui empruntent la voie maritime séparant l'Afrique des Canaries (Espagne). Le 10 avril 2024, l'Union européenne (UE), complice de ce bilan macabre, a franchi un nouveau cap vers une « nécropolitique »[1]. L'adoption du nouveau pacte sur la migration et l'asile par les vingt-sept pays de l'Union se traduira par une sélection brutale entre les personnes qui seront sauvées et celles qui seront condamnées. Après le vote des eurodéputé·es et l'approbation du Conseil de l'UE, le texte entrera en vigueur d'ici 2026. Ce pacte renforce une politique centrée sur les frontières, qui érige des barrières contre l'immigration dite « irrégulière » et risquant dès lors d'intensifier les dangers rencontrés par les nouveaux et nouvelles arrivant·es[2] tout au long de leur périple. Le texte prévoit un durcissement du contrôle à l'arrivée dans l'UE ainsi qu'un système de solidarité entre États membres pour l'accueil des demandeurs et demandeuses d'asile, tout en maintenant le système dit « de Dublin »[3]. Cette volonté de « maîtrise des flux migratoires » alimente les fantasmes sur une immigration perçue comme une menace pour l'intégrité et la sécurité des pays européens, offrant un terrain fertile aux politiques racistes venant de l'extrême droite. À l'approche des élections européennes (juin 2024), l'adoption du pacte a représenté un tournant stratégique pour les électeurs et les électrices, appelé·es à se positionner dans les urnes sur la direction à donner à leur continent concernant la question migratoire.
Une « crise de l'accueil » plutôt qu'une « crise migratoire »
Depuis les larges mouvements de population déclenchés en 2014-2015 par la guerre civile en Syrie, les pays européens font le choix de mobiliser la rhétorique de la « crise migratoire »[4]. Avec l'adoption du Nouveau Pacte européen sur la migration et l'asile, dont les négociations ont débuté en septembre 2020, l'UE s'érige en grand régulateur de la migration dite « irrégulière ». Il serait pourtant bien plus justifié de caractériser cette situation non pas comme une « crise migratoire » mais comme une « crise de l'accueil » en Europe[5] . Dans une série de condamnations retentissantes, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a multiplié les sévères réprimandes envers les États membres pour leurs pratiques inhumaines à l'encontre des nouveaux et nouvelles arrivant·es en quête de protection internationale : traitements dégradants, enfermements en centres de rétention , échecs patents à garantir une protection adéquate aux demandeur·euses d'asile. La CEDH souligne le désarroi persistant auquel sont confrontés les nouveaux et nouvelles arrivant·es sur le sol européen et le manque d'application du droit international. Alors que le bilan tragique s'aggrave, avec des milliers de disparu·es en Méditerranée en 2023, la gestion des politiques migratoires de l'EU a fait l'objet de nombreuses remontrances. Le dernier rapport en date du Réseau d'observation de la violence aux frontières met en lumière de nombreuses preuves de l'implication ou de la complicité de Frontex dans l'absence de secours porté aux personnes en danger dans la mer[6]. On pourrait également citer l'exemple lourd de sens de Fabrice Leggeri, ancien directeur de Frontex aujourd'hui élu député européen du Rassemblement national. Cette multiplication de constats révèle l'absence de réponse institutionnelle aux conditions inhumaines de l'accueil en Europe. Le bilan macabre exige un réexamen urgent de la manière dont l'Europe traite celles et ceux qui cherchent refuge, sécurité, prospérité sociale et économique sur ses rivages.
Présenté comme un rempart à l'échec de la « politique de Dublin », le nouveau Pacte comprend principalement de nouvelles législations visant à établir un mécanisme pour faire face aux « arrivées irrégulières massives de migrants dans un État membre ». Concrètement, le Pacte met en place un système d'évaluation rapide des demandes d'asile, avec une « procédure à la frontière » obligatoire, visant à déterminer la validité des demandes. Le pacte vise ainsi à faciliter le retour de celles et ceux jugé·es inaptes à recevoir la protection internationale. La base de données Eurodac, qui se fonde sur l'identification des empreintes digitales des nouveaux et nouvelles arrivant·es afin de déterminer si une personne a déjà été enregistrée dans un autre État membre de l'UE, selon les dispositions du règlement Dublin, sera désormais utilisée à de nouvelles fins. Eurodac permettra le partage des données biométriques entre les autorités chargées du maintien de l'ordre, facilitant l'identification de la migration dite « irrégulière » et justifiant alors des mesures de détention ou d'exclusion. La réforme prévoit l'abaissement de l'âge de la prise de données de 14 à 6 ans, la possibilité d'utiliser la force comme mesure de dernier recours pour obliger les personnes à donner leurs données biométriques ainsi que celle de maintenir des enfants en détention en vue de la prise de ces données. Ce nouveau tournant approfondit la politique migratoire européenne basée non pas sur un accueil mais une criminalisation des personnes en déplacement.
Une « solidarité » entre États contre l'immigration
Dans ce texte, le recours à la notion de « solidarité » entre États membres revêt une signification particulière. Plutôt que de promouvoir une assistance dans la Méditerranée ou une coopération en faveur de l'aide, l'accueil et la justice sociale, cette « solidarité » semble plutôt orientée vers une approche collective dirigée contre l'immigration. Il s'agit de collectiviser les mécanismes de surveillance aux frontières, de renforcer les infrastructures de gestion des frontières (construction de murs, installation de vidéos surveillance, mise en place de barbelés) au sein de l'UE. Dans une logique de « partage des responsabilités », le pacte autorise les contributions financières à des projets de limitation de l'immigration dans les pays tiers. Cela se traduit par davantage d'accords avec des États frontaliers, comme la Tunisie, l'Égypte ou la Turquie, qui acceptent de tenir le rôle de gardes-frontières en échange d'importants transferts financiers. À titre d'exemple, depuis 2018, l'Italie a déjà conclu un transfert de compétence avec les garde-côtes libyens selon lequel ces derniers ont l'obligation de désigner un port sûr pour les bateaux naufragés. Cependant, l'expression sinistre « enfer libyen » est devenu célèbre pour évoquer les conditions prétendument « sûres » dans lesquelles se trouvent les personnes en exil : viols, torture, détention, esclavage. Sophie Beau, directrice de SOS-Méditerranée France, raconte comment les garde-côtes libyens ont tiré sur le navire humanitaire Ocean Viking, destiné à secourir les naufragé·es. De plus, le dernier accord signé en mai 2024 entre l'UE et le Liban prévoit, en échange de milliards d'euros, des mesures visant à freiner les départs des exilés syriens vers l'Europe. L'adoption du Pacte témoigne clairement d'une solidarité interétatique dirigée contre la « menace migratoire » : ensemble contre l'« immigration irrégulière ».
L'UE a récemment reconduit son Mémorandum d'entente avec la Tunisie moyennant un soutien financier d'une valeur de 150 millions d'euros. Cet engagement s'appuie sur 5 piliers dont l'un concerne la migration et la mobilité visant une « gestion efficace des frontières, le développement d'un système d'identification et de retour des migrants irréguliers déjà présents en Tunisie vers leurs pays d'origine ». La Tunisie a annoncé avoir intercepté 21 545 personnes migrantes au moment de leur tentative de traverser la Méditerranée vers l'Italie depuis ses côtes, entre janvier et avril 2024. Dans le même temps, plusieurs enquêtes internationales mettent en lumière le soutien financier de l'Europe à des opérations clandestines dans les pays d'Afrique du Nord dont le but est d'arrêter les personnes en route vers l'Europe lorsque celles-ci se trouvent au Maroc, en Mauritanie et en Tunisie. Avec l'argent de l'UE, les autorités de ces pays ont pour mission de détenir ces personnes pour les transférer dans des zones désertiques ou reculées afin de les empêcher de partir demander l'asile aux portes de l'Europe. Une fois transférées dans ces zones, elles sont abandonnées sans aucune assistance, eau ou nourriture, et sont ainsi exposées aux risques d'enlèvement, d'extorsion, de torture, de violences sexuelles et, dans les cas les plus graves, de mort. D'autres sont emmenées vers des zones frontalières où, selon les témoignages, elles sont vendues par les autorités à des trafiquants d'êtres humains et à des gangs qui les torturent pour obtenir une rançon. Les enquêtes ont révélé que l'Europe finance sciemment, et dans certains cas participe directement à des détentions et expulsions systématiques basées sur des critères racistes visant des communautés noires dans ces trois pays d'Afrique du Nord. Ces enquêtes révèlent que ce système de déplacements massifs et d'abus est non seulement connu à Bruxelles depuis des années, mais aussi qu'il est soutenu par l'argent, les véhicules, les équipements, les renseignements et les forces de sécurité fournis par l'UE et les pays membres.
Décider qui peut entrer ou décider qui régulariser ?
La Présidente de la Commission européenne, Ursula Von Der Layen a déclaré que « ce sont les Européens qui décideront qui vient dans l'UE et qui peut y rester, pas les passeurs ». Le choix de déterminer qui peut franchir les portes de l'UE et qui se voit refuser l'accès découle d'une décision politique, d'une gestion que l'on peut qualifier de « nécropolitique ». La conséquence pour celui ou celle qui voit son accès refusé entraine une issue radicale : la mort. D'après le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), en 2024, sur les 11 889 arrivées en Grèce 48,8 % proviennent d'Afghanistan, 13,8 % de Syrie, tandis que moins de 5 % sont originaires de pays tels que l'Érythrée, la Palestine, le Yémen, le Soudan, ou l'Éthiopie, entre autres. Ces pays ont tous en commun de faire face à une situation de crise : guerre civile, instabilité politique significative, conflits ou crises humanitaires, entraînant des mouvements de personnes en quête de meilleures conditions sociales et économiques. Utiliser le pouvoir politique pour dicter qui pourra entrer et qui se verra refuser l'accès traduit une logique politique largement axée sur des critères inégalitaires. La majorité des personnes qui traversent les frontières européennes de manière irrégulière viennent de pays autrefois colonisés. L'histoire coloniale de ces pays a largement façonné des dynamiques de dépendance envers les anciens pays impérialistes. Cette relation a grandement profité à l'enrichissement des nations du Nord, notamment l'Europe. Aujourd'hui, le système global des relations économiques internationales maintient une nouvelle forme de domination, avec de nouvelles expressions d'impérialisme. La dette, en particulier, demeure un instrument de domination du Sud par le Nord. Elle permet, via des institutions comme le FMI ou la Banque mondiale, de perpétuer un système de domination économique en échange de prêts pour rembourser d'anciennes dettes. Ainsi, l'instabilité politique et le manque de structures sociales pour garantir la sécurité et les moyens de subsistance d'une grande partie de la population dans de nombreux pays des Suds, entraînent d'importants mouvements de populations.
Dans le cadre de la nécropolitique, l'UE exerce son autorité en adoptant des politiques qui discriminent les individus en fonction de leurs origines. Cette tendance est particulièrement visible dans le nouveau pacte asile et migration, qui prévoit que les décisions sur l'admission ou le renvoi des nouveaux et nouvelles arrivant·es sont influencées par leur nationalité ou leur région d'origine. En pratique, cela se traduit par des politiques migratoires européennes racistes qui favorisent les ressortissant·es de pays considérés comme économiquement ou politiquement stables, tandis que celles et ceux des régions en crise sont d'abord vu comme de l'immigration « irrégulière ». De plus, contraint·es de suivre le processus de demande d'asile de plus en plus complexe des pays européens, ces dernier·es se heurtent à des obstacles administratifs croissants pour accéder à leur demande de protection, pourtant garantie par le droit international. Récemment, plusieurs États européens ont adopté de nouvelles législations nationales qui bafouent l'accès à une politique d'accueil digne, comme c'est le cas en France avec l'adoption de la loi asile et migration en décembre 2023. En Europe des millions de personnes sont issues de l'exil. Dans les années 1970, l'Europe et notamment les anciennes puissances coloniales comme la France et le Royaume-Uni ont organisé la venue massive de personnes venant des anciennes colonies afin d'accueillir une main d'œuvre peu chère pour reconstruire les pays d'après-guerre. L'utilisation d'une main-d'œuvre provenant en grande partie de pays anciennement colonisés représente matériellement l'exploitation et la domination d'une partie de cette population. Dans Les damnés de la terre, Frantz Fanon traitait principalement du colonialisme et des effets psychologiques de l'oppression sur les peuples colonisés. Achille Mbembe s'inspire de sa formule pour parler aujourd'hui des « damnés de la mer » qui partent à la recherche d'un refuge et trouvent en fait la faim en Europe. Aujourd'hui, les politiques d'austérité ont affaibli les espoirs d'une vie digne en Europe. Face aux crises économiques successives traversées par les pays européens au cours des trente dernières années, l'immigration est désignée comme étant en partie responsable d'une politique sociale coûteuse. En réponse, la nouvelle politique migratoire a eu un impact majeur sur le droit d'asile dans les États, entraînant la montée des nationalismes de plus en plus axés sur la notion de frontières comme remparts contre l'insécurité et le « raz-de-marée » que représenterait l'immigration irrégulière[7].
Pourtant, les personnes en situation irrégulière continuent de jouer un rôle majeur dans nos économies européennes. A titre d'exemple, la transition écologique, prévoyant l'adoption d'ici 2030 de véhicules sans émission de carbone, renforce fortement l'exploitation des personnes sans papiers. La Hongrie ambitionne le rôle de principal producteur de batteries pour véhicules électriques. Pour ce faire, elle facilite l'arrivée de personnes non régularisées en situation de migration pour assurer la production de ces batteries. Alors que Giorgia Meloni coopère avec les autorités tunisiennes pour renforcer les contrôles à la frontière maritime afin d'empêcher les nouveaux et nouvelles arrivant·es d'atteindre les côtes italiennes, les gros exploitants du sud de l'Italie continuent de bénéficier d'une main-d'œuvre bon marché dans le domaine agricole. La ligne qui sépare l'Europe du reste du monde, principalement des pays du Sud, est souvent qualifiée d'« Europe Forteresse ». Sous couvert de « gestion de crise migratoire », l'UE opte pour une régulation qui semble répondre aux exigences fluctuantes du marché mondial[8]. Ce pacte, concentré davantage sur la gestion des conséquences que sur la mise en place de réponses structurelles visant à réduire le nombre de décès aux frontières, caractérise les politiques migratoires actuelles et leurs logiques racistes et nécropolitiques. Du fait d'une économie mondialisée axée sur la surexploitation, les larges chaînes qui nous alimentent déterminent désormais le droit ou non à la mobilité. Dans ce contexte, la question des frontières devient cruciale. La nécropolitique européenne s'inscrit dans une logique marchande où l'Europe forteresse maintient la main-d'œuvre en dehors de l'UE ou bien en Europe dans des conditions déplorables.
Conclusion
Un constat s'impose : le Nouveau Pacte sur l'Asile et l'Immigration s'inscrit pleinement dans une politique préexistante, consolidant une approche centrée sur les frontières et renforçant les obstacles aux arrivées qualifiées « d'irrégulières ». Alors que l'UE prétend exercer un contrôle sur les flux migratoires pour garantir la sécurité et l'intégrité de ses membres, ce pacte révèle une orientation mortifère, où la sélection des nouveaux et nouvelles arrivant·es est dictée par des critères largement hérités d'un système colonial. Les fondements de cette politique se déploient dans un contexte économique mondialisé, où les inégalités entre les travailleurs et les travailleuses issus des grandes puissances économiques et ceux et celles de la périphérie définissent la dynamique des chaînes de valeur mondiales. L'« Europe forteresse » émerge ainsi comme un symbole de cette gestion sélective de la main d'œuvre, favorisant les ressortissant·es de pays jugés politiquement ou économiquement stables (qui sont souvent des personnes blanches), tout en excluant ou en marginalisant celles et ceux provenant des régions en conflit ou en crise (qui sont souvent des personnes racisées). Derrière cette façade de régulation se cache une réalité plus sombre. Les politiques migratoires actuelles se révèlent souvent être des réponses superficielles, focalisées sur les angoisses racistes agitées par les partis d'extrême droite d'une partie de la population plutôt que sur les causes profondes des migrations, notamment lors des élections européennes de juin 2024. Cette rhétorique axée sur la peur est largement créée et exploitée par les partis d'extrême droite, ceci à leur avantage. Dans un climat où l'extrême-droite progresse très vite, il est crucial de recentrer le débat sur le désarmement des frontières et l'accueil des personnes en exil. Cela nécessite avant tout de reconnaître l'humanité des individus qui se heurteront aux réalités du nouveau Pacte, où les angles tranchants des politiques migratoires menacent leur dignité et leur vie.
*
Emmanuelle Carton est diplômée d'un Master d'études africaines à l'Université de Copenhague. Animatrice d'éducation permanente au CADTM, elle est impliquée dans la critique sociale et tente de comprendre les racines de la crise écologique et sociale, ses liens avec les inégalités Nord-Sud ainsi que les alternatives possibles au sein de la politique des communs et des systèmes horizontaux et associatifs de solidarité.
Une première version de cet article a été publié le 4 juin 2024 sur le site du CADTM.
Illustration : Photo Merle Thiel – Calais, avril 2024.
Notes
[1] La « nécropolitique » fait référence à la notion proposée par Achille Mbembe qui y voit l'expression ultime de la souveraineté : la capacité d'un État à gouverner et de son contrôle absolu sur les affaires internes et externes se trouve dans le pouvoir de décider qui peut vivre et qui doit mourir. Souvent basée sur des catégories raciales, ethniques ou sociales, la nécropolitique désigne la façon dont l'utilisation de la violence devient un outil de gouvernance par lequel certaines populations sont soumises à des conditions qui rendent leur vie précaire, ou impossible, tandis que d'autres sont privilégiées et protégées.
[2] Le terme ‘nouveau-arrivant' est une terminologie neutre qui englobe à la fois les réfugiés, les sans-papiers et les demandeurs d'asile. Le terme « migrant » a parfois été utilisé dans des discours déshumanisants, englobant un grand nombre d'individus sans distinction et justifiant des rhétoriques qui bafouent le droit à la dignité humaine.
[3] Selon la réglementation de Dublin, adoptée par l'UE en 1990, chaque État membre est chargé d'examiner les demandes d'asile lorsque ses frontières sont franchies en premier par l'individu. Ce règlement a entraîné des déséquilibres criants entre des États en « première ligne » comme la Grèce, l'Espagne ou l'Italie, situés aux frontières extérieures de l'UE et largement tenus comme responsables du traitement des demandes d'asile, et les autres États membres.
[4] Cf. Laura Calabrese, Chloé Gaboriaux et Marie Veniard, « L'accueil en crise : pratiques discursives et actions politiques », Mots. Les langages du politique, n° 129, 2022 [En ligne].
[5] Cf. Annalisa Lendaro, Claire Rodier et Youri Lou Vertongen, La crise de l'accueil : Frontières, droits, résistances, Paris, La Découverte, 2019.
[6] Frontex est l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Créée en 2004, elle est chargée de coordonner et de mettre en œuvre les opérations de gestion des frontières dans les États membres de l'UE. Officiellement, les principaux objectifs de Frontex sont de renforcer la sécurité des frontières extérieures de l'UE, de faciliter les flux d'immigration légaux et fluides et de prévenir l'immigration irrégulière. Pourtant, l'agence est l'objet de nombreuses critiques. Travaillant en étroite collaboration avec les agences frontalières nationales, les autorités chargées du contrôle et de la gestion des frontières au sein de l'UE ont été régulièrement accusées de mauvais traitements, de mises en danger et de négligence envers les personnes en détresse.
[7] Cf. les vidéos du colloque « Pour l'asile, une autre politique de l'immigration est possible » (Université de Paris 8, 5 mars 2018).
[8] Cf. Jacques Rancière, Les trente inglorieuses : Scènes politiques, Paris La fabrique, 2022.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Face à la droite et à l’extrême droite : Urgence antiraciste !

Macron, après deux mois de cirque pour éviter un gouvernement Nouveau Front populaire, a donc sorti de son chapeau comme Premier ministre Michel Barnier : vieux cheval de retour, choisi dans le groupe de droite extrême minoritaire de l'Assemblée nationale. Avec la bénédiction de l'extrême droite à qui Macron a délibérément laissé la maîtrise du jeu.
19 septembre 2024 | tiré de l'Hebdo L'Anticapitaliste - 721
https://lanticapitaliste.org/actualite/politique/face-la-droite-et-lextreme-droite-urgence-antiraciste
Et le RN, devenu indispensable, de se vanter : « Rien ne peut se faire sans le RN », dixit Bardella assurant ne pas vouloir participer au « désordre institutionnel et au chaos démocratique » mais à condition que le gouvernement se conforme à une politique acceptable pour le RN — c'est-à-dire toujours plus xénophobe et raciste.
La guerre contre les étrangerEs
Le CV du nouveau Premier ministre a en effet tout pour plaire à Marine Le Pen : outre ses positions réactionnaires en matière sociale, en 2022 il plaidait « pour une pose migratoire » de 3 à 5 ans, appelait à « cesser les régularisations inconditionnelles des sans-papiers », à remettre en cause l'Aide médicale d'État, à restreindre les regroupements familiaux et, tout comme les extrêmes droites européennes, demandait que la CEDH (Cour européenne des droits de l'Homme) n'impose pas ses décisions à la France. Sans surprise, ses premières déclarations sont dénuées d'ambiguïté : la lutte contre l'immigration sera sa priorité et, pour ce faire, pourquoi pas le retour d'un ministère de l'Immigration : une armada de fonctionnaires afin de mieux traquer une population soumise à un régime d'exception, indésirable sur le territoire national. Nul doute que la loi Darmanin, arme de guerre contre tous les étrangerEs, va continuer — et en pire — à transformer en enfer la vie de celles et ceux qui, avec ou sans papiers, n'ont pas la bonne couleur/origine ou la bonne religion.
Combattre le capitalisme, c'est aussi combattre le racisme
Le racisme est inhérent au capitalisme. Plus que jamais avec la crise économique et politique, il lui est nécessaire pour continuer à exploiter les êtres humains et la nature. La poursuite et l'aggravation des attaques racistes, relayées par les grands médias, seront au cœur de la politique gouvernementale. Elles sont indispensables pour s'assurer une certaine neutralité parlementaire — sous conditions — du RN mais aussi pour reprendre les attaques antisociales que réclame la bourgeoisie. Pour diviser les classes populaires soumises à ces attaques, les migrantEs et les populations racisées servent de boucs émissaires pour les méfaits du capitalisme. Mais, ce faisant, ce sera à nouveau le RN, héraut de la « préférence nationale » raciste (au profit des prétendus « Français de souche »), qui tirera les marrons du feu si jamais la gauche se montre incapable d'offrir une alternative sociale et démocratique progressiste, intégrant la défense des migrantEs et des personnes racisées.
Faire échec à Barnier-Macron et barrage à Le Pen implique de mener, et de façon conséquente, la lutte antiraciste. Loin d'être opposées, la lutte pour les droits démocratiques et sociaux et la lutte antiraciste sont complémentaires et imbriquées. L'unité de combat contre le capitalisme et ses méfaits en dépend.
Contre le racisme systémique de l'État et de l'État colonial
Une gauche de combat, politique et syndicale, se doit d'être à la pointe des mobilisations avec les premierEs concernéEs : contre les campagnes islamophobes ; pour l'abrogation de la loi Darmanin et de toutes les autres lois racistes, la fermeture des centres de rétention administrative (CRA), l'abrogation du Ceseda (Code d'entrée et de séjour des étrangers et demandeurs d'asile), le désarmement de la police, la régularisation de touTEs les sans-papiers, l'ouverture des frontières, la liberté de circulation et d'installation.
Contre le racisme systémique d'État qui écrase les personnes racisées de ce pays, nous exigeons l'égalité des droits, l'égalité dans l'accès à l'éducation, à la santé, au logement ou à l'emploi et les pleins droits de citoyenneté pour toutes celles et tous ceux qui vivent sur ce territoire.
Combattre le racisme, c'est aussi dénoncer les forfaits et crimes de « notre » impérialisme en Afrique et ailleurs, et mener une politique sans faille de solidarité avec les peuples eux aussi infériorisés et opprimés par le racisme, et encore sous le joug colonial de la France, et qui, comme aujourd'hui en Kanaky, luttent pour leur indépendance.
Josie Boucher
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
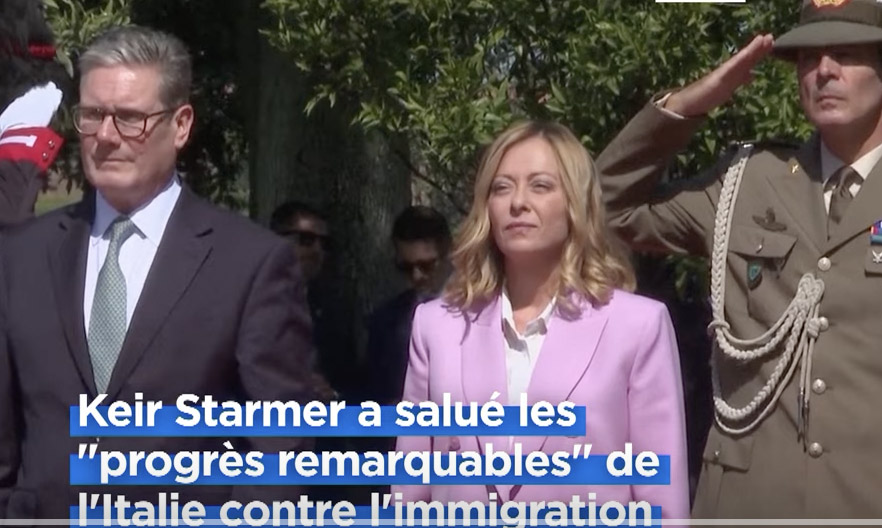
Keir Starmer cherche son inspiration auprès de Giorgia Meloni pour « gérer les migrant·e·s »
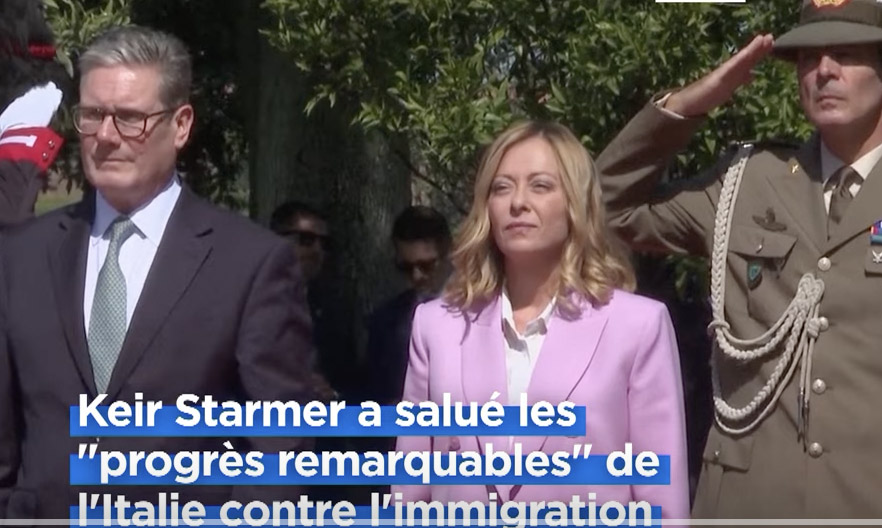
Après avoir rencontré [le lundi 16 septembre, à la Villa Doria Pamphili, à Rome] Giorgia Meloni, Keir Starmer a exprimé son admiration pour les plans de la Cheffe du gouvernement italien visant à déporter les réfugié·e·s vers des camps en Albanie, signe de la volonté du gouvernement travailliste d'embrasser les politiques du néofascisme.
Tiré de A l'Encontre
25 septembre 2024
Par Nathan Akehurst et Kristina Millona
Capture d'écran d'Euronews.
Lorsque Keir Starmer a abandonné l'accord funeste des conservateurs sur les déportations vers le Rwanda quelques jours après son entrée en fonction, un soupir de soulagement s'est fait entendre. Beaucoup se sont félicités de ce qui semblait être un changement résolu par rapport à la stratégie du gouvernement précédent qui, lui, utilisait une cruauté implacable à l'égard des migrant·e·s pour détourner l'attention de ses échecs en matière de gestion des affaires publiques.
Certains espéraient même que la campagne du parti travailliste – qui mettait en scène une députée conservatrice [Natalie Elphicke] de la droite dure ayant fait défection et affirmant que les conservateurs n'étaient pas assez durs sur la question des frontières – n'était qu'une habile manœuvre électorale. Mais alors que le gouvernement travailliste multiplie les déportations massives et les descentes sur les lieux de travail, rouvre des centres de détention où les abus sont légion et envisage de ramener le Royaume-Uni dans le giron d'un régime européen de contrôle mortel des migrations, il semble que la campagne de Keir Starmer doive être prise au pied de la lettre.
Cette semaine, mi-septembre, le Premier ministre s'est rendu en Italie pour rencontrer Giorgia Meloni, une dirigeante qui est arrivée au pouvoir à la tête d'une formation [Fratelli d'Italia] qui s'inscrit dans la continuité du MSI [Movimento sociale italiano], parti construit au lendemain [1946] de la Seconde Guerre mondiale afin de maintenir un héritage de Benito Mussolini et du fascisme italien. Keir Starmer a déclaré qu'il souhaitait s'inspirer de l'approche de Giorgia Meloni en matière d'immigration et coopérer avec elle. [Starmer a expliqué : « Il y a eu ici une réduction assez remarquable des entrées de clandestins, donc je veux comprendre comment cela s'est produit ».]
Cette déclaration intervient dans le contexte où l'Italie et l'Albanie ont signé [le 6 novembre 2023] un accord [ratifié par la Chambre des députés italiens le 24 janvier 2024 et le Parlement albanais le 22 février 2024] prévoyant la construction de centres de détention sur le territoire albanais, où les ressortissants de pays tiers secourus en Méditerranée seraient transférés en vue du traitement extraterritorial de leur demande d'asile et, éventuellement, de leur expulsion. Giorgia Meloni a salué le protocole comme un « accord historique pour l'ensemble de l'UE » [1].
Les organisations de défense des droits de l'homme préviennent que la détention arbitraire légitimée par l'accord pourrait conduire à des violations potentielles des droits de l'homme, notamment en ce qui concerne la défense juridique et les droits d'asile. Les audiences sur les demandes d'asile se tiendront à distance et les autorités italiennes, dont le personnel est surchargé, seront chargées de traiter les demandes en provenance d'Albanie en seulement 28 jours, ce qui limitera encore davantage les procédures régulières.
Lors d'une visite des centres en Albanie cette semaine (3e de septembre), nous avons vu la construction rapide d'un mur de sept mètres de haut clôturant les camps de détention, qui, selon les gardes patrouillant sur les sites, « garantira qu'aucun migrant détenu là ne puisse s'échapper ».
L'accord avec l'Albanie est le dernier d'une série de mesures italiennes qui ont aggravé la situation déjà désastreuse en Méditerranée centrale, la route migratoire la plus meurtrière au monde. Giorgia Meloni est entrée en fonction en promettant un « blocus naval » contre les migrant·e·s. L'année dernière, l'un d'entre nous était à bord d'un navire civil de sauvetage en mer, qui a été immobilisé et qui fut condamné à une amende pour le crime supposé d'avoir sauvé trop de vies.
I'Italie a régulièrement recours à la détention arbitraire, à l'assignation de ports de sécurité éloignés [ce qui pose des problèmes de santé pour les migrants, de sécurité, de coût de transport, au harcèlement bureaucratique [le « droit » à un seul sauvetage] ou à l'arrestation pure et simple pour empêcher les gens de sauver des vies en mer. La rhétorique sur la répression des bandes de passeurs semble simple. Mais en réalité, les personnes qui recherchent la sécurité, celles qui apportent de l'aide et celles qui fournissent des services de base sont régulièrement criminalisées en tant que passeurs.
Le cas d'Ibrahima Bah, un adolescent sénégalais reconnu coupable d'entrée « illégale » au Royaume-Uni et d'homicide involontaire, nous rappelle les conséquences de la criminalisation des personnes qui émigrent en tant que passeurs. Bah a été arrêté en décembre 2022 et, plus tard, condamné à neuf ans de prison par les autorités britanniques pour avoir conduit un bateau lors d'une traversée de la Manche.
L'embarcation a tragiquement coulé ce qui a entraîné la mort de quatre personnes. En raison de la rareté des parcours praticables et légaux, Ibrahima Bah a été contraint de conduire le « bateau » en échange d'un passage gratuit pour lui et son frère. De tels cas sont monnaie courante aussi en Italie.
Et tout ne se résume pas à l'expérience italienne. Il y a pire. Keir Starmer et David Lammy [ministre des Affaires étrangère, du Commonwealth et du Développement] ont également indiqué qu'ils s'inspireraient des accords européens avec la Libye et la Syrie.
Externaliser les « contrôles frontaliers »
Pendant des années, l'Italie, la France et l'UE ont injecté de l'argent dans ce qu'on appelle les « garde-côtes libyens », une force qui maltraite régulièrement les personnes qui traversent la Méditerranée, voire leur tire dessus, et les ramène en détention en Libye.
Dans les tristement célèbres centres de détention libyens, la violence, la torture et l'esclavage sont monnaie courante. De nombreux détenus se retrouvent enfermés dans ces centres après avoir été interceptés et repoussés dans leurs tentatives désespérées de traverser vers l'Europe. Des récits poignants font état de la surpopulation dans des pièces non ventilées où la nourriture est glissée sous les portes verrouillées, de passages à tabac systématiques et d'épidémies régulières dues à l'insalubrité des lieux.
Loin de la rhétorique sur le « démantèlement des gangs », les fonds européens se sont retrouvés souvent entre les mains de milices profondément impliquées dans la contrebande, à qui Frontex, l'agence européenne des frontières, confie les positions (géolocalisation) des bateaux en détresse. Au début de l'année, il a également été établi que les fonds européens étaient complices d'opérations de maintien de l'ordre au cours desquelles des milliers de migrants, principalement des Noirs, sont rassemblés et jetés dans les déserts d' Afrique du Nord [voir l'enquête menée, entre autres, par le Washington Post, Der Spiegel, El Pais, Le Monde sur les pratiques en cours au Maroc, en Tunisie et Mauritanie] souvent laissés pour morts.
La Syrie reste un endroit profondément dangereux pour les personnes qui souhaitent y retourner, malgré les tentatives de certains Etats de l'UE de « découper » des zones sûres à l'intérieur de la Syrie où les réfugiés pourraient être renvoyés. Un récent rapport sur la Syrie publié par la commission d'enquête des Nations unies a mis en évidence l'escalade des crises humanitaires dans plusieurs régions du pays ravagées par des affrontements de plus en plus intenses. Le rapport conclut que le pays reste dangereux et que les soi-disant « zones de sécurité » sont fondamentalement inadaptées et inhumaines. [Voir la série de reportages, intitulé « Carnets de Syrie », publiés dans Le Monde, du 15 septembre 2024 au 21 septembre 2024.]
Lorsque le gouvernement travailliste a annulé le plan pour le Rwanda, il a souligné, à juste titre, qu'il était cruel et inapplicable. La sous-traitance de la gestion de la violence frontalière à d'autres pays n'empêche pas les gens d'émigrer, elle ne fait qu'engendrer la misère et la souffrance pour les personnes migrantes. Elle détourne des fonds publics indispensables vers des gouvernements sans scrupules et des firmes à but lucratif qui fournissent des armes, des murs et des moyens de surveillance pour entretenir la machinerie. [Voir l'ouvrage de Claire Rodier, Xénophobie business, Editions La Découverte, 2012]
Il y a une ironie tragique dans le fait que la visite de Starmer en Italie comprenne également l'annonce d'un investissement britannique de 485 millions de livres sterling de la part de Leonardo [firme d'origine italienne – anciennement Leonardo-Finmeccanica – installée dans de nombreux pays, entre autres au Royaume-Uni] , une entreprise d'armement impliquée à la fois dans la vente d'armes vers des zones de conflits – impliquant le déplacement contraint de personnes – et dans la construction des frontières militarisées auxquelles s'affrontent les personnes qui fuient.
Le récit des « crises migratoires » occulte la complicité de pays puissants tels que l'Italie et le Royaume-Uni, qui alimentent les déplacements par le biais de leur politique économique et étrangère. Et cela concourt à dégrader les dispositifs de protection des droits de l'homme qui nous protègent tous.
Un premier ministre, Keir Starmer, qui a fait valoir son expérience d'avocat spécialisé dans les droits de l'homme devrait le comprendre. Nous vivons un recul sans précédent de ces droits, des valeurs et des normes, et dont celles ayant trait à la « gestion de l'immigration » ne sont qu'un exemple parmi d'autres.
La promesse des sociaux-démocrates et des progressistes était de restaurer la dignité en politique, et non de prendre des conseils politiques auprès de gouvernements d'extrême droite. Plutôt que de répéter la stratégie du gouvernement conservateur précédent, qui a consisté à dénigrer les migrant·e·s et à faire preuve de brutalité – ce qui a contribué à ce que des foules tentent d'incendier des demandeurs d'asile il y a quelques semaines à peine [début août 2024] – Keir Starmer devrait utiliser sa majorité pour tracer une voie différente : une voie qui respecte nos obligations de protéger, plutôt que faire du tort aux personnes en quête de sécurité et une orientation qui n'aboutissent pas à nous diviser en fonction de l'endroit où nous sommes nés.
A son retour d'Italie, le Premier ministre devrait se concentrer plus près de chez lui, sur les besoins des personnes et des services publics qui souffrent d'années d'austérité et de mauvaise gestion, et sur la construction d'une Grande-Bretagne plus juste et plus décente, comme il l'avait promis. (Article publié dans le magazine Tribune le 18 septembre 2024 ; traduction par la rédaction de A l'Encontre)
Nathan Akehurst est chercheur et militant sur la problématique de la violence frontalière en Europe, et bénévole dans le domaine de la recherche et du sauvetage civils.
Kristina Millona est une chercheuse et journaliste d'investigation basée à Tirana, en Albanie. Elle travaille sur des sujets tels que la migration albanaise, la violence frontalière et le capitalisme racial.
[1] Le quotidien économique français Les Echos, écrivait le 7 novembre 2023 : « Giorgia Meloni a pris acte de l'échec de l'accord de partenariat entre l'UE et la Tunisie signé en juillet dernier pour endiguer les flux migratoires. Elle se tourne donc vers l'Albanie voisine pour l'accueil des migrants qui ont afflué en masse ces derniers mois sur les côtes transalpines. Alors qu'elle avait promis un soutien économique au président tunisien, elle offre cette fois au Premier ministre albanais, Edi Rama, le soutien de l'Italie pour sa candidature à l'entrée dans l'UE […] Deux centres [l'un situé dans le voisinage d'un village agricole : Gjadër, l'autre près de la ville portuaire de Shëngjin] seront donc construits en Albanie […] Ils seront placés sous la juridiction italienne et devraient être opérationnels au printemps 2024. »
La fin des travaux – qui coûteraient 800 millions d'euros payés par l'Italie – a sans cesse été décalée. Dès lors, Giorgia Meloni, lors d'un point presse récent (Les Echos, 5 août 2024), a souligné que cet accord est en train de devenir un « modèle » : « Une quinzaine d'Etats membres sur 27 ont signé un appel à la Commission lui demandant, entre autres, de suivre le modèle italien. Même l'Allemagne, par l'intermédiaire de sa ministre de l'Intérieur, a exprimé son intérêt. »
Voir de même l'article de Migreurop publié sur le site alencontre.org en date du 13 février 2024.(Réd).
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le mouvement syndical mondial doit demander des comptes à la Russie pour les crimes de guerre commis à l’encontre des travailleurs ukrainiens.

Les crimes de guerre perpétrés par la Fédération de Russie contre le peuple ukrainien ont atteint un nouveau degré d'escalade. Les transgressions comprennent le bombardement délibéré d'hôpitaux, d'usines, de supermarchés et de bureaux de poste, et le meurtre de plus de onze mille civils. Les travailleurs ukrainiens sont attaqués, car le « syndicat » FNPR (Fédération des syndicats indépendants de Russie), fidèle au régime, a persécuté les syndicats ukrainiens dans les territoires occupés de Donbas et de Crimée, tandis que le gouvernement russe a bombardé les sièges des syndicats.
L'Organisation internationale du travail (OIT) doit s'attaquer au mépris flagrant de la Russie pour les droits fondamentaux des travailleurs et la dignité humaine. En tant qu'autorité mondiale en matière de normes du travail, l'OIT a à la fois le devoir et la capacité de faire face à ces violations de ses conventions. Il est essentiel que ces abus soient portés à la connaissance de l'OIT et que l'organisation prenne des mesures pour que la Russie réponde de ses crimes de guerre.
Une inhumanité persistante
Les attaques criminelles de la Russie contre le système de santé ukrainien doivent être comprises comme visant non seulement les infrastructures vitales, mais aussi les lieux de travail et les travailleurs. En octobre 2024, Physicians for Human Rights a recensé 1 442 attaques contre des établissements de santé, dont 742 hôpitaux et cliniques ont été détruits, entraînant la mort de 210 travailleurs de la santé. Il s'agit peut-être d'une sous-estimation puisque, en août, Human Rights Watch a indiqué que la Russie avait endommagé ou détruit 1 736 installations médicales. L'OMS a condamné à plusieurs reprises la tactique systématique de la Russie consistant à détruire les établissements de santé et à s'en prendre aux travailleurs de la santé, la qualifiant de crime de guerre.
Les travailleurs de la santé sont loin d'être les seuls à supporter le poids de l'agression russe. Les cas les plus flagrants sont ceux où les forces d'occupation russes non seulement torturent, tuent et déportent des civils ukrainiens, mais ont également instauré un système de travail forcé dans les territoires temporairement occupés de l'Ukraine, en particulier dans l'industrie de l'énergie atomique. Le phénomène du travail forcé dans les centrales nucléaires occupées par les Russes est étayé par de nombreux éléments de preuve.
En outre, la persécution et l'expropriation des syndicats ukrainiens, coorganisés par la FNPR dans les territoires temporairement occupés par la Russie, constituent une grave atteinte aux droits fondamentaux des travailleurs ukrainiens. Ils ont interdit les activités des syndicats libres ukrainiens et persécutent sauvagement toute personne qui tente de maintenir le contact avec leur syndicat.
Ce qui est particulièrement grave, c'est que la FNPR sert volontairement de bourreau et de complice au régime de Poutine dans ses efforts pour supprimer la liberté d'association. La FNPR joue un rôle central dans la persécution des travailleurs ukrainiens dans les territoires occupés par le régime russe et est activement impliquée dans l'expropriation illégale des syndicats ukrainiens, dont elle tire profit.
Le FNPR fait partie intégrante de l'appareil répressif, criminel et inhumain de la dictature de Poutine et, par extension, de ses crimes de guerre. Poutine a publiquement fait l'éloge de la FNPR lors de son congrès de 2024 pour avoir mis en œuvre le système de la « Nouvelle Russie » sur les lieux de travail de l'Ukraine occupée. La FNPR est le seul syndicat autorisé dans les territoires, et ceux qui n'y adhèrent pas et n'acceptent pas le processus de « russification » sont considérés avec suspicion par les forces d'occupation russes. Cette suspicion peut conduire à l'enlèvement ou à l'emprisonnement dans un centre de torture, comme l'ont montré de nombreux rapports de l'ONU.
L'attaque barbare de la Russie contre la Fondation suisse pour le déminage (FSD) à Kharkiv en juillet 2024 constitue une nouvelle violation grave du droit international par la Russie, qui ne sera certainement pas la dernière, et souligne l'urgence de cette question. Un mépris aussi flagrant des droits de l'homme et des normes internationales exige une action constante et décisive.
Il est impératif que ces cas soient portés devant l'OIT et que celle-ci tienne la Russie pour responsable de ses violations flagrantes des conventions de l'OIT destinées à protéger les droits les plus fondamentaux des travailleurs et la dignité humaine. Le système de l'OIT, en tant qu'autorité mondiale en matière de normes du travail, a la responsabilité et la fonction de s'attaquer à ces violations et de prendre position contre les actions de la Fédération de Russie.
Expulser le FNPR et cesser toute collaboration
Il est essentiel d'aborder le rôle de la FNPR dans ce conflit. La FNPR, agissant comme une marionnette du gouvernement russe, a soutenu la persécution des syndicats ukrainiens dans les territoires occupés. Compte tenu de cette complicité, la FNPR ne représente pas les intérêts des travailleurs en Russie ou ailleurs.
La Confédération syndicale internationale (CSI) doit donc cesser tout soutien direct ou implicite à la FNPR. La poursuite de la reconnaissance ou de la collaboration avec une telle organisation ne ferait que légitimer ses actions et saper la crédibilité du mouvement syndical mondial. Cela signifie explicitement que la CSI devrait empêcher la FNPR d'obtenir un siège au Conseil d'administration de l'OIT lors des prochaines élections.
Malheureusement, cette année, la CSI a permis (ou du moins n'a pas essayé d'empêcher) l'élection du représentant de la FNPR, Alexei Zharkov, en lui laissant une place vacante. Malgré l'amabilité malavisée de la CSI et le lobbying agressif de la FNPR et de ses alliés de l'ACFTU chinoise, Zharkov a été élu de justesse. Ce résultat est une réprimande cinglante pour la FNPR. Si la CSI s'était opposée à Zharkov, il n'aurait pas été élu.
En outre, le rôle des représentants russes à l'OIT dans la machine de guerre de Poutine devrait faire l'objet d'une enquête et ceux qui sont impliqués dans des crimes de guerre ou qui les soutiennent devraient être sanctionnés et se voir refuser l'octroi de visas. Il est incompréhensible que Mikhail Shmakov, qui agit sans vergogne en tant que complice de Poutine, ne figure encore sur aucune liste de sanctions, à notre connaissance - en particulier contrairement aux représentants de l'association des employeurs russes qui ont été sanctionnés.
Enfin, lors de la prochaine réunion statutaire compétente, la CSI - le mouvement syndical démocratique mondial - doit faire un choix décisif et expulser la FNPR de ses rangs. Le fait que cette organisation belliciste ne soit que suspendue nuit déjà à la crédibilité de la CSI.
Fermeture du bureau de l'OIT à Moscou
Dans la Russie de Poutine, la liberté d'expression et de pensée est étouffée et il n'est plus possible de travailler librement. Cette situation s'étend même au personnel diplomatique, y compris celui de l'OIT, qui est régulièrement harcelé, comme on le murmure souvent à huis clos. Des rapports d'intimidation à l'encontre du personnel non russe ont également fait surface à plusieurs reprises.
Les travailleurs de nombreux pays ne se sentent plus en sécurité lorsqu'ils se rendent à Moscou, et beaucoup, en particulier ceux d'Europe de l'Est et du Caucase - régions qui ont souffert de l'agression russe - ne veulent pas travailler à Moscou. De nombreux syndicats d'Europe de l'Est, du Caucase et d'Asie centrale refusent d'être « gérés » depuis Moscou. Compte tenu de la situation en Géorgie, en Arménie et en Asie centrale, cette position est tout à fait compréhensible.
Il est particulièrement insoutenable que le Belarus, où Lukashenko, allié de Poutine, a interdit tous les syndicats démocratiques et emprisonné plus de 40 syndicalistes, soit officiellement couvert par un bureau de l'OIT basé à Moscou.
Par conséquent, le bureau de l'OIT devrait être déplacé sans plus attendre.
Les syndicats démocratiques doivent s'opposer au poutinisme
Nous exigeons une véritable solidarité syndicale avec nos collègues syndicalistes et travailleurs d'Ukraine, qui sont actuellement confrontés à l'invasion et à la tentative de destruction de leur nation. Nous attendons de tous les mouvements syndicaux démocratiques, y compris et surtout ceux des pays appartenant à l'UE, au G7, au G20 et aux BRICS, qu'ils s'opposent au fascisme criminel de guerre incarné par le poutinisme.
Rien ne peut justifier que les syndicats collaborent avec un tel régime et ses syndicats asservis, en particulier dans des cadres tels que le G20 et d'autres groupes dont la Russie est membre. Si le G20, les BRICS, etc. ne se distancient pas de ces actions et de ces membres, ils risquent de devenir des « clubs » qui protègent, légitiment et, en fin de compte, soutiennent les dictateurs et les criminels de guerre.
Points d'action contre le régime de Poutine
En conclusion, l'ensemble de la communauté syndicale internationale doit s'exprimer clairement et bruyamment face à ces atrocités. Porter ce cas devant l'OIT n'est pas seulement une étape nécessaire pour demander des comptes à la Russie, c'est aussi une mesure essentielle pour protéger l'intégrité des normes internationales du travail. L'OIT et la CSI doivent rester unies dans leur engagement en faveur de la justice, des droits de l'homme et de la protection des travailleurs dans le monde entier.
Par conséquent, tous les mouvements syndicaux démocratiques devraient exiger
Que l'OIT, en utilisant tous les moyens légaux disponibles, prenne immédiatement toutes les mesures nécessaires pour poursuivre, nommer et punir toutes les violations des droits des travailleurs et des syndicats commises par la Russie en Ukraine. La CSI et les organisations syndicales internationales doivent prendre toutes les mesures juridiques et pratiques nécessaires à cette fin lors de la prochaine réunion de l'OIT.
Que la CSI et tous ses organes régionaux se distancient complètement de la FNPR en tant que complice du régime de Poutine - non seulement en Europe mais aussi en Asie, en Australie, en Amérique du Nord, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Nous exigeons une véritable solidarité syndicale contre le régime dictatorial imprudent et agressif de Poutine et ses mandataires au sein de la FNPR. La CSI doit enfin expulser la FNPR de ses membres.
Le déménagement immédiat du bureau de l'OIT de Moscou, car son maintien serait en contradiction avec les valeurs et la mission de l'OIT qui est de promouvoir les droits des travailleurs et la justice, étant donné les violations constantes du droit international par la Fédération de Russie.
En tant que syndicats démocratiques fiers et forts, la CUT brésilienne et le COSATU sud-africain devraient envisager de ne pas donner de légitimité et de crédibilité à la FNPR et à l'ACFTU en s'engageant dans le Forum syndical des BRICS.
Vasco Pedrina
Vasco Pedrina a été coprésident du syndicat Unia et vice-président de l'IBB (Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois) et représentant de l'Union syndicale suisse auprès de l'AELE (Association européenne de libre-échange).
Ce texte a été publié en anglais sur : https://globallabourcolumn.org/2024/09/18/the-global-labour-movement-must-hold-russia-accountable-for-war-crimes-against-ukrainian-workers/
Traduction :deepl.com

Blinken a ignoré les évaluations américaines selon lesquelles Israël a bloqué l’aide à Gaza

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a ignoré les évaluations d'agences et de fonctionnaires du gouvernement américain indiquant qu'Israël avait bloqué l'aide américaine à Gaza au début de l'année, selon un nouveau rapport, le plus haut diplomate américain ayant présenté une conclusion différente au Congrès.
Tiré de France Palestine Solidarité. Photo : Rencontre entre le Secrétaire d'État americain Antony Blinken et Benjamin Netanyahu en Israël pour discuter d'un cessez-le-feu à Gaza, le 20 août 2024 © Quds News
Network
Le média d'investigation ProPublica a rapporté mardi que l'Agence américaine pour le développement international (USAID) avait indiqué au département d'État, dans un rapport datant de fin avril, qu'Israël soumettait l'aide humanitaire américaine destinée à Gaza à « des refus, des restrictions et des entraves arbitraires ».
Selon ProPublica, des fonctionnaires du bureau des réfugiés du département d'État ont également constaté en avril que « les faits sur le terrain indiquent que l'aide humanitaire américaine est restreinte ».
Mais en mai, M. Blinken a remis au Congrès un rapport du département d'État contenant une conclusion différente.
« Nous n'évaluons pas actuellement que le gouvernement israélien interdit ou restreint le transport ou la livraison de l'aide humanitaire américaine », a déclaré le département d'État dans son évaluation du 10 mai.
Les mémos divulgués auraient eu des implications majeures sur la politique américaine s'ils avaient été adoptés par Blinken, y compris sur les livraisons d'armes américaines à Israël.
En effet, la loi américaine interdit toute assistance sécuritaire à un pays qui « interdit ou restreint, directement ou indirectement, le transport ou l'acheminement de l'aide humanitaire des États-Unis ».
Les États-Unis fournissent chaque année à Israël une aide militaire d'au moins 3,8 milliards de dollars et, cette année, M. Biden a approuvé une aide supplémentaire de 14 milliards de dollars pour financer les efforts du gouvernement israélien dans la guerre de Gaza.
Ce soutien a fait l'objet d'une condamnation généralisée et d'un examen minutieux à mesure que la guerre de Gaza s'éternise.
Le rapport de mai du département d'État, qui a finalement conclu qu'Israël ne bloquait pas l'aide américaine à Gaza, soulignait en même temps comment les responsables israéliens avaient encouragé les manifestations visant à empêcher l'aide d'atteindre les Palestiniens.
Le document indique également qu'Israël a mis en œuvre « d'importants retards bureaucratiques » dans l'acheminement de l'aide et a lancé des frappes militaires sur « des mouvements humanitaires coordonnés et des sites humanitaires déconflictuels ».
L'armée israélienne a tué plus de 41 000 Palestiniens à Gaza tout en imposant un siège strict sur le territoire qui a conduit la population au bord de la famine.Selon le bureau des médias du gouvernement de Gaza, au moins 34 enfants palestiniens sont morts de malnutrition cette année.
En mars, Bill Burns, directeur de la CIA, a reconnu que les Palestiniens de Gaza mouraient de faim.
« La réalité, c'est qu'il y a des enfants qui meurent de faim », a déclaré M. Burns aux sénateurs américains lors d'une réunion d'information. « Ils souffrent de malnutrition parce que l'aide humanitaire ne peut pas leur parvenir.
Au début de l'année, la Maison Blanche a également reconnu les efforts déployés par Israël pour bloquer l'aide américaine à Gaza.
Le ministre israélien des finances, Bezalel Smotrich, avait déclaré publiquement qu'il bloquait la farine fournie par les États-Unis à Gaza, ce qui avait amené la Maison Blanche à réagir.
« J'aimerais pouvoir vous dire que de la farine a été acheminée, mais je ne peux pas le faire pour l'instant », a déclaré John Kirby, porte-parole de la Maison-Blanche, à la presse le 15 février.
ProPublica a rapporté mardi que l'ambassadeur des États-Unis en Israël, Jack Lew, avait exhorté M. Blinken à accepter les assurances israéliennes selon lesquelles Israël ne bloquait pas l'aide à Gaza.
« Aucune autre nation n'a jamais fourni autant d'aide humanitaire à ses ennemis », a déclaré M. Lew à ses subordonnés, selon le rapport.
La Cour internationale de justice a statué que Gaza était sous occupation israélienne.
En vertu de la quatrième convention de Genève, une puissance occupante a le « devoir d'assurer l'approvisionnement alimentaire et médical de la population » dans le territoire qu'elle occupe.
Le Conseil des relations américano-islamiques (CAIR), une organisation américaine de défense des droits civiques des musulmans, a demandé mardi à M. Blinken de démissionner.
« Lorsqu'un haut fonctionnaire américain ment au Congrès en plein génocide pour que le gouvernement puisse continuer à financer ce génocide, il bafoue délibérément la loi et prolonge les souffrances de millions d'innocents qui ont désespérément besoin que notre gouvernement cesse de financer leur massacre », a déclaré Nihad Awad, directeur exécutif national du CAIR, dans un communiqué.
Traduction : AFPS
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le racisme de Trump sème le chaos dans une petite ville de l’Ohio

Nous savons que le racisme est au cœur de la politique de Donald Trump, mais une histoire absurde récente montre à quel point il est dangereux. Et elle révèle à quel point notre société est profondément malade pour qu'il ait encore le soutien de la moitié de l'électorat.
Hebdo L'Anticapitaliste - 722 (26/09/2024)
Par Dan La Botz
Crédit Photo
wikimedia commons
Lors du débat présidentiel entre Kamala Harris et Donald Trump, ce dernier a affirmé que le pays était envahi par des millions d'immigréEs clandestins, libérés de prisons et d'hôpitaux psychiatriques de pays du monde entier, qui ont provoqué une vague de criminalité dans les villes américaines. Et, a t-il dit, dans la ville de Springfield dans l'Ohio, « ils mangent les chiens, les gens qui sont venus, ils mangent les chats, ils mangent les animaux de compagnie des gens qui vivent là ».
Les HaïtienNEs viséEs
L'histoire a commencé par une publication sur Facebook d'Erika Lee, une habitante de Springfield, qui affirmait qu'un voisin avait vu le chat du petit ami de sa fille, qui avait disparu, enlevé et mangé par des HaïtienNEs. « On m'a dit qu'ils faisaient cela aux chiens, ils l'ont fait à Snyder Park avec les canards et les oies ». Il n'y avait rien de vrai dans tout cela, mais le message Facebook a été repris sur des sites de médias sociaux d'extrême droite, puis par le sénateur J.D. Vance, colistier de Trump, qui a repris le récit. Une fois que Trump en a fait état lors du débat, l'histoire est devenue une nouvelle nationale.
Le maire et le directeur de la ville de Springfield ont contesté les fausses affirmations selon lesquelles les immigréEs mangeaient les animaux domestiques, mais M. Trump et M. Vance ont continué à répéter l'histoire lors de leurs rassemblements. L'histoire bien sûr suggère que le peuple haïtien est un peuple sauvage.
Donald Trump Jr., qui parle souvent au nom de son père, a ajouté ceci. « Vous regardez Haïti, vous regardez la composition démographique, vous regardez le QI moyen – si vous importez le tiers-monde dans votre pays, vous allez devenir le tiers-monde », a-t-il déclaré sur une chaîne de télévision conservatrice. « C'est tout simplement élémentaire. Ce n'est pas raciste. C'est juste un fait. »
Trump dénoncé par le gouverneur républicain de l'Ohio
Le langage raciste de Trump a rapidement créé le chaos à Springfield, car des provocateurs ont commencé à lancer des alertes à la bombe qui ont finalement conduit les autorités à fermer les écoles localement, les hôpitaux et la mairie, ainsi que l'université Wittenberg et le Clark State College. Les autorités de Springfield ont également annulé une fête de la culture prévue avec de l'art et de la musique « à la lumière des récentes menaces et des préoccupations en matière de sécurité ». Les HaïtienNEs de Springfield ont peur et sont inquiets.
Mike DeWine, le gouverneur républicain de l'Ohio, qui est né et a grandi à Springfield, a également désavoué les fausses affirmations sur les immigrantEs haïtienNEs et a écrit dans un article d'opinion du New York Times : « En tant que partisan de l'ancien président Donald Trump et du sénateur JD Vance, je suis attristé par la façon dont eux et d'autres continuent de répéter des affirmations qui manquent de preuves et dénigrent les migrants légaux qui vivent à Springfield. Cette rhétorique nuit à la ville et à ses habitants, ainsi qu'à ceux qui y ont passé leur vie. »
Springfield est une ville de 60 000 habitants qui a accueilli ces dernières années entre 12 000 et 15 000 immigrantEs haïtienNEs. Ces immigrantEs ne sont pas des « illégaux », comme l'ont prétendu Trump et Vance, mais bénéficient d'un « statut de protection temporaire », qui leur permet de vivre et de travailler aux États-Unis parce qu'il n'est pas sûr pour eux de retourner dans leur pays d'origine. Comme l'a écrit M. DeWine, « ils sont là légalement. Ils sont là pour travailler ».
Dans ses meetings, Trump s'insurge contre ce qu'il appelle une invasion d'immigrantEs qui sont, selon lui, des « animaux », de la « vermine » et qui « empoisonnent le sang de notre pays ». Trump promet qu'en tant que président, il lancera un effort national pour rassembler des millions d'immigréEs clandestins et les expulser. Il dit maintenant qu'il commencera à Springfield. Raison de plus pour empêcher ce dangereux raciste de devenir président.
Dan La Botz, traduction par la rédaction
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Elections 2024 (Etats-Unis) : Un argument marxiste en faveur du vote pour Kamala Harris

Les personnes qui me connaissent seront probablement choquées et sidérées de lire ma signature accolée à un tel titre. Nom de dieu, je suis choqué. Il s'agit d'un revirement à 180 degrés d'une opinion – non d'un principe – que j'ai fermement défendue pendant la plus grande partie de ma vie. Cinquante-trois ans, pour être exact – de 1967 à 2020.
Tiré de Europe Solidaire Sans Frontières
5 septembre 2024
Par Cliff Conner
En réalité, ce titre sous-estime ma position. Non seulement je pense que les socialistes et les travailleurs, y compris les lecteurs de cette publication [New Politics], devraient voter pour Kamala Harris, mais je les appelle à faire campagne pour elle. Sonnez aux portes. Passez des coups de fil. Distribuez des tracts. Donnez le pognon que vous avez durement gagné si vous en avez les moyens. Faites tout ce qu'il faut pour assurer son élection.
OK. Après avoir énoncé la proposition d'une manière aussi directe que possible, pour ne pas dire provocante, je vais maintenant tenter de la justifier.
Un principe fondamental de l'organisation socialiste à laquelle j'ai adhéré en 1967 stipulait qu'aucun socialiste ne devait jamais voter pour les partis démocrate et républicain ni leur apporter un quelconque soutien politique. Ces partis étaient et sont toujours les partis jumeaux du capitalisme, de l'impérialisme, de la guerre, du racisme, du sexisme, de l'homophobie et de la destruction de l'environnement. Voter pour un démocrate ou un républicain, c'était franchir la ligne de classe, c'était devenir l'équivalent d'un jaune franchissant le piquet de grève syndical.
J'avais adopté ce principe à cause de la guerre du Vietnam. Je m'opposais à la guerre depuis 1964, l'année où j'ai eu l'âge légal de voter. Ayant suivi la campagne présidentielle de Lyndon B. Johnson et celle de Barry Goldwater, j'étais convaincu que Johnson mettrait fin à la guerre – parce qu'il avait dit qu'il le ferait – et que Goldwater pourrait mettre fin au monde – parce qu'il menaçait d'utiliser la bombe atomique au Vietnam s'il était élu. Lorsque Johnson a été élu haut la main, j'ai été très soulagé. Puis vint la grande trahison.
Johnson a presque immédiatement fait le contraire de ce qu'il avait promis pendant sa campagne. En l'espace de deux ans, non seulement il n'a pas mis fin à la guerre, mais il l'a transformée en une guerre aux proportions monstrueuses, envoyant des centaines de milliers de soldats américains au combat et bombardant l'Asie du Sud-Est plus intensément que les puissances de l'Axe ne l'avaient été pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette guerre a coûté la vie à des millions de combattants de la liberté et de civils. Bien que nous n'en ayons pas eu la preuve définitive avant la divulgation des « Pentagon Papers » en 1971, il était avéré que Johnson avait planifié cette escalade alors qu'il faisait campagne comme « candidat de la paix !
Pour faire court, je suis alors devenu un chantre du slogan « Hey, Hey, LBJ : combien d'enfants as-tu tués aujourd'hui ? ». J'ai rejoint le mouvement antiguerre et j'ai commencé à participer à son organisation. J'ai rejoint le mouvement socialiste, je suis devenu marxiste et j'ai juré de ne plus jamais me faire avoir par un démocrate. Au cours des cinquante années qui ont suivi, à chaque élection, j'ai soutenu que démocrates et républicains étaient pour l'essentiel les mêmes. Pas identiques, bien sûr, car s'ils ne faisaient pas semblant d'être différents, ils ne pourraient pas embobiner l'électorat. Mais les conséquences politiques seraient les mêmes, quel que soit le parti qui remporterait les élections : la classe capitaliste continuerait à gouverner, la classe ouvrière continuerait à être exploitée et, comme le chantait Bob Marley, « le rêve d'une paix durable ne restera qu'une illusion éphémère [1] ».
J'écris ces lignes en réponse à un défi affectueux lancé par l'une de mes filles, qui m'a rappelé que je lui avais appris à éviter comme la peste les deux partis jumeaux du capitalisme. Pourquoi, m'a-t-elle demandé, ai-je changé ?
La réponse courte est que je n'ai pas changé. C'est la situation politique américaine qui a changé si radicalement que je me suis senti obligé de revoir mon approche. Mais ne lui avais-je pas dit que voter pour un démocrate serait une violation de principe ?
Oui, je l'ai dit et je le pense toujours. Cependant, j'ai appris que les principes ne sont pas des absolus comme je le croyais autrefois. Parfois, on se retrouve coincé entre deux principes qui s'opposent et qui nous obligent à choisir celui qui est le plus important. C'est le cas ici. Le principe d'assumer la responsabilité d'agir pour éviter une catastrophe historique pour la classe ouvrière l'emporte [2] sur le principe de ne pas voter pour un démocrate.
La politique du « moindre mal » ?
Les personnes décentes et bien intentionnées que je connais et qui ne sont pas socialistes affirment que, malgré tout ce qui ne va manifestement pas dans la société américaine, les démocrates libéraux ne sont pas aussi mauvais que les républicains de droite. Les démocrates sont le « moindre mal » et c'est donc une bonne chose qu'ils gagnent les élections.
Les socialistes ont entendu cet argument ad nauseum et nous nous y sommes opposés à juste titre pendant longtemps. Je m'y suis opposé, comme je l'ai dit, jusqu'en 2020. Et puis les circonstances ont changé. Un mal beaucoup, beaucoup plus grand est soudain entré dans la danse.
La différence entre les deux maux n'était plus simplement une question de plus ou de moins ; elle était désormais qualitative. Et cette différence, j'en suis convaincu, si Donald Trump remporte un second mandat, pourrait bien se traduire par l'oppression et la mort d'une ampleur dépassant ce qui s'est passé en Europe au milieu du 20e siècle. Elle pourrait plonger non seulement les États-Unis, mais aussi une grande partie du monde, dans l'obscurité et l'horreur politiques pendant une génération ou plus. Essayer d'ignorer cela, c'est comme allumer une cigarette dans la soute à munitions. J'estime qu'il est de mon devoir, au nom des principes, de m'y opposer activement, non pas avec de la pensée magique, des fanfaronnades ou des théorisations vides de sens, mais d'une manière matériellement significative. Allez voter ! Pour Kamala Harris !
C'est la situation électorale d'aujourd'hui : on n'a pas le luxe de voter pour qui on voudrait. Les ennemis du prolétariat nous contraignent à un choix purement binaire. Il faut choisir entre Harris et Trump. On peut, bien entendu, s'abstenir, mais pour les électeurs de la classe ouvrière, ce serait une demie voix pour Trump.
Voter pour le candidat d'un tiers parti [3], c'est s'abstenir virtuellement. Tu n'es pas d'accord ? Tu penses que l'un tiers parti pourrait vraiment l'emporter ? Je serais tout à fait à l'aise et confiant en pariant littéralement ma vie que ce ne sera pas le cas. C'est aussi impossible que pour moi de gagner le cent mètres aux Jeux olympiques. Si tu perçois au plus profond de toi le danger existentiel que représente Trump, tu commenceras immédiatement à faire campagne pour Harris.
Cette position, m'a-t-on rétorqué, signifie que je soutiens Kamala Harris, que je soutiens le Parti démocrate ou encore que je soutiens le génocide à Gaza. Aucune de ces affirmations n'est vraie, quel que soit le nombre de fois où l'on m'a demandé si c'est bien ce que je « voulais dire ». Je ne soutiens pas Kamala Harris. Je ne soutiens pas le Parti démocrate. Je déteste leur politique de soutien moral et matériel inconditionnel à Israël, qui commet un génocide contre le peuple palestinien. Je suis partisan de nous débarrasser du Parti démocrate, du Parti républicain et de l'ensemble du système électoral bipartite.
Je soutiens l'idée d'un parti du travail et d'une Amérique socialiste. Non pas l'Amérique du business-as-usual et qui est dirigée par des politiciens qui se disent socialistes, mais une Amérique où l'ensemble du système de production est nationalisé et sous le contrôle des travailleurs. Malheureusement, il n'y a pas de véritable parti du travail à soutenir dans cette élection, et une Amérique socialiste est un objectif, pas une option pour aujourd'hui que l'on puisse obtenir en la souhaitant.
Je rejette la politique impuissante qui consiste à « réclamer » ce qui ne se produira pas à temps pour faire la différence, y compris un parti du travail et une résistance de masse organisée des travailleurs contre l'oppression trumpiste. Je me souviens de Jerry Gordon citant Shakespeare aux ultragauchistes qui « appelaient » à une grève générale contre la guerre au Vietnam :
« Je peux appeler les esprits des vastes profondeurs. »
« Pourquoi, ne le pourrais-je pas moi aussi, et n'importe qui d'autre ! Mais viendront-ils ? »
Mark Twain a eu ces mots restés célèbres : « La foi, c'est croire ce que l'on sait ne pas être. » La politique qui consiste à « réclamer » ce qui n'adviendra pas de sitôt sont des cousins germains des actes de foi.
Bref, mon appel à voter et à faire campagne pour la candidate du Parti démocrate en 2024 est uniquement basé sur le fait qu'elle n'est pas Trump et qu'elle ne représente pas la menace de gouverner comme un autocrate n'ayant aucun compte à rendre.
Quelle est la réalité et l'ampleur du danger que représente une réélection de Trump ?
De nombreux lecteurs de New Politics sont aussi familiers que moi des horreurs de l'époque nazie en Allemagne. En outre, la représentation du 3e Reich dans la culture populaire (livres, films et télévision) devrait permettre à des millions d'Américains de comprendre au moins ce que l'on entend par « le 3e Reich était un régime d'une cruauté presque inimaginable ». Le meurtre de millions de victimes innocentes a fourni un nouveau point de référence de la limite extrême de « l'inhumanité de l'homme envers l'homme (4) ».
« Je n'ai pas de boule de cristal », comme on dit, mais je crois qu'il est tout à fait possible qu'une deuxième administration Trump « sans garde-fou » atteigne et dépasse la cruauté nazie. Je m'attendrais à ce qu'elle commence par descendre des centaines de manifestants antigénocide ou de Black Lives Matter dans les rues. La population de Guantánamo pourrait augmenter rapidement, y compris avec manifestants américains et « immigrés ». Trump a explicitement fait savoir qu'il aimerait voir des camps de concentration « partout dans notre nation » pour lutter contre la criminalité urbaine et les sans-abris ; et bien sûr, la « criminalité urbaine » est étroitement associée dans son cerveau reptilien aux « immigrés » et aux personnes de couleur. C'est ainsi qu'il présente les choses :
« Il se peut que certains n'aimeront pas entendre cela, mais la seule façon d'évacuer les centaines de milliers de personnes, et peut-être même les millions de personnes dans toute notre nation […], c'est d'ouvrir de grandes parcelles de terrain bon marché à la périphérie des villes […], de construire des salles de bain permanentes et d'autres installations, bonnes, solides, mais rapidement construites, et de fabriquer des milliers et des milliers de tentes de bonne qualité, ce qui peut être fait en un jour. Un seul jour. Il faut déplacer les gens (5). »
Trump a explicitement promis que s'il obtenait le contrôle légal de l'exécutif, au « premier jour » de sa prise de fonction, il sera un dictateur qui ne rendra de comptes à personne d'autre qu'à lui-même.
Si tu as besoin d'une preuve supplémentaire de ses intentions, va sur You-Tube et regarde le fameux débat avec Joe Biden du 27 juin 2024. Le monde entier s'est focalisé sur la triste prestation de Biden. […] Cependant, ce qui était le plus affreux ce n'était pas la façon dont Biden s'est exprimé, mais ce que Trump a dit. Quelles que soient les questions que les journalistes lui posaient, il reprenait sans cesse sa diatribe contre les immigrés « violeurs et assassins ». C'était de la démagogie nazie classique, les « immigrés » remplaçant les « juifs » comme boucs émissaires de tous les maux de la société.
Je crois Trump lorsqu'il dit qu'il veut des camps de concentration à profusion, et tu devrais toi aussi le croire, car ses récentes attaques contre les « socialistes », les « communistes » et les « marxistes » nous visent directement, toi et moi. Lorsqu'il qualifie ses opposants politiques, y compris les démocrates, de « vermine » et qu'il accuse les immigrants d'« empoisonner le sang » des États-Unis, il démontre clairement ses intentions fascistes.
Si Trump est élu, son second mandat sera presque certainement « sans garde-fou ». Il a déjà la Cour suprême dans sa poche et, avec son soutien, il pourrait rapidement placer le ministère de la justice entièrement sous son commandement. Quiconque pense que « l'armée américaine par principe apolitique » va s'interposer et l'arrêter, se trompe malheureusement. Tout cela est-il vraiment « sans différence » avec ce que l'on peut attendre d'une administration Kamala Harris ?
Le marxisme et la révolution bourgeoise
Permettez-moi d'expliquer la différence en termes marxistes. Les démocrates disent que Trump représente une menace pour la « démocratie ». Le problème, c'est que la démocratie américaine n'est pas « la cité brillante sur une colline » qu'elle a toujours promise. Elle n'a certainement pas tenu ses promesses à l'égard des populations indigènes d'Amérique du Nord, des Afro-Américains – que ce soit pendant ou après la période de l'esclavage – ou encore des réfugiés et des immigrants qui n'ont vu qu'hypocrisie dans les mots d'accueil : « Donnez-moi vos fatigués, vos pauvres, vos masses recroquevillées qui aspirent à respirer librement. » La promesse d'une « justice égale pour tous » a été profondément corrompue par la capacité des criminels fortunés à « jouer » avec le système juridique en achetant les services d'avocats très coûteux (sans parler de l'encombrement de tous les tribunaux par des juges de droite […]).
Il n'en reste pas moins vrai que la société américaine bénéficie depuis ses origines de ce que les marxistes appellent la « démocratie bourgeoise ». C'est-à-dire la démocratie capitaliste. On l'appelle parfois « démocratie politique » pour la distinguer de la « démocratie économique » ou de la « démocratie socialiste ».
L'essence de la démocratie bourgeoise est la fidélité à l'État de droit et l'égalité devant la loi, ce qui exclut le règne d'autocrates qui n'ont pas de comptes à rendre. Quiconque pense que Marx, Lénine ou Trotsky ont crotté sur la démocratie bourgeoise en la qualifiant de « pas différente de la monarchie » se trompe tragiquement. Ils ont compris que la démocratie bourgeoise était l'aboutissement monumental de l'une des révolutions sociales les plus importantes au monde : La Révolution française de 1789-1793.
Les droits démocratiques bourgeois sont le fondement nécessaire de tous les droits humains. Ils ont été codifiés pour la première fois dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la Révolution française et dans le Bill of Rights de la Constitution américaine. La consolidation et l'extension des acquis démocratiques des révolutions bourgeoises sont des conditions préalables à la démocratie socialiste. La démocratie bourgeoise et les droits démocratiques bourgeois aux États-Unis sont souvent considérés comme étant acquis, mais les marxistes, entre tous, devraient être parfaitement conscients de ce que signifierait leur perte. Cela rendrait les luttes dans lesquelles nous sommes actuellement engagés beaucoup, beaucoup plus difficiles et, par conséquent, encore plus difficiles à gagner. Si nous perdions la démocratie bourgeoise, les mouvements contre le génocide, pour le droit à l'avortement, pour les droits syndicaux, pour la justice pour Cuba, pour la justice climatique, seraient écrasés, réprimés et poussés dans la clandestinité – pour au moins une génération et peut-être beaucoup plus longtemps. Aucun principe politique ne peut primer sur la nécessité de résister activement à cette éventualité. Oui, la « résistance » implique bien plus que la simple tenue d'un vote alternatif à un démagogue, mais à l'heure actuelle, c'est la seule voie qui s'offre à nous. Les Palestiniens et leurs alliés poursuivront certainement la lutte contre le génocide à Gaza par tous les moyens nécessaires, et contre les politiques de Biden et Harris qui fournissent les armes qui tuent à Gaza. Peut-on concilier cela avec le fait de voter pour Harris contre Trump ? C'est possible et cela doit l'être, pour toutes les raisons que j'ai exposées ici.
En tant que marxiste, j'adhère également au matérialisme philosophique par opposition à l'idéalisme. J'ai donc compris depuis longtemps que le socialisme ne peut pas être atteint par des arguments logiques influençant les idées des gens, mais par des événements matériels qui poussent les travailleurs à résister par millions au système capitaliste qui s'effondre et à créer une alternative socialiste pour le remplacer. Pour la même raison, je ne m'attends pas à ce que mes arguments changent l'état d'esprit de ceux dont l'adhésion au principe de ne pas voter pour les démocrates est profonde et de longue date. Mais garder mon opinion pour moi reviendrait à violer le plus grand de mes principes : faire tout ce qui est en mon pouvoir limité pour empêcher la destruction désastreuse de la démocratie bourgeoise.
Ceux qui considèrent que ne pas voter pour un démocrate est un principe absolu disent que cela pourrait politiquement induire la classe ouvrière en erreur en lui faisant croire qu'un parti capitaliste peut résoudre ses problèmes. C'est vrai, mais c'est une erreur de l'idéalisme philosophique que de considérer les idées, erronées ou non, comme le facteur principal de la lutte des classes. Ce n'est pas le cas. Les conditions matérielles qu'un régime protofasciste à la Trump imposerait dépassent de loin la confusion politique à quelque échelle que ce soit. […]
Pour illustrer ce contre quoi je m'élève ici, je citerai une opinion parue le 28 août 2024 dans Socialist Organizer, le périodique d'une organisation que je respecte et admire :
« Les candidats [du Parti démocrate] n'obtiendront pas un vote garanti de la part de tout le monde simplement parce que nous ne voulons pas de Trump. Il est évident que nous ne le voulons pas. Personne ne veut quatre années supplémentaires de cette absurdité, mais il est dommage que nous n'ayons que deux options. Pour moi, Kamala n'est que Biden 2.0. Nous avons besoin d'un parti du travail. Il nous faut d'autres partis qui peuvent avoir des candidats que les gens voudront soutenir et pour lesquels ils voudront voter. ».
Cette opinion donna lieu au commentaire suivant de la rédaction : « Nous sommes d'accord ! »
Je suis catégoriquement en désaccord, camarades. La menace de Trump n'est pas simplement « quatre années supplémentaires de cette absurdité ». Il n'est pas simplement « dommage » que nos seules options électorales se limitent à Harris et Trump. Kamala n'est pas « juste Biden 2.0 ». Elle est la candidate démocratique bourgeoise qui se présente contre l'antithèse de la démocratie bourgeoise. La différence est une question de vie ou de mort à l'échelle mondiale.
Cliff Conner
1 « Guerre ». Marley citait en fait un discours d'Hailé Sélassié.
2 NdT. Ici l'auteur fait un jeu de mots intraduisible en utilisant le verbe « to trump » qui signifie éclipser » .
3 NdT. C'est ainsi qu'on désigne les candidats à la présidentielle ni démocrate ni républicain. Pour le scrutin de novembre, ils sont XXX
4 Que l'on me pardonne l'emploi du mot “homme” pour évoquer « l'inhumanité du genre humain », mais c'est ainsi que cette expression nous est parvenue.
5 Discours du 26 juillet 2022.
P.-S.
• Entre les lignes entre les mots. 24 septembre 2024 :
Source : Publié par Against The Current :
https://againstthecurrent.org/a-marxist-case-for-voting-for-kamala-harris/
Les diverses prises de position publiées sur la site d'Against The Current sont disponibles en anglais sur ESSF.
• Clifford D. Conner's latest book is The Tragedy of American Science. He previously authored A People's History of Science : Miners, Midwives, and Low Mechanicks and Jean Paul Marat : Tribune of the French Revolution.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Comment la guerre à Gaza a fracturé la société américaine

Manifestations sur les campus, divisions au sein du Parti démocrate, conflit générationnel… L'offensive israélienne et le soutien constant apporté par Joe Biden à Benyamin Nétanyahou ont creusé un fossé parmi les Américains. De quoi entamer la “relation spéciale” entre Israël et les États-Unis, analyse “The Guardian”. Un an après les attaques du 7 octobre, “Courrier International” revient toute cette semaine sur le conflit qui a déstabilisé le Moyen-Orient.
Tiré de Courrier international. Article publié dans The Guardian à l'origine. Dessin de Cristina Sampaio, Portugal.
[Cet article est à retrouver dans notre hors-série “Israël-Palestine, une fracture mondiale”, en vente à partir du 25 septembre chez votre marchand de journaux et sur notre site.]

Rarement un chef d'État a été reçu avec un accueil aussi glacial que le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, lorsqu'il est arrivé à Washington pour s'exprimer devant le Congrès, à la fin de juillet. Aucune personnalité politique américaine n'est venue l'accueillir sur le tarmac, et des milliers de personnes ont manifesté contre sa venue : 200 membres de l'organisation Jewish Voice for Peace ont même été arrêtés devant le Capitole.
Plus révélateur encore, la moitié des élus démocrates du Congrès ont décidé de boycotter son discours. “Il y a une dizaine d'années, cela aurait été impensable”, commente Peter Frey, président de J Street, un groupe de pression juif de Washington qui soutient le droit d'Israël à se défendre, mais aussi la création d'un État palestinien. L'une des parlementaires présentes, la députée Rashida Tlaib, portait un keffieh et brandissait une pancarte qualifiant Nétanyahou de “criminel de guerre, coupable de génocide”.
Pendant ce temps, un certain nombre de syndicats, dont celui des enseignants, des employés de services et des ouvriers de l'automobile, ont adressé une lettre à Joe Biden pour lui demander de mettre fin au soutien des États-Unis à l'offensive israélienne à Gaza.
Coup de semonce
Selon les sondages, 70 % des démocrates et 35 % des républicains souhaitent poser des conditions à l'aide militaire apportée à Israël. Sur ce sujet, le fossé n'a cessé de se creuser entre les électeurs et le gouvernement Biden. Première conséquence : la confiance déjà chancelante des citoyens à l'égard du gouvernement continue de s'éroder. “C'est la démocratie qui est en jeu, analyse Peter Frey. Et cette bataille se joue devant nos yeux. Ce n'est pas sain. Et ce n'est pas une bonne chose pour Israël.” Et dans la mesure où les Américains s'intéressent à la politique étrangère, ajoute-t-il, “je pense qu'à long terme cela risque de saper leur confiance dans les institutions politiques”.
Bien avant sa performance catastrophique lors du débat télévisé face à Donald Trump, Joe Biden avait subi un premier revers avec la campagne menée par les militants du mouvement uncommitted [qui préconisait de voter “non engagé”, soit l'équivalent d'un vote blanc, aux primaires démocrates pour critiquer son soutien inconditionnel à Nétanyahou]. En persuadant plus de 100 000 démocrates de voter uncommitted lors de la primaire du Michigan, plutôt que de soutenir l'homme qui, selon eux, encourageait un génocide, ils ont envoyé au Parti démocrate un message fort : l'un des États clés les plus stratégiques pour l'élection de 2024 risquait de basculer. Pour finir, plus de 700 000 électeurs dans 23 États ont choisi de voter “non engagé” lors des primaires démocrates.
Ce vote de protestation a montré que la position traditionnelle de soutien à Israël était en train de s'éroder, du moins chez les progressistes, devenant une victime collatérale supplémentaire d'un conflit brutal, apparemment sans issue et qui menace toujours de prendre une ampleur régionale. Outre la mort de plus de 40 000 Palestiniens (et probablement beaucoup plus), le déplacement de millions de personnes et la destruction de plus de la moitié du bâti dans la bande de Gaza, cette guerre semble avoir porté un coup dur, peut-être fatal, à la “relation spéciale” d'Israël avec son plus proche allié.
Un fossé générationnel
Entre-temps, l'entêtement avec lequel Joe Biden soutient l'offensive menée par Benyamin Nétanyahou, même si celle-ci n'a pas réussi à détruire le Hamas ni à faire libérer tous les otages, ne menace pas seulement l'unité au sein des démocrates mais creuse un fossé générationnel.
Les jeunes Américains sont désormais presque deux fois plus nombreux que leurs parents à soutenir la cause palestinienne, ce qui provoque des tensions, en particulier au sein des familles juives. Des tensions que l'on a retrouvées sur les campus universitaires, amenant de vénérables institutions – dont la mission est avant tout de développer le libre arbitre et l'esprit critique – à répondre par la violence policière aux manifestations majoritairement pacifiques de leurs étudiants. Plus inquiétant encore, ce positionnement pro-israélien fait douter de nombreux Américains de l'engagement de leur nation en faveur de la liberté d'expression, des droits de l'homme et de l'État de droit – et les pousse à se demander, en somme, où sont passées les valeurs de l'Amérique.
Les Américains les plus déstabilisés par cette dynamique sont les étudiants juifs de gauche, dont la plupart restent attachés à Israël même s'ils sont très critiques de sa politique actuelle. Aujourd'hui, nombre d'entre eux se retrouvent de plus en plus isolés de leurs alliés politiques d'autrefois. S'ils sont gênés par les discours virulents entendus lors de certaines manifestations – auxquelles ils participent cependant –, ils ne se retrouvent pas dans le positionnement des groupes pro-Israël, de certains hommes et femmes politiques et des présidents d'universités qui cherchent à présenter toutes les manifestations antiguerre comme antisémites.
“Je suis de gauche, déclare Lauren Haines, étudiante en dernière année à l'université du Michigan et ancienne présidente de la branche universitaire de J Street sur son campus. Je m'informe sur Gaza tous les jours et je mets un point d'honneur à ne pas regarder ailleurs et je dois dire que j'ai du mal à dormir sachant que mes impôts servent à ça. Mais je ne comprends pas certaines tactiques de la gauche, tout ce discours ‘soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous' manque singulièrement de nuances. Je soutiens le peuple palestinien, et je suis convaincue que l'on peut faire avancer sa cause sans devoir pour autant propager des discours clivants et dangereux, comme dire que tous les sionistes sont des monstres ou encore attaquer des institutions juives parce qu'elles sont liées à Israël.”
Des campus sous haute tension
Cela dit, Lauren Haines condamne fermement l'usage de la force pour réprimer les manifestations propalestiniennes. “Les violences policières sur les campus sont scandaleuses, observe-t-elle, même si je ne suis pas toujours d'accord avec les propos des manifestants.”
Le romancier [canado-égyptien] Omar El-Akkad a lui aussi été choqué par la répression violente des étudiants. “Pour moi, c'était une mobilisation qui rassemblait des gens issus d'horizons très différents, une situation inédite dans le contexte américain, note-t-il. Et la réaction des présidents d'université et de quelques politiques va, selon moi, à l'encontre de tous les principes fondateurs des États-Unis, qui font de ce pays une exception.”
Si les conservateurs restent apparemment de marbre face à ce qui se passe à Gaza (Trump a même conseillé à Israël de “finir le boulot”), de nombreux Américains demeurent profondément attachés à une vision de l'Amérique comme phare du monde libre. Ce qui gêne le plus la jeune génération, ce n'est pas seulement le soutien militaire américain à l'offensive israélienne à Gaza, mais ce qu'il dit du rôle du pays en tant que garant de la paix dans le monde, analyse Michael Barnett, professeur de relations internationales et de sciences politiques à l'université George-Washington. “L'idée que notre politique étrangère est immorale – et donc contraire aux valeurs américaines, contraire à l'éthique – fait son chemin”, analyse-t-il. Dénoncer l'invasion de l'Ukraine par la Russie tout en donnant un blanc-seing à Israël pour rayer la Palestine de la carte ne passe pas, “c'est de la pure hypocrisie, poursuit Barnett. Et les jeunes ne l'acceptent pas.”
Que va faire Kamala Harris ?
Kamala Harris va-t-elle changer la donne ? Rien n'est moins sûr. Certains observateurs ont été rassurés par la teneur, très critique, de la rencontre entre la vice-présidente américaine et Benyamin Nétanyahou et sa décision de choisir Tim Walz comme colistier plutôt que Josh Shapiro [le gouverneur de Pennsylvanie, de confession juive] dont le positionnement pro-Israël et les propos sur les manifestants antiguerre ont indigné l'aile gauche du Parti démocrate.
Mais on ignore s'il faut s'attendre à du changement en matière de politique étrangère [si Kamala Harris venait à être élue à la présidentielle du 5 novembre]. La rumeur d'une rencontre avec des délégués du mouvement uncommitted pour mettre en place un embargo sur les livraisons d'armes à Israël a vite été démentie par son conseiller à la sécurité nationale, Phil Gordon. La vice-présidente “va toujours faire en sorte qu'Israël ait les moyens de se défendre contre l'Iran et tous les groupes terroristes soutenus par l'Iran. Elle n'est pas favorable à un embargo sur les armes livrées à Israël. Elle va continuer à travailler pour protéger les civils à Gaza et faire respecter le droit humanitaire international.”
Alors qu'Israël poursuit son offensive, détruit méthodiquement Gaza et tue, sans faire de distinction, des civils et des combattants du Hamas avec des armes qui lui ont été fournies par les États-Unis, ce genre de déclarations équivoques sonnent creux pour de nombreux Américains.
La question de la complicité des États-Unis, dans ce que certains spécialistes qualifient de génocide, ne pourra être éludée longtemps. Le positionnement de Kamala Harris aura des répercussions considérables, non seulement sur sa potentielle élection à la Maison-Blanche, mais sur la paix au Moyen-Orient, sur le sort des civils qui cherchent à échapper aux bombardements, ainsi que sur le prestige des États-Unis à l'international et leur réputation de “force du bien” dans le monde.
Aaron Gell
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

15 Règles-Média couvrant Israël

Aujourd'hui, Israël a massacré un demi-millier de personnes au Liban avec Tsahal lançant plus de mille attaques aériennes. Les États-Unis, encore une fois, envoient des troupes additionnelles au Moyen-Orient, sous les ordres d'un cerveau présidentiel qui a complètement arrêté de fonctionner. Israël lance un nouveau projet de violence militaire massive afin que Nétanyahou évite la prison en son pays révolté et ailleurs sous l'ordre de la Cour Pénale internationale de La Haye.
Merci à Caitlin Johnstone pour l'inspiration
24 septembre
Artistes pour la Paix P.J.
Rafraîchissons la mémoire des média des 15 règles appliquées :
Règle 1 : l'histoire israélienne a commencé le 7 octobre 2023 (personne ne se souvient de ce qui est arrivé avant).
Règle 2 : tous les meurtres causés par Israël sont justifiés par la règle 1, vérité à retenir, même si Nétanyahou commet des horreurs considérées injustifiables quand elles sont perpétrées par Poutine ou par les Ayatollahs iraniens.
Règle 3 : Israël a le droit de se défendre, mais personne d'autre.
Règle 4 : Israël ne bombarde jamais des civils, que des terroristes. Si de nombreux civils meurent, c'est qu'ils étaient des terroristes, ou que des terroristes les ont tués ou qu'ils habitaient trop près des terroristes. Sinon, il y a eu une raison mystérieuse qu'il faut laisser du temps à Tsahal d'enquêter.
Règle 5 : si vous critiquez quoi que ce soit fait par Israël, c'est par haine des Juifs. Il n'y a aucune autre raison pour laquelle vous vous opposez à ce qu'on laisse tomber des bombes explosives sur des refuges peuplés d'enfants et de secouristes humanitaires.
Règle 6 : aucune action d'Israël ne dépasse en haine les critiques évoquées en règle 5. Les critiques des actions de Tsahal sont bien pires que les actions elles-mêmes, puisqu'ils haïssent les Juifs et veulent commettre un nouvel Holocauste que 100% de notre énergie politique doit s'employer à prévenir.
Règle 7 : Israël n'est jamais le bourreau, il ne peut être que victime. Si Israël a attaqué le Liban, c'est que le Hezbollah a lancé des roquettes sur un pays occupé à son petit business génocidaire de paix. Et s'il y a des manifestants contre Tsahal réduisant des villes entières en poussières, Israël doit rester LA victime pleurée par les pays qui lui procurent ses armes.
Règle 8 : le fait qu'Israël est perpétuellement en guerre avec ses voisins et ses populations indigènes déplacées doit être interprété comme preuve que la règle 7 est vraie, au lieu de penser qu'elle n'est qu'un non-sens ridicule.
Règle 9 : les vies arabes sont beaucoup moins importantes que les vies occidentales ou israéliennes. Personne n'a le droit de réfléchir longtemps à ce fait avéré.
Règle 10 : les média disent toujours la vérité sur Israël et ses conflits. Si vous entretenez des doutes, vous êtes vraisemblablement en violation selon la règle 5.
Règle 11 : toutes allégations décrivant les ennemis d'Israël sous un jour négatif peuvent être rapportées comme des nouvelles factuelles sans aucune vérification, tandis que toutes les preuves confirmées de criminalité israélienne doivent être rapportées avec prudence et scepticisme comme « Le Liban ou le ministère de la santé contrôlé par le Hamas » affirment, précautions essentielles pour ne pas être accusé d'être propagandiste antisémite.
Règle 12 : Israël doit continuer à exister en sa forme politique actuelle, peu importent les coûts ou les vies humaines gaspillées. Aucune raison opposée ne doit être présentée (comme la formation de deux nations), sinon vous violez la règle 5.
Règle 13 : les gouvernements canadien et américain ne vous ont JAMAIS menti sur quoi que ce soit, en étant TOUJOURS du bon côté des guerres faites pour votre bien.
Règle 14 (pour les Américains seulement) : rien de ce qui arrive au Moyen-Orient n'est aussi urgent ou signifiant que de s'assurer que la bonne personne gagne les élections présidentielles. Aucun méfait ne doit vous écarter de cette mission d'importance cruciale.
Règle 15 : Israël doit être protégé parce que dernier bastion de la liberté et de la démocratie au Moyen-Orient, peu importe le nombre de journalistes que Tsahal doit assassiner, peu importe le nombre d'institutions de presse qu'il doit fermer, peu importe le nombre de manifestations que ses partisans doivent démanteler par la force brutale, peu importe la liberté d'expression qu'il doit éliminer, peu importe le nombre de droits civils qu'il doit effacer, et peu importe le nombre d'élections que ses lobbyistes doivent acheter.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
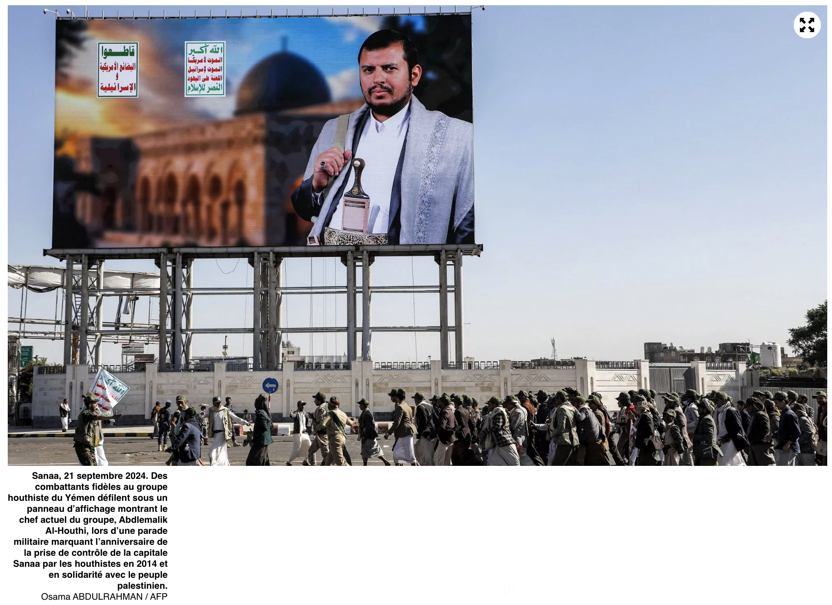
Yémen. Dix ans de pouvoir houthiste, une emprise encore précaire
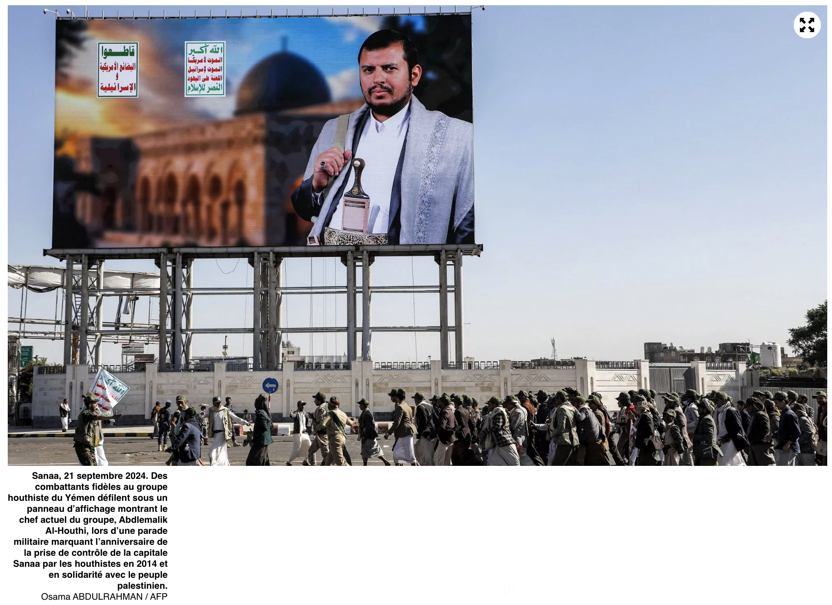
Il y a dix ans, le 21 septembre 2014, les rebelles houthistes s'emparaient de Sanaa et renversaient le gouvernement issu du « Printemps yéménite ». Depuis lors, leur exercice du pouvoir dans de larges parties du Yémen s'est affirmé tant en interne, à travers la mise en place d'un État autoritaire, qu'à l'échelle régionale, où leur capacité militaire va croissante. Le 15 septembre 2024, un de leurs missiles atteignait à nouveau le centre d'Israël, éloigné de plus de 2 000 kilomètres. Bilan.
Tiré d'Orient XXI.
Depuis vingt ans, la place prééminente occupée par les houthistes au Yémen est le fruit de divers paradoxes. Né dans les montagnes de l'extrême nord du pays, non loin de l'Arabie saoudite, le mouvement emmené par la famille Al-Houthi avait profité de sa confrontation militaire avec l'État yéménite, entamée en juin 2004, pour gagner en expérience et légitimité. Au prix de dizaines de milliers de morts et de destructions de villages entiers, il avait alors accru sa puissance armée, ses connexions tribales, sa cohérence idéologique et son assise géographique jusqu'à gagner les confins de la capitale Sanaa peu avant le soulèvement de 2011. Rattaché à une expression marginale du paysage politique et religieux, le groupe Ansar Allah (Partisans de Dieu), courant de renouveau zaydite lié au chiisme dans un pays majoritairement sunnite, avait su mettre de côté les enjeux identitaires pour capitaliser d'abord sur le ressentiment face au pouvoir du président Ali Abdallah Saleh (jusqu'en 2012), puis contre le processus révolutionnaire du « printemps yéménite ». Ce dernier avait pourtant abouti au départ de l'ancien président et à son remplacement par Abd Rabbo Mansour Hadi chargé de mener la transition vers la démocratie. C'est toutefois en s'alliant avec leurs anciens ennemis du clan Saleh à compter de 2012 que paradoxalement les houthistes ont atteint leur masse critique, devenant le « monstre de Frankenstein » que les Yéménites connaissent. En effet, entre 2012 et 2014, les houthistes ont pu s'appuyer sur les ressources de Saleh, financières et militaires, pour mettre à mal le processus révolutionnaire qu'ils avaient pourtant initialement soutenu. Ce faisant, tous deux pouvaient atteindre un autre de leurs objectifs : mettre en pièce leurs ennemis communs, les Frères musulmans du parti al-Islah. Pour Saleh, ce pacte devait lui permettre de se venger de ceux qui l'avaient trahi lorsqu'ils s'étaient engagés dans le soulèvement révolutionnaire. Mais à l'évidence, l'accord était pour lui un trompe-l'œil et était passé au bénéfice des houthistes. Ils pouvaient dès lors entamer une phase d'exercice et de consolidation du pouvoir qui, dix ans plus tard, perdure malgré d'évidentes fragilités.
Incarner l'État
Passée la surprenante phase militaire de prise de contrôle de structures étatiques (radio et télévision nationale, ministères, casernes), les houthistes à compter du 21 septembre 2014 ont agi avec méthode. Leur coup d'État a autant été caractérisé par une volonté de dénoncer les compromis du nouveau gouvernement par rapport au projet révolutionnaire que de répondre à des aspirations réactionnaires. Les houthistes ont d'abord pu neutraliser le pouvoir reconnu par la communauté internationale en assignant à résidence le président Abd Rabbo Mansour Hadi. Ce dernier a pu fuir vers Aden et de là faire appel à l'Arabie saoudite qui est intervenue militairement à compter du 26 mars 2015 pour restaurer son pouvoir et vaincre les houthistes, sans succès.
Le processus interne essentiel de construction d'un État houthiste a été largement occulté par l'intervention de l'armée saoudienne ainsi que par les liens entre Ansar Allah et l'Iran. L'un et l'autre ont été certes importants et expliquent l'impasse que connait le pays. Mais ils n'épuisent aucunement l'analyse d'un pouvoir qui s'est affirmé au fil du temps et dont l'organisation a été finalement contre-intuitive. En effet, loin de l'image de combattants rétrogrades venus des tribus arriérées des hautes terres du Yémen, l'exercice du pouvoir par les houthistes s'est avéré efficace à divers titres. Ils se sont employés à incarner pleinement l'État dans l'ensemble des zones qu'ils ont contrôlé — le quart occidental du pays et environ la moitié de la population. Bien que n'étant pas reconnus par la communauté internationale et confrontés aux bombardements de la coalition emmenée par l'Arabie saoudite, ils ont su mettre en place des institutions qui ont empêché un effondrement général des services publics, de l'économie et de la sécurité. La stabilité du taux de change du riyal dans les zones sous leur contrôle est comparativement meilleure à celle dans les réduits du gouvernement reconnu par la communauté internationale. Le faible nombre d'attentats jihadistes atteste également de cette réalité, tout comme la permanence de médias gouvernementaux, d'une façade de vie partisane et institutionnelle.
Tout d'abord pour construire l'État houthiste, les nouveaux maitres de Sanaa ont assuré une forme de continuité en s'appuyant sur les réseaux de fonctionnaires liés à Saleh. Dans les banques, l'armée, la police, les entreprises publiques, la stabilité a un temps primé. Les petits fonctionnaires issus de domaines perçus comme moins essentiels, par exemple dans l'éducation, étaient eux délaissés, souvent privés de salaires et forcés donc de trouver des moyens de subsistance. Leur engagement, comme celui du personnel de santé, assurait malgré tout souvent une forme de continuité tout en n'empêchant pas le ressentiment parmi la population.
S'autonomiser
Progressivement les houthistes ont placé leurs hommes — d'autant plus aisément qu'Ali Abdallah Saleh, en décembre 2017, s'est retourné contre eux, finissant alors assassiné. Ils ont pu recomposer les élites politiques et sécuritaires en offrant une prime particulière à leur propre groupe, les hachémites se revendiquant descendants du Prophète. Ces derniers, forme de noblesse très minoritaire à l'échelle de la société mais qui joue un rôle central dans le zaydisme, ont avec les houthistes retrouvé leur rang perdu au moment de la révolution du 26 septembre 1962 qui avait mis fin à la monarchie.
Pour mener à bien cette recomposition, ils ont pu instrumentaliser et capter une part de l'aide humanitaire internationale, prenant en tenailles les agences de l'ONU ainsi que les ONG. Celles-ci ont été depuis 2015 tétanisées par la crainte d'une famine généralisée, acceptant finalement les exigences des houthistes et une corruption manifeste des structures de distribution. C'est ainsi qu'en 2018 l'offensive contre Hodeïda, cinquième ville la plus peuplée du Yémen, a pu être annulée à la suite de l'accord de Stockholm, ancrant leur position dans ce port et donc sur la Mer Rouge. Parallèlement, au niveau local, les houthistes ont développé un maillage sécuritaire, accentuant la surveillance et la répression de la société civile. Ils se sont appuyés sur un réflexe nationaliste en décrivant l'opération de la coalition arabe, soutenue par les Occidentaux, comme une agression, préservant ainsi un certain niveau de popularité. L'alignement de leurs ennemis yéménites sur les positions des pays étrangers — Arabie saoudite donc, mais aussi Émirats arabes unis pour ce qui concerne les sudistes —a pu faire oublier leur propre proximité idéologique et diplomatique avec l'Iran. L'idéologie portée par leur leader Abdlemalik Al-Houthi s'est affirmée, infusant dans la société à travers l'armée mais aussi les structures éducatives et religieuses, tournées vers l'effort de guerre. Une génération s'en trouve sacrifiée. Le zaydisme s'est aussi transformé, parfois à travers l'instauration de nouvelles célébrations religieuses comme Achoura ou au moment du Mouloud. Un système de taxation spécifique au bénéfice des hachémites, les restrictions exercées sur les droits élémentaires des femmes et une police morale ont enfermé la société dans une logique que bien des opposants des houthistes décrivent comme totalitaire ou finalement proche de ce que les talibans afghans imposent. L'idéologie est également structurée autour d'une contestation de l'ordre international, faisant de la question palestinienne un élément essentiel et ancrant le mouvement dans l'Axe de la résistance porté par l'Iran. Au plus fort de la guerre en Syrie, les portraits du président syrien Bachar Al-Assad trônaient dans Sanaa. L'idéologie reste pourtant caractérisée par des non-dits autour de la place des hachémites et des objectifs politiques internes. Bien que se revendiquant républicains, il est entendu que la prééminence d'Abdelmalik Al-Houthi et de son clan en général, notamment la tutelle exercée par Hussein, son demi-frère et fondateur du mouvement, tué par l'armée en 2004, acte pour les houthistes le passage vers un pouvoir héréditaire. Celui-ci s'autonomise en partie aussi de l'État et marginalise de fait la majorité sunnite, il s'appuie sur une peur de la répression qui est d'autant plus efficace dans un contexte de guerre.
Humilier les Saoudiens
L'inefficacité militaire de l'opération Tempête décisive menée par l'Arabie saoudite depuis 2015 a été largement actée, y compris par les dirigeants saoudiens. Ceux-ci ont en effet depuis avril 2022 entrepris de se retirer du dossier yéménite. Depuis lors, les bombardements aériens des positions houthistes ont cessé. Abd Rabbo Mansour Hadi a été forcé à la démission et les discussions menées grâce à Mascate ont un temps donné le sentiment que la paix était à portée de main. Les houthistes toutefois n'entendaient pas faciliter le travail des Saoudiens. En interne, ils tiennent militairement leurs positions et n'ont pas réduit la pression sur Taez par exemple. Depuis plus de deux ans, ils s'emploient à humilier l'Arabie saoudite en faisant monter le prix de la paix. Leurs exigences ont ainsi notamment été financières, visant à faire payer à la coalition les arriérés de salaires des fonctionnaires.
L'engagement armé des houthistes en Mer Rouge depuis novembre 2023 a rendu toute signature d'un accord impossible. Il a placé les Saoudiens dans l'embarras, incapables de reprendre les armes au nom des Américains et des Israéliens contre un mouvement affirmant s'engager en faveur des Palestiniens et qui a gagné en popularité sur le plan régional. Le mufti omanais, Ahmed Al-Khalili, avait pu signaler sa reconnaissance, tout comme Yahya Sinouar, chef du Hamas.
En dix mois, les plus de 120 attaques contre les navires marchands, de plus en plus sophistiquées, puis les missiles envoyés vers Israël en solidarité avec la population de Gaza ont de nouveau braqué les projecteurs sur le Yémen. En réaction à l'ouverture de ce nouveau front, les États-Unis et les Britanniques ont relancé les bombardements contre les houthistes dès décembre 2023, sans davantage de succès. Le bombardement israélien du port de Hodeïda le 20 juillet 2024 a eu pour effet principal de désorganiser l'aide humanitaire, aucunement d'affecter la capacité de projection des houthistes. Deux mois plus tard, un missile d'une nouvelle technologie explosait à six kilomètres de l'aéroport de Tel-Aviv.
La stratégie régionale des houthistes pèse indéniablement sur les Yéménites ainsi que sur les populations des pays voisins. L'attaque contre le navire Ruby Mar qui transportait des engrais en mars 2024 et a coulé avec sa cargaison, puis contre le pétrolier Sounion en août 2024 rendent compte d'une logique jusqu'au-boutiste. Une marée noire d'ampleur historique a, semble-t-il, été évitée in extremis en septembre 2024. L'Égypte elle-même a perdu près de la moitié des revenus liés à l'exploitation du canal de Suez. Les ONG et agences onusiennes gérant l'aide internationale ont subi au cours de l'été une vague de répression à Sanaa. Les houthistes se sentent autorisés à s'extraire des règles internationales.
Si la nuisance causée par les houthistes en Israël (et pour les pays occidentaux) n'est pas que symbolique et si elle flatte l'engagement sincère de la population en faveur des droits des Palestiniens, nombre des Yéménites sont avant tout impatients d'en finir avec la guerre. Ils demandent des houthistes une clarification de leur projet politique de long terme sans laquelle la stabilité de leur régime imposée depuis dix ans risque de ne pas durer.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.















