Derniers articles

Elections 2024 (Etats-Unis) : Un argument marxiste en faveur du vote pour Kamala Harris

Les personnes qui me connaissent seront probablement choquées et sidérées de lire ma signature accolée à un tel titre. Nom de dieu, je suis choqué. Il s'agit d'un revirement à 180 degrés d'une opinion – non d'un principe – que j'ai fermement défendue pendant la plus grande partie de ma vie. Cinquante-trois ans, pour être exact – de 1967 à 2020.
Tiré de Europe Solidaire Sans Frontières
5 septembre 2024
Par Cliff Conner
En réalité, ce titre sous-estime ma position. Non seulement je pense que les socialistes et les travailleurs, y compris les lecteurs de cette publication [New Politics], devraient voter pour Kamala Harris, mais je les appelle à faire campagne pour elle. Sonnez aux portes. Passez des coups de fil. Distribuez des tracts. Donnez le pognon que vous avez durement gagné si vous en avez les moyens. Faites tout ce qu'il faut pour assurer son élection.
OK. Après avoir énoncé la proposition d'une manière aussi directe que possible, pour ne pas dire provocante, je vais maintenant tenter de la justifier.
Un principe fondamental de l'organisation socialiste à laquelle j'ai adhéré en 1967 stipulait qu'aucun socialiste ne devait jamais voter pour les partis démocrate et républicain ni leur apporter un quelconque soutien politique. Ces partis étaient et sont toujours les partis jumeaux du capitalisme, de l'impérialisme, de la guerre, du racisme, du sexisme, de l'homophobie et de la destruction de l'environnement. Voter pour un démocrate ou un républicain, c'était franchir la ligne de classe, c'était devenir l'équivalent d'un jaune franchissant le piquet de grève syndical.
J'avais adopté ce principe à cause de la guerre du Vietnam. Je m'opposais à la guerre depuis 1964, l'année où j'ai eu l'âge légal de voter. Ayant suivi la campagne présidentielle de Lyndon B. Johnson et celle de Barry Goldwater, j'étais convaincu que Johnson mettrait fin à la guerre – parce qu'il avait dit qu'il le ferait – et que Goldwater pourrait mettre fin au monde – parce qu'il menaçait d'utiliser la bombe atomique au Vietnam s'il était élu. Lorsque Johnson a été élu haut la main, j'ai été très soulagé. Puis vint la grande trahison.
Johnson a presque immédiatement fait le contraire de ce qu'il avait promis pendant sa campagne. En l'espace de deux ans, non seulement il n'a pas mis fin à la guerre, mais il l'a transformée en une guerre aux proportions monstrueuses, envoyant des centaines de milliers de soldats américains au combat et bombardant l'Asie du Sud-Est plus intensément que les puissances de l'Axe ne l'avaient été pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette guerre a coûté la vie à des millions de combattants de la liberté et de civils. Bien que nous n'en ayons pas eu la preuve définitive avant la divulgation des « Pentagon Papers » en 1971, il était avéré que Johnson avait planifié cette escalade alors qu'il faisait campagne comme « candidat de la paix !
Pour faire court, je suis alors devenu un chantre du slogan « Hey, Hey, LBJ : combien d'enfants as-tu tués aujourd'hui ? ». J'ai rejoint le mouvement antiguerre et j'ai commencé à participer à son organisation. J'ai rejoint le mouvement socialiste, je suis devenu marxiste et j'ai juré de ne plus jamais me faire avoir par un démocrate. Au cours des cinquante années qui ont suivi, à chaque élection, j'ai soutenu que démocrates et républicains étaient pour l'essentiel les mêmes. Pas identiques, bien sûr, car s'ils ne faisaient pas semblant d'être différents, ils ne pourraient pas embobiner l'électorat. Mais les conséquences politiques seraient les mêmes, quel que soit le parti qui remporterait les élections : la classe capitaliste continuerait à gouverner, la classe ouvrière continuerait à être exploitée et, comme le chantait Bob Marley, « le rêve d'une paix durable ne restera qu'une illusion éphémère [1] ».
J'écris ces lignes en réponse à un défi affectueux lancé par l'une de mes filles, qui m'a rappelé que je lui avais appris à éviter comme la peste les deux partis jumeaux du capitalisme. Pourquoi, m'a-t-elle demandé, ai-je changé ?
La réponse courte est que je n'ai pas changé. C'est la situation politique américaine qui a changé si radicalement que je me suis senti obligé de revoir mon approche. Mais ne lui avais-je pas dit que voter pour un démocrate serait une violation de principe ?
Oui, je l'ai dit et je le pense toujours. Cependant, j'ai appris que les principes ne sont pas des absolus comme je le croyais autrefois. Parfois, on se retrouve coincé entre deux principes qui s'opposent et qui nous obligent à choisir celui qui est le plus important. C'est le cas ici. Le principe d'assumer la responsabilité d'agir pour éviter une catastrophe historique pour la classe ouvrière l'emporte [2] sur le principe de ne pas voter pour un démocrate.
La politique du « moindre mal » ?
Les personnes décentes et bien intentionnées que je connais et qui ne sont pas socialistes affirment que, malgré tout ce qui ne va manifestement pas dans la société américaine, les démocrates libéraux ne sont pas aussi mauvais que les républicains de droite. Les démocrates sont le « moindre mal » et c'est donc une bonne chose qu'ils gagnent les élections.
Les socialistes ont entendu cet argument ad nauseum et nous nous y sommes opposés à juste titre pendant longtemps. Je m'y suis opposé, comme je l'ai dit, jusqu'en 2020. Et puis les circonstances ont changé. Un mal beaucoup, beaucoup plus grand est soudain entré dans la danse.
La différence entre les deux maux n'était plus simplement une question de plus ou de moins ; elle était désormais qualitative. Et cette différence, j'en suis convaincu, si Donald Trump remporte un second mandat, pourrait bien se traduire par l'oppression et la mort d'une ampleur dépassant ce qui s'est passé en Europe au milieu du 20e siècle. Elle pourrait plonger non seulement les États-Unis, mais aussi une grande partie du monde, dans l'obscurité et l'horreur politiques pendant une génération ou plus. Essayer d'ignorer cela, c'est comme allumer une cigarette dans la soute à munitions. J'estime qu'il est de mon devoir, au nom des principes, de m'y opposer activement, non pas avec de la pensée magique, des fanfaronnades ou des théorisations vides de sens, mais d'une manière matériellement significative. Allez voter ! Pour Kamala Harris !
C'est la situation électorale d'aujourd'hui : on n'a pas le luxe de voter pour qui on voudrait. Les ennemis du prolétariat nous contraignent à un choix purement binaire. Il faut choisir entre Harris et Trump. On peut, bien entendu, s'abstenir, mais pour les électeurs de la classe ouvrière, ce serait une demie voix pour Trump.
Voter pour le candidat d'un tiers parti [3], c'est s'abstenir virtuellement. Tu n'es pas d'accord ? Tu penses que l'un tiers parti pourrait vraiment l'emporter ? Je serais tout à fait à l'aise et confiant en pariant littéralement ma vie que ce ne sera pas le cas. C'est aussi impossible que pour moi de gagner le cent mètres aux Jeux olympiques. Si tu perçois au plus profond de toi le danger existentiel que représente Trump, tu commenceras immédiatement à faire campagne pour Harris.
Cette position, m'a-t-on rétorqué, signifie que je soutiens Kamala Harris, que je soutiens le Parti démocrate ou encore que je soutiens le génocide à Gaza. Aucune de ces affirmations n'est vraie, quel que soit le nombre de fois où l'on m'a demandé si c'est bien ce que je « voulais dire ». Je ne soutiens pas Kamala Harris. Je ne soutiens pas le Parti démocrate. Je déteste leur politique de soutien moral et matériel inconditionnel à Israël, qui commet un génocide contre le peuple palestinien. Je suis partisan de nous débarrasser du Parti démocrate, du Parti républicain et de l'ensemble du système électoral bipartite.
Je soutiens l'idée d'un parti du travail et d'une Amérique socialiste. Non pas l'Amérique du business-as-usual et qui est dirigée par des politiciens qui se disent socialistes, mais une Amérique où l'ensemble du système de production est nationalisé et sous le contrôle des travailleurs. Malheureusement, il n'y a pas de véritable parti du travail à soutenir dans cette élection, et une Amérique socialiste est un objectif, pas une option pour aujourd'hui que l'on puisse obtenir en la souhaitant.
Je rejette la politique impuissante qui consiste à « réclamer » ce qui ne se produira pas à temps pour faire la différence, y compris un parti du travail et une résistance de masse organisée des travailleurs contre l'oppression trumpiste. Je me souviens de Jerry Gordon citant Shakespeare aux ultragauchistes qui « appelaient » à une grève générale contre la guerre au Vietnam :
« Je peux appeler les esprits des vastes profondeurs. »
« Pourquoi, ne le pourrais-je pas moi aussi, et n'importe qui d'autre ! Mais viendront-ils ? »
Mark Twain a eu ces mots restés célèbres : « La foi, c'est croire ce que l'on sait ne pas être. » La politique qui consiste à « réclamer » ce qui n'adviendra pas de sitôt sont des cousins germains des actes de foi.
Bref, mon appel à voter et à faire campagne pour la candidate du Parti démocrate en 2024 est uniquement basé sur le fait qu'elle n'est pas Trump et qu'elle ne représente pas la menace de gouverner comme un autocrate n'ayant aucun compte à rendre.
Quelle est la réalité et l'ampleur du danger que représente une réélection de Trump ?
De nombreux lecteurs de New Politics sont aussi familiers que moi des horreurs de l'époque nazie en Allemagne. En outre, la représentation du 3e Reich dans la culture populaire (livres, films et télévision) devrait permettre à des millions d'Américains de comprendre au moins ce que l'on entend par « le 3e Reich était un régime d'une cruauté presque inimaginable ». Le meurtre de millions de victimes innocentes a fourni un nouveau point de référence de la limite extrême de « l'inhumanité de l'homme envers l'homme (4) ».
« Je n'ai pas de boule de cristal », comme on dit, mais je crois qu'il est tout à fait possible qu'une deuxième administration Trump « sans garde-fou » atteigne et dépasse la cruauté nazie. Je m'attendrais à ce qu'elle commence par descendre des centaines de manifestants antigénocide ou de Black Lives Matter dans les rues. La population de Guantánamo pourrait augmenter rapidement, y compris avec manifestants américains et « immigrés ». Trump a explicitement fait savoir qu'il aimerait voir des camps de concentration « partout dans notre nation » pour lutter contre la criminalité urbaine et les sans-abris ; et bien sûr, la « criminalité urbaine » est étroitement associée dans son cerveau reptilien aux « immigrés » et aux personnes de couleur. C'est ainsi qu'il présente les choses :
« Il se peut que certains n'aimeront pas entendre cela, mais la seule façon d'évacuer les centaines de milliers de personnes, et peut-être même les millions de personnes dans toute notre nation […], c'est d'ouvrir de grandes parcelles de terrain bon marché à la périphérie des villes […], de construire des salles de bain permanentes et d'autres installations, bonnes, solides, mais rapidement construites, et de fabriquer des milliers et des milliers de tentes de bonne qualité, ce qui peut être fait en un jour. Un seul jour. Il faut déplacer les gens (5). »
Trump a explicitement promis que s'il obtenait le contrôle légal de l'exécutif, au « premier jour » de sa prise de fonction, il sera un dictateur qui ne rendra de comptes à personne d'autre qu'à lui-même.
Si tu as besoin d'une preuve supplémentaire de ses intentions, va sur You-Tube et regarde le fameux débat avec Joe Biden du 27 juin 2024. Le monde entier s'est focalisé sur la triste prestation de Biden. […] Cependant, ce qui était le plus affreux ce n'était pas la façon dont Biden s'est exprimé, mais ce que Trump a dit. Quelles que soient les questions que les journalistes lui posaient, il reprenait sans cesse sa diatribe contre les immigrés « violeurs et assassins ». C'était de la démagogie nazie classique, les « immigrés » remplaçant les « juifs » comme boucs émissaires de tous les maux de la société.
Je crois Trump lorsqu'il dit qu'il veut des camps de concentration à profusion, et tu devrais toi aussi le croire, car ses récentes attaques contre les « socialistes », les « communistes » et les « marxistes » nous visent directement, toi et moi. Lorsqu'il qualifie ses opposants politiques, y compris les démocrates, de « vermine » et qu'il accuse les immigrants d'« empoisonner le sang » des États-Unis, il démontre clairement ses intentions fascistes.
Si Trump est élu, son second mandat sera presque certainement « sans garde-fou ». Il a déjà la Cour suprême dans sa poche et, avec son soutien, il pourrait rapidement placer le ministère de la justice entièrement sous son commandement. Quiconque pense que « l'armée américaine par principe apolitique » va s'interposer et l'arrêter, se trompe malheureusement. Tout cela est-il vraiment « sans différence » avec ce que l'on peut attendre d'une administration Kamala Harris ?
Le marxisme et la révolution bourgeoise
Permettez-moi d'expliquer la différence en termes marxistes. Les démocrates disent que Trump représente une menace pour la « démocratie ». Le problème, c'est que la démocratie américaine n'est pas « la cité brillante sur une colline » qu'elle a toujours promise. Elle n'a certainement pas tenu ses promesses à l'égard des populations indigènes d'Amérique du Nord, des Afro-Américains – que ce soit pendant ou après la période de l'esclavage – ou encore des réfugiés et des immigrants qui n'ont vu qu'hypocrisie dans les mots d'accueil : « Donnez-moi vos fatigués, vos pauvres, vos masses recroquevillées qui aspirent à respirer librement. » La promesse d'une « justice égale pour tous » a été profondément corrompue par la capacité des criminels fortunés à « jouer » avec le système juridique en achetant les services d'avocats très coûteux (sans parler de l'encombrement de tous les tribunaux par des juges de droite […]).
Il n'en reste pas moins vrai que la société américaine bénéficie depuis ses origines de ce que les marxistes appellent la « démocratie bourgeoise ». C'est-à-dire la démocratie capitaliste. On l'appelle parfois « démocratie politique » pour la distinguer de la « démocratie économique » ou de la « démocratie socialiste ».
L'essence de la démocratie bourgeoise est la fidélité à l'État de droit et l'égalité devant la loi, ce qui exclut le règne d'autocrates qui n'ont pas de comptes à rendre. Quiconque pense que Marx, Lénine ou Trotsky ont crotté sur la démocratie bourgeoise en la qualifiant de « pas différente de la monarchie » se trompe tragiquement. Ils ont compris que la démocratie bourgeoise était l'aboutissement monumental de l'une des révolutions sociales les plus importantes au monde : La Révolution française de 1789-1793.
Les droits démocratiques bourgeois sont le fondement nécessaire de tous les droits humains. Ils ont été codifiés pour la première fois dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la Révolution française et dans le Bill of Rights de la Constitution américaine. La consolidation et l'extension des acquis démocratiques des révolutions bourgeoises sont des conditions préalables à la démocratie socialiste. La démocratie bourgeoise et les droits démocratiques bourgeois aux États-Unis sont souvent considérés comme étant acquis, mais les marxistes, entre tous, devraient être parfaitement conscients de ce que signifierait leur perte. Cela rendrait les luttes dans lesquelles nous sommes actuellement engagés beaucoup, beaucoup plus difficiles et, par conséquent, encore plus difficiles à gagner. Si nous perdions la démocratie bourgeoise, les mouvements contre le génocide, pour le droit à l'avortement, pour les droits syndicaux, pour la justice pour Cuba, pour la justice climatique, seraient écrasés, réprimés et poussés dans la clandestinité – pour au moins une génération et peut-être beaucoup plus longtemps. Aucun principe politique ne peut primer sur la nécessité de résister activement à cette éventualité. Oui, la « résistance » implique bien plus que la simple tenue d'un vote alternatif à un démagogue, mais à l'heure actuelle, c'est la seule voie qui s'offre à nous. Les Palestiniens et leurs alliés poursuivront certainement la lutte contre le génocide à Gaza par tous les moyens nécessaires, et contre les politiques de Biden et Harris qui fournissent les armes qui tuent à Gaza. Peut-on concilier cela avec le fait de voter pour Harris contre Trump ? C'est possible et cela doit l'être, pour toutes les raisons que j'ai exposées ici.
En tant que marxiste, j'adhère également au matérialisme philosophique par opposition à l'idéalisme. J'ai donc compris depuis longtemps que le socialisme ne peut pas être atteint par des arguments logiques influençant les idées des gens, mais par des événements matériels qui poussent les travailleurs à résister par millions au système capitaliste qui s'effondre et à créer une alternative socialiste pour le remplacer. Pour la même raison, je ne m'attends pas à ce que mes arguments changent l'état d'esprit de ceux dont l'adhésion au principe de ne pas voter pour les démocrates est profonde et de longue date. Mais garder mon opinion pour moi reviendrait à violer le plus grand de mes principes : faire tout ce qui est en mon pouvoir limité pour empêcher la destruction désastreuse de la démocratie bourgeoise.
Ceux qui considèrent que ne pas voter pour un démocrate est un principe absolu disent que cela pourrait politiquement induire la classe ouvrière en erreur en lui faisant croire qu'un parti capitaliste peut résoudre ses problèmes. C'est vrai, mais c'est une erreur de l'idéalisme philosophique que de considérer les idées, erronées ou non, comme le facteur principal de la lutte des classes. Ce n'est pas le cas. Les conditions matérielles qu'un régime protofasciste à la Trump imposerait dépassent de loin la confusion politique à quelque échelle que ce soit. […]
Pour illustrer ce contre quoi je m'élève ici, je citerai une opinion parue le 28 août 2024 dans Socialist Organizer, le périodique d'une organisation que je respecte et admire :
« Les candidats [du Parti démocrate] n'obtiendront pas un vote garanti de la part de tout le monde simplement parce que nous ne voulons pas de Trump. Il est évident que nous ne le voulons pas. Personne ne veut quatre années supplémentaires de cette absurdité, mais il est dommage que nous n'ayons que deux options. Pour moi, Kamala n'est que Biden 2.0. Nous avons besoin d'un parti du travail. Il nous faut d'autres partis qui peuvent avoir des candidats que les gens voudront soutenir et pour lesquels ils voudront voter. ».
Cette opinion donna lieu au commentaire suivant de la rédaction : « Nous sommes d'accord ! »
Je suis catégoriquement en désaccord, camarades. La menace de Trump n'est pas simplement « quatre années supplémentaires de cette absurdité ». Il n'est pas simplement « dommage » que nos seules options électorales se limitent à Harris et Trump. Kamala n'est pas « juste Biden 2.0 ». Elle est la candidate démocratique bourgeoise qui se présente contre l'antithèse de la démocratie bourgeoise. La différence est une question de vie ou de mort à l'échelle mondiale.
Cliff Conner
1 « Guerre ». Marley citait en fait un discours d'Hailé Sélassié.
2 NdT. Ici l'auteur fait un jeu de mots intraduisible en utilisant le verbe « to trump » qui signifie éclipser » .
3 NdT. C'est ainsi qu'on désigne les candidats à la présidentielle ni démocrate ni républicain. Pour le scrutin de novembre, ils sont XXX
4 Que l'on me pardonne l'emploi du mot “homme” pour évoquer « l'inhumanité du genre humain », mais c'est ainsi que cette expression nous est parvenue.
5 Discours du 26 juillet 2022.
P.-S.
• Entre les lignes entre les mots. 24 septembre 2024 :
Source : Publié par Against The Current :
https://againstthecurrent.org/a-marxist-case-for-voting-for-kamala-harris/
Les diverses prises de position publiées sur la site d'Against The Current sont disponibles en anglais sur ESSF.
• Clifford D. Conner's latest book is The Tragedy of American Science. He previously authored A People's History of Science : Miners, Midwives, and Low Mechanicks and Jean Paul Marat : Tribune of the French Revolution.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Comment la guerre à Gaza a fracturé la société américaine

Manifestations sur les campus, divisions au sein du Parti démocrate, conflit générationnel… L'offensive israélienne et le soutien constant apporté par Joe Biden à Benyamin Nétanyahou ont creusé un fossé parmi les Américains. De quoi entamer la “relation spéciale” entre Israël et les États-Unis, analyse “The Guardian”. Un an après les attaques du 7 octobre, “Courrier International” revient toute cette semaine sur le conflit qui a déstabilisé le Moyen-Orient.
Tiré de Courrier international. Article publié dans The Guardian à l'origine. Dessin de Cristina Sampaio, Portugal.
[Cet article est à retrouver dans notre hors-série “Israël-Palestine, une fracture mondiale”, en vente à partir du 25 septembre chez votre marchand de journaux et sur notre site.]

Rarement un chef d'État a été reçu avec un accueil aussi glacial que le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, lorsqu'il est arrivé à Washington pour s'exprimer devant le Congrès, à la fin de juillet. Aucune personnalité politique américaine n'est venue l'accueillir sur le tarmac, et des milliers de personnes ont manifesté contre sa venue : 200 membres de l'organisation Jewish Voice for Peace ont même été arrêtés devant le Capitole.
Plus révélateur encore, la moitié des élus démocrates du Congrès ont décidé de boycotter son discours. “Il y a une dizaine d'années, cela aurait été impensable”, commente Peter Frey, président de J Street, un groupe de pression juif de Washington qui soutient le droit d'Israël à se défendre, mais aussi la création d'un État palestinien. L'une des parlementaires présentes, la députée Rashida Tlaib, portait un keffieh et brandissait une pancarte qualifiant Nétanyahou de “criminel de guerre, coupable de génocide”.
Pendant ce temps, un certain nombre de syndicats, dont celui des enseignants, des employés de services et des ouvriers de l'automobile, ont adressé une lettre à Joe Biden pour lui demander de mettre fin au soutien des États-Unis à l'offensive israélienne à Gaza.
Coup de semonce
Selon les sondages, 70 % des démocrates et 35 % des républicains souhaitent poser des conditions à l'aide militaire apportée à Israël. Sur ce sujet, le fossé n'a cessé de se creuser entre les électeurs et le gouvernement Biden. Première conséquence : la confiance déjà chancelante des citoyens à l'égard du gouvernement continue de s'éroder. “C'est la démocratie qui est en jeu, analyse Peter Frey. Et cette bataille se joue devant nos yeux. Ce n'est pas sain. Et ce n'est pas une bonne chose pour Israël.” Et dans la mesure où les Américains s'intéressent à la politique étrangère, ajoute-t-il, “je pense qu'à long terme cela risque de saper leur confiance dans les institutions politiques”.
Bien avant sa performance catastrophique lors du débat télévisé face à Donald Trump, Joe Biden avait subi un premier revers avec la campagne menée par les militants du mouvement uncommitted [qui préconisait de voter “non engagé”, soit l'équivalent d'un vote blanc, aux primaires démocrates pour critiquer son soutien inconditionnel à Nétanyahou]. En persuadant plus de 100 000 démocrates de voter uncommitted lors de la primaire du Michigan, plutôt que de soutenir l'homme qui, selon eux, encourageait un génocide, ils ont envoyé au Parti démocrate un message fort : l'un des États clés les plus stratégiques pour l'élection de 2024 risquait de basculer. Pour finir, plus de 700 000 électeurs dans 23 États ont choisi de voter “non engagé” lors des primaires démocrates.
Ce vote de protestation a montré que la position traditionnelle de soutien à Israël était en train de s'éroder, du moins chez les progressistes, devenant une victime collatérale supplémentaire d'un conflit brutal, apparemment sans issue et qui menace toujours de prendre une ampleur régionale. Outre la mort de plus de 40 000 Palestiniens (et probablement beaucoup plus), le déplacement de millions de personnes et la destruction de plus de la moitié du bâti dans la bande de Gaza, cette guerre semble avoir porté un coup dur, peut-être fatal, à la “relation spéciale” d'Israël avec son plus proche allié.
Un fossé générationnel
Entre-temps, l'entêtement avec lequel Joe Biden soutient l'offensive menée par Benyamin Nétanyahou, même si celle-ci n'a pas réussi à détruire le Hamas ni à faire libérer tous les otages, ne menace pas seulement l'unité au sein des démocrates mais creuse un fossé générationnel.
Les jeunes Américains sont désormais presque deux fois plus nombreux que leurs parents à soutenir la cause palestinienne, ce qui provoque des tensions, en particulier au sein des familles juives. Des tensions que l'on a retrouvées sur les campus universitaires, amenant de vénérables institutions – dont la mission est avant tout de développer le libre arbitre et l'esprit critique – à répondre par la violence policière aux manifestations majoritairement pacifiques de leurs étudiants. Plus inquiétant encore, ce positionnement pro-israélien fait douter de nombreux Américains de l'engagement de leur nation en faveur de la liberté d'expression, des droits de l'homme et de l'État de droit – et les pousse à se demander, en somme, où sont passées les valeurs de l'Amérique.
Les Américains les plus déstabilisés par cette dynamique sont les étudiants juifs de gauche, dont la plupart restent attachés à Israël même s'ils sont très critiques de sa politique actuelle. Aujourd'hui, nombre d'entre eux se retrouvent de plus en plus isolés de leurs alliés politiques d'autrefois. S'ils sont gênés par les discours virulents entendus lors de certaines manifestations – auxquelles ils participent cependant –, ils ne se retrouvent pas dans le positionnement des groupes pro-Israël, de certains hommes et femmes politiques et des présidents d'universités qui cherchent à présenter toutes les manifestations antiguerre comme antisémites.
“Je suis de gauche, déclare Lauren Haines, étudiante en dernière année à l'université du Michigan et ancienne présidente de la branche universitaire de J Street sur son campus. Je m'informe sur Gaza tous les jours et je mets un point d'honneur à ne pas regarder ailleurs et je dois dire que j'ai du mal à dormir sachant que mes impôts servent à ça. Mais je ne comprends pas certaines tactiques de la gauche, tout ce discours ‘soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous' manque singulièrement de nuances. Je soutiens le peuple palestinien, et je suis convaincue que l'on peut faire avancer sa cause sans devoir pour autant propager des discours clivants et dangereux, comme dire que tous les sionistes sont des monstres ou encore attaquer des institutions juives parce qu'elles sont liées à Israël.”
Des campus sous haute tension
Cela dit, Lauren Haines condamne fermement l'usage de la force pour réprimer les manifestations propalestiniennes. “Les violences policières sur les campus sont scandaleuses, observe-t-elle, même si je ne suis pas toujours d'accord avec les propos des manifestants.”
Le romancier [canado-égyptien] Omar El-Akkad a lui aussi été choqué par la répression violente des étudiants. “Pour moi, c'était une mobilisation qui rassemblait des gens issus d'horizons très différents, une situation inédite dans le contexte américain, note-t-il. Et la réaction des présidents d'université et de quelques politiques va, selon moi, à l'encontre de tous les principes fondateurs des États-Unis, qui font de ce pays une exception.”
Si les conservateurs restent apparemment de marbre face à ce qui se passe à Gaza (Trump a même conseillé à Israël de “finir le boulot”), de nombreux Américains demeurent profondément attachés à une vision de l'Amérique comme phare du monde libre. Ce qui gêne le plus la jeune génération, ce n'est pas seulement le soutien militaire américain à l'offensive israélienne à Gaza, mais ce qu'il dit du rôle du pays en tant que garant de la paix dans le monde, analyse Michael Barnett, professeur de relations internationales et de sciences politiques à l'université George-Washington. “L'idée que notre politique étrangère est immorale – et donc contraire aux valeurs américaines, contraire à l'éthique – fait son chemin”, analyse-t-il. Dénoncer l'invasion de l'Ukraine par la Russie tout en donnant un blanc-seing à Israël pour rayer la Palestine de la carte ne passe pas, “c'est de la pure hypocrisie, poursuit Barnett. Et les jeunes ne l'acceptent pas.”
Que va faire Kamala Harris ?
Kamala Harris va-t-elle changer la donne ? Rien n'est moins sûr. Certains observateurs ont été rassurés par la teneur, très critique, de la rencontre entre la vice-présidente américaine et Benyamin Nétanyahou et sa décision de choisir Tim Walz comme colistier plutôt que Josh Shapiro [le gouverneur de Pennsylvanie, de confession juive] dont le positionnement pro-Israël et les propos sur les manifestants antiguerre ont indigné l'aile gauche du Parti démocrate.
Mais on ignore s'il faut s'attendre à du changement en matière de politique étrangère [si Kamala Harris venait à être élue à la présidentielle du 5 novembre]. La rumeur d'une rencontre avec des délégués du mouvement uncommitted pour mettre en place un embargo sur les livraisons d'armes à Israël a vite été démentie par son conseiller à la sécurité nationale, Phil Gordon. La vice-présidente “va toujours faire en sorte qu'Israël ait les moyens de se défendre contre l'Iran et tous les groupes terroristes soutenus par l'Iran. Elle n'est pas favorable à un embargo sur les armes livrées à Israël. Elle va continuer à travailler pour protéger les civils à Gaza et faire respecter le droit humanitaire international.”
Alors qu'Israël poursuit son offensive, détruit méthodiquement Gaza et tue, sans faire de distinction, des civils et des combattants du Hamas avec des armes qui lui ont été fournies par les États-Unis, ce genre de déclarations équivoques sonnent creux pour de nombreux Américains.
La question de la complicité des États-Unis, dans ce que certains spécialistes qualifient de génocide, ne pourra être éludée longtemps. Le positionnement de Kamala Harris aura des répercussions considérables, non seulement sur sa potentielle élection à la Maison-Blanche, mais sur la paix au Moyen-Orient, sur le sort des civils qui cherchent à échapper aux bombardements, ainsi que sur le prestige des États-Unis à l'international et leur réputation de “force du bien” dans le monde.
Aaron Gell
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

15 Règles-Média couvrant Israël

Aujourd'hui, Israël a massacré un demi-millier de personnes au Liban avec Tsahal lançant plus de mille attaques aériennes. Les États-Unis, encore une fois, envoient des troupes additionnelles au Moyen-Orient, sous les ordres d'un cerveau présidentiel qui a complètement arrêté de fonctionner. Israël lance un nouveau projet de violence militaire massive afin que Nétanyahou évite la prison en son pays révolté et ailleurs sous l'ordre de la Cour Pénale internationale de La Haye.
Merci à Caitlin Johnstone pour l'inspiration
24 septembre
Artistes pour la Paix P.J.
Rafraîchissons la mémoire des média des 15 règles appliquées :
Règle 1 : l'histoire israélienne a commencé le 7 octobre 2023 (personne ne se souvient de ce qui est arrivé avant).
Règle 2 : tous les meurtres causés par Israël sont justifiés par la règle 1, vérité à retenir, même si Nétanyahou commet des horreurs considérées injustifiables quand elles sont perpétrées par Poutine ou par les Ayatollahs iraniens.
Règle 3 : Israël a le droit de se défendre, mais personne d'autre.
Règle 4 : Israël ne bombarde jamais des civils, que des terroristes. Si de nombreux civils meurent, c'est qu'ils étaient des terroristes, ou que des terroristes les ont tués ou qu'ils habitaient trop près des terroristes. Sinon, il y a eu une raison mystérieuse qu'il faut laisser du temps à Tsahal d'enquêter.
Règle 5 : si vous critiquez quoi que ce soit fait par Israël, c'est par haine des Juifs. Il n'y a aucune autre raison pour laquelle vous vous opposez à ce qu'on laisse tomber des bombes explosives sur des refuges peuplés d'enfants et de secouristes humanitaires.
Règle 6 : aucune action d'Israël ne dépasse en haine les critiques évoquées en règle 5. Les critiques des actions de Tsahal sont bien pires que les actions elles-mêmes, puisqu'ils haïssent les Juifs et veulent commettre un nouvel Holocauste que 100% de notre énergie politique doit s'employer à prévenir.
Règle 7 : Israël n'est jamais le bourreau, il ne peut être que victime. Si Israël a attaqué le Liban, c'est que le Hezbollah a lancé des roquettes sur un pays occupé à son petit business génocidaire de paix. Et s'il y a des manifestants contre Tsahal réduisant des villes entières en poussières, Israël doit rester LA victime pleurée par les pays qui lui procurent ses armes.
Règle 8 : le fait qu'Israël est perpétuellement en guerre avec ses voisins et ses populations indigènes déplacées doit être interprété comme preuve que la règle 7 est vraie, au lieu de penser qu'elle n'est qu'un non-sens ridicule.
Règle 9 : les vies arabes sont beaucoup moins importantes que les vies occidentales ou israéliennes. Personne n'a le droit de réfléchir longtemps à ce fait avéré.
Règle 10 : les média disent toujours la vérité sur Israël et ses conflits. Si vous entretenez des doutes, vous êtes vraisemblablement en violation selon la règle 5.
Règle 11 : toutes allégations décrivant les ennemis d'Israël sous un jour négatif peuvent être rapportées comme des nouvelles factuelles sans aucune vérification, tandis que toutes les preuves confirmées de criminalité israélienne doivent être rapportées avec prudence et scepticisme comme « Le Liban ou le ministère de la santé contrôlé par le Hamas » affirment, précautions essentielles pour ne pas être accusé d'être propagandiste antisémite.
Règle 12 : Israël doit continuer à exister en sa forme politique actuelle, peu importent les coûts ou les vies humaines gaspillées. Aucune raison opposée ne doit être présentée (comme la formation de deux nations), sinon vous violez la règle 5.
Règle 13 : les gouvernements canadien et américain ne vous ont JAMAIS menti sur quoi que ce soit, en étant TOUJOURS du bon côté des guerres faites pour votre bien.
Règle 14 (pour les Américains seulement) : rien de ce qui arrive au Moyen-Orient n'est aussi urgent ou signifiant que de s'assurer que la bonne personne gagne les élections présidentielles. Aucun méfait ne doit vous écarter de cette mission d'importance cruciale.
Règle 15 : Israël doit être protégé parce que dernier bastion de la liberté et de la démocratie au Moyen-Orient, peu importe le nombre de journalistes que Tsahal doit assassiner, peu importe le nombre d'institutions de presse qu'il doit fermer, peu importe le nombre de manifestations que ses partisans doivent démanteler par la force brutale, peu importe la liberté d'expression qu'il doit éliminer, peu importe le nombre de droits civils qu'il doit effacer, et peu importe le nombre d'élections que ses lobbyistes doivent acheter.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
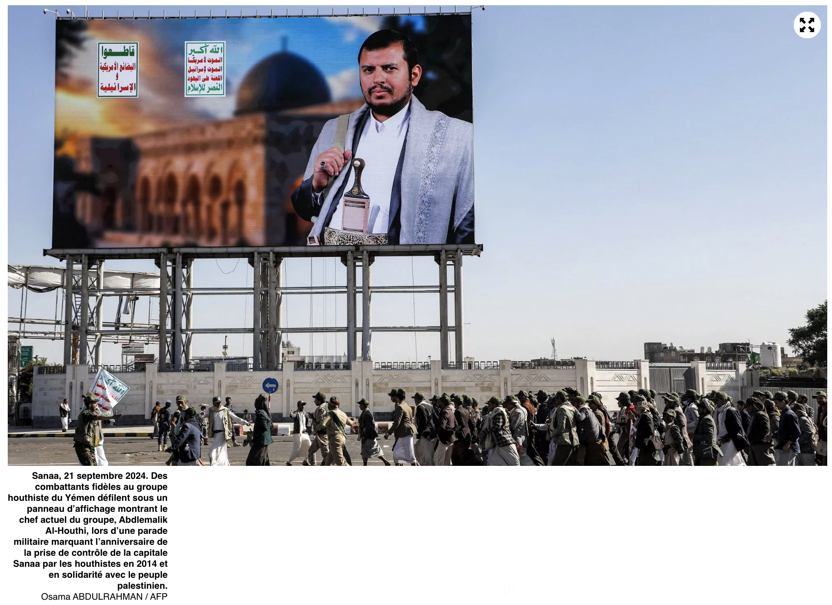
Yémen. Dix ans de pouvoir houthiste, une emprise encore précaire
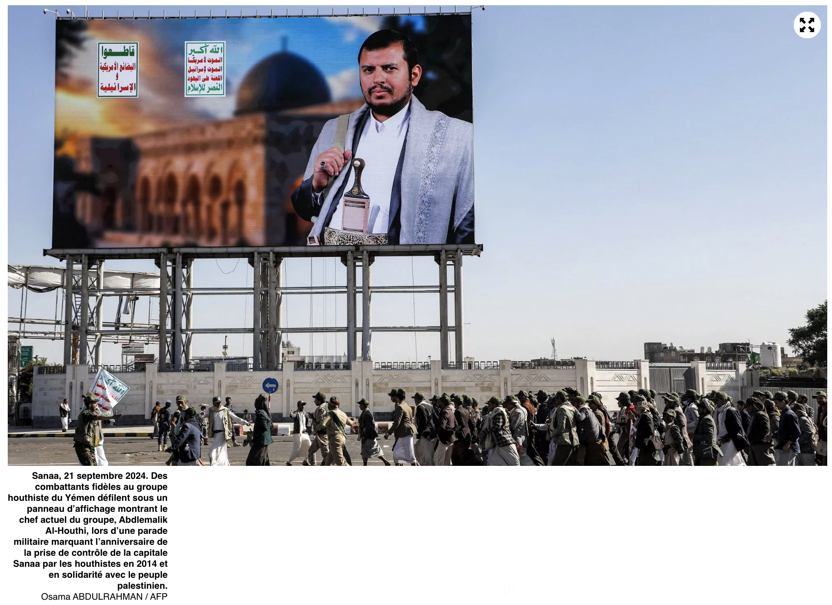
Il y a dix ans, le 21 septembre 2014, les rebelles houthistes s'emparaient de Sanaa et renversaient le gouvernement issu du « Printemps yéménite ». Depuis lors, leur exercice du pouvoir dans de larges parties du Yémen s'est affirmé tant en interne, à travers la mise en place d'un État autoritaire, qu'à l'échelle régionale, où leur capacité militaire va croissante. Le 15 septembre 2024, un de leurs missiles atteignait à nouveau le centre d'Israël, éloigné de plus de 2 000 kilomètres. Bilan.
Tiré d'Orient XXI.
Depuis vingt ans, la place prééminente occupée par les houthistes au Yémen est le fruit de divers paradoxes. Né dans les montagnes de l'extrême nord du pays, non loin de l'Arabie saoudite, le mouvement emmené par la famille Al-Houthi avait profité de sa confrontation militaire avec l'État yéménite, entamée en juin 2004, pour gagner en expérience et légitimité. Au prix de dizaines de milliers de morts et de destructions de villages entiers, il avait alors accru sa puissance armée, ses connexions tribales, sa cohérence idéologique et son assise géographique jusqu'à gagner les confins de la capitale Sanaa peu avant le soulèvement de 2011. Rattaché à une expression marginale du paysage politique et religieux, le groupe Ansar Allah (Partisans de Dieu), courant de renouveau zaydite lié au chiisme dans un pays majoritairement sunnite, avait su mettre de côté les enjeux identitaires pour capitaliser d'abord sur le ressentiment face au pouvoir du président Ali Abdallah Saleh (jusqu'en 2012), puis contre le processus révolutionnaire du « printemps yéménite ». Ce dernier avait pourtant abouti au départ de l'ancien président et à son remplacement par Abd Rabbo Mansour Hadi chargé de mener la transition vers la démocratie. C'est toutefois en s'alliant avec leurs anciens ennemis du clan Saleh à compter de 2012 que paradoxalement les houthistes ont atteint leur masse critique, devenant le « monstre de Frankenstein » que les Yéménites connaissent. En effet, entre 2012 et 2014, les houthistes ont pu s'appuyer sur les ressources de Saleh, financières et militaires, pour mettre à mal le processus révolutionnaire qu'ils avaient pourtant initialement soutenu. Ce faisant, tous deux pouvaient atteindre un autre de leurs objectifs : mettre en pièce leurs ennemis communs, les Frères musulmans du parti al-Islah. Pour Saleh, ce pacte devait lui permettre de se venger de ceux qui l'avaient trahi lorsqu'ils s'étaient engagés dans le soulèvement révolutionnaire. Mais à l'évidence, l'accord était pour lui un trompe-l'œil et était passé au bénéfice des houthistes. Ils pouvaient dès lors entamer une phase d'exercice et de consolidation du pouvoir qui, dix ans plus tard, perdure malgré d'évidentes fragilités.
Incarner l'État
Passée la surprenante phase militaire de prise de contrôle de structures étatiques (radio et télévision nationale, ministères, casernes), les houthistes à compter du 21 septembre 2014 ont agi avec méthode. Leur coup d'État a autant été caractérisé par une volonté de dénoncer les compromis du nouveau gouvernement par rapport au projet révolutionnaire que de répondre à des aspirations réactionnaires. Les houthistes ont d'abord pu neutraliser le pouvoir reconnu par la communauté internationale en assignant à résidence le président Abd Rabbo Mansour Hadi. Ce dernier a pu fuir vers Aden et de là faire appel à l'Arabie saoudite qui est intervenue militairement à compter du 26 mars 2015 pour restaurer son pouvoir et vaincre les houthistes, sans succès.
Le processus interne essentiel de construction d'un État houthiste a été largement occulté par l'intervention de l'armée saoudienne ainsi que par les liens entre Ansar Allah et l'Iran. L'un et l'autre ont été certes importants et expliquent l'impasse que connait le pays. Mais ils n'épuisent aucunement l'analyse d'un pouvoir qui s'est affirmé au fil du temps et dont l'organisation a été finalement contre-intuitive. En effet, loin de l'image de combattants rétrogrades venus des tribus arriérées des hautes terres du Yémen, l'exercice du pouvoir par les houthistes s'est avéré efficace à divers titres. Ils se sont employés à incarner pleinement l'État dans l'ensemble des zones qu'ils ont contrôlé — le quart occidental du pays et environ la moitié de la population. Bien que n'étant pas reconnus par la communauté internationale et confrontés aux bombardements de la coalition emmenée par l'Arabie saoudite, ils ont su mettre en place des institutions qui ont empêché un effondrement général des services publics, de l'économie et de la sécurité. La stabilité du taux de change du riyal dans les zones sous leur contrôle est comparativement meilleure à celle dans les réduits du gouvernement reconnu par la communauté internationale. Le faible nombre d'attentats jihadistes atteste également de cette réalité, tout comme la permanence de médias gouvernementaux, d'une façade de vie partisane et institutionnelle.
Tout d'abord pour construire l'État houthiste, les nouveaux maitres de Sanaa ont assuré une forme de continuité en s'appuyant sur les réseaux de fonctionnaires liés à Saleh. Dans les banques, l'armée, la police, les entreprises publiques, la stabilité a un temps primé. Les petits fonctionnaires issus de domaines perçus comme moins essentiels, par exemple dans l'éducation, étaient eux délaissés, souvent privés de salaires et forcés donc de trouver des moyens de subsistance. Leur engagement, comme celui du personnel de santé, assurait malgré tout souvent une forme de continuité tout en n'empêchant pas le ressentiment parmi la population.
S'autonomiser
Progressivement les houthistes ont placé leurs hommes — d'autant plus aisément qu'Ali Abdallah Saleh, en décembre 2017, s'est retourné contre eux, finissant alors assassiné. Ils ont pu recomposer les élites politiques et sécuritaires en offrant une prime particulière à leur propre groupe, les hachémites se revendiquant descendants du Prophète. Ces derniers, forme de noblesse très minoritaire à l'échelle de la société mais qui joue un rôle central dans le zaydisme, ont avec les houthistes retrouvé leur rang perdu au moment de la révolution du 26 septembre 1962 qui avait mis fin à la monarchie.
Pour mener à bien cette recomposition, ils ont pu instrumentaliser et capter une part de l'aide humanitaire internationale, prenant en tenailles les agences de l'ONU ainsi que les ONG. Celles-ci ont été depuis 2015 tétanisées par la crainte d'une famine généralisée, acceptant finalement les exigences des houthistes et une corruption manifeste des structures de distribution. C'est ainsi qu'en 2018 l'offensive contre Hodeïda, cinquième ville la plus peuplée du Yémen, a pu être annulée à la suite de l'accord de Stockholm, ancrant leur position dans ce port et donc sur la Mer Rouge. Parallèlement, au niveau local, les houthistes ont développé un maillage sécuritaire, accentuant la surveillance et la répression de la société civile. Ils se sont appuyés sur un réflexe nationaliste en décrivant l'opération de la coalition arabe, soutenue par les Occidentaux, comme une agression, préservant ainsi un certain niveau de popularité. L'alignement de leurs ennemis yéménites sur les positions des pays étrangers — Arabie saoudite donc, mais aussi Émirats arabes unis pour ce qui concerne les sudistes —a pu faire oublier leur propre proximité idéologique et diplomatique avec l'Iran. L'idéologie portée par leur leader Abdlemalik Al-Houthi s'est affirmée, infusant dans la société à travers l'armée mais aussi les structures éducatives et religieuses, tournées vers l'effort de guerre. Une génération s'en trouve sacrifiée. Le zaydisme s'est aussi transformé, parfois à travers l'instauration de nouvelles célébrations religieuses comme Achoura ou au moment du Mouloud. Un système de taxation spécifique au bénéfice des hachémites, les restrictions exercées sur les droits élémentaires des femmes et une police morale ont enfermé la société dans une logique que bien des opposants des houthistes décrivent comme totalitaire ou finalement proche de ce que les talibans afghans imposent. L'idéologie est également structurée autour d'une contestation de l'ordre international, faisant de la question palestinienne un élément essentiel et ancrant le mouvement dans l'Axe de la résistance porté par l'Iran. Au plus fort de la guerre en Syrie, les portraits du président syrien Bachar Al-Assad trônaient dans Sanaa. L'idéologie reste pourtant caractérisée par des non-dits autour de la place des hachémites et des objectifs politiques internes. Bien que se revendiquant républicains, il est entendu que la prééminence d'Abdelmalik Al-Houthi et de son clan en général, notamment la tutelle exercée par Hussein, son demi-frère et fondateur du mouvement, tué par l'armée en 2004, acte pour les houthistes le passage vers un pouvoir héréditaire. Celui-ci s'autonomise en partie aussi de l'État et marginalise de fait la majorité sunnite, il s'appuie sur une peur de la répression qui est d'autant plus efficace dans un contexte de guerre.
Humilier les Saoudiens
L'inefficacité militaire de l'opération Tempête décisive menée par l'Arabie saoudite depuis 2015 a été largement actée, y compris par les dirigeants saoudiens. Ceux-ci ont en effet depuis avril 2022 entrepris de se retirer du dossier yéménite. Depuis lors, les bombardements aériens des positions houthistes ont cessé. Abd Rabbo Mansour Hadi a été forcé à la démission et les discussions menées grâce à Mascate ont un temps donné le sentiment que la paix était à portée de main. Les houthistes toutefois n'entendaient pas faciliter le travail des Saoudiens. En interne, ils tiennent militairement leurs positions et n'ont pas réduit la pression sur Taez par exemple. Depuis plus de deux ans, ils s'emploient à humilier l'Arabie saoudite en faisant monter le prix de la paix. Leurs exigences ont ainsi notamment été financières, visant à faire payer à la coalition les arriérés de salaires des fonctionnaires.
L'engagement armé des houthistes en Mer Rouge depuis novembre 2023 a rendu toute signature d'un accord impossible. Il a placé les Saoudiens dans l'embarras, incapables de reprendre les armes au nom des Américains et des Israéliens contre un mouvement affirmant s'engager en faveur des Palestiniens et qui a gagné en popularité sur le plan régional. Le mufti omanais, Ahmed Al-Khalili, avait pu signaler sa reconnaissance, tout comme Yahya Sinouar, chef du Hamas.
En dix mois, les plus de 120 attaques contre les navires marchands, de plus en plus sophistiquées, puis les missiles envoyés vers Israël en solidarité avec la population de Gaza ont de nouveau braqué les projecteurs sur le Yémen. En réaction à l'ouverture de ce nouveau front, les États-Unis et les Britanniques ont relancé les bombardements contre les houthistes dès décembre 2023, sans davantage de succès. Le bombardement israélien du port de Hodeïda le 20 juillet 2024 a eu pour effet principal de désorganiser l'aide humanitaire, aucunement d'affecter la capacité de projection des houthistes. Deux mois plus tard, un missile d'une nouvelle technologie explosait à six kilomètres de l'aéroport de Tel-Aviv.
La stratégie régionale des houthistes pèse indéniablement sur les Yéménites ainsi que sur les populations des pays voisins. L'attaque contre le navire Ruby Mar qui transportait des engrais en mars 2024 et a coulé avec sa cargaison, puis contre le pétrolier Sounion en août 2024 rendent compte d'une logique jusqu'au-boutiste. Une marée noire d'ampleur historique a, semble-t-il, été évitée in extremis en septembre 2024. L'Égypte elle-même a perdu près de la moitié des revenus liés à l'exploitation du canal de Suez. Les ONG et agences onusiennes gérant l'aide internationale ont subi au cours de l'été une vague de répression à Sanaa. Les houthistes se sentent autorisés à s'extraire des règles internationales.
Si la nuisance causée par les houthistes en Israël (et pour les pays occidentaux) n'est pas que symbolique et si elle flatte l'engagement sincère de la population en faveur des droits des Palestiniens, nombre des Yéménites sont avant tout impatients d'en finir avec la guerre. Ils demandent des houthistes une clarification de leur projet politique de long terme sans laquelle la stabilité de leur régime imposée depuis dix ans risque de ne pas durer.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Syrie : Nous et les manifestations en Israël

Les grèves et les manifestations populaires en Israël contre le gouvernement de Benjamin Netanyahou en raison de sa guerre génocidaire contre Gaza ne concernent pas la sauvagerie d'Israël, les horribles violations commises, le meurtre systématique de civils... Il s'agit avant tout de la vie des otages. Cela en dit long sur la capacité de la « démocratie » à donner naissance à des clones aveugles sur le plan humain. Cela trace également une ligne claire entre les protestations mondiales, en particulier celles des étudiants dans les universités, qui ont une dimension de droits de l'homme, et les protestations israéliennes, qui reposent sur le même terrain que le déni par les gouvernements israéliens des droits des Palestinien.nes, y compris des droits humains fondamentaux.
Tiré d'Europe solidaire sans frontière.
Néanmoins, ces manifestations démontrent ce qui nous a toujours fait défaut dans nos propres pays : une influence du peuple sur les décisions et les politiques de guerre. Ceci est étroitement lié à la relation à sens unique entre les gouvernements et les gouverné.es, une relation à sens unique basée sur l'absence totale des individus dans la gestion de leur vie et le déni de tout droit « populaire » à intervenir ou même à réfléchir à l'intérêt supérieur du pays. En temps de guerre notamment, nos systèmes politiques prétendent défendre l'intérêt suprême du pays, ne laissant au peuple d'autre choix que celui de la soumission ou de la trahison. Le même type de relation s'applique aux formations non étatiques, en particulier celles qui reposent sur une base religieuse, qui entreprennent des missions militaires contre Israël, mais ces formations ne disposent pas d'une capacité de domination suffisante sur la sphère nationale et sont donc moins à même de contrôler les individus que les États. Cependant, l'émergence de ces formations non étatiques est en soi l'expression d'un problème national profond.
Notre incapacité chronique à libérer l'État de l'emprise des cliques dirigeantes renforce notre vulnérabilité chronique à l'égard d'Israël.
Le fait que les politiques intérieures, et plus encore les orientations, les décisions et la gestion de la guerre, ne soient pas soumises à l'obligation de rendre des comptes a pour point de départ et pour aboutissement le fait que le peuple est privé de toute possibilité d'influer sur sa situation et que les « dirigeants » sont réputés infaillibles, ce qui signifie que leurs décisions et leurs politiques sont les meilleures possibles, les plus propices à l'intérêt national, et que le fait de protester contre ces décisions ne fait que faire le jeu de l'ennemi. Ainsi, il semble que les protestations du peuple « ennemi » et la mise en cause de ses dirigeants, la chute de certains d'entre eux, et peut-être leur procès pour les actes qu'ils ont commis, soient la preuve de la justesse des politiques de nos « dirigeants » qui sont infaillibles. C'est pourquoi nous nous réjouissons lorsqu'une commission d'enquête israélienne publie un rapport qui rend les dirigeants israéliens responsables d'un échec, comme ce fut le cas, par exemple, lors de l'annonce du rapport de la Commission Vinograd en avril 2007. Après la fin de la guerre israélienne contre le Liban à l'été 2006, sans qu'Israël ait atteint ses objectifs déclarés (destruction du Hezbollah, libération de prisonniers sans échange, mise en œuvre de la résolution 1559 du Conseil de sécurité des Nations unies), la rue israélienne s'est mobilisée pour faire pression sur le gouvernement afin qu'il forme une commission chargée d'enquêter sur les activités des dirigeants israéliens dans les domaines politique, militaire et de la sécurité. La commission Vinograd a été créée et, quelques mois plus tard, elle a publié son premier rapport, qui tenait le gouvernement pour responsable de l'échec de la guerre. L'échec ne signifie pas la défaite, mais plutôt que de meilleurs résultats auraient pu être obtenus, que ce soit en infligeant plus de dégâts à l'ennemi ou en évitant plus de pertes. Le chef d'état-major a démissionné au cours de l'enquête, avant la publication du rapport, le ministre de la Défense a démissionné après la publication du rapport et la popularité du Premier ministre Ehoud Olmert a chuté.
Le Hezbollah voulait faire croire à une victoire triomphale et a salué la « chute » des chefs de guerre israéliens comme une confirmation de sa victoire. En effet, le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, avait déjà déclaré que cette guerre coûterait leur poste aux dirigeants israéliens, et c'est ce qui s'est passé. Mais est-ce une manifestation du succès du Hezbollah, du fait qu'il est sur la bonne voie et qu'il n'est pas nécessaire d'enquêter sur ses dirigeants ou de leur demander des comptes, ou est-ce une manifestation du fait qu'il existe en Israël un mécanisme de responsabilité fondé sur les intérêts suprêmes de l'État et que les dirigeants israéliens, même s'ils se situent très en deçà de ces intérêts, restent comptables de les avoir servis ? Il est évident que l'objectif de ces commissions d'enquête est que les dirigeants israéliens se comportent mieux, ce qui signifie qu'il faut accroître le différentiel entre Israël et son environnement, car Israël doit non seulement être supérieur sur le plan technique et matériel, mais aussi sur le plan de la conduite et de la gestion de la guerre. La démocratie intérieure qui permet les protestations n'est pas moins importante que ces deux aspects, car elle préserve d'une relation aliénée entre le peuple et son gouvernement, de sorte que le gouvernement n'apparaisse pas comme un organe répressif indépendant du peuple et échappant à son influence.
La situation inverse est largement et profondément ressentie en Syrie : les Syriens sont devenus indifférents à toutes les formes d'agression que subit leur pays sous le régime de la junte au pouvoir, et certains Syriens en sont même venus à apprécier les frappes israéliennes répétées comme un affaiblissement du régime et à les considérer comme une manifestation de la crise et de l'incapacité croissantes de la junte. Ainsi, la répression généralisée n'est pas seulement efficace pour le maintien de la junte au pouvoir, mais aussi, dans le même temps, efficace sur le plan interne au service d'un ennemi extérieur.
Si, en 2006, le Hezbollah a effectivement fait preuve d'une cohésion, d'une discipline et d'une excellente capacité de combat qui ont étonné le monde à l'époque, en particulier face à l'offensive terrestre israélienne dans les derniers jours de la guerre, lorsque l'armée israélienne voulait atteindre le fleuve Litani, il a fait montre de ce que les régimes arabes ont toujours montré : l'absence de toute forme de prise en compte ou de lien vivant avec les populations sous leur contrôle qui leur donnerait un droit à demander des comptes, à quoi il faut ajouter son régime partisan interne qui a produit une dissociation paralysante entre le patriotisme affiché comme objectif et la réalité du patriotisme que révèlent les moyens employés.
La vitalité de la relation entre le peuple d'Israël et son gouvernement favorise l'expansionnisme et la domination israéliens, contrairement à une perception qui voit dans les manifestations un signe de la désintégration de la société israélienne et une menace pour l'État occupant. Cette vitalité est un élément de supériorité politique qui s'ajoute aux autres atouts d'Israël. En revanche, notre incapacité chronique à libérer l'État de l'emprise des cliques dirigeantes renforce notre vulnérabilité chronique à l'égard d'Israël, et les droits de nos peuples glissent de plus en plus sur la pente savonneuse.
Rateb Shabo
• Traduction automatique par Deepl (légèrement remaniée pour ESSF par Pierre Vandevoorde) d'un article publié en arabe sur alaraby.co.uk
L'auteur n'a pas pu vérifier la traduction.
• Rateb Shabo est né en 1963. Il est chirurgien, traducteur de l'anglais et écrivain. Il est actuellement réfugié politique en France. Il a été détenu 16 ans dans les prisons syriennes (1983-1999). Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels « Le monde de l'islam à ses débuts » (en arabe, non traduit), le récit de ses années de prison (« Achter deze Muren »-« derrière ces murs-là » disponible en arabe et en néerlandais) et « Une histoire du Parti de l'Action Communiste en Syrie (1976-1992) », non traduit.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La persécution méthodique du Liban par Israël

Déjà confronté depuis 2019 à une crise économique et financière sans précédent, à laquelle s'ajoute un vide institutionnel depuis 2022, le Liban subit une fois de plus d'intensifs bombardements israéliens sur son sol. Lundi 23 septembre, on dénombrait plus de 550 morts à l'issue du pilonnage du sud du pays (ainsi que du sud de la capitale et d'autres régions). Ces actes, indissociables de la question palestinienne et des massacres à Gaza, s'inscrivent aussi dans une tradition de martyrisation du pays du cèdre par l'armée israélienne. Ce n'est pas le Hezbollah qui est visé, mais tout un pays.
27 septembre 2024 | tiré de AOC info
Le 14 août dernier nous quittait Georges Corm, auteur prolifique sur le Proche-Orient, ministre des Finances du Liban à la fin des années 1990 et infatigable soutien de la cause palestinienne. Il insistait souvent sur une caractéristique géopolitique mortifère de son pays : le Liban est un État tampon et en tant que tel, sa stabilité dépend de la stabilité régionale. La guerre en Syrie, le bras de fer saoudo-iranien ou la politique israélienne sont donc autant de facteurs d'instabilité. Mais s'agissant des tensions israélo-libanaises en particulier, Georges Corm aimait dire que le Liban était un contre-modèle pour Israël : là où ce dernier est un État d'apartheid et de colonisation, le Liban privilégie malgré tout la concorde et la coexistence entre communautés diverses.
La guerre actuelle rappelle la centralité de la question palestinienne, mais elle rappelle aussi la profonde hostilité israélienne à l'égard du Liban. La présentation médiatique des événements est problématique : comme en Palestine où tout est résumé à un conflit entre Israël et le Hamas, il est question de « frappes » contre les positions du Hezbollah. Quand, pour la première fois depuis les guerres du Liban (1975-1990), plus de 550 personnes, dont une cinquantaine d'enfants, sont tuées en une seule journée, peut-on vraiment parler de « frappes ciblées » ? La cible a un nom : le Liban.
La ritournelle du Hezbollah
La place prépondérante du Hezbollah, à la fois parti politique libanais et groupe armé, ne fait aucun doute. Il est vrai que le « Parti de Dieu », qui bénéficie du soutien de l'Iran depuis ses débuts dans les années 1980, s'inscrit pleinement dans « l'axe de la résistance » face à Israël, et agit au-delà du périmètre de l'État libanais. Et il est vrai aussi que la question de son armement est régulièrement posée par ses opposants. Son désarmement est même demandé par des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. En somme, les adversaires et les ennemis du Hezbollah ne manquent pas d'arguments. Et certains commentateurs semblent trouver l'action israélienne « légitime ».
Le récit déployé par Israël, et hélas trop souvent relayé, est celui de la bienveillance étatique face à l'irrationalité des groupes « terroristes ». Associer systématiquement le Hezbollah à une communauté confessionnelle en particulier (les chiites) et à un allié extérieur (l'Iran), c'est contester sa dimension nationale. Le Hezbollah, et plus généralement ce qu'on appelait la résistance islamique dans les années 1980, est né contre l'occupation israélienne du Liban. Et c'est bien cette résistance, qui s'est poursuivie jusqu'en 2000 avec des soutiens dans toute la société libanaise, qui finit par débarrasser le pays de l'armée israélienne – qui occupe encore le Golan syrien et les fermes de Chebaa libanaises.
Le pire défaut du Hezbollah ces dernières années n'a pas été la subversion de l'État libanais, mais au contraire, son émergence comme gardien du système politique libanais, notamment face au soulèvement populaire de 2019. Souvent décrit soit comme une organisation hostile à l'État libanais, soit comme un acteur omnipotent en son sein, le Hezbollah n'est ni l'une ni l'autre. Il est membre du gouvernement libanais et il exerce assurément une influence sur les équilibres politiques du pays, mais il demeure tributaire de ses partenariats politiques, dans un paysage marqué par le confessionnalisme et la corruption – l'un nourrissant l'autre, le confessionnalisme empêchant une citoyenneté aboutie.
Depuis 2022, le Liban est sans président et un gouvernement d'affaires courantes a été reconduit ; le Hezbollah peine à imposer son candidat et il est loin de dominer le gouvernement.
Parmi ses partenaires, certains n'ont pas hésité à lui indiquer leur refus d'un « front libanais » censé soulager les Palestiniens (et maintenir la pression en vue d'un cessez-le-feu à Gaza). Pour eux, la solidarité avec les Palestiniens ne peut pas passer par une mise en danger d'un Liban, déjà largement fragilisé par une crise économique et financière inédite. C'est notamment le cas du courant aouniste (en référence au général Michel Aoun, président de 2016 à 2022 avec l'appui du Hezbollah), son principal allié chrétien de 2006 à 2022, favorable à la résistance à Israël tant que l'armée n'a pas les moyens d'assumer une telle mission seule, mais hostile à « l'unité des fronts » (un front libanais solidaire du front palestinien). Exploiter de telles divisions est l'un des objectifs constants d'Israël.
Détruire et diviser : les objectifs d'Israël au Liban
Tout cela n'est pas nouveau. Rappelons les années de ce que l'on a pris l'habitude d'appeler la « guerre civile » libanaise (1975-1990). L'un des buts d'Israël était d'exacerber les divisions confessionnelles (qui ne se confondaient pas avec les divisions politiques) du pays et d'apparaître comme une espèce de défenseur des chrétiens contre les Palestiniens (et leurs alliés libanais) et contre les Syriens. Israël est allé jusqu'à former une armée de supplétifs au sud du pays, ce même sud qui deviendra un bastion de la résistance anti-israélienne. Israël pouvait alors s'appuyer sur certains chefs politiques chrétiens (de ce que l'on appelait la « droite chrétienne ») dans sa lutte contre l'Organisation de libération de la Palestine (OLP). En 1982, cette lutte a pris la forme d'une invasion du Liban, quand Beyrouth était – déjà – prise pour cible.
L'expérience libanaise de l'armée israélienne n'a pas été un succès. Certes, l'OLP est poussée à quitter Beyrouth, mais ce qui succède à l'OLP en termes de résistance à Israël au Liban est redoutable pour l'armée israélienne : c'est dans ce contexte qu'est né le Hezbollah, au lendemain de l'invasion israélienne. L'organisation, soutenue par la République islamique d'Iran, s'insérera peu à peu dans la vie politique libanaise et sa résistance à Israël lui permettra d'acquérir une légitimité certaine auprès de toutes les communautés. Avant les affrontements actuels, la guerre de 2006 – considérée comme une déroute israélienne – était le dernier grand épisode de cette résistance.
L'autre échec est politique. En 1982, Israël n'obtient pas la « normalisation » escomptée – destinée à noyer la question palestinienne et à isoler la Syrie. Et depuis les années 2000, Israël n'arrive pas à obtenir l'exclusion du Hezbollah de la vie politique libanaise.
Bien sûr, on ne peut pas nier que les actions du Hezbollah divisent la population et la classe politique libanaises. C'était le cas en 2006, et c'est encore le cas cette fois. Néanmoins, la violence israélienne, aussi bien à l'égard des Libanais que des Palestiniens, laisse peu de place aux critiques à l'encontre du Hezbollah. Devant les bombardements continus et les centaines de morts, et même si certains réfutent l'opportunité des tirs du Hezbollah dirigés contre Israël, c'est bien ce dernier qui est largement perçu comme l'objet prioritaire des condamnations. Aujourd'hui, le parti des Forces libanaises (principale formation chrétienne du pays à l'issue des dernières législatives et principal adversaire du Hezbollah) se montre discret, tandis que les autres formations politiques – des aounistes au chef druze Walid Joumblatt – se focalisent sur les intentions d'Israël.
En dépit de la permanence des rhétoriques confessionnelles (sunnites versus chiites en 2006 ; chiites versus chrétiens aujourd'hui), Israël aura du mal à trouver au Liban les relais qu'il pouvait avoir naguère. Par ailleurs, le Hezbollah et la population chiite du sud du pays ont été et sont encore les premiers à payer le prix de cette guerre. Mais, si en décembre dernier, nous pouvions constater à Beyrouth une dichotomie entre ceux qui perdaient des proches au sud du pays et ceux qui présentaient une sorte de vitrine de vie « normale », désormais, c'est tout le pays qui constate l'étendue des attaques israéliennes.
Il est pourtant plus question de cibler le Hezbollah, ce qui donne l'impression qu'il s'agit d'une opération militaire. Mais s'agit-il vraiment d'une opération militaire ? Le politologue Pierre France partage sa réflexion sur ce point : « Il n'y a jamais eu de si grand nombre de morts en une journée au Liban sur une opération militaire, ni en 1978, ni en 1982, ni en 2006 : même pendant la guerre civile, où les chiffres se sont parfois affolés ». Autrement dit, si le Hezbollah est bien ciblé, tous les civils autour sont aussi intentionnellement tués. Bombarder en les sachant là, tuer des civils par centaines, les déplacer par milliers, cela relève du crime de guerre.
Une complaisance confirmée
Le Liban est ainsi le théâtre de la confirmation de l'impunité dont jouit Israël. Cette impunité auprès des États est sans doute inversement proportionnelle à la détestation qui s'étend parmi les opinions publiques face à l'ampleur des massacres. Sur le plan médiatique, les euphémismes (des « frappes » contre le Hezbollah pour parler de centaines de civils tués), voire une admiration malsaine (dans l'affaire des bipeurs piégés), reflètent cette complaisance. On en oublie le caractère parfois inédit de ce qui advient en Palestine comme au Liban.
On est même invité à considérer les bombardements israéliens comme une riposte presque normale, ce qui permet de négliger le crime originel (l'occupation, la colonisation, les massacres) et même d'ignorer la responsabilité israélienne dans la précipitation des événements (l'escalade après une guerre d'attrition). La propagande israélienne contribue directement à cette distorsion, d'autant plus qu'elle est peu questionnée. Lorsque l'on reprend le noble objectif du retour des populations du nord d'Israël affiché par le gouvernement israélien, on a tendance à mésestimer le prix payé sous nos yeux : le déplacement de milliers de Libanais.
Quant au soutien inconditionnel des alliés d'Israël – de Washington à Paris, en passant par Londres –, là encore, on est enclin à croire que c'est la seule position envisageable tant il est devenu automatique. Mais quelques rappels s'imposent. En 1982, après l'invasion israélienne du Liban, les positions britannique et française étaient autrement plus fermes. Margaret Thatcher est allée jusqu'à imposer un embargo sur les armes pendant douze ans. Et François Mitterrand a condamné « sans réserve » ce qu'il a lui-même qualifié « d'agression ». Où sont les condamnations française et britannique aujourd'hui ? Elles ont cédé la place à de vagues manifestations affectives. Cette pusillanimité reflète le mélange d'impotence et d'indifférence qui règne parmi les États occidentaux.
Il est trop facile de déplorer la montée en puissance d'acteurs non étatiques (Hamas, Hezbollah, Houthis…) dans la lutte contre Israël et dans la défense de la cause palestinienne quand les États eux-mêmes – pourtant principaux objets et sujets du droit international – ne trouvent rien de concret à offrir pour protéger des civils qui meurent par dizaines de milliers. La rationalité étatique face aux acteurs non étatiques ne se décrète pas. Elle se démontre par la rigueur et la cohérence.
Photo d'ouverture : De la fumée s'échappe d'un site visé par un bombardement israélien dans le village de Zaita, au sud du Liban, le 23 septembre 2024. (Photo par Mahmoud ZAYYAT / AFP)
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Forum de la gauche arabe : au Liban, résistance contre l’agression israélienne

Le Forum de la gauche arabe est une coalition d'une vingtaine de partis politiques de gauche, représentant plusieurs pays arabes, née en 2010 à l'initiative du Parti communiste libanais (PCL). Animé essentiellement par le PCL, le Forum de la gauche arabe a tenu sa dixième rencontre le 15 septembre 2024 à Beyrouth, avant le déclenchement de la guerre d'Israël contre le Liban.
Tiré de la revue Contretemps
28 septembre 2024
Par Forum de la gauche arabe
Afin que notre lectorat puisse se faire une idée de la position politique du PCL, la principale force de gauche au Liban, et d'une partie des gauches arabes actuelles, sur la guerre israélienne en cours contre le Liban, nous avons traduit de l'arabe le communiqué du Forum de la gauche arabe en date du 26 septembre 2024.
Les principaux mots d'ordre sont : résilience, résistance et unité contre l'agression israélienne.
***
Le Liban, son peuple et sa résistance sont confrontés depuis le 17 septembre à une agression sioniste-impérialiste brutale, à une guerre méthodique d'anéantissement et de destruction qui frappe les enfants, les civils et les institutions sur l'ensemble du territoire libanais. Cette agression vient prolonger la guerre menée contre la bande de Gaza et la Cisjordanie, avec pour objectif de défaire la lutte et les fronts du soutien [à la résistance palestinienne], d'éliminer la résistance du peuple libanais et sa résilience, en vue d'isoler le peuple palestinien, d'éliminer sa résistance, de liquider sa cause, d'annihiler ses droits et de l'expulser de sa terre. Il s'agit d'une agression coloniale impérialiste qui, par son essence et ses dimensions, vise l'ensemble du monde arabe.
Le Liban, son peuple et sa résistance ont fait le serment – avant-même le lancement du Front de la résistance nationale libanaise (FRNL) en 1982, puis avec la libération inconditionnelle de son territoire de l'occupant sioniste en 2000, la mise en défaite de l'agression sioniste en juillet 2006, et encore aujourd'hui – de porter la cause palestinienne et de brandir l'étendard de la libération. De la même manière que la Palestine persévère et résiste toujours, depuis un an, à Gaza, en Cisjordanie, à Jérusalem et dans tous les territoires palestiniens occupés. Le Liban restera ainsi ferme et résistant, par son peuple et sa résistance nationale dans toutes ses formes, et par l'ensemble de ses composantes politiques nationales, syndicales, travailleuses, féminines et jeunes. Il sera présent et prêt à repousser l'agression sioniste sauvage de toutes les manières et par tous les moyens, main dans la main avec les forces de la résistance libanaise et palestinienne, ainsi qu'avec les forces de gauche et de la libération nationale arabe, pour mettre en échec les objectifs et les plans tactiques et stratégiques de l'agression, jusqu'à sa défaite.
Le Forum de la gauche arabe, en vertu de la traduction pratique des résolutions de la « Déclaration de Beyrouth » publiée lors de la dixième rencontre du 15 septembre 2024, apprécie hautement les positions politiques émises depuis le 17 septembre par les partis du Forum de la gauche arabe. Celles-ci constituent un appui et une base importantes pour soutenir la résilience et la résistance du peuple libanais. En raison de son importance politique, nous espérons des dirigeants des partis qui composent le Forum de la gauche arabe qu'ils engagent une série de mesures pratiques en soutien à la résilience populaire et au front de la résistance nationale libanaise dans la dangereuse confrontation en cours :
1/ Le lancement de campagnes politiques, de manifestations et de marches populaires de façon continue sur les places publiques en soutien aux peuples palestinien et libanais, et en opposition à la normalisation [avec Israël] sous toutes ses formes ;
2/ Une participation médiatique large pour fortifier l'opinion publique et pour soutenir l'action de résistance contre l'ennemi sioniste ;
3/ La constitution de comités de soutien dans tous les pays et la liaison avec les partis et les forces de gauche dans le monde ;
4/ Le soutien impératif à un plan d'urgence pour la résilience des populations sur le terrain au Liban, notamment à la suite des déplacements importants des zones larges ciblées au Liban. En particulier, travailler à garantir les besoins vitaux des personnes déplacées du Liban et cela compte tenu de l'absence et de l'incapacité de l'État libanais d'assurer ces nécessités urgentes.
La bataille contre l'ennemi israélien – avec ses alliés et ses instruments – est longue, rude et dangereuse. C'est pourquoi toutes les initiatives révolutionnaires sont requises d'urgence de la part du Forum de la gauche arabe, pour matérialiser sa présence et sa contribution politique et sur le terrain dans l'affrontement de la guerre d'agression sioniste qui nous cible tous, ainsi que pour maintenir notre bannière levée afin de renforcer le « Front de la résistance nationale arabe » et la « fermeté populaire » jusqu'à la défaite de cette agression sioniste, impérialiste étasunienne, atlantiste et réactionnaire arabe contre la Palestine, le Liban et la région.
À Beyrouth, le 26 septembre 2024.
Illustration : Naji al-Ali, caricaturiste palestinien.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Gaza – Liban. Une guerre occidentale

Jusqu'où ira Tel-Aviv ? Non content d'avoir réduit Gaza à un champ de ruines en plus d'y commettre un génocide, Israël étend ses opérations au Liban voisin, avec les mêmes méthodes, les mêmes massacres, les mêmes destructions, convaincu du soutien indéfectible de ses bailleurs occidentaux devenus complices directs de son action.
Tiré d'Orient XXI.
Le nombre de morts libanais des bombardements a dépassé 1 640, et les « exploits » israéliens se sont multipliés. Inaugurés par l'épisode des bipeurs, qui a suscité la pâmoison de nombre de commentateurs occidentaux devant « l'exploit technologique ». Tant pis pour les victimes, tuées, défigurées, aveuglées, amputées, passées par pertes et profits. On répétera ad nauseam qu'il ne s'agit après tout que du Hezbollah, d'une « humiliation », organisation que, rappelons-le, la France ne considère pas comme une organisation terroriste. Comme si les explosions n'avaient pas touché l'ensemble de la société, tuant miliciens ou civils de manière indifférenciée. Pourtant, le recours à des objets piégés est une violation du droit de la guerre, comme l'ont rappelé plusieurs spécialistes et organisations humanitaires (1).
Les assassinats sommaires des dirigeants du Hezbollah, dont celui de son secrétaire général Hassan Nasrallah, accompagnés chaque fois de nombreuses « victimes collatérales », ne font même pas scandale. Dernier pied de nez de Nétanyahou à l'ONU, c'est au siège même de l'organisation qu'il a donné le feu vert pour le bombardement de la capitale libanaise.
À Gaza et dans le reste des territoires palestiniens occupés, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU enfouissent chaque jour un peu plus les avis de la Cour internationale de justice (CIJ). La Cour pénale internationale (CPI) tarde à émettre un mandat contre Benyamin Nétanyahou, alors même que son procureur fait état de pressions « par des dirigeants mondiaux » et par d'autres parties, y compris personnelles et contre sa famille (2). Avons-nous entendu Joe Biden, Emmanuel Macron ou Olaf Scholz protester contre ces pratiques ?
Cela fait presque un an que quelques voix, qui passeraient presque pour les fous du village, dénoncent l'impunité israélienne, encouragée par l'inaction occidentale. Jamais une telle guerre n'aurait été possible sans le pont aérien des armes américaines — essentiellement, et dans une moindre mesure européennes —, et sans la couverture diplomatique et politique des pays occidentaux. La France, si elle le voulait, pourrait prendre des mesures qui frapperaient vraiment Israël, mais elle refuse encore de suspendre les licences d'exportation d'armement qu'elle lui a accordées. Elle pourrait aussi défendre à l'Union européenne, avec des pays comme l'Espagne, la suspension de l'accord d'association avec Israël. Elle ne le fait pas.
Cette Nakba palestinienne qui n'en finit pas et cette destruction en règle qui s'accélère au Liban ne sont pas seulement des crimes israéliens, mais aussi des crimes occidentaux, dans lesquels Washington, Paris et Berlin portent une responsabilité directe. Loin des gesticulations et des mises en scène dont l'Assemblée générale de l'ONU a été le théâtre ces jours-ci, ne soyons dupes ni des colères de Joe Biden, ni des vœux pieux énoncés par Emmanuel Macron sur la « protection des civils », lui qui n'a jamais manqué une occasion pour montrer un soutien sans faille au gouvernement d'extrême droite de Benyamin Nétanyahou. Oublions même nombre de ces diplomates qui ont quitté la salle de l'Assemblée générale de l'ONU au moment de la prise de parole du Premier ministre israélien, dans un geste qui relève davantage de la catharsis que de la politique. Car si des pays occidentaux sont les premiers responsables des crimes israéliens, d'autres, comme la Russie ou la Chine n'ont pris aucune mesure pour mettre fin à cette guerre dont le périmètre s'étend chaque jour, et déborde sur le Yémen aujourd'hui et peut-être sur l'Iran demain.
Cette guerre nous enfonce dans un âge sombre où les lois, le droit, les garde-fous, tout ce qui empêcherait cette humanité de sombrer dans la barbarie, sont méthodiquement mis à terre. Une ère où une partie a décidé de la mise à mort de l'autre partie jugée « barbare ». Des « ennemis sauvages », pour reprendre les mots de Nétanyahou, qui menacent « la civilisation judéo-chrétienne ». Le premier ministre cherche à entraîner l'Occident dans une guerre de civilisation à connotation religieuse, dont Israël se pense comme l'avant-poste au Proche-Orient. Avec un succès certain.
Par les armes et les munitions dont ils continuent à alimenter Israël, par leur soutien indéfectible à un fallacieux « droit à se défendre », par le rejet de celui des Palestiniens à disposer d'eux-mêmes et à résister à une occupation que la CIJ a décrété illégale et dont elle ordonne l'arrêt — décision que le Conseil de sécurité de l'ONU refuse d'appliquer —, ces pays portent la responsabilité de l'hubris israélien. Membres d'institutions aussi prestigieuses que le Conseil de sécurité de l'ONU ou le G7, les gouvernements de ces États entérinent la loi de la jungle imposée par Israël et la logique de la punition collective. Cette logique était déjà à l'œuvre en Afghanistan en 2001 et en Irak en 2003, avec les résultats que l'on connaît. Déjà en 1982, Israël avait envahi le Liban, occupé le Sud, assiégé Beyrouth et supervisé les massacres des camps palestiniens de Sabra et Chatila. C'est cette « victoire » macabre qui a abouti à l'essor du Hezbollah, tout comme la politique israélienne d'occupation a abouti au 7 octobre. Car la logique de guerre et de colonialisme ne peut jamais déboucher sur la paix et la sécurité.
Notes
1- Lire, par exemple, le rapport d'Amnesty International, « Sept choses à savoir sur les attaques aux bipeurs et talkies-walkies au Liban », 23 septembre 2024.
2- Lire et écouter son entretien à la BBC, « ICC chief prosecutor defends Netanyahu arrest warrant in BBC interview », 5 septembre 2024.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le vote historique des Nations unies en faveur de sanctions à l’encontre d’Israël changera-t-il la réalité pour les Palestiniens ?

Les Palestiniens n'ont jamais perdu espoir dans la résistance qu'ils opposent depuis des décennies au régime d'oppression impitoyable d'Israël.
Tiré de France Palestine Solidarité. Article publié pr The Guardian et traduit par l'organisme. Photo : Résultat du vote de l'AGNU sur une résolution relative aux politiques et pratiques d'Israël dans le Territoire Palestinien Occupé © UN photo/Evan Schneider.
Le Canada s'est abstenu lorsque l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté à une écrasante majorité une résolution appelant à des sanctions contre Israël le 18 septembre 2024, objectant que la résolution « s'aligne sur le boycott, le désinvestissement et les sanctions, auxquels le Canada s'oppose fermement ». Cette formulation, toute hypocrisie mise à part, renverse la vérité. Lancé en 2005, le mouvement non violent et antiraciste BDS, inspiré par la lutte anti-apartheid sud-africaine et le mouvement des droits civiques aux États-Unis, a toujours défendu les droits des Palestiniens dans le respect du droit international.
Le mouvement BDS appelle à mettre fin à l'occupation illégale et à l'apartheid d'Israël et à défendre le droit des réfugiés palestiniens à rentrer chez eux et à recevoir des réparations. C'est l'Assemblée générale des Nations unies qui commence enfin à s'aligner sur la tâche urgente d'appliquer le droit international de manière cohérente, même à l'égard d'Israël. Comme le dit Craig Mokhiber, ancien haut fonctionnaire des Nations unies chargé des droits de l'homme, l'arrêt de la Cour internationale de justice (CIJ) fait du BDS « non seulement un impératif moral et un droit constitutionnel et humain, mais aussi une obligation juridique internationale ».
Loin d'être un énième vote de l'ONU, ce vote est historique. C'est la première fois que l'assemblée générale dénonce le régime d'apartheid d'Israël et la première fois en 42 ans qu'elle demande des sanctions pour mettre fin à l'occupation illégale, comme l'a décidé la CIJ en juillet.
De nombreux Palestiniens et militants de la solidarité restent cependant sceptiques. Près d'un an après le début du génocide israélien contre 2,3 millions de Palestiniens dans la bande de Gaza occupée et assiégée, Israël commet quotidiennement des atrocités, faisant preuve d'un niveau sans précédent d'invincibilité apparente, ou de ce que même le docile secrétaire général de l'ONU appelle « l'impunité totale ». En partenariat avec les puissances occidentales hégémoniques, les États-Unis en tête, Israël extermine non seulement des dizaines de milliers de Palestiniens indigènes, mais bafoue également les principes mêmes du droit international.
De nombreux experts des Nations unies en matière de droits de l'homme partagent cet avis. Dans une déclaration publiée le même jour, ils affirment que « l'édifice du droit international est sur le fil du rasoir, la plupart des États ne prenant pas de mesures significatives pour se conformer à leurs obligations internationales réaffirmées dans l'arrêt [de la CIJ] ». Pour se conformer à l'arrêt, les États doivent imposer des sanctions économiques, commerciales, universitaires et autres de grande ampleur à l'occupation illégale et au « régime d'apartheid » d'Israël, écrivent-ils, précisant qu'un embargo militaire complet est la mesure la plus urgente.
Dès octobre 2023, quelques jours après l'attaque génocidaire d'Israël contre Gaza, le président colombien Gustavo Petro a mis en garde contre « la montée sans précédent du fascisme et, par conséquent, la mort de la démocratie et de la liberté... Gaza n'est que la première expérience visant à nous considérer tous comme jetables ». En d'autres termes, « plus jamais ça, c'est maintenant », comme l'ont dit les groupes juifs progressistes et antisionistes. Cela signifie que la priorité la plus urgente de l'humanité est de mettre fin au génocide israélien, tout en reconnaissant que la justice pour les Palestiniens croise et est entrelacée avec les luttes pour la justice raciale, climatique, économique, sociale et de genre.
Les décisions de la CIJ, le vote historique de l'assemblée générale et les déclarations des experts de l'ONU reflètent tous une majorité mondiale montante qui soutient non seulement la lutte pour l'émancipation des Palestiniens, mais aussi la mission fondamentale de sauver l'humanité, rien de moins, d'une ère de « la force fait le droit », sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale, qui relègue les institutions de l'ONU dans les poubelles de l'histoire.
Quoi qu'il en soit, les Palestiniens ne se font aucune illusion sur le fait que la justice leur sera rendue par la CIJ ou l'ONU, cette dernière étant historiquement responsable de la Nakba de 1947-1949, du nettoyage ethnique de la plupart des Palestiniens et de l'établissement d'Israël en tant que colonie de peuplement sur la majeure partie du territoire de la Palestine historique. L'échec total du système juridique international, dominé par les puissances coloniales euro-américaines, à fournir la base nécessaire, non ambiguë et juridiquement contraignante pour arrêter le premier génocide télévisé du monde, sans parler de rendre la justice, en dit long.
Nous avons le droit international de notre côté. En tant que peuple autochtone luttant contre un système d'oppression dépravé et génocidaire, nous avons une position éthique élevée pour faire valoir nos droits. L'éthique et le droit sont nécessaires dans notre lutte de libération ou dans toute autre, mais ils ne sont jamais suffisants. Pour démanteler un système d'oppression, les opprimés ont invariablement besoin de pouvoir : le pouvoir du peuple, le pouvoir de la base, le pouvoir de la coalition intersectionnelle, le pouvoir de la solidarité et le pouvoir des médias, entre autres.
En construisant le pouvoir populaire, les Palestiniens ne demandent pas la charité au monde ; nous appelons à une solidarité significative. Mais avant tout, nous exigeons la fin de la complicité. L'obligation éthique la plus profonde dans les situations d'oppression extrême est de ne pas faire de mal et de réparer le mal fait par vous ou en votre nom.
Comme l'a montré la lutte qui a mis fin à l'apartheid en Afrique du Sud, mettre fin à la complicité des États, des entreprises et des institutions avec le système d'oppression israélien, en particulier par le biais de la tactique non violente du BDS, est la forme la plus efficace de solidarité, de construction du pouvoir populaire pour aider à démanteler les structures d'oppression.
Près d'un an après le génocide, certains se plaignent de la « fatigue du génocide ». Mais les Palestiniens, en particulier à Gaza, n'ont pas le luxe de la « fatigue du génocide », car Israël continue de massacrer, d'affamer et de déplacer de force, commettant ce que les experts de l'ONU ont identifié comme « le domicide, l'urbicide, le scolasticide, le médicide, le génocide culturel et, plus récemment, l'écocide ».
Les Palestiniens n'ont jamais perdu espoir dans la résistance qu'ils opposent depuis des décennies au régime d'oppression impitoyable d'Israël. Cet espoir illimité n'est pas fondé sur des vœux pieux ou sur la croyance naïve en une victoire inévitable qui tomberait du ciel, mais sur le sumud incessant de notre peuple, sur son insistance à exister dans sa patrie, dans la liberté, la justice, l'égalité et la dignité. Elle est également ancrée dans la croissance inspirante du mouvement de solidarité mondiale et dans son impact.
Par ailleurs, comme le dit l'écrivain britanno-pakistanais Nadeem Aslam, « le désespoir se mérite. Personnellement, je n'ai pas fait tout ce que je pouvais pour changer les choses. Je n'ai pas encore gagné le droit de désespérer ». Si vous n'avez pas gagné ce droit, vous devez continuer à organiser, à espérer, à mettre fin à la complicité dans votre sphère d'influence relative. Avec un radicalisme stratégique, nous pouvons et devons vaincre le génocide, l'apartheid et toute cette oppression indescriptible.
Traduction : AFPS
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Quand les complices d’Israël nous accoutument à un monde monstrueux et inhumain, car sans coeur !

Pire que les crimes d'Israël est le fait que l'ensemble du monde dit « civilisé » les suit et les commente comme s'ils n'étaient qu'un jeu vidéo. Quand évidemment il ne les célèbre pas en armant le criminel. Ou ne les approuve pas en le laissant impuni. Et ça depuis plusieurs décennies. Et aussi, en direct sur les écrans de nos télévisions. Jour après jour, heure après heure. Comme si ces massacres quotidiens étaient une série télévisée sans fin, entrecoupée par des messages de publicité, qu'on peut suivre allongés sur nos canapés, pendant qu'on mange une pizza ou on sirote une boisson…
Tiré du site du CADTM.
Il y a presque un an on écrivait qu'un des objectifs de Netanyahou et de ses acolytes était de nous accoutumer « à un monde ressemblant de plus en plus à une jungle où règne uniquement le droit du plus fort et où sont « permises » les pires atrocités contre les plus faibles ! ». Aujourd'hui, et tenant compte du bilan de douze mois d'atrocités et de crimes qui dépassent souvent l'imagination, on peut dire que l'État sioniste est en train de nous accoutumer à quelque chose de bien plus grave : à la perversité, au sadisme de masse et à la violence aveugle et sans limite contre les civils, lesquelles sont tolérées, reconnues et même acceptées dernièrement comme des comportements « normaux » par ceux d‘en haut ! Ce qui fait que sont bestialisés non seulement ceux qui commettent ces crimes innommables, mais aussi tous ceux qui les tolèrent et les encouragent feignant de ne pas les voir…
On se trouve ici devant un « phénomène qui n'a aucun précédent historique, qui est totalement nouveau. Car s'il y a eu dans le passé des crimes aussi ou peut être plus graves que ceux commis aujourd'hui par Israël, il n'y a jamais eu l'indifférence et l'apathie, et même la tolérance et la bienveillance montrées à leur égard par les gouvernants, les centres de décision, les médias et même la majorité des opinions publiques du monde entier ! Donc, aucune comparaison avec les réactions des contemporains des nazis face aux crimes perpétrés par le Troisième Reich. Même si la majorité de leurs réactions étaient motivées non pas par l'antifascisme mais par un patriotisme anti-allemand, le fait est que, quand ils étaient connus, les crimes des nazis étaient presque unanimement condamnées, comme d'ailleurs ceux perpétrés plus tard par les États-Unis au Vietnam ou la France en Algérie.
Et maintenant ? Comment réagit la soi-disant « communauté internationale » face aux crimes en série d'Israël ? Dans la majorité des cas, elle réagit par un silence assourdissant. Pas un mot. Ses médias et ses autorités préfèrent ne rien dire. Alors, on parle à dessein de tout sauf des hécatombes quotidiennes en Palestine. On commente abondamment des histoires à dormir debout, on s'exaspère du sort des otages israéliens, et on s'apitoie a longueur de journée sur une victime d'un fait divers mais on passe sous silence la mort des dizaines, des centaines et des dizaines de milliers de Palestiniens de Gaza et des Territoires Occupées. Car manifestement il y a des morts qui pèsent bien moins que d'autres... ou ne pèsent rien du tout…
Mais, il y aussi ceux qui en parlent. Sauf qu'ils le font d'une façon bien... bizarre. En réalité, ils en parlent pour ne rien dire. À l'instar de leurs collègues poutinistes qui pérorent sur la guerre... « défensive » que mène la Russie en Ukraine, ils abondent eux aussi en « analyses » truffées de très savantes considérations « géostratégiques » sur le prétendu sens profond des opérations (militaires et autres) d'Israël, mais évitent soigneusement de parler de l'essentiel : des victimes humaines et de leurs bourreaux, des civils, surtout des femmes et des enfants bombardés et massacrés par dizaines de milliers. En somme, ils brouillent les cartes, afin de semer la confusion et ne pas nommer ni le criminel et ses crimes, ni ses victimes et leurs souffrances indicibles . Faisant preuve d'un cynisme et d'un amoralisme sans pareil, ces « analystes » et autres journalistes et « experts » en mission commandée, inaugurent ainsi une ère nouvelle : celle des sociétés monstrueuses où sont mal vues sinon bannies et criminalisées la compassion, la fraternité et la solidarité entre les humains. En somme, des sociétés totalement inhumaines condamnées à disparaître tôt ou tard dans un paroxysme de violence aveugle...
Ceci étant dit, il reste de réfléchir sur le présent et l'avenir des protagonistes de cette tragédie sans fin : les Israéliens et leur État. La parole donc à l'indomptable Israélien qu'est le célèbre journaliste et écrivain Gideon Levy, dont les prises de position plus que courageuses et toujours contre le courant ne font que sauver l'honneur non seulement des Juifs mais aussi de toute l'humanité. Voici donc son dernier et si terrible texte que nous avons traduit en français, publié il y a quelques jours dans le quotidien Haaretz. Il assène des vérités premières et existentielles à ses compatriotes...
Les Israéliens doivent se demander s'ils sont prêts à vivre dans un pays qui vit dans le sang
Il faudra des générations pour que Gaza se rétablisse, si tant est qu'elle le puisse.
par Gideon Levy
Israël se transforme, à une vitesse alarmante, en un pays qui vit de sang. Les crimes quotidiens de l'occupation ont déjà perdu de leur pertinence. Au cours de l'année écoulée, une nouvelle réalité de massacres et de crimes d'une toute autre ampleur est apparue. Nous sommes dans une réalité génocidaire ; le sang de dizaines de milliers de personnes a coulé.
C'est le moment pour tous les Israéliens de se demander s'ils sont prêts à vivre dans un pays qui vit dans le sang. Ne dites pas qu'il n'y a pas de choix - bien sûr qu'il y en a un - mais nous devons d'abord nous demander si nous sommes prêts à vivre ainsi.
Sommes-nous prêts, nous les Israéliens, à vivre dans le seul pays au monde dont l'existence est fondée sur le sang ? La seule vision répandue en Israël aujourd'hui est de vivre d'une guerre à l'autre, d'une saignée à l'autre, d'un massacre à l'autre, avec des intervalles aussi espacés que possible. Les gens pleins d'espoir promettent de longs intervalles, tandis que la droite promet une réalité sanguinolente permanente : la guerre, les massacres, la violation systématique du droit international, un État paria, se répétant dans un cycle sans fin.
Les Palestiniens continueront à être massacrés et les Israéliens continueront à fermer les yeux ? Difficile à croire. Un jour viendra où davantage d'Israéliens ouvriront les yeux et reconnaîtront que leur pays vit dans le sang. Sans effusion de sang, nous dit-on, nous n'avons pas d'existence - et nous sommes en paix avec cette horrible déclaration.
Non seulement nous croyons qu'un tel pays ne peut pas exister éternellement, mais nous sommes convaincus que sans l'offrande de sang, il n'a pas d'existence. Tous les trois ans, une saignée à Gaza, tous les quatre ans, au Liban. Entre les deux, il y a la Cisjordanie et, occasionnellement, une sortie de sang vers d'autres cibles. Il n'y a pas d'autre pays comme celui-là dans le monde.
Le sang ne peut pas être le carburant du pays. De même que personne n'imaginerait conduire une voiture alimentée par du sang, aussi bon marché soit-il, il est difficile d'imaginer que 10 millions d'habitants acceptent de vivre dans un pays qui fonctionne au sang. La guerre à Gaza marque un tournant. Est-ce ainsi que nous continuerons ?
Les médias tentent de nous faire croire qu'il s'agit d'une nécessité. Grâce à des campagnes qui diabolisent et déshumanisent les Palestiniens, un chœur unifié et monstrueux de commentateurs réussit à nous vendre l'idée que nous pouvons vivre pour l'éternité dans le sang. 'Nous tondrons l'herbe' à Gaza tous les deux ans, nous exécuterons génération après génération de jeunes opposants au régime, nous emprisonnerons des dizaines de milliers de personnes dans des camps de concentration, nous expulserons, nous abattrons, nous exproprierons et, bien sûr, nous tuerons, et c'est ainsi que nous vivrons : dans le pays du sang.
Nous avons déjà tué le peuple palestinien. Nous avons commencé par le massacre de Gaza, et maintenant nous nous tournons vers la Cisjordanie. Là aussi, le sang coulera à flots, si personne n'arrête le bataillon. Le massacre est à la fois physique et émotionnel. Il ne reste plus rien de Gaza.
Les détenus, les orphelins, les traumatisés, les sans-abri ne redeviendront jamais ce qu'ils étaient. Les morts ne le seront certainement pas. Il faudra des générations pour que Gaza se remette, si tant est qu'elle le puisse. Il s'agit d'un génocide, même s'il ne répond pas à la définition légale. Un pays ne peut pas vivre sur une telle idéologie, et certainement pas s'il a l'intention de continuer à le faire.
Supposons que le monde continue de l'autoriser. La question est de savoir si nous, les Israéliens, sommes prêts à l'accepter. Combien de temps pourrons-nous vivre en sachant que notre existence dépend du sang ? Quand nous demanderons-nous s'il n'y a vraiment pas d'alternative à un pays de sang ? Après tout, il n'y a pas d'autre pays comme celui-ci.
Israël n'a jamais sérieusement essayé une autre voie. Il a été programmé et dirigé pour se comporter comme un pays qui vit du sang, et ce encore plus après le 7 octobre. Comme si ce jour terrible, après lequel tout est permis, avait scellé son destin de pays du sang.
Le fait est qu'aucune autre possibilité n'a été évoquée. Mais un pays de sang n'est pas une option, tout comme une voiture alimentée au sang n'est pas une option. Lorsque nous nous en rendrons compte, nous commencerons à chercher des alternatives, ne serait-ce que par manque d'autres options. Elles sont là et attendent d'être testées. Elles peuvent nous surprendre, mais dans la réalité actuelle, il est impossible même de les suggérer.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Toute accusation est un aveu : Israël et le double mensonge des « boucliers humains ».

De nombreux rapports d'organismes de défense des droits de l'homme montrent que les groupes armés palestiniens n'utilisent pas de boucliers humains, mais qu'Israël le fait. Les fausses allégations d'Israël sur les boucliers humains palestiniens ne sont que des tentatives pour justifier son propre ciblage des civil·es.
Tiré de l'Agence Média Palestine
21 septembre 2024
Par Craig Mokhiber
Un Palestinien blessé attaché à l'avant d'un véhicule militaire israélien et l'utilise comme bouclier humain, Jénine, 22 juin 2024. (Photo : Social Media)
La prétendue pratique des « boucliers humains » est l'un des arguments les plus fréquemment déployées dans l'arsenal de la hasbara israélienne.
Depuis des décennies, Israël utilise systématiquement ce ressort de propagande pour justifier ses crimes de guerre, rejeter la responsabilité de ses crimes sur d'autres, contourner le principe de distinction du droit humanitaire, déshumaniser les victimes palestiniennes et armer ses mandataires occidentaux et les médias complices de munitions pour protéger l'impunité israélienne.
Mais une série d'enquêtes internationales révèle deux conclusions claires sur ces accusations :
Premièrement, les groupes armés palestiniens n'utilisent généralement pas de boucliers humains.
Et, deuxièmement, Israël le fait.
Le droit international
L'expression « boucliers humains » désigne une violation particulière du droit international humanitaire et des droits de l'homme. Cette pratique est strictement interdite en toutes circonstances.
Comme le résume le commentaire du CICR, qui fait autorité en la matière, il s'agit du « regroupement intentionnel d'objectifs militaires et de civil·es ou de personnes hors de combat dans l'intention spécifique de tenter d'empêcher que ces objectifs militaires soient pris pour cible ». (« Les personnes hors de combat » comprennent les combattant·es qui ont déposé les armes, les prisonnier·es, les malades et les blessé·es, etc.)
Le cas classique est celui où un groupe de soldat·es force des civil·es de l'autre camp à marcher devant elles et eux dans une zone de combat ou dans une structure non sécurisée, dans l'espoir que l'ennemi ne tirera pas sur les soldat·es de peur d'atteindre les civil·es.
Mais Israël, avec son allégation systématique de « boucliers humains » chaque fois qu'il tue un grand nombre de civil·es et détruit des infrastructures civiles protégées, ne tient pas compte de cette définition. Au lieu de cela, il étend simplement la phrase à tous les décès de civil·es. Sans preuve, les politicien·nes occidentales·aux complices, leurs porte-parole officiel·les et les médias répètent consciencieusement le mantra d'Israël, encore et encore, du bouclier humain.
Pour Israël, les réfugié·es qui vaquent à leurs occupations quotidiennes dans les camps de réfugiés, les patient·es et les médecins dans les hôpitaux, les personnes qui prient dans les églises et les mosquées, et les travailleur·euses humanitaires qui distribuent de la nourriture aux affamé·es sont tous·tes des boucliers humains.
Peu importe qu'elles et ils n'aient pas été contraint·es par le Hamas et qu'elles et ils ne se soient pas porté·es volontaires pour protéger qui que ce soit ni quoi que ce soit. Et peu importe qu'il n'y ait souvent aucun objectif militaire légitime (ou proportionné) dans les situations où Israël invoque les boucliers humains.
Si ces civil·es sont tués par des bombes ou des balles israéliennes, selon le récit israélien, c'est de leur propre faute ou de celle du Hamas, parce qu'elles et ils vivent dans les mêmes endroits densément peuplés.
Mais la simple présence de forces armées ou de membres de l'ennemi dans des zones civiles peuplées ne constitue pas l'utilisation de boucliers humains. Par ailleurs, Israël devrait examiner attentivement les implications de ses propres affirmations, étant donné qu'il maintient son quartier général militaire dans un quartier animé de la ville de Tel-Aviv.
La présence de combattant·es dans un lieu civil protégé ne supprime pas non plus le statut de protection de ce lieu. On peut voir des soldat·es israélien·nes dans tous les hôpitaux israéliens. Cela fait-il de ces hôpitaux une cible militaire légitime ? Bien sûr que non. Refuser la même protection aux Palestinien·nes constitue à la fois une grave violation du droit humanitaire et (que les journalistes occidentales·aux prennent note) un acte de racisme flagrant.
Il va sans dire que ce n'est pas ainsi que fonctionne le concept de bouclier humain dans le droit international.
En prétendant que c'est le cas, Israël et ses mandataires occidentaux ignorent volontairement trois éléments gênants : La logique, les faits et le droit.
La pratique d'Israël de ciblage les civil·es
Tout d'abord, l'acceptation de ces affirmations exige que les mandataires souples d'Israël en Occident ignorent des décennies d'expérience et de nombreux éléments de preuve recueillis selon lesquels Israël ne fait souvent aucune distinction entre les civil·es et les combattant·es dans ses activités militaires et, dans de nombreux autres cas, prend directement pour cible les civil·es et les infrastructures civiles.
Israël attaque régulièrement des hôpitaux, des écoles, des abris et des camps de réfugié·es. Ses tireur·ses d'élite et ses drones traquent et exécutent les civil·es. Ses armes guidées par l'intelligence artificielle, qui portent des noms cruels tels que « Où est papa », sont conçues pour attendre que les cibles soient chez elles avec leur famille avant de les bombarder. Elles abattent même des civil·es brandissant des drapeaux blancs, y compris des enfants et des femmes. Ces pratiques criminelles sont bien connues et bien documentées par les enquêtes successives des Nations unies et des organisations internationales, israéliennes et palestiniennes de défense des droits de l'homme.
Mais la logique même des boucliers humains repose sur l'idée de dissuasion, c'est-à-dire que les soldat·es hésiteront à tirer si des civil·es sont en danger. Une telle logique n'existe pas avec une force militaire comme celle d'Israël qui ne fait pas de distinction entre les civil·es et les combattant·es et qui pratique régulièrement le ciblage direct des civil·es.
En effet,la doctrine israélienne Dahiya, sur la base de laquelle Israël procède depuis longtemps à la destruction massive et intentionnelle de zones civiles afin de terroriser les populations civiles, est la preuve qu'Israël ne peut être dissuadé par l'utilisation de boucliers humains palestiniens ou libanais. La vague actuelle de génocide perpétrée par Israël à Gaza ne laisse aucun doute sur sa volonté de tuer intentionnellement et sans hésitation des civil·es palestinien·nes. La directive Hannibal, en vertu de laquelle Israël tue ses propres citoyen·nes (soldats et civil·es) pour les empêcher d'entraver ses objectifs militaires, signifie qu'il ne sera peut-être même pas dissuadé par l'utilisation d'un bouclier humain composé de ses propres citoyens.
Étant donné que les groupes qui contestent Israël en sont parfaitement conscientes, pourquoi essaieraient-elles d'utiliser une tactique qu'elles savent inutile ? La réponse est qu'elles ne le font pas. Ainsi, l'accusation de boucliers humains ne résiste pas à l'épreuve de la logique.
Mais elle échoue également au test de la loi. Tout d'abord, les situations dans lesquelles Israël prétend que des boucliers humains sont utilisés ne peuvent pas être considérées comme des cas de boucliers humains selon la définition juridique internationale décrite ci-dessus. En clair, et comme cette définition l'indique clairement, la simple présence de combattant·es à proximité ne transforme pas magiquement les civil·es en boucliers humains.
Par conséquent, l'accusation d'Israël concernant les boucliers humains n'a généralement aucun fondement juridique.
Deuxièmement, Israël allègue l'existence de boucliers humains pour tenter de retirer la responsabilité de ses forces et de les exonérer de toute responsabilité juridique. Mais ce qui leur échappe, c'est que même si des boucliers humains étaient utilisés, cela ne réduirait pas les obligations légales des attaquant·es.
En fait, les allégations d'utilisation de boucliers humains ne justifient pas une attaque contre des civil·es sans les contraintes imposées par le droit international humanitaire et le droit international des droits de l'homme, et l'attaquant reste responsable, même si l'utilisateur des boucliers humains l'est également.
L'attaquant doit toujours respecter les principes de précaution, de distinction et de proportionnalité pour éviter de blesser des non-combattant·es. En d'autres termes, la déclaration de boucliers humains n'est pas une excuse applicable en vertu du droit international.
Par conséquent, en droit, même en présence de boucliers humains, la tentative de rejeter la faute sur le tireur et de l'exonérer de toute responsabilité échoue.
Les Palestinien·nes n'utilisent pas de « boucliers humains », mais Israël le fait
Et puis il y a l'épineux problème des faits.
Israël n'a produit, lors de ses attaques récentes et en cours contre Gaza, aucune preuve crédible de l'utilisation de boucliers humains par les palestinien·nes. Il s'appuie au contraire sur la répétition par cœur et sans esprit critique de cette accusation par ses soutiens et mandataires occidentales·aux et par les sociétés de médias favorables à Israël.
Cela ne veut pas dire qu'aucun·e combattant·e palestinien·ne n'a jamais utilisé de boucliers humains dans l'histoire. Mais l'accusation selon laquelle elles et ils le font régulièrement ou systématiquement est une accusation sans preuve, et une accusation régulièrement brandie non pas pour demander des comptes aux contrevenant·es, mais plutôt pour justifier la perpétration de crimes de guerre israéliens.
Dans le même temps, nous avons tous vu les vidéosde soldat·es israélien·nes utilisant des Palestinien·nes comme boucliers humains à Gaza (et en Cisjordanie). Nous avons vu de nos propres yeux des images de Palestinien·nes (souvent des enfants) attaché·es au capot de jeeps militaires israéliennes, forcé·es de marcher devant une colonne de soldat·es israélien·nes ou de conduire les soldat·es dans des bâtiments ou d'autres structures. Cette pratique est aussi ancienne que l'État d'Israël lui-même.
Lors de chaque attaque israélienne successive contre des communautés palestiniennes, le schéma est le même : Israël accuse les Palestinien·nes d'utiliser des boucliers humains, les organisations internationales et les groupes de défense des droits de l'homme enquêtent, et les enquêtes révèlent que la partie qui utilise systématiquement des boucliers humains n'est pas la Palestine, mais Israël.
En effet, le groupe israélien de défense des droits de l'homme B'Tselem a documentél'utilisation répétée par Israël de boucliers humains au moins depuis 1967. Les enquêtes menées par Amnesty International et Human Rights Watch sur les attaques menées par Israël dans le cadre de l'opération « Plomb durci » à Gaza ont montré qu'Israël avait utilisé des boucliers humains (y compris des enfants), mais n'ont trouvé aucune preuve que des groupes palestiniens l'avaient fait.
De même, les commissions d'enquête des Nations unies qui ont enquêté sur les attaques israéliennes massives contre Gaza en 2008-2009 et en 2014 ont examiné les affirmations d'Israël et n'ont trouvé aucune preuve de l'utilisation de boucliers humains par les Palestiniens. Le Comité des droits de l'enfant des Nations unies a constaté « l'utilisation continue (par Israël) d'enfants palestinien·nes comme boucliers humains » entre 2010 et 2013. Le rapporteur spécial des Nations unies sur le terrorisme a fait le même constat.
L'enquête d'Amnesty International sur les attaques israéliennes « Plomb durci » fait état d'une constatation typique : « Dans plusieurs cas, les soldat·es israélien·nes ont également utilisé des enfants palestinien·nes comme boucliers humains ». Cependant, contrairement aux allégations répétées des responsables israéliens concernant l'utilisation de « boucliers humains », Amnesty International n'a trouvé aucune preuve que le Hamas ou d'autres combattant·es palestinien·nes aient agi de la sorte.
Et dans le rapport sur les « meurtres sous drapeau blanc » de civils palestiniens, Human Rights Watch a confirmé qu'« Israël affirme que le Hamas a combattu à partir de zones peuplées et a utilisé des civils comme “boucliers humains” — c'est-à-dire qu'il a délibérément utilisé des civils pour dissuader les attaques contre les forces palestiniennes… Human Rights Watch n'a trouvé aucune preuve que les victimes civiles (dans son enquête) ont été utilisées par les combattant·es palestinien·nes comme boucliers humains ».
Mais la pratique israélienne de l'utilisation de boucliers humains est de notoriété publique en Israël et fait depuis longtemps l'objet d'un débat public. Des soldat·es israélien·nes, s'adressant à l'organisation israélienne Breaking the Silence, ont eux-mêmes avouécette pratique répandue. Les médias israéliens en ont fait état, notamment dans un article paru le mois dernier dans Haaretz. L'armée israélienne a même défendu publiquement son « droit » à utiliser des boucliers humains dans des procès israéliens successifs. Bien entendu, les cas où elle a perdu son argumentaire n'ont eu que peu d'impact sur l'armée, qui continue la pratique jusqu'à aujourd'hui.
Ainsi, les tactiques de désinformation de la hasbara israélienne ont constitué un pilier important de sa stratégie de destruction de Gaza depuis le début de la vague actuelle de génocide à Gaza, il y a près d'un an. Les fausses accusations de bouclier humain ont été la clé de ces tactiques.
Mais cette tromperie s'effondre même après un examen superficiel. Si les politicien·nes et les journalistes occidentales·aux faisaient preuve d'un minimum de diligence avant de répéter les affirmations israéliennes, si elles et ils les soumettaient aux tests du droit, des faits et de la logique, la vérité serait rapidement révélée. La partie qui utilise régulièrement des boucliers humains est Israël, pas la Palestine.
Un adage veut que dans le discours public sur la Palestine, « chaque accusation israélienne est un aveu ». Le double mensonge des boucliers humains en est un exemple.
Craig Mokhiber est un avocat international spécialisé dans les droits de l'homme et un ancien haut fonctionnaire des Nations unies. Il a quitté l'ONU en octobre 2023, après avoir rédigé une lettre ouverte mettant en garde contre un génocide à Gaza, critiquant la réaction internationale et appelant à une nouvelle approche de la Palestine et d'Israël fondée sur l'égalité, les droits de l'homme et le droit international.
Traduction : JB pour l'Agence Média Palestine
Source : Mondoweiss
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Assemblée générale des Nations unies 2024 : Israël fait fi des efforts de paix alors que les alliés et les dirigeants mondiaux exigent des cessez-le-feu

La guerre d'Israël contre Gaza et l'escalade de la violence au Liban n'ont pas réussi à faire bouger les choses. Lors de la 79e Assemblée générale des Nations unies, qui se tient au siège de l'ONU à New York, les dirigeants du monde entier ont continué à lancer des appels passionnés en faveur de l'arrêt de la guerre d'Israël contre Gaza et de l'escalade de la violence au Liban.
Tiré de France Palestine Solidarité. Photo : Mahmoud Abbas, président de l'Etat de Palestine, prend la parole à la 79ème session de l'Assemblée générale des Nations unies © UN Photo/Loey Felipe.
Le dirigeant palestinien Mahmoud Abbas est monté sur scène avec une annonce pleine de défi.
« Nous ne partirons pas. Nous ne partirons pas. Nous ne partirons pas. La Palestine est notre patrie. C'est la terre de nos pères, de nos grands-pères. Elle restera la nôtre et si quelqu'un devait la quitter, ce serait les usurpateurs qui l'occupent », a déclaré M. Abbas.
Le dirigeant palestinien a interpellé les personnes présentes dans la salle sur ce qu'il a appelé les « mensonges » d'Israël devant le Congrès américain quelques mois auparavant, en leur demandant qui était responsable de la mort de 15 000 enfants palestiniens, si ce n'est Israël.
Il a déploré la centaine de familles qui ont été complètement éliminées de Gaza, la propagation de la famine et des maladies, les dizaines de milliers de morts et les dommages incalculables causés à l'enclave assiégée.
« Arrêtez ce crime. Arrêtez maintenant. Arrêtez de tuer des enfants et des femmes. Arrêtez le génocide. Arrêtez d'envoyer des armes à Israël. Cette folie ne peut plus durer. Le monde entier est responsable de ce qui arrive à notre peuple à Gaza et en Cisjordanie ».
Mais les appels répétés des nations occidentales et des plus proches alliés d'Israël sont restés lettre morte.
Plus tôt dans la journée de mercredi, le président français Emmanuel Macron s'est lui aussi longuement exprimé sur Gaza. Décriant les pertes dévastatrices de plus de 41 000 Palestiniens, il les a qualifiées d'« outrage à l'humanité tout entière ».
Le président, qui avait appelé à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU plus tard dans la journée pour faire face à l'escalade de la crise au Liban et s'assurer qu'une « voix diplomatique » soit entendue, a souligné qu'il s'agissait d'un appel urgent pour éviter une conflagration régionale.
« Israël ne peut pas, sans conséquence, étendre ses opérations au Liban. La France exige que chacun respecte ses obligations le long de la ligne bleue ».
Pousser à la paix
Des réunions entre les États-Unis et l'administration Biden ont débouché mercredi sur une initiative franco-américaine en faveur d'une trêve de 21 jours entre Israël et le Hezbollah, mais cette initiative a été catégoriquement rejetée jeudi par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.
Haaretz a rapporté jeudi que M. Netanyahou s'était d'abord engagé verbalement auprès des États-Unis, mais qu'il était revenu sur sa décision après avoir essuyé des critiques de la part de certaines factions de sa coalition gouvernementale.
L'Assemblée générale des Nations unies se tient cette semaine à la suite de frappes aériennes meurtrières menées par Israël le long de la frontière sud du Liban et dans plusieurs banlieues de Beyrouth, ainsi que du déploiement récent de brigades supplémentaires de l'armée à la frontière nord.
Les frappes aériennes israéliennes sur le Liban ont déjà tué plus de 600 personnes.
La demande de trêve a reçu le soutien de plusieurs pays, dont les États-Unis, l'Australie, le Canada, l'Union européenne et plusieurs pays du Moyen-Orient, appelant en outre au « soutien immédiat des gouvernements d'Israël et du Liban ».
Le président français Macron a averti que la poursuite de l'agression israélienne pourrait engendrer « une source dangereuse de haine et de ressentiment, mettant en péril la sécurité de tous, y compris celle d'Israël ».
« La France veillera à ce que tout puisse être fait pour que le peuple palestinien puisse enfin avoir un État. Aux côtés d'Israël », a ajouté M. Macron.
Plusieurs groupes ont organisé des manifestations devant le siège de l'ONU jeudi, bien que le discours du premier ministre israélien ait été reporté à vendredi. La presse israélienne rapporte à présent que le voyage aux États-Unis du dirigeant contesté pourrait être purement et simplement annulé.
La position de l'Europe
L'atmosphère de l'assemblée générale est restée tendue, les dirigeants soulignant le besoin critique de solidarité et de mesures unifiées comme seul moyen de rétablir la paix.
S'exprimant au nom de l'Union européenne, Charles Michel, le président du Conseil européen, a également exhorté Israël à œuvrer en faveur d'une solution pacifique à ce qui ressemble désormais à une guerre sur deux fronts, Gaza et le Liban.
« Je dis ceci au gouvernement d'Israël : il est impossible d'essayer d'obtenir la sécurité sans la paix. Sans paix, il ne peut y avoir de sécurité durable. Un monde animé par la vengeance est un monde moins sûr ».
M. Michel a déclaré que « la sécurité de tous les Juifs » serait compromise si les Palestiniens n'avaient pas leur propre État et que cela conduirait également à « l'affaiblissement du système international qui ne peut être soutenu par une politique de deux poids, deux mesures ».
Au cours des onze derniers mois, les États-Unis, Israël et l'Occident en général ont été accusés par le reste du monde de n'appliquer le droit international que lorsque cela les arrangeait.
Dans un discours qui a duré plus de 15 minutes, le président espagnol Pedro Sanchez a réaffirmé l'attachement de son pays aux valeurs internationales, aux principes du droit international et à une gestion responsable sur la scène mondiale.
M. Sanchez a souligné la foi inébranlable de l'Espagne dans l'obligation de rendre des comptes et dans la lutte sans relâche contre l'impunité, en insistant sur le rôle essentiel que jouent des institutions telles que la Cour internationale de justice (CIJ) et la Cour pénale internationale (CPI) dans l'exercice de la justice et la réparation des préjudices subis par les victimes.
La CIJ examine actuellement une affaire présentée par l'Afrique du Sud accusant Israël de génocide, et le procureur général de la CPI, Karim Khan, a demandé des mandats d'arrêt contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le ministre de la défense Yoav Gallant.
Les deux institutions ont été critiquées et menacées par Israël et les États-Unis.
M. Sanchez a ensuite insisté sur la nécessité d'une réponse collective à l'escalade de la violence au Moyen-Orient. La position de l'Espagne sur la guerre de Gaza, a-t-il déclaré, « est restée la même depuis octobre » 2023 et s'aligne sur ses propres principes. « L'Espagne défend la paix, les droits de l'homme et un ordre international fondé sur des règles.
Plus loin dans son discours, M. Sanchez a souligné la nécessité impérieuse de s'attaquer aux causes profondes du conflit israélo-palestinien, déclarant qu'il était « largement temps » de mettre en œuvre une solution à deux États et soulignant que la paix et la sécurité ne pouvaient être obtenues que par le dialogue et le respect du droit international.
La paix et la démocratie dans le monde, comme l'a noté le président, sont soumises à de fortes pressions. « Ce même système multilatéral est celui que le monde a construit, brique par brique, sur les cendres de la barbarie », a-t-il averti.
La réaffirmation de la reconnaissance de la Palestine par l'Espagne, en mai dernier, a constitué un moment clé de son discours.
Le président a déclaré que cette décision reflétait le soutien massif du peuple espagnol. « Cette reconnaissance vise uniquement à promouvoir la paix dans la région », a-t-il affirmé.
Jeudi, le dirigeant palestinien Abbas s'est fait l'écho du statut de membre de l'ONU de la Palestine en demandant : « Que nous manque-t-il pour être assis parmi vous ? Que nous manque-t-il pour être sur un pied d'égalité avec les 194 États membres officiels de l'ONU ? »
M. Abbas a plaidé pour que la résolution récemment adoptée à une écrasante majorité sur l'occupation des territoires palestiniens par Israël ne soit pas vaine.
« Sur les 1000 résolutions prises sur le peuple palestinien depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui, pas une seule n'a encore été mise en œuvre ».
Traduction : AFPS
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Une base de données complète sur les résolutions de l’ONU relatives aux sanctions et aux embargos

L'ONG de défense des droits de l'homme Law for Palestine (L4P) lance ce 24 septembre une base de données qui recense l'entièreté des résolutions décisives de l'ONU de sanctions et d'embargos pris contre les États qui violent les normes juridiques internationales.
L'initiative vise à fournir aux États, aux organisations de la société civile et aux chercheur·ses un vaste registre, allant de 1948 à nos jours, permettant de considérer l'éventail d'actions possibles et pouvant servir de référence pour traiter les violations d'Israël.
« Cette base de données met en lumière à la fois les pratiques internationales antérieures et la responsabilité actuelle de mettre fin à cette situation illégale, notamment par l'imposition d'embargos sur les armes et de sanctions », a déclaré Anisha Patel, membre du conseil d'administration de Law for Palestine. « En présentant les résolutions adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies, y compris la plus récente, le 17 septembre 2024, nous souhaitons soutenir les efforts de responsabilisation et faire pression pour que des mesures efficaces soient prises contre les violations du droit international. »
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Liban, Gaza et Jordanie : les mouvements de colons affichent leurs projets

La colonisation de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est occupée est un processus en cours depuis 57 ans. Au cours des dernières années et encore plus au cours des derniers mois, le nombre de colons implantés dans ces territoires a connu une augmentation exponentielle.
Tiré de France Palestine Solidarité. Les auteurs sont de Middle east eye.
Il y a désormais 600 à 800 000 colons dans le Territoire Palestinien Occupé, dont au moins 200 000 dans les quartiers et les extérieurs de Jérusalem-Est occupée. La guerre génocidaire menée contre le peuple palestinien dans la Bande de Gaza a permis à une multitude de leaders politiques israéliens d'officialiser leurs projets de recolonisation de Gaza. Ce même contexte a vu surgir des mouvements de colons appelant à l'occupation et à la colonisation du Sud-Liban et de la Jordanie.
Bande de Gaza
A Gaza, les appels à la colonisation constituent un élément clé de la guerre génocidaire. Les troupes israéliennes mettent constamment en avant la symbolique coloniale et les références aux colonies de Gush Katif, un ensemble d'implantations coloniales israéliennes dans le sud de l'enclave gazaouie, démantelées en 2005 par le gouvernement israélien.
Ces dizaines de soldats israéliens ne sont pas esseulés. Ils bénéficient du soutien et de la mobilisation de pans entiers de la classe politique israélienne. Les soutiens à la recolonisation de Gaza s'expriment des mouvements de colons jusqu'au conseil des ministres israélien, en passant par une grande partie des partis politiques de droite et de dizaines de députés du parlement israélien. Au début de l'année 2024, le ministre de la Sécurité Intérieure a déclaré :
« Ils m'ont dit : nous retournerons à Gush Katif. et je leur ai retorqué : pas seulement à Gush Katif, nous coloniserons dans tout Gaza. »Quelques semaines plus tard, les organisations de colons et les partis de l'extrême droite ont organisé, à Jérusalem, la "Conférence pour la victoire d'Israël - La colonisation apporte la sécurité : Retour dans la bande de Gaza et le nord de la Samarie".
Ces mêmes projets politiques ont pu être exprimées au cours de la « Marche pour Gaza », organisée en mai 2024.

Au cours de cette manifestation, le Député du Likoud, Amit Halevi, a déclaré que la voie privilégiée devait être la réoccupation et la recolonisation intégrale de Gaza. « Plus seulement Gush Katif, mais plutôt 3,4,5 grandes villes comme Ashkelon qui devront être bâties sur la route jusqu'à Rafah ».

Sud du Liban
En parallèle de la guerre génocidaire menée à Gaza, les mouvements de colons se font de plus en plus pressants quant à la colonisation du Sud du LibanEn décembre 2023, un journal sioniste religieux israélien avait annoncé la création future de cinq colonies qui seraient implantées dans « les nouvelles frontières nord d'Israël » qui correspond au territoire du Sud du Liban.Quatre mois plus tard, un mouvement appelant à la colonisation du Liban est officiellement né, le « Mouvement pour la Colonisation du Sud du Liban ».

Enfin à la fin du mois de septembre 2024, le mouvement a publié un projet de carte des colonies israéliennes au sud du Liban. Ce projet montre l'étendue territoriale de cette entreprise coloniale et met en lumière sa volonté de remplacement puisque les noms des colonies sur la carte, sont simplement des versions traduites en hébreu des noms des villes et villages libanais où s'implanteraient les potentielles futures colonies.

Jordanie
Contrairement à Gaza ou au sud du Liban, les volontés d'expansion coloniales en Jordanie n'ont que très rarement été publiquement affichées par les mouvements de colons. Mais l'été 2024 a marqué un tournant. L'inexorable avancée du processus de colonisation de la Cisjordanie occupée, et plus particulièrement de la Vallée du Jourdain, a légitimé et rendu possible les velléités expansionnistes des leaders colons dans la région.Depuis le mois d'août 2024, des affiches ont été placardées dans la Vallée du Jourdain et des distributions de tracts ont eu lieu dans les colonies de la région. Dans quel but ? Appeler à coloniser la « East Bank » la vallée orientale du Jourdain, en d'autres termes la Jordanie.

Sources : Younis Tirawi / Oren Ziv / Middle East Eye / Breaking The Silence / B.M. / Quds News NetworkPhoto : Younis Tirawi
Compilation de photographies de soldats israéliens posant fièrement avec les drapeaux du Gush Katif et affichant des banderoles appelant à la recolonisation de Gaza.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La Chine change de stratégie pour relancer sa croissance

La banque centrale chinoise a annoncé une série de mesures monétaires de grande ampleur pour soutenir le crédit, le secteur immobilier et les marchés financiers. Le signe d'une forme de panique de Pékin face à l'affaiblissement de la croissance et à l'épuisement de son modèle économique.
Tiré d'Europe solidaire sans frontière.
Trois ans après la faillite du plus grand promoteur immobilier chinois Evergrande, Pékin sort le « bazooka » monétaire pour tenter de stopper l'affaiblissement continu de son économie. Mardi 24 septembre 2024, la Banque populaire de Chine (BPC), la banque centrale du pays, a annoncé une série de mesures de soutien massif à l'économie dans une mise en scène particulièrement rare.
Le gouverneur de la BPC, Pan Gongsheng, a convoqué une conférence de presse inopinée pour dérouler son plan. D'abord, une baisse du taux de refinancement à sept jours des banques, l'équivalent du taux directeur chinois, de 1,7 % à 1,5 %. Cette mesure devrait conduire à un recul des taux à moyen et long terme.
En parallèle, et pour la première fois, la BPC a doublé cette baisse des taux par une baisse des réserves obligatoires des banques de 1 000 milliards de yuans (environ 128 milliards d'euros) et par une baisse du taux de crédit immobilier pour les crédits en cours. Cette dernière mesure devrait, selon Pan Gongsheng, soutenir les revenus de 150 millions de personnes à hauteur de 150 milliards de yuans (environ 19,1 milliards d'euros).
Le plan de la BPC inclut également le soutien direct aux rachats des terrains des sociétés d'immobilier en difficulté par le secteur privé, venant compléter les 300 milliards de yuans (environ 38,2 milliards d'euros) accordés en mai aux autorités locales pour racheter les logements non vendus. Les mesures prises en 2021 par le gouvernement central pour freiner la spéculation immobilière, notamment la surcharge sur les rachats de résidences secondaires, sont abolies.
Enfin, la BPC a annoncé qu'elle mettait en place un programme de liquidité de 500 milliards de yuans, soit environ 63,8 milliards d'euros, pour les acteurs des marchés financiers chinois, compagnies d'assurance, fonds de gestion, courtiers. Ces acteurs pourront venir piocher dans cette facilité en plaçant des actions en garantie.
Pan Gongsheng a d'ores et déjà promis que, si cette mesure était un succès, 500 milliards de yuans supplémentaires pourraient être débloqués. Et pour faire bonne mesure, les autorités chinoises ont annoncé discuter d'un « fonds de stabilisation » pour « soutenir le marché financier ». En tout, ce serait là encore 1 000 milliards de yuans qui seraient injectés dans le système financier chinois.
L'ampleur de la crise chinoise
Toutes ces mesures ont logiquement réjoui les opérateurs boursiers chinois et, plus largement, asiatiques. L'indice CSI de Shanghai a bondi de 4,3 %, par exemple. Mais l'ampleur de l'annonce, que ce soit en termes de fonds injectés comme en termes de diversité des mesures, semble surtout montrer qu'une forme de panique s'est emparée des autorités de Pékin.
Depuis trois ans, la crise immobilière pèse lourdement sur la croissance chinoise. Avec la fuite en avant du pays dans la spéculation immobilière, qui s'est accélérée en 2015-2016 lorsqu'il a dû prendre des mesures contre la surproduction industrielle, construction et immobilier ont représenté jusqu'à 30 % du PIB chinois.
La faillite d'Evergrande à l'automne 2021 s'est propagée aux autres grands promoteurs ayant le même modèle économique (payer les constructions en cours avec les paiements des constructions futures) a logiquement donné un coup d'arrêt aux programmes immobiliers. Beaucoup d'acheteurs se sont retrouvés sans fonds et sans logements, conduisant à une baisse des ventes, soit faute de moyens, soit par précaution. Les prix se sont alors effondrés, conduisant à de nouvelles faillites qui ont fini par peser sur le secteur de la construction.

Pendant longtemps, Pékin a pris des mesures de stabilisation minimales et les autorités se sont toujours refusées à reconnaître le sérieux de la situation. L'effet négatif sur les revenus et la confiance des ménages s'est diffusé et a commencé à peser sur la demande intérieure. La baisse des prix a alors commencé à se généraliser. En 2023, le déflateur du PIB, c'est-à-dire l'évolution des prix s'appliquant à l'ensemble de l'économie, a reculé de 0,5 %. Cette amorce de déflation a pesé sur la rentabilité du secteur privé chinois, ce qui a conduit à une demande encore plus faible.
Pour contrer le phénomène, les autorités de Pékin ont répondu en accélérant les investissements dans les technologies de pointe et en relançant le moteur des exportations. La Chine a cherché à tirer profit de ses tensions internes en exportant sa surcapacité à des coûts très bas. La stratégie a partiellement fonctionné : les exportations chinoises ont, selon le Fonds monétaire international (FMI), gagné, en 2023, 1,5 point de part de marché par rapport à la période 2017-2019.
L'ennui, c'est que ces gains de part de marché affaiblissent la demande des autres économies, par exemple l'Allemagne en Europe, sans régler les problèmes internes, puisqu'ils se font à des prix bas. En parallèle, les investissements massifs dans les technologies de pointe peinent à produire des effets macroéconomiques concrets : ce secteur ne peut pas être un moteur de l'activité globale.
L'affaiblissement de la croissance
Résultat : la croissance n'a cessé de s'affaiblir. Au deuxième trimestre 2024, le PIB chinois a progressé de 4,7 % sur un an, bien en deçà des attentes des économistes à 5,1 %. Ce niveau met en doute l'objectif gouvernemental de 5 % pour l'ensemble de l'année. La croissance est très fortement portée par les investissements publics dans les transports et les infrastructures, mais l'investissement privé, lui, est pratiquement stagnant.
La situation n'est pas tenable en l'état. La croissance repose sur la construction publique de capacités déjà excédentaires dans les infrastructures et l'industrie. L'effet d'entraînement de ces mesures est quasiment inexistant : elles permettent tout juste de maintenir une forme de statu quo qui, dans le contexte chinois, signifie une croissance de 5 %. Le chiffre du deuxième trimestre vient même prouver que cette stabilisation n'est pas acquise. Certains économistes prédisent une croissance qui n'excédera pas 4 % cette année.

Un tel décrochage est inadmissible pour le pouvoir central chinois, dont l'objectif est de rejoindre les puissances occidentales en termes de PIB par habitant. Aujourd'hui, ce ratio en parité de pouvoir d'achat représente, en Chine, 30 % de celui des États-Unis. Pékin ne peut donc espérer rattraper son retard avec une croissance de 4 %, supérieure de 1,5 point à celle des États-Unis. Autrement dit : pour sortir du « piège du revenu moyen » que Xi Jinping redoute depuis son arrivée au pouvoir, il faut maintenir un taux de croissance élevé.
L'objectif semble de moins en moins tenable. Ce même Xi Jinping a dû même implicitement reconnaître ce fait le 12 septembre dans un symposium à Lanzhou. Il n'y a pas évoqué l'objectif des 5 %, mais a indiqué que la Chine devait « aspirer à remplir les objectifs et les tâches de développement économique et social pour l'année ». Ce changement sémantique subtil a beaucoup inquiété les observateurs. Il traduisait sans doute une forme de panique.

Le risque est que la spirale déflationniste s'accélère et que l'ensemble du secteur privé chinois tombe en récession. Les remontées du terrain sont fort inquiétantes. Ainsi, le quotidien de Hong Kong South China Morning Post relate, mardi 24 septembre, la situation critique du secteur de la distribution chinoise d'automobiles. Le secteur est pris dans une logique de demande faible, de baisses agressives de prix et de surstockage. 138 milliards de yuans (environ 18 milliards d'euros) seraient déjà perdus par les entreprises.
Pour l'instant, la demande publique permet de réduire les effets sur l'emploi, mais le chômage des jeunes ne cesse d'augmenter. Malgré un changement de mode de calcul destiné à réduire le taux de chômage des 16-24 ans, celui-ci a bondi en août à 17,4 %, contre 13,2 % en juin. Plus la déflation sera forte, plus le maintien de l'emploi sera difficile. Or, ici, l'enjeu devient politique : le Parti communiste chinois s'appuie sur une promesse de prospérité et d'emploi qui semble de plus en plus difficile à tenir.
Panne de modèle économique
C'est dans ce contexte que Pékin a décidé de changer de stratégie et de reconnaître le caractère sérieux de la situation. Les mesures annoncées par la BPC visent à soutenir le secteur privé et à mettre fin aux difficultés du secteur immobilier. L'ambition principale est de créer un « choc de confiance » qui permette aux entreprises et aux consommateurs de reprendre leurs dépenses et de les financer par l'accès au crédit.
Sur le papier, ce réveil peut paraître bienvenu. Mais la réussite de la nouvelle stratégie chinoise reste très incertaine. Le problème de la Chine est plus structurel que conjoncturel, c'est un problème de modèle économique. La Chine reste plus que jamais l'atelier d'un monde en surproduction industrielle et son rythme de croissance dépend de la dépense publique, qui elle-même repose sur le succès des exportations.
Mais, pour maintenir son rythme d'accumulation du capital, les succès à l'export ne suffisent pas. La solution n'est-elle pas alors de soutenir la consommation des ménages en augmentant les salaires ? En réalité, cette option, qui a longtemps été un objectif, est difficilement réalisable pour le capitalisme chinois.
Les gains de productivité du pays sont trop faibles pour basculer vers un régime dominé par la consommation des ménages. La hausse de la consommation pourrait certes temporairement venir éponger la surcapacité industrielle, mais elle menacerait la compétitivité externe du pays, qui repose encore largement sur les coûts et conduirait à ajuster la dépense publique. En définitive, la croissance s'affaiblirait. C'est un phénomène bien connu en Occident dans les années 1970 : l'aboutissement du développement de la consommation de masse a été la désindustrialisation et l'affaiblissement du régime de croissance.
Pour sortir de cette contradiction, la Chine a déjà essayé la bulle immobilière, ce qui a encore aggravé la situation. L'idée de Xi Jinping de « développer les nouvelles forces productives », c'est-à-dire de faire de la Chine le centre des nouvelles technologies, a connu de beaux succès, mais il est illusoire de penser que ce secteur puisse se substituer aux secteurs traditionnels pour fournir des emplois et des revenus à la masse de la population. Le risque, là aussi, est de se retrouver face à une bulle.
L'annonce de Pan Gongsheng laisse presque penser que la BPC espère développer un régime de croissance fondé sur la financiarisation et le crédit. Mais là encore, faute de perspectives concrètes, la seule possibilité est celle d'une bulle financière qui, comme la bulle immobilière, viendra, in fine, rajouter une crise à la crise.
On compare souvent la situation actuelle de la Chine à celle du Japon des années 1990. La comparaison est en partie valable et conduit à douter du succès du « bazooka » monétaire. Au Japon, l'assouplissement monétaire n'a pas mis fin à la déflation, bien au contraire, précisément parce que les salaires étaient sous la pression de compétitivité externe.
Mais la crise chinoise est encore plus complexe, dans la mesure où la Chine n'a pas achevé son développement capitaliste et se retrouve face à des impasses qui sont celles des pays occidentaux avancés, comme la surcapacité industrielle, l'épuisement de la financiarisation et les limites de la croissance technologique.
La Chine avait réussi à déjouer toutes les crises depuis sa transition vers le capitalisme dans les années 1980. Elle avait évité le sort des pays de l'ex-URSS, n'avait pas été emportée par les crises de 2001 et 2008. Mais depuis une dizaine d'années, elle est rattrapée par la crise du capitalisme global, dont elle est devenue un maillon essentiel.
La vitesse de son développement a donc un revers : celui d'arriver plus rapidement, et bien trop tôt au goût de ses dirigeants, dans l'impasse où se trouvent les pays avancés. Le besoin continuel de croissance du capital s'oppose, en Chine comme ailleurs, aux conditions de sa réalisation. Il ne reste alors plus que la fuite en avant, pratiquée ici comme ailleurs.
Romaric Godin
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Northvolt annonce de nouvelles réductions, inquiétant les investisseurs

Présentation Northvolt, cette petite multinationale suédoise qui ne possède qu'une seule usine en production, cherche à devenir le fer de lance de la filière batterie de l'Union européenne tout en s'insérant en même temps dans celle nord-américaine par l'intermédiaire du Canada-Québec prêt à risquer des sommes faramineuses pour la soutenir. Le ralentissement inattendu du marché des véhicules électriques sur fond de compétition avec la Chine plus avancée technologiquement dans ce domaine, produisant à meilleur marché et dominant de loin le marché mondial met en évidence l'enflure de la stratégie de l'entreprise cherchant en même temps à construire la partie manufacturière de la filière de haut en bas (de la cathode au recyclage) et de s'implanter sur deux marchés majeurs. Il serait tout à fait logique pour l'entreprise de lâcher le morceau nord-américain si la pression des grands financiers mondiaux devenait trop forte.
Marc Bonhomme, 29/09/24.
Traduction : Marc Bonhomme
26 septembre 2024 | tiré de The Economist
Source : https://www.economist.com/business/2024/09/26/northvolt-announces-more-cuts-worrying-investors?etear=nl_business_7&utm_id=1928018
Northvolt avait tous les atouts d'un champion industriel. Les capitaux avaient afflué de titans de Wall Street tels que Goldman Sachs et BlackRock. Plusieurs gouvernements avaient béni ses projets en lui accordant de généreuses subventions et de gros clients s'étaient portés garants de sa technologie. Mais le 23 septembre, le fabricant suédois de batteries, âgé de sept ans, a annoncé qu'il suspendait les travaux dans l'une de ses nouvelles usines, qu'il ralentissait l'expansion de son unité de recherche et de développement et qu'il licenciait un cinquième de sa main-d'œuvre. Il s'agit de la deuxième série de réductions en un mois.
Peter Carlsson, le patron de Northvolt, a mis en cause "les vents contraires du marché de l'automobile et le climat industriel général". Les constructeurs automobiles, y compris Volkswagen, le plus grand investisseur de Northvolt, se sont heurtés à l'économie des véhicules électriques (VE), certains affichant des pertes dans leurs divisions électriques. La demande de véhicules électriques s'est ralentie, ce qui a entraîné une baisse de la demande de cellules qui les alimentent. Même les grands fabricants de batteries, comme le sud-coréen SKOn et LG Energy Solution, sont confrontés à des marges de plus en plus faibles. Northvolt a perdu 1,2 milliard de dollars US l'année dernière, soit quatre fois plus qu'en 2022.
Pourtant, le plus gros problème de Northvolt est auto-infligé. Alors que son financement cumulé sous forme de dette, d'actions et de subventions atteignait 15 milliards de dollars US l'année dernière, l'entreprise a multiplié les paris technologiques. Elle a développé une nouvelle batterie sodium-ion, investi dans des batteries à base de bois avec Stora Enso, une société papetière, et soutenu des batteries pour l'aviation par l'intermédiaire de Cuberg, une startup qu'elle a rachetée en 2021.
Elle a agrandi son centre de R&D et s'est lancée dans l'intelligence artificielle - en vogue auprès des investisseurs - en mettant en place une nouvelle équipe chargée des logiciels. Elle a soutenu Liminal, une startup spécialisée dans l'analyse des batteries, et s'est engagée dans des coentreprises telles qu'un centre de R&D avec Volvo Cars et une raffinerie de lithium portugaise. En raison de ces dépenses, 2023 a été son "année d'investissement la plus importante", a déclaré Northvolt, avec un investissement moyen de 200 à 300 millions de dollars par mois. L'objectif de Northvolt est de devenir rapidement un géant européen de la batterie intégré verticalement.
Avec des sites de production à forte intensité de capital au Canada, en Allemagne, en Pologne et en Suède, Northvolt espère disposer d'une capacité de production de cellules de plus de 150 gigawattheures (gwh) d'ici 2030, soit dix fois sa capacité actuelle. (Les sceptiques ont fait remarquer que si les 15 milliards de dollars de financement de Northvolt étaient allés aux fabricants de batteries en place, tels que les entreprises sud- coréennes possédant des usines en Europe, ils auraient pu presque doubler la capacité de fabrication de batteries de l'Europe, pour atteindre plus de 300 gwh).
Au lieu de cela, la jeune entreprise a été détournée de son objectif principal : produire des batteries pour les véhicules électriques dans les délais impartis. Le 20 juin, le constructeur automobile allemand BMW a annulé une commande de 2,1 milliards de dollars à Northvolt en raison des retards. Rien de tout cela ne devrait surprendre M. Carlsson : le rapport annuel de Northvolt fait état d'un risque de "dépassement du plan en raison de multiples projets d'expansion". Ces problèmes nuisent aux efforts déployés par l'Europe pour soutenir une industrie d'importance stratégique sur le continent.
Le contrôle des opérations tentaculaires de Northvolt permettra de réduire la consommation de liquidités, mais les investisseurs et les créanciers commencent à s'inquiéter. Northvolt compte des banques américaines comme JPMorgan Chase parmi les 25 prêteurs qui lui ont accordé un prêt de 5 milliards de dollars en janvier. Les créanciers devraient se réunir le 27 septembre pour décider si l'entreprise peut utiliser ce prêt. Ces derniers jours, certains prêteurs ont fait appel à des conseillers pour évaluer les options qui s'offrent à eux si la pénurie de liquidités s'aggrave. Pour éviter une grave crise de confiance, M. Carlsson devra commencer à livrer rapidement le carnet de commandes de Northvolt, qui s'élevait à 53 milliards de dollars l'année dernière. Dans le même temps, il devra réduire encore davantage la taille de l'entreprise surchargée.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Projet de loi n°69 : le gouvernement doit faire les choses dans l’ordre, selon des groupes de la société civile

Montréal, le 26 septembre 2024 – Au lendemain de la fin des consultations particulières sur le projet de loi n°69, Loi assurant la gouvernanceresponsable des ressources énergétiques et modifiant diverses dispositions législatives, des groupes issus de la société civile réitèrent leur demande de suspendre les procédures parlementaires sur ce projet de loi
et de le réviser de fond en comble, après un véritable débat public large sur l'énergie effectué dans le cadre d'une commission indépendante et lors de laquelle l'ensemble des voix de la société québécoise auront été entendues.
Ce débat public, réclamé de toutes parts depuis près de deux ans par de nombreux groupes et spécialistes, devrait constituer le socle sur lequel plusieurs scénarios de plan de gestion intégrée des ressources énergétiques (PGIRE) devront être élaborés et débattus en misant sur une approche systémique plutôt qu'une approche en silo. Ces scénarios devraient notamment inclure :
l'identification des véritables besoins en énergie pour réussir la décarbonation complète du Québec ;
– les différents usages possibles de l'énergie ;
– les multiples impacts de la production d'énergie sur le territoire ;
– les mesures garantissant l'accès aux services énergétiques et un niveau de vie décent pour toutes et tous, en conservant les tarifs d'électricité à un niveau accessible pour les ménages à faible revenu pour répondre à leurs besoins essentiels ;
– les options liées à la sobriété, la réduction de la demande, à l'efficacité énergétique et aux sources d'énergies renouvelables.
Ces scénarios devraient être débattus au sein d'une institution indépendante du gouvernement. Les groupes réitèrent leur offre de collaboration à cet égard.
Les groupes sont également préoccupés parles éléments suivants :
Ils doutent que le projet de loi permette la décarbonation du Québec et la protection du territoire. Si le présent est garant de l'avenir, rien ne permet de croire que l'avalanche de nouvelle puissance bénéficierait nécessairement aux entreprises existantes qui veulent verdir leurs opérations et à qui on refuse les quelques mégawatts nécessaires, comme les Forges de Sorel. Le PL-69 favorise plutôt de nouveaux projets industriels, souvent initiés par des multinationales ayant peu ou même rien à voir avec la décarbonation.
Des impacts importants sur les tarifs. L'ajout massif de capacités électriques favorisé par le PL-69 ferait inévitablement augmenter les tarifs résidentiels et commerciaux, puisque les nouvelles infrastructures coûtent beaucoup plus cher que les capacités existantes et que le gouvernement cherche à appâter les industries avec une électricité à rabais. Les commerces et les ménages, surtout les moins nantis, assumeraient ainsi une part disproportionnée des coûts de la transition.
Un projet de privatisation. Sous le prétexte d'accélérer l'ajout de capacités énergétiques sans preuve à l'appui, le PL-69 ouvrirait des brèches béantes dans le caractère public du secteur électrique québécois, et ce, sans l'aval de la population. En 1962, nous avons collectivement rejeté la mainmise du privé sur l'électricité lors d'une élection référendaire qui a façonné le Québec d'aujourd'hui. De la même façon, nos décisions d'aujourd'hui façonnent le Québec de demain.
Un projet de loi qui ne priorise pas la sobriété énergétique, bien que cela permette de minimiser la construction de nouvelles infrastructures et ainsi contrôler les coûts de production, l'impact tarifaire et les impacts sur le territoire.
Pour toutes ces raisons, nous demandons au gouvernement de mettre le PL-69 de côté, le temps d'élaborer collectivement une politique énergétique et un PGIRE, un outil demandé depuis longtemps par les groupes, qui exprimera clairement la volonté de la population quant à son avenir. Les groupes insistent sur la nécessité que cette politique énergétique et ce PGIRE soient adoptés à la suite d'un véritable débat public. Il sera ensuite possible d'enchâsser la volonté de la population dans une loi qui serait le fruit d'un véritable processus démocratique.
Signataires :
Mélanie Busby, Front commun pour la transition énergétique
Bruno Detuncq, Regroupement vigilance énergie Québec (RVÉQ)
Émilie Laurin-Dansereau, ACEF du Nord de Montréal
Maxime Dorais, Union des consommateurs
Michel Jetté, GroupMobilisation (GMob)
Alice-Anne Simard, Nature Québec
Patricia Clermont, Association québécoise des médecins pour l'environnement (AQME)
Charles-Edouard Têtu, Équiterre
Jacques Lebleu, Mobilisation environnement Ahuntsic-Cartierville
Shirley Barnea, Pour le futur Montréal
Jean-Pierre Finet, Regroupement des organismes environnementaux en énergie
Pour la liste complète des signataires.
Immigration : vers une Europe forteresse ?
L’incompréhensible impunité d’Israël
tiré du site de Blast
https://www.youtube.com/watch?v=xNv-8dIT-wk
Présentée comme une opération contre le Hezbollah, Israël mène depuis le 17 septembre, des attaques meurtrières au Liban. Explosions de bipeurs et talkies-walkies, bombardements sur tout le Liban et menace d'invasion terrestre. À ce jour, on compte plus de 500 Libanais tués, dont 50 enfants. Dans la prolongation du génocide en cours à Gaza, Netanyahu semble résolu à tout écraser sur son passage. Depuis le début des attaques, c'est la même propagande qui a été utilisée pour raser Gaza, qui est à l'œuvre : le Hezbollah utilise les civils comme boucliers humains, les habitations cachent des armes et l'armée israélienne se toise de prévenir les civils avant de les bombarder. On va donc tenter ici de comprendre ce qu'il se joue, aux cotés de Ziad Majed, politiste et chercheur franco-libanais, spécialiste du Moyen-Orient et des relations internationales. Et Sylvain Cypel, journaliste franco-israélien à Orient XXI et à l'hebdomadaire le 1.
Journaliste : Yanis Mhamdi
Montage : Mehdi Lakhal
Son : Baptiste Veilhan
Graphisme : Morgane Sabouret
Production : Hicham Tragha
Directeur des programmes : Mathias Enthoven
Rédaction en chef : Soumaya Benaïssa
Directeur de la publication : Denis Robert
Le site : https://www.blast-info.fr/

Manifestation nationale Les Fonds Publics pour le Filet Social – 3 octobre à Québec

Le 3 octobre 2024 marque le 2ème anniversaire de la ré-élection de la CAQ. Dénonçons ses choix budgétaires inégalitaires ! Alors que les Kings de Los Angeles arrivent en ville pour un match de hockey financé à même les fonds publics, rejoignez des dizaines d'organisations sociales, communautaires, syndicales et féministes pour défendre les services publics, les programmes sociaux et la justice sociale.
Les décisions de la CAQ favorisent les riches et le secteur privé : privatisation croissante, centralisation des pouvoirs en santé et en éducation, financement insuffisant du logement social, baisses d'impôts qui profitent aux plus fortunés, etc… Ces choix creusent les inégalités, entrainent plus de souffrance sociale, des files d'attente aux banques alimentaires et une augmentation des personnes en situation d'itinérance. La fiscalité doit redistribuer la richesse, pas la laisser s'accumuler dans les poches d'une minorité. La CAQ détourne les fonds publics et privatise nos services. Ça suffit !
La Coalition Main Rouge, le RÉPAC-03-12, le Regroupement des groupes de femmes de la Capitale nationale et le Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches–CSN vous invitent à une grande manifestation à Québec. Faisons entendre notre voix !
Rendez-vous à Québec le 3 octobre 2024, à 12h00
Départ au Parc Cartier Brébeuf (175 Rue de l'Espinay)
MATÉRIEL DE MOBILISATION :
– Affiche
– Tract
🚌Départs en autobus de différentes villes
📍 Formulaire d'inscription pour le transport qui partira de l'Estrie : https://forms.gle/RoxGufmsfKLcj86y7
📍Formulaire pour l'un des autobus qui partira de Montréal : https://framaforms.org/inscription-et-transport-pour-la-manifestation-les-fonds-publics-pour-le-filet-social-montreal
📍Formulaire d'inscription pour le transport qui partira de Joliette dans Lanaudière : https://forms.office.com/r/bA8kscXwVB
📍Départ de Trois-Rivières, en Mauricie à 10h00. Les personnes intéressés doivent s'inscrire par courriel à Pascal.bastarache@csn.qc.ca.
📍 Formulaire d'inscription pour le bus qui partira de Longueuil
📍Départ de la Rive-Sud de Québec : Il faut s'inscrire en écrivant à julie.boudreault@csn.qc.ca
Départ Cégep Lévis-Lauzon à 10h45 Départ du Maxi de St-Romuald à 11h15.
Chers vivants, tous les humains ne sont pas identiques
Des nouvelles de la Coop Raquette

La connaissance, cinquième élément du hip-hop

Raccoon, âgé de 25 ans, est originaire de l'est de Montréal. Il se définit comme auteur, compositeur, interprète, écrivain, poète et animateur d'ateliers.
Propos recueillis par Audrée Thériault Lafontaine et Samuel Raymond
À bâbord ! : Comment le hip-hop est-il entré dans ta vie ?
Raccoon : Il y a toujours eu de la musique chez nous, on est de très grands fans de musique dans la famille. J'ai une grande sœur qui importait tous les plus grands hits américains, surtout hip-hop. Tout ce que ma grande sœur écoutait, je l'écoutais aussi. Tous mes goûts viennent de là. J'ai aussi un grand frère qui s'intéresse au rap et qui m'a initié à la création musicale. Ce qui m'a poussé vers le rap francophone, c'est l'amour du français qui m'a été donné par mes parents. J'ai toujours eu des bibliothèques bien garnies. Je me rappelle de leurs yeux qui s'illuminaient lorsque je m'y intéressais. Ça a été un point important de ma relation avec mes parents. Ce qui lie le mieux la littérature et la musique, c'est le rap, soit Rhythm And Poetry.
ÀB ! : Tu as déjà décrit le hip-hop comme un vecteur de messages sociaux. Est-ce qu'il y a des messages en particulier que tu souhaites transmettre par ta musique ?
R. : Ce que j'essaie d'abord et avant tout de transmettre, c'est la réflexion intellectuelle, l'excellence et la connaissance. L'avenir de la poésie se retrouve dans le rap. C'est mon créneau principal. Le rap est une discipline complexe, intellectuelle, poétique et qui devrait être reconnue pour ça. Pour moi, ça devrait être autant reconnu que les orchestres symphoniques !
Il y a aussi le côté discours, la volonté de défendre quelque chose. On dit que le hip-hop a quatre éléments, le Graf, le DJing, le Rap et le Break. Mais il y a aussi un cinquième élément, la connaissance. La transmission des connaissances sert à l'émancipation. C'est né du bas, dans le Bronx, à New York. Ça vient des personnes racisées et marginalisées. Le hip-hop c'était un vecteur de conscience noire pour éduquer son quartier, sa communauté.
Un rappeur n'est pas obligé d'être dans ce créneau-là. Le rap évolue avec le temps. Aujourd'hui, c'est plus du divertissement. En fait, ça l'a toujours été, mais avant, le divertissement était un prétexte pour distribuer de la connaissance et favoriser l'empowerment. Il y a des notions ou des traditions qui se perdent avec le temps et moi je souhaite les garder.
ÀB ! : Dans une des chansons de ton nouvel album, tu « exiges qu'on rende hommage aux endommagé·es » Qui sont-iels ?
R. : Les endommagé·es, ce sont les personnes des quartiers défavorisés, celles qui subissent de l'oppression, les personnes racisées, celles pour qui la vie a mis plus d'obstacles que d'autres dans leurs pas. Les endommagé·es, ce sont aussi les personnes créateurices de cette culture-là, donc celles qui viennent du bas de la société, qui essaient avec les moyens du bord de s'en sortir, de s'en sauver, d'être créatives. Pour une fois, j'ai envie qu'on rende hommage aux personnes pour qui c'est plus difficile.
ÀB ! : Tu animes des ateliers d'écriture auprès de jeunes. Pour quelles raisons est-ce important pour toi ? Qu'est-ce qui en ressort ?
R. : Mis à part mon histoire familiale qui m'a poussé vers le rap, ce qui m'a poussé vers une carrière, ce sont les ateliers parascolaires à la Maison des jeunes juste en bas de chez nous, dans mon plan HLM. Ce sont des moments qui m'ont marqué à vie. Ils m'ont donné une raison de vivre. Aussi, quand j'étais jeune, je me questionnais sur mes capacités intellectuelles, parce que je n'étais pas très bon à l'école. Dans ces ateliers, c'était la première fois que je me trouvais des qualités. Je me dis que si je peux recréer ces moments-là pour d'autres adolescent·es qui sont dans la même position que moi – et je sais qu'il y en a – ça va permettre de recréer ces moments-là que j'adore, mais ça va aussi leur donner des mots. Les jeunes ont des choses à dire, des réalités à exprimer. Tu as accès à l'intimité des gens à travers l'art. C'est unique. J'ai la chance d'avoir accès à ces moments-là. Je suis très proche des jeunes avec qui je fais ces ateliers.
L'autre volet, c'est aussi qu'avec toute l'expansion de la culture hip-hop – c'est le style le plus écouté dans le monde – tou·tes les jeunes écoutent du rap. Il y en a beaucoup qui sont intéressé·es par le rap, mais qui n'en connaissent pas vraiment l'origine. Faire un atelier, ça me permet de rappeler les codes de base, de favoriser une tradition de la transmission, qui est l'une des valeurs fondamentales du hip-hop. C'est donc ma responsabilité, pas seulement en tant que rappeur, mais en tant que personne qui s'identifie à cette culture.
Première révélation rap de Radio-Canada et finaliste de la première saison de La fin des faibles à Télé-Québec, Raccoon a su se tailler une place dans le milieu artistique québécois. Aussi reconnu par ses pairs pour sa plume et son flow, il a collaboré avec plusieurs grands noms du hip-hop québécois, dont Loud, sur la chanson « Win Win ». Son troisième album, intitulé C00N : La prophétie, a été lancé à l'automne dernier.

Court circuit panoramique D.I.Y.

Le punk, malgré ses outrances et ses révoltes, a subi, comme à peu près tous les idiomes musicaux, la récupération commerciale et capitaliste d'une part, et, d'autre part une standardisation de « style » dans laquelle l'histoire de la musique (médias, hits, encyclopédies, etc.) l'a confiné. Envers et contre ce triste réductionnisme, prenons les chemins de traverses séditieux en allant à la rencontre de l'underground – au lieu d'Internet, allons pour ce faire dans les salles de seconde zone pour rencontrer cette musique enragée !
À la fin des années 1980, VALIUM ET LES DÉPRESSIFS constitue un point de départ bariolé conjuguant provocation et BD weird avec Henriette Valium (chanteur et BD underground). Ils étaient de la compil Lâchés Lousses (Tir Groupé 1990) – associée aux sources du punk québécois, qui présentait aussi LES REX, B.A.R.F. (Blasting All Rotten Fuckers) et un incontournable maudit : AMNÉSIE – la pièce « Pas des leurs » fait figure d'hymne de ce groupe qui avait une bassiste avant l'heure.
Les années 90 et 2000 sont foisonnantes… La scène anglophone bûche avec des sous-genres, dont le garage punk de DÉJÀ VOODOO quasi tribal et le punk rock de RIP'CORDZ (Paul Gott, chanteur et guitariste, a publié le journal/zine Rear Guard, un précurseur des hebdos culturels à Montréal). N'oublions pas les résistants RHYTHM ACTIVISM de Norman Nawrocki qui frappe fort en déconstruisant le punk, en y insérant du violon, mais aussi en y insufflant l'esprit de Crass, Chumbawamba et même Uz Jsme Doma pour porter des textes inimitables – « Jesus Was Gay » (G-7 Welcoming Committee) en est une pièce à conviction. L'imprimeur catholique initial avait détruit la pochette, sacrilège ! C'est d'ailleurs de RHYTHM ACTIVISM qu'émergea URBAIN DESBOIS – chanson anar avec, notamment « Ma maison travaille plus que moi ». Après quelques disques chez La Tribu, le doux cinglé redeviendra souterrain…
Côté francophone, attirons l'attention sur des oubliés incandescents : BANLIEUE ROUGE (Safwan, chanteur et guitariste, fera ensuite AKUMA) en punk rock dans la foulée de Bérurier Noir, LES MALADES MARTEAUX en minimaliste duo guitare et boîte à rythmes, et fan du dadaïsme (à la fin de l'année 2022, ils jouaient aux Foufs lors du lancement du bookzine Macadam !), GUÉRILLA au rap métal agité (voir Manifeste, un album inspiré par la mouvance politisée et la mémoire du FLQ) et un coup de foudre pour GOUVERNEMENT ZEL, un trio singulier à l'album unique Vente de feu (où on trouve « À vos dictionnaires » ou « La Gigue des mal formés »).
ANONYMUS / MONONC' SERGE pour l'amalgame métal lourd et l'irrévérence en chanson baveuse fait date dans la stratosphère punk. Un salut particulier à VOÏVOD qui a rallié la scène punk à leur brouet métalcore sans compromis. LA CAGE DE BRUITS (leur disque D.I.Y. Pouvoir fascine), cofondé par le tandem mixte Danielle Richard, chanteuse et bassiste, et Patrick Dostie à la guitare, ose à la fois la radicalité hardcore (« Pu rien à perdre ») tout en étant capable de musique actuelle (« Pour vrai »). Dans cette veine ultra marginale et fertile, ajoutons PLACEBO avec des aspects tchèques (où ils tournèrent) d'un hardcore punk ciselé phénoménal, MONSIEUR TOAD avec des accents d'horreur (« Vivre embaumé » ou « Je suis décédé, merci ») ainsi que GHOULUNATICS (Cryogénie) – qui tournèrent avec Tagada Jones, font partie des excès marécageux et monstrueux paraphrasant ce monde de somnambules qui, inlassablement, travaillent et se reposent…
L'univers baroque et populaire du punk puise aussi dans le ska, dans la foulée de la vague 2Tone (étiquette britannique née à la fin des années 1970), qui l'avait propulsé. Les compilations 2Tongue (Sapristi) ont marqué cette déferlante, souterraine pour l'essentiel, avec, notamment : 2STONE 2SKANK, FOUS ALLIÉS et L'ORBITAL SPOUTNIK. Retenons aussi LES CONARDS À L'ORANGE du génial ska-punk autodérisoire (« Tout nu dans la rue » et « Le magasin des choses utiles »). M.A.P. (Mort Aux Pourris) aura été un groupe d'exception – Repose en paix leur dernier disque produit par Paul Cargnello l'atteste et, leurs projets suivants sont des musts : CHARLIE FOXTROT, ACHIGAN, VARLOPE, etc. Leurs écrits et leur vélocité évoquent le turbo punk gauchiste de Randy ou d'International Noise Conspiracy ; rien de moins. Quelques autres qui fricotèrent avec le ska en privilégiant le punk ? ANOMALIES, dont les pièces « Dissident » et « Vent de révolte » sont torrides, BOULIMIK FOODFIGHT qui boute le feu avec ses albums Photos de famine et Grossir selon ses moyens. Leur pièce « L'anarchie pour les nuls » sur 2Tongue est même forcenée !
TOMAS JENSEN de l'époque des FAUX-MONNAYEURS et JEAN-FRANÇOIS LESSARD ont certes croisé punk politisé avec musique du monde ou la chanson afin d'accoucher de morceaux assassins envers un système broyant les perdants… Il y a peu, la mouvance du folk-sale soulignait les coups de gueule acoustiques de ROBERT FUSIL ET LES CHIENS FOUS, TINTAMARE et LES SOFILANTHROPES.
En fait, le punk grouille toujours et ressurgit en nous sautant à la figure ; là où on l'attend le moins. Après les mythiques VULGAIRES MACHINS revenant récemment, on aurait tort de ne pas citer la pertinence d'ÉRIC PANIC, qui a vécu dans leur ombre, ou encore d'ignorer LES ZÉROS qui joua « Envie de tuer », ou le groupe BRUTAL CHÉRIE – il faut pogoter sur « Debout »… Le mariage qui dure depuis trois albums entre musique trad et punk offre une conclusion aussi ouverte que tonique à ce pétaradant panorama keupon, on a nommé CAROTTÉ, dont le mantra est Punklore et Trashdition (Slam) !
Le punk, dans une compréhension large de l'idiome, n'en démord pas envers l'autorité, le pouvoir et le conformisme. Il y a là matière à musique engagée d'autant plus que, à la base, n'importe qui pourrait en faire minimalement un bordélique exutoire ou même un levier d'agit-prop…
Illustration : Ramon Vitesse

Quand chanter est politique

L'auteur-compositeur-interprète Mike Paul Kuekuatsheu nous a livré ses réflexions sur la place du chant chez les Ilnus, ainsi que sur sa propre démarche politique, où la musique rejoint la défense du territoire et des pratiques ancestrales.
Propos recueillis par Isabelle Bouchard , Philippe de Grosbois et Audrée Thériault Lafontaine
À bâbord ! : Quelle place occupe la chanson dans la communauté ilnue ? Quel rôle vient-elle jouer ?
Mike Paul Kuekuatsheu : La chanson est partie intégrante de l'identité, la culture, la langue du peuple ilnu – parce que c'est beaucoup plus large qu'une communauté. À l'origine même de notre identité, le chant, c'est un moyen de survie pour nous depuis les temps immémoriaux pour pouvoir aller chasser, communiquer avec l'esprit du caribou. Les chants se sont toujours transmis de façon orale. Il y avait des chants que les femmes utilisent pour endormir les nourrissons. Il y a des chants qui sont utilisés pour les mariages ou des cérémonies. Des chants pour célébrer les festins, parce que le caribou a offert son esprit donc on fait un makushan. C'est une communion, un festin en l'honneur du caribou qui a offert sa vie. C'est une danse qui se danse en cercle du côté du soleil levant avec le teueikan. Le teueikan est un tambour issu de notre culture traditionnelle, pour chanter, pour avoir un lien direct avec le monde animal, le monde des esprits. C'est vraiment un instrument spirituel.
C'est sûr qu'aujourd'hui, le chant ilnu a beaucoup évolué. Là, on est en train de perdre beaucoup la culture à cause de la perte du caribou, de la biodiversité, tous les changements climatiques, donc ça affecte beaucoup notre culture. Dans ma communauté, il reste une centaine de locuteur·rices. La langue est en péril. C'est ça le défi aujourd'hui. C'est pour ça que je me suis donné comme mission de chanter et de réapprendre la langue. C'est pour ça que j'ai renoué avec les pratiques de chasse cérémoniale.
AB ! : Vous avez fait des albums plus inspirés de la chanson populaire. Comment situez-vous votre musique par rapport aux chants que vous venez de décrire ?
M. P. K. : Je suis très influencé par la musique rock. Parmi mes influences, il y a Link Wray et Jimi Hendrix, qui sont des musiciens de mouvances autochtones, qui se sont inspirés des chants autochtones et qui l'ont introduit dans la musique rock. On entend beaucoup la répétition, les loops dans les chants autochtones, c'est un peu ça la base du blues et du rock [1].
C'est ce que j'écoutais dans mon adolescence. La musique traditionnelle était comme une graine en moi, qui n'était pas germée. À l'école, on avait un contact avec un aîné qui venait jouer le teueikan et qui venait nous expliquer la base de l'instrument et qui venait pour nous chanter des chants. C'était le seul contact que j'avais eu avec la musique traditionnelle ilnue. La graine a germé à partir de 18 ans : je me suis dit qu'il fallait que j'incorpore des éléments traditionnels dans ma musique.
Je trouvais ça important par souci de conserver la culture aussi, de témoigner des histoires qui m'ont été transmises par les aîné·es. On dit que notre vie est des atalukan, des récits, des enseignements. J'incorpore des chants des légendes anciennes, des chants en langue ilnue, mais aussi des instruments, des tambours à travers la musique.
Dans mes chansons, je parle de protection du territoire, des changements climatiques, de la surexploitation et de l'extractivisme, des impacts que ça a sur les populations autochtones. Le sens sacré de chaque élément pour nous, soit l'eau, la pierre. Pour nous, ce sont des entités qui sont vivantes et qui sont animées dans notre langue. Le titre de mon dernier album, Ashuapmushuan, c'est le nom d'une rivière. J'ai choisi le nom d'une rivière parce que c'est animé, c'est vivant.
AB ! : Les thèmes dont vous parlez partent de la réalité vécue, finalement.
M. P. K. : Mes paroles touchent autant le passé que le présent et le futur. Notre identité, issue d'une culture nomade, s'attache au territoire. Chaque famille est reliée à un lieu, à une rivière par laquelle elle est arrivée. Ensuite, je parle du présent, des enjeux actuels, comme l'extinction du caribou. J'ai la chanson Caribouman qui parle de la légende de l'homme caribou. Mais aussi, mes chansons parlent de l'importance de la transmission culturelle pour le futur.
Il y a aussi des chansons en faveur de l'autodétermination. Pour moi, l'autodétermination, c'est de faire un, dans le respect du cercle vivant sacré. C'est d'être libres et de continuer de pratiquer notre culture et notre identité, en harmonie avec tous les gens qui vivent sur ce territoire. Actuellement, aux yeux de la loi, nous sommes mineur·es, elle nous classe dans une sous-catégorie. On veut s'élever au même niveau et être reconnu·es comme des êtres humains qui s'autodéterminent.
Les chants ont été interdits longtemps, le Canada et la Loi sur les Indiens nous interdisaient de chanter nos chants, nous jetaient en prison. C'est juste depuis 1982 qu'on peut chanter librement nos chants sans se faire jeter en prison. Depuis ce temps-là, on sent qu'il y a une renaissance du chant.
AB ! : Donc, à cette époque-là, le simple fait de chanter ces chants, c'était politique !
M. P. K. : Si on prend l'histoire de Wounded Knee [2], ça a commencé avec les chants, la ghost dance (la danse des esprits). Le gouvernement les interdisait, il voyait ça comme un acte de menace de guerre et les ont massacrés à cause de ça.
Pendant longtemps, on a porté des traumatismes à cause des pensionnats, où c'était interdit de chanter nos chants, de parler notre langue. Mais aujourd'hui, les jeunes ilnu·es se sentent plus libéré·es, prennent plus la parole et leur place. Par l'engagement des femmes autochtones, des jeunes, on sent qu'il y a un esprit de décolonisation fort. Les jeunes autochtones sont plus conscient·es de ces réalités-là.
AB ! : Vous êtes aussi gardien des territoires. Voyez-vous des liens entre ce statut et celui d'auteur-compositeur ?
M. P. K. : Je suis un gardien des territoires, un protecteur de l'eau. Je m'implique depuis de nombreuses années sur le terrain, pour protéger les forêts et les rivières par des actions directes, en m'opposant à des projets miniers, avec d'autres Autochtones. Je suis très engagé là-dedans, pour notre autodétermination, pour décoloniser les systèmes paternalistes qui ont été mis en place. Être gardien des territoires, c'est une fierté et ça a un lien direct avec ma démarche artistique. Pour moi, la musique est un moyen d'expression et de transmission de nos connaissances, mais aussi de sensibilisation à nos réalités.
[1] NDLR : Pour plus d'informations à ce sujet, voir le documentaire de Catherine Bainbridge, Rumble. The Indians Who Rocked Our World, Rezolution Pictures, 2017.
[2] NDLR : Le massacre de Wounded Knee est une intervention militaire où des centaines de membres de la nation Lakota ont été tué·es par les États-Unis, dans le Dakota du Sud, en 1890. Pour en connaître plus sur le siège de Wounded Knee (1973), voir le texte de Mélissa Miller et Miriam Hatabi aux pages 8.
Illustration : Ramon Vitesse

Le top 3 de quelques membres du collectif de rédaction
Quelques membres du collectif de rédaction nous présentent leurs trois chansons engagées préférées.










Lobbyisme. Le pouvoir obscur

Pour vous procurer une copie papier de ce numéro, rendez-vous sur le site des Libraires ou consultez la liste de nos points de vente.
Les lobbyistes forment aujourd'hui un grand pouvoir de l'ombre très bien établi. L'objet et les fruits de leurs actions tentaculaires échappent pour l'essentiel au regard public, mais la vigilance citoyenne et journalistique, notamment, parviennent à en dévoiler parfois la portée de leurs actions. Pensons, par exemple, à la firme-conseil McKinsey qui obtient un nombre extraordinaire de contrats gouvernementaux malgré les nombreux scandales dans lesquels elle a été impliquée. Ou à Uber, qui a réussi à imposer aux gouvernements une réglementation idéale pour son développement, aux dépens de ses concurrents. Ou aux entreprises pétrolières et gazières qui ne ménagent aucun effort pour retarder la transition écologique, malgré la période d'urgence climatique dans laquelle nous nous trouvons.
Entrer dans l'univers du lobbyisme est une surprenante aventure. S'y cachent notamment des moyens financiers considérables destinés à influencer les gouvernements. Pour atteindre leurs fins, les lobbies s'en prennent aussi à leurs adversaires des mouvements sociaux, soit en tentant de les faire passer eux aussi pour des lobbyistes, soit en se camouflant derrière de fausses organisations citoyennes, par le similitantisme (ou astroturfing), créant ainsi une malsaine confusion. Autant de tactiques destinées à brouiller le débat public, en masquant le déséquilibre des rapports de force et des objectifs poursuivis par les groupes en présence.
Selon certains, le lobbyisme puise une certaine légitimité dans un besoin des entreprises de fournir des informations utiles à la prise de décision des gouvernants. Le problème, c'est qu'il traduit essentiellement une capacité de représentation, sur le plan humain et financier, manifestement disproportionnée face à celle dont disposent les groupes citoyens. Tout cela pour faire valoir des intérêts et une conception de la société aux antipodes les uns des autres. Que valent les plaintes de contribuables exigeant de meilleurs services et filets sociaux face à l'artillerie relationniste d'entreprises en quête de contrats au chevet des décideurs ?
Ce qui ne manque pas de soulever des questions fondamentales sur la concrétude du débat public, l'exercice du pouvoir démocratique, la transparence, la redevabilité et, en fin de compte, la souveraineté populaire sur les choix de société opérés en notre nom. Le pouvoir d'influence de certains intérêts privés leur donne de tels privilèges, permettant notamment de contourner les mécanismes démocratiques, qu'il n'est pas difficile d'en conclure que les gouvernements accordent plus d'importance à la voie des capitalistes qu'à celle de la population dont ils sont censés représenter les intérêts.
Le lobbyisme est un sujet si vaste et complexe que nous n'avons pu en effleurer que quelques pans. Plusieurs lobbies aux objectifs fort discutables n'ont pas pu être abordés : celui des compagnies pharmaceutiques, faisant pression pour maintenir un coût très élevé aux médicaments ; celui des armes favorisant la multiplication des armes à feu ; celui des banques, des entreprises de produits chimiques, des compagnies minières… Sans oublier d'autres aspects laissés de côté, comme les firmes de relations publiques au service des lobbyistes ou le rôle bien imparfait des registres des lobbyistes.
Notre but a surtout été d'amorcer une réflexion sur la démocratie, stimulée par la diversité des points de vue exprimés dans ce dossier. Comment la démocratie peut-elle se maintenir si des entreprises richissimes disposent de moyens aussi puissants pour orienter, voire dicter les politiques à leur avantage, en se soustrayant impunément à la vigilance et au débat publics ? Comment discuter de bien commun si celui-ci est vu comme un obstacle devant les profits des entreprises ? Il nous semblait essentiel de démontrer que le progrès social doit s'envisager, entre autres, en limitant fortement le pouvoir et l'opacité dont profitent les lobbyistes pour tirer les ficelles de notre avenir collectif.
Un dossier coordonné par Wilfried Cordeau , Yannick Delbecque et Claude Vaillancourt
Illustré par Ramon Vitesse
Avec des contributions de Marie-Ève Bélanger-Southey, Collectif scientifique sur les enjeux énergétiques au Québec, Yannick Delbecque, Flory Doucas, Thierry Pauchant, Mercédez Roberge, Louis Robert, Sophie Thiébaut, Claude Vaillancourt et Stéphanie Yates.
Pour vous procurer une copie papier de ce numéro, rendez-vous sur le site des Libraires ou consultez la liste de nos points de vente.

Washington et Bruxelles, le modèle imposé

Le lobbyisme a ses capitales : Washington et Bruxelles, soit celles des deux principaux lieux de pouvoir des grandes puissances occidentales, les États-Unis et l'Union européenne. Non seulement les lobbyistes y règnent en grand nombre et suivent pas à pas les projets de loi qui les concernent, mais ils imposent un modèle d'ingérence politique reproduit à plus petite échelle dans la plupart des pays, y compris le nôtre.
Dans chacune de ces villes, les lobbyistes se sont installé·es à deux pas des grandes institutions gouvernementales, dans une zone limitée, où se prennent de façon très centralisée des décisions qui affecteront des centaines de millions de personnes, si ce n'est pas la planète entière.
À Washington, les lobbyistes avaient établi leurs pénates dans la fameuse K Street, tout près de la Maison-Blanche et à peine un peu plus loin du Capitole, un lieu qu'ils ont délaissé depuis pour se disséminer dans la ville. Mais le nom de cette rue sert toujours de dénomination lorsqu'on veut dénoncer les abus du lobbyisme.
À Bruxelles, les lobbyistes gravitent autour des trois grandes institutions, le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil de l'Union européenne, toutes trois situées dans le quartier européen, légèrement en périphérie du centre historique de la ville, caractérisé pas son architecture terne, sans âme, mais fonctionnelle. L'ONG Corporate Europe Observatory (CEO) y organise son lobby tour, promenant les visiteuses et visiteurs devant les immeubles anonymes du quartier, y décrivant les manœuvres douteuses et les réseaux d'influences des lobbyistes qui s'y cachent. Un tourisme particulier, aussi instructif qu'affligeant par les histoires qu'on y découvre.
Dans chacune de ces villes, des organisations citoyennes effectuent une veille très efficace sur l'activité des lobbyistes : on compte parmi elles OpenSecrets à Washington et CEO à Bruxelles, la même qui organise les visites guidées. Mais le travail indispensable de documentation de ces organisations, malgré la lumière qu'il jette sur une pratique nébuleuse, ne règle en rien un problème dont les solutions doivent être politiques.
Washington, là où tout a commencé
L'activité des lobbyistes est bourdonnante à Washington. OpenSecrets nous dit qu'ils ont atteint un nombre record en 2007, avec 15 000 personnes exerçant ce métier, un chiffre qui s'est depuis stabilisé à près de 12 000. Leurs dépenses, quant à elles, ont été de plus de 3 milliards $ en 2021. Les entreprises investissant les sommes les plus élevées changent d'année en année. Pour l'année 2022, les champions sont, entre autres, la Chambre de commerce des États-Unis au premier rang (avec des dépenses de près de 60 millions $), un regroupement de compagnies pharmaceutiques au 3e rang (plus de 22 millions $), la Croix bleue (assurances) en 4e (20 millions $) et Amazon en 6e (16 millions $). De nombreuses entreprises familières se classent bien, comme Meta, Pfizer, Lockheed Martin, Alphabet et AT&T. Le secteur de la santé est celui qui a dépensé le plus globalement, suivi par le secteur financier.
Les statistiques d'OpenSecrets montrent bien à quel point le lobbying des grandes entreprises et la représentation citoyenne ne jouent pas dans la même ligue. En 2022, le secteur des affaires a compté pour 87 % des dépenses, alors que les autres, identifiés comme « ideological groups », « labor » ou tout simplement « others », – toutes des catégories plutôt floues qui pourraient elles aussi être financées par l'entreprise – ne sont responsables que de 13 % des sommes dépensées.
Ces chiffres nous montrent surtout comment le lobbyisme est bien implanté à Washington. Il va de pair avec le financement des partis politiques, dont on sait à quel point il prend une place importante dans les activités quotidiennes d'un·e élu·e étatsunien·ne. Recevoir tant d'argent, qu'on le veuille ou non, affecte grandement l'indépendance des élu·es et les rend particulièrement ouvert·es aux revendications des lobbyistes. Il est difficile de ne pas y voir une sorte de corruption légalisée, acceptée, normalisée, qui permet au pays de ne pas se trouver haut dans la liste des pays les plus corrompus, mais qui soumet quotidiennement sa démocratie aux entreprises les plus puissantes, de façon à bien répondre à leurs intérêts.
Bruxelles, la bonne élève
Ce modèle, qu'il aurait été sain de réfuter du tout au tout, s'est reproduit spontanément lorsque le pouvoir européen s'est retrouvé concentré dans la ville de Bruxelles, alors que l'Union européenne gagnait en puissance et en centralisation. L'élève a même dépassé le maître en nombre de lobbyistes, un chiffre estimé à 26 500, toutes catégories confondues, selon Transparency International. Mais la majorité de ces lobbyistes provient de l'entreprise privée : les lobbys d'affaires ont 60 % des lobbyistes accrédité·es au parlement européen, et selon une étude de CEO en 2014, ils dépenseraient 30 fois plus que les syndicats et les ONG combinés.
En première position des plus grands dépensiers selon LobbyFacts.eu, en ce début d'année 2023, on trouve le Conseil européen de l'industrie chimique, avec 9 millions €. Si on ajoute, au 4e rang, Bayer AG (6,8 millions €), on constate à quel point l'industrie chimique ne craint pas d'investir pour défendre ses produits, dont plusieurs sont toxiques, alors que la population européenne demeure très rébarbative devant les OGM et le glyphosate. Quatre des sept premiers dépensiers sont des firmes étatsuniennes : FTI Consulting Belgium, Apple, Google, et Meta – quoique cette dernière est enregistrée en Irlande, paradis fiscal reconnu pour avoir rendu de généreux services aux GAFAM. La somme de leur contribution s'élève à plus de 25 millions €. Ces entreprises étrangères, par cette remarquable ingérence, s'assurent d'être traitées aux petits oignons par une importante partie du personnel et des élu·es de l'UE à Bruxelles.
Bonne ou mauvaise influence
Au Québec et au Canada, peut-être pouvons-nous nous croire à l'abri de ces excès. Après tout, le financement des partis politiques est beaucoup mieux règlementé qu'aux États-Unis, et nos élu·es n'ont pas de pareils comptes à rendre à leurs généreux donateurs. Nous avons des registres des lobbyistes au niveau fédéral et provincial, ce qui nous permet de récolter des données fiables, contrairement à ce qui se passe à Bruxelles, alors que leur propre registre n'est pas obligatoire (toutes les statistiques mentionnées plus haut pourraient, en fait, sous-représenter la situation réelle).
Pourtant, il est évident que nous n'échappons pas à l'activité des lobbyistes. Le zèle déployé à Washington et Bruxelles n'est qu'une partie de ce que les grandes entreprises entreprennent, alors que leurs stratégies se déploient à l'échelle internationale. Pensons à Uber qui s'est établie un peu partout en défiant les lois, puis en envoyant leurs lobbyistes pour demander aux gouvernements que celles-ci soient réécrites à leur avantage, rendant légal ce qu'elle n'avait pas respecté. Ou à McKinsey, avec son armée de consultants convainquant les gouvernements qu'il vaut mieux s'adresser à elle plutôt qu'avoir recours à des fonctionnaires compétent·es (et cela, en dépit d'une série de scandales qui entachent depuis longtemps la réputation de cette entreprise [1]).
Constater ce qui se passe à Washington et à Bruxelles permet cependant de comprendre les stratégies multiples des lobbyistes, en concentré, mais à la plus haute échelle, avec des conséquences plus grandes qu'ailleurs. Cette observation nous permet de suivre les plus grandes préoccupations de l'empire des multinationales. En ce moment, l'assaut des firmes de la santé à Washington et celui des compagnies de produits chimiques nous montre à quel point les profits de ces géants interfèrent avec la volonté de protéger la santé des populations, à quel point ce secteur veut continuer à s'intégrer, avec le moins de réserves possible, dans le système capitaliste. Dans tous les cas, là-bas comme ici, on peut voir comment l'empire des GAFAM se maintient par un lobbying intensif et grassement financé.
Devant l'exploit colossal qui consisterait à réguler le lobbyisme à Washington et Bruxelles, un pays comme le nôtre est un peu mieux armé pour lutter contre ses excès. Il pourrait aller de l'avant en proposant une législation beaucoup plus stricte afin de ramener davantage de démocratie et limiter les pressions des firmes. Il faudra cependant beaucoup de courage politique, denrée rare en ce moment, et beaucoup de pressions citoyennes pour tenter d'y arriver.
[1] L'article de l'encyclopédie Wikipédia consacré à cette firme en cite plusieurs.
Illustration : Ramon Vitesse

La bête noire de l’économie politique

Revenir à la naissance de l'économie politique permet de réaliser que le lobbyisme ou l'influence des gens d'affaires sur les gouvernements est une pratique fort ancienne qui nuit au bien public et qui se doit d'être rigoureusement contrôlée. À ce sujet, et de façon surprenante, la pensée d'Adam Smith est très éclairante.
Le lobbyisme, dans son aspect technique, est une pratique moderne. Elle n'émerge qu'après l'invention de la propagande politique et d'entreprise en 1928 par Edward Bernays, premier conseiller de l'histoire en Relations publiques. Normand Baillargeon a raison d'affirmer que la propagande est antidémocratique [1] : elle déforme le dialogue raisonné en persuasion émotive, transforme le droit à l'information en désinformation et remplace la participation citoyenne par l'imposition du pouvoir d'une élite. De plus, cette pratique, quand elle promotionne une entreprise ou une industrie, biaise les décisions de l'administration publique, en renforçant le seul point de vue mercantile.
Mais l'influence des gens d'affaires sur les gouvernements a des racines bien plus anciennes. Elle fut considérée comme la bête noire de l'économie politique dès sa naissance, au 18e siècle.
La richesse des nations
Il est important de se rappeler que le père de l'économie politique, Adam Smith, a fait la promotion de la richesse des nations et non celle des nantis. Aussi, pour lui, la richesse ne se mesurait pas en or et en argent. Une nation est riche par ses champs, ses bâtiments et ses technologies, son éducation et sa justice, son éthique et ses mœurs.
Aujourd'hui il existe de nombreux auteur·es qui affirment qu'Adam Smith n'est pas le fondateur de la théorie de la main invisible du marché ou celle du laissez-faire économique. Ces théories lui ont été attribuées par la suite, par des personnes qui voulaient rendre légitime le capitalisme [2]. La pratique du lobbyisme requiert, entre autres choses, l'élaboration d'un argumentaire de vente, quitte à manipuler la vérité. Et aujourd'hui, les néolibéraux et les libertariens entretiennent ce « hold-up » intellectuel, en faisant d'Adam Smith leur fer de lance.
Très différemment, le Smith de la Révolution industrielle voyait d'un bon œil la transformation de la société féodale en une société commerciale. Les serfs et les vilains allaient, peut-être, pouvoir profiter de cette révolution. En devenant boucher·ères et boulanger·ères, salarié·es et entrepreneur·euses, les personnes pouvaient se libérer de l'emprise de leur seigneur et devenir capables de mieux gérer leur vie. Écrivant près d'un siècle ensuite, Karl Marx partagea cette vision. Il insista cependant sur le fait que les bourgeois avaient capturé à leur avantage cette révolution.
Smith anticipa le même danger. Auteur de l'une des premières théories de l'évolution des sociétés, il proposa que si les propriétaires de troupeaux avaient dominé dans les sociétés pastorales et les aristocrates dans les sociétés agricoles, les manufacturiers et les marchands risquaient de dominer les sociétés commerciales, si on les laissait faire. Et, malheureusement, on les a laissé faire.
Les intérêts de classes
Smith n'a jamais suggéré qu'une prétendue main invisible allait harmoniser les intérêts différents existant entre les marchands et le public. Très différemment, il suggère que « l'intérêt des marchands [...] diffère toujours à quelques égards de l'intérêt public ». Pour lui, cet intérêt mène à « rétrécir la concurrence des vendeurs » alors que cela est défavorable pour le public. Comme il l'explique, « Les seuls commerçants y trouvent leur compte puisqu'ils en grossissent leur bénéfice au-delà de ce qu'ils doivent naturellement attendre et qu'ils lèvent par-là à leur profit une taxe exorbitante sur leurs concitoyens ».
Cette différence d'intérêt existe aussi pour Smith entre employeurs et employé·es, les deux formant des ligues. La première tente de limiter les salaires, la seconde de les augmenter. Comme il le note, « les maîtres forment, et partout et toujours, une sorte de ligue tacite, mais constante et uniforme pour empêcher les salaires du travail de s'élever au-dessus de leur taux actuel ».
Considérant ces intérêts de classes et la supériorité des moyens financiers des marchands, Smith recommande que toute proposition de nouvelle loi avancée par cette ligue soit analysée « avec la plus grande défiance ». Il précise que « ces projets viennent d'une classe d'hommes dont l'intérêt n'est jamais dans une exacte conformité avec l'intérêt public, d'une classe d'hommes généralement intéressés à le tromper et même à l'opprimer, enfin d'une classe d'hommes qui plus d'une fois en effet l'a trompé insidieusement et cruellement opprimé ».
Aussi, Smith a insisté combien il était difficile mais nécessaire de contrôler l'influence des manufacturiers et les marchands. Il note par exemple qu'« un membre du parlement » conciliant est considéré comme un « homme versé dans la science du commerce » alors qu'un opposant est « exposé à la détraction, à l'infâme calomnie, aux insultes personnelles et quelques fois même à des dangers réels ».
La East India Company
Cette corruption de l'État par ces stratégies de propagande et de persuasion devint évidente au 18e siècle par les activités frauduleuses et criminelles des compagnies détenant un monopole. La East India Company était à l'époque la plus grande entreprise de Grande-Bretagne. Créée en 1600, elle détenait des entrepôts, des ports, une flotte de navire et une armée de 200 000 hommes, contrôlant la vie de plus de 20 millions de personnes en Inde. Elle est considérée aujourd'hui comme l'archétype des multinationales modernes [3].
Smith dénonça les abus commis par cette compagnie, incluant des extravagances, des scandales financiers et des crises monétaires. Il documenta aussi comment ses stratégies mercantiles ont généré une famine au Bengale, entrainant la mort de dizaines de milliers de personnes. Empathique au sort des Autochtones, il conclut qu'une telle compagnie est « nuisible sous tous les rapports » pour la population locale et qu'« une compagnie de marchands est incapable de se conduire en souveraine ».
Alors qu'on tente de nous convaincre aujourd'hui que le sens des affaires est essentiel pour gouverner une nation, Smith affirme que pour une compagnie de marchands, « sa principale affaire, c'est le commerce ou le soin d'acheter pour revendre. Par la plus étrange absurdité, elle ne voit dans son caractère de souverain qu'un simple accessoire à celui de marchand ».
Une société de boutiquiers
À la fin du siècle dernier, de nombreuses personnes se sont élevées contre la financiarisation abusive de nos démocraties, incluant Pierre Bourdieu, Susan George et Ignacio Ramonet. Ces critiques dénonçaient, entre autres choses, la différence fondamentale qui existe entre la science économique, prétendument neutre et objective, et l'économie politique, qui rend centrales les dimensions du pouvoir et de la démocratie. Smith, Marx et Keynes furent tous les trois d'ardents défenseurs de l'économie politique. Malgré leurs différences, ils faisaient une nette distinction entre le monde des affaires et celui de l'administration publique. Cette différence est souvent oubliée aujourd'hui.
Par exemple, le gouvernement du Canada a invité à 3 reprises des représentants de l'industrie pétrolière à tenir des événements à son pavillon durant la COP27. Un total de 636 lobbyistes furent même présents à cette conférence où les États étaient censés s'entendre pour réduire leur dépendance aux énergies fossiles. Aussi, aujourd'hui des gouvernements deviennent eux-mêmes des genres de lobbyistes qui promotionnent la marchandisation de nos sociétés. Provenant du monde des affaires, de l'économie ou de la finance, ces personnes ont tendance à surreprésenter l'idéal de « l'argent dans sa poche » et des « jobs payantes ». Si, évidemment, l'argent est nécessaire pour vivre, beaucoup d'autres idéaux nourrissent l'âme humaine.
Réexaminer l'histoire peut nous permettre de relativiser nos réflexes actuels, influencés par une propagande mercantile. Adam Smith était contre l'idée qu'une nation ne devienne qu'une « société de boutiquiers ». Le lobbyisme a été la bête noire de l'économie politique dès sa naissance. Car il n'est pas libérateur de passer de l'emprise des aristocrates dans une société agricole à l'emprise des marchands dans une société commerciale. Il est grand temps de mieux contrôler l'influence politique des gens d'affaires.
[1] Edward Bernays, Propaganda. Comment manipuler l'opinion en démocratie (Traduction Oriselle Bonies, présentation de Normand Baillargeon), Montréal, Lux Éditeur, 2008.
[2] Thierry Pauchant, Adam Smith, l'antidote ultime au capitalisme. Sa théorie du capabilisme, Paris, Éditions Dunod, 2023
[3] Nick Robin, The Corporation that Changed the World. How the East India Company Shaped the Modern Multinational, London, Pluto Press, 2006.
Thierry Pauchant est professeur honoraire à HEC Montréal.
Illustration : Ramon Vitesse

Lobbyisme des géants d’Internet

Il n'est guère surprenant que les géants d'Internet influencent le monde politique à leur avantage, comme le font toutes les entreprises possédant énormément de capital. Le lobbyisme a joué un rôle essentiel à leur développement, même si on voudrait nous faire croire que c'est la pure « innovation » qui en est la clé.
Le lobbyisme exercé par les géants d'Internet n'est pas très différent, dans ses grandes lignes, des stratégies d'influence politique des compagnies dominantes dans d'autres secteurs économiques : rencontres multiples avec des personnes ayant des charges publiques, financements de candidat·es politiques et de think tanks, campagnes de similitantisme, etc.
La leçon de Microsoft
À la fin des années 1990, Microsoft est poursuivie pour pratiques anticoncurrentielles. La compagnie avait auparavant réussi, à l'aide de contrats et de stratégies commerciales diverses, à s'assurer du contrôle du socle logiciel dont tous les autres logiciels destinés au grand public dépendraient, Windows. Craintifs de voir cette position dominante remise en question par l'arrivée du Web, les dirigeants de l'entreprise élaborent une stratégie commerciale visant à transférer la popularité de son produit phare à son nouveau produit donnant accès au Web, Internet Explorer.
La menace de voir Microsoft scindée pousse la compagnie à se lancer dans une importante campagne de lobbyisme. Auparavant, Microsoft était critiquée par certains investisseurs comme pour n'avoir que très peu d'influence à Washington, employant un seul lobbyiste. La poursuite pousse la compagnie à devenir l'un des plus importants groupes d'influence du pays et à dépenser 12 millions $ US pour employer une équipe impressionnante de plusieurs lobbyistes, comportant notamment d'anciens conseillers de chacun des présidents Bush et des anciens membres du congrès, autant démocrates que républicains. Ces jeux d'influence pouvaient affecter le dénouement par la nomination par des élu·es des personnes clés dirigeant la poursuite gouvernementale.
Tout ce jeu d'influence a finalement été bénéfique à l'entreprise qui, en appel, a réussi à faire renverser un jugement initial ordonnant de scinder Microsoft.
Influence judiciaire
Le lobbyisme de Microsoft a aussi pavé la voie à l'apparition des autres géants du secteur Internet en minant toute tentative de briser juridiquement ou politiquement un monopole dans ce secteur d'activité. L'argumentaire classique justifiant l'existence d'une réglementation antitrust est qu'un monopole est contraire à l'intérêt public quand l'absence de compétition nuit à l'innovation. Microsoft a réussi à faire valoir un renversement de cet argument auprès d'une partie de la classe politique. En effet, l'intérêt du public consisterait à ce que des outils technologiques de pointe soient développés et améliorés, ce qui exigerait des géants capables de prendre assez de parts de marché pour compétitionner à l'échelle mondiale et pour faire de la recherche. On aurait donc intérêt à laisser les compagnies reliées à Internet devenir très grandes, voire carrément des monopoles dans leur secteur d'activité, sans leur faire subir de sanctions.
Microsoft a tout de même dû refaire quelques fois face à la justice européenne pour pratiques anticoncurrentielles. Chaque fois, le lobbyisme a joué un rôle important dans la stratégie de défense de la compagnie.
Accès aux populations-ressources
Le chiffre d'affaires des grandes entreprises du secteur numérique dépend de l'adoption de leurs produits à l'échelle mondiale. Il n'est donc pas surprenant que le lobbyisme de ces géants vise aussi à leur donner accès aux marchés comme ceux de l'Inde ou de la Chine. L'importante campagne de Facebook menée en Inde est un exemple de lobbying ayant un tel objectif.
Le gouvernement indien souhaitait augmenter le taux d'accès à Internet dans le pays, particulièrement dans les régions rurales. Facebook a proposé à l'Inde un programme national visant à accroître le nombre de personnes ayant accès à Internet. Le programme proposait des téléphones cellulaires gratuits où l'univers d'Internet était essentiellement limité à… Facebook. Des efforts colossaux ont été déployés par la compagnie, impliquant même directement son fondateur. Une réaction forte d'une coalition de plusieurs acteurs du secteur technologique indien a défendu l'application du principe de neutralité d'Internet que le projet de Facebook bafouait. La coalition a réussi à influencer le département indien des télécommunications pour qu'il applique ce principe. Sur cette base, le projet de Facebook a finalement été écarté.
Contrôler la réglementation
Le lobbyisme des grandes compagnies Internet vise aussi à influencer les législations afin que les lois adoptées soient favorables à leurs activités commerciales.
On sait par exemple qu'Uber a utilisé les services de personnes connaissant bien le parti libéral du Québec, comme l'ex-chef de cabinet de la ministre Line Beauchamp, dans le but d'influencer l'élaboration d'une réglementation provinciale de ce que l'entreprise qualifie de « covoiturage urbain », alors que l'industrie du taxi réclamait que ce type de service soit illégal. En France, entre 2014 et 2016, alors que l'actuel président Macron était ministre de l'économie, celui-ci a entretenu des liens avec
Uber qui ont permis à la compagnie de s'établir dans le pays malgré une opposition importante. En plus de la réglementation sur les taxis, Uber tente d'influencer les lois du travail pour ne pas avoir à considérer comme employées les personnes offrant leur service sur ses plateformes de transport ou de livraison.
Airbnb offre un exemple de lobbyisme multinational à tous les niveaux, y compris niveau municipal. L'entreprise a fait campagne pour obtenir une réglementation favorable à ses activités au Japon, en Australie, aux États-Unis et en Europe, y compris au niveau des institutions européennes. Quand les activités de location à court terme de l'entreprise ont été considérées illégales, Airbnb a aussi utilisé le lobbyisme en appui à sa défense devant les tribunaux. Au Québec, la compagnie exerce son influence depuis 2014 et ses activités actuelles visent huit ministères, Revenu Québec et plus de 40 municipalités allant de Montréal aux Îles-de-la-Madeleine.
Quant à elle, Netflix mène des activités de lobbyisme au Québec et au Canada depuis 2010. En 2017, la compagnie a facilement pu rencontrer à plusieurs reprises Mélanie Joly, alors ministre du Patrimoine canadien, pendant une période où on se questionnait sur les taxes à appliquer aux plateformes numériques.
Stratégies classiques et nouvelles
Sur plusieurs plans, les stratégies de lobbyisme déployées par les géants d'Internet ne sont pas différentes de celles des grandes compagnies internationales des autres secteurs économiques. Un des scénarios caractérisant le mieux le secteur est l'utilisation du « fait accompli ». Ce stratagème consiste en l'introduction rapide de produits avant la mise en place de réglementation les encadrant. On vise à les faire adopter par le plus grand nombre de personnes pour ensuite exercer des pressions sur les gouvernements afin de transformer les réglementations à leur avantage. La popularité de leur produit est une forme de capital leur permettant d'exercer davantage de pression sur les gouvernements. Ainsi, toute restriction de l'usage de leurs produits les plus populaires serait perçue comme une privation par une partie de la population.
Le secteur Internet jouit d'un autre avantage stratégique propre, lié à l'incompréhension relative de plusieurs politicien·nes du fonctionnement des nouvelles technologies et à leur difficulté à anticiper leurs impacts sociaux et économiques. Cela permet d'entretenir un certain degré de confusion entre ce qui relève de la technologie et ce qui relève de la réglementation. Les entreprises du numérique peuvent alors, grâce à leur influence politique, élaborer à la fois leurs produits et la réglementation qui les encadre. De plus, elles peuvent se présenter comme un « partenaire » incontournable pouvant fournir aux gouvernements et aux services publics leur expertise et leurs « solutions technologiques. »
Pour limiter l'efficacité de la stratégie du fait accompli, il faudrait mettre en place un cadre réglementaire qui devance la commercialisation des nouvelles technologies. Par exemple, on pourrait imposer le respect de principes généraux comme la neutralité d'Internet ou l'interopérabilité. Les principes à considérer ont souvent déjà été identifiés par des mouvements militants liés à l'informatique, comme le Mouvement pour l'informatique libre.
Illustration : Ramon Vitesse
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.












