Derniers articles

Assez

Trop longtemps, nos voix ont été étouffées, nos récits effacés, nos blessures niées. Trop longtemps, l'impunité a prospéré sur notre silence.
ىفك
Aujourd'hui, je refuse le silence. Je refuse l'impunité. Aujourd'hui j'accuse.
J'accuse les puissances occidentales, leurs gouvernements respectifs depuis 1948, de complicité active avec un génocide qu'elles savent organisé, savamment peaufiné et orchestré. J'accuse les puissances occidentales de financer et de légitimer ce génocide qui, jusqu'à aujourd'hui, sert leurs élites politiques et financières. J'accuse Emmanuel Macron et son annonce en août d'une reconnaissance par la France de l'État de Palestine… en septembre, de collusion assumée avec un État ouvertement raciste et colonial.
Deux questions au coupable : pourquoi pas aujourd'hui ? Pourquoi différer ce qui aurait déjà dû être ? Pourquoi remettre à demain ce qui est une évidence et une urgence sinon pour laisser aux bourreaux et à leurs complices le temps de poursuivre et achever l'extermination ?
Reconnaître plus tard, c'est déjà nier. Reconnaître sous condition c'est encore nier. Reconnaître quand les bombes pulvérisent chaque école, chaque hôpital, chaque maison c'est toujours nier. Reconnaître, cela a-t-il encore un sens quand la terre est éventrée et que le peuple a presque déjà disparu ? De sens il n'y en a que dans le cadre de cette pratique à laquelle vous et vos complices
excellez, le blanchiment moral. Il faut avouer qu'à ce jeu vous faîtes pâlir Ponce Pilate. Ajoutez donc l'insulte à l'horreur.
Aujourd'hui je mets des mots sur ce qui nous écrase.
Ce qui se joue aujourd'hui ce n'est pas seulement la tragédie palestinienne – soudanaise, congolaise, yéménite, syrienne, libanaise, birmane : c'est la réflexion d'un système plus vaste, où les proclamations de droits et de justice masquent la logique froide des intérêts marchands, stratégiques et impériaux.
Car il faut dire les choses. Le capitalisme n'est pas une simple organisation économique. Il est colonialisme. L'un alimente l'autre, l'autre justifie l'un. Deux visages, une matrice. Cette alliance n'a cessé de transformer la vie en ressource, les vivants en marchandises, la terre en gisements. C'est la logique première du monde occidental : s'approprier, exploiter, effacer.
L'Occident, esclavagiste, féminicide, impérialiste, suprémaciste, capitaliste, n'a pas surgi dans le vide, encore moins dans l'échange. Il est né dans le sang et la spoliation. Il a germé sur les cadavres de terres pillées, de langues effacées, de forêts abattues, d'océans violés, de peuples exterminés. Le capitalisme n'est pas né sur les places boursières. Il a commencé dans les cales des marchands d'esclaves, des forêts abattues, des fleuves détournés, des sols éventrés, des étoiles déjà promises à l'extraction future. Il n'existe que par l'aliénation, la capture, la mise en marché de la vie sous toutes ses formes. Il s'érige sur des ruines, son fondement est l'arrachement. Arracher la terre à celles et ceux qui la cultivent, arracher des enfants à leurs parents, arracher les mots aux lèvres de ceux qui les chantent. Le capitalisme n'est pas l'art de l'échange, il est celui de la prédation systématisée. Il est colonialisme perpétué sous d'autres masques, colonialisme en costume-cravate, colonialisme algorithmique, colonialisme financiarisé. Il est une mécanique qui ne se soutient qu'en réduisant le vivant à l'inerte monnayable, en dévorant la vie - passée, présente et à venir - pour nourrir les marchés.
Les traites grecques, arabes et transsahariennes, romaines avaient déjà fait des corps une marchandise. Bientôt, l'esclavage transatlantique transforma des millions d'Africains en carburant de coton, de sucre et de tabac, tandis que l'annexion des Amériques anéantissait les civilisations autochtones des Andes jusqu'au pôle nord et celle de l'Australie spoliait les Aborigènes de leurs
lieux sacrés. Au XIXe siècle, la logique s'intensifie : les terres sont extorquées, les langues interdites, les « générations volées », jetées dans des pensionnats afin de briser toute mémoire et velléité de résistance. En Inde, l'Empire britannique affame des millions de paysans en exportant les récoltes vers l'Europe. En Afrique, la conférence de Berlin trace à la règle des frontières coloniales, réduisant le continent à une carte de concessions. Au Congo de Léopold II, des mains sont tranchées pour assurer le caoutchouc des bicyclettes et des câbles télégraphiques. Les Hereros et Namas en Namibie sont massacrés par l'Allemagne dans l'un des premiers génocides modernes, prélude à d'autres exterminations.
Le XXe siècle ne rompt pas cette chaîne : il la perfectionne. Les bordels militaires coloniaux, où des femmes du Vietnam, d'Algérie ou du Maroc furent enrôlées de force pour servir les troupes, illustrent l'instrumentalisation des corps par l'impérialisme tout autant que la traite organisée des femmes en Europe. La colonisation française en Algérie, les guerres d'Indochine et d'Afrique, poursuivent l'exploitation sous couvert de mission civilisatrice. En Afrique du Sud, l'apartheid institutionnalise la dépossession et la ségrégation. Pardon, à ceux et celles que je ne peux nommer sans rendre ma mise en examen indigeste. Ils/Elles ne sont pas oublié.e.s.
Après 1945, les indépendances politiques n'abolissent pas le colonialisme : elles le transforment. Cette mécanique se pare d'autres oripeaux. L'annexion du Tibet par la Chine, les bases militaires américaines dans le Pacifique, ou l'occupation sionniste en Palestine démontrent que la logique de contrôle territorial persiste. Les guerres en Sierra Leone, au Congo, au Rwanda se nourrissent du diamant, de l'or, du coltan et du cobalt, indispensables aux téléphones et aux armes. L'Amazonie est brûlée pour le soja, le bétail et les mines, au prix du massacre des Yanomami et de peuples non contactés. En Bolivie et au Chili, l'exploitation du lithium assèche les salines millénaires pour
fournir les batteries électriques du Nord. Au Mexique, les maquiladoras transforment la frontière en zone franche où la vie humaine est sacrifiée au profit. Au Bangladesh, les usines du textile imposent la fast fashion au prix de la misère et d'effondrements meurtriers. Dans les îles du Pacifique et des
Caraïbes, le tourisme extractiviste dépossède les habitants de leurs terres et de leurs eaux au nom des loisirs mondialisés.
De la traite occidentale aux mines de cobalt, des pensionnats canadiens ou australiens aux guerres pour les diamants, des femmes autochtones disparues aux ouvrières du textile, une seule logique se répète : l'accumulation capitaliste justifie l'appropriation, la spoliation, la destruction de la vie. Partout, les visages changent et la mécanique demeure. Ce qui est colonialisme se nomme aujourd'hui développement, relance, transition énergétique ou libre-échange.
Aujourd'hui je brise l'édifice de la supercherie.
C'est la même matrice sourde aux contestations et oppositions qui détruit des forêts au Québec pour une usine de batteries dites « vertes », qui empoisonne des sols à Blainville sous prétexte de gestion des déchets, qui bétonne les rives du Saint-Laurent pour étendre un port, qui arrache des enfants à leurs parents, qui ignore ou protège la disparition des femmes autochtones, mères, sœurs, filles, et qui ferme les yeux sur les massacres à Gaza tant que les contrats d'armement et les alliances stratégiques se maintiennent. La colonisation ne meurt pas : elle change de nom, de visage, de géographie. Partout, le scénario se répète : pillage, répression, asservissement, accaparation, extraction, anéantissement des cultures et des vies.
Mais ce scénario ne tient que parce qu'il est soutenu par des idéologies qui fabriquent sa légitimation. La doctrine du Terra nullius, proclamant que les terres n'appartenaient à personne dès lors qu'elles échappaient aux critères européens d'occupation ; le mythe du « sauvage inculte » qu'il fallait redresser, civiliser, catéchiser ; celui de l'impureté et du déficit féminins ; les pseudo théories raciales hiérarchisant les peuples et naturalisant l'esclavage et la colonisation ; la fable moderne de l'individu autosuffisant - fiction de l'autonomie individuelle - qui occulte les liens sociaux et écologiques pour mieux justifier la propriété privée absolue ; l'illusion d'un État neutre, alors même qu'il orchestre les inégalités, la violence et la répression ; le dogme d'une croissance « nécessaire », transmuant la destruction en horizon de prospérité pour quelques uns. Chaque étape de la domination s'accompagne de récits, de doctrines, de discours qui rendent l'horreur pensable et acceptable. Chaque étape de la domination comprend l'anéantissement des savoirs autres et des
savoirs des autres, des intelligences et génies qui la précède.
Aujourd'hui encore, en Palestine, les mêmes mécanismes idéologiques se rejouent. La rhétorique coloniale prend les habits d'un slogan cynique : « une terre sans peuple pour un peuple sans terre ». Elle brandit des accusations incessantes : « terroristes nés », « barbares », « décapiteurs d'enfants »,
« violeurs de femmes ». Toujours le même artifice, la même réthorique : présenter les opprimés comme des monstres pour mieux effacer leur humanité et légitimer leur anéantissement. C'est l'éternel refrain de la démagogie coloniale : regardez-les, ces sauvages, ce sont eux les bourreaux, et nous, victimes, n'avons d'autre choix que de nous défendre.
Et, comme une ultime perversion, l'instrumentalisation d'un autre drame : l'Holocauste. Au lieu d'en tirer une responsabilité universelle contre toutes les oppressions, les élites sionnistes, européennes et américaines en ont fait une industrie mémorielle, un capital politique qui justifie et
finance l'oppression d'autres peuples. Le prix du génocide nazi, ce ne sont pas les nations européennes qui l'assument - mais bien les peuples du Levant, en premier lieu les Palestiniens, écrasés au nom d'une dette historique qui ne leur appartient pas. L'horreur subie par les Juifs, les homosexuel.les, les communistes, les résistant.e.s, les Tsiganes, les esprits libres, les différent.e.s
d'Europe est instrumentalisée pour en infliger une autre, transformée en légitimité pour la colonisation et le massacre.
Aujourd'hui j'arrache les masques.
Si les états occidentaux ne lèvent pas le petit doigt pour arrêter mais au contraire soutiennent activement ce génocide ouvertement déchaîné depuis le 7 octobre 2023 mais aussi tous les précédents et certainement les prochains c'est tout simplement parce qu'ils ne le peuvent pas sans se renier. Les génocidaires d'hier et d'aujourd'hui sont issus de la même matrice mercantile, exploiteuse, destructrice, aliénante. Comment condamner l'État israélien pour ses politiques
d'occupation et de nettoyage ethnique, quand l'Europe et l'Amérique se sont construites ellesmêmes par l'expropriation des terres autochtones, l'esclavage des peuples arrachés d'Afrique, et la mise en coupe réglée de continents entiers ? Comment dénoncer le mur en Cisjordanie quand les frontières militarisées de l'Occident, de la Méditerranée aux déserts du Sud-Ouest américain, sont elles aussi des tombeaux pour les réfugiés ?
Le Capital ne condamne pas parce qu'il y reconnaît son reflet. Ses institutions économiques, ses alliances militaires, son langage diplomatique sont imprégnés de cette logique coloniale : le droit du plus fort, la valeur du profit au-dessus de la vie, la marchandisation de la terre et des corps. Le capitalisme libéral ne s'oppose pas au colonialisme : il en est la continuation méthodique, l'habillage idéologique. Les pipelines, les mines de lithium, les déforestations massives et les guerres de ressources ne sont que des répétitions actualisées de ce qui fut jadis conquête et mission civilisatrice. Ce génocide n'est pas une aberration étrangère à l'histoire des puissances occidentales. Il est l'écho de leur propre genèse, la continuation de la logique qui les a fait naître et prospérer.
Car, et surtout, l'Occident en tire profit. Chaque bombe larguée est un contrat pour ses industries d'armement - Lockheed Martin, Dassault, BAE Systems, Thalès, Raytheon, Northrop Grumman (la liste est trop longue pour être exhaustive) engrangent des milliards. Chaque missile vendu, chaque char livré, chaque avion de chasse déployé gonfle leurs bilans financiers, avec la bénédiction des gouvernements actionnaires. Chaque embargo sélectif est une opportunité de marché ; chaque reconstruction promise est un chantier pour ses multinationales ; chaque terre volée alimente les circuits agricoles mondialisés. Le sang versé irrigue ses marchés financiers, ses flux énergétiques, ses chaînes de production. Les technologies de surveillance et de contrôle développées sur le terrain - drones, systèmes biométriques, logicielsde reconnaissance faciale, techniques de « gestion » des foules - sont ensuite exportées vers les polices et les armées du monde entier. Gaza, comme les
autres Terres et Peuples sacrifiés, constituent des laboratoires mondiaux de l'oppression. Et chaque victoire coloniale sur ce front devient une ressource à exporter, à rentabiliser, à intégrer dans l'économie globale.
Ainsi, le génocide n'est pas seulement toléré : il est rentable. Chaque mort devient dividende, chaque ruine un contrat, chaque effacement culturel un marché. Tel le fantasme obscène d'un Gazasur-mer où les ruines se muent en casinos et hôtels, vitrine clinquante du capitalisme le plus
vulgaire. L'Occident ne se contente pas d'y voir son reflet. Il s'en nourrit, il en dépend, il y puise la sève qui alimente encore son empire chancelant. Car son système économique, son imaginaire politique, sa structure même demeurent coloniales : prospérer par, sur, à travers et grâce à la destruction de l'autre.
C'est là la vérité nue : le monde occidental ne soutient pas le gouvernement sionniste actuel malgré le génocide, mais parce qu'il y trouve sa continuité et son intérêt. L'horreur qui nous sidère est pour lui un modèle, une ressource, une rente, doctement maquillé en progrès, civilisation, universalité. Le capitalisme est colonialisme perpétué et étendu : il colonise les terres et le temps, les chairs et les semences, les eaux et les respirations, les esprits et les imaginaires.
Aujourd'hui je rejette leur marché de dupes.
Dans ce monde, la reconnaissance ne saurait être réduite à un geste diplomatique ou à l'octroi différé de droits. Et je vous récuse la possibilité même de l'évoquer en passant, comme une menace à une échéance dans votre planification électorale. Je vous récuse le droit de vous en vêtir comme
l'éclat d'une bienveillance qui vous honore. La reconnaissance n'est pas une concession, une faveur octroyée, encore moins un don. Elle ne peut servir de supplément d'âme au sein de votre ordre brutal, dans l'économie de votre domination. Elle n'est pas une identité tamponnée, ni un droit inscrit dans vos registres. Elle est une exigence ancrée en un principe ontologique. Être, c'est être digne. Vivre, c'est déjà exiger. Elle est un fait premier, antérieur à vos institutions, antérieur à vos crimes. Et il n'appartient à personne d'accorder ce qui est déjà inscrit dans l'être. Qui êtes-vous, bourreaux, pour prétendre m'attribuer des droits, une dignité ou mon humanité ? Je n'ai pas à les recevoir. Ils sont en moi, tissés dans le simple fait d'exister.
Votre responsabilité, vous les héritiers du désastre, est en revanche tout autre. La reconnaissance dans votre ordre capitalo-colonial ne peut avoir de sens qu'en tant que l'aveu de vos crimes, de votre dette, de votre persistance à nier la vie des autres.
C'est vous obliger à restituer ce que vous avez volé : terres, eaux, air, langues, récits, savoirs, générations. La reconnaissance exige la reddition de comptes - restitution matérielle, réappropriation culturelle, renaissance linguistique. Mais pas que.
C'est vous dépouiller de la fiction de votre innocence. C'est affronter la violente vérité de votre histoire. Reconnaître, c'est nommer vos crimes. C'est comprendre que vos richesses sont faites de nos cadavres, que vos villes brillent du feu de nos villages, que vos musées sont des tombeaux volés, que vos nations prospèrent sur la négation de la vie des autres.
La reconnaissance vous est un devoir. Celui de vous admettre violeurs de terres, génocidaires de mondes, effaceurs de mémoire, tortionnaires de diversités, oppresseurs.
La reconnaissance n'est pas un discours mais une pratique. Elle n'engage pas seulement des mots mais des transformations structurelles au niveau des savoirs, des échanges, des relations. Elle est rupture avec l'ordre économique et juridique qui vous maintient dans une arrogance suicidaire. Elle est engagement ferme à rompre avec la logique capitalo-coloniale et à choisir la vie, sous toutes ses formes.
Dans ce monde fracturé, la reconnaissance est une dette, la vôtre.
Vous la devez non seulement aux peuples et aux êtres que vous avez réduits au silence, mais à la Terre elle-même. Car votre monde est écocide. Il dévore les sols, étouffe les mers, assassine le climat et les vivants, la possibilité même d'habiter la planète.
Reconnaître n'est donc pas un apanage de puissant, ni un luxe moral : c'est votre devoir, et notre dû. Reconnaître, c'est restituer la vie à la vie.
Aujourd'hui, j'invite.
J'invite chacun.e à rompre le silence. À choisir le camp de la vie plutôt que celui de l'indifférence. À agir, chacun et chacune à la mesure de ses forces : par la parole, par la rue, par le refus, par l'organisation. J'invite à faire de nos voix des armes. De nos gestes des foyers de résistance. De nos solidarités des remparts contre la destruction. J'invite à transformer l'indignation en actes. La douleur en luttes, l'espoir en mouvement.
Car résister, c'est déjà bâtir.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Sénégal. Un pays qui ne déteste pas les femmes ?

Les violences sexistes et sexuelles se banalisent-elles au pays de la Teranga ? En effaçant le mot « Femme » du ministère qui lui était consacré, en laissant ses députés insulter des citoyennes à la télévision, le gouvernement actuel envoie un signal négatif et fait plus que douter de « l'amour » que leur porterait le pays.
Tiré d'Afrique XXI.
Lors du symposium-hommage à la chercheuse en sociologie et féministe sénégalaise Fatou Sow (1), organisé en mai à Dakar par la Fondation de l'innovation pour la démocratie, avec comme titre « La démocratie au féminin », la professeure Fatou Sow a prononcé une leçon inaugurale magistrale intitulée « Sexe, genre et démocratie : des leçons pour les Africaines ? ». Il s'agissait d'historiciser les luttes féministes africaines sous le double prisme du sexe et du genre. Une partie de cette leçon a aussi porté sur le corps des femmes africaines : « Pourquoi tant de violence à l'égard des femmes ? À qui appartient le corps des femmes ? »
Cette interrogation, chargée de tout son poids politique, renvoie au contexte de violences envers les femmes au Sénégal. En effet, depuis janvier 2024, 196 cas de viols et de meurtres de femmes ont été commis. Le 31 mai, des organisations féminines et féministes ont organisé un sit-in (2) pour dénoncer ces violences et exiger une prise en considération de la problématique par les pouvoirs publics. Ces violences, qui, dans la plupart des cas, aboutissent à des meurtres, ont poussé plusieurs centaines de femmes, toutes de noir vêtues, à se réunir et à protester. Un mémorandum, envoyé à la fin du rassemblement, a consigné toutes les exigences, dont l'une des plus urgentes demeure la révision du Code de la famille (3) ainsi que l'application d'une loi spécifique contre les féminicides.
Outre les voix – somme toute bien audibles – des féministes, il est urgent aujourd'hui de se saisir de façon ciblée et efficiente du problème de société que constituent les féminicides au Sénégal. Même si les féministes militent contre ce phénomène avec tous les moyens dont elles disposent, ces violences envers les femmes ne devraient pas être une préoccupation uniquement… féministe, mais de la société dans son entièreté.
Des « cœurs » plutôt qu'une indignation profonde
Dans la une de son édition du 7 août (4), le quotidien L'Observateur relatait une affaire de cambriolage ayant entraîné un viol. Lors du casse de la villa de l'architecte béninoise Lydia Assani, les malfrats, en plus de dérober le coffre-fort, ont violé sa fille âgée de 28 ans. Ce énième viol, en plus de susciter colère et indignation, notamment sur les réseaux sociaux, vitrine de nos existences, nous fait nous poser la question suivante : ce pays qu'est le Sénégal aime-t-il les femmes ? L'un des lieux communs les plus tenaces dans la psyché collective sénégalaise, c'est l'amour (charnel, filial, sororal, et même religieux) porté aux femmes.
D'un point de vue exogène, on s'accorde à dire que les femmes sénégalaises sont aimées. Ce qui crée une certaine contradiction entre le « tone policing (5) », ou « police du ton », et la manière absolument taboue dont on veut discuter de la problématique des violences sexuelles.
Que l'on soit féministe ou non, à chaque fois que le sujet des féminicides ou un autre type de violence (physique ou psychique) est abordé, l'amour est brandi pour censurer les propos et atténuer l'indignation. Mais le problème demeure et la violence s'accroît. En atteste la série de vidéos faite par l'actrice Halima Gadji, où elle dénonce clairement les abus sexuels dont elle a été victime. Mettant ces accusations sur le compte de la dépression dont elle souffre depuis quelques années, la plupart des personnes ayant assisté en ligne à ses confidences ont détourné le regard et préféré envoyer des « cœurs » plutôt qu'une indignation profonde. Voilà le Sénégal d'aujourd'hui…
Les femmes considérées comme des subalternes
Le Sénégal, ce pays où une femme est tuée parce que le repas n'a pas été préparé, ce pays où une femme ne peut pas avorter de manière médicalisée en cas de viol ou d'inceste malgré la ratification du Protocole de Maputo (6) (qui garantit le droit à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction des femmes), ce pays où, quand on s'insurge contre le faible pourcentage de femmes dans les instances de décision, on nous appose l'argument de « la compétence »... Ce pays n'aime pas les femmes.
En juin 2023, à la suite au verdict du procès de Adji Sarr contre Ousmane Sonko, nous, membres du Réseau des féministes du Sénégal, avions écrit une tribune nous indignant de ce verdict arbitraire, car l'accusation de « viol » avait été requalifiée en « corruption de la jeunesse ». Car il nous a semblé inconcevable qu'au moment où le Sénégal se glorifie de l'exception démocratique qui a émaillé sa trajectoire politique, installant chaque régime de façon pacifique, les femmes soient toujours à la traîne, traitées comme des subalternes, leur corps servant à assouvir les pulsions masculines, leurs préoccupations jamais prises en compte.
Aujourd'hui, une misogynie d'État, portée aussi bien par les hommes que par les quelques femmes qui travaillent avec eux, s'est installée à la tête du Sénégal. Car il est utile de noter que les maigres acquis en matière de droits des femmes que le Sénégal a eus – grâce à l'action conjointe des associations féminines et féministes – sont en train de voler en éclats, en raison de l'inaction des autorités face aux violences perpétrées sur les femmes, de la montée en puissance du masculinisme sur toutes les plateformes médiatiques mais aussi à cause de la banalisation des violences sexistes et sexuelles, dont le traitement médiatique est plus que problématique.
À la télévision, Adji Sarr est traitée de « prostituée »
Pour rappel, en janvier 2020, la loi 2020-05 (7), portant aux rangs de crimes le viol et la pédophilie, a été promulguée, fruits de plusieurs années de plaidoyer de nombreuses activistes, chercheuses et personnalités officielles. En 2023, le procès opposant Adji Sarr à Ousmane Sonko avait été l'occasion de l'appliquer, mais que nenni. En août, les affaires de viols continuent de faire les gros titres de la presse, sans aucune autre réaction que des indignations de façade. À titre d'exemple, toutes les fois où l'affaire Adji Sarr-Ousmane Sonko est mentionnée, comme ce fut le cas en juillet entre le chroniqueur Badara Gadiaga et le député de la majorité Amadou Bâ sur le plateau de Télé Futurs Médias (8), la jeune femme est traitée de « prostituée ». L'échange houleux qui a suivi dans l'émission, et surtout l'épilogue judiciaire, à savoir l'arrestation de l'animateur (toujours en détention provisoire), sont une fois de plus la preuve de la violence institutionnelle contre les femmes.
Les féministes sénégalaises, avec toute la charge qu'elles portent sur leurs épaules, sont quasi les seules qui réagissent et pointent du doigt le climat de banalisation des violences sexistes et sexuelles dans lequel est plongé le Sénégal. Cette quasi-communauté légale fait un travail de veille qui aurait normalement dû être celui du ministère de la Famille et des Solidarités, qui, rappelons-le, s'appelait auparavant ministère de la Femme, de la Famille et du Genre. Cette disparition des mentions « Femme » et « Genre », au profit de la « Famille », a inauguré l'effacement systémique des femmes sénégalaises de l'espace public. Cette décision, largement partagée par les soutiens du régime en place, a installé des lendemains plus qu'incertains pour les droits des femmes au Sénégal. En les effaçant des sphères de décision, en les violant et en les tuant dans la plus grande impunité, seuls demeurent les savoirs féministes disruptifs pour contrecarrer cette violence.
Tant que l'on ne créera pas au Sénégal un cadre sociopolitique et légal pour prendre en considération cette cause d'intérêt national que constituent les violences faites aux femmes, tant que l'on continuera d'étouffer les voix discordantes qui s'élèvent pour protester, tant que l'on ne sortira pas de l'effet spectateur pour enfin diffuser les responsabilités, les féminicides continueront d'être une réalité dans ce pays. Et que l'on ne vienne pas nous parler d'amour et de bienveillance, car comment croire sinon que ce pays ne déteste pas les femmes ?
Notes
1- « Symposium international en hommage à la professeure Fatou Sow : démocratie au féminin », 15-17 mai 2025, voir ici.
2- Moussa Ndongo, « Féminicides au Sénégal : les organisations féministes exigent des lois plus strictes et une action immédiate de l'État », Pressafrik, 31 mai 2025, à lire ici.
3- L'article 152 du Code de la famille réaffirme le rôle de l'homme en tant que chef de famille en stipulant que « La notion de puissance paternelle figure encore dans le Code de la famille, qui prévoit que celle-ci appartient conjointement au père et à la mère, mais est exercée durant le mariage par le père, en qualité de chef de famille ».
4- Voir la une du quotidien L'Observateur du 7 août ici.
5- « Tone policing », ou « police du ton », est une attitude et un type d'argument ad personam dénonçant la manière de s'exprimer d'une personne plutôt que le contenu factuel ou logique de ses propos, afin de la discréditer.
6- L'instrument communément appelé « Protocole de Maputo » garantit, de façon spécifique, le droit à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction des femmes. Il résulte clairement de l'article 14.2 que les États-parties s'engagent à prendre des mesures appropriées pour autoriser l'avortement médicalisé, en cas d'agression sexuelle d'une manière générale et de viol en particulier, en cas d'inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie de la mère ou du fœtus. Il s'agit là du tout premier instrument juridique régional à reconnaître l'avortement médicalisé à certaines conditions comme un des droits humains des femmes, dont elles devraient jouir sans restriction et sans craindre des poursuites judiciaires. Pour en savoir plus, lire ici.
7- « Loi criminalisant le viol et la pédophilie », à retrouver sur le site du gouvernement.
8- L'émission « Jakaarlo Bi » du 10 juillet 2025 est disponible ici.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Au Kenya, les féminicides sont devenus un fléau

L'absence de statistiques fiables et de stratégie cohérente pour lutter contre les féminicides au Kenya a laissé place à une culture d'insécurité quotidienne pour les femmes dans le pays.
Tiré d'Afrique XXI. Cet article a été initialement publié sur le site Africa Is a Country, avec lequel Afrique XXI a conclu un partenariat.
Traduit de l'anglais par Michael Pauron.
Lorsque je me suis installée en Afrique du Sud, en 2021, le pays figurait parmi les endroits les plus dangereux pour les femmes. Avec l'un des taux de féminicides les plus élevés au monde, le gouvernement sud-africain avait déclaré une crise du féminicide à la fin de l'année 2019. Au moment de cette déclaration, la presse ne parlait que du viol et du meurtre d'Uyinene Mrwetyana, une étudiante de 19 ans tuée par Luyanda Botha, un employé du bureau de poste où elle se rendait.
Les données du Service de police sud-africain pour 2018-2019 montraient qu'une femme était assassinée toutes les trois heures. Inquiète pour ma sécurité, une amie de Nairobi m'a proposé de m'héberger : « Juste pour quelques semaines, m'a-t-elle dit, jusqu'à ce que tu sois installée. »
Quatre ans plus tard, je suis de retour au Kenya, en pleine crise des féminicides. Une amie me parle d'une collègue en Suisse, une professionnelle en milieu de carrière, qui envisageait de déménager à Nairobi mais qui hésite désormais : le pays n'est pas un endroit sûr pour les femmes, d'après les gros titres (1) des journaux.
« Il y a plus d'une femme tuée par jour »
Judy Ngina, chercheuse en études de genre à l'université Johns-Hopkins, aux États-Unis, mène une enquête pilote sur les féminicides au Kenya et en Tanzanie. Son étude vise à identifier les lacunes dans les lois existantes, les difficultés rencontrées dans les poursuites judiciaires et les obstacles auxquels se heurtent les survivantes dans leur quête de justice. « En réalité, il y a plus d'une femme [tuée] par jour, dit-elle, mais comme on ne peut pas compter “les personnes de référence”, les conclusions doivent indiquer “une femme est tuée par jour”. »
En raison du manque de données centralisées, les statistiques sur le taux de féminicides au Kenya varient, mais toutes dressent un tableau sanglant. Selon les médias (2), un rapport publié en avril par le Service national de police du Kenya (NPS) a révélé qu'en moyenne 44 femmes sont tuées chaque mois dans le pays, soit plus de 1 par jour. Le rapport du NPS, remis (3) à un groupe de travail présidentiel composé de quarante-deux membres récemment nommés pour travailler sur les violences basées sur le genre (Gender-based violence, GBV), a également recensé 129 femmes et filles, des bébés aux personnes âgées, tuées au cours des trois premiers mois de 2025.
Pour mettre les choses en perspective, 127 féminicides (4) ont été signalés pour l'ensemble de l'année 2024. Bien que le Kenya ne recueille pas de données sur les féminicides en tant que crime distinct, les données du NPS ont révélé que 60 % des meurtres de femmes et de filles signalés ont été commis par des membres de la famille, et que la majorité de ces meurtres ont eu lieu au domicile de la victime. Les espaces publics sont le deuxième lieu le plus fréquent, représentant 20 % des cas. Ce chiffre est légèrement supérieur à celui des zones isolées, qui représentent 15 % de tous les meurtres. Il ne fait aucun doute que « cette violence ressemble désormais à une guerre menée par le pays contre ses femmes », pour reprendre les mots d'une militante sud-africaine citée en 2019 par Voice of America, dans un article (5) sur la situation en Afrique du Sud. Les lignes de front s'étendent aux maisons et aux rues.
Une normalisation des autres formes de violence
« Il est effrayant d'être une femme au Kenya en ce moment », explique Ngina. « Si la majorité des cas de féminicides signalés sont le fait de partenaires, nous constatons également un sentiment croissant d'insécurité même dans les espaces publics. »
Si le féminicide, c'est-à-dire le meurtre de femmes ou de filles en raison de leur sexe, est l'acte de violence ultime à leur encontre, son augmentation coïncide souvent avec une normalisation croissante d'autres formes de violence à l'égard des femmes, notamment le harcèlement sexuel, le viol et la violence sexiste en ligne. « Le féminicide n'est souvent pas le premier acte de violence », explique Ngina. « Si nous décourageons les signalements, ces incidents finissent par aboutir à des féminicides. »
Ngina rappelle également l'incident récent d'une jeune femme droguée et agressée dans un bus alors qu'elle voyageait de Nairobi à Mombasa. Lorsqu'elle s'est réveillée, désorientée, à l'hôpital, les responsables, notamment les infirmières, ont tenté de dissuader la jeune femme de signaler l'affaire.
Une longue liste d'organismes gouvernementaux...
Il a fallu un lobbying intense de la part de la société civile et des groupes féministes, organisés sous la bannière #EndFemicideKE, pour que le président William Ruto annonce enfin un groupe de travail sur les violences sexistes... Treize mois après que les femmes kényanes et leurs alliés sont descendus dans la rue pour réclamer des mesures urgentes. Les marches de janvier 2024, qui ont eu lieu à la suite des meurtres brutaux de Rita Waeni, 20 ans, et Starlet Wahu, 26 ans, dans des locations de courte durée à Nairobi, ont appelé le gouvernement kényan à déclarer le féminicide comme une « urgence nationale », une désignation qui obligerait le pouvoir exécutif à lancer une réponse immédiate et coordonnée, à allouer des fonds d'urgence et à émettre des directives aux ministères de l'Intérieur, de la Santé, de la Justice et de l'Éducation afin de traiter la crise de manière urgente.
Au lieu de cela, le groupe de travail technique présidentiel rejoint une longue liste d'organismes gouvernementaux et d'abréviations chargés de réduire la violence sexiste dans le pays. Il s'agit notamment du Bureau du directeur des poursuites publiques (ODPP), du ministère du Genre et de l'Action positive, du Comité national du groupe de travail sur la violence sexiste, de la Direction de la lutte contre la violence sexiste, du Centre national de recherche sur la criminalité et de la Politique nationale de prévention et de lutte contre la violence sexiste... En réalité, les bonnes idées ne manquent pas pour lutter contre les féminicides ou la violence sexiste au Kenya ; ce qui manque aux femmes kényanes, ce sont des acteurs de bonne foi.
Pour cet article, j'ai discuté avec une autre chercheuse, Pendo (le prénom a été changé), qui a demandé à rester anonyme. Elle explique que dès novembre 2020, huit mois après le début de la pandémie de Covid-19, les chercheurs, les décideurs politiques et les acteurs de la société civile suivaient de près une deuxième pandémie. Cette « pandémie cachée », ou « pandémie fantôme (6) », comme l'a qualifiée ONU Femmes, touchait les filles et les femmes, et tous les types de violence sexiste, en particulier les cas de violence domestique, étaient en augmentation.
Des statistiques éparpillées
L'escalade de la violence résultant des mesures de confinement et du stress psychologique liés à la pandémie a clairement montré que le domicile est souvent l'endroit le plus dangereux pour les filles et les femmes. En réponse à cette autre pandémie cachée, Pendo explique qu'une coalition d'ONG et d'organisations de défense des droits humains s'est associée au département d'État kényan chargé des questions de genre pour proposer une initiative visant à améliorer la collecte et le partage de données sur la violence sexiste. Le réseau de partage d'informations permettrait de suivre en temps réel les données relatives aux incidents de violence sexiste, aux victimes et, surtout, aux auteurs. « Sans données, ce ne sont que des récits », explique Pendo, qui faisait partie du consortium.
S'il avait été couronné de succès, le projet du département d'État aurait considérablement amélioré le système kényan en matière de signalement et de suivi des violences sexistes. Actuellement, le signalement est réparti entre plusieurs institutions qui collectent à la fois des données administratives et privées, notamment le Bureau national des statistiques du Kenya, la Fédération des femmes juristes du Kenya, le Bureau du directeur des poursuites publiques, la Commission nationale pour l'égalité des sexes, la Direction des enquêtes criminelles, le Fonds des Nations unies pour la population, ONU Femmes et Healthcare Assistance Kenya 1195. Cela limite la diffusion et l'utilisation des données, tout en entravant la coordination de la réponse nationale. Le système de collecte et d'analyse des données proposé serait conçu pour identifier et traiter les contraintes liées à la « réponse à la violence sexiste aux niveaux individuel, institutionnel et communautaire », reprend Pendo.
Elle ajoute : « Il est vraiment difficile de suivre les affaires depuis le moment où elles sont signalées jusqu'à leur passage devant les tribunaux. » Actuellement, si une femme se présente au poste de police pour signaler une violence sexiste et qu'elle a la chance de trouver un policier compréhensif ou un bureau dédié aux questions de genre, sa plainte est enregistrée à la main et classée dans un dossier au poste. Lorsque les victimes doivent se présenter en personne au poste de police, sachant que leur témoignage sera écrit à la main et conservé dans un bâtiment public, les risques d'exposition, de représailles ou d'ingérence dans l'affaire semblent particulièrement élevés. Les rapports manuscrits comme celui-ci sont ensuite accumulés au poste de police local avant d'être transmis à l'ODPP, à Nairobi, qui gère une base de données nationale sur les crimes. L'accès à cette base de données n'est pas rendu public, sauf dans les rapports annuels de l'ODPP, qui n'identifient pas les auteurs, ce qui amène certains à se demander : « Où sont les meurtriers ? »
« Nous dépendons des Bill et Melinda Gates de ce monde »
Si le projet imaginé pendant la Covid-19 avait été couronné de succès, il y aurait eu quatre années de données centralisées pour alimenter l'élaboration des politiques sur la crise nationale des féminicides. Que ce soit en raison d'un manque de volonté politique ou de priorités de financement concurrentes, le projet du département d'État n'a pas abouti, et, en l'absence d'une déclaration d'urgence nationale, explique Pendo, le département d'État ne dispose pas des fonds nécessaires pour mener à bien ce type de programmes de son propre chef, « ce qui signifie que [nous] dépendons des Bill et Melinda Gates de ce monde ».
L'amélioration du partage et de l'analyse des données sur la violence sexiste et le féminicide est un objectif extrêmement facile à atteindre pour les acteurs de bonne foi au sein du gouvernement. Une telle base de données permettrait d'identifier les schémas de violence et les récidivistes, ce qui contribuerait ainsi à la sécurité et à la survie des femmes. L'analyse des statistiques sur la violence sexiste et le féminicide permettrait également de mieux comprendre une question politique peu étudiée et d'aider ainsi les acteurs concernés à mieux surveiller et orienter leurs interventions.
Malgré tout, nous disposons déjà de suffisamment de données pour agir. Avec 60 % des féminicides commis dans le monde à domicile et, surtout, par des membres de la famille et des partenaires intimes, lutter contre la crise des féminicides au Kenya signifie également s'attaquer à la famille en tant que lieu de violence. Les systèmes policier et judiciaire ne suffisent pas à relever le défi qui consiste à faire de nos foyers des lieux sûrs pour les femmes et les filles. Compter sur eux – uniquement ou principalement – revient à renoncer à ses responsabilités et à nier aveuglément le travail nécessaire pour créer et entretenir des environnements familiaux sûrs, sains et propices dans les sociétés patriarcales.
Comme l'écrit Andrea Smith dans The Revolution Starts at Home (Aka Press, 2016) : « La question n'est pas de savoir si une victime doit appeler la police, mais plutôt pourquoi nous n'avons pas laissé aux victimes d'autre choix que d'appeler la police. »
Notes
1- Lire par exemple Wedaeli Chibelushi, « Kenyan man allegedly caught carrying wife's body parts in backpack », BBC, 22 janvier 2025.
2- Voir notamment Citizen TV Kenya, « Police reveal 129 women killed in the past three months », 9 avril 2025, disponible en vidéo ici.
3- Awino Okech, « Femicide in Kenya : William Ruto has set up a task force – feminist scholar explains its flaws », The Conversation, 29 janvier 2025.
4- Africa Uncensored, Femicide in Kenya : 2024 Was the Worst Year on Record, 24 janvier 2025. Le communiqué est disponible ici.
5- Thuso Khumalo, « South Africa Declares “Femicide” a National Crisis », VOA, 20 septembre 2019.
6- « UN Women raises awareness of the shadow pandemic of violence against women during COVID-19 », 27 mai 2020. Lire le communiqué ici.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Cameroun. Les féminicides enflamment le débat public

Si ces crimes sexistes sont davantage visibilisés, grâce notamment à l'action des militantes féministes, leur nombre reste très sous-estimé, dans une société fortement patriarcale, démunie d'un instrument coercitif adapté, et qui abandonne les familles des victimes à d'interminables et vaines démarches pour obtenir justice.
Envoyé spécial à Yaoundé et à Douala.
Tiré d'Afrique XXI.
En cette matinée du 9 juin, le réveil est particulièrement difficile pour Parfait Eli depuis l'enterrement de sa sœur de 24 ans. Jacqueline Essimbi, en poste à la présidence de la République du Cameroun, a été mortellement frappée par son compagnon, l'officier de police Bertrand Essomba. Dans le domicile familial de la défunte, au quartier Ahala Barrière, dans l'arrondissement de Yaoundé 2, cette tragédie est perçue comme un drame « qui pouvait être évité », selon les mots de Parfait Eli.

« Il n'en était pas à sa première tentative avec Jacqueline, témoigne-t-il. On avait beau lui dire que cette histoire allait mal se terminer, elle n'écoutait pas. Plusieurs personnes nous ont confirmé que c'était un multirécidiviste et qu'il battait ses compagnes, y compris pendant leur grossesse. Il y avait comme une force qui la retenait auprès de cet homme. Je ne sais pas si ce sont les deux enfants qu'ils ont eus ensemble, aujourd'hui âgés de 1 an et de 4 ans, mais voilà qu'ils ont perdu leur mère. » Les circonstances de la mort de la jeune femme restent floues. « Elle a débarqué ici fin avril avec toutes ses affaires. Elle souffrait déjà de problèmes respiratoires. C'est sa fille de 4 ans qui a fini par nous avouer que sa maman avait essuyé une bastonnade de son papa. Il lui a sauté sur la poitrine. Nous l'avons conduite à l'hôpital, où elle est malheureusement décédée le 13 mai. »
En fuite, l'officier de police suspecté a été rattrapé par la gendarmerie, qui a ouvert une enquête sur laquelle la famille n'a pas souhaité communiquer. Pour Parfait Eli, il faut « que justice soit faite et que jamais plus une autre femme ne puisse être victime de cet homme ! ».
Des chiffres élevés et un climat d'impunité
Dans un document (1) publié le 8 mars 2021 à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l'Institut national de la statistique (INS) du Cameroun indique que 45,5 % des femmes interrogées ont subi, à un moment de leur vie, une forme de violence. Les violences conjugales sont également constatées chez les femmes enceintes, avec un pourcentage de 5 % au niveau national et de 8 % en milieu rural. Mais les spécialistes estiment que ces chiffres sont en deçà de la réalité, nombre de victimes renonçant à déposer plainte pour des raisons culturelles, pratiques et financières. De janvier à mi-août de cette année, le collectif d'associations Stop féminicides 237 a répertorié quarante féminicides.
Le Code pénal camerounais punit de cinq à dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 à 200 000 francs CFA (152 à 304 euros) les auteurs de viols. Les violences sur femmes enceintes, en cas de mort de l'enfant à naître, sont punies de la même peine de prison et d'une amende de 100 000 à 2 millions de francs CFA. Les blessures causées par des violences sont punies de six jours à quinze ans d'emprisonnement, peine aggravée en cas d'utilisation d'une arme ou d'une substance dangereuse. Mais cet arsenal judiciaire reste sous-utilisé, et la violence conjugale et le viol souvent impunis.
Les militantes féministes réclament donc l'adoption d'un texte spécifique pour lutter contre les féminicides permettant une prévention et une répression plus efficaces. Dans ce cadre, une rencontre entre Stop féminicides 237 et la Commission des affaires culturelles, sociales et familiales de l'Assemblée nationale s'est tenue le 18 juin. Plus largement, les activistes ont recommandé l'adoption rapide de la loi contre les violences sexistes et sexuelles (en chantier depuis novembre 2023), la prise en charge psychosociale des enfants des victimes et l'abrogation des lois dites « féminicidaires », qui permettent au mari, par exemple, d'assurer la gestion totale des biens du foyer et d'empêcher sa femme de travailler. Elles demandent aussi la mise sur pied d'un tribunal des affaires domestiques pour pallier la lenteur de la chaîne judiciaire, la généralisation des « gender desk » promis par le gouvernement et la formation systématique des policiers.
Un phénomène « en forte recrudescence »
« Il faut continuer à se faire entendre au cœur même du système législatif de notre nation », plaide Viviane Tathi, présidente de l'association Sourires de femmes-Cameroun, spécialisée dans les questions de violences faites aux femmes. Avant la dernière audition à l'Assemblée, Stop féminicides 237 avait plaidé en février devant la chambre basse du Parlement pour dénoncer « la lenteur des institutions ».
Au ministère de la Promotion de la femme et de la Famille, on affirme vouloir se doter de tous les moyens pour prendre le dessus sur un phénomène en forte recrudescence. Une étude visant la mise en place « des éléments inclusifs et participatifs » a été lancée le 7 juin par la ministre, Marie-Thérèse Ondoua Abena. Mais, selon des sources au ministère qui ont souhaité garder l'anonymat, des obstacles subsistent, notamment sur le plan financier.

Sur la table de Viviane Tathi, le programme des obsèques de Liliane Lucie Alima Mbazoa, 20 ans, plus connue sous le pseudonyme de « Mabel ». Elle était en couple depuis quatre ans avec un homme de huit ans son aîné. En dépit des interventions de ses frères, le compagnon de la jeune femme avait toujours réussi à la convaincre de revenir. En mai dernier, il l'a aspergée d'essence après l'avoir accusée d'avoir volé son portefeuille. C'est une voisine du couple qui a cassé la porte de la chambre envahie par les flammes et conduit la victime à l'hôpital de Sa'a, dans le département de la Lekié, avant son transfert à Douala, où elle a finalement succombé à de graves brûlures. Le meurtrier est actuellement détenu à la prison de Monatélé. Selon les membres de la famille approchés par Sourires de femmes, les deux premières audiences dans le cadre de cette affaire se sont soldées par des renvois.
Au quartier Dispensaire Messassi, vers la sortie ouest de Yaoundé, au lieu-dit « Derrière Neptune », une autre famille pleure toujours la disparition de Christiane Bele Etoundi. Atteinte de drépanocytose et enceinte de quelques semaines, la jeune femme de 28 ans a succombé le 26 mai aux coups de son concubin, Abdou Ngouongou, dans la maison où elle vivait avec lui.
« C'est ton compagnon qui va te tuer, pas la maladie »

À notre arrivée, la tension est palpable. Seule une enceinte laisse échapper une musique de circonstance. Bernadette, l'aînée de la victime, a la mine crispée. Elle jette un coup d'œil sur la photo de sa défunte sœur avant de raconter son histoire :
- Le 9 mai, elle est a subi la bastonnade de son petit ami. Elle a été transportée en urgence à l'hôpital du district de Messassi, où des soins lui ont été immédiatement administrés. Malheureusement, elle n'avait pas assez d'argent pour poursuivre le traitement prescrit. Je n'ai été informée qu'une semaine plus tard. Je suis venue ici, au domicile familial, et j'ai pris connaissance de ses ordonnances. Après les soins, elle semblait se rétablir. Mais la situation s'est aggravée par la suite, jusqu'à son décès à l'Hôpital central de Yaoundé le lendemain de son admission. Son compagnon l'avait déjà frappée. La première fois, je l'avais emmenée à l'hôpital récupérer un certificat médical puis déposer une plainte qui n'a jamais abouti : son copain connaissait des policiers qui ont réussi à noyer toutes les plaintes. Je l'ai toujours prévenue que ce ne serait pas la maladie qui la tuerait mais son compagnon.
Ce dernier est toujours parvenu à convaincre sa victime de retourner dans ses bras. Il a essayé de s'enfuir après son crime avant d'être rattrapé par la police à Kye-Ossi, une localité frontalière avec la Guinée équatoriale, à 274 km de chez lui. Il a été incarcéré à la prison centrale de Yaoundé en attente de son jugement, après plusieurs semaines passées dans les locaux de la brigade d'Emana.
Des victimes abandonnées dans les morgues
Le 1er avril, la condamnation à cinq ans de prison avec sursis et à une amende de 53 000 francs CFA du meurtrier de Diane Yangwo a mis le feu aux poudres. Cette enseignante a succombé aux coups de son mari le 18 novembre 2023. Après ce verdict dénoncé comme trop clément, une vague d'indignation a traversé l'opinion publique. Libéré en première instance, le prévenu était absent lors de son procès en appel, qui s'est tenu en juin...
Sur les quarante cas de féminicides enregistrés de janvier à mi-août, à peine une dizaine font l'objet de procédures judiciaires. « Certaines familles pensent, à tort, qu'il suffit que l'affaire soit rapportée par les médias pour qu'une procédure en justice soit déclenchée, explique Viviane Tathi. D'ailleurs, il n'est pas rare que des familles découvrent que les auteurs de crimes contre leurs filles sont libres alors qu'elles les croient en prison. » À l'origine de ce dysfonctionnement, l'absence d'accompagnement des familles, souvent abandonnées à elles-mêmes et, pour certaines, dépourvues des moyens financiers nécessaires pour suivre de longues procédures.
Dans le cas du féminicide de Christiane Bele Etoundi, la jeune femme enceinte décédée en mai, la première plainte déposée au commissariat d'Emana, à Yaoundé, n'a pas abouti. Si le dépôt d'une plainte est théoriquement gratuit, les agents réclament souvent « du carburant » (un pot-de-vin) pour se déplacer dans le cadre d'une enquête. Face à ces difficultés, les associations proposent aux familles de les aider dans leurs démarches et de les mettre en contact avec leurs avocats.
Beaucoup de victimes sont issues de milieux sociaux modestes. Le peu de revenus dont dispose la famille est souvent absorbé par les frais de morgue et les obsèques. Des corps sont d'ailleurs parfois abandonnés par les familles incapables d'assumer la facture de la morgue, qui s'allonge au fur et à mesure que l'enquête se prolonge.
« Une société en pleine crise symbolique »
Marthe Adjanie Nguimsahmé est doctorante en anthropologie du développement à l'université de Yaoundé I. Les féminicides sont « aussi vieux que le monde dans nos sociétés patriarcales », dit-elle. Mais la « visibilité » de ces crimes et le fait qu'ils « suscitent désormais une indignation publique » sont des phénomènes nouveaux. Les communautés, du fait de l'archétype patriarcal qui parcourt la société, ont intégré « une certaine violence domestique ou conjugale dans les normes sociales et familiales », poursuit-elle. Les relations entre les hommes et les femmes sont régies par des logiques de « hiérarchisation genrée », où l'homme est perçu comme le détenteur de l'autorité et de la légitimité décisionnelle dans le foyer. Les féminicides sont la conséquence de cette banalisation masquée par le silence familial, justifié par une lecture culturelle et morale des conflits conjugaux.
Au Cameroun comme ailleurs, la place du secret familial est importante, car il protège l'image de la famille. Les associations de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles sont confrontées à cette dure réalité : « Il arrive que ce soit la famille de la victime qui s'oppose à toute poursuite judiciaire », dit Viviane Tathi. Les victimes sont souvent enterrées en catimini, car les familles redoutent que les enfants soient abandonnés financièrement en cas d'arrestation du père. Pour l'éviter, elles mentent sur les causes de la mort.
On est « en pleine crise symbolique », analyse Marthe Adjanie Nguimisahmé : « L'archétype du mari protecteur, chef du foyer, est mis à mal. Dans l'imaginaire traditionnel, l'homme est le gardien de la paix domestique. Lorsqu'il est présenté comme l'assassin de sa femme, son mandat symbolique est trahi. » Peu de familles sont prêtes à franchir le pas du scandale, confirme Viviane Tathi. Dans certaines communautés, un procès est perçu comme une perspective de honte. Les activistes assurent œuvrer à la « réduction de cet isolement symbolique » par un appui militant, juridique et social.
« De la possession plutôt que de l'amour »
Pour la dirigeante de Sourires de femmes-Cameroun, la cause première des féminicides dans le pays est liée à « l'autonomisation croissante des femmes ». Certains hommes recourent à la violence pour affirmer leur domination : « La plupart des féminicides sont nourris par la volonté de l'homme de contrôler, voire de posséder à sa guise les rentrées financières de sa conjointe. »
Le mari et bourreau de Diane Yangwo voulait ainsi la contraindre à contracter un prêt. Le compagnon de Jacqueline Essimbi exigeait qu'elle lui remette son argent, et il ne voyait pas d'un bon œil le fait qu'elle contribue à la construction d'une église dont elle était membre. Une autre jeune femme ayant échappé récemment à un féminicide nous a confié, sous le couvert de l'anonymat, que son mari l'avait poignardée parce qu'elle ne voulait pas lui remettre son fonds de commerce. En somme, l'assassinat des femmes dans l'espace familial relève davantage de la « possession que de l'amour », conclut Viviane Tathi.
Elle estime qu'il y a urgence à nommer les féminicides et à punir sévèrement leurs auteurs pour éviter que les communautés continuent de croire que l'impunité « protège l'équilibre familial et les enfants ». Certains auteurs séjournent tout juste deux semaines en prison, du fait de « marchandages » de plus en plus fréquents sur la chaîne pénale et « qui occultent la vérité du droit ». Les familles ne sont pas toujours au fait des procédures qui peuvent, même en cas de flagrant délit, traîner une année, voire plus. Selon Stop Féminicides 237, des crimes remontant à 2023 n'ont toujours pas été jugés.
Notes
1- « Leadership féminin : pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Que disent les statistiques ? », Institut national de la statistique, 36e édition, le PDF est disponible ici.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Quand les dictatures africaines tendent la main à Trump

L'objectif des USA est d'arracher aux pays africains l'accueil des personnes expulsées, certains despotes ont déjà accepté.
Le Sud Soudan, l'Eswatini, le Rwanda et dernièrement l'Ouganda, outre d'être des dictatures ont un autre point en commun, la signature d'un accord avec les USA pour accueillir les personnes renvoyées. Point d'orgue de la politique d'harcèlement des immigrés de Trump.
« Pressions considérables »
La décision de la Cour suprême des USA où les juges conservateurs ont la majorité, a validé les mesures d'expulsion massive au mépris des conventions internationales que les USA ont pourtant ratifiées. Celle de 1984 qui interdit la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, tout comme la convention de 1951 et son protocole de 1967 qui proscrivent le renvoi des réfugiés vers des pays qui ne respectent pas les droits humains. Les premiers expulsés en Eswatini ont déjà vu leurs droits bafoués. Ainsi le Centre de contentieux de l'Afrique australe a lancé une requête parce que cette monarchie absolue avait refusé qu'ils puissent accéder à leur avocat.
L'objectif de l'administration Trump est de passer des accords pour l'accueil des personnes bannies avec 58 pays dont 31 en Afrique. Yusuf Maitama Tuggar, le ministre des affaires étrangères du Nigeria, confirme que des pressions considérables ont été exercées à l'encontre de son pays qui a tout de même maintenu son refus.
Une aubaine pour les dictateurs
Les conventions restent secrètes. Cependant certaines ont fuité et ne sont guère rassurantes. Au Sud Soudan, gangréné par des milices armées, le président Salva Kiir partie prenante d'une guerre civile qui a déjà causé la mort de dizaines de milliers de personnes a fait part de ses exigences lors des négociations. La levée des sanctions contre un des trois hauts responsables du régime, l'annulation de l'interdiction des visas, le déblocage d'un accès à un compte bancaire basé aux États-Unis et le soutien aux poursuites judiciaires contre son principal opposant, le premier vice-président Riek Machar, toujours assigné à résidence.
Quant au Rwanda où les tortures sont fréquentes dans les prisons, le président Paul Kagamé se veut un allié privilégié du camp occidental. Cela lui permet de se faire élire régulièrement avec des scores de 98% et de mener une guerre d'agression contre le Congo voisin sans crainte de mesures de rétorsion.
Pour le président ougandais, pays où l'homosexualité peut être passible de la peine de mort, signer l'accord avec les USA est une assurance. La certitude que l'administration états-unième ne sera pas trop regardante sur la répression qui entoure l'élection présidentielle qui entérinera un septième mandat.
Que cela soit l'Union Européenne qui utilise des pays africains pour externaliser ses frontières, ou les USA qui tentent de leur imposer l'accueil « des personnes parmi les plus méprisables » selon la formule du secrétaire d'état Marco Rubio, les deux s'accommodent parfaitement des régimes despotiques africains au détriment des peuples.
Paul Martial
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Ukraine : la russification forcée des territoires occupés

La population des régions administrées par Moscou a jusqu'au 10 septembre pour partir ou « régulariser » sa situation, c'est-à-dire adopter le passeport russe. Beaucoup de gens décident de devenir russes afin de préserver leurs biens et leurs droits fondamentaux, tels que la santé.
https://vientosur.info/ucrania-la-rusificacion-a-marchas-forzadas-de-los-territorios-ocupados/
4 septembre 2025
Kiev (Ukraine). – Jusqu'au bout, Ihor* a résisté aux pressions russes. Après trois mois d'occupation, les soldats de Moscou ont d'abord demandé à l'adolescent, alors âgé de 15 ans, de prendre un passeport russe pour remplacer le laissez-passer nécessaire pour se rendre à Louhansk depuis son village, occupé en 2022. Avant lui, sa mère n'avait pas d'autre choix, car le passeport russe était le seul moyen de continuer à percevoir les prestations liées à son handicap.
Puis, l'école a refusé de remettre à Ihor son certificat d'études, équivalent au diplôme. Un refus poli dans un premier temps, suivi de menaces : « Si tu n'acceptes pas d'avoir un passeport russe, tu recevras d'abord une amende, puis ta mère sera privée de ses droits parentaux ».
Face à cette pression, Ihor a finalement accepté les papiers de l'occupant à l'été 2023, dans un bureau flanqué de drapeaux russes. « Ce n'est pas une simple formalité administrative : les fonctionnaires nous font jurer de défendre ce passeport « avec notre sang » », raconte Ihor, qui a fui la zone occupée par crainte d'être mobilisé dans l'armée russe. Réfugié à Kiev depuis mai, Ihor a aujourd'hui 18 ans.
D'autres témoins ont raconté à Mediapart avoir été contraints de chanter l'hymne russe lors de la remise des passeports, parfois devant les caméras.
Après les discussions en Alaska, le Kremlin espère légitimer son contrôle sur la région et même récupérer les 25 % de la région de Donetsk qu'il ne contrôle pas, en obtenant de l'Ukraine la reconnaissance de ces territoires comme russes, en échange d'un cessez-le-feu. Si, pour l'instant, Kiev et ses alliés restent réticents, le Kremlin est déjà en train de russifier ces territoires en intensifiant la pression sur les habitants pour qu'ils adoptent le passeport russe.
Le 20 mars, Vladimir Poutine a promulgué un décret obligeant les citoyens ukrainiens résidant en Russie et dans les quatre régions partiellement occupées à « régulariser leur statut juridique » ou à « partir volontairement » avant le 10 septembre. Dans le cas contraire, les Ukrainiens deviendront des étrangers sur leur propre territoire et seront soumis à la réglementation russe en matière d'immigration : séjour limité à 90 jours, examens médicaux obligatoires et restrictions d'accès à l'emploi.
Six millions de personnes menacées
Cette mesure menace près de six millions d'Ukrainiens (dont 1,5 million d'enfants) qui sont restés dans les territoires occupés, exposés à la déportation ou à l'emprisonnement, selon Kiev.
« Les Russes ne se contentent pas de distribuer des passeports. Si vous refusez, ils créent des conditions telles que vous ne pouvez plus vivre sans », déplore Yuri Belusov, chef du département des crimes de guerre du bureau du procureur général ukrainien.
« Il s'agit d'une violation du droit international [...] qui ouvre la voie à la commission d'autres crimes de guerre par la Russie », ajoute Human Rights Watch. « Le droit international interdit à la Russie de modifier la démographie des zones occupées, de forcer les résidents à déclarer leur allégeance à la puissance occupante, de les enrôler dans ses forces armées ou de transférer des populations par la force. Les deux derniers constituent des crimes de guerre, et toute déportation ou expulsion de personnes ukrainiennes pourrait également constituer un crime contre l'humanité ».
« Vous ne pouvez pas vivre sans passeport russe : vous ne pouvez pas toucher de pension ou d'allocations, vous ne pouvez pas travailler légalement. » Olena*, habitante de la région de Louhansk
La « passeportisation » ne date pas d'aujourd'hui : Moscou avait déjà distribué massivement des passeports aux habitants des régions séparatistes géorgiennes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, puis les avait utilisés pour justifier son intervention militaire de 2008 au nom de la protection de « ses » ressortissants.
En Ukraine, cette méthode est appliquée depuis l'annexion de la Crimée (en 2014), où la citoyenneté russe a été automatiquement attribuée aux résidents permanents. Neuf mois après l'occupation de la péninsule, la Russie revendiquait déjà la délivrance de 1,5 million de passeports, même si certains habitants parvenaient encore à vivre sans. Après l'invasion à grande échelle de 2022, cette politique s'est durcie et accélérée.
À partir de mai 2022, la Russie a adopté une série de lois visant à faciliter la naturalisation des Ukrainiens dans les régions occupées. En avril 2023, elle a mis en place des sanctions contre les réfractaires : ceux qui refuseraient la citoyenneté russe seraient considérés comme apatrides. Initialement fixée à quinze mois et reportée à plusieurs reprises par Vladimir Poutine, la date limite est désormais fixée au 10 septembre.
Toutefois, selon les experts, cette date limite reste largement arbitraire et pourrait être reportée à nouveau. Le chef du Kremlin avait déjà annoncé en mars qu'il avait « pratiquement achevé » la délivrance de passeports russes à tous les Ukrainiens des territoires occupés, avec près de 3,5 millions de documents.
Ni médicaments ni accès à l'hôpital
« Depuis 2022, sans passeport, vous n'avez plus aucun droit, vous ne pouvez même plus quitter le village car vous ne pouvez pas passer les postes de contrôle russes », explique Olena* au téléphone, depuis son village occupé dans la région de Louhansk. Cette Ukrainienne est revenue en 2024 de l'étranger pour s'occuper de son père âgé et malade. « À mon arrivée, on m'a dit que j'avais soixante jours pour régulariser ma situation, sinon je serais expulsée vers une destination inconnue, car avec notre passeport ukrainien, nous sommes considérés comme des étrangers », explique cette retraitée, dont certaines connaissances ont été expulsées.
Il a fallu près de six mois à Olena et à son père pour obtenir leur passeport, car les services administratifs sont submergés de demandes. « De toute façon, vous ne pouvez pas vivre sans passeport russe : vous ne pouvez pas toucher de pension ou d'allocations, vous ne pouvez pas travailler légalement, vous ne pouvez même pas vous faire soigner », poursuit cette femme qui survit grâce à ses économies.
Pour accroître la pression sur les habitants, les autorités d'occupation ont également durci les conditions d'accès aux soins médicaux. Yevgeny Balitsky, gouverneur désigné par la Russie dans la partie occupée de la région de Zaporijia, avait annoncé fin 2023 qu'à partir du 1er janvier 2024, les titulaires d'un passeport ukrainien seraient exclus des soins médicaux.
Un hôpital de la région de Zaporijia a reçu l'ordre de fermer parce que le personnel médical refusait d'accepter la citoyenneté russe.
« Sans passeport russe, il n'est plus possible d'obtenir des médicaments sur ordonnance dans une pharmacie ou d'être reçu en consultation dans un hôpital », déplore Maryna Slobodianiouk, de l'ONG Truth Hounds, qui documente les crimes de guerre. « Nous avons même recueilli le témoignage d'une personne qui vivait là-bas et à qui on a refusé une ambulance parce qu'elle n'avait pas de passeport russe. »
« Ils ne disent pas toujours directement qu'il faut un passeport », ajoute Ouliana Poltavets, coordinatrice du programme Ukraine de l'ONG Physicians for Human Rights (« Médecins pour les droits humains »). Les services de santé exigent uniquement une assurance maladie, obligatoire dans le système russe, mais il est impossible de l'obtenir sans passeport. » Entre février et août 2023, avant l'entrée en vigueur de l'assurance russe obligatoire le 1er janvier 2024, son ONG a recensé près de quinze cas de refus de soins pour absence de passeport.
Certains hôpitaux ont même créé un guichet dédié aux passeports afin d'accélérer la procédure pour les patients désespérés. Un hôpital de la région de Zaporijjia a reçu l'ordre de fermer parce que le personnel médical refusait d'accepter la citoyenneté russe.
Confiscation de biens
Les exemples de restriction d'accès aux services essentiels se multiplient. Depuis le 1er avril, les conducteurs doivent passer au permis de conduire russe avant 2026. Dans la région de Kherson, les autorités russes exigent un passeport russe pour obtenir ou conserver sa carte SIM.
Depuis 2024, les autorités d'occupation ont également procédé à des confiscations massives des logements des personnes qui ont quitté les territoires occupés. Selon la loi russe, les biens déclarés « sans propriétaire » sont transférés à la municipalité par décision judiciaire. Pour éviter la confiscation, il faut se présenter sur place, muni d'un passeport russe.
C'est finalement ce qui a convaincu Olena : réenregistrer sa maison et ses deux appartements sous la loi russe était le seul moyen d'éviter leur confiscation. « Ici, nous avons des terres, des biens. Nous avons travaillé toute notre vie pour que nos enfants, nos petits-enfants et nous-mêmes ayons un endroit où vivre. Il était donc naturel que nous revenions, car nous avons compris que nous allions nous retrouver sans rien », dit-elle.
« La tendance générale est de serrer la vis pour pousser les gens à partir ou à « devenir russes », résume Maryna Slobodianiouk. Aujourd'hui, beaucoup de gens acceptent le passeport russe non pas pour rester, mais pour partir.
Sans ce document, il devient presque impossible de franchir les postes-frontières entre les territoires occupés et la Russie, rapporte Myroslava Kharchenko, de l'ONG Save Ukraine, qui accompagne les enfants ukrainiens fuyant l'occupation.
« Les occupants exploitent également le fait que les Ukrainiens des territoires occupés vivent dans un véritable trou noir informationnel. Ils les menacent, leur assurant qu'ils seront poursuivis dans l'Ukraine libre pour avoir accepté un passeport russe, qu'ils risquent la prison, la perte de la garde de leurs enfants », explique cette avocate. « Les Russes font tout leur possible pour enfermer ces personnes, pour les empêcher de partir. Il ne s'agit pas d'un enlèvement physique, mais mental. Ils prennent leurs esprits en otage pour s'assurer que ces familles ne retournent jamais en Ukraine, qu'elles perdent tout espoir et se résignent à vivre là-bas, dans leur prétendue Russie. »

L’après-Bayrou : ce qui fait courir le bloc bourgeois (et ses alliés).

Dans cet article, Stathis Kouvélakis – philosophe membre de la rédaction de Contretemps – revient sur la séquence politique de cette dernière année, de la nomination de François Bayrou à la tête du gouvernement jusqu'à sa chute. Il insiste en particulier sur un aspect généralement occulté, à savoir le rôle de l'Union européenne, et analyse la stratégie du PS dans la conjoncture politique actuelle.
9 septembre 2025 | tiré de Contretemps.eu
https://www.contretemps.eu/apres-bayrou-bloc-bourgeois-macron-union-europeenne/
Le vide de la répétition
On connait cette mésaventure récurrente de Coyote Rusé « Wile », un personnage des dessins animés de Tex Avery, obsédé par l'oiseau du désert « Bip-Bip » : à un certain moment de la course-poursuite, le coyote, emporté par son élan, se lance au-dessus d'un précipice et continue allégrement à courir dans le vide. Les lois de la pesanteur sont transgressées, et pourtant rien de fâcheux n'arrive, il poursuit sa course comme si de rien n'était. Jusqu'à l'instant où il finit par regarder en bas et découvre le vide au-dessus duquel il est comme suspendu. Ce vide devient alors « effectif », et les lois de la physique reprennent leurs droits.
Le philosophe slovène Slavoj Zizek se réfère souvent à cet épisode pour illustrer le paradoxe d'un « voile d'ignorance » doté, dans certaines situations, d'une fonction protectrice, paradoxe qui renvoie au décalage entre l'objectivité d'une situation et le moment de sa perception subjective qui la rend agissante. Il faut toutefois remarquer que ce qui déclenche cette perception subjective n'est pas tant une « prise conscience », au sens d'un processus mental se déroulant dans l'intériorité d'une conscience, mais un geste, un acte : regarder ses pieds.
La question qui se pose est dès lors double : qu'est-ce qui pousse le coyote à faire ce geste fatal ? Et de quoi ce drôle d'oiseau bleu, un Grand Géocoucou selon la classification animalière, est-il la représentation allégorique ? Sur ce dernier point, nous disposons d'une indication claire : comme l'indique le nom onomatopéique dont il est affublé, l'oiseau représente la répétition en tant que telle, en d'autres termes le vide d'une répétition aveugle, indestructible, qui est son propre but. « Bip-Bip » ne cesse d'afficher une mine imperturbable et satisfaite, et c'est l'affichage insolent de cette pure jouissance libidinale qui alimente la rage de poursuite de Coyote.
L'ensemble des dessins animés de cette série est construit sur le contraste entre le mouvement incessant mais toujours identique à lui-même de l'oiseau et les stratagèmes toujours renouvelés de Coyote, entièrement livré à son obsession, non moins répétitive et vide de sens que le son émis par l'oiseau coureur. C'est fort logiquement dans le vide, i.e. dans la béance d'une répétition, que « tombe » l'opposition entre les deux mouvements pulsionnels, pour réapparaître aussitôt dans les images qui suivent immédiatement la chute : car les personnages de Tex Avery sont indestructibles, ils représentent selon Zizek le « non-mort », le circuit perpétuellement recommencé de la pulsion de mort dépersonnalisée.
Le parallèle avec le sort annoncé de François Bayrou est évident : il aura suffi de l'annonce d'un mouvement social, d'autant plus inquiétant que son ampleur et ses modalités sont imprévisibles, pour que Bayrou accomplisse le geste fatal : il « réalise » alors qu'il ne dispose d'aucune majorité parlementaire et que les ruses par lesquelles il avait jusqu'alors réussi à se maintenir « dans la course » n'auront pas suffi à atteindre son objectif – sauf, bien sûr, celui de faire gagner du temps au camp bourgeois, ce qui est loin d'être négligeable, tout particulièrement en situation de crise politique.
Dans ces conditions, la demande d'un vote de confiance se présente comme l'ultime manœuvre pour prendre de court la mobilisation annoncée et mettre la pression sur la force qui lui a permis de se maintenir jusqu'ici au pouvoir, le Parti socialiste. Reste qu'un gouvernement incapable de faire adopter un budget par l'Assemblée nationale est condamné à connaître le sort de celui dirigé par son prédécesseur, Michel Barnier, en décembre dernier.
Si tout cela est de l'ordre de l'évidence, il reste quelques points à éclaircir, qui restent trop souvent dans l'ombre[1]. En nous inspirant de la chorégraphie de Tex Avery, nous nous pencherons sur ce qui a permis à Bayrou de poursuivre la course au-dessus du vide nettement plus longtemps que son prédécesseur. Nous analyserons également les conditions dans lesquelles la course-poursuite mortifère (pour les classes populaires et travailleuses) à laquelle se livrent les personnages – si cartoonesques dans leur jouissance béate du pouvoir – de la macronie pourrait se poursuivre, moyennant un changement de Coyote Rusé, ou, à l'inverse, si elle est amenée à prendre fin, du moins sous la forme que nous lui connaissons depuis l'été 2024. Mais nous nous interrogerons d'abord sur ce que l'objectif réel que cherche à atteindre dans l'immédiat Bayrou, et, derrière lui, l'ensemble du bloc bourgeois dont Macron reste le pivot, soit leur équivalent du Grand Géocoucou Bip-Bip.
« Bip-Bip » : l'Union européenne, ou la répétition compulsive de l'orthodoxie budgétaire
L'obsession de François Bayrou avec la dette publique est, on le sait, ancienne. Elle a souvent fait l'objet de commentaires ironiques, qui font apparaître Bayrou comme une sorte de Cassandre ratée. Car, à l'inverse de celles proférées par l'héroïne de la mythologie grecque, les prédictions funestes de Bayrou ont été contredites par le cours des choses, aucune crise de la dette n'ayant affecté la France depuis 2007, lorsque le président du Modem fait de cet épouvantail l'axe central de son discours.
Il est sans doute inutile de démontrer longuement ici que ce propos alarmiste sert, aujourd'hui comme hier, à justifier des politiques néolibérales, plus exactement des politiques d'austérité, qui combinent une fiscalité allégée pour le capital et les couches aisées avec la restriction de la dépense publique, avant tout aux dépens de l'Etat social. Des économistes de gauche ont à plusieurs reprises démontré le caractère fallacieux des affirmations de Bayrou, en particulier celles sur lesquelles repose l'actuel projet de budget : la dette publique n'est jamais payée, seuls les intérêts le sont, et cette charge est soutenable, et même sensiblement plus faible que par le passé, malgré la hausse du stock de cette dette[2].
Il en va de même des arguments selon lesquels les causes du creusement du déficit budgétaire, qui conduit à l'endettement de l'Etat, résident dans des dépenses excessives, que ce soit des investissements publics, des frais de fonctionnement de l'Etat ou des transferts sociaux. En réalité, le problème est à chercher du côté des recettes, c'est-à-dire dans les cadeaux fiscaux faits au capital et aux ménages aisés, qui atteignent des proportions inégalées depuis le début de la présidence Macron – ses prédécesseurs, et notamment François Hollande (baisse continue des « charges » sur les entreprises et de la fiscalité du capital, CICE etc.), s'étant déjà engouffrés dans cette voie[3].
Cette contre-expertise est aussi pertinente sur le fond que politiquement nécessaire face à au discours dominant, incessamment relayé dans les médias et par les porte-parole du pouvoir. A s'en tenir là, on risque toutefois de passer à côté de la logique interne du discours de Bayrou, qui ne relève pas d'une simple mystification idéologique mais bien d'un projet politique cohérent, qui dépasse de très loin sa personne et emporte des conséquences tout à fait concrètes.
Ce projet a un nom, c'est l'Union européenne, les règles et les procédures sur lesquelles elle repose, et il s'inscrit lui-même dans les tendances à plus long terme du capitalisme contemporain : la crise de l'Etat keynésien de l'après-guerre et son remodelage par le néolibéralisme et la financiarisation. Le sociologue allemand Wolfgang Streeck a désigné cette transformation comme un passage de l'Etat fiscal de la période précédente, orienté vers la redistribution et le maintien du compromis social fordiste de l'après-guerre, à l'Etat-dette, qui repose sur un régime institutionnalisé de consolidation fiscale visant à le placer sous la surveillance permanente des marchés financiers[4].
A l'origine de ce processus se trouve la « crise fiscale de l'Etat » déclenchée par la crise des années 1970[5], avec une baisse des recettes (résultat mécanique de la baisse de la croissance) et le maintien à un haut niveau – voire, dans un premier temps, une hausse – des dépenses due à la relative rigidité des « stabilisateurs automatiques » keynésiens visant à faire face à la montée du chômage et aux effets récessifs d'un contexte inflationniste. L'endettement public, maintenu à un niveau très bas jusqu'au début des années 1980, a amorcé dès lors sa courbe ascendante au niveau mondial.
La réponse néolibérale à cette crise s'est appuyée sur la « révolte fiscale » conjointe du capital, confronté à une baisse de sa profitabilité, et des couches aisées, qui remettent en cause le pacte redistributif de l'après-guerre et misent sur la privatisation néolibérale des conditions de la reproduction sociale. Elle s'est amplifiée avec le double mouvement de la « mondialisation » et de la financiarisation, qui a libéré les mouvements des capitaux et incité au dumping fiscal entre les États. La montée de la finance se nourrit à son tour de la spéculation sur la dette publique et l'endettement des ménages, lequel compense le retrait de l'Etat social (dans l'éducation, la santé, l'accès au logement, les retraites etc.) et, pour la masse du salariat, la stagnation des rémunérations.
La « consolidation budgétaire » se présente ainsi comme un dispositif visant à « renforcer la confiance », i.e. à rendre l'État attractif pour les marchés financiers en leur assurant qu'il est en mesure d'assurer le service de sa dette. Les marchés financiers veulent avoir l'assurance que la dette publique est effectivement placée sous contrôle politique, ce qui doit être démontré par la capacité des gouvernements à enrayer, voire à inverser, sa croissance à long terme.
Dans un contexte de dumping fiscal entre États, qui fait obstacle à tout accroissement de la taxation du capital, donc de la progression des recettes, cette consolidation opère immanquablement par la compression continue de la dépense publique, en particulier des dépenses sociales. La dynamique de dérégulation et de privatisation continue des biens publics alimente ainsi la transformation de l'État social (welfare State) en État visant à discipliner la force de travail (workfare State)[6].
Ce tournant autoritaire et répressif est redoublé par la dépossession démocratique inscrite dans le mécanisme même de la consolidation fiscale. Son institutionnalisation implique que cet Etat affiche une détermination sans faille à faire passer ses obligations envers ses créanciers avant toutes les autres. Cela nécessite une configuration des rapports de force politiques qui rend difficile toute augmentation des dépenses et facilite les coupes budgétaires, sauf en ce qui concerne le service de la dette et les dépenses dites « régaliennes » (défense, police, etc.).
Comme le souligne Streeck, un tel État « intériorise fermement la primauté de ses engagements envers ses prêteurs sur ses engagements publics et politiques envers ses citoyens. [Ceux-ci] sont subordonnés aux investisseurs, leurs droits sont supplantés par les revendications issues des contrats commerciaux. (…) Les résultats des élections sont moins importants que ceux sur les marchés obligataires, l'opinion publique importe moins que les taux d'intérêt, et le service de la dette prend le pas sur les services publics »[7].
Il est aisé de voir que l'Union européenne a été le vecteur fondamental de la construction d'un tel régime de consolidation dans une aire géographique où les rapports de force rendaient sa mise en place plus difficile que dans le monde anglo-étatsunien. Ses tables de la loi ont été énoncées dans les fameux « critères » institués par le Traité de Maastricht et resserrés par les traités et pactes qui ont suivis : déficit budgétaire et dette publique plafonnés, respectivement, à 3% et 60% du PIB, priorité accordée à la maîtrise de l'inflation.
Ces critères ne résultent pas d'un simple choix idéologique : ils visent à rendre crédible sur le plan international l'idée d'un euro fort, à savoir une monnaie unique inédite dans l'histoire puisqu'elle ne s'adosse pas à la banque centrale d'un Etat unifié, et ne dispose donc pas des capacités d'intervention de la Fed étatsunienne à laquelle elle est souvent comparée. De là l'obsession de l'orthodoxie ordolibérale, qui avait déjà assuré au mark son statut de monnaie forte, par opposition au franc, sujet à de fréquentes dévaluations.
C'est aussi la raison pour laquelle la banque centrale en question est à la fois « indépendante », à savoir extraite de toute contrôle politique (ce qui est la marque distinctive des institutions européennes), et tenue par un seul mandat, la maîtrise de l'inflation sous un plafond de 2%. Ses statuts interdisent le recours des Etats à un endettement intérieur, rendant impossible quelque chose comme le « circuit du Trésor » qui a permis, entre la Libération et la fin des années des années 1960, à l'Etat français de se financer sans avoir recours aux marchés.
Avec la monnaie unique, les Etats de la zone euro sont désormais tenus de se financer sur les marchés internationaux et, pour y parvenir, de faire continuellement la preuve de leur conformité aux contraintes de la consolidation macroéconomique codifiées dans les Traités européens. Certes, depuis la crise de 2015, la BCE intervient (et même de façon massive entre 2015 et 2022) sur le marché secondaire de la dette publique des Etats-membres de l'UE. C'est la politique de l'« assouplissement monétaire » qui a consolidé la baisse des taux, donc du coût de l'emprunt pour les Etats.
C'est ce qui a permis de « vendre » cette politique aux opinions publiques comme un allègement de la pression que les marchés financiers exercent sur les Etats via le mécanisme de la dette. En réalité, l'objectif de la BCE était tout autre, à savoir fournir les marchés financiers en liquidité en garantissant une forte demande en titres de dette publique. Ainsi, outre le caractère temporaire de cette mesure, le rôle décisif du marché primaire n'est pas remis en cause, les interventions de la BCE étant loin de correspondre à l'ensemble des besoins de financement des Etats.
Entre 2015 et 2022, soit au pic de cette politique de rachat, la BCE n'a acheté que l'équivalent de 48% de la dette émise par la France, et la BCE détient actuellement (via la banque de France) moins du quart de la dette française, une proportion qui chute d'ailleurs rapidement depuis la fin de l' « assouplissement quantitatif » et le retour à une politique de hausse des taux d'intérêt. Actuellement, une majorité des titres de la dette publique de la France (54,7% selon les chiffres de 2025) se trouve entre les mains de « résidents étrangers ».
La composition de ce groupe est particulièrement opaque, car protégée par l'anonymat du Code du commerce, mais il s'agit pour l'essentiel des « investisseurs institutionnels » (banques, fonds de pensions, fonds d'assurance, fonds d'investissements souverains, et autres fonds spéculatifs) au comportement par définition opportuniste, i.e. extrêmement sensible au moindre frémissement des « marchés ». Loin de contrecarrer l'emprise des marchés sur les Etats, la BCE ne cesse ainsi d'agir comme leur plus fidèle soutien, ajustant sa politique aux cycles de l'accumulation du capital.
Depuis la crise des années 2010-2015, le régime de consolidation imposé par l'UE s'est en réalité rigidifié. L'éphémère relâchement de la période du Covid, au cours de laquelle les règles des Traités avaient été suspendues, avait conduit certains europhiles invétérés à déclarer la fin du corset austéritaire[8].
Sous une forme atténuée, de telles illusions s'étaient également répandues à gauche. En témoigne notamment le programme de la NUPES de 2022 qui affirmait (dans son chapitre 8) que « le contexte de remise en cause des règles européennes face aux urgences joue en notre faveur ». Se voyait ainsi doté d'un semblant de crédibilité le mantra de la « renégociation des Traités européens » qui aurait permis d'en « modifier durablement les règles incompatibles avec notre ambition sociale et écologique légitimée par le peuple ». Une proposition destinée d'avance à rester incantatoire, l'unanimité des Etats-membres étant, comme chacun sait, requise pour changer ne serait-ce qu'une virgule des traités en question.
D'ailleurs, une fois le contexte de la pandémie dépassé, les lois intangibles gravées dans le marbre des traités ont aussitôt repris le dessus, et même sous une forme aggravée. En fait, le processus était engagé depuis la crise de l'eurozone des années 2010-2015. L'adoption d'un ensemble de dispositifs – appelés dans la novlangue de l'UE « Six Pack », « Two Pack » et « semestre européen » – a permis d'accroître la surveillance des politiques budgétaires par les autorités de Bruxelles, en renforçant notamment l'automaticité des sanctions et en systématisant la mise en place de plans d'ajustement structurel pour les pays qui font face à des difficultés financières, sur le modèle de ce qui a été fait pour la Grèce.
L'instauration d'un régime de « surveillance renforcée » est prévu dans le cadre de la mise en œuvre de ces programmes jusqu'à remboursement de 75% de la dette. Début 2024, l'adoption du « pacte de stabilité et de croissance réformé » a sonné pour de bon la fin de la parenthèse « dépensière » des années Covid et le retour de l'austérité : les pays avec un déficit budgétaire supérieur à 3 % devront le réduire d'au moins 0,5 point de pourcentage de PIB par an. De plus, les Etats-membres dont la dette est comprise entre 60 et 90 % du PIB devront la réduire d'au moins 0,5 point par an, et ceux dont la dette excède les 90 %, d'au moins 1 point par an.
Certes, formellement, les traités et pactes de l'UE ne s'opposent pas à la hausse de la fiscalité du capital et des plus riches. Néanmoins, en vertu des fameuses « libertés » qui guident l'intégration européenne dès sa fondation[9], ils sanctuarisent la libre circulation des biens, des services et des capitaux. Dans la pratique, cela signifie que si le gouvernement d'un Etat-membre augmente les impôts sur le capital, celui-ci peut (menacer de) partir dans le pays voisin sans perdre l'accès le marché du pays dont il s'apprête à partir (du fait de la libre circulation des biens et des services). Ainsi, la combinaison des règles budgétaires et des principes de la « concurrence libre et non faussée » aboutit à une situation qui ne laisse pas d'autre option pour atteindre l'ajustement budgétaire que la baisse des dépenses. Les traités et pacte de l'UE institutionnalisent donc la paralysie de la fiscalité, en mettant en place des mécanismes qui s'appliquent de façon permanente, même en l'absence de pression des marchés financiers[10].
A l'instar de l'oiseau de Tex Avery, l'UE est condamnée à répéter sans fin le « Bip-Bip » de l'austérité et de l'orthodoxie néolibérale inscrit dans ses traités fondateurs. Sauf qu'ici, loin d'être vide de sens, cette répétition est au service non pas d'un mécanisme psychique inconscient mais d'intérêts de classe parfaitement identifiables. Et elle entraîne des conséquences bien plus graves que les plongées fracassantes dont le Coyote se sort toujours indemne, à savoir sur la sanction des « marchés » et de leur relais interne à l'UE, la BCE de Francfort.
La Grèce en a été l'illustration la plus dramatique, mais rappelons-le, c'est une grande part de la périphérie européenne (Espagne, Portugal, Irlande, Chypre) qui en a également fait les frais. La récente déclaration de Christine Lagarde, en sa qualité de présidente de la BCE, est à cet égard tout à fait claire pour qui sait décoder ce type de langage : « Les risques de chute de gouvernement dans tous les pays de la zone euro sont préoccupants. Ce que j'ai pu observer depuis six ans [à ce poste], c'est que les développements politiques, la survenance de risques politiques, ont un impact évident sur l'économie, sur l'appréciation par les marchés financiers des risques pays et par conséquent sont préoccupants pour nous ». La France d'aujourd'hui n'est sans doute pas la Grèce de 2015, elle n'est pas pour autant un cas à part, exemptée par on ne sait quel miracle de sa « grandeur » des contraintes dans lesquelles sa classe dominante et le personnel politique qui s'est mis à son service l'ont soumis depuis des décennies.
La course austéritaire de Barnier et de Bayrou
Vue sous cet angle, la séquence française de cette dernière année apparaît sous un jour nouveau. Le fait a été peu commenté, il est pourtant essentiel : pour asseoir son déni du résultat des élections législatives de juin-juillet 2024, Macron a nommé successivement à Matignon deux personnalités de droite, Michel Barnier et François Bayrou, qui partagent une fidélité absolue au cadre européen. Le premier est un ancien membre de la Commission de Bruxelles et son représentant dans les négociations sur le Brexit avec le gouvernement britannique.
Le second, un zélote du projet européen, a fait de la radicalisation de l'orthodoxie budgétaire maastrichienne sa marque de fabrique, en proposant, dès sa campagne présidentielle de 2007, l'inscription dans la Constitution de l'interdiction pour tout gouvernement de présenter, hors période de récession, un budget déficitaire. Il a ainsi anticipé de deux ans la constitutionnalisation de cette prétendue « règle d'or » par l'Allemagne, qui en avait déjà énoncé le principe dans la « Loi fondamentale » qui lui sert de Constitution depuis 1949, et sa reprise au niveau de l'UE tout entière dans le pacte budgétaire européen (TSCG) de 2012.
Le choix de ses personnalités ne peut se comprendre que si l'on prend en compte la décision, annoncée dès juin 2024, de la Commission européenne d'engager, conformément aux prescriptions du pacte de croissance réformé, une procédure contre la France pour dépassement des seuils de déficit budgétaire et d'endettement public. Comme le précise le document officiel du gouvernement de décembre 2024, « la Commission européenne a fixé une trajectoire de référence exigeante : un ajustement structurel qui représente 0,6 point de PIB par an en moyenne sur la période ».
Avant même la nomination de Michel Barnier, Macron avait assuré la continuité de la politique économique en maintenant aux manettes le trio de hauts fonctionnaires de Bercy, proches du secrétaire de l'Elysée Alexis Kohler, qui relaient les grandes lignes de la politique économique depuis le début de son premier mandat. La relation avec l'Union européenne et son régime de consolidation budgétaire sont au cœur de cette continuité.
Selon des propos d'un ancien ministre rapportés par Le Monde en septembre 2024, « leurs invariants [de ces hauts fonctionnaires] tiennent en deux points : rassurer Bruxelles et placer la dette à de bonnes conditions, quels que soient les aléas. Ils savent faire, ils ont tous les réseaux et contacts pour cela ». Belle illustration de la thèse marxiste classique de la continuité de l'appareil étatique par-delà les changements de gouvernement, et même de régime politique, qui caractérise l'Etat capitaliste[11] !
La course à la conformité au carcan austéritaire renforcé de l'UE est donc au cœur de la crise politique française. On peut raisonnablement penser que cette donnée est entrée en ligne de compte dans la décision de Macron de dissoudre l'Assemblée suite à la débâcle de son camp aux élections européennes de juin 2024. L'éventualité d'un gouvernement RN, à ses yeux la plus probable au moment de la dissolution, qui n'aurait pas d'autre choix que de mettre en œuvre le choc austéritaire préconisé par Bruxelles, pour en payer le prix par la suite, pouvait paraître comme un calcul rationnel en vue de 2027.
Le résultat des élections législatives, avec l'arrivée en tête à l'Assemblée du NFP, a obligé à un changement d'approche. Il n'a bien sûr jamais été question de confier un mandat pour Matignon à la personnalité proposée par l'alliance de gauche arrivée en tête (en nombre de sièges) à l'Assemblée. L'objectif était de gagner du temps, d'assurer la continuité d'un macronisme devenu nettement minoritaire, et, pour cela, s'efforcer de casser l'alliance de la gauche, « obtenir le scalp du NFP » comme l'avait bien vu Olivier Faure en août 2024, avant de lui apporter lui-même le scalp en question six mois plus tard, en refusant de voter la censure contre le gouvernement Bayrou.
Davantage que des porteurs d'un véritable mandat de gouvernement, qui aurait impliqué a minima un programme digne de ce nom, une ligne politique cohérente et approuvée par l'électorat (rappelons que, contrairement au NFP, le mal-nommé « socle commun » ne s'est jamais présenté aux urnes comme tel), Barnier et Bayrou sont en fait de simples chargés de mission. Celle-ci consiste à mettre en œuvre au plus vite la thérapie austéritaire prévue par le cadre européen, aggravée par la course à la militarisation lancée par l'UE depuis le début de la guerre en Ukraine.
Pour mener à bien cette « sale besogne », des personnalités sans véritable légitimité politique, ni même assise parlementaire, sont de loin préférables à des gouvernements devant rendre des comptes à des électeurs. Les précédents de la Grèce et de l'Italie de 2011, lorsque l'UE a directement organisé la chute de Georges Papandréou et de Silvio Berlusconi, remplacés par deux banquiers (respectivement : Lucas Papademos et Mario Monti) à la tête de coalition hétéroclites et chancelantes, sont à cet égard instructif.
Depuis l'été dernier, et la mise sous surveillance renforcée de la France, sa politique budgétaire ne fait que se conformer au « pilotage automatique » prévu par le « pacte de croissance » de l'UE, à savoir une « trajectoire » de coupes budgétaires équivalentes à une réduction du déficit d'au moins 0,5% du PIB. Les « rapports d'avancement annuel » envoyés en avril de chaque année par le gouvernement français à Bruxelles n'ont pour seul objet que de détailler l'avancement du Plan budgétaire et structurel à moyen terme (PMST) pour 2025-2029, soit, comme l'annonce le document officiel d'avril dernier, de « présenter une trajectoire budgétaire qui respecte les exigences des nouvelles règles budgétaires européennes ainsi que des réformes et investissements sur la durée, justifiant un allongement de la période d'ajustement budgétaire de quatre à sept ans ».
Mais il y a des nuances entre les deux équipes qui se sont succédées à Matignon : comme l'expliquent les études (ici et ici) de l'Institut Avant-Garde, Michel Barnier a voulu faire du zèle, en prévoyant un « ajustement plus ambitieux que ce qu'exigeaient strictement les règles budgétaires européennes et [qui] comprenait un effort important en début de période visant à ramener le déficit public à 5 % en 2025 ». Le plan de Bayrou signale un retour à la « normale » stipulée par les pactes : il « supprime la concentration des efforts en début de période prévue initialement et se rapproche davantage de la structure d'ajustement linéaire définie par les règles budgétaires de l'UE.
L'ajustement total sur la période de sept ans allant de 2025 à 2031 demeure toutefois inchangé ». L'objectif de réduction du déficit budgétaire pour 2025 est ramené par Bayrou de 5,4% à 5% – soit de 1,4% à 0,8% de point de PIB – mais il est supérieur à celui de Barnier pour l'année suivante (0,9% au lieu de 0,6%). On peut penser que Bayrou était convaincu que cet « assouplissement » pouvait suffire pour renouveler, moyennant quelques concessions cosmétiques (sur la suppression des jours de congé en particulier), le quitus du PS qui lui a permis d'accéder à Matignon. Serait alors confirmée une recomposition politique qui verrait le bloc bourgeois s'adjoindre une nouvelle composante, renouvelant ainsi l'opération fondatrice de l' « extrême-centre » macroniste : la convergence sous le signe de la réforme néolibérale et de l'allégeance européenne du « social-libéralisme » et de la droite libérale. Mais, aux yeux du pouvoir actuel et de ses alliés, il semble que cet objectif puisse être atteint par d'autres voies, i.e. sans un Bayrou usé et à court de cartouches.
Un Coyote relooké : vers une recomposition du bloc bourgeois ?
S'exprimant le 26 août dans le quotidien des milieux patronaux, Patrick Martin, le président du Medef, a eu le mérite de la clarté et d'une certaine lucidité : « Ce qui est certain, c'est que le Parti socialiste reste le pivot dans cette affaire ». La suite lui a donné raison, et tort à celles et ceux qui pensaient (et font semblant de croire) que l'accord entre le PS et le bloc macronien de février n'était qu'une incartade passagère, que de lyriques rappels « unitaires » permettraient rapidement de surmonter.
Comme le rapporte Le Monde, la ligne que Macron a présenté devant les représentants des formations qui le soutiennent est claire : il s'agit « de « travailler avec les socialistes » pour préparer l'après-Bayrou ». Gabriel Attal, secrétaire général du parti macroniste Renaissance, abonde dans le même sens : « Quelle que soit l'issue du 8 septembre, on doit impérativement se mettre autour de la table avec les forces politiques qui sont prêtes à travailler à un compromis ». Or, comme le précise le même article, « l'initiative présidentielle a reçu un accueil favorable d'Olivier Faure. (…) A Blois [où s'est tenue l'université d'été du PS en août dernier], lors d'un déjeuner avec la presse, le patron du PS avait ainsi tendu la main au bloc central : ‘Nous ne cherchons pas à faire le programme de nos rêves. Nous avons à chercher à bâtir un projet qui peut trouver une majorité' ».
L'objectif partagé est donc d'éviter une dissolution, en cherchant des « compromis » qui iraient plus loin dans la voie des « assouplissements » envisagés par Bayrou sans remettre en cause l'ajustement structurel en tant que tel. Raphaël Glucksmann a été encore plus clair que Faure à la sortie de son entretien avec Macron : il s'agit d'ouvrir un « véritable processus de négociation » que « l'annonce du vote du 8 septembre » a malheureusement rendu impossible.
La maire de Nantes Johanna Rolland, s'exprimant dans Mediapart en tant que première secrétaire déléguée du PS, est sur la même longueur d'onde : « laisser à penser que l'hypothèse qui réglerait la situation du pays serait la dissolution est illusoire ». Il s'agit de « gouverner maintenant », avec une équipe qui irait « de Glucksmann à Ruffin », et qui chercherait des « majorités au cas par cas ». Les chances que l'actuel locataire de l'Elysée accepte ce type de scénario sont nulles. Mais l'objectif réel n'est pas tant de permettre à un tel gouvernement de voir le jour que d'inciter à une recomposition politique « centriste » qui puisse tenir jusqu'à la prochaine présidentielle.
C'est le but du « budget alternatif » présenté par le PS (sans la moindre référence, faut-il le préciser, au programme du NFP, ni discussion préalable avec toute autre formation de gauche, y compris celles avec lesquelles il affirme vouloir gouverner) : diviser par deux le niveau de l'ajustement structurel revient à peu de choses près à placer la barre au niveau du seuil-plancher prévu par le pacte budgétaire européen (soi un demi-point de PIB par an), et à demander un délai d'une année supplémentaire (2032 au lieu de 2031) pour ramener le déficit sous la barre fétiche des 3%. Dans la conférence de presse à l'issue de l'université d'été du PS, Faure a été très précis sur ce point : « Les équilibres sont inamendables sauf à dire qu'on ne peut pas gouverner ».
Même son de cloche chez la sénatrice du Val-de-Marne Laurence Rossignol : « L'esprit de ce plan (…) est de proclamer que‘oui, nous adhérons à l'idée qu'il faut une trajectoire de réduction du déficit' ». Quelques mesures largement symboliques du type taxe Zucman – dont certains cadres du parti laissent déjà entendre que son montant pourrait être revu à la baisse – , ou le toilettage de certaines niches fiscales pour les entreprises, mais au bénéfice des « TPE et PME innovantes » (la start-up nation n'est pas très loin), donnent l'illusion de justice fiscale.
Rappelons ici que cette taxe Zucman à 2% est censée rapporter 15 milliards – à mettre en parallèle avec les 153 milliards de profits, les quelque 70 milliards de dividendes distribués aux actionnaires et les 30 milliards de rachats d'actions réalisés par les entreprises du CAC 40 pour la seule année 2023, des « montants inégalés » comme le relève Le Monde. De même, les 7,5 milliards de recettes supplémentaires attendues par la « refonte de la fiscalité sur les dividendes et les plus-values », la « révision des exonérations de cotisations sociales pour les entreprises » et la « contribution GAFAM », sont à comparer aux plus de 200 milliards d'aides publiques annuelles aux grandes entreprises, selon les chiffrage effectué dans le rapport des sénateurs Fabien Gay (PCF) et Olivier Rietmann (LR), soit, pour l'année 2023, 48 milliards de subventions, 75 milliards d'allègement de cotisations et 88 milliards de niches fiscales. Autant dire que l' « autre budget » du PS ne rompt en rien avec la logique de détaxation du capital mise en place par les gouvernements successifs – et garantie par les traités européens – depuis plusieurs décennies.
Quant aux mesures d'apparence plus audacieuse, elles relèvent davantage d'un effet d'annonce : la « suspension » de la réforme des retraites ne vise qu'à relancer le « dialogue entre partenaires sociaux » pour « trouver les conditions pérennes à son financement ». En d'autres termes, il s'agit de réitérer l'opération du « conclave », l'alibi principal invoqué par le PS pour justifier son refus de censurer le gouvernement Bayrou. Conclave qui a abouti au fiasco que l'on sait, mais qui a permis au macronisme de gagner un temps précieux, avec l'appui des directions syndicales.
Autre pseudo-mesure « de gauche », la soi-disant « augmentation des bas salaires » est censée se faire par une baisse de la CSG, soit un assèchement des ressources de la protection sociale, dans une logique typiquement néolibérale. Selon les déclarations répétées des responsables socialistes, rapportées par Les échos, « ce n'est pas un plan d'affreux gauchistes ». Comme le relève Julie Cariat dans Le Monde « l' ‘autre projet pour la France'du PS ressemble déjà à un outil pour l'après-Bayrou et ses futures négociations gouvernementales ».
Un point de convergence supplémentaire, et fondamental, entre le pouvoir macronien et le PS doit être également souligné : c'est celui de l'augmentation des budgets militaires, engagé dès le premier mandat de Macron mais qui s'accélère de façon proprement vertigineuse depuis le début de la guerre en Ukraine. Elle est boostée par l'adoption par la Commission européenne du plan ReArm Europe, qui prévoit des dépenses supplémentaires de 800 milliards d'euros d'ici 2030. Pour y parvenir les Etats sont même autorisés à déroger à la règle des 3% de déficit budgétaire, à hauteur de 1,5% de leur PIB pour une durée de 4 ans : l'austérité ne saurait toucher le complexe militaro-industriel.
Concernant la France, deuxième exportateur mondial d'armement et dont l'industrie de défense est à peu près tout ce qui reste de significatif dans un tissu industriel en lambeaux, les chiffres donnent le vertige : entre le début du mandat de Macron et l'année en cours, les dépenses militaires (hors pensions) sont passées de 32 à 50 milliards, soit une augmentation de plus de 55% (et une hausse de 1,8% à 2,06% du PIB), et l'équivalent de 80% des économies prévues par le budget alternatif du PS. Selon la loi de programmation militaire d'un montant de 413 milliards adoptée en juillet 2023 par l'ensemble des partis représentés à l'Assemblée, à l'exception de LFI et du PCF, qui ont voté contre, et des Ecologistes, qui se sont abstenus, il est prévu de porter ses dépenses à 68 milliards en 2030 (soit 2,6% du PIB). Mais il est question de revoir ce chiffre à la hausse pour atteindre un « poids de forme budgétaire » de 90 milliards d'euros, et l'objectif de 3%, du PIB, comme l'a évoqué Sébastien Lecornu en mars dernier.
Or, sur ce terrain, le consensus est réel dans l'ensemble du camp atlantiste, qui va du RN aux Verts. Après avoir voté l'augmentation vertigineuse des budgets militaires, le PS a chaudement applaudi le plan ReArm Europe, Olivier Faure déclarant « se retrouve[r] parfaitement » dans les propos d'Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen sur la défense européenne. Plus hésitants, et divisés, sur l'augmentation des budgets de défense, les Verts n'en ont pas moins – par une décision de leur Conseil fédéral – chaleureusement applaudi au plan ReArm Europe et à l'idée d'une défense, et même d'une armée, européenne. De son côté, Marine Tondelier a fait la preuve qu'elle savait manier un langage martial lorsqu'elle a appelé à rejoindre l'unanimité (supposée) derrière Macron pour faire face à la menace russe et défendre l'Ukraine.
La donne a donc changé. « L'Europe, nous assurait-on, c'est la paix ». Maintenant on sait qu'au verrouillage des politiques néolibérales et à la dépossession démocratique, il nous faut ajouter la militarisation et le bellicisme.
Les conditions politiques de la riposte
On perçoit mieux dès lors le sens de ses appels à « l'unité », pour un « gouvernement [allant] de Ruffin à Glucksmann » dans les mots du secrétaire du PS. Il s'agit tout simplement d'une unité fondée sur l'exclusion de LFI et dont le véritable enjeu n'est pas tant la (fort improbable) candidature « unitaire » de la gauche (et même de cette partie de la gauche) en 2027 que d'enterrer toute politique de rupture.
Comment croire dès lors à une possible reconstitution du NFP quand l'une de ses composantes – la deuxième par la taille de son groupe parlementaire – a rompu cette alliance pour permettre à un macronisme minoritaire de s'accrocher au pouvoir et s'affirme prête à poursuivre sur cette voie ? Comment justifier l'appellation « Front populaire 2027 », présentée publiquement lors d'une réunion publique à Bagneux début juillet, et avalisée peu après par une résolution du bureau national du PS, alors qu'elle repose sur l'exclusion de la force qui est en tête des groupes élus sous l'étiquette « Nouveau Front Populaire » à l'Assemblée ? Après l'éclatement de la NUPES et celui du NFP, quelle crédibilité politique peut avoir un n-ième rafistolage électoral « unitaire » qui, aux yeux des dirigeants du PS s'est révélé être un calcul cynique qui a permis à gagner des sièges pour tourner casaque aussitôt après et servir de béquille à un pouvoir agonisant ?
Alain Bertho a fort justement appelé à se tenir « loin d'initiatives ‘unitaires' qui démultiplient les unités partielles et les anathèmes ciblés, dans le temps suspendu des stratégies présidentielles ». Pour autant, le problème stratégique posé à la gauche, et tout particulièrement à la gauche de rupture regroupée au tour de LFI, est évident et, autant le dire clairement, aucune solution ne semble actuellement à portée de main.
Cette panne stratégique renvoie à une question de fond : que peut signifier un « programme de rupture » qui n'assume pas de rompre avec le cadre des pactes européens et du régime de « surveillance renforcée » par la Commission de Bruxelles ? Que sens peut avoir la prétention « unitaire » à un programme « de rupture » si l'on s'aligne sur la militarisation, l'atlantisme et le bellicisme ? On peut comprendre qu'au cours de l'automne de l'an dernier, les groupes parlementaires du NFP, LFI en tête, aient voulu faire œuvre de pédagogie et montrer qu'une hypothèse de gouvernement NFP était légitime, exposant ainsi le déni de démocratie perpétré par Macron. Ils ont ainsi mis en avant le vote à l'Assemblée d'amendements fiscaux qui auraient permis de rapporter 50 ou 60 milliards, soit l'équivalent des coupes budgétaires prévues par le budget Barnier. Le projet de « budget alternatif » du PS reprend du reste certaines des propositions pour lesquelles la gauche a bataillé à l'Assemblée, notamment la taxe Zucman. On avait pu parler ainsi d'un « budget NFP-compatible », selon les mots du président LFI de la Commission des finances Eric Coquerel. Mais, comme c'était entièrement prévisible, le volet recettes de ce budget a été très largement rejeté par l'Assemblée. Le problème avec ce genre d'exercice pédagogique est toutefois qu'à trop oublier leurs limites on risque de perdre l'essentiel, à savoir l'impossibilité de mettre en œuvre des politiques de rupture avec le cadre néolibéral dans le cadre du carcan de l'orthodoxie budgétaire, et plus largement des traités – auxquels ils faut désormais ajouter les plans de militarisation – dont l'UE est la promotrice et la gardienne sourcilleuse.
Toute la question se ramène en fin de compte à celle de la « désobéissance » à ces traités. Les négociations en vue de l'élaboration du programme de la NUPES de 2022, qui s'étaient pourtant déroulées – du fait des rapports de force établis à gauche lors du 1er tour de l'élection présidentielle – dans les conditions les plus favorables aux positions « rupturistes » défendues par LFI, avaient montré que la ligne de démarcation au sein même de la gauche passaient bien par là. Les contorsions des formulations finales du programme en témoignent. Il est ainsi précisé que « si certaines règles européennes sont des points d'appui, chacun constate aujourd'hui à quel point d'autres, et non des moindres, sont en décalage avec les impératifs de l'urgence écologique et sociale et constituent de sérieux blocages à la mise en œuvre de notre programme ».
La liste qui suit est longue et touche à la quasi-totalité des axes du programme : traités de libre-échange, application de la « concurrence libre et non-faussée » aux services publics et aux biens communs, modèle productiviste et agro-industriel de la PAC, statuts de la BCE et règles budgétaires d'austérité du « semestre européen », libre circulation des capitaux qui « nous empêche de maîtriser un secteur financier de plus en plus agressif et nocif ». Que faire alors pour ne pas se laisser enfermer dans cette cage de fer ?
L'une des formulations les plus âprement débattues de cet accord a été celle qui a consisté à dire qu'« il nous faudra être prêts à ne pas respecter certaines règles [souligné dans le texte]. Du fait de nos histoires, nous parlons de désobéir pour les uns, de déroger de manière transitoire pour les autres, mais nous visons le même objectif : être en capacité d'appliquer pleinement le programme partagé de gouvernement et respecter ainsi le mandat que nous auront donné les Français ». « Désobéissance » ou « dérogation transitoire », au-delà de la terminologie, les mesures concrètement envisagées s'inscrivent pour l'essentiel dans le cadre d'une impossible « renégociation » des traités ou d'une plus utopique encore « Convention européenne pour la révision et la réécriture des traités européens, construite avec les Parlements nationaux et le Parlement européen », dont les conclusions seraient par la suite soumises à référendum à l'échelle des Etats-membres.
On s'imagine aisément les sarcasmes que de tels propos hallucinatoires susciteraient chez des gouvernants européens de l'heure s'ils parvenaient à leurs oreilles. Plus sobre, le programme du NFP réitère le même type d'acrobaties, en affirmant, d'une part, « refuser le pacte de stabilité budgétaire », tout en dressant, de l'autre, une longue liste de « plans » et de dispositifs (« pour l'urgence sociale et climatique », de « réindustrialisation de l'Europe », de « protectionnisme écologique et social aux frontières de l'Europe », de taxation des riches « au niveau européen pour augmenter les ressources propres du budget de l'UE ») conçus pour n'être réalisables qu'à l'échelle de l'UE. Autant dire qu'il ne peut s'agir que d'incantations vides de sens.
Pourtant, ce chapitre « Europe » se conclut par un engagement modeste mais qui a le mérite d'une certaine clarté : « nous refuserons, pour l'application de notre contrat de législature, le pacte budgétaire, le droit de la concurrence lorsqu'il remet en cause les services publics et nous rejetterons les traités de libre-échange ». Minimal, cet engagement s'est pourtant révélé inacceptable pour le PS, qui, comme l'indique son projet de « budget alternatif » (et avant cela son accord de non-censure avec Bayrou) s'est empressé de montrer sa volonté de se conformer au pacte budgétaire ici rejeté – un pacte dont les contraintes, nous l'avons montré, se sont entretemps renforcées davantage encore.
Faut-il donc se résigner à cette panne d'alternative stratégique ? Non, car, même si elle ne saurait s'en abstraire, la lutte sociale et politique déborde la logique des programmes et des rapports de force électoraux. L' issue n'est pas à chercher ailleurs que dans le réveil populaire qui s'annonce pour les semaines qui suivent. L'expérience l'a montré : c'est la mobilisation populaire qui est décisive pour ouvrir une brèche dans les situations qui paraissent sans issue positive. A condition bien sûr de s'inscrire dans la durée, et de construire pour cela les formes adéquates. Le défi pour le mouvement qui se dessine est de faire preuve à la fois de souplesse et d'inventivité.
Le chantier qui s'ouvre est celui d'une véritable auto-organisation populaire, d'une articulation – qui assurément ne va pas sans tension et difficultés – entre formes existantes et formes nouvelles, initiatives locales ou sectorielles et structures souples de coordination. Ce processus ne part pas de rien, car il prolonge l'expérience riche des mouvements très importants de ces dernières années. Des mobilisations qui n'ont certes pas remporté de victoires mais ont permis à une intelligence collective et une volonté de combat de se déployer parmi de larges secteurs sociaux.
La capacité créatrice surgit du peuple quand il se lance dans l'action de masse mais elle demande également à être fécondée par des propositions cohérentes et structurées. Parmi celles-ci, les forces de la gauche de rupture, et tout particulièrement LFI, portent une responsabilité particulière : celle de clarifier les conditions politiques et programmatiques d'un affrontement victorieux avec l'adversaire de classe, aujourd'hui avec le bloc bourgeois, c'est-à-dire avec le pouvoir macroniste et ses alliés, déclarés ou honteux, et avec l'Union européenne, qui en est l'expression politique d'autant plus redoutable qu'elle s'affirme comme la condensation de la force coalisée de l'ensemble des bourgeoisies européennes.
Le 4 septembre 2025.
Notes
[1] Parmi les rares exceptions signalons cet article stimulant de Noam Drif, « L'Union européenne, tabou de la gauche à l'ère de la servitude », Le vent se lève, 12 août 2025.
[2] Cf. la tribune de 5 économistes membres d'ATTAC publiée le 31 août 2015 dans Le Monde.
[3] Lire le démontage minutieux d'Eric Berr dans sa note de blog sur Mediapart.
[4] Wolfgang Streeck, Buying Time. The Delayed Crisis of Democratic Capitalism, Londres et New York, Verso, 2014.
[5] Sur ce sujet voir l'ouvrage classique de l'économiste marxiste et théoricien de l'écosocialisme James O'Connor, The Fiscal Crisis of the State, Abingdon, Routledge, 2001 (1ère édition 1973).
[6] Cf. notamment Loïc Wacquant, Punir les pauvres. Le nouveau gouvernement de l'insécurité sociale, Marseille, Agone, 2004.
[7] Wolfgang Streeck, The Rise of the European Consolidation State, Max Planck Institute for the Study of Societies, Discussion Paper, No. 15/1, Cologne, 2015, p. 17.
[8] Par exemple, l'eurodéputé macroniste Pascal Canfin qui déclarait en mai 2022 : « La Commission a longtemps privilégié l'orthodoxie budgétaire sur l'investissement public. Sa décision d'aujourd'hui prouve qu'elle a effectué un renversement de doctrine. On est dans une autre Europe », Le Monde, 23 mai 2022.
[9] Les « quatre libertés » sur lesquelles repose l'intégration européenne depuis le traité fondateur de Rome (1957) sont la libre circulation des capitaux, des marchandises, des services et des personnes. Conformément aux principes de l'ordolibéralisme, elles sont censées garantir la « libre concurrence », en empêchant la constitution de situations de monopole ou de rentes, et assurer ainsi le jeu du marché, que l'Etat se doit de garantir.
[10] Je remercie Benjamin Bürbaumer pour ces remarques sur ce point essentiel. Cf. son étude co-écrite avec Nicolas Pinsard Benjamin « The corporate welfare turn of state capitalism in France : Reassessing state intervention in the French economy, 1945–2022 », Economy and Society, n° 54. 2, 2025, p. 283–309.
[11] Dans le même article du Monde, le sociologue spécialiste des élites de l'Etat Pierre Birnbaum constate que « Le macronisme, c'est le triomphe de la haute fonction publique, qui prend en charge toutes les fonctions de l'Etat, y compris les fonctions politiques ».

Qui est Sébastien Lecornu, nouveau pantin fade de Macron ?

Terrifié par l'approche du 10 septembre, Bayrou a préféré se suicider politiquement. Sa longue et pitoyable carrière politique se termine donc, comme il en avait toujours rêvé, par une entrée dans l'Histoire : il est le premier Premier ministre de la Ve République à perdre son vote de confiance. Toutefois, au-delà des raisons des différents groupes politiques qui l'ont censuré, il est évident que pour les participants et participantes du 10 septembre, ce qui est reproché à François Bayrou n'était pas un problème de personne : celui-ci était tellement fade et insipide qu'il se rendait presque difficile à détester. Non, le problème, et tout le monde l'a bien compris, c'est sa politique d'austérité, c'est-à-dire d'appauvrissement généralisé et de massacre des services publics. Cette politique n'a rien de spécifique à Bayrou, c'est celle, bourgeoise, de Macron. Depuis sa défaite aux législatives 2024, le président de la République s'est radicalisé dans son mépris de la démocratie. Bien qu'ayant perdu ces élections, et sans majorité (ni absolue, ni relative), il passe son temps à placer des Premiers ministres macronistes, qui se font, en toute logique, dégager les uns après les autres (malgré quelques magouilles avec le RN et le PS qui leur permettent généralement un petit sursis). Comme les précédentes fois, les médias et la classe politique – en particulier le PS – ont fait croire qu'il y avait une once de suspens et qu'il n'allait pas forcément se passer exactement ce qui s'est passé : à savoir que Macron a nommé un clone de Bayrou, qui était déjà dans les short-lists précédentes. Ce clone, relativement inconnu du grand public, c'est cette fois Sébastien Lecornu. Pour arriver à un tel poste, il faut avoir donné des gages de mesquinerie, de prises de positions puantes, de politiques qui détruisent la vie des gens. Il n'y fait donc pas exception. Portrait.
10 septembre 2025 | tiré du site Frustrations
https://frustrationmagazine.fr/sebastien-lecornu
L'origin story de Sébastien Lecornu est classique et peu passionnante. Petit-fils d'un ancien vice-président d'une chambre de commerce, issu d'une famille de commerçants et d'agriculteurs, le petit Lecornu semble avoir hésité entre la vie monastique et l'armée. Adolescent et scolarisé dans un lycée privé catholique, il est déjà de droite et ringard : « J'aime l'ordre. Pour moi, la gauche représente le désordre. Et malgré mes origines populaires, je n'ai jamais cru à l'excuse sociale. Quand on travaille, on y arrive toujours » dit-il. Il poursuit ensuite par des études de droit, avant de devenir assistant parlementaire de Franck Gillard, puis de créer, en 2013, une entreprise de lobbying(on dit de “conseil en relations publiques et de communication dans la sphère publique”).
Opposé aux droits égaux pour les homosexuels
En 2012, il s'oppose vivement à l'obtention de l'égalité des droits pour les homosexuels, à savoir le droit au mariage et à la PMA (avant de changer d'avis en 2019 sur pression des macronistes). Il déclarait ainsi que “le communautarisme gay m'exaspère autant que l'homophobie” et qu' “une famille se construit entre un homme et une femme”.
Un collègue d'Alexandre Benalla et un professionnel de la politique
Sébastien Lecornu s'engage rapidement comme officier dans la réserve de la Gendarmerie (des volontaires qui sont appelés dans certains cas pour renforcer les effectifs). C'est dans ce cadre qu'il devient commandant de peloton d'Alexandre Benalla, un proche de Macron, s'étant rendu coupable de violences contre des manifestants en se déguisant en policier. Sébastien Lecornu déclare ainsi avoir eu le sinistre personnage sous sans commandement “une dizaine de fois” et loue ses qualités, disant qu'il “n'était pas un mauvais gendarme de réserve, au contraire”.
En 2014, Lecornu devient maire de Vernon. Il démissionne au bout d'un an pour un autre mandat. Crédit : Hôtel de Ville de Vernon ; Giverny888, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
En 2014, il commence véritablement sa vie de politicard et est élu maire de Vernon, ce qu'il reste jusqu'en 2015. Il est aussi vice-président de la communauté d'agglomération des Portes de l'Eure puis de Seine Normandie Agglomération de 2014 à 2020.
Au département de l'Eure (2015-2017, 2021-2022) : la chasse aux pauvres et la précarisation des associations
En 2015 puis en 2021, Lecornu a été élu Président de l'Eure, après avoir, selon Médiapart, bénéficié de son amitié avec Bruno Le Maire. Le journal y voit d'ailleurs “la figure la plus emblématique du “système Le Maire”” dans le département.
Il a consacré son mandat à martyriser les allocataires du RSA, c'est-à-dire les gens les plus pauvres de son département, en les soupçonnant de fraude. “On préfère serrer la vis, diminuer les dépenses” dit-il. C'est également dans ce sens qu'il avait décidé de ne pas verser les 2% d'augmentation du RSA, une décision abjecte qui posait même des questions légales.
Il est aussi connu pour avoir mis de la vidéosurveillance dans les collèges et pour avoir fermé deux collèges en éducation prioritaire, c'est-à-dire accueillant les élèves en difficulté ayant besoin d'un accompagnement spécifique. La secrétaire départementale du Snes, Céline Chandavoine, expliquait dans Médiapart que sous la présidence de Lecornu, le conseil départemental avait fait “d'énormes coupes, parfois de moitié” dans les budgets des collèges, ajoutant qu'ils “ont supprimé le financement d'opérations comme Collège au cinéma”.
Les subventions locales pour les associations se sont, elles, écroulées.
Celui que Ouest-France décrit comme un “adepte de la cash attitude”, est plutôt qualifié de “brutal” par son opposante PS Janick Léger. Timour Veyri, patron des socialistes de l'Eure, décrit “des petits commissaires politiques” qui “administrent le département en son absence et mettent la vie locale en coupe réglée”. Lecornu s'en vante d'ailleurs. Dans une interview pour Le Démocrate Vernonnais en 2015, il déclarait :“Je suis autoritaire. Mais est-ce que c'est un défaut après tout ?” (oui).
En mars 2019,le Parquet national financier ouvre une enquête pour prise illégale d'intérêts et “omission de déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique”. Il est, en effet, accusé d'avoir approuvé, dans son poste au département, au moins quatre délibérations concernant la Société des autoroutes Paris-Normandie tout en étant rémunéré par cette dernière (à hauteur de 7 874 euros). L'enquête fut finalement classée “sans suite” en juin 2023.
Lors de sa deuxième élection en 2021,où PCF et France Insoumise avaient appelé à voter pour lui au second tour pour “faire barrage” au RN, il parvient à convaincre Macron de rester cumulard, en gardant sa fonction de de président du conseil départemental en plus de son poste de ministre.
La “bande Bellota-Belotta”
En 2017, alors qu'il était directeur de campagne adjoint du candidat d'extrême droite LR François Fillon, il abandonne finalement son candidat englué dans son affaire de détournement de fonds (le “penelopegate”).
Avec Thierry Solère, Edouard Philippe et Gérald Darmanin, il fait partie de la bande “Bellota-Bellota” du nom d'un restaurant du très bourgeois VIIe arrondissement de Paris où une partie de ces Républicains passés au macronisme avaient leurs habitudes. Se retrouvant souvent le soir, ces hommes aiment, selon Le Monde, se moquer autour d'une bière, “des personnes handicapées, des féministes, des écolos”. Ils furent exclus à peu près en même temps de LR pour avoir rejoint Macron.
Parmi eux, il est particulièrement ami avec Gérald Darmanin, qui fut accusé en 2017 d'avoir violé une femme en 2009 (la plainte aboutit à “un non-lieu”), Lecornu rappelant leur militantisme commun aux “Jeunes pop” et qu'il fut “témoin de mariage” de celui-ci.
Un pro-nucléaire et pro-chasse à la Transition écologique (2017-2018)
En juin 2017 il est nommé Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot (qui démissionne en septembre 2018, avant d'être accusé de nombreuses agressions sexuelles et de viol par plusieurs femmes, dans le cadre d'une enquête classée sans suite pour prescription) puis de François de Rugy (qui démissionnera lui suite à de nombreuses controverses sur son utilisation des fonds publics) .
Pro-nucléaire, c'est à lui que Nicolas Hulot confie l'ouverture de la centrale de Flamanville, qui n'advint qu'en 2024, suite à de nombreux retards. En juin 2019, après le départ de Lecornu du ministère, 36 infractions furent constatées à la centrale nucléaire de Flamanville, liées à « de très inquiétantes négligences dans la gestion de substances dangereuses” (source : rapport de l'Autorité de sûreté nucléaire) entraînant une plainte d'associations comme France nature environnement, Stop EPR ni à Penly ni ailleurs, ou le Crilan. En 2021 et 2022, un groupe électrogène installé pour assurer le refroidissement des réacteurs en cas de défaillance des installations électriques prend feu à trois reprises.
C'est aussi à Lecornu qu'est confié le projet d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure. En février 2018, quelques heures avant son arrivée, les opposants au projet sont violemment évacués du bois Lejuc par 500 gendarmes. “Il n'y aura pas d'installation de Zad nouvelle dans ce pays” déclarait-il alors. Des interpellations d'opposants, des gardes à vue, et des perquisitions avaient suivies, puis des convocations au tribunal pour “outrages et/ou rébellion”, certains jugés en comparution immédiate. En toute logique, les opposants avaient refusé de rencontrer le ministre. Le même mois, Le Monde publiait un article sur la thèse d'un chercheur démontrant l'impossibilité de prouver la sûreté du projet. GreenPeace dénonçait, elle, des failles de sûreté (risques d'incendies, d'infiltration, de dispersion de la radioactivité), des failles géologiques, logistiques, d'irréversibilité, économiques et éthiques.
C'est lui qui s'occupa également de la violente évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes en avril 2018 où une trentaine d'opposants furent blessés suite à l'envoi de 25 escadrons de gendarmes, soit 2 500 hommes pour environ 300 zadistes. “Le compte à rebours est lancé” avait-il déclaré en mars 2018, comme un mauvais méchant de film. Il avait multiplié les propos de ce genre lors d'une visite dans la ZAD, promettant “une réponse de la République très très vite”, et ajoutant, menaçant, que “la main de l'Etat ne tremblera pas”.
Il est par ailleurs qualifié par Paris Match de “Monsieur Chasse” “officieux” de Macron. Chassons.com, reconnaissant, rappelait que Lecornu avait “travaillé à rendre la chasse plus accessible en réduisant le coût du permis national”.
En 2018, il est nommé ministre chargé des Collectivités territoriales, où il ne laissera aucune trace notable. Il restera à ce poste jusqu'en juillet 2020.
“Ministre des colonies” (2020-2022) : mépris pour la Guadeloupe, deux-poids deux-mesures pour le Covid
En juillet 2020, il est nommé ministre des Outre-mer. Il est le premier depuis 2009 à ne pas être lui même originaire des Outre-mer, ce qui suscita, légitimement, de nombreuses critiques. La présidente du conseil départemental de Guadeloupe, Josette Borel-Lincertin écrivit : “Je regrette que le ministère des Outre-mer ne soit plus confié à un originaire de ces territoires dans un gouvernement où, d'ailleurs, la diversité est absente.” tandis que le député de Guyane Gabriel Serville partageait sur X une affiche du ministère des colonies en 1935, commentant “Les Outre-mer sans les ultramarins, saison 7, épisode 125”. Le député européen Younous Omarjee allait dans le même sens en écrivant ironiquement “Vive le temps des colonies !”.
En novembre 2021, en Guadeloupe, un mouvement radical s'est déclenché autour de l'obligation vaccinale des soignants et des pompiers. Comme en dictature, le préfet avait instauré un couvre-feu “jusqu'au retour au calme” pour faire face aux blocages, aux piquets de grèves et aux émeutes. Evidemment, dans un pays où 34,5% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, avec 19% de chômage (dont 35% chez les jeunes), la contestation avait aussi d'autres dimensions que la seule question vaccinale.
Lecornu préférait gérer le dossier… depuis Paris. Cette attitude avait un peu consterné la classe politique. C'est ce qui avait fait se demander à Xavier Bertrand : « S'il y avait les mêmes problèmes en métropole, vous ne croyez pas que le ministre y serait ?”, tandis que Jean-Luc Mélenchon disait qu'il n'était “pas un grand courageux” et qu'Aurélien Pradé (LR) l'accusait de se “planquer à Paris”. Le président du conseil régional de la Guadeloupe s'était aussi étonné que le ministre ne vienne pas, et qu'aucune délégation ne soit envoyée pour discuter avec les syndicats. Cet élu, pourtant macroniste, constatait que l'Etat ne traite pas la Guadeloupe “de la même manière qu'une région” de l'hexagone. Même le sénateur macroniste de Guadeloupe Dominique Théophile trouvait que celui-ci s'est “s'est montré un peu brutal, sans exprimer beaucoup d'empathie”. D'une manière générale, les critiques étaient présentes jusqu'au sein de la majorité présidentielle : les élus de la République en Marche trouvant que le ministre, symbole d'une “droitisation du quinquennat” selon Le Monde, était bien plus focalisé sur la campagne présidentielle de 2022 qu'à faire son travail de ministre. Il était en effet suspecté d'être resté à Paris pour s'occuper de la diffusion d'une tribune d'élus locaux en soutien à Macron dans Le Journal du dimanche…
Alors que les mesures autoritaires sous prétexte de lutter contre le COVID allaient parfois jusqu'au délire, le ministre Lecornu faisait lui preuve d'une grande légèreté quant aux gestes barrières, Médiapart ayant dévoilé sa participation à un apéro le 16 octobre 2021 en Nouvelle-Calédonie alors que celle-ci subissait un confinement délirant interdisant tout déplacement et rassemblement, puis, en novembre, une vidéo d'une “soirée rhum”, où on le voyait sans masque avec une dizaine de personnes dans un salon de son ministère.
Au ministère des armées (depuis 2022), des centaines de milliards d'euros pour l'industrie d'armement et la guerre, des livraisons d'armes à Israël et un dîner avec l'extrême droite
Nommé ministre des Armées, celui qui défendait jusqu'ici l'austérité partout, au point de grappiller sur le RSA, les collèges etc., devint extrêmement dispendieux. Entre servir les pauvres et le complexe militaro-industriel, le choix est vite fait pour Lecornu. C'est ainsi qu'il promit de doter l'armée de 413 milliards d'euros entre 2023 et 2030, en faisant passer le budget annuel de 32 milliards en 2017 à 69 milliards en 2030, c'est-à-dire plus du double.
Disclose a révélé à plusieurs reprises, en mars 2024 puis en juin 2025, des livraisons de mitrailleuses à Israël, nation qui commet un génocide à l'encontre des Gazaouis. Il y a quelques jours Médiapart montrait que “les exportations à destination de l'État hébreu ont atteint un montant inégalé depuis huit ans” : “les prises de commandes d'Israël ont été de 27,1 millions d'euros en 2024”, et “au-delà des commandes, les livraisons à Israël représentent 16,1 millions d'euros”. Sébastien Lecornu avait répondu qu'il ne s'agissait pas d'armes mais de “composants”, puisqu'une fois assemblées ces armes étaient “réexportées”, ou bien que qu'il s'agissait d'armes de “défense”… Mais dans les faits les dockers CGT de Marseille de ont bien bloqué l'envoi de pièces pour fusils-mitrailleurs à destination d'Haïfa en Israël en juin dernier.
En avril 2025, Le Canard Enchaîné révélait que le ministre des Armées avait reçu les deux leaders de l'extrême droite française, Jordan Bardella et Marine Le Pen, à dîner, en anticipation (déjà) de sa nomination comme Premier ministre.
Sébastien Lecornu illustre parfaitement ce qu'est la macronie finissante : un mélange de brutalité policière, de refus de la démocratie et de fidélité sans faille aux intérêts du capital et des lobbys réactionnaires – qu'il s'agisse du nucléaire, de la chasse, des industriels de l'armement ou des notables locaux. À chaque étape de sa carrière, il a incarné cette logique : taper sur les plus fragiles et les plus pauvres, réprimer les contestations, flatter les lobbys, tout en accumulant les postes et les privilèges. Son arrivée à Matignon, après l'échec de Bayrou, constitue la suite logique d'un système qui recycle ad vitam aeternam les mêmes profils interchangeables. Derrière la façade d'un « nouveau » Premier ministre, c'est toujours la même politique qui se poursuit : celle de Macron, autoritaire, antisociale et profondément réactionnaire.

10 septembre : beaucoup d’appels à tout bloquer !

Nous publions quelques appels de ceux compilés par le site Entre les ligne Entre les mots (PTAG)
9 septembre 2025 | tiré entre les lignes entre les mots
https://www.reseau-bastille.org/2025/09/09/beaucoup-dappels-beaucoup-dappelants-beaucoup/
Appel à soutenir, amplifier et prolonger la mobilisation du 10 septembre
Depuis que la macronie s'est installée, le président de la République et ses gouvernements successifs n'ont cessé de gouverner contre le peuple et la planète, organisant avec minutie la casse sociale démocratique et écologique au profit des milliardaires. Ils ont joué avec la démocratie comme ils auraient joué une partie de poker. Ils ont fait de la tactique, jouant aux cartes nos vies et notre avenir Nous nous sommes mobilisé·es par centaines de milliers contre la réforme des retraites, la loi Duplomb, les licenciements, contre les contrôle au faciès, l'islamophobie, l'antisémitisme et tous les racismes, les violences faites aux femmes, les politiques climaticides, l'A69 et tous les grand projets inutiles et imposés, contre les expulsions locatives, contre la destruction du monde associatif et de la culture…
Nous n'avons cessé de lutter. La seule réponse à la mobilisation a été, avec constance, la répression, le 49.3, la propagande médiatique et finalement la poursuite aveugle et irresponsable d'un projet visant à écraser toujours plus la population, accaparer toujours plus de richesses, conserver toujours plus le pouvoir. Mais la colère est toujours là. Le cri sourd des femmes et des hommes qui subissent est en train de se transformer en clameur. Un mot d'ordre est repris, partout organisons-nous pour bloquer le pays à partir du 10 septembre.
Nous militant·es, écologistes, féministes, antiracistes, syndicalistes, antivalidistes, mobilisé·es pour la biodiversité, la paix, la démocratie, les droits des personnes LGBTQIA+, la justice sociale, climatique et fiscale, nous qui luttons de notre mieux contre toutes les oppressions, les injustices et les inégalités, appelons à signer et faire signer cet appel pour soutenir, amplifier et prolonger le 10 septembre.
Dans chaque quartier, chaque village, rassemblons-nous sur les places et les ronds points et décidons ensemble comment agir. Dans nos entreprises, nos administrations, nos écoles, organisons-nous, avec nos collectifs d'actions nos syndicats et associations. Ne laissons personne de coté, faisons du 10 septembre le début de la lutte de tous et toutes pour tous et toutes. Par la manifestation, la désobéissance, la grève, le blocage, l'occupation, arrachons une vie digne et heureuse pour chacun et chacune, dans un monde vivable. Ils nous empêchent de penser à demain en créant chez nous la peur de l'avenir.
Ensemble construisons les conditions de nos dignités.
Nous militons entre autres dans les organisation suivantes : Action Justice Climat-Paris, AFPS, Agir ensemble Contre le Chômage, Alternatiba, Alternative Communiste, ANVCOP21, Attac, Assemblée Populaire de Pantin, Bio Consom'Acteurs, Cannabis Sans Frontière, Cedetim, Cerise la Coopérative, Cimade, CGT Educ, CGT spectacle, Confédération Paysanne, Coordination des Intermittents et Précaires, Debout !. Egalités, Ensemble, Extinction Rébellion, Fondation Copernic, France Nature Environnement, Force Ouvrière, Fédération Syndicale Unitaire, Fondation Good Planet, Génération.S, Greenpeace, L214, La France Insoumise, Radio LaiR NU, L'APRÈS, Les amis de la conf, Les amis de l'Humanité, La Révolution Écologique pour le Vivant, Le Baranoux, Les Désobéissants, Les Écologistes, Les Gilets Jaunes, Le Parti Communiste, Le Parti Socialiste, Les Jeunes Ecologistes, Ligue des Droits de l'Homme, LPO, Mouvement de la Paix, Nouveau Parti Anticapitaliste, Nous Toutes, On s'en Mêle, PEPS, Printemps écologique, Printemps de la Psychiatrie, Radio Cause Commune, Radio Parleur, Réseau Education Sans Frontières, Réseau Salariat,Rosies, SNAC, SNES, SNUIPP, Solidaires Asso, Soulèvements de la terre, Stop Violences Policières, Sud Rail, Terres de Liens, UJFP, Victoires populaires, …
Nous sommes ouvrier·es, chômeurs chômeuses, ingénieur·es, retraité·es, barmans, barmaids, paysan·ne, conseiller·es régionales, Travailleurs et travailleuses handicapé·es, consultant·es, cheminot·es, avocat·es, téléconseiller·es, médecins, lycéen·nes, scénaristes, artistes, auteurs autrices, menuisier·es, enseignant·es, bénévoles, technicien·nes, responsables politiques, directeurs directrices, intérimaires, agriculteurs agricultrices, économistes, cadre, activistes, maires, étudiant·es, juristes, musicien·nes, pédopsychiatres, employé·es, philosophes, conseiller·es municipales, jardinier·es, député·es, chef·fe de projet, conseiller·es communautaires, assistant·es sociale, sénateurs sénatrices, hôtelier·es peintre·s, député·es Intermittentes, historien·nes, développeurs développeuses, secrétaires, traducteurs traductrices, cuisinier·es, géographes, chercheurs chercheuses, conseiller·es, formateurs formatrices, ébénistes, sociologues, journalistes, postier·es, anthropologues, professeur·es …
Nous venons de : Abbeville, Angers, Antibes, Argenteuil, Arles, Audincourt, Auray, Bagnolet, Beaumes de Venise, Beuvrages, Brunoy, Bruyères, Captieux, Charenton-le-Pont, Châteauroux, Chaumont, Chelles, Clichy, Concarneau, Cremieu, Dieppe, Dole, Ermont, Eyragues, Fontenay Sous Bois, Gap, Gradignan, Ivry Sur Seine, Joigny, Joyeuse, La Baule, Langeais, Langon, Languidic, Lapeyrouse, La Tour Du Pin, La Trinité, Le pré Saint Gervais, Les Pavillons Sous Bois, Levallois Perret, Lille, Lorgues, Lyon, Narbonne, Maison Alfort, Marignane, Marseille, Merignac, Miramas, Monterault-Fault-Yonne, Mongerons, Montalieu-Vercieu, Montferrand, Montpellier, Montreuil, Mours, Neuvilles sur Saône, Nice, Nîmes, Nivillac, Noisy Le Sec, Olivet, Orléans, Paris, Pantin, Passy, Peyrehorade, Plérin, Plouaret, Pugnac, Rembercourt, Reims, Rennes, Ribérac, Romainville, Quimper, Saint-Brieuc, Saint-Cyr-l'Ecole, Saint-Martin-Boulogne, Saint Michel sur Orge, Saint Père en Retz, Saint-Pierre-des-Corps, Saint Savinien, Salérans,Salon, Sens, Serris, Strasbourg, Toulouse, Tours, Treigny, Valenciennes, Veynes, Villejuif, Vire, Viroflay, Vitry-Sur-Seine, …
Pour signer et/ou voir les signataires :
https://framaforms.org/appel-a-soutenir-amplifier-et-prolonger-la-mobilisation-du-10-septembre-1754304474
https://regards.fr/tribune-appel-a-soutenir-amplifier-et-prolonger-la-mobilisation-du-10-septembre/
*-*
Les Soulèvements de la terre contribueront à « tout bloquer »
Les Soulèvements de la terre contribueront à « tout bloquer » contre le plan Bayrou à partir du 10 septembre. De nombreux comités locaux et greniers des Soulèvements ont commencé à mettre à disposition leurs moyens matériels, réseaux et savoir-faire. Nous livrons à la discussion au sein du mouvement qui s'annonce quelques réflexions sur les luttes contre l'intoxication du monde et contre l'alliance des milliardaires réactionnaires. Réflexions qui peuvent donner des idées sur « quoi bloquer » au moment de « tout bloquer ».
https://lessoulevementsdelaterre.org/blog/10-septembre–tout-bloquer-et-bien-viser
******
Construisons un processus de lutte pour gagner, construisons la grève ! Déclaration du CCN des 26 et 27 août
Les organisations de la CGT réunies en CCN sont particulièrement préoccupées de la situation des millions de travailleuses et de travailleurs, de leurs familles victimes de la guerre et des conflits. En Ukraine, au Soudan, en République Démocratique du Congo, en Palestine et partout dans le monde, la paix et le droit international doivent être mis en œuvre immédiatement, les populations civiles doivent être protégées. À Gaza et en Palestine occupée, la folie génocidaire de Netanyahou doit être stoppée et un cessez le feu immédiat imposé par la communauté internationale permettant l'acheminement de l'aide humanitaire, la fin de l'occupation militaire israélienne, la reconstruction de Gaza et le droit à l'autodétermination pour le peuple palestinien. La CGT soutient et participe à toutes les initiatives de mobilisations permettant d'arrêter immédiatement le génocide en cours. Elle portera la proposition de faire du 21 septembre, journée mondiale pour la Paix, un temps fort de mobilisation nationale pour la Palestine. La France a enfin décidé de reconnaître l'État de Palestine, il est urgent de le faire sans délai, de cesser toute coopération avec le gouvernement d'extrême droite israélien, de prendre des sanctions et de cesser toute livraison d'armes et de composants militaires.
C'est dans ce contexte international dramatique et en pleine période de congés que le gouvernement, au service du patronat, a annoncé un budget d'une violence inédite : vol de 2 jours fériés ; doublement des franchises médicales ; gel du salaire des fonctionnaires, des pensions des retraité·e·s, de toutes les allocations sociales (aides au logement, allocations familiales, allocation adulte handicapé…) ; réforme de l'assurance chômage ; suppression de 3000 postes de fonctionnaires avant des dizaines de milliers d'autres ; coupes dans les budgets des hôpitaux, des écoles, de la culture ; volonté affichée de remettre en cause la 5ème semaine de congés payés et précariser toujours plus les contrats… Si ce budget était adopté, chacune et chacun perdrait plusieurs centaines d'euros en 2026, nos services publics et notre système de protection sociale seraient considérablement affaiblis. Dans les territoires d'Outre-Mer, ce serait la double peine : de violentes baisses de revenus alors que les prix sont déjà beaucoup plus élevés.
Pourquoi une telle cure d'austérité ? Parce qu'Emmanuel Macron a multiplié les cadeaux aux plus riches et aux grandes entreprises tout en engageant une augmentation massive des budgets militaires au profit des vendeurs d'armes. Nous refusons qu'encore une fois, le monde du travail soit sommé de passer à la caisse : c'est aux grandes entreprises et aux rentiers, qui se gavent d'argent public et de dividendes, de payer !
Alors que cet été a encore battu des records de chaleur, avec de violents incendies et des morts au travail, il est temps d'arrêter la fuite en avant et de prendre enfin des mesures pour limiter le réchauffement climatique et adapter nos sociétés. Cela passe dans l'immédiat par l'abrogation des mesures anti-environnementales qui n'ont pas encore été retirées de la loi Duplomb, heureusement déjà amputée sous la pression d'une mobilisation citoyenne massive dont la CGT se félicite.
La CGT exige l'abandon du projet de budget et la mise en place de mesures d'urgence autour de 5 priorités :
* La justice fiscale : la taxation des patrimoines, des dividendes et des rachats d'action, la remise à plat des 211 Mds d'aides publiques aux entreprises, le rétablissement de l'ISF et la mise en place d'une vraie progressivité de l'impôt sur le revenu
* La justice sociale par l'abrogation de la réforme des retraites, première étape pour gagner la retraite à 60 ans, et une Sécurité sociale répondant aux enjeux actuels, rétablie dans ses prérogatives issues du programme du Conseil national de la Résistance, dotée de l'ensemble des moyens nécessaires pour répondre aux besoins
* Le financement de nos services publics et de la transformation environnementale de notre économie, de l'argent pour nos hôpitaux, nos écoles et nos universités et nos infrastructures et notre politique culturelle
* L'augmentation des salaires, des pensions, des minimas sociaux, l'égalité F/H et des mesures contre la vie chère dans les outre-mer
* L'arrêt des licenciements et l'organisation d'assises de l'industrie
Grâce à notre mobilisation contre la réforme des retraites, le gouvernement n'a jamais été aussi faible, Emmanuel Macron n'a plus de majorité pour faire passer ses réformes régressives et la colère sociale est énorme. Pour éviter d'avoir à modifier son budget, F. Bayrou en est réduit à servir de fusible. Nous ne nous laisserons pas distraire par cette manœuvre de diversion. Quelle que soit la situation gouvernementale, ce que nous voulons, c'est un autre budget correspondant aux urgences sociales et environnementales. Tous les ingrédients sont réunis pour gagner ! Pour cela, il nous faut construire une mobilisation massive et unitaire !
La CGT se félicite que les initiatives se multiplient d'ores et déjà et appelle à les amplifier. Le 25 août, les salarié·e·s de Radio France ont commencé une grève reconductible et les hôpitaux de Paris ont engagé un processus de mobilisation, suivis le 2 septembre par les salarié·e·s du secteur de l'énergie, le 4 septembre les salarié·e·s de Novasco seront en grève comme ceux d'Owens Illinois le 9 septembre pour empêcher la fermeture de leurs usines, les fédérations CGT des Industries chimiques et du Commerce et des Services appellent depuis déjà plusieurs mois à la grève le 10 septembre contre la répression antisyndicale, pour les salaires, les conditions de travail et contre la casse sociale, une manifestation nationale des professionnel·le·s de la santé et de l'action sociale est d'ores et déjà prévue à Paris le 9 octobre ainsi qu'une grève dans les organismes sociaux et des mobilisations dans les services d'insertion/probation du ministère de la Justice.
La dynamique de l'initiative citoyenne du 10 septembre démontre l'ampleur de la colère sociale. La CGT souhaite que cette journée soit une première étape réussie, ce qui passe en particulier par la grève sur les lieux de travail. Elle appelle donc ses syndicats à débattre avec les salariés et à construire la grève partout où c'est possible.
Lors de l'intersyndicale nationale interprofessionnelle du 29 août, la CGT proposera d'appeler en septembre à une journée interprofessionnelle unitaire de mobilisation de grève et de manifestations, et de construire un processus dans la durée pour gagner un budget à la hauteur des besoins.
La CGT appelle l'ensemble de ses organisations :
* A organiser des intersyndicales, dans les professions, les territoires et les entreprises
* A se déployer en grand auprès des salarié·e·s, retraité·e·s, privé·e·s d'emploi en continuant à faire signer la pétition intersyndicale stopbudgetbayrou.fr, diffusant les tracts explicatifs et en faisant connaître le simulateur CGT qui permet à chacune et chacun de mesurer l'impact des mesures.
La CGT appelle l'ensemble des salarié·e·s, retraité.e.s et privé.e.s d'emplois qui souhaitent se mobiliser à se syndiquer et se mettre en contact avec la CGT pour agir.
Tous les ingrédients sont réunis pour gagner, prenons les choses en main pour imposer nos exigences sociales et environnementales.
Montreuil, le 27 août 2025
https://www.cgt.fr/actualites/mobilisation/construisons-un-processus-de-lutte-pour-gagner-construisons-la-greve
******
Grève et mobilisations dès le 10 septembre pour une autre politique budgétaire, sociale et le partage des richesses ! L'Union syndicale Solidaires
L'Union syndicale Solidaires appelle à se mettre en grève et à soutenir le mouvement « bloquons tout » qui exprime la colère sociale multiforme et grandissante face aux annonces budgétaires du gouvernement Bayrou.
La tentative désespérée de F. Bayrou montre que nous pouvons gagner et ne fait que renforcer notre volonté de combattre le projet de budget injuste et dont les travailleurs·euses et la population, les plus précaires, les femmes, les retraité·es, les allocataires d'aides, les personnes malades feront plus particulièrement les frais.
Quel que soit le gouvernement, nous refusons l'austérité et défendons d'autres choix budgétaires. L'Union syndicale Solidaires prend la responsabilité de travailler à construire un mouvement social pour faire aboutir nos revendications et instaurer un autre partage des richesses.
D'ores et déjà des mouvements de grève sont en cours, comme à Radio France. Contre les « économies » qu'on veut nous imposer, mobilisons-nous et notamment par la grève le 10 septembre et après. L'Union syndicale Solidaires appelle dès à présent les travailleurs et travailleuses à se réunir en assemblées générales pour construire ces mobilisations.
L'Union syndicale Solidaires s'inscrira de manière pleine et entière dans la construction d'un rapport de force par la grève dans l'intersyndicale du vendredi 29 août 2025.
Pas d'économies sur nos vies ! Imposons dans la rue un budget de justice fiscale, sociale et environnementale !
Pourquoi Scientifiques en rébellion se joint au « mouvement du 10 septembre »
Scientifiques en rébellion a signé un appel de nombreux collectifs visant à soutenir, amplifier et prolonger la mobilisation du 10 septembre. C'est pour élargir et enraciner, dans le présent et le futur, des valeurs d'équité, de démocratie, de solidarité et de liberté, que nous soutenons un mouvement social qui s'oppose et veut mettre fin à la politique des gouvernements Macron successifs.
Scientifiques en rébellion a signé un appel de nombreux collectifs visant à soutenir, amplifier et prolonger la mobilisation du 10 septembre, qui porteront un mouvement social maintenant rejoint par des fédérations syndicales comme Solidaires et la CGT. Ces dernières années, nous avons travaillé ensemble pour construire des argumentaires et nous positionner publiquement en tant que scientifiques, à partir de notre raison d'être, de nos connaissances, compétences et positions institutionnelles, aux côtés d'autres citoyen·nes militant·es :
* réitérant les alertes sur les crises climatiques et de la biodiversitéet pointant l'inaction climatique dont sont victimes en premier les classes populaires.
* nous positionnant contre des projets de grandes infrastructures inutiles et néfastes (méga-bassines, A69, CERN, LGV) et rejoignant de nombreuses manif-actions coordonnées par les Soulèvements de la Terre et bien d'autres collectifs engagés contre des projets contestés dans les territoires.
* dénonçant par le verbe et des actions de blocage ou d'occupation les positionnements et activités de grands groupes industriels (Pierre Fabre, Schneider Electric, Vivendi, TotalEnergies) et de leurs soutiens financiers (BNP Paribas) qui défendent leurs privilèges au détriment du vivant.
* rappelant notre engagement pour une démocratie antiraciste, antifasciste et anticoloniale à l'occasion d'épisodes électoraux frappants (élections législatives et européennes, accession de Trump au pouvoir) et soulignant les dérives autoritaires et répressives.
* rappelant l'inconsistance ou la nuisance des politiques actuelles au vu des enjeux : COPs, politique agricole.
C'est donc bien pour élargir et enraciner, dans le présent et le futur, des valeurs d'équité, de démocratie, de solidarité et de liberté, que nous soutenons un mouvement social qui s'oppose et veut mettre fin à la politique des gouvernements Macron successifs qui aggravent les crises systémiques, écologiques et sociales. En effet, leur politique visant à résorber la dette de la France par des baisses de dépenses publiques et un soutien à la production est à la fois injuste et stérile : l'affaiblissement des services publics essentiels et la casse des politiques environnementales préparent une dégradation de la vie des personnes, et notamment les plus précaires (voir quelques références en fin de texte). Nous pensons que le mouvement du 10 septembre peut ouvrir un débat démocratique sur la façon d'enclencher un processus de bifurcation désirable : vers une société écologique, égalitaire, antiraciste, antifasciste, décoloniale, inclusive…
Le collectif encourage ses membres et sympathisant·es, les étudiant·es et personnels de l'ESR, et plus largement tous les citoyen.es sensibles aux questions de justice sociale et environnementales à inventer ou rejoindre des actions locales et régionales du mouvement du 10 septembre. Notamment, il semble essentiel de rejoindre ou d'aider à organiser des actions visant des acteurs contribuant aux ravages écologiques et sociaux, et/ou portant les intérêts de luttes en soutien à des minorités.

Le Parti Rouge de Norvège offre une alternative de classe ouvrière

Le parti radical de gauche norvégien, Rødt, a recruté des milliers de membres ces dernières années et semble prêt à améliorer ses scores lors de l'élection de lundi. Seher Aydar, députée, explique comment le parti capitalise sur le mécontentement envers les partis établis.
Tiré de Europe Solidaire Sans Frontières
8 septembre 2025
Par Seher Aydar et Judith Scheytt
La Norvège est l'un des pays les plus riches du monde, en grande partie grâce à ses réserves pétrolières massives. Mais tout aussi important que le pétrole du pays a été le mouvement ouvrier fort qui, à partir des années 1960, a veillé à ce que les profits pétroliers ne finissent pas dans les poches des riches mais dans les coffres de l'État-providence. Contrairement à d'autres États riches en pétrole, la richesse de la Norvège a été utilisée pour construire une société remarquablement égalitaire, transformant la vie des travailleurs en une seule génération.
Mais ces dernières années ont vu les inégalités sociales augmenter en Norvège comme partout en Europe. Une combinaison de crise économique et d'austérité imposée par le gouvernement a rongé les acquis du mouvement ouvrier d'après-guerre et vidé le soutien aux partis traditionnels. Ce malaise politique et social a largement profité aux forces de droite. Le Parti du progrès d'extrême droite est maintenant au coude à coude dans les sondages avec le Parti travailliste — une force qui gouverne traditionnellement la Norvège mais a vu son soutien décliner précipitamment au cours des dernières décennies.
À la gauche du Parti travailliste, cependant, un nouveau concurrent a émergé : Rødt, ou le Parti rouge, qui s'est formé en 2007 comme une fusion de différents courants communistes et socialistes. Il a vu son soutien presque tripler depuis son entrée au parlement en 2017 et s'apprête à s'appuyer sur ces gains lors de l'élection parlementaire de lundi.
L'élection de 2021 a vu votre parti, Rødt, presque doubler son résultat. Si les sondages actuels sont révélateurs, vous êtes prêts à améliorer ce résultat lors de cette élection. À quoi attribuez-vous le succès actuel de votre parti ?
Je pense qu'il y a deux raisons principales. La première raison est que, même si beaucoup d'autres pays voient la Norvège comme une sorte de paradis social-démocrate, ce n'est pas le cas. Bien sûr, la situation est bien meilleure que dans beaucoup d'autres pays, même en Europe, mais on voit toujours des différences de classe. Les riches ne deviennent pas seulement plus riches, ils veulent aussi plus de pouvoir politique, et donnent de l'argent aux partis de droite pour l'obtenir. Je pense que les gens veulent changer cette constellation, et pour beaucoup d'entre eux, cela signifie soutenir notre parti, qui a eu un focus laser sur l'égalité économique depuis sa fondation.
Les gens remarquent aussi la hausse des prix alimentaires. En Norvège, deux entreprises familiales contrôlent 70 % de tous les magasins d'alimentation. Les gens voient ces inégalités et pensent : d'accord, voici un parti qui veut travailler pour les gens de la classe ouvrière, même ceux qui ne peuvent plus travailler. Je pense que les Norvégiens deviennent plus conscients des inégalités et veulent du changement, c'est pourquoi je pense — et j'espère — que nous obtiendrons un meilleur résultat cette année qu'il y a quatre ans.
Le deuxième facteur majeur, je pense, est le génocide en cours à Gaza, qui est un gros problème en Norvège. La solidarité avec le peuple palestinien a toujours été importante pour notre parti, mais surtout maintenant. Beaucoup de gens veulent soutenir les Palestiniens et veulent que la Norvège fasse plus, et ils choisissent donc des partis qui soutiennent la Palestine.
Pourquoi pensez-vous que les gens deviennent plus conscients des inégalités, comme vous le dites ?
Je pense que c'est à cause de la situation économique. Tout est plus cher qu'avant. Maintenant, même la famille norvégienne moyenne se sent en insécurité financière, ce qui n'était pas le cas il y a vingt ans. Leurs parents se sentaient en sécurité, mais eux ne le font pas.
En même temps, les personnes les plus riches de Norvège écrivent des articles de journaux se plaignant de la difficulté d'être riche ici...
Exactement. C'est à la fois l'insécurité économique que les gens ressentent, et l'injustice très visible dans la façon dont la richesse est distribuée. Nous n'avons jamais eu autant d'individus super-riches en Norvège qu'aujourd'hui, donc les gens voient le contraste plus clairement.
Nous nous tenons ici devant le plus grand hôpital d'Oslo. C'est un lieu de travail majeur et un gros employeur, mais le personnel connaît des pénuries parce que, comme disent les politiciens, « Nous n'avons pas assez d'argent pour les hôpitaux. » Mais tout le monde sait qu'il y a assez d'argent en Norvège. C'est pourquoi tant de gens ici veulent nous parler et nous dire qu'ils prévoient de voter pour nous. Ce n'est pas seulement le cas dans le secteur public mais dans l'industrie privée aussi.
Vous avez parlé de la hausse du coût de la vie. Dans quelle mesure l'invasion russe de l'Ukraine a-t-elle contribué à la hausse des prix ?
C'est un grand débat en Norvège. Certains partis, particulièrement ceux au pouvoir, prétendent que les prix de l'électricité augmentent à cause de l'invasion. Mais ce n'est pas vraiment vrai.
Le problème est que la Norvège a beaucoup d'énergie, et cette énergie était auparavant sous contrôle démocratique et public. Maintenant, le réseau énergétique norvégien est intégré au marché européen, et les prix sont plus élevés. Mais c'est un choix politique : laisser le marché contrôler votre infrastructure ou la garder sous contrôle démocratique. Bien sûr, la guerre a affecté certains prix, mais ce n'est pas tout le tableau.
Comment l'invasion a-t-elle impacté la politique norvégienne plus largement, étant donné que la Norvège était déjà membre de l'OTAN avec des niveaux de dépenses de défense comparativement élevés ? Votre parti a-t-il subi des pressions pour inverser sa position sur le retrait de l'OTAN ?
L'invasion russe a déclenché un débat renouvelé sur le secteur de la défense. De nos jours, tous les partis s'accordent à peu près à dire que nous devons renforcer notre propre défense. Auparavant, il y avait une attente que les États-Unis nous sauveraient, mais les gens ne pensent plus comme ça — surtout après Donald Trump.
Au sein de notre parti, il y a aussi eu un grand débat sur l'envoi d'armes à l'Ukraine. Ce n'était pas facile, mais à la fin je pense que nous avons atteint une bonne position. Nous sommes toujours opposés à l'OTAN, mais nous soutenons l'Ukraine et croyons qu'elle a le droit de se défendre, y compris avec des armes.
La guerre nous affecte aussi plus parce que la Russie est le voisin de la Norvège, et ce voisin attaque maintenant un autre pays voisin. Nous à Rødt nous opposons à l'impérialisme et à l'agression d'où qu'ils viennent — Russie, États-Unis, Israël, peu importe, nous avons une position de principe. Malheureusement, les autres partis norvégiens ne respectent pas toujours ces mêmes principes de manière cohérente, s'opposant à certaines guerres mais pas à d'autres.
Comme dans d'autres pays européens, le populisme de droite en Norvège est en hausse. Pendant un moment, il semblait même que le Parti du progrès d'extrême droite pourrait devenir la force la plus forte au parlement. Même si ce ne semble plus être le cas, à quel point pensez-vous que cette tendance est dangereuse, et quelle est la stratégie de Rødt pour la contrer ?
Bien sûr, c'est inquiétant, pas seulement pour moi mais pour beaucoup de gens, parce que c'est un symptôme de problèmes plus profonds dans la société. Notre stratégie principale pour faire face à la menace d'extrême droite est de parler de notre propre politique et de nos politiques — de ce que nous pouvons faire ensemble en Norvège. Les partis de centre-gauche et centristes, d'autre part, ont tendance à se limiter à dire aux électeurs que l'extrême droite est dangereuse. Bien que ce soit vrai, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi donner aux gens une alternative.
C'est pourquoi nous mettons l'accent sur l'économie. À Rødt, nous essayons de montrer aux électeurs que les gens de la classe ouvrière, les malades et les personnes âgées ont tous plus à gagner de nos politiques que de celles de l'extrême droite. Si l'agenda économique du Parti du progrès était mis en œuvre, la vie quotidienne des travailleurs empirerait. Le Parti du progrès travaille pour les plus riches — si vous regardez leurs actions, c'est évident. Nous essayons d'exposer cela.
Les sondages actuels suggèrent que le Parti travailliste prendra à nouveau la première place, mais ses partenaires de gouvernement, le Parti du centre et la Gauche socialiste, sondent moins bien, ce qui signifie que la coalition actuelle semble peu susceptible de survivre. Si votre parti se voyait offrir une chance de rejoindre le gouvernement, accepteriez-vous pour garder la droite hors du pouvoir ?
Rødt veut contribuer au changement politique afin de réduire les inégalités. Être au gouvernement n'est pas un objectif en soi pour nous. Nous sommes sceptiques quant à rejoindre pour administrer le capitalisme aux conditions du capitalisme. Pour que la participation au gouvernement soit une option réaliste à l'avenir, nous devrions être assez forts pour défier le système d'aujourd'hui. Par exemple, en reprenant le contrôle démocratique sur les ressources énergétiques ou en terminant l'Accord sur l'Espace économique européen [1] et en négociant un nouvel accord commercial plus démocratique avec l'UE. Nous n'en sommes pas encore là, même si nous grandissons.
Au lieu de cela, le plan de Rødt est de rassembler les partis de la constellation majoritaire pour créer un accord dans lequel nous nous mettons d'accord sur certaines lignes principales de politique pour les quatre prochaines années. Pour nous, il est important que le Parti travailliste s'engage envers la gauche et ne zigzague pas entre la droite et la gauche selon l'humeur du jour. Nous voulons que les riches et les entreprises contribuent plus à la société, pour assurer que les soins dentaires deviennent partie des services de santé publique et que les prestations pour les malades, les handicapés et les retraités soient augmentées.
Un nouveau développement cette année est que la principale confédération syndicale nationale a reconnu Rødt comme partie de la coalition rouge-verte plus large et soutient notre campagne financièrement.
Bien que ses jours de gloire soient loin derrière, le Parti travailliste domine encore la politique norvégienne. Alors que sa position décline, quel rôle voyez-vous pour Rødt ? Cherchez-vous à finalement remplacer le Parti travailliste comme principal parti de la classe ouvrière ?
Nous nous voyons comme le vrai parti de la classe ouvrière. Le Parti travailliste est devenu un parti d'establishment qui essaie de trouver un équilibre entre différents groupes sociaux. Mais les Norvégiens les plus riches se battent dur pour leurs intérêts, et on ne peut pas juste équilibrer entre eux et tous les autres — il faut se battre pour les intérêts de la classe ouvrière.
Bien sûr, nous préférerions que le Parti travailliste soit plus fort que les partis de droite, mais ce n'est pas notre travail de les rendre plus forts — notre rôle est de pousser le Parti travailliste vers la gauche et de soutenir les syndicats. Je pense que nous faisons déjà ce travail aujourd'hui.
Carola Rackete, qui a été brièvement membre du Parlement européen pour le parti socialiste allemand Die Linke, a récemment fait les gros titres pour une action de protestation en Norvège dans laquelle elle a comparé les exportations pétrolières continues du pays aux trafiquants de drogue, gardant l'Europe « accro » aux combustibles fossiles. Comment votre parti aborde-t-il l'industrie pétrolière massive de la Norvège et, plus spécifiquement, ses travailleurs du pétrole ?
Je ne connais pas ce que Rackete a dit, donc il est difficile de commenter directement. Mais quand il s'agit de l'industrie pétrolière norvégienne, Rødt est d'accord qu'elle doit être éliminée progressivement. L'État norvégien a gagné beaucoup d'argent du pétrole, et nous avons une responsabilité climatique majeure à assumer — une qui n'a pas encore été remplie.
Certains politiciens en Norvège veulent que nous soyons une nation qui vit de la vente de matières premières. Nous ne sommes pas d'accord. Notre proposition principale est d'arrêter toute nouvelle exploration pétrolière pour que la production décline naturellement. Mais Rødt est aussi un parti ouvrier, et nous nous préoccupons qu'il doit y avoir un plan approprié pour développer des emplois verts alternatifs avant que les anciens disparaissent. La Norvège a une énergie hydroélectrique sans émissions qui peut être utilisée pour l'industrie propre — un potentiel énorme que nous ne réalisons pas aujourd'hui parce que nous sommes aussi devenus un exportateur majeur d'électricité vers le continent.
J'ajouterais aussi que, grâce à une social-démocratie forte dans les années 1960 et 1970, la Norvège a réussi à réaliser ce que d'autres nations de matières premières n'ont pas fait : sécuriser la propriété et le contrôle de l'État sur les ressources naturelles. Nous sommes fiers de cette histoire.
Votre parti est assez jeune, ayant été fondé seulement en 2007 comme une fusion de divers courants d'extrême gauche plus petits. Comment a été votre croissance depuis ?
Rødt a été fondé en 2007, et à cette époque nous avions moins de 2 000 membres. Aujourd'hui nous en avons environ 14 000. Bien sûr, chaque parti a une histoire, et beaucoup de membres apportent leurs propres histoires, mais le parti aujourd'hui est façonné par nos membres et les luttes dans lesquelles ils sont impliqués. Je pense que le plus encourageant est le changement démographique que nous avons subi : alors que nous avons commencé comme un parti principalement urbain et académique, notre croissance au cours de la dernière décennie s'est produite largement parmi les travailleurs à bas salaires et les chômeurs, et de plus en plus, nous attirons des votes de tout le pays, pas seulement des grandes villes.
Nous sommes aussi devenus beaucoup plus jeunes depuis notre fondation, et notre direction actuelle est un produit de Rødt lui-même, pas de ses prédécesseurs. Cela montre aussi que Rødt n'était pas juste un exercice de changement de marque mais vraiment une force nouvelle et organique dans le mouvement ouvrier norvégien. Nous avons encore un long chemin à parcourir, mais j'ai espoir que nous continuerons à élargir notre base dans la classe ouvrière et, petit à petit, devenir une force dirigeante de la gauche norvégienne.
Seher Aydar est une militante féministe et antiraciste, et l'ancienne dirigeante de Solidarité avec le Kurdistan. Elle représente Rødt au Storting [le parlement norvégien] pour la circonscription d'Oslo.
Judith Scheytt est une militante et critique des médias et chroniqueuse pour l'édition allemande de Jacobin.
P.-S.
https://jacobin.com/2025/09/norway-red-party-working-class
Traduit pour ESSF par Adam Novak
Notes
[1] L'Accord sur l'Espace économique européen (EEE) permet à la Norvège d'accéder au marché unique européen sans être membre de l'UE
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La plus grande crise de l’histoire dans les relations entre le Brésil et les États-Unis

La guerre tarifaire de Trump dévoile l'extrême droite brésilienne dans un contexte encore incertain.
9 septembre 2025
Le ministère des Affaires étrangères n'a laissé planer aucun doute en qualifiant cette situation de plus grande crise de notre histoire en ce qui concerne les relations entre le Brésil et les États-Unis. Trump a officialisé hier le décret sur la hausse des droits de douane, qui entrera en vigueur le 6 août. Il en a profité, comme cela avait déjà été annoncé, pour utiliser le mécanisme connu sous le nom de loi Magnitsky afin de prendre des mesures de rétorsion contre Alexandre de Moraes et le STF.
La nouvelle version de la hausse des droits de douane arrive affaiblie, ce qui incite le gouvernement à poursuivre avec arrogance les affrontements, cherchant à isoler l'extrême droite nationale comme traîtresse aux intérêts du Brésil. L'interview de Lula dans le New York Times et la déclaration officielle du gouvernement brésilien ont souligné le caractère « non négociable » de la souveraineté nationale.
Les sénateurs brésiliens ont averti que de nouvelles restrictions pourraient entrer en vigueur — dans 90 jours — dans le cadre des représailles contre les BRICS. Trump a déjà menacé l'Inde dans les mêmes termes.
Moraes a répondu sans céder à Trump et en considérant les sanctions pour ce qu'elles sont : une nouvelle attaque frontale contre le Brésil. Et avec Zambelli emprisonnée en Italie, l'étau se resserre sur les détracteurs qui portent atteinte à la souveraineté brésilienne.
Dans cette période de turbulences, il est nécessaire de comprendre et d'agir pour défendre les intérêts du Brésil et de son peuple travailleur.
La déshydratation de la hausse tarifaire
Trump a vociféré et menacé ouvertement, sans cacher ses intentions, lorsqu'il a élevé la ligne du clan Bolsonaro au rang de politique d'État. Il a fait du cas brésilien un chapitre spécial de la guerre tarifaire qu'il mène à travers le monde. La guerre est la politique par d'autres moyens, comme le disait déjà le stratège allemand Clausewitz. Même s'il ne s'agit pas d'une guerre militaire, avec des flottes, des armées et des bombes, c'est une guerre dans le sens où elle exacerbe les conflits d'intérêts opposés. Elle n'est pas militaire, mais tarifaire.
Trump a conclu des accords importants, notamment avec le Japon et l'Union européenne, ce qui a suscité une plainte de la part de Macron. Les effets sur le Brésil, avec le décret de 50 %, sont graves, les entreprises paniquant et certaines envisageant de fermer des usines ou de décréter des congés collectifs. Le bras de fer a atteint un niveau sans précédent.
Trump a reporté de quelques jours l'entrée en vigueur de la hausse des droits de douane, désormais prévue pour le 6 août, et a ouvert près de 700 cas d'exception. Parmi les 694 articles concernés figurent des poids lourds de l'économie brésilienne, tels que l'industrie aéronautique civile, le jus d'orange, le papier et la cellulose, les noix du Brésil, le charbon, le gaz naturel, le pétrole et ses dérivés, entre autres. Ce répit, bien qu'incertain, représente près de 45 % des ventes brésiliennes aux États-Unis, retirant de la liste d'importantes entreprises de pointe telles qu'Embraer.
D'autre part, certains secteurs stratégiques, notamment liés à l'agriculture, tels que le café, les fruits, la viande et le poisson, restent sous la menace d'une forte augmentation des tarifs. Et en marge de tout ce processus, comme des questions transversales, se pose le problème des grandes entreprises technologiques et des terres rares. Le conflit va se poursuivre et aucune solution claire n'est en vue.
Trump n'a pas réussi à imposer totalement ce qu'il voulait et maintenant, des secteurs clés de l'économie nationale sont divisés, ce qui renforce les négociateurs du gouvernement, tant sur le plan « institutionnel » que dans l'opinion publique. La presse libérale a attribué la crise au clan Bolsonaro et à l'intransigeance de Trump. Moraes en sort renforcé. Les pressions en faveur d'une « capitulation ouverte » exercées par certains secteurs de la bourgeoisie ont pour l'instant diminué.
Le retour de la question anti-impérialiste a occupé le devant de la scène nationale. Un niveau de « cohésion sociale » qui n'avait pas été vu depuis longtemps a remis l'agenda politique au centre des préoccupations, a sorti le gouvernement de sa position défensive et a semé la désorganisation dans les rangs de l'extrême droite.
L'arrestation de Zambelli a exercé une pression maximale, une semaine après que Bolsonaro ait été, selon ses propres termes, humilié en étant contraint de porter un bracelet électronique.
Il est possible de vaincre le chantage
Certaines certitudes ressortent déjà clairement de la réaction des analystes politiques : le Brésil s'en est bien sorti face à la pression du 1er août ; Trump devient de plus en plus la cible des peuples du monde entier, avec ses pratiques oppressives, comme en témoigne le symbole de Gaza ; l'action de Bolsonaro, du moins à court terme, s'est véritablement retournée contre lui.
Seuls 19 % de la population brésilienne ont vu d'un « bon œil » les mesures prises par Trump. Le gouvernement se renforce lorsqu'il affirme la souveraineté nationale.
En revenant en partie sur son décret, l'impérialisme montre qu'il est fort, mais qu'il peut être arrêté. La question des BRICS et la reconnaissance de l'État palestinien — qui a déjà trouvé un écho en France, en Angleterre et maintenant au Canada — ouvre une nouvelle voie.
L'« autre moitié » de la hausse des tarifs douaniers vise de plein fouet l'agriculture. Que feront ces secteurs, divisés, dont une partie soutient Bolsonaro et le coup d'État, mais dont le principal partenaire commercial est la Chine, grande responsable de la reprimarisation de l'économie brésilienne au cours des dernières décennies ?
La crise va se poursuivre, mais le recul de Trump indique qu'il est possible de vaincre le chantage, à deux conditions : isoler et démoraliser l'extrême droite, avec des arrestations touchant le clan Bolsonaro, et maintenir la cohésion de la société, mobilisée dans les rues et sur les réseaux sociaux. La manifestation prévue le 1er août en est un exemple : descendre dans la rue pour défendre la souveraineté nationale rassemble une grande partie de la population. Le mouvement étudiant a raison de prendre la tête de ce combat. Les actions ne peuvent pas seulement être convoquées, elles doivent être construites, afin d'avoir un véritable sens d'unité et de déclaration commune, capable de mobiliser des dizaines de milliers de personnes dans tout le pays.
Renforcer notre programme
C'est pourquoi nous défendons l'unité d'action, l'unité des mouvements sociaux et les actions que le MST est en train de construire. Trump est imprévisible, de nouvelles crises se profilent à l'horizon, comme celle qui annonce un nouvel effondrement des bulles de l'IA.
Il est temps de renforcer notre programme, autour de tâches concrètes, qui unissent le PSOL et la gauche dans son ensemble : le référendum contre l'échelle 6×1, la défense de l'impôt sur les multimillionnaires, la lutte pour que Lula oppose son veto total au « PL de la dévastation », et la centralité du programme de souveraineté nationale, avec des changements dans la politique économique, l'approbation de la réglementation des big techs et la rupture des brevets américains.
Parallèlement, il est bien sûr nécessaire d'emprisonner les putschistes du 8 janvier, de mettre Bolsonaro en prison et de démanteler le réseau de soutien, de financement et d'articulation politique et communicationnelle qui porte atteinte aux intérêts du Brésil.
Les batailles à venir exigeront ténacité et combativité de la part des militants, qui se forgent et accumulent une expérience importante face à l'extrême droite dans le monde. Défendre la souveraineté du Brésil et la reconnaissance de l'État palestinien fait partie intégrante d'un combat qui ne fait que commencer.
Israel Dutra est sociologue, secrétaire des mouvements sociaux du PSOL, membre de la direction nationale du parti et du Mouvement de la gauche socialiste (MES/PSOL).
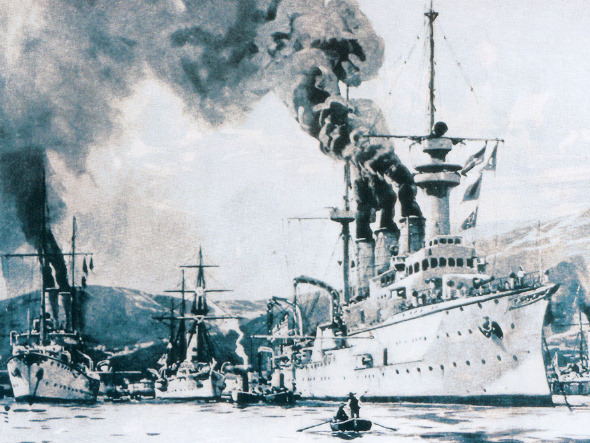
Les canonnières impériales reviennent dans les Caraïbes
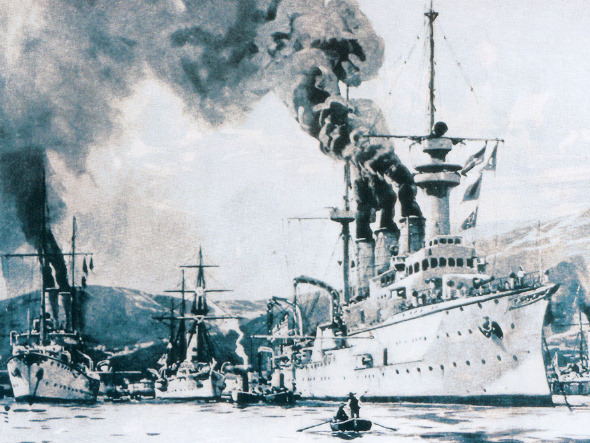
« L'histoire se répète, d'abord comme une tragédie, puis comme une farce. » - Karl Marx
En voyant les silhouettes des navires de croisière américains au large des côtes vénézuéliennes - venus affronter le régime du président Nicolás Maduro, accusé de complicité avec le trafic international de drogue -, plusieurs épisodes d'agressions impérialistes dans notre Amérique me reviennent à l'esprit. L'un des plus notables, mais peut-être peu connu, est l'agression d'une flotte européenne envoyée pour recouvrer la dette extérieure que le Venezuela n'arrivait pas à payer.
https://rebelion.org/las-canoneras-imperiales-retornan-al-caribe/
11 septembre 2025
Au tournant du siècle, il y a plus d'un siècle, ce pays, héritier d'une partie de la lourde dette extérieure de la Grande Colombie, s'est retrouvé pris au piège des exigences des créanciers. En décembre 1902, la Grande-Bretagne et l'Allemagne ont envoyé un ultimatum. Le gouvernement du président Cipriano Castro faisait tout son possible pour payer. Les nouvelles taxes et la remise aux créanciers des recettes douanières, avec les sacrifices que cela impliquait pour la société, se sont avérées insuffisantes. Castro a proposé des négociations séparées aux créanciers, leur assurant qu'il paierait dès que possible.
Les créanciers ont ignoré sa réponse et ont envoyé leurs canonnières dans les Caraïbes.
Le pays fut bloqué par une flotte anglo-germano-italienne. Les quelques navires vénézuéliens furent détruits. Puerto Cabello, La Guaira et Maracaibo furent bombardés. Les troupes étrangères débarquèrent pour protéger leurs compatriotes et leurs intérêts contre la « tyrannie étrangère », comme le dira le ministre allemand des Affaires étrangères Bernhard von Bülow pour justifier l'agression. Le coût de l'opération militaire fut supérieur au montant dû. Il convient de noter que la raison impériale s'imposa, quel qu'en soit le prix.
Le Venezuela a invoqué sans succès la doctrine Monroe : les États-Unis sont restés les bras croisés face à l'agression européenne afin de ne pas perturber leurs plans visant à « rendre indépendant » le Panama ; une attitude complice similaire se reproduira en 1982, pendant la guerre des Malouines... La seule condition imposée par Washington était que « la punition infligée par tout Européen n'inclue pas la prise de territoire américain ». Il ne faut pas oublier que peu de temps auparavant, les États-Unis, en pleine phase expansionniste, avaient occupé Porto Rico et Cuba, progressant également vers Hawaï, Guam et les Philippines. Et on ne peut pas non plus oublier les agressions militaires des États-Unis pour recouvrer les dettes en Haïti, en République dominicaine, au Nicaragua...
À l'époque, l'Argentine a mené la protestation continentale. Le ministre des Affaires étrangères, Luis Drago, a envoyé une note rejetant le recours à la force pour obtenir le paiement de la dette extérieure par les États, car cela constituait une violation du droit international. Cette approche, connue sous le nom de doctrine Drago, a renforcé la doctrine Calvo, formulée quelques décennies plus tôt par un autre Argentin, Carlos Calvo, qui, en tant que représentant du Paraguay à Paris, avait protesté contre l'ingérence britannique dans les affaires intérieures de ce pays. C'est de là qu'est né le principe de non-intervention et, peu après, le principe moderne d'égalité juridique des États. Eloy Alfaro, le grand libéral équatorien, ainsi que les dirigeants de Bolivie, du Chili et du Mexique ont soutenu les Vénézuéliens.
Pour conclure ce bref aperçu historique, rappelons qu'à l'époque, le Venezuela commençait à être la proie de la voracité extractiviste, en particulier de la New York & Bermúdez Company, une entreprise américaine qui contrôlait l'exploitation du lac d'asphalte de Guanoco et qui, forte de son pouvoir économique, influençait la vie politique de ce pays. Peu à peu, l'influence des intérêts impérialistes qui cherchaient à contrôler le pétrole de ce pays andin-caribéen se faisait sentir. Il suffit de se rappeler que Castro a été destitué par son vice-président Juan Vicente Gómez, avec l'aide des puissances étrangères. Cette marionnette de l'impérialisme a garanti le paiement de la dette et la remise des richesses pétrolières vénézuéliennes.
Aujourd'hui, les prétentions impériales sont à nouveau présentes. En réalité, la lutte contre le trafic de drogue n'est qu'un prétexte, si l'on considère que la majeure partie de la drogue consommée aux États-Unis n'est ni produite au Venezuela, ni transitée par ce pays. Le gouvernement de Washington, capitale du pays où se trouve la plus grande part des profits du trafic de drogue, ne s'intéresse manifestement pas à la démocratie ni au bien-être de la population vénézuélienne. Ce que recherche le colosse du Nord, c'est le contrôle des énormes ressources stratégiques vénézuéliennes pour sa sécurité géopolitique et énergétique. Dans ce contexte, la « guerre contre la drogue », qui s'est soldée par un échec, comme nous l'avons constaté à maintes reprises, fait partie de la politique impériale des États-Unis.
Il est essentiel de se souvenir de l'histoire. Cette grande enseignante nous fournit les connaissances et les outils nécessaires pour mieux comprendre les aspirations actuelles d'un empire en déclin, qui se replie sur ce qu'il considère comme son arrière-cour : Notre Amérique !
Alberto Acosta : Économiste équatorien. Président de l'Assemblée constituante 2007-2008.

La Chine vers un automne de luttes ouvrières

Au cours des trente-trois derniers jours, le secteur manufacturier chinois a été secoué par une série inhabituelle de grèves : vingt-deux mouvements collectifs dans différents secteurs, de l'industrie pharmaceutique au textile, de l'aérospatiale aux semi-conducteurs. Il ne s'agit pas d'épisodes isolés, mais du symptôme d'un malaise généralisé.
Tiré d'Europe solidaire sans frontière.
D'une part, la conjoncture économique défavorable a entraîné une chute des commandes et une baisse des bénéfices, d'autre part, l'adoption de règles pour la pleine application de la « sécurité sociale obligatoire » a augmenté les coûts fixes des entreprises, poussant nombre d'entre elles à la fermeture. En effet, pendant des décennies, le gouvernement a fermé les yeux sur le non-paiement des cotisations par les entreprises, leur permettant ainsi de gonfler leurs bénéfices, mais le changement soudain de politique, dû au fait que les fonds de pension sont à court de capitaux, provoque des bouleversements en faisant à nouveau peser le poids sur les travailleurs – outre les entreprises qui ferment, beaucoup d'autres ont simplement reclassé leurs salarié.e.s en travailleurs à temps partiel, pour lesquels le paiement des cotisations sociales n'est pas obligatoire. Ce n'est pas un hasard si l'adoption soudaine de la nouvelle réglementation, en l'absence de mesures d'accompagnement et de protection, est largement contestée par les travailleurs eux-mêmes. Dans ce contexte, les ouvriers ont choisi la grève comme dernier recours pour défendre leurs salaires et leurs indemnités.
Derrière les chiffres cités se cachent des histoires d'usines en difficulté et de travailleurs livrés à eux-mêmes. La société Kaiyi Paper Packaging de Guangzhou, avec plus de 100 millions de yuans de production annuelle, a soudainement déclaré faillite après que les nouvelles cotisations sociales eurent érodé toute marge bénéficiaire : des centaines d'employé.e.s se sont retrouvés sans salaire depuis des mois et avec un patron qui a disparu. À Shanghai, Guoli Automotive Leather a proposé des indemnités de licenciement que les travailleurs considèrent comme « les plus basses de la ville », tandis qu'à Hebei, plus d'un millier d'employés de Aerospace Zhenbang, liée à de grands programmes spatiaux nationaux, sont descendus dans la rue après des mois passés sans salaire. Ces cas montrent que la crise n'épargne ni les petites entreprises privées ni les entreprises stratégiques.
Les motifs des protestations se reproduisent régulièrement : réductions unilatérales des salaires, licenciements sans indemnité, transferts forcés vers d'autres provinces sans compensation. À Dongguan, plus de deux mille travailleurs de Maorui Electronics se sont mis en grève pour protester contre le refus de l'entreprise de les indemniser pour le déménagement de la production ; à Guilin, les ouvriers de BYD ont demandé l'application du salaire minimum des grands centres urbains au lieu de celui, plus bas, du district, sans toutefois obtenir de résultats en raison de l'intervention des autorités locales. Ces exemples témoignent d'une dynamique commune : les entreprises font supporter les conséquences de la crise à leurs employé.e.s en réduisant les coûts de main-d'œuvre jusqu'à la limite de la survie.
Cette série de grèves met en évidence un autre élément : la montée de la conscience collective parmi les ouvrier.e.s. Chez Shenzhen Advanced Semiconductor, environ un millier d'employé.e.s ont obtenu une indemnisation supérieure aux normes grâce à quatre jours consécutifs de mobilisation organisée. Dans d'autres cas, comme dans les industries textiles ou de l'habillement, les mobilisations se sont prolongées pendant plusieurs jours, signe d'une cohésion croissante et d'une détermination accrue à revendiquer des droits sociaux et contractuels. Ces formes d'action ne sont pas le fruit d'un choix idéologique, mais une réponse immédiate à des conditions de vie devenues insoutenables
Le tableau d'ensemble est celui d'un secteur industriel sous tension, où la stabilité de l'emploi semble de plus en plus fragile. En trente-trois jours, neuf des vingt-deux usines concernées ont déjà déclaré faillite et les autres se trouvent dans une situation précaire. La mise en place d'une protection sociale obligatoire, qui vise en théorie à élargir les garanties, se traduit dans la pratique par une pression insoutenable pour les petites et moyennes entreprises qui ferment ou répercutent les coûts sur les travailleurs. Pour les ouvriers, en revanche, cela les expose au risque de perdre non seulement leur salaire, mais aussi toute garantie sociale, alimentant ainsi un cercle vicieux de précarité et de conflit.
Cette vague de protestations constitue un signal d'alarme pour l'ensemble du système productif chinois. Si, d'une part, elle met en évidence les contradictions entre les politiques sociales et la viabilité économique des entreprises, d'autre part, elle montre que le monde ouvrier n'est plus disposé à accepter passivement des sacrifices unilatéraux. Pour beaucoup, la grève n'est plus considérée comme un geste extrême et isolé, mais comme un moyen légitime et nécessaire de résister à la compression des droits. Il est à prévoir que ces mobilisations se poursuivront dans les mois à venir, signe que la crise de l'industrie manufacturière n'est pas seulement une question de commandes et de coûts,mais surtout de dignité et de survie quotidienne pour des millions de travailleurs.
De plus, il convient d'ajouter que le suivi des informations et des images diffusées sur les réseaux sociaux chinois montre une nette augmentation, en cette période d'août et de septembre, des protestations contre le non-paiement des salaires, souvent en retard de plusieurs mois. Il ne s'agit pas de grèves organisées, mais d'actions menées par des travailleurs exaspérés qui montent sur les toits des usines et menacent de se jeter dans le vide, dans une demande désespérée d'attention. Il n'existe pas de données officielles, que le régime chinois a tendance à dissimuler, mais la fréquence de ces actes rappelle fortement un phénomène déjà observé ailleurs, comme en Italie en 2009 pendant la crise mondiale, à commencer par la lutte symbolique des ouvriers de l'usine Innse à Milan.
Andrea Ferrario
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
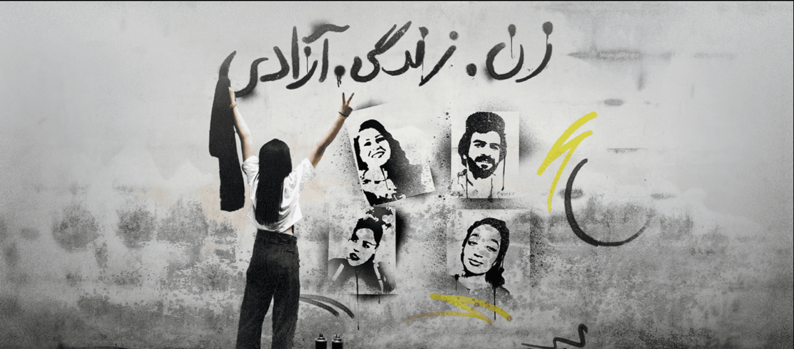
Iran : Retour sur les trois années écoulées depuis le début du soulèvement « Femme, Vie, Liberté »
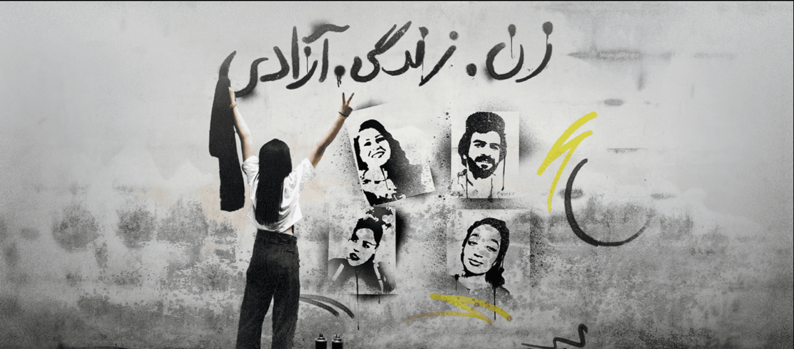
Le 16 septembre 2022, la jeune kurde Jina-Mahsa AMINI a été tuée par la police des mœurs pour « port de vêtements inappropriés ». Sur la pierre tombale de Jina est écrit : « Bien aimée Jina, tu ne mourras pas ; ton nom sera un symbole ». Et effectivement, ce féminicide d'Etat a suscité une colère qui s'est étendue au-delà de l'Iran. Une lame de fond a vu le jour dont « Femme, Vie, Liberté » est devenu le slogan.
Tiré d'Europe solidaire sans frontière.
Les revendications intersectionnelles du mouvement « Femme, Vie, Liberté », ne se sont pas limitées à la question du port obligatoire du voile. Elles se sont élargies au refus de la dictature des mollahs, à la défense des libertés, aux droits des femmes et de genre, des minorités ethniques, des salarié-es, etc.
Initiées dans un premier temps par des femmes notamment dans les régions dont la majorité de la population appartient à des minorités nationales comme le Kurdistan et le Balouchistan, les mobilisations ont gagné ensuite tout le pays et une grande partie de la population. Plus de 155 villes peuvent témoigner du courage sans limite des femmes et hommes ayant affronté sans relâche les forces répressives tirant à balles réelles.
Pour le seul premier mois du mouvement, plus de 434 mort-es ont été dénombrés dont au moins 50 enfants. Au 12 janvier 2023, plus de 19 000 personnes ont été arrêté.es dont beaucoup de jeunes ayant été éduqués dans les écoles de la République islamique, et notamment des étudiant.es, des journalistes, des artistes, des sportifs/ves.
Le régime islamique a mobilisé tout son appareil sécuritaire pour réprimer les manifestations, qui ont fini par s'essouffler. Depuis, la répression n'a pas cessé : en 2025, plus de 889 personnes ont été exécutées au 5 septembre, dont au moins 50 pour leur engagement militant.(1)
De multiples formes de résistance
Sous les cendres, les braises sont restées chaudes.
– Nombre de femmes, surtout dans les grandes villes ont défié le pouvoir en circulant dans la rue sans porter le voile. Suite à cela, le 15 décembre 2024, la loi sur le hidjab obligatoire a été abolie.
– Des grèves éclatent périodiquement, malgré la répression, l'ampleur du chômage, et la généralisation de la précarité.(2)
– Des organisations syndicales ou associatives ont réussi à se maintenir ou se sont crées.(3)
L'action de ces structures ne se limite pas à soutenir les luttes sur les revendications immédiates et le refus de la répression. Le 15 février 2023, par exemple, certaines d'entre elles ont lancé un appel à la mise en place, par en bas, d'une alternative au régime des Mollahs.(4)
La guerre des 12 jours
Le 13 juin 2025, et ce durant 12 jours, la population d'Iran a subi une guerre dite préventive, déclenchée par Israël qui poursuit sa guerre génocidaire contre le peuple palestinien.(5) Suite aux interventions militaires d'Israël puis des Etats-Unis, 657 Iranien-nes ont été tué-es, et 2 037 ont été blessé-es.6
Comme le déclarait une tribune à laquelle Solidaires a participé « À l'unisson avec toutes celles et ceux qui luttent en Iran depuis des décennies pour la liberté, l'égalité et la justice sociale, nous refusons tout changement de régime « par en haut » et par des interventions étrangères. Le renversement de la République Islamique ne doit résulter que de la lutte des peuples d'Iran. »(7)
Prétendre que ces attaques ont pour but la libération de la population est une ignominie. Bien au contraire, le régime a profité de la guerre pour aggraver considérablement la répression contre les opposant-es ou supposé-es tel-les en les accusant d'être des agents d'Israël ou des USA : plus de 250 exécutions ont eu lieu après les bombardements de juin, et d'autres lourdes condamnations sont prononcées ;
L'intervention militaire extérieur a permis au pouvoir de réduire les espaces de contestation, et de tenter d'étouffer l'expression des mécontentements.
Néanmoins le 16 juin, plusieurs organisations syndicales ou associatives ont courageusement condamné simultanément les bombardements israëliens et affiché leur opposition radicale au régime des mollahs.(8)
A l'inverse, pendant qu'Israël et les USA déversaient un déluge de bombes sur le pays, certains iranien-nes de la diaspora se lêchaient déjà les babines à la perspective de revenir au pays dans les fourgons l'armée américaine pour y établir leur pouvoir. Trump ayant rapidement décrété un cessez-le feu, ils/elles ont été contraint-es de renvoyer leurs espoirs à plus tard.(9)
Un pays dans une situation catastophique
La pénurie d'eau actuelle n'est pas une simple conséquence de la crise climatique mondiale. L'épuisement des nappes phréatiques résulte en grande partie de l'existence d'innombrables barrages construits par les Gardiens de la révolution, la pièce centrale de l'appareil militaire et sécuritaire où règne une corruption endémique.
Le détournements de rivières au profit de notables du régime est une autre cause de cette sécheresse.
Par manque d'eau, une partie de la faune et de flore est menacée d'extinction et les agriculteurs voient leur production diminuer.
Alors que l'Iran possède les deuxièmes plus grandes réserves de gaz au monde et les troisièmes plus grandes réserves de pétrole, la pénurie d'hydrocarbures porte un coup terrible à une économie déjà exsangue.
Les fréquentes coupures d'électricité entraînent de fréquents arrêts des systèmes de climatisation/chauffage et des processus de travail. Des établissements scolaires et des administrations sont périodiquement fermés.
Sur un an, la devise iranienne a perdu plus de la moitié de sa valeur.
La déliquescence de l'économie iranienne a été aggravée par :
– D'une part le coût faramineux du financement de milices armées dans nombre de pays voisins, des années de soutien à l'ex-dictature syrienne, la poursuite du programme nucléaire iranien ;
– D'autre part le poids des sanctions économiques internationales, dont les principaux bénéficiaires sont des réseaux de contrebande liés à des responsables de l'appareil sécuritaire.(10)
L'inflation est faramineuse, en particulier sur les produits alimentaires. Les couches populaires en sont les premières victimes. La pomme de terre, aliment de base des plus pauvres, a vu son prix multiplié par cinq en un an. De nombreux/euses iranien.nes suspendent leurs traitements médicaux devenus trop onéreux et certain-es renoncent même à se faire soigner.
Face à cela il est plus nécessaire que jamais de :
– Soutenir les syndicats et organisations iranien.nes combattant la répression et défendant les droits des opprimé-es et exploité-es ;
– Apporter une solidarité concrète aux luttes en cours et aux victimes de la répression ;
– Aider à marginaliser les forces de la diaspora cherchant à s'emparer du pouvoir en Iran dans la foulée d'une intervention occidentale.
L'Union syndicale Solidaires soutient en particulier :
– Le droit inconditionnel des femmes sur leur corps, dont celui de porter ou pas le voile ;
– L'abolition de toute discrimination envers les femmes, les LGBTIQ+, les minorités nationales et religieuses ;
– La libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers·ères d'opinion, dont Sharifeh MOHAMMADI, ainsi que de tous/toutes les syndicalistes dont Davood RAZAVI du syndicat VAHED ;
– L'abolition immédiate de la peine de mort et de l'usage de la torture ;
– La liberté d'expression, d'organisation, de manifestation et de grève, le démantèlement des organes de répression existants ;
– Les luttes contre la destruction de l'environnement.
Paris, le 10 septembre 2025
Notes
1. Première page du blog Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran www.iran-echo.com
2. Comme dans les hydrocarbures, la siderurgie, l'enseignement, les soins infirmiers, les transports routiers, etc.
3. Notamment dans les transports en commun de Téhéran et sa banlieue (VAHED) dont un des responsable (Davood RAZAVI) est emprisonné depuis 2022, à la sucrerie Haft-Tapeh, parmi les enseignant.es, les retraité.es, etc.
5. La politique guerrière d'Israël bénéficie du soutien actif de Trump et de la complaisance de nombreux pays.
6. Human Rights Activists News Agency https://www.en-hrana.org/
8. https://laboursolidarity.org/fr/n/3500/declaration-commune-des-organisations-independantes-en-iran
9. C'est notamment le cas du fils de l'ex-monarque qui détient une fortune colossale accumulée par son père sur le dos du peuple iranien, et qui a ses entrées auprès de politicien-nes de divers pays dont notamment Israêl. C'est aussi le cas de l'Organisation des Moudjahiddines du peuple qui dispose d'une armée privée, et dont la façade est un autoproclamé Conseil national de la résistance iranienne (CNRI) pratiquant également le lobbying au niveau international. Ces deux courants ont pour emblème le drapeau traditionnel de la monarchie iranienne (avec le lion et l'épée).
10. En ayant inclus les biens de consommation courante dans l'éventail des sanctions, les puissances occidentales pénalisent avant tout une population qui n'est en rien responsable de la politique de ses dirigeants.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
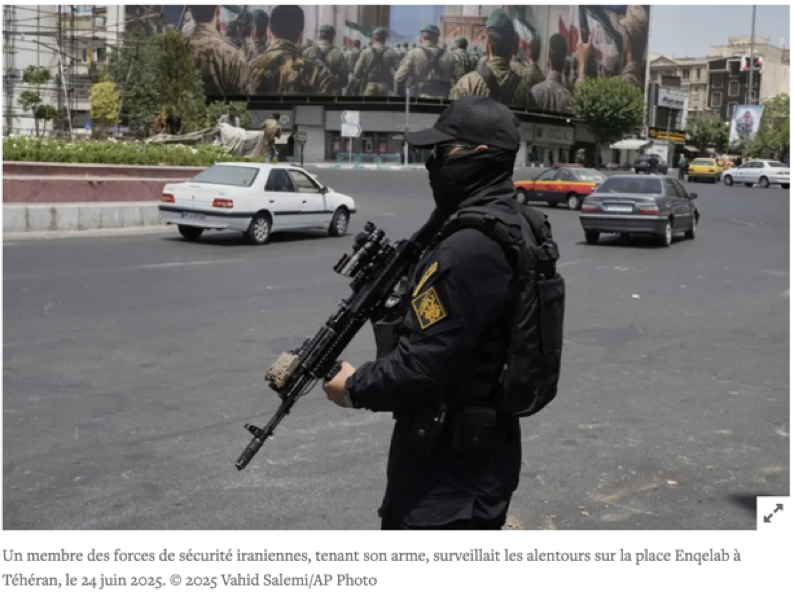
Iran : Vague de répression après les hostilités avec Israël
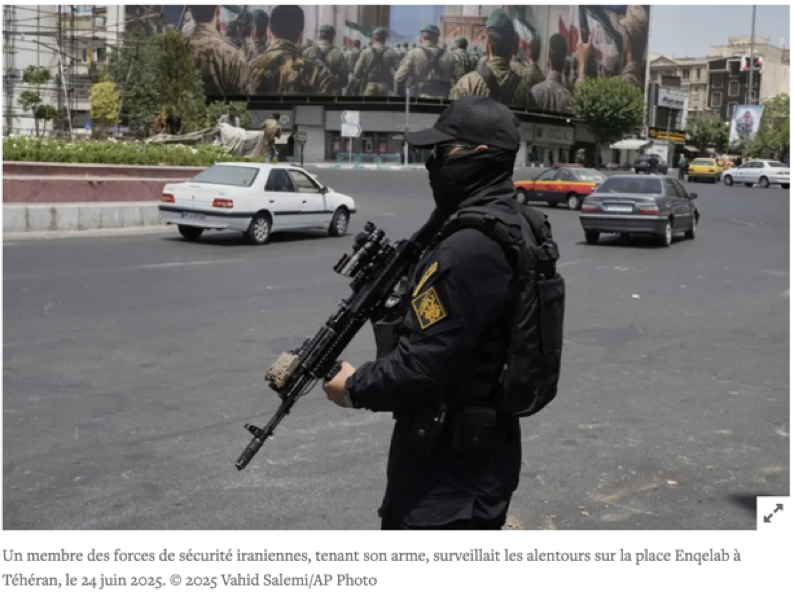
(Beyrouth) – Les autorités iraniennes mènent une répression terrifiante sous prétexte de renforcer la sécurité nationale suite aux hostilités avec Israël en juin, ont déclaré aujourd'hui Amnesty International et Human Rights Watch. Cette crise croissante met en évidence la nécessité urgente pour la communauté internationale de prendre des mesures concrètes visant l'obligation de rendre des comptes pour diverses violations.
Tiré de Human rights watch.
Depuis le 13 juin 2025, les autorités iraniennes ont arrêté plus de 20 000 personnes, dont des dissidents, des défenseurs des droits humains, des journalistes, des utilisateurs des réseaux sociaux, des familles de victimes illégalement tuées lors de manifestations nationales et des ressortissants étrangers. Parmi les autres personnes ciblées figurent des Afghans, des membres des minorités ethniques baloutches et kurdes, ainsi que des membres des minorités religieuses bahaïe, chrétienne et juive.
« Alors que la population peine à se remettre des effets dévastateurs du conflit armé entre l'Iran et Israël, les autorités iraniennes se livrent à une répression terrifiante », a déclaré Sara Hashash, directrice adjointe pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à Amnesty International. « Le dispositif répressif des autorités dans le pays reste implacable ; elles intensifient une surveillance déjà oppressive et généralisée, les arrestations de masse, ainsi que l'incitation à la discrimination, à l'hostilité et à la violence à l'égard des minorités. »
Les forces de sécurité ont tué des personnes aux points de contrôle de véhicules, dont une fillette de 3 ans. Des responsables et des médias affiliés à l'État ont appelé à des exécutions accélérées, prônant dans certains cas une répétition des massacres de 1988 dans des prisons, au cours desquels de hauts responsables avaient ordonné l'exécution sommaire et extrajudiciaire de milliers de prisonniers politiques. Au moins neuf hommes ont été exécutés pour des motifs politiques et/ou des accusations d'espionnage pour le compte d'Israël, et un projet de loi parlementaire visant à élargir encore le champ d'application de la peine de mort est en attente d'approbation définitive.
« Depuis juin, la situation des droits humains en Iran s'est aggravée, les autorités iraniennes désignant et ciblant les dissidents et les minorités comme boucs émissaires d'un conflit dans lequel ils n'ont joué aucun rôle », a déclaré Michael Page, directeur adjoint de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord à Human Rights Watch. « La répression brutale menée par les autorités iraniennes contre un peuple encore sous le choc de la guerre laisse présager une catastrophe imminente en matière de droits humains, en particulier pour les groupes les plus marginalisés et persécutés du pays. »
Les autorités iraniennes devraient immédiatement instaurer un moratoire sur les exécutions en vue d'abolir la peine de mort, libérer toutes les personnes détenues arbitrairement et veiller à ce que toutes les autres personnes détenues soient protégées contre les disparitions forcées, la torture et autres mauvais traitements. Les autres pays devraient enquêter sur les crimes de droit international commis par les autorités iraniennes et engager des poursuites en vertu du principe de compétence universelle, ont déclaré Amnesty International et Human Rights Watch.
Arrestations massives et appels alarmants à accélérer les procès et exécutions
Les services de renseignement et de sécurité iraniens ont commencé à procéder à des arrestations massives quelques jours après l'escalade des hostilités avec Israël, sous couvert de sécurité nationale.
Gholamhossein Mohseni Eje'i, le chef du pouvoir judiciaire, a annoncé le 22 juillet que de lourdes peines, y compris la peine de mort, seraient infligées aux personnes qui, selon lui, avaient « coopéré avec Israël ». Dans une déclaration du 12 août, Saeed Montazer Al-Mahdi, porte-parole de la police, a annoncé qu'environ 21 000 personnes avaient été arrêtées.
De hauts responsables ont réclamé des procès et des exécutions accélérés pour « soutien » ou « collaboration » avec des États hostiles. Les médias affiliés à l'État ont prôné la répétition des massacres de 1988 dans les prisons, notamment dans un article de Fars News, affirmant que « les éléments mercenaires… méritent des exécutions similaires à celles de 1988 ».
Les autorités judiciaires ont également annoncé la création de tribunaux spéciaux pour poursuivre « les traîtres et les mercenaires ». Le Parlement a accéléré l'adoption d'une législation d'exception, en attendant l'approbation finale du Conseil des gardiens, qui étendrait le recours à la peine de mort, y compris pour des accusations vagues liées à la sécurité nationale, telles que « coopération avec des gouvernements hostiles » et « espionnage ».
Les détenus sont exposés à un risque élevé de disparition forcée, de torture et d'autres mauvais traitements, de procès inéquitables et d'exécutions arbitraires, ont déclaré Amnesty International et Human Rights Watch.
Intensification de la répression contre les minorités ethniques
Les autorités ont également utilisé le climat d'après-conflit comme prétexte pour intensifier la répression contre les minorités ethniques opprimées.
Amnesty International a documenté que les forces de sécurité de la province du Sistan-Baloutchistan ont tué illégalement deux femmes appartenant à la minorité ethnique baloutche opprimée d'Iran lors d'un raid sur le village de Gounich le 1er juillet. Une source principale a indiqué à l'organisation que des agents avaient tiré des plombs métalliques et des balles réelles sur un groupe de femmes, tuant l'une d'elles, Khan Bibi Bamri, sur place, et blessant mortellement Lali Bamri, décédée plus tard à l'hôpital. Au moins dix autres femmes ont été blessées.
Les agents de forces de sécurité ont avancé des justifications contradictoires pour justifier le raid, invoquant la présence d'un « groupe terroriste », d'« Afghans » et « [d'agents d'] Israël ». Une vidéo de l'incident examinée par Amnesty International montre des agents en uniforme du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) pointant leurs armes à feu vers les femmes tandis que des coups de feu répétés retentissent.
Le 25 juin, les médias d'État ont annoncé l'arrestation de plus de 700 personnes à travers le pays pour collaboration présumée avec Israël. Les provinces de Kermanshah et du Khuzestan, où vivent des minorités ethniques, notamment des Kurdes et des Arabes ahwazis, figurent parmi celles ayant enregistré le plus grand nombre d'arrestations. Selon le Réseau des droits humains du Kurdistan, au 24 juillet, les autorités avaient arrêté au moins 330 personnes issues de la minorité ethnique kurde.
Les autorités ont également mené contre des personnes afghanes une campagne massive d'arrestations et d'expulsions, ainsi que de diffamation dans les médias d'État.
Répression contre les minorités bahaïe, chrétienne et juive
En outre, les autorités iraniennes ont exploité le climat sécuritaire tendu pour intensifier la répression à l'encontre des minorités religieuses.
Les membres de la minorité bahaïe ont été particulièrement ciblés par une campagne de propagande coordonnée de l'État, incitant à l'hostilité, à la violence, à la discrimination et à la désinformation, accusant à tort les bahaïs d'espions et de collaborateurs d'Israël. Dans un communiqué du 28 juillet, le ministère du Renseignement a qualifié la foi bahaïe de « secte sioniste ». Le 18 juin, Raja News, média affilié au CGRI, a accusé les bahaïs d'être « des mandataires et des espions d'Israël ».
L'enquête d'Amnesty International et de Human Rights Watch a révélé que les mesures prises contre les bahaïs comprennent des arrestations et des détentions arbitraires, des interrogatoires, des perquisitions à leur domicile, la confiscation de biens et la fermeture d'entreprises.
Dans un cas, une source bien informée a indiqué aux organisations que les autorités avaient arrêté Mehran Dastoornejad, 66 ans, lors d'une perquisition à son domicile à Marvdasht, dans la province de Fars, le 28 juin, après l'avoir battu et confisqué ses biens. Les autorités ont refusé à l'avocat désigné par sa famille tout accès à lui et toute information sur les accusations portées contre lui. Il a été libéré sous caution de la prison de Chiraz le 6 août. Une autre source a indiqué à Human Rights Watch que Noyan Hejazi et Leva Samimi, un couple marié, avaient été arrêtés dans la province de Mazandaran les 25 juin et 7 juillet respectivement, et privés de l'accès à un avocat jusqu'à leur libération sous caution le 3 août.
Fin juin, les autorités iraniennes ont convoqué et interrogé au moins 35 membres de la communauté juive de Chiraz et de Téhéran au sujet de leurs liens avec des proches en Israël et les ont mis en garde contre tout contact, selon Human Rights in Iran, une organisation basée hors d'Iran.
Malgré les démentis initiaux des médias d'État, fin juillet et début août, des publications sur la chaîne Telegram d'un député juif, Homayoun Sameyeh Najafabadi, ont confirmé que des membres de la communauté juive iranienne avaient été arrêtés dans trois provinces et que plusieurs d'entre eux avaient été jugés devant un tribunal révolutionnaire à Téhéran pour des chefs d'accusation non identifiés. Ces publications indiquaient que les personnes arrêtées à Téhéran étaient accusées d'espionnage, mais que ces accusations avaient été abandonnées.
Dans un communiqué du 28 juillet, le ministère iranien du Renseignement a accusé des secteurs de la communauté chrétienne d'être des « mercenaires du Mossad » ayant des liens avec Israël, et les médias d'État ont diffusé des « aveux » de chrétiens détenus le 17 août, suscitant de vives inquiétudes quant à leur extorsion sous la torture. Le 24 juillet, une association de défense des droits humains hors d'Iran a signalé l'arrestation d'au moins 54 chrétiens depuis le 24 juin.
Recours illégal à la force meurtrière aux points de contrôle de sécurité
Les points de contrôle de véhicules mis en place depuis le conflit de juin sont devenus un autre instrument de répression. Les autorités ont procédé à des fouilles intrusives de véhicules et de téléphones portables, arrêtant des personnes pour « collaboration » avec Israël, souvent sur la seule base de publications sur les réseaux sociaux, selon les médias d'État. Les points de contrôle ont également été utilisés pour arrêter des ressortissants « non autorisés », un terme discriminatoire utilisé par les autorités pour désigner les Afghans.
Le 1er juillet, les forces de sécurité de Tarik Darreh, dans la province de Hamedan, ont abattu deux personnes et en ont blessé une troisième sous prétexte qu'elles fuyaient les points de contrôle, selon les médias. Dans un communiqué du 2 juillet, Hemat Mohammadi, chef de l'Organisation judiciaire des forces armées de la province de Hamedan, a déclaré qu'une enquête était en cours, mais a affirmé que les forces de sécurité avaient tiré sur un véhicule qui tentait de fuir. Sur les réseaux sociaux, des activistes ont identifié les deux hommes tués comme étant Alireza Karbasi et Mehdi Abaei.
D'après les médias d'État et les déclarations officielles, le 17 juillet, les forces de sécurité de Khomein, dans la province de Markazi, ont également abattu quatre membres d'une famille voyageant à bord de deux voitures : Mohammad Hossein Sheikhi, Mahboubeh Sheikhi, Farzaneh Heydari et une fillette de 3 ans, Raha Sheikhi. Vahid Baratizadeh, le gouverneur de Khomein, a indiqué que les forces de sécurité avaient tiré sur deux voitures « suspectes ». Le 12 août, un porte-parole du gouvernement a annoncé, sans plus de précisions, l'arrestation de plusieurs agents impliqués dans la fusillade.
Selon les déclarations des autorités, rien ne prouve que les personnes tuées par balle lors de ces incidents représentaient une menace imminente de mort ou de blessure grave. En vertu du droit international, le recours à une force potentiellement létale à des fins de maintien de l'ordre est une mesure extrême, qui ne doit être utilisée qu'en cas de stricte nécessité pour protéger des vies ou prévenir des blessures graves dues à une menace imminente.

Les leaders lilliputiens européens et le mécanisme de snapback contre l’Iran

La photo dont dans son commentaire, Yanis Varoufakis utilise le terme « Lilliputiens » pour les guides européennes est vraiment crue.
Kaveh Boveiri
Ce ministre des Finances dans le gouvernement d'Aléxis Tsípras et le lanceur du Mouvement pour la démocratie en Europe 2025 (DiEM25) voit ces leaders « comme les élèves méchants dans le bureau de l'instituteur ».
Dans leur acte d'obéissance moutonnière, le plus récent, le 28 août, trois leaders de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni ont demandé dans une lettre au Conseil de sécurité de l'ONU le déclenchement du mécanisme de « snapback » (réactivation automatique) contre l'Iran. Ainsi, une fois mises en pratique, les sanctions de l'ONU seront réimposées contre l'Iran après avoir été levées dans lecadre d'Accord de Vienne sur le nucléaire iranien de 2015. Et la réaction des États-Unis ? La réponse officielle est sans équivoque : Les États-Unis saluent le déclenchement du mécanisme de snapback.
Mais aucune de ces leaders ne critique Washington de se retirer unilatéralement de cet accord en 2018. Personne ne critique l'Israël d'avoir mis fin à une telle négation le 13 juin 2025, juste la veille du sixième cycle de négociations entre les États-Unis et l'Iran.
Et les cas semblables sont nombreux.
Dans sa déclaration du 13 juin de l'Agence internationale de l'énergie atomique, et à la suite de bombardements de site nucléaires iraniens, Rafael Mariano Grossi, le Directeur général de l'Agence dit : « J'ai rappelé à maintes reprises que les installations nucléaires ne devaient jamais être attaquées, quel que soit le contexte ou les circonstances, car tant les populations que l'environnement pourraient en pâtir. Ces attaques sont lourdes de conséquences pour la sûreté, la sécurité et les garanties nucléaires, et nuisent également gravement à la paix et à la sécurité régionales et internationales ». Ces leaders en restent silencieux.
À la suite de bombardement de trois autres sites nucléaires de l'Iran le 22 juin, cette fois par les États-Unis, le même directeur dit : « Le régime de non-prolifération nucléaire qui a sous-tendu la sécurité internationale depuis plus d'un demi-siècle est en jeu ». Ni cette agence ni les leaders présents dans cette photo n'ont pas les moyens ou la volonté de demander à Israël ni les États-Unis de se joindre à ce régime. De plus, ils ne se trouvent pas responsables d'une clarification de la part du régime génocidaire de l'Israël concernant leurs armes nucléaires.
Selon Amnesty International : « Les frappes aériennes délibérées de l'armée israélienne contre la prison d'Evin, à Téhéran, le 23 juin 2025, constituent une grave violation du droit international humanitaire et doivent faire l'objet d'une enquête pour crimes de guerre ». Les leaders en restent silencieux.
Un regard plus attentif relève un autre aspect dans cette photo. Un nombre de cadeaux se trouve sur le pupitre de l'instituteur Trump. Ce sont les carottes de Trump, et le bâton ? Les tarifs, entre autres.
Cette obéissance peut être vue dans uneautre occasion. C'est le moment où le premier ministre de l'Espagne, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, ose se protester pas contre l'investissement militaire, mais seulement contre l'augmentation d'un tel investissement. Cette fois, les leaders de l'OTAN accompagnés par Vladimir Zelensky gardent leur distance.
Bienvenue à l'ère de Trump ! Une ère qui n'est pas, ou très peu, résistée par les leaders de pays occidentaux. Un auteur compétent doit faire un suivi du statu quo de La haine de l'occident (2008) décrit par Jean Ziegler.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le règlement de comptes horrifique du Népal avec sa classe politique défaillante

Après des manifestations anticorruption de la génération Z et un soulèvement meurtrier qui ont forcé le premier ministre et le gouvernement à démissionner, le Népal recherche une nouvelle politique capable de se débarrasser de son establishment défaillant.
Tiré d'Europe solidaire sans frontière.
Les Népalais ne prêtent pas souvent attention à la politique de leurs voisins sud-asiatiques au-delà de l'Inde. Mais quand les Sri-Lankais se sont soulevés en 2022 pour chasser le régime Rajapaksa [1], ils ont pris note. Puis est venu le Bangladesh et sa Révolution de juillet l'année dernière, avec Sheikh Hasina [2] et tout le système politique qui l'entourait dans le viseur du public. Encore une fois, le Népal a pris note. Dans de nombreuses conversations à Katmandou [3], lors de ces deux occasions, j'ai entendu le même refrain : notre tour viendra.
Alors le voici maintenant. Des jeunes, sous la bannière des « manifestations Gen Z », sont descendus dans la rue le 8 septembre – fatigués d'un système politique corrompu et d'une classe politique corrompue, fatigués de voir les mêmes vieux hommes discrédités se relayer pour diriger et piller le pays, fatigués de ne voir d'autre avenir que de partir travailler à l'étranger, ce que font des milliers de personnes chaque jour. Les manifestations pacifiques ont soudain basculé dans la violence, et après que la police a ouvert le feu, le bilan est monté à 19 morts, avec des hôpitaux bondés de blessés. Ce fut la journée de manifestation la plus meurtrière que le Népal ait jamais connue.
Le gouvernement de K P Oli du Népal a assassiné 19 personnes
Le matin du 9 septembre, la douleur et la rage ont fait sortir des milliers de personnes, défiant les couvre-feux. Dans tout le pays, tout ce qui était lié au gouvernement et à l'establishment politique est soudain devenu une cible légitime. Les bureaux des partis et les maisons des politiciens sont partis en fumée. Dans l'après-midi, de lourdes colonnes de suie s'élevaient de la cuvette de la vallée de Katmandou. Le principal aéroport du pays a été fermé, les vols détournés. Aux nouveaux quartiers ministériels dans le sud de la capitale, des hélicoptères ont atterri pour évacuer les résidents vers la sécurité. Puis, plus de coups de feu, plus de sirènes, d'explosions, des panaches de fumée encore plus épais.
Les ministres ont commencé à démissionner, suivant l'exemple du ministre de l'Intérieur, qui avait démissionné la nuit précédente. Les parlementaires de l'opposition ont démissionné en masse, les appels se multipliant pour dissoudre le gouvernement et organiser de nouvelles élections. Avant 15h, le premier ministre, K P Sharma Oli [4] – dans son troisième mandat au pouvoir, et aussi têtu et égoïste qu'ils le sont – a également annoncé qu'il démissionnait.
Au fur et à mesure que la journée avançait, les choses ont complètement échappé à tout contrôle. Ce n'étaient plus les manifestants de la génération Z de la veille. La foule avait pris le relais. Des vidéos ont circulé montrant des dirigeants politiques se faire tabasser, leurs maisons être lapidées et incendiées. La maison du premier ministre brûlait, la résidence du président, la Cour suprême, le parlement, les supermarchés, les postes de police, et bien plus encore. Et, bien sûr, plus de morts à compter. Le chef de l'armée a fait une apparition pour appeler à la retenue et au calme, mais cela n'a guère permis d'arrêter les pillages et la violence. Finalement, bien avant dans la nuit, est venue l'annonce que l'armée était déployée pour restaurer l'ordre.
Aujourd'hui, le Népal s'est réveillé dans une profonde incertitude. Le sentiment est que le gouvernement devait répondre des 19 morts, qu'Oli et la vieille garde devaient partir. Mais l'ampleur des incendies criminels, l'effusion de sang, la foule en liberté – au-delà du voile rouge de la colère, peu peuvent justifier tout cela. Personne ne sait qui est maintenant aux commandes. Personne ne peut dire ce qui va se passer ensuite.
Les événements de ces deux derniers jours, avec leur rapidité et leur ampleur, défient presque l'entendement. Mais il y a des schémas du passé qui se feront sentir alors que les Népalais se tournent vers la question de ce qui va suivre.
La fin incomplète de la monarchie hindoue du Népal
Premièrement : cela fait longtemps que ça couvait, et le système enraciné nécessitera un démantèlement sérieux. La colère évidente dans les réactions aux soulèvements du Sri Lanka et du Bangladesh s'était accumulée pendant des années. La sortie du Népal de sa guerre civile [5], terminée il y a presque deux décennies, avait été pleine d'espoir. Les partis de l'establishment – au premier rang desquels le Congrès népalais et le Parti communiste du Népal (marxiste-léniniste unifié) d'Oli, les mêmes partis qui dirigeaient le gouvernement qui vient de tomber – avaient promis une nouvelle aube démocratique après s'être finalement retournés contre la monarchie [6]. Les maoïstes, ayant déposé les armes et accepté de se présenter aux élections démocratiques, avaient vendu des rêves d'une société plus juste à des millions de Népalais qui n'avaient jamais eu leur chance équitable. Puis, dans l'ensemble, les espoirs ont été brisés, les promesses rompues.
Les maoïstes ont remporté le premier vote d'après-guerre, signe de la soif de changement du peuple népalais. Mais ils ont échoué à avoir un réel impact et sont rapidement devenus juste un autre parti de l'establishment. Leur échec est mieux symbolisé par la façon dont leur dirigeant – le président Prachanda [7] lui-même – est rapidement devenu plus connu pour sa richesse personnelle que pour ses références révolutionnaires. Un nouveau projet de constitution, choquamment progressiste dans le contexte historique du Népal, a été retardé et retardé jusqu'à ce qu'il soit adopté de force après un édulcorement considérable. Les élections suivantes ont vu le vote largement fragmenté entre les trois partis de l'establishment, avec des accords en coulisses et des trahisons publiques livrant un carrousel rotatif des mêmes dirigeants discrédités allant et venant du pouvoir.
Le Népal a progressé dans les années qui ont suivi la guerre, mais cela a été lent et tortueux, et plus souvent gagné malgré le gouvernement qu'à cause de lui. Les services publics restent lamentables, même si les charges fiscales sont élevées. Pour la plupart des Népalais, les principales sources d'espoir et d'élévation sont les envois de fonds de leurs proches qui peinent à l'étranger, beaucoup d'entre eux dans des conditions terribles [8]. Pendant ce temps, ceux de l'élite politique – dominée, comme elle l'a longtemps été, par des hommes de caste dominante de la région Pahad du pays [9] – s'en sortent très bien, et ont soigneusement cultivé leurs capitalistes de connivence préférés. Une longue série de scandales de corruption ces dernières années impliquant des politiciens, des bureaucrates et des hommes d'affaires de tout l'éventail de l'establishment n'a fait que renforcer la vision sombre du système par le public.
Deuxièmement : les Népalais savent quelque peu comment mener une révolution populaire, mais ils n'ont jamais vraiment compris comment la faire durer. Le premier élan démocratique du pays, dans les années 1950, a déposé les premiers ministres héréditaires Rana [10] et a donné au peuple un vote libre. Mais la monarchie, libérée d'un siècle de contrôle Rana, s'est rapidement retournée contre les partis démocratiques naissants, et la dynastie Shah a réaffirmé son pouvoir. Après des décennies de régime Panchayat [11] – une sorte de démocratie gérée et factice sous la monarchie – les Népalais se sont à nouveau soulevés en 1990. Cette révolution a ramené les partis démocratiques au pouvoir, quoique avec le roi comme monarque constitutionnel, avant qu'elle aussi ne s'effondre. La mauvaise gouvernance et une insurrection maoïste qui s'intensifiait ont ouvert la porte à un coup d'État royal en 2005 [12]. Puis est venue la fin de la guerre, en 2008 ; la fin de la monarchie ; et tous les espoirs trahis.
Ce moment est la dernière tentative de correction du Népal. Elle ne passera peut-être pas à l'histoire comme une révolution – certainement personne ne demande de renverser le système de gouvernement – mais ce que le peuple veut, c'est un changement sismique dans les règles du pouvoir. Malheureusement, le passé est un ennemi puissant, et les anciennes façons du Népal se sont trop souvent réincarnées avec de nouveaux visages. L'humeur publique maintenant est de se tourner vers une nouvelle garde apparente : des figures émergentes comme Rabi Lamichhane [13], un présentateur de télévision devenu politicien, ou Balen Shah [14], un rappeur devenu maire de Katmandou. Le premier a fondé un nouveau parti à la mi-2022, et il a remporté un stupéfiant 10 pour cent des voix lors d'une élection nationale quelques mois plus tard seulement. Le second est sorti de nulle part la même année pour bouleverser deux candidats de l'establishment en remportant l'élection municipale de la capitale. Mais les antécédents de ces deux hommes laissent plus qu'un peu de place à l'inquiétude, même si de nombreux Népalais pourraient ignorer cela dans une recherche de sauveurs.
Lamichhane est poursuivi par de nombreuses polémiques, y compris des accusations de corruption qui l'ont mis derrière les barreaux jusqu'à ce qu'il soit libéré au milieu du soulèvement. Ces accusations sont politiquement motivées, une façon pour l'ancien establishment de battre un challenger – mais il n'est pas clair non plus si elles sont totalement infondées, et Lamichhane a du travail à faire pour prouver qu'il est propre. De plus, Lamichhane n'a montré aucun scrupule à se joindre aux mains de l'ancien ordre lors d'un bref passage au gouvernement après l'élection de 2022. Le mandat de Shah en tant que maire a été entaché par un dysfonctionnement administratif, et sa principale réalisation reste le culte de la personnalité qu'il s'est construit en ligne. Si la vieille garde doit vraiment partir, les Népalais peuvent-ils être sûrs qu'une telle nouvelle garde sera meilleure ?
Les résultats électoraux de Lamichhane et Shah, donnant des coups de poing dans l'œil aux anciens partis, étaient les signes avant-coureurs de la colère anti-establishment qui a maintenant débordé. Si le Népal retourne aux urnes de sitôt, les paris intelligents seront sur un vote qui basculera durement contre les anciens partis. Mais cela seul ne peut garantir de nouveaux dirigeants avec les moyens de résister aux tentations qui ont défait ceux qui les ont précédés, ou un gouvernement qui apportera un vrai changement. Quand il s'agit de corrections systémiques, de vraiment réinventer la politique du pays, le Népal s'aventure en territoire inexploré.
Avec le soulèvement du Népal qui s'ajoute à ceux du Bangladesh et du Sri Lanka, il est tentant de voir un Printemps sud-asiatique, semblable au Printemps arabe du début des années 2010 [15]. Les éléments sont là : des gouvernements pourris, des gens excédés, un soulèvement lié au suivant. Mais aussi : la mort, la dévastation, et aucun chemin sûr vers un meilleur endroit. Il est inquiétant de se rappeler comment le Printemps arabe a fini, avec la démocratie étouffée à nouveau par l'autocratie. Au Bangladesh, les foules ont aussi eu leur façon après la chute nécessaire du gouvernement Hasina, et un gouvernement intérimaire a eu du mal à nettoyer le système alors que le pays approche d'une nouvelle élection nécessaire. Le prochain gouvernement là-bas pourrait bien ramener certains anciens pouvoirs, et avec eux d'anciennes façons. Au Sri Lanka, un nouveau gouvernement dépourvu de l'ancien establishment brise ses promesses antérieures une par une [16]. Il n'y a pas eu d'aube nouvelle éclatante. Et maintenant le Népal, depuis son abîme actuel, rêve d'une nouvelle politique qui fonctionne réellement pour le peuple. Qu'il n'ait pas à voir plus de sang dans ses efforts.
Pour l'instant, il y a toute l'horreur à traiter de ces jours, des corps encore à incinérer, un semblant d'ordre à restaurer. Rien de ce qui vient ensuite ne sera facile.
Roman Gautam
Traduit pour ESSF par Adam Novak
Notes
[1] La famille Rajapaksa a dominé la politique sri-lankaise pendant des décennies. Mahinda Rajapaksa a été président de 2005 à 2015, suivi par son frère Gotabaya de 2019 à 2022, avant d'être chassé par un mouvement populaire
[2] Sheikh Hasina Wajed, fille du fondateur du Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman, a dirigé le pays de 2009 à 2024 avant d'être renversée par un soulèvement populaire
[3] Capitale du Népal, située dans la vallée de Katmandou, comptant environ 1,5 million d'habitants
[4] Khadga Prasad Sharma Oli, membre du Parti communiste du Népal (marxiste-léniniste unifié), a été premier ministre à trois reprises : 2015-2016, 2018-2021, et 2024-2025
[5] La guerre civile népalaise (1996-2006) opposait les forces gouvernementales aux maoïstes du Parti communiste du Népal, faisant plus de 17 000 morts
[6] La monarchie népalaise a été abolie en 2008, mettant fin au règne de la dynastie Shah qui dirigeait le pays depuis 1768
[7] Pushpa Kamal Dahal « Prachanda » (« le Féroce »), dirigeant historique des maoïstes népalais et ancien premier ministre
[8] Plus de 2 millions de Népalais travaillent à l'étranger, principalement dans les pays du Golfe, en Malaisie et en Inde, leurs envois représentant environ 25% du PIB du pays
[9] Les Pahads sont les collines du centre et de l'ouest du Népal, traditionnellement dominées par les castes Brahman et Chhetri
[10] La dynastie Rana a régné sur le Népal de 1846 à 1951 en tant que premiers ministres héréditaires, réduisant les rois Shah à un rôle de figure
[11] Le système Panchayat (1962-1990) était une démocratie dirigée et factice sous la monarchie, interdisant les partis politiques
[12] Le roi Gyanendra a pris le pouvoir absolu en février 2005, suspendant le gouvernement démocratique
[13] Rastriya Swatantra Party (Parti national indépendant), fondé en 2022 par cet ancien présentateur télé
[14] Balendra Shah, rappeur devenu maire indépendant de Katmandou en 2022
[15] Le Printemps arabe (2010-2012) fut une série de soulèvements populaires dans le monde arabe, commencée en Tunisie et s'étendant à l'Égypte, la Libye, la Syrie et d'autres pays
[16] Référence au président Anura Kumara Dissanayake, élu en 2024 sur une plateforme de changement radical mais qui a dû faire des compromis une fois au pouvoir
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Déclaration à propos des manifestations actuelles en Indonésie

Prabowo, Halte à la violence d'État ! Suppression des avantages et indemnités parlementaires ! Fin de la répression contre le peuple ! Justice pour les victimes !
Tiré de Entre les lignes et les mots
Depuis le 25 août 2025, une vague de manifestations populaires a déferlé sur différentes régions. Ces actions ont d'abord été provoquées par l'augmentation insensée des indemnités des membres de la Chambre des représentants Dewan Perwakilan Rakyat ou DPR, alors que le peuple est confronté à des conditions économiques de plus en plus difficiles. Le mécontentement de la population face à son sort a atteint son paroxysme, attisé par des mesures économiques et politiques qui, loin d'apporter la prospérité, sont devenues de plus en plus étouffantes. Cependant, cette colère s'est rapidement étendue à un autre problème tout aussi profond : la violence policière.
La tragédie a frappé lorsqu'un chauffeur de taxi-moto en ligne, Affan Kurniawan, a été tué après avoir été écrasé par un véhicule de combat de la brigade mobile Brimob [1] pendant les manifestations. Cet incident a été le catalyseur de la propagation des manifestations et a exacerbé la colère populaire dirigée contre l'État.
Le 31 août 2025, le président Prabowo Subianto [2] a répondu à la vague d'actions populaires qui avait déferlé sur différentes régions depuis le 25 août en recourant aux méthodes de manipulation caractéristiques de ce gouvernement.
Au lieu de reconnaître les échecs de l'État, il a choisi de classer les aspirations populaires en deux catégories, les manifestations « pures » et « impures », refusant de donner une réponse sérieuse à la répression policière et ne faisant aucune mention des manifestant.e.s qui ont perdu la vie à cause de la violence étatique.
De plus, il a qualifié de manière ambiguë les manifestations populaires d'« actions anarchiques », présentant les personnes qui ont manifesté leur opinion comme des menaces pour la stabilité de l'État. Pourtant, si Prabowo était véritablement attaché à la démocratie, il aurait dû répondre aux demandes du peuple. Ignorer cela ne fait que révéler encore plus clairement le visage militariste de Prabowo.
En date du 3 septembre 2025, 10 personnes ont été tuées lors de manifestations dans différentes villes. Des violences policières ont eu lieu à Jakarta [3] et Yogyakarta [4], tandis qu'à Makassar [5], l'incendie du bureau du Conseil régional des représentants du peuple DPRD [6] a également entraîné des pertes humaines. Des rapports d'origine locale font état de décès à Solo [7] et Manokwari [8], qui seraient dus à l'exposition aux gaz lacrymogènes employés massivement par les forces de sécurité. Outre les décès, le LBH-YLBHI [9] a recensé au moins 3 337 personnes arrêtées et 1 042 blessées et transportées à l'hôpital.
Les manifestant.e.s n'ont pas été les seules cibles : des journalistes et des auxiliaires de justice ont également subi des mauvais traitements de la part des forces de sécurité, comme cela s'est produit à Jakarta, Manado [10] et Samarinda [11]. Le 1er septembre 2025, peu avant minuit, Delpedro Marhaen, directeur exécutif de la Fondation Lokataru [12], a été arbitrairement arrêté par la police de Metro Jaya [13] dans les locaux de Lokataru. La police a inculpé Delpedro en vertu de l'article 160 du Code pénal KUHP [14] et de la loi sur les informations et les transactions électroniques UU ITE [15], des lois floues qui ont été utilisées pour criminaliser les militant.e.s et faire taire les critiques populaires. Ce type de comportement montre que la violence étatique ne vise plus seulement les voix populaires, mais aussi celles qui exercent des fonctions démocratiques de surveillance, de dénonciation et de défense. Les arrestations arbitraires semblent être devenues une pratique légitimée ; les manifestants sont arrêtés au hasard, avant même que les actions ne commencent. La police procède à des rafles systématiques à divers endroits, traquant et arrêtant les personnes qui ont l'intention de manifester. De telles actions violent non seulement la loi, mais portent aussi ouvertement atteinte à la démocratie.
Bizarrement, au lieu de réformer complètement l'institution, le président Prabowo Subianto a demandé au chef de la police nationale, le général Listyo Sigit, de donner des promotions spéciales aux policiers blessés lors des récentes manifestations. En même temps, l'impunité continue de régner au sein des forces de police, ce qui montre clairement que l'État est du côté des appareils répressifs, et pas de celui des personnes qui en sont victimes.
L'État devrait garantir la protection des libertés civiles et politiques conformément aux mandats constitutionnels et aux normes internationales en matière de droits humains. Pourtant, c'est le contraire qui se produit : l'État utilise son pouvoir pour faire taire les voix critiques par la criminalisation, l'intimidation et la violence à l'encontre des citoyen.ne.s qui exercent leurs droits. Kontras [16] a ouvert un guichet de dépôt de plaintes pour répondre aux nombreuses signalements de personnes disparues lors des manifestations du 25 au 31 août 2025. À ce jour, au moins 23 personnes sont signalées comme disparues et leur sort reste inconnu.
Cette situation révèle la pratique des disparitions forcées organisée par l'État, une pratique qui est strictement interdite par le droit international et qui ne peut être justifiée en aucune circonstance. Elle est encore aggravée par le fait que les campus universitaires, qui devraient être des lieux sûrs où la liberté académique et la liberté d'expression sont garanties, n'ont pas échappé à ce type de manœuvres d'intimidation. À l'université islamique de Bandung Unisba [17] et à l'université Pasundan Unpas [18], les forces armées et la police [19] ont tiré des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes, faisant des espaces universitaires la cible de la répression étatique.
La présence de soldats dans les espaces civils, en particulier lors de manifestations, avec leur équipement complet, des véhicules de combat et des armes à gros calibre, aggrave non seulement la situation, mais sème également la peur parmi la population. La présence militaire dans les espaces civils montre le visage de plus en plus militariste de l'État, loin des principes démocratiques. L'action d'aujourd'hui est une forme de protestation née du rejet de la violence et de la brutalité des unités TNI et Polri, ainsi que d'une affirmation des positions prises contre les méthodes militaires qui continuent d'être utilisées pour faire taire les voix populaires.
Nous rejetons le discours construit par le régime de Prabowo, qui associe les manifestations à des accusations de trahison et de terrorisme. MANIFESTER n'est pas un crime, mais un DROIT démocratique dont jouit chaque citoyen.ne. Interdire, restreindre ou dénigrer les manifestations est la manière la plus sournoise de réprimer la démocratie. Malheureusement, les manifestations populaires sont souvent réprimées par l'État avec violence, par l'intermédiaire de la police et de l'armée. Pourtant, les cris du peuple sont l'expression de la revendication de droits fondamentaux : des moyens de subsistance décents, un environnement sain et une véritable protection juridique. Au lieu de remplir ces obligations, l'État adopte des politiques qui perpétuent la confiscation des droits du peuple et l'exploitation des ressources naturelles.
Dans ces situations où l'État ne se range pas du côté du peuple, les femmes subissent le poids de différents éléments de vulnérabilité qui s'accumulent. La violence sexiste n'est jamais isolée, mais elle est exacerbée par le croisement des identités : femmes handicapées, femmes ayant des identités de genre et des orientations sexuelles variées, femmes issues de minorités religieuses, femmes issues de communautés autochtones et locales, femmes pauvres des villes et des villages, travailleuses migrantes et ouvrières, survivantes de conflits et de catastrophes. Chaque strate d'identité accroît les inégalités, tandis que l'État continue de manquer à son devoir de protection.
C'est pourquoi l'Alliance des femmes indonésiennes (API) exige que :
* le président Prabowo mette fin à toutes les formes de violence étatique, notamment en retirant les forces armées (TNI) et la police (Polri)
* le président Prabowo, le ministre de la Défense Sjafrie Sjamsoeddin [20] et le commandant des forces armées Agus Subiyanto [21] retirent immédiatement les troupes engagées aux côtés de la police dans le maintien de la sécurité et de l'ordre publics
* le chef de la police nationale Listyo Sigit démissionne immédiatement de son poste et que la police libère sans condition tous les membres de la communauté arrêtés
* le président Prabowo mette fin à toute forme de criminalisation à l'encontre de la population, des militant.e.s, des journalistes et des auxiliaires de justice, et libère sans condition toutes les personnes détenues
* Prabowo renvoie l'armée dans ses casernes et mette fin à toute forme d'implication de l'armée dans les affaires civiles
la garantie intégrale des droits constitutionnels des citoyen.ne.s à se réunir, à s'associer et à exprimer leurs revendications en public sans intimidation ni violence
Alliance des femmes indonésiennes (API)
Contact médias
Mutiara Ika | Ija Syahruni | Eka Ernawati
L'Alliance des femmes indonésiennes (API) est un espace de regroupement politique initié par des organisations et des mouvements de femmes ainsi que par divers groupes de la société civile tels que des journalistes, des personnes handicapées, des travailleurs domestiques, des syndicats, des groupes LGBTIQ+, des étudiants, des organisations de défense des droits humains et des communautés autochtones. L'API a pour objectif de faire face à la détérioration de la vie démocratique et au renforcement des pratiques militaristes qui intensifient la violence à l'égard des femmes et d'autres groupes vulnérables.
Cet article a été publié pour la première fois le mercredi 3 septembre 2025 sur le site web féministe indonésien Perempuan Mahardhika
https://mahardhika.org/5093-2/
Traduit pour ESSF par pierre Vandevoorde avec l'aide de Deeplpro
https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article76109
Notes
[1] Force de police paramilitaire indonésienne.
[2] Président de l'Indonésie depuis le 20 janvier 2025, ancien général et gendre de l'ancien dictateur Suharto
[3] Capitale de l'Indonésie
[4] Grande ville du centre de Java.
[5] Capitale de la province du Sulawesi du Sud.
[6] Parlement régional.
[7] Capitale de la province de Papouasie occidentale.
[8] Ville du centre de Java.
[9] Fondation indonésienne d'aide juridique
[10] Capitale de Sulawesi du Nord
[11] Capitale de Kalimantan oriental
[12] Organisation de défense des droits humains.
[13] Police métropolitaine de Jakarta
[14] Code pénal indonésien datant de l'époque coloniale.
[15] Loi controversée sur la cybercriminalité fréquemment utilisée pour criminaliser la dissidence.
[16] Commission pour les disparus et les victimes de violences, organisation indonésienne de défense des droits humains
[17] Université islamique privée de Java occidental
[18] Université privée de Bandung
[19] Forces armées nationales indonésiennes et police nationale.
[20] Ancien général et ministre de la Défense.
[21] Commandant des forces armées indonésiennes
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’attaque contre le Qatar montre qu’Israël ne veut pas d’un cessez-le-feu à Gaza

Netanyahu ne cesse de changer de position sur un cessez-le-feu à Gaza, utilisant différentes stratégies pour poursuivre la guerre.
Tiré d'Agence médias Palestine.
Depuis près de deux ans, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu fait tout son possible pour éviter d'accepter un cessez-le-feu à Gaza.
En novembre 2023, un accord a permis la libération de 110 otages capturés lors de l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre.
Mais une semaine plus tard, Netanyahu a refusé de prolonger le cessez-le-feu, laissant les autres otages sur le carreau.
Depuis lors, chaque fois qu'un cessez-le-feu semblait à portée de main, Netanyahu a changé les règles du jeu. En mai 2024, le Hamas a accepté un accord proposé, mais Israël a refusé de l'approuver et a envahi Rafah à la place. En septembre, Netanyahu a introduit une nouvelle condition : le contrôle permanent par Israël du corridor de Philadelphi, la zone située entre l'Égypte et Gaza, que Le Caire et le Hamas ont tous deux rejetée.
Plus tard, après avoir insisté sur le fait que seul un accord partiel serait accepté, Netanyahu a changé les paramètres et a insisté pour qu'Israël n'accepte qu'un accord prévoyant la libération de tous les prisonniers, et non en échange de la fin de la guerre.
Même lorsque ses alliés ont présenté des propositions, Netanyahu les a éludées. Toujours en mai 2024, le président américain de l'époque, Joe Biden, a annoncé qu'Israël avait proposé un plan de cessez-le-feu, mais Netanyahu est resté silencieux et aucun accord n'a suivi.
Lorsqu'un accord a été conclu et mis en œuvre, Netanyahu a fait en sorte qu'il échoue. En janvier 2025, sous la pression du nouveau président américain Donald Trump, Netanyahu a accepté un accord de cessez-le-feu progressif qui se poursuivrait jusqu'à ce qu'un accord final mettant fin à la guerre soit conclu. Pourtant, en mars, Israël l'a violé unilatéralement, reprenant les bombardements et le blocus.
Et la semaine dernière, alors que les négociateurs du Hamas se réunissaient à Doha pour discuter d'une nouvelle proposition soutenue par les États-Unis, Israël les a bombardés, sabotant ainsi les pourparlers.
Un jeu d'équilibriste
Le gouvernement israélien insiste sur le fait qu'aucun accord n'a été conclu parce que le groupe palestinien Hamas n'a pas été un intermédiaire honnête et qu'il doit être éradiqué, car il tentera de se réarmer.
Mais après l'attaque de Doha, Einav Zangauker, la mère de Matan Zangauker, un Israélien retenu captif à Gaza depuis près de deux ans, sait clairement qui est responsable.
« Pourquoi le Premier ministre [Netanyahu] insiste-t-il pour faire échouer tout accord qui semble sur le point d'aboutir ? Pourquoi ? », demande-t-elle de manière rhétorique.
Pourquoi, en effet.
Netanyahu est le Premier ministre israélien ayant exercé le plus longtemps. L'une des raisons de son succès est sa capacité à mener plusieurs projets de front, à jongler avec différentes priorités, même si elles sont parfois contradictoires, sans les résoudre complètement.
Cette capacité lui permet de repousser les décisions qui pourraient lui faire perdre le soutien du public ou de ses alliés politiques. Et dans un pays comme Israël, où la politique parlementaire repose sur la capacité à maintenir la plus grande coalition possible, cela est essentiel.
Netanyahu est également confronté à des problèmes juridiques au niveau national – il est jugé pour corruption – et rester au pouvoir est probablement son meilleur moyen d'éviter la prison.
Pour en revenir à la question d'un cessez-le-feu à Gaza, Netanyahu est confronté à un problème fondamental : il est redevable à l'extrême droite messianique qui soutient son gouvernement, et celle-ci a clairement fait savoir qu'une fin de la guerre à ce stade la conduirait à se retirer de la coalition du Premier ministre, ce qui entraînerait presque certainement son effondrement.
L'extrême droite – des Israéliens comme le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir et le ministre des Finances Bezalel Smotrich – veut chasser les Palestiniens de Gaza et faire venir des colons israéliens pour vivre sur les terres laissées vacantes par ceux qui ont été victimes du nettoyage ethnique.
Netanyahu n'est peut-être pas totalement opposé à cet objectif, mais il comprend également la difficulté de le réaliser. Même Israël serait mis à rude épreuve sur le plan militaire s'il tentait de conquérir et de conserver l'ensemble de la bande de Gaza, et des mois ou des années de conflit intense provoqueraient davantage de dissensions au sein d'une armée qui dépend fortement de la mobilisation de milliers d'Israéliens en tant que réservistes.
Et, bien sûr, une tentative aussi effrontée de nettoyage ethnique isolerait davantage Israël sur la scène internationale.
Que va-t-il se passer ensuite ?
Au lieu de cela, Netanyahu continue de jouer sur tous les tableaux. Il garde Ben-Gvir et Smotrich de son côté en refusant systématiquement de mettre fin à la guerre, il mène les médiateurs en bateau en envoyant des équipes de négociation discuter de propositions qu'il n'acceptera jamais, et il ne s'engage jamais pleinement dans la lutte militaire qui serait nécessaire pour tenter de prendre complètement le contrôle de Gaza.
Il insiste sur le fait que le Hamas ne peut pas être autorisé à diriger Gaza et rejette l'Autorité palestinienne qui gouverne l'enclave, tout en affirmant qu'Israël ne veut pas la contrôler.
Combien de temps Netanyahu pourra-t-il tenir ? Il y a eu des moments où il a connu des difficultés et où tout a failli s'effondrer.
En janvier, Trump a refusé d'entendre un « non », forçant Netanyahu à accepter un accord qui était sur la table depuis plus de six mois. Cela a conduit Ben-Gvir à démissionner de son poste au gouvernement et Smotrich à menacer de démissionner si l'accord aboutissait et mettait fin à la guerre.
Comme mentionné précédemment, cela n'a pas été le cas. Et Ben-Gvir est rapidement revenu. Trump tient des propos contradictoires sur la fin de la guerre, sans jamais demander fermement à Netanyahu d'y mettre un terme.
Les prochaines élections israéliennes doivent avoir lieu avant octobre 2026. Peut-être Netanyahou sera-t-il en mesure de présenter suffisamment de victoires à l'électorat – il peut déjà affirmer qu'il a affaibli le Hamas, vaincu le Hezbollah et bombardé les sites nucléaires iraniens – pour obtenir un soutien suffisant afin de ne plus dépendre de Ben-Gvir et Smotrich et de pouvoir mettre fin à la guerre selon ses propres conditions, quelles qu'elles soient.
Ou peut-être que la guerre se poursuivra, avec éventuellement des pauses, pour qu'Israël recommence à bombarder Gaza lorsqu'il en ressentira le besoin.
Sinon, la poursuite de la guerre sans fin en vue pourrait accroître l'opposition tant étrangère que nationale, augmentant la pression sur Netanyahu jusqu'à ce qu'il soit contraint de prendre une décision pour mettre fin à la guerre ou qu'il soit confronté à une défaite aux urnes en 2026.
Les Palestiniens de Gaza – dont Israël a tué plus de 64 800 – sont les victimes ultimes de la prolongation de cette guerre, tout comme les prisonniers israéliens toujours détenus à Gaza.
Pour l'instant, ils continueront à souffrir, tandis que Netanyahu continuera à jongler avec les différents enjeux.
Traduction : JB pour l'Agence Média Palestine
Source : Al Jazeera
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Haaretz : Vous refusez de croire que les Gazaouis meurent de faim ? Voyez ce qui arrive aux Palestiniens dans les prisons israéliennes

Depuis le début de la guerre, des ONG et des médias ont documenté la torture, les mauvais traitements et la famine généralisés dans les prisons israéliennes. Il a fallu 18 mois, mais la Cour suprême israélienne a interpellé l'État et exigé qu'il fournisse aux prisonniers détenus pour raisons de sécurité « les conditions de base pour exister ». Des pétitions similaires concernant Gaza continuent d'être ignorées.
Tiré de France Palestine Solidarité. Photo : Les gardiens israéliens font subir des abus aux détenus palestiniens à la prison de Meggido, avril 2025 © Motassem A Dalloul
La Haute Cour de justice israélienne a statué dimanche que l'État devait garantir un niveau minimum d'alimentation aux prisonniers palestiniens détenus dans les prisons israéliennes pour des raisons de sécurité. Cette décision fait suite à une requête déposée en avril 2024 par deux organisations israéliennes de défense des droits humains, l'Association pour les droits civils en Israël et Gisha – Centre juridique pour la liberté de circulation, après la multiplication des preuves de torture, de mauvais traitements et de privation de nourriture.
Les trois juges « ont statué à l'unanimité que le service pénitentiaire est tenu par la loi de fournir aux prisonniers détenus pour raisons de sécurité les conditions de base nécessaires à leur existence, y compris la quantité et les types de nourriture appropriés pour maintenir leur santé », selon le résumé de la Cour.
Noa Sattath, directrice exécutive de l'ACRI, a déclaré dans un communiqué que cette décision « représente une victoire cruciale pour l'État de droit et la dignité humaine. La Cour suprême a rejeté sans équivoque la politique de privation systématique de nourriture menée par le ministre [Itamar] Ben-Gvir, affirmant que même en temps de guerre, Israël doit respecter les normes fondamentales en matière de droits humains ».
Cette décision est arrivée trop tard pour un nombre indéterminé de prisonniers qui ont été maltraités, torturés et affamés depuis le 7 octobre.
Fin août, Haaretz a rapporté que l'administration pénitentiaire refusait de restituer le corps d'un prisonnier palestinien de 17 ans décédé en détention. Il était en bonne santé lorsqu'il a été arrêté et accusé d'avoir lancé un cocktail Molotov. Il est mort après six mois de prison ; l'autopsie officielle a révélé qu'il souffrait de « malnutrition, de scorbut et d'une infection intestinale ». Dans une autre affaire, un homme de 40 ans faisant l'objet d'une enquête du service de sécurité Shin Bet est mort après être tombé d'un étage élevé, alors qu'il était menotté.
S'agit-il d'incidents malheureux, mais inhabituels ?
Alex de Waal, l'un des plus grands experts mondiaux en matière de famine et d'affamement, a déclaré à Haaretz en juillet que « tout ce que nous savons sur le déroulement d'une famine nous indique que ce sont les actions d'Israël qui ont créé ces conditions ». Il a ensuite écrit dans le New York Times que « la famine prend du temps ; les autorités ne peuvent pas affamer une population par accident ». Si tel est le cas, les prisonniers des prisons israéliennes ne peuvent certainement pas être affamés ou maltraités accidentellement. De plus, ces pratiques n'étaient ni cachées, ni récentes.
Les médias israéliens ont fait état de graves abus commis à l'encontre de prisonniers palestiniens détenus pour des raisons de sécurité depuis le début de la guerre, notamment Haaretz, +972 Magazine et son site hébreu Local Call. Les rapports datent de fin 2023 et début 2024. En mars de cette année-là, Hagar Shezaf, journaliste à Haaretz, a révélé que 27 détenus de Gaza arrêtés depuis le 7 octobre ou depuis le début de la guerre étaient morts dans des établissements israéliens. En avril 2024, les organisations de défense des droits humains ont déposé leur requête auprès de la Haute Cour.
Fin juillet 2024, tous les grands médias israéliens ont rapporté un cas de sodomie commise par des gardiens sur un prisonnier à la prison de Sde Teiman, mais comme ces médias couvraient rarement le sujet, la plupart des Israéliens y ont vu une anomalie, comme d'habitude. En août 2024, B'Tselem a publié un rapport accablant documentant les abus systématiques dont sont victimes les prisonniers sécuritaires.
En d'autres termes, le public aurait pu être au courant, mais il ne l'était pas, ou s'en moquait. Une poignée de personnes ont même participé à une émeute pour soutenir les auteurs des abus à Sde Teiman. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, responsable du service pénitentiaire israélien, est fier de sa politique, même si les rapports faisant état d'abus et de privation de nourriture se sont succédé presque sans interruption de fin 2023 à 2025. Le 6 juillet, Shezaf a rapporté que 73 prisonniers ou détenus palestiniens étaient morts en détention, selon le Club des prisonniers palestiniens.
Revenons à la décision rendue dimanche par la Haute Cour : la longue attente du verdict, près de 18 mois après le dépôt de la requête, « semble sans précédent », a déclaré Tania Hary, directrice de Gisha, dans une interview accordée à Haaretz. La requête d'avril 2024 a été présentée comme urgente lors de son dépôt, et Tania Hary pose la question suivante : « Y a-t-il un cas qui mérite davantage le qualificatif d'« urgent » que [la question de savoir] si les gens ont suffisamment à manger ? »
Mais la cour que les libéraux israéliens traditionnels aiment et soutiennent massivement ces dernières années a largement échoué à protéger les droits humains des Palestiniens. La cour que la droite israélienne adore détester a statué en avril dernier qu'Israël n'occupe ni ne contrôle Gaza, et n'est pas tenu d'apporter une aide humanitaire aux civils qui s'y trouvent, mais seulement de la laisser entrer, en vertu du droit de la guerre.
Il est à noter que bon nombre des excuses avancées par Israël pour justifier la famine dans la bande de Gaza se concentrent sur le sort malheureux de l'aide une fois qu'elle entre dans la bande. La Cour n'a même pas tenu d'audience sur une autre requête urgente visant à mettre fin à la famine à Gaza, déposée en mai ; les requérants ont demandé à la retirer en signe de protestation.
Après la fusillade meurtrière perpétrée lundi par des Palestiniens, qui a fait au moins six morts dans un bus à Jérusalem, et après la mort de quatre soldats supplémentaires de l'armée israélienne à Gaza, il sera trop facile pour beaucoup de minimiser l'importance des droits fondamentaux des prisonniers, dont certains ont participé à des attentats terroristes (tandis que d'autres n'ont jamais été condamnés et que certains n'ont même jamais été inculpés). Mais les Israéliens qui nient la famine à Gaza auront beaucoup plus de mal à se décharger de leur responsabilité dans la famine, les mauvais traitements, la torture et la mort des Palestiniens dans les prisons israéliennes, sur un territoire souverain, où il n'y a pas de complot du Hamas, de l'ONU ou des médias internationaux à blâmer.
Traduction : AFPS
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

En septembre, « all eyes on Gaza » 11 septembre...

L'été a été terrifiant en Palestine. À Gaza tout d'abord avec l'accélération de la famine, mais aussi en Cisjordanie où les offensives israéliennes se sont multipliées. Mais de flottilles en manifestations, la résistance s'organise après près de deux ans de génocide.
Tiré de Inprecor 736 - septembre 2025
11 septembre 2025
Par Antoine Larrache
© CC BY-SA 3.0
L'UNRWA souligne que la malnutrition a atteint 28,5 % dans la ville de Gaza et qu'elle a examiné 100 000 enfants de moins de 5 ans depuis mars. Selon elle, la famine sévit dans le gouvernorat de Gaza s'étendra à ceux de Deir al Balah et Khan Younis d'ici la fin du mois de septembre (1). MSF a effectué plus de 1 000 consultations par semaine pour des cas de diarrhées aqueuses aiguës, conséquence du manque d'eau potable. 70 % de l'eau qui circule dans les canalisations à Gaza est perdue en raison des fuites causées par les bombardements (2). Et les points de distribution de nourriture sont attaqués par l'armée israélienne ou des milices qu'elle finance.
En Cisjordanie, selon MSF, 40 000 personnes ont été « déplacées » depuis le début de l'année, dans le cadre de l'opération militaire israélienne Iron Wall (mur de fer). « La plupart des villages de Masafer Yatta, au sud-est d'Hébron, sont confrontés quotidiennement à des attaques de colons et à des perquisitions militaires » (3). À Hébron, la compagnie des eaux israélienne a réduit l'approvisionnement, entraînant une baisse de plus 50% de l'approvisionnement public en eau.
Mobilisations et accélérations morbides
Mais, en ce mois de septembre, les rapports de forces pourraient évoluer. D'abord parce que les mobilisations de solidarité ont repris, pour exercer une pression sur les gouvernements européens. Ainsi, 300 000 personnes ont manifesté en Italie, avec la participation du Parti démocrate, du Mouvement 5 étoiles, des verts et de la gauche. Le Tour d'Espagne cycliste, la Vuelta, a été l'occasion de voir des actions dans de multiples villes. 20 000 personnes ont défilé à Londres le 7 septembre contre le génocide et contre l'interdiction de Palestine Action, la police ayant arrêté environ 900 personnes lors de cette manifestation. Le même jour, 70 000 personnes ont défilé à Bruxelles.
Des manifestations qui ont aussi eu lieu dans l'État colonial. Des centaines de Palestinien·nes manifestent régulièrement, malgré une répression intense, dans les territoires de 48. Et 700 000 personnes auraient défilé mi-août pour l'arrêt de la guerre et la libération des otages. Ces dernières manifestations sont ambiguës dans leurs objectifs, mais s'opposent clairement à la politique de Netanyahou et Trump. Alors que ceux-ci ont refusé les propositions de cessez-le-feu, Trump a annoncé avoir envoyé un « dernier avertissement » au Hamas concernant la libération des otages et Netanyahou a annoncé une « extension des opérations militaires dans et autour dans la ville de Gaza ».
Un mois de septembre chargé de mobilisations
Il est donc clair que le pouvoir génocidaire entend poursuivre son offensive. L'abject plan américain pour l'après-guerre prévoit le « déplacement volontaire » de 2 millions de gazaouis (4). Les mobilisations qui se sont déroulées ces dernières semaines dans le monde se poursuivront, notamment autour du 7 octobre prochain. Dans le monde entier, on manifestera, et la pression s'exercera davantage sur les grandes puissances. Le projet de reconnaissance de l'État palestinien par différents pays apparaît de plus en plus comme un mirage visant à détourner les yeux du génocide en cours.
La flottille Global Sumud, en revanche, montre une autre logique : puisque nos dirigeants de font rien, alors les peuples doivent casser le blocus et ouvrir un couloir humanitaire par eux-mêmes. Plusieurs dizaines de bateaux devraient s'approcher de Gaza vers le 15 ou le 20 septembre. Plus de 30 000 personnes se sont portées volontaires, depuis de nombreux pays. L'État colonial israélien sera en grande difficulté politique lorsqu'il voudra les intercepter, d'autant que les dockers et d'autres professions promettent de bloquer le commerce avec Israël en cas d'attaque contre les bateaux. Les organisations syndicales ont une occasion de renforcer leur implication. Nos actions militantes pèseront dans ces rapports de forces politiques. La flottille montre la voie, celle d'une coordination internationale de nos actions anticoloniales, par en bas, visant à soutenir la nécessaire révolte populaire de masse au Moyen-Orient.
Le 8 septembre 2025
2. « Gaza : la privation d'eau s'inscrit dans la campagne génocidaire israélienne », 21 août 2025, MSF.
4. « Gaza postwar plan envisions ‘voluntary' relocation of entire population », Karen DeYoung et Cate Brown, 2 septembre 2025, The Washington Post.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les objecteurs de conscience de l’armée israélienne bravent la répression en s’opposant au génocide

Face à des peines de prison plus longues et à une hostilité publique grandissante, une nouvelle génération de réfractaires considère le refus du génocide à la fois comme un devoir moral et un acte porteur d'espoir.
Tiré d'Agence médias Palestine. En collaboration avec Local Call
Mi-juillet, quelques dizaines de jeunes militants juifs israéliens ont défilé dans les rues de Tel Aviv pour protester contre le génocide en cours à Gaza. La manifestation s'est terminée sur la place Habima, au centre-ville, où dix participants ayant reçu des convocations de l'armée les ont brûlées et ont publiquement déclaré leur refus de s'enrôler.
L'acte a provoqué un véritable tollé sur les réseaux sociaux israéliens, déclenchant une vague de messages privés — certains de soutien, d'autres hostiles— ainsi que des appels à la violence lancés par des pages de droite.
« Tous les jours après avoir brûlé nos convocations, je recevais des appels », raconte Yona Roseman, 19 ans, l'une des participantes, dans un entretien avec +972. « Je ne sais pas si ce geste à lui seul peut changer les choses, mais si ne serait-ce qu'un seul soldat prend parti contre ce génocide, c'est déjà une victoire. »
Roseman est l'un.e des sept jeunes Israélien.nes emprisonné.es en août pour avoir refusé d'effectuer leur service militaire, en signe de protestation contre le génocide et l'occupation menés par Israël. Selon le réseau d'objecteurs de conscience Mesarvot, il s'agit du nombre le plus élevé d'objecteurs incarcérés au cours de la même période depuis la création du collectif en 2016. Leurs peines varient de 20 à 45 jours, probablement suivies de nouvelles convocations, et de plusieurs autres peines de prison avant d'être officiellement exemptés.
Au total, 17 jeunes Israéliens ont été emprisonnés pour avoir publiquement refusé la conscription depuis le début de la guerre. Le premier, Tal Mitnick, a passé 185 jours derrière les barreaux. Un autre, Itamar Greenberg, est resté incarcéré près de 200 jours — la plus longue peine infligée à un objecteur de conscience depuis plus d'une décennie. Ces deux situations reflètent le durcissement de la position de l'armée : selon Mesarvot, celle-ci semble avoir abandonné sa politique précédente de libération des réfractaires après 120 jours, faisant désormais des peines prolongées la nouvelle norme de la répression.
Si l'objection de conscience parmi les jeunes appelés reste rare dans la société israélienne, l'agression d'Israël contre Gaza a déclenché une vague de refus plus conséquente parmi les réservistes . Plus de 300 d'entre eux, la plupart ayant été rappelés pour servir dans la guerre contre Gaza, ont demandé du soutien au mouvement de refus Yesh Gvul (« Il y a une limite »).
« Ce qui distingue cette vague de refus, contrairement à celles liées à la Première guerre du Liban ou aux Intifadas, c'est qu'à l'époque, il s'agissait de réfractaires sélectifs, qui refusaient de partir au Liban ou en Cisjordanie », explique Ishai Menuchin, président de Yesh Gvul. « Aujourd'hui en revanche, la plupart des réfractaires refusent en bloc de participer à l'armée, et donc à la machine du génocide. »
Parmi les 300 réservistes soutenus par Yesh Gvul, seuls quatre d'entre eux ont été traduits en justice. En effet, l'armée choisit généralement soit de libérer rapidement les réservistes réfractaires, soit de trouver d'autres arrangements, à l'inverse du traitement réservé aux jeunes objecteurs n'ayant pas encore été appelés .
« La décision de refuser est beaucoup plus simple aujourd'hui »
Le 17 août, le jour où Roseman a annoncé son refus, environ 150 manifestants se sont rassemblés devant le bureau de recrutement de sa ville natale, Haïfa. Roseman, elle-même arrêtée six fois lors de manifestations dirigées par des Palestiniens à Haïfa, a assisté à l'intervention rapide de la police qui a déclaré la manifestation illégale et, comme c'est régulièrement le cas lors des rassemblements anti-guerre palestiniens dans la ville, a violemment arrêté dix personnes.
« Une véritable prise de conscience de l'ampleur de la destruction que notre État orchestre, de la souffrance qu'il inflige à ses citoyens, exige une action en conséquence », a déclaré Roseman à la foule avant que la manifestation ne soit dispersée. « Si vous percevez l'ampleur des atrocités et que vous vous considérez comme des êtres moraux, vous ne pouvez pas continuer à faire comme si de rien n'était, quelque soit le coût social ou légal de vos actions. »
Roseman avait pris la décision de refuser la conscription dès début 2023, alors qu'elle participait aux manifestations hebdomadaires contre les efforts du gouvernement pour affaiblir le pouvoir judiciaire. À l'époque, elle défilait avec le « bloc anti-occupation », une petite section qui militait pour établir le lien entre la réforme judiciaire et l'occupation continue par Israël des territoires palestiniens — au grand dam des organisateurs de manifestations plus traditionnels. Elle faisait également partie des 230 jeunes ayant signé, quelques semaines avant le 7 octobre, la lettre « Jeunesse contre la dictature », s'engageant à « refuser de rejoindre l'armée tant que la démocratie ne sera pas garantie pour tous ceux qui vivent sous la juridiction du gouvernement israélien ».
« Je pense que la décision de refuser est bien plus simple aujourd'hui, dit Roseman. Le militarisme et l'obéissance ne sont plus des sujets de débat, car un génocide est en cours, et il est évident qu'on ne s'engage pas dans une armée qui commet un génocide. »
Déjà très impliquée dans l'activisme avec les Palestiniens — en assurant une “présence protectrice” dans les communautés rurales palestiniennes de Cisjordanie face à la violence des colons et de l'armée, et en rejoignant les manifestations contre le génocide à Haïfa — Roseman a déclaré que ses relations personnelles avec des militants palestiniens n'ont fait que renforcer sa décision de ne pas s'engager sous les drapeaux. « Si vous voulez être partenaire des Palestiniens, vous ne pouvez pas intégrer l'armée qui les tue, dit-elle. Ce sont des personnes que vous connaissez, dont on a détruit les maisons, ou qui sont assassinées ».
Son œuvre de solidarité avec les Palestiniens lui a également fait comprendre les limites de toute tentative de réformer le système de l'intérieur. « Il arrive qu'un soldat me lance une grenade assourdissante, ou m'arrête, j'ai assisté à la démolition de maisons dans lesquelles j'avais dormi, les maisons de camarades militants palestiniens. Cela change vraiment votre perspective, vous comprenez réellement que cette armée n'est pas la vôtre, qu'elle est en fait contre vous. »
Outre les effets sur sa vie de militante, la décision de Roseman de refuser l'appel a également un coût personnel. « Certain·es camarades de classe ont coupé les ponts avec moi à cause de cela. J'ai quitté mon programme d'année de césure plus tôt en raison des difficultés liées à mon refus, » expliqua-t-elle. Sa famille « est restée à ses côtés en tant que fille, mais ce n'est pas une décision qu'ils ont soutenue. »
Contrairement à la plupart des objecteurs emprisonnés dans les prisons militaires israéliennes, Roseman passe la majeure partie de ses journées en isolement. En tant que prisonnière trans, elle n'est autorisée à sortir que pour de courtes pauses, en dernier dans la file, conformément à la politique de l'armée, également subie cette année par une autre objectrice trans, Ella Keidar Greenberg.
« Il est important pour moi de le souligner, surtout après avoir été traitée de manière humiliante lors de mon arrestation pendant des manifestations : l'attitude de l'État à l'égard des personnes queer n'est libérale et progressiste que dans des conditions bien précises, dit-elle. Dès que vous ne correspondez plus aux critères nationaux, vos droits vous sont retirés. »
« Nous n'en sommes pas là par hasard »
Le 31 juillet, quelques semaines avant l'incarcération de Roseman, deux Israéliens de 18 ans — Ayana Gerstmann et Yuval Peleg — ont été condamnés respectivement à 30 et 20 jours de prison pour avoir refusé de s'enrôler. Gerstmann a depuis été libérée, tandis que Peleg a écopé d'une peine supplémentaire de 30 jours. Au vu de cas similaires, il est probable que sa peine soit prolongée 4 ou 5 fois avant qu'il ne soit libéré de ses obligations militaires.
« Je suis ici pour avoir refusé de prendre part à un génocide et pour envoyer un message à quiconque veut bien l'entendre : tant que le génocide continue, nous ne pouvons pas vivre dans la paix et la sécurité », a déclaré Peleg avant d'entrer en prison.
Issu d'une famille sioniste libérale de la ville aisée de Kfar Saba, Peleg explique que sa décision de refuser la conscription est récente. « À la maison, on ne parlait jamais du refus. On parlait beaucoup de Bibi [Netanyahou], et un peu de l'occupation », a-t-il expliqué dans une interview commune avec Gerstmann avant leur incarcération.
Pour Peleg, la découverte de médias en ligne non israéliens, dans les premiers jours de la guerre, a constitué un tournant. « Cela m'a donné une perspective que je n'avais pas en grandissant. À un moment donné, j'ai compris que l'armée israélienne n'était pas l'armée droite, protectrice et juste que je croyais. »
Peu à peu pendant la guerre, à mesure que l'ampleur de l'offensive israélienne contre Gaza devenait plus claire, « la décision de ne pas m'enrôler est devenue relativement facile, » explique-t-il. Le refus lui a aussi offert une possibilité d'exprimer sa dissidence. « Il n'y a pratiquement aucun endroit dans ce pays où l'on peut dire ce genre de choses. »
Pour Gerstmann, qui a grandi dans la banlieue de Tel-Aviv, à Ramat Gan, la décision de refuser l'appel s'est construite sur plusieurs années. « En cinquième, on nous avait donné un devoir pour la Journée de Jérusalem : écrire sur des lieux de Jérusalem. C'était censé éveiller des sentiments patriotiques, mais pour moi, cela a eu l'effet inverse », se souvient-elle.
Bien que l'occupation ait souvent été discutée à la maison, elle ne l'avait réellement découverte qu'à ce moment-là. « Ma mère m'a suggéré d'aller voir le site de B'Tselem et de lire sur Jérusalem-Est pour le projet scolaire, » a-t-elle raconté à +972. « C'était la première fois que je voyais ce qui s'y passait. J'ai été choquée. »
Dans le système éducatif israélien, ajoute-t-elle, « on parle toujours de Jérusalem-Est uniquement dans le contexte de ‘l'unification' de la ville, et on glorifie la guerre de 1967 [au cours de laquelle Jérusalem-Est a été prise]. Soudain, j'ai découvert toutes les injustices et les souffrances que cela impliquait. »
À 16 ans, elle avait déjà pris la décision de ne pas s'enrôler dans l'armée. « J'ai dit à une amie que je voulais obtenir une exemption pour raison de santé mentale parce que je m'opposais à l'occupation, » raconte-t-elle. Son amie l'a mise au défi : « Si ce sont tes convictions, pourquoi ne pas simplement les assumer et les dire ? Pourquoi as-tu besoin de te cacher derrière des mensonges ? »
« C'est à ce moment-là que ça a fait tilt pour moi, » se souvient-elle. « J'ai compris qu'elle avait raison — que je devais crier mon refus haut et fort, clairement et publiquement. »
À l'instar de Roseman et Peleg, Gerstmann a réalisé que les raisons de refuser l'appel devenaient évidentes, et ce dès le début de la guerre à Gaza, avec l'intensification de l'offensive israélienne contre le peuple palestinien. « Il est devenu beaucoup plus clair que ce refus était le bon choix, qu'il ne fallait en aucun cas coopérer avec les agissements de l'armée à Gaza ».
Gerstmann et Peleg espèrent que chaque soldat envoyé à Gaza lira leur refus comme un message exprimant la liberté de choisir. « Pendant des années, on nous a conditionnés à croire qu'il fallait s'enrôler, qu'il était impossible de remettre cela en cause. Mais ce que nous voyons aujourd'hui à Gaza, c'est la ligne rouge qui prouve qu'il existe bel et bien un choix. »
« Nous avons atteint un niveau de violence et de destruction inégalé dans l'histoire de cette terre, » a déclaré Peleg. « Israël ne redeviendra jamais ce qu'il était le 6 octobre 2023. Il est clair qu'un génocide se déroule autour de nous. Face à cela, nous refusons. »
Pour Peleg, il était important de souligner que la campagne d'anéantissement d'Israël à Gaza ne surgit pas de nulle part. « Nous n'en sommes pas arrivés là par accident, » explique-t-il. « Israël a toujours porté en lui des éléments d'occupation, de fascisme et de racisme envers les Palestiniens — depuis 1967 bien sûr, mais depuis la Nakba en réalité. Le génocide actuel contre les Palestiniens suit la même logique ».
Même si l'opinion publique israélienne tend de plus en plus vers la droite, Gerstmann espère toujours que ses actes auront une influence. « La phrase « Il n'y a pas d'innocents à Gaza » est entendue fréquemment, elle se banalise. C'est très inquiétant ; mon refus de l'appel est en réalité une façon de lutter contre le désespoir », a-t-elle expliqué. « J'espère que cela ouvrira les yeux de certains et leur permettra de réfléchir et de comprendre ce que l'armée fait en leur nom. »
Toutes deux disent avoir peur de déclarer publiquement leur refus de la conscription, dans une société où un tel acte est assimilé à de la trahison. « Bien sûr, c'est effrayant, mais cela ne m'a pas dissuadée », a déclaré Gerstmann. « Au contraire, ce que nous voyons depuis le début de cette guerre m'a fait comprendre que je devais absolument m'opposer à la conscription »
« Je ne peux plus en faire partie »
Deux autres objecteurs de conscience ont été emprisonnés le mois dernier. Ils se sont confiés à +972, tout en choisissant de rester anonymes pour des raisons personnelles et familiales.
R., un jeune homme de 18 ans originaire de la ville de Holon, a été condamné à 30 jours de prison. « J'ai décidé de refuser l'appel avant le 7 octobre, mais après avoir vu la destruction à Gaza, j'ai compris que je ne pouvais plus continuer à hésiter », a-t-il déclaré. « À partir de là, m'enrôler était tout simplement hors de question pour moi. »
Son message à l'intention des autres jeunes est direct : « Refusez, tout simplement. Dans le climat actuel, au vu de ce qui se passe à Gaza, il faut résister. »
Un autre objecteur, B., a suivi un parcours plus atypique. À 19 ans, il s'était enrôlé dans l'Administration Civile — l'organisme militaire qui dirige les Palestiniens en Cisjordanie. Il a toutefois décidé, après huit mois de service, de refuser l'appel, ce qui lui a valu une peine de 45 jours de prison.
« Avant de m'enrôler, j'étais allé en Cisjordanie, j'y ai rencontré des gens et j'ai compris la situation sur place », se souvient B. « C'était déjà difficile pour moi à ce moment-là, je n'avais vraiment pas envie de rejoindre l'armée. [Mais ensuite] j'ai parlé avec certaines personnes, et elles m'ont convaincu de le faire malgré tout. »
Ce qu'il a vu à la base militaire a confirmé son choix de refuser la conscription. « Pendant l'entraînement et sur le terrain, j'ai vu beaucoup de choses et je me suis dit : “Waouh, je ne peux plus faire partie de ça.” L'attitude des autres soldats — la manière dont ils parlaient, dont ils se comportaient — des gens animés par un racisme extrême, a motivé ma décision en grande partie. »
La brutalité, selon lui, était omniprésente. « J'ai vu des Palestiniens se faire frapper sans aucune raison. Ils les attachent, les laissent menottés en plein soleil pendant 24 heures, face contre terre, à genoux, sans eau ni nourriture. Les soldats passaient à côté et leur donnaient des coups de pied. J'étais choqué. »
« Dès mon deuxième jour, j'ai vu un détenu et j'ai demandé ce qu'il avait fait. On m'a dit qu'il ‘n'avait pas obéi'. Puis j'en ai vu un autre attaqué à coups de pied. On m'a dit : ‘Il le mérite.' Ces situations étaient fréquentes. »
Un incident le hante encore. « Un soldat parlait en hébreu à un Palestinien, et quand celui-ci répondait en arabe, le soldat lui a violemment cogné la tête contre un mur en disant : ‘Tu es en Israël, parle hébreu.' Je lui ai dit : ‘Il ne comprend pas.' On voyait ce genre de violence tout le temps. »
Personne n'est à l'abri de tels abus— pas même les personnes âgées. « J'ai vu un Palestinien de 70 ans battu comme plâtre. Quand j'ai demandé aux autres soldats ce qu'il avait fait, ils m'ont répondu qu'il avait ‘manqué de respect aux militaires'. »
« Ils n'avaient rien à lui reprocher, alors ils l'ont retenu pendant 14 ou 15 heures, sans nourriture ni eau, puis lui ont dit : ‘La prochaine fois, ne le refais pas.' Ils ne l'ont même pas transféré à la police — qu'auraient-ils bien pu lui reprocher ?
Oren Ziv est photojournaliste, reporter pour Local Call, et membre fondateur du collectif de photographie Activestills.
Traduction : CB pour l'Agence Média Palestine
Source : +972 Magazine
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Chicago veut repousser les forces trumpistes.

Trump avait annoncé la bataille de Chicago pour son investiture, c'est-à-dire le lâcher des troupes de l'ICE (Immigration and Customs Enforcement) sur les migrants et étrangers réels et supposés et leurs proches, et s'était dégonflé. La mobilisation s'était amorcée, autour notamment des écoles et du syndicat de l'enseignement, le Chicago Teachers Union, pour' protéger les enfants et les familles latinos et au delà.
7 septembre 2025 | tiré du site aplutsoc
https://aplutsoc.org/2025/09/07/chicago-veut-repousser-les-forces-trumpistes/
La bataille de Chicago a été annoncée par un incroyable tweet de Trump, pas du tout un fake, datant du 7 septembre au matin. Entre janvier 2025 et maintenant l'affrontement, démocratique et donc social, n'a cessé de grandir aux Etats-Unis. L'ICE a massivement recruté des nervis : l'équivalent des milices fascistes s'y concentre. Le langage et les objectifs du pouvoir sont clairement la guerre : la guerre, la Civil War, aux Etats-Unis, contre les pouvoirs locaux et contre la démocratie. Et il fait référence au ministère des Armées, confié au taré masculiniste Egseth, qu'il vient précisément de rebaptiser ministère de la Guerre. Voici le tweet de Trump :
Il fut un temps, pas lointain, où un POTUS (président des Etats-Unis) qui annonçait ainsi vouloir anéantir militairement une grande ville du pays, car à la lettre c'est cela le message de Trump, subissait immédiatement une procédure de destitution. Ne cherchons pas à faire l'autruche en disant « oui mais c'est du Trump, c'est du cinéma, on voit bien qu'il fait le bravache et qu'il s'amuse ». Qu'il fait le bravache, certainement. Qu'il s'amuse, non : Trump ne sait pas ce que c'est. La référence est le colonel fou du film Apocalypse Now qui fait bombarder au napalm les villages vietnamiens au son de la chevauchée des Walkyries de Wagner. Symbole de la connerie furieuse impérialiste, symbole connoté très positivement pour Trump, qui paraphrase sa phrase fétiche, « J'aime l'odeur du napalm au petit déjeuner » : « J'aime l'odeur des déportations au petit matin ».
Voici le fascisme 2.0, nourri à l'Axe Trump/Poutine et à la synthèse MAGA-libertarianisme-masculinisme-accélérationnisme du capital-extractivisme fou. « Oui mais où sont les Sections d'Assaut qui détruisent le mouvement ouvrier organisé ? », réciteront encore quelques fossiles politiques incapables de saisir le réel. Faut-il attendre que les Sections d'Assaut aient fait leur office pour reconnaître l'ennemi mortel ?

Les habitants de Chicago ne s'y sont pas trompés. C'est la plus grande manifestation de cette année qui a éclaté à Chicago en réaction au tweet de Trump.
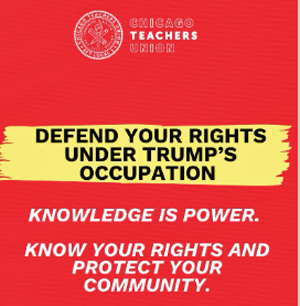
Le Chicago Teachers Union appelle à la mobilisation, sans toutefois envisager l'organisation de l'autodéfense physique pour interdire à l'ICE et éventuellement à la Garde nationale et à l'armée l'entrée dans la ville et les quartiers, cela bien lorsqu'il parle de résistance à l'occupation annoncée.
Mais une rumeur concernant le maire démocrate de Chicago (où le conseil municipal ne comporte pas de républicains et comprend une opposition de gauche formée d'élus socialistes-démocratiques par ailleurs liés au Chicago Teachers Union), Brandon Johnson, selon laquelle il avait donné un signal fort en faisant intervenir les services municipaux pour disposer des sacs de sable et de sel sur les lieux d'entrée dans la ville, et positionner les camions anti-neige en barricades, rumeur à laquelle nous avons cru car elle a dominé pendant quelques heures les réseaux sociaux américains … s'est avérée fausse.
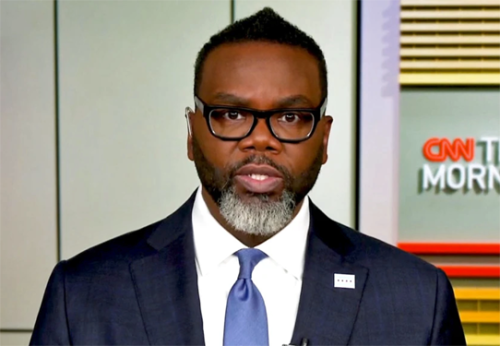
Le maire n'a pas voulu faire de la résistance passive à l'ICE suggérant en fait une résistance active. En fait, ce positionnement de camions serait une mesure banale liée à des manifestations dans la ville …

N'empêche : la rumeur ne dénonce-t-elle pas la nécessité ? Ne faut-il pas des barricades modernes, avec les travailleurs organisés pour repousser et infliger, avec le moins de pertes possibles, la raclée nécessaire aux bandes de l'ICE ? Un peu plus sérieuse en effet que les alignements de camions à sel, qui donnent quand même une idée !
Oui, il faut organiser l'auto-défense physique et donc armée quand c'est nécessaire contre les raids trumpistes ! L'illégalité est de leur côté : la défense de la démocratie est avec la résistance, et la résistance doit passer à la contre-attaque :
CONTRE TRUMP ET SES BANDES
GREVE ET AUTODEFENSE SONT INDISPENSABLES !
Le 07/09/2025.

Trump veut une Amérique plus militariste et belliqueuse

Derrière ses prétentions à incarner la paix, Donald Trump multiplie les actes militaires et les menaces d'escalade. Rebaptisant le département de la Défense en département de la Guerre, il affiche sa volonté d'une Amérique plus belliqueuse, au-dehors comme au-dedans.
Tiré de Inprecor
10 septembre 2025
Par Dan La Botz
Les membres du deuxième gouvernement de Donald Trump posent pour une photo dans le bureau ovale.
Donald Trump a rebaptisé le département de la Défense des États-Unis, qui s'appelle désormais le département de la Guerre. Ce changement de nom suggère que Trump veut un pays encore davantage tourné vers la guerre, malgré ses affirmations selon lesquelles il serait un artisan de la paix. En réalité, l'administration Trump affiche déjà un bilan impressionnant en matière d'actions militaires.
Un « artisan de la paix » aux bilans inexistants
Trump a pratiquement supplié qu'on lui décerne le prix Nobel de la paix, affirmant qu'il avait mis fin à six ou sept guerres dans différents pays. Il dit avoir instauré des relations pacifiques entre Israël et l'Iran, le Rwanda et la République démocratique du Congo, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, la Thaïlande et le Cambodge, l'Inde et le Pakistan, l'Égypte et l'Éthiopie, ainsi que la Serbie et le Kosovo. Pourtant, aucun de ces conflits n'a réellement été réglé. Et il n'a rien fait pour mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine et la guerre d'Israël contre Gaza.
De l'Iran au Venezuela, Trump sème la guerre
Le président autoproclamé de la paix s'est en réalité livré à plusieurs actes violents et guerriers. En janvier 2020, Trump a ordonné une frappe de drone qui tua le général iranien Qassem Soleimani à Bagdad, sans approbation du Congrès ni du gouvernement irakien, alors que les États-Unis n'étaient pas en guerre avec l'Iran. En juin 2025, lors de la guerre israélo-iranienne, l'aviation et la marine américaines ont frappé trois installations nucléaires iraniennes, sans déclaration de guerre.
Plus récemment, Trump a fait couler un « bateau de drogue vénézuélien », supposément lié au cartel Tren de Aragua, sans preuve et au mépris du droit international, causant la mort de 11 personnes. Son geste, salué par le sénateur Lindsey Graham, a été présenté comme un avertissement, et Trump a promis d'autres attaques similaires avec son équipe.
Dans les Caraïbes, la marine américaine a renforcé sa présence avec huit navires de guerre et un sous-marin, tandis que Trump a doublé à 50 millions de dollars la prime pour l'arrestation du président vénézuélien Nicolás Maduro, qu'il accuse de narcotrafic. Certains redoutent une guerre ouverte, d'autant que Trump a aussi évoqué l'idée de s'emparer du Groenland ou de « reprendre » le Panama.
Frappes extérieures et militarisation intérieure
Depuis des mois, Trump autorise des attaques militaires non médiatisées dans plusieurs régions du globe. Le projet ACLED (Armed Conflict Location and Event Data Project) a rapporté ce mois-ci que, depuis son retour à la présidence, les États-Unis ont mené 529 frappes aériennes dans 240 lieux différents au Moyen-Orient, en Asie centrale et en Afrique. Ce chiffre est proche du total de 555 frappes menées par l'administration de Joe Biden pendant l'intégralité de son mandat de 2021 à 2025.
Mais Trump ne veut pas seulement employer l'armée à l'étranger : il se prépare aussi à faire la guerre au peuple américain. Il prévoit maintenant d'envoyer des troupes à Chicago, comme il l'a déjà fait à Los Angeles et à Washington D.C. Trump a publié : « Chicago va bientôt découvrir pourquoi on appelle ça le département de la GUERRE. »
Trump se transforme en dictateur agressif, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, et c'est au peuple de l'arrêter.
Traduit par L'Anticapitaliste. Le 8 septembre 2025
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

États-Unis. Israël au cœur des divisions de MAGA

La victoire de Donald Trump a été possible par sa capacité à unir sur son nom trois courants de la politique étatsunienne : la mouvance évangélique, les néoconservateurs et les nationalistes protectionnistes. Mais s'ils se reconnaissent dans le même homme, ils ne partagent pas les mêmes objectifs, notamment sur le plan international, comme l'illustrent leurs prises de position divergentes sur l'Iran et le Proche-Orient.
Tiré d'Orient XXI.
Le 18 juin 2025, six jours après les premiers bombardements israéliens de sites d'enrichissement nucléaire iraniens, menés avec l'aide logistique de l'armée étatsunienne, Steve Bannon, une des grandes figures publiques de la sphère MAGA (Make America Great Again, « Restaurer la grandeur de l'Amérique »), qui regroupe les partisans de Donald Trump, dénonce publiquement la politique de son président en des termes peu amènes. « Le peuple américain vous dit qu'il faut sortir du Proche-Orient. Nous ne voulons plus de guerres interminables » (1). Trois jours plus tard, il réitère, rappelant à Trump qu'il a été réélu sur un programme dont « un des fondements » était de « mettre fin aux guerres sans fin » des États-Unis. Bannon n'est pas n'importe qui. Il a été le premier conseiller stratégique de Trump après son élection en 2016. Et il s'exprime sur un sujet de première importance — quelle est la stratégie de politique étrangère des États-Unis, dans le cas présent au Proche-Orient ? Enfin, son attaque pointe les divergences internes à MAGA, donc les fragilités de Trump.
Le président étatsunien, depuis son retour au pouvoir en janvier 2025, peut déjà se targuer de beaucoup plus de succès (de son point de vue) qu'après sa première élection. Mais il affronte aussi des difficultés multiformes. Ses mesures tarifaires dans le commerce international sont beaucoup critiquées. Et il multiplie les changements de cap. Ainsi, il a récemment annulé sa promesse d'interdire l'entrée de 600 000 étudiants chinois aux États-Unis durant les deux ans à venir. Sur Fox News, la chaîne à sa dévotion, la présentatrice Laura Ingraham s'étrangle : « C'est à n'y rien comprendre ! Six cent mille places échappent aux jeunes américains. » Quant à sa politique étrangère, elle est souvent erratique. Il a échoué à faire plier le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou et le président russe Vladimir Poutine. Au contraire, chaque fois qu'il a cru pouvoir clamer un succès, une concession sur Gaza comme sur l'Ukraine, les deux hommes n'en ont fait qu'à leur tête.
Trois piliers
L'apparition de dissensions internes à la sphère MAGA n'est pas due qu'à la nature versatile du chef. Elle tient aussi à la composition de sa base, qu'il se doit de câliner. Or, elle est constituée de tendances diverses, et parfois divergentes.
- Trump doit satisfaire un électorat idéologiquement composite, dont le socle est composé de fractions qui partagent des idées et des priorités différentes, voire, parfois, carrément antagoniques.
L'alliance qui a ramené Trump au pouvoir est fondée sur trois piliers. Le premier est trumpiste par pur intérêt opportuniste : il s'agit de la très puissante mouvance politique évangélique. Comment un mouvement qui professe la crainte de Dieu et le respect absolu de l'héritage du Christ peut-il massivement vénérer un homme, Trump, qui ne professe aucun autre culte que celui de Mammon (2), qui a fauté en divorçant deux fois et qui se vante d'« attraper les femmes par la chatte » ? L'explication est analogue à celle de la montée en puissance du messianisme en Israël. Les rabbins les plus fanatiques y expliquent que le sionisme, né comme un mouvement laïc, n'a contribué, en érigeant un État mécréant, qu'à accélérer sans en être conscient l'arrivée prochaine du Messie. Une partie massive du bloc évangélique étatsunien adhère aujourd'hui à une vision qui fait du « Grand Israël » et du rétablissement du « royaume de David » le prélude obligatoire au retour du Christ sur terre.
Le second pilier du trumpisme est constitué d'une partie de la mouvance néo-conservatrice qui connut son apogée sous la présidence de George W. Bush (2001-2009), lequel lui octroya une place politique de premier plan dans son administration. Un jeune politicien israélo-étatsunien dénommé Benyamin Nétanyahou avait très tôt adhéré au néoconservatisme. Il y a joué un rôle prépondérant, notamment en théorisant « la guerre contre le terrorisme ». Ces partisans développent une vision expansionniste de la promotion de la démocratie dans le monde, au bénéfice prioritaire de la « destinée exceptionnelle » des États-Unis, qui sont nés pour diriger la planète. Et cette mission ne sera menée à bien que par la projection de la puissance étatsunienne sur le reste du monde, si nécessaire par la force armée.
Le troisième est celui des nationalistes, et particulièrement des nationalistes protectionnistes, ceux qui, durant les deux guerres mondiales du XXe siècle, par exemple, ont mis très longtemps à s'y engager. Cette mouvance considère qu'il ne faut entrer en guerre que si les intérêts directs des États-Unis sont immédiatement menacés. Cette droite n'est pas que protectionniste au plan international, elle est aussi puissamment « nativiste », selon le terme étatsunien. « Natif », à ses yeux, ne désigne pas les Amérindiens. Non, les « natifs » sont ceux qui, en conquérant le territoire des États-Unis, s'y sont imposés comme les fondateurs. En conséquence, les nationalistes protectionnistes sont aussi férocement hostiles aux immigrés et, de tout temps, aux citoyens qui ne sont pas blancs, qu'ils soient méditerranéens ou asiatiques (le « péril jaune » est né aux États-Unis à la fin du XIXe siècle). Au nom du « nativisme », le célèbre aviateur étatsunien Charles Lindbergh fut en 1941 un des initiateurs d'un courant nommé… « America First », l'Amérique d'abord, un slogan que Trump n'a pas repris à son compte par mégarde.
Une alliance puissante mais divisée
Ces trois piliers forment une alliance puissante. Elle a permis à Trump, à deux reprises, d'accéder à la présidence, et à ne pas s'effondrer politiquement lorsqu'en 2020, il fut battu par Joe Biden. Ils disposent de « passerelles » qui tentent de les coaliser. La principale est la frange dite NatCon (nationaux conservateurs) qui tente de réunir ces trois piliers sous le drapeau du primat de la culture « judéo-chrétienne », dont l'idéologue est l'Israélo-étatsunien Yoram Hazony. Chacune des trois tendances est entrée dans l'alliance pour faire progresser sa propre emprise sur la Maison Blanche. Trump doit donc satisfaire un électorat idéologiquement composite, dont le socle est composé de fractions qui partagent des idées et des priorités différentes, voire, parfois, carrément antagoniques. Son talent consiste à leur donner des gages et à éviter que les frictions internes ne dégénèrent. Des trois, les évangéliques sont les plus nombreux ; les néoconservateurs, longtemps affaiblis, connaissent un regain de forme. Les nationalistes protectionnistes forment un groupe un peu moins important, mais qui se perçoit comme la « vraie » incarnation de MAGA. Trump ne peut pas les ignorer s'il veut préserver sa majorité. Surtout, cette mouvance politique est celle qui lui est la plus chère, parce qu'elle est celle dans laquelle il a été politiquement éduqué, et dont la pensée lui est la plus proche.
Le vent de révolte des cercles nationalistes dans MAGA a bondi en mai 2025 lorsque l'éventualité d'une attaque israélienne imminente contre l'Iran est revenue en tête de l'actualité. Les nationalistes s'y opposaient, dénonçant le risque d'une guerre en Iran entrainant les États-Unis dans un bourbier pire que ceux rencontrés en Afghanistan puis en Irak. L'enjeu iranien ravive aussi l'hostilité de certains cercles MAGA à la relation entretenue par Washington avec Tel-Aviv. Ainsi, le 29 mai, le représentant républicain du Kentucky à la Chambre, Thomas Massie, clamait que « la guerre d'Israël à Gaza est si déséquilibrée qu'il n'y a aucun argument rationnel pour que les contribuables américains paient pour cela » (3).
« Plus de guerres stupides et sans fin »
D'autres voix appelaient à la cessation des fournitures gratuites d'armes à Israël, rappelant répétitivement le slogan de campagne de Trump : « Plus de guerres stupides et sans fin. » Ceux-là n'avaient pas de mots trop durs pour Lindsay Graham, le sénateur de Caroline du Sud, porte-parole de la fraction néoconservatrice, qui martelait sur Fox News : « Il faut être à fond pour aider Israël à éliminer la menace nucléaire. S'il faut fournir des bombes, fournissons-les. Et s'il faut voler à leurs côtés, faisons-le. » Mais le matin avant les bombardements, Tal Axelrod, analyste du journal en ligne Axios, citait les propos de certains leaders d'opinion nationalistes pronostiquant un possible « schisme profond » au sein de MAGA (4). Il citait Jack Posobiec, un podcasteur d'extrême droite très influent, assurant qu'« une frappe directe contre l'Iran diviserait de façon désastreuse la coalition Trump » (5).
- L'opinion républicaine est entrée dans un processus de distanciation critique vis-à-vis de Tel-Aviv, y compris parmi les « conservateurs » et « très conservateurs » — c'est-à-dire la droite et l'extrême droite, l'électorat le plus acquis à Trump.
Les frappes israéliennes ont eu lieu et n'ont donné suite à aucun schisme dans MAGA. Mais les propos tenus par une flopée de nationalistes ont montré combien les tensions sont fortes au sein de la sphère trumpiste. Des influenceurs politiques de premier plan comme Steve Bannon, Tucker Carlson, Matt Gaetz, Joe Rogan et d'autres ont poursuivi leur travail de sape. Le premier tançait, en particulier, le risque que constituait Nétanyahou pour les États-Unis, lui lançant, le 19 juin : « Bon Dieu, pour qui vous prenez-vous pour vouloir entraîner l'Amérique dans une guerre avec l'Iran ? » (6). Après avoir évoqué la poursuite des frappes israéliennes visant un « changement de régime » en Iran, Bannon ajoutait, à l'attention de Trump : « Le peuple américain vous dit massivement que nous voulons sortir du Proche-Orient. Nous ne voulons plus de guerres éternelles. »
Fin juin, le rejet des « guerres sans fin » menées par Nétanyahou amenait pour la première fois une élue républicaine à prononcer le « mot qui commence par G ». Le 28 juillet, Marjorie Taylor-Greene, représentante de Géorgie et porte-parole en vue de MAGA, devenait la première républicaine à qualifier les actes perpétrés à Gaza par Israël de « génocide ». « Bien sûr, disait-elle, nous sommes opposés au terrorisme radical islamiste, mais nous sommes aussi opposés au génocide » (7). Son parti ne l'a ni exclue ni réprimandée, et elle ne s'est pas rétractée. Le lendemain, Donald Trump évoquait une « vraie famine » à Gaza.
Le désenchantement de MAGA envers Israël
Depuis, les critiques de MAGA envers la Maison Blanche se sont progressivement résorbées, au vu de la brièveté de l'attaque israélienne et de sa dimension plus modeste que ce que Nétanyahou et Trump avaient initialement proclamé. Mais la crise interne au camp trumpiste a laissé des traces qui pourraient être le prélude d'une crise plus ample demain. Entre nationalistes isolationnistes et néo-conservateurs, les relations sont plus que fraîches. Début août, The Economist titrait en une sur « Le désenchantement de MAGA envers Israël » (8). L'hebdomadaire anglo-étatsunien accompagnait son article d'un graphique exposant l'évolution de ses sondages depuis le 7 octobre 2023 sur le rapport aux Israéliens et aux Palestiniens dans la société étatsunienne. Ils montrent non seulement un recul progressif du soutien de l'opinion démocrate à Israël, c'était déjà connu. Mais ils montrent aussi que l'opinion républicaine est entrée dans un processus de distanciation critique vis-à-vis de Tel-Aviv, y compris parmi les « conservateurs » et « très conservateurs » — c'est-à-dire la droite et l'extrême droite, l'électorat le plus acquis à Trump.
- L'alliance des mouvances évangélique et néoconservatrice sur le dossier israélo-palestinien reste clairement dominante dans MAGA.
Le podcasteur Jack Posobiec évoque l'apparition d'une « fracture générationnelle » dans MAGA. Chez les moins de 40 ans, dit-il, le rapport à Israël va « du scepticisme à la volonté de couper tout lien ». D'autres observateurs indiquent que la « hasbara », la communication de l'État d'Israël niant non seulement tout génocide, mais même toute famine à Gaza, apparaît de moins en moins crédible à l'opinion étatsunienne. Quant aux médias les plus impliqués dans le soutien à Donald Trump, ils sont eux aussi divisés. Enfin, de même qu'elle est hostile à la poursuite de la fourniture d'armes à l'Ukraine, la mouvance nationaliste isolationniste est aussi devenue publiquement hostile à l'aide militaire gigantesque de Washington à Tel-Aviv. Elle reste très minoritaire sur ce point, mais sa voix influence désormais d'autres cercles conservateurs.
Mais bien qu'en recul, l'alliance des mouvances évangélique et néoconservatrice sur le dossier israélo-palestinien reste clairement dominante dans MAGA. Un exemple : l'activiste Charlie Kirk, très hostile à une attaque israélienne contre l'Iran, déclara une fois qu'elle fut lancée : « Dans de tels moments, j'ai une confiance totale et entière dans le président Trump » (9). De même, Laura Loomer, une activiste proche de Trump mais hostile aux engagements armés étatsuniens, déclara soudainement : « L'Amérique d'abord, c'est ce que dit le président Trump ». (10) Pour la plupart de ses fidèles, la parole du Guide est insurpassable.
Notes
1- Joseph Cameron, « Bannon warns Trump against heavy US involvement in Iran », The Christian Science Monitor, 18 juin 2025.
2- Mammon désigne la richesse ou le gain, souvent mal acquis. Dans les Évangiles, le terme personnifie l'argent qui asservit le monde.
3- « Republican Says US Should End All Military Aid to Israel », Newsweek, 29 mai 2025.
4- Tal Axelrod, « MAGA warns Trump of ‘massive schism' », Axios, 12 juin 2025.
5- Ibidem.
6- « 'Who in the hell are you ?” Bannon blasts Netanyahu for dragging US toward potential war with Iran », Reuters – TRT Global, 20 juin 2025.
7- Robert Jimison et Annie Karni, « Greene Calls Gaza Crisis a ‘Genocide,' Hinting at Rift on the Right Over Israel », The New York Times, 29 juillet 2025.
8- « MAGA's disenchantment with Israël », The Economist, 5 août 2025.
9- Huo Jingnan, « Pro Trump media figure split over the U.S. role in the israeli-iran conflict », National Public Radio (NPR), 18 juin 2025.
10- Ibidem.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le génocide qui étouffe la vérité à Gaza
21 septembre : une journée de la paix dans un contexte de guerre !
« Nuns vs Vatican » : quand le cinéma braque ses projecteurs sur le silence de l’Église
Les travailleurs du secteur public de la C.-B. intensifient leur grève

Réparer le tissu social

Le Centre de services de justice réparatrice (CSJR) a été fondé le 11 septembre 2001. Quelles sont ses particularités et comment se déploie-t-il ? Propos recueillis par Isabelle Bouchard.
À bâbord ! : Qu'est-ce qui a donné naissance au CSJR ?
Estelle Drouvin : Dans les années 1990, l'aumônier de prison David Shantz se questionnait : « Comment faire pour réparer sachant que je ne dispose que d'une moitié de l'histoire, celle de la personne incarcérée ? ». S'inspirant des bons résultats d'une démarche réparatrice en Ontario, l'aumônier a eu l'idée de la transférer auprès de personnes détenues en sécurité médium. À l'époque, mettre en contact des personnes détenues avec leurs victimes directes était trop avant-gardiste. C'est pourquoi Shantz a eu l'idée de faire rencontrer, sur une base volontaire, des personnes détenues et des personnes qui ont été victimes de crimes semblables, avec des citoyen·nes qui s'engagent à leurs côtés dans le processus. Même si aujourd'hui, il y a des démarches de justice réparatrice qui placent en relation le duo « victime et agresseur réel·les », nous, nous avons choisi de poursuivre en rencontres indirectes, car des rencontres directes ne sont pas toujours possibles. C'est la mission du Centre.
Thérèse de Villette, qui a participé à des rencontres entre détenu·es et victimes avec David Shantz, a souhaité que cette démarche soit mieux connue à l'extérieur des pénitenciers. Aujourd'hui, le CSJR organise des rencontres de justice réparatrice à la fois dans les pénitenciers, et en dehors des murs (avec des ex-détenu·es).
ÀB ! : Une des raisons d'être du Centre est de « réparer la toile humaine dans sa dimension collective ». Qu'est-ce que cela signifie ?
E. D. : Les crimes ont un caractère social. Ils entraînent des conséquences sur l'entourage proche, évidemment, mais aussi sur l'ensemble du tissu social. Ainsi, pour le CSJR, la justice réparatrice, c'est l'idée de regarder les conséquences d'un crime dans toutes ses dimensions. Et ne l'oublions pas, il y a aussi des causes collectives à certaines violences (discriminations multiples, racisme, colonialisme, cléricalisme, patriarcat…). C'est pourquoi nous avons réalisé des projets pilotes qui abordent cette dimension collective (des agressions sexuelles par exemple, ou des relations entre personnes issues des communautés autochtones et allochtones). Pour nous, le vivre-ensemble passe par un tissu social sain. Lorsque de la violence ou des abus sont commis, c'est comme si on créait des trous dans la toile de confiance humaine. L'adoption de comportements de méfiance et de peur agrandit ces trous. C'est pourquoi, derrière notre vison de la justice réparatrice, il y a l'idée de réparer la toile dans sa dimension collective. Après tout, lorsqu'une personne ayant commis ou ayant subi une agression se remet debout de manière ajustée, c'est la communauté en entier qui en bénéficie !
ÀB ! : Quels sont les services offerts par votre Centre ?
E. D. : Nous offrons trois principaux services. ll y a les rencontres de justice réparatrice, lesquelles se divisent en deux types. Il y a le « face à face », qui ouvre le dialogue entre une personne détenue (ou ex-détenue) et une personne victime (ayant porté plainte ou non) d'un crime ou d'une violence apparentée. À ces personnes s'ajoutent deux personnes animatrices et un·e citoyen·ne. Puis, il y des rencontres de justice réparatrice, qui se déroulent en groupe en présence de douze personnes : quatre victimes, quatre personnes ayant été reconnues coupables ou ayant causé des torts, deux citoyen·nes et deux personnes animatrices.
Depuis 2016, nous organisons aussi des ateliers de guérison des mémoires grâce à notre partenariat avec l'Institut Healing of Memories en Afrique du Sud. Ces ateliers ont été créés dans ce pays à la suite de la Commission vérité et réconciliation. Ils permettaient la rencontre entre des personnes blanches et noires qui acceptaient de parler de leur histoire et d'écouter l'histoire de l'autre. Au Québec, il y a aussi des blessures historiques, entre francophones et anglophones ou entre Autochtones et Allochtones. C'est pourquoi il nous est apparu important de se former à cette démarche. Ces ateliers de 24 personnes, offerts deux fois par an durant une fin de semaine, ouvrent la possibilité d'explorer et de reconnaître les blessures émotionnelles que portent les personnes participantes sur les plans individuel et collectif.
Le troisième volet de nos services vise la sensibilisation auprès du grand public. À ce chapitre, le Centre est l'initiateur de toute une série d'activités, il est aussi présent dans des cours de cégep et d'université. Des personnes qui ont participé à nos démarches acceptent souvent de témoigner de leur expérience.
ÀB ! : Quelles sont les attentes des participant·es ?
E. D. : Le but des rencontres est tout simple : ouvrir un espace sécuritaire de dialogue. On souhaite que les gens se sentent assez en confiance pour s'ouvrir sur ce qui peut être profondément blessé ou honteux en eux. Les motivations sont variées. Certaines personnes espèrent être apaisées, dans le sens de diminuer leur peur, leur anxiété ou leur colère. Pour d'autres, iels souhaitent tourner une page de leur histoire. D'autres viennent avec des objectifs de justice sociale et veulent notamment contribuer à la non-récidive en cherchant à faire comprendre aux détenu·es les conséquences de leurs actes. Parfois, les personnes responsables de torts souhaitent montrer qu'iels ont changé ou qu'iels peuvent participer à la réparation des traumas.
ÀB ! : Quels liens établir entre art et justice réparatrice ?
E. D. : L'association avec l'art a été naturelle. À l'origine, il y avait beaucoup de personnes qui venaient pour des cas d'inceste. Dans ces situations, le dessin pour libérer la parole est tout indiqué. Même si les personnes qui participent sont adultes, elles ont été blessées alors qu'elles étaient enfants, et leur enfant intérieur n'a pas toujours les mots pour faire le récit de ce qu'il a vécu. Le dessin permet aussi à l'inconscient de s'exprimer. Le CSJR utilise des activités de créativité autant dans les rencontres de justice réparatrice que lors des ateliers de guérison des mémoires. On a aussi remarqué qu'une quantité de personnes qui sortent de nos activités se mettent à créer (dessins, photo, dance, etc.) comme si en reléguant le passé au passé, elles avaient désormais de la place pour du nouveau. C'est le signe d'une transformation intérieure, ça donne beaucoup d'espérance.
Estelle Drouvin est directrice des services du CSJR.
Illustration : Ramon Vitesse
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.











