Revue À bâbord !
Publication indépendante paraissant quatre fois par année, la revue À bâbord ! est éditée au Québec par des militant·e·s, des journalistes indépendant·e·s, des professeur·e·s, des étudiant·e·s, des travailleurs et des travailleuses, des rebelles de toutes sortes et de toutes origines proposant une révolution dans l’organisation de notre société, dans les rapports entre les hommes et les femmes et dans nos liens avec la nature.
À bâbord ! a pour mandat d’informer, de formuler des analyses et des critiques sociales et d’offrir un espace ouvert pour débattre et favoriser le renforcement des mouvements sociaux d’origine populaire. À bâbord ! veut appuyer les efforts de ceux et celles qui traquent la bêtise, dénoncent les injustices et organisent la rébellion.

Apartheid israélien et nécropolitique. Jusqu’où compter les morts ?

Avec le nouveau gouvernement israélien, l'hypothèse de l'annexion totale de la Cisjordanie devient de plus en plus plausible. Parallèlement, les opérations meurtrières de l'armée israélienne se poursuivent, et le blocus contre Gaza perdure depuis 2007. Israël s'empare d'un droit de vie ou de mort sur la population palestinienne. Si la « nécropolitique » fait référence à une politique de la mort, comment l'État d'Israël la met-il en œuvre et jusqu'où ira-t-il ?
Dans ce texte, nous allons nous pencher sur un cadre d'analyse élaboré par Achille Mbembé, historien et politicologue camerounais, qui, s'appuyant sur les notions de souveraineté et de biopouvoir développées par Foucault, explique que « l'expression ultime de la souveraineté réside largement dans le pouvoir et la capacité de dire qui pourra vivre et qui doit mourir. Faire mourir ou laisser vivre constituent donc les limites de la souveraineté, ses principaux attributs. » (Mbembé, 2006 : 29)
Je définis d'abord la souveraineté comme le droit de tuer. Aux fins de ma démonstration, je lie la notion foucaldienne de biopouvoir à deux autres concepts : l'état d'exception et l'état de siège. J'examine les trajectoires par lesquelles l'état d'exception et la relation d'inimitié sont devenus la base normative du droit de tuer. Dans ces situations, le pouvoir (qui n'est pas nécessairement pouvoir d'État) fait continuellement référence, et a toujours recours, à l'exception, à l'urgence et à une notion « fictionnalisée » de l'ennemi. (Mbembé, 2006 : 30).
La souveraineté à laquelle se réfère Mbembé renvoie au pouvoir, notamment celui qui permet de décider qui fait partie du « Nous » et qui en est exclu. En d'autres mots, la souveraineté dont il est question ici permet de désigner l'Ennemi, celui ou celle sur qui l'État, mais pas seulement, a le droit de vie ou de mort. De là, Mbembé établit un lien avec le racisme. De son avis, l'établissement de la division des espèces humaines en différents groupes et la subdivision en sous-groupes distribués à partir de critères reposant sur une césure biologique aboutit au racisme. Il précise : « Dans l'économie du biopouvoir, la fonction du racisme est de réguler la distribution de la mort et de rendre possibles les fonctions meurtrières de l'État. » C'est, dit-il, « la condition d'acceptabilité de la mise à mort ». Il rappelle que pour Foucault, « l'État nazi est l'exemple le plus achevé d'un État exerçant le droit de tuer ». Il ajoute : « l'État nazi est perçu comme ayant ouvert la voie à une formidable consolidation du droit de tuer, qui a culminé dans le projet de la solution finale. Ce faisant, il est devenu l'archétype d'une formation de pouvoir qui a combiné les caractéristiques de l'État raciste, l'État meurtrier et l'État suicidaire » (ibidem, 32).
Fractionnements territoriaux
Cette approche théorique proposée par Mbembé et ici synthétisée nous permet d'extrapoler et d'avancer l'hypothèse voulant qu'Israël constitue un régime d'apartheid menant une nécropolitique, ou politique de la mort. À l'instar de ce qui s'est passé en Afrique du Sud, le régime d'apartheid israélien constitue une entrave majeure au développement individuel et collectif de la population palestinienne vivant à Jérusalem, en Cisjordanie et à Gaza, et empêche le regroupement du peuple palestinien désormais dispersé sur plusieurs territoires et États. En dissociant le territoire conquis par les sionistes en 1948 (qu'on appelle aujourd'hui Israël) de la Cisjordanie et de Gaza par une ligne d'armistice, en séparant Jérusalem-Est du reste de la Cisjordanie en 1967, puis en séparant la Cisjordanie de la bande de Gaza pour les traiter comme deux territoires distincts, et enfin en fragmentant la Cisjordanie en zones A, B, et C à l'issue des Accords d'Oslo [1], Israël a, de facto, divisé la population palestinienne qui ne faisait qu'une avant la création d'Israël en 1948. À chaque zone territoriale correspond un statut spécifique pour les habitant·es, et une règlementation distincte qui exercent des contraintes sur les conditions de vie des Palestinien·nes, et les séparent les un·es des autres.
En outre, ces divisions et subdivisions territoriales et la multiplication de statuts distincts ont pour effet d'affaiblir, voire d'effriter le sentiment d'appartenance à une identité commune, le peuple palestinien, à une histoire et un territoire commun. Les contraintes imposées par l'État d'Israël font en sorte qu'un·e jeune Palestinien·ne d'une vingtaine d'années vivant en Cisjordanie n'a jamais mis les pieds à Jérusalem parce qu'Israël le lui interdit. Il ou elle ne connaît pas cette ville pourtant au cœur de son histoire, et au centre du territoire revendiqué pour en faire la capitale d'un futur État palestinien. Les nombreux barrages routiers sont des entraves de plus à la mobilité des Palestinien·nes à l'intérieur des mêmes secteurs géographiques, ce qui contraint grandement la poursuite des études, le travail et la plupart des activités commerciales et économiques. De plus, ce découpage sociospatial accroît le pessimisme de celles et ceux qui estiment que de facto, il est devenu impossible de démanteler les colonies de peuplement en vue de créer un État palestinien sur un territoire contigu. La matérialité de cette fragmentation territoriale empêche même la représentation visuelle d'un éventuel État palestinien qui permettrait à la société palestinienne de s'émanciper politiquement.
Même si Mbembé n'aborde pas directement la question du territoire, la notion de souveraineté y est intimement liée. Ainsi il est permis d'avancer que le biopouvoir est celui qui permet de déterminer qui a le droit de vivre sur un territoire délimité, et qui n'y a pas droit. Pensons ici aux villes blanches sud-africaines durant la période de l'apartheid qui étaient interdites aux Noir·es d'Afrique du Sud. Ces dernier·ères pouvaient certes y travailler, mais ils et elles étaient obligé·es de rentrer dormir dans leurs townships (villes habitées exclusivement par les Noir·es), à moins d'avoir un permis. Autrement, ils et elles risquaient de fortes pénalités qui pouvaient aller jusqu'à leur couter la vie.
Apartheid et appropriation spatiale
Le biopouvoir, la souveraineté, le territoire et le racisme sont donc liés et justifieraient l'accaparement du droit de vie ou de mort ou la nécropolitique au sens de Mbembé. Un peu à l'image de l'Afrique du Sud, l'État d'Israël a découpé et aménagé le territoire sur lequel il a établi et consolidé sa « souveraineté » depuis 1948, à la faveur des intérêts juifs. En 1967, à la suite de l'occupation militaire de la Cisjordanie, de la bande de Gaza et de Jérusalem-Est [2] (occupation illégale à l'égard du droit international), le gouvernement israélien adoptait un schéma d'aménagement prévoyant les futurs sites pour la construction des colonies de peuplement à Jérusalem-Est, en Cisjordanie et à Gaza. Au fil du temps, environ 280 colonies ont été érigées pour l'usage exclusif de 710 000 colons juifs [3]. Là-dessus, 138 sont reconnues officiellement par le gouvernement israélien, les autres sont des « avant-postes », c'est-à-dire des noyaux d'habitation créés par des militant·es juif·ves plus radicaux qui prennent l'initiative de créer des sites appelés à être reconnus officiellement par le gouvernement israélien. Ces colonies pourtant établies à l'extérieur de la Ligne verte, soit la ligne d'armistice imposée en 1949 qui sépare l'État d'Israël à la Cisjordanie, ont été construites pour la très grande majorité sur des terres confisquées par Israël, qui appartenaient à des familles palestiniennes. Très souvent, elles sont construites par des ouvriers palestiniens qui pour vivre ou survivre n'ont d'autres choix que d'accepter ce travail. À titre de rappel, à Gaza, il y avait 21 colonies de peuplement où 9 000 colons jusqu'en 2005, date d'un retrait unilatéral israélien.
À Jérusalem-Est, la situation diffère quelque peu de celle qui prévaut en Cisjordanie et à Gaza, car le gouvernement israélien a officiellement annexé cette partie de la ville, ce qui signifie qu'aux yeux des Israélien·nes, la ville est entièrement sous souveraineté israélienne. Cela vaut pour les quartiers de la vieille ville comme pour les quartiers palestiniens qui sont à l'extérieur. La région métropolitaine de Jérusalem a, elle aussi, été découpée selon un schéma d'aménagement ségrégationnel. On y retrouve des quartiers palestiniens et des colonies de peuplement érigées à Jérusalem-Est. Et depuis les années 2000, des familles de colons s'établissent, sous protection policière, au sein même de quartiers palestiniens, ce qui accroît grandement le climat d'insécurité [4].
Par ailleurs, même si Israël n'a pas étendu sa souveraineté aux territoires de la Cisjordanie et de Gaza, il demeure qu'il les judaïse en y établissant des colons juifs et juives. De plus, à partir de la première Intifada [5], les dirigeants israéliens ordonnaient la construction de routes de contournement afin que les véhicules immatriculés de plaques israéliennes ne passent pas trop près des villes et villages palestiniens. Par la suite, des infrastructures routières séparées seront construites. Bref, la planification et l'aménagement territorial ont permis à Israël de matérialiser un régime d'apartheid sur l'ensemble du territoire de la Cisjordanie et de Gaza, aujourd'hui reconnu comme tel par Amnistie internationale, Human Rights Watch et l'organisation israélienne B'tselem.
En outre, il importe de saisir que la stratégie israélienne d'appropriation spatiale des territoires palestiniens s'accompagne de l'accaparement de l'eau, une ressource essentielle à la vie. Selon B'Tselem, 80 % de l'eau de la Cisjordanie serait consacrée au service des activités agricoles israéliennes.
Par ailleurs, ce régime d'apartheid s'accompagne d'un récit qui entretient la peur et la haine de l'Autre, encourage différentes formes de violence et banalise la mort, tant celle des hommes, des femmes que des enfants. C'est ici que la pensée de Mbembé apparaît encore plus pertinente, car elle permet d'avancer que la souveraineté et le biopouvoir ont conduit Israël et des groupes de colons à pratiquer une nécropolitique, soit une politique de la mort pour l'ennemi d'Israël.
Fabrique de l'ennemi palestinien
À la fin du 19e siècle, les Palestinien·nes habitant le territoire de Palestine ont d'abord été considéré·es comme un « peuple absent » comme le rappelle d'ailleurs le fameux slogan des premiers colons sionistes : « Une terre sans peuple pour un peuple sans terre. » Progressivement, ils et elles sont devenu·es indésirables, aux yeux des Israélien·nes, parce qu'ils s'opposaient à la puissance occupante, et résistaient aux confiscations des terres. Plus encore, ils n'ont jamais collaboré avec Israël et se sont rangés derrière l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) de façon quasi unanime. Ajoutons enfin qu'ils et elles ont été associé·es au terrorisme, à la volonté de jeter les Juif·ves à la mer, et au projet de destruction de l'État d'Israël. Ces images de l'Autre qui imprègnent encore aujourd'hui les discours gouvernementaux, les manuels scolaires, la muséologie et la culture contribuent au sentiment d'insécurité des Israélien·nes, laissant croire de façon récurrente à des attaques palestiniennes imminentes, à des enlèvements ou à des attentats à la bombe. Ce discours permet ainsi à l'État d'Israël d'agir en toute impunité sous prétexte qu'il y a état d'urgence ou état d'exception. Les gouvernements israéliens au pouvoir, qu'ils soient de droite ou de gauche, autorisent ainsi des opérations militaires de grande envergure comme celles qui ont été menées contre la bande de Gaza depuis 2006 (date de la victoire électorale du Hamas à la tête du gouvernement de Gaza), ou appellent à briser les os de la jeunesse palestinienne comme cela avait été le cas lors de la première Intifada. Dès lors qu'on évoque la menace palestinienne, les dirigeant·es israélien·nes autorisent le recours à des mesures illégales à l'égard du droit international. On parle ici de détentions administratives ou d'emprisonnements sans procès, d'emprisonnement de mineur·es, ou de mesures dites de représailles comme la destruction de maisons où un membre de la famille est soupçonné d'avoir participé à une action contre Israël. De leur côté, des colons israéliens vont déraciner des arbres sur les terres palestiniennes ou entraveront le travail des paysan·nes palestinien·nes, qui demeurent pour un bon nombre de familles palestiniennes le principal moyen de subsistance.
Cette lecture très synthétisée de la souveraineté et de la nécropolitique permet de mettre à nu la véritable nature colonialiste, raciste et meurtrière de l'État d'Israël, un État qui se dit encore un État d'exception [6] alors qu'il a l'une des plus puissantes armées de la région du Machrek et qu'il bénéficie de l'aide militaire et financière des États-Unis.
[1] À l'issue des Accords d'Oslo, la Cisjordanie a été divisée en trois zones géographiques distinctes, soit la zone A constituée des grandes villes palestiniennes et placée sous l'Autorité palestinienne, la zone B qui recouvre les zones en périphérie de ces grandes villes, et enfin, la zone C.
[2] Le Golan syrien et une partie du Sinaï égyptien ont également été occupés à l'issue de la Guerre des Six jours, mais nous n'en traitons pas dans cet article.
[3] Ces données proviennent de l'organisme israélien des droits humains et concernent l'année 2022.
[4] Les colons israéliens qui sont réservistes portent leurs armes sur eux jour et nuit.
[5] « Intifada » signifie en arabe « soulèvement ». La première Intifada a eu lieu de décembre 1987 à 2001.
[6] Selon Universalis : « On désigne par “ état d'exception ” la situation dans laquelle se trouve un État qui, en présence d'un péril grave, ne peut assurer sa sauvegarde qu'en méconnaissant les règles légales qui régissent normalement son activité. L'organisation de l'État, en période normale, est conçue de manière à réaliser un équilibre entre les exigences du pouvoir et celles de la liberté ; elle ne convient plus lorsqu'il s'agit de faire face à un danger exceptionnel et que le besoin d'efficacité et de rapidité passe au premier plan. »
Anne Latendresse est militante internationaliste.
Illustration : Marcel Saint-Pierre, Méli-mélo, 1978. Huile sur toile libre, 213 x 619 cm

Antigone et la fondation nationale par le deuil

Comment appréhender la succession morbide de tueries de masse aux États-Unis ? Si elles sont le fruit de la folie du siècle, elles s'ancrent aussi dans l'histoire américaine et contribuent à refonder la nation.
Sur certains sites de prévention de la violence, une carte des États-Unis marque d'un point rouge les villes ayant servi de scène à des fusillades de masse durant les dernières années. Le territoire américain se trouve ainsi reconfiguré à partir des massacres qui l'habitent. En menant une recherche sur le mot mass shooting (fusillade de masse), on tombe sur une longue liste de lieux associés à cette pratique. Aucun pays n'est à l'abri de tels massacres et les exemples récents nous montrent leur mondialisation. Certes, les États-Unis ont développé une pratique routinière des fusillades de masse s'inscrivant dans une expérience de la violence par armes à feu. En 2013, on dénombrait aux États-Unis 21 175 suicides et 11 313 homicides involontaires et volontaires par armes à feu, alors qu'au Japon, durant la même année, 13 mort·es de la même manière étaient recensé·es. Un·e Américain·e a 300 fois plus de chances de mourir d'un homicide par arme à feu qu'un·e Japonais·e. [1]
Si le massacre établit un temps de la répétition (« encore un ») développé à partir d'un récit comptable, voire maniaque (20 200 morts causées par des armes et travers 647 fusillades de masse en 2022), il dialogue aussi avec la géographie des États-Unis (Uvalde, Aurore, Bernardino, Half Moon Bay et tant d'autres lieux). Les fusillades de masse (en très grande majorité perpétrées par des hommes ou des personnes qui s'identifient au genre masculin) [2] perpétuent des récits de territoires et de conquêtes possibles et impossibles. La part de la construction nostalgique du genre à travers le port d'armes n'est pas à négliger, comme le montrent de nombreuses études [3].
À chaque instant, tout·e citoyen·ne américain·e sait qu'il ou elle peut être la cible d'un tireur fou dans une salle de concert, une école, une université, un centre d'achats, un bar, un restaurant, une salle de cinéma et même sur l'autoroute. Des criminologues affirment qu'éliminer le risque de meurtre de masse aux États-Unis impliquerait des mesures « extrêmes » : abolir le second amendement, faire advenir le plein emploi, réinstaurer le sens de la communauté et introduire la possibilité d'arrêter toute personne qui a l'air suspecte ou qui agit de façon considérée étrange (ce qui est tout de même le cas dans le profilage racial, mais passons…). « Les fusillades sont peut-être le prix que nous devons payer pour vivre dans une société où la liberté personnelle est si estimée » [4].
Les fusillades ont une histoire
Or, ces fusillades de masse ne sont pas nouvelles dans l'histoire américaine, malgré le sentiment général. Il est habituel de faire remonter la première fusillade de masse en août 1966, à l'Université du Texas à Austin. 15 personnes moururent et 31 furent blessées lors de cet événement. Le Smithsonian Institute, lui, voit la première fusillade de masse en 1949 quand un vétéran de guerre mit à mort 13 personnes en 12 minutes dans la ville de Camden (New Jersey). S'il n'y a pas de bataille ici pour la première place dans cette série de l'horreur, force est de constater qu'il est difficile, après une brève recherche sur internet, d'avoir accès aux données relatives aux fusillades de masse avant le XXe siècle. Pourtant, on découvre des récits montrant l'existence de tels événements : en 1891, un homme armé blesse, dans une salle de concert d'une école au Mississippi, 14 personnes [5]. En 1893, quatre étudiants furent tués par balle et moururent durant une danse festive au Plain Dealing High School en Louisiane. Ces meurtres de masse souvent haineux, racistes, sont peu pris en compte par la mémoire historique américaine, relevant simplement dans les esprits des dommages collatéraux de l'esclavage ou encore de querelles intimes et privées.
En effaçant ainsi le passé américain et en faisant de la fusillade de masse le produit d'une modernité, d'un éventuel relâchement des mœurs, on évite de faire remonter à la surface de l'histoire le fait que les États-Unis d'Amérique se sont construits sur des génocides (peuples autochtones) et des violences terribles (ségrégations de toutes sortes, guerres civiles) qui leur ont permis de se constituer en nation. Le second amendement, sur lequel on s'appuie pour défendre l'accès aux armes, va en ce sens. La folie meurtrière, souvent aveugle et banalisée, est peut-être un des gestes problématiques, mais fondateurs, de la nation américaine et de beaucoup de nations occidentales qui ont longtemps été fières de leur capacité à dominer d'autres peuples, à effacer des altérités et à nier leur violence fondatrice, dont l'archaïsme pulsionnel ne colle pas avec les progrès dont se targuent ces pays.
Cette idée d'un trauma à répétition est avancée par des psychologues aux États-Unis [6]. Rossolatos par exemple va dans le sens d'un traumatisme culturel où les membres d'une collectivité, ici les États-Unis, sont l'objet (ou le sujet) d'événements horribles qui laissent des marques indélébiles sur la conscience d'un groupe, marques que les fusillades de masse à répétition mettent en scène et réactivent. Rossolatos suggère que les fusillades de masse servent de glu sociale. L'Amérique sans cesse rejoue sa violence fondatrice et crée du bouc émissaire, du sacrifice qui vient refonder, à travers le deuil des communautés et des groupes politiques. Il est commun d'entendre les discours politiques présidentiels commencer ainsi : « J'aimerais que tout le monde à travers le pays garde dans ses pensées et prières les familles et la communauté de… ».
Un trauma national
Les fusillades de masse constituent des traumas collectifs sur des territoires d'abord limités. Mais elles deviennent vite des traumas nationaux par l'intermédiaire des médias qui configurent souvent les événements dans la hâte demandée par le sensationnalisme. Ce deuil collectif, en série et demeurant toujours à refaire, concerne l'ensemble du territoire américain qui se voit atteint. Pourtant, ce n'est pas seulement un discours de deuil qui se fait jour à l'occasion de ces fusillades, mais un plaidoyer pour la résilience du peuple américain qui, comme le phénix renaît plus fort de ses cendres et ses blessures, garantissant sa liberté. Peu de textes ont réfléchi sur ces traumatismes à répétition comme récits refondateurs et donc nécessaires à la « grandeur » d'une nation. Les fusillades de masse n'occuperaient-elles pas dans la nation une place semblable aux récits de guerre ?
Ces meurtres de masse visant un groupe déterminé ou non doivent être pensés dans un rapport au territoire national, sans cesse conquis. En effet, si le meurtrier, par son geste, n'a pris possession d'un lieu que momentanément, il est impossible de négliger la place imaginaire et symbolique créée par un espace que la fusillade a propulsé dans un ensemble de lieux de terreur et de résilience politique et religieuse. Après l'événement, cet espace est le terrain d'une occupation identitaire, communautaire et politique, puisque la mort et le deuil, comme nous l'a si bien montré la grande Antigone, créent des territoires réels et symboliques pour lesquels des partis se battent et s'arrogent des droits sur les morts.
S'il semble loin le temps pour la pensée occidentale où les suicidé·es des chrétiens n'avaient pas droit au cimetière, il faut néanmoins se pencher sur les modalités actuelles des lieux de commémoration des fusillades de masse pour comprendre que la question de l'hommage aux mort·es est encore très importante dans les sociétés occidentales.
L'appropriation du deuil
On ne peut pas négliger de penser les discours conflictuels et belliqueux qui ont lieu dans l'après-coup des fusillades. La reconstruction de la mémoire et le culte des morts après un tel événement viennent conforter des récits stratégiques. La mort et les mort·es servent les fins de l'État ou encore de groupes religieux ou/et politiques. C'est du moins ce que montre dans une étude importante Crystal Lacount [7] qui analyse la construction de la mémoire après le massacre de Columbine perpétré en 1999 dans un collège du Colorado, par deux étudiants.
Comme lors de beaucoup de fusillades, tout juste après le massacre, un désir spontané de témoigner aux mort·es une dernière pensée s'est exprimé aux alentours du collège devenu scène de crime. Des chapelles spontanées furent érigées par des citoyen·nes dévasté·es qui apportaient des objets personnels symboliques. Ces gestes, qui pouvaient redonner aux gens une capacité d'agir, se voulaient une offrande faite aux jeunes mort·es. Ces lieux spontanés de commémoration se présentent comme neutres politiquement. D'un commun accord tacite, on peut même parfois pleurer sur ces sites les meurtriers, tant ces espaces se veulent accueillants envers une douleur vive. Notons cependant que ces gestes ne sont pas le privilège des fusillades de masse, mais de morts qui viennent toucher viscéralement le public (mort de Lady Diana, de la reine Élisabeth, etc.). Il s'agit de laisser la trace d'une émotion, d'une douleur sur le site de la mort ou dans ses alentours qui restent dans la pensée populaire porteurs de quelque chose. Personne n'est en effet immédiatement inclus·e dans ces rituels de mémoire ou n'en est exclu·e. Ce mélange d'artefacts, de pensées, ce bric-à-brac d'offrandes, montre un tissu social qui se fait à travers le deuil et étonnamment parfois dans une diversité.
Or, dans l'après-coup des fusillades, la mort devient un territoire politique où est demandé un contrôle des armes, mais où sont instrumentalisées de prétendues persécutions contre les communautés religieuses ou encore contre la NRA (National Rifle Association) qui voit une appropriation par la gauche anti-armes des mortes et des morts. Certaines de ces organisations de droite tentent donc de s'immiscer dans la construction des lieux officiels de commémoration du massacre pour mieux leur donner un ancrage idéologique.
Une semaine après le massacre de Columbine, une bataille eut lieu sur la question de croix commémoratives. Fallait-il ériger des croix pour les meurtriers ? Greg Zanis, charpentier (comme le Joseph du Nouveau Testament) de son état, vint tout droit de Chicago pour édifier 15 croix de six pieds. Ces « Crosses for losses » ont créé des dissensions dans la communauté de Littleton au Colorado. Le père d'une victime de Columbine détruisit les croix dédiées aux meurtriers. Entre un geste spontané de deuil et une érection de croix par un charpentier de Chicago atteint de prosélytisme national et religieux, il y a un monde que seule la prise de possession du territoire de la mort semble justifier. Mais très mal…
Devant cette violence chrétienne, on préféra reconstruire le collège qui avait été très abimé par la fusillade. Les parents de victimes et les blessé·es joignirent leurs efforts et créèrent un groupe nommé Healing of People Everywhere (H.O.P.E.) qui érigea un mur de la guérison. Le Wall of Healing, fait des pierres rouges du Colorado, crée de nos jours un ovale englobant, qui se veut inclusif et hospitalier. Dans ce mémorial, chaque famille des victimes put fournir un texte personnel dont les mots furent gravés dans la pierre. Après ces massacres par fusillade et après de longues et intéressantes consultations publiques, il est possible dans certaines communautés de créer un mieux-être collectif en rendant hommage aux mort·es et à la douleur à travers une diversité et un mélange des voix.
Est-ce que les États-Unis pourront refonder de vraies collectivités dans un deuil respectueux et diversifié ? C'est ce que souhaitent beaucoup de gens qui sentent que c'est malheureusement à travers le deuil que le politique peut se renouveler. Comme quoi, même en Amérique, les Antigone se rebellent encore et toujours contre des deuils politiques qui font dans la parole toute faite et dans l'appropriation des morts.
[1] Fisher, Max, and Keller , J. (2017) « What explains US Mass Ahootings ? International Comparisons Suggest an Answer. » The New York Times.
[2] Bridges, Tristan, and Tober, Tara Leigh (2022) « Mass shootings and masculinity ».
[3] Morgan, S., Allison, K., & Klein, B. R. (2022) “Strained Masculinity and Mass Shootings : Toward A Theoretically Integrated Approach to Assessing the Gender Gap in Mass Violence, Homicide Studies, 2022, p. 10887679221124848.
[4] Fox, J. A., & DeLateur, M. J. (2014) « Mass Shootings in America : Moving Beyond Newtown », Homicide Studies, 18 (1), 125–145. Ma traduction de la dernière phrase de l'article.
[5] behindthetower.org/a-brief-history-of-mass-shootings
[6] Rossolatos, G. (2020) « Consuming the Scapegoat : Massshootings as Systemically Necessary Cultural Trauma », International Journal of Marketing Semiotics & Discourse Studies, Vol. VIII, pp.1-16.
[7] LaCount, Crystal (2020) Commemoration, Memorialization and Mass School Shootings : an Analysis of Collective Memory and Power Structures. A thesis submitted to the Graduate Council of Texas State.
Catherine Mavrikakis est écrivaine et professeure de création littéraire à l'Université de Montréal
Illustration : Marcel St-Pierre, Sous le chapiteau, 1999, détail. Pellicule d'acrylique sur toile, 120 x 150 cm. Collection particulière

Colombie. Entre la violence et l’espoir
Plusieurs analystes ont expliqué la persistance de la violence en Colombie par des manifestations de criminalité individuelle. Il faut toutefois, même si cela est complexe, tenter de comprendre la violence autrement pour rendre compte de sa persistance dans le temps et l'espace.
De nombreuses générations ont vécu dans ces circonstances, depuis le moment de notre naissance en tant que république en 1810 par la main du libérateur Simon Bolivar et son rêve d'une Amérique unie. À cette époque, il est évident que les guerres menées par les Espagnols ont été guidées par des intérêts individuels qui s'opposaient à ce rêve.
Une clarification nécessaire
Il est important de garder à l'esprit que les différents actes de violence en Colombie ont été si nombreux et d'une telle ampleur qu'il n'est pas possible de les traiter dans leur ensemble. Les facteurs qui ont déclenché ces conflits sont multiples. Les victimes ne peuvent pas être entièrement comptabilisées.
Le sociologue colombien Orlando Fals Borda a avancé plusieurs hypothèses sur les raisons de cette violence. Certaines d'entre elles sont liées à une série de luttes régionales, d'autres à des causes structurelles telles que la pauvreté et les inégalités sociales. Une troisième hypothèse concerne les idéologies politiques en jeu. Une autre analyse s'intéresse au manque de légitimité de l'État et à l'exercice du monopole de la force [1].

Par ailleurs, de l'État colombien et son appareil militaire et paramilitaire aux groupes de paysans armés en passant par les diverses guérillas insurgées ou les groupes criminels en général, de nombreux acteurs violents ont été impliqués. Chacun d'entre eux a contribué à ces conflits.
Les origines de la violence
Le contexte actuel trouve ses racines dans les évènements connus sous le nom de « La Violencia » qui se sont produits entre 1946 et 1963. Un cap est franchi le 9 avril 1948, avec l'assassinat du dirigeant du Parti libéral Jorge Eliécer Gaitan. Cet épisode décisif pour l'histoire de la Colombie marque la naissance des groupes d'autodéfense paysans. Ces derniers vont engendrer des guérillas proches du Parti libéral qui constituaient alors la réponse armée aux groupes paramilitaires liés au Parti conservateur.
La période de violence s'est approfondie avec la barbarie vécue dans les campagnes, où la mise à mort par empalement des hommes, des femmes et des enfants est devenue chose courante. Cela a entraîné de grands déplacements des communautés paysannes qui ont été contraintes d'occuper de nouvelles terres pour leurs cultures, ce qui a déclenché diverses confrontations avec les propriétaires terriens.
Il convient de mentionner que les oligarques ont accepté de mettre fin à la guerre entre les conservateurs et les libéraux par la construction du Front national, qui était un pacte entre les deux partis pour écarter le général dictateur Gustavo Rojas Pinilla du pouvoir et « arrêter l'effusion de sang ». Cependant, le Front national a fermé les portes du pouvoir politique à certains groupes sociaux, dont les groupes paysans, les communautés autochtones et la population à gauche politiquement, en assurant l'alternance du pouvoir entre libéraux et conservateurs tous les quatre ans. Les problèmes dans les campagnes se sont poursuivis, les paysans n'ayant pas de terres à cultiver et la misère dans les villes continuant de croître. En conséquence, certaines guérillas libérales ont refusé la paix proposée par le gouvernement et ont continué d'affronter l'État.
Parallèlement à l'augmentation du déséquilibre dans la distribution des terres, la répression exercée par l'État s'est accrue. Plusieurs groupes émergent face à cette situation. En 1967, les guérillas révolutionnaires des FARC-EP [2], de l'EPL [3], et de l'ELN [4], tous d'orientation marxiste-léniniste, apparaissent. En 1970, le M-19 nait en réponse à la fraude électorale qui a profité au conservateur Misael Pastrana. D'une autre perspective, le mouvement indigène Quintín Lame nait à son tour en 1981.
De difficiles accords de paix
Bien que l'histoire de la Colombie ait été marquée par la violence, il est important de mentionner que la société civile – les communautés paysannes, les syndicats, les peuples autochtones, les femmes, les afrodescendant·es, les étudiant·es et les communautés locales – a toujours recherché la paix.
Les années 1980 ont été caractérisées par le travail de diverses communautés pour cesser les hostilités entre les différents groupes armés, y compris l'armée nationale. C'est pourquoi, en 1984, une table de négociation a été ouverte entre le gouvernement de Belisario Betancur et la guérilla des FARC-EP à Uribe-Meta. Elle avait pour but d'obtenir un cessez-le-feu bilatéral et de négocier une solution politique au conflit social et armé.
L'un des éléments les plus importants qui ont été discutés concernait la nécessité d'élargir la démocratie et de faire participer les secteurs de la société qui avaient été historiquement marginalisés par les politiques du Front national. Ainsi est né le parti La Unión Patriótica-UP. Son objectif était de consolider un accord de paix qui permettrait la participation politique de la guérilla et d'autres secteurs populaires et alternatifs.

L'UP était composée d'un grand nombre de personnes avec et sans affiliation politique. Elle comprenait des membres des FARC et du Parti communiste colombien, des syndicalistes, des organisations paysannes, communautaires et étudiantes, et même des libéraux et conservateurs ayant des positions démocratiques.
Cependant, il n'a pas fallu longtemps pour que la violence contre l'UP commence. Dès le premier instant de sa consolidation, des milliers de militant·es ont été assassiné·es, torturé·es et contraint·es de fuir le pays. Le nombre de victimes de ce génocide a été estimé à 6000 personnes. Il convient de mentionner l'assassinat de deux candidats à la présidence : Jaime Pardo Leal et Bernardo Jaramillo. L'extermination de l'Unión Patriótica signifiait la perte de son statut juridique et donc la perte de son action politique. D'ailleurs, ce n'est pas seulement l'UP qui a été victime de la répression de l'État et de son appareil paramilitaire, mais aussi d'autres coalitions comme le mouvement syndical et populaire A Luchar.
Ces massacres faisaient partie d'un plan d'extermination systématique contre le parti politique. Ils et elles ont été exécuté·es avec la participation d'agents de l'État et du secteur paramilitaire, et avec la complaisance des autorités. Dans ce contexte, les FARC-EP ont considéré qu'il n'y avait pas de conditions politiques favorables pour continuer le processus de paix et ont repris les armes.
Malgré la répression et la persécution politique, le peuple colombien n'a pas renoncé à son rêve de vivre en paix, et, en 1990, la paix a été signée avec le M-19, une partie de l'EPL, le Mouvement Quintín Lame et une faction de l'ELN. Cependant, la violence s'est fait à nouveau sentir le 8 mars de la même année lorsque le candidat présidentiel du M-19, Carlos Pizarro, a été assassiné. En 1991, la nouvelle constitution néolibérale est promulguée, laissant derrière elle de nombreux éléments démocratiques qui avaient été acquis.
Les années 1990 ont été caractérisées par une violence intense dans le pays où les oligarques ont travaillé avec les trafiquants de drogues et les paramilitaires, faisant des milliers de mort·es, de disparu·es, de torturé·es et de déplacé·es.
Malgré ce climat politique, de nombreuses organisations, partis de gauche et secteurs démocratiques ont continué à travailler pour la paix. À la fin de la décennie, une table de négociation a été créée entre le gouvernement d'Andrés Pastrana et la guérilla des FARC-EP à El Caguán. Malheureusement, elle a échoué en raison de l'aggravation du conflit et du renforcement du paramilitarisme.
Après la rupture de la table des négociations, le conflit s'est aggravé avec l'arrivée d'Álvaro Uribe et sa politique de « sécurité démocratique ». Celle-ci se concentrait prétendument sur l'élimination militaire de l'insurrection, tout en renforçant la répression contre les organisations sociales, les défenseur·euses des droits humains et les militant·es de gauche. Durant cette période sombre, 6 402 exécutions extrajudiciaires ont été dénombrées à ce jour. Le plus souvent, il s'agissait de civil·es déguisé·es en guérillero·as et tué·es par l'armée pour obtenir des prix et des promotions.
Des années plus tard, en 2012, l'UP a de nouveau été légalement autorisée à fonctionner. La même année, l'État colombien a accepté une certaine responsabilité dans le génocide. Et en novembre 2016, la guérilla des FARC et le gouvernement de Juan Manuel Santos ont signé l'Accord final pour la fin du conflit et la construction d'une paix stable et durable.
Le dénouement de ce long conflit rend manifeste la nécessité de mettre fin aux violences, de distribuer plus équitablement les terres, de mettre en place un système de justice, de vérité, de réparation et de non-répétition des erreurs passées.
Un moment historique
La Colombie a une longue histoire de violence qui a laissé des blessures profondes, dont la plupart ne sont toujours pas cicatrisées. Mais en même temps, elle a une histoire de résistance et de résilience. Ses principaux acteurs et actrices ont contribué à une politique démocratique, à la mémoire historique, à l'art et à la transformation sociale. La lutte pour la paix à partir du principe moral de justice sociale a été un but décisif pour la construction de la démocratie dans le pays.
À chaque épisode de violence, les communautés ont appris à affronter les scénarios les plus douloureux. Il n'est pas possible de parler de la violence en Colombie sans parler des actions collectives qui visent toujours à construire et transmettre la mémoire collective. Les luttes historiques pour la terre, les revendications des communautés historiquement marginalisées comme les communautés autochtones, afrodescendantes, paysannes et ouvrières, la signature de l'accord de paix et le soulèvement de millions de jeunes en 2021 ont créé les conditions sociopolitiques nécessaires pour qu'une coalition des forces alternatives et de gauche arrive au pouvoir en juin 2022. C'est une première dans l'histoire de la Colombie.
Cette coalition s'est engagée à vérifier certains des besoins des populations vulnérables. Six mois après l'arrivée au pouvoir du gouvernement de Gustavo Petro, ancien guérillero du M-19, une série de réformes ont été mises en place, comme la protection de l'Amazonie, la réforme agraire, la loi de paix totale, le rétablissement des relations avec le Venezuela et la reprise des négociations avec l'ELN [5].
Mais ni la paix ni la justice sociale ne viendront du gouvernement seul. Les mouvements sociaux et les partis de gauche en sont conscients et travaillent chaque jour pour éviter d'être victimes d'un nouveau conflit ou d'être instrumentalisés par les institutions.
Tant les mouvements que les partis travaillent à mettre un terme définitif à un système oppressif, extractiviste, raciste, criminel et patriarcal qui a fait de la Colombie sa véritable forteresse économique. C'est pourquoi notre slogan restera le suivant : « Ils peuvent couper une fleur, mais ils ne mettront pas fin au printemps. »
[1] Centro Nacional de Memoria Histórica, ¡Basta Ya ! Colombia : memorias de guerra y dignidad. Resumen, Bogotá, CNMH, 2013, page 13. German Guzman Campos, Orlando Fals Borda, Eduardo Umana Luna, La violencia en Colombia Tomo 1, Bogotá, Taurus, 2005, page 15.
[2] Forces armées révolutionnaires de la Colombie-Armée populaire.
[3] Armée populaire de libération.
[4] Armée populaire de libération nationale.
[5] INFOBAE, Colombia/ Estos son los 50 logros que destacó Gustavo Petro en sus primeros 100 días de gobierno, www.infobae.com/america/colombia/2022/11/15/estos-son-los-50-logros-que-destaco-gustavo-petro-en-sus-primeros-100-dias-de-gobierno/
Jessica Ramos et Ronald Arias, militant·es de l'Unión Patriótica (parti politique colombien)
Photos : Unión Patriótica
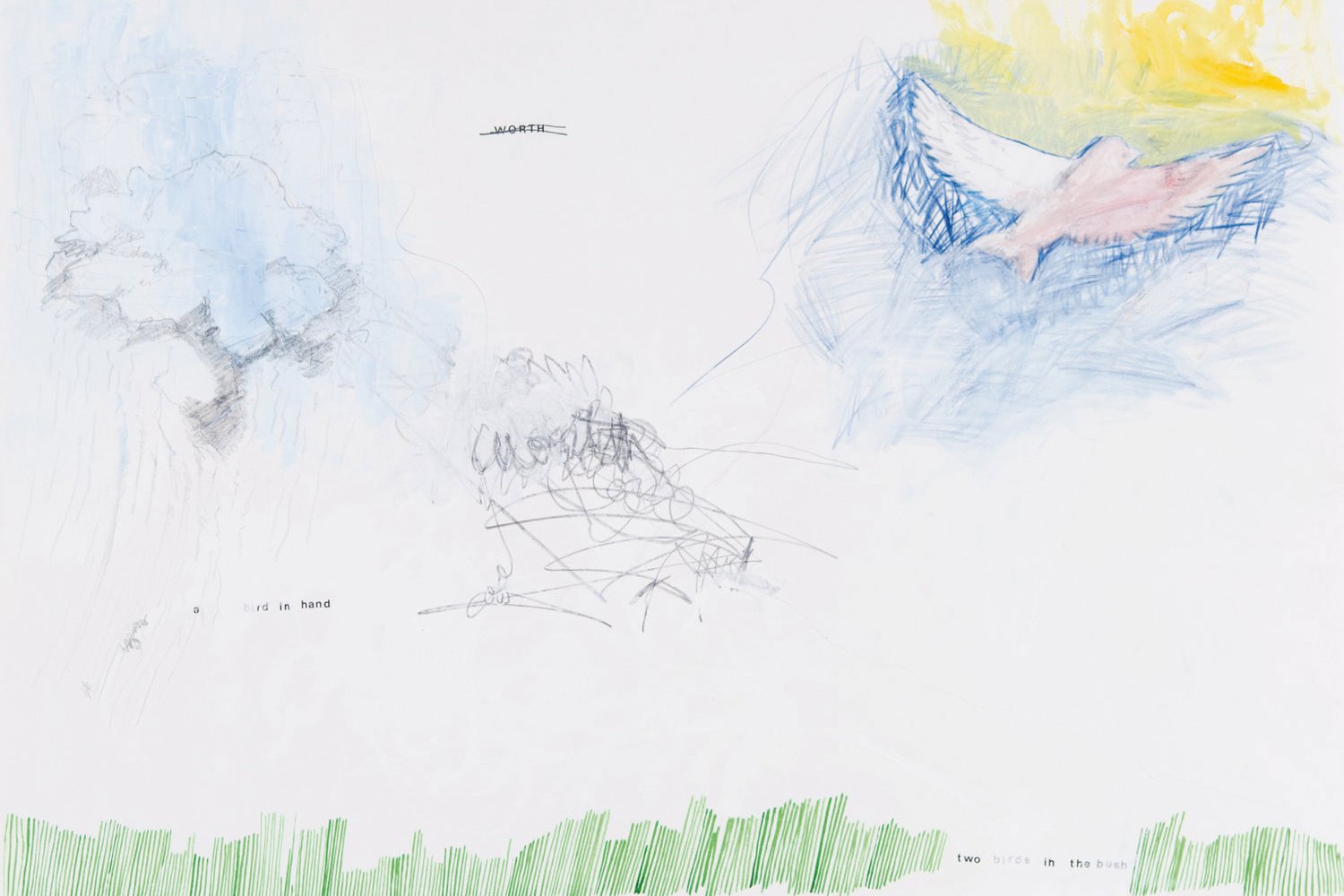
Acadie : Un accent sur notre monde

L'Acadie : une communauté, un peuple, une nation ? Le besoin de se nommer, de se placer et de se (re)définir conduit à une multitude de réponses qui convergent toutes vers une volonté d'expression d'un groupe distinct, ancré au sein d'un territoire atlantique sans frontières claires. L'identité acadienne est à la fois forte et fragmentée, autant dans les espaces variés qui la composent que dans la façon de la vivre au quotidien.
Ce questionnement sans cesse renouvelé mène pourtant vers une expansion de l'identité et devient une force qui cherche constamment les meilleurs agencements pour construire le vivre-ensemble sur le territoire. Autrement dit, l'exercice de se réinventer pousse vers la résilience et l'agir. L'Acadie est à même de se bâtir au quotidien, de se reformuler à travers des discours identitaires fondamentalement hétérogènes et multiples.
Toute lutte, toute prise de conscience, tout projet de société qui figure dans ce dossier peut servir de réponse à la question qu'on se pose (trop) souvent : « c'est quoi, l'Acadie ? ». À dire vrai, si cette grande question reste sans réponse fixe, c'est parce que l'Acadie est tournée vers l'avenir.
Le dossier brosse un portrait de l'Acadie d'aujourd'hui, qui se définit par sa multiplicité et sa contemporanéité au-delà des marqueurs identitaires classiques (la Déportation, la généalogie, la langue française, la pêche, etc.). On y interroge le rapport au territoire et à la langue, en plus d'y explorer le rapport que les Acadien·nes entretiennent avec le pouvoir politique. Le dossier présente aussi des réflexions sur les enjeux queer en contexte minoritaire francophone et rural, ainsi que sur l'accueil que réserve l'Acadie du Nouveau-Brunswick aux immigrant·es racisé·es. Les enjeux féministes sont quant à eux abordés dans un texte sur l'accessibilité des services publics d'avortement et de santé reproductive au Nouveau-Brunswick. Le dossier se termine par une réflexion sur l'impact de la crise climatique sur le littoral acadien et les activités économiques et culturelles reliées à l'océan, car, bien que l'Acadie soit en redéfinition constante, la mer demeure centrale dans son rapport au territoire.
En réponse à la fameuse phrase d'Irène Doiron (dans le documentaire L'Acadie, l'Acadie !!? de Michel Brault et Pierre Perreault) comme quoi « l'Acadie, c'est un détail », le présent dossier suggère plutôt que l'Acadie est la somme, vaste et remarquable, de tous ses détails, hétérogènes, mouvants, imaginatifs.
Nous remercions chaudement l'artiste Angèle Cormier pour les illustrations de la couverture et de la page d'ouverture du dossier.
Dossier coordonné par Valérie Beauchamp, Arianne Des Rochers, Isabelle LeBlanc et Charles MacDougal
Avec des contributions de Alex Arseneau, Kevin Arseneau, Rébeka Frazer-Chiasson, Mélodie Jacquot-Paratte, Michelle Landry, Geneviève L. Latour, Philippe LeVoguer, Charles MacDougall, Leyla Sall, Isabelle Violette et Mathieu Wade
Isabelle LeBlanc est professeure agrégée en sociolinguistique. Charles MacDougall est citoyen engagé.
Illustration : Angèle Cormier œuvre dans le domaine des arts visuels depuis plus
de 20 ans. Après avoir obtenu son baccalauréat en arts visuels à l'Université de Moncton, elle a travaillé sur des plateaux de tournage, dans un centre d'artiste autogéré, auprès d'un festival de cinéma et un festival de littérature. Elle est présentement technicienne à la Galerie d'art Louise-et-Reuben-Cohen et au Musée acadien de l'Université de Moncton. Elle travaille principalement en sérigraphie à l'atelier d'estampe Imago, situé au Centre culturel Aberdeen.
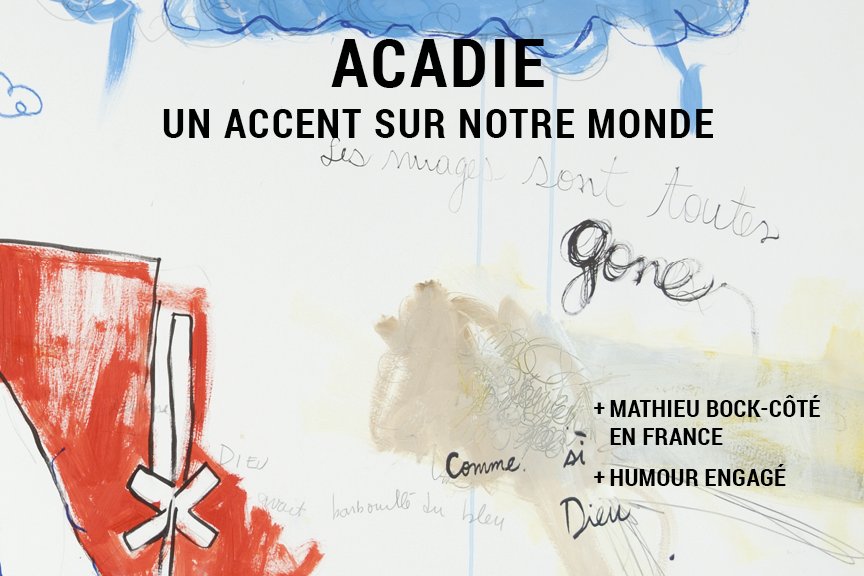
Sommaire du numéro 104

Travail
Projet de loi 89 : Ode à la grève / Élisabeth Béfort-Doucet
Politique
Fondation Walter J. Somers : Un think tank néolibéral financé par la philanthropie et les contribuables / Maxim Fortin
Jeunes et politique : La relève ignorée ! / Sara Arseneault, Lydia Bachi, Steven Flores-Pimentel, Ophélie Fortin, Émilie Gauvin
Féminisme
Abattoir : une féministe en tabarnak / Avec A., par Isabelle Bouchard
Conquérir la nuit / Kharoll-Ann SouffrantEnvironnement
Droit minier et respect des populations locales / Frédérique Bordeleau
Bien réfléchir sur l'injustice et le climat / Entrevue a
vec Amélie Chanez et Anne-Marie Le Saux, par Claude VaillancourtÉconomie
Le bon et le mauvais usage des tarifs douaniers / Claude Vaillancourt
Coup d'œil
« S'illes nous méprisent tellement, qu'illes viennent le dire dans notre face » / Louise Nachet
Culture numérique
Convergence technologique anarchiste de Montréal / Yannick Delbecque
Société
Dans les communautés juives, les antisionistes se mobilisent / Glenn Rubenstein
Politique municipale
Chefferie de Projet Montréal, un choix rassurant ? / Marie-Christine Jeanty
Analyse du discours
Ce que Mathieu Bock-Côté raconte en France / Philippe Boudreau
Médias
Ripostes : les voix du communautaire / Entrevue avec Patrizia Vinci. Propos recueillis par Samuel Raymond
Mémoire des luttes
Alerta ! Le cri de la Wawa. Une voix autonome contre le néolibéralisme / Alexis Lafleur-Paiement
Mini-dossier : Remettons les pendules à nos heures !
Les technologies trompe-l'œil du temps reproductif / Myriam Lavoie-Moore
Le temps de sommeil dans le capitalisme / Jonathan Martineau
Temps et travail / Entrevue avec Julia Posca, sociologue, par Philippe de Grosbois et Valérie Beauchamp
Dossier : Acadie, un accent sur notre monde
Coordonné par Valérie Beauchamp, Arianne Des Rochers, Isabelle LeBlanc et Charles MacDougall
Un territoire dispersé qui se cherche / Mathieu Wade
Le pouvoir acadien : Petite histoire de l'organisation sociopolitique / Michelle Landry
Souveraineté alimentaire : Les résistant·es de la Ridge / Kevin Arseneau, Rébeka Frazer-Chiasson, Geneviève L. Latour et Philippe LeVoguer
De l'insécurité à l'émancipation linguistique / Isabelle Violette
Soins d'avortement au Nouveau-Brunswick : Disponibilité ne veut pas dire accessibilité / Geneviève L. Latour
Discrimination raciale : Élargir la francophonie acadienne, éviter la fragmentation / Leyla Sall
Pour un plaidoyer queer acadien / Entrevue avec Alex Arseneau, par Arianne Des Rochers
Crise climatique et érosion des côtes : Partons (lutter) la mer est belle / Mélodie Jacquot-Paratte et Charles MacDougall
Culture
« Déstabiliser les pouvoirs ». L'humour de gauche au Québec / Entrevue avec Emna Achour, Coralie LaPerrière et Xavier Boisrond, par Philippe de Grosbois et Samuel Raymond.
La progression des femmes et des personnes racialisées en humour : De la marge à la scène humoristique / Sophie-Anne Morency
Les vilaines vedettes syndicales du folklore ouvrier québécois / Entrevue a
vec Eric Sédition, Mathieu Stakh et SanSan, par Isabelle BouchardRecensions
À tout prendre ! / Ramon vitesse
Couverture : Angèle Cormier
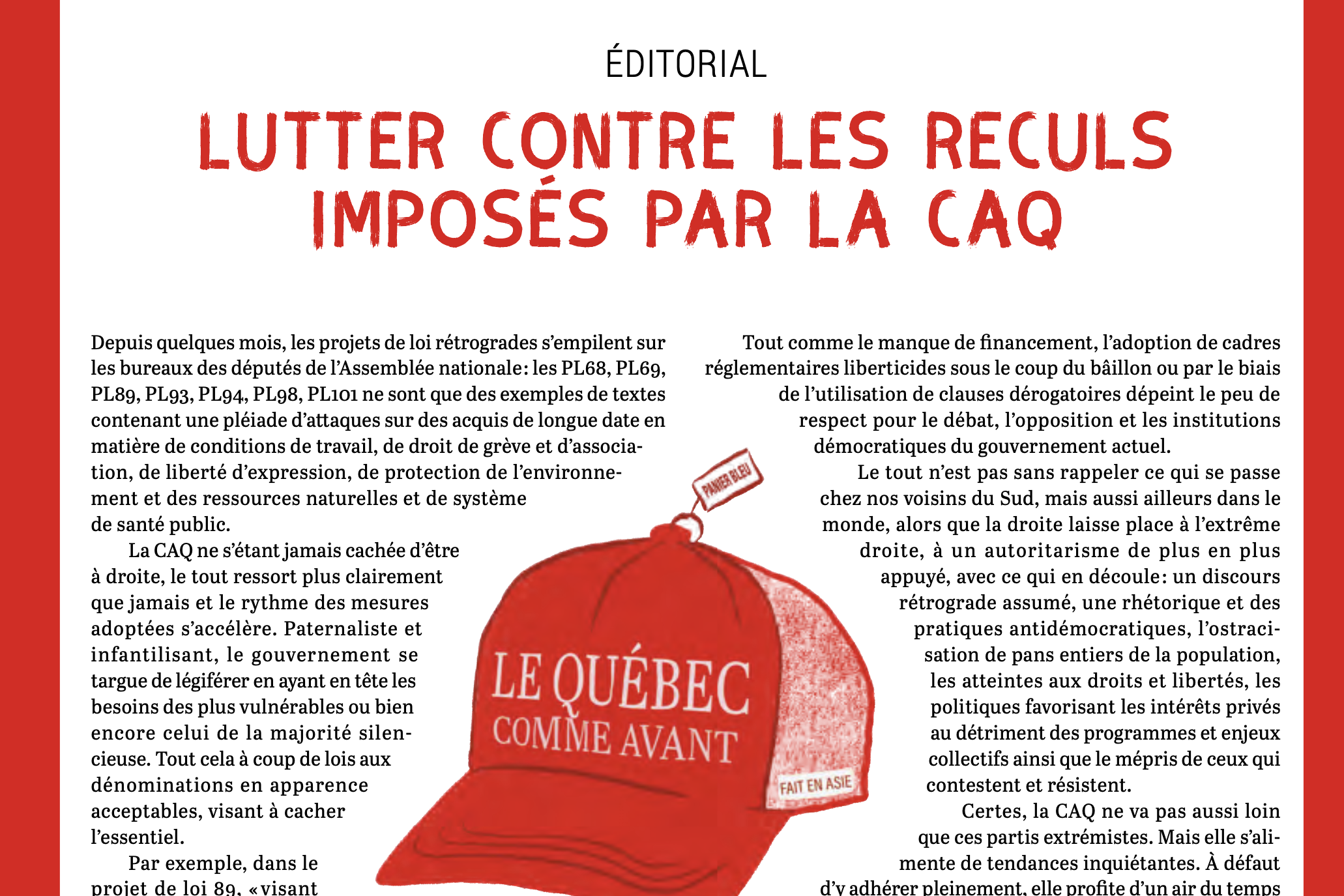
Lutter contre les reculs imposés par la CAQ

Depuis quelques mois, les projets de loi rétrogrades s'empilent sur les bureaux des députés de l'Assemblée nationale : les PL68, PL69, PL89, PL93, PL94, PL98, PL101 ne sont que des exemples de textes contenant une pléiade d'attaques sur des acquis de longue date en matière de conditions de travail, de droit de grève et d'association, de liberté d'expression, de protection de l'environnement et des ressources naturelles et de système de santé public.
Par exemple, dans le projet de loi 89, « visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève et de lock-out », on limite le droit de grève au nom de la protection du bien-être des enfants lors de conflits de travail. Dans le PL93, « concernant notamment le transfert de propriété d'un immeuble de la Ville de Blainville », on autorise une entreprise privée à entreposer ses déchets toxiques en faisant fi de rapports environnementaux, au nom de l'« intérêt », voire de la sécurité nationale. Ou encore, sous le prétexte d'une « gouvernance responsable des ressources énergétiques » (PL69), on envisage une production fortement accentuée d'énergie, au détriment de l'environnement, et une privatisation partielle d'Hydro-Québec.
Le gouvernement Legault, adepte de lois tout sauf progressistes, n'est pas enclin d'autre part à encourager les discussions. On le voit notamment par les difficultés vécues dans les secteurs de la culture, du communautaire et des médias alternatifs – incluant des organisations connues pour dénoncer, critiquer et résister –, tous en crise faute de financement adéquat. Ce traitement dont ils sont victimes contribue à éliminer les voix discordantes et dérangeantes qu'elles représentent.
Tout comme le manque de financement, l'adoption de cadres réglementaires liberticides sous le coup du bâillon ou par le biais de l'utilisation de clauses dérogatoires dépeint le peu de respect pour le débat, l'opposition et les institutions démocratiques du gouvernement actuel.
Le tout n'est pas sans rappeler ce qui se passe chez nos voisins du Sud, mais aussi ailleurs dans le monde, alors que la droite laisse place à l'extrême droite, à un autoritarisme de plus en plus appuyé, avec ce qui en découle : un discours rétrograde assumé, une rhétorique et des pratiques antidémocratiques, l'ostracisation de pans entiers de la population, les atteintes aux droits et libertés, les politiques favorisant les intérêts privés au détriment des programmes et enjeux collectifs ainsi que le mépris de ceux qui contestent et résistent.
Certes, la CAQ ne va pas aussi loin que ces partis extrémistes. Mais elle s'alimente de tendances inquiétantes. À défaut d'y adhérer pleinement, elle profite d'un air du temps réactionnaire. Plusieurs des éléments normatifs mis de l'avant par ce parti constituent bel et bien une offensive sur des gains durement acquis. Ne nous méprenons pas : la CAQ sent la fin de son règne et tente d'abattre le plus de travail possible pour démanteler des droits et avantages arrachés au prix de luttes laborieuses. Ne nous laissons pas submerger par la quantité abondante de la réglementation qui déferle, mais organisons-nous, dénonçons les pratiques antidémocratiques au service du secteur privé, du patronat et d'intérêts réduits. Démontrons, au sein de nos organisations, toute la solidarité dont nous sommes capables. Nous n'avons ni la place ni le temps pour l'apathie !

De Tunis à Gaza, de Montréal à Rafah : briser le siège, refuser le silence

Il est des gestes qui ne relèvent ni du secours humanitaire ni du symbole abstrait, mais bien de l'histoire. La Marche mondiale vers Gaza en fait partie. Plus qu'un simple rassemblement international, c'est un soulèvement moral et politique. Un refus collectif de l'indifférence. Une réponse populaire, transnationale, résolue et indocile à la mise à mort programmée d'un peuple.
Le 15 juin 2025, des milliers de personnes venues de plus de trente pays convergeront vers la frontière de Rafah. De Tunis à Vancouver, de Dakar à Santiago, une génération dispersée mais insoumise a choisi d'écrire une autre page de notre histoire. Elle incarnera une conviction profonde : la solidarité n'est pas une option morale, c'est un impératif politique.
Cette initiative n'est ni charitable, ni symbolique. Elle est une riposte, une dénonciation vivante de l'ordre mondial qui laisse mourir de faim un peuple entier dans un silence organisé. C'est le cri de celles et ceux qui refusent de normaliser le génocide, de réduire Gaza à une parenthèse humanitaire dans un monde saturé de cynisme.
Née dans l'urgence d'un monde anesthésié, la Marche mondiale pour Gaza est le fruit d'un refus : celui de détourner les yeux alors qu'un des pires génocides du XXIe siècle s'accomplit sur nos écrans, en toute impunité. Depuis octobre 2023, plus de 55 000 Palestinien·nes ont été martyrisé·es, soit environ 2,4 % de la population de Gaza. Et ce chiffre, déjà insoutenable, reste sous-estimé. Selon The Lancet, revue scientifique de référence, le nombre réel de martyrs pourrait avoir atteint 186.000 dès juin 2024. Imaginons ce qu'il en est aujourd'hui.
Face à cette barbarie orchestrée, la Marche est une insurrection morale. Une coordination citoyenne mondiale rassemblant plusieurs réseaux :
* la Freedom Flotilla Coalition, qui tente de briser le blocus par la mer ;
* la Marche Mondiale vers Gaza, mobilisée par voie aérienne ;
* et la Coordination de l'action commune pour la Palestine, partie de Tunisie, qui emprunte la voie terrestre.
Et c'est justement de Tunis, ma ville natale, que le convoi Al-Soumoud, la caravane terrestre de la ténacité a choisi de faire ses premiers pas. Tunis, témoin d'une solidarité enracinée avec la cause palestinienne, terre d'accueil de l'Organisation de Libération Palestinienne (OLP) après les massacres de Sabra et Chatila en 1982, terre d'exil des résistant·es jusqu'au retour à Gaza en 1994, et terre frappée par les bombes israéliennes lors de l'attaque aérienne du 1e octobre 1985 contre le quartier général de l'OLP à Hammam Chott. Ici, Gaza n'est pas une abstraction, mais une mémoire vivante. Une mémoire populaire, que ni la répression ni les renoncements gouvernementaux n'ont pu effacer. Une ville qui continue de dire non, même bâillonnée.
Je suis aussi Canadienne, de cette terre qui m'a accueillie, et c'est depuis Montréal que je m'engage au sein de la coordination nationale de la Marche mondiale pour Gaza. Cette double appartenance n'est pas une contradiction, mais une richesse : celle de pouvoir tisser des ponts entre les rives, relier les récits, faire dialoguer les mémoires, et assumer les responsabilités qui découlent de chaque côté de l'océan.
Car le Canada n'est pas neutre. Il continue d'exporter des armes, de signer des contrats militaires, de soutenir Israël diplomatiquement, et de voter contre les droits des Palestinien·nes dans les instances internationales. Marcher depuis ici, c'est refuser cette complicité active. C'est agir depuis le cœur même de l'Empire. Car ce génocide est commis avec notre argent, nos lois, nos impôts, et surtout nos silences.
La délégation canadienne, dont je fais partie, composée de militant·es, de syndicalistes, de professionnel·les de la santé, de jeunes et d'artistes engagé·es s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Nous marchons parce que ce faux lointain, cette illusion de distance, expose crûment notre participation, passive ou structurelle, au système qui rend le massacre possible. Nous marchons pour dire que nous refusons d'être complices. Que nos passeports ne nous protègent pas de la honte. Que nous aurons des comptes à rendre à nos enfants, et aux leurs.
Depuis le 2 mars 2025, Israël impose une fermeture totale des points de passage vers Gaza, empêchant toute entrée de nourriture, médicaments et aide humanitaire. Le blocus de Rafah a provoqué famine, effondrement sanitaire, déplacements forcés à grandes échelle. Face à cette situation, la Marche mondiale pour Gaza porte trois revendications claires : la levée immédiate du blocus de Gaza, l'ouverture inconditionnelle du passage de Rafah, l'entrée de l'aide humanitaire et la fin des complicités internationales qui rendent ce génocide possible et durable.
Nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que les États ne plient pas sous la seule pression morale. Mais nous savons aussi que l'histoire avance par accumulation : de cris, de pas, de ruptures. Sans cette marche, nous serions plus seul·es et sans doute plus honteux·euses. Elle est un acte de mémoire, mais aussi un pari sur l'avenir. Elle affirme que la Palestine vit encore : dans chaque slogan, chaque keffieh, chaque regard levé.
Nous ne marchons pas pour nous donner bonne conscience. Nous marchons pour ouvrir une brèche dans le mur de l'indifférence. Pour rappeler à nos peuples que la lutte palestinienne est aussi la nôtre : une lutte contre le colonialisme, pour la justice globale, pour le droit à la vie, à la dignité, à la terre et au rêve.
Je marcherai pour Gaza, oui. Mais aussi pour mes enfants et pour les enfants de Tunis, ceux que j'ai vus écrire encore sur les murs : « القدس لنا / À nous Jérusalem ». Je marcherai pour les jeunes de Montréal qui ne comprennent pas pourquoi les bombes reçoivent plus de soutien que les vies. Pour toutes celles et ceux qui croient encore que marcher, c'est résister ; que résister, c'est espérer ; et qu'espérer, c'est déjà se battre.
Cette marche, enfin, est une promesse. Celle de ne pas céder. Car tant qu'il y aura des peuples qui marchent, il y aura des peuples qui résistent. Et tant qu'il y aura des résistances, le projet colonial ne dormira jamais tranquille. Palestine vaincra !
Safa Chebbi est militante décoloniale et membre de la coordination nationale canadienne de la Marche mondiale pour Gaza.
Crédit photo : Yassine Gaidi.
Contrat de service – Permanence à la revue À bâbord !
La revue sociale et politique À bâbord ! est à la recherche d'une personne pour assurer la permanence de la revue. Revue autonome et indépendante, la revue À bâbord ! est réalisée par des membres bénévoles depuis 2003. Le rôle de la personne permanente est central pour assurer les publications. Cette personne devra effectuer les tâches suivantes, notamment.
Survol du poste
- • Assurer le suivi hebdomadaire des deux boîtes courriel (info + achats/pubs).
- • Relayer les propositions d'articles au secrétaire de rédaction.
- • Relayer les demandes ou les problèmes d'abonnements à la SODEP.
- • Relayer les questions spécifiques au collectif ou au comité de coordination.
- • Assurer le suivi avec l'imprimeur, et ce, toute l'année, en collaboration avec la personne secrétaire de rédaction.
- • Assurer le suivi avec la SODEP (ex. : remplir les sondages, faire les demandes pour le Printemps des revues) en collaboration avec le ou la responsable des abonnements.
- • Rassembler les nouvelles pubs (en relançant chaque syndicat qui a un contrat avec nous) pour le numéro 105 et les suivants, en collaboration avec le comité dédié aux annonces publicitaires et la personne secrétaire de rédaction.
- • Renouveler les contrats de vente d'espaces publicitaires et les achats groupés après le numéro 105 et les suivants.
- • Vendre des espaces publicitaires à l'aide d'un nouveau kit médias (à créer : 2025-2026).
- • Transférer toutes les publicités à l'infographiste et au secrétaire de rédaction avant chaque date de tombée.
- • Produire toutes les factures publicitaires.
- • Produire des factures et faire le suivi des ventes et invendus auprès des librairies indépendantes deux fois par année.
- • Coordonner l'ajout de chaque numéro aux plateformes de vente des Libraires et de la SODEP.
Compétences requises et atouts
- • Bonnes capacités de communication et de rédaction en français.
- • Familiarité avec les outils de gestion et de suivi des boites courriels.
- • Aptitude à travailler en équipe et de manière autonome.
- • Connaissance des milieux syndicaux et militants québécois (atout).
- • Expérience ou connaissance en édition (atout).
- • Expérience de mise en marché (atout).
Conditions de travail
- • Il s'agit d'un contrat de service d'une moyenne de 40 heures par numéro (quatre numéros par année), mais les heures sont réparties en fonction des besoins.
- • La rémunération est de 20,00 $ de l'heure.
- • Toutes les données d'À bâbord ! devront être versées sur le serveur Nextcloud À Bâbord ! financé par la revue, et ce, dès la conclusion du contrat de services pour la personne assurant la permanence de la revue.
- • Le contrat sera renouvelable annuellement en juin), après entente entre les parties, et ce, notamment, si la situation financière de la revue le permet.
- • Le travail se réalise au domicile de la personne.
- • L'entrée en poste est prévue pour juin 2025.
Procédure pour postuler
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur CV accompagné d'une lettre de motivation avant le 12 juin à 17 h à l'adresse suivante : candidature@ababord.org.

Le capitalisme à son apogée

Aux États-Unis, les politiques du care, les programmes d'aide sociale, l'industrie des soins de santé, les organismes à but non lucratif qui luttent contre la pauvreté, les programmes de tutelle, les agences d'aide sociale, les programmes de garde d'enfants et l'aide au logement ont servi de sites de croissance économique et d'expansion du capital.
L'investissement dans l'économie du care à des fins d'accumulation financière a augmenté rapidement au cours des 30 dernières années et l'engouement pour le care comme nouvel horizon pour l'investissement et l'entrepreneuriat dans le secteur des entreprises ne cesse de grandir. La hausse des profits tirés du care indique qu'il existe un nouveau rapport entre les individus et le capital, ainsi qu'entre l'État-providence et l'accumulation de capital. Un rapport qui permet au capital de tirer profit de la pauvreté, de la maladie, de la dépendance et de la fragilité. Le point de départ de notre réflexion se base sur une analyse du capitalisme racial. En effet, les spécialistes de l'esclavage et du racisme ont démontré que le profit tiré du care s'inscrit dans la longue histoire du capitalisme et du colonialisme.
Capitalisme racial
L'exemplele plus frappant est celui de l'esclavage transatlantique. Le travail des esclaves était une composante nécessaire de l'économie industrielle naissante en Europe et aux Amériques. Outre l'exploitation de leur travail, l'achat et la vente d'esclaves constituaient également une source de profit. Par conséquent, les personnes asservies produisaient des marchandises et constituaient elles-mêmes une marchandise.
Bien que très différente de l'esclavage mobilier [1], l'économie contemporaine du care est fondée sur la rentabilité des personnes et des soins qui leur sont prodigués. Dans le cadre de l'économie néolibérale du care, les entreprises gagnent de l'argent en exploitant les besoins qu'ont les personnes, qu'il s'agisse de soins de santé, de logement, d'éducation, de garde d'enfants, de soins aux personnes âgées ou aux personnes handicapées.
En prenant en compte les voix des personnes les plus marginalisées – militant·es, travailleuses et travailleurs domestiques, bénéficiaires de l'aide sociale – nous sommes à même de comprendre l'économie du care sous l'angle du capitalisme racial. Par exemple, les personnes employées de maison perçoivent leur emploi comme une exploitation (ou du moins une obligation liée au travail) et non comme un engagement affectif, et se mobilisent ainsi dans le secteur grandissant des services du care. Pour la majorité, il s'agit de femmes noires et de couleur. De même, les récits des bénéficiaires d'aide sociale illustrent bien le fait que la réduction et la nature plus punitive des programmes qui leur sont destinés leur cause davantage de difficultés.
On voit alors se dessiner un secteur du care enraciné dans l'exploitation du travail et l'extraction du profit. Tout cela met en évidence les contradictions entre le discours sur les soins (l'idée que le care est une préoccupation publique majeure) et les politiques adoptées.
Rôle de l'État
Un besoin majeur semble être de reconsidérer le rôle de l'État-providence dans le cadre d'une économie du care extractive. L'État-providence a été vu comme un moyen d'atténuer les excès du capitalisme. Or, les programmes gouvernementaux sont souvent externalisés, administrés par des entreprises privées, et il y a peu de surveillance à l'égard de la manière dont l'argent peut être dépensé. L'État-providence est devenu une source de profit pour le secteur privé et une mangeoire pour les riches. Par exemple, Maximus, une entreprise qui offre des services de gestion de programmes pour le gouvernement américain, génère un chiffre d'affaires de 4 milliards de dollars en exploitant des ménages et en fournissant les services de Medicaid [2], de Medicare [3] et de formations professionnelles, entre autres, destinés aux personnes dans le besoin. Seul un quart des fonds publics destinés aux bénéficiaires du Temporary Assistance to Needy Families Program [programme d'assistance temporaire aux familles nécessiteuses] est consacré à l'aide monétaire accordée auxdites personnes démunies.
Le profit tiré du care augmente et devient ainsi une forme dominante d'accumulation de capital. Aux États-Unis, parmi les dix premières entreprises du classement Fortune 500 de 2024, quatre relèvent de l'économie du care : CVS Santé, United Health Group, McKesson et Cencora. À titre de comparaison, en 1980, les dix premières entreprises du palmarès comprenaient six compagnies pétrolières et gazières, trois constructeurs automobiles et une entreprise technologique. Même si l'industrie manufacturière demeure importante, la production de matières premières et l'exploitation de la main-d'œuvre ne sont plus le seul fondement du capitalisme ; désormais, pour créer du profit, les regards sont portés vers le bien-être et la survie des personnes.
Pour un care radical
Toutes les formes de care ne sont pas ancrées dans un marché et une logique capitaliste. D'autres expériences nous invitent à réfléchir à la manière de le réimaginer. Les services médicaux et les programmes de petits-déjeuners gratuits du Black Panther Party en son temps, les collectifs trans du début des années 1970, et les réseaux du care qui se sont formés dans la communauté de la justice pour les personnes handicapées en sont de bons exemples. Ce care radical et communautaire comble un besoin important, en plus de constituer la préfiguration d'une vraie politique du care – les premiers jalons d'une société différente dans laquelle le care n'est pas défini par le profit capitaliste ou les normes raciales et sexistes, mais par un engagement partagé en faveur du bien-être des autres.
[1] Système dans lequel les personnes asservies sont aussi considérées comme des biens par leurs asservisseurs.
[2] Couverture médicale pour certaines personnes avec un revenu et des ressources limités.
[3] Assurance maladie fédérale, notamment pour les personnes âgées de 65 ans.
Premilla Nadasen est professeure d'histoire à l'Université Columbia, New York.
Photo : Selena Phillips−Boyle

Des féminicides coloniaux

Si le discours public sur la mort de personnes de groupes marginalisés est toujours politique, cela devient très clair quand on a affaire aux débats d'opinion sur le génocide perpétré envers les peuples autochtones et sur les féminicides de femmes autochtones au Québec et au Canada. Chronique d'un militantisme anti-autochtones bien de chez nous.
Le 3 juin 2019, nous étions de nombreux·euses observateur·rices et chercheur·euses à sortir ébranlé·es de la cérémonie de clôture de l'Enquête nationale sur les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA [1] autochtones disparues et assassinées (ENFFADA), au Musée canadien de l'histoire, à Hull. Nous étions ébranlé·es par cette communion des deuils et par la vibrante et contagieuse indignation des proches de victimes. Nous n'étions toutefois pas étonné·es par la conclusion phare de l'enquête : les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA autochtones sont des cibles du génocide colonial canadien.
Un « non » catégorique
Cependant, dès l'après-midi du 3 juin, des chroniqueurs se scandalisaient. Sur TVA, Mario Dumont déclarait « le [rapport] a commencé à circuler […] avec cette fameuse expression, un “ génocide ”… c'est pas acceptable, c'est pas vrai ». Le même jour, Yves Boisvert de La Presse titrait sa chronique « C'était pas un “ génocide ” » et y affirmait que « ce tordage de mots militants suggère au final de comparer les chambres à gaz nazies et les assassinats massifs à coups de machette au Rwanda avec la situation des femmes autochtones ».
Le 8 juin, sur les ondes de Global News, Andrew Scheer, alors chef du Parti conservateur, déclarait que l'enjeu des disparitions et des assassinats de femmes autochtones était « its own thing », « un dossier particulier » qu'on ne pouvait qualifier de génocide. Entre autres propos suintant de racisme, Normand Lester du Journal de Montréal écrivait le lendemain que « le rapport […] a habilement utilisé cette réalité en l'associant au mot honni « génocide » pour réaliser une fantastique et malhonnête opération de propagande à l'échelle internationale ». Encore tout récemment, à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones de juin dernier, Jean-François Lisée usait de sa tribune dans le Devoir pour défendre la liberté d'expression des négationnistes de partout au pays et réclamer le droit de douter de l'existence de tombes anonymes d'enfants sur les sites des pensionnats fédéraux. Pour appuyer ses propos, Lisée se faisait le relais des écrits de Tom Flanagan, négationniste de renom et l'un des porte-étendards du militantisme anti-autochtones au Canada.
Un génocide colonial
Les rédactrices du rapport avaient vu venir cette levée de boucliers. On peut lire, dans le rapport, qu'il est souvent difficile, voire impossible de faire reconnaître certains événements qui correspondent en beaucoup de points à des génocides en raison de l'intensité extrême de la violence qu'on associe à l'Holocauste, à l'Holodomor ou au génocide rwandais. Ce sont des événements dont la violence a été brutale autant dans le temps que dans l'espace, alors que le génocide canadien, lui, repose sur des structures diffuses, des actions et des omissions dont les effets génocidaires (létaux et non létaux) s'étalent longuement dans le temps. Pensons à la Loi sur les Indiens, aux pensionnats, à la rafle des années 1960, aux déplacements forcés de communautés inuites dans l'Extrême Arctique, au long bras de la Protection de la jeunesse ou aux biais persistants de la police et du système judiciaire, from coast to coast to coast.
Cumulées, coordonnées et à long terme, ces structures créent une violence à la fois culturelle, économique, institutionnelle et de santé publique qui vise l'extinction de la souveraineté autochtone et l'effacement de la présence autochtone sur le territoire. Cette extinction est fondamentale pour assurer l'emprise de l'État canadien sur ce territoire et ses ressources : le génocide colonial est un mode d'opération inscrit dans l'ADN de l'État colonial de peuplement [2]. Sa souveraineté et son intégrité territoriale dépendent de l'effacement des Premiers Peuples.
Féminicides
Le féminicide est le meurtre misogyne d'une femme ou d'une personne dont l'expression de genre est féminine. On le décrit souvent comme la face la plus visible des violences de genre, qu'on peut positionner sur un continuum d'intensité. En ce qui concerne les féminicides perpétrés envers des femmes autochtones, il s'agit de l'un des nombreux rouages et effets de la violence structurelle que produit le colonialisme. C'est une violence qui se situe au confluent de la misogynie, de la colonialité et du racisme.
Au Québec, depuis 2021, on a réalisé une avancée dans le discours en délaissant plus ou moins les fâcheuses expressions « drame conjugal » ou « drame familial » pour leur préférer le terme « féminicide » [3]. Une avancée, parce que dire « féminicide » nous éloigne d'une compréhension purement criminaliste pour mieux représenter le caractère politique de la violence faite à la victime en raison de son genre. Dans un contexte où les meurtres conjugaux – ces meurtres commis par un (ex-)partenaire – sont les plus médiatisés, parler enfin de féminicide a aussi le potentiel d'élargir la couverture médiatique vers tous les types de violences commis envers les femmes, même hors de la sphère domestique, et de complexifier notre compréhension collective du féminicide.
En réalité, tous les féminicides ne sont pas des meurtres conjugaux. Parler de féminicide est particulièrement important lorsqu'il est question des femmes autochtones assassinées qui, selon l'Observatoire canadien du fémicide, sont plus susceptibles d'être tuées par un inconnu ou par une connaissance que les femmes allochtones. Sachant cela, et sachant qu'au moins une femme assassinée sur cinq au Canada est une femme autochtone, on ne saurait faire du féminicide un synonyme de meurtre conjugal : ce mot doit conserver toute sa force et refléter toutes les réalités des violences de genre, notamment coloniales [4].
La violence policière ne date pas d'hier
Au moment où l'ENFFADA est lancée, en 2015, des militant·es et des associations de femmes autochtones luttent depuis plusieurs décennies déjà pour que ces disparitions et ces assassinats soient examinés et traités avec l'urgence qu'ils méritent. Dès 2004, Amnistie internationale, en collaboration avec l'Association des femmes autochtones du Canada, publiait un rapport intitulé On a volé la vie de nos sœurs : discrimination et violence contre les femmes autochtones. Les organisations y signalaient le vif contraste entre le nombre alarmant de femmes autochtones disparues et assassinées et l'indifférence des corps de police et des élu·es devant la violence commise envers elles.
À lire les transcriptions des audiences de l'ENFFADA, on voit que celles-ci étaient l'occasion pour les proches de répondre aux discours déshumanisants et à l'indifférence des autorités. La plupart des témoignages dénoncent le traitement général que les femmes autochtones reçoivent de la société coloniale dominante, qui se traduit par cette phrase, parfois même entendue de la bouche des autorités : « c'est rien qu'une (autre) femme autochtone ». Ce qu'on y comprend, c'est un appel à économiser ses énergies pour une femme qu'on décrit comme indistincte, dispensable et de peu de valeur. De nombreux témoins à l'ENFFADA en ont montré les graves conséquences, comme le ralentissement des enquêtes, la décrédibilisation des témoignages de proches et de victimes, et l'indifférence générale de la population devant le sort réservé aux femmes autochtones disparues et assassinées.
Au Québec, nous avons été aux premières loges de ce traitement discriminatoire. En 2015, des femmes anishinabeg et cries de la région de Val-d'Or témoignent à l'émission Enquête du mépris des policiers à leur égard, mais aussi des abus et des violences commises par les forces de l'ordre à l'endroit des femmes autochtones. On apprend aussi que des agents commettent des starlight tours [5]. En dépit de la gravité des actes dénoncés et du grand nombre de témoignages entendus, plusieurs s'obstinent à remettre en doute la parole des femmes victimes.
En réplique à l'appui offert aux femmes par les communautés autochtones et les allié·es allochtones, une manifestation s'organise à Val-d'Or en soutien aux policiers. Certain·es manifestant·es diront à Radio-Canada : « Je suis tannée en maudit d'entendre parler contre nos policiers. Je ne crois pas que nos policiers soient des abuseurs » ; « Nous, comme citoyens, nous sommes tannés d'entendre parler de Val-d'Or du côté très négatif » ; « Ça été ben que trop loin. C'est pas la réalité. Non. C'est pas ça. » On verra aussi l'apparition du bracelet rouge 144, distribué et porté par des policiers du Québec pour signifier leur appui aux huit agents suspendus du poste 144 de Val-d'Or.
Le déni se poursuit encore aujourd'hui. En mai dernier, le caquiste Pierre Dufour avançait encore, au conseil municipal de Val-d'Or, que l'émission d'Enquête était « bourrée de menteries », qu'elle avait « attaqué des policiers qui étaient très honnêtes ». Dufour accusait aussi la municipalité d'avoir failli à sa tâche de protéger ses policiers après la diffusion de l'épisode d'Enquête et la publication du rapport de la commission Viens, lequel soulignait que les femmes autochtones vivent une victimisation secondaire dans leurs rapports avec les policiers.
Le dos large du crime
Dans un contexte plus qu'hostile à la dénonciation, les militant·es et les associations autochtones tiraient donc sans relâche la sonnette d'alarme depuis des dizaines d'années. Mais elles se butaient à des élu·es qui défendaient un discours selon lequel les féminicides étaient une affaire criminelle, pas un phénomène sociologique ni un enjeu politique – une attitude bien utile pour ceux et celles qui veillent à évacuer la responsabilité de l'État et de ses appendices policier et judiciaire.
Parmi les politicien·nes insistant pour faire des féminicides un problème de criminalité, on compte Stephen Harper, qui tenait ces propos en 2014 : « Comme l'a montré la GRC dans sa propre enquête, la vaste majorité [des cas de disparition et d'assassinat] sont pris en charge et résolus par les enquêtes policières, on va les laisser continuer de s'en occuper. […] Il ne faut pas voir ça comme un phénomène sociologique, il faut plutôt voir ça comme une affaire de crimes. Ce sont des crimes commis envers des personnes innocentes, il faut les traiter comme tels. » En insistant sur l'acte criminel, Harper veillait à faire des violences des événements indépendants les uns des autres, n'impliquant à chaque fois qu'une victime innocente et un agresseur troublé et dangereux. La solution, c'est donc l'arrestation, le procès et la sentence, le tout opéré et supervisé dans l'impartialité par l'appareil policier et le système judiciaire canadiens.
Depuis la mort tragique de Joyce Echaquan, François Legault prend le relais de Harper en refusant de reconnaître l'existence du racisme systémique. Le 5 octobre 2021, en point de presse, Legault faisait dans la question rhétorique et dans la parodie des recommandations d'expert·es : « Est-ce qu'il y a quelque chose qui part d'en haut et qui est communiqué partout dans le réseau de la santé en disant “soyez discriminatoires dans votre traitement des Autochtones” ? C'est évident pour moi que la réponse, c'est non. Par contre, je comprends qu'à certains endroits, il y a des employés, je dirais même dans certains cas des groupes d'employés et même des dirigeants qui ont des approches discriminatoires. » En martelant que des individus sont racistes, mais pas le système, Legault usait de la même manœuvre discursive que l'ancien premier ministre conservateur pour circonscrire la violence à des événements isolés et des actes individuels.
Les féminicides de femmes autochtones peuvent bien être perpétrés par des individus (très souvent impunis, par ailleurs), mais ils sont rendus possibles par un contexte politique qui vulnérabilise, précarise et oppresse les femmes autochtones. Canadien·nes ou Québécois·es, les négationnistes du génocide des peuples autochtones, ces chiens de garde du colonialisme, arrivent toujours à l'heure pour dégager l'État de sa responsabilité dans la mort de Joyce Echaquan et celle d'autres Autochtones. Les efforts mis à contredire, tour à tour, les conclusions de l'ENFFADA sur le génocide canadien et décrédibiliser les témoignages sur lesquels elle s'appuie sont autant d'énergies investies pour compromettre la sécurité des femmes autochtones.
[1] L'acronyme 2ELGBTQQIA rassemble les personnes deux esprits, lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans, queer, en questionnement, intersexes et asexuelles.
[2] Selon Patrick Wolfe (2006), un État colonial de peuplement « vise à dissoudre les sociétés autochtones » pour « ériger une nouvelle société coloniale sur les terres expropriées – les colonisateurs viennent pour rester ».
[3] À l'échelle internationale, le Québec est en retard. Cela fait maintenant plus de vingt ans que les termes « femicidio » et « feminicidio » sont employés couramment en Amérique latine pour dénoncer le nombre effrayant de meurtres misogynes qui y sont perpétrés. Le Québec est aussi légèrement à la remorque de la France, où on commence à parler plus couramment de féminicide vers 2017.
[4] Au-delà du sujet du présent texte, cela doit inclure les violences perpétrées envers les femmes et personnes à l'expression de genre féminine issu·es de divers groupes minorisés et marginalisés, qui sont les cibles de violences s'inscrivant dans d'autres systèmes de maintien du pouvoir, comme le classisme et la queerphobie.
[5] Les starlight tours, littéralement « voyages sous la lumière des étoiles », sont une pratique policière qui consiste à intercepter et embarquer des Autochtones en milieu urbain pour les déposer à plusieurs kilomètres à l'extérieur des limites de la ville, en plein hiver et en pleine nuit. Si certain·es réussissent à regagner la ville à pied, un nombre important meurent d'hypothermie. La pratique est bien documentée dans les Prairies canadiennes, mais elle est aussi utilisée au Québec – c'est ce que nous apprenaient les femmes autochtones de Val-d'Or qui ont témoigné de ces abus à l'émission Enquête en 2015.
Illustration : Marcel Saint-Pierre, Sous le chapiteau, 1999, détail. Pellicule d'acrylique sur toile, 120 x 150 cm. Collection particulière.












