Nouveaux Cahiers du socialisme
Faire de la politique autrement, ici et maintenant...

La question nationale québécoise à l’ombre du capitalisme

La collection « Regards croisés sur la gauche québécoise » L’historiographie québécoise traditionnelle a pendant longtemps ignoré la gauche, mais plus largement encore, les mouvements sociaux. Des pans entiers de l’histoire québécoise sont rayés de la carte. Cette situation commence cependant à changer dans les années 1960 avec des travaux d’avant-garde comme ceux de Stanley Ryerson et d’Alfred Dubuc, puis d’une nouvelle génération d’historiens et de sociologues, notamment à l’Université du Québec à Montréal, qui publient des essais percutants dans le cadre des revues comme Parti Pris et Révolution Québécoise. Dans les années 1970, le mouvement de « libération » de l’histoire s’accélère à travers diverses expériences politiques et intellectuelles dont celles du FRAP et des interventions des mouvements populaires pour relancer la perspective de la transformation. Après l’éclipse des années 1980, le regain d’intérêt pour une « autre histoire » suscite d’autres initiatives (notamment le Bulletin d’histoire politique du Québec), projets et publications. L’édition ou la réédition d’essais historiques, d’analyses et de mémoires connaissent une embellie depuis les dernières années, notamment avec Lux Éditeur, Écosociété et M Éditeur, ainsi que les revues Les Nouveaux Cahiers du socialisme et À Bâbord. La collection « Regards croisés sur la gauche québécoise » s’inscrit donc dans un mouvement d’idées important qui ne survient pas par hasard, mais qui, au contraire, coïncide avec l’irruption de nouvelles générations militantes. Celles-ci savent que le présent est fait du passé, selon l’expression de Marx : « Le poids des générations mortes pèse lourd dans le cerveau des vivants ». Ce qui est moins connu parfois est que le présent fabrique le passé, c’est-à-dire qu’il le relit, le réinterprète et, à la lumière des développements contemporains, nous permet de mieux comprendre les dédales de la pensée et de l’intervention des générations antérieures.
Révision des textes : Chantal Drouin
Introduction
En 1978, dans l’effervescence québécoise de l’époque naît une revue, les Cahiers du socialisme. Son but est de relire la société québécoise au prisme des classes et des luttes de classes, plus particulièrement « de faire l’analyse des « rapports entre classes sociales au Québec et au Canada, de la nature de l’État capitaliste fédéral et québécois, de la place du Canada dans le système impérialiste, des voies d’organisation et d’accession au pouvoir des classes opprimées, de la question nationale »[1]. L’« aventure » durera jusqu’en 1984 [2].
L’irruption du Parti Québécois
Les Cahiers du socialisme apparaissent au moment où le mouvement populaire se retrouve confronté à un nouveau contexte. En 1976 en effet, le Parti Québécois (PQ) remporte les élections provinciales grâce à un fort appui populaire. Bien que mis en place par des éléments dissidents du Parti Libéral et un groupe social principalement composé de professionnels et de technocrates, le PQ est de toute évidence le choix du peuple et même des éléments organisés du peuple à travers le riche tissu associatif qui prend la forme de syndicats, de groupes populaires, de mouvements étudiants et féministes, etc. D’emblée, le PQ se présente comme un parti ayant un « préjugé favorable » pour les travailleurs et travailleuses. Au début du mandat effectivement, des réformes sont mises en place, dans le domaine du travail (la loi 45 interdisant l’utilisation de scabs), de la protection des consommateurs (mise en place d’un système public d’assurance-automobile), du monde rural (zonage agricole) et bien sûr, la loi 101 dont le but est de faire du français la langue dominante. Dès la fin des années 1970, le PQ remplit sa promesse de tenir un referendum sur l’avenir du Québec, d’où le projet de « souveraineté-association », qui débouche sur le vote de 1980. Les organisations populaires sont interpellées : faut-il participer à cette stratégie ? De quelle manière ? N’y a-t-il pas un risque d’être instrumentalisés dans une lutte entre élites ?
Les divisions de la gauche
Après plusieurs années de mobilisation et d’organisation populaire, les militants et les militantes de gauche sont dans une situation précaire. Des fractures sévères éparpillent la gauche entre plusieurs tendances. Dans la lignée de Charles Gagnon, une gauche dite « marxiste-léniniste » (ou « ML ») est structurée autour du groupe En Lutte ! et plus tard, du Parti communiste ouvrier. Grands rivaux pour s’imposer comme LE parti révolutionnaire, ces formations politiques s’entendent cependant pour décrier non seulement le PQ, mais l’idée même de la souveraineté, selon En Lutte ! :
Le prolétariat du Québec doit savoir qu’il n’a rien à gagner à flirter avec le mouvement indépendantiste québécois dont les intérêts fondamentaux sont anti-ouvriers ; le prolétariat du Québec doit reconnaître pleinement que son avenir réside dans la révolution socialiste et que celle-ci n’est possible que dans l’unité des forces ouvrières et populaires du Canada tout entier[3].
Jusqu’au référendum de 1980, les groupes « ML » mènent campagne contre le projet du PQ en prônant l’abstention ou l’annulation lors du referendum :
Nous ne militons pas en faveur de la séparation du Québec parce qu’elle nuirait à la cause révolutionnaire du prolétariat en le divisant face à la bourgeoisie canadienne, notre ennemi principal, et en affaiblissant notre peuple face aux visées hégémoniques des deux superpuissances. (…) Le PQ, parti bourgeois anti-ouvrier, n’est pas le défenseur conséquent de la nation québécoise. Il doit être combattu pour ce qu’il est : un parti nationaliste bourgeois pour qui les intérêts de classe priment sur les intérêts nationaux[4].
L’influence de ces groupes est réelle auprès de segments du mouvement populaire qui cherchent un projet qu’ils espèrent « authentiquement révolutionnaire » autour d’un projet totalement défini. L’indépendance, selon cette vision, est une terrible tromperie qui risque de fragmenter le Canada et de le rendre plus vulnérable à l’influence des États-Unis. La révolution prolétarienne canadienne, par ailleurs, reconnaîtra le droit à l’autodétermination du peuple québécois.
Après la défaite du « oui » cependant, une crise larvée éclate parmi ces groupes qui entrent alors dans une période de déclin irrésistible[5]. Le PCO se dissout en 1983, précédé d’En Lutte ! en 1982. Certes, il serait simpliste d’attribuer le déclin des « ML » à leur position extrême sur la question nationale, puisque plusieurs autres éléments ont déclenché cette crise terminale (la place des femmes dans l’organisation, le style de fonctionnement quasi-militaire, une pensée caractérisée par la « ligne juste » envers et contre tout, etc.).
Socialisme et indépendance
Si les « ML » en mènent large à la fin des années 1970, ils ne constituent pas le seul courant dominant dans le mouvement populaire. Des réseaux pluralistes agissent dans les mouvements populaires et expriment la continuité de l’option « socialisme et indépendance » élaborée dès les années 1960. Cette option continue l’opération politique et intellectuelle entreprise par divers mouvements comme le Parti socialiste du Québec et le Mouvement de libération populaire, les revues Parti Pris et Révolution québécoise. L’idée est de mener une lutte de libération nationale contre le colonialisme et le capitalisme[6]. Au bout de la ligne, la majorité de cette génération militante finit par accepter l’idée que l’indépendance du Québec est une condition préalable à l’émancipation sociale et se rallie au PQ. C’est ce qu’exprime Jean-Marc Piotte à l’époque :
On peut définir le courant Lévesque comme social-démocrate, et, entre la social-démocratie et le néo-capitalisme, la marge est plus qu’étroite. Mais il faut voir aussi le progrès que marque Lévesque par rapport au parti libéral et à l’UN (…) Et, plus important, une large fraction des masses les plus politisées et les plus conscientes suivent Lévesque (…) Se situer hors du mouvement Lévesque, c’est se condamner à être marginal, sans aucune prise réelle sur les événements, sur les masses populaires. C’est se condamner à créer une autre petite secte qui éclatera au bout de quelques années[7].
Cependant, toutes les personnes impliquées dans la gauche intellectuelle et militante de l’époque ne sont pas d’accord
L’initiative du mouvement indépendantiste est momentanément passée à ces petits bourgeois qui sont motivés par des intérêts de classe immédiats. La domination économique croissante des Américains sur le Québec, les limites à leur liberté politique qu’entrainent cette domination, et le pouvoir centralisateur d’Ottawa réduisent leur rôle et leur pouvoir à presque rien. Incapable de s’attaquer à la puissance économique yankee, convaincue même de pouvoir s’en passer, la bourgeoisie indépendantiste québécoise (…) ne rêve plus qu’à se débarrasser de cet intermédiaire constitué par la bourgeoisie anglo-saxonne de Montréal et de Toronto[8].
Plus tard, cette thématique évolue sous l’influence de mouvements radicalisés voulant toujours lier l’émancipation sociale à l’émancipation nationale, avec une certaine emphase sur le premier terme de l’équation (tels le Front de libération populaire, les Comités d’action politique du FRAP, la revue Mobilisation et même une fraction du Front de libération du Québec). Même d’autres groupes continuent d’argumenter en faveur d’une indépendance par et pour les travailleurs :
Il n’y a qu’une seule solution possible : que le peuple québécois sous la direction des travailleurs organisés renverse la domination impérialiste, libère les forces productives de l’emprise du capital nord-américain et prenne collectivement le contrôle de la richesse sociale. Le nationalisme déplace les problèmes en insistant sur les aspects ethniques et culturels de la domination étrangère : « C’est la faute aux Anglais ! C’est contre Ottawa qu’il faut se battre ! ». Alors qu’en réalité les responsables étaient et sont encore avant tout capitalistes, anglais autrefois, surtout américains aujourd’hui. Pour le faire, d’abord libérer nos consciences, changer notre mentalité individualiste pour une solidarité et une conscience claire des intérêts communs de la classe ouvrière (…) Nous rendre capables de reprendre en mains nos moyens de production, notre sol, nos ressources naturelles, en somme, l’ensemble de notre richesse sociale[9].
À la veille du référendum de 1980, des centrales syndicales comme la CSN et la CEQ (l’ancêtre de la CSQ), des mouvements communautaires et étudiants, et des organisations de gauche tels le Regroupement pour la socialisme (RPS), le Groupe socialiste des travailleurs (GST) et le Groupe marxiste révolutionnaire (GMR)[10] convergent pour à la fois se distancier du PQ qui est pour eux un « parti bourgeois », tout en proclamant la nécessité d’une indépendance par et pour le peuple :
Nous sommes indépendantistes parce que l’oppression de la nation québécoise constitue un problème social majeur dont la solution ne peut être trouvée dans le cadre du système fédéral canadien (…) Dans ce contexte, les classes populaires francophones frappées à la fois par l’exploitation capitaliste, par le sous-développement régional et par l’oppression nationale se trouvent à constituer une force potentielle de changement social stratégique[11].
Pour plusieurs syndicalistes de gauche de l’époque :
Il est important de soustraire les travailleurs de l’influence du PQ. Ceci implique une lutte idéologique dans le but de dégager la portée réelle de la lutte nationale et la nécessité d’une hégémonie des travailleurs organisés dans cette lutte. Renforcer la lutte nationale, c’est s’attaquer à l’ennemi principal dans lutte nationale et à des ennemis dans la lutte anticapitaliste. C’est lier ensemble lutte de classe et lutte nationale comme condition de développement de l’organisation politique autonome des travailleurs[12].
Dans le contexte du référendum de 1980, ces courants de gauche pro-indépendance ont font campagne pour un « oui critique », ce qui veut dire oui à la question posée concernant l’accession à la souveraineté, et critique à l’endroit du PQ :
Le défi de la bourgeoisie québécoise est réaménager son espace dans le capitalisme nord-américain. Le PQ espère trouver un partenaire prêt à élaborer un fédéralisme renouvelé tout en lui donnant plus de pouvoir (…) Au contraire, l’indépendance sera le moment d’un nouveau rapport de forces, d’une brèche dans le système de domination capitaliste en Amérique du Nord (…) L’indépendance préconisée par le mouvement ouvrier québécois implique l’élaboration d’une stratégie anti-impérialiste et anticapitaliste à l’échelle continental.
Plus encore :
Notre appui à l’indépendance est un aspect de la lutte politique pour le socialisme, c’est une position de démarcation sans équivoque avec le nationalisme, car nous sommes conscients que les intérêts des travailleurs sont antagoniques à ceux de la bourgeoisie et de toute autre force sociale qui préconise une « autre voie » que le socialisme, ce qui conduirait le Québec à s’intégrer d’une nouvelle manière dans le système capitaliste mondial[13].
Par rapport au PQ, la gauche indépendantiste précise que :
Les projets qu’il véhicule tant sur la question sociale et économique que sociale, sont colorés et déterminés par sa volonté de construire un bloc social, une alliance de classe, dans lesquels la première place revient au capital, la seconde aux petites-bourgeoisies de couches supérieures et la troisième seulement aux classes populaires. Cela signifie que le gouvernement du PQ sacrifie les classes populaires chaque fois qu’il est impossible de leur faire des concessions sans heurter en même temps les capitalistes de la petite et de la moyenne entreprise[14].
Après la défaite du référendum de 1980, la tendance « indépendance et socialisme », comme les autres groupes de gauche connaîtra un déclin[15]. Ce déclin est la conséquence de plusieurs facteurs dont une certaine démobilisation temporaire des mouvements populaires, le désarroi idéologique reliée au collapse des groupes marxistes et du socialisme «réellement existant» et à d’autres facteurs importants qui méritent d’être étudiés mais qui ne sont pas l’objet de cette publication
Une revue et un projet
Face à cette évolution, de jeunes intellectuels, pour la plupart professeurs à l’UQAM, décident à la fin des années 1970 de reprendre un certain nombre de débats plus ou moins mis de côté depuis la disparition de la revue Parti Pris, dont l’influence a été importante entre 1963 et 1968. D’ailleurs, un certain nombre de rédacteurs de Parti Pris se retrouve dans les Cahiers du socialisme. D’emblée, la question nationale, dans le contexte du référendum annoncé, devient un des thèmes privilégiés. De concert avec divers secteurs du mouvement populaire et des réseaux de gauche indépendantes, la revue s’acharne à décortiquer la nature du bloc de classe qu’essaie de construire le PQ, de manière à s’en distinguer et à proposer un projet contre-hégémonique enraciné dans la société et dans ses luttes. À cette époque, plusieurs professeurs des départements de sciences sociales de l’UQAM sont engagés dans une réflexion critique et pédagogique, pour poursuivre une rigoureuse analyse théorique d’une part, et traduire celle-ci d’une manière à interpeller une partie importante de la gauche et du mouvement populaire, ce qui fait que les textes ne sont pas contraints à la forme académique en usage.
Ce qu’on retrouve dans le recueil
Le premier texte provient du numéro de lancement des Cahiers (par Gilles Bourque) et tente de mettre sur la table un certain nombre d’hypothèses concernant le fait national. Pour Bourque, la nation n’est pas une réalité intangible et éternelle, mais un processus marqué par la lutte des classes. Le tout doit être historicisé à travers les luttes traversant l’espace canadien et québécois depuis 1945 (comme l’explique Dorval Brunelle). Par la suite, les rédacteurs des Cahiers tentent d’expliquer le « phénomène » du PQ à travers les rapports de classe (Levasseur et Lacroix), la gestion du pouvoir (Niosi, Piotte et Dostaler), et la composition des groupes sociaux au coeur du projet péquiste (Bourque et Légaré). Cette analyse est poursuivie dans d’autres textes qui analysent la stratégie des dominants (le collectif du Centre de formation populaire) et la nature du projet libéral-fédéraliste (Brunelle). Le tout constitue un bon aperçu des débats, travaux et recherches en cours à cette époque de démarcation. L’échec du référendum de 1980, suivi du détournement du PQ vers la gestion néolibérale et l’abandon du projet de souveraineté (la politique dite du « beau risque » consistant à appuyer le gouvernement conservateur à Ottawa), mettra un terme temporaire à ces explorations, du moins jusque dans les années 1990, ce qui explique sans doute la dislocation du projet des Cahiers.
Aujourd’hui, la tradition des Cahiers continue sous la forme des Nouveaux Cahiers du socialisme.
- « Présentation », Les Cahiers du socialisme, numéro 1, 1978, p. 2. ↑
- Richard Poulin, « Des revues engagées, Cahiers du socialisme, Critiques socialistes et Nouveaux Cahiers du socialisme », Bulletin d’histoire politique, volume 19, numéro 2, hiver 2011. ↑
- 11 Marc Ferland et Yves Vaillancourt, Socialisme et indépendance au Québec, Éditions Albert Saint-Martin, 1981, pages 62-63.En Lutte !, Pour l’unité du prolétariat canadien, publié par En Lutte !, avril 1977, page 27. ↑
- Document d’entente politique pour la création de la Ligue communiste (marxiste-léniniste) du Canada, novembre 1975. ↑
- David Milot et al., « Histoire du mouvement marxiste-léniniste au Québec 1973-1983 », Bulletin d’histoire politique du Québec, volume 13, numéro 1, automne 2004. ↑
- Lucille Beaudry, « Le marxisme au Québec: une hégémonie intellectuelle en mutation (1960-1980). » publié dans l’ouvrage sous la direction de Lucille Beaudry, Christian Deblock et Jean-Jacques Gislain, Un siècle de marxisme. Les Presses de l’Université du Québec, 1990. ↑
- Jean-Marc Piotte, « Lettre à une militante », Partis Pris, volume 5, numéro 8, été 1968. ↑
- Charles Gagnon, « Proposition pour la révolution nord-américaine », été 1968, reproduit dans Charles Gagnon, Feu sur l’Amérique, Écrits volume un 1966-72, Lux Éditeur, 2006 ↑
- CAP Maisonneuve et Cap Saint-Jacques, La nécessité d’une organisation politique des travailleurs, avril 1972 ↑
- Ces deux derniers se réclamant de l’héritage de la Quatrième Internationale ↑
- Marc Ferland et Yves Vaillancourt, Socialisme et indépendance au Québec, Éditions Albert Saint-Martin, 1981, pages 62-63. ↑
- Bernard Normand et Victor Lapalme, Travailleurs québécois et lutte nationale, Document de travail de la CEQ, janvier 1973, p. 71. ↑
- CFP, La question nationale, un défi à relever pour le mouvement ouvrier, mai 1978. ↑
- Yves Vaillancourt avec la collaboration d’Annie Antonès, Le PQ et le social, éléments de base des politiques sociales du gouvernement du Parti Québécois, 1976-1982, Éditions Saint-Martin, 1983. ↑
- Le Regroupement pour le socialisme, le Mouvement socialiste (créé en 1980 par Marcel Pepin) et le Groupe socialiste des travailleurs seront tous dissous. Voir à ce sujet Pierre Beaudet, « La radicalisation des mouvements sociaux dans les années 1970, Bulletin d’histoire politique, « La gauche au Québec depuis 1945 », volume 19, no 2, automne 2010. Les raisons complexes de ce déclin seront développées dans un autre cahier de la collection. ↑

LES CAHIERS, LES REVUES, LA CONJONCTURE – Les Cahiers du socialisme (1981)

Les Cahiers du socialisme sont une revue publiée à Montréal de 1978 à 1984. D’abord centrée autour du nationalisme de gauche, la revue s’oriente davantage vers le socialisme à partir du numéro 7 puis vers les questions internationales et culturelles dans les derniers numéros, avant de cesser sa publication à la suite du numéro 16. La revue est animée principalement par des professeur.es du département de sociologie de l’UQAM et a le statut de revue scientifique malgré qu’elle délaisse souvent l’analyse au profit du positionnement politique. La revue se dissocie des organisations d’extrême-gauche comme des partis politiques et des syndicats, se voulant un lieu d’analyse indépendant, mais se lie de fait à des groupes socialistes. Les articles les plus pertinents de la revue restent d’ailleurs ceux de la « période socialiste » des Cahiers, qui sont les plus engagés et les plus significatifs politiquement.
Faisant le bilan de son parcours ainsi que de l’état des publications de gauche au tournant des années 1980, les Cahiers du socialisme publient dans le numéro 8 (automne 1981) un éditorial critique traitant ces questions. La revue est alors en repositionnement théorique et cherche à évaluer son rôle dans l’univers des publications radicales au Québec, cherchant notamment à être moins académique et plus attentive à la lutte des classes. Nous republions ici cet éditorial qui offre à la fois une présentation des groupes et des publications de gauche actifs dans les années 1970 ainsi que l’appréciation critique des Cahiers vis-à-vis de ceux-ci. L’éditorial offre ensuite un aperçu du projet politique défendu par la revue, à savoir un socialisme devant mener le Québec à l’indépendance.
Notons enfin que les Cahiers du socialisme ont une postérité littéraire dans la revue des Nouveaux cahiers du socialisme (publiés depuis 2009) qui se réclament directement des Cahiers des années 1980. Les idées des premiers Cahiers sont aussi reprises par Québec Solidaire, qui reconduit donc certaines apories présentes dans la revue. Le parti politique reste aux prises avec la contradiction interne du « réformisme socialisant » en régime capitaliste, avec le rôle contradictoire des syndicats – collaborant avec le patronat – dans la lutte pour le socialisme ou encore avec le problème du dépassement du nationalisme québécois puisque celui-ci se base sur une souveraineté coloniale inconciliable avec les droits des peuples autochtones. Cette convergence des idées entre Cahiers des années 1980, Nouveaux cahiers du socialisme et Québec Solidaire est très perceptible dans le présent éditorial de 1981.
Les Cahiers, les revues, la conjoncture
Par Pierre Milot et Jean-Guy Lacroix (pour le Comité de rédaction)
La problématique « indépendance et socialisme » avait, dans les années 60, regroupé les progressistes autour de la revue Parti Pris ; dans une moindre mesure la revue Socialisme (devenue par la suite Socialisme Québécois) avait joué un certain rôle dans l’élaboration et la diffusion de cette problématique.
Avec l’éclatement de Parti Pris et le passage d’une partie de ses collaborateurs au PQ, avec les « évènements d’Octobre » et leurs conséquences pour l’ensemble du mouvement ouvrier et populaire, avec le développement du courant contre-culture endigué au sein de la revue Mainmise au début des années 70, la problématique « indépendance et socialisme » s’est progressivement canalisée dans l’appareil péquiste tout en s’élaguant de ses postulats fondamentaux (et plus particulièrement ceux concernant la question du socialisme).
Ce processus devait s’accélérer avec l’arrivée de la presse marxiste-léniniste (La Forge, En Lutte !, etc.) qui mettait de l’avant le projet d’un socialisme canadien, reléguant la question nationale dans les abîmes du nationalisme bourgeois. C’est ainsi que des revues comme Mobilisation et le Bulletin populaire en vinrent à adopter la conception d’un socialisme pan-canadien, la question nationale devenant une « contradiction secondaire » selon la grille d’analyse maoïste appliquée par les « m-l » canadiens, au milieu des années 70.

Il faut se rappeler qu’en 1972, lorsque Charles Gagnon publia « Pour le Parti Prolétarien » (brochure qui donna naissance au groupe En Lutte !), il y était question de socialisme québécois : ce n’est qu’en 1974, au moment où en En Lutte ! s’ajusta à la politique extérieure chinoise des « trois mondes » que la thèse du socialisme canadien fut mise de l’avant. Puis en 1975 avec l’arrivée de la Ligue Communiste (marxiste-léniniste) du Canada (qui donnera naissance au PCO), la défense de l’indépendance nationale… du Canada sera lancée comme mot d’ordre : la Ligue ira même jusqu’à proposer l’appui des marxistes-léninistes à l’augmentation du budget militaire du gouvernement fédéral ! L’application de la « théorie des trois-mondes » au Canada avait donc produit l’équation suivante : il faut défendre l’indépendance nationale du Canada, pays du « second monde », contre l’impérialisme américain (pays du « premier monde »), et par conséquent s’opposer à toute déstabilisation de la structure canadienne par la question nationale1.
Les thèses « m-l » eurent une influence considérable parmi certaines revues socio-culturelles de cette époque. C’est ainsi qu’entre 1977 et 1978 deux revues (Stratégie et Champs d’application) se sont littéralement sabordées pour se mettre « au service du prolétariat canadien » (i.e. rallier les rangs de la Ligue ou d’En Lutte !), tandis que Chroniques s’est dissoute suite à une longue polémique avec Stratégie et Champs d’application à propos du réalisme socialiste et du marxisme-léninisme sur le front culturel.
 Documents divers de l’organisation En Lutte ! (1972-1982) et d’autres groupes marxistes-léninistes.
Documents divers de l’organisation En Lutte ! (1972-1982) et d’autres groupes marxistes-léninistes.
Bien que la revue Possibles aie publié depuis 1976 quelques numéros où soufflait la brise d’un nationalisme autogestionnaire bien éloigné de la bourrasque « m-l », il faudra attendre 1978 et la parution du Temps fou, d’Interventions critiques en économie politique et des Cahiers du socialisme pour voir réapparaître un certain type de questionnement sur les formes de transition au socialisme, la nature de classe du projet péquiste, de même qu’une redéfinition des stratégies de résistance basées sur les groupes autonomes et les alternatives régionales (dont la revue Focus du Saguenay-Lac-Saint-Jean est un reflet actif).
Si Le Temps fou palliait à un manque au niveau de la « critique de la vie quotidienne », les Cahiers quant à eux répondaient à un « vide théorique » dû au rabaissement de la question nationale par le pouvoir péquiste et à la réduction dogmatique du socialisme par l’orthodoxie marxiste-léniniste.
Avec l’avènement des années 80 et « l’impasse » causée par les résultats du référendum, c’est à une restructuration des forces progressistes que l’on assiste : la problématique « indépendance et socialisme » revient en filigrane mais à partir de postulats nouveaux axés sur la critique des pratiques politiques antérieures. C’est ainsi que la publication du mensuel Presse-libre, au début de l’année dernière, est venue soulever un fond d’air frais parmi les militants syndicaux et les membres des groupes populaires.
D’autre part, bien des choses ont « évolué » dans la presse « m-l », et plus particulièrement au sein du journal En Lutte ! qui a innové en instituant dans ses pages une chronique (plus ou moins régulière) sur les « Débats au sein de la gauche ». En fait, cette chronique à surtout servi de tentative de rapprochement avec la gauche socialiste québécoise : c’est dans cette optique qu’ont été analysés les livres de Bourque-Dostaler (« Socialisme et indépendance »), de Dézy-Ferland-Lévesque-Vaillancourt (« La conjoncture au Québec… »), de même que le recueil collectif « L’impasse » (sous la direction de Laurin-Frenette et Léonard). En parallèle à cette démarche qui a toutes les allures d’une opération tactique de survie politique, le journal En Lutte ! s’est lancé dans la publication de « Documents pour la critique du révisionnisme », où l’on se pose de « sérieuses questions » sur Staline, les années 30 en URSS et sur les « erreurs » de la IIIe Internationale ! Au printemps dernier, le journal annonçait la faillite d’En Lutte ! dans sa tentative de reconstruction d’une nouvelle Internationale monolithique (programme et statuts communs, etc.), et un article récent proposait l’hypothèse qu’En Lutte ! abandonne son projet de parti prolétarien et se réorganise à la façon du groupe italien Lotta Continua. Un débat intéressant à suivre pour la gauche socialiste québécoise, mais qui laisse perplexe à bien des égards. Quant au PCO, mieux implanté dans les syndicats, il poursuit une démarche moins dogmatique qui le démarque peu à peu du maoïsme d’antan.
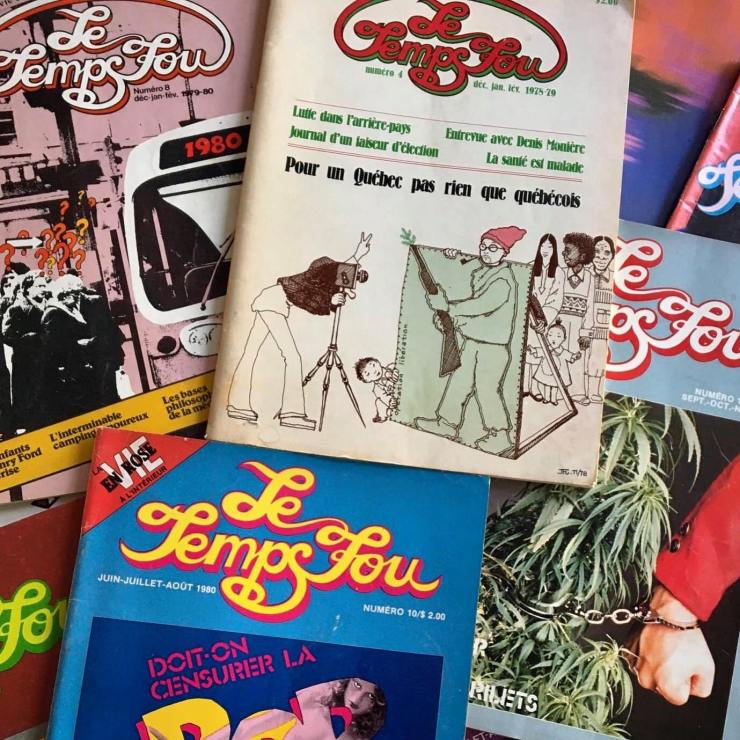 Quelques numéros de la revue Le Temps fou (1978-1983).
Quelques numéros de la revue Le Temps fou (1978-1983).
C’est dans ce bouillonnement des nouvelles pratiques politiques et culturelles que les Cahiers du socialisme entendent s’inscrire dans les mois et les années à venir : déjà l’éditorial du numéro 7 (hiver-printemps 81) avait posé les balises d’une certaine relance de la revue à partir d’un socle moins académique et plus près de la mouvance des alternatives actuelles.
La « crise du marxisme » engendrée par les pratiques politiques des pays du « socialisme réel », le rejet de certaines formes organisationnelles hyper-centralisées par le mouvement féministe, ont entraîné la remise en question des relations parti-syndicats (l’exemple polonais n’a plus à être rappelé) et des rapports hiérarchiques hommes-femmes (les scissions provoquées par des femmes au sein d’organisations politiques en témoignent). La question nationale québécoise et la lutte des Autochtones ne constituent pas une problématique séparée, et c’est à ce titre que les Cahiers entendent s’interroger et débattre par des textes théoriques de fond, des analyses conjoncturelles et des dossiers thématiques.
C’est donc la conjoncture actuelle qui a déterminé l’objectif de la transformation des Cahiers, c’est-à-dire faire de la revue un instrument de réactualisation de la problématique « indépendance et socialisme » et montrer la nécessité du projet de société qui en découle. Il s’agit en somme de faire des Cahiers un outil de discussion s’inscrivant dans la convergence présente d’initiatives militantes (le Regroupement des militants pour le socialisme, le Comité des 100, le Centre de Formation Populaire, etc.), dans une ouverture à une pluralité de gauche.
Cette perspective « ouverte » vise à assurer que dans cette effervescence d’idées se développe un projet unifié de société par l’enrichissement des diverses propositions et non pas par un réductionnisme auquel conduirait une démarcation par la négative et le ralliement à un dogme, tel que nous l’a montré la « lutte pour l’unité » des « m-l » canadiens par le passé.
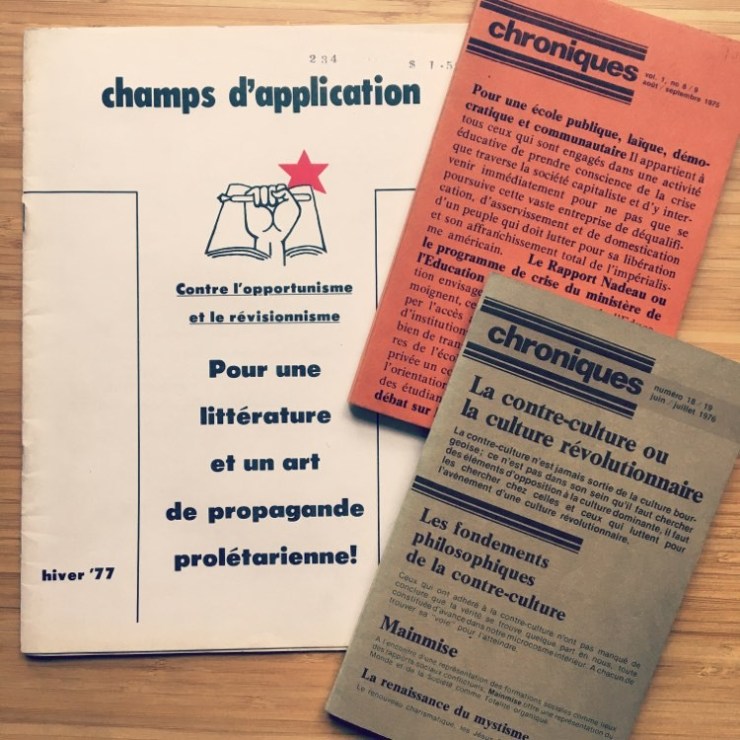 Quelques numéros des revues Champs d’application (qui se saborde au profit de l’organisation En Lutte !) et Chroniques (1975-1977).
Quelques numéros des revues Champs d’application (qui se saborde au profit de l’organisation En Lutte !) et Chroniques (1975-1977).
La conjoncture actuelle semble se caractériser par la démarcation positive, la mise en lumière des points de rapprochement. On peut même affirmer qu’émerge, sur la base des leçons tirées de l’expérience politique des pratiques militantes antérieures, un mouvement de convergence de la gauche socialiste québécoise autour du projet « socialisme et indépendance » (il faut noter qu’ici l’inversion des termes n’est pas qu’une simple nuance sémantique mais un effet politique qui postule un objectif stratégique).
L’idée que le projet alternatif de société doit intégrer conjointement socialisme ET indépendance est de plus en plus partagée, par rapport à l’ancienne tactique de l’indépendance d’abord, le socialisme ensuite.
Les dix dernières années ont été déterminantes dans l’évolution de cette analyse historique. D’une part la vague « m-l », malgré sa relative importance, n’a pas conduit à une unification populaire dans un projet de société, d’autre part la gestion sociale péquiste, avec son lot de désillusions chez les militants des syndicats et des groupes populaires, a fait en sorte que malgré son accession au pouvoir et sa réélection le PQ n’a pu imposer au peuple québécois son projet de Souveraineté-Association.
L’actuel mouvement de convergence, au sein de la gauche socialiste québécoise, cherche à lever l’obstacle historique que constituait pour le peuple québécois la traditionnelle division de l’indépendance et du socialisme, division faisant du socialisme une question séparée de l’indépendance. C’est ce postulat qui a fait que les organisations de gauche ont toutes trébuché sur la question nationale par le passé. Avec pour conséquence que ni le vieux PCC (Parti Communiste Canadien), ni le NPD (Nouveau Parti Démocratique), ni les « m-l » canadiens n’ont réussi à véritablement s’implanter au Québec et à être légitimé par les couches populaires et ouvrières québécoises. À l’inverse, le nationalisme « traditionnel » comme le nationalisme « moderne » de la Révolution tranquille et de la Souveraineté-Association n’ont jamais intégré les revendications ouvrières et populaires que pour les détourner de leurs objectifs propres, au nom de la Nation. Le peuple québécois s’est toujours tôt ou tard détaché de ces mouvements et partis politiques : c’est ce que montre la « rupture populaire » avec le duplessisme, avec la Révolution tranquille, et c’est ce qui pend au nez du PQ qui, le sachant fort bien, tente de raviver la flamme (même celle « de gauche » !) de ses adhérents par un appel à la survie de la communauté nationale.
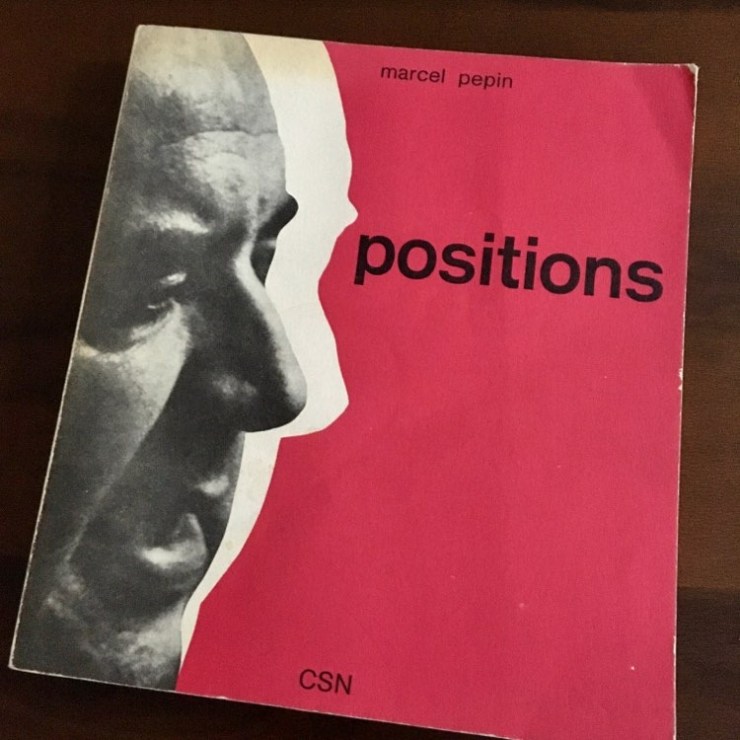 Marcel Pepin (1926-2000), président de la Confédération des Syndicats Nationaux (CSN) de 1965 à 1976, instigateur du Comité des 100 et de leur manifeste puis fondateur du Mouvement Socialiste du Québec en 1981.
Marcel Pepin (1926-2000), président de la Confédération des Syndicats Nationaux (CSN) de 1965 à 1976, instigateur du Comité des 100 et de leur manifeste puis fondateur du Mouvement Socialiste du Québec en 1981.
La question nationale doit être abordée nécessairement et prioritairement par le point de vue des couches ouvrières et populaires : c’est le projet socialiste qui doit donner tout son sens à la revendication d’indépendance. Cette échappée interdit donc de penser une quelconque fraction de la bourgeoisie québécoise comme un allié ou d’imaginer accorder une nouvelle « chance au coureur ». Ce projet socialiste ne pourra s’élaborer qu’en solidarité avec les peuples autochtones et les travailleurs immigrés.
Mais doit-on considérer que la problématique « socialisme et indépendance » constitue le seul axe du projet alternatif ? N’y a-t-il pas d’autres composantes de réflexion et de revendications qui doivent se fusionner dans ce projet et ainsi enrichir cette alternative de société par les solidarités multiples bien qu’autonomes ? Comme nous le mentionnions plus haut, la question des femmes constitue un élément fondamental de questionnement des pratiques politiques passées. Cette attitude témoigne d’une rupture avec l’analyse dogmatique qui centre toute sa théorisation et sa stratégie autour d’une « contradiction principale » sous laquelle sont subsumées toutes les « contradictions secondaires », au fur et à mesure qu’elles surgissent ou resurgissent dans un contexte donné.
Proposer que la revue soit un instrument de débat concerne donc en premier lieu l’interrogation sur l’identification et l’articulation des axes structuraux de socialisme comme processus de rupture du capitalisme, ce qui implique une analyse historique des sociétés dites socialistes, les pays du « socialisme réel ».
Il faudra chercher à saisir la signification des pratiques politiques nouvelles, les analyser, les critiquer, en révéler les contradictions, témoigner de leur existence. Bref, faire place à la pratique sociale tout en travaillant à la théorie de cette pratique.
Le Comité de rédaction compte annoncer à l’avance la thématique de certains numéros à venir, de sorte que des dossiers puissent être montés à partir de groupes ou d’individus œuvrant dans divers champs : ainsi le numéro 9 devrait simultanément faire appel à des témoignages provenant des différents fronts de lutte (question nationale, mouvement féministe, lutte des Autochtones et des immigrants, groupes populaires, etc.) à partir de la thèse présentée ici d’un mouvement de convergence de la gauche socialiste québécoise.
Les changements annoncés dans l’éditorial du numéro 7 sont en cours. Le présent texte en témoigne de même que l’élargissement du Comité de rédaction. D’autres transformations sont à venir au niveau d’une meilleure distribution de la revue à Montréal et dans les régions du Québec.

Notes :
[1] Sur cette thèse, voir MILOT, Pierre, « Le schisme Chine-Albanie et le mouvement marxiste-léniniste canadien », in Les Cahiers du socialisme, no. 6, automne 1980.

Crise climatique. Les données montrent que le point de basculement de la forêt amazonienne est imminent

Selon des données, l’Amazonie s’approche d’un point de basculement, après quoi la forêt tropicale disparaîtrait, ce qui aurait des conséquences «profondes» pour le climat mondial et la biodiversité.
Des modèles informatiques avaient déjà indiqué qu’un dépérissement massif de l’Amazonie était possible, mais la nouvelle analyse se fonde sur des observations satellitaires réelles effectuées au cours des trois dernières décennies.
Une nouvelle analyse statistique montre que plus de 75% de la forêt vierge a perdu sa stabilité depuis le début des années 2000, ce qui signifie qu’elle met plus de temps à se rétablir après les sécheresses et les incendies.
La perte de stabilité la plus importante se situe dans les zones proches des exploitations agricoles, des routes et des zones urbaines et dans les régions qui deviennent plus sèches, ce qui suggère que la destruction des forêts et le réchauffement climatique en sont la cause. Ces facteurs «pourraient déjà avoir poussé l’Amazonie près d’un seuil critique de dépérissement de la forêt tropicale», concluent les scientifiques.
***
L’étude ne permet pas de prédire quand le point de basculement pourrait être atteint. Mais les chercheurs ont prévenu que lorsque le déclenchement du point de basculement pourrait être détecté, il serait trop tard pour l’arrêter.
Une fois déclenchée, la forêt tropicale se transformerait en prairie en quelques décennies tout au plus, libérant d’énormes quantités de carbone et accélérant encore le réchauffement de la planète.
Les points de basculement à l’échelle planétaire font partie des plus grandes craintes des climatologues, car ils sont irréversibles à l’échelle humaine de temps. En 2021, la même technique statistique a révélé des signes avant-coureurs de l’effondrement du Gulf Stream et d’autres courants clés de l’Atlantique, avec «une perte presque totale de stabilité au cours du siècle dernier».
Un arrêt de ces courants aurait des conséquences catastrophiques dans le monde entier, perturbant les pluies de mousson et mettant en danger les calottes glaciaires de l’Antarctique.
Une autre étude récente a montré qu’une partie importante de la calotte glaciaire du Groenland est sur le point de basculer, ce qui entraînerait une hausse du niveau de la mer de 7 mètres à terme.
***
«De nombreux chercheurs avaient élaboré théoriquement qu’un point de basculement amazonien pourrait être atteint, mais notre étude fournit des preuves empiriques essentielles que nous nous approchons de ce seuil», a déclaré le professeur Niklas Boers, de l’Université technique de Munich (Technische Universität München) en Allemagne. «Voir une telle perte de résilience dans les observations est inquiétant. La forêt amazonienne stocke d’énormes quantités de carbone qui pourraient être libérées en cas de dépérissement même partiel.
Les scientifiques ont déclaré que le dépérissement de l’Amazonie avait «de profondes implications à l’échelle mondiale». Niklas Boers a ajouté: «L’Amazonie est certainement l’un des éléments les plus rapides de ces éléments de basculement dans le système climatique.»
Les recherches, publiées dans la revue Nature Climate Change, ont établi sur la base des données satellitaires un bilan de la quantité de végétation dans plus de 6 000 cellules de quadrillage à travers l’Amazonie vierge de 1991 à 2016. Ils ont constaté qu’au cours des 20 dernières années, les zones touchées par des sécheresses ou des incendies ont mis beaucoup plus de temps à se rétablir qu’auparavant. C’est un signe clé d’une instabilité croissante, car cela montre que les processus de restauration s’affaiblissent.
Les zones sèches de la forêt ont perdu plus de stabilité que les zones humides. «Ce constat est alarmant, car les modèles du GIEC [Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat] prévoient un assèchement général de la région amazonienne en réponse au réchauffement climatique», a déclaré Niklas Boers.
Les zones les plus proches de la destruction de la forêt par l’homme sont également devenues plus instables. Les arbres sont essentiels à la production de pluie, et leur abattage pour dégager des terres pour l’élevage et la production de soja crée un cercle vicieux de conditions plus sèches et de pertes d’arbres supplémentaires.
***
Une autre étude réalisée en 2021, fondée sur les données de centaines de vols de petits avions, a montré que l’Amazonie émet désormais plus de dioxyde de carbone qu’elle n’en absorbe, principalement à cause des incendies.
Mais Niklas Boers a déclaré que les données indiquaient que le point de basculement n’avait pas encore été franchi: «Il y a donc de l’espoir». Le professeur Tim Lenton, de l’université d’Exeter au Royaume-Uni, coauteur de l’étude, a déclaré: «Cette étude soutient les efforts visant à inverser la déforestation et la dégradation de l’Amazonie pour lui redonner une certaine résilience face au changement climatique en cours.»
Chris Jones, du Met Office Hadley Centre au Royaume-Uni, qui ne fait pas partie de l’équipe de l’étude, a déclaré: «Cette recherche ajoute des preuves irréfutables que le changement climatique est un risque actuel, et que ces impacts graves et irréversibles pourraient devenir une réalité. Nous disposons d’une fenêtre d’opportunité étroite pour prendre des mesures urgentes.»
***
«La conclusion inquiétante [de l’étude] correspond à d’autres recherches récentes sur l’augmentation de la mortalité des arbres, la multiplication des incendies et la réduction des puits de carbone régionaux. Le rapport du GIEC, publié la semaine dernière [voir le résumé sur ce site publié le 5 mars], estime que «les risques d’événements singuliers de grande ampleur, tels que le dépérissement de l’Amazonie, sont plus proches que jamais.»
Bernardo Flores, de l’Université fédérale de Santa Catarina au Brésil, a déclaré: «L’étude montre que même si la forêt semble aller bien, avec sa structure et sa biodiversité normales, les processus internes sont déjà en train de changer, silencieusement, réduisant la capacité du système à persister à long terme. L’approche utilisée est intéressante car elle révèle des signaux d’alerte précoces de ces changements.» Les recherches de Bernardo Flores ont révélé que les savanes s’étendaient au cœur de l’Amazonie à cause des feux de forêt.
Le gouvernement du président brésilien, Jair Bolsonaro, a été sévèrement critiqué pour avoir encouragé la déforestation, qui a augmenté de 22% au cours de l’année écoulée jusqu’en novembre 2021, soit le niveau le plus élevé depuis 2006.
Niklas Boers a déclaré: «Il est vraiment compliqué de dire ce qui arrivera en premier: atteindre un point de basculement par [perte de stabilité] du système de végétation naturelle, ou simplement l’arrivée des bulldozers qui détruisent la forêt.» (Article publié dans The Guardian, en date du 7 mars 2022; traduction rédaction de A l’Encontre)
Damian Carrington est rédacteur responsable pour la rubrique environnement.

Personnes immigrées et logement : le grand défi

S’installer dans un logement décent et abordable dans un quartier accueillant et sécuritaire constitue une étape primordiale de l’établissement des nouveaux arrivants et arrivantes au pays. Plus qu’un simple toit, le premier logement permanent permet d’organiser la vie quotidienne et d’accéder aux services d’insertion linguistique et économique. Souvent, ce premier logement répond aux exigences de base, sans plus, à cause du contexte migratoire, des ressources financières très restreintes des personnes immigrées ou de leur faible connaissance du marché. Ces personnes aspirent cependant à améliorer leur qualité de vie à moyen terme, d’où la deuxième étape qui consiste idéalement à passer de la situation de locataire à celle de propriétaire; cela revêt une importance autant symbolique que matérielle et représente un gage de réussite de l’insertion dans la société nord-américaine.
À Montréal, les immigrantes et les immigrants des années 1960 et 1970, issus principalement des pays d’Europe du Sud, accédaient à la propriété en plus grande proportion que les autres ménages, parce qu’ils cumulaient les revenus de plusieurs membres de la famille en vue de l’achat et de la remise en état d’un immeuble de type « plex » alors disponible à très bon marché dans les quartiers centraux. Or, de nos jours, les ménages qui immigrent au Québec dépendent plus souvent et plus longtemps du marché locatif. Dans le Grand Montréal, les immigré·e·s arrivés il y a 15-20 ans affichent un taux de propriété plus faible (52 %) que les non-immigré·e·s (59 %)[1]. Cela s’expliquerait par la plus grande précarité économique des cohortes récentes d’immigré·e·s ainsi que par le resserrement du marché locatif abordable qui frappe presque tous les arrondissements de la ville. Ainsi l’accès au logement constitue-t-il un enjeu de plus en plus important pour les personnes immigrées, surtout celles arrivées depuis moins de 10 ans[2].
Abordabilité du logement : la population immigrante durement touchée
Le logement social ne rejoint qu’une petite proportion des ménages québécois. La capacité de se loger convenablement sans se priver d’autres nécessités de la vie dépend de l’accessibilité du logement sur le marché privé et se mesure au pourcentage du prix du loyer par rapport au revenu. Or, les personnes immigrées, surtout celles établies depuis moins de 10 ans, sont plus susceptibles que la population en général de vivre une grande précarité financière. Un résident du Québec sur neuf (11,1 %) touche généralement un revenu en deçà du seuil de faible revenu après impôts. Or cette proportion s’élève à un sur sept (14,3 %) chez les personnes qui se sont établies au Canada entre 2001 et 2010 et atteint 22,6 % chez celles arrivées il y a moins de cinq ans (chiffres de 2016). La vaste majorité des immigrantes et immigrants au Québec relèvent, en langage administratif, de la catégorie économique. Si, pour bon nombre de ceux-ci, l’insertion économique va bon train, plusieurs se trouvent au rang des travailleurs pauvres en raison de la non-reconnaissance de leurs titres de compétences et leur expérience de travail à l’étranger. Comme on peut s’y attendre, le faible revenu est plus fréquent chez les personnes admises comme réfugiées et moins fréquent chez celles qui relèvent de la catégorie de réunification familiale car ces dernières peuvent compter sur le soutien de leurs proches[3].
La mesure des besoins en logement la plus souvent déployée à des fins de politiques publiques est l’indice des « besoins impérieux en matière de logement ». Cet indice tient compte de l’accessibilité financière (le coût du logement ne doit pas dépasser 30 % du revenu), de la taille du logement (au regard de la composition du ménage) ainsi que de la qualité du logement (besoin de réparations majeures).
Parmi les locataires du Grand Montréal, plus d’un ménage sur cinq était en situation de « besoins impérieux » en 2016. Ce taux s’élevait à 26,4 % chez les ménages dont le soutien avait immigré au Canada moins de cinq ans plus tôt. Or, à Montréal, ce taux varie beaucoup selon la catégorie d’admission au pays; il s’élève à 35 % chez les ménages admis en tant que réfugiés et à 45 % chez les réfugiés pris en charge par le gouvernement ou par un groupe de parrainage privé[4].
L’entassement : un réel défi
À Montréal, comme dans les autres grandes villes, l’abordabilité est le principal facteur qui contribue aux besoins impérieux de logement des personnes, immigrantes et non immigrantes. Toutefois, les immigrants récents sont un peu plus susceptibles que les Montréalais de vivre dans un logement qui nécessite des réparations majeures. Une enquête de 2021 confirme l’expérience de terrain des organismes communautaires œuvrant dans les quartiers d’accueil des nouveaux arrivants : le logement des néo-Montréalais est plus souvent insalubre[5].
De plus, l’entassement dû à l’exiguïté du logement par rapport à la taille et à la composition du ménage est une source plus importante de besoins impérieux chez les immigrants récents et particulièrement chez les personnes récemment réfugiées. Ainsi, le groupe des Syriens admis en 2015-2016 comprend un taux important – et inattendu – de familles nombreuses et multigénérationnelles. Selon les données canadiennes de 2016, 31 % des ménages de réfugiés récents comportent six membres et plus, comparativement à 16 % pour les immigrants récents admis selon les programmes d’immigration économique ou de réunification familiale. La pénurie de logements abordables de taille convenable jumelée à la faiblesse de la prestation mensuelle octroyée aux familles réfugiées pose un défi herculéen aux organismes communautaires et aux groupes de parrainage chargés de leur trouver un premier logement; ces familles ont d’ailleurs tendance à y demeurer plusieurs années. Les réfugié·e·s (demandeurs d’asile ou réfugiés rétablis) arrivés seuls doivent composer avec des contraintes financières encore plus importantes parce qu’ils ne sont pas admissibles à l’allocation pour enfants. Cette situation mène très souvent au partage d’un petit logement avec d’autres personnes seules. Si cette situation peut apporter un soutien social, elle peut aussi créer un sentiment d’insécurité[6].
Les personnes immigrantes vivent aussi plus souvent dans des familles multigénérationnelles : c’est le cas, en 2016, de 6,6 % des immigrants et de presque 9 % des immigrants arrivés entre 1980 et 2000, comparativement à 3,3 % des Montréalais non immigrants. Elles vivent également plus souvent dans des familles nucléaires auxquelles s’ajoutent d’autres personnes apparentées ou non : en 2016, 6,7 % des immigrants récents et 5,5 % des immigrants sont dans cette situation contre 3,7 % des Montréalais non immigrants. Ce sont là des expressions de solidarité familiale, culturelle et économique, comme on l’a observé dans des cohortes antérieures d’immigrants des pays méditerranéens. Or, en raison des plus grandes difficultés d’insertion économique et de la flambée des prix immobiliers, ces familles sont plus à risque de vivre une situation d’entassement[7].
L’impact de la pandémie
Enfin, la pandémie de la COVID-19 a mis en évidence l’importance des conditions d’habitation sur la santé des résidents et résidentes. Le risque de transmission au sein du ménage s’accroît lorsque la taille du logement est insuffisante pour permettre l’isolement d’une personne atteinte du virus. L’entassement dans les logements s’est ainsi avéré un facteur de risque additionnel, surtout dans le cas des ménages dont des membres travaillent dans les secteurs des services essentiels, situation fréquente chez les personnes immigrantes et réfugiées. Et si le ménage est multigénérationnel, le risque est encore plus grand pour les aîné·e·s qui y vivent. En ce qui concerne la santé mentale, le stress associé aux cycles de confinement prolongés et répétés serait aggravé chez les personnes et les familles vivant dans des logements exigus, sans espaces extérieurs privés où se détendre et jouer. Ainsi, les inégalités relatives à la qualité de l’habitat s’associent aux inégalités sociospatiales observées lors de la pandémie qui, à Montréal comme dans d’autres grandes villes, a frappé plus durement les quartiers à forte densité d’immigrantes et immigrants récents ainsi que de minorités racisées[8].
Des obstacles particuliers, des barrières discriminatoires
Qu’il s’agisse de la recherche du premier logement ou de celle d’un logement plus convenable, de nombreuses études scientifiques, dont des enquêtes menées à Montréal, montrent que les immigrantes et immigrants récents font très souvent face à des obstacles qui ne relèvent pas de leur capacité financière ou de la pénurie de logements abordables convenant à la taille de leur famille. L’absence de références ou de cote de crédit émises au Canada est une barrière fréquente. Alors que la Société canadienne d’hypothèques et de logement a instauré un programme d’aide aux nouveaux arrivants sans antécédents de crédit qui veulent devenir propriétaires, les locataires n’ont droit à aucun programme de ce type. Souvent, les propriétaires exigent un dépôt élevé ou un garant, ce qui pose un défi majeur aux personnes sans parents ou amis déjà établis au pays. De surcroît, un nombre préoccupant de nouveaux arrivants vivent des problèmes de logement en raison de la discrimination fondée sur le statut, notamment les demandeurs d’asile, ou sur l’origine ethnique. De telles pratiques, illégales selon la Charte des droits et libertés de la personne, ont pour effet de restreindre le choix d’un logement et d’accroître le risque de se trouver dans un immeuble mal entretenu ou dans un logement insalubre[9].
Les organisations communautaires à la rescousse
Au Québec, un important réseau d’organismes communautaires de recherche de logements pour les nouveaux arrivants tente de pallier les obstacles d’accès à un logement décent et abordable. L’État et des organismes caritatifs, religieux et autres financent ces groupes communautaires et de nombreux bénévoles y œuvrent. Ces groupes collaborent avec des propriétaires plus accueillants, tiennent des inventaires de logements disponibles, expliquent aux immigrants le fonctionnement de notre système de logement, qui peut paraître opaque, et prodiguent des conseils aux personnes qui ont un problème de logement. Certains organismes offrent un soutien intensif aux réfugié·e·s pris en charge par le gouvernement afin d’assurer leur installation dans un premier logement décent, ce qui fait partie des obligations humanitaires de l’État. Malgré leur dévouement, les organismes communautaires n’arrivent pas à rejoindre toutes les personnes concernées. Ainsi, les immigrants économiques et les demandeurs d’asile recourent-ils plus souvent aux réseaux informels de leur groupe ethnoculturel pour recevoir de l’aide ou des conseils en matière de logement; or, l’information qui y circule tend à être moins fiable ou incomplète.
Que faire ?
En quoi pourraient alors consister des réponses progressistes aux enjeux et défis soulevés ? Esquissons, en conclusion, quelques éléments de politique qui tiennent compte des points de vue des intervenants clés de l’aide aux nouvelles et nouveaux arrivants consultés lors des recherches antérieures.
- En matière de politiques d’habitation, il importe de prioriser, à tous les paliers de l’État, la remise en état des immeubles locatifs détériorés. Il s’agit notamment des immeubles modestes de trois ou quatre étages sans ascenseur construits dans les années 1950 à 1970. Les personnes immigrées et à revenus faibles et modestes sont de plus en plus concentrées dans le parc locatif situé dans les premières banlieues de l’après-guerre. Il faut privilégier le transfert de ces immeubles aux bailleurs sociaux ou à but non lucratif (OBNL) afin d’éviter les « rénovictions[10] » dans les quartiers où s’amorce la gentrification[11] ou la « studentification[12] ».
- La planification des nouveaux besoins en logement, tant la réhabilitation des immeubles que la construction de maisons neuves, devrait tenir compte de la diversité croissante des modèles familiaux amenée par l’immigration : des familles de plusieurs enfants ou de plusieurs adultes, des familles multigénérationnelles.
- L’octroi d’un logement social de type HLM (habitations à loyer modique) à certains nouveaux arrivants et arrivantes à statut très précaire – dont une partie des réfugié·e·s sélectionnés à l’étranger – constituerait la solution la plus durable en matière de logement abordable et convenable. Or, au-delà de l’insuffisance globale de logements subventionnés en fonction du revenu, le Québec impose une barrière supplémentaire aux immigrantes et immigrants récents en exigeant d’eux un an de résidence pour les inscrire sur la liste d’attente d’un HLM. Pourquoi ne pas diminuer ce délai, à l’instar de l’allocation pour enfants à laquelle les familles immigrantes sont admissibles trois mois après leur arrivée ?
- Les vagues récentes d’arrivée de nombreux réfugié·e·s et demandeurs d’asile dans de courts laps de temps et dans un contexte de forte pénurie de logements abordables et convenables posent des défis majeurs aux organismes communautaires qui viennent à leur secours. Cela a fait ressortir le besoin de créer un parc de logements où les nouveaux arrivants pourraient vivre pendant environ deux ans. Gérées par des OBNL associés aux organismes communautaires d’aide à l’établissement des personnes réfugiées et immigrantes, ces résidences offriraient aussi des services sur place de façon à favoriser l’insertion sociale et économique des résidents et résidentes. Ce modèle a été bien rodé à Winnipeg[13].
Damaris Rose est professeure honoraire, Centre Urbanisation Culture Société, Institut national de la recherche scientifique.
- Un tel écart n’existe pas dans les autres métropoles de l’immigration canadienne, Toronto et Vancouver. ↑
- Michael Haan, « Do I buy with a little help from my friends ? Homeownership-relevant group characteristics and homeownership disparities among canadian immigrant groups, 1971-2001 », Housing Studies, vol. 22, n° 6, 2007; Société canadienne d’hypothèques et de logement, Caractéristiques, ménages avec besoins impérieux de logement, Canada, PT, RMR, Ottawa, SCHL 2020, <www.cmhc-schl.gc.ca/fr/professionals/housing-markets-data-and-research/housing-data/data-tables/household-characteristics/characteristics-households-core-housing-need-canada-pt-cmas>. ↑
- Xavier Leloup, Florence Desrochers et Damaris Rose, Les travailleurs pauvres dans la RMR de Montréal. Profil statistique et distribution spatiale, Montréal, INRS-Centre Urbanisation Culture Société et Centraide du Grand Montréal, 2016; Statistique Canada, Catégorie d’admission et type de demandeur (47), certaines caractéristiques du revenu (92), statut d’immigrant et période d’immigration (10A), âge (10B) et sexe (3) pour la population dans les ménages privés du Canada, provinces et territoires et régions métropolitaines de recensement, Recensement de 2016 – Données-échantillon (25 %). Tableau 98-400-X2016367, Ottawa, 2020, <www150.statcan.gc.ca/n1/fr/catalogue/98-400-X2016367>. ↑
- SCHL, Caractéristiques, ménages avec besoins impérieux de logement, Canada, PT, RMR, op. cit.; Rachel Shan, Conditions de logement des nouveaux réfugiés au Canada, Ottawa, SCHL, 2019. ↑
- Thomas Gulian, Monica Schlobach, Danic Ostiguy, Yanick Tadjalogue-Agoumfo et Monica Grigore-Dovlette, Baromètre Écho 2020 de la Ville de Montréal sur l’inclusion des personnes immigrantes, Montréal, Rapport de recherche de l’Institut de recherche sur l’intégration professionnelle des immigrants, 2021. ↑
- Shan, op. cit.; Damaris Rose et Alexandra Charette, « Accommodating government assisted Syrian refugee newcomers : the experiences of Resettlement Assistance Program providers », dans Leah Hamilton, Luisa Veronis et Margaret Walton-Roberts (dir.), A National Project. Syrian Refugee Resettlement in Canada, Montréal, McGill-Queens, 2020. ↑
- Statistique Canada, Catégorie d’admission et type de demandeur (47), statut d’immigrant et période d’immigration (11B), âge (7A), sexe (3) et certaines caractéristiques démographiques, culturelles, de la population active et de la scolarité (825) pour la population dans les ménages privés du Canada, provinces et territoires et régions métropolitaines de recensement, Recensement de 2016 – Données-échantillon (25 %). Tableau 98-400-X2016203, Ottawa, 2018, <www150.statcan.gc.ca/n1/fr/catalogue/98-400-X2016203>. ↑
- Janet Cleveland, Jill Hanley, Annie Jaimes et Tamar Wolofsky, Impacts de la crise de la COVID-19 sur les « communautés culturelles » montréalaises. Enquête sur les facteurs socioculturels et structurels affectant les groupes vulnérables, Montréal, Institut universitaire SHERPA, 2020 ; Organisation de coopération et de développement économiques, What is the impact of the COVID-19 pandemic on immigrants and their children ?, Paris, OCDE, 2020. ↑
- Gulian et al., op. cit.; Damaris Rose et Alexandra Charette, « Housing experiences of users of settlement services for newcomers in Montréal : does immigration status matter ? », dans Kenise Murphy Kilbride (dir.), Immigrant Integration. Research Implications for Public Policy, Toronto, Canadian Scholars’ Press, 2014. ↑
- NDLR. Le terme rénoviction fait référence au processus par lequel un propriétaire évince illégalement un locataire de son immeuble sous prétexte qu’il souhaite faire des rénovations. ↑
- NDLR. Plusieurs auteurs et autrices préfèrent le terme anglais gentrification à celui d’embourgeoisement qui n’aurait pas tout à fait le même sens. ↑
- NDLR. Le phénomène d’afflux d’étudiants dans les quartiers traditionnellement occupés par des familles et les transformations engendrées par l’arrivée de cette nouvelle population a été désigné sous le terme de « studentification » par Darren Smith en Angleterre (2002). ↑
- Jill Hanley et al., S’installer : Comprendre les enjeux du parcours et de l’intégration des demandeurs d’asile au Québec. Rapport final de recherche soumis au FRQSC – Actions concertées, Montréal, Université McGill et SHERPA, 2021; Jill Bucklaschuk, They Can Live a Life Here. Current and Past Tenants’ Experiences with IRCOM’s Model of Housing and Wrap-Around Supports, Winnipeg, Centre canadien de politiques alternatives, 2019; Écobâtiment, Bâtiments résilients, logements sains et accueillants. Feuille de route, Montréal, 2021; Rose et Charette, 2020, op. cit. ↑

Les pays méditerranéens redoutent la pénurie de blé ukrainien

Dans un moulin à blé, à Deir al-Balah, dans la bande de Gaza, le 1er mars 2022. © Photo Majdi Fathi / NurPhoto via AFP
Depuis que la Russie a envahi l’Ukraine, l’un des plus grands exportateurs au monde de céréales, les prix explosent et les premières pénuries apparaissent. Au Liban, en Tunisie et en Égypte, très consommateurs de pain, la sécurité alimentaire est déjà menacée.
Complètement dépendants des importations de blé ukrainien, les pays du bassin méditerranéen, englués dans de profondes crises économiques et sociales, ressentent déjà les effets collatéraux de la guerre provoquée par la Russie. Les tensions sur les prix des céréales et du blé sont au plus haut. Les premières pénuries se font sentir. Les gouvernements se veulent rassurants, mais l’inquiétude est à son comble.
En Tunisie, les pénuries s’aggravent
Dans ce pays qui subit déjà une crise économique et une inflation supérieure à 6 %, les conséquences de la guerre en Ukraine se font déjà ressentir. La Tunisie importe près de 50 % des besoins de sa consommation en blé, mais elle importe aussi des céréales telles que le maïs, l’orge et le soja, nécessaires pour l’alimentation du bétail.
Pour l’année 2021-2022, les importations en céréales représentent 3,7 millions de tonnes, avec 47,7 % du blé importé qui vient d’Ukraine et 3, 97 % de Russie. Le ministre du commerce tunisien a tenté un discours rassurant, déclarant que les stocks en blé étaient suffisants pour tenir jusqu’au moins de juin 2022 mais la Tunisie doit commencer à trouver des marchés alternatifs.
La guerre en Ukraine arrive dans un contexte très tendu en Tunisie. Ces dernières semaines, le pays vivait déjà au rythme des pénuries de semoule, de farine et d’huile végétale, des produits de première nécessité subventionnés par l’État qui se font de plus en plus rares, souvent récupérés par les circuits de spéculation et le marché noir, face à l’augmentation de la demande.
Avec la hausse des prix, de nombreux Tunisiens et Tunisiennes n’arrivent plus à se permettre un panier de courses sans recourir aux produits subventionnés. Les boulangers ont aussi dû augmenter parfois le prix de la baguette, faute de trouver la farine subventionnée, et rationner la consommation.
Mais c’est la crise de l’importation des céréales nécessaires pour l’alimentation du bétail qui inquiète le plus les agriculteurs tunisiens. Bien qu’en Tunisie, le secteur agricole se soit montré résilient face aux nombreuses crises économiques, climatiques et sanitaires, il est composé à près de 80 % de petits agriculteurs qui souffrent déjà depuis plusieurs années de la hausse des coûts de production et du transport.
Outre le problème des stocks et des pénuries, ces augmentations des prix, sur le pétrole également, vont creuser le déficit en Tunisie.
Aram Belhadj, économiste
Ferid Belhaj, vice-président de la Banque mondiale pour les régions Afrique du Nord et Moyen-Orient, a renchéri en déclarant dans un post de blog que la Tunisie pourrait être l’une des économies les « plus durement affectées », notamment au niveau des petits agriculteurs, dont le métier représente l’unique source de revenu familial.
« Il y a une inquiétude, notamment pour tout ce qui est alimentation concentrée du bétail qui est faite d’un mélange de soja et de maïs », explique Karim Daoud, agriculteur et président du Synagri, un syndicat agricole en Tunisie. L’alimentation concentrée pour les vaches laitières est passée, en un an, de 950 dinars la tonne (292 euros) à 1 300 dinars (400 euros). « Le problème, c’est que le stock pour cette alimentation n’est viable que sur 15 jours, donc nous ne savons pas ce qu’il va se passer après », ajoute-t-il.
Du côté des importateurs, beaucoup se préparent ainsi à une année « difficile », comme le directeur général de la société Carthage Grains, spécialisée dans la transformation des graines de soja et de colza. Maher Affes achète principalement sur les marchés américain et brésilien, mais, actuellement, la pression de la demande sur ces marchés, faute de pouvoir acheter à l’Ukraine et à la Russie, a aussi entraîné une augmentation des prix.
« Les contrats que nous avions faits au mois de juin l’année dernière étaient à 1 300 dollars la tonne (400 euros). Là, sur les nouveaux contrats pour 2022, nous sommes déjà à 1 850 dollars », explique-t-il. À cela s’ajoute l’augmentation des coûts de transport avec l’emballement des prix du pétrole. Le transport qui coûtait 30 dollars la tonne revient désormais à 100 dollars. « Toutes ces augmentations se répercutent ensuite sur le prix de vente du tourteau de soja en Tunisie et donc sur les agriculteurs », confirme Maher Affes.
Quant au maïs, plusieurs commandes à l’Ukraine ont été annulées mais la Tunisie peine à trouver des marchés alternatifs. Beaucoup craignent que le pays ne soit considéré comme moins prioritaire face à d’autres, « un peu comme avec le vaccin finalement », ajoute Karim Daoud.
Il rappelle que pendant la crise alimentaire mondiale en 2007-2008, quand les cours du blé et, plus largement, des céréales avaient brusquement augmenté, « la Tunisie s’était retrouvée aussi dans une situation similaire face à ses importations ». Il rappelle que cette crise « pose plus que jamais la question de notre sécurité alimentaire et de nos modes de consommation, surtout après les deux ans de pandémie qui ont aussi mis à mal ces circuits ».
À l’approche des pics de consommation alimentaire pour le mois saint du ramadan en avril, de nombreux experts économiques appellent le gouvernement à anticiper d’éventuelles pénuries. « Nous savons qu’outre le problème des stocks et des pénuries, ces augmentations des prix, sur le pétrole également, vont creuser le déficit en Tunisie puisque cela va avoir un impact aussi sur le taux de change avec le dinar, déjà faible face au dollar et à l’euro », explique l’économiste Aram Belhadj.
Le pays en est à sa deuxième hausse des prix des carburants en un mois et les autorités sont en train de négocier un nouveau prêt avec le Fonds monétaire international (FMI), annonçant aussi une politique d’austérité. « La guerre en Ukraine arrive à un très mauvais moment pour la Tunisie sur le plan économique », conclut-il.
En Égypte, le prix du pain bondit
En quelques jours, le prix du pain a bondi dans les boulangeries. Dans le quartier populaire de Sayeda Zeinab, au Caire, la galette de pain se vend 1,5 livre, contre une livre avant le déclenchement de l’invasion russe.
Aux client·es excédé·es l’accusant de « voracité », la boulangère Iman explique que « la tonne de farine coûte 11 000 livres égyptiennes, contre 8 500 auparavant, parce qu’il y en a moins sur le marché à cause de la guerre ».
Les représentants des boulangeries auprès de l’Union des chambres du commerce au Caire accusent les marchands de blé de profiter de leur situation de monopole pour accentuer la pénurie et faire grimper les prix.
Face à l’inquiétude grandissante de la population, le gouvernement égyptien tente de rassurer. Selon le premier ministre, Mostafa Madbouly, l’Égypte a des stocks de blé pour tenir quatre mois et n’aura pas besoin de livraisons supplémentaires avant la fin de l’année, grâce aux récoltes locales du printemps.
Du fait de l’extension des exploitations agricoles sur des parcelles auparavant désertiques, le gouvernement espère récolter sur place jusqu’à 5,5 millions de tonnes de blé cette année, contre 3,5 millions en 2021. Sauf qu’en 2021, l’Égypte a importé près de 12,4 millions de tonnes pour nourrir ses 100 millions d’habitant·es.
L’optimisme affiché du gouvernement risque de ne pas suffire à combler les besoins du premier pays importateur de blé au monde. D’autant que l’Égypte se fournit à 80 % en Russie et en Ukraine.
Dès le début de l’invasion russe, le gouvernement a d’ailleurs essayé de trouver d’autres vendeurs via des appels d’offres. Fin février, une entreprise a proposé d’importer 60 000 tonnes de blé français à 399 dollars la tonne, c’est-à-dire 25 % plus cher que les précédents appels d’offres. L’État a également renoncé à acheter du blé américain, hors de son budget. Des discussions seraient en cours avec la Russie, selon le média indépendant Mada Masr.
Car les réserves de l’État risquent de vite se révéler insuffisantes. « Les stocks constitués par l’État sont réservés au pain subventionné, mais une grande partie de la population achète du pain et de la farine sur le marché privé », analyse le responsable du syndicat des agriculteurs, Saddam Abou Hussein.
Au Liban, « il ne reste plus qu’un mois et demi de réserves de blé »
Les difficultés d’approvisionnement en blé menacent la sécurité alimentaire du Liban. Le pays est en effet très dépendant des importations originaires de la mer Noire. Il a ainsi acheté 66 % de son blé à l’Ukraine et 12 % à la Russie en 2020, d’après les statistiques de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture.
« Le risque de pénurie est réel. Il ne reste plus qu’un mois et demi de réserves de blé », alerte Geryes Berbari, directeur général de l’Office des céréales et de la betterave sucrière. Le pays ne peut en effet plus compter sur ses réserves stratégiques en céréales depuis l’explosion mortelle du 4 août 2020 à Beyrouth qui a détruit les silos à grains installés près du port.
« Face à l’urgence, il faut trouver des alternatives au blé ukrainien, très compétitif en raison de la proximité géographique. Elles seront nécessairement plus chères, notamment dans le contexte de la flambée mondiale du cours du blé », continue-t-il.
Or, le Liban est déjà en proie à une grave crise économique depuis deux ans et demi, qui a entraîné plus des trois quarts de la population dans la pauvreté. « La hausse des prix va aussi peser sur les maigres réserves en devises de la Banque du Liban (BDL), qui subventionnent les importations de blé », dit Zeina el-Khatib, chercheuse associée au centre de recherche Triangle basé à Beyrouth.
Le gouvernement se veut cependant rassurant. Le ministre libanais de l’économie, Amine Salam, a nié mardi lors d’une conférence de presse l’imminence d’une pénurie. Il a indiqué par ailleurs avoir contacté d’autres pays producteurs de blé, tout en insistant sur la capacité de la Banque centrale de débloquer les fonds nécessaires.
Un optimisme loin d’être partagé par le président du syndicat libanais des importateurs de denrées alimentaires, Hani Bohsali. « La BDL n’a plus les devises nécessaires pour assurer les subventions sur le blé et accumule déjà les retards de paiement des importations. »
Une levée partielle des subventions, qui occasionnerait une hausse du prix du pain, est désormais crainte par une partie de la population, dans un pays où l’inflation a déjà atteint près de 240 % en janvier en glissement annuel.

Pour l’indépendance de l’Ukraine soviétique

« Malgré le pas de géant franchi par la Révolution d’Octobre dans le domaine des relations nationales, la révolution prolétarienne isolée dans un pays arriéré s’est avérée incapable de résoudre la question nationale, en particulier la question ukrainienne qui est, dans son essence même, de caractère international. La réaction thermidorienne, couronnée par la bureaucratie bonapartiste, a également relégué loin en arrière les masses laborieuses dans la sphère nationale. Les grandes masses du peuple ukrainien sont insatisfaites de leur sort national et souhaitent le changer radicalement. C’est ce fait que le politique révolutionnaire doit, contrairement au bureaucrate et au sectaire, prendre comme point de départ.
Si notre critique était capable de penser politiquement, il aurait deviné sans grande difficulté les arguments des staliniens contre le mot d’ordre d’une Ukraine indépendante : « Elle nie la position de défense de l’Union soviétique » ; « perturbe l’unité des masses révolutionnaires » ; “ne sert pas les intérêts de la révolution mais ceux de l’impérialisme.” En d’autres termes, les staliniens répéteraient les trois arguments de notre auteur. Ils le feront immanquablement le lendemain….
Le sectaire, comme cela arrive si souvent, se retrouve du côté de la police, couvrant le statu quo, c’est-à-dire la violence policière, par des spéculations stériles sur la supériorité de l’unification socialiste des nations sur leur maintien divisé. Certes, la séparation de l’Ukraine est un handicap par rapport à une fédération socialiste volontaire et égalitaire : mais elle sera un atout incontestable par rapport à l’étranglement bureaucratique du peuple ukrainien. Pour se rapprocher plus étroitement et honnêtement, il faut parfois d’abord se séparer. » [1]
L’article cité ci-dessus, « L’indépendance de l’Ukraine et les sectaires confus » de Trotsky (juillet 1939), est, à bien des égards, beaucoup plus important que son article d’avril de la même année, « La question ukrainienne ». Tout d’abord, il démasque et désarme les pseudo-marxistes sectaires qui, au nom de la défense de l’internationalisme prolétarien, le transforment en une abstraction stérile, et rejettent le mot d’ordre d’indépendance nationale d’un peuple opprimé par la bureaucratie du Kremlin. Dans cet article, Trotsky se situe dans la continuité de la lutte idéologique menée par Lénine contre la «tendance à l’économisme impérialiste», une tendance active dans les rangs du parti bolchevik comme dans l’extrême gauche de la social-démocratie internationale. Il doit être clair que l’adjectif « impérialiste » que Lénine attribue à cette forme d’économisme dans le mouvement révolutionnaire par rapport à la question nationale est justifié par les raisons théoriques évoquées par l’auteur du terme. Un examen sociologique montrerait que cette tendance est principalement basée chez les socialistes révolutionnaires appartenant aux nations dominantes et impérialistes. Les sectaires dénoncés par Trotsky ne sont qu’une nouvelle version de la même tendance contre laquelle Lénine a combattu lors de la discussion sur le droit des nations à l’autodétermination dans le contexte d’une révolution anticapitaliste. Un examen sociologique montrerait que cette tendance est principalement basée chez les socialistes révolutionnaires appartenant aux nations dominantes et impérialistes. Les sectaires dénoncés par Trotsky ne sont qu’une nouvelle version de la même tendance contre laquelle Lénine a combattu lors de la discussion sur le droit des nations à l’autodétermination dans le contexte d’une révolution anticapitaliste. Un examen sociologique montrerait que cette tendance est principalement basée chez les socialistes révolutionnaires appartenant aux nations dominantes et impérialistes. Les sectaires dénoncés par Trotsky ne sont qu’une nouvelle version de la même tendance contre laquelle Lénine a combattu lors de la discussion sur le droit des nations à l’autodétermination dans le contexte d’une révolution anticapitaliste.
Deuxièmement, l’article de Trotsky contient des considérations théoriques et politiques qui sont indispensables pour comprendre la justesse et la nécessité d’un mot d’ordre comme celui de l’indépendance de l’Ukraine soviétique ainsi que d’une révolution nationale d’un peuple opprimé comme facteur et composante de l’anti- révolution bureaucratique en Union soviétique et en Europe de l’Est. Pour apprécier pleinement la richesse de cette contribution, les lecteurs sont invités à étudier l’article eux-mêmes.
Troisièmement, Trotsky explique que dans un cas comme celui de l’Ukraine, un véritable internationalisme et une véritable recherche de l’unité internationale de la classe ouvrière sont impossibles sans un soutien clair et résolu au « séparatisme » national.
Pour rendre possible une véritable fraternité des peuples à l’avenir, les travailleurs avancés de la Grande Russie doivent dès maintenant comprendre les causes du séparatisme ukrainien ainsi que la puissance latente et la légalité historique qui le sous-tendent, et ils doivent sans aucune réserve déclarer à l’Ukraine peuple qu’il est prêt à soutenir de toutes ses forces le mot d’ordre d’une Ukraine soviétique indépendante dans une lutte commune contre la bureaucratie autocratique et contre l’impérialisme. [2]
Il va sans dire que cette tâche incombe à l’avant-garde du mouvement ouvrier international avant même d’être celle du prolétariat russe. La défense du mot d’ordre d’indépendance de l’Ukraine adopté par les Congrès mondiaux de la Quatrième Internationale en 1957 et 1979 est aujourd’hui une tâche d’une énorme importance politique. La montée des mouvements nationaux de masse des peuples opprimés de l’URSS exige que le mot d’ordre de l’indépendance nationale fasse partie de notre propagande et de notre agitation générales. Si cela n’est pas fait, l’opposition socialiste en URSS laissera le champ libre à la bureaucratie, qui espère isoler les luttes anti-bureaucratiques menées dans les républiques non russes du combat des ouvriers en Grande Russie. Ils omettent ainsi l’une des tâches transitionnelles fondamentales de la lutte anti-bureaucratique.
Quatrièmement, Trotsky apporte une clarification essentielle à la discussion historique sur le droit des nations à l’autodétermination en éliminant de ce slogan léniniste ses traits abstraits et politiquement redondants. Trotsky explique que, si l’oppression d’un peuple est un fait objectif, nous n’avons pas besoin que ce peuple soit en lutte et réclame l’indépendance pour faire avancer le mot d’ordre de l’indépendance. Au moment où Trotsky a lancé ce mot d’ordre, personne en Ukraine soviétique ne pouvait exiger une telle chose sans devoir faire face à l’exécution ou être prisonnier du Goulag. Une politique attentiste ne conduirait qu’au désarmement politique et programmatique des révolutionnaires. Un peuple opprimé a besoin d’indépendance parce qu’il est opprimé. L’indépendance, déclare Trotsky, est le cadre démocratique indispensable dans lequel un peuple opprimé devient libre de se déterminer. En d’autres termes, il n’y a pas d’autodétermination en dehors du contexte de l’indépendance nationale.
Pour déterminer librement ses relations avec les autres républiques soviétiques, pour avoir le droit de dire oui ou non, l’Ukraine doit retrouver sa pleine liberté d’action, au moins pour la durée de cette période constituante. Il n’y a pas d’autre nom pour cela que l’indépendance de l’État.
Pour exercer son autodétermination — et tout peuple opprimé a besoin et doit avoir la plus grande liberté d’action dans ce domaine — il faut qu’il y ait une assemblée constituante de la nation.
Mais un congrès « constituant » ne signifie rien d’autre que le congrès d’un État indépendant qui se prépare à nouveau à déterminer son propre régime intérieur ainsi que sa position internationale. [3]
Face à la rigueur implacable de cette explication, tout autre discours sur le droit des nations opprimées à l’autodétermination ne peut être soutenu que par un tour de passe-passe. Ce droit ne peut être défendu sans lutter pour que les peuples opprimés aient les moyens de l’exercer; c’est-à-dire sans exiger l’indépendance étatique nécessaire à la convocation d’une assemblée constituante ou d’un congrès libres.
Enfin, et c’est une question d’une importance capitale, Trotsky a reconnu que la Révolution d’Octobre n’avait pas résolu la question nationale héritée de l’Empire russe. Isolé dans un pays arriéré, il ne put le résoudre qu’à grand-peine. Mais était-il équipé pour cela ? Dans la perspective d’une nouvelle révolution anti-bureaucratique, nous devons décider si les mêmes moyens peuvent être réutilisés ou si une approche totalement nouvelle est nécessaire. Je pense que Trotsky était convaincu que la deuxième option était correcte. C’est une question de première importance qui semble n’avoir jamais été reprise par le mouvement trotskyste, bien qu’elle soit un point de départ nécessaire à toute discussion sur la pertinence du mot d’ordre de Trotsky de 1939.
La République socialiste soviétique d’Ukraine – formellement (et fictivement comme la Biélorussie) membre des Nations Unies – est la plus importante des républiques non russes de l’Union soviétique. C’est aussi le plus grand pays d’Europe après la Russie en superficie (603 700 kilomètres carrés) et l’un des plus grands en population (plus de 50 millions d’habitants, dont 74 % sont ukrainiens). Le peuple ukrainien forme la plus grande nation opprimée d’URSS et d’Europe. La classe ouvrière urbaine constitue plus de 50 % de la population totale et plus de 75 % de la population ukrainienne de la république. La libération de l’énorme potentiel que représente cette classe du double fardeau de la dictature bureaucratique et de l’oppression nationale est une tâche fondamentale et une condition pour le développement de la révolution anti-bureaucratique en URSS et en Europe de l’Est, ainsi que pour la révolution sociale sur tout le continent. Il est impossible d’imaginer une quelconque avancée dans la construction du socialisme en URSS et en Europe sans la victoire de la révolution nationale ukrainienne qui a, comme l’a expliqué Trotsky, une dimension stratégique internationale. Ce que les sectaires ignorent en abordant cette question, c’est que la révolution nationale, l’une des formes les plus importantes et les plus complexes de la lutte des classes, ne peut être évitée par de simples références à la révolution antibureaucratique en URSS dans son ensemble ou la future révolution européenne et mondiale.[4]
Le bolchevisme face à une révolution nationale inattendue
Considéré par beaucoup – dont Marx et Engels à une certaine époque – comme un « peuple sans histoire » [5] , le peuple ukrainien s’est constitué en nation de manière « historique » par excellence, c’est-à-dire héroïquement. En 1648, la communauté des hommes libres et de la démocratie militaire, connue sous le nom de cosaques, forma une armée populaire de libération et lança un immense soulèvement paysan contre l’État polonais, sa classe dirigeante et son Église. L’État-nation mis en place lors de ce soulèvement n’a pas réussi à se stabiliser mais la révolution cosaque et paysanne a cristallisé une nation historique avant même la formation des nations modernes par l’expansion du capitalisme. [6]Depuis la fin du XVIIIe siècle, la majeure partie du territoire ukrainien avait été transformée en une province de l’empire tsariste, connue sous le nom de « Petite Russie ». A la veille de la révolution russe, c’était une colonie de type «européen ». [7]Comparée au niveau général de développement socio-économique de cet empire, cette région était l’une des plus industrialisées et se caractérisait par une forte pénétration du capitalisme dans l’agriculture. «Ukrainien» était synonyme de «paysan» car environ 90% de la population vivait à la campagne. Parmi les 3,6 millions de prolétaires (12 % de la population), 0,9 million travaillaient dans l’industrie et 1,2 million dans l’agriculture. Produit d’un développement très inégal du capitalisme, la moitié du prolétariat industriel était concentrée dans l’enclave minière et sidérurgique du Donbass. En raison du développement colonial et de la « solution » tsariste à la question juive, seuls 43 % du prolétariat étaient de nationalité ukrainienne, le reste étant russe, russifié et juif.[8] La partie occidentale de l’Ukraine, la Galice, appartenait à l’empire austro-hongrois. Les deux revendications centrales du mouvement national renaissant étaient l’indépendance et l’unité ( samostiniste et soborniste ) de l’Ukraine.
La révolution de 1917 a ouvert la voie à la révolution nationale ukrainienne. Ce fut la plus puissante, la plus massive et la plus violente de toutes les révolutions des nations opprimées de l’empire. Les masses réclamaient une réforme agraire radicale, la constitution d’un gouvernement ukrainien et l’indépendance. Les partis opportunistes petits-bourgeois et ouvriers de la Rada centrale (conseil) qui dirigeaient le mouvement national s’opposèrent à la revendication d’indépendance. Ils ne l’ont proclamé qu’après la Révolution d’Octobre à laquelle ils étaient hostiles. En autorisant le passage d’unités militaires contre-révolutionnaires, la Rada centrale a provoqué une déclaration de guerre de la Russie soviétique contre la République populaire ukrainienne. Les bolcheviks étaient très mal préparés à faire face à la révolution nationale ukrainienne.
Le droit à l’autodétermination nationale mis en avant par Lénine était un mot d’ordre mal assimilé par le Parti. Il a même été contesté par un courant important, qualifié par Lénine d’«économisme impérialiste ». Cette contestation était d’autant plus dangereuse qu’elle se présentait au sein d’un parti prolétarien d’une nation traditionnellement oppressive et devenue impérialiste, dans un empire caractérisé par Lénine comme une énorme prison de peuples. En dehors des écrits de Lénine, le seul travail d’ensemble sur la question nationale dont disposait le parti bolchevik était l’étude confuse, voire largement erronée, de Staline. Rédigé en 1913, il n’abordait même pas la question nationale dans le cadre de l’impérialisme. [9]Lénine lui-même exprime des positions confuses et irréfléchies comme l’inspiration excessive qu’il tire de l’exemple du creuset américain et le rejet catégorique d’une solution fédéraliste. Il a condamné cela comme contraire à son idée d’un État centralisé et a exigé que chaque nationalité choisisse entre la séparation complète et l’autonomie nationale-territoriale au sein d’un État multinational centralisé. Il a éduqué le Parti dans cet esprit pendant plus de dix ans. Après la révolution, et sans donner aucune explication à son revirement, il a proclamé la fédération des nations comme la solution correcte et compatible avec le centralisme d’État – un virage que de nombreux dirigeants bolcheviks n’ont pas pris au sérieux. Au-delà du mot d’ordre démocratique du droit à l’autodétermination,
En Ukraine, à quelques exceptions près, le parti bolchevik (comme le parti menchevik) n’était actif qu’au sein de la section la plus concentrée et la plus moderne du prolétariat, qui n’était pas de nationalité ukrainienne. La diffusion du communisme au sein du prolétariat a suivi la dynamique de développement d’un capitalisme industriel colonial. L’action politique au sein du prolétariat national était le domaine de la social-démocratie ukrainienne qui se plaçait en dehors du clivage bolchevik/menchevik et était accusée par le premier de capituler devant le «nationalisme bourgeois » ukrainien. La bourgeoisie « nationale » existait à peine. A cette époque, la distinction entre le nationalisme des oppresseurs et celui des opprimés était déjà présente dans les écrits de Lénine mais tous deux étaient considérés comme bourgeois. La notion de nationalisme révolutionnaire n’était pas encore apparue. Le populisme social-révolutionnaire, qui devenait national et autonome par rapport à son équivalent russe, représentait une autre force politique active au sein des masses ukrainiennes. Le parti bolchevik en Ukraine n’a utilisé que le russe dans sa presse et sa propagande. Il a ignoré la question nationale et n’avait même pas de centre de direction sur le territoire. Il n’est pas surprenant que lorsque la révolution nationale a éclaté, elle ait été prise désarmée.
En Ukraine, le parti bolchevique n’a tenté de s’organiser en tant qu’entité distincte qu’après le traité de Brest-Litovsk, c’est-à-dire lors de la première retraite bolchevique et au début de l’occupation du pays par l’armée impérialiste allemande. Lors de la conférence ad hoc de Tahanrih en avril 1918, plusieurs tendances étaient présentes. A droite, les « Katerynoslavians » avec Emmanuil Kviring. A gauche, les « Kiévans » avec Yuri Piatakov, mais aussi les « Poltavans » ou « nationaux » avec Mykola Skrypnyk et Vasyl Shakhrai, renforcés par le soutien d’un groupe d’extrême gauche de la social-démocratie ukrainienne. La droite, se basant sur le prolétariat industriel russe, a proposé de former le PC(B) russe [Parti communiste (bolchevik)] en Ukraine. Les « Poltavans » et les « Kiévans » voulaient un parti bolchevik entièrement indépendant. Une partie des « Poltavans » voulait régler radicalement la question nationale par la fondation d’une Ukraine soviétique indépendante. Shakhrai, le plus radical, voulait même que le parti s’appelle le PC(B) ukrainien. Les « Kiévans » étaient pour un parti indépendant (et peut-être un État) tout en niant l’existence de la question nationale et en considérant le droit à l’autodétermination nationale comme un slogan opportuniste. Avec Piatakov, ils représentaient les partisans les plus extrêmes de « l’économisme impérialiste ». Cependant, en même temps, ils s’identifiaient au « communisme de gauche » boukharinien et étaient hostiles à la paix de Brest-Litovsk et au centralisme léniniste. Pour s’affirmer contre Lénine, il leur fallait un parti bolchevik indépendant en Ukraine. En outre, ils considéraient qu’une stratégie particulière était nécessaire en Ukraine dirigée vers les masses paysannes et basée sur leur potentiel insurrectionnel. C’est pour cette raison que les “Kievans” se sont alliés aux “Poltavans”. Et c’est la position de Skrypnyk qui l’a emporté. Rejetant l’approche de Kviring d’une part et celle de Shakhrai d’autre part, la conférence a proclamé le PC(B) en Ukraine comme la section ukrainienne, indépendante du PC(B) russe, de l’Internationale Communiste.[dix]
Skrypnyk, ami personnel de Lénine et réaliste, étudiant toujours les rapports de forces, recherchait un minimum de fédération ukrainienne avec la Russie et un maximum d’indépendance nationale. Selon lui, c’est l’extension internationale de la Révolution qui permettra de résister de la manière la plus efficace à la pression centralisatrice de la Grande Russie. A la tête du premier gouvernement bolchevique d’Ukraine, il avait vécu des expériences très amères : le comportement chauvin de Mouraviev, le commandant de l’Armée rouge qui avait pris Kiev ; et le refus de reconnaître son gouvernement et le sabotage de son travail par un autre commandant, Antonov-Ovseyenko, pour qui l’existence d’un tel gouvernement était le produit de fantasmes sur une nationalité ukrainienne. En outre, Skrypnyk a été obligé de lutter âprement pour l’unité ukrainienne contre les bolcheviks russes qui, dans plusieurs régions, ont proclamé des républiques soviétiques, fragmentant le pays. L’intégration de la Galice à l’Ukraine ne les intéressait pas non plus. L’aspiration nationale soborniste , de l’unité du pays, était ainsi ouvertement bafouée. C’est avec l’aile droite « katérynoslavienne » du parti qu’il y a eu l’affrontement le plus sérieux. [11] Il a formé une république soviétique dans la région minière et industrielle de Donetsk-Kryvyi Rih, y compris le Donbass, dans le but de l’incorporer à la Russie. Cette république, proclamaient ses dirigeants, était celle d’un prolétariat russe « qui ne veut rien entendre d’une soi-disant Ukraine et n’a rien de commun avec elle ». [12] Cette tentative de sécession pouvait compter sur un certain soutien à Moscou. Le gouvernement Skrypnyk devait lutter contre ces tendances de ses camarades russes, pour le soborniste de l’Ukraine soviétique à l’intérieur des frontières nationales fixées, par l’intermédiaire de la Rada centrale, par le mouvement national des masses.
Le premier congrès du PC(B) d’Ukraine a eu lieu à Moscou. Pour Lénine et la direction du PC(B) russe, la décision de Tahanrih avait le goût d’une déviation nationaliste. Ils n’étaient pas prêts à accepter un parti bolchevique indépendant en Ukraine ou une section ukrainienne du Komintern. Le PC(B) d’Ukraine ne pouvait être qu’une organisation régionale du PC(B) panrusse, selon la thèse « un pays, un parti ». L’Ukraine n’est-elle pas un pays ?
Skrypnyk, considéré comme responsable de la déviation, a été éliminé de la direction du Parti. Dans cette situation, Shakhrai, le plus intransigeant des « Poltavans », est passé à la dissidence ouverte. Dans deux livres au contenu incendiaire, écrits avec son camarade juif ukrainien Serhii Mazlakh, ils ont jeté les bases d’un communisme ukrainien indépendantiste. Pour eux, la révolution nationale ukrainienne était un acte d’une énorme importance pour la révolution mondiale. La tendance naturelle et légitime de cette révolution et sa transformation en révolution sociale ne pouvaient que conduire à la formation d’une Ukraine soviétique ouvrière et paysanne en tant qu’Etat indépendant. Le mot d’ordre de l’indépendance était donc crucial pour assurer ce dépassement, pour former l’alliance ouvriers-paysans, permettre au prolétariat révolutionnaire de prendre le pouvoir et d’établir une unité réelle et sincère avec le prolétariat russe. Ce n’est qu’ainsi que l’Ukraine pourrait devenir un bastion de la révolution prolétarienne internationale. La politique contraire conduirait au désastre. C’était le message du courant Shakhrai.[13]
Et ce fut effectivement une catastrophe.
Les raisons de l’échec du deuxième gouvernement bolchevique
En novembre 1918, sous l’impact de l’effondrement des pouvoirs centraux dans la guerre impérialiste et du déclenchement de la révolution en Allemagne, une insurrection nationale généralisée renversa l’Hetmanat, un faux État établi en Ukraine par l’impérialisme allemand. Les dirigeants opportunistes de l’ancienne Rada centrale de la République populaire ukrainienne qui, peu de temps auparavant, avaient conclu un compromis avec l’impérialisme allemand, prirent la tête de l’insurrection pour restaurer la République et son gouvernement, cette fois appelé le Directoire. Symon Petlyura, un ancien social-démocrate devenu un droitier jurant une haine féroce du bolchevisme, est devenu de facto le dictateur militaire. Mais cette montée sans précédent d’une révolution nationale des masses était aussi la montée d’une révolution sociale. Tout comme ils l’avaient fait auparavant, face à la Rada centrale, les masses perdirent rapidement leurs illusions sur le Directoire de Petlioura et se tournèrent de nouveau vers le programme social des bolcheviks. L’extrême gauche du Parti social-révolutionnaire ukrainien, appelé les Borotbistes, de plus en plus procommuniste, affirme son influence idéologique dans les masses.[14]
Dans une situation favorable à la possibilité d’une convergence entre la Révolution russe et la Révolution ukrainienne, l’Armée rouge entre à nouveau dans le pays, chasse le Directoire et établit le second gouvernement bolchevik. Piatakov était à la tête de ce gouvernement avant d’être rapidement rappelé à Moscou.
Tout en continuant à ignorer la question nationale — pour lui la révolution ukrainienne n’est pas une révolution nationale mais une révolution paysanne —, le gouvernement Piatokov, sensible à la réalité sociale de l’Ukraine, se veut un pouvoir d’État indépendant. Il considérait ce pouvoir comme indispensable pour assurer le passage de la révolution paysanne à la révolution prolétarienne et pour donner la direction prolétarienne à la guerre révolutionnaire populaire. Moscou a nommé Christian Rakovsky pour prendre la place de Piatakov. Arrivé depuis peu des Balkans, où la question nationale était particulièrement compliquée et aiguë, il s’est déclaré spécialiste de la question ukrainienne et a été reconnu comme tel à Moscou, y compris par Lénine. En réalité, bien qu’il ait été un militant très talentueux et totalement dévoué à la cause de la révolution mondiale, il était complètement ignorant et dangereux dans sa soi-disant spécialité. Danslzvestiya, le journal gouvernemental soviétique, il énonce les thèses suivantes : les différences ethniques entre Ukrainiens et Russes sont insignifiantes ; les paysans ukrainiens n’ont pas de conscience nationale ; ils envoient même des pétitions aux bolcheviks pour exiger d’être sujets russes ; ils refusent de lire des proclamations révolutionnaires en ukrainien tout en dévorant la même chose en russe. La conscience nationale des masses a été submergée par leur conscience de classe sociale. Le mot « Ukrainien » est pratiquement une insulte pour eux. La classe ouvrière est purement d’origine russe. La bourgeoisie industrielle et la majorité des grands propriétaires terriens sont russes, polonais ou juifs.[15]
Rakovsky comprenait parfaitement que la révolution bolchevique en Ukraine était le « nœud stratégique » et le « facteur décisif » dans l’extension de la révolution socialiste en Europe. [16] Cependant, incapable de replacer sa vision dans le contexte de la révolution nationale ukrainienne ou de reconnaître que cette dernière était une force active incontournable et indispensable, Rakovsky condamna sa propre stratégie a condamné sa propre stratégie à faire naufrage sur les rochers de la question ukrainienne. Une erreur tragique mais relative si on la compare à celle de Lénine dix-huit mois plus tard, qui plongea la révolution européenne dans le bourbier de la question nationale polonaise en donnant l’ordre d’envahir la Pologne.
Contrairement aux revendications de Piatakov, le gouvernement de Rakovsky — qui était sur le papier celui d’une « république indépendante » — se considérait comme une simple délégation régionale de pouvoir de l’Etat ouvrier russe. Mais la réalité objective est implacable. Face à la tentative de Rakovsky d’imposer un centralisme communiste de la Grande Russie, la réalité nationale, déjà expliquée par des bolcheviks comme Shakhraï, et aussi à leur manière par des bolcheviks comme Piatakov, se fait sentir. Ce centralisme a déclenché de puissantes forces centrifuges. La révolution prolétarienne n’a pas conduit la révolution nationale, pas plus qu’une direction militaire prolétarienne ne s’est imposée à la tête de l’insurrection nationale et sociale armée des masses. Pour atteindre la conscience de classe, les masses d’un peuple opprimé doivent d’abord passer par l’étape de la prise de conscience nationale. Ayant aliéné et même réprimé les porteurs de cette conscience, le recrutement dans l’administration se restreignit à la petite bourgeoisie russe, souvent réactionnaire, habituée à servir sous les ordres de celui qui était au pouvoir à Moscou. Il en va de même pour l’armée : le recrutement se fait parmi des personnes de très faible niveau de conscience, pour ne pas dire d’éléments lumpen. Le résultat fut un conglomérat de forces armées disparates, avec des commandants allant de Nestor Makhno (présenté par la presse centrale en termes élogieux comme un leader révolutionnaire naturel des paysans pauvres en révolte, ignorant entièrement ses convictions anarcho-communistes, totalement en contradiction avec le bolchevisme ) à de simples aventuriers comme Matvii Hryhoryiv.[17]
La politique agraire de gauche, celle de la commune, transplantée en Ukraine depuis la Russie sur le principe d’un seul pays et d’une seule politique agraire, aliéna inévitablement les paysans moyens. Il les a jetés dans les bras des paysans riches et a assuré leur hostilité au gouvernement Rakovsky tout en isolant et en divisant les paysans pauvres. Le pouvoir était exercé par le parti bolchevik, les comités révolutionnaires et les comités de paysans pauvres, imposés d’en haut par le Parti. Les soviets n’étaient autorisés que dans certaines grandes villes et n’avaient même alors qu’un rôle consultatif. La revendication populaire la plus largement soutenue était celle de tout le pouvoir à des soviets démocratiquement élus – une revendication d’origine bolchevique qui frappait maintenant la politique bolchevique actuelle. Sur le plan national, la politique était celle de la russification linguistique, la « dictature de la culture russe » proclamée par Rakovsky et la répression des militants de la renaissance nationale. Le grand philistin russe a su s’envelopper du drapeau rouge pour réprimer tout ce qui sentait le nationalisme ukrainien et défendre la Russie « une et indivisible » historique. Par la suite, Skrypnyk a dressé une liste de quelque 200 décrets «interdisant l’usage de la langue ukrainienne» rédigés sous le règne de Rakovsky par «une variété de pseudo-spécialistes, de bureaucrates soviétiques et de pseudo-communistes».[18] Dans une lettre à Lénine, les borotbistes devaient décrire la politique de ce gouvernement comme celle de « l’expansion d’un impérialisme “rouge” (nationalisme russe) », donnant l’impression que « le pouvoir soviétique en Ukraine était tombé en les mains de Cent Noirs endurcis préparant une contre-révolution. [19]
Au cours d’une escapade militaire, l’armée rebelle de Hryhoryiv s’empare d’Odessa et proclame avoir jeté à la mer le corps expéditionnaire de l’Entente (en fait en train d’évacuer la ville). Cet exploit fictif a été soutenu par la propagande bolchevique. Sentant un changement de vent, le «vainqueur de l’Entente », Hryhoryiv, s’est rebellé contre le pouvoir de « la commune, de la Tcheka et des commissaires » envoyés de Moscou et du pays «où ils ont crucifié Jésus-Christ». Il a donné le signal d’une vague d’insurrections pour renverser le gouvernement Rakovsky. Conscient de l’état d’esprit des masses, il les appela à établir partout des soviets d’en bas, et à ce que leurs délégués se réunissent pour élire un nouveau gouvernement. Quelques mois plus tard, Hryhoryiv a été abattu par Makhno en présence de leurs armées respectives, accusé de responsabilité dans des pogroms antisémites. Même l’extrême gauche pro-communiste de la social-démocratie a pris les armes contre le « gouvernement russe d’occupation ». Des pans entiers de l’Armée rouge ont déserté et ont rejoint l’insurrection. Les troupes d’élite des « cosaques rouges » se sont désintégrées politiquement, tentées par le banditisme, le pillage et les pogroms.[20]
Ces soulèvements ont ouvert la voie à Dénikine et isolé la Révolution hongroise. De Budapest, un Bela Kun désespéré a exigé un changement radical de la politique bolchevique en Ukraine. Le commandant du front ukrainien de l’Armée rouge, Antonov-Ovseyenko, a fait de même. Parmi les bolcheviks ukrainiens, le courant “fédéraliste”, en accord effectif avec les idées de Shakhrai et de Borotbisme, a commencé une activité fractionnelle. Les borotbistes, protecteurs de leur autonomie, bien que toujours alliés aux bolcheviks, formèrent le parti communiste ukrainien (borotbiste) et demandèrent à être reconnus comme section nationale du Komintern. Avec une grande influence parmi la paysannerie pauvre et la classe ouvrière ukrainienne dans les campagnes et les villes, ce parti se tournait vers une Ukraine soviétique indépendante.
Les révolutions hongroise et bavaroise, privées du soutien militaire bolchevique, ont été écrasées. La révolution russe elle-même était en danger de mort à cause de l’offensive de Dénikine.
La Russie « une et indivisible » ou l’indépendance de l’Ukraine ?
C’est dans ces conditions que Trotsky, au cours d’un tournant nouveau et décisif de la guerre civile — alors que l’Armée rouge passait à l’offensive contre Dénikine — prit une initiative politique d’une importance fondamentale. Le 30 novembre 1919, dans son ordre aux troupes rouges à leur entrée en Ukraine, il déclara :
« L’Ukraine est la terre des ouvriers ukrainiens et des paysans travailleurs. Eux seuls ont le droit de régner en Ukraine, de la gouverner et d’y construire une nouvelle vie…. Gardez bien ceci à l’esprit : votre tâche n’est pas de conquérir l’Ukraine mais de la libérer. Lorsque les bandes de Dénikine auront finalement été brisées, les travailleurs de l’Ukraine libérée décideront eux-mêmes des conditions dans lesquelles ils doivent vivre avec la Russie soviétique. Nous sommes tous sûrs, et nous savons, que les travailleurs d’Ukraine se déclareront pour l’union fraternelle la plus étroite avec nous…. Vive l’Ukraine soviétique libre et indépendante ! » [21]
Après deux ans de guerre civile en Ukraine, il s’agissait de la première initiative du régime bolchevique visant à attirer les forces sociales et politiques de la révolution nationale ukrainienne – c’est-à-dire les ouvriers et les paysans ukrainiens – dans les rangs de la révolution prolétarienne. Trotsky était également soucieux de contrecarrer la dynamique de plus en plus centrifuge du communisme ukrainien, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du parti bolchevique.
La recherche par Trotsky d’une solution politique à la question nationale ukrainienne était soutenue par Rakovsky, qui avait pris conscience de ses erreurs, et se coordonnait étroitement avec Lénine, lui aussi désormais conscient des conséquences désastreuses de politiques qu’il avait lui-même souvent soutenues, voire promu. Au Comité central bolchevique, Lénine a appelé au vote d’une résolution qui imposait à tous les membres du parti d’utiliser tous les moyens pour aider à lever toutes les barrières au libre développement de la langue et de la culture ukrainiennes… supprimées pendant des siècles par le tsarisme russe et les classes exploiteuses…. [22]
La résolution annonçait qu’à l’avenir, tous les employés des institutions soviétiques en Ukraine devraient pouvoir s’exprimer dans la langue nationale. Mais Lénine est allé beaucoup plus loin. Dans une lettre-manifeste adressée aux ouvriers et paysans d’Ukraine, il reconnaît pour la première fois quelques faits fondamentaux :
« Nous, grands communistes russes, [avons] des divergences avec les communistes bolcheviks ukrainiens et les borotbistes et ces divergences concernent l’indépendance de l’État ukrainien, les formes de son alliance avec la Russie et la question nationale en général… Il ne doit y avoir aucune divergence sur ces questions. Ils seront décidés par le Congrès pan-ukrainien des soviets. »
Dans la même lettre ouverte, Lénine affirme pour la première fois qu’il est possible d’être à la fois militant du parti bolchevik et partisan de l’indépendance complète de l’Ukraine. C’était une réponse à l’une des questions clés posées un an plus tôt par Shakhraï, expulsé du parti avant son assassinat par les Blancs. Lénine affirmait en outre :
L’une des choses qui distinguent les borotbistes des bolcheviks est qu’ils insistent sur l’indépendance inconditionnelle de l’Ukraine. Les bolcheviks ne considéreront pas cela comme un obstacle à l’effort prolétarien concerté. [23]
L’effet était spectaculaire et avait une signification stratégique. Les insurrections des masses ukrainiennes ont contribué à la défaite de Dénikine. En mars 1920, le congrès borotbiste décida la dissolution de l’organisation et l’entrée de ses militants dans le parti bolchevik. La direction borotbiste a pris la position suivante : elle s’unirait aux bolcheviks pour contribuer à l’extension internationale de la révolution prolétarienne. Les perspectives d’une Ukraine soviétique indépendante seraient beaucoup plus prometteuses dans le cadre de la révolution mondiale qu’au niveau panrusse. Avec un grand soulagement, Lénine déclara :
« Au lieu d’une révolte des borotbistes, qui semblait inévitable, nous constatons que, grâce à la politique correcte du Comité central, qui a été menée si magnifiquement par le camarade Rakovsky, tous les meilleurs éléments parmi les borotbistes ont rejoint notre parti sous notre contrôle. …. Cette victoire valait quelques bons combats. » [24]
En 1923, un historien communiste a fait remarquer que c’est en grande partie sous l’influence des borotbistes que le bolchevisme a subi l’évolution de « le Parti communiste russe en Ukraine » pour devenir le « Parti communiste d’Ukraine ». [25] Même ainsi, il restait une organisation régionale du Parti communiste russe (bolchevique) et n’avait pas le droit d’être une section du Komintern.
La fusion des borotbistes avec les bolcheviks a eu lieu juste avant une nouvelle crise politique – l’invasion de l’Ukraine par l’armée bourgeoise polonaise accompagnée de troupes ukrainiennes sous le commandement de Petlyura, et la guerre soviéto-polonaise qui en a résulté. Cette fois, le grand chauvinisme russe des masses se déchaîna à une échelle et avec une agression qui échappèrent à toute retenue des bolcheviks.
Pour les éléments conservateurs de Russie, c’était une guerre contre un ennemi héréditaire, avec la réémergence duquel ils ne pouvaient pas se réconcilier en tant que nation indépendante – une véritable guerre russe, bien que menée par des internationalistes bolcheviks. Pour les grecs orthodoxes, c’était un combat contre le peuple incorrigible dans sa loyauté envers le catholicisme romain, une croisade chrétienne même si elle était menée par des communistes impies. [26]
Les masses ont été émues par la défense de la Russie «une et indivisible», une humeur attisée par la propagande. Izvestia a publié un poème presque incroyablement réactionnaire glorifiant l’État russe. Son message était qu'”il y a aussi longtemps, le tsar Ivan Kalita s’est réuni dans tous les pays de Russie, un par un… maintenant tous les dialectes, et tous les pays, tout le monde multinational seront réunis dans une nouvelle foi afin de “apporter leur puissance et leurs richesses aux palais du Kremlin”. [27]
L’Ukraine a été la première victime de l’explosion chauvine. Un social-démocrate ukrainien de gauche, Volodymyr Vynnychenko, qui avait été le chef de la Rada centrale et qui avait rompu avec le Directoire de Petlioura pour négocier aux côtés de Bela Kun un changement de politique bolchevique en Ukraine, se retrouve à Moscou à l’invitation du gouvernement soviétique à l’époque où de nombreux officiers blancs répondaient à l’appel de l’ancien commandant en chef de l’armée tsariste de « défendre la patrie russe » et rejoignaient l’Armée rouge. Georgy Chicherin, alors commissaire aux affaires étrangères, a expliqué à Vynnychenko que son gouvernement ne pouvait pas se rendre à Canossasur la question ukrainienne. Dans son journal, Vynnychenko écrit : « L’orientation vers le patriotisme russe de la variété « une et indivisible » exclut toute concession aux Ukrainiens… la fédération, l’autodétermination ou toute autre chose qui pourrait bouleverser la Russie « une et indivisible ». De plus, sous l’influence de la marée chauvine grand-russe qui traversait les couloirs du pouvoir soviétique, Chicherin a ressuscité l’idée que la Russie pourrait annexer directement la région ukrainienne du Donbass. [28] Dans la campagne ukrainienne, les responsables soviétiques ont demandé aux paysans : « Voulez-vous apprendre le russe ou le Pétliouriste à l’école ? Quel genre d’internationalistes êtes-vous, si vous ne parlez pas russe ?
Face à cette grande régression chauvine russe, les borotbistes devenus bolcheviks poursuivent le combat. L’un de leurs principaux dirigeants, Vasyl Ellan-Blakytny, écrivait à l’époque :
« Se fondant sur les liens ethniques de la majorité du prolétariat ukrainien avec le prolétariat, le semi-prolétariat et la petite bourgeoisie de Russie et utilisant l’argument de la faiblesse du prolétariat industriel d’Ukraine, une tendance que nous qualifions de colonialiste appelle à la construction d’un système économique dans le cadre de la République russe, qui est celle de l’ancien Empire auquel appartenait l’Ukraine. Cette tendance veut la subordination totale du Parti communiste (bolchevique) d’Ukraine au parti russe et envisage en général la dissolution de toutes les jeunes forces prolétariennes des « nations sans histoire » dans la section russe du Komintern…. En Ukraine, la force motrice naturelle d’une telle tendance est une partie du prolétariat urbain et industriel qui n’a pas accepté la réalité ukrainienne. Mais au-delà, et surtout, c’est la petite bourgeoisie urbaine russifiée qui a toujours été le principal soutien de la domination de la bourgeoisie russe en Ukraine. »
Et les bolcheviks d’origine borotbiste concluaient :
« Le projet colonialiste de grande puissance qui prévaut aujourd’hui en Ukraine nuit profondément à la révolution communiste. En ignorant les aspirations nationales naturelles et légitimes des masses laborieuses ukrainiennes précédemment opprimées, il est totalement réactionnaire et contre-révolutionnaire et est l’expression d’un chauvinisme impérialiste grand-russe ancien, mais toujours vivant. » [29]
Pendant ce temps, l’extrême gauche des sociaux-démocrates forma un nouveau parti, appelé parti ukapiste, afin de continuer à revendiquer l’indépendance nationale et d’accueillir les éléments borotbistes qui n’avaient pas rejoint les bolcheviks. Issu de la tradition théorique de la social-démocratie allemande, ce nouveau parti était bien plus fort sur le plan théorique que le borotbisme, qui avait des origines populistes et où l’art poétique était mieux compris que la science de l’économie politique. Mais ses liens avec les masses étaient plus faibles. [30]Les masses étaient, en tout cas, de plus en plus lassées de cette révolution permanente, dans un sens à la fois mondain et théorique. La conception théorique de Trotsky de la révolution permanente ne correspondait cependant pas en réalité à un dépassement, mais à une scission permanente entre une révolution nationale et une révolution sociale. L’un des pires résultats de cela a été l’incapacité de parvenir à une Ukraine unie (la demande de sobornist ). L’erreur fatale de Lénine en envahissant la Pologne a exacerbé la question nationale polonaise dans une direction anti-bolchevique et a bloqué l’extension de la révolution. Il en résulta une défaite de l’Armée rouge et la cession à l’État polonais de plus d’un cinquième du territoire national ukrainien en plus des zones absorbées par la Roumanie et la Tchécoslovaquie.
Tout historien honnête, et a fortiori tout marxiste révolutionnaire, doit reconnaître que la promesse faite par les bolcheviks lors de l’offensive contre Dénikine — de convoquer un congrès constituant des soviets en Ukraine capable de prendre position sur les trois options (indépendance complète, plus ou liens fédéraux moins étroits avec la Russie, ou fusion complète avec cette dernière) avancée par Lénine dans sa lettre de décembre 1919, n’a pas été retenue. Selon Trotsky, pendant la guerre civile, la direction bolchevique envisagea de mettre en avant un projet audacieux de démocratie ouvrière pour résoudre la question anarchiste dans la région sous le contrôle de l’armée insurrectionnelle de Makhno. Trotsky lui-même a discuté plus d’une fois avec Lénine de la possibilité d’attribuer aux anarchistes certains territoires où, avec l’accord de la population locale, ils réaliseraient leur expérience sans État.[31]
Mais il n’y a aucune trace de discussions similaires sur la question beaucoup plus importante de l’indépendance de l’Ukraine.
Ce n’est qu’après des luttes acharnées menées à la fin de sa vie par Lénine lui-même, ainsi que par des bolcheviks comme Skrypnyk et Rakovsky, par d’anciens borotbistes comme Blakytny et Oleksandr Shumsky, et par de nombreux communistes dirigeants des diverses nationalités opprimées de l’ancien empire russe, que le XIIe Congrès du parti bolchevik en 1923 a formellement reconnu l’existence dans le Parti et dans le régime soviétique d’une « tendance très dangereuse au chauvinisme impérialiste grand-russe ». Bien que cette victoire soit très partielle et fragile, elle offre aux masses ukrainiennes la possibilité d’accomplir certaines tâches de la révolution nationale et de connaître une renaissance nationale sans précédent dans les années 1920. Mais cette victoire n’a pas empêché la dégénérescence de la Révolution russe et une contre-révolution chauvine et bureaucratique qui, dans les années 1930, a été marquée par un holocauste national en Ukraine. Des millions de paysans sont morts au cours d’une famine provoquée par la politique stalinienne de pillage du pays, l’intelligentsia nationale a été presque complètement anéantie physiquement, tandis que les appareils du Parti et de l’État de la République soviétique d’Ukraine ont été détruits par la terreur policière. Le suicide de Mykola Skrypnyk en 1933, un vieux bolchevik qui tenta de concilier la révolution nationale avec l’allégeance au stalinisme, sonna le glas de cette révolution pour toute une période historique. L’intelligentsia nationale a été presque complètement anéantie physiquement, tandis que les appareils du Parti et de l’État de la République soviétique d’Ukraine ont été détruits par la terreur policière.
Erreurs tragiques à ne pas répéter
La révolution russe a eu deux effets contradictoires sur la révolution nationale ukrainienne. D’un côté, la révolution russe a été un facteur essentiel pour le renversement du pouvoir bourgeois en Ukraine. D’autre part, il a freiné le processus de différenciation de classe parmi les forces sociales et politiques de la révolution nationale. La raison en était le manque de compréhension de la question nationale. L’expérience de la Révolution de 1917-1920 a posé de façon dramatique la question des rapports entre la révolution sociale du prolétariat d’une nation dominante et une révolution nationale des masses laborieuses de la nation opprimée. Comme l’écrivait Skrypnyk en juillet 1920 :
Notre drame en Ukraine est que pour gagner la paysannerie et le prolétariat rural, une population de nationalité ukrainienne, nous devons compter sur le soutien et sur les forces d’une classe ouvrière russe ou russifiée qui était antagoniste à la moindre expression de Langue et culture ukrainiennes. [32]
Dans la même période, le Parti communiste ukrainien (Ukapiste) a tenté d’expliquer à la direction du Komintern :
Le fait que les dirigeants de la révolution prolétarienne en Ukraine puisent leur soutien dans les couches supérieures russes et russifiées du prolétariat et ignorent la dynamique de la révolution ukrainienne, signifie qu’ils ne sont pas obligés de se débarrasser du préjugé du « une et indivisible » Russie qui imprègne toute la Russie soviétique. Cette attitude a conduit à la crise de la révolution ukrainienne, coupe le pouvoir soviétique aux masses, aggrave la lutte nationale, pousse une grande partie des ouvriers dans les bras des nationalistes petits-bourgeois ukrainiens et freine la différenciation du prolétariat la petite-bourgeoisie. [33]
Ce drame aurait-il pu être évité ? La réponse est oui – si les bolcheviks avaient eu à leur disposition une stratégie adéquate avant le déclenchement de la révolution. En premier lieu, si, au lieu d’être un parti russe en Ukraine, ils avaient résolu la question de la construction d’un parti révolutionnaire du prolétariat de la nation opprimée. Deuxièmement, s’ils avaient intégré la lutte pour la libération nationale de l’Ukraine dans leur programme. Troisièmement, s’ils avaient reconnu la nécessité politique et la légitimité historique de la révolution nationale en Ukraine et du mot d’ordre de l’indépendance ukrainienne. Quatrièmement, s’ils avaient éduqué le prolétariat russe (en Russie et en Ukraine) et les rangs de leur propre parti dans l’esprit d’un soutien total à ce mot d’ordre, et combattait ainsi le chauvinisme de la nation dominante et l’idéal réactionnaire du «rassemblement des terres russes». Rien ici n’aurait empêché les bolcheviks de faire de la propagande parmi les ouvriers ukrainiens en faveur de l’unité la plus étroite avec le prolétariat russe et, pendant la Révolution, entre l’Ukraine soviétique et la Russie soviétique. Au contraire, ce n’est qu’à ces conditions qu’une telle propagande pourrait être politiquement cohérente et efficace.
Il y avait eu une occasion où Lénine avait essayé de développer une telle stratégie. C’est ce que révèle son « discours séparatiste » prononcé en octobre 1914 à Zurich. Il a ensuite dit:
« Ce que l’Irlande était pour l’Angleterre, l’Ukraine est devenue pour la Russie : exploitée à l’extrême, et sans rien en retour. Ainsi, les intérêts du prolétariat mondial en général et du prolétariat russe en particulier exigent que l’Ukraine retrouve son indépendance d’État, car seule cela permettra le développement du niveau culturel dont le prolétariat a besoin. Malheureusement, certains de nos camarades sont devenus des patriotes russes impériaux. Nous, les Moscovites, sommes réduits en esclavage non seulement parce que nous nous laissons opprimer, mais parce que notre passivité permet d’opprimer les autres, ce qui n’est pas dans notre intérêt. » [34]
Plus tard, cependant, Lénine ne s’en tient pas à ces thèses radicales. Ils réapparaissent cependant dans la pensée politique du communisme ukrainien indépendantiste, chez Shakhrai, les « fédéralistes » bolcheviks, les borotbistes et les ukapistes.
Il ne faut cependant pas s’étonner que les bolcheviks n’aient eu aucune stratégie pour les révolutions nationales des peuples opprimés de l’Empire russe. Les questions stratégiques de la Révolution étaient en général le talon d’Achille de Lénine lui-même, comme le montre sa théorie de la révolution par étapes. Quant à la théorie de la révolution permanente de Trotsky, implicitement adoptée par Lénine après la Révolution de Février, elle n’a été élaborée que par rapport à la Russie, pays capitaliste sous-développé et non pour le prolétariat des peuples opprimés par la Russie, qui était aussi un État impérialiste et une prison des nations. Les bases théoriques de la stratégie de révolution permanente pour le prolétariat d’une nation opprimée sont apparues pendant les années révolutionnaires parmi les courants indépendantistes du communisme ukrainien.
L’idée de base, d’abord esquissée par Shakhrai et Mazlakh, puis reprise par les Borotbistes avant d’être élaborée par les Ukapistes, était simple. A l’époque impérialiste, le capitalisme est bien sûr marqué par le processus d’internationalisation des forces productives, mais ce n’est qu’un côté de la médaille. Déchirée par ses contradictions, l’époque impérialiste ne produit pas une tendance sans produire aussi une contre-tendance. La tendance inverse dans ce cas est celle de la nationalisation des forces productives manifestée notamment par la formation de nouveaux organismes économiques, ceux des pays coloniaux et dépendants, tendance qui conduit à des mouvements de libération nationale.
La révolution prolétarienne mondiale n’est l’effet que d’une des tendances contradictoires du capitalisme moderne, l’impérialisme, même si c’est l’effet dominant. L’autre, inséparable de la première, ce sont les révolutions nationales des peuples opprimés. C’est pourquoi la révolution internationale est inséparable d’une vague de révolutions nationales et doit s’appuyer sur ces révolutions pour s’étendre. La tâche des révolutions nationales des peuples opprimés est de libérer le développement des forces productives entravées et déformées par l’impérialisme. Une telle libération est impossible sans la création d’États nationaux indépendants dirigés par le prolétariat. Les États ouvriers nationaux des peuples opprimés sont une ressource essentielle pour la classe ouvrière internationale si elle veut résoudre les contradictions du capitalisme et établir une gestion ouvrière de l’économie mondiale. Si le prolétariat tente de construire son pouvoir sur la base d’une seule de ces deux tendances contradictoires dans le développement des forces productives, il sera divisé contre lui-même.
Dans un mémorandum au deuxième congrès de l’Internationale communiste à l’été 1920, les ukapistes résument leur approche dans les termes suivants :
« La tâche du prolétariat international est d’entraîner vers la révolution communiste et la construction d’une nouvelle société non seulement les pays capitalistes avancés, mais aussi les peuples arriérés des colonies, en profitant de leurs révolutions nationales. Pour remplir cette tâche, elle doit participer à ces révolutions et jouer le rôle moteur dans la perspective de la révolution permanente. Il faut empêcher la bourgeoisie nationale de limiter les révolutions nationales au niveau de la libération nationale. Il est nécessaire de poursuivre la lutte jusqu’à la prise du pouvoir et l’installation de la dictature du prolétariat et de mener la révolution démocratique bourgeoise jusqu’au bout par la création d’États nationaux destinés à rejoindre le réseau international de l’union naissante des républiques soviétiques.
Ces états doivent reposer sur :
Les forces du prolétariat national et des masses laborieuses ainsi que sur l’entraide de tous les détachements de la révolution mondiale. »[35]
A la lumière de l’expérience de la première révolution prolétarienne, c’est précisément cette stratégie de révolution permanente qu’il faut adopter, pour résoudre la question des nations opprimées dans le cadre de la révolution politique anti-bureaucratique en URSS.
Comme le disait Mykola Khvylovy, militant communiste ukrainien et grand écrivain, en 1926, « l’Ukraine doit être indépendante parce que la volonté de fer et irrésistible des lois de l’histoire l’exige, parce que ce n’est qu’ainsi que nous accélérerons la différenciation des classes en Ukraine. Si une nation (comme cela a déjà été dit il y a longtemps et répété à plusieurs reprises) au cours des siècles manifeste la volonté de se manifester, son organisme, en tant qu’entité étatique, alors toutes les tentatives d’une manière ou d’une autre pour se retenir un tel processus naturel bloque d’une part la formation des forces de classe et, d’autre part, introduit un élément de chaos dans le processus historique général à l’œuvre dans le monde. » [36]
Lectures complémentaires : Le contexte historique de l’invasion de l’Ukraine par Poutine , par Rohini Hensman.
Traduction NCS à l’aide de Deepl
[1] Écrits de Léon Trotsky (1939-40) (New York : Pathfinder Press, 1977), pp. 47-48. https://www.marxists.org/archive/trotsky/1939/07/ukraine.htm
[2] Idem, p. 53.
[3] Idem, p. 52.
[4] Idem, p. 50.
[5] Voir l’un des ouvrages les plus importants sur la question nationale, celui du marxiste ukrainien R. Rosdolsky, Engels and the Nonhistoric Peoples : The National Question in the Revolution of 1848

Haïti : migration et surexploitation

L’un des phénomènes marquants de l’histoire haïtienne du début du vingtième siècle est celui de la migration. Ce phénomène prend une telle ampleur que « durant les années 1920, il y a autour de 20 % de la population active masculine haïtienne qui est employée à l’étranger, dont environ les deux-tiers à Cuba et le reste en République dominicaine[1] ».
À l’origine : spoliation, surexploitation et immigration
Précisons que durant la décennie de 1920, le pays est sous occupation étatsunienne (1915-1934) et que les déplacements de population qui s’opèrent de façon cyclique s’expliquent par le besoin criant de main-d’œuvre des usines centrales sucrières qui se trouvent surtout à Cuba, mais aussi en République dominicaine. Ces centrales sucrières sont le résultat de l’expansion du capital nord-américain qui tire d’énormes profits de la grande quantité de terres disponibles et de l’abondante main-d’œuvre haïtienne importée. En général, on comprend mal pourquoi les capitalistes étatsuniens n’ont pas autant investi dans l’industrie sucrière en Haïti qu’ils l’ont fait à Cuba et en République dominicaine. Selon une hypothèse discutable, l’une des raisons serait la difficulté pour l’occupant de prendre possession de la terre[2].
Des études démontrent cependant que des compagnies étatsuniennes ont accaparé plus de 266 000 acres de terre. Cela explique en grande partie pourquoi près de 300 000 Haïtiens et Haïtiennes, pendant l’occupation, ont dû quitter le pays vers Cuba et la République dominicaine[3]. Tout laisse croire que dans ce nouvel impérialisme mis en place par les États-Unis dans les Antilles, les travailleurs haïtiens sont utilisés comme main-d’œuvre bon marché, quasi esclave. Soulignons également que l’expropriation des terres de la paysannerie haïtienne s’est poursuivie bien après l’occupation militaire. Au cours des années 1940, en vue de ravitailler l’armée nord-américaine, la compagnie étatsunienne Société haïtiano-américaine de développement agricole (SHADA) s’approprie plusieurs dizaines de milliers d’hectares pour produire du caoutchouc et de la pite, une matière textile extraite des feuilles de l’agave[4]. Ayant perdu leur terre, des milliers de paysans sont contraints de s’expatrier, principalement vers Cuba et la République dominicaine.
Ce flux migratoire haïtien qui se poursuit de façon irrégulière constitue l’essentiel de la force de travail de l’industrie sucrière à Cuba jusqu’à la révolution et en République dominicaine jusqu’aux années 1970. Haïti devient au cours de cette période un pays pourvoyeur de main-d’œuvre à faible coût[5]. Cette migration de la force de travail ne touche pas uniquement les deux pays déjà mentionnés : « En 1970, 30 000 Haïtiens vivent aux États-Unis ; en 1973, 40 000 aux Bahamas ; de 1974 à 1985, la croissance de l’immigration haïtienne en Guyane est si élevée que le nombre d’immigrés représente 20 % de la population totale du pays en 1985. De façon générale, cette migration est constituée d’ouvriers (particulièrement aux États-Unis), d’artisans, de petits commerçants et d’agriculteurs (particulièrement aux Bahamas et en Guyane)[6] ».
Dictature, politique néolibérale et exode rural
À la fin des années 1960 et surtout durant la décennie 1970, les politiques néolibérales mises en place par l’État haïtien sous la pression du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale (BM) contribuent à dégrader l’agriculture et à éliminer de nombreuses industries locales. L’exode rural s’intensifie. La population de la capitale, Port-au-Prince, augmente de façon exponentielle, de 50 000 habitants au cours de la décennie 1950 à 300 000 au milieu des années 1970[7].
Cette surpopulation allait constituer l’armée de réserve en main-d’œuvre pour les compagnies de sous-traitance installées dans la capitale. Le nombre de celles-ci croît rapidement au cours des années 1970, passant de 55 en 1971 pour atteindre 200 en 1984[8]. L’implantation des mesures néolibérales eut pour résultat non seulement la dégradation de l’agriculture, ce qui induisit un exode rural et la faillite des industries de l’État, mais aussi une augmentation importante du chômage, la sous-traitance ne pouvant absorber qu’une infirme partie de la population en âge de travailler (6 % en 1973)[9].
Cette situation sociale difficile est aggravée par la répression de la dictature des Duvalier. Depuis le début des années 1960, le régime spolie systématiquement les caisses de l’État et exproprie violemment les paysans. Toutes les formes d’organisation sociale (syndicales, paysannes, étudiantes, politiques, journalistiques, etc.) sont réprimées dans le sang. Des milliers de personnes sont assassinées ou disparaissent, beaucoup d’autres prennent le chemin de l’exil. Puisqu’aucune revendication ni critique n’est permise, la dictature ouvre la voie à l’exploitation impitoyable des ouvriers et des ouvrières particulièrement dans l’industrie du textile et, de façon générale, à l’implantation des politiques néolibérales, comme ce fut le cas au Chili sous la dictature de Pinochet.
L’exode rural devient donc le seul choix de survie de la classe paysanne qui, historiquement, nourrissait le pays. « On assiste à un changement structurel imposé par les groupes sociaux dominants et le marché mondial pour satisfaire la demande étrangère, changement qui crée les conditions non seulement d’une dégradation de l’économie paysanne traditionnelle, mais aussi d’une désertification constante du sol[10]. » Ce sont ces conditions également qui vont pousser nombre d’habitants des classes populaires et de la petite-bourgeoisie à quitter le pays au début des années 1970.
Immigration haïtienne prolétarisée au Québec
À partir de 1968, le nombre d’immigrantes et d’immigrants haïtiens s’établissant au Québec s’accroît substantiellement. En 1974, cette immigration haïtienne occupe la première place parmi les immigrants reçus dans la province. C’est une immigration caractérisée par le gouvernement canadien comme une main-d’œuvre majoritairement « non qualifiée », c’est-à-dire destinée à pourvoir des postes que les personnes du pays ne veulent pas. Cette immigration diffère de celle de la décennie 1960 qui était constituée principalement de professionnel·le·s travaillant dans le secteur tertiaire de l’économie.
À l’époque, la politique d’immigration canadienne s’oriente sur les besoins de l’industrie, en particulier de l’industrie du textile, localisée à 80 % au Québec, principalement à Montréal, et où les salaires sont parmi les moins élevés au Canada. Les Haïtiennes sont surreprésentées dans le secteur où elles constituent plus de 50 % de la main-d’œuvre[11].
Ces immigrantes, de même que d’autres femmes venues de pays comme la Grèce, le Portugal, la Colombie travaillent dans des conditions très difficiles, et le nombre d’heures de travail annuel est de 5,6 % plus élevé que la moyenne[12]. De façon générale, ces travailleurs et travailleuses qui intègrent le marché du travail au Québec au début des années 1970 se trouvent dans une situation de précarité qui rend possible leur surexploitation : statut juridicopolitique vulnérable, incompréhension de la langue, isolement, racisme.
Les dessous de la poussée migratoire haïtienne en Amérique latine
Depuis les années 2000, on observe une tendance à la hausse du nombre de migrantes et migrants haïtiens vers l’Amérique latine[13]. Cette tendance devient une grande traversée au cours de la décennie 2010[14], après le tremblement de terre qui a ravagé l’aire métropolitaine de Port-au-Prince. Selon les données de l’ONU de 2019, environ 1,5 million d’Haïtiens ont émigré ces dix dernières années, soit 14,26 % de la population haïtienne active. Leurs nouvelles destinations incluent le Brésil et le Chili alors que le Mexique, le Panama, l’Équateur et le Pérou servent souvent de lieu de transit[15]. Cette augmentation dans la région coïncide avec la transformation des politiques d’immigration. Le Brésil, notamment, allège sa politique de régulation de l’immigration de manière à attirer cette main-d’œuvre corvéable à merci dans le contexte des préparatifs de plusieurs compétitions sportives internationales, dont la Coupe du monde et les Jeux olympiques[16]. Le capital transnational et la bourgeoisie brésilienne en profitent pour effectuer la construction d’infrastructures. L’économie brésilienne s’intéresse à ces migrants en quête d’espoir, mais sans saisir les raisons pour lesquelles le territoire haïtien est devenu si peu désirable pour ses citoyens et citoyennes. Dans un contexte où l’armée de plusieurs pays de la région, dont le Brésil, participe à l’occupation militaire d’Haïti sous le label de l’ONU, il s’avère pertinent de s’interroger sur la cause de cette grande traversée des Haïtiens vers les pays de l’Amérique latine.
L’impensé de la grande traversée
Les trois dernières décennies constituent une période charnière dans la mise en œuvre des politiques néolibérales en Haïti. Depuis le retour à l’ordre démocratique en 1994, le pays est entré dans une seconde vague de néolibéralisation[17]. Sous la menace des soldats américains, les gouvernements successifs sont contraints de privatiser les principales entreprises d’État, de réduire au minimum les investissements sociaux et de dégraisser l’appareil d’État. Si ces troupes sont parties en 1999, après avoir été progressivement remplacées par des missions militaires et civiles de l’ONU, l’année 2004 donne lieu à une autre occupation militaire par les États-Unis. La composante militaire a par la suite fait place aux Casques bleus de l’ONU sous le commandement de l’armée de terre du Brésil[18]. Depuis lors, Haïti est sous la tutelle de l’ONU[19]. La saignée néolibérale des masses urbaines et rurales se poursuit sous la pression des chars et des mitraillettes des militaires des Nations unies.
Dans le jargon des ambassades occidentales et du Conseil de sécurité de l’ONU, l’objectif de l’occupation onusienne vise la « stabilisation des institutions haïtiennes ». Celle-ci se définit par la restauration d’un climat sûr et stable, le renforcement des institutions gouvernementales et des structures d’un État de droit, la promotion et la protection des droits humains[20]. Dans les faits, la présence militaire sert d’appui à un processus de néolibéralisation à grande échelle qui a pour résultat un accroissement de la pauvreté dans les principaux centres urbains et ruraux, ainsi que l’explosion d’un chômage de masse. Entretemps, les entreprises publiques et des pans entiers du territoire sont livrés à vil prix aux multinationales[21]. L’enjeu consiste à tenir en respect les mouvements sociaux haïtiens tout au long de ce processus dit de « stabilisation du pays ».
Le bilan de la répression est lourd, dont des milliers de morts dans les quartiers populaires de l’aire métropolitaine de Port-au-Prince et des villes secondaires du pays. Des centaines de femmes et d’enfants subissent des viols commis par des Casques bleus. De surcroît, le choléra introduit par les troupes onusiennes tue plus de 10 000 personnes sur 800 000 infectées, sans le moindre dédommagement pour les victimes. Les troupes militaires d’occupation quittent Haïti en 2017, mais l’ONU maintient le pays sous tutelle à travers la Mission civile des Nations unies. Les deux décennies de tutelle génèrent une situation de chaos social et institutionnel[22], où des gangs armés sèment la terreur avec l’appui des agences gouvernementales et internationales. Ce chaos rend la majorité de la population haïtienne désireuse de quitter le territoire.
En guise de conclusion
Il ressort de tout cela que la migration haïtienne est essentiellement une migration de main-d’œuvre bon marché. Tout au long du XXe siècle, les différentes formes qu’elle a prises relèvent soit d’une situation de coercition, d’expropriation et de dépossession de la terre, comme cela a été le cas au cours de l’occupation étatsunienne ou encore au cours des années 1940, soit de l’implantation des politiques néolibérales à partir des années 1970. Cette migration touche particulièrement la paysannerie, même si la petite bourgeoisie est également concernée, constituée en bonne partie d’exilé·e·s politiques victimes de la dictature des Duvalier dans la décennie 1960. Un demi-siècle plus tard, le capitalisme mondialisé et la financiarisation de l’économie ont provoqué la fermeture et la délocalisation de nombreuses industries à forte intensité de main-d’œuvre. Les immigrantes et immigrants en tant que force de travail déqualifiée deviennent de moins en moins importants pour l’économie des pays du centre. Cependant les déplacements de population restent encore, et surtout aujourd’hui, un enjeu majeur : réfugié·e·s venant des pays du Sud, théâtres des guerres impérialistes, réfugié·e·s de la crise écologique, de la destruction des économies paysannes, de la paupérisation constante des classes moyennes. Cette nouvelle réalité de la migration explique en partie la montée de l’extrême droite occidentale et redéfinit du même coup les luttes sociales au niveau mondial pour sortir de la domination du capital.
Alain Saint-Victor est historien et militant communautaire et Renel Exentus doctorant en études urbaines à l’INRS
- Alex Bellande, La grande migration haïtienne vers Cuba. Économie et condition paysanne au début du XXe siècle, Montréal, Éditions du CIDIHCA, 2019, p. 7. ↑
- Ibid., p. 192-196. ↑
- Voir Suzy Castor, L’occupation américaine d’Haïti, version française, Imprimerie Résopresse, 1978 et Fred Doura, Haïti. Histoire et analyse d’une extraversion dépendante organisée, Boucherville, Éditions DAMI, 2011. ↑
- Voir Myrtha Gilbert, SHADA : Chronique d’une extravagante escroquerie, Port-au-Prince, L’Imprimeur, 2012. ↑
- Pour approfondir cette notion, voir : Alejandro Portes, « Migration and underdevelopment », Politics & Society, 1er mars 1978. ↑
- Alain Saint-Victor, De l’exil à la communauté. Une histoire de l’immigration haïtienne à Montréal, 1960-1990, Boucherville, Éditions DAMI, 2020, p. 59. ↑
- Georges Anglade, Atlas critique d’Haïti, Montréal, Centre de Recherches Caraïbes et E.R.C.E., 1982. ↑
- Doura, op. cit., p. 124. ↑
- Saint-Victor, op. cit., p. 58. ↑
- Ibid., p. 59. ↑
- Bernard Bernier, « Main-d’œuvre féminine et ethnicité dans trois usines de vêtement de Montréal », Anthropologie et Sociétés, vol. 3, n° 2, 1979, p. 117-139. ↑
- Micheline Labelle, Geneviève Turcotte, Marianne Kempeneers et Deidre Meintel, Histoires d’immigrées. Itinéraires d’ouvrières colombiennes, grecques, haïtiennes et portugaises de Montréal, Montréal, Boréal, 1987, p. 215. ↑
- Pierre Rigaud Dubuisson, « Politiques migratoires en Amérique Latine entre 2010 et 2020, et choix du Brésil comme pays de destination par les migrantes et migrants d’Haïti », Alterpresse.org, 14 décembre 2020. Voir également Renel Exentus, « Haïti–États-Unis, crise migratoire dans la ville Del Rio », Presse-toi à gauche, 28 septembre 2021; Nations unies, International Migration 2019, New York, 2019; Organisation internationale pour les migrations (OIM), Rapport du Directeur général sur les travaux de l’Organisation pour l’année 2014, Genève, 2015; OIM, La migration haïtienne vers le Brésil : caractéristiques, opportunités et enjeux, Cahiers migratoires n° 6, Genève, OIM, 2015.↑
- Dans son analyse des déplacements massifs des Haïtiens vers les pays de l’Amérique latine au cours des dernières années, l’historien-géographe Georges Eddy Lucien a repris l’image de « grande traversée ». Il associe cette poussée migratoire à l’histoire des grandes traversées lors des traites musulmanes et occidentales. Pour plus de précisions, voir la vidéo « L’invité du midi, Georges Eddy Lucien », Radio Télévision Caraïbes, 27 septembre 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=uAjROnI3O6Y>. ↑
- Dubuisson, op. cit. ↑
- Il s’agit de la Résolution Recommandée no 06/08 du Conseil national de l’Immigration (CNIg) du Brésil de mars 2011, qui permet l’octroi, pour des raisons humanitaires, d’une résidence permanente aux Haïtiennes et Haïtiens qui sont au Brésil ; la Résolution Normative no 97, publiée le 13 janvier 2012, qui décide d’octroyer annuellement 1 200 visas aux Haïtiennes et Haïtiens, et la Résolution Normative 102/2013, publiée le 29 avril 2013, qui révoque la limite de 1 200 visas annuels (Dubuisson, 2020, p. 2). ↑
- À côté de la privatisation des entreprises publiques, des projets de création de zones franches deviennent l’unique programme économique des pouvoirs publics. Pour avoir une vue globale des zones franches en Haïti, voir Laura Louis, « Privilèges et impacts des zones franches en Haïti », AyiboPost, 5 juin 2019, <https://ayibopost.com/privileges-et-impacts-des-zones-franches-en-haiti/>. ↑
- Les gouvernements de gauche libérale de Lula et de Dilma Vana Roussef n’ont pas hésité à diriger une force d’occupation sous l’égide de l’ONU en Haïti. Cette fonction leur a permis de développer des occasions d’affaires pour leur bourgeoisie et de se positionner pour occuper un siège au Conseil de sécurité de l’ONU. Voir Jean-Jacques Kourliandsky, « Lula et la politique étrangère brésilienne de 2003 à 2010 », Alternatives Sud, vol. 17, n° 1, 2010, <https://cetri.be/IMG/pdf/3-3.pdf>. ↑
- Voir MINUSTAH, Mission des Nations unies pour la stabilisation en Haïti, <https://peacekeeping.un.org/fr/mission/minustah>.↑
- Ibid. ↑
- Georges Eddy Lucien, Le Nord-Est d’Haïti. La perle d’un monde fini : entre illusions et réalités (Haïti open for business), Paris, L’Harmattan, 2018. ↑
- Pour de plus amples informations sur le comportement sanguinaire de l’institution policière haïtienne (Police nationale d’Haïti, PNH), sa complicité avec les gangs armés, voir « La PNH assume le massacre à “Ravine pintade” », Gazettehaïti, 22 septembre 2021, < https://www.gazettehaiti.com/node/4882> ; Harvard Law School International Human Rights Clinic et Observatoire Haïtien des crimes contre l’humanité, Massacres cautionnés par l’État : règne de l’impunité en Haïti, avril 2021, <http://hrp.law.harvard.edu/wp-content/uploads/2021/04/Massacres-cautionnes-par-lEtat-2.pdf>.↑

Brésil. Avec Bolsonaro, l’extrême droite se développe

Plus que de l’inquiétude, l’humanité vit des jours de profonde angoisse à cause de ce qui se passe en Ukraine. Il est impossible de prévoir comment tout cela va se terminer. La seule chose prévisible est que, quoi qu’il arrive, cela finira mal. Le contexte ne sera plus jamais le même. Il n’y a jamais eu une telle tension depuis la crise entre Washington et Moscou en 1962, lorsque les Soviétiques ont installé des bases militaires à Cuba.
Le Brésil n’est pas à l’abri de ce qui se passe de l’autre côté de la planète. Les attitudes folles et ineptes du déséquilibré d’ultra-droite Jair Bolsonaro, le pire président de l’histoire, sur l’Ukraine [1] ne font que consolider l’isolement du pays sur la scène internationale.
Mais le fait que nous soyons désormais des parias mondiaux ne nous permet pas d’ignorer ce qui se passe dans le Brésil que Bolsonaro n’a de cesse de déchirer à chaque minute de chaque heure de sa vie.
Une étude récemment publiée par l’ONG Anti-Defamation League montre que le Brésil est actuellement le pays où le nombre de groupes d’extrême droite augmente le plus. Depuis 2018, année où Bolsonaro a été élu président, le nombre de ces groupes a augmenté de 300%, contre une croissance de 10% dans les pays d’Europe centrale et orientale.
Selon l’Observatoire de l’extrême droite, un groupe qui réunit des universitaires de dix universités brésiliennes et étrangères, ces cellules extrémistes sont concentrées dans les Etats de São Paulo, le plus riche et le plus peuplé du pays, de Rio de Janeiro, de Santa Catarina (où la popularité de Bolsonaro reste intouchable) et de Rio Grande do Sul.
Cela représente pas moins de 530 cellules. Une étude coordonnée par la professeure Adriana Dias, de la très prestigieuse Université de Campinas (Unicamp) à l’intérieur de São Paulo, a réparti ces groupes en différentes catégories, allant des hitlériens/nazis à l’ultranationalisme blanc, en passant par le catholicisme intégriste et le fascisme.
Plusieurs études menées au Brésil et à l’étranger indiquent clairement que depuis 2018, le pays est devenu la scène où l’extrême droite se développe le plus, et que le phénomène est directement lié à l’arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro.
A l’heure actuelle, les sondages relatifs aux élections d’octobre indiquent clairement qu’au moins 15% des personnes interrogées sont d’extrême droite, et ce non seulement pour avoir déclaré leur vote irréductible pour Bolsonaro, mais aussi pour leurs observations relatives à ce qu’elles attendent au cas où il parviendrait à se faire réélire.
La croissance de ceux qui sont sortis de leur réserve pour s’affirmer des conservateurs clairement extrémistes a commencé plus tôt, à la veille du coup d’Etat institutionnel qui a chassé la présidente Dilma Rousseff en août 2016. Mais ce mouvement était encore timide et limité.
Déjà lors de la campagne de 2018, avec des déclarations racistes, homophobes et clairement extrémistes, Bolsonaro a accordé une sorte blanc-seing à ces groupes pour sortir au grand jour. Et ces regroupements se développent à grande vitesse, principalement grâce aux médias sociaux.
Il est facile de constater cette croissance ainsi que l’expansion des contacts avec les groupes du monde entier, notamment en Pologne et en Hongrie, mais aussi en Espagne et au Portugal.
Les universitaires qui étudient le phénomène affirment que l’extrême droite se consolide au Brésil, et que la plupart d’entre eux tentent de se rallier à Bolsonaro, tout en renforçant leurs liens à l’étranger.
Même si le président actuel est battu dans les urnes en octobre, comme l’indiquent les sondages à l’unisson, rien ne permet de penser que cette extrême droite perdra du poids et de l’espace. Au contraire, elle pourrait devenir plus radicale et plus active.
A cette fin, ils utilisent largement le réseau social Telegram, qui compte environ 50 millions d’utilisateurs dans le monde et n’exerce aucun contrôle sur ce qui est publié et diffusé. Leur action a une influence particulière sur la jeunesse brésilienne.
Dans le cas spécifique de Rio de Janeiro, le scénario devient particulièrement inquiétant. Il existe des signes clairs de rapprochement entre les groupes nazis et les «milices», des bandes de tueurs à gages composées de policiers ou d’anciens policiers qui contrôlent une part importante du commerce de la drogue.
Si l’on se souvient que depuis que Jair Bolsonaro est devenu président, il a élargi l’accès aux armes d’une manière sans précédent, y compris celles qui étaient auparavant limitées aux forces armées, il y a de plus en plus de raisons de s’inquiéter sérieusement.
Et rien n’indique que ce mouvement, qui, il faut le répéter, se développe davantage au Brésil que partout ailleurs sur la planète, perd de sa force. Pauvre pays, mon pays. (Article publié sur le site du quotidien argentin Página 12, le 7 mars 2022; traduction rédaction A l’Encontre)
[1] A diverses occasions, Bolsonaro a déclaré sa «neutralité» face au «conflit» et a écarté l’idée de «condamner» l’invasion de l’Ukraine. Le 16 février 2022, Bolsonaro a tenu une «réunion exceptionnelle» avec Poutine à Moscou, qui donna suite à une conférence de presse. Il y affirma partager «des valeurs communes» avec son homologue. (Réd.)

Prendre à bras le corps le défi de l’immigration

Nous vous présentons le texte introductif au numéro 27 des Nouveaux Cahiers du Socialisme LE DÉFI DE L’IMMIGRATION AU QUÉBEC signé par Pierre Beaudet, numéro qu’il a cordonné auquel il a beaucoup participé. Sa dernière contribution aux numéros des NCS avant son décès.
L’immigration constitue au Québec et au Canada, comme dans l’ensemble des pays capitalistes, un vaste enjeu sur tous les terrains, y compris, et peut-être surtout sur le terrain politique. Pour les partis de centre droit comme celui qui gouverne le Québec depuis 2018, l’immigration est perçue comme un problème qui menace la société et qu’il faut, autant que possible, limiter. Aux États-Unis et ailleurs, les politiques étatiques consistent à bloquer l’immigration dite « illégale » et à mieux contrôler les flux migratoires passant par les voies officielles et répondant aux besoins du dispositif capitaliste et impérialiste. Tout cela n’est pas nouveau, mais prend des formes particulièrement intenses à l’ombre du capitalisme mondialisé qui est maintenant dominant partout. Devant cela, une réponse internationaliste est la seule qui puisse mettre des grains de sable dans cet engrenage. Cela devient donc un impératif incontournable pour tous ceux et celles qui se battent pour l’émancipation.
Capitalisme et flux migratoires
Les communautés humaines, on le sait, se déplacent depuis longtemps, peuplant à partir de l’Afrique le reste du monde. À l’époque des grands empires méditerranéens, des populations entières ont ainsi été bousculées par la conquête et l’esclavage. D’immenses migrations ont eu lieu à partir de l’Asie centrale vers l’est et l’ouest, provoquant une transformation profonde de la démographie planétaire.
C’est toutefois avec l’essor du capitalisme en Europe que le phénomène a pris une tout autre ampleur. Le capitalisme « moderne », pour son expansion, avait besoin d’une masse humaine considérable lui servant de « main-d’œuvre », considérée comme une marchandise destinée à réaliser du profit. Marx a bien expliqué que le capitalisme avait besoin d’une « armée industrielle de réserve » pour faire tourner la machine productive, de nouvelles couches ouvrières dont l’avantage, en plus de fournir la force de travail requise, était de créer une situation de compétition entre travailleurs et travailleuses dont il tirait aussi des gains. « Plus la richesse sociale est grande…, notait Marx, plus est grande la surpopulation relative ou l’armée de réserve industrielle. Mais plus cette armée de réserve est grande par rapport à l’armée active du travail et plus massive est la surpopulation permanente, ces couches d’ouvriers dont la misère est en proportion inverse de la peine de leur travail. […] Telle est la loi générale, absolue de l’accumulation capitaliste[1] ».
| La réflexion de Marx
Le cœur de la théorisation de Marx sur le « rapport social capitaliste » repose sur la corrélation qu’il établit entre la « loi d’accumulation » du capital et la « loi de la population » qui en forme l’envers[2], en polémique constante avec les thèses de Malthus. L’intérêt mais aussi la difficulté de cette théorie résident dans l’ajustement de deux catégories hétérogènes, que Marx réussit à présenter comme les deux aspects d’une même structure : d’un côté, l’armée industrielle de réserve, catégorie économique relative aux alternances d’emploi et de chômage correspondant aux cycles économiques et aux effets des transformations technologiques ; de l’autre, la surpopulation relative, catégorie démographique et anthropologique correspondant aux phases successives de la destruction des modes de vie « traditionnels » par l’extension du capitalisme. Comme l’expliquait Marx, la surpopulation et la formation d’une armée industrielle de réserve sont les moyens fondamentaux dont dispose le capital pour opposer les uns aux autres les porteurs de la force de travail. Il s’agit d’un déséquilibre entretenu, qui présente une dimension politique autant qu’économique. C’est pourquoi d’ailleurs l’ajustement des deux catégories importe tellement à Marx : c’est la clé d’une réflexion sur la façon dont le capitalisme décompose et fragmente tendanciellement la « classe » des producteurs salariés en même temps qu’il la reproduit, et par conséquent sur les obstacles structurels qui empêchent les prolétaires de se constituer immédiatement en classe « pour soi » (unifiée, organisée dans la lutte contre le capital), au-delà de la concurrence entre les individus et les groupes qui la composent. Il y a là certainement le fondement d’une analyse qui conserve une grande valeur, mais à condition de tenir compte en même temps des effets d’aveuglement qu’elle comporte, comme on le voit lorsque des politiciens et des théoriciens se réclament du « marxisme » pour déclarer qu’il est de l’intérêt des travailleurs de refuser ou de limiter l’entrée des migrants et des réfugiés sur le territoire national, car celle-ci alimente la formation de « l’armée industrielle de réserve » qui, à son tour, favorise la compression des salaires et menace les droits sociaux. La faiblesse relative de Marx, c’est justement de donner à penser (pour contrer le malthusianisme) que les mouvements de population (qui englobent des distributions inégales selon le genre ou la race) sont unilatéralement « au service » des fluctuations de l’armée industrielle de réserve, sans trop se poser la question de leur autonomie relative et des « contre-tendances » qu’ils impriment à la lutte des classes. Étienne Balibar[3] |
Pendant sa première phase, l’histoire du capitalisme a pris la forme de ce terrible « triangle de la mort » qui s’est façonné dans l’Europe en voie d’industrialisation, notamment en Angleterre, accompagné de la mise en esclavage d’une grande partie de l’Afrique et du génocide des populations autochtones des Amériques. Le capitalisme a parallèlement poursuivi son accumulation par la destruction de la paysannerie européenne mise au service de l’industrie dans les conditions sordides de l’époque. Comme dans le cas de la subjugation du peuple irlandais par l’Angleterre, un transfert massif de population vers les usines anglaises avait comme résultat de diviser la classe ouvrière en camps hostiles :
En raison de la concentration toujours plus grande des exploitations agricoles, l’Irlande fournit sans cesse un excédent de main-d’œuvre au marché du travail anglais et exerce, de la sorte, une pression sur les salaires dans le sens d’une dégradation des conditions matérielles et intellectuelles de la classe ouvrière anglaise.
Ce qui est primordial, c’est que chaque centre industriel et commercial d’Angleterre possède maintenant une classe ouvrière divisée en deux camps hostiles : les prolétaires anglais et les prolétaires irlandais. L’ouvrier anglais moyen déteste l’ouvrier irlandais en qui il voit un concurrent qui dégrade son niveau de vie. Par rapport à l’ouvrier irlandais, il se sent membre de la nation dominante et devient ainsi un instrument que les aristocrates et capitalistes de son pays utilisent contre l’Irlande. Ce faisant, il renforce leur domination sur lui-même. Il se berce de préjugés religieux, sociaux et nationaux contre les travailleurs irlandais. Il se comporte à peu près comme les blancs pauvres vis-à-vis des nègres dans les anciens États esclavagistes des États-Unis. L’Irlandais lui rend avec intérêt la monnaie de sa pièce. Il voit dans l’ouvrier anglais à la fois un complice et un instrument stupide de la domination anglaise en Irlande[4].
Une fois ce processus arrivé à terme vers la fin du dix-neuvième siècle, le projet s’est internationalisé avec les flux migratoires immenses dirigés vers l’Europe occidentale et l’Amérique du Nord. Ce processus a réussi jusqu’à un certain point à réduire la résistance ouvrière. Devant cela, des organisations ouvrières et socialistes ont adopté une posture « nationaliste », réclamant la fermeture des frontières et la mise en place de mesures discriminatoires envers les « non-nationaux ». Avec Marx et l’Association internationale des travailleurs (AIT), cependant, des mouvements se sont levés contre cette fausse solution pour construire une perspective internationaliste basée sur la solidarité et la coopération.
Un monde de migrants et de migrantes
Aujourd’hui comme hier, l’immigration est nécessaire pour les classes dominantes. Il faut laisser entrer les hommes et les femmes qui vont renouveler les couches populaires en voie de vieillissement, surtout dans les niches d’emploi dites du « 3-D » (dangerous, dirty, difficult), où les mauvaises conditions de travail et les salaires bas de gamme exigent la venue de personnes aux droits restreints qui seront en quelque sorte obligées de s’accommoder de ces conditions. Travailleurs « temporaires », domestiques, préposées dans les résidences et autres établissements de santé, ouvriers dans la construction, le transport, l’industrie alimentaire et bien d’autres sont indispensables, permettant à l’accumulation et à la hausse des profits de croître sans entraves. Le capitalisme requiert parallèlement un grand nombre de personnes techniquement qualifiées et habilitées à manipuler les circuits scientifiques et technologiques émanant du nouveau cycle de production. Ingénieurs, informaticiens et scientifiques en tout genre, formés aux frais de leur pays d’origine, viennent combler les besoins, étant souvent corvéables à volonté et mal payés.

Source : https://alencontre.org/economie/economie-mondiale-une-situation-systemique-qui-est-specifique-a-la-financiarisation-comme-phase-historique.html/attachment/carte-flux-migratoires
Diviser pour régner
Aujourd’hui la situation ressemble, sans être parfaitement identique, à celle qui a prévalu à l’époque du capitalisme mondialisé de la période coloniale.
Les flux migratoires en un coup d’œil[5]
|
Au Canada, des discriminations systémiques
L’État canadien a été bâti à partir d’un projet explicitement colonialiste. L’immigration « blanche et chrétienne » devait combler les besoins de « l’armée industrielle de réserve » tout en fournissant des contingents ouvriers qui subissaient une forme moderne d’esclavage, comme ces milliers de Chinois qui ont construit l’infrastructure de transport dans l’Ouest[7]. Les générations successives d’immigré·e·s qui ont afflué d’Europe entre les guerres ont été ainsi mises au service de l’accumulation dans l’industrie, les transports, la construction.
La gestion de l’immigration par l’État canadien et par son subalterne québécois s’est depuis inscrite dans la phase actuelle du capitalisme communément désignée sous le nom de néolibéralisme[8]. Durant cette période, la situation des immigré·e·s s’est aggravée avec la montée de discriminations extrêmes prenant la forme du racisme et de l’islamophobie. De vastes segments de la population immigrante se retrouvent stigmatisés et enfermés dans des ghettos d’emplois à bas salaires. À Montréal, qui reçoit 75 % de cette population, les immigrantes et les immigrants peuplent les quartiers délabrés. La détérioration de leur situation se produit dans un contexte où la majorité des migrants sont maintenant admis sur des bases temporaires et conditionnelles, ce qu’illustre l’expansion très importante des programmes qui concernent les migrants « temporaires » auxquels on impose des contrats très restrictifs comme l’expose bien l’article de Marie-Hélène Bonin. On verra dans le texte de Leah Woolner qu’en marge de ces flux légalisés subsiste également un important « trafic des personnes » dont les femmes sont les premières victimes.
Les migrantes et migrants au Canada
|
Aujourd’hui, l’État canadien est le principal intervenant de ce système. La politique de l’immigration vise d’abord des objectifs économiques, dans le cadre des politiques capitalistes en place. Elle est aussi inscrite dans une démarche géopolitique, en fonction des positions du Canada sur un certain nombre de grands enjeux tels qu’ils se présentent d’une région à l’autre. Au total, le gouvernement canadien de même que l’élite économique et les instituts de recherche qui leur sont associés s’avèrent fortement favorables à une augmentation contrôlée de l’immigration. Selon le ministre fédéral de l’Immigration Marco E. L. Mendicino, l’immigration comporte d’« énormes avantages pour préserver notre mode de vie et notre prospérité[9] ». Le Conference Board du Canada, un think tank parmi les plus influents auprès de l’élite canadienne, estime pour sa part que l’immigration est un des facteurs-clés de la croissance de la production et une source très importante d’investissement[10].
|
Immigration et immigration… Les personnes admises comme immigrantes peuvent obtenir la résidence permanente, puis la citoyenneté canadienne : ce sont pour une part des immigrants économiques, pour une autre part des immigrants familiaux et enfin des personnes « protégées ». En 2009, sur les 252 124 nouveaux résidents permanents, la catégorie des immigrants économiques (incluant conjoints et personnes à charge) représentait 61 % du total. Parmi les immigrants économiques, on distingue :
Enfin, il existe deux catégories de résidence temporaire : celle couverte par le programme des étudiants internationaux et celle des travailleurs étrangers temporaires (travailleurs agricoles saisonniers, aides familiales résidantes, etc.). Depuis 2002, le nombre total de travailleurs étrangers temporaires a augmenté de 148 % (de 101 259 personnes à 251 235). Ces immigrants de « deuxième classe » sont maintenant plus nombreux que les immigrants économiques. Si les travailleurs étrangers temporaires sont licenciés ou perdent leur emploi pendant la durée de leur permis de travail, ils doivent demander un nouveau permis de travail auprès d’un nouvel employeur. Source: Erika Gates-Gasse, « Two steps » Immigration. Canada’s new immigration system raises troubling issues, Ottawa, Centre canadien de politiques alternatives, octobre 2020 |
C’est ce portait d’ensemble qui est décrit dans la première partie du dossier avec des textes sur la condition immigrante vue au prisme du logement (Damaris Rose), de la discrimination dans l’emploi (Alain Saint-Victor), du genre (Chantal Ismé et Marjorie Villefranche), de la précarisation et même de la COVID-19 (entrevue de John Shields). Fait à noter, les migrations temporaires, selon les besoins à court terme de l’économie et des entreprises, de phénomène relativement marginal dans les décennies antérieures, sont aujourd’hui « normalisées » et ont crû considérablement.
Le « modèle » québécois et ses périls
La situation socioéconomique des migrantes et migrants au Québec ne diffère pas substantiellement de celle qui sévit au Canada.
Faits saillants de l’immigration au Québec[11]
|
Sous l’égide du gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ), le discours a changé, et le but maintes fois réaffirmé par cette formation politique est de limiter les flux de l’immigration. Pour le gouvernement et certains médias, les migrantes et les migrants représentent une « menace » contre l’identité québécoise. La loi 21, la Loi sur la laïcité de l’État, est discriminatoire envers les femmes musulmanes dans le contexte d’une flambée de violence islamophobe et fait partie, selon Leila Benhadjoudja et Leila Celis (voir leur contribution), « d’un processus à travers lequel le gouvernement de la Coalition avenir Québec fait la promotion d’une société exclusive, marquée par des écarts socioéconomiques importants et stables, processus dont fait partie aussi la législation en matière d’immigration, qui vise, entre autres, à la fois à réduire le nombre d’immigrants et d’immigrantes et à augmenter la “bonne” immigration, c’est-à-dire celle des Européens et Européennes ».
Contre-pouvoirs, stratégies et résistances
Au tournant des années 1930, le Parti communiste du Canada avait mené plusieurs grandes batailles avec et pour les immigrantes et immigrantes dont plusieurs ont joué un rôle central dans leur syndicalisation, notamment[13]. Par la suite, la montée du nationalisme de droite inspiré par l’Église catholique et géré par le régime duplessiste a stigmatisé les immigrantes et immigrants présentés comme des voleurs (surtout s’ils étaient juifs) ou des communistes (surtout s’ils étaient ouvriers). Un discours haineux animé entre autres par l’abbé Lionel Groulx s’est distillé dans la société contre les immigrants de l’époque, surtout européens. Puis, dans les années 1970, des communautés, notamment grecques et italiennes, se sont organisées pour défendre leurs droits. L’arrivée massive des migrantes et migrants d’Haïti, du Vietnam, d’Amérique latine a fait bouger l’opinion au moment où l’idée de l’émancipation sociale et nationale reprenait de la vigueur, prenant la forme d’une insertion croissante de ces populations dans les mouvements populaires, les syndicats, les groupes de gauche et même le Parti québécois qui incarnait alors l’espoir du changement. Avec le reflux du capitalisme, accompagné d’un recul des mouvements sociaux dans les années 1980, la situation de discrimination s’est reproduite à nouveau avec les flux croissants venant d’Amérique centrale, du Moyen-Orient, d’Asie et de l’Afrique subsaharienne. La lutte contre la discrimination s’est élargie et diversifiée couvrant une vaste gamme de problématiques sociales, économiques et politiques.
Aujourd’hui, les initiatives venant de la base prolifèrent, comme celles du Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (CTI) et du Comité d’action de Parc-Extension (CAPE) dont les expériences sont décrites dans ce dossier. Les syndicats s’impliquent davantage tout en tentant de modifier leur culture organisationnelle pour être plus accueillants envers les immigrants comme le montrent les entrevues de Marc-Édouard Joubert et de Ramatoulaye Diallo. De grandes mobilisations ont eu lieu contre le massacre au Centre culturel islamique de Québec (rappelées dans le texte de Sébastien Bouchard) et dans le cadre de la solidarité avec les Africains-Américains. L’initiative de Québec solidaire est également porteuse à travers les contributions de certains membres et élu·e·s de cette formation qui en reconnaissent toute l’importance (comme l’illustre l’entrevue avec le député Andrés Fontecilla).
Repenser les paradigmes
Devant ces transformations, les intellectuels progressistes un peu partout dans le monde s’impliquent dans les multiples dimensions de l’immigration. La décolonisation d’une certaine tradition, jusqu’ici plutôt « autiste », est en cours à travers des travaux d’une grande qualité provenant de chercheuses et chercheurs d’origine immigrante (voir les contributions de Osna, Hernandez, Idir et Zennia, Rosso, Hanieh). Selon Saïd Bouamama (voir son texte), il faut que la gauche refasse ses devoirs, dans un contexte où « les approches idéalistes du racisme présentent celui-ci comme une réalité éternelle ayant caractérisé l’humanité de son apparition sur terre à aujourd’hui. L’intérêt d’une telle approche pour les classes dominantes est d’invisibiliser le moment historique d’apparition de cette idéologie de légitimation de la domination et, ce faisant, d’occulter ses liens avec le capitalisme comme mode de production. L’approche matérialiste souligne au contraire l’historicité du racisme et le lien de celle-ci avec l’historicité du capitalisme ».
- Karl Marx, Le Capital, Tome 3, <https://wikirouge.net/Arm%C3%A9e_de_r%C3%A9serve_industrielle>. ↑
- Karl Marx, Le Capital, VIIe section du Livre Premier, chapitre 23; pour la traduction française du Capital, Livre 1, sous la responsabilité de Jean-Pierre Lefebvre, Paris, Éditions sociales, 1983. ↑
- Étienne Balibar, « Sur la situation des migrants dans le capitalisme absolu », Les Possibles, n° 19, 2019. ↑
- Karl Marx, Lettre à Sigfrid Meyer et August Vogt, 9 avril 1870, <https://wikirouge.net/texts/fr/Lettre_%C3%A0_Sigfrid_Meyer_et_August_Vogt,_9_avril_1870>. ↑
- Organisation internationale pour les migrations, État de la migration dans le monde 2020, Genève, Rapport de l’OIM, 2020. ↑
- Roger Martelli, « Accueil des migrants : enjeux de civilisation », dans Claude Calame et Alain Fabart (dir.), Migrations forcées, discriminations et exclusions. Les enjeux de politiques néocoloniales, Vulaines-sur-Seine, Éditions du Croquant, 2020. ↑
- Dans les années 1880, l’État et les entreprises qui ont construit le chemin de fer ont importé des dizaines de milliers de travailleurs chinois, dont le salaire était inférieur de 30 à 50 % à celui des autres travailleurs. Une fois ces infrastructures érigées, l’État a imposé un « droit d’entrée » de 50 dollars pour les Chinois (l’équivalent de 5000 dollars aujourd’hui) qui voulaient immigrer au Canada, ce qui a réduit énormément cette immigration jusqu’à l’annulation de cette loi discriminatoire en 1947. ↑
- Déjà, il y a 10 ans, les Nouveaux Cahiers du socialisme avaient établi un diagnostic des normes, réglementations et principes à la base de la politique de l’immigration, Migrations : stratégies, acteurs, résistances, n° 5, printemps 2011. ↑
- Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Rapport annuel au Parlement sur l’immigration, 2020. ↑
- Conference Board du Canada, Counting on immigration, mai 2021. ↑
- Source : Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration Québec, 2019, Présence et portraits régionaux des personnes immigrantes admises au Québec de 2008 à 2017, Québec, Gouvernement du Québec, 2020. ↑
- Mathieu Forcier et Laura Handal, L’intégration des immigrants et immigrantes au Québec, Montréal, Institut de recherche et d’informations socioéconomiques, novembre 2012. ↑
- Évelyne Dumas, une journaliste courageuse des années 1970, avait écrit une partie de cette histoire dans un ouvrage magnifique, Dans le sommeil de nos os. Quelques grèves au Québec entre 1934 et 1944, Montréal, Leméac, 1971. ↑

MERCI Pierre Beaudet

Notre ami Pierre Beaudet est décédé aujourd’hui. Nous sommes sous le choc. Il y a quelques jours à peine, Pierre participait à des réunions avec nous et semblait déterminé à se rétablir de sa maladie. Mais le corps n’a pas tenu le coup.
Les Nouveaux Cahiers du socialisme sont en deuil. Pierre a fondé ce collectif il y a une quinzaine d’années avec d’autres camarades désireux et désireuses de participer à la création d’une nouvelle culture politique de gauche, pluraliste et critique.
Les membres des Nouveaux Cahiers du socialisme veulent offrir leurs profondes condoléances à à ses proches. Nous prendrons plus tard le temps nécessaire pour rendre hommage à Pierre, ce militant et homme de conviction depuis sa jeunesse. Sa contribution à la gauche tant québécoise qu’internationale est immense, sa feuille de route est depuis longtemps impressionnante.
Nous perdons un frère et un ami de longue date.
Repose en paix camarade.














