Derniers articles
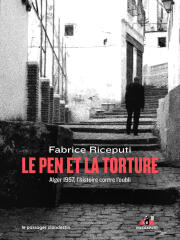
Le Pen : la torture « républicaine » en colonie et le déni pour « vérité » mémorielle « apaisée »
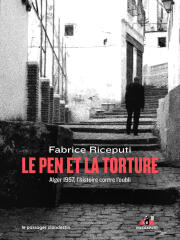
Qui n'a pas vu, lu ou entendu ? Peu de temps avant, pendant et après les commémorations du soixantième anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, le cirque politico-académique et sa gueule de bois médiatique de « la guerre des mémoires » a imposé le sentimentalisme de la « réconciliation des deux Rives » comme l'unique grille de lecture du moment colonial en Algérie. A force de mettre l'histoire au service du ressentiment d'Etat français et algérien, on en est même arrivé à oublier ce qu'était la colonisation et l'après-Libération, pour se perdre dans le désastreux mirage d'une histoire antihistorique, dite « apaisée » et contre la « repentance ».
Les premiers laissés pour compte de ce cirque ? La recherche universitaire, les chercheurs, les professeurs d'université et leurs travaux. Des bibliothèques entières réduites aux cendres des manipulations politiciennes de l'extrême droite et de l'autoritarisme. D'un côté, tout ce qui va à l'encontre du « gros bon sens commun » des « bienfaits de la colonisation » est taxé d'« autoflagellation », de « haine de la France », de « soumission aux minorités revanchardes », d' « islamo- gauchisme », de « wokisme » et, dans certains cas, d' « apologie du terrorisme du FLN » ; de l'autre, la roue de l'histoire doit se contenter de ressasser les pieuses légendes de l'avant-1962. Tout ce qui va au-delà risquerait de nuire, selon une certaine « vérité » pour d'aucuns irréfutable, à l' « intégrité de la nation et sa sécurité »…
Le temps est au confusionnisme chez nombre de politiques et d'« intellectuels » de plateaux de télévision, dans les médias (privés surtout) mensonges plus généralement. Marine Le Pen est désormais la pierre angulaire de « l'arc républicain » et il ne faut pas s'étonner d'écouter sur une radio publique une certaine musique révisionniste selon laquelle Le Pen n'aurait sans doute pas torturé en Algérie.
A l'occasion de la récente parution de Le Pen et la torture. Alger 1957, l'histoire contre l'oubli, Le Matin d'Algérie s'entretient avec Fabrice Riceputi, historien et chercheur associé à l'Institut d'histoire du temps présent, autour de ce déni colonial qui va à l'encontre de la vérité solidement établie par des faits historiques depuis plusieurs décennies.
***
Le Matin d'Algérie : Pourquoi avez-vous décidé d'écrire un livre sur le passé tortionnaire et criminel de Le Pen ? Est-ce le manque d'études consacrées à ce sujet qui a déterminé un tel choix, leur dispersion ou le contexte politique délétère dans lequel évolue la France actuellement ?
Fabrice Riceputi : Personne n'avait jamais songé à réunir l'ensemble du dossier historique relatif au passé tortionnaire de Jean-Marie Le Pen. Jusqu'aux années 2000, lorsqu'étaient publiées les dernières révélations à ce sujet, l'affaire paraissait suffisamment entendue. Et si quelques historiens ont travaillé sur la terreur militaro-policière à laquelle il a participé, aucun n'a logiquement jugé utile de s'intéresser à son cas particulier, qui est celui d'un tortionnaire mais parmi beaucoup d'autres, même s'il était député.
Mais plus de 20 années ont passé, les années de la « dédiabolisation » des Le Pen et du lepénisme. Et en février 2023, on a pu très sérieusement affirmer sur France Inter que « le soldat Le Pen n'a sans doute pas torturé » à Alger et qu'on n'aurait en tout cas « pas de preuves ». C'est là que j'ai réalisé la nécessité de faire ce travail, qui est aussi une manière de raconter au travers du cas Le Pen les premiers mois de ce qu'on appelle « la bataille d'Alger ». Désormais, ce dossier est à la disposition de tous et je suis heureux qu'il soit aussi publié en Algérie.
Le Matin d'Algérie : A quand remontent les premières accusations et revendications de la torture par Le Pen ?
Fabrice Riceputi : Les premières accusations remontent à juin 1957, c'est-à-dire deux mois après son départ d'Alger le 31 mars. Le périodique du FLN Résistance algérienne raconte le supplice infligé par le député parachutiste Le Pen à un certain « Dahman », à la Villa Les Roses sur les hauteurs d'El Biar, où cantonnait effectivement la compagnie de Le Pen. Puis, en 1962, Pierre Vidal-Naquet rend public le rapport du commissaire principal René Gille exposant deux plaintes pour torture déposées par deux Algériens contre Le Pen. L'un des deux a été conduit par Le Pen à la Villa Sésini parce qu'il refusait de lui ouvrir le bar de l'Hôtel Albert 1er à 2 heures du matin…Ensuite, plus rien jusqu'à ce que la presse française s'intéresse au passé d'un Le Pen devenu leader d'un parti à succès : le Front National.
Durant la guerre, Le Pen a fait l'apologie de la torture et, en 1962, a fièrement confirmé avoir lui-même torturé. Mais à partir des années 1980, face à des accusations très circonstanciées de plusieurs de ses victimes directes dans la presse, il doit réagir, alors qu'il brigue les plus hautes fonctions politiques : il attaque systématiquement en diffamation, nie avoir torturé lui-même, tout en jugeant totalement justifiée la torture « anti-terroriste ». L'impunité lui étant garantie par l'amnistie depuis 1962 et les faits eux-mêmes ne pouvant être jugés, il peut gagner ses premiers procès, avant d'en perdre trois autour de 2000, dont celui contre Le Monde, avec un jugement particulièrement définitif.
Le Matin d'Algérie : Pouvez-vous revenir sur le parcours de Le Pen durant « la grande répression d'Alger » (selon la formule de Gilbert Meynier pour parler de « la bataille d'Alger) ? Durant quelle période de l'année 1957 le « lieutenant Marco » a-t-il intensifié ses pratiques inhumaines sur les corps des colonisés ?
Fabrice Riceputi : Ce jeune militant nationaliste et anticommuniste s'engage d'abord en Indochine, où il reste un an. C'est là qu'il apprend comme beaucoup d'autres militaires français les méthodes de la guerre contre-insurrectionnelle qui vont être appliquées ensuite en Algérie. Notamment, l'usage de la torture. Elu député poujadiste en 1956, il s'engage à nouveau pour l'Algérie où il arrive comme lieutenant dans le 1er Régiment Etranger Parachutiste à la fin décembre 1956. Le 7 janvier 1957, le gouvernement du socialiste Guy Mollet lance près de 10 000 parachutistes sur Alger avec le projet d'en finir avec le nationalisme algérien dans la ville-vitrine de l'Algérie française. Leur première tâche est d'écraser la grève des 8 jours appelée par le FLN, dont le succès démontrerait au monde l'audience de ce dernier. Le mode opératoire mis au point est celui qu'on appellera plus tard, en Argentine, la disparition forcée. Les militaires enlèvent, détiennent, interrogent, exécutent parfois qui leur paraît « suspect », sans rendre de comptes à quiconque. Le Pen est des officiers qui font « du renseignement ». Dans la quinzaine de témoignages de ses victimes, on le voit traquer des « suspects », la nuit, dans tout Alger, et torturer, à domicile ou dans certains des très nombreux centres de torture dont Alger et sa région sont couverts : villa Les Roses, Villa Sésini, Fort-L'Empereur notamment. Il utilise surtout les méthodes très normées et enseignées alors aux officiers de renseignement que sont la torture par ingestion forcée d'eau souillée et celle à l'électricité, la « gégène », censées ne pas laisser trop de traces sur les corps des suppliciés. Certains témoins mentionnent aussi des exécutions sommaires. L'un d'eux le relie directement à Paul Aussaresses, qui dirigeait clandestinement les escadrons de la mort de l'armée française. Il est très possible que Le Pen ait agi sous les ordres de ce dernier. Au total, plusieurs dizaines de victimes lui sont imputées, en deux mois et demi de présence effective à Alger.
Le Matin d'Algérie : Que disent les victimes de la torture à propos de Le Pen ? L'historiographie de l'Algérie coloniale, quelle légitimité accorde-t-elle aujourd'hui à leurs témoignages
Fabrice Riceputi : Dans une sorte de prolongement de l'idéologie colonialiste, on a longtemps refusé en France de prendre en compte la parole algérienne sur ces questions. C'est ce que font certains commentateurs quand ils disent qu'il n'y a pas de preuves que Le Pen a torturé. Ils s'assoient sur les témoignages. Or, dans les contextes de crimes d'Etat niés et dissimulés, qu'il s'agisse de la torture en Algérie ou par exemple du génocide des Arméniens, l'historien doit avoir recours aux témoignages des victimes, qui sont la source quasi-unique dont on dispose. Il n'y a par définition rien ou presque dans les archives et les acteurs des répressions les avouent très rarement. Il faut bien sûr soumettre ces témoignages à la critique. C'est ce que j'ai fait avec les victimes de Le Pen, fort notamment de ma connaissance du contexte algérois en 1957, sur lequel je travaille depuis plusieurs années avec Malika Rahal. Et ma conclusion est qu'ils sont parfaitement crédibles.
Le Matin d'Algérie : Quand certains médias, politiques et « intellectuels » de plateaux de télévision critiquent Le Pen en France, ils parlent souvent de collaborationnisme, de nazisme et de racisme, mais jamais de colonialisme. Selon vous, qu'est-ce qui explique le déni de la matrice coloniale du lepénisme ? Ce déni, a-t-il un rapport avec le refus de l'Etat français de reconnaître officiellement, d'abord pour ses propres citoyens, le caractère inhumain de ses différentes entreprises coloniales et de rompre définitivement avec ses ambivalences vis-à-vis du mythe des supposés « aspects positifs de la colonisation » ?
Fabrice Riceputi : En France, il n'est pas jugé particulièrement infâmant d'avoir trempé dans les crimes coloniaux. Car c'est la chose la mieux partagée par tous les courants politiques ou presque. L'extrême droite, mais aussi les socialistes et les gaullistes. Aucun n'a fait le moindre inventaire critique de ce passé honteux. Les initiatives mémorielles de Macron évitent soigneusement cette question et perpétuent en réalité le légendaire déni français des crimes commis durant l'époque coloniale.
***
Propos recueillis par Faris LOUNIS
Journaliste indépendant
Bibliographie sélective :
Ici on noya les Algériens, Lorient, Le passager clandestin, 2021.
Le Pen et la torture. Alger 1957, l'histoire contre l'oubli, Lorient, Le passager clandestin, 2023.
Fabrice Riceputi coanime le site « histoirecoloniale.net » et mène avec l'historienne Malika Rahal le projet « Mille autres » sur les enlèvements, la torture et les exécutions sommaires d'Algériens durant la grande répression d'Alger (la « bataille d'Alger »). Leurs publications sont consultables sur le site éponyme « 1000autres.org ».
Crédit : Serge d'Ignazio.
*Cet entretien a été publié pour la première fois, le 3 mars 2024, dans Le Matin d'Algérie.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

États-Unis. En 2023, les grèves importantes ont augmenté de 280%. Toutefois, la protection du droit de grève est très insuffisante

L'année dernière a vu une relance de l'action collective parmi les travailleurs et travailleuses. Plus de 16,2 millions d'entre eux et elles étaient représentés par des syndicats en 2023, soit 191 000 de plus qu'en 2022. Les travailleurs ont déposé des pétitions et votes pour établir des sections syndicales en nombre record. Ils ont obtenu des gains salariaux significatifs grâce à des débrayages, grèves et arrêts de travail et grâce à des négociations contractuelles. En outre, les efforts de syndicalisation se sont poursuivis dans divers secteurs, notamment les soins de santé, les organisations à but non lucratif, l'enseignement supérieur, les musées, le commerce de détail et l'industrie manufacturière (Shierholz et al. 2024).
1 mars 2024 | tiré du site alencontre.org
Les grèves ont été l'une des principales formes d'action collective en 2023. On parle de grève lorsque des travailleurs refusent de travailler pour leur employeur dans le cadre d'un conflit du travail. En refusant leur travail – travail dont les employeurs dépendent pour produire des biens et fournir des services – les travailleurs et travailleuses peuvent contrecarrer l'asymétrie de rapports de pouvoir existant entre eux et leur employeur. Les grèves constituent un moyen de pression essentiel pour les travailleurs lorsqu'ils négocient avec leurs employeurs des salaires et des conditions de travail correctes, lorsque les employeurs enfreignent le droit du travail ou lorsqu'ils refusent de reconnaître volontairement les syndicats.
Les données du Bureau of Labor Statistics (BLS) montrent que 458 900 travailleurs et travailleuses ont été impliqués dans des « arrêts de travail significatifs » en 2023. Le nombre de travailleurs impliqués dans des arrêts de travail significatifs a augmenté de 280% en 2023, retrouvant les niveaux observés avant la pandémie de Covid-19. Ces grèves ont touché des salarié·e·s de tout le pays, des ouvriers de l'automobile aux scénaristes et acteurs d'Hollywood, en passant par les infirmières et les enseignants des écoles publiques.
Un thème commun aux grèves de 2023 était la revendication d'une augmentation des salaires dans un contexte de chocs inflationnistes résultant de la relance après la pandémie, de crises mondiales, de bénéfices records pour de nombreuses entreprises et de rémunérations stratosphériques pour les PDG. Parmi les autres motifs de grève, citons des décennies de stagnation des salaires, l'érosion des soins de santé et des prestations de retraite [les deux liés à l'emploi], les longues heures de travail et les conditions de travail dangereuses (Bivens et al. 2023 ; Dickler 2023). Il n'est pas surprenant que les travailleurs et travailleuses entreprennent des actions collectives pour améliorer leurs salaires et leurs conditions de travail, mais nous devrions nous demander pourquoi cela se produit maintenant. Depuis plusieurs décennies, l'économie des Etats-Unis se caractérise par une croissance inégale des revenus et une stagnation des salaires. Les recherches montrent que les syndicats et la négociation collective sont des outils essentiels pour lutter contre l'inégalité des revenus et améliorer les salaires, les avantages et les conditions de travail des travailleurs syndiqués et non syndiqués (Bivens et al. 2023). Toutefois, l'augmentation continue de l'action collective n'est pas susceptible d'accroître sensiblement le taux de syndicalisation, à moins que des changements politiques significatifs ne soient adoptés pour garantir à tous les travailleurs et travailleuses le droit de former des syndicats, de négocier collectivement et de faire grève.
Dans cette note, nous mettons en évidence les arrêts de travail survenus en 2023 et discutons des politiques nécessaires pour renforcer le droit de grève aux Etats-Unis.
Données sur les arrêts de travail « majeurs »
Le Bureau of Labor Statistics (BLS) définit les « arrêts de travail majeurs » comme ceux qui impliquent au moins 1000 travailleurs et durent un quart de durée de travail complète entre le lundi et le vendredi, à l'exclusion des jours fériés fédéraux. Les données du BLS montrent que 458 900 travailleurs ont été impliqués dans 33 arrêts de travail majeurs qui ont débuté et pris fin en 2023 (BLS 2024c). Il s'agit d'une augmentation de plus de 280% par rapport au nombre de travailleurs impliqués dans des arrêts de travail majeurs en 2022, qui était de 120 600. En outre, elle est comparable à l'augmentation observée dans les niveaux prépandémiques en 2018 et 2019, comme le montre le graphique A.

Notes : Le Bureau of Labor Statistics ne fait pas de distinction entre les grèves et les lock-out dans ses données sur les arrêts de travail. Toutefois, les lock-out (qui sont lancés par l'employeur) sont rares par rapport aux grèves, de sorte qu'il est raisonnable de considérer les données sur les arrêts de travail majeurs comme une approximation des données sur les grèves significatives. Les données concernent les travailleurs des secteurs public et privé.
Source : Bureau of Labor Statistics : Bureau of Labor Statistics, « Work Stoppages Summary » (communiqué de presse), 21 février 2024, et tableau connexe, « Annual Work Stoppages Involving 1,000 or More Workers, 1947-Present ».
Environ 75% des arrêts de travail majeurs en 2023 (25) ont eu lieu dans le secteur privé, dont plus de la moitié (14) dans le secteur de la santé. Les administrations publiques ont été à l'origine de cinq arrêts de travail majeurs, la majorité d'entre eux concernant des collèges et des universités publics. Les collectivités locales ont été à l'origine de trois arrêts de travail importants, qui concernaient des écoles primaires publiques.
Exemples d'arrêts de travail importants (majeurs) en 2023
Les données sur les arrêts de travail du Bureau of Labor Statistics comprennent une ventilation des organisations dans lesquelles se sont produits les principaux arrêts de travail. Ces données, combinées à un examen par l'EPI (Economic Policy Institute) des sources accessibles au public, suggèrent un éventail d'activités de grève en 2023. Les thèmes récurrents des principaux arrêts de travail survenus en 2023 sont les suivants : les travailleurs et travailleuses citent des décennies de stagnation des salaires réels (corrigés de l'inflation), l'érosion de l'assurance maladie ou des prestations de retraite, les longues heures de travail et les conditions de travail dangereuses ou stressantes comme motivation pour obtenir des améliorations significatives des salaires, des prestations et des conditions de travail. Voici quelques exemples d'arrêts de travail importants couverts par les données du BLS.
Grève « Debout » des United Auto Workers (UAW)
Le 15 septembre 2023, plus de 12 000 travailleurs se sont mis en grève chez General Motors, Ford et Stellantis après l'expiration de leur contrat [par grève debout, « Stand Up », on entend le choix des secteurs entrant en grève, à l'opposé de grèves mobilisant tous les travailleurs d'une entreprise]. Les travailleurs, représentés par le syndicat United Auto Workers, se sont mis en grève pour obtenir de meilleurs salaires et avantages sociaux après les concessions contractuelles accordées à la suite de la grande récession. Entre 2013 et 2023, les trois constructeurs automobiles ont vu leurs bénéfices augmenter de 250 milliards de dollars, alors que les membres de l'UAW n'ont pas bénéficié d'un ajustement du coût de la vie depuis 2009 (Hersh 2023).
Pendant l'arrêt de travail, l'UAW a appliqué une stratégie de « grève debout ». Au lieu de mettre les 150 000 membres en grève en même temps, ils ont choisi des sites spécifiques pour faire grève, d'autres sites étant prêts à « se lever » et à rejoindre la grève à mesure que les négociations se poursuivaient avec les trois constructeurs automobiles (UAW 2024). Au total, environ 53 000 travailleurs ont participé aux arrêts de travail. C'était la première fois que l'UAW se mettait en grève simultanément chez les trois constructeurs automobiles.
La grève a pris fin au bout de deux mois, lorsque les United Auto Workers et General Motors, Ford et Stellantis ont conclu des accords prévoyant des augmentations d'au moins 33% pour tous les travailleurs, l'élimination d'un système salarial à deux vitesses [avec des salaires d'entrée pouvant durer plus bas que la moyenne], la réouverture d'une usine Stellantis précédemment fermée, un engagement en faveur d'une transition équitable avec les véhicules électriques et des primes annuelles pour les retraités (UAW 2023). En outre, les travailleurs non syndiqués ont bénéficié des retombées des avancées de l'UAW. Par exemple, Toyota, Honda, Hyundai et Tesla ont augmenté les salaires de leurs travailleurs et travailleuses aux Etats-Unis (dont aucun n'est syndiqué) peu après que l'UAW a conclu un accord de principe avec General Motors, Ford et Stellantis (Brooks 2023 ; Kolodny 2024).
Grève des travailleurs de la santé de Kaiser Permanente
En octobre 2023, plus de 75 000 travailleurs de la santé de Kaiser Permanente, représentés par une coalition de plusieurs syndicats, ont entamé la plus grande grève de l'histoire des Etats-Unis dans le secteur de la santé (Isidore et Delouya 2023). La grève de trois jours a concerné des infirmières, des techniciens médicaux et du personnel de soutien dans des centaines d'établissements Kaiser dans sept Etats et dans le district de Columbia, les plus grands groupes de salarié·e·s (agents de santé) de Kaiser étant en grève en Californie (Reuters 2023).
Comme de nombreuses grèves dans le secteur de la santé ces dernières années, la grève des employé·e·s de Kaiser a attiré l'attention sur les propositions syndicales visant à remédier aux retards de salaires et à la crise du personnel. A l'issue de la grève de trois jours, les salarié·e·s ont conclu avec Kaiser un accord de principe prévoyant une augmentation générale des salaires de 21% sur quatre ans, des primes supplémentaires et une rétribution collective des objectifs fixés, ainsi que de nouvelles initiatives en matière de formation, d'éducation et d'embauche afin d'accroître les niveaux de personnel. L'accord qui en a résulté, ratifié par plus de 98% des membres en novembre 2023, a également fixé un nouveau salaire minimum pour les salarié·e·s de la santé de Kaiser à 23 dollars (qui sera fixé à 25 dollars d'ici 2026) en Californie et à 21 dollars (qui sera fixé à 23 dollars d'ici 2026) dans tous les autres Etats couverts par le contrat (Coalition of Kaiser Permanente Unions 2023).
Grève des employés diplômés de l'Université du Michigan
En mars 2023, environ 2200 employé·e·s de l'Université du Michigan se sont mis en grève. Représentés par la section locale 3550 de la Graduate Employees' Organization (GEO), ils comprennent des étudiants assistants et des assistants de troisième cycle répartis sur trois campus. Les employés ont voté en faveur de la grève afin d'améliorer leurs salaires et leurs avantages sociaux et d'obtenir des protections contre le harcèlement et des conditions de travail plus sûres (P. Lucas 2023).
La grève a été controversée, ce qui a conduit le GEO et l'Université du Michigan à porter plainte l'un contre l'autre pour pratiques déloyales de travail. Les accusations ont finalement été réglées entre les deux parties (Anderson 2023).
La grève de cinq mois a pris fin lorsque la Graduate Employees' Organization (GEO) et l'Université du Michigan ont convenu d'un nouveau contrat de trois ans qui prévoyait d'importantes augmentations de salaire sur les trois campus, des mesures de protection contre le harcèlement, un congé maternité rémunéré, une couverture d'assurance maladie pour les soins liés à l'affirmation du genre et une prime de 1000 dollars à l'embauche (Bruckner, 2023 ; Mackay, 2023). La grève a été le plus long arrêt de travail majeur en 2023 et la plus longue grève dans l'histoire du syndicat et de l'université (Bruckner, 2023). La grève de l'Université du Michigan est un exemple de la vague croissante d'actions syndicales parmi les étudiants diplômés ces dernières années (Bivens et al. 2023).
Grèves des travailleurs de Starbucks United lors de la « Journée de la tasse rouge » (Starbucks Workers United Red Cup Day)
Le 16 novembre 2023, plus de 5000 travailleurs de Starbucks se sont mis en grève pour protester contre le refus de l'entreprise de négocier de bonne foi un premier contrat. Cette grève d'une journée a été organisée pour coïncider avec la promotion « Red Cup Day » de Starbucks, qui est historiquement l'une des journées les plus chargées de l'entreprise. La grève du Red Cup Day de 2023 a été le plus grand arrêt de travail de Starbucks Workers United à ce jour, impliquant plus de 5000 salarié·e·s dans 200 magasins (Durbin 2023).
Depuis décembre 2021, les travailleurs de 43 Etats, dans 391 des magasins appartenant à Starbucks aux Etats-Unis, ont voté en faveur de la syndicalisation (More Perfect Union 2024). Depuis plus de deux ans, Starbucks refuse de négocier de bonne foi et n'a signé aucun contrat collectif avec ses magasins syndiqués. Au cours de cette période, les fonctionnaires du National Labor Relations Board ont déposé 105 plaintes alléguant que l'entreprise avait violé le droit du travail, y compris une procédure nationale accusant Starbucks de ne pas avoir négocié avec les travailleurs syndiqués dans les magasins à travers le pays (Saxena 2023). Peu après la grève du Red Cup Day de 2023, Starbucks a annoncé qu'elle souhaitait reprendre les négociations avec Starbucks Workers United afin de conclure un premier contrat en 2024 (A. Lucas, 2023).
Les arrêts de travail qui n'apparaissent pas dans les données du BLS
Les données du Bureau of Labor Statistics sur les arrêts de travail, bien qu'utiles, présentent une limitation majeure. Elles ne comprennent que des informations sur les arrêts de travail (grèves et lock-out) impliquant au moins 1000 travailleurs et durant une durée de travail complète entre le lundi et le vendredi, à l'exclusion des jours fériés fédéraux. En restreignant ainsi les données, on passe à côté d'une énorme quantité d'informations. Selon les données du BLS sur la taille des entreprises, près des trois cinquièmes (58%) des travailleurs du secteur privé sont employés par des entreprises de moins de 1000 salariés (BLS 2024b). Pourtant, toute activité de grève de ces travailleurs ne serait pas prise en compte dans les données du Bureau of Labor Statistics sur les arrêts de travail. Par exemple, une grève de six semaines impliquant 750 étudiants diplômés de l'Université Temple (située à Philadelphie en Pennsylvanie) n'a pas été prise en compte dans les données de 2023, car elle ne répondait pas aux limites de taille du BLS (AP 2023).
Ces limites de taille et de durée signifient que les données du Bureau of Labor Statistics ne tiennent pas compte des nombreux salarié·e·s qui ont débrayé en 2023 pour réclamer des salaires équitables et des conditions de travail sûres. Alors que les données du BLS font état de 33 arrêts de travail majeurs en 2023, l'ILR Labor Action Tracker de Cornell University montre que 470 arrêts de travail – 466 grèves et 4 lock-out – ont eu lieu en 2023 (Ritchie, Kallas, Iyer 2024).
Conclusion. Une action du pouvoir fédéral et des Etats est nécessaire pour garantir le droit de grève
Les données du BLS de 2023 sur les principaux arrêts de travail montrent que plus de 450 000 travailleurs ont exercé leur droit de grève pour obtenir des augmentations de salaire, de meilleurs avantages et des conditions de travail plus sûres. Il n'en reste pas moins que le droit du travail actuel ne protège pas de manière adéquate le droit fondamental de grève des travailleurs et travailleuses. Les politiques fédérales suivantes renforceraient le droit des travailleurs à se syndiquer et à négocier collectivement.
La loi Richard L. Trumka sur la protection du droit d'organisation (PRO) comprend des réformes essentielles qui renforceraient le droit de grève des salarié·e·s du secteur privé. La loi PRO élargirait le champ d'application des grèves en supprimant l'interdiction des grèves de solidarité et en autorisant le recours aux grèves intermittentes [elles sont sans protection légale]. Elle renforcerait également le droit de grève des salarié·e·s en interdisant aux employeurs de remplacer de manière permanente les salarié·e·s en grève.
- La loi sur la protection des soins de santé des salarié·e·s en grève et subissant un lock-out empêcherait les employeurs d'interrompre la couverture médicale des travailleurs et des membres de leur famille en guise de représailles contre les grévistes.
- La loi sur la sécurité alimentaire des grévistes (Food Secure Strikers Act) permettrait aux grévistes de bénéficier des prestations du programme d'aide à l'alimentation (Supplemental Nutrition Assistance Program – SNAP).
- Le Congrès devrait également mettre en œuvre des politiques visant à étendre un droit de grève pleinement protégé aux salarié·e·s des chemins de fer, des compagnies aériennes, du secteur public, de l'agriculture et de l'économie domestique. Aucun de ces travailleurs n'a le droit fondamental de faire grève en vertu de la législation fédérale actuelle.
L'exclusion des salarié·e·s du secteur public, des employé·e·s de maison et des agriculteurs de la couverture du droit du travail fédéral signifie que les droits syndicaux fondamentaux de millions de travailleurs de ces professions sont laissés à l'appréciation des Etats. Pour remédier à une grande partie de ces exclusions, le Congrès devrait, dans un premier temps, adopter la loi sur la liberté de négociation dans la fonction publique (Public Service Freedom to Negotiate Act), établissant une norme minimale en matière de droits de négociation collective que tous les Etats et toutes les localités doivent accorder aux employés du secteur public.
En l'absence d'action du Congrès, les Etats devraient garantir les droits de négociation collective et protéger le droit de grève pour tous les travailleurs et travailleuses du secteur public, de l'agriculture et de l'économie domestique. A l'heure actuelle, seule une douzaine d'Etats accordent des droits de grève limités à certains travailleurs du secteur public. Les Etats devraient également rejoindre l'Etat de New York et du New Jersey en rendant les travailleurs et travailleuses en grève éligibles aux allocations de chômage (Perez 2024). (Article publié sur le site Economic Policy Institute le 21 février 2024 ; traduction rédaction A l'Encontre)
Références
Anderson, Miles. 2023. “UMich and GEO Reach Settlement on Unfair Labor Practices and Lawsuit.” Michigan Daily, June 8, 2023.
Associated Press (AP). 2023. “Temple Graduate Students Ratify New Pact, End 6-Week Strike.” March 13, 2023.
Bivens, Josh, Celine McNicholas, Margaret Poydock, Jennifer Sherer, and Monica Leon. 2023. What to Know About This Summer's Strike Activity : What's Spurring the Rise in Labor Actions ? Economic Policy Institute, August 2023.
Brooks, Khristopher J. 2023. “Hyundai, Honda and Toyota Have All Raised Worker Pay Since UAW Strike Ended.” CBS News, November 13, 2023.
Bruckner, Meredith. 2023. “University of Michigan Grad Student Employees Ratify New Deal After Historic Strike.” CBS News, August 25, 2023.
Bureau of Labor Statistics (BLS). 2024a. “Annual Work Stoppages Involving 1,000 or More Workers, 1947–Present” (table). Major Work Stoppages. Accessed on February 16, 2024.
Bureau of Labor Statistics (BLS). 2024b. “Table F. Distribution of Private Sector Employment by Firm Size Class : 1993/Q1 Through 2023/Q1, Not Seasonally Adjusted” (table). National Business Employment Dynamics Data by Firm Size Class. Accessed on February 7, 2024.
Bureau of Labor Statistics (BLS). 2024c. “Work Stoppages Summary” (press release). February 21, 2024.
Coalition of Kaiser Permanente Unions. 2023. “98.5% Yes Vote Ratifies 2023 National Agreement.” November 9, 2023.
Dickler, Jessica. 2023. “Why So Many Workers Are Striking in 2023 : ‘Strikes Can Often Be Contagious,' Says Expert.” CNBC, October 9, 2023.
Durbin, Dee-Ann. 2023. “Thousands of Starbucks Workers Go on a One-Day Strike on One of Chain's Busiest Days.” Associated Press, November 16, 2023.
Hersh, Adam. 2023. “UAW-Automakers Negotiations Pit Falling Wages Against Skyrocketing CEO Pay.” Working Economics Blog (Economic Policy Institute), September 12, 2023.
Isidore, Chris, and Samantha Delouya. 2023. “Union Workers Reach a Tentative Deal with Kaiser Permanente After the Largest-Ever US Health Care Strike.” CNN, October 13, 2023.
Kolodny, Lora. 2024. “Tesla Raising Factory Worker Pay in U.S. Following UAW Victories in Detroit.” CNBC, January 11, 2024.
Lucas, Amelia. 2023. “Starbucks Tells Union It Wants to Resume Contract Talks in January.” CNBC, December 8, 2023.
Lucas, Peter. 2023. “Graduate Workers at the University of Michigan Have Been on Strike for over a Month.” Jacobin, May 14, 2023.
Mackay, Hannah. 2023. “Striking UM Grad Student Instructors Begin Voting to Ratify New 3-Year Deal.” Detroit Free Press, August 22, 2023.
More Perfect Union. 2024. “Map : Where Are Starbucks Workers Unionizing ?” (web page). Last updated February 14, 2024.
Perez, Daniel. 2024. “Extending Unemployment Insurance to Striking Workers Would Cost Little and Encourage Fair Negotiations.” Working Economics Blog (Economic Policy Institute), January 29, 2024.
Reuters. 2023. “Kaiser Healthcare Workers Ratify New Contract.” November 9, 2023.
Ritchie, Kathryn, Johnnie Kallas, and Deepa Kylasam Iyer. 2024. Labor Action Tracker : Annual Report 2023. ILR School, Cornell University and School of Labor and Employment Relations, University of Illinois Urbana-Champaign, February 2024.
Saxena, Jaya. 2023. “Starbucks Workers United's Red Cup Rebellion, Explained.” Eater, November 14, 2023.
Shierholz, Heidi, Celine McNicholas, Margaret Poydock, and Jennifer Sherer. 2024. Workers Want Unions, but the Latest Data Point to Obstacles in Their Path. Economic Policy Institute, January 2024.
United Auto Workers (UAW). 2023. “UAW Members Ratify Historic Contracts at Ford, GM, and Stellantis” (press release). November 20, 2023.
United Auto Workers (UAW). 2024. “Stand Up Strike Frequently Asked Questions” (web page). Accessed on February 7, 2024.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le huit mars a vu l’émergence de la grève féministe dans maints pays

Empêcher l'humanité de glisser sur la pente raide du déboulement vers la terre- étuve alors qu'elle marche en funambule sur son étroite bordure exige dès maintenant la mise en branle d'un mouvement de masse mondial.
La mobilisation de la journée des femmes du 8 mars à travers le monde, de par intersectionnalité, y contribue. D'autant plus que depuis quelques années, inspirées de la première grève féministe en Islande en 1975, ces manifestations se sont doublées de grèves dans maints pays, notamment en Espagne et en Argentine mais aussi en Suisse et cette année en Italie et en France. Reprenant son souffle après la Marche mondiale des femmes du tournant du siècle, « [l]a déflagration du mouvement #MeToo en 2017 (grâce aussi aux flammes courageusement allumées et entretenues par les féministes les années précédentes) a réussi à réintégrer le féminisme comme un cadre d'action acceptable dans l'espace public. »
Mais #MeToo a également eu lieu à une époque où les mouvements anti-genre gagnaient lentement et sûrement du terrain, s'attaquant souvent aux droits des femmes sous prétexte de les défendre contre ce qu'ils considéraient comme les aberrations du féminisme radical. […] [L'héritage féministe] a été réinventé et réinterprété dans ce que l'auteure américaine Susan Faludi a appelé le "fémonationalisme" pour cibler le féminisme progressiste, les droits reproductifs et les migrants. C'est ce qu'a résumé de manière frappante Giorgia Meloni [Première ministre d'Italie] lorsqu'elle s'est adressée à une foule de partisans du parti d'extrême droite espagnol Vox en 2022 : « Oui à la famille naturelle, non au lobby LGBT ! Oui à l'identité sexuelle, non à l'idéologie du genre ! Oui à la culture de la vie, non à l'abîme de la mort ! Oui aux valeurs universelles de la Croix, non à la violence islamiste ! Oui à la sécurité des frontières, non à l'immigration de masse ! »
L'intégration de l'activisme antiféministe et antigenre dans un mouvement conservateur plus large à travers le monde est devenue évidente pendant la présidence de Trump. […] Ces réseaux transnationaux sont puissants et efficaces. Issus de l'extrême droite, ils sont non seulement européens mais aussi mondiaux. […] Ils visent également les droits des personnes LGBTQIA+ et, dans le même ordre d'idées, la Convention d'Istanbul, l'instrument juridique le plus solide pour les droits des femmes en termes de violence sexuelle et sexiste, et en particulier de violence domestique et intrafamiliale", explique le rapport [Rapport 2023 de la Fondation Jean-Jaurès et de l'ONG Equipop].
Malgré des contextes politiques et sociétaux souvent défavorables, l'espoir continue de germer. […] L'un des principaux triomphes de ces dernières décennies a été le référendum irlandais sur l'avortement en 2018, lors duquel près de 70 % des électeurs se sont prononcés en faveur de la légalisation de l'avortement [mais contrebalancée par ladéfaite du référendum visant l'égalité des genres, NDLR] […] La force de la mobilisation féministe contre l'interdiction de l'avortement en Pologne est un autre exemple frappant. En 2016, plus de 100 000 femmes sont descendues dans la rue lors des « manifestations noires ». Le mouvement s'est transformé en grève des femmes en 2020, lorsque le gouvernement a proposé d'adopter la législation la plus restrictive d'Europe en matière d'avortement. L'impact des manifestations a ensuite atteint le parlement, le parti conservateur Droit et Justice (PiS) perdant sa majorité en octobre 2023. […]
Des changements positifs sont également intervenus au sein des gouvernements. Dans le paysage politique européen actuel, c'est l'Espagne qui place la barre très haut en matière de droits de la femme. […] La mobilisation de l'équipe espagnole de football féminin (et de la société dans son ensemble) à la suite du baiser forcé sur la bouche d'une des joueuses lors de la célébration de leur victoire à la Coupe du monde cet été montre que ces lois ont changé les termes du débat, même si les tentatives d'ignorer ces changements se sont avérées puissantes.
Les progrès réalisés dans un pays - en particulier lorsque ce pays est perçu comme catholique et conservateur, comme l'Irlande ou l'Espagne - stimulent les mouvements féministes au-delà des frontières. […] La solidarité internationale a alimenté des manifestations dans le monde entier, telles que les manifestations noires polonaises depuis 2016, les mouvements de femmes iraniennes et le mouvement argentin contre la violence fondée sur le genre Ni Una Menos, qui a débuté en 2015 et s'est depuis étendu à des pays tels que l'Espagne et l'Italie.
Les étudiantes de McGill pour la Palestine et Mères au front contre Northvolt
Cette montée de l'extrême droite qui menace les États-Unis et le Canada, si l'on en croit les sondages électoraux, est de plus en plus portée au Québec par le parti au gouvernement. Que ça soit la droite globaliste néolibérale aux ÉU, au Canada, dans l'Union européenne ou l'extrême-droite nativiste tout aussi néolibérale en Russie ou en Israël, elles deviennent des va-t'en-guerre génocidaires ou leurs complices. Tant leur sexisme militariste et répressif en découlant que la mobilisation des ressources vers la guerre désarçonnent autant le mouvement féministe que celui écologique. Dans un tel contexte il ne faut pas se surprendre que les femmes prennent à bras-le-corps la lutte contre la guerre comme cesétudiantes de McGill qui jeûnent pour la Palestine et qu'elles animent celles écologiques comme les Mères au front contre l'usine de batteries Northvolt et contre la pollution du dépotoir Stablex à Blainville sans oublier la direction femme de Mob6600 pour un parc nature dans Hochelaga-Maisonneuve. Les femmes étaient bien sûr au cœur de la grève du secteur public pour l'école publique. Cette lutte comme le disait le tract des Travailleuses et travailleurs pour la justice climatique était aussi une lutte climatique par son « aspect de « prendre soin », aspect qu'on oublie trop souvent ».
Une intersectionnalité gréviste à l'origine ouvrière et inspirée du marxisme
Cette intersectionnalité de la lutte des femmes était déjà à l'origine de la journée internationale des femmes car elle fut d'abord « une histoire d'ouvrières » et même « à l'origine de la Révolution russe ». La journée internationale des femmes renaquit au Québec « le 8 mars 1971 pour l'avortement libre et gratuit » inséré en France dans la Constitution, non sans arrière-pensée électoraliste par un gouvernement carrément droitiste, et renié aux ÉU par sa réactionnaire Cour suprême. Les tentacules tous azimuts du féminisme opposent au « capital [qui] épuise les deux seules sources de toute richesse : la Terre et le travailleur », dixit Karl Marx dans le Capital, le prendre soin des gens et de la terre-mère. Comme le dit un article de The Conversation,
Cette organisation [pour la grève féministe] s'appuie aussi sur la mobilisation d'un corpus féministe-marxiste des théories de la reproduction sociale. Celles-ci reprennent les analyses de Marx, « étendues au travail reproductif des femmes et à leur rôle dans les rapports de (re)production capitaliste ». Ces théories mettent en lumière le travail reproductif principalement pris en charge par les femmes, consistant à « produire l'être humain », c'est-à-dire l'ensemble des activités nécessaires à produire le travailleur, à faire en sorte qu'il/elle soit apte au travail dit productif au quotidien (travail domestique, prise en charge des enfants, mais aussi santé publique, éducation, etc.).
Au Québec, mais aussi au Canada anglais et aux ÉU malgré la mobilisation pour le droit à l'avortement, côté grève féministe « ça gronde » mais on n'y est pas encore. Les manifestations du huit mars sont restées confidentielles. Le mouvement féministe québécois, à l'avant-garde de la Marche mondiale des femmes en 2000, n'a pas encore repris son souffle. N'en reste pas moins que dans cette conjoncture adverse, les acquis des femmes dans le monde se maintiennent même s'ils n'avancent pas. Modestement, ici et là se tissent des liens intersectoriels pour la convergence des lutte. S'en sont inspirées les jeunes femmes du mouvement Fridays for Future de Greta Thunberg qui ont tendu la main aux grévistes surtout hommes du syndicat des chauffeurs de transport collectif d'Allemagne. C'est une telle intersectionnalité mondialisée qui requinquera le mouvement climatique pour qu'il reparte à l'offensive.
Marc Bonhomme, 10 mars 2024
www.marcbonhomme.com ; bonmarc@videotron.ca

8 mars : Les femmes, surtout certaines, sont les premières victimes des guerres, de l’extrême droite et du système financier international. Toutes en grèves et vivent les luttes féministes intersectionnelles !

Dans le contexte de la crise multidimensionnelle du capitalisme, de la gravité de la crise écologique, de la montée en puissance de l'extrême-droite partout dans le monde et de viols et assassinats de femmes [1] au cours de guerres de plus en plus nombreuses, il est plus qu'urgent de rester mobilisé·es et d'amplifier les luttes féministes intersectionnelles.
Tiré de CADTM infolettre , le 2024-03-08
par CADTM International
Photo : Womin
25 000 femmes et enfants ont été tué·es à Gaza depuis le début de la guerre génocidaire menée par le gouvernement sioniste d'Israël le 8 octobre 2023. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, environ 3.238 femmes et filles ont été tuées et 4.872 ont été blessées, et la guerre a déplacé quelque 4 millions de personnes en Ukraine, dont 56 % sont des femmes. Médecins Sans Frontières a recensé 18 000 cas de violences sexuelles entre janvier et octobre 2023 [2] dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo (RDC). Victimes des conséquences directes des bombardements comme toute la population (la faim, manque de soins …), les femmes, leurs corps, leur dignité, sont spécifiquement ciblés par la violence patriarcale et guerrière.
De plus, la crise migratoire touche particulièrement les femmes et accroît leur oppression et leur exploitation. Cette violence n'est qu'une des nombreuses raisons derrière la migration qui, contrairement à la guerre, la destruction et les viols de masse, est criminalisée, générant elles aussi de nombreuses violences économiques, physiques, sexuelles, symboliques... Dans un contexte où de nombreux métiers dévalorisés sont toujours assignés aux femmes, l'exploitation des femmes migrantes dans ceux-ci ne fait que croître, amplifiant ainsi les oppressions croisées qu'elles subissent, y compris entre femmes.
Parallèlement, l'extrême-droite monte partout dans le monde. Avec elle, des revendications réactionnaires mettent en péril des droits qui nous semblaient inébranlables, comme celui de l'avortement. Aux États-Unis, par exemple, l'arrêt Roe v. Wade a été abrogé par la Cour suprême en juin 2022, supprimant le droit fédéral à l'avortement et laissant la liberté à chaque État de statuer individuellement sur la question. Depuis lors, 14 États ont interdit l'accès à l'avortement [3]. Autre exemple, Javier Milei, élu Président de l'Argentine en novembre 2023, s'attaque très durement aux droits des femmes. Il souhaite également abroger la loi qui légalise l'avortement.
Par ailleurs, le capitalisme néolibéral touche les femmes de manière spécifique. Les institutions financières internationales comme le Fonds monétaire international (FMI) ou la Banque mondiale imposent, au nom du remboursement de la dette publique, des politiques d'austérité et d'ajustement budgétaire dans le monde entier. Ces politiques impactent spécifiquement les femmes, surtout certaines (femmes migrantes, pauvres, mères célibataires, personne LGBTQIA+). Elles subissent la fermeture des services publics, dont elles sont les travailleuses et bénéficiaires majoritaires, pour elles (maternités, planning familiaux, centres d'accueils,…) et les personnes qu'elles ont à charge (crèches...) , et compensent le retrait de l'État providence. Leur travail gratuit (activités de soin envers leurs proches), mais aussi leurs dépenses (suppression de subsides, augmentation des prix sans augmentation de revenus, endettement…), augmentent considérablement.
Aux Suds, notamment en Afrique et en Asie du Sud, les institutions de microfinance ne cessent de se développer. Elles imposent souvent des taux d'intérêt démentiels aux femmes (jusqu'à 200% au Sri Lanka). Les débitrices subissent les pressions des créanciers qui les poussent parfois au suicide. De plus, l'influence de ces institutions donne lieu, dans certains pays comme le Sri Lanka, à l'interdiction des pratiques de prêts communautaires et solidaires entre femmes.
Les femmes sont également les principales productrices des produits de base dans les pays du Sud. Elles sont très impactées par le changement climatique et l'agrobusiness destructeur.
Les femmes sont clairement au premier plan dans de vastes mouvements de protestation de masse et dans des soulèvements populaires ces dernières années contre l'ordre établi, contre l'exploitation, les violences, le racisme et un ordre économique qui ne fait que renforcer les inégalités de genre, et ce en pleine conscience. Elles sont aussi au devant des batailles environnementales, paysannes, pour la défense de la terre et de l'eau, des droits humains et contre la répression.
Dans ce contexte d'attaques très claires sur les droits des femmes, le réseau CADTM International est plus que jamais mobilisé. Récemment, la coordination féministe du CADTM Afrique a organisé un séminaire de renforcement des capacités des femmes, à Yaoundé, au Cameroun. Parmi les revendications exprimées par les 38 participantes :
Fédérer et organiser des actions autour de la lutte pour l'annulation des dettes illégitimes et contre l'extractivisme, en insistant sur leurs impacts sur les femmes
Lutter pour la mise en place d'audits féministes de la dette et des mégaprojets financés par les institutions financières internationales
Au sein des luttes, donner la parole aux femmes des communautés et prendre en compte leurs besoins
Exiger des réparations pour les dommages causés aux populations et aux femmes en particulier, suite à l'implantation de projets de développement aux impacts négatifs sur les conditions de vie des communautés locales
Dénoncer la microfinance abusive qui accentue la pauvreté et le harcèlement des institutions de microfinance envers les femmes et développer des alternatives : Des crédits sans intérêt ou à taux très bas pour les populations marginalisées.
La lutte continue !
Notes
[1] Lorsque nous faisons référence aux femmes, il s'agit de toute personne identifiée et/ou s'identifiant comme femme. Le terme « femme » est ici utilisé comme catégorie politique pour dénoncer des rapports de domination qui ont lieu dans l'ordre genré et patriarcal dans lequel nous vivons. Les rapports de genre et les luttes qui y sont liées ne se limitent évidemment pas à deux genres ; les vécus et les identités de genre sont multiples.
[2] Bastien Massa, « RDC : à l'ombre du conflit, les femmes en proie à une hausse des viols », Mediapart, 20/02/2024, https://www.mediapart.fr/journal/international/200224/rdc-l-ombre-du-conflit-les-femmes-en-proie-une-hausse-des-viols.
[3] Fatoumata Sillah, « Etats-Unis : un an après Roe vs Wade, le droit à l'IVG Etat par Etat », Le monde, 24 juin 2023, https://www.lemonde.fr/international/article/2023/06/24/etats-unis-un-an-apres-roe-vs-wade-le-droit-a-l-ivg-etat-par-etat_6179041_3210.html
Auteur.e
CADTM International
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Solidarité avec les femmes en lutte du monde entier

Par sa dimension internationale, la journée du 8 mars constitue une occasion pour exprimer notre solidarité avec les femmes en lutte dans le monde entier, d'autant plus dans un contexte marqué par l'émergence de nouveaux conflits inter-impérialistes et la présence insupportable de la guerre sur différents continents.
Tiré de Inprecor 718 - mars 2024
10 mars 2024
Par Commission d'intervention féministe du NPA
Photothèque Rouge / Martin Noda / Hans Lucas
photo montage manif 8 mars Paris de Serge D'ignazio
https://www.flickr.com/photos/119524765@N06/albums/72177720315358049/
En Palestine, au Soudan, en Ukraine, au Rojava, en Iran comme au Chiapas, les femmes sont en première ligne dans la défense du droit des peuples à l'autodétermination et dans les combats contre les agressions impérialistes. Mais elles sont aussi les premières victimes des conflits armés et leurs conditions de vie peuvent atteindre un seuil dramatique.
Les femmes et la guerre
Dans les guerres contre les populations civiles, les femmes « ne sont plus des victimes occasionnelles, dont l'agression représente une sorte de sous-produit de la guerre, elles sont devenues des adversaires désignées ».
D'une façon générale, les conflits armés augmentent la violence contre les femmes et les personnes LGBTI. L'utilisation du viol comme arme de guerre s'associe à une amplification des violences sexuelles ainsi qu'à une très forte exposition des femmes aux risques de pauvreté.
C'est le cas notamment à l'est de la République démocratique du Congo, dans le contexte d'un conflit entre les différentes milices militaires. En Ukraine, selon Amnesty international, la guerre d'invasion russe a un effet néfaste sur la santé mentale, physique et reproductive des femmes.
Le contexte de la guerre entraîne partout une amplification des actions visant à contrôler les corps des femmes, soit dans le sens d'une atteinte à la production de la vie, soit dans le sens d'une injonction à engendrer de la chair à canon. Le projet de « réarmement démographique » de Macron s'inscrit dans cette logique de biopouvoir, c'est-à-dire d'un pouvoir patriarcal et capitaliste qui soumet la vie aux règles de compétition, d'optimisation et de mise en concurrence du marché.
Les guerres impérialistes apparaissent alors pour ce qu'elles sont, le stade suprême du capitalisme, la façon trouvée par les puissances du monde pour essayer de dépasser les crises d'approvisionnement et d'accumulation du capital.
En Palestine, les femmes accouchent dans des conditions inhumaines et endurent d'innombrables souffrances en raison de l'absence d'anesthésie et d'accès aux soins. Cette atteinte à la vie et à la mise au monde s'inscrit dans une volonté plus globale de destruction du peuple palestinien. La démolition des principales infrastructures de Gaza, les déplacements forcés, les maladies et l'impossibilité d'accéder aux biens essentiels pour la vie entraînent une crise humanitaire sans précédent.
En faisant face aux agressions brutales de l'armée, en préservant les enfants et les liens sociaux et familiaux dans une situation de deuil permanent, les femmes palestiniennes s'illustrent par leur courage et leur détermination dans la résistance depuis plus de 75 ans d'occupation coloniale par l'État d'Israël.
Grève féministe contre l'impérialisme et le patriarcat
Le 8 mars, nous appelons à une grève féministe internationale pour dénoncer la barbarie des guerres impérialistes entraînant une exacerbation des oppressions et des inégalités de genre. Nous construisons des actions unitaires et de solidarité envers les femmes et les minorités de genre confrontées aux privations et aux abus de la guerre, en Palestine, en Ukraine, au Soudan, au Congo et dans le monde entier.
Les femmes refusent d'être réduites au rôle de victimes collatérales de la guerre ou de cibles désignées. Nous revendiquons la place des femmes dans les prises de décision dans le cadre des conflits mondiaux. Nous réaffirmons l'importance d'un mouvement des femmes international et autonome qui s'oppose à l'ordre social capitaliste, impérialiste et patriarcal.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Pourquoi le 25 novembre et le 8 mars sont-ils les deux faces d’une même médaille ?

Cette note a été rédigée par le groupe anti-sexisme d'Attac, avec la précieuse relecture de Youlie Yamamoto et Lou Chesné, autrices du Manifeste des Rosies (2024).
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/03/07/violences-sexistes-et-sexuelles-violences-sociales/
En ce début d'année 2024, le président Emmanuel Macron a par deux fois réaffirmé son soutien à l'ordre patriarcal. Alors qu'il prétendait en 2017 faire de l'égalité de genre la « grande cause du quinquennat », ses actions n'ont cessé de démentir ses déclarations. C'est qu'on ne lutte pas contre le patriarcat et la domination masculine par la promotion de quelques femmes dans un système socio-économique globalement inchangé. Lorsqu'on prend en compte sérieusement l'intersectionnalité, on sait qu'on ne pourra transformer profondément les rapports de pouvoir entre les genres qu'en transformant tout aussi profondément les autres rapports de pouvoir, de domination et d'exploitation : capitalisme, suprématie blanche, validisme, hétéropatriarcat…
Dans cette note, nous invitons à un double déplacement de perspective. Tout d'abord, nous suggérons d'envisager les violences faites aux femmes non seulement comme la conséquence de leur domination par les hommes mais aussi des autres oppressions qu'elles subissent. Il s'agit de prendre au sérieux l'idée selon laquelle chaque expérience sociale est spécifique en fonction des rapports sociaux à l'intersection desquels elle se situe. Toutes les femmes sont ainsi exposées à des violences sexistes et sexuelles mais pas de la même manière en fonction de la place qu'elles occupent dans l'espace social. Ensuite, nous proposons de faire des violences faites aux femmes un levier pour penser et combattre les autres violences sociales, comme nous invite à le faire le slogan suivant : « Le féminisme sans lutte des classes, c'est du développement personnel ».
En somme, il s'agit de construire des ponts entre le 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, et le 25 novembre, journée internationale contre les violences faites aux femmes, car c'est bien parce que les femmes sont dominées à la fois dans l'ordre du genre et dans l'ordre économique que des violences s'exercent sur elles. Les violences sont toujours l'une des expressions du pouvoir (sauf quand il s'agit de la retourner contre l'oppresseur, consciemment ou inconsciemment). Exercer des violences psychologiques ou physiques sur une personne est une manière de la rappeler à l'ordre social, de lui rappeler quelle est sa place et provoquer de la sidération pour s'assurer qu'elle n'aura aucune prétention ni velléité à quitter cette place, ce qui subvertirait l'ordre social et bousculerait les rapports sociaux qui garantissent à certains de jouir de leurs privilèges.
Lire la note complète sur le site d'ATTAC
https://france.attac.org/se-mobiliser/le-8-mars-toutes-et-tous-en-greve/article/violences-sexistes-et-sexuelles-violences-sociales
Et voici la conclusion de ce texte d'Attac
Conclusion
Ces différents éléments dessinent un tableau éclairant des violences de genre et des violences faites aux femmes. Les vio-lences faites aux femmes sont une manière pour les hommes de perpétuer l'oppression patriarcale. Elles sont l'expression d'une contrainte et traduisent sur le corps des femmes toute la violence symbolique qui leur est par ailleurs faite. Dans la sphère professionnelle, la domination masculine s'appuie sur les autres rapports de pouvoir qui font des salarié·es les subor- donné·es de leurs employeurs et de leurs responsables hiérar- chiques et de la relation de service un support d'abus. Tout ceci est décuplé par la place subalterne que les femmes occupent dans le monde du travail du fait des postes qui leur sont ac-cessibles et des secteurs vers lesquels elles s'orientent. Les vio-lences de genre sanctionnent quant à elles la subversion des rapports de genre et visent à remettre les femmes à leur place.
C'est d'autant plus visible lorsqu'elles visent les femmes dans les espaces publics. Aussi, si le 25 novembre a pour vocation de lutter contre les violences faites aux femmes et les violences de genre, le 8 mars ne peut en faire abstraction puisqu'il s'at- taque à la racine du problème. Pour que cessent les violences, il faut délégitimer le pouvoir de ceux qui en usent.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

France : Pourquoi des Assises de la santé et la sécurité des travailleur⋅ses ?

Si les médias se saisissent de plus en plus de la question des dégâts du travail, force est de constater que la situation reste catastrophique. On recense pour chaque jour travaillé plus de 3 000 accidents du travail et maladies professionnelles déclarés en 2022. Le bilan que vient de publier la Caisse Accidents du travail .
– Maladies professionnelles est sans appel : 1 227 salarié⋅es sont décédées en 2022 du travail dont 738 par accident du travail, 286 durant leur trajet et 203 à la suite de maladies professionnelles. A cela se rajoutent les accidents et maladies concernant les agents de la fonction publique dont les chiffres sont toujours occultés. Ces milliers de morts au travail sont en grande partie le résultat de politiques d'entreprise sacrifiant la santé et la sécurité pour réduire les coûts !
Le bilan du Ministre du travail sortant est accablant : le nombre de morts est identique à celui de 2019. A part une vague campagne médiatique, rien n'a été fait, ne serait-ce que vis-à-vis du travail par forte chaleur !
Sur le terrain, nous sommes nombreux⋅ses à agir quotidiennement dans des conditions difficiles. Nous avons besoin de partager ces expériences, d'unifier nos luttes tant au niveau local que national pour créer un véritable rapport de force sur ces questions. Les employeurs responsables doivent être sévèrement sanctionnés personnellement au pénal pour les infractions commises et au civil dans l'objectif d'une réparation intégrale des préjudices pour les victimes. Il faut les obliger à prendre des mesures de prévention. Des instances spécifiques de protection de la santé et la sécurité des travailleuses et travailleurs (CHSCT renforcés) doivent être recréées partout et dotées de pouvoirs d'intervention. Il faut partout reconstruire les collectifs de travail et le rapport de force pour obtenir des mesures de prévention.
Pourquoi des Assises de la santé et la sécurité des travailleur⋅ses ?
• Pour mettre en commun ces combats divers et les rendre visibles,
• Pour aider chacun·e à s'investir davantage en s'appuyant sur les connaissances et expériences des autres, mettre en œuvre un réseau de soutien permanent,
• Pour faire converger ces luttes afin que les pouvoirs publics en fassent un sujet prioritaire.
Les 13 et 14 mars, participez aux Assises de la santé et la sécurité des travailleurs·ses !
Je m'inscris :https://www.billetweb.fr/assises-de-la-sante-et-securite-des-travailleurs-ses.
La présence aux assisses peut se faire dans le cadre de journées de formation syndicale. Contactez votre organisation qui peut aussi participer aux frais de transport et d'hébergement.
Les organisations signataires suivantes vous invitent à participer aux Assises de la Santé au Travail, premier rendez-vous d'une rencontre annuelle, et aux mobilisations qui se tiendront autour du 28 avril, journée mondiale de la santé et la sécurité au travail : CGT, FSU, Solidaires, Andeva, ASD-Pro, Association des experts intervenant en santé au travail, ATTAC, Ateliers Travail et Démocratie, Cordistes en colère, réseau féministe « Ruptures », Association-Santé-Médecine-Travail.
Pour tout contact : mobilisation28avril@gmail.com. Site : http://assises-sante-travail.ouvaton.org/
Dès maintenant, préparons les Assises de mars !
Appel à témoignages
Lors des Assises, nous souhaitons mettre en commun nos expériences, dans leurs succès et leurs échecs, pour apprendre ensemble à reconstruire du rapport de forces et mieux défendre la santé de nos collègues et l'environnement. Nos réflexions, notre élaboration commune sont d'autant plus riches qu'elles se nourrissent de récits concrets, d'expériences vécues qui parlent à chacun⋅e d'entre nous.
Vous avez sûrement mené des actions, enquêtes et mobilisations collectives pour : faire reconnaître un accident ou une maladie professionnelle, résister à une dégradation des conditions de travail, soutenir une victime d'agissements sexistes, inventer des manières de travailler autrement…
Comment résister aux ordonnances Macron, et garder le lien avec les problématiques du terrain malgré la suppression des délégué⋅es du personnel et CHSCT ? Comment utiliser au mieux nos droits pour résister et agir ?
Comment partir des souffrances mais aussi des aspirations des salarié⋅es pour reconstruire de l'action collective ?
Comment surmonter les divisions statutaires, la sous-traitance des risques, l'éparpillement des collectifs ? Comment rendre visibles les atteintes à la santé et contraindre les employeurs à vraiment agir en prévention ? etc.
Partant de vos expériences, nous vous invitons à envoyer un texte, un tract, un enregistrement audio ou vidéo, et/ou à préparer une courte intervention orale : lors des ateliers qui se tiendront tout au long des Assises, vous aurez la possibilité de présenter ce témoignage.
Vous pouvez envoyer ces témoignages à l'adresse suivante
:mobilisation28avril@gmail.com.
Comment s'organisent les Assises ? Une salle de 450 places et quatre salles de réunion nous accueillent le mercredi de 9h à 19h et le jeudi de 9h à 17h à la Bourse du travail de Paris, 29 Bd du Temple. Une large place sera laissée à vos interventions.
Les débats seront organisés autour de quatre grandes thématiques avec des ateliers en commun(programme définitif à venir sur le site http://assises-sante-travail.ouvaton.org/)
• Thème 1 : Femmes, Santé, Travail : Violences sexistes et sexuelles au travail – milieu professionnel, syndical, associatif ; Cancers des femmes au travail ; Santé invisibilisée, travail invisibilisé, salariées invisibles ; Risques invisibilisés dans les métiers du soin, le syndicalisme, etc.
• Thème 2 : Accidents du travail – Maladies professionnelles : Quelle reconnaissance des troubles psychiques dus au travail ? Statuts multiples, sous-traitance : comment agir ? Jeunes, chair à canon du capitalisme ? Vers la réparation intégrale ? Comment agir dans les services et entreprises après la disparition des CHSCT ?
• Thème 3 : Santé au travail et environnement : De l'amiante au chlordécone, lutter contre une réglementation qui autorise les industriels à tuer les travailleur⋅ses ! ; Construire des mobilisations collectives entre travailleur⋅ses/ riverains, entre expositions professionnelles et environnementales ; Construire les collaborations entre les équipes syndicales, les institutions (Inspection du travail, CARSAT, médecine du travail…), les avocat⋅es, la recherche…
• Thème 4 : Organisation du travail, souffrance au travail : des situations individuelles à la mobilisation collective ; enquêter sur le travail pour le transformer.
Les Assises se concluront par une table-ronde réunissant Sophie Binet (CGT), Murielle Guilbert (Solidaires) et Benoît Teste (FSU)
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Suisse. Après le OUI à la 13e rente amplifier la mobilisation sociale et syndicale pour les retraites et l’assurance maladie !

L'initiative pour une 13e rente AVS a été largement acceptée en votation populaire le 3 mars. Elle garantit une augmentation de toutes les rentes AVS de 8,3% dès 2026. C'est la première fois depuis les années 1970 que les rentes AVS sont augmentées pour toutes et tous [1]. C'est la première fois, depuis que le droit d'initiative existe, qu'une proposition des syndicats pour un renforcement d'une assurance sociale passe la rampe. Le OUI à la 13e rente le 3 mars 2024 constitue donc réellement un succès d'importance.
Un vote socialement motivé
« Une victoire des pauvres sur les riches » (Tages Anzeiger du 4 mars 2024), « Les aînés s'offrent une 13e rente contre l'avis des jeunes » (24 heures du 4 mars 2024). Voilà les titres de deux médias, appartenant tous deux au groupe Tamedia, basés sur le même sondage « sortie des urnes » et introduisant un article censé analyser les résultats de la votation. Un bel exemple de la manière dont l'opinion est construite… et tordue.
Sans vouloir abonder la littérature « journalistique » qui ne manquera pas d'interpréter et déformer ce vote, trois constats :
selon le sondage Tamedia, le Oui est très majoritaire dans les classes de revenus inférieures à 10 000 francs par mois et il reste majoritaire jusqu'à 13 000 francs, avec un gradient social régulier : plus le revenu est bas, plus la part de Oui est élevée. Pour repère : en 2015-2017 (dernières données disponibles de l'Enquête sur le revenu des ménages de l'Office fédéral de la statistique), le revenu brut moyen des ménages était de 9 349 francs par mois ; 60% des ménages avaient un revenu mensuel inférieur à 9 288 francs, 80% un revenu inférieur à 12 855 francs. Le OUI à la 13e rente est donc socialement ancré et il a convaincu non seulement parmi les salarié·e·s, les indépendants et les retraités avec des revenus très bas, mais également parmi les familles disposant de ce qu'il est convenu d'appeler des revenus « moyens » [2]. L'idée que seuls les « pauvres » auraient « vraiment » besoin d'un « coup de pouce » n'a pas passé.
L'opposition entre « classes d'âges » est construite et alimentée depuis des années par les milieux patronaux et les partis de droite : elle constitue le bras de levier dont ils usent pour diviser les salarié·e·s sur ce thème et imposer leurs choix. Cette argumentation rencontre un écho. Et elle se retrouve, à peine la votation passée, de nouveau au cœur des argumentaires revanchards de droite. Il est probable que sa résonance médiatique est sans rapport avec son écho réel. On ne prend pas grand risque en supposant que le taux de participation aux débats politiques et aux votations, bas chez les jeunes, l'est encore davantage parmi celles et ceux faisant partie du salariat le plus exploité, et que cette différence n'est pas entièrement « corrigée » par les calages du sondage [3]. Il n'en demeure pas moins que la surreprésentation du non parmi les plus jeunes renvoie aussi à la difficulté, jusqu'à maintenant, du mouvement syndical et social à entrer en contact et en échanges avec ces couches, qui seront au cœur du salariat de demain. Un défi à relever.
Il ne faut pas se lasser de répéter qu'un tiers environ de la population active et 26% de la population résidante est de nationalité étrangère, privée de droit de vote. Ces hommes et ces femmes vivent ici, travaillent ici, contribuent à financer les assurances sociales comme l'AVS et sont directement concernés par les prestations qu'ils garantissent. Cela devrait relever de l'évidence qu'ils et elles ont aussi le droit de se prononcer sur ces questions. Il ne fait pas de doute que le OUI en serait encore plus massif. Le combat démocratique pour la reconnaissance des droits de citoyenneté à toutes les personnes résidant durablement dans le pays reste crucial. Il est important – et concret socialement – pour combattre le climat xénophobe systématiquement entretenu par l'UDC, sous l'œil souvent fort bienveillant du reste de la droite.
L'émergence d'une dynamique
Plus qu'un bilan « sociologique », un bilan politique a son intérêt. La revendication d'une 13e rente AVS et la mobilisation croissante en sa faveur trouvent leurs origines au milieu des années 2010, avec le projet de réforme des retraites PV2020 et les positionnements opposés qu'il a suscités au sein du mouvement syndical et de la gauche. La dynamique qui s'est déployée est digne d'intérêt.
Le paquet PV2020, cuisiné sous la houlette du chef Alain Berset, alors conseiller fédéral « socialiste », prévoyait, pour faire simple : une hausse de l'âge de la retraite des femmes à 65 ans, une baisse du taux de conversion dans le 2e pilier réduisant ainsi les rentes versées par les caisses de pension et, prétendument pour « compenser » cela, une augmentation de 70 francs par mois des rentes AVS versées aux seuls nouveaux retraités.
La majorité du mouvement syndical, de même que le PS et les Verts, soutinrent ce projet avec l'argument, grand classique de la politique helvétique, que c'était le « meilleur compromis possible ». Emportée par cette orientation et pour se justifier, cette majorité se retrouva implacablement amenée à reprendre à son compte de larges pans de l'argumentaire bourgeois et du Conseil fédéral sur le vieillissement de la population, les finances de l'AVS courant soi-disant à leur perte, etc.
La résistance à ce positionnement, emmenée en particulier par des syndicalistes féministes, fit aboutir le référendum, a contré cet argumentaire trompeur et a contribué de manière décisive au refus du paquet lors de la votation populaire en 2017. L'impact de ce combat minoritaire mais plus que justifié, par la solidité de son argumentaire et l'ampleur de l'écho social rencontré, combiné avec la défaite du projet en votation, a ouvert l'espace pour rediscuter et redéfinir les positions syndicales sur la question des retraites.
Il en a résulté la deuxième bataille contre l'élévation de l'âge de la retraite des femmes, réunissant l'ensemble du mouvement syndical cette fois mais malheureusement perdue de peu en 2022, la proposition de revaloriser les retraites avec une 13e rente, et le refus de cautionner à n'importe quel prix la baisse du taux de conversion du 2e pilier.
Tout aussi important, ce repositionnement et l'intransigeance de classe des milieux bourgeois ont conduit à remettre en valeur les fondements de l'argumentaire en faveur d'une AVS renforcée : son puissant mécanisme de solidarité, sa solidité grâce au mécanisme de la répartition, sa place centrale dans les revenus des personnes retraitées.
Cette dynamique, où se sont succédé et combinées des batailles, minoritaires s'il le fallait, pour la défense des fondements d'une retraite sociale, unitaires chaque fois que cela est possible, a joué un rôle clé pour rendre possible la victoire sur la 13e rente. L'enjeu est désormais de construire son prolongement.
Transformer l'essai
Deux enjeux majeurs pour l'avenir des assurances sociales se profilent ces prochains mois :
Cet automne, la réforme du 2e pilier, combattue par les syndicats et les partis de gauche, sera probablement soumise au vote. Elle impose la baisse du taux de conversion, qui détermine la rente obtenue à partir du capital accumulé dans la partie obligatoire du 2e pilier. Le recul de ce taux de 6,8% à 6% correspond à une diminution de plus de 12%, qui s'ajoute à l'érosion constante des rentes du 2e pilier depuis deux décennies. Elle propose également d'augmenter fortement les cotisations des très bas revenus, avec l'argument de garantir ainsi des rentes meilleures aux salarié·e·s, des femmes travaillant à temps partiel en premier lieu, qui n'ont (presque) pas de deuxième pilier pour le moment. En réalité, l'amélioration ainsi obtenue sera extrêmement réduite et elle se paiera au prix d'une forte baisse du salaire disponible pour les personnes concernées.
L'enjeu de cette votation est crucial. Un OUI équivaudrait à consolider et étendre encore le système du 2e pilier, dont les rentes ne cessent, proportionnellement, de baisser, qui est profondément inégalitaire et très rentable pour les assurances et les banques impliquées dans sa gestion, et qui sert de rempart contre l'extension de l'AVS comme assurance solidaire garantissant à toutes et à tous des retraites suffisantes.
Un NON créerait au contraire des conditions plus favorables pour poser l'exigence d'un renforcement conséquent de l'AVS et un redimensionnement progressif du 2e pilier.
En juin 2024 aura lieu la votation sur l'initiative du Parti socialiste voulant plafonner à 10% du revenu disponible les montants que les ménages doivent consacrer au paiement de leurs cotisations à l'assurance maladie, le reste étant financé par la Confédération ou les cantons. La proposition est modeste : elle n'aborde pas la question d'une caisse unique publique, ni celle d'un financement sur le modèle de l'AVS. Pour mémoire, les cotisations versées par les ménages à l'assurance maladie en 2021 (25,4 milliards de francs) correspondent à 6,3% de cotisations salariales de type AVS, c'est-à-dire 3,15% déduits du salaire et 3,15% versés « directement » par l'employeur. Malgré cela, un plafond de 10% du revenu disponible améliorerait la situation financière d'une partie de la population avec des bas et moyens revenus. Une victoire permettrait aussi de relancer la question de changements plus profonds de l'assurance maladie et de mettre en lumière le combat initié par le Syndicat des services publics (SSP) contre la réforme EFAS, qui veut donner tout le contrôle du financement du système de santé aux assurances maladie.
Une des forces de la mobilisation pour la 13e rente est qu'elle a combiné une campagne syndicale dynamique, qui a rencontré un écho chez un grand nombre de personnes ayant répondu en contribuant activement, à leur échelle, à soutenir la 13e rente, et des mobilisations militantes diverses, popularisant de manière argumentée la défense de cette revendication et, plus généralement, du mécanisme social au cœur de l'AVS. La poursuite et l'amplification de cette dynamique seront déterminantes pour transformer l'essai du 3 mars lors de ces deux prochaines votations.
La poursuite de cette mobilisation sera aussi nécessaire face à un camp bourgeois qui n'a pas encore renoncé au sujet de la 13e rente. « Une AVS plus élevée à coup sûr dès 2026 – ou finalement non ? », titre la Neue Zürcher Zeitung (NZZ) du 5 mars 2024. Elle s'interroge avec intérêt sur la possibilité que la loi d'application de l'article constitutionnel accepté en votation puisse contenir des « mesures impopulaires, comme une augmentation des impôts, des cotisations ou de l'âge de la retraite ». « Il va de soi, poursuit-elle réjouie, qu'une telle réforme pourrait échouer en votation ». Le respect de la « volonté populaire », lorsqu'elle contredit les intérêts des dominants, n'a jamais étouffé la droite et le patronat. On vient encore de le voir avec le fiasco de la loi d'application de l'initiative « Jeunes sans tabac ». Le combat sur ce terrain est donc loin d'être terminé. Sans même parler des projets de suppression de la rente de veuve et d'orphelin portés par le Conseil fédéral et la droite parlementaire…
Prendre la mesure des affrontements à venir
Le 2 mars, la veille de la votation sur la 13e rente donc, la NZZ encore elle, quotidien qui se pense comme l'orienteur de larges secteurs bourgeois, titrait en une, sur toute la largeur de la page : « Plus de sécurité, moins d'Etat social ». L'argument est simple et direct. La guerre en Ukraine et le nouveau contexte géostratégique « obligent » à un effort massif de réarmement. Pour le financer, il faut réduire les dépenses sociales. L'autre option, qui serait une augmentation durable et très progressiste des impôts (entre autres sur la fortune), est « une alternative plus mauvaise ».
Cette perspective, combinée avec le mécanisme du frein à l'endettement qui corsète la politique budgétaire fédérale, annonce un affrontement de classe, avec son expression politique, au sujet des priorités d'allocation des ressources et de distribution des revenus dans les années à venir. Et aussi, par ailleurs, une pression certaine sur les droits démocratiques, à l'image des restrictions au droit de manifestation adoptées dans le canton de Zurich. On peut faire confiance à la conseillère fédérale responsable des Finances, la radicale Karin Keller-Sutter, pour porter avec brutalité cette perspective de « moins d'Etat social ».
Le frein à l'endettement et la baisse de fait des contributions fiscales des entreprises et des personnes les plus riches aux budgets des services publics comme des assurances sociales ne sont pas la résultante de « lois économiques » immuables. Ils concrétisent les intérêts bourgeois dans leur lutte constante pour s'approprier une part accrue des richesses produites par le travail. Et ce sont les mêmes milieux, qui ont fait durant des décennies d'excellentes affaires avec les oligarques soutenant le régime de Poutine – qui traînent les pieds depuis le début de la guerre d'invasion de l'Ukraine dans la mise en œuvre de sanctions qui léseraient leurs affaires ainsi que leur liberté de faire des affaires – qui voudraient aujourd'hui que la population sacrifie les assurances sociales, comme l'AVS, à une course aux armements débridée… et n'augurant rien de bon. Qu'on le veuille ou non, ces combats aussi feront partie de la bataille engagée autour de l'avenir de l'AVS et des assurances sociales en Suisse.
[1] Les rentes des femmes ont considérablement augmenté avec l'introduction du bonus éducatif dans le cadre de la 10e révision de l'AVS entrée en vigueur en 1997, mais avec l'élévation de leur âge de la retraite de deux ans.
[2] De manière réaliste, avec une formule marquée par la victoire du OUI, le correspondant parlementaire du quotidien La Liberté écrivait le 4 mars : « C'est un pays qui se redécouvre un vote de classes avec, ici, la combinaison gagnante de l'électorat populaire et de la classe moyenne. »
[3] Il faut le flair populaire d'un ancien gendarme, positionné à droite, Roger Golay du MCG/GE, pour souligner deux données d'évidence (24 heures, 5 mars 2024) : « Quand on n'a pas encore 50 ans, la retraite ça paraît lointain. Et je pense que cette génération s'est laissé entraîner dans la propagande de la droite libérale qui fait de l'alarmisme sur les finances de l'AVS. »
Benoit Blanc, 6 mars 2024
Suiza : ampliar la movilización social y sindical por las pensiones y el seguro de enfermedad
https://vientosur.info/suiza-ampliar-la-movilizacion-social-y-sindical-por-las-pensiones-y-el-seguro-de-enfermedad/
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Appel unitaire : Citoyens et citoyennes, paysannes et paysans, nous voulons une alimentation saine, au juste prix, pour toutes et tous !

Le modèle alimentaire et agricole actuel détruit les humains autant que la nature : burn-out, suicides, maladies professionnelles non reconnues, endettement, maladies chroniques, cancers, faim et insécurité alimentaire en quantité et en qualité, perte d'emplois agricoles, épuisement des sols, pollution des eaux, effondrement vertigineux de la biodiversité…
Photo et article tirés de NPA 29
Profitant de leur quasi-monopole, de l'inflation et de l'opacité de leurs marges pour augmenter leurs profits, la grande distribution, les géants de l'industrie agroalimentaire et les firmes de l'agrochimie spolient les agricultrices et agriculteurs et la pêche artisanale en mer. Ils rendent inaccessible à toutes et tous une alimentation saine. Ces acteurs favorisent une offre de produits alimentaires orientée vers la malbouffe et une agriculture productiviste mortifère au détriment de la juste rémunération des productrices et producteurs, de notre santé et de la planète. Le système est malade. Pourtant, le gouvernement, poussé par la fraction la plus productiviste du monde agricole, décide d'aggraver l'empoisonnement alimentaire par un recul sans précédent des politiques publiques menées depuis le Grenelle de l'environnement qui visaient notamment à réduire significativement l'usage des pesticides – même si elles n'y arrivaient pas encore.
Nous voulons des paysannes et paysans nombreux dans nos campagnes. Dans le pays dont la gastronomie est classée au patrimoine immatériel de l'humanité, nous voulons de la “bonne bouffe”, pour toutes et pour tous. Le droit à une alimentation favorable à la santé, durable, choisie et accessible est fondamental.
Citoyennes et citoyens, agricultrices et agriculteurs, scientifiques, consommatrices et consommateurs, associations, syndicats, mouvements divers, ensemble nous appelons la France à se réapproprier son alimentation et ses modes de productions. Là est la conquête d'une réelle souveraineté alimentaire.
Loin d'apporter des solutions durables à la crise agricole et au système alimentaire à la dérive, le gouvernement s'engage dans une fuite en avant. Il déroule le tapis rouge à toujours plus de dépendance aux pesticides, aux OGM, laisse l'agriculture biologique et la pêche artisanale s'enfoncer dans la crise et passe à côté de l'enjeu central : une alimentation favorable à la santé à prix juste pour toutes et tous. Nous voulons faire entendre la voix du plus grand nombre qui aspire à un autre quotidien alimentaire et agricole.
Nous voulons :
• La juste rémunération des agricultrices et agriculteurs, des pêcheuses et des pêcheurs
• Le droit et l'accès pour toutes et tous à une alimentation favorable à la santé et choisie
• La sortie des pesticides
• La transparence totale sur les marges de l'industrie agroalimentaire et de la grande distribution et une modération de leurs marges sur les produits les plus sains et durables
• La sortie et l'arrêt des négociations des accords de commerce (UE-Mercosur, UE Nouvelle Zélande, etc.), pour une refonte de la politique commerciale de l'Europe
• La généralisation de l'agriculture biologique et paysanne à échelle humaine qui n'empoisonne ni notre alimentation, ni celles et ceux qui la produisent, ni les sols, ni les eaux, ni la biodiversité, plus résiliente face au changement climatique et qui respecte le bien-être animal
• Une politique publique de formation et d'installation massive de paysans et paysannes.
Un autre modèle alimentaire et agricole est possible. Les solutions existent. À ce jour, c'est clairement la volonté politique du gouvernement actuel qui fait cruellement défaut et nous amène collectivement dans le mur d'une fracture sociale et environnementale intolérable, et dangereuse.
C'est pourquoi, ensemble, partout dans les territoires et sous toutes les formes possibles, nous appelons à prendre en main notre alimentation et nos modes de productions. C'est à nous de décider ce que nous voulons dans nos assiettes et dans nos champs. Organisons-nous localement partout où nous le pouvons et mobilisons-nous.
Première étape de notre action commune, le samedi 30 mars nous invitons la population à partager le repas de la grande bonne bouffe avec des centaines de banquets populaires autour des productions bio et locales dans toute la France.
>> Pour signer l'appel, pour lire la liste des signataires, pour enregistrer un banquet, pour nous contacter, voici un lien unique :linktr.ee/agrialimsante
mer. 06/03/2024
https://www.bioconsomacteurs.org/
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Un « passeport climatique » pour les migrants : l’idée fait son chemin

Face aux migrations vouées à exploser avec le réchauffement, l'idée d'un « passeport climatique » refait surface. Une « citoyenneté mondiale » à laquelle se heurtent des intérêts politiques.
1er mars 2024 | tiré de reporterre.net
Face aux fortes tensions générées par l'immigration à Mayotte, Gérald Darmanin a annoncé le 11 février vouloir supprimer le droit du sol dans ce département français de l'océan Indien. Le projet du ministre de l'Intérieur, qui nécessiterait une révision de la Constitution, suscite de vives inquiétudes de dérives politiques vers l'extrême droite.
Il interroge également notre capacité politique à nous adapter à ce type de crises à plus long terme. Nous ne sommes en effet qu'aux prémices des flux migratoires voués à exploser à cause des catastrophes engendrées par le changement climatique. Plusieurs dizaines de millions de personnes sont d'ores et déjà contraintes chaque année de se déplacer en raison des catastrophes naturelles. La Banque mondiale évoque 216 millions de migrants climatiques intérieurs potentiels en 2050, et l'Institut pour l'économie et la paix livre l'estimation la plus haute (et controversée) de 1,2 milliard de migrants climatiques en 2050.
Gérer de tels déplacements massifs de personnes sans entraîner de crispations politiques extrêmes s'avère plus que délicat. À rebours des tentations sécuritaires et de fermetures de frontières, une proposition audacieuse a toutefois refait surface ces derniers mois : la création d'un « passeport climatique » qui faciliterait les déplacements et l'accueil de ces personnes fuyant les sécheresses, inondations, processus de désertification et autres catastrophes engendrées par le réchauffement global.
« Citoyenneté mondiale » pour apatrides climatiques
En octobre 2023, le Conseil d'experts sur la migration et l'intégration, un organe indépendant chargé de conseiller le gouvernement allemand, a proposé dans son rapport annuel d'instaurer un « passeport climatique », ainsi qu'une « carte climatique » et un « visa climatique », avec des durées d'accueil différentes. Trois instruments qui permettraient à l'Allemagne de montrer l'exemple à l'international pour « répondre au défi des migrations engendrées par le changement climatique », estime le conseil.
Dès 2018, on retrouvait l'idée d'accorder un passeport climatique pour les citoyens d'îles du Pacifique risquant de disparaître. L'idée était alors promue par l'université des Nations unies de Bonn, en Allemagne.
Depuis, l'idée s'est également épanouie dans la fiction. On la retrouve parmi la myriade d'utopies plus ou moins réalistes portées par le best-seller mondial Le Ministère du futur, paru en 2020 et traduit en français fin 2023. L'auteur, Kim Stanley Robinson, imagine que les États finissent par s'entendre pour mettre en place un passeport climatique. Une « sorte de citoyenneté mondiale » validée par les signataires de l'Accord de Paris pour accueillir les réfugiés, « afin que la charge humaine et financière soit répartie équitablement », selon les responsabilités historiques dans le changement climatique.

Selon les acteurs qui le convoquent, le concept de passeport climatique peut recouvrir différentes réalités. La source d'inspiration première remonte au passeport Nansen. Imaginé par Fridtjof Nansen dans les années 1920, il avait permis aux réfugiés apatrides, notamment russes après la révolution soviétique, de passer les frontières.
Sur cette base, le passeport climatique pourrait a minima être imaginé pour les populations dont les États vont totalement disparaître, à l'instar de certaines nations du Pacifique condamnées, à terme, par la montée des eaux. Les choses évoluent déjà sur le sujet : l'Australie et les Tuvalu, dans l'archipel polynésien, ont ainsi signé en novembre 2023 un traité accordant des « droits spéciaux » à des citoyens de Tuvalu, ouvrant la voie à l'asile climatique pour les habitants de cet archipel particulièrement menacé d'être englouti par les eaux.
« Les données montrent que les gens partent déjà de ces îles, vers l'Australie notamment. À la fin, il ne restera que ceux qui ne voulaient pas ou n'avaient pas les moyens de partir : ça ne concernera pas tant de gens et ça restera gérable pour les pays d'accueil », estime Antoine Pécoud, professeur de sociologie à l'université Paris 13, et codirecteur de l'ouvrage collectif Migrations sans frontières (éd. Unesco, 2009).
Des quotas d'accueil pour les pays riches ?
Mais peut-on imaginer une application plus large de ce mécanisme d'accueil, intégrant comme l'imagine Kim Stanley Robinson des dizaines de millions de réfugiés climatiques, y compris lorsque leur pays ravagé n'a pas formellement disparu ? Juridiquement, l'affaire semble complexe : « Parler de “réfugiés climatiques” n'a pas de sens juridique, car le terme de réfugié, selon la Convention de Genève, implique une persécution, qui ne s'applique pas au climat », nous dit Samuel Lietaer, chercheur en sciences sociales et environnementales, spécialiste des migrations à l'université libre de Bruxelles. Sans compter qu'il est presque impossible d'identifier une cause unique aux migrations, les raisons économiques, sociales et climatiques étant souvent imbriquées les unes aux autres.
Politiquement, cependant, les choses évoluent ostensiblement. Au début des années 2010, l'Initiative Nansen, portée par des États, a abouti à un « Agenda de protection » approuvé par plus de 100 États en 2015 puis la mise en place d'une Plateforme sur les déplacements liés aux catastrophes, qui vise à faire avancer ce sujet dans les différentes instances de négociations internationales, sans trop proposer de mesures concrètes.
Rien de contraignant donc, mais une reconnaissance internationale qui progresse, les migrations étant de plus en plus reconnues comme un volet essentiel des stratégies d'adaptation au changement climatique. L'Accord de Paris de 2015 entérine ainsi le lien entre le changement climatique et la nécessité pour les États signataires de « respecter, promouvoir et prendre en considération leurs obligations » concernant les droits des migrants. « Les COP ont reconnu que les migrations faisaient partie des enjeux liés aux “pertes et dommages” dans les négociations climatiques. Cela ouvre la voie à l'idée de compensations financières et même de droit d'accès au territoire », analyse Samuel Lietaer.
« Cela reviendrait à ce que l'Europe et les États-Unis accueillent l'essentiel des migrants »
Problème : la compensation pour les « pertes et dommages » dans les négociations climatiques achoppe généralement sur la reconnaissance de la responsabilité historique de l'Occident dans la catastrophe climatique. Les pays riches rechignant à payer leur dette. Appliquée à l'enjeu migratoire, cette responsabilité différenciée pourrait se traduire par la répartition de quotas d'accueil pour les migrants climatiques, qui recevraient des passeports climatiques fléchés vers des pays historiquement responsables du désastre.
« Cette idée est évidemment politiquement très sensible et a vite été mise sous le tapis. Cela reviendrait à ce que l'Europe et les États-Unis accueillent l'essentiel des migrants », commente Antoine Pécoud. Le chercheur rappelle, en outre, qu'un système de répartition très précis par quotas serait probablement contre-productif : « Des réfugiés arrivant en Europe n'auront aucune envie d'être redirigés vers la Lituanie si leurs réseaux ou leurs proches sont à Londres ou Francfort. Et ils auront raison : c'est grâce à ces réseaux qu'ils auraient des chances de trouver du travail, des ressources et de s'intégrer. Imaginer redistribuer les gens de manière rationnelle n'est qu'un fantasme. »

Un passeport climatique très libéral, qui permettrait à ses bénéficiaires de se déplacer où bon leur semble, comme l'imagine Robinson, reviendrait dans les faits à supprimer les frontières pour ces personnes, ainsi que le propose Antoine Pécoud dans son ouvrage. « Il s'agit de faire confiance aux individus : ils vont là où il y a du travail et là où ils ont les meilleures chances de s'intégrer. C'est l'idée que la liberté est le meilleur allié du développement, comme l'a théorisé Amartya Sen [un économiste et philosophe indien] », dit-il.
Un telle définition ambitieuse du passeport climatique se heurte frontalement aux tensions et peurs identitaires. Mais l'idée « d'invasion » ou « d'appel d'air » que provoquerait une ouverture des frontières est contredite par les données historiques. La grande majorité des gens qui se déplacent migrent à l'intérieur de leurs frontières ou dans des pays limitrophes. La pauvreté limite énormément les capacités de migration lointaine. En Afrique subsaharienne par exemple, 70 % des migrations se font dans la région et seulement 15 % en Europe, illustre Gilles Pison, professeur au Muséum national d'histoire naturelle.
L'exemple de l'ouverture des frontières en Europe est également révélateur : « On a oublié les discours médiatiques et politiques lors de l'ouverture de l'Union européenne à l'Espagne. La presse était terrorisée par une invasion incontrôlable d'Espagnols en France. Idem avec l'Europe de l'Est, on les disait trop éloignés culturellement pour s'intégrer à nos valeurs démocratiques, on redoutait la concurrence du plombier polonais, etc. Rien de tout cela ne s'est produit », raconte Antoine Pécoud.
Le problème, souligne le chercheur, ne serait pas celui d'une invasion, mais bien au contraire celui de l'incapacité des populations victimes de ravages climatiques à se déplacer. « Les populations les plus vulnérables resteront coincées chez elles, sans moyens financiers ni compétences linguistiques et techniques pour fuir à l'étranger. Pour ces personnes-là, sans aide, un passeport climatique sera inutile. »
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Sénégal : Un projet d’amnistie controversé franchit une première étape à l’Assemblée

Un projet de loi d'amnistie au Sénégal a franchi hier une première étape à l'Assemblée nationale, avec l'adoption en commission de ce texte critiqué par l'opposition, en pleine crise autour du report de l'élection présidentielle, rapporte l'AFP.
Tiré d'El-Watan.
L'amnistie des faits liés aux manifestations politiques meurtrières entre 2021 et 2024 est un des éléments de la réponse du président Macky Sall à la crise provoquée par l'ajournement surprise du scrutin, initialement prévu le 25 février.
Ce report décidé par le chef de l'Etat a causé un choc dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest, qui attend depuis une nouvelle date. On ignore si Ousmane Sonko, principal opposant actuellement détenu et dont la candidature a été invalidée en raison d'une condamnation définitive pour « diffamation », et si le candidat à qui il a depuis apporté son soutien Bassirou Diomaye Faye, lui aussi détenu pour des « actes de nature à troubler l'ordre public », seraient concernés par l'amnistie.
Le texte, initié par le Président et approuvé en Conseil des ministres il y a une semaine, a été adopté hier par la commission des lois, ont indiqué le président de la commission, Moussa Diakhaté, et une députée de l'opposition.
Selon un document authentifié de source parlementaire, seraient amnistiés « tous les faits susceptibles de revêtir la qualification d'infraction criminelle ou correctionnelle commis entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024, tant au Sénégal qu'à l'étranger, se rapportant à des manifestations ou ayant des motivations politiques ».
Ces manifestations, liées aux déboires judiciaires d'Ousmane Sonko et au report du scrutin, ont donné lieu à des centaines d'arrestations d'opposants, fait des dizaines de morts et provoqué d'importantes dégradations matérielles, comme le saccage de l'université de Dakar. Le projet de loi est élaboré, selon la Présidence, dans un but « d'apaisement du climat politique et social ». Selon Moussa Sarr, un avocat qui suit les dossiers de plusieurs dizaines d'opposants emprisonnés, les personnes arrêtées dans le cadre des manifestations seraient libérées dès la publication de la loi au Journal officiel, et les poursuites seraient abandonnées.
De fait, plusieurs centaines d'opposants ont été remis en liberté provisoire depuis mi-février par les autorités, dans le but, selon elles, de « pacifier l'espace public ».
Une grande partie de l'opposition s'est prononcée contre le projet d'amnistie, dénonçant un « déni de justice » et une manœuvre pour assurer l'impunité aux forces de sécurité impliquées dans la répression, ainsi que celle de leurs responsables, y compris gouvernementaux. Le projet ne fait pas non plus l'unanimité au sein du camp présidentiel, qui dispose d'une majorité précaire à l'Assemblée.
Le président Sall a reçu lundi les conclusions d'un « dialogue national » préconisant d'organiser la présidentielle le 2 juin et suggérant que ce dernier reste en fonction jusqu'à l'investiture de son successeur, soit plus de deux mois après l'expiration de son mandat. Le chef de l'Etat, élu en 2012 et réélu en 2019 mais non candidat en 2024, a indiqué qu'il compte demander l'avis du Conseil constitutionnel sur ces deux points, alors que l'opposition réclame toujours une élection avant le 2 avril.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
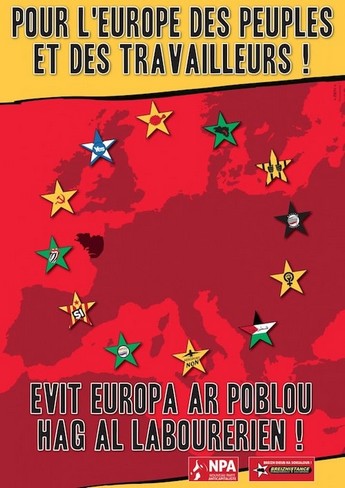
Bruxelles s’inquiète...
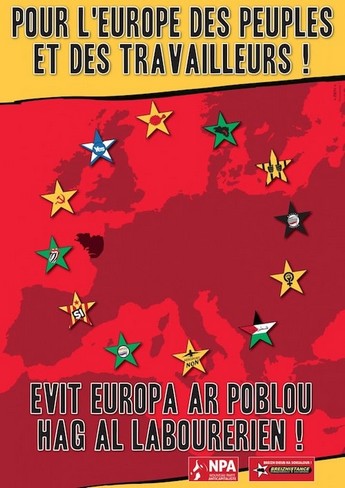
Bruxelles s'inquiète parce que l'instrument favori des bourgeoisies européennes pourrait bien vite ne plus remplir le rôle que peu à peu il a été amené à jouer, à savoir celui de réducteur d'incertitude contrariant l'amplitude de l'oscillation du balancier politique dans les États membres.
Tiré de : La chronique de Recherches internationales
MICHEL ROGALSKI
Directeur de la revue Recherches internationales
Au départ simple marché commun favorisant les grands groupes économiques et financiers l'Union européenne s'est vite transformée sous l'empilement de Traités successifs, dont la portée était supérieure aux lois nationales, en gangue engluante interdisant toute mise en œuvre de politiques s'écartant du « cercle de la raison ». Les bourgeoisies européennes avaient trouvé là une nouvelle « Sainte alliance » de nature à les protéger de toute secousse politique à même de les menacer. Tout était verrouillé pour que les programmes progressistes et socialement avancés viennent se fracasser sur le mur de l'Europe remplaçant le « Mur d'argent » d'il y a un siècle. Les deux dernières présidentielles françaises ont révélé des questionnements sur la possibilité d'appliquer un programme dans le cadre d'une Union européenne hostile et capable de résister à des changements internes dans un quelconque État-membre. Chaque fois la question du rapport à l'Europe fut posée. La mise en œuvre d'une véritable alternative de gauche porte en elle les germes d'un affrontement avec le carcan européen constitutionnalisé. Elle est lourde de désobéissances, de résistances, de confrontations, de renégociations. Faut-il plier ou désobéir ? Aucun programme politique de gauche ne sera crédible s'il n'explore pas cette dimension.
Des précédents avaient de quoi faire réfléchir.
La construction européenne n'a jamais rimé avec démocratie. La campagne sur le Traité constitutionnel européen en 2005 avait déjà désilé les regards. Il ne fut tout simplement pas tenu compte du refus exprimé par referendum par le peuple français auquel on imposa par un vote du Congrès l'adoption du Traité de Lisbonne qui reprenait l'essentiel de ce qui avait été rejeté deux ans plus tôt. L'enjeu était alors clair. Il s'agissait de constitutionnaliser, c'est à dire de graver dans le marbre l'ensemble des traités qui s'étaient empilés au cours de la construction européenne. C'est au refus de ce quitus qu'il convenait de s'attaquer. Quand dix années plus tard, la Grèce s'avise de refuser par referendum les mesures austéritaires proposées par la Troïka (Banque centrale européenne, la Commission européenne, le FMI) il lui fut répondu par Jean-Claude Juncker, alors président de la Commission européenne « qu'il ne pouvait y avoir de choix démocratique contre les traités européens déjà ratifiés » sans qu'aucun chef d'État ne s'en émeuve.
Tout ceci a contribué une dépolitisation portée par l'illusion de la politique unique entrainant nombre d'électeurs dans la conviction que certes on pouvait changer de Gouvernements mais pas des politiques menées. À cela s'ajoute la multiplication des affaires de corruption ayant touché lors de la dernière mandature nombre de députés européens. Sur ce terreau un nationalisme d'extrême droite s'est mis à prospérer à travers le continent et menace désormais les grands équilibres politiques de l'institution européenne. Les sondages prédisent une montée de ces forces permettant aux deux formations qui les représentent – l'ECR et l'ID – d'atteindre chacune une centaine de députés. Si ces deux groupes fusionnaient malgré leurs divergences quant au rapport à la Russie, principal point de discorde, ils formeraient le premier groupe du Parlement européen et pourraient ainsi peser sur la candidature au poste de Commissaire européen dont on connaît l'importance des attributions. Une autre hypothèse fréquemment évoquée envisage la fin de l'actuelle cogestion entre le groupe PPE et le groupe des sociaux-démocrates au profit d'une grande coalition des droites dans laquelle l'extrême droite prendrait une large place, réalisant ce qui s'est déjà produit dans 5 ou 6 États européens. Le débat reste ouvert de savoir pourquoi ce sont ces forces qui ont su labourer les travers de la construction européenne et non pas les forces progressistes.
Bruxelles devrait s'inquiéter car les deux piliers qui ont servi à vendre l'Union européenne ne font plus recette. Il y a longtemps que les discours sur l'Europe censée protéger de la mondialisation ou sur celle devant instiller une dimension sociale font sourire.
La construction européenne présente un cas particulier de la mondialisation. C'est un espace continental où ses formes ont été les plus accentuées et où les traités se sont empilés entrainant chaque fois des délégations de souveraineté : Acte unique, Traité de Maastricht, Pacte de stabilité, le tout repris et rassemblé dans le corset du Traité de Lisbonne et complétés et aggravés par ceux découlant des critères de la gestion de la monnaie unique allant jusqu'à faire obligation aux parlement nationaux à faire viser par la Commission européenne les projets de budgets de chaque pays. La construction européenne est ainsi devenue le laboratoire de la mondialisation, sa forme la plus avancée et ne peut être considérée comme potentiellement lui être porteuse de résistance. Car elle en réunit tous les ingrédients : marché unique, libre circulation des marchandises, des services, des capitaux et des travailleurs dans un espace où les écarts de salaires s'échelonnent de 1 à 9 et où les normes sociales, fiscales et environnementales sont différentes. Dans un tel espace ce qui s'échange ce ne sont pas des marchandises mais les conditions contextuelles dans lesquelles elles sont produites. Il est vain alors de parler de concurrence libre et non faussée. Les dérives délétères de la mondialisation y ont été multipliées rendant problématiques les conditions de l'exercice de la souveraineté dans cet ensemble européen. On comprend ainsi pourquoi prétendre construire l'Europe pour s'opposer à la mondialisation qu'on n'a pas hésité à présenter comme « heureuse » relève de l'escroquerie et combien il est vain d'espérer que l'Europe sociale vendue dès 1986 par Martine Aubry puisse se réaliser. Il ne s'agissait guère d'autre chose que d'un contre-feu allumé pour sauver l'idée de construction européenne en panne à l'époque. Ce serait l'amplification des « concurrences » qui tirerait les droits sociaux vers le bas et aggraverait les écarts de développement et les nombreuses inégalités sociales et territoriales.
On comprend comment dans un tel contexte les projets d'élargissement de l'UE à 5-6 nouveaux pays membres inquiètent au moment même où l'Europe affiche sa division sur maints problèmes. À l'ancienne division Nord-Sud qui la travaillait vient s'ajouter une opposition Est-Ouest au moment où le couple franco-allemand affiche publiquement ses désaccords sur la conduite de l'assistance à l'Ukraine et où les pays européens se divisent à l'ONU sur le conflit israélo-palestinien. Si l'on ajoute à cela les approches souvent opposées sur le Pacte migratoire en voie d'adoption, la notion d'autonomie stratégique ou la lecture de l'atlantisme, l'élargissement risque de rimer avec ingouvernabilité ou avec dislocation. Conscient de ces obstacles le Rapport rédigé par le député Jean-Louis Bourlanges sur les conditions de l'élargissement de l'Europe pose la question des conséquences institutionnelles, c'est à dire du mode de gouvernance. La formule d'une « union sans cesse plus étroite entre les peuples européens », reste son mantra. Pour piloter cet élargissement, il propose « d'étendre le champ d'application du vote à la majorité qualifiée », saut supplémentaire vers une Europe fédérale.
L'Europe ne doit pas être perçue comme une mécanique d'où partiraient oukases et interdits mais bien au contraire comme une structure permissive à même d'accompagner les trajectoires singulières librement choisies de ses États membres. Faute d'une telle orientation l'Europe ne sera plus la solution mais le problème. Bruxelles devrait s'inquièter.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Algérie. Cinq ans après le mouvement de protestation du Hirak, la répression continue sans relâche

Les autorités algériennes continuent de réprimer les droits à la liberté d'expression et de réunion pacifique cinq ans après le début du mouvement de protestation du Hirak, a déclaré Amnesty International le 22 février 2024, en ciblant les voix critiques et dissidentes, qu'il s'agisse de manifestant·e·s, de journalistes ou de personnes exprimant leurs opinions sur les réseaux sociaux.
Tiré d'Afrique en lutte.
Après l'arrêt du mouvement de protestation du Hirak en raison du COVID-19 en 2020, les autorités algériennes ont intensifié leur répression de la dissidence pacifique. Des centaines de personnes ont été arrêtées et placées en détention de façon arbitraire. Des dizaines de manifestant·e·s pacifiques, de journalistes, de militant·e·s et de défenseur·e·s des droits humains continuent de languir derrière les barreaux pour avoir critiqué les autorités.
« Il est tragique de constater que, cinq ans après que de courageux Algériens et Algériennes soient descendus dans la rue en masse pour exiger des changements et des réformes politiques, les autorités continuent de mener une campagne de répression glaçante », a déclaré Heba Morayef, directrice régionale d'Amnesty International pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.
« Les autorités algériennes doivent libérer immédiatement et sans condition toutes les personnes détenues uniquement pour avoir exercé leurs droits aux libertés d'expression, de réunion pacifique et d'association. Elles doivent veiller à ce que les défenseur·e·s des droits humains, les journalistes, les militant·e·s, les syndicalistes et d'autres puissent exercer leurs droits et exprimer librement leurs opinions critiques sans craindre des représailles. »
« Les autorités algériennes doivent faire du cinquième anniversaire du mouvement de protestation du Hirak un tournant en mettant fin à ce climat de répression et en ordonnant la libération immédiate des personnes détenues arbitrairement, ainsi qu'en autorisant la tenue de manifestations pacifiques. Les autorités doivent également mettre fin au harcèlement des opposant·e·s et des personnes considérées comme critiques et réformer des textes législatifs clés, notamment en abrogeant les dispositions vagues et trop générales qui ont été utilisées pour réprimer les droits humains. »
Complément d'information
Le mouvement de protestation du Hirak a débuté en février 2019, lorsque des manifestations de grande ampleur essentiellement pacifiques ont eu lieu dans toute l'Algérie contre le président de l'époque, Abdelaziz Bouteflika. Ces dernières années, les revendications des manifestant·e·s ont évolué à mesure qu'ils et elles réclamaient des réformes politiques et davantage de libertés.
Depuis mai 2021, les autorités font obstacle aux manifestations, exigeant désormais une notification préalable pour chacune d'entre elles. Elles ont également intensifié la répression de l'espace civique et le musèlement de la dissidence, arrêtant des dizaines de personnes, dont des journalistes, des défenseur·e·s des droits humains, des personnes lanceuses d'alerte et des personnes s'exprimant en ligne ou participant à des manifestations pacifiques.
En septembre 2023, Amnesty International a lancé une campagne pour réclamer la libération de dizaines de détenu·e·s. Parmi eux, Slimane Bouhafs, un militant amazigh emprisonné en septembre 2021 et dont la condamnation a été confirmée en appel l'année dernière, a été condamné à trois ans de prison et à une amende pour « atteinte à l'intégrité du territoire national ».
Mohamed Tadjadit, appelé le « poète du Hirak », en fait également partie. Il a été placé en détention dans le cadre de quatre affaires distinctes entre 2019 et 2022, toutes pour sa participation à des manifestations pacifiques ou pour avoir exercé son droit à la liberté d'expression. Il a de nouveau été arrêté en janvier 2024.
En octobre 2023, la Cour suprême algérienne a rejeté deux appels interjetés par les avocats d'Ihsane El Kadi, un journaliste indépendant, confirmant sa condamnation à sept ans de prison, pour des accusations liées à son travail de journalisme.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’Égypte durcit son discours envers les migrants et réfugiés

Il y aurait neuf millions de migrants en Égypte, pays qui a connu un fort afflux à chacune des crises régionales, notamment les guerres en Syrie, au Yémen et au Soudan. Depuis peu, les autorités ont changé de discours à leur égard, en parlant de plus en plus d'un “fardeau”. Un des enjeux serait de monnayer un rôle de “rempart” contre l'immigration vers l'Europe à travers la Méditerranée.
Tiré de Courrier international. Légende de la photo de couverture : Des réfugiés soudanais à leur arrivés à la gare routière d'Assouan, dans le sud de l'Égypte, en mai 2023. Photo Heba Khamis/The New York Times.
“Environ 300 réfugiés arrivent en Égypte tous les jours par la frontière soudanaise”, rapporte le quotidien soudanais Sudan Tribune en citant “un responsable onusien”. Depuis le début de la guerre au Soudan en avril dernier, ce sont ainsi “plus de 450 000 personnes” qui sont arrivées par cette voie, ajoute le site Al-Monitor.
L'Égypte n'est en effet pas seulement un pays d'émigration, mais aussi une destination pour de nombreux migrants de la région. Parmi les plus grandes communautés, il y aurait ainsi quelque 4 millions de Soudanais en Égypte, ainsi que 1,5 million de Syriens, 1 million de Yéménites et 1 million de Libyens, selon le quotidien égyptien Al-Watan.
“Chaque crise dans les pays arabes s'est accompagnée d'une vague de migration” vers l'Égypte, ajoute Ayman Zohri, spécialiste égyptien des migrations, cité par le quotidien britannique The Independent en langue arabe.
“À commencer par le début des affrontements au Soudan dans les années 1950 et jusqu'à la guerre en cours actuellement à Khartoum. Il y a également eu l'invasion de l'Irak [par les États-Unis] en 2003, puis en 2011 la révolution en Libye, la guerre civile en Syrie à partir de 2012, puis la guerre au Yémen depuis 2015.”

Selon le chercheur, la cohabitation avec les nombreux étrangers se passe dans une bonne entente, dans un pays où “la haine des étrangers n'est pas quelque chose de répandu” :
- “On s'est habitué à voir un Syrien qui loue une échoppe dans un immeuble qui appartient à un Soudanais, tandis qu'un Sud-Soudanais travaille dans un atelier à côté.”
Contribution à l'économie
Loin de poser un problème à l'économie égyptienne, ces migrants rapportent par ailleurs plus à l'État qu'ils ne lui en coûtent, indique le site égyptien indépendant Mada Masr. C'est également ce qu'explique Al-Manassa, autre site indépendant égyptien, à propos des réfugiés yéménites, qui auraient largement investi en Égypte pour y créer leurs propres entreprises.
Il n'empêche que, depuis quelque temps, le gouvernement égyptien met de plus en plus l'accent sur le “fardeau financier” que leur présence ferait peser sur les services publics. Cela a été suivi d'une multiplication de messages “hostiles” sur les réseaux sociaux pour demander leur expulsion.
Un discours de plus en plus hostile
Plusieurs signes indiquent un resserrement de la politique du Caire vis-à-vis des migrants. Sous couvert de leur “régularisation”, il leur serait à l'avenir demandé de faire des démarches pour l'obtention d'un certificat de résidence, contre le versement “de frais de 1 000 dollars”, toujours selon Ayman Zohri dans The Independent.

D'autre part, les autorités du pays se préparent à “prendre en charge l'enregistrement et des décisions au sujet des demandes d'asile politique, avec de possibles conséquences dramatiques”, estime à ce propos Al-Monitor.
Jusqu'alors, c'est en effet le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés qui s'occupait des demandes d'asile à la place des autorités égyptiennes. “Mais cela serait sur le point de changer”, ajoute le site, et risque d'avoir des conséquences graves pour des personnes que Le Caire jugerait encombrantes, que ce soient des militants politiques ou encore des personnes LGBT.
Aides européennes
Tout cela se passe dans un flou entretenu autour du nombre total de réfugiés et de migrants présents en Égypte. Alors qu'Ayman Zohri estime leur nombre à 5 à 6 millions, les chiffres officiels le situent à 9 millions, note The Independent.
Mais en ce début du mois de mars, le président de la commission pour les droits humains du parlement égyptien, Tarek Radwan, a parlé de “plus de 10 millions” lors d'une visite de son homologue allemande Renata Alt, apprend-on dans le quotidien égyptien Al-Masry Al-Youm.
Toujours selon The Independent, l'Égypte chercherait ainsi à monnayer la question migratoire auprès des Européens, pour “obtenir des aides en contrepartie desquelles elle empêcherait le départ de quelque 10 millions de personnes à travers la Méditerranée”.
Et de rappeler que “d'autres pays” que l'Égypte ont “reçu plus de soutien financier” de la part des Européens pour “surveiller les migrations”, dont notamment la Turquie, avec 6 milliards d'euros en 2020, ainsi que la Jordanie, qui a reçu plus de 10 milliards d'euros entre 2011 et 2023 de l'Union européenne, notamment pour soutenir les réfugiés syriens qu'elle a accueillis, toujours selon The Independent.
Philippe Mischkowsky
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Argentine - Milei : sortir du labyrinthe

Avec les défaites politiques subies par le gouvernement tant au parlement et qu'avec les gouverneurs, le moment inauguré avec l'accession de Javier Milei à la présidence de la nation a connu un tournant. Depuis lors, les temps ont pris une dynamique vertigineuse. La temporalité de la crise a ouvert le temps des urgences. Celles du gouvernement pour faire avancer au plus vite son programme et celles des travailleurs pour fixer des limites à ce programme. Quand ce n'est pas pour le faire échouer purement et simplement.
Tiré de Inprecor 718 - mars 2024
7 mars 2024
Par Eduardo Lucita
Compte tenu de la personnalité clivante du Président de la Nation, il n'est pas étonnant que de ce labyrinthe, créé par ses propres actes et paroles, il cherche à sortir par le haut (1) . C'est-à-dire non pas en freinant mais en accélérant. C'est ce qu'il vient de préciser dans son discours d'ouverture des sessions ordinaires du Congrès national, vendredi dernier.
Les pièces de l'échiquier
Tant à la Political Action Conference de Washington qu'au Forum économique mondial de Davos, le président a exposé en termes théoriques son projet politico-économique. Celui-ci a pour pierre angulaire l'équilibre fiscal, la déification du marché comme mesure de la valeur de toutes les valeurs, et la propriété privée comme droit supérieur à tous les droits, tout en revalorisant le rôle des monopoles et en réduisant l'État à son expression minimale. Ce qu'il a fait dans son récent discours au Congrès, c'est ramener ces (ses) concepts fondateurs sur terre.
C'était un discours militant – lu sur une scène soigneusement préparée – avec un fort contenu de classe et un esprit triomphaliste profondément déshumanisé avec lequel il reprend l'initiative, se replace au centre et, comme il le fait depuis la campagne électorale, fixe l'agenda politique dans le pays.
La construction politique
Comme nous l'avons souligné dans les notes précédentes, « l'expérience Milei » est suivie de près par toutes les droites du monde, car c'est la première fois qu'un anarcho-libéral accède à la présidence d'un pays. À cet intérêt s'en ajoute un autre : sa méthode de construction politique, alors qu'il dispose d'une représentation parlementaire faible, d'aucun pouvoir territorial et d'un parti faiblement structuré. La « pas de négociation » ne fait pas seulement référence au déficit fiscal zéro, à la tronçonneuse [les coupes budgétaires] ou au mixeur [la politique monétaire] ; elle s'est également installée au niveau politique. Le président se sent porteur d'un ensemble de conceptions (ses vérités) qui ne sont pas négociables, il exerce une sorte de messianisme-religieux qui le présente comme un élu qui s'en remet aux « forces du ciel ». Il n'y a donc pas de compromis possible, elles sont acceptées ou rejetées in totum (en totalité, NDLR).
Le moyen qu'il a trouvé pour consolider et élargir son « noyau dur » n'est autre que de continuer à fabriquer son ennemi (un éventail très large qui va de la caste au radicalisme, en passant par les syndicalistes, les leaders sociaux, les personnalités culturelles et tout ce qui fait face à lui). En même temps, il est de plus en plus clair que son projet implique une transformation radicale (et donc profonde) de la structure sociopolitique du pays.
C'est ce qu'indiquent les dix points qu'il a proposés aux gouverneurs sous la forme d'un Pacte Fondamental (rappelant le Consensus de Washington des années 1990) – à signer le 25 mai – conditionné à leur approbation de la loi Omnibus et du paquet fiscal. En contrepartie, il permettrait le transfert des fonds coupés aux provinces (2) . L'image d'extorsion de fonds n'est pas une simple coïncidence. Le tout présidé par un nouveau type de leadership et la préfiguration d'un système de pouvoir qualitativement différent de ce que l'on a connu jusqu'à présent.
Cela peut-il fonctionner ?
« Le déficit zéro n'est pas négociable », a répété Milei à l'envi, tout en se félicitant d'avoir atteint en janvier un excédent financier (après paiement des intérêts). Il s'est également réjoui du fait que la Banque centrale a continué à acheter des dollars, a liquéfié les dettes portant intérêt, a abaissé les taux de change financiers et a réduit l'écart de taux de change.
Ces résultats sont le fruit de l'application d'une politique de choc extrême avec trois objectifs : réduire l'émission monétaire à zéro, atteindre un nouvel équilibre des prix relatifs de l'économie (taux de change, tarifs, prix, salaires) et améliorer le bilan de la Banque centrale.
Dans ce contexte, l'idée que le programme de choc « fonctionne mieux que prévu » commence à se répandre. Ils s'attendent à une forte récession au premier trimestre, avec une baisse de la demande et des prévisions d'un taux d'inflation plus faible en février/mars (15-17%). La reprise s'amorcera au deuxième trimestre avec l'afflux de dollars provenant de la récolte. Il en résulterait une baisse annuelle estimée entre -2,6 et -4,4 % du PIB. Il s'agirait d'un élément préalable à la levée du contrôle des changes et à l'unification des taux de change d'ici le milieu de l'année. La dollarisation serait alors à portée de main.
Des célébrations hasardeuses ?
Face à cette vision exaltée, il est légitime de s'interroger : l'ajustement est-il soutenable dans la durée, puisque le mixeur ne peut fonctionner en permanence ? Face à la hausse des prix, l'économie peut-elle se passer d'une nouvelle dévaluation ou du moins d'une augmentation du pourcentage de dévaluation quotidienne ; la baisse de la demande ne va-t-elle pas également entraîner une baisse des recettes fiscales, ce qui nécessiterait un second choc d'ajustement ? Même si la Banque centrale achète des dollars, les réserves sont toujours négatives, alors comment ajouter au moins 20 milliards de dollars nécessaires à la dollarisation ? Ce n'est pas pour rien que Milei a précisé que « sa » dollarisation serait en fait un régime de « concurrence entre les monnaies », une sorte de convertibilité. Cependant, il milite en faveur de la dollarisation parce qu'elle lui apporte auprès de ses électeurs.
Des appuis sous condition
Le FMI et les États-Unis soutiennent généralement le programme mais exigent des lois pour le consolider et pourvoir aux besoins des plus défavorisés. Ils soutiennent également le bloc de la classe dominante – ils y voient l'occasion historique d'imposer un rapport de force durable en faveur du capital – mais craignent que la récession ne se transforme en dépression ou que la querelle entre dollarisateurs et dévaluateurs ne s'engage. Ils s'inquiètent également de savoir qui exercera l'hégémonie dans le commandement du bloc de pouvoir, aujourd'hui totalement aux mains du capital financier. Dans son discours au Congrès, Milei n'a pas fait une seule référence à l'industrie ou au commerce intérieur.
La gouvernabilité en question
Les deux camps se concentrent sur la manière de garantir la gouvernabilité, alors qu'ils constatent que les réactions sociales se multiplient et que de nouveaux acteurs descendent dans la rue (mouvements culturels, réapparition des assemblées de quartier, nombreuses grèves sectorielles), précédés et animés par une intense activité des partis de gauche. En moins de trois mois, on constate une forte baisse du pouvoir d'achat des revenus populaires, un fort impact sur la demande intérieure et une baisse de l'activité, une baisse de l'utilisation des capacités installées dans le secteur privé et le début des licenciements et des suppressions d'emplois. Tout ceci est synthétisé dans le bond impressionnant des niveaux de pauvreté et d'indigence (57,4% et 14,2% respectivement), qui seront dépassés en février/mars. Nombreux sont ceux qui voient des risques de désintégration sociale.
Le temps presse, tant pour le gouvernement, qui doit afficher des succès pour le milieu de l'année avant que la réaction sociale ne se généralise, que pour les travailleurs, qui doivent rapidement articuler les résistances pour avancer vers un avenir différent de la barbarie sociale qui s'approche.
Le 3 mars 2024, publié par la revue Movimento, traduit par Luc Mineto, le 6 mars 2024.
1. « Des labyrinthes on sort par le haut », est une métaphore produire par le romancier Leopoldo Marechal en référence à l'inconnu pour résoudre un conflit. Pour l'Académie Royale d'Espagne, le labyrinthe « est une chose confuse et enchevêtrée ».
2. Dans son offensive contre les dépenses publiques pour atteindre le déficit fiscal zéro, le gouvernement a également coupé les fonds aux provinces, en particulier à Chubut, l'une des provinces productrices de pétrole, ce qui a conduit son gouverneur à menacer de fermer la vanne qui permet l'écoulement du gaz et du pétrole vers le reste du pays, et d'autres provinces se sont jointes à lui. Une crise politique à l'issue imprévisible, pour l'instant close par la justice, qui a ordonné au gouvernement national de rétablir les fonds supprimés.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Argentine. « Milei a annoncé, le 1er mars, qu’il intensifiait son plan de guerre contre les travailleurs et travailleuses »

Dans son discours devant le Congrès le 1er mars [contrairement à ce qui était prévu, il l'a fait le soir, debout derrière un pupitre], le président a justifié son gigantesque plan d'ajustement et la mise en œuvre des contre-réformes structurelles. Il a ouvertement menti en disant que ce plan était financé par la « politique » [1], alors qu'en réalité il est financé par les majorités. Il a présenté un « paquet de lois anti-caste » démagogique visant les politiciens, les syndicalistes, les juges, les députés et les journalistes. A la fin, Milei a proposé un « pacte » qui implique une acceptation de l'ensemble de son plan, offrant en échange un pacte de soulagement budgétaire pour les provinces [dans le système fédéral argentin, elles dépendent en partie des revenus du pouvoir fédéral], mais, comme un monarque, il a menacé d'avancer par décret si les lois n'étaient pas adoptées par le législatif [2]. Nous devons faire face à sa démagogie et à son plan qui appauvrit le peuple. Sur la Plaza de los Dos Congresos il y a eu une journée de protestations, de manifestations – avec une grande audience – avec des « molinetazos » [utilisation massive du métro sans payer, en enjambant les portes].
2 mars 2024 | tiré du site alencontre.org | Photo : Meilei, discours présidentiel le 1er mars.
https://alencontre.org/ameriques/amelat/argentine/argentine-milei-a-annonce-le-1er-mars-quil-intensifiait-son-plan-de-guerre-contre-les-travailleurs-et-travailleuses.html
La Izquierda Diario
Quelques minutes avant 21 heures, le président Javier Milei a commencé son premier message en tant que président devant l'Assemblée législative. Auparavant, il était arrivé en grande pompe, entouré de grenadiers, depuis la Quinta de Olivos [résidence officielle du président].
A l'extérieur, sur la Plaza de los Dos Congresos, une manifestation de quelques milliers de personnes issues d'assemblées populaires, de centres étudiants, de secteurs syndicaux combatifs et de la gauche a exprimé son rejet du président et de ses politiques d'austérité brutales.
Auparavant, des « molinetazos » avaient été organisés contre les tarifs dans les stations de Once, Constitución, Retiro et d'autres stations. Ces manifestations ont eu un impact considérable. Elles s'inscrivent dans le cadre des manifestations qui se déroulent depuis le 20 décembre de l'année dernière contre les plans du gouvernement. Depuis lors, il y a eu des assemblées populaires, des actions coups de poing, une grève nationale [le 24 janvier] – sans reconduction – convoquée par la CGT et une succession de conflits de différents syndicats face à l'explosion de l'inflation. Mais la journée de protestation de ce vendredi 1er mars aurait pu être beaucoup plus importante sans le nouveau retrait des leaders syndicaux qui divisent les luttes.
La retransmission officielle à la télévision nationale a été proprement scandaleuse. Après avoir présenté le président embrassant et souriant avec la vice-présidente Victoria Villarruel [qui se déclare favorable aux militaires, à la dictature et pour « un régime d'ordre »] – démentant en apparence les rumeurs de désaccords internes diffusés dès le mois de janvier – la retransmission a montré ceux qui l'acclamaient tout au long du discours, cachant l'opposition et les manifestants qui se trouvaient à l'extérieur. Un découpage de la réalité typique de quelqu'un qui a l'intention d'établir un régime monolithique et autoritaire.
Dans une allocution lue intégralement, qui a duré un peu plus d'une heure, Javier Milei est revenu sur certains des thèmes classiques de sa rhétorique et a également fait quelques annonces. Dès le début, il a attaqué la gauche à trois reprises et a fait allusion à sa reconnaissance de la dernière dictature militaire.
Une grande partie de son message était prévisible [voir extraits ci-dessous]. Comme il le fait depuis son entrée en fonction, il a consacré de longs passages à la description de l'héritage qu'il a reçu, afin d'en faire un argument pour justifier son vaste plan d'austérité. Il a dénoncé le « populisme » et « l'Etat présent », l'émission monétaire, « l'orgie de dépenses publiques », la dette « au bord du défaut », les réserves en devises négatives, les prix réprimés [il milite pour la libéralisation complète des prix, entre autres alimentaires] et l'écart de taux de change [dollar-peso], entre autres. Tout cela pour justifier que nous nous trouvons dans le « moment le plus critique de l'histoire ».
Il a également dénoncé avec démagogie un système « en faillite morale et injuste qui ne génère que des pauvres et une caste qui vit comme des monarques », composée de politiciens qui reçoivent des pots-de-vin, de médias qui vivent des subventions [il propose leur suppression], d'hommes d'affaires jouissant de prébendes et de syndicalistes qui promeuvent un régime de travail qui ne leur profite qu'à eux.
Face à cela, selon la caractérisation de Milei, « une majorité silencieuse a élevé la voix : ceux qui travaillent, qui produisent, les travailleurs indépendants, les femmes au foyer, les travailleurs ruraux ». Cette Argentine « s'est réveillée » et l'a conduit à la Casa Rosada lors des élections, La Libertad Avanza [parti de Milei] étant « une nouvelle force, sans gouverneurs [de provinces], sans députés, sans rien, mais qui sait ce qu'elle doit faire et qui en a la conviction. La victoire ne dépend pas du nombre de soldats mais des forces du ciel. »
Il a ensuite énoncé l'un des principaux mensonges de son discours : que le plan d'ajustement est payé par la « politique », alors qu'en réalité depuis ses 82 jours au gouvernement s'est opéré un transfert de revenus de plusieurs millions de la classe ouvrière et des classes moyennes vers les grands hommes d'affaires des secteurs de l'énergie, de l'alimentation et de l'exportation, qui sont les bénéficiaires de son plan.
Selon Milei, il avait annoncé que « l'effort allait en valoir la peine, pour mettre fin à l'inflation, pour réaliser des réformes structurelles, pour mettre fin à l'apartheid politique où les politiciens et leurs amis sont des citoyens de première classe et les Argentins des citoyens de seconde classe ».
Faisant le bilan du début de son gouvernement, il a déclaré qu'il réalisait le « programme le plus ambitieux de mémoire d'homme » et a poursuivi en justifiant les axes de l'ajustement budgétaire, de la déréglementation du DNU [décret de nécessité et d'urgence qui vise à abroger 300 normes, depuis l'encadrement des loyers, la protection des travailleurs jusqu'aux limites aux privatisations], de la réduction de l'émission monétaire, de la répression de la protestation sociale [Patricia Bullrich, ministre de la Sécurité, en constitue l'avant-garde], de l'attaque contre les syndicats et les organisations sociales, de la suppression de l'Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo), de l'annonce de la fermeture de l'agence de presse publique Télam [voir à ce sujet l'article publié sur ce site le 16 février], entre autres.
Cependant, il a annoncé que « tout ceci n'est que la surface des grands changements » et qu'il « enverrait un paquet de lois anti-caste » qui éliminerait les pensions privilégiées des présidents et des députés, qu'il réformerait les syndicats avec des changements dans l'élection des directions et des limites aux réélections, qu'il donnerait la priorité aux accords d'entreprise plutôt qu'aux accords de branche, qu'il mettrait en œuvre une sorte de « casier vierge » pour empêcher la candidature de dirigeants politiques comptant des condamnations, qu'il modifierait le financement des partis politiques et pénaliserait l'émission de monnaie pour financer le déficit [il a qualifié de « crime contre l'humanité » l'approbation d'un budget déficitaire financé par une l'émission monétaire], entre autres.
Sur ces aspects, un passage clé de son discours a consisté à déclarer que « nous avancerons avec des lois, des décrets ou en modifiant des règlements », confirmant son intention de gouverner comme un monarque. Il l'a fait dès le début avec le méga DNU et en demandant ensuite des délégations de pouvoirs dans la loi dite Omnibus. Toutefois, il a finalement dû la retirer [fin janvier]. Il y a dénoncé la « défiance » des dirigeants politiques et syndicaux qui ne veulent pas de changements et a averti que « nous ne sommes pas venus ici pour jouer le jeu médiocre de la politique, du donnant-donnant, de l'échange de faveurs. Nous voulons vraiment changer le pays, nous ne négocions pas le changement. »
Vers la fin, cependant, il a fait une proposition qu'il a appelée le « Pacte de mai » en échange d'un « soulagement budgétaire pour les provinces » (voir en fin d'article la traduction de la déclaration de Milei titrée « Pacte de mai »).
Après le discours du président, quelques voix se sont élevées, prêtes à accepter la négociation de ce plan brutal d'ajustement et de réformes structurelles, tandis que la bureaucratie syndicale de la CGT (Confederación General del Trabajo de la República Argentina) et de la CTA (Central de Trabajadores de la Argentina, fondée en 1991, scission de la CGT) poursuit sa trêve malgré la détérioration accélérée des conditions de vie de la majorité populaire.
Il n'y a rien à attendre de la démagogie ultra-droitière du président, ni des gouverneurs des différents partis politiques qui s'adaptent dans leurs provinces et cherchent à négocier avec Milei. Il faut renforcer l'auto-organisation par le bas, comme le font les assemblées populaires, donner du poids à la lutte dans la rue et, à partir de là, lutter pour arracher les directions bureaucratiques à leur passivité et imposer une nouvelle grève nationale dans la perspective d'une grève générale pour mettre en échec le plan d'ajustement. Cela dans le cadre d'un programme contre le gouvernement de droite mais aussi indépendant du péronisme, qui est également responsable de nous avoir conduits dans cette situation. (Article publié sur le site La Izquierdia Diario, organe du PTS-Parti des travailleurs socialistes et du Frente de Izquierdia, le 1er mars 2024 ; traduction rédaction A l'Encontre)
***
Le Pacte de mai
« Le premier jour du mois de mars de l'an de grâce 2024, les représentants du peuple réunis au Congrès de la Nation, sous le regard de l'Eternel, nous déclarons la nécessité d'un nouveau pacte fondateur pour la République argentine.
Le Président de la Nation, Javier Milei, convoque les vingt-trois provinces et la Ville Autonome de Buenos Aires à signer le 25 mai de cette année, dans la juridiction de Cordoba, cœur productif de notre Patrie, un accord en dix points qui renouvelle les Fondations de l'Argentine.
Ces orientations seront soumises à l'approbation préalable de la « Loi des Bases et des Points de Départ pour la Liberté des Argentins » [« méga-décret » signé par la présidence le 20 décembre] présentée et d'un nouveau pacte fiscal.
– 1 L'inviolabilité de la propriété privée.
– 2 L'équilibre budgétaire non négociable.
– 3 La réduction des dépenses publiques à des niveaux historiques, soit environ 25% du produit intérieur brut.
– 4 Une réforme fiscale qui réduit la charge fiscale, simplifie la vie des Argentins et favorise le commerce.
– 5 La redéfinition de la co-participation fédérale aux impôts afin de mettre un terme définitif au modèle extorqueur actuel.
– 6 L'engagement des provinces à progresser dans l'exploitation des ressources naturelles du pays.
– 7 Une réforme moderne du travail qui favorise le travail formel.
– 8 Une réforme des retraites qui assure la durabilité du système, respecte ceux qui ont cotisé et permet à ceux qui le préfèrent de souscrire à un système de retraite privé.
– 9 Une réforme politique structurelle qui modifie le système actuel et réaligne les intérêts des représentants et des représentés.
– 10 L'ouverture au commerce international, afin que l'Argentine redevienne un acteur du marché mondial.
Que Dieu bénisse tous les Argentins et nous accorde la sagesse et la force de surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés en tant que société et de construire un avenir prospère pour notre nation. Que les forces du ciel soient avec nous.
Javier Gerardo Milei
Président de la nation »
[1] Milei ne dispose pas de majorité parlementaire et doit faire face à des manifestations – y compris de mobilisations devant le Congrès lors du discours où les cris résonnaient de formules telles que « la patrie ne se vend pas », « Milei, ordure, tu es la dictature » – et tente de jouer la carte apparente de « l'anti-caste » en affirmant : « Nous ne vivons pas de la politique. Nous ne vivons pas pour la politique. Loin de là. Nous n'avons qu'une soif de changement. » (Réd.)
[2] Comme le souligne la politique Lara Goyburu, sur le site du Monde du le 2 mars 2024 : « Alors que les propositions du pacte devront nécessairement passer par le Congrès, Javier Milei ne s'adresse pas aux législateurs, mais à leurs “chefs”, les gouverneurs. » (Réd.)
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Ukraine : Au-delà de la paix – Entretien avec l’Atelier féministe

En collaboration avec Bread&Roses à Bari, nous avons interviewé Alla et Yarina, deux militantes ukrainiennes de l'Atelier féministe. L'entretien a eu lieu le 16 février 2024 et, nous avons de parler de guerre et de régimes répressifs.
Tiré de Entre les lignes et les mots
Municipi Sociali Bologna : Pourriez-vous revenir sur les raisons pour lesquelles vous avez écrit un manifeste pour le droit à la résistance en réponse aux féministes occidentales il y a deux ans ? Pourquoi la résistance a-t-elle été importante dès le premier jour et que signifie résister après deux ans de guerre ?
Yarina, Atelier féministe : Nous avons rédigé ce manifeste dans l'intention d'inciter les féministes occidentales à réexaminer leurs privilèges, à comprendre leur manque d'expérience et de connaissances en matière de libération coloniale, de conflits militaires et d'angles morts historiques, en particulier en Europe de l'Est. Lorsque les féministes occidentales rédigent leurs propres manifestes, il semble qu'elles récusent souvent notre droit, en tant que personnes opprimées, de parler en notre nom, d'évoquer nos expériences et de nier notre droit à l'autodéfense et à l'autodétermination. Pour nous, la résistance est une question de capacité d'action, d'expression et d'autodétermination. De nombreuses personnes, en particulier au sein de la gauche occidentale, discutent fréquemment du militarisme en Ukraine. Cependant, je tiens à souligner que lorsque des vies ukrainiennes sont réellement en danger, les déclarations antimilitaristes peuvent refléter un certain privilège de ne pas voir la guerre avoir un impact direct sur leur pays. Nous rencontrons souvent ces déclarations de la part de celles et ceux qui n'ont pas l'expérience de l'oppression impériale.
En ce qui concerne l'évolution de notre résistance au cours des deux dernières années face aux attaques russes, la situation reste désastreuse. Nous nous efforçons actuellement de nous aligner sur les politiques de l'UE car nous percevons que des alternatives limitées. La dynamique a changé depuis le début du conflit, lorsque la droite et la gauche étaient plus unies. Aujourd'hui, nous sommes divisés par des opinions et des politiques différentes. Notre approche est multitâche : d'une part, nous soutenons l'autodéfense ukrainienne et, d'autre part, nous critiquons notre gouvernement pour contrer certaines de ses politiques illibérales. Les défis se sont intensifiés à mesure que nous menions de front notre vie quotidienne et la nécessité de survivre aux attaques russes. L'équilibre entre le travail et la stabilité personnelle est devenu plus difficile, aggravé par l'épuisement collectif et la déception à l'égard de notre gouvernement. Malgré ces difficultés, nous continuons à nous battre, en gérant simultanément les différents aspects de notre lutte.
Atelier féministe d'Alla : J'ai le sentiment que les Ukrainien·nes, dont je fais partie, sont confronté·es à des changements significatifs depuis le début du conflit jusqu'à aujourd'hui. Le changement le plus notable est une perte profonde subie par la plupart d'entre nous en raison de la guerre en cours. Un récent message viral en Ukraine a révélé que 78% des Ukrainien·nes ont perdu un proche, qu'il s'agisse d'un ami, d'un membre de la famille ou d'un partenaire. Yarina exprime bien ce sentiment, en décrivant le défi que représente la gestion simultanée des exigences de la vie quotidienne, de la recherche d'un emploi et de la lutte intérieure au sein de notre pays, où le combat n'est pas en pause, mais permanent. Nous nous protégeons des missiles tout en essayant d'affirmer notre droit à la vie. Le manifeste féministe occidental, dans sa version initiale, m'a semblé problématique. Il dépeignait l'Ukraine comme presque inexistante, réduite à un simple territoire et à un peuple à défendre. Ce qui ressortait, c'était le manque d'intérêt pour la compréhension des pensées et des besoins des Ukrainien·nes qui souffrent et résistent. Le manifeste semblait parler depuis une position condescendante et privilégiée, dictant ce qui devrait être fait pour nous, sans chercher à obtenir notre contribution ou à reconnaître notre rôle. Il est surprenant de voir la gauche occidentale, censée défendre les droits des opprimés, adopter une telle position. La réponse des féministes ukrainiennes, qui mènent depuis longtemps diverses luttes dans le pays, est naturelle : elles affirment leur existence et partagent la réalité de leurs expériences. La frustration réside dans le fait d'être réduites au silence et à l'état d'objet. Il est décourageant de voir la gauche occidentale, alliée supposée dans la lutte contre l'autoritarisme et l'oppression, ignorer les voix et l'action des Ukrainien·nes. Compte tenu de la situation actuelle, outre les défis tangibles auxquels l'Ukraine est confrontée, la perception de la situation du pays par les citoyens suscite une frustration croissante. Certain·es expriment leur lassitude face au conflit en cours et souhaitent des solutions rapides. Il est surprenant de constater que ceux et celles qui ne sont pas directement touché·es ou engagé·es dans la lutte expriment leur lassitude. Ces sentiments soulèvent des questions sur le niveau de compréhension et d'empathie de qui observe la situation à distance.
Yarina, Atelier féministe : Il est essentiel de souligner que la résistance à une attaque armée par un pays impérial implique inévitablement une résistance armée. Cette vérité fondamentale est un point clé abordé dans le premier manifeste féministe en réponse au manifeste des féministes occidentales. L'appel à la paix et le rejet de la fourniture d'armes à l'Ukraine, tels que mentionnés dans certains récits occidentaux, ne sont pas des options viables pour nous. L'acquisition d'armes n'est pas une question de choix, c'est une nécessité. Se plier à certaines exigences signifierait faire partie de la Russie, un compromis impensable. Même si nous nous engagions dans des négociations avec la Russie, en acceptant de renoncer aux territoires occupés et aux populations qui y souffrent, cela ne mettrait pas fin au conflit. Sa raison profonde réside dans la nécessité pour la Russie de se démilitariser et de se décoloniser. Toute résolution doit s'attaquer à ce problème plus profond, faute de quoi nous risquons d'être confronté·es à une nouvelle invasion de grande ampleur à l'avenir. Les ambitions impériales de la Russie sont profondément enracinées, et le simple fait de mettre un terme à l'invasion actuelle par le biais de négociations ne résout pas le problème de fond. Il s'agit d'une situation complexe qui nécessite une stratégie globale et à long terme pour garantir une paix et une stabilité durables dans la région.
Bread&Roses Bari : Deux ans après l'invasion, comment concevez-vous la « paix » tout en reconnaissant les droits à la résistance et à l'autodéfense, ainsi que l'idée occidentale de la solidarité ? De plus, en agissant dans le paysage complexe de l'après-invasion, comment proposez-vous de réconcilier l'opposition à l'invasion avec l'impératif de forger des alternatives au cadre néolibéral promu par le gouvernement ukrainien ?
Alla, Atelier féministe : Je voudrais commencer par le concept de paix, qui, selon moi, n'est pas simplement l'absence de guerre ou une action militaire impliquant des armes et des armées sur un territoire. En simplifiant l'idée, la paix signifie qu'il n'y a pas d'armée, pas d'actions militaires, mais le problème central des actions militaires réside dans le meurtre de civils et de soldats, qui sont essentiellement des civils. Cela conduit à la souffrance et à l'oppression des populations qui favorisent l'inégalité. L'idée est que sans armes et sans armées, la paix peut régner. Toutefois, si l'on examine la situation en Ukraine, une question se pose : si la guerre s'arrêtait et que les Ukrainien·nes cessaient de résister, qu'adviendrait-il de l'Ukraine et de ses jeunes ? Les exemples de 2014 à aujourd'hui dans les territoires occupés, aujourd'hui appelés républiques méridionales de l'est de l'Ukraine, en révèlent les conséquences. Avant l'invasion massive, la vie dans ces régions semblait relativement paisible. Cependant, des rapports faisaient état d'une augmentation significative des inégalités. Les gens perdaient leur emploi, l'accès aux droits fondamentaux tels que les soins médicaux, et même pendant la pandémie de COVID, ces territoires ont été isolés, empêchant l'accès aux vaccins et à l'aide médicale. En l'absence d'actions militaires, les gens pouvaient mourir de la pauvreté et de la montée en puissance de divers groupes militaires ou milices non légales au sein de ces républiques. Etait-ce la paix ? Peut-être, mais ce n'est pas le genre de paix qui respecte les droits humains fondamentaux et apporte une vie normale à ceux qui vivent dans ces républiques.
Les actions de l'armée russe dans les territoires occupés après l'invasion en donnent une image sinistre, avec des rapports faisant état de viols utilisés comme armes, de chambres de torture créées et de la persécution violente des personnes. Ceux et celles qui parviennent à s'échapper ou à entrer en contact avec le monde extérieur racontent qu'ils et elles n'avaient qu'un accès limité à la nourriture et à l'aide médicale, avaient constamment peur et ne pouvaient pas s'exprimer librement. Au-delà des besoins humains fondamentaux, les populations sous occupation se voient refuser le droit d'être Ukrainien·nes ou sont persécutées pour leur appartenance à la communauté LGBTQ+. Le concept de paix, tel qu'il est perçu en Occident, a été déconstruit selon moi. Il ne s'agit plus seulement ici de l'absence de guerre ou d'armée, mais peut-être des idées destructrices qui causent de la douleur et de la souffrance. Je me demande ce que signifie la paix aujourd'hui et s'il n'est pas temps de redéfinir le concept, en considérant non seulement l'absence de guerre mais aussi mettre en cause la présence d'idées qui détruisent l'humanité sur un territoire. En réfléchissant à l'Europe, où la paix existe malgré certaines limites, on peut encore y trouver la démocratie et une sécurité relative.
Toutefois, dans un scénario où l'Ukraine vivrait en paix avec la Russie, le sens de la paix serait fondamentalement différent Si vous nouez des relations avec des enfants dans les territoires occupés, vous verrez que leurs récits brossent un tableau sombre. Ils décrivent une existence qui ne peut être qualifiée d'enfance ou de quiétude. Il est troublant d'entendre des enfants exprimer leur désir de voir l'armée ukrainienne les libérer, car pour eux, cela représente l'espoir d'une vie normale. Cela contredit les notions antérieures de la paix, nous incitant à reconsidérer ce qu'elle signifie vraiment et comment elle protège et préserve le bien-être humain.
Yarina, Atelier féministe : Je suis tout à fait d'accord avec ce concept de paix et les complexités auxquelles l'Ukraine est confrontée, en particulier lorsqu'il s'agit de discussions sur le gouvernement et les politiques libérales. Il est en effet surréaliste de s'engager dans des conversations théoriques sur les structures gouvernementales alors que la réalité immédiate implique l'incertitude du lendemain et de la guerre en cours. Les préoccupations soulevées par la gauche occidentale au sujet de certaines politiques semblent éloignées des luttes quotidiennes et du besoin urgent de soutien alors que nous sommes au milieu de crimes de guerre et sous des attaques de missiles. Malgré les difficultés, il est important de souligner que les Ukrainien·nes, en tant que militant·es et individus ayant des convictions profondes, n'ont pas abandonné leurs idées et leur travail. Les difficultés accrues rencontrées dans la gestion de ces questions ne diminuent en rien leur attachement aux principes qu'elles et ils défendent. Il est essentiel de reconnaître que le soutien étranger à l'Ukraine n'équivaut pas à un soutien au gouvernement ukrainien. La racine du conflit, comme le souligne la rhétorique de Poutine, est centrée sur la négation du droit de l'Ukraine à exister en tant que nation indépendante. En ce qui concerne le gouvernement ukrainien, il est admis que tous les Ukrainien·nes n'en sont pas satisfaits. Certaines lois, comme dans le domaine du droit du travail, suscitent des inquiétudes et des efforts sont déployés pour résister et s'opposer sur ces questions. La société civile ukrainienne est solide et, malgré d'éventuelles divergences avec le gouvernement, le soutien des pays étrangers est considéré comme nécessaire compte tenu des circonstances. Le scénario de l'après-guerre suscite des inquiétudes quant à la dette ukrainienne et aux conséquences potentielles qui y sont liées, y compris en raison des politiques libérales. Malgré les défis, il y a un effort collectif pour faire ce qui peut être fait, en particulier par ceux qui n'ont pas rejoint l'armée. L'engagement permanent à travailler avec la société civile et à aborder les questions sociales, même au-delà du conflit immédiat, reflète une détermination à façonner un meilleur avenir pour l'Ukraine. En substance, la complexité de la situation exige de faire des choix difficiles, et même si cela peut devenir encore plus difficile après la guerre, la détermination à agir dans ces complexités et à plaider pour un avenir meilleur reste forte parmi les Ukrainien·nes.
B&R Bari : Pourriez-vous nous parler de l'influence des pratiques transféministes dans ce contexte et de leurs effets potentiels sur la formation de l'opinion publique ?
Alla, Atelier féministe : Il semble que les pratiques féministes et le mouvement féministe gagnent du terrain en Ukraine, et qu'ils deviennent potentiellement plus influents. L'invasion a suscité un intérêt accru pour les contextes locaux et les divers mouvements sociaux, les gens se montrant de plus en plus curieux de ce qui se passe dans le pays. Auparavant, les femmes ukrainiennes avaient tendance à se tourner vers l'Occident ou le féminisme russe, et les féministes russes étaient des figures d'inspiration pour de nombreuses Ukrainiennes. L'invasion semble avoir ramené l'attention sur le contexte national, les féministes ukrainiennes devenant des figures d'influence, attirant même l'attention des médias et des personnes influentes. Ce nouvel intérêt dépasse les affiliations politiques et touche aussi bien les libéraux que les conservateurs. Même au sein des féministes, on observe un regain d'intérêt pour le féminisme en général, car de plus en plus de femmes reconnaissent la pertinence des discussions féministes pour faire face à leurs responsabilités croissantes, à leur vulnérabilité et à leurs exigences dans les circonstances actuelles. Les exigences accrues qui pèsent sur les femmes, notamment leur rôle dans la gestion des ménages, la garde des enfants et le travail bénévole, ont conduit à une sensibilisation accrue aux droits et aux besoins des femmes. Le féminisme intersectionnel pratiqué en Ukraine reconnaît que les différentes expériences sont importantes et doivent être prises en compte dans le cadre d'une discussion plus large. Cette approche aide les femmes à s'orienter dans leurs nouveaux rôles et à communiquer leurs expériences de manière plus efficace. Dans le domaine de la communication internationale, la théorie féministe s'est avérée essentielle pour expliquer les différentes difficultés auxquelles sont confrontées les Ukrainiennes. Elle fournit un cadre permettant d'articuler des expériences qui auraient pu être négligées ou passées sous silence. En établissant des parallèles avec des luttes historiques, telles que les dynamiques genrées au sein du mouvement féministe, les Ukrainiennes peuvent mettre en lumière leur oppression unique et attirer l'attention sur leurs voix qui ont été historiquement marginalisées. Dans l'ensemble, il semble que les féministes ukrainiennes tirent parti de la théorie féministe non seulement pour agir à partir de leurs propres expériences, mais aussi pour communiquer efficacement ces expériences à la communauté internationale au sens large. Ce cadre théorique devient un outil puissant pour aborder l'oppression coloniale profondément ancrée qui persiste depuis des siècles et pour trouver une résonance auprès d'autres personnes qui ne connaissent peut-être pas les subtilités de leur lutte.
Yarina, Atelier féministe : L'accent que vous mettez sur la nécessité de rendre le mouvement féministe plus inclusif et de donner la parole aux personnes les plus opprimées, telles que les femmes pauvres, est crucial. Reconnaître que l'objectif n'est pas seulement de faire progresser les droits et le pouvoir d'un groupe spécifique, mais de répondre aux divers besoins et défis auxquels sont confrontées toutes les femmes, est un aspect essentiel de la construction d'un mouvement véritablement équitable et inclusif. Reconnaître les conséquences potentielles de la période d'après-guerre et trouver un équilibre délicat entre la défense des droits humains et la prise en compte des craintes de réactions négatives est une approche judicieuse. Il est essentiel de rester vigilantes et réalistes face aux défis à venir, sans pour autant porter des « lunettes roses ». Avoir conscience des menaces potentielles qui pèsent sur les mouvements féministes en période de militarisation accrue et de potentielles conceptions contre les droits fait preuve d'un état d'esprit pragmatique et stratégique. Bien que l'on puisse observer des changements positifs dans l'opinion publique, notamment en ce qui concerne le soutien aux droits des LGBTQI, il est essentiel de ne pas supposer que ces tendances se maintiendront indéfiniment. Si l'on constate une augmentation sensible du soutien aux personnes LGBTQI, comme l'acceptation des mariages entre personnes de même sexe et des droits d'adoption, il ne faut pas croire que cette tendance est irréversible. Nous avons constaté des changements dans les attitudes de la société et notre vigilance est essentielle.
Nous devons nous préparer à d'éventuels revers, comme les tentatives de restriction des droits reproductifs, qui deviennent évidentes à l'échelle mondiale, en particulier en période de conflit. Votre connaissance des tendances mondiales et européennes, en particulier en temps de guerre, permet de mieux comprendre la nature dynamique des mouvements de défense des droits humains. Nous donnons la priorité à l'amplification des voix des personnes les plus opprimées, et faisons face aux défis potentiels découlant des contextes d'après-guerre. Nous restons vigilantes en ce qui concerne les droits des LGBTQI. Notre objectif est de favoriser un changement durable tout en reconnaissant les incertitudes qui persistent dans la recherche de l'égalité.
Municipi Sociali Bologna : En ce qui concerne la Russie, les contacts avec les activistes russes se sont-ils multipliés ou sont-ils restés au point mort ? Considérez-vous que les élections en Russie sont liées à l'offensive et aux attaques qui ont lieu en ce moment même ?
Yarina, Atelier féministe : J'ai eu des contacts avec différentes féministes russes, ainsi qu'avec certaines d'entre elles qui ont quitté la Russie. Elles font un excellent travail en soutenant l'Ukraine ou en parlant par exemple d'envoyer des armes à l'Ukraine. Mais en même temps, de nombreuses féministes russes engagées dans la résistance contre la guerre reproduisent souvent les préjugés impériaux. Dans ce cas également, il y a un problème concernant les observateurs occidentaux : tout le monde s'enthousiasme pour l'opposition russe, mais les mêmes se taisent sur la résistance ukrainienne. Je pense que c'est parce qu'il est commode de soutenir la résistance russe, parce que les Russes se dressent contre leur gouvernement et qu'elles et ils n'ont pas d'armes. Littéralement, tout ce qui concerne cette opposition convient à la gauche occidentale. En revanche, la résistance ukrainienne et les Ukrainien·nes sont souvent présenté·es comme des victimes, des nationalistes ou un pays militariste, ce qui n'est pas très commode pour la gauche occidentale. Pour moi, c'est terrible, car il y a de grandes différences entre l'opposition russe et la résistance ukrainienne. Ce ne sont pas les Russes qui sont attaqués par un gouvernement impérial et ce n'est pas la Russie qui se bat pour l'autodétermination. Ainsi, même si je pense que l'opposition russe fait un excellent travail, je suis préoccupée par la façon dont elle est discutée dans les dialogues internationaux et les plates-formes internationales.
En ce qui concerne les élections russes, il est temps de comprendre qu'on ne peut pas détruire le régime par des élections, parce qu'il n'y a pas d'élections en Russie. Beaucoup de gens qui font partie de l'opposition russe s'opposent en fait à Poutine et certain·es s'opposent peut-être même au régime, mais ne s'opposent pas toujours à son impérialisme. Par conséquent, je ne pense pas qu'il soit possible de gagner quoique ce soit avec cette élection, mais même si un·e membre de l'opposition gagne cette élection, je n'ai aucun espoir que nous récupérions notre territoire, ou du moins pas tous les territoires occupés. Encore une fois, je ne sais pas ce que les Russes devraient faire ou ce que la résistance anti-guerre russe devrait faire dans ce cas. Je n'ai pas de réponse à cette question et, pour l'instant, je n'ai pas d'espoir concernant les élections.
Alla, Atelier féministe : Je suis d'accord avec Yarina pour dire que les élections russes, pendant de nombreuses années, n'ont été qu'un grand spectacle pour le monde et pour les Russes eux-mêmes. Pour moi, il est surprenant de voir qu'il y a encore des gens en Russie qui croient aux élections ou qui essaient d'y croire, ou qui sont si naïfs qu'ils ou elles disent, en citant l'un des opposants qui a essayé de participer, « ces élections ne marcheront pas et Poutine gagnera, mais peut-être que nous pourrions montrer que nous sommes contre ». Il s'est passé trop de choses au cours de ces dix années, et en particulier au cours de ces deux années d'invasion à grande échelle, pour croire que la personne qui a donné l'ordre d'envahir l'Ukraine, de détruire des villes et de commettre tous ces crimes que nous avons vus, dirait maintenant « Je vous entends, alors je quitte mon poste » ; c'est très naïf, mais c'est peut-être aussi utile pour eux d'être aussi naïfs, parce que si vous êtes aussi naïfs, vous n'avez pas besoin d'agir comme si quelque chose devait être changé en Russie. Pour les habitant·es de villes privilégiées comme Moscou et Saint-Pétersbourg, où les sources [d'information] sont nombreuses, par exemple, l'idée qu'il faille changer quelque chose de l'intérieur est probablement effrayant et désagréable, et il est donc plus facile pour eux de jouer à ce jeu. Par ailleurs, j'ai vérifié qui était dans l'opposition lors de ces élections et aucun d'entre eux ne s'oppose réellement aux idées de la Russie impériale. Aucun dirigeants de l'opposition ne mènent pas une opposition idéologique. Ce sont les mêmes qui avaient des désirs impériaux et une mentalité impériale, même si ils et elles sont contre Poutine. Ils et elles ne veulent pas la guerre, mais c'est parce que la guerre rend la Russie pauvre et que les gens en Russie meurent : c'est pourquoi ils et elles considèrent la guerre comme mauvaise, non parce que l'Ukraine est envahie, non parce que l'Ukraine est occupée et non parce que la Russie est un immense empire qui apporte la destruction non seulement à l'Ukraine, mais à tous les autres pays qui font partie de l'empire russe. Shulman, Duntsova ou Nadezhdin, par exemple, sont des personnes qui ont accepté l'annexion, qui ont accepté l'occupation des régions du Donbass en 2014. Cette « opposition » n'apporte aucune aide à l'Ukraine et, de toute façon, le seul moyen pour elle d'avoir du pouvoir est la victoire militaire de l'Ukraine et la défaite de l'armée russe.
En ce qui concerne les militantes féministes, les relations n'ont jamais été absentes. Il y a des militantes ukrainiennes qui sont toujours en contact avec des collègues russes et pour qui il est normal de continuer à développer ces contacts. Il y a deux aspects à cela, l'un plus politique et l'autre plus personnel. Sur le plan politique, nous pouvons avoir une vision féministe à ce sujet : il semble qu'au lieu de donner la parole aux femmes qui souffrent, la voix est donnée aux hommes qui racontent comment le patriarcat n'est pas non plus un paradis pour eux. On ne donne pas le micro et l'attention à celles qui souffrent et qui sont l'objet direct de l'oppression. La voix est plutôt donnée aux oppresseurs qui expliquent ce qui ne va pas et ce que les autres devraient modifier leur point de vue. Il serait bon que les féministes russes accordent de l'espace aux féministes ukrainiennes, qu'elles promeuvent la lutte ukrainienne. Aujourd'hui, il semble que les féministes russes promeuvent les problèmes russes et se tournent vers la guerre ukrainienne simplement parce qu'elle fait également partie de leur libération. Pour avoir une Russie libre, le régime russe doit être détruit et c'est l'armée ukrainienne qui s'en charge. Pour l'instant, du moins de mon côté, je ne vois pas beaucoup de remises en question de leurs propres récits impériaux au sein de leurs propres mouvements. Les minorités ethniques de Russie sont également très critiques à l'égard de cette importante tendance, parce qu'elle est très centralisée sur les activistes de Moscou, mais la Russie n'est pas seulement faite de grandes villes, il y a beaucoup d'activistes féministes parmi les minorités ethniques en Russie qui n'ont pas droit à la parole et dont les voix sont couvertes par des Russes plus influents et plus puissants.
Je pense également que le mouvement féministe russe veut répondre aux attentes de la gauche occidentale, en se présentant comme plus faciles à suivre. Il y a beaucoup de belles histoires qu'ils essaient de présenter, par exemple « les femmes russes contre la mobilisation » qui sont beaucoup publiées maintenant ; en tant qu'Ukrainienne, sa signification me pose une grande question. Le narratif est que les femmes russes qui participent à ces manifestations s'opposent à ce que leurs hommes soient en première ligne parce que ce sont leurs maris, leurs frères et leurs fils. Cependant, si vous regardez les bannières russes, elles disent « nous avons besoin de démobilisation », ce qui signifie que leurs hommes devraient revenir, tandis que d'autres doivent aller en Ukraine, et non pas que « les troupes russes quittent l'Ukraine ». D'un point de vue personnel, il arrive souvent que nous nous sentions traitées avec condescendance lorsque nous parlons avec des activistes. Certain·es activistes Ukrainien·nes font un travail remarquable en apportant une aide mutuelle aux deux parties, mais dans ces cas précis, il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la communication.
Municipi Sociali Bologna : Avez-vous peur de la nouvelle offensive de la Russie ? Pensez-vous que ce qui se passe ouvre une nouvelle phase de cette guerre ?
Yarina, Atelier féministe La peur de l'avancée russe est quelque chose qui a toujours existé et qui existe toujours, parce que nous ne savons pas comment l'avancée progresse et nous ne pouvons pas prédire comment elle progressera, donc il y a toujours cette peur, même si nous nous y habituons. Nous connaissons toujours ces moments où nous commençons à avoir très peur et où la peur grandit. C'est ce qui se passe, et c'est arrivé à de nombreuses reprises au cours de ces deux années, c'est comme une escalade de la peur dans la société, puis l'escalade retombe. C'est quelque chose que nous avons toujours à l'esprit.
Alla, Atelier féministe : Il y a une grande peur parce qu'ils avancent. Ce que nous entendons ces jours-ci, c'est qu'il y a une grande bataille à Avdiivka, que la ville est en train de devenir une deuxième Bakhmut, que sur cette ligne de front, de nombreux soldat·es Ukrainien·nes meurent et qu'en ce moment même, la ville est prise d'assaut. La crainte est de savoir jusqu'où ils iront.
Il existe également une autre forme de crainte, celle d'un gel de la guerre. Dans ce cas, cela ne signifie pas que la Russie n'attaquerait plus. Elle n'attaquerait probablement pas pendant un ou deux ans, parce qu'elle a besoin de ressources pour faire la guerre, mais nous devrions nous préparer à une autre série d'attaques. De plus en plus de mes ami·es qui ne sont pas encore en uniforme voient la nécessité de s'engager dans l'armée. Les Russes recrutent énormément de gens, tant dans le pays qu'à l'étranger, en Syrie par exemple et dans d'autres pays. Ils n'accordent pas vraiment d'importance à la vie de leurs soldats, c'est pourquoi le nombre de personnes qu'ils jettent sur le terrain est énorme et même si l'Ukraine mobilise un grand nombre de soldats, le combat ne sera pas égal.
Il reste l'espoir d'une aide militaire. Les pays européens ont annoncé qu'ils enverraient beaucoup d'aide l'année dernière, mais sur ce qu'ils ont annoncé, seule une petite partie est arrivée. L'Espagne, si je ne me trompe pas, a déclaré qu'elle enverrait un certain nombre de chars, mais de ces chars, un seul est arrivé parce que tous les autres ne fonctionnaient pas. Je suppose que les Européens ont l'impression d'avoir envoyé beaucoup d'aide et de ne voir aucun résultat, mais en réalité, la majeure partie de cette aide n'est pas arrivée et même lorsqu'elle est arrivée, elle n'était pas suffisante. C'est le principal problème : nous avons besoin de beaucoup de soutien militaire pour résister à ce qui se passe en ce moment et pour penser qu'il est possible d'en finir. C'est un point de vue un peu pessimiste et je suppose que beaucoup d'Ukrainien·nes partagent aujourd'hui, avec la peur et la frustration de ce qui se passe.
Municipi Sociali Bologna : Dans de nombreux pays occidentaux, le cessez-le-feu est le message qui se répand concernant la guerre en Palestine. Pensez-vous que le message de cessez-le-feu aurait un sens pour l'Ukraine ?
Yarina, Atelier féministe : En ce qui concerne la Palestine et le cessez-le-feu, je pense qu'il s'agit d'une situation différente et que nous ne pouvons donc pas comparer les deux. Bien sûr, nous voulons soutenir la Palestine, nous voulons soutenir le peuple palestinien. Mais lorsque nous parlons de la Palestine, nous devons tenir compte du fait que le Hamas détient le pouvoir et que des organisations terroristes radicales ont tué des civils et qu'Israël tue des civils. Dans cette situation, le cessez-le-feu semble préférable. En Ukraine, cependant, nous avons beaucoup de territoires occupés pour l'instant. Je crains que si nous nous arrêtons à ce stade, nous resterons dans cette situation figée pendant encore dix ans. Je ne pense pas que ce soit ce que veulent les Ukrainien·nes.
Alla, Atelier féministe : Je pense que la réponse est déjà dans la question. En Palestine, c'est le peuple palestinien qui demande le cessez-le-feu. En Ukraine, les gens demandent une aide militaire. Un cessez-le-feu en Ukraine signifierait la poursuite de la souffrance des gens sans aucune résistance possible à l'oppresseur et une menace existentielle. Je pense que les gens devraient écouter les appels de ceux qui souffrent et les soutenir dans leurs besoins. De même, dans le cas de l'Ukraine, l'appel et la pression pour « mettre fin à la guerre » devraient être appliqués à la Russie, l'oppresseur et l'agresseur. Au lieu de cela, l'appel à l'arrêt de la guerre dans le monde est généralement adressé aux Ukrainien·nes, qui se défendent eux-mêmes et luttent pour leur libération.
Yarina, Atelier féministe Le fait que Zelensky ait soutenu Israël a également influencé l'opinion des Européens sur les Ukrainien·nes. Mais par exemple, nous essayons de parler de la Palestine en Ukraine. Nous essayons de donner la parole à d'autres personnes opprimées, car lorsque nous parlons d'occupation ou de pays impériaux, il ne s'agit pas seulement de nous.
22 février 2024
Publié par Municipio Zero
https://municipiozero.it/en/beyond-peace-interview-with-feminist-workshop/
Traduction Patrick Le Tréhondat
Site internet de l'Atelier féministe
https://femwork.org/en/
Page Facebook
https://www.facebook.com/feministworkshop
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Attal déclare la guerre sociale : Toutes attaquéEs, toutEs mobiliséEs

À peine nommé, le Premier ministre Attal essuie déjà la tempête. Son gouvernement, encore incomplet à l'heure où nous écrivons ces lignes, insupporte déjà. Les sondages ont beau dire qu'il recueille le meilleur score d'opinions positives (39 %) parmi tous les Premiers ministres de Macron, les opinions négatives restent supérieures (40 %) !
1er mars 2024 | tiré de l'Hebdo L'Anticapitaliste - 693
https://lanticapitaliste.org/actualite/politique/attal-declare-la-guerre-sociale-toutes-attaquees-toutes-mobilisees
Il faut dire qu'après les « affaires » des ministres, le feuilleton Oudéa-Castéra, voilà la rue, ou plutôt les champs, qui lui rappelle que le niveau de vie de la population ne connaît pas les mêmes envolées que les dividendes.
Car, les inégalités continuent de croître. Le coût de la vie des étudiantEs a ainsi augmenté de 25,5 % depuis 2017. La semaine dernière, une étude pointait une augmentation de 11,9 % des prix de l'alimentation en 2023 par rapport à 2022, avec des pics pour certains aliments (+ 21 % pour l'huile d'olive, + 20,4 % pour le riz, + 18,9 % pour les produits laitiers). Et le prix de l'électricité, déjà insoutenable pour de nombreuses familles, augmente dès le 1er février. Les revenus, les salaires n'augmentent pas dans les mêmes proportions, loin de là !
Le déverrouillage
De cela, pas un mot dans le discours de politique générale de Gabriel Attal du 30 janvier. Plutôt un satisfecit de la politique macroniste depuis 2017 aux accents cocardiers. Et, surtout, un plan de bataille pour une libéralisation accrue (si c'était possible !) dans tous les secteurs : le « déverrouillage » de la France. Terminé le « en même temps » à droite et à gauche, dont on a vu l'équilibre (introuvable) chanceler au cours des années, la macronie fait désormais du « en même temps » à droite et à l'extrême droite, tout en s'en défendant, tout en s'opposant aux partisans du Frexit (soit le RN !).
Ne nous y trompons pas, si le Premier ministre a annoncé des mesures de libéralisation économique sur tous les fronts, il a aussi donné des gages à tous les réactionnaires et partisans de l'ordre, notamment à propos de la jeunesse. Dans la droite ligne du « Travailler plus pour gagner plus » de Sarkozy, il a annoncé la remise en cause du Smic au motif que trop de salaires en sont proches ! Mais aussi la généralisation du conditionnement du RSA à 15 heures d'activité d'ici le 1er janvier 2025, la suppression de l'allocation spécifique de solidarité (ASS) pour les chômeurEs en fin de droits et la révision des règles de l'assurance chômage. Mediapart l'annonçait le même jour : « L'exécutif étudie des pistes de réduction des droits au chômage, parmi lesquelles une baisse supplémentaire de 20 % de la durée d'indemnisation et un durcissement des règles concernant les seniors ».
Attal veut également réformer l'AME, aide médicale d'État, « par voie réglementaire » et la loi SRU imposant aux communes un taux de logements sociaux, dans lequel il compte inclure « le logement intermédiaire, accessible à la classe moyenne », faisant de fait baisser le nombre de logements sociaux. Sur l'éducation et la jeunesse, il a réaffirmé les annonces sur le collège, le SNU, l'uniforme… et déployé des mesurettes en matière de santé. Quant à l'agriculture et l'écologie, on continue droit dans le mur… avec la fierté d'être « dans un gouvernement pronucléaire avec une majorité pronucléaire » !
Construire la convergence des colères
Rien de nouveau, donc, dans ce discours de droite ? Si ! Car la bourgeoisie vit désormais avec des hantises : celle des Gilets jaunes, celle des révoltes de juillet 2023. Elle est bien décidée à poursuivre sa politique en faveur des riches et à faire la chasse aux pauvres, aux classes travailleuses/classes dangereuses en fondant sa légitimité sur la classe moyenne : « Je veux m'adresser à tous ces Français de la classe moyenne, qui ne se plaignent pas alors qu'ils ont souvent le sentiment de subir », a déclaré le Premier ministre. C'est désormais cette classe moyenne que le banquier-président Macron cherche à séduire par la voix d'Attal, en lui montrant le sort qu'il réserve aux pauvres et en la détournant des profondes inégalités qu'il cultive. La macronie a appris de ses voisins, notamment de Meloni en Italie !
Il y a urgence pour les travailleurEs à construire la convergence des colères, à renouer avec le combat d'ensemble en faveur de la répartition des richesses et du respect des droits fondamentaux de se loger, se nourrir, recevoir des soins et une éducation. Nos intérêts sont aussi ceux de la société tout entière pour gagner contre les inégalités sociales criantes, le productivisme, l'agriculture intensive, l'exploitation du vivant et les oppressions !
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Italie : un printemps social pour reconstruire les rapports de force

On ne peut que se réjouir que le gouvernement de droite se soit [électoralement] fracassé sur les rochers de Sardaigne, mais le néolibéralisme a aussi pris la démocratie dans son étau et seul un mouvement de masse pourra à nouveau libérer l'énergie émancipatrice des classes populaires.
28 février 2024 | tiré d'Europe solidaires sant frontières, par TURIGLIATTO Franco Turigliatto
Europe solidaire sans frontières
https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article69999
On ne peut que se réjouir que Meloni l'arrogante et le piètre navire du gouvernement de droite se soient fracassés sur les rochers de la Sardaigne. Chaque événement et chaque erreur de la coalition réactionnaire au pouvoir qui affaiblit sa crédibilité et sa force est une bonne chose, surtout s'il favorise une réorganisation des forces qui s'opposent à lui et suscite un peu plus d'espoir de pouvoir construire dans le pays une opposition sociale et politique aux choix du gouvernement et du capital qu'il représente.
Les considérations positives, y compris bien sûr la satisfaction légitime de la majorité des citoyen.ne.s sardes de ne pas voir une personne comme Truzzu à la présidence de la région, s'arrêtent cependant ici ; non seulement parce qu'une hirondelle (et une toute petite) ne fait pas le printemps, mais parce que ce qu'il faut, ce n'est pas seulement et pas tant l'unité institutionnelle et électorale des forces d'opposition, par ailleurs très modérées et dont les programmes politiques sont bien insuffisants, tout en portant une grande responsabilité, en raison de leur action passée et de leur politique au gouvernement, dans la dégradation politique du pays et dans la crédibilité acquise par la droite (même si elle est minoritaire), mais bien un mouvement social, politique et revendicatif d'ensemble des classes laborieuses, sans lequel nous n'irons nulle part, et encore moins vers un renouveau printanier.
En outre, le vote sarde lui-même met en évidence et confirme un certain nombre de considérations politiques et démocratiques essentielles. La première est que la moitié de l'électorat est tellement désabusée, éloignée et désintéressée de la compétition électorale qu'elle ne va même pas voter, un état de faiblesse de la démocratie qui non seulement ne peut être ignoré comme l'ont fait les médias, mais doit au contraire être souligné.(...)
L'alliance PD-M5S a gagné grâce aux erreurs de la droite, grâce à la capacité d'Alessandra Todde de présenter une liste avec un visage neuf et renouvelé, attentive aux problèmes d'une région historiquement malmenée, mais elle a gagné avec un écart de moins de 2 000 voix et un pourcentage à peine supérieur à 45 % : 330 000 électeurs par rapport aux 1 447 753 citoyens ayant le droit de vote, c'est-à-dire avec environ 22 % !
Ce fait n'est pas nouveau, il caractérise les « victoires » de tous les vainqueurs, quels qu'ils soient, tant aux élections politiques qu'aux élections régionales et municipales, car il est le résultat des systèmes électoraux mis en place par la droite et le centre-gauche au fil des ans, des mécanismes profondément antidémocratiques conçus pour assurer la capacité de gouverner de la classe dirigeante au détriment de la représentation politique légitime des citoyen.ne.s. Un système qui vise à exclure les partis politiques de la scène politique et à les empêcher de participer aux élections. Un système qui vise à exclure des institutions les minorités politiques, même les plus visibles, et surtout une gauche de classe et de combat.
Nous nous trouvons face à une démocratie « représentative » qui n'est qu'un simulacre. Les extrêmes droites, pourtant minoritaires dans le pays, ont pu profiter de ce système électoral (profitant aussi de la nullité du PD et du M5S), pour conquérir une hégémonie numérique absolue au parlement et exercer un pouvoir qui vise aussi à construire une hégémonie politique idéologique dans de larges couches de la population.
Pour en rester au système électoral spécifique de la Sardaigne, celui qui obtient plus de 40 %, même avec une seule voix d'écart, obtient une majorité de 60 % au conseil régional ; cela va jusqu'à exclure de la représentation de façon absurde même une coalition qui n'atteint pas 10 % ou une liste qui fait moins de 5 %. Il n'est pas étonnant que la moitié de l'électorat trouve tout à fait inutile de se rendre dans les bureaux de vote.
Mais ces remarques sur les lois électorales antidémocratiques, voire anticonstitutionnelles, ne font que mettre en évidence le processus de régression de la démocratie bourgeoise et de ses institutions telles que nous les avons connues depuis la Seconde Guerre mondiale. Face aux contradictions capitalistes et au libéralisme dominant, on assiste depuis des années à une restriction des mécanismes démocratiques, et pas seulement des droits sociaux. Les exécutifs, de plus en plus incontrôlés et dominants, prennent le pouvoir ; la démocratie réelle s'étiole et même la démocratie représentative devient de plus en plus formelle, voire autoritaire. Suite à la dégradation des pouvoirs parlementaires et à la mise en place de systèmes électoraux faussés, l'autonomie différenciée et le présidentialisme/premierministrisme sont l'aboutissement pernicieux de ce processus.
Tout cela nous amène à une seule conclusion, à savoir que la véritable partie, celle qui se rapporte aux rapports de forces entre les classes, tant politiques que sociales, se joue et se jouera sur le terrain de la lutte sociale, de la lutte des classes, d'autant plus que les droites extrêmes ont pour objectif de conserver le gouvernement et de renforcer leur hégémonie sur la société, non seulement par leur propagande tous azimuts et la division des différents secteurs de la classe ouvrière, mais aussi grâce à leur marque de fabrique, la politique de la matraque et l'utilisation d'instruments répressifs, ceux hérités des gouvernements précédents et les nouveaux dont elles se sont abondamment dotées au cours des 15 derniers mois.
Aussi voulons-nous concentrer notre attention sur la construction des mouvements sociaux et en particulier sur l'absolue nécessité d'un mouvement social et syndical qui reparte résolument de l'essentiel, la défense des salaires, de l'emploi, de la santé, de l'école et de la protection sociale pour tous, contre la logique du profit et, bien sûr, contre le réarmement et la guerre.
Les échéances électorales du printemps prochain seront certes importantes, mais telle est la boussole qui permettra de les apprécier et d'y faire face.
Franco Turigliatto Sinistra Anticapitalista (Gauche anticapitaliste)
P.-S.
• Traduit pour ESSF par Pierre Vandevoorde avec l'aide de DeepLpro.
Source : Anticapitalista. 28 février 2024
https://anticapitalista.org/2024/02/28/una-primavera-sociale-per-riscrivere-i-rapporti-di-forza/
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Europe - Se regarder dans les yeux pour construire la route au fur et à mesure

Des fantômes de toutes sortes hantent l'Europe. Des monstres de l'ancien et du nouveau monde qui aiment le clair-obscur. Depuis des années, l'Europe saigne aux frontières et fait pousser des barbelés. Aujourd'hui, l'UE est un grand laboratoire du néolibéralisme sécuritaire. Aujourd'hui, elle veut aussi redevenir un acteur mondial au milieu du désarroi de la gouvernance mondiale. Militarisation, austérité, extractivisme, privatisation, précarité, dérégulation, accords commerciaux transocéaniques et complicité avec des génocidaires comme Netanyahou.
Tiré de Quatrième internationale
10 mars 2024
Par Gonzalo Donaire
Copyright
Sylvain Loube
Pendant des décennies, l'Europe a vécu des profits de l'accumulation capitaliste et coloniale primitive. Pendant des années, l'UE a prétendu être le bon flic de la mondialisation heureuse. Mais aujourd'hui, l'échiquier géopolitique se déplace sous ses pieds et les élites européennes voient leur influence mondiale traditionnelle menacée. D'anciennes et de nouvelles puissances se disputent le trône et les maigres ressources nécessaires pour faire face à l'effondrement climatique du capitalisme tardif.
Il est temps de renforcer notre agressivité extérieure sur tous les fronts. Il est temps de parler la "langue dure du pouvoir" pour défendre ce "jardin européen" dont parlait Borrell. Parce que les intérêts des élites qui gouvernent le capitalisme européen ne se défendront pas seuls. Parce que pour que les voitures électriques circulent à Berlin, Paris ou Barcelone, il faut augmenter la pression minière dans le Sud. Et certainement pour ouvrir de nouvelles mines sur le territoire européen.
Des attaques sans frontières contre le territoire et contre ceux qui y vivent. Des attaques qui suscitent et susciteront des réponses populaires. Résistance contre le néo-extractivisme peint en vert ; contre les attaques du capital déguisées en changement de modèle productif. L'urgence climatique comme toile de fond critique pour ceux d'en bas et comme alibi pour ceux d'en haut.
Pendant ce temps, l'extrême centre néolibéral a adopté l'agenda réactionnaire et xénophobe d'une extrême droite qui, en cours de route, a remplacé son europhobie traditionnelle par un euro-réformisme ultra-conservateur et chauvin. Pourquoi quitter l'UE s'ils peuvent la co-gouverner comme ils le font déjà dans plusieurs États membres ? Machisme, homophobie, racisme, islamophobie, criminalisation de la protestation. Les majorités populaires, avec toute leur diversité de dissidence, sont devenues de dangereuses minorités. Une guerre ouverte contre le monde du travail, les services publics et la vie commune. De nouvelles batailles dans la guerre du capital contre la vie.
Qui a le droit d'avoir des droits dans cette Europe des marchés, de la guerre et des barbelés ? Les dirigeants sont clairs sur la question et sur leur réponse. Quelle est la réponse de la gauche anticapitaliste ? La réponse ne peut être que chorale. Mais la choralité appelle à la création d'espaces de rencontre et de discussion. Parce que les attaques internationales appellent des réponses internationalistes.
Or, l'absence d'espaces de coordination internationale et internationaliste dans le camp de la gauche radicale est une réalité aussi palpable qu'inquiétante. Il existe des vestiges du Parti de la gauche européenne sur lequel reposait une partie de l'héritage de l'eurocommunisme. Il existe des recréations proto-électorales de la nouvelle gauche qui ont émergé ces dernières années dans plusieurs pays européens. Mais aucun de ces espaces n'a vocation à dépasser ses propres cadres électoraux et institutionnels. Nous avons besoin de quelque chose de plus. Et nous ne sommes pas les seulEs. Outre les organisations politiques, il existe dans toute l'Europe des dizaines d'acteurs sociaux et syndicaux qui se réclament de l'anticapitalisme et de l'internationalisme, de l'antimilitarisme, de l'écosocialisme, de l'anticolonialisme et du féminisme.
Avec l'intention modeste mais déterminée de contribuer à poser une pierre sur ce long chemin, Anticapitalistas et la CUP ont convoqué et co-organisé le 3 février à Barcelone une rencontre européenne d'organisations anticapitalistes et de gauche alternative pour réfléchir ensemble au moment dans lequel nous nous trouvons et discuter des alternatives que nous pouvons mettre en place pour changer l'Europe à partir de la base.
Des délégations de 16 organisations politiques de 13 territoires européens (1) ont discuté avec des représentantEs d'autres organisations sociales (Transnational Institute, Centre Delàs, Observatori del Deute en la Globalització, Rosa Luxemburg Foundation) des conséquences de la militarisation mondiale croissante et du rôle de l'UE, ainsi que des réponses écosocialistes possibles au projet capitaliste vert des élites européennes. Deux tables rondes ont permis de mettre à jour les caractérisations communes, d'avancer des propositions concrètes et de discuter des divergences existantes, telles que celles qui ont tourné au cours de la dernière période autour de la caractérisation du conflit en Ukraine après l'invasion russe. La principale conclusion est peut-être qu'il faut davantage d'espaces de face-à-face et de camaraderie comme celui qui a été créé, afin de continuer à échanger sans la distance froide et violente des réseaux sociaux, qui n'apportent rien au débat entre camarades.
Et comme les luttes et les résistances ne se construisent pas dans l'abstrait, mais sur des agendas partagés, les organisations participantes ont pris le relais du mouvement BDS pour promouvoir, dans les plateformes respectives de solidarité avec la Palestine auxquelles elles participent, l'appel à manifester le 25 février ou les jours suivants, dans le but de lancer une première expérience de journée de protestation à l'échelle européenne. De même, des informations ont été données sur la réunion européenne des organisations de solidarité avec la Palestine qui se tiendra à Barcelone les 16 et 17 mars.
Et tout aussi importants que les discussions formelles ont été et seront toujours les échanges informels qui ont eu lieu pendant la réunion. La dimension émotionnelle et affective de la camaraderie est un pilier de la construction des organisations révolutionnaires. Et elle sera aussi un pilier de leur coordination internationale potentielle. Dans la tension dialectique permanente entre ambition et prudence, les participants à la rencontre européenne se sont rapprochés un peu plus de l'étape suivante vers un espace d'échange et de coordination entre anticapitalistes de toute l'Europe, qui devra continuer à grandir, mais qui est déjà en train de se remettre en marche. Mais, comme l'effondrement du capitalisme ou des vieux empires, il ne viendra pas tout seul : il dépendra de l'élan militant que voudront bien lui donner ceux qui participent à cet espace. Car le chemin se fait en marchant.
Publié le 16/02/2024 sur Punto de Vista Internacional.
1. CUP (Països Catalans), Anticapitalistas (Estado español), Adelante Andalucía (Andalucía), Alternatiba (Euskal Herria), NPA, Gauche Éco-socialiste y Ensemble, (Francia), Gauche anticapitaliste (Bélgica), People Before Profit (Irlanda), SolidaritéS (Suiza), Socialistisk Politik (Suecia), Bloco de Esquerda (Portugal), Marx21 (Alemania), Campaign for Socialism / Labour Party-Unions (Escocia), Anametrisi y DEA (Grecia).
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Guerre à Gaza : pourquoi l’administration Biden évoque enfin un « cessez-le-feu » ?

Alors que la position du président sortant s'affaiblit dans les sondages, la vice-présidente Kamala Harris a porté une évolution dans la position officielle de Washington sur la guerre à Gaza. Une politique des petits pas qui pourrait ne pas convaincre la base électorale démocrate.
Tiré de L'Humanité, France. Mise à jour le 4 mars 2024 à 18h37
www.humanite.fr/monde/benjamin-netanyahou/guerre-a-gaza-pourquoi-ladministration-biden-evoque-enfin-un-cessez-le-feu <http://www.humanite.fr/monde/benjam...>
Par Christophe Deroubaix <https://www.humanite.fr/auteurs/chr...>
,
« Cessez-le-feu immédiat. » Un membre de l'administration américaine a fini par prononcer ces quelques mots tant attendus. Ce n'est pas Joe Biden mais la vice-présidente,https://www.humanite.fr/monde/etats...>
,">Kamala Harris qui a porté cette parole. Cette dernière a pris <https:/www.humanite.fr/medias/atta...>'>position pour un « cessez-le-feu immédiat pour au moins les six prochaines semaines » et appelé le gouvernement de Benyamin Netanyahou à prendre des mesures pour accroître l'aide dans la bande de Gaza, menacée de famine selon l'ONU.
Cette évolution s'est accompagnée de propos critiques adressés au premier ministre israélien. Sur la façon de menerla <https:/www.humanite.fr/monde/etats...>'>guerre à Gaza : « Ce que nous voyons chaque jour à Gaza est dévastateur. Nous avons vu des familles se nourrir de feuilles ou d'aliments pour animaux. Des femmes donnent naissance à des bébés souffrant de malnutrition, avec peu ou pas de soins médicaux. Des enfants meurent de malnutrition et de déshydratation. Comme je l'ai dit à maintes reprises, trop de Palestiniens innocents ont été tués. » Comme sur la gestion de la crise humanitaire : « Le gouvernement israélien doit en faire davantage pour augmenter de manière significative le flux d'aide. Il n'y a pas d'excuses. »
*L'administration Biden piégée par ses contradictions*
Pourtant, pour sa première intervention de poids sur le sujet, Kamala Harris a également exposé les limites de la position américaine en déroulant des éléments de langage traditionnels qui donnent presque quitus au gouvernement israélien. Elle a ainsi qualifié le Hamas d'« organisation terroriste brutale » qui constitue une menace pour Israël et doit être éliminée, tout en répétant que le pays avait le « droit de se défendre ». C'est exactement sur cette base rhétorique et politique quele gouvernement israélien <https:/www.humanite.fr/politique/e...>'>d'extrême droite a lancé sa guerre totale contre la bande de Gaza. L'administration Biden – par la voix du président lui-même – trouve juste « excessive » une riposte dont l'intensité et l'échelle sont contenues dans la logique de départ.
Pris dans cette contradiction extérieure, l'establishment démocrate essaie aussi de desserrer un étau intérieur : l'opposition de la base électorale qui prend des<https:/www.humanite.fr/monde/etats...>'>allures de fronde. « Alors que M. Biden a de plus en plus critiqué la réponse d'Israël à l'attentat du 7 octobre, son rejet des appels à un cessez-le-feu permanent et une série de faux pas antérieurs témoignant d'un manque d'empathie pour les Palestiniens ont divisé le Parti démocrate. Ils lui ont également aliéné des électeurs clés, notamment les Noirs, les jeunes et les Arabes américains », rappelle le New York Times. Mardi dernier, lors de la primaire dans le Michigan, 100 000 électeurs – soit près de 15 % des suffrages exprimés – ont voté « uncommitted » ( « non engagé » ) en signe de protestation.
*Une fronde de plus en plus prononcée*
Les sondages, plus mauvais les uns que les autres pour Joe Biden, se succèdent. La dernière livraison de l'enquête d'opinion du New York Times donne des sueurs froides aux stratèges démocrates : 48 % pour Donald Trump, 43 % pour <https:/www.humanite.fr/monde/etats...>'>Joe Biden. Le président sortant est également distancé dans tous les Swing States, ces États-clés qui, dans le système du collège électoral, feront la décision le 5 novembre.Le Michigan <https:/www.humanite.fr/monde/bande...>'>en fait partie. La réussite, en quelques semaines, de la démarche « uncommitted » constitue clairement un signal d'alarme pour la Maison-Blanche.
La stratégie ne se limite pas seulement à cet État qui compte de nombreux électeurs arabes et/ou musulmans très sensibles à la question palestinienne. Jeudi dernier, United Food & Commercial Workers, le plus grand syndicat de l'État de Washington, a recommandé à ses 50 000 membres de ne pas s'engager dans les primaires présidentielles démocrates qui se tiendront dans l'État, le 12 mars. Le mouvement syndical constitue l'une des poutres maîtresses de la coalition démocrate, sans laquelle Joe Biden ne peut envisager de décrocher un second mandat.
L'électorat africain-américain en représente une autre. Or, c'est dans ce « segment » que l'on retrouve l'opposition la plus forte au soutien inconditionnel de Joe Biden à Benyamin Netanyahou. D'où le symbole grossièrement choisi du pont Edmund-Pettus à Selma, dans l'Alabama pour annoncer un mini-virage sur l'aile. La rencontre, lundi, de <https:/www.humanite.fr/monde/israe...>'>Benny Gantz , membre du cabinet de guerre mais rival de Benyamin Netanyahou, avec Kamala Harris, Antony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, et Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale, peut être lue comme un autre symbole de distanciation avec le premier ministre israélien, qui évite pourtant la mobilisation de moyens diplomatiques lourds : non-opposition d'un veto à l'ONU, arrêt des livraisons d'armes.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

USA : Le mouvement des non-engagés pour la défense de la Palestine

Il est étrange de parler d'un mouvement de non-engagés. Mais en ce moment, dans des États comme le Michigan et Washington, les non-engagés constituent l'avant-garde d'un mouvement politique de défense du peuple palestinien contre la guerre génocidaire d'Israël, dont les armes sont fournies par les États-Unis.
Hebdo L'Anticapitaliste - 698 (07/03/2024)
Par Dan La Botz
Crédit Photo
Facebook-Jewish Voice for Peace
L'horreur des 30 000 morts à Gaza, dont la moitié sont des femmes et des enfants, et les événements tels que la provocation par Israël d'une bousculade de 120 personnes abattues ou piétinées qui tentaient d'obtenir de la nourriture dans les camions d'un convoi d'aide humanitaire, alimentent un puissant mouvement en faveur d'un cessez-le-feu et de la fin de l'aide militaire américaine à Israël.
Le Michigan fait pression sur le candidat démocrate
Le Michigan compte 200 000 électeurEs musulmanEs et, si on compte autrement, 300 000 électeurs du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Il y a quelques mois, les PalestinienEs du Michigan ont commencé à organiser un mouvement exhortant les électeurEs des primaires démocrates de l'État à voter pour des « non engagés » plutôt que pour le président Joe Biden, afin de protester contre son incapacité à appeler à un cessez-le-feu. « Dans une démocratie, on vous dit que lorsque les choses ne vont pas bien, vous utilisez les urnes pour envoyer votre message », a déclaré Abraham Aiyash, représentant de l'État du Michigan et partisan de la campagne.
Le mouvement des non-engagés du Michigan espérait convaincre 10 000 personnes de le faire lors des primaires présidentielles du 27 février, mais il a obtenu le soutien non seulement des communautés arabes et musulmanes, mais aussi de certains JuifEs, comme ceux de Jewish Voice for Peace, d'Afro-AméricainEs et de jeunes électeurEs de diverses ethnies, et a finalement obtenu 100 000 voix. Le journal israélien Haaretz a rapporté que la directrice de campagne du Michigan, Layla Elabed – la sœur de la députée Rashida Tlaib – a déclaré que les résultats signifieraient probablement que « le Michigan enverra deux délégués à Chicago pour déclarer qu'ils ne s'engagent pas envers le candidat démocrate tant qu'il ou elle financera la guerre d'Israël à Gaza ».
Le Michigan, un État charnière, est un élément clé de l'élection présidentielle américaine. Lors des dernières élections, Joe Biden n'a remporté le Michigan qu'avec 150 000 voix d'avance. Si les musulmanEs et les Arabes restent chez eux, il pourrait donc perdre l'État.
Désengagement envers les démocrates dans plusieurs États
Dans l'État de Washington, où les élections primaires auront lieu le 12 mars, on observe un autre mouvement important de non-engagement. L'Union des travailleurs de l'alimentation et du commerce (United Food and Commercial Workers Union) qui compte 50 000 membres dans l'État, a appelé ses membres à voter sans s'engager. L'UFCW a félicité M. Biden pour avoir été « un allié des travailleurs au fil des ans », mais a ajouté : « En solidarité avec nos partenaires du Michigan qui ont envoyé un message clair lors de leurs primaires, M. Biden doit faire davantage pour résoudre la crise humanitaire à Gaza. M. Biden doit faire pression en faveur d'un cessez-le-feu durable et mettre fin au financement américain de cette guerre irresponsable ».
L'État de Washington est majoritairement démocrate et le syndicat ainsi que d'autres électeurs non engagés sont susceptibles de voter pour M. Biden lors de l'élection générale, mais nombreux sont ceux qui souhaitent manifester leur opposition à ses politiques. La présence d'un bloc de délégués non engagés pourrait avoir une incidence sur la convention nationale du parti démocrate, au cours de laquelle le candidat à la présidence sera désigné.
Tous les États n'offrent pas la possibilité de voter sans engagement, mais plusieurs le font, notamment le Kentucky, le Maryland, le Rhode Island, le Tennessee et le Colorado. La plupart de ces États ont une faible population arabe et musulmane, et certains d'entre eux, comme le Colorado, mènent des campagnes pour obtenir des votes non engagés, voire des déléguéEs.
Le mouvement dans les rues se poursuit également. Le 2 mars, journée internationale de solidarité avec la Palestine, des centaines de milliers de personnes ont manifesté dans le monde entier pour réclamer un cessez-le-feu. Nous avons défilé dans 85 villes américaines, dont Los Angeles, Denver, Chicago et, sous la pluie, New York, où je me suis joint à la manifestation. Tant que la guerre se poursuivra, le mouvement continuera et l'opposition à Israël et au soutien des États-Unis à la guerre se renforcera.
Dan La Botz, traduction DeepL revue par la rédaction
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
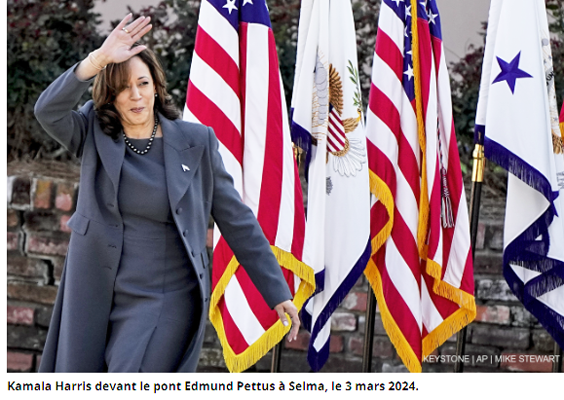
États-Unis-Israël. « Kamala Harris a simplement demandé une pause dans le génocide »
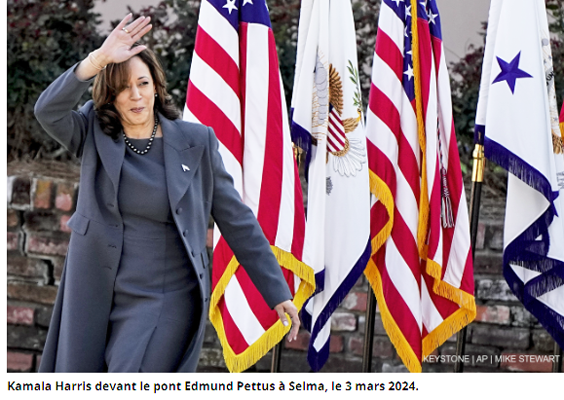
Lors d'une étape de sa campagne dimanche 3 mars [pour les primaires du Parti démocrate], la vice-présidente des Etats-Unis, Kamala Harris, a appelé à une pause de six semaines – qu'elle a qualifiée de « cessez-le-feu » – dans les frappes d'Israël contre Gaza [et sa population], reprenant la formulation que les défenseurs de la Palestine utilisent depuis des mois pour promouvoir ce qui, selon eux, équivaudrait simplement à une « pause dans le génocide ».
6 mars 2024 | tiré du site alencontre.org | Photo : Kamala Harris devant le pont Edmund Pettus à Selma, le 3 mars 2024.
https://alencontre.org/ameriques/americnord/usa/etats-unis-israel-kamala-harris-a-simplement-demande-une-pause-dans-le-genocide.html
Lors d'un discours prononcé devant le pont historique Edmund Pettus à Selma [le 7 mars 1965, sur ce pont, une marche sur les droits civiques est attaquée par les forces de police ; le 21 mars, Martin Luther King conduit une nouvelle marche de Selma à Montgomery, capitale de l'Etat], en Alabama, Kamala Harris s'est interrompue après avoir appelé à un « cessez-le-feu immédiat ». Elle laissa la foule applaudir avant de poursuivre : « pour au moins les six prochaines semaines, ce qui est actuellement à l'ordre du jour ». Elle a reproché aux dirigeants palestiniens de ne pas vouloir de l'accord, bien que des rapports indiquent que les négociations sont toujours en cours. Les forces du Hamas n'étant pas disposées à libérer tous les otages israéliens tant qu'Israël n'aura pas accepté de retirer ses troupes et de libérer un certain nombre parmi les milliers d'« otages palestiniens » que les forces armées ont arrêtés [à Gaza et en Cisjordanie] au cours des derniers mois.
Le refus de Kamala Harris d'appeler à un cessez-le-feu permanent intervient alors que la campagne militaire génocidaire d'Israël à Gaza a tué plus de 30 000 Palestiniens et en a blessé 70 000 [en date du 5 mars : 30 631 tués dont 12 300 enfants et 8400 femmes, et 72 043 blessés], des milliers de personnes [quelque 8000] étant toujours portées disparues sous les décombres.
De nombreux organes de presse, y compris ceux qui ont un parti pris pro-israélien affirmé, ont simplement rapporté que Kamala Harris avait appelé à un cessez-le-feu dans des titres et des messages sur les médias sociaux. Le Washington Post est allé jusqu'à qualifier les paroles de Kamala Harris de « changement de ton ». Cependant, sans préciser qu'il s'agissait d'un cessez-le-feu temporaire – ou de ce que d'autres responsables ont appelé une « pause humanitaire » –, les titres des médias donnent l'impression que Kamala Harris a lancé un appel plus fort qu'elle ne l'a fait en réalité. Ce qu'ont souligné les défenseurs des droits de l'homme.
La vice-présidente Kamala Harris est en train de rebaptiser « cessez-le-feu » le précédent appel de Joe Biden à une pause humanitaire de six semaines », a écrit Waleed Shahid, conseiller stratégique et ancien porte-parole des Justice Democrats [courant fondé en 2017, avec l'appui de Bernie Sanders, pour un « nouveau type de majorité Démocrate au Congrès »], sur les réseaux sociaux lundi. « Il s'agit principalement d'un changement de message sans changement de politique, alors que Biden continue de financer [le Premier ministre israélien Benyamin] Netanyahou avec des milliards d'euros d'aide à l'armement. »
En effet, le mois dernier, Joe Biden a déclaré qu'il travaillait sur un accord pour une « période de répit » de six semaines et a dit la semaine dernière qu'il espérait qu'une pause commencerait lundi – ce qui, lundi soir 4 mars, heure de Gaza, n'avait pas encore eu lieu.
D'autres défenseurs des droits des Palestiniens ont souligné que les appels de Kamala Harris et de Joe Biden en faveur d'un cessez-le-feu temporaire au cours des dernières semaines interviennent alors que l'administration s'efforce de contenir la campagne de plus en plus importante visant à voter « non-engagés » [uncommitted] au détriment de Joe Biden lors des primaires démocrates dans certains Etats [ce qui s'est constaté lors des primaires démocrates au Michigan le 27 février].
Cette campagne, lancée le mois dernier par des militants antisionistes du Michigan, a connu un grand retentissement lors des primaires de cet Etat, la semaine dernière, avec plus de 101 000 électeurs ayant choisi de ne pas « s'engager », soit suffisamment de voix pour obtenir deux délégués à la convention nationale du Parti démocrate qui se tiendra à Chicago au mois d'août. Depuis, la campagne s'est étendue à d'autres Etats du pays, les électeurs et électrices se mobilisant pour adresser un blâme sévère à Joe Biden en raison de son soutien indéfectible à Israël.
Abed A. Ayoub, directeur exécutif national de l'Arab-American Anti-Discrimination Committee, le plus grand groupe de défense des droits civiques des Américains d'origine arabe aux Etats-Unis, a écrit sur X le 4 mars : « L'appel de la vice-présidente Kamala Harris en faveur d'un cessez-le-feu temporaire de six semaines implique un délai très précis. En fait, c'est juste assez de temps pour que la plupart des primaires démocrates soient terminées. Après le 15 avril, il ne restera plus qu'une poignée de primaires, la plus importante étant celle de Pennsylvanie, le 23 avril. »
L'appel de Kamala Harris à une pause est également intervenu deux jours avant le Super Tuesday [le 5 mars], où 15 Etats et les îles Samoa américaines organisent des élections primaires, y compris la Caroline du Nord, qui est un Etat crucial pour le scrutin.
Abed A. Ayoub a poursuivi : « Ce qu'elle a demandé n'est pas un cessez-le-feu, c'est une pause dans le génocide. » (Article publié par Truthout le 4 mars 2024 ; traduction rédaction A l'Encontre)
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Sur la question de la Palestine, comment Israël a cherché à faire taire les premiers contestataires juifs états-uniens

Le gouvernement israélien s'est clandestinement immiscé dans la politique juive états-unienne depuis le début des années 1950 jusqu'aux années 1970, et ce afin d'étouffer les critiques juives concernant la Nakba de 1948 – la dépossession et l'expulsion massives des Palestiniens lors de la fondation d'Israël – et concernant l'oppression des Palestiniens par Israël. Les diplomates israéliens qui ont supervisé cette campagne secrète ont été assistés, à un certain moment, par Wolf Blitzer – aujourd'hui animateur de l'émission de grande écoute de CNN « The Situation Room ».
5 mars 2024 | tiré du site alencontre.org | Photo : Activistes de Jewish Voice for Peace, le 11 décembre 2023 à Washington.
Telles sont quelques-unes des conclusions de Our Palestine Question. Israel and American Jewish Dissent, 1948-1978 (Yale University Press, 2023), un nouveau livre explosif écrit par Geoffrey Levin, chercheur à l'Université Emory [université privée située à Atlanta en Géorgie]. Il offre une vision historique sur la crise actuelle à Gaza, en particulier telle qu'elle se joue aujourd'hui parmi les Juifs des Etats-Unis.
Depuis les attaques meurtrières du 7 octobre du Hamas contre Israël et les représailles massives d'Israël contre les civils palestiniens à Gaza, des Juifs des Etats-Unis ont organisé des manifestations spectaculaires. Ils et elles ont tout réclamé : du cessez-le-feu à la fin du financement militaire d'Israël par les Etats-Unis.
Ce regroupement hétérogène de Juifs opposés à la politique israélienne et, parfois, à Israël lui-même, s'appuie sur une histoire de l'activisme aux Etats-Unis qui est depuis longtemps tombée dans l'oubli – et ils la font revivre aujourd'hui.
Nombre de ces militant·e·s citent explicitement des mouvements politiques antérieurs comme source d'inspiration. L'un d'entre eux est le General Jewish Labor Bund, un mouvement socialiste et antisioniste fondé il y a plus d'un siècle [en 1897 et dissous en avril 1921 pour ce qui est du GJL Bund en Lituanie, Pologne et Russie] en Europe de l'Est, mais disparu depuis des générations. Les autres mouvements sont un rassemblement de groupes états-uniens postérieurs à 1980, dont le New Jewish Agenda, aujourd'hui disparu, et le mouvement libéral J Street [créé en fin 2007, favorable à une solution dite diplomatique du « conflit israélo-palestinien], existe toujours. Ce dernier exerce des pressions sur les hommes politiques, bien qu'il dispose de moins de ressources que la droite sioniste. Ces petits groupes se sont formés après que les sionistes et les antisionistes avoués ont cessé de se parler, sauf pour s'affronter.
Ce que peu d'activistes remarquent, cependant, c'est l'époque, relativement récente, des années 1950, où la plus grande organisation juive des Etats-Unis – l'American Jewish Committee (AJC) – critiquait publiquement la Nakba et faisait pression sur Israël pour qu'il accorde aux Palestiniens tous les droits civils et humains. Ce qui est moins souligné et moins connu, c'est la façon dont ce remarquable état des choses a été effacé : des années 1950 à la fin des années 1970, Israël a orchestré des attaques en sous-main contre des personnes et des groupes influents, dont l'AJC, qui militaient en faveur des droits des Palestiniens. Notre question palestinienne lève le voile sur cette histoire étouffée.
Le maccarthysme juif américain
Geoffrey Levin a eu connaissance de cette histoire cachée il y a quelques années. Il était alors doctorant en études hébraïques et judaïques et fouillait dans les collections spéciales d'histoire juive à Manhattan ainsi que dans les archives de l'Etat d'Israël à Jérusalem, lorsqu'il a déterré des preuves du maccarthysme juif états-unien sub rosa (très caché). Il a été le premier chercheur à découvrir comment le gouvernement israélien, par l'intermédiaire de ses diplomates et d'un espion aux Etats-Unis, a fait pression sur les institutions juives états-uniennes pour qu'elles se débarrassent d'un éminent journaliste, licencient un brillant chercheur et discréditent une organisation de Juifs qui critiquaient le traitement réservé par Israël aux Palestiniens et tentaient d'ouvrir des canaux de discussion avec les Arabes.
Prenons le cas du journaliste William Zukerman. Ecrivain yiddish et anglais respecté dans les années 1930 et 1940, ayant publié des articles dans Harpers et le New York Times, William Zukerman a lancé son propre bihebdomadaire, la Jewish Newsletter, en 1948. Il y critique vivement le nationalisme juif et ses effets dévastateurs dans le nouvel Etat d'Israël et au-delà.
Dans un article, William Zukerman parle d'une survivante de l'Holocauste qui s'est récemment installée en Israël, dans l'ancienne maison d'une famille arabe. La survivante est devenue « clairement préoccupée » par sa conscience morale, écrit William Zukerman, après que ses enfants ont trouvé certains des biens de la famille expulsée. « La mère a été soudainement frappée par l'idée que ses enfants jouaient avec les jouets d'enfants arabes qui étaient maintenant exilés et sans abri », poursuivait William Zukerman. « Ne fait-elle pas aux Arabes ce que les nazis ont fait à elle et à sa famille ? »
Au début des années 1950, la Jewish Newsletter comptait quelques milliers d'abonnés et son travail était republié dans de nombreux autres médias, juifs et non juifs, avec des tirages beaucoup plus importants – le Time magazine, par exemple. Tous les lecteurs de William Zukerman n'étaient cependant pas opposés au sionisme. Chacune des centaines de sections de l'organisation étudiante juive Hillel était abonnée à la Jewish Newsletter.
Selon les dossiers déclassifiés du ministère israélien des Affaires étrangères trouvés par Geoffrey Levin, le gouvernement israélien s'est alarmé de l'influence de William Zukerman sur les Juifs des Etats-Unis. Il a lancé une campagne pour l'empêcher de « perturber » les sionistes au sujet d'Israël et des droits des Palestiniens. Israël a lancé une campagne d'envoi de lettres au New York Herald Post pour décourager le journal de publier davantage d'articles de William Zukerman. Il a mis au point un plan pour distribuer des textes types que les sionistes devaient envoyer à d'autres rédactions pour leur demander de ne plus publier Zukerman. Le directeur du Bureau d'information d'Israël à New York (Israel's Office of Information in New York) s'efforce de faire supprimer la rubrique de Zukerman dans le prestigieux Jewish Chronicle, basé à Londres, et Zukerman perd son poste. En 1953, son travail ne paraissait plus dans la presse juive.
Il y avait aussi Don Peretz, un Juif américain dont les attaches au Moyen-Orient et en Palestine remontaient à plusieurs générations. Jeune homme au début des années 1950, il avait rédigé la première thèse de doctorat sur la crise des réfugiés palestiniens après la Nakba. L'étude a été considérée comme faisant tellement autorité qu'elle a été publiée sous la forme d'un livre qui, pendant des années, a été utilisé comme référence académique. Le travail de Peretz lui a valu l'attention de l'AJC (American Jewish Committee). Fondée au début du XXe siècle, l'organisation a passé des décennies à défendre les droits civils et humains des Juifs américains et, plus tard, des groupes opprimés dans le monde entier. Préoccupée par le sort des Palestiniens et craignant que les mauvais traitements infligés par Israël ne renforcent l'antisémitisme aux Etats-Unis, l'AJC a engagé Don Peretz comme chercheur en 1956.
Don Peretz a eu de nombreux contacts amicaux avec les Palestiniens. Il a commencé à rédiger des brochures d'information et des rapports. Dans l'un d'eux, qu'un dirigeant de l'AJC a personnellement remis au secrétaire d'Etat John Foster Dulles [républicain, janvier 1953-avril 1959], Peretz a suggéré qu'Israël pourrait rapatrier les Palestiniens expulsés pendant la Nakba. Après avoir lu la brochure, les responsables israéliens ont demandé à un employé de l'AJC de leur envoyer des informations sur l'auteur, dans le but de le faire licencier. Israël a ensuite demandé à l'AJC de soumettre tous les travaux de Peretz relatifs au Moyen-Orient à l'ambassade d'Israël à Washington ou au consul général à New York, pour examen avant publication. L'AJC s'est exécutée. Lorsque Peretz a écrit un nouveau livre sur Israël et la Palestine, les Israéliens l'ont vivement désapprouvé et ont fait part de leur mécontentement à l'AJC. L'AJC a relégué Peretz à un emploi à mi-temps. Il a alors démissionné.
Ce n'est probablement pas une coïncidence si le départ de Peretz a eu lieu en 1958, l'année où le roman Exodus a été publié. Ce roman est rapidement devenu une superproduction et, plus tard, un film mettant en scène Paul Newman, blond aux yeux bleus, dans le rôle d'un guerrier paramilitaire israélien d'acier, avant l'indépendance. Il semblait alors que les Américains, juifs ou non, aimaient de plus en plus le sionisme israélien et se préoccupaient de moins en moins des Palestiniens.
Pendant ce temps, les Juifs de la diaspora s'assimilaient triomphalement au courant dominant des Etats-Unis. Leur intégration s'est accompagnée de difficultés. L'affaiblissement des liens avec les pratiques religieuses traditionnelles, l'augmentation des mariages mixtes et la péri-urbanisation massive débouchent dans ce milieu sur une crise d'identité et une recherche de nouveaux points de repère. L'un d'entre eux était la mise en œuvre communautaire du souvenir de l'Holocauste. Un autre était la célébration d'Israël – quoi qu'il arrive.
Ce fut un tournant culturel pour les défenseurs d'Israël : les Juifs des Etats-Unis se ralliaient en masse, nourris par les changements sociétaux de la diaspora, mais aussi par des éléments organisés, en grande partie orchestrés par Israël. Ces derniers catalysaient et renforçaient les changements. Au cours de la décennie suivante, la tendance ne fera que s'accentuer, la victoire improbable d'Israël sur ses voisins arabes lors de la guerre israélo-arabe de 1967 renforçant les thèmes d'un Israël admirable et combatif et d'une nation ayant grand besoin du soutien de ses concitoyens juifs à travers le monde. Aux Etats-Unis, les Juifs américains ont de plus en plus répondu à cette sollicitation.
Contre deux Etats

Alors même que l'omniprésence du soutien juif américain à Israël augmentait, Israël et ses défenseurs ont commencé à s'opposer non seulement à l'antisionisme, mais aussi à ce qui allait être largement connu aux Etats-Unis sous la dénomination de sionisme libéral. C'est à ce titre que Wolf Blitzer, l'animateur de CNN, s'est impliqué dans le type d'efforts dont Levin parle dans Our Palestine Question.
Geoffrey Levin évoque un incident survenu à la fin de l'année 1976, au cours duquel Wolf Blitzer, encore jeune reporter, et des sources gouvernementales israéliennes ont collaboré pour neutraliser un groupe pacifiste juif américain appelé Breira : A Project of Concern in Diaspora-Israel Relations (Projet de débat dans les relations entre la diaspora et Israël). Breira signifie « alternative » en hébreu [c'était une forme de réponse à ein breira – il n'y a pas d'alternative]. Le groupe s'est d'abord organisé en 1973 pour protester contre les positions organisationnelles juives dures qui ont émergé après la toute dernière guerre israélo-arabe de 1973.
Les défenseurs d'Israël aux Etats-Unis adoptaient des approches plus à droite du sionisme et réagissaient à la guerre en adoptant l'idée que les implantations sionistes [colonies] dans les territoires occupés et la mise à l'écart de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) étaient essentielles à la survie d'Israël. Au contraire, Breira voulait offrir une « alternative » et demandait à Israël de reconnaître le désir des Palestiniens d'avoir un pays. Ce fut le premier groupe juif américain à plaider pour une solution à deux Etats. Au début de l'année 1976, le New York Times écrivait dans un éditorial que Breira était en train de dépasser « l'incompréhension de nombreux juifs américains qui pensaient que la critique de la politique israélienne serait perçue comme un rejet d'Israël ».
Puis Israël a riposté. En novembre 1976, une poignée de personnes travaillant pour plusieurs organisations juives américaines ont rencontré secrètement et à titre privé des représentants modérés de l'OLP. Les participants étaient affiliés au Congrès juif américain, au Comité juif américain, au B'nai B'rith (Les Fils de l'Alliance), au Conseil national des femmes juives et à Breira. Ils insisteront plus tard sur le fait qu'ils ne souhaitaient pas s'engager dans la diplomatie avec l'OLP, mais seulement dans un dialogue informel pour discuter du rétablissement de la paix. L'une des réunions a eu lieu à New York, l'autre à Washington. Par la suite, certains participants ont rédigé des rapports et envoyé des copies à des fins d'information aux diplomates israéliens qu'ils connaissaient personnellement. Ils étaient convaincus que ces diplomates ne rendraient pas les réunions publiques.
A l'époque où les réunions ont eu lieu, Wolf Blitzer travaillait comme correspondant à Washington pour le Jerusalem Post. Son travail consistait à rendre compte de la manière dont les situations au Moyen-Orient se traitaient aux Etats-Unis, en particulier en ce qui concerne Israël. Le Jerusalem Post n'était cependant pas son seul employeur. Wolf Blitzer travaillait également pour deux publications qui, en fait, étaient les organes internes de l'American Israel Public Affairs Committee (AIPAC).
Quelques jours après la réunion de Washington, Wolf Blitzer a écrit un article sur la réunion de Washington pour le Jerusalem Post et a nommé les participants juifs américains. Sur la base des détails de son reportage et des informations de la presse [article de Bernard Gwertzman dans le New York Times titré « American Jewish Leaders Are Split Over Issue of Meeting With P.L.O. », Des dirigeants juifs américains sont divisés sur la question de la rencontre avec l'OLP], les participants ont déclaré qu'il était clair que Wolf Blitzer avait reçu un rapport confidentiel transmis par Israël. Son article citait des « responsables israéliens » et un diplomate anonymes exprimant leur « inquiétude » au sujet de la réunion, qu'ils considéraient comme faisant partie d'une nouvelle « tactique de propagande de l'OLP » visant à « la destruction d'Israël ».
Une tornade s'est abattue sur ces groupes juifs américains. Toutes les organisations dont les membres avaient participé à titre individuel ont dénoncé ces réunions – toutes, à l'exception de Breira. Le fait que Breira ait continué à défendre les rencontres a incité l'AIPAC à qualifier le groupe d'« anti-israélien », de « pro-OLP » et de « juifs qui se haïssent eux-mêmes ». Pratiquement aucune organisation juive influente ne s'est opposée publiquement à ces dénonciations. Le congrès national de Breira en 1977 a été perturbé et vandalisé par des intrus qui ont laissé des tracts soutenant la Ligue de défense juive d'extrême droite. Breira a perdu des membres et des conflits internes ont conduit son principal donateur à retirer son financement. En 1978, Breira s'est éteint. Ainsi, grâce à un journaliste lié à l'AIPAC et à des fonctionnaires israéliens, un autre courant de désapprobation à l'égard des politiques israéliennes, parmi les Juifs américains, avait été supprimé.
Bien que l'ouvrage de Geoffrey Levin ait été mis sous presse avant les attentats du 7 octobre, l'histoire occultée qu'il présente est devenue particulièrement actuelle [1]. Si la communauté juive avait été informée, sensibilisée, il y a plusieurs décennies, de l'ingérence d'Israël, « on aurait pu avoir des échanges plus approfondis », suppose-t-il, « ce qui aurait peut-être conduit à une moins grande gêne pour aborder des questions difficiles actuelles ».
Geoffrey Levin ajoute que « beaucoup de personnes très brillantes ont été exclues du courant principal de l'establishment juif américain » pour avoir débattu de questions qui sont aujourd'hui vivement relancées. La « question palestinienne » pour l'Amérique juive recevrait-elle des réponses plus convaincantes aujourd'hui sans les tentatives insidieuses d'Israël – il y a des années – pour faire taire ses détracteurs au sein de la diaspora des Etats-Unis ? « On peut se demander, a déclaré Geoffrey Levin, à quoi aurait ressemblé la communauté juive américaine si elle avait accueilli certaines de ces voix critiques. » (Article publié par le site The Intercept le 3 mars 2024 ; traduction rédaction A l'Encontre)
[1] Dans Le Monde daté des 3 et 4 mars 2024, les auteurs de l'article intitulé « L'UNRWA, l'agence de l'ONU, dans le viseur d'Israël » citent Mario Carera, membre du Parti socialiste suisse, ancien délégué du CICR en Israël-Palestine : “[En Suisse] avant même la crise le parlement a voté de justesse la contribution [en fait divisée par deux] financière de l'UNRWA. Il n'y a eu aucune marque de soutien à Philippe Lazzarini [commissaire général de l'UNRWA]. Des ONG qui font du lobbying contre l'UNRWA, comme UN Watch [basée à Genève], ont l'oreille de la droite souverainiste.” »
On pourrait ajouter : ces divers lobbyings, relayés directement au sein du parlement helvétique, ont aussi réussi à silencer les élu·e·s du PSS, placés sous la houlette de Samuel Bendahan, à l'exception plus qu'honorable de Carlo Sommaruga, élu genevois au Conseil des Etats. (Réd.)
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La « machine à tuer » d’Israël : comment le soutien militaire américain sape les pourparlers sur le cessez-le-feu et prolonge la guerre

Alors qu'Israël poursuit ses bombardements et son siège permanent de Gaza, où la faim et la déshydratation ont atteint des niveaux mortels, le Hamas a accusé Israël de « contrecarrer » les efforts visant à parvenir à un accord de cessez-le-feu. Une délégation du Hamas au Caire a déclaré qu'Israël avait insisté sur le rejet d'éléments d'un accord pour un processus progressif qui aboutirait à la fin de l'agression israélienne contre Gaza, ainsi qu'à l'entrée de l'aide et à la facilitation du retour des Palestinien-ne-s déplacés dans leurs foyers à Gaza. Pendant ce temps, l'administration Biden fait pression sur le Hamas pour qu'il accepte les conditions en discussion, affirmant qu'une offre « rationnelle » avait été faite pour une trêve de six semaines en échange de la libération des otages israéliens. Les déclarations de la Maison-Blanche semblent être « une manœuvre très politiquement calculée afin qu'elles puissent essentiellement rejeter le blâme sur le Hamas si cela échoue », a déclaré Tahani Mustafa, analyste principal de la Palestine à l'International Crisis Group. Mustafa fournit également des mises à jour sur l'effondrement des opérations de l'UNRWA, la répression en Cisjordanie et l'utilité du droit international pour la Palestine aujourd'hui.
7 mars 2024 | tiré de democracy.now
https://www.democracynow.org/2024/3/7/israel_hamas_ceasefire_talks
NERMEEN SHAIKH : Une délégation du Hamas qui se trouvait au Caire pour des pourparlers de cessez-le-feu a quitté l'Egypte, accusant Israël de, je cite, de « contrecarrer » les efforts pour parvenir à un accord. Les pourparlers devraient reprendre la semaine prochaine. Un haut responsable du Hamas, Sami Abu Zuhri, a déclaré à Reuters qu'Israël insistait sur le rejet d'éléments d'un accord pour un processus progressif qui aboutirait à la fin de l'agression israélienne contre Gaza, ainsi qu'à l'entrée de l'aide et à la facilitation du retour des Palestiniens déplacés dans leurs foyers à Gaza.
Les négociateurs du Hamas, du Qatar et de l'Égypte – mais pas d'Israël – étaient au Caire pour tenter d'obtenir un cessez-le-feu de 40 jours à temps pour le mois sacré musulman du Ramadan, qui commence au début de la semaine prochaine. Alors que les pourparlers sont dans l'impasse et ne doivent reprendre que la semaine prochaine, cette date limite officieuse pour un accord semble hautement improbable.
AMY GOODMAN : Mardi, le président Biden a exhorté le Hamas d'accepter les termes en discussion et a affirmé qu'une offre rationnelle avait été faite pour un cessez-le-feu en échange de la libération des otages israéliens. Biden a déclaré aux journalistes : « C'est entre les mains du Hamas en ce moment. Si nous en arrivons à la situation où cela se poursuit jusqu'au Ramadan, ce sera très dangereux », a déclaré Biden.
Alors que les pourparlers étaient en cours, Israël a poursuivi ses bombardements incessants de Gaza, tuant plus de 80 personnes au cours des dernières 24 heures. Le bilan après près de cinq mois d'assaut est d'au moins 30 800 morts et près de 73 000 blessés. Pendant ce temps, la faim a atteint des niveaux catastrophiques en raison du siège d'Israël. Au moins 20 Palestiniens sont morts de malnutrition et de déshydratation, selon le ministère de la Santé.
Pour en savoir plus, nous sommes rejoints par Tahani Mustafa, analyste principal de la Palestine à l'International Crisis Group. Elle est normalement basée à Ramallah, en Cisjordanie occupée, mais elle se joint à nous aujourd'hui depuis Doha, au Qatar, où elle assiste à un symposium sur la Palestine organisé par l'Université de Georgetown.
Bienvenue à Democracy Now !, Tahani. Pouvez-vous commencer par parler de la situation sur le terrain et de ces pourparlers sur le cessez-le-feu ? Le Hamas dit qu'Israël a saboté les pourparlers et le Hamas a quitté Le Caire. Et puis on nous apprend qu'en fait, des négociations sont toujours en cours.
TAHANI MUSTAFA : Donc, je pense que les négociations en ce moment sont très précaires. Nous avons vu que l'accord de cessez-le-feu, ou du moins ce qui est proposé par Israël et les États-Unis, qui, soit dit en passant, ont unilatéralement proposé certaines de ces conditions plutôt que de s'engager efficacement avec le Hamas – cela semble être une manœuvre très politiquement calculée afin qu'ils puissent essentiellement rejeter le blâme sur le Hamas si cela échoue. Mais ce que nous avons vu dans les propositions qui ont été faites, c'est qu'elles n'offrent pas grand-chose au Hamas et à Gaza. Il n'y a aucune garantie en termes d'aide et sur son niveau. Déjà, Israël prétend qu'il autorise des quantités suffisantes d'aide, contrairement à ce que disent les organisations de défense des droits de l'homme, de sorte que nous avons déjà vu qu'ils trafiquent la réalité là-bas.
Et il y a aussi l'inquiétude, et à juste titre, que cela va simplement – je veux dire, en termes de ce qui a été proposé, c'est une pause de six semaines, c'est ce qu'Israël et les États-Unis offrent. Et donc, pour le Hamas et pour les Gazaouis, ils voient essentiellement cela comme une pause dans la machine à tuer, essentiellement, où le Hamas remet ces otages, rend toutes les cartes à sa disposition, puis la machine à tuer reprend.
NERMEEN SHAIKH : Ce qui est remarquable dans les pourparlers, c'est qu'Israël a, en fait, refusé de participer aux pourparlers qui se sont tenus au Caire, disant que le Hamas devait présenter une liste de 40 otages âgés, malades et féminins qui seraient les premiers à être libérés dans le cadre d'une trêve. Alors, pourriez-vous expliquer quels sont les obstacles à la publication d'une telle liste et pourquoi le Hamas hésite à le faire ?
TAHANI MUSTAFA : Ce n'est pas nécessairement de l'hésitation. C'est la difficulté d'essayer d'évaluer combien d'otages sont réellement en vie, d'autant plus que le Hamas ne détient pas tous ces otages. Donc, vous savez, il pourrait y avoir — il pourrait très bien y avoir des otages retenus captifs par d'autres groupes. Maintenant, étant donné, évidemment, la difficulté en termes de mouvement en raison de l'attaque israélienne, il a été très difficile de rassembler des chiffres concrets, en particulier en ce qui concerne le nombre de personnes réellement vivantes. Donc, c'est plus la question logistique d'être en mesure de fournir une liste confirmée appropriée qui retient le Hamas.
NERMEEN SHAIKH : Tahani, quels sont les risques qu'un accord ne soit pas trouvé la semaine prochaine ? Parce qu'au départ, on craignait qu'Israël n'aille de l'avant avec son invasion de Rafah.
TAHANI MUSTAFA : La semaine prochaine marquera le début du Ramadan. Vous savez, depuis quelques années maintenant, nous avons vu que le Ramadan a été une période incroyablement explosive. Le mois de mai 2021 a marqué le précédent conflit transfrontalier entre Israël et le Hamas, et cela n'avait rien à voir avec les événements à Gaza et tout à voir avec les provocations que nous avons vues dans des endroits comme Jérusalem-Est.
Si nous ne voyons pas – ce que nous ne verrons probablement pas – un cessez-le-feu ou une sorte de pause avant le Ramadan, compte tenu de l'escalade de la violence, compte tenu des tensions sur le terrain, vous savez, cela pourrait être catastrophique, pas seulement pour Gaza en termes de ce que cela signifie également à propos d'une invasion imminente de Rafah. Ce qui, selon les analystes israéliens, n'est pas une question de « si » mais de « quand », mais aussi dans des endroits comme la Cisjordanie et même Jérusalem-Est, où Israël a jusqu'à présent affirmé qu'il ne limiterait pas l'accès à des endroits comme le complexe d'Al-Aqsa, mais nous avons vu dans le passé qu'il l'a effectivement fait. Et souvent, cela a été très arbitraire en termes de temps et de conditions qu'ils ont mis en termes de restrictions d'accès, mais, plus important encore, comment cela a conduit, en particulier au cours des deux dernières années, à de graves escalades de la violence.
AMY GOODMAN : Dans le prochain segment, nous allons parler plus en détail de cet exposé du Washington Post qui dit que les États-Unis ont tranquillement inondé Israël d'une centaine de transferts d'armes, qui n'ont pas été, pour la plupart, approuvés par le Congrès, à une écrasante majorité. Pouvez-vous nous parler de l'importance de la déclaration du président Biden : « Nous devons acheminer plus d'aide à Gaza. Il n'y a pas d'excuses. Aucune », mais en même temps, la chose qui arrête les bombardements israéliens, l'arrêt des groupes d'aide, les États-Unis l'ont soutenue quand il s'agit de Gaza, avec l'appui de bombes, de missiles et de munitions ?
TAHANI MUSTAFA : Eh bien, c'est exactement cela que je veux dire. Les États-Unis n'ont pas fait grand-chose pour faire pression sur Israël afin qu'il limite une partie de la violence sur le terrain, qu'Israël limite l'intensité de sa campagne militaire. Et dans le même temps, il se plaint maintenant qu'il n'y a pas suffisamment de voies pour acheminer l'aide.
Les États-Unis ont le pouvoir de s'assurer qu'il y a suffisamment de voies d'acheminement de l'aide. Les États-Unis ont le pouvoir de s'assurer qu'Israël respecte les mesures provisoires énoncées par la Cour Internation de Justice lorsqu'ils ont affirmé qu'Israël avait des comptes à rendre en matière de génocide. Mais il ne l'a tout simplement pas fait. Il n'y a absolument aucune ligne rouge, aucune pression n'est exercée sur Israël. Et pire encore, nous assistons à des baisses d'aide de ce genre où, même en termes de valeur nutritionnelle et d'aide suffisante. Les aides sont loin de répondre aux besoins de la plupart des Gazaouis du nord. Je veux dire, c'est honnêtement plus une sorte de posture d'une diplomatie inefficace des États-Unis qu'autre chose.
NERMEEN SHAIKH : Tahani, vous êtes normalement basé – en dehors de Gaza, pouvez-vous nous parler de la situation en Cisjordanie occupée depuis le 7 octobre ?
TAHANI MUSTAFA : La situation est incroyablement désastreuse. Et, malheureusement, compte tenu de toute l'attention médiatique sur Gaza, il n'y a pas vraiment eu beaucoup d'attention sur les nombreuses violations qui ont eu lieu en Cisjordanie, où nous avons – au cours du premier mois seulement, nous avons vu une augmentation de la violence des colons israéliens, où nous avons vu environ 15 communautés palestiniennes déplacées. Nous avons vu la Cisjordanie être soumise à un siège économique, qui dure jusqu'à aujourd'hui, soit dit en passant. Il y a eu des restrictions de mouvement, où la capitale administrative de l'AP a été coupée de la partie nord de la Cisjordanie en raison de l'érection de points de contrôle de fortune et de fermetures de routes et de barrages routiers.
Pire encore, vous avez vu, avant le 7 octobre que la plupart des points chauds en Cisjordanie se trouvaient principalement dans le nord, dans des endroits comme Jénine et Naplouse. Maintenant, cela s'est à peu près répandu un peu partout. Vous voyez apparaître des endroits où le militantisme n'était pas un problème avant le 7 octobre, dans des endroits comme Tubas, dans des endroits comme Hébron. Pire encore, vous voyez des images similaires à celles que vous avez vu lors de la destruction de localités à Gaza. Vous voyez maintenant exactement les mêmes images, mais à plus petite échelle, dans des endroits comme le camp de réfugiés de Jénine, dans des endroits comme le camp de réfugiés de Tulkarem, où les soldats israéliens sont entrés et ont rasé ces localités, ces quartiers, jusqu'au sol. où ils ont détruit les lignes électriques, l'assainissement de l'eau, les centres culturels, qui servaient autrefois de forme d'expression civique et de mécanismes permettant aux jeunes Palestiniens d'évacuer leurs frustrations sous des formes plus pacifiques, n'est-ce pas ? Mais vous avez vu les jeunes générations être davantage influencées, par nécessité, vers le militantisme et la résistance armée, dans ces quartiers qui sont pratiquement devenus inhabitables.
Donc, vous savez, vous avez vu une augmentation significative de la violence, non seulement de la part des colons, mais aussi des soldats israéliens. Du 7 octobre à aujourd'hui, rien qu'en Cisjordanie, nous avons vu quelque chose comme 420 Palestiniens tués, et la majorité d'entre eux l'ont été par des opérations de recherche et d'arrestation et des assassinats ciblés.
AMY GOODMAN : L'un des enjeux du cessez-le-feu est la libération d'otages, ainsi que de prisonniers palestiniens. Parlez du nombre de Palestiniens qui ont été arrêtés depuis le 7 octobre – par exemple, en Cisjordanie occupée. S'agit-il de quelque chose comme, eh bien, plus de 7 000 ? Combien d'entre eux sont des enfants ? Combien d'entre eux ont moins de 18 ans ? Et de quoi ont-ils été accusés ?
TAHANI MUSTAFA : Eh bien, la majorité de ceux qui ont été arrêtés sont — environ 7 000 — une proportion importante d'entre eux sont des enfants, vous savez, des personnes de moins de 18 ans. Et en termes de charge, ils n'ont été accusés de rien. Il s'agit d'une détention administrative, où ils peuvent être détenus indéfiniment sans inculpation ni procès. Et cela peut aller de n'importe quel type d'activité, qu'il s'agisse de loker un post Facebook ou simplement d'exprimer toute forme de solidarité avec Gaza. Les Israéliens n'ont pas vraiment besoin d'excuses ou de raisonnements légitimes pour arrêter des gens en Cisjordanie. Il s'agit d'arrestations très arbitraires. Et, je veux dire, ces arrestations peuvent aller de 50 à 100 par jour. Ce sont quellques-uns des chiffres que nous avons vus, depuis le début du 7 octobre.
Et je pense qu'il vaut la peine de rappeler à vos téléspectateurs qu'il s'agit d'une population qui n'a rien à voir avec les événements du 7 octobre. Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas s'est exprimé immédiatement après les attentats du 7 octobre et a condamné à la fois le Hamas et la résistance armée, affirmant que la résistance armée n'était pas un moyen d'autodétermination. Et pourtant, nous avons vu le châtiment collectif infligé à une population qui, comme je l'ai dit, n'avait rien à voir avec les événements du 7 octobre.
NERMEEN SHAIKH : Et, Tahani, pourriez-vous expliquer ? Je veux dire, il y a eu un certain nombre de détenus de Gaza, 27, qui sont morts en détention. Si vous pouviez nous expliquer, vous savez, qui sont ces gens ?
TAHANI MUSTAFA : Encore une fois, ces arrestations sont incroyablement arbitraires. Vous savez, ils ont effectivement arrêté des hommes, des femmes et des enfants. Nous avons vu des soldats israéliens, littéralement, publier des images et des vidéos d'eux-mêmes en train de torturer, d'arrêter et de retenir, encore une fois, des jeunes hommes, des femmes, des enfants sur des comptes de médias sociaux comme Telegram, TikTok, vous savez, publiant beaucoup de ces crimes, ce qui équivaut, effectivement, à des crimes de guerre sur les médias sociaux, ce qui montre vraiment le niveau d'impunité. Israël sait qu'il peut s'en tirer.
Et comme je l'ai dit, ces arrestations ont été très arbitraires. Souvent, ces personnes ne sont pas affiliées au Hamas. En fait, je pense qu'il y a quelques mois, nous avons vu – et c'était en fait quelque chose de surprenant – la façon dont Israël a essayé de trafiquer ces images pour montrer qu'ils étaient des militants, alors qu'en fait ils ne l'étaient pas. Ainsi, beaucoup de ceux qui ont été arrêtés sont des civils ordinaires de Gaza qui n'ont absolument aucune affiliation à une faction politique particulière.
AMY GOODMAN : J'aimerais vous poser une question sur le fait que l'Afrique du Sud s'adresse une fois de plus à la Cour internationale de Justice, qu'elle prenne des mesures d'urgence supplémentaires à Gaza, y compris l'ordre d'un cessez-le-feu. Bien sûr, l'Afrique du Sud a porté l'affaire de génocide contre Israël devant la Cour, mais a déclaré : « La menace d'une famine totale s'est maintenant matérialisée. Le tribunal doit agir maintenant pour mettre fin à cette tragédie imminente. Tahani ?
TAHANI MUSTAFA : Je veux dire, écoutez, je pense, dans la pratique, vous savez, le droit international est inutile. Il n'est utile que dans la mesure où les puissants le permettent. Et, vous savez, à bien des égards, les audiences de la CIJ ont été stimulantes, en ce sens que c'est la première fois qu'Israël est tenu de rendre des comptes dans le luxe de l'impunité qui dure depuis des décennies et dont il a pu s'en tirer. Mais en même temps, nous avons vu que depuis que la CIJ a ordonné à Israël de prendre des mesures provisoires, Israël ne l'a pas fait. Et pire encore, il n'y a eu absolument aucune pression pour s'assurer qu'Israël le fasse. Nous avons assisté à la suppression du financement d'organisations comme l'UNRWA, qui ont été la principale source d'aide et d'assistance aux personnes sur le terrain. Nous avons vu, vous savez, je pense que plus de 15 000, voire 20 000, Palestiniens ont été tués depuis que la CIJ a émis des mesures provisoires. Et nous n'avons vu absolument aucune pression sur Israël pour qu'il essaie de se contenter d'un cessez-le-feu ou d'une quelconque pause.
NERMEEN SHAIKH : J'aimerais vous poser une question au sujet de l'UNRWA. Le Canada a déclaré qu'il reprendrait le financement de l'agence, après avoir interrompu son soutien en janvier à la suite d'affirmations israéliennes selon lesquelles 12 membres du personnel étaient impliqués dans l'attaque du 7 octobre. Pourriez-vous nous parler de ce qui se passe avec le financement de l'agence et de l'impact du retrait de tant de pays, y compris les États-Unis, qui sont le plus grand bailleur de fonds, ou qui l'ont été ?
TAHANI MUSTAFA : Eh bien, à l'heure actuelle, l'UNRWA ne tient qu'à un fil. Nous avons assisté à une reprise du financement et à des fonds supplémentaires provenant de diverses autres sources, mais l'UNRWA tient vraiment un fil. Et le pire, c'est qu'il n'y a absolument aucune organisation capable de combler ce vide. Vous savez, il y a eu des tentatives d'obtenir des organisations comme le Programme alimentaire mondial, mais elles n'ont tout simplement pas la capacité de faire ce que fait l'UNRWA. Vous savez, aucune organisation n'est aussi intégrée dans l'infrastructure civique de Gaza que l'UNRWA. Et plus important encore, il ne peut pas – il ne peut pas se substituer à la plupart des services fournis par l'UNRWA, ce qui, de l'aveu même du PAM, ne peut pas se substituer à la plupart des services fournis par l'UNRWA. Donc, à l'heure actuelle, vous savez, l'UNRWA ne tient vraiment qu'à un fil et aux conséquences de tout type d'assèchement potentiel des fonds, et j'espère qu'il n'en arrivera pas là, mais si c'est le cas, ce sera incroyablement catastrophique.
AMY GOODMAN : Tahani, nous n'avons qu'une minute, mais nous voulions vous poser une question au sujet de Benny Gantz, membre du cabinet de guerre israélien, qui s'est rendu – sans autorisation, apparemment, de Netanyahu – à Washington, où il a rencontré Blinken, où il a rencontré la vice-présidente Harris, où Netanyahu a dit à l'ambassade d'Israël de ne pas coopérer avec ce qu'il a appelé un voyage non autorisé. Voyez-vous une scission qui pourrait faire tomber Netanyahou ?
TAHANI MUSTAFA : Il y a certainement eu une scission au sein de l'administration israélienne. Et c'est quelque chose qui a commencé à faire surface au cours des deux derniers mois entre l'establishment politique et militaire, mais même en interne au sein de l'establishment politique. De toute évidence, l'accueil de Gantz est substantiel pour la politique israélienne. Encore une fois, vous savez, c'est un signe de l'inefficacité de la diplomatie américaine, par laquelle, pour réitérer leur mécontentement à l'égard de la politique de Netanyahou, ils accueillent et s'engagent maintenant avec un politicien de l'opposition.
Mais encore une fois, cela ne change rien vraiment à la réalité sur le terrain pour les Palestiniens. Rien n'est sorti de cette réunion, où Israël était – vous savez, il n'y avait pas de lignes rouges posées en termes de ce qu'Israël peut et ne peut pas faire à Gaza. Là encore, aucune pression n'est exercée sur Israël. Simplement, vous savez, réaffirmer votre mécontentement à l'égard de la stratégie de Netanyahou en ce moment en vous engageant avec un politicien de l'opposition n'est pas suffisant pour réellement changer la réalité sur le terrain pour les Palestiniens.
AMY GOODMAN : Tahani Mustafa, nous tenons à vous remercier d'être avec nous, analyste principal de la Palestine à l'International Crisis Group. Elle est normalement basée en Cisjordanie occupée, à Ramallah, mais elle se joint à nous aujourd'hui depuis Doha pour un symposium auquel elle assiste sur la Palestine, organisé par Georgetown, au Qatar.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Journée internationale pour les droits des femmes Sororité avec les femmes d’Iran - « Femme, Vie, Liberté »

Les femmes sont les premières victimes du régime patriarcal iranien. La discrimination contre les femmes est institutionnalisée et organisée, comme le soulignent les lois misogynes en majeure partie fondée sur la charia, qui les placent au rang de citoyennes de seconde zone.
Tiré du Réseau syndical international de solidarité et de lutte
4 mars 2024
Par Union syndicale Solidaires
Outre le fait que le voile est obligatoire dans les lieux publics, les inégalités entre les femmes et les hommes sont criantes notamment en matière de droit pénal et de droit de la famille. Par exemple, le témoignage d'une femme au tribunal vaut la moitié de celui d'un homme, elles ne peuvent pas voyager sans la permission de leur mari, et en cas de divorce, les hommes conservent la garde des enfants. La loi autorise la conclusion d'un « contrat de mariage temporaire », qui sert souvent de couverture légale à la prostitution et au tourisme sexuel. La législation permet par ailleurs le mariage des filles à partir de 13 ans.
Cet arsenal législatif entrave la place des femmes dans la société. Alors qu'elles représentent plus de la moitié des diplômé-es des universités, le taux de chômage des femmes est le double de celui des hommes.
Un rapport d'Amnesty International publié en décembre dernier souligne l'horreur que les femmes ont subi dans les prisons et les lieux publics, suite à leurs arrestations arbitraires lors du soulèvement « Femme Vie Liberté ». L'ampleur des violences sexuelles et des viols perpétrés par les membres de l'appareil répressif témoigne que l'oppression de genre est un marqueur identitaire de ce système dictatorial.
Outre ces actes de torture, qui permettent au régime de recueillir des aveux forcés et de les condamner à mort, les femmes sont également victimes de conditions de détention inhumaines dans les prisons iraniennes. Très souvent, les forces de sécurité refusent que les victimes reçoivent les soins médicaux nécessaires.
Face à ces violences les réponses judiciaires apportées aux victimes sont biaisées. Et cela d'autant plus que les femmes sont sous-représentées au sein de l'appareil judiciaire : le métier de juge leur est par exemple interdit.
Les victimes subissent donc en silence une impunité institutionalisée.
Les violences exercées sur les femmes dans les prisons ont toujours été brutales. Outre la volonté de domination masculine, le viol des prisonnières est un outil stratégique utilisé pour faire taire la contestation contre des décennies d'oppression.
Malgré cette répression brutale, le mouvement de contestation perdure, amplifié par les réseaux, car les femmes sont à l'avant-garde des mouvement sociaux. Elles restent déterminées à se réapproprier leurs corps, à acquérir leurs droits fondamentaux et se débarrasser de l'ensemble des lois et règlements misogynes faisant partie de l'ADN de ce régime.
Nous soutenons notamment :
Le droit essentiel des femmes à disposer de leurs corps ;
l'abrogation de la loi rendant obligatoire le port du hijab dans les lieux publics, ainsi que toutes les lois phallocratiques en vigueur.
Paris, le 4 mars 2024
P.-S.
https://laboursolidarity.org/fr/n/3070/sororite-avec-les-femmes-d039iran---femme-vie-liberte
Version en farsi : http://www.iran-echo.com/
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Chine : le budget militaire en hausse de 7,2 % en 2024 sur fond de crise

Comment analyser ce qui se dit à l'occasion des « deux Assemblées » ? Les réunions annuelles concomitantes du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CNCCPC) et de l'Assemblée Nationale Populaire (ANP) sont une mine de signaux faibles. Il faut savoir les décrypter, entre grandes orientations économiques et nominations stratégiques. Dans ce contexte, la Chine a annoncé mardi 5 mars une progression de son budget militaire, le deuxième du monde après celui des États-Unis, de 7,2 % en 2024, soit le même taux que l'an dernier. Une hausse rendue publique dans le rapport d'activité du gouvernement, publié en marge des travaux de ces deux assemblées aux ordres du pouvoir.[/asl-article-text]
Tiré de Asialyst
10 mars 2024
Par Pierre-Antoine Donnet
La Chine possède entre 400 et 500 ogives nucléaires opérationnelles et va probablement en avoir plus de 1000 d'ici 2030. (Source : Telegraph)
Pékin prévoit de dépenser 1 665,5 milliards de yuans (231,4 milliards de dollars) pour sa défense, soit trois fois moins que Washington. Le géant asiatique maintient une « croissance raisonnable » de son budget militaire afin de « sauvegarder sa souveraineté, sa sécurité et ses intérêts de développement », a justifié Lou Qinjian, le porte-parole de la session de l'ANP.
Les dépenses militaires de la Chine augmentent depuis plusieurs décennies, globalement à un rythme semblable à sa croissance économique. Mais cette tendance est vue avec suspicion par les États-Unis, l'Australie, l'Inde ou encore les Philippines, pays avec lequel la Chine se dispute le contrôle d'îlots et récifs en mer de Chine du sud. Elle suscite également des craintes à Taïwan, île de 23 millions d'habitants revendiquée par la Chine, laquelle espère « réunifier », par la force si nécessaire, ce territoire insulaire grand comme la Belgique avec le reste du pays.
D'après l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri), référence en la matière, les États-Unis restent le pays ayant les dépenses militaires les plus élevées, avec 877 milliards de dollars en 2022, selon les derniers chiffres disponibles. Suivent la Chine (292), la Russie (86,4), l'Inde (81,4), l'Arabie saoudite (75), le Royaume-Uni (68,5), l'Allemagne (55,8), la France (53,6), la Corée du Sud (46,4) et le Japon (46). Cette hausse du budget de la défense annoncée offre cependant un curieux contraste avec une crise économique inédite qui secoue la Chine depuis quelques années, illustrant ainsi la volonté du Parti communiste chinois (PCC) de poursuivre l'effort de guerre coûte que coûte, estiment les analystes occidentaux. De plus, le montant officiel des dépenses militaires du pays est notoirement très inférieur aux dépenses réelles, une opacité traditionnelle en Chine communiste qui, cependant, ne trompe guère les observateurs de ce pays.
Cet effort militaire a pour contexte des tensions entre la Chine et les États-Unis qui ne cessent de s'aiguiser depuis l'arrivée à la Maison Blanche du président Joe Biden en janvier 2022, tensions auxquelles s'ajoutent celles non moins virulentes avec le Japon et d'autres pays en Asie de l'Est. Il s'agit de la troisième année consécutive d'une hausse supérieur à 7 % en dépit du ralentissement marqué de la croissance du PIB depuis 2021.
Dans son projet de budget militaire, le ministère chinois des Finances a souligné la nécessité de concentrer les efforts sur des « domaines clés » représentant des « engagements obligatoires » pour renforcer les avancées technologiques. Cette hausse est en phase avec « la mise en œuvre complète de la pensée Xi Jinping sur le renforcement militaire ». Pékin, précise le document, « prévoit d'apporter des garanties financières plus fortes pour moderniser […] la défense nationale et les forces armées sur tous les fronts et consolider l'intégration des stratégies nationales de même que les capacités stratégiques ».
Les dépenses militaires représentent le cœur du budget chinois, soit quelque 40 % des dépenses totales du gouvernement central. Ces dépenses représentent dix fois celles consacrées à l'éducation et presque cinq fois celles réservées aux sciences et technologies. Le gouvernement chinois a insisté : les dépenses militaires représentaient « une priorité » alors que celles des autres secteurs sont toutes revues à la baisse « en accord avec les nécessités d'économies » budgétaires.
Le président Xi Jinping a régulièrement mis en avant la nécessité pour la Chine de renforcer ses capacités militaires pour être en mesure de faire face à un environnement qu'il juge de plus en plus hostile. Il met l'accent sur le fait que ces préparatifs sont réalisés à l'approche du centenaire de la création de l'Armée populaire de libération (APL) en 2027.
En septembre dernier, le sénateur américain Dan Sullivan, membre de la Commission militaire du Sénat à Washington, avait affirmé que le budget militaire « réel » de la Chine était en réalité proche de 700 milliards de dollars. Ce chiffre, avait-il précisé, est fondé sur l'analyse réalisée par les services de renseignement américains. S'il est avéré, ce montant est plus de trois fois supérieur au budget officiel annoncé par Pékin.
Les autorités chinoises n'ont fourni aucun détail sur la répartition de ces dépenses militaires mais, selon certains analystes occidentaux, l'essentiel concerne le secteur nucléaire militaire. Pékin s'efforce de rattraper son retard dans ce domaine avec les États-Unis. Lou Qinjian s'est contenté d'affirmer lors d'une conférence de presse le 4 mars que l'augmentation du budget de la défense était « raisonnable » dans le contexte économique de la Chine.
Le Premier ministre Li Qiang, de son côté, a expliqué le 5 mars que son pays entendait renforcer ses capacités militaires dans tous les domaines. « Nous, à tous les niveaux dans mon gouvernement, allons apporter un soutien fort au développement de la défense nationale. » La hausse du budget de la Défense doit être interprétée avec prudence lorsque les chiffres sont comparés aux données du Produit intérieur brut (PIB), car ils représentent des augmentations nominales et non réelles, souligne la revue Le Grand Continent.
Inquiétude japonaise
Cité le 4 mars par le mensuel américain The Diplomat, l'ancien ministre japonais de la Défense Hamada Yasukazu explique que le monde se trouve à un moment de changement historique : « La communauté internationale est confrontée à son défi le plus grand depuis la Seconde Guerre mondiale. » En effet, pour le Japon, le contexte régional ne pourrait pas être plus compliqué que maintenant : l'invasion russe de l'Ukraine a suscité une crise inédite en Europe tandis que la Chine ne cesse d'augmenter ses dépenses militaires à la fois sur le plan quantitatif et qualitatif, souligne la revue américaine.
Selon Akiyama Nobumasa, professeur à la School of Public and International Policy de l'université japonaise Hitotsubashi, la Chine pourrait posséder de 400 à 500 têtes nucléaires à brève échéance, un arsenal qui pourrait grimper à 1 500 têtes d'ici 2035. « Cet arsenal est très dangereux, ce qui provoque une inquiétude pour nous tous qui sommes les avocats de la dénucléarisation », dit-il, tout en ajoutant que la Chine diversifie sa panoplie de missiles nucléaires avec des missiles de longue portée capables de frapper n'importe où aux États-Unis. Pékin introduit également des missiles nucléaires de portée intermédiaire qui peuvent frapper le Japon, les Philippines, Guam et d'autres pays de la région, poursuit Akiyama Nobumasa. Mais cela a pour résultat de susciter l'inquiétude chez ses voisins. « Leur tendance à augmenter leur arsenal nucléaire qui ne répondrait selon eux qu'à la menace venant des États-Unis, suscite des questions : pourquoi alors des missiles de portée intermédiaire qui peuvent frapper des cibles plus proches tels que le Japon ? »
De ce fait, le Japon n'a d'autre choix que de préparer sa propre défense car Tokyo serait mal avisé de ne dépendre que des États-Unis. « Si la Chine augmente de façon considérable ses capacités nucléaires et la variété de ses missiles, nous sommes face à plusieurs défis, souligne Akiyama Nobumasa : le premier est qu'en cas de conflit international […] la Chine et les États-Unis [pourraient] s'engager dans une guerre qui pourrait devenir nucléaire. Si tel était le cas, les Etats-Unis ne seraient plus réellement en état d'aider le Japon si la guerre devait s'étendre à l'Asie. » Conséquence des risques de conflit croissants en Asie, le Japon renforce ses liens avec ses voisins dans la région : les Philippines, la Corée du Sud, l'Australie, l'Inde, le Vietnam, l'Indonésie, Singapour et d'autres pays encore. « La Chine augmente le nombre de ses missiles nucléaires et la Corée du Nord fait pareil. Pouvons-nous fermer les yeux ? »
Profonde mutation de l'armée chinoise
C'est la troisième année consécutive que la hausse franchit les 7 %, un chiffre bien supérieur à l'objectif de croissance établi à 5 %. Xi Jinping entend faire de l'APL une « force de classe mondiale » à l'horizon 2027, l'année du centenaire de sa fondation par le PCC. Le chiffre réel des dépenses militaires de Pékin est probablement bien plus important. Des analystes avancent que les sommes allouées à la recherche et au développement ne sont pas comprises dans ce montant. Et les régions contribuent également à l'effort de guerre qui n'a cessé de grimper. « Les dépenses militaires chinoises ont augmenté pendant vingt-huit années consécutives, rappelait l'année dernière l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. La Chine est restée le deuxième pays au monde, avec un montant estimé à 292 milliards de dollars en 2022. C'est 4,2 % de plus qu'en 2021 et 63 % de plus qu'en 2013. »
Depuis son arrivée au pouvoir en 2012, Xi Jinping a engagé une profonde mutation structurelle et stratégique de l'APL. L'une de ses priorités a été la sécurisation des frontières du pays. Sous sa direction, l'APL a désormais pour mission de se projeter vers la conquête des mers et du Pacifique. Étant le bras armé du PC, c'est la Commission militaire centrale du Parti qui a piloté cette modernisation à marche forcée. Instance suprême qui dirige l'armée, elle a réorganisé les sept régions militaires en cinq « théâtres de commandement » ou « zones de combats ». L'APL doit « se préparer au combat » et « gagner des guerres », affirmait Xi Jinping en 2016 en accélérant les grands travaux militaires. La Chine possède aujourd'hui la plus grande marine de la planète en nombre de navires avec une capacité de construction navale inégalée et trois porte-avions. Le dernier en date, le Fujian, est un monstre des mers de 85 000 tonnes, long de 320 mètres. Mis à l'eau en 2022, il est deux fois plus gros que le Charles-de-Gaulle et c'est le premier porte-avions 100 % made in China. Le 5 mars, l'amiral Yuan Huazhi a évoqué pour la première fois officiellement la construction d'un quatrième porte-avions. « Je vous dirai bientôt s'il est à propulsion nucléaire », a-t-il déclaré en réponse à la question d'un journaliste. Pour rappel, les États-Unis possède onze porte-avions.
Le régime communiste chinois entend imposer sa présence hégémonique en mer de Chine du Sud. Il a poldérisé et militarisé des îlots et des récifs et menace ainsi la souveraineté des États voisins. Dans les airs, l'APL peut aligner des avions de 5ème génération qu'elle est capable de produire tout comme la Russie et les États-Unis. Devant la Commission militaire du Sénat la semaine dernière, le chef du commandement spatial américain, le général Stephen Whiting, a reconnu que l'espace était devenu un « défi sécuritaire croissant » pour les États-Unis. Avant de prévenir que la Chine développait ses capacités militaires dans l'espace à un « rythme époustouflant ».
Mais ces ambitions chinoises restent entravées par des dysfonctionnements en série. Sans que l'on mesure pleinement ses limites et ses objectifs, la « guerre difficile et prolongée contre la corruption » va se poursuivre, selon le Quotidien de l'APL. Le pouvoir militaire a déjà connu de sérieux trous d'air en 2023, avec le limogeage de deux ministres de la Défense, de deux généraux commandant la stratégique Force des fusées, pourtant pensée, créée et dotée par Xi. Ils ont été remplacés sans explication.
Ces disparitions en série de responsables politiques et militaires et une chasse aux sorcières dans les milieux militaires ont suscité des interrogations sur la stabilité du régime. La Chine a changé deux fois de ministre de la Défense l'an passé. Retraité depuis mars 2023, l'ex-ministre Wei Fenghe n'apparaît plus en public, comme son successeur, Li Shangfu, limogé en octobre sans explication après quelques mois. D'autres hautes personnalités militaires, en particulier dans la branche de l'armée chargée des missiles nucléaires, ont été limogées sans explication. La corruption « doit être traitée » pour que l'armée puisse « espérer atteindre l'objectif du [président] Xi Jinping, qui est de supplanter les forces armées américaines en tant que première puissance militaire mondiale », note James Char, expert de l'armée chinoise à l'Université de technologie de Nanyang à Singapour.
La croissance militaire chinoise suscite également des craintes à Taïwan. Pékin a réitéré, mardi, son opposition à toute indépendance de Taïwan. « Nous nous opposons vigoureusement aux activités séparatistes visant à l'indépendance de Taïwan et aux ingérences extérieures », souligne un rapport d'activité du gouvernement consulté par l'AFP.
La Chine se dit inquiète des alliances militaires nouées par ses rivaux régionaux avec les Etats-Unis ou encore de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN), qui la présente désormais comme un « défi » pour les « intérêts » de ses membres. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, avait déclaré en janvier que la Chine « se rapproche de nous » : « Nous la voyons en Afrique, nous la voyons dans l'Arctique, nous la voyons essayer de contrôler les infrastructures critiques. »
Dans ce contexte, la Chine a mené en 2023 « une augmentation substantielle du nombre de ses ogives nucléaires », a déclaré à l'AFP James Char. Pékin comptait quelque 410 têtes nucléaires en 2023, loin derrière Washington (3 708) et Moscou (4 489). « Les récents scandales de corruption dans l'armée soulèvent néanmoins des doutes quant à l'efficacité de sa force de missiles et au professionnalisme des forces militaires, explique à l'AFP Adam Ni, rédacteur en chef de China Neican, une lettre d'information sur l'actualité chinoise. Par ailleurs, les Américains ont une présence mondiale et des réseaux d'alliances, ce que la Chine ne peut avoir sur le court terme. » Washington compte des centaines de bases militaires à l'étranger, Pékin seulement une à Djibouti et une autre en construction au Cambodge.
« Compte tenu des lacunes de l'armée chinoise […] il paraît logique que Pékin n'ait ni les moyens ni l'envie de s'engager dans un conflit contre Washington ou de lancer une invasion […] de Taïwan, note James Char. Ce qui reste préoccupant, toutefois, ce sont les frictions [avec] les autres armées de la région, qui peuvent potentiellement déraper et dégénérer en conflit ouvert. »
Par Pierre-Antoine Donnet
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Fin des « obligations électorales » en Inde : un grain de sable dans la machine Modi

Alors que les élections législatives se profilent au printemps 2024, la Cour suprême indienne vient de prendre une décision historique mettant fin aux « obligations électorales », ces contributions financières anonymes aux partis politiques. Celles-ci ont été jugées « inconstitutionnelles » au motif qu'elles violent le droit à l'information des électeurs quant aux sources du financement politique.
Tiré du blogue de l'auteur.
Une analyse d'Aurélie Leroy, chercheuse au CETRI - Centre tricontinental.
Le système très controversé des « Electoral Bonds » a été introduit en 2017 par le gouvernement Modi pour formaliser les dons aux organisations politiques. Défendu par ses promoteur·trices comme un moyen de lutter contre l'argent noir dans les processus électoraux, il a été, dès le départ, fortement critiqué par des institutions de contrôle (comme la Banque centrale indienne et la Commission électorale) et par des opposant·es, qui y ont vu « une forme de corruption institutionnalisée » (The Wire, 26/02/2024) et « l'une des plus grandes fraudes à la démocratie électorale » (The Wire, 25/02/2024).
Le principe de ce mode de financement est simple. Des obligations sont achetées, sans limite, auprès de la State Bank of India (SBI) par des particuliers ou des entreprises pour ensuite être remises de manière anonyme aux partis politiques. En théorie, ces contributions sont donc anonymes, mais dans la pratique, la SBI, en tant que plus grande banque commerciale du secteur public, donc sous le contrôle du gouvernement, a donné au parti au pouvoir un accès non déclaré à ses données. Le nom des contributeur·trices est donc inconnu des électeur·trices, mais connu du pouvoir.
Le jugement rendu ce 15 février par la plus haute juridiction du pays est sans appel. Il rejette un système opaque et exige le droit pour les citoyen·nes de savoir qui finance les partis politiques. La Cour suprême somme également la SBI, vu l'imminence des élections, de cesser de vendre des « bonds » et de soumettre les détails des encaissements réalisés depuis 2019.
Cette décision représente un revers significatif pour l'homme fort de l'Inde. Elle le prive non seulement d'une source de financement dont il avait abondamment profité lors des scrutins de 2014 et 2019. Mais remet aussi en cause « la position morale du gouvernement » (Frontline, 16/02/2024) dans sa lutte contre la corruption, le cheval de bataille de Modi au cours de son premier mandat. La magistrature estime en effet qu'un tel système a permis aux entreprises donatrices d'offrir des pots-de-vin aux partis en échange de faveurs politiques ou de renvois d'ascenseur, à la base du « capitalisme de copinage » indien.
Lever le voile sur les contributeur·trices et les contreparties risque de causer quelques embarras au premier ministre, en raison de ses liens étroits avec des industriels comme Gautam Adani et Mukesh Ambani, qui ont exercé une influence grandissante sur le monde des affaires depuis son accession au sommet de l'État. Une situation d'autant plus fâcheuse qu'elle intervient quelques mois après le scandale autour de l'affaire Adani, accusé par Hindeburg Research de s'être rendu coupable de « fraude comptable éhontée, de manipulation d'actions et de blanchiment d'argent » (Le Monde, 19/11/2023). Cette récente décision de la Cour suprême met ainsi le doigt sur les relations fusionnelles et de dépendance mutuelle qui existent entre les mondes politique et une poignée de conglomérats privilégiés qui se partagent les richesses du pays. L'interdiction des obligations électorales n'est qu'une première étape, certes insuffisante, mais néanmoins indispensable pour réduire cette collusion qui gangrène l'économie et la politique indienne.
Cet acte fort replace aussi la Cour suprême, fortement affaiblie ces dernières années, dans un rôle de contre-pouvoir et de garante de la démocratie et de la Constitution. Il restaure une certaine confiance dans le pouvoir judiciaire et constitue « un point lumineux dans une longue série de verdicts judiciaires inexplicablement timorés » (Venkatesan, 2024). En 2023, la cour semblait en effet avoir baissé les bras et renoncé à s'opposer au pouvoir, en entérinant la décision prise par l'exécutif en 2019 d'abroger l'article 370 relatif à l'autonomie de l'État du Jammu-et-Cachemire ; ou encore en autorisant, toujours en 2019, la construction d'un temple hindou à Ayodhya sur les ruines de la mosquée Babri, démolie par des extrémistes hindous.
Les retombées de la décision de la Cour suprême sont potentiellement explosives en cette période de campagne pré-électorale. Les détails des obligations achetées depuis 2019 pourraient révéler quelles sont les entreprises ayant financé le principal parti au pouvoir et les avantages en retour qui leur ont été accordés (modification de réglementation, octroi de licence, etc.). Tout comme les « désavantages en retour » subis par les entreprises qui ont soutenu des partis de l'opposition. Si le processus en cours aboutit, les dons octroyés par les médias seront certainement, eux aussi, passés à la loupe. Cela pourrait entacher la crédibilité de certains organes de presse et de leurs contenus si des liens électoraux douteux sont identifiés.
Cette victoire judiciaire, sans juger de ses effets sur les prochaines élections générales, a permis de braquer les projecteurs sur les dysfonctionnements et les défaillances dans la marche de l'État et de l'économie. Elle est aussi un soubresaut démocratique bienvenu, qui freine le glissement progressif de l'Inde vers l'autoritarisme. Mais la démocratie indienne n'en reste pas moins vulnérable. « L'épisode des obligations électorales révèle les limites des contrôles institutionnels dans notre démocratie. Lorsqu'un pouvoir exécutif fort décide qu'il veut quelque chose, même quelque chose de dangereux et d'inconstitutionnel, il y a peu de résistance interne pour l'arrêter » (Patel, 2024).
Bibliographie
– Bardhan P. (2023), « Unmasking India's Crony Capitalist Oligarchy », Project Syndicate, 13 février, https://www.project-syndicate.org/commentary/gautam-adani-scandal-india-crony-captalism-by-pranab-bardhan-2023-02?barrier=accesspaylog
– Dieterich C. (2023), « En Inde, le scandale de l'affaire Adani embarrassant pour Narendra Modi », Le Monde, 19 novembre, https://www.lemonde.fr/economie/article/2023/11/19/en-inde-le-scandale-de-l-affaire-adani-remonte-jusqu-a-narendra-modi_6201125_3234.html
– Patel A. (2024), « Modi Government's Tryst with Electoral Bonds Should Neither Be Forgotten Nor Forgiven », The Wire, 20 février.
– The Wire (2024), « Humiliation and the Upending of Poll Narratives : The Impact of the SC's Electoral Bonds Judgment », 26 février.
– The Wire (2024), « Electoral Bonds : Where Did They Come From, Where Did They Go ? », 25 février.
– Venkatesan V. (2024), « Supreme Court declaring electoral bonds unconstitutional is a monumental defence of democracy », Frontline, 16 février, https://frontline.thehindu.com/columns/supreme-courts-decision-to-declare-electoral-bonds-unconstitutional-is-a-monumental-defense-of-democracy/article67852053.ece
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Entre bombardements, famine et déplacements forcés : Un Ramadhan si triste à Ghaza

Voici donc planté le décor de ce triste Ramadhan 2024 qui même pour nous, citoyens d'Algérie, n'aura pas la même saveur, affectés que nous sommes par ce qu'endurent nos frères palestiniens. Alors que dire de ce que ressentent ceux qui subissent depuis plus de cinq mois maintenant, depuis exactement 156 jours, un véritable déluge de feu et des violences en tout genre, entre la famine, le froid, la peur, les affres de l'arrachement…
Tiré d'El Watan.
Alors que les espoirs d'une trêve arrachée avant le début du Ramadhan sont complètement anéantis, c'est donc sous les bombes et dans un climat de terreur inouïe que les Ghazaouis s'apprêtent à accueillir le mois sacré.
Et c'est sans doute le pire mois de jeûne qu'auront à vivre les Palestiniens, et tout spécialement la population civile de Ghaza qui aura eu à subir une succession d'épreuves d'une ampleur inédite depuis le début de la guerre totale déclenchée par l'occupant israélien contre l'enclave palestinienne.
Les Ghazaouis sont confrontés à une machine de guerre impitoyable qui fauche quotidiennement une centaine d'âmes en moyenne. A quoi s'ajoute la violence du déracinement quand on sait que plus de 85% des habitants de ce minuscule territoire ont perdu leur maison et sont condamnés à l'errance.
Et il faut citer également la famine qui est en train de déchiqueter les entrailles des survivants. Selon le ministère de la Santé dans la bande de Ghaza, la malnutrition a fait 26 morts ces derniers jours, majoritairement des enfants.
Même si le volume de l'aide humanitaire qui arrive à Ghaza a connu une légère hausse à la faveur des largages humanitaires qui se succèdent, cela reste dérisoire comparé à l'ampleur des besoins. Les ONG et les responsables onusiens ne cessent de le rappeler : rien ne peut remplacer efficacement la voie terrestre pour l'acheminement des aides.
Et même le port temporaire annoncé par Biden, et qui serait en mesure de fournir « plus de deux millions de repas par jour », selon le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder, ne sera pas opérationnel avant deux mois, soit le temps nécessaire pour construire cette « jetée temporaire », d'après le même Ryder.
Des tablées en deuil
Voici donc planté le décor de ce triste Ramadhan 2024 qui même pour nous, citoyens d'Algérie, n'a pas la même saveur, affectés que nous sommes par ce qu'endurent nos frères Palestiniens. Alors que dire de ce que ressentent ceux qui subissent depuis plus de cinq mois maintenant, depuis exactement 156 jours, un véritable déluge de feu et des violences en tout genre, entre la famine, le froid, la peur, les affres de l'arrachement…
On est loin des ambiances « chamarrées » des mois de Ramadhan d'Orient. Le Ramadhan palestinien, cette année, sera, oui, plus âpre, plus âcre et plus dur que tous ceux qui l'ont précédé. Il faudrait peut-être remonter à l'année de la Nakba pour goûter à pareille amertume. Ghaza n'a guère le cœur aux préparatifs qui font que l'odeur du Ramadhan se fait déjà sentir avant même le commencement du jeûne.
Effroyablement démunie, désemparée, exsangue, la population de Ghaza n'a ni le cœur ni les moyens pour les caprices du mois gourmand. Ghaza affreusement défigurée, martyrisée, muée en nécropole géante. Les tablées de l'iftar à Ghaza, sous une tente vacillante, harcelée par le vent et les bombes, à la lueur d'une bougie, seront doublement dégarnies cette année. Dégarnies « gastronomiquement », mais surtout dégarnies socialement.
Car dans toutes les familles, il manquera des aimés à l'appel du muezzin. Le décor de ce Ramadhan noir, ce sont aussi tous ces lieux de culte réduits à leur tour en cendres. Mois de spiritualité, les Ghazaouis n'ont même pas de mosquée plus ou moins debout où prier. Ils vont devoir célébrer l'office des « tarawih » parmi les décombres des dômes et des minarets.
Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a adressé un message vidéo plein d'empathie pour le peuple palestinien à l'occasion de ce Ramadhan si particulier justement.
Si pesant. Le patron de l'ONU émet d'abord le vœu que « cette période soit utilisée pour créer une dynamique visant à mettre fin aux divisions, à aider ceux qui en ont besoin et à travailler ensemble pour la sécurité et la dignité de chaque habitant de ce monde ».
Il a insisté sur le fait que ce rituel « porte les valeurs de paix, de résilience et de générosité ». « Malheureusement, regrette-t-il, nombreux sont celles et ceux qui passeront ce mois dans les conflits, les déplacements forcés et la peur. » Et de lancer : « Mes pensées et mon cœur les accompagnent, de l'Afghanistan au Sahel, de la Corne de l'Afrique à la Syrie et au-delà.
Et je voudrais adresser un message particulier de solidarité et de soutien à celles et ceux qui souffrent des horreurs à Ghaza. » Nivine Al Siksik, une jeune maman palestinienne rencontrée par un journaliste de l'AFP, ne cache pas son désarroi.
Elle agite un « fanous » en plastique, une lanterne typique des accessoires du Ramadhan en Orient pour distraire sa petite fille sous une tente à Rafah. « Ces lanternes traditionnelles, appelées ‘fanous'', sont emblématiques du mois de jeûne.
Cette année, dans le territoire palestinien assiégé et dévasté par la guerre, elles sont sans doute les seuls signes de la préparation du Ramadhan » note le reporter de l'AFP. « Au lieu de manger comme chaque année de l'agneau et des pâtisseries traditionnelles dans leur maison du nord de Ghaza, Nivine Al Siksik et sa famille rompront le jeûne dans la tente partagée avec d'autres déplacés. S'ils trouvent quelque chose à manger », ajoute-t-il.
« Tout manque. Nous n'avons aucune nourriture à préparer », soupire la jeune maman. « Avant, le Ramadhan, c'était la vie, la joie, la spiritualité, les décorations et une merveilleuse atmosphère », se remémore son mari de 26 ans, Yasser Rihane. « Aujourd'hui, le Ramadhan arrive et nous avons la guerre, l'oppression et la famine », se désole-t-il.
« Nous n'avons que nos prières »
L'édition en ligne de BBC News Arabic a consacré il y a quelques jours, elle aussi, un reportage à l'atmosphère qui règne à Ghaza à l'approche du Ramadhan. Une journaliste du site a rencontré à cet effet plusieurs Ghazaouis. Parmi eux, Siham Hussein, une mère de six enfants, dont deux filles handicapées.
Elle a fui le nord de l'enclave pour chercher refuge près de la frontière avec l'Egypte, dans le gouvernorat de Rafah, où elle végète sous une tente. A la journaliste qui l'interroge sur les conditions de vie de la famille la veille du mois sacré, elle rétorque : « Comment apprécier le Ramadhan quand nous nous retrouvons dans cet état ?
Nous ne pouvons même pas manger ni boire ? » s'indigne-t-elle. Siham est profondément peinée en songent à ses deux filles handicapées : « Elles ne sont pas responsables de ce qui se passe. Tout ce qu'elles savent faire, c'est manger et boire. » Mme Hussein confie qu'elle ne dispose même pas de quoi « acheter une tomate ».
La journaliste s'entretient ensuite avec un homme de 53 ans qui a dix personnes à sa charge : Abou Shadi Al Ashqar. « Nous manquons de tout pour le Ramadhan et nous n'avons que notre patience et notre endurance pour accueillir le mois sacré », résume l'homme. « Nous avions pour habitude de décorer la maison à l'approche du Ramdhan et de faire la fête, mais pas cette année.
Il n'y a rien qui indique qu'on est aux portes du Ramadhan. Même les étals des commerçants sont vides. Ils n'ont que quelques conserves à proposer, et nous n'avons pas d'argent pour les acheter », témoigne-t-il. Ayad Bakr, un autre déplacé sexagénaire, père de sept filles, déclare que son vœu le plus cher est de se réveiller un matin sur le mot « trêve ».
L'homme est à bout. Le Ramadhan pour lui ne vaut que par la force spirituelle qu'il insuffle aux survivants du génocide. « Nous n'avons rien pour accueillir le Ramadhan hormis notre foi et nos prières », souffle-t-il, selon le reportage du site de BBC Arabic.
« Les boîtes de conserves sont les seules denrées disponibles dans la bande de Ghaza et elles sont à des prix exorbitants. » Et de s'emporter : « Comment jeûner ou s'autoriser un s'hour ? Les conserves seront-elles nos repas éternels ?
Je ne sais pas comment nous allons faire pour nous accommoder de cette calamité ! » Youcef Shaaban, un déplacé originaire de Cheikh Radwan, dans la ville de Ghaza, et qui s'est établi à Tall Al Soltane, dans la ville de Rafah, fait remarquer pour sa part : « C'est un Ramadhan difficile à un niveau inédit », en pointant notamment la pénurie généralisée qui a frappé les bazars habituellement animés de Ghaza.
Il dénonce les spéculateurs et autres profiteurs de guerre : « Ici, nous sommes en guerre à la fois contre les Israéliens et contre les commerçants. Quand je vais au marché, je me contente de reluquer les produits sans pouvoir en acquérir aucun. Il n'y aura aucune provision pour le Ramadhan cette année. Nous confions notre sort à Dieu. »
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’ultimatum israélien sur le Liban expire le 14 mars

L'ultimatum fixé par Tel-Aviv pour un règlement diplomatique de l'embrasement sur le front libanais expirerait le 14 mars, date à laquelle Israël serait prêt, dit-on, à imposer sa propre solution qui consiste notamment à repousser le Hezbollah loin de sa frontière nord. Benny Gantz, membre du cabinet de guerre israélien, avait déjà mentionné cette échéance, il y a deux semaines.
Tiré de MondAfrique.
Associées aux récentes menaces israéliennes contre le Liban, notamment celles du ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, qui avait précisé, le 3 février 2024, qu'une trêve à Gaza ne s'étendra pas forcément à la frontière au Liban, les informations sur l'ultimatum israélien font craindre un élargissement du conflit entre le Hezbollah et le Liban.
Par la voix de Gallant, Tel-Aviv demeure déterminé à poursuivre ses opérations militaires contre le Hezbollah « jusqu'au rétablissement de la sécurité pour les résidents des kibboutz du nord » israélien.
Dans le même temps, il répète à l'envi qu'il ne veut pas d'une guerre avec le Liban et qu'il reste favorable à une solution diplomatique qui assurera la sécurité des habitants du nord d'Israël. Yoav Gallant a ainsi réitéré, mardi, à l'émissaire américain, Amos Hochstein, l'engagement de l'État hébreu en faveur des « efforts politiques » pour une solution à la frontière sud, sans toutefois écarter l'option militaire pour sécuriser sa frontière nord.
Quelle option finira par l'emporter, surtout qu'Israël alterne le chaud et le froid à l'encontre du Liban ? Le risque d'une potentielle opération israélienne d'envergure contre le Hezbollah est-il réel ? Ou, au contraire, Israël fait-il monter les enchères pour accélérer une solution diplomatique ? Autant de questions qui se posent.
Dans les milieux diplomatiques à Beyrouth, on se veut plus ou moins rassurant. Selon une source diplomatique occidentale contactée par Ici Beyrouth, l'échéance de la mi-mars ferait partie de « la guerre psychologique » israélienne qui va de pair avec un volet militaire qui reste envisageable. Ce genre de « déclarations agressives » faites par Israël « n'est pas nouveau », rappelle-t-on de même source.
Le problème est que les contours d'une solution diplomatique ne sont toujours pas clairs. Il semble d'ailleurs qu'il y ait actuellement deux initiatives distinctes, l'une française et l'autre, américaine, qui vont dans le sens d'un règlement politique, mais qui suivent deux trajectoires différentes. Celle de la France avait été présentée aux autorités libanaises en février dernier et prévoit, entre autres, un retrait des combattants du Hezbollah à une distance de 10 kilomètres de la frontière sud, ainsi que le déploiement de 15.000 soldats de l'armée libanaise dans les régions frontalières.
Il s'agit d'un plan en trois étapes, la première étant une accalmie de 10 jours, suivie d'un retrait des combattants du Hezbollah, puis de négociations au sujet de la frontière libano-israélienne.
Les propositions de règlement américaines restent cependant entourées du plus grand secret. Elles avaient été soumises par Amos Hochstein au président de la Chambre, Nabih Berry, qui est censé les soumettre à son tour au Hezbollah.
La feuille de route française a pour but de « montrer aux belligérants qu'une solution politique est possible », affirme-t-on de même source, en relevant que l'initiative américaine ne comprend, en revanche, « aucun papier concret ». Elle demeure « très secrète, aucune information n'ayant fuité », au sujet de sa teneur, d'après la même source. Ce qui laisse, pour le moment, les perspectives de résolution politique dans le flou.
Comme l'échéance de la mi-mars coïncide avec le début du Ramadan, dont on dit qu'il marquerait aussi le début d'une accalmie à Gaza, elle indiquerait ainsi « une imbrication entre la trêve discutée à Gaza et le front au Liban-Sud ». Or, les pourparlers engagés au Caire autour de cette trêve n'ont toujours pas débouché, même si on parle d'avancées. Celles-ci restent cependant hypothétiques.
Une logique du 50/50
Tous ces points d'ombre font dire à la source précitée, que « nous sommes toujours dans la logique du 50/50, dans le sens où le risque d'embrasement généralisé est égal aux chances d'une issue diplomatique, d'autant que les derniers développements montrent une volonté israélienne de dépasser toutes les restrictions géographiques, visant ses cibles partout sur le territoire libanais ».
Sollicité par Ici Beyrouth, un politologue libanais, qui a voulu garder l'anonymat, a également situé l'ultimatum israélien dans le cadre du « jeu des négociations ». « Cela permet à Israël d'avoir plus de crédibilité tout en accentuant la pression » sur le Hezbollah, afin d'atteindre ses objectifs, poursuit-il. Cela s'inscrit, selon lui, dans le cadre de la stratégie d' »escalade calculée », adoptée par Tel-Aviv dès le début des affrontements avec le Hezb, « même si l'armée israélienne a quelquefois enfreint les règles d'engagement » du conflit frontalier entre les deux parties.
Toujours selon la logique de cet analyste, qui laisse quand même entendre que toutes les options restent ouvertes, Israël n'a pas intérêt à s'engager dans une guerre de grande envergure avec le Liban, car celle-ci « ne lui apportera que davantage de problèmes ». « Il sera pris à son propre piège », commente-t-il.
L'État hébreu voudrait une solution radicale à sa frontière nord, « pour ne pas retourner à la situation d'avant le 7 octobre », explique-t-on de même source. Il tenterait donc, par tous les moyens, « d'exercer une pression sur le Hezbollah pour obtenir le retrait de ce dernier au sud du Litani », garantissant ainsi le retour des colons israéliens aux zones frontalières désertées dans le nord israélien.
Pour Tel-Aviv, les deux fronts, celui de Gaza et du Liban, sont clairement séparés. Il n'en reste pas moins que la situation est tellement critique et volatile qu'elle demeure exposée à n'importe quel retournement.
Toujours de même source, on évoque ainsi la Cisjordanie « où la situation chauffe, notamment à l'approche du mois du Ramadan, pendant lequel les Palestiniens se dirigeront pour la prière à la mosquée d'Al-Aqsa ». Dans ce contexte, le risque d'une « réaction agressive de la part de la droite radicale israélienne » pourrait, à n'importe quel moment, réveiller le volcan, avec les conséquences qu'on peut deviner.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.











