Derniers articles

Syndiquer les travailleur·euses autonomes

Le Syndicat associatif des travailleur·euses autonomes du Québec (S'ATTAQ) se consacre à la défense des droits des travailleur·euses autonomes. Quels sont les enjeux propres à cette condition d'emploi bien particulière, et quelles sont les stratégies d'organisation de S'ATTAQ ?
Propos recueillis par Isabelle Bouchard.
À bâbord ! : Quels sont les principaux mythes quant à la syndicalisation des travailleur·euses autonomes ?
Selena Phillips-Boyle : Il y a de nombreuses faussetés qui circulent. On entend souvent qu'il est impossible de les syndiquer étant donné leur dispersion à travers différents milieux et différentes industries. C'est vrai que cette situation rend la syndicalisation plus difficile que pour des emplois salariés typiques, mais elle n'est pas impossible. Nous en sommes la preuve. Il faut, en tant qu'officières et officiers syndicaux, faire preuve d'imagination et utiliser les leviers qui s'offrent à nous. Par exemple, dans le cas de celles et ceux qui exercent dans le numérique, il est aisé de trouver des données qui nous permettent de les identifier. La communication avec eux et elles s'en trouve simplifiée et nous pouvons alors mieux appliquer nos principes d'agitation, d'éducation, d'organisation et de syndicalisation.
Un autre mythe, c'est de penser qu'il y a de plus en plus de travailleuse·eurs autonomes au Québec alors qu'il n'en est rien. En fait, leur nombre est assez stable. On parle de 550000 personnes. Si, à une certaine époque, elles étaient surtout concentrées dans le domaine de l'agriculture, force est de constater qu'actuellement, elles œuvrent dans une multitude de secteurs professionnels. Il faut aussi savoir que des travailleurs·euses autonomes travaillent parfois dans plus d'un secteur ou dans plus d'une industrie à la fois.
ÀB ! :L'existence du statut de travailleur·euses autonomes est-il une fatalité ou un choix ?
S. P.-B. : L'idée que les travailleuse·eurs autonomes choisissent leur statut relève aussi du mythe, en tout cas pour les membres de notre syndicat. Selon cette vision romancée, le travail automne est un travail idéal parce qu'il permet le choix de l'industrie pour laquelle s'effectue le contrat, le choix du lieu de travail, l'autonomie dans la détermination du nombre d'heures que la personne consacre et une grande flexibilité dans l'horaire de travail. À cette vision romancée s'ajoute l'idée généreuse que le travailleur ou la travailleuse autonome est libre puisque sans patron pour l'exploiter. C'est sans prendre en compte que les conditions concrètes du travail autonome sont en elles-mêmes exploitantes !
Même certain·es travailleurs et travailleuses autonomes font semblant qu'elles ou ils choisissent librement leur statut. Pourtant, le travail autonome existe parce que les entreprises n'offrent pas de postes à temps plein ni à temps partiel, d'ailleurs. Le travail autonome, c'est une manière pour elles d'épargner de l'argent parce qu'elles n'ont pas à accorder de (bonnes) conditions de travail. Elles ne donnent pas de vacances, pas plus que de congé maladie ni de congé parental. Tout cela relève du privilège individuel. Les industries ne fournissent pas de local ni d'équipement de travail. La charge revient aux travailleuses et travailleurs de se les procurer. Il s'agit vraiment d'une logique néo-libérale à laquelle s'ajoute une condition salariale injuste. En effet, beaucoup de travailleurs et travailleurs autonomes ne gagnent pas plus que le salaire minimum, en tout cas chez nos membres.
Le travail autonome est la prochaine étape du capitalisme. C'est une conception du travail qui profite largement des éléments qui sont à la charge des travailleurs et travailleuses autonomes. La situation s'est gravement transformée avec cette pandémie qui a conduit plusieurs personnes à travailler plus à la maison, les rendant responsables de leurs outils de travail et ce, sans que les salaires soient ajustés en conséquence.
ÀB ! :Le carburant traditionnel du syndicalisme est (devrait être) la mobilisation de ses membres. Quelles stratégies de mobilisation avez-vous déployées ou comptez-vous déployer ?
S. P.-B. : Au début de la pandémie, nos membres étaient mieux organisé·es que les autres étant donné qu'ils et elles avaient déjà l'habitude d'avoir un bureau à la maison, de travailler seul·es et à distance. Mais actuellement, c'est vraiment difficile. Les gens sont vraiment épuisés et les troubles de santé mentale sont nombreux. À titre de d'officière de mobilisation interne, je tente de redémarrer la mobilisation. Je propose aux membres des sessions de cotravail en ligne, des moments de lunchs communs et aussi des 5 à 7 à distance. Je tente d'organiser des événements à saveur plus sociale. Éventuellement, nous allons remettre sur pied des formations syndicales sur une base plus régulière. Toutefois, notre activité de mobilisation principale, c'est d'organiser des campagnes de syndicalisation dans des industries. C'est la base de notre action.
ÀB ! : Dans un monde idéal, à quoi ressembleraient les normes du travail pour les travailleuses et travailleurs autonomes ? Quelles sont vos inspirations en la matière ?
S. P.-B. : Déjà, les normes du travail au Québec ne sont pas très généreuses pour les salarié·es, alors, pour les autonomes, elles sont tout à fait obsolètes. Il serait urgent de légiférer en premier lieu pour fixer un maximum de seize jours pour être payé·e comme c'est le cas pour les personnes salariées typiques.
La ville de New York est très inspirante pour la construction d'un modèle de travail autonome plus respectueux. Sa loi selon laquelle« freelance isn't free » (le travail autonome n'est pas gratuit) est très inspirante pour notre syndicat. La loi fixe un maximum de jours pour la rémunération des travailleuses et travailleurs autonomes et accorde un recours officiel si cette clause n'est pas respectée. Les personnes ne sont pas laissées à elles-mêmes comme c'est le cas pour nos membres lorsqu'il y a des litiges. De plus, la loi new-yorkaise exige la signature d'un contrat pour tout mandat d'une valeur de plus de 800$US commandé par une entreprise à un·e travailleur·euse autonome. En outre, le programme prescrit un modèle de contrat ainsi qu'un recours officiel en cas de difficulté dans l'application des clauses du contrat type. En sachant que la plupart des travailleuses et travailleurs autonomes sont sans contrat officiel, en tout cas chez nos membres, cette loi prend tout son sens.
Nous sommes aussi inspirée·es par d'autres campagnes qui s'intéressent notamment à la santé et à la sécurité des travailleurs et travailleuses. Par exemple, avant 2019,les agences de placement n'avaient pas d'obligation de sécurité envers les travailleur·euses qu'elles plaçaient dans les industries et celles-ci n'en avaient pas non plus. Il y avait un grand vide. La sécuritédes travailleur·eusesqui avaient recours aux services de placement n'était absolument pas prise en compte. Grâce à la campagne du Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (CTI), les lois ont changé. Il est souhaitable que cetteresponsabilité à l'endroit de la sécurité s'applique à toutes les personnes qui occupent un emploi autonome.
Finalement, dans un monde idéal, le travail autonome compterait pour le chemin d'immigration, ce qui n'est pas le cas actuellement. Le travail autonome n'est pas tenu en compte aux fins du statut d'immigration, ce qui est une injustice flagrante. Il est grand temps que le travail autonome cesse d'être invisibilisé.
ÀB ! :Quelles sont vos principales campagnes de syndicalisation ?
S. P.-B. : Le S'ATTAQ étant membre des Industrial Workers of the World (IWW), il organise, depuis 2017, des campagnes de syndicalisation qui suivent les mêmes principes que l'organisation mère. Il s'agit de principes de base comme l'anticolonialisme, l'antiracisme, l'anticapitalisme et l'inclusion des personnes queers. Nous tentons aussi d'organiser des campagnes bilingues, même si la plupart de nos membres sont anglophones. De plus, nous adhérons au principe de non-hiérarchie, ce qui fait que chaque membre peut apporter des idées et des projets et que chaque personne peut changer les orientations des campagnes d'organisation.
Pour moi, le plus important était d'abord de créer un sentiment d'appartenance entre les travailleur·euses autonomes, parce que le système capitaliste actuel les individualise tellement. Or, plus nous sommes isolé·es, moins nous avons de pouvoir sur notre situation professionnelle. Pour répondre à cet objectif, nous avons d'abord organisé différents projets, comme des sessions de cotravail entre travailleur·euses autonomes et des ateliers d'éducation populaire sur des sujets propres au travail autonome (rédaction de contrats, de demande de bourses, de rapport d'impôts, etc.). Le but de ces activités était de développer des liens entre les membres.
Puis, les premières campagnes de syndicalisation visaient les pigistes dans les domaines du journalisme, du jeu vidéo et du milieu des aides domestiques. Actuellement, nous tenons des campagnes dans l'industrie du sexe et une autre dans le milieu de la traduction. Nous organisons aussi des actions directes comme Réclame ta paye ou Réclame ton respect en appui à des membres qui sont privé·es de leurs droits. Nous vous invitons à appuyer ces campagnes d'amélioration des conditions de travail.
Selena Phillips-Boyle est officière au Syndicat associatif des travailleuses et travailleurs autonomes du Québec (S'ATTAQ) de la branche IWW de Montréal.
Propos recueillis par Isabelle Bouchard.
Illustration : Elisabeth Doyon

La langue française est straight

Les luttes queers, comme elles se jouent inévitablement sur le terrain de la langue, invitent à la révolution linguistique, ce qui n'est pas sans causer de vives réactions. Retour sur la controverse autour du pronom « iel » en français.
Peu d'ajouts aux dictionnaires de langue française ont créé autant de controverse que celui, en 2021, du pronom « iel » dans la version numérique du dictionnaire Le Robert, dont la mission est descriptive. Pourtant, la même année, les mots « sérophobie », « cododo » et « bouquinerie », pour n'en nommer que trois, ont aussi fait leur apparition dans Le Petit Robert, la version papier (et prescriptive) du dictionnaire de l'Académie française, sans soulever de tollé. Chaque année, de « nouveaux » mots s'ajoutent en effet au répertoire lexical de toutes les langues standardisées qui font l'objet de dictionnaires. Ces mots n'ont d'ailleurs rien de nouveau, ils existent déjà : ils sortent de la bouche des gens et circulent par le fait même dans l'espace social depuis longtemps. La norme accuse effectivement des années de retard sur l'usage (et non l'inverse), et les gens n'attendent pas nécessairement qu'un mot apparaisse comme par magie dans le dictionnaire de l'élite française pour nommer le monde qui change autour d'eux, et pour se nommer eux/elles/elleux/iels—mêmes.
La levée de boucliers à l'annonce de l'inclusion du pronom « iel » est due au fait que celui-ci force une faille à la fois dans la langue française et dans la binarité de genre, puisque c'est le système grammatical tout entier, lui-même fondé sur la binarité féminin/masculin, qu'il remet en question. Au-delà de symboliser le changement linguistique, le pronom rend visibles les gens qui ne s'identifient ni comme hommes, ni comme femmes, ou entre les deux, ou les deux, ce que beaucoup de gens ont du mal à concevoir. C'est que le pronom « iel » signale, pour reprendre les propos de Paul B. Preciado, non pas une nouvelle identité délimitée et facilement reconnaissable (ce qu'on pourrait appeler un troisième genre), mais bien une désidentification vis-à-vis des identités dominantes (les catégories homme/femme, mutuellement exclusives) qui n'aspire pas pour autant à forger une nouvelle identité fixe. [1]
Une telle désidentification (aux genres binaires, mais aussi aux pronoms, aux accords grammaticaux, et par conséquent aux formes linguistiques sanctionnées et reconnues comme légitimes) est déstabilisante. C'est qu'on a tendance à croire que les catégories identitaires (sexuelles ou linguistiques) qui nous définissent sont naturelles, qu'elles découlent de l'ordre normal des choses. La plupart des gens s'identifient effectivement à des catégories prédéterminées, déjà disponibles, qui dicteront par la suite, à différents degrés, leurs possibilités de vie. Le pronom « iel » représente donc pour certains une perte de repères, puisqu'il pointe vers de nouvelles possibilités au-delà de ce qui est généralement (re)connu, familier et permis. Dans un monde construit pour favoriser des formes de vie très précises et homogènes (hétéros, monogames, capitalistes, monolingues, etc.), le pronom « iel » bouleverse à la fois l'ordre sexuel et l'ordre linguistique. Il brouille autant les frontières des identités de genre — et, par extension, des orientations sexuelles — que celles de la langue française.
La langue, une affaire de nation
La langue française, dans toute sa normativité, son académicité et son monolithisme, est straight. Les gens qui la défendent becs et ongles contre ce qu'ils présentent comme des menaces extérieures ne réservent aucune place à la déviance, à l'exploration, à la nouveauté ; l'objectif serait de préserver le français, ce qui insinue qu'il existe dans un état canonique, ancien et pur, voire naturel, dont il faut assurer la reproduction. Or la langue française, comme toutes les autres langues nationales et standardisées, est une construction sociale, solidifiée au 19e siècle avec l'émergence de l'État-nation capitaliste en Europe pour servir de pilier unificateur et d'outil de communication (ou de propagande, c'est selon) à celle-ci. Ce qu'on appelle maintenant une « langue » est en vérité un ramassis de formes linguistiques autrement disparates qu'on a au cours de l'histoire fixées, homogénéisées, rapatriées sous le même drapeau : anglais, italien, français. Tout ce qui tombe en dehors des limites ainsi construites du français — le pronom « iel » et les problèmes d'accord qu'il suscite, mais aussi les « anglicismes », les fautes d'orthographe, les « accents étrangers » — figure donc comme menace à l'homogénéité (ethno)linguistique de la nation.
Le pronom « iel » figure doublement comme menace à la nation du fait qu'en plus de transgresser la norme linguistique, il chamboule l'ordre hétéronormatif et patriarcal en évoquant de nouvelles identités de genre et de nouvelles sexualités qui rompent avec la famille nucléaire et ses fonctions reproductives. La visibilité accrue de ces identités et sexualités, y compris dans la langue, révèle à de plus en plus de gens la nature construite, flexible et artificielle de la binarité de genre et des catégories qui en découlent (homme/femme, straight/gay). « Iel » est donc un problème doublement épineux pour la nation : iel corrompt le français et participe à l'érosion de l'outil de communication qui unit ses membres, et iel met en danger sa reproduction en menaçant son taux de natalité.
Les réactions au pronom « iel » visent ainsi à protéger le statu quo sur deux fronts : la normativité linguistique et la normativité sexuelle. Ce n'est pas une coïncidence si, au cours d'une même semaine au mois de mai 2022, le premier ministre François Legault a parlé de l'éventuelle disparition du français et des francophones au Québec (en faisant une comparaison boiteuse et condescendante avec la Louisiane), et l'élue républicaine Marjorie Taylor Greene a prédit l'extinction des personnes hétérosexuelles d'ici cinq générations aux États-Unis. Ce n'est pas non plus une coïncidence si, en novembre 2021, le chroniqueur Christian Rioux a ridiculisé le pronom « iel » et ses adeptes de la même manière qu'il ridiculise régulièrement les artistes s'exprimant en chiac et en franglais : en nous traitant de bébés gâtés, de fous furieux, de « handicapés », bref, en tentant de nous déshumaniser à coups d'insultes délibérément capacitistes. Les réactions au pronom « iel » sont un rejet en bloc non pas d'un simple pronom, mais de ce qu'il représente : il s'agit d'une négation des vies, des corps et des langues queer et d'un refus de brouiller les frontières, quelles qu'elles soient.
Parler queer
Quand des voix s'élèvent contre le pronom iel, quand on nous dit que son inclusion dans Le Robert en ligne est « destructrice des valeurs qui sont les nôtres » et qu'elle aboutira à une langue « souillée qui désunit les usagers plutôt que de les rassembler [2] », ce qu'on nous dit, c'est que le pronom (et ce qu'il représente) érode les valeurs nationales (lire : hétéropatriarcales). And you know what ? C'est vrai : la révolution queer veut voir tomber les frontières sexuelles, nationales et linguistiques. La révolution queer veut détruire les soi-disant valeurs nationales, car les communautés queer subissent régulièrement la violence de ces valeurs. La révolution queer reconnaît qu'elle est incompatible avec la nation, et travaille activement à créer un monde en marge de celle-ci plutôt que de chercher à s'y tailler une place. José Esteban Muñoz : « le là-bas de l'utopie queer ne peut être celui de la nation, qui est toujours très puissante bien qu'affaiblie. [3] »
La révolution queer ne se fera pas en français, ni en aucune autre langue standardisée, coloniale, rigide for that matter : elle se fera en chiac, en spanglish, en mi'kmawi'simk, pour autant que ces formes demeurent insaisissables et fugitives, c'est-à-dire queer et méconnaissables par l'État et le capitalisme. Vivre queer, faire queer, c'est d'abord et avant tout désinvestir dans les formes reconnues par l'État, le but étant de toujours produire des formes, des discours, des vies que le pouvoir sera incapable de reconnaître et de hiérarchiser, y compris dans l'arène de la langue.
[1] En entretien avec Victoire Tuaillon dans le balado Les couilles sur la table : « Cours particulier avec Paul B. Preciado (1/2) ».
[2] Le député français François Jolivet, dans une lettre envoyée à l'Académie française le 16 novembre 2021 et publiée sur Twitter.
[3] José Esteban Muñoz, Cruising Utopia : The Then and There of Queer Futurity, New York University Press, 2019, p. 29. Traduction libre.
Arianne Des Rochers est professeur·e de traduction à l'Université de Moncton.
Le titre de l'article se veut un clin d'œil à la formulation d'Audra Simpson, « the state is a straight white man ». Audra Simpson, « The State Is a Man : Theresa Spence, Loretta Saunders and the Gender of Settler Sovereignty », Theory & Event, vol. 19, no 4, 2016. En ligne : https://www.muse.jhu.edu/article/633280.
Photo : Marine CC

Analtochtone

« Le péteux est un péché mortel en français. Père LaFleur me l'a dit une fois au confessionnal. »
— Tomson Highway, Kiss of the Fur Queen [1]
quand le gouvernement fédéral
a conquis peguis en signant le traité 1
il nous a placé·es dans une dépression
concave, comme un verre de contact
enfermé·es dans le marécage
masse de terre spongieuse
trop lourde pour retenir les corps
saturée de post[inf]érieurs dès lors
la baie d'hudson est allée chercher l'aide fédérale
pour construire un barrage le long de la fisher
là où les sifflements et les promesses vides et les nageoires
brisent la crête des vagues
se prélassant au soleil
ils ont pris nos terres
en ont fait une base militaire
les casernes de kapyong à winnipeg
la baie d'hudson a même joké qu'elle nous remettrait
toustes là si jamais ils nous les donnaient back
ville fantôme militaristique de l'autre côté de l'horizon
comme une maison hantée affamée
spectres rouges, polter[zeit]geist ndn
ça garde les jeunes à kapyong ;
« un potentiel immobilier exceptionnel » disaient les katz
« pas un endroit pour une réserve urbaine »
même si tout winnipeg-nord
grouille de décimation, de notre décompo —
situation qu'il vaut mieux ignorer
les nicimosak veulent tous me snagger
comme un pogneur de cul, le feu au cul
exigent : « bleache-toi et douche-toi
le cul si tu veux que j'te baise »
ne veulent pas de la honte de se retirer
et de trouver une pépite sur leur bite
analité de fourrure d'hermine
je fouine au fond d'un wendigo
belette une selle je lionise
c'est-tu pas un genre d'excavation ?
à quel point il faut s'annuler soi-même
pour demander ça à un ndn ?
de sortir ma peau brune de ses marais
de purger un trou de ver, une galaxie
des torts entreposés et sauvegardés ?
je me demande si la marde est une sorte de mécanisme de défense ?
j'ai vu sikâk faire fuir une bite ou deux
loin des colonies au pourtour de l'orifice
je me demande si les excréments sont aussi une médecine ?
ça fait sortir le viral des yeux
je chasse pas les moustiques, je les chicane
un manteau de piqûres de punaises de lit
se doucher chaque semaine, voire chaque jour
revient à désinfecter l'archive de mes intestins
but whenever que j'entends infecter, j'entends envahir
j'ai eu des poux une ou deux fois dans ma vie ;
faque, même mon cul a besoin d'être blanchi maintenant ?
d'avoir l'air d'un beignet saupoudré de sucre glace
pogné là comme des algues dans un filet de pêche ?
« c'est drôle, j'ai dit, ma mère blague
que j'ai des banniques à la place des fesses,
c'est-tu pas un type de pâtisserie ça aussi ? »
peguis est devenu un marécage
un bourbier naturel pour le ruissellement des coloneux
des fugitifs se sauvent des villes
après s'être fait brasser les entrailles
pour leur avoir trop fait confiance —
peut-être que c'est le cas de le dire :
started from the bottom
juste pour finir at the bottom, à regarder vers le haut
l'eau souillée de mercure
réserve de minéralisation
puits de carcasses, puits de cosmos
plage de pourritures résurgentes ;
si la langue est un épiderme
la marde est-elle une théorie
traînée dans la boue du can[y]on ?
un genre de toile d'araignée spongieuse
élastique comme un bandeau à cheveux
ou un continuum, une parallaxe
un ruban de möbius
une théorie des cordes supersymétriques
ou encore un changement de dimension
une porte, un portail, relativité
je suis analtochtone
ma pickup line ces jours-ci est un jeu de mots barthésien :
« parler d'amour revient à confronter la boue du langage »
je me demande si sakihitin est un type de repli
entre deux muscles —
l'amour est parfois un triomphe
traîné dans la saleté
alors pour l'amour de dieu, je te prie de me baiser le cul
avant de me faire saigner et saigner et saigner.
[1] Traduction libre.
Ce texte est d'abord paru en anglais dans Prism International, vol. 57, no 3, printemps 2019. Traduit par Arianne Des Rochers.
PRÉCISIONS SUR LA TRADUCTION
peguis – Première Nation (ojibwée et crie) qui comprend plus de 10 000 membres, située à 200 km au nord de Winnipeg
ndn – Acronyme composé des trois consonnes du « mot en i », utilisé par les Autochtones pour se désigner elleux-mêmes
katz – Référence à Samuel Katz, magnat de l'immobilier et ancien maire de Winnipeg
snagger – Francisation du verbe « to snag », expression courante chez les autochtones qui signifie « baiser » ou « se pogner quelqu'un »
Pour les expressions en langue crie, on vous invite à explorer l'une des nombreuses ressources offertes en ligne, par exemple le Plains Cree Dictionary de l'Université de l'Alberta (https://altlab.ualberta.ca/itwewina/) ou le Online Cree Dictionary (https://www.creedictionary.com/)

Mouvements queers et féministes : l’intersectionnalité est une exigence stratégique

La communauté queer naît d'abord d'une identité politique radicale. Elle entretient l'ambition d'un mouvement de libération qui puise dans l'anti-autoritarisme et qui pose l'intersectionnalité comme une composante essentielle de son discours. Pourtant, il existe peu de réflexions stratégiques pour s'assurer que ces exigences survivent au test de la lutte.
Quand on m'a demandé d'écrire un texte sur les orientations stratégiques d'un mouvement queer, j'avoue que je ne savais pas tellement où donner de la tête. Est-ce que je devais aborder l'acharnement ouvertement génocidaire contre les personnes trans aux États-Unis [1] et la nécessaire solidarité internationale pour nos communautés ? Peut-être était-il préférable de me concentrer sur les enjeux locaux comme la pauvreté et l'exclusion ?
J'ai pensé faire un bilan de la mobilisation contre le projet de loi 2 [2]. Ça m'aurait semblé à propos étant donné qu'il s'agit de la plus récente lutte à laquelle j'ai participé depuis une posture militante grassroots. Parce qu'en fin de compte, est-il réellement possible de parler de stratégie sans aborder les débats internes d'un mouvement ? Sans aborder les joies et les peines immenses qui nous affligent dans ces moments désespérés où nous n'avons rien que nos corps pour nous battre ? Peut-on parler de stratégie sans parler des divisions politiques, raciales, économiques et identitaires qui touchent la communauté ?
Est-ce qu'on peut parler de stratégie sans parler du mouvement ? En fait, je me questionne parfois s'il y a un tel mouvement.
Passer de la communauté à la pratique politique
Il ne faut pas se méprendre : on se reconnaît entre nous, on partage les mêmes espaces et, souvent, les mêmes esthétiques. On va aux mêmes partys, on aime les mêmes artistes. La scène queer de Montréal est en pleine effervescence, comme en témoignent les nombreuses fêtes et regroupements. Il y a une communauté c'est sûr, mais y a-t-il un mouvement ?
La posture queer en est une de précarité. Nos corps et nos vies souvent sinueuses nous portent presque inéluctablement à la pauvreté. Les problèmes de santé mentale sont tellement fréquents qu'ils sont une source d'humour et de dérision. Et bonne chance pour trouver un·e thérapeute transaffirmatif·ve ou sensible aux réalités LGBTQIA2S+ – si on en a les moyens ou qu'on a survécu à la longue attente d'accès aux services du CLSC. Nous sommes poqué·es, traumatisé·es et méfiant·es. Je crois que nos luttes reflètent cela.
On n'imagine pas à quel point c'est difficile de rassembler des personnes queers et trans autour d'un objectif commun. Tout le monde s'entend pour porter des pins « fuck the cistem », mais, concrètement, les moyens de se mobiliser manquent à plusieurs. S'engager politiquement, c'est aussi prendre des risques : des risques pour sa sécurité, d'abord, et aussi le risque de commettre des erreurs. Et notre méfiance fait de nous une communauté politique très exigeante.
Pour moi, cette exigence est une force. Notre pensée politique est rigoureuse et précise, elle est complexe et intersectionnelle. Parce qu'elle naît de l'expérience de l'exclusion, la posture queer reconnaît la violence des frontières. Elle se nourrit de cette opposition entre « nous » et « elleux » en plaçant l'insulte – queer, bizarre, anormal – au centre de son identité. C'est pour cette raison sans doute que la pensée queer militante [3] actuelle est fortement antiraciste, anticolonialiste, anticapitaliste, anticapacitiste, prochoix, prosexe et antinationaliste. Ça fait beaucoup de cases à cocher et, dans l'urgence de la mobilisation et les choix que cela implique, ça laisse peu de place à l'erreur. On est toujours à la merci d'une dénonciation, d'un call out.
Être redevables
Bien que je crois à la possibilité de faire des erreurs, je crois aussi à la redevabilité [4]. Mais être redevable, ce n'est pas seulement s'excuser quand on se plante et ça ne se résume pas à des slogans de solidarité comme « Black Lives Matter » ou « Trans Women are Women ». Ça exige un questionnement intime et profond de ses pratiques et de son existence dans le monde. C'est difficile et ça ne s'arrête jamais. Pour les personnes blanches par exemple, cela demande non seulement de se percevoir comme telles, mais de comprendre les ramifications symboliques, historiques et sociales du fait d'être blanc·he dans un régime de suprématie blanche. Même chose pour les personnes cis, hétéros, citoyennes, etc. Être redevable, c'est plus qu'être « allié·e ». C'est savoir qu'on ne peut jamais être qu'un·e allié·e imparfait·e et que sans un effort constant, on est condamné·e à reproduire les mêmes schémas d'oppression, peu importe la noblesse de nos intentions.
Mes expériences militantes récentes dans le milieu queer me laissent croire que nos pratiques héritent encore d'une tradition politique qui fait obstacle à cette redevabilité. Encore aux prises avec l'équivalent de la conscience de classe marxiste du « nous femmes » [5] féministe, il me semble que nous tendons à construire un sujet politique aux intérêts prétendument universels. Quand nous entrons en lutte, il ne peut y avoir qu'une seule cause et cette cause, c'est celle des personnes LGBTQIA2S+ prises dans leur ensemble.
Or, ce sujet politique est abstrait et, comme toute abstraction qui en appelle à une oppression commune universellement partagée, il prend généralement les traits d'une minorité privilégiée. Tout ce qui ne se soumet pas à ce cadre supposément commun est renvoyé à des luttes spécifiques. Cette critique n'est pas neuve, elle est au cœur d'un des textes importants de bell hooks, De la marge au centre, publié en anglais en 1984 [6]. Je crois d'ailleurs que le féminisme noir, parmi d'autres, a jeté les bases d'un mouvement politique réellement intersectionnel fondé sur cette exigence de redevabilité.
Autonomie des luttes et politique de coalition
Que ce soit volontaire ou non, le féminisme et les luttes LGBTQIA2S+ sont des mouvements de coalition. Ils regroupent des intérêts divers et parfois divergents sur une variété d'enjeux. La tendance universaliste que j'ai mentionnée plus tôt a forcé les femmes noires, les lesbiennes et les travailleuses du sexe, entre autres, à former des luttes autonomes au sein du mouvement. La même chose peut être dite des personnes trans, intersexes ou bispirituelles au sein du mouvement gai.
Cette volonté autonomiste est souvent perçue à tort comme « divisant le mouvement », mais, au contraire, elle le renforce en centrant l'action politique sur les personnes opprimées. L'autonomie est essentielle pour former une pratique politique cohérente avec les luttes particulières de certains groupes. Je sais comme femme trans que les discussions et les priorités politiques sont radicalement différentes en non-mixité transféminine et dans un groupe féministe mixte. Nous ne serons jamais majoritaires parmi les féministes et nous avons besoin de cet espace pour faire exister nos luttes dans un milieu qui nous a longtemps exclues et qui comprend mal nos intérêts.
Dans un discours célèbre prononcé en 1979, Audre Lorde disait qu'il n'y a pas de libération sans communauté, mais que cette communauté ne signifie pas la négation de nos différences [7]. Pour bâtir un mouvement queer de coalition, il faut selon moi encourager et soutenir les initiatives autonomes au sein de nos communautés. Cela nous permet de nous éloigner d'une politique à prétention universaliste en embrassant la complexité des enjeux qui nous affectent. Nous sommes toustes à l'intersection d'oppressions et de privilèges qui interagissent de façon complexe et nous mènent à cadrer la lutte d'une façon singulière.
En ce sens, j'invite les personnes opprimées à réfléchir à la manière dont l'articulation de leur oppression est susceptible d'exclure les autres personnes concernées. Il ne s'agit pas de s'adonner à des olympiques des oppressions, ni de faire le décompte de ses privilèges, encore moins de redoubler sur l'expression de sa culpabilité. Il s'agit simplement de reconnaître que notre façon de cadrer une question politique relève d'un choix rhétorique potentiellement exclusif et, in fine, nuisible au maintien d'une véritable politique de coalition.
Reconnaître l'autonomie des luttes, c'est donc reconnaître la légitimité et l'expertise des perspectives divergentes. La redevabilité est conditionnelle à toute politique de coalition. Cela exige des discussions patientes, un intense travail émotionnel et beaucoup d'humilité. Cela exige de la loyauté.
En fin de compte, entretenir un mouvement politique queer, c'est refuser l'idée d'un seul mouvement, d'une cause unique qui rallierait toute la communauté. C'est embrasser la complexité de nos luttes, comme nous embrassons la complexité de nos identités et de nos affects.
C'est aussi admettre qu'il n'y a pas de lutte qui n'affecte pas nos communautés. Il n'y a pas de dénominateur commun, seulement un groupe éclectique de personnes vulnérables qui partagent la nécessité de se défendre dans un contexte politique et social hostile.
Toutes les luttes sont queers
Nous devons donc être de tous les fronts. Quand les droits des migrant·es sont attaqués, c'est notre communauté qui est attaquée. Quand les consommateur·trices de drogues sont criminalisé·es, ce sont des membres de notre communauté qui sont incarcéré·es. Quand les personnes racisé·es sont l'objet de profilage racial, ce sont des femmes trans et des hommes gais qui sont harcelé·es. La sécurité des travailleur·euses du sexe, c'est la sécurité de femmes bisexuelles et de personnes non binaires. Il n'y a pas de lutte qui ne soit pas queer.
Mais si nous persistons à entretenir une fausse équivalence entre la communauté et la lutte, nous continuerons à créer des postures minoritaires et marginalisées. Je crois sincèrement que quand nous concevons notre politique comme une politique de coalition et que nous soutenons avec conviction l'autonomie des luttes, c'est la communauté elle-même qui se trouve enrichie. Vivement les collectifs de femmes trans et de migrant·es ; vivement les collectifs de migrantes au sein des collectifs de femmes trans et inversement !
L'intersectionnalité est au centre de nos préoccupations politiques. Il est naïf de penser que cet objectif peut être atteint par le seul examen de conscience des groupes privilégiés. Donnons-nous les moyens d'être réellement intersectionnel·les en nous assurant que les personnes opprimées soient toujours en position de force et puissent poser leurs conditions pour la mise sur pied d'une coalition. Je crois qu'à ce moment nous pourrons peut-être être redevables les un·es envers les autres.
[1] Plus de 300 projets de lois anti-trans et anti-LGBT ont été introduits dans la première moitié de 2022 à différents paliers législatifs américains, après l'adoption depuis 2020 d'une centaine de lois similaires. Les attaques de milices d'extrême droite se multiplient dans un climat de haine nourrit par la rhétorique de politiciens républicains. Le gouverneur de la Floride, Ron De Santis, a plusieurs fois qualifié les homosexuels de pédophiles et un ex-candidat républicain au poste de gouverneur du Mississipi a appelé à la mise sur pied de pelotons d'exécution pour les personnes trans. Pour plus de détails, voir entre autres le site Web de l'Union américaine pour les libertés civiles : https://www.aclu.org/issues/lgbtq-rights.
[2] Introduit par le ministre caquiste Simon Jolin-Barrette, le projet de loi révise le droit de la famille ainsi que les dispositions concernant le changement de mention de sexe à l'état civil. Il a été dénoncé unanimement par les communautés LGBTQIA2S+, forçant le gouvernement à amender substantiellement le texte pour en retirer les éléments transphobes et attentatoires aux personnes intersexes. Voir l'article à ce sujet dans le n°92 d'À bâbord ! : Judith Lefebvre, « Les corps trans contre l'État ». Disponible en ligne.
[3] Je distingue la Queer Theory de la pensée queer militante, plus fluide, moins académique et plus intéressée aux enjeux matériels. Je partage par ailleurs certaines critiques concernant l'exploitation épistémique des femmes trans par le milieu académique et notre réduction à un objet théorique limité à la question du genre. Voir Viviane Namaste, « Undoing Theory : The “Transgender Question” and the Epistemic Violence of Anglo American Feminist Theory », Hypatia, vol. 24, no 3, 2009, pp. 11-32.
[4] Ma traduction de accountability. Il n'existe pas à ma connaissance de traduction communément admise pour cet usage spécifique du terme, surtout employé dans le contexte du militantisme antiraciste américain. En raison de ses origines militantes, les définitions du terme varient, mais renvoient généralement à un ensemble d'attitudes et de pratiques par lesquelles les personnes prennent individuellement la responsabilité de leur position dans un système d'oppression et de leurs biais internalisés. Cela concerne principalement les personnes blanches à l'égard des personnes racisées, mais aussi des personnes racisées entre elles.
[5] Cette expression a fait l'objet de plusieurs recherches et commentaires dans les milieux féministes et renvoie généralement à la notion d'une « classe » des femmes dans l'approche matérialiste. Elle est souvent utilisée pour caractériser un féminisme universaliste peu sensible aux disparités raciales, économiques, etc. entre les femmes.
[6] bell hooks, De la marge au centre : Théorie féministe, Cambourakis, 2017.
[7] « Without community there is no liberation, only the most vulnerable and temporary armistice between an individual and her oppression. But community must not mean a shedding of our differences, nor the pathetic pretense that these differences do not exist. » Audre Lorde, « The Master's Tools Will Never Dismantle the Master's House », dans Sister Outsider, Essays and Speeches, Crossing Press Berkeley, 2007 [1984], p. 112.
Judith Lefebvre est militante transféministe.
Photo : Marine CC

Cinq phrases pour embrasser les écologies queers

Les propositions qui suivent découlent du portait que dresse l'auteur Cy Lecerf Maulpoix de ces écologies fondamentalement intersectionnelles, anticapitalistes, décoloniales, féministes et queers.
Dans une friche industrielle de Montréal/Tiohtià:ke, un doux soir de juin où la pleine lune était à son périgée, nous nous sommes réuni·es, des lecteur·ices intéressé·es à parler d'écologies queers, autour du livre Écologies déviantes : voyage en terres queers [1]. Le présent texte met de l'avant quelques-unes des propositions fortes qui ont retenu notre attention.
« La destruction n'a pas le même sens pour tou·tes »
Les approches écoqueers – que Lecerf Maulpoix appelle écologies déviantes – proposent de considérer que les enjeux environnementaux affectant l'ensemble du vivant sont également des phénomènes sociaux. Les catastrophes écologiques doivent être envisagées dans leur articulation avec les systèmes d'oppression qui sont, suivant les propos de Ruth Wilson Gilmore qui parlait du racisme, « l'exposition de certaines parties de la population à une mort prématurée ».
Toute crise accentue les vulnérabilités sociales et économiques déjà existantes, notamment celles des différents groupes et personnes minorisées. Dans les sociétés où les vies ne sont pas toutes « digne[s] d'être pleurée[s], d'être sauvée[s], de bénéficier de droits ou de protections », écrit Lecerf Maulpoix après Judith Butler, « la destruction n'a pas le même sens pour tou.tes ». Dans le film Fire & Flood (2020), Vanessa Raditz a documenté les effets de catastrophes récentes sur les personnes non conformes aux normes hétérocispatriarcales : les domicides (perte de son logement, de son domicile) ; l'accès incertain aux refuges, aux soins de santé, aux matériels médicaux, à la nourriture et aux produits nécessaires ; les agressions et discriminations au sein des processus d'assistance et des refuges s'ajoutent aux difficultés systémiques préexistantes – pauvreté, expérience de la rue, exposition à l'insalubrité, maladies, handicaps, incarcérations, etc. « Les populations les plus affectées, notamment les LBGTQI raciséEs, ont été confrontées à un constat : celui de ne pouvoir compter que sur elles-mêmes face à l'absence de soutiens adéquats de la part des institutions » ou de leur famille à laquelle elles ne peuvent souvent pas recourir.
Les approches écoqueers refusent de faire l'impasse sur la manière dont certaines vies sont toujours déjà partie prenante d'« histoires spécifiques de domination et de destruction ».
Le vivant à défendre ne doit pas être modelé par l'hétérocisnormativité
Les écologies queers impliquent de tourner le dos aux approches qui, d'une part, ramènent la diversité des espèces non humaines à des patterns hétéro-cis et, d'autre part, associent, au sein de l'espèce humaine, des formes d'expression de genre, de sexualité, de corporalité et de relations non hétéronormées à la « déviance » ou à la « contrenaturalité ». Les écologistes les plus conservateurs mêlent ainsi à la lutte pour l'environnement la défense d'un ordre hétérocispatriarcal (la famille nucléaire hétérosexuelle au premier chef) sur la base d'une acception étriquée du concept de nature. La prise d'hormones ou de médicaments, la procréation médicalement assistée, la gestation par autrui, auxquelles ont recours des personnes trans, des familles non hétéros ou des femmes seules – aussi bien que des personnes cis ou des couples hétéros… –, sont mises sur le même plan que les formes dangereuses de manipulation du vivant et les technologies productivistes les plus destructrices (« après les légumes OGM, les enfants à un seul parent », scandaient des opposant·es à la loi autorisant le mariage et l'adoption aux personnes LGBTQ+ en France). « Les accès et bénéfices de la technique ne s'appliquent qu'aux modèles familiaux compatibles avec une certaine vision de l'organisation sociale et économique, devenue la “nature” dans la bouche de ses défenseurs ». Car, notons-le, ce ne sont pas les mutilations génitales exercées sur les personnes intersexes que pourfendent les héraults de cette « naturalité » binaire et hétéronormée…
Refusant de telles formes de naturalisation du social et de socialisation de la nature, les écologies queers cherchent plutôt à reconnaître aussi bien la diversité des espèces que la pluralité des sexualités, des identités, des corps et des modes de relation, comme dignes d'exister en soi et comme facteurs d'adaptabilité, de créativité et d'agentivité garants d'avenir en contexte de crise climatique. Les « comportements uniques et manifestations extraordinaires dans la diversité des oiseaux, des plantes et des êtres vivants, passent inaperçues parce que nous les observons à travers le prisme de la normalité, de la similitude et de l'homogénéité », soutient la biologiste colombienne Brigitte Baptiste, qui conclut : « rien n'est plus queer que la nature, car elle produit de la différence en permanence, notamment en favorisant l'émergence du singulier et de l'anomalie, en expérimentant constamment. »
La lutte contre les techniques productivistes écocidaires est parfaitement compatible avec une épistémologie non hétéronormée du vivant, avec la réappropriation démocratique des technologies et des connaissances scientifiques, botaniques et médicinales, et avec l'autodétermination individuelle et collective.
Les écologies queers invitent à l'élargissement du lien au vivant
Partir des expériences minoritaires pour penser et vivre concrètement notre relation aux écosystèmes permet d'éventuellement développer des types d'interactions et de réciprocités émancipés des logiques d'exploitation et de domination. Les écologies queers cherchent aussi à (re)connecter avec les façons égalitaires d'interagir qu'ont les sociétés non occidentales et les Premiers Peuples, présentes au sein des « régimes alimentaires, des rapports aux animaux, aux plantes, aux cours d'eau, aux terres cultivées, aux arbres, aux astres et aux esprits » (Malcom Ferdinand).
Mais leur apport sans doute le plus spécifique concerne la place dévolue aux corps dans le développement d'un lien sensible au monde. Une attention est accordée à ce qui traverse notre condition d'êtres désirants, notamment ce qui a trait aux plaisirs, aux sexualités et aux formes d'amour, de relations et de coexistences non straights, aux désirs de devenir, à la créativité dans le genre, aux corporalités dissidentes. Un tel rapport aux autres et à la Terre peut mener à des formes d'échanges, de coopération, de compagnonnage, d'attachement et d'intimité qui n'excluent pas la sensualité, voire l'érotisme entendu comme « puissance de rencontre ». « Jouir dans les bois, sur ces crêtes nacrées, suspendues entre ciel et terre pourrait-il être l'occasion de nouvelles alliances et responsabilités » et de « faire de son être et de son corps une instance de réception, de transformation, mais aussi de relais entre soi et le monde ? »
Les écologies queers sont créatrices d'espaces liminaires
Du fait des violences ordinaires et des obstacles que connaissent les personnes LGBTQ+ dans l'accès au logement et aux espaces sécuritaires, la création de lieux – en ville ou hors des villes – qui soient des lieux de vie, de rencontre, d'appartenance et d'organisation a été et demeure un besoin et une préoccupation constante au sein des groupes queers et de leurs luttes. Même s'ils viennent souvent avec la menace de représailles ou de mesures administratives répressives visant à chasser les « indésirables », ces espaces liminaires de réappropriation (terres, fermes sanctuaires, squats, immeubles ou quartiers délaissés, etc.) sont des endroits où peuvent s'expérimenter et s'épanouir des formes d'individuation, des modalités organisationnelles et des modes de relations et de coexistences que le langage hétéronormé peine à traduire.
Sur le plan écologique, les initiatives figurant dans Écologies déviantes impliquent des types d'accord plus accueillants avec le vivant. Elles sont proches en cela de la permaculture selon Annie Rose London : toutes sont faites de « valorisation de la diversité des espèces, des marges des jardins et des bordures naturelles », mais aussi de la « réutilisation des “déchets” et des rebuts dans la création d'un écosystème productif et viable écologiquement ».
Les écologies queers sont fortement coalitionnelles
Suivant Lecerf Maulpoix, ces interstices et initiatives individuelles et collectives sont, à des degrés variables, tournées vers d'autres efforts de résistance contre la destruction des milieux de vie et contre les phénomènes d'oppression. C'est que « le refuge est toujours plus qu'un refuge pour soi, il devient une forme de philosophie et de pratique de vie, engageant chacunE […] à entrer en relation avec d'autres communautés et luttes locales ». Plus largement, les organisations et les luttes écoqueers semblent toutes coalitionnelles. L'implication est large, intersectionnelle, portée par « le désir de s'engager sur d'autres enjeux, dans le cadre de mobilisations collectives et intergroupes », portée aussi par le souci d'élargir les alliances. C'est dans cette direction que Lecerf Maulpoix lance son appel général aux allié·es d'aujourd'hui et de demain : « Face à la montée des écofascismes, face aux nouvelles mutations du capitalisme prêt à intégrer des formes de pensée écologiste ou minoritaire, n'avons-nous pas encore à conduire ensemble une lutte tentaculaire, carnavalesque, excitante, non assimilable aux logiques d'exploitation capitaliste, coloniale et hétéropatriarcale ? »

Les raisons de lutter, donc de nous coaliser, ne manquent déjà pas. Sans doute faut-il pour cela nous réjouir de nos coexistences et de nos interdépendances, et contribuer à ce que l'amour triomphe des frontières que dressent en nous, autour de nous et entre nous les schèmes de pensée découlant souvent de la peur et de la haine.
[1] Elsa, Laurie, Maël : merci pour les échanges et les commentaires. Sauf exceptions signalées dans le corps du texte, toutes les citations sont tirées de Cy Lecerf Maulpoix, Écologies déviantes : voyage en terres queers, Paris, Éditions Cambourakis, 2021.
Illustration : Collages Féminicides Montréal

Wu Ming en Russie soviétique
Peu connu dans le monde francophone, le collectif Wu Ming a une renommée immense en Italie. Derrière ce pseudonyme se trouve un collectif composé d'écrivains italiens qui se donnent des numéros (Wu Ming 1 à 5) quand ils écrivent ensemble. Dans leur dernier livre, Proletkult, ils ramènent à l'avant-plan l'un des personnages les plus étonnants du bolchévisme, Bogdanov.
Le choix du nom Wu Ming est en accord avec la démarche politique et artistique du collectif. En mandarin, Wu Ming a deux significations selon la prononciation : soit « cinq noms », en référence au nombre de membres du collectif, soit « anonyme », en hommage à la signature de dissidents chinois.
Aux antipodes du vedettariat littéraire, Wu Ming travaille en collectif, sous pseudonyme, et dépose la version numérique originale de ses textes en licence Creative Commons. Ses œuvres précédentes traitaient de la Résistance italienne (Asce di guerra en 2000), du leader mohawk Joseph Brant (Manituana en 2007) ou encore de la Venise de la Renaissance (Cantalamapa en 2015), toujours avec un mélange de réflexion politique et de travail littéraire. Dans Proletkult (publié en italien en 2018), Wu Ming s'intéresse cette fois à la figure du révolutionnaire Alexandre Alexandrovitch Malinovski, dit Bogdanov.

Le roman nous le présente en 1927 et le suit jusqu'à sa mort, l'année suivante. À cette époque, Bogdanov n'a plus aucune importance politique ni même littéraire en URSS. Pourtant dépourvu de formation médicale, il est devenu directeur de l'Institut de transfusion sanguine de Moscou, dont le but était de tester le « collectivisme physiologique », ce qui consistait à échanger du sang, entre groupes sanguins compatibles, et d'accomplir, dans la réciprocité du fluide vital, la communion sociale. Un communisme rouge sang, en quelque sorte.
Pour Bogdanov, c'était là l'application du stade ultime de sa théorie générale de l'organisation, dans toutes les sphères de l'activité humaine, qu'il a nommée la « tectologie ».
Le prolétariat et sa culture
Bogdanov occupe une place tout à fait à part dans la tragique épopée de la Révolution russe. Il a été parmi les premiers membres du parti bolchevique, mais en a été exclu dès 1909. Plus tard, il a écrit des textes importants sur la littérature prolétarienne et a participé à la fondation du Proletkult (pour Proletarskaïa koultoura ou « culture du prolétariat » ), mais s'est rapidement détaché de la direction du mouvement. D'ailleurs, si Bogdanov est resté un peu célèbre, c'est moins pour ses idées que parce que Lénine en a publié une violente réfutation dans Matérialisme et empiriocriticisme (1909). On comprend pourquoi : Bogdanov plaidait pour la fusion dans la collectivité tandis que Lénine ne jurait que par un Parti agissant avec fermeté.
En Russie, pendant les années qui ont suivi la révolution d'Octobre, le Proletkult a été un immense mouvement d'éducation populaire, fort de 450 000 membres en 1920, visant à stimuler l'édification d'une culture prolétarienne. D'abord autonome, selon les préceptes d'« auto-émancipation » culturelle prônés par Bogdanov, le Proletkult a ensuite été encadré de plus en plus sévèrement, jusqu'à son épuisement complet. Au moment où s'ouvre le récit de Wu Ming, le Proletkult n'est plus qu'une inscription sur le portail d'un bâtiment, un collectif fantôme.
Entre science-fiction et fiction historique
Proletkult est un roman historique empruntant aussi les caractéristiques d'un roman de science-fiction. Dans le prologue, on rencontre un certain Léonid Volok qui aurait participé à un attentat anti-tsariste à Tbilissi en juin 1907, en compagnie de Bogdanov et du futur Staline. Vingt ans plus tard, une jeune femme aux traits androgynes apparaît au détour d'une forêt. Personne ne sait ni qui elle est ni comment elle est arrivée là. Elle se présente sous le nom de Denni et dit venir de la planète Nacun. Elle serait la fille de Léonid et le cherche.
Elle parvient à aller à Moscou pour rencontrer Bogdanov. Celui-ci, entre autres activités (philosophe, économiste, médecin), a écrit plusieurs récits de science-fiction, dont L'étoile rouge (1908), qui présente une société communiste extra-terrestre. Dans le roman de Wu Ming, cette histoire de planète socialiste aurait été inspirée à Bogdanov par Léonid, victime d'hallucinations après l'attentat en Géorgie. L'écrivain aurait entendu les délires de son camarade et les aurait pris en note. Mais voilà que Denni affirme que toute l'histoire était authentique. Pour Bogdanov et son équipe, la jeune femme présente un intérêt scientifique certain parce qu'elle a des caractéristiques hématologiques inconnues. Bogdanov la croit non seulement perdue dans un monde imaginaire, mais atteinte d'un mal inconnu que seule son ascendance pourrait expliquer.

Le retraité de la Révolution part donc en quête de Léonid disparu vingt ans plus tôt. Il retourne voir de vieux compagnons de lutte, devenus des apparatchiks (l'un d'eux est devenu titulaire de la chaire d'Hygiène sociale à l'Université de Moscou, c'est dire). Il rend même visite à la célèbre militante soviétique Alexandra Kollontaï qui, dans le roman, aurait jadis entretenu une relation avec Léonid. La fascination de Bogdanov envers Denni ne cesse d'augmenter : Denni est-elle une admiratrice de ses romans qui aurait pris la fiction pour la réalité ? Comment la projection délirante de la jeune femme dans cette planète d'invention peut-elle être si complète ? Et si le monde fictionnel d'où elle vient, celui d'une société sans classe où la révolution socialiste a réussi, le renvoyait à l'échec de la Révolution, la vraie, qui dix ans plus tard a produit une société bureaucratique, obtuse et totalitaire ?
Débats révolutionnaires
Le roman passe savamment des évocations du roman L'étoile rouge aux discussions sur les enseignements de Bogdanov et sur l'engagement révolutionnaire. Wu Ming fait de la réflexion historique et politique avec les moyens propres au roman. À l'évocation des célébrations du dixième anniversaire de la révolution d'Octobre, qui en réécrivent le récit officiel, correspond l'interrogation sur le monde fictif du socialisme en actes. Qui raconte l'histoire de L'étoile rouge ? Léonid qui en a rêvé, Bogdanov qui l'a écrite, les lectrices et lecteurs qui s'en sont saisi·es ou Denni qui en a fait sa réalité ?
Proletkult peut aussi se lire comme un roman sur des phénomènes collectifs situés au début du régime soviétique. Les théories de Bogdanov concernent l'organisation collective, le mouvement du Proletkult reposait sur les rencontres entre ses membres et la planète Nacun est celle du communisme heureux. Le roman fait de nombreux retours en 1909 quand, avec Maxime Gorki, Lounatcharski et d'autres intellectuels russes, Bogdanov a mis sur pied, dans l'île de Capri, une école de pensée socialiste destinée aux travailleurs russes. L'idée d'organiser le mouvement social par le bas plutôt que par le haut se transmet dans tout le roman. Partout, chez Wu Ming, on échange, on débat, on tente de penser ensemble et de comprendre les limites de la contribution individuelle. Roman à la fois très littéraire et très politique, Proletkult interroge les espoirs et les échecs passés de l'action et de l'écriture collectives.
Wu Ming, Proletkult, traduit par Anne Echenoz, Paris, Métailié, 2022, 352 p.
Anthony Glinoer est professeur de littérature à l'université de Sherbrooke.
Illustration : Ramon Vitesse
Pour aller plus loin
Lynn Mally, Culture of the Future. The Proletkult Movement in Revolutionary Russia, University of California Press, 1990, disponible en accès ouvert à l'adresse https://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft6m3nb4b2/.
Sur la littérature prolétarienne, voir Jean-Pierre Morel, Le roman insupportable. L'Internationale littéraire et la France (1920-1932), Paris, Gallimard, 1985 et James E. Murphy, The Proletarian Moment : The Controversy over Leftism in Literature, Urbana & Chicago, University of Illinois Press, 1991.

La ville analogique

Guillaume Éthier, La ville analogique. Repenser l'urbanité à l'ère numérique, Atelier 10, 2022, 96 pages.
Dans ce bref ouvrage, Guillaume Ethier propose une réflexion au sujet de l'organisation de la ville dans un futur rapproché. La réflexion se veut utopiste tout en s'assurant d'avoir le potentiel de se concrétiser éventuellement. Pour ce faire, il présente différents éléments d'une ville idéale en la comparant à la ville numérique dite « intelligente », composée de lieux virtuels où la société passe maintenant beaucoup de temps, une ville hyperconnectée où diverses données sur les habitudes de ses habitant·es, accumulées par de multiples consultations et « capteurs d'informations » sur les déplacements ou la consommation d'eau et d'électricité servent à « optimiser » tous les aspects du fonctionnement de la ville. La ville analogique, à l'inverse, est une cité utopique qui permettrait de combler les lacunes de la cité numérique. Cette ville analogique a quatre caractéristiques principales : elle doit être lente, tangible, intime et imparfaite. L'ouvrage invite ainsi à découvrir des projets, nombreux et passionnants, qui reprennent ces quatre caractéristiques et qui rendent concrète l'utopie proposée. Il est même probable que certains de ces projets soient familiers aux lecteurs et lectrices d'À bâbord !
La brièveté volontaire de l'ouvrage limite tout de même le développement de certaines propositions et de certaines critiques, notamment celles qui portent sur les inégalités sociales. L'auteur fait aussi observer que les projets de villes intelligentes s'adressent à des personnes de la classe moyenne supérieure : il suffit d'un coup d'œil aux images faisant la promotion de projets de ville intelligente pour comprendre qu'on n'a pas en tête un quartier défavorisé de Montréal. Ceci révèle à quel point ces projets peuvent devenir des outils de contrôle social si on les transpose dans des quartiers défavorisés : l'utilisation de capteur pour l'optimisation des déplacements des habitantes et habitants d'un quartier défavorisé ne correspondant pas à l'image idéalisée voulue par les promoteurs de ces projets ressemble dangereusement à de la surveillance et du contrôle social. Face aux projets de villes intelligentes qui se multiplient au Québec, comme c'est le cas notamment à Trois-Rivières, La ville analogique propose une réflexion et une vision appréciables de la ville du futur, et permet de mieux réfléchir au phénomène de la ville numérique et d'en entrevoir les limites.
La diaspora haïtienne à Montréal dit non à l’ingérence sur l’avenir du pays
Qu’avaient à dire les manifestantes ce 8 mars ?
Éducation et écologie
Report de la conférence internationale antifasciste au Brésil
Vieillissement et spiritualité

Célébration du 8 mars à Istanbul : des milliers de femmes défient le pouvoir turc

Manifestation féministe à Istanbul : les femmes turques revendiquent avec détermination leurs droits et s'opposent vigoureusement à l'orientation conservatrice adoptée par Erdogan.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/03/14/celebration-du-8-mars-a-istanbul-des-milliers-de-femmes-defient-le-pouvoir-turc/
En cette soirée du 8 mars 2024, quelques milliers de femmes bravent la pluie et les collines d'Istanbul pour se rassembler aux portes de la place Taksim, lieu historique de protestation politique, scrupuleusement gardée par les forces de l'ordre. Les stations de métro desservant la place sont fermées depuis 14 heures.
« Je suis ici pour défendre les droits des femmes, depuis quelques années cet événement est important . Les femmes se rassemblent sans la présence des hommes pour discuter de leurs droits. En Turquie, chaque jour des femmes connaissent une fin tragique, la question de la violence contre les femmes est cruciale. »
Après quelques minutes d'attente, des groupes de femmes parviennent à se frayer un chemin à travers les ruelles de Taksim, entre des policiers effectuant des fouilles de sacs et interrogeant les manifestantes. Elles finissent par se retrouver rue Siraselviler et forment un cortège enthousiaste, prêt à faire valoir ses droits.
« Avec Erdogan, nous sommes en danger »
« L'akp promeut un islam radical, je suis musulmane mais Erdogan se montre parfois plus extrême que l'Arabie saoudite. Avec lui nous sommes en danger », m'affirme une étudiante de 21 ans.
Point de vue partagé par cette médecin généraliste de 65 ans, militante féministe de la première heure, elle explique : « Je pense qu'en Turquie nous sommes confrontés au fascisme islamique. Ils [le pouvoir] sont sous la pression de leurs propres électeurs et tentent de remodeler le mode de vie de la Turquie selon un modèle islamique. Ils se sont retirés de la Convention d'Istanbul et poussent de plus en plus les femmes à retourner à des rôles traditionnels au sein du foyer, plutôt que de les encourager à participer à la vie sociale. »
La convention d'Istanbul, un traité international adopté par la Turquie en 2011 visait à protéger les femmes et les individus LGBT contre toute forme de violence. L'AKP a jugé que cette convention menaçait les valeurs traditionnelles de la famille turque. Fahrettin Altun, le chef de la communication du palais présidentiel, avait alors affirmé que ce texte de loi tentait de « normaliser l'homosexualité (…) » incompatible avec les valeurs sociales et familiales de la Turquie, le gouvernement d'Erdogan avait annoncé le retrait de la Turquie de la convention d'Istanbul en mars 2021.
Mais ce soir la foule est dense et enjouée, les visages sont presque exclusivement ceux de femmes, pour la plupart très jeunes. Leurs corps s'animent au rythme des tambours, des youyous, et des slogans qui résonnent en turc ou en kurde : « La rébellion contre tout ! La liberté contre tout ! » Certains, plus graves, préviennent : « Nous ne nous suicidons pas, nous ne nous taisons pas, nous n'avons pas peur ».
« Je suis fière qu'on me qualifie de terroriste, cela signifie que je les terrorise. »
Les manifestantes sont déterminées à défendre leurs droits qui ne cessent d'être remis en question par un gouvernement qui courtise toujours plus activement les partis les plus conservateurs et nationalistes de la société. Après la convention d'Istanbul, c'est la loi n°6284, également connue sous le nom de « Loi sur la protection des membres de la famille contre la violence » qui est remise en cause.
« Les manifestations sont criminalisées, c'est la manière la plus facile d'étouffer tout mouvement, pas seulement les féministes » déclare la militante.
« Il a peur des femmes, car nous avons un pouvoir considérable. Il y a actuellement beaucoup de policiers que nous n'avions pas vus lors du tremblement de terre. » déplore une jeune femme qui vient tout juste de rentrer dans la vie active. C'est aussi l'avis de l'une des rares présences masculines sur place : « En Turquie, la plupart des hommes ont peur d'aller manifester, ça n'est pas le cas des féministes et cela inquiète le gouvernement ».
En moins de deux heures, nous croisons deux femmes ayants eut des problèmes judiciaires, l'une est journaliste, elle a passé un an en prison ; la seconde vient juste de finir ses études, elle confie : « J'ai des problèmes avec le gouvernement. J'ai été devant le tribunal, je ne peux pas participer à des manifestations ni m'engager dans des activités considérées comme illégales. Je dois conserver un casier judiciaire propre pendant cinq ans, sinon je risque une peine de prison de huit mois. » Ces intimidations la préoccupent, mais ne l'empêchent pas de revendiquer haut et fort des droits pour les femmes. Elle ajoute : « Ils disent que je suis terroriste et j'en suis fière (…) car cela signifie que je les terrorise. »
Pareillement, la journaliste de 54 ans parait résolue à lutter, elle n'a pas peur d'aller manifester « J'ai déjà passé un an en prison pour mon implication dans une autre organisation de jeunesse, donc je suis habituée. Il y a beaucoup de jeunes femmes ici, et elles sont très fortes. »
Dans un pays où les mouvements contestataires se terminent souvent dans le sang, c'est avec admiration pour certains et perplexité pour d'autres que les passants observent le cortège qui se met en marche. Au-dessus de cette foule compacte parsemée de violet, symbole du combat féministe, flottent des drapeaux arc-en-ciel, tandis que des pancartes pailletées sont brandies. Sur l'une d'entre elle on peut lire : « Tu devrais avoir peur car cette foule brûle les hommes et les palais. »
Au même moment, la première dame de Turquie, Emine Erdogan, déclarait au « Sommet du travail des femmes dans l'agriculture » où le gouvernement l'avait mandatée en s'adressant à son auditoire féminin : « D'une part, vous maternez notre nation en nourrissant votre patrie, et d'autre part, vous protégez les droits de nos enfants à naître. » Une autre façon de célébrer le 8 mars…
La foule s'est dispersée à Cihangir presque sans heurts aux alentours de 22 heures. Les forces de l'ordre ont continué à patrouiller pendant plusieurs heures et ont escorté les femmes quittant la manifestation, empêchant ainsi la formation de nouveaux cortèges.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Mythes et faillites du privé en santé au Canada

En pleine mise en oeuvre de la réforme Dubé, qui ouvre la porte au privé, Écosociété est fière d'annoncer la parution d'un essai coup de poing : Santé inc. - Mythes et faillites du privé en santé, de la chercheuse Anne Plourde. Partout, depuis des dizaines d'années, on nous dit que le privé en santé est bénéfique et complémentaire au système public. Mais est-ce que ça fonctionne vraiment ? Pas du tout, selon l'autrice. Un livre qui promet de remettre les pendules à l'heure. Voir plus bas pour les détails.
Notre système de santé est en état de crise permanent. Depuis des décennies, nos gouvernements présentent le privé comme une solution. Il serait plus efficace, moins cher, nouveau, bénéfique pour le système public et de qualité. La réforme Dubé va d'ailleurs dans ce sens. Mais au-delà des considérations idéologiques, qu'on soit a priori pour ou contre, est-ce que ça fonctionne, le privé en santé ?
Se basant sur une abondance de données provenant du Québec et d'ailleurs, la chercheuse Anne Plourde a soumis à l'épreuve des faits cinq soi-disant vertus du privé en santé. Son constat est implacable : non, ça ne fonctionne pas. Pas du tout. Le privé en santé fait moins avec plus, ce qui est l'exact contraire de l'effet recherché.
Mais ce n'est pas une fatalité. À rebours des discours officiels, la chercheuse propose une solution pragmatique aux problèmes constatés : choisir l'efficacité et le meilleur rapport qualité-prix en déprivatisant complètement notre système de santé.
Un livre à déposer dans toutes les salles d'attentes !
Mythes et faillites du privé en santé au Canada (en librairie le 19 mars)
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
« Guerres » | L’antimilitarisme et les anarchistes en 2024
« La jeunesse népalaise peut avoir un impact profond sur la société » – Yogesh Kaphle
La désignation de service essentiel utilisée comme tactique d’intimidation par les patrons

Gaza, un moment de vérité

Après des mois de bombardements, la guerre vengeresse menée par Israël à Gaza s'est installée dans la durée. Les assauts dévastateurs de l'armée israélienne, les politiques génocidaires du gouvernement de Benjamin Netanyahu et l'appui des puissances occidentales représentent un moment de vérité pour le monde.
Dans ces instants critiques, les faux semblants de nos gouvernements et de plusieurs de nos médias perdent toute efficacité et sonnent creux. Le décalage entre les belles paroles humanitaires et l'indifférence réelle devant le massacre crève les yeux pour quiconque prête minimalement attention.
De fait, la position des gouvernements canadien et québécois couvrira nos sociétés de honte pour les années, voire les décennies à venir. Si Justin Trudeau a (timidement) appuyé un cessez-le-feu après des semaines de mobilisations citoyennes, il a engagé le Canada dans des opérations militaires en mer Rouge en appui à Israël et a balayé du revers de la main la décision de la Cour internationale de Justice. Celle-ci s'est rangée derrière le plaidoyer de l'Afrique du Sud à l'effet qu'il y a bien des risques de génocide à Gaza. Pendant ce temps, le Canada a décidé de suspendre son financement à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugié·es de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), un geste qualifié par plusieurs expert·es de punition collective. Rappelons que comme signataire de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, le Canada a l'obligation de prendre des mesures pour prévenir de telles atrocités.
Du côté québécois, François Legault a simplement rejeté l'appel à un cessez-le-feu, tournant le dos à une longue tradition d'appui à la libération de la Palestine au sein de la société civile, y compris dans les milieux nationalistes.
Sur le plan médiatique, le quasi-silence de journalistes canadien·nes, québécois·es et de plusieurs sociétés occidentales est consternant. Le contraste avec les prises de position suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie est frappant et révélateur : en février 2022, trois jours seulement après le début de l'invasion russe, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec tenait « à souligner son immense respect pour les journalistes ukrainiens qui font leur travail et contribuent ainsi à soutenir la démocratie contre l'invasion russe ». À Gaza, les assassinats de plus d'une centaine de journalistes ne semblent susciter que des haussements d'épaules. On a là, d'une part, une forte démonstration de l'existence de racisme systémique au sein des médias d'information au Québec et ailleurs : clairement, les vies palestiniennes comptent moins que d'autres. D'autre part, la partialité des médias se targuant d'être « neutres » est plus claire que jamais : invisibiliser à la fois la violence coloniale, la complicité du Canada et les contestations citoyennes participe au maintien du statu quo d'un État colonial.
Malgré les obstacles rencontrés (comme la censure de prises de position en appui à la Palestine sur les médias sociaux, sur les campus, dans les arts et dans plusieurs milieux de travail, ou encore les accusations automatiques d'antisémitisme pour quiconque critique Israël), la mobilisation de la population s'est traduite notamment par des manifestations hebdomadaires dans toutes les grandes villes canadiennes, ainsi que par la mise sur pied de canaux d'entraides sur le Web et de chaînes d'appels aux élus. Cette mobilisation doit être saluée et soutenue avec plus de vigueur par les divers secteurs de la gauche d'ici.
En ce moment de vérité, il est vital de dénoncer sans relâche cette situation et d'entretenir nos solidarités. Il faut également pousser nos dirigeant·es à prendre action et à rendre des comptes dans la lutte contre le génocide palestinien. Par tous les canaux, à toutes les occasions, sur tous les réseaux, il nous faut crier haut et fort notre appui à la libération palestinienne.
Prendre soin des forêts

Sommaire du numéro 99

Sortie des cales
Solidarité féministe avec la Palestine / Jade Almeida et les Féministes Racisé·es Uni·es et Solidaires
Mémoire des luttes
Une vie entre sociologie et syndicalisme / Entretien avec Mona-Josée Gagnon. Propos recueillis par Thomas Collombat
Cuba, ou comment faire la révolution en Amérique / Alexis Lafleur-Paiement
Mouvements
André Querry, photographe des luttes / Propos recueillis par Isabelle Larrivée et Claire Ross-Couture
Sciences
Six décennies de science et de luttes / Entretien avec Dr Donna Mergler. Propos recueillis par Jennifer Laura Lee
Regards féministes
Les idoles (il)légitimes / Kharoll-Ann Souffrant
Mobilité
Les angles morts des pistes cyclables / Vincent Savary
Climat
Peut-on encore prendre l'avion ? / Claude Vaillancourt
Éducation
Forums citoyens sur l'éducation : Il faut travailler à changer le rapport de force / Entretien avec Suzanne-G. Chartrand. Propos recueillis par Wilfried Cordeau
Société
L'innovation au service des locaux communautaires / Gessica Gropp et Audrée T. Lafontaine
Mini-Dossier : Pour l'autogestion au travail !
Coordonné par Valérie Beauchamp, Isabelle Bouchard et Samuel Raymond
Autogestion démocratique pour tous… et toutes / Carole Yerochewski
Milieu communautaire : Pas besoin de patron ! / Entretiens réalisés par Valérie Beauchamp
Propositions pour une autogestion viable / Paolo Miriello
« Entreprise libérée » : Expérimentations et apprentissages / Entrevue avec Vincent Roy. Propos recueillis par Isabelle Bouchard et Samuel Raymond
Dossier : Pauvreté, un enjeu collectif
Coordonné par Yannick Delbecque, Nathalie Garceau et Audrée T. Lafontaine. Illustrations par Anne Archet
Changer de cadre pour détruire la grande pauvreté / Léo Berenger Benteux et Daniel Marineau
L'aide alimentaire, un garrot pour les plus vulnérables / Camille Dupuis
L'individualisation de l'itinérance : « Si tu veux, tu peux ! » / Catherine Marcoux
La pauvreté, cause et conséquence de violations de droits humains / Marie Carpentier
Le droit comme outil de contrôle des corps / Clara Landry pour l'Association des juristes progressistes
Travailler au rabais / Marie-Pierre Boucher, Laurence Hamel Roy et Yanick Noiseux
Repères de pauvreté, repères de société / Vivian Labrie
Une personne sur dix / Entrevue avec Virginie Larivière. Propos recueillis par Yannick Delbecque
Le capitalisme coupable / Collectif Emma Goldmann, Comité intersyndical Montréal métropolitain, Mouvement action-chômage
International
Le sahel face au péril militariste / A. T. Moussa Tchangari
Guatemala : Victoire pour la démocratie / Laurence Ouellet-Boivin
Israël – Palestine : La fabrique du consentement occidental / Anne Latendresse
Coup d'œil
Québec-Palestine. Plus de 50 ans de solidarité / André Querry
Culture
Conteurs à gages. Des récits pour se réconcilier avec la/notre nature / Entretien avec Étienne Laforge et Félix Morissette. Propos recueillis par Samuel Raymond
Récit de vie : Auprès de la mort / Geneviève Manceaux
Il n'y a pas de mémoire révolutionnaire sans illustrations /Entretien avec Rémo. Propos recueillis par Élisabeth Doyon
Recensions
À tout prendre ! / Ramon Vitesse
Couverture : Anne Archet
Palestine : le récit d’un siècle de dépossession par Rachad Antonius
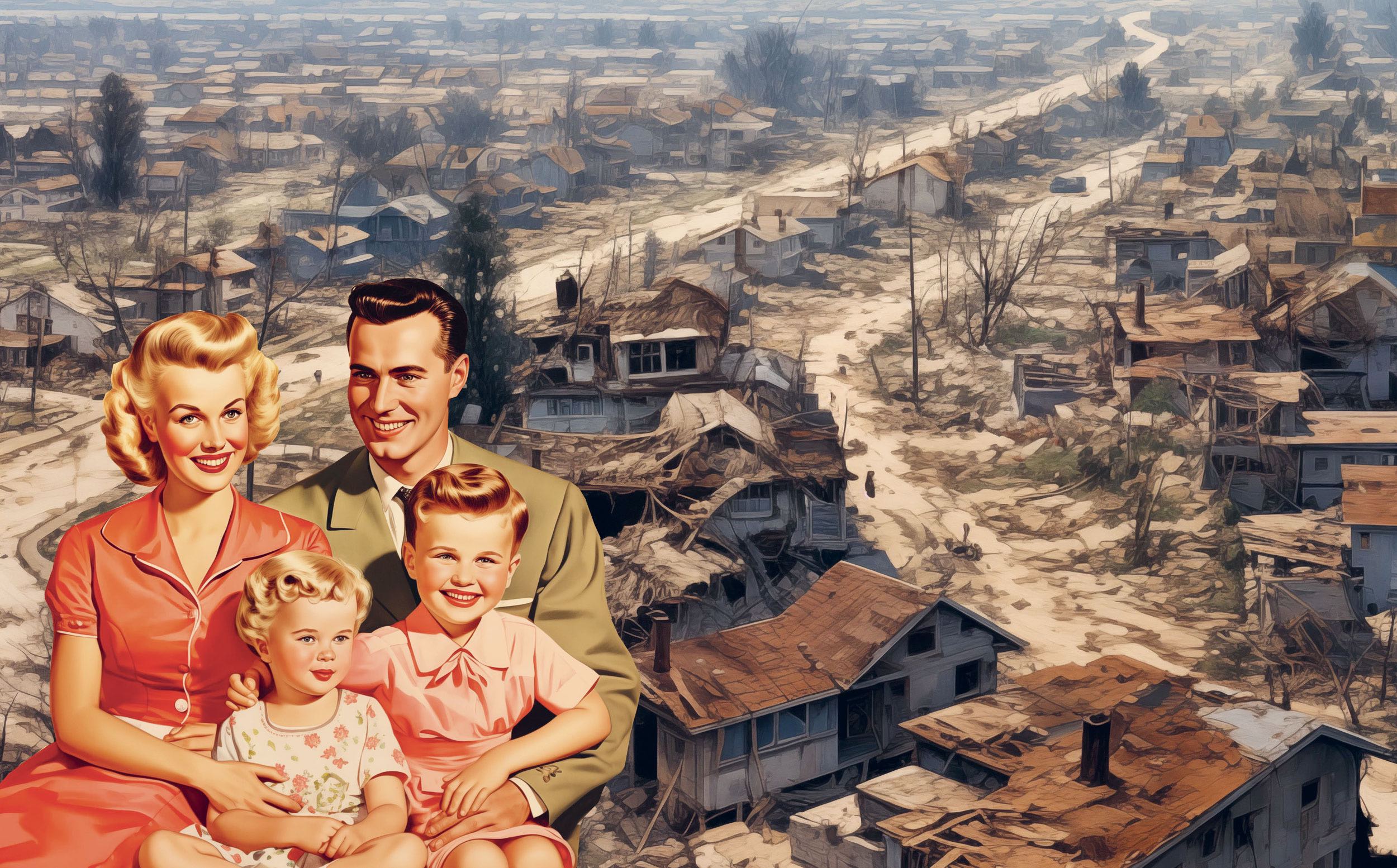
Pauvreté, un enjeu collectif
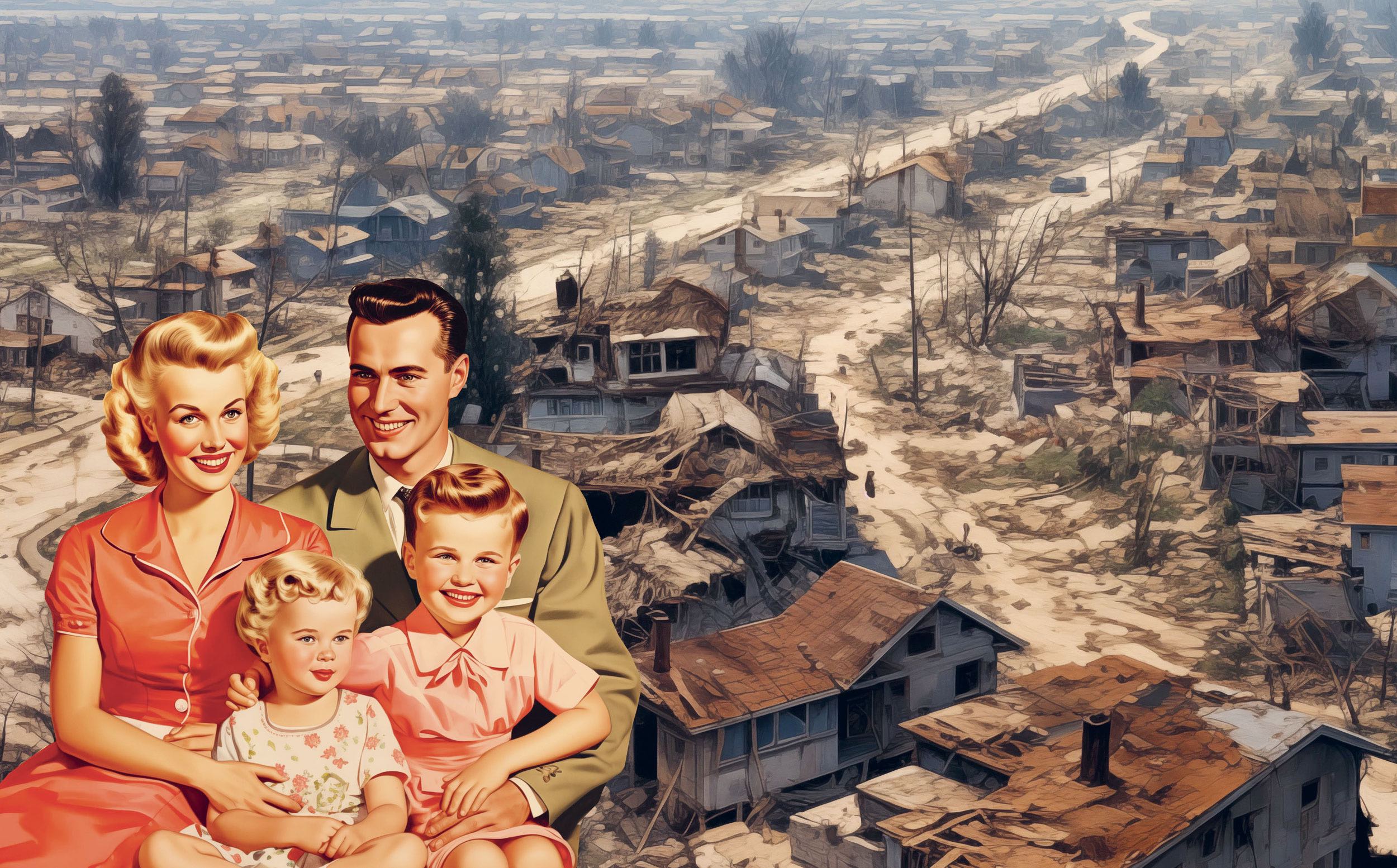
« Nous nous appauvrissons ! » Ce constat actuel et généralisé occupe de plus en plus d'espace médiatique, bien plus qu'au moment où le collectif de notre revue a envisagé pour la première fois de consacrer un dossier à la question de la pauvreté. La multiplication du nombre d'articles et de reportages traitant d'une manière ou d'une autre de cette question nous a réjoui·es – enfin on commence à dénoncer que certaines personnes vivent dans des situations inexcusables de pauvreté ! Cette couverture élargie nous a aussi inquiété·es : si les réalités de la pauvreté sont grandement exposées, les racines du problème semblent trop souvent écartées.
Dans ce dossier, nous avons donc donné la parole à différents groupes afin d'approfondir ce constat général d'appauvrissement collectif. Pourquoi y a-t-il de la pauvreté ? Comment s'y prendre pour y mettre collectivement fin ?
La pauvreté est une forme de violence collective très pernicieuse. On tente de nous convaincre qu'elle est l'effet d'une conjoncture plus ou moins mystérieuse face à laquelle nous serions impuissantes. Pire encore : certaines personnes tentent de nous rendre individuellement responsables de la pauvreté – il suffirait de travailler plus, d'investir son argent ou de mieux le gérer.
La question de la pauvreté est présente dans l'ensemble des luttes chères à toutes les tendances de la gauche, que l'on parle de racisme, de féminisme, de travail, de logement, de santé, d'éducation, d'âgisme, d'égalité ou de droits fondamentaux, par exemple. La pauvreté des personnes est la conséquence concrète des inégalités sociales et économiques. Elle les fait entrer dans une spirale insoutenable en amplifiant les effets des inégalités sociales et politiques, qui, en retour, amplifient les inégalités économiques et la pauvreté.
Un même constat traverse les textes de ce dossier : la pauvreté est la conséquence de multiples choix politiques et nous pouvons la combattre ou l'éradiquer par l'action politique collective. La concentration des richesses due au capitalisme peut être combattue. Il faut s'allier aux diverses luttes sociales systémiques et refuser l'exclusion, la déshumanisation et l'exploitation. Ensemble, nous ne sommes pas impuissant·es !
Dossier coordonné par Yannick Delbecque, Nathalie Garceau et Audrée T. Lafontaine
Illustrations par Anne Archet
Avec des contributions de Léo Berenger Benteux, Marie-Pierre Boucher, Marie Carpentier, Collectif Emma Goldmann, Comité intersyndical Montréal métropolitain, Camille Dupuis, Laurence Hamel Roy, Vivian Labrie, Clara Landry, Virginie Larivière, Catherine Marcoux, Daniel Marineau, Mouvement action-chômage et Yanick Noiseux.
Illustration : Anne Archet
Évacuation de familles québécoises de Gaza : la CAQ bloque un motion de QS pour faire pression sur Ottawa
L’imposition de visas aux Mexicain.nes : une violation des droits humains – CTI et CDHAL
Mexique : 30 ans plus tard, qu’est devenu le mouvement zapatiste ?
Urgence Palestine – soutenons la mobilisation du 23 mars
JdA-PA met en place un Fonds jeunesse en soutien au développement d’un journalisme engagé

Budget du Québec 2024 ; les réactions syndicales et populaires

Voici la revue de presse des réactions au dépôt du budget Girard. Vous trouverez les communiqués émis par les organisations syndicales et populaires ainsi que par Québec solidaire. Ils seront mis en ligne au fur et à mesure de leur parution.
#Le Groupe des treize - #Québec solidaire - #FRAPPRU - #Auberges du cœur du Québec - #Réseau des conseils régionaux de... - #SFPQ - #FSSS-CSN - #FADOQ - #RQ-ACA - # CSQ - #FIQ - #FECQ - #APTS - #Banques alimentaires du Québec - #FTQ - #SPGQ - #CSD - #IRIS - #CSN - #Haroun Bouazzi - #Collectif pour un Québec sans pau... -
Quelques faits saillants du budget 2024-2025 - Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale (Portneuf-Ouébec-Charlevoix)
15 mars 2024 | tiré de Facebook du RGF
Hier, le ministre des finances déposait un budget « exigeant et responsable », un budget décevant qui ne permet pas d'améliorer la qualité de vie de la population, d'améliorer nos services publics et nos programmes sociaux et de surmonter la crise écologique.
Rappelons le refus du gouvernement d'annuler sa baisse d'impôts du dernier budget provincial qui prive l'État de 1,7 milliard$ par année et de réinvestir cet argent dans le filet social. Les allègements fiscaux consentis par la CAQ depuis son arrivée au pouvoir privent le gouvernement de 2,7 milliards de dollars annuellement. Ces choix politiques ont des conséquences ! Nous sommes précipitées vers une nouvelle période d'austérité alors que les solutions, elles existent et elles sont multiples : instauration d'un impôt sur le patrimoine du 1% des plus riches, réinstauration de la taxe sur le capital pour les banques, augmentation du nombre de paliers d'imposition, imposition plus grande des dividendes et des gains en capital, augmentation des impôts des grandes entreprises, fin de l'évitement et de l'évasion fiscale.
Quelques points saillants du budget :
– Absence d'analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle (ADS+) du budget 2024-2025.
– Pour la lutte à la pauvreté : annonce d'un insuffisant 784 M$ pour les cinq prochaines années afin de « réduire la pauvreté et favoriser l'inclusion sociale » (investissement pour le transport pour les personnes à mobilité réduite, financement d'actions dans les communautés, soutien à l'aide alimentaire, conservation d'un maigre 10 % des gains de travail nets pour les personnes assistées sociales).
– Pour la régie des rentes : Fin de la disparité de traitement pour les personnes invalides de plus de 65 ans qui voyaient leurs revenus diminuer considérablement lorsque leurs prestations d'invalidité s'arrêtaient.
– Pour le logement : pas de financement pour de nouveaux logements sociaux. Nouvel investissement pour soutenir l'exploitation et la rénovation de HLM, poursuite de la bonification du programme Allocation-logement.
– Pour le transport en commun : Bonification d'un maigre 0,29% des infrastructures de transport en commun, alors que les sommes allouées au réseau routier augmentent de 10%.
– Violence conjugale : Investissement de 140 millions de dollars sur 5 ans pour déployer le Tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle. Aucun budget dédié à la construction de maisons d'hébergement.
– Pour les organismes en santé et services sociaux : Ajout d'un maigre 39M$ pour les organismes communautaires en santé et services sociaux sans garantie que ce montant aille à la mission globale.
– Pour l'éducation : Les dépenses dans le système d'éducation augmenteront de 7,6% (à titre comparatif, les dépenses doivent augmenter d'au moins 7 % pour suivre la croissance des coûts en éducation, donc très peu de nouvel argent).
– Pour la santé : 4,2 % de croissance en 2024-2025 (une baisse comparativement à l'année dernière où la croissance du budget 2023-2024 de la santé était de 7,7 %). Poursuite de la privatisation des services de santé (chirurgies, mini-hôpitaux privés), augmentation des sommes pour les soins à domicile.
– Pour l'environnement : Les annonces se limitent à un maigre 20,8 M$ et sont toutes affectées à l'adaptation aux changements climatiques.
– Pour la transition écologique : 1,86 G$ par année sont prévus dans le Plan pour une économie verte, ce qui représente à peine 1% des dépenses totales de l'État québécois.
– Pour les services de garde : aucune somme supplémentaire.
Budget du Québec : la CAQ brise sa promesse de compléter le réseau des CPE - Québec solidaire
QUÉBEC, le 14 mars 2024 - Suite au dévoilement du budget 2024-2025, Québec solidaire et Ma place au travail dénoncent la promesse brisée de la CAQ de compléter le réseau de CPE et le manque de mesures pour les familles québécoises.
« Le Grand chantier des familles se retrouve désormais lui aussi au cimetière des promesses brisées du gouvernement caquiste alors que les sommes nécessaires à la complétion du réseau des CPE avant mars 2025 ne sont pas au rendez-vous dans le budget. Alors que des milliers de parents, principalement des femmes, comptaient sur la ministre de la Famille pour regagner leurs emplois, ces derniers se butent à un autre engagement rompu. La CAQ a décidé que la petite-enfance ne faisait plus partie de ses priorités et c'est inacceptable ! » souligne Guillaume Cliche-Rivard, responsable solidaire pour le dossier Famille.
« Le gouvernement nous a toujours assuré que le Grand chantier pour les familles réglerait la pénurie et que, d'ici 2025, le réseau des garderies serait complété. Mais suite aux annonces du plus récent budget, force est de constater que cela n'arrivera tout simplement pas. Disons-le carrément : le Grand chantier pour les familles est un échec. » a ajouté Marilou Fuller, directrice générale de Ma place au travail.
Budget 2024-2025 : la CAQ maintient le cap droit dans le mur (Le Groupe des treize)
Montréal, le 13 mars 2024 — Le Groupe des Treize (G13), coalisant vingt-trois organisations féministes nationales engagées dans la défense des droits des femmes au Québec, accueille avec perplexité le budget 2024-2025 du gouvernement caquiste. Le G13 s'inquiète de l'absence de solutions structurantes aux crises auxquelles la société québécoise fait face et de la tactique employée pour justifier la mise en place, dès l'année prochaine, de mesures d'austérité.
Le gouvernement caquiste a annoncé, hier, son budget centré sur la santé et l'éducation. Tandis que les médias répétaient avec insistance le déficit historique de 11 milliards, notre perplexité à l'égard du budget et du discours médiatique grandissait : « Tout se passe comme si le gouvernement ne prenait pas acte des nombreuses crises qui sévissent au Québec, actuellement : la crise environnementale, la crise du logement, la crise de nos services publics, l'aggravation de la pauvreté et l'accroissement des inégalités ! », s'exclame Sara Arsenault, de la Fédération des femmes du Québec.
Les membres du G13 regroupent des organismes communautaires qui travaillent au quotidien avec, par et pour les personnes les plus affectées par ces crises. « Qu'y a-t-il dans ce budget, M. Legault, pour les femmes et les personnes les plus marginalisées ? », demande Marie-Eve Blanchard du Regroupement Naissances Respectées (RNR). Rien de nouveau pour faire face à la crise du logement, rien pour permettre aux personnes assistées sociales de vivre dignement, et ce, dans un contexte où une réforme en santé, pourtant vertement critiquée et passée sous bâillon, donne une large part au privé ; où une stratégie en égalité se poursuit sans ministère pour la coordonner ; où un silence assourdissant en matière d'environnement pèse lourd.
Pour nous, expertes en matière d'égalité, l'absence chronique d'analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle (ADS+) du budget gouvernemental est le problème numéro 1. Si le gouvernement respectait ses engagements en matière d'égalité, il utiliserait l'ADS+ afin de questionner les impacts des décisions budgétaires sur les femmes et les personnes à la croisée des oppressions. En conséquence, nous aurions des décisions éclairées en matière de politiques publiques et des résultats efficaces pour réduire les inégalités, respecter les droits humains et construire la société égalitaire que méritent les Québécoises et les Québécois.
À la place, la CAQ nous sert un budget qui maintient le cap droit vers le mur. Nous entrevoyons qu'elle va brandir sous peu l'épouvantail de la dette pour apeurer la population dans le but de faire passer des mesures d'austérité et de sabrer dans ce qu'il nous reste de filet social. « La dette ne nous empêche pas de dormir la nuit… mais les personnes qui se retrouvent à la rue, celles qui ont faim, celles dont l'électricité est coupée, celles qui n'ont pas accès aux soins de santé et celles dont l'avenir est fragilisé à cause de l'inaction climatique, ça, ça nous empêche de dormir la nuit », laisse tomber Annie-Pierre Bélanger, de Relais-femmes.
Ce gouvernement est capable d'investir pour le hockey, pour les « top guns _du privé », ou pour défendre en cour ses lois discriminatoires. Pourquoi manque-t-il tant de courage pour soigner ses institutions et ses services, et exercer sa fonction publique ?
Le Groupe des Treize
Budget Girard : aucun nouvel investissement pour le logement social malgré la sévère crise du logement (FRAPPRU)
QUÉBEC, le 13 mars 2024 - Le Front d'action populaire en réaménagement urbain ? (FRAPRU) est extrêmement déçu du budget présenté aujourd'hui par le ministre des Finances Éric Girard. Alors que la crise du logement sévit durement à travers le Québec, le budget ne prévoit pas de financement pour de nouveaux logements sociaux. « Monsieur Girard table sur les 8000 logements sociaux et abordables annoncés lors de la mise à jour économique suite à une entente avec Ottawa et dont la moitié a déjà fait l'objet d'annonces gouvernementales : ça laisse trop peu d'unités pour de nouveaux projets au moment où il faudrait accélérer la cadence », déplore Véronique Laflamme. Celle-ci se désole aussi que le ministre des Finances refuse toujours d'offrir davantage de prévisibilité aux villes et aux organismes développant des logements sociaux, en fixant un objectif de développement sur plusieurs années. « Les besoins criants sont pourtant connus et les sommes actuellement prévues sont clairement insuffisantes pour y répondre », insiste-t-elle.
Le plan budgétaire souligne que les investissements prévus dans le cadre des précédents budgets et mises à jour économiques, incluant ceux dont le financement avait été annoncé avant 2018, permettront de contribuer à la réalisation de plus de 23 000 nouveaux logements d'ici 2028-2029 et semble s'en satisfaire. Pour le FRAPRU, qui note au passage que la part de logements sociaux hors marché privé n'est pas connue, le gouvernement caquiste se cantonne strictement à sa promesse électorale, faite avant que le gouvernement ne reconnaisse la crise du logement, sans tenir compte de la situation qui se détériore partout au Québec.
« Après 5 budgets où l'on a annoncé au compte-goutte le financement de nouveaux logements sociaux, c'était le moment de donner un grand coup », commente Véronique Laflamme. Le FRAPRU espérait le lancement d'un chantier de 50 000 logements sociaux en 5 ans pour répondre à l'urgence de la situation et à la diversité des besoins des locataires du Québec, que ce soit les locataires aînés, les familles à modestes revenus, les personnes seules ne réussissant plus à joindre les deux bouts avec les prix exorbitants des logements disponibles, les femmes victimes de violence conjugale, etc. Un tel chantier permettrait non seulement d'accélérer la construction neuve, mais également l'acquisition de bâtiments résidentiels locatifs encore abordables pour les sortir du marché spéculatif, tout en protégeant les locataires en place.
Le plan d'action en habitation promis relégué aux oubliettes
Selon le FRAPRU, il semble clair que le gouvernement caquiste abandonne en douce le plan d'action gouvernemental en habitation promis depuis plusieurs mois par les ministres qui se sont succédé à l'Habitation ou que celui-ci sera vide de toute substance. L'adoption d'un objectif ambitieux de développement de logements sociaux et son financement pluriannuel devait être selon plusieurs, dont le FRAPRU, la colonne vertébrale de ce plan.
Selon le regroupement de défense du droit au logement, pour sortir de la crise, il faut à moyen terme se doter de la perspective d'augmenter substantiellement la part de logements hors marché privé en doublant le parc de logements sociaux. « On espérait une vision claire d'où le gouvernement s'en va, mais elle n'est pas là » se désole Véronique Laflamme. Le FRAPRU, comme plus de 500 organisations sociales à travers le Québec, demande depuis plusieurs mois une politique globale en habitation. Celle-ci semble dorénavant incontournable selon Véronique Laflamme.
Le budget confirme par ailleurs que le gouvernement semble avoir décidé d'abandonner les quelques milliers de logements sociaux budgétés avant son arrivée dont il avait promis la construction dans son premier mandat et qui ne sont toujours pas livrés, dont 800 à Montréal. Aucun investissement n'est prévu pour permettre à ces projets de boucler leurs budgets. Selon le regroupement, ce sont des projets qui risquent d'être abandonnés ou forcés de changer de programme et autant d'unités promises plusieurs fois qui sont menacées d'être perdues.
Quelques mesures accueillies positivement
Au rang des bonnes nouvelles, le FRAPRU se réjouit des investissements de 66 millions $ pour soutenir l'exploitation des HLM dont l'entente d'exploitation avec Ottawa est échue. Il souligne aussi les 153 millions $ prévus cette année pour la rénovation des HLM qu'Ottawa doublera en vertu de l'Entente Québec-Canada sur le logement de 2020 qui prévoyait 2,2 milliards pour ces rénovations. En outre selon le FRAPRU et la Fédération des locataires de HLM du Québec, il serait judicieux de profiter de ces travaux pour densifier certains immeubles d'habitations à loyer modique en prévoyant des sommes supplémentaires pour un nouveau programme de logements publics, ce que le budget ne prévoit pas.
Le FRAPRU apprécie également les investissements nécessaires à la poursuite de l'allocation-logement, bonifiée en 2022 à la suite d'une autre entente avec Ottawa. Or, selon lui, miser sur les aides financières individuelles ne réglera pas la crise du logement vécue durement par les ménages à faibles et modestes revenus. Malgré le récent rehaussement des prestations, dans le contexte actuel, de telles aides financières individuelles absorbent à peine, voire pas du tout, le choc de la hausse des loyers. Dans les faits, au regard de la cherté actuelle des loyers, de leur croissance rapide et du taux d'effort des ménages locataires concernés, l'allocation-logement gonfle surtout les poches des propriétaires, selon le regroupement. Pour que cette aide, même imparfaite, puisse aider davantage de locataires, il faudrait enfin mettre fin à la discrimination exercée contre les personnes seules ou en couple et âgées de moins de 50 ans. Il faudrait également instaurer un contrôle obligatoire et universel des loyers, afin d'éviter des hausses injustifiées qui dissipent la faible prestation obtenue, souligne le FRAPRU.
Vu l'augmentation des besoins à cet égard dans toutes les régions du Québec étant donnée la pénurie extrême de logements, le FRAPRU est soulagé que le gouvernement ait augmenté les fonds prévus pour l'aide d'urgence aux ménages locataires se trouvant sans-logis autour du 1er juillet. Il espère que tous les ménages en ayant besoin recevront une aide concrète en 2024, incluant de l'hébergement temporaire et que l'aide sera suffisante pour offrir des services à l'année là où les besoins se font sentir. « Des centaines de ménages se trouvent dorénavant mal pris souvent pendant plusieurs semaines, c'est une autre illustration de l'urgence de prévoir les mesures structurantes pour éviter ces situations en amont, ce que le gouvernement ne fait toujours pas », conclue Véronique Laflamme.
Un vrai programme de logement social : ça ne peut plus attendre
Alors que de nombreux écueils persistent dans le Programme d'habitation abordable Québec (PHAQ) et que ce dernier est mal adapté aux impératifs du logement social, le FRAPRU espère maintenant que le gouvernement mettra en place promptement un programme complet, durable et spécifiquement dédié au logement social afin de s'assurer que les projets qui seront financés dans les prochains mois lèvent de terre plus rapidement et de freiner la place grandissante accordée à des acteurs privés et aux choix politiques discrétionnaires dans la sélection des projets financés.
Réactions au budget provincial de 2024- Douche froide pour les Auberges du cœur du Québec
MONTRÉAL, le 13 mars 2024 - Le Regroupement des Auberges du cœur du Québec (RACQ) considère le dernier budget crève-cœur pour les maisons d'hébergement jeunesse communautaires et, plus largement, pour l'ensemble du milieu communautaire autonome du Québec. Cet exercice annuel est l'occasion pour le gouvernement d'indiquer à la population ses priorités. Manifestement, malgré les crises du logement, de l'itinérance, des enjeux de santé mentale et d'accessibilité à des soins de santé physique et psychologique, les populations marginalisées et les jeunes vulnérables ne représentent pas l'électorat caquiste.
Le RACQ revendique pour ses membres un rehaussement significatif de leur financement à la mission depuis de nombreuses années. Pourtant, après plusieurs rencontres avec le personnel des ministres des Services Sociaux et de l'Action communautaire, plusieurs participations à des comités et des consultations, force est de constater que la stratégie politique est de faire semblant d'écouter les enjeux urgents et pressants des milieux d'hébergement jeunesse. Nos doléances se trouveront balayées du revers de la main une fois le temps de poser un véritable geste pour améliorer le sort des jeunes vulnérables du Québec.
En termes de financement à la mission, les Auberges du cœur restent à la traîne des ressources d'hébergements dont la mission est similaire, soit celle d'offrir des services 24/7, 365 jours par année. Ensemble, elles cumulent un retard de 27M$ de plus annuellement pour répondre à leurs besoins.
« Certaines des maisons membres du Regroupement peinent à boucler leur budget annuel. Non seulement les Auberges ne reçoivent pas plus, mais tout ce qui touche la transition à la vie adulte des jeunes non plus. Pas plus de logement abordable pour les jeunes. Pas de mesure en prévention de l'itinérance des jeunes. Pas plus d'accès à des soins de santé mentale pour les jeunes. Ces mêmes jeunes-là sont dans nos ressources et on doit en refuser plein par manque de financement. C'est vraiment choquant. », affirme Paule Dalphond, directrice générale du Regroupement des Auberges du cœur du Québec.
Le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) vecteur d'appauvrissement des Auberges du coeur
L'ajout de 39M$ dans le PSOC, un des programmes phares dont s'est doté notre société pour soutenir l'action communautaire et le filet social québécois, contribue à maintenir les organismes dans la précarité en ne donnant pas accès aux ressources financières nécessaires pour mener à bien leur mission. Ce faisant, les maisons d'hébergement jeunesse peinent à maintenir des services et en développer de nouveaux pour répondre aux besoins de plus en plus importants des jeunes vulnérabilisées.
Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre ainsi que du récent renouvellement des conventions collectives du secteur public, le fossé s'est dramatiquement élargi en ce qui a trait aux conditions salariales, freinant notre capacité d'agir. Aux prises avec de hauts taux de roulement, dans des processus d'embauches et de formations à recommencer constamment, ce sont les jeunes fréquentant ces organisations qui en paient la note. Ainsi, ils ne peuvent recevoir pleinement le soutien dont ils ont besoin pour se sortir de la pauvreté, de l'isolement, développer davantage leur autonomie et espérer améliorer leurs conditions de vie.
Une prophétie autoréalisée
En consentant des baisses d'impôts, que personne ne réclamait vraiment, tout en sachant que l'État devrait renégocier les conventions collectives de centaines de milliers de travailleuses et travailleurs, le gouvernement a réalisé sa prophétie : les finances ne sont pas assez bonnes pour soutenir les demandes du milieu de l'hébergement jeunesse communautaire. Il concrétise aussi une gestion néolibérale de l'État québécois avec les effets déshumanisants de son idéologie marchande qu'il impose à notre secteur dont les relations humaines, l'éthique et l'équité sociale sont les pierres d'assises. Les décisions prises au fil des derniers mois (subventions aux Kings de Los Angeles et Northvolt, pour ne nommer que celles-ci) illustrent bien une collectivisation des coûts par la population du Québec pour une privatisation des profits.
Tandis que nous mettons en garde le gouvernement de points de rupture dans les services offerts depuis des années, ce dernier s'entête à regarder le filet de sécurité et les services aux jeunes vulnérables s'effriter. En conséquence, ces mêmes jeunes qui peinent déjà à se nourrir et se loger convenablement ne verront aucune amélioration de leur situation. Pire, ils seront de plus en plus nombreux à se tourner vers nos ressources qui peinent déjà à répondre à la demande.
Budget du Québec 2024-2025 - Des investissements culturels loin des attentes
TROIS-RIVIÈRES, QC, le 13 mars 2024 - Le Réseau des conseils régionaux de la culture du Québec (RCRCQ) était présent, mardi 12 mars, au huis clos du Budget du Québec 2024-2025 pour analyser les mesures qui concernent le milieu culturel. Dans un contexte de rigueur budgétaire annoncé par la Coalition Avenir Québec (CAQ) et de pression inflationniste, le RCRCQ constate que les nouvelles mesures annoncées dans le nouveau budget ne parviennent pas à maintenir les investissements du gouvernement du Québec en culture faits en 2023-2024.
Faits saillants du budget en culture
Le gouvernement du Québec a annoncé pour 44,6 M$ de nouvelles mesures en culture pour 2024-2025 dont 21,1 M$ pour mettre en valeur la culture et le patrimoine québécois, ce qui permettra d'appuyer les organismes culturels (4,8 M $), de bonifier le Fonds du patrimoine culturel québécois (13,3 M$) et de poursuivre la mise en place du passeport culturel pour les jeunes (3 M$).
Le gouvernement compte aussi investir 19,2 M$ en appui aux médias et à la diffusion de la culture québécoise, ce qui permettra de poursuivre la Stratégie d'aide aux médias, de bonifier la programmation de Télé-Québec et d'adapter le financement du secteur audiovisuel. Enfin, le gouvernement ajoute 8,2 M$ pour soutenir la promotion et la valorisation de la langue française.
Des investissements culturels en baisse
On constate toutefois que les crédits de transfert du ministère de la Culture et des Communications passent de 837,2 M$ à 814,5 M$ (une diminution de 22,7 M$) et que le budget du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) passe de 193,5 M$ à 171,8 M$ (une diminution de 21,7 M$) malgré l'annonce d'une nouvelle mesure de 4,8 M $. Pour la SODEC, on constate que le budget de dépenses 2024-2025 diminue également, passant de 194,2 M$ à 170,7 M$ (une diminution de 23 M$) malgré l'annonce d'une nouvelle mesure de 21 M$ d'ici 2028-2029.
Ces investissements sont inférieurs aux besoins exprimés par le milieu culturel qui évolue dans un contexte difficile. Le Réseau avait d'ailleurs fait des recommandations pour maintenir le niveau des investissements en culture notamment en soutenant le milieu de manière importante par le biais du CALQ et de la SODEC.
Des investissements pour la production audiovisuelle et les expositions des musées
Dans le cadre des consultations prébudgétaires 2024-2025, le RCRCQ a présenté 10 recommandations pour assurer la vitalité des territoires du Québec. Le RCRCQ est ravi de constater que le gouvernement a accueilli favorablement sa recommandation en lien avec le secteur de l'audiovisuel en bonifiant le Crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle québécoise, en haussant le plafond de dépenses de main-d'œuvre admissibles de 50 % à 65 % des frais de production et en majorant le taux de base du de 20 % à 25 %, pour favoriser l'attraction de tournages étrangers au Québec.
Le RCRCQ se réjouit également de la bonification du fonds du patrimoine culturel qui permettra notamment de soutenir les expositions permanentes des musées.
Julie Martineau, présidente du Réseau des conseils régionaux de la culture du Québec précise : « Fondamental pour la société et l'identité québécoise, le milieu culturel vit présentement une série de grandes perturbations. L'inflation, la pénurie de main-d'œuvre, l'explosion des coûts relatifs à la production, à l'immobilisation et à la diffusion, la domination des géants du web, l'effritement des médias locaux et régionaux ainsi que la diminution du « portefeuille culture » des citoyens ont de lourdes conséquences. Des investissements importants auraient été nécessaires pour consolider un secteur toujours fragile. »
Soutenir la vitalité culturelle de toutes les régions du Québec
En tant qu'organismes de conseils et d'expertises bien ancrés dans chaque région, les Conseils régionaux de la culture disposent d'une offre de services adaptés aux réalités du milieu et jouent un rôle essentiel et stratégique pour l'ensemble des secteurs culturels et artistiques. Le RCRCQ a présenté au ministère de la Culture et des Communications une demande pour bonifier et actualiser leur capacité d'action et celle de leur réseau, articulée dans une vision globale pour assurer la vitalité culturelle partout sur le territoire.
Éric Lord, directeur général du RCRCQ mentionne : « À l'analyse, nous remarquons que cette demande est absente du budget, mais nous souhaitons que l'étude des crédits nous permettra de constater que notre vision sera appuyée par le gouvernement du Québec pour soutenir la culture dans toutes les régions et pour concrétiser la politique culturelle Partout la culture ».
Budget 2024-2025 - L'austérité pour le personnel des ministères et organismes, les services à la population souffriront, constate le SFPQ
QUÉBEC, le 12 mars 2024 - L'absence d'investissements suffisants dans les ministères et organismes, combinée au manque de personnel découlant des conditions de travail non compétitives, affectera grandement les services à la population, déplore le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ). Dans son budget déposé aujourd'hui, le gouvernement de la CAQ limitera la croissance des dépenses à seulement 4,4 % cette année et à 2,9 % en moyenne dans les prochaines années, laissant entrevoir un retour aux années d'austérité malgré ce qu'en disait le premier ministre, il y a quelque temps. Le SFPQ constate que la fonction publique et les services offerts par ses membres ne font toujours pas partie des priorités gouvernementales, contrairement aux réseaux de la santé et de l'éducation.
« La CAQ ne se soucie guère des inspections, des contrôles, de la vérification, de la justice, de la sécurité de la population, de l'octroi d'aide financière sous toutes formes et de l'entretien du réseau routier, tous des services offerts par le personnel de la fonction publique. Le gouvernement Legault a plutôt choisi, depuis son arrivée au pouvoir, de baisser les impôts, se privant ainsi de milliards de dollars chaque année. Si aujourd'hui les coffres sont vides, c'est en raison de cette stratégie électoraliste et non pas en raison des négociations du secteur public qui ne sont d'ailleurs toujours pas terminées avec nous », rappelle Christian Daigle, président général du SFPQ.
Visiblement, le gouvernement de la CAQ n'a pas l'intention de mettre de l'argent neuf sur la table pour obtenir un règlement des conventions collectives pour des milliers de travailleuses et travailleurs de la fonction publique, constate le SFPQ. « Ce gouvernement refuse obstinément de faire une nouvelle offre à la hauteur des ententes conclues avec le reste du secteur public. Il doit reconnaître que son personnel des ministères et organismes mérite d'être mieux valorisé et respecté pour le travail accompli. Le gouvernement devra en tenir compte s'il veut éviter un conflit de travail de plus en plus imminent avec les 4000 ouvrières et ouvriers dans les prochaines semaines, ainsi qu'une grogne qui s'amplifie du côté des fonctionnaires », avertit monsieur Daigle.
Au chapitre des effectifs, le gouvernement de la CAQ n'augmente que de 900 personnes à temps complet les effectifs de la fonction publique. Dans un contexte où la CAQ déclare avoir supprimé 5000 postes administratifs, et où les services aux citoyennes et aux citoyens sont au point de rupture dans la plupart des ministères, il est irresponsable de limiter à ce point la croissance des effectifs. La CAQ se tire donc elle-même dans le pied, car elle devra recourir à la sous-traitance pour offrir les services, ce qui coûtera plus cher à l'ensemble des citoyennes et citoyens du Québec. Avec les gels de personnel imposés par les gouvernements précédents, la CAQ continue le travail de sape de sa propre fonction publique que le SFPQ a toujours dénoncé. Sans ressources suffisantes, le gouvernement continuera de gérer le risque et demeurera en mode réaction plutôt qu'en mode prévention.
Budget du Québec - Par manque de vision de la CAQ, les graves crises en santé et services sociaux vont se poursuivre, déplore la FSSS-CSN
MONTRÉAL, le 12 mars 2024 - Le ministre des Finances de la Coalition avenir Québec (CAQ), Eric Girard, a déposé un budget austère dans lequel, par manque de vision, il refuse d'imposer le traitement choc nécessaire pour mettre fin aux crises qui secouent durement le réseau public de la santé et des services sociaux. Le filet social continuera de s'effriter, déplore la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), la plus grande organisation syndicale en santé et services sociaux.
« Austère, la CAQ limite la hausse du financement du réseau public de la santé et des services sociaux en deçà de ce qui est nécessaire pour maintenir les services à la population québécoise », fait remarquer Réjean Leclerc, président de la FSSS-CSN. « En plus, il passe à côté des solutions connues et efficaces afin de requinquer le réseau public bien amoché. »
« Réseau de la santé mal en point, logement, aide aux femmes et enfants victimes de violence conjugale, itinérance, insécurité alimentaire, soutien aux jeunes en difficulté, santé mentale, manque de places dans les CPE, hébergement des aînés, soins à domicile, secteur ambulancier… La liste des crises qui font régulièrement la manchette est longue », observe Réjean Leclerc.
Austérité ?
La FSSS-CSN en appelle à une large réflexion nationale sur les revenus de l'État, la fiscalité des grandes entreprises, les subventions aux riches corporations, l'évitement fiscal, une taxe sur le patrimoine des 1% les plus fortunés. Voilà certaines mesures parmi les nombreuses qui permettraient d'accroître les revenus de l'État et d'offrir les services auxquels les citoyennes et les citoyens sont en droit de s'attendre. Tout en favorisant le filet social, qui fait la fierté de la population québécoise.
« Le ministre des Finances annonce plutôt une révision des dépenses, ce qui pourrait ouvrir la porte à une nouvelle ère d'austérité libérale à la sauce caquiste », critique Réjean Leclerc.
Privatisation
Le gouvernement aurait pu dégager des sommes importantes en déprivatisant le réseau de la santé et des services sociaux. La première ligne est contrôlée par les médecins entrepreneurs, la marchandisation des soins aux personnes en perte d'autonomie est dispendieuse, les cliniques privées lucratives reçoivent de l'argent public pour dégager des profits, etc. Il y a place aux économies.
De grands besoins
Les besoins sont nombreux en santé et services sociaux. Parmi ceux identifiés par la FSSS-CSN :
– Accroissement du budget des établissements publics au-delà des « coûts de système » ;
– Réinvestir dans les soins à domicile publics et les soins de santé communautaires, une priorité pour la population ;
– Augmenter les investissements dans la prévention de la maladie ;
– Hausse du financement des organismes communautaires autonomes qui bouchent tant bien que mal les trous dans le filet social ;
– Accroître les budgets dédiés au secteur préhospitalier afin d'augmenter le nombre de paramédics sur la route, en phase avec l'idée de désengorger les urgences et la première ligne. Également, accroître leur autonomie afin de rendre la profession attractive ;
– Financer adéquatement le réseau public pour l'hébergement digne des personnes âgées qui ne peuvent demeurer à la maison ;
– Accélérer le développement du réseau des CPE ;
– Soutenir les familles d'accueil qui reçoivent des jeunes de la DPJ ou des adultes vivant avec une déficience intellectuelle et physique.
Conditions de travail dans le réseau
Judith Huot, première vice-présidente de la FSSS-CSN, désapprouve particulièrement que la CAQ fasse porter son déficit record de 11 milliards $ en bonne partie sur les épaules des travailleuses et travailleurs, sur la hausse de leur rémunération. « Le ministre Girard a-t-il déjà oublié que les conditions d'emploi peu attractives dans le réseau public, composé à très grande majorité de femmes, ont engendré une difficile pénurie de main-d'œuvre au cours des dernières années ? »
Hébergement pour femmes et enfants victimes de violence
Lucie Longchamp, aussi vice-présidente FSSS-CSN, est déçue du peu d'investissement dans les secteurs qu'elle représente : préhospitalier, services de garde éducatifs, RPA, hébergement pour jeunes et adultes... Particulièrement par le sous-financement des organismes pour femmes et enfants victimes de violence conjugale, dont les difficultés ont fait la manchette récemment.
« C'est un non-sens, avec la hausse des féminicides, qu'on ne finance pas correctement et de manière pérenne ces ressources essentielles », lance Lucie Longchamp. « Qu'est-ce qu'on attend ? Pour la FSSS-CSN, il ne peut y en avoir une de plus. »
FADOQ : Un budget satisfaisant malgré quelques angles morts
MONTRÉAL, le 12 mars 2024 - Malgré un contexte budgétaire difficile, le Réseau FADOQ a été entendu.
Le budget du gouvernement du Québec a apporté une bonne nouvelle aux bénéficiaires de la rente d'invalidité. À compter du 1er janvier 2025, la réduction de la rente de retraite pour les personnes aînées de 65 ans et plus en situation d'invalidité sera abolie. Il s'agissait d'une de nos demandes de longue date puisque ces pénalités, imposées actuellement à 77 000 personnes, s'apparentaient pour nous à de la discrimination de la part de l'État.
« Le gouvernement du Québec pose le bon geste en mettant fin à ces pénalités, autant pour les personnes qui les subissent actuellement que pour les futurs bénéficiaires », a déclaré Gisèle Tassé-Goodman, présidente du Réseau FADOQ.
La plus grande organisation de personnes de 50 ans et plus au Québec demandait également des investissements en santé pour accroître la main-d'œuvre et pour le virage vers les soins à domicile. Ce budget répond aux attentes en ce sens puisqu'il contient 3,7 milliards $ sur cinq ans pour le réseau de la santé.
Les investissements seront destinés à la main-d'œuvre, à l'ajout de lits et au rehaussement de l'efficacité de la prestation des soins, notamment avec la réduction de la paperasse. De plus, cet argent permettra l'augmentation de l'offre de soins et de services à domicile.
« Les personnes aînées souhaitent vivre à domicile le plus longtemps possible. Le Réseau FADOQ insistait sur le rehaussement des investissements en la matière puisque trop de gens sont en attente d'un premier service », a commenté Mme Tassé-Goodman.
Angles morts
Bien que le budget soit satisfaisant, le Réseau FADOQ tient à avoir des précisions sur deux points.
En premier lieu, le gouvernement a réitéré sa volonté de se retirer du Régime canadien de soins dentaires et d'obtenir une pleine compensation financière sans condition de la part du gouvernement fédéral. L'enthousiasme des personnes aînées envers ce régime de soins dentaires est évident. Il est donc nécessaire que le gouvernement du Québec envoie le signal qu'il réinvestira les sommes associées à son retrait dans des soins dentaires.
En deuxième lieu, le ministre des Finances, Éric Girard, a annoncé un examen des dépenses gouvernementales.
Le Réseau FADOQ est tout à fait conscient que le Québec fait face à une situation économique difficile et que certains postes de dépenses pourraient être révisés. Cependant, il est primordial que les personnes aînées ne fassent pas les frais de cet exercice, particulièrement celles qui sont parmi les plus vulnérables de notre société.
Autres mesures positives
Ce budget contient aussi 15 millions $ afin de renforcer les actions du Curateur public pour prévenir et détecter les abus sur les personnes faisant l'objet d'une tutelle privée d'ici 2029. Des abus ont été constatés au cours des dernières années. Le gouvernement en prend acte et déploie plus de ressources pour que le Curateur public mène à bien ses mandats.
Ce budget a permis une consolidation des investissements, notamment de l'allocation-logement et du transport adapté, des mesures essentielles pour les plus vulnérables.
Budget du Québec 2024-2025 : le mouvement d'action communautaire autonome négligé (RQ-ACA)
TIOHTIÁ:KE/MONTRÉAL, le 12 mars 2024 - Le Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA) déplore la quasi-absence de mesures de bonification significative pour le financement des organismes d'action communautaire autonome (ACA) au budget 2024-2025.
L'espoir suscité à la sortie du Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027 n'a pas fait long feu. Alors que le RQ-ACA estime que les investissements supplémentaires nécessaires pour l'ensemble des 4500 organismes se calculent dorénavant en milliards$, les quelques 82 millions$ identifiés pour 2024-2025 dans des mesures bien précises sont loin du compte : banques alimentaires 30 M$ ; intégration des personnes immigrantes 10 M$ ; haltes-garderies 1,3 M ; organismes en difficulté dans le domaine de la santé et des services sociaux (santé mentale, déficience, dépendance, etc.) 39 M$ dont seulement 10 M$ qui seront déployés dans le programme général.
"L'écart entre les besoins des organismes d'ACA et le financement gouvernemental accordé pour soutenir leurs missions ne cesse de croître", constate Hugo Valiquette, président du RQ-ACA. Encore pire, faute d'indexation du financement à la mission, un grand pan du mouvement voit son financement décroitre chaque année.
Dans le contexte social et économique actuel où la population a plus que jamais recours aux services et activités des organismes communautaires, le financement insuffisant se traduit par une surcharge de travail sans espoir de nouvelles embauches et d'amélioration des conditions de travail pour les travailleuses et travailleurs. Il en résulte un exode vers d'autres secteurs d'emploi, augmentant ainsi la charge de travail des équipes en place qui se voient happées dans une spirale sans fin d'épuisement professionnel. Les constats de l'Observatoire de l'ACA sont sans équivoque : 74% des organismes d'ACA font face à des difficultés de rétention du personnel et 80% à des problèmes de recrutement. Que faire alors pour éviter l'hécatombe, si ce n'est d'offrir un meilleur soutien financier à la mission des organismes ?
Avec son budget 2024-2025, le gouvernement a malheureusement raté une occasion de corriger la situation, mais nous ne baissons pas les bras. L'augmentation substantielle et l'indexation du financement à la mission, ainsi que les enjeux d'autonomie demeureront au cœur de nos revendications tout comme la consolidation de l'action communautaire autonome par une loi ou un autre levier.
Rappelons que le gouvernement Legault a amputé les finances publiques d'environ 1,8 milliard$ par année en raison de la diminution de 1% des taux des 2 premiers paliers d'imposition et qu'il prévoit les réduire d'un autre 1,5% d'ici 2032. Indigné par l'accentuation des inégalités sociales et par la détérioration du filet social, le RQ-ACA invite le gouvernement du Québec à plutôt s'appuyer sur une meilleure redistribution de la richesse pour réinvestir dans les services publics et les programmes sociaux ainsi que dans la mission des groupes d'action communautaire autonome.
Réaction de la CSQ au budget 2024-2025
« Un budget qui évite le pire… pour l'instant »
QUÉBEC, le 12 mars 2024 - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et son président, Éric Gingras, réagissent à chaud au budget du Québec 2024-2025 : « Le gouvernement accepte de repousser à plus tard son objectif de retour à l'équilibre budgétaire. Il évite ainsi, pour l'instant, de replonger le Québec dans le cercle vicieux de l'austérité. Avec un déficit réel de 7,2 G$ (11 G$ après la provision pour éventualité et le versement au Fonds des générations), le gouvernement subit les impacts du ralentissement économique, des baisses d'impôt tout en assurant le maintien des missions de la santé et de l'éducation », déclare Éric Gingras.
« Bien qu'il n'y ait pas d'investissements qui auraient permis de poursuivre l'impulsion donnée à nos réseaux publics par les négociations, on ne peut pas parler d'austérité cette année pour ces deux missions essentielles. Dans un contexte où la réduction de la dette est sous contrôle et que l'atteinte de l'équilibre budgétaire réel est prévue pour 2027-2028, c'était le bon choix à faire », souligne le président de la CSQ.
Ne pas rejouer dans le film de l'austérité
« Si le pire est évité à court terme, il faudra être vigilant au prochain budget lors de la publication du plan de retour à l'équilibre budgétaire. Il faut craindre un retour à l'austérité alors que le gouvernement voudra alors freiner la croissance de ses dépenses. Rappelons que le gouvernement vit maintenant les conséquences des importantes et récurrentes baisses d'impôt consenties l'année dernière », ajoute M. Gingras.
En éducation et en enseignement supérieur
« Avec l'augmentation de 6,7 % du budget de l'éducation et de 3,5 % en enseignement supérieur, le gouvernement ne se permet de financer que le maintien des services tout en recyclant quelques annonces précédentes », affirme Éric Gingras. De fait, la part du lion des 293 M$ supplémentaires annoncés pour cette année sert à financer le plan de retour en classe qui avait déjà été annoncé à la suite de la grève et à prolonger de 2 ans des mesures d'attraction et de rétention déjà en place dans le réseau scolaire.
Rien pour la formation professionnelle et l'éducation aux adultes
Malheureusement, alors que la pénurie de main-d'œuvre continue de sévir, rien n'est prévu pour donner enfin accès à la formation professionnelle à temps partiel. De même, à la formation générale des adultes, le financement par enveloppe fermée continuera de restreindre les effectifs. « Or, l'accès à l'éducation et à la formation représente la première clé dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités », avance M. Gingras.
Un déficit d'entretien toujours important
Le budget prévoit 15,5 millions de plus par année pour accélérer l'entretien des écoles et majore de 450 M$ sur 10 ans son plan d'investissement dans le réseau scolaire. « Ces annonces sont les bienvenues, mais apparaissent nettement insuffisantes face au 8,5 G$ de déficit d'entretien des infrastructures d'éducation reconnu par le gouvernement », souligne le président de la CSQ.
Pour une vaste réflexion en éducation
« Si l'éducation est véritablement une priorité pour le gouvernement Legault, il faut éviter les mesures à la pièce et jeter rapidement les bases d'une réflexion collective sur l'avenir de notre système d'éducation », plaide M. Gingras.
Enseignement supérieur
Le gouvernement Legault poursuit le surplace en enseignement supérieur. « Encore une fois, le secteur de l'enseignement supérieur ne fait l'objet d'aucun investissement additionnel. Les seules sommes prévues dans le budget sont en prévision de la révision de la politique québécoise de financement des universités dont nous connaîtrons les impacts plus tard », déplore Éric Gingras.
En santé et services sociaux
Avec une croissance moyenne de 4,4 % du budget du système de santé et services sociaux sur 3 ans, le gouvernement s'appuie trop fortement sur les changements de structure pour bonifier les services de santé. Des sommes considérables sont consacrées au virage numérique (180 M$), aux soins à domicile (91 M$), au Guichet d'accès (23 M$) et à l'élargissement du financement axé sur le patient. « On peut douter que ces réformes de structure viennent compenser pour les besoins importants de notre système. Du bon côté, dans le contexte démographique actuel, les investissements supplémentaires (243,5 M$) pour soutenir le maintien à domicile et l'hébergement des personnes aînées sont les bienvenus », souligne M. Gingras.
Déception en petite enfance
Le budget prévoit, pour 2024-2025, un financement pour la conversion de 1000 places non subventionnées en places subventionnées. C'est 1000 places de plus que les 8603 places déjà prévues, mais contrairement à nos demandes, le gouvernement n'offre toujours pas d'incitatifs pour qu'elles soient intégrées au réseau des centres de la petite enfance (CPE). On peut se demander si, à terme, le réseau québécois de CPE sera remplacé par un réseau de garderies privées subventionnées », affirme M. Gingras.
Logement, environnement et culture
Malgré la crise du logement qui perdure, les sommes prévues pour favoriser l'accès au logement sont nettement insuffisantes et non adaptées aux besoins criants. Il aurait fallu un plan costaud et pluriannuel de création de logements sociaux afin de combler le retard accumulé au Québec depuis plusieurs années.
De même, ce n'est pas avec ce budget que la CAQ va améliorer son bilan environnemental. Le Plan québécois des infrastructures (PQI) consacre encore la majorité des sommes au développement du réseau routier (57 %). « Le développement d'un réseau efficace et accessible de transport collectif si essentiel à la transition juste et pour réduire les dépenses des ménages devra attendre », affirme Éric Gingras.
Finalement, la CSQ salue les nouveaux investissements pour promouvoir la culture, la langue française et les médias, notamment le soutien accru à Télé-Québec.
Condition des aînés
Enfin, la CSQ tient à saluer l'élimination de la réduction de la rente pour les aînés en situation d'invalidité qui atteignent l'âge de 65 ans. Cela représente une bonification pouvant atteindre 3930 $ par année, soit une hausse d'environ 32 % de la rente de retraite.
La CSQ est cependant préoccupée par le silence du gouvernement quant à sa volonté de contribuer à parts égales à la surindexation du RREGOP que permettent les plus récents résultats financiers. Les retraités actuels ont eu droit à une majoration de 0,8 % de la part autofinancée de leur rente. « Le gouvernement a jusqu'au 1er juillet pour annoncer qu'il ajustera la sienne. Nous sommes déçus que le budget ne le confirme pas encore », déplore le président de la CSQ.
Prendre les devants - Le balado de la CSQ
Pour aller plus loin dans l'analyse détaillée du budget, le président Éric Gingras animera en direct, ce soir, dès 19 h, le quatrième épisode du balado de la CSQ, « Prendre les devants », au cours duquel est notamment prévue une discussion avec deux économistes de la Centrale sur les enjeux qui touchent directement les membres de la CSQ.
Budget 2024-2025 en santé et services sociaux - Un pied dans l'austérité : une croissance des dépenses incohérente avec les défis qui attendent le réseau public de santé (FIQ)
MONTRÉAL, le 12 mars 2024 - La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ s'inquiète des impacts de la baisse drastique de la croissance des dépenses en santé et services sociaux prévue au budget provincial présenté aujourd'hui. Alors que dans les dernières années, le réseau a pu compter sur une augmentation annuelle moyenne de 7,3 %, le budget 2024-2025 limite la croissance des dépenses à 4,2 %, variation qui diminuera encore davantage l'année prochaine. Toutes les prémisses sont mises en place pour dérouler le tapis rouge à l'austérité dès l'année prochaine, au détriment des services de santé et de services sociaux.
« C'est insensé de diminuer les dépenses alors qu'une réforme gigantesque du réseau est sur un point de voir le jour » affirme la présidente de la FIQ, Julie Bouchard. Dans son mémoire prébudgétaire, la FIQ avait, au contraire, exhorté le gouvernement à prévoir un poste budgétaire supplémentaire distinct pour soutenir financièrement la gestion du changement devant mener à la création de Santé Québec. « Les dernières réformes en santé n'ont jamais été soutenues par des moyens financiers conséquents, avec les contrecoups dévastateurs que l'on connaît aujourd'hui : désertion des professionnelles en soins, attentes en chirurgie, difficile accès aux soins de première ligne et j'en passe. On ne peut plus rejouer dans ce film-là ».
La Fédération s'indigne également du fait qu'aucune distinction ne soit réalisée entre les investissements faits dans les établissements publics de santé et les dépenses octroyées aux prestataires privés de soins de santé. De plus, aucune balise ou limite de dépenses n'est imposée en ce qui concerne le détournement de l'argent public vers les investisseurs privés. « Nous savons très bien que les chiffres sont astronomiques, nous l'avons constaté avec le coût des chirurgies au privé. Le ministère des Finances a une part de responsabilité dans le contrôle des dépenses attribuables à cette dérive », souligne la présidente de la FIQ.
La FIQ tient toutefois à saluer :
• L'annulation de la réduction de la rente de retraite pour les aîné-e-s de 65 ans et plus en situation d'invalidité ;
• L'augmentation de la proportion des soins dédiée aux soins à domicile (581 millions / 5 ans) ;
• L'investissement de 140 millions de dollars sur 5 ans pour déployer le Tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle ;
• Le financement des 16 CHSLD privés restants à conventionner à hauteur de 182 M$.
Dans le contexte actuel, il est responsable de la part du gouvernement de reporter l'atteinte de l'équilibre budgétaire. Toutefois, notons que la CAQ est le maître d'œuvre de cette décision budgétaire difficile par ses décisions passées. Pour terminer, nous partageons des objectifs communs avec le Plan santé, notamment l'attribution d'un groupe de médecine familiale à plus de 900 000 Québécoises et Québécois ; la bonification des soins et services d'aide à domicile ; et la mise en place du Guichet d'accès à la première ligne (GAP), dans l'ensemble du Québec, pour les personnes qui n'ont pas accès à un médecin de famille. Mais les sommes demeurent insuffisantes pour réaliser ces objectifs.
Budget du Québec 2024-2025 : Quand un ministre des Finances « féministe » abandonne ses étudiantes stagiaires (FECQ)
QUÉBEC, le 12 mars 2024 - Bien que le budget du Québec 2024-2025 se targue de prioriser la santé et l'éducation, les associations étudiantes québécoises réunies au sein du Front pour la rémunération s'indignent de l'absence totale d'investissement visant la rémunération des stages. Alors que la société québécoise constate un déclin drastique de ses services publics et que la population étudiante québécoise est tout particulièrement frappée par la hausse du coût de la vie, on ne daigne toujours pas accorder une juste rémunération aux stagiaires du Québec. Ces stagiaires, principalement des étudiantes, effectuent un travail essentiel au sein des réseaux de la santé et de l'éducation. Ces femmes seront pour, une énième année, forcées de choisir entre la poursuite de leurs études et leur sécurité financière.
Au cours de la dernière année, l'Institut de recherche et d'information socioéconomique (IRIS) a sorti les chiffres suivants : 84% des stages sont non rémunérés, 74% sont effectués par des femmes et 64% sont effectués au sein du réseau public. Afin de résoudre cette injustice historique qui favorise clairement l'étudiant en génie à l'étudiante en soins infirmiers, la Fédération étudiante collégiale du Québec et l'Union étudiante du Québec ont été claires : dans le budget 2024-2025, il devait absolument y avoir des investissements permettant de rémunérer toutes les personnes effectuant des stages de mise en pratique au Québec, investissements se chiffrant à 545,6 M$ par année.
Au fil des derniers mois, deux motions soulignant l'importance de la rémunération des stages présentées à l'Assemblée nationale ont été adoptées à l'unanimité tandis que la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Déry, a affirmé que l'enjeu faisait partie de ses priorités. Dans un tel contexte, l'absence complète de crédits budgétaires pour la rémunération des stages est une véritable insulte pour l'entièreté du mouvement étudiant. Les associations étudiantes collégiales et universitaires tiennent à rappeler que le réseau de l'enseignement supérieur est indispensable afin de combattre la pénurie de main-d'œuvre qui sévit au sein des réseaux de l'éducation, de la santé et des services sociaux.
Alors que le ministre Girard a affirmé à de nombreuses reprises en conférence de presse être un ministre des Finances féministe, il abandonne une fois de plus les milliers d'étudiantes stagiaires indispensables à nos réseaux. Ces étudiantes abandonnées sont des mères de famille, des immigrantes ou des étudiantes en situation de handicap qui veulent toutes avoir les moyens de réussir leurs stages de manière à obtenir leur diplôme pour éduquer ou soigner tout en payant leur loyer. Aujourd'hui, le gouvernement clame haut et fort que ce seront elles qui devront payer, pour une année de plus, le prix de son inaction.
Citations :
« En matière de revendications étudiantes, la non-rémunération des stages est l'éléphant dans la pièce d'un budget qui laisse les stagiaires sur leur faim. Après un automne de mobilisation et une volonté affichée d'agir de la part de la ministre, la FECQ se voit amèrement déçue de l'absence totale d'investissements à cet égard. »
– Laurence Mallette-Léonard, présidente de la Fédération étudiante collégiale du Québec
« L'UEQ craint que les efforts que le Québec a faits cette année pour améliorer les conditions de travail, notamment celles des personnes enseignantes et infirmières, soient peine perdue si nous ne réglons pas le problème criant des stages non rémunérés. Si nous voulons régler les problèmes de pénurie d'emplois, il nous apparaît incontournable que nous nous devons de rémunérer nos stagiaires pour leur travail ! »
– Catherine Bibeau-Lorrain, présidente de l'Union étudiante du Québec
Budget du Québec 2024-2025 - Le gouvernement Legault met la table pour un retour à l'austérité, prévient l'APTS
QUÉBEC, le 12 mars 2024 - « À peine un an après avoir consenti des milliards en baisses d'impôts mal avisées, le gouvernement annonce être dans une situation financière difficile et devoir amorcer une révision des dépenses. La table est mise pour un retour aux compressions et aux mesures d'austérité, à faire toujours plus avec toujours moins. Une chose est sûre, on est loin de pouvoir qualifier ce budget de responsable ». C'est en ces mots qu'a réagi le président de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), Robert Comeau, à la présentation du budget du Québec 2024-2025.
Pour l'APTS, deux ingrédients se révéleront essentiels pour assurer la pérennité des services à la population ainsi que le contrôle de leurs coûts : un engagement ferme envers la déprivatisation du réseau de la santé et des services sociaux et un plan sérieux pour le sevrer de sa dépendance à la main-d'œuvre indépendante. Autrement, l'exercice à venir de révision des dépenses ne peut que se traduire par des mesures d'austérité, des compressions dans des services cruciaux pour les Québécois•es et une place encore plus grande pour les entreprises privées dans l'offre de services.
« Il faut faire passer la santé avant les profits. On doit cesser d'entretenir la place du privé dans la santé et les services sociaux. Le choix des services publics sera toujours le choix le plus responsable. Nous exigeons un engagement clair du gouvernement en ce sens », poursuit Robert Comeau.
Les plateaux techniques, incontournables pour assurer la fluidité dans le réseau hospitalier
Parmi les priorités de ce budget figure un engagement du gouvernement « d'améliorer l'accès aux soins et aux services et accroître la fluidité hospitalière ». Or, le secteur névralgique des plateaux techniques — laboratoires, imagerie médicale, médecine nucléaire, électrophysiologie médicale et radio-oncologie — est essentiel pour y parvenir mais reste encore une fois dans l'angle mort du gouvernement.
« Sans investissements importants pour valoriser les professions et moderniser les équipements dans les laboratoires ainsi que dans le grand secteur de l'imagerie médicale, il va continuer d'être très difficile d'effectuer les analyses et examens nécessaires aux diagnostics et traitements requis pour la population. Le gouvernement doit envoyer un signal fort, démontrant qu'il en fera une priorité afin d'assurer la fluidité dans le réseau hospitalier », ajoute Robert Comeau.
Des solutions responsables, qui demandent du courage
Des alternatives étaient cependant à la portée du gouvernement pour mieux financer les services publics, à condition d'avoir le courage politique de faire des choix véritablement responsables, notamment une marche arrière sur les milliards dont s'est privé le gouvernement avec les baisses d'impôts du budget 2023-2024, et la suspension immédiate des versements au Fonds des générations. À elles seules, ces deux mesures permettraient d'injecter entre 3 et 4 milliards de dollars supplémentaires dans les services publics.
Il faut arrêter de mettre à mal les services publics et éviter tout nouveau cycle d'austérité. Pour ce faire, l'APTS enjoint le gouvernement à se mettre à l'écoute des propositions innovantes promues par la Coalition main rouge - dont est membre l'APTS - regroupant des organisations syndicales, du milieu communautaire et des groupes de la société civile.
Budget 2024-2025 : réaction des Banques alimentaires du Québec - Les Banques alimentaires du Québec se réjouissent de l'aide annoncée pour assurer un approvisionnement en denrées permettant de répondre à la demande historique
LONGUEUIL, QC, le 12 mars 2024 - Le réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ) app

La démarche d’accès à l’indépendance

J'ai participé à un panel concernant à l'invitation du Mouvement Québec Indépendant (MQI). J'y ai défendu la position de QS concernant l'assemblée constituante et exposé mes positions concernant l'indépendance qui se doit nécessairement d'être inclusive, citoyenne et comme le dit si bien Émilise Lessard-Therrien : On ne fera pas un pays pour les patrons des multinationales, mais pour qu'il appartienne au peuple.
Description des panélistes
ANDRÉ FRAPPIER
D'abord militant syndical au Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) ainsi qu'à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), il s'est impliqué en politique avec Québec solidaire, lors de la fondation du parti, en 2006. Il a été candidat de ce parti aux élections de 2007, de 2008, 2012 et 2014. En 2012, il a succédé à Amir Khadir comme président co-porte-parole de QS et il a participé au États généraux de la souveraineté. Co-auteur du Printemps des carrés rouges publié en 2013, il fait partie du comité de rédaction de Presse-toi à gauche et de Canadian Dimension.
DANIEL MICHELIN
Formé en criminologie et en administration publique, il a été attaché politique au cabinet de Véronique Hivon puis au bureau de comté de la député de Joliette de 2012 à 2017. Il a aussi occupé la même fonction auprès de l'ex-députée de Marguerite-D'Youville, Monique Richard. En 2018 et 2022, il a été candidat du Parti québécois dans la circonscription de Montarville. Actuellement, il coordonne les instances du Parti québécois dans six circonscriptions de la Montérégie.
MARTINE OUELLET
Ingénieure de formation, Martine Ouellet a fait carrière à HydroQuébec. Avant son entrée en polique, elle milite dans le mouvement écologique Eau Secours. De 2010 à 2019, elle est députée de Vachon pour le Parti québécois et ministre des Ressources naturelles dans le Gouvernment Marois. Elle est par la suite candidate à la direction du PQ à deux reprises. En 2017-2018 elle est cheffe du Bloc québécois. En mai 2021, elle crée son propre parti écologiste et indépendantiste, Climat Québec.
André Frappier
J'ai passé une bonne partie de ma vie au sein d'un syndicat canadien, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes. Cela m'a permis de tisser des liens avec les progressistes du ROC et de lier la question de l'indépendance à la solidarité avec les travailleurs et travailleuses du Reste du Canada et vice versa. L'establishment canadien ne laissera pas une population prendre sa destinée en main en faisant l'indépendance sans réagir. Les liens de solidarité seront importants.
Le constat, où va-t-on quelles sont les embuches ?
En ce moment environ 35% de la population serait en faveur de l'indépendance. Mais là encore on ne sait pas exactement quel projet cela signifie dans la tête des gens. Même au sein des partis souverainistes il y a un taux significatif de personnes qui ne sont pas favorable à l'indépendance. Le taux le plus élevé favorable (43%) se situe dans les 65ans et plus, on manque visiblement de relève. Même au sein du PQ et de QS une certaine proportion n'est pas indépendantiste. Elle est plus forte à QS pour des raisons spécifiques. Plusieurs adhèrent au projet de changement social et à l'aspect progressiste avant tout.
Nous devons réfléchir à la façon d'aller chercher ceux et celles qui n'adhèrent pas à l'indépendance et se poser la question pourquoi. On ne peut pas réduire notre stratégie pour l'indépendance à une élection ou un éventuel référendum. Il faut travailler dès maintenant à gagner une majorité de personnes à la nécessité de rupture avec l'État canadien.
Comment y arriver
Ce n'est certainement pas en refusant aux enfants de personnes immigrantes sans statut le droit aux garderies comme le fait le gouvernement Legault qu'on envoie un message d'un Québec inclusif.
L'immigration. La crise environnementale planétaire causée par l'industrialisations et l'exploitation effrénée des ressources naturelles, par les multinationales, combinée à l'exploitation économique dont profite les sociétés nordiques, va obliger de plus en plus les populations du sud global à migrer vers le nord. On doit à la fois se préparer à les accueillir, on doit lutter contre le capitalisme global et développer notre solidarité internationale avec ceux et celles qui luttent dans le même sens. L'indépendance doit être un moyen de prendre le contrôle de nos ressources naturelles et de gérer notre environnement.
L'indépendance c'est un peu comme une révolution, c'est un changement de société. Les citoyens et citoyennes ne vont pas poser un geste aussi important si ça ne change pas leur vie. L'indépendance c'est reprendre en main notre économie, nos institutions. C'est enlever le contrôle de notre territoire aux multinationales, c'est développer l'exercice démocratique populaire.
À ce chapitre la filière batterie du gouvernement de la CAQ va complètement dans le sens opposé. Penser remplacer le parc automobile à essence par des batteries est lourd de conséquences en termes d'exploitations des minerais. Cela va décupler l'extraction minière déjà nocive et sous le contrôle des multinationales. Sans compter le nom respect des normes environnementales et les subventions gouvernementales éhontées. C'est un combat qu'on peut et doit mener maintenant.
Le plan de transport élaboré par QS lors de la dernière campagne électorale liait à la fois l'efficacité et la décroissance énergétique, mais bien sûr pour y arriver il faut aussi avoir le contrôle des voie ferrées.
Maintenant comment QS pense-t-il réaliser l'indépendance, par quel processus y arriver ? Un gouvernement solidaire mettra sur pied une assemblée constituante dès son élection. Cette assemblée procédera d'en processus électif qui permettra la parité homme femme.
L'assemblée constituante, c'est un projet d'exercice démocratique et rassembleur. La liberté d'un peuple dépend notamment de sa capacité de contrôler, d'exploiter et de transformer ses propres ressources. Sans maîtrise des outils économiques, la souveraineté politique n'est qu'une illusion. Québec solidaire s'engage à enclencher, dès son arrivée au pouvoir, une démarche d'Assemblée constituante :
Sera élue au suffrage universel et sera composée d'un nombre égal de femmes et d'hommes. Le mode de scrutin assurera la proportionnelle des tendances et des différents milieux socio-économiques présents au sein de la société québécoise.
Les membres de l'Assemblée nationale ne pourront pas se faire élire à l'Assemblée constituante, celle-ci aura la responsabilité et les moyens de mener un vaste processus de démocratie participative visant à consulter la population du Québec sur son avenir politique et constitutionnel.
En fonction des résultats de la démarche cette dernière élaborera un projet de constitution. Le projet de constitution sera soumis à la population par référendum, ce qui marquera la fin du processus
On peut avoir des désaccords sur la mécanique du processus constituant, mais le débat principal n'est pas là. Il faut regarder aujourd'hui, comment on fait pour arriver là ? Comment gagner une majorité à la lutte pour l'indépendance, on est très loin du compte en ce moment. Selon les sondages ce sont les 65 ans + qui sont majoritairement indépendantistes. Les plus jeunes le sont moins, ils sont plus souvent altermondialistes, ce qui dénote une importante conscience politique.
Il y a des questions fondamentales qui ont divisé les partis qui se réclament de la souveraineté, qu'on ne peut éviter de soulever. Les populations racisées et les populations immigrantes semblent exclues de ce débat. En fait comment convaincre ces populations que notre projet de changement les inclue ? Ce n'est certainement pas avec les positions prises concernant le port du voile qui exclue une partie de la population du droit de travailler à certains emplois sous prétexte que nous serions un État laïque. (Ce qui est faux en pratique, la liste est longue, les noms de ville, les jours fériés, les subventions aux écoles religieuses et aux congrégations religieuses catholiques…)
Tant qu'on n'agit pas de façon à démontrer que tout le monde jouit de droits égaux dans la société que nous voulons bâtir, tant que des gens vont se sentir exclus, tant qu'on fait des différences et qu'on porte des jugements, si on ne construit pas un Québec inclusif où tout le monde a sa place, on est très mal pris.
Le nombre de personnes immigrantes que nous pouvons accueillir n'est pas une question de chiffres ou de quotas mais relève d'un problème planétaire. Les populations du Sud Global exploitées par les multinationales, dont les compagnies minières ayant leur siège social à Toronto, subissent plus fortement les conséquences du réchauffement climatique, sont confrontées à la nécessité de migrer vers le nord pour des raisons de survie. Ces populations n'ont pas le choix, elles ne viennent pas ici en touristes.
Alors la vraie question est d'abord comment se préparer à les accueillir. Ensuite, comment agir pour qu'ils ne soient plus dans la déchéance économique, comment exprimer notre solidarité internationale avec ceux et celles qui se battent pour leur survie.
La question de la laïcité a beaucoup divisé les souverainistes. Les positions véhiculées par la loi 21 et 96 ont stigmatisé une partie de la population, qui ne peut se voir comme inclue dans le projet d'indépendance.
Défendre l'indépendance c'est proposer un projet où on reprend en main notre économie, où on nationalise les compagnies minières et forestières. Où on crée un engouement pour une nouvelle société égalitaire. C'est maintenant que nous devons mener ces luttes qui vont stimuler les gens à agir et à se mobiliser.
Daniel Michelin
Il faut chercher des voies de passage. On a fait le bilan de la campagne électorale de 2018, il faut effacer le tableau noir et recommencer. On a fait un bilan lucide et rigoureux avec nos sympathisants. Il faut que le projet national du PQ soit recentré sur l'indépendance. On doit s'adresser à l'intelligence et toujours dire ce qu'on va faire.
En 2022 c'est ce qu'on a fait, Paul St-Pierre Plamondon a promis qu'il refuserait de prêter serment à la couronne britannique et a tenu parole. Quand on se tient debout avec nos convictions, on brise le statu quo.
C'est un projet qui va demander effort, courage, confiance et détermination. Il faut élever ce débat, on est sur une trajectoire avec nos alliés et on ne va pas dévier. Comment y arriver ? À l'élection de 2026 on va mettre de l'avant le projet de pays avec le Livre Bleu qui va tracer les contours du Québec souverain. Les Québécois vont savoir qu'ils vont voter pour un parti qui enclenche le processus de l'indépendance, pour un Québec libre de ses choix avec le Budget de l'an 1.
Pour PSPP les conditions gagnantes pour gagner un référendum c'est fini, la gouvernance souverainiste c'est fini. Nous ne voulons pas gouverner une province, nous voulons gouverner une province qui est en train de devenir un pays. À partir des élections de 2026 avec une pluralité de sièges, on lance le processus.
Au PQ nous allons être des démocrates intraitables. Tous les outils démocratiques ont leur place. Si la tendance se maintient et qu'on est élus avec une pluralité de sièges, 32% des votes signifie que beaucoup n'ont pas voté pour nous. Le système uninominal à un tour entraine des distorsions importantes. Martine voudrait qu'on déclare l'indépendance avec un système avec autant de distorsions que celui-là, je suis ahuri.
Tous les outils démocratiques ont leur importance, c'est comme une symphonie. En démocratie on a l'élection, on a les référendums. Je ne savais pas que c'était une invention des anglais parce-que ça se parle à travers le monde. C'est la partie 4 de la symphonie. La partie 1 c'est la démocratie représentative, la 2 les commissions parlementaires la 3 l'assemblée constituante.
QS nous parle de l'exemple extraordinaire de la Bolivie qui durant le processus a été obligé loger les constituants dans une caserne militaire parce que ça se tirait dessus dans les rues. Ce n'est pas la panacée.
On ne mettra pas les Québécois dans un piège. On va lancer une grande délibérante nationale, c'est un défi énorme, inclusivement tous les Québécois vont être conviés à cette prise de décision.
Un référendum s'il est instrumentalisé c'est mauvais. Au Chili il a été paqueté à gauche et rejeté à 62%. Ensuite orienté à droite et encore rejeté. Pour nous il n'y aura pas de trappe à souris.
Je respecte le projet de QS qui veut lier le projet d'indépendance à un projet social bien défini. Mais nous ce n'est pas notre position, sinon on n'y arrivera jamais. Faisons l'indépendance et après on se chicanera où on met le rideau et les stores. L'indépendance ça ouvre tous les possibles, c'est une valeur en soi. Ce qui s'en vient dans les prochaines années c'est la bataille de notre vie, il faut s'élever pour rencontrer cet objectif, il faut s'élever au-dessus de nos contingences.
Martine Ouellet
La démarche d'accession à l'indépendance, depuis 1990 ça fait 30 ans au PQ qu'on n'a jamais eu l'occasion de discuter de la démarche. La réponse qu'on entend c'est le référendum. Ce n'est à peu près pas discutable, on a été brainwashé par ça.
QS a adopté cette approche qui n'était pas celle d'ON. Pré indépendance.
Il y a très peu de pays qui ont fait un référendum pour déclarer leur indépendance. La plupart ont fait un référendum après leur déclaration d'indépendance pour adopter leur constitution permanente. Le Canada ne s'est jamais formé par un référendum mais par un simple vote au parlement, basé sur la démocratie parlementaire.
Le livre de Gilbert Paquette mentionne qu'avant 1976 il n'était pas question de référendum. Cette idée est venue de Claude Morin, payé par la GRC. Cela a été suggéré en 1969 par trois personnes, le ministre des finances, Marc Lalonde et un sous-ministre. Pour contrer l'indépendance et gagner du temps, Claude Morin a reçu l'équivalent de $100,000 d'aujourd'hui. C'est une idée des fédéralistes, ils sont brillants. Il ne faut jamais sous-estimer ses adversaires.
On se fait élire pour gouverner une province et on se dit qu'on va faire un référendum plus tard. Tout le temps entre notre élection et le référendum, c'est le temps de tous les pièges. Ne pas penser que pendant tout ce temps-là nos adversaire vont nous faire du sabotage. On l'a vécu en 1980, en 1995 on a eu de bonnes claques dans la face, on devrait se réveiller.
Jamais le Canada ne va rester les bras croisés. Les forces au gouvernement sont occupées avec des crises comme Mégantic, les feux de forêt, donc il faut gérer la province sous contrôle canadien en même temps qu'on veut préparer l'indépendance. C'est beaucoup, donc division des forces. Les fédéralistes eux n'ont pas besoin de diviser leurs forces, ils s'enlignent pour contrer l'indépendance.
En jouant le jeu d'agir comme un gouvernement provincial, on joue contre nous-même. Parce que si on réussit à faire des avancées (comme le refus du serment au roi) cela démontre qu'on peut faire des choses à l'intérieur du Canada, qu'on peut être utiles. Si on ne réussit pas, on se fait de ennemis et on se fait reprocher de ne pas avoir réussi. C'est perdant-perdant.
On s'expose à accumuler des échecs ou des demi succès. On est incapables d'agir, on n'a pas tous les pouvoirs. Regardez Legault avec l'immigration, il ne va rien se passer, il n'a pas de rapport de force.
Climat Québec compte sortir de l'approche référendaire. (Inspiré de PQ RIN 70-73). On met au jeux la constitution initiale de transition avant l'élection. Un vote pour climat Québec c'est l'indépendance du Québec. Une fois au pouvoir avec une majorité de députés indépendantistes, peu importe les partis, on vote la constitution de transition (grand consensus). On enlève le multiculturalisme, le bilinguisme, on met la laïcité, la langue française, on prend la charte des droits et libertés du Québec et on enlève celle du Canada. Ensuite les lois canadiennes s'appliquent jusqu'à ce qu'on les remplace par des lois québécoises.
Il y aura des débats à faire mais on les fera comme pays indépendant et non comme province avec des fédéralistes qui vont venir saboter ces débats-là. On vote la constitution, on aura la constitution indépendantiste à discuter, nous on le fait après avoir fait l'indépendance. QS le fait avant, ce qui est un peu bizarre.
Est-ce qu'on veut un système proportionnel ? Je pense que oui, est-ce qu'on veut un système présidentiel ou un système britannique ? La grande question c'est le pouvoir, on va délimiter des régions administratives, quels seront les pouvoirs délimités dans les grandes régions, ce sera des grands débats. Avec un référendum à la fin pour adopter la constitution permanente.
Mais la grande différence c'est que nous on sera déjà indépendants. Alors si les gens disent que la constitution n'est pas exactement comme ils le voulaient alors ils vont voter contre. Alors on restera indépendants sous la constitution provisoire – initiale- contrairement à Québec solidaire. S'ils se font voter non à leur constitution, ça va être compliqué. Manon Massé s'était déjà fait poser la question et ne savait pas quoi répondre. Alors c'est comme si on restait dans le Canada en posant des gestes de rupture, mais ne pensez pas que le Canada ne va pas réagir, c'est comme un peu ambigu.
C'est pour ça que nous on préfère la clarté, et se détacher du Canada pour ne pas être pris avec le carcan de la constitution canadienne. Parce que les gestes qu'on voudra poser après une élection pour le Québec dans la constitution canadienne, on ne veut plus ça. Si on met les choses claires on sera de très bons voisins. On n'aura plus les problèmes de dire « les conditions gagnantes » parce que le PQ c'est encore dans votre programme, un référendum gagnant, les conditions gagnantes. On n'aura plus cette contrainte, on n'aura pas besoin de référendum.
On est tellement brainwashé par les fédéralistes qu'on les utilise contre nous-même d'avoir appuyé la clause nonobstant sur la laïcité. La mécanique nécessaire c'est de converger vers une démarche commune.
L'ensemble du programme du PQ est provincialiste, même Ruba Ghasal a dit qu'on ne peut se permettre de perdre le prochain référendum. La meilleure façon de ne pas le perdre c'est de ne pas le faire. Entrer dans cette logique c'est culpabiliser le peuple.
Extrait d'une vidéo réalisée par le Mouvement Québec Indépendant
Commentaires émis sur le site du MQI
Gilbert Paquette
Ce débat a démontré que la notion de convergence des forces indépendantistes rencontre la volonté très assumée de la grande majorité des participants de réunir les forces dès maintenant en vue de l'établissement d'une stratégie entre les partis en vue des élections de 2026.
André Frappier
Je remercie le Mouvement Québec Indépendant de m'avoir invité. Pour ma part j'ai mentionné que l'indépendance doit être liée à un projet de société égalitaire et plus démocratique ce qui implique un Québec inclusif. Et non pas une stratégie entre les partis en vue des élections de 2026. C'est maintenant qu'il faut s'attaquer à ces questions et se mobiliser contre l'injustice. Il y a des différences fondamentales entre le PQ et QS. Entre autres en ce qui concerne l'accueil des personnes immigrantes et la façon dont on considère les personnes racisées. Retirer des droits civiques au moyens de la loi 21 est à l'opposé d'un Québec rassembleur et égalitaire. Le projet d'indépendance doit commencer par des luttes communes pour le contrôle de notre économie et contre l'évasion fiscale, pour le contrôle de nos ressources naturelles et pour la démocratie. C'est de cette façon qu'on inspirera la population à l'idée de l'indépendance et non par des tractations électorales.
Gilbert Paquette
Je dois manifester mon désaccord amical et celui de notre mouvement avec André Frappier sur deux points précis. Je crois que le PQ, tout comme Climat Québec et Québec solidaire ont des projets de société égalitaires, plus démocratiques et inclusifs. Cela fait honneur aux indépendantistes. Prétendre le contraire nuit à l'accession à l'indépendance en alimentant des luttes qui ne mènent nulle part. La loi 21, malgré sa faiblesse ne retire aucun droit fondamental et préserve la liberté de conscience face au fondamentalisme religieux dans la dispensation de certains services de l'État, et ce, quelle que soit la religion. La séparation des églises et de l'État est au contraire rassembleuse et égalitaire, contrairement à la constitution canadienne qui repose sur le multiculturalisme qui sépare les Québécois de diverses origines.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Ponds-moi une loi !

– Ponds-moi une Loi !
- Au fil des mois.
– Dans l'hémicycle somnolente ou en émoi.
- Pardon ! Je te tutoie.
– Toi qui sièges au Bourbon paré de dorure et de soie.
– Ponds-moi une Loi !
- En mon absence, c'est toi qui vois.
- Ponds-moi une Loi !
- Elu (e), à chaque fois.
- Donnant matière à tes séances meublées de vacuité sans joie.
- Ponds-moi une Loi.
– A débattre à l'Assemblée, ça va de soi.
- Alambiquant ma vie et ma foi.
– Ponds-moi une Loi
– Je compte jusqu'à trois.
– A corseter ma Liberté aux abois. -
Ponds-moi une Loi !
– Je ne vois pas ce que tu vois.
– Mon âme se noie.
– Ponds-moi une Loi !
– A me taxer mort(e) ou vif (ve), t'en as le droit.
– Ponds-moi une Loi !
– Sur tout et n'importe quoi.
– Ô Député (e) qui a pris du poids.
– Ponds-moi une Loi !
– Pour mes enfants en proie.
– A tes intrications rétribuées avec joie.
– Ponds-moi une Loi !
– A accoucher d'une autre Loi !
Texte et illustration : Omar HADDADOU Paris 2024
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.











