Derniers articles
Un hôtel en grève contre ses patrons adeptes de paradis fiscaux
Lettre : La promesse aux accidentés de la route a été trahie
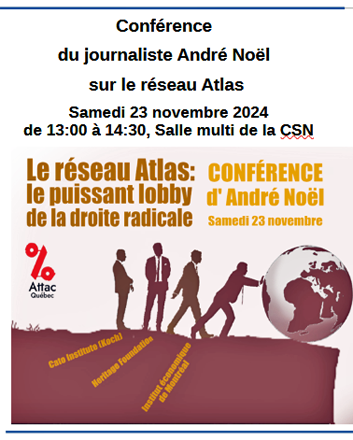
Conférence du journaliste André Noël sur le réseau Atlas
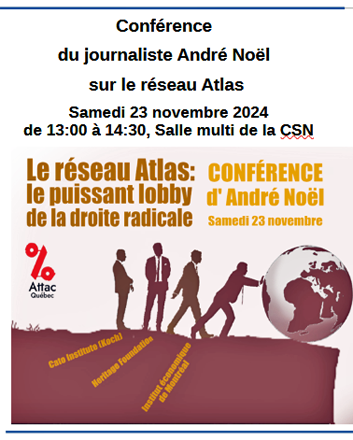
À l'heure où Donald Trump est réélu à la présidence des États-Unis, et en lien avec les prochaines élections fédérales au Canada, cette conférence d'André Noël sur le réseau Atlas, le puissant lobby de la droite radicale, tombe à point. Attac Québec vous y convie le 23 novembre prochain à 13 h, à la salle multi de la CSN au 1601, avenue De Lorimier à Montréal. Entrée libre (pas de webdiffusion). Événement Facebook à partager.
Journaliste indépendant, M. Noël est ex-journaliste d'enquête à La Presse et ex-enquêteur/rédacteur à la Commission Charbonneau. Il nous fera connaître ses recherches sur ce réseau tentaculaire qui doit nous préoccuper, mais qui reste méconnu. Le réseau Atlas est l'un des plus grands réseaux diffusant des idées libertariennes et de droite radicale, en faveur de la privatisation des services publics, de la baisse de la taxation des grandes entreprises, du déni du réchauffement climatique, etc. Il rassemble plus de 500 think tanks conservateurs dans le monde, parmi lesquels l'Institut économique de Montréal. Il chapeaute les activités de ses partenaires et les met en relation.
Cette activité suivra l'Assemblée générale annuelle d'Attac Québec qui se tiendra en avant-midi. Nous espérons vous y voir nombreux et nombreuses !
Lieu
Salle multi de la CSN
1601, avenue De Lorimier
Montréal, QC CA
Le lien à mettre :
https://quebec.attac.org/conference-du-journaliste-andre-noel-sur-le-reseau-atlas/
<https://quebec.attac.org/conference...>
Offre d’emploi : Représentant.e aux ventes publicitaires

Les années de formation de Stanley Ryerson – Andrée Lévesque
Alors qu’il s’était jadis démarqué comme l’imposante figure de l’intellectuel du Parti communiste du Canada (PCC), Stanley B. Ryerson est aujourd’hui moins connu des nouvelles générations. En tant qu’historien marxiste, il a proposé une synthèse inégalée de l’origine socio-économique du Canada, en s’intéressant à l’articulation des catégories de nation et de classe. Son ouvrage Capitalisme et confédération, initialement paru aux éditions Parti pris en 1972, sera d’ailleurs réédité chez M Éditeur à l’automne 2024.
Archives Révolutionnaires entend aussi contribuer à faire connaître Ryerson. C’est pourquoi nous publions un article tiré du livre Stanley Bréhaut Ryerson, un intellectuel de combat (1996). Cet ouvrage est, à ce jour, la somme la plus aboutie portant sur la vie et les travaux de celui que l’on peut sans doute considérer – sans adulation excessive – comme le plus grand historien révolutionnaire canadien. Dans son article « Les années de formation du militant » (chapitre 1, p. 23-34), l’historienne Andrée Lévesque plonge dans la jeunesse de Ryerson et ses premières expériences politiques. Sa formation intellectuelle et idéologique est notamment façonnée par la crise économique de 1929 et la crainte qu’inspire la montée du fascisme en Europe. Après ses années d’études en France, où il participe au Front populaire antifasciste, Ryerson embrasse rapidement le rôle de « révolutionnaire professionnel », comme intellectuel du PCC et rédacteur de son journal québécois Clarté. Dans cette première période, Ryerson pose aussi les grands jalons de son travail intellectuel futur, notamment avec la publication de ses ouvrages 1837 : The Birth of Canadian Democracy (1937) et French Canda (1943), où il défend le caractère républicain et universel des insurrections patriotes, en plus de la spécificité de l’oppression nationale des Canadiens français.
Le livre Stanley Bréhaut Ryerson, un intellectuel de combat est disponible intégralement sur les classique de l’UQAC.

Les années de formation du militant
Andrée LÉVESQUE
STANLEY BRÉHAUT RYERSON s’engage dans l’action militante au moment de la plus grande débâcle qu’ait connue le capitalisme au XXe siècle. Cette période, qualifiée d’apocalyptique, voit la montée des idéologies de droite et le triomphe du fascisme et du nazisme. Les bouleversements économiques et idéologiques favorisent une prise de conscience des lacunes du capitalisme, une vague d’engagements sociaux et une relecture du passé à la lumière des préoccupations de l’heure. Cette remise en cause de la société, Stanley Bréhaut Ryerson a tôt choisi d’y contribuer à l’intérieur du mouvement communiste. Il demeurera fidèle à cette idéologie et à cette orientation politique pendant quatre décennies.
En 1932, la gauche canadienne accueille une recrue qu’une trajectoire inusitée a conduite à la Ligue des jeunes communistes de Toronto. Le jeune militant a vingt et un ans, il vient de passer une année à la Sorbonne et termine des études de philosophie et de langues modernes à l’Université de Toronto. Ryerson se plaira à rappeler son intérêt marqué pour l’étude des langues. À l’instar de Vico et de Marx, il reconnaît l’importance épistémologique de la langue, instrument d’expression des sociétés. Initié très tôt par sa mère au français et à l’italien, il entreprend des cours d’allemand et de français au Upper Canada College qu’il fréquente de 1919 à 1929. Mme Dumarbois, l’épouse de son professeur de français, est d’origine russe et elle lui apprend les premiers rudiments de sa langue maternelle. Lorsqu’il obtient une bourse de l’État français pour faire à la Sorbonne l’équivalent de sa troisième année d’université, il choisit les lettres italiennes et rédige un mémoire sur le romancier réaliste Giovanni Verga, en vue de l’obtention du diplôme d’études supérieures en langue et littérature italiennes.
Cette année à Paris marquera profondément sa formation politique. Pendant l’été 1931, il y rencontre des professeurs de Toronto qui préparent une grande randonnée dans les Pyrénées : Otto Berkelbach van der Sprenkel, professeur d’économie à l’Université de Toronto qui, le premier, éveille son intérêt pour la politique et pour le marxisme, Felix Walter, professeur de français à Trinity College, et Dorothea Walter, futurs traducteurs de Trente Arpents de Ringuet [1], ainsi que Barker Fairley, éminent spécialiste de Goethe et de Heine, critique d’art et critique littéraire, et Margaret Fairley, tous deux bien connus dans les milieux progressistes torontois et fondateurs de la revue Canadian Forum. À Paris, il se familiarise avec la gauche par le biais de l’Association des écrivains et artistes révolutionnaires. Le 5 mars 1932, il participe aux manifestations organisées à l’occasion de la mort de Zéphyrin Camélinat, le dernier survivant de la Commune de Paris de 1871. Plus tard, il participe à une réunion de protestation contre la répression française en Indochine. L’année 1931-1932 est cruciale pour son éducation politique – il lit pour la première fois Le Manifeste du Parti communiste – et contribue au développement chez lui d’un sens aigu de l’histoire qui ne le quittera jamais [2].
Depuis le VIe congrès de l’Internationale en 1928, le communisme est entré dans une nouvelle période. Période dure, où la stratégie de la lutte des classes est au premier plan. Les exclusions pleuvent à droite et à gauche. D’une part, les réformistes et les sociaux-démocrates sont répudiés comme agents du capitalisme ; d’autre part, les trotskystes sont dénoncés et expulsés. C’est une période sans compromis pendant laquelle le Parti communiste du Canada (PCC), qui, en 1930, compte près de 3000 membres, développe ses propres institutions : la Ligue d’unité ouvrière (LUO) pour l’organisation syndicale, la Ligue de défense ouvrière (LDO) pour assurer la défense des travailleurs poursuivis pour leurs activités ouvrières, la Ligue ouvrière des femmes, la Ligue des jeunes communistes et les amis de l’Union soviétique [3].
De retour à Toronto en 1932 pour y terminer ses études universitaires, Ryerson participe à la formation de la Ligue étudiante du Canada [4], et devient membre de la direction de la Ligue des jeunes communistes. Il est délégué au congrès international de la Ligue étudiante du Canada à Chicago ou s’affrontent trotskystes et staliniens. Il y défend la proposition de ces derniers sur l’étude des problèmes économiques face à la contre-proposition trotskyste sur la dictature du prolétariat. Les dissensions au sein de la gauche canadienne ne font que refléter les déchirements qui frappent tout le mouvement communiste international.
Au Canada, la répression s’est intensifiée depuis l’arrivée au pouvoir du Parti conservateur à l’automne 1930. La « peur du rouge » est alimentée par l’agitation qui accompagne les pires années de la crise économique, par les manifestations de travailleurs et de chômeurs, premières victimes de la faillite du capitalisme. À Toronto, le chef de police Daniel Draper lance sa propre vendetta anticommuniste. En août 1931, les leaders du Parti sont arrêtés ; sept d’entre eux, dont le secrétaire Tim Buck et le secrétaire de la LUO Tom McEwen, sont condamnés à cinq ans de détention qu’ils purgent au pénitencier de Kingston. Avec ses camarades de la Ligue des jeunes communistes, Ryerson participe, avant son second départ pour Paris en 1933, aux campagnes de la Ligue de défense ouvrière en faveur des détenus. Les manifestations et les campagnes de mobilisation sollicitent beaucoup les militants, mais, outre ces actions à caractère public, les membres du Parti sont tenus de participer aux groupes de formation politique. Celui de Ryerson est dirigé par Bill Sparks du Parti communiste des États-Unis, son mentor [5].
Ryerson débute dans le journalisme marxiste a la rédaction de Young Worker, le journal de la jeunesse communiste, et il collabore bientôt aussi à Masses, l’organe du Progressive Arts Club (PAC) de Toronto, publié d’avril 1932 à mars-avril 1934 [6]. Le premier numéro annonçait l’objectif de la revue : « Fournir la base pour le développement d’une littérature et d’un art ouvriers militants […] Elle s’adresse aux travailleurs, aux fermiers pauvres, aux chômeurs. » Et il proclame : « L’Art est propagande ! [7] »
Les premiers articles de Ryerson dans Masses traitent de l’éducation, ou plutôt des inégalités de l’accès à l’éducation. Il s’insurge contre les écarts entre l’école privée réservée aux classes supérieures et l’école publique de l’enfant prolétaire [8]. L’ancien élève du Upper Canada College, l’arrière-petit-fils d’Adolphus Egerton Ryerson, père du système d’éducation publique de l’Ontario, aborde l’éducation en tant qu’instrument de propagande, lieu d’endoctrinement contrôlé par les classes dirigeantes.
Ryerson est le premier à admettre l’influence de ses maîtres. Le Upper Canada College, reconnu comme une des meilleures institutions d’enseignement au Canada anglais, où étaient formés les fils de l’élite anglo-saxonne ontarienne, pouvait se permettre de tolérer certains non-conformistes qui allaient lui insuffler « un esprit de contestation radicale [9] ». Ainsi, le professeur de français Owen Classey, ancien tuteur de H.G. Wells, a fortement impressionné le jeune Stanley en motivant ainsi son absence lors d’une visite d’Edward Beatty, président du Canadien Pacifique et grand apôtre de l’impérialisme britannique : « I hate flags, expliqua le professeur, and all people who wave them ! » Une position que son étudiant allait rapidement faire sienne [10]. En ce qui concerne Wells lui-même, la lecture de Outline of History éveilla Ryerson à l’universalité de l’histoire et suscita chez lui un grand intérêt pour la géologie [11]. Si Ryerson a pu profiter d’une éducation de qualité supérieure, il a pris conscience du privilège que représentait une telle formation. Aussi, à l’époque où il obtient son Baccalauréat es arts, au printemps 1933, partage-t-il son temps entre ses études et diverses activités artistiques et politiques.
La session universitaire terminée, il s’embarque de nouveau pour la France où il va continuer des études de littérature italienne. Outre Vico et Santayana, son emploi du temps réserve une place à la poursuite de son éducation politique et il développe des amitiés qui marqueront son séjour. Il est membre de la Fédération des Jeunesses communistes et collabore à L’avant-garde, Rabcor, la revue d’informations ouvrières, à titre d’assistant à la rédaction. Toujours attiré par le théâtre et les arts, il fait partie de l’Association des écrivains et artistes révolutionnaires dont le secrétaire général, Paul Vaillant-Couturier, écrivain et homme politique d’allégeance communiste, se fait le défenseur du rôle des écrivains au sein du mouvement ouvrier.
Il fréquente de jeunes amies torontoises, la poétesse Dorothy Livesay et « Jim » Watts, infirmière et future metteuse en scène, toutes deux liées au PAC de Toronto [12]. Il partage pendant quelque temps, avec Livesay, un petit appartement boulevard Saint-Germain. Ensemble ils vont au théâtre, aux manifestations organisées par le Parti et au mur des Fédérés, au cimetière du Père-Lachaise, pour la célébration annuelle du massacre des communards [13].
Ryerson est gagné par l’effervescence des années 1933-1934. Hitler accède au pouvoir en Allemagne ; en France les gouvernements se succèdent après l’échec de l’union des gauches de 1932. Ryerson partage les inquiétudes des communistes français sur la position à adopter devant la menace fasciste. En février 1934, il se trouve au congrès des Jeunesses communistes à Ivry quand les ligues d’extrême droite déferlent violemment dans les rues de Paris. Dans la foulée des événements de février, le Parti communiste français (PCF) amorce une tentative de collaboration avec la Section française de l’Internationale ouvrière : la gauche française s’achemine vers la formation du front populaire. Deux mois plus tard, Ryerson s’embarque à Anvers pour un séjour de dix jours à Leningrad [14]. Il y trouvera une confirmation des fondements de son option politique. Son voyage en URSS, l’expérience directe des affrontements entre la droite et la gauche en France, et les débats qu’ils suscitent au sujet de la collaboration entre communistes et socialistes, de même que son engagement dans la lutte antifasciste, laisseront leurs traces chez lui et influenceront son analyse politique pendant toute cette décennie.
De Paris, il garde contact avec le Progressive Arts Club et maintient sa collaboration à Masses. Il se mêle aux débats qui agitent l’intelligentsia de gauche autour des questions relatives à l’esthétique et à la propagande. Dans les pages de la revue du PAC, Ryerson entretient une polémique avec le dramaturge Cecil-Smith sur une définition marxiste de la propagande [15]. Cecil-Smith a porté à la scène sa vision du théâtre-propagande ; sa pièce Eight Men Speak s’inspire de l’emprisonnement des leaders communistes. Le succès de cette pièce illustre le rôle très important du théâtre dans le mouvement communiste des années 30. De New York à Toronto, Montréal et Vancouver, on met en scène des pièces inspirées par la dépression économique, la situation ouvrière et le chômage. Forme privilégiée d’agit-prop, le théâtre se veut un véhicule didactique, un instrument de conscientisation des travailleurs, tout en constituant un moyen de levée de fonds pour les organisations du Parti. Le dynamisme du théâtre prolétaire engagé, auquel a participé Ryerson, a fortement animé la culture de gauche nord-américaine pendant la crise économique [16].
Ryerson a été très jeune attiré par le théâtre. N’a-t-il pas joué Prospero à quatorze ans ? À l’université, il compose une pièce sur Abélard, montée par le Players’ Guild de Toronto, et dont il s’attribue le rôle-titre. En 1934, inspiré par la situation internationale, il écrit « War in the East », joué à Toronto et publié dans Masses [17]. En un acte et quatre scènes, la solidarité internationale des travailleurs japonais et chinois triomphe de l’alliance du Mikado, de l’armée, du capitalisme et de la religion lors de l’invasion de la Mandchourie par le Japon. Cette courte pièce d’un dramaturge de vingt-deux ans, qui se termine par le chant de l’Internationale, s’inscrit tout à fait dans le courant agitprop révolutionnaire. Il ne faudrait pas y voir une production servile, obéissant aux exigences du moment et du Parti, mais bien une dénonciation des puissances impérialistes, dont le Japon incarnait le cynisme depuis 1932, et un appel à un internationalisme qui transcende les différences ethniques, internationalisme auquel Ryerson était bien sensibilisé.
À partir de 1934, son engagement est entier. Il y est arrivé non sans déchirements, après des mois de réflexion. En toute lucidité, il réalise que l’adoption de son « approche » (outlook) exigera le sacrifice de tout confort matériel, de toute quiétude intellectuelle et probablement d’une carrière universitaire. Une lettre de dix pages à ses parents, écrite à la veille de son départ pour l’Union soviétique, exprime toutes ses angoisses devant un avenir incertain, et sa crainte de les blesser par son option politique [18] [voir : annexe].
Chargé de cours en littérature française au Sir George William’s College à l’automne de 1934, il s’arrête d’abord à Toronto au début d’août pour présider le premier congrès de la jeunesse contre la guerre et le fascisme. Plus de deux cents délégués, représentant un grand nombre d’organisations préoccupées par la montée du fascisme en Europe et la répression de la gauche au Canada, élisent Ryerson président national de la nouvelle organisation [19]. À Montréal, il rejoint immédiatement la section québécoise du PCC et devient directeur du programme d’éducation du Parti. Il anime un groupe d’études marxistes ouvert aux membres du Parti et à des sympathisants, pour discuter du matérialisme historique ou de la solidarité internationale contre le fascisme. Grâce à sa connaissance de la langue, il fait le lien entre les groupes de gauche francophones et anglophones, et agit souvent comme interprète. Ainsi, quand la Ligue de défense ouvrière invite Louis Retigaud, du Comité mondial contre la guerre et le fascisme, on fait appel à Ryerson pour la traduction simultanée [20]. En décembre 1935, il devient secrétaire provincial du Parti au Québec et accède au Comité central du PCC, poste qu’il conservera jusqu’en 1969.
La section québécoise du Parti a alors pour président Évariste Dubé, pour organisateur William Kashtan et pour secrétaire Stanley Bréhaut Ryerson. Afin de protéger l’anonymat des membres les plus vulnérables, on crée une cellule spéciale ou se réunissent certains intellectuels et même des membres des professions libérales. C’est ce groupe qui accueille Norman Bethune à l’automne de 1935 [21]. Le médecin a alors quarante-cinq ans, Ryerson vingt-quatre. Une affinité se développe, mêlée d’admiration de la part du jeune militant dont le père, chirurgien, vice-doyen de la faculté de médecine à l’Université de Toronto, avait aussi participé à des projets de médecine sociale sans toutefois aller jusqu’au socialisme. Les parents étaient d’ailleurs loin d’approuver les choix politiques de leur fils. Mais ce dernier rencontrait chez Bethune l’aîné compréhensif à qui, ironiquement, il servait un peu de mentor dans leur cercle d’études marxistes.

En 1935, la section québécoise du Parti lance son journal, Clarté, avec comme rédacteur Stanley Bréhaut Ryerson, qui signe ses articles : Étienne Roger. Les succès du fascisme en Europe amènent un changement dans la ligne du Parti, faisant tomber l’intransigeance qui le caractérisait depuis 1929. Durant l’été de 1935, en réaction contre la montée de l’extrême droite en Italie, en Allemagne et en France, la Troisième Internationale, à son septième congrès, adopte la politique de front commun. Désormais, tous les partis membres du Komintern tenteront des alliances avec un large éventail de forces démocratiques. Ce nouvel esprit de conciliation et de solidarité empreint désormais tous les écrits de Ryerson, et le journal Clarté sera marqué au sceau de l’unité ouvrière [22].
Au Canada, le PCC est toujours sujet aux accusations de sédition selon l’article 98 du Code criminel ; conformément aux vœux des représentants de la Cooperative Commonwealth Federation (CCF) à la Chambre des communes d’Ottawa, le Parti libéral avait promis de le supprimer. Au début de l’année 1936, le rappel de l’article 98 facilite les activités des organisations de front commun, comme la Ligue pour la paix et la démocratie, mais au Québec le gouvernement d’Union nationale et le cardinal Villeneuve conjuguent leurs efforts pour contrer la tolérance des mouvements de gauche. En mars 1937, l’Assemblée législative vote à l’unanimité la « loi du cadenas » permettant d’apposer les scellés à toute salle servant à propager le bolchevisme. Les réunions du Parti devront se tenir dans la clandestinité ou risqueront d’être interrompues par la police, alors que les propriétaires de salles hésiteront à s’exposer à la fermeture et refuseront de louer à ces gênants locataires. Les communistes doivent faire preuve d’ingéniosité pour déjouer les forces de l’ordre. Ils tiennent même des réunions dans les hôtels les plus huppés de la ville, car qui songerait à appliquer un cadenas au Ritz Carleton ou à l’hôtel Windsor ? La loi ne parvient pas à freiner le recrutement puisque, de l’avis même des informateurs de la Gendarmerie royale du Canada, le Parti comptera 150 nouveaux membres en 1938 [23]. Malgré les mesures clandestines, le Sir George Williams College a vent des allégeances de son professeur et ne renouvellera pas son contrat pour l’automne 1937. La Police provinciale est également renseignée sur les activités de Ryerson et, en vertu de la « loi du cadenas », elle opère une perquisition à son domicile, le 24 décembre 1937, et confisque une quarantaine d’ouvrages ainsi que des notes de travail [24].
Dès son arrivée au Québec, à l’automne de 1934, Ryerson s’intègre à son nouveau milieu. Il ne cache pas sa fierté pour les ascendants français de sa mère – les Bréhaut ont immigré des îles anglo-normandes en 1637. Il établit des contacts avec les organisations de gauche francophones. Depuis 1925, les socialistes francophones de toutes tendances fréquentaient l’Université ouvrière fondée par Albert Saint-Martin. En proie à la répression policière et aux scissions idéologiques, l’Université donne naissance à l’Association humanitaire, dirigée par Abel et Émile Godin et vouée à la défense des intérêts des chômeurs. Ryerson participe bientôt aux réunions qui rassemblent jusqu’à trois cents personnes dans la salle sise à l’intersection nord-ouest des rues Montcalm et Sainte-Catherine. Les conférences portent sur l’histoire ou le matérialisme historique, et Ryerson participe à un débat public avec le père Archange Godbout, o.f.m., célèbre pour ses attaques contre le « péril rouge [25] ».
Ses activités de militant ne le confinent pas à Montréal. En janvier 1937, il s’en va en train à Mexico, en tant que membre du Progressive Arts Club, participer au congrès de l’Association internationale des artistes et travailleurs. Or, le Parti communiste mexicain tient en même temps son congrès au Palacio de Bellas Artes, et Ryerson profite de l’occasion pour y assister. Il voyage aussi dans la campagne mexicaine et publiera ses impressions dans deux articles parus en anglais dans New Frontier et en français dans Clarté [26].
Durant l’année 1938, il consacre de plus en plus de chroniques à la politique provinciale et participe aux grands débats sur la politique ouvrière, l’éducation, le retour à la terre, la liberté d’expression. Pendant la coalition contre la législation ouvrière du gouvernement d’Union nationale – les fameux Bills 19 et 20 qui ont une incidence sur les conventions collectives et exemptent le gouvernement d’offrir dans ses contrats des salaires raisonnables -, il propose de transformer cette opposition en un vaste parti politique des travailleurs et des cultivateurs. Il revient plusieurs fois sur la nécessité impérative de créer un troisième parti, une « action démocratique ». Le PCC existe certes, mais à l’échelon provincial il est plus réaliste de miser sur une coalition rassemblant les socialistes de toutes tendances et les libéraux progressistes. La menace fasciste, la politique du gouvernement de Maurice Duplessis, rendent le front commun aussi nécessaire au Québec qu’en Europe.
À la recherche d’appuis dans les milieux libéraux, il rencontre Jean-Charles Harvey avec qui il se lie bientôt d’amitié, ainsi que les membres les plus progressistes de l’Action libérale nationale. Il partage certaines critiques de Harvey sur l’éducation et déplore le bas niveau de scolarité de la population québécoise [27]. Comme son collègue du jour, il ne ménage pas ses sarcasmes à l’endroit du mouvement en faveur d’un retour à la terre, qu’il nomme le « retour au rouet [28] ».
À l’automne de 1938, il est mêlé de près aux deux élections complémentaires qui se déroulent dans la circonscription provinciale de Cartier et dans la circonscription fédérale de Saint-Louis, lesquelles occupent sensiblement le même espace géographique. Dans ce quartier des minorités ethniques de Montréal, nombre de travailleurs originaires d’Europe centrale appuient diverses organisations socialistes ou communistes. Dans l’esprit d’un front commun, Ryerson discutera de tactiques concertées avec le CCE. Finalement, pour ne pas diviser les votes de la gauche, le Parti ne présentera pas de candidat dans Saint-Louis et retirera Fred Rose dans Cartier. Ryerson s’acquitte de la délicate mission d’expliquer ce geste sur les ondes de Radio-Canada [29]. Deux mois plus tard, en décembre 1938, des élections municipales posent des problèmes stratégiques et demandent une constante réévaluation du potentiel progressiste des forces en présence. Comme en témoignent ses rapports à titre de secrétaire général de la section québécoise du Parti et ses articles dans Clarté, Ryerson est toujours bien au fait de la situation politique au Québec.
Le Québec auquel il s’identifie n’est pas celui des formations politiques traditionnelles, mais plutôt celui de la base ouvrière montréalaise ; celui de la critique du clérico-nationalisme et de la bourgeoisie d’affaires. On détecte les mêmes accents dans ses dénonciations du grand capitalisme et des trusts que dans celles des dissidents libéraux de l’Action libérale nationale (ALN). D’ailleurs, le front commun favorise les appels à l’unité des forces progressistes dont il se fait l’apôtre. Il multiplie dans les journaux et les conférences publiques les exhortations à l’établissement d’une coalition qui réunirait les « véritables libéraux, les éléments de l’ALN qui savent résister à l’engouement du corporatisme, et même les nationalistes honnêtes ouverts à la collaboration avec le mouvement syndical [30] ».
Malgré les exigences d’une vie de militant, Ryerson parvient à concilier les demandes incessantes du Parti et une activité intellectuelle remarquable. Suivant son penchant pour la philosophie, il assiste au Congrès international de philosophie de Stuttgart en 1937. Or, cette même année il termine la rédaction de son ouvrage 1837 : The Birth of Canadian Democracy [31] auquel il travaille depuis quelques années, mais qui est rédigé en quelques semaines [32]. Le livre paraît en anglais ; Clarté en publiera la traduction par tranches, de décembre 1938 à mai 1939 [33]. La rébellion de 1837 demeure pour Ryerson l’événement le plus décisif de l’histoire canadienne [34]. Il en fait le sujet d’articles dans The Worker, New Frontier, The Daily Clarion et Clarté [35]. Pour en célébrer le centenaire, le 30 novembre 1938, Clarté consacre un numéro spécial aux rébellions. Près de cinquante ans plus tard, en 1987, Ryerson se penchera de nouveau sur son interprétation des événements : « La lecture proposée des soulèvements de 1837-38 comportait une mise en relief du rôle dynamique des forces populaires dans le mouvement séculaire pour la démocratisation décolonisatrice [36]. »
Ryerson déplorera plus tard de n’avoir pas eu assez de temps pour accomplir tout le travail d’archives nécessaire à une telle entreprise. Ses recherches sur les rébellions de 1837-1838 l’ont toutefois mené au British Museum, à la Bibliothèque nationale à Paris et, grâce à Jean-Charles Harvey [37], à la Bibliothèque du parlement à Québec [38]. Toujours en 1937, il publie en français, sous le nom de E. Roger, Le réveil du Canada français [39]. L’historien Gregory Kealey a fait une analyse poussée de l’œuvre historique de Ryerson [40]. Il convient ici de s’attarder sur quelques lignes maîtresses qui se retrouvent à l’époque parmi tous ses écrits. Dans ces deux ouvrages, on relève les grands thèmes qui avaient fait l’objet de ses chroniques depuis quelques années : l’héritage démocratique du Québec et du Canada, la solidarité internationale, l’oppression économique du Québec.
Dans le contexte québécois, les marxistes devaient expliquer pourquoi le Canada français qui, objectivement, offrait un potentiel révolutionnaire, avec son prolétariat et l’aliénation de ses richesses, semblait résister à l’action révolutionnaire. Peuple de prédilection, les Québécois ne formaient-ils pas le « maillon faible » du système capitaliste, les « Nègres blancs d’Amérique » comme les qualifiait Earl Browder [41] ? Ryerson, dans Le réveil du Canada français, se penche sur les causes de l’infériorité économique du Québec depuis 1760 et adopte dans son analyse ce qu’il est maintenant convenu d’appeler la « thèse de la Conquête ». Ryerson devient l’historien de la résistance à l’oppression économique de la colonie britannique. Pour croire au potentiel révolutionnaire du Canada français, il fallait reconnaître un esprit démocratique à la base, plongeant ses racines dans l’histoire, et qui ne demandait qu’à s’exprimer. Cet « esprit démocratique », Ryerson le soulève constamment, à une époque où le Parti est présenté par la droite comme une menace à la démocratie, noyauté par des agents étrangers tentant de s’implanter dans un Québec imperméable aux valeurs matérialistes. Or, le Québec est aussi présenté, cette fois par certains éléments de gauche et par des représentants du libéralisme anglo-saxon, comme réfractaire à la démocratie. Les positions de Ryerson repoussent tous ces postulats : loin d’être étranger, le Parti est ancré dans la situation québécoise, dans un peuple aux traditions démocratiques. Il se fait l’héritier des premiers héros de la lutte démocratique au Canada et au Québec, les rebelles de 1837.
Pour contrer ce qu’il nomme « la légende » de l’anti-démocratie du Québec, Ryerson se donnera pour mission de ressusciter tout un passé de luttes contre le pouvoir établi, depuis les rebelles de 1837 jusqu’aux Rouges de 1848, évoquant Louis Fréchette qui cite Victor Hugo, en passant par l’Institut canadien jusqu’au mouvement ouvrier et à la lutte contre le capitalisme de monopoles et les fameux « trustards » [42]. Dans l’esprit conciliateur du front commun, il souligne la filiation du Parti libéral qui remonte jusqu’en 1837, renforçant ainsi la légitimité du libéralisme, la possibilité de collaboration de toutes les forces de gauche, libéraux inclus, dans la lutte contre le fascisme et dans la campagne contre le capitalisme de monopoles qu’incarnent les compagnies comme la Montreal Light, Heat and Power. Un vaste mouvement démocratique s’appuie sur une longue tradition.
Longtemps avant la rébellion, la politique occupait une place dans la vie du peuple du Québec, soit à la campagne ou la ville, beaucoup plus importante, généralement parlant, que dans les autres provinces […] ce qui signifie un attachement à la substance de la démocratie, [… à] la liberté de discussion et d’expression [43].
Si cet esprit démocratique constitue un leitmotiv dans les écrits des années 30, l’universalisme de la situation québécoise forme un autre thème persistant. À l’encontre des traditionalistes qui insistent sur la spécificité québécoise, Ryerson ne rate jamais une occasion de situer l’expérience québécoise dans un contexte global. Il insiste sur « la signification universelle de notre rébellion » qui, suivant les lois du matérialisme historique, appartient à la transition du féodalisme au capitalisme [44].
Il partage l’optimisme de tous ceux qui ont la conviction d’appartenir à un mouvement universel, d’aller dans le sens de l’histoire, d’en être les agents. L’universalisme appelle à la solidarité internationale. La dimension internationale du communisme est mise en relief et se trouve reflétée, par exemple, dans la solidarité des travailleurs londoniens avec les rebelles du Haut-Canada. Par ailleurs, les divisions au sein des forces rebelles de 1837 reproduisent celles entre Jacobins et Girondins [45]. Un siècle plus tard, « la masse canadienne-française […] se sent spontanément solidaire de ces masses ouvrières et démocratiques qui manifestent dans les rues de Londres, de Prague, de Paris… » contre Hitler [46].
Seul l’internationalisme pourra servir de rempart contre le fascisme. En ces temps où le nationalisme se situe à droite, où il fait des ravages en Europe et s’allie au corporatisme au Québec, il n’est pas étonnant qu’il soit décrié par Ryerson. Lorsque Dostaler O’Leary lance Séparatisme. Doctrine constructive, la recension signée E. Roger dénonce son antisémitisme, sa perspective bourgeoise, sa complaisance pour le nazisme et un nationalisme qui occulte l’exploitation capitaliste [47]. La situation internationale et québécoise explique la position antinationaliste de Ryerson, surtout dans son ouvrage Le réveil du Canada français. Il revient à Robert Comeau d’analyser dans le présent ouvrage l’évolution de sa pensée sur ce sujet, évolution qui le mènera à appuyer le mouvement en faveur de l’autodétermination puis l’idée de l’indépendance du Québec quelques quarante ans plus tard.
La crise économique des années 30 suscite chez Ryerson la contestation de l’ordre établi et les engagements politiques. En tant que militant et intellectuel, il ancre son action dans les bouleversements de son époque, dans les problèmes sociaux, économiques et politiques de son pays. De Toronto à Paris puis à Montréal, il fait l’apprentissage du militantisme tout en poursuivant des analyses historiques. Il a la chance de bientôt voir ses premières années d’activité politique profiter du réalignement du communisme vers un front commun. Il milite dans un parti qui s’est assoupli et qui se consacre à des luttes quotidiennes et immédiates : contre les grandes corporations, pour l’assurance-chômage, pour l’organisation syndicale sur une base industrielle. Un parti soucieux de trouver racine dans les situations locales. Ses convictions guident ses recherches qui, en retour, nourrissent son orientation idéologique. Sa prédilection pour les rebelles de 1837 s’inscrit donc dans la logique de ses choix politiques. La cause de la classe ouvrière, le combat antifasciste, tout converge dans l’intérêt de Ryerson pour les Patriotes dont la célébration du centenaire coïncide avec le déploiement de la menace nazie en Europe.
Avec le recul du temps, il serait intéressant de percer le mystère de l’universitaire que nous connaissons, de révéler, dans le sens photographique, le jeune étudiant d’hier pour y discerner ce que sera le militant des décennies suivantes, d’y repérer déjà les bornes qui jalonneront tout son itinéraire politique et intellectuel. Il est intéressant également de saisir le parcours de cet homme qui vit au Québec depuis vingt-six ans, qui s’est engagé dans la lutte sociale, qui a pris parti pour l’indépendance du Québec et qui, dès son arrivée à Montréal en 1934, avait analysé la situation québécoise en fonction de critères auxquels il est toujours reste attaché.
L’importance accordée à l’essence même de la démocratie dans les années 60 et 70, « une question urgente exigeant une action immédiate [48] », fait écho aux écrits de 1937 et de 1938. Sa lutte contre l’assujettissement à l’URSS lors de l’invasion de la Tchécoslovaquie en 1968, traduit le même souci de reconnaître le milieu dans lequel se déploie la lutte socialiste. Communiste historien, historien communiste, les deux attributs se confondent totalement.
Annexe
Extraits d’une lettre de Stanley B. Ryerson à Edward Stanley et Tessie Ryerson. Paris, 13 avril 1934 (Archives personnelles de Stanley B. Ryerson).
Dearest Mum & Dad –
Late again : my letters this year are terribly spasmodic […]
When I got here in the autumn, I felt utterly hopeless about everything, being in a dilemma that was insoluble. I’ve still the dilemma, & have worried consistently over it since then; but I’ve got back my energy into the bargain, which changes things somewhat.
University work & political work are mutually exclusive […]
Art & culture can only flourish – now – under socialism; & only the workers can bring it in. That the millionnaires will use machine guns as well as slander to prevent it, & to keep the right to starve the poeple, doesn’t prove them in the right. Far from it.
If someone were to ask me if I had the strength to fight for the liberation of the wage workers, for the wiping out of unemployment & mass starvation of the poor by the rich – Id say I didn’t know. I don’t know. The worry of my hurting you, the trouble of my nerves, & my horror of discomfort & physical pain, may prove too much for me. All I’m sure of is, that if there’s anything worth while in me, any ‘guts’ at all, I’ll have to try […]
The fact that my being a communist […]
Dad knows what it is to do a work that’s bigger than oneself, for something beyond oneself. And both of you should believe in me enough to feel that I wouldn’t give myself’ for a thing that hadn’t some good in it.
So terribly much love to both of you
Stan.
Notes
[1] Philippe Panneton RINGUET, Thirty Acres, Trad. Dorothea and Felix Walter, Toronto, Macmillan, 1940.
[2] Ces renseignements biographiques sont en partie contenus dans Stanley Bréhaut RYERSON, « Connaître l’histoire, comprendre la société : un rapport en voie de mutation ? Histoire de cas : une prise de conscience des vecteurs sociohistoriques du casse-tête Canada/Québec », texte présenté à l’École des gradués de l’Université Laval pour l’obtention du grade de Philosophie Doctor (Ph.D.), 1987. Voir aussi Sydney JORDAN, « Stanley B. Ryerson, Author of a New Book, Brilliant Personality », Daily Clarion, 2 novembre 1937; Gregory S. KEALEY, « Stanley Bréhaut Ryerson : intellectuel révolutionnaire canadien », dans Robert COMEAU et Bernard DIONNE (dir.), Le droit de se taire. Histoire des communistes au Québec, de la Première Guerre mondiale à la Révolution tranquille, Outremont, VLB éditeur, 1989, p. 202-206; Vivian MCCAFFREY, « Stanley B. Ryerson : Marxist Intellectual and the French-Canadian Question », thèse de M.A., Université d’Ottawa, 1981, p. 7-9. Des renseignements supplémentaires nous ont été fournis par Stanley Bréhaut Ryerson lors d’une entrevue réalisée au mont Saint-Grégoire, le 31 juillet 1994.
[3] Annie KRIEGEL, « La Troisième Internationale », dans Jacques Droz (dir.), Histoire générale du socialisme, vol. III : de 1919 à 1945, Paris, Presses universitaires de France, 1977, p. 92-100. Andrée LÉVESQUE, Virage à gauche interdit. Les communistes, les socialistes et les ennemis au Québec, 1929-1939, Montréal, Boréal Express, 1984, p. 45-46. Ian ANGUS, Canadian Bolsheviks. The Early Years of the Communist Party of Canada, Montréal, Vanguard Publications, 1981, p. 269-270.
[4] La Canadian Student League, fondée à l’Université de Toronto par des étudiants communistes, tentait d’unir les étudiants et étudiantes avec les élèves de niveau secondaire pour obtenir des bourses pour les jeunes, pour abolir l’entraînement militaire dans les écoles, ainsi que pour garantir la liberté d’expression. Paul AXELROD, Making a Middle Class. Student Life in English Canada during the Thirties, Montreal & Kingston, McGill-Queen’s University Press, 1990, p. 132-133.
[5] Bill Sparks, né George Rudas, était originaire de Yougoslavie.
[6] Le Progressive Arts Club est fondé à Toronto en 1931 et aura bientôt des succursales dans toutes les villes canadiennes, de Halifax à Vancouver. Voir Toby RYAN, Stage Left. Canadian Workers Theatre 1929-1940, Toronto, Simon & Pierre, 1981, p. 24-47.
[7] Masses, vol. 1, no 1 (avril 1932). Traduction libre.
[8] Stanley B. RYERSON, « Education and the Proletariat », Masses, vol.1, no 8 (mars-avril 1933), et vol. 1, no 9 (mai-juin 1933).
[9] Idem, « Connaître l’histoire, comprendre la société », op. cit., p. 4.
[10] Entrevue avec Stanley Bréhaut Ryerson, mont Saint-Grégoire, 31 juillet 1994. En 1992, il affirmait : « C’est le Upper Canada College qui m’a amené au communisme. » (Le Devoir, 8 juin 1992.)
[11] H. G. WELLS, The Outline of History : being a Plain History of Life and Mankind, 3e éd., New York, Macmillan, 1921. RYERSON, « Connaître l’histoire, comprendre la société… », op. cit., p. 5-6.
[12] « Jim » Watts, née Myrtle Eugenia Watts, avait changé son nom pour Jean et était connue sous le nom de Jim.
[13] Dorothy LIVESAY, Right Hand Left Hand, Toronto, Press Porcepic, 1977, p. 36, 40; Idem, journey with My Selves. A Memoir 1909-1963, Vancouver et Toronto, Douglas & McIntyre, 1991, p. 139. Dans ses mémoires, Livesay cache Stanley sous le pseudonyme de Tony. Entrevue avec Stanley Bréhaut Ryerson, 31 juillet 1994.
[14] Lettre de Stanley Bréhaut Ryerson à Edward Stanley et Tessie Ryerson, 13 avril 1934. Archives personnelles de Stanley B. Ryerson.
[15] Stanley B. RYERSON, « Out of the Frying Pan », Masses, vol. 1, no 12 (mars-avril 1934).
[16] Toby RYAN, op. cit. Voir aussi le témoignage éloquent d’une militante new-yorkaise, Annette T. RUBENSTEIN, dans Michael BROWN, et al (dir.), New Studies in the Politics and Culture of U.S. Communism, New York, Monthly Review Press, 1993, p. 248-260.
[17] Masses, vol.1, no 12 (mars-avril 1934).
[18] Lettre de Stanley Bréhaut Ryerson à Edward Stanley et Tessie Ryerson, 13 avril 1934. Archives personnelles de Stanley B. Ryerson.
[19] Gregory S. KEALEY et Reginald WHITAKER (dir.), RCMP Security Bulletins. The Depression Years, Part 1, 1933-1934, St. Johns, Canadian Committee on Labour History, 1993, p. 200-203. Le Canada est le premier pays où une section jeunesse a précédé la fondation de la Ligue contre la guerre et le fascisme en 1935. Peter HUNTER, Which Side Are You On Boys ? Toronto, Lugus Productions, 1988, p. 52-53, 70.
[20] Gregory S. KEALEY et Reginald WHITAKER, op. cit., p. 346.
[21] Stanley RYERSON, « Comrade Beth », dans Wendell MACLEOD, Libbie PARK et Stanley RYERSON, Bethune. The Montreal Years, Toronto, James Lorimer & Company, 1978, p. 148-149, 153.
[22] Ce n’est pas un hasard si le journal porte le nom du groupe intellectuel français et de sa revue, fondés en 1919, pour promouvoir une « internationale de la pensée » et un nouvel ordre social opposé à la guerre. On y trouvait, entres autres sommités intellectuelles, Henri Barbusse et Paul Vaillant-Couturier qui eut une influence déterminante sur Ryerson. Nicole RACIE, « The Clarté Movement in France, 1919-1921 », Journal of Contemporary History, vol.2, no 2 (avril 1967), p. 195-208.
[23] Archives nationales du Canada, Service canadien du renseignement et de la sécurité (SCRS), Parti communiste du Canada, document 157, vol. 1, A.R. Gagnon, Commanding « C » Division, 11 janvier 1939.
[24] Clarté, 1er janvier 1938.
[25] Andrée LÉVESQUE, op. cit., p. 128.
[26] E. ROGER, « Le Mexique : pays d’ombres et de lumières », Clarté, 20 et 27 février 1937. Stanley RYERSON, « Mexican Daybreak », New Frontier, vol. 1, no 11 (mars 1937); « Mexico’s Age of Enlightenment », New Frontier, vol. 1, no 12 (avril 1937).
[27] Clarté, 7 février 1935.
[28] Clarté, 19 et 26 décembre 1936.
[29] Andrée LÉVESQUE, op. cit., p. 111-113. Clarté, 19 octobre 1938.
[30] Archives nationales du Canada, Service canadien du renseignement et de la sécurité (SCRS), Parti communiste du Canada, document 157, vol. 1, 2252-2255. Stanley RYERSON, « Building the Democratic Front in Quebec » (23 février 1939). Traduction libre.
[31]1837 : The Birth of Canadian Democracy, Toronto, Francis White Publ., 1937.
[32] S. JORDAN, op. cit.
[33] E. ROGER, « 1837-1838 : la naissance de la démocratie canadienne », Clarté, 6, 21, 28 décembre 1938, 11, 18, 25 janvier, 1er, 8, 18, 25 février, 8, 15, 22, 29 avril, 6, 20 mai 1939.
[34] Clarté, 24 juin 1937. Cent ans auparavant, le père de la grand-mère paternelle de Ryerson, John Beatty; aumônier, accompagnait à l’échafaud deux leaders du soulèvement de 1837 au Haut-Canada. RYERSON, « Connaître l’histoire, comprendre la société… », op. cit., p.4.
[35] Idem, « Our Fathers Fought for our Freedom : LouisJoseph Papineau and 1837 », The Worker, 28 septembre 1935; « God be Thanked for These Rebels ! », New Frontier, vol.1, no 2 (mai 1936) ; « 1837-1838 : la naissance de la démocratie canadienne » et « La rébellion de 1837, bataille pour la démocratie ! », Clarté, 22 mai 1937.
[36] Il regrettera aussi d’avoir sous-estimé le « national » dans son analyse de 1837. RYERSON, « Connaître l’histoire, comprendre la société… » op, cit., p. 12.
[37] Ryerson a toujours apprécié l’amitié de Jean-Charles Harvey. Le journaliste avait vu son roman Les Demi-Civilisés condamné par Son Éminence le cardinal Villeneuve de Québec et, conséquemment, avait été démis de son poste de rédacteur au journal Le Soleil. Le premier ministre Alexandre Taschereau, qui le sacrifiait ainsi aux intérêts du Parti libéral, le fit nommer conservateur de la Bibliothèque de l’Assemblée législative. Marcel-Aimé GAGNON, Jean-Charles Harvey. Précurseur de la Révolution tranquille, Montréal, Beauchemin, 1970, p. 65-66.
[38] Entrevue avec Stanley Bréhaut RYERSON, 31 juillet 1994.
[39] E. ROGER, Le réveil du Canada français, Montréal, Éditions du peuple, 1937.
Rassemblement de protestation contre l’OTAN : une menace pour l’humanité
Quand La Presse+ trouve du « positif » dans la victoire de Trump

Une "COP de la paix" ? Comment l’Azerbaïdjan, pays autoritaire qui bafoue les droits humains, peut-il accueillir cela ?

La COP29 : Ne pas rire ni pleurer mais comprendre l'indicible
Lors de son discours de bienvenu comme hôte de la COP29 sur le climat, le président de l'Azerbaïdjan a qualifié de « cadeau de Dieu » la richesse pétrolière et gazière de son pays. Il faut le faire. L'élection de Trump plombe la COP de dire le correspondant de Radio-Canada à l'émission Midi-Info d'aujourd'hui. Pour renchérir sur ses propos, les grands pays émetteurs de GES se disent pourquoi faires des sacrifices si les ÉU quittent le navire des COP ? Tant l'attention portée aux guerres génocidaires en cours que la difficile conjoncture économique (ressac de la Grande Dépression de 2008 et de la pandémie) et les « finances publiques exsangues » en découlant étant donné l'austérité néolibérale devenue dogmatique font que seulement quatre des plus hauts dirigeants du G-20 vont se présenter à cette troisième COP d'affilée qui se tient dans une dictature et la deuxième d'affilée dans un État pétrolier.
Le défi financier de cette COP veut aboutir à un fonds annuel de mitigation de mille milliards $US. Il n'atteint aujourd'hui qu'un peu plus de 100 milliards dont 70% en prêts alors que des dizaines de pays bénéficiaires risquent la banqueroute. Cet objectif majeur de la COP en devient une farce macabre quand on pense à l'urgence climatique. Mais d'entrée de jeu, pour sauver la face, ont été quasi imposées les règles du marché du carbone mondial convenu à la COP de Paris sans garantie de protection des droits humains. Greta Thunberg, avec son discours factuel, incisif, droit au but sans fioritures, dénonce les contradictions insolubles de cette « COP de la paix » :
Introduction et traduction : Marc Bonhomme, 12/11/24
11 novembre 2024 | The Guardian
https://www.theguardian.com/commentisfree/2024/nov/11/greta-thunberg-cop29-authoritarian-human-rights-azerbaijan-greenwashing
Alors que les crises climatiques et humanitaires s'aggravent rapidement, un autre État pétrolier autoritaire ne respectant pas les droits humains accueille la COP29, le dernier sommet annuel des Nations unies sur le climat qui commence aujourd'hui et se tient après la réélection d'un président américain hostile au climat.
Les réunions de la COP se sont révélées être des conférences d'écoblanchiment qui légitiment l'incapacité des pays à garantir un monde et un avenir vivables et ont également permis à des régimes autoritaires comme l'Azerbaïdjan et les deux hôtes précédents - les Émirats arabes unis et l'Égypte - de continuer à violer les droits humains.
Les génocides, les écocides, les famines, les guerres, le colonialisme, les inégalités croissantes et l'escalade de l'effondrement climatique sont autant de crises interconnectées qui se renforcent mutuellement et entraînent des souffrances inimaginables. Alors que des crises humanitaires se déroulent en Palestine, au Yémen, en Afghanistan, au Soudan, au Congo, au Kurdistan, au Liban, au Baloutchistan, en Ukraine, au Nagorno-Karabakh/Artsakh et dans de très nombreux autres endroits, l'humanité est également en train de dépasser la limite de 1,5 °C fixée pour les émissions de gaz à effet de serre, sans qu'aucun signe de réduction réelle ne se profile à l'horizon. C'est plutôt le contraire qui se produit : l'année dernière, les émissions mondiales ont atteint un niveau record. Des records de chaleur ont été battus, et il est « pratiquement certain » que cette année sera la plus chaude jamais enregistrée, avec des phénomènes météorologiques extrêmes sans précédent qui poussent la planète vers des territoires inexplorés. La déstabilisation de la biosphère et des écosystèmes naturels dont nous dépendons pour survivre entraîne des souffrances humaines indicibles et accélère encore l'extinction massive de la flore et de la faune.
Toute l'économie de l'Azerbaïdjan repose sur les combustibles fossiles, les exportations de pétrole et de gaz de la compagnie pétrolière publique Socar représentant près de 90 % des exportations du pays. Malgré ce qu'il pourrait prétendre, l'Azerbaïdjan n'a pas l'ambition de prendre des mesures en faveur du climat. Il prévoit d'accroître la production de combustibles fossiles, ce qui est totalement incompatible avec la limite de 1,5 °C et les objectifs de l'accord de Paris sur le changement climatique.
De nombreux participants à la COP de cette année ont peur de critiquer le gouvernement azerbaïdjanais. Human Rights Watch a récemment publié une déclaration expliquant qu'elle ne pouvait être certaine que les droits des participant-e-s à manifester pacifiquement seraient garantis. En outre, les frontières terrestres et maritimes de l'Azerbaïdjan resteront fermées pendant la COP29, de sorte qu'il ne sera possible d'entrer et de sortir du pays que par voie aérienne, ce qui est polluant et que de nombreux citoyen-ne-s azerbaïdjanais n'ont pas les moyens de s'offrir. La raison invoquée pour fermer les frontières lors de toutes les COP depuis le début de la pandémie de Covid est le maintien de la « sécurité nationale », mais j'ai entendu de nombreux Azerbaïdjanais décrire la situation comme étant « enfermés dans une prison ».
Le régime azerbaïdjanais est coupable de nettoyage ethnique, de blocus humanitaire et de crimes de guerre, ainsi que de répression de sa propre population et de persécution de la société civile du pays. L'organisme de surveillance indépendant Freedom House classe le pays comme l'État le moins démocratique d'Europe, le régime s'en prenant activement aux journalistes, aux médias indépendants, aux militants politiques et civiques, ainsi qu'aux défenseurs des droits de l'homme. L'Azerbaïdjan représente également environ 40 % des importations annuelles de pétrole d'Israël, alimentant ainsi la machine de guerre israélienne et se rendant complice du génocide en Palestine et des crimes de guerre d'Israël au Liban. Les liens entre l'Azerbaïdjan et Israël sont mutuellement bénéfiques puisque la majorité des armes utilisées par l'Azerbaïdjan pendant la deuxième guerre du Haut-Karabakh et probablement celles utilisées lors de l'opération militaire de septembre 2023 dans la région du Karabakh ont été importées d'Israël.
La "Cop de la paix" est l'un des thèmes choisis pour la conférence sur le climat de cette année par l'hôte, qui souhaite encourager les États à observer une "trêve de la Cop". Parler de paix mondiale après les terribles violations des droits de l'homme commises par le régime azerbaïdjanais d'Aliyev à l'encontre des Arméniens de souche vivant dans la région du Haut-Karabakh/Artsakh est pour le moins dérangeant. En outre, l'Azerbaïdjan prévoit de blanchir ses crimes contre les Arméniens en construisant une "zone d'énergie verte" sur des territoires où la population a été ethniquement nettoyée.
Comment ce pays a-t-il pu accueillir le sommet sur le climat ? C'était le tour de l'Europe de l'Est. La Russie ayant mis son veto aux États membres de l'UE, il ne restait plus que l'Arménie ou l'Azerbaïdjan. L'Arménie a levé son veto contre l'Azerbaïdjan et a soutenu sa candidature en échange de la libération de prisonniers, bien qu'un grand nombre de prisonniers politiques arméniens soient toujours détenus. L'année dernière, Gubad Ibadoghlu, critique du régime, a été emprisonné après avoir critiqué l'industrie des combustibles fossiles de l'Azerbaïdjan. Parmi les autres prisonniers politiques figurent le militant pacifiste Bahruz Samadov, le chercheur sur les minorités ethniques Iqbal Abilov, les militants politiques Akif Gurbanov et Ruslan Izzatli, ainsi que des journalistes.
Pendant ce temps, l'UE continue d'acheter des combustibles fossiles à l'Azerbaïdjan et prévoit de doubler ses importations de gaz fossile en provenance de ce pays d'ici 2027.
La crise climatique concerne tout autant la protection des droits humains que la protection du climat et de la biodiversité. On ne peut prétendre se soucier de la justice climatique si l'on ignore les souffrances des personnes opprimées et colonisées aujourd'hui. Nous ne pouvons pas choisir les droits humains dont nous nous soucions et ceux que nous laissons de côté. La justice climatique est synonyme de justice, de sécurité et de liberté pour tous.
Pendant la COP29, l'image de l'Azerbaïdjan rapportée par les médias sera une version blanchie et écologisée que le régime s'efforce désespérément de présenter. Mais ne vous y trompez pas : il s'agit d'un État répressif accusé de nettoyage ethnique.
Nous avons besoin de sanctions immédiates contre le régime et d'un arrêt des importations de combustibles fossiles azerbaïdjanais. Des pressions diplomatiques doivent également être exercées sur le régime pour qu'il libère les otages arméniens et tous les prisonniers politiques, et qu'il garantisse le droit au retour en toute sécurité des Arméniens.
Tunisie : où va l’UGTT ?

Allemagne. L’industrie automobile face à une crise systémique

[Le mercredi 6 novembre 2024 a éclaté une crise du gouvernement Ampel (feu tricolore : SPD, Grünen, FDP) portant sur la politique budgétaire. Un des éléments de cette politique porte sur le financement par le gouvernement de l'industrie automobile. Option choisie par le chancelier Olaf Scholz (SPD) à laquelle le ministre des Finances Christian Lindner (FDP) s'est opposé par un veto. Cela intervient alors que la crise de l'industrie automobile – composante centrale de l'industrie de l'Allemagne – s'affirme depuis quelques années, mais a éclaté avec force au premier semestre 2024. En effet, l'indice de production dans ce secteur a chuté de 7,9% sur un an, en juillet. Après une relance en août, en septembre le recul s'est de nouveau manifesté. C'est dans ce contexte que se pose, du point de vue d'une « orientation écosocialiste », le thème du futur de l'industrie automobile et d'une reconversion des modes de transport, dans ce pays de même qu'en Europe. C'est à cette interrogation que Stephan Krull, dans le cadre de la Fondation Rosa Luxemburg, répond en dessinant les lignes de force d'un programme à moyen terme. – Réd. A l'Encontre]
8 novembre 2024 tiré de alencontre.org
http://alencontre.org/europe/allemagne-lindustrie-automobile-face-a-une-crise-systemique.html
Les crises dans l'industrie automobile arrivent régulièrement, les intervalles entre elles se raccourcissent et elles deviennent plus violentes. Comme actuellement, il s'agit de la concurrence entre groupes, d'accès à marchés et de parts de marché, de l'édification puis de la destruction de capacités productives sur des sections de marchés en déclin.
Les crises ont tendance à éliminer des concurrents, à provoquer une tendance plus ou moins grande à la monopolisation et à la concentration et centralisation, à des restructurations de l'ensemble de l'appareil productif, comme annoncé en fin octobre 2024 chez Volkswagen [1]. La fermeture de l'usine Opel de Bochum (2014) et celle de l'usine Ford de Sarrelouis [début février 2024 est annoncé l'arrêt de production de la Ford Focus en novembre 2025, avec suppression de plus de 2000 emplois] sont des exemples du premier processus. La formation du groupe Stellantis [en 2021], avec Peugeot, Citroën, Opel, Fiat et Chrysler, est l'un des exemples de la concentration dans le secteur. Au cours des cinq dernières années, plus de 60'000 emplois ont été délocalisés ou détruits dans l'industrie de la sous-traitance, et de nombreux sites ont été abandonnés.
La crise est avant tout une crise de l'emploi (avec ses diverses facettes), pas une crise des profits. Les bénéfices réalisés l'année dernière par Volkswagen (22 milliards d'euros), Mercedes (15 milliards) et BMW (12 milliards) s'élèvent à 49 milliards d'euros, le total des bénéfices non distribués des trois groupes (Konzerne) s'est élevé à 250 milliards.
On peut le montrer clairement avec l'exemple de Volkswagen. Il ne s'agit nullement de pertes, comme l'entreprise l'affirme publiquement et comme les journalistes zélés se plaisent à le relayer. Les propriétaires et les managers ne se contentent pas d'une marge opérationnelle [2] de 3,5% sur le chiffre d'affaires de la marque Volkswagen [elle est évaluée à 2,3% pour le premier semestre 2024 – réd.], ils veulent 6,5%. Sur un chiffre d'affaires d'un peu plus de 100 milliards d'euros, la seule question est donc de savoir si l'on réalise 3,5 milliards ou 6,5 milliards d'euros de profits.
Les surcapacités productives créées à grands frais constituent bien sûr un problème réel – il y a peu, le groupe VW voulait construire à Wolfsburg (Basse-Saxe) une « Gigafactory » pour de nouveaux véhicules de luxe (Trinity), sur le modèle de Tesla. Or, aujourd'hui, il est question de licenciements massifs et de fermetures d'usines [Le projet Trinity devait se concrétiser en 2028, il a été repoussé en 2032, et est mis en question étant donné le recul des ventes de voitures électriques.]
Stagnation et recul des ventes
La conduite continue en marche arrière de VW a commencé avec la gigantesque fraude sur les gaz d'échappement en 2016 – depuis lors, la demande baisse en Allemagne et en Europe. A cela s'ajoute la présence sur le marché de plusieurs nouvelles entreprises technologiquement avancées en provenance de Chine [BYD, NIO, XPeng, Li Auto, et SAIC Motor, qui produit des véhicules sous la marque MG].
Et bien sûr, s'y ajoutent : les guerres et les rivalités internationales à la tonalité agressive [tarifs douaniers et diverses normes protectionnistes], la course à l'armement accompagné du démantèlement de l'Etat social avec ses effets sur le pouvoir d'achat, le débat sur le changement de motorisation au profit des voitures électriques et l'infrastructure à cet effet qui piétine. Tout cela joue un rôle important dans la demande de voitures.
Après 40 ans de bonnes affaires, les ventes de Volkswagen, BMW et Mercedes ont chuté de manière spectaculaire en Chine. La production mondiale de voitures a chuté de 73 millions en 2017 à 55 millions en 2020, avant de remonter à 67 millions en 2023.
La même année, il s'est vendu en Europe deux millions de voitures de moins que cinq ans auparavant, ce qui correspond à la capacité de quatre très grandes usines automobiles ou aux ventes mondiales réunies d'Audi et de Peugeot. Mais cela touche particulièrement un constructeur de gros volumes comme Volkswagen, pour lequel il manque dans son bilan les ventes d'environ 500 000 véhicules. En revanche, le luxe se vend toujours très bien.
Crise climatique
Depuis quelques années, la simultanéité entre la crise climatique, le débat sur l'avenir de l'automobile et la perte de centaines de milliers d'emplois donne un mélange explosif. Le glissement général vers la droite, le soutien au parti de Björn Höcke (un des leaders de l'Afd-Alternative für Deutschland) dans les clusters automobiles de Saxe, du Bade-Wurtemberg, de Hesse et de Basse-Saxe est extrêmement préoccupant. Il existe un risque de backlash en matière de politique des transports, ce qui aggraverait la crise climatique, gaspillerait des milliards et mettrait en danger d'autres emplois.
La construction ininterrompue de nouvelles autoroutes et les subventions aberrantes qui sont versées à l'industrie automobile constituent une redistribution de la richesse allant du bas vers le haut. De nombreuses personnes dépendent encore de la voiture faute de transports publics de qualité, alors que la densité des voitures [nombre de véhicules pour 1000 personnes] et les émissions décroissent avec le niveau de revenu des ménages
Au lieu de répondre aux exigences de la majorité du pays, comme la limitation de vitesse et la suppression des subventions, le gouvernement fait des concessions à l'industrie automobile et renforce encore sa politique centrée sur la voiture.
Même l'abandon du moteur à combustion est sans cesse remis en question par des forces anti-écologiques comme le FDP (Freie Demokratische Partei, libéral), la CSU (Christlich-Soziale Union in Bayern) et le BSW (Büdnis Sarah Wagenknecht). La protection du climat et le tournant en matière de mobilité sont ainsi mis à mal, ou plutôt passe sous le bitume.
Pourtant, des centaines de milliers d'emplois peuvent être créés dans la construction de véhicules ferroviaires (matériel roulant), dans les chemins de fer et dans les entreprises de transport public à condition que ces firmes disposent d'une planification assurée sur le long terme. Cela accompagné, pour les générations futures, de la perspective d'obtenir un bon salaire, une vie de qualité et un avenir digne d'être vécue. Dans ce processus, il s'agit d'assurer la sécurité des salarié·e·s, notamment par le biais d'une formation continue et d'un perfectionnement professionnel garantis par la loi, d'une garantie d'emploi et d'une indemnité de reconversion professionnelle.
Un programme immédiat pour la reconversion écologique
L'argent pour la reconversion de l'industrie automobile est disponible. La reconversion est l'alternative à une concurrence exacerbée, au démantèlement social, aux licenciements massifs et aux fermetures d'usines, à plus de subventions pour l'industrie automobile. A la place, il faudrait créer un fonds spécial par l'Etat fédéral de 200 milliards d'euros ainsi qu'un prélèvement sur les bénéfices des groupes automobiles pour la réorientation des transports, le développement des infrastructures, la création de capacités pour la production de matériel ferroviaire et de bus intelligents.
De larges alliances pour la protection du climat et opérer un virage dans les transports. En vue d'un meilleur travail et d'une meilleure vie pour tous et toutes !
Le syndicat Ver.di et Fridays for Future luttent ensemble pour le développement des transports publics et pour de meilleures conditions de travail des personnes qui y sont employées. Les syndicats, les associations environnementales et sociales ont fondé « l'Alliance pour un tournant vers la mobilité socialement acceptable ». Le mouvement pour la justice climatique met du sable dans les rouages de la machinerie de promotion d'automobiles comme l'IAA-Internationaler Automobil-Ausstellung (Salon international de l'automobile de Francfort). Cette perspective complète les revendications pour une transformation de l'industrie et un tournant dans les transports urbains et dans les zones rurales.
Cela permet de nouvelles alliances pour la transformation socio-écologique. Il existe des déclarations communes des syndicats, des associations environnementales et des églises, mais on ne leur donne pas assez de poids – surtout dans la pratique des syndicats, mais aussi de la gauche. La gauche sociale a la grande responsabilité de résoudre la contradiction prétendument insoluble entre l'écologie et l'emploi et de lier à la réorientation des transports, les intérêts légitimes des travailleurs et travailleuses à un bon travail et à une vie de qualité.
Récemment, plusieurs études ont montré le grand potentiel pour un travail de qualité dans le cadre d'un développement résolu d'un changement de la mobilité [voir les études éditées par Mario Candeias et Stephan Krull (Hrsg.), Spurwechsel Studien zu Mobilitätsindustrien, Beschäftigungs potenzialen und alternativer Produktion, VSA Verlag, 2022]. Il existe un grand besoin de main-d'œuvre dans la construction de matériel roulant ferroviaire, dans les entreprises de transport ferroviaire et de transport public. Si l'on ajoute à cela le besoin de main-d'œuvre lié au nécessaire développement du secteur des soins et que l'on prend en compte le potentiel d'une réduction du temps de travail vers la semaine de 28 heures en termes de politique de l'emploi et de sociabilité, il devient évident qu'il y a beaucoup à y gagner.
Mais cela présuppose que les syndicats et la gauche reprennent systématiquement les initiatives de changement de mode de transport. Cela suppose en outre que les syndicats assument leur engagement politique en faveur d'une transformation socio-écologique. Et cela présuppose que les nombreuses approches et réflexions positives émanant des salarié·e·s de l'industrie automobile ne soient plus balayées par les directions respectives, mais qu'elles soient reprises par les scientifiques, les syndicats et les courants de gauche, réunies sur l'ensemble des différents sites et intégrées de manière offensive dans les débats sociopolitiques.
Le nombre de voitures sur nos routes doit être réduit de manière drastique, surtout dans les grandes villes dotées de transports publics développés. Les manques dans les zones rurales peuvent être comblés par des services de transport, des bus à la demande et le covoiturage, dans le cadre d'une planification intégrée des transports et des services publics d'intérêt général. Pour cela, il faut une politique d'investissement durable dans les transports publics. Une mobilité publique peu coûteuse et, à long terme, gratuite est un droit socio-économique fondamental.
Ce dont il faudrait s'occuper maintenant
1. La mise en place de conseils de transition régionaux composés de syndicats, de responsables politiques régionaux, d'associations de protection de l'environnement et de transport, de groupes de réflexion sur la transition énergétique et les transports. Ils ont pour mission d'initier des forums sociaux et d'exercer une influence directe sur la transformation socio-écologique des productions dans l'ensemble de l'industrie de la mobilité. Ces forums sociaux doivent être soutenus, tout comme les conseils régionaux de transformation, par le Fonds d'avenir pour l'automobile.
2. Encourager et soutenir les initiatives et les alliances locales pour la transformation socio-écologique de l'industrie automobile et de la mobilité.
3. La création et le développement d'entreprises (d'utilité publique, démocratiques) qui comblent les lacunes de l'industrie actuelle de la mobilité pour le transport écologique des bus, des trains et de la logistique, ce qui permet de compenser judicieusement les emplois supprimés. En complément : la socialisation des entreprises qui bloquent le tournant des transports, conformément aux articles 14 et 15 de la Constitution allemande.
4. Une réforme du code de la route et de la loi sur la circulation routière, afin que les communes soient habilitées à décider et à mettre en œuvre des mesures socio-écologiques telles que des limitations de vitesse, des voies de bus et autres.
5. Une politique industrielle européenne visant à développer une industrie européenne de la mobilité pour la construction si nécessaire de bus et de matériel roulant ferroviaires. La possibilité d'adjudication directe pour les transports publics et les chemins de fer doit être maintenue.
6. Telles sont les propositions du groupe de discussion de la fondation Rosa Luxemburg sur l'avenir de l'automobile, de l'environnement et de la mobilité.
7. Un tournant dans le domaine des transports et de la mobilité ainsi compris fait partie d'une transformation de la production et des services dans notre pays axée sur les besoins. Il s'agit de remettre l'économie à l'endroit, de réduire les activités socialement et écologiquement nuisibles et de mettre la créativité humaine et les ressources sociales au service d'une vie de qualité. Le tournant dans la mobilité est à la fois un élément constitutif et le résultat d'une telle transformation. (Article publié sur le site de la SoZ, novembre 2024 ; traduction et édition rédaction A l'Encontre)
[1] Thomas Schaefer PDG de Volkswagen a déclaré le 28 octobre 2024 : « Nous ne gagnons pas assez d'argent avec nos voitures actuellement. Dans le même temps, nos coûts en matière d'énergie, de matériaux et de personnel continuent d'augmenter. Ce calcul ne peut pas fonctionner à long terme. Nous devons donc nous attaquer à la racine du problème : nous ne sommes pas assez productifs sur nos sites allemands et nos coûts d'usine sont actuellement 25 à 50 % plus élevés que ce que nous avions prévu. Cela signifie que les usines allemandes sont deux fois plus chères que la concurrence.
»En outre, chez Volkswagen, nous traitons encore en interne de nombreuses tâches que la concurrence a déjà externalisées de manière plus rentable. Cela signifie que nous ne pouvons pas continuer comme avant. Nous devons rapidement trouver une solution commune et durable pour l'avenir de notre entreprise. » (Reuters-Réd.)
[2] La marge opérationnelle mesure le bénéfice qu'une entreprise réalise sur un dollar de ventes après avoir payé les coûts variables de production, tels que les salaires, les matières premières et les biens intermédiaires, mais avant de payer les intérêts ou les impôts. (Réd.)
[3] Les articles 14 et 15 de la Constitution allemande (appelée Loi fondamentale pour la République fédérale d'Allemagne ou Grundgesetz) sont les suivants :
Article 14 : Droit de propriété, droit d'héritage
1. La propriété et le droit d'héritage sont garantis.
2. L'expropriation n'est permise que pour un intérêt public, dans le cadre des lois. Elle doit être suivie d'une indemnisation équitable.
Article 15 : Transfert de biens à la collectivité
1. Des biens peuvent être transférés à la collectivité en vertu de lois spéciales, en vue de leur exploitation ou de la mise en œuvre d'objectifs d'intérêt public. Ces biens peuvent être expropriés dans le cadre de cette procédure.
2. La compensation doit être décidée par un tribunal, et elle doit être équitable pour les personnes concernées. (Réd.)
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Appel à la solidarité internationale avec la population des régions catalanes

Chers camarades,
À la lumière des terribles événements qui se sont produits dans la région de Valence au cours des derniers jours nous, les organisations de Esquerra Independentista dels Països Catalans ( Gauche indépendantiste des pays Catalans), lançons un appel à tous et toutes pour la solidarité internationale en ce moment de grande tristesse.
Leur nationalisme espagnol et leur déni du changement climatique les ont amenés à se débarrasser de leurs propres unités d'urgence dans le Pais Valencia et ont été incapables d'apporter une réponse immédiate pour aider les milliers de personnes piégées sur les routes, dans les rues, sur leur lieu de travail ou chez eux. Ils ont ignoré les avertissements du service météorologique et n'ont pas envoyé les alarmes d'urgence à la population jusqu'à ce que l'eau et la boue recouvrent déjà de nombreux villages. À l'heure où ce genre d'événement peut se produire plus fréquemment, le gouvernement laisse dans une situation de grande fragilité les services publics qui pourraient y répondre. En échange, ils continuent d'investir dans les « corridas » de taureaux et les fêtes espagnoles.
Les inondations font des centaines de morts. Nous nous joignons au deuil pour chacun d'entre eux et envoyons tout notre soutien et notre chaleur aux personnes qui ont perdu des parents, des amis et des collègues. Mais la douleur que nous ressentons ne nous fait pas oublier que la grande majorité des victimes auraient pu être évitées et qu'il y a des responsables directs de cette tragédie : le président du gouvernement de Pais Valencia, Carlos Mazon, et son parti, le PP (Parti populaire), et ils doivent assumer leurs responsabilités.
Nous dénonçons également le gouvernement de l'État du PSOE (le Parti socialiste espagnol) et de Sumar (leurs partenaires gouvernementaux), car ils n'ont pris aucune mesure pour éviter la tragédie, par exemple, en déterminant l'arrêt de toute activité non essentielle. De plus, leur programme économique est aussi dévastateur contre la nature et la terre que celui de leurs adversaires électoraux, le PP, et est maintenant la cause de ces événements naturels qui causent tant de destruction.
Enfin, nous attirons l'attention sur tous les propriétaires d'entreprises qui ont mis en danger la vie de milliers de travailleurs en les obligeant à continuer à travailler alors qu'il y avait un avertissement de cette ampleur. Des hommes d'affaires comme Juan Roig, propriétaire de la plus grande marque de supermarché de l'État espagnol, ont un tel pouvoir et se sentent si impunis qu'ils n'ont pas risqué un centime de leurs prestations pour laisser leurs employés partir pour se rendre dans un endroit sûr. Ils bénéficient de la connivence et de la collaboration totales des gouvernements, soit par le soutien direct du gouvernement de Mazon, soit par le cynisme montré par le gouvernement de l'État, lorsque le ministre du Travail, Yokanda Diaz, a simplement demandé aux propriétaires d'entreprises de faire preuve d' « empathie ».
Pour tout ce qui précède, nous demandons aux organisations et aux collectivités des peuples du monde de :
Exprimez leur solidarité avec les victimes et dénoncez les coupables de ce drame sur les réseaux sociaux, en utilisant les hashtags #MazónDimissió #DANA
• Nous mettons à disposition un compte de solidarité et de résistance afin de collecter des fonds pour apporter une aide matérielle aux personnes touchées. Toute contribution sera reçue avec plaisir.
• Montrons que la solidarité, c'est vraiment la tendresse des peuples et qu'elle peut aller là où les institutions ont tant à le faire, en montrant clairement qu'elles sont redevables au capital.
Pour plus d'informations, vous pouvez suivre les comptes de nos organisations sur les réseaux sociaux.
Arran- Youth organisation : @Arran_jovent
Canditatura d'Undat Popular (CUP) : @cupnacional
Coordinadora Obrera Sindical- Workers' Union : @COSnacional
Endavant – Socialist organisation for national liberation : @Endavant_OSAN
Itaca- International organisation : @ItacaPPCC
Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC)- Student's Union of the Catalan Countries : @SEPC_nacional
Solidarity account : IBAN ES74 3025 0002 4614 3344 7057
La réélection de Trump place le Canada sous une nouvelle pression
L’art pour visibiliser les récits palestiniens

Planifier l’obsolescence de Postes Canada

Si vous avez entendu parler de Postes Canada récemment, c'est probablement qu'elle perd de l'argent. Beaucoup d'argent. Et rien n'indique que cette hémorragie s'arrêtera de sitôt.
4 novembre 2024 | tiré de Canadian Dimension | Photo : Boîte aux lettres de Postes Canada à Markham, en Ontario. Photo de Raysonho/ Wikimedia Commons.
https://canadiandimension.com/articles/view/planning-the-obsolescence-of-canada-post
L'an dernier, la société d'État a déclaré une perte annuelle de 748 millions de dollars et a prévenu qu'elle pourrait manquer de fonds de roulement d'ici le début de 2025, à moins qu'elle ne trouve de nouvelles options d'emprunt ou de refinancement. Les activités de Postes Canada ne sont pas subventionnées par le gouvernement fédéral. On s'attend à ce que Postes Canada desserve chaque adresse du pays et qu'elle parvienne à atteindre le seuil de rentabilité, avec des limites quant aux prix qu'elle peut facturer et aux services qu'elle peut offrir.
Avec l'essor des communications électroniques, les volumes de courrier ont chuté, ce qui signifie que les revenus tirés de la vocation première de Postes Canada sont moindres. Elle livre également des colis, mais elle doit faire face à la concurrence non seulement des services de livraison de colis traditionnels, mais aussi d'un modèle de salaires encore plus bas lancé par Amazon.
Postes Canada a commencé à vendre des parties de ses activités pour tenter de combler le vide, ce qui a amené les détracteurs de longue date de la poste, comme Ian Lee, professeur d'administration des affaires à l'Université Carleton, à déclarer que le service postal « disparaît sous nos yeux ». Ces dernières années, Lee a mis de l'avant une proposition radicale visant à réduire le nombre de bureaux de poste desservant les collectivités rurales, à réduire les effectifs des deux tiers et à réduire considérablement le réseau de livraison. Il ne s'agit pas seulement d'un plan visant à réduire les coûts, mais aussi de forcer le service public à devenir une entreprise comme une autre sur le marché.
Le débat sur cette question est délibérément circonscrit. Il y a un refus d'envisager un avenir dans lequel le rôle de Postes Canada pourrait évoluer en permanence pour répondre aux besoins des Canadiens. Et la dégradation du travail de livraison par Amazon est acceptée comme un fait accompli, au lieu d'être quelque chose que nous pouvons inverser si le gouvernement est prêt à défendre les droits des travailleurs contre une entreprise dont le modèle d'affaires vise à les affaiblir.
La réponse des travailleurs
Ce genre de discours au sujet de Postes Canada est promu par des organisations patronales et de gens comme monsieur Lee, qui ont des préjugés contre l'idée que le service postal public puisse survivre et prospérer au 21e siècle. Les médias le reprennent sans discernement, laissant entendre au public que Postes Canada est condamnée et qu'il n'y a que peu d'options pour se sortir du trou dans lequel elle se trouve, à part répondre aux appels à la privatisation et au démantèlement. Mais les choses ne doivent pas se passer comme ça.
Depuis plusieurs années, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) prône une vision beaucoup plus optimiste de cette institution dont dépend chaque personne au Canada. La Campagne Vers les Collectivités Durables du syndicat envisage un avenir où Postes Canada pourra se développer afin d'offrir des services bancaires, assurer des services de garde pour les personnes âgées et pourra jouer un rôle encore plus essentiel dans les collectivités durables de l'avenir. Contrairement au projet de Lee qui vise à fermer des bureaux de poste partout au pays, ce plan reconnaît le rôle crucial que joue cette institution et cherche à garantir qu'elle puisse continuer à fournir des services essentiels aux Canadiens même si leur dépendance à la poste aux lettres diminue. Mais il y a des obstacles à la réalisation de cette vision.
L'expansion du service postal nécessitera des fonds, ce qui n'est pas une mince affaire compte tenu des pertes financières que subit Postes Canada. Pourtant, le STTP conteste le discours adopté par la direction de l'entreprise et ceux et celles qui veulent voir la fin du service postal tel que nous le connaissons. Selon le syndicat, Postes Canada a vu ses dépenses non liées à la main-d'œuvre augmenter de plus de 56 % entre 2017 et 2023, ce qui comprend un plan quinquennal visant à dépenser 4 milliards de dollars pour des mises à niveau de l'infrastructure en raison d'une forte croissance du trafic de colis qui ne s'est pas concrétisée. Le syndicat soutient que ces décisions de dépenses expliquent en grande partie les pertes que subit Postes Canada. De plus, le volume de colis n'a pas réellement diminué, mais le marché total de la livraison de colis s'est plutôt élargi et Postes Canada n'a pas maintenu sa part de cette croissance, en partie parce que la direction a indiqué à Amazon qu'elle ne pourrait pas répondre à ses demandes en 2022, ce qui a fait fuir un client important.
La vision du STTP brosse un tableau différent des difficultés auxquelles Postes Canada est confrontée. Il ne s'agit pas tant d'une entreprise en phase terminale de déclin, mais plutôt d'une entreprise mal gérée qui prend de mauvaises décisions quant à l'avenir d'une institution publique. La vision limitée de la direction, combinée au manque d'intérêt du gouvernement à réinventer l'avenir de Postes Canada, explique en partie ce qui a mis l'entreprise dans cette situation difficile. La banque postale générerait des revenus importants qui pourraient aider à financer l'entreprise de livraison, mais le gouvernement n'aurait pas seulement à donner à la société d'État la permission d'élargir son mandat ; il devrait probablement aussi investir dans l'infrastructure nécessaire pour assurer la livraison du courrier. Et ni les libéraux ni les conservateurs n'ont intérêt à dépenser cet argent – et à mettre en colère les grandes banques par la même occasion.
Postes Canada fait face à une autre menace qui pourrait être bien plus existentielle que ce que beaucoup de gens pensent. Amazon n'est pas seulement un client de Postes Canada, qui compte sur elle pour les livraisons hors de portée de son propre réseau ; c'est aussi un concurrent majeur dont le modèle d'affaires repose sur des offres de prix les plus bas rendus possibles en partie par des offensives agressives contre le pouvoir des travailleurs et travailleuses. Si ce problème n'est pas réglé, il sera difficile pour les employés syndiqués de Postes Canada de faire face à la concurrence.
La menace d'Amazon
Amazon a indéniablement changé la façon dont beaucoup de gens effectuent leurs achats au cours des dernières décennies et a joué un rôle important dans l'augmentation du nombre de colis que la plupart des gens reçoivent en moyenne au cours d'une année. Amazon est généralement considérée comme une plateforme de commerce électronique prospère qui a utilisé sa position dominante pour s'étendre à de nombreux autres secteurs d'activité, comme le streaming vidéo et les soins de santé. Mais ce succès est également le résultat de sa vigoureuse opposition aux syndicats et de la baisse des salaires de ses employés.
Si vous pensez à la manière dont un colis arrive d'Amazon à un client, il doit passer par un entrepôt, puis être chargé dans le camion d'un livreur avant d'arriver à la porte de celui-ci. Au fil du temps, Amazon s'est implanté dans ces secteurs et a essayé de transformer leur façon de travailler. La logistique est un secteur traditionnellement syndiqué où les travailleurs et travailleuses ont tendance à percevoir de bons salaires, mais ce n'est pas le cas avec le modèle d'Amazon. Le géant du commerce électronique combat farouchement toute tentative des travailleurs et travailleuses de former des syndicats dans ses centres de traitement des commandes, car il tente de redéfinir le travail en entrepôt comme un travail non qualifié pour lequel les employéEs ne devraient guère s'attendre à plus que le salaire minimum, et bien moins que dans les installations syndiquées.
Amazon a adopté une approche similaire dans le domaine de la livraison. Contrairement à ses entrepôts, Amazon n'embauche pas ses propres chauffeurs-livreurs. Au lieu de cela, elle fait appel à des entrepreneurs indépendants ou à des travailleurs et travailleuses « indépendantEs » via sa plateforme Amazon Flex, ou elle sous-traite le service à des partenaires de services de livraison comme Intelcom, qui effectuent eux-mêmes l'embauchent. Avec ce modèle, Amazon peut fixer des objectifs de livraison agressifs qui contraignent les travailleurs et travailleuses à une existence stressante et précaire . Il n'est pas étonnant que les employéEs d'Amazon, affectéEs aux entrepôts et à la livraison subissent un taux élevé de blessures.
Considérons maintenant les conséquences plus larges de cette évolution. À mesure que les modèles d'entreposage et de livraison d'Amazon se développent, ils exercent une pression sur leurs concurrents pour qu'ils suivent le mouvement : accélérer le rythme de travail, adopter de nouvelles formes de surveillance et de gestion algorithmique, et restreindre les salaires des travailleurs et travailleuses, voire attaquer leurs syndicats. Lorsque Lee parle de la nécessité de rendre les services de livraison de Postes Canada plus compétitifs par rapport à Amazon ou FedEx, dont les employéEs ne sont pas non plus syndiqués, on voit assez clairement ce qu'il suggère : pas seulement des licenciements massifs, mais aussi une attaque contre le Syndicat des Travailleurs et Travailleuses des Postes.
Cela nous amène à une question importante à laquelle nous devons réfléchir. Non seulement ce que nous voulons pour l'avenir de Postes Canada, mais aussi dans quel genre de société nous voulons vivre. Nous devrions vouloir tirer parti de l'infrastructure nationale unique de Postes Canada pour offrir des services plus nombreux et de meilleure qualité à la population canadienne au lieu de démanteler un service que nous ne pourrons peut-être jamais reconstruire. Mais plus encore, le gouvernement devrait considérer le modèle à bas salaires et non syndiqué d'Amazon comme une menace non seulement pour Postes Canada, mais pour l'ensemble des travailleurs et travailleuses du Canada, et intervenir pour le maîtriser.
Paris Marx est critique technologique et animateur du podcast Tech Won't Save Us. Il rédige la newsletter Disconnect et est l'auteur de Road to Nowhere : What Silicon Valley Gets Wrong about the Future of Transportation.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Lock out à l’Hôtel Radisson, chez Prelco inc., grève à la SAQ…

Les Assemblées générales du Conseil central du Montréal métropolitain – CSN, qui se tiennent le premier mercredi de chaque mois et accueillent une soixantaine de délégué·es des syndicats de la région, sont de rares occasion d'entendre des travailleurs et des travailleuses en lutte. Ces récits des conflits en cours nous apportent de précieuses informations que les médias traditionnels ne relaient pas, préférant réserver leurs pages économiques au point de vue des patrons, à la valeur des actions des grandes compagnies et à la gestion des finances personnelles.
Nous restituons ici, à partir de nos notes prises sur le vif en tant que délégués, les témoignages au sujet du déroulement des négociations et une partie des revendications de ces travailleurs et travailleuses en lutte.
- Journées de grève à la Société des alcools du Québec (SAQ)
C'est tout d'abord un travailleur de la Société des alcools du Québec (SEMB-SAQ) qui raconte que cela fait presque deux ans que les employé·es sont sans Convention collective, car l'employeur fait délibérément trainer les négociations. La SAQ est pourtant en plein développement, avec un profit net de 1.4 milliard de dollars en 2023-2024. C'est une augmentation de 5.6% qui permettra certainement de bonifier le salaire fixe de son patron (528 215$), dont le contrat de travail prévoit des bonis liés au rendement.
En revanche, l'entreprise ne semble pas prête à partager ces profits avec les travailleurs et les travailleuses. Au contraire, début 2024, en plein milieu des négociations, la SAQ a décidé de couper 64 postes.
« Quand ça fait 21 ans que tu travailles là, que t'as réussi à avoir ton poste permanent, que tu commences à pouvoir choisir tes horaires et qu'un jour on te dit que t'as plus de poste, tout s'écroule ».
Ces coupures n'ont évidemment pas facilité les négociations et les salarié·es, dont environ 70% sont précaires, ont adopté 15 jours de grève « à utiliser au moment opportun ». Plusieurs jours de grève ont déjà eu lieu en avril 2024 et il y a eu des « actions de visibilité » au Centre-ville, ce qui permis quelques avancées :
« On a obtenu des gains sur l'aménagement des horaires, la création d'un babillard. C'était une nouveauté incorporée dans la Convention, qui permet des horaires un peu plus prévisibles pour les précaires, mais également pour les personnes permanentes ».
Mais depuis que les discussions monétaires ont débuté, « la SAQ n'a montré aucune ouverture ». Elle propose « 16.5% pour six ans ; 5% pour la première année ; après, faites le calcul : c'est à peine 2% par année. Et puis ils n'arrêtent pas de nous demander de renoncer à toute revendication salariale ; ils disent qu'il n'y a aucune marge de manœuvre ». D'autres journées de grève sont prévues.
Au micro à la période de questions et d'échanges, une déléguée s'insurge, dénonce la rapacité des dirigeants et rapporte qu'elle a vu des gens traverser les lignes de piquetage, y compris des camarades de la CSN : « alors non ! On ne traverse pas les lignes de piquetage ! ».
- Lock out à l'Hôtel Radisson de Montréal
« J'ai rêvé d'être ici devant vous pour pouvoir enfin parler de notre conflit à l'Hôtel Radisson, pour faire connaitre et dénoncer ce que nous fait vivre notre employeur », déclare d'emblée l'un·e des trois travailleur·euse de l'Hôtel (STT de l'Hôtel Côte-de-Liesse) qui ont témoigné mercredi soir.
L'employeur a décrété un lock out le vendredi 1er novembre. Les salarié·es ont alors adopté un mandat de grève illimitée, « pour décider, nous, quand on retournera au travail ; car c'est pas l'employeur qui va décider ».
La principale demande porte sur un rattrapage de 2$ de l'heure.
« Aujourd'hui, une préposée aux chambres gagne 17$ de l'heure ; dans d'autres hôtels équivalents, elles gagnent déjà 23$. Donc, même si on obtenait les 2$, notre hôtel il sera toujours en arrière et il faudra des années pour arriver à obtenir les mêmes salaires qu'ailleurs dans le secteur ».
Comme à la SAQ, la négociation sur le normatif a trainé en longueur, mais elle n'a pas posé de problème majeur.
« On a avancé beaucoup sur le normatif. Mais c'est le rattrapage salarial qui empêche la négociation de finir. Le propriétaire ne veut pas payer les 2$. Le représentant de l'employeur nous dit : “vous savez, 2$ de l'heure, ça nous coute plus de 100 000$ chaque année” ».
L'hôtel a cependant des revenus importants. Il a notamment un contrat avec le Gouvernement fédéral qui lui rapporte 1.7 millions de dollars par mois ; « donc, c'est pas 100 000$ qui vont le ruiner » :
« Un côté fait le travail, un autre côté s'enrichit du travail de l'autre. Ce n'est plus un enjeu de négociation, c'est un enjeu de société. Les travailleurs s'appauvrissent chaque jour, incapables de participer dans la vie économique ; c'est triste de voir des conditions de travail comme ça... On ne peut pas laisser l'indifférence gagner ! Il faut aller jusqu'à la fin, jusqu'au bout ! Solidarité ! »
- 5 mois de lock out chez Prelco
C'est ensuite un travailleur du STT de chez Prelco, une entreprise spécialisée dans le vitrage, qui vient présenter leur conflit de travail : l'assemblée le connait bien, puisque ça fait presque 5 mois que le patron ne leur verse plus de salaire et que ce salarié est déjà venu présenter le conflit. Les négociations ont débuté le 1er février et l'employeur a décrété un lock out le 19 juin dernier. Depuis le conflit s'envenime, l'employeur a déposé de multiples recours judiciaires et il ne montre aucune ouverture pour le moment. Malgré la durée du conflit, malgré l'absence de ressource, malgré les pratiques patronales, les travailleurs maintiennent la pression et viennent de rejeter la dernière proposition patronale à 92% :
« Pour le normatif ça a ben été ; mais quand le monétaire a commencé, c'est là que ça a commencé à se corser. Il nous propose 10.5% pour 6 ans ! Et depuis, on a été scabé, beaucoup judiciarisé, on a eu une injonction… On a fait une plainte en 12 [article du code du travail qui interdit d'entraver les activités syndicales] à l'employeur, car il s'amuse à nous envoyer des lettres à la maison, pour faire peur aux membres, en disant que tout le monde va pas rentrer après le conflit…Aussi, le 30 octobre dernier, on avait une AG pour se prononcer sur l'offre finale de l'employeur, qui était la même offre qu'au début des négos. On avait un peu peur du vote des membres, car après cinq mois, c'est dur de tenir, c'est difficile… L'offre finale a été rejetée à 92% ; on était vraiment fier de nos membres… Mais je veux vous remercier, c'est grâce à vous autres qu'on tient. Grâce aux dons, mais pas seulement. Après 5 mois c'est difficile ».
La conseillère syndicale renchérit :
« C'est un conflit extrêmement judiciarisé. L'injonction est très restrictive. On a eu 9 outrages au tribunal ; 20 mises en demeure ; l'employeur essaie de casser les membres, qui sont pourtant bizarrement très sages, très disciplinés… C'est violent, un lock out, c'est violent quand ton employeur te méprise à ce point là… Et te scabe. Quand tu vois les cadres rentrer tous les jours, passer devant toi ; c'est violent de vivre ça pendant 5 mois de temps. Ce qui aide les gens à tenir bon, c'est les messages de solidarité qu'ils reçoivent ».
À la période des questions et d'échange, un camarade à pris la parole pour suggérer que les travailleurs et travailleuses dans la constriction refusent de poser des vitres de chez Prelco. Pour participer à la campagne de dons (50$ suggérés), voir ici.
Francis Dupuis-Déri, délégué du Syndicat des professeurs et et professeures de l'Université du Québec à Montréal (SPUQ-CSN) au CCMM.
Martin Gallié, délégué du Syndicat des professeurs et et professeures de l'Université du Québec à Montréal (SPUQ-CSN) au CCMM.
Le 12 novembre 2024.
Un enseignant dénonce la répression par la commission scolaire

Déclaration de Bernie Sanders suite au résultat de l’élection présidentielle 2024

Bernie Sanders a été réélu pour un quatrième mandat dans l'État du Vermont. Au lendemain de la défaite de Kamala Harris et de la perte du Sénat au profit des républicains, il dresse un bilan sévère envers son parti qui est passé à côté des besoins de la classe ouvrière américaine.
Il ne devrait pas être surprenant qu'un Parti Démocrate qui a abandonné la classe ouvrière se retrouve abandonné par la classe ouvrière. D'abord, c'était la classe ouvrière blanche, et maintenant ce sont aussi les travailleurs latinos et noirs. Pendant que la direction du Parti Démocrate défend le statu quo, la population américaine est furieuse et revendique du changement. Et elle a raison.
Aujourd'hui, alors que les biens nantis nagent dans l'opulence, 60% de la population américaine vit d'une paye à l'autre et nous avons plus d'inégalités de revenus et de richesse que jamais auparavant. Incroyablement, les salaires hebdomadaires réels, pris en compte de l'inflation, pour le travailleur américain moyen sont en fait inférieurs aujourd'hui à ce qu'ils étaient il y a 50 ans.
Aujourd'hui, malgré l'explosion de la technologie et de la productivité des travailleurs et travailleuses, les jeunes auront un niveau de vie inférieur à celui de leurs parents. Et beaucoup d'entre eux et elles craignent que l'intelligence artificielle sur la robotique n'aggrave encore une situation déjà mauvaise.
Aujourd'hui, bien que nous dépensions beaucoup plus per capita que d'autres pays, nous restons le seul pays riche à ne pas garantir les soins de santé à tous et toutes en tant que droit humain et nous payons, de loin, les prix les plus élevés au monde pour les médicaments sur ordonnance. Nous, seuls parmi les grands pays, ne pouvons même pas garantir des congés familiaux et médicaux payés.
Aujourd'hui, malgré la forte opposition d'une majorité de femmes et d'hommes Américains, nous continuons à dépenser des milliards pour financer la guerre totale du gouvernement extrémiste de Netanyahu contre le peuple Palestinien, qui a conduit à l'horrible désastre humanitaire de la malnutrition de masse et à la famine de milliers d'enfants.
Les grands intérêts financiers et les consultants grassement payés qui contrôlent le Parti Démocrate tireront-ils de véritables leçons de cette campagne désastreuse ? Comprendront-ils la douleur et l'aliénation politique que vivent des dizaines de millions d'Américains ? Ont-ils des idées sur la façon dont nous pouvons affronter l'oligarchie de plus en plus puissante qui a tant de pouvoir économique et politique ? Probablement pas.
Dans les semaines et les mois à venir, ceux qui se préoccupent de la démocratie populaire et de la justice économique doivent avoir des discussions politiques très sérieuses.
Restez à l'écoute.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Mort de Madeleine Riffaud, sentinelle d’un siècle de tempêtes

Une héroïne s'en est allée. Son legs : tout un siècle de combats.
La liberté c'est ce cours d'eau...*
par Madeleine RIFFAUD
La liberté c'est ce cours d'eau
Qui vient passer sur ta maison.
Tous les gens de la rue y puisent à pleins seaux
Les filles fatiguées y viennent se baigner
Le soir, quand la sirène ouvre les ateliers.
Et l'on y lave, aussi, les vestes de travail.
Je te regarde face à face
Et je vois l'eau du fleuve
Aux hublots de tes yeux.
Tu t'en vas sur le fleuve,
Avec le fleuve, vers la mer.
Je viens, nous venons tous, nous nageons près de toi,
Écume du sillage ou feuilles emportées,
Frôlés de poissons d'or, survolés d'éperviers.
C'est un fleuve sans rive et notre foule s'y perdra,
Se fondra, fraternelle, à celle de partout.
Demain, ceux qui vivront trouveront naturel
D'être au large, au soleil, sur la mer Liberté.
Madeleine RIFFAUD
Poème écrit en 1946, dédié à Paul ÉLUARD
Tiré de l'Humanité
https://www.humanite.fr/culture-et-savoir/deces/mort-de-madeleine-riffaud-sentinelle-dun-siecle-de-tempetes
* Madeleine Riffaud, poétesse, résistante, ancienne journaliste à l'Humanité, est décédée ce mercredi 6 novembre. Elle était un personnage de roman, à l'existence tramée par la lutte, l'écriture, trois guerres et un amour. Une vie d'une folle intensité, après l'enfance dans les décombres de la Grande guerre, depuis ses premiers pas dans la résistance jusqu'aux maquis du Sud-Vietnam.
Dans son appartement parisien, la vieille dame, front plissé, traits durs, regard perçant malgré la cécité, dépliait d'elle-même un récit sûr, précis, ponctué du pépiement des oiseaux qui l'entouraient, dans leurs grandes volières. Vêtue de noir, ses longs cheveux toujours nattés de côté, elle fumait, en se remémorant l'intime et l'histoire, et jusqu'à la première blessure, longtemps enfouie dans l'oubli, un viol enduré alors qu'adolescente, elle devait passer la ligne de démarcation pour rejoindre le sanatorium. La tuberculose était tombée sur elle comme un malheur de plus, dans l'exode, alors que sa famille fuyait Paris occupé.
Embrasser le combat
De la maladie, elle se releva, pour embrasser le combat. « Je suis entrée dans la Résistance avec un nom d'homme, un nom d'Allemand, un nom de poète » : dans la clandestinité, elle était Rainer, pour Rainer Maria Rilke. Il avait fallu la force de conviction de Raymond Aubrac pour qu'elle accepte de témoigner de son action dans la Résistance – « Je suis un antihéros, quelqu'un de tout à fait ordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que j'ai fait, rien du tout », insistait-elle dans le documentaire que lui consacra en 2020 Jorge Amat, Les sept vies de Madeleine Riffaud.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
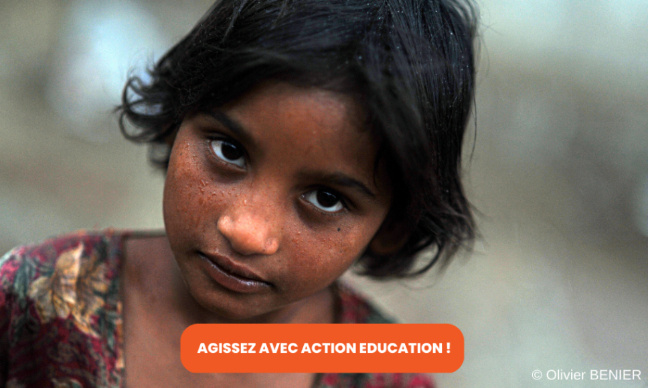
Le 16 novembre, ensemble contre les violences faites aux enfants et adolescent·es
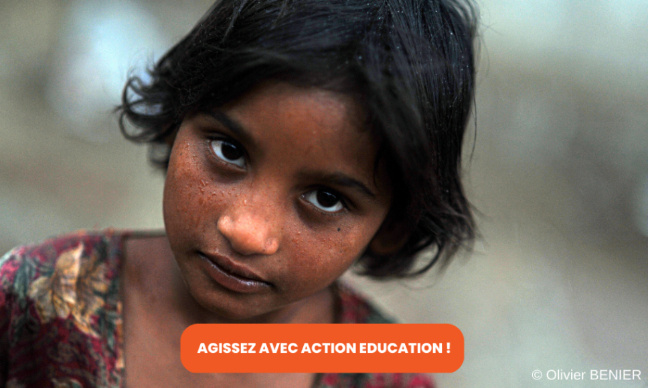
Texte collectif Associations, collectifs, personnalitéEs et organisations syndicales, engagéEs contre les violences faites aux enfants et aux ados appellent à une mobilisation générale le samedi 16 novembre 2024 à 14h à Paris et dans plusieurs villes de France.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/11/12/le-16-novembre-ensemble-contre-les-violences-faites-aux-enfants-et-adolescent%c2%b7es/?jetpack_skip_subscription_popup
Pour les enfants et les ados, nous appelons la société à dire stop aux infanticides, à l'inceste, à la pédocriminalité, à l'exploitation sexuelle, aux mutilations sexuelles, aux maltraitances, au mariage forcé, à la violence éducative ordinaire, aux violences intra-familiales et institutionnelles, aux multiples discriminations et à toutes formes de violences qui leur sont faites.
Certaines figures publiques et/ou politiques orientent l'attention de la société vers une image d'enfants et de jeunes prétendument incontrôlables ou délinquantEs, occultant ainsi la réalité de ces violences qu'iels subissent partout, tout le temps et dans tous les milieux. La jeunesse n'est vue par la classe politique que sous un angle autoritariste, considérant qu'il faudrait simplement « dresser » les enfants et les jeunes.
Pendant que nous critiquons les supposés enfants-rois, des bébés dépérissent dans nos pouponnières, des enfants se suicident, des ados sont violéEs, chaque jour iels meurent un peu plus, dans l'indifférence générale. Mobilisons-nous pour que cela change !
La protection des enfants et des ados est une urgence pour notre société
Les discours et les actes en faveur de la protection des enfants et des jeunes sont trop peu nombreux. 80% des violences sexuelles en France, commencent ou ont lieu avant 18 ans [1]. Cela concerne 130 000 filles et 30 000 garçons par an. 1 enfant meurt tous les 5 jours [2], tué majoritairement par ses propres parents. 400 000 enfants sont victimes de violences conjugales parentales [3], 129 sont devenus orphelinEs de féminicide en 2022 [4]. Que fait la France pour tous ces enfants ? Elle les abandonne parce qu'il y a d'autres priorités et des économies à faire. Cette société semble de plus en plus déconnectée des besoins primaires des enfants, oubliant parfois l'importance de les écouter et de les protéger. Mobilisons-nous pour que cela change !
Des enfants vulnérables qu'on ne veut pas voir
Les enfants et les ados raciséEs sont parmi les plus vulnérables. Iels sont stigmatiséEs et exposéEs à un racisme décomplexé, systémique et quotidien. Cela affecte gravement leur développement et leur confiance en la société.
Les enfants en situation de handicap sont 3 à 4 fois plus exposés aux violences sexuelles [5] que les autres. Iels n'ont pas tous·tes Toustes accès à la scolarité alors que l'école est un droit pour tous·tes Toustes en France. Les enfants placéEs sont, quant à eux, elleux invisibles. Personne ne se préoccupe de leur sort. Iels peuvent subir des maltraitances au sein de leur famille d'accueil, mourir seulE dans leur foyer, sans que cela suscite la moindre réaction. En moyenne, les enfants issus de l'ASE ont 20 ans d'expérience de vie en moins [6]. Le harcèlement des jeunes LGBTQIA+ est en constante augmentation et conduit à des suicides que nous aurions pu prévenir. Les enfants trans sont aujourd'hui particulièrement victimes de campagnes réactionnaires visant à pathologiser leur situation et à remettre en question leur libre-arbitre. Les enfants intersexes sont mutilés dès la naissance sans justification pour leur santé et avec souvent des conséquences néfastes durables sur leur corps et leur vie.
Chaque année, environ 2000 enfants et ados dorment dans la rue [7] et 1 enfant sur 5 vit en dessous du seuil de pauvreté [8]. En Outre-mer, les difficultés d'accès à l'éducation, à la santé, à l'eau, à la nourriture et à la protection affectent de enfants. A Mayotte, ce sont 8 enfants sur 10 en situation de pauvreté [9], certainEs n'ont pas accès à l'eau potable. Tous les territoires ultramarins sont touchés par ces inégalités et l'Hexagone semble bien muet. La précarité impacte gravement le développement des enfants, comment pouvons-nous laisser faire cela ?
Les enfants et les ados sont victimes de violences partout dans le monde, premières victimes des guerres actuelles, premières victimes de la colonisation, on leur enlève leur culture et leur humanité pour mieux contrôler les peuples. Actes de torture, mutilations, éducation coloniale, placement, emprisonnement : de nombreux enfants seront détruitEs par nos sociétés. Nous en sommes tous·tes responsables.
Mobilisons-nous pour que cela change !
Des institutions en crise
A cela s'ajoutent des institutions en crise : petite enfance, éducation nationale, aide sociale à l'enfance, justice, santé à bout de souffle, elles n'ont ni les moyens, ni parfois les formations adéquates pour prendre en charge les nombreux enfants et ados victimes de violences. De plus, dans un contexte de réduction systématique des dépenses publiques et de dégradation de la qualité de vie au travail, même les professionnels formés, et aux pratiques adaptées, sont conduits malgré eux, à adopter des comportements inappropriés. Il est urgent de mettre en place une véritable politique publique dédiée à la protection des mineur·es et de redonner des moyens financiers conséquents pour restaurer pleinement le fonctionnement de ces institutions essentielles.
Mobilisons-nous pour que cela change !
La libération de la parole face à une société adultiste
Les enfants et les ados parlent, mais leurs voix restent souvent ignorées voire niées. 92 % d'entre elleux ayant dénoncé des violences sexuelles n'ont pas été protégéEs [10]. Trop souvent, iels sont réduitEs à leur statut de mineurEs, perçus comme insignifiants, soumisEs à un devoir d'obéissance aveugle envers leurs aînés. Pire encore, la présence des enfants est considérée comme si dérangeante que certains espaces leur sont désormais interdits alors même que l'espace public, largement occupé par les adultes, n'est en très grande partie déjà pas conçu pour les enfants. Notre société est adultiste. Mobilisons-nous pour que cela change ! Un pays qui ne s'occupe pas des enfants est un pays qui va mal, une société qui a peur des ados est une société à la dérive. Comment notre société pourrait bien se porter quand elle accepte sans broncher qu'un enfant ou un·e ados soit violéE toutes les 3 minutes dans notre pays [11]. Qui décide des priorités pour l'avenir de notre peuple ? Qui se lèvera pour dire stop ?
Aujourd'hui, nous comptons sur vous tous·tes pour vous lever avec nous et dire stop aux violences faites aux enfants et aux ados. Nous invitons les enfants, les jeunes et toute la société à se mobiliser le 16 novembre. Montrons à tous les enfants et aux ados que nous sommes là, que nous nous indignons face à leur souffrance et que nous ferons tout pour que ces jeunes puissent grandir en toute sécurité.
« Chaque monde sera jugé sur ce qu'il a considéré comme négociable ou non négociable ». – Charles Peguy
[1] Enquête IPSOS – Violences sexuelles de l'enfance – 2019
[2] Rapport Igas, IGJ, IGAENR – Mission sur les morts violentes d'enfants au sein des familles – 2019
[3] Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes – 2019
[4] Ministère de l'Intérieur – Étude nationale sur les morts violentes au sein du couple – 2022
[5] Etude publié dans The lancet child & adolescent health – 2022
[6] Association Impactes
[7] Unicef – 2024
[8] Unicef–Insee–2018
[9] Rapport Unicef – 2023
[10] Rapport Ciivise – 2023
[11] Rapport Ciivise – 2023
Premiers et premières signataires : Collectif Enfantiste ; Cofrade ; Protéger l'enfant ; Association Allegria ; AVI – Action contre les Violences Infantiles ; Chris-à-VIF ; Collectif féministe contre le viol (CFCV) ; Collectif Nos Enfants Trans ; Embrase Le Monde ; Enfance sauvage 84 ; EspacCollective des mères isolées Mineur.e.s Trans Toulouse (EM2T) ; FAGE ; Fondation pour l'enfance ; FNAREN ; FSU ; Héroïnes 95 ; Fédération Nationale des victimes de féminicides ; IELES ; Je te crois, je te protège ; Justice des familles ; Le déni, ça suffit ! ; Le monde à travers un regard, groupeFemmes avec.. de parole Chateaulin ; Les chiens de justice ; Les Unschorrigibles ; Les Midis du MIE ; Mendorspas ; Mouv'enfants ; NonSco'llectif ; #NousToutes ; Observatoire des politiques du handicap ; OVEO ; Pépite sexiste ; Pour une M.E.U.F. (Pour une Médecine Engagée Unie et Féministe) ; Prévenir & protéger ; Renaitre après l'inceste, agir avec les Bonnes Mères Organisation de Solidarité Trans (OST) ; SNJMG Syndicat National des Jeunes Médecins Généralistes ; SNPPE ; Soutien Ciivise ; Stop Bébé Secoué ; StopVEO Enfance sans violences ; Team Eunomie ; Toustes en colo ; UNEF, le syndicat étudiant ; Union syndicale Solidaires ; SOS Inceste & Violences Sexuelles
Publié dans le Courrier N° 437 de la Marche Mondiale des Femmes
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

École Bedford, plus jamais de climat malsain dans une école du Québec

Depuis plus d'un mois, la dynamique interne à l'école Bedford occupe les manchettes. Des problématiques concernant le climat à l'école et des lacunes au niveau pédagogique ont été relevées depuis l'année scolaire 2016-17 nous apprend-on. À la suite de la parution récente d'un rapport d'enquête demandé par le ministère de l'Éducation (MEQ), le Centre de services scolaires de Montréal (CSSDM) a suspendu 11 des 22 titulaires de l'école. Les partis politiques s'en mêlent. On va même jusqu'à parler d'entrisme religieux dans les écoles publiques. La laïcité de nos écoles est menacée, affirme certain-es. Des enquêtes journalistiques dans les quotidiens La Presse et Le Devoir complètent l'information disponible. Regardons cela de plus près. Qu'en est-il vraiment ? Qui est responsable d'un tel gâchis ? Et quelles seraient les pistes de solution ?
L'école Belford en 2024
Cette école de 370 élèves est composée de 5 groupes de niveau préscolaire, 4 et 5 ans, et de 17 groupes de niveau primaire. C'est une équipe comprenant 22 groupes classe ayant chacun un-e titulaire dont l'enseignement est complété par 5 enseignant-es spécialisé-es en éducation physique, musique, anglais et art dramatique.
Située dans le quartier Côte-des-Neiges, l'école a une cote de défavorisation de 10 sur 10, ce qui lui permet de recevoir plus de services pour les élèves et d'avoir un ratio d'élèves moindre par classe (17 ou 18 au maximum).
Les services complémentaires sont assurés par une psychoéducatrice, une orthophoniste, des orthopédagogues (3), un enseignant en soutien linguistique et des techniciennes en éducation spécialisées (3). Un service de garde qui compte plus de 30 intervenantes est actif au sein de l'école. Une aide aux devoirs pour les élèves de 4e, 5e et 6e année est disponible à raison de 2 fois semaine.
Rapports d'enquête de la CSSDM (2020) et du MEQ (2024) et suivi ministériel
Comme nous l'avons mentionné, des problématiques concernant le climat de l'école et des lacunes au niveau pédagogique ont été relevées dès l'année scolaire 2016-17. Dès 2018-2019, une clarification des attentes de la direction à l'endroit de certain-es enseignant-es est faite. La direction demande aussi au CSSDM la tenue d'une enquête sur le climat qui prévaut à l'école Bedford. Le CSSDM, plutôt que d'acquiescer à cette demande, choisit une approche ciblant les relations interculturelles. La situation ne se résorbant pas, il s'ensuit en 2020 une première enquête effectuée par une firme de psychologues industriels qui constate des problèmes relationnels entre les membres de l'équipe école ainsi qu'un besoin de supervision des pratiques pédagogiques. Un plan d'action est alors mis en place en septembre 2020. Malgré cela, la situation continue de se détériorer.
En 2022, une nouvelle direction met fin au plan d'action. S'en est suivi le départ de plusieurs membres du personnel enseignant. En 2023, des reportages faits par Valérie Lebeuf sur 98,5 FM ont permis de recueillir 18 témoignages sous couvert de l'anonymat dénonçant le climat de travail qui prévaut à Bedford. En septembre 2023, le MEQ sollicite du CSDM toute la documentation pour faire enquête sur la situation médiatisée. Un rapport d'enquête réalisé à la demande du MEQ est rendu public en octobre 2024.
Voici les différents constats effectués :
• Il y a absence de mécanisme efficace d'évaluation de la compétence des enseignants en cours d'emploi ;
• Globalement, le niveau de compétence des enseignants de l'école Bedford est inquiétant ;
• Le climat de l'école Bedford ne s'est pas amélioré malgré toutes les actions entreprises par le CSSDM ;
• Le CSSDM a perdu de vue la situation de l'école Bedford en cours de route ;
• Le CSSDM dispose d'une faible capacité à effectuer des suivis ;
• Les directions peinent à imposer des formations aux membres du personnel ;
• Certains enseignants cherchent à se dérober des mesures de surveillance.
Par la suite, 11 enseignant-es concerné-es par les allégations faites à leur endroit ont été suspendus. « Les suspensions resteront en vigueur durant toute la durée des travaux des comités d'enquête mandatés par le ministre de l'Éducation ». Ces derniers doivent déterminer si les 11 enseignant-es en question « ont commis une faute grave ou un acte dérogatoire à l'honneur ou à la dignité de la profession enseignante dans l'exercice de leurs fonctions ».
Dans sa conclusion, le rapport affirme que « la CSSDM a utilisé les moyens dont elle disposait, sans qu'une amélioration de la situation ne s'observe. »
Problématiques tues
Il importe de considérer quelles sont les problématiques qu'on a tues ou dont on n'a pas tenu compte, pour espérer une vraie sortie de crise et assurer qu'une telle situation ne se reproduise pas.
1- À l'interne :
• Le roulement du personnel de direction : pendant la période où on a noté un climat et des lacunes pédagogiques problématiques, soit entre 2016 et 2024, 4 directions et 5 directions adjointes se succéderont à l'école Bedford.
• L'identification du problème lié au climat malsain a été mal circonscrite voire erronée : la CSSDM a ciblé les rapports interculturels et non un non-respect des exigences de la Loi de l'instruction publique (LIP), du régime pédagogique ou de l'application de la convention collective qui définit la tâche des enseignant-es et les obligations associées dont celle de travailler en collaboration avec les autres membres de l'équipe école, sur des bases de respect mutuel, exempt de harcèlement. Est-ce par crainte d'être taxée de racisme ?
• L'absence de mesures disciplinaires explicites face à des manquements sévères. Le rapport indique que le CSSDM « conseillait plutôt de faire attention et de ne pas être coercitifs pour ménager le climat. « (p. 67)
• Les exigences pédagogiques non explicites, l'encadrement déficient et l'absence de suivi sont énoncés sans relation aux élèves. Le rapport ne comporte aucune mention des résultats scolaires de l'ensemble des groupes classe de l'école.
• L'absence de données comparatives et longitudinales sur la réussite éducative des élèves (2014-2024) pour l'ensemble des écoles primaires du quartier Côte-des-Neiges. Ces données sont nécessaires pour savoir si les élèves de l'école Bedford ont des résultats scolaires comparables à ceux des élèves d'écoles similaires malgré les approches pédagogiques décriées.
• Le projet éducatif de l'école n'est jamais mentionné. Quelle place joue l'équipe école dans la détermination du projet éducatif de l'école ?
• Le mode de fonctionnement en assemblée générale de l'ensemble du personnel de l'école (enseignant, non enseignant et service de garde), n'est pas abordé. Les problèmes identifiés concernent-ils l'ensemble du personnel de l'école ? Les organisations syndicales du personnel de soutien, des services professionnels et des services de garde ont-ils été associés aux démarches faites par le CSSDM auprès de l'Alliance des professeures et professeurs de Montréal (APPM) ?
• La place des parents et des élèves dans ce processus scolaire n'est pas abordée. Nulle part ne fait-on référence aux besoins, demandes ou critiques tant des parents que celles des enfants. Ils sont pourtant les premiers concernés. La suspension des titulaires des enfants a eu des impacts directs sur eux.
• Le conseil d'établissement n'est pas mentionné dans le rapport d'enquête. Qu'en est-il de sa composition et de son fonctionnement ? Quels échanges s'y déroulent en lien avec le climat qui a prévalu et qui prévaut à l'école ?
2- Au CSSDM :
• L'abandon d'un soutien soutenu à la direction de l'école par le CSSDM et le tâtonnement dans l'approche. Le CSSDM n'a pas eu une approche cohérente dans le soutien aux directions de l'école. La direction en poste en 2018 qui cherchait à encadrer les enseignant-es récalcitrant-es n'a pas été outillée adéquatement et la débandade s'est enclenchée. Les interventions faites n'ont pas été évaluées, ni des ajustements apportés. On a plutôt privilégié un changement de cap, une approche multiculturelle. Deux enquêtes et 4 directions plus tard, la situation perdure.
• Malgré les reportages de Valérie Lebeuf, la direction générale du CSSDM dit publiquement en 2023 que les problèmes soulevés à cette école sont réglés.
• La quantité de services déployés au détriment d'une réponse adéquate validée à la problématique de climat malsain indique non pas que le CSSDM a fait tout ce qu'il pouvait mais plutôt qu'il a failli à analyser correctement les manquements qui sévissaient dans cette école. Le dossier de l'école est éparpillé au sein de plusieurs services du CSSDM nous dit le rapport d'enquête.
• Les outils de la convention collective locale des enseignant-es ont-ils été utilisés ? Deux comités existants, le comité des politiques pédagogiques (CPE) et le comité des relations de travail (CRT) sont les endroits où les problématiques de climat malsain et de compétence pédagogique peuvent être soulevées et des solutions apportées. On n'en fait aucunement mention dans le rapport d'enquête.
• Le français langue de travail en milieu scolaire est-il garanti au sein du CSSDM ? Comment peut-on justifier que le français en tout temps et en tout lieu ne soit pas exigible au sein du CSSDM ? L'école publique francophone ne doit-elle pas être le lieu privilégié pour ce faire ?
3- À l'Alliance des profs :
• L'absence de prise en compte des plaignant-es et de soutien explicite quant au climat malsain. Des problématiques signalées entre membres d'un même syndicat ne peuvent être banalisées, voire non répondues. Des enquêtes ne doivent-elles pas être entreprises, des réponses trouvées, des revendications à la faveur d'un climat sain faites auprès de l'employeur ?
• La définition erronée par certain-es enseignant-es du concept de l'autonomie professionnelle n'a pas été contredite par le syndicat. L'autonomie professionnelle ne peut se substituer au devoir de travailler conjointement à la réussite des élèves, à la complémentarité des approches et à la nécessaire coordination entre toutes celles et ceux qui interviennent auprès des élèves d'un même groupe classe. Le soutien aux élèves en difficultés d'apprentissages doit être garanti ainsi que leur accès aux services adéquats offerts.
• Quelles ont été les interventions effectuées en CRT à la suite du rapport de la firme de psychologues industriels en 2021 ? Cette instance paritaire syndicale-patronale n'est pas abordée dans le rapport.
• Quel suivi le syndicat a-t-il fait auprès de ses membres à l'école Bedford ? Et auprès du CSSDM ?
4- Au ministère de l'Éducation
• La compétence professionnelle de certain-es enseignant-es est remise en cause dans le rapport d'enquête. Toutefois, le ministère qui décerne l'autorisation d'enseigner le fait en suivi à des qualifications acquises et reconnues par les universités. Comment le rapport d'enquête peut-il mener à modifier cette démarche ?
• Le rapport conclut que le CSSDM a fait tout ce qu'il a pu. Nous pouvons en douter. Le rapport n'indique nullement que tous les outils à sa disposition ont été utilisés. Les enseignant-es ciblés ne semblent pas avoir de dossier disciplinaire en lien avec des manquements dans l'exercice de leur tâche ou liés à de l'insubordination. Les résultats des élèves de ces groupes classes ne sont pas considérés.
Somme toute, le CSSDM a failli à sa tâche, n'ayant pas assuré le respect des lois, règlements et contrats de travail permettant de résoudre les problèmes rencontrés.
Les recours pédagogiques et disciplinaires à sa portée n'ont pas été utilisés, les directions d'école ont été laissées à elles-mêmes.
Le syndicat n'a pas pris fait et cause pour les enseignant-es victimes de harcèlement, voire de violence. Le syndicat devrait pouvoir assurer un mécanisme de traitement neutre et sans parti pris des plaintes.
Sortie de crise
Pour assurer une sortie de crise satisfaisante du point de vue du personnel mais aussi des parents et des élèves, il convient d'agir.
• En offrant une réponse adéquate et valorisante de la qualification légale des enseignant-es et de son encadrement. Elle doit être apportée non seulement pour les enseignant-es suspendu-es mais pour l'ensemble du personnel enseignant du CSSDM.
Alors que la pénurie d'enseignant-es dans les écoles du Québec subsiste, que la lourdeur de la tâche est décriée et n'a pas été répondue à la satisfaction des enseignantes et enseignants au sortir de la grève de 2024, il faut trouver une réponse qui favorise l'acquisition des savoirs essentiels aux apprentissages des élèves et valoriser la complémentarité des approches pédagogiques plutôt que de les opposer.
• En mettant de l'avant une approche multipartite CSSDM/directions écoles/syndicat pour :
-
- Solutionner et garantir un climat sain à l'école Bedford en mettant en place des mesures explicites et concrètes ;
- Prévenir toute récidive là ou ailleurs d'un tel climat malsain ;
- Rassurer les familles de Côte-des-Neiges de la prise en compte des besoins de leurs enfants au sein des écoles du quartier (assemblées citoyennes, médiation au besoin en lien avec les organismes du quartier, etc.) ;
- Promouvoir l'école québécoise publique laïque où le français et la culture québécoise sont au cœur du projet éducatif à convenir.
Des réponses innovantes doivent être trouvées tant par les premières et premiers intervenants de l'école soit le personnel, les élèves et les parents que par les instances en autorité (CSSDM, directions d'école et syndicats). Le MEQ doit s'assurer que le CSSDM assume ses responsabilités et qu'il clarifie, pour le bénéfice de tous les personnels à son emploi, ce que signifie travailler dans un climat de travail sain, où le français et la culture québécoise sont au cœur du projet éducatifs de toutes et tous. Le cas échant, l'employeur doit être sanctionné pour ses manquements. Plus jamais un climat malsain dans une école du Québec ne doit être toléré.
Ghislaine Raymond
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

De quel parti avons-nous besoin ?

Avant d'aborder les sujets qui seront à l'ordre du jour du congrès de Québec solidaire sur les statuts, il convient de se demander quelles sont les tâches de la gauche dans la période actuelle et quel type d'organisation convient le mieux à la réalisation de ces tâches. En effet, un parti n'est rien d'autre qu'un instrument, un outil, dont l'utilité ne se mesure qu'à sa capacité à accomplir ce qui est nécessaire.
En ce qui concerne les tâches de la gauche pour les années qui viennent, il apparaît évident, notamment suite aux résultats de la présidentielle étasunienne, que nous aurons à mener de multiples batailles difficiles contre un vent de droite et d'extrême-droite intense. Le simple respect des droits humains n'est pas une référence pour bien des gens. En particulier, le droit de quitter son pays pour fuir la guerre, la misère ou la répression est nié par l'autoritarisme sécuritaire et le nationalisme étroit. Les efforts visant à minimiser le chaos climatique se heurtent à un individualisme exacerbé et parfois violent, en plus des intérêts financiers du capitalisme extractiviste. Les acquis du mouvement féministe des dernières générations sont remis en question par divers mouvements conservateurs, nationalistes ou religieux.
La liste des batailles à venir pourrait être très longue. L'essentiel est de s'entendre sur le fait que l'évolution récente et prévisible du paysage politique n'est pas favorable aux idées féministes, humanistes, écologistes ou internationalistes. La démocratie libérale elle-même est minée par les tendances autoritaires démagogiques, parfois fascisantes. Partout, les forces politiques de centre-droite et de centre-gauche démontrent leur incapacité à mener les batailles nécessaires avec succès. Bref, nous allons devoir ramer à contre-courant pour toute une période et s'atteler à construire, patiemment, des contre-pouvoirs, des mouvements de résistance et une vision collective d'une alternative globale et radicale. Les petites réformes à la marge ou le simple remplacement des personnes présentement au pouvoir par d'autres ne suffiront pas. Gagner les élections ne suffira pas. On l'a vu récemment en France avec la victoire du Nouveau front populaire, effacée par l'autoritarisme présidentiel et les manigances de coulisse entre les partis de droite.
ACTION POLITIQUE OU CONSOMMATION POLITIQUE ?
Quel type de parti convient à ces efforts de résistance sur plusieurs fronts à la fois, à la construction patiente d'un mouvement social capable de renverser la vapeur ? Une machine électorale bien huilée avec un plan de communication en béton, des candidatures prestigieuses et un gros budget ne fera pas l'affaire. On vient de voir les limites de ce modèle avec la faillite totale du Parti démocrate étasunien. Si on se limite à une compétition électorale pour attirer des consommateurs politiques atomisés vers “notre produit”, nous n'avancerons pas. Québec solidaire pourrait même perdre des plumes d'une élection à l'autre, face au rouleau compresseur institutionnel et au capitalisme médiatique.
Face à l'individualisme exacerbé et de plus en plus autoritaire qu'on pourrait qualifier d'égofascisme, l'alternative doit être une démarche d'action politique collective. La gauche doit se définir non seulement par ce qu'elle propose, mais aussi par sa manière de mener le travail politique, toujours sur le terrain des luttes et des résistances quotidiennes. Notre mode de fonctionnement doit être centré sur la délibération collective dans des espaces de démocratie participative. Le parti dans son ensemble doit être une école de militantisme, un incubateur de résistances, un point de rencontre pour toutes les personnes qui refusent de se laisser assimiler par la machine à produire des travailleurs-consommateurs-citoyens dociles.
QUE PENSER DES CHANGEMENTS PROPOSÉS AUX STATUTS ?
Plusieurs propositions en débat au congrès vont clairement dans la mauvaise direction. Tout ce qui encourage un rapport de consommation politique individuelle entre les membres et la structure de l'organisation est à rejeter. Non aux référendums décisionnels. Non au suffrage universel pour toute élection interne. Dans les deux cas, les membres se retrouvent seuls face à une décision politique et n'ont pas l'obligation d'en discuter avec qui que ce soit. On peut créer “des espaces de formation et de discussion”, tel que souhaité par le conseil national, mais les membres n'ont aucune obligation d'y participer.
Les grandes décisions politiques et les élections internes devraient demeurer entre les mains des structures de délibération, d'échange et de débat, comme le congrès ou le conseil national. C'est ce qui fait notre force depuis presque vingt ans. À noter, tant pour les élections au suffrage universel que pour les référendums, on abandonnerait le principe de la parité. On peut difficilement imaginer une manière de limiter les droits de vote individuels dans ce contexte.
Tout ce qui mine la collégialité des structures exécutives et l'égalité entre les personnes qui y participent est aussi à rejeter. C'est le cas de l'élection des porte-paroles ou de la présidence au suffrage universel. C'est certainement le cas avec l'introduction de courses à la chefferie. On nous dit que c'est pour que les courses au porte-parolat s'autofinancent et aussi que la collégialité du CCN sera maintenue. Ce sont là de belles intentions et de belles paroles qui font fi de la réalité politique. Si des milliers de dollars sont recueillis et dépensés pour une course à la chefferie, la personne qui va emporter cette course n'aura pas un statut égal à l'autre porte-parole, tant dans les yeux de la plupart des membres que dans les médias et dans l'opinion publique. Et la loi nous interdit d'utiliser ces sommes pour autre chose que la course. Alors pourquoi rompre avec nos principes pour ce plat de lentilles ?
Il y a aussi de bonnes idées dans ce cahier de synthèse. Un conseil national composé de personnes désignées pour des mandats d'un an (comme les membres des comités de coordination des associations) sera mieux à même de jouer son rôle de supervision de l'ensemble des activités du parti. Il pourra se réunir plus rapidement, plus souvent, pour des rencontres de durée variable, et donc réagir aux revirements fréquents de la conjoncture. Bref, ce sera un gouvernail efficace dans les tempêtes politiques qui s'annoncent.
L'ajout d'une personne responsable des liens pancanadiens et internationaux au CCN est aussi une excellente idée. Les luttes que nous aurons à mener seront internationales par la force des choses. Notamment, la bataille pour l'indépendance du Québec va devoir se mener avec des alliances pancanadiennes et internationales pour briser la résistance de l'État fédéral et obtenir la reconnaissance rapide du nouveau pays.
DES DÉBATS À POURSUIVRE
Sur d'autres questions, il semble, après quelques mois d'échanges sur le cahier initial de propositions, que le fruit n'est pas mûr et que le congrès devrait reporter les décisions à plus tard. C'est notamment le cas avec la réforme des structures locales et régionales. Des échanges plus approfondis sont nécessaires pour fignoler une réforme qui nous donne de la flexibilité tout en respectant le principe de l'égalité des droits pour les membres. Présentement, trop de membres n'ont pas la possibilité de participer à une association locale et ce sont ces associations qui dominent le congrès et le CN. Aussi, trop d'associations régionales sont moribondes ou dormantes. On doit redéfinir leur rôle en pratique avant de refléter ces nouvelles pratiques dans une réforme des structures.
C'est aussi le cas avec l'idée intéressante des comités d'action politique. Ceux-ci devraient représenter un renforcement du rôle des structures thématiques dans le parti, en combinant les rôles de la mobilisation, de la formation et du développement des orientations. Mais il y a trop de résistance à cette idée parmi les personnes présentement impliquées dans les réseaux militants et les commissions thématiques. Manifestement, les intentions initiales du comité de révision des statuts ont été mal traduites en amendements spécifiques. Aussi, les répercussions indirectes de cette réforme (sur la commission politique notamment) manquent de précision.
En conclusion, le congrès sur les statuts sera une occasion de décider quel type de parti nous voulons construire au cours des prochaines années. Allons-nous céder aux pressions institutionnelles et médiatiques et faire de QS un parti de plus en plus semblable aux autres ? Allons-nous au contraire résister à ces pressions et insister sur la nécessité de “faire de la politique autrement”, comme on le disait souvent dans les premières années ? Espérons que le congrès retiendra la seconde option.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Pourquoi le gouvernement Trudeau annule-t-il soudainement la rencontre prévue avec Francesca Albanese, la rapporteuse spéciale de l’ONU pour les territoires palestiniens occupés depuis 1967

La semaine passée, je critiquais de façon cinglante l'ambassadrice étatsunienne au Conseil de sécurité de l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, qui s'en prenait carrément à Francesca Albanese, cette si courageuse et impressionnante rapporteuse spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens occupés depuis 1967, qui ose dénoncer sans relâche, publiquement et avec force et ténacité, les atrocités en cours à Gaza, qu'elle n'hésite pas, d'ailleurs, à qualifier de génocide.
Et qui faisait cela alors que l'assaut ne montre aucun signe de relâche ? Israël, non satisfaite d'avoir déjà tué 43 000 Palestiniens et Palestiniennes, dont 17 000 enfants et 700 bébés, d'avoir fait 103 000 blessés et bombardé tellement d'infrastructures que Gaza en soit devenu majoritairement que débris et restes humains, impose, depuis un mois, un siège total sur le nord de Gaza, coupant systématiquement cette région de toute énergie et de tout aliment et produit médical, et ordonnant à nouveau à la population de se déplacer vers le sud ; alors que la Knesset, le parlement israélien, vient d'adopter, et ce à très forte majorité, une motion déclarant terroriste la seule agence de l'ONU ayant l'infrastructure et l'expérience nécessaire pour fournir aide humanitaire, éducation, et services de santé au peuple palestinien, l'UNRWA, et bannissant formellement toutes les opérations de celle-ci à Gaza, en Cisjordanie, et à Jérusalem-est alors qu'elle se trouve à New York pour assister à la réunion urgente du Conseil de sécurité de l'ONU, convoquée à cause de la motion si troublante adoptée par la Knesset le jour précédent.
Ce qui m'indigne et me révolte profondément, c'est de voir Thomas-Greenfield, dans un tel contexte apocalyptique, diriger sa fureur contre Albanese, celle qui dénonce le génocide en cours, et non contre le pays qui est en train de le perpétuer.
« Je tiens à réaffirmer la conviction des États-Unis qu'elle est indigne de ses fonctions », tweete Thomas-Greenfield. « Les Nations Unies ne devraient pas tolérer de l'antisémitisme de la part d'une fonctionnaire affiliée à l'ONU et engagée pour promouvoir les droits de la personne. »
Ce qui m'indigne et me révolte profondément cette semaine, c'est de voir le comportement de notre gouvernement canadien.
Le 5 novembre, Francesca Albanese se trouvait à Ottawa pour une rencontre avec la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, et d'autres hauts fonctionnaires du gouvernement canadien. Et voilà que, soudainement et à la toute dernière minute, on lui apprend que le gouvernement annule la rencontre.
Incroyable et révoltant !
N'est-ce pas une stratégie grossière et immorale de la part de notre gouvernement que de refuser de rencontrer la personne qui pourrait lui occasionner énormément d'embarras public ? La personne qui l'obligerait à se regarder dans le miroir... La personne qui l'inviterait publiquement à sanctionner et rompre ses liens commerciaux et diplomatiques avec un pays qui, selon la Cour internationale de justice, non seulement occupe de façon totalement illégale des territoires palestiniens depuis 1967, mais serait aussi plausiblement en train de commettre un génocide...
Pourquoi Israël a-t-elle toujours refusé à Francesca Albanese d'aller enquêter directement dans les territoires occupés ? N'a-t-elle pas reçu son mandat directement de l'ONU ? Selon l'ONU, tout pays n'a-t-il pas l'obligation formelle d'ouvrir ses portes à tout rapporteur spécial ? Si Israël et son grand allié étatsunien trouvent qu'Albanese est antisémite et ne donne qu'une version des événements, pourquoi ne pas lui donner l'opportunité d'exercer son droit d'aller sur le terrain ? Cette expérience ne constituerait-elle pas la meilleure façon de lui permettre de voir la réalité comme la perçoivent les Israéliens ?
Pourquoi Israël refuse-t-elle systématiquement aux médias étrangers d'entrer à Gaza ? Est-ce vraiment la meilleure façon de se protéger de toute fausse information qui serait teintée d'antisémitisme ? Est-ce vraiment la meilleure façon de démontrer au monde entier qu'Israël représente, dans le Moyen-Orient, le joyau de la liberté et de la démocratie ? N'est-ce pas tout simplement un effort on ne peut plus grossier de cacher la réalité ?
Pourquoi les militaires israéliens, le 5 mai dernier,envahissaient-ils les bureaux d'Al Jazeera en Israëll, confisquant son matériel de diffusion, coupant cette chaîne de télévision des compagnies de câble et de satellite et bloquant tous ses sites web ? Al Jazeera, qui, grâce à ses nombreux reporters palestiniens qui vivent à Gaza, permet aux téléspectateurs et téléspectatrices de voir en direct les images d'horreurs. Des reporters, dont le courage et la persévérance sont extraordinaires, un nombre historiquement sans précédent d'eux ayant trouvé la mort, souvent directement ciblés par les militaires israéliens.
******
Je reproduis ci-bas, pour lectrices et lecteurs, de larges extraits de la conférence de presse qu'accordait Francesca Albanese, peu après qu'elle eut appris que sa rencontre avec Mélanie Joly n'aurait pas lieu.UN Special Rapporteur on the Palestinian Territories Speaks to Media in Ottawa, CPAC, le 5 novembre 2024. Consulté le jour même.
« Il ne m'a pas échappé qu'en dépit de l'urgence du moment, à quelques exceptions près, les dirigeants politiques de ce pays ont choisi de ne pas me rencontrer ou ont retiré leurs invitations. En attendant, c'est un honneur pour moi de savoir que les premiers gardiens de cette terre prévoient venir de tout le pays pour me rencontrer et discuter de ce qui se passe en Palestine. Ce sont également les jeunes et un bon nombre de mes pairs qui se sont battus pour que je prenne la parole et qui ont cherché des lieux de rencontre.
« Il semblerait que mes paroles, ma lecture franche des faits, du droit international et de la justice, mon insistance à parler honnêtement du génocide qui se déroule à Gaza et du risque sérieux qu'il se propage dans toute la région, effraient la classe politique et ceux qui détiennent le pouvoir. Y compris le pouvoir économique et financier. Nous savons, depuis Edward Said jusqu'à Antonio Gramsci, que la détention du pouvoir détermine également l'hégémonie culturelle.
« Il est clair pour moi que le peuple canadien veut plus de clarté, d'intégrité et d'actions concrètes de la part de son gouvernement par rapport aux atrocités que nous voyons tous se dérouler en Palestine. À Gaza, nous sommes contraints de regarder les bombardements, les tirs de snipers et les tirs d'artillerie incessants d'Israël qui n'épargnent personne : journalistes, médecins, enseignants, universitaires, infirmières, personnes handicapées, personnes en quête de nourriture et de sécurité, travailleurs humanitaires, y compris le personnel des Nations unies, notamment dans les zones dites humanitaires.
« Selon des estimations prudentes, l'assaut israélien sur Gaza a tué, blessé, mutilé ou enseveli sous les décombres quelque 155 000 Palestiniens, des familles entières ayant été exterminées. Et 70 % des personnes tuées sont des femmes et des enfants. Parmi les 17 000 enfants tués, 700 étaient des bébés. Gaza n'est plus qu'un champ de ruines, d'ordures et de restes humains, où les survivants s'accrochent à la vie au milieu des privations et des maladies.
« Les Palestiniens qui y sont piégés ont connu un niveau de violence sans précédent au cours de ce siècle. Leurs résidences ont été démolies. Et tout cela se fait de façon intentionnelle. Et pourtant, Israël intensifie ses attaques en ce moment même.
« Pendant ce temps, la violence s'étend à la Cisjordanie, où on voit se reproduire le même pattern qu'à Gaza. Depuis le 7 octobre 2023, le nombre de Palestiniens tués en Cisjordanie a été multiplié par dix par rapport à la moyenne des vingt années précédentes, dont 169 enfants. Cela représente un cinquième de tous les enfants qu'Israël a tués en Cisjordanie depuis 2000. Des universitaires palestiniens, des défenseurs des droits de l'homme, des universitaires, des médecins, des infirmières, des enfants sont arbitrairement arrêtés et incarcérés dans le cadre d'une campagne d'arrestations massives, et sont maintenant confrontés à la privation et à la torture dans des conditions sordides, et tout cela sans inculpation ni procès.
« Des milliers de Palestiniens ont été déplacés dans le cadre de la plus grande opération d'accaparement de terres en Cisjordanie et à Jérusalem-Est de ces trente dernières années.
« Alors que je continue à enquêter et à documenter les actes de génocide, il est clair qu'il existe également un déni et un obscurantisme qui se cachent derrière la perception commune de ce qu'est un génocide. Cette perception a été clairement façonnée par les horreurs massives de l'Holocauste et probablement par les caractéristiques du génocide rwandais. Dans les deux cas, l'échelle quasi industrielle et la brutalité de l'extermination ont défini notre compréhension collective du crime. Mais je vous rappelle que le génocide n'est pas défini par des opinions ou des histoires personnelles. Il peut y avoir génocide sans massacre ni extermination ; cependant, on retrouve ces deux éléments en Palestine.
« L'amnésie coloniale de la plupart des États occidentaux nous a fait oublier les centaines de millions de personnes qui ont vécu un génocide, que ce soit en Namibie, en Australie, dans les Amériques ou ici. C'est la mémoire du passé qui permettra à l'avenir d'être différent. C'est pourquoi la connaissance est aujourd'hui subversive.
« Le crime de génocide consiste en des actes accompagnés de l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. Si la destruction du groupe s'interprète en termes physiques, biologiques, la loi génocidaire découle d'actes dont l'intention est de détruire l'esprit d'un peuple, la volonté de vivre, la vie elle-même. Ainsi, lorsque nous exprimons l'intention, nous devons nous rappeler que le génocide est un processus, et non un acte unique, comprenant une pluralité d'actes et d'acteurs. L'essentiel est donc d'identifier le fil conducteur de cette conduite collective.
« Ainsi, conformément à la jurisprudence la plus récente, mon dernier rapport évalue l'intention d'Israël de détruire le peuple palestinien de manière holistique par le biais d'une approche à triple lentille. En considérant la totalité de la conduite et des crimes israéliens contre la totalité du peuple palestinien en tant que tel, à travers la totalité du territoire palestinien illégalement occupé par Israël.
« Et si j'insiste sur ce cadre, permettez-moi de vous expliquer pourquoi. Parce que les Palestiniens subissent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité depuis des décennies. Mais ces faits ne suffisent pas à révéler l'ampleur du crime, ni à mettre en lumière le risque sérieux d'effacement auquel ils sont confrontés. Et je suis loin d'être le seul à le penser. En novembre 2023, 13 experts indépendants des Nations unies avaient déjà conclu à l'existence d'un génocide plausible. »
Enfin, j'invite lectrices et lecteurs à lire le rapport complet que Francesca Albanese soumettait, le 1 octobre dernier, à l'Assemblée générale des Nations Unies. [1] Une lecture aussi difficile à digérer, sur le plan humain et émotionnel, que les horreurs que nous voyons dérouler quotidiennement sur nos écrans.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
[1] Situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, le 1 octobre 2024. Consulté le 10 novembre 2024.

Grand rassemblement syndical 23 novembre 2024 Colisée de Trois-Rivières

La CSN invite ses membres et leur famille au grand rassemblement syndical de l'année ! Sous le thème Pas de profit sur la maladie, l'événement sera animé par la comédienne engagée Eve Landry et réunira une variété d'artistes, d'humoristes et de conférenciers.
Plusieurs invité-es surprise seront annoncés dans les prochaines semaines.
L'événement est gratuit, réservez dès maintenant votre place en vous inscrivant en ligne.
Détails de l'événement
Quand ? 23 novembre 2024, de 10 h 30 à 14 h 30
Où ? Colisée Vidéotron de Trois-Rivières
Qui ? Les membres de la CSN, tous secteurs d'activité confondus, ainsi que leur famille.
Comment ? Transport gratuit en autobus fourni. Pour vous inscrire, cliquez sur ce lien.
Vous voulez être tenu au courant ? Rendez-vous sur la page Facebook de l'événement.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La victoire de Trump, un avertissement majeur !

L'élection nette de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis d'Amérique constitue un développement majeur du processus de droitisation et d'extrême-droitisation en cours au niveau du capitalisme mondial.
Tiré de Gauche anticapitaliste
6 novembre 2024
Par Daniel Tanuro
Alors que le néolibéralisme a creusé des inégalités sociales abyssales qui frappent en premier lieu les femmes et les personnes racisés.e.s ;
Alors que les classes dominantes se vautrent chaque jour davantage dans une opulence dont les sources légales et illégales se mélangent au point qu'on ne peut plus les distinguer ;
Alors que la catastrophe climatique et l'effondrement de la biodiversité causés par la course au profit du capital fossile frappent durement et menacent d'emporter des millions de pauvres ;
Alors que la course à l'hégémonie prend de plus en plus le visage hideux du suprémacisme néocolonial et de l'appropriation sauvage des richesses au prix de massacres monstrueux ;
Bref, alors que le monde se rapproche d'une bascule dans la barbarie, un système électoral hérité de l'esclavage, des médias privés ouvertement réactionnaires et des réseaux sociaux actionnés par des capitalistes voyous à la Elon Musk livrent le gouvernement de la principale superpuissance à un milliardaire fasciste sans scrupule. Un lumpen-capitaliste, fraudeur, menteur, violeur, manipulateur, raciste, putschiste avéré, ouvertement climatonégationniste et militariste à tout crin…
C'est un tremblement de terre planétaire, une avancée majeure du nihilisme autoritaire qui gangrène les classes dominantes.
Poutine et Netanyahou jubilent : ils pourront continuer à faire couler des fleuves de sang et de larmes, en Ukraine et en Palestine, sans même un semblant de réprobation de Washington.
Orban, Meloni, Le Pen, Wilders et leurs ami.e.s d'extrême-droite jubilent : ils voient se rapprocher le moment où l'Union Européenne pourrait tomber complètement dans leurs filets.
Du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, les criminels jubilent : les insultes, la démagogie, le virilisme, les mensonges les plus éhontés permettent de s'emparer du pouvoir pour se blanchir et s'enrichir encore plus au service du dieu Capital.
Déjà incapable d'assurer la paix et la justice, ou de protéger le climat face aux diktats des puissants, l'ONU et ses agences ne peuvent qu'être de plus en plus impuissantes face aux périls de toutes sortes. On le vérifiera rapidement, lors de la COP de Bakou, en Azerbaïdjan. Ou en cas de nouvelle pandémie… Sans parler du danger de guerre entre la Chine et les USA !
Aux Etats-Unis même, le pire est à craindre. A la différence de son premier mandat, Donald Trump arrive au pouvoir avec une équipe résolue à appliquer un programme précis : le « Project 2025 » concocté par le lobby catholique ultra-réactionnaire de la « Heritage Foundation ».
Financé par l'aile la plus droitière de la classe dominante (notamment les frères Koch, magnats de l'industrie chimique et fossile), ce programme est un véritable déclaration de guerre contre les exploité.e.s et les opprimé.e.s :
. l'instauration d'un pouvoir fort avec une administration fédérale et une justice à sa botte ;
. la traque, l'enfermement et la déportation de 10 à 11 millions de migrant.e.s illégaux/ales ;
. la restauration de l'autorité patriarcale par l'interdiction de l'avortement, la suppression des droits des LGBTQ et la remise en cause des politiques d'inclusion ;
le démantèlement des régulations environnementales, notamment pour favoriser l'extraction des combustibles fossiles ;
. le démantèlement des timides protections sociales instaurées par l'Affordable Care Act (« Obamacare ») ;
. une nouvelle vague de réduction massive des impôts payés par les entreprises et les riches ;
. une option délibérée en faveur du protectionnisme économique.
Il n'est pas sûr que Trump pourra réaliser ce programme, qui est bourré de contradictions (les impôts à l'import, notamment, ne peuvent que relancer l'inflation !) . Mais la direction générale est sans ambiguïté.
Cette victoire de la réaction ne tombe pas du ciel. D'une part, elle s'enracine dans le passé esclavagiste et ségrégationniste des Etats-Unis, terreau d'une droite conservatrice blanche, revanchiste, patriarcale et catholique, paniquée par la crainte fantasmatique du « grand remplacement ». D'autre part, elle est l'expression frelatée du dégoût populaire croissant face aux élites politiques des deux partis, surtout depuis que Démocrates et Républicains (Bush et Obama en tête) se sont donné la main pour sauver les banques frappées par la crise des surprimes, en 2008. Tout en s'appuyant sur l'histoire longue de la domination blanche, le succès de Trump est d'avoir réussi le pari improbable de capitaliser ce dégoût, non pas pour construire un nouveau parti – à l'instar de Mussolini ou d'Hitler – mais pour conquérir le parti républicain au point de le transformer complètement en instrument à son service…
Après le retrait de Joe Biden, « Kamala, you're fired » est devenu le cri de guerre de Trump. Face à sa brutalité, alors que la candidature de la vice-présidente avait d'abord soulevé beaucoup d'enthousiasme et de combativité, l'état-major démocrate a opté pour une campagne fade et lisse, entièrement subordonnée à la quête d'un rassemblement « bipartisan » avec les Républicains anti-Trump. Face au « Project 2025 », Harris s'est ralliée à l'exploitation du gaz de schiste par « fracking ». Face à Elon Musk et à ses semblables, elle n'a même pas osé revendiquer un impôt sur les grosses fortunes. Sa tournée de meetings avec Liz Cheney, politicienne ultra-conservatrice, fille du faucon Dick Cheney, délivrait un message très clair : électeurs et électrices, vous n'avez le choix qu'entre la continuité néolibérale (emballée dans de belles paroles sur la « démocratie ») ou « le changement ». Les électeurs/trices ont choisi « le changement »… Le changement concret incarné par Trump – sur le dos des femmes, des migrant.e.s, du climat et des pauvres en général.
Cette séquence aurait pu avoir une autre issue. Il aurait fallu pour cela que la gauche incarnée un moment par Bernie Sanders ose aller jusqu'à la rupture avec les Démocrates. Il aurait fallu aussi qu'elle ose porter radicalement le message qu'un autre monde est possible – un monde non capitaliste où il fait bon vivre pour toutes et tous sur une planète préservée. Il aurait fallu enfin que, face à Trump, s'amplifient les puissantes mobilisations sociales, féministes, antiracistes et antifascistes des années 2016-2018. Au lieu de cela, on a misé principalement sur l'opposition démocrate au Congrès.
Toute cette courbe rentrante a culminé quand Sanders s'est rallié à Biden en 2020 et que les principales figures des Démocratic Socialists of America ont fait de même. Résultat : l'ébauche d'alternative sociale et écologique, que représentait le « Green New Deal » s'est dégonflée au profit de la politique de capitalisme vert de Biden. Une politique violemment inflationniste dont Trump a cueilli les fruits. Une politique protectionniste donnant raison à Trump. Une politique impérialiste portée à son comble par le soutien indéfectible de Biden à la guerre génocidaire de Netanyahou contre le peuple palestinien.
Au-delà de l'inquiétude légitime qu'elle suscite, la victoire de Trump sonne comme un avertissement – un de plus : face à la catastrophe sociale et écologique qui grandit, les stratégies du moindre mal pavent toujours la voie d'un mal plus grand encore. Ce n'est pas encore « le fascisme », mais on s'en rapproche. Trump est un genre de fasciste et il ne manque pas de fascistes authentiques dans son entourage. Seules des luttes de masse, l'indépendance politique des luttes et leur convergence en vue d'une alternative politique radicalement écosocialiste pourront arrêter la marche à l'abîme. Cette voie devient encore plus ardue, tant la victoire de Trump amplifie la dégradation des rapports de forces. Mais il n'y en a pas d'autre. Aux Etats-Unis, les syndicalistes de la santé, de l'enseignement et de l'automobile, qui ont mené des luttes importantes récemment, seront sans doute en première ligne. Avec les femmes en lutte pour leurs droits. Leur combat est le nôtre.
Crédit photo : Licence Creative Commons
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Etats-Unis. « Donald Trump est le symptôme morbide d’un pays en train de rejouer sa guerre civile »

Pour l'historienne Sylvie Laurent, le trumpisme s'inscrit dans une très longue tradition américaine de synergie entre capital et race. Mais, cette année, une victoire du candidat républicain ouvrirait la voie à la mise en place de son projet réactionnaire et autoritaire.
Tiré de A l'Encontre
5 novembre 2024
Entretien avec Sylvie Laurent conduit par Christophe Deroubaix
(Site de Trump)
Qu'est-ce qui a changé entre Trump 2016 et Trump 2024 ?
Le personnage n'a pas du tout changé, il a juste affûté sa violence rhétorique. Sa xénophobie, son ultranationalisme, son mépris des normes, du droit et de la civilité, son aigreur à l'endroit des opposants étaient déjà présents en 2016. Ce qui est vraiment nouveau à mon sens, c'est que l'ensemble des institutions et du personnel qui l'entourent aujourd'hui n‘est plus en mesure de le contenir.
Trump est désormais parfaitement préparé pour capturer l'État et mettre en place une politique réactionnaire qui n'a été qu'entrevue lors de son premier mandat. À bien des égards, elle a été empêchée, à l'époque. Il est désormais armé de cadres, de milliers de fonctionnaires potentiels aux ordres, d'intellectuels, de financements et d'une part importante de la classe capitaliste qui, tous, convergent vers l'idée de mettre en place une contre-révolution profonde grâce à un État autoritaire.
En 2016, le Parti républicain, la justice, les grandes institutions et les hauts fonctionnaires ont entravé son projet, par ailleurs peu structuré. Aujourd'hui, la riposte à ce genre de résistance est prête, c'est tout l'objet du « Projet 2025 » [de la Heritage Foundation, connu sous le nom de projet de transition présidentielle, un document de 900 pages de propositions politiques ultra-conservatrices]. À cet égard, Trump est beaucoup plus dangereux en 2024.
On peut parler de fascisation de son discours, mais aussi de son projet de société. Son colistier, J. D. Vance, est un idéologue au service de l'ordre moral, de la tradition, du culte du chef et de la violence politique à l'égard des dissidents et des « déviants », c'est-à-dire de tout groupe social n'étant pas blanc, hétérosexuel et chrétien.
En 2016, Donald Trump avait mené une campagne sur des positions anti-immigration et à la fois tenu un discours hétérodoxe, pour les républicains, sur les questions économiques. Désormais, il assume que le facteur principal de sa campagne, c'est l'immigration. Qu'est-ce que cela dit de la nature du trumpisme et surtout du ressort du vote trumpiste ?
Je me souviens que j'avais eu beaucoup de mal en 2016, au moment de la sortie de mon livre Pauvre Petit Blanc. Le mythe de la dépossession raciale (éditions de la Maison des sciences de l'homme, 2020), à faire valoir l'artifice du vernis ouvriériste que se donnait Trump. Chacun répétait à l'envi que « les classes laborieuses laissées-pour-compte »avaient exprimé un vote de classe [1]. C'était une version très simpliste de l'ascension du démagogue.
En réalité, il est le champion d'une petite classe moyenne, individualiste, travaillée à la fois par le déclin continu de son niveau de vie et par un sentiment de perte de statut symbolique depuis que les femmes et les minorités ont pleinement pris place – bien que dans un cadre toujours inégalitaire – dans la société. Trump propose du statut en lieu et place d'une redistribution matérielle, de la revanche plutôt que des salaires décents. D'ailleurs, bien que Joe Biden ait mené une véritable politique de réindustrialisation, la séduction exercée par Trump est inaltérée.
Une fois gratté le vernis superficiel du discours de classe, dans lequel on ne considère d'ailleurs que les classes populaires blanches puisqu'elles seules ont les faveurs de Trump, il ne reste que le racisme crasse. On l'a entendu ad nauseam dans cette campagne, la haine de l'immigré et du non-Blanc est une obsession primale.
Trump, Vance et leurs troupes ne parlent plus seulement du mur pour conjurer la menace de l'immigration clandestine mais de l'« occupation » des États-Unis, qui seraient envahis par des hordes aux « gènes défectueux », une « vermine » qui déposséderait l'homme blanc jusque dans son lit. C'est un discours dont même le Rassemblement national se défierait aujourd'hui. Nous sommes donc dans un registre qui a justifié l'usage du terme « fasciste » pour le qualifier. Sauf que ce à quoi nous avons affaire n'est en rien importé d'Europe. Ce fascisme-ci est indigène !
De quelle façon l'est-il ?
Mon nouveau livre Capital et race. Histoire d'une hydre moderne (éditions du Seuil, 2024) est justement le récit de la longue histoire de l'entrelacement entre capital et race en Amérique. La construction historique du capital racial des Blancs sur ce continent et la suprématie des possédants blancs jusqu'à une date très récente aux États-Unis expliquent que la démocratisation véritable du pays depuis la fin des années 1960 avec le vote des droits civiques, la fin de la ségrégation raciale et l'accès aux biens publics des anciens parias, ait été perçue comme une injustice. C'est ce que racontent les républicains depuis Nixon [janvier 1969-9 août 1974] et cela résonne dans un pays qui s'est construit sur quatre siècles de domination.
Trump interprète donc avec le langage de la décadence nationale la réalité vécue d'une classe moyenne américaine véritablement paupérisée par quarante années de néolibéralisme et aliénée par une classe politique largement incapable d'enrayer les inégalités et l'appauvrissement de sa qualité de vie. Revenir à la suprématie blanche, c'est comme revenir à la société d'ordres pour les antimodernes après la Révolution française : la promesse de retrouver autorité, hiérarchie et grandeur.
Pour les Américains blancs sans diplôme, dont la vulnérabilité économique et sociale est patente, Trump est un réaliste : nul doute qu'il est plus facile de débarrasser le pays de millions d'« indésirables » que de remettre en cause l'économie politique générale. On croit plus efficace la guerre en interne (déporter 10 millions d'immigrés clandestins et la neutralisation des « gauchistes ») et la guerre commerciale avec la Chine que de tenter de domestiquer le capitalisme néolibéral finissant et la démocratie de marché qui ont créé de la souffrance, en premier lieu. Qu'Elon Musk, l'homme le plus riche du monde et antisyndicaliste notoire, soit annoncé comme prochain ministre de la Réforme de l'État en dit long sur le nihilisme à l'œuvre.
Donald Trump s'inscrit donc dans une très longue tradition américaine, dont la clé est la synergie entre capital et race ?
Même si mon dernier livre ne parle pas de Donald Trump en tant que tel, il montre la longue genèse de cette espèce de fantasme de la création des États-Unis comme un lieu d'invention du monde à partir du néant, alors même qu'il s'est agi d'une entreprise de colonisation, de dépossession des terres indigènes et d'établissement pendant plusieurs siècles d'un système de démocratie partielle où seuls les Blancs, les descendants des Européens, avaient le droit à la terre et aux richesses.
Depuis la fin de la guerre civile en 1865, qui tenta de réécrire la destinée du pays vers davantage de justice, les forces de la réaction et du retour à l'âge premier n'ont jamais disparu. Réactivées par différentes figures au fil des siècles, elles sont un peu un fascisme latent, du Ku Klux Klan aux eugénistes, de George Wallace [trois fois gouverneur de l'Alabama de 1963 à 1967, de 1971 à 1979 et de 1983 à 1987] qui voulait défendre la ségrégation jusqu'à la mort, jusqu'à la nouvelle droite américaine très puissante aujourd'hui.
Ressuscitant ces traditions, Donald Trump est le symptôme morbide d'un pays toujours en train de rejouer, sous la forme de farce cruelle, sa grande guerre civile. Promettre la restauration d'un capitalisme autoritaire accordant l'immunité aux puissants et à leurs obligés s'ils sont hommes et blancs, c'est s'inscrire dans la longue histoire du pays qui, de sa naissance à l'après-Seconde Guerre mondiale, a garanti l'exclusivité de l'accès aux ressources et à la propriété aux descendants d'Européens.
Marx, que vous citez souvent dans vos livres, estimait que lorsque les idées s'emparent des masses, elles deviennent des forces matérielles. Est-ce que l'idée de la dépossession du pays, ressentie par une partie de la population blanche, est en train de devenir une force matérielle aux États-Unis, à travers le trumpisme ?
Il convient de ne pas sous-estimer la force des idéologies. Les ressentiments, les amertumes deviennent, à force d'être politisées, une réalité tangible. Le Parti républicain a sciemment organisé la radicalisation de sa base militante en hystérisant les questions de l'avortement, des armes à feu, de la sexualité, de la « criminalité noire » et de l'immigration.
Après des décennies de manipulation des opinions publiques, alors que la classe politique consentait au creusement des inégalités, aux guerres sans fin et à la captation démocratique par les finances privées des campagnes, la situation est devenue intenable. Depuis 2010 et le Tea Party [qui apparaît au début de la présidence d'Obama dans le contexte de la crise économique ouverte en 2008], le Parti républicain est dévoré en interne par sa propre créature : une vague d'extrême droite centrée sur des questions culturelles devenues existentielles, non négociables, objet d'une lutte dans laquelle la démocratie elle-même passera par pertes et profits. L'homme de cette créature, c'est Trump.
Vous évoquiez le trumpisme comme incarnation de contre-révolutions. Il nous permet donc aussi de voir les révolutions en cours : le mouvement MeToo, les femmes plus diplômées que les hommes, Black Lives Matter, les droits LGBTQI +…
Martin Luther King, dont j'ai écrit une biographie intellectuelle, disait : « L'arc de l'univers est long mais il se courbe en direction de la justice. » Sa vision était moins idéaliste qu'empreinte d'une nécessité historique : ne jamais renoncer à penser que la justice est à portée de main. Donc, oui, vous avez raison : l'émancipation du plus grand nombre est en marche aux États-Unis. Pas à pas, femmes, Noirs, musulmans, transgenres… se font une place et se font entendre. À certains égards, la société américaine est bien plus tolérante que la société française. La tolérance n'est pas la justice mais elle permet d'organiser la lutte pour y parvenir.
Il y a bien sûr une espèce d'inquiétude vis-à-vis de ces changements récents du paysage social : nombre d'Américains les vivent comme une décadence, le brouillage des normes naturelles. Trump excite le masculinisme d'hommes qui se sentent menacés par les nouveaux droits et libertés des autres, comme il excite le bellicisme contre la Chine qui, à l'échelle du monde, aurait contesté l'hégémonie des États-Unis. D'une certaine façon, la puissance de la réaction est un hommage aux avancées remarquables, encore loin d'être suffisantes, sur la route de la reconnaissance et de l'émancipation des femmes et des minorités. (Entretien publié par le quotidien L'Humanité le 4 novembre 2024)
Sylvie Laurent est américaniste, enseignante à Science Po. Chercheuse Associée durant longtemps au W.E.B. Du Bois Insitute d'Harvard. Elle est l'autrice de plusieurs ouvrages dont Martin Luther King. Une biographie (Point 2016) et Pauvre petit Blanc. Le mythe de la dépossession raciale (Ed. Maison des Sciences de l'Homme, 2020) et de Capital et race. Histoire d'une hydre Moderne, Seuil, janvier 2024)
Voir la tribune de Sylvie Laurent reproduite sur le site alencontre.org le 30 octobre 2024, deuxième article du dossier Etats-Unis : Trump et le trumpisme. De même le site alencontre.org avait publié un article de Sylvie Laurent le 18 mai 2015 intitulé « Combien vaut la vie d'un Noir en Amérique », année où le Seuil a publié sa biographie de Martin Luther King.
1. Voir à ce sujet la contribution de Lance Selfa publiée sur ce site le 22 septembre 2024, intitulée « Trump se déclare comme “le parti de la classe ouvrière”. Qu'en est-il ? » (Réd. A l'Encontre)
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Victoire de Trump : la faillite des élites du Parti démocrate

La victoire de Donald Trump et des républicains aux élections du 5 novembre a été d'abord et avant tout la défaite de la rivale démocrate, et le révélateur de la faillite de la présidence Biden. Celle-ci ne se résume pas à son soutien obscène à Israël et au génocide du peuple palestinien, elle s'étend aux principaux aspects de son bilan en matière économique et sociale, dissimulés par des chiffres qui ont permis aux démocrates de persévérer dans le déni des effets concrets de leur politique, en particulier pour les classes populaires.
Tiré de la revue Contretemps
9 novembre 2024
De son côté, Kamala Harris a non seulement refusé de se démarquer en quoi que ce soit de celui dont elle fut la vice-présidente mais a fidèlement reproduit la stratégie « centriste » qui avait déjà conduit à l'échec fracassant de Hillary Clinton en 2016 : faucon en matière de politique étrangère, quasi-inexistante en matière d'agenda social, obsédée par la volonté de séduire un « électorat républicain anti-Trump », indifférente au gouffre grandissant entre le Parti démocrate et les classes populaires.
Comme l'a résumé Bernie Sanders, « il ne faut pas s'étonner qu'un Parti démocrate qui a abandonné la classe travailleuse se rende compte que la classe travailleuse l'a abandonné. D'abord, c'était la classe ouvrière blanche, et maintenant ce sont les travailleurs latinos et noirs. Alors que les dirigeants démocrates défendent le statu quo, le peuple américain est en colère et veut du changement. Et il a raison ».
En France, la défaite de Harris a suscité un débat prévisible, principalement à gauche. Du côté de la gauche de rupture, LFI en tête, on a souligné que la défaite de Harris a montré qu'on « on ne bat pas l'extrême droite réactionnaire sans un projet alternatif clair [et qu']on ne mobilise pas le peuple sur une ligne néolibérale et sans ruptures sociales et géopolitiques ». Son refus de la condamnation du génocide commis à l'encontre du peuple palestinien a également été soulignécomme un facteur décisif de sa défaite.
Par la voix de sa porte-parole en matière de politique étrangère Dieynaba Diop, le Parti socialiste s'est, par contre, livré à un éloge de la « vision d'espoir, de justice sociale et de progrès pour tous les Américains » portée par Kamala Harris, et attribué la défaite à une « courte campagne… [qui] n'a pas suffi à surmonter la vague populiste ». Dans le même communiqué, le PS en a immédiatement profité pour revendiquer « l'autonomie stratégique de l'Europe », à savoir sa militarisation et son orientation belliciste – également vue par la classe politique hexagonale comme un terrain privilégié pour le rétablissement d'un semblant de puissance française sur la scène internationale. Cette demande, alimentée par la guerre en Ukraine dont Trump a déclaré vouloir se désengager, est du reste reprise de façon quasi-unanime par l'establishment politique français et européen.
Dans l'article qui suit, Branko Marcetic, l'un des rédacteurs réguliers du magazine de la gauche socialiste états-unienne Jacobin, analyse les raisons de la défaite de Harris, défaite qu'il avait déjà largement prédit dans son article précédant l'élection que nous avons publié dans nos colonnes. Il détaille le repli de la présidence Biden par rapport aux engagements en matière d'agenda social qui avaient permis la victoire de 2020 face à Trump – engagements dont il faut souligner qu'ils étaient pour l'essentiel le produit de la pression exercée par la campagne de Sanders lors des primaires de 2019-2020 et les succès électoraux de représentants de l'aile gauche du Parti démocrate combinée à celle des mobilisations sociales de la période antérieure.
Plus que des facteurs conjoncturels, tels que l'âge du capitaine ou la brièveté de la campagne de la vice-présidente sortante, ou la popularité – toute relative – de Trump, c'est cette tendance de fond vers une ligne « centriste », ainsi que, bien évidemment, le scandale de l'obstination pro-israélienne de « genocide Joe », qui ont conduit à la démobilisation de l'électorat démocrate et à la deuxième victoire du héros mondial de l'extrême droite.
Stathis Kouvélakis
***
Un vieux dicton dit que la définition de la folie est de faire deux fois la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Comment appeler dès lors le fait d'essuyer un échec, puis d'obtenir un meilleur résultat en faisant quelque chose de différent, pour revenir finalement en arrière et répéter la chose qui a échoué la première fois ?
Le Parti démocrate avait déjà eu l'occasion de tester à deux reprises, en situation réelle, ce qui fonctionne, ou pas,dans une élection contre Donald Trump. L'une de ces campagnes a connu un succès notoire [Biden en 2020], l'autre avait échoué de manière catastrophique [Hillary Clinton en 2016]. Pourtant, à l'approche d'une élection qu'il ne cessaitde qualifier de « la plus importante de notre vie », ce parti a mystérieusement décidé de rééditer celle qui avait échoué.
Vivre dans le déni
Les démocrates ont à présent perdu contre Donald Trump dans deux élections présidentielles sur trois, malgré le fait que celui-ci ait été profondément impopulaire et polarisant à chaque fois qu'il s'est présenté, et qu'une grande majorité d'électeurs l'aient décrit comme « embarrassant » et « mesquin » il y a à peine quatre mois. Cette fois-ci, les démocrates n'ont pas seulement perdu dans le collège des grands électeurs face à lui : pour la première fois de sa carrière, Trump a remporté le vote populaire, gagné les sept États clés et pourrait bien se retrouver avec un parti contrôlant à la fois le Congrès et la Chambre es représentés.
Les démocrates ont perdu malgré un financement nettement supérieur à celui de Trump et de son équipe, et malgré des adversaires qui semblaient parfois saboter leur propre campagne dans la dernière ligne droite : insultes aux Portoricains, promesse d'abroger l'Obamacare, promesse de plonger les Américains dans des difficultés économiques, et, parmi tant d'autres choses du même ordre, un candidat évoquant à voix haute la possibilité de tirer sur les journalistes et mimant une fellation avec un micro.
Les efforts déployés tout au long de l'année pour faire barrage Trump en évoquant ses démêlés judiciaires et en soulignant ses tentatives de renverser le résultat de l'élection de 2020 se sont soldés par un échec. Cela intervient également quelques mois après que les responsables démocrates aient semblé prêts à accepter une défaite plutôt que de pousser leur leader manifestement malade hors de la course avant qu'il ne les précipite dans le précipice.
Il semble que l'establishment démocrate ne soit pas seulement incapable d'assurer les victoires électorales qu'il promet aux électeurs, mais qu'il ne puisse même pas se sauver lui-même.
Comment en est-on arrivé au résultat du 5 novembre ? Les influenceurs démocrates se livrent en ce moment même à une multitude d'accusations désespérées, mettant, comme d'habitude, tout sur le dos de la Russie, de la race et du genre de leur candidate, de son colistier, de la prétendue bassesse du public américain, bref de tout ce qui ne relève pas de leurs propres échecs. La véritable explication est pourtant beaucoup plus simple.
Depuis des années, l'électorat dit aux sondeurs qu'il est mécontent de la situation économique, et les sondages qui se sont succédé au cours de cette campagne ont montré qu'il s'agissait de la question qui pèserait le plus dans le vote, en particulier parmi celles et ceux qui penchaient pour Trump. C'est ce qui ressort des sondages effectués hier soir à la sortie des bureaux de vote.
Dans les sept États clés et au niveau national, les résultats des sondages étaient pratiquement identiques : l'électorat considérait l'économie comme l'enjeu le plus important de l'élection ; il estimait que leur situation financière personnelle s'était détériorée, et ce dans des proportions nettement plus élevées qu'en2020. Une grande majorité de celles et ceux qui ont voté pour Trump se sont exprimés pour le candidat qui, selon eux, allait apporter le « changement ».
C'est exactement ce que de nombreux électeurs et électrices indécis qui ont voté pour Trump avaient dit aux journalistes avant le vote : ils et elles n'aimaient pas nécessairement l'ancien président, mais ils et elles étaient troublés par l'incapacité de Kamala Harris à proposer un changement par rapport à la présidence de Biden. En d'autres termes, ce qui s'est passé hier soir n'était pas seulement prévisible, mais tout à fait typique dans l'histoire des élections américaines : un président impopulaire en exercice voit son parti sanctionné sans ménagement par un électorat en quête de changement.
C'est exactement ce qui s'est passé il y a quatre ans, mais aussi quand Barack Obama a remporté un triplé démocrate en 2008, quand Ronald Reagan a battu Jimmy Carter près de trente ans auparavant, et quand Franklin Delano Roosevelt a été élu président pour la première fois près de cinquante ans plus tôt.
Comme l'a rappelé Harry Enten de CNN, jamais dans l'histoire des États-Unis un parti n'a été reconduit quand la cote de popularité de son président était aussi basse et que dominait le sentiment que le pays allait dans la mauvaise direction sous son mandat – et l'histoire n'a pas été bouleversée hier soir.
Pour de nombreux démocrates, les explications avancées ne passent pas. Les experts fidèles au parti ont répété à l'envi que sous Biden la situation économique était formidable – faible taux de chômage, forte croissance du PIB, ralentissement de l'inflation, marché boursier en plein essor – et que toute personne mécontente avait simplement subi un lavage de cerveau.
Dans ce miroir aux alouettes de l'autosatisfaction, ils n'ont pas pris en compte les statistiques qui disent le contraire : les expulsions ont dépassé les niveaux d'avant la pandémie, le nombre de sans-abri a atteint un niveau record, le nombre de locataires à la charge de l'État n'a jamais été aussi élevé, le revenu médian des ménages est inférieur à celui de la dernière année d'avant la pandémie, les inégalités reviennent aux niveaux d'avant 2020, et l'insécurité alimentaire et la pauvreté ont connu une croissance à deux chiffres depuis 2021, avec notamment un pic historique de la pauvreté infantile.
Voici une autre chose que vous n'avez peut-être pas entendu. En grande partie grâce à un concours de circonstances, notamment la pandémie de COVID-19 et un Congrès contrôlé par les démocrates, Trump a été, pour une part, l'artisan de la création, en 2020, de ce que le New York Times a appelé « quelque chose qui s'apparente à un État-providence de style européen », qui a réduit les inégalités et a même aidé certains Américains à améliorer, pendant une courte période, leur situation financière. Or, sous Biden, tout cela a disparu.
Cela s'est produit parfois du fait de facteurs indépendants de la volonté de Biden, parfois en raison de ses propres décisions. Dans tous les cas, le président ne s'y est jamais opposé, et cela a contribué à l'augmentation inquiétante des difficultés de la population sous son mandat. L'effet n'a pas seulement été d'alourdir les dépenses contraintes déjà lourdes des ménages.
Du fait d'une décision-surprise en octobre, les conditions de remboursement des prêts étudiants sont devenu beaucoup plus dures pour des dizaines de millions d'emprunteurs juste avant le vote. Vingt-cinq millions de personnes ont également été exclues de l'assurance maladie publique, dont un grand nombre dans les États où Harris a perdu la bataille hier soir. Rappelons que l'une des lignes d'attaque de Biden contre Trump il y a quatre ans était que ce dernier allait priver vingt millions de personnes de leur assurance maladie.
Cette situation aurait pu être atténuée si le président avait réellement mis en œuvre les mesures phares de son programme de 2020, en aidant les citoyen.ne.s à faire face à la hausse du coût de la vie. Il ne l'a pas fait et celles qu'il a adoptées ont parfois échouées d'elles-mêmes. Les démocrates et les commentateurs qui leur sont associés ne sont guère incités à parler du fait que, même si cela s'est produit de manière fortuite, des millions de citoyen.ne.s ont bénéficié de nouvelles protections économiques au cours de la dernière année de Trump et même d'améliorations matérielles dans certains aspects de leurs vies, avant de tout perdre sous la présidence de M. Biden. Mais s'ils l'avaient fait, ils auraient peut-être compris une partie de l'attrait durable de Trump.
Pour n'importe quel parti politique, ces handicaps auraient été difficiles à surmonter. Mais les démocrates ont aggravé leurs difficultés en contournant une fois de plus le processus démocratique et en choisissant simplement une candidate qui, comme une grande partie du parti l'avait craint dès le début, s'est avérée faible. Kamala Harris s'était illustrée lors des précédentes primaires démocrates en échouant à en gagner une seule. En tant que vice-présidente, elle s'est distinguée par ses interviews peu convaincantes et son langage embrouillé qui l'ont handicapée en tant que candidate.
Mais plutôt que de laisser un processus démocratique se dérouler pour la mettre à l'épreuve, elle et d'autres, le parti l'a installée comme porte-drapeau, et c'est à ce moment-là qu'elle a eu du mal à répondre aux questions, qu'elle a semblé réticente à l'égard de ses propres positions politiques, qu'elle a donné l'impression de ne pas avoir de convictions profondes et qu'elle a évité la plupart du temps les apparitions non scénarisées dans les médias.
Son incapacité à se démarquer de la présidence impopulaire de Biden et à expliquer en quoi la sienne serait différente – avec, idéalement, des éléments précis, ce que les électeurs n'ont cessé de réclamer de sa part avant de se décider – s'est avérée fatale. À plusieurs reprises, Harris s'est refusée à cet exercice, se contentant de dire qu'elle nommerait un républicain à son cabinet et de se lancer dans un long soliloque sur la « nature ambitieuse des Américain.e.s ».
Le soutien des démocrates au génocide israélien dans la bande de Gaza est une plaie politique qui plane au-dessus de tout cela. Alors qu'elle disposait d'une occasion unique de faire table rase d'un problème qui avait démoralisé la base du parti, menacé ses chances dans le Michigan [1] et plongé le monde dans le chaos, Harris a choisi de la gâcher en se rangeant loyalement derrière la politique de chèque en blanc méprisable et impopulaire de l'homme que le parti venait d'évincer en le jugeant inapte à exercer ses fonctions.
Alors que le massacre se poursuivait et s'amplifiait, avec le soutien explicite de Harris, les électeurs arabo-américains et musulmans furieux ont décidé de punir le parti en la faisant perdre, tandis que Trump a profité de l'occasion pour courtiser ces électeurs mécontents et se faire passer pour une colombe. Il semble que cela ait fonctionné : Trump s'est emparé du Michigan en partie grâce à une marge en sa faveur choquante dans la ville de Dearborn [2].
Pour couronner le tout, il a été décidé de rééditer, dans les grandes lignes, la stratégie d'Hillary Clinton en 2016 – une stratégie qui avait déjà échoué une fois, face au même candidat. Cette décision a, sans surprise, produit le même résultat, mais de façon amplifiée, du fait du rejet de l'électorat contre le candidat sortant.
Le choix de la défaite
Le Parti démocrate aurait pu s'inspirer de deux modèles. Il aurait pu s'inspirer des récentes victoires électorales au Mexique et en France, où des coalitions de gauche ont remporté des succès importants et stoppé ce qui semblait être la progression quasi certaine d'un candidat d'extrême droite en apportant ou en promettant (ou les deux) des augmentations du pouvoir d'achat de la population, notamment par le biais d'augmentations du salaire minimum.
Il aurait également pu mener le même type de campagne que le leader travailliste britannique Keir Starmer, en adoptant une stratégie conservatrice qui ne promettait pas grand-chose aux électeurs, si ce n'est de ne pas être le parti de droite au pouvoir, qui est impopulaire. La décision de l'équipe de campagne démocrate de travailler avec celle de Starmer était une bonne indication de l'orientation prise.
En pratique, Kamala Harris a mené une campagne qui tenait à la fois de l'approche des démocrates pour les élections de mi-mandat de 2022 et de la stratégie perdante de Hillary Clinton en 2016 qui consistait à échanger les progressistes et l'électorat de la classe ouvrière contre celui des « républicains de banlieue », et celui qui a accordé la victoire à Starmer en juillet. Au-delà des problèmes évidents, il s'agissait d'un plan plutôt absurde, puisque cela signifiait que Harris devait s'appliquer à dépeindre Trump, le défier, comme le président en exercice, alors qu'elle était la vice-présidente sortante et qu'elle avait servi dans l'administration impopulaire d'un président dont elle avait refusé de se démarquer publiquement.
En conséquence, sa candidature a représenté un recul important par rapport aux efforts déployés par les démocrates en 2020. Les ambitions de Joe Biden, qui ne se sont jamais concrétisées, d'étendre historiquement le filet de sécurité sociale, ont été fermement reléguées au rang de souvenirs lointains ; seuls le crédit d'impôt pour les enfants et une modeste extension des prestations de Medicare ont survécu.
La campagne a combiné un net virage à droite en matière de politique étrangère et d'immigration avec une poignée de propositions sociales louables visant à interdire les prix abusifs et à aider les primo-accédants à la propriété (tout en évitant le plafonnement national des loyers à 5% sur lequel Biden s'était engagé avant de l'abandonner et qui avait fait son chemin dans la plate-forme démocrate).
Au-delà de la proposition relative à l'assurance-maladie et des vagues promesses de protéger et de renforcer l'Obamacare [couverture sociale très partielle mise en place sous Obama], l'idée de réformer le système de santé défaillant – l'un des coûts les plus importants et les plus anxiogènes pour les ménages états-uniens – a été presque totalement absente de la campagne.
Lors d'une réunion publique organisée par Univision [un média hispanophone],les électeurs ont fait part à Harris de leur triste expérience en matière d'accès au système de santé et lui ont demandé comment elle comptait y remédier. Elle n'a rien pu leur répondre, car sa seule véritable politique de santé concernait les personnes âgées de plus de 65 ans et déjà assurées au titre de Medicare [système de couverture médicale minimale].
Kamala Harris a davantage fait campagne avec la républicaine belliciste Liz Cheney qu'avec n'importe quel autre allié, et davantage avec le milliardaire Mark Cuban – qui publiquement insisté sur le fait qu'elle n'était pas sérieuse concernant certaines de ses propositions économiques à orientation sociale – qu'avec le dirigeant syndical Shawn Fain [dirigeant du syndicat de l'industrie automobile UAW qui a remporté plusieurs victoires grâce à des grèves]. Tout cela en courtisant les grandes entreprises et en envisageant de licencier Lisa Khan, la forte personnalité chargée de la lutte contre les monopoles nommée par Biden, que ces grandes firmes détestent.
Le cas le plus flagrant, c'est que Harris a refusé de s'engager pour l'augmentation du salaire minimum de 15 dollars, pourtant largement plébiscitée, qui constituait une grande partie de la plateforme gagnante de Biden en 2020. Pendant des semaines, elle n'a pas voulu dire de combien elle augmenterait le salaire, et n'a jamais abordé le sujet lors du débat avec Trump ou dans d'autres apparitions télévisées. Elle n'a officiellement adopté le chiffre désormais dépassé de 15 dollars de l'heure que trois semaines avant le vote.
En trente-cinq apparitions publiques entre le jour où elle a officiellement été nommée candidate, le 22 octobre, et le 4 novembre, Harris n'a mentionné la mesure qu'à deux reprises : les deux fois dans le Nevada et sans citer de montant précis. Cette politique ne figurait pas parmi les principaux messages de sa publicité sur Facebook, ni dans sa dernière campagne publicitaire, et elle n'apparaissait certainement pas dans les messages publicitaires que j'ai pu voir lors de mon séjour en Caroline du Nord, un État clé, au cours du week-end avant l'élection.
Cette décision lui a probablement coûté cher. Les électeurs du Missouri et de l'Alaska, qui ont voté pour Trump, ont approuvé ou sont sur le point d'approuver des mesures visant à porter le salaire minimum à 15 dollars de l'heure et à instaurer des congés de maladie rémunérés (une autre mesure populaire sur laquelle Harris a refusé de s'engager).
Plutôt que de s'intéresser aux questions fondamentales qui, aux yeux de l'électorat, sont au centre de leurspréoccupations, Harris et les démocrates étaient déterminés à faire de cette élection un débat sur l'avortement, la démocratie et le caractère de Trump. Dans l'ensemble, l'avortement et la politique fiscale de Harris – qui, avec sa promesse de réduction d'impôts, apparaissait liée aux préoccupations sur le coût de la vie – ont représenté de loin la plus grande part des dépenses publicitaires des démocrates, l'investissement du parti dans des publicités sur le caractère de Trump ayant augmenté au cours du dernier mois, tandis que la part consacrée aux soins de santé, à l'inflation et à l'assurance-maladie a baissé.
La publicité de Harris sur les réseaux sociaux mentionnait davantage le nom de Trump que celui de la candidate elle-même. Une enquête tardive a montré que les messages concernant Trump qui ont le plus touché les électeurs au cours des dernières semaines de l'élection concernaient son éloge des généraux d'Adolf Hitler, ses commentaires sur le pénis du golfeur Arnold Palmer et la question de la démocratie.
Le présentateur amical à son égard Stephen Colbert lui a donné une seconde chance de répondre à la question de savoir en quoi sa présidence serait différente de celle de Biden, mais Harris a tâtonné avant de rappeler qu'elle « n'était pas Donald Trump ». Cela aurait pu être le slogan de la campagne.
Le pari de l'équipe de Harris n'a pas été payant. Les sondages sortie des urnes montrent que le soutien de l'électorat républicains à Harris est inférieur à 10%, et qu'elle a fait moins bien que Biden dans plusieurs fiefs électoraux du Parti démocrate. Elle a amélioré la marge des démocrates auprès de l'électorat aisé tout en perdant la bataille de celui à revenus moyens et faibles au profit de Trump. La fameuse proclamation de Chuck Schumer en 2016, selon laquelle le parti échangerait simplement un électeur « col-bleu » [ouvrier] contre deux républicains « de banlieue » [de classe moyenne], s'est avérée erronée pour la deuxième fois.
La guerre des récits
Le récit qui est sur le point d'être diffusé partout est que Harris a perdu parce qu'elle était trop à gauche. Il sera mis en avant parce que c'est l'explication privilégiée de l'establishment démocrate pour tous ses échecs, et parce qu'il est préférable d'admettre que l'élite du parti et les grands patrons donateurs ont une fois de plus échoué dans la seule promesse minimale qu'ils ont faite à leur base.
Mais il s'agit là d'un non-sens évident. Harris a mené une campagne nettement plus conservatrice que celle de Biden en 2020, une campagne qui s'est détournée de l'ambitieux programme progressiste de cette année-là, qui a tenu à l'écart nombre de ses mesures phares, qui s'est employée de mettre l'aile gauche à l'écart et qui s'est contentée de se lier avec l'Amérique des entreprises et d'essayer de gagner l'électorat conservateur. Cette stratégie avait déjà échoué par le passé et les voix progressistes ont averti à plusieurs reprises qu'elle risquait d'échouer à nouveau. Elles avaient raison.
Nous voyons déjà les communicants démocrates travailler pour s'assurer que le parti ne tire que les mauvaises leçons de ce résultat. « Je pense qu'il est important de dire que quiconque a vécu l'histoire de ce pays et la connaît ne peut pas croire qu'il serait facile d'élire une femme présidente, et encore moins une femme de couleur, a déclaré Joy Reid, de la chaîne MSNBC, ajoutant que Kamala Harris avait mené une « campagne historique et sans faille ».
Mais certains signes montrent que, sous ce récit, la réalité est en train de percer. « Il s'agit de l'héritage de l'échec de 2016, qui n'a jamais été réglé de manière adéquate en raison du chaos de la pandémie », a déclaré l'historienne Leah Wright Rigueur à CNN au lendemain des résultats. Alors que le Parti démocrate recolle les morceaux et réfléchit à ce qu'il va faire à l'avenir, une voix importante sera celle de Bernie Sanders et de ses appels fréquents à ce que « le parti parle des problèmes de fin de mois ».
Au vu des dégâts causés par la campagne de Kamala Harris, il est difficile de ne pas être d'accord.
Notes
[1] Un Etat clé qui compte une proportion significative d'électeurs originaires du monde arabe (NdT).
[2] Commune de la banlieue de Detroit où vit la plus importante communauté arabo-musulmane des États-Unis, et où, déjouant les pronostics, le candidat républicain a largement battu sa rivale (NdT).
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Pourquoi Trump en 2024

Le populisme économique ; l'épuisement de la démocratie libérale ; la destruction de l'éducation, en particulier de l'enseignement supérieur : voilà les trois facteurs qui permettent de comprendre la nette victoire de Donald Trump face à Kamala Harris.
8 novembre 2024 | tiré d'AOC.media
https://aoc.media/opinion/2024/11/07/pourquoi-trump-en-2024/
Les électeurs de Trump ne forment pas un bloc monolithique. Bien sûr, il y a toujours les membres du Ku Klux Klan, les incels, les nazis, les alt-right, les hyper-masculins et les hyper-racistes – tous ceux qui se repaissent des promesses délirantes de Trump, de ses insultes nauséabondes et de ses manières grossières.
Il y a aussi ceux qui sont animés par la haine des « libéraux », dont ils absorbent quotidiennement le mépris ou le simple dédain. Il y a des chrétiens, des sionistes et même des islamistes (de la dernière heure) qui attendent de Trump qu'il serve mieux leur cause que ne l'a fait le régime Biden-Harris. Il y a ceux qui veulent une frontière sud du pays fortifiée et l'expulsion des migrants récents. Il y a des propriétaires de petites entreprises qui veulent des impôts moins élevés et moins de restrictions, et d'anciens travailleurs des mines et de l'industrie qui réclament des emplois aussi bien rémunérés que les emplois autrefois protégés par les syndicats.
Mais rien de tout cela n'explique le triomphe de Trump hier, son exploit historique d'être le premier candidat républicain à la présidence à remporter la victoire populaire depuis 2004. Comment l'expliquer alors ? Par trois facteurs clés : le populisme économique de Trump dans un contexte où les démocrates sont devenus le parti de l'élite ; l'épuisement de la démocratie libérale en tant que forme viable ou digne de confiance ; la destruction de l'éducation, en particulier de l'enseignement supérieur aux États-Unis.
Le populisme économique
Depuis 2015, Trump défend une position économique anti-establishment. Celle-ci n'est peut-être pas sincère – il bénéficie d'un large soutien du capital et des ultra-riches – mais elle répond aux inégalités extrêmes et croissantes aux États-Unis. Ces inégalités, bien sûr, sont le résultat d'une politique néolibérale de délocalisations, d'externalisation de la production (outsourcing) et de démantèlement des syndicats ; de la spéculation qui a propulsé le coût du logement dans la stratosphère ; et de la privatisation des infrastructures, depuis les transports « publics » jusqu'à l'enseignement supérieur. Trump s'adresse directement à la colère et au dénuement des familles de la classe ouvrière et de la classe moyenne qui n'ont pas les moyens d'assurer leur propre subsistance ni d'envisager un avenir meilleur pour leurs enfants. Au début de sa campagne, Kamala Harris a fait quelques incursions dans ce domaine, en promettant de mettre fin à la « flambée des prix » et d'accorder de petites subventions pour l'accession à la propriété. Mais depuis les années Clinton, le parti démocrate est devenu le parti des diplômés et (par conséquent) des plus aisés, un parti fidèle au statu quo, même si l'Obamacare et la loi sur la réduction de l'inflation ont apporté quelques nouveaux projets dans ce cadre. De plus, la campagne de Harris a largement laissé de côté les questions de politique économique au cours des dernières semaines, se concentrant plutôt sur l'inaptitude de Trump à assumer la présidence d'une démocratie.
L'épuisement de la démocratie libérale
Cela fait des décennies que la démocratie libérale, dans ses institutions et ses valeurs, se délite. Elle a été sapée par les ambitions néolibérales visant à la remplacer par les marchés et les technocrates, attaquée par les partis et les mobilisations de droite, dévoyée par les tribunaux. Ses liens étroits avec le capital n'ont jamais été aussi palpables. En outre, ce modèle est inapte à contrôler les forces mondiales, telles que la haute finance, ou à résoudre les problèmes mondiaux, comme le changement climatique ou les vastes mouvements de population. En conséquence de tout cela, la démocratie libérale a perdu l'estime et la confiance de millions de personnes qui la considèrent, non sans raison, comme jouant contre eux. La rhétorique ouvertement anti-démocratique de Trump n'est ni particulièrement dérangeante ni importante pour ces personnes. Ce qu'elles veulent, c'est un dirigeant fort qui ne s'inclinera pas devant d'autres puissances politiques ou économiques, qui améliorera leur vie et qui saura vaincre une partie des dangers et de la précarité que tout être humain sensible ressent au XXIe siècle. Si cela implique un modèle politique différent – autoritaire ou néo-fasciste – alors qu'il en soit ainsi. Là encore, la campagne de Harris n'a cessé de marteler l'idée que la démocratie était en jeu. Mais combien d'électeurs s'en souciaient ?
La déséducation
Trump a depuis longtemps et ouvertement ciblé et courtisé ce qu'il appelle « les non-éduqués » pour en faire sa base électorale de prédilection. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont bâti l'un des systèmes éducatifs les plus démocratiques au monde, offrant une éducation gratuite, accessible et de bonne qualité à la plupart des hommes blancs, et ensuite aux minorités raciales et aux femmes également. À partir des années 1970, tous les aspects de ce système ont été mis à mal : le financement public a été supprimé, les frais de scolarisation ont grimpé en flèche, les effectifs des classes se sont accrus et la qualité s'est effondrée. En outre, les programmes d'enseignement ont été politisés et contestés, l'enseignement professionnel (formation à l'emploi) a été valorisé au détriment du savoir et des formes de pensée plus générales, et la droite est montée au créneau contre les universités, jusqu'à mener aujourd'hui des campagnes directes contre le « lavage de cerveau totalitaire » de celles-ci. Combinée à des médias sociaux cloisonnés et à des médias grand public fortement politisés, cette déséducation rend les citoyens exceptionnellement manipulables et identifie l'éducation elle-même à l'élitisme et au « wokisme », c'est-à-dire aux démocrates.
Mis bout à bout, ces éléments montrent à quel point la campagne de Kamala Harris était déconnectée des préoccupations des gens et de son époque, tout comme l'est le parti démocrate. En effet, beaucoup de ceux qui ont voté pour elle ne l'ont pas fait parce qu'elle incarnait leurs préoccupations ou leurs espoirs, mais simplement pour faire barrage à Trump et au fascisme. La campagne Harris n'a pas abordé les conditions économiques cautionnées et favorisées par son parti depuis des décennies, ni n'a-t-elle été en mesure d'évoquer la crise de la démocratie libérale et de la citoyenneté, crise qui appelle un nouveau modèle de démocratie. Le parti républicain de Trump nous conduit vers une version de ce modèle. Le parti démocrate finira-t-il par prendre conscience qu'il doit en promouvoir une autre ? Qu'il doit défendre un modèle au service du plus grand nombre et de la planète et non de quelques-uns et des profiteurs ? Un modèle qui dissocie capital et démocratie pour construire un projet d'État porteur de transformation ? Un modèle qui prend au sérieux une citoyenneté démocratique éduquée, plutôt qu'un électorat manipulable ? Bref, un modèle adapté aux pouvoirs, aux problèmes et aux possibilités du XXIe siècle ?
Traduit de l'américain par Hélène Borraz.
Wendy Brown
Politiste, Professeure à l'Institute for Advanced Study (Princeton)
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Etats-Unis : comment affronter la politique raciste, autoritaire et anti-ouvrière de Trump ?

Donald Trump retournera à la Maison Blanche après une victoire écrasante. Une fois en fonction, il déploiera une politique ultra-réactionnaire. Nous devons nous organiser pour l'arrêter. Un édito de Left Voice, organisation révolutionnaire aux Etats-Unis.
7 novembre 2024 | tiré de Révolution permanente
A la veille de la nuit électorale, personne ne savait ce qui allait se passer, mais beaucoup pensaient qu'il faudrait plusieurs jours pour connaître le vainqueur. Ça n'a pas été le cas. Donald Trump a remporté tous les principaux États charnières, remportant à la fois une majorité au collège électoral et sur le vote populaire. Cela s'accompagne d'une prise de contrôle républicaine du Sénat et probablement de la Chambre des représentants. Après des mois de campagne, ce qui nous attend devient plus clair : nous allons devoir faire face à un triple contrôle républicain de la Présidence, du Congrès et de la Cour suprême.
La plupart des districts à travers le pays ont glissé vers la droite. Des États bleus aux États rouges, des villes aux villages, le pourcentage de votes pour Trump a augmenté. En même temps, Trump a gagné avec moins de voix que Biden lors de sa victoire en 2020, dans le cadre d'un taux de participation légèrement plus faible. Fait important,le niveau de participation des électeurs indépendants a été plus élevé que celui des électeurs démocrates, révélant un manque d'enthousiasme pour la candidate. Ce glissement vers la droite doit être compris comme une expression de la crise économique, de la crise du néolibéralisme et de la crise du Parti démocrate, qui ont propulsé Harris comme candidate tout en démontrant que son projet n'avait rien à la classe ouvrière et à l'ensemble des opprimés.
L'importante victoire de Trump représente une énorme menace pour la classe ouvrière et les opprimés, car il utilisera ce pouvoir pour lancer des attaques contre les immigrés, les droits des travailleurs, les droits reproductifs, les droits des personnes trans et d'autres droits démocratiques, comme nous l'avons vu dans les États sous contrôle républicain. Beaucoup se sont réveillés le lendemain des élections avec un sentiment de désespoir. Mais nous devons transformer ce sentiment en action et nous organiser contre Trump et ses alliés d'extrême droite. Il faut aller au-delà de la résistance contre la première présidence Trump - qui avait été détournée en soutien au Parti démocrate - et bâtir un véritable mouvement, un front uni, contre la droite.
Une évolution des tendances électorales
L'évolution des profils de l'électorat en faveur de Trump sont remarquables, notamment en ce qui concerne les jeunes hommes, les hommes noirs, et les personnes latino-américaines (dont plus de 40 % ont soutenu Trump). Les hommes de moins de 30 ans sont passés de soutenir Biden avec un avantage de 15 points en 2020 à soutenir Trump avec un avantage de 13 points. Trump a cherché, et en grande partie réussi, à faire du Parti républicain le parti de la classe ouvrière sans diplôme universitaire.
Le « fossé de genre » a été largement discuté avant l'élection et s'est révélé moins marqué qu'il aurait pu l'être, une majorité de femmes blanches ayant voté pour Trump pour la troisième fois consécutive. Harris a tout de même gagné chez les femmes dans leur ensemble avec une avance de 10 points sur Trump, en baisse par rapport à la marge de 14 % de Biden sur Trump en 2020, tandis que Trump a remporté les voix des hommes avec la même marge d'avance.
Les Démocrates n'ont pas réussi à capitaliser sur le soutien au droit à l'avortement pour les mener à la victoire. En effet, dans plusieurs États comme le Missouri et le Montana, les électeurs ont voté pour protéger le droit à l'avortement mais également pour Trump. En Floride, le soutien à l'avortement a été plus élevé que le soutien à Trump. Incapables de construire un mouvement national fort pour défendre les droits reproductifs, les Démocrates n'ont pas été perçus comme essentiels pour garantir ces droits, notamment dans les États disposant d'initiatives électorales pour inscrire ces droits dans la constitution de l'État.
Les Démocrates avaient pu repousser la potentielle vague rouge lors des élections de mi-mandat de 2022 en se basant sur le droit à l'avortement, mais la situation a changé, en partie parce que Trump a modifié la position officielle du Parti républicain sur l'avortement, et est devenue moins favorable aux Démocrates. Le repositionnement de Trump sur l'avortement a été très astucieux. En avançant l'idée que la question devrait « être laissée aux États », il a pu convaincre certains électeurs qu'un vote pour Trump n'était pas un vote contre l'avortement. Malgré ses liens avec des secteurs anti-avortement, les électeurs semblent considérer que Trump se distingue du reste de son parti en ce qui concerne l'avortement, bien que cela ne change rien au fait qu'il est à la tête d'un parti qui a durement attaqué les droits reproductifs. Cette situation n'est pas facilitée par le fait que les Démocrates ont fait très peu au niveau national pour protéger l'avortement et - comme Trump l'a souligné lors de son débat avec Harris - il semble extrêmement improbable que la restauration de Roe v. Wade que Harris a promis de signer soit jamais adoptée par le Congrès sans une lutte des classes significative, que les Démocrates n'ont évidemment pas voulu organiser.
Lire aussi : Etats-Unis. Comment les Démocrates ont pavé la voie à Trump
Le résultat pour Trump montre également qu'une majorité d'Américains, 55 % de la population, souhaite réduire l'immigration. Cela est lié à l'anxiété économique à la fois des travailleurs nés aux États-Unis et de certains travailleurs immigrés, qui ont transformé ces craintes en positions réactionnaires envers les immigrés. Trump s'est présenté comme le candidat qui serait le plus dur envers les immigrés, avec des slogans comme « déportations massives maintenant » affichés lors de ses rassemblements, ou la promesse de stopper la « crise à la frontière ». Bien que Harris ait adopté une position nettement plus à droite sur l'immigration, elle n'a pas réussi à surpasser Trump, qui a construit toute sa carrière politique sur une opposition aux immigrés. Il y a aussi la contradiction du fait que la campagne de Biden en 2020 s'était positionnée comme pro-immigrés, collaborant avec des ONG pour canaliser le mouvement des droits des immigrés vers cette campagne, avant de gouverner de manière très dure envers les immigrés sans qu'un mouvement pour les droits des immigrés (qui avait été désorienté et démobilisé par les dirigeants des ONG) ne s'y oppose. En l'absence de ce mouvement, les sentiments anti-immigrés ont commencé à se répandre et sont devenus un bouc émissaire fonctionnel à Trump pour tous les problèmes qui touchent la classe ouvrière.
Au total, le problème n'est pas seulement que les Démocrates n'ont pas réussi à séduire les électeurs sur les questions dont Trump a fait les piliers de sa campagne. Le résultat de l'élection montre qu'ils ont fait un mauvais pari en se présentant comme le parti qui « protégerait la démocratie » face à Trump. Comme Jacobin l'a constaté dans une étude interrogeant des travailleurs en Pennsylvanie, les questions de démocratie ont été les moins populaires des questions politiques sondées. Le message « défendre la démocratie » sonne creux pour une grande partie de l'électorat lorsque les Démocrates ne font rien pour protéger les droits démocratiques ou les attaquent directement. En outre, une grande partie de la population perd confiance dans les institutions gouvernementales et ne se soucie guère de la protection des normes auxquelles les démocrates s'accrochent.
La crise du Parti démocrate
La majorité des électeurs considèrent l'économie comme le principal enjeu de l'élection, et la majorité des électeurs voient en Trump la personne capable de redresser l'économie. Bien que Biden ait réussi à stabiliser l'économie après les confinements liés au COVID et ait adopté certaines initiatives majeures comme la loi CHIPS, les conditions économiques de l'Américain moyen sont restées précaires, avec une inflation croissante, des coûts élevés pour les biens de consommation courants comme les produits alimentaire, et une hausse des prix de l'immobilier. Face à cette situation, les Démocrates ont insisté sur le fait que l'économie allait bien, tandis que Trump et les Républicains dénonçaient vigoureusement ces conditions.
En 2020, Biden a mené une campagne de compromis Sanders afin de conserver la base sociale de ce dernier au sein du Parti démocrate. Il a mené des politiques plus « progressistes », avec l'annulation des prêts étudiants, le PRO Act et le retour d'emplois syndiqués dans l'industrie. En comparaison, les promesses de Harris en 2024 étaient ternes et visaient davantage la classe moyenne que la classe ouvrière. Harris a renforcé ses liens avec les milliardaires de Wall Street. Cela a conduit des secteurs de la classe ouvrière à s'aligner sur Trump, sapant encore davantage leur relation historique avec le Parti démocrate.
L'élection témoigne d'un phénomène politique qui s'amplifie depuis 2008 : le « désalignement » entre certains secteurs de la classe ouvrière et le Parti démocrate. En 2016, Trump avait remporté certains États de la Rust belt. Cette fois, le « mur bleu » a été anéanti. Les personnes qui n'ont pas fait d'études supérieures sont désormais solidement républicaines, ce qui marque un nouveau « fossé des diplômes » en politique. Les Démocrates n'ont pas été en mesure de rétablir leurs relations avec la classe ouvrière et les mouvements sociaux, même si Biden a beaucoup essayé avec ses appels aux travailleurs. Les travailleurs, épuisés par des décennies de politique néolibérale et de politique de « représentation » creuses en direction des secteurs opprimés, ne considèrent plus le Parti démocrate comme leur foyer naturel.
Le mouvement pour la Palestine a reflété des éléments de cette dynamique. En raison de son adhésion totale au sionisme, le Parti démocrate n'a pas fait la moindre concession au mouvement pour la Palestine. Il a refusé d'accorder à un représentant du mouvement un temps de parole au DNC et a exclu les Arabo-Américains des rassemblements. En conséquence, le mouvement « Uncommited » n'a pas soutenu pleinement Mme Harris et beaucoup ont refusé de voter pour elle. D'autres Américains d'origine arabe ont voté pour Trump. Les Démocrates n'ont pas été en mesure d'amener ce mouvement aux urnes comme ils l'ont fait en 2020 avec le mouvement Black Lives Matter.
Comme dans les années 1960, lorsque la jeunesse se radicalisait autour du Vietnam et du mouvement des droits civiques, on assiste aujourd'hui à une rupture entre les jeunes militants et le Parti démocrate. Le fait que Rashida Tlaib - qui est la seule membre de l'aile « gauche » du Parti démocrate a ne pas avoir soutenu Harris - ait été réélu avec 70%% des voix, obtenant plus de votes que Harris dans son district, montre la popularité d'une position plus pro-palestinienne. Harris a perdu en partie parce qu'elle a évité sa base militante mobilisée pour la Palestine.
Sur fond de craintes économiques des électeurs, Donald Trump et le Parti républicain ont réussi à se présenter comme le parti qui promettait de sortir les États-Unis de guerres coûteuses, y compris en Ukraine. Les Démocrates, en revanche, ont redoublé leur rhétorique faucon sur le rôle des États-Unis dans l'ordre mondial. En essayant de séduire les secteurs centristes de la base républicaine, Mme Harris s'est alliée à Liz Cheney - la fille de l'un des cerveaux de la guerre d'Irak, responsable d'innombrables crimes de guerre - et a laissé à M. Trump le soin de se présenter comme le candidat qui retirerait les États-Unis des « guerres éternelles » coûteuses.
Les raisons de la défaite de Mme Harris face à M. Trump sont multiples et feront probablement l'objet de débats pendant des mois, voire des années. Les Démocrates ont clairement mal joué leur rôle dans cette élection et même la peur de Trump n'a pas pu les sauver. Harris a mené une campagne pleine de messages positifs : « joie », « liberté » et « cocotiers ». Pendant ce temps, elle a viré à droite sur pratiquement tous les sujets - les droits des immigrés, le changement climatique, l'armée, les droits des transgenres, et bien plus encore. Sa campagne large, mobilisant des Républicains non trumpistes comme les Cheney, l'a fait apparaître comme une défenseuse de l'establishment bipartisan que Trump est censé rejeter.
La nouvelle droite au pouvoir
Dans son discours de victoire, Trump a déclaré qu'il avait reçu un agenda pour son prochain mandat présidentiel. Mais cet agenda est complexe et contradictoire. La coalition sociale de Trump est composée de divers secteurs. D'un côté, elle regroupe des travailleurs séduits par son populisme économique ; de l'autre, elle inclut des idéologues d'extrême droite. Elle rassemble des conservateurs religieux mécontents de la position de Trump sur l'avortement, tout en incluant beaucoup de personnes qui souhaitent le protéger. Elle comprend également les différentes ailes du mouvement MAGA, engagées dans des luttes d'influence.
Trump est soutenu par de nouveaux secteurs du grand capital, différents de ceux qu'il avait réussi à attirer en 2016 et 2020. Bien que Trump soit un candidat présidentiel atypique et que des secteurs importants de la bourgeoisie aient soutenu la campagne de Harris, certains grands capitalistes comme Elon Musk se sont rangés derrière Trump. Les allégeances changeantes des capitalistes témoignent des divisions au sein de la bourgeoisie impérialiste au sujet de l'avenir des États-Unis.
Comme l'écrit Anton Jäger dans la New Left Review :
« L'anatomie sociale des deux partis reflète la tectonique changeante de l'économie politique américaine des années 2010, coincée entre les prétendus impératifs de la réindustrialisation verte et ceux de la production de combustibles fossiles onshore et off-shore ; la lutte contre l'inflation et la demande continue pour le dollar en tant qu'actif le plus sûr du monde. Deux blocs se sont coagulés autour de cette structure contradictoire. D'une part, une coalition interclassiste, qui défend une économie à forte intensité carbone, s'est regroupée autour de Trump et de ses acolytes, purgée des piliers néoconservateurs du GOP et des conservateurs de banlieue pour conséquence les cols bleus périphériques ainsi que les petits bourgeois ruraux, les cadres moyens exurbains, les capitalistes immobiliers, les crypto-marchands, l'aile droite de la Silicon Valley et les producteurs d'acier qui ont survécu à l'assaut du laissez-faire des années 1980. Contrairement à la coalition rassemblée par Reagan, la coalition de Trump est dépourvue de blancs diplômés dans l'enseignement supérieur et soutenue par des Blancs sans diplôme.
Elle bénéficie largement des dispositifs anti-majoritaires de la Constitution américaine et s'appuie sur les mesures à la fois formelles et informelles qui permettent de restreindre le poids du vote populaire. Sa capacité de mobilisation est aujourd'hui élargie par l'intervention d'un magnat de la technologie, semblable à Ford, qui espère utiliser Trump pour obtenir un accès à des fonds publics, tandis que certains dirigeants syndicaux se sont ralliés à la nouvelle droite révisionniste au sein du parti, qui défend ouvertement le système de codétermination et les négociations salariales collectives. »
Au regard de cette caractérisation de la coalition groupée autour de Trump, il faut s'attendre à un gouvernement dont les traits autoritaires seront plus marqués, exerçant probablement un contrôle accru du ministère de la Justice et multipliant les tentatives pour consolider le pouvoir de l'exécutif, au service d'un programme de plus en plus attrayant pour les secteurs les plus importants du capital. Ce programme est basé sur la déréglementation financière, la réduction du fossé entre l'État et l'Église, le protectionnisme et l'attaque contre les droits démocratiques. Ce gouvernement appliquera des politiques violemment xénophobes qui renforceront les milices anti-immigrés.
Il continuera à soutenir le projet génocidaire du « Grand Israël » et ce n'est pas une coïncidence si l'un des premiers dirigeants mondiaux à féliciter Trump a été Netanyahou. Le gouvernement tentera de renégocier ses relations avec ses alliés internationaux, ce qui pourrait marquer une rupture dans la position étatsunienne sur la guerre l'Ukraine. Il ne faut pas se leurrer : Trump ne sera pas un président anti-guerre ; il veut au contraire réorganiser la société américaine en vue d'une plus grande confrontation avec la Chine, notamment par la militarisation et le déploiement de troupes à la frontière. Trump se prépare à gouverner comme un ultra-impérialiste. Pour lutter contre cela, il faut un internationalisme ouvrier fort qui se bat en solidarité avec nos frères et sœurs de classe dans le monde entier. Menaçant de réprimer tous azimuts les mobilisations aux Etats-Unis, Trump se prépare dans le même temps à une lutte de classe intérieure.
Prochaines étapes
Les analystes et les politiciens du courant dominant ne tiennent pas compte de la lutte des classes. Dans un épisode récent du Ezra Klein Show, Gary Gerstle explique que l'ancien ordre néolibéral est révolu, mais qu'il n'y a pas encore d'ordre nouveau pour le remplacer. C'est une autre façon de formuler le concept gramscien de crise organique, une situation dans laquelle « l'ancien meurt et le nouveau est encore à naître ». Mais ce que Klein et Gerstle oublient, c'est que la lutte des classes façonne la situation et peut la faire évoluer rapidement. Les élections ont créé une situation nouvelle, mais elle sera également façonnée dans la rue, sur les lieux d'étude et de travail.
L'absence de lutte des classes conduit logiquement à l'idée selon laquelle Trump sera en mesure d'imposer ses mesures autoritaires et anti-droits sans opposition. Mais la lutte des classes peut perturber et mettre fin à ses projets. Ce qui se passera durant cette nouvelle présidence Trump dépend ainsi des actions de la classe ouvrière.
Avec le retour de Trump, les démocrates tenteront de se recomposer en construisant un large front populaire, avec la complicité des bureaucraties des syndicats et des mouvements sociaux. Jacobin et une aile de DSA ont beaucoup travaillé pour tenter de réaligner le Parti démocrate vers la classe ouvrière et la gauche. Ils n'ont pas réussi - comme l'a montré le blocage de Sanders en 2016 et en 2020 - et ont contribué à désorienter la gauche à mesure que la nouvelle droite émergeait. Les démocrates ne mèneront pas le type de lutte dont nous avons besoin contre Trump et l'extrême droite parce qu'ils sont liés au capital et à son régime.
Si cette élection est l'expression d'un tournant droitier, elle intervient dans un contexte marqué par des signes encourageant : il y a des secteurs qui rompent avec le Parti démocrate par la gauche. Le mouvement palestinien n'a pas encore été conduit au cimetière des mouvements sociaux, ce qui oblige le régime et ses alliés dans les universités à employer des tactiques plus dures pour le réprimer. Alors que le génocide se poursuit, il n'est pas exclu que ce mouvement réapparaisse, suscitant peut-être un soutien encore plus large de la population face aux mesures répressives de Trump.
Le mouvement ouvrier poursuit son processus de réveil après des années d'hibernation suite aux attaques du néolibéralisme. De nouveaux syndicats se forment, des grèves combatives sont organisées et les travailleurs commencent à considérer leurs syndicats comme des lieux de lutte pour des revendications qui ne se limitent pas au pain et à la farine. Cela aussi est de bon augure et doit être pris en compte dans l'analyse de la situation. Alors que les bureaucraties tenteront d'étouffer cette lutte, la base a le pouvoir de riposter et d'exiger davantage de ses syndicats.
Le pouvoir de résister à Trump réside dans la classe ouvrière et les mouvements sociaux. Si nous pouvons nous organiser ensemble, indépendamment des Démocrates, la lutte des classes arrêtera Trump dans son élan. Nous sommes dans un moment convulsif où la lutte des classes peut émerger organiquement et nous devons être prêts à affronter ces moments. L'ancien est mort, mais le nouveau n'est pas encore né. La lutte des classes peut faire accoucher quelque chose de nouveau, à condition de s'organiser. Pour cela, nous avons besoin non seulement d'un front uni contre la droite, mais aussi d'un parti politique de la classe ouvrière et des opprimés avec un programme socialiste qui unifie nos luttes et nous donne des bases pour lutter pour un monde meilleur.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Le second mandat de Trump - le moment est venu de mener une riposte mondiale

Donald Trump à remporté une deuxième élection à la présidence des États-Unis le 6 novembre 2024. Le Parti républicain contrôle désormais presque totalement toutes les institutions politiques américaines, puisqu'il a également progressé au Sénat, ce qui lui permet de contrôler l'ensemble du pouvoir législatif, la présidence et la Cour Suprême. C'est une victoire pour les oligarques américains, Elon Musk, Jeff Bezos, les crypto-fanatiques et les Tech Bros de la côte ouest. Le trumpisme fait partie de la vague contre-révolutionnaire mondiale que nous observons avec les populistes d'extrême droite, les autoritaires, les semi-fascistes et les libertariens qui prennent le pouvoir dans les pays du monde entier.
Tiré de Inprecor
6 novembre 2024
Par Anticapitalist Resistance
Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America — Donald Trump, CC BY-SA 2.0
Nous assistons à un processus de glissement général vers l'extrême droite provoqué par le néolibéralisme et l'effondrement du consensus libéral de l'après-guerre qu'il a entraîné. Le trumpisme est la même tendance qui a produit Modi en Inde, Duterte aux Philippines, Meloni en Italie, etc.
Mais cette victoire, en particulier, est un désastre pour des milliards de personnes à travers la planète. Le pouvoir de l'impérialisme américain d'agir ou de ne pas agir reste un facteur décisif dans la politique mondiale.
Une deuxième présidence Trump sera aussi chaotique et vile que la première. Mais maintenant, ses principaux soutiens intellectuels seront beaucoup plus clairs sur ce qu'ils veulent en retirer. Le projet 2025 est un plan détaillé pour des États-Unis autoritaires ; il comprend des propositions visant à licencier des milliers d'employés du gouvernement et à placer le reste de la bureaucratie du gouvernement américain sous le contrôle central du président. L'élimination du ministère de l'Éducation pour permettre aux États de contrôler les programmes scolaires. Il s'agit de faire reculer les soins de santé et les droits sociaux des transgenres, rendant l'existence des transgenres presque intenable dans certains États. Cela signifie l'élimination des protections fédérales pour l'égalité des sexes, l'orientation sexuelle et les droits reproductifs. Il est presque certain que les pilules abortives ne pourront plus être envoyées par la poste, alors qu'il s'agit du premier moyen d'avorter aux États-Unis. Nous assisterons à la généralisation des « réflexions » sur la privation des droits des femmes. Il s'agit également de réduire le financement de la recherche et du développement des énergies renouvelables, d'augmenter la production d'énergie et d'abandonner les objectifs de réduction des émissions de carbone.
On ne sait pas si la promesse de Trump d'être un dictateur dès le premier jour et d'utiliser l'armée contre les opposants politiques était ou non de la poudre aux yeux à des fins électorales. Mais le fait qu'il ait mené une campagne aussi réactionnaire et obtenu un vote aussi décisif révèle quelque chose sur la croissance des idées populistes d'extrême droite. Nous savons que lui et son vice-président JD Vance ont récemment apporté leur soutien à un livre intitulé Unhumans, un manifeste pour l'assassinat en masse de militants de gauche dans la lignée de Pinochet au Chili. Cela révèle le noyau fasciste de la politique néolibérale, qui a bouclé la boucle.
Cette défaite repose en grande partie sur la politique misérable et la stratégie ratée des démocrates. Il est clair que les démocrates ne sont même pas un bouclier ébréché contre la croissance de l'extrême droite ; ils alimentent activement le problème. Ils ont fait comme si de rien n'était dans une période d'anxiété et de division.
Ils ont mené une campagne contre un populiste qui faisait appel aux « gens ordinaires » en se concentrant plutôt sur la vertu de la classe dirigeante - en répétant constamment que Trump était un criminel, comme s'il n'y avait pas des millions de criminels aux États-Unis dans un système judiciaire corrompu et injuste qui pourraient voir en lui un martyr persécuté. La fixation des démocrates sur les cours de justice pour le décrédibiliser avant l'élection a totalement échoué et a renforcé ses arguments populistes. Ils ont préféré une campagne centriste, axée sur l'appui de célébrités, la conquête de républicains de base et le défilé de Liz Cheney. Ils ont fait appel à la croyance selon laquelle les États-Unis sont un pays d'égalité des chances et de post-racisme, alors que ce n'est manifestement pas le cas.
Trump et ses partisans ne s'y trompent pas. Ils savent que c'est un mensonge. Ils préfèrent les postures machistes, la loi du plus fort, l'absence de conséquences. Ces dernières semaines, les démocrates se sont attachés à qualifier Trump de fasciste - la réponse de ses partisans a été soit de hausser les épaules, soit d'accepter le fait qu'il ait autant énervé les libéraux. Trump est le symbole de tous les points de vue les plus égoïstes et réactionnaires de la société américaine, mais les démocrates ne représentaient pas une alternative. Son mouvement a cristallisé une vision des États-Unis qui rejette l'égalité et embrasse la domination. Son mouvement n'est pas étranger à la politique générale des États-Unis, il y est enraciné.
La vague contre-révolutionnaire mondiale est en grande partie une réaction aux acquis de l'après-guerre - les avancées réalisées par les femmes, les Noirs, la communauté LGBTQIA+ et d'autres. Trump a surtout séduit les Blancs et les jeunes hommes, les nationalistes chrétiens d'extrême droite et les partisans d'Elon Musk. Il a également recueilli les voix de la communauté arabo-américaine qui s'est détournée des démocrates en raison de leur financement du génocide israélien à Gaza (même si Trump poursuivra la même politique). Mais il a aussi obtenu le soutien d'un nombre important de Noirs(c'est-à-dire de personnes de couleur) et de femmes, qui rejettent l'establishment libéral et veulent résoudre les contradictions de la société américaine en embrassant ses valeurs suprématistes. Une partie de la population noire américaine soutient également les déportations massives d'immigrés récemment arrivés, si cela permet de faire baisser les prix et d'améliorer les salaires (comme le prétend Trump). C'est là tout l'intérêt du populisme : il combine les contradictions et s'adresse à différentes personnes de différentes manières, tout en prétendant apporter des réponses simples à des questions complexes et en refusant d'apporter des changements significatifs.
Son programme populiste comportera des contradictions considérables. Trump a promis une prime au carbone et aux combustibles fossiles pour faire baisser les coûts des factures d'énergie et lutter contre l'inflation, mais il veut aussi imposer des droits de douane sur les importations pour renforcer l'industrie américaine, ce qui fera grimper les prix. Il semble peu probable qu'il parvienne à améliorer le niveau de vie et à créer davantage d'emplois pour les citoyens américains, notamment en procédant à des coupes sombres dans le secteur public. Le paysage politique moderne est bien plus complexe et partagé par des divisions idéologiques que par de simples calculs financiers.
Le fait qu'il ait indiqué qu'il retirerait son soutien à l'Ukraine et « mettrait fin à la guerre dans ce pays » signifie presque certainement que l'annexion impériale de la Russie pourra se poursuivre. Il reste à voir ce que cela signifie pour l'ensemble de la région, alors que Poutine poursuit son projet expansionniste. Il est certain que l'émergence d'un monde plus multipolaire nous rapprochera d'une troisième guerre mondiale à un moment ou à un autre. Pour les Palestiniens, cela signifie aussi plus de massacres et de défaites. Trump a été clair avec Netanyahu : les dirigeants d'extrême droite d'Israël peuvent « faire tout ce qu'ils doivent faire » pour gagner.
La nécessité de poursuivre la résistance ne fait aucun doute. De nombreuses personnes se sentent sans espoir ou désespérées en ce moment, et c'est exactement ce que veulent l'extrême droite et les fascistes. Ils prennent un plaisir sadique dans les défaites qu'ils infligent aux « éveillés » et à la gauche. Mais la politique est déterminée par les luttes pour le pouvoir et le contre-pouvoir, la construction de coalitions de masse de résistance, l'identification des points faibles de l'ennemi et la mobilisation des forces pour briser sa puissance.
Anticapitalist Resistance est totalement solidaire de celles et ceux qui, aux États-Unis, rejettent ce tournant autoritaire et veulent lutter pour un monde meilleur. Nous savons que les prochaines années seront difficiles, mais notre mouvement a déjà connu des périodes difficiles par le passé. Nous savons que les choses vont empirer avant de s'améliorer. Mais nous savons aussi que nous pouvons plaider pour un monde au-delà du capitalisme, de l'impérialisme et du militarisme, basé sur une société qui subvient aux besoins de tous et qui est durable avec l'environnement. L'emballement du réchauffement climatique est déjà présent, tout comme le renforcement de l'extrême droite à l'échelle mondiale ; les deux sont liés. Et la politique ne s'arrête pas aux urnes - c'est un autre mensonge sur lequel les démocrates se sont appuyés. Le pouvoir vient de notre organisation et de notre résistance. Nous nous battons pour un changement révolutionnaire. Notre rôle est de faire partie de la riposte internationale pour changer le monde, se réapproprier l'avenir et construire une société meilleure pour tous !
Déclaration du Conseil d'Anticapitalist Resistance le 6 novembre 2024
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« Le Québec, terre des fausses promesses… »

« Pour moi le Québec représentait une page blanche où je pouvais commencer une nouvelle vie, un nouveau départ »…C'est du moins ce que pensait Maria1 avant d'arriver au Québec. En ce 7 octobre, la Vigile en santé et sécurité au travail de l'Estrie profite de cette Journée internationale pour un travail décent pour dénoncer les abus de trop nombreux employeurs québécois envers les travailleuses et les travailleurs migrants
Tiré du Journal Entrée Libre
Date : 1 novembre 2024
| Chroniqueur.es : Vigile en santé et sécurité au travail
Crédit image : PxHere
Comme Maria*, nombreux sont les immigrants permanents ou temporaires à qui les employeurs québécois font miroiter une meilleure vie. Malheureusement à leur arrivée, ils sont plongés dans un affreux cauchemar… Conditions de travail en deçà des normes du travail, salaire moindre que promis, instabilité d'emploi, fausses promesses de statut de résidence permanente, conditions d'hébergement insalubres, harcèlement, menaces, abus… La situation est telle que l'ONU a qualifié la situation des travailleurs ayant des permis de travail fermés au Québec et au Canada d'esclavagisme moderne !
Plusieurs migrants se sont présentés aux différents organismes pouvant leur venir en aide dont Illusion Emploi qui soutient les personnes victimes du non respect des normes du travail :
Juan* témoigne de son expérience personnelle : « On riait de mon accent hispanophone et on m'imitait pour se moquer de moi. Je me sentais humilié et mis à l'écart. Nous [les travailleurs migrants] étions insultés chaque jour. On nous traitait d'incompétent et on nous sacrait après. L'employeur nous a même déjà lancé des objets lorsqu'il n'était pas satisfait de la rapidité à laquelle nous effectuions les tâches. C'était un environnement extrêmement stressant et toxique. Ça m'a beaucoup affecté psychologiquement. »
« L'offre d'emploi indiquait 19 $/heure avec des conditions de travail intéressantes : 40h/semaine, 2 semaines de congé par année, etc. Une fois arrivé ici, je réalise que tout ce qu'on m'a promis était des mensonges. Je travaille 50h/semaine par semaine pour 400 $ clair ce qui équivaut à 8 $ de l'heure. » nous dit Mohamed*.
Pour sa part, Adira* nous rapporte « J'ai eu un accident sur mon milieu de travail et on a refusé de m'amener à l'hôpital. Je n'avais pas de moyen de me déplacer et j'étais à 45 minutes de voiture de l'hôpital. J'ai pris quelques jours de repos non rémunérés. J'avais tellement mal au dos que je n'arrivais pas à dormir. Rapidement, on m'a mis de la pression pour revenir au travail. Je suis revenu après deux jours. Mon dos me faisait extrêmement mal, mais je n'avais pas le choix de travailler si je voulais être payé. »
« Le gouvernement du Canada annoncent des mesures de protection pour prévenir les abus et en cas d'urgence offrir, entre autres, aux travailleurs/travailleuses migrants temporaires ayant un permis de travail fermé, qui les oblige à un seul employeur, à obtenir un permis ouvert… Une démarche de 5 jours sur papier mais qui en réalité peut prendre de 3 à 4 mois avant d'être traité par les services appropriés. » déplore l'équipe des Services de soutien aux travailleurs étrangers temporaires de l'organisme Actions interculturelles.
De son côté, le Comité des travailleurs et travailleuses accidentés de l'Estrie (CTTAE) critique sévèrement la CNESST, qui fait très peu d'efforts, en cas d'accident de travail, pour mettre en place des moyens d'informer et de soutenir les travailleurs migrants qui n'ont aucune connaissance de nos lois, de leurs recours, qui sont isolés par la barrière de la langue ou la méconnaissance de nos codes culturelles. « Les cas de harcèlement et d'abus sont de plus en plus nombreux mais la plupart du temps refusés faute de preuve alors que les victimes peinent à s'exprimer et se faire comprendre et que les autres travailleurs migrants témoins de la situation n'osent s'avancer par craintes de représailles ou sous les menaces des employeurs », mentionne Patrick Morin du CTTAE.
Au cours des derniers mois, François Legault a souvent accusé les travailleurs migrants d'être la cause de la crise du logement, de la surcharge des services gouvernementaux ou encore des ratés de notre système de santé alors que se sont, en grande partie, les décisions, les coupures et la mauvaise gestion de son gouvernement et de ceux du passé qui en sont responsables. Les travailleurs migrants représentent une force de travail importante au Québec acceptant souvent des emplois jugés trop ardus, trop dangereux ou n'offrant tout simplement pas des conditions de travail appropriés à nos yeux de québécois. Plusieurs entreprises agricoles, hôtelières, manufacturières et autres seraient grandement affectées sinon en péril si tous ces travailleurs migrants venaient à disparaître.
Pour être à la hauteur de notre réputation de Terre accueillante, citoyens, employeur, syndicats, nous avons tous un rôle à jouer et nous devons nous impliquer et dénoncer les abus tant pour les travailleurs migrants que pour l'ensemble de nos collègues. Soyons vigilants, à l'écoute et n'ayons pas peur d'aller au–devant et de soutenir les travailleurs migrants pour les aider à comprendre le Québec, à s'y installer et participer pleinement à la société québécoise car nous avons toutes et tous droit à un travail décent…
* Par craintes de représailles les noms ont été modifiés
La Vigile est un regroupement de centrales syndicales et d'organismes communautaires qui ont à coeur la santé et la sécurité des travailleuses et des travailleurs. Le rôle de la Vigile est de donner une voix aux travailleurs et travailleuses afin de faire entendre aux gouvernements et aux employeurs que la santé et la sécurité en milieu de travail doivent passer avant les profits et les bénéfices…
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.















