Derniers articles

Trump prend le commandement et la résistance a commencé

Le président élu Donald Trump a déclaré dans son discours de victoire que « l'Amérique nous a donné un mandat puissant et sans précédent ». Bien que cela ne soit pas vrai. Obama avait remporté en 2008 une victoire bien plus importante avec 53 % du vote populaire et 365 mandats de grands électeurs.
Hebdo L'Anticapitaliste - 729 (14/11/2024)
Par Dan La Botz
Crédit Photo
Wikimedia Commons
Trump va tenter néanmoins de gouverner en autocrate, en imposant sa volonté à la nation. Il reste à voir si ses projets autoritaires déboucheront sur le fascisme, mais la gauche commence à résister.
Nous pouvons nous attendre à ce qu'il commence par tenir les promesses qu'il a faites à sa base ouvrière et de la classe moyenne, ainsi qu'à ses partenaires milliardaires, tels que le magnat de la technologie Elon Musk et le chef d'Amazon Jeff Bezos.
Fermeture des frontières annoncées
Il a promis aux travailleurEs de fermer la frontière et de procéder à une déportation massive des immigréEs sans-papiers qui, selon lui, prennent les emplois des AméricainEs et font régner la violence dans leurs communautés. Il y a aujourd'hui 22 000 agents de la USBP (US Border Patrol). Pour sceller la frontière entre les États-Unis et le Mexique, qui s'étend sur 3 145 kilomètres, il faudra davantage que les 22 000 agents actuels de la BP. Trump affirme qu'il mobilisera la Garde nationale pour compléter les effectifs de la BP, mais il aura besoin de l'autorisation des gouverneurs des États et tous ne la donneront pas.
Trump a promis d'expulser les quelque 12 millions d'immigréEs sans-papiers, mais les rassembler et les expulser serait un travail énorme qui coûterait des millions et nécessiterait bien plus que les 21 000 agents de l'U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) existants. Les familles seront déracinées et brisées et il y aura de la résistance. Ces politiques auraient un impact énorme et désastreux sur l'économie américaine, car de nombreux immigrantEs travaillent dans la construction, l'hôtellerie et la restauration, les soins aux personnes âgées et aux enfants, le nettoyage, le jardinage, l'agriculture et d'autres secteurs.
Libéralisation, protectionnisme et carbo-capitalisme
Trump prévoit de prendre davantage le contrôle du gouvernement américain, en commençant par mettre fin aux protections de la fonction publique pour des centaines de milliers d'employéEs fédéraux, qui deviendraient des employéEs de contrat privé, susceptibles d'être licenciéEs à tout moment. Il affirme qu'il réorganisera le ministère de la Justice et l'utilisera pour poursuivre ses ennemis politiques.
Sur le plan économique, Trump a promis de nouvelles réductions d'impôts comme il l'a fait en 2017, et il ne fait aucun doute que ce sont les riches qui en bénéficieront le plus. S'il le fait, cela coûtera au gouvernement 4 000 milliards de dollars de recettes au cours de la prochaine décennie. Il a également déclaré qu'il réduirait les impôts sur les prestations de sécurité sociale (retraite) des travailleurEs et les taxes sur les pourboires des travailleurEs.
Trump propose des droits de douane de 10 % sur la plupart des marchandises, mais de 60 % sur les produits chinois et même de 200 % sur les voitures chinoises. Ces tarifs augmenteraient les prix pour les AméricainEs et perturberaient le commerce et les investissements mondiaux.
Trump annulera les politiques climatiques du président Joe Biden en réduisant les subventions aux énergies vertes et en incitant les compagnies pétrolières à forer pour trouver du pétrole. Il annulera également les politiques pro-travail de Joe Biden.
Résistance et répression possible
La résistance à Trump, qui s'est manifestée pour la première fois lors de la Marche des femmes à l'occasion de son investiture en 2016, s'est ravivée. Des manifestations de centaines de personnes dirigées par la gauche ont eu lieu après son élection à Seattle, Portland, Berkeley, Milwaukee, Chicago et Philadelphie. Le 9 novembre, plus d'un millier de personnes d'organisations syndicales, environnementales, féministes et d'immigréEs ont défilé à New York.
Une nouvelle coalition nationale de plus de 200 organisations s'est formée sous l'impulsion du Working Families Party, de Seed the Vote, du Movement for Black Lives et de Showing up for Racial Justice. Le groupe a organisé un appel de masse/livestream intitulé « Making Meaning in the Moment » (« Donner un sens au moment présent »), auquel 140 000 personnes ont participé sur internet.
Comme l'a écrit un participant, « l'opinion dominante était la résistance totale à l'administration Trump et le recentrage des progressistes dans la classe ouvrière multiraciale et inclusive du point de vue du genre ».
Si le mouvement de protestation devient massif dans les rues, Trump s'est dit prêt à invoquer la loi sur l'insurrection de 1792, qui autorise le président à utiliser l'armée américaine sur le territoire des États-Unis pour réprimer une rébellion ou des violences.
Trump est un autoritaire. Va-t-il créer un parti et un État fascistes ? Nous ferons tout pour l'en empêcher.
Dan La Botz, traduit par la rédaction
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les démocrates ont délaissé les travailleurs.euse pauvres

Le Révérend William Barber parle des soins de santé, de salaire décent et des droits de vote
Democracy Now, 8 novembre 2024,
Traduction, Alexandra Cyr
Amy Goodman : Donald Trump et ses alliés.es ont célébré leur victoire électorale et appelé à la mise en place de la politique d'extrême droite qui va couvrir tout le gouvernement fédéral et connue sous le nom de Project 2025. Les Républicains.nes ont aussi gagné la majorité au Sénat et probablement à la Chambre des représentants.
(…) Nous commençons à examiner les erreurs des Démocrates avec Monseigneur William Baber 11, vice-président national de la Poor People Campaign. Elle a travaillé à faire sortir le vote chez les résidents.es à bas revenus qui sont souvent ignorés.es mais constituent un bloc impressionnant. Mgr Barber est aussi un conférencier à Repairers of the Breach et le fondateur et directeur du Center for Public Theology and Public Policy à la Yale Divinity School. Il est le co-auteur d'un dernier livre : White Poverty : How Exposing Myths About Race and Class Can Reconstruct American Democracy.
Mgr Barber soyez à nouveau le bienvenu sur Democracy Now. Parlez-nous d'abord de ce que vous pensez est arrivé dans cette élection. Que répondez-vous à la Présidence de D. Trump ? Et qu'elles ont été les erreurs des Démocrates selon vous ?
Mgr William Barver 11 : Merci Amy. Je me suis levé ce matin en étant capable de dire « Democracy Now » !
Nous sommes face à de nombreuses questions sur lesquelles nous devons nous acharner en profondeur. Nous ne pouvons être désinvoltes ou ne faire que réagir spontanément en ce moment. Nous devons faire face au fait que les États-Unis ont souvent fait de mauvais choix qu'ils payent plus tard. Nous devons faire face au fait que ce sont 71 millions, 72 millions de personnes qui ont choisi de renvoyer D. Trump à la Maison blanche en dépit de son langage vitriolique, de sa haine, de son retour en arrière, de ses outrances racistes et d'une tendance vers le fascisme. Nous ne savons probablement pas ce qu'il va faire exactement mais il peut le faire à un point tel que même ses partisans.es en seront plus offensés.es et si terriblement qu'ils et elles demanderont : « Qu'avons-nous fait » ?
Nikole Hannah-Jones (journaliste américaine qui s'intéresse aux droits civiques et a gagné un prix Pullitzer. N.d.t.) a dit quelque chose l'autre jour que j'ai partagé avec ma vice-présidente, Lez Theoharis. Elle nous a rappelé que 60 ans après la première tentative des États-Unis en faveur de la reconstruction en 1920, juste après l'élection de 1918, excusez-moi, de 1865-1866 environ, la majorité des Américains.es se sont retournés.es et ont embrassé la suprématie blanche. Et si vous y réfléchissez, nous somme en ce moment, 60 ans après les années 1960, après la White Southern Strategy (stratégie républicaine pour s'attacher le vote de la population blanche du sud en instant sur le racisme contre les Noirs.es. n.d.t.).
Qu'avons-nous vu il y a deux jours ? Il faut nous poser une profonde question. Nous avons vu la plupart des Américains.es voter, mais beaucoup ne l'ont pas fait. D. Trump a gagné 2 à 3 millions de voix de moins qu'en 2020. Mme Harris a récolté 13, 14 millions de voix de moins que J. Biden ne l'avait fait en 2020. Ils ont ramassé 81 millions de votes. Beaucoup de gens n'ont pas voté.
Et pourquoi ? Nous savons qu'en 2020, J. Biden et K. Harris ont mis l'accent sur le salaire minimum et sur le droit de vote. Ils ont récolté 56% des voix de ceux et celles qui gagnent moins de 50,000$ pour une famille de quatre. Cette année, les sondages à la sortie des urnes montrent que c'était 49% contre 49%. Le score de D. Trump a augmenté, celui des Démocrates a diminué. Et voilà la question : pourquoi ? Nous sommes-nous suffisamment centrés sur les 30 millions de pauvres, ceux et celles qui vivent avec de bas salaires, ceux et celles qui ne votent pas souvent mais qui tiennent les clés du plus grand vote pivot du pays ? Ces personnes sont environ 12 millions dans le pays.
Nous devons nous confronter à de sérieuses questions. Par exemple, est-ce que les femmes blanches qui sont en faveur de l'avortement auraient aussi voté pour D. Trump, choisi D.Trump ? Elles sont avec K. Harris sur les questions d'avortement mais pas pour la Présidence. Où les hommes hispanophones sont-ils allés ? Nous avons beaucoup à faire. Pourquoi les enjeux les plus endossés par le public, ceux relatifs aux soins de santé, au salaire décent, aux droits de vote, à la démocratie, n'ont-ils pas été plus à l'avant plan ? Et pourquoi des personnes choisiraient de voter contre, contre ce pourquoi un pourcentage significatif d'autres disent être en accord ? Ce sont des enjeux sérieux.
Ce que nous ne pouvons pas faire en ce moment, c'est de baisser les bras. Je pense que les médias portent aussi une certaine responsabilité. Je n'ai vu dans aucun débat, la pauvreté et les bas salaires être au centre des discussions. Et cela même si 800 personnes décèdent tous les jours à cause de la pauvreté et que plus de 32 millions de personnes travaillent à des salaires qui ne permettent pas de vivre. Le salaire minimum n'a pas été augmenté depuis 2009. Rien dans les débats les plus importants à ce sujet au Congrès. Pourquoi les Démocrates n'ont-ils pas amené l'augmentation du salaire minimum au Sénat avant l'élection et ainsi forcer un vote qui aurait rendu visible la position des Républicains.nes à ce sujet crucial ? Mais partout où cette augmentation du salaire minimum et des congés payés pour les familles étaient mis aux voix, ils ont gagné ; au Missouri, en Alaska et d'autres endroits semblables. Nous avons de sérieuses questions à nous poser.
Aussi, finalement, je voudrais soulever quelque chose. Quelqu'un a dit que D. Trump avait un mandat. Personne n'a de mandat pour renverser la Constitution. Personne n'a de mandat pour aller de l'avant avec quelque chose comme le Project 2025, pour essayer de nous pousser vers l'arrière et de détruire le progrès. Personne n'a de mandat pour nous empêcher de nous adresser aux personnes qui meurent littéralement à cause des ravages de la pauvreté. Personne n'a de mandat pour dire que nous allons retirer à des gens les soins de santé.
Nous devons nous lever chaque matin à partir de maintenant et jusqu'à … avec chaque outil non violent à notre disposition et nous opposer à n'importe quelle régression peu importe qui est au pouvoir. J'ai réfléchi à ça. Quand l'arrêt Plessy c. Ferguson (où la Cour suprême décrétait que la ségrégation raciale n'était pas illégale. N.d.t.) a été décrété en 1896, les militants.es ont choisi le slogan : séparés mais égaux ». La bataille a duré 58 ans jusqu'à la victoire. Ils et elles se sont levés.es et ont continué la bataille. Donc, quand nous nous levons le matin nous devons aller dans ce sens, avoir la même sorte de force que celle que les gens de 1877 ont eue. Il y avait une élection qui pouvait virer les États-Unis à l'envers ; que ce soit en 1896 ou en 1914 quand un suprémaciste blanc est arrivé à la Maison blanche et qu'on a joué Birth of a Nation (référence à un film qui met en vedette des soldats confédérés des États du sud. N.d.t.) dans le bureau ovale ; en 1955 quand le réveil s'est fait avec l'annonce de l'assassinat d'Emmett Till (jeune noir capturé et lynché au Mississipi) ; en 1963, quand quatre petites filles ont été assassinées dans l'église de Birmingham ; en 1963 quand un Président a été assassiné ; en 1968 quand Martin L. King a été assassiné. Les gens ont dû ravaler leurs larmes, garder leur peine à l'intérieur comme leurs frustrations mais, se relever et déclarer que nous devons nous battre pour cette démocratie. Nous n'allons pas partir et disparaitre dans le noir.
A.G. : Je voulais revoir le message du Sénateur B. Sanders : « Nous ne devrions pas être si surpris.es, le Parti démocrate a abandonné la classe ouvrière, pas étonnant qu'elle abandonne ce Parti à son tour. Pendant que la direction démocrate défends le statut quo la population américaine est en colère et veut du changement. Et elle a raison ».
Jaime Harrison, le président du Comité central démocrate a qualifié la déclaration de B. Sander de : « pur B. Sanders » et il a ajouté : « Biden a été le Président les plus en faveur des travailleurs.euses que j'ai vu de ma vie ».
Je voulais aussi que nous nous arrêtions sur le commentaire de David Brooks, le chroniqueur bien connu du New York Times. Son article est intitulé : Les électeurs.trices aux élites. Il écrit : « Me voyez-vous maintenant ? Je suis un modéré. J'aime les candidats.es démocrates qui font campagne au centre. Mais je dois dire que même si K. Harris l'a fait plutôt efficacement, ça na pas donné le résultat voulu. Peut-être qu'il leur faudrait embrasser le style dérangeant de Bernie Sanders, quelque chose qui rende les gens comme moi, inconfortables ».
Pourriez-vous répondre à ça et nous mettre au fait du nombre de personnes dont nous parlons dans ce pays (à ce sujet) ? Bien sûr pas que les nombres. C'est au sujet de ce avec quoi les gens doivent se débattre, des millions de gens partout dans le pays et qui ont pu voter.
B.W.B.11 : D'accord. Amy, nous devons sortir de nos émotions. Nous pouvons critiquer nos politiques, dire que nous avons aidé les gens et que cela ait été cohérant ou non, que la population l'a entendu. Par exemple nous avons besoin de soins de santé, de crédits d'impôts, de crédits d'impôts pour les enfants et nous soutenons tout ça. Et oui nous avons besoin de soins de santé, d'argent pour le logement, pour de nouveaux logements. Nous sommes clairs.es à ce sujet, nous soutenons cela. Mais de dire : « Minute ! Nous devons prendre le temps de voir où nous en étions et où nous allons. Est-ce que c'est un message ? Qu'est-ce que c'est » ? Parce que nous savons que partout dans le pays, par exemple augmenter le salaire minimum, affecterait 32 millions de personnes qui vivent tous les jours sans salaire décent. Par exemple il faut faire face à des prix qui vous mettent dans le trou mais les gens ont besoin d'argent pour acheter des biens, de l'essence, et toutes autres choses. Nous n'avons pas augmenté le salaire minimum, ni les Démocrates ni les Républicains.nes (ne l'ont fait). Nous trainons cet enjeu depuis 15 ans. Nous parlons de 140 millions de pauvres et de personnes qui sont à faibles salaires. Nous parlons d'environ 43% de la population de notre pays qui est pauvre et/ou à faible revenu. Nous parlons d'adultes, de gens qui sont peu ou prou à 500$ de la ruine économique. Nous parlons de 800 personnes qui meurent tous les jours. Ce n'est pas une exagération, nous devons être capables d'en parler.
Et en parler ne veut pas dire qu'un.e candidat.e était de mauvaise foi. L'exercice vise à évaluer ce qui se passe et comment nous allons nous positionner. Par exemple, pourquoi n'avons-nous pas fait un effort déterminant chaque fois que nous avons ouvert la bouche pour dire : « Écoutez, si vous élisez les Démocrates de la Présidence jusqu'à la totalité du Congrès, au cours des 50 premiers jours, nous allons augmenter le salaire minimum à 15$ ou un peu plus ». Nous avons les données. Trois économistes détenteurs du Prix Nobel d'économie ont prouvé qu'augmenter le salaire minimum ne jouerait pas négativement sur l'emploi, ne ferait pas augmenter les taxes et les impôts et ne ferait pas augmenter les prix. Il faut que nous prenions cela au sérieux.
Je connais des gens … nous sommes tous dans nos émotions et c'est normal. Mais ce n'est pas le seul problème. Je serais d'accord avec Jaime sur ça. Ce n'est pas le seul problème. Il y a beaucoup de problèmes. Et nous devons creuser celui-ci. Quel rôle a joué la « race » (dans cette élection) ? Quel rôle y ont joué la sexualité et le genre ? Nous devons prendre au sérieux des enjeux fondamentaux. Même au Mississipi 66% des Républicains.es disent vouloir des soins de santé, et soutiennent l'Affordable Care Act appelé Obamacare. Nous devons voir sérieusement les autres États où, quand le salaire décent figurait sur les bulletins de vote, ce fut approuvé. Nous devons nous assurer que partout dans le pays, ces enjeux soient mis aux voix. Ce que nous ne pouvons pas faire, c'est nous en écarter.
Nous avons une introspection à faire. Nous devons comprendre pourquoi le taux de votes a baissé. Je me souviens, en 2020, quand Biden et Harris étaient en campagne, ils disaient toujours : « Si vous nous élisez, nous allons introduire des salaires décents, l'assurance santé et (consolider) les droits de vote ». 56% des gens gagnant moins de 50,000$ par année les ont soutenus. Et nous devons intégrer le fait qu'une partie de la situation n'est la faute de J. Biden ou de K. Harris. Cela a commencé quand les Démocrates ont mis aux voix (au Congrès), la hausse du salaire minimum à 15$ de l'heure et que 8 de leurs membres se sont joint aux Réublicains.es et ont bloqué cette proposition de loi qui avait été acceptée par la Chambre des représentants. Nous devons prendre conscience qu'il peut y avoir des Démocrates voyous avec leur pouvoir et voter contre quelque chose qui va affecter 55 millions de personnes. Et ce serait encore ce nombre si l'administration Biden-Harris n'avait relevé le salaire minimum des fonctionnaires fédéraux. Alors, vous devenez voyou quand vous êtes au pouvoir et ensuite vous vous présentez devant la population lors des élections en disant : « Nous sommes avec vous ». C'est blessant, des gens meurent ici. Tant que nous ne pourrons pas faire face à la pauvreté et aux bas salaires dans ce pays, cela affectera 66 millions de gens de race blanche. Il est question de 60% de Noirs.es, de 30% de Blancs.hes, de 68% de Latinos.as et de 68% d'Autochtones. Nous ne pouvons faire fi de cet enjeu.
Finalement, nous ne pouvons laisser dire que cet enjeu en est un d'extrême gauche. C'est un enjeu américain, moral. Le niveau de pauvreté et des bas salaires dans ce pays, est une violation de ce que nous reconnaissons dans la Constitution comme l'appel à la justice et à la promotion du bien-être général. C'est dégoutant et condamnable que nous n'en ayons pas eu de suivi dans les médias, dans les couloirs du Congrès et au cours de l'élection. Durant les débats entre les candidats.es, personne ne leur a demandé : « Quelle est votre position sur les enjeux de la pauvreté et des bas salaires ? Quel est votre plan à cet égard ? Et comment allez-vous diriger ce pays » ? Et ce sont des enjeux qui concernent presque 50% de la population. Nous devons y faire face.
Amy, je veux dire une chose : Venice Williams a dit quelque chose dans un poème, je vais vous le lire.
You are awakening to the
same country you fell asleep to.
The very same country.
Pull yourself together
And,
when you see me,
do not ask me
« What do we do now ? Or
« How do we get through the next four
Years ?
Some of my Ancestors dealt with
at least 400 years
under worse conditions ».
Elle a dit :
« Continue to do the good work.
Continue to build bridges and not walls.
Continue to lead with compassion.
Continue to demand
the liberation of all ».
J'ajouterais, continue à sérieusement te battre pour des salaires décents, des soins de santé accessibles et la fin des génocides autour du monde et à Gaza. Continue, continue la lutte pour les droits des femmes, des enfants et pour l'extension des droits de votes.
Quelle portion de cette baisse du vote peut être attribuée au retrait d'électeurs.trices des listes ? Pourquoi est-ce que dans un État comme la Caroline du nord par exemple, les Démocrates candidats.es à des postes divers ont, sans exception, gagné leurs élections mais la candidate à la Présidence a perdu ? Nous devons nous attaquer à de sérieuses questions. Nous ne pouvons nous en remettre à nos émotions. Et il nous faut nous poser ces questions parce qu'il y a de la souffrance ici, les gens sont meurtris, des millions n'ont pas voté du tout. Ils n'ont pas voté. Je veux que ça se sache. Il y a eu une baisse du vote au total. Et nous devons prendre ça très sérieusement.
A.G. : Mgr Barber, je veux vous remercier d'avoir été avec nous. (…)
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Élections US – Les chiffres.

Les chiffres de Wikipedia (Page en langue anglaise) donnent une idée exacte des élections US. Ci-dessous, je les arrondis (d'autant que ceux de 2024 ne sont pas complets à 100% à cette heure).
11 novembre 2024 | tiré du site Arguments pour la lutte sociale
https://aplutsoc.org/2024/11/11/elections-us-les-chiffres-par-vp/
En 2016, il y a presque 109 millions d'abstentions – comme d'habitude jusque là. Du fait du caractère confédéral du pays Trump est élu avec moins de voix que Clinton : près de 63 millions contre 66,85. Jill Stein est à 1,45 million (1,07%).
En 2020, participation historiquement élevée : Biden fait 81,2 millions, Trump 74,2 millions (Howie Hawkins du Green Party 0,4 million). Les abstentions sont tombées à 80,8 millions.
En 2024, il n'y a pas de progression numérique significative de Trump – le fait politique étant bien entendu qu'après avoir tenté un putsch, il est toujours là et que le Parti républicain s'est livré à lui : il fait 74,7 millions (on peut y ajouter les 0,5 million de Robert Kennedy Junior).
C'est le vote démocrate qui baisse : Harris ne fait que près de 71 millions, soit 10 millions de voix de moins que Biden en 2020. Les abstentions remontent à 98 millions et quelques. Stein a 0,64 million (près de 0,4%).
Trump est bien sûr à un niveau élevé mais ce n'est pas un fait nouveau : il n'y a PAS eu de « vague » supplémentaire. Je ne dis pas cela pour que l'on se rassure, mais pour que l'on ne joue pas à se faire peur : il faut partir du réel.
C'est le recul démocrate la clef, que je n'expliquerai pas par les faiblesses de leur campagne car elles sont consubstantielles à la nature, capitaliste et institutionnelle de ce parti, mais par :
1°) le recul du niveau de vie réel depuis 2020,
2°) l'absence d'une mobilisation comparable à Black Lives Matter de 2020, le « mouvement pro-palestinien des campus » y ayant fait obstacle. Numériquement, les abstentions ou votes gauchistes « pour punir Genocide Joe » sont difficiles à évaluer, mais politiquement leur impact électoral global est décisif car il a interdit une mobilisation indépendante pour barrer la route à Trump.
Les courants gauchistes ou liberals (au sens US du terme) qui ont roulé contre « Genocide Joe » ne sont pas ceux d'où peut sortir une alternative ouvrière indépendante : ils sont alliés au capital sous la forme de l'impérialisme multipolaire.
L'alternative indépendante se trouve du côté des forces qui ont appelé au vote Harris malgré tout pour barrer la route à Trump, y compris dans les syndicats où la campagne UAW n'a pas été une campagne pro-démocrate traditionnelle, mais de fait un début de campagne indépendante, se prolongeant maintenant par l'appel à former un pôle ouvrier.
VP, le 11/11/2024.

États-Unis - Une victoire décisive pour les républicains

Donald Trump a remporté une victoire décisive pour lui-même et pour le parti républicain, en prenant la présidence, le Sénat et, semble-t-il, la Chambre des représentants, tandis qu'au cours de son premier mandat, les nominations de Trump ont remodelé la Cour suprême, qui le soutient pleinement.
Hebdo L'Anticapitaliste - 729 (14/11/2024)
Par Dan La Botz
Trump et le parti républicain contrôlent donc les trois branches du gouvernement, ce qui lui donne le pouvoir de mettre en œuvre son programme de droite et de transformer les États-Unis, voire de démanteler leur système démocratique et de supprimer les libertés civiles.
Un vote populaire pour les républicains
Trump a non seulement remporté le collège électoral par 312 voix contre 226, mais il a aussi, pour la première fois, remporté le vote populaire, avec plus de 74,6 millions de voix contre 70,9 millions pour les démocrates. Les républicains ont gagné trois sièges au Sénat américain — Virginie occidentale, Ohio et Montana —, ce qui leur donne la majorité et met fin à quatre années de contrôle par le parti démocrate. Le décompte des voix à la Chambre des représentantEs n'est pas encore terminé, mais les républicains semblent en mesure de l'emporter également.
Le total des voix de Trump n'a pas été écrasant, mais il a continué à bénéficier du soutien de sa base d'électeurEs blancs plus âgés et plus aisés, des électeurEs des banlieues et des zones rurales, et a également trouvé de nouveaux soutiens parmi les électeurEs de la classe ouvrière, les NoirEs, les Latino-AméricainEs et les femmes. Il a obtenu le vote de 56 % des personnes n'ayant pas fait d'études supérieures, de 13 % des électeurEs noirEs et de 46 % des électeurEs latinos. Il a obtenu 45 % des votes des ménages syndiqués. La candidate du parti démocrate Kamala Harris a obtenu moins de voix que le président Joe Biden lors de l'élection de 2020, y compris moins de voix de la part des femmes et des électeurEs noirs. De nombreuses personnes ont estimé que les prix du logement et de la nourriture étaient trop élevés, tandis que d'autres ont été motivées par le message raciste, sexiste et xénophobe de Trump. Des centaines de milliers d'électeurEs du parti démocrate ne se sont tout simplement pas présentés dans plusieurs États, comme l'Ohio. Trump a bénéficié d'un soutien plus important dans 9 comtés sur 10 dans l'ensemble du pays. Bien qu'il n'y ait pas eu de réalignement général, il y a eu un glissement vers la droite dans tout le pays.
Comme l'ont noté les experts, Trump a désormais créé une base ouvrière multiraciale pour le parti républicain. Pendant des décennies, les démocrates ont prétendu être le parti de la classe ouvrière ; aujourd'hui, les républicains leur ont ravi ce titre.
Les démocrates ont abandonné les travailleurEs
Pourquoi les démocrates ont-ils perdu ? Comme l'a écrit Bernie Sanders immédiatement après l'élection, « il ne faut pas s'étonner qu'un parti démocrate qui a abandonné la classe ouvrière s'aperçoive que la classe ouvrière l'a abandonné ». D'abord, c'était la classe ouvrière blanche, et maintenant ce sont les travailleurEs latinos et noirs. Alors que les dirigeantEs démocrates défendent le statu quo, le peuple américain est en colère et veut du changement. Et ils ont raison.
Après avoir perdu les élections, les démocrates sont confrontés à une crise d'identité et d'idéologie. Bernie Sanders a demandé : « Les grands intérêts financiers et les consultants bien payés qui contrôlent le parti démocrate tireront-ils de véritables leçons de cette campagne désastreuse ? » Probablement pas.
La direction du parti reste centriste, mais nombreux sont ceux qui souhaitent que le parti prenne un virage à gauche, vers la classe ouvrière.
La plupart des progressistes ont voté pour les démocrates, à leur grande déception. D'autres ont voté pour des partis de gauche, en vain. La physicienne Jill Stein, candidate à la présidence du parti vert, n'a obtenu que 685 149 voix (0,5 %), tandis que le théologien noir Cornel West en a obtenu encore moins. La gauche devra elle aussi réévaluer sa stratégie électorale.
Dan La Botz, traduit par la rédaction
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Étincelles Écosocialistes de Michael Löwy paraitra au Québec le 21 janvier 2025

Il n'y a pas de solution à la crise écologique dans le cadre du capitalisme. Ce qui s'y présente comme un progrès est toujours marqué du sceau de la destruction, et contribue à accentuer la rupture entre les sociétés humaines et la nature. Renverser cette dynamique implique une réorganisation d'ensemble des modes de production et de consommation de nos sociétés – autrement dit, une véritable rupture civilisationnelle. Le projet écosocialiste est l'utopie concrète qui porte cette rupture. Adossé à une vision exigeante de la planification démocratique, il entend concilier la satisfaction des véritables besoins des populations et le respect des équilibres de la planète.
Dans cet ouvrage, Michael Löwy propose une vue d'ensemble de la genèse, des enjeux et des manifestations de ce projet. Présentant ce que l'écosocialisme doit tant à la pensée de Karl Marx qu'à celle de Walter Benjamin, il en déplie les implications à la fois politiques et éthiques – au premier rang desquelles se trouve l'existence d'un lien intime entre lutte contre la marchandisation du monde et défense de l'environnement, résistance à la dictature des multinationales et combat pour l'écologie.
Michael Löwy
Philosophe et sociologue franco-brésilien, Michael Löwy est directeur de recherche émérite au CNRS.
Couverture © Juliette Maroni
ISBN 9782354803049
218 pages
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
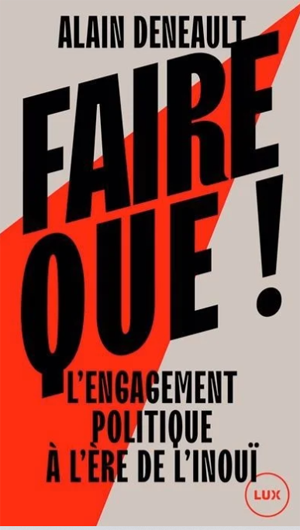
Faire que ! L’engagement politique à l’ère de l’inouï d’Alain Denault
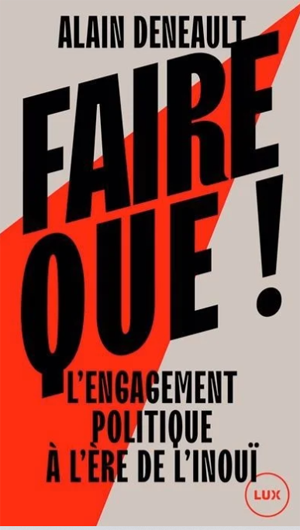
Alain Deneault est un philosophe québécois et docteur en philosophie de l'Université Paris-VIII. Il a été directeur de programme au Collège international de philosophie à Paris de 2016 à 2022. Il enseigne au campus de Shippagan de l'Université de Moncton dans la Péninsule acadienne.
Il est auteur d'essais critiques, notamment sur l'idéologie managériale, la souveraineté des pouvoirs privés et l'histoire de la notion polysémique d'économie.
https://alaindeneault.net/faire-que-alain-deneault-veut-changer-le-climat/
Son plus récent essai Faire que ! L'engagement politique à l'ère de l'inouï est publié chez Lux Éditeur qui a également publié la réédition en format poche des trois essais classiques : La médiocratie, Politique de l'extrême centre et « Gouvernance » dans sa collection Pollux.
Comment s'orienter dans une époque marquée par des bouleversements écologiques sans précédent, auxquels, manifestement, ni les États ni le capital ne remédieront ? Comment agir politiquement à l'ère de l'inouï, quand on ne dispose d'aucun pendant historique pour appréhender les catastrophes annoncées ? Comment s'engager quand l'extrême droite sème la confusion et détourne la colère des objets réels ? Comment s'y prendre quand le libéralisme dissout tous nos repères dans la gouvernance technocratique ?
Que faire ? Cette question obnubile la pensée politique depuis plus d'un siècle. Alain Deneault nous convie à en penser les prémisses et les incidences pour l'ancrer dans les temps présents. Hors de toute programmatique serrée, mais avec la lucidité qu'on lui connaît, il invite notamment à explorer un nouveau mode d'engagement politique, la biorégion.
Alors que faire ? Livrer la guerre à la médiocratie. Évoquer les enjeux qui fâchent. Penser à l'échelle collective. Mal faire les choses, faire mal. Cesser de se poser la question et sortir de la sidération de l'écoanxiété.
Le moment est venu de faire que !
Entrevue d'Alain Denault sur son livre par Blast
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
Les sceptiques sont confondus
Certains observateurs et commentateurs espéraient (sans trop y croire peut-être) que Donald Trump n'irait pas au bout de sa logique une fois élu et qu'il mettrait l'eau du réalisme dans le vin de ses principes tranchants et de ses projets intransigeants.
Hélas, ce n'est pas ce qu'on remarque en ce moment. Bien au contraire, Trump, fort de sa conquête d'une majorité républicaine au Sénat et à la Chambre des représentants, est pressé de les appliquer. Il tente sans vergogne de mettre l'appareil d'État à sa botte (y compris l'armée). Il promet aussi des lendemains cruels à ses opposants. Je n'aborderai pas ici la question de ces initiatives dont les médias font abondamment état ces jours-ci. Le problème qui se pose est celui-ci : l'administration Trump a-t-elle vraiment les moyens de ses ambitions ? Il ne suffit pas de la volonté forcenée d'un homme, même à la tête de la puissance hégémonique mondiale pour faire plier ses rivaux et adversaires. Examinons cela de plus près.
Tout d'abord, abordons la question des relations américano-chinoises. Le Chine est devenue une puissance d'envergure mondiale, en mesure désormais de disputer aux États-Unis la suprématie internationale, même s'il lui reste encore un peu de chemin à parcourir pour en acquérir la couronne. Afin de se protéger de la concurrence commerciale chinoise, Trump envisage sérieusement d'imposer des droits de douane prohibitifs sur les produits de l'Empire du milieu qui entrent sur le territoire américain, ce qui nuirait incontestablement à l'économie chinoise. Sauf qu'il s'agit là d'un petit jeu qui peut être réciproque. Beijing peut rendre la pareille aux produits américains que la Chine achète présentement. Il s'ensuivrait alors une guerre commerciale qui léserait non seulement le commerce américain mais aussi à celui des pays occidentaux, vu l'étendue des échanges Chine-Occident ; à moins que certains de ces pays ne tentent de profiter de cette situation en se dissociant de Washington dans ce dossier pour accroître leurs échanges avec l'Empire du milieu, lequel essaierait sans doute de toute façon de compenser la relative fermeture du marché américain vis-à-vis de ses produits. Des marchés de remplacement pour Beijing.
Il est donc loin d'être certain que des mesures brutales de rétorsion suffiraient à faire plier la Chine. On assisterait plutôt à un "retour du boomerang" des mesures protectionniste américaines dans le front des États-Unis eux-mêmes et donc indirectement, du Canada, le principal partenaire de ceux-ci et lui aussi grand acheteur de produits chinois. Soixante-quinze pour cent de son commerce se fait toutefois avec "les States".
Précisément, Trump a évoqué la possibilité (sinon la probabilité) d'imposer des tarifs douaniers élevés sur les produits canadiens vendus aux États-Unis (on parle de droits variant de vingt à cinquante pour cent). Le Canada est beaucoup plus vulnérable que la Chine aux pressions commerciales et économiques américaines. Il suffit de penser à la disproportion de leurs marchés respectifs : trois cent quarante millions d'Américains d'un côté, quarante millions de Canadiens de l'autre, dont neuf millions de Québécois.
Dans quelle mesure l'administration Trump est-elle prête à pousser ce dossier délicat des relations commerciales canado-américaines ? Difficile à dire pour l'instant. Mais a-t-elle même intérêt à affaiblir son plus proche vassal ? Là aussi, elle s'expose à des mesures défensives comme avec la Chine, mais évidemment à un niveau bien plus modeste. Cependant, l'économie de certains États américains dépend pour une part plus ou moins considérable du commerce avec le Canada. Le gouvernement d'Ottawa, qu'il soit dirigé par les libéraux de Justin Trudeau ou éventuellement les conservateurs de Pierre Poilievre ferait sûrement pression sur ces États pour les convaincre de continuer à acquérir les biens canadiens et aussi sur la Maison-Blanche pour qu'au moins Trump assouplisse sa position sur cette question-clé. Ottawa pourrait aussi rendre la pareille à Washington en imposant des droits plus élevés sur certains produits américains.
Mais il résulterait de ce chassé-croisé de mesures et de contre-mesures protectionnistes un relatif fractionnement économique et commercial nord-américain, ce qui desservirait à sa cohésion et par ricochet, constituerait une entrave économique pour les États-Unis eux-mêmes.
La faiblesse du Canada réside dans sa dépendance économique et commerciale à l'endroit des États-Unis. Mais elle comporte aussi quelques avantages, puisque le gouvernement américain ne peut aller trop loin dans une éventuelle guerre commerciale avec Ottawa sans affaiblir les États-Unis eux-mêmes, d'autant plus que l'Union européenne semble dans la mire des néo-conservateurs américains. En dépit de sa puissance, la république américaine ne peut combattre sur tous les fronts à la fois.
Sur le plan intérieur, les républicains trumpistes on remporté la victoire par une faible majorité de voix (cinquante et un pour cent pour Trump contre quarante-huit pour cent en faveur de Harris). Ses divers projets sociaux sont donc loin de faire l'unanimité chez les électeurs et électrices américains. Il risque donc de devoir affronter en cours de mandat bien des oppositions de la part de plusieurs de ces gens. Ses menaces de recourir à l'armée pour réprimer les mouvements de dissidence ont peu de chances d'aboutir. Une certaine anarchie sociale peut donc s'installer. Il devrait alors affronter une crise de légitimité grave. Il se peut également qu'au scrutin de mi-mandat, les démocrates reconquièrent une majorité à la Chambre des représentants, ce qui briderait alors les ambitions trumpistes de refaçonner la société américaine dans un sens réactionnaire.
L'appui d'une légère majorité de l'électorat à Trump et surtout à ce qu'il représente illustre bien le déclin de l'empire américain. Coups de gueule et mesures brutales ne pourront l'enrayer, ils peuvent même l'accélérer en éloignant des États-Unis plusieurs de leurs alliés.
Le Canada en est à la fois le spectateur et l'acteur. Comment réagira-t-il ?
Jean-François Delisle
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
𝑷𝒐𝒖𝒓𝒒𝒖𝒐𝒊 𝒍𝒆 𝑱𝒖𝒈𝒆 𝑱𝒆𝒂𝒏 𝑾𝒊𝒍𝒏𝒆𝒓 𝑴𝒐𝒓𝒊𝒏 𝒂̀ 𝒍𝒂 𝒕𝒆̂𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝑳’𝑶𝑷𝑪 𝒂𝒖 𝒍𝒊𝒆𝒖 𝒅’𝒖𝒏 𝒎𝒆𝒎𝒃𝒓𝒆 𝒅𝒖 𝒔𝒆𝒄𝒕𝒆𝒖𝒓 𝒅𝒆𝒔 𝒅𝒓𝒐𝒊𝒕𝒔 𝒉𝒖𝒎𝒂𝒊𝒏𝒔
Comme responsable d'organisation, Défenseur et Éducateur aux Droits Humains, on se questionne sur le choix du Juge Jean Wilner Morin comme nouveau Protecteur du Citoyen ai au sein de l'Office de Protection de Citoyen (OPC) au lieu le choix d'un membre ou d'une personnalité crédible du secteur des droits humains.
Étant responsable d'organisation et citoyen avisé, on a pas la prétention de mettre en doute, la compétence, l'intégrité, la personnalité et la crédibilité du Juge Morin. Mais il est juge et juge d'instruction depuis des années au sein du système judiciaire Haitien. Les pratiques du Juge et Juge d'instruction sont différentes de celles de promouvoir les droits humains.
La fonction du Protecteur du Citoyen est de faire le plaidoyer, renforcer les liens entre les droits et le citoyen, dénoncer les dérives et les violations des droits humains, recadrer les politiques publiques de l'état en faveur des droits humains. Entre autres c'est d'assurer le respect des droits des citoyens et citoyennes dans leurs relations avec les services publics Haïtiennes. Veiller à l'intégrité et à l'amélioration des services publics. Or Monsieur Jean Wilner Morin avait comme la pratique de Poursuivre, d'instruire, d'arrêter entre procéder à des actes d'instructions.
On croit que c'est un non-respect pour les personnalités du secteur des droits humains. c'est un non-respect pour les organisations sérieuses du secteur et c'est aussi un gifle contre toutes celles et ceux qui se battent pour que l'Office de Protection du Citoyen (OPC) redevienne la première instance de promotion des droits humains et qui défend ses citoyens.
On estime que le choix du Juge Morin à la tête de l'Office de Protection du Citoyen (OPC) est très précipité et laisser dernière des zones d'ombres en termes de questionnement. De plus, ce serait une décision unilatéralement prise par le Conseil Présidentiel de Transition (CPT).
En fait, l'Homme qu'il faut à la place qu'il faut n'est en aucun cas considéré par le Conseil et du coup, on doit s'inquiéter sur les vagues de nomination de ce dernier.
L'Office de Protection du Citoyen (OPC) comme institution nationale de Promotion et de Protection des droits humains ayant pour mission de veiller au respect par l'État de ses engagements en matière des droits humains, doit obligatoirement diriger par une personnalité du secteur qui connait les pratiques et techniques adéquates pour adresser les problèmes liés aux violations systématiques des droits humains.
Vive une Haïti Juste !
Vive le respect des Droits Humains !
Me. Louimann MACEUS, Av.Sec. Gl. ECCREDHHDefenseur et Educateur aux Droits Humains.Formation Spécialisée en Droits Humains et en Droit International Humanitaire CUHD/GENÈVE.Membre Amnesty International.Formation Spécialisée en Politique Publique des Droits de l'Homme à IPPDH/CIDH/ Mercosur.Ex-Point Focal OSI-HAÏTI (objectif Sciences international).Ethnojuriste@gmail.com
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
Nouvelles de la RD Congo
Bonjour !
Merci beaucoup pour les nouvelles de Presse-toi à gauche
Oui ! Une nouvelle du bulletin a retenu notre attention ; mettre fin aux
guerres !!!
J'illustre ici le cas de la République Démocratique du Congo ! où dans sa
partie Est une guerre oubliée fait des milliers des morts pendant plus de
25 ans !!!! durant lesquels des populations ont été massacrées !!! des femmes
et filles violées !!!! violentées !!!
Sincèrement nous sommes épuisées d'assister à des massacres de nos
parents !!!, de nos frères et soeurs !!! de nos enfants !!! de nos
grands-parents !!! ....
Les guerres nous exterminent !! nous rendent malheureux et misérables !!!!
nous ne jouissons plus de nos richesses !!! de notre propre pays et sommes
devenues des prisons à ciel ouvert !!! chacun dans son coin !!! pas moyens de
se déplacer librement dans ce si beau pays !!! à causes des insécurités
généralisées
Nous voulons vraiment que les guerres finissent dans notre pays !!! dans le
Monde !!!
Solidarité !
Jacqueline,
Pour l'équipe IFESIDDI en RD CONGO
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Les syndicats palestiniens appellent à intensifier la pression du BDS pour mettre fin à la complicité avec le #GazaGenocide et l’apartheid israéliens

27 octobre 2024
Plus d'un an après le génocide diffusé en direct contre 2,3 millions de Palestiniens dans la bande de Gaza occupée et assiégée, les Palestiniens sont unis dans la résistance au génocide israélien et au régime de colonialisme, d'occupation et d'apartheid en place depuis des décennies. Nous appelons les syndicats et les travailleurs du monde entier à intensifier la pression du BDS pour mettre fin à la complicité des États, des entreprises et des institutions dans les crimes d'Israël contre l'ensemble du peuple palestinien, ainsi que contre le peuple frère du Liban, entre autres.
La solidarité internationale des travailleurs commence par la fin de la complicité. Il ne s'agit pas seulement d'une question morale, mais aussi d'une obligation légale. Les arrêts de la Cour internationale de justice contre le génocide, l'occupation et l'apartheid israéliens, l'appel du Conseil des droits de l'homme des Nations unies en faveur d'un embargo militaire sur Israël et les appels de l'Assemblée générale des Nations unies en faveur de sanctions montrent que les mesures BDS ne sont pas seulement un droit, mais aussi une obligation légale.
Voici quelques-unes des mesures les plus inspirantes prises par les syndicats du monde entier au cours de la seule année dernière pour soutenir la lutte de libération palestinienne :
– IndustriALL Global Union, une fédération syndicale mondiale qui représente 50 millions de travailleurs dans 140 pays dans les secteurs de l'exploitation minière, de l'énergie et de l'industrie manufacturière, a approuvé le BDS, devenant ainsi de loin la plus grande organisation syndicale à soutenir le BDS.
– La fédération syndicale norvégienne LO, forte d'un million de membres, a joué un rôle important dans le désinvestissement du fonds souverain norvégien, le plus important au monde, de l'ensemble des obligations israéliennes qu'il détenait pour un montant d'environ 500 millions de dollars.
– Les principaux syndicats indiens, qui représentent des dizaines de millions de travailleurs, ont demandé au gouvernement indien d'annuler un accord visant à « exporter » des travailleurs indiens en Israël pour remplacer les travailleurs palestiniens, en exhortant les travailleurs à boycotter les produits israéliens et à ne pas manipuler les marchandises israéliennes.
– Les syndicats de dockers de Belgique, d'Inde, de Catalogne, d'Italie, de Grèce, de Turquie, de Californie et d'Afrique du Sud ont mené des actions contre des navires israéliens ou des livraisons d'armes à Israël.
– Le Trades Union Congress (TUC) du Royaume-Uni, qui représente 5,5 millions de travailleurs et 48 syndicats, a appelé à l'unanimité à un embargo total sur les armes contre le système d'occupation et d'apartheid d'Israël, rappelant au gouvernement ses obligations en matière de prévention des génocides.
– L'IAATW, une alliance internationale de syndicats de travailleurs du transport basés sur des applications et comptant 100 000 membres dans plus de 27 pays et sur 6 continents, a décidé de boycotter les stations-service Chevron.
– USS, l'un des plus grands fonds de pension du Royaume-Uni, a désinvesti les 100 millions de dollars d'obligations israéliennes qu'il détenait, sous la pression de l'University and College Union (UCU).
– Pour la première fois, sept grands syndicats américains, représentant près de la moitié de l'ensemble des syndiqués, ont appelé à « mettre fin à l'aide militaire américaine à Israël ».
– L'Union générale des travailleurs de l'Équateur (UGTE) a approuvé le BDS, y compris le boycott culturel d'Israël, en se déclarant zone exempte d'apartheid israélien (AFZ).
– Le Syndicat national de l'enseignement tertiaire d'Australie, qui représente 27 000 travailleurs universitaires, a approuvé le boycott de toutes les universités israéliennes complices et a appelé les universités australiennes à mettre fin à leurs liens avec l'armée israélienne et ses fournisseurs.
– En France, la CGT Thalès (syndicat représentant les travailleurs de cette entreprise d'armement) a appelé à « suspendre toute collaboration avec Israël en raison de ce qui se passe à Gaza ». Plus récemment, la section parisienne de la fédération syndicale CGT a soutenu le BDS.
– 700 membres du syndicat hollywoodien SAG-AFTRA, dont des lauréats d'Oscars, ont condamné le génocide perpétré par Israël contre les Palestiniens de Gaza et l'assassinat de journalistes palestiniens.
– Le syndicat argentin ATE Córdoba a approuvé le BDS, se déclarant zone libre de l'apartheid israélien.
– L'Union des artistes écossais et l'Union des artistes irlandais (Praxis) ont toutes deux approuvé le BDS, y compris le boycott culturel d'Israël, cette dernière se déclarant zone exempte d'apartheid israélien (AFZ).
La Fédération palestinienne des syndicats de professeurs et d'employés d'université (PFUUPE) et l'Académie palestinienne pour la science et la technologie (PalAST), qui représentent près de 10 000 travailleurs universitaires, ont salué les mesures prises par les universités du monde entier pour « revoir, suspendre et rompre les accords de collaboration avec les universités et les centres de recherche israéliens qui sont complices des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et du génocide perpétrés par Israël ».
La pression exercée par le BDS est la forme la plus efficace de solidarité internationale avec la lutte des Palestiniens pour la libération, la justice et le retour de nos réfugiés, car elle renforce le pouvoir des peuples pour mettre fin à la complicité. En conséquence, et en harmonie avec notre appel d'octobre 2023, nous vous demandons à tous d'intensifier la pression BDS :
– Désinvestissez et excluez des contrats et des investissements, le cas échéant, les entreprises complices comme Intel, Chevron, Amazon, Google, HP, Caterpillar, HD Hyundai, Carrefour, McDonald's, FANUC, Siemens, AXA, et d'autres. Faites pression sur votre institution (conseil municipal, université, etc.) ou votre employeur pour qu'il fasse de même. Associez-vous également à des mouvements stratégiques pour la justice (y compris des groupes dirigés par des étudiants) afin de faire pression sur les institutions, comme les universités et les conseils municipaux, pour qu'elles désinvestissent et mettent fin aux liens avec les entreprises militaires, technologiques et autres qui arment ou soutiennent le génocide, l'apartheid et l'occupation militaire d'Israël. Cela a été fait avec succès à l'Union Theological Seminary, affilié à l'université de Columbia, à l'université d'État de San Francisco, aux conseils municipaux de Richmond (Californie), de Liège (Belgique), d'Oslo (Norvège) et de Belem (Brésil), entre autres.
– Mettre fin au commerce d'armes avec les génocidaires : Refuser de construire, de manipuler ou de transporter tout article militaire ou à double usage destiné à l'État génocidaire d'Israël. Arrêter les navires et les cargaisons militaires à destination d'Israël, y compris en fournissant des « pavillons de complaisance », par des manifestations, des piquets, des actions de lobbying auprès des gouvernements, des actions en justice, des mesures « bureaucratiques » et des campagnes dans les médias.
– Pas de technologie pour le génocide ou l'apartheid ! Travailleurs de la technologie et syndicats : s'organiser au sein du secteur de la technologie pour renforcer le pouvoir afin de mettre fin à la complicité d'entreprises telles qu'Amazon, Google, Microsoft, HP, Intel, Palantir et Cisco qui permettent le génocide d'Israël et/ou l'automatisation de son apartheid.
– Faites pression sur les gouvernements pour qu'ils mettent fin à leur complicité et imposent un embargo militaire et des sanctions ! Continuez à suivre les orientations politiques et les demandes de la société civile palestinienne ici.
– Pas de liens avec l'Union de l'Apartheid : Coupez les liens avec la Histadrout d'Israël, pilier du colonialisme et de l'apartheid.
Signé :
Fédération générale palestinienne des syndicats (PGFTU) - Gaza
Syndicat général des travailleurs palestiniens (GUPW)
Syndicat palestinien des travailleurs des postes, de l'informatique et des télécommunications
Fédération des syndicats indépendants
Syndicat général des enseignants palestiniens (GUPT)
Union générale des femmes palestiniennes
La nouvelle fédération palestinienne des syndicats
Association du barreau palestinien
Association dentaire palestinienne - Centre de Jérusalem
Association des pharmaciens palestiniens - Centre de Jérusalem
Association médicale - Centre de Jérusalem
Association des ingénieurs - Centre de Jérusalem
Association des ingénieurs agronomes - Centre de Jérusalem
Syndicat des vétérinaires - Centre de Jérusalem
Syndicat des journalistes palestiniens (PJS)
Union des travailleurs des organes locaux - Hébron
Syndicat des employés de la compagnie d'électricité du sud
Association des employés du secteur financier
Association des employés des services de santé
Syndicat des électriciens de Palestine
Association des employés de Jawwal
Syndicat national de la banque et de l'assurance
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
Publié sur : https://bdsmovement.net/news/palestinian-trade-unions-professional-syndicates-call-for-escalating-bds-pressure
Traduit avec Deepl.com
Jour 407 de la guerre — comment raconter la guerre ? L’absence de réactions !

Nommer et combattre un système d’immigration colonialiste et raciste

Outre la régularisation des personnes sans papiers, il faut obtenir une refonte du système d’immigration : au lieu de produire vulnérabilités et discriminations, il s’agit d’accueillir les personnes migrantes et immigrantes comme des êtres humains et comme des citoyennes à part entière, de quelque région du monde qu’elles proviennent[2].
Depuis quelques mois, l’attention médiatique et politique sur les personnes immigrantes et migrantes, aiguisée par de petites phrases « assassines » qui les rendent responsables de tous nos maux[3], et en particulier de la crise du logement, de celle de l’éducation[4] et du déclin du français, s’est focalisée sur les travailleuses et travailleurs temporaires, dont le nombre atteint les 2,2 millions au Canada dont 528 000 au Québec selon Statistique Canada, au 4e trimestre de 2023. Les chiffres auraient fait sursauter l’automne dernier Christine Fréchette, ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, qui présentait sa planification des seuils d’immigration qui tient compte uniquement des entrées au pays avec la résidence permanente (ce qu’on appelle couramment l’immigration économique). Cependant, comme le souligne en février la journaliste du Devoir Sarah Champagne[5], Québec a une responsabilité indéniable dans la situation car, quoi qu’en dise le gouvernement caquiste de François Legault, il a ouvert largement la porte : c’est lui en effet qui a demandé au fédéral que les employeurs du Québec qui voulaient recourir au programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) obtiennent un « traitement simplifié » de leur demande, ce qui veut dire que ces employeurs n’ont plus à « faire la démonstration qu’ils ont cherché à recruter quelqu’un localement[6] ». Le résultat est qu’en 2023, le nombre d’entrées par le PTET (58 885) a dépassé au Québec le nombre d’entrées avec un statut de résident permanent (52 790)[7]. Or, les travailleuses et travailleurs du PTET disposent seulement d’un permis temporaire qui, pour les emplois peu qualifiés (en dessous de 26 $/h) ne leur donne pas de voie d’accès à la résidence permanente[8]. En outre, ce permis temporaire de travail est « fermé », c’est-à-dire attaché à un employeur unique : si celui-ci décide de ne pas les garder, ils ou elles doivent rentrer dans leur pays ou se trouver un autre employeur, ce qui, en filigrane, veut dire vivre sans statut, sans papiers, dans une situation extrêmement difficile. Sara Champagne rapporte des témoignages de travailleurs licenciés à peine arrivés au Québec avec leur famille, alors qu’ils ont tout vendu dans leur pays d’origine (La Tunisie et le Maroc en l’occurrence) pour venir y travailler : « Je voudrais que personne ne fasse l’erreur de quitter son pays avec un permis fermé », indique l’un d’eux. Un autre travailleur déplore : « Juridiquement, tout est bien propre, on fait un contrat. Mais on n’a pas sensibilisé les gens aux risques qu’ils vont prendre », et un troisième souligne : « Le gouvernement sait ce qui arrive avec les permis fermés et il ferme les yeux[9] ».
Les batailles de chiffres sur les seuils d’immigration permanente que se sont livrés les partis politiques l’automne dernier semblent bien anecdotiques devant ces témoignages qui renvoient à des enjeux structurels du système d’immigration canadien. Au-delà des chiffres, on ne peut pas comprendre l’emballement pour le recrutement sur permis temporaire sans resituer le phénomène : d’abord dans l’héritage colonialiste-raciste dans lequel sont ancrées ces mesures ; puis dans le changement de paradigme intervenu depuis les années 2000 en matière de politiques d’accès à la résidence permanente, lequel a mis l’accent sur l’utilité économique de l’immigration et a réactualisé la colonialité du pouvoir et le racisme systémique.
Pour éclairer ce fondement colonialiste-raciste, il est nécessaire de croiser des connaissances portant sur les principales lois régissant l’accès à la citoyenneté pour les personnes immigrantes ainsi que sur les principaux statuts d’immigration. Grosso modo, au Canada, la gestion et le contrôle des flux de main-d’œuvre internationale reposent d’un côté sur une voie d’accès vers la résidence permanente et donc vers une forme de citoyenneté, surtout utilisée jusqu’il y a trente à quarante ans par des Européens ou des francophones recherchés par le Québec (comme le montrent les données des recensements de Statistique Canada) et, d’un autre côté, sur des programmes de permis temporaires.
Les permis temporaires structurés par les rapports Nord-Sud
Outre les permis pour les étudiantes et étudiants venant faire leurs études ou profitant du permis vacances-travail (réservé aux pays du Nord[10]), les programmes de permis temporaires se divisent en deux principaux volets : 1) le Programme de mobilité internationale qui inclut différents cas de figure dont le déplacement de salarié·e·s entre filiales, les jeunes de certains pays signataires d’accords avec le Canada ou des situations spécifiques qui sont utilisées, dans bien des cas, pour des emplois considérés comme hautement qualifiés et principalement pourvus par des travailleurs du Nord; 2) les programmes des travailleurs étrangers temporaires (PTET, programme des travailleurs agricoles saisonniers, PTAS, et programme des aides familiaux résidants, PAFR) qui s’adressent essentiellement aux populations du Sud, car ces programmes dépendent d’accords bilatéraux entre le Canada et certains pays comme les Philippines, le Mexique et le Guatemala. Comme déjà mentionné, les permis sont particulièrement restrictifs, ou dits « fermés », parce qu’ils sont émis pour un employeur unique, qui a le pouvoir de le rompre unilatéralement et donc de faire perdre le statut migratoire. Jusqu’en 2002, ces programmes restrictifs de travail temporaire étaient principalement destinés à apporter de la main-d’œuvre saisonnière dans l’agriculture ou à fournir des aides familiales ; celles-ci, car il s’agit majoritairement de femmes, étaient les seules à avoir accès à la résidence permanente, mais devaient cependant attendre avant de pouvoir faire la demande et se faisaient (se font) entretemps durement exploiter, d’autant plus que jusqu’en 2014, elles étaient obligées de vivre chez le particulier employeur qui abusait fréquemment de la situation.
Ce système de migration peut être qualifié d’héritage colonial. Il a en effet été construit après l’abolition en 1962 de l’Acte d’immigration adopté en 1910 par le Canada et qui interdisait l’immigration aux personnes « déclarées comme “inadaptées au climat ou aux besoins du Canada”, bloquant dans les faits la plupart des immigrants non blancs[11] ». Deux mesures significatives ont été prises après cette abolition.
D’une part, en 1966, le Canada adopte un programme pilote destiné à faire venir en Ontario de la main-d’œuvre jamaïcaine de Porto Rico pour répondre aux besoins des fermiers, tout en s’assurant que ces personnes ne resteraient pas au pays. Depuis, la démarche s’est élargie pour déboucher sur les PTAS, PTET et PAFR. De tels programmes ne sont pas spécifiques au Canada. D’autres pays du Nord recourent à la main-d’œuvre du Sud selon le même schéma. Ces programmes bilatéraux ont été dénoncés à maintes reprises à l’issue de travaux de recherche pour leur sexisme et racisme, car ils servent à mettre à la disposition des employeurs une force de travail (physique, émotionnel, etc.) choisie selon son sexe et sa nationalité, ces critères servant à attribuer des « compétences » auxquelles la main-d’œuvre doit se conformer. Au Canada, cette forme d’exploitation genrée et racisée a connu un essor particulièrement important à partir de 2002, lorsque le PTET, d’abord réservé aux emplois qualifiés ou à certains emplois marqués par la rareté de la main-d’œuvre, a été élargi aux emplois dits peu spécialisés, ceux qui connaissent la croissance la plus importante depuis.
Dès 2008, si on inclut les étudiantes et étudiants étrangers qui sont de plus en plus nombreux à venir des pays du Sud global, mais qui appartiennent dès lors à des classes sociales ayant les moyens de payer les frais d’inscription, le nombre d’entrées au Canada de personnes migrantes ayant un statut temporaire a dépassé le nombre d’entrées par la résidence permanente. Depuis, la croissance des entrées de travailleuses et travailleurs temporaires ne s’est pas démentie, et ce, malgré différentes interventions dont celle de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec, qui a clairement exprimé dès 2012[12] que les programmes délivrant un permis fermé entretiennent la discrimination systémique à l’égard des populations migrantes en raison de leur sexe, de leur langue, de leur condition sociale, de leur origine et de leur « race » – la majorité des personnes occupant des emplois dits peu spécialisés proviennent du Guatemala, du Mexique et des Philippines. Le recours à ces programmes, destinés à exploiter mais aussi à contrôler les flux de main-d’œuvre venant des pays du Sud global, a été facilité dans l’ensemble du Canada depuis le gouvernement Harper, qui a simplifié les démarches des employeurs pour obtenir des autorisations à procéder à de tels recrutements ou qui les en a dispensés dans certaines conditions. Au Québec, le gouvernement Legault a continué dans cette lignée[13].
La dénaturation de la voie d’accès à la résidence permanente
D’autre part, en 1967, le système de points a été introduit comme voie d’accès à la résidence permanente. Selon Dufour et Forcier[14], la création de ce système de points s’inscrit dans la volonté de réduire le regroupement familial introduisant des travailleurs peu qualifiés et d’augmenter la part d’immigration économique et qualifiée. Ce caractère potentiellement discriminatoire à l’égard des personnes provenant du Sud global, moins massivement qualifiées à l’époque, sera accentué à partir de l’ère Harper; les gouvernements suivants vont en effet renforcer l’immigration économique qualifiée au détriment du regroupement familial – processus qui sera même gelé pendant deux ans – et au détriment des personnes réfugiées et demandeuses d’asile, dont la figure sera en quelque sorte criminalisée soit parce qu’elles seront considérées comme des personnes cherchant à profiter du système de protection sociale, soit comme de « faux » réfugié·e·s « menaçant la sécurité nationale[15]». Parallèlement, alors que les personnes issues des pays du Sud global vont progressivement constituer, après les réformes des années 1960, la majorité des candidats (par rapport aux Européens) empruntant la voie de la résidence permanente, le système de points connait deux modifications majeures. Celles-ci restreignent l’accès aux personnes dont la déclaration d’intérêt (c.-à-d. les postes pour lesquels elles se présentent) correspond aux besoins à court terme des employeurs, qui deviennent en quelque sorte les maitres d’œuvre d’un processus d’immigration qui se privatise[16].
Il s’agit là d’un changement de paradigme amorcé au début des années 2000, qui dénature la voie d’accès à la citoyenneté en réduisant l’être humain, jusqu’alors considéré dans sa globalité, à son intérêt économique, c’est-à-dire à son utilité en termes de main-d’œuvre. Cette utilité économique consiste le plus souvent – au-delà des discours sur la recherche d’une main-d’œuvre qualifiée – à combler à moindre coût les postes délaissés en raison de leur salaire insuffisant et de leurs difficiles conditions de travail. À titre d’exemple, environ la moitié des permis temporaires le sont en réalité pour des emplois peu spécialisés.
Le permis « fermé », forme moderne d’esclavage
Tandis que se déploient les discours qui transforment l’immigration sous ses différentes formes en bouc émissaire, on comprend mieux l’accent mis sur le travail temporaire et en particulier sur les programmes de travail temporaire délivrant un permis fermé. Objet de toutes les attentions pour les employeurs, ces programmes sont profondément rejetés par nombre d’organisations communautaires et syndicales qui demandent la suppression du permis de travail « fermé » au profit d’un permis ouvert et d’un statut permanent. Elles dénoncent ce système d’immigration à deux vitesses, source d’abus, de sous-salaires et d’heures supplémentaires non payées, de violence et de harcèlement psychologique et sexuel, et d’accidents du travail. Un rapporteur spécial de l’ONU, Tomoya Obokata, venu au Canada en septembre dernier pour enquêter à ce sujet a clairement conclu que le « permis fermé » ouvrait la porte à des formes d’« esclavage moderne[17] ». Et pour cause : le statut migratoire dégradé agit auprès des employeurs, qu’on le veuille ou non, comme un signal stigmatisant celles et ceux qui les occupent, les épinglant comme des sous-citoyennes et sous-citoyens.
Un système qui produit vulnérabilités et pertes de statut
Depuis la visite du rapporteur de l’ONU, le Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration de la Chambre des communes s’est saisi de ce sujet ainsi que de celui des personnes sans papiers, très nombreuses au Canada (entre 500 000 et 600 000 selon les estimations) en raison de ces politiques. Car ce système d’immigration produit à grande échelle des pertes de statut. Si la vie des employeurs a été simplifiée, celle des détenteurs de permis temporaires fermés ne l’a été en aucun cas, malgré l’ouverture, formellement, de l’accès à la résidence permanente. En pratique, les obstacles sont si nombreux que très peu de personnes titulaires du permis fermé arrivent à obtenir le statut de résident permanent (1 sur 14 entre 2015 et 2022 au Canada). Cette proportion n’est qu’une moyenne : au Québec, comme mentionné, les personnes occupant des emplois peu spécialisés continuent à quelques exceptions près de se voir interdire l’accès à la résidence permanente ou se heurtent à l’insuffisance des moyens disponibles pour la francisation et à la difficulté des tests de français, ce que le gouvernement québécois a fini par reconnaitre. Par ailleurs, nombre de personnes fuyant des employeurs abusifs ne réussissent pas à obtenir ce « permis ouvert pour personnes vulnérables » prévu par Ottawa dans les cas d’abus, car les démarches sont extrêmement lourdes, ou elles n’arrivent pas à obtenir de nouveau un permis « fermé » à l’issue de la durée d’un an accordé avec ce permis ouvert.
Outre la perte de statut en raison de la nature même des politiques d’immigration, qui institutionnalisent la précarité comme moyen de gérer les flux de main-d’œuvre en provenance du Sud global, on peut aussi se retrouver sans papiers quoique dans une moindre mesure, malgré ce que laisse croire la large couverture médiatique du « chemin Roxham », à cause de la non-effectivité ou de l’insuffisance des politiques humanitaires qui accordent trop souvent au compte-gouttes la résidence permanente et qui la refusent pour des raisons aberrantes : on peut voir à cet effet le documentaire L’audience[18], où le juge refuse le statut de réfugié à un couple avec enfants considérant qu’il « magasine » le pays dans lequel il veut vivre ! C’est sans compter les restrictions apportées à des programmes comme le parrainage collectif, victime de son engouement auprès d’une population prête à accompagner financièrement, pendant un an après leur arrivée au Canada, des personnes qui ont auparavant obtenu le statut de réfugié. Il faut aussi rajouter au tableau les quotas annuels imposés par Québec, qui restreint même les entrées par regroupement familial et retarde du coup la réunion des familles des années durant – des conséquences guères différentes de celles résultant de la politique « tolérance zéro » édictée par Trump aux États-Unis envers les demandeurs d’asile provenant du Mexique et qui avait mené à séparer près de 4 000 enfants de leurs parents.
Les annonces début novembre des gouvernements fédéral et québécois sur la planification de l’immigration n’ont pas montré de volonté de corriger ces politiques qui perpétuent la domination envers les travailleuses et travailleurs du Sud global. Cependant, la ministre de l’Immigration du Québec n’a pu éviter de parler de ces travailleurs temporaires et de l’ampleur du phénomène qui avait été révélée par des médias quelques semaines avant l’annonce de la planification. Elle a ainsi indiqué vouloir mettre une condition de maitrise minimale du français à l’oral pour obtenir un renouvellement au bout de trois ans d’un permis temporaire, ce qui a paru totalement indécent aux yeux des organisations syndicales et communautaires œuvrant avec les personnes migrantes, ou pour faire respecter leurs droits humains, puisqu’on ne leur donne même pas la possibilité de s’installer au Québec avec un statut permanent ! Cela semble également ingérable par les employeurs, qui devraient assurer des heures de français sur les lieux de travail alors que bon nombre d’entre eux ne respectent même pas le droit du travail.
Le 14 décembre dernier, Marc Miller, ministre fédéral de l’Immigration, a donné une entrevue au Globe and Mail où il rappelait la promesse faite par Trudeau, il y a déjà deux ans, concernant l’adoption d’un programme de régularisation de grande ampleur. Cependant, l’entrevue montre que les objectifs seraient restreints là encore aux secteurs d’activité pour lesquels les immigrantes et immigrants sont économiquement utiles, comme la construction et la santé, où ils sont jugés « indispensables », et le processus serait très long (s’étirant jusqu’en 2026) pour des raisons explicitées dans l’entrevue, qui se réfèrent à la montée d’un sentiment anti-immigrant parmi la population – un sentiment que les dirigeants politiques sont en réalité en train d’amplifier si ce n’est de créer. Or, les organisations communautaires ou syndicales qui se mobilisent pour obtenir la régularisation des personnes sans papiers demandent de leur côté un programme complet et véritablement inclusif.
Longtemps, face aux politiques discriminatoires d’immigration et à leurs conséquences parfois lourdes sur l’état physique et mental des personnes, des organismes comme le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants et le Réseau d’aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec ont œuvré de façon assez isolée durant leurs premières années, ne recevant un soutien que d’autres organismes communautaires, puis, petit à petit, d’organisations syndicales. Mais avec la pandémie, qui a jeté une lumière crue sur toutes ces personnes migrantes, précaires ou sans papiers qui ont dû continuer à travailler en s’exposant à l’épidémie, y perdant parfois la vie, ces organisations de travailleuses et travailleurs migrants ont acquis une visibilité et une reconnaissance indéniables, tandis que le sort de ces personnes alors qualifiées d’essentielles n’a pu rester dans l’ombre, et ce, d’autant moins qu’elles ont été les premières à se mobiliser pour faire reconnaitre leurs droits.
À présent, au Québec en particulier, les organisations syndicales sont impliquées dans la campagne pour la régularisation des personnes sans papiers, qui rassemble une trentaine d’organismes communautaires d’envergure provinciale et même internationale[19]. Cette coalition qui a élargi ses objectifs a tenu le 15 février dernier une rencontre stratégique pour déterminer ses priorités et stratégies afin de ne plus être seulement réactive. Au cœur des discussions, il y a la nécessité de déconstruire les discours anti-immigrants et de mettre fin à ce système d’immigration discriminatoire et raciste tout en continuant à réclamer haut et fort un programme de régularisation complet et inclusif.
Un tournant dans la mobilisation pour la régularisation
La mobilisation se trouve en effet à un tournant. Un bras de fer s’est véritablement engagé avec les classes dirigeantes qui cherchent sans pudeur à travers les responsables politiques et la montée des discours anti-immigrants des appuis ou des voix jusqu’à l’extrême droite. Ce n’est pas pour rien que le patronat se montre quasi inflexible à maintenir le système du permis fermé. C’est tout un modèle économique qu’il s’agit de préserver et qui repose sur une main-d’œuvre flexible et à bas salaires permettant, par exemple, de vendre les fruits et légumes cultivés au Québec moins cher ou de faire de la province un espace d’entreprises logistiques à moindre coût. Si tant le gouvernement fédéral que celui du Québec se défendent de poursuivre des objectifs racistes ou inconsidérés, il n’en reste pas moins que transformer les personnes migrantes et immigrantes en boucs émissaires est un moyen de tenter de les isoler, de leur faire perdre un pouvoir de négociation qu’elles ont durement acquis ces dernières années.
L’issue du bras de fer dépendra des mobilisations en cours, et donc aussi de l’engagement des syndicats, notamment au Québec mais pas seulement. Feront-ils de ces enjeux une campagne prioritaire, en se donnant les moyens d’informer et de former les syndicats locaux à connaitre et à faire valoir les droits des travailleuses et travailleurs migrants qu’ils retrouvent de plus en plus souvent dans leur entreprise ?
À l’heure des petites et grandes phrases transformant les personnes migrantes et immigrantes en boucs émissaires de toutes les faillites des responsables politiques en matière d’inflation et de coût de la vie, de logement et d’accroissement des inégalités, l’enjeu dépasse celui de négocier quelques avancées ou de limiter les reculs; il est d’opposer une autre vision du monde, un autre récit qui favorise de larges alliances entre les différents mouvements sociaux et organismes communautaires luttant pour le logement social, contre la pauvreté, contre le racisme, etc. Et pour ce faire, il est fondamental de mettre à nu les ressorts colonialistes et racistes sur lesquels reposent les politiques d’immigration, comme il est nécessaire de montrer en quoi la crise du logement et la spéculation immobilière représentent, comme l’accroissement des inégalités, un des moteurs du processus d’accumulation capitaliste.
Par Carole Yerochewski, sociologue
Carole Yerochewski remercie le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants, notamment Cheolki Yoon, Nina Gonzalez, Noémie Beauvais, Ryan Faulkner, pour leur apport à la mise en lumière et à l’analyse de ces réalités. ↑
- Sur la question de l’immigration, on pourra aussi se référer au dossier du n° 27 des Nouveaux Cahiers du socialisme, Le défi de l’immigration au Québec : dignité, solidarité et résistances, 2022. ↑
- Rappelons, entre autres, la déclaration de Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, comme quoi une « crise sociale sans précédent » menace le Québec à cause du nombre d’immigrants, celle du ministre Jean Boulet qui avait lancé une fausse information à l’automne 2022, en disant que « 80 % des immigrants ne travaillent pas, ne parlent pas français, ou n’adhèrent pas aux valeurs de la société québécoise » et plus récemment, le 22 février, le premier ministre déclarant lors d’un point de presse que « les demandeurs d’asile menacent la langue française » (titre de l’article de Lisa-Marie Gervais, dans Le Devoir du 23 février 2024). Le plus virulent dans les discours anti-immigrants est sans doute le chef conservateur Pierre Poilievre, mais pratiquement aucun parti politique n’évite de reprendre ce type de discours. ↑
- Le gouvernement Legault met sur le dos des demandeurs d’asile les surcharges dans les garderies et les classes. Débouté par la Cour d’appel, il annonce vouloir porter en Cour suprême sa volonté de maintenir l’exclusion des enfants des demandeurs d’asile de l’accès aux garderies subventionnées – une mesure qualifiée de discriminatoire en raison du sexe par la Cour d’appel. ↑
- Sarah Champagne. « Un programme des travailleurs temporaires “totalement dénaturé”, tonne un leader syndical », Le Devoir, 23 février 2024. ↑
- Ibid. ↑
- Le nombre de demandeurs d’asile entrés au Québec, notamment par le chemin Roxham, était près de 59 000 en 2022, mais 27 % d’entre eux, soit environ 16 000 personnes, se sont installés ailleurs au Canada dans l’année même de leur demande d’asile selon les informations collectées par Lisa-Marie Gervais dans son article « La proportion de demandeurs d’asile au Québec ne serait pas aussi élevée que le dit le gouvernement Legault », Le Devoir, du 5 février 2024. ↑
- Contrairement à ce qui est en vigueur dans le reste du Canada depuis la deuxième moitié des années 2010. Le gouvernement Legault, utilisant les prérogatives du Québec en matière d’immigration, a en effet fermé cette possibilité d’accéder à la résidence permanente pour les personnes occupant des emplois peu qualifiés, et ce, y compris pour les aides familiales, alors que ce programme, contrairement au programme des travailleurs agricoles saisonniers (PTAS) et au PTET, avait toujours donné accès à la résidence permanente. ↑
- Sarah Champagne. « Congédiés sur des permis fermés, des travailleurs temporaires se retrouvent dans l’impasse », Le Devoir, 23 février 2024. ↑
- Sur les 35 pays participants, cinq appartiennent au Sud global : Costa Rica, Mexique, Corée du Sud, Hong Kong et Taïwan. Voir Vivez au Canada. ↑
- Extrait de la Fiche d’information du gouvernement du Canada à l’occasion du Mois de l’histoire des personnes noires au Canada : <https://www.justice.gc.ca/fra/jp-cj/scjn-cbjs/fait2-fact2.html>. ↑
- <https://www.cdpdj.qc.ca/fr/nos-positions/enjeux/travailleurs-migrants>. ↑
- On peut se référer en particulier à l’article de Marie-Hélène Bonin, « Le Québec, de terre d’accueil à club privé », dans le n° 27 des Nouveaux Cahiers du socialisme, qui décrit la façon dont le gouvernement Legault a négocié dès 2018 une « flexibilisation » du PTET au profit des employeurs. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que le nombre de travailleurs et travailleuses temporaires ait cru beaucoup plus vite ces dernières années au Québec que dans le reste du Canada. ↑
- Frédérick Guillaume Dufour et Mathieu Forcier, « Immigration, néoconservatisme et néolibéralisme après la crise de 2008 : le nouveau régime de citoyenneté canadien à la lumière des trajectoires européennes », Revue Interventions économiques, n° 52, 2015. ↑
- Ibid., para. 24. ↑
- Ibid. ↑
- Mélanie Marquis, « Un danger d’esclavage moderne, s’alarme un représentant de l’ONU », La Presse, 6 septembre 2023. ↑
- Émilie B. Guérette et Peggy Nkunga Ndona, L’audience, documentaire, 93 min., Québec, 2023. ↑
- Voir par exemple la lettre ouverte de Nina Gonzalez du Centre des travailleurs et travailleuses immigrants et de 28 organisations, « Cessez les expulsions, régularisez les sans-papiers ! », La Presse, 18 décembre 2023. ↑
La CAQ impose l’austérité aux étudiants et travailleurs des écoles
L’Antifascisme de Mark Bray : une plongée dans l’histoire et les idéaux du mouvement antifasciste

Quand le temps devient fou

L'expression « temps fou » désigne d'abord une revue culturelle et politique ayant connu deux moments : une première existence couvrant les années 1978-1983, suivie d'une seconde, un rebondissement dix ans plus tard de 1993 à 1998. Véronique Dassas, auteure de Chronique d'un temps fou [1], a participé aux deux périodes de cette aventure, dirigeant la deuxième mouture de la revue avec enthousiasme et brio.
Le temps fou désigne également une atmosphère plus englobante, qualifiant notre époque depuis, en gros, les années 1980, qui serait caractérisée par un temps déréglé, sorti de ses gonds, dont les guerres récentes seraient un des principaux symptômes, un retour de la barbarie sous des formes sophistiquées. C'est cet air du temps qu'évoque l'auteure dans la première partie de son livre, tandis que la seconde est constituée « d'exercices d'admiration », constituant autant de célébrations d'écrivain·es et d'artistes particulièrement affectionné·es.
Bifurquer
Si les sujets abordés sont nombreux, ils relèvent toutefois d'une approche générale que Dassas qualifie de bifurcation, dans laquelle il s'agit non seulement de critiquer les productions culturelles et les pratiques politiques d'aujourd'hui, mais d'en imaginer, d'en inventer de nouvelles dans une période où l'utopie d'une révolution globale, qui avait inspiré les militant·es des années 1960-1980, est disparue, sauf dans quelques groupes ultraminoritaires.
L'effervescence culturelle remplace depuis les années 1980 la désaffection politique. Les nouveaux créateurs et les nouvelles créatrices sont souvent, dans cette perspective, des militant·es reconverti·es qui deviennent acteur·rices dans les milieux de l'art et de la communication ou qui se professionnalisent : d'étudiant·es contestataires, ils et elles deviennent par exemple des professeur·es bien intégré·es dans les institutions qu'ils et elles critiquaient naguère.
Dassas, pour sa part, se tient à la fois à l'intérieur et en dehors de cette transformation générale par son approche oblique caractérisée par une lucidité qui ne laisse guère de place aux illusions lyriques.
Guerre à la guerre
Son invention d'un « abécéguerre » pour désigner les véritables motifs des guerres contre l'Irak témoigne de cette prise de conscience de la réalité concrète de ces affrontements, très différente de la rhétorique « démocratique » qui les légitime. La guerre soi-disant « juste » pour la « libération » du Koweït en 1991 s'avérera dans les faits un véritable massacre, dont les victimes se compteront à quelques centaines pour les Américains et leurs alliés et à plus de 100 000 du côté irakien. Il en ira de même pour la seconde guerre du Golfe en 2003, justifiée par la présence présumée d'armes de destruction massive dont l'existence ne sera jamais prouvée et qui ne « fut, note Dassas, qu'une vaste mise en scène indigne d'Hollywood ». On pourrait en dire autant pour l'Afghanistan tenu pour responsable de la destruction des tours de New York en septembre 2001, dont l'invasion sera considérée comme nécessaire et juste sous prétexte qu'al-Qaïda y avait son QG.
Cette lucidité et cette vigilance sont également présentes dans l'analyse que propose l'auteure de la guerre entre la Russie de Poutine et l'Ukraine. Dans ce conflit, elle donne tort à Poutine et, dans une moindre mesure, à Zelensky pour son nationalisme guerrier, guère porté, comme son adversaire, à des compromis et elle prône une « trêve », afin de comprendre un peu mieux les fondements historiques et politiques de cette guerre qui apparaît absurde et impensable à première vue. Cela permettrait de s'interroger notamment sur le rôle de l'OTAN dans cet affrontement, engagement qui implique une généralisation de la guerre, un accroissement des armes et, du coup, du nombre de morts. Cela permettrait également de réfléchir sur la russophobie qui s'est emparée de l'Occident au point de s'en prendre à la culture russe, autrefois louangée, et devenue objet de suspicion dont il convient de se méfier. Bref, elle propose des nuances qui s'opposent à la seule logique guerrière au nom de la complexité et de la nécessité de savoir sans donner raison pour autant à Poutine et à sa volonté impériale.
Sur un autre plan, bien que féministe convaincue, Dassas s'interroge sur la nécessité de la présence des femmes dans les armées revendiquée au nom du principe d'égalité entre les femmes et les hommes. S'adressant à ses amies féministes, elle affirme que cela ne justifie pas « qu'il nous faille passer par toutes les institutions que les hommes ont taillées à leur image en nous conformant à leurs règles, à leurs perversions, à leurs barbaries ». Et elle conclut : « je pense que l'armée, comme la police, ne sont pas faites pour les femmes », car ce sont des « institutions massacreuses ».
Féministe inorthodoxe ?
Cette conception souple du féminisme sous-tend son analyse de la critique féministe du film célèbre de Denys Arcand, Le déclin de l'empire américain, qui fut l'objet de controverses passionnées au moment de sa sortie en 1986. Succès de salle, note Dassas, le film devient bientôt « succès de salon » qui fait beaucoup jaser dans les chaumières du Québec, y compris dans le camp des féministes. On lui reprochera entre autres de reprendre à son compte des représentations sexistes et éculées de la femme qui sont une caricature de sa condition réelle dans la vie sociale. En cela, le film constituerait une sorte de mensonge, sinon une trahison, des femmes et de leurs combats pour l'émancipation et du coup son auteur est considéré comme conservateur, sinon réactionnaire, et profondément machiste.
Cette critique contient une part de vérité, bien entendu, mais elle est limitée, remarque Dassas, par les « simplifications de l'idéologisme » qui s'en tient aux représentations explicites des femmes sans tenir compte du regard et de la vision du monde du cinéaste, essentiellement pessimiste et qui n'épargne pas davantage les hommes, relevant plutôt d'un cynisme généralisé en ce qui a trait à la condition humaine et à l'avenir d'un monde voué au déclin. « Les choses sont plus complexes », note l'auteure, que ce que met en relief une certaine critique féministe qui insiste davantage sur la justesse (ou non) des représentations des femmes que sur le fondement qui la soutient : une vision profondément satirique et critique de la décadence non seulement de l'empire américain, mais du type de civilisation mortifère qu'il répand sur l'ensemble de la planète.
La venue à l'indépendantisme
On retrouve cette attitude nuancée dans le traitement que réserve Dassas au nationalisme qu'elle associe d'emblée à la xénophobie, voire au racisme, et qu'elle perçoit sur le mode de la tragédie, sous la forme du fascisme ou du national-socialisme davantage que sous celle des luttes pour la décolonisation.
C'est la situation du Québec où elle arrive dans les années 1970 qui lui fera connaître la dimension positive de l'indépendantisme dans sa phase progressiste que lui présentent des amis de gauche : « Et moi qui n'aimais ni le peuple, ni les nations, ni les élections, écrit-elle, je devins indépendantiste par sympathie. » L'adhésion à l'indépendantisme, favorisée par la contagion amicale, vaut toutefois dans la mesure où elle est une composante d'une lutte plus générale pour l'émancipation qu'elle retrouve dans le PQ des débuts, dont elle prendra ses distances lorsqu'il paraîtra s'engager dans le nationalisme identitaire qui émerge déjà au début des années 1980 et qui s'imposera au premier plan dans les années récentes. Elle s'inscrit donc dans le courant indépendance-socialisme prôné par Parti pris, revue phare des années 1960 et qui innerve le RIN et le PQ dans sa période d'émergence.
Sur tous les sujets qu'elle aborde, Dassas propose une analyse fine et pénétrante reposant sur un fond de scepticisme qui favorise un questionnement critique qui s'exprime toutefois sur le mode empathique. Les exemples évoqués ici, prélevés sur un large corpus, en témoignent de même que les « exercices d'admiration » qui constituent la deuxième partie de son livre.
Éloge des singularités
Les personnages évoqués dans cette partie se distinguent par leur profonde humanité ou leur destin original et parfois fantasque. J'en retiens ici deux à titre d'exemples parmi une dizaine décrits par l'auteure.
Primo Levi, auteur de Si c'est un homme [2], incarne le premier cas de figure. Détenu durant la dernière année d'existence d'Auschwitz, il a décrit la condition effroyable des prisonnier·ères dans un enfer qui n'a d'autres lois et d'autres règles que celles de la survie à tout prix, y compris au détriment des autres incarcéré·es. Dans cet univers insensé, il n'y a que deux sortes d'individus : ceux que l'on considérerait dans la vie ordinaire comme des profiteurs qui recourent à tous les moyens pour demeurer vivants, y compris au détriment des autres qui, pour leur part, en raison de leur vulnérabilité et de leur faiblesse, sont voués à devenir des « musulmans », c'est-à-dire des morts-vivants condamnés à une mort aussi indigne que certaine.
Dans le camp, il n'y a pas de troisième voie, de conduite qui permettrait de vivre dans la décence. On survit dans l'infamie et grâce à la chance davantage que par le courage et le mérite. Du moins c'est la conclusion que Levi tire de son expérience à Auschwitz et qui la rend particulièrement éclairante pour Dassas.
Le personnage de Patrick Straram pourrait apparaître comme l'envers, le négatif du portrait de Levi, endossant plutôt celui de l'intellectuel excentrique et irresponsable. Français et parisien, issu d'une grande famille bourgeoise, il déserte l'école et la famille au profit de la vie de bohème dans les clubs et les bars de Saint-Germain-des-Prés dès l'adolescence. En 1958, il s'installe à Montréal où il se fait rapidement connaître dans le milieu culturel, se liant d'amitié avec tout ce qui compte dans cet univers en ébullition. Il s'implique à la revue Parti pris dans laquelle il tient une chronique significativement intitulée « Interprétations de la vie quotidienne ». Ce sont surtout des textes autobiographiques dans lesquels il s'explique sur sa quête de l'absolu à travers des conduites extrêmes comme ses fameuses « dérives », déambulations accompagnées de beuveries, qui lui donnent une image de délinquant intellectuel qui fascine certain·es et qui en rebute d'autres.
Il est ensuite attiré par la contre-culture. Il aime le mode de vie de ses adeptes axé sur l'importance de la vie quotidienne et la place qu'elle accorde au sexe, aux drogues et autres pratiques de la marge. Et il vit de petits contrats et d'expédients, devenant de plus en plus pauvre et malade au fil des années, sombrant dans le désespoir et mourant de ses excès en tous genres qui comportent une dimension suicidaire.
Par sa trajectoire, Straram incarne à sa manière la figure de l'écrivain maudit. Il est admiré par Dassas parce qu'il fait partie des rares individus qui agissent selon leurs convictions, sans compromis, quitte à payer un lourd tribut. C'est cette détermination qu'elle met en relief et qui n'est pas le moindre mérite d'un personnage haut en couleur, dans son œuvre comme dans sa vie.
* * *
Le livre de Véronique Dassas s'offre comme un témoignage passionnant, autant dans sa dimension critique que dans son éloge de ceux et celles qui se proposent toujours de transformer le monde dans les périodes favorables comme dans celles rongées par le doute et le désespoir. Il évoque à sa manière fine, souple et nuancée la transition qui s'opère entre la période des grandes espérances des années 1960-1980 et celle des grandes déceptions que nous connaissons aujourd'hui à travers les événements et les acteurs qui l'ont marquée pour le meilleur et pour le pire. En quoi, elle offre, de manière pointilliste, une fresque historique qu'on a tout intérêt à connaître pour mieux saisir les enjeux auxquels nous sommes actuellement confronté·es.
[1] Véronique Dassas, Chronique d'un temps fou, Montréal, Lux éditeur, 2023.
[2] Primo Levi, Si c'est un homme, Paris, Robert Laffont, 1996. Publié en italien en 1947.
Illustration : Elisabeth Doyon

Les déchirures. Essais sur le Québec contemporain

Alex Gagnon, Les déchirures. Essais sur le Québec contemporain, Del Busso, 2023, 350 pages.
Dans Les déchirures, le docteur en littérature Alex Gagnon propose quatre « essais sur le Québec contemporain », qui sont en fait des analyses de discours assez techniques portant sur quatre objets de polémique des dernières années : les chroniqueurs de droite du Journal de Montréal, l'ouvrage L'empire du politiquement correct, de Mathieu Bock-Côté, le « Manifeste contre le dogmatisme universitaire » paru dans le Devoir en 2020, et l'affaire Lieutenant-Duval. Gagnon affirme d'emblée qu'« avoir des opinions [… l']'intéresse peu » (p. 10). Il préconise plutôt une approche « descriptive » (p. 11) surtout fondée sur les théories discursives de Marc Angenot et sur la sociologie des champs de Pierre Bourdieu.
L'auteur applique plus ou moins la même méthode à ses quatre sujets. Pour chacun, il identifie deux camps, et cherche à faire ressortir les similarités et les différences dans le style argumentatif. Son travail n'est pas strictement descriptif ; il se permet des critiques, surtout envers le côté « droit » des polémiques (Richard Martineau, Bock-Côté, et le Manifeste), et dans l'affaire VLD, il prend clairement le parti de la liberté académique. Mais il trouve le moyen d'y adosser le côté « gauche » et parfois, cela donne des incongruités, comme le rapprochement des styles de Bock-Côté et de Francis Dupuis-Déri (p. 106-8), ou l'acharnement sur une pétition de gauche radicale somme toute insignifiante comme principal interlocuteur des pro-VLD, alors que pourtant, la plupart des interventions publiques contre l'usage sans retenue du « mot en N » furent modérées et constructives.
Il y a une forte intention chez Gagnon de se placer au-dessus de la mêlée, mais comme il ne s'intéresse pas vraiment au contexte sociopolitique (sauf pour l'affaire VLD, qu'il décrit assez bien), cela nous donne un portrait de la polémique au Québec où les antagonistes ne valent pas mieux l'un que l'autre. Il termine l'ouvrage avec une présentation plutôt intelligente des théories de Bourdieu, mais il surestime gravement l'« effet de classement ». Pour lui, « les membres d'une société prennent les positions idéologiques qu'ils “choisissent” […], non pas pour elles-mêmes, parce qu'ils les trouvent vraies ou justes, mais pour l'identité sociale qui s'y rattache » (p. 342). Gagnon insiste là-dessus : les « polémistes » de tous côtés ne croient pas vraiment ce qu'ils disent, tout cela ne serait qu'un jeu sémantique de classement et de déclassement (p. 344-345). Qu'en est-il alors de son propre travail ? Il affirme à la toute fin qu'on peut faire de la « science » en valorisant « l'usage idéal de la raison » comme marqueur identitaire (p. 346). Il croyait s'en sortir, mais tout le monde dans le champ polémique affirme faire usage de raison contrairement à leurs adversaires obnubilés par les idéologies…

Monocultures de l’esprit

Vandana Shiva, Monocultures de l'esprit, Éditions Wildproject, 2022, 196 pages.
Au départ, je me disais qu'il s'agissait certainement d'un livre sur la culture au sens de musique, écriture, images, etc. Même si cette analogie y trouve tout autant des pistes critiques et résistantes, il s'agit d'un recueil de cinq essais acérés concernant l'agriculture au sens large comme, seuls, selon cette autrice physicienne de renom, militante écologiste et écoféministe indienne d'influence mondiale, les savoirs traditionnels la conçoivent. La question du « développement », supportée par les vérités colportées par une science occidentale vouée aux diktats économiques – plus particulièrement capitalistes –, fausse lamentablement notre rapport macroscopique à la terre et à la Terre, en instillant nombre de biais mortifères et, finalement, non seulement contreproductifs, mais également délétères au point de rendre stériles les meilleures terres agricoles. Un de ces biais consiste à considérer en silo l'agriculture et la foresterie qui, dans les faits, sont intimement interreliées. La culture du sapin de Noël, comme on cultive les laitues, peut faire rigoler, mais rappelons qu'il s'agit là d'une énième variante de cette pensée scientifique frelatée… Évidemment, de marginaliser, voire d'éjecter les savoirs ancestraux « véritablement durables » plonge des millions de personnes dans la pauvreté. Incidemment, dans ce livre tonique et limpide, l'autrice appelle nommément à une « insurrection des connaissances subjuguées par la démocratisation des savoirs légitimant la diversité ».

Le privilège de dénoncer

Kharoll-Ann Souffrant, Le privilège de dénoncer, Remue-ménage, 2022, 120 pages.
Dans ce petit essai percutant né aux Éditions du Remue-ménage, l'autrice féministe Kharoll-Ann Souffrant, collaboratrice d'À bâbord ! dont les travaux de recherche et les interventions publiques portent sur les croisements entre racisme anti-noir, genre et violences sexuelles, s'adresse à ses consœurs survivantes de violences sexuelles.
Le privilège de dénoncer nous initie au concept de « misogynoire », encore peu utilisé au Québec : cette misogynie raciste pratiquée envers les femmes et les filles noires. En se basant sur ce concept, Kharoll-Ann Souffrant décortique pourquoi et comment les femmes et les filles noires sont invisibilisées dans l'espace public lorsqu'on parle de violences sexuelles : elle nous entretient des impacts actuels de l'esclavage et du colonialisme, du sexisme, des graves carences du système de justice quand il est question de violences sexuelles, des stéréotypes liés à la sexualité des femmes et des filles noires, etc.
Kharoll-Ann Souffrant démontre que les femmes et les filles noires sont invisibilisées en tant que survivantes de violences sexuelles, mais qu'elles sont aussi invisibilisées au sein de la lutte contre les violences sexuelles et au sein du mouvement féministe dominant en nous rappelant (ou nous apprenant, c'est selon) que le mot/mouvement #MeToo a été originalement lancé en 2007 par une femme noire, Tarana Burke, pour dénoncer les violences sexuelles perpétrées envers les femmes racisées. Mais qui sait cela aujourd'hui ?
D'entrée de jeu, Kharoll-Ann Souffrant nous fait aussi connaitre son choix juste et assumé de ne pas faire sienne la honte que les agresseurs et le système veulent imposer aux victimes de violences sexuelles, le premier chapitre de l'ouvrage étant une dénonciation de tous ceux – institutions et individus – qui n'ont pas agi pour l'appuyer et contre son agresseur alors qu'elle était jeune adolescente.
La honte doit changer de camp, on ne le dira jamais assez. Et pour ce faire, il faut absolument élargir la compréhension sociale des violences sexuelles en prenant en compte l'intersectionnalité des oppressions, ce concept honni par le gouvernement Legault. Cet ouvrage nous presse de le faire.

La rébellion est-elle passée à droite ?

Pablo Stefanoni, La rébellion est-elle passée à droite ?, La Découverte, 2023, 220 pages.
Ne prenons pas quatre chemins : La rébellion est-elle passée à droite ? est un livre nécessaire qui doit se retrouver sur le chevet des forces militantes progressistes. Dans cet essai remarquablement bien appuyé par une recherche de grande qualité, Pablo Stefanoni, historien et journaliste au Monde diplomatique et à la revue Nueva Sociedad, propose un portrait des diverses forces, idées et discours actuels de l'extrême droite. L'originalité de son approche réside dans le fait que Stefanoni prend acte de la grande diversité des idées, groupes et discours qui composent la nébuleuse de la nouvelle droite « dure » (nationalisme radical, paléolibertarinisme, misogynie violente, écofascisme, suprémacisme blanc, islamophobie, pour n'en nommer que quelques-uns) pour montrer comment ces divers « topoï » (p. 278), bien qu'en apparence distincts, se rejoignent pour former des alliances surprenantes.
Ainsi, si Stefanoni montre comment le libertarianisme classique s'est rapproché des classes moyennes et prolétaires américaines, sous l'impulsion de Myrray Rothbard, en devenant un « paléolibertarianisme », soit une défense du tout au marché couplé avec des valeurs conservatrices dures (famille, Église), sa démonstration se complète en montrant comment les idées paléolibertariennes percent d'autres sociétés que celles des États-Unis, comme l'Argentine, grâce aux efforts de diffusion de Javier Milei, ou le Brésil et l'Espagne, par l'entremise de Agustin Laje. Et grâce aux efforts de ces derniers, les idées paléolibertariennes auront même fini par ensemencer les politiques de Jair Bolsonaro ou du parti d'extrême droite espagnol Vox (p. 186), où on devine que le tout au marché libertarien finit par défendre un nationalisme dangereux aux implications autoritaires.
Ces rencontres et liens, Stefanoni les multiplie : des nouvelles formes de nationalisme à la peur paranoïaque du « marxisme culturel », le « politiquement incorrect » comme manière à la fois de dénoncer les prétentions à l'égalité et de choquer pour polariser à outrance les débats, de la normalisation des droits LGBT à l'islamophobie ou du nationalisme grincheux à l'écologie et les idéologies new age, le livre de Stefanoni permet à une gauche confuse de mieux saisir l'adversaire qui lui fait face.
Le livre de Stefanoni s'inscrit en effet dans un bilan pessimiste et négatif de la gauche. Force est de le constater, ce qu'on nomme la gauche s'est rangé, souvent bien malgré elle, à défendre le « capitalisme tel qu'il est contre le capitalisme tel qu'il menace de devenir » (p. 30-31). La capacité de s'indigner et de canaliser les forces vives de la colère serait passée de la gauche, devenue partisane de l'establishment néolibéral, aux mouvances réactionnaires, qui dénoncent l'alliance du pouvoir traditionnel avec les forces progressistes et réformistes.
Que faire alors ? En proposant une exploration des articulations des différents discours de la nouvelle droite, on comprend finalement que le moyen ne réside peut-être pas à établir un « populisme de gauche », reflet progressiste du populisme réactionnaire (p. 278). Cette stratégie a échoué notamment parce qu'elle ignorait les articulations propres à la nouvelle droite réactionnaire. Toutefois, l'exploration de Stefanoni révèle justement ces articulations, et comment elles sont fragiles : peut-être est-il temps de se moquer des nouveaux thuriféraires de la droite (p. 280), d'opposer le rire cinglant à leur venin, plutôt que l'indignation qu'ils attendent déjà. Loin d'être une simple soupape esthétique, cette stratégie permettrait de dé-polariser le débat et de montrer la droite dure pour ce qu'elle est : une opération de manipulation (p. 34).
À voir comment réagissent nos propres bonzes québécois de la réaction, les Martineau, Bock-Côté ou Rioux, dès qu'on élève un peu la voix contre eux, cette proposition rieuse mérite d'être considérée bien sérieusement.

La fin du néolibéralisme. Regard sur un virage discret

Claude Vaillancourt, La fin du néolibéralisme. Regard sur un virage discret, Écosociété, 2023, 197 pages.
Va-t-on enfin voir la fin du néolibéralisme ? Au regard des crises récentes, le crash financier de 2007, le réchauffement climatique et la COVID-19, on ne peut que l'espérer. Malgré son titre choc, le dernier livre de Claude Vaillancourt décrit plutôt un virage discret dans notre monde actuel, avec ses opportunités et ses dangers.
Le propos est convaincant. Le cadre idéologique qu'offrait le néolibéralisme depuis les années 1980 a perdu de son attrait. On ne peut plus aujourd'hui affirmer sans ombrage que des politiques de libre-échange, de laissez-faire, de privatisation ou d'austérité vont engendrer, de façon automatique, un avenir meilleur. De plus en plus de personnes se rendent compte, en effet, que de telles politiques accentuent les inégalités, ne garantissent pas l'accès à des produits essentiels et sont nuisibles pour la planète. Aussi, les grandes firmes transnationales, comme les GAFAM, les entreprises pétrolières ou les grands groupes financiers sont régulièrement critiqués pour leurs manquements à l'éthique, leurs fraudes fiscales et leurs contributions aux problèmes écologiques.
Malgré ces critiques, les changements substantiels se font cependant attendre, affirme Claude Vaillancourt. Le monde d'hier était surtout polarisé entre la vision néolibérale du développement et celle, plus minoritaire, des altermondialistes. Pour l'auteur, deux tendances se dessinent actuellement : la croissance d'un discours progressiste timoré dans la majorité des partis, de centre droit et de centre gauche, et la montée des partis d'extrême droite, décomplexés. Signe des incertitudes actuelles, les votes aux dernières élections dans de nombreux pays se sont répartis entre quatre ou cinq partis. C'est le cas au Québec, malgré la victoire de la CAQ surtout pour des raisons de mode de scrutin, et en France. Aux États-Unis, les deux grands partis se sont partagés entre les partisans de Trump et les autres républicains, et entre les partisans de Bernie Sanders et les démocrates de Joe Biden.
Après cette analyse politique, l'auteur se livre à une lecture sociologique de notre société. En six courts chapitres, il couvre la dangereuse montée de l'extrême droite dans de nombreux pays, l'ouverture à la diversité parfois pour des raisons mercantiles, l'hystérisation de la communication et l'hypermultiplication des médias, la place grandissante que certaines entreprises multinationales prennent dans nos vies, l'hégémonie culturelle des États-Unis malgré ses excès, et le péril bien réel du réchauffement climatique après des décennies de mensonge et de lobbyisme.
Sortir du virage discret et entrer dans l'ère « post-néolibérale », propose Claude Vaillancourt, demandera de nouvelles stratégies de militantisme. Si la fin du néolibéralisme apporte son lot d'incertitudes et de dangers, elle libère aussi les esprits et les actions potentielles. L'auteur conseille aux mouvements sociaux de ne pas tomber dans le piège des divisions internes, mais de rallumer l'élan commun, éteint par la pandémie. Il suggère aussi d'inventer des stratégies différentes pour contrer l'extrême droite. Venant d'un militant avec plus de 20 ans d'expérience, membre du conseil du Front commun pour la transition énergétique (FCTÉ), président d'Attac-Québec et membre du collectif d'À bâbord, ce livre offre des analyses et des conseils précieux.
Le plan de Ford pour enrichir les plus grands promoteurs de l’Ontario
Le congrès Solidaire doit féliciter le député Bouazzi de sa franchise et de son courage
Le député Haroun Bouazzi aurait mis Québec solidaire dans la merde ? N'est-ce pas plutôt le contraire ? Le député a dit tout haut ce que toute personne progressiste, et même non-progressiste, a remarqué depuis longtemps de la part de la CAQ et du PQ au point que même le parti Conservateur du Québec en a pris quelque distance ! L'utilisation systématique du persiflage (Dog whistle) raciste par le biais du blâme de l'immigration pour expliquer à peu près tous les problèmes sociaux, de la crise du logement à celle du français en passant par celle des services publics, pèse lourd sur toute la population non-blanche. C'est pourtant elle qui assure à bon marché plus que proportionnellement les services essentiels du Québec tant publics que privés.
Celui qui se leurre n'est pas le député mais les porte-parole Solidaire qui le blâment. Comme le dit le député de Maurice-Richard, ils ratent l'occasion d'en profiter pour faire de la pédagogie sur le persiflage qui sert aux nationalistes ethniques d'explication fourre-tout. Ainsi ces nationalistes esquivent-ils les conséquences de leurs politiques austéritaires de coupes vis-à-vis le logement social, les conventions collectives et même les cours de français.
Je salue l'ancien député Amir Khadir qui affirme :
Haroun a raison et si cela choque certains c'est que bien malheureusement c'est vrai. […] Si des médias et certains politiciens inspirés par François Legault s'y appliquent davantage – comme ils le font depuis quelque temps – et continuent à susciter une sourde xénophobie teintée de racisme à l'endroit des communautés arabes et immigrantes, eh bien malheureusement nous aurons tôt fait de rattraper la France qui vote à 33 % pour l'héritier du parti raciste qu'est le Front National.
Il faut essayer d'imaginer la souffrance de la population québécoise d'origine-arabo musulmane qui chaque jour doit endurer les images archi-pénibles du génocide en cours en Palestine, ce que vient enfin d'admettre en toutes lettres un comité de l'ONU. Cette population doit endurer le déni de la CAQ qui a refusé la motion déposée par Québec solidaire qui « appelait l'Assemblée à prendre acte des propos de la rapporteuse spéciale des Nations unies, Francesca Albanese, selon laquelle on assiste au "premier génocide colonial diffusé en direct à Gaza". » ce à quoi le député Bouazzi a réagi en clamant fort à propos : « L'Histoire vous jugera ».
Lors du congrès de Québec solidaire qui s'ouvre ce soir, il est à souhaiter que le député soit l'objet d'une motion de félicitations.
Marc Bonhomme, 15 novembre 2024
www.marcbonhomme.com ; bonmarc@videotron.ca

Au nom de la transition : utilisation de la crise climatique et hégémonie du capital d’extraction

«Une conjoncture n’est pas une période de temps, elle ne peut être définie que par l’accumulation/la condensation de contradictions, la fusion ou l’amalgame – pour reprendre les termes de Lénine – de « différents courants et circonstances ».
C’est un « moment » et non une « période » surdéterminée dans son principe.»
- Stuart Hall[1]
«La manière d’écrire une histoire du présent – ou de la conjoncture actuelle – implique d’importants enjeux politiques.»
- Gillian Hart[2]
Cet article discute les récents développements et les politiques en lien avec la transition énergétique au Québec. Inspirée par l’analyse conjoncturelle de Stuart Hall et d’Antonio Gramsci, nous tenterons de comprendre les développements en matière de transition énergétique et d’offrir une analyse du moment présent marqué par une récupération du discours de la transition par la droite et sa mise au service d’un régime capitaliste d’extraction. Dans un premier temps, le texte contextualise le projet de transition énergétique au Québec et l’urgence climatique actuelle. Puis, l’analyse conjoncturelle est présentée brièvement. L’article présente ensuite une analyse conjoncturelle du déploiement de la transition énergétique au Québec. L’analyse situe ce moment politique à l’intersection de la géopolitique internationale actuelle et du développement énergétique historique propre à la province. La conclusion ouvre la discussion sur les implications de cette conjoncture pour le projet politique de la gauche québécoise en 2024.
La transition énergétique au Québec
La transition énergétique s’effectue au Québec depuis quelque temps déjà. Le Québec n’est pas seul à avoir amorcé sa grande marche vers un nouveau régime énergétique et vers de nouvelles formes d’énergie. Les transitions énergétiques ne sont pourtant pas des phénomènes nouveaux. Les termes « transitions énergétiques » se veulent d’abord descriptifs pour désigner les transitions qui ont traversé l’histoire depuis l’énergie solaire à l’énergie hydraulique et éolienne jusqu’au charbon et la vapeur, et plus récemment, jusqu’à l’utilisation des hydrocarbures. Bien que les transitions énergétiques soient un fait social récurrent dans l’histoire, la transition énergétique actuelle est complètement différente.
Le gouvernement québécois définit la transition énergétique comme :
l’abandon progressif de l’énergie produite à partir de combustibles fossiles en faveur des diverses formes d’énergie renouvelable. Elle correspond également à des changements dans les comportements afin d’éliminer la surconsommation et le gaspillage d’énergie, tout en favorisant l’émergence d’une culture d’efficacité énergétique[3].
Au-delà d’une simple description, la transition énergétique se présente au Québec comme un projet de transformation sociale. Alors que les transitions antérieures ont eu lieu de manière organique – résultat d’une interaction entre facteurs biophysiques, innovations technologiques et opportunités de marché – la transition actuelle est différente dans le sens qu’on s’applique à la faire arriver, à la manufacturer de toutes pièces. Bien au-delà de la description, la transition énergétique et le discours qui l’encadre sont fermement de l’ordre des politiques et se déploient avec une force matérielle dans l’économie, au sein de la société et sur le territoire québécois. « Le plus gros projet que l’histoire du Québec n’aura jamais vu[4] », au dire du ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie Pierre Fitzgibbon, la transition énergétique est un véritable projet de développement.
La géographe Gillian Hart[5] distingue le Développement – stylisé avec une majuscule – du développement pour expliquer la différence entre un Développement qui résulte d’un effort conscient et intentionnel d’intervention pour promouvoir un changement, et le développement qui désigne plus largement un processus de changement social à travers le temps. À l’instar de Hart qui distingue entre le Développement comme quelque chose qui « est réalisé » du développement qui « arrive », on pourrait distinguer entre les transitions énergétiques passées et la « Transition » faisant actuellement l’objet d’une politique ouvertement développementaliste par le gouvernement québécois.
Trente-quatre ans après la publication du premier rapport du GIEC[6], au Québec comme ailleurs, l’urgence d’agir a gagné la classe politique – certains diront enfin ! Pourtant, la crise climatique à elle seule explique peu la conjoncture actuelle et le déploiement de la Transition énergétique au Québec.
Crise et conjoncture
Si les politiques liées à la Transition énergétique peuvent être perçues comme une réponse de la classe politique à l’appel des scientifiques et des groupes écologistes, cette lecture est trop simple. La crise climatique est un fait indéniable. Pourtant, l’urgence d’agir face à cette crise, comme on l’expliquera plus bas, n’offre pas en elle-même une explication aux dynamiques politiques qui caractérisent le moment présent et qui se traduisent par le projet de la Transition énergétique.
Dans un passage des Cahiers de prison s’intéressant spécifiquement aux crises économiques, Gramsci écrit : « On peut exclure que, par elles-mêmes, les crises économiques immédiates produisent des évènements fondamentaux ; elles peuvent seulement créer un terrain plus favorable à la diffusion de certaines façons de penser, de poser et de résoudre les questions qui impliquent tout le développement ultérieur de la vie de l’État[7] ». L’analyse de la conjoncture devient, pour Gramsci, nécessaire à toute analyse historico-politique afin d’éviter un excès d’économisme ou un excès d’idéologisme et trouver le « juste rapport entre ce qui est organique et ce qui est occasionnel » – ou conjoncturel. Pour Gramsci, « le lien dialectique entre les deux ordres de mouvements, et donc entre les deux ordres de recherche, est difficile à établir exactement et si l’erreur est grave dans le champ de l’historiographie, elle le devient encore plus dans l’art politique, où il ne s’agit pas de reconstruire l’histoire passée, mais de construire l’histoire présente et à venir ». C’est ce point qui mène Gillian Hart au constat offert en épigraphe.
Voilà précisément la tâche et le rôle politique de l’analyse conjoncturelle[8]. Au-delà d’une simple « méthode » pouvant être séparée de la théorie et de la politique, l’analyse de la conjoncture porte attention aux processus dialectiques qui s’opèrent entre les forces globales de la mondialité et de la vie quotidienne et l’hégémonie bourgeoise qui fait médiation entre les deux[9]. Ainsi, elle détermine les tensions traversant le moment présent et « les contradictions à partir desquelles différentes possibilités peuvent émerger[10]». Pour Gillian Hart, l’analyse conjoncturelle offre une méthode de travail politique qui permet d’intervenir dans le présent pour le changer[11].
Géopolitique internationale de la Transition
Ce détour théorique nous permet de mieux entreprendre l’analyse de la conjoncture actuelle et de la Transition énergétique québécoise. Déjà en 2018, le premier Plan directeur en transition énergétique (2018-2023) signé par le premier ministre Philippe Couillard annonçait en introduction : « Cette transition constitue également une véritable occasion de croissance que nous devons saisir[12] ». Depuis, les citations du genre saturent l’espace public. Pour le gouvernement et la classe dirigeante, la Transition énergétique était, dès le départ, une bonne opportunité d’affaires qu’on doit maintenant plus que jamais s’empresser de saisir. L’urgence de la Transition énergétique telle qu’elle se manifeste dans les politiques actuelles n’est pas seulement climatique, elle est aussi économique.
En effet, la Transition constitue une occasion d’affaires pressante, car un tout nouveau marché se dessine à l’horizon alors que la géopolitique mondiale de l’énergie est en remaniement. Ce remaniement est accéléré par la guerre en Ukraine[13], et possiblement accentué par les récents blocus maritimes, incluant le blocus du groupe yéménite des Houthis dans l’important détroit de Bab el-Mandeb[14]. Ces évènements auront un effet structurant sur le long terme pour la géopolitique de l’énergie au même titre que les chocs pétroliers des années 1970 et les évènements du 11 septembre 2001 ont animé une volonté de production et d’autosuffisance pétrolières chez nos voisins du Sud qui sont aujourd’hui devenus un des plus importants producteurs au monde.
Bien que les engagements climatiques et certaines politiques de Transition énergétique soient antérieurs à ces récents évènements, on ne peut analyser le déploiement des politiques et des investissements en lien avec la Transition énergétique au Québec en dehors du contexte géopolitique international, en commençant par les répercussions de la Loi sur la réduction de l’inflation (Inflation Reduction Act, IRA), adoptée par l’administration américaine en août 2022. Cette loi est, elle-même, une réponse à la montée en puissance de la Chine qui, non seulement domine les marchés pour un nombre important de ressources clés pour le XXIe siècle, comme les minéraux critiques et stratégiques, mais qui tend aussi à un rapprochement avec la Russie, notamment sur le plan économique.
L’adoption de l’IRA a provoqué une onde de choc dans le secteur de l’automobile nord-américain en offrant de fortes subventions à la production de voitures électriques aux États-Unis et destinées au marché américain. La réaction au Canada fut rapide. Quelques semaines après cette annonce historique, le premier ministre Justin Trudeau ordonnait en octobre 2022, par la Loi sur Investissement Canada, le désinvestissement de compagnies chinoises dans le secteur du lithium canadien. Depuis, plus de neuf milliards de dollars en subventions ont été offerts pour le développement d’une filière batterie au pays. La Transition s’ancre au territoire à la vitesse grand V.
À preuve, le Québec fait face à un boom minier sans précédent : l’intérêt pour les minéraux critiques et stratégiques s’étend maintenant « au sud » de la province. Entre janvier 2021 et mai 2022, Mining Watch Canada répertoriait une augmentation dans l’octroi des titres miniers (claims) dans la région de Lanaudière de 408 % – la plus forte augmentation dans la province. Pour la même période, l’augmentation pour l’Outaouais était de 211 %, pour les Laurentides de 71,2 % et de 49,1 % pour la Mauricie. Il s’agit d’une augmentation moyenne de 129 %, soit 4,9 fois plus élevée que l’augmentation observée sur l’ensemble du territoire québécois au cours de la même période[15]. Au total, près de 140 000 titres miniers ont été octroyés dans les deux dernières années[16].
Dans la vallée du Saint-Laurent, on développe une filière batterie. Déjà, des cours d’eau ont été détournés et des milieux humides asséchés dans le territoire de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour pour faire place aux usines de cette filière. À McMasterville, les travaux de déboisement pour la construction de l’usine de Northvolt ont débuté. Aucun de ces projets n’atteint les seuils requérant une évaluation environnementale, pas même la giga-usine de Northvolt, depuis la modification des seuils d’assujettissement à un examen du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) en février 2023. Sans une évaluation environnementale, on accélère les travaux au nom de la Transition, urgence climatique à l’appui.
La littérature scientifique tout comme le discours public et les politiques en lien avec la Transition énergétique présentent un fort biais technologique. Face à la crise, le progrès technologique se présente comme l’unique voie de sortie. À défaut de remettre en question notre surconsommation ou notre relation à l’environnement, la Transition énergétique trace la continuation d’un régime extractiviste bien plus qu’un réel tournant.
Transition populiste et patriotique
Appréhender la Transition énergétique comme la simple poursuite du cours des choses n’offre cependant qu’une compréhension partielle. L’analyse de la conjoncture s’intéresse à ce qui est différent et spécifique au moment présent. Ainsi, derrière le « business as usual » se cachent un populisme et un patriotisme mis à profit pour la relance du long projet hégémonique du capitalisme extractiviste au Québec.
Au nom de l’urgence climatique et de la Transition, on justifie le plus vaste projet de développement depuis la construction des grands barrages de la baie James. En faisant explicitement référence à ce passé et au portefeuille énergétique décarboné du Québec, les politiques qui visent à développer une filière batterie dans la province récupèrent du même coup un discours patriotique émanant d’une autre époque. L’énergie propre qui a fait le développement du Québec, et qui fait sa fierté encore aujourd’hui, sera mise à profit dans le nouveau régime énergétique de la Transition. L’appel populiste de ce discours patriotique résonne chez les Québécoises et Québécois fiers d’avoir un des réseaux électriques les plus propres au monde. Ces comparaisons trop rapides omettent de mentionner les impacts sur le territoire du développement hydroélectrique de la province ainsi que tout le reste de l’histoire qui a mené à la signature de ce qu’on appelle la paix des braves[17] en 2002. On néglige pareillement de mentionner que ce développement qui fait la fierté de tous les Québécois s’est effectué dans certains territoires et s’est fait sur le dos de certaines communautés. On ne parle pas, non plus, de qui devra composer avec les répercussions du développement d’une filière batterie – de l’extraction des minéraux critiques et stratégiques jusqu’au recyclage de ces batteries.
Le gouvernement, par ce rappel du développement hydroélectrique de la province et par la comparaison entre les projets de la baie James et le développement de la filière batterie, présente les politiques de Transition énergétique, le développement de la filière batterie en particulier, comme un projet social qui bénéficiera au Québec et à son économie, et donc aux Québécoises et aux Québécois. Avec un discours nationaliste et écologique, le gouvernement ouvre le territoire – et les coffres de l’État – aux multinationales qui souhaitent venir exploiter ces ressources. La longue marche du capitalisme d’extraction amorcée depuis Duplessis au profit des intérêts privés et du capital poursuit son cours. La Transition énergétique réussit exactement là où le Plan Nord du gouvernement libéral n’avait pas su le faire dans les années 2010.
Sous cette nouvelle mouture, il devient encore plus difficile de critiquer ouvertement les politiques de Développement et de Transition : non seulement la Transition sera bénéfique aux Québécois, mais elle est nécessaire. L’urgence climatique qui est pourtant bien réelle est invoquée pour évacuer la critique. En réponse à une demande d’injonction intentée par le Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE) qui dénonçait justement le manque de transparence et l’empressement dans le dossier Northvolt, le ministre Fitzgibbon s’est dit inquiet face au « risque » que représente cette demande d’injonction qui selon lui porte atteinte à la crédibilité du Québec aux yeux des investisseurs. Ces derniers « clairement, se questionnent […] et se demandent “est-ce qu’on est bienvenu au Québec” ? », a-t-il ensuite expliqué[18]. Les inquiétudes et les questions des Québécois et Québécoises qui s’interrogent au sujet de l’impact environnemental de la Transition et de sa réelle contribution à l’économie de la province préoccupent visiblement moins le ministre. À la veille de l’audience dans le dossier opposant Northvolt au CQDE, le ministre se montrait provocateur sur les ondes de TVA : « Si la population n’en veut pas du projet, il n’y en aura pas de projet. Ce n’est pas grave[19] ».
L’effet implicite et pernicieux de propos comme ceux du ministre est qu’ils servent à recadrer la critique comme une forme de déni de l’urgence elle-même. On confond ici la forme et le fond. L’opposition à la forme que prennent ces politiques et leurs impacts territoriaux, économiques et sociaux est réinterprétée comme une critique du fond, à savoir les bienfaits, voire la nécessité, de décarboner l’économie. En tirant ainsi sur les pieds de la critique, on nie l’alternative. Critiquer le développement d’une filière batterie revient à dire qu’on préfère le statu quo. Il n’y a pas de place ici pour des solutions à la crise climatique qui reposeraient sur autre chose que l’électromobilité et la voiture solo. Au nom de la Transition, le ministre et le gouvernement se donnent non seulement l’autorisation d’aller vite, mais ils manipulent aussi le discours pour évacuer la critique au profit d’un régime extractiviste redoré d’une vertu écologique.
« Voir le présent différemment[20] »
Le gouvernement caquiste offre une solution interventionniste à la crise climatique, certes. Néanmoins, la critique face à ce développement s’intensifie. Depuis les annonces de l’implantation de l’usine de batteries de Northvolt à l’automne dernier, le discours public tend à changer. On s’interroge par exemple à savoir si les batteries construites au Québécois bénéficieront aux Québécois et Québécoises et à l’environnement local. On se demande si les minéraux critiques et stratégiques extraits au Québec contribueront à la chaine de valeur de la batterie québécoise.
Bien qu’après plus d’un demi-siècle de libéralisation économique, l’état du commerce international et des chaines d’approvisionnement mondialisées complexifie les possibles réponses à ces questions, ces dernières expriment des préoccupations légitimes que l’on gagnerait à considérer avec sérieux. La population québécoise se demande à quel prix se fera le plus grand développement de son histoire, pour le bénéfice ou au détriment de qui, et surtout de quelle façon.
Par son mépris envers ces préoccupations et par le contournement des réglementations et des institutions québécoises comme le BAPE, mises en place expressément pour assurer un respect de l’environnement, la Transition du gouvernement caquiste forge, à même la solution, les contradictions pouvant créer son échec. L’analyse succincte de la conjoncture actuelle présentée ici permet de mettre en lumière la réarticulation de l’hégémonie capitaliste sous le couvert de la Transition énergétique. Cette analyse permet aussi de déceler des tensions et des contradictions au sein de ce projet. Comme Gillian Hart nous le rappelle, l’hégémonie est toujours instable et fragile[21].
L’analyse conjoncturelle témoigne également de la transformation du terrain de luttes. Aujourd’hui plus que jamais, la question environnementale n’appartient pas, ou plus, à la gauche. On assiste à une nouvelle articulation idéologique entre l’écologie et le capital. À ses débuts, idéologie conservatrice au service de l’aristocratie, l’écologie représentait néanmoins une opposition aux forces industrielles du capital. La gauche, il faut se le rappeler, a parfois même soutenu le développement industriel au nom de la classe ouvrière. Avec la Transition énergétique, on assiste pour la première fois à une collusion idéologique entre l’« écologie » et l’industrialisation au service du capital. Ce constat démontre la nécessité de revoir l’articulation du projet politique de la gauche selon la présente conjoncture.
Par Cynthia Morinville, professeure au Département des sciences de l’environnement à l’Université du Québec à Trois-Rivières
- Stuart Hall, « Popular democratic vs authoritarian populism : two ways of taking democracy seriously », dans Alan Hunt (dir.), Marxism and Democracy, Londres, Lawrence & Wishart, 1980, p. 165. Notre traduction. ↑
- Gillian Hart, « D/developments after the Meltdown », Antipode, n° 41, 2010, p. 119. Notre traduction. ↑
- Gouvernement du Québec, Transition énergétique, 22 février 2024. ↑
- « La filière batterie arrive à Granby : entrevue avec Pierre Fitzgibbon », Le téléjournal avec Patrice Roy, Radio-Canada, 5 septembre 2023. ↑
- Gillian Hart, « Development debates in the 1990s : culs de sac and promising paths », Progress in Human Geography, vol. 25, n° 4, 2001, p. 649-658 ; « Development/s beyond neoliberalism ? Power, culture, political economy », Progress in Human Geography, vol. 26, n° 6, 2002, p. 812-822 ; « Geography and development : critical ethnographies », Progress in Human Geography, vol. 28, n° 1, 2004, p. 91-100 ; « D/developments after the Meltdown », Antipode, n° 41, 2010, p. 117-141. Voir aussi Michael Cowen et Robert Shenton, Doctrines of Development, Londres/New York, Routledge, 1996. ↑
- GIEC : Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. ↑
- Antonio Gramsci, Cahiers de prison. Anthologie, Cahier 13, § 17, Paris, Gallimard, 2022, p. 428. ↑
- La dernière décennie, depuis la mort de Stuart Hall en 2014, a vu un bourgeonnement d’écrits sur l’analyse conjoncturelle. D’importantes divergences conceptuelles existent dans ce corpus. Pour une discussion des différences et des convergences dans l’analyse conjoncturelle de Stuart Hall, Antonio Gramsci et Louis Althusser, voir Gillian Hart, « Modalities of conjunctural analysis : “Seeing the present differently” through global lenses », Antipode, vol. 56, n° 1, 2024, p. 135-164. ↑
- Ces trois « domaines » d’analyse repris par Hart (2024) sont tirés de la théorie de la production de l’espace d’Henri Lefebvre dans La révolution urbaine, Paris, Gallimard, 1970. ↑
- Gillian Hart, « Modalities of conjunctural analysis », op. cit., 2024, p. 137. ↑
- Ibid. ↑
- Gouvernement du Québec, Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques du Québec 2018-2023. Conjuguer nos forces pour un avenir énergétique durable, Québec, 2018. ↑
- Mark Winfield, « How the war in Ukraine will shape Canada’s energy policy – and climate change », The Conversation, 7 mars 2022. ↑
- Maxence Brischoux, « Le retour des blocus navals en mer Noire et en mer Rouge : vers le démembrement d’un espace commun », The Conversation, 6 février 2024. ↑
- Coalition Québec meilleure mine, « Boom minier sans précédent autour du Mont Tremblant et dans le sud du Québec : Appel au moratoire », MiningWatch Canada, 18 août 2022. ↑
- Eau Secours, Coalition Québec meilleure mine et Mining Watch, « Lancement du premier guide citoyen sur les impacts de l’industrie minière », communiqué, 21 novembre 2023.↑
- Entente entre le gouvernement du Québec et les Cris du territoire de la baie James qui met fin à des dizaines d’années de batailles juridiques. ↑
- Stéphane Blais, « Fitzgibbon est inquiet du message qu’envoie la judiciarisation du dossier Northvolt », Le Devoir, 22 janvier 2024. ↑
- TVA Nouvelles, 22 janvier 2024, <https://www.tvanouvelles.ca/2024/01/22/northvolt-si-la-population-ne-veut-pas-du-projet-il-ny-aura-pas-de-projet-dit-pierre-fitzgibbon>. ↑
- Ce sous-titre, emprunté à Gillian Hart, dans « Modalities of conjunctural analysis », est inspiré du concept de previsione d’Antonio Gramsci : ni prévision, ni prédiction, le previsione permet de voir le présent différemment afin de rendre possible l’intervention dans le présent. Voir aussi Peter D. Thomas, « The plural temporalities of hegemony », Rethinking Marxism, vol. 29, n° 2, 2017, p. 281-302. ↑
- Gillian Hart, « Modalities of conjunctural analysis », op. cit., 2024. ↑

Libérer la parole citoyenne face à une école qui va mal

L’école québécoise va mal : en témoignent d’innombrables lettres aux médias à chaque rentrée scolaire, la désertion de la profession dans les cinq premières années d’environ 20 % des nouvelles enseignantes et enseignants, la grève et la mobilisation importante des enseignantes et enseignants à l’automne 2023, ainsi que les cris d’alarme nombreux et récurrents de spécialistes, observatrices et observateurs de l’éducation. Dans un documentaire d’Érik Cimon, L’école autrement[2], Guy Rocher laisse tomber cette phrase terrible : « J’ai honte de ce qu’est devenue l’école québécoise ». Ce grand sociologue, l’un des architectes du Rapport de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la province de Québec, le fameux rapport Parent, commentait alors l’iniquité de notre système scolaire.
Pendant ce temps, le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ), totalement imperméable à ces appels de détresse, fricote et pilote sans vergogne des projets de loi décriés par le milieu. Les consultations sont factices et les résistances organisées totalement ignorées, à l’instar de la levée de boucliers provoquée par le projet de loi 23, finalement adopté le 7 décembre 2023, qui retire au Conseil supérieur de l’éducation sa mission de veiller à la qualité de l’ensemble du réseau d’éducation québécois, qui accroit une centralisation administrative déjà exagérée et qui crée un institut d’excellence dont plusieurs craignent qu’il ne vienne dicter des pratiques pédagogiques censées relever de l’autonomie professionnelle.
Cette détérioration à petit feu de l’école publique dure depuis trop longtemps. Pour faire le point et organiser une réflexion large sur la situation, le regroupement citoyen Debout pour l’école a lancé, au printemps 2023, une vaste consultation populaire, Parlons éducation, sur l’état de l’éducation un peu partout dans la province, conjointement avec trois autres groupes citoyens – Je protège mon école publique, École ensemble et le Mouvement pour l’école moderne et ouverte (MÉMO) – et avec l’appui d’une cinquantaine d’organisations partenaires. Dans le but avoué de libérer la parole citoyenne, Parlons éducation s’est décliné en une vingtaine de forums organisés dans 18 villes du Québec. À cela s’est ajoutée la tenue de rencontres destinées spécifiquement aux jeunes, à partir d’un guide conçu par un comité jeunesse et reprenant les grandes lignes du matériel proposé dans les forums.
Il s’agissait d’un véritable pari, basé sur la conviction que des échanges sur la situation étaient nécessaires et souhaités par un nombre élevé de personnes interpellées par la condition de notre système éducatif. Pari gagné : à partir d’un Document de participation[3], plus de mille personnes ont participé à une cinquantaine d’ateliers, entre mars et juin 2023, consacrant un vendredi soir et un samedi entier à discuter des cinq thèmes proposés : la mission de l’école, l’iniquité actuelle du système scolaire, le sort réservé à certaines populations laissées pour compte, les conditions dégradées d’exercice et de travail des personnels et la démocratie scolaire. Parallèlement, plusieurs centaines de jeunes s’exprimaient aussi sur les mêmes sujets.
Au-delà d’une participation importante à ces forums et aux ateliers jeunesse, il faut souligner la qualité des interventions et la richesse des échanges. Même si les constats avérés par l’exercice sont loin d’être reluisants, le fait de pouvoir les partager, d’en discuter les causes et les conséquences a eu, entre autres, l’effet de raviver l’espoir qu’il se passe quelque chose en éducation.
De graves problèmes
Dès la conclusion des forums et ateliers jeunesse, une équipe de cinq personnes s’est attelée à produire la synthèse du millier de pages de transcription des échanges. Rendu public le 6 décembre dernier, le portrait[4] qu’elle trace de notre école est désolant.
Il y a longtemps que la mission de l’école n’a pas été revue et qu’elle n’a pas fait l’objet d’un débat public. Le moins qu’on puisse dire, c’est que sa déclinaison actuelle – instruire, socialiser, qualifier – n’est pas comprise de la même manière par tout le monde. La dimension « qualification » semble avoir pris trop de place ou ne couvrir que la formation de la main-d’œuvre future; le terme « instruction » fait l’impasse sur l’éducation et l’interprétation de « socialiser » est pour le moins variable.
Or, à l’heure où de grands bouleversements sociaux sont en cours (dérèglements climatiques, omniprésence du numérique, désinformation, développement fulgurant de l’intelligence artificielle, pour ne nommer que ceux-là) ne serait-il pas opportun de faire le point sur ce qu’on attend de l’école ? Ne serait-il pas impératif de rebâtir un consensus social sur la mission de l’école et de la recentrer sur l’élève, selon une visée de développement personnel, d’ouverture sur les enjeux de société, d’émancipation et de formation citoyenne critique ? Cela favoriserait certainement une meilleure synergie de l’ensemble des intervenantes et intervenants en éducation et permettrait de mieux juger de l’adéquation avec les moyens consentis au système scolaire.
À propos de l’iniquité actuelle du système scolaire, les participantes et participants en avaient long à dire. Déjà dénoncée par le Conseil supérieur de l’éducation dans son rapport de 2016[5], la segmentation des populations étudiantes de l’école québécoise semble s’être accentuée, si l’on se fie aux nombreux témoignages recueillis. Les effets sont délétères.
Cette réalité est beaucoup plus prégnante dans les grands centres. Avec la présence d’écoles privées subventionnées et le foisonnement de projets particuliers sélectifs à l’école publique, le système québécois est devenu un véritable marché scolaire où règne le culte de la performance[6]. Comme le soulignent plusieurs, il s’agit d’un cercle vicieux : complètement privée de la possibilité d’une saine émulation entre pair·e·s s et aux prises avec une concentration indue de cas lourds, l’école publique, qui assume seule toutes ces classes qu’on dit maintenant ordinaires, suffoque et ne peut plus assurer l’égalité des chances de réussite aux enfants qui la fréquentent. Les parents craignent d’y envoyer leurs enfants et font tout pour les inscrire ailleurs, ce qui accentue le problème. On parle déjà de sélection à la fin du primaire ! La course effrénée à une prétendue « meilleure école », avec ce que cela suppose de stress pour les parents comme pour les enfants, est-ce bien ce que nous voulons comme système éducatif ?
Le Document de participation aux forums faisait aussi état de nombreuses populations scolaires laissées pour compte dans le système actuel. Dans ce domaine, les problèmes sont connus depuis longtemps : les ateliers ont permis de confirmer qu’ils perdurent ! Le manque de moyens, en particulier l’insuffisance de personnels spécialisés, pour venir en aide aux élèves handicapé·e·s ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) est criant, alors que le nombre d’enfants présentant des problèmes particuliers a explosé au Québec depuis une quinzaine d’années, un phénomène dont le gouvernement ne semble pas s’inquiéter. La trop grande proportion d’élèves en difficulté dans les classes régulières, le manque de services de soutien, le temps grugé par les formalités administratives liées à l’évaluation des cas, tout cela s’ajoute aux différents obstacles à surmonter pour répondre adéquatement aux besoins des élèves.
Il y a aussi peu de ressources et de soutien pour garantir la reconnaissance, la valorisation et l’inclusion des savoirs, des valeurs et des points de vue des Premières Nations et des Inuits dans le système scolaire. Dans les régions où la présence autochtone est importante, il s’agit d’une réalité bien concrète qui constitue un frein puissant à l’intégration scolaire des élèves.
Même si beaucoup d’efforts ont été mis pour accueillir les élèves nouvellement arrivés au Québec, des accompagnements additionnels demeurent nécessaires. On insiste, par exemple, sur l’importance d’assurer l’accès à des cours de francisation gratuits et prolongés pour les enfants, mais aussi pour leur famille, et de fournir les ressources nécessaires au bon fonctionnement des classes d’accueil et à la mise en œuvre de mesures favorisant la mixité interculturelle.
Le peu de valorisation de la formation professionnelle (FP) constitue un obstacle important à la scolarisation de nombreux jeunes qui auraient de l’intérêt pour des formations diplômantes dans une grande variété de métiers utiles et bien rémunérés. Ils pourraient trouver dans cette filière – c’est déjà le cas pour certains secteurs – la motivation à persévérer dans leurs études ou pour raccrocher. L’importance de la formation générale des adultes (FGA) a aussi été mise de l’avant comme « seconde chance » pour des élèves en difficulté au secondaire, pour des décrocheuses ou décrocheurs ou pour tout adulte qui a besoin de formation générale pour acquérir des connaissances et des compétences de base. La FGA mérite plus de reconnaissance et de moyens pour lui permettre de jouer le rôle spécifique et nécessaire qui lui est dévolu dans le système éducatif.
Les critiques nombreuses faites aux conditions d’exercice et de travail de la profession enseignante ne surprendront personne : l’appui de la population aux grèves de l’automne 2023 dans le cadre des négociations des conventions collectives du secteur public montre que la situation est connue du grand public. Dans les forums, plusieurs enseignantes et enseignants ont illustré par des exemples bien concrets ce qu’est devenu leur métier. Une reddition de comptes beaucoup trop lourde qui restreint l’autonomie professionnelle, la lourdeur de la tâche, la place énorme de l’évaluation au regard du temps nécessaire pour l’apprentissage, le trop grand nombre d’élèves en difficulté dans les classes, la précarisation des emplois et des conditions de travail, autant d’éléments qui se résument en un unique cri du cœur : il n’y a pas d’espace pour s’occuper vraiment des élèves !
Les commentaires débordent largement la seule situation de l’enseignement. On a notamment soulevé de façon récurrente l’insuffisance des différents personnels d’appui à l’enseignement. Les écoles doivent composer avec un manque de psychologues, d’orthophonistes et d’employé·e·s de soutien, inutile de dire que les services aux élèves en pâtissent, ce qui augmente d’autant la tâche enseignante.
Sur la démocratie scolaire, finalement, les participantes et les participants en avaient aussi beaucoup à dire. Sans doute faut-il éviter de généraliser trop rapidement, mais on a rapporté à de nombreux endroits que les conseils d’administration des centres de services scolaires (CSS) se comportent souvent comme des chambres d’écho de décisions prises en amont. Les conseils d’établissement fonctionnent mieux, mais leur pouvoir d’orientation et de décision est très limité. Si l’ancien modèle des commissions scolaires présentait des défauts, l’abolition de celles-ci par la loi 40 en 2020 a empiré les choses, et la récente loi 23, qui donne davantage de pouvoirs au ministre sur les directions des CSS, ne va certainement pas améliorer la démocratie scolaire.
L’existence d’une forme d’omerta dans le milieu scolaire a par ailleurs été plusieurs fois dénoncée dans les échanges. Peut-être basée en partie sur une fausse conception du devoir de réserve, mais sûrement entretenue par une peur bien réelle de représailles, les artisans du monde scolaire n’osent pas dénoncer les situations problématiques qu’ils observent. Dans au moins deux régions du Québec, une directive interne aurait d’ailleurs circulé de la part de la direction des CSS pour déconseiller la participation de membres du personnel aux forums Parlons éducation.
Le thème de l’éducation est large et plusieurs sujets n’ont pas pu être traités directement dans les ateliers des forums. Mais les échanges ont été émaillés de nombreuses références à la tyrannie de la gestion axée sur les résultats – incompatible avec un milieu éducatif et porteuse de dérives dans le fonctionnement des écoles –, à l’obsession de l’évaluation, à la nécessité de valoriser le français et les compétences langagières sous toutes leurs formes ainsi qu’au problème des surdiagnostics et de la médicalisation qui ont cours dès la petite enfance, pour ne nommer que ceux-là.
Que faire ?
Il y aura eu, en dernière analyse, bien peu de controverses dans ces forums, tant ont pu émerger sur chaque sujet des consensus spontanés. Mais au-delà du tableau déprimant que l’exercice a brossé de l’école québécoise, il faut souligner l’appétit des participantes et des participants pour qu’il se passe quelque chose, pour qu’on trouve le moyen de forcer la mise en œuvre de changements à apporter au système scolaire. Plusieurs orientations et éléments de solutions ont d’ailleurs été proposés lors de ces rencontres.
Que faire face à un gouvernement « téflon » qui prend systématiquement les choses par le mauvais bout ? Qui, par exemple, cherche éperdument du nouveau personnel, sans se préoccuper des causes de cette défection ? Qui, en contradiction flagrante avec son discours, centralise les pouvoirs et refuse d’écouter la parole citoyenne ?
La réflexion sur ces questionnements a commencé avant même la fin des forums citoyens. Ces derniers ont pu permettre d’avaliser l’état des lieux : il faut, dans une deuxième phase, dégager un consensus sur les chantiers les plus urgents à mettre en place et se centrer sur la formulation des solutions les plus pressantes pour que l’école québécoise soit véritablement équitable et émancipatrice.
Une tâche moins simple qu’elle n’y parait : il est plus facile de s’entendre sur les problèmes à dénoncer que sur la nature des solutions à préconiser ! C’est tout de même à élaborer une telle démarche que s’est attelé le collectif citoyen Debout pour l’école, tout de suite après les forums.
Le collectif s’est d’abord restructuré, embauchant un coordonnateur à plein temps et se dotant d’un comité directeur d’une douzaine de personnes qui a établi un plan de travail.
Dans une première étape, des groupes constitués (communautaires, citoyens, syndicaux) seront invités, à partir de la synthèse des forums, à formuler les changements qu’il faudrait apporter au système scolaire, en ciblant les plus pressants d’entre eux. Qu’est-ce qui devrait être entrepris au premier chef pour que le système éducatif québécois puisse véritablement offrir à tous les enfants une éducation de qualité, inclusive et émancipatrice ? À partir d’un outil d’animation, tous les groupes seront conviés à participer à cette démarche. Des comités régionaux sont déjà à pied d’œuvre pour susciter des rencontres régionales autour de cette question.
Le comité directeur de Debout pour l’école fera ensuite la synthèse des commentaires et propositions reçues, pour élaborer une déclaration qui, en plus de cerner concrètement des priorités, étayera et argumentera solidement chacune d’elles.
L’idée générale est d’obtenir ultimement un appui formel d’une part importante de la société civile. Il faut rappeler qu’une cinquantaine d’organisations avaient positivement répondu pour appuyer la tenue des forums citoyens. Cette fois, elles seront sollicitées pour un appui politique aux revendications principales qui seront retenues.
Un rendez-vous national
Il y a fort à parier cependant que l’obtention d’un consensus, même très large, sur l’urgence de mettre en place quelques chantiers prioritaires en éducation au Québec, ne suffira pas à influencer un gouvernement qui n’écoute personne.
Depuis des lustres, au Québec, on gère l’éducation, devenue un poste budgétaire parmi d’autres. L’impulsion à ne considérer l’éducation que sous l’angle de la productivité a été donnée par François Legault lui-même, alors ministre de l’Éducation, au début des années 2000. Depuis, à coup de plans de réussite, la préoccupation pour la quantité de jeunes diplômé·e·s a largement pris le pas sur celle de la nature et de la qualité de l’éducation qu’elles et ils reçoivent. L’éducation vue comme capital individuel à développer dans un monde de concurrence : le paradigme, foncièrement néolibéral, a fait son chemin. Pourquoi dès lors s’embarrasser de réflexions ou de débats sur le bien commun ?
Ce cadre idéologique est d’autant plus alarmant que pour entreprendre avec succès des réformes progressistes, il faut au préalable prendre le temps et les moyens d’obtenir des consensus sociaux. À titre d’exemple, citons le cas du financement de l’école privée. Combien de parents de la classe moyenne, attachés à l’idée que l’élitisme sert les intérêts de leurs enfants, combattraient avec vigueur le plan du groupe citoyen École ensemble[7] et l’idée même d’une école commune ?
S’il est possible qu’une déclaration commune sur l’avenir de l’école québécoise soit élaborée et qu’elle rassemble suffisamment d’appuis, il faudra donner à la publication d’une telle déclaration toute l’envergure nécessaire. C’est la raison pour laquelle Debout pour l’école pense organiser, en 2025, un grand rendez-vous national sur l’éducation dans le but de lancer publiquement cette déclaration et d’exiger du gouvernement qu’il y donne suite.
Un tel rendez-vous pourrait constituer une pression politique importante et mettre de l’avant des idées essentielles, à une petite année des élections provinciales, tout en se faisant le porte-voix de la nécessité d’agir en éducation. Cela pourrait être aussi un lieu d’échange privilégié sur des problématiques qui, tout en étant importantes, n’auront pas trouvé leur chemin vers les éléments essentiels d’une déclaration.
Outre Debout pour l’école, plusieurs groupes militent au Québec pour une meilleure éducation. Rappelons qu’École ensemble, le Mouvement pour une école moderne et ouverte et Je protège mon école publique étaient aussi impliqués dans l’organisation des forums. L’existence de ces groupes, le succès des forums citoyens Parlons éducation, l’ampleur des grèves enseignantes du secteur public et le soutien qu’elles ont reçu, tout cela laisse entrevoir qu’une importante mobilisation provenant de la base pourrait se constituer en faveur d’une refonte progressiste de l’école québécoise.
C’est ce qui donne espoir et ce à quoi Debout pour l’école[8] entend travailler au cours des prochains mois.
Par Jean Trudelle, professeur retraité et militant syndical[1]
- Jean Trudelle a été président de la Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) de 2009 à 2012. Il milite actuellement dans le groupe Debout pour l’école ! ↑
- Érik Cimon, L’école autrement, documentaire, 52 min., Télé-Québec, 2022. ↑
- Forums citoyens Parlons éducation, Document de participation, printemps 2023. ↑
- Debout pour l’école, Des citoyennes et citoyens ont parlé d’éducation. Il faut les écouter !, Synthèse des propos tenus dans les forums citoyens et les ateliers jeunesse de Parlons éducation, novembre 2023. ↑
- Conseil supérieur de l’éducation, Remettre le cap sur l’équité, Rapport sur l’état et les besoins de l’éducation 2014-2016, Québec, 2016. ↑
- On parle d’une école à trois vitesses. Voir notamment : Anne Plourde, Où en est l’école à trois vitesses au Québec ?, IRIS, 19 octobre 2022; Philippe Etchecopar, Ghislaine Lapierre, Marie-Christine Paret, Fikry Rizk et Jean Trudelle, « Projets particuliers et ségrégation scolaire. Une meilleure école… pour tout le monde », Nouveaux Cahiers du socialisme, n° 26, 2021. ↑
- L’école ensemble propose de transformer les écoles privées en écoles pleinement financées, mais sans droit de sélectionner les élèves et dans le cadre d’une carte scolaire qui respecte la diversité sociale. Voir : <https://www.ecoleensemble.com/reseaucommun>. ↑
- On peut devenir membre en allant sur son site : <https://deboutpourlecole.org/>. ↑
Postes Canada est paralysée, ses travailleurs exigent une nouvelle vision
Rio Tinto : les retraités passent à l’action
Grève imminente pour 55 000 postiers, le PDG menace de lock-out

Quand la prison fait mourir

Retour à la table des matières Droits et libertés, printemps / été 2024
Quand la prison fait mourir
Catherine Chesnay, professeure à l'École de travail social de l'UQAM Mathilde Chabot-Martin, candidate à la maîtrise en travail social à l'UQAM En novembre 2019, Michelle Messina, également connue sous le pseudonyme Madame M, s’est enlevée la vie dans sa cellule de l’Établissement de détention Leclerc de Laval. Quelques mois plus tard, le 20 mai 2020, Robert Langevin, un homme de 72 ans incarcéré à l’Établissement de détention de Montréal (Bordeaux) en attente de son procès, a succombé à la COVID-19. Dès le 19 mars 2020, la Ligue des droits et libertés (LDL) a fait valoir les droits des personnes incarcérées et œuvré à ce qu’un maximum de personnes puissent sortir de prison. À la demande des proches de personnes incarcérées ainsi que de la famille de Robert Langevin, la LDL a aussi tenté d’obtenir plus d’informations sur les derniers moments de M. Langevin, sur les soins qui lui ont été prodigués. Tout au long de ces démarches, la LDL a dénoncé l’opacité des services correctionnels. Le 24 décembre 2022, Nicous D’Andre Spring, un homme noir de 21 ans détenu illégalement à Bordeaux est décédé des suites d’une intervention violente des agents correctionnels. Récemment, en l’espace de quelques mois seulement, deux femmes sont décédées à l’Établissement Leclerc, l’une par suicide (novembre 2023) et l’autre de causes dites naturelles (janvier 2024). [caption id="attachment_19979" align="alignright" width="380"] Évolution par Eve | Projet Société Elizabeth Fry 2024.[/caption]
Ces décès ayant retenu une certaine attention médiatique au moment de leur annonce ne sont que quelques exemples d’une problématique largement répandue dans les prisons provinciales du Québec. Dans une recherche visant à faire l’analyse des décès répertoriés par le ministère de la Sécurité publique (MSP) entre 2009-2010 et 2021-2022, nous avons constaté qu’au moins 256 personnes sont décédées dans une prison provinciale (Chesnay, Chabot-Martin et Ouellet, 2024). Pour l’ensemble de cette période, le nombre de décès survenus s’est situé entre 13 décès (2010-2011) et 29 décès (2020-2021), avec une hausse totale de 87 % du taux de décès annuel entre le début et la fin de la période. Si l’on s’attarde à la classification de ces décès, 38 % des décès ont été classés comme suicide, 33 % comme mort de cause naturelle et 28 % comme mort de cause indéterminée. Selon nos analyses, c’est principalement la hausse dans le nombre de décès classés comme suicide qui explique l’augmentation du nombre de décès dans les prisons. Plus précisément, l’analyse de l’évolution des taux de suicide dans les prisons démontre qu’il y a à la fois une hausse globale dans les taux de suicide et trois pics d’augmentation ponctuels pour 2011-2012 ; 2017-2018 et ; 2020-2021.
Évolution par Eve | Projet Société Elizabeth Fry 2024.[/caption]
Ces décès ayant retenu une certaine attention médiatique au moment de leur annonce ne sont que quelques exemples d’une problématique largement répandue dans les prisons provinciales du Québec. Dans une recherche visant à faire l’analyse des décès répertoriés par le ministère de la Sécurité publique (MSP) entre 2009-2010 et 2021-2022, nous avons constaté qu’au moins 256 personnes sont décédées dans une prison provinciale (Chesnay, Chabot-Martin et Ouellet, 2024). Pour l’ensemble de cette période, le nombre de décès survenus s’est situé entre 13 décès (2010-2011) et 29 décès (2020-2021), avec une hausse totale de 87 % du taux de décès annuel entre le début et la fin de la période. Si l’on s’attarde à la classification de ces décès, 38 % des décès ont été classés comme suicide, 33 % comme mort de cause naturelle et 28 % comme mort de cause indéterminée. Selon nos analyses, c’est principalement la hausse dans le nombre de décès classés comme suicide qui explique l’augmentation du nombre de décès dans les prisons. Plus précisément, l’analyse de l’évolution des taux de suicide dans les prisons démontre qu’il y a à la fois une hausse globale dans les taux de suicide et trois pics d’augmentation ponctuels pour 2011-2012 ; 2017-2018 et ; 2020-2021.
Imprécision des causes de décès
L’importante proportion de décès classés comme suicide s’inscrit en continuité avec les recherches sur les décès en prisons menées dans le Nord global (par ex., voir Bensimon, Liebling), ainsi qu’avec celles menées par Jean Claude Bernheim en 1997, démontrant l’influence des conditions de détention sur le nombre de suicides. Ainsi, de façon non exhaustive, le régime d’incarcération, l’architecture carcérale, la cote de sécurité de l’établissement, l’accès aux soins de santé, les transferts d’établissement, et toute forme d’isolement ou de confinement sont des éléments ont des effets importants sur les taux de suicide. En ce sens, la hausse des suicides nous renseigne sur une certaine dégradation des conditions d’incarcération, s’étant exacerbée au moment de la pandémie de COVID-19. Les décès classés comme mort naturelle par le MSP, entendus comme tous les décès découlant d’une maladie ou d’une complication associée à une maladie, soulèvent aussi plusieurs questions. Selon nos analyses, l’évolution du taux de mort naturelle pendant la période ne suit pas de tendance claire ou significative, rendant inutile une analyse chronologique de leur distribution. C’est plutôt la stabilité dans le nombre de morts naturelles qui nous invite à nous questionner sur les conditions de détention, ainsi que l’accès à des soins de santé adéquats pour les personnes incarcérées. Dans presque tous les rapports annuels produits, le Protecteur du citoyen dénonce l’insalubrité des établissements de détention ainsi que des mesures d’hygiène défaillantes1. La LDL s’est également maintes fois manifestée dans l’espace public pour dénoncer les violations du droit à la santé dans les prisons provinciales. L’accès à des soins de santé de qualité équivalents à ceux offerts à l’extérieur des murs de la prison est aussi un enjeu majeur, tel que souligné par le Protecteur du citoyen. Finalement, en ce qui concerne les décès classés comme mort de cause indéterminée, ceux-ci soulèvent également plusieurs questions, tant sur leurs causes, que sur la classification des décès. D’une part, les documents fournis aux chercheuses et chercheurs par le MSP ne contiennent aucune information concernant les critères utilisés pour établir qu’une mort est de cause indéterminée. La classification en devient à la fois si vaste et si imprécise que des décès survenant dans des circonstances très variées pourraient s’y retrouver. Par exemple, un récent rapport du Bureau du Coroner de l’Ontario souligne la hausse du nombre de décès attribuable aux surdoses dans les prisons provinciales2. Or, selon la classification actuelle des décès, la seule catégorie qui pourrait capter ces décès est celle de cause indéterminée. Or, du fait de l’imprécision de cette catégorie, il est impossible de vérifier si le même phénomène se joue dans les prisons québécoises. À la lumière des analyses des taux de décès pour chaque catégorie, il en ressort que le système de classification des décès est à la fois un révélateur du contexte dans lequel ces décès se produisent, mais aussi, de l’opacité des mécaniques institutionnelles qui entourent la mort en prison.Plus de questions que de réponses
Les données que nous avons présentées soulèvent plus de questions qu’elles n’apportent de réponses. D’abord, ces dernières reposent sur des documents fournis par le MSP, obtenus grâce à 11 demandes d’accès à l’information s’échelonnant sur quatre années. Les documents obtenus reposent sur des classifications préétablies et sur l’interprétation des employé-e-s des services correctionnels. Ils n’offrent donc qu’une vision partielle (et même partiale) des évènements qui se déroulent dans les prisons provinciales. Ensuite, la qualité même des données est questionnable. En plus de noter des différences entre les documents que nous avons obtenus, une autre équipe de recherche (Tracking (In)justice)3, ayant mené une démarche similaire d’accès à l’information, a obtenu une liste comportant 52 décès supplémentaires à celle que nous avons obtenue pour la même période. Bien que nous ayons demandé une clarification au MSP au sujet de cette disparité, nous n’avons pas obtenu de réponse de leur part. Nous faisons l’hypothèse que cette différence est en partie attribuable à l’inclusion des décès de personnes suivies par les services correctionnels dans la communauté dans les données fournies à l’équipe de recherche de McClelland. Néanmoins, avec les informations dont nous disposons, on ne peut infirmer ou confirmer cette hypothèse.[…] le système de classification des décès est à la fois un révélateur du contexte dans lequel ces décès se produisent mais, aussi, de l’opacité des mécaniques institutionnelles qui entourent la mort en prison.L’enjeu de la piètre qualité des données correctionnelles provinciales a déjà été soulevé à maintes reprises, par différents actrices et acteurs, et dans plusieurs juridictions canadiennes. En 1997, Bernheim faisait état du peu de fiabilité des données issues des services correctionnels. Au Québec, le système de gestion des données carcérales, soit le système DACOR (dossier administratif correctionnel), est reconnu comme étant obsolète et peu convivial à l’usage. Il contient des informations judiciaires sur les personnes incarcérées, mais aussi des données démographiques et des informations sur leurs antécédents médicaux, entre autres. Le manque de rigueur avec lequel les données carcérales sont consignées se répercute non seulement sur les personnes incarcérées elles-mêmes (incarcération qui dépasse les délais judiciaires ; manque d’information sur le risque suicidaire, etc.), mais également sur la possibilité de brosser un portrait fiable de la population carcérale. Ce même phénomène a par ailleurs été soulevé en Ontario dans un rapport du Bureau du coroner en 2023 faisant état d’enjeux de fiabilité et de transparence des données des services correctionnels de la province4. D’ailleurs, dans le cadre de recommandations pour prévenir les décès en détention, on suggère notamment la mise sur pied d’une stratégie sur la transparence et la qualité des données correctionnelles.
Toujours un décès de trop
À ce stade-ci de nos analyses, bien que nos données ne nous permettent pas d’articuler des analyses sur les causes et les circonstances de chaque décès, nous ne pouvons pas éluder le caractère mortifère de la prison. D’emblée, souli-gnons que le personnel correctionnel peut être directement impliqué dans le décès d’une personne incarcérée. C’est d’ailleurs ce qui est en jeu dans le décès de Nicous D’Andre Spring. Cependant, les personnes impliquées ne se retrouvent que rarement devant une cour de justice — faisant des accusations criminelles l’exception et non la règle. Une exception notable est la poursuite criminelle d’un agent correctionnel, au Manitoba, pour des accusations de négligence et de non- assistance à une personne à la suite du décès d’un homme Anishinaabe de 45 ans. Son décès le 7 février 2021 faisait suite à une intervention d’agents correctionnels durant laquelle il avait répété à 27 reprises ne pas pouvoir respirer5. Soulignons aussi que l’inaction du personnel correctionnel en ce qui a trait à des mesures de soin et de prévention, conjuguée avec des pratiques disciplinaires et des techniques de contention, peut aussi entraîner des conséquences mortifères. Sept ans après le décès de Soleiman Faqiri et au terme d’une lutte acharnée de sa famille, le jury appelé dans le cadre de l’enquête du Bureau du coroner de l’Ontario a conclu en décembre 2023 que son décès devait être considéré comme un homicide. Son incarcération alors qu’il était en crise, l’absence totale de services en santé mentale ainsi que l’escalade de la réponse correctionnelle (allant de l’isolement à l’usage de mesures de contention) sont tous des éléments ayant mené à son décès6. Les conclusions de l’enquête, tenue avec des audiences publiques, ne sont toutefois pas contraignantes, elles visent uniquement à informer le public sur les circonstances du décès. Dans son rapport, le jury, formé de cinq membres de la collectivité, a émis plus de 57 recommandations, incluant la création d’un organisme indépendant pour enquêter sur chaque décès de personnes incarcérées ainsi que sur les enjeux systémiques.Plus que compter les morts
Bien que chaque mort soit unique, et que les causes et circonstances soient toujours différentes, il en ressort que chacune d’entre elles révèle simultanément les failles d’un système correctionnel déficient et mortifère. Or, l’absence de surveillance institutionnelle des décès en prison — se manifestant, entre autres, par l’inhabilité à compter avec exactitude le nombre de morts qui s’y produit et à en identifier la cause dans 28 % des cas — est symptomatique d’une certaine banalisation de la mort entre ces murs. La prison (re)produit les violences coloniales, racistes, sexistes, capacitistes, en toute impunité. En milieu carcéral, certains corps considérés comme irrécupérables par l’institution en raison de leur identité de genre, de leur état mental ou de certaines caractéristiques physiques sont plus exposés à la mort7. Se questionner sur la mort en prison va donc au-delà de « compter les morts » ; il s’agit d’interroger pourquoi autant de personnes meurent en prison et de réfléchir à la manière dont les morts sont comprises, classifiées et, surtout, ignorées.- En ligne : https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes/rapports-annuels/2022-2023
- Office of the Chief coroner, An obligation to prevent - Report from the Ontario Chief Coroner’s Expert Panel on Deaths in Custody, 2023.
- En ligne : https://trackinginjustice.ca/
- Office of the Chief coroner, 2023.
- En ligne : https://www.aptnnews.ca/national-news/i-cant-breathe-court-sees-video-of-guards-overpowering-inmate-william-ahmo/
- En ligne : https://toronto.ctvnews.ca/soleiman-faqiri-s-jailhouse-death-ruled-a-homicide-1.6683448 En ligne : https://globalnews.ca/news/10167257/faqiri-family-coroners-inquest/
- Bromwich, Theorizing the Official Record of Inmate Ashley Smith : Necropolitics, Exclusions, and Multiple Agencies. Manitoba Law Journal, 2017 ; A. Mbembe, Nécropolitique, 2006 ; Razack, It Happened More Than Once : Freezing Deaths in Saskatchewan, Canadian Journal of Women and the Law, 2014. En ligne : https://doi.org/10.3138/cjwl.26.1.51 ; C. M. Zhang,Biopolitical and Necropolitical Constructions of the Incarcarated Trans Body, Columbia Journal of Gender and Law, 2019.
L’article Quand la prison fait mourir est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.
Au lendemain de la COP16, le financement demeure incertain
Les histoires deviennent vraies
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.











