Derniers articles

Quelles alternatives face aux fausses solutions promues par la Banque africaine de développement ? : Critique de la stratégie globale des échanges dette-nature en Afrique (Partie 3)

Dans la partie 1, vous avez lu l'analyse contextuelle introductive qui remet en cause la stratégie globale de la Banque Africaine de Développement ( BAD) telle quelle est développée dans un rapport d'octobre 2022 intitulé « Échanges dette-nature, faisabilité et pertinence stratégique pour le secteur des ressources naturelles en Afrique ». Dans la partie 2, nous avons abordé avec un regard critique et des exemples concrets les diverses solutions promues par la BAD dans ce même rapport. Cette partie 3 poursuit l'analyse des fausses solutions et apporte des conclusions en lien avec la déception du sommet de Paris du 22 et 23 juin 2023 pour un « Nouveau Pacte Financier Mondial » ainsi que les propositions alternatives de ATTAC et du CADTM. Cette partie 3 porte sur les alternatives éventuelles aux fausses solutions citées plus haut. Les obligations vertes sont-elles une alternative ? Quelles critiques peut-on en faire ? Quelles sont les recommandations de l'association ATTAC concernant la finance dite verte ? Quelle est la politique européenne dans ce domaine ? Enfin, quelles sont les recommandations du CADTM sur ces différentes questions ?
Tiré du site du CADTM.
1) Le plan d'action « relance verte » de la BAD (2021-2027)
Il est proposé à l'Union Africaine en Juillet 2021 pour une durée de 5 ans. Ces Cinq priorités concernent le financement climatique, les énergies renouvelables, la nature et la biodiversité par la gestion durable des terres, forêts et océans ainsi que par l'écotourisme, l'agriculture résiliente, les villes vertes. Pour réaliser ces objectifs, le plan encourage les opérations de dettes innovantes telles que les obligations dites vertes ou bleues. Il faut assurer une bonne coordination entre les États membres, assurer le soutien des partenaires internationaux. Nous apportons une critique de cette politique orientée principalement vers les obligations vertes dans la partie qui suit.
2) Les obligations vertes : mécanismes pour lier les dettes souveraines aux résultats sur le plan climatique et écologique
Sur le site du gouvernement français, voici comment on définit une obligation verte : « Une obligation verte est un emprunt émis sur le marché par une entreprise ou une entité publique auprès d'investisseurs pour lui permettre de financer ses projets contribuant à la transition écologique (énergies renouvelables, efficacité énergétique, gestion durable des déchets et de l'eau, exploitation durable des terres, transport propre et adaptation aux changements climatiques...), plus particulièrement les investissements en infrastructures. Elle se distingue d'une obligation classique par un reporting détaillé sur les investissements qu'elles financent et le caractère vert des projets financés ».
Des OBLIGATIONS VERTES sont émises en 2007 par la Banque européenne d'Investissement puis en 2008 par la Banque Mondiale. Elles se divisent en deux catégories : les obligations durables traditionnelles ou à utilisation ciblée comme les obligations vertes et bleues et les obligations liées aux Objectifs de Développement Durables (ODD) qui sont conditionnelles et en principe essentiellement réservées au secteur privé (avec l'exception des obligations ODD émises par le Chili en mars 2022. Cependant le mouvement de la « La Relance Verte » essaie de mettre au point un modèle plus adapté aux obligations ODD de type souveraines).
Les agences gouvernementales, les institutions multilatérales, les conseillers juridiques et financiers, les ONG environnementales ont essayé de mettre en place une stratégie d'accompagnement pour conseiller les structures de financement les plus adaptées (entre les échanges de dette-nature, l'obligations à utilisation ciblée et les obligations liées aux ODD) en fonctions des objectifs poursuivis, des besoins identifiés et du profil d'endettement du pays. (Voir le tableau comparatif p35 dans le rapport de la BAD)
a) Les obligations à objectifs ciblés ou obligations durables traditionnelles
Elles sont émises contre l'engagement d'affecter au moins une partie des fonds à
un projet connu d'avance lié au Développement Durable. En contrepartie les
détenteurs de obligations doivent accepter des rendements moins élevés. Cet
écart est appelé PRIME VERTE ou GREENIUM.
Par exemple, le Bénin, le 15 juillet 2021, a émis des obligations ciblant deux objectifs de développement durable : l'environnemental et le social et 15 des 17 ODD définis par les Nations Unies (l'accès à l'eau, l'énergie, l'agriculture, l'éducation, la santé, le logement, la conservation de la biodiversité...). L'atteinte de ses objectifs a été évalué grâce à des Indicateurs Spécifiques. Il a récolté 500 millions d'euros avec une rendement à 5,25% ce qui a permis la constitution d'une Prime verte de 20 points de base. 91% des obligations émises ont été souscrites par des investisseurs ESG (Environnemental, Social et de Gouvernance).
Ces obligations vertes sont des instruments prédominants aujourd'hui sur les marchés, bien plus que les traditionnels échanges dette-nature. En 2021, les banques facilitatrices de ces obligations ont remporté plus de commissions sur les transactions vertes que sur les énergies fossiles et celles-ci ont encore augmenté de 1,4 milliards de USD de 2020 à 2021 ( chiffres du rapport de la BAD).
Malgré cet engouement, on peut souligner des inconvénients : elles ne disposent pas de mécanisme de surveillance intégré à la structure permettant de vérifier si les fonds sont bien utilisés par les gouvernements pour la conservation.
Le cadre législatif national n'oblige pas à la destination des ressources. Il y a donc une crainte justifiée d'écoblanchiment, "ce qui conduirait à une dépréciation des primes vertes. On peut s'attendre aussi à ce que les gouvernements en raison d'urgences sociales ou de santé préfèrent utiliser des fonds pour d'autres dépenses publiques que celles liées à l'environnement. Les gouvernements n'ont pas intérêt à être trop contraints quant à la destination des financements vu les instabilités circonstancielles » nous explique la BAD. Ce type d'obligations ciblées est donc plus adapté aux pays ayant accès aux marchés internationaux et cherchant un financement pour un projet environnemental spécifique mais par contre il ne convient pas aux pays surendettés qui veulent améliorer la viabilité de leur dette à long terme et pour lesquels les obligations liées aux ODD sont plus pertinentes.
b) Les obligations liées au développement durables
Elles sont plus récentes et apparues avant la pandémie. Elles s'adressent principalement au secteur privé. Elles sont émises à un taux inférieur à celui du marché. Elles sont indexées à un ou plusieurs ODD (objectifs de Développement Durable) et dépendent d'Indicateurs Clés de Performance (ICP) à atteindre à une échéance précise. Des normes de bonnes pratiques sont définies. L'encadrement méthodologique est plus précis et contrôlé. Elles présentent l'avantage d'un plus grand choix d'affectation des fonds mobilisés. Elles sont utilisables pour combler des déficits budgétaires, refinancer des dettes existantes... « Elles sont plus transparentes pour les créanciers et peuvent plus difficilement cacher des écoblanchiments »
Selon le rapport de la BAD, « Des experts secondaires peuvent évaluer à mi-chemin les progrès effectués sur base des ICP et les paramètres financiers peuvent être modifiés si les conditions ne sont pas remplies dans la première partie. Le taux d'intérêt peut être relevé et un coupon progressif peut être émis dans le secteur privé, le paiement d'une prime supplémentaire à l'amortissement ou coupon dégressif en cas d'atteinte ou un système d'ajustement pondéré peut être mis en place en fonction des ICP plus ou moins respectés. Ces obligations peuvent avoir des retombées positives et ne détériorent pas la prime verte ». Une obligation ODD souveraine est attendue et le groupe POTOMAC (cabinet de conseil pour les PME, investisseurs, grands groupes et fonds d'investissement) et la Banque Mondiale y réfléchissent. En effet, les conséquences de la non atteinte d'ICP sont différentes quand il s'agit d'un acteur privé car un État souverain ne peut pas faire faillite. Ils ont besoin d'un cadre juridique pour permettre l'analyse et l'audit par un tiers.
« Un créancier reçoit le paiement d'un coupon à un taux inférieur au marché. La différence est transférée par le gouvernement dans un fonds fiduciaire extraterritorial, subventionné par des donateurs. Si les ICP ne sont pas réalisés, le créancier reçoit la part versée par le souverain dans ce fonds, un rendement cette fois au taux du marché. Si les ICP sont atteints, le souverain reçoit un paiement en espèce de la fiducie (la différence de rendement auquel s'ajoute un fonds supplémentaire). Pour qu'un Etat puisse être intéressé, il faut que l'atteinte des ICP lui apporte une plus-value plus importante, ou que l'obligation se réalise à une plus large échelle. Un simple ajustement de coupon serait insuffisant à ses yeux. »
c) Les obligations ODD de la BOAD
Dans son article « L'Afrique lance aussi ses obligations vertes » publié le 2 juin 2021 sur le site du Figaro, Anne Cheyvialle, journaliste spécialisée en économie internationale, décrit le phénomène avec enthousiasme.
Depuis 2020, la banque ouest africaine BOAD lance sa première obligation à objectif durable (pour un montant de 750 millions d'euros, sur 12 ans, sursouscrite 6 fois, avec une demande totale de 4,4 milliards d'euros) « Elle a attiré, dès le début, 260 investisseurs internationaux avec un taux attractif de 2,75%, bien inférieur au prix de marché. À titre de comparaison, le coût moyen des eurobonds sur des émissions d'une durée de dix à quinze ans, réalisées entre 2018 et 2020, a atteint 7,5 %, selon une récente étude de l'Agence française du développement sur la soutenabilité des dettes africaines ». Ainsi, en mars, le Ghana a emprunté pour 1 milliard de dollars à douze ans au taux de 8,625 % !
« Les obligations vertes et sociales de la BOAD ont beaucoup de succès pour diverses raisons. Tout d'abord, elles sont en accord avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations unies. Elles visent prioritairement à financer les secteurs de l'agriculture, de la sécurité alimentaire, des énergies renouvelables, des infrastructures de santé, de l'éducation et l'habitat. Des objectifs de résultats par rapport à ses ODD sont inscrits dans le plan stratégique de la BOAD à horizon 2025. Ensuite, nous avons vu que leur taux d'intérêt sont compétitifs. Enfin, elles présentent des garanties de transparence (grâce à un fléchage rigoureux des projets, un reporting précis) qui attirent les grands gestionnaires d'actifs et les fonds de pension. Ces derniers apprécient aussi le fait que ces emprunts puissent être de longue durée ce qui est nécessaire pour financer par exemple des projets d'infrastructure pour les énergies et les transports renouvelables. »
Basée à Lomé, la BOAD intervient dans huit pays – le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo - de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Un des premiers projets financés par l'émission pourrait être une centrale solaire au Bénin.
Le cas des obligations ODD du Bénin
Le Bénin a été retenu en 2018 pour participer au programme pilote conjoint du FMI et de l'ONU portant sur l'évaluation des besoins de financement pour l'atteinte des ODD, aux côtés de 4 autres pays à travers le monde. À la fin seuls deux pays africains ont été sélectionnés dans cette liste restreinte. Suite à cette sélection, le Bénin publie un document-cadre d'émission obligataire ODD en juillet 2021 fort étayé et bien présenté qui fait rêver, à la manière d'un prospectus publicitaire. Dans son introduction, Romuald WADAGNI, le Ministre d'État chargé de l'Économie et des Finances et du Plan, en précise l'intention. Ce document cadre d'émission obligataire ODD vise à intégrer l'Agenda 2030 des Nations Unies à toute l'action publique du Bénin. Sur base d'un diagnostic et d'une analyse chiffrée de la situation du Bénin au regard des ODD, après concertation avec différentes parties-prenantes pour une planification stratégique budgétisée, il présente la stratégie de financement extérieur via les marchés internationaux de capitaux. Le Bénin veut ainsi offrir aux investisseurs une transparence accrue sur l'utilisation des fonds levés. Comme garantie, il signale que l'agence Vigeo Eiris (V.E.) a attesté de sa conformité aux meilleurs standards pratiques de marché en finance durable (obtenant le score le plus élevé) et précise qu'il jouit d'un partenariat technique innovant avec le Réseau des solutions de développement durable des Nations unies (SDSN).
« Ce partenariat technique avec une organisation qui travaille sous les auspices des Nations unies et est spécialisée dans le diagnostic et la documentation des tendances ODD permettra de suivre les progrès accomplis, d'évaluer la pertinence des politiques publiques menées, ou encore d'identifier les lacunes à combler, permettant ainsi une réorientation et une adaptation des politiques ». Le Bénin souhaite élargir sa base d'investisseurs internationaux, partenaires financiers bilatéraux et multilatéraux, mais aussi et avant tout d'investisseurs privés béninois.
Pourtant, en lisant les avertissements à la fin du document, on comprend aussi les limites et la fragilité de cette présentation stratégique d'investissement.
En effet, on comprend qu'il n'a finalement aucune valeur juridique, aucune obligation d'exactitude, intégrité, caractère raisonnable et exhaustivité des informations ; aucun devoir de rectification s'il y a erreur ou de réactualisation en cas de changement données. Il ne s'agit pas de promesses ou de prévisions mais juste d'hypothèses prospectives.
Il n'y pas de vérification ou d'évaluation extérieure aux parties prenantes, indépendante et impartiale. Le document n'a aucune valeur juridique ou contractuelle contraignante. Le document n'est pas approuvé par une autorité réglementaire financière. Il n'y pas d'obligation de résultat ou même de respect des objectifs défendus, aucun recours n'est possible contre l'État dans ces cas-là.
« Un manquement de la République du Bénin au titre de ce Cadre ne constituera pas un cas de défaut ou un manquement à une quelconque obligation contractuelle des termes et conditions de tout titre émis en référence au présent Cadre, y compris si des projets éligibles ne sont pas financés ou ne sont pas réalisés, si un financement, directement ou indirectement, bénéficie à des activités exclues, si les rapports sur l'utilisation des produits et les impacts environnementaux ne peuvent être remis aux investisseurs conformément au présent Cadre en omettant (en raison d'un manque d'informations et/ou de données fiables ou autre), ou de toute autre manière ».
Pas de garantie non plus face à des catastrophes externes ou internes. Seuls les investisseurs sont rendus entièrement responsables.
« Sur la base de ce qui précède, toute responsabilité, qu'elle soit délictuelle, contractuelle ou autre que tout acheteur de titres ou toute autre personne pourrait autrement avoir en lien avec le présent cadre ou tout titre émis par la République du Bénin lié à un manquement au titre de ce cadre est par les présentes exclue dans toute la mesure permise par la loi ».
Malgré ces avertissements, les obligations ODD du Bénin remportent un grand succès comme le clame Romuald Wadagni, le Ministre d'Etat de l'Economie et des Finances béninois, dans un article intitulé « Le Bénin réussit sa première émission d'un Eurobond ODD » publié sur le site de Financial Afrik le 16 juillet 2021. Il se réjouit de cette première émission d'obligations internationales dédiées au financement de projets à fort impact sur l'atteinte des Objectifs de Développement Durable des Nations-Unies, la première émise par un Etat africain, pour un montant de 500 millions d'euros (328 milliards FCFA), avec une échéance de remboursement fixée en 2035.
« A cet effet, une délégation officielle de la République, conduite par, M. Romuald Wadagni, a tenu des entretiens bilatéraux avec un grand nombre d'investisseurs institutionnels internationaux de premier plan, organisés les 13 et 14 juillet 2021. Les investisseurs ont adhéré aux réalisations et au programme social du gouvernement du président Patrice Talon. Cet Eurobond a été conclu à un coupon de 4,95%, traduisant la confiance des investisseurs en la signature du Bénin. Une prime négative de nouvelle émission de 0,20 point de pourcentage a été obtenue, traduisant l'appétit significatif des investisseurs pour cet instrument innovant. Le niveau de sursouscription a représenté près de 3 fois le montant recherché. Une centaine d'investisseurs y ont participé, dont plusieurs pour la première fois pour une opération du Bénin. Le Bénin parvient donc à mobiliser des fonds à des taux plus bas que ceux des Eurobonds de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, deux poids lourds de l'Union économique et monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ». L'auteur de l'article espère qu'à la suite du Bénin, « beaucoup de pays africains s'engouffreront dans la nouvelle voie pour le financement équitable et vert de leur économie ».
d) Critique des obligations vertes
Malgré cet espoir, de nombreux avis contraires appellent à la prudence et émettent des réticences par rapport à la relance verte, cette forme de capitalisme vert, qui peut utiliser les obligations vertes et bleues, comme des opérations de marketing tout en continuant à nuire aux équilibres naturels et humains de notre planète.
Les obligations vertes ou bleues perpétuent le mécanisme vicieux de la dette qui engendre lui-même la destruction des systèmes de régulation publics et socialisés cherchant à protéger la nature, les biens communs et les intérêts des populations contre les abus de certains acteurs institutionnels et privés plus intéressés par des gains immédiats et particuliers. Les dangers du greenwashing et de l'écoblanchiment via ces obligations sont bel et bien réels.
Faire appel à des acteurs privés, guidés par la maximalisation du profit à court terme, et leur confier la gestion des problèmes mondiaux du réchauffement climatique ou la protection la biodiversité, dont notre survie à toustes dépend, ce n'est pas la stratégie que défend ATTAC et le CADTM. Ils revendiquent des changements plus structurels et profonds indispensables à une véritable bifurcation écologique et climatique et qui semblent inconciliables à leurs yeux avec des politiques néolibérales qui se sont révélées jusqu'à présent écocides, injustes, non démocratiques et meurtrières, politiques qui ne sont toujours pas remises en causes fondamentalement par les institutions internationales telles que le FMI, la Banque Mondiale ou la BAD, malgré les crises récurrentes et dramatiques qu'elles provoquent, en dépit de la colère croissante des populations des pays surendettés africains qu'elles ont continuellement lésées. Ces institutions s'obstinent à promouvoir coûte que coûte une même logique même si elles prétendent lancer des réformes pour une transition douce et durable, en invitant aujourd'hui le secteur privé à atténuer les effets dévastateurs les plus gênants du système capitaliste.
En fait le Font Monétaire International, La Banque Mondiale, les institutions européennes, la Banque Africaine de Développement essaient de garantir ce que jean Nanga appelle « le suprématisme du secteur privé », l'extension de son emprise sur nos existences, sur le vivant. Ils cherchent à « légitimer cette domination capitaliste en voie d'absolutisme, cette mondialisation marchande, ce totalitarisme du capital ».
Celui-ci est pourtant de plus en plus contesté par des mouvements sociaux qui résistent et protestent à travers le monde malgré la violence des répressions.
Dans son rapport de 2017 « La finance verte est-elle vraiment verte ? », ATTAC doute de l'efficacité des Green Bonds ( obligations vertes) et Climate Bonds ( obligations climat) à financer la bifurcation écologique et sociale espérée, une société sans carbone, écologiquement, socialement et démocratiquement saine.
Voici quelques points critiques des obligations vertes utiles pour notre analyse, exposés dans l'étude précitée :
1) Les obligations sont autoproclamées vertes ou respectueuses du climat la plupart du temps sur une base volontaire, en se basant sur des principes édictés mais qui n'ont aucune valeur contraignante. En effet, sur les 3493 obligations émises par 1128 institutions ou entreprises, de 2005 à 2017, seulement 25% étaient certifiées ce qui représente seulement 221 milliards de US.
2) Même si elles sont en pleine expansion (avec une hausse de 92% en 2016 qui se réduit à 59% en 2017), les obligations vertes ne représentent qu'une goutte d'eau par rapport au marché obligataire international global (seulement 0,1% en 2017 c'est-à-dire 100 000 milliards de USD sur un total de 700 000 milliards de USD !). Elles ne sont pas suffisantes pour répondre à l'importance de l'enjeu climatique. Selon le rapport « Mobilising Bond Markets or a low carbone transition » de l'OCDE en 2017, « les obligations vertes pourraient atteindre 5000 Milliards de USD en 2035 et augmentent annuellement de 700 milliards de dollars annuellement mais nous avons besoin de 2260 milliards de dollars annuels en 2035 pour permettre une diminution du carbone suffisante afin de ne pas dépasser la limite des 2°c de réchauffement climatique préconisée par le GIEC ».
3) Les institutions internationales et les gouvernements réalisent un effet d'annonce important mais ne mettent rien en place pour éviter que ces obligations vertes ne soient utilisées que comme des opérations de greenwashing par les géants pollueurs publics ou privés.
4) Aucune liste précise des projets financés par cette voie n'a été publiée.
5) Le fait que certaines obligations vertes soient validées par les agences de notation comme Vigéo n'est pas une garantie suffisante car beaucoup de projets que cet organisme a certifié sont aujourd'hui controversés au point de vue social ou écologique.
6) Il est important que les obligations vertes exclues certains secteurs incompatibles avec les objectifs verts et sociaux poursuivis tels que les énergies fossiles, le nucléaire, l'armement et qu'ils soutiennent d'autres importants pour assurer la transition : le transport, le bâtiment, l'énergie renouvelables, tout ce qui protège la biodiversité et favorise l'adaptation au changement durable.
7) Les obligations vertes ne doivent pas être qu'un effet d'aubaine ou un coup de com bon marché. Elles doivent servir à financer des projets d'infrastructures vertes sur le long terme.
8) Il n'y a pas de certification verte standard communément admise et externe, impartiale même si certaines initiatives comme la Taxonomie verte de la Commission Européenne semble avancer dans ce domaine ( voir plus loin la partie sur les avancées européennes dans la finance durable)
9) Les critères ne sont pas contraignants et ne sont que des recommandations
Il existe des labels internationaux et des initiatives volontaires pour réguler la finance verte : les Green Bond Principles et la Climate Bonds Initiative qui rendent publics les critères pour encadrer les obligations vertes et l'Union Européenne a aussi rendu public en 2020 son « Standard Européen d'Obligations Vertes » ( voir la partie consacrée aux avancées européennes dans le finance durable).
Les Green Bonds Principles (GBP) sont admis par 150 membres principalement des acteurs financiers et 114 observateurs dont le WWF. 270 sur 567 obligations émises en 2016 proviennent des membres du GBP et malheureusement, l'on peut constater que la plupart ne respectent pas eux-mêmes leurs principes comme par exemple Engie, UnibailRodamco ou la BAD qui ne rendent pas publique la liste des projets verts qu'ils soutiennent alors que cela fait partie des préconisations GBP. Autre exemple, Engie, émet des obligations vertes GBP qui indirectement participent à la destruction de l'Amazonie et violent les droits des autochtones sur les terres faisant l'objet de déforestations pour construire les barrages « durables » soutenus par Engie ! On ne tient pas compte de l'effet rebond c'est-à dire du fait qu' Engie, par exemple, utilise des obligations vertes pour financer des projets d'efficacité énergétiques et d'infrastructures durables... d'usines qui vont finalement contribuer à émettre d'avantage de Gaz à Effet de Serre nocifs pour l'environnement. C'est donc très contradictoire et controversé.
Les Climate Bonds Standards (CBS) sont un peu plus strictes et détaillés. Au moins, à la différence des CBS, ils excluent les énergies fossiles, l'extraction d'uranium, les barrages, la capture et le stockage de carbone. Néanmoins, souvent, ce qui compte le plus pour les investisseurs, ce qui est vraiment évalué, c'est la cote que ces obligations ont sur les marchés or celle-ci dépend plutôt de leur rentabilité que du respect des normes vertes avancées qui ne sont pas souvent vérifiées. Il n'y a pas de contrôle à posteriori.
De toute manière, aussi bien les GBP que les CBS sont admis sur base volontaire, non assortis de sanctions ou de réduction de cote en cas de non-respect des principes convenus et les violations des droits humains ne sont pas prises en compte.
10) On n'évalue ni la qualité ni l'atteinte des objectifs et surtout, on n'évalue pas la qualité de l'institution ou de l'entreprise qui émet les obligations dans son ensemble or ce sont souvent des acteurs fort pollueurs qui utilisent les obligations vertes pour séduire l'opinion publique. Peu nous importe qu'ils financent une activité durable avec des obligations vertes si par ailleurs ils continuent à promouvoir globalement une majorité d'actions néfastes pour l'environnement. Par exemple, Repsol est la première compagnie pétrolière à émettre une obligation verte pour prolonger la durée de vie ...de ses raffineries ! Elle a émis 500 millions d'euros d'obligations vertes à échéance pour 2022 pour financer l'efficacité énergétique de raffineries énergétiques et d'usines chimiques en Espagne et au Portugal ce qui lui a permis de diminuer de 1,2 millions de tonnes de CO2 sur un total de ... 20 millions de tonnes de CO2 qu'elle continue à dégager par an ! Ces obligations vertes ont été certifiées GBP et elle a passé l'examen externe de Vigéo ! Repsol n'a rien mis en place pour contrer cet effet rebond !
11) Les agences de notations comme Moody's notent les obligations vertes en fonction de la capacité des émetteurs à rembourser leur dette obligataire. GB1 est excellent, GB5 est très mauvais. Les obligations de l'aéroport de Mexico sont notées GB1 alors qu'au bout du compte le projet promeut une activité polluante très nocive pour l'environnement et le climat - le transport aérien - même si par ailleurs il est alimenté par des panneaux solaires, économise l'eau et est neutre en carbone.
12) Quelles sont donc les garanties ? La Pologne est un des premiers pays à avoir émis des obligations vertes alors que d'un autre côté, c'est un État qui freine fortement les négociations pour plus de prise en compte des impératifs climatiques et écologiques lors des COP et qu'il a du mal à renoncer au développement de ces centrales productrices de charbon. La certification verte ne peut être accordée sans tenir compte du contexte plus global. Il faut que les acteurs émetteurs d'obligations vertes soient cohérents et prennent activement part à une stratégie globale en faveur du climat et de l'environnement, qu'ils ne se contentent pas seulement de quelques actions superficielles pour reverdir leur réputation.
13) Des taux d'intérêts des obligations vertes moins élevés pourraient encourager le changement
14) Pour l'instant, l'émission d'obligations vertes est restreinte aux opérateurs bénéficiant d'une grande assise financière (gouvernements, transnationales, banques etc.) mais ce serait intéressant que de petites et moyennes entreprises, des coopératives, des collectivités locales bien ancrées localement et conscientes des enjeux sociaux, démocratiques et écologiques puissent aussi émettre des obligations vertes pour financer des projets durables participatifs et locaux. Vaut-il mieux financer une petite entreprise développant des énergies renouvelables ou bien EDF, le champion nucléaire pour une activité qui sert à reverdir son image ou la Chine qui finance avec les obligations vertes les infrastructures durables...de sa nouvelle route de la soie (OBOR) ! Car la certification verte devient parfois un prétexte pour remporter des parts de marché dans un contexte de compétition internationale.
Après la crise financière de 2007-2008 et face aux manipulations du greenwashing, peut-on encore faire confiance au marché financier non régulé ? Quelles sont les recommandations tirées du rapport d'ATTAC sur la finance verte ?
3) Les recommandations sur la finance verte d'ATTAC
1) Assurer la régulation du marché obligataire vert par les pouvoirs publics
2) Établir un cadre clair et précis, avec un stand européen ou international garanti par un régulateur public
3) Tenir compte dans la certification de la qualité de l'émetteur, de l'ensemble de ses activités soutenables ou en cours de transition, et de l'engagement manifeste de l'émetteur dans la transition
4) Exclure fermement et définitivement tout projet climaticide et écocide relatif aux énergies fossiles, au nucléaire, aux agro carburants, à de grands barrages, au stockage ou captage de carbone, des incinérateurs à haut niveaux de déchets.
5) Garantir la transparence, la vérification des résultats sur base d'études d'impacts préalables et prévoir des sanctions par le régulateur avec une possibilité de décertification en cas de non-respect des normes
6) Créer une nouvelle agence de notation impartiale et publique pour encadrer les obligations vertes, financée par des fonds européens, internationaux ou par une taxe sur les transactions financières ne concernant pas les produits verts. Elle serait composée d'un collège tripartite (avec des représentants des investisseurs, des syndicats et d'ONG). Son évaluation des projets financés portera sur leur totalité en tenant compte des dimensions sociale, écologique, climatique et démocratique. Elle pourra dégrader la note et sanctionner financièrement les émetteurs si les engagements annoncés ne sont pas satisfaits, si l'information communiquée n'est pas correcte, manipulée ou pas disponible pour le public et les investisseurs concernés.
7) Contraindre l'ensemble du marché obligataire à respecter l'environnement et devenir compatible avec les impératifs climatiques et pas seulement une partie minime et marginale du marché consacrée aux obligations vertes. Interdire tout investissement dans les secteurs climaticides et augmenter la régulation et le contrôle par les pouvoirs publics dans ce domaine.
8) Créer de nouveaux canaux financiers à un taux d'intérêt avantageux pour les petits acteurs qui n'ont pas accès au marché obligataire et qui pourraient développer des projets locaux participatifs favorables à l'environnement, au développement durable et au climat notamment grâce à l'épargne publique et de nouveaux crédits bancaires
9) Créer une banque publique dotée de moyens suffisants pour financer des investissements à long terme nécessaire à la bifurcation écologique et sociale sans être directement prisonniers des critères de rentabilité économique à court termes qui caractérisent la majorité des investissements privés.
4) Avancées européennes en matière de finance verte
Sur le site du Conseil de l'Europe, on constate différentes propositions de directives récentes qui montrent que les institutions européennes bien que très favorables aux obligations durables, qu'elles considèrent comme l'un de leurs principaux instruments de lutte contre le réchauffement climatique et pour la transition durable, et bien qu'elles soient prêtes à en émettre elles-mêmes, sont aussi conscientes de certains problèmes évoqués précédemment et certains membres essaient de légiférer pour mieux contrôler leurs dérives potentielles.
Tout d'abord, le 25 septembre 2019, elle publie un communiqué de presse relatif à un accord sur une proposition de création d'une taxonomie unifiée à l'échelle de l'UE, c'est-à-dire sur un système de classification commun qui définisse clairement ce qu'est une activité économique durable sur le plan environnemental car elle reconnaît que jusque-là, il n'en existe aucun.
Le 8 novembre 2019, le Conseil adopte deux règlements sur la finance durable. L'un introduit des obligations de publication d'informations sur la manière dont les sociétés financières intègrent les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leurs décisions en matière d'investissement. Le deuxième crée de nouveaux types d'indices de référence visant à donner davantage d'informations sur l'empreinte carbone d'un portefeuille d'investissement.
Le 7 mars 2019, le conseil publie un communiqué de presse annonçant un accord provisoire entre le Conseil de l'Europe et le Parlement européen sur la proposition d'introduire des obligations de transparence concernant la manière dont les sociétés financières intègrent les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leurs décisions d'investissement.
Le 4 octobre 2022, le Conseil approuve des conclusions dans lesquelles il est fermement résolu à obtenir des résultats en ce qui concerne le Financement de l'action climatique, dans la perspective de la conférence des Nations unies sur le climat (COP27) qui s'est tenue à Charm el- Cheikh. Le Conseil a rappelé que l'UE et ses États membres étaient les plus grands contributeurs au financement public international de l'action climatique et que, depuis 2013, ils avaient plus que doublé leur contribution au financement de l'action climatique pour soutenir les pays en développement. Le Conseil a également invité les autres donateurs à intensifier leurs efforts et espère que l'objectif collectif de réunir 100 milliards de dollars par an pour financer l'action climatique sera atteint en 2023. Cette promesse n'a toujours pas été tenue actuellement.
Dans un graphique, le Conseil de l'Europe reprend les contributions de l'Europe au financement de l'action climatique des pays en développement qui ont plus que doublé de 2013 à 2021 dont voici les chiffres :
L'UE et ses États membres ont mobilisé pour l'action climatique des PVD :
9,60 milliards d'euros en 2013
14,5 milliards d'euros en 2014
17,6 milliards d'euros en 2015
20,2 milliards d'euros en 2016
20,4 milliards d'euros en 2017
21,7 milliards d'euros en 2018
23,2 milliards d'euros en 2019
23,4 milliards d'euros en 2020
23,0 milliards d'euros en 2021
Ces chiffres comprennent les fonds provenant des budgets publics et des institutions de financement du développement de l'UE, de ses États membres (y compris le Royaume-Uni) et de la Banque européenne d'investissement.
Le 13 avril 2022, le Conseil arrête sa position sur les obligations vertes européennes considérées comme l'un des principaux instruments de financement des investissements liés aux technologies vertes, à l'efficacité énergétique et à l'utilisation efficace des ressources, ainsi qu'aux infrastructures de transport et de recherche durables. L'UE prend de nouvelles mesures pour mettre en œuvre sa stratégie relative au financement de la croissance durable et de la transition vers une économie neutre pour le climat et efficace dans l'utilisation des ressources. Le règlement concerné définit des exigences
uniformes applicables aux émetteurs d'obligations qui souhaitent utiliser l'appellation « obligation verte européenne » ou « EuGB » pour les obligations durables sur le plan environnemental qu'ils proposent aux investisseurs dans l'Union, et établit un système d'enregistrement et un cadre de surveillance pour les examinateurs externes d'obligations vertes européennes.
Maintenant que le Conseil a arrêté sa position sur la proposition, il est prêt à entamer des négociations avec le Parlement européen afin de parvenir à un accord sur une version définitive du texte.
Le 28 février 2023, le Conseil et le Parlement sont parvenus à un accord provisoire sur la création sur la création d'obligations vertes européennes (EuGB). Le nouveau règlement vise à prévenir l'écoblanchiment sur le marché des obligations. Les émetteurs d'obligations seront en mesure de démontrer qu'ils financent des projets écologiques alignés sur la taxinomie de l'UE, tandis que les investisseurs pourront identifier plus facilement les obligations vertes de haute qualité.
Conclusions
Les échanges dette-nature, sous leurs formes variées, innovantes et médiatiquement séduisantes, malgré les efforts d'adaptation aux circonstances aggravantes, aux différents types de débiteurs et de créanciers concernés, ne peuvent répondre au surendettement, aux obstacles au développement durable et au réchauffement climatique qui mettent l'Afrique en danger, sans une remise en cause radicale du système capitaliste, extractiviste et écocide qui continue à engendrer et exacerber ces réalités problématiques.
a) Les résultats décevants du sommet de Paris de juin 2023
Lors du sommet de Paris de juin 2023 chapeauté par Emmanuel Macron, le président français pensait trouver, à travers un nouveau pacte financier, un consensus pour lutter à la fois contre le réchauffement climatique et le surendettement des pays africains entre autres au moyen d'une nouvelle relance verte, basée sur les obligations vertes et l'investissement croissant du secteur privé, stratégie encouragée par la Banque Africaine de Développement comme nous venons de le voir. D'ailleurs Akinnwumi Adesina, le président de la BAD, a profité de cette occasion pour résumer en 7 points sa vision très néolibérale des réformes qu'il souhaite entreprendre. L'article du Monde Afrique publié le 21 juin 2023 en reprend les grandes lignes.
« Il s'agit de s'attaquer en priorité au changement climatique (1) et aussi de faire face aux crises croissantes de la dette dans le monde (2), en particulier en Afrique. Dans cet objectif, il faut déclencher des fonds et instruments financiers urgents mondiaux via la Banque Africaine de Développement (nous en avons eu un aperçu dans les parties 1, 2 et 3 de cette étude) et le FMI (3). Il faut changer les modèles opérationnels des institutions financières multilatérales (4) et renforcer l'effet de levier du financement du développement par le secteur privé (5) de manière à augmenter le capital libéré des Banques Mondiales de Développement (6). Enfin, il faut promouvoir les efforts régionaux pour s'attaquer aux risques systémiques en Afrique par le Mécanisme Africain de Stabilité Financière (7). »
Le sommet n'a pas remporté l'adhésion des pays africains malgré quelques nouvelles restructurations ou transfusions accordées.
En effet, les états ne se sont pas accordés sur la clause de « dette résistante au climat » ou « clause des catastrophes naturelles » pour laquelle la Première ministre de la Barbade, Mia Mottley, a longuement bataillé, sur laquelle un certain soutien international avait semblé émerger et qui a pour objectif de permettre la suspension des remboursements de la dette en cas de désastres naturels. Il ne met pas en place des fonds d'adaptation mais aussi de réparations écologiques et climatiques qui pourraient justifier des annulations massives de dettes ou des financements directs. Que prévoit-il concrètement contre l'évasion fiscales et la fuite des capitaux afin de dégager des marges de manœuvre budgétaire ? Les suggestions ne manquaient pas : un registre mondial des sociétés-écrans, un échange automatique d'informations, un cadastre financier mondial...mais elles n'ont pas été retenues. La remise en cause du pillage des pays les plus pauvres par les traités de libre-échange et d'investissements, les conséquences de l'hégémonie du dollar ou bien l'injustice d'un taux d'intérêt inégal dans le monde n'ont pas été entendus. Un ministre raconte : « un gouvernement du pays riche emprunte sur dix ans à un taux de 1,4 % par an, tandis que le pays en développement emprunte à 11 %. Certains de ses voisins empruntent à 20 %. Les taux d'emprunt du secteur privé sont le taux du gouvernement plus une prime, donc le coût du capital d'un projet d'énergie renouvelable financé par le secteur privé dans le pays riche aurait été proche de 4 %. Dans les pays en développement, il est de 15 % ». Mais cet argument n'est pas pris en compte. « Depuis 1980, les pays du Sud ont remboursé 18 fois ce qu'ils devaient en 1980 et dans le même laps de temps, leur niveau d'endettement a été multiplié par plus de 12 : quand le système dette s'arrêtera-t-il ! » Protestent certains interlocuteurs africains alors que l'énumération des nouveaux prêts, suspensions et facilités très partielles accordées ne résout rien à la détresse des pays surendettés. Les nouvelles taxes internationales comme la taxe carbone sur le transport maritime ou la taxe sur les transactions pour alimenter les fonds à destination des pays les plus vulnérables et leur permettre de se protéger face au changement climatiques (comme le fond de pertes et dommages) ont été citées mais pas adoptées. Le principe du pollueur/payeur ou l'interdiction de financer des projets fossiles semblent communément admis mais pour l'instant pas encore opérationnalisés de manière généralisée. Comment abandonner les énergies fossiles sans compensations pour les pays les plus vulnérables qui dépendent complètement de ces ressources ? Que de demandes et de questions restées sans réponses ! Le sommet de Paris est bien décevant.
Le CADTM, ATTAC s'opposent fermement à cette stratégie exposée par le président français Emmanuel Macron ou à celle des institutions financières internationales comme la BAD qui ne rencontrent pas les besoins urgents des pays africains et ne répondent pas à leur gronde légitime.
b) Reprendre la main pour financer la bifurcations sociale et écologique (ATTAC)
Dans le rapport de l'Observatoire de la justice fiscale et de l'espace banque finance d'ATTAC « Reprendre la main pour financer la bifurcation sociale et écologique », sorti en octobre 2022, des analystes critiques appellent à une bifurcation écologique et sociale transformant complètement la société et ils recommandent pour y parvenir la mise en œuvre d'une gamme d'instruments et de politiques publiques coordonnées, par un policymix combinant des mesures budgétaires, fiscales, financières, monétaires et réglementaires orientées vers le changement durable.
Il ne s'agit plus uniquement de faire plus avec moins, d'axer tout le système de management sur la performance économique à court terme et la rigueur budgétaire, creusant les déficits publics et aggravant les dettes. Il faut de vrais investissements politiques et financiers solidaires, planifiés et contrôlés publiquement et impartialement, pour protéger l'humanité et la planète, en dehors des seuls critères de rentabilités et des recherches de profits particularistes.
Cela passe par des réformes fiscales qui instaurent la progressivité dans l'imposition du capital et du revenu, assurent une redistribution de manière à réduire les inégalités entre les pays, entre les individus, entre les hommes et les femmes et une fiscalité qui refinance les services publics essentiels à la qualité du développement.
Il faut réorienter les BCE, BM et FMI afin que ces institutions financières et monétaires annulent les dettes publiques des pays du sud et qu'elles se concentrent sur des financements à long terme, visant à transformer le système productif et à renforcer les normes, la régulation et les contrôles contre la spéculation sur l'endettement des plus démunis et l'exploitation abusive des ressources naturelles, contre la course vers le profit de transnationales les plus puissantes souvent les plus polluantes et parfois criminelles. Il faut s'opposer à la corruption des fonctionnaires qui les laissent faire ainsi qu'aux évasions fiscales et à la fuite des capitaux. Le rapport salue l'initiative proposée en 2019 de créer un réseau international des banques centrales et des superviseurs pour le verdissement du système financier qui rassemble déjà une centaine de pays. Une belle avancée qui répond à un besoin de coordination de toutes ces initiatives à l'échelle mondiale.
Le rôle des banques centrales ne devrait pas seulement réduire l'inflation en augmentant les taux d'intérêt ce qui fait pression sur la masse salariale, et les pouvoirs d'achat des ménages en créant des dégâts sociaux et en rendant plus « chère » la transition durable escomptée. Lire à ce sujet l' article critique d' Éric Toussaint « La Banque centrale européenne au service des 1% les plus riches » paru le 30 juin 2023 . Il faut reconsidérer leur indépendance politique actuelle, distinguer leur autonomie opérationnelle de leurs intérêts politiques, pour qu'elles se mettent vraiment au service de l'intérêt général. Ce sont les élus et leurs gouvernements qui doivent fixer les priorités et objectifs à atteindre. Les Banques Centrales doivent alors choisir les instruments les plus appropriés pour y parvenir au moyen de leur politique monétaire. Elles doivent ensuite rendre des comptes aux instances démocratiques. Elles devraient donc plutôt exercer un contrôle démocratique et veiller à ce que les financements servent bien à la bifurcation sociale et écologique en régulant et responsabilisant tous les acteurs en ce sens, sur l'ensemble et non sur une infime partie des opérations financières (donc pas seulement via des obligations vertes par exemple).
Elles pourraient financer directement des projets verts de grande envergure et des infrastructures de long terme qui n'ont pas de rentabilité immédiate tels que les hôpitaux publics, des voies ferrées, des écoles pour toustes etc. Il faut veiller à ce que les plans de relance concernent aussi les secteurs féminisés tels que la santé, l'éducation qui sont mis à mal par la logique du marché car ils ne sont pas immédiatement « rentables ».
Traditionnellement les banques centrales financent les banques commerciales à des taux d'intérêt directeurs : elles pourraient accorder un taux directeur préférentiel aux banques qui financent des projets durables (1% en dessous du taux officiel, par exemple). Après la crise de 2007-2008, la BCE a pu adopter une politique monétaire non conventionnelle facilitant le renflouement des entreprises et des États européens par l'achat d'obligations et titres de dettes émis par les États et les entreprises. Pourquoi ne pas le faire pour assurer la bifurcation écologique et sociale via l'achat d'obligations soutenant les projets durables et l'arrêt de tout investissement favorisant la production et la consommation d'énergies fossiles ? Pour l'instant, 60% des achats financés
par la BCE concernent au contraire le secteur les plus polluants de l'économie selon Attac, Oxfam, Veblen dans un communiqué du 4 juillet 2022 ! Elle annonce cependant de prochaines réformes.
Il faudrait obliger chaque banque à mettre en œuvre un plan de décarbonisation d'ici 2050, réduire la part des actifs bruns (qui à long terme seront dévalorisés jusqu'à disparaître) et en même temps augmenter significativement celle des actifs verts dans les bilans bancaires ; les banques doivent se prémunir des risques futurs de faillite en ayant un ratio fonds propres/fonds déclarés raisonnable mais aussi un ratio actifs verts/ actifs bruns de plus en plus positif. Elles doivent contrôler le marché des obligations vertes pour éviter le greenwashing, standardiser et vérifier la véracité des labellisations.
Sinon, une proposition de loi pour l'utilisation de l'épargne populaire en matière énergétique est une piste intéressante. Les livrets d'épargnes populaires LDDS (Livrets de Développement Durable et Solidaire) sont parfois aussi classés dans la finance verte. Ces livrets au fonctionnement proche du livret A mettent en avant leur participation dans la transition écologique. Ils ne doivent plus servir à développer des activités nocives mais uniquement des projets durables. Pour cela il faut accroître la transparence et le contrôle de l'emploi de ces sommes par les Banques Centrales et augmenter le rôle des
parlements par la publication d'un rapport trimestriel détaillé sur la nature des prêts accordés avec l'épargne populaire et que ce rapport soit accessible à la société civile. La même demande est formulée pour l'utilisation de l'argent des caisses de retraites.
En gros, pour les auteurs de cette étude, il est nécessaire de renforcer un pôle bancaire public ou socialisé, et de recourir à des lois internationales, nationales et locales protectrices des biens et intérêts communs des populations. Les banques privées gouvernent selon les intérêts de leurs actionnaires. Les banques publiques d'investissement et de développement devraient répondre aux intérêts généraux. Il faut diminuer le pouvoir des actionnaires et améliorer la coordination des politiques monétaires et budgétaires publiques (policymix) orientées vers les urgences sociales et écologiques. Il est important de rendre aussi aux parlements leurs rôles de propositions,
d'amendement des lois sur la finance et de contrôle démocratique des résultats en y associant les populations (en respectant leur droit d'être informées, formées, consultées, de voter), accroître la transparence, les possibilités de débats publics. Pouvoir évaluer les politiques publiques menées, avant, pendant et après, sur base de nouveaux critères et indicateurs, clairs, orientés vers la bifurcation écologique et sociale est essentiel. Les nouveaux critères pourraient être : la diminution des inégalités entre les individus, entre les hommes et les femmes, de la pauvreté, de la maladie, des Gaz à Effet de Serre et du carbone, des énergies fossiles, de l'artificialisation des sols ; l'augmentation de l'espérance de vie, du pouvoir d'achat, des conditions de vie, des services publics à la petite enfance et au personnes âgées, de l'éducation, des transports et bâtiments et les énergies renouvelables, de l'agriculture non intensive... Il faut donc une réorganisation et une attribution différentes des aides publiques sous contrôle véritable des parlements, dans des conditions et règles précises et en fonction des résultats obtenus en lien avec les objectifs de bifurcation écologique et sociale.
On peut aussi envisager de taxer les produits ou services les plus polluants mais à condition qu'une alternative existe : « si tu prends la voiture tu paies la taxe, si tu utilises les transports en commun, tu en es exonéré ». Ceci afin que le consommateur ne se sente pas prisonnier et lésé par un prélèvement supplémentaire sur la consommation, déjà que son pouvoir d'achat est limité et que ce système de taxe risque de peser plus lourd proportionnellement sur les classes moyennes et modestes que sur les milieux aisés. Attention, les écotaxes sur la consommation souvent plébiscitées par les économistes libéraux ont des limites : elles diminuent l'assise sur laquelle se calculent les prélèvements publics et par ailleurs, comme l'objectif est de diminuer la consommation de services et produits qui polluent, à long terme comme celle-ci devrait se réduire, les recettes qui en résulteraient tendraient donc à disparaître alors que les besoins de financement des réformes continueront d'augmenter. Ce n'est donc pas efficace. Il vaut mieux, taxer les kilomètres parcourus sans frontière, supprimer les exonérations des quotas d'émissions gratuits aux entreprises climaticides, établir des taxes de justice carbone sur les plus grosses entreprises surtout des secteurs polluants. La recette serait redistribuée aux ménages selon leurs revenus par un mécanisme progressif.
D'autres mesures intéressantes sont recommandées par ATTAC : supprimer les niches fiscales injustes et inefficaces ; créer un impôt progressif indexé sur les émissions de GES, induits par les placements financiers des ménages les plus fortunés ; moderniser l'impôt sur les sociétés en tenant compte de la numérisation ; taxer les superprofits des entreprises pour augmenter les recettes et neutraliser les hausses anormales de prix...
Mais toutes ces mesures doivent se faire dans le cadre d'une planification écologique et sociale assurant une cohérence globale des politiques publiques. En conclusion, voici les 7 recommandations mises en avant par le CADTM lors de sa présentation au parlement européen en octobre 2022.
c. Les 7 recommandations du CADTM
1.Annuler les dettes et s'opposer aux conditionnalités des créanciers
Les allègements ne suffisent pas. Les conditionnalités publiques ou privées aggravent la situation avec des conséquences désastreuses. Commencer par supprimer les paiements déjà suspendus.
Utiliser tous les leviers dont la promulgation de lois et règlementations pour obliger le secteur privé à prendre sa part dans les opérations de restructuration. L'annulation des dettes dues au FMI et à la Banque mondiale par les pays éligibles à l'Initiative ISSD dans la période allant d'octobre 2020 à décembre 2021 pourrait être financée très facilement par les bénéfices provenant de la seule vente de 6,7 % de l'or détenu par le FMI. Cela rapporterait jusqu'à 8,2 milliards de dollars US aux pays éligibles à l'ISSD. Si cela était fait immédiatement, le FMI disposerait encore de 164,5 milliards de dollars US de réserves.
2. Procéder à un audit de la dette publique avec participation citoyenne
Associer la société civile d'en bas du pays créancier et des pays débiteurs à l'audit de cette dette publique pour révéler les irrégularités et l'illégitimité de certaines dettes dont les créanciers continuent à percevoir le remboursement aujourd'hui.
Pour ce faire, rendre accessibles aux populations des pays africains à travers leurs associations/organisations autonomes, l'ensemble des documents, les classés « secret défense » inclus , afin de découvrir l'origine des dettes réclamées par les différentes catégories de créanciers.
3. Poser des actes unilatéraux pour assurer une protection effective des droits humains
Suspendre immédiatement et unilatéralement le paiement de dette par les États dans les cas où c'est nécessaire à la protection de leur population et afin de pouvoir assurer la satisfaction de leurs droits humains fondamentaux sur base du droit international en conformité avec leurs engagements internationaux (sur base de la Charte de l'ONU, de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 (DUDH), de la Charte sur les droits et les devoirs économiques des États (1974), de la Déclaration sur le droit au développement (1986) ou encore du Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) de 1966. Avec l'argent ainsi libéré, renforcer les systèmes publics, assurer de meilleurs services publics gratuits pour tous.
4. Lever les brevets privés pour un accès à la santé pour toutes et tous
Suspendre les brevets privés sur toutes les technologies, connaissances, traitements et vaccins liés au Covid-19. Éliminer des secrets commerciaux et publier les informations sur les coûts de production et les investissements publics utilisés, de manière claire et accessible à l'ensemble de la population. Assurer l'accès universel, libre et gratuit à la vaccination et au traitement. Exproprier sans indemnité des entreprises pharmaceutiques et des laboratoires privés de recherche et organiser leur transfert dans le secteur public sous contrôle citoyen.
5. Mettre un terme aux dispositifs fiscaux inégalitaires
Généraliser au niveau de l'Union européenne et au niveau international la loi belge qui s'attaque aux comportements des fonds vautours. S'opposer à la promotion systématique du secteur privé pour financer le développement des pays africains, et notamment s'opposer à la promotion des Partenariats Public-Privé (PPP). S'opposer aux traités d'investissement qui incluent la dette souveraine dans la couverture des traités d'investissement et le règlement des différends entre investisseurs et États. Mettre fin à l'aide publique au développement dans sa forme actuelle et la remplacer par une « Contribution de réparation et de solidarité » inconditionnelle et sous forme de dons, en excluant dans le calcul de celle-ci les annulations de dette et les montants ne servant pas les intérêts des populations africaines. Sanctionner lourdement les entreprises coupables de toute forme de corruption de fonctionnaires publics des pays africains.
Sanctionner les hauts fonctionnaires et le personnel politique qui dans les pays européens ont favorisé ou favorisent la spoliation sous différentes formes des peuples africains. Sanctionner lourdement les banques (y compris en allant jusqu'au retrait de la licence bancaire et à l'imposition de fortes amendes) qui se prêtent à du blanchiment d'argent sale, à l'évasion fiscale, à la fuite des capitaux, au financement d'activités participant au changement climatique et à la spoliation des populations africaines. Mettre fin au franc CFA.
6. Pour une politique d'endettement légitime auprès de banques socialisées
Socialiser les banques et les assurances en expropriant les grands actionnaires, afin de créer un véritable service public de l'épargne, du crédit et des assurances sous contrôle citoyen. Réaliser des emprunts légitimes en tant que pouvoirs publics pour lutter contre la crise écologique et pour booster les secteurs sociaux. Financer les pays africains, hors aide publique au développement, par des prêts à taux zéro, remboursables en tout ou partie dans la devise souhaitée par le débiteur. Introduire des taxes sur la richesse (patrimoine et revenus du 1 % le plus riche) pour financer la lutte contre la pandémie et assurer une sortie socialement juste et écologiquement pérenne des différentes crises du capitalisme mondial. Annuler le soutien au système du microcrédit abusif et à ses institutions, en favorisant leur remplacement par de véritables coopératives gérées par les populations locales et par un service public de crédit octroyant des prêts à taux zéro ou très bas.
7. Mettre en place une véritable politique de réparations
Adresser des excuses officielles publiques pour l'ensemble des crimes et des méfaits accomplis par les puissances européennes à l'égard des populations africaines, ouvrant le droit à des réparations. Affirmer le droit à des réparations et/ou compensations aux peuples victimes du pillage colonial et de la spoliation par le mécanisme de la dette. Exproprier les « biens mal acquis » par les gouvernants et les classes dominantes d'Afrique et les rétrocéder aux populations spoliées via un fonds spécial de développement humain et de restauration des équilibres écologiques sous contrôle effectif des citoyens et citoyennes des pays concernés. Reconnaître la dette écologique à l'égard des pays africains et procéder à des réparations et/ou compensations en récupérant le coût de ces dépenses par un impôt ou des amendes prélevées sur les grandes entreprises responsables de la pollution.

“Capacité à mobiliser, promesse de rupture” : la victoire écrasante du Pastef au Sénégal

Mamadou Albert Sy, analyste politique et journaliste passé par le quotidien “Walfadjri” et Info7 TV, décrypte pour “Courrier international” les raisons du succès du parti de Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko lors des législatives anticipées du 17 novembre. Une razzia électorale qui suscite d'énormes attentes au sein de la population.
Tiré de Courrier international. Légende de la photo : Le premier ministre sénégalais et chef du parti Pastef, Ousmane Sonko, lors d'un meeting de campagne dans la banlieue de Dakar, le 13 novembre 2024. Photo : Zohra Bensemra/Reuters
Courrier international : Le parti des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (Pastef) est arrivé en tête dans 47 des 54 circonscriptions électorales, selon les résultats officiels provisoires des élections législatives anticipées du 17 novembre. Il revendique 132 députés sur les 165 de l'Assemblée nationale. La “razzia” du parti au pouvoir, telle que l'a qualifiée la presse, est-elle une surprise ?
Mamadou Albert Sy : Au regard de la campagne électorale, ce n'est pas surprenant. Face aux trois coalitions emmenées par l'ex-président Macky Sall, l'ex-Premier ministre Amadou Ba et le maire de Dakar, Barthélémy Dias, le Pastef s'est démarqué par sa présence et sa capacité à mobiliser les foules à travers le pays.
Ce qui est un peu plus surprenant, c'est l'ampleur de la victoire. Lors des législatives de 2022, la coalition de la majorité présidentielle Benno Bokk Yakaar avait obtenu 83 sièges, et l'opposition, 80 sièges. Aujourd'hui, la coalition qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages face au Pastef, Takku Wallu, représentée par Macky Sall, n'aurait que 16 sièges.
Une telle domination parlementaire du parti au pouvoir est inédite depuis que le cycle d'alternance politique au Sénégal a débuté, en 2000. Dans l'histoire politique sénégalaise, cela renvoie à la domination du Parti socialiste à l'Assemblée nationale, de 1978 à 2001, face au Parti démocratique sénégalais (PDS, parti de l'ancien président Abdoulaye Wade).
Quels sont les ingrédients de cette large victoire ?
Outre la réussite de sa campagne, le Pastef bénéficie du désir de changement des électeurs. Ce vent-là continue de souffler : le parti au pouvoir incarne la rupture avec un système politique qui prévaut depuis l'indépendance.
De son côté, l'opposition n'a pas réussi à concurrencer Ousmane Sonko sur le terrain. Elle était moins visible et s'est confrontée à un problème de leadership. Macky Sall était à l'étranger, Karim Wade, chef de file du Parti démocratique sénégalais rallié à la coalition Takku Wallu, également. Ils ont fait campagne sur WhatsApp. Cela peut marcher avec les états-majors des partis politiques, mais pas avec les électeurs.
Qui sont les plus grands perdants de ce scrutin ?
Il s'agit des anciens partis. L'Alliance pour la République (APR) de Macky Sall est affaiblie. Le Parti socialiste et l'Alliance des forces de progrès (AFP), les partis de gauche, ralliés à Amadou Ba pour ces législatives, n'ont guère pesé. L'ex-Premier ministre, qui avait recueilli 35 % des voix à la présidentielle de mars, se retrouverait finalement avec deux députés. C'est une grosse déception.
Tous les partis qui ont été aux affaires sont en déclin, qu'ils soient socialistes, démocrates, libéraux, ou républicains. Ces vieux partis n'ont pas intégré les mutations de la société sénégalaise et de l'électorat, de plus en plus jeunes. Ils doivent se réorganiser. Leur recomposition pourrait se dessiner autour d'un bloc regroupant la famille libérale et d'un bloc socialiste.
Parmi les mesures du projet du Pastef, et du plan Sénégal 2050 dévoilé à la mi-octobre, quelles sont les priorités pour les Sénégalais ?
En ce qui concerne la lutte contre le chômage et l'abaissement du coût de la vie, la mise en place de pôles de développements régionaux est une mesure phare [visant à répartir plus équitablement les activités et les investissements à travers le territoire, alors que la région de Dakar est le moteur de l'économie].
La reddition des comptes [d'anciens dignitaires soupçonnés d'enrichissement illicite], liée à l'installation d'une Haute Cour de justice est également scrutée. Est-ce que les tenants du pouvoir iront jusqu'au bout ? On se souvient que leurs prédécesseurs avaient plié face aux pressions de certains leaders religieux, qui voyaient d'un mauvais œil ces procédures judiciaires.
Idem pour les violences politiques entre 2021 et 2024, qui ont fait des dizaines de morts, des centaines de blessés et des milliers d'arrestations. L'exécutif aura-t-il le courage d'abroger la loi d'amnistie couvrant les manifestations politiques sur cette période, et d'engager des enquêtes ? Ces deux derniers dossiers sont très délicats pour le pouvoir. Si ces mesures ne se traduisent pas en acte, la confiance des citoyens peut s'effriter.
Les adversaires politiques du Pastef, lorsqu'ils ont reconnu sa victoire, ont pour la plupart salué la “maturité démocratique” du Sénégal. Ces termes sont également fréquents dans la presse ouest-africaine. Qu'en pensez-vous ?
Je suis plus nuancé. Certes, nous avons une démocratie électorale assez dynamique. Les Sénégalais se mobilisent, les scrutins se déroulent généralement dans le calme… Les réflexes sont là. Lors de la présidentielle de mars, les électeurs ont sanctionné dans les urnes les violences précitées.
Mais la démocratie ne devrait pas se résumer aux élections. La maturité s'acquiert notamment par des débats contradictoires si on entend se prémunir des risques de manipulation de l'opinion. Lors de cette campagne électorale, c'est le débat sur les grandes orientations politiques qui a fait défaut. Pourtant, ces jeunes électeurs qui soutiennent la rupture promise par le Pastef sont demandeurs. Ils veulent mieux comprendre les mesures proposées, la mise en œuvre des politiques publiques, et doivent être mieux informés.
Propos recueillis par Agnès Faivre
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Mozambique : Dans l’ombre de Mondlane

Après une élection historique et à la veille de célébrer les cinquante ans de l'indépendance, les Mozambicains doivent se demander si les valeurs, les symboles et les institutions créés pour donner forme à « l'unité nationale » sont toujours légitimes aujourd'hui.
Tiré d'Afrique en lutte.
Le 9 octobre 2024, le Mozambique a tenu ses septièmes élections présidentielles depuis l'ouverture politique et l'instauration du multipartisme en 1992. Jusqu'alors, le pays vivait sous un régime à parti unique, dirigé par le Frelimo (Front de libération du Mozambique), résultat d'un processus d'indépendance en 1975, obtenu dans le contexte de la guerre froide au cours duquel le pays s'était aligné sur le bloc socialiste au niveau géopolitique. Cependant, depuis les premières élections générales de 1994, le parti au pouvoir a remporté toutes les élections, en grande partie grâce au contrôle qu'il a toujours exercé historiquement sur l'appareil d'État, les institutions publiques étant invariablement en sa faveur. Cet état de fait a conduit à une méfiance généralisée à l'égard de la transparence du processus électoral mozambicain dans divers secteurs de la société, tant au pays qu'à l'étranger. Les élections actuelles semblent montrer qu'un point critique a été atteint.
Comme cela a été le cas lors de toutes les élections précédentes, le scrutin de 2024 a été caractérisé par des malversations électorales récurrentes de toutes sortes, le plus souvent dans le but de favoriser le parti Frelimo. Cette perception ne se limite pas aux plaintes de ses adversaires politiques mais fait également consensus dans l'opinion publique, parmi les observateurs nationaux et internationaux, en plus de diverses études et rapports publics qui démontrent cette tendance historique . Cependant, depuis les élections locales de 2023, la contestation populaire et sociétale des résultats des élections s'est accrue, avec des manifestations violentes auxquelles a répondu une répression policière tout aussi violente et disproportionnée. Depuis lors, le Mozambique connaît une situation de tension politique et sociale, aggravée par l'augmentation de la pauvreté et la précarité générale des conditions de vie de la population. Il existe en effet un sentiment général de mécontentement à l'égard du présent et de l'avenir du pays, souvent interprété comme une conséquence directe de la concentration excessive du pouvoir politique, économique, idéologique et institutionnel entre les mains d'une seule force politique.
Le Mozambique s'apprête à célébrer le 50e anniversaire de son indépendance politique vis-à-vis du Portugal. Un tel événement historique s'accompagne naturellement d'une série de réflexions et d'auto-analyses, afin de faire le point sur ces cinq dernières décennies, non seulement au Mozambique mais aussi dans d'autres anciennes colonies portugaises du continent dont les processus historiques récents sont directement liés. Un événement qui a eu lieu deux semaines avant le vote illustre la signification historique plus profonde des événements actuels.
Le 25 septembre 2024, la nation a célébré le 60e anniversaire du début de la lutte armée pour la libération nationale, le processus politique et militaire de lutte contre le colonialisme portugais, qui a débuté en 1964. Pour commémorer cet événement, une statue d'Eduardo Mondlane, fondateur et premier président du Frelimo, reconnu dans l'histoire officielle comme « l'architecte de l'unité nationale », a été érigée dans la ville de Maputo. Cependant, le gouvernement a dû faire face à de nombreuses critiques de la part de l'opinion publique. Pour les critiques, la statue ne correspondait pas aux caractéristiques physiques de Mondlane, avec de graves erreurs de proportions présumées. Le mécontentement du public a même conduit le ministère de la Culture à mettre en place une équipe technique pour évaluer l'œuvre et, si nécessaire, apporter les corrections nécessaires.
Au-delà des aspects techniques et esthétiques, cet épisode est symptomatique d'un problème structurel très profond de la société mozambicaine : la culture politique autoritaire, héritage d'une nation construite sous un régime monolithique. Il est frappant de constater que la statue, qui a remplacé une précédente au même endroit, a été inaugurée sans aucune forme de communication, de consultation ou d'interaction avec la population. En d'autres termes, le gouvernement a décidé d'intervenir dans un symbole national important lié à la construction même du pays sans au moins impliquer la communauté d'une certaine manière. Cette situation renforce une perception largement répandue selon laquelle le parti au pouvoir s'est « approprié » le pays. Dans ce cas, nous avons affaire à une appropriation de la mémoire collective, plus précisément de la mémoire de la lutte pour l'indépendance, qui est souvent utilisée comme source de légitimation pour maintenir le pouvoir du Frelimo.
Les allégations de fraude électorale se fondent sur cette perception, corroborée par les faits, et sur la confusion notoire entre parti, État et gouvernement au Mozambique. En effet, les innombrables rapports de délits électoraux enregistrés lors de cette élection et de toutes les autres témoignent de l'instrumentalisation de diverses institutions publiques, de la police, des fonctionnaires et des installations de l'État, des médias, ainsi que des organes électoraux et judiciaires eux-mêmes. Dans le cas spécifique de la statue, son inauguration à la veille des élections ouvre la voie à de nouvelles spéculations sur l'utilisation de l'appareil public pour promouvoir le régime.
Tout cela n'est pas nouveau, sauf que la contestation populaire actuelle des élections se déroule à un moment de reconfiguration de la politique mozambicaine, marquée par l'affaiblissement des principaux partis d'opposition historiques au Frelimo : la Renamo et le MDM. Ce vide de pouvoir a été comblé cette année par le parti Podemos, récemment créé, qui est devenu la plus grande menace réelle pour le pouvoir en place grâce au leadership charismatique de son candidat, Venâncio Mondlane. En tant que membre de la Renamo, VM7, comme on l'appelle, a perdu les élections locales de 2023 à Maputo, la capitale du pays, face au candidat du Frelimo. En réponse, il a mené une série de marches et de manifestations populaires contestant les résultats des élections prétendument truqués, qui se sont soldées par une forte répression policière dans diverses régions du pays.
Ces manifestations se sont distinguées par la mobilisation massive des jeunes, qui constituent la grande majorité de la population du pays, dont 80 % ont moins de 35 ans et la moitié moins de 16 ans, selon les données de l'UNFPA. Ce segment de la population est très insatisfait de ses conditions actuelles et de ses perspectives d'avenir, hanté par le chômage, la pauvreté et la violence. Outre la dimension matérielle, de nombreux jeunes ne s'identifient pas au discours idéologique nationaliste officiel, car il s'agit d'une génération qui a été peu exposée à la rhétorique de la lutte armée et à l'ensemble des valeurs qui lui sont associées. Le soutien des jeunes à Venâncio est également le reflet de l'époque : une grande partie de leur expression et de leur mobilisation autour du candidat s'est faite via Internet et les réseaux sociaux, « faisant éclater la bulle » des médias publics, constitués de la radio et de la télévision publiques, ainsi que des principaux journaux nationaux imprimés. A cela s'ajoute le renforcement notoire de la société civile mozambicaine, qui a également contribué à donner la parole et à mobiliser non seulement cette masse de jeunes, mais aussi divers autres secteurs de la société qui réclament plus de justice sociale et de respect des droits de l'homme.
En bref, la situation est très tendue, alimentée par la crainte de violences politiques. Les principaux partis et candidats de l'opposition se sont exprimés publiquement pour contester les résultats partiels publiés par les organes électoraux officiels, qui donnaient la victoire à Daniel Chapo, le candidat du Frelimo. De plus, Venâncio Mondlane s'est même déclaré vainqueur légitime de l'élection, sur la base de décomptes parallèles internes de son parti, et a appelé à une grève générale et à des manifestations dans tout le pays si les organes électoraux confirmaient la victoire du parti au pouvoir. Cette situation pourrait aussi constituer un tournant historique pour cette jeune nation, à la veille de son cinquantième anniversaire. Les Mozambicains doivent donc réfléchir à leur propre parcours historique : dans quelle mesure les idéaux, les valeurs, les symboles et les institutions créés pour donner forme à « l'unité nationale » sont-ils encore légitimes aujourd'hui ?
Le cas de l'inauguration de la statue de Mondlane dans le contexte des élections est une allégorie symptomatique de la façon dont divers secteurs de la société mozambicaine ont historiquement été exclus des processus de prise de décision, qui ont été concentrés entre les mains d'un groupe spécifique. Concrètement, la célébration unilatérale et arbitraire d'un héros national révèle un modèle de relations entre l'État et la société qui ne contribue certainement pas au renforcement de la citoyenneté dans le pays. Elle renforce surtout la corrosion de la crédibilité des institutions publiques en général – et des organismes électoraux en particulier –, cause fondamentale du mécontentement populaire et de la menace d'instabilité et de violence politique qui prévaut actuellement.
En transposant cela au contexte africain plus large, nous parlons de la crise de légitimité notoire que traversent de nombreux mouvements de libération africains, tels que l'ANC (Afrique du Sud), le MPLA (Angola) et la ZANU-PF (Zimbabwe), qui ne sont pas par hasard des alliés historiques du Frelimo. Compte tenu de ce qui précède, la question se pose : cette crise de légitimité pourrait-elle être un tournant pour une sorte de « seconde indépendance » capable de générer une nouvelle « architecture d'unité nationale » au Mozambique ?
Le 19 octobre dernier, le Mozambique a connu une tragédie qui a confirmé les pires craintes concernant l'instabilité politique résultant d'un processus électoral marqué par des irrégularités notoires en faveur du régime. Elvino Dias, avocat de Venâncio Mondlane, et Paulo Guambe, représentant du parti Podemos, deux éminents militants de l'opposition, ont été sauvagement assassinés. Bien que les circonstances et le mode opératoire du crime restent encore flous, ils ont suscité le rejet et l'indignation de larges secteurs de la société mozambicaine et de la communauté internationale. Entre-temps, comme prévu, le 24 octobre, les organismes électoraux officiels ont annoncé la victoire de Daniel Francisco Chapo, candidat du Frelimo, avec 70 % des voix. En conséquence, les manifestations populaires de protestation se sont intensifiées dans plusieurs régions du pays, qui ont rapidement été réprimées par la police, avec des arrestations et même des morts. Bref, il règne une atmosphère de grande tension politique après l'annonce des résultats officiels de ces élections, qui promettent de changer le cours de l'histoire, comme beaucoup le disent et le souhaitent dans les rues du pays.
Marílio Wane est titulaire d'une maîtrise en études ethniques et africaines de l'Université fédérale de Bahia (Brésil) et est chercheur dans le domaine du patrimoine culturel immatériel au Mozambique.
Traduction automatique de l'anglais
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Sauver le climat pour construire un autre Brésil

De nombreuses villes brésiliennes ont connu, le 22 septembre 2024, des manifestations importantes contre les incendies et pour la justice climatique. Parce que la construction d'un mouvement pour le climat est vitale pour l'avenir du pays et de la planète. Comment il peut s'opposer à l'agro-industrie et à son alliance avec le gouvernement.
12 novembre 2024 | tiré du site Inprecor.org | Photo : Déforestation en Amazonie brésilienne en 2016. © Ibama from Brasil – Operação Hymenaea,
https://inprecor.fr/node/4424
Les incendies, dont les fumées n'auront épargné qu'une seule capitale brésilienne, Teresina (État de Piauí), et les inondations, qui ont ravagé une grande partie de la région de Porto Alegre, montrent que le changement climatique est un problème majeur pour le peuple brésilien et qu'il est en passe de devenir le plus grand défi auquel le Brésil ait jamais été confronté. Ils établissent un lien direct entre les grandes villes du pays, où vit la grande majorité de la population brésilienne – qui est à 85 % urbaine – et la nécessité de préserver les biomes 1 que sont le Cerrado, le Pantanal et l'Amazonie.
97 % des Brésilien·nes reconnaissent l'existence du changement climatique et 78 % pensent qu'il a des causes humaines, l'un des taux les plus élevés au monde. C'est peut-être le résultat d'un apprentissage pratique : 5 233 municipalités brésiliennes (94 % des 5 565 municipalités au total) ont déclaré des situations d'urgence ou des calamités entre 2013 et 2023, principalement en raison de pluies torrentielles et d'inondations, de glissements de terrain ou de sécheresses prolongées. Mais lorsqu'on leur demande qui est responsable, la plupart des gens répondent par des termes génériques tels que « les hommes » ou « les êtres humains ». Cependant, contrairement à de nombreux autres pays, où les conséquences du réchauffement climatique semblent être le résultat de processus systémiques plus éloignés (principalement dus à l'utilisation de combustibles fossiles), au Brésil nous avons une interaction entre les biomes et le climat, et l'existence d'un réseau de surveillance par satellite des incendies nous donne le nom et l'adresse de ceux qui bénéficient et sont responsables des incendies.
Le nom et l'adresse des responsables
Ce sont les « ruralistes », le segment de la classe capitaliste lié au contrôle de la terre, un groupe numériquement insignifiant dans la population, mais qui détient le pouvoir dans le pays. Ils gèrent les territoires qu'ils conquièrent comme des essaims de sauterelles en guerre contre la terre, l'exploitant jusqu'à l'épuisement de sa capacité productive et se déplaçant ensuite vers d'autres régions où ils reproduisent le même processus. Ils constituent le bloc social aux racines agraires qui a dominé le Brésil d'une main de fer jusqu'en 1930, date à laquelle ils ont été partiellement évincés du pouvoir central, mais ils ont repris le contrôle du pouvoir après 1990, en désindustrialisant le pays et en le positionnant sur la scène mondiale, dans une large mesure, comme une grande ferme.
Les « ruralistes » sont liés au secteur financier et bénéficient de l'appui dans leur prédation des territoires et du climat par les acteurs de la production et de l'utilisation de combustibles fossiles, de l'exploitation minière et par leurs représentants politiques, leurs agents idéologiques et les gestionnaires de l'État. Propriétaires de logements souvent inoccupés, ils alimentent les booms immobiliers spéculatifs dans les grandes villes, qui défigurent le tissu urbain. Alliés à des pasteurs néo-pentecôtistes, ils alimentent la vague néo-fasciste qui déferle sur le pays.
La classe dirigeante agraire s'est établie au Brésil sur la base de l'esclavage et du contrôle de l'accès à la terre (formalisé par la loi foncière de 1850), puis de diverses formes de travail obligatoire, et enfin du travail salarié, en utilisant toujours la violence comme méthode de contrôle social. Aujourd'hui encore, les accusations de travail forcé dans des conditions analogues à l'esclavage sont courantes. Son autre fondement était et reste la prédation environnementale. On le voit bien avec la forêt tropicale atlantique, qui couvrait 1,3 million de kilomètres carrés (15 % du territoire national) en grande partie détruite au cours du 20e siècle et dont il ne reste aujourd'hui que des fragments. Aujourd'hui, la grande agriculture d'élevage répète le processus dans le Cerrado, le Pantanal et l'Amazonie.
Le ruralisme producteur de matières premières (soja, canne à sucre, viande, café) reproduit, à chaque moment de l'histoire, ce que Caio Prado 2 appelait « le sens de la colonisation », en produisant des richesses pour le marché mondial au détriment du pillage interne de la nature et du travail humain. Aux antipodes de l'agriculture vivrière, destinée au marché intérieur, dont la quasi-totalité est produite par la paysannerie et l'agriculture familiale, qui est beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Les matières premières ne participent pas directement de l'alimentation mais sont des intrants pour la malbouffe ultra-transformée. Dans cette chaîne, l'élevage a la particularité d'être aussi le principal mécanisme d'accaparement des terres et un vecteur de déforestation dans le biome amazonien, où la frontière agricole se déplace.
L'agriculture productrice de matières premières détruit des pans entiers de territoire à son seul profit et s'est toujours opposée à la construction nationale. C'est pourquoi, contrairement au discours actuel, le Brésil n'est pas victime d'une dette climatique à l'égard du Nord. Ce discours ne prend en compte que les émissions industrielles ; au contraire, nous sommes le quatrième plus grand émetteur de carbone accumulé après 1850 en raison de la déforestation – derrière les États-Unis, la Chine et la Russie, selon l'étude Carbon Brief. Quelqu'un pense-t-il que la destruction de l'immense Forêt atlantique, du Cerrado et d'une partie de l'Amazonie par le ruralisme brésilien n'a pas rejeté et continue de rejeter des milliards de tonnes de carbone dans l'atmosphère, ou que le cheptel bovin brésilien, plus important que la population du pays, ne constitue pas un gigantesque passif pour l'environnement ? Si nous prenons au sérieux la dynamique de l'effondrement environnemental en cours, le « ruralisme » brésilien est, avec les producteurs de pétrole et de charbon, l'un des plus grands fléaux climatiques de la planète, l'un des plus grands ennemis de l'humanité.
La dynamique globale-locale de l'urgence climatique
Depuis juin 2023, le réchauffement climatique a fait un bond en avant, lourd de conséquences pour toutes les régions de la planète. Johan Rockstrom a présenté un bon résumé des conclusions des scientifiques dans ses récentes conférences, telles que « Les points d'inflexion du changement climatique – et où nous en sommes » 3. Le réchauffement de la planète s'accélère : de 0,18° par décennie à 0,26° par décennie après 2010. Nous dépasserons certainement 2° de réchauffement au-dessus des températures préindustrielles avant 2050, et atteindrons peut-être les 2,5°. Chez nous, Carlos Nobre a produit le même diagnostic 4. La grande accélération capitaliste extrapole les limites naturelles de la planète et laisse présager la rupture, dans les années à venir, de plusieurs « points de bascule » décisifs du système terrestre. La crise de la civilisation capitaliste prend des contours dramatiques : guerres, crises sociales, déplacements de population et fascisme accompagnent l'effondrement climatique, y compris la possibilité de l'effondrement de l'Amazonie. Le sort de la forêt amazonienne, dont les recherches de Luciana Gatti montrent qu'elle est en train de devenir un émetteur de carbone, est une question brûlante pour l'ensemble de l'humanité.
Le climat a perdu la relative stabilité qu'il avait au cours des dix mille dernières années, période de l'holocène 5. Il est devenu à l'ère de l'anthropocène le résultat d'un conflit entre la destructivité du capitalisme extractiviste et fossile, qui menace la biosphère de la planète, et les forces sociales qui cherchent une alternative que l'on ne peut qualifier aujourd'hui que d'écosocialiste. C'est là, de plus en plus, le vecteur résultant de la lutte civilisatrice de la vie contre la mort, menée par les peuples toujours sur le terrain local, mais qui se projette dans l'espace national et mondial. Il n'y a pas de hiérarchies rigides et, si certains territoires sont déterminants pour l'ensemble de l'humanité (comme la forêt amazonienne dans notre cas) ou pour un pays (comme le Cerrado, réservoir d'eau du Brésil, et le Pantanal, source d'une biodiversité unique), les échelles sont très variables, en fonction des conditions écologico-territoriales, socio-économiques et politiques. Un programme écosocialiste doit impliquer de multiples acteurs et situations, des alliances et des relais de transition.
Le problème ne se pose pas seulement dans les campagnes, mais aussi dans les villes, qui se transforment en îlots de chaleur infernaux. L'expansion du secteur immobilier dans les villes intensifie la chaleur, détruit les espaces verts et rejette toute idée de « ville éponge » 6. Une ville comme São Paulo est plus chaude de 5 à 10 degrés que le reste de la végétation de la forêt atlantique qui l'entoure. Les grands projets immobiliers sont le pendant urbain de l'irresponsabilité de l'agro-industrie dans les campagnes.
L'engagement et la lutte politique s'inscrivent donc dans de multiples dimensions, y compris la dimension mondiale. Les clauses environnementales dans le commerce international sont un instrument de pression essentiel contre le comportement criminel d'innombrables secteurs économiques. L'élevage brésilien est un exemple de secteur qui doit être encadré par des structures politiques beaucoup plus fortes que celles du gouvernement brésilien. Les éleveurs refusent de tracer l'origine des bovins dont la viande est exportée, car la plupart d'entre eux sont élevés illégalement dans l'Amazonie déboisée, puis emmenés dans des États d'autres régions pour y être abattus. À partir de 2025, l'Union européenne met en œuvre une loi contre la déforestation qui affectera les importations de matières premières telles que la viande et le soja – les plus destructeurs pour l'environnement brésilien. Selon Itamaraty – le ministère des Affaires étrangères – et le ministère de l'agriculture, qui protestent contre cette législation auprès des autorités européennes, elle devrait affecter 30 % des exportations du secteur vers l'Europe. D'autre part, l'Observatoire du climat a soutenu à juste titre que l'Europe devrait commencer à l'appliquer au début de l'année prochaine. Ce n'est que le début d'une pression que nous devons tous nous efforcer d'accroître de manière exponentielle.
Construire des alliances, cibler l'ennemi, saisir les opportunités
Les incendies actuels sont, en bonne partie, des incendies criminels provoqués dus à l'agro-business. Comme le dit Luciana Gatti, « la forêt Amazonienne est assassinée », et nous savons par qui. On connaît les responsables des incendies dans le Pantanal et dans les champs de canne à sucre de São Paulo. Depuis la promulgation du nouveau code forestier sous le gouvernement de Dilma en 2012, nous avons assisté à une offensive croissante du secteur contre tous les mécanismes visant à limiter ses activités et à protéger la nature. De l'utilisation de toutes sortes de produits agrochimiques interdits en Europe, à l'offensive actuelle visant à assouplir la législation que nous avons jusqu'ici réussi à maintenir, en passant par « le portail pour le bétail » de Salles7, 8 et de Bolsonaro, la majorité vénale du Congrès est une machine à entériner la destruction des biomes brésiliens.
Comme l'a déclaré Luiz Marques dans une récente interview accordée au site web O joio e o trigo, « l'agro-business est le grand problème du Brésil. S'il n'est pas éradiqué, le Brésil n'a pas la moindre chance d'être viable en tant que société et en tant que nature. Il s'agit d'une activité sociale fondamentalement criminelle et prédatrice. Il contrôle le Congrès national par l'intermédiaire du front parlementaire agricole et a pour alliés les groupes parlementaires de la Bible et de la Balle. Le Brésil se trouve donc dans une situation très claire : soit nous réagissons en rompant vigoureusement avec ce processus, soit nous n'avons aucune chance de survie en tant que société » (8).
Cela peut sembler une mission impossible. Mais qui, en regardant le Brésil en 1928, aurait pensé que cinq ans plus tard, l'oligarchie du café serait écartée du pouvoir de l'État central ? Comme nous le rappelle Chico de Oliveira dans son Ornitorrinco, la possibilité de changements structurels dans les sociétés périphériques est directement liée à des scénarios de crise générale dans le système international qui peuvent être exploités par des acteurs politiques nationaux bien positionnés. Nous avons laissé derrière nous une mondialisation vigoureuse et sommes entrés dans une phase de conflits inter-impérialistes qui fragmentent le marché mondial et produisent une certaine dé-mondialisation, qui ne fera que s'approfondir. Le monde va devenir un environnement de plus en plus hostile, dans tous les sens du terme, au cours des prochaines années.
Le projet agro-industriel brésilien est vulnérable, d'une part, parce qu'il est suicidaire sur le plan environnemental dans un monde où les conditions de durabilité deviendront les conditions de survie d'une société. Mais il est également vulnérable parce qu'il réitère l'ancienne dépendance du marché libre à l'égard des cycles des matières premières de l'économie mondiale, ce qui supprime toutes les conditions permettant au Brésil de résister aux fluctuations de l'économie mondiale dans un monde de plus en plus instable. Lula ne fait-il qu'aggraver ces vulnérabilités ? Comme le dit Liszt Vieira, « à quoi sert un ministère de l'Environnement qui ne peut pas empêcher la dégradation de l'environnement causée, par exemple, par le ministère de l'Agriculture qui soutient l'agro-industrie qui déforeste les forêts, par le ministère des Transports qui soutient l'asphaltage de l'autoroute BR-319 qui dévastera l'Amazonie et par le ministère de l'Énergie qui soutient l'exploration pétrolière dans le bassin de Foz do Amazonas ? » 9.
En devenant de plus en plus parasitaire et en détruisant ses propres conditions d'existence, l'agrobusiness se révèle également de plus en plus destructeur pour la vie de la majorité de la population brésilienne. Nous pouvons résumer cette dynamique en disant que, soit le Brésil met fin au « ruralisme », soit le « ruralisme » met fin au Brésil. Qui peut faire face à cette tâche ? Une gauche différente de celle d'aujourd'hui, qui est paralysée face à l'agrobusiness. Comme nous le rappelle E.P. Thompson, les classes se forment dans la lutte des classes.
Un mouvement climatique fort au Brésil sera un mouvement pour une transition éco-sociale dans le pays, organisé par des acteurs de base, capable d'affronter les responsables de la prédation de la nature et de lutter pour la restauration des biomes forestiers. L'alternative pour le Brésil sera créée dans la lutte politique pour une autre économie, une autre société, un autre métabolisme avec la nature.
Le 22 septembre 2024
Cet article a été publié par la revue Movimento et traduit par Luc Mineto.
Notes
1. Un « biome » est défini comme étant « une des principales communautés, animales et végétales, classées en fonction de la végétation dominante et caractérisées par les adaptations des organismes à leur environnement spécifique (Campbell-1996) ». Le terme de « zone de vie majeure » est considéré comme synonyme.
2. Caio da Silva Prado Júnior (1907 -1990) est un intellectuel marxiste, spécialiste du Brésil colonial.
3. Conférence « The tipping points of climate change - and where we are », disponible avec des sous-titres en français.
4. « Combattre l'urgence climatique », entretien de Juca Kfouri avec Carlos Nobre.
5. L'holocène est une époque géologique s'étendant sur les 12 000 dernières années, toujours en cours. C'est une période interglaciaire, tempérée, du Quaternaire.
6. Une ville éponge ou ville perméable (Sponge City ou haimian chengshi) est un type de ville résiliente capable d'absorber les eaux pluviales dans le sol et les zones humides afin de réguler les inondations urbaines et diminuer la vulnérabilité durant les périodes de sécheresse. Il s'agit d'un concept d'urbanisme et d'hydrologie urbaine.
7. Ricardo Salles, alors ministre de l'Environnement, a proposé lors d'un Conseil des ministres le 20 avril 2020 de profiter du moment où l'attention se portait presque exclusivement sur l'épidémie de Covid-19 pour revoir les réglementations relatives à l'environnement ou, selon ses termes, « ouvrir le portail pour faire passer les troupeaux ».
8. « O agronegócio é o principal inimigo do Brasil », « L'agro-industrie est le principal ennemi du Brésil », 17 septembre 2024.
9. « Explodiu a questão ambiental ! », « La question de l'environnement a explosé ! », A terra é redonda, 15 septembre 2024.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

« La vie chère en Martinique est la conséquence du système colonial » Entretien avec Philippe Pierre-Charles

Depuis le mois de septembre, la Martinique se soulève contre la vie chère. Face à cette révolte, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau répond par la violence. L'Insoumission couvre ce mouvement depuis son commencement. Grâce à son réseau de reporteurs, elle publie un entretien avec notre camarade Philippe Pierre-Charles ancien secrétaire général de la Centrale Démocratique Martiniquaise des Travailleurs, (CDMT).
12 novembre 2024 | tiré d'inprecor.org
https://inprecor.fr/node/4425
Militant politique, syndical et associatif martiniquais, il dénonce l'injustice de la vie chère et les pratiques économiques héritées du colonialisme en Martinique. Selon lui, les prix élevés sont dus à des monopoles locaux contrôlés par la caste béké (blanc créole descendant des premiers colons esclavagistes), qui limite la production locale et impose des marges incontrôlées. Bien que la grève générale de 2009 ait permis d'obtenir des gains, comme une prime salariale et des baisses de prix, ces avancées ont été érodées, car les grands groupes ont repris leurs pratiques d'exploitation.
M. Pierre-Charles critique également la répression actuelle des mouvements sociaux en Martinique. L'envoi de la CRS 8, unité policière spéciale, rappelle l'histoire coloniale de répression. La violence policière lors de récentes manifestations a même conduit l'Assemblée de Martinique à demander leur retrait.
En tant que porte-parole du collectif contre le chlordécone, Pierre-Charles milite pour la reconnaissance du scandale sanitaire et l'indemnisation des victimes. Il souligne l'importance d'une loi de réparation pour traiter les conséquences économiques, sanitaires et environnementales de cette pollution. Pour lui, une mobilisation hexagonale est essentielle afin de pousser l'État à reconnaître et réparer cet empoisonnement durable qui touche toute la société martiniquaise. Notre entretien exclusif.
Est-ce que vous pouvez vous présenter et quels sont vos engagements politiques au sens large, aujourd'hui ?
Je suis Philippe Pierre-Charles, je suis militant politique, syndical, associatif. Syndicalement, j'étais secrétaire général de la Centrale Démocratique Martiniquaise des Travailleurs, (CDMT) qui est l'une des grandes centrales syndicales du pays. Politiquement, j'appartiens au groupe Révolution socialiste. Et je suis dans différentes associations dont une qui est impliquée dans le combat sur le chlordécone et qui s'appelle Lyannaj pou depolye Matinik
La vie chère est un problème structurel en Martinique. Quelles en sont les causes profondes ?
Aujourd'hui, pour l'alimentation, le différentiel de prix avec la France est d'environ 40 %. Au global, les prix sont plus élevés de 17 % en moyenne.
Les causes nous renvoient au système colonial. Le système colonial bride la production locale, organise tout en fonction de l'importation et dans lequel règne des monopoles. La production locale est bridée parce que dans le système « de l'exclusif », le rôle de la colonie c'était de fournir des matières qui intéressent la métropole. C'était la canne, le sucre, le coton etc.
Cela fait que la production locale est simplifiée. La colonie n'avait pas le droit de produire un clou si la métropole produisait des clous.
Donc il reste de cette Histoire, un certain nombre de pratiques très fortes. C'est pourquoi la production locale ne contribue qu'à 20 % de l'alimentation de la population. À cela s'ajoute le problème de la caste coloniale qu'on appelle ici les békés. Ce sont d'anciens colons, grands propriétaires terriens qui règnent sur l'import-export. Ils font la loi et fixent les prix en se réservant des marges sur lesquelles nous n'avons absolument aucun contrôle. Tout cela combiné fait que les prix sont exorbitants.
À cela s'ajoutent les causes conjoncturelles qui sont liées à la situation du pays. Par exemple, le passage à l'euro a entrainé un renchérissement de la vie. Ensuite, des événements comme la guerre en Ukraine servent de prétextes à des hausses faramineuses. Pareil pour le Covid. On aboutit à une situation où les prix sont élevés.
Dans les années 1950, il y a eu une grande grève des fonctionnaires qui réclamaient une indemnité de vie chère. Ce mouvement a abouti à une prime de 40% pour les fonctionnaires « métropolitains » mais pas au reste de la population. La lutte contre la vie chère est donc un vieux combat qui resurgit régulièrement.
En 2009, il y a une grève générale qui avait secoué la Martinique contre la vie chère. Qu'est ce que ce mouvement de grève générale avait permis de gagner et quelles sont les limites qui expliquent qu'une nouvelle révolte éclate quinze ans après ?
La grande grève de 2009 qui a agité la Martinique et la Guadeloupe n'était pas seulement une grève contre la vie chère. C'était une grève contre ce que nous avons appelé la « profytasion » c'est-à-dire contre l'exploitation et l'oppression outrancière. Les revendications portaient sur la vie chère mais aussi sur les salaires trop bas, les services publics, et toute une série de causes populaires. Ce mouvement, par sa puissance, avait permis d'arracher un certain nombre de choses. En Martinique comme en Guadeloupe, le mouvement social avait créé un position de négociation puissante face au pouvoir économique et politique.
La première victoire a été une augmentation de 200 euros sur les salaires jusqu'à 1,4 SMIC. Une partie était payée par le patronat, une partie par l'État et une partie par les collectivités. La deuxième victoire fut une baisse des produits de première nécessité d'environ 20%. Cela concernait 2586 produits dont la liste avait été publiée dans la presse. Rendre cette baisse effective a été un véritable combat social. Des équipes militantes syndicales allaient dans les grandes surfaces pour vérifier qu'elles appliquaient les bons prix.
Nous avons aussi obtenu des encadrements de prix pour la téléphonie, les services bancaires, l'eau, de l'électricité. Par exemple, sur l'eau et l'électricité, les premières quantités, nécessaires à la vie, étaient moins chères que les suivantes. Enfin, nous avons gagné sur de nouveaux principes : comme la priorité d'embauche pour les originaires au niveau de la fonction publique, en particulier dans l'enseignement ou la reconnaissance pleine et entière du fait syndical martiniquais.
Une fois que le mouvement social s'est affaibli, nous avons perdu notre position de négociateur. Immédiatement, la grande distribution en a profité pour recommencer à faire monter les prix. Une partie des employeurs a commencé à contester la part qu'il devait payer des 200 euros. Finalement, les bénéfices de ce combat ont été grignoté par le fait que les acteurs économiques sont restés les mêmes, les grands groupes de la distribution n'ont pas changé, et ils ont donc remis en place les mêmes pratiques de profytasion.
La première leçon à tirer de 2009, c'est que les victoires sont possibles quand la mobilisation est forte. La deuxième, c'est que pour que ces victoires soient durables, il faut viser des réformes de structures pour donner au peuple les moyens de peser sur le pouvoir économique et politique.
C'est une leçon très utile pour le mouvement d'aujourd'hui. Le protocole d'accord qui a été signé par un certain d'acteurs à l'exception du RPPRAC (Rassemblement pour la Protection des Peuples et des Ressources Afro-Caribéens, ndlr) qui est à l'initiateur de la lutte, ne contient aucun moyen sûr pour garantir son application. Le protocole contient des affirmations de principes.
Il stipule que l'État doit contrôler les marges des grandes entreprises, que l'institution territoriale va mettre en place un service de contrôle des prix. Mais il n'existe aucun dispositif pour que le mouvement social, les syndicats, les associations puissent prendre part à ce contrôle, ni aucune remise en cause du principe du secret des affaires. Il sera toujours impossible de voir ce qu'il y a à l'intérieur des coffres forts du grand capital. Il ne sera donc pas possible de formuler des revendications de partage des richesses à la hauteur des possibilités.
Ce secret des affaires est un sujet tabou. La grande distribution se permet de ne pas remettre ses comptes comme c'est prévu par la loi. L'une des revendications majeures aujourd'hui pour un certain nombre de structures comme la CDMT (Comité de Défense des Métiers et des Travailleurs, ndlr), c'est l'application du principe de l'ouverture des livres de compte.
En septembre, face à cette révolte, Bruno Retailleau, le nouveau ministre de l'intérieur, envoie la CRS8 qui est une unité spéciale qualifiée de « va-t-en guerre » par un préfet. En quoi cette réponse, principalement répressive, est la suite d'une longue histoire de répression coloniale en Martinique ?
En décembre 1959, une révolte populaire s'est déclenchée suite à un banal accident de la circulation. Le pouvoir a fait appel aux CRS. Il y a eu des affrontements pendant trois nuits. Trois jeunes ont été tués. Alors qu'ils ne participaient même pas aux affrontements. Cela a déclenché une immense colère. Un mot d'ordre est apparu : « CRS dehors ».
Ce mouvement était tellement puissant que même le conseil général avait réclamé à ce que les CRS soient rembarqués. Et ils avaient obtenu gain de cause. Ce qui fait que la Martinique est libre de CRS depuis 1959. Le retour des CRS en Martinique imposé par Bruno Retailleau est donc un symbole très fort.
La répression a rythmé toutes les luttes populaires en Martinique. Dès le début, les esclavagisés ont refusé leur condition. Ils se sont révoltés et ont été réprimés. Il y a eu des morts lors de l'insurrection qui a mené à l'abolition de l'esclavage en 1848, lorsque l'abolition de l'esclavage a été imposée par un député esclave, ce fut au prix du sang.
Une autre insurrection s'est déroulée en 1870, appelée « l'insurrection du Sud », elle s'est terminée dans un véritable massacre, non seulement immédiatement mais aussi après il y a eu des condamnations à mort, au bagne. Une véritable terreur a été installée qui a conduit à enfouir pendant longtemps cette révolte dans la mémoire populaire.
Par la suite, le mouvement ouvrier, qui a pris naissance autour des ouvriers agricoles, a payé un lourd tribut lors des grèves. En février 1900, il y a eu 11 victimes de l'armée qui a tiré sur les grévistes. Et depuis, périodiquement, tous les 10 ans environ, il y a des mouvements réprimés, en 1923, en 1953, en 1961… Chaque grève d'ouvriers agricoles devient l'occasion d'une nouvelle tuerie. La dernière a eu lieu en février 1974, lors de laquelle deux grévistes sont tués.
En plus des morts, il y a aussi des poursuites judiciaires et lors des manifestations. Le système colonial se maintient par la répression. Pas uniquement puisque le pouvoir cherche aussi à endormir la population dans le rêve assimilationniste. Ce à quoi on assiste aujourd'hui est donc la poursuite de cette répression coloniale.
Les CRS qui sont arrivés en septembre sur ordre de Bruno Retailleau n'hésitent pas à provoquer les gens qui tiennent les barrages. On a vu des gazages et des matraquages hors de proportion. Au Carbet, même le maire a été gazé. Le vendredi 25 octobre, une manifestation était organisée par le RPPRAC et les syndicats de la CGTM (Confédération générale des travailleurs de Martinique) et de la CDMT.
Le cortège a été barré en arrivant du siège du Groupe Bernard Hayot (GBH), l'un des principaux acteurs de la grande distribution. La manifestation se tenait pacifiquement depuis 1h30. Le barrage du cortège a entraîné une montée des tensions, puis le gazage et le matraque des manifestants par les CRS. Voilà la réalité aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle même l'assemblée de la Collectivité Territoriale de Martinique a réclamé dans une motion le départ des CRS.
Pour finir, vous êtes porte-parole du collectif pour dépolluer la Martinique. Le procès en appel de l'empoisonnement au chlordécone s'est ouvert le 22 octobre à Paris. Quel est l'objectif de ce collectif dont vous êtes le porte-parole ? Pourquoi cette qualification d'empoisonnement est essentielle dans ce procès et quels sont les impacts, les effets de l'empoisonnement au chlordécone en Martinique ?
Le combat sur la question du chlordécone est un combat multiforme avec trois objectifs essentiels. D'abord, la vérité. Jusqu'à maintenant, il y a des zones d'ombre. Il faut la vérité scientifique, il faut que la recherche se développe.
Deuxièmement, la justice. Il n'est pas normal qu'une série de crimes de ce type reste absolument impunie, sans sanction, comme si il n'y avait pas des responsables. Emmanuel Macron a dit un jour qu'il n'y avait pas de responsabilité de l'État mais une responsabilité collective. Toujours est-il que rien n'est arrivé aux gens qui ont répandu ce produit qu'on savait nocif, dangereux, cancérigène probable. Ils ne sont même pas nommés clairement pas le pouvoir.
Le troisième volet est celui de la réparation. Elle concerne les ouvriers agricoles qui sont les premières victimes de cette tragédie. Mais aussi la population qui est largement impactée avec l'explosion des cas de cancer de la prostate, d'endométriose, et d'autres maladies que l'on a n'a pas encore documentées. Mais on sait déjà qu'une série de maladies découlent de cela.
Le chlordécone a été reconnu comme une maladie professionnelle mais jusqu'à maintenant, seulement à peine une centaine de salariés ou de familles d'ouvriers agricoles qui sont indemnisés et de façon très insuffisante.
Nous réclamons des indemnités bien plus larges pour toutes les victimes économiques puisque la terre, l'eau, la mer côtière, tout est empoisonné. Donc tous les métiers qui sont en lien avec ces espaces sont atteints et ce qui existe comme moyen de réparation est pratiquement inexistant.
Notre collectif se bat sur tous ces trois objectifs. Sur le plan judiciaire, une série d'associations ont réussi à porter plainte depuis 2006-2007 avant même l'existence de Lyannaj pou depolye Matinik. Lorsque nous avons vu le risque de non-lieu, nous avons lancé une campagne de constitution de parties civiles pour la population. Notre collectif s'inscrit dans un mouvement plus large Gaoulé Kont chlordécone.
Nous avons réussi à réunir 800 personnes qui se sont constituées partie civile et qui sont donc engagé dans des actions judiciaires aujourd'hui. Nous en sommes à une étape particulière. Pour avoir gain de cause, les avocats ont posé des questions préalables de constitutionnalité (QPC) pour faire reconnaître que cela relève de l'empoisonnement même s'il n'y a pas d'intention de tuer.
L'objet du procès du 22 octobre était de plaider ces QPC. Nous attendons le résultat. Si les questions sont acceptées, cela voudra dire que l'affaire ira devant la Cour de cassation qui décidera ou pas de transmettre au Conseil constitutionnel qui dira s'il y a lieu de revoir ce qui existe comme jurisprudence en matière d'empoisonnement.
La plainte qui a été lancée contre le non-lieu ne sera examinée qu'à la suite de ce processus. Cela peut donc prendre du temps.
Le 22 octobre a aussi été une date importante dans notre combat puisque pour la première fois, il y a eu un rassemblement devant le tribunal qui a réuni une centaine de personnes. Or nous sommes persuadés qu'il est essentiel que nous soyons rejoints par le mouvement ouvrier, démocratique, progressiste en Hexagone.

Tant que l'État aura l'impression que c'est une affaire qui ne concerne que les « écuries coloniales », il aura toujours un mépris envers notre mobilisation. Nous espérons que la mobilisation populaire grandisse dans tout le pays. Nous sommes convaincus que c'est nécessaire pour que nous obtenions gain de cause.
Et il faudra aussi finalement une loi qui prenne en main la question des réparations. La revendication de notre collectif c'est une loi programme. C'est-à-dire non pas quelque chose bricolé mais une loi qui mette en place un plan véritablement de réparation qui prenne en compte tous aspects économiques, sociaux, sociétaux, scientifiques, médicaux, sanitaires que ce problème du chlordécone pose.
C'est un vaste combat. Il est rare que la Guadeloupe et la Martinique se mobilisent sur une aussi longue période sur un même problème. Cela prouve que ce problème est sérieux. Tous les efforts qui ont été fait pour faire diversion n'ont jamais réussi. C'est aujourd'hui un combat essentiel pour tous les Guadeloupéens et les Martiniquais.
Propos recueillis par Ulysse, publié par L'Insoumission le 11 novembre 2024.
https://linsoumission.fr/2024/11/11/vie-chere-martinique-pierre-charles/
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Argentine : un nouveau temps politique

La nouvelle situation politique en Argentine sous le gouvernement d'extrême droite de Javier Milei.
La scène internationale montre un fort « risque géopolitique » dû aux guerres qui menacent de s'étendre, à la montée de l'extrême droite et à des sociétés divisées presque complètement en deux avec de sérieux risques de confrontation interne et à la situation dans Notre Amérique. Avec des gouvernements comme celui de Milei dans notre pays, de Bukele au Salvador et de Noboa en Équateur. Il y a en outre la situation au Venezuela, objet de débats dans toute la région, qui est plus complexe.
13 novembre 2024 | tiré du site d'Inprecor
https://inprecor.fr/node/4432
C'est dans ce contexte que le président Milei s'est exprimé à l'Assemblée générale de l'ONU, après l'« acting » de la cloche à Wall Street et sa rencontre avec des hommes d'affaires de premier plan. Il a accusé l'ONU d'être une institution qui ne sert qu'à stimuler des idées socialisantes tout en réitérant son négationnisme environnemental et sa vision rétrograde des progressismes. Il a rejeté le « Pacte pour l'avenir » et décidé de ne pas adhérer à l'Agenda 2045. Il a entériné sa non-neutralité et son alignement inconditionnel sur les États-Unis et Israël. C'est un sacré changement de cap pour le pays.
Si quelque chose était clair dans son discours à l'Assemblée générale, c'est qu'il ne s'adressait pas aux présidents réunis, mais aux puissants de ce monde. Aux 1% qui concentrent la richesse mondiale, aux grandes entreprises, cherchant à démontrer qu'idéologiquement, il est l'un d'entre eux. Que l'Argentine, sous sa présidence, veut être le plus ardent défenseur et de porte-parole du programme du grand capital international et de la constitution d'un organisme supranational, au-dessus de la souveraineté des États-nations.
C'est ce positionnement international, ainsi que ses convictions sur les propositions de l'école autrichienne, qui définissent l'orientation des politiques officielles dans notre pays et par lesquelles le président Milei se voit et se présente comme le fondateur d'une nouvelle étape historique de la politique locale.
Ce nouveau moment mondial s'est accélérée de manière vertigineuse dans notre pays. Depuis l'adoption de la Loi Bases1 et d'un ensemble de mesures fiscales. La temporalité de la crise a ouvert le temps des urgences. Celles du gouvernement (pour faire avancer son programme au plus vite) et celles des travailleurs (pour stopper la barbarie sociale en cours). Le temps joue en faveur des deux côtés.
Tout se déroule dans le cadre d'une macroéconomie qui, en termes néolibéraux, « s'arrange », même avec ses incohérences et ses contradictions, et d'une microéconomie qui, confiée par le président aux hommes d'affaires, ne décolle pas et où le coût de l'arrangement de la macroéconomie se manifeste dans les indices dramatiques de pauvreté et d'indigence et la peur de perdre son emploi.
Il y a quelques mois encore, on disait que le gouvernement était davantage remis en question par « le haut » que par « le bas ». Aujourd'hui, « le haut » semble plus calme. Les pressions du patronat, de divers économistes libéraux et de la CGT ont été tempérées, le FMI observe attentivement, fait pression mais n'étrangle pas. Il n'y a pas, pour l'instant, de conflits inter-capitalistes ouverts. Seuls subsistent les différends et les tensions au sein du gouvernement et dans la LLA2, et entre la LLA et le PRO, qui monte en intensité. Des différends qui ne changent pas le cours général des choses.
En bas, les conflits se multiplient, sans que l'on puisse parler d'une vague de luttes. Il y a des conflits, des mobilisations et des débats pour des raisons et des objectifs multiples et variés dans tout le pays sans qu'on parvienne à les unifier, ni commencer à dépasser la fragmentation (est-elle déjà structurelle ?) et à leur donner une perspective commune. Il n'y a pas non plus de grands projets politiques en vue qui rompraient avec le néolibéralisme et ouvriraient des voies vers des transformations plus profondes.
Cependant, le conflit sur le financement des universités et peut-être aussi celui de l'aéronautique, auquel s'ajoute maintenant celui de la santé, pourraient être les cas emblématiques qui ouvriraient une nouvelle ère politique.
Nous sommes en attente des décisions des syndicats des transports sur une éventuelle grève générale le 30 de ce mois, ce qui constituerait une manifestation de solidarité qui élargirait le champ du conflit. Quant à la récente marche fédérale pour la défense de l'université publique, elle a été massive dans tout le pays, avec des changements quantitatifs et surtout qualitatifs en termes de composition et d'objectifs plus politiques. Cette massivité exerçait une pression sur le parlement pour qu'il renverse enfin le veto du président et maintienne la loi en vigueur. Au contraire, le gouvernement a réussi à imposer son veto, mais il s'agit d'un triomphe à la Pyrrhus : il a gagné au parlement, mais il perd dans la rue.
Après l'imposition du veto, le mouvement étudiant, très calme depuis longtemps, a spontanément explosé. Les étudiants, les enseignants et les travailleurs non enseignants se sont réunis et se sont déclarés en état d'assemblée permanente où les décisions sur la conduite du mouvement sont prises collectivement. Les facultés sont occupées (une soixantaine dans 29 universités du pays à l'heure où nous écrivons ces lignes), des cours publics sont organisés, des rues et des avenues sont bloquées. Il s'agit d'un mouvement fédéral de grande ampleur nationale, qui reprend les vieilles traditions du mouvement étudiant, lequel a joué un rôle important à plusieurs moments de notre histoire (réforme universitaire de 1918, Cordobazo de 1969).
Tous sont conscients qu'il ne s'agit pas seulement d'un problème de financement – la somme demandée est minime en termes de PIB – mais qu'il s'agit d'une lutte politique et idéologique pour le destin de la culture générale du pays et son horizon futur. Ils sont également conscients qu'il s'agit d'un combat de longue haleine, le gouvernement n'ayant pas la possibilité de reculer. La manière dont ce conflit sera résolu, s'il pourra stimuler les luttes dans d'autres secteurs, en particulier dans le mouvement ouvrier, peuvent décider comment la lutte des classes se poursuivra dans le pays et du sort du gouvernement Milei lui-même.
En attendant, nous entrons dans le dernier trimestre de l'année sans indices significatifs de sortie de la phase dépressive du cycle. Le taux d'intérêt va-t-il enfin franchir le plancher des 3% comme l'espère le gouvernement pour octobre ? Le flux de dollars, résultat d'une batterie de mesures dont le blanqueo3, va-t-il enfin améliorer le niveau des réserves ? La levée du contrôle des changes va-t-elle enfin apporter les investissements espérés ? Tout reste à voir.
Les vieilles questions demeurent : comment intervenir dans la crise, sans se limiter à soutenir et stimuler les luttes ? Comment exprimer l'objectif commun qui fasse converger toutes les luttes ? Comment faire prendre conscience aux protagonistes que les événements dans lesquels ils sont impliqués dépassent l'objectif immédiat ? Comment élever le niveau politique des protagonistes et de leurs luttes ?
Et l'ambiance sociale ? Combien de temps allons-nous supporter cette barbarie qui semble ne pas avoir de fin ? Le mouvement étudiant en cours pourrait être décisif. Là aussi, tout reste à voir.
Publié le 16 août 2024 par la revue Movimento, traduit par Luc Mineto
1. La loi « Loi Bases et points de départ pour la liberté des Argentins », qui organise le démantèlement de l'État argentin a finalement été adoptée par le Sénat dans la nuit du mercredi 12 au jeudi 13 juin [NdT].
2. LLA, La Liberté Avance est la coalition d'extrême droite représentée par Milei au premier tour des élections présidentielles. Le PRO, Proposition Républicaine est une coalition de droite, regroupant en particulier les partisans de Macri ; représenté par Patricia Bulich au premier tour, il apporte on soutien à Milei au second tour [NdT]
3. Blanqueo (blanchiment). Une des mesures fiscales mise en œuvre par Milei prévoit de amnistier les fraudeurs et de « blanchir » les capitaux non déclarés pourvus qu'ils soient investis dans l'économie argentine jusqu'en décembre 2025 [NdT].
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Témoignage d’un camarade ukrainien libéré après une intense campagne

Cette importante interview de Maksym Butkevych est parue en ukrainien dans Zmina, (« Changement ») site de l'organisation de défense des droits humains du même nom, dont il fut l'un des fondateurs. C'est avec émotion, et avec la fierté d'avoir participé, à notre échelle, au combat pour sauver Maksym Butkevych, et qui, comme il le dit lui-même, doit continuer pour toutes et tous les autres, que nous reproduisons cette traduction, effectuée dans le cadre du RESU par Anne Le Huérou – qu'ils en soient remerciés.
19 novembre 2024 | tiré du site Arguments pour la lutte sociale
https://aplutsoc.org/2024/11/19/maksym-butkevych-raconte/
C'est un document de valeur, de valeur humaine, et par là de haute valeur politique. Pour avoir suivi les tout premiers témoignages et commentaires à propos de Maksym depuis sa mise en liberté, nous pouvons dire qu'il est pudique sur lui-même et préoccupé des autres, et laisse entendre ou ne dit pas tout ce qu'il a subi, mais que son récit en a plus de force. Démocrate radical, nationaliste libertaire, chrétien libre-penseur … n'essayons pas de cataloguer ce camarade : il est Maksym Butkevych et il est en liberté, c'est une belle victoire pour l'émancipation humaine que nous n'osions espérer !
L'interview est suivie d'un court résumé des actions de Maksym Butkevych, également traduit et reproduit ici. Nous avons parfois remplacé le mot « réhabilitation, », qui peut prêter à contresens en français, par « réadaptation ».
La rédaction d'Aplutsoc.
« Pour moi, c'est quelque chose d'essentiellement humain. C'est vraiment ce qui fait qu'une personne est humaine : la liberté, la conscience de sa liberté et le sens que cette liberté apporte.
J'ai parfaitement compris que si les Russes l'emportaient, il n'y aurait plus de protection des droits de l'homme sur ce territoire.
» Le plus grand danger en captivité, c'est de perdre une partie de soi-même » : le défenseur des droits humains Maksym Butkevytch à propos de son engagement sur le front, de sa détention et de son retour.
Toute l'équipe du centre de défense des droits humains ZMINA attendait cette conversation après avoir reçu la bonne nouvelle de la libération du militant des droits de l'homme, cofondateur de l'organisation, journaliste et prisonnier de guerre Maksym Butkevych. Cette libération a eu lieu le 18 octobre de cette année, lors du 58e échange de prisonniers de guerre. Le militant des droits de l'homme a passé plus de deux ans en détention.
ZMINA a rencontré Maksym dans une gare, lors d'une étape entre deux lieux de son parcours de « réhabilitation », pour évoquer sa participation à la guerre sur le terrain, ses plus de deux ans de captivité, le sens qu'il a pu y trouver, mais aussi le déroulement de la réhabilitation des militaires après leur retour de captivité et les difficultés du retour à la vie civile.
Maksym, cela fait plus de 20 ans que tu t'occupes de défense des droits et au début de l'invasion à grande échelle, tu as décidé de rejoindre les forces armées ukrainiennes. Qu'est-ce qui a guidé ton choix de changer d'activité pour aller à l'armée ?
C'est une question très importante. Je viens de découvrir que beaucoup de choses ont été dites et écrites sur moi dans les médias pendant mon absence. Et certains de ces textes disaient que j'étais pacifiste. Mais je ne suis pas pacifiste. En revanche, je ne suis en effet pas un partisan de la violence en tant que méthode, et l'engagement militaire, d'une manière ou d'une autre, implique de tuer des gens. C'est pour moi un problème et un dilemme moral et éthique.
La situation dans laquelle nous nous sommes trouvés le 24 février 2022 nous a placés devant un choix : soit laisser notre liberté être détruite, soit nous battre. Sinon, nous aurions été contraints de renoncer à notre activité, contraints d'obéir, de simplement manger, boire, dormir, avoir peur et faire ce qu'on nous disait. Telle aurait été notre perspective. Nous avons donc dû résister pour sauver notre liberté. Pour moi, c'est quelque chose d'essentiellement humain. C'est vraiment ce qui fait qu'une personne est humaine : la liberté, la conscience de sa liberté et le sens que cette liberté apporte.
J'ai parfaitement compris que si les Russes l'emportaient, il n'y aurait plus de protection des droits de l'homme sur ce territoire. Ce serait impossible. Nous nous sommes battus pendant très longtemps pour les droits que nous avons aujourd'hui. Nous avons réussi certaines choses, nous avons échoué dans d'autres, mais s'ils occupaient ces territoires, tout serait détruit. En fin de compte, si je raisonne égoïstement, il s'agit de nombreuses années de ma vie, en fait, la principale chose que j'ai faites ces dernières années, toutes les réalisations, toutes les réussites, auraient été détruites.
Comment t'es-tu retrouvé à l'armée en particulier dans le bataillon spécial numéro 210 Berlingo ?
J'avais effectué la préparation militaire à l'université alors de mes études et j'étais officier. Dans l'armée on appelle ce genre de personne des « veston » c'est-à-dire des gens qui ont un grade d'officier mais qui n'ont aucune expérience de l'armée et encore moins des opérations de combat.
Je me suis présenté au bureau d'enregistrement et d'enrôlement militaire dans la soirée du 24 février pour trouver une unité de défense territoriale et la rejoindre. Ils m'ont demandé mon grade militaire, et j'ai dit que j'avais le grade de lieutenant du fait de la préparation militaire universitaire mais que je ne me souvenais plus de rien. Mais j'étais prêt à prendre une pelle et à creuser ce qu'il fallait.
A cette époque, les combats commençaient près de Kiev et les Russes étaient déjà visibles à la périphérie. J'avais préparé un sac à dos à l'avance, acheté quelques affaires et une Bible de voyage et j'étais prêt à m'engager. D'ailleurs, pendant mon séjour dans la colonie, ma foi a été l'un des piliers qui m'a permis de tenir le coup. Je n'en parlais pas auparavant, c'était avant tout une affaire intime. Je n'accepte pas que l'on impose quoi que ce soit, y compris dans le domaine religieux. En même temps, il ne faut pas confondre imposer et prêcher. Beaucoup de gens, y compris mes ami.e.s, ne connaissaient pas mes convictions religieuses. Aujourd'hui, j'y pense plus souvent, car quelque chose a changé – en moi et dans le monde.
« Nous ne nous attendions pas à être fait prisonnier nous nous pensions à être des « 200 » (tués) ou des « 300 » (blessés) [nom de code donné dans l'armée soviétique aux soldats morts ou blessés à rapatrier NdT] ».
Tu as le sentiment que des forces supérieures ont aidé à dépasser l'épisode de ta captivité ou bien s'agissait-il de ta force intérieure ?
Oui, j'ai ce sentiment. Mais à mon sens la foi et les forces intérieures sont liées. J'ai le sentiment qu'il y a un sens, indissociable du sens de la vie. Pour le dire autrement c'est le sentiment que les choses ne sont pas « juste comme ça ».
Lors de l'un des interrogatoires on a essayé de prendre les mots de passe de mon compte Facebook et de ma boîte mail. À ce moment-là je ne savais pas encore que mon compte Facebook avait heureusement été désactivé par des amis mais de toute façon j'avais une double authentification… Je leur ai dit que de toute façon ils ne pourraient pas rentrer sur mon compte puisque ils avaient eux-mêmes perdu mon téléphone. J'ai ajouté que le mot de passe avait probablement été changé et que si je leur donnais maintenant un vieux mot de passe ils allaient dire que je les trompais. Ils ont demandé qui les avaient changé et j'ai répondu : « des amis à qui j'ai laissé mes mots de passe ».
En effet, je les avais laissés au cas où je finirai « 200 » pour que ces amis aillent sur ma page et l'annoncent et qu'il puisse entrer sur mon compte mail et écrivent une réponse automatique du genre « malheureusement la personne ne peut lire votre message car elle est morte ». C'est toujours triste lorsque l'on commente les postes d'une personne qui a disparu… L'enquêteur m'a regardé avec des yeux ronds et m'a demandé si j'avais vraiment pensé à l'avance que je pouvais devenir un « 200 ». Je lui ai répondu que c'était la guerre, que nous étions partis la faire et qu'il y avait en effet des situations où je pouvais devenir un « 200 » et que donc bien sûr j'y avais pensé comme toute personne qui se retrouve sur la ligne de front.
Vous avez donc admis la possibilité de mourir à la guerre ?
Je pense que tous ceux qui vont en première ligne réfléchissent intérieurement – consciemment ou inconsciemment – à ce qui se passera quand il sera « 300 » ou « 200 ». Cependant, je n'ai vu pratiquement personne réfléchir à ce qui se passerait s'il était capturé. Nous n'étions pas préparés à cela. Par conséquent, lorsque nous avons été capturés, nous avons été surpris.
Nous nous créons nous-mêmes en faisant différents choix dans la vie. Les choix que nous faisons maintenant déterminent qui nous serons plus tard. Plus tard, à de nombreuses reprises en prison, à la fois dans le centre de détention provisoire et ensuite dans la colonie pénitentiaire, les gars et moi avons discuté de ce qui s'était passé et de la raison pour laquelle cela s'était passé. J'avais 20 hommes. Sous mes ordres, j'étais commandant de peloton dans le 210e bataillon spécial « Berlingo » des forces terrestres de l'armée ukrainienne. Mais en captivité, mes codétenus me disaient régulièrement : nous ne savons pas quel genre de commandant tu étais – je ne le sais pas moi-même, pour être honnête, seuls mes hommes pourraient me le dire – mais vous auriez mieux fait de travailler dans le domaine des médias, ou aider les gens, puisque c'est en effet des choses que je sais faire, et cela aurait été plus utile pour nous tous que mon séjour au dans le centre de détention provisoire (SIZO) de Luhansk. De fait, tout est plus utile que d'être enfermé dans le SIZO de Luhansk.
Mais je dois dire que je ne considère pas ce temps comme perdu. Parfois, les gars étaient tellement déprimés qu'ils pensaient que leur temps de captivité avait été perdu, tout simplement rayé de leur vie. Mais je n'ai pas eu ce sentiment. Et lorsque j'ai examiné ce que j'avais fait de mal depuis le début de l'invasion, les mauvais choix que j'avais faits, je suis arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas de mauvais choix. Il y a des choses que je regrette dans ma vie, mais pas dans cette chaîne d'actions. J'ai fait tout ce qu'il fallait.
Comment as-tu pris conscience que le temps passé en captivité n'avait pas été perdu ?
C'est bien sur une période de perte. C'est une période de manque, de privation de quelque chose de très humain et de très personnel. Le plus grand danger de la captivité est de perdre une partie de soi-même. En ce qui me concerne, j'ai essayé de comprendre ce que je pouvais apprendre de cette expérience, ce qui pourrait m'aider plus tard, si quelque chose pouvait m'aider à mieux aider les autres.
En captivité, j'ai appris à mieux connaître les gens, le monde et, bien sûr, les violations des droits de l'homme. En somme je peux dire que j'ai fait deux ans et demi de recherche de terrain. Je ne m'étais jamais spécialisée dans le système pénitentiaire et les violations des droits de l'homme qui y sont commises, mais en captivité, j'ai appris à le connaître très bien et à comprendre les choses fondamentales de manière plus approfondie et plus large.
J'ai également eu l'occasion d'organiser mes pensées et mes croyances, de comprendre comment elles sont liées entre elles, dans quelle mesure mes positions sont fondées, mon attitude à l'égard de certaines choses, si j'ai suffisamment de raisons de penser ce que je pense et de dire ce que je dis. Et surtout, quelles devraient être les priorités dans mes activités, dans ma vie.
« En captivité, je pensais constamment à ce à quoi je n'avais pas le temps de penser dans la vie civile »
En tant que défenseur des droits de l'homme, tu as été façonné par des valeurs fondamentales liées aux droits humains. Ont-elles changé d'une manière ou d'une autre en prison ?
Je pense que mes valeurs n'ont fait que se renforcer. Dans notre vie quotidienne, nous sommes constamment immergés dans un flux d'événements, d'informations, d'activités, et parfois nous n'avons tout simplement pas le temps d'examiner certaines choses d'un point de vue différent – plus large ou plus élevé.
En captivité, j'ai très vite, littéralement dès les premiers jours, pensé que j'avais maintenant une chance de le faire. J'ai essayé de faire intérieurement des choses que je n'avais pas eu le temps de faire pendant des années. En captivité, je pensais constamment à ceux à qui je n'avais pas eu le temps de penser correctement dans la vie civile. Et ce n'est pas tout. J'ai aussi prié. D'ailleurs, c'était probablement la seule chose que je pouvais faire pour de nombreuses personnes formidables.
Après un an et demi de captivité, lorsque j'ai eu la possibilité de lire, j'ai commencé à lire beaucoup de livres, comme je le faisais auparavant. En plus des livres en russe et en ukrainien, j'ai mis la main sur quelques livres en anglais que quelqu'un d'autre possédait, et grâce à eux et à la compilation de textes dans ma tête, j'ai essayé de conserver la langue autant que possible. Tous les livres que je lisais étaient notés dans mon carnet.
Qu'avez-vous lu exactement ? Quels sont les livres dont vous vous souvenez le plus ?
Dans la colonie pénitentiaire, il y avait une bibliothèque, et on pouvait y trouver les choses les plus inattendues. J'ai été enchanté par le livre « Theoretical and Applied Linguistics » du professeur Zvegintsev, publié en 1968, que j'ai lu une fois et demi. J'ai découvert de nombreux livres différents – sur la zoopsychologie, la philosophie, la théologie et la fiction. Par exemple, j'ai lu Tchekhov, que je n'avais pas eu le temps de lire depuis longtemps. J'ai relu beaucoup de choses que j'avais lues auparavant, mais je les ai lues d'une nouvelle manière. On pouvait également trouver dans cette bibliothèque des livres en ukrainien, qu'il s'agisse d'œuvres ukrainiennes ou de traductions de grands auteurs étrangers, jusqu'à ce qu'ils soient finalement retirés au printemps et au début de l'été de cette année.
De retour au centre de détention provisoire, le premier livre qui mérite ce nom est le Nouveau Testament et les Psaumes, qui, par une étrange coïncidence, sont arrivés dans notre cellule et que j'ai dû lire 15 fois. D'ailleurs, nous lisions parfois à haute voix, car tous les membres de la cellule ne savaient pas lire. Un camarade, prisonnier de guerre, était blessé et avait presque perdu la vue, et un autre prisonnier ne pouvait pas le faire à cause de son âge. En général, pendant ma détention, j'ai lu plus des dizaines de livres, 50, je crois, au moins. Dans la colonie, lorsque je travaillais, le moment privilégié pour moi était 40 minutes avant le couvre-feu. Je m'allongeais sur mon « palmier » – un lit situé au deuxième niveau des couchettes – et je lisais pendant les 40 minutes précédant l'extinction des feux.
Nous pratiquions également l'anglais au SIZO et dans la colonie. Je l'ai enseigné pour la première fois de ma vie. L'un de mes « élèves » faisait d'assez bons progrès. Il a insisté pour que je brevette cette méthodologie, car nous apprenions la langue sans texte, sans stylo, sans papier, en mémorisant les mots selon un certain système et en utilisant les outils à notre disposition.
Par exemple, nous avions un filtre de cigarette, une allumette brûlée, un morceau de paquet de cigarettes, et c'est ainsi que j'expliquais la structure d'une phrase – où se trouve le verbe auxiliaire, etc. Nous avons appris l'anglais à travers les paroles de chansons. J'ai soudain découvert que je me souvenais de paroles tout à fait inattendues, bien que très peu nombreuses. Il s'est avéré que les paroles d'une célèbre chanson anglaise dont je me souvenais étaient parfaites pour apprendre le présent continu.
Revenons à ton engagement dans l'armée. Quelle est la tâche ou la bataille dont tu te souviens le plus ?
Il y a eu deux étapes dans mon engagement : la première fois c'est vers Irpin-Vorzel, dans la région de Zhytomyr, près de l'autoroute de Zhytomyr, et la seconde dans l'est de l'Ukraine. Mon unité était chargée de renforcer la Garde nationale dans une certaine zone de la région de Kiev. Nous nous sommes rendus au poste de contrôle avec nos véhicules et avons constaté qu'il ne s'agissait pas d'un poste de contrôle, mais de la ligne de front : les Russes se tenaient à quelques centaines de mètres. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés en première ligne dans la région de Kiev.
Au bout de la rue où nous étions stationnés il y avait une pharmacie, une agence postale et et plusieurs maisons détruites par les tirs des chars russes. Il y avait le corps d'un civil qui avait fui les bombardements et n'avait pas réussi à s'en sortir ; sa jambe tenait debout toute seule. Quelques minutes après notre arrivée, avant même que nous ayons eu le temps de prendre nos lance-grenades, un véhicule blindé de transport de troupes a déboulé à grande vitesse du côté russe et, se plaçant devant nous, a commencé à nous tirer dessus avec une mitrailleuse de gros calibre, à travers la rue. Je me souviens très bien de cet épisode, le premier contact direct. Je me souviens également de notre entrée à Mykhailivka-Rubezhivka lors de la libération de ces villages. Les habitants nous ont accueillis les larmes aux yeux, nous ont apporté des fleurs, des boîtes de jus de tomate – tout ce qu'ils avaient après un mois d'occupation. Bref, c'était absolument incroyable. On sentait que les gens nous attendaient.
La deuxième expérience est liée à un voyage dans l'Est. Nous avons reçu l'ordre de nous déplacer pour renforcer nos unités qui tenaient la défense dans le Donbass. C'était une expérience complètement différente, car nous étions dans la steppe, où certaines de nos armes étaient tout simplement inefficaces. Par exemple, ce qui constituait notre avantage dans les combats urbains a été complètement réduit à néant là-bas. Nous avons rempli la fonction de troupes terrestres conventionnelles, accomplissant les tâches qui nous étaient assignées.
D'abord, nous avons perdu le contact radio, puis au matin nous avons compris que nous étions pratiquement encerclés
Peux-tu nous dire quand et dans quelles circonstances tu as été capturé ?
Nous avions reçu l'ordre de nous rendre dans le village de Myrna Dolyna, dans la région de Louhansk. Près du village, il y a des forêts et un terrain assez difficile, c'est-à-dire pas de la steppe, mais des ravins. À notre arrivée dans la soirée, nous avons immédiatement essuyé des tirs de mortier nourris. Le feu a duré toute la nuit.
Le matin, le village était complètement différent de la veille au soir. Il n'en restait plus grand-chose. Lors d'une pause nous avons reçu l'ordre de nous déplacer et de prendre des postes d'observation, le long de la route qui allait de Lysychansk au nord à Zolote au sud. C'était une route stratégiquement importante pour nous. Notre tâche consistait à observer et, s'il y avait des forces ennemies, de les signaler. Cependant, nous ne devions pas engager le combat sans en avoir reçu l'ordre. Pendant que l'ordre nous était transmis, une autre attaque au mortier a commencé, et c'est ainsi accompagnés que nous nous sommes rendus à notre poste d'observation.
À un moment donné, nous avons eu des problèmes de communication. Les radios que nous avions n'étaient pas assez bonnes, il n'y en avait pas assez, et de toute évidence, le matériel électronique de l'ennemi fonctionnait. De plus, nous avons rapidement manqué d'eau sur le chemin du poste, c'était un mois de juin très chaud. En quelques heures, nous avons perdu toute communication. Même les talkies-walkies qu'on nous avait donnés ne captaient personne. Au matin, nous avions remarqué qu'un grand nombre de personnes et de véhicules ennemis avaient pénétré dans le terrain voisin.
Alors que nous nous dirigions déjà vers Myrna Dolyna, il était clair que nous étions presque encerclés par l'ennemi. Tu vois c'est comme une sorte de bouteille dans laquelle on entre par le goulot, et il y avait déjà un territoire contrôlé par l'ennemi autour de cette bouteille. Nous comprenions que cela n'augurait rien de bon, mais nous avions des ordres et nous devions les exécuter. Plus tard, arrivés au poste, lorsque nous avons vu les marques sur les véhicules « O », nous avons compris qu'il s'agissait de l'ennemi. Mais à ce moment-là, nous ne pouvions plus exécuter l'ordre de rendre compte de la présence de forces ennemis, il n'y avait plus de communication, il n'y avait pas non plus d'ordre d'engager le combat et cela n'avait pas de sens, étant donné la différence de nombre nous et nos ennemis, et il était clair que nous devions nous retirer.
C'est alors que l'un des soldats de l'unité voisine a pris contact avec nous et nous a amenés au poste d'observation. Il nous a dit que toute la zone était encerclée, mais que l'anneau n'était pas encore fermé. Par conséquent, nous devions essayer de partir en utilisant ses points de repère. C'est ce que nous avons fait. Pour être honnête, nous avions le sentiment que quelque chose n'allait pas, mais nous n'avions pas le temps d'y réfléchir et nous n'avions pas d'autres options. Nous n'avions pratiquement pas dormi depuis plusieurs jours, nous étions sans eau depuis presque 24 heures, nous étions fatigués, et certain de mes hommes n'allaient pas bien. Alors ce soldat a tiré une fusée éclairante, ce qui était très étrange dans ces conditions de quasi-encerclement. Nous avons dû courir à travers le champ jusqu'à la ceinture forestière d'où provenait la fusée. Lorsque nous avons été à quelques dizaines de mètres, il nous a dit qu'il était désolé, mais qu'il était prisonnier depuis la nuit dernière, que nous étions maintenant dans le collimateur et que si nous ne déposions pas les armes, ils nous tueraient.
Qu'as-tu ressenti à ce moment-là ?
Il y avait un champ ouvert autour de nous. Il n'y avait aucune possibilité de se jeter à terre, de se cacher ou de s'enfuir. Nous n'accomplissions plus aucune mission de combat – nous ne couvrions plus personne, nous ne défendions plus rien. J'avais huit hommes et j'étais responsable d'eux. J'ai donc donné l'ordre de déposer les armes.
Le type qui nous a fait sortir était dans la même cellule que nous. Il a été contraint de le faire sous la pression physique et la violence. Mais surtout, il croyait qu'en nous forçant à nous rendre, il nous avait sauvé la vie – c'est ce que les Russes lui ont dit. C'était peut-être vrai, il m'est difficile d'en juger.
Comment les Russes t'ont-ils traité ?
Ils ont immédiatement pris nos documents, nos téléphones et certains objets de valeur. Par exemple, ils ont pris mes écouteurs sans fil, la montre l'un, un objet à un autre … L'un des soldats russes a demandé à qui appartenaient ces écouteurs. J'ai répondu que c'était les miens. Il m'a demandé si je les lui donnais.
C'est vrai que quand on est à genoux, qu'on a les mains attachées et qu'une mitrailleuse est pointée sur vous, on est prêt à donner n'importe quoi, en principe. Mais j'ai dit non. Il a été très surpris, même un peu troublé. Je lui ai dit que c'était un cadeau d'un proche, et que « on ne redonne pas des cadeaux ». Il était d'accord, mais il ne comprenait pas ce qu'il devait faire.
Manifestement, ils essayaient d'éviter de comprendre qu'ils volaient des choses aux prisonniers. Je lui ai dit qu'il devrait probablement appeler cela un « trophée » ou quelque chose de plus beau que ce que c'était réellement. Plus tard, à un autre moment, un autre soldat a pris ce qui restait, par exemple une montre tactique chinoise neuve, bien que bon marché. Il n'a pas pris la peine de nommer quoi que ce soit, il a simplement tout pris. Un autre soldat qui avait encore son gilet pare-balles a été emmené, en lui demandant de ne pas en parler à ses commandants. Comme nous l'avons compris, ils en avaient de pires à l'époque. Ils nous ont également retiré nos chaussures – nous avons passé les mois suivants en chaussettes.
Les Russes savaient-ils qui tu étais et ce que tu faisais dans la vie civile ? Tes activités dans le domaine des droits de l'homme et du journalisme ont-elles eu un impact sur ton séjour en captivité ?
Après quelques jours dans le centre de détention, j'ai commencé à faire l'objet d'une attention particulière. Mais ensuite, pendant le reste de la captivité, l'attitude était tout à fait normale. Sur le chemin du point de transfert, les Russes m'ont demandé lequel d'entre nous était un officier, et j'ai répondu. Ils voulaient faire une vidéo de moi en train de gronder le commandement. J'ai refusé de le faire. Je leur ai dit qu'ils pouvaient bien sûr me forcer à le faire, mais qu'il serait visible et clair que cela avait été fait sous la contrainte physique.
Où avez-vous été emmenés pour la première fois lorsque vous avez été capturés ?
À la fin de la journée, nous avons été emmenés dans un bâtiment délabré où nous avons passé la nuit sur le sol en béton. À un moment donné, un officier cagoulé est apparu, un officier supérieur, et tout le monde lui a obéi. Il nous a mis à genoux, les mains attachées, et nous a parlé, provoquant chez les gars des réactions émotionnelles fortes, nous agressant verbalement pour démontrer sa prétendue « supériorité ».
Il demandait par exemple qui avait des épouses à l'étranger, en Pologne, en Allemagne ou en Turquie. Il commençait ensuite à raconter aux gars ses fantasmes sexuels pathologiques sur ce que les hommes devaient leur faire là-bas, en ce moment même, avec des détails. Il leur dessinait des images de rapports sexuels collectifs, oraux et anaux forcés. Il était clair que cet homme avait des problèmes de pathologie sexuelle. Il nous a menacés de nous condamner à une peine de 10 à 15 ans et de nous envoyer dans une colonie pénitentiaire pour « plaisirs sexuels », et de nous faire arriver à Kiev sans nos dents de devant. En expliquant pourquoi nous n'aurions plus de dents de devant.
Ensuite, ils nous ont apporté des rations militaires et ne nous ont délié les mains que lorsque nous sommes allés un par un, sous la menace d'une arme, déféquer dans un tonneau en plastique transparent, coupé par le haut, qui se trouvait dans un coin.
Il faut dire que par la suite, nous avons été traités plus calmement, sans humiliation. Pour être honnête, j'ai essayé de ne pas trop insister. J'ai tout de suite choisi la ligne de conduite suivante : je n'ai rien à cacher, mais je ne dois pas non plus me faire passer pour quelqu'un d'autre. J'ai essayé de prendre sur moi les conversations risquées et provocatrices afin que les gars ne s'y laissent pas entraîner.
Est-ce que vous ou vos hommes avez subi des violences de la part de l'armée russe ?
Plus tard, lorsque de nouveaux soldats en uniforme sont arrivés, ils nous ont emmenés un par un dans des pièces voisines, nous ont posé des questions sur notre service et ont enregistré des vidéos de nous. C'était un peu comme un interrogatoire. Ainsi, lorsqu'un des soldats a été amené pour être interrogé, il a dit qu'il ne se souvenait pas des indicatifs de ses commandants. Il a donc été frappé à plusieurs reprises avec un crochet en bois. J'ai immédiatement dit aux gars que puisque nous n'avions pas d'informations confidentielles, nous devions tout dire pendant l'interrogatoire pour sauver notre peau.
Ils m'ont intimidé ensuite en me montrant une fosse dans l'arrière-cour, menaçant de m'y jeter et de me montrer ceux qui « ne comprenaient pas comment se comporter ».
Il y a eu un moment intéressant lorsqu'ils ont enregistré une vidéo avec moi. L'un d'eux a dit à l'autre : « Regarde, c'est vraiment un journaliste, parce qu'il a dit ce qu'il voulait, pas ce dont nous avions besoin ». Plus tard, l'officier cagoulé mentionné plus haut nous a lu des extraits du message de Poutine du 22 février 2022, je crois, où il parle de l'Ukraine, et ceux qui étaient pointés du doigt par l'officier devaient réciter ces extraits mot pour mot, et si quelqu'un faisait une erreur ou bégayait, je serai battu avec un bâton. Parce que j'étais le seul officier, le commandant, et que je ce « connaisseur de l'histoire de Poutine » avait une dent contre moi. J'ai pensé qu'il valait mieux qu'ils me battent moi plutôt que mes hommes.
Ensuite, on nous a emmenés ailleurs et on nous a jetés sur un sol en béton. Là, ils nous ont enlevé les bandeaux des yeux, nous ont délié les mains et nous avons vu que nous étions dans une cellule. Ils ont ensuite apporté de vieux matelas déchirés et des serviettes. Certains d'entre eux portaient le cachet du SIZO de Luhansk. C'est ainsi que nous avons su où nous étions. Au total, j'ai passé un an et trois mois dans le centre de détention, jusqu'en septembre 2023.
Le 6 mars 2023, le tribunal d'occupation de la région de Louhansk vous a condamné à 13 ans de prison et vous a accusé de « traitement cruel de civils et d'utilisation de méthodes interdites dans un conflit armé ». Comment cet article a-t-il vu le jour ?
Dans le SIZO de Luhansk, nous avons été activement interrogés par diverses structures : des personnes en uniforme militaire et en civil. On nous posait des questions sur les mouvements de notre unité, sur l'endroit où nous nous trouvions et sur notre nombre. Le 16 juillet, j'ai été interrogé par deux personnes, l'une en civil et l'autre dans une sorte de camouflage non réglementaire. L'un des enquêteurs s'intéressait aux activités de la Fondation Soros en Ukraine et voulait que je donne une interview à un « média international réputé » non nommé pour en parler. Je lui ai dit que je ne voulais pas donner d'interview, mais que s'ils me forçaient à le faire, je pourrais lui dire ce que je savais : que la branche ukrainienne de la fondation soutenait des projets sur la décentralisation, le gouvernement local, l'aide juridique et les publications universitaires.
Il n'a pas beaucoup apprécié la conversation et c'est à ce moment-là que j'ai entendu pour la première fois : « Nous allons te mettre en prison ». Cette promesse s'est concrétisée un mois plus tard, le 13 août. J'ai été emmené pour un interrogatoire, où des personnes en uniforme, le visage couvert, m'ont assis de telle sorte que je ne pouvais voir que le sol, c'était inconfortable, ils m'ont déséquilibré de diverses manières, ils m'ont intimidé. Puis ils m'ont dit qu'il y avait trois options : la première était de signer tout ce qu'ils me donnaient sans le lire, ce serait un aveu de crime de guerre, je serais condamné et ensuite échangé ; la deuxième était de refuser de signer les documents, et je serais alors emmené pour une « enquête expérimentale » à savoir que je serai tué en ayant soi-disant essayer de m'échapper ; la troisième option était de rester en prison sans aucun échange pour on ne sait combien de temps, ou plutôt, aussi longtemps qu'ils le voulaient. Ainsi, si je ne coopérais pas et ne signais rien, je ne sortirais pas indemne, ni physiquement ni psychologiquement. Ils m'ont dit qu'à 45 ans, on pouvait mettre fin à sa vie. Si j'acceptais, ils m'emmèneraient dans l'arrière-cour, me donneraient une cigarette, me laisseraient appeler chez moi, puis ils me tireraient dessus.
L'un des interrogateurs m'a demandé si je voulais vivre et j'ai répondu que oui, si Dieu me le permettait. Il s'est accroché à cette réponse et, lorsqu'il a appris que j'étais chrétien, il a dit : « Eh bien, nous ne sommes pas chrétiens, cela ne nous concerne pas. » Ils ont ensuite imprimé le rapport d'interrogatoire, en se trompant sur l'endroit où j'avais « commis le crime ». Plus tard, j'ai appris qu'il s'agissait du fait que j'avais prétendument tiré avec un lance-grenades sur un immeuble résidentiel où il y avait des gens, et que deux femmes avaient été blessées. De toute façon, selon eux, peu importe ce qui était écrit sur les papiers, ils pouvaient me condamner sans mon témoignage. Ils m'ont dit que si je signais rapidement les documents, ils seraient envoyés au procureur puis au tribunal, et que je pourrais rentrer chez moi en octobre – je serais échangé.
Plus tard, alors qu'ils finalisaient mon dossier, ils m'ont emmené à Sievierodonetsk, dans la maison sur laquelle j'aurais tiré. Ils m'ont demandé de lever la main, de montrer une fenêtre spécifique, m'ont pris en photo, m'ont dit de montrer la fosse et de me souvenir de l'adresse. Lorsque j'ai demandé de quoi il s'agissait, ils m'ont répondu que je le saurais plus tard. La seule chose sur laquelle j'ai insisté à ce moment-là, dans la mesure où il était possible d'insister dans cette situation, c'est que je ne témoignerais contre personne, mais seulement contre moi-même, et que l'affaire devait se dérouler en l'absence de cadavres.
Comment avez-vous réagi à la condamnation à 13 ans de prison ?
Je m'y attendais. Les gars de la cellule et moi-même réfléchissions à la durée de ma peine. Ils étaient plus optimistes. Je m'attendais à 12-15 ans, c'est donc ce qu'ils m'ont donné. Mais j'espérais qu'il y aurait bientôt un échange et que je serais échangé. Quoi qu'il en soit, je savais que je ne resterai pas en prison aussi longtemps. Je n'avais aucun doute sur le fait que je ne purgerai pas la totalité de la peine.
Au cours de l'une des actions dites d'enquête, un officier du comité d'enquête de la Fédération de Russie a déclaré que la partie ukrainienne emprisonnait les Russes pour de longues périodes sous l'accusation de « franchissement illégal de la frontière de l'État par un groupe organisé de personnes armées afin de prendre une partie du territoire en faveur d'un autre État ». En d'autres termes, de longues peines sont prononcées pour ces faits et pour les crimes de guerre, et par conséquent, pour que leurs militaires soient échangés, disent-ils, ils ont dû nous condamner à des peines tout aussi longues.
Sais-tu ce qu'il est advenu de tes compagnons d'armes avec lesquels tu as été capturé ?
Deux d'entre eux ont été échangés à la fin de l'année 2022, et l'un d'eux est malheureusement décédé plus tard, en défendant notre pays et notre liberté. Deux autres ont été échangés cette année. Les autres sont toujours en captivité. Aucun d'entre eux n'a été condamné. Ils ont le statut de prisonniers de guerre.
D'après ton expérience, qu'est-ce qui t'a aidé à survivre à la captivité et à rentrer ?
Je n'avais aucun doute sur le fait que l'on se souvenait de moi, que l'on essayait de tout faire pour me libérer, que l'on pensait à moi, que l'on priait pour moi. J'essayais constamment de m'occuper l'esprit. J'ai essayé de résumer mes expériences antérieures, d'établir des liens internes entre ce en quoi je crois, ce dont je suis convaincu et ce que je fais.
J'analysais ma vie, j'essayais de la comprendre. J'ai réfléchi à la manière de mieux faire les choses, j'ai travaillé sur mes erreurs, j'ai donné la priorité aux choses vraiment importantes dans ma vie, j'ai essayé de ne pas oublier l'anglais et l'ukrainien, j'ai écrit des chroniques ou des discours dans ma tête, je me les suis lus, j'ai formulé des pensées et je me suis souvenu des personnes que j'avais rencontrées dans ma vie.
Tu suis actuellement une rééducation après votre captivité. Comment se déroule-t-elle, en quoi consiste-t-elle et quelle est son efficacité ?
C'est un processus intéressant. Pour être honnête, je pensais qu'il serait plus rapide et plus formel. Le processus de réhabilitation peut être divisé en quatre types d'activités : la première est la réhabilitation médicale, l'examen, le diagnostic pour comprendre ce que la personne a rapporté avec elle de captivité en termes de pathologies éventuelles ; la deuxième est psychologique, des psychologues travaillent avec vous et tentent de vous ramener à la vie dans un contexte plus libre ; la troisième est administrative, elle est liée à la récupération de documents volés, à toutes sortes de choses administratives ; et la quatrième est, bien sûr, la collaboration avec les forces de l'ordre et l'établissement des circonstances de la captivité. Ils essaient de faire tenir ces quatre sujets dans un laps de temps assez court, de sorte que le calendrier est en fait assez serré.
J'essaie maintenant de déterminer où je peux être le plus utile.
Que comptes-tu faire après la réadaptation ?
J'ai encore le temps d'y réfléchir. Après la captivité et la période de soins, une personne a droit à un congé de 30 jours pour se rétablir. Pendant cette période, je réfléchirai à ce que je veux accomplir à court terme, ou plutôt à la manière d'y parvenir mieux et plus efficacement. J'essaie de déterminer où je serai le plus utile et dans quel statut.
Je ne vais pas quitter la protection des droits de l'homme. Elle m'accompagnera longtemps, probablement jusqu'à la fin de ma vie. C'est vraiment une partie intégrante de ma vie, et c'est pourquoi je vais continuer à le faire. Bien sûr, je n'abandonnerai pas les sujets liés à la migration forcée, aux réfugiés, aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, à la discrimination, à la xénophobie et à la haine. Je me rends compte aujourd'hui qu'il faudrait accorder plus d'attention à l'analyse de la propagande et au travail sur l'information, à la pensée critique et à la perception de la réalité. Mais ma priorité dans un avenir proche sera la libération de nos militaires et de nos civils de la captivité.
Maksym Butkevych milite pour les droits humains depuis près de 20 ans. Il a été coordinateur du projet No Borders et cofondateur du centre des droits de l'homme ZMINA et deHromadske Radio. Depuis de nombreuses années, il est l'un des organisateurs et des hôtes des projections et des événements du festival international de films documentaires sur les droits de l'homme Docudays UA.
Ce militant des droits de l'homme a donné des conférences sur les droits de l'homme, les discours haineux et les réfugiés à des journalistes, des militants et des représentants du gouvernement en Ukraine et dans d'autres pays. Il a travaillé au Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés en Ukraine.
Après le déclenchement de la guerre à grande échelle en mars 2022, M. Butkevych a rejoint les forces armées ukrainiennes et a été fait prisonnier par la Russie en juin de la même année.
Une affaire criminelle a été montée de toutes pièces contre Maksym Butkevych. Le 6 mars 2023, un « tribunal » illégal de la partie temporairement occupée de la région de Luhansk a condamné le militant des droits de l'homme et officier militaire à 13 ans de prison pour avoir prétendument blessé deux femmes en tirant un lance-grenades dans l'entrée d'un immeuble résidentiel alors qu'il se trouvait à Sievierodonetsk.
La cour d'appel de Moscou a confirmé la peine, mais a décidé qu'une partie de la période de détention – à partir du 19 août 2022 – devait être prise en compte dans le calcul de la peine.
En mars 2024, la Cour suprême de la Fédération de Russie a confirmé la condamnation à 13 ans de prison d'un militant des droits de l'homme et soldat capturé. Lors de l'audience, il a déclaré qu'il avait été contraint de s'incriminer sous la menace de la torture. Les juges russes ont refusé d'inclure dans le dossier la preuve que Butkevich n'était pas du tout sur le lieu du crime présumé, ni à Sievierodonetsk, ni le jour indiqué dans le « dossier », ni aucun autre jour de la guerre. La déclaration des activistes des droits de l'homme selon laquelle il s'est incriminé lui-même en raison de promesses d'échange rapide et de menaces de torture n'a pas été prise en compte.
Le procès de Maksim Butkevich a été condamné par les organisations ukrainiennes de défense des droits de l'homme, Amnesty International, Human Rights Watch,Memorial, les membres de l'APCE et d'autres organisations.
L'association russe Mémorial a reconnu Maksym Butkevych comme prisonnier politique.
En novembre 2022, Maksym Butkevych reçoit le prix tchèque de l'histoire de l'injustice : son père, Alexander, reçoit le prix à Prague à la place de son fils. En 2023, Maksym Butkevych a reçu le prix Anne Frank pour la dignité humaine et la tolérance, décerné par l'ambassade des Pays-Bas aux États-Unis, ainsi que le prix national des droits de l'homme, décerné par la plateforme ukrainienne Human Rights Agenda.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

L’immigration est-elle « utile » ? En finir avec un débat réactionnaire

Depuis la nomination de Bruno Retailleau et ses annonces chocs sur une loi immigration 2.0 ultra répressive, le débat sur l'équation coûts/bénéfices de l'immigration refait surface, y compris à « gauche ». Une « défense » des immigrés alignée sur les besoins du patronat qui participe d'un consensus xénophobe avec laquelle il est grand temps d'en finir.
20 novembre 2024 | tiré de Révolution permanente
https://www.revolutionpermanente.fr/L-immigration-est-elle-utile-En-finir-avec-un-debat-reactionnaire
Depuis quelques mois quelques voix s'élèvent contre la surenchère réactionnaire à l'œuvre du côté de la place Beauvau contre les immigrés. De Sophie Binet à Olivier Faure, en passant par une large partie de la gauche institutionnelle et syndicale, la « riposte » aux politiques anti-immigrés du gouvernement participe cependant du même argumentaire. L'offensive raciste de Retailleau serait critiquable moralement, politiquement, …, mais surtout parce qu'elle manquerait l'essentiel : les « immigrés » servent à quelque chose ; ils sont utiles.
« Notre position est de dire qu'il faut en finir avec une forme d'hypocrisie, avec ces femmes et ces hommes qui font tenir le pays debout, qui travaillent, qui sont dans des conditions souvent d'exploitation, et ceux-là doivent être régularisés » explique ainsi Olivier Faure. Sophie Binet avance aussi que : « les personnes immigrées travaillent et rapportent beaucoup plus au pays qu'elles ne lui coûtent ».
L'ensemble des enquêtes et études au sujet de l'immigration corroborent ces propos : les immigrés rapportent plus qu'ils ne coûtent. Il y a cependant un problème à enfermer d'emblée tout débat sur l'immigration dans une logique comptable. Puisque l'immigration « rapporte », encore faut-il se demander quels sont les immigrés qui sont rentables ? Et bien souvent cela amène à réaliser un tri entre les travailleurs sans-papiers et les autres sans-papiers. C'est le cas notamment d'Olivier Faure, secrétaire général du Parti Socialiste qui défend une régularisation réservée uniquement aux travailleurs sans-papiers.
La logique, par-delà la différence de posture et de programme, n'est en réalité pas différente de celle qui anime les différentes organisations patronales au sujet de l'offensive xénophobe en cours. Assumant une position qui nuance les propositions du ministre de l'Intérieur, le président du Medef défendait à ce titre en septembre dernier au micro de France Info la nécessité de « ne pas s'interdire de recourir à tous les niveaux de qualification à de la main d'œuvre immigrée ». Il ajoutait que son organisation est « contre les sans-papiers car sur le plan des distorsions de concurrence, c'est inadmissible ». Une position adoubée par la ministre du travail Astrid Panosyan-Bouvet qui a expliqué vouloir « travailler » le sujet avec son collègue de l'Intérieur, Bruno Retailleau.
Et une ligne en adéquation par ailleurs avec la proposition du titre de métiers en tension dans la dernière loi immigration portée par Gérald Darmamin et votée en janvier dernier. Ce titre, défendu par une partie du patronat et de la gauche syndicale et politique cherchait à favoriser la régularisation de travailleurs sans papiers dans les secteurs dans lesquels la main d'oeuvre se fait rare. Cette mesure présentée au moment des débats comme le volet progressiste de la loi ne constituait pourtant en réalité qu'un moyen d'entériner la surexploitation des travailleurs sans-papiers dans les secteurs les plus difficiles et les plus mal payés. Par exemple, dans le seul secteur de l'aide à la personne considéré comme un secteur en tension, on compte 25% de travailleurs étrangers.
Cette logique en voie d'expansion s'est accompagnée de l'intensification depuis les années 2000 de la chasse aux étrangers en situation irrégulière sur les lieux de travail, contribuant ainsi largement à alimenter la surexploitation des travailleurs étrangers. La loi du 24 juillet 2006 qui réintroduit la carte de séjour lié au travail et autorise des régularisations exceptionnelles pour les sans-papiers parrainés par leur employeur avec un contrat de travail a eu pour corollaire d'inciter davantage encore les travailleurs immigrés à accepter n'importe quel emploi tout en les rendant plus dépendants de leurs patrons. Dans le même temps, ceux qui auraient refusé de pourvoir les emplois vacants et aux conditions de travail dégradées ont vu leur expulsion facilitée. Un chantage qui n'a profité qu'aux patrons.
De plus, cette régularisation quasi exclusivement par le travail participe d'une logique de multiplication et de hiérarchisation des titres de séjour qui aboutissent in fine à une précarisation du séjour. Les récentes politiques migratoires restrictives organisent cette fabrique du sans-papier très largement fonctionnelle au système capitaliste. Cette « organisation pyramidale » [1] de l'immigration selon la stabilité du titre de séjour instaure une pression permanente, comme une épée de Damoclès sur la tête des travailleurs sans-papiers pour qu'ils acceptent leur assignation à la surexploitation.
De la surexploitation au consensus raciste
Toutes ces positions qui ont en commun de conditionner la régularisation des sans-papiers de façon plus ou moins assumée à leur rentabilité pour le patronat jouent également un jeu dangereux et plus insidieux encore. Ce faux débat sur les coûts/bénéfices des travailleurs sans-papiers pour le patronat participe en effet à conforter les politiques pro-immigration choisie contre ladite immigration subie et, en dernière instance, alimente le consensus xénophobe et raciste à l'œuvre. L'immigré est alors perçu comme acceptable à la condition qu'il soit une ressource, un corps corvéable à merci qui permettra au patronat de baisser les coûts de la main d'œuvre, y compris « blanche », dans des secteurs qui ne sont pas délocalisables comme le bâtiment, l'aide à la personne ou encore la restauration
Accepter de défendre la logique de l'immigration choisie, c'est défendre la précarisation subie de tous les sans-papiers et une dégradation des conditions de l'ensemble de la classe ouvrière. Une telle position revient à s'adapter largement aux propositions du Rassemblement National et plus largement aux politiques migratoires réactionnaires. Elle cherche à « rassurer » les travailleurs nationaux auxquels on rabâche depuis des années que les immigrés « vont voler leur travail » ou qu'ils « profitent des services publics ». Comme une manière de dire : « ne vous inquiétez pas trop travailleurs nationaux - et blancs - certains immigrés nous rapportent de l'argent ». Des propositions qui se révèlent donc inutiles voire dangereuses au moment de lutter contre le racisme qui infuse dans notre classe.
Pourtant sur cette voie, la « gauche » a joué une partition active. L'adaptation au langage libéral et à ses politiques en effet n'est pas une nouveauté. On pensera par exemple à la ligne protectionniste et nationaliste des années Marchais au PCF ou encore à François Mitterrand qui, dans les années 90 affirmait que le « seuil de tolérance » des Français à l'égard des étrangers avait été atteint dans les années 70. En rejoignant progressivement la position de la droite, le PS a fini par imposer l'idée qu'il n'y aurait pas d'alternative et que l'immigration constituerait en soi un problème dont il s'agirait de minimiser les conséquences négatives.
On remarquera enfin à quel point les discussions autour des « bénéfices » du travailleur immigré, du RN à la gauche, participent d'une discussion plus large sur la productivité des travailleurs immigrés ou non. Comment ne pas voir que la surenchère anti-immigré de l'extrême-droite et du macronisme et l'offensive anti-sociale contre les « assistés » partagent le même vocabulaire et la même logique intrinsèque ? Comment ne pas voir que dans la séquence austéritaire en cours ce sont l'ensemble des travailleurs qui sont menacés ici et là de licenciements ou de baisses de salaires précisément parce que la crise ferait qu'ils ne « rapporteraient » plus assez ?
Il y aurait bien évidemment une discussion plus large à porter au débat sur qui fait « tourner la société » et surtout au profit de qui. Mais en réduisant cet enjeu à la seule question de l'immigration, les hérauts de « l'utilité de l'immigration » participent d'une double division : entre les immigrés eux-mêmes (ceux qui seraient utiles et ceux qui ne le seraient pas), entre les travailleurs immigrés et les travailleurs nationaux ensuite.
A rebours de ces logiques de division et d'adaptation au consensus xénophobe et sécuritaire, les syndicats et les organisations qui se réclament de la gauche devraient au contraire chercher à unifier les travailleurs nationaux et immigrés et refuser la logique de précarisation du séjour à l'oeuvre. Cela passe par revendiquer la régularisation de tous les sans-papiers sans condition, l'ouverture des frontières et la liberté de circulation pour toutes et tous. Alors que le gouvernement mène des politiques austéritaires d'ampleur et que le patronat prévoit des plans de licenciements massifs, ces revendications doivent s'accompagner de la défense du partage du temps de travail entre tous et toutes, de la fin des contrats précaires. Ce sont les seules mesures capables de résorber le chômage, d'en finir avec la surexploitation d'une partie de notre classe et avec la division travailleurs étrangers et nationaux qui ne profite qu'aux grands capitalistes.
[1] Said Bouamama, Des classes dangereuses à l'ennemi intérieur, Editions Syllepse, p.139
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Espagne. La tempête parfaite

La tragédie de Valence du 29 octobre [1] a mis en évidence la coïncidence temporelle et géographique de plusieurs crises concomitantes : la crise climatique, le modèle urbanistique piloté par le capital financier et immobilier, et l'aggravation de la dégradation institutionnelle du « régime de 78 » [2].
18 novembre 2024 | tiré du site alencontre.org
L'accélération du réchauffement climatique produit par les gaz à effet de serre – notamment le CO2 et le méthane – est évidente, avec ses conséquences terribles pour l'humanité. Pourtant, les très puissants courants négationnistes ont été renforcés dans le discours public, dopés par la victoire de Trump et financés par les entreprises les plus liées au « capital fossile », qui contrôlent cyniquement et sans vergogne la réunion de la COP29 à Bakou. La hausse des températures est à l'origine de la modification des régimes de précipitations et d'évaporation sur de vastes zones de la planète. Les phénomènes de désertification et de pluies torrentielles sont les deux faces d'une même médaille.
Le point zéro de la DANA
La Méditerranée (mer fermée) connaît des températures de 30°C dans certaines zones et la moyenne générale ne cesse d'augmenter tant en surface qu'à des profondeurs intermédiaires [liéee à la double caractéristique de température et de salinité]. Le phénomène des « canicules marines » s'installe, provoquant l'anoxie [diminution de la quantité de dioxygène] et la mort des coraux et des poissons. Comme le dit le poète et auteur-compositeur Joan Manuel Serrat dans son poème « Plany al mar », la Méditerranée que nous connaissions est mortellement blessée [3]. Dans le même temps, l'atmosphère retient 7% d'eau en plus pour chaque degré Celsius d'augmentation de la température. A des températures de surface de l'eau supérieures à 27ºC, la tempête peut se transformer en ouragan (avec son propre nom : medicane : mot-valise pour l'anglais Mediterranean hurricane, ouragan méditerranéen), une sorte de cyclone tropical méditerranéen. Ces deux facteurs (température de l'eau et rétention de vapeur) expliquent la bombe atmosphérique DANA [acronyme espagnol de la « dépression isolée à des niveaux élevés », « goutte froide » en français, voir graphique en fin d'article].
Le phénomène de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) a provoqué ces deux dernières semaines dans plusieurs régions de l'est de l'Espagne des précipitations d'une intensité, d'un volume et d'une violence jamais enregistrés auparavant. Les scientifiques nous mettent en garde sur le fait que ce qu'ils appellent la période de retour s'est raccourcie [4]. Dans le cas précis de Valence, Félix Francés, professeur d'ingénierie hydraulique à l'université polytechnique de Valence, affirme que l'événement est tellement extraordinaire que pour trouver un événement de cette intensité il faudrait remonter à une période que l'on peut situer entre 1000 et 3000 ans. Il n'est donc pas exagéré de reprendre l'expression de Jeremy Rifkin lorsqu'il décrit la mer Méditerranée comme le point zéro du changement climatique, bien qu'il faille noter qu'il existe malheureusement déjà de nombreux « points zéro » où le réchauffement climatique se manifeste, sous différentes formes.
La DANA est un phénomène météorologique bien connu dans le Pays valencien, mon pays d'origine, mais qui n'a jamais atteint les dimensions apocalyptiques que nous avons connues [5]. Un autre poète et auteur-compositeur-interprète de la même génération de 1968 que Joan Manuel Serrat, Raimon, a également écrit un beau poème en 1984 intitulé « Al meu país la pluja no sap ploure » (Dans mon pays, la pluie ne sait pas comment pleuvoir) [6]. Tout au long de l'histoire, la Méditerranée a vu naître d'importantes civilisations basées sur les ressources en eau et s'effondrer à cause des sécheresses. Pour une fois, nous pouvons nous rallier à l'opinion du conservateur François-René de Chateaubriand lorsqu'il dit que « les forêts précèdent les civilisations, les déserts les suivent ». Et nous sommes à nouveau à la croisée des chemins en Espagne. Pendant des années, la DANA a été connue sous le nom de « goutte froide » [7] et pendant des années, on a dit que des mesures pouvaient être adoptées pour en atténuer les effets. Rien n'a été fait, ni au niveau macro, ni au niveau micro.
La DANA du 29 octobre met en évidence le fait que ce type de phénomène météorologique sera plus fréquent et plus intense dans un pays comme l'Espagne, qui est particulièrement vulnérable au changement climatique en raison de sa position géographique. Il s'agit d'un phénomène dans lequel une masse d'air polaire très froid est isolée et commence à circuler à très haute altitude, entre 5000 et 9000 mètres. Elle entre en contact avec d'énormes masses de vapeur d'eau causées par l'évaporation, dans ce cas de la mer Méditerranée. Si ces masses d'air sont situées au-dessus de la péninsule Ibérique, lorsqu'elles atteignent le golfe de Valence, elles se rechargent en raison de la température élevée de la Méditerranée. Cela forme un flux linéaire de tempêtes qui déversent de grandes quantités d'eau dans les montagnes proches de la côte en un court laps de temps. A son tour, plus la Méditerranée se réchauffe, plus elle s'évapore ; et plus le front polaire ondule en raison de l'augmentation de la température, plus il est probable qu'une masse d'air froid s'y installe. Un système de rétroaction parfait. Paradoxalement, il pleut moins tout au long de l'année, mais les précipitations peuvent être plus intenses et durer plus longtemps à un moment donné.
Dans le cas de Valence et d'une grande partie de la côte méditerranéenne espagnole, l'orographie [le relief] favorise la chute soudaine des précipitations dans les montagnes côtières voisines. Les rivières et les torrents qui, pendant une grande partie de l'année, ont un faible débit d'eau ou sont soudainement à sec, servent de canal d'écoulement à de grandes quantités d'eau de pluie. Mais ces phénomènes atmosphériques, aujourd'hui aggravés par le changement climatique, produisent des effets dévastateurs lorsqu'ils se produisent dans un contexte sociopolitique capitaliste où le profit a pris le pas, à divers égards, sur les intérêts de la majorité sociale. Disons que les malheurs ne tombent pas du ciel et qu'ils ne sont pas non plus une punition divine.
Chaos, spéculation et business urbain
Tout d'abord sont remontés à la surface les effets de l'accumulation de décisions urbanistiques suicidaires sur des territoires inondables prises au cours des cinquante dernières années, pour des raisons spéculatives, par le capital immobilier. La décision de libéraliser tous les terrains disponibles afin de faciliter la construction résidentielle, industrielle et touristique (par ailleurs mal contrôlée par les municipalités concernées) promue par le Premier ministre espagnol [1999-2004] José María Aznar du Parti populaire (PP) de droite dans les années 1990 a facilité la construction de logements sur des plaines inondables situées, dans le cas de Valence, entre les montagnes et la mer. Trente pour cent des logements sociaux construits en Espagne depuis lors se trouvent en zones inondables. Cela représente une zone à risque de 2500 km2 et 3 millions de personnes potentiellement exposées aux conséquences des inondations.
Il convient également de noter que les conseils locaux (gouvernés par les grands partis) qui disposent de certaines compétences légales en matière d'urbanisme et de réglementations de la construction des bâtiments destinés à l'habitation, au secteur tertiaire et à l'industri dans leur municipalité n'ont pas adopté une approche rationnelle, à quelques exceptions près. Au contraire, leur système de financement étant très précaire, ils ont financé leurs activités grâce aux recettes municipales et aux impôts liés à la construction et à l'utilisation des bâtiments. En outre, tout au long de la côte méditerranéenne, des autoroutes et des routes ont été construites parallèlement au littoral, ainsi que de grands complexes hôteliers, touristiques et résidentiels qui forment une véritable barrière de plusieurs kilomètres linéaires, rendant difficile l'accès à la mer de l'eau provenant des montagnes ou des précipitations dans la zone concernée, comme on peut le voir à vol d'oiseau ou par drone si vous préférez.
La libéralisation des terres sans critères urbanistiques rationnels dans l'organisation du territoire a conduit avant tout à la grande bulle de la construction avec l'implication des banques et des grandes entreprises de construction durant la première décennie du XXIe siècle. Mais pas seulement : ses conséquences sociales dramatiques sont évidentes.
Dans le cas de la dernière DANA de Valence, la planification urbaine sans loi ni critères a eu des effets dévastateurs avec la mort de plus de 200 personnes, avec des dégâts frappant maisons et écoles, avec la destruction d'installations industrielles et de cultures agricoles. A quoi s'ajoutent les dommages ayant frappé des infrastructures telles que des routes et des ponts et bien d'autres éléments dans une zone de 56 000 hectares où vivent 230 000 personnes dans 75 municipalités et où sont implantées 10% des entreprises industrielles et logistiques du pays de Valence. Les pertes économiques dans l'industrie et l'agriculture sont en cours de quantification, mais les premières estimations se chiffrent déjà en milliards d'euros. Pourtant, le PP valencien s'apprêtait ces dernières semaines à voter une loi qui permettrait de construire des hôtels à 200 mètres du littoral au lieu des 500 mètres actuels.
La politique, les politiciens et la négation des preuves
Il est clair que Carlos Mazón, membre du PP et président de la Generalitat de la Comunidad Valenciana (gouvernement régional autonome de Valence), est coupable d'une négligence extrême ayant entraîné des décès pour n'avoir pas fixé le niveau d'urgence correspondant à la situation et n'avoir envoyé les alertes à la population – comme il en avait l'obligation légale – qu'en fin d'après-midi, alors que la situation était déjà catastrophique. Il a des responsabilités politiques, mais il devrait être tenu responsable de ses responsabilités pénales pour ses actions criminelles.
De leur côté, de nombreux employeurs, les véritables « propriétaires » et dirigeants occultes du PP dans toute l'Espagne, mais en particulier à Valence, ont forcé leurs salarié·e·s à poursuivre leur travail de manière inhumaine et en violation de la loi sur la prévention des risques professionnels qui stipule explicitement qu'en cas de situation d'urgence le travail doit cesser. Si le travail avait cessé, de nombreuses vies auraient été sauvées. Ce faisant, ces employeurs ont également engagé leur responsabilité pénale.
Le gouvernement régional est le produit d'une alliance entre le PP conservateur, qui se manifeste progressivement comme un parti d'extrême droite au vernis centriste, et Vox, une formation ouvertement trumpiste, sans complexe, selon une déclinaison hautement réactionnaire et autoritaire similaire à celle du Hongrois Viktor Orban. Son principal dirigeant, Santiago Abascal, vient d'être nommé président du parti européen le plus réactionnaire, Patriotes pour l'Europe. Bien que très récemment les deux partis, PP et Vox, aient rompu leurs accords à Valence, accords qui avaient conduit le gouvernement valencien à s'aligner en pratique sur le négationnisme de Vox, on assiste néanmoins à un phénomène contradictoire : progressivement, le parti conservateur incorpore (PP) ou remet à son ordre du jour les thèmes de l'extrême droite : migration-délinquance, anti-catalanisme, etc.
Vox est ouvertement négationniste en matière de changement climatique, mais le PP abrite en son sein de nombreux négationnistes éhontés ou ouvertement stupides comme Nuria Montes, ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme (équivalent du poste de ministre) du gouvernement régional conservateur, capable d'affirmer sans rougir que le changement climatique est bon pour Valence car il allonge la saison touristique estivale. Les deux partis découragent l'abandon des combustibles fossiles, ont des projets industriels et touristiques développementalistes sans aucun contrôle sur le type de croissance, relativisent le réchauffement, ont éliminé des budgets régionaux les postes destinés aux situations d'urgence – au profit de la barbare « fiesta de toros » – et forment une coalition pour la défense des intérêts des entreprises de construction.
Dans la gestion de la DANA, les deux partis PP et Vox – comme dans presque tous les dossiers – forment une « Sainte Alliance » qui inclut également dans la pratique des formations ouvertement nazies dont le seul objectif est de disculper le président régional Carlos Mazón – qui légalement aurait dû prendre les mesures pour prévenir de la situation d'urgence. Ce dernier a ignoré les avertissements de l'Agence météorologique espagnole (AEMET) et de la Confédération hydrographique qui donnaient des informations en temps opportun sur la gravité de la situation parce qu'entre-temps il était en train de prendre un long déjeuner avec un journaliste. Le but de cette disculpation explicite ou implicite de Carlos Mazón par la droite dure et l'extrême droite est de faire porter le chapeau au gouvernement central espagnol dans sa lutte pour délégitimer Pedro Sánchez [8].
Carlos Mazón n'a pas démissionné comme l'exigeait la clameur populaire. En outre, le PP dans son ensemble est en train – comme par le passé [9] – d'« externaliser » les responsabilités, même au prix non seulement de la vérité, du discrédit de la politique auprès des citoyens, ou de la création d'une crise au sein de l'Union européenne à deux mois de l'entrée en fonction de Trump, qui menace les accords préexistants. En d'autres termes, le PP espagnol a transféré ses querelles sectaires dans l'arène européenne et a probablement provoqué non seulement une crise institutionnelle aux résultats imprévisibles [le PP, avec le Parti populaire européen, a lancé une offensive contre la commissaire européenne désignée, Teresa Ribera, ministre de la Transition écologique du gouvernement Sanchez, invoquant « sa gestion des inondations catastrophiques »], mais aussi une nouvelle étape dans le glissement vers la droite du Parti populaire européen et son rapprochement avec les forces autoritaires.
Le PP a de nouveau employé les vieilles tactiques nazies, reprises par le trumpisme, consistant à affirmer un mensonge comme une vérité, en créant une réalité « alternative ». Une tactique dans laquelle ils se sont montrés extrêmement efficaces. Ce n'est pas un hasard si la plupart des conseillers qui encadrent le PP dans tous les domaines sont des experts en communication politique, sans aucune formation sur les sujets qu'un gouvernement doit traiter. Il s'agit de gagner la bataille de la communication et de l'image.
Cela s'inscrit dans un contexte plus large de stagnation et de crise permanente sur le plan institutionnel où toutes les forces issues du franquisme (qu'elles n'ont jamais critiqué) avec la connivence d'une grande partie de l'appareil d'Etat – police parallèle, juges, etc. – s'emploient à judiciariser la vie politique pour attaquer le gouvernement central mais aussi et surtout les organisations sociales, les luttes syndicales, les indépendantistes et la gauche révolutionnaire, en utilisant toute une batterie de mesures répressives. L'objectif stratégique est de mettre fin à toute résistance populaire sans avoir recours à un coup d'Etat, en utilisant simplement les mécanismes de la démocratie dite libérale. Le but de ce néolibéralisme autoritaire est de parvenir à de meilleurs rapports de forces au plan social et politique afin d'imposer de nouvelles attaques contre les droits politiques et du travail et de pouvoir passer à une nouvelle phase de déréglementation du travail dans le but d'obtenir de plus grandes marges de plus-value.
Face à cette situation, la donnée fondamentale de la conjoncture réside dans la faiblesse, la prostration, la démobilisation et la désorganisation de la classe laborieuse et des mouvements sociaux. Le cycle ouvert le 15-M (15 mai 2011) avec le mouvement des Indignados, qui a donné lieu à la formation d'organisations comme Podemos, s'est achevé par un échec total des responsables politiques populistes qui ont intégré électoralement cette force et un retour à un bipartisme imparfait des forces du régime de 78. Aujourd'hui, la mobilisation sociale est très faible et les grands syndicats ont renoncé à jouer un rôle organisateur dans cette mobilisation. L'objectif des directions syndicales majoritaires est de parvenir à une concertation sociale avec des organisations patronales de plus en plus agressives et droitières. Dans le même temps, il faut noter que le découragement gagne la base électorale de gauche qui voit se consolider dans l'opinion publique l'influence de la droite dure et d'une partie de l'extrême droite. Et progressivement, plus dangereusement, un rejet de ce qui relève du collectif, du politique, se répand dans la société, ce qui constitue un bon terreau pour les organisations d'extrême droite. L'idée qu'il faut un « sauveur » même au prix des libertés est le germe d'un Etat autoritaire.
Le gouvernement social-libéral de Pedro Sánchez porte une responsabilité majeure dans cette situation. Il s'est consacré à l'adoption de mesures compassionnelles et palliatives à l'égard de la classe laborieuse sans s'attaquer aux problèmes sous-jacents et n'a pas tenu ses promesses électorales : par exemple, l'abrogation de la « loi bâillon » répressive (loi organique de protection de la sécurité publique entrée en vigueur en juillet 2015) ou la lutte contre le déficit structurel en matière de logement, etc. Tout cela en continuant à creuser l'écart entre les salaires et les prestations sociales dans le contexte d'une croissance significative de l'économie espagnole.
En ce qui concerne la DANA du 29 octobre, sa responsabilité n'est pas la même que celle du gouvernement PP de Valence en ce qui concerne les événements de ce jour-là. Mais elle l'est pour ce qui a trait à la question fondamentale évoquée ci-dessus. Il n'a pas mis à profit ses années de gouvernement pour éradiquer le modèle irrationnel de planification urbaine et n'a pas non plus pris de mesures urgentes contre le changement climatique. En particulier, alors qu'il se présente comme le champion de la transition écologique, il est révélateur qu'il n'ait pas sérieusement amorcé l'abandon des énergies fossiles. Au contraire, il a alloué des aides publiques de plus de 10,5 milliards d'euros aux entreprises qui tirent profit des énergies fossiles. En même temps, pour ce qui relève de cette DANA, il se cache derrière un discours sur la question des compétences des gouvernements centraux et régionaux pour expliquer ses interventions. C'est un argument logique pour des juristes, mais au moment du drame, personne ne le comprend, en particulier les personnes touchées, qui ne s'arrêtent pas pour évaluer qui est responsable de rechercher leurs disparus, d'enterrer leurs morts, de trouver de l'eau et de la nourriture, de rétablir l'électricité ou de dégager les chaussées encombrées de dizaines de milliers de voitures rendues inutilisables par l'eau.
Une fois de plus, il apparaît clairement que le soi-disant « Etat des autonomies », à mi-chemin entre le centralisme et le fédéralisme, présente des failles majeures dans son fonctionnement réel.
Questions soulevées par l'expérience
Les syndicats et les organisations populaires disposant d'une audience large auraient-ils pu jouer un rôle différent ? Oui, certainement. Dès le premier moment, ils auraient dû appeler à se mettre à l'abri en quittant les lieux de travail, comme l'ont fait, par exemple, les enseignants et les étudiants de l'université de Valence. Les syndicats n'ont même pas utilisé, comme on l'a dit, la loi sur la prévention des risques professionnels. Ils auraient pu organiser immédiatement des brigades pour soutenir les populations touchées. Ils auraient pu aller plus loin et promouvoir l'auto-organisation populaire pour faire face à la catastrophe.
Les forces de gauche auraient pu promouvoir dès le début l'expropriation des moyens pour faire face aux conséquences de l'ouragan : machines, installations, hôtels, nourriture, etc. Elles ne l'ont pas fait parce que les concepts élémentaires ont disparu de l'agenda et de l'horizon de la plupart des forces de gauche.
Les services d'urgence de l'Etat auraient-ils pu agir plus rapidement ? Au-delà des débats juridiques sur les compétences des différentes administrations, je pense que oui. Même au risque d'encourir de nouvelles accusations tordues de la part de l'extrême droite et de la droite dure. La question est la suivante : les forces armées (armée de terre, armée de l'air et marine) doivent-elles avoir le monopole des ressources dont dispose l'Unité militaire d'urgence créée par l'ancien président socialiste [2004-2011] José Luis Rodríguez Zapatero ? La réponse est sans équivoque : les services d'urgence de l'Etat doivent et peuvent être civils, comme le sont, par exemple, les brigades de pompiers de chaque ville ou région pour éteindre les incendies et autres sinistres.
Cependant, la réponse populaire spontanée de solidarité et de soutien mutuel a été spectaculaire. Bien que seules quelques organisations sociales et politiques aient pris l'initiative d'organiser la collecte de moyens d'aide et la présence de volontaires sur le terrain, des milliers de jeunes et de moins jeunes se sont mobilisés. Des milliers de jeunes et de moins jeunes, les femmes jouant un rôle particulièrement important, se sont jetés dans la boue avec leurs maigres moyens pour aider leurs voisins.
Au sein de cette multitude de volontaires, des escouades fascistes et des fabricants de canulars réactionnaires ont fait leur apparition dans le but de gagner en influence et de semer leurs idées grâce à une habile campagne de publicité dans les réseaux sociaux, soutenue également par certains médias de droite (presse, télévision et radio). Et, en toute impunité – comme les nazis dans le passé – ils ont tenté d'imposer leur conception du peuple et, comme leurs prédécesseurs, ils ont eu l'audace de reprendre et détourner des slogans et des mots d'ordre qui étaient jusqu'alors l'héritage de la gauche, tels que « Seul le peuple peut sauver le peuple », un slogan qui servait de bannière après la crise de 2008 aux mobilisations sociales. Il en alla de même le slogan international « Le peuple uni ne sera jamais vaincu ». En bref, ils ont attisé un affrontement prenant appui sur le malaise et de la colère du peuple et, de la sorte, affirmé une hégémonie de leur discours. Dans la situation européenne et mondiale actuelle, nous ne pouvons pas sous-estimer ces manifestations.
Il est vrai que, dans ce contexte, surgit un débat de fond : dans de telles circonstances, et par conséquent dans une transition éco-sociale, peut-on se passer de l'Etat, et ne faut-il pas exiger des gouvernements qu'ils agissent ? Ma réponse est non. Certes à court terme, en pleine crise du type de la DANA, l'intervention des services publics (quels que soient les gouvernants) est nécessaire en raison de la mobilisation des ressources matérielles requises. A l'horizon d'une transition éco-sociale, il faudra combiner la prise de pouvoir de l'Etat et l'auto-organisation et l'autogestion sociale. Et ce n'est qu'ainsi que l'on pourra construire en même temps et par la suite une démocratie socialiste autogestionnaire capable d'impliquer l'ensemble de la société dans les décisions nécessaires à la planification démocratique.
Et maintenant, au milieu de la tragédie, que faire ?
Face à la situation dramatique actuelle de Valence et à son ampleur, que peut faire une petite organisation révolutionnaire ?
En premier lieu, être solidaire et se tenir aux côtés des sinistrés, de notre peuple. En commençant par participer aux tâches de sauvetage et de survie sur le terrain. Et collecter des fonds pour répondre aux besoins urgents afin d'aider les groupes les plus défavorisés, car nous sommes conscients que les effets de la DANA ont également eu des retombées très différentes sur les différentes classes sociales. Personne ne peut avoir d'audience politique s'il ne part pas d'un tel principe de base. Ce principe a également été repris par diverses organisations sociales et quelques (rares) organisations politiques de gauche. Il y a eu une véritable mobilisation de la jeunesse pour participer aux tâches sur le terrain, et ce n'est qu'en étant avec eux que leur solidarité a pu être canalisée politiquement. Des fascistes de diverses organisations sont apparus dans les villages touchés pour y mener leur travail de propagande et d'agitation.
Deuxièmement, contrairement à la position de la majorité des forces syndicales et politiques de gauche, qui prétendent que l'heure n'est pas à la dénonciation politique ni à la mobilisation populaire, et qu'il faut seulement accompagner la douleur, nous, Anticapitalistas, affirmons que l'aide matérielle (et l'accompagnement de la douleur) n'est pas incompatible avec l'exigence de la responsabilité politique et la mobilisation des travailleurs dès la première minute. C'est pourquoi nous avons soutenu la réunion des organisations sociales qui préparaient une grande mobilisation dans les rues. Nous ne devons pas laisser la parole aux seuls représentants institutionnels des grands médias ou aux créateurs de mensonges des réseaux sociaux animés par les fascistes.
Troisièmement, et dès le premier moment, nous avons soutenu par la propagande et l'agitation une série de revendications immédiates et transitoires en défense des travailleurs et travailleuses sinistrés et dans la perspective d'un horizon écosocialiste. Nous nous sommes particulièrement adressés à la jeunesse afin de contester l'hégémonie des fascistes dans le discours et de canaliser la rage populaire en la transformant en pouvoir populaire.
La manifestation du 9 novembre dans la ville de Valence représente le carton rouge brandi par une grande partie des citoyens et citoyennes face aux actions du gouvernement valencien dans la tragédie des inondations causées par la DANA. A l'appel d'une vingtaine de petites organisations sociales et sans le soutien des grands syndicats de travailleurs ou des grands partis de gauche, cette mobilisation a réussi à rassembler 200 000 Valenciens et Valenciennes. Elle a été suivie par des militant·e·s de la solidarité du reste de l'Espagne. Voilà un premier pas dans la bonne direction. (Article reçu le 18 novembre 2024 ; traduction rédaction A l'Encontre)
Manuel Garí est économiste, membre d'Anticapitalistas et de la rédaction de la revue Viento Sur.
––––––––
[1] Dans une moindre mesure et avec des résultats moins tragiques, de fortes pluies et des débordements de rivières ont également eu lieu dans différentes parties de l'Espagne, en bordure de la Méditerranée.
[2] La Constitution de 1978 est l'expression du régime conclu entre les franquistes et les socialistes, plus les eurocommunistes – aujourd'hui disparus –, après la mort du dictateur Franco [en novembre 1975], dont le résultat a été la paralysie du mouvement de masse et, en particulier, du syndicalisme classiste. Cela a donné naissance à la monarchie parlementaire actuelle, à la survie de l'ancien appareil franquiste (juges, police, armée) et à ce que l'on nomme « Etat des autonomies » dont l'objectif était de mettre fin aux revendications d'autodétermination nationale de l'Euskal Herria et de la Catalogne en créant un Etat fédéral déficient avec d'importantes impulsions d'un Etat centralisateur.
[3] Dans son magnifique poème écrit en catalan en 1984, « Llanto al mar » (Les pleurs de la mer), Joan Manuel Serrat dit : « Mire hecho una alcantarilla/Herido de muerte/Cuánta abundancia/Cuánta belleza/Cuánta energía/ ¡Ay, quién lo diría !/ ¡Hecha añices !/ Por ignorancia, por imprudencia/Por inconsciencia y por mala leche ». [Regardez quel caniveau suis-je devenue / Blessée à mort / Tant de profusion / Tant de beauté / Tant d'énergie/ Oh, à qui le ferai-je savoir / Je suis brisée en mille pièces / Par ignorance, par insouciance / Par inconscience et par mauvais esprit].
[4] Les experts en inondation utilisent un concept statistique pour parler des risques extrêmes : la période de retour. Par exemple, s'ils disent que des précipitations de 200 mm à un endroit donné ont une période de retour de 20 ans, ils signifient que ce niveau d'intensité ne se produira qu'à cette fréquence. Imaginons une gorge menacée d'inondation : les débits supérieurs à la période de retour de 100 ans ne devraient se produire qu'une fois par siècle, en moyenne, au cours de l'histoire. Or, l'inondation de l'oued Poyo (canyon naturel) – ce sont les zones les plus proches cet oued qui ont été le plus touchées – a été d'une ampleur extrême.
[5] Lorsque j'avais 9 ans, en octobre 1957, il y a eu une grande inondation du Turia [fleuve long de 280 km, qui prend sa source sur la Muela de San Juan dans la sierra de Albarracín et se jette dans la Méditerranée à Valence] et je garde encore en mémoire l'image de mon père et de mon oncle sortant des corps du bourbier et de l'eau du mieux qu'ils pouvaient, sans aucun moyen. Des années plus tard, en 1982, ce fut mon tour de le faire dans ma région, Ribera Alta, également en octobre.
[6] « Dans mon pays, la pluie ne sait pas comment pleuvoir / Il pleut trop ou trop peu / S'il pleut trop peu, c'est la sécheresse / S'il pleut trop, c'est la catastrophe / Qui emmènera la pluie à l'école / Qui lui dira comment pleuvoir / Dans mon pays, la pluie ne sait pas pleuvoir. »
[7] Traduction anglaise de l'allemand Kaltlufttropfen par « goutte d'air froid ». La définition initialement donnée était celle d'une dépression marquée en altitude, sans reflet à la surface, dans la partie centrale de laquelle se trouve l'air le plus froid.
[8] Cette situation est une nouvelle manifestation du bourbier qu'est devenue la vie politique publique en Espagne et de la crise institutionnelle permanente. Elle témoigne du degré de détérioration du régime conclu entre franquistes et socialistes (plus les eurocommunistes disparus) après la mort du dictateur Franco, qui a fait place à l'actuelle monarchie parlementaire et au soi-disant « Etat des autonomies ». Mais c'est aussi un exemple clair de l'absence d'alternatives politiques de gauche fortes capables d'inspirer et de mobiliser la majorité sociale.
[9] C'est le cas de la pollution de la mer par le pétrole du Prestige [novembre 2002] ; des mensonges et du soutien aux Etats-Unis dans la guerre d'Irak ; de l'accident d'avion du Yak-42 en mai 2003 en Turquie qui a coûté la vie à des dizaines de soldats ; de l'attentat mortel du 11 mars 2004 dans la gare d'Atocha à Madrid causé par des terroristes islamistes que le PP a tenté d'attribuer à l'ETA ; de l'accident du métro de Valence en juillet 2006 entraînant la mort de 43 personnes ; des nombreux cas de corruption et en particulier de l'affaire Gürtel ; du sauvetage des banques ; des décès dans les maisons de retraite de Madrid lors de la pandémie de Covid et bien d'autres encore.
***
Une goutte froide est une poche d'air très froid située à plus de 5000 m d'altitude. Lorsque le courant-jet polaire se déforme, il arrive qu'une poche, que l'on nomme une goutte froide, se détache de la circulation associée au courant jet polaire pour descendre jusqu'à nos latitudes. (Réd.)

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

L’alarmante ascension de l’extrême droite au Royaume-Uni

En juillet dernier, le Royaume-Uni a été le théâtre de violentes émeutes racistes lancées par l'extrême-droite, quelques semaines après l'entrée en fonction du nouveau gouvernement travailliste (la “gauche” britannique). Parallèlement, le parti de Nigel Farage, Reform UK, a pris son envol, faisant entrer l'extrême-droite dans le champ politique institutionnel. Comment cette nouvelle donne est-elle advenue dans un pays plutôt épargné par les mouvements fascistes, contrairement au reste de l'Europe ? Olly Haynes (https://x.com/reality_manager) nous raconte cette inquiétante dynamique.
14 novembre 2024 | tiré du site Frustrations
https://www.frustrationmagazine.fr/extreme-droite-royaume-uni/
Jusqu'en juillet dernier, le Royaume-Uni était une exception en Europe, car l'extrême droite n'y disposait encore d'aucune représentation parlementaire à l'échelle nationale.
Il est vrai qu'il arrivait ponctuellement qu'un député conservateur s'emporte. En temps normal, cela se soldait par une expulsion du parti et la perte de son siège lors des élections suivantes. Il est vrai aussi que le DUP, parti évangéliste de droite radicale, faisait partie du paysage politique en Irlande du nord, mais ce dernier a vu son pouvoir politique s'affaiblir au fil des années et se concentrer localement.
Jusqu'en juillet dernier, le Royaume-Uni était une exception en Europe car l'extrême droite n'y disposait encore d'aucune représentation parlementaire à l'échelle nationale.
Mais c'est bien l'élection générale de 2024 qui marque un important tournant avec l'arrivée de Reform UK, le parti d'extrême droite dirigé par Nigel Farage. Il obtient 4 circonscriptions (avec un pourcentage de vote qui équivaut à 94 sièges dans un système proportionnel). Il est rejoint à Belfast par Jim Alister, dirigeant de TUV, un parti à la droite du DUP.
En dehors du parlement, l'extrême-droite s'était déjà réunie après l'assassinat de citoyen.nes blanc.hes, de la même manière que les groupuscules fascistes avaient instrumentalisé le meurtre de Lola en France. Toutefois, des émeutes à travers le pays se sont révélées d'une importance et d'une gravité sans précédent après le meurtre brutal d'un groupe d'enfants dans la ville de Southport, l'été dernier.
Le drame de Southport et sa violente récupération raciste
Le 29 Juillet 2024, un jeune homme âgé de 17 ans s'est rendu dans une école de danse et a poignardé élèves et personnel. Au total, Il aura tué trois jeunes filles, et mutilé 8 autres, ainsi que deux membres du personnel qui tentaient de l'arrêter. Il est arrêté par la police sur les lieux du drame, et ses motivations restent à ce jour méconnues.
Après tout, le suspect est un homme noir de parents immigrés, ce qui, dans l'imaginaire ethno-nationaliste de l'extrême droite britannique, revient à la même chose qu'être musulman.
La loi sur la restriction de la presse au Royaume Uni prévoit que les médias ne peuvent pas identifier publiquement un suspect de moins de 18 ans. Mais cela n'a pas empêché l'extrême droite de spéculer sur la confession musulmane du suspect. Des influenceurs fascistes comme Tommy Robinson, David Atherton ou encore Andrew Tate ont participé à propager des rumeurs sur l'appartenance religieuse du meurtrier. Certains lui ont même attribué une fausse identité, le présentant sans fondement comme un homme palestinien arrivé en Grande Bretagne par bateau. Ces rumeurs ont participé au déclenchement d'émeutes, tout d'abord à l'encontre de la mosquée de Southport.
Le parquet a donc décidé de révéler l'identité du suspect de 17 ans afin de mettre fin à ces troubles. Bien qu'il se soit avéré que le coupable soit un chrétien né au pays de Galles de parents Rwandais, les émeutes ont continué à se propager à travers le pays. Après tout, le suspect est un homme noir de parents immigrés, ce qui, dans l'imaginaire ethno-nationaliste de l'extrême droite britannique, revient à la même chose qu'être musulman.
Un pogrom raciste et une riposte antifasciste de grande ampleur
Les évènements qui ont suivi sont particulièrement choquants et intolérables et ne peuvent être qualifiés autrement qu'un pogrom. Des militant.es fascistes et racistes, souvent issus des classes populaires précaires, se sont mis à tenter d'attaquer et expulser toute personne musulmane et racisée de leur communauté, allant jusqu'à des tentatives de meurtre.
À Southport, on a pu donc observer la foule jeter des briques sur la mosquée. A Middlesbrough, des groupuscules fascistes ont tenté de créer des « No go Zone » dans le centre-ville en y refusant l'accès aux personnes non blanches. À Belfast, on a pu observer une femme voilée se faire frapper au visage alors qu'elle portait son bébé dans les bras.
Mais le pic de cette violence s'est sûrement déroulé à Tamworth où une foule hilare a enfermé des demandeurs d'asiles dans l'hôtel où ils résidaient avant d'y mettre le feu. Bien que l'incendie ait été heureusement maîtrisé, l'intention de la foule était claire : tenter de tuer les résidents enfermés à l'intérieur du bâtiment. Une liste des centres d'immigration à cibler a par ailleurs été partagée sur Telegram, à destination des émeutiers.
À Southport, on a pu donc observer la foule jeter des briques sur la mosquée. A Middlesbrough, des groupuscules fascistes ont tenté de créer des « No go Zone » dans le centre-ville en y refusant l'accès aux personnes non blanches. À Belfast, on a pu observer une femme voilée se faire frapper au visage alors qu'elle portait son bébé dans les bras.
D'autres actes violents ont été commis à travers le pays contre des hommes et femmes racisés ou de confession musulmane, les poussant parfois à s'armer pour se défendre face à une violence croissante. Des images d'hommes noirs et arabes masqués et armés pour se protéger contre leurs agresseurs, qui ont, selon les médias, conforté les émeutiers et leurs alliés dans leur croyance du Grand remplacement et du « Two tier policing », une théorie complotiste selon laquelle les blancs seraient traités plus durement par la police que les personnes racisées.
Pendants les jours qui ont suivi les émeutes, une liste des centres d'aide à l'immigration circula sur Telegram. Ces centres furent la cible de mobilisations fascistes prévues pour le 7 Août, soit 9 jours après la première émeute.
Ce même jour, des milliers de militant.es antifascistes se sont mobilisés à travers le pays pour s'opposer à cette violence, décourageant ainsi les émeutiers en infériorité numérique. La manifestation la plus grande a eu lieu à Walthamstow, dans le Nord-Est de Londres, où j'ai rencontré le député LFI Raphaël Arnault. Aucun fasciste ne s'est manifesté, probablement découragé par la taille de la foule. La député locale du parti travailliste, Stella Creasy a seulement découragé les manifestations contre l'extrême droite,mais après avoir vu la taille de la foule, a tenté de donner l'impression qu'elle participait à la manifestation. Dans la plupart des contre-manifestations , les antifascistes ont largement dépassé en nombre les fascistes. Une victoire idéologique saluée par les médias, pompiers-pyromanes de cette escalade de violence. Dans quelques endroits périurbains et plus pauvres, des affrontements furent observés entre les deux factions. Quelques interpellations sans blessé grave ont eu lieu en Hampshire, à Northampton et à Blackpool.
Tommy Robinson, un influenceur fasciste
Ces émeutes ont démontré plusieurs tendances de l'extrême droite britannique. Tout d'abord, les mouvements fascistes et néonazi n'opèrent plus à travers des structures à proprement parler mais s'organisent plutôt en ligne. En effet, après l'effondrement du BNP (Parti National Britannique), et la dissolution de EDL (League de La Défense des anglais) dans les années 2010, la pensée ethnonationaliste a peiné à construire un nouveau parti, et ce malgré les tentatives de Homeland ou Patriotic Alternative. Les influenceurs d'extrême droite, partageant leurs théories du complot via leurs plateformes, ont quant à eux un pouvoir non négligeable pour rassembler les gens dans la rue.
Sociologiquement parlant, les émeutiers se divisent en deux grandes catégories. Un noyau dur petit bourgeois d'abord, et un groupement prolétaire ensuite, majoritairement issu d'une classe ouvrière précarisée.
Tommy Robinson en fait partie : il est le fondateur de la English Defense League, un groupe d'extrême droite, tout droit sorti du milieu hooligan dans le football. Au début de sa carrière, Robinson était constamment encouragé par les pouvoirs dominants, ayant même participé à un débat à l'université d'Oxford. Cependant, sa rhétorique fasciste est jugée trop radicale après son adhésion au média d'extrême droite Rebel News. Ce média comptait parmi ses membres Jack Posobiec qui partageait habituellement des memes néonazis et la théorie du “génocide blanc”, Laura Loomer qui se décrit elle-même comme “nationaliste blanche”, et Jack Buckby qui a tenu les victimes du massacre homophobe d'Orlando en 2016 de responsables de leur sort car « les LGBTs ont alliés avec l'islamisme ».
Peu avant les émeutes, Robinson avait organisé avec succès un rassemblement à Londres réunissant des milliers de participants. Cette action avait été lancée sur Twitter, après que son compte, qui avait été banni de la plateforme, soit remis en ligne par la nouvelle politique d'Elon Musk sur le réseau social. Tommy Robinson est un influenceur dans le sens premier du terme. Il a quitté le Royaume-Uni pour éviter des ennuis judiciaire et organise depuis des attaques racistes tout en partageant des théories du complot, dans le confort de sa chaise longue à Ayia Napa (à Chypre).
Sociologiquement parlant, les émeutiers se divisent en deux grandes catégories. Un noyau dur petit bourgeois d'abord, et un groupement prolétaire ensuite, majoritairement issu d'une classe ouvrière précarisée. Toutefois, si le théoricien Richard Seymour affirme que ces émeutes ne sont catégoriquement pas une forme de lutte des classes dégradée (contrairement à l'idée souvent répété par les médias selon laquelle les émeutiers exprimeraient les préoccupations de la classe ouvrière), l'historien Anton Jaeger quant à lui, souligne que “Derrière le pogromisme britannique se cache encore une grande misère qu'il est de la tâche historique de la gauche de combattre”.
En effet, les régions où les émeutes se sont déroulées sont aussi les régions les plus durement touchées par l'austérité des années 2010.
Comment Nigel Farage a radicalisé la droite britannique
Autre personnalité principale et véritable pôle d'attraction de l'extrême droite britannique ces deux dernières décennies : Nigel Farage. Farage est un ancien banquier issu de la haute bourgeoisie, qui, dans sa jeunesse, s'est dit admiratif d'Oswald Mosley, le dirigeant de l'Union des Fascistes Britannique (BUF, British Union of Fascists, fondé dans les années 30 et allié de Mussolini, interdit en 1940). Depuis, il est devenu dirigeant du parti pro-Brexit UKIP en 2006, se donnant pour mission de faire évoluer la politique britannique à droite. Réduire l'immigration et déréguler l'économie, cela devait être obtenu par la sortie de L'Union Européenne. Sa ligne actuelle, celle de Reform UK, son nouveau parti, est essentiellement poujadiste (mouvement politique français qui, dans les années 50, a réuni le petit patronat et les commerçants contre l'élite politique, économique et culturelle). Il promet l'austérité dans certains secteurs en dénonçant le « gaspillage gouvernemental » mais aussi de défendre les petits patrons et producteurs contre le grand capital et l'Etat.
Bien qu'un parti de masse fasciste n'ait jamais pu s'imposer en Grande Bretagne, la pensée ethnonationaliste y est devenue de plus en plus acceptable dans le paysage politique. Historiquement, Farage s'est positionné à droite du parti conservateur afin de récupérer les votes contestataires. Cela l'a en grande partie conduit à défendre un nationalisme civique ayant pour but de défendre la nation. Une nation qui peut, selon lui, être multiethnique, mais pas multiculturelle.
Malgré tout, la cohésion au sein du parti conservateur s'effondre depuis 2016. En effet, le parti s'est vu gouverné par 5 premiers ministres en 10 ans et différentes factions se sont rapprochées de l'extrême droite, adoptant sa rhétorique, tout en augmentant pourtant les impôts et l'immigration. C'est en profitant de cette incohérence entre les discours et les actes que Farage a décidé de lancer son propre parti. Pour y parvenir, il a dû se placer à droite des conservateurs, tolérant l'ethnonationalisme dans ses rangs et portant parfois des positions ouvertement ethnonationalistes.
On peut donc constater un avant et après Farage. Par exemple, avant sa prise de pouvoir au sein du parti, deux candidats que j'avais révélé dans des articles pour le journal Byline Times comme étant ouvertement racistes et proches de l'extrême droite, avaient été licenciés. Depuis l'arrivée de Farage à la tête du parti, mes nouvelles révélations contre d'autres candidats ont été ignorées.
Comme en France, les grands médias facilitent la montée de l'extrême-droite
Les médias ont également joué un grand rôle dans la montée de l'islamophobie, qu'ils banalisent ouvertement. Cela fait des années maintenant que les musulmans sont la cible d'attaques et de calomnies dans les médias, si bien que même les manifestations pro-palestiniennes des derniers mois ont été qualifiées injustement d'orgies antisémites, de « manifestations pour la haine » et de djihadisme. En même temps, des oligarques comme Paul Marshall (un équivalent britannique à Bolloré ou Pierre-Edouard Stérin) achètent des chaînes comme GB News et Talk TV pour déplacer encore plus le discours politique à l'extrême droite. Nigel Farage est par ailleurs présentateur sur GB News et la chaîne est un incubateur de carrière pour des idéologues d'extrême droite. Les médias britanniques, à peu d'exception près, propagent ainsi l'idée qu'il est possible de mentir et d'attaquer la communauté musulmane en toute impunité. Aussi, ce que font des personnalités comme Tommy Robinson ne sont finalement que des échos moins « légitimes » de ce qui se fait sur GB News ou The Spectator.
En même temps, des oligarques comme Paul Marshall (un équivalent britannique à Bolloré ou Pierre-Edouard Stérin) achètent des chaînes comme GB News et Talk TV pour déplacer encore plus le discours politique à l'extrême droite.
Pendant que les émeutes avaient lieu, Keir Starmer, nouveau premier ministre, dormait quant à lui sur ses deux oreilles. Il lui a fallu plusieurs jours pour annuler ses vacances prévues, et quant il a enfin pris la parole, celle-ci est restée très formaliste. Il a présenté les émeutiers comme des « casseurs » d'extrême droite et a promis de rétablir l'ordre. Une proposition de loi de censure en ligne a pourtant été sa seule réponse. Rien n'a été proposé comme réponse au racisme ambiant, et rien n'a été promis pour les communautés touchées par la violence et la haine des dernières semaines.
Les émeutes auront par ailleurs permis aux néonazis comme aux antifascistes de renforcer leurs rangs. Les organisations de gauche ont certes été lentes à réagir, mais ont démontré une grande force d'action une fois en marche. La situation actuelle reste tendue, chaotique et teintée de mensonges. Ce qui est parfaitement clair en revanche, c'est que les slogans antiracistes et les chants de protestation ne suffiront pas. Les émeutes incarnent la peur du déclin qui grandit à travers tout le Royaume Uni. C'est seulement en relevant économiquement le pays et en affrontant l'extrême droite sur toutes les lignes que la gauche peut espérer mettre fin à cette escalade de violence. Une tâche bien trop importante pour être laissée entre les mains du parti travailliste.
Les organisations de gauche ont certes été lentes à réagir, mais ont démontré une grande force d'action une fois en marche.
Deux choses se sont produites depuis les émeutes. La première, c'est que Tommy Robinson a organisé un nouveau rassemblement à la fin d'Octobre, mais il a été interpellé pour ses délits précédents et a été condamné à 18 mois de prison. On peut espérer sans doute une baisse du dynamisme de l'extrême droite pour l'instant. La deuxième est l'élection de Donald Trump aux États-Unis. L'extrême droite Britannique, surtout Tommy Robinson, est proche du monde Trumpiste. Robinson est proche de Steve Bannon (ancien conseiller senior de Trump, admirateur de Charles Maurras et intermédiaire pour l'extrême droite autour du monde), et de plusieurs figures du monde Trumpiste qui inclut le membre du congrès Paul Gosar, l'influencer Alex Jones, et quelques éditorialistes de Fox News. Il est aussi soutenu financièrement par des oligarchies Trumpistes. L'étoile de Robinson montait pendant le premier quinquennat de Trump. On peut craindre que cela s'aggrave lors de celui qui commence maintenant.
Olly Haynes
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

La dimension néofasciste de l’axe Poutine-Trump au prisme de la guerre d’Ukraine, ce qui échappe à certaines gauches

À l'heure où ces lignes sont écrites, le 6 novembre 2024, deux sujets dominent l'actualité du monde et plus spécialement celle qui concerne la guerre d'Ukraine : d'une part, l'élection américaine avec, à l'heure qu'il est, l'élection confirmée de Donald Trump et le basculement du Sénat en faveur des Républicains, et, d'autre part, l'envoi de troupes nord-coréennes sur le front russe de Koursk. Bien que le débordant largement, ces deux données de la situation internationale se croisent pour éclairer le cours nouveau que tend à prendre la guerre en Ukraine et, en retour, vilaine dialectique, la possible concrétisation d'un véritable axe mondial totalitaire.
19 novembre 2024 | tiré du site Entre les lignes entre les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/11/19/la-dimension-neofasciste-de-laxe-poutine-trump-au-prisme-de-la-guerre-dukraine-ce-qui-echappe-a-certaines-gauches/#more-87509
Derrière l'épouvantail nord-coréen, le test poutinien pour avancer vers un axe du néofascisme international
Tout d'abord, il est plus que probable que la décision de la Russie d'enrôler des troupes de Corée du Nord dans son projet impérialiste visant l'Ukraine participe de sa volonté de peser hic et nuncsur le moment électoral nord-américain, tendu à l'extrême, pour évidemment affaiblir toujours plus ce centre de l'« Occident collectif », que sont les États-Unis et qu'elle est décidée à défier. D'une pierre nord-coréenne deux coups, l'un aux États-Unis, l'autre en Ukraine, qui vont dans le même sens (l'affirmation d'un projet mondial de reconstitution de la puissance impériale de la Russie). En effet, celle-ci envoie le signal violent que, par le saut qualitatif (plutôt que quantitatif pour le moment) de cette participation militaire nord-coréenne sur son sol occupé par l'Ukraine, elle assume une logique d'escalade ouverte au constat qu'en face, les alliés de celle-ci fléchissent dans leur aide (Allemagne), la contiennent (administration Biden-Harris) pour ne pas alimenter l'escalade et se déchirent sous la pression interne qu'exercent les amis pro-russes qui vont de l'extrême droite à l'extrême gauche brunissante (Trump, Orban, Le Pen, Wagenknecht [1], etc.). Le défi est d'autant plus grand que, de toute évidence, la dynamique expansionniste propre au régime russe le poussera inéluctablement à faire intervenir ces militaires étrangers en Ukraine même.
En somme, Poutine, tout à ses mises en garde adressées à l'Occident de ne pas se lancer dans une escalade militaire en Ukraine, s'y engage, lui, pleinement en se payant, sans grand risque, selon lui, la tête des dirigeants de l'OTAN et des puissances occidentales qui, ayant fait jusqu'ici la preuve de leurs atermoiements, voire de leur veulerie, dans l'aide militaire apportée à Kyiv, se donnent désormais à voir, à travers leurs déclarations convenues dénonçant la dernière manœuvre russe, tout bonnement tétanisés.
Mais, par cet épouvantail nord-coréen agité par Moscou dans l'espoir d'accréditer qu'il signe un pas en avant décisif pour donner l'impression qu'il plie la guerre d'Ukraine en sa faveur sans que l'Occident soit en état de réagir, Poutine compte accréditer autre chose : que Trump a toutes les raisons du monde de vouloir extraire les États-Unis d'une guerre perdue d'avance qui, au demeurant, ne les concerne pas, qui ne peut pas, ne doit pas les concerner. Avec, en corollaire trumpiste que le slogan du MAGA (« Make America Great Again », littéralement « Rendre l'Amérique à nouveau grande », « Rendre sa grandeur à l'Amérique ») repose fermement sur un socle isolationniste, ô combien apprécié du chef russe, pouvant, mais seulement à la marge, nécessiter de gendarmer telle ou telle zone du monde qui contreviendrait à la grandeur économique des États-Unis ! Le tout misant fondamentalement sur une bonne entente américaine avec une Russie vue comme une nation amie, sans risque qu'elle bascule ennemie (tant pis pour l'UE/tant mieux pour la trame brune européenne), puisqu'il est (devrait être ?) de notoriété publique que c'est envers elle que Trump est endetté politiquement (à partir d'un endettement financier passé !) pour lui avoir permis d'émerger hier, avec succès, comme candidat au pouvoir aux États-Unis et de remettre cela aujourd'hui [2].
Le cours actuel de la géopolitique poutinienne est désormais plus clair que jamais, tout délirant qu'il soit, tout dangereux qu'il soit : il repose sur la constitution à marche forcée d'un axe néofasciste Russie/États-Unis trumpisés-(Corée du Nord), travaillé au cordeau, dévitalisant, en fracturant méchamment le vieil impérialisme occidental, de l'intérieur, (trumpisme et autres extrêmes droites) comme de l'extérieur (Russie/ Corée du Nord avec, en arrière-plan, une Chine, pour le coup, hésitante car elle n'aime pas être bousculée, par ce qu'elle considère probablement de l'amateurisme aventuriste, dans ses préparatifs de confrontation, à moyens-longs termes, avec les États-Unis). Tout cela au profit d'un néo-impérialisme fasciste émergent auquel ladite Chine pourrait finir tout de même par se joindre, alléchée finalement, si cet axe venait à prendre forme, par l'idée d'en devenir la puissance hégémonique.
Ce scénario, dont Poutine, chef de guerre en Ukraine, est à l'initiative est une véritable mise à l'épreuve de la capacité de l'Occident à dépasser ce qui, sans être proclamé par lui, revient à autolimiter son aide à l'Ukraine pour éviter, assez paradoxalement au vu de ce bras de fer que Poutine est en train de lui opposer sans trembler jusqu'en son cœur impérial, que ne s'enclenche un engrenage menant, par une défaite militaire totale, à la chute du dictateur russe aux conséquences géopolitiques et économiques jugées incalculables et indésirables. Le problème étant, nous sommes en train de le voir avec l'opération mobilisation coréenne en Russie et donc contre une Ukraine, toujours en quête de moyens militaires permettant de neutraliser la puissance de feu ennemie, que cette stratégie de l'évitement de la confrontation en Ukraine avec l'expansionnisme russe ne fait que pousser celui-ci à la chercher toujours plus en se pensant assuré de la capacité de ses relais au cœur de l'Occident à tétaniser et bloquer toute velléité de riposte cinglante de celui-ci.
Le scénario poutinien d'ébranlement néofasciste de l'ordre international : quelques atouts mais aussi quelques faiblesses
C'est au demeurant là que le bât blesse, sans que cela en diminue la dangerosité, dans cette « manœuvre nord-coréenne » de Poutine pour finir de percuter son ennemi américain, accroître sa division, le rendre incapable de parer le coup et faire advenir à sa tête l'ami de la Russie.
Le coup de poker, car cela en est un, du dictateur russe s'expose en effet à échouer, comme ont échoué ses initiatives depuis le 24 février 2022 sans pour autant, malheureusement, l'empêcher de poursuivre la destruction de l'Ukraine. Envisageons, sans prétention à l'exhaustivité, ce qui pourrait déboucher sur l'échec. […]
* L'imprévisibilité, une fois devenu président, du bonhomme dont il est notoire qu'il n'est pas spécialement porté, entre autres, à faire ami-ami avec une Chine, ce partenaire incontournable à ménager absolument pour Poutine, avec laquelle l'Américain prévoit d'entrer en guerre commerciale, ce qui pourrait faire s'effondrer le château de carte russe.
* La capacité redoutable à faire capoter la machination russe de la part des rouages systémiques états-uniens impérialistement peu enclins à voir le pays entrer, en contradiction, au demeurant, avec le mirage trumpiste du MAGA, en symbiose avec ledit axe international placé sous l'égide de Poutine.
* La crainte, enfin, par la Chine que l'opération poutinienne autour de Trump et Kim Jong-un ne mette en péril, par l'aventurisme expansionniste russe qui la sous-tend, son propre calendrier impérialiste ciblant les États-Unis mais à moyen-long terme, son Ukraine à venir, Taïwan, et plus (domination de la mer de Chine).
Ce que révèle l'affrontement interimpérialiste, autour de la fascisation du monde en cours, de la mise hors jeu politique des gauches
Tout ce qui précède concerne un jeu interimpérialiste, à deux pôles, qui met dramatiquement en évidence un tiers exclu : les gauches internationales profondément divisées sur la guerre d'Ukraine, une partie d'entre elles se refusant à toute solidarité internationaliste avec le peuple ukrainien, autour d'un positionnement pacifiste ou ouvertement en soutien avec la Russie prônant, dans les deux cas, le refus d'armer la résistance ukrainienne. Favorisant ainsi la victoire de la Russie (à court terme par conservation des territoires occupés mais, à plus ou moins court terme, ouvrant sur une nouvelle tentative de sa part de s'attaquer au reste de l'Ukraine tout en menaçant le reste de son « étranger proche »). Par où serait mise en cause l‘intangibilité du droit de tout peuple à lutter pour sa libération nationale, en recourant à tous les moyens possibles pour s'armer, qui est le noyau de tout internationalisme conséquent.
Il y aurait beaucoup à dire sur ce reniement qui n'affaiblit pas que la solidarité, même si heureusement une autre gauche persiste à la mettre en œuvre, à l'égard du peuple ukrainien mais aussi, en laissant libre cours au jeu impérialiste exposé plus haut, la solidarité envers l'ensemble des peuples en lutte. Lesquels, en tout cas pour certaines de leurs fractions, emportés par le confusionnisme semé par ces gauches « campistes », prenant parti pour un camp impérialiste contre un autre, tombent parfois dans le piège de croire, comme on le voit dans le cas exemplaire de l'Afrique, que la Russie martyrisant sauvagement le peuple ukrainien puisse aider à leur libération alors qu'elle s'appuie sur les castes militaires locales pas spécialement favorables à l'émancipation de leurs peuples, qui plus est, en accaparant, dans la logique prédatrice de tout impérialisme, les richesses de leur sous-sol.
Pour aborder la dernière partie de cet article, je voudrais avancer l'hypothèse que cette dérive qui met hors jeu les gauches internationales a à voir profondément, dans le contexte de la crise de désorientation née de la chute de l'URSS, avec leur incapacité à prendre la pleine mesure du fascisme qui avance. Entendons-nous, on lit bien, du moins chez certaines d'entre elles, la dénonciation de ces progrès du fascisme et l'appel à se mobiliser pour le contrer. Mais elles le font, et pour cause, sans situer ce qui est un activateur, sinon l'activateur principal, desdits fascismes que pourtant le positionnement de ceux-ci sur la guerre en Ukraine met clairement en évidence, à savoir la Russie de Poutine que lesdits fascismes soutiennent à quelques exceptions près (en particulier l'italien).
Pourtant, une entrevue d'août 2023 d'un opposant russe, Ilya Budraitskis, aurait pu ouvrir les yeux de celleux qui, à gauche, se refusent à voir la responsabilité criminelle, dans cette guerre, de la Russie de Poutine, guerre qu'il connecte, en quelque sorte, organiquement à l'avènement de la fascisation de celle-ci. Lisons quelques ex- traits de ce document :
Le régime russe existe depuis plus de vingt ans et il a subi une sérieuse transformation au cours de cette période. Il a commencé comme un régime bonapartiste néolibéral et s'est transformé en une sorte de dictature fasciste ouverte. Et je pense que cette transformation en régime fasciste a commencé après le début de l'invasion de l'Ukraine [3].
Cette dernière phrase est d'une importance capitale qui met au jour le lien de continuité, sinon de causalité stricte, entre le déclenchement de la guerre contre l'Ukraine et la mutation fasciste du régime russe.
La guerre d'Ukraine et la clé russe de la volonté de fasciser l'ordre international
Mais l'auteur précise encore les choses en revenant sur les mobilisations en Russie de 2011 apparues alors que Poutine lançait sa campagne pour être réélu, pour la troisième fois, en 2012, puis les mobilisations de 2017 dont la figure la plus visible était Alexei Navalny. Entre-temps, en 2014, la Russie avait commencé à intervenir militairement en Ukraine, au Donbass puis en Crimée, qu'elle finit par annexer la même année. Cette intrication temporelle des mobilisations en Russie et l'implication militaire de celle-ci en Ukraine est, nous dit Ilya Budraitskis, la matrice, critique violente de la révolution ukrainienne du Maïdan, du discours antirévolutionnaire de Poutine qui va le mener à engager la fascisation du régime :
Quel était donc le principal problème en Ukraine ? Selon Poutine, c'était Maïdan, le renversement illégal du gouvernement par le peuple, ce qui était absolument inacceptable. Il fallait donc empêcher que cela se produise en Ukraine et en Russie. Poutine a ensuite pris position contre cette possible révolution car, pour lui, toutes les révolutions qui ont eu lieu en Russie, y compris celle de 1917, sont le fruit de l'activité d'ennemis extérieurs. Selon lui, toutes les révolutions sont une conspiration, ce sont des processus qui viennent de l'extérieur pour déstabiliser l'État russe.
Cette vision paranoïaque, chez Poutine, des peuples ukrainiens et russes compris comme manipulables par l'étranger et devenant ainsi une menace pour la Russie, c'est-à-dire pour le pouvoir qu'il entend y perpétuer, appelait la nécessité de mettre en place un système, à deux faces structurellement liées, de prévention radicale de cette menace : la guerre en Ukraine et la répression de toute dissidence avec le régime en Russie :
Il est possible de voir comment le début de l'invasion n'était pas seulement une question de politique étrangère, mais aussi une manière de discipliner la société russe.
À la suite de la mise en place de ces repères chronologiques et politiques, Ilya Budraitskis s'arrête sur ce que le poutinisme, en tant qu'il est à l'origine, suivant ses mots, de « la transformation fasciste de l'État russe », dit de l'actualité du fascisme… bien au-delà de la Russie :
En ce sens, le cas russe n'est pas unique. Il ne s'agit pas d'une exception à la tendance globale, mais d'une image de celle-ci. Si nous voulons comprendre comment ces mouvements d'extrême droite peuvent transformer la société, nous devrions prendre la Russie comme exemple.
Je ne résiste pas à la tentation de reproduire l'intégralité de ce passage essentiel de l'entrevue :
Je pense que si nous parlons du mouvement fasciste aujourd'hui, de ce à quoi ressemble le fascisme au 21e siècle, nous devrions regarder ce qui se passe déjà en Russie. Parce que nous sommes dans un contexte où un mouvement de masse venant d'en bas n'est plus nécessaire, il pourrait s'agir d'un tournant fasciste venant d'en haut. Si vous regardez, le fascisme classique, qui a émergé au 20e siècle, a toujours été la combinaison de mouvements de masse avec la classe dirigeante, qui a utilisé le mouvement de masse pour transformer le régime politique. Aujourd'hui, dans les sociétés qui ont déjà été fortement détruites par le néolibéralisme, avec la destruction de toute tradition d'organisation, de solidarité, etc., un mouvement de masse fasciste n'est plus nécessaire. C'est pourquoi je pense qu'il est important de parler de la transformation fasciste de l'État russe, et je pense qu'en ce sens, le cas russe n'est pas unique. Il ne s'agit pas d'une exception à la tendance globale, mais d'une image de celle-ci. Si nous voulons comprendre comment ces mouvements d'extrême droite peuvent transformer la société, nous devrions prendre la Russie comme exemple.
Ce fascisme, que j'appelle, tout en restant dans la logique de cette analyse d'Ilya Budraitskis, néofascisme, qui 1) a pris forme en Russie, contre la société russe, et en prise directe avec la visée belliciste du régime poutinien sur l'Ukraine, et qui 2) selon l'auteur, nous tend un miroir éclairant sur le danger fasciste international, permet de prendre la mesure des impasses des gauches dont je parle plus haut : leur anti- fascisme repose, en effet sur la paradoxale élision par eux de la nature néofasciste du régime russe alors que, pour Ilya Budraitskis, celle-ci a le pouvoir heuristique d'éclairer ce qu'est le fascisme international du 21e siècle dans sa spécificité par rapport aux modèles nazi et mussolinien, lesquels « combinaient des mouvements de masse avec la classe dirigeante, qui a utilisé le mouvement de masse pour transformer le régime politique » alors qu'« aujourd'hui, dans les sociétés qui ont déjà été fortement détruites par le néolibéralisme, avec la destruction de toute tradition d'organisation, de solidarité, etc., un mouvement de masse fasciste n'est plus nécessaire [4] ».
Mais ce que nous voyons aujourd'hui de l'axe Poutine-Trump-(Kim Jong-un), combiné à la montée internationale des partis néofascistes, en particulier européens, doit nous faire aller plus loin : la Russie n'est pas que l'image la plus claire, comme le dit Ilya Budraitskis, de ce que sont et peuvent devenir ces fascismes. Elle est l'agent d'une dynamique tout à la fois centripète poutinophile desdits fascismes et centrifuge par occupation de positions de pouvoir dans divers pays dont, depuis aujourd'hui, probablement, les États-Unis !
L'« internationalisme » du campisme pro-russe d'une partie des gauches internationales mis à l'épreuve, au miroir des guerres en Ukraine et en Palestine
De ce qui précède se vérifie la magistrale faute politique commise par le campisme de gauche qui, par son positionnement pro-russe et anti-ukrainien face à la guerre que l'on sait, se fait, malgré lui ou sciemment, le propagateur du néofascisme international que, par ailleurs, il dit combattre sans vouloir voir qu'il est largement sous influence russe : dénonçant ainsi, par exemple, le fascisme du régime israélien massacreur des Palestinien·nes et des Libanais·es tout en absolvant le néofascisme poutinien, oppresseur de ses peuples mais aussi massacreur des Ukrainien·nes et transformant en chair à canon des milliers de Russes enrôlés contre l'Ukraine. Et en oubliant, par où se boucle le cercle de fer du reniement internationaliste, que l'ami américain du destructeur de l'Ukraine est l'ami indéfectible du destructeur de la Palestine et du Liban !
Alors, pour conclure, j'avoue, une fois mise en évidence la faute rédhibitoire des gauches campistes à l'antifascisme et à l'internationalisme à géométrie variable, que je crois urgent que les gauches amies du peuple ukrainien fassent valoir bien plus qu'elles ne le font, certaines ne le font pas du tout, 1) la nature néofasciste du poutinisme, 2) la dimension profondément antifasciste, structurellement induite par la guerre menée par celle-ci en Ukraine, de la résistance ukrainienne du fait même, par-delà la conscience qu'en ont ou n'en ont pas les résistant·es, d'être la ligne avancée de la lutte anti-fasciste internationale et 3), enfin, la nécessité logique que cette résistance antifasciste soit totalement soutenue et, notamment, approvi-ionnée en armes à la hauteur de l'enjeu que la montée de ce néofascisme représente mondialement ! Peu de ces trois points cardinaux de l'internationaliste soutien à apporter au peuple ukrainien figure centralement et régulièrement, à l'égal de ce qui est fait, au demeurant, très justement pour les Palestinien·nes et les Libanais·es, dans les analyses et appels à mobilisation en faveur des Ukrainien·nes de certaines de ces gauches qui conservent heureusement une authentique fibre internationaliste.
De ce point de vue, il est remarquable que l'organisation la plus représentative du soutien à la résistance de l'Ukraine en France, le RESU (Comité français du Réseau européen de solidarité avec l'Ukraine [5]), ait pleinement saisi l'importance d'énoncer que la guerre contre l'Ukraine est une guerre intrinsèquement néofasciste et impérialiste et qu'elle est par là une menace pour tous les peuples du monde !
Antoine Rabadan
Membre du Comité français du RESU à Montpellier.
[1] Elsa Conessa, « En Allemagne, Sahra Wagenknecht veut imposer une ligne prorusse dans les Länder de l'Est », Le Monde, 2 novembre 2024.
[2] « Les ingérences russes dévoilées », Le Monde en marche
[3] si nous voulons comprendre l'extrême droite au 21e siècle. Mon amie Mariana me communique le texte de 2022 d'Oleg Orlov, dirigeant du Centre de défense des droits humains Mémorial (interdit par le régime russe en décembre 2021), par ailleurs Prix Nobel de la paix 2022 et qui a été libéré de prison, en août 2024 lors d'un échange de prisonniers, texte dans laquelle son auteur défend, lui aussi, l'importance de caractériser le régime russe comme fasciste en corrélant ce fascisme avec la guerre qu'il a engagée en Ukraine. « Le pays, dit-il, qui s'est éloigné il y a trente ans, du totalitarisme communiste, est retombé dans le totalitarisme, mais désormais fasciste » (« Russie : “Ils voulaient le fascisme, ils l'ont eu” », Mediapart, 12 novembre 2022).
[4] Le trumpisme pourrait apparaître comme dérogeant à cette caractéristique propre au néofascisme de se dispenser d'une mobilisation de masse. Je crois qu'en fait le néofascisme actuel conserve cette capacité à mobiliser en masse… électoralement comme moyen d'accès au pouvoir. À ceci près qu'avec l'assaut du Capitole, le trumpisme a montré et, envoyé le signal à ces alter ego néofascistes du monde, que la mobilisation de masse non électorale, anti-électorale dans ce cas, restait un recours à ne pas négliger. L'échec de cette opération du Capitole ne devrait pas rassurer pour autant, puisqu'il aura montré à son instigateur et à ses éventuels épigones internationaux, que le sujet doit être mieux préparé et qu'il peut être un élément essentiel pour au moins faire peser la menace extra-institutionnelle et ainsi peser pré-électoralement ou post-électoralement. Trump, en l'état de ce qui se dessine électoralement, aura montré le gain que ses menaces de contester violemment un éventuel échec électoral lui ont donné pour gagner en construisant l'image démagogique de l'anti-système radical à l'extrême, image propre à séduire celleux qui sont décidé·es à en découdre avec le « système ». La suite dira s'il tentera de transformer cette mobilisation de l'instant électoral en force de percussion de masse durant son mandat pour tenter de… fasciser, ce qui se dit fasciser, l'État américain. Et à quel prix ! En somme, la caractéristique du fascisme historique de la mobilisation de masse, qui, d'une part, est absente du néofascisme qu'analyse Ilya Budraitskis et qui, comme cela est le cas dans le poutinisme d'État, parie sur le maintien de la population dans la passivité la plus totale, mais, d'autre part, n'est pas absente dans le cas du trumpisme, pourrait se retrouver opérante, en aval ou/et en amont d'une conquête électorale néofasciste renouant ainsi avec sa préhistoire fasciste, par des dynamiques de radicalisation dudit néofascisme devant des résistances qui lui seraient opposées et de par l'appui qu'il recevrait, pour ce faire, de couches conséquentes du capital. De ce point de vue il nous faudrait avoir une vision du néofascisme comme virtuellement capable de retrouver, avec toutes ses spécificités, le recours proprement fasciste au mouvement de masse.
[5] https://www.facebook.com/people/comité-français-du-réseau-européen-de-solidarité-avec-l-Ukraine/100087563586225/
Publié dans Soutien à l'Ukraine résistante (Volume 35)
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/11/12/patrick-le-trehondat-lukraine-st-seule-ou-presque/
https://www.syllepse.net/syllepse_images/soutien-a—lukraine-re–sistante–n-deg-35_compressed.pdf
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Qu’est ce que cette guerre étrange en Ukraine où on demande au pays envahi de se soumettre à la volonté de l’envahisseur ?*

Évidemment, rien de plus normal que l'actuelle escalade de la guerre en Ukraine fasse peur.
*par Yorgos Mitralias*
*Et aussi, rien de plus normal que la possession de l'arme nucléaire par l'une des forces impliquées (la Russie) donne lieu à des inquiétudes tout à fait justifiées. Cependant, rien ne pourrait justifier l'actuel -énième depuis presque quatre ans- déchaînement de déclarations alarmistes qui se concluent toujours par des appels adressés non pas à l'envahisseur possédant l'arme nucléaire (la Russie) mais au pays envahi (l'Ukraine) de se montrer raisonnable, en faisant des concessions pour ne pas provoquer l'ire nucléaire de son ennemi envahisseur ! *
Conclusion logique : face à une puissance possédant l'arme nucléaire, les pays qui n'en possèdent pas ont le devoir de ne pas résister et d'accepter de se soumettre sans discussion. En somme, tous ceux qui se sont battus becs et ongles dans le passé contre des puissances nucléaires, n'étaient que des décervelés irresponsables qui s'en foutaient éperdument du mal qu'ils faisaient au reste de l'humanité ! Comme par exemple, *les Vietnamiens * qui se sont battus avec le succès que l'on sait, contre la superpuissance nucléaire nord-américaine ou *les Algériens* qui ont fait de même contre la puissance nucléaire française. Ce qui nous conduit également logiquement à considérer (rétroactivement) ceux qui ont soutenu ces Vietnamiens et ces Algériens luttant pour leur liberté et leur autodétermination, comme des aventuriers politiques, des inconscients et des apprentis sorciers qui jouaient avec le sort de l'humanité…
En réalité, ces appels des bien pensants de tous bords -de gauche et de droite- à la raison des... victimes, n'a de nouveau que leur trop claire référence à l'arsenal nucléaire de l'envahisseur russe. Car ça fait déjà presque quatre ans, qu'on entend la même litanie des mises en demeure adressés aux Ukrainiens, les invitant à céder une partie de leur pays afin de ne pas trop énerver M. Poutine. Ce qui nous oblige à (ré)proposer, sans changer un seul mot, ce qu'on écrivait déjà en juin 2022, quelques mois après le début de cet interminable guerre que nous qualifions déjà d' "étrange" en acceptant comme allant de soi que « *les deux pays en guerre n'ont pas les mêmes droits et ne se battent donc pas à armes égales * » :
“*Cette guerre est « étrange » parce que la plupart de ceux qui se déclarent solidaires de la lutte du peuple ukrainien sont en même temps opposés à l'envoi d'armes qui permettraient à ce peuple de se défendre de manière un tant soit peu efficace. En d'autres termes, ils sont solidaires d'eux à condition qu'ils ne puissent pas se défendre, et qu'ils se contentent du rôle… de cadavre héroïque !*
*Mais les « bizarreries » de cette guerre – qui n'en est pas une – n'ont pas de fin. Par exemple, comment expliquer le fait – sans précédent dans l'histoire mondiale – que les deux pays en guerre n'ont pas les mêmes droits et ne se battent donc pas à armes égales ? C'est-à-dire que tandis que l'un (la Russie qui agresse) a le droit d'avoir une force aérienne, l'autre (l'Ukraine qui se défend) ne l'a pas. Que l'un (la Russie) a le droit de monopoliser le ciel de l'autre (l'Ukraine), tandis que cet autre – qui est en fait celui qui se défend – n'a que le droit de se faire arroser de bombes et de missiles tombés du ciel. Et aussi, alors que la Russie peut avoir et utiliser des armes lourdes de toutes sortes et sans aucune restriction, l'Ukraine qui se défend ne peut utiliser que des armes « défensives » et aucune arme « offensive ». Et en plus, alors que la Russie peut bombarder l'Ukraine en canonnant et en tirant des missiles depuis les territoires russe et biélorusse, il est expressément interdit à l'Ukraine de riposter en frappant des cibles à l'intérieur de la Russie et du Belarus, etc. etc*
*Mais, le plus « étrange » dans cette guerre, n'est pas que l'Ukraine ait été soumise à toutes ces restrictions scandaleuses de son droit (inaliénable) à se défendre comme elle l'entend. Le plus « étrange », c'est surtout que tous les gouvernements occidentaux et tous les médias occidentaux non seulement soutiennent ces « restrictions », qui n'ont aucun précédent dans l'histoire des guerres, mais les présentent en permanence comme évidentes, allant de soi, indiscutables et incontestables ! Et le résultat de cette situation scandaleuse est que lorsque Zelensky ose défier l'une de ces « restrictions », par exemple en demandant des avions pour protéger ses villes et leurs habitants, non seulement sa demande est instantanément rejetée, mais elle est également qualifiée d'inappropriée et… « dangereuse »…*
*La raison de ce traitement « étrange » de l'Ukraine par les ennemis, et surtout par les amis, s'est fait connaître progressivement, au fil du temps, et seulement à partir du moment où la possibilité d'un échec ou même d'une défaite de l'« opération militaire spéciale » russe a commencé à être envisagée : l'Ukraine n'a droit qu'à une défense de basse intensité contre l'invasion russe parce que… « Le président Poutine ne doit être ni vaincu ni humilié » ! Et pas seulement ça. Les partisans de cette position qui ne sont pas seulement des réactionnaires avérés comme Orban ou le vieux zombie qu'est Kissinger, mais aussi des démocrates néolibéraux plus présentables, comme tous les dirigeants occidentaux, Macron en tête, ne cessent d'affirmer avec une insistance croissante qu'« il doit y avoir une porte de sortie pour Poutine », une proposition qui lui permette de gagner quelque chose dans cette guerre afin d'éviter d'affronter ses compatriotes les mains vides au moment du décompte final. Et tout cela pour qu'il ne soit pas évincé et pour qu'il reste au pouvoir, ce qui est d'ailleurs ce qu'ils souhaitent tous publiquement ! Et pour atteindre cet objectif, non seulement ils commencent à « conseiller » de plus en plus instamment à Zelensky d'abandonner sa « rigidité » actuelle, de devenir plus
« réaliste » et d'accepter de donner à Poutine une partie de son pays. Mais ils ont aussi le culot de commencer à discuter entre eux quelle partie de l'Ukraine ils pourraient céder, ces impérialistes occidentaux (!), à Poutine, dans le dos des Ukrainiens et de leur gouvernement !*
*Bien que nous ayons ici un cas carabiné de l'interventionnisme et du paternalisme impérialiste le plus scandaleux, il y a peu de gens de gauche qui osent faire ce qui va de soi, à savoir le dénoncer publiquement, comme il le mérite. Et malheureusement, sont encore moins nombreux ceux qui osent soutenir le droit encore plus évident et élémentaire des Ukrainiens – qu'ils défendent bec et ongles – de se battre jusqu'au bout et par tous les moyens contre les envahisseurs russes, en décidant eux-mêmes librement et démocratiquement, et sans aucune ingérence étrangère hostile ou « amicale », de l'avenir de leur pays et des personnes qui y vivent !*
*En fait, un regard sur le passé très récent montre que l'attitude actuelle de l'Occident à l'égard de la Russie n'est pas surprenante, mais, contrairement à ce que pensent certains poutinistes plutôt naïfs, elle s'inscrit dans la continuité de sa position ferme en faveur du développement sans entrave de ses relations économiques avec ce pays, véritable eldorado pour ses capitalistes. En effet, rappelons-nous quelles ont été les premières réactions de tous ses dirigeants (Biden, Macron, Johnson…) dans les heures et les jours qui ont suivi l'invasion russe en Ukraine : Ils ont suggéré à Zelensky de l'exfiltrer d'Ukraine, car eux-mêmes et les médias de leur pays croyaient fermement que l'occupation de Kiev, et du pays entier, par l'armée russe était une question de quelques jours.*
*Tout a changé lorsque Zelensky a exhorté ses compatriotes à résister, en répondant à la proposition de Biden par la phrase désormais historique « La bataille sera menée ici, en Ukraine. J'ai besoin d'armes, pas d'un taxi » ! Et en effet, c'est parce que le peuple ukrainien a résisté et résiste encore bec et ongles, provoquant une vague de sympathie et de solidarité sans précédent dans l'opinion publique internationale, qu'il a de fait forcé les gouvernements occidentaux à faire quelque chose qui n'était pas dans leur agenda et qui était radicalement différent de la passivité dont ils ont fait preuve lorsque Poutine a occupé et annexé la Crimée en 2014 : Soutenir l'effort de guerre de l'Ukraine et imposer des sanctions économiques de plus en plus sévères à la Russie de Poutine et à ses oligarques »*.(1)
Notes
*1.*
*https://www.pressegauche.org/Qu-est-ce-que-cette-guerre-etrange-ou-on-interdit-a-l-Ukraine-que-Poutine-soit*
<https://www.pressegauche.org/Qu-est...>
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Trump, un cabinet de dangereux fanatiques

Donald Trump a rapidement choisi des loyalistes pour occuper des postes ministériels et autres hautes fonctions. Le Sénat devrait normalement voter pour confirmer les membres du cabinet, et les choix présidentiels sont controversés même parmi les républicains.
Hebdo L'Anticapitaliste - 730 (21/11/2024)
Par Dan La Botz
Dans certains cas, les choix capricieux de Trump, qui n'ont fait l'objet d'aucun contrôle, risquent de conduire au chaos gouvernemental s'ils sont confirmés. Des humoristes et des journalistes ont qualifié le nouveau cabinet de « voiture de clowns de Trump ». Mais les clowns ne sont pas drôles, ils sont effrayants.
Anti-vax à la Santé, climato-sceptique à l'Énergie…
Le plus scandaleux est peut-être que Trump a désigné le représentant Matt Gaetz pour le poste de procureur général. En 2020, Gaetz a été accusé de trafic sexuel d'enfants et de détournement de mineur pour avoir emmené une lycéenne de 17 ans au-delà des frontières d'un État afin d'avoir des relations sexuelles avec elle. Le ministère de la Justice et le comité d'éthique de la Chambre des représentantEs ont enquêté sur l'affaire, mais il n'a pas été mis en examen.
Le choix de Trump pour le poste de secrétaire à l'énergie se porte sur Chris Wright, PDG de Liberty Energy, une entreprise de fracturation basée à Denver. Il soutiendra l'industrie des combustibles fossiles et s'opposera aux efforts de réduction des gaz à effet de serre. L'année dernière, Wright a déclaré : « Il n'y a pas de crise climatique, et nous ne sommes pas non plus en pleine transition énergétique ».
Trump a désigné Robert F. Kennedy Jr, un anti-vax, comme secrétaire à la santé et aux services sociaux, un ministère doté d'un budget de 1 700 milliards de dollars et exerçant une influence considérable sur les politiques de santé. Son choix a été largement critiqué par les médecins et les scientifiques spécialisés dans le domaine de la santé.
Brutalité envers les migrantEs et dans l'armée
Trump a fait campagne sur la question de l'immigration en disant qu'il fermerait la frontière et commencerait les déportations dès le premier jour, et pour y faire face, il a choisi le nationaliste blanc Steven Miller comme chef de la politique de sécurité intérieure et un policier au langage dur nommé Thomas Homan comme « tsar de la frontière ». Homan a été responsable de la politique de séparation des familles pendant le premier mandat de Trump. Ils traiteront les immigrantEs de manière brutale.
Pour ce qui est de la politique étrangère, Trump a choisi Pete Hegseth, vétéran d'Irak et d'Afghanistan, major de la Garde nationale et animateur de télévision sur la chaîne d'extrême droite Fox News en 2014, pour le poste de secrétaire à la Défense. Hegseth, qui n'a jamais dirigé une grande organisation, sera en charge des 3,4 millions d'employéEs du ministère de la Défense. Son choix a indigné des membres du Congrès et d'anciens officiers, en partie à cause de son soutien aux soldats accusés de crimes de guerre. Il estime que l'armée est trop « woke » et s'oppose aux politiques de diversité, d'équité et d'inclusion qui, selon lui, ont affaibli les valeurs militaires. Il s'oppose également à ce que les femmes soient placées à des postes de combat. Hegseth a été accusé d'agression sexuelle lors d'une manifestation de femmes républicaines et, bien qu'il n'ait pas été mis en examen, il a payé la femme concernée. Hegseth a un tatouage, Deus Vult (la volonté de Dieu) et porte une croix de Jérusalem, deux symboles du mouvement nationaliste blanc.
Tulsi Gabbard, choix de Trump pour le poste de directeur du renseignement national, a été qualifiée d'« agent russe » et de « traître » par un membre de la Chambre des représentants en raison de son soutien à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
Musk et ses milliards, les PalestinienNEs niéEs
Pour le poste d'ambassadeur des États-Unis en Israël, Trump a choisi le pasteur baptiste Mike Huckabee, ancien gouverneur de l'Arkansas. Huckabee soutient que l'État d'Israël a le droit de contrôler la Cisjordanie, un nom qu'il rejette, préférant les termes bibliques de Judée et Samarie. Il affirme que la Cisjordanie n'existe pas, qu'il n'y a pas d'occupation et que les PalestinienNEs n'existent pas.
Enfin, Elon Musk, le magnat de la technologie et l'homme le plus riche du monde, qui a donné au moins 132 millions de dollars à la campagne de Trump, a été choisi avec l'entrepreneur pharmaceutique Vivek Ramaswamy pour diriger un nouveau ministère de l'efficacité gouvernementale. Musk a conclu des contrats avec le gouvernement pour un montant d'environ 1 000 milliards de dollars.
Les nominations ministérielles doivent en principe être confirmées par le Sénat américain, bien que Trump puisse tenter d'éviter cela en procédant à des « nominations d'urgence » lorsque le Sénat n'est pas en session. Les républicains désormais majoritaires au Sénat ne semblent pas avoir l'intégrité et le courage de lui tenir tête. Les clowns de Trump pourraient mettre en péril la bonne marche du gouvernement.
Dan La Botz (traduction Henri Wilno)
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

De l’utilité du journalisme à l’ère du chaos trumpiste

Donald Trump les considère comme les « ennemis du peuple ». Alors que les journalistes états-uniens s'inquiètent pour leur avenir, une question se pose : à quoi servent les médias ?
Tiré d'Europe solidaire sans frontière.
« Uh, Houston, we've had a problem » : c'est par ces mots laconiques que Jack Swigert, un des trois membres d'équipage de la mission Apollo 13, en pleine ascension vers la Lune, s'est adressé aux ingénieurs du centre de contrôle de la Nasa, le 13 avril 1970, pour alerter de la baisse subite des réserves d'oxygène dans la navette spatiale. La survie des astronautes était en jeu, il fallait trouver des solutions sans plus attendre.
Plus d'un demi-siècle plus tard, la catastrophe annoncée s'applique au secteur des médias. Le « problème » s'appelle Trump, et les malheureux contraints de colmater la brèche pour espérer en réchapper sont les journalistes. Le crash des « ennemis du peuple », tels que les désigne le nouveau président, est assuré si rien n'est fait pour redresser la barre.
En pleine introspection dès le lendemain de l'élection, la presse états-unienne en convient : elle a « perdu » face au candidat des républicains, comme l'écrit le journaliste Kyle Paoletta dans la Columbia Journalism Review, victime de sa stratégie d'étouffement, de dénigrement et de contournement.
Trump a en effet gagné, non pas malgré sa haine des journalistes, mais parce qu'il l'a si bien mise en scène qu'ils sont devenus, aux yeux de ses électeurs et électrices, ces « salauds de corrompus » qu'il dénonçait.
Nous pataugeons dans les égouts de l'information.
– Carole Cadwalladr, journaliste à « The Observer »
Il les a essorés en saturant la campagne de mensonges, fake news et autres saillies clownesques, les obligeant à un fact-checking incessant. Il les a insultés et les a menacés de s'en prendre à leurs sources, de surveiller leurs mails et leurs téléphones, voire de les emprisonner, de les empêcher de couvrir les manifestations, de leur interdire l'accès à la Maison-Blanche, de privatiser les chaînes de radio et de télé publiques, et de retirer les autorisations d'émettre aux médias qui lui déplaisent.
Il les a dédaignés en s'adressant aux influenceurs acquis à sa cause, capables de diffuser ses messages à de gigantesques audiences. Il leur a préféré les réseaux sociaux, dont il savait pouvoir manipuler les algorithmes. « You are the media now », a d'ailleurs tweeté Elon Musk, patron du réseau social X, le jour de sa victoire, pour marquer le début d'une nouvelle ère.
« Notre défi est de nous rendre compte que nous pataugeons dans les égouts de l'information. Trump est un bacille mais le problème ce sont les tuyaux. Nous pouvons et devons résoudre ce problème », a réagi Carole Cadwalladr, journaliste à The Observer.
Si, aujourd'hui, seule compte la capacité de la presse américaine à se préparer aux attaques à venir, une réflexion critique sur ses erreurs n'est pas inutile pour aider à penser la suite.
Pourquoi n'a-t-elle pas vu que les chiffres flatteurs de la croissance, tels que les égrenait la candidate démocrate Kamala Harris en défense du bilan de Joe Biden, cachaient une difficulté grandissante des États-Unien·nes à tenir les deux bouts face à l'inflation ? Comment, après la gestion calamiteuse du covid, a-t-elle pu négliger le décrochage de pans entiers de la population à l'égard des élites ?
A-t-elle sous-estimé l'impact de l'implication dans la campagne de géants de la tech capables, à coups de millions de dollars, de reconfigurer, au service de leur candidat, l'espace public médiatique et la formation des opinions politiques ? Pourtant traditionnellement moins révérencieuse qu'en France à l'égard des institutions, la presse états-unienne a-t-elle pu, au nom de la « neutralité » et de « l'objectivité », être aveuglée par des positions centristes favorables aux élites ?
Ce qui est certain, c'est qu'elle n'a pas su, non pas faire gagner Kamala Harris, mais empêcher qu'un autocrate patenté, raciste, misogyne, homophobe et climato-sceptique remporte à la fois le vote des grands électeurs et le vote populaire. Elle n'a pas su convaincre l'opinion des dangers que ce réactionnaire fascisant fait peser sur la démocratie états-unienne et l'ensemble du monde.
Alors que l'extrême droite prospère en Europe, cette défaite des valeurs progressistes – de l'égalité à la justice sociale, en passant par la solidarité, la probité et la sobriété écologique – doit être considérée comme un test grandeur nature de ce côté-ci de l'Atlantique.
Des faits et de l'impact
Elle nous oblige tous et toutes, en tant que journalistes, à interroger notre rôle social en revenant à l'essence même de notre métier. Dans un discours prononcé en 1907, le magnat de la presse Joseph Pulitzer, pas vraiment un extrémiste, déclarait à propos de son journal qu'il « combattra[it] toujours pour le progrès et les réformes, ne tolérera[it] jamais l'injustice ou la corruption ; il n'appartiendra[it] à aucun parti, s'opposera[it] aux classes privilégiées et aux exploiteurs du peuple, ne manquera[it] jamais de sympathie pour les pauvres, demeurera[it] toujours dévoué au bien public, maintiendra[it] radicalement son indépendance ».
Contre le poison des fausses nouvelles et des préjugés, aussi payant soit-il électoralement et sans doute médiatiquement, nous ne devons jamais renoncer à notre éthique journalistique en publiant toujours des informations basées sur des faits recoupés, vérifiés et documentés.
Nos informations, à la différence des commentaires engorgeant les réseaux sociaux, peuvent changer le cours de l'Histoire.
« La liberté d'opinion est une farce si l'information sur les faits n'est pas garantie et si ce ne sont pas les faits eux-mêmes qui font l'objet du débat », écrivait Hannah Arendt en 1967, dans Vérité et politique. Notre travail journalistique, fondé sur la rigueur et l'honnêteté, est la garantie du lien de confiance avec nos lecteurs et nos lectrices.
À nous, en publiant des informations exclusives ayant de l'impact sur la vie des gens, d'apporter la preuve de notre utilité, article après article, révélation après révélation. Nos informations, à la différence des commentaires engorgeant les réseaux sociaux, peuvent changer le cours de l'Histoire ; elles peuvent aussi aider à lutter contre la confusion, telle qu'elle est propagée par les influenceurs, en donnant du sens au monde tel qu'il est.
Contre le risque de déconnexion qui guette les rédactions, il est nécessaire de rappeler haut et fort que la mission d'intérêt public des journalistes est de rendre aux citoyens et aux citoyennes ce qui leur revient en droit dans un régime démocratique : des informations sur les gouvernant·es qui prennent des décisions en leur nom.
Du côté de la société
À Mediapart, depuis nos débuts, nous nous engageons à placer les puissances économiques et politiques face à leurs responsabilités et assumons d'être là pour leur demander des comptes. La totale indépendance de notre modèle économique nous le permet, puisque, comme l'affirme notre slogan, « seuls nos lecteurs et nos lectrices peuvent nous acheter ».
Pour le dire autrement : nous ne représentons pas les intérêts de quelques-uns mais de l'ensemble des citoyens et citoyennes, dans toute leur diversité. À la différence des journaux mainstream qui revendiquent une « objectivité » journalistique sans voir qu'ils relayent la vision d'une certaine bourgeoisie, nous réfutons l'idée d'une quelconque neutralité, qui n'est jamais qu'un équilibre trompeur entre des positions situées, et préférons rappeler d'où nous parlons : nous sommes fondamentalement du côté de la société.
C'est pour cela que nous donnons la priorité, dans notre couverture éditoriale, aux difficultés rencontrées quotidiennement par nos concitoyen·nes : par nos reportages, nous racontons, au jour le jour, la hausse des prix des produits de première nécessité, la crise du logement et le délitement des services publics, et, par nos analyses, nous nous efforçons d'expliquer les mécanismes structurels creusant les inégalités.
Contre l'entre-soi, notre responsabilité est de nous rendre accessibles à toutes et tous, quelles que soient les origines sociales et géographiques de nos lecteurs et nos lectrices. Les résultats des élections états-uniennes montrent non seulement que les diplômes et le lieu de résidence (ville/campagne) restent déterminants dans le vote, mais aussi que chaque électorat est enfermé dans sa bulle.
À nous d'en tirer les conclusions et de faire en sorte de nous rendre lisibles et compréhensibles par tout le monde. À Mediapart, notre ambition est de nous adresser au plus grand nombre sans jamais laisser un pan du lectorat au bord du chemin. Soyons pédagogique et adressons-nous franchement à notre public, sans complaisance, mais sans mépris.
C'est dans l'adversité que l'utilité politique et sociale des journalistes prend tout son sens.
Cela ne doit pas nous empêcher de défendre les valeurs émancipatrices qui sont les nôtres, bien au contraire. Dans un moment où les régimes autoritaires remportent des batailles, il est de notre devoir de ne pas banaliser leurs pratiques et de dénoncer les risques qu'ils font peser sur la vie de la cité. C'est le constat que dresse aujourd'hui le New York Times, qui s'est vu reprocher par une partie de son lectorat de minimiser la menace, comme le rapporte Max Tani dans le journal en ligne Semafor.
Il est aussi de notre responsabilité de comprendre cet électorat attiré par l'extrême droite. À nous, via nos reportages, de l'interroger pour mieux appréhender ses motivations, tout en donnant à voir, par nos investigations, le vrai visage des partis vers lesquels il se tourne.
Après l'élection de Trump, la rédactrice en cheffe du quotidien britannique The Guardian, Katharine Viner, pose ainsi les enjeux : « Nous maintiendrons la distinction importante entre faits et opinions. Nous chercherons à analyser et à expliquer. Nous rassemblerons les fils conducteurs qui rendent cette élection si importante pour la planète. Nous demanderons des comptes avec énergie et force à Trump et à ses collaborateurs. Et, aussi difficile que cela puisse paraître cette semaine, nous essaierons de comprendre la vie et les réalités économiques de celles et ceux qui, nombreux, ont voté pour [Trump], sans jamais trouver d'excuses pour le racisme et la misogynie déclenchés par les élections. »
À l'image du Guardian, Mediapart a décidé de faire de la diversité de son équipe une priorité : nous avons encore du chemin à parcourir, mais nous sommes convaincu·es qu'améliorer notre accessibilité suppose que nous reflétions la société dans toutes ses composantes. Recruter des profils variés est une nécessité, chacun·e apportant des expériences, des préoccupations et des sources complémentaires les unes des autres.
La bataille du droit de savoir, enfin, ne pourra pas être gagnée sans une prise de conscience collective du secteur des médias. Lutter contre la concentration des journaux dans les mains de quelques milliardaires soucieux de défendre leurs intérêts, réguler les réseaux sociaux utilisés comme des armes de déstabilisation et empêcher les Gafam d'appauvrir la presse en pillant ses informations : tels sont quelques-uns des enjeux à relever.
Ils sont immenses, mais nous ne pouvons pas nous permettre de baisser les bras : c'est dans l'adversité que l'utilité politique et sociale des journalistes prend tout son sens. C'est dans des périodes comme celle que nous traversons, de guerres, de crise du capitalisme et de déclin des démocraties, que nous mesurons l'importance de notre fonction de contre-pouvoir. Nous sommes plus que jamais requis pour informer honnêtement nos lectrices et nos lecteurs. Nous savons comment le faire, au service des citoyennes et des citoyens : ils peuvent compter sur nous, comme nous comptons sur eux.
Carine Fouteau
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
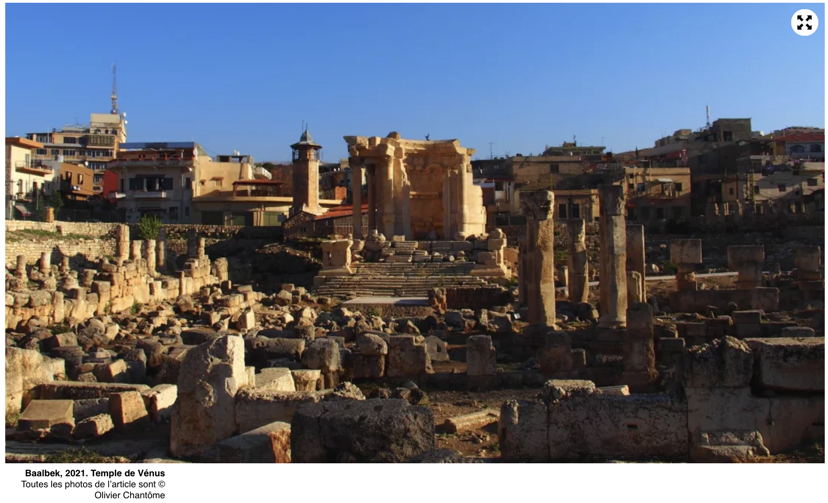
Liban. Villages rasés et patrimoine menacé par Israël
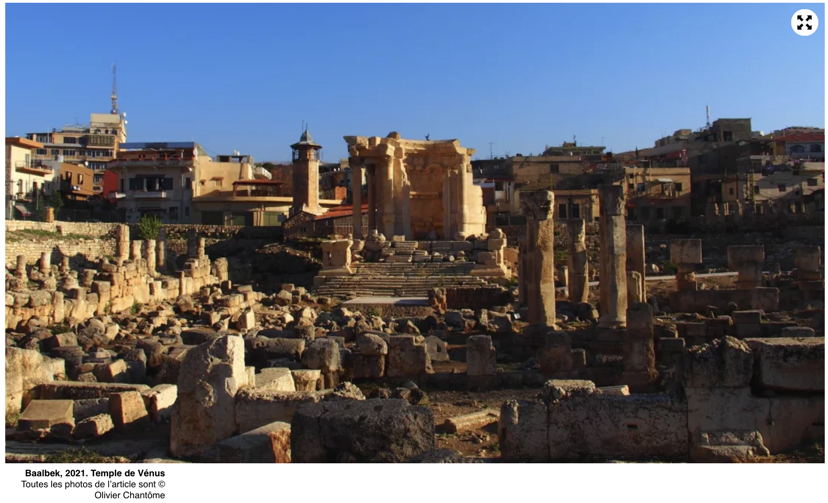
La destruction d'une partie du patrimoine libanais suite aux bombardements israéliens intensifs mettent en alerte différents acteurs politiques et associatifs du pays.
Tiré d'Orient XXI.
Lundi 18 novembre 2024, le comité spécial de l'Unesco (l'agence des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture) chargé de la protection des biens culturels en cas de conflit armé s'est réuni en urgence à la demande de Beyrouth pour décider de placer 34 sites du patrimoine libanais sous « protection renforcée ». Une initiative bienvenue, mais qui laisse encore sceptique beaucoup d'acteurs de la société civile et d'archéologues.
« Tout dépend de l'ampleur que va prendre cette décision et de ses mécanismes d'application », relativise Charles Al-Hayek, chercheur en histoire basé à Beyrouth. Ce dernier a créé en 2020 la page Heritage and roots (Héritage et racines) sur les réseaux sociaux ainsi qu'une chaine Youtube pour parler d'histoire libanaise et de patrimoine (architectural, gastronomique, etc.). Depuis le début des bombardements israéliens, il tente de relayer les appels à l'aide pour protéger plusieurs sites archéologiques.
La décision de l'Unesco de mettre sous protection renforcée 34 sites se base sur la convention de la Haye de 1954 pour la protection du patrimoine en cas de conflit, notamment avec la création « au sein des forces armées des unités spéciales chargées de la protection des biens culturels ». La prise pour cible de sites protégés par l'Unesco peut constituer un crime de guerre selon la Cour pénale internationale. Le critère pour choisir les lieux à protéger est fait en fonction de « leur plus haute valeur pour l'humanité », explique sur France culture le chercheur au CNRS Vincent Negri, et auteur du livre Le patrimoine culturel, cible des conflits armés. Il estime que la décision de l'Unesco doit surtout envoyer un « signal fort » aux forces armées israéliennes dans un premier temps.

Des palis, et des oliviers centenaires
Plus de 300 universitaires et professionnels du monde de la culture avaient aussi signé une pétition le 17 novembre 2024 pour demander à garantir la protection du patrimoine libanais. Une centaine de députés libanais avaient aussi alerté début novembre sur les destructions, et réclamé à l'Unesco de protéger les sites. « Ce qui est sûr, c'est qu'au moins une trentaine de villages ont été détruits » dans le Sud Liban, rappelle Charles Al-Hayek.

En plus des trois sites libanais — Tyr, Baalbek et Anjar — classés au patrimoine mondial et directement menacés, le sud du pays, bombardé depuis le 8 octobre 2023, compte pléthore de villages avec des églises, des mosquées et des souks datant de la période des croisades et ottomane.
Depuis le début des bombardements israéliens, plus de 3 480 personnes ont été tuées et plus de 880 000 ont été déplacées à l'intérieur du pays, selon les chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Face au drame humain, le patrimoine tangible et intangible est souvent mis de côté, « mais il ne doit pas être oublié, car pour les Libanais, c'est une partie de leur identité », explique Sarkis Khoury, directeur général des Antiquités au sein du ministère de la culture libanais. Il a été chargé avec son département d'élaborer la liste des sites menacés, soumise ensuite à l'Unesco. On y trouve notamment les forteresses de Tebnine et Beaufort (XIIe et XIIIe siècles), le palais Beiteddine (XIXe siècle) et le musée national de Beyrouth, en plus de sites déjà classés au patrimoine mondial de l'UNESCO.
« Pour l'instant, nous documentons et recensons les destructions et les dommages. Ce sera ensuite au gouvernement libanais de décider s'il dépose plainte auprès de la Cour pénale internationale », explique Mostafa Adib, ambassadeur du Liban à l'Unesco et à Berlin.
Sarkis Khoury ajoute :
Nous recevons beaucoup d'informations alarmantes du terrain de la part des gardiens des sites et de nos agents sur place. Lorsque vous détruisez un village, ce sont aussi les oliviers centenaires, les vignes ancestrales, les anciens pressoirs qui disparaissent, cela aussi fait partie du patrimoine libanais.
Tout en alertant sur ce risque de « déracinement identitaire », il rappelle que le patrimoine libanais s'est souvent construit sur la « stratification de chaque civilisation sur l'autre », « et là on se retrouve face à une destruction totale, comme si notre histoire n'existait plus ».
Résister aux séismes, mais pas à l'artillerie israélienne
Autre difficulté, l'impossibilité de réaliser une réelle évaluation de l'ampleur des dégâts, plusieurs sites se trouvant dans des zones sinistrées et inaccessibles. « Normalement on doit pouvoir faire voler des drones et envoyer des experts pour ce genre d'évaluation, tout est compliqué actuellement », confirme Sarkis Khoury. Outre les sites classés et le marché couvert de Nabatiyé (début XXe) détruit mi-octobre par l'aviation israélienne, les historiens et archéologues craignent aussi pour les sites archéologiques romains de Tyr et de Baalbek. Celui-ci a été ébranlé par les tirs de roquettes lancées depuis le 6 novembre 2024 à 500 mètres de son emplacement. Selon l'ambassadeur du Liban à l'Unesco, Mostafa Adib, un mur à proximité de la citadelle de Baalbek a été touché et un bâtiment de l'époque ottomane (années 1920) a été entièrement détruit.

« Ces sites ont été construits par des Romains pour faire face à des tremblements de terre et autres, ils ont survécu aux aléas du temps, mais ils ne sont pas conçus pour faire face à l'équipement militaire israélien », s'inquiète Charles Al-Hayek. Le château de Chamaa (XIIe siècle) à une centaine de kilomètres de Beyrouth, qui fait l'objet d'une restauration avec un soutien italien depuis 2021, a été provisoirement occupé par l'armée israélienne mi-novembre : « Pour l'instant, nous ne savons pas si le site a été endommagé ou pas », précise Charles Al-Hayek. La forteresse de Beaufort, qui a déjà servi de base militaire à l'armée israélienne pendant dix-huit ans lors de l'occupation du Liban-Sud (1982-2000), est de nouveau menacée. La mosquée ottomane de Kfar Tebnit (fin XIXe) à proximité de Nabatiyé a été également détruite. L'unique site datant de l'époque omeyyade (VIe – VIIe siècles), situé à Anjar dans la vallée de la Bekaa, est aussi en danger selon l'ambassadeur du Liban à l'Unesco Mostafa Adib.

Maroun Khreich, maître de conférences en histoire, langues anciennes et patrimoine à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth rappelle :
Il y a aussi des sites méconnus comme ceux de Qatmoun à Rmeich (déjà bombardé en 2006 par Israël), le centre du village Alma dont l'architecture vernaculaire est centenaire, le marché couvert de Bint Jbeil, les sites de la région de Wadi-Zebqin et Rob El Tatlin qui ont été détruits.
Il estime que la décision de l'Unesco est importante mais tardive. Icomos, une ONG qui se consacre à la protection et la conservation des sites patrimoniaux, avait lancé l'alerte depuis le 17 octobre sur le sort des sites archéologiques au Liban. « Malheureusement il y a eu un silence assourdissant sur les événements, aussi bien au niveau des pertes humaines que sur le patrimoine », déplore l'universitaire.
Alors que l'attente d'un cessez-le-feu est toujours au cœur des discussions politiques et diplomatiques, Charles Al-Hayek pense déjà à l'après :
Nous avons besoin de ne pas oublier notre patrimoine, car c'est ce qui motivera ensuite la reconstruction et le lien social face à ce nouveau traumatisme. Préserver l'histoire de ces sites et la publier a une double fonction : rappeler que nous faisons partie de l'histoire mondiale, car beaucoup semblent l'oublier, et aider aussi les communautés sinistrées qui auront besoin de ce travail mémoriel pour tisser un lien social lors de la reconstruction.
Malgré cette détermination, d'autres problèmes ont été soulevés par les chercheurs. Le risque de pillage de certains sites dans les zones sinistrées comme c'est souvent le cas lorsque le patrimoine se retrouve au centre des conflits armés.
La question de la mise à l'abri des collections dans le cas du musée de Beyrouth ou celui de Sursock (musée d'art moderne qui porte le nom de son fondateur Nicolas Ibrahim Sursock) a été aussi soulevée. Ces problématiques ont des airs de déjà-vu pour le Liban, bien que le contexte soit radicalement différent. Pendant la guerre civile de 1975 à 1990, les œuvres du Musée national de Beyrouth avaient été, dans les années 1980, déplacées au sous-sol et emmurées, pour être protégées. Des coffres en béton armé avaient été disposés autour des œuvres les plus imposantes afin de les protéger. Des archéologues avaient également enfoui des vestiges retrouvés à Tyr et près de 600 pièces issues des fouilles avaient été transportées du dépôt de Tyr à celui Byblos. Aujourd'hui, les bombardements massifs israéliens et l'artillerie lourde utilisée génère des dégâts beaucoup difficiles à évaluer ou anticiper. Mostafa Adib précise toutefois que la décision de protéger les 34 sites libanais a été accompagnée du déblocage d'un fond d'urgence de 80 000 dollars (76 360 euros) « dont une partie pourrait être utilisée pour déplacer et protéger certaines œuvres, mais seulement dans les sites auxquels nous pouvons accéder actuellement », précise-t-il.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Analyse du virage à gauche au Sri Lanka avec Ahilan Kadirgamar et Balasingham Skanthakumar

Les élections parlementaires sri-lankaises ont donné un mandat massif au National People's Power (NPP). Ils ont remporté 159 sièges sur 225, soit plus d'une majorité des deux tiers. Des citoyens de toute l'île ont voté pour le NPP. Ceci est particulièrement significatif dans un pays marqué par les divisions ethniques, où les habitants du nord et de l'est n'avaient jusqu'alors jamais fait confiance aux partis nationaux.
Tiré d'Europe solidaire sans frontière.
Pour analyser ces développements, The Wire a invité Ahilan Kadirgamar, maître de conférences en sociologie à l'Université de Jaffna, observateur de longue date de la politique sri-lankaise qui vit à Jaffna depuis la fin de l'insurrection des Tigres tamouls, et Balasingham Skanthakumar, co-rédacteur en chef du magazine Polity du Sri Lanka, qui vit à Colombo et suit de près l'évolution du pays.
Amit Baruah
Bonjour et bienvenue à ce direct YouTube de The Wire. Nous allons discuter des résultats parlementaires des élections sri-lankaises, qui ont donné un mandat massif au NPP. Deux mois seulement après l'élection d'Anura Kumara Dissanayake à la présidence, le soutien au NPP a été considérable. En incluant les sièges de la liste nationale, ils ont remporté 159 sièges sur 225, soit plus d'une majorité des deux tiers. Des citoyens de toute l'île, y compris du nord et de l'est, ont voté pour le NPP. Ceci est particulièrement significatif dans un pays marqué par les divisions ethniques, où les habitants du nord et de l'est n'avaient auparavant jamais fait confiance aux partis nationaux. Cela représente un changement majeur dans la politique sri-lankaise. Lors d'un rassemblement le 10 novembre à Jaffna, M. Dissanayake a reconnu qu'ils n'en avaient pas fait assez pour gagner les électeurs tamouls. Tout cela a changé, et les gens attendent maintenant de voir ce que le nouveau gouvernement peut faire pour les citoyens de toute l'île - au nord, à l'est, au sud et à l'ouest.
Pour analyser les résultats, nous accueillons Ahilan Kadirgamar, maître de conférences en sociologie à l'Université de Jaffna, observateur de longue date de la politique sri-lankaise qui vit à Jaffna depuis la fin de l'insurrection des Tigres tamouls, et Balasingham Skanthakumar, co-rédacteur en chef du magazine Polity, qui vit à Colombo et suit de près l'évolution du pays.
Amit Baruah
Je me tourne d'abord vers vous, Ahilan, puisque vous êtes à Jaffna, et les résultats de là-bas sont assez surprenants, même pour ceux qui pensaient que le NPP réussirait bien. Expliquez à nos téléspectateurs ce que signifie ce mandat.
Ahilan Kadirgamar
C'est une victoire historique - la première fois qu'un parti national remporte une victoire aussi écrasante dans le nord du Sri Lanka. Ils ont gagné les deux circonscriptions de la province du nord, montrant clairement un mandat pour la réconciliation et la résolution des griefs de longue date de la communauté tamoule. Le peuple a placé une confiance significative dans le NPP. Lors de sa visite à Jaffna, le Président a spécifiquement promis de régler la question des terres saisies par l'armée et divers services gouvernementaux comme l'archéologie et les forêts. La première priorité serait de tenir cette promesse et de libérer des quantités substantielles de terres. Mais il y a beaucoup d'autres questions en suspens depuis la fin de la guerre que le Président et son parti doivent aborder, y compris une solution politique. Il y a eu un vaste débat au Sri Lanka, avant et après l'accord indo-lankais, sur de nouvelles formes de décentralisation et de partage du pouvoir. La question est maintenant de savoir si le NPP, avec leur majorité des deux tiers nécessaire pour des changements constitutionnels majeurs, aura la volonté politique d'aller dans cette direction.
Amit Baruah
Ahilan, avant de me tourner vers Kumar, je voulais vous demander - avez-vous vu cela comme une vague, étant donné le peu de votes qu'Anura Kumara Dissanayake a reçus dans les zones tamoules lors des élections présidentielles ? S'agit-il d'un vote tactique des habitants du nord et de l'est, ou de quelque chose de plus ?
Ahilan Kadirgamar
Pendant 15 ans après la fin de la guerre, la politique nationaliste tamoule a dominé le Nord. Les LTTE ont créé l'Alliance nationale tamoule comme coalition, et après leur défaite, ils ont continué mais n'étaient pas organiquement liés au peuple. C'étaient des individus qui perpétuaient l'héritage et les slogans des LTTE, avec un soutien considérable de la diaspora. Ils se positionnaient comme intermédiaires avec la communauté internationale, y compris Delhi. Avant ou après chaque élection, ils allaient à New Delhi chercher des bénédictions, affirmant que cela aboutirait à un règlement politique. Cela a continué pendant un certain temps, mais il y a eu un changement significatif après l'élection présidentielle. Pour cette élection, beaucoup de ces mêmes acteurs ont présenté un candidat commun, sachant qu'il ne gagnerait pas, mais comme moyen de démontrer l'unité tamoule et d'en appeler à la communauté internationale. Cependant, deux choses se sont produites par la suite : comme dans le reste du pays, il y a eu une vague pour le changement politique, et les partis politiques tamouls se sont fragmentés. Les gens ont estimé que ces partis ne servaient que leurs intérêts personnels en cherchant des sièges parlementaires. La prolifération des partis politiques, leur incapacité à s'unir, tout cela a contribué à leur défaite massive. C'était à la fois un vote anti-sortants et une vague vers le NPP.
Amit Baruah
Kumar, je veux vous interroger sur ce mandat massif. Bien que la participation ait été légèrement inférieure aux élections présidentielles, le vote NPP a considérablement augmenté. De votre perspective à Colombo, que représente cela ? Est-ce une rupture avec les élections passées, un rejet de la classe politique traditionnelle du Sri Lanka ?
Balasingham Skanthakumar
Tout cela et plus encore. L'électorat a envoyé un message très clair. Ce sentiment se construisait depuis 2021-2022, mais nous n'avons pas eu l'occasion d'exercer notre droit de vote jusqu'à cette année. Même à l'époque, il y avait une énorme répulsion dans tout le Sri Lanka, à travers les classes sociales, les ethnies, les régions et les religions, dirigée contre les politiciens. Pendant longtemps dans ce pays, comme dans de nombreuses parties du monde, les gens pensaient que les politiciens professionnels existaient pour se servir eux-mêmes. Mais il a fallu cette crise - cette crise économique et sociale - et l'émergence du NPP, considéré comme non entaché par la politique, pour que le public rejette finalement les politiciens traditionnels. Les gens ont toujours su que les politiciens avaient les deux mains dans la caisse et s'aidaient eux-mêmes avec les ressources publiques. Ils voyaient la corruption morale, mais ils avaient besoin de quelque chose pour quoi voter, même s'ils n'étaient pas tout à fait sûrs de ce que c'était. C'est absolument sans précédent. Vous avez utilisé le terme « tsunami » ce matin, et je l'avais utilisé indépendamment pour décrire ce résultat. Il y a quelques semaines, après l'élection présidentielle, nous l'avons appelé un tremblement de terre. Du tremblement de terre au tsunami - cela traduit à quel point ces développements ont été dramatiques pour le système politique du Sri Lanka, envoyant un message à travers la région et au-delà.
Amit Baruah
Kumar, vous avez beaucoup écrit sur la crise économique et noté la hausse des niveaux de pauvreté au Sri Lanka. Diriez-vous que le NPP a construit son soutien sur les pressions économiques - les mesures d'austérité, les temps difficiles, les files d'attente pour le carburant et les bouteilles de gaz, la hausse des prix, les pénuries de nourriture et de médicaments ?
Balasingham Skanthakumar
Je n'en suis pas encore tout à fait sûr. Ces questions de classe n'ont pas nécessairement conduit à des réactions similaires à travers l'île. Oui, il y a une convergence dans la façon dont les réformes d'austérité ont impacté les gens, mais même pendant le COVID-19 et la crise économique, beaucoup dans le nord et l'est ont dit qu'ils ne le ressentaient pas de la même manière, ayant vécu pendant des décennies sans nécessités. Autant j'aimerais dire que c'est un sentiment purement basé sur la classe, c'est encore trop amorphe pour l'attribuer à un seul facteur. Ce qui est commun, comme nous l'avons entendu d'Ahilan, c'est vraiment un rejet de la politique comme d'habitude. C'est un cri du peuple pour un changement dans le système politique. Mais cela ne signifie pas que le nord et le sud, l'est et l'ouest, ont tous les mêmes attentes.
Amit Baruah
Ahilan, quel est votre sentiment depuis Jaffna ? Est-ce la fin de la classe politique qui a longtemps gouverné votre pays ? L'élite de Colombo est-elle menacée, n'étant plus capable de diriger la politique comme elle l'a fait ces 70-75 dernières années ? Et le NPP est-il vraiment un outsider de la politique sri-lankaise ?
Ahilan Kadirgamar
Je dirais que c'est une perturbation majeure dans la façon dont le pays a été gouverné. Ce n'est pas quelque chose que l'élite attendait, et même les gens ordinaires ne pouvaient pas imaginer ce genre de changement. Une fois qu'une telle perturbation se produit, il devient très difficile de reconstruire rapidement une autre coalition d'élite, même cinq ans plus tard. C'est un moment crucial pour la direction du pays. Le NPP a reçu un mandat énorme pour traiter de multiples questions. Dans le nord, il y a la militarisation, le chômage, et les jeunes qui sentent qu'ils n'ont pas d'avenir, les conduisant à quitter le pays. Les gens ont différentes explications - certains blâment la corruption pour l'état du pays, d'autres disent que c'est une mauvaise gouvernance ou de mauvaises politiques. Néanmoins, le NPP a ce mandat pour faire avancer le pays. Si le NPP ne réussit pas, je ne pense pas que nous reviendrons aux affaires comme d'habitude. Cela pourrait être bien pire. Un autre acteur devrait combler le vide, ce qui pourrait être très dangereux - peut-être l'émergence d'une tendance droitiste, populiste autoritaire, ou même fasciste. Donc c'est un moment très différent des nombreuses décennies passées. Je le comparerais à quand [J. R.] Jayewardene est arrivé au pouvoir à la fin des années 70. C'était similaire - le monde connaissait un ralentissement économique, le Sri Lanka faisait face à une grave crise économique dans les années 1970 sous le gouvernement de gauche du Front uni, qui ne pouvait pas gérer la crise. Jayewardene a remporté une victoire écrasante avec les cinq sixièmes du parlement sous le système uninominal à un tour. Maintenant sous la représentation proportionnelle, cette majorité des deux tiers est similaire à ce moment. Il a apporté des changements massifs vers la libéralisation - le Sri Lanka est devenu le premier pays à libéraliser son économie, il a introduit la Loi sur la prévention du terrorisme, et tout cela a contribué à la tragédie de la guerre civile. Le NPP est à un moment similaire maintenant - seront-ils capables de s'écarter de cette trajectoire néolibérale ? Parce que cela semble avoir atteint son impasse, sinon nous ne continuerions pas à faire face à des crises.
Amit Baruah
Désolé d'interrompre, mais quel est votre sentiment - personne ne s'attendait à cette énorme majorité. Même le Président a dit qu'il serait content avec juste une majorité il n'y a pas longtemps. Pensez-vous que ce nombre massif, qui permet au NPP de modifier la Constitution et de faire des changements législatifs majeurs, signifiera une pression supplémentaire sur le président et le gouvernement ?
Ahilan Kadirgamar
Oui, d'une certaine manière, mais même avant cette élection, je sentais que ce gouvernement pourrait avoir plus d'espace pour traiter les questions juridiques et constitutionnelles, même la question des minorités. Leur plus grand défi sera les questions économiques. Ce n'est pas purement domestique - nous avons fait défaut sur notre dette, nous devons rembourser les créanciers, et nous sommes dans un programme du FMI. Toutes les grandes puissances de la région - l'Inde, la Chine, les États-Unis - nous tiennent à la gorge en utilisant le FMI. S'ils continuent à presser le Sri Lanka, comme ils l'ont fait pour les régimes progressistes en Amérique latine, alors la question économique et comment la gérer devient un défi encore plus grand, étant donné que nous vivons dans cette économie très globalisée et néolibérale.
Amit Baruah
Kumar, je voulais vous interroger sur le mouvement à grande échelle hors du Sri Lanka - les gens cherchant des emplois et l'immigration permanente. Bien que travailler à l'étranger ne soit pas nouveau pour les Sri-Lankais ou les Sud-Asiatiques en général, beaucoup de professionnels qui partent ont tendance à revenir. Les files d'attente pour les passeports à Colombo montrent que l'émigration est une préoccupation majeure. Si ce gouvernement crée des opportunités, en particulier des emplois, au Sri Lanka, cela pourrait-il endiguer le flux de personnes qui partent ?
Balasingham Skanthakumar
Bien que beaucoup de gens, y compris les partisans du gouvernement, aimeraient voir ce scénario, je serais plus prudent. Premièrement, les gens ont besoin d'un soulagement économique maintenant - ils ne peuvent pas attendre des mois ou des années pour que les programmes et politiques de développement génèrent des emplois et des revenus. Il y a toujours un sentiment de pessimisme sur la situation globale. Je ne spéculerais pas que le changement politique seul réduira le nombre de personnes cherchant du travail à l'étranger. Cependant, nous pourrions voir des changements en raison de la situation mondiale morose. De nombreux pays occidentaux, destinations traditionnelles pour l'immigration permanente, ferment leurs portes plus étroitement en raison de leurs propres problèmes économiques et de la montée des sentiments d'extrême droite anti-immigrants. Quant aux pays du Moyen-Orient et aux destinations non traditionnelles comme la Corée du Sud et la Malaisie, où vont de nombreux travailleurs sri-lankais moins qualifiés, ces économies sont impactées par les développements dans le Nord global. Nous pourrions voir une demande réduite de main-d'œuvre bon marché en provenance de pays comme le Sri Lanka. Mais alors quelles sont les alternatives ? Le fait que tant de personnes aient pu partir signifie que nos envois de fonds, notre plus grande source de devises étrangères, sont restés élevés en 2023 et cette année. Ces envois de fonds, générés en grande partie par les femmes, maintiennent notre économie et nos ménages à flot. Je ne pense pas qu'il y ait un substitut immédiat facile au Sri Lanka, même si le NPP réalise rapidement ses plans économiques. Tout gouvernement éclairé devrait travailler à supprimer les raisons de la migration de détresse tout en respectant la liberté de mouvement et les choix des gens. La migration de détresse que nous avons vue est absolument inacceptable, et il était tragique que le gouvernement précédent soit indifférent, semblant vouloir augmenter le nombre de personnes partant à l'étranger pour augmenter les envois de fonds. Ce cynisme et cette insensibilité sont aussi ce que les électeurs sri-lankais ont rejeté dans leur verdict pour la coalition Dissanayake.
Amit Baruah
Ahilan, vous avez mentionné la crise de la dette sri-lankaise et les obligations de remboursement à venir. Pour un observateur extérieur, le NPP semble lié au JVP, qui est associé à deux insurrections en '71 et '87-89. Pourriez-vous expliquer quelle approche économique le NPP est susceptible d'adopter, et quelles implications cela a pour les relations du Sri Lanka avec l'Inde, la Chine, les États-Unis et l'Occident ?
Ahilan Kadirgamar
Le NPP n'a pas été très explicite sur leur programme économique. Ils se sont concentrés sur l'accession au pouvoir, ont eu une bonne stratégie électorale, ont attendu le bon moment, et ont mobilisé les classes moyennes. Ils ont été assez silencieux sur les questions comme la redistribution. Concernant l'économie plus large, alors qu'avant l'élection présidentielle ils parlaient de renégocier le programme du FMI et de créer une nouvelle analyse de viabilité de la dette pour les négociations avec les créanciers, il y a eu une pression énorme de l'Occident et du FMI après les élections présidentielles. Ils semblent avoir accepté, pour l'instant, de rester avec le programme du FMI, ce qui limite leur capacité à fournir le soulagement immédiat dont les gens ont besoin. Ils ont dit qu'ils soutiennent une économie de production et ne procéderont pas à la privatisation, mais n'ont pas pris de positions politiques explicites sur le modèle axé sur l'exportation ou les questions plus larges de libéralisation. Cela reste à voir. Beaucoup d'entre nous attendent - je pense qu'ils attendaient aussi de voir s'ils obtiendraient une majorité parlementaire. Maintenant, ils doivent commencer à gouverner, faisant face aux compromis entre le remboursement des créanciers et l'aide publique. La question est jusqu'où ils défieront les puissants acteurs externes comme l'Inde, la Chine et les États-Unis, étant donné la faible position de négociation du Sri Lanka après avoir fait défaut sur sa dette. Le prochain choc externe pourrait aggraver la crise.
Amit Baruah
Qu'en est-il de leur approche de l'investissement étranger ? Il y a des inquiétudes dans la communauté des affaires concernant le mot « marxiste ». De nombreux pays et partis se prétendent marxistes mais ont des politiques favorables aux entreprises et sont ouverts aux changements économiques. Le JVP ou le NPP seraient-ils similaires ?
Ahilan Kadirgamar
Oui, je caractériserais le NPP maintenant comme un parti de centre-gauche. Et ils ont été très ouverts à ce sujet, qu'ils accueillent l'investissement étranger, que leurs politiques seront orientées vers l'obtention d'investissements étrangers. Maintenant, la vraie question est le type d'investissement étranger qui arrive au Sri Lanka, n'est-ce pas ? Ce que nous avons vu ces dernières années, je veux dire, l'IDE a été inférieur à un milliard de dollars américains, et même dans ce milliard de dollars américains, environ 70% sont des investissements spéculatifs dans l'immobilier. Ce n'est pas le type d'IDE que nous connaissions autrefois qui mène à la production et à l'emploi et ainsi de suite. C'est de l'investissement spéculatif. Et maintenant avec la crise économique, que voyons-nous ? Nous voyons une saisie stratégique d'actifs. Vous savez, des actifs stratégiques au Sri Lanka. Donc, que ce soit des ports, des centrales électriques, des acteurs comme Adani qui s'implantent au Sri Lanka, Sinopec, la Corporation pétrolière chinoise qui essaie de construire de grandes raffineries. Donc, ce sont les types d'investissements qui arrivent au Sri Lanka en ce moment, il y a de grandes questions quant à savoir s'ils sont réellement souhaitables, étant donné les intérêts à long terme du Sri Lanka, s'ils éloigneraient réellement le Sri Lanka d'une histoire où, vous savez, malgré être un pays à faible revenu pendant longtemps, nous avons pu avoir des indicateurs de développement humain beaucoup plus élevés. Vous savez, nous avions 99% de notre population qui avait l'électricité — pour un pays d'Asie du Sud, vous pouvez voir à quel point c'est différent. Mais ces deux dernières années, avec la crise économique et le programme du FMI, 1,3 million de ménages ont été déconnectés du réseau électrique. C'est environ 20% de nos ménages. Donc, ce sont les réalités et si ces entreprises à but lucratif viennent et commencent à générer de l'électricité, si ce sont elles qui vont fournir le carburant, serait-ce disponible pour notre peuple travailleur dans cinq ans ? C'est la grande question devant nous.
Amit Baruah
Kumar, vous savez, avant que nous ne terminions notre discussion pour aujourd'hui, je voulais vous demander maintenant que cette majorité massive est en place. Il y a bien sûr des discussions sur l'abolition de la présidence exécutive, que cela arrive maintenant ou plus tard. C'est quelque chose que le NPP s'était engagé à faire. Il y a aussi des discussions sur l'écriture d'une nouvelle législation ou d'une nouvelle constitution. Donc la question qui me vient à l'esprit est celle des minorités, en particulier le peuple tamoul, qui a voté pour le NPP, dans un sens, vous savez, après une insurrection de 26 ans et un désir vieux de plusieurs décennies de, vous savez, plus de droits pour le peuple tamoul au Sri Lanka, le 13e amendement, dans un sens, est ce qui a été inscrit dans la Constitution, qui fait partie de la Constitution suite à l'accord indo-sri-lankais. Pensez-vous que tout changement au statut, vous savez, comment cela pourrait affecter le 13e amendement ? Pensez-vous que c'est quelque chose dont il faut s'inquiéter, ou est-ce quelque chose que la direction du NPP comprend, et l'importance de cela, et les préoccupations du peuple tamoul concernant de tels changements ?
Kumar
Je pense que le NPP comprend bien l'importance du 13e amendement pour l'État indien. Cela leur a été très clairement signifié, je pense, par les gouvernements indiens successifs et les secrétaires aux affaires étrangères. Je ne suis pas si sûr qu'il y ait le même attachement au 13e amendement au sein des polités tamoule et cinghalaise. Certes, certaines sections voient la valeur de la dévolution, la dévolution limitée, que le 13e amendement offrait. Et certainement, de nombreux politiciens accueillent favorablement la capacité d'avoir un grand nombre de sièges à disputer afin d'obtenir également certaines positions politiques. Et bien sûr, il y a une certaine dévolution en ce qui concerne les ressources financières. Ce qui fait une différence quand il s'agit de certaines choses comme les écoles ou les hôpitaux qui font partie du système des Conseils provinciaux. Mais Amit, ici, je dois vous rappeler que, comme vous le savez bien, quand il s'est agi de sa deuxième insurrection, le JVP, à la fin des années 80, a pris les armes contre le 13e amendement, contre l'accord indo-lankais, qui était à l'origine de ce qui est devenu le 13e amendement à la Constitution. Et depuis lors, le JVP, bien qu'il participe maintenant aux élections et ait été représenté dans les conseils provinciaux, a été assez prudent pour ne pas s'associer trop étroitement au 13e amendement. De même, dans la polité tamoule, Amit comme vous le savez bien que quand il s'est agi des divisions au sein du nationalisme militant tamoul, vous aviez une section qui a déposé les armes et a participé à ce processus ; et vous aviez une autre section, les LTTE [Tigres de libération de l'Eelam tamoul] qui ne l'a pas fait ; et c'était la perspective des LTTE sur les conseils provinciaux qui, je dirais, dans une large mesure, continue d'influencer les vues des partis politiques tamouls, ainsi que la polité tamoule en général, y compris les citoyens du nord, au moins ; quand il s'agit de leur attitude envers cela [les conseils provinciaux], ils le voient comme étant inadéquat, comme n'étant pas suffisant. Et jusqu'à présent, le NPP ne nous a donné aucune indication qu'il prend d'une manière ou d'une autre le 13e amendement comme point de départ. Je pense que c'est assez significatif que dans son manifeste, il n'y ait fait aucune référence. Au lieu de cela, il examine ces questions, ou réfléchit à ces questions à nouveau. Bien sûr, cela signifie qu'il devra y avoir certains apprentissages tirés de la façon dont le 13e amendement a fonctionné dans la pratique, il devra y avoir certains apprentissages sur ce que nous faisons en ce qui concerne la division des sujets et des fonctions et des pouvoirs entre le centre et les provinces. Il devra certainement y avoir des apprentissages en ce qui concerne la levée des impôts, des revenus, et ainsi de suite. Mais jusqu'à présent, et je pense que ce n'est probablement pas une mauvaise idée. Ce serait bien si nous ne commencions pas un exercice de rédaction de constitution, je pense, sur, vous savez, sur la base du 13e amendement. Au lieu de cela, nous avons déjà un projet assez élaboré qui a été développé pendant les premières années du régime dit de 'bonne gouvernance', en 2015, 2016, 2017, pendant cette période. Et donc ce n'est pas que nous devions repartir de zéro au Sri Lanka. Ce projet a été développé à travers un processus de consultation publique extensif, donc nous avons un projet de travail. Et je pense que ce dont nous avons besoin et ce qui nous manquait à cette période, et même dans les périodes précédentes, c'est un gouvernement qui va et se bat pour le partage du pouvoir, qui ne prend pas une approche mains libres ou une approche neutre, mais qui va réellement faire campagne et solliciter pour cela et explique aux gens dans chaque partie du pays, pas seulement dans le nord et l'est, mais aussi dans le sud, dans les hautes terres, à l'est et à l'ouest, comment, en rapprochant le pouvoir des gens, ils ont plus de contrôle sur leur vie. Ils ont plus de contrôle, leurs représentants leur sont plus redevables, et que donc c'est bon pour la démocratie.
Amit Baruah
Je crains que nous devions conclure rapidement, mais je voulais juste faire intervenir Ahilan pour une réponse rapide. Vous savez, Kumar fait ce point important de cet attachement au 13e amendement. Et je voudrais reformuler ma question d'une certaine manière. Et vous savez, vous demander une brève réponse est que l'approche basée sur les droits est peut-être plus importante qu'un amendement à la Constitution. Et si vous pensez qu'il y a de la confiance entre les communautés ethniques et ces parties prenantes qui sont impliquées dans la gouvernance du Sri Lanka, vous pensez qu'il pourrait y avoir plus d'opportunités pour le peuple tamoul ou les musulmans de, dans un sens, jouir de plus de droits dans le pays.
Ahilan Kadirgamar
Oui. Je veux dire, il y a aussi un débat au Sri Lanka sur, vous savez, assurer qu'il y a des droits économiques, sociaux et culturels inscrits dans notre Constitution et de manière justiciable. Mais je pense toujours que la question est le partage du pouvoir, n'est-ce pas ? Ce n'est pas seulement aussi une question de dévolution territoriale, qui est importante. Donc vous rapprochez le pouvoir des gens, mais les minorités sont aussi dispersées dans tout le pays. Donc pour leur donner la confiance qu'à l'avenir, notre État et le pouvoir d'État seraient partagés d'une manière qui ne fonctionne pas contre une communauté. Donc pour créer ce type de structure et donner cette confiance, et comme Kumar l'a mentionné, vous savez, le besoin d'une volonté politique, et c'est quand quelqu'un est au pouvoir qu'il peut le faire, plutôt que de dire, d'accord, voici une proposition, choisissez si vous voulez. Donc, c'est je pense, la chose importante. Je veux juste faire un dernier point Amit. Le Sri Lanka est à ce moment crucial, le peuple a parlé. Et ce que nous avons vu quand les choses au Sri Lanka se mettent en place, c'est que parfois des acteurs externes très puissants ont tendance à perturber ce qui se passe ici. Et je pense que cette fois, le Sri Lanka devrait avoir l'espace pour résoudre cela. Et je pense que c'est ce dont nous avons besoin en termes de solidarité internationale. Parce qu'avec un peu de chance, vous savez, avec ces quatre décennies et demie de néolibéralisme et ce que nous voyons à travers le monde, avec un peu de chance, le Sri Lanka peut devenir un exemple pour aller de l'avant, mais cet espace doit être donné pour que nous puissions avancer.
Amit Baruah
En tant qu'observateur extérieur, la seule chose que je voudrais ajouter est que je pense que c'est un grand moment d'espoir pour le Sri Lanka et les Sri-lankais. C'est une grande opportunité. Les gens veulent du changement. Ils veulent une vie meilleure. Je pense que le mandat est très clair. Le peuple a parlé, et tous les yeux seront tournés vers votre gouvernement pour voir comment ils tiennent leurs nombreuses promesses, s'ils sont capables de maintenir cet élan d'espoir qui a été généré parce qu'au final dans une démocratie, c'est la seule voie disponible, et on ne peut qu'espérer qu'un processus de consultation avec le peuple continuera, et toutes les crises auxquelles vous faites face, tant économiques, politiques que sociales, sont résolues, vous savez, conformément aux souhaits de tous les Sri-lankais, transcendant les barrières ethniques et religieuses. Merci beaucoup Ahilan de m'avoir rejoint, et merci beaucoup Kumar d'avoir consacré votre temps à cette analyse de ce qui se passe, ce qui s'est passé pendant les élections et ce qui est susceptible de se passer dans les semaines et mois à venir. Merci. Et c'est Amit Baruah qui vous quitte depuis Colombo, merci.
Ahilan Kadirgamar
Balasingham Skanthakumar
Amit Baruah
Traduction par Adam Novak
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

En Israël, le gouvernement Nétanyahou “tente de faire taire” le journal “Ha’Aretz”

Le cabinet israélien a approuvé un boycott éditorial et financier du principal journal d'opposition de l'État hébreu. Une “nouvelle étape vers le démantèlement de la démocratie israélienne”, réagit le journal, très hostile au Premier ministre.
Tiré de Courrier international. Légende de la photo : Une femme lisant l'édition anglophone du quotidien israélien "Ha'Aretz, à Jérusalem en 2013. Photo : Ahmed Gharabli/AFP.
Le gouvernement israélien a approuvé, le 24 novembre, une décision interdisant aux officiels et organismes liés au gouvernement d'avoir des contacts avec le quotidien Ha'Aretz et d'y placer des publicités.
Une tentative de “faire taire un journal critique et indépendant”, alerte Ha'Aretz, très hostile au Premier ministre Benyamin Nétanyahou et à son cabinet, considéré comme le plus à droite de l'histoire de l'État hébreu.
Le gouvernement justifie sa décision, actée en Conseil des ministres sur la base d'une proposition du ministre des Communications, Shlomo Karhi, par les “nombreux éditoriaux qui ont mis à mal la légitimité de l'État d'Israël et de son droit à la légitime défense”, explique l'exécutif.
“Combattants de la liberté”
Une réaction, surtout, à des propos tenus par l'éditeur de Ha'Aretz, Amos Schoken, qui, selon lui, “soutiennent le terrorisme et appellent à imposer des sanctions au gouvernement”. Lors d'une conférence à Londres, le 27 octobre, Schoken avait notamment déclaré que le gouvernement Nétanyahou se battait contre “les combattants de la liberté palestiniens, qu'Israël qualifie de terroristes”.
Ces propos avaient suscité un tollé, certains y voyant une légitimation du Hamas et des attaques du 7 octobre. De quoi pousser l'éditeur de Ha'Aretz à les clarifier en expliquant qu'il parlait des Palestiniens de Cisjordanie, et en affirmant que “le recours à la terreur n'est pas légitime. Quant au Hamas, il n'est pas un combattant de la liberté.”
Même après cette clarification, le journal a publié un éditorial, le 4 novembre, pour se distancier un peu de ces propos.
“‘Ha'Aretz' ne reculera pas”
Le journal a réagi à la décision du gouvernement Nétanyahou, non inscrite à l'ordre du jour et prise “sans aucun contrôle juridique”.
“La résolution opportuniste de boycotter Ha'Aretz […] marque une nouvelle étape dans le parcours de Nétanyahou vers le démantèlement de la démocratie israélienne. Comme ses amis Poutine, Erdogan et Orban, Nétanyahou essaie de faire taire un journal critique et indépendant.”

Et d'assurer : “Ha'Aretz ne reculera pas et ne se transformera pas en un tract gouvernemental publiant des messages approuvés par le gouvernement et son chef.”
Fondé en 1919, ce journal qui est le plus ancien quotidien israélien existant, est depuis longtemps dans le collimateur du gouvernement.
Ha'Aretz a publié de nombreuses enquêtes sur les abus de la guerre à Gaza, et s'est positionné en faveur d'un cessez-le-feu pour la libération des derniers otages encore retenus dans l'enclave palestinienne.
Et depuis quelques semaines, il suit particulièrement les affaires de documents déclassifiés impliquant le très proche entourage de Benyamin Nétanyahou.
Courrier international
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Liban : Des armes américaines utilisées lors d’une frappe israélienne contre des journalistes

Une frappe aérienne israélienne menée au Liban le 25 octobre 2024, qui a tué trois journalistes et a blessé quatre autres journalistes, était très vraisemblablement une attaque délibérée contre des civils et donc un crime de guerre apparent, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui.
Human Rights Watch a déterminé que les forces israéliennes ont mené cette attaque en utilisant une bombe larguée par avion et équipée d'un kit de guidage « Joint Directed Attack Munition » (JDAM - Munition d'attaque dirigée conjointe) fabriqué aux États-Unis. Le gouvernement américain devrait suspendre les transferts d'armes vers Israël en raison des attaques répétées et illégales commises par l'armée israélienne contre des civils, et pour lesquelles des responsables américains risquent de se rendre complices de crimes de guerre.
« L'utilisation par Israël d'armes américaines pour attaquer et tuer illégalement des journalistes qui se trouvaient loin de toute cible militaire entache terriblement l'image des États-Unis et d'Israël », a déclaré Richard Weir, chercheur senior auprès de la division Crises, conflits et armes à Human Rights Watch. « Les précédentes attaques meurtrières menées par l'armée israélienne contre des journalistes, restées sans conséquences, ne laissent que peu d'espoir d'aboutir à la reddition de comptes pour cette violation, ou pour de futures violations subies par les médias. »
Cette attaque a été menée tôt dans la matinée du 25 octobre contre le Hasbaya Village Club Resort, un complexe hôtelier situé à Hasbaya dans le sud du Liban, où plus d'une dizaine de journalistes séjournaient depuis plus de trois semaines. Human Rights Watch n'a trouvé aucune preuve de combats, ni de présence de forces militaires ou d'activité militaire dans cette zone au moment de l'attaque. Selon les informations recueillies par Human Rights Watch, l'armée israélienne savait ou aurait dû savoir que des journalistes séjournaient dans la zone, et plus particulièrement dans le bâtiment ciblé. Après avoir initialement affirmé que ses forces avaient frappé un bâtiment où « des terroristes opéraient », l'armée israélienne a déclaré quelques heures plus tard que « l'incident est en cours d'examen ».
Human Rights Watch a mené des entretiens avec huit personnes qui séjournaient au Hasbaya Village Club Resort ou à proximité lors de l'attaque, dont trois journalistes blessés et le propriétaire de ce complexe hôtelier. Des chercheurs de Human Rights Watch ont visité ce site le 1er novembre, et ont examiné 6 vidéos et 22 photos de l'attaque et de ses conséquences, ainsi que des images satellite. Le 5 novembre et le 14 novembre, Human Rights Watch a transmis respectivement un courrier à l'armée libanaise contenant des questions, et un courrier à l'armée israélienne contenant les conclusions de ses recherches ainsi que des questions, mais n'a reçu aucune réponse à ces deux lettres.
L'attaque contre le bâtiment dans lequel les journalistes séjournaient a eu lieu peu après 3 heures du matin le 25 octobre, selon les témoignages recueillis et des images de vidéosurveillance affichant l'heure d'enregistrement. La plupart des journalistes dormaient à ce moment-là, mais pas tous. Zakaria Fadel, âgé de 25 ans, est un assistant caméraman pour ISOL for Broadcast, un fournisseur libanais de services de diffusion par satellite ; il a déclaré qu'il était en train de se brosser les dents lorsque l'explosion l'a projeté en l'air.
La munition a frappé le bâtiment d'un étage, puis a explosé en touchant le sol. L'explosion a tué Ghassan Najjar, journaliste et caméraman pour la chaîne de télévision Al Mayadeen, et Mohammad Reda, ingénieur de diffusion par satellite pour cette chaîne ; l'explosion a aussi tué Wissam Kassem, un caméraman travaillant pour la chaîne de télévision Al Manar TV, propriété du Hezbollah. Al Mayadeen est une chaîne de télévision panarabe basée au Liban, politiquement alliée au Hezbollah et au gouvernement syrien.
Human Rights Watch a vérifié des vidéos prises quelques minutes après l'attaque, qui montrent le bâtiment ciblé complètement détruit, et les bâtiments voisins endommagés. La frappe a fait s'effondrer un mur du bâtiment adjacent, blessant gravement Hassan Hoteit, 48 ans, un caméraman pour ISOL for Broadcast. La frappe a aussi considérablement endommagé le mur d'un petit bâtiment situé à environ 10 mètres de là, blessant d'autres journalistes, dont Ali Mortada, un caméraman pour Al Jazeera âgé de 46 ans.
Ali Mortada a déclaré avoir été réveillé par l'explosion et par des morceaux de béton qui lui tombaient dessus, le blessant au visage et au bras droit. Lorsque les débris ont cessé de tomber, il est sorti de sa chambre pour prendre des nouvelles de ses collègues. Avec d'autres personnes, il a alors retrouvé Hassan Hoteit, qui était blessé. Le bâtiment qui avait été directement frappé était détruit. Ali Mortada a déclaré avoir vu les corps de Wissam Kassem et de Ghassan Najjar gisant à proximité. Une partie du corps de Mohammad Reda gisait un plus loin.
Peu après, le concierge du Hasbaya Village Club Resort est venu vers eux, disant qu'il avait trouvé deux jambes humaines dans une chambre. Ehab el-Okdy, un journaliste d'Al Jazeera qui séjournait dans le complexe, a déclaré avoir également vu les corps et les parties des corps des journalistes morts. « Nous avons vu les corps », a-t-il déclaré. « Nous avons vu que Mohammad Reda était brisé partout. »
Anoir Ghaida, le propriétaire du Hasbaya Village Club Resort, a déclaré que les journalistes y étaient arrivés le 1er octobre, suite à un ordre d'évacuation émis par l'armée israélienne et portant sur une zone située au sud de Hasbaya. Les journalistes avaient précédemment effectué leurs reportages à Ibl al-Saqi, une ville libanaise située dans la zone mentionnée dans l'ordre d'évacuation.
Les journalistes avec qui Human Rights Watch s'est entretenu ont déclaré qu'entre le 1er octobre et le 25 octobre, date de l'attaque, ils avaient effectué des déplacements réguliers et répétés aux alentours de Hasbaya, réalisant plusieurs reportages télévisés en direct depuis une colline qui surplombait de vastes parties du sud du Liban. Les journalistes ont déclaré qu'ils quittaient le complexe hôtelier le matin et y revenaient le soir, à peu près à la même heure chaque jour, ce qu'a corroboré Anoir Ghaida. Sur la plupart des véhicules figuraient en grandes lettres les mots « Press » (presse) ou « TV ».
Les journalistes et Anoir Ghaida ont aussi déclaré avoir constamment entendu le bourdonnement de drones aériens dans cette zone, ce qui indique que la zone était très probablement sous surveillance israélienne. Avant le 25 octobre, aucune attaque n'avait été menée contre contre la ville de Hasbaya.
Depuis le début des hostilités entre Israël et le Hezbollah le 8 octobre 2023, au lendemain du 7 octobre, l'armée israélienne a attaqué et tué des journalistes, et a pris pour cible la chaîne de télévision Al Mayadeen. Le 23 octobre, les forces israéliennes ont attaqué et détruit un bureau utilisé par Al Mayadeen à Beyrouth. Al Mayadeen avait pu évacuer son personnel du bâtiment, avant cette frappe.
Durant la période du 8 octobre 2023 au 29 octobre 2024, des frappes israéliennes ont tué au moins six journalistes libanais, selon le Comité pour la protection des journalistes (Committee to Protect Journalists, CPJ). Human Rights Watch a conclu que l'attaque israélienne du 13 octobre 2023, qui a tué Issam Abdallah, un journaliste de Reuters, et blessé six autres journalistes, était un crime de guerre apparent. Le 21 novembre 2023, une frappe israélienne menée à Tayr Harfa, dans le sud du Liban, a tué Rabih al-Maamari et Farah Omar, deux journalistes libanais qui travaillaient pour la chaîne de télévision Al Mayadeen, ainsi que leur chauffeur, Hussein Akil.

Human Rights Watch a vérifié une photo et une vidéo montrant les funérailles de Ghassan Najjar, dont le cercueil était enveloppé dans un drapeau du Hezbollah, dans un cimetière du sud de Beyrouth où sont enterrés des combattants du Hezbollah ; l'emplacement était proche de la tombe de Rabih al-Maamari. Le 14 novembre, un porte-parole du Hezbollah a déclaré à Human Rights Watch que Ghassan Najjar avait demandé à être enterré près de son ami et collègue Rabih al-Maamari, et a ajouté que Najjar « n'était qu'un civil » qui n'avait « participé d'aucune manière à des activités militaires ».
Human Rights Watch a trouvé des fragments de la munition sur le site de l'attaque, et a examiné des photographies d'autres fragments récupérés par le propriétaire du complexe hôtelier. Human Rights Watch a déterminé que ces fragments correspondaient à un kit de guidage JDAM assemblé et vendu par la société américaine Boeing. Human Rights Watch a également identifié un fragment de bombe comme faisant partie du système d'actionnement du kit de guidage qui pilote les ailerons. Un code numérique sur le fragment correspondait à l'entreprise américaine Woodward, qui fabrique des composants pour les systèmes de guidage des munitions, y compris le JDAM. Le kit JDAM, fixé à des bombes larguées par voie aérienne, permet de les guider vers une cible en utilisant des coordonnées satellite, ce qui permet un ciblage plus précis, compris dans un rayon de plusieurs mètres.
Le 14 novembre, Human Rights Watch a transmis des courriers aux sociétés Boeing et Woodward, mais n'a reçu aucune réponse. Les entreprises ont des responsabilités en vertu des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises, ainsi que d'autres directives visant à empêcher, stopper ou atténuer les violations réelles et potentielles du droit international humanitaire qu'elles causent ou auxquelles elles contribuent, et à y remédier.

Compte tenu des violations généralisées des lois de la guerre par Israël et de l'absence de reddition de comptes pour ces violations, les entreprises devraient cesser de vendre des armes à ce pays ; dans la mesure du possible, elles devraient aussi instaurer un rappel de produits pour les armes déjà vendues, et cesser tout service d'assistance technique pour ces armes.
Human Rights Watch a précédemment documenté l'utilisation illégale par l'armée israélienne d'une arme américaine lors d'une frappe menée le 27 mars 2024, qui a tué sept travailleurs humanitaires dans le sud du Liban.
Le droit international humanitaire, qui rassemble les lois de la guerre, interdit les attaques contre les civils et les biens civils. Les journalistes sont considérés comme des civils, et doivent être protégés contre toute attaque, tant qu'ils ne participent pas directement aux hostilités. Les journalistes ne peuvent pas être attaqués en raison de leur travail, même si la partie adverse considère que les médias pour lesquels ils travaillent ont des points de vue biaisés, ou sont utilisés à des fins de propagande. Lorsqu'elles mènent une attaque, les parties belligérantes doivent prendre toutes les précautions possibles pour minimiser les dommages causés aux civils et aux biens civils. Cela comprend la prise de toutes les mesures nécessaires pour vérifier que les cibles sont des objectifs militaires, ou non.
Les personnes qui commettent de graves violations des lois de la guerre avec une intention criminelle – c'est-à-dire intentionnellement ou par imprudence – peuvent être poursuivies pour crimes de guerre. Des personnes peuvent également être tenues pénalement responsables d'avoir aidé, facilité, aidé ou encouragé un crime de guerre.
Le Liban devrait d'urgence reconnaître la compétence de la Cour pénale internationale (CPI) pour enquêter sur les crimes internationaux graves commis dans ce pays, afin que le Procureur de la CPI puisse disposer d'un mandat l'autorisant à mener une telle enquête.
Les principaux alliés d'Israël – les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et l'Allemagne – devraient suspendre leurs ventes d'armes et leur assistance militaire à Israël, compte tenu du risque réel que ces armes soient utilisées pour commettre de graves abus. La politique américaine sur les transferts d'armes vers d'autres États interdit de tels transferts s'il est « plutôt probable » (« more likely than not ») que ces armes soient utilisées en violation du droit international.
« Face à l'accumulation de preuves de l'utilisation illégale d'armes américaines par Israël, y compris lors de crimes de guerre apparents, les hauts responsables des États-Unis doivent décider s'ils respecteront le droit américain et international en mettant fin aux ventes d'armes à Israël, ou s'ils s'exposeront au risque d'être reconnus légalement complices de violations graves », a conclu Richard Weir.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Gaza, jour 402 : les civils tentant de fuir sont assassinés

Israël poursuit sa guerre génocidaire à Gaza, en Cisjordanie et au Liban. Point sur la situation cette semaine à Gaza, alors que l'armée israélienne a déclaré qu'elle ne permettrait pas aux Palestinien·nes déplacé·es du nord de Gaza de retourner chez elles et eux.
Tiré d'Agence médias Palestine.
Chiffres clés
à Gaza depuis le 7 octobre 2023 :
43 665 mort·es
103 076 blessé·es
1,9 million de déplacé·es
au Liban depuis le 7 octobre 2023 :
3243 mort·es
14 134 blessé·es
1,2 million de déplacé·es
en Cisjordanie depuis le 7 octobre 2023 :
783 mort·es
dont 146 enfants
19 031 déplacé·es
L'armée israélienne poursuit ses massacres dans l'ensemble de la bande de Gaza, et principalement au nord de l'enclave. Le ministère de la santé de Gaza a annoncé que 49 Palestinien·nes avaient été assassiné·es dimanche 10 novembre, et 50 autres lundi.
Le camp de Nuseirat, situé sur le « corridor de sécurité » désigné par Israël comme passage pour les gazaoui·es qui fuient le nord, a été bombardé à plusieurs reprises au cours des derniers jours, et des tanks israéliens y ont mené une attaque dimanche, assassinant plus de 11 Palestinien·nes.
Les résident·es du camp témoignent que les chars israéliens ont ouvert le feu en entrant dans le secteur ouest secteur du camp, provoquant la panique au sein de la population et des familles déplacées. Zaik Mohammad, habitant du camp, explique que l'avancée des chars est survenue sans aucun avertissement : « Certaines personnes n'ont pas pu partir et sont restées bloquées à l'intérieur de leurs maisons, suppliant qu'on les laisse sortir, tandis que d'autres se sont précipitées pour fuir avec tout ce qu'elles pouvaient porter ».
Le siège du nord de Gaza
Le 4 novembre, les Nations unies et leurs partenaires estimaient qu'environ 100 000 personnes avaient été déplacées en quatre semaines depuis le nord vers la ville de Gaza, et qu'il restait entre 75 000 et 95 000 personnes dans la zone assiégée. La défense civile palestinienne (PCD) estime qu'au moins 1 300 Palestinien·nes ont été assassiné·es au cours de cette offensive.
Décrivant la situation au nord de Gaza comme « apocalyptique », les directeurs de 15 organisations et consortiums humanitaires et des Nations Unies ont renouvelé leur appel à toutes les parties qui se battent à Gaza pour protéger les civils, ont demandé à l'État d'Israël de « cesser son assaut sur Gaza et sur les humanitaires qui tentent de l'aider ». Constatant que l'aide de base et les fournitures vitales ont été refusées alors que les bombardements et autres attaques se poursuivent, les chefs d'État et de gouvernement ont souligné que « le mépris flagrant de l'humanité fondamentale et des lois de la guerre doit cesser », que les attaques contre les civils et les infrastructures civiles restantes doivent cesser, que l'aide humanitaire doit être facilitée et que les biens commerciaux doivent être autorisés à entrer dans la bande de Gaza.
Les réfugié·es du nord affluent dans la ville de Gaza
Les civil·es qui se résignent à quitter le nord de Gaza arrivent dans la ville de Gaza et s'installent dans des camps de réfugiés nouvellement créés. Ces camps débordent cependant déjà, et il n'y a plus de tentes pour les nouveaux·lles arrivant·es.
« Plus de 350 familles sont arrivées du nord et il n'y a pas assez de tentes pour les accueillir. » explique Muhammad Saada, directeur adjoint du centre de déplacement. Le camp a été établi par plusieurs initiatives caritatives mais n'est pas suffisamment approvisionné, et devient rapidement invivable alors que des familles cherchant un abri continuent d'affluer.
Les réfugié·es du nord de Gaza décrivent les scènes d'horreur qu'ils et elles ont vécu, et de nombreux témoignages dénoncent des traitements inhumains de la part de l'armée israélienne sur les routes pourtant désignées par celle-ci comme « sûres » pour évacuer.
« Une femme atteinte d'un cancer se tenait sur le bord de la route, accompagnée de quatre enfants », raconte Jinan Suleiman, 18 an, qui vient d'arriver dans la ville de Gaza. « Elle en portait deux dans ses bras, et les deux autres étaient à terre, pleurant et criant de faim. Elle demandait de l'aide à tous ceux qui passaient près d'elle. Elle criait et disait : ‘J'ai un cancer, je ne peux pas porter mes enfants et mes sacs'. Elle voulait que quelqu'un·e prenne ses enfants, qui étaient couché·es sur le sol, mais moi, comme tous les autres, je suis passée à côté d'elle et je n'ai pas pu l'aider. (…) Les soldats nous guettaient, elles et ils tiraient sous nos pieds et nous empêchaient d'aider les autres ou de nous arrêter pour quelque raison que ce soit. »
« Sur le chemin, les blessé·es marchaient ensemble et saignaient ; ils tombaient au milieu de la route et personne ne les aidait », raconte une autre réfugiée. « Il y avait des enfants qui avaient perdu leur famille et d'autres qui s'étaient débarrassés de leur sac pour pouvoir continuer à marcher et survivre. L'armée nous a délibérément fait marcher sur une route accidentée afin de nous épuiser et de nous tuer en chemin ».
Les craintes de saisies de terres se concrétisent
Mardi 5 novembre, un porte-parole de l'armée israélienne, Yitzhak Cohen, a déclaré lors d'un point de presse que l'armée était sur le point de procéder à l'« évacuation » complète de la population du nord de Gaza, et a affirmé que les résidents palestiniens du nord ne seront pas autorisés à retourner chez eux. Cette déclaration marque la première admission officielle par Israël de son intention d'expulser définitivement les Palestiniens du nord de la bande de Gaza.
La semaine dernière, l'armée israélienne avait pourtant déclaré qu'elle avait mis fin à la plupart de ses « opérations » dans le nord de Gaza et qu'elle mettrait bientôt fin à son offensive dans cette région. La dernière annonce de Yitzhak Cohen vient donc renforcer les craintes qu'Israël ambitionne de se saisir des terres du nord de Gaza en appliquant le « Plan des Généraux », une proposition d'un groupe de généraux israéliens de haut rang qui vise à vider Gaza de sa population par une campagne systématique de famine, de massacres et de déplacements forcés.
« Ils veulent détruire le nord », explique Umm Omar Salman, une enseignante qui a fui sa maison pour se réfugier à Gaza. « Surtout la zone frontalière, Beit Lahia. C'est de là que nous venons. Nous avons tenu bon jusqu'au dernier moment, lorsque nous avons découvert des dizaines de chars entourant les abris de l'école. Les soldats nous ont fait sortir de force. »
Gaza invivable
Dans un rapport, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) alerte des dangers que constitue l'environnement même de Gaza suite aux bombardements continus d'Israël depuis plus d'un an. La dernière analyse du Centre satellitaire de l'ONU (UNOSAT), réalisée au début du mois de septembre, a montré que plus de 65 % de toutes les structures de Gaza avaient été soit endommagées, soit détruites.
Des milliers de civil·es continuent d'être contraint·es de se déplacer à plusieurs reprises, de survivre au milieu des décombres et de s'abriter dans des endroits peu sûrs, y compris dans des bâtiments endommagés ou détruits. Outre les risques liés aux bombardements israéliens incessants, à la famine et aux épidémies, les Palestinien·nes évoluent dans des zones dangereuses et instables, où de nombreux restes explosifs sont enfouis dans les sols et les décombres.
Le service d'action contre les mines de l'ONU (UNMAS) rappelle que la contamination par les restes explosifs de guerre est susceptible de se produire à la fois en surface et sous la surface, impliquant non seulement des munitions de service terrestres (projectiles, mortiers, roquettes, missiles, grenades et mines terrestres), mais aussi des bombes profondément enfouies. L'UNMAS alerte aussi que les difficulté d'accès ne permettent pas à leurs équipes d'évaluer pleinement l'étendue des risques et de les prévenir.
Le PNUD alerte aussi que l'amiante hautement cancérigène libérée dans l'air en raison de la destruction généralisée des infrastructures, ainsi que d'autres contaminants, continueront d'affecter les communautés de Gaza pendant longtemps.

Benjamin Netanyahu cherche à provoquer une fragmentation du Moyen-Orient

Depuis son retour au pouvoir, Benjamin Netanyahu s'inscrit dans une continuité stratégique : celle de la fragmentation de ses voisins pour renforcer la sécurité d'Israël.
Tiré de MondAfrique.
Une vision qui s'inspire des recommandations du rapport A Clean Break : A New Strategy for Securing the Realm, publié en 1996 par des stratèges néoconservateurs américains. Ce document suggérait de remodeler le Moyen-Orient en exacerbant les divisions internes de ses États, une approche que Netanyahu semble avoir adoptée avec constance.
Une doctrine au service de la puissance israélienne
Le rapport A Clean Break préconisait de rompre avec les processus de paix traditionnels et d'utiliser la puissance militaire et politique pour affaiblir les adversaires d'Israël. Cette doctrine repose sur deux piliers principaux :
– Rejeter les compromis territoriaux, notamment le principe de « la terre contre la paix » inscrit dans les accords d'Oslo.
– Exploiter les divisions internes des adversaires pour maintenir un avantage stratégique.
Cette logique se reflète dans plusieurs initiatives israéliennes, notamment le soutien à l'indépendance kurde, qui vise à fragmenter des États comme l'Irak, la Syrie ou l'Iran. Autre exemple : la division entre le Hamas et le Fatah, qui affaiblit les Palestiniens en rendant plus difficile toute forme d'unité nationale.
Une stratégie qui fragmente le Moyen-Orient
Depuis deux décennies, cette approche a eu des répercussions majeures sur les équilibres régionaux :
– En Irak, l'éviction de Saddam Hussein en 2003, bien que menée par les États-Unis, a laissé un pays fracturé entre tensions sectaires et ingérences étrangères.
– En Syrie, les frappes israéliennes ciblées contre les infrastructures militaires et les soutiens indirects à certains groupes d'opposition affaiblissent le régime de Bachar Al-Assad.
– Au Liban, les actions israéliennes contre le Hezbollah, combinées à la crise économique, contribuent à fragiliser un État déjà en grande difficulté.
Ces interventions, bien qu'efficaces à court terme pour limiter les menaces immédiates, alimentent un cycle d'instabilité dans la région.
Un risque d'effet domino
Cette politique de fragmentation pourrait cependant produire des effets inverses :
1- L'instabilité pourrait s'étendre à des puissances régionales telles que l'Iran ou l'Arabie saoudite. La diversité ethnique en Iran ou les fractures religieuses en Arabie saoudite pourraient devenir des points de tension exploités par des acteurs externes.
2- Des risques pour les intérêts américains : La fragmentation des États du Moyen-Orient risque d'affaiblir les alliances des États-Unis et de créer des vides de pouvoir où prospèrent les groupes extrémistes.
Un paradoxe face aux Accords d'Abraham
La stratégie de Netanyahu entre en contradiction avec les dynamiques de normalisation portées par les Accords d'Abraham, signés en 2020, qui visent une intégration régionale autour de la coopération économique et politique. Cette tension se manifeste particulièrement dans les relations avec l'Arabie saoudite :
– La priorité saoudienne à la stabilité régionale s'oppose aux actions israéliennes au Liban ou en Syrie, qui amplifient les crises.
– La question palestinienne demeure un point central : Riyad exige des avancées concrètes pour envisager une normalisation avec Israël, une exigence incompatible avec la doctrine de fragmentation.
Une vision stratégique aux limites évidentes
Si la doctrine de Netanyahu a permis de contenir des menaces à court terme, elle repose sur une vision à court terme de la sécurité régionale. L'instabilité qu'elle alimente pourrait renforcer des groupes extrémistes et éloigner Israël de partenaires potentiels.
Alors que le Moyen-Orient évolue vers une interconnexion accrue, portée par des initiatives comme les Accords d'Abraham ou la Vision 2030 de l'Arabie saoudite, la persistance d'une stratégie de rupture pourrait isoler Israël. La quête de sécurité pourrait alors se transformer en un pari risqué, où l'instabilité finit par affecter tous les acteurs, y compris ceux qui la provoquent.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Tourmente à la CPI : les craintes d’ingérence d’Israël et des États-Unis augmentent

Le retard dans la délivrance des mandats d'arrêt de la CPI à l'encontre de Benjamin Netanyahou et de Yoav Gallant, suivi du remplacement du juge président, a fait naître de sérieuses inquiétudes quant au fonctionnement de la Cour et à d'éventuelles machinations en coulisses.
Tiré d'Agence médias Palestine.
Le 20 mai 2024, le procureur de la Cour pénale internationale (CPI), Karim Khan, a demandé à la CPI de délivrer des mandats d'arrêt contre les dirigeants israéliens Benjamin Netanyahu et Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, y compris l'extermination.
Dans la même déclaration, il a lancé un avertissement extraordinaire : « J'insiste pour que cessent immédiatement toutes les tentatives d'entrave, d'intimidation ou d'influence indue sur les fonctionnaires de cette Cour. Mon Bureau n'hésitera pas à agir en vertu de l'article 70 du Statut de Rome si de tels agissements se poursuivent ».
Le Procureur n'a pas précisé la source des menaces contre les fonctionnaires de la CPI.
Conformément à ses procédures établies, la Cour a ensuite confié l'affaire à une chambre préliminaire composée de trois juges et présidée par la juge Iulia Motoc.
Huit jours seulement après l'annonce par le procureur des demandes de mandats et de son avertissement concernant l'intimidation des fonctionnaires de la Cour, le Guardian et +972 Magazine ont publié un exposé révélant une décennie d'interférences, de pressions et de menaces de la part de célèbres agences de renseignement israéliennes à l'encontre du personnel de la Cour pénale internationale afin de faire dérailler les enquêtes sur les crimes israéliens.
Mais à ce moment-là, la Cour est restée silencieuse sur le dossier de la Palestine – un silence qui durera cinq mois. Les observateurs de la Cour ne pouvaient que s'interroger et s'inquiéter de ce retard sans précédent dans l'émission des mandats.
Et puis, comme s'il fallait s'y attendre, au début du mois d'octobre, des publications pro-israéliennes ont commencé à faire circuler des allégations anonymes accusant le Procureur de la CPI d'avoir harcelé une employée de la Cour.
Quelques jours plus tard, le 20 octobre 2024, la CPI a annoncé que M. Motoc, le juge président de la chambre préliminaire de trois juges chargée de décider s'il y a lieu d'émettre des mandats d'arrêt à l'encontre du Premier ministre et du ministre de la Défense d'Israël, avait soudainement démissionné.
Invoquant des « raisons de santé » non précisées, la Cour n'a pas fourni d'autres informations. M. Motoc a été remplacé par la juge slovène Beti Hohler, tandis que le juge français Nicolas Guillou préside désormais la chambre.
En temps normal, ces développements pourraient être à peine remarqués. Mais ce ne sont pas des temps ordinaires, et ce n'est pas une affaire ordinaire.
Israël, un État qui a bénéficié pendant 75 ans d'une impunité soutenue par l'Occident, est enfin, semble-t-il, appelé à rendre compte de ses crimes. Déjà poursuivis pour génocide devant la Cour internationale de justice (CIJ) et faisant l'objet d'une série d'ordonnances provisoires, les dirigeants israéliens ont reçu en mai un avis de l'autre côté de la ville, à La Haye, leur indiquant que le filet continuait à se resserrer.
La demande de mandat d'arrêt présentée en mai par le procureur de la CPI à l'encontre de Benjamin Netanyahu et Yoav Gallant a suscité une réaction prévisible de la part d'Israël, qui a lancé des récriminations furieuses, des invectives et les tactiques habituelles de diffamation à l'encontre de la Cour.
Ses alliés occidentaux se sont immédiatement joints à lui pour attaquer la requête du procureur, les responsables américain-es allant même jusqu'à menacer la Cour elle-même.
Aujourd'hui, le retard dans l'émission des mandats, suivi de l'annonce du remplacement du juge président, a soulevé de sérieuses inquiétudes quant au fonctionnement de la Cour et à d'éventuelles machinations en coulisses.
Interférences et retards
Le fait que ce retard de cinq mois survienne alors que la première enquête préliminaire sur les crimes d'Israël en Palestine a été ouverte il y a près de dix ans n'a fait qu'exacerber ces craintes.
À titre de comparaison, la CPI a répondu en trois semaines à une demande de mandat d'arrêt à l'encontre du président russe Vladimir Poutine. Dans ses autres affaires, la Cour a mis en moyenne huit semaines pour délivrer des mandats.
L'arrivée de ces derniers développements, qui fait suite à la révélation d'années de menaces et de harcèlement de juges et de fonctionnaires de la Cour par des agent-es des services de renseignement israéliens et des fonctionnaires de gouvernements occidentaux, a mis les partisan-es de la Cour et les opposant-es à l'impunité d'Israël en état d'alerte maximale.
Dans un cas, le chef du Mossad lui-même a menacé l'ancien procureur de la CPI, Fatou Bensouda, et sa famille. (À son crédit, Fatou Bensouda a résisté aux attaques et, avec un courage et des principes exemplaires, a ouvert une enquête sur les crimes israéliens).
Le changement de juge dans cette affaire devrait encore prolonger la décision sur les mandats d'arrêt dans un processus déjà excessivement retardé. Les retards sans précédent (et maintenant encore plus importants) ont soulevé des questions quant à l'existence de facteurs « en coulisses ».
Mais Israël n'est pas le seul État à interférer avec les travaux de la CPI. Agissant au nom d'Israël, les législateur-ices américain-es, le département d'État et les responsables du Conseil national de sécurité des États-Unis ont uni leurs forces pour faire pression, menacer et tenter de faire dérailler les poursuites engagées contre les responsables israéliens, menaçant même de prendre des sanctions contre la Cour.
Risques fondamentaux
Bien qu'il soit impossible de savoir comment ces juges vont finalement statuer, et qu'il n'y ait rien dans le dossier public qui puisse remettre en question leur intégrité judiciaire, les changements dans la composition de la chambre pourraient également avoir d'importantes implications sur le fond.
Par exemple, la nouvelle juge Hohler a publié un article en 2015 (bien avant de rejoindre la CPI) dans lequel elle suggère que la complémentarité peut empêcher l'examen d'Israël parce que « Israël en général a un système juridique qui fonctionne bien et qui est dirigé par une Cour suprême respectée ».
Si l'on fait abstraction de la vaste critique internationale de la Cour suprême israélienne (déjà évidente en 2015) pour son long passé d'approbation des politiques d'apartheid et des crimes d'État contre les Palestiniens, et pour son long passé de tolérance des crimes de guerre israéliens, il est depuis devenu clair qu'Israël n'a aucune intention d'enquêter ou de poursuivre Netanyahou ou Gallant pour les crimes allégués dans la demande de mandats d'arrêt du Procureur de la CPI.
Nous devons espérer que la juge Hohler réalisera maintenant que toute objection de complémentarité (c'est-à-dire qu'Israël enquêtera sur lui-même) est sans fondement, comme l'a déjà constaté la CIJ. Mais l'évaluation profondément déformée qu'elle a faite précédemment du système judiciaire israélien est néanmoins préoccupante.
Dans le même article, la juge Hohler laissait entendre que des considérations politiques externes pouvaient influencer les décisions de la Cour, car « la CPI dépend fortement du soutien de ses États parties, y compris pour tout type d'exécution et pour garantir la présence des auteurs présumés à La Haye ».
Bien que cela puisse être vrai, et que de nombreuses parties au statut (de Rome) de la CPI soient des alliées occidentales d'Israël, les préoccupations relatives à la mise en œuvre ne devraient pas jouer de rôle dans les décisions des juges sur le fond.
Pour sa part, le nouveau juge président français, M. Guillou, est arrivé à la Cour avec un profil « antiterroriste » très marqué. Il a été chef de cabinet du président du Tribunal spécial pour le Liban, qui a condamné un membre du Hezbollah pour l'assassinat de Rafik Harri en 2005, et ancien agent de liaison auprès du ministère américain de la justice, où il a travaillé avec les États-Unis (entre autres) sur des poursuites antiterroristes au plus fort de la « guerre contre le terrorisme » américaine, qui a donné lieu à de nombreux abus.
Le juge Guillou a également (avant de rejoindre la Cour) plaidé publiquement en faveur de la poursuite du « terrorisme » non étatique devant les tribunaux internationaux (ce qui ne s'est jamais produit que dans le cadre du Tribunal pour le Liban, où il a siégé), malgré l'absence de définition du terrorisme dans le droit international et malgré les objections des défenseurs des droits de l'homme et d'autres personnes préoccupées par l'effet juridique corrosif de la « guerre contre la terreur » en matière pénale et dans les situations de conflit armé.
Rien de tout cela ne prouve l'existence d'irrégularités dans le changement de composition de la chambre, ni ne suggère l'existence d'un quelconque manquement à l'éthique de la part des juges. Mais le droit n'est pas non plus une machine dans laquelle les décisions sont prises sur la base d'une application neutre de la loi aux faits. Les opinions, les expériences, les prédispositions et les biais des juges comptent. Quiconque cherche à influencer la Cour le sait.
Et ce fait ne tient même pas compte de l'influence corruptrice des menaces israéliennes et des campagnes de pression américaines contre le personnel de la CPI.
Les défenseurs des droits de l'homme se souviennent bien de la campagne de pression similaire lancée par Israël contre le juge Richard Goldstone, qui dirigeait la Mission d'établissement des faits de l'ONU sur Gaza en 2009, et qui a contraint Goldstone à se rétracter sur les conclusions de la Mission, détruisant ainsi sa réputation dans les cercles juridiques internationaux et les cercles des droits de l'homme, après une carrière juridique de plusieurs décennies et riche en rebondissements.
Accusations infondées contre le procureur
Pour ajouter aux inquiétudes concernant les attaques contre l'indépendance de la Cour, en octobre, un compte X anonyme et peu suivi a tweeté des allégations non fondées de tiers, selon lesquelles le procureur de la CPI, Karim Khan, avait harcelé une employée de la Cour.
D'une manière ou d'une autre, le Daily Mail, un tabloïd anglais de droite pro-israélien (qui est devenu célèbre pour avoir publié de la désinformation israélienne et qui a été banni par la Wikipedia anglaise en raison de son manque de fiabilité et de ses fabrications) a trouvé ce petit compte X et a reproduit les allégations. À partir de là, l'histoire a été reprise par des sites d'information pro-israéliens dans tout l'Occident.
Bien qu'il soit impossible de savoir si ces allégations sont fondées, M. Khan les a démenties et a déclaré qu'elles faisaient partie de la campagne de menaces et de harcèlement dont lui et la Cour font l'objet en raison de leur travail.
Pour sa part, la victime présumée n'a pas déposé de plainte, et ni elle ni le mécanisme de contrôle indépendant (MCI) de la Cour n'ont jugé opportun d'ouvrir une enquête ou de porter des accusations.
Ce qui est clair, cependant, c'est que cette accusation anonyme a rapidement alimenté une campagne de délégitimation contre le Procureur et, par extension, contre la CPI.
Les médias pro-israéliens et les groupes mandataires, voyant la valeur de propagande de lier les allégations à l'affaire contre Netanyahu et Gallant, les ont rapportées avec des titres tels que « Le procureur pour les crimes de guerre qui a inculpé Netanyahu est accusé de harcèlement sexuel », dans une tentative évidente de discréditer les accusations portées contre les accusés israéliens.
Piraterie à La Haye
Ce que nous savons, c'est que (1) la Cour, par crainte ou par faveur, a longtemps été réticente à faire avancer les affaires contre les Israéliens, (2) les agences de renseignement israéliennes et occidentales et les acteurs gouvernementaux ont travaillé pour faire pression sur les juges et les fonctionnaires de la CPI, et (3) les retards dans le dossier de la Palestine sont déjà sans précédent.
Sachant cela, nous devons au moins poser trois questions :
Premièrement, si les « raisons de santé » du juge Motoc étaient dues à quelque chose de plus sinistre ou si elles en étaient la couverture.
Deuxièmement, si les nominations de remplacement qui ont suivi ont été influencées par les positions de fond des juges, présumées ou réelles.
Et troisièmement, si les changements ont été conçus pour justifier de nouveaux retards dans les procédures, profitant ainsi aux accusés israéliens et offrant plus de temps pour des manipulations en coulisses.
Sauf nouvelles fuites ou révélations de la part de la CPI, nous ne connaîtrons peut-être pas la réponse à ces questions avant le coup de marteau, si tant est qu'il y en ait un.
Mais sachant que les retards judiciaires continuent d'augmenter alors même que l'extermination en Palestine se poursuit sans relâche, et sachant que des acteurs néfastes ont pris la Cour pour cible afin d'entraver la justice, la vigilance du public est impérative.
La CPI et celles ou ceux qui cherchent à la corrompre doivent savoir que le monde les observe.
Risque pour la réputation
En effet, la réputation de la CPI, de ses juges et de son procureur actuel est déjà sérieusement entamée, non seulement en raison d'une décennie de retards dans le dossier palestinien, mais aussi en raison d'un déséquilibre dramatique dans son action à l'échelle mondiale.
La Cour s'est presque entièrement concentrée sur le Sud et sur les adversaires présumés de l'Occident. À ce jour, les auteur-es de crimes commis par Israël et tous les autres pays occidentaux jouissent d'une impunité totale sous le statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI).
Pour les États du Sud et les défenseurs de la justice dans le monde, la CPI est de plus en plus suspecte. L'échec de la justice dans l'affaire en cours, toute perception de partialité en faveur d'Israël, toute concession aux pressions américaines ou aux sponsors occidentaux de la Cour, représenteront presque certainement le début de la fin de la CPI.
Poursuivre les délits contre l'administration de la justice
Mais Israël et les États-Unis devraient en prendre bonne note. Le risque auquel ils sont confrontés va au-delà du simple risque de réputation. Le type d'ingérence dans lequel ils ont été impliqués constitue non seulement un outrage moral, mais aussi une violation du droit international.
Et certains des actes révélés pourraient faire l'objet de poursuites pénales de la part de la Cour elle-même.
L'article 70 du statut de Rome de la CPI codifie les crimes contre l'administration de la justice et, surtout, confère à la Cour la compétence de poursuivre ces crimes.
Il s'agit notamment d'« entraver, intimider ou influencer par la corruption un fonctionnaire de la Cour dans le but de le contraindre ou de le persuader de ne pas s'acquitter, ou de s'acquitter indûment, de ses fonctions », et de « prendre des mesures de rétorsion à l'encontre d'un fonctionnaire de la Cour en raison des fonctions exercées par ce fonctionnaire ou par un autre fonctionnaire » (entre autres infractions).
Les personnes reconnues coupables de ces infractions peuvent être emprisonnées par la CPI pour une durée maximale de cinq ans.
En outre, chaque État partie au statut de Rome serait légalement tenu de traduire en justice ces infractions si elles sont commises par ses ressortissant-es ou sur son territoire. Si les États-Unis et Israël ne sont pas parties à la CPI, la plupart de leurs alliés occidentaux les plus proches le sont et seraient contraints de coopérer.
De plus, les Pays-Bas, où se trouve la CPI, sont tenus, en vertu d'un accord de pays hôte avec la Cour, d'assurer la sûreté et la sécurité du personnel de la Cour et de protéger la CPI contre toute ingérence.
D'ailleurs, les procureur-es néerlandais-es envisagent actuellement d'intenter une action en justice contre de haut-es responsables des services de renseignement israéliens pour les pressions et les menaces exercées sur les fonctionnaires de la CPI dans le cadre des affaires concernant la Palestine.
Dernière chance pour la justice
Les risques qui pèsent sur la CPI sont réels.
Israël et les États-Unis ont démontré qu'ils ne respectaient pas l'État de droit et qu'ils n'hésitaient pas à menacer ou à corrompre la Cour.
Et la CPI elle-même a un long chemin à parcourir pour prouver au monde qu'elle est engagée dans le rôle de justice universelle qui lui a été confié, plutôt que de servir de simple bras sélectif de la puissance occidentale.
Mais la solidité du dossier contre Netanyahu, Gallant et d'autres dirigeants israéliens, dans le cadre du premier génocide au monde retransmis en direct, et sous les feux d'une attention publique sans précédent, donne des raisons d'espérer.
Aujourd'hui, Israël est en procès, ses dirigeants sont en procès, et le système de justice internationale lui-même est en procès.
Des acteur-ices malveillant-es s'emploient, publiquement et dans l'ombre, à entraver le cours de la justice.
Si nous voulons que la justice soit rendue, nous devons faire preuve de vigilance.
Craig Mokhiber est un avocat international spécialisé dans les droits de l'homme et un ancien haut fonctionnaire des Nations unies. Il a quitté l'ONU en octobre 2023, après avoir rédigé une lettre ouverte qui mettait en garde contre un génocide à Gaza, critiquait la réaction internationale et appelait à une nouvelle approche de la Palestine et d'Israël fondée sur l'égalité, les droits de l'homme et le droit international.
Traduction : JB pour l'Agence Média Palestine
Source : Mondoweiss
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Un commandant israélien confirme le nettoyage ethnique dans le nord de Gaza : « Pas de retour possible »

Le commandant Itzik Cohen, qui dirige la division 162 opérant dans le nord de la bande de Gaza, a déclaré aux journalistes que ses ordres étaient clairs : « Personne ne retournera dans la partie nord… Ma tâche est de créer un nettoyage ethnique dans la région. Ma tâche consiste à nettoyer la zone ».
Tiré de Agence médias Palestine.
Le commandant de la division Itzik Cohen, qui dirige la division 162 opérant dans le nord de la bande de Gaza, a déclaré aux journalistes, selon Haaretz, que ses ordres étaient clairs : « Personne ne retournera dans la partie nord… Nous avons reçu des ordres très clairs. Ma tâche consiste à nettoyer la zone ».
Cette déclaration intervient alors que des informations de plus en plus nombreuses font état d'un nettoyage ethnique dans le nord de la bande de Gaza. Les rapports indiquent qu'Israël a forcé le déplacement de presque tous et toutes les habitant-es de zones comme Jabalia, Beit Hanoun et Beit Lahiya.
Les évacuations forcées, réalisées par une série de bombardements aériens, la famine et la destruction des infrastructures civiles, ont laissé des dizaines de milliers de personnes sans maison ou sans accès aux produits de première nécessité.
Déplacement systématique
Selon le rapport, Israël a délibérément pris pour cible des bâtiments résidentiels, des écoles et des abris où les Palestiniens déplacés cherchaient refuge.
Ces destructions ont provoqué un exode massif de civil-es du nord de la bande de Gaza, l'armée israélienne ayant clairement fait savoir qu'aucun-e habitant-e ne pourrait y retourner. Ces actions s'inscrivent dans une stratégie préméditée de nettoyage ethnique dans le cadre du « plan des généraux ».
Le général de brigade Elad Goren, responsable du soi-disant « effort humanitaire “ à Gaza, a encore exacerbé ces préoccupations en déclarant que les personnes restées à Jabalia avaient « suffisamment d'aide » grâce aux livraisons passées, tout en prétendant que Beit Hanoun et Beit Lahiya étaient désormais dépourvues d'habitant-es.
Ses remarques suggèrent une approche calculée pour affamer et déplacer les civil-es, contredisant directement les affirmations d'efforts humanitaires.
L'armée israélienne a nié à plusieurs reprises avoir adopté le « plan des généraux », qui prévoit l'évacuation de centaines de milliers de Palestiniens de la ville de Gaza et de ses environs sous la famine et les bombardements.
La semaine dernière, l'administration Biden a décidé de maintenir son aide militaire à Israël, malgré les preuves de plus en plus nombreuses de la campagne d'affamement systématique menée par Israël contre Gaza, affirmant qu'Israël n'avait pas enfreint les lois américaines sur le blocage des fournitures d'aide.
Plus tôt dans la journée, le ministère israélien de la défense a confirmé qu'il n'avait pas l'intention, dans l'immédiat, d'envoyer de l'aide à la bande de Gaza assiégée.
Traduction : JB pour l'Agence Média Palestine
Source : Quds News Network
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Des postiers dénoncent la mauvaise gestion de Postes Canada

Le paradoxe du réformisme – Robert Brenner
Archives Révolutionnaires : L’abandon par le NPD de ses fondements socialistes, le travail actif des directions syndicales pour maintenir la paix industrielle, les capitulations récurrentes de Québec solidaire face aux exigences du parlementarisme et du patronat, un Front commun historique qui laisse pourtant une masse considérable de travailleur·euse·s sur leur faim… Alors que les politiques néolibérales saccagent nos droits, l’environnement et nos conditions de vie, qu’est-ce qui explique cette frilosité de plusieurs organisations de la gauche et du mouvement ouvrier ? Pourquoi, tout en prêchant pour le réinvestissement dans le « filet social », ces organes puissants semblent parallèlement incapables d’obtenir gain de cause sur ces revendications ? Robert Brenner proposait déjà quelques pistes d’explication en 1993, dans son article consacré aux bases idéologiques et aux dynamiques politiques du réformisme. Nous présentons ici la traduction française de l’article, publiée initialement par la revue en ligne Période.
Robert Brenner (né en 1943) est un historien et un militant socialiste américain. Il est notamment membre du comité de rédaction de la New Left Review. L’article original est disponible dans la revue Against the Current (no. 43, mars-avril 1993).
Le paradoxe du réformisme
La différence entre réforme et révolution n’est pas une question de programme. En réalité, le réformisme est incapable d’obtenir des réformes par son seul concours. Dans cette formation (1993) à destination des cadres de son organisation, Solidarity, Robert Brenner détaille les raisons sociologiques de ce paradoxe, et en formule les conséquences stratégiques aux États-Unis. Le réformisme est l’idéologie spontanée d’une couche sociale bien précise : les permanents syndicaux et les politiciens sociaux-démocrates. Pour Brenner, la social-démocratie est une « forme de vie » à part entière dont les ressorts ne dépendent pas des défaites ou des victoires de la lutte des classes, mais de la négociation syndicale ou des résultats électoraux. Il en résulte que les révolutionnaires n’ont pas à combattre des « programmes » réformistes, mais une orientation au sein de la lutte qui rend inévitable la défense de l’ordre établi.
On m’a demandé de parler des leçons historiques des révolutions du XXe siècle. Mais puisque notre intérêt principal porte sur des enseignements qui puissent être pertinents pour le XXIe siècle, je pense qu’il est plus à propos de se pencher sur l’expérience de la réforme et du réformisme. Le « réformisme » est bel et bien parmi nous, bien qu’il ne se présente que rarement sous cette appellation, préfère se montrer sous un jour plus favorable. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de notre principal concurrent politique et nous devons par conséquent mieux le comprendre. Pour commencer, il est clair que le réformisme ne se distingue pas par son souci de mettre en place des réformes. Les révolutionnaires et les réformistes tentent tous deux de parvenir à des réformes. En effet, la lutte pour des réformes reste la principale préoccupation des révolutionnaires. En réalité, les réformistes partagent notre programme en grande partie – c’est du moins ce qu’ils prétendent. Ils sont pour des salaires plus élevés, le plein emploi, un meilleur État providence, des syndicats plus forts, et même une forme de parti ouvrier.
Or, si nous souhaitons gagner les réformistes à notre politique, nous n’y parviendrons pas en surenchérissant sur les propositions de leur programme. Nous ne pouvons gagner à nous les réformistes que par notre théorie (notre compréhension du monde) et, de façon plus importante encore, par notre méthode et notre pratique. Ce qui distingue au quotidien le réformisme, c’est sa méthode politique et sa théorie, et non pas son programme. Pour le dire schématiquement, les réformistes considèrent que même si l’économie capitaliste tend d’elle-même vers la crise, l’intervention étatique peut aider le capitalisme à atteindre un état de stabilité et de croissance à long terme. D’autre part, l’État est pour eux un instrument qui peut être utilisé par n’importe quel groupe, y compris la classe ouvrière, pour servir ses propres intérêts.
Ces prémisses permettent de comprendre toute la méthode et la stratégie des réformistes. Les travailleurs, les travailleuses et les opprimés devraient mettre toute leur énergie dans la lutte électorale pour s’emparer du contrôle de l’État et mettre en place des législations visant à réguler le capitalisme et améliorer sur cette base leurs conditions de travail et leur niveau de vie.
La base matérielle du réformisme
Les marxistes révolutionnaires ont toujours opposé leurs propres théories et stratégies à celles des réformistes. Mais comme souvent, il s’avère que la théorie et la pratique réformistes se comprennent mieux lorsqu’on tient compte des forces sociales spécifiques qui en constituent la base historique. Dans cette perspective, le réformisme s’affirme comme une vaste rationalisation des besoins et intérêts des responsables syndicaux et des politiciens, ainsi que des leaders du mouvement des opprimés issus des classes moyennes.
La base sociale distinctive du réformisme ne constitue pas un simple intérêt sociologique. C’est la clé d’un paradoxe central qui définit obstinément le réformisme, et ce depuis qu’il a existé des courants s’en réclamant explicitement au sein des partis sociaux-démocrates [ancienne appellation des partis communistes n.d.l.r], autour de 1900. Ce paradoxe est le suivant : les forces sociales qui constituent le cœur du réformisme se sont toujours rabattues sur des méthodes politiques – en particulier la voie électorale-législative et la négociation des conditions de travail par le biais de l’État – qui finissent à un moment ou un autre par mettre en péril leurs propres objectifs de réforme.
La conséquence est que, contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, la mise en place de réformes majeures tout au long du XXe siècle a généralement requis non seulement de rompre avec le réformisme, mais de lutter systématiquement contre le réformisme organisé, ses principaux dirigeants, et leurs organisations. En effet, ces gains ont dans presque tous les cas nécessité des stratégies et des tactiques que le réformisme organisé ne pouvait se permettre d’approuver, dans la mesure où elles menaçaient sa position sociale et ses intérêts. Parmi ces orientations tactiques que les réformistes étaient amenés à rejeter, on compte par exemple les degrés très élevés d’action militante (à la base), des actions illégales de masse, et la mise en place de liens de solidarité active dans toute la classe – entre syndiqués et non-syndiqués, employés et chômeurs, etc.
La vision réformiste
La proposition principale de la vision réformiste du monde est la suivante : bien que la crise constitue une tendance irréductible au sein de l’économie capitaliste, celle-ci est en dernier instance susceptible d’être régulée par l’État. En d’autres termes, pour les réformistes, c’est la lutte des classes non régulée qui mène à la crise. Deux hypothèses théoriques permettent d’affirmer cette idée. D’une part, la lutte de classe est susceptible d’aboutir à une « trop grande » exploitation des travailleurs et travailleuses par les capitalistes, qui veulent augmenter la profitabilité. C’est là une source de problème pour l’ensemble du système puisque le pouvoir d’achat des travailleurs et travailleuses se révèle alors insuffisant pour acheter ce qu’ils ont eux-mêmes produits. Cette insuffisance de la demande serait à l’origine d’une « crise de sous-consommation », et c’est de cette façon que les théoriciens réformistes interprètent la Grande dépression des années 1930.
D’autre part, les réformistes suggèrent parfois que la crise capitaliste survient en raison d’une résistance « trop forte » des travailleurs et travailleuses à l’exploitation capitaliste. En bloquant la mise en place d’innovations technologiques ou en refusant de travailler davantage, les travailleurs et travailleuses bloqueraient les gains de productivité. Il en résulterait une croissance plus faible, une réduction de la profitabilité, une baisse des investissements, et pour finir une « crise de l’offre » – selon les théories réformistes, le déclin économique actuel qui a débuté à la fin des années 1960 s’explique de cette façon.
Selon cette approche, puisque les crises sont des résultats imprévus de la lutte des classes non régulée, l’État peut assurer la stabilité économique et la croissance précisément en intervenant pour réguler à la fois la distribution des revenus et les relations de travail. Il en découle que la lutte de classes n’est pas réellement nécessaire puisqu’à long terme elle ne sert pas les intérêts de la classe capitaliste, ni ceux de la classe ouvrière, qui devraient donc coordonner leurs efforts.
L’État comme appareil neutre
La théorie réformiste de l’État va de pair avec son économie politique. Selon cette conception, l’État est un appareil autonome de pouvoir, neutre en principe, utilisable par quiconque s’en saisit. Il en découle que les travailleurs, les travailleuses et les opprimés devraient tenter d’en prendre le contrôle afin de réguler l’économie et ainsi assurer la stabilité économique et la croissance, pour ensuite mettre en place sur cette base des réformes servant leurs propres intérêts matériels.
La stratégie politique réformiste est une conséquence logique de sa vision de l’économie et de l’État. Les travailleurs, travailleuses et opprimés devraient concentrer leurs efforts à l’élection de politiciens réformistes. Puisque l’intervention étatique d’un gouvernement réformiste peut assurer la stabilité à long terme et la croissance, dans l’intérêt du capital et du travail, il n’y a pas de raison de croire que les employeurs s’opposeront obstinément à un gouvernement réformiste. Un tel gouvernement serait à même de prévenir des crises de sous-consommation en mettant en place des politiques budgétaires redistributives. Les crises de l’offre seraient elles aussi fortement limitées grâce à des commissions conjointes capital-travail régulées par l’État ayant pour objectif d’augmenter la productivité. Dans cette vision, sur la base d’une économie croissante et de plus en plus productive, l’État aurait les moyens d’augmenter continuellement ses dépenses publiques tout en régulant les négociations de conventions collectives pour assurer l’équité envers toutes les parties.
Pour les réformistes, il ne fait cependant aucun doute que les travailleurs et travailleuses doivent demeurer organisés et vigilants – surtout au sein de leur syndicat – et prêts à en découdre avec les capitalistes récalcitrants qui refuseront de se soumettre à l’intérêt commun : prêts à faire grève contre des employeurs qui refuseraient d’accepter de négocier, et prêts encore, dans le pire des cas, à se soulever en masse contre des coalitions capitalistes réactionnaires qui tenteraient de subvertir l’ordre démocratique. Ce n’est pas beaucoup s’avancer de dire que, pour autant que les réformistes les évoquent, ces batailles demeurent subordonnées à la lutte électorale et législative. Dans l’idéologie réformiste, ces luttes devraient s’atténuer avec le temps, dans la mesure où les politiques seraient menées non seulement dans l’intérêt des travailleurs et des opprimés, mais aussi dans l’intérêt des employeurs, bien que ces derniers n’aient pas la vue assez longue pour s’en rendre compte.
Une réponse politique au réformisme
Les révolutionnaires ont traditionnellement rejeté la méthode politique des réformistes, qui consiste à se fier au processus électoral-législatif et aux négociations collectives régulées par l’État, pour la simple et bonne raison qu’elle ne fonctionne pas. Aussi longtemps que les rapports de propriété capitalistes demeurent en place, l’État ne saurait être une instance autonome. La raison à cela n’est pas que l’État serait toujours sous le contrôle direct des capitalistes (les gouvernements travaillistes ou sociaux-démocrates, par exemple, ne le sont que rarement). C’est plutôt parce que quiconque contrôle l’État a des moyens extrêmement limités, dans la mesure où la force au gouvernement doit mener une politique compatible avec le maintien de la profitabilité capitaliste et que, à long terme, la profitabilité capitaliste est très difficile à réconcilier avec des réformes dans l’intérêt des exploités et des opprimés.
Dans une société capitaliste, il ne peut y avoir de croissance économique sans investissement, et les capitalistes n’investiront pas à moins de pouvoir obtenir un taux de profit qu’ils estiment adéquat. Puisque la baisse du chômage et l’extension des services publics à l’intention de la classe ouvrière (qui dépend des recettes fiscales) sont fondés sur la croissance économique, même les gouvernements qui souhaitent faire avancer les intérêts des exploités et des opprimés – par exemple des gouvernements sociaux-démocrates ou travaillistes – doivent faire de la profitabilité capitaliste et de la croissance économique leur priorité. Le vieux dicton « ce qui est bon pour General Motors est bon pour tout le monde » contient malheureusement un important fond de vérité, aussi longtemps que les rapports de propriété capitalistes demeurent en place.
Cela ne veut pas dire que les gouvernements capitalistes ne feront jamais de réformes. En période d’expansion économique, lorsque les taux de profit sont élevés, le capital et l’État sont bien disposés à accorder des gains à la classe ouvrière et aux opprimés, afin de maintenir l’ordre social. Toutefois, dans des périodes de déclin, lorsque les taux de profit sont plus faibles et que la concurrence s’intensifie, le coût (fiscal) de telles réformes peut mettre en danger la survie même de firmes. Les réformes ne sont que très rarement accordées en l’absence de luttes vigoureuses sur les lieux de travail et dans la rue. Par ailleurs, dans de telles périodes, les gouvernements de tout acabit – qu’ils représentent le capital ou le travail – s’ils ont refusé de rompre avec les rapports de propriété capitalistes, finissent par tenter de restaurer les taux de profit en coupant dans les salaires et les services sociaux, de baisser les impôts qui touchent les capitalistes, etc.
Économie politique et stratégie
L’idée que des périodes de crise prolongée sont inhérentes au capitalisme est d’une importance capitale pour les révolutionnaires, et la raison en est évidente. De ce point de vue, les crises découlent de la nature anarchique du capitalisme, qui suscite des sentiers d’accumulation contradictoires. Puisque, par sa nature même, une économie capitaliste opère de façon non-planifiée, les gouvernements ne peuvent prévenir les crises.
Ce n’est pas l’endroit approprié pour une discussion détaillée des débats portant sur la théorie des crises. On peut tout de même souligner que l’histoire du capitalisme étaye la vision non réformiste. Depuis la fin du XIXe siècle, pour ne pas remonter encore plus loin, peu importe le type de gouvernement en place, les longues périodes d’expansion capitaliste (des années 1850-1870, 1890-1913, 1940-1970) ont toujours été suivies de de longues périodes de dépression capitaliste (années 1870-1890, 1919-1939, 1970-aujourd’hui). L’une des contributions fondamentales d’Ernest Mandel dans les dernières années a été de mettre l’accent sur ce mode de développement capitaliste par longues vagues de boom et de déclin.
Lors des deux premières décennies de la période d’après-guerre, le réformisme et sa vision politique apparaissaient victorieux. La période d’expansion économique fut sans précédent, accompagnée par la mise en œuvre de mesures keynésiennes de soutien de la demande et d’une augmentation des dépenses gouvernementales associées à l’État providence. Toutes les économies capitalistes avancées ont non seulement connu une montée rapide des salaires, mais aussi une croissance du secteur public, dans l’intérêt des exploités et des opprimés.
Vers la fin des années 1960 et le début des années 1970, un certain nombre d’observateurs défendaient l’idée qu’améliorer les conditions de vie de la classe ouvrière impliquait de mener la « lutte des classes à l’intérieur de l’État » – c’est-à-dire de pousser à des victoires électorales et législatives de partis sociaux-démocrates et travaillistes (et du Parti démocrate aux États-Unis).
Les deux décennies suivantes ont radicalement invalidé cette perspective. La baisse des taux de profit a donné lieu à une crise de long terme de la croissance et des investissements. Dans ces conditions, les gouvernements réformistes qui ont accédé au pouvoir – le Parti travailliste à la fin des années 1970, les partis socialistes français et espagnol dans les années 1980, tout comme le Parti social-démocrate suédois dans ces mêmes années – se sont trouvés dans l’impossibilité de restaurer la prospérité à l’aide des méthodes habituelles de soutien de la demande, et ont conclu qu’ils n’avaient guère d’autre choix que de rétablir les taux de profits pour favoriser les investissements et restaurer la croissance. Le résultat fut le suivant : les partis réformistes ont, pratiquement sans exception, non seulement échoué dans la défense des salaires et du niveau de vie des travailleurs et travailleuses contre les attaques des employeurs, mais ont été à l’initiative d’une puissante vague d’austérité visant à augmenter le taux de profit aux dépens de l’État providence et des syndicats. Il ne saurait y avoir de réfutation plus définitive des théories économiques réformistes et de la notion d’autonomie de l’État. C’est précisément le fait que l’État n’a pu prévenir la crise capitaliste qui l’a révélé comme complètement dépendant du capital.
Pourquoi le réformisme est incapable de réformer
La question demeure : pourquoi les partis réformistes au pouvoir ont-ils continué à respecter les droits de propriété capitalistes et tenté de restaurer les profits capitalistes ? Pourquoi n’ont-ils pas plutôt cherché à défendre les conditions de vie et de travail de la classe ouvrière, par la lutte de classe si nécessaire ? Si cette approche était susceptible d’amener les capitalistes à arrêter d’investir ou à retirer leurs capitaux, pourquoi ne pas nationaliser les moyens de production et emboîter le pas vers le socialisme ? Nous revenons au paradoxe du réformisme. La réponse à la question se situe dans les forces sociales spécifiques qui dominent la politique réformiste : les responsables syndicaux et les politiciens sociaux-démocrates. L’élément distinctif de ces forces est que leur existence dépend d’organisations de la classe ouvrière, mais qu’elles ne font pas elles-mêmes partie de la classe ouvrière[1].
Cette catégorie sociale est précisément déconnectée de la réalité concrète du travail salarié. Sa base matérielle, son gagne-pain, se situe directement dans les syndicats ou l’organisation du parti. Ce n’est pas qu’une question de salaire (même si c’est un aspect important du problème). Le syndicat ou le parti façonne tout le mode de vie de ces individus – ce qu’ils font, leurs rencontres, etc. – tout comme leur trajectoire professionnelle. Par conséquent, leur position sociale et matérielle dépend de leur place au sein du syndicat et du parti. Aussi longtemps que l’organisation est viable, ils peuvent aspirer à une vie stable et des possibilités de carrière raisonnables.
Le gouffre qui sépare la forme de vie des salariés de base de celle d’un permanent syndical (et a fortiori d’un membre dirigeant) est donc énorme. La position économique – salaire, retraite, conditions de travail – des travailleurs et travailleuses ordinaires dépend directement du déroulement de la lutte de classes sur les lieux de travail et dans leur branche. Obtenir des victoires sur le plan salarial est leur seule manière de défendre leur niveau de vie. L’employé d’un syndicat, par contraste, peut bénéficier d’une situation confortable même en cas de défaites répétées dans la lutte de classes : il suffit que l’organisation syndicale survive. Il est vrai qu’à long terme, la survie même de l’organisation syndicale dépend de la lutte de classes, mais il est rare que ce soit un facteur important. Il se trouve en réalité qu’à court terme, surtout en période de crise où les taux de profit sont menacés, la lutte de classes est probablement la menace principale à la viabilité de l’organisation.
Dans la mesure où la combativité sociale est susceptible d’être suivie d’une répression du capital et de l’État qui menace la trésorerie et la survie même du syndicat, les responsables syndicaux cherchent généralement à l’éviter. Les syndicats et les partis réformistes ont donc, historiquement, tenté de tenir le capital en bride en composant avec lui. Ils ont fini par donner l’assurance au capital qu’ils acceptent le système de propriété capitaliste et la priorité des profits au sein des entreprises. Ils ont également cherché à s’assurer que les travailleurs et travailleuses n’adoptent pas des formes d’actions combatives et illégales, qui apparaîtraient au capital comme une menace et le pousserait à y réagir avec virulence. Or, dans la mesure où la perspective d’une lutte « radicale » est mise de côté comme moyen d’obtenir des réformes, la voie parlementaire devient une stratégie politique fondamentale pour les responsables syndicaux et les politiciens sociaux-démocrates. Par la mobilisation passive d’une campagne électorale, ces forces espèrent créer les conditions propices à la réforme, tout en évitant ce faisant de trop offenser le capital.
La thèse avancée ici ne revient pas à adopter la position absurde que les travailleurs et travailleuses sont toujours prêts à en découdre avec le grand capital, et ne sont retenus que par les tromperies de leurs directions politiques et syndicales. En réalité, les travailleurs et travailleuses sont souvent aussi conservateurs que ces dirigeants, voire davantage. Pour autant, il faut rappeler qu’à long terme et contrairement aux permanents syndicaux ou politiques, les travailleurs et travailleuses ne peuvent pas défendre leurs intérêts sans recourir à la lutte de classe. Et dans ce processus, pour les raisons évoquées plus haut, il se trouve que les responsables syndicaux sont le plus souvent des obstacles à cette action indépendante des travailleurs et travailleuses contre leurs employeurs. Bien entendu, ces dirigeants syndicaux et politiques ne sont pas dans leur totalité opposés à la lutte de classes et vont même parfois jusqu’à en prendre l’initiative. L’idée est simplement que, étant donné leur position sociale, la mobilisation ne saurait reposer sur eux, et ce quelque soit le degré de radicalisme de leur rhétorique.
C’est à partir de cette analyse, selon laquelle on ne saurait compter sur les responsables syndicaux et les politiciens sociaux-démocrates pour mener à bien la lutte de classes, que s’élabore notre stratégie visant à construire des organisations de base qui soient indépendantes des responsables syndicaux (bien qu’elles puissent travailler avec eux), et à envisager la création d’un parti politique ouvrier indépendant des démocrates.
Le réformisme et l’unité
Notre compréhension du réformisme n’est pas qu’un exercice universitaire : elle a des conséquences sur l’ensemble de nos initiatives politiques. On le voit clairement aujourd’hui au travers les tâches de regroupement des forces antiréformistes au sein d’une organisation commune et en rupture avec le Parti démocrate. Depuis plusieurs années, les perspectives de coalition avec des forces de gauche (plus ou moins organisées) sont liées à ces individus et groupes qui se positionnent à gauche du réformisme officiel et sont en rupture avec lui. Il s’avère pourtant qu’un certain nombre de ces forces de gauche continuent de s’identifier, implicitement ou explicitement, à une approche de la politique qu’on pourrait appeler, un peu crûment, « front populiste ».
Bien qu’elle soit née à l’extérieur du camp de la social-démocratie organisée, la doctrine des fronts populaires donne une portée systématique au réformisme. L’Internationale communiste a été la première à faire la promotion de l’idée d’un front populaire en 1935, en complément de la politique étrangère soviétique visant à former une alliance avec les pouvoirs capitalistes « libéraux » pour se défendre contre l’expansionnisme nazi (« sécurité collective »). Dans ce contexte, les communistes ont avancé, à l’international, l’idée qu’il était possible pour la classe ouvrière de forger une alliance interclasse très large, non seulement avec la classe moyenne libérale, mais aussi avec une section éclairée de la classe capitaliste, et ce dans l’intérêt de la démocratie, des libertés civiles et de la réforme sociale.
L’hypothèse fondamentale de cette stratégie était qu’une section éclairée de la classe capitaliste préférait un ordre constitutionnel à un ordre autoritaire, et que cette frange était prête à consentir à une intervention gouvernementale plus soutenue, à davantage d’égalitarisme, dans une optique « progressiste » (liberal) avec un objectif général de cohésion sociale. Comme d’autres doctrines réformistes, le front populaire se basait, sur le plan économique, sur une théorie de la crise en terme de « sous-consommation ». Cette théorie de la sous-consommation était en fait très répandue dans les cercles « progressistes » et socialistes-radicaux au cours des années 1930, gagnant encore davantage en popularité avec le succès des idées de Keynes. Aux États-Unis, le front populaire se devait d’investir le Parti démocrate. L’administration Roosevelt, qui comptait un certain nombre d’éléments relativement progressistes, était considérée comme l’archétype de l’aile capitaliste éclairée. L’impératif de travailler avec les démocrates n’a semblé que plus justifié dans la mesure où, au même moment, le mouvement ouvrier devenait une force d’ampleur dans tout le pays. Au départ, les communistes ont été les fers de lance de l’organisation syndicale CIO, et ont grandement contribué à son succès spectaculaire dans le secteur automobile en adoptant, pour une période brève mais décisive (1935-début 1937), une stratégie d’organisation depuis la base. Le corrélât de cette stratégie à un niveau politique était le refus des communistes de soutenir Roosevelt au cours de ces premières années.
À partir de 1937, à l’issue de l’adoption par l’Internationale communiste de la doctrine des « fronts populaires » et de son impératif de ne pas s’aliéner l’administration Roosevelt, le Parti communiste a dû faire obstacle à la combativité des travailleurs et travailleuses (grèves sur le tas, grèves sauvages) : il s’agissait de reconduire la politique sociale-démocrate classique de s’allier avec l’aile « gauche » des responsables syndicaux. Cette politique était en clair retrait par rapport à l’idée que les responsables syndicaux constituent une couche sociale distincte dont on doit attendre qu’elle place les intérêts de leurs organisations au-dessus de ceux de leur base – une hypothèse pourtant au cœur de la stratégie de la gauche du mouvement social-démocrate avant la Première Guerre mondiale (Luxembourg, Trotski, etc.), ainsi que de la Troisième Internationale au temps de Lénine.
L’application du front populisme par le PC impliquait de différencier les responsables syndicaux en terme de ligne politique (gauche, centre, droite) et non plus en terme de division cadres syndicaux/base. Cette approche était absolument constitutive de l’objectif des communistes consistant à pousser les nouveaux syndicats industriels à entrer au Parti démocrate. Bien entendu, la majorité des représentants syndicaux n’étaient que trop heureux de mettre l’accent sur leur rôle politique au sein de l’aile réformiste émergente du Parti démocrate, surtout en comparaison avec leur rôle économique beaucoup plus dangereux consistant à organiser leurs membres et à lutter contre les offensives patronales. La politique duelle de s’allier aux représentants « de gauche » à l’intérieur du mouvement syndical, et de travailler pour la réforme à l’aide de moyens électoraux et législatifs au sein du Parti démocrate (avec un peu de chance aux côtés des leaders syndicaux progressistes) demeure jusqu’à ce jour très attirante pour une grande partie de la gauche.
Une perspective par et pour la base
Au cours des années 1970 dans les syndicats, les représentants des tendances qui ont fini par se retrouver au sein du groupe Solidarity ont eu à s’opposer à l’idée des front populaires partagée par divers courants de la gauche radicale, impliquant d’appuyer les dirigeants « progressistes » existants. Notre point de vue était alors en opposition avec l’idée que les responsables syndicaux progressistes seraient obligés de se ranger à gauche et de s’opposer aux employeurs, ne serait-ce que pour défendre leur propre organisation. La gauche révolutionnaire était au contraire convaincue que, précisément en raison de la virulence de l’offensive patronale, les responsables syndicaux seraient pour la plupart prêts à faire des concessions substantielles afin de contourner l’affrontement avec les employeurs. Le démantèlement morceau par morceau du mouvement ouvrier était dès lors loisible de se poursuivre indéfiniment.
Cette dernière perspective s’est plus que confirmée, les responsables syndicaux ne levant pas le petit doigt alors que l’étendue des concessions atteignait des proportions désastreuses et que le taux de syndicalisation passait de 25-30 % dans les années 1960 à 10-15 % aujourd’hui.
En outre, les révolutionnaires au sein du mouvement syndical devaient riposter à l’idée que les leaders syndicaux étaient « à gauche de leur base ». Si vous parliez avec des militants de la gauche radicale à cette époque, vous étiez sûr d’entendre à un moment ou un autre que la base était politiquement arriérée. Après tout, plusieurs syndicats « progressistes » se sont opposés à l’intervention américaine en Amérique centrale (et ailleurs) plus fermement que leurs membres, se sont affirmés plus fermement que leurs membres sur la question de l’extension de l’État providence, et se sont même prononcés, dans quelques cas, pour un Parti des travailleurs indépendant. Notre réponse à cet argument était de montrer le contraste entre ce que les leaders syndicaux « progressistes » étaient prêts à faire en parole sur le plan « politique », où très peu est en jeu, avec ce qu’ils étaient prêts à faire contre les patrons, où ils risquaient réellement leur peau. Il n’en coûtait pas grand-chose au dirigeant de l’IAM William Winpisinger d’être membre de la Democratic Socialist Association (DSA) et de se réclamer d’un projet de société social-démocrate absolument clair sur des questions telles que la reconversion de l’économie, le système de santé national, et autres.
Mais lorsqu’il était question de la lutte des classes, nous faisions remarquer que, non seulement Winpisinger s’est clairement prononcé contre les Teamsters pour un syndicat démocratique, mais a envoyé ses machinistes traverser le piquet de grève lors de la grève cruciale de la PATCO (les contrôleurs aériens).
Dans la dernière décennie, plusieurs courants de la gauche radicale ont rompu leurs liens avec l’Union Soviétique ou la Chine et se sont engagés dans un réexamen complet de leur vision politique du monde. Mais cela ne signifie pas qu’ils se dirigeront automatiquement vers nous, puisque leur stratégie politique de front populaire est semblable à ce que nous avons décrit sous le terme de « réformisme ». Si nous voulons convaincre ces camarades de se joindre à nous, nous devons leur démontrer, systématiquement et en détail, que leur stratégie traditionnelle consistant à travailler avec les « gauches » syndicales et à infiltrer le Parti démocrate est en fait contre-productive.
L’action politique indépendante
À certains moments au cours de la campagne électorale, des éléments importants du mouvement des Noirs, du mouvement des femmes, et même du mouvement ouvrier, ont déclaré qu’ils aimeraient qu’une alternative politique viable au Parti démocrate puisse voir le jour. Leurs intentions semblaient rendre la construction d’une force politique indépendante soudainement beaucoup plus concrète. Ces franges sont désormais indispensables à n’importe quelle tentative de recomposition à gauche des démocrate, pour la simple et bonne raison que la grande majorité des Noirs, des femmes et des militants ouvriers combatifs s’en remettent, en matière de direction politique, à eux et à personne d’autre. Mais ces franges ont-elles une attitude réaliste au regard de cette exigence d’agir de façon autonome ?
En un certain sens, il est évident que toutes ces forces ont besoin d’une action politique autonome. Le Parti démocrate a depuis trop longtemps mis toute son initiative dans des mesures qui visent à rétablir les taux de profit, aux dépens des intérêts des travailleurs, des femmes, et des minorités opprimées. Il a donc perdu de son utilité pour les directions établies des syndicats, des mouvements noirs et des femmes, qui, après tout, travaillent auprès des démocrates pour obtenir des gains en faveur de leurs membres.
Les directions officielles de ces mouvements aimeraient donc sans doute qu’il y ait un troisième parti qui soit viable. Mais c’est le paradoxe de leur couche sociale et de leur politique réformiste : ils sont incapables de faire le nécessaire pour créer les conditions propices à la naissance d’un tel parti. Il est en effet difficile de réunir ces conditions sans une revitalisation des mouvements sociaux, et surtout du mouvement ouvrier – à travers une le renforcement d’une ligne combative et unitaire au sein du mouvement syndical et au-delà. Des mouvements de masse nouvellement dynamisés pourraient fournir une base matérielle pour transformer une conscience politique émergente en un troisième parti capable de succès électoraux. Mais les directions établies ont peur de susciter de tels mouvements.
D’autre part, en l’absence d’une rupture profonde dans l’activité et la conscience des mouvements de masse, il n’y a aucune raison pour que les directions établies rompent leurs liens avec le Parti démocrate. La voie électorale est pour eux un élément indispensable : il s’agit du meilleur moyen dont ils disposent pour obtenir des gains en faveur de leurs membres. Et la condition sine qua non pour obtenir quoique ce soit par la voie électorale est bien évidente : il faut gagner. Sans victoire électorale, rien n’est possible. Le problème est que dans un futur proche, aucun troisième parti n’a de chance de gagner. Le niveau de conscience politique n’est pas suffisamment élevé pour cela. En outre, les troisièmes partis sont particulièrement désavantagés dans notre pays en raison du système présidentiel. Dans cette situation, les directions établies des mouvements ouvriers, des Noirs et des femmes sont dans une impasse : ils ne peuvent rompre avec les démocrates avant que les conditions soient propices à ce qu’un troisième parti puisse faire des gains électoraux ; mais ils ne peuvent créer les conditions pour un troisième parti sans mettre de côté, probablement pour une période conséquente, leurs méthodes établies pour faire des gains par la voie électorale.
Ce n’est malheureusement pas du tout surprenant que des partisans parmi les plus sérieux d’une rupture vers un troisième parti au sein des directions établies de ces mouvements – notamment au sein du mouvement des femmes – se soient montrés beaucoup moins intéressés par « leur propre » parti du XXIe siècle que par les candidatures démocrates de Carole Moseley Braun, Barbara Boxer, et même Dianne Feinstein. Tout hypothétique renouveau du mouvement ouvrier, des mouvements sociaux et de la gauche, et tout projet de construire un nouveau parti à gauche des démocrates, dépendra d’une rupture – et d’une confrontation – avec les forces sociales et politiques qui sous-tendent le réformisme.
Traduit de l’anglais par Jonathan Martineau.
Notes
[1] Pour un examen sociologique et historique plus détaillé de cet argument, voir « The Paradox of Social Democracy: the American Case » in Mike Davis, Fred Pfeil, and Michael Sprinker (eds). The Year Left: an American Socialist Yearbook 1985. Vol. 1. Londres & New York: Verso. pp. 33-86 [ ]
]
Celia Izoard, l’autrice de « La ruée minière au XXIe siècle », en tournée au Québec
Jour 414 de la guerre – Beyrouth, de nouveau frappée en plein cœur
Les politiciens de l’Ontario augmentent les subventions… à eux-mêmes
La tension monte au mégacentre de tri du courrier à Montréal
La fin du néolibéralisme préfigure la montée du fascisme
Solidarité féministe : 16 jours d’action pour agir contre les violences de genre
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.











