Derniers articles
Grève chez Postes Canada
FSMÉT 2024 en Colombie : le rendez-vous des économies populaires, sociales et solidaires
Une activité des JQSI témoigne de l’impact de l’extractivisme au Honduras au Guatemala et au Chiapas
Une austérité mal déguisée menace le transport en commun, selon les travailleurs

Gaza, Israël, USA : angle mort de l’acclamée lauréate du prix Pulitzer 2024 Anne Applebaum

Penguin Random House, juillet 2024
Je viens de terminer la lecture de ce livre récent fort intéressant et bien documenté.
Plus j'avançais dans ma lecture de ce bestseller, cependant, plus je sentais que l'analyse de l'autrice, si impressionnante soit-elle, souffrait d'une lacune.
Ovide Bastien
Et non pas une lacune quelconque. Une immense lacune, qui, dans le contexte du génocide présentement perpétré par Israël à Gaza, et ce, avec l'appui indéfectible de son grand allié étatsunien, invalide, à toutes fins pratiques, une bonne partie de la thèse principale de son livre.
La thèse principale du livre Autocracy, Inc.
De nos jours, affirme Applebaum, les autocraties sont dirigées par des réseaux sophistiqués s'appuyant sur des structures financières kleptocratiques, un ensemble de services de sécurité - militaires, paramilitaires, policiers - et des experts technologiques qui assurent la surveillance, la propagande et la désinformation.
Et quelles sont, selon elle, ces autocraties ? Parmi elles, on trouve des régimes qui ont des racines historiques et objectifs fort différents. Le communisme chinois et le nationalisme russe, par exemple, diffèrent non seulement l'un de l'autre mais aussi du socialisme bolivarien du Venezuela, du Juche de la Corée du Nord ou du radicalisme chiite de la République islamique d'Iran. Et ces derniers diffèrent tous des monarchies arabes et autres autocraties - Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Vietnam - qui, pour la plupart, ne cherchent pas à saper le monde démocratique. Ils se distinguent également des autocraties plus douces et des démocraties hybrides - Turquie, Singapour, Inde, Philippines, Hongrie - qui tantôt s'alignent sur le monde démocratique et tantôt non.
Ce groupe d'autocraties, poursuit Applebaum, ne fonctionne pas comme un bloc mais plutôt comme une agglomération d'entreprises, liées non pas par une idéologie mais plutôt par la ferme et unique détermination de préserver richesse personnelle et pouvoir.
Les membres de ces réseaux sont connectés non seulement entre eux au sein d'une autocratie donnée, mais aussi avec des réseaux d'autres pays autocratiques, et parfois aussi avec certaines démocraties. Entreprises corrompues que contrôle l'État d'une dictature font affaire avec entreprises corrompues que contrôle l'État d'une autre dictature. La police d'un pays arme, équipe et forme la police d'un autre pays. Le propagandiste d'un dictateur partage ses ressources, fermes à trolls et réseaux médiatiques avec un autre dictateur. Et même le message à propager est partagé : les autocraties représenteraient ordre et stabilité, alors que les démocraties ne représenteraient que dégénérescence et instabilité, et Washington le mal incarné.
Au lieu d'idées, les hommes forts qui dirigent la Russie, la Chine, l'Iran, la Corée du Nord, le Venezuela, le Nicaragua, l'Angola, le Myanmar, Cuba, la Syrie, l'Azerbaïdjan et peut-être trois douzaines d'autres pays, ont en commun la volonté de priver leurs citoyens de toute influence réelle ou de toute voix publique, affirme Applebaum. Ils s'opposent à toute forme de transparence ou de responsabilité et répriment toute personne, dans leur pays ou à l'étranger, qui ose les défier.
Ces autocrates partagent également une approche brutalement pragmatique par rapport à la richesse. Contrairement aux dirigeants fascistes et communistes du passé, qui étaient soutenus par les machines du parti et ne faisaient pas étalage de leur cupidité, ces autocrates structurent ouvertement une partie importante de leur collaboration comme entreprises à but lucratif et ne montrent souvent aucune gêne à vivre dans des résidences opulentes. Ce sont des accords ou ‘deals', et non pas des idées, qui cimentent les liens entre eux et avec leurs amis du monde démocratique. Des accords visant à atténuer les sanctions, à échanger des technologies de surveillance, et à s'entraider pour s'enrichir.
Les autocrates collaborent aussi pour se maintenir au pouvoir, poursuit Applebaum. On sait que depuis 2008, les États-Unis, le Canada et l'Union européenne renforcent les sanctions contre le Venezuela en réponse à la brutalité du régime et ses liens avec le trafic de drogue et le crime organisé international. Cependant, les amis autocrates du régime Maduro lui viennent au secours, neutralisant l'impact de ces sanctions. La Russie lui accorde des prêts et investit, comme l'Iran d'ailleurs, dans l'industrie pétrolière vénézuélienne. Une entreprise biélorusse assemble des tracteurs au Venezuela. La Turquie facilite le commerce illicite de l'or vénézuélien. Cuba fournit, et ce depuis longtemps, des conseillers en sécurité et des technologies de sécurité à ses homologues de Caracas. La Chine fournit à Maduro canons à eau, bombes lacrymogènes et boucliers qui seront utilisés pour écraser les manifestants de rue à Caracas en 2014, et à nouveau en 2017. La Chine fournit aussi au Venezuela la technologie de surveillance nécessaire pour surveiller la population. Pendant ce temps, les hauts placés du régime Maduro, grâce au trafic international de stupéfiants, continuent d'être bien approvisionnés en Versace et en Channel.
Cette étroite collaboration internationale fait en sorte que même si des autocrates comme Alexandre Loukachenko en Biélorussie, ou Nicolas Maduro au Venezuela, sont largement méprisés dans leurs pays respectifs ; même si tous deux seraient perdants face à des élections libres, si jamais de telles élections avaient lieu ; et même si tous deux font face à de puissants mouvements d'opposition qui pourraient normalement les renverser, ils demeurent néanmoins solidement ancrés au pouvoir.
Car ces mouvements d'opposition ne luttent pas seulement contre les autocrates de leur propre pays, poursuit Applebaum. Ils luttent contre les autocrates du monde entier qui contrôlent des entreprises publiques qui peuvent venir à l'aide de leurs amis autocrates en procédant à des investissements à coup de milliards de dollars ; en leur vendant caméras de sécurité et robots de fabrication chinoise. Aussi et surtout, ils combattent des autocrates qui ont appris, et ce depuis longtemps, à se foutre éperdument des sentiments et opinions de leurs compatriotes, ainsi que des sentiments et opinions du monde entier. Le groupe de pays autocratiques offre à ses membres non seulement argent et sécurité ; il lui offre aussi quelque chose de moins tangible mais sans doute encore plus important : l'impunité.
Autrefois, poursuit Applebaum, les autocraties s'inquiétaient beaucoup de la façon qu'elles étaient perçues sur le plan international. C'était le cas, par exemple, de l'Union soviétique, l'autocratie la plus puissante de la seconde moitié du XXe siècle. Aujourd'hui cependant, ce n'est plus le cas. Les autocrates actuels les plus radicaux se foutent éperdument de l'opinion des autres nations. Ils croient que l'opinion internationale n'a aucune importance et qu'aucun tribunal de l'opinion publique ne les jugera jamais. Les dirigeants de l'Iran ignorent avec assurance les opinions des infidèles occidentaux ; ceux de Cuba et du Venezuela considèrent les critiques de l'étranger comme la preuve d'un vaste complot impérial organisé contre eux. Et ceux de la Chine et de la Russie ont passé une décennie à contester le langage des droits de l'homme utilisé par les institutions internationales, réussissant à convaincre de nombreuses personnes dans le monde que les traités et les conventions sur la guerre et le génocide - et des concepts tels que « libertés civiles » et « État de droit » - incarnent des idées occidentales qui ne s'appliquent pas à eux, affirme Applebaum.
Arguments du livre qui semblent valides
On peut difficilement nier la validité de plusieurs aspects de la thèse présentée dans Autocracy, Inc. Cela explique sans doute pourquoi il est rapidement devenu un best-seller.
En voici quelques-uns.
Depuis le soulèvement populaire massif d'avril 2018 contre le régime Ortega-Murillo au Nicaragua, je suis devenu de plus en plus critique d'une certaine gauche radicale qui persiste à qualifier ce gouvernement de progressiste, socialiste et révolutionnaire. Et qui fait sienne le narratif du régime selon lequel la droite nicaraguayenne, financée et orchestrée par le méchant impérialisme étatsunien, aurait orchestré une tentative de coup d'État contre lui.
Ayant séjourné pendant plus de 18 ans consécutifs au Nicaragua, la plupart du temps accompagnant un groupe d'étudiants du Collège Dawson lors de leur stage d'un mois ; ayant donné chaque année aux futures stagiaires un cours de 45 heures sur le Nicaragua, je connais fort bien ce pays.
Voir la répression brutale utilisée par le régime Ortega-Murillo pour écraser les immenses manifestations qui secouaient pendant des mois le pays entier, une répression qui faisait plus de 320 morts et de milliers de blessés ; voir comment le régime éliminait systématiquement toute presse indépendante, emprisonnait, et soumettait à la maltraitance et souvent à la torture tous les dissidents, même d'anciens héros sandinistes avec lesquels Daniel Ortega avait collaboré étroitement pour vaincre la dictature de Somoza ; voir comment Cuba, le Venezuela, la Russie, la Chine, et l'Iran offraient immédiatement leur appui à Ortega-Murillo : tout cela me secouait et m'ébranlait profondément, me plongeant dans une crise émotionnelle.
Une crise émotionnelle qui, pour moi, était d'autant plus déchirante que la plupart des Nicaraguayens et Nicaraguayennes avec lesquelles j'avais collaboré pendant ces 18 ans – campesinos, enseignants, maires, médecins, membres d'ONGs, etc. - étaient des adeptes du gouvernement Ortega-Murillo, et que j'avais développé avec eux une profonde amitié.
Afin de voir plus clair, afin de me retrouver dans tout cela, j'ai donc entamé une recherche dans laquelle je tentais de présenter, le plus objectivement possible, le point de vue des masses nicaraguayennes qui se soulevaient contre le régime Ortega-Murillo, et celui de ce dernier, qu'appuyait fermement une partie la gauche internationale, surtout en Amérique latine.
À l'automne 2018, je publiais le résultat de cette recherche dans Racines de la crise : Nicaragua 2018.
La crise nicaraguayenne, et ma démarche pour la décortiquer, m'amenaient à affirmer l'urgence, pour une certaine gauche plus radicale, de sortir de son aveuglement. Comment peut-on continuer à qualifier de progressiste et révolutionnaire un gouvernement, qui, pour se maintenir au pouvoir, n'hésite pas à écraser impitoyablement le peuple ? Comment peut-on présenter comme anti-impérialiste et espoir pour les marginalisés de la planète, un gouvernement qui penche de plus en plus vers l'autocratie, voire la dictature, et qui est dirigé par un homme et sa conjointe, lesquels octroient à leurs nombreux enfants les postes clés du gouvernement et deviennent rapidement la famille la plus riche du pays ?
Lorsque la Russie envahissait l'Ukraine le 24 février 2022, je vivais un autre questionnement difficile. Plusieurs de mes amis dans la gauche, surtout des Latino-américains, avaient tendance à placer le gros du blâme, non pas sur l'esprit impérialiste et colonialiste de Poutine, mais carrément sur l'expansion de plus en plus menaçante de l'OTAN, une expansion propulsée surtout par Washington. Même si ce point de vue me paraissait avoir un certain fondement, je trouvais qu'on exagérait carrément le pouvoir de Washington dans tout cela, et qu'on ignorait, à toutes fins pratiques, la volonté à maintes fois exprimée par la population des pays qui s'étaient graduellement joints à l'OTAN. Le fait qu'une partie de l'extrême droite, surtout chez les Républicains aux Etats-Unis, adoptait le même point de vue que cette gauche qui focalisait sur l'OTAN, ne faisait qu'accroitre mes doutes à cet égard.
En décembre 2022, je n'étais pas du tout étonné de voir que, sur 195 pays membres, le régime Ortega-Murillo, la Syrie, la Corée du nord, et la Biélorussie étaient les seuls à voter contre la motion de l'Assemblée générale de l'ONU condamnant l'annexion par la Russie des quatre territoires qu'elle venait d'envahir en Ukraine.
Applebaum dénonce le caractère autocratique, répressif, et corrompu du régime Maduro au Venezuela. La fraude monumentale que nous avons tous vu dans les dernières élections vénézuéliennes, une fraude qui est même reconnue par de nombreux pays latinoaméricains progressistes, semble lui donne raison.
Applebaum dénonce la répression brutale par la Chine des Ouighours. Elle dénonce l'Iran pour son oppression des femmes, pour sa répression brutale des dissidents, pour ses actions terroristes, en particulier ses assassinats de dissidents.
Ce n'est qu'un petit échantillon d'une abondance de faits troublants que documente fort bien Autocracy, Inc.
L'angle-mort de la lauréate du prix Pulitzer 2024
Tout cela étant reconnu, j'en viens maintenant à ce qui m'amenait, plus j'avançais dans ma lecture, à douter de plus en plus de la validité de la thèse principale du livre. À percevoir que celle-ci souffrait d'un angle-mort. Non seulement d'une lacune quelconque, mais d'une lacune qui, en quelque sort, remettait en question sa validité.
En lisant Autocracy, Inc., il devient vite évident que, selon Applebaum, les puissances occidentales, et bien sûr les États-Unis, représentent État de droit, libertés civiles, ordre international fondé sur les règles, respect des droits humains, respect des Nations unies, respect des traités et conventions sur la guerre et le génocide, etc.
Par ailleurs, Applebaum ne cesse de nous rappeler tout au long du livre que les pays qu'elle qualifie d'autocraties ne reconnaissent pas ces mêmes valeurs. Qu'ils les rejettent même, les qualifiant d'idées purement occidentales.
Le 20 novembre 2024, le Conseil de sécurité des Nations unies tenait une autre réunion sur Gaza. Celle-ci fut convoquée, à la demande, cette fois, des onze membres élus de ce conseil. Une motion de cessez-le-feu, élaborée pendant des semaines, et adoucie pour plaire aux Etats-Unis, fut proposée. Il était question d'imposer des sanctions à Israël si elle n'acquiesçait pas au cessez-le-feu. Par esprit de compromission, on accepte d'enlever cette clause que rejetait Washington.
La motion demande à la fois un cessez-le-feu inconditionnel et permanent à Gaza et la libération par le Hamas de tous les otages israéliens.
Aucun des 15 membres s'abstient, et tous, sauf le grand allié indéfectible d'Israël, les États-Unis, votent en faveur.
Depuis l'invasion israélienne de Gaza, qui en est maintenant à son 412ième jour, c'est la quatrième fois que Washington utilise son véto pour empêcher l'adoption d'une motion de cessez-le-feu !
Au moment où Applebaum publiait Autocracy, Inc. en juillet dernier, certains experts en santé publique estimaient que si on tient compte des effets indirects d'une guerre – épidémies, absence de soins médicaux, destruction de l'infrastructure permettant la production, etc. - l'assaut israélien de Gaza qui débutait en octobre 2023 finirait par tuer, même si cette guerre se terminait immédiatement en juillet, au moins 180 000 Palestiniens et Palestiniennes.i
Environ 70 % des victimes – au 24 novembre il y en a plus de 44 000 – sont, selon le ministère de Santé du Hamas, des enfants et femmes, dont plus de 700 bébés. Ce que semble confirmer le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH) dans le rapport qu'il publiait le 8 novembre, après avoir vérifié 8 119 des plus de 34 500 personnes qui auraient été tuées au cours des six premiers mois de la guerre. Dans l'ensemble, affirme ce rapport, 44 % des victimes étaient des enfants, la catégorie la plus importante étant celle des 5 à 9 ans, suivie de celle des 10 à 14 ans, puis de celle des 4 ans et moins. Ce qui se passe à Gaza, poursuit le rapport, revêt toutes les caractéristiques d'un génocide.ii
Le nombre de blessés à Gaza dépasse présentement 104 000. Les bombardements sans relâche d'Israël ont obligé l'immense majorité des 2 millions de survivants de se déplacer à plusieurs reprises dans une bande de Gaza devenu inhabitable, et où on n'observe un peu partout que décombres et ordures. Depuis plus de 40 jours, Israël se sert de plus en plus de la faim comme arme de guerre, surtout dans le nord de Gaza. Une stratégie militaire que dénonce de façon répétée les Nations unies, ainsi que toutes les ONGs. En janvier, la Cour internationale de justice estimait plausible qu'un génocide avait lieu à Gaza et entamait une enquête.
Dans une situation aussi apocalyptique, où, chaque jour sur nos écrans on voit en direct des scènes déchirantes, où on voit le peuple palestinien s'enfoncer de plus en plus dans un enfer qui dépasse l'entendement, le représentant étatsunien au Conseil de sécurité de l'ONU, Robert Wood, prend la parole pour expliquer pourquoi son pays rejette, pour la quatrième fois consécutive, la motion de cessez-le-feu.
« Selon nous, affirme Wood, la motion est inacceptable. Il aurait fallu que le cessez-le-feu soit conditionnel à la libération des otages israéliens. »
Une astuce sémantique digne d'un monstre impérialiste qui veut que le carnage se poursuive ! Même les familles des otages réclament depuis des mois un cessez-le-feu ! C'est pourquoi ils manifestant massivement dans les rues de Tel Aviv.
Quelques jours plus tôt, Washington avait recours à une autre astuce sémantique afin de permettre à Israël de poursuivre sa campagne de destruction et de tuerie.
On sait que la Maison Blanche écrivait une lettre étonnante à Israël le 13 octobre dernier. Sans doute pour donner un petit coup de pouce à Kamala Harris, qui risquait de perdre le vote du secteur plus progressiste, et surtout arabe, du parti démocrate, on permettait que cette lettre, grâce à une fuite, devienne publique. Dans cette lettre, Washington exprime une profonde inquiétude au sujet de la situation humanitaire de plus en plus catastrophique à Gaza ; elle dénonce l'absence d'aide humanitaire et accorde à Israël 30 jours (comme par hasard, exactement quelques jours après la tenue des élections étatsunienne !) pour remédier à la situation, précisant même une série de mesures qu'Israël doit prendre pour augmenter substantiellement l'aide humanitaire, la plus spectaculaire de celles-ci étant un minimum de 350 camions d'aide entrant à Gaza chaque jour ; enfin, Washington menace de couper de façon substantielle son soutien militaire à Israël si elle n'accomplit pas ce qui est demandé.
Grande surprise, un mois plus tard, le 13 novembre... Même si Israël, dans le délai qui lui a été accordé, n'a permis que 57 camions d'aide en moyenne entrent à Gaza quotidiennement ; même si tous les ONGs ainsi que les Nations Unies voient bien qu'Israël n'a pas du tout augmenté de façon substantielle l'aide humanitaire à Gaza et nous avertissent que la plupart des Gazaouis, surtout dans le nord, font face à une famine imminente...
Que fait l'administration Biden ?
Elle a recours à une astuce sémantique pour justifier la poursuite de son soutien militaire à Israël.
« Nous constatons que toutes les mesures exigées n'ont pas été parfaitement respecté » affirme-elle. « Cependant, nous sommes satisfaits du progrès réalisé dans l'accroissement de l'aide humanitaire ! »
Autrement dit, le président Biden accorde encore une fois le feu vert à son allié...
Que se poursuive la campagne de carnage et destruction !
Au lendemain de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, soit le 21 novembre, la Cour pénale internationale émet un mandat d'arrêt contre le premier ministre d'Israël, Benjamin Nétanyahou, et son ex-ministre de la Défense, Yoav Gallant (aussi contre un leader du Hamas qu'Israël aurait supposément déjà assassiné). Les deux sont accusés de crimes contre l'humanité, notamment de l'utilisation de la famine comme arme de guerre, de meurtre, et d'autres actes inhumains. La cour estime aussi qu'il existe des motifs raisonnables de penser que le siège israélien de Gaza « a créé des conditions de vie calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la population civile ».
Cela veut dire que si ces deux leaders israéliens se rendent dans un des 124 pays qui reconnaissent la Cour pénale internationale, ils risquent d'être immédiatement détenus et soumis à un procès devant cette cour.
La réaction du Premier ministre Nétanyahou à ces mandats d'arrêt : mensonges éhontés, pur antisémitisme !
La réaction de Washington va dans le même sens :
« Ces mandats d'arrêt sont révoltants, » déclare le Président Joe Biden. « Quoi que la CPI puisse laisser entendre, il n'y a absolument pas d'équivalence entre Israël et le Hamas. Nous défendrons toujours Israël contre les menaces qui pèsent sur sa sécurité ».
J'en reviens maintenant à ce que je qualifie d'énorme angle-mort dans le livre Autocracy, Inc. Un angle-mort à mon sens impardonnable.
Dans son livre, Applebaum mentionne l'attaque brutale d'Israël par le Hamas le 7 octobre 2023, se réfère souvent à l'Iran et aux proxys de ce dernier : le Hamas à Gaza, le Hezbollah au Liban, et les Houthis au Yémen. Tous, selon elle, seraient horriblement terroristes, et tous seraient étroitement liés à l'ensemble des autocraties.
À la page 155 de son livre, Applebaum écrit :
« Les autocraties suivent les défaites et les victoires des uns et des autres, programmant leurs propres actions pour créer un maximum de chaos. À l'automne 2023, l'Union européenne et le Congrès américain se sont trouvés dans l'incapacité d'envoyer de l'aide à l'Ukraine parce que des minorités ayant des liens profonds avec la Russie, dirigées respectivement par Victor Orban en Hongrie et par une poignée de Républicains Maga au Congrès, agissant sous les instructions de Donald Trump, ont bloqué la majorité et retardé l'aide. Un récit promouvant la « fatigue de l'Ukraine » s'est répandu sur Internet, poussé par des mandataires russes et des médias chinois en plusieurs langues. C'est à ce moment précis que les militants du Hamas, soutenus par l'Iran, ont lancé une attaque brutale contre Israël. Dans les semaines qui ont suivi, les militants houthis soutenus par l'Iran ont commencé à tirer sur des pétroliers et des cargos en mer Rouge, perturbant le commerce mondial et détournant l'attention des États-Unis et de l'Europe de la guerre en Ukraine. »
Tout semble donc se passer, selon Applebaum, comme si l'attaque d'Israël par le Hamas était une chose orchestrée. « C'est à ce moment précis, » dit-elle. Idem pour les attaques par les militants houthis de pétroliers et cargos en mer Rouge. Orchestrée par une bonne partie des autocraties, y inclus « une poignée de Républicains Maga au Congrès », qui veulent détourner l'attention de la guerre en Ukraine.
Tout semble se passer comme si Israël, partie intégrale des pays démocratiques occidentaux, devenait soudainement la cible des méchantes autocraties à tendance terroriste. Rien de plus.
J'avais remarqué que si Applebaum se permettait, à un moment donné, de lancer une flèche contre le gouvernement archi-conservateur de Nétanyahou, laissant entendre que ce dernier ignorait parfois les droits humains, elle faisait cependant sienne le narratif sioniste selon lequel Israël, dans son développement historique, se comportait de façon tout à fait démocratique. Les troubles, elle laissait entendre, avaient commencé avec l'attaque brutale du Hamas, mouvement religieux fanatique et fondamentalement terroriste, qui agissait de concert avec les autocraties.
Je n'ai pas vu un seul mot dans son livre au sujet de la guerre génocidaire qui se déroule à Gaza. Je n'ai pas entendu un seul mot non plus au sujet de cette guerre dans les conférences qu'elle donnait sur son livre dans les semaines suivant sa publication en juillet dernier. Du moins pas celles que j'ai moi-même écoutées sur YouTube.
Il n'y a pas un seul mot dans son livre sur l'oppression coloniale et on ne peut plus brutale dont souffre le peuple palestinien depuis des décennies, oppression qui a donné naissance au PLO, au Hamas, au Hezbollah, et qui explique pourquoi les militants houthis tiraient sur des pétroliers et cargos en mer Rouge. Pas un seul. Et ce, malgré le fait qu'Applebaum est une historienne, journaliste et écrivaine à la fois fort réputée et admirée.
Ignorant complètement le fait que l'attaque d'Israël par le Hamas le 7 octobre avait lieu dans un contexte où de nombreux pays arabes concluaient des accords de normalisation avec Israël qui laissait complètement tomber la cause palestinienne, le prochain sur le point de le faire étant l'Arabie Saoudite ; ignorant le fait qu'Israël imposait depuis plus de 16 ans un siège illégal et inhumain à Gaza, qualifié par plusieurs observateurs de plus grande prison ouverte du monde entier, soumettant les Gazaouis à pauvreté, malnutrition, marginalisation et absence de future, dans un des territoires le plus densément peuplé du monde entier, où la moitié de la population a moins de 18 ans ; ignorant le fait que de milliers de Palestiniens sévissaient dans des prisons israéliennes depuis des années, souvent après avoir été détenu sans accusation et possibilité de procès...
Ignorant complètement tout cela, Applebaum interprète l'attaque d'Israël par le Hamas non pas pour ce qu'elle est – une action brutale issue d'années de frustration croissante, de souffrances inimaginables sous une occupation brutale et illégale, un cri de désespoir visant à secouer le monde arabe et à vrai dire aussi le monde entier, visant à les faire sortir de leur apathie et indifférence – mais plutôt selon ce qui fait son affaire. Plus précisément, elle lui accorde le sens qui correspond à la thèse principale qu'elle défend dans son livre.
Les autocraties, affirme Applebaum, programment « leurs propres actions pour créer un maximum de chaos ». D'abord, la Hongrie sous Victor Orban et les Républicains Maga sous Trump bloquent l'aide à l'Ukraine. Ensuite, les Russes et les Chinois répandent sur Internet le récit de la « fatigue de l'Ukraine ». Après, c'est « à ce moment précis que les militants du Hamas, soutenus par l'Iran, » lancent « une attaque brutale contre Israël », poursuit Applebaum. Enfin, les militants houthis jouent leur rôle dans cette grande programmation autocratique. Dans les semaines qui suivent, affirme-t-elle, « les militants houthis soutenus par l'Iran » commencent « à tirer sur des pétroliers et des cargos en mer Rouge, perturbant le commerce mondial et détournant l'attention des États-Unis et de l'Europe de la guerre en Ukraine. »
La preuve est faite. L'attaque d'Israël par le Hamas fait partie d'une série d'actions coordonnées par les autocraties !
Rien de plus normal, dès lors qu'Israël, pays démocrate, entre en action pour se défendre contre ce terrorisme qu'appuient les autocraties !
Chose étrange, si la lauréate du Prix Pulitzer 2024 ne semble pas du tout consciente de l'épouvantable drame dont souffre depuis des décennies le peuple palestinien, presque tous les pays du monde le sont. Refusant de réduire l'attaque du Hamas à du simple terrorisme, ils dénoncent sans relâche les barbaries qu'Israël est en train de commettre présentement.
Depuis l'éclatement de la guerre à Gaza, j'ai passé d'innombrables heures à écouter les discours des représentants de nombreux pays lors des séances de l'Assemblée générale de l'ONU et du Conseil de sécurité de l'ONU. Des pays d'Afrique, des pays du Moyen-Orient, des pays de l'Amérique latine.
Les propos qu'ils tenaient au sujet de Gaza et du conflit Israël-Palestine m'étonnaient. M'émouvaient profondément, même... Au point que qu'il m'arrivait parfois d'en avoir des larmes aux yeux.
La plupart de ces pays étaient d'anciennes colonies des grandes puissances, et plusieurs figurent dans la liste de ce qu'Applebaum qualifie d'autocraties. Ils ont souffert de ce dont souffre présentement le peuple palestinien. Ils savent, en chair et en os, ce que veut dire souffrir de l'oppression d'un empire.
Et lorsque j'écoutais les propos de la Chine, de l'Iran, et de la Russie au sujet de ce qui se passe à Gaza, j'étais encore agréablement étonné de voir leur degré de compréhension de la situation. Même si je sais parfaitement bien que ces pays soient loin d'être des saints au niveau des droits humains, leurs propos m'étonnaient néanmoins, car ils étaient fort similaires à ceux de la grande majorité des pays. Comme ces derniers, ils semblaient comprendre en profondeur la souffrance du peuple palestinien et l'injustice historique qu'il subit.
Je ne pouvais pas en dire autant, par ailleurs, des propos tenus par plusieurs puissances occidentales. Surtout pas des propos du Royaume Unie et des États-Unis.
À la page 139 de son livre, Applebaum souligne le fait que les autocraties assassinent souvent leurs dissidents, en particulier les journalistes. Et je sais qu'elle a parfaitement raison d'affirmer cela. Cependant, elle ne mentionne pas une seule fois dans son livre les assassinats par Israël de leaders palestiniens, même si on sait que le nombre de ces assassinats est inouï. Elle ne mentionne pas une seule fois non plus les journalistes tués par Israël à Gaza depuis octobre 2023. Pourtant, leur nombre est ahurissant et historiquement sans précédent. De plus, les militaires israéliens les ciblent souvent directement. Silence total aussi par rapport aux innombrables hôpitaux, écoles, universités, mosquées, édifices de l'ONU, résidences, etc., bombardés, et souvent complètement pulvérisés par Israël à Gaza.
Les pays autocratiques offrent à leurs membres non seulement argent et sécurité, affirme Applebaum. Aussi et surtout, ils leurs offrent une chose moins tangible mais sans doute plus importante : l'impunité.
Après avoir vu les États-Unis utiliser leur véto au Conseil de sécurité de l'ONU pour bloquer une motion de cessez-le-feu à Gaza, et cela pour la quatrième fois depuis l'invasion israélienne de Gaza en octobre 2023, cette dernière affirmation d'Applebaum m'a frappée comme un coup de masse.
Pourquoi la plus grande puissance militaire au monde, qui se prétend la leader internationale de la démocratie, qui affirme défendre un ordre international fondé sur les règles, etc., accorde-t-elle à son grand allié israélien cette impunité totale ? Pourquoi offre-t-elle à Israël argent, soutien militaire à coup de dizaines de milliards de dollars, et sécurité ? Pourquoi rejette-t-elle le jugement de la Cour internationale de la justice qui estime plausible un génocide à Gaza et entame une enquête ? Pourquoi rejette-t-elle catégoriquement l'action de la Cour pénale internationale qui vient d'émettre un mandat d'arrêt contre le Premier ministre d'Israël Benjamin Nétanyahou et son ex-ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes contre l'humanité ?
L'argument d'Applebaum selon lequel seules les autocraties ne respectent pas l'ordre international fondé sur des règles et les traités et convention sur le génocide tient-il vraiment la route ?
Notes
1.Counting the dead in Gaza : difficult but essential, The Lancet, le 10 juillet 2024. Consulté le 23 novembre 2024.
2.Nearly 70 percent of deaths in Gaza are women and children : UN, Al Jazeera, le 8 novembre 2024. Consulté le 23 novembre 2024.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Visa le pouvoir, tua le pays

Après la défaite du référendum de 1995, Jacques Parizeau allait dans son discours faire porter la responsabilité de la défaite indépendantiste sur « L'argent, puis des votes ethniques ». En six mots, il avait réussi à aliéner à la cause de l'indépendance une bonne partie des québécois issus de l'immigration.
Par Sébastien Robert, Syndicaliste, conseiller municipal et ex-candidat de Québec solidaire
Dans les années qui ont suivi, l'austérité péquiste menée par Lucien Bouchard a mené à l'aliénation au PQ des Québécois progressistes, issus des classes populaires et des jeunes. Avec beaucoup d'autres de ma génération, c'est me faire gazer pendant une fin de semaine complète au Sommet des Amériques, sous le gouvernement de Bernard Landry, qui m'a convaincu que le PQ travaillait contre mes idées et moi.
J'ai néanmoins toujours été pour que le Québec devienne un pays. Avec d'autres, j'ai participé à fonder l'UFP, puis Québec solidaire. Dans les 25 dernières années, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui étaient devenues énormément réticentes à l'indépendance parce que l'idée était associée au PQ, un parti qui les avait trahis ou maltraité énormément dans le passé.
Avec énormément d'effort, on a réussi à construire des ponts et rebâtir la confiance avec ces Québécois et on a réussi à leur montrer qu'ils avaient une place dans le mouvement indépendantiste. Certaines de ces personnes, comme Ruba Ghazal, Andres Fontecilla, Haroun Bouazzi et Alejandra Zaga-Mendez, sont maintenant députés indépendantistes à l'Assemblée nationale.
Cette semaine, après avoir vu le PQ mener la charge contre Haroun Bouazzi et Québec solidaire, beaucoup de ces personnes vont conclure qu'ils n'auraient pas leur place dans un pays du Québec. On peut difficilement leur reprocher quand c'est un message qui leur est régulièrement transmis par le PQ depuis bientôt 30 ans.
La stratégie de Paul St-Pierre-Plamondon est de devenir premier ministre du Québec en 2026 et d'appeler le Québec à un référendum sur l'indépendance en 2027 ou 2028. Cette semaine, je me suis surpris à me demander ce que j'allais faire si la stratégie du PQ se concrétisait. Est-ce que j'allais donner le mandat d'écrire la Constitution de mon pays à ceux qui disent que je suis un « woke antidémocratique » ?
J'ai encore le temps de réfléchir à la question et, dans ma situation, je crains peu pour ma sécurité et celle de ma famille dans un pays du PQ. Je ne peux pas en dire autant pour tous les québécois issus de l'immigration, qui vive de la précarité ou qui font partie de groupes régulièrement discriminés. Pour eux, c'est réellement inquiétant de donner les clés du pays à un parti qui les prend régulièrement comme boucs-émissaires et qui les présente comme des menaces à la nation québécoise. Vous pensez que le Oui obtiendra la majorité des votes si le pays du Québec qui en résulte fait peur à la majorité des Québécois ?
Blâmer les immigrants et les wokes pour tous les maux de la société, c'est le discours que Trump a utilisé pour prendre le pouvoir. En adoptant le même discours dans le but de prendre le pouvoir à la CAQ, le PQ est en train de tuer les chances que le Québec devienne un jour un pays. Paul St-Pierre-Plamondon et les péquistes n'auront qu'eux-mêmes à blâmer si les résultats d'un éventuel référendum en 2027-2028 sont similaires à ceux des référendums de 1980 ou 1995. Les personnes que le discours actuel du PQ aura poussé vers le fédéralisme n'auront alors que protégé leur sécurité et celle de leur famille. Peut-on vraiment les en blâmer ?
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

TES Canada : la nouvelle idole

Nous avons eu droit mercredi dernier, à la Cité de l'énergie, à la première célébration de la dernière idole des GENS D'AFFAIRES.
En plus des officiants, quelques fidèles étaient présents. Tous participaient au culte du jour, tous communiaient avec la même ferveur à la table des redevances de TES Canada, l'hostie ostentatoire capable d'apaiser les pires tourments de l'âme et de faire taire les pires remords engendrés par la culpabilité de céder à l'intérêt personnel.
Certes, le prochain n'est pas totalement oublié par ces gens d'affaires malgré la ferveur qui les transporte. Seuls les citoyens égarés, qui tournent le dos à leur idole, ne trouvent pas place dans leur cœur. Mais ils sont peu nombreux selon leurs dires. Un groupuscule d'opposants ! Malheureusement, ils menaceraient la majorité des fidèles, pacifique, silencieuse et invisible qui aimerait manifester sa foi ouvertement.
Ils seraient dangereux, ces opposants. Vindicatifs, aux dires des fidèles interrogés, ils seraient prompts à lancer des pierres aux apôtres du nouveau culte. Voilà la raison pour laquelle ces derniers ont tant attendu avant d'affirmer leur foi vacillante. Mais voilà, c'est chose du passé. Leur courage a crû parce que les débordements des opposants seraient aujourd'hui moindres.
Mais qui sommes-nous, nous qui nous opposons au projet de TES Canada ?
Nous ne sommes pas contre les éoliennes, mais nous sommes contre les éoliennes en milieu habité.
Nous ne sommes pas contre la transition énergétique, mais contre le fait que l'urgence climatique puisse servir à excuser toutes manœuvres, plus intéressées par le profit que par des solutions réelles capables d'en enrayer la progression.
Le gouvernement actuel agit dans la précipitation, progresse « de risques calculés » en « risques calculés » et abuse de son pouvoir pour contourner les mesures élémentaires de prudence. On peut penser à l'abolition du BAPE dans le cas de Northvolt qui non seulement n'agit pas contre le dérèglement climatique, mais provoque celui du climat social.
D'autres solutions existent et sont proposées par plusieurs experts, mais le gouvernement semble vouloir poursuivre une mission pour laquelle il n'a pas obtenu le mandat lors de son élection. À qui obéit notre gouvernement et qui sert-il ?
La panique, à laquelle il semble obéir, le conduit à proposer un remède qui risque d'engendrer des maux pires que le mal qu'il veut guérir. Ces parcs éoliens ont des impacts et même TES Canada le reconnaît puisqu'il consent à indemniser les résidents demeurant à moins de 1000 mètres de ses éoliennes. Mais TES Canada ne reconnaît pas tous les impacts. Il a même le culot, si ce n'est le ridicule, d'en enjoliver certains ou d'en présenter d'autres comme des mythes. Selon ses dires, les éoliennes « ajoutent une touche de modernité au paysage ». TES Canada pense-t-il qu'en ridiculisant les faits et maquillant la réalité, il abolira le réel ? Un parc éolien n'améliore pas un paysage, il le dénature. La nuisance sonore et les risques indirects susceptibles d'affecter la santé sont bien réels, la dévaluation foncière est bien réelle, les impacts sur la faune et la biodiversité sont bien réels, sinon pourquoi TES Canada entend-il « minimiser » les impacts ?
Ces parcs éoliens en milieu habité, construits sous le prétexte de sauver la planète, de nous sauver, font de nous de nouvelles victimes de ce dérèglement climatique. Ils ajoutent des victimes aux victimes.
Il faut cesser de nous présenter les GENS D'AFFAIRES et les PROMOTEURS comme des philanthropes magnanimes et généreux. Il s'en trouve sûrement, mais c'est l'exception, non la règle. Ils pensent avant tout à leur propre intérêt : « faire des AFFAIRES ». S'ils sont utiles à la bonne marche de l'économie, ils ne sont qu'un rouage d'une politique qui doit trouver ailleurs ses lumières. On oublie trop facilement qu'une politique dominée par l'argent accouche toujours d'un monstre.
M. Angers, maire de Shawinigan, par un grossier subterfuge, substitue la « pertinence sociale » à « l'acceptabilité sociale ». Il biffe ainsi cette notion capitale sur laquelle insistent tous les documents officiels du gouvernement. Cette condition préalable et indispensable à tout projet de société, supprimée par M. Angers, est un bel exemple de l'humanisme de certains GENS D'AFFAIRES.
Il n'y a pas que les gens d'affaires qui font passer leur intérêt avant le bien-être de leur voisinage et de leur environnement.
Le témoignage poignant d'une propriétaire terrienne, qui accepta de signer une entente pour accueillir une éolienne, est apporté pour illustrer la mansuétude dont peut faire preuve TES Canada. Eh oui, TES accepta de modifier l'emplacement choisi pour son éolienne parce que la dame ne la voulait pas à cet endroit sur sa terre. Elle devait craindre la trop grande proximité de l'éolienne par rapport à sa résidence, le bruit ou la détérioration du paysage, bref des raisons légitimes de demander cette modification. Tous les voisins de tous ces propriétaires ayant signé des ententes avec TES Canada n'auront pas cette chance de se faire entendre.
Gaston Rivard
Citoyen de Saint-Adelphe
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Contre l’OTAN, contre le militarisme et pour la libération des peuples

Francesca Albanese, Rapporteuse spéciale de l'ONU sur la situation des droits humains dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, a soutenu dans son plus récent rapport que l'on assiste actuellement au « premier génocide colonial diffusé en direct »
. Depuis octobre 2023, Israël bombarde la bande de Gaza de manière indiscriminée et la population est privée de toutes ressources essentielles. Parallèlement, l'indifférence de la communauté internationale et la complicité de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), dont le soit-disant Canada fait partie, est consternante.
Israël a le statut d'allié majeur non-membre de l'OTAN, qui lui offre un accès prioritaire et quasi illimité aux technologies militaires les plus avancées des États-Unis et de l'Europe. Le génocide en cours est donc loin d'être un événement soudain, mais s'inscrit dans une stratégie d'effacement du peuple palestinien qui perdure depuis des décennies grâce à l'appui occidental inconditionnel offert à l'État sioniste, notamment via des outils de contrôle et de surveillance à la fine pointe de la technologie militaire primée par l'OTAN. Gaza est connue depuis longtemps comme la plus grande prison à ciel ouvert de la planète grâce à un sytème complexe de murs-frontières composés de grillages de métal, de béton armé, de caméras de surveillance, de drones et de tourelles où opère la milice sioniste. À ces barrières physiques s'ajoutent la cybersurveillance, la reconnaissance faciale et l'espionnage constant. La Palestine est donc un laboratoire pour l'industrie militaire et technologique israélienne, soutenue logistiquement et financièrement par les membres de l'OTAN.
Les pays membres de l'alliance se servent ensuite de ces expérimentations pour mieux réprimer leurs propres citoyen-nes. Par exemple, en 2012, les balles de plastique de la Sûreté du Québec (SQ) qui ont crevé les yeux et défiguré les militant·es étudiant·es avaient d'abord été testées par les forces sionistes.
Nous devrions aussi nous inquiéter de la volonté de l'OTAN à renforcer son appui indéfectible à Israël par des interventions militaires directes. Le think tank NATO Watch a publié un briefing faisant la promotion d'une intervention de l'OTAN pour « stabiliser la région » en s'appuyant notamment sur le « succès » des missions de stabilisation en ex-Yougslavie à la fin des années 1990. Pourtant, si l'on pose un regard critique sur les missions passées de l'OTAN au Kosovo, en Afghanistan ou en Libye, on comprend très bien ce que « stabilisation » ou « maintien de la paix » veut dire : détruire tout sur son passage, y compris des lieux de refuges des populations civiles puis quitter après avoir semer l'instabilité politique et le chaos.
Militarisme et capitalisme : un duo destructeur
Au moment d'écrire ce texte, nous sommes encore à digérer l'élection de Donald Trump. Largement soutenu par les puissants lobbys du complexe militaro-industriel, ses politiques autoritaires et bellicistes posent de réels dangers pour la paix mondiale. Qu'on nous comprenne bien, on n'aurait pas applaudi l'élection de son adversaire ! À une ère de multiplication de conflits armés d'une violence inédite, nous devons nous préoccuper de la montée de l'extrême-droite aux États-Unis, pilier central de l'OTAN.
Les politiques capitalistes de nos gouvernements maintiennent des pans complets de la population dans la précarité et la vulnérabilité. Maintenus à l'écart de toute possibilité de mobilité sociale, ces groupes deviennent un bassin de recrutement inépuisable pour les armées occidentales. Ce sont donc les corps de notre jeunesse qui se feront mutiler physiquement et psychologiquement pour aller massacrer des peuples entiers afin de préserver les intérêts coloniaux et impérialistes des élites économiques et politiques, le tout sous couvert de sauvetage et de sécurité mondiale.
La situation ne s'améliorera pas avec le gouvernement canadien qui cède à des années de pression des États-Unis pour augmenter son budget militaire à hauteur de 2% de son PIB, ce qui devrait représenter 82 milliards de dollars en 2032-2033.
Alors que les budgets militaires ne cessent de croître, on nous dit que des programmes sociaux essentiels comme le transport collectif et le logement social ne sont pas rentables.
Appel à se mobiliser contre l'OTAN
Pour s'engager activement pour la paix, il est crucial de contester le rôle de l'OTAN dans la militarisation du monde et son soutien à des politiques autoritaires et colonialistes. Alors que Tiohtià:ke/ Montréal accueillera la prochaine assemblée parlementaire de l'OTAN du 22 au 25 novembre, il est temps de faire entendre nos voix. Nous appelons la population à manifester le 22 novembre à 17h30, Place des Arts. Montrons notre rejet du militarisme aveugle et de la domination exercée par l'OTAN. Construisons une solidarité active entre tous les peuples et refusons que la mémoire des victimes des guerres serve à légitimer d'autres conflits. Unissons-nous pour une paix durable, libérée de toute forme de colonialisme, d'impérialisme et de militarisme !
Lettre de Désinvestir pour la Palestine
Co-signée par :
Actions contre les armes / Actions against arms
Collectif UdeM pour la Palestine
Convergence des luttes anticapitalistes
Femmes de diverses origines / Women of diverse origins
Groupe de recherche et de formation sur la pauvreté au Québec
Organisation révolutionnaire anarchiste
Palestiniens et Juifs Unis (PAJU)
Syndicat Industriel des Travailleuses et Travailleurs — Industrial Workers of the World (SITT – IWW)
*********************
Manifestation du 22 novembre
*Le Collectif Désinvestir pour la Palestine dénonce les violences policières et la complicité de l'OTAN dans le génocide colonial en Palestine*
*Tiohtià:ke/Mooniyang/Montréal, le 24 novembre 2024 *— Le collectif Désinvestir pour la Palestine dénonce fermement les tentatives malhonnêtes des politicien-nes de détourner le message politique porté par la manifestation du 22 novembre contre l'OTAN et le génocide colonial en Palestine. Nos gouvernements, qui offrent un soutien indéfectible et honteux à Israël depuis des décennies, se sont empressés de détourner les messages anti-militaristes, anti-impérialistes et anticolonialistes portés par les manifestant-es en lançant de fausses accusations d'antisémitisme.
Il s'agit d'accusations mensongères qui visent à délégitimer le mouvement de solidarité avec la libération de la Palestine et qui nuisent à la lutte contre l'antisémitisme. Soyons clairs : incendier une poupée à l'effigie d'un chef d'État visé par deux mandats d'arrestation de la Cour pénale internationale (CPI) n'a rien d'un acte d'antisémitisme. Cela relève de l'expression légitime d'une colère collective face à l'indifférence politique au coeur d'un génocide colonial.
De plus, le Collectif dénonce fermement les violences policières contre la foule qui manifestait contre la complicité des membres de l'OTAN dans les guerres impérialistes et le génocide du peuple palestinien. Les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont fait un usage excessif de gaz lacrymogène et ont asséné des coups de matraques et de boucliers aux manifestant·es lors de manœuvres de dispersion dangereuses.
Au moins quatre personnes ont dû être évacuées d'urgence par ambulance afin d'être hospitalisées. Parmi les blessé·es, une personne matraquée à la tête a subi des lésions sérieuses. En attente de l'ambulance, la personne blessée a été assistée par des secouristes qui ont été violemment agressé-es par des policiers <https://we.tl/t-aBizBSmaWJ> . Parmi les personnes hospitalisées, un photographe a été blessé après avoir été atteint à l'œil par un projectile lancé par la police, puis aspergé de poivre de cayenne. Une autre personne a subi une fracture au bras suite à des coups de matraque, sans compter les malaises chez plusieurs manifestant-es suivant une surexposition dangereuse aux irritants chimiques.
Le Collectif est atterré : la répression brutale envers des manifestant-es est non seulement tolérée, mais applaudie par les mêmes politicien-nes qui appuient la campagne génocidaire d'Israël contre le peuple palestinien. Le Collectif dénonce l'hypocrisie de ces représentant-es qui disent défendre la loi, tout en soutenant des violations graves, répétées et documentées du droit international en Palestine depuis des décennies.
Le message du Collectif à l'OTAN et aux gouvernements complices de l'oppression des peuples à travers le monde reste le même : on ne construit pas la paix par les armes et la répression. On la construit par la solidarité entre les peuples et la résistance à l'oppression et la colonisation sous toutes ses formes.
*Citation *
« La manifestation du 22 novembre nous a montré une fois de plus le vrai visage de nos institutions. Plutôt que de mettre fin à leur complicité avec le génocide colonial en Palestine, leur réponse est celle de la répression. Cependant, la solidarité ne se brise pas à coups de matraque. Ce que nous avons vu lors de la manifestation, c'est que la violence policière n'a fait que renforcer la détermination du mouvement à lutter jusqu'à la libération de la Palestine et de tous les peuples opprimés et colonisés » déclare Benoît Allard, porte-parole du collectif Désinvestir pour la Palestine.
*Collectif Désinvestir pour la Palestine*
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Adoption du projet de loi 71 - « Ne reste-t-il donc personne à l’Assemblée nationale pour défendre les droits des personnes assistées sociales ? »

Le titre de ce communiqué du Collectif pour Québec sans pauvreté n'est pas sans nous poser de multiples questions ? Où était donc Québec solidaire pour s'opposer au projet de loi 71 ? Pourquoi notre députation n'a-t-elle été convaincu par les représentations des groupes de défenses des personnes asistées sociales ? Quand Québec solidaire expliquerait-il les fondements d'une attitude qui est appuru comme un refus d'appui par ces groupes de défense ? La transparence exige une explications sérieuse. (PTAG)
Sans surprise, le projet de loi 71 de la ministre Chantal Rouleau vient d'être adopté par l'Assemblée nationale. Ce qui est toutefois surprenant pour le Collectif pour un Québec sans pauvreté, c'est l'unanimité qu'a su faire le projet de loi parmi les député-es. Comment cela est-il possible quand on sait que la « réforme » de la ministre ne prévoit aucune augmentation des prestations des personnes assistées sociales et comporte même des reculs pour des dizaines de milliers d'entre elles ?
« C'est un jour triste pour les personnes assistées sociales et toutes les organisations qui, depuis plus de 50 ans, se battent pour défendre leurs droits, se désole le porte-parole du Collectif, Serge Petitclerc. Qu'un projet de loi s'attaque aux acquis des personnes les plus mal prises, c'est malheureux, mais c'est dans l'ordre des choses avec un gouvernement qui depuis six ans se préoccupe davantage d'enrichir les plus riches que d'améliorer le sort des plus pauvres. Que personne n'ose se lever en chambre pour dire non à ce projet de loi est cependant inconcevable et autrement révélateur. Ne reste-t-il donc personne à l'Assemblée nationale pour défendre les droits des personnes assistées sociales ?
« Depuis le dépôt du projet de loi le 11 septembre dernier, nous avons tenté de faire entendre notre point de vue avec des dizaines d'autres organisations. Nous avons manifesté, produit un mémoire, participé aux auditions publiques, rencontré les partis d'opposition. Nous nous expliquons mal que notre message n'ait été compris ni par le parti au pouvoir, ni par les autres partis.
Deux problèmes majeurs
« Un des problèmes avec le projet de loi 71 est que, malgré quelques assouplissements, il ne prévoit aucune augmentation des prestations d'assistance sociale, rappelle Serge Petitclerc. Il est évident, par exemple, que c'est une bonne chose que le délai de prescription pour l'établissement de certaines catégories de dettes passe de 15 à 5 ans. Cela simplifiera probablement la vie de quelques personnes, mais ne change absolument rien au problème de fond : la nette insuffisance des revenus, et ce, peu importe le programme d'assistance sociale.
« Faut-il rappeler que les personnes qui touchent l'aide sociale de base disposent d'un revenu annuel de 11 245 $, de quoi couvrir à peine 46 % des besoins de base définis par la Mesure du panier de consommation ? Même au Revenu de base, le programme le plus généreux qui s'adresse aux personnes avec des contraintes de santé de longue durée, les gens ne reçoivent de quoi couvrir que 87 % de leurs besoins.
« L'autre problème majeur avec le projet de loi 71 est qu'il vient réduire le nombre de motifs donnant droit à une allocation pour contraintes temporaires. Parmi les personnes qui se verront touchées par cette modification, notons les familles monoparentales comptant un enfant à charge de moins de 5 ans (environ 8000 personnes actuellement) et les personnes de 58 ans et plus (environ 30 000 personnes actuellement). Il est spécifié dans le projet de loi que les personnes qui touchent actuellement cette allocation y auront droit tant qu'elles demeureront à l'assistance sociale. Mais toutes les nouvelles personnes qui arriveront au nouveau programme d'Aide de dernier recours en seront privées. L'allocation pour contraintes temporaires est présentement de 161 $ par mois.
« Quand on connaît l'insuffisance des prestations d'assistance sociale, surtout au programme d'Aide sociale, cet aspect du projet de loi de la ministre Rouleau nous semble particulièrement inhumain. Pour une personne dans cette situation, 161 $ de plus ou de moins par mois, ça fait toute la différence du monde. »
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
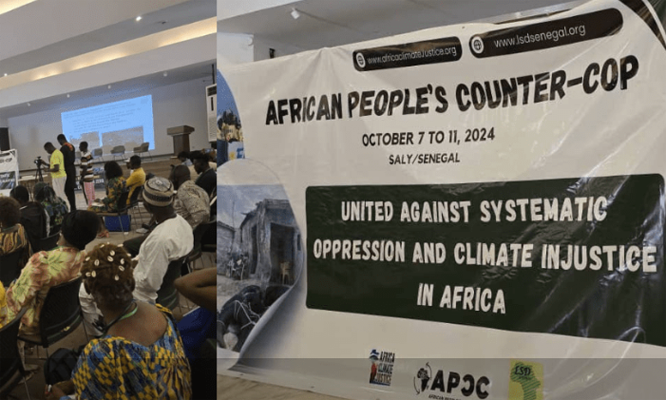
Du berceau de l’humanité au dépotoir-cercueil !
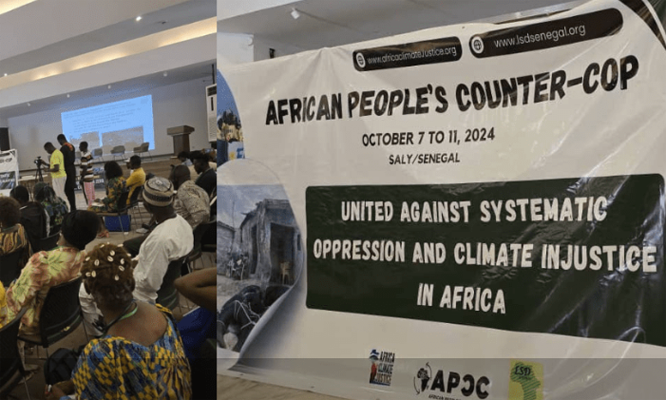
D'une COP à l'autre, sur la biodiversité ou sur les changements climatiques, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres ne cesse de s'époumoner sur le fait que l'être humain est seul coupable. Mais quand et comment cet être humain sera-t-il enfin responsable ? Comment faire en sorte que ces exercices des COP deviennent contraignants et efficaces ? À l'inverse de bien d'autres précédemment, Serge Proulx, membre GMob, trace ici un bilan non jovialiste de la situation de la biodiversité (COP 16) pour mieux la lier aux changements climatiques (COP 29).
Tiré de GMob
Serge Proulx, biologiste, M. Sc. (Hydrologie forestière)
La Convention sur la Diversité Biologique (CDB) est un traité international adopté lors du sommet de la Terre, à Rio de Janeiro, en 1992. Son objectif est de développer des stratégies nationales pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique.
Les trois buts principaux de la CDB sont :
- la conservation de la biodiversité ;
- l'utilisation durable de ses éléments ;
- le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques. l'exploitation des ressources
Trente-deux ans plus tard, nous venons de vivre la COP16 dont les objectifs étaient de s'entendre sur les moyens à prendre d'ici 2030 pour respecter les engagements pris en décembre 2022 lors de la COP15 à Montréal (Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal), soit protéger 30 % des milieux naturels de la planète (terrestres et marins), freiner l'extinction des espèces, réduire les risques liés aux pesticides et financer au moins 200 milliards de dollars par an pour aider les nations plus pauvres à préserver les écosystèmes.
D'ici 2030, il ne reste que 5 ans, et pourtant, seulement 17,6 % des terres et des eaux intérieures (Canada 13,7 % en 2023) et 8,4 % des océans et zones côtières (Canada 9,1 % en 2023) se trouvent dans des zones « protégées » et aucune entente pour les fonds considérés comme nécessaires, soit 200 milliards par année, n'a été obtenue.
Comme ordre de grandeur, rappelons les profits pour le dernier trimestre de trois des GAMAM (Google, Apple, Meta, Amazon et Microsoft) : Google gagne désormais 26 milliards de dollars par trimestre, Microsoft, 25 milliards, et Meta, 15 milliards. Donc, les profits pour trois trimestres de ces trois compagnies seulement sont l'équivalent du besoin pour la planète entière. Et on ne parle pas ici des actifs de ces 5 compagnies dont la valeur combinée dépasse maintenant les 10 000 milliards de dollars. Rappelons aussi que selon le Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), le total des dépenses militaires mondiales s'élève à 2 443 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation de 6,8 % par rapport à 2022. Juste l'augmentation des dépenses militaires se rapproche du 200 milliards jugé nécessaire. Le pire est que l'orgie de destruction qui se trouve derrière ces chiffres est souvent vendue comme le moteur de notre « croissance économique », par ces usines qui produisent l'armement et la reconstruction ensuite.
Pendant ce temps, le gouvernement du Canada se vante sur son site de faire preuve de leadership et d'ambition à l'échelle internationale en matière de protection de la nature et de la biodiversité en annonçant à Cali « un financement total de 62 millions de dollars pour sept projets visant à protéger la biodiversité partout dans le monde ». À titre de comparaison du « leadership et de l'ambition » du Canada, rappelons qu'un simple tronçon de 11 km de l'autoroute 20 (de Cacouna à L'Isle-Verte) a couté 69 millions de dollars en 2011. Du côté du Québec, il est le premier État fédéré au monde à avoir contribué au Fonds-cadre de la biodiversité à hauteur de 2 millions de dollars… soit environ 300 mètres d'autoroute, valeur de 2011.
Notons aussi que seulement 44 pays ont remis leur stratégie nationale sur la biodiversité, et 119 autres n'ont remis que de grands objectifs, sur les 195 parties membres de la COP. Mais le bilan de ces feuilles de route et objectifs, ainsi que la façon de les suivre dans le temps, n'ont pas fait l'objet d'accords qui, de toute manière, sont généralement non contraignants. Autre exemple risible, par rapport aux besoins : dans un communiqué, huit gouvernements ont annoncé des promesses de contributions portant à quelque 400 millions de dollars la dotation du fonds mondial pour la biodiversité, soit 2 millièmes des besoins annuels. Les 23 000 participants annoncés à cette COP ont donc probablement plus contribué au réchauffement planétaire qu'à la conservation de la biodiversité.
Comment s'en étonner alors que sur les 15.000 participants, on trouvait seulement 12 chefs d'État et 103 ministres de l'environnement, mais plus de 1.000 journalistes du monde entier ? Les 196 pays présents peuvent bien, depuis le 21 octobre, avoir tenté d'accorder leurs positions pour les objectifs définis de 2030, mais en l'absence générale des décideurs politiques, les délégations sont restées sur leurs mandats. Par exemple, le Canada n'y a envoyé aucun représentant parlementaire, tous les partis étant probablement plus préoccupés des enjeux parlementaires que du sort de la biodiversité et de la planète, tout comme pour notre ministre de l'environnement du Québec, Benoit Charette, absent lui aussi. Ils ont donc oublié, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, que l'oxygène de chacune de nos respirations a été produit par les plantes, qu'elles soient terrestres ou marines comme le phytoplancton, et que chaque bouchée de notre alimentation provient de cette nature. Les mandats portaient probablement pour la plupart sur la défense des intérêts nationaux, intérêts qui se concentrent surtout sur la croissance économique, si l'on se fie aux discours que l'on entend ici, autant aux niveaux fédéral que provinciaux.
Si l'évolution biologique est indissociable du fait que des espèces disparaissent et que de nouvelles apparaissent, jamais la perte de biodiversité n'a été aussi massive et fulgurante que ces deux derniers siècles : de 10 à 1000 fois plus rapide que le rythme naturel, ce qui nous fait entrer de plain-pied dans une 6e extinction de masse, capable de mener à l'effondrement de nombreux écosystèmes de manière irrémédiable et d'être une menace pour la « civilisation », menace « existentielle », comme l'a dit à Cali le secrétaire général de l'ONU António Guterres.
Ce qui a changé ces deux cents dernières années ? La pression de l'Homme, la première et la seule cause directe de cet effondrement fulgurant de la biodiversité ! L'espèce humaine ne représente pourtant que 0,01% de l'ensemble du poids de tout le monde vivant sur la terre. Mais notre impact sur les écosystèmes est démesuré et ne cesse de s'accroître. D'ailleurs, même lorsque l'on regarde l'ensemble de la biomasse des mammifères, l'humain (n'oublions jamais que nous sommes des mammifères) représente 36% de cette biomasse ; les mammifères que nous élevons (surtout les bovins) en représentent 58%. Le reste de tous les autres mammifères, ce que l'on appelle la nature « sauvage », ne représente que 6% du total (2% terrestre et 4% marin, principalement les baleines). Si l'on considère les oiseaux, la biomasse pour toute la planète Terre de nos oiseaux d'élevage, principalement le poulet, compte pour 75% du total. Côté végétal, 38% des espèces d'arbres sont maintenant inscrites sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), qui répertorie les espèces en fonction de leur risque de disparition.
En 2019, un effort gigantesque d'inventaire à l'échelle mondiale a permis d'identifier 435 000 espèces de plantes (2 sur la planète, dont 36,5 % étant qualifiées de « rares » (observées moins de cinq fois), et 28,3 % « d'extrêmement rares » (observées moins de trois fois). Le drame est que les zones où se concentrent ces plantes rares sont généralement les zones les plus impactées par les changements provoqués par l'homme, directement (urbanisation, développement de l'agriculture intensive et déforestation) ou indirectement via les changements climatiques. De plus, au-delà de 30 % des espèces végétales mondiales sont natives des îles, comme à Madagascar, un trésor de biodiversité, qui arrive en tête de cette liste, avec pas moins de 9 318 espèces végétales qui ne se trouvent nulle part ailleurs. Pour les plus petites îles, les menaces aux écosystèmes sont multiples, mais les principales actuellement sont les événements climatiques extrêmes qui se multiplient et sont de plus en plus intenses, et, évidemment, la hausse du niveau des océans, conséquence directe et irréversible pour plusieurs milliers d'années du réchauffement planétaire que nous provoquons. Pour revenir à notre exemple, c'est aussi à Madagascar que la proportion d'espèces menacées d'arbres est la plus élevée (59%). En mars 2023, le territoire malgache n'est plus qu'à environ 10% recouvert de forêt, contrairement à environ 50% au début des années ‘70.
Concernant la biodiversité, nous sommes très loin de tout connaître. Selon MUSÉUM, « à ce jour, environ 2 millions d'espèces ont été inventoriées, mais on estime qu'il en existe entre 8 et 20 millions ! » Toujours pour Madagascar, des chercheurs ont découvert récemment dans ce 10% résiduel sept nouvelles espèces de grenouilles arboricoles, qu'ils ont nommées d'après les noms des capitaines de Star Trek en raison de leurs sifflements uniques et fantastiques. Combien d'autres sont disparues avec les forêts avant même d'être connues ? Mais avec l'échec à la COP16 des négociations sur le financement, la mise en place d'aires protégées y est problématique, comme partout ailleurs dans les pays en développement.
Comme si ce n'était pas maintenant évident, à Cali, Greenpeace a tenu à alerter sur le lien entre la crise de la biodiversité et la crise climatique. La COP29 se tient cette année à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan et de son gouvernement autocratique, autre haut lieu du dieu pétrole, et pour laquelle l'ONG Transparency International et le collectif Anti-corruption data collective nous rappellent que « La corruption et la kleptocratie menacent aussi l'intégrité des conférences sur le climat, y compris la prochaine COP29 à Bakou ». Selon eux, il y a un risque sérieux que la COP29 soit cooptée par les élites politiques azerbaïdjanaises, les compagnies pétrolières et gazières, et les lobbyistes pour promouvoir une industrie profossile, situation déjà dénoncée par des organisations non gouvernementales à l'occasion de la COP 28 de Dubaï. Rien pour être optimiste, autant pour la lutte au réchauffement planétaire que pour la préservation de la biodiversité et l'atténuation des crises sociales, trois enjeux très interreliés, mais toujours traités en silo, autant par les instances internationales que par nos gouvernements.
Si elles ont toujours existé, les nombreuses menaces qui pèsent sur le monde vivant sont de plus en plus aggravées par nos activités humaines. Les activités généralement mentionnées sont les changements d'usage des milieux naturels et leur morcellement, les différents types de pollutions de plus en plus planétaires, la surexploitation des ressources (l'extractivisme débridé de notre supposée « transition ») et l'introduction exacerbée par la mondialisation d'espèces invasives. À présent, le réchauffement planétaire est déjà considéré par plusieurs comme l'une des raisons principales de la disparition des espèces, car l'intensité et la rapidité des changements climatiques mettent en péril la faculté d'adaptation de nombreuses espèces animales et végétales.
Pire, une étude récente menée par des chercheurs du NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research et des universités d'Utrecht et de Bristol montre que le doublement des niveaux de CO2 atmosphérique pourrait augmenter la température moyenne de la Terre de 7 à 14 degrés Celsius. Ces valeurs sont nettement supérieures aux estimations du GIEC sur le réchauffement planétaire. Ironiquement (mais ce n'est pas drôle), une vingtaine de régions du Québec ont connu leur journée d'Halloween 2024 la plus chaude jamais enregistrée, avec des températures atteignant jusqu'à 26 °C.
Concernant l'impact du réchauffement planétaire, le 8e rapport de la revue médicale The Lancet montre que 10 des 15 indicateurs mesurant l'impact des changements climatiques sur la santé ont enregistré de nouveaux records en 2023. Fruit du travail d'une centaine de chercheurs du monde entier, ce document est publié chaque année depuis l'Accord de Paris en 2015. Ces impacts ne se font pas uniquement sentir sur les humains, mais aussi sur toute la faune et la flore qui, eux, n'ont pas de climatiseurs. Nous savons que pendant près de deux mille ans, la température moyenne à la surface du globe est restée stable. Au maximum, celle-ci a pu varier de quelques dixièmes de degré. Mais depuis le début de la révolution industrielle, le consensus scientifique est clair : l'activité humaine a un impact direct sur le climat, car en émettant des gaz à effet de serre, l'humanité réchauffe la planète.
Au Nord, les écosystèmes et les réseaux trophiques sont bouleversés, le caribou migrateur agonise, espèce centrale dans les modes de vie traditionnels des habitants du nord. Plus au sud, ici même au Québec, le caribou des bois est au bord de l'extinction, principalement par la perte de son habitat, les forêts anciennes, elles aussi écosystèmes menacés, qui sont détruites pour le crédo de la nécessité de préserver nos emplois dans l'exploitation forestière alors que rien n'a été fait pendant toutes les dernières décennies pour diversifier l'économie des communautés concernées et sans réponses positives de notre ministère de l'environnement quant aux demandes des premières Nations d'y créer des aires protégées.
Ailleurs, conséquences aussi du réchauffement planétaire, les forêts brûlent (Canada, Sibérie, Amazonie) ou se dessèchent (Portugal, Grèce, etc.), devenant des sources de carbone au lieu d'être des puits, ce qui évidemment bouleverse aussi les écosystèmes de ces milieux. Les événements climatiques extrêmes sont aussi localement très destructeurs pour les écosystèmes. Les pluies torrentielles dans la région de Valence en sont un dramatique exemple. Le « Protected Planet Report 2024 » rapporte que malgré que des progrès aient été réalisés pour ce qui est d'accroître la couverture des aires protégées et conservées (progrès très maigres d'ailleurs), ces progrès doivent être considérablement accélérés si l'on veut atteindre l'objectif de 30% d'ici 2030.
Mais l'accélération de la couverture doit aller de pair avec des efforts encore plus importants pour répondre aux autres éléments de la cible, soit de s'assurer de la qualité des systèmes des zones protégées et conservées. D'autres aspects importants à considérer lors de l'expansion des zones protégées et conservées sont d'inclure le respect des engagements de la cible en matière de droits de la personne, une gouvernance équitable et la reconnaissance des territoires autochtones et traditionnels. Mais que signifie une « aire protégée » quand, par exemple, le gouvernement albanais, pays signataire de toutes les conventions, autorise la construction d'un aéroport à l'intérieur des limites de l'aire protégée Vjosë-Nartë en Albanie, paradis des oiseaux migrateurs de l'Europe en bordure de la mer Adriatique, et que Jared Kushner, neveu d'un certain Donald Trump, y planifie un grand complexe hôtelier aussi à l'intérieur du parc ? Objectif : soutenir l'industrie touristique qui explose en Albanie. Que signifie « le respect des engagements de la cible en matière de droits de la personne, et la reconnaissance des territoires autochtones et traditionnels » quand, en Colombie, pays hôte de la COP16, 361 défenseurs de l'environnement y ont été assassinés ces six dernières années, révèle l'ONG colombienne Fondation Paix et Réconciliation (PARES) ?
À la lueur de ces constats, nous n'avons que peu de choix : obliger toutes les instances politiques - municipales, provinciales et fédérales - à tenir compte de l'existence de ces situations dramatiques et à poser des gestes concrets pour y faire face. Nous, individuellement, avons tous des gestes à poser envers nos élu.e.s. Nous devons tous et toutes être vigilant.e.s et mettre l'épaule à la roue afin qu'ils et elles posent les gestes nécessaires, et que ce ne soit pas des gestes d'écoblanchiment ou contradictoires l'un par rapport à l'autre.
Ces gestes doivent répondre aux enjeux de justice sociale, de respect de l'environnement et de lutte contre les changements climatiques, conséquences du réchauffement planétaire. Ces gestes sont d'autant plus nécessaires et urgents suite aux récents résultats de l'élection américaine. À n'écouter que les discours et comptes-rendus qui ne mettent pas de l'avant les vrais enjeux, à savoir la survie de l'humanité, nous oublions que de nous préoccuper que de la fin du prochain mois nous condamne à en vivre des centaines qui viennent qui ne seront que pires. Cette fameuse fixation pour la fin de mois semble avoir aussi dominé les élections américaines, et nous en vivrons tous et toutes les conséquences.
GMob, GroupMobilisation, a mis de l'avant un plan d'action GOUVERNEMENTAL, MUNICIPAL et CITOYEN, le Plan de la DUC, pour s'attaquer à la réduction des gaz à effet de serre. Ce plan devrait servir de base à nos actions et être adapté afin de devenir des réponses de résilience et de sauvegarde de nos environnements de vie et des écosystèmes.
Des objectifs de décroissance, ou mieux d'un autre type de croissance (le PIB n'étant pas le meilleur indicateur de la santé des économies et des sociétés), donc des objectifs pouvant mesurer l'équité et la résilience devraient être mis de l'avant dans différents secteurs d'activité humaine (j'évite volontairement les mots « secteurs économiques » qui justifient toutes sortes de dérives) et à différentes échelles, comme les biorégions.
Faisons pression sur tous les élu-e-s, à tous les niveaux, pour qu'ils cessent de ne se préoccuper que de la fin de leur mandat (leur « fin de mois » à eux et elles), et s'attaquent aux enjeux existentiels auxquels nous faisons tous face ! Au travail, parce qu'il y a urgence !
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

L’instrumentalisation de la peur juive, de Tel-Aviv à Amsterdam

L'Agence Média Palestine propose une traduction de cet article d'Em Hilton, écrivaine et militante juive basée à Londres, initialement publié par le média +972. Em Hilton est directrice pour le Royaume-Uni et la politique de Diaspora Alliance, cofondatrice de Na'amod : British Jews Against Occupation, et siège au comité directeur du Center for Jewish Non-Violence.
Tiré d'Agence médias Palestine.
La rhétorique des « pogroms » et de la « chasse aux juifs » vise à masquer la réalité en générant une hystérie de masse, qui peut ensuite être utilisée pour faire avancer un programme d'extrême droite.
« Demain, il y a 86 ans, avait lieu la Nuit de Cristal, une attaque contre des Juifs simplement parce qu'ils étaient Juifs, sur le sol européen. Elle est de retour aujourd'hui ; nous l'avons vue hier dans les rues d'Amsterdam. Il n'y a qu'une seule différence : entre-temps, l'État juif a été créé. Nous devons y faire face. »
Il y a beaucoup à analyser dans cette déclaration du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sur les troubles et les violences qui ont entouré le match de football de la semaine dernière entre le Maccabi Tel Aviv et l'Ajax. Ces événements ont commencé avant le match, lorsque les supporters du club israélien ont parcouru la ville en arrachant les drapeaux palestiniens des fenêtres des appartements, en attaquant un chauffeur de taxi et en scandant « Que Tsahal gagne et que les Arabes aillent se faire foutre » (à leur retour en Israël, ils ont également été filmés en train de scander « Pourquoi l'école est-elle fermée à Gaza ? Parce qu'il n'y a plus d'enfants là-bas »). Pendant les heures qui ont suivi la fin du match, jeudi soir, une série d'attaques a été menée contre les supporters du Maccabi par des riverains, dont certains portaient des drapeaux palestiniens et criaient des slogans pro-palestiniens, faisant une trentaine de blessés et cinq personnes hospitalisées.
De nombreux médias de premier plan et des dirigeants du monde entier se sont empressés d'affirmer que les troubles étaient un cas flagrant de violence antisémite. Le président israélien Isaac Herzog n'a pas hésité à parler de « pogrom ». Geert Wilders, chef du parti d'extrême droite « Parti pour la liberté », actuellement le plus grand parti de la Chambre des représentants des Pays-Bas, a parlé d'une « chasse aux juifs ». Le roi des Pays-Bas a déclaré à M. Herzog : « Nous avons failli la communauté juive des Pays-Bas pendant la Seconde Guerre mondiale, et cette nuit, nous avons encore failli. »
Les médias sociaux ont été inondés des parallèles les plus grossiers que l'on puisse imaginer – y compris des mèmes montrant Anne Frank portant un maillot du Maccabi Tel Aviv – portant à un niveau supérieur l'avilissement de la mémoire de la persécution des Juifs aux mains des nazis et de leurs alliés. Quelle sombre ironie que ces événements aient éclipsé l'anniversaire de la Nuit de Cristal, à un moment où les conséquences de la violence raciste soutenue par l'État semblent si pertinentes.
Dans le sillage du 7 octobre, les spécialistes de l'antisémitisme, du génocide et de l'histoire juive ont mis en garde contre la manière dont des épisodes particulièrement traumatisants de l'histoire juive ont été évoqués pour justifier l'assaut d'Israël sur Gaza et réprimer ceux qui le critiquent. Comme l'a clairement expliqué Brendan McGeever, spécialiste de l'antisémitisme, l'incident d'Amsterdam, bien que brutal et troublant, n'était pas un pogrom, terme qui désigne une attaque contre un groupe opprimé avec le soutien des autorités. La prolifération de ce terme et d'autres semblables à la suite des violences n'a servi qu'à obscurcir la réalité de ces événements en créant une hystérie de masse.
Il s'agit, bien entendu, d'une tactique courante de l'extrême droite : générer le chaos et la peur pour réaffirmer sa vision du monde. L'effacement de la violence raciste des supporters du Maccabi Tel Aviv par la négligence de la plupart des grands médias n'a fait que l'accélérer dans ce cas précis. À une époque où le véritable antisémitisme est en hausse et où les Juifs se sentent particulièrement menacés dans le monde entier, cette instrumentalisation de la peur des Juifs est particulièrement choquante.
La question que nous devons nous poser à la suite de ces événements et du discours qui les entoure est la suivante : quel type de politique cela sert-il ? Il est certainement dans l'intérêt du gouvernement israélien de présenter les violences comme étant uniquement motivées par le racisme antijuif, et donc d'étouffer tout effort visant à les relier à la guerre génocidaire de Gaza.
Les dirigeants israéliens sont déterminés à renforcer le principe sioniste fondamental selon lequel Israël est le seul endroit sûr pour les Juifs et que les musulmans et les Arabes représentent une menace existentielle pour nous, où qu'ils se trouvent. Nous effrayer, c'est nous maintenir dans le droit chemin – sinon, comment continueront-ils à obtenir le consentement à la guerre ?
Plus l'assaut sur Gaza se poursuit, plus il est probable que l'hostilité envers les Israéliens à l'étranger continue à déboucher sur la violence et que le débordement de l'hostilité anti-israélienne en antisémitisme devienne de plus en plus difficile à contenir. Nous l'avons d'ailleurs constaté à Amsterdam, lorsque des personnes ont crié « kanker jood » (juif cancéreux) lors d'attaques contre des supporters du Maccabi.
Il s'agit là d'une illustration claire et terrifiante de l'incapacité d'Israël à être ce qu'il a toujours professé : la réponse à la question de la sécurité des Juifs. Lorsqu'il déclare continuellement qu'il fait la guerre aux Palestiniens au nom de la sécurité des Juifs et qu'il reçoit le soutien enthousiaste de grandes organisations juives du monde entier, il semble inévitable qu'il y ait un glissement entre l'hostilité anti-israélienne et l'antisémitisme. En outre, l'incapacité de la communauté internationale à demander des comptes à Israël n'a fait qu'exacerber les théories du complot sur le pouvoir juif, qui détournent l'attention des mécanismes de l'impérialisme occidental.
Cela ne rend pas acceptable la violence contre les Juifs au nom de la rage contre Israël, loin de là. Mais pour la combattre, nous devons reconnaître que les actions d'Israël rendent les Juifs du monde entier moins en sécurité et chercher à mettre de la distance entre les Juifs de la diaspora et les machinations d'un État-nation totalement désintéressé par notre sécurité.
Les serviteurs de l'extrême droite
Pourtant, le cœur du problème n'a toujours pas été abordé. Nous ne sommes pas en 1938, mais en 2024. Ce qui s'est passé à Amsterdam n'est pas, pour l'essentiel, une histoire d'antisémitisme, mais plutôt une histoire d'islamophobie et de racisme en rapide escalade en Europe. L'horrible vérité est que moins d'un siècle après avoir été pourchassés et exterminés par les nazis et leurs alliés dans toute l'Europe, le prétendu souci des Juifs sert aujourd'hui de serviteur aux ambitions de l'extrême droite, qui brandit nos peurs comme une arme contre les musulmans, les Arabes et les immigrés du Sud.
Ces batailles politiques régressives ont été pleinement affichées depuis le 7 octobre, justifiées par le récit – que les dirigeants israéliens et les organisations juives de droite du monde entier ont encouragé – selon lequel le soutien à la Palestine représente une menace directe pour la sécurité et le bien-être des juifs. La réaction des autorités néerlandaises aux événements de la semaine dernière a été alarmante à cet égard : Wilders a déclaré qu'Amsterdam était devenue « la bande de Gaza de l'Europe » et a promis d'expulser « les Marocains qui veulent détruire les Juifs ». Et il n'est pas le seul à nourrir cette ambition : le gouvernement néerlandais dans son ensemble envisage la possibilité de retirer leur nationalité aux personnes ayant une double nationalité et condamnées pour « antisémitisme ».
Ces mesures sont le résultat inévitable de la rhétorique extrême contre les critiques d'Israël qui s'est développée au cours de l'année écoulée. Qu'il s'agisse de qualifier les manifestations pro-palestiniennes de « marches de la haine », de créer des paniques morales à propos des « zones interdites » aux Juifs ou de procéder à de violentes arrestations de manifestants pacifiques, nous assistons à l'effondrement de l'antisionisme en une forme de terrorisme et d'anti-européanisme. La « lutte contre l'antisémitisme » est devenue de plus en plus synonyme de maintien du pouvoir de l'État, notamment de son pouvoir de punir et de surveiller d'autres minorités.
Il existe une myriade de cas, au cours de l'année écoulée, dans lesquels le nationalisme européen a été invoqué pour aligner la lutte contre l'antisémitisme sur un programme xénophobe et anti-immigrés. En France, par exemple, la première « Marche contre l'antisémitisme et pour la République » a été menée par Marine Le Pen, leader du Rassemblement national, qui a ensuite réussi à pousser le gouvernement français actuel à adopter une législation anti-immigration draconienne qui cible spécifiquement les personnes de couleur. Autrefois persécutés en tant qu'ennemis de l'État, les Juifs ont été transformés en une minorité modèle au nom de laquelle la France exclut et attaque les communautés musulmanes.
Des changements politiques similaires ont eu lieu en Grande-Bretagne, où les événements de l'année dernière ont donné naissance à une nouvelle situation dans laquelle le soutien à la communauté juive en est venu à représenter une sorte de valeur britannique au sein de l'élite politique, tandis que le soutien à la Palestine est considéré comme une importation étrangère. Les lois sur l'immigration et la lutte contre le terrorisme ont été utilisées pour cibler les partisans de la Palestine ; dans un cas, un ancien ministre du Parti conservateur est intervenu personnellement dans le processus de révocation du visa d'un étudiant étranger qui avait pris la parole lors d'une manifestation pro-palestinienne. En août, des leaders d'extrême droite comme Tommy Robinson ont galvanisé les émeutes raciales à travers le Royaume-Uni, invoquant la nécessité de reprendre les rues au « Hamas ».
En Allemagne, la police a interdit et réprimé des manifestations pro-palestiniennes avec une extrême violence, y compris contre des Juifs allemands et des Israéliens qui protestaient contre les actions d'Israël à Gaza. Il y a deux semaines à peine, le Bundestag a adopté une résolution controversée sur l'antisémitisme, proposée pour la première fois à la suite du 7 octobre, qui supprime le financement public de toute organisation appelant au boycott d'Israël. Une autre loi adoptée au début de l'année exige que les nouveaux citoyens allemands reconnaissent le « droit à l'existence » d'Israël.
De Netanyahou à Wilders en passant par Robinson et Le Pen, il est dans l'intérêt des dirigeants d'extrême droite d'enrôler les Juifs comme fantassins dans la guerre qu'ils mènent contre ceux qu'ils méprisent le plus. Alors qu'ils s'efforcent de plus en plus de brouiller la frontière entre l'antisémitisme et l'antisionisme, nous devons résister à cet amalgame tout en soutenant les communautés juives contre la menace très réelle que représente l'antisémitisme débridé.
Mais les Juifs, aussi, devraient se rappeler que l'extrême droite n'est pas notre alliée. Même si nous ne sommes pas les cibles actuelles de leur colère, l'antisémitisme a toujours alimenté le nationalisme blanc et la suprématie blanche. Permettre que les craintes des Juifs soient utilisées comme un bélier contre d'autres minorités ne fait qu'accroître notre insécurité ; nous devons de toute urgence chercher de nouvelles voies pour la sécurité des Juifs en solidarité avec d'autres communautés marginalisées plutôt qu'en opposition avec elles.
Des groupes juifs de gauche comme Oy Vey Amsterdam, le Jewish Bloc à Londres, Jews for Racial and Economic Justice à New York, et bien d'autres, sont les fers de lance de ce type d'organisation, construisant des coalitions solidaires qui peuvent servir d'inspiration à d'autres. Il est inquiétant de voir que ces efforts sont vertement réprimandés par l'establishment communautaire juif.
En outre, nous devons faire face au fait que, face à plus de 400 jours de génocide, de destruction et de mort aux mains de l'armée israélienne à Gaza, le soutien à Israël en Europe vise en fin de compte à consolider un projet politique d'extrême droite à l'intérieur du pays. Nous ne devons pas laisser l'histoire des désordres d'Amsterdam se répéter de manière à renforcer l'islamophobie de longue date de l'extrême droite et son projet d'escalade anti-migrants.
Traduction : JB pour l'Agence Média Palestine
Source : +972
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Trump : quelque chose comme un « coup de force de basse intensité »

Les individus nominés par Trump aux postes clés de l'administration US font apparaître une réalité encore plus effrayante que ce qu'on pouvait craindre.
Tiré de Gauche anticapitaliste
17 novembre 2024
Par Daniel Tanuro
Un gouvernement d'illuminé·es fanatiques
Robert Kennedy Jr, qui est confirmé comme ministre de la Santé, est un antivax et antiscience notoire, adversaire déclaré du droit a l'avortement (même en cas d'inceste ou de viol).
Personne ne s'attendait a la nomination de Tulsi Gabbard, transfuge du parti démocrate, fidèle amie de Vladimir Poutine et de Bachar Al Assad. Militante anti-woke, Gabbard a relayé les pires mensonges poutiniens (e.a. sur les « 30 labos secrets de création d'armes chimiques-bactériologiques US en Ukraine ») et rendu une visite amicale a Al Assad (après qu'il ait usé d'armes chimiques contre son propre peuple). Qu'elle soit chargée de diriger les services de renseignement étasuniens (CIA, FBI, NSA) est vraiment hallucinant.
Personne ne s'attendait non plus a ce que Trump choisisse un présentateur de Fox News, Pete Hegseth, comme secrétaire a la défense. Le type a certes servi dans l'armée (contrairement a Trump, qui a su éviter le Vietnam !), mais avec un grade intermédiaire et il n'a aucune connaissance des enjeux géostratégiques. Anti-« wokiste » virulent, Hegseth s'est illustré récemment en déclarant qu'il fallait saquer dans l'état-major (il vise en particulier les Noirs et les femmes). Il a plaidé a plusieurs reprises pour que l'armée soit chargée de la déportation massive des migrant·es, promise par Trump. Un boutefeu incompétent et ignare en charge de la plus puissante armée du monde : voilà ou en est l'impérialisme étasunien !
Cette déportation, et la gestion des frontières, est confiée a Tom Homan. Son plan est prêt : Homan est en effet un des auteurs du chapitre que le « Project 2025 » de la Heritage Foundation consacré a ce sujet. On lui a demandé récemment comment éviter des drames humains en reportant des « illégaux » qui ont des enfants aux USA (ceux-ci ont donc le droit d'y résider). Réponse : « c'est simple, on déporte toute la famille »… Voila ce que ce quasi-fasciste appelle une « solution humaine ».
Une autre énorme et scandaleuse surprise (la plus scandaleuse, peut-être ?) est la nomination de Matt Gaetz comme attorney General (ministre de la justice). Le mec, ouvertement et crapuleusement misogyne (« seules les femmes laides » se battent pour l'avortement), consommateur de drogues, est connu pour ses agressions sexistes et pour l'achat de services sexuels a des mineures (il a échappé de justesse a une condamnation, un témoin ne s'étant pas présenté, mais une enquête du comité d'éthique du Sénat US est en cours a son sujet). Gaetz n'a travaillé que quelques mois comme avocat. Dans une interview, il a traité les fonctionnaires du département de la justice de « cafards ».
Marco Rubio, le futur secrétaire d'État (ministre des affaires étrangères) parait presque « normal » au milieu de cette bande d'illuminé·es fanatiques. Mais, là aussi, les choses sont claires : Rubio, de même que le nouvel ambassadeur US en Israël, n'évoque jamais la Cisjordanie : pour lui, il s'agit de la Judée et de la Samarie… La Palestine, pour ces salauds, n'existe pas davantage que les Palestinien·nes. Mais qu'on ne s'y trompe pas : ils sont aussi violemment antisémites que pro-sionistes (leurs récits complotistes sur le rôle de Soros en témoignent).
En attendant la nomination d'un·e climato-négationniste à la politique énergétique (tiens ! Pourquoi pas cette cinglée de Marjorie Taylor Green ?!), la cerise sur le gâteau est évidemment la désignation de Vivek Ramaswamy et d'Elon Musk comme responsables de la simplification de l'État. Les deux capitalistes ultra libertariens ont l'intention de déréguler à tout va et de couper à la hache, voire de supprimer des administrations qui emmerdent les patrons (notamment l'agence de protection de l'environnement, EPA). Et de se servir au passage ! Musk a mis plus de 100 millions de dollars dans le trumpisme, il en attend un « retour sur investissement ».
Le symptôme de la décomposition de la classe dominante
Voila le ramassis de canailles avides et fanatiques qui prétend contrer « le déclin » afin de « make America great again ». En réalité, ce panier de crabes (prêts a s'entre-dévorer à la moindre occasion) illustre plutôt l'incroyable « déclin » nihiliste d'une classe dominante tellement intoxiquée par sa propre idéologie fantasmagorique et rapace qu'elle ne semble même plus capable de « dominer » intelligemment ni le monde, ni la société, ni ses propres instincts les plus vils.
Normalement, toutes ces nominations doivent passer par le Sénat, mais Trump invoque un article de la constitution qui rend possible de passer outre (en cas de relâche du Sénat) pour une période d'un an renouvelable, au nom de l'urgence. Plusieurs responsables républicains se sont empressés de donner servilement leur accord avec cette procédure. On verra… Rappelons de toute manière que la Cour suprême a offert à Trump l'immunité pour les actes commis dans le cadre de sa fonction.
Ce « gouvernement » de copains et de coquins (en fait, une kleptocratie oligarchique), est rassemblé autour de la loyauté au Chef putschiste et à ses mensonges, d'une « pensée » réactionnaire catholique et de quelques objectifs assez clairs : utiliser la justice pour se blanchir, blanchir ses amis, et se venger de ses adversaires ; soutenir le bandit Netanyahou sans la moindre limitation, y compris les projets d'annexion pure et simple de Gaza et de la Cisjordanie ; conclure un deal avec son autre ami Poutine sur le dos du peuple ukrainien et des ses droits démocratiques ; attaquer brutalement les syndicats, les droits des femmes et des LGBTQ, le mouvement pour l'environnement ; faire diversion en flattant des penchants réactionnaires et en organisant des rafles contre les migrant·es, accusé·es de tous les maux. Mais ce sont pour ainsi dire des objectifs au coup par coup, ils ne définissent pas une stratégie de long terme pour l'impérialisme US.
Il faudra suivre attentivement l'évolution des réactions dans la classe dominante et dans son appareil d'État. Profitant de la crise du système bipartisan, Trump s'est approprié le parti républicain pour en faire un instrument national-populiste-autoritaire, lié a l'extrême-droite (plusieurs fachos authentiques dans son équipe, comme S. Miller). Sur la base de son triomphe électoral, il tente maintenant une sorte de « coup de force de basse intensité ». Il le fait avec le soutien militant d'une fraction de la bourgeoisie très active (Musk, Koch et les autres 5 grandes fortunes qui ont finance le Project 2025…). Le grand capital voit évidemment d'un bon œil nombre de ses projets (baisse des impôts, dérégulation…) Mais de nombreux secteurs semblent réservés, au moins sur certains aspects. Le coté kleptocratique du trumpisme (1) inspire de la méfiance – Trump, c'est un mélange d'Al Capone et de Barry Goldwater au pouvoir. Surtout, la puissante caste militaire est certainement inquiète. Pour des raisons géostratégiques évidentes, mais aussi parce que l'aventurisme trumpiste met en danger le consensus autour de son rôle comme bras armé impérialiste censé ne pas faire de politique ( la « grande muette »).
Les tâches de la gauche
En attendant, l'heure est très grave. On n'en serait sans doute pas la si les puissants mouvements sociaux (féministes, antiracistes, environnementaux, syndicaux) qui se sont dressés contre Trump lors de son premier mandat s'étaient structurés et coordonnés pour tenir sur la durée. Au lieu de cela, ils ont majoritairement choisi de miser sur l'opposition démocrate au parlement, puis sur le soutien au gouvernement Biden. Erreur. On voit bien aujourd'hui qu'il n'y a d'autre moyen que de reprendre le chemin des luttes, de la démocratie dans les luttes et de leur convergence. Aux États-Unis et de ce coté-ci de l'Atlantique !
Crédit photo : Licence Creative Commons
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« Affaire Bouazzi » : La pensée unique nationaleuse

Derrière la charge contre Bouazzi se trouve une charge contre toute la gauche. Leur objectif est de la faire taire, et de s'arroger le droit de dire ce qu'ils veulent.
Photo Crédit : André Querry
Tiré de Révolution Communiste
Dans la République de bananes du Québec, le politburo règne en maître. Depuis les bureaux du Journal de Montréal, celui-ci détermine le cadre du débat politique acceptable. Quiconque ose sortir des limites de la pensée unique est immédiatement désigné ennemi public numéro un et attaqué par tous les médias et toutes les institutions au service du régime.
Voilà le sort qui est tombé sur Haroun Bouazzi, qui a commis le crime le plus grave qui soit : insinuer que l'Assemblée nationale est raciste.
Il ne lui restait plus de choix que de faire son autocritique et d'être humilié par tout l'establishment politico-médiatique.
Sous la pression de la direction de Québec solidaire, qui s'est tortillée devant les journalistes comme des vers sous le soleil, il a dû présenter ses excuses. « Je ne considère pas que l'Assemblée nationale et ses membres sont racistes ». « Le fond de mon propos […] n'a jamais consisté à cibler des personnes ».
Oubliez ce que j'ai dit, aucune institution ni aucune personne n'est raciste au Québec, passons au prochain sujet !
Le cirque des derniers jours est absolument délirant. Cette indignation chorégraphiée apparaît encore plus ahurissante quand on considère que les politiciens et chroniqueurs québécois enchaînent les déclarations grossières contre les immigrants et les musulmans depuis des décennies.
Où était l'indignation quand le ministre Jean Boulet a déclaré que 80% des immigrants n'adhèrent pas aux valeurs québécoises ? Où était l'indignation quand François Legault a affirmé que lesimmigrants temporaires sont à 100%la cause de la crise du logement ? Où était l'indignation quand Jean-François Lisée a dit qu'il y avait « des hijabs partout » autour de nos enfants ?
Ceux qui veulent clouer Haroun Bouazzi sur le pilori pour avoir osé parler du racisme à l'Assemblée nationale sont les mêmes qui défendaient bec et ongles leur droit à dire le « mot en N » au nom de la liberté d'expression.
Dans ce contexte, c'était une erreur pour Bouazzi de s'excuser, et c'est absolument pathétique et déplorable de la part de la direction de QS d'avoir plié sous la pression.
Chaque capitulation face à ces chiens enragés ne fait que les encourager. Chaque recul de la part de QS et de la gauche en général confirme à la droite qu'elle domine le terrain politico-médiatique et qu'elle peut déterminer le cadre du débat public.
Les députés solidaires, alors qu'ils se faisaient attaquer de toutes parts, ont fait des pieds et des mains pour réitérer leur respect de la sacro-sainte Assemblée nationale et de leurs « collègues » des partis du statu quo.
Ce que le leadership du parti semble incapable de comprendre, c'est que QS ne sera jamais accepté par l'establishment.
Le parti sera constamment sous la pression des médias et des partis bourgeois pour aseptiser son discours, se conformer aux règles du jeu. Et ce ne sera jamais assez.
Sans surprise, les excuses de Bouazzi d'hier n'ont pas fait taire la meute.
En réalité, derrière la charge contre Bouazzi se trouve une charge contre toute la gauche. Leur objectif est de la faire taire, et de s'arroger le droit de dire ce qu'ils veulent.
Il est temps que la gauche se dote d'une colonne vertébrale et passe à l'offensive.
Mais cela ne peut se faire qu'avec une perspective de classe. Si les politiciens de droite réussissent à faire taire la gauche ainsi, c'est que celle-ci s'accroche depuis des années à une perspective libérale discréditée. Quand la gauche se concentre sur des mesures purement symboliques, des changements de langage, et des condamnations moralistes de comportements individuels, elle se rend facile à caricaturer par la droite.
L'ensemble de la classe dirigeante québécoise, qui contrôle tout l'appareil politico-médiatique, n'a aucune solution aux problèmes que le capitalisme engendre. Elle ne peut pas régler la crise du logement, la crise des services sociaux, la crise du coût de la vie, car cela nécessiterait de s'attaquer à ses propres intérêts de classe. Elle a donc besoin de se servir des immigrants, des musulmans et autres minorités comme boucs-émissaires.
Seule une perspective de classe peut démasquer ces clowns comme des ennemis des immigrants et des travailleurs québécois en général. Une telle perspective de classe permet de recadrer le débat vers la source réelle des problèmes : les patrons et leur système en banqueroute. Tant que QS n'offrira rien de tel, ils se feront passer sur le corps comme c'est le cas depuis une semaine, incapables de répondre aux attaques des partis de l'establishment.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

À « propos » des « propos » de Haroun Bouazzi : Une tempête dans un verre d’eau !

Au Québec, il faut dénoncer nos « travers » en prenant soin de mettre des gants blancs, de le faire avec une voix feutrée, toute douce, exempte de la moindre tonalité un peu grave, qui ne laisse transparaître aucune prise de position un tant soit peu « ferme » et qui ne trahit surtout pas le moindre radicalisme (au sens étymologique de : « prendre les problèmes à leur « racine ») même lorsque la situation l'exige.
Ce qui fait que, autant les parlementaires (toutes orientations confondues) que les médias (sans parler des gérants d'estrade qui étalent leur médiocrité intellectuelle sur les réseaux sociaux) exigent que Haroun Bouazzi présente des excuses pour des propos soi-disant inacceptables, voire insultant, qu'il aurait tenus au sujet d'une atmosphère pour le moins « toxique » à l'Assemblée Nationale (et aussi, ajouterions-nous — à moins qu'il ne l'ait fait — dans l'espace public) qui a pour conséquence la stigmatisation de l'« Autre », entendre tous les citoyens qui n'ont pas la chance d'être des Québécois de « souche » et qui, selon les dires du gouvernement lui-même, exerceraient une pression indue sur les services sociaux, seraient responsables de la crise du logement et représenteraient une « menace » pour la survie du français au Québec.
Que faut-il de plus pour s'inquiéter de cette montée, déjà entamée depuis la fin des années 2000, du nationalisme identitaire chez nos élites, et du fait que les deux partis qui, vraisemblablement, vont se disputer la prise du pouvoir aux prochaines élections (CAQ/PQ) assument sans broncher cette vision du Québec qui érige une frontière (de façon tout à fait aléatoire) entre « Eux », les nouveaux arrivants, et « Nous », les Québécois d'origine canadienne-française ? Encore là, fidèle à notre réputation de gens « affables », ouverts aux compromis, allergiques aux « extrêmes », il faudrait dire les choses sans vraiment les dirent, dénoncer le génocide à Gaza sans mentionner que la CAQ a longtemps « refusé » d'exiger un cessez-le-feu (et qu'elle s'y est contraint sur le bout des lèvres), qu'elle accuse Québec Solidaire (QS) d'être « complice » du Hamas, que, malgré la tuerie de masse en cours en Palestine orchestrée par le gouvernement Nétanyahou, lui-même noyauté et manipulé par l'extrême-droite religieuse, il faille quand même s'assurer que, au-delà des « chicanes » politiques entre Musulmans et Juifs, ces conflits ne viennent pas entamer « la bonne marche des affaires » au Moyen orient !
C'est exactement la teneur du discours qu'a servi Martine Biron à l'Assemblée Nationale pour justifier cette décision (qui relève d'un manque flagrant de professionnalisme en matière de relations internationales et de diplomatie, étant donné les circonstances) d'installer et de maintenir une ambassade du Québec à Tel-Aviv en plein processus « sioniste » de nettoyage ethnique dans le but avoué d'instaurer le « Grand Israël » au Proche Orient, quitte à grignoter des parties de territoire souverain en Égypte, en Jordanie, au Liban, en Syrie, en Irak, en Arabie Saoudite, etc. Les « affaires » vont-t-elles pouvoir prospérer si la région s'enflamme comme elle a déjà commencé à le faire ?
N'en déplaise au Caucus de QS, aux éditorialistes du Devoir qui tentent constamment de souffle sur le chaud et le froid en même temps ou aux député(e)s à Québec qui s'évertuent à jouer les vierges offensées, l'intervention de Haroun Bouazzi se situe dans la droite ligne de la raison d'être même de la présence de QS à l'Assemblée Nationale. Le parti a vu le jour dans le contexte d'une résurgence du capitalisme sauvage en Occident, d'une sacralisation du néolibéralisme comme seule philosophie socio-économique acceptable, d'une dévalorisation grandissante de la délibération parlementaire au profit d'une concentration du pouvoir entre les mains de diverses instances décisionnelles (Exécutif, Conseil des Ministres, prérogative et veto présidentiels), du retour des mouvances d'extrême-droite dont les discours font la fortune des plate-formes numériques et de certains médias mainstream qui y voient une opportunité pour augmenter leur tirage et d'une soi-disant « crise » identitaire de la civilisation occidentale en train de perdre ses repères habituels qui l'avaient hisser au rang de modèle de démocratie à imiter.
Faut-il le rappeler, QS est un parti de « gauche », féministe, altermondialiste, écologiste, indépendantiste, qui défend un nationalisme « civique », donc inclusif, ce qui signifie qu'il s'engage à dénoncer toutes les formes de xénophobie, de racisme, de discrimination basée sur des considérations d'ordre ethnique, culturel, religieux (dont on peut observer les linéaments même dans l'enceinte « sacro-sainte » d'un parlement !) D'où son opposition à la Loi 21 (qui recèle, au regard du droit international, un aspect éminemment « discriminatoire »), son parti-pris pour la cause palestinienne — non pas parce que les Palestiniens sont des arabo-musulmans mais parce que leur État-en-devenir est occupé par un autre État, occupation déclarée « illégale » à plusieurs reprises par l'ONU, au grand fou rire d'Israël (si c'était les Juifs de Palestine qui étaient opprimés par les Arabes, QS prendrait position pour les Israélites, tout comme si c'était un autre gouvernement, disons français ou russe, que celui qui, actuellement, ne reconnaît pas le droit des « non-Juifs » à exister sur le même territoire, le jugement porté sur ce comportement anti-démocratique, colonialiste, anti-humaniste serait le même), sa dénonciation du peu d'intérêt du gouvernement de la CAQ pour la cause environnementale, soumise de plus en plus aux considérations « économiques » (au sens « néo-libéral » et « néo-capitaliste » du terme), alors qu'il règne sur la planète un « climat » de fin du monde digne de l'Apocalypse de Saint-Jean !
Donc, avis aux indécis et aux sceptiques : on est à « gauche » ou on l'est pas…
Mario Charland
Shawinigan
Diplômé en philosophie
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Haussez le salaire minimum

Voici une lettre au Ministre Boulet . Nous savons que le Ministre doit prendre sa décision pour le salaire de 2025 dans les prochaines semaines.
Monsieur le Ministre,
Pour les membres du Front de défense des non-syndiqué.e.s, il apparaît urgent de modifier la méthode de fixation du salaire minimum au Québec.
Nous demandons au gouvernement de livrer sa promesse de créer des « emplois payants » en utilisant le principal outil législatif à sa disposition pour influencer les emplois du secteur privé. Parce qu'il est urgent de permettre à des centaines de milliers de travailleuses et travailleurs de sortir de la pauvreté, le gouvernement doit annoncer un salaire minimum qui dépassera les 20 $.
L'application sans modification de la méthodologie de votre ministère résulterait en un salaire minimum de 16,60 $ pour 2025 en conservant le ratio actuel de 50,8 % avec le salaire moyen. En effet, selon les prévisions récentes, celui-ci se situera autour de 32,60 $ entre avril 2025 et mars 2026. Ainsi, il va sans dire qu'une autre augmentation d'à peine 0,75 $ ou de 1 $ l'heure ne saurait être acceptable dans le contexte actuel.
D'une part, bien que l'inflation se résorbe, les prix des produits de base ont explosé depuis la fin de la pandémie et ils ne redescendront jamais. Alors que l'inflation générale dépassait les 13 % entre septembre 2021 et 2024, le coût de l'alimentation et du logement a augmenté de plus de 20 %. Pour les travailleuses et les travailleurs pauvres, dont une plus grande part de leurs revenus doit être consacrée pour subvenir à leurs besoins essentiels, le début de rattrapage du salaire minimum (16 % sur la période) n'aura pas pu freiner leur perte de pouvoir d'achat. Pour arriver à joindre les deux bouts, bon nombre de salariés doivent avoir recours aux banques alimentaires. Parmi le nombre de personnes ayant recours aux banques alimentaires, celles occupant un emploi atteint maintenant près de 20 %1.
D'autre part, c'est très clair, le salaire minimum ne permet pas de se sortir de la pauvreté. Un grand saut s'avère nécessaire. En 2016, nous rapportions qu'une travailleuse à temps plein au salaire minimum demeurait 35 % en dessous du seuil de sortie de pauvreté. Aujourd'hui encore, le salaire minimum fixé à 15,75 $ ne permet pas de s'élever au-dessus de la pauvreté puisqu'il demeure à 32 % sous la Mesure de faible revenu.
En d'autres mots, la méthode de fixation du salaire minimum du gouvernement favorise le maintien de centaines de milliers de travailleuses et travailleurs dans la pauvreté.
Vous répondrez qu'il faut protéger les emplois. Ces craintes non démontrées empiriquement ne sont aucunement pertinentes dans un contexte où le marché du travail se porte très bien : il manque encore près de 140 000 travailleuses et travailleurs afin de pourvoir des postes vacants. Près de la moitié de ces postes exigent un diplôme d'études secondaires ou moins, et le salaire offert est en moyenne de 20,63 $2. Le taux d'emploi des 15-24 ans est toujours à un niveau supérieur à ce que l'on a connu avant la pandémie (60,2 % contre une moyenne de 57,5 % depuis 2000).
C'est la « recherche de l'équilibre » entre une rémunération équitable et la protection des emplois et de la compétitivité des entreprises qui est évoquée pour justifier la fixation de la hausse annuelle du salaire minimum. Or, cet équilibre est brisé, parce que le salaire minimum n'a rien d'équitable.
Les membres du Front de défense des non-syndiqué.e.s
Notes
1. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2115512/insecurite-alimentaire-record-canada-2024#:~:text=Pr%C3%A8s%20de%2020%20%25%20des%20visiteurs,ann%C3%A9e%20derni%C3%A8re%2C%20indique%20le%20rapport
2.https://statistique.quebec.ca/fr/document/postes-vacants-au-quebec/publication/postes-vacants-au-quebec-par-trimestre#remuneration
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

La ville de Québec doit utiliser ses leviers pour promouvoir le logement social

Québec, le 20 novembre 2024 - La Table citoyenne Littoral Est, l'Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep de Limoilou et le Conseil de quartier de Maizerets demandent à la Ville de Québec de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour acquérir le terrain situé au 1600 boulevard Henri-Bourassa, particulièrement à risque de gentrification, et l'ajouter à sa réserve foncière afin d'en faire du logement social et étudiant.
Le 27 septembre dernier, la Table citoyenne a appris que le promoteur Brivia affichait son terrain en vente sur le site internet de l'agence Landerz, spécialisée dans la revente rapide de terrains à haut potentiel de développement immobilier. « Ce terrain-là est situé dans un secteur stratégique du quartier Maizerets, à proximité de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, du CLSC de Limoilou, du Cégep Limoilou, d'un éventuel projet de tramway et en face d'un projet de centre social autogéré réclamé par la communauté ! » indique Martial Van Neste, vice président du Conseil de quartier de Maizerets.
Nous y voyons un danger important de gentrification dans un quartier dont les citoyen.ne.s qui y vivent peinent déjà à se loger. Selon les chiffres du recensement de 2021 disponibles dans la carte interactive produite par la Table citoyenne Littoral Est, jusqu'à 60% de la population des secteurs avoisinants est affectée par des besoins impérieux en matière de logement. 1 ! « Le quartier est composé à grande majorité de personnes à faible et revenu modeste. Ce sont elles qui sont le plus durement touchées par la crise du logement ! Il faut à tout prix freiner la spéculation immobilière. Ce ne sont pas des logements privés dont nous avons besoin, mais plus de logements sociaux ! » ajoute Azélie Rocray, coordonnatrice de la Table citoyenne Littoral Est.
En outre, dans sa vision d'aménagement des quartiers de la Canardière publié en juin dernier, la Ville de Québec s'est donnée pour objectif de hausser l'offre de logements sociaux, communautaires et abordables de 12% à 20% répartis sur le territoire « tout en priorisant l'aire d'influence du tramway pour contrer l'embourgeoisement »2. La réserve foncière destinée au logement social et abordable de la ville de Québec est un levier 1Les besoins impérieux en matière de logement est un indice statistique utilisé lorsqu'un logement ne rencontre pas l'un des critères suivants : l'abordabilité (plus de 30% des revenus pour se loger), la salubrité et la taille. Statistique Canada 2024. 2Ville de Québec. 2024. « Vision d'aménagement : quartiers de la Canardière ». p.50-51. important pour l'atteinte de ces objectifs en mettant à l'abri de la spéculation des terrains propices au développement immobilier.
La coalition :
Conseil de quartier de Maizerets
Association générale des étudiantes et des étudiants du Cégep de Limoilou
Table citoyenne Littoral Est
Notes
1.Les besoins impérieux en matière de logement est un indice statistique utilisé lorsqu'un logement ne rencontre pas l'un des critères suivants : l'abordabilité (plus de 30% des revenus pour se loger), la salubrité et la taille. Statistique Canada 2024.
2.Ville de Québec. 2024. « Vision d'aménagement : quartiers de la Canardière ». p.50-51.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Face à la dématérialisation, Gardons l’humain au cœur des services publics !

Montréal, le 19 novembre 2024 — Aujourd'hui, le Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ) et ses membres invitent la population à joindre sa voix aux plus de 5400 signataires de la <https:/rgpaq.qc.ca/traversons#d%C3...>'>déclaration Traversons l'écran : pour que l'humain demeure au cœur des services publics ! Il est possible de signer la déclaration en ligne, mais aussi en personne !
En effet, depuis le lancement de la déclaration en avril 2024, le RGPAQ, ses membres et ses alliés se mobilisent régulièrement partout au Québec pour permettre à tout le monde de se faire entendre. Rien qu'aujourd'hui, une <https:/www.facebook.com/share/1Y2i...>'>quinzaine d'organismes dans plusieurs régions sont en action. « Alors que l'on dénonce les effets du virage numérique des services gouvernementaux, nous appliquons à nous-mêmes les solutions que nous proposons pour ne laisser personne de côté. Notamment, l'idée qu'il faut maintenir plusieurs choix d'accès ! Dans notre campagne, pour signer la déclaration, il y a un code QR et un formulaire en ligne, mais grâce aux activités sur le terrain, les deux tiers des signatures récoltées sont papier ! » indique Cécile Retg, responsable à la défense collective des droits.
La campagne s'inscrit dans une démarche plus large du RGPAQ et de ses groupes membres pour favoriser l'exercice du droit à l'information et assurer l'accès aux services pour les personnes peu alphabétisées et en situation de pauvreté. « Je ne suis pas capable d'aller faire les affaires du gouvernement en ligne […]. J'ai peur des conséquences si je fais une erreur […]. C'est humiliant pour moi de ne pas pouvoir faire mes papiers. C'est pas facile d'apprendre à utiliser les ordinateurs. Le gouvernement devrait arrêter de tout mettre sur Internet. » témoigne Claude Blain, membre du comité des participants et participantes du RGPAQ.
À l'image de monsieur Blain, de nombreuses personnes vivent des difficultés avec le numérique. Selon<https://rgpaq.sharepoint.com/:b:/s/...>'>une consultation, à laquelle ont participé 38 groupes d'alphabétisation populaire et plus de 400 personnes : 61 % des répondants vivent des difficultés pour accéder et parler à des personnes, 23 % ont des difficultés de compréhension et 16 % n'arrivent pas à prendre des rendez-vous. Les conséquences sont donc graves sur leur qualité de vie, leur santé et leurs revenus. À l'heure de la « rigueur budgétaire » où les services publics en personne seront sans aucun doute touchés, le tout numérique ne permettra pas d'économies, il y aura des coûts sociaux et humains.
À propos du RGPAQ
Le Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec<https://rgpaq.qc.ca/> (RGPAQ) représente 77 groupes<https://rgpaq.qc.ca/#nos-membres> répartis à travers le Québec. Il œuvre à la promotion et au développement des groupes d'alphabétisation populaire et de leur approche, ainsi qu'à la défense collective des droits des adultes peu alphabétisées.
Liste des alliés
https://www.aqdr.org/>
,">L'AQDR
le <https:/www.pauvrete.qc.ca/>'>Collectif pour un Québec sans pauvreté,
le <https:/fcpasq.qc.ca/>'>Front commun des personnes assistées sociales
et la https://fmpdaq.ca/>
.">Fédération des mouvements personne d'abord du Québec
– 30 –
À noter
Aujourd'hui, l'équipe du RGPAQ effectue un rallye dans le Grand Montréal pour visiter des groupes durant leurs activités de récolte de signatures. Nous publierons en direct via notre page <https:/www.facebook.com/rgpaq>'>Facebook. #traversons
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Les 4es États généraux de l’itinérance débutent ce mercredi à Québec

Québec, le 25 novembre 2024 – Du 27 au 29 novembre, plus de 450 participants se réuniront au Centre de foires de Québec pour les 4es États généraux de l'itinérance. Cet évènement phare réunira tous les acteurs concernés par la crise de l'itinérance pour co-construire une vision commune de la lutte à l'itinérance qui servira à orienter les stratégies nationales, provinciales et locales.
Sous le thème « Renversons la tendance : un devoir collectif », cet évènement rassemblera experts, chercheurs, intervenants de première ligne, personnes ayant vécu l'itinérance, représentants ministériels et élus. Parmi eux, près d'une vingtaine d'élus municipaux, provinciaux, fédéraux et autochtones, une participation qui illustre la mobilisation intersectorielle et intergouvernementale autour de cet enjeu de société prioritaire.
Une mobilisation exceptionnelle
Le Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec (RSIQ), organisateur de l'évènement, se réjouit de la diversité des participants et de l'ampleur de la mobilisation.
« Avec plus de 450 personnes engagées, dont des élus, des experts et des intervenants de première ligne, ces États généraux sont un véritable reflet de la détermination collective à mettre un terme à la crise de l'itinérance », a déclaré Boromir Vallée Dore, directeur général du RSIQ.
Briser les silos pour optimiser la réponse à la crise
Le RSIQ voit grandir la volonté d'agir des acteurs concernés par la crise de l'itinérance. Toutefois, face à l'ampleur de la tâche, ils se sentent parfois dépassés et limités dans leur capacité d'action. Trop d'initiatives restent isolées, diminuant leur impact global.
Ces États généraux visent précisément à briser ces silos. Une réponse véritablement concertée, ancrée dans une vision commune, permettra de créer un effet de levier significatif, en maximisant l'impact des actions menées sur le terrain.
Les 4es États généraux offriront un espace unique de réflexion et d'échange pour orienter les futures actions. En s'appuyant sur une approche globale, les discussions viseront à élaborer une déclaration commune. Celle-ci incarnera une vision partagée des stratégies à adopter aux niveaux national, provincial et local pour prévenir et réduire durablement l'itinérance.
Un moment charnière pour la lutte à l'itinérance
Cette édition des États généraux s'inscrit dans un contexte particulier : les 10 ans de la Politique nationale de lutte à l'itinérance du Québec. Depuis son adoption, l'itinérance a pris de l'ampleur, exacerbée par des facteurs multiples tels que le manque de logements sociaux, les inégalités économiques, et l'accès limité aux soins de santé. En 2022, plus de 10 000 personnes vivaient en situation d'itinérance visible, une augmentation de 44 % en quatre ans.
Les discussions permettront non seulement de revisiter la politique, mais aussi de réaffirmer un engagement commun face à ce phénomène complexe.
Trois axes au cœur des discussions des États généraux
1. Les droits des personnes en situation d'itinérance : Identifier les avancées en matière de droits des personnes en situation d'itinérance et leur application en lien avec la Politique nationale de lutte à l'itinérance.
2. La prévention de l'itinérance : développer une vision commune de la prévention, partager des actions préventives et porteuses, discuter des actions préventives au Québec, au Canada et ailleurs.
3. La réponse à l'itinérance, une responsabilité partagée : Faire reconnaître la responsabilité partagée en tant que composante essentielle de la prévention et de la réduction de l'itinérance et augmenter la capacité d'agir collectivement.
Pour connaitre la programmation détaillée des 4es États généraux de l'itinérance au Québec : https://itinerance.ca/eg24/programmation-eg/
À propos du Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec
Le Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec a été créé en 1998 et consiste en un regroupement de quinze concertations régionales de lutte à l'itinérance et une vingtaine de membres associés, totalisant plus de 200 organismes à travers le Québec qui visent entre autres à améliorer les conditions de vie des personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Les six façons par lesquelles Justin Trudeau induit la population en erreur à propos de l’immigration

Le nouveau plan de J. Trudeau sur l'immigration est une capitulation devant les Conservateurs.trices.
Syed Hussan, The Breach, 20 novembre 2024
Traduction, Alexandra Cyr
Introduction
Syed Hussan est le directeur de l'Alliance des travailleurs migrants pour le changement. Il critique ici chaque argument par lequel le Premier ministre induit la population en erreur à ce sujet.
- 1- Il s'agit d'un énorme changement
- 2- Une coupe significative en immigration. Une réduction de l'immigration permanente d'au moins 20%.
- 3- L'introduction d'une série de mesures permettant de s'attaquer aux immigrants.es temporaires.
- 4- Conséquence : une diminution des étudiants.es et de travailleurs.euses temporaires étrangers.ères.
Justin Trudeau : le nouveau plan canadien en immigration est honnête. Il diminue le nombre d'immigrants.es entrant au pays que ce soit temporairement ou de manière permanente.
S. Hussan : Ce que je J. Trudeau nous présente ici ce n'est pas un plan ; c'est une capitulation devant les Conservateurs.trices.
Il ne diminue pas le nombre de nouveaux.elles immigrants.es, il expulse 2,300 millions d'immigrants.es du pays. Il tente de justifier cette politique.
J.T. : Parlons d'immigration.
S.H. : Voici l'épreuve des faits.
1- Accepter plus d'immigrants.es ne s'est pas fait par accident. Ce fut un projet bipartisan.
J.T. : Historiquement, le plan visait les résidents.es permanents.es. Le nombre d'étudiants.es et de travailleurs de l'étranger qui était acceptés.es chaque année ne rejoignait pas la demande de l'économie.
S.H. : Depuis 2008, les gouvernements conservateurs et libéraux ont accepté plus d'immigrants.es temporaires que de permenents.es. C'est un virage intentionnel pour réduire le nombre de personnes ayant des droits et rendre les immigrants.es plus exploitables. Une récente enquête des Nations Unies rapporte que le programme des travailleurs.euses temporaires canadien sert à implanter les conditions pour une forme d'esclavage contemporain.
2- Le nouveau plan ne protégera pas les immigrants.es. Il va les rendre encore plus vulnérables.
J.T. : Beaucoup trop de collèges et universités se servent des étudiants.es de l'étranger pour assurer leur fonctionnement. Ils peuvent en exiger des dizaines de milliers de dollars supplémentaires qui ne sont demandés aux citoyens.nes canadiens.nes.
S.H. : Des droits de scolarité très élevés, des permis de travail restreints, peu d'accès à la résidence permanente sont des choix faits par le gouvernement fédéral et ceux des provinces qui permet des traitements injustes. Et ce n'est pas le nouveau plan qui change cela. Le gouvernement permet cette exploitation et puni les exploités.es.
J.T. : Il y a clairement de mauvaises personnes qui exploitent franchement les immigrants.es vulnérables avec des promesses d'emploi, de diplômes et d'accès facile à citoyenneté.
S.H. : Les plans libéraux vont mener à l'expiration de 2,300 millions de permis au cours des deux prochaines années. Cela ne va qu'empirer les conditions d'exploitation, rendre des gens désespérés et encore plus susceptibles d'être mal traités.
3- Les immigrants.es ne sont pas la variable d'ajustement de l'économie
J.T. : Comme équipe fédérale, nous aurions pu agir plus tôt, fermer le robinet plus vite.
S.H. : Les immigrants.es ne sont pas un flot continue qu'on peut arrêter à sa guise. Nous sommes des gens avec des droits, des familles, des rêves et du potentiel. On nous a promis l'égalité des droits et la justice. Le Canada arrache des millions de personnes à ce pays où ils et elles ont construit leur vie.
4- Les immigrants.es ne sont pas un poids pour le Canada. Ils et elles y contribuent massivement.
J.T. : Cette pause va donner à notre économie et à nos communautés une chance de retrouver leur équilibre.
S.H. : Le migrants.es ne sont pas un boulet pour l'économie, au contraire. Leur contribution y ajoute : leur part soutient les services publics auxquels ils et elles n'ont pas accès. La part des étudiants.es de l'étranger au PIB canadien en 2022, a été de 31 milliards de dollars. Ces personnes remplissent des fonctions critiques dans les soins de santé, de l'agriculture et les technologies formant la colonne vertébrale de beaucoup de secteurs.
5- Les immigrants.es ne sont pas à blâmer pour la crise du logement
J.T. : Notre limitation du nombre d'étudiants.es de l'étranger a déjà fait baisser le coût des loyers dans les grandes villes. Et si nous maintenons cette règle, la baisse continuera.
S.H. : Les étudiants.es de l'étranger et les travailleurs.euses temporaires ne fixent pas le coût des loyers ni ne contrôlent le stock de logements. C'est l'action des propriétaires corporatifs qui rénovent et font augmenter les prix des loyers. Les gouvernements provinciaux ont éliminé le contrôle des loyers et n'investissent pas dans le logement social. Le marché spéculatif du logement rend l'achat de maison impossible pour la vaste majorité de la population.
6- L'accès au statut d'asile au Canada n'est pas un jeu de courte échelle ; c'est un droit
J.T. : Certains.es résidents.es temporaires se tournent parfois vers notre système d'asile quand leur visa expire ; c'est une manœuvre pour rester au pays.
S.H. : Ici, J. Trudeau alimente de dangereux stéréotypes au sujet des immigrants.es et des requérants.es du droit d'asile. Rechercher la sécurité, la stabilité ou des « opportunités » n'est pas une manœuvre, c'est un droit humain fondamental inscrit dans les lois canadiennes et internationales.
J.T. : Nous faisons en sorte que le système fonctionne pour les Canadiens.nes et ceux et celles qui arrivent ici plutôt que pour les grands magasins, les chaines de restaurants, les consultants.es en immigration et les collèges tricheurs qui exploitent la situation.
S.H. : S'il veut que le système fonctionne, voici ce qu'il devrait faire :
- Cesser de prendre les immigrants.es comme bouc émissaires.
- Souligner leur contribution indispensable.
- Les protéger immédiatement des coupes à venir.
Leur garantir le statut de résidents.es permanents.es à tous et toutes. Faire cesser le règne de terreur lié aux intérêts corporatifs qui profitent de la nécessité d'assurer ses besoins de base. Et investir dans le logement, les soins de santé et les infrastructures pour tous les résidents et résidentes de ce pays, une bonne fois pour toute.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Taxe éco-irresponsable

L'administration Trudeau annonce aujourd'hui un congé de TPS. Il peut être intéressant de voir cette taxe supprimée pendant deux mois sur certains produits mais il serait préférable de la voir abolie pour toujours sur les biens essentiels. Parmi ceux-ci nous plaçons le transport en commun.
Les <http:/www.oubliesdelautobus.sitew.ca/>'>oubliés de l'autobus ont déposé pour signature sur le site du gouvernement fédéral une pétition qui demande le retrait de la TPS sur les billets d'autocars et de trains, cette taxe ajoutant 5% à leurs prix déjà très élevés. Le groupe constate que ce choix éco-responsable est taxé quand pourtant l'utilisateur de transport collectif contribue déjà au-delà de sa juste part à construire et maintenir les infrastructures routières.
Il reste encore quelques jours pour signer la <https://www.noscommunes.ca/petition...>'>pétition e-5053 qui se lit comme suit :
Attendu que :
• Le transport est un besoin essentiel, particulièrement dans les régions éloignées des centres ;
• Les taxes sur les transports collectifs qui s'ajoutent aux prix des billets les rendent prohibitifs pour les usagers les plus démunis ;
• Les fournisseurs de service de transport collectif peinent à maintenir des horaires suffisants et des circuits universels ;
• Les services de transport collectif contribuent efficacement à la diminution des gaz à effet de serre (GES) ;
• Les citoyens qui utilisent ces services doivent être encouragés car ils collaborent à réduire la congestion et l'émission de GES.
Nous soussignés, citoyennes et citoyens utilisateurs de services de transport collectif au Canada, prions la Chambre des communes réunie en Parlement de supprimer la taxe (TPS/TVH) sur la vente de billets d'autocars interurbains et de trains de passagers.
On peut signer jusqu'au 3 décembre à https://www.noscommunes.ca/petitions/fr/Petition/Details?Petition=e-5053
(enanglais :)
Colette Provost, secrétaire du CA
Les oubliés de l'autobus
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Des groupes pacifistes appellent au retrait du Canada de l’OTAN

L'Assemblée parlementaire de l'OTAN s'ouvre aujourd'hui à Montréal et plusieurs groupes pacifistes se mobilisent pour appeler au retrait du Canada de l'alliance militaire euro-atlantique. Ces groupes dénoncent notamment la pression exercée par l'OTAN sur le Canada pour qu'il augmente ses dépenses militaires à 2 % du PIB. Ils condamnent également la complicité de l'OTAN avec Israël.
Du jeudi 22 au lundi 25 novembre, la 70e session annuelle de l'Assemblée parlementaire de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) se tient à Montréal, réunissant près de 400 délégué·es des 32 pays membres et de 25 autres pays et instances parlementaires partenaires.
22 novembre 2024 | tiré de Pivot
L'OTAN est une alliance militaire réunissant la plupart des pays d'Europe et ceux d'Amérique du Nord, qui s'engage à « défendre la liberté et la sécurité de ses membres par des moyens politiques et militaires ». Elle dit « promouvoir les valeurs démocratiques » et être « attachée à la résolution pacifique des différends ».
Mais à l'approche de son assemblée, les mobilisations de la société civile contre l'OTAN se multiplient. Plusieurs manifestations et activités de sensibilisation sont prévues cette fin de semaine, appelant au retrait du Canada de l'alliance militaire euro-atlantique.
****
Le collectif Désinvestir pour la Palestine, la Convergence des luttes anticapitalistes, le collectif Échec à la guerre et le Mouvement québécois pour la paix organisent plusieurs manifestations les 22 et 23 novembre.
Le collectif Désinvestir pour la Palestine organise également un rassemblement suivi d'une performance artistique le 21 novembre.
Le Réseau pan-canadien pour la paix et la justice organise pour sa part un contre-sommet intitulé « Non à l'OTAN, oui à la paix » le 24 novembre.
****
« Investir dans l'OTAN, dans la soi-disant « défense », ce n'est pas investir dans la paix, c'est investir dans la guerre, dans le militarisme et dans l'impérialisme », déclare Benoît Allard, porte-parole du collectif Désinvestir pour la Palestine.
« L'OTAN n'est pas une alliance défensive, c'est une machine de guerre, de mort, de destruction », dénonce Raymond Legault, porte-parole du collectif Échec à la guerre, en énumérant les conflits armés dans lesquelles l'OTAN s'est lancée au cours des 30 dernières années : Irak, Kosovo, Afghanistan, Libye, Syrie…
Notamment, la guerre « contre le terrorisme » initiée par les États-Unis après le 11– Septembre a causé plus de 4,5 millions de morts directes et indirectes et a créé au moins 38 millions de personnes déplacées, selon des estimations de l'Institut Watson d'affaires publiques et internationales, à l'Université Brown.
« Il faut réveiller le public, mais aussi remettre en question l'agenda de l'ensemble de la classe politique canadienne et québécoise, qui n'ose plus dire un mot contre l'OTAN », souligne Alex Tyrrell, chef du Parti vert du Québec et co-organisateur du contre-sommet.
« Ce qui construit la paix et la sécurité, c'est la solidarité entre les peuples qui se mobilisent pour la paix, pour la réduction des inégalités et des injustices. »
Benoît Allard, Désinvestir pour la Palestine
Aujourd'hui, face à l'escalade des conflits en Ukraine et au Moyen-Orient, les groupes pacifistes affirment aussi qu'il est urgent que les Canadien·nes prennent l'initiative de rebâtir le mouvement pour la paix. Ils appellent les citoyen·nes à descendre dans la rue pour manifester leur opposition à la guerre, comme ils et elles l'ont fait en 2003 contre l'invasion de l'Irak, quand 200 000 personnes avaient pris les rues de Montréal, un événement record à l'époque.
Doublement des dépenses militaires
En 2006, les ministres de la Défense des pays de l'OTAN ont convenu que les alliés consacreraient au moins 2 % de leur produit intérieur brut (PIB) au budget militaire, afin d'assurer une disponibilité opérationnelle à l'échelle de l'alliance. Lors du dernier sommet de l'OTAN, qui s'est tenu en juillet 2024 à Washington, deux tiers des alliés avaient atteint cet objectif.
Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, a réaffirmé l'engagement du Canada à l'atteindre d'ici 2032-2033. Pour ce faire, selon la projection du Directeur parlementaire du budget, les dépenses de défense nationale devraient s'élever à 81,9 milliards $ d'ici 2032-2033, soit près du double du montant prévu pour 2024-2025, estimé à 41 milliards $.
De plus, comme convenu par les alliés de l'OTAN au sommet de Vilnius en 2023, le Canada s'engage également à consacrer 20 % de ces dépenses à l'acquisition de nouveaux équipements majeurs, y compris la recherche et le développement liés, afin d'assurer une modernisation rapide de ses capacités militaires.
« Ce n'est absolument pas nécessaire à la sécurité de la population canadienne », dénonce Raymond Legault. « L'OTAN est de très loin l'alliance militaire la plus armée dans le monde. »
En effet, les dépenses militaires de la trentaine de membres de l'OTAN représentent 55 % du total mondial, selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI). À elles seules, les dépenses militaires des États-Unis ont constitué 37,5 % des dépenses mondiales, soit plus que le total des neuf autres pays en tête de liste, incluant la Chine et la Russie.
« Investir dans l'OTAN, c'est investir dans la guerre, dans le militarisme et dans l'impérialisme. » Benoît Allard
« C'est inacceptable d'investir davantage dans l'armée alors qu'il y a des besoins criants ailleurs », déplore Benoît Allard.
« Ça risque d'avoir des impacts désastreux sur l'ensemble de nos politiques sociales », soutient Raymond Legault.
Les groupes pacifistes soulignent que ce n'est qu'un des nombreux exemples où les grandes puissances de l'OTAN, notamment les États-Unis, influencent voire déterminent la politique canadienne, par exemple en l'incitant à participer à des opérations militaires.
Complice d'Israël
Au cours des sept dernières décennies, les alliés de l'OTAN ont fermement soutenu Israël, y compris dans l'occupation et la colonisation illégales du territoire palestinien ainsi que dans le génocide en cours à Gaza.
« Sauf de rares exceptions, la complicité ou l'inaction des pays membres de l'OTAN, qui se contentent d'appeler à un cessez-le-feu sans la moindre sanction contre Israël, nous donne la mesure réelle de leur attachement aux droits humains et au droit international », déplore le collectif Échec à la guerre dans un communiqué.
Ce sont les mêmes puissances majeures qui avaient soutenu la création de l'État d'Israël au milieu du 20e siècle, dont des États coloniaux tels que les États-Unis et le Royaume-Uni.
En 1987, le président américain de l'époque, Ronald Reagan, avait désigné Israël comme un allié majeur non-membre de l'OTAN. Cela a permis aux pays membres de collaborer plus étroitement avec Israël, notamment en matière de recherche, de développement et de transfert d'armements.
Entre 2013 et 2022, la quasi-totalité des armes importées en Israël provenait de deux pays de l'OTAN, soit les États-Unis et l'Allemagne, selon SIPRI.
Notamment, depuis octobre dernier, les États-Unis ont fourni plus de 10 000 munitions MK-84 à Israël, un type de bombe de 2 000 livres que les forces américaines n'ont presque jamais utilisé dans des zones densément peuplées. Israël, en revanche, en a largué même dans des camps de réfugié·es.
Aujourd'hui, après plus de treize mois de génocide à Gaza, plusieurs pays de l'OTAN continuent d'armer Israël. Dans le cas du Canada, des composantes d'armement sont encore acheminées vers Israël, bien que la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, ait déclaré la suspension d'une trentaine de permis d'exportation de marchandises militaires vers Israël.
« Il faut réveiller le public, mais aussi remettre en question l'agenda de l'ensemble de la classe politique canadienne et québécoise, qui n'ose plus dire un mot contre l'OTAN. »
Alex Tyrrell, Parti vert du Québec
Benoît Allard dénonce que cette collaboration étroite en matière de défense fait d'Israël un laboratoire de l'OTAN pour le développement d'armements. « Les armements qu'Israël a expérimentés sur les Palestinien·nes seront réutilisés par les puissances de l'OTAN dans des conflits et des interventions militaires ailleurs dans le monde, mais aussi contre leur propre population civile. »
Construire la paix
Les groupes pacifistes soulignent que la défense de la sécurité dont se réclame l'OTAN ne sert que les intérêts de certains États occidentaux, au détriment de ceux des populations du Sud global.
Ils soutiennent aussi que la paix et la sécurité ne se construisent pas par les armes.
Benoît Allard fait valoir qu'en se livrant à une course à la puissance militaire, on se retrouve dans une sécurité illusoire. « Si votre voisin s'achète un fusil pour se protéger, il y a des chances que vous vous disiez que la solution est de vous acheter un plus gros fusil pour vous sentir en sécurité », explique-t-il. « Mais c'est un jeu à somme nulle. »
« L'OTAN considère les armes nucléaires comme la garantie ultime de la sécurité de ses pays membres. Ça fait en sorte qu'aucun des 32 pays membres n'a signé le traité sur l'interdiction des armes nucléaires », ajoute Raymond Legault. « C'est absolument suicidaire. Les armes nucléaires menacent l'existence de toute l'humanité. »
« Ce qui construit la paix et la sécurité, c'est la solidarité entre les peuples qui se mobilisent pour la paix, pour la réduction des inégalités et des injustices », souligne Benoît Allard. « Ce sont, par exemple, les blocages des ouvriers portuaires partout dans le monde, qui refusent que leur travail serve à transférer des armes à un état génocidaire, comme c'est le cas d'Israël. »
Selon Benoît Allard, face à la montée de l'extrême droite partout dans le monde, « c'est clair qu'on ne peut pas compter sur nos États et nos gouvernements pour freiner la marche du militarisme. Il faut qu'on le fasse par nos propres moyens, sur nos propres bases, en nous mobilisant dans la rue, sur nos milieux de travail, pour exiger la fin du financement militaire et des guerres impérialistes ».
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Discours de Bruce Katz pour Palestiniens et Juifs unis

Depuis la fondation de l'OTAN en 1949 par douze pays d'Europe et d'Amérique, les alliés euro-atlantiques ont fermement soutenu Israël, malgré son régime d'apartheid et son occupation illégale du territoire palestinien. Depuis le début de sa participation à l'OTAN, le Canada s'est mêlé à des activités pro-israéliennes et anti-palestiniennes. Un exemple frappant est celui de la visite du président israélien Reuven Rivlin à Ottawa en 2019.
22 novembre 2022 | Photo : Bruce Katz, militant pour la paix
Lors de cette visite de Reuven Rivlin à Ottawa, le premier ministre Trudeau a déclaré : « Une relation de longue date entre nos deux pays, avec une coopération étroite qui va bien au-delà des questions de sécurité. Nous sommes devenus non seulement des alliés inébranlables, mais aussi des amis chers. Des amis qui se soutiennent mutuellement dans les bons comme dans les mauvais moments. Des amis qui partagent les mêmes valeurs de paix, de liberté et d'État de droit. » Des amis dans le génocide quoi !
Les ventes d'armes entre les alliés de l'OTAN et Israël ont toujours été la priorité dans les relations entre Israël et les pays de l'OTAN et cela perdure avec le génocide à Gaza. Les alliés de l'OTAN, en particulier les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne, sont les principaux exportateurs d'armes vers Israël, selon le rapport 2023 Trends in International Arms Transfers de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI).
Entre 2019 et 2023, les États-Unis représentaient plus des deux tiers (69 %) de toutes les armes vendues à Israël depuis l'étranger, tandis que l'Allemagne était le deuxième plus grand fournisseur avec 30 %, selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm.
Fin avril, l'Observatoire euro-méditerranéen des droits de l'Homme a estimé qu'environ 70 000 tonnes de bombes avaient été larguées sur Gaza, couvrant une période de six mois entre le 7 octobre et le 24 avril, dépassant largement le total des bombes larguées sur Dresde, Hambourg et Londres combinées pendant la Seconde Guerre mondiale.
Il s'agit de bombes fournies en grande partie par les États-Unis avec d'autres armements sophistiqués provenant de ses alliés de l'OTAN, dont le Canada, qui continue d'expédier des armes à Israël. Le génocide qui se déroule à Gaza et les bombardements indiscriminés au Liban par Israël n'auraient pas pu avoir lieu sans le soutien des États-Unis et de leurs alliés de l'OTAN.
Alors que les États-Unis et l'OTAN menaient des guerres contre l'Afghanistan et l'Irak, Israël a signé en 2006 un Programme de coopération individuelle (PCI) dans le cadre du Dialogue méditerranéen renforcé de l'Alliance. Cela a facilité un partenariat plus étroit entre l'OTAN et Israël dans le cadre d'opérations dites « antiterroristes ». Cependant, pour les États-Unis, qui dominent l'OTAN, et Israël, les « terroristes » figurant sur leurs listes sont des groupes de libération palestiniens. Alors les groupes palestiniens dont la résistance s'avère une lutte anticolonialiste, se font taxer de « terroriste » par les pouvoirs colonialistes dont le Canada. Un exemple concret est l'ajout récent à la liste des organisations terroristes du Canada du réseau de prisonniers palestiniens, Samidoun. Il convient de noter que même si Nelson Mandela est devenu président de la République d'Afrique du Sud, libérée de l'apartheid, en 1994, Mandela est resté sur la liste des organisations terroristes des États-Unis jusqu'en 2008 !
Ces opérations dites « antiterroristes » menées par l'OTAN et Israël visent à empêcher l'autodétermination palestinienne et à saper toute tentative d'aboutir à une paix permanente au Proche Orient. Deux ans après la signature du Protocole d'entente en 2008, l'armée israélienne a lancé l'opération « Plomb durci » et pilonné la bande de Gaza, densément peuplée, avec des bombes et des munitions au phosphore blanc qui brûle la peau au contact, tuant plus de 1 000 Palestiniens et en blessant plus de 5 000 autres. Ce sont les alliés de l'OTAN qui ont fourni à Israël la majeure partie de ses armes, qui ont ciblé les Palestiniens et détruit des infrastructures civiles.
En 2014, l'armée israélienne a lancé une attaque violente appelée Opération Protective Edge contre Gaza qui a causé d'énormes dommages et traumatismes, en particulier aux femmes et aux enfants. Selon l'UNWRA, the United Nations Works and Relief Agency pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient, Israël a tué plus de 2 000 Palestiniens, blessé 11 000 personnes et détruit des établissements de santé, des mosquées, des écoles et des maisons en 2014. Nous notons donc que le génocide à Gaza soutenu par les alliés de l'OTAN a commencé bien avant l'actuel génocide et prend un essor encore plus destructeur avec la Nakba génocidaire à Gaza de 20023 à 2024.
Aujourd'hui, il ne reste pratiquement plus rien à Gaza. Hôpitaux, centres médicaux, écoles, immeubles résidentiels, mosquées, églises, tout est détruit. Plus de 47 000 morts officiels, plus de 100 000 blessés. 70% des morts sont des femmes et des enfants. Plus de 17 000 enfants palestiniens ont été assassinés. Le nombre de morts est bien plus élevé parce que des milliers de Palestiniens disparus, ensevelis sous les décombres laissés par les bombardements incessants israéliens, n'ont pas encore été ajoutés à la liste officielle des morts palestiniens.
En fait, plus de cent mille Palestiniens ont été tués à Gaza. Israël a provoqué une famine artificielle contre la population palestinienne sans défense, tout cela avec le soutien explicite des pays de l'OTAN.
Ce n'est que récemment que des vidéos ont été diffusées montrant les troupes israéliennes pillant ouvertement les camions d'aide humanitaire devant les Palestiniens affamés. C'est un génocide classique qui se déroule à Gaza, fabriqué en Amérique avec le soutien des alliés de l'OTAN. À cela, s'ajoute des centaines de Palestiniens en Cisjordanie occupée tués dans les pogroms de colons israéliens d'extrême droite, appuyés dans leurs exactions par l'armée de l'occupation, et quelques mille Libanais tués dans les bombardements au Liban, tout cela avec la bénédiction de l'OTAN. Le gouvernement Trudeau est complice de ce génocide et cela ne doit jamais être oublié, car il n'y a pas de prescriptions pour le crime de génocide, des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité.
Netanyahou et Gallant ont maintenant un mandat d'arrêts contre eux pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Je pose la question suivante : Si Justin Trudeau et Mélanie Joly ont soutenu le génocide à Gaza, les crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Cisjordanie et au Liban en soutenant le régime terroriste de Benjamin Netanyahou par le biais des armes qu''ils envoient à Israël, et le soutien politique et diplomatique qu'ils offrent au criminel de guerre Netanyahou, ne devraient-ils pas également faire l'objet d'une enquête de la Cour pénale internationale pour complicité de crimes contre l'humanité et crimes de guerre ? Je dis « oui », et PAJU exhorte des avocats du Canada qui voudraient entreprendre la cause de voir à ce que Trudeau et Joly soient poursuivis pour leur soutien militaire, politique et diplomatique inconditionnel à la campagne génocidaire à Gaza.
Canada Hors de l'OTAN. Vive la Palestine libre et indépendante, libérée des entraves et du joug du colonialisme « Otanien » et du culte de l' » Israélisme ». Oui au judaïsme, non à l' »Israélisme ». Oui à la paix, non à l'OTAN !
Bruce Katz
Coprésident
Palestiniens et Juifs unis (PAJU)
le 22 novembre 2024
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Les femmes en marche : Nouvelles d’Afrique Kenya : Renforcer la résilience féministe

Cette semaine au Kenya, les alliés du Mathare Social Justice Centre (MSJC) ont organisé une session communautaire puissante sur la violence basée sur le genre, en se concentrant sur la violence sexuelle à l'encontre des femmes et des personnes handicapées.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/11/17/les-femmes-en-marche-nouvelles-dafrique/?jetpack_skip_subscription_popup
La session a abordé des questions urgentes telles que la souillure, l'inceste et le viol, suscitant des discussions approfondies sur la défense du corps des femmes et la protection des personnes vulnérables. Les membres de la communauté se sont rassemblés pour aborder ces questions cruciales, en s'engageant fermement dans la lutte contre la violence.
Simultanément, dans le comté de Kisumu, le nouveau groupe Nambokana/Nyando a tenu une réunion centrée sur la construction d'une économie féministe. Cette réunion a marqué une étape importante vers l'autonomisation économique et structurelle des femmes, renforçant ainsi le leadership et la solidarité féministes au niveau local.
L'équipe kenyane a également participé activement à la production du film « Women on the March : #UntilWeAreAllFree », une plateforme dynamique qui amplifie les voix défendant la liberté, la justice et l'égalité.
Sahara occidental : Une lutte pour la justice et la souveraineté
La situation actuelle au Sahara occidental demeure une préoccupation majeure pour les défenseurs des droits des femmes et de la libération dans le monde entier. Légalement reconnu comme un territoire non autonome sous mandat des Nations unies, le droit à l'indépendance du Sahara occidental est inscrit dans le droit international, mais reste une question contestée. Sur le plan politique, la région a connu des décennies de troubles, à commencer par l'accord de Madrid de 1975, qui a vu sa partition entre le Maroc, la Mauritanie et l'Espagne.
L'exploitation par le Maroc des ressources naturelles du Sahara occidental s'est heurtée à des obstacles juridiques, la Cour européenne reconnaissant finalement la souveraineté du peuple sahraoui sur ses ressources. Cette victoire juridique pour le Sahara occidental souligne le rejet international des revendications marocaines et renforce la légitimité du Sahara occidental en tant que territoire distinct. Récemment, la Cour internationale de justice a renforcé la cause sahraouie en se prononçant contre l'accord de pêche qui incluait le Sahara occidental, symbolisant ainsi une victoire majeure dans la lutte juridique mondiale pour la souveraineté.
Zimbabwe : élargissement des réseaux de lutte agricole
Au Zimbabwe, Shanty, Martha et Caroline ont représenté la Marche Mondiale des Femmes (MMF) lors d'un rassemblement important pour le Programme Détaillé de Développement de l'Agriculture Africaine (PDDAA), ainsi que lors d'une réunion parallèle avec la FAO. L'équipe a présenté la coordination de la MMF avec les agricultrices et les jeunes, en particulier dans le domaine de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Elle a également élargi le réseau pour inclure davantage d'organisations et de groupes alliés qui partagent ces priorités.
Les mises à jour de cette semaine soulignent le courage et la résilience des femmes à travers l'Afrique, travaillant sans relâche pour la justice, l'autonomisation et la vision d'une économie féministe. Des réunions locales au Kenya aux victoires internationales pour le Sahara occidental, la mission de la MMF reste claire : « Nous marchons jusqu'à ce que toutes les femmes soient libres ».
https://marchemondiale.org/index.php/2024/11/07/les-femmes-en-marche-nouvelles-dafrique/?lang=fr
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
.*

Les 12 jours contre les violences envers les femmes : la campagne 2024

Les cyberviolences genrées constituent un fléau discret, mais pernicieux touchant les femmes ainsi que les personnes issues des minorités de genre, religieuse ou en situation de handicap, et ce, dans tous les aspects de leur vie quotidienne. Avec l'essor du numérique, ces violence se multiplient et prennent des formes toujours plus variées, se manifestant dans les espaces virtuel tels que les réseaux sociaux, les jeux en ligne et les forums, mais également au sein d'échanges privés.
Pourquoi maintenant ?
Les cinq dernières années ont vu une augmentation alarmante des cyberviolences basées sur le genre. Cette montée est exacerbée par :
– La prolifération d'espaces numériques sans régulation adéquate.
– Des lois insuffisantes pour encadrer les cyberviolences, souvent inadaptées à la réalité technologique.
– Une mise en œuvre inefficace des lois existantes, aggravée par une banalisation généralisée et un manque de sensibilisation des acteurs du système judiciaire.
Les impacts de la cyberviolence
– Isolement social et peur de s'exprimer publiquement
– Détresse psychologique et perte de dignité
– Recul significatif de la participation des femme, des minorités de genre et de religion dans les débats publics et numérique
En refusant d'agir, nous normalisons...
– Le harcèlement psychologique sur les réseaux sociaux
– prolifération de discours sexistes et haineux, détruisant l'espace public numérique
– le contrôle numérique dans la sphère publique, utilisé comme outil d'oppression
Un appel à l'action
Cette campagne vise à informer les publics cibles sur les différentes formes de cyberviolences genrées, à encourager des actions collectives pour contrer ces violences et soutenir les personnes touchées, et promouvoir les initiatives des différentes organisations de l'écosystème à travers un calendrier centralisé, afin de lutter efficacement contre ces violences en ligne.
– Faire connaître les différentes formes de cyberviolences genrées.
– Encourager des actions collectives pour contrer ces violences et soutenir les personnes touchées.
– Promouvoir les initiatives des différentes organisations à travers un calendrier centralisé.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

C’est l’urgence FÉMINICIDES au Québec, qu’attendons-nous pour agir ?

Voici le communiqué de presse en lien avec l'action d'aujourd'hui tenue devant le Palais de Justice à Québec.
Québec, le 21 novembre 2024 –
À quelques jours du lancement de la Campagne des douze jours d'action contre les violences faites aux femmes, le Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale (RGF-CN) lance un cri d'alarme face à l'actuelle vague de féminicides.
Minnie Ivilla a succombé à ses blessures le 8 novembre, à la suite d'une attaque survenue en octobre à Puvirnituq. Le meurtrier, son petit-fils, avait été libéré un mois plus tôt malgré des accusations d'agression sexuelle et d'attaque à la hache. Ce meurtre de marque le 25e féminicide connu en 2024, alors que l'année n'est pas encore terminée. À ce rythme, nous atteindrons, voire dépasserons le nombre de féminicides commis pendant la pandémie en 2021, année considérée comme une année de crise sur le plan des violences envers les femmes. Dans le dernier mois, il y a eu 5 féminicides au Québec.
« Combien de femmes des Premières nations ou Inuites sont victimes de féminicides dans le silence ? Les femmes autochtones constituent le tiers des victimes de féminicides au Canada, alors qu'elles sont 5 % de la population. Nous constatons que les féminicides de femmes autochtones sont souvent moins médiatisés et davantage invisibilisés, ce qui nous porte à croire que le nombre de féminicides pourrait être beaucoup plus élevé, » souligne Élise Landriault-Dupont, co-coordonnatrice du Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale (RGF-CN).
Réunies devant le Palais de justice, les manifestantes ont voulu interpeller le gouvernement et le système de justice, qui échouent trop souvent à protéger les victimes de violence. Dans de nombreux cas de féminicides, les agresseurs étaient judiciarisés ou connus des milieux policiers. Ces meurtres auraient pu être évités.
Les meurtres de femmes et de filles sont la pointe de l'iceberg d'un continuum de violences normalisées et banalisées. Ces violences envers les femmes et les filles sont le fruit d'un rapport de domination des hommes sur les femmes. La société tolère et parfois même encourage ce type de domination, comme en témoignent les discours antiféministes et masculinistes. Phénomène très inquiétant, un récent sondage a démontré qu'au Canada, 40% des jeunes hommes entre 18 et 30 ans sont en accord avec l'affirmation que : « Le père de famille doit commander chez lui ». Les organisatrices la manifestation dénoncent fortement toute tolérance à l'égard de ce type de propos.
Pas une de plus
Devant l'urgence de la situation, le Regroupement des groupes de femmes exhorte le gouvernement et la ministre à la Condition féminine, le Ministre de la Sécurité publique ainsi que le Premier Ministre, à mettre en place un plan d'action d'urgence pour contrer les féminicides, dès maintenant !
« Il faut faire les changements nécessaires dans notre système de justice, pour que les agresseurs ne puissent plus récidiver ou poser des gestes violents en attente de leur procès. Il faut refuser de baisser les bras et d'accepter que d'autres femmes soient agressées, violentées, tuées.
Plusieurs solutions sont déjà connues, comme augmenter le nombre de places en maisons d'hébergement et en maison de deuxième étape. Au cours de la dernière année SOS Violence conjugale n'a pu trouver de places en maisons d'hébergement pour la moitié des femmes demandant de l'aide. Vivement des investissements témoignant d'une réelle volonté politique ! », scande Élise Landriault-Dupont, co-coordonnatrice du Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale (RGF-CN).
Le RGF-CN regroupe des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale et travaille la défense des droits et des intérêts de toutes les femmes, l'égalité des femmes entre elles, l'amélioration des conditions de vie.
Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale – RGF-CN
info@rgfcn.org
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Causons éoliennes

C'est le titre d'une annonce de la MRC des Maskoutains qui invite les citoyens et citoyennes à une démarche participative au sujet des énergies renouvelables. À première vue, c'est une très bonne idée.
De plus, à la même page, le député de Saint-Hyacinthe-Bagot, M. Savard-Tremblay, en remet avec un texte dont le titre est « Transition énergétique : plus que jamais, Maîtres chez nous ».[1] Au moment où la désastreuse COP29 a lieu dans l'état pétrolier de l'Azerbaïdjan,[2] nous sommes comblés d'entendre toutes ces belles paroles que nous désirons si ardemment entendre ! Malgré la bonne volonté de certains intervenants, le parcours vers cette transition énergétique est parsemé d'embûches.
Malheureusement, les experts en communications des multinationales des énergies utilisent les mots de la transition énergétique comme des pièges à ours pour mousser leurs intérêts au détriment de la population. Ces experts prostituent le sens des mots. Dans mon dictionnaire, la deuxième définition de ce verbe se lit comme suit : « prostituer : 2.litt. avilir par intérêt… » [3] Avec cette désinformation systématique, est-il étonnant que bon nombre de personnes de bonne foi en viennent à perdre leur latin ? Pour se protéger de ces attrape-nigauds, il faut apprendre à analyser CE QUI N'EST PAS DIT dans chaque situation car c'est dans le non-dit que se cachent les arnaques !
À titre d'exemple, prenons le mot « renouvelable ». Comme tout le monde veut se l'approprier, les « pimps de l'information » l'utilisent à toutes les sauces. Par exemple, est-ce que faire des coupes à blanc de forêts en Colombie-Britannique pour que la multinationale DRAX produise de « l'électricité renouvelable » en Angleterre est une bonne idée ?[4] D'accord, c'est renouvelable, mais il faudra un siècle pour que la forêt se régénère ! Entre-temps, nous avons un urgent besoin de ces arbres pour capturer du carbone et fournir des matériaux de construction. De même, la bioraffinerie de Greenfield Global, à Varennes, produit de l'éthanol « renouvelable » fabriqué avec du maïs-grain pour rendre l'essence plus « verte ». Selon un article du Devoir, si on acceptait la proposition d'ajouter 15 % d'éthanol à l'essence, la quasi totalité de la production de maïs-grain du Québec serait nécessaire pour produire ce « carburant renouvelable ».[5] La question qui tue : est-ce que notre agriculture doit nourrir les automobiles ou doit-elle nourrir la population ? Reste à savoir si l'empreinte totale de ce « carburant renouvelable » (le labourage, la préparation du sol, l'utilisation d'engrais et de pesticides, la récolte, le séchage, etc) produit plus de gaz à effet de serre (GES) que son équivalent fossile !
Tout comme M. Savard-Tremblay, je grince des dents lorsque mes impôts servent à payer les 34 milliards de dollars requis pour tripler la capacité de l'oléoduc Trans Mountain. Ce pipeline a un seul but : produire plus de barils de « Western Canadian Select » qui rejetteront des millions de tonnes de GES dans l'atmosphère. Peut-on m'expliquer logiquement comment le fait d'augmenter notre production de GES avec ce pétrole contribuera à « décarboner » notre production d'énergie dans le cadre des changements climatiques ?
Alors, comme le suggère la MRC, « causons énergies » en ce début du 21e siècle. Cette conversation doit obligatoirement tenir compte du projet de loi no 69 (PL 69) présenté par le ministre Fitzgibbon et maintenant défendu par la ministre Fréchette. Ce projet de loi est touffu et difficile à comprendre. Si on le simplifie à l'extrême, on peut dire qu'il produira les effets suivants : a) il concentre le pouvoir dans les main du ministre, ce qui laisse le secteur énergétique dépendre de l'humeur politique du moment ; b) il donne le droit de vendre des actifs ou d'avoir un réseau privé, ce qui pourrait constituer un détournement d'actifs qui nous appartiennent vers des compagnies privées ; c) il concentrera les activités d'Hydro-Québec sur les terres publiques du nord tandis que les compagnies privées agiront dans les milieux habités comme sur nos terres agricoles ; d) il semble nier l'expertise d' Hydro-Québec en plus d'obliger celle-ci à acheter « à perte » de l'électricité de ces compagnies privées, ce qui, à moyen terme, hypothèquera la santé financière d'Hydro-Québec ; e) chaque éolienne devient une enclave énergétique privée, ce qui est contraire au schéma d'aménagement des municipalités et de la MRC. Dans un mémoire de 25 pages (plus les 4 annexes) présenté à la Commission parlementaire, le CCCPEM a exigé le retrait de ce projet de loi dans sa forme actuelle tout en continuant de réclamer un BAPE générique pour débattre de la transition énergétique.
Au centre-ville de Saint-Hyacinthe, nous avons un symbole d'une politique énergétique éviscérée de son sens premier. La centrale électrique située à l'extrémité du barrage Penman a été construite par Boralex durant les années 90, puis a été revendue à la compagnie ontarienne Algonquin Power. Le seul objectif d'Algonquin Power est de fournir des profits à ses actionnaires, peu importe les effets négatifs de son surturbinage sur la qualité de vie des Maskoutain·es et de tous les êtres vivants du bassin versant de la Yamaska. En période d'étiage, si la ville a « l'outrecuidance » de demander un peu de respect pour le vivant et le bien commun de ses 60 000 citoyens, cela devient une excuse « légale » parfaite pour ne pas payer de redevances. Pourtant, on a nommé cette centrale « T.-D.-Bouchard » pour honorer la mémoire de ce ministre qui a piloté la loi créant Hydro-Québec et qui est devenu son premier président en avril 1944.
Cette centrale « T-D-Bouchard » serait-elle le symbole des absurdités d'une privatisation « à la pièce » que le PL 69 semble proposer ? Serait-ce le symbole d'un cheval de Troie qui s'est donné comme mission de revenir au TRUST DE L'ÉLECTRICITÉ des années 1930 ? Est-ce que l'utilisation erronée du nom de « T-D-Bouchard » par une compagnie privée comme Algonquin Power se veut une insulte à la mémoire du père fondateur de la nationalisation de l'électricité ?
La notion de développement durable doit nécessairement inclure des composantes économiques, environnementales et sociales. Si on veut réellement « causer éoliennes », cette conversation doit ignorer les slogans faciles des « proxénètes de l'information » et aller au coeur du sujet. Au 21e siècle, l'électricité sera l'énergie primordiale de la transition énergétique. Présentement, sur l'échiquier politique continental, le Québec a « dans sa main » un atout puissant, soit LA SOURCE d'énergie du siècle à venir. Il faudrait un manque flagrant de sens stratégique pour DONNER « cette carte » à des compagnies privées comme Algonquin Power, Boralex, Innergex et tutti quanti. Si nous voulons être véritablement MAÎTRES CHEZ NOUS, nous devons nous assurer que le projet de loi no 69 n'inocule pas une mort programmée à notre symbole national. La « centrale T-D-Bouchard », située au centre-ville, est le symbole d'un slogan émasculé, et vidé de son sens véritable.[6 ] Hydro-Québec ne doit jamais être un partenaire ou un actionnaire d'une compagnie privée : MAÎTRES CHEZ NOUS veut dire qu'Hydro-Québec est le maître d'oeuvre !
Gérard Montpetit
Membre du CCCPEM
le 18 novembre 2024
1] Le Courrier de Saint-Hyacinthe, édition papier du 14 novembre 2024, page 11
2] https://www.nationalobserver.com/2024/11/18/opinion/burning-comforting-illusions-cop29-baku ?
3] Dictionnaire du français Plus, ISBN 2-7617-0508-4, page 1347
4] https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1923288/foret-exploitation-durable-arbres-ancienne
6] https://rveq.ca/replique-opinions/pl69nbsp-brader-notre-hritage-pour-un-plat-de-lentilles-
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Fondation du Mouvement Onésime Tremblay

Saguenay, Québec - le vendredi 22 novembre 2024 – Une quinzaine de personnes de différents milieux : groupes communautaires, association de retraités, syndicats et Climat Québec se sont réunies cette semaine pour jeter les bases d'un comité de suivi et de mobilisation dans la foulée du succès remporté par le colloque du 22 octobre dernier intitulé : 1926-2026, cent ans d'occupation par Alcan et Rio Tinto : le bilan s'impose.
Qui est Onésime Tremblay
Les membres ont choisi de donner le nom d'Onésime Tremblay au mouvement en l'honneur du cultivateur de Métabetchouan qui s'est battu pendant plus de trente ans contre les agissements illégaux des investisseurs et des gouvernements qui ont procédé au rehaussement permanent du lac St-Jean. Onésime Tremblay est cet homme qui, peu de temps avant de mourir et après avoir perdu ce qui était selon plusieurs la plus belle terre de la région, s'est fait offrir un chèque en blanc signé d'Alcan sur lequel il pouvait inscrire le montant qu'il désirait. M. Tremblay a refusé en disant que ce qui l'intéressait n'était pas l'argent mais sa terre. Même si ce sont de grandes bottes à chausser, notre mouvement s'inscrit dans la logique du combat d'Onésime Tremblay, celle d'une affirmation citoyenne pour le bien commun face à une multinationale toute puissante dont les agissements sont cautionnés par les pouvoirs publics et trop souvent relayés automatiquement par les médias.
« Je m'inscris, comme citoyen de la région, dans le MOUVEMENT inspiré par ONÉSIME TREMBLAY, pour retrouver notre droit de propriété sur nos ressources naturelles. Droits qui ont été usurpés en retour d'un pacte social qui n'est plus du tout respecté par Rio Tinto. Pire, le déséquilibre avec la région serait amplifié avec le projet de loi 69, dont la raison première est la privatisation de l'électricité. Pour nous c'est NON à la loi 69. » Martin Lavoie, membre et porte-parole du Mouvement Onésime Tremblay
« Nous voulons contribuer à la reprise en main de nos ressources électriques pour l'ensemble de la collectivité. Le Mouvement, Je suis Onésime, se fera le défenseur du bien commun face à l'appétit insatiable des grosses corporations. » Martine Ouellet, membre et cheffe de Climat Québec
Axes d'interventions
Dans cet esprit, les membres du mouvement ont adopté de multiples axes d'intervention : entre autres la question de l'érosion des berges du Lac St-Jean, celle du crassier des résidus de bauxite, du pouvoir d'achat des retraité(e)s et de la fiscalité municipale. Le mouvement entend aussi s'impliquer activement dans la commémoration du centième anniversaire de la tragédie du lac St-Jean en 2026. Pour s'assurer d'être entendu, le mouvement Onésime Tremblay utilisera une multitude de moyens dont les manifestations dans des endroits publics.
Projet de loi 69 de privatisation de l'électricité
À court terme, les membres du mouvement ont choisi de prioriser la lutte contre le projet de loi 69 en appuyant la mobilisation panquébécoise qui s'organise actuellement. Rio Tinto a un projet gigantesque de parc éolien de 700 à 1000 mégawatts. Ce projet de parc éolien privé c'est l'injure ajoutée à l'insulte. Déjà, Rio Tinto profite d'un privilège exorbitant avec ses barrages non-nationalisés. Ce parc éolien, assorti à la possibilité de vendre de l'électricité à des tiers, qui serait légalisée si le projet de loi 69 était adopté encourageraient Rio Tinto à se désinvestir de la production d'aluminium. L'électricité des barrages de Rio Tinto pourrait être vendue ailleurs plutôt que pour la production d'aluminium. C'est complètement contraire à l'intérêt commun de la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du Québec.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

En attendant le Black Friday

Dans une rue à sens unique avec stationnement des deux côtés, ayant un seul corridor de circulation au milieu, mais assez large au besoin pour deux voitures tout en se frôlant (comme pour se garder au chaud malgré le réchauffement climatique dû en partie aux émissions des dites voitures), un livreur typique de l'ère numérique « se met sur les flashers » le temps d'aller porter un colis requérant signature. La circulation est ainsi réduite à la vitesse rampante du concombre de mer, se profilant à l'horizon la menace d'un classique bouchon de circulation inattendu un jour de semaine à 11AM. Un Montreal Special avec rage au volant on the side.
En dépassant le goulot d'étranglement après plusieurs minutes de frustration automobile, surprise, s'étalent plusieurs espaces de stationnement disponibles, tous à quelques dizaines de pieds de l'endroit de la fatidique catastrophe routière en cours. « Sapristi de livreur à m… » se disent, peut-être, les bons usagers de la route qui obéissent aux règles et ne s'expliquent pas l'ampleur de l'égoïsme sans limites dudit livreur. En effet, ce parasite paresseux a osé causer un inconvénient aux troupeaux de VUS éléphantesques qui arpentent les rues plutôt que de se stationner un plus loin et de marcher un peu. En plus, c'est bon pour la santé marcher, ne le sait-il donc pas ?
Simultanément, Jeff Bezos et autres PDG et actionnaires majoritaires machiavéliques millionnaires et milliardaires du même acabit se baladent devant des œuvres d'art de la Renaissance1 affichées dans leurs yachts tout en comptant les nouveaux millions qui s'accumulent heure par heure2 dans leurs comptes de banque en paradis fiscaux à l'abri des lois et gouvernements3.
En établissant directement ou indirectement des contraintes et objectifs de performance inhumains sur toute la longueur des chaines d'approvisionnement4, de l'extraction des ressources jusqu'à la livraison au pas de ma porte de mon gri-gri dont je n'ai vraiment pas besoin, cette nouvelle classe ploutocratique réussit à nous convaincre d'effacer l'humanité d'autrui et par le fait même à nous monter les uns contre les autres. Cette classe de milliardaires obscènes veut détourner notre attention de l'exploitation dont ils sont coupables, exploitation sur laquelle est bâtie leur opulence ostentatoire de moins en moins inhibée, le tout en nous vendant leurs valeurs entrepreneuriales et leur succès financier comme un idéal à atteindre.
En effet, bien qu'il soit vrai que ce livreur puisse tout à fait s'en foutre d'où il stationne, il est esclave des désirs de croissance débridée imposés par ces PDG aux poches et ambitions sans fond, objectifs qui sont entérinés à leur tour par la société de consommation. Ce livreur a peut-être des cibles quotidiennes de performance fixées par un algorithme, probablement irréalistes ou impossibles à atteindre, surtout s'il se stationne plus loin des destinations, devant marcher à chaque livraison. Il est exploité par des compagnies qui priorisent les travailleurs autonomes, « l'engageant » sans s'engager envers lui, afin de se dédouaner des avantages et protections qu'un emploi en bonne et due forme lui octroierait. Ce livreur est un sous-traitant, un entrepreneur, un maître de son destin tout comme Musk ou Bezos. Du moins, c'est ce qu'on voudrait nous faire croire. Il court contre la montre en tentant d'échapper au spectre d'une plainte, à une action punitive de son non-employeur ou à une mise à pied qui le guette à tout moment. Le tout afin d'à peine réussir à ne pas se noyer sous le poids des inégalités exacerbées par les maitres de l'industrie qui l'emploie5.
L'augmentation du volume de colis et les attentes en matière de rapidité de livraison, le désir et le plaisir de recevoir sa gugusse en 24 heures et la dépendance à la dopamine rapide et bon marché que le consumérisme nous procure sont à la source même de ce bouchon de circulation à Montréal un vendredi matin de novembre à deux semaines du Black Friday. Ainsi, la prochaine fois que montera la marée de la rage au volant, voulant engloutir sous son écume un livreur Intelcom qui bloque le chemin en n'ayant pas pris conscience de la primordialité des mastodontes à quatre roues, il faudrait plutôt penser à redistribuer les milliards de Bezos et ses consorts parmi ceux qu'ils oppriment et qu'ils poussent de plus en plus vers le gouffre de la misère, ou au minimum, il faudrait penser à fermer nos comptes Amazon.
Notes
1.Par exemple, un tableau de De Vinci se trouverait au bord du Yacht de Mohammed bin SalmanLe tableau le plus cher du monde sur le yacht d'un prince saoudien ? | La Presse
2. Jeff Bezos aurait généré l'équivalent de 7.9$ millions par heure en 2023 :
How Did Jeff Bezos Make $7.9 Million Per Hour Last Year ? By Embracing an Owner's Mentality ;
Jeff Bezos Made Over $7.9 Million An Hour Every Hour In 2023 — In Under 13 Minutes, He Brought In The Equivalent Of What The Typical Person Earns In A Lifetime
3. La Société de provocation de Dahlia Namian explore, entre autres, comment les milliardaires s'affairent à se soustraire des lois et de la souveraineté des pays pour se protéger eux et leurs fortunes.La société de provocation - Lux Éditeur
‘They're more concerned about profit' : Osha, DoJ take on Amazon's grueling working conditions
Amazon a aussi un pouvoir outre mesure sur les chaines d'approvisionnement et les marchés, dictant des conditions aux entreprises en aval et en amont :
Fact Sheet : Amazon's Market Power - American Economic Liberties Project
5.Des livreurs de l'ère du numérique sont souvent payés au colis, aussi peu que 1.15$ par livraison :
La précarité à votre porte
Prime Day d'Amazon : les mauvaises conditions des employés derrière ces offres alléchantes
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Palmarès 2023 : Plus intenses que jamais

Que vous l'attendiez ou non, la voilà : nous venons de publier la quatrième édition du Palmarès des déversements d'eaux usées.
Tiré de infolettre Fondation Rivières
Cette année, l'accent est mis sur l'augmentation marquée de l'intensité des déversements dans un contexte de changements climatiques.
Pour voir le classement de votre municipalité
Moins de déversements, mais plus intenses
En 2023, il y a eu 44 765 déversements d'eaux usées dans nos lacs et rivières. Oui, vous avez bien lu, près de 45 000 déversements... Ça semble énorme, mais en réalité, c'est un peu moins qu'en 2022, où on en comptait environ 53 000. De prime abord, c'est une bonne nouvelle ... Eh bien ... pas vraiment.
En fait, même si le nombre a baissé, l'intensité des déversements a augmenté de 25 %. Concrètement, ça veut dire que les déversements sont plus longs, plus fréquents, et ils arrivent souvent l'été, quand l'impact sur la qualité de l'eau est au plus fort. On a analysé les données de la Montérégie et cet été, la pluie a été presque aussi intense qu'en 2020, mais l'intensité des déversements a bondi de 41 % !
Pour voir l'évolution des déversements depuis 2017
Le ministère doit changer son indicateur}
Aujourd'hui, le gouvernement se base sur le nombre de déversements pour évaluer l'ampleur des conséquences des déversements. Mais cet indicateur ne permet pas vraiment de savoir quel est l'impact réel sur nos rivières. À Beloeil, par exemple, la qualité de l'eau à la piscine en eaux vives a mis plusieurs jours à se rétablir après la tempête Debby à cause des débordements majeurs qui se sont produits en amont tout au long de la rivière Richelieu. Ce qu'on demande, c'est un indicateur qui tienne compte non seulement du nombre de déversements, mais aussi de leur durée et de leur taille, pour mieux évaluer leur impact sur l'environnement. L'indice d'intensité, développé par la Fondation Rivières, tient compte de la durée des déversements et de la taille de l'ouvrage qui déborde.
Les déversements d'eaux usées ne sont pas juste un problème de pollution visible, ils affectent les espèces aquatiques et la biodiversité. Ils peuvent affecter la qualité de l'eau aux prises d'eau potable et compliquer les opérations de traitement et de désinfection requises pour éliminer un maximum d'éléments nuisibles à la santé. Les déversements limitent également la disponibilité de sites de baignade et les activités nautiques.
Restez à l'affût de nos communications sur le Palmarès !
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Appuyez les travailleurs et travailleuses des postes !

Postes Canada est l'une des institutions publiques les plus prisées au pays, reliant les familles, les collectivités et les entreprises d'un océan à l'autre. Postes Canada fournit de bons emplois assortis de bons avantages sociaux à des dizaines de milliers de travailleurs et travailleuses. En retour, ces emplois permettent de faire vivre des familles et de faire rouler l'économie de la région.
Nous sommes présentement en négociation avec Postes Canada. Nous luttons pour maintenir de bons emplois et un régime d'avantages sociaux solide, et pour nous assurer que les conditions de travail de nos membres demeurent sécuritaires. Nous voulons aussi la diversification des services postaux afin de préserver notre service postal public tout en répondant aux besoins modernes de la population et des collectivités.
Ensemble, donnons à Postes Canada un avenir à sa hauteur en misant sur l'innovation et la diversification des services.
Voici trois façons de nous aider :
1- Dites à Doug Ettinger, PDG de Postes Canada, que le STTP peut compter sur votre soutien, que la croissance du service postal ne se fera pas à coups de hache, et que nous devons trouver des solutions qui profitent à tous, y compris aux travailleurs et travailleuses.

2- Syndicats et alliés : vous avez besoin d'affiches ou de pancartes pour une action de solidarité ?
Voici des affiches que vous pouvez télécharger et imprimer.
Format pancarte – 22 po x 28 po
Graphiques pour réseaux sociaux
Vous avez besoin d'affiches pour votre usage personnel ?
Téléchargez cette affiche dans ses différents formats, imprimez-la et affichez-la dans une fenêtre, sur une porte ou encore sur votre boîte aux lettres. Un excellent moyen de manifester votre appui.
Graphiques pour réseaux sociaux
3- Renseignez-vous sur nos propositions de diversification des services postaux dans le cadre de notre campagne Vers des collectivités durables.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.











