Derniers articles

Crise et particularité du capitalisme chinois

Le régime chinois n'a jamais été aussi opaque qu'aujourd'hui. Nous vivons un moment d'incertitude, ne sachant pas encore comment Donald Trump va abattre ses cartes concernant la Chine. Entre crise climatique et démondialisation chaotique, nous vivons des temps sans précédent. Tentons néanmoins un décryptage, sans chercher à lever les points d'interrogation, avec Pierre Rousset.
Tiré de Europe Solidaire Sans Frontières
26 janvier 2025
Par Pierre Rousset
Selon les chiffres officiels publiés le 17 janvier, le produit intérieur brut (PIB) de la Chine aurait cru de 5 % en 2024 et l'objectif assigné par Xi Jinping aurait été atteint, comme (presque ?) toujours. En décembre pourtant, des économistes chinois « de poids » avaient émis de sérieux doutes à ce sujet, dont Gao Shanwen qui estimait la croissance à environ 2 % seulement – avant de se voir sévèrement sanctionné. En fait, depuis la crise du Covid-19, les mesures de relance n'ont pas permis le rétablissement de la consommation. Le pays traverse une crise de surproduction. Le décalage entre une faible demande intérieure et une hausse marquée des exportations s'accroit encore.
Mutation capitaliste grippée
Deuxième puissance économique mondiale, la Chine est devenue une composante majeure de l'ordre capitaliste international, mais sa formation sociale reste très complexe, marquée par une histoire spécifique. Comme le soulignent mon ami Au Loong-yu ou Romaric Godin dans Mediapart du 24 septembre, il faut prendre en compte les caractéristiques propres du capitalisme chinois pour comprendre comment le pays est aujourd'hui confronté à des impasses qui sont celles des pays occidentaux avancés (surcapacité industrielle, épuisement de la financiarisation, limites de la croissance technologique pour reprendre les termes de Godin), alors qu'elle n'a pas achevé sa mutation, engagée par Deng Xiaoping après l'écrasement du mouvement ouvrier, étudiant et populaire en 1986.
L'achèvement de cette mutation capitaliste est grippé par le poids à tous les échelons de l'appareil bureaucratique, par la corruption systémique et par les modifications du pouvoir introduites par Xi Jinping quand il a décidé de devenir président à vie : marginalisation accrue des structures gouvernementales et fin de la collégialité dans les directions du PCC au profit de sa seule fraction. La collégialité constituait un gage de continuité et un garde-fou. La grande différence entre le processus de la pleine réintégration de la Russie et de la Chine dans le marché mondial, c'est qu'à Pékin, il y avait un pilote efficace dans l'avion. Ce succès est avant tout celui des trois prédécesseurs de Xi, plutôt que celui de ce dernier.
Dettes, corruption et marasme
L'éclatement de la « bulle immobilière », avec la faillite du géant Evergrande en 2021, illustre la place des liens, souvent familiaux, entre le public et le privé dans le système capitaliste chinois. Si cette crise a pris une telle ampleur, c'est qu'à chaque échelon il y a eu collusion entre bureaucrates au pouvoir et leurs proches dans le secteur privé pour multiplier les investissements, sources de profits légaux et illégaux. Ses conséquences sont profondes en raison du poids des dettes accumulées, mais aussi des conséquences sociales. Xi Jinping se refuse à déployer une politique de protection sociale. Pour préparer leur retraite et prévoir leurs dépenses de santé (payante), de nombreux Chinois modestes ont acheté sur plan des appartements qui n'ont jamais été construits ou se sont logés dans des villes restées largement fantômes.
De nombreux Chinois modestes ont acheté sur plan des appartements qui n'ont jamais été construits ou se sont logés dans des villes restées largement fantômes
Les parents craignent aujourd'hui que leurs enfants vivent plus mal qu'eux. Le chômage des jeunes est très élevé et les diplômes n'assurent plus l'accès à un emploi décent. La population s'appauvrit et doit épargner face à un avenir très incertain. Harold Thibault, dans un reportage du Monde publié le 9 janvier, décrit les commerces et restaurants désertés par les « les déclassés de la consommation ». Xi Jinping exhorte la population à faire preuve de résilience avant que l'économie ne se redresse, mais les entreprises sont soumises à une concurrence féroce qui les amène à rogner sur tout.
La volonté de pouvoir absolue rend paranoïaque. Xi Jinping incarcère des hommes d'affaires, « discipline » la finance, purge de façon répétée l'appareil du parti, l'état-major de l'armée, les services secrets… La Chine reste un marché qui ne peut être ignoré, mais y investir est devenu un jeu risqué, plongeant dans la perplexité le capital international. On peut parler d'une véritable crise de régime aux soubresauts imprévisibles.
Crédit PhotoWikimedia Commons
Démondialisation de crise
La mondialisation heureuse (pour le Capital) appartient à un passé déjà lointain. La crise de la démondialisation lui a succédé, ouvrant un espace aux conflits géopolitiques entre États et à des replis protectionnistes partiels.
Cependant, on ne se libère pas facilement des interdépendances tissées par la formation d'un marché mondial unique et l'internationalisation des chaînes de production. Elles sont toujours vivaces, alors que d'autres enjeux s'invitent à l'attention des gouvernants, comme les guerres et le réchauffement climatique.
Rapport de forces avec les États-Unis
Les premiers signaux envoyés par Donald Trump sont ambivalents. Il a nommé à des postes clés de farouches opposants à Pékin, mais a suspendu l'interdiction de TikTok. Et que penser de la place de « président bis » que semble occuper Elon Musk, ce grand investisseur et soutien de Xi qui a proposé un plan de règlement de la question taïwanaise au profit de Pékin (l'homme le plus riche du monde s'accorde tous les droits d'ingérence) ? Xi Jinping doit avoir bien du mal à prévoir si un deal sera souhaitable et possible avec Trump – pour une fois on le comprend. Est-ce un signe si sa politique reste très prudente sur le front des monnaies ? Les temps étaient mûrs pour renforcer le rôle international du yuan, il n'en profite pour l'heure pas. Le bras de fer technologique et commercial entre les deux puissances est engagé, il pourrait aboutir à l'imposition au monde d'un duopole sino-étatsunien ou, inversement, à des affrontements armés.
Le bras de fer technologique et commercial pourrait aboutir à l'imposition au monde d'un duopole sino-étatsunien ou à des affrontements armés
Les États-Unis restent dominants sur le plan militaire, ainsi que pour les semi-conducteurs de pointe. Ils exigent que le champion néerlandais des puces d'intelligence artificielle, Nvidia, renonce à livrer ses produits hauts de gamme à la Chine. En dépit de subventions massives à la recherche, les entreprises chinoises semblent incapables de combler leur retard en ce domaine crucial. Du coup, Pékin menace de bloquer l'exportation vers les États-Unis de plusieurs métaux essentiels à la production des semi-conducteurs (gallium, germanium…). Vous avez dit interdépendance ?
Entre l'Europe de l'Ouest et Poutine
L'influence chinoise s'étend notablement de l'Afrique à l'Amérique latine, mais cela ne saurait remplacer les liens avec les pays capitalistes développés. Or, l'accès aux États-Unis devrait se restreindre. En conséquence, Xi Jinping pourrait se tourner vers l'Europe de l'Ouest, l'Australie, la Corée du Sud — mais il y a la guerre en Ukraine de son copain Poutine, allié à la Corée du Nord ! Est-ce le moment de sacrifier cette amitié indéfectible ? Difficile alors qu'avec le réchauffement climatique, les régions polaires s'ouvrent à l'exploitation et aux communications maritimes. Pékin n'est pas un pays riverain de l'Antarctique et a besoin de Moscou pour participer au grand jeu stratégique engagé dans cette région, à l'heure où Donald Trump veut prendre possession du Groenland !
Le sort du monde dépend pour une part de dirigeants comme Donald Trump et Xi Jinping, ce qui n'a rien de rassurant. Au chaos par en haut, opposons donc l'internationalisme par en bas.
Pierre Rousset
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les menaces qui pèsent sur une Syrie démocratique et progressiste

À un moment presque inattendu, le régime de Bachar Al-Assad s'est effondré le 8 décembre 2024 face à l'offensive éclair dirigée par le groupe islamiste Hayat Tahrir al-Cham, soutenu par la Turquie.
Tiré du site de la revue Contretemps.
Cette date met ainsi fin à cinq décennies de la dynastie tyrannique Al-Assad. Issu du parti Baath, Hafez Al-Assad prend le pouvoir par un coup d'État en novembre 1970. Tout en poursuivant des politiques de redistribution des ressources suivant un modèle social-étatique qui domine depuis le début des années 1960 mais également suivant des logiques clientélistes, il écarte de manière extrêmement violente toute opposition à son pouvoir, jetant ce faisant les bases d'un autoritarisme d'État qui se poursuivra jusqu'à la chute du régime. À partir des années 1980, se développent, dans le giron du régime, des réseaux entre le secteur public et le secteur privé ainsi qu'une nouvelle bourgeoisie.
Sur le plan régional, une inflexion violemment hostile est opérée à l'égard de l'Organisation de libération de la Palestine par Hafez Al-Assad qui entend contrôler la scène politique palestinienne ainsi que le Liban. En 1990, le régime syrien s'allie aux États-Unis dans la coalition contre l'Irak et il met sous sa tutelle le Liban dont, au sortir de la guerre civile, il contrôle la vie politique et sécuritaire tout en assurant le droit au Hezbollah de mener la résistance contre l'occupation israélienne. Au début des années 2000, alors que les États-Unis ouvrent une ère de lutte contre le « terrorisme », le régime syrien fait l'objet d'une offensive diplomatique étasunienne essentiellement en raison de son soutien au Hezbollah.
Entretemps, le « contrat social » en Syrie consistant à légitimer la terreur d'État par le volet social se brise peu à peu au cours des années 2000. En effet, sous le mandat de Bachar Al-Assad, les logiques répressives sont toujours d'une brutalité terrifiante, les services publics deviennent de plus en plus délabrés, les politiques de libéralisation économique s'accélèrent aux dépens des classes populaires urbaines et paysannes, les privatisations renforçant la corruption et la monopolisation des ressources par le clan Al-Assad.
Dans ce contexte, le soulèvement du peuple syrien pour ses droits sociaux et démocratiques de 2011 est violemment réprimé par le régime et, assez vite, l'ingérence des puissances régionales et internationales conduit à une guerre multidimensionnelle aux conséquences dévastatrices, dont la responsabilité incombe en premier lieu au régime de Bachar Al-Assad.
À l'aune de ce contexte, on ne peut que se réjouir pour le peuple syrien à présent libéré de la dictature des Al-Assad. Dans le même temps, la situation présente de nombreuses inconnues quant aux politiques que vont mener les nouveaux dirigeants à Damas, quant aux moyens pour le peuple syrien dans sa pluralité de réellement prendre en main son destin, et quant à l'unité de la Syrie et à sa position vis-à-vis du colonialisme israélien dans la région. Toute incertaine qu'elle soit, la nouvelle conjoncture ouvre en tous cas de réelles possibilités de changement pour le peuple syrien.
Dans cette optique attentive aux questions sociales, démocratiques et coloniales, et soucieuse d'éclairer les enjeux et les défis complexes face auxquels se trouve le peuple syrien, la rédaction de Contretemps propose une série d'articles sur le sujet dont les points de vue variés ne sont pas nécessairement convergents mais permettent chacun d'éclairer les divers aspects de la situation. Après un premier article de Bassam Haddad, nous publions un article de Joseph Daher qui analyse notamment la menace que représentent les vestiges de l'ancien régime, puis la manière dont le Hayat Tahrir al-Cham (HTC) cherche à asseoir son pouvoir sur la nouvelle Syrie.
***
La chute du régime de Bachar el-Assad s'inscrit dans la continuité des processus révolutionnaires qui ont débuté au Moyen-Orient et en Afrique du Nord en 2011. Le renversement du régime de la famille Assad au pouvoir depuis 1970 est le produit de toutes les luttes qui ont été menées depuis le soulèvement populaire de mars 2011. L'offensive militaire conduite par les groupes d'opposition armés, qui a débuté en novembre 2024, lui a porté le coup de grâce quelques semaines plus tard, en décembre.
De nombreuses questions se posent quant à l'avenir de la Syrie, et notamment au sujet des principales menaces qui pèsent sur la mise en place d'une société démocratique. Certains commentateurs, intellectuels et activistes libéraux et démocrates se sont focalisés sur les « feloul », c'est-à-dire les résidus de l'ancien régime, en particulier les secteurs de la sécurité et de l'armée, comme étant la principale menace actuelle pour le pays. Sur les réseaux sociaux, il est souvent fait mention d'un scénario égyptien, celui du coup d'État mené par Sisi contre le président Morsi, qui faisait partie de la confrérie des Frères musulmans, en juillet 2013.
D'un autre côté, une partie des commentateurs et des démocrates est relativement peu critique, voire pas du tout, à l'égard de ce gouvernement dirigé par les HTC. Ils saluent généralement la façon dont le groupe salafiste conduit la transition.
Cet article se propose d'étudier les principales menaces qui pèsent sur l'avenir démocratique de la Syrie, autrement dit pour la justice sociale et l'égalité de tous et toutes dans le pays. En premier lieu, il analysera la menace représentée par les résidus de l'ancien régime, puis il examinera la politique du HTC en vue de consolider son pouvoir sur la nouvelle Syrie.
Quelle était la nature du régime Assad ?
Tout d'abord, il est important d'analyser la nature de l'ancien régime. La famille Assad avait établi un régime despotique et patrimonial en Syrie. Ce régime despotique et patrimonial était un système de pouvoir autocratique et héréditaire absolu qui reposait sur l'appropriation de l'État par un petit groupe d'individus liés par des liens familiaux, tribaux, communautaires et clientélistes, dont le symbole était le palais présidentiel occupé par Bachar al-Assad et sa famille. Les forces armées étaient dominées par une garde prétorienne (force dont l'allégeance va aux dirigeants et non à l'État) incarnée par la quatrième brigade commandée par Maher al-Assad, tout comme les ressources économiques et les organes moteurs de l'administration. Le régime syrien a instauré un capitalisme de copinage dominé par un petit groupe d'hommes d'affaires totalement dépendants du palais présidentiel (Bachar al-Assad, Asma al-Assad et Maher al-Assad), qui ont profité de la position dominante garantie par ce dernier pour amasser des fortunes considérables. La nature rentière de l'économie a également renforcé la nature patrimoniale de l'État. En d'autres termes, les centres de pouvoir (politique, militaire et économique) au sein du régime syrien étaient concentrés au sein d'une famille et de sa clique, les Assad, à l'instar de ce qu'il en était en Libye sous Mouammar Kadhafi, en Irak sous Saddam Hussein ou dans les monarchies du Golfe. Cela a poussé le régime à utiliser toute la gamme des ressources violentes à sa disposition pour protéger son pouvoir.
La mise en place de ce système patrimonial moderne a commencé sous la direction d'Hafez al-Assad, après son arrivée au pouvoir en 1970. Il a patiemment construit un État dans lequel il pouvait asseoir son pouvoir par divers moyens tels que le communautarisme confessionnel, le régionalisme, le tribalisme et le clientélisme, qui étaient gérés au moyen de réseaux informels de pouvoir et de parrainage. Cette politique s'est accompagnée d'une répression brutale de toute forme de dissidence. Ces outils ont permis au régime d'intégrer, de renforcer ou d'affaiblir des groupes appartenant à des ethnies et à des communautés religieuses diverses. Cela s'est traduit au niveau local par la collaboration de différents éléments inféodés au régime, notamment des fonctionnaires de l'État ou du Ba'th, des agents des services de renseignement et des membres influents de communautés locales (religieux, représentants de tribus, hommes d'affaires, etc.) qui en assuraient la direction. Hafez al-Assad a également ouvert la voie à la libéralisation de l'économie, en opposition aux politiques radicalement étatiques des années soixante.
L'arrivée au pouvoir de Bachar al-Assad en 2000 a considérablement renforcé la nature patrimoniale de l'État, avec un poids croissant des « capitalistes de connivence ». Le renforcement des politiques néolibérales du régime a conduit à un glissement croissant de sa base sociale, constituée à l'origine de paysans, de fonctionnaires et de quelques franges de la bourgeoisie, vers une sorte de coalition au cœur de laquelle se trouvent les « capitalistes de connivence » – l'alliance de courtiers politiques en quête de rente (menée par la famille de la mère d'Assad, les Makhlouf) et la bourgeoisie qui soutient le régime et les classes moyennes supérieures. Ce glissement s'est accompagné de l'affaiblissement des organisations corporatistes traditionnelles de travailleurs et de paysans et des réseaux qu'elles entretenaient, ainsi que de la cooptation à leur place de représentants des milieux d'affaires et de la classe moyenne supérieure. Toutefois, cela n'a pas permis de contrebalancer ou de compenser son ancienne source de soutien. Plus généralement, la nature patrimoniale renforcée de l'État et l'affaiblissement de l'appareil du parti Ba'th et des organisations corporatistes ont rendu les liens clientélistes, tribaux et sectaires d'autant plus importants, ce qui s'est reflété dans la société.
Après le soulèvement de 2011, la répression et la politique du régime se sont largement appuyées sur sa principale assise, ancienne et nouvelle : les capitalistes de copinage, les services de sécurité et les grandes institutions religieuses liées à l'État. Dans le même temps, il a mis à profit ses réseaux en faisant jouer les liens sectaires, clientélistes et tribaux pour obtenir un soutien populaire. Au cours de la guerre, l'accentuation de la dimension communautaire et clientéliste alaouite du régime lui a permis d'éviter des désertions importantes, tandis que les liens clientélistes ont été essentiels pour attacher au régime les intérêts de groupes sociaux disparates.
L'assise populaire du régime a mis en évidence la nature de l'État et la manière dont l'élite au pouvoir était liée au reste de la société, ou plus précisément ici à sa base populaire, par un mélange de formes modernes et archaïques de relations sociales, et non dans le cadre d'une société civile étendue et structurée. Le régime ne pouvait s'appuyer que sur des pouvoirs coercitifs, ce qui impliquait des opérations de répression et l'instauration de la peur, mais pas seulement. Le régime a également pu compter sur la passivité, ou du moins l'opposition non-active, d'une grande partie des agents de l'administration urbaine et plus généralement des couches moyennes dans les deux principales villes de Damas et d'Alep, bien que leurs banlieues aient souvent été des foyers de révolte. Cela participait de l'hégémonie passive imposée par le régime.
De plus, cette situation a démontré que la base populaire du régime ne se limitait pas aux secteurs et groupes issus des populations alaouites et/ou des minorités religieuses, bien qu'ils soient prédominants, mais incluait des personnalités et des groupes de diverses communautés religieuses et ethniques qui apportaient leur soutien au régime. Plus généralement, de larges secteurs de la base populaire du régime, mobilisés au travers de leurs liens sectaires, tribaux et clientélistes, agissaient de plus en plus en tant qu'agents de la répression exercée par le régime.
Cette capacité de résilience a eu un prix, en plus d'accroître considérablement la dépendance du régime à l'égard d'États et d'acteurs étrangers. Les caractéristiques et les tendances anciennes ont été amplifiées. Un petit groupe de « capitalistes de connivence » a considérablement renforcé son pouvoir, alors que de larges secteurs de la bourgeoisie syrienne avaient quitté le pays en retirant massivement leur soutien politique et financier au régime. Cette situation a contraint le régime à adopter un comportement de plus en plus prédateur en aspirant les ressources qui lui étaient de plus en plus indispensables sur les milieux d'affaires restés dans le pays. Dans le même temps, les caractéristiques clientélistes, sectaires et tribales du régime ont été renforcées. L'identité sectaire alaouite du régime a été renforcée, en particulier dans les institutions clés telles que l'armée et, dans une moindre mesure, dans les administrations de l'État. Dans le même temps, les frustrations de la population alaouite se sont accrues ces dernières années en raison de l'appauvrissement continu de la société et des exactions des milices du régime à leur encontre.
Plus globalement, on comprend ainsi que le fait de considérer le régime comme uniquement alaouite, malgré l'alaouitisation de certaines institutions, notamment de son appareil répressif armé, ne permet pas de saisir sa dynamique et son mode de domination. En outre, le régime ne sert pas les intérêts politiques et socio-économiques de la population alaouite dans son ensemble, bien au contraire. Les morts de plus en plus nombreux dans l'armée et les diverses milices étaient en bonne partie des Alaouites ; l'insécurité et les difficultés économiques croissantes ont en fait créé des tensions et attisé l'animosité des populations alaouites à l'égard des responsables du régime.
La chute du régime a démontré sa faiblesse structurelle, à la fois militaire, économique et politique. Il s'est effondré comme un château de cartes. Cela n'est guère surprenant, car il semblait évident que les soldats n'allaient pas se battre pour le régime d'Assad au vu de la médiocrité de leurs salaires et des conditions qui leur étaient faites. Ils ont préféré fuir ou simplement ne pas se battre plutôt que de défendre un régime pour lequel ils n'ont que très peu de sympathie, notamment parce que beaucoup d'entre eux ont été enrôlés de force.
La dépendance du régime à l'égard de ses alliés étrangers est devenue cruciale pour sa survie, démontrant ainsi sa faiblesse. La Russie, le principal parrain international d'Assad, a détourné ses forces et ses ressources vers sa guerre impérialiste contre l'Ukraine. En conséquence, son engagement en Syrie a été nettement plus limité que lors d'opérations militaires comparables au cours des années précédentes. Ses deux autres principaux alliés, le Hezbollah libanais et l'Iran, ont été considérablement affaiblis par Israël depuis le 7 octobre 2023. Tel-Aviv a procédé à l'assassinat des dirigeants du Hezbollah, dont Hassan Nasrallah, a décimé ses cadres par ses attaques aux bipeurs et a pilonné ses positions au Liban. Le Hezbollah est sans aucun doute confronté à son plus grand défi depuis sa création. Israël a également lancé des vagues de frappes contre l'Iran, révélant ainsi ses faiblesses. Il a également intensifié les bombardements des positions de l'Iran et du Hezbollah en Syrie au cours des derniers mois.
Ses principaux soutiens étant ainsi accaparés et affaiblis, la dictature d'Assad se trouvait dans une position vulnérable. En raison de toutes ses faiblesses structurelles, du manque de soutien de la population, du manque de fiabilité de ses propres troupes et de l'absence de soutien international et régional, elle s'est avérée incapable de résister à l'avancée des forces rebelles, et ville après ville, son pouvoir s'est effondré comme un château de cartes.
Dans ce contexte, nous pouvons affirmer que le Palais présidentiel est politiquement mort. La famille d'Assad a quitté le pays, la quatrième brigade dirigée par Maher al-Assad n'existe plus en tant qu'unité militaire organisée et ce qui restait de ses principaux réseaux de pouvoir, que ce soient les copains-capitalistes, les chefs religieux ou chefs tribaux, etc. sont devenus inutiles et réduits à un petit nombre d'individus dépourvus de tout pouvoir. Entre-temps, certains chefs de tribus, leaders religieux et représentants des chambres économiques viennent de se rallier aux nouvelles autorités en place, comme en témoigne le fait qu'ils ont adopté le nouveau drapeau syrien.
Retour de l'ancien régime ?
Dans cette optique, le modèle du coup d'Etat égyptien est-il applicable en Syrie ? L'ancien régime et ses vestiges constituent-ils la principale menace pour la Syrie ? Je pense qu'il s'agit d'une analyse qui pose problème. Il y a deux raisons principales qui sont liées : la différence de nature du régime ainsi que le fait qu'une menace ne peut pas être réduite à des individus mais qu'elle est plutôt le fait de structures de pouvoir.
Contrairement à ce qui se passe en Syrie, la chute du dictateur Hosni Moubarak n'a pas signifié la fin du régime égyptien. Dans le cas de l'Egypte, le système politique ressemblait davantage à une forme de néo-patrimonialisme. Le népotisme et le copinage y étaient présents à travers la famille Moubarak et le sont encore aujourd'hui dans le gouvernement dirigé par Sisi. En d'autres termes, il s'agit d'un système républicain autoritaire institutionnalisé avec un degré plus ou moins élevé d'autonomie de l'État par rapport aux dirigeants qui sont susceptibles d'être remplacés. En effet, dans l'État égyptien, les forces armées constituent l'institution centrale du pouvoir politique. Aucune famille ne possède l'État au point d'en faire ce que ses membres désirent, comme ce fut le cas dans le régime syrien de la famille Assad. C'est le haut commandement militaire qui domine collégialement l'État égyptien. Cela explique pourquoi les militaires ont fini par se débarrasser de Moubarak et de son entourage pour sauvegarder le régime en 2011. Gamal Moubarak et ses acolytes ont été évincés de la coalition au pouvoir et les réseaux de l'ancien parti dirigeant, le Parti national démocratique, de même que le pouvoir du ministère de l'Intérieur, ont été ébranlés en conséquence.
Pareillement, même avec l'arrivée au pouvoir des Frères musulmans lors de l'élection de Morsi à la présidence en 2012 cela ne signifiait pas la fin du régime égyptien dirigé par le haut commandement militaire. De plus, Morsi et la confrérie ont d'abord tenté de former une alliance directement avec l'armée dès les premiers jours du soulèvement en 2011, conscients qu'ils étaient de son poids politique et de son rôle répressif depuis des décennies. Dès les premiers jours de la révolution, la confrérie a agi comme un rempart contre les critiques et les protestations à l'égard de l'armée jusqu'au renversement de Morsi en juillet 2013. Avant cette date, ils ont dénoncé ceux qui manifestaient contre l'armée en les qualifiant de contre-révolutionnaires et de séditieux. La constitution de décembre 2012 soutenue par les Frères musulmans maintenait le budget de l'armée à l'abri du contrôle parlementaire et garantissait le pouvoir des forces armées. Morsi et les Frères musulmans se sont opposés aux mobilisations populaires et ouvrières en Égypte, les ont même réprimées et ont défendu l'armée. En effet, Morsi a nommé Sisi à la tête de l'armée en toute connaissance du fait qu'il avait fait emprisonner et torturer des protestataires.
Malgré tous les efforts de collaboration déployés par la Confrérie, l'armée a renversé Morsi et a réprimé massivement le mouvement des Frères musulmans et toutes les formes d'opposition, militante de gauche et démocrates inclus.es. En fin de compte, l'armée et la Confrérie représentaient des ailes différentes de la classe capitaliste, avec des soutiens régionaux différents, qui ne pouvaient pas trouver de solution de conciliation. L'armée, bien plus puissante, a finalement décidé de mettre en place son pouvoir dictatorial direct, au détriment de tout le monde en Égypte. Sisi a mis en place le régime le plus répressif que l'Égypte ait connu depuis des décennies, un régime néolibéral dictatorial qui a mis en œuvre de la manière la plus brutale l'ensemble des recommandations d'austérité du FMI, entraînant un appauvrissement massif et une inflation galopante.
Dans ce contexte, à aucun moment et jusqu'à aujourd'hui, le cœur du pouvoir en Egypte n'a été évincé, bien au contraire. Dans le cas de la Syrie, comme expliqué auparavant, les structures de pouvoir liées au Palais présidentiel n'existent plus et les comparaisons avec le scénario égyptien ne sont donc pas pertinentes.
Cela dit, des individus de l'ancien régime, en particulier des milices, des services de sécurité et de la quatrième brigade, peuvent représenter une menace pour la stabilité de la Syrie. Ils ont intérêt à alimenter les conflits à caractère communautaire, en particulier dans les régions côtières où ils sont principalement basés depuis la chute du régime d'Assad, et dans une moindre mesure à Homs. C'est ce qu'ont montré les attaques menées contre les forces du HTC près de la ville côtière de Tartous, qui ont fait 14 morts et 10 blessés le 25 décembre. En réponse, les forces du HTC ont lancé des opérations « à la poursuite des restes des milices d'Assad ». De même, l'Iran a également intérêt à créer de l'instabilité en jouant sur les tensions communautaro-confessionnelles par le recours à des individus liés à ses réseaux dans le pays.
Certains des éléments liés à l'ancien régime étaient également impliqués dans les dernières mobilisations à Homs et dans les régions côtières qui ont fait suite à la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant le saccage d'un sanctuaire alaouite à Alep, survenue quelques semaines avant. Pour autant, il ne faudrait pas en conclure que ces manifestations ne sont rien d'autres que des manipulations organisées de l'extérieur par l'Iran ou par des éléments de l'ancien régime ; il existe en effet des craintes au sein de la population alaouite à l'égard du nouveau pouvoir, le HTC, en lien avec des appels à la vengeance qui suivi la chute du régime.
Voilà pourquoi il faut être attentif à l'augmentation des incidents, jusqu'à présent isolés ou en tout cas sans caractère généralisé, de nature sectaire qu'on observe depuis la chute du régime, et en particulier aux exécutions et aux assassinats perpétrés dans une dynamique de vengeance. Cela a été le cas contre des individus qui ont été impliqués dans des crimes sous l'ancien régime, dans lesquels se mêlent souvent des motivations de vengeance à la fois politiques et sectaires, en particulier contre les Alaouites. Les crimes du régime Assad ont déchiré la société syrienne, laissant derrière eux un héritage d'atrocités et de souffrances généralisées. Dans ce contexte, il est nécessaire de mettre en place une action coordonnée pour répondre aux besoins immédiats des victimes et d'établir des mécanismes de justice transitionnelle globale et à long terme. Il est essentiel de s'attaquer aux séquelles de la brutalité systémique du régime Assad pour tracer la voie d'une paix durable. La justice transitionnelle peut jouer un rôle crucial dans la prévention des actes de vengeance et de l'aggravation des tensions intercommunautaires.
En plus d'un processus encourageant la justice transitionnelle et la punition de tous les individus impliqués dans des crimes de guerre, qu'ils appartiennent à l'ancien régime ou à des groupes armés de l'opposition, seul un nouveau cycle politique permettant une large participation par en bas des classes populaires pour débattre et décider des questions démocratiques et sociales les plus diverses peut restaurer la stabilité à longue échéance.
Conclusion
Les éléments résiduels de l'ancien régime, en particulier les services de sécurité et l'armée, constituent sans aucun doute une menace pour la stabilité de la Syrie à court terme, comme nous l'avons mentionné plus haut. Ils doivent être arrêtés et jugés pour leurs crimes.
Cependant, et sans sous-estimer les menaces que représentent ces groupes d'individus, ils ne constituent pas une menace au sens où ils pourraient revenir au pouvoir et réimposer une dictature. Ils n'ont pas les moyens politiques, militaires et économiques d'atteindre un tel objectif. Il est important de comprendre la nature du régime d'Assad et la différence avec le cas égyptien. Alors que l'ancien régime syrien est structurellement mort, comme en témoigne la disparition du Palais présidentiel et de ses réseaux, en Égypte, les centres de pouvoir au sein du haut commandement militaire sont restés au pouvoir en dépit de la chute de Moubarak en 2011 et de la présence de Morsi à la présidence entre juillet 2012 et juillet 2013.
La compréhension de ces différentes dynamiques est également importante pour contrer les accusations d'être des « feloul » (nostalgiques de l'ancien régime ; ndt) lancées par certains commentateurs et médias proches du nouveau pouvoir, le HTC, à l'encontre de tous ceux qui le critiquent ou manifestent contre lui. Cela permet de discréditer les individus et les groupes ainsi que leurs revendications politiques. De même, il y a quelques semaines, la manifestation en faveur d'un État démocratique et laïque de Damas a fait l'objet de telles accusations, car plusieurs personnes ont été présentées, parfois à tort, comme des partisans de l'ancien régime. Au-delà de la présence de quelques individus susceptibles d'être des partisans de l'ancien régime parmi des milliers et des milliers de manifestant.e.s, l'objectif réel était de jeter le discrédit sur la manifestation et les revendications qui s'y rattachaient. De plus, il y a une volonté de présenter des sujets tels que la laïcité et le socialisme comme étant associés à l'ancien régime et/ou à une importation occidentale afin de les discréditer.
En fait, ceci renvoie à la deuxième partie de l'article. Encore une fois, si des groupes d'individus liés à l'ancien régime constituent une menace pour la stabilité du pays, c'est la consolidation du pouvoir du HTC et de ses associés de l'Armée nationale syrienne (ANS), soutenue par la Turquie et le Qatar, qui constitue une véritable menace pour une Syrie démocratique et progressiste.
La consolidation du pouvoir de HTC, une menace pour une future Syrie démocratique et progressiste
Le rôle prépondérant de HTC dans l'offensive militaire qui a entraîné la chute du régime Assad en décembre 2024 a valu à l'organisation et à son chef Ahmed al-Chareh (Al-Joulani) une immense popularité. Ils bénéficient depuis lors d'une forme de légitimité « révolutionnaire » dont ils se servent pour consolider leur domination politique et militaire dans les régions qu'ils contrôlent.
Si le groupe a évolué politiquement et idéologiquement, abandonnant ses ambitions djihadistes transnationales pour se muer en une force qui s'inscrit dans le cadre national syrien, cela ne signifie pas pour autant que HTC serait devenu un acteur favorable à une société démocratique et à la promotion de l'égalité et de la justice sociale, bien au contraire.
Dans cette perspective, il est important d'analyser comment ils cherchent à consolider leur pouvoir sur la société et à établir un nouvel ordre autoritaire.
Le HTC consolide son pouvoir
Après la chute du régime, Ahmed al-Chareh a commencé par rencontrer l'ancien Premier ministre Mohammed al-Jalali pour organiser la passation de pouvoir, avant de nommer Mohammed al-Béchir à la tête du gouvernement de transition chargé d'expédier les affaires courantes. Celui-ci était auparavant à la tête du Gouvernement du Salut (SG). Il exercera en tout état de cause ses fonctions jusqu'au 1er mars 2025. Le nouveau gouvernement est composé uniquement de personnes issues des rangs de HTC ou proches de celui-ci.
Ahmed al-Chareh a également nommé de nouveaux ministres, des responsables de la sécurité et des gouverneurs pour diverses régions, affiliées à HTC ou aux groupes armés de l'ANS qui en sont proches. Par exemple, Anas Khattab (également connu sous le nom de Abou Ahmed Houdoud) a été nommé chef des services de renseignement. Membre fondateur de Jabhat al-Nosra, il était le principal responsable de la sécurité du groupe djihadiste. Depuis 2017, il dirige les affaires internes et la sécurité de HTC. Suite à sa nomination, il a annoncé la restructuration des services de sécurité sous son autorité.
De même, la formation de la nouvelle armée syrienne est le fait d'Ahmed al-Charaa et de ses associés au pouvoir. Ils ont nommé des commandants deHTC parmi les plus hauts gradés, notamment le nouveau ministre de la défense et commandant de longue date du HTC, Mourhaf Abou Qasra, qui a été nommé général.
En procédant à la réorganisation de l'armée syrienne, le gouvernement de HTC cherche également à consolider son contrôle et sa suprématie sur les groupes armés dispersés du pays en justifiant ses mesures et ce processus par l'interdiction faite à toute autre entité de porter des armes en dehors du contrôle de l'État, les ministères syriens de la défense et de l'intérieur étant les seuls autorisés à détenir des armes. Si l'unification de tous les groupes armés au sein d'une nouvelle armée syrienne ne soulève pas d'opposition en soi, de larges secteurs de la communauté druze à Soueida ou des Kurdes dans le nord-est s'y opposent toujours, en l'absence de certaines garanties, telles que la décentralisation et un véritable processus de transition démocratique.
Dans l'une de ses dernières interviews, Ahmed al-Chareh a également déclaré que l'organisation de futures élections pourrait prendre jusqu'à quatre ans et la rédaction d'une nouvelle constitution jusqu'à trois ans. Au même moment, une « Conférence du dialogue national syrien », réunissant 1 200 personnalités qui devait initialement se tenir les 4 et 5 janvier 2025 a été reportée à une date inconnue. Aucune information n'a été donnée sur la manière dont ces personnalités ont été sélectionnées, si ce n'est que chaque gouvernorat sera représenté par 70 à 100 personnalités, en tenant compte de tous les segments des différentes classes sociales et scientifiques, avec des représentants des jeunes et des femmes.
Des avocats syriens ont récemment lancé une pétition demandant que soient organisées des élections libres à leur chambre syndicale à la suite de la désignation par les nouvelles autorités d'un conseil syndical non élu.
Le HTC cherche à consolider son pouvoir tout en effectuant une transition contrôlée ; il cherche en même temps à apaiser les craintes à l'étranger, à établir des contacts avec les puissances régionales et internationales et à être reconnu comme une force légitime avec laquelle il est possible de négocier. L'un des obstacles à cette normalisation est le fait que HTC est toujours considérée comme une organisation terroriste par les États-Unis, la Turquie, les Nations Unies tandis que la Syrie est toujours sous le coup de sanctions. En outre, dans le cadre de la Loi d'autorisation de crédits pour la défense nationale pour l'année fiscale 2025, le président américain Joe Biden a signé le 23 décembre la reconduction de l'application de la loi César jusqu'au 31 décembre 2029, malgré la chute du régime de Bachar el-Assad. Promulgué cinq ans plus tôt par l'ancien président Donald Trump, ce texte prévoit des sanctions à l'encontre de tous les acteurs – y compris étrangers – qui aident le régime syrien à se procurer des ressources ou des technologies susceptibles de renforcer ses activités militaires ou de contribuer à la reconstruction de la Syrie.
Mais des signes laissant présager un changement d'orientation des capitales régionales et internationales à l'égard de HTC sont d'ores et déjà observables. Il est clair qu'Ankara est le principal soutien politique et militaire de la nouvelle Syrie, tandis que le Qatar jouera un rôle majeur comme pilier de son économie. Parallèlement, El-Chareh s'efforce d'établir des relations avec d'autres États arabes et des acteurs régionaux et internationaux. Par exemple, le chef du HTC a rencontré une délégation saoudienne à Damas et a fait l'éloge des plans de développement ambitieux du royaume saoudien, en référence à son projet Vision 2030, et a exprimé son optimisme quant à une future collaboration entre Damas et Riyad. Pour l'Arabie saoudite et les autres monarchies du Golfe, l'évolution des relations avec les nouveaux dirigeants syriens dépendra de leur capacité à répondre à leurs préoccupations relatives à la situation politique dans le pays et à éviter que la Syrie ne devienne une nouvelle source d'instabilité régionale. Une délégation syrienne s'est rendue dans le Royaume saoudien, composée notamment du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense et du chef des services de renseignement.
Du côté des puissances occidentales également, un changement de cap est perceptible, y compris de la part des États-Unis. La responsable pour le Moyen-Orient de la diplomatie américaine, Barbara Leaf, après avoir rencontré Ahmed el-Chareh à Damas fin décembre, a déclaré qu'ils avaient eu une « bonne réunion, très productive et approfondie » sur la suite de la transition politique dans ce pays. Elle a également qualifié Ahmed el-Chareh d'« homme pragmatique », annonçant que Washington levait la prime de 10 millions de dollars qui était placée sur sa tête depuis 2013 en raison de son rôle au sein de Jabhat al-Nosra.
Les récentes déclarations d'el-Chareh sur la possibilité d'une dissolution de HTC pourraient également contribuer à la résolution de certains de ces problèmes.
Qui plus est, 90 % de la population vit sous le seuil de pauvreté, ce qui rend son pouvoir d'achat très faible et a donc un impact négatif sur la consommation intérieure. Alors qu'en Syrie le travail ne manque pas, les gens ne sont pas suffisamment payés pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Dans ce contexte, les Syrien.ne.s dépendent de plus en plus des sommes envoyées par les émigré.e.s pour survivre.
Certains responsables du nouveau gouvernement, comme Ahmed el-Chareh lui-même, ont annoncé qu'ils s'efforceraient d'augmenter les salaires des travailleurs de 400 % dans les jours à venir, ce qui porterait le salaire minimum à 1 123560 livres (environ 75$, 72€). Bien qu'il s'agisse d'un pas dans la bonne direction, cela ne suffirait pas à répondre aux besoins des gens alors que le coût de la vie continue à augmenter. De fait, le média Kassioun a estimé en octobre 2024 que le coût moyen de la vie pour une famille syrienne composée de cinq personnes à Damas était de 13,6 millions de livres (environ 1077 dollars ou 1033 euros). Le salaire minimum était lui de 8,5 millions (environ 673 dollars, 645 euros).
Pour couronner le tout, l'influence des puissances étrangères en Syrie reste une source de menace et d'instabilité, comme l'a démontré la dernière invasion par Israël et la destruction encore en cours des infrastructures militaires. Sans oublier les attaques et les menaces constantes de la Turquie dans le nord-est de la Syrie, en particulier dans les zones où les Kurdes sont en majorité.
L'un des plus grands problèmes, dans la mer d'incertitude dans laquelle se trouve le pays, c'est que la plupart des acteurs politiques de premier plan, y compris le HTC, n'ont pas de programme économique politique alternatif.
Le HTC n'a rien d'autre à proposer que le système économique néolibéral et, conformément aux mécanismes et aux formes de capitalisme de connivence qui existaient sous le régime précédent, le groupe s'efforce de conforter ces façons d'agir au sein des réseaux d'affaires (où l'on retrouve aussi bien d'anciens que de nouveaux personnages). Au cours des années passées, le Gouvernement de Salut d'Idlib a favorisé le développement du secteur privé, et des hommes d'affaires proches de HTC et d'al-Joulani lui-même.
Dans le même temps, la plupart des services sociaux – en particulier la santé et l'éducation – ont été assurés par des ONG et des organisations non gouvernementales internationales.
Bassel Hamwi, président de la Chambre de commerce de Damas, a déclaré qu'après la chute du régime, le nouveau gouvernement syrien nommé par HTC a annoncé aux chefs d'entreprise qu'il adopterait un système d'économie de marché et intégrerait le pays dans l'économie mondiale. M. Hamwi a été « élu » à son poste actuel en novembre 2024, quelques semaines avant la chute d'Assad. Il est également président de la Fédération des chambres de commerce syriennes.
Le HTC n'a rien d'autre à proposer que le système économique néolibéral et, conformément aux mécanismes et aux formes de capitalisme de connivence qui existaient sous le régime précédent, le groupe s'efforce de conforter ces façons d'agir au sein des réseaux d'affaires.
Al-Chareh et son ministre de l'économie ont également tenu de nombreuses réunions avec des représentants de ces chambres économiques et des hommes d'affaires de différentes régions pour leur exposer leurs idées en matière d'économie et écouter leurs doléances, dans l'optique de satisfaire leurs intérêts. La grande majorité des représentants des différentes chambres économiques de l'ancien régime occupent toujours leurs postes.
Au bout du compte, ce système économique néolibéral, combiné à l'autoritarisme du HTC, débouchera très certainement sur des inégalités socio-économiques et un appauvrissement continu de la population syrienne, ce qui a été l'une des principales raisons du soulèvement de 2011.
Le nouveau ministre de l'économie membre de HTC a réaffirmé cette orientation néolibérale quelques jours après, déclarant que « nous passerons d'une économie socialiste […] à une économie de marché respectant les lois islamiques ». Indépendamment du fait qu'il est totalement faux de qualifier le régime antérieur de socialiste, l'orientation de classe du ministre se reflète clairement dans l'accent mis sur le fait que « le secteur privé… sera un partenaire efficace et contribuera à la construction de l'économie syrienne ».
Pas un seul mot sur la place des travailleurs, des paysans, des agents de l'État, des syndicats et des associations professionnelles dans l'économie future du pays.
En dernière analyse, la façon dont la reconstruction se déroulera dépendra des forces sociales et politiques qui en seront partie prenante et des rapports de forces qui s'établiront entre elles. À cet égard, la construction d'organisations syndicales autonomes et de masse sera essentielle pour améliorer les conditions de vie et de travail de la population et, plus généralement, pour lutter en faveur des droits démocratiques et d'un système économique fondé sur la justice sociale et l'égalité.
Une idéologie réactionnaire
Dans le même ordre d'idées, le HTC a fait plusieurs déclarations et pris plusieurs décisions qui confirment la nature réactionnaire de son idéologie.
Quelques jours plus tard, Aïcha al-Dibs, nouvellement nommée à la tête des Affaires féminines et seule femme à ce jour à faire partie du gouvernement de transition, répondant à une question sur l'« espace » qui serait accordé aux organisations féministes dans le pays, a déclaré que si « les actions de ces organisations soutiennent le système que nous allons construire, elles seront les bienvenues », ajoutant : « Je ne vais pas ouvrir la voie à quiconque n'est pas d'accord avec ma façon de penser » Elle a poursuivi l'entretien en développant une vision réactionnaire du rôle des femmes dans la société, en exhortant les femmes à « ne pas aller au-delà des limites que Dieu a fixées à leur nature » et à être bien conscientes de l'importance de leur rôle d'éducatrices au sein de la famille ».
En complément, le ministère syrien de l'éducation a modifié les programmes scolaires dans une optique plus islamo-conservatrice, notamment en retirant la théorie de l'évolution des programmes de sciences, en présentant les Juifs et les Chrétiens comme ceux qui se sont « égarés » du vrai chemin ou en remplaçant les références à la « défense de la nation » par la « défense d'Allah ». Devant les nombreuses critiques suscitées par ces changements, le ministre de l'Éducation a annoncé le jour suivant que « les programmes de toutes les écoles syriennes restent en l'état jusqu'à ce que des comités spécialisés soient formés pour examiner et évaluer les programmes. Nous avons seulement imposé la suppression de tout ce qui faisait l'apologie du défunt régime Assad, et nous avons substitué dans tous les manuels scolaires des images du drapeau de la révolution syrienne à celles du drapeau du régime disparu… ». Ainsi, certains des changements qui avaient été effectués ont été annulés.
Il est donc insuffisant de faire des déclarations floues sur la tolérance envers les minorités religieuses ou ethniques ou sur le respect des droits des femmes. La question fondamentale est la reconnaissance de leurs droits en tant que citoyens et citoyennes égaux et égales participant à la prise de décision sur l'avenir du pays. De façon plus générale, les responsables de HTC ont clairement affiché leur préférence pour un régime islamique et l'application de la charia.
Pas de solution pour la question kurde
Dans le même temps, il est peu probable que HTC soit disposé à soutenir les demandes des FDS et de l'AANES, en particulier en ce qui concerne les droits nationaux des Kurdes. C'est que les régions du nord-est sont riches en ressources naturelles, en particulier pour le pétrole et l'agriculture, et qu'elles sont donc stratégiquement et symboliquement importantes. En réalité, HTC n'est pas différent du Conseil national syrien et de la Coalition nationale des forces de l'opposition et de la révolution, deux coalitions de l'opposition en exil qui sont hostiles aux droits nationaux des Kurdes.
Avec la chute du régime, la Turquie est devenue le principal intervenant régional dans le pays. En soutenant Hayat Tahrir al-Cham, Ankara consolide son pouvoir sur la Syrie. Le principal objectif de la Turquie, outre le fait de procéder au retour forcé des réfugiés syriens et de profiter des futures retombées économiques de la phase de reconstruction, est de nier les aspirations des Kurdes à l'autonomie, et plus particulièrement de saper les bases de l'AANES. Cela créerait un précédent défavorable à l'autodétermination kurde en Turquie.
Le principal objectif de la Turquie, outre le fait de procéder au retour forcé des réfugiés syriens et de profiter des futures opportunités économiques durant la phase de reconstruction, est de nier les aspirations kurdes à l'autonomie, et plus particulièrement de saper les bases de l'AANES.
Le ministre turc des affaires étrangères, Hakan Fidan, a déclaré lors d'une conférence de presse conjointe avec le chef de HTC que l'intégrité territoriale de la Syrie était « non négociable » et que le PKK « n'avait pas sa place » dans le pays. Quelques jours plus tard, le président Erdogan a déclaré que les FDS « ou bien diront adieu à leurs armes, ou bien seront enterrées en terre syrienne ». L'armée turque n'a par ailleurs cessé de bombarder la population civile et certaines infrastructures essentielles du nord-est de la Syrie depuis la fin de l'année 2023.
Si HTC n'a pris part à aucune confrontation militaire contre les FDS au cours des dernières semaines, l'organisation n'a pas pour autant fait entendre une opposition aux attaques menées par la Turquie, bien au contraire. Mourhaf Abou Qasra, un des principaux commandants de HTC et nouveau ministre de la Défense du gouvernement de transition, a déclaré que « la Syrie ne sera pas divisée et qu'il n'y aura pas de fédéralisme inchallah. Si Dieu le veut, toutes ces régions seront placées sous l'autorité de la Syrie ». De même, al-Chareh s'oppose lui aussi au fédéralisme.
En outre, al-Chareh a déclaré à un journal turc que la Syrie établirait une relation stratégique avec la Turquie à l'avenir, et il a ajouté : « Nous n'acceptons pas que des territoires syriens puissent menacer et déstabiliser ni la Turquie ni quoi que ce soit d'autre ».
Il a également déclaré que toutes les armes devaient passer sous le contrôle de l'État, y compris celles qui se trouvent dans les zones tenues par les FDS.
Tout cela alors que les responsables des FDS ont déclaré à plusieurs reprises qu'ils voulaient négocier avec les HTC. Le commandant des FDS Mazloum Abdia déclaré qu'il était favorable à la décentralisation de l'État et à l'auto-administration, mais pas au fédéralisme, tout en étant ouvert à l'idée de s'intégrer dans une future armée nationale syrienne (avec des garanties). Il a déclaré que les FDS n'étaient pas une extension du PKK et qu'elles étaient prêtes à renvoyer les combattants non syriens immédiatement après la conclusion d'une trêve.
Al-Chareh a déclaré ces derniers jours qu'il négociait avec les FDS dans le but de dénouer la crise dans le nord-est de la Syrie et que le ministère syrien de la défense intégrerait les forces kurdes dans ses rangs. Mais il reste à savoir comment et dans quelles conditions.
Une course contre la montre pour la défense d'un espace démocratique
La grande majorité des organisations et forces sociales démocratiques à l'origine du soulèvement populaire de mars 2011 ont été réprimées dans le sang. D'abord et avant tout par le régime, mais aussi par diverses organisations islamiques fondamentalistes armées. Il en a été de même pour les institutions ou entités politiques alternatives locales mises en place par les protestataires, telles que les comités de coordination et les conseils locaux qui assuraient des services de proximité à la population. Il existe néanmoins des groupes et des réseaux civils, bien que principalement liés à des organisations de type ONG, sur l'ensemble du territoire syrien, et en particulier dans le nord-ouest de la Syrie, mais dont la dynamique est différente de celle qui prévalait au début du soulèvement.
Il existe néanmoins des groupes et des réseaux civils, bien que principalement liés à des organisations de type ONG sur l'ensemble du territoire syrien, et en particulier dans le nord-ouest de la Syrie, mais dont la dynamique était différente de celle qui prévalait au début du soulèvement.
Dans le même temps, d'autres expériences de lutte se sont développées, même si elles sont de moindre intensité. Par exemple, depuis la mi-août 2023, il y a des manifestations populaires et des grèves dans le gouvernorat de Soueida, peuplé principalement par la minorité druze, De manière plus générale, le mouvement de protestation n'a cessé de souligner l'importance de l'unité syrienne, de la libération des prisonniers politiques et de la justice sociale, tout en exigeant la mise en œuvre de la résolution 2254 de l'ONU qui préconise la mise en place d'une transition politique. Ce sont de fait les réseaux et groupes locaux qui ont proposé une figure de proue de la contestation, Mouhsina al-Mahithawi, qui a été nommée récemment au poste de gouverneur de la province de Soueïda.
D'autres villes et régions sous le contrôle du régime syrien, notamment les gouvernorats de Daraa et, dans une moindre mesure, les banlieues de Damas, ont également été le théâtre de manifestations ponctuelles, bien qu'à une échelle beaucoup plus réduite.
Ces formes de contestation ont pour partie préparé le terrain au soulèvement qui s'est produit dans les jours précédant la chute de la dynastie Assad.
Plus généralement, l'expérience accumulée au cours des premières années du début du soulèvement populaire, qui a été la plus dynamique en termes de résistance civile populaire, a été préservée grâce à leur transmission par les militant.e.s qui ont vécu ces expériences et grâce à une documentation sans précédent sur le soulèvement, comprenant des écrits, des enregistrements vidéo, des témoignages et autres. Ces vastes archives documentaires sur le mouvement de résistance civile ont vocation à être intégrées à la mémoire populaire et à constituer une ressource cruciale pour ceux et celles qui résisteront à l'avenir.
Depuis la fin du régime Assad, les initiatives locales se multiplient pour mettre en place des comités locaux ou des réseaux d'activistes de formes variées dans les différentes régions, afin d'encourager l'auto-organisation, la participation par le bas et de garantir la paix civile. Des manifestations ont déjà eu lieu, notamment pour dénoncer certaines déclarations réactionnaires à l'encontre des femmes.
Ceci dit, nous devons regarder en face l'absence criante d'un bloc démocratique et progressiste indépendant, capable de s'organiser et de s'opposer clairement au nouveau pouvoir en place. La construction de ce bloc prendra du temps. Il devra combiner les luttes contre les autocrates, l'exploitation et toutes les formes d'oppression. Il devra avancer des revendications en faveur de la démocratie, de l'égalité, de l'autodétermination kurde et de la libération des femmes afin de créer une solidarité entre les exploité.es et les opprimé.es du pays.
Pour promouvoir ces revendications, ce bloc progressiste devra construire et reconstruire les organisations populaires, depuis les syndicats jusqu'aux organisations féministes, en passant par les organisations communautaires, ainsi que les structures nationales qui permettront de les fédérer. Cela nécessitera une collaboration entre les acteurs démocratiques et progressistes de l'ensemble de la société.
En outre, l'une des tâches essentielles consistera à s'attaquer à la principale division ethnique du pays, celle qui oppose les Arabes aux Kurdes. Les forces progressistes doivent mener une lutte sans merci contre le chauvinisme arabe afin de surmonter cette division et de forger une solidarité entre ces populations. Il s'agit là d'un défi qui se pose depuis le début de la révolution syrienne en 2011 et qui devra être relevé et résolu de manière progressiste si l'on veut que le peuple syrien soit réellement libéré.
Conclusion
Il est important de rappeler que HTC est surtout le produit de la contre-révolution menée par le régime syrien, qui a réprimé dans le sang le soulèvement populaire et ses organisations démocratiques, et qui s'est de plus en plus militarisé. La progression de ce type de mouvements fondamentalistes islamiques est le résultat de diverses raisons, notamment le fait que le régime ait facilité leur développement, la répression du mouvement de contestation qui a conduit à la radicalisation de certains éléments, la meilleure organisation et discipline de leurs groupes et, enfin, le soutien de pays étrangers.
Par la suite, HTC, comme d'autres organisations islamiques fondamentalistes armées, a constitué à bien des égards la deuxième aile de la contre-révolution, derrière le régime Assad. Leur vision de la société et de l'avenir de la Syrie s'oppose aux objectifs initiaux du soulèvement et à son message universel de démocratie, de justice sociale et d'égalité. Leur idéologie, leur programme politique et leurs pratiques ont fait preuve de violence non seulement à l'égard des forces du régime, mais aussi à l'égard des groupes démocratiques et progressistes, tant civils qu'armés, des minorités ethniques et religieuses et des femmes.
En conclusion, la sauvegarde et la lutte pour une société démocratique et progressiste ne passent pas par la confiance dans les autorités actuelles de HTC ou par l'attribution de bonnes notes ou de satisfecits pour la gestion de la phase de transition, mais par la construction d'un contre-pouvoir indépendant rassemblant des réseaux et des associations démocratiques et progressistes. Le calendrier d'organisation des élections et de rédaction d'une nouvelle constitution, ou la sélection des personnalités qui participeront à une « conférence de dialogue national », peuvent faire l'objet de débats et de critiques, mais le problème essentiel est l'absence de participation de la base au processus décisionnel et l'incapacité à faire pression sur HTC pour lui imposer des concessions. Le pouvoir de décision est uniquement entre les mains de HTC. Ce cadre bénéficie également du soutien de ses principaux soutiens, la Turquie et le Quatar, mais aussi, plus généralement, de la grande majorité des puissances régionales et internationales. Plus globalement, elles ont pour objectif commun de (ré)imposer une forme de stabilité autoritaire en Syrie et dans la région. Cela ne signifie évidemment pas pour autant qu'il y ait une unanimité parmi les puissances régionales et impériales. Elles ont chacune leurs intérêts propres, souvent antagonistes, mais elles ne veulent pas d'une déstabilisation du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord.
L'espoir d'un avenir meilleur est dans l'air après la chute d'Assad. Tout cela dépendra de la capacité des Syrien.ne.s à reconstruire les luttes à partir de la base. Actuellement, le pouvoir et le contrôle des HTC sur la société ne sont pas encore complets, car leurs capacités humaines et militaires sont encore trop limitées pour imposer pleinement leur autorité sur l'ensemble de la Syrie, et il existe donc un certain espace pour s'organiser. Cet espace doit être mis à profit.
En fin de compte, seule l'auto-organisation des classes populaires luttant pour des revendications démocratiques et progressistes ouvrira la voie vers une libération et une émancipation réelles.
Au moins maintenant, cette opportunité existe mais nous sommes engagés dans une course de vitesse ; les classes populaires de Syrie doivent s'organiser pour faire fructifier tous les sacrifices consentis pour que se réalisent enfin les aspirations initiales de la révolution à la démocratie, à la justice sociale et à l'égalité.
*
Publié initialement sur Syria untold, 4 janvier 2025, traduit pour ESSF par Pierre Vandevoorde avec l'aide de DeepL.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Au bout de plusieurs décennies, un mouvement insurrectionnel en perte de vitesse – Les maoïstes philippins sous pression

Après avoir été longtemps la force de gauche la plus puissante du pays, le Parti communiste maoïste des Philippines subit une érosion due à la répression et aux promesses d'amnistie faites par le gouvernement à ceux qui acceptent de se rendre. Les explications d'Alex de Jong.
Photo et article tirés de NPA 29
Le Parti communiste maoïste des Philippines (CPP), qui se trouve à la tête de l'une des guérillas les plus anciennes au monde et compte des dizaines de milliers de membres, reste une référence pour une partie de la gauche radicale au niveau international.
La Ligue internationale de la lutte des peuples (ILSP), représentée aux États-Unis par des organisations telles que Bayan, définit sa ligne politique dans un cadre fixé par le CPP. Aux Philippines même, le CPP et le mouvement « national-démocratique » qu'il dirige demeurent la force dominante à gauche. C'est pourquoi l'évolution récente du parti est une question qui intéresse les socialistes internationalistes du monde entier.
Aussi longtemps que subsisteront une pauvreté de masse et un système politique ostensiblement dominé par les riches, les matériaux susceptibles d'alimenter un mouvement de guerilla seront toujours là.
Ces dernières années, il est apparu clairement que le PPC était soumis à une pression croissante. Après que l'alliance avec le président Rodrigo Duterte a volé en éclats en 2017, la répression violente exercée contre le parti, ses fronts de guérilla et ses partenaires légalement reconnus s'est intensifiée1. [Une stratégie gouvernementale combinant les opérations meurtrières et les incitations matérielles à l'abandon du mouvement a permis d'affaiblir l'insurrection. Fin 2022, Le décès de l'idéologue et président fondateur du parti, Jose Maria Sison, exilé aux Pays-Bas,a marqué une date symbolique. Plus significatif encore a été ce qui est arrivé à Benito et Wilma Tiamzon au mois d'août de la même année. Ce couple s'était radicalisé alors qu'ils étaient étudiants au début des années 1970 et l'un comme et lautre étaient devenus des militant.e.s de premier plan du PPC au cours des décennies qui ont suivi. En avril 2023, le parti a confirmé le fait qu'il et elle avaient été tués par l'armée quelque huit mois plus tôt. Au moment de leur mort, Benito Tiamzon était président du comité central et Wilma Tiamzon était la secrétaire générale. Un article paru sur le site d'information Rappler expliquait comment le couple avait été traqué par l'armée pendant des mois sur l'île de Samar, autrefois bastion du CPP et de sa branche armée, la Nouvelle Armée Populaire (NPA). Ils ne sont pas les seuls membres haut placés du CPP à avoir été tués ces dernières années. Moins de six mois auparavant, Ka Oris (Jorge Madlos), ancien commandant et porte-parole de la NPA, avait été tué. À la fin de l'année 2020, le corps d'Antonio Cabanatan a été retrouvé. Membre du comité exécutif du parti, Cabanatan était l'un des responsables de la funeste décision de boycotter les élections de 1986. Parmi les autres dirigeants du CPP-NPA tués ces dernières années figurent également des membres du comité central du parti et des commandants de haut rang de la NPA.
Des signes de recul
Pour des raisons évidentes, il est difficile de recueillir des informations sur la situation du CPP/NPA clandestin. Les déclarations du parti, formulées sous forme de slogans, ne sont pas très significatives : la révolution « avance à grands pas » et « la crise du système pourri ne cesse de s'aggraver », et il en est ainsi depuis des décennies. Les données recueillies par l'ONG Armed Conflict Location Event Data (ACLED) montrent une légère diminution des affrontements armés impliquant la NPA au cours de la période 2016-2023, mais ne précisent pas qui en est (ICG) à l'origine. Selon un rapportdu centre d'études et de recherches International Crisis Group, le nombre de personnes tuées dans le conflit est de l'ordre de quelques centaines par an, l'année 2024 étant probablement moins meurtrière que les précédentes. Ang Bayan, le journal du parti, présente des rapports détaillés sur les activités de la NPA. En additionnant les chiffres qui y sont donnés, on obtient un tableau assez semblable du nombre de pertes annuelles, la plupart des affrontements se déroulant dans un petit nombre de régions. Le parti affirme qu'il « érode » le potentiel militaire de l'État philippin, mais dans un pays de près de 120 millions d'habitant.e.s, où l'âge moyen est de moins de 26 ans et où le chômage est massif, l'armée peut facilement trouver de nouvelles recrues.
Globalement, la conclusion selon laquelle le parti a été affaibli par rapport aux dernières années de la présidence de Gloria Macapagal-Arroyo, au cours de la première décennie des années 2000, se révèle inévitable. Ces années-là avaient vu une augmentation de l'activité de la NPA et un renforcement du parti au regard de la crise qu'il avait traversée dans les années 1990. À la suite de l'effondrement du régime de Ferdinand Marcos en 1986, lequel avait instauré la loi martiale en 1972, le parti a été pris par surprise par ce qui était à bien des égards une restauration de la « démocratie d'élite » de la période précédant Marcos. Les révélations sur la façon dont des centaines de camarades ont été torturé.e.s et tué.e.s lors de purges paranoïaques au cours des années 1980 ont mis à mal la confiance dans la capacité de la NPA à représenter une alternative2.
Derrière une façade d'unité idéologique monolithique, avec Sison comme figure d'autorité en toute chose, le CPP a toujours été un mouvement assez décentralisé dont les différentes expériences ont produit un certain pluralisme idéologique. Cette situation est devenue manifeste lorsqu'une période de débats intenses a débuté au sein du mouvement. Au début et jusqu'au milieu des années 90, les partisan.e ;s de la ligne dure maoïste sont parvenus à y mettre un terme par des expulsions massives, qui ont conduit des unités entières du parti à annoncer qu'elles s'en séparaient. Une grande partie de la gauche philippine est née de ces scissions et désaffiliations. Lorsque le CPP est sorti de cette crise, il avait considérablement fondu. Extrêmement hostile aux autres composantes de la gauche, il a entrepris une campagne d'assassinats de « faux militants de gauche », notamment des responsables paysans qui avaient adopté une stratégie différente3 et des membres d'autres groupes révolutionnaires4. [Bien qu'il ne soit plus jamais parvenu à se rapprocher de son plus haut niveau du milieu des années 1980, après avoir « réaffirmé » le maoïsme, le CPP, désormais plus homogènement stalinien et rigide sur le plan organisationnel, a été en mesure de récupérer une partie du territoire perdu au cours de la présidence d'Arroyo, qui devenait de plus en plus impopulaire.
En parcourant les écrits stéréotypés du parti, on constate que les déclarations du CPP ne laissent entrevoir que tout ne va pas pour le mieux. Au lieu des centaines de fronts de guérilla que le parti revendiquait dans les années 1980, les déclarations récentes font état de « plus de 110″ fronts de guérilla. En 2007, le parti avait fixé un délai de cinq ans pour que la lutte armée aboutisse à une « impasse stratégique », mais après avoir admis que l'objectif n'avait pas été atteint, aucun nouveau délai n'a été fixé, ce qui signifie que la guérilla se trouve dans la même phase qu'il y a quarante ans. Dans ses rapports, la NPA affirme avoir des « milliers » de combattants, mais selon les dires du gouvernement, la NPA ne compte plus que 1 500 combattant.e.s permanent.e.s. Les deux parties ont fait des déclarations trompeuses. Comme dans le passé, les deux parties ont déjà fait des déclarations douteuses, ces chiffres ne peuvent pas être acceptés sans réserve.
L'indication la plus claire que le parti est confronté à des difficultés a été son communiqué de 2023 à l'occasion de l'anniversaire de sa fondation. De telles déclarations sont censées donner une orientation générale pour l'année à venir. Le document de 2023 était quelque peu différent, car il annonçait un « mouvement de rectification » pour surmonter « les erreurs et les tendances négatives, les faiblesses et les lacunes ». » Nombre de fronts de guérilla de la NPA ont stagné « , écrit le parti, et il y a eu de » graves revers « . Ces revers sont imputés à des déviations de la ligne maoïste : Puisque la ligne est censée être correcte et les « conditions objectives » excellentes, les revers sont forcément le résultat d'une déviation par rapport au maoïsme. Par conséquent, la réponse aux difficultés du parti consiste à renforcer le maoïsme. Ce type de logique circulaire est bien connu au sein du parti. Le fait que le CPP qualifie cet appel de « mouvement de rectification » mérite cependant d'être souligné. Il n'a qualifié une campagne de « mouvement de rectification » qu'à deux reprises auparavant : lors de la fondation du parti à la fin des années 1960, lorsqu'il s'est séparé du Partido Komunista ng Pilipinas5, et lors de la campagne contre les dissident·es au milieu des années 1990. L'utilisation de l'expression « mouvement de rectification » témoigne de la gravité du problème.
Un paysage en mutation
Comment le mouvement en est-il arrivé là ? Une partie de la réponse réside dans le fait que le cours suivi par le parti sur le long terme depuis le début des années 1990 a été un mouvement de déclin, même si, comme nous l'avons vu, ce recul n'a pas été constant. Le parti est profondément attaché à une perception de la société philippine comme étant non pas capitaliste, mais « semi-féodale ». Le problème fondamental du pays, affirme le parti, est « l'exploitation semi-féodale » à la campagne, c'est-à-dire une exploitation qui ne passe pas par l'exploitation d'une main-d'oeuvre salariée, « libre », mais qui repose sur la coercition directe. L'archétype de cette exploitation est le métayer, qui vit et travaille sur des terres appartenant à un propriétaire et qui est contraint de lui remettre une grande partie de sa récolte et d'effectuer des travaux non rémunérés pour lui. De cette lecture, le parti déduit de manière mécanique et directe que la lutte révolutionnaire consiste fondamentalement à mener une guérilla qui s'appuie sur la paysannerie.
Quel que soit le bien-fondé de son analyse pour les Philippines du milieu du vingtième siècle ou même des années 1980, elle se heurte de plus en plus à la réalité. Bien que l'économie philippine reste largement basée sur l'agriculture et l'exportation de produits agricoles, les rapports de production ont changé de manière significative depuis la fondation du CPP. Parmi les » opérateurs agricoles « , le statut de métayer est passé de plus d'un tiers dans les années 1960 à seulement 15 % il y a déjà une dizaine d'années. La proportion de personnes qui travaillent comme paysans a diminué de moitié au cours de la même période6. [Les travailleuses et travailleurs salariés des secteurs formel et « informel » constituent aujourd'hui la majorité de la population active. La paysannerie a diminué en proportion de la population active et en termes d'importance pour la production économique. D'autre part, le secteur des services a connu une croissance rapide, ce que n'avaient pas prévu les maoïstes, qui supposaient que le développement économique emprunterait nécessairement la voie de l'industrialisation, qu'ils considéraient comme bloquée par l'impérialisme. Mais en 2020 encore, Sison déclarait qu'aucun changement « qualitatif » ne s'était produit depuis les années 1960, ni d'ailleurs depuis la période du colonialisme américain. Le programme du CPP est de moins en moins pertinent, mais le parti a passé des décennies à dénoncer ceux qui ne partagent pas son point de vue selon lequel les Philippines sont une société non capitaliste et semi-féodale.
Le dogmatisme théorique va de pair avec des embardées dans la pratique. La plus spectaculaire d'entre elles a été la tentative du parti, en 2016, de forger une alliance avec le président récemment élu, M. Duterte. Lorsque Duterte a été élu, il était inconnu sur le plan politique pour la plupart des gens, mais pas pour le PPC. Pendant des décennies, Duterte avait été à la tête de Davao City, la ville la plus importante du sud du pays, où il entretenait une relation mutuellement bénéfique avec le parti. Duterte avait adopté une approche non interventionniste à l'égard des clandestins qui, en retour, ne troublaient pas la paix dans « sa » ville de Davao et fermaient les yeux sur l'utilisation d'un escadron de la mort comme outil de lutte contre la criminalité. Duterte, bien évidemment, a mis en place cet instrument à l'échelle nationale, ce qui s'est traduit par des milliers d'assassinats. Cela n'a pas fait obstacle à une période de lune de miel entre le président et le parti. Le premier signal indiquant que le mouvement étendrait son alliance avec Duterte au-delà de Davao a été donné par les déclarations de Sison. Sison a en effet annoncé que la présidence de Duterte serait bénéfique pour « l'unité nationale », et Duterte a proposé aux maoïstes des postes ministériels. Le CPP a poliment proposé à plusieurs de ses partenaires légallement reconnus d'occuper ces postes. L'une d'entre eux, Liza Maza, a continué à occuper un poste ministériel auprès de Duterte jusqu'en août 2018. Par la suite, Liza Maza est devenue secrétaire générale de l'ILSP.
Une photo datant de septembre 2016 illustre bien l'évolution des relations. Prise le 26 septembre dans la salle à manger d'apparat du palais présidentiel de Malacañang, elle montre Duterte en compagnie de membres de son équipe de négociation et de celle du Front national-démocratique ( FND), l'étiquette utilisée par le CPP pour mener à bien ses activités diplomatiques. Les sourires emplissent la pièce, Duterte lève le poing avec les représentant.e.s du FND. À ses côtés, Luis Jalandoni, l'actuel président du FND, ainsi que Wilma et Benito Tiamzon. Ces deux derniers avaient été libérés le mois précédent. Au cours des mois suivants, les relations se sont détériorées et, en février 2017, le cessez-le-feu entre le gouvernement et la NPA a été rompu.
Avec le recul, on ne voit pas très bien ce que le CPP pensait tirer de cette tentative d'alliance. Tant que Duterte n'était qu'une figure régionale, les relations amicales avec le CPP étaient à son avantage, car cela garantissait qu'ils ne l'importuneraient pas. Mais dès qu'il est devenu président, cette possibilité n'a plus existé. C'est probablement Sison, en sa qualité de président du groupe d'experts du FND, qui a soutenu avec le plus d'enthousiasme l'idée de transformer les relations existantes avec Duterte en une alliance nationale. Pendant des mois, le FND a continué à discuter de réformes profondes avec un gouvernement qui n'a jamais eu l'intention de les mettre en œuvre. De toute évidence, Sison a surestimé l'influence qu'il exerçait sur Duterte, qui avait été autrefois un de ses étudiants.
Un avenir incertain
Les déclarations du CPP sont répétitives, mais les déclarations du gouvernement philippin prédisant la défaite imminente de l'insurrection le sont tout autant. Aussi longtemps que subsisteront une pauvreté de masse et un système politique ostensiblement dominé par les riches, les matériaux susceptibles d'alimenter un mouvement de guerilla seront toujours là. Hormis un recul important pendant le COVID, l'économie philippine a connu une forte croissance au cours des dernières années, notamment grâce à l'essor du secteur des services. Mais cette croissance n'a guère profité aux pauvres du pays, en particulier dans les campagnes reculées. Après six décennies, le CPP ne va pas disparaître soudainement.
Lorsque le cessez-le-feu a été rompu, le parti a semblé retourner à la normale. Il y a cependant une différence. Sous Duterte, le gouvernement n'a pas seulement relancé le recours à la répression meurtrière et à la chasse aux activistes de terrain, marqué.e.s comme « rouges », il les combine désormais avec des mesures de grâce et d'aide financière pour les rebelles qui se rendent, ainsi qu'avec un soutien aux communautés qui abandonnent le soutien qu'elles apportaient jusqu'alors à la NPA. Le gouvernement actuel de Marcos Jr poursuit cette politique. Il est évident que le gouvernement gonfle l'ampleur et le succès de ce programme, mais l'utilisation de la « carotte et du bâton » n'est pas sans succès. À propos de la répression réussie d'une rébellion menée par les communistes dans les années 1950 aux Philippines, Edward Lansdale, expert en contre-insurrection de la CIA, disait qu'une promesse qui semble crédible était plus importante qu'un changement réel. Selon le rapport déjà évoqué de l'ICG, « les rebelles se sont retrouvés de plus en plus à la dérive et sur la défensive. Les arrestations et les redditions de combattants se sont succédé à un rythme soutenu ».
Les difficultés du CPP et du bloc d'organisations sociales qui reprennent sa ligne politique ne se développent pas dans un isolement total par rapport au reste de la gauche. Le mouvement dirigé par le CPP reste la force la plus puissante de la gauche philippine. Et si la répression se concentre sur le CPP, elle ne s'y limite pas. Plusieurs membres de la section philippine de la Quatrième Internationale, le RPM-M, ont également été tués, par exemple.
La société philippine est en train de changer, l'urbanisation progresse et la composition des classes laborieuses se transforme. La gauche doit avoir la volonté de rompre avec les vieux dogmes et les vieilles divisions et de faire face à de nouvelles questions telles que la crise climatique. Il est peu probable que le PPC y parvienne, mais il y a, surtout dans sa périphérie « émergée », beaucoup de jeunes militant.e.s dévoué.e.s qui sont plus motivé.e.s par le désir de changer la société que par le dogme maoïste. Mais pour l'instant, c'est la droite qui domine, comme le montre la popularité de Duterte dans le passé et du président Marcos Jr aujourd'hui. Lors des élections de 2022, Leody de Guzman, du parti socialiste Lakas ng Masa, s'est présenté à l'élection présidentielle avec pour colistier le célèbre militant et universitaire Walden Bello. La campagne a ouvert une nouvelle voie, puisqu'il s'agissait de la première campagne présidentielle ouvertement socialiste de l'histoire des Philippines, mais avec 0,17 % des voix, le résultat a déçu les militant.e.s. Un nouveau pôle d'attraction de gauche reste à construire.
Publié par Tempest le 2 janvier 2025, traduit pour ESSF par Pierre Vandevoorde avec l'aide de DeepLpro
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Il a demande a l’Égypte et à la Jordanie d’accueillir les Ghazaouis : Le plan d’une nouvelle « Nakba » de Donald Trump

Donald Trump a déclaré s'être entretenu avec le roi Abdallah II de Jordanie et avec le président égyptien Abdel Fattah Al Sissi au sujet de l'avenir de Ghaza, les exhortant à accueillir une partie de la population de l'enclave martyrisée. « Je préférerais m'impliquer avec certaines nations arabes et construire des logements dans un endroit différent, où ils pourraient peut-être vivre en paix pour une fois », a assuré le président américain.
Tiré d'El Watan.
C'est la dernière sortie du fantasque Donald Trump. Samedi, le président américain fraîchement investi a suggéré de transférer une partie de la population de Ghaza vers l'Egypte, la Jordanie et d'autres pays arabes, à titre temporaire ou même définitif, a-t-il laissé entendre. Le prétexte avancé est de permettre de « faire le ménage », comme il dit, et de « nettoyer » Ghaza, au sens littéral du terme, c'est-à-dire déblayer et reconstruire l'enclave dévastée par quinze mois de bombardements sans relâche.
Mais connaissant Trump et son soutien sans réserve à l'entité sioniste, on ne peut s'empêcher de songer aux conséquences démographiques de ce plan improbable qui appelle en réalité à provoquer une nouvelle Nakba, comme en 1948, à l'encontre du peuple palestinien, en faisant déplacer massivement les Palestiniens de Ghaza. Auquel cas, « nettoyer » ce territoire ravagé, comme le proclame Trump, sous-entend commettre un nouveau « nettoyage ethnique », sous une autre forme, purement et simplement.
D'après Associated Press, c'est « au cours d'une séance de questions-réponses de 20 minutes avec les journalistes à bord d'Air Force One » que Trump a fait part de son étrange plan pour Ghaza. « Le président Donald Trump a déclaré samedi qu'il aimerait voir la Jordanie, l'Egypte et d'autres pays arabes augmenter le nombre de réfugiés palestiniens qu'ils accueillent, issus de la bande de Ghaza, ce qui pourrait permettre de déplacer suffisamment de population pour ‘'nettoyer'' la région déchirée par la guerre et faire table rase du passé », rapportait hier l'agence AP.
Ghaza « est un chantier de démolition »
Le président des Etats-Unis a indiqué qu'il s'était entretenu plus tôt dans la journée, ce samedi, avec le roi Abdallah II de Jordanie et qu'il s'entretiendrait ensuite avec le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi. « J'aimerais que l'Egypte prenne des gens », a lancé le leader US, selon AP. « Il s'agit d'un million et demi de personnes pour nettoyer tout le territoire. Vous savez, au cours des siècles, cette région a connu de nombreux conflits.
Je ne sais pas, mais il faut que quelque chose se passe », a-t-il affirmé. Trump a confié avoir félicité la Jordanie pour avoir accueilli des réfugiés palestiniens, avant de lancer à l'adresse du roi Abdallah II : « J'aimerais que vous en acceptiez davantage, parce que je regarde toute la bande de Ghaza en ce moment, et c'est un vrai gâchis.
C'est un vrai gâchis. » Pour le président américain, le transfert des habitants de Ghaza « pourrait être temporaire ou à long terme ». A ses yeux, Ghaza « c'est littéralement un chantier de démolition à l'heure actuelle. Presque tout a été démoli, et les gens meurent là-bas ».
Et de souligner : « Je préférerais donc m'impliquer avec certaines nations arabes et construire des logements dans un endroit différent, où ils pourraient peut-être vivre en paix pour une fois ». Lors de son investiture le 20 janvier, le successeur de Joe Biden avait estimé que Ghaza « doit vraiment être reconstruite d'une manière différente ».
Trump parlait comme un businessman, un cynique magnat de l'immobilier, sans un mot pour l'horreur génocidaire subie par la population palestinienne de l'enclave sauvagement pilonnée durant quinze mois. Il lâche : « Ghaza est intéressante. C'est un endroit phénoménal, au bord de la mer. Il y fait très beau, vous savez, tout va bien.
On pourrait en faire de belles choses, mais c'est très intéressant ». Réagissant à cette déclaration, Sami Abou Zuhri, un porte-parole du Hamas, a répliqué à Trump en disant, selon des propos rapportés par RT Arabic : « Les habitants de Ghaza ont enduré la mort pour ne pas quitter leur patrie et ils ne la quitteront pas.
Il n'est donc pas nécessaire de perdre du temps avec des projets que M. Biden a essayés et qui ont été une raison de prolonger les combats ». Et d'ajouter : « La mise en œuvre de l'accord (de cessez-le-feu) résoudra tous les problèmes dans la bande de Ghaza, et les tentatives de contournement de l'accord n'ont aucune valeur. »
Une livraison de bombes débloquée
De son côté, Bassem Naïm, membre du bureau politique du Hamas, a indiqué hier à l'AFP que « les Palestiniens feront échouer la proposition de Trump comme ils ont fait échouer tous les projets de déplacement pendant des décennies ».
Le Jihad Islamique a également répliqué à la proposition de Trump via un communiqué où on peut lire : « Ces déclarations déplorables s'alignent sur les pires facettes de l'agenda de l'extrême droite sioniste et poursuivent la politique de déni de l'existence du peuple palestinien ». Pour le Jihad Islamique, ce genre de sorties ne fait qu'encourager « la perpétration continue de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité ».
Côté israélien, on ne pouvait qu'applaudir la dernière trouvaille de Donald Trump comme l'a fait le ministre d'extrême-droite Bezalel Smotrich pour qui la proposition du président US « est une excellente idée », selon des propos repris par Al Jazeera. « Aider les habitants de Ghaza à trouver d'autres endroits pour commencer une nouvelle vie est une excellente idée ».
Les Palestiniens « pourront établir une nouvelle et belle vie ailleurs », s'est réjoui l'extrémiste ministre israélien des Finances. Smotrich a ajouté qu'il travaillerait volontiers avec le cabinet de Netanyahou « pour s'assurer que l'idée qu'un grand nombre d'habitants puissent quitter Ghaza pour les pays voisins soit mise en œuvre ».
Pour sa part, son acolyte dans la coalition d'extrême-droite israélienne, le ministre de la Sécurité nationale sortant, Itamar Ben-Gvir, a également accueilli avec ferveur le plan de Trump visant à « nettoyer » Ghaza, en déclarant, selon Al Jazeera : « Je félicite le président Trump pour son initiative visant à transférer la population de Ghaza vers la Jordanie et l'Egypte. »
Il a fait savoir dans la foulée qu'une de ses demandes « au Premier ministre Benjamin Netanyahu est d'encourager la migration volontaire ». Ben-Gvir renchérit en disant que lorsque « le président de la plus grande puissance mondiale propose une migration volontaire des Palestiniens, il est sage pour notre gouvernement de l'encourager et de la mettre en œuvre ».
Par ailleurs, Donald Trump a déclaré durant son échange avec les journalistes à bord du Air Force One ce samedi qu'il a ordonné de « débloquer une livraison de bombes de 2000 livres (907 kg) » au profit d'Israël. « M. Trump a déclaré qu'il a mis fin à la suspension par son prédécesseur de l'envoi de bombes de 2000 livres à Israël » indique Associated Press. « Nous les avons libérées aujourd›hui. Ils (les Israéliens) les attendaient depuis longtemps », a annoncé le président américain.
A la question de savoir pourquoi avoir débloqué ces bombes particulièrement dévastatrices, il a répondu : « Parce qu'ils les ont achetées ». Joe Biden avait interrompu la livraison des bombes de ce calibre en mai 2024 « afin d'empêcher Israël de lancer un assaut généralisé sur la ville de Rafah, au sud de la bande de Ghaza », précise AP. « Des civils ont été tués à Ghaza à cause de ces bombes et d'autres moyens utilisés pour s'attaquer aux centres de population », avait alors déploré Biden dans une interview à CNN, rappelle AP.
La Jordanie rejette tout projet de déplacement de Palestiniens
La Jordanie a réitéré, hier, son rejet de la réinstallation des Palestiniens hors de leur terre, après l'appel du président Trump à « nettoyer » la bande de Ghaza. « Nos principes sont clairs, et la position inébranlable de la Jordanie en faveur du maintien des Palestiniens sur leur terre reste inchangée et ne changera jamais », a déclaré le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, cité par Anadulu lors d'une conférence de presse conjointe à Amman avec Sigrid Kaag, coordinatrice principale des Nations unies pour l'aide humanitaire et la reconstruction à Ghaza.
Le rejet par la Jordanie du déplacement des palestiniens « est inébranlable et essentiel pour parvenir à la stabilité et à la paix que nous appelons tous de nos vœux », a-t-il ajouté. « La solution à la question palestinienne se trouve en Palestine ; la Jordanie est pour les Jordaniens et la Palestine est pour les Palestiniens », a encore affirmé Safadi. Décrivant Ghaza comme un « chantier de démolition », Donald Trump a appelé, samedi, à « vider » l'enclave sinistrée et à réinstaller les Palestiniens en Jordanie et en Égypte.
Une proposition qui intervient une semaine après l'entrée en vigueur, le 19 janvier, d'un accord de cessez-le-feu dans la Bande de Gaza, suspendant la guerre génocidaire qu'Israël mène depuis le 7 octobre 2023 et qui a tué plus de 47 300 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d'enfants, et en a blessé plus de 111 400 autres."
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Trump lève la suspension de l’envoi de bombes de 2 000 livres à Israël et supprime les sanctions à l’encontre des colons

Ces derniers jours, le président Trump a annulé certaines des petites restrictions que l'administration Biden avait imposées à Israël, s'attirant les louanges de l'extrême droite israélienne.
Tiré de agencemédiaspalestine
27 janvier 2025
Par Michael Arria
Netanyahu et Trump se rencontrent à la Maison Blanche le 27 janvier 2020, un jour avant la publication de « l'accord du siècle ». Photo officielle de la Maison Blanche par Shealah Craighead
Ces derniers jours, le président Trump a fait sauter certaines des petites restrictions que l'administration Biden avait imposées à Israël.
L'un des premiers décrets de Trump a été de lever les sanctions imposées à 30 groupes de colons israéliens. « Nous avons insisté à plusieurs reprises auprès de nos homologues israéliens sur le fait qu'Israël devait faire davantage pour mettre fin à la violence contre les civils en Cisjordanie et demander des comptes à ceux qui en sont responsables », a déclaré Matthew Miller, ancien porte-parole du département d'État, aux journalistes après que Biden eut annoncé une nouvelle série de sanctions à l'encontre des colons en novembre dernier. » Mais, comme nous l'avons également précisé, en l'absence de telles actions de la part du gouvernement israélien, nous continuerons à prendre nos propres mesures pour que les responsables de l'extrémisme violent répondent de leurs actes ».
Ces mesures n'ont en rien dissuadé les colons de s'en prendre aux Palestiniens. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) a indiqué que l'année 2024 avait été marquée par le nombre le plus élevé de violences commises par des colons depuis près de vingt ans, c'est-à-dire depuis que l'organisation a commencé à documenter de tels cas. Selon l'OCHA, 4 250 Palestiniens ont été déplacés et 1 760 structures ont été détruites lors de quelque 1 400 attaques de colons israéliens en Cisjordanie.
Une heure avant que M. Trump n'annule les mesures prises par M. Biden, des dizaines de colons masqués ont attaqué des maisons et des commerces dans les villages palestiniens de Jinsafut et d'Al-Funduq. Le Croissant-Rouge palestinien a déclaréavoir soigné 12 personnes qui avaient été rouées de coups par les colons.
Bien que les sanctions n'aient pas eu d'impact perceptible, leur levée a été célébrée par les membres d'extrême droite du gouvernement israélien. Le ministre israélien des finances, Bezalel Smotrich, a qualifié les sanctions d'« intervention étrangère grave et flagrante » et a salué le « soutien inébranlable et intransigeant de M. Trump à l'État d'Israël ».
Itamar Ben-Gvir, qui était ministre israélien de la sécurité nationale avant de démissionner à la suite du récent cessez-le-feu, a déclaré qu'il saluait la « décision historique du nouveau président américain Donald Trump de lever les sanctions imposées par l'administration Biden aux colons de Judée et de Samarie ».
Quelques jours après l'abrogation des sanctions contre les colons, Axios a rapportéque M. Trump allait lever l'interdiction imposée par M. Biden sur les bombes de 2 000 livres destinées à Israël. L'administration Biden avait instauré cette pause en réponse à l'invasion de Rafah par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu en mai dernier.
L'équipe Biden a continué à envoyer d'autres armes à Israël et aurait même fait pression sur les membres démocrates du Congrès pour qu'ils soutiennent un important contrat d'armement, mais cela n'a pas empêché M. Netanyahu d'affirmer que les États-Unis entravaient sa guerre contre Gaza.
« Nous ne savons généralement pas de quoi il parle, nous ne le savons tout simplement pas », a déclaré à l ‘époque la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, aux journalistes. » Il n'y a pas d'autres pauses, aucune, aucune autre pause ou suspension en place ».
« Beaucoup de choses qui ont été commandées et payées par Israël, mais qui n'ont pas été envoyées par Biden, sont maintenant en route ! », a écrit Trump sur Truth Social.
M. Trump a également suscité des inquiétudes en semblant approuver un plan de nettoyage ethnique de la bande de Gaza.
« J'aimerais que l'Égypte prenne des gens, et j'aimerais que la Jordanie prenne des gens. Je pourrais – je veux dire, on parle probablement d'un million et demi de personnes« , a-t-il déclaré à des journalistes au cours du week-end. » Et on pourrait faire nettoyer tout ça. C'est – vous savez, c'est – au cours des siècles, c'est – c'est beaucoup, beaucoup de conflits, ce terrain. Et je ne sais pas. Il faut que quelque chose se passe. Mais c'est littéralement un chantier de démolition en ce moment. Presque tout a été démoli ».
Ses commentaires ont été rapidement condamnés par les groupes de défense des droits de l'homme et les législateurs.
« Nettoyer Gaza immédiatement après la guerre serait en fait une continuation de la guerre, par le biais du nettoyage ethnique du peuple palestinien », a déclaré Hassan Jabareen, directeur d'Adalah.
Trump a dit qu'il voulait « nettoyer » Gaza et pousser les millions de Palestiniens qui y vivent vers les pays voisins », a tweeté le sénateur du Vermont Bernie Sanders. « Il y a un nom pour cela – le nettoyage ethnique – et c'est un crime de guerre. Cette idée scandaleuse devrait être condamnée par tous les Américains ».
Lors d'une récente interview, l'envoyé spécial pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, a indiqué qu'il accueillerait favorablement un « dialogue » avec le Hamas et a fait l'éloge du gouvernement qatari pour avoir contribué à faciliter le cessez-le-feu.
« Je pense qu'il est possible de rallier tout le monde dans cette région. Je le pense vraiment. Avec un nouveau sens du leadership dans cette région », a-t-il déclaré.
Un récent rapport du Jewish Insider pro-israélien déplore le fait que Dan Caldwell, vétéran de la guerre d'Irak, semble jouer un rôle clé au Pentagone. M. Caldwell a déjà critiqué les relations entre les États-Unis et Israël par le passé.
« En fin de compte, comme dans le cas de l'Ukraine, nous n'avons plus rien à leur donner », a déclaré M. Caldwell lors d' un podcast l'année dernière. » Nous pourrions nous retrouver dans la même situation avec Israël, et nous ne pourrons pas y remédier immédiatement en injectant davantage d'argent dans le complexe militaro-industriel ».
Traduction : JB pour l'Agence Média Palestine
Source : Mondoweiss
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le bilan s’alourdit à Gaza alors que le cessez-le-feu permet aux secouristes de fouiller les décombres

Israël a largué environ 100 000 tonnes d'explosifs sur Gaza et a détruit 88 % de ses infrastructures, selon les données du gouvernement.
Tiré d'Agence médias Palestine.
Alors que les habitants de Gaza fouillent ce qui reste de leurs maisons et de leurs terres à la suite du cessez-le-feu entré en vigueur dimanche, les victimes de la campagne de bombardements intensifs menée par Israël depuis le 7 octobre 2023 sont exhumées des décombres.
Selon les derniers chiffres du ministère palestinien de la santé, le bilan de la guerre de 15 mois à Gaza s'élève à 47 107 morts et 111 147 blessés, alors que l'évaluation de l'ampleur des destructions se poursuit.
Depuis le cessez-le-feu, plus de 248 personnes se sont ajoutées au bilan, dont 183 corps retrouvés sous les décombres.
Le ministère a noté mercredi que 54 corps ont été transportés vers les hôpitaux au cours des dernières 24 heures, 53 d'entre eux ayant été récupérés dans des bâtiments détruits, ainsi que 19 blessés.
Dans le même temps, les équipes de la défense civile de l'enclave ont annoncé qu'en fouillant les décombres, elles avaient récupéré plus de 66 corps mardi et 62 autres lundi.
« Nous attendons les tâches difficiles et ardues que représente la recherche des corps de plus de 10 000 martyrs, qui se trouvent encore sous les décombres des maisons, des bâtiments et des installations détruits, et qui ne sont pas enregistrés dans les statistiques des martyrs », ont-ils déclaré dans un communiqué de presse dimanche.
Les forces de défense civile elles-mêmes ont subi d'énormes pertes, avec environ 48 % de leur personnel tué, blessé ou emprisonné.
Après plus de 15 mois de guerre, les Palestiniens découvrent les destructions massives infligées par Israël à l'enclave. Les statistiques les plus récentes du bureau des médias du gouvernement, publiées mardi, estiment à 100 000 tonnes les bombes larguées sur Gaza.
La campagne de bombardements a détruit 88 % des infrastructures et des zones résidentielles de la bande de Gaza, notamment les habitations, les réseaux d'égouts, les réseaux électriques et les canalisations d'eau.
Violations de l'accord de trêve
Les forces israéliennes ont violé les dispositions de l'accord de cessez-le-feu à plusieurs reprises depuis son entrée en vigueur dimanche matin.
Selon l'agence de presse palestinienne Wafa, l'armée israélienne a mené plusieurs attaques dans la bande de Gaza, tirant des balles réelles et visant directement les civils.
Des rapports ont également fait état de pièges placés dans des maisons et d'autres infrastructures quelques heures avant le début de la trêve, dont un dans une maison du nord de la bande de Gaza qui a fait plusieurs blessés.
Les correspondants de Wafa ont confirmé dimanche que 10 Palestiniens ont été admis à l'hôpital al-Ahli dans la ville de Gaza après avoir été blessés par des munitions non explosées laissées par les forces israéliennes près du camp de réfugiés de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza.
L'armée israélienne a complètement détruit 161 600 unités d'habitation, rendu 81 000 maisons inhabitables et partiellement détruit 194 000 autres, selon les dernières évaluations du bureau du gouvernement.
Quelque 216 sièges gouvernementaux et 42 installations sportives ont également été endommagés au cours des 15 mois de bombardements israéliens.
Le secteur de l'éducation a été sévèrement touché, avec 137 écoles et universités complètement détruites et 357 partiellement démolies.
Les infrastructures religieuses de l'enclave ont également été visées, avec trois églises et plus de 832 mosquées détruites. En outre, 206 sites archéologiques et patrimoniaux ont été détruits au cours de la campagne de bombardement israélienne.
Les réseaux d'eau de Gaza ont également été largement endommagés, avec environ 330 000 mètres d'infrastructures laissées en ruine.
Traduction : JB pour l'Agence Média Palestine
Source : Middle East Eye
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Ce que l’interdiction de l’UNRWA par Israël signifie pour des millions de Palestiniens : en chiffres

Israël ordonne à l'Office de secours et de travaux des Nations unies, pilier de l'aide humanitaire palestinienne, de cesser ses activités d'ici jeudi.
Tiré d'Agence médias Palestine.
Plusieurs pays ont déclaré au Conseil de sécurité des Nations unies qu'ils « déploraient profondément » la décision du parlement israélien d'« abolir » les opérations de l'agence d'aide des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est, qui doit prendre effet jeudi.
Dans une déclaration commune, la Belgique, l'Irlande, le Luxembourg, Malte, la Norvège, la Slovénie et l'Espagne ont condamné le retrait d'Israël de l'accord de 1967 conclu entre Israël et l'UNRWA, ainsi que tous les efforts visant à entraver la capacité de l'agence à fonctionner et à remplir le mandat qui lui a été confié par l'Assemblée générale des Nations unies.
Philippe Lazzarini, commissaire général de l'UNRWA, a déclaré mardi au Conseil de sécurité que l'interdiction « aggraverait l'instabilité et le désespoir dans le territoire palestinien occupé dans une période critique ».
La Knesset approuve des textes de loi visant à interrompre l'aide de l'UNRWA
En octobre, le parlement israélien, la Knesset, a adopté deux projets de loi visant les opérations de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).
Le premier texte interdit à l'UNRWA de mener des activités à l'intérieur des frontières israéliennes, tandis que le second rend illégal tout contact entre les fonctionnaires israéliens et l'UNRWA. La législation devrait entrer en vigueur jeudi.
Juliette Touma, porte-parole de l'UNRWA, a fait part de ses inquiétudes quant aux conséquences potentielles de l'interdiction, déclarant à Al Jazeera : « Si l'interdiction a lieu et que nous ne sommes pas en mesure d'opérer à Gaza, le cessez-le-feu, qui comprend également l'acheminement de fournitures humanitaires pour l'agence et les personnes dans le besoin, pourrait s'effondrer ».
La première phase du cessez-le-feu, qui a débuté le 19 janvier, prévoit un afflux d'aide dans l'enclave pouvant aller jusqu'à 600 camions par jour.
L'interdiction d'Israël empêcherait l'Office d'obtenir des permis d'entrée pour opérer en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, toutes deux sous contrôle israélien, ce qui l'empêcherait de remplir son mandat.
Qu'est-ce que l'UNRWA et où opère-t-il ?
L'UNRWA a été créé par l'Assemblée générale en 1949 pour fournir une assistance humanitaire aux 750 000 réfugiés palestiniens qui ont été déracinés de leurs terres lors de la création d'Israël en 1948, un événement connu par les Palestiniens sous le nom de Nakba, ou « catastrophe ».
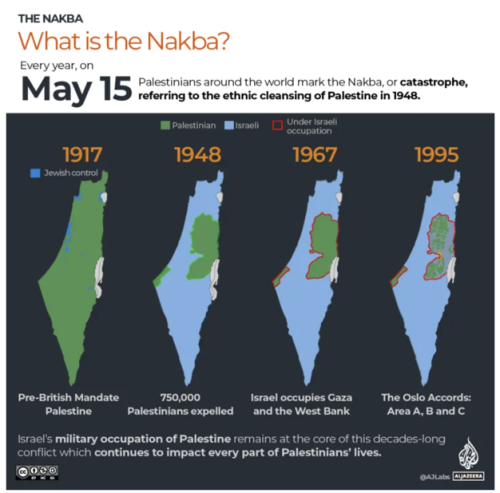
L'organisation, qui emploie 30 000 personnes, principalement des réfugiés palestiniens, ainsi qu'un petit nombre d'employés internationaux, fournit une aide d'urgence, une éducation, des soins de santé et des services sociaux à au moins 5,9 millions de Palestiniens en Palestine et dans les pays voisins.
L'UNRWA gère 58 camps de réfugiés :
– Cisjordanie : 19 camps abritant 912 879 réfugiés enregistrés
– Gaza : huit camps abritant 1,6 million de personnes
– Jordanie : 10 camps abritant 2,39 millions de personnes
– Liban : 12 camps, abritant 489 292 personnes
– Syrie : neuf camps abritant 438 000 personnes
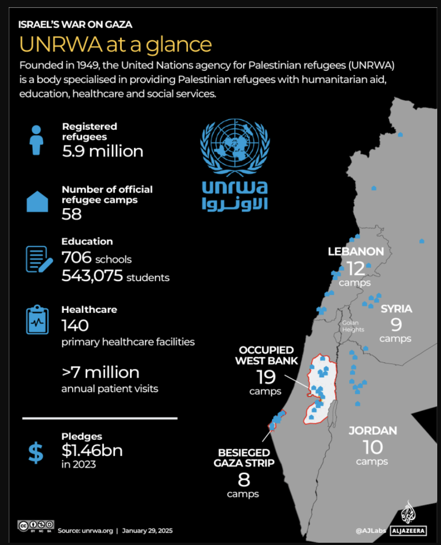
Le rôle de l'UNRWA à Gaza et en Cisjordanie
Depuis des générations, l'UNRWA est le principal fournisseur de services de santé et d'éducation à des millions de Palestiniens vivant sous l'occupation israélienne à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est occupée.
Selon M. Lazzarini, « l'interdiction paralyserait la réponse humanitaire à Gaza et priverait des millions de réfugiés palestiniens de services essentiels en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est. Elle éliminerait également un témoin éloquent des innombrables horreurs et injustices que les Palestiniens endurent depuis des décennies ».
En Palestine, l'UNRWA offre un enseignement primaire et secondaire gratuit à plus de 300 000 enfants, dont 294 086 enfants à Gaza :
– 294 086 enfants à Gaza, soit la moitié des élèves de l'enclave
– 46 022 enfants en Cisjordanie
L'UNRWA offre également des soins de santé primaires gratuits, ainsi que des services de santé maternelle et infantile :
– 1,2 million de personnes à Gaza, soit plus de la moitié de la population
– 894 951 personnes en Cisjordanie
L'UNRWA fournit également de la nourriture à :
– 1,13 million de personnes à Gaza, soit la moitié de la population
– 23 903 personnes en Cisjordanie

L'UNRWA joue également un rôle essentiel en offrant des possibilités d'emploi, des programmes de microfinancement et un soutien aux initiatives lucratives.
L'épine dorsale des opérations humanitaires à Gaza
Parmi les régions placées sous le mandat de l'UNRWA, la bande de Gaza, qui compte 2,3 millions d'habitants, est celle dont la survie dépend le plus des services de l'agence.
Alors que d'autres organisations des Nations unies, telles que l'UNICEF, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, le Programme alimentaire mondial et l'Organisation mondiale de la santé, fournissent toutes des services vitaux, l'UNRWA est « l'épine dorsale des opérations humanitaires » à Gaza, a déclaré Touma à Al Jazeera.
« Toutes les agences des Nations unies dépendent fortement de l'UNRWA pour leurs opérations humanitaires, notamment pour l'acheminement des fournitures et du carburant. Nous sommes la plus grande agence humanitaire à Gaza », a-t-elle déclaré à Al Jazeera.
En janvier 2024, les autorités israéliennes ont accusé les employés de l'UNRWA d'avoir participé aux attaques du 7 octobre 2023 menées par le Hamas contre le sud d'Israël. Cela a conduit plusieurs pays à réduire le financement de l'organisation.
Toutefois, après une enquête de l'ONU et le licenciement de neuf membres du personnel, tous les donateurs, à l'exception des États-Unis et de la Suède, ont repris leur financement.
Depuis qu'Israël a commencé son génocide contre les Palestiniens de Gaza, son armée a tué au moins 47 354 personnes et en a blessé au moins 111 563 autres. Ceux qui ont survécu au conflit ont presque tout perdu.
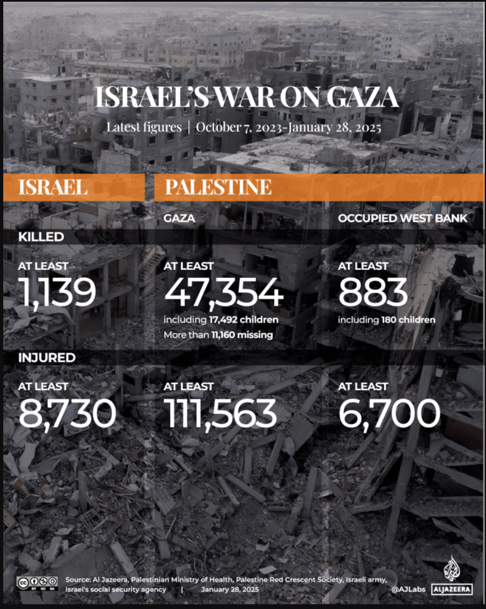
Pendant les 15 mois de guerre, l'UNRWA a fourni :
– Assistance alimentaire : a fourni de la nourriture à 1,9 million de personnes en situation de famine extrême.
– Soins de santé : consultations de soins de santé primaires pour 1,6 million de personnes
– Soutien à la santé mentale : a fourni un soutien à la santé mentale et un soutien psychosocial à 730 000 personnes.
– Eau : accès à l'eau potable pour 600 000 personnes
– Gestion des déchets : collecte de plus de 10 000 tonnes de déchets solides dans les camps.
Selon un rapport de situation de l'UNRWA, 272 membres de l'équipe de l'UNRWA ont été tués dans 665 attaques israéliennes et 205 installations de l'UNRWA ont été endommagées.

Que se passera-t-il une fois l'interdiction entrée en vigueur ?
Malgré l'interdiction d'Israël et l'environnement de travail déjà hostile, Lazzarini a réaffirmé l'engagement de l'UNRWA à « rester et à tenir ses promesses ».
La première loi adoptée par la Knesset interdit toute présence ou activité de l'UNRWA en Israël, ce qui affecte directement des centaines de milliers de Palestiniens dans la partie occupée de Jérusalem-Est, annexée par Israël en 1980 en violation du droit international.
« Il y a ensuite une deuxième loi qui interdit tout contact entre les fonctionnaires israéliens et les fonctionnaires de l'UNRWA. La loi ne dit pas qu'il faut arrêter les activités en Cisjordanie ou à Gaza, mais qu'il faut empêcher tout contact – mais le fait est que si vous n'avez pas de relations bureaucratiques ou administratives, cela rend votre environnement opérationnel encore plus difficile », a déclaré M. Lazzarini.
L'interdiction restreindra également les déplacements du personnel non palestinien de l'UNRWA, mais les employés palestiniens seront toujours autorisés à effectuer leur travail.
« L'agence reste déterminée à faire tout ce qui est en son pouvoir pour remplir son mandat et fournir des services essentiels pour soulager la détresse des réfugiés palestiniens », a souligné M. Lazzarini.
Les principaux donateurs de l'UNRWA
En 2023, l'UNRWA a reçu un total de 1,46 milliard de dollars de promesses de dons, les contributions les plus importantes provenant des États-Unis (422 millions de dollars), de l'Allemagne (212,9 millions de dollars) et de l'Union européenne (120,2 millions de dollars).
Besoins de financement pour 2025
L'UNRWA déclare avoir besoin de 1,7 milliard de dollars pour répondre aux besoins humanitaires les plus critiques de 1,9 million de personnes à Gaza et de 275 000 personnes en Cisjordanie et à Jérusalem-Est.
Ces besoins sont les suivants :
– La nourriture (568,5 millions de dollars) : Près de la moitié de la population de Gaza dépend de l'aide alimentaire de l'UNRWA. Ce financement soutiendra la distribution de nourriture à 1,13 million de personnes à Gaza et à plus de 23 000 personnes en Cisjordanie.
– Eau et assainissement (282,6 millions de dollars) : Cet argent servira à garantir l'accès à l'eau potable et à des installations sanitaires adéquates, en particulier à Gaza, où la guerre d'Israël a décimé les infrastructures d'approvisionnement en eau.
– Coordination et gestion (202,3 millions de dollars) : Des fonds sont également nécessaires pour financer le personnel, la logistique et la coordination afin d'acheminer l'aide de manière efficace.
Le financement est essentiel pour soutenir les opérations de sauvetage de l'UNRWA. Sans lui, des services essentiels comme l'aide alimentaire, les soins de santé et l'accès à l'eau pourraient s'effondrer, ce qui aggraverait la crise humanitaire.
Traduction : JB pour l'Agence Média Palestine
Source : Al Jazeera
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Découvrir le zine : Une immersion dans la réalité congolaise avec Ange Made

Le temps qui passe finira bien par passer…

Manifestement, Donald Trump est un ethnocentrique autoritaire qui valorise l'être soi. Il est ultra méfiant à l'endroit des autres. Il est même porteur de la crispation anti-immigré. Il a en plus le réflexe répressif bien avant celui de la compassion ou de la fine compréhension des choses complexes. Il est injuste et provoque le désordre en se revendiquant comme l'incarnation de l'eunomie. Dans le jeu de la négociation, il veut s'imposer à ses vis-à-vis par la peur. Il se dit invincible. Il a trois règles : toujours attaquer (always attack) ; ne rien avouer (never admit wrong doing) et toujours revendiquer la victoire (always claim victory). Son type de leadership est fragile. Tôt ou tard, certainEs de ses supporteurEs réaliseront que sa grâce charismatique s'effrite et s'éloigne de lui. Sa puissance magique cessera de lui donner des victoires, victoires toujours illusoires. Sur la base de ces succès refusés et n'apportant plus de prospérité chez celles et ceux qu'il dirige et domine, son lustre charismatique faiblira jusqu'à s'éteindre…
Yvan Perrier
2 février 2025
19h30
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
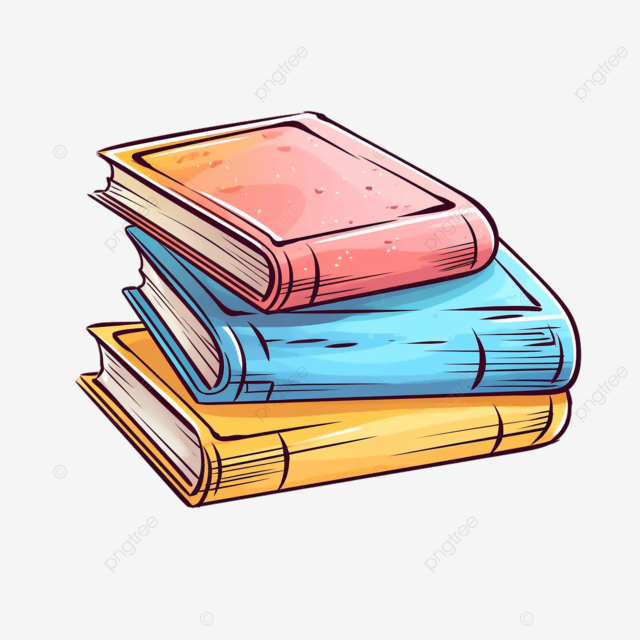
Comptes rendus de lecture du mardi 4 février 2025
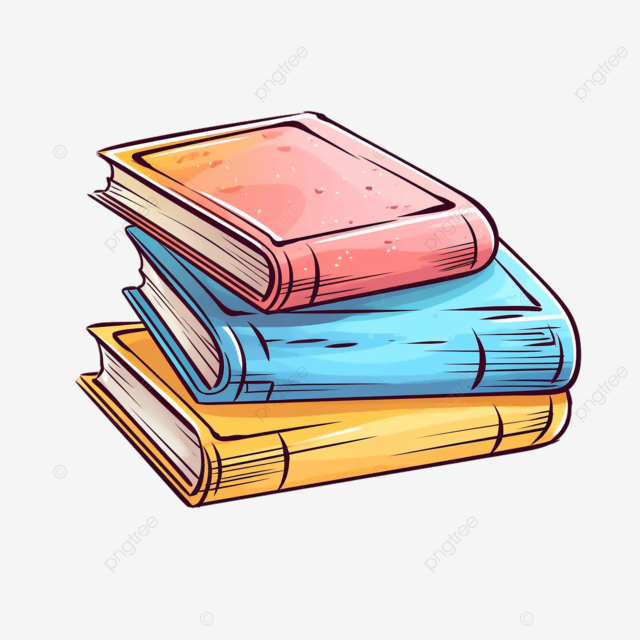

L'économie participaliste
Pascal Lebrun
Aussi connue sous le nom d'écopar, l'économie participaliste est une solution économique développée aux États-Unis par Michael Albert et Robin Hahnel en vue de remplacer le capitalisme ; elle s'appuie sur la vraie démocratie, la coopération, l'égalité et la justice et est, on le devine, beaucoup plus respectueuse de l'environnement et du véritable progrès. Pascal Lebrun, dans cet essai, en fait une critique très poussée, en y abordant tous les aspects, surtout ceux restés dans l'ombre, avec ceux qui se sont penchés sur la question au cours des vingt dernières années. Si, à mon avis, l'économie participaliste constitue une solution théorique fort valable au capitalisme, ce n'est cependant qu'à travers la démocratie, la vraie — la démocratie directe —, que doit s'élaborer et se construire une vraie solution au capitalisme. « L'économie participaliste » de Pascal Lebrun demeure un superbe essai que l'on devrait lire...
Extrait :
Personne ne s'oppose à la vertu ; l'équité est une valeur fondamentale de toutes les pensées économiques. Encore faut-il s'entendre sur sa définition. Comment répartir le travail et la richesse équitablement ? Ce dont on parle ici, c'est de la division du travail et de la rémunération, comprise comme le droit à la consommation des biens et services produits dans la société. En ce sens, la rémunération est le moyen de répartition de la richesse, et n'est pas seulement un salaire.
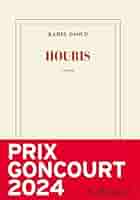
Houris
Kamel Daoud
Il était évident que ce roman allait se mériter le prix Goncourt. Il nous rappelle cette terrible et barbare guerre civile algérienne des années 1990, avec ses plus de 200 000 morts, guerre que le gouvernement algérien s'emploie depuis 2005 à effacer de l'histoire. Il nous fait découvrir également, si besoin est, l'impitoyable misogynie des islamistes. Aube est une jeune Algérienne muette de vingt-huit ans. Sous forme de journal à Houris, sa fille à naître, elle nous raconte sa vie dans l'Algérie d'aujourd'hui et surtout comment à l'âge de cinq ans, le 31 décembre 1999, elle a été égorgée et laissée pour morte par des islamistes qui massacraient cette nuit-là plus de mille personnes de son village Had Chekala, dont son père, sa mère et sa sœur à peine plus âgée qu'elle. Un roman dérangeant pour certains, mais certainement bouleversant pour la plupart !
Extrait :
Chaque fois qu'un danger me guette ou qu'un événement me bouleverse, c'est comme si le jour du massacre des miens se rejouait. Comme si l'instant où je fus égorgée par un terroriste devait se répéter. Tout est lié à ce jour fatidique et ce jour est lié au vide. Je le fixe mal dans ma mémoire, j'en ai fait des tatouages sur ma peau pour qu'il ne se perde pas dans la brume.
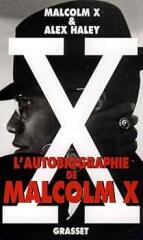
L'autobiographie de Malcolm X
Malcolm X et Alex Haley
Traduit de l'anglais
Il y a longtemps que je voulais lire cette autobiographie de Malcolm X, cette importante figure de la lutte de libération des Noirs américains dans les années 1960. J'ai beaucoup aimé et j'y ai appris beaucoup sur le personnage et la société américaine d'alors, société, comme on le sait, profondément raciste. Malcolm X – avec l'aide du journaliste et écrivain Alex Haley - nous y décrit sa jeunesse, ses années de délinquance dans Harlem, son séjour en prison, ses années au sein de la Nation de l'Islam, ses voyages, ses conférences... Un livre à lire !
Extrait :
Je sais que mes mots doivent choquer pas mal d'entre-vous. Mais durant mon pèlerinage, ce que j'ai pu voir et vivre m'a amené à réviser mon mode de pensée et à me débarrasser de certaines convictions qui étaient les mêmes depuis fort longtemps. Cela ne m'a pas été vraiment difficile. Je suis un homme qui a toujours fait face aux faits, au point d'en accepter la réalité. J'ai toujours eu un esprit ouvert qui m'a permis d'enrichir mes connaissances et mes expériences de vie. La recherche de la vérité nécessite que l'on fasse preuve d'intelligence et de flexibilité.
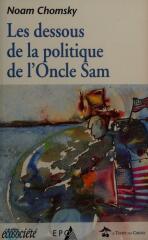
Les dessous de la politique de l'Oncle Sam
Noam Chomsky
Traduit de l'anglais
Je crois bien que « Les dessous de la politique de l'Oncle Sam » aura été le bouquin qui aura le plus fait connaître Chomsky aux lecteurs francophones. C'est du moins ce petit bouquin vraiment très intéressant qui me l'aura fait connaître. Je l'ai relu avec beaucoup de plaisir il y a peu de temps. Chomsky nous dévoile avec rigueur et mordant ce que nous savons probablement tous, mais que nous nous refusons d'aborder ou d'admettre...
Extrait :
Des études plus étendues réalisées par l'économiste Edward S. Herman révèlent qu'il existe une corrélation étroite, à l'échelle mondiale, entre la torture et l'aide américaine, et elles en fournissent l'explication : les deux sont liées de façon indépendante à l'amélioration du climat nécessaire au bon déroulement des opérations commerciales. Comparés à ce principe moral de premier plan, des sujets comme la torture et les tueries se diluent dans l'insignifiance.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
La pensée libérale et l’idéologie de l’esclavage racial
Ukraine : état de la guerre d’usure et cygnes noirs
Des fermetures d’Amazon au Québec et des campagnes syndicales en C-B
Imaginer un avenir désirable pour la MRC
L’Ontario se rend aux urnes en février
Manifestation du 26 janvier un succès pour la Coalition du Québec URGENCE Palestine
Célébration du Mois de l’Histoire des Noir.es 2025

Paul St-Pierre Plamondon veut être un bon voisin pour Donald Trump

Les déclarations du chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon (PSPP), face à l'intention du gouvernement Trump d'imposer une hausse des tarifs et d'exiger un durcissement de la frontière canadienne constituent un positionnement politique dangereux. Il vaut la peine d'expliciter les fondements des choix politiques derrière ces déclarations pour comprendre l'importance de la dérive actuelle du nationalisme péquiste et ses conséquences pour l'avenir du Québec.
1. Les déclarations de PSPP et leurs fondements
Ruba Ghazal, dans une lettre aux membres de Québec solidaire du 28 janvier 2025, a écrit : « D'après M. St-Pierre Plamondon, nous aurions été de « mauvais voisins » pour les États-Unis, alors que ce même pays nous menace quotidiennement et veut envoyer l'armée à ses frontières. Qui sont réellement les mauvais voisins de l'histoire ? »
Non seulement PSPP donne raison à Trump sur sa gestion des frontières, mais il propose même que le gouvernement du Québec renforce de son propre chef la sécurité à la frontière. Il propose ainsi la création d'une « escouade spéciale » aux « endroits les plus à risque », notamment sur le territoire de la communauté d'Akwasasne ». Ces propositions se situent dans le droit fil de la politique du gouvernement Legault qui « vient d'annoncer le plan « Pélican » qui permettrait de coordonner la réponse policière face à un flux migratoire soudain, dans le contexte où la nouvelle administration américaine promet une expulsion massive de migrants. » ? C'est la logique des murs matériels ou policiers pour protéger la forteresse assiégée que seraient devenus les pays capitalistes avancés.
Cette prise de position est la conséquence directe de la rhétorique de PSPP sur l'immigration. Depuis plusieurs mois, il fait des personnes migrantes les responsables de tous les maux de la société québécoise : la crise du logement, l'itinérance, le manque d'accès aux services de santé, le recul de la langue française,… Les personnes migrantes seraient même responsables de la faible automatisation des entreprises québécoises !
La politique migratoire que Paul Saint-Pierre Plamondon a publiée en octobre dernier et qu'il veut faire adopter par le PQ, sous le titre Un Québec libre de ses choix, pour un modèle viable en immigration, se donne comme objectifs de réduire l'immigration économique pendant quatre ans, de réduire de moitié le nombre de travailleuses et de travailleurs étrangers temporaires, de diminuer à 35 000 le seuil d'immigrant-es accueilli-es de façon permanente chaque année, de rendre plus difficile l'accès aux demandes d'asile, de renforcer les obligations faites aux personnes migrantes et de multiplier les blocages possibles à la liberté de circulation. Le contrôle aux frontières découle logiquement de cette orientation. Ce que refuse de voir le chef du PQ, c'est que les personnes migrantes, si elles apportent beaucoup par leur travail à la société québécoise, se retrouvent souvent dans des situations de surexploitation alors que la précarité de leur situation ne fait que s'accentuer étant donné : les permis de travail fermés les liant à un seul employeur qui ont augmenté de 354% par rapport à 2015, la multiplication des obstacles qui les séparent de la résidence permanente et leur accès différencié aux droits sociaux en fonction de leur statut migratoire. Les gouvernements du Canada et du Québec vont encore renforcer cette précarité migratoire aiguillonnée par les pressions de l'administration Trump.
2. Le refus de dénoncer Trump et sa politique d'expulsion massive
Ce que PSPP refuse de dénoncer, c'est la répression migratoire et la campagne d'expulsion de millions de travailleurs et travailleuses sans papiers, justifiés par une démagogie raciste présentant ces personnes comme étant des criminelles. Il refuse de reconnaître que cette politique d'expulsion va entraîner des incarcérations de masse dont se réjouissent déjà les propriétaires de centres de détentions privés. Trump, la répression anti-migratoire et les profits de la peur,
Comme l'écrit Alberto Toscano : « La principale fonction de l'expulsion dans les économies capitalistes qui dépendent de la main-d'œuvre immigrée et sans papiers n'est pas d'expulser les travailleurs, mais de les subordonner, en rendant leur main-d'œuvre bon marché et contrôlable du fait qu'ils sont expulsables. (ibid)
Voilà ce que laisse dans l'ombre les aspirations de PSPP à devenir un bon voisin du gouvernement de Trump. Dans une publication sur X, PSPP va jusqu'à écrire : « Nous demandons au gouvernement fédéral de travailler avec l'administration Trump pour régler les enjeux aux frontières et nous permettre d'avancer. Entre s'engager dans une guerre commerciale avec les États-Unis et reprendre le contrôle des frontières, il n'y a aucune commune mesure entre le coût des deux. » Cette demande au gouvernement fédéral de collaborer avec le gouvernement d'extrême droite de Trump montre où en est la dérive du PQ dans l'expression du nationalisme le plus chauvin et dans sa stigmatisation des personnes migrantes.
3. Trump et l'indépendance du Québec
En ce qui concerne la souveraineté, PSPP dit garder le cap. Sur la souveraineté, sa position demeure la même, a-t-il affirmé. Son travail ne serait pas influencé par la nouvelle administration américaine. Il promet de tenir un référendum sur la souveraineté du Québec dans un premier mandat.
Pourtant, le chef du PQ devrait analyser les rapports que le président Trump entretient avec la souveraineté des pays. Il a annoncé sa volonté de faire du Canada un 51e état des États-Unis. Il a affirmé qu'il prendrait possession du Groenland. Il a affirmé qu'il reprendrait le contrôle du canal de Panama. Le droit international et la souveraineté nationale ne semblent pas peser lourd dans la politique du gouvernement américain. Quelle attitude prendrait-il face à une éventuelle indépendance du Québec ? La question mérite d'être posée. Accepterait-il une fragmentation de la géopolitique de l'Amérique du Nord ? À plus court terme, va-t-il, comme pour le Canada, chercher la vassalisation du Québec et imposer une politique en faveur des énergies fossiles, une remise en question de la gestion de l'offre en agriculture, et donner le champ libre à la domination culturelle sur le territoire du Québec en refusant toute réglementation ou imposition des GAFAM ? Poser les questions, c'est savoir fixer les yeux et l'analyse sur le réel, pour pouvoir comprendre ce qui vient et tracer les voies de la résistance à cette vassalisation.
4. L'indépendance du Québec ne pourra qu'être anti-impérialiste
Le gouvernement canadien, fidèle allié des États-Unis, est déjà invité à augmenter ses dépenses militaires. Comme État pétrolier, il est appelé à soutenir l'économie du capital fossile américain. Le gouvernement Trump lui demandera également de continuer, sinon d'augmenter, la vente du pétrole brut aux raffineries américaines. Trump remet en question, plus agressivement encore que les administrations américaines précédentes, la souveraineté du Canada sur son territoire arctique.
Ce projet stratégique de l'impérialisme américain ne rencontre pas l'opposition conséquente de son associé junior canadien. Dans ce contexte l'indépendance du Québec ne pourra être qu'anti-impérialiste. Elle passera :
• par le refus d'une économie fossile, par le refus du passage de pipelines ou de gazoducs sur son territoire et par le développement public des énergies renouvelables
• par la défense d'une approche de décroissance centrée sur l'économie des ressources minières forestières et énergétiques qui devront devenir des biens communs de la population du Québec et non d'entreprises multinationales
• par une industrie tournée vers la production de moyens de transports publics visant la sortie du tout à l'auto solo et par la production publique de logements sociaux
• par le refus de la privatisation de services publics de santé et d'éducation
• par une agriculture visant la souveraineté alimentaire et tournée vers les marchés de proximité
• par une politique de liberté de circulation et d'installation des personnes migrantes faisant du Québec une terre d'accueil accordant les mêmes droits à toutes les personnes vivant et travaillant sur le territoire du Québec dans une perspective d'égalité
• par le rejet de la participation aux alliances militaires américaines (OTAN et NORAD)
Un tel projet de société fait de l'indépendance un combat anti-impérialiste et internationaliste. Il ne pourra se réaliser que par la construction de vastes alliances avec les forces sociales – qui s'opposent au Canada au projet de sa vassalisation, particulièrement le mouvement syndical, les mouvements féministes, populaires et les Premières Nations, qui aspirent à leur libération de la sujétion coloniale imposée par l'État fédéral.
Il ne pourra se construire que par des alliances avec les forces sociales des minorités nationales opprimées aux États-Unis (particulièrement les Afro-américains et les Hispaniques soumis au racisme systémique et qui constituent une part importante de la classe laborieuse de ce pays qui sont aujourd'hui sous une offensive en règle du gouvernement d'extrême droite au pouvoir aux États-Unis. Dans la société américaine, des secteurs importants du mouvement ouvrier et de différents mouvements sociaux refusent le type de société que fonde le capitalisme sauvage au service d'oligarques et d'un impérialisme sans entrave mis de l'avant par le Trumpisme au pouvoir.
Cette recherche d'alliance devra également se diriger vers les partis de la gauche mondiale et des gouvernements progressistes du monde qui refusent les politiques de prédation de l'impérialisme américain, refus qui exprime la volonté des peuples d'en finir avec cette domination. D'autant plus que la bourgeoisie mondiale tend à se ranger derrière Trump. "Ce qui s'est joué lors de ce sommet de Davos, c'est le soutien de ces élites mondiales, jusqu'alors adeptes de la mondialisation heureuse, à la contre-révolution illibérale lancée par Donald Trump. Toutes souscrivent à ce capitalisme de prédation et à la violence sociale et politique qu'il implique."
5. Vouloir s'entendre avec le gouvernement fasciste de Trump – conduira non à l'indépendance, mais à la vassalisation du Québec
Le PQ de PSPP cherche à dépouiller complètement les aspirations nationales à l'indépendance de leur dimension populaire, égalitaire et anti-impérialiste. C'est ainsi que l'indépendantisme (ratatiné sous la forme de la souveraineté-association) a pu pervertir complètement une aspiration démocratique à la libération nationale en son contraire. Le soutien au libre-échange, le soutien aux politiques américaines dans le monde, la volonté de faire du gouvernement américain un allié ou du moins un acteur neutre dans la lutte contre la domination de l'État fédéral sur le Québec. Cette orientation a tari les fondements de l'indignation sociale pouvant être véhiculée par la volonté d‘indépendance nationale, a participé à l'affaiblissement du soutien à l'indépendance et a finalement débouché sur un repli identitariste de la question nationale dont la rhétorique de PSPP est une expression aboutie.
Il est plus urgent que jamais, de reconnaître que le projet d'indépendance inspiré par la majorité populaire n'est pas celui des élites nationalistes, mais constitue un projet anti-impérialiste qui participe de la volonté de libération nationale et d'égalité sociale.

Habiter et cohabiter

Retour à la table des matières Droits et libertés, automne 2024 / hiver 2025
Habiter et cohabiter
Michel Parazelli, Professeur associé, École de travail social, UQAM
La crise de l’itinérance à laquelle nous assistons dans plusieurs villes québécoises n’est pas le seul fruit de la crise des opioïdes, de l’inflation, de la pénurie de personnel, des taux d’intérêt élevés, ou des effets de la pandémie. Elle résulte surtout des décennies de désinvestissement du gouvernemental fédéral, depuis les années 1990, dans la construction publique de logements sociaux. Du côté du privé, nous faisons aussi face à une financiarisation internationale de l’habitation où la marchandisation des logements locatifs tend à privilégier la maximisation des profits par de gros investisseurs et investisseuses fixant le loyer au-dessus de la moyenne du marché. [caption id="attachment_20787" align="alignright" width="321"]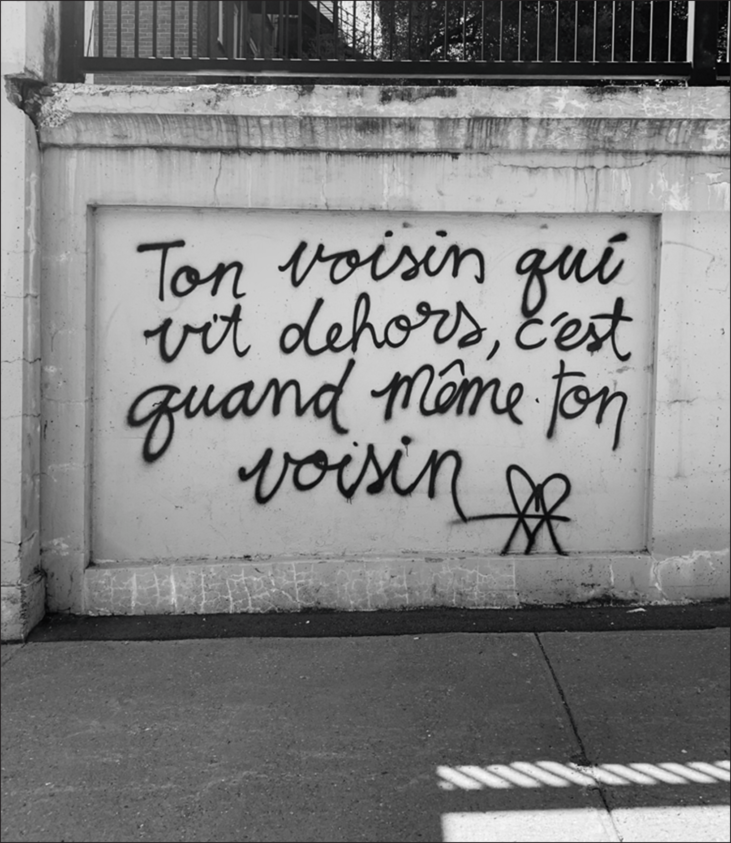 Crédit : Virginie Larivière[/caption]
Ne négligeons pas non plus les effets délétères de la réforme québécoise de l’administration publique adoptée en 2000. Inspirés du monde des affaires, les principes comptables de la nouvelle gestion publique ont généré non seulement des coupes budgétaires dans les services sociaux, de santé et d’éducation, mais aussi une technocratisation accrue des actes professionnels.
Habituellement, ce sont les services publics, produits de notre solidarité sociale, qui viennent en aide à ces personnes pour leur permettre de réintégrer le circuit de la vie dite normale. Mais quand nous constatons à quel point ce filet social a été négligé depuis une trentaine d’années au profit du secteur privé, nous concluons que cette conception entrepreneuriale du service public détériore les conditions d’accès aux services publics. La combinaison de ces choix politiques, souvent confondus avec du laxisme, met les intervenant-e-s sociaux et les citoyen-ne-s dans des situations impossibles face à l’ampleur des problèmes et des difficultés à surmonter.
La complexité de ces situations favorise un sentiment d’impuissance chez les intervenant-e-s et les gestionnaires municipaux qui doivent en plus assurer une cohabitation dans les espaces publics et faire face à la colère des résident-e-s qui perçoivent la présence accrue des personnes en situation d’itinérance comme une intrusion insécurisante ou menaçante dans leur environnement. Deux demandes d’action collective1 de résident-e-s ont même été déposées contre le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal, des organismes communautaires et religieux ainsi que des institutions en santé et services sociaux en juin 2024 face aux désagréments causés par l’installation de refuges dans le quartier Milton Park.
Crédit : Virginie Larivière[/caption]
Ne négligeons pas non plus les effets délétères de la réforme québécoise de l’administration publique adoptée en 2000. Inspirés du monde des affaires, les principes comptables de la nouvelle gestion publique ont généré non seulement des coupes budgétaires dans les services sociaux, de santé et d’éducation, mais aussi une technocratisation accrue des actes professionnels.
Habituellement, ce sont les services publics, produits de notre solidarité sociale, qui viennent en aide à ces personnes pour leur permettre de réintégrer le circuit de la vie dite normale. Mais quand nous constatons à quel point ce filet social a été négligé depuis une trentaine d’années au profit du secteur privé, nous concluons que cette conception entrepreneuriale du service public détériore les conditions d’accès aux services publics. La combinaison de ces choix politiques, souvent confondus avec du laxisme, met les intervenant-e-s sociaux et les citoyen-ne-s dans des situations impossibles face à l’ampleur des problèmes et des difficultés à surmonter.
La complexité de ces situations favorise un sentiment d’impuissance chez les intervenant-e-s et les gestionnaires municipaux qui doivent en plus assurer une cohabitation dans les espaces publics et faire face à la colère des résident-e-s qui perçoivent la présence accrue des personnes en situation d’itinérance comme une intrusion insécurisante ou menaçante dans leur environnement. Deux demandes d’action collective1 de résident-e-s ont même été déposées contre le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal, des organismes communautaires et religieux ainsi que des institutions en santé et services sociaux en juin 2024 face aux désagréments causés par l’installation de refuges dans le quartier Milton Park.
L’acte d’habiter
Faut-il rappeler que pour cohabiter, il faut pouvoir habiter un lieu qui ne se réduit pas nécessairement au fait d’en avoir la propriété ou d’en être locataire. L’acte d’habiter vise à « créer un système d’emprise sur les lieux que l’individu interprète en termes de possession et d’attachement2 », ce qui relève d’un défi quotidien pour plusieurs de nos concitoyen-ne-s. Pourtant, avoir une place dans un lieu où l’acte d’habiter est possible en toute sécurité permet de stabiliser son identité et de favoriser les interactions sociales. C’est pourquoi la propriété privée et le logement locatif sont plus que de simples marchandises, ils représentent des supports à l’individualité d’une personne, considérée alors comme sujet de droit pouvant s’exprimer en son propre nom.Face à ce constat peu reluisant du contexte actuel, une piste démocratique de cohabitation pourrait être tentée dans la perspective d’introduire l’acteur principal, à titre de citoyen-ne dans le jeu politique des négociations institutionnelles.Lorsque ces conditions socioéconomiques (propriété et logement) pour exercer sa citoyenneté n’existent plus, nous sommes déconcertés face à la présence de personnes en situation d’itinérance qui occupent les espaces publics des quartiers centraux. C’est surtout le cas lorsqu’elles s’y installent en s’appropriant des lieux pouvant reproduire les conditions potentielles d’un chez soi, à l’exemple des campements urbains; cela ne s’applique pas aux refuges qui ne sont pas conçus pour favoriser l’acte d’habiter. Rappelons que l’objectif de ces pratiques marginalisées d’appropriation de l’espace public n’est pas de nuire mais d’essayer d’y retrouver un minimum d’intimité et de protection pour pouvoir se ramasser soi-même, seul ou avec d’autres (tentes, protection par des bâches et cartons, sacs de couchage ou couverture). Les démantèlements répétés de ces installations par les autorités municipales fragilisent l’acte d’habiter de la personne en situation d’itinérance, en le réduisant à un acte précaire d’appropriation de lieux pouvant être maîtrisés de façon éphémère, mais dont l’occupation ne peut être stabilisée. On viole ainsi non seulement le droit au logement, mais aussi le droit à la dignité et à la santé, en marginalisant davantage ces personnes traitées alors comme si elles avaient moins de valeur que les autres citoyen-ne-s. Si cet acte précaire d’habiter ne peut être réalisable à cause de répressions constantes et de déplacements, non seulement la cohabitation est impossible, mais la situation des personnes en situation d’itinérance se dégrade. Faute de logements disponibles, la reconnaissance de ce besoin d’habiter à l’extérieur des lieux habituellement reconnus pour cette fonction devient un enjeu sociopolitique fondamental affectant les droits humains (dignité, sécurité, santé). Depuis 16 ans, une jurisprudence canadienne confirme cette lecture en vertu, notamment, de la Charte canadienne des droits et libertés.
La nuisance publique
Les rapports que nous avons avec les personnes en situation d’itinérance sont non seulement influencés par notre conception de l’acte d’habiter, mais aussi par les orientations économiques et les aspirations culturelles de la vie urbaine actuelle. Pensons ici à l’utilisation des espaces publics du centre-ville-est de Montréal pour vendre l’identité du Quartier des spectacles (branding urbain). (Ex. : signature lumineuse de l’ancien Red Light, aménagement de la place des Festivals, animation continue à la place Émilie-Gamelin, sécurité privée dans les espaces publics, etc.). Faire des espaces publics une vitrine commerciale pour attirer de nouveaux investissements ou favoriser l’attraction d’une destination urbaine incontournable relève en fait de choix politiques et économiques en phase avec les exigences du marché mondial. Cette logique de marché est une orientation idéologique qui s’éloigne d’une conception démocratique de l’espace public. En effet, l’accessibilité aux espaces publics a été modifiée par les promotrices et promoteurs de revitalisation urbaine qui imposent depuis 30 ans, avec le concours des municipalités, leur modèle industriel de développement fondé sur le divertissement sécuritaire et l’aménagement d’un environnement convivial favorisant « l’expérience-client ». Cet usage spécialisé des espaces publics limite considérablement leur potentiel d’habitabilité en dehors des prescriptions commerciales et de consommation. La présence des personnes en situation d’itinérance dans ces lieux a progressivement été perçue comme autant de nuisances publiques face aux projets de revitalisation économique et d’environnements résidentiels. C’est pourquoi les principales stratégies dites de cohabitation visent surtout l’invisibilisation des personnes en situation d’itinérance en contrôlant leur mobilité par des stratégies d’expulsion, de repoussement, de concentration ou de dilution de leur présence3. Toutes et tous en conviennent, ces stratégies ne font que gérer de façon permanente des solutions provisoires, car elles ne s’attaquent pas aux causes structurelles de l’itinérance, mais ne font que calmer le jeu tout en l’entretenant. L’ajout récent de subventions provinciales aux services d’hébergement et d’urgence ne fait que confirmer le statu quo de ces solutions provisoires, question de sauver une certaine image de bienveillance envers les personnes en situation d’itinérance pour lesquelles on dit espérer qu’elles puissent retrouver leur dignité. L’acte d’habiter les marges de l’espace public pour exister socialement devient alors tout un défi lancé à la démocratie citoyenne, surtout lorsque l’acteur principal brille par son absence lors des discussions le visant directement.Une piste de cohabitation
Face à ce constat peu reluisant du contexte actuel, une piste démocratique de cohabitation pourrait être tentée dans la perspective d’introduire l’acteur principal, à titre de citoyen-ne dans le jeu politique des négociations institutionnelles. S’il existe des pratiques ponctuelles de médiation calmant le jeu des divers conflits interpersonnels, il n’existe pas encore de cadre démocratique où des collectifs d’actrices et d’acteurs concernés s’engageraient dans un dialogue continu sur leurs pratiques mutuelles de cohabitation (et non seulement dans le cadre d’une consultation ou d’un incident). Pourquoi ne pas soutenir l’organisation collective des personnes en situation d’itinérance en les impliquant dans un réel dialogue sur les pratiques d’habiter l’espace public? Cela peut se faire avec d’autres collectifs d’actrices et d’acteurs qui ont un impact sur leurs pratiques urbaines (responsables politiques, commerçant-e-s, intervenant-e-s sociaux, résident-e-s, etc.). Si l’organisation collective de personnes en situation d’itinérance ne s’improvise pas, elle n’est pas pour autant impossible; on peut voir comment plusieurs arrivent à survivre dans des conditions très difficiles et à s’organiser comme le campement de la rue Notre-Dame en 2020 et en 2024. Il s’agirait d’organiser des rencontres entre des collectifs d’actrices et d’acteurs marginaux et non marginaux permettant aux participant-e-s de s’exprimer librement, de s’apprivoiser mutuellement, de reconnaître les problèmes et difficultés associées aux conditions d’habiter de toutes et tous, et de traiter le conflit pour être en mesure d’envisager des pistes de solutions ensemble. Autrement dit, expérimenter des formes démocratiques de coopération entre les personnes en situation d’itinérance pour qu’elles puissent avoir les moyens d’une action solidaire entre citoyen-ne-s partageant des conditions d’existence communes. Bref, briser ce rapport infantilisant envers les personnes en situation d’itinérance pour expérimenter des rencontres sociales à la hauteur des principes démocratiques, comme on a su le faire pour les femmes, les jeunes, les personnes en situation de handicap, etc. Cet acte citoyen est nécessaire à la réalisation du droit au logement dans une perspective d’interdépendance des droits.1 Voir dossiers 500-06-001315-247 et 500-06-001314-240, Cour supérieure du Québec. 2 Vassart, Habiter, Pensée plurielle, vol. 2, no 12, p. 13. 3 Pour en savoir plus, consulter : Parazelli et K. Desmeules, Stratégies de gestion du partage de l’espace public avec les personnes en situation de marginalité. Dans Parazelli (dir.), Itinérance et cohabitation urbaine. Regards, enjeux et stratégies d’action, Presses de l’Université du Québec, Québec, 2021, p. 209-252, 2021, .
L’article Habiter et cohabiter est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

Du Bandung de 1955 à 2024 ! Les Suds du Nord parlent !

Retour à la table des matières Droits et libertés, automne 2024 / hiver 2025
Du Bandung de 1955 à 2024 ! Les Suds du Nord parlent !
Safa Chebbi, Militante décoloniale et initiatrice du Bandung du Nord à Montréal
Septembre dernier, Tiohtià:ke (Montréal) a accueilli la quatrième édition, et la première en Amérique du Nord, de la Conférence Bandung du Nord qui s’intitule Pour une Internationale décoloniale, les subalternes du Nord parlent. Cette Conférence s’inscrit dans la continuité de l’esprit de Bandung de 1955, la première conférence intercontinentale réunissant des peuples non blancs dans l’histoire de l’humanité. À l’époque de la guerre froide, alors que le monde était polarisé entre les blocs soviétique et occidental, un groupe d’États du Sud nouvellement souverains s’est organisé politiquement pour accélérer le processus d’indépendance des États encore sous domination coloniale. C’est dans la modeste ville de Bandung, sur l’île indonésienne de Java, que cette première conférence internationale s’est tenue du 18 au 24 avril 1955. « Il s’agit de la première conférence intercontinentale réunissant des peuples de couleur dans l’histoire de l’humanité ! [...] Je reconnais que nous sommes rassemblés ici aujourd’hui, suite à des sacrifices. Sacrifices que nos aïeux ont faits, mais aussi les gens de notre propre génération et les jeunes générations. [...] Leurs luttes et leurs sacrifices ont ouvert la voie à cette réunion des plus hauts représentants des nations indépendantes et souveraines de deux des plus grands continents de la planète. [..] Que les dirigeants des peuples d’Asie et d’Afrique puissent se réunir dans leurs propres pays pour discuter et débattre de questions d’intérêt commun marque un nouveau départ dans l’histoire du monde ! » C’est par ces mots que le président Sukarno a ouvert le Bandung. [caption id="attachment_20898" align="alignright" width="328"]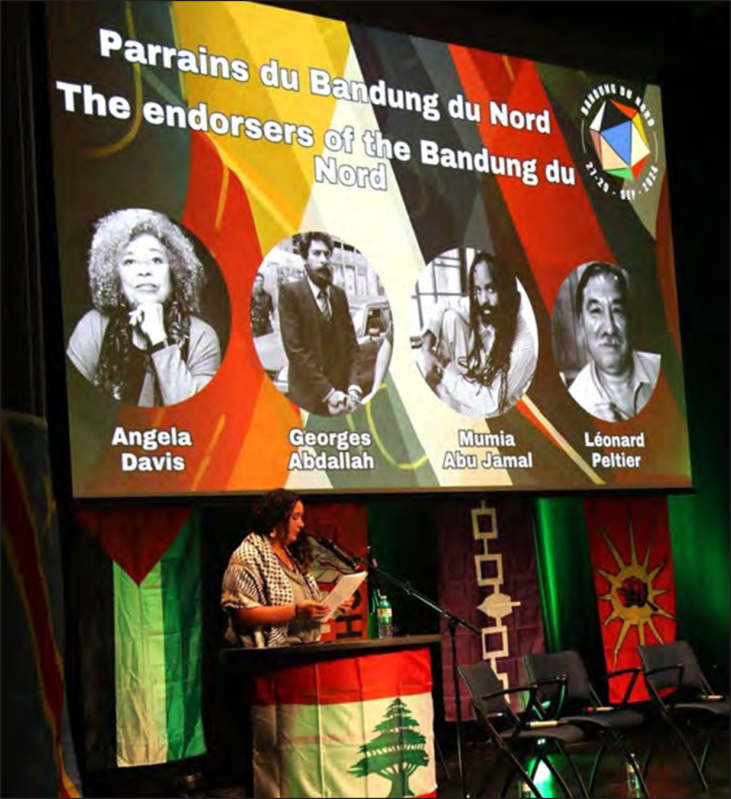 Crédit : Minette Carole Djamen Nganso[/caption]
Près de 70 ans après le moment historique de Bandung, les peuples non blancs du Nord global1 choisissent de renouer avec cette histoire de lutte. Ils s’engagent à raviver l’esprit de Bandung et à célébrer les principes énoncés par Zhou En Lai, Sukarno et Malcolm X, dans une démarche visant à poursuivre un combat pour la libération qui reste inachevé. Ces principes, tout autant pertinents pour le Sud global que pour le Nord global, affirment une vérité fondamentale : « Nous ne sommes pas des migrants sans visage qui avons voyagé du Sud vers le Nord. Nous sommes les représentants de cultures ancestrales d’Asie, du Moyen Orient, d’Afrique, d’Océanie et des Amériques. Nous avons une histoire fière de luttes contre le colonialisme et pour la dignité humaine. Nous avons produit de la connaissance, qui a été considérée comme arriérée par l’Occident et qui nous inspire aujourd’hui pour esquisser de nouvelles philosophies de la libération. Notre existence et notre identité dépassent largement les limites imposées par le colonialisme occidental ».
Malgré les avancées de ces luttes, cette logique coloniale persiste aujourd’hui encore. Les pays d’origine des peuples du Sud demeurent sous domination, tandis que l’accumulation de richesses continue de se faire exclusivement en faveur du Nord. Cette accumulation unidirectionnelle du pouvoir au Nord engendre un déplacement inévitable et forcé des populations du Sud vers le Nord, donnant lieu à une réalité sociale et démographique spécifique, caractérisée par des traitements inégalitaires découlant d’un racisme systémique qui se manifeste dans toutes les sphères de leur existence. Ces populations, issues du Sud, incarnent une diversité d’expériences historiques ; le génocide des peuples autochtones et la spoliation de leurs terres, l’esclavage transatlantique, d’autres formes de migrations forcées provoquées par les guerres néocoloniales, la pauvreté, et les inégalités accrues par le système capitaliste mondial. Ainsi, la nécessité d’un Bandung du Nord s’impose ; il s’agit de créer une force politique autonome au cœur même de l’Empire (le Nord global), à travers un projet d’Internationale décoloniale, dépassant les frontières de la nation et forgeant des alliances entre les mouvements décoloniaux d’Occident.
Dans cette optique, une première conférence du Bandung du Nord a été organisée en 2018 à Paris, rassemblant des militant-e-s emblématiques de ces luttes, tels qu’Angela Davis, Fred Hampton Jr. et Ramón Grosfoguel. Cet événement a marqué un moment clé pour initier les discussions sur l’idée d’une Internationale décoloniale, mettant en lumière les intérêts communs des peuples non blancs dans leur lutte contre l’héritage colonial. Par la suite, une deuxième conférence s’est tenue à Bruxelles en 2022, suivie d’une troisième à Barcelone en 2023, consolidant ainsi cette plateforme d’échanges et de résistances, et renforçant la solidarité entre les mouvements décoloniaux face aux injustices persistantes du colonialisme.
La conférence du Bandung de Tiohtià:ke en 2024 a suivi la même trajectoire en invitant des personnalités qui incarnent la lutte décoloniale, telles qu’Ellen Gabriel, Joseph Massad, Amzat Boukari, Houria Boutelja et plusieurs autres. Il convient également de souligner qu’Angela Davis est la marraine du Bandung du Nord, apportant ainsi son soutien symbolique et son engagement historique à cet événement.
L’ouverture de la conférence a été marquée par la lecture de trois lettres de ses parrains, trois figures emblématiques injustement incarcérées dans des prisons occidentales : Georges Ibrahim Abdallah, révolutionnaire arabe, détenu en France depuis 1984 ; Léonard Peltier, militant autochtone, emprisonné aux États-Unis depuis 1976 ; et Mumia Abu Jamal, journaliste et militant politique, incarcéré aux États-Unis depuis 1981. Ces trois hommes incarnent la résistance des peuples non blancs au cœur de l’Empire et continuent d’inspirer les luttes d’aujourd’hui.
Cette conférence a proposé des sessions plénières animées par des conférenciers et conférencières venu-e-s des quatre coins du monde, qui ont abordé des thématiques variées, notamment l’impérialisme, la libération, la destruction des dynamiques raciales et la signification du non-alignement dans le contexte d’un Bandung du Nord. Ces discussions ont permis de poser les bases d’un engagement commun, où chaque génération est invitée à se définir face à sa propre mission.
Comme l’a si bien dit Frantz Fanon :
« Chaque génération doit, dans une relative opacité, affronter sa mission : la remplir ou la trahir ». À travers ce Bandung, les non-blancs ont choisi de saisir cette mission et de l’accomplir, en marchant sur les pas de leurs ancêtres et en s’engageant sur différents fronts pour abolir toutes les formes de racisme, de domination sociale et d’exploitation économique, toujours cristallisées par la domination blanche. C’est à ce Bandung que les subalternes du Nord, les Suds du Nord, ont parlé !
Mais l’esprit de Bandung ne se limitera pas uniquement aux paroles : il s’incarnera aussi dans l’action politique pour construire un monde véritablement égalitaire pour toutes et tous. On peut d’ailleurs se réjouir du lancement imminent du projet d’une école décoloniale internationale, qui verra le jour à Paris et à Montréal dans les prochains mois, ainsi que l’organisation du prochain Bandung à Grenade en 2025. La multiplication de tels espaces dédiés à la réflexion politique, à la résistance et à l’action s’impose d’autant plus aujourd’hui, dans un contexte marqué par la montée des nationalismes suprémacistes et de l’ultra-libéralisme et par à la poursuite de la domination impérialiste sous toutes ses formes.
Crédit : Minette Carole Djamen Nganso[/caption]
Près de 70 ans après le moment historique de Bandung, les peuples non blancs du Nord global1 choisissent de renouer avec cette histoire de lutte. Ils s’engagent à raviver l’esprit de Bandung et à célébrer les principes énoncés par Zhou En Lai, Sukarno et Malcolm X, dans une démarche visant à poursuivre un combat pour la libération qui reste inachevé. Ces principes, tout autant pertinents pour le Sud global que pour le Nord global, affirment une vérité fondamentale : « Nous ne sommes pas des migrants sans visage qui avons voyagé du Sud vers le Nord. Nous sommes les représentants de cultures ancestrales d’Asie, du Moyen Orient, d’Afrique, d’Océanie et des Amériques. Nous avons une histoire fière de luttes contre le colonialisme et pour la dignité humaine. Nous avons produit de la connaissance, qui a été considérée comme arriérée par l’Occident et qui nous inspire aujourd’hui pour esquisser de nouvelles philosophies de la libération. Notre existence et notre identité dépassent largement les limites imposées par le colonialisme occidental ».
Malgré les avancées de ces luttes, cette logique coloniale persiste aujourd’hui encore. Les pays d’origine des peuples du Sud demeurent sous domination, tandis que l’accumulation de richesses continue de se faire exclusivement en faveur du Nord. Cette accumulation unidirectionnelle du pouvoir au Nord engendre un déplacement inévitable et forcé des populations du Sud vers le Nord, donnant lieu à une réalité sociale et démographique spécifique, caractérisée par des traitements inégalitaires découlant d’un racisme systémique qui se manifeste dans toutes les sphères de leur existence. Ces populations, issues du Sud, incarnent une diversité d’expériences historiques ; le génocide des peuples autochtones et la spoliation de leurs terres, l’esclavage transatlantique, d’autres formes de migrations forcées provoquées par les guerres néocoloniales, la pauvreté, et les inégalités accrues par le système capitaliste mondial. Ainsi, la nécessité d’un Bandung du Nord s’impose ; il s’agit de créer une force politique autonome au cœur même de l’Empire (le Nord global), à travers un projet d’Internationale décoloniale, dépassant les frontières de la nation et forgeant des alliances entre les mouvements décoloniaux d’Occident.
Dans cette optique, une première conférence du Bandung du Nord a été organisée en 2018 à Paris, rassemblant des militant-e-s emblématiques de ces luttes, tels qu’Angela Davis, Fred Hampton Jr. et Ramón Grosfoguel. Cet événement a marqué un moment clé pour initier les discussions sur l’idée d’une Internationale décoloniale, mettant en lumière les intérêts communs des peuples non blancs dans leur lutte contre l’héritage colonial. Par la suite, une deuxième conférence s’est tenue à Bruxelles en 2022, suivie d’une troisième à Barcelone en 2023, consolidant ainsi cette plateforme d’échanges et de résistances, et renforçant la solidarité entre les mouvements décoloniaux face aux injustices persistantes du colonialisme.
La conférence du Bandung de Tiohtià:ke en 2024 a suivi la même trajectoire en invitant des personnalités qui incarnent la lutte décoloniale, telles qu’Ellen Gabriel, Joseph Massad, Amzat Boukari, Houria Boutelja et plusieurs autres. Il convient également de souligner qu’Angela Davis est la marraine du Bandung du Nord, apportant ainsi son soutien symbolique et son engagement historique à cet événement.
L’ouverture de la conférence a été marquée par la lecture de trois lettres de ses parrains, trois figures emblématiques injustement incarcérées dans des prisons occidentales : Georges Ibrahim Abdallah, révolutionnaire arabe, détenu en France depuis 1984 ; Léonard Peltier, militant autochtone, emprisonné aux États-Unis depuis 1976 ; et Mumia Abu Jamal, journaliste et militant politique, incarcéré aux États-Unis depuis 1981. Ces trois hommes incarnent la résistance des peuples non blancs au cœur de l’Empire et continuent d’inspirer les luttes d’aujourd’hui.
Cette conférence a proposé des sessions plénières animées par des conférenciers et conférencières venu-e-s des quatre coins du monde, qui ont abordé des thématiques variées, notamment l’impérialisme, la libération, la destruction des dynamiques raciales et la signification du non-alignement dans le contexte d’un Bandung du Nord. Ces discussions ont permis de poser les bases d’un engagement commun, où chaque génération est invitée à se définir face à sa propre mission.
Comme l’a si bien dit Frantz Fanon :
« Chaque génération doit, dans une relative opacité, affronter sa mission : la remplir ou la trahir ». À travers ce Bandung, les non-blancs ont choisi de saisir cette mission et de l’accomplir, en marchant sur les pas de leurs ancêtres et en s’engageant sur différents fronts pour abolir toutes les formes de racisme, de domination sociale et d’exploitation économique, toujours cristallisées par la domination blanche. C’est à ce Bandung que les subalternes du Nord, les Suds du Nord, ont parlé !
Mais l’esprit de Bandung ne se limitera pas uniquement aux paroles : il s’incarnera aussi dans l’action politique pour construire un monde véritablement égalitaire pour toutes et tous. On peut d’ailleurs se réjouir du lancement imminent du projet d’une école décoloniale internationale, qui verra le jour à Paris et à Montréal dans les prochains mois, ainsi que l’organisation du prochain Bandung à Grenade en 2025. La multiplication de tels espaces dédiés à la réflexion politique, à la résistance et à l’action s’impose d’autant plus aujourd’hui, dans un contexte marqué par la montée des nationalismes suprémacistes et de l’ultra-libéralisme et par à la poursuite de la domination impérialiste sous toutes ses formes.
1 Le Nord global fait référence aux pays d’Europe occidentale, d’Amérique du Nord et d’Océanie, qui ont colonisé et se sont partagé l’Afrique, l’Asie et les Amériques. Aujourd’hui, de larges communautés du Sud global vivent au sein de leurs métropoles. Sur 800 millions de personnes vivant dans ces pays, on estime le nombre de non blancs à 160 millions.
L’article Du Bandung de 1955 à 2024 ! Les Suds du Nord parlent ! est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.
La mobilisation au Québec pour le FSMI
Haïti : actualité politique 2024 en photos à Port-au-Prince
Espaces sécurisés et logement social
Journaliste : Un métier dans la tourmente
L’indépendance : l’incontournable défi de résoudre ce qui est encore irrésolu
J’ai participé à la consultation budgétaire
Les travailleurs de My Indigo exigent le paiement des salaires volés

La filière éolienne québécoise : un lourd déficit démocratique

53 Pour, 55 Contre. Il n'y aura pas d'usine de bio méthanisation à St-Nazaire dans Bellechasse, un processus industriel qui transforme la matière organique en méthane. Après un an de discussions, le référendum a tranché, la démocratie a parlé. Les citoyens ont choisi de préserver leur qualité de vie plutôt que de subir odeurs et bruits dérangeants générés par une usine à la rentabilité douteuse.
Un tel scénario est très improbable lorsqu'il s'agit d'un projet d'éoliennes industrielles en milieu habité. Pourtant rien ne va changer plus le cadre de vie des résidents que l'ajout de dizaines d'infrastructures plus hautes que la Place Ville-Marie et dont l'effet cumulatif des impacts est majeur (pollution sonore et visuelle, paysages patrimoniaux dégradés, baisse de la valeur des résidences, risques sanitaires, impacts psycho-sociaux, etc.). Tout le monde veut s'arracher la tête, insultes, menaces, vandalisme, foire d'empoignes aux séances du conseil. Alors pourquoi, à l'instar de St-Nazaire, ne pas avoir recours à un référendum pour éviter la crise sociale ?
Il y a 25 ans la création de la filière éolienne attribuée à l'entreprise privée n'est pas étrangère à cette situation. Dans une perspective d'énergie verte et de développement régional une brèche a été ouverte dans le monopole public d'Hydro-Québec marquant le début de la dénationalisation de l'électricité. Ce choix politique douteux s'avère surtout une affaire de gros sous avec pour principaux bénéficiaires les promoteurs privés dont les généreux profits sont financés par des hausses de tarifs des abonnés d'Hydro-Québec et une baisse des transferts vers le Trésor Public. La notion de « profits et redevances » combiné à l'entêtement de l'État à poursuivre une idéologie sans nuances sera au cœur de cette implantation chaotique de la filière éolienne n'importe où, n'importe comment et à n'importe quel prix. Mais pourquoi vouloir enfoncer dans la gorge des citoyens des projets dont ils ne veulent pas alors que le Québec regorge de gisements éoliens beaucoup plus performants en territoires non organisés ?
En 2023 Hydro-Québec réduit considérablement la durée de son appel d'offres pour l'approvisionnement de 1500 MW d'énergie éolienne, de surcroît en période estivale, de façon à accélérer les mises en chantier et empêcher l'organisation de groupes citoyens dénonçant depuis plusieurs années une énergie coûteuse, non fiable, non stockable, socialement inacceptable et ne générant aucune activité économique dans les communautés d'accueil pendant la phase d'exploitation. Les critères d'acceptabilité sociale et d'obligation d'un pourcentage de contenu local sont abandonnés. Les distances de protection des habitations restent pratiquement inchangées face à des éoliennes beaucoup plus hautes et puissantes encore jamais testées au Québec
Forts de dizaines de contrats avec clauses de confidentialité, les promoteurs exigent des conseils municipaux un cadre légal calqué sur leurs besoins pour implanter leurs projets. Des ententes sont signées, des résolutions adoptées, des montants sont négociés, dans la frénésie plusieurs élus se retrouvent en conflit d'intérêts ; le secret est de mise, le citoyen attendra, la transition énergétique, elle, ne peut attendre. Sans mandat de la population, sourds aux doléances de leurs citoyens et à la solde des promoteurs pour vendre le projet à leurs citoyens les MRC et les municipalités se placent dans une position de soumission quant au projet contraire à la recherche constante de l'intérêt public. Aveuglés par les redevances, les MRC adoptent des réglementations ou comportements moralement, éthiquement et démocratiquement discutables ; des séances publiques écourtées, des mises en demeure, l'adoption de RCI au bénéfice exclusif du promoteur et la création de régies qui incite les municipalités à abandonner leur compétence en matière d'énergie sur leur territoire. Rien n'est prévu pour que les populations puissent s'exprimer démocratiquement sur l'opportunité ou non d'implanter des éoliennes industrielles dans leur milieu de vie. Les référendums, outil démocratique par excellence, sont proscrits et toute tentative d'y recourir deviendra un véritable parcours du combattant. Les Chambres de commerce, les organismes bénévoles, les commerces sont abreuvées de promesses économiques qui s'avéreront exagérées sinon fausses. Au gouvernement plus d'une cinquantaine de lobbyistes de l'éolien dont le profit est le motif principal harcèlent députés et ministres pour les convaincre de ce qui est bon pour les québécois.
Sans réponses et sans arguments les élus locaux lancent : « Citoyens, adressez-vous au BAPE ! »
Après plusieurs commissions d'enquête sur l'éolien, le BAPE reconnaît lui-même qu'il intervient trop tard. Ses recommandations sont systématiquement ignorées par le conseil des ministres. Le BAPE devient un exutoire pour les doléances des citoyens plutôt qu'un réel moteur de changements. Les commissaires du BAPE ont recommandé à maintes reprises de « considérer un référendum pour communiquer au décideur gouvernemental la position réelle de la population sur le projet » (BAPE no 267, page 110) et ont constaté l'absence de réelles consultations de la population de la part des autorités municipales. Celles-ci s'en remettent presqu'exclusivement au discours des promoteurs et à la politique de l'État qui a érigé l'éolien en dogme. Marie-Claude Prémont, docteure en droit et ingénieure, conclut ainsi son analyse sur les ententes signées entre les parties : « La filière éolienne démontre que l'État a mis tout son poids afin de s'assurer de trouver la formule la plus flexible et implacable pour forcer l'implantation d'une production privée d'énergie renouvelable au Québec. Le citoyen se trouve ainsi éjecté du triangle de la justice négociée entre les trois parties que sont l'État, la municipalité et le promoteur, ce qui remet en question les fondements mêmes de la démocratie municipale. » *
Révoltés, les citoyens ne font plus confiance aux élus et aux institutions qu'ils représentent. Les principaux intéressés, les riverains qui vont se retrouver à l'ombre des éoliennes, placés devant un fait accompli, calculent leurs pertes. Debout pour défendre leur milieu de vie ils n'ont de cesse d'exiger un moratoire immédiat sur tout projet éolien industriel en milieu habité et des référendums obligatoires pour les projets déjà retenus par Hydro-Québec.
Claude Charron, comité des riverains des éoliennes de L'Érable
*Marie-Claude Prémont, La justice négociée de l'énergie éolienne au Québec, Cahiers de droit, juin 2019, page 365
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Comptes rendus de lecture du mardi 28 janvier 2025

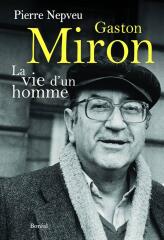
Gaston Miron - La vie d'un homme
Pierre Nepveu
Il y a longtemps – presque depuis sa publication - que je voulais lire cette imposante biographie du grand poète Gaston Miron. Après des années de recherche à rencontrer les proches du poète et à parcourir d'abondantes archives, Pierre Nepveu nous en dresse un portrait saisissant de réalisme, depuis la jeunesse de Miron à Saint-Agathe, en passant par son passage au Mont-Sacré-Coeur de Granby, où il fera son noviciat, puis à Montréal, comme jeune adulte, avec plus tard la fondation des Éditions de l'Hexagone, maison d'édition qui deviendra une référence dans le monde de la poésie et de l'édition québécoise, et son ascension dans le monde de la poésie et de la littérature, au Québec, en France et ailleurs… L'auteur nous y parle de ses amours, de ses nombreuses et grandes amitiés, de ses tergiversations aussi, de son implication politique. Un livre et un homme dans lequel on se retrouve, parce que Miron est un peu l'incarnation du Québec moderne...
Extrait :
Le lendemain, 9 janvier, on les retrouve donc réunis pour la première fois, les trois Miron qui reposent aujourd'hui ensemble au cimetière. Ils sont là, dans la majestueuse église en pierre de Sainte-Agathe, devant l'abbé De Grandpré, vicaire de la paroisse : Charles, le grand-père, accompagné de sa seconde épouse, Wilhelmine Servais ; Charles-Auguste, le père, encore mal remis de ses émotions de la veille ; et le bébé que le prêtre baptise sous le nom de « Joseph Marcel Gaston Edgar Miron, né la veille ». Edgar ? Est-ce une erreur de l'abbé qui aurait inversé les prénoms, à moins que le premier choix des parents n'ait été celui-là avant qu'ils ne se ravisent ? L'auteur de L'Homme rapaillé aurait peut-être pu s'appeler Edgar Miron, aussi cocasse et peu concevable que cela paraisse.
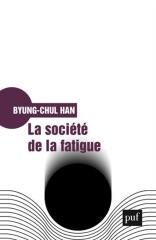
La société de la fatigue
Byung-Chul Han
Traduit de l'allemand
Byung-Chul Han, d'origine sud-coréenne et vivant actuellement en Allemagne, est une des importantes figures de la philosophie moderne. Il traite, dans ce court essai, de notre passage d'une société disciplinaire, aux multiples contraintes sociales, à une société de la performance, qui nous mène à notre auto-exploitation… et à la fatigue. Ce n'est pas souvent d'une lecture facile et c'est donc parfois peu agréable à lire.
Extrait :
La société de la discipline de Foucault, composée d'hôpitaux, d'asiles, de prisons, de casernes et d'usines, n'est plus la société d'aujourd'hui. Elle a été remplacée par une toute autre société, une société des salles de fitness, des tours de bureaux, des banques, des aéroports, des centres commerciaux et des laboratoires de génétique. La société du 21e siècle n'est plus une société de la discipline mais une société de la performance.
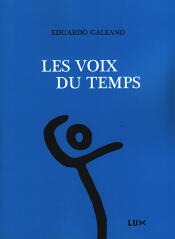
Les voix du temps
Eduardo Galeano
Traduit de l'espagnol
L'auteur du fameux « Les Veines ouvertes de l'Amérique latine » est un écrivain qu'il faut absolument lire. Ce magnifique recueil de courts textes nous fait découvrir de fort nombreuses vérités cachées de l'histoire, de l'Amérique latine aux États-Unis, à l'Europe, à l'Asie et à l'Afrique, des temps reculés jusqu'à nos jours. Un bouquin d'une grande intelligence et d'une grande humanité.
Extrait :
Au matin du 13 février 1991, deux bombes téléguidées détruisent une base militaire souterraine dans un quartier de Bagdad. Seulement, la base militaire n'en était pas une. C'était un refuge où dormaient des gens et qui, en quelques secondes, se transforma en immense bûcher. Quatre cent huit civils moururent calcinés, parmi lesquels cinquante-deux enfants et douze bébés. Le corps de Khaled Mohamed était une flamme. Il crut qu'il était mort, mais non. Il se fraya un passage en marchant à tâtons et réussit à sortir. Il ne voyait rien. Le feu lui avait collé les paupières. Le monde non plus ne voyait rien. La télévision était trop occupée à monter les derniers modèles de machines à tuer que cette guerre avait lancés sur le marché.
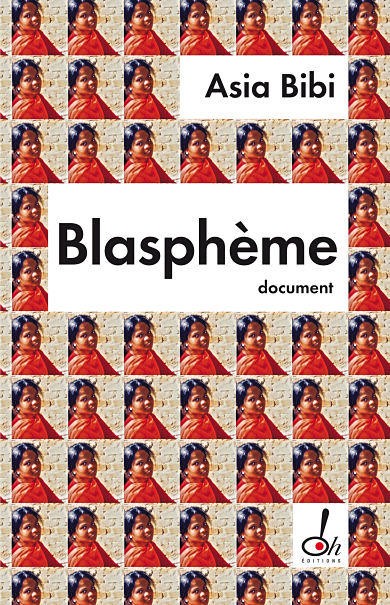
Blasphème
Asia Bibi et Anne-Isabelle Tollet
Asia Bibi, une ouvrière agricole pakistanaise d'obédience chrétienne, est accusée de blasphème envers l'Islam en 2009 à la suite d'une dispute près d'un puits. Avec l'aide de la journaliste Anne-Isabelle Tollet, elle témoigne ici de cette dispute, de sa condamnation à la peine de mort par les autorités du pays et de ses longues années passées à croupir dans un cachot insalubre. Ce document éclairant et émouvant se termine sur l'espoir qu'elle sera un jour libérée et qu'elle pourra rejoindre son mari et ses enfants. Elle le sera finalement par la Cour suprême du pays en 2018, décision qui sera confirmée un an plus tard à la suite d'un ultime recours. Elle vit maintenant au Canada avec son mari et ses filles.
Extrait :
Je suis peut-être, moi, la pauvre fille de ferme non instruite, celle qui va, à travers mon histoire, aider des gens comme moi, et, qui sait, leur éviter la peine de mort. Si je continue à vivre, cette loi contre le blasphème sera peut-être modifiée un jour.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

L’arrivée de Trump et la gauche

C'est vrai que l'arrivée de Trump au pouvoir crée beaucoup d'inquiétudes. Françoise David, dans sa lettre du jeudi 22 janvier au Devoir, exprime bien les angoisses que nous pouvons ressentir.
« Donald Trump est désormais président des États-Unis. Depuis le jour de l'An, des voisins, des amis, des inconnus (surtout des femmes) rencontrés au hasard des jours me parlent de leur inquiétude devant l'arrivée de cet homme vindicatif, sexiste, raciste, mythomane à la tête des États-Unis. Je sens chez ces personnes beaucoup de désarroi et surtout, une tentation : se réfugier dans des petits bonheurs quotidiens et attendre que l'orage passe. »
Mais, face à ce climat d'incertitude, la gauche reste assez muette. Au Canada, c'est Jean Chrétien qui, de ses 91 ans, écrit aux Canadiens et Canadiennes pour tenter d'éviter que le bateau libéral ne coule trop vite. C'est aussi Doug Ford qui apparaît comme le capitaine Canada avec sa casquette « Le Canada n'est pas à vendre ». C'est donc autour des partis politiques bourgeois que se concentre une vision d'unité. Mélany Joly l'a dit : c'est le temps de s'unifier. Et cette nécessaire unification pour préserver l'espace canadien dérange les plans politiques de Polievre et Paul St-Pierre Plamondon.
La gauche quant à elle demeure silencieuse et sans perspective face à cette unité des forces politiques bourgeoises.
En ce sens, la lettre de Françoise David brise la glace. Ce qu'aurait dû faire Ruba Ghazal et Qs.
Elle place bien, dans un premier temps, les dangers réels des changements idéologiques qui peuvent pervertir nos valeurs sociales.
« Les politiques de Donald Trump s'appliquent surtout aux États-Unis. Pourquoi devrions-nous résister à ce tsunami de droite, voire d'extrême droite ? Parce que les courants de pensée qui prennent de l'ampleur chez nos voisins finissent souvent par nous contaminer. Comment agir ? Par une résistance active. »
Ensuite, elle aborde la situation sociale à partir des inégalités qui se creusent.
« Je n'en peux plus de ces discours qui appellent soi-disant à la raison, mais qui, en fait, favorisent toujours les mêmes : les gens bien nantis, assis sur leur fortune, capables de se donner des services privés en santé, par exemple, mais qui rechignent devant le moindre effort fiscal additionnel. »
Elle mentionne différentes situations d'injustice sociale et touche particulièrement la question environnementale. Elle l'aborde avec une grande clairvoyance des enjeux majeurs :
« Un mot commence à m'horripiler : adaptation. Il faut, disent les politiciens, s'adapter aux changements climatiques. Évidemment. Mais il faut surtout et de toute urgence combattre ces changements par tous les moyens possibles. Cela suppose du leadership, de la volonté, du courage de la part de celles et ceux qui savent quoi faire, mais n'osent pas le proposer.
Ils prétendent que la population n'est pas prête à modifier des comportements néfastes pour l'environnement. Il est vrai que tout changement est un défi. Mais avec ce genre de raisonnement, les féministes québécoises n'auraient jamais combattu le patriarcat, les lois sexistes, les comportements machos. Elles l'ont fait, en ont parfois payé le prix, mais peuvent se réjouir aujourd'hui de n'avoir jamais capitulé, car leurs luttes ont largement porté leurs fruits. Même s'il s'agit d'un combat à poursuivre. »
Après avoir bien placé l'analyse sociale, elle présente des initiatives pour se mobiliser :
« Agissons pour que le Québec demeure et soit de plus en plus une terre où il fait bon vivre ensemble ! Répondons aux discours discriminants, marginalisants. Engageons-nous dans des organismes communautaires, syndicaux, écologistes, féministes, antiracistes. Soutenons celles et ceux qui se battent pour l'avenir de la prochaine génération, Mères au front ou les éducatrices en CPE, par exemple. Donnons du temps dans notre communauté.
Opposons au défaitisme une mobilisation sociale et politique nationale, rassembleuse et forte. Les grands mouvements sociaux ont la capacité de l'organiser, ils l'ont démontré par le passé ! »
Cet article de Françoise David a donc comblé un vide dans la gauche au Québec. Mais il nous faut nous poser la question :« Pourquoi Qs n'a pas écrit un tel texte ? » Bernard Rioux, dans son article « Les-défis posés à la gauche par le nouveau cours de l'imperialisme-americain » pour Presse-toi à gauche montre bien comment Qs pose la situation :
« Pour ce qui est de Québec solidaire, sa porte-parole Ruba Ghazal a fait sa suggestion, qui s'inscrit dans le cadre d'une éventuelle guerre commerciale : « Dans le cadre des tensions commerciales, un gouvernement solidaire n'hésiterait pas à agiter des hausses de prix importantes de l'électricité vendue sur la côte est américaine pour se faire respecter. Le Québec doit se tenir debout devant Trump. Ce n'est pas à coup de taxes sur le jus d'orange qu'il va nous prendre au sérieux. » [6] Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette suggestion se colle aux modalités d'une politique commerciale et ne cherche nullement à mettre le peuple québécois dans le coup. Même lorsqu'elle évoque l'indépendance, la prise de position de Québec solidaire reste engoncée dans une logique de politique commerciale : « Un Québec indépendant pourrait mettre ses intérêts au cours de ce bras de fer commercial, avec l'hydro-électricité comme principal levier de négociation, et s'assurer que les emplois et l'économie du Québec soient protégés. »
Aucune critique argumentée du projet de l'extrême droite trumpiste, aucune dénonciation de la politique environnementale désastreuse qu'il promeut, aucune dénonciation de ses projets d'expulsion des personnes migrantes, aucune critique de la réaction du gouvernement de la CAQ et du PQ en matière d'immigration face aux politiques d'intimidation de Trump. Pourtant, il nous apparait impératif d'opposer une réponse globale au cours actuel de l'impérialisme trumpiste dans le contexte actuel. »
Les perspectives tracées par Françoise David sont en fait les perspectives que doit développer un parti de la rue. En parlant d'adaptabilité et de population pas prête à changer, madame David touche ici des cordes sensibles d'une approche purement électoraliste : il faut plaire à la population, reprendre ce qu'elle demande, adapter notre programme, pas être trop dogmatique. En fait, cette approche efface l'image de Qs, ce pour quoi il a été créé : refléter les revendications des mouvements sociaux. Les dernières prises de positions du parti à l'Assemblée nationale ont créé bien des remous dans les groupes communautaires. Qs y a perdu des plumes et des militantes et militants. Pas étonnant qu'il ne soit pas en mesure de répondre aux angoisses actuelles et de développer des mesures anti-trumpistes.
Merci madame David d'avoir allumé une petite bougie d'espoir avec votre texte.
Peut-être que Qs pourrait le distribuer à ses membres pour discussion ? Et je vous invite à lire le texte de Bernard Rioux dans Presse-toi à gauche https://www.pressegauche.org/Les-defis-poses-a-la-gauche-par-le-nouveau-cours-de-l-imperialisme-americain
Ginette Lewis
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.












