Derniers articles

Haïti : le gouvernement intérimaire aurait signé un contrat avec Blackwater pour lutter contre les gangs armés

Port-au-Prince, 27 mai 2025 — Selon une enquête du New York Times publiée ce week-end, le gouvernement intérimaire haïtien aurait conclu un contrat confidentiel avec Erik Prince, fondateur de la société militaire privée Blackwater, pour mener des opérations contre les gangs armés qui terrorisent plusieurs quartiers de la capitale et d'autres zones urbaines du pays.
Par Smith PRINVIL
Le document, que le journal américain affirme avoir consulté, établirait une collaboration directe entre les autorités haïtiennes et la firme de sécurité, tristement célèbre pour son rôle controversé dans des opérations militaires en Irak et en Afghanistan. Blackwater, aujourd'hui connue sous le nom de Constellis, a vu plusieurs de ses employés condamnés pour leur implication dans le massacre de 14 civils irakiens à Bagdad en 2007.
Le contrat aurait été négocié au plus haut niveau avec l'appui de conseillers étrangers proches de l'administration américaine, selon la même source. Il prévoit l'envoi d'unités paramilitaires spécialisées dans la guerre urbaine, avec mission de "neutraliser" des groupes criminels armés jugés incontrôlables par la Police Nationale d'Haïti (PNH), dont les effectifs sont largement dépassés par l'ampleur de la crise sécuritaire.
Erik Prince, entrepreneur militaire privé et ancien conseiller officieux de l'ex-président américain Donald Trump, est considéré comme un acteur influent du secteur de la sécurité privée internationale. Sa présence dans un contexte aussi explosif qu'Haïti inquiète plusieurs observateurs.
« Confier la sécurité nationale à une société privée, c'est franchir une ligne rouge », estime un analyste haïtien du secteur des droits humains joint par Le Concret Info. « Blackwater, ce n'est pas une ONG. C'est une machine à faire la guerre, sans obligation de rendre compte à la population. »
La société civile, pour l'heure, n'a pas été consultée sur la question. Les autorités n'ont pas encore officiellement réagi aux révélations du New York Times, et aucun détail n'a été publié par le Bureau du Premier ministre ni par le Ministère de la Justice.
Haïti est confrontée depuis plus de trois ans à une montée en puissance des gangs armés qui contrôlent de larges pans du territoire, en particulier dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Kidnappings, assassinats, violences sexuelles et déplacements forcés se multiplient, dans un contexte de vide institutionnel et d'affaiblissement chronique des forces de sécurité.
Face à l'incapacité de l'État à reprendre le contrôle, plusieurs puissances étrangères, dont les États-Unis, le Canada et l'ONU, appellent à une « réponse robuste » contre les gangs. Mais le recours à une entreprise militaire privée, déjà controversée, pourrait aggraver la défiance de la population et attiser la colère populaire, prévient une source diplomatique en poste à Port-au-Prince.
L'ampleur du contrat, ses modalités d'exécution, et son financement restent à ce stade inconnus.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Argentine. Milei, l’audace et le calcul

Javier Milei aurait pu se présenter, le 18 mai 2025, aux élections législatives locales de la ville de Buenos Aires en alliance avec la droite libérale-conservatrice de l'ancien président Mauricio Macri [décembre 2015-décembre 2019]. S'ils s'étaient présentés ensemble, les partis Propuesta Republicana (Pro, Mauricio Macri) et La Libertad Avanza (Javier Milei) auraient peut-être obtenu un résultat proche de 50% des voix. Mais le dirigeant libertarien a décidé de rechercher une position hégémonique pour la droite dure, et pour cela, il devait vaincre le macrisme dans son bastion électoral, où il gouverne sans interruption depuis 2007. La capitale argentine était le seul territoire véritablement macriste de la géographie électorale et Milei a décidé de s'y attaquer, au risque de diviser le vote de la droite et de permettre une victoire du péronisme.
24 mai 2025 | tiré du site alencontre.org
https://alencontre.org/ameriques/amelat/argentine/argentine-milei-laudace-et-le-calcul.html
Au final, il a obtenu plus que ce qu'il espérait : non seulement il a détrôné les forces de Macri, reléguées à une lointaine troisième place avec 15,9% des voix, mais son candidat, le porte-parole présidentiel Manuel Adorni, est arrivé en tête avec 30,1% des suffrages, contre 27,3% pour le candidat péroniste de centre-gauche Leandro Jorge Santoro (Es Ahora Buenos Aires). Le taux de participation le plus bas de l'histoire (53% tenant compte du vote obligatoire) témoigne toutefois d'une forte désaffection politique et des limites de l'engouement pour le libertarianisme [en 2021, la participation pour les élections législatives dans la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-CABA était de 73,4% et en 2017 elle a atteint 78%].
Les résultats des élections législatives de Buenos Aires du dimanche 18 mai auraient été importants, mais de nature locale (il s'agissait d'élire le Conseil législatif de la ville), si le chef du gouvernement, Jorge Macri, cousin de Mauricio, ne les avait pas séparées des élections nationales, fixées dorénavant du 26 octobre, afin que les enjeux municipaux pèsent davantage que les enjeux nationaux. Mais l'effet a été inverse : plusieurs partis ont décidé de placer en tête de liste des personnalités de premier plan et le gouvernement s'est lancé dans une campagne visant à transformer ces élections en référendum pour le président. « Adorni, c'est Milei », a insisté la campagne libertarienne, qui a également cherché à unifier sous ses drapeaux le camp anti-péroniste : « Kirchnerisme ou liberté » était son autre slogan de campagne, afin d'attirer le « vote utile » de la droite, craignant une victoire de Leandro Jorge Santoro [Es Ahora Buenos Aires] dans une ville qui fait office de « vitrine » politique importante.
Milei s'est personnellement impliqué dans l'élection et tous ses ministres ont participé au meeting de clôture de campagne d'Adorni, le porte-parole présidentiel à l'esthétique troll qui fait partie du cercle restreint de Karina Milei, la puissante sœur du président, et qui est un rouage important de la machine discursive et propagandiste du gouvernement. En quête de victoire, le président n'a pas hésité à s'en prendre frontalement à Macri, dont le soutien avait été décisif dans sa large victoire au second tour en 2023 et pour faire adopter les lois les plus importantes de son gouvernement, étant donné que le pouvoir exécutif dispose d'une faible représentation parlementaire. La sale guerre a atteint son paroxysme lorsque, à la veille des élections, une vidéo réalisée à l'aide de l'intelligence artificielle a été publiée, dans laquelle on pouvait voir l'ancien président déclarer que sa candidate, Silvia Gabriela Lospennato [Buenos Aires Primero], se retirait de la course et appelait à voter pour Adorni afin d'éviter une victoire du kirchnérisme. Un message similaire a été diffusé par Lospennato elle-même, dans une autre vidéo tout aussi frauduleuse. Le jour même des élections, Macri a dénoncé une « fraude numérique » orchestrée par le gouvernement lui-même et son armée de trolls financés par l'Etat. Milei a répondu, implacable envers son ancien allié : « Macri est devenu un pleurnichard. »
Dès le début, Lospennato s'est révélée être une candidate idéologiquement floue pour la bataille en cours. Pour une partie des électeurs et électrices, la députée est une sorte de « wokiste », terme à la mode pour disqualifier le progressisme, car elle a été l'une des promotrices les plus visibles de la loi sur la légalisation de l'avortement en 2018. Tout le monde se souvient d'elle avec son foulard vert au poignet, défendant avec un discours héroïque et le poing levé le droit des femmes à disposer de leur propre corps. Pour une autre partie des électeurs, c'est la parlementaire qui, avec un discours anti-kirchnériste radical, a défendu avec la même ferveur le vote de la Ley Bases, la méga-loi d'austérité qui soutient le « projet tronçonneuse » à la Milei. Elle se souciait peu à ce moment-là des velléités anti-woke du président, qui le mènent sur la voie du discours homophobe lors du World Economic Forum de Davos [janvier 2025].
Déjà en campagne, acculée par la propagande officielle agressive, qui comprenait de violentes attaques personnelles, la députée candidate a tenté sans succès de se distancier du mileisme et de retrouver le discours institutionnel et républicain du Pro contre le style brutaliste de Milei. Mais il était trop tard. Macri lui-même a tenu un curieux discours défaitiste tout au long de la campagne, même lorsqu'il accompagnait sa candidate dans les médias, incapable de réagir face à la guerre sans merci menée par le gouvernement : l'ancien président sait que s'il se montre plus critique à l'égard du président, de nombreux dirigeants de son parti, ainsi que beaucoup de ses électeurs, ne le suivront pas : la base sociologique d'une droite anti-mileiste ou non mileiste s'est réduite et pourrait encore se réduire si Milei parvient à maintenir la stabilité économique, même précaire et socialement exclusive. De plus, plusieurs des figures les plus importantes du gouvernement sont issues des rangs du macrisme, y compris son équipe économique.
Ce n'est pas la première fois que la droite pense pouvoir utiliser l'extrême droite pour atteindre ses objectifs et se retrouve peu après dévorée par la spirale de la radicalisation. C'est ce qui est arrivé à Macri. Milei s'en est pris à eux et leurs défenses se sont effondrées face à l'offensive libertarienne. La stratégie de Milei est claire : d'abord vaincre le Pro dans son fief (ce qu'il a déjà fait), puis coopter tous les dirigeants possibles dans la province de Buenos Aires, un bastion électoral décisif en cette année électorale. Il s'agit d'un territoire gouverné par Axel Kicillof [ministre de l'Economie de novembre 2013 à décembre 2015 et gouverneur de la province de Buenos Aires depuis le 10 décembre 2019], candidat potentiel à la présidence pour le péronisme, que Milei a qualifié de « nain communiste ». La crise du macrisme est évidente ; ses deux candidats à la présidence pour 2023 ont quitté le parti : Patricia Bullrich est ministre de la Sécurité de Milei et l'une de ses armes contre Macri, et l'ancien chef du gouvernement de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta [de décembre 2015 à décembre 2023], s'est présenté sur une liste séparée qui a fait perdre huit points au Pro lors des élections de dimanche 18 mai 2025.
Le message de La Libertad Avanza au macrisme était clair : « Nous, nous pouvons, vous avez essayé et vous avez échoué », « Vous, lorsque vous avez gouverné entre 2015 et 2019, vous avez échoué parce que vous manquiez d'audace idéologique. Nous, nous sommes en train de changer les choses, il n'y a pas de place pour les tièdes ni pour les bonnes manières. » Pour les partisans de Milei, le macrisme représente un « antikirchnérisme inefficace », qui aboie mais ne mord pas assez et qui, en définitive, n'ose pas entreprendre la tâche de destruction qu'ils revendiquent. De plus, les partisans de Milei savent qu'en fin de compte, Pro n'a d'autre choix que de les accompagner. Macri lui-même l'a dit dans une interview télévisée après la défaite électorale : « Je pense que les deux partis qui soutiennent le changement devraient pouvoir cohabiter. » Presque résigné par la défaite, il s'est prononcé en faveur du « changement », mais avec des nuances, et a timidement insisté sur « l'institutionnalité républicaine », qu'il a jugée nécessaire pour « attirer les investisseurs ». Mais à aucun moment il n'a remis en cause le gouvernement. Il ne peut pas le faire. Toute opposition à Milei fait peser sur le macrisme l'ombre de la « complicité avec le kirchnérisme », ce qui est un risque impossible à assumer, même si l'alternative – continuer à soutenir Milei – met en péril sa propre survie, comme on l'a vu ce 18 mai.
La droite au discours institutionnel et républicain, au-delà de sa cohérence lorsqu'elle est arrivée au pouvoir, semble appartenir au passé face à la « révolution libertarienne ». Le publiciste Agustín Laje, fer de lance du discours contre-révolutionnaire culturel du gouvernement, a résumé la situation le 18 mai dernier : « [Au sein du macrisme], ils pensaient que la clé résidait dans les bonnes manières et non dans les idées, que la forme primait sur le fond. La clé était la bataille culturelle, détruire culturellement l'ennemi. Le battre sur le terrain des idées, des symboles, du langage, des histoires et des représentations. » Laje qualifie les centres droits démocratiques – comme celle de Sebastián Piñera au Chili ou de Luis Lacalle Pou en Uruguay – de « petites droites lâches ».
Javier Milei lui-même s'est lancé dans une campagne virulente contre la presse, y compris le quotidien Clarín, autrefois vilipendé par le kirchnérisme, mais jamais avec un tel niveau de violence verbale. « Les gens ne détestent pas assez les journalistes », a déclaré le président. Et il leur a lancé des épithètes telles que « ordures menteuses », « merde humaine », « tueurs à gages du micro ». Une fois au pouvoir, et après avoir conclu des accords avec une partie de la classe politique traditionnelle, notamment les gouverneurs, Milei semble avoir largement remplacé les politiciens par les journalistes dans la fameuse « caste » qu'il était venu démanteler. Dans le même temps, il a commencé à tenir un discours anti-kirchnériste virulent, autrefois davantage utilisé par le macrisme, afin d'hégémoniser le bloc anti-péroniste. Milei aspire ainsi à représenter 50% de la société et à ne plus être cantonné à un tiers de l'électorat.
Pendant presque toute la campagne, les sondages donnaient Leandro Santoro en tête avec environ 30% des voix, le résultat habituel du péronisme dans la CABA, mais qui pouvait cette fois être valorisé compte tenu de la division de la droite. Cependant, dans la dernière ligne droite de la campagne, on a perçu un enlisement, parallèlement à la montée en puissance de Manuel Adorni, soutenu par l'activisme de la Casa Rosada [Palais présidentiel]. Milei, sa sœur et son obscur conseiller Santiago Caputo n'hésitent pas à utiliser toutes les ressources de l'Etat pour construire leur projet politique, malgré l'idéologie prétendument « anarcho-capitaliste » de Milei. Au final, « détester » l'Etat depuis les marges de la politique n'est pas la même chose que depuis le centre du pouvoir, lorsque cela s'avère très utile pour construire sa propre hégémonie. De plus, lors des sommets nationalo-conservateurs auxquels il participe, Milei peut voir comment ses alliés, tels que Viktor Orbán ou désormais Donald Trump, font appel au damné Etat pour promouvoir leur projet réactionnaire et « illibéral ».
Face au déclin de Cristina Fernández de Kirchner [présidente de 2007 à 2015 et vice-présidente de 2019 à 2023] – qui doit en outre faire face à son ancien dauphin Kicillof – et à un péronisme à la dérive, Leandro Jorge Santoro a choisi de provincialiser sa campagne, de prendre ses distances avec les dirigeants nationaux et de miser sur un espace de centre gauche organisé à partir du péronisme local par de vieux politiciens. La ville de Buenos Aires est un territoire historiquement difficile depuis l'époque de Juan D. Perón, et ce n'est qu'à de très rares occasions, notamment sous l'hégémonie de Carlos Menem [président de 1989 à 1999], que le péronisme a réussi à y remporter une victoire. C'est pourquoi, si Adorni était Milei et Lospennato était Macri, Santoro s'est contenté d'être Santoro. Mais ce qui pouvait être une force, le fait de ne pas dépendre de parrains ou marraines politiques, était aussi une faiblesse : pour de nombreux électeurs, Santoro ne faisait que cacher les dirigeants d'une force politique qui souffre aujourd'hui d'un rejet social généralisé, surtout après la présidence ratée d'Alberto Fernández [décembre 2019 à décembre 2023] – dont Santoro faisait partie – et qui est plongée dans des conflits, comme la lutte entre Cristina et Kicillof, que personne ne comprend en dehors des cercles étroits du pouvoir.
Le candidat péroniste, issu de l'aile gauche d'une Union civique radicale (UCR) presque éteinte en tant que parti, a mené une campagne aux accents municipaux, critiquant la gestion inefficace du maire Jorge Macri – entachée en outre d'affaires douteuses – avec un discours contre la « politique de la brutalité ». Un spot dans lequel il démontait une tronçonneuse visait à renforcer son slogan visant à freiner Milei depuis la ville. Bien qu'il ait recueilli un bon nombre de voix, y compris celles d'électeurs trotskisants de gauche qui ont opté pour le vote utile, il n'a pas réussi à obtenir la première place qui aurait changé l'équation symbolique de l'élection. [La candidate du Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, Biasi Vanina, a obtenu 3,2% des voix, soit 51'925 suffrages.]
Une donnée marginale mais significative : les deux courants du péronisme anti-woke (ou du moins non woke), qui attribuaient le recul électoral à l'excès de progressisme culturel, comme celui représenté par Alejandro Kim – le candidat d'origine coréenne qui répond à Guillermo Moreno [secrétaire d'Etat au commerce extérieur de 2006 à 2013 et antérieurement à la communication de 2003 à 2006, sous Nestor Kirchner] – et l'ancien chef de cabinet de Cristina Kirchner, Juan Manuel Abal Medina (un nom emblématique du péronisme), ont obtenu respectivement 2,03% et 0,51% des voix, malgré leur forte présence dans les streaming [audios et vidéos en ligne] surtout dans le cas de Kim.
Pour remporter cette victoire, qui est toutefois loin d'être une vague électorale imparable et n'a pas empêché une abstention historique, Milei a profité de la conjoncture économique. Même si l'inflation reste élevée (2,8% en avril), il peut montrer qu'elle est « en baisse ». En outre, il parvient à maintenir le dollar à un niveau bas, même après la levée partielle du « cepo » [verrou] (restrictions sur l'achat de devises), ce qui constitue un frein à l'inflation et permet aux classes moyennes d'acheter des biens importés en grande quantité et de voyager plus facilement à l'étranger. Son gouvernement, de plus, a évité de sabrer dans les allocations sociales, ce qui a conjuré la menace d'une explosion sociale, toujours présente en Argentine. Bien que de nombreux économistes, même libéraux, doutent de la viabilité du modèle, le récent crédit accordé par le Fonds monétaire international (FMI) lui a donné un peu de répit financier – ou du moins, c'est ce que l'on croit – pour arriver aux élections d'octobre sans trop de remous et sans dévaluer le peso. Mais il ne s'agit pas seulement d'économie. Le « mileisme » représente un état d'esprit plus global, dans lequel les « rébellions du public », comme les appelle Martín Gurri [La rebelión del público. La crisis de la autoridad en el nuevo milenio, Ed. Adriana Hidalgo, 2023] contre les élites traditionnelles, notamment politiques et culturelles, bouleversent les champs politiques dans une grande partie de l'Occident, mettant en crise la droite conventionnelle et alimentant diverses formes de réaction anti-progressiste.
L'essayiste Beatriz Sarlo a écrit un livre sur Néstor Kirchner intitulé La audacia y el cálculo (L'audace et le calcul), qui rendait compte de la manière dont l'ancien président avait construit son pouvoir et son discours politique. Milei fait preuve d'une audace démesurée. Il reste à voir comment ses calculs, et ceux de son « triangle de fer », formé avec sa sœur Karina et Santiago Caputo, fonctionneront pendant le reste de cette année électorale, et si l'élection à Buenos Aires deviendra un tremplin pour construire une nouvelle hégémonie, comme l'imagine Milei, actuellement triomphant. (Article publié par la revue Nueva Sociedad, mai 2025 ; traduction rédaction A l'Encontre)
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Fatou Sow : Les femmes, l’État et le sacré

Dans le débat sur la laïcité, c'est devenu une habitude dans le raisonnement d'associations islamiques, à propos des revendications sur les libertés de la personne et singulièrement celles de la femme, de voir opposer, au citoyen et à la citoyenne qui revendiquent des droits, comme aux décideurs et à l'État qui cherchent à gérer et légiférer sur ces mêmes préoccupations, l'argument péremptoire et absolu du sacré.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/05/26/fatou-sow-les-femmes-letat-et-le-sacre/?jetpack_skip_subscription_popup
Avec l'aimable autorisation de l'autrice
Introduction
La polygamie ou l'inégalité filles et garçons en matière d'héritage : on ne peut en réviser les dispositions car elles relèvent du sacré. Pour prendre un exemple extrême, le trafic contemporain des esclaves entre le Nigeria du Nord, la Mauritanie, le Niger, le Soudan, l'Arabie Saoudite ou les pays du Golfe, bien que régulièrement dénoncé par les organisations de droits humains tels que SOS-Esclaves-Mauritanie [2], American Anti-Slavery Group (AASG) ou Amnesty International, est rarement discuté par les autorités.
L'abolition de l'esclavage en Mauritanie, (ordonnance n°81-234 du 9 novembre 1981) rencontre encore des difficultés d'application) Les « ayant droits » réclament des dommages et intérêts, arguant du fait que l'esclave a statut dans le Coran. Le Coran est parole de Dieu ! La femme, le citoyen et l'État ont bel et bien un problème avec la sharî'a ou la lecture que l'on peut en donner à Kano (Nord Nigeria), Madina Gounas (Sénégal) ou Riad (Arabie Saoudite) !
Le Sénégal, faut-il le rappeler, est un État laïc. La laïcité est inscrite dans toutes les constitutions dont le pays s'est doté depuis 1960. Pourtant, la discussion est périodiquement engagée entre les défenseurs de la laïcité comme insigne de la République et les tenants de son abolition, qui se prévalent de l'identité religieuse musulmane de la majorité des citoyens sénégalais. Elle a été vive lors de l'élaboration de la nouvelle constitution votée en 2001, quelques mois après l'arrivée au pouvoir du Parti démocratique sénégalais et d'une large coalition des forces de l'opposition au Parti socialiste sénégalais. La tradition juridique héritée de la colonisation française s'est finalement maintenue : le Sénégal demeure un État laïc. Les institutions politiques et les textes juridiques qui ont géré le pays depuis une quarantaine d'années, ne font pas, dans l'ensemble, de référence explicite comme source de réglementation, à une obédience religieuse ou même à l'islam, religion dominante. Ce n'est pas le cas des républiques islamiques de Mauritanie ou du Soudan ni celui de certains États du Nord Nigeria qui se proclament islamiques malgré l'inconstitutionnalité d'une telle disposition dans le cadre de la Fédération nigériane. D'autres États, comme le Tchad et le Niger, tout en se réclamant de la laïcité, n'ont pas promulgué de code de la famille, pour ne pas « enfreindre la sharî'a ». Dans de nombreux pays subsahariens à majorité musulmane, le retour à la sharî'a est une revendication émergente qui devrait intéresser les études sur l'islam politique en Afrique subsaharienne.
La contestation évidente de la laïcité et la présence forte ou en filigrane de la loi coranique dans l'Afrique musulmane, de même que le redéploiement de la question de l'islam dans le monde actuel invitent à s'interroger sur son évolution comme fait religieux et culturel, à la fois identitaire et politique.
La résurgence du discours islamique des années 1970-1980 avait, en partie, été liée à l'avènement de la révolution iranienne et au renforcement du pouvoir des monarchies du Golfe et autres États d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient. Enrichis par la crise du pétrole et le boum des prix, ces pays ont largement financé les associations islamiques dans le monde, notamment en Afrique subsaharienne. Cette résurgence tient aussi à l'exigence de nombreuses communautés musulmanes, face à la crise contemporaine de la modernité, de penser pouvoir à l'occasion reconstruire leur identité et leur foi. Ces phénomènes ont eu un impact certain sur la vie religieuse et associative des musulmans africains et sénégalais.
Nous partirons, dans cet article, d'une part, des revendications multiples des femmes, ces deux trois décennies (1970-2000), à plus d'égalité notamment en matière de droit de la famille et, d'autre part, des reproches d'anti-islam et d'atteinte à la volonté divine proférés à leur encontre par certains groupes musulmans. Le débat sur l'islam et les droits des femmes est souvent dénoncé comme une polémique importée du féminisme occidental et aggravée par le discours antimusulman récurrent. Les attentats, en septembre 2001, contre les tours du World Trade Center de New York et la vive riposte américaine contre un ‘fondamentalisme' musulman accusé de terrorisme n'ont fait qu'envenimer, voire embrouiller la controverse dont il était déjà difficile de poser clairement les termes. L'atmosphère qui a entouré les campagnes internationales de presse dénonçant les cas extrêmes d'amputation de la main de voleur, en Mauritanie, dans les années 1980, et les peines de mort punissant l'adultère et la grossesse ‘illégitime' de femmes hausa du Nord Nigeria, au début de ces années 2000 témoignent du poids des passions. Tous ces cas ont vivement interpellé l'opinion africaine et internationale.
En ce qui concerne les droits humains des femmes, l'étude de l'islam politique africain et sénégalais d'hier à aujourd'hui ne peut faire l'économie d'une réflexion critique sur son impact sur leurs statuts et conditions de vie dans les pays musulmans. Cette question constitue un volet essentiel des interrogations portant, sur l'importance du mouvement de renaissance de l'islam.
L'islam politique renvoie ici à l'utilisation de la religion comme argument politique, soit par la société elle-même, notamment ses confréries et associations religieuses, soit par l'État dont le pouvoir législatif s'inspire volontiers du Coran pour le code de la famille tout en utilisant les communautés musulmanes et leurs leaders comme masses de manœuvre électorales pour l'accession ou le maintien au pouvoir politique. Dans un contexte aussi ambigu, laïcité et religion se côtoient et font l'objet de débats épisodiques.
Les communautés musulmanes du Sénégal colonial ont exprimé une vive hostilité à l'application du Code civil, en raison des valeurs judéo-chrétiennes qu'elles impliquaient à leurs yeux (monogamie par exemple), malgré les efforts de laïcisation que représentait cette initiative [3]. De Durand Valentin (élu en 1848), Carpot (1904), Blaise Diagne (1914), à Lamine Guèye (1946), leurs représentants au parlement français ont soutenu leur volonté de leurs électeurs de maintenir la sharî'a repense selon leurs coutumes, comme source de gestion des relations familiales. Les autorités coloniales ont ainsi été amenées à reconnaître les décisions rendues sur les questions relevant de lafamille par le tribunal musulman présidé par un cadi. Mais ce recours d'ordre théologique et juridique qui était une revendication aussi bien religieuse qu'identitaire contre les colons est devenu un appel au sacré qu'il est de plus en plus difficile de contester dans le Sénégal contemporain. Le débat dans ce contexte, porte rarement sur une analyse des mutations et des aspirations sociales contemporaines. Elle se réduit à une polémique autour de leur caractère religieux. On est ramené à la parole de Dieu !
Mustafa Kemal, comme Bourguiba, avaient dû, dans la même atmosphère, trancher ces questions.
Le présent article participe d'une double réflexion sur les femmes, les lois et l'islam en Afrique. La première est personnelle et procède d'un ensemble de travaux de recherche sur les femmes et les rapports sociaux de sexe dans la société sénégalaise. La seconde, de nature collective, a été initiée par le Groupe de recherche sur les femmes et les lois au Sénégal, membre du réseau international Femmes sous lois musulmanes (Women Living Under Muslim Laws – WLUML). Elle étudie l'impact de l'islam sur les lois affectant les relations hommes/femmes dans le cadre familial et social. Cette réflexion revêt une importance particulière, car le religieux est une dimension incontournable de la vie des femmes musulmanes. « Les paramètres de la vie d'une femme sont déterminées par une combinaison de dispositions statutaires formelles et de pratiques coutumières informelles qui peuvent chacune être fondées sur la religion, les coutumes traditionnelles de la région et sur d'autres sources telles que la réglementation coloniale ou les tendances mondiales »[4]. Or, à l'étude, on s'aperçoit que toutes ces dispositions participent d'une hiérarchisation sociale inégalitaire entre les sexes qui pousse à des interrogations : Quelle est la part de l'État et quelle est celle du sacré dans l'élaboration des règles et des politiques qui gèrent la vie des femmes, leur position dans la société et leurs relations avec les hommes ? Pourquoi le recours au sacré ? Comment en dépasser les contradictions dans un contexte qui se veut laïc ?
1- Le débat laïcité/religion dans le contexte sénégalais
Sans entrer dans un débat théologique inapproprié dans cet article, il convient cependant de définir quelques termes pour mieux asseoir la réflexion.
Le Coran, comme parole de Dieu révélée au Prophète Muhammad, est considéré comme un code de conduite religieux, moral et social pour tout musulman. Il est la source fondamentale de la Loi islamique. « La Loi, ensemble de prescriptions juridico-religieuses qui doivent de tous temps régir la communauté des croyants, repose sur le Coran » [5]. Face à l'évolution historique et politique des communautés musulmanes et à l'obligation de répondre à leurs nouvelles interrogations, les ulémas, savants de la Loi, ont dû recourir à la sunna comme deuxième source de la Loi. La sunna rassemble les traditions orales (hadith) rapportant les pratiques de l'époque de Prophète Muhammad et de ses compagnons. L'ijtihad, comme effort de réflexion et d'interprétation, a permis, au cours des siècles, de discuter, de (re)construire et de renforcer le discours musulman, en permettant de procéder à certaines adaptations, de recourir à une certaine flexibilité face aux coutumes locales. Il habilite, des personnes qualifiées par leur érudition coranique, de raisonner et d'établir les liens qui ne sont pas toujours explicites entre le texte coranique et les règles de la sharî'a qui en découlent. L'ijtihad est un moyen de répondre aux questionnements des fidèles sur leurs pratiques religieuses, en se référant au Coran et à la sunna. La sharî'a, comme « 'ensemble des prescriptions cultuelles et sociales (au sens large) tirées du Coran et de la sunna » [6], organise la vie religieuse et sociale des fidèles et réglemente aussi bien la prière, le jeûne, le code vestimentaire que le mariage, le divorce, le veuvage ou l'héritage. Elle est au cœur, du débat actuel sur l'islam et la modernité, car son application est critiquée pour son opposition à la ‘modernisation' sociale.
Les termes islamisme, intégrisme et fondamentalisme sont ceux qui prêtent le plus à controverse aujourd'hui qu'ils ont un sens politique plus marqué en relation avec des mouvements actifs.
Les islamistes appartiennent à un courant politico-religieux, conservateur et intégriste de l'islam. Leur revendication majeure est d'une islamisation totale des lois, du gouvernement et des institutions. L'islamisme est souvent associé au fondamentalisme dont le concept a d'abord désigné des courants protestants de l'Amérique des années 1920 attachés au respect scrupuleux de la Bible, face à une société américaine en pleine transformation politique et sociale. C'était une manière de réaffirmer leur identité sur une base raciale et religieuse. Il faut constater « la difficulté de traiter des formes contemporaines d'extrémisme religieux [qui] tient surtout à la variété et à l'émiettement des systèmes de sens et des confessions à travers le monde, à la disparité des catégories qu'ils recouvrent, aux réputations qui leur sont faites, aux exclusions dont on les frappe, aux déformations dont ils sont victimes »[7]. Ainsi, on qualifie, aujourd'hui, de fondamentalistes, intégristes ou extrémistes des groupes aussi hétérogènes que les Wahhabites, les Talibans, les Hezbollah, les Frères musulmans, les Pentecôtistes, Adventistes et télévangélistes américains, les Hassidim juifs ou les intégristes catholiques de Mgr Lefebvre, ancien archevêque français de Dakar entre 1948 et 1962.
On peut cependant reconnaître que tous ces mouvements ont en commun de respecter une pensée, un texte ou un livre de référence absolue. Ils prétendent en garantir l'interprétation et en protéger l'immuabilité contre toute critique ou révision moderniste. Ils en viennent à un ‘fondamentalisme politique' qui guide leur action à partir d'un respect qui se veut strict de principes religieux, avec un degré très variable d'intolérance, voire de violence. Les partisans de la révolution islamique en Iran, comme les défenseurs de la foi chrétienne qui appuient l'administration actuelle du Président George W. Bush proclament leur foi comme base de leur action politique. L'administration républicaine tente, par exemple, de revenir sur de nombreux droits sexuels et reproductifs obtenus de haute lutte, au cours de deux décennies de conférences mondiales des Nations Unies pour les femmes [8]. La communauté internationale s'apprête à célébrer le dixième anniversaire de la Conférence sur la Population et le développement, communément appelé Caire 1994. Or, le gouvernement américain menace de se retirer du programme d'action du Caire, adopté par 179 pays, si les termes de services de santé reproductive et de droits en matière de reproduction n'en sont pas supprimés ou, à défaut, remplacés. Or ceux-ci relèvent de droits humainsfondamentaux. Le fait pour les États-Unis de récuser ces engagements auprès des Nations Unies et de la communauté internationale prêtent à de graves conséquences pour toutes les femmes dans le monde qui ont besoin d'informations et de services efficaces et sans risques en matière de contraception et d'avortement, notamment les adolescentes exposées à des grossesses précoces non désirées. Le gouvernement américain refuse de financer les programmes de santé qui en traitent, dans les pays qui bénéficient de leur appui. Les efforts de lutte, en Afrique, contre la mortalité maternelle due à des taux de fécondité trop élevés ou des avortements dans de mauvaises conditions de sécurité risquent d'en être annihilés.
Le ‘fondamentalisme culturel' s'appuie sur la religion, la culture, la langue ou autre spécificité, comme gages d'une identité communautaire, ethnique ou raciale à préserver. Les retours imposés à la tradition de Tombalbaye, président du Tchad entre 1960 et 1975 ou à « l'authenticité » de Mobutu du Zaïre en sont de bons exemples. Ils ont obligé des populations entières à se plier à des règles vestimentaires ou de conduite pour témoigner de leur identité culturelle. L'authenticité fut la révolution culturelle enclenchée par Mobutu à partir de 1971, avec notamment l'adoption de noms africains pour les personnes, les villes et même le pays devenu Zaïre. Interdits de se vêtir à l'occidentale, les hommes furent tenus de porter l'abascos et les femmes, le pagne [9]. Le port obligatoire du voile pour de très jeunes filles, comme dans les écoles primaires et secondaires de Zanzibar ou sur le campus de l'Université de Dakar, relève du même fondamentalisme.
Enfin, le ‘fondamentalisme global' témoigne de l'expansion et de la complexité du phénomène et des relations créés entre ces groupes dans le monde. Il fait d'abord référence à ces mouvements qui constitueraient un ensemble « nébuleux » à travers les continents. C'est souvent l'épithète attribué à Al Qaida que les discours actuels contre le terrorisme fustigent. Pour notre propos, le fondamentalisme global représente sur un ensemble de groupes et d'institutions dont les actions se fondent sur des revendications identitaires religieuses, culturelles ou nationalistes. Ils constituent une alliance forte lors d'évènements précis. On pense ici à l'alliance entre les représentants du Vatican et ceux de l'Iran lors de l'élaboration du programme d'action du Caire, en 1994, et la plate-forme d'action des femmes de Beijing, en 1995. Ils ont en commun d'être des groupes conservateurs et combattu de toutes leurs forces l'adoption de textes favorables aux droits sexuels et reproductifs des femmes.
Les interrogations sur l'islam soulèvent plusieurs questions d'importance. Le débat sur la religion et la laïcité est-il concevable dans la société musulmane africaine, notamment celle du Sénégal ? Peut-on en admettre une lecture critique du message islamique, au nom de principes éthiques universels ? Une réinterprétation du Coran en faveur des droits humains des femmes est-elle possible ? Comment interpréter le port du hijab qui ne défraie pas encore la chronique au Sénégal, comme c'est le cas actuellement en France. Les femmes portent-elles volontairement le hijab en soumission à la tradition islamique ? Y sont-elles obligées ?
Dans le débat laïcité/religion, on observe généralement deux positions qui s'opposent volontiers dans le champ politique sénégalais.
Pour la première, la laïcité est la base même de la démocratie, et ce, quelle que soit la religion. « La gestion de la cité et du politique ne peut être que laïque ». C'est en ces termes que s'exprimait l'ancien Président du Sénégal, Abdou Diouf, lors de sa nomination au poste secrétaire général de l'Organisation de la Francophonie, lors du Sommet de Beyrouth, le 20 octobre 2002. A la question du journaliste de Radio France International « Est-ce significatif qu'un musulman soit nommé à la tête de l'organisation ? », le Président répondait avec sérénité : « Ma religion n'a rien voir avec ma nomination. Elle relève du privé et exclusivement du privé ».
La laïcité a été et reste en vigueur dans toutes les institutions politiques, judiciaires, économiques et financières sénégalaises. La France, « fille aînée de l'Église », y avait donné le ton, comme dans ses anciennes colonies. Toute discrimination en fonction de la religion est anticonstitutionnelle et aucun parti politique ne peut être fondé sur la religion. A aucun moment, les droits constitutionnel, commercial ou pénal ne sont influencés par le droit musulman. Les dispositions légales relevant de la sharî'a (ou de l'esprit de la sharî'a) [10] ne s'appliquent qu'à la famille. L'autorité coloniale s'est pliée à cette exigence communautaire et a juxtaposé droit civil et ‘coutume' africaine islamisée. Les nouvelles autorités de l'indépendance ont agi de à ce niveau, même si elles renforcent la culture de laïcité en supprimant les tribunaux musulmans.
L'avancée des confréries musulmanes dans l'arène politique n'a jamais été aussi forte [11]. Tous les partis politiques qu'ils soient de tendance libérale ou se disent de gauche, qu'ils aient été autrefois communiste, maoïste ou trotskyste, entretiennent des relations suivies avec les leaders religieux. Leurs dirigeants leur rendent visite, assistent à leurs manifestations religieuses (magal [12], veillées de prière, etc.), sans doute pour attester de leur prise en compte du pouvoir de la religion.
Pourtant, lors des élections présidentielles de mars 2000, l'opinion publique sénégalaise, comme le démontrent les résultats officiels du vote, rejetait les programmes des trois candidats qui avaient affirmé leur obédience musulmane. Interrogé par un électeur, lors de campagne électorale, sur le retour souhaité à la sharî'a, l'un d'eux, professeur d'université en fonction, répondait que la suspension du Code de la famille serait l'une des décisions majeures de son septennat. Il soutenait que le Code actuel de la famille était contraire aux principes islamiques. Il le jugeait d'inspiration chrétienne, trop proche du code civil français que les Saint-Louisiens avaient rejeté à l'époque coloniale. Malgré le recours à l'islam comme argument de campagne, aucun de ces candidats n'obtenait plus de 1% des votes.
Cette même opinion publique avait été choquée de voir le khalife des mourides, Saliou Mbacké, porté en tête de la liste régionale du Parti démocratique sénégalais [13], lors des élections municipales et régionales de mai 2002. La question de savoir si un chef religieux pouvait occuper un poste politique électif était au cœur de la polémique. Même si le Président Abdoulaye Wade observait qu'il n'y avait pas forcément d'incompatibilité entre les deux rôles, le khalife, face à l'hostilité ouverte des Sénégalais, avait rapidement exigé le retrait de son nom de la liste [14].
La seconde position, dans le débat laïcité/religion, plus qu'elle ne remet en question la laïcité, réclame une plus grande participation du religieux au politique. L'ancien Président Léopold Sédar Senghor avait toujours négocié, mais contrôlé les relations de l'État avec les ‘marabouts de l'arachide' qui l'avaient porté au pouvoir [15]. L'État d'Abdou Diouf paraît relativement ‘débordé' par ces relations avec les classes maraboutiques [16]. Les lobbies tijaan et surtout mouride renforcent leur position de pouvoir en usant de leur influence électorale et économique. Les activités agricoles et entrepreneuriales de la communauté mouride essaimée au Sénégal, en Afrique et ailleurs dans le monde (Europe, États-Unis) ont connu, en une vingtaine d'années, une expansion considérable, ce qui donne une emprise plus forte de la ville de Touba, capitale économique et politique du mouridisme et de son khalife [17].
Les pouvoirs religieux mouride, tijaan et même layeen étaient déjà politiques. Ils ont remplacé les aristocraties du Baol, du Cayor et du Cap-Vert éliminées par la colonisation. Les populations locales se sont attachées à eux comme autorités de référence autant religieuses que politiques. Ces pouvoirs recherchent aujourd'hui une participation plus affirmée à la direction du pays et fondent leur légitimité sur le fait que le Sénégal est un pays à dominante musulmane. Cette ambition est confortée par un double courant intellectuel plus revendicatif : Il y a d'une part, des groupes d'intellectuels qui, déçus des partis politiques de ces quarante dernières années [18], se refont une ‘virginité' politique avec l'adhésion à l'islam politique (exemples du CERID ou de Jamra.19) Il y a de l'autre, les associations musulmanes [20] auxquelles il convient de joindre les diplômés de l'enseignement arabe soucieux de faire reconnaître leur valeur [21]. Tous ces mouvements ont certes connu des fortunes diverses, mais nombre d'entre eux se développent avec le renouveau islamique dans le monde et en Afrique. Ils organisent de très nombreuses conférences et causeries, en français ou dans les langues nationales, dans des salles et mosquées [22] ou sur la place publique, sur les thèmes islam et … développement, science, enseignement, femmes, SIDA et autres grandes questions d'actualité, etc.
Les radios privées, qui ont connu un formidable essor à partir des années 1990, sont investies par les causeries sur la religion. Les débats de société y prennent rapidement une tournure religieuse, dans le ton, les salutations, la morale, les conseils donnés, les références à l'islam, etc. Certaines stations se sont, dès leur création, proclamées d'influence musulmane : Wal Fadjri, Radio Dunya. D'autres, Sud FM, ont fini par incorporer des émissions religieuses dans leurs programmes on ne peut plus laïcs, pour capter l'attention des auditeurs, rejoignant ainsi ces chaînes privées et la radio et la télévision sénégalaises. Les animateurs se livrent à des prêches tous les jeudi soir, durant le vendredi (jour de la grande prière). Ils commentent des passages du Coran et instruisent les fidèles sur les pratiques religieuses (prière, jeûne, piété, aumône, pèlerinage à la Mecque…). Ils organisent des débats quotidiens sur des questions de société (polygamie, mariage, vie conjugale, droits et devoirs des femmes, rôle du chef de famille, divorce, code de la famille, etc.). Les émissions interactives entre animateurs et auditeurs se poursuivent une bonne partie de la nuit et semblent connaître du succès,vu le nombre d'appels téléphoniques. Tous ces programmes produisent un discours ‘conformiste', voire réactionnaire de retour à l'islam et de soumission à Dieu, porteur d'arguments usés sur le péché, l'enfer et le paradis, l'absence de valeurs morales, la crise religieuse et contemporaine, les méfaits de la laïcité, les ennemis de l'islam, etc. Certains programmes prônent aussi la soumission à un chef religieux sensé être un intercesseur entre le croyant et Dieu, voire son envoyé.
Les messages en direction des femmes n'ont jamais été archaïques et … dévalorisants. Le fait que quelques femmes, notamment des arabisantes, figurent parmi les animateurs ne modifie guère le message ‘d‘enfermement' dans une position subordonnée à l'homme, chef de famille, et le rôle d'épouse et de mère. Lors d'une émission de Radio Dunya, en septembre 2003, l'animateur définissait la relation de l'être humain au divin sur la base d'une hiérarchie dont le marabout est le maillon central : La femme doit obéir à son mari qui lui-même obéit à son marabout, intercesseur entre lui et Dieu. D'autres, lors d'émissions relatives aux pratiques cultuelles, dénient la validité de la prière aux femmes qui ne veulent pas se mouiller les cheveux ou le cuir chevelu, lors des ablutions rituelles, afin de ne pas déranger leur coiffure. On traite de même celles qui sont coiffées de mèches ou se mettent du vernis à ongles. Les mèches empêchent l'eau de toucher le cuir chevelu, comme le vernis isole l'ongle. Et de citer une parole attribuée au Prophète : « Tout partie non lavée sera purifiée par le feu ».
Les femmes reçoivent, aussi bien à travers les émissions que dans les écrits musulmans sur la vie en société, des recommandations les ‘enfermant' dans leurs rôles d'épouse et de mère, comme en attestent les enseignements de Serigne Mor Diop dont l'une des daara se situe dans la Médina de Dakar. Le mariage et la maternité sont des obligations religieuses pour tout musulman. On reste cependant sceptique sur les conduites recommandées, tant ce type de relations conjugales paraît d'un autre âge comparées à la pratique dans les familles sénégalaises contemporaines.
« […] Assister son mari est supérieur en bienfaits au fait de donner en aumône l'équivalent de toutes les richesses du monde. Le simple fait de regarder aimablement son mari équivaut à glorifier Dieu. L'agrément du mari entraîne celui de Dieu. Tout franc ou dirham donné ou toute dette pardonnée (au bénéfice du mari) équivaut aux bienfaits obtenus en effectuant un pèlerinage et une oumra [23] agréés. Le simple fait de servir à manger à son mari équivaut en bienfaits à faire le pèlerinage et la oumra. De même lorsqu'une femme offre un habit à son mari, elle est considérée comme ayant effectué le pèlerinage et la oumra. Cela équivaut également à un an d'adoration décompté pour chaque cheveu du mari, donc autant d'années décomptées que de cheveux. Préparer soi-même à manger à son époux correspond en grâces aux bienfaits découlant d'une mort pour la cause de Dieu (martyrs dans la vie de Dieu). De même, une telle épouse n'ira jamais en enfer. Enfin Dieu désignera 1000 anges qui demanderont pardon pour votre compte » [24]
Il en est de même des « bienfaits » de la maternité :
« Toute musulmane mariée qui tombe enceinte a les bienfaits d'un shahid (martyr dans l'islam). De même pour chaque douleur liée ou provoquée par la grossesse, elle est considérée comme ayant affranchi un esclave. Enfin elle est considérée durant la grossesse comme quelqu'un qui a passé son temps à : jeûner en permanence, prier en permanence, faire la guerre sainte. Si la femme fait un avortement, elle aura en compensation de cet enfant perdu une place au paradis. Si la femme accouche, elle est lavée de tout péché. Lorsqu'elle allaite son enfant (au sein bien entendu), pour chaque tétée, elle est considérée comme ayant affranchi 10 esclaves en vue de l'agrément de Dieu. Si l'enfant est sevré, tous les péchés de la maman sont pardonnés. Si elle est décédée au cours de l'accouchement, le paradis lui est garanti ». […] De même, laver le linge de son enfant, coudre ses habits, s'occuper de son enfant, tous ces actes constituent un mur entre elle et l'enfer et seront considérés comme un combat dans la voie de Dieu (jihad) au cours duquel on meurt martyr (shahid) » [25]
C'est au niveau des questions de la famille que se situe le débat sénégalais sur la laïcité et le retour à la sharî'a. A aucun moment, la gestion de l'État ou des affaires n'est passée au crible islamique par les associations religieuses. Celles-ci ne remettent en question ni le droit commercial ni les pratiques bancaires (taux d'intérêt), ni le droit constitutionnel, ni même le droit pénal, comme en République islamique de Mauritanie.
C'est dans le domaine du privé que la confrontation laïcité/religion est la plus tangible, avec le droit de la famille comme socle de la contestation. Le retour à la sharî'a est, à ce niveau, une prise de position politique qui engage les dirigeants d'associations religieuses et les arabisants qui ciblent particulièrement l'encadrement des femmes et des jeunes. C'est leur manière de participer au politique et de se donner une base de légitimité.
2. Repenser le sacré : la remise en question de la sharî'a est-elle un débat possible ?
En raison de leur identité musulmane, des communautés dans le monde revendiquent le droit de gérer leur État et leur société selon des lois conformes aux principes de l'islam, tant au niveau constitutionnel, politique, judiciaire que commercial. C'est une exigence des partis fondamentalistes d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient ou d'Asie. Des pays comme l'Arabie Saoudite, l'Iran, le Pakistan ou le Soudan se proclament islamiques et en appliquent les principes. Ce n'est pas le cas du Sénégal.
Face à cette quête, une autre position, qui n'est pas non plus celle du Sénégal, se dessine. Tout en reconnaissant que le besoin de vivre selon les règles de sa foi est légitime, elle préconise cependant, pour toute application des règles de la sharî'a, des révisions, des adaptations ou des reformulations afin de les rendre conformes aux exigences de l'époque contemporaine. Nombre de pays (y compris les pays musulmans) ont hérité, avec la colonisation européenne, de l'État-nation comme système de gouvernance et de la laïcisation des lois qui l'accompagne. Aussi, avec les multiples crises politiques et économiques et la résurgence actuelle de l'islam, on ne peut guère s'étonner, remarque Abdullahi Ahmed An-Na'im, « de voir les Musulmans réaffirmer leur identité culturelle et rechercher des forces dans leur foi et leur tradition pour combattre les causes de la désorganisation sociale, de la faiblesse politique et de la frustration économique » [26] Musulman d'origine soudanaise, Abdullahi Ahmed An-
Na'im, professeur de Droit à Emory University (USA), appartient à une culture politique islamique qui ne fait pas de différence entre les lois qui réglementent le privé et celles du public. Sa démarche qui est une remise en cause globale est importante, voire incontournable, du fait de l'actualité des questions qu'il soulève, à propos de l'évolution de l'islam dans le monde. Le Soudan, ancienne colonie britannique devenue république islamique, connaît de vives tensions [27]. Il est tenaillé entre la nécessité de gérer l'État-nation contemporain et la volonté de légiférer avec la sharî'a. Tout au long de son argumentation, An-Na'im propose, aux communautés musulmanes contemporaines qui désirent appliquer la Loi islamique, d'en réformer la nature et la signification et de l'adapter à la modernité. Ceci n'est possible dit-il qu'en retournant au Coran et a la Sunna comme source fondatrice a réinterpréter et en s'éloignant de la sharî'a historique, celle des textes de l'époque de Médine. Or la plupart des fondamentalistes s'enferment dans ces textes. La réforme nécessaire de la sharî'a est possible, malgré les difficultés d'ordre à la fois théologique et politique. Il conclut :
« A moins d'éloigner la base de la loi islamique moderne de ces textes du Coran et de la sunna de l'époque de Médine, il n'existe pas de manière d'éviter une sérieuse violation du standard universel des droits humains. On ne peut en aucune façon abolir l'esclavage comme institution légale et éliminer toutes les formes et ombres de discrimination contre les femmes et les non musulmans, aussi longtemps que l'on reste enfermé dans le cadre de la sharî'a » [28].
A propos de la sharî'a, la société africaine en général et la société sénégalaise en particulier avaient déjà procédé à des relectures du Coran. Il ne s'agissait pas tant de l'adapter à la modernité que de le mettre au registre de leurs valeurs culturelles et de leurs contextes socio-historiques propres. Même si les ulémas locaux que sont les tierno, modibo, serigne ou mallam, refusent, aujourd'hui, un débat critique sur la sharî'a, pour ne pas tomber dans le piège de la modernité, les faits sont là. Nous en donnerons quelques exemples.
On sait que l'islam, dès la disparition du Prophète Muhammad, l'interprétation des textes a fait l'objet de multiples contestations signifiant des rapports de pouvoir entre groupes. Plusieurs écoles juridiques se sont formées autour de personnalités prestigieuses [29], pour donner naissance aux malékisme, hanafisme, chafiisme, hanbalisme. Ces écoles juridiques se sont construites autour de controverses sur l'interprétation des sources. On peut constater des divergences sur une question ou une pratique donnée au sein de la même école.
Parlant de l'islam en Afrique subsaharienne, il est important de souligner que les sociétés musulmanes de cette région ne sont pas arabes, malgré la présence de populations métisses et la prégnance d'une culture arabe ou arabo-berbère. De ce fait, le vécu culturel de l'islam affiche de fortes différences. Elles se traduisent par des nuances parfois profondes au niveau des droits et des liens entre le religieux et l'environnement socio-économique. On retiendra que l'islam africain, qui est une réalité spécifique et incontournable, tout en reposant sur les cinq piliers fondateurs, ne s'est jamais assimilé à cet islam trop marqué par sa naissance dans la péninsule arabique. Il s'est enraciné, durant des siècles, dans des expériences socioculturelles propres qui ont été en rupture avec la sharî'a classique, ses règles, ses institutions et ses écoles de pensée arabe. Alors que les prières continuent d'être dites en arabe et que les récitations du Coran sont de mise, les imams et les guides religieux traduisent et commentent aussi les textes dans les langues nationales [30]. Ces traductions sont en langues africaines avec des caractères arabes ou latins : exemple du wolofal, mais aussi en pulaar, du mandeng, du hausa, etc. Elles permettent de lire et d'interpréter les textes auprès des disciples.
Les chefs religieux influents auprès des populations musulmanes, marginalisent ou excluent ce qui, dans le Coran, est trop différent, voire en opposition avec les valeurs des civilisations locales. Ils ne font généralement pas référence à la validation religieuse et juridique de l'esclavage, l'application de la loi du talion comme base d'un code pénal qui ne respecte pas l'intégrité physique de la personne humaine (lapidation à mort pour adultère, ablation de la main des voleurs, etc.). Serigne Abdoul Aziz Sy, khalife des Tijaan, avait coutume de dire, à ses fidèles, que « la sharî'a autorise ce que l'honneur (africain) refuse » [31], reconnaissant implicitement la spécificité culturelle du discours coranique, face à des valeurs vécues par les fidèles. En fait, les principales valeurs acceptées sont fondées sur l'acceptation de l'unicité de Dieu reconnue dans nombre de religions africaines, la piété, l'honnêteté, le pardon, la charité qui sous-tendent les pratiques religieuses.
Dans l'espace religieux sénégalais, on note des ruptures importantes avec l'avènement des confréries musulmanes mourides et layeen. Cheikh Amadou Bamba donne à la ville de Touba qu'il fonde au début du siècle le caractère sacré de la Mecque. Les fidèles n'ont plus besoin de se rendre en pèlerinage dans la ville sainte du Coran. Touba en prend la place. Alors que la Tijaania est encore tournée vers le monde arabo-musulman, il se démarque en fixant les termes d'un Islam plus ancré dans la culture wolof. Il utilise aussi la religion à des fins politiques et fonde une aristocratie politico-religieuse. Dans le Cap-vert, Limamou Laye, un marabout lébu, se déclare mahdi (prophète) et fonde, en 1865, la confrérie layeen essaimée entre les villages de Ouakam, Ngor, Yoff et Cambérène, sur la côte Nord de la péninsule. Dans sa profession de foi, le Khalife des Layeen supprime l'esclavage et le système inégalitaire des castes, au nom de l'égalité des hommes devant Dieu.
Pourquoi le débat sénégalais sur la sharî'a s'avère-t'il si difficile aujourd'hui, alors que l'étude de l'islam sénégalais montre que les communautés musulmanes n'ont, dans l'ensemble, pas retenu les règles de la sharî'a opposées à leurs identités culturelles et à leurs pratiques sociales. Au cœur de ce débat qui porte principalement sur la gestion patriarcale de la famille, le caractère sacré de plusieurs dispositions coraniques en rend la remise en cause délicate. L'impact du sacré est manifeste dans nombre de législations et de politiques de l'État en direction des femmes. C'est ce rapport de l'État au sacré à propos des femmes qu'étudie cette troisième partie.
3. Les femmes, l'État, et le sacré
Nombre de sociétés musulmanes sont encore régies par des législations écrites et des règles non écrites qui, dérivées d'interprétations du Coran, sont imbriquées dans les coutumes locales et acceptées ouvertement ou tacitement. Ces interprétations varient selon les lieux et les contextes et peuvent avoir un impact considérable sur la vie des femmes et l'exercice de leurs droits citoyens.
La résurgence du discours musulman, dans un Sénégal à la pratique islamique ancienne, profondément ancrée dans la culture et ‘paisible' a contribué à l'essor de nombreuses dahira [32] féminines. Certains mouvements ‘fondamentalistes' (Jama'atu Ibaadu Rahman,dahira de Madina Gounas) ont favorisé le port du voile féminin dans de nombreuses catégories de la population, pratique jusqu'alors inconnue, dans les milieux urbanisés et estudiantins. Dans la même veine, la pression sociale islamique en est arrivée à empêcher les hommes et les femmes de se serrer la main, comme c'en était l'usage. On assiste à une pratique religieuse de plus en plus ostentatoire. Les employésinterrompent leur service ou quittent les salles de réunion sous prétexte de prier à l'heure.
Le discours islamique se renforce dans les media, ainsi qu'au niveau du pouvoir politique. Le Président Abdoulaye Wade ne proposait-il pas la suppression du terme laïcité lors de l'élaboration de la nouvelle constitution, peu après son élection ? Même le sport en est imprégné. Lors des premières rencontres de la Coupe mondiale du football (mai-juin 2002), les succès de l'équipe sénégalaise qui n'était pas classée parmi les favorites ont largement été imputés à Dieu, grâce aux prières des grands leaders religieux mourides et tijaan. Les effigies des ‘stars' du football sénégalais (El Hadj Diouf, Henri Kamara, Ferdinand Coly, Khalilou Fadiga, Salif Diaw, …) ont côtoyé celles de Cheikh Bamba Mbacké et de Babacar Sy, chefs charismatiques des confréries mouride et tijaan. Jésus-Christ a lui-même fait plus qu'une timide apparition.
Quelques exemples sur le débat sur les droits des femmes illustrent la collusion entre le politique et le sacré pour renforcer le système patriarcal.
L'accès à l'école est devenu un droit élémentaire. L'école coloniale a enrôlé les fils de chefs ou otages, deux à trois générations avant de faire place aux femmes. Malgré les progrès accomplis en en matière de scolarisation des filles, dans les années 1990, le Sénégal a dû leur établir, avec l'appui d'organisations internationales dont l'UNICEF, un programme spécifique à leur intention. Le programme SCOFI [33] a pour objectif non seulement d'organiser des campagnes d'inscription, mais également de les y maintenir. Aujourd'hui il faut encore pour qu'elles n'en soient pas arrachées mineures, soit pour leur donner les tâches domestiques, soit pour les mettre sur le marché du travail ou les marier. En avril 2002, une fillette de 12 ans d'un village de la vallée du fleuve était retirée de l'école primaire pour être donnée en mariage à son cousin âgé d'une trentaine d'années, et ce malgré le refus de son père travailleur émigré et de sa mère restée sur place. Suite à de violentes hémorragies lors de la consommation du mariage, elle tombait malade et décédait quelques jours plus tard. L'affaire ne fut divulguée dans la presse, que grâce à la vigilance de la RADHO [34]. Le conjoint déféré au Parquet a été condamné à trois mois d'emprisonnement. Ni la famille, ni l'Imâm qui avait célébré le mariage n'ont été inquiétés par la justice. Pourtant le mariage n'aurait jamais dû être célébré : la fillette était mineure et non consentante. L'âge légal au mariage est fixé à 16 ans pour les filles et le consentement au mariage est obligatoire.
Depuis avril 2002, le principe de l'enseignement de la religion dans toutes écoles publiques a été accepté officiellement, sous la pression des associations islamiques. L'introduction de cet enseignement avait été une question épineuse, lors des États généraux de l'éducation de 1982, à l'avènement d'Abdou Diouf [35]. Il s'agissait clairement d'introduire l'enseignement des religions, notamment du Coran, à l'instar des établissements privés catholiques. Afin de s'assurer que les élèves musulmans apprendraient le Coran [36], on en était à lui réserver des heures en fin d'après-midi. La recommandation n'avait pas été retenue, de peur de contrevenir à la laïcité. On ne peut s'empêcher de ressentir les mêmes inquiétudes aujourd'hui. Il est évident que l'étude du fait religieux est importante dans l'éducation, si elle ne suscite pas de dérives qui enfreignent la laïcité, notamment de voir les filles contraintes à porter le voile lors des cours de Coran, d'imposer un code vestimentaire, de supprimer la mixité scolaire, de respecter les heures de prière, etc.
La loi abrogeant les mutilations génitales féminines a fait l'objet d'un immense tollé dans la société sénégalaise, avant son adoption en février 1999. L'excision, qui en est un aspect, était généralement présentée comme une pratique initiatique culturelle africaine. Dans les régions où elle est pratiquée, elle est élément marqueur de la féminité. Il a fallu plus d'une trentaine d'années de polémiques internationales pour en arriver à élaborer la loi. Au cours des débats, des arguments culturels et religieux ont été brandis contre les féministes occidentales et leurs consœurs africaines dont le discours, plus tardif, de rejet ne pouvait être qu'occidental [37]. L'argument, auquel se sont accrochés les communautés musulmanes hal pulaar, soninké et mandeng, était que les femmes non excisées étaient impures et ne pouvaient prier, d'où un fort ostracisme à leur endroit. C'est certainement la dénonciation des conséquences médicales néfastes de ces pratiques qui fait voter la loi, alors que celles qui altèrent la jouissance sexuelle sont tout aussi importantes.
C'est sur les lois relatives à la famille que l'impact du sacré est le plus marquant. Aussi, les Sénégalaises sont-elles fréquemment accusées de porter atteinte à la parole de Dieu, lorsqu'elles tentent de faire avancer leurs droits démocratiques de citoyennes, droits déniés ou non appliqués, malgré les dispositions claires et sans équivoque de l'actuelle Constitution.
Le Sénégal s'est appuyé sur l'ancien Code civil français et le Coran pour promulguer, en 1973, le premier Code de la famille de l'État indépendant. Ce Code a été vivement contesté au sein de la communauté musulmane, dès sa promulgation en 1973. On mobilisa contre ses percées. Une certaine opinion parlera de code contre la sharî'a et ses règles, contre le Musulman et sa foi. On l'accusera d'être le Code des femmes. Vingt-cinq ans plus tard, aux élections présidentielles de 2000, l'un des candidats religieux, sans doute le plus excessif, allait jusqu'à promettre sa suppression pure et simple pour rétablir la sharî'a ? Il fut sanctionné par ses faibles résultats qui ont témoigné du désaveu populaire. Ce code, que ses détracteurs dénoncent comme celui des femmes, montre, en de nombreux articles, son assise patriarcale. Chaque revendication des femmes pour en éradiquer les dispositions discriminatoires à leur endroit a été dénoncée par les hommes comme une remise en cause de la religion. Le sacré est sans cesse avancé comme argument de légitimité des emprunts à la sharî'a.
Pourtant le Code de la famille procédait du principe de miséricorde et de protection des femmes affirmée par le Coran. Il exprimait la volonté de ‘modernisation' juridique de la société sénégalaise, à partir de ses valeurs supérieures. Il était voulu par le Président Léopold Sédar Senghor qui légiférait en même temps sur la réforme administrative et territoriale et sur un domaine national qu'il estimait devoir protéger pour un usage communautaire. C'est vrai que le code protégeait les femmes. Il obligeait, notamment, les conjoints à enregistrer le mariage à l'état-civil pour assurer le consentement de la femme. Il tentait de réduire les excès d'une polygamie qui revient souvent à la simple sujétion d'épouses souvent commises pour entretenir elles-mêmes leur ménage, leur époux et leurs enfants. C'était le sens de l'option matrimoniale. La polygamie a été supprimée dans d'autres pays musulmans tels que la Turquie, la Tunisie et la Côte d'Ivoire. En Irak, la demande de polygamie doit être faite devant la justice.
Seule le juge est habilité à prononcer le divorce et à fixer les obligations réciproques et les conditions de la garde des enfants et de la pension alimentaire, etc.
Des dispositions contraignantes sont encore maintenues dans ce code dit des femmes. Certaines injustices ont été corrigées au fil des revendications féminines, toujours décriées à travers les media. Ainsi la polygamie, qui relève de la seule initiative de l'homme, même si elle est négociée par les options du code de la famille, n'a pu être supprimée. Il en sera de même pour le partage inégal de l'héritage entre garçons et filles. Et ce, au nom de la sharî'a, texte juridique qu'il ne faut pas confondre avec le Coran. Pourtant les Sénégalais et les Sénégalaises devraient savoir que :
« [si la polygamie est répandue au Sénégal, elle concernait], selon les résultats de l'EDSIII (1997), 45,5% des femmes mariées. On observait même une légère diminution de la fréquence de ces unions, car le pourcentage était de 48,5%, en 1978. Cette baisse est probablement liée à l'instruction et à l'urbanisation. On retrouve des personnes sans instruction et des femmes rurales dans les mêmes proportions (48-49%), en unions polygames. En 1992, 50,5% des femmes sans instruction, 32% du niveau de l'enseignement primaire et 29% des femmes du niveau secondaire ou supérieur étaient engagées dans la polygamie. En 1997, leur pourcentage était, respectivement, à 49,4%, 34,4% et 27,1%. Les femmes sans instruction constituent le seul groupe, dans lequel, la fréquence de la polygamie ne semble pas avoir baissé, dans la période (49-50%). De même, le pourcentage de femmes en union polygame diminue avec le degré d'urbanisation. Alors qu'en milieu rural, la baisse est de 50% à 48% de 1978 à 1997, elle se révèle plus rapide en ville, avec des taux passant de 46% à 41%, pour cette même période » [38].
Ceci pour souligner que si la polygamie est une pratique légale et religieuse, le Sénégal est aussi un pays de monogamie.
Toujours en matière de discriminations à l'endroit des femmes dans le Code de la famille, on peut citer l'ancien droit pour le mari de s'opposer à l'exercice d'une profession, par son épouse, s'il la jugeait susceptible d'entacher l'honneur de la famille. Cette clause qui ne pouvait être remise en cause que par l'intervention du juge a mis dix ans à être abolie (1984). On était à la veille de la dernière Conférence de la Décennie mondiale des femmes de Nairobi, ce qui donnait à Maïmouna Kane, Ministre chargée de la question des femmes, une écoute particulière auprès du gouvernement. Malgré cela, les journalistes (des hommes) de la presse locale [39] qui venait de se voir accorder la liberté de parole en avaient fait des gorges chaudes. Ils avaient mis de gros titres accusant les femmes de vouloir se livrer à la prostitution, en rejetant le droit de ‘veto' conjugal à leur emploi. Aujourd'hui, les ménages sénégalais ont de plus en plus besoin des revenus de tous leurs membres et ne peuvent plus se priver de celui de l'épouse. Le droit de l'homme d'autoriser sa femme à sortir du territoire national, quel que soit son statut professionnel, n'est devenu caduc qu'avec la suppression de l'autorisation de sortie pour tous les Sénégalais, à l'avènement de la présidence d'Abdou Diouf, en 1981.
Contre toute attente, certains consulats, dont celui de la France, continuent, à leur manière de l'exiger, en demandant un certificat de mariage et l'attestation des biens du mari. Les célibataires ont peu de chance d'obtenir un visa, à cause de leur statut. Enfin, les revendications féminines ont permis de négocier, avec la première révision du Code de la famille, en 1984, la fixation du domicile conjugal qui relevait uniquement de l'autorité maritale.
Ce que les personnes qui s'opposent à la loi redoutent le plus, c'est fondamentalement le contrôle, par les femmes elles-mêmes, de leur propre corps, de leur sexualité et de leur fécondité. Ce contrôle de la fécondité que permet l'utilisation de méthodes contraceptives fait régulièrement réagir. Les agences internationales comme le FNUAP qui encouragent la planification des naissances sont accusées de vouloir dépeupler la planète et d'avoir trompé les Sénégalais et leurs guides religieux et d'avoir agi contre la volonté divine [40]. En effet, l'utilisation de la contraception donne en même temps aux femmes le pouvoir de contrôler leur fécondité : choix de faire (ou de ne pas faire) d'enfants, la décision du nombre, l'espacement des naissances, etc. Il est vrai que l'islam autorise l'espacement des naissances et même l'avortement à des fins exclusivement thérapeutiques [41]. C'est la position des chefs religieux qui, malgré tout, ne s'accommodent pas de la maîtrise par les femmes de leur sexualité et de leur fécondité.
Au-delà du désir propre d'enfant, la maternité reste une obligation du mariage. On attend d'elles qu'elles assurent leur fonction de reproduction. La femme stérile sera marginalisée, car elle ne contribue pas à la « fabrication » de cette descendance nombreuse que tout homme « doit » avoir, pour assurer sa masculinité et asseoir son pouvoir social. Dans la société hausa, comme dans nombre de sociétés africaines, « l'accumulation d'enfants participe de manière active à l'acquisition de prestige » [42]. Ce prestige passe par le corps des femmes, dont la sexualité et la fécondité sont contrôlées par des règles sociales définies dans chaque groupe : virginité, circoncision, surveillance, mariage, soumission au désir du conjoint, gestion de la fertilité, etc. D'où la difficulté à discuter de la fécondité non en termes médicaux, mais en termes de droit élémentaire à faire des enfants et à décider du nombre pour celles qui les portent, en accouchent et les entretiennent. Malgré les injonctions du Vatican, les Italiennes ont détiennent actuellement le taux de natalité le plus bas d'Europe.
Le débat actuel sur l'autorité parentale est un autre exemple qui illustre la collusion entre le politique et le sacré pour renforcer le système patriarcal. Plusieurs articles ont été comme des cris du cœur exprimant l'indignation d'une partie de l'opinion sénégalaise devant les requêtes de liberté et d'égalité des Sénégalaises [43].
La proposition de loi sur l'autorité parentale est en instance de vote, depuis 2001. La question est débattue dans les familles, dans la presse, au cours de débats laïcs ou religieux dans les radios et à la télévision. La loi veut remédier à la situation actuelle en passant de l'autorité paternelle, dans laquelle le père de famille est seul responsable légal de l'enfant à l'autorité parentale. L'autorité maternelle n'est légale que si le père est décédé ou déclare son incapacité à le prendre en charge. En cas, il doit en faire la déclaration devant le juge.
La revendication de l'autorité parentale n'est pourtant que l'une portant sur les discriminations affectant les femmes mariées. Les associations professionnelles et syndicats de femmes dénoncent aussi bien le caractère discriminatoire de l'impôt des salariées que la difficulté de prendre en charge leur famille en termes de sécurité sociale. L'impôt est individuel et est prélevé à la source par l'employeur. L'épouse salariée ne peut bénéficier des déductions sur l'impôt dues au nombre d'enfants, comme son mari. Elle est imposée comme célibataire sans enfant. Elle ne peut prendre en charge médicalement, ni ses enfants, ni son conjoint, car elle n'est pas le chef de famille. Les détracteurs de la proposition de loi sur l'autorité parentale, qu'il s'agisse departiculiers ou d'associations islamiques, accusent ouvertement les femmes de vouloir rejeter, par toutes ces revendications, l'autorité maritale. Ici le Code de la famille ne fait que respecter les prescriptions coraniques qui renforcent le pouvoir des hommes sur les femmes.
Plus que l'abolition de la puissance paternelle et de l'autorité maritale, ce qui est mis en cause relève de la reconnaissance et l'établissement de l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. Cette égalité a été garantie par toutes les constitutions depuis l'indépendance ; elle est renforcée par celle de l'an 2001, votée par la majorité des Sénégalais. Plusieurs articles sur l'accès à l'éducation, à l'emploi ou à la terre, par exemple, font une mention explicite de l'égalité entre hommes et femmes. La source de nombreuses contraintes subies par les femmes dans l'espace familial et qui a souvent des répercussions dans l'espace public provient de deux articles du Code de la famille qui déterminent que l'homme est le chef de la famille et que la femme lui doit soumission et obéissance. L'anti-constitutionalité de ces deux articles a été dénoncé par les Sénégalaises, renforcées dans leurs convictions par les dispositions de la nouvelle constitution, votée lors d'élections transparentes.
Le 11 juillet 2003, l'Union africaine adoptait le Protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l'homme relatif aux droits des femmes qui résulte d'une longue lutte des femmes pour leurs droits au niveau continental. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, agréée en 1993, ne faisait aucune place particulière aux préoccupations des femmes, d'où la nécessité d'ajouter un protocole spécifique qu'il a bien fallu une dizaine d'années à mettre en place. Le Protocole reconnaît les droits des femmes à l'accès égal à l'emploi et au salaire (equal pay for equal work), au congé de maternité dans les secteurs public et privé. Il met un accent particulier sur la protection des femmes handicapées et en détresse, femmes âgées, veuves, femmes en détention, etc. Mais dans le domaine des droits sexuels et reproductifs que les acquis sont le plus marquants, notamment le droit à l'avortement en cas de viol et d'inceste, l'abolition des mutilations génitales féminines, et la protection contre les violences physiques et sexuelles. Le Protocole attend encore d'être ratifié par les États.
La famille dont se prévalent les religieux et les politiques n'existe plus, même en milieu rural. Les données ont changé sous l'impact des diverses transformations sociales, pas toujours négatives depuis l'indépendance, pour prendre une date récente. L'urbanisation, la scolarisation, les nouvelles activités économiques, les changements juridiques et politiques ont aussi contribué à changer la famille sénégalaise. D'aucuns souhaitent que les hommes continuent de s'accrocher à la domination masculine, en évoquant comme dernier recours, non plus l'esprit du Livre saint, mais sa littéralité. Cela, pour pouvoir exercer ‘pleinement' une autorité légitimée par la culture et les religions du Livre. La réalité sociale incontournable est que l'on compte de plus en plus de femmes chefs de famille. Nombre d'entre elles couvrent les hommes du pagne de la sutura(pudeur). Ce rôle est renforcé à la fois par les progrès de l'éducation, l'initiative féminine et l'aggravation actuelle de la crise économique et de la pauvreté.
Conclusion
Le débat sur l'exigence de laïcité face à une certaine réislamisation agressive et intolérante des sociétés africaines et sénégalaise en particulier est essentiel quand on lutte pour l'égalité entre les sexes et l'avancement du statut des femmes. Les liens entre l'État et la religion, le politique et le sacré sont complexes dans une société où la religion et la culture sont profondément imbriquées. Le soubassement religieux qu'il soit préislamique, islamique ou chrétien reste tissé dans les actes de la vie quotidienne.
La résurgence du discours musulman dans le monde a eu des impacts considérables alors que la laïcité, comme principe de base avait accusé des progrès en matière de lois. A ce niveau, les femmes restent prises entre un État chargé de garantir l'égalité entre citoyens et une élite religieuse, dont le souci est de préserver un ordre patriarcal révélé et immuable. La famille est le dernier bastion à prendre. Seule la laïcisation de l'État et celle de ses lois peut résoudre la contradiction.
Fatou Sow [1]
in Muriel Gomez-Perez (dir.) L'Islam politique en Afrique subsaharienne, Karthala, Paris, 2007.
[1] Chercheure au CNRS, membre du Laboratoire SEDET, Université Paris 7 Denis Diderot.
[2] SOS–Esclaves, fondé en 1995, en Mauritanie, par Boubacar Messaoud, architecte d'origine harratine, dénonce « Le vide juridique ainsi maintenu favorise la perpétuation de la pratique d'esclavage en toute impunité, d'autant plus que les esclaves ne disposent d'aucune juridiction de recours et qu'aucun texte ne prévoit des pénalités criminelles contre ceux qui pratiquent l'esclavage. »
[3] Rappelons que le code civil a lui-même été en butte aux revendications de l'Église, dans la mesure où il rendait le mariage civil obligatoire avant la célébration religieuse, pouvait remplacer le mariage religieux, autorisait le divorce, etc.
[4] Women Living under Muslim Laws / Femmes sous lois musulmanes. Femmes et lois, Initiatives dans le monde musulman. « Femmes, lois, initiatives dans le monde musulman ». Débats tirés de la réunion internationale : Sur le chemin de Beijing : Femmes, lois et statut dans le monde musulman, 11-12 décembre 1994, Lahore (Pakistan), Montpellier, WLUML, 1996, p.7.
[5] Sourdel, D. L'Islam, Paris, PUF, 1984, p. 42.
[6] Ramadan, T. Islam, Le face à face des civilisations. Quel projet pour quelle modernité ? Lyon, Editions Tawhid, 2001, p. 64.
[7] Tincq. H. « La montée des extrémismes dans le monde » in Delumeau, J., (sous la dir. de), Le fait religieux, Paris, Fayard, 1993, p. 716.
[8] Les deux décennies mondiales des Nations Unies pour la femme ont été ponctuées de grandes conférences : Mexico (1975), Copenhague (1980), Nairobi (1985) et Beijing (1995). Les débats contradictoires menés par les femmes, au cours de ces conférences, ont influencé les débats et les décisions sur la contraception, l'avortement et la liberté sexuelle comme à la conférence sur la Population et le développement du Caire (1994). C'est la première fois que les questions démographiques étaient discutées en termes de droits sexuels et reproductifs.
[9] L'abacos (à bas le costume) était un veston à col fermé à porter sans cravate. Le pagne féminin s'esttransformé en jupe longue. Il était interdit aux femmes de porter une robe ou jupe courte, et un pantalon.
[10] Les dispositions utilisées ne sont pas une application stricte de la sharî'a.
[11] Des confréries ont donné, à leurs tâlibés, des consignes (ndigël mouride) de vote en faveur de candidats, lors d'élections présidentielles. Falilou Mbacké, khalife des mourides dans les années 1960, donnait un ndigël discret en faveur de Léopold Sédar Senghor. Ce ndigël prit une dimension que l'on a pu juger outrancière, tant il détonnait sur la prudence habituelle des mourides. Serigne Abdou Lahad Mbacké, khalife des mourides, affirmait à ses fidèles, notamment lors des élections présidentielles de 1988 :
« Voter pour Abdou Diouf, c'est suivre les recommandations de Serigne Touba ». Les dirigeants de la confrérie tijaan, tout en appuyant les hommes du pouvoir, ont généralement été plus mesurés, du fait de la plus grande autonomie de leurs fidèles, surtout urbains
[12] Commémoration du départ en exil forcé de Cheikh Amadou Bamba Mbacké, fondateur de la confrérie mouride, en 1906.
[13] La visite du candidat Abdoulaye Wade, au lendemain de sa victoire aux élections présidentielles, pour remercier son marabout, l'actuel khalife de la confrérie des mourides de ses prières avait été diversement commentée par les Sénégalais, comme en ont témoigné les media de l'époque relatant ces évènements.
[14] P
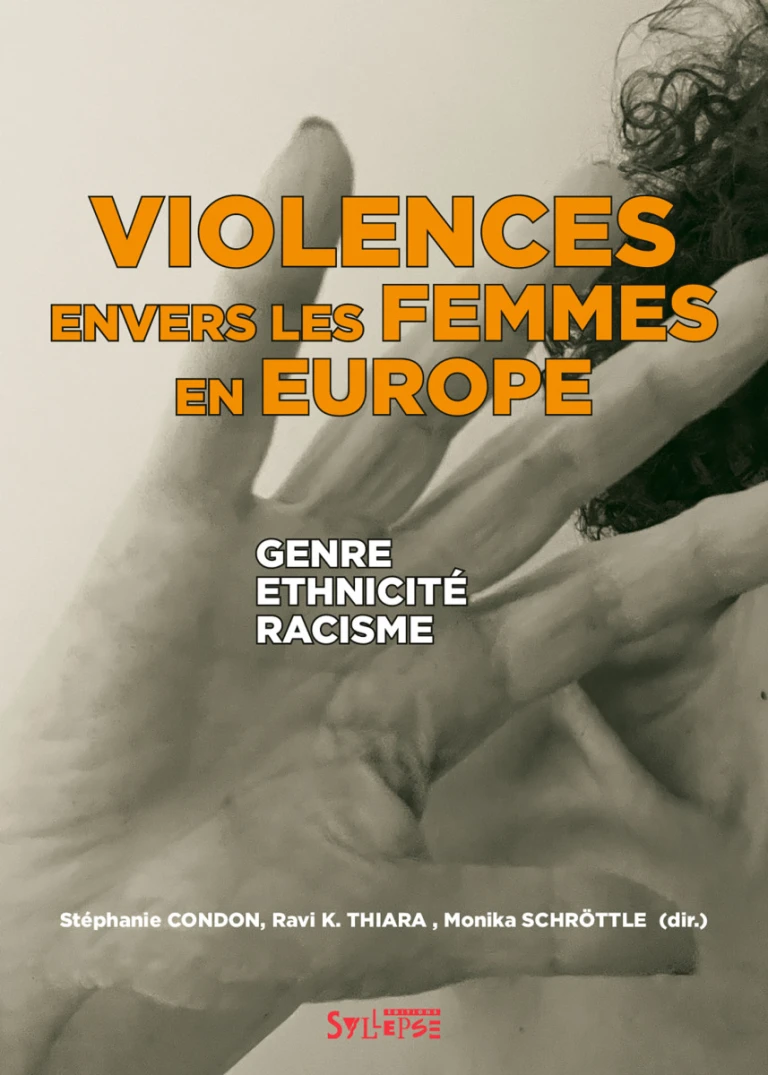
Introduction par les coordinatrices du livre : Violences envers les femmes en Europe
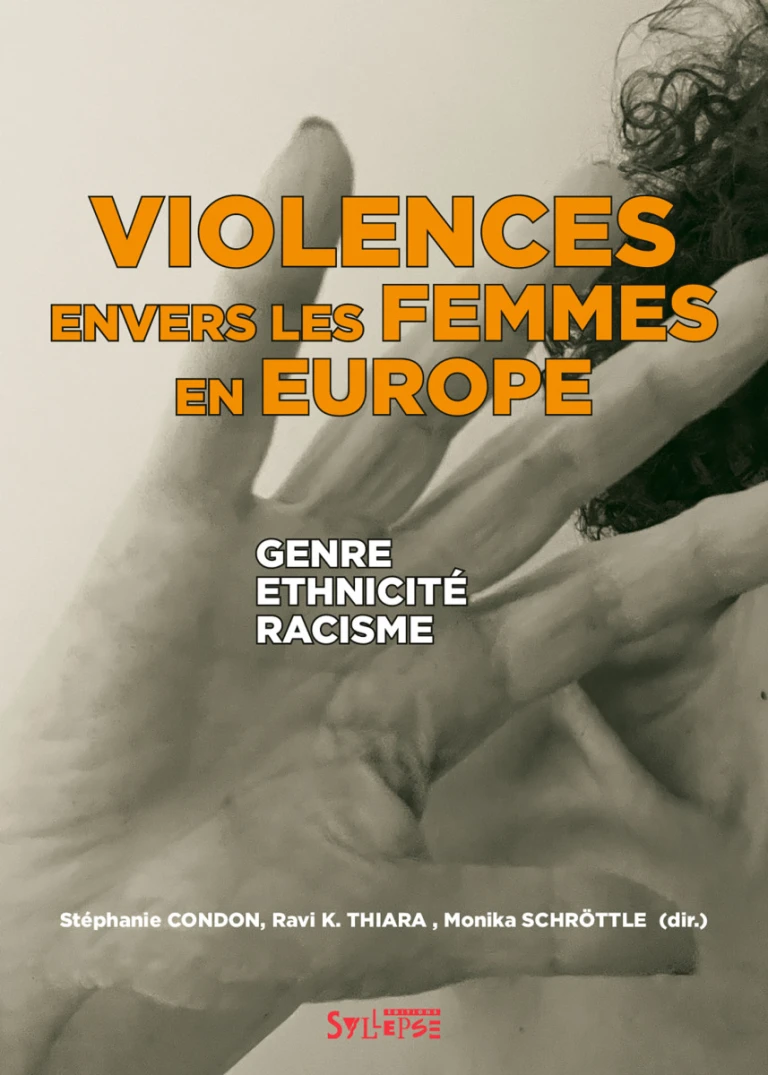
L'idée de ce recueil, le premier à réunir des travaux de recherche et des écrits consacrés aux liens entre les violences faites aux femmes et la thématique de l'« ethnicité » en Europe, a pris forme en 2005, lors de conversations entre les coordinatrices. Elles participaient alors au projet européen d'action de coordination sur les violations des droits humains (Cahrv), financé par la Commission européenne et dont l'objectif principal a été d'ancrer la question des violences faites aux femmes sur l'agenda européen.
Tiré de Entre les lignes et les mots
À cette époque-là, dans bon nombre de pays européens, les universitaires et pouvoirs publics commençaient à peine à s'intéresser aux violences à l'encontre des femmes sous l'angle de l'ethnicité, et cette question n'était évoquée qu'à la marge dans les débats plus larges sur les violences de genre. C'est donc la préoccupation vis-à-vis de l'absence de visibilité de la thématique des violences faites aux femmes et de la condition des femmes migrantes ou des minorités immigrées ou « ethniques », et aussi le fait que ces femmes étaient rarement présentes pour exposer ces questions lors des conférences européennes et d'autres événements consacrés aux violences envers les femmes, qui ont motivé l'élaboration de ce volume.
Comme l'ont démontré de nombreux travaux de recherche et l'évolution de la prise en compte de la question dans les politiques publiques, les violences faites aux femmes sont extrêmement répandues, et coûtent chaque année plusieurs milliards aux services sociaux, judiciaires et de santé. Le coût humain dont elles s'accompagnent, qui va des problèmes de santé chroniques, des blessures graves, de la détresse mentale et affective jusqu'aux décès, est encore plus lourd que leur coût économique. La reconnaissance du caractère persistant de ces violences et de leur coût pour la société, le militantisme concerté de la part des mouvements de défense des femmes, ainsi que les évolutions dans les instances internationales, au sein des Nations unies, notamment, ont commencé à influer sur les mesures prises pour remédier à ce problème en Europe. Au début des années 1990, à la suite de l'adoption de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (Cedaw) ainsi que de la Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, les Nations unies ont assimilé les violences à l'encontre des femmes à une violation des droits humains. Cette évolution a culminé avec la création du mandat de « rapporteuse spéciale » des Nations unies chargée de la question de la violence contre les femmes (UNSRVAW), laquelle a pour mission de surveiller la situation dans ce domaine à travers le monde (UNSRVAW, 2009). Non sans difficultés, ce mandat de rapporteuse spéciale instauré en 1994 a donné l'élan et l'impulsion nécessaires pour que les autorités nationales s'attaquent aux violences faites aux femmes, dont la définition et l'étendue évoluent au fil du temps. De plus, lors de sa conférence ministérielle de Rome en 1993, le Conseil de l'Europe a explicitement reconnu que l'élimination des violences faites aux femmes jouait un rôle central dans le respect de la démocratie et des droits de la personne humaine. De manière générale, bien que les violences à l'encontre des femmes ne soient plus considérées comme une affaire strictement familiale, elles n'en demeurent pas moins un problème inextricable, malgré des évolutions et des avancées non négligeables dans de nombreux pays, y compris en Europe.
Si les rapports sociaux ethnicisés et le genre ne peuvent pas être réduits respectivement à la question des minorités ethniques1 ou à celle des femmes, le présent recueil étudie l'ethnicité et les violences faites aux femmes sous l'angle des problèmes des femmes migrantes et appartenant à une minorité ethnique subissant des violences de genre. Ce recueil est le premier de ce type et il rassemble une grande partie des travaux existants sur ce sujet. De ce fait, il remédie en quelque sorte au silence qui régnait jusqu'ici sur ces questions et à leur marginalisation, ainsi que du socle de savoirs fragmenté dans ce domaine. Il apportera ainsi une contribution aux débats sur les idées, sur les politiques publiques et sur la pratique dans de nombreux pays d'Europe.
Migration et ethnicité
Dans la plupart des pays européens, on retrouve une population de migrants récents qui côtoie des descendants de migrations plus anciennes, la majorité de ces derniers étant citoyens européens. La diversité de ces populations est le résultat de courants migratoires de provenances différentes, se produisant au cours de périodes et donc dans des contextes sociopolitiques et économiques distincts. Le tableau est notamment marqué par les relations historiques entre les anciennes puissances coloniales et les territoires colonisés, qui expliquent les flux depuis les ex-colonies vers les anciens pays colonisateurs. Le rôle des femmes dans ces processus migratoires n'a pas toujours reçu une grande attention de la part de la recherche, bien que la féminisation de la migration en direction de nombreux pays européens soit mise en évidence depuis le début des années 19802.
De même que la migration, les dynamiques et la composition de minorités ethniques présentent des différences d'un pays européen à l'autre, on observe également des disparités dans les politiques publiques et dans le discours officiel à propos de l'incorporation de ces minorités dans la société d'accueil, fréquemment dominé par le débat assimilation/intégration contre multiculturalisme, ainsi que dans l'accueil que leur réserve la population majoritaire (Favell, 1998). Les modes d'intégration institutionnelle des immigrés et leurs descendants ont, à leur tour, façonné les moyens utilisés pour s'auto-organiser et militer contre leur marginalisation. Par exemple, au Royaume-Uni, forts de leur expérience de la lutte contre le colonialisme, les migrants caribéens ou sud-asiatiques ont entrepris très tôt de s'organiser et de créer des formations politiques afin de contester le traitement discriminatoire dont ils faisaient l'objet. Dans le cadre de ce mouvement, les féministes noires ont aussi commencé à mettre sur pied leurs propres organisations autonomes dès le début des années 1970. Quelques-unes de ces organisations existent encore et jouent un rôle essentiel dans la lutte contre les violences faites aux femmes migrantes ou des minorités ethniques. Pour des raisons historiques et politiques, dans de nombreux pays européens, ces femmes ne se sont pas aussi bien organisées qu'au Royaume-Uni et cette question reste considérée comme marginale. Malgré ces différences non négligeables, on peut également déceler de nombreuses similitudes dans la construction de l'immigrant comme « autre » et dans les discours y afférents.
Genre, ethnicité et violences faites aux femmes
À quelques exceptions près, de nombreux chercheurs ont relevé une séparation entre les approches exclusivement théoriques et empiriques dans l'étude des relations entre genre et ethnicité en Europe3. Des travaux importants ont été consacrés à la question du genre et de l'ethnicité. Ils ont été influencés par les développements théoriques dans les études sur la « race » et les études ethniques, ainsi que par le féminisme postcolonial, lequel a cherché à contester la construction négative et homogène des femmes migrantes et appartenant à une minorité ethnique (Lutz, 1997). Dans le corpus théorique plus large sur l'ethnicité et le genre dans une grande partie de l'Europe, malgré l'abondance de la littérature consacrée au thème de l'immigration et de l'ethnicité, l'étude des liens entre genre, ethnicité et violences faites aux femmes brille par son absence (Condon, 2005).
Les violences faites aux femmes, que l'on ne désigne pas toujours sous ce terme, constituent une priorité des luttes féministes en Europe depuis les années 1970. Cependant, ces luttes peuvent revêtir des formes variables, suivant l'environnement local et les influences internationales, de même que la nature et les objectifs des mouvements de défense des femmes et de lutte contre les violences qu'elles subissent. Les évolutions, y compris au niveau législatif, ainsi que les mesures juridiques et d'aide visant à combattre ces violences, varient également d'un pays d'Europe à l'autre, mais sur ce continent, c'est essentiellement aux violences conjugales que l'on s'attache4. Tous les pays n'interviennent pas de la même manière pour aider les femmes victimes de violences. Par exemple, en Autriche et en Allemagne, les centres d'accueil des victimes de violences conjugales sont gérés par des organisations non gouvernementales (ONG) mais financés par les ministères fédéraux de l'intérieur, des affaires sociales et de la Famille. Aux Pays-Bas, les victimes reçoivent une aide spécialisée dans des centres d'aide polyvalents. Au Royaume-Uni, Women's Aid, une fédération de refuges indépendants et d'autres formes de services d'aide aux victimes de violences conjugales, ainsi que Refuge, organisation nationale proposant des services à l'échelon local, demeurent les principales sources de soutien5. Au lieu de s'intéresser aux détails des mesures prises pour aider les migrantes subissant des violences en Europe, le présent recueil s'attache à l'impact de ces mesures, au niveau à la fois symbolique et matériel, sur les femmes migrantes ou des minorités ethniques subissant des violences sous toutes leurs formes.
En Europe, plusieurs études se penchent sur la question des violences faites aux femmes dans divers contextes nationaux et renferment des données intéressantes6. À quelques exceptions près (voir la contribution de Condon, Lesne et Schröttle dans le présent recueil), ces études ne s'intéressent pas à la place des femmes migrantes ou des minorités ethniques dans ces débats et ces évolutions. Le programme Daphné, qui finance de nombreux projets de recherche sur les violences conjugales et les violences faites aux femmes, apporte, lui aussi, des informations précieuses (Commission européenne, 2009). Globalement, dans la majeure partie des débats sur l'ethnicité et l'immigration ainsi que sur le genre et les violences faites aux femmes, les femmes migrantes ou des minorités ethniques sont, soit absentes, soit occupent une place marginale, ou, depuis peu, sont construites et représentées de manière particulière. Ce n'est que récemment que certains chercheurs se sont mis à étudier les problèmes spécifiques rencontrés par ces femmes. Leurs travaux ont donné lieu à des publications qui commencent à mettre en évidence ces interdépendances et ces intersections7. D'ailleurs, il est vrai qu'à l'exception des travaux rassemblés dans le présent recueil, les recherches et les informations disponibles en Europe sont extrêmement restreintes, si bien que le socle de savoir est très inégal d'un contexte à l'autre. Les données qui existent portent souvent sur l'expérience de formes de violences culturellement spécifiques ou construisent les violences faites aux femmes davantage comme une question de culture que de genre. Le Royaume-Uni, où l'histoire de l'immigration et du militantisme est plus ancienne pour les femmes migrantes ou des minorités ethniques, constitue peut-être une source d'informations et de savoir plus riche à cet égard.
En abordant la question des violences faites aux femmes dans différents groupes et contextes nationaux, la rapporteuse spéciale chargée de la question de la violence contre les femmes (SRVAW) joue un rôle significatif car elle élargit et nuance le débat sur les causes et les conséquences de ces violences, ainsi que sur la responsabilité des États dans le traitement des vastes effets de ces violences sur différentes catégories de femmes. Par exemple, en contestant le clivage public/privé et en « élargissant la responsabilité de l'État au-delà des acteurs privés pour les actes de violence commis dans la sphère privée », la SRVAW demande aux États de remédier aux facteurs extérieurs qui exacerbent les violences conjugales pour des catégories particulières, y compris le racisme, la marginalisation socio-économique et les politiques d'immigration restrictives (UNSRVAW, 2009 : 12). Dans des pays tels que la Suède, dotés d'une politique d'égalité de genre bien établie, cette évolution s'est traduite par un appel à remédier aux lacunes restantes pour atteindre l'égalité ainsi qu'aux carences de la protection de certaines catégories de femmes, y compris les immigrées, les réfugiées ou les demandeuses d'asile. Aux Pays-Bas, l'attention se porte non seulement sur les actions de l'État neutres du point de vue du genre (dans le cadre de l'approche de l'intégration systématique de la dimension de genre, également appelée gender mainstreaming), mais aussi sur les « réactions culturelle essentialistes » (ibid. : 13) aux violences dans les communautés de migrants. De manière générale, on estime que pour être efficaces, les ripostes aux violences faites aux femmes requièrent des « stratégies multifacettes » face aux multiples formes de violence, et notamment une révision de la législation qui interdit aux femmes d'accéder à une aide et à une protection en raison de leur statut d'immigrées8.
Le présent recueil intègre les discours parallèles sur les violences faites aux femmes et l'ethnicité en Europe afin d'étudier cette question du point de vue particulier des femmes migrantes ou des minorités ethniques. Bien que pour certains pays, le corpus de données soit plus fourni que pour d'autres, la sélection des contributions s'est attachée à mettre en lumière les expériences de plusieurs pays, même s'il reste de nombreuses disparités. Par conséquent, les débats diffèrent et dans certains pays, l'expérience des femmes migrantes ou des minorités ethniques commence à peine à être rapportée tandis que dans d'autres, le débat est inextricablement lié aux critiques plus larges adressées à la politique, à l'action publique et à la pratique, tant générales que dans le domaine de la lutte contre ces violences. Bien que les données sur lesquelles les expériences des violences et sur le recours à l'aide juridique ou sociale soient extrêmement limitées, les recherches montrent que ces femmes connaissent davantage l'exclusion et pâtissent d'un accès nettement réduit aux recours juridiques par rapport aux femmes immigrantes en situation régulière. Une étude autrichienne montre que les immigrantes sont souvent dans l'incapacité de contacter la police parce qu'elles ne parlent pas la langue ou parce qu'elles ont peur de faire intervenir les autorités9. De nombreuses femmes migrantes demandent donc de l'aide aux refuges ou aux centres d'accueil pour femmes, dans lesquels elles sont souvent surreprésentées10. Or, cette surreprésentation en amène certains à affirmer que les femmes migrantes ou des minorités ethniques ne rencontrent guère de problèmes pour accéder à l'aide. Cependant, ces arguments ignorent que la majorité des femmes européennes (blanches) ont souvent davantage recours à d'autres actions et mesures que les femmes migrantes ou des minorités, qui sont socialement et économiquement marginalisées, qui dépendent davantage des hommes et de leur famille et dont les possibilités sont probablement réduites. Ainsi, le statut d'immigrée, ou l'absence de citoyenneté, demeure l'une des principales causes des inégalités dans l'accès à la protection pour les femmes victimes de violences en Europe. Les pays ont adopté des textes et une législation variés à ce sujet. Par exemple, l'étude du Cahrv considère que l'immigration constitue une « quatrième planète » qui détermine l'accès des femmes à la justice et à la protection (Humphreys et col., 2006). En effet, le statut d'immigrée prolongé revient à une violation des droits humains et ne protège pas les femmes contre les violences. De plus, sous prétexte de protéger les femmes contre les violences, réelles ou potentielles, y compris le mariage forcé, les pouvoirs publics restreignent l'immigration (Bredal, 2005).
Toutefois, aucune étude n'a encore été menée à l'échelle européenne pour faire le point sur la nature des réponses aux problèmes des femmes migrantes et appartenant à une minorité ethnique. Faute de ces données, il est difficile d'affirmer avec une quelconque certitude que l'on répond correctement aux besoins d'aide et de protection de ces femmes. Même dans les pays qui communiquent sur les mesures prises pour remédier aux problèmes des migrants et desminorités ethniques, les évolutions récentes laissent à penser que ces mesures s'érodent plus qu'elles ne se renforcent. Le présent recueil a pour objectif de constituer un socle de savoir plus cohérent sur ce qui se passe à l'intersection entre ethnicité, genre et violences faites aux femmes, tout en axant résolument le cadre du discours sur ces violences sur les spécificités des femmes migrantes ou des minorités ethniques. Il cherche également à mettre en évidence la complexité et les interconnections entre les différentes catégories de violences dont sont victimes les femmes. Les contributions présentes dans ce recueil permettent également de comprendre l'absence d'écrits sur ces questions par les femmes de ces minorités dans de nombreux pays d'Europe. Si des lacunes demeurent et qu'il faut pousser bien plus avant les recherches pour explorer la spécificité des violences vécues par ces femmes, ainsi que les réponses apportées à ces violences, ce recueil décrit les particularités de plusieurs contextes européens s'agissant de la construction des discours sur les violences faites aux femmes et l'ethnicité. Ces discours revêtent des formes distinctes en Europe, bien que l'on observe également des traits communs. Par ailleurs, depuis peu, on souligne de plus en plus, quoique de manière essentialiste, la discrimination intersectionnelle, qui exacerbe les risques pour les femmes appartenant à des communautés marginalisées ou racialisées.
Violences faites aux femmes et ethnicité
L'intersection entre violences faites aux femmes et ethnicité donne lieu à un débat intéressant depuis quelques années. Les violences perpétrées sur les femmes immigrées ou leurs descendantes sont devenues un thème récurrent dans les débats politiques, dans l'élaboration de l'action publique et dans les médias. Cela étant, on reproche dans une large mesure à ces débats de considérer les cultures et les communautés migrantes/minorisées de manière essentialiste et de les percevoir comme intrinsèquement violentes11. D'ailleurs, la rapporteuse spéciale a problématisé cette approche en ces termes :
La particularisation des violences conjugales entre immigrants non occidentaux comme une question culturelle [est] problématique, car elle ramène la relation entre désavantage socio-économique et politique restrictive de l'immigration à celle des violences dans la famille (UNSRVAW, 2009 : 13).
La progression du fondamentalisme religieux et du « terrorisme musulman », avec la panoplie des mesures sécuritaires adoptées depuis le 11-Septembre et les tendances politiques conservatrices qu'elle a alimentées, ajoute un angle particulier aux débats sur les violences à l'encontre des femmes migrantes et appartenant à une minorité ethnique. La polarisation entre les pays et les communautés, qui s'est accentuée après le 11-Septembre, procure un terreau fertile pour les discours culturels qui remettent gravement en question l'égalité de genre et les droits des femmes, à la fois au sein de leur communauté et dans les discours nationalistes extérieurs12. Ainsi, dans certains contextes nationaux, les discours sur les « pratiques traditionnelles néfastes », telles que le mariage forcé, les violences perpétrées au nom de l'honneur et les mutilations génitales, se tiennent parfois en parallèle de façon distincte à celui sur les violences faites aux femmes, malgré les tentatives de nombreuses femmes migrantes ou des minorités ethniques et d'autres mouvements féministes de contrer cette évolution et de conceptualiser ces pratiques comme des violences de genre dans laquelle l'intersection entre culture et genre est prépondérante13.
Il est possible de cerner et problématiser deux tendances dans les discours « culturels14 ». D'un côté, on distingue les arguments, sous-tendus par le relativisme culturel, qui rejettent les droits humains universels et portent atteinte à l'égalité des femmes (exprimés depuis l'intérieur des « communautés culturelles »). De l'autre, on discerne des approches essentialistes culturelles, lesquelles, dans le processus d'altérisation, perçoivent certaines cultures, certaines communautés et certains pays comme intrinsèquement et uniformément toxiques pour les femmes, perception qui s'est imposée dans l'imaginaire populaire dans une grande partie de l'Europe. Cette perception sert également à concevoir les violences dans les sociétés majoritaires comme des aberrations individualisées15. Ces deux tendances placent les femmes migrantes et appartenant à une minorité ethnique, subjectivement et structurellement, dans des positions extrêmement difficiles et contradictoires. De plus, ces réactions n'améliorent pas le sort de ces femmes, qui se retrouvent souvent contraintes de nier certains aspects de leur culture et de leurs traditions auxquelles elles sont attachées pour être construites comme des victimes des violences dites « traditionnelles » et patriarcales. Il ne reste ainsi à ces femmes guère de possibilités, car beaucoup d'entre elles veulent être protégées contre les violences perpétrées par les hommes sans faire le choix de « sortir » de leur communauté (Gill et Mitra-Khan, 2010). Ensemble, ces deux perspectives ne remédient en rien aux causes sous-jacentes des violences que subissent les femmes. Afin d'établir des connexions au sein de ce thème et entre différentes femmes et les violences faites aux femmes, ce recueil souligne l'importance d'exposer les schémas de domination au sein des cultures plutôt que les différences entre les cultures, d'interroger les interprétations hégémoniques de la culture et de s'intéresser aux intérêts politiques et socio-économiques patriarcaux, intérieurs et extérieurs, qui bénéficient de ces interprétations. Dans certains pays, les migrants et les minorités ethniques se sont ménagé un troisième espace pour se faire entendre et ont même été les premiers à critiquer la montée du fondamentalisme religieux (comme au Royaume-Uni via le groupe Women Against Fundamentalism).
Ainsi, les discours « culturels » (qu'ils soient relativistes culturels et essentialistes culturels) s'opposent aux droits des femmes et maintiennent l'ordre patriarcal, d'un côté, tout en « figeant » les communautés culturelles par des constructions homogénéisantes, de l'autre. Ce point est étudié plus en détail à la section consacrée au clivage « leur » culture, « notre » honneur dans la dernière partie de ce recueil. D'ailleurs, comme on le voit dans plusieurs pays d'Europe, l'essentialisme culturel sert à justifier l'action ou l'inaction de l'État face aux violences subies par les femmes migrantes ou des minorités ethniques. En mettant en avant des discours renforçant l'idée que ces femmes sont davantage touchées par les violences, certains États européens resserrent leur politique d'immigration sous prétexte de protéger ces femmes. Ils imposent aussi des critères d'intégration sociale et culturelle qui ne tiennent aucun compte de la marginalité politique et socio-économique de ces femmes (Hester et col., 2008).
Culture contre genre
Comme indiqué plus haut, l'utilisation de la « culture » par certains projets politiques culturo-religieux, qui recourent à des justifications culturelles pour restreindre les droits des femmes, est de plus en plus documentée et critiquée. Les auteurs féministes s'inquiètent tout particulièrement de voir que les pouvoirs publics et les acteurs politiques, et parfois les féministes, acceptent non seulement les voix patriarcales dominantes au sein des communautés qui marginalisent les voix (divergentes) des femmes, mais aussi un point de vue qui privilégie la culture pour justifier les violences à l'encontre des femmes migrantes ou des minorités ethniques (comme au Royaume-Uni par exemple16). D'ailleurs, certains travaux insistent sur l'importance et sur l'intérêt de mettre en avant la voix des femmes à titre de contre-récit qui exprime la contestation au sein des communautés et perturbe les explications homogénéisantes de la culture, par opposition aux interprétations hégémoniques de la culture et de l'identité, qui peuvent servir à restreindre les espaces laïcs (Patel et Siddiqui, 2010). Ces récits concurrents émanant des femmes font apparaître que « la menace pour les droits humains des femmes vient du monopole de l'interprétation et de la représentation de la culture détenu par une poignée de puissants et non de la culture elle-même » (UNSRVAW, 2009 : 29)
Depuis un certain temps, des auteurs soulignent le rôle d'entrepreneurs culturels joué par les femmes, qui n'ont de cesse de négocier et de renégocier les normes et valeurs culturelles, ce qui se traduit, dans le contexte de la migration, par des formes culturelles syncrétiques ou hybrides. C'est la raison pour laquelle il importe de considérer la culture comme un terrain non pas statique, mais en évolution permanente, perpétuellement contesté et renégocié. Considérer uniquement les femmes migrantes et appartenant à une minorité ethnique comme des « victimes » de leur culture, ce qui constitue un point de vue largement contesté, dessert par conséquent le rôle positif que la culture joue aussi dans la vie de beaucoup de ces femmes. De plus, la vision simpliste de femmes victimes d'une culture dont il faudrait les protéger, qui est la résultante logique de l'acceptation de l'argument des « pratiques traditionnelles néfastes », est largement remise en cause, car elle essentialise les communautés de migrants ou les minorités ethniques en les présentant comme arriérées et non civilisées. C'est par exemple la raison pour laquelle la rapporteuse spéciale a rejeté le terme de « pratiques traditionnelles néfastes » au profit de celui de « pratiques néfastes » (harmful practices) pour désigner les pratiques culturelles qui érodent les droits des femmes (UNSRVAW, 2009).
Se borner à considérer les violences faites aux femmes comme une facette des communautés culturelles revient aussi à dissocier ces violences des inégalités structurelles qui sous-tendent les systèmes de « race », de classe et de genre et à engendrer des explications conceptuelles inadaptées. Au niveau international, le fait que les Nations unies se soient employées à s'attaquer aux causes et aux conséquences des violences faites aux femmes permet de mettre en avant les inégalités de genre et de s'interroger sur les approches qui dissocient les violences faites aux femmes de la subordination des femmes en général. Ainsi, lorsque les violences faites aux femmes sont considérées comme le résultat de la discrimination fondée sur le genre, elles deviennent le produit inéluctable de l'inégalité des structures socio-économiques, culturelles et politiques. Cette perspective permet de voir les femmes non simplement comme des victimes vulnérables qui ont besoin d'être protégées, mais de considérer les violences faites aux femmes comme la résultante d'un ordre genré, fréquemment contesté au niveau individuel et collectif, qui accorde un privilège à la violence masculine, individuelle et collective, laquelle sert à obtenir que les femmes respectent la norme. Cette situation est exacerbée pour les femmes migrantes et appartenant à une minorité ethnique, car elles se situent à l'intersection de multiples axes d'oppression et de discrimination. Cependant, comme l'indiquent plusieurs contributions dans ce volume, les discours sur les violences commises au nom de l'honneur et le mariage forcé ont tendance à privilégier la culture plutôt que le genre dans des explications qui s'appuient sur des notions essentialisées de culture et de tradition, et servent à stigmatiser les femmes migrantes ou des minorités ethniques ainsi que leurs communautés. Ces discours ont engendré un binôme composé de la femme blanche émancipée et de la femme migrante/minorisée opprimée, qui servent toutes deux à normaliser la violence et la discrimination des femmes blanches et à marginaliser les femmes migrantes ou des minorités (UNSRVAW, 2009 : 36).
Depuis quelques années, il est devenu courant d'invoquer les violences commises au nom de l'honneur pour expliquer le niveau élevé de contrôle et de violence dans la vie des femmes migrantes et appartenant à une minorité ethnique. La force du discours sur le mariage forcé/les violences d'honneur apparaît avec évidence lorsque l'on constate que les professionnels et les autorités évoquent l'« honneur » pour expliquer ce que l'on aurait pu appeler des violences conjugales il n'y a encore pas si longtemps. Ce rhabillage de l'éventail des violences vécues par les femmes migrantes et appartenant à une minorité ethnique peut servir à dissocier ces expériences de la question plus large des violences faites aux femmes et à ghettoïser ces dernières dans leurs enclaves de « pratiques traditionnelles et culturelles ». En guise de contre-argument à ces explications culturelles, plusieurs auteurs montrent du doigt les violences d'honneur et leurs liens avec le contrôle sur la sexualité des femmes et mettent en évidence la manière dont les arguments religieux et culturels perçoivent les femmes comme des marqueurs et des gardiennes de l'honneur de la communauté, ce qui les contraint à se conformer à l'idée de la femme idéale/honorable et à éviter les violences masculines en se gardant de toute transgression sexuelle17. Ces auteurs avancent ainsi que le genre doit occuper une place prépondérante dans toute explication de ces formes de violences faites aux femmes. Malgré quelques différences, cette forme de contrôle n'est pas spécifique aux femmes migrantes ou desminorités ethniques, car la plupart des formes de violences faites aux femmes sont utilisées comme instrument pour contrôler et réguler le comportement sexuel des femmes. C'est ce que confirme une grande partie de la recherche sur les violences conjugales, puisque les femmes évoquent souvent la jalousie sexuelle comme cause ou justification principale à la violence des hommes.
Intersectionnalité
Être opprimé […] est toujours construit et imbriqué dans d'autres divisions sociales (Yuval-Davis, 2006 : 195).
Si les critiques adressées à ceux qui utilisent la culture pour expliquer/justifier les violences faites aux femmes nous aident à privilégier le genre comme explication dominante, l'intersectionnalité permet de comprendre la particularité de la violence perpétrée à l'encontre des femmes migrantes et appartenant à une minorité ethnique et de définir des mesures contre cette violence. Plusieurs auteurs indiquent combien il importe de recourir à une approche intersectionnelle pour repérer les effets du fonctionnement simultané de systèmes multiples d'oppression/discrimination et d'y remédier plutôt que de s'attaquer à chacun d'entre eux isolément18. Si le débat sur l'intersectionnalité entre auteurs féministes est riche, nous n'avons pas ici pour objectif de le répéter. Toutefois, tout comme plusieurs contributeurs au présent volume, nous privilégions l'outil que constitue le concept d'intersectionnalité pour désembrouiller la complexité des questions relatives aux violences faites aux femmes, car ces questions produisent un impact sur la vie et l'expérience des femmes migrantes et appartenant à une minorité ethnique qui se situent au sein de structures de discrimination et de pouvoir qui sont interconnectées et se chevauchent.
En bref, l'« intersectionnalité », ou l'analyse intersectionnelle, suggère que dans une société fondée sur des systèmes multiples de domination, l'expérience individuelle n'est pas façonnée par une identité/un emplacement structurel unique (en tant que femme ou personne rattachée à une minorité ethnique). Elle reconnaît donc que l'expérience de certaines femmes est marquée par de multiples formes d'oppression et de position de soumission et qu'il est possible d'affiner davantage les catégories sociales individuelles de façon à situer « les femmes » en termes de pouvoir/d'impuissance les unes vis-à-vis des autres (Crenshaw, 1991). Il faut pour cela chercher à savoir comment le pouvoir est inscrit dans les systèmes individuels d'oppression et entre eux19, et ce qui peut créer à la fois de l'oppression et une opportunité20. On a utilisé il y a peu l'intersectionnalité, ou analyse intersectionnelle, pour examiner les violences faites aux femmes au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada (Sokoloff et Pratt, 2005), même si l'on débat toujours pour savoir si cela ne reproduit pas certaines notions additives de l'oppression, surtout lorsque l'on utilise l'intersectionnalité de manière limitée dans le cadre d'une mobilisation politique (Yuval-Davis, 2006).
Si de nombreuses explications apportées aux violences faites aux femmes ou à la relation entre genre et ethnicité, soit homogénéisent les expériences diverses des femmes, soit fragmentent l'expérience individuelle de la violence de chaque femme, l'intersectionnalité tient compte de l'universalité des violences faites aux femmes sans perdre ces particularités de l'expérience des femmes, qu'elle soit individuelle ou collective. En s'attachant à l'intersection des divisions sociales et des multiples systèmes de domination/oppression, l'intersectionnalité a le potentiel d'expliquer la complexité et la différence sans recourir à des explications essentialistes (Phoenix et Pattynama, 2006).
Note sur la traduction et la terminologie
Sachant qu'il serait difficile d'harmoniser les termes et les définitions relatifs à l'ethnicité et aux violences faites aux femmes utilisés tout au long du présent recueil et dans le souci d'éviter d'imposer nos propres définitions et nos disciplines de recherche, nous avons, dans un premier temps, décidé de permettre aux auteurs de s'exprimer en leur propre nom dans les termes employés dans les contextes nationaux à propos desquels elles écrivent, et à se référer aux cadres politiques dans leur contexte qu'elles décrivent et l'action publique y afférente. Ce volume comprend donc des contributions de militant·es et de chercheur·euses relevant de diverses disciplines des sciences sociales, ce qui transparaît invariablement dans les concepts et les termes employés. Ce livre apporte également des informations plus nuancées et plus riches sur les débats actuels à propos des violences faites aux femmes et de la question des femmes migrantes ou des minorités ethniques dans les différents contextes européens.
Deuxièmement, convaincues de la nécessité de rendre ces écrits sur les femmes migrantes et appartenant à une minorité ethnique et sur les violences faites aux femmes accessibles aux personnes travaillant dans le domaine de la prévention de la violence et de l'aide aux victimes, ainsi qu'aux chercheurs, nous avons jugé utile de produire le présent volume dans les trois principales langues européennes, le français, l'allemand et l'anglais. Nous avons incité les auteur·trices à écrire dans la langue dans laquelle elles ou ils se sentaient le plus à l'aise. Cette décision allait entraîner de nouvelles difficultés, non seulement pour la coordination et le financement du travail de traduction, mais aussi pour la définition conjointe d'équivalences terminologiques pour les concepts et les catégories relevant socialement et politiquement de contextes nationaux spécifiques. Grâce à notre collaboration au programme du Cahrv, nous étions sensibilisé·es aux problèmes sémantiques qui se posent lorsque l'on compare les résultats des travaux de recherche, et aussi aux complexités de la traduction des termes en anglais. S'est ensuite posée la question de quel « anglais » choisir, sachant que de nombreux chercheur·euses européens en dehors du Royaume-Uni publient en anglais sans pour autant utiliser forcément les termes employés par les chercheurs·euses écrivant au Royaume-Uni. Connaissant les différents points de vue qui prévalent en Europe sur la manière de catégoriser les personnes immigrées et leurs descendant·es, nous avions anticipé que la traduction des contributions rédigées en français ou en allemand poserait un certain nombre de problèmes. Nous avons choisi de ne pas généraliser le recours à une terminologie unique, par exemple le terme de « minorité ethnique », lequel non seulement ne correspond pas aux conceptualisations théoriques ou politiques de l'intégration et ne cadre pas avec les références aux migrant·es et à leurs descendant·es, mais se révèle également inapproprié dans des contextes tels que l'Allemagne, où de nombreux migrant·es d'Europe de l'Est ou de Russie sont considéré·es comme appartenant à des « ethnies germaniques ».
Ce recueil constitue une première étape importante vers la synthèse des écrits et des débats sur l'ethnicité, le racisme et les violences faites aux femmes en Europe. Nous espérons qu'il sera utilisé par les chercheurs, les décideurs et les professionnels lorsqu'elles ou ils s'efforceront d'élaborer des mesures efficaces pour remédier à la situation des femmes migrantes et appartenant à une minorité ethnique victimes de violences de genre. En outre, nous espérons qu'il donnera à d'autres l'envie de poursuivre l'initiative engagée ici, et d'explorer ces mécanismes et processus complexes, ainsi que leurs conséquences au niveau individuel, collectif et sociétal.
Stéphanie Condon, Monika Schröttle, Ravi K. Thiara (cordinatrices) : Violences envers les femmes en Europe
Editions Syllepse, Paris 2025, 532 pages, 28 euros
https://www.syllepse.net/violences-envers-les-femmes-en-europe-_r_22_i_1123.html
1. Par la suite, dans ce chapitre de présentation de l'ouvrage, on conservera (en italiques) ce terme utilisé notamment dans le contexte britannique de la recherche et des politiques.
2. Morokvasic (1984) ; Phizaclea (1983, 2003) ; Andall (2003).
3. Voir Lloyd (2000) ; l'ouvrage d'Andall (2003) sur le genre, l'ethnicité et la migration a contribué très tôt à établir un lien entre ces aspects en prenant acte de l'expérience sociale, culturelle et politique des femmes des minorités ethniques en Europe.
4. Martinez et Schröttle et col., rapports Cahrv (2006-2007).
5. Humphreys et col. (2006, rapports Cahrv, 11).
6. Martinez et col. (rapports Cahrv, 2006-2007).
7. Hovarth et Kelly (2007) ; Sokoloff et Pratt (2005) ; Thiara et Gill (2010).
8. UNSRVAW (2009) ; Roy (2008) ; Thiara et Gill (2010).
9. Humphreys et col. (2006).
10. Voir Guiditta Creazo et col. dans le présent ouvrage, p. 265.
11. Voir Marion Manier dans le présent ouvrage, p. 351.
12. Voir Prgana Patel et Hannana Siddiquin dans le présent ouvrage, p. 309.
13. Bredal (2005, 201) ; Gill et Anitha (2011).
14. Voir Khatidja Chantler et Geetanjali Gangoli, dans le présent ouvrage, p. 421 ; Welchmann et Hossain (2005).
15. Voir Khatidja Chantler et Geetanjali Gangoli, p. 421.
16. Voir Prgana Patel et Hannana Siddiqui dans le présent ouvrage, p. 309.
17. Sen (2005) ; Welchmann et Hossain (2005).
18. Sauer (2011) ; Thiara et Gill (2010) ; Verloo (2006) ; Yuval-Davis (2006).
19. Razack (1998) ; Thiara et Gill (2010).
20. Hill Collins (1990) ; Zin et Dill (1996).
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’ombre et la fièvre

À Port-au-Prince, les nuits n'ont plus d'étoiles. Elles sont peuplées de sirènes, de rafales, de clameurs étouffées, et de corps qu'on vend. Ce n'est pas une métaphore. C'est la réalité crue de centaines de jeunes filles – parfois mineures – qui, au cœur de l'insécurité chronique, s'adonnent au commerce sexuel pour assurer leur survie.
Par Smith PRINVIL
La capitale haïtienne, désormais fragmentée entre zones rouges et poches de résistance, abrite chaque soir un autre théâtre : celui de la faim, de l'abandon, de la débrouillardise extrême. Dans les rues de Pétion-Ville, au Carrefour de l'Aéroport, dans certains recoins de Delmas ou des places discrètes de Tabarre, des jeunes filles s'exposent au danger, plus par nécessité que par choix. Le sexe tarifé devient l'ultime ressource dans une économie de survie, là où l'État est absent, la famille impuissante, et l'avenir suspendu.
Elles ont 14, 15, parfois 20 ans. Étudiantes décrocheuses, déplacées internes, orphelines ou filles de familles effondrées. Certaines vivaient à Carrefour-Feuilles, à Solino, à Martissant ou à Bel-Air, territoires ravagés par les gangs et les incendies. D'autres viennent de camps d'infortune où les promesses humanitaires se sont évaporées. Elles vendent leur corps comme on vend des mangues au bord de la route – parce qu'il faut manger, se laver, aider les plus jeunes à survivre aussi.
Dans ce Port-au-Prince ravagé, il n'y a plus d'innocence. Il n'y a que la débrouille. Le commerce sexuel n'est pas ici un choix libertaire ou une revendication de pouvoir. Il est un appel au secours. Une stratégie de survie. Une transaction quotidienne entre précarité extrême et danger permanent.
On pourrait croire que la violence dissuade. Au contraire, elle fait partie du décor. Quand les filles sortent le soir, elles savent qu'elles risquent autant un viol qu'une rafle, un assassinat qu'un simple mépris. Mais elles y vont quand même. Parce que les besoins sont primaires : une bouteille d'eau, un peu de riz, une recharge pour le téléphone, un savon pour laver le peu de dignité qu'il leur reste.
Et qui paie ? Qui "consomme" ? Des policiers, des politiciens, des employés d'ONG, des petits commerçants, parfois même des bandits. La société toute entière. Celle-là même qui les juge en silence le matin, les désigne du doigt à l'église, mais les sollicite une fois la nuit tombée.
Ce n'est pas un simple fait divers. C'est une tragédie sociale. Une preuve accablante de la faillite de l'État haïtien, mais aussi de l'indifférence d'une société qui a normalisé l'exploitation des plus vulnérables. Là où il aurait fallu des bourses scolaires, on trouve des hôtels miteux. Là où il aurait fallu des centres d'accueil et de protection, on trouve des rues sombres et des trottoirs hostiles. Là où il aurait fallu une politique publique, on trouve le silence.
Il est temps de dire les choses. Ce pays ne peut pas continuer à tolérer l'indicible, à normaliser l'exploitation sexuelle des mineures, à détourner le regard face à une forme moderne d'esclavage. Il faut un sursaut, une levée d'indignation, une mobilisation collective pour que ces jeunes filles retrouvent ce qu'on leur a volé : leur avenir.
Chaque fois qu'une fillette est contrainte de vendre son corps pour manger, c'est toute la nation qui se prostitue un peu plus. C'est l'image de Dessalines que l'on piétine. C'est le rêve d'un peuple souverain qu'on prostitue sur l'autel du désespoir.
Port-au-Prince brûle, gémit, s'enfonce. Mais au cœur de cette nuit, il y a des voix qu'il faut entendre. Et des combats qu'il faut mener, non pas demain, mais aujourd'hui. Maintenant.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
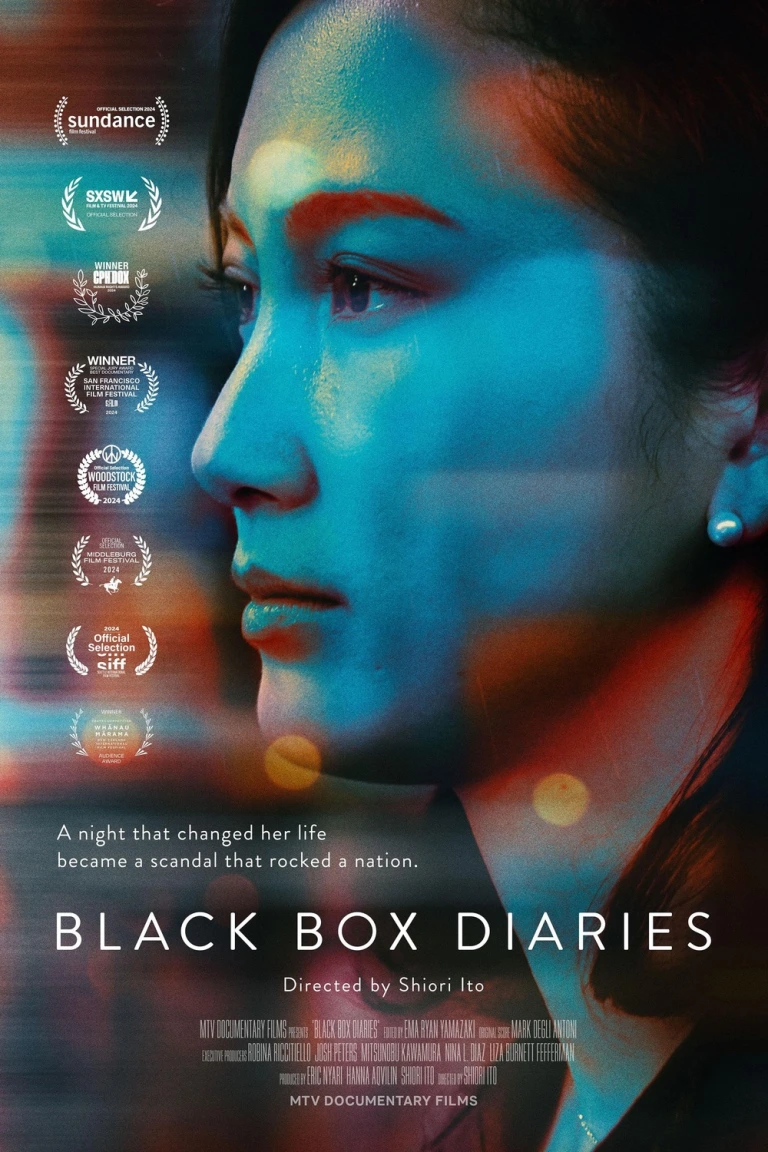
« Black Box Diaries », la journaliste courageuse qui a lancé le mouvement #MeToo japonais
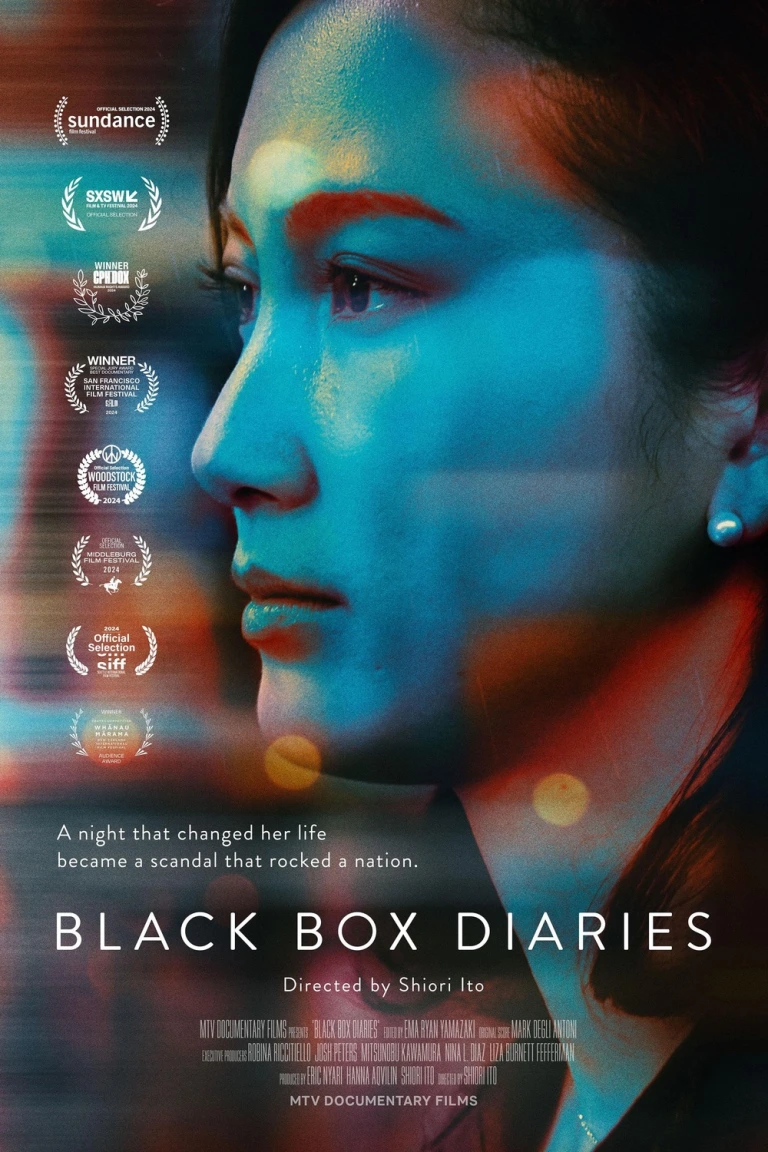
Le documentaire de la journaliste qui a initié le mouvement #MeToo au Japon continue de recevoir des prix ; le dernier en date au Fipadoc de Biarritz. Et bien qu'il puisse également remporter un Oscar, il reste censuré dans son pays. La plateforme de streaming Filmin vient de le sortir, et en mars il arrivera dans les salles françaises.
Tiré de Entre les lignes et les mots
Lauréat le 31 janvier dernier du Grand Prix de la dernière édition du Fipadoc, le prix principal du festival du film documentaire de Biarritz, « Black Box Diaries » est également l'un des documentaires favoris pour remporter un Oscar dans sa catégorie. Après être passé par les principaux festivals spécialisés, on peut maintenant le voir sur Filmin, après que la plateforme de streaming vient de l'inclure dans son catalogue, tandis qu'en France, il sortira dans les salles commerciales le 12 mars.
En France, une pétition est également en cours sur Change.org, exhortant sa sortie au Japon, où il ne trouve toujours pas de distributeur. C'est assez gênant : le documentaire a été distribué dans 58 pays à travers le monde et continue de recevoir des prix. Mais dans son pays d'origine, « Black Box Diaries » reste un sujet inconfortable.
Le début du documentaire, qui se déroule comme un véritable thriller d'investigation, est si direct qu'il est percutant. Regardant la caméra, la journaliste Shiori Ito annonce qu'elle commencera à tout documenter en enregistrant des vidéos sur son iPhone et confesse sa peur de ce qui se passera lorsque le procès contre son agresseur commencera ; c'est-à-dire contre le célèbre journaliste qui l'a violée deux ans plus tôt. Et puis viennent les images réelles des caméras de l'hôtel, prises la nuit où le viol a eu lieu.
Saut dans le temps, deux ans en arrière : mai 2015, après le dîner auquel Shiori Ito, une jeune femme qui veut devenir journaliste, est invitée par Noriyuki Yamaguchi, ancien chef du bureau de Washington du Tokyo Broadcasting System. On les voit arriver à l'hôtel Sheraton de Tokyo en taxi.
Le véhicule est arrêté à la porte de l'hôtel et, tandis que le portier – qui sera un témoin essentiel – tient la porte ouverte, Yamaguchi tire et sort de force Shiori Ito de l'intérieur, qui résiste et chancelle. Il est évident qu'elle ne va pas bien, ne tient pas sur ses jambes, mais il la traîne à l'intérieur de l'hôtel. Le viol n'est pas montré, ce n'est pas non plus nécessaire.
La journaliste et cinéaste Shiori Ito est la réalisatrice et protagoniste de ce documentaire, un travail journalistique de premier ordre dans lequel elle raconte l'enquête courageuse et l'épreuve qu'elle a dû endurer jusqu'à ce qu'elle réussisse à traduire son agresseur en justice, sachant qu'il était peu probable qu'il soit poursuivi.
Car l'homme qui l'a agressée était connu pour être le journaliste le plus proche de l'ancien Premier ministreShinzo Abe, sur qui il a même écrit une biographie. Le même Shinzo Abe qui, en 2022, mourrait sous les balles lors d'un meeting.
« Je me suis concentrée, en tant que journaliste, sur la recherche de la vérité. Je n'ai pas eu d'autre choix. Mon travail a été la seule façon de me protéger », confesse Shiori Ito, regardant la caméra. Car ce qui est extraordinaire chez cette femme, c'est qu'elle a tout documenté, avec des vidéos ou des enregistrements secrets des conversations que, pendant les deux années d'enquête précédant le procès, elle a eues avec des procureurs et des enquêteurs. Elle savait que si elle ne conservait pas les preuves, personne ne la croirait.
« Quand je me suis réveillée, il était en train de me violer », l'entend-on dire en pleurant dans une déclaration. « Il n'y a pas de preuves », répond froidement le policier.
Les chances qu'une femme policière soit assignée à l'affaire étaient très rares : moins de 8% des forces de police japonaises sont des femmes. De plus, les victimes devaient reconstituer leur incident avec des poupées grandeur nature. Tokyo, une ville de 14 millions d'habitants, ne possédait alors qu'un seul centre d'aide aux victimes de viol et une ligne téléphonique d'assistance. C'est à cette société que Shiori Ito a dû faire face lorsqu'elle a décidé de porter plainte.
Par-dessus tout, il y avait la question culturelle. « Au Japon, où parler de viol reste tabou, seules 4% des victimes signalent leurs cas à la police. Les victimes et leur entourage peuvent être stigmatisés et même exclus de la société. Ma famille était contre mes actions », reconnaît-elle. Elle a découvert que le viol ne pouvait être prouvé que par une violence physique grave ou des menaces, en raison des systèmes judiciaires obsolètes du pays, où la législation sur les agressions sexuelles datait d'il y a 110 ans.
Le viol était moins punissable que le vol d'un sac à main. Socialement, il était également mal vu de le signaler. La législation devait changer. Et son cas est devenu un cas historique au Japon.
Le documentaire suit le chemin tortueux qu'elle a dû emprunter pour porter l'affaire devant la justice. Même lorsque la police était sur le point d'arrêter le violeur, un ordre est venu d'en haut pour le libérer, et ils ont retiré l'enquêteur principal de l'affaire. Le procès pénal ayant été rejeté, ils ont dû chercher une voie civile. Le dépôt de la plainte a été un choc total au Japon, le début d'un mouvement #MeToo auquel se sont également jointes ses collègues journalistes femmes. « Cela a choqué le public », explique la journaliste. « Il y a eu une réaction violente de l'extrême droite, avec une campagne en ligne de messages désobligeants et de menaces de mort, en plus des gens dans la rue qui critiquaient tout : mon apparence et mon passé. Pourquoi avais-je le bouton supérieur de mon chemisier déboutonné lors de la conférence de presse ? se demandaient-ils. C'était une preuve que j'étais une prostituée : une vraie Japonaise ne parlerait pas d'une telle honte. »
D'abord, elle a écrit un livre, intitulé « Black Box », puis ce documentaire, un journal audiovisuel. Pourquoi une boîte noire ? « Une boîte noire est définie comme un système dont le fonctionnement interne est caché ou n'est pas facilement compris », explique-t-elle. « Le Japon est une terre de boîtes noires, et j'ai appris ce qui se passe dans cette société quand on commence à les ouvrir. »
Shiori Ito a finalement gagné… bien que l'affaire soit actuellement en appel et que son documentaire ne soit toujours pas diffusé au Japon. Mais quelque chose a changé : la loi et, surtout, le soutien social à cette cause. « Plus tard, lorsqu'un changement historique dans la loi japonaise sur le viol a été adopté, j'ai senti que mon objectif principal avait été atteint et que je pouvais revenir à une vie normale », ajoute-t-elle. « Mais c'était trop tard. J'étais devenue une héroïne, une méchante, une icône, mais je ne pouvais pas vivre avec moi-même. » La blessure était trop grande. Elle continue de guérir du préjudice subi.
Amaia Ereñaga
https://vientosur.info/black-box-diaries-la-periodista-valiente-que-inicio-el-metoo-japones/
Traduit pour ESSF par Adam Novak
https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article75080
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Pourquoi les femmes de Malaisie attendent encore l’égalité

Chaque année, la Journée internationale des femmes revient avec son mélange habituel de hashtags de célébration et de platitudes d'entreprise.
Et bien que la Malaisie ait connu sa part de percées – comme la nomination historique de Tengku Maimun Tuan Mat en tant que première femme juge en chef du pays – la réalité pour la plupart des femmes reste un combat épuisant pour les droits fondamentaux.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/05/29/pourquoi-les-femmes-de-malaisie-attendent-encore-legalite/?jetpack_skip_subscription_popup
L'inégalité de genre profondément enracinée et les préjugés institutionnels jettent encore une longue ombre sur tout progrès accompli. Le plafond de verre peut avoir des fissures, mais il est loin d'être brisé.
Mirage de progrès
Oui, les femmes malaisiennes sont plus nombreuses que les hommes dans les universités – une statistique prometteuse qui semble excellente sur le papier.
Mais le pipeline de l'académie au leadership est obstrué par la discrimination systémique.
Les chiffres racontent l'histoire : la représentation féminine au Parlement a chuté à 13,6% en 2022 contre 14,4% en 2018 – loin de la moyenne mondiale de 25,5%. Le quota de 30% tant vanté pour la représentation politique féminine reste un objectif insaisissable, plus un slogan qu'une stratégie.
Cela ne s'arrête pas là. Une enquête de 2019 intitulée « Perceptions et réalités : les droits publics et personnels des femmes musulmanes en Malaisie » par Sisters in Islam (SIS) a révélé que 74% des répondants croient que les femmes font face à une discrimination institutionnalisée, tandis que 63% pointent du doigt les autorités religieuses qui policent de manière disproportionnée le comportement des femmes.
Les infractions des hommes, bien sûr, passent largement inaperçues. C'est un système à deux niveaux qui protège le patriarcat derrière une façade de piété.
Même les réformes légales qui semblaient être des pas en avant se sont avérées être un tour de passe-passe.
L'amendement récent permettant aux mères malaisiennes de transmettre la citoyenneté à leurs enfants nés à l'étranger est venu avec un piège : la révocation de la citoyenneté automatique pour les enfants nés en Malaisie de résidents permanents.
Pendant ce temps, les épouses étrangères d'hommes malaisiens risquent de perdre leur citoyenneté si elles divorcent dans les deux ans.
Ces politiques ne visent pas à protéger la souveraineté – elles visent à maintenir les femmes dépendantes.
Pandémie cachée : Violence domestique
Si vous pensez que la violence domestique est une « question privée », détrompez-vous.
Les cas signalés ont grimpé de 5 260 en 2020 à 7 468 en 2021. Ils ont légèrement diminué en 2022 et 2023 mais ont de nouveau augmenté en 2024 à 7 116.
Et ce ne sont que les cas que nous connaissons. Pour chaque femme qui signale des abus, d'innombrables autres restent silencieuses – piégées par la peur, la stigmatisation et un système judiciaire qui se range souvent du côté de l'agresseur.
La police est réticente à intervenir, les refuges sont sous-financés et le processus légal est un labyrinthe cauchemardesque. Les ordonnances de protection sont retardées, les affaires judiciaires traînent pendant des années et, au bout du compte, beaucoup de femmes se demandent si cela en valait même la peine. Justice différée est justice refusée – peu importe comment vous l'interprétez.
Le bureau n'est pas mieux
L'écart salarial entre les genres se situe à un énorme 21% – et c'est si vous avez la chance d'être embauchée en premier lieu.
Les préjugés de genre dans l'embauche et les promotions sont aussi communs que le café de bureau. Dans les bâtiments gouvernementaux, les femmes font face à des codes vestimentaires qui ont moins à voir avec le professionnalisme qu'avec le contrôle.
Les commentaires récents du mufti de Penang questionnant la participation des femmes aux activités de team-building révèlent un préjugé plus profond : les rôles des femmes dans la société devraient être confinés et secondaires.
Cette mentalité s'étend aussi au sport. Depuis 2019, Terengganu a interdit les gymnastes féminines, et les plongeuses musulmanes ont récemment été empêchées de concourir aux Jeux malaisiens (Sukma) en raison de leur tenue. Ce n'est pas à propos de moralité – c'est à propos de contrôle.
Divorce : Liberté refusée
Il n'a besoin que de trois mots ; je reçois des questions.
Je peux demander le fasakh, attendre des mois en file
Prouver la douleur, les cicatrices, chaque grief en nature
Ce vers résume les iniquités dans les lois familiales islamiques de Malaisie. Tandis que les hommes peuvent prononcer talaq trois fois et s'en aller, les femmes doivent endurer un marathon bureaucratique pour obtenir le fasakh – prouvant chaque cicatrice, chaque trahison, dans un détail exhaustif.
Une étude de 2024 par Sisters in Islam a trouvé qu'un nombre significatif de femmes musulmanes dans la communauté à faible revenu croient que ces lois favorisent massivement les hommes, avec plus de la moitié rapportant des difficultés à obtenir une pension ou une pension alimentaire pour enfants après le divorce.
Ce n'est pas la justice. C'est un système conçu pour épuiser les femmes jusqu'à la soumission, les piégeant dans des mariages toxiques ou de longs combats légaux.
Police de la moralité : Contrôle sous un autre nom
La police religieuse est devenue un instrument brutal pour faire respecter les normes patriarcales. La flagellation publique d'un homme malaisien à Terengganu en décembre 2024 pour khalwat (proximité étroite avec un non-mahram, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas proche parent) était un avertissement stark à tous : les lois de moralité sont en hausse. Et soyons honnêtes – elles ciblent de manière disproportionnée les femmes.
Ces lois ne protègent pas la moralité publique ; elles l'instrumentalisent. Elles justifient la surveillance, codifient la discrimination basée sur le genre et privent les femmes de leur autonomie – tout en prétendant défendre les valeurs religieuses.
Réalité sombre : Mariage d'enfants
Malgré les affirmations de progrès, le mariage d'enfants reste une réalité sinistre en Malaisie, avec des filles musulmanes dès l'âge de 16 ans – ou même plus jeunes avec l'approbation du tribunal de la charia – étant mariées, souvent à des hommes plus âgés.
Selon le Département des statistiques de Malaisie, 1 124 mariages d'enfants ont été enregistrés en 2020, en baisse par rapport à 1 856 en 2018. De 2022 à 2024, près de 90 mariages d'enfants ont été enregistrés sous les tribunaux de la charia, avec les chiffres les plus élevés au Kelantan, Selangor et Kedah.
Ces mariages, souvent justifiés comme « protection » ou soulagement de la pauvreté, nient en vérité aux filles leurs droits à l'éducation, à la santé et à un avenir de leur choix.
Un rapport de 2018 par Sisters in Islam (SIS) et Arrow a mis en évidence les grossesses hors mariage comme un facteur majeur conduisant aux mariages d'enfants. Bien que certains États comme Selangor aient fait des progrès, le problème persiste à l'échelle nationale.
Les efforts pour interdire le mariage d'enfants ont été bloqués par des affirmations que cela violerait les normes religieuses et culturelles.
Nancy Shukri, la ministre du Développement des femmes, de la famille et de la communauté, a reconnu la complexité du problème en raison de la juridiction des États.
Elle a aussi révélé, en 2024, que 44 263 grossesses d'adolescentes ont été enregistrées au cours des cinq dernières années, avec 17 646 impliquant des adolescentes non mariées. Au Sarawak, 9 258 cas ont été signalés entre 2019 et 2023, en partie à cause des lois coutumières permettant les mariages d'enfants.
La persistance du mariage d'enfants ne reflète pas seulement un échec à protéger les filles de Malaisie mais expose aussi le besoin urgent d'une action fédérale complète pour mettre fin à cette pratique une fois pour toutes.
Plan pour un vrai changement
La Malaisie a besoin de plus que des gestes symboliques et des promesses vides. Il est temps pour une stratégie complète pour démanteler l'inégalité de genre.
Voici ce qui doit arriver :
– Réformer la loi familiale islamique – Assurer que les femmes aient des droits égaux dans les cas de mariage, divorce et garde d'enfants. Simplifier le processus de fasakh et éliminer le préjugé de genre dans les tribunaux de la charia
– Renforcer les protections contre la violence domestique – Élargir les définitions légales d'abus domestique pour inclure le contrôle psychologique et financier. Augmenter le financement pour les refuges et rationaliser les ordonnances de protection
– Faire respecter l'égalité salariale et l'égalité au travail – Implémenter et surveiller les lois d'égalité salariale et faire respecter les quotas de diversité de genre dans les postes de direction dans tous les secteurs
– Mettre fin à la police de la moralité – Abroger les lois qui ciblent de manière disproportionnée les femmes et codifient le patriarcat sous le prétexte de moralité religieuse
– Atteindre le quota de 30% – pour de vrai – Faire respecter le quota de 30 % pour la représentation politique féminine pour s'assurer que les voix des femmes ne soient pas seulement entendues mais qu'on agisse en conséquence
Plus de compromis
Les aspirations de modernité de la Malaisie sonnent creux tant que la moitié de sa population est retenue par des lois et des mentalités dépassées.
Les droits des femmes ne peuvent pas être relégués en marge des négociations politiques ou écartés comme des sensibilités culturelles.
Le temps du changement incrémentiel est fini. Si la Malaisie veut vraiment avancer, elle doit prendre une position décisive pour l'égalité de genre.
Tout autre chose est un compromis inacceptable.
Ameena Siddiqi
Ameena Siddiqi est directrice des communications chez Sisters in Islam (SIS). Avec une solide expérience en édition, médias et communications, elle joue un rôle central dans l'avancement de la mission de SIS de promouvoir les droits des femmes dans le cadre islamique en Malaisie. Son travail est motivé par un engagement à amplifier les voix, favoriser le dialogue et plaider pour un changement significatif.
Aliran
https://m.aliran.com/civil-society-voices/why-malaysias-women-are-still-waiting-for-equality
Traduit pour l'ESSF par Adam Novak
https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article75089
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Ethiopie : la santé malade de l’austérité

Malgré la répression, les grévistes de la santé continuent leur mobilisation et mettent en exergue leurs conditions déplorables de travail et de rémunération.
Depuis le 12 mai, le personnel de santé des différents hôpitaux que compte le pays est en grève. Sur la dizaine de revendications avancées figure en bonne place la question des rémunérations. L'exigence est d'être au niveau du standard des pays d'Afrique de l'Est soit 1000 dollars par mois.
Réparer des années d'injustice
A cela, s'ajoute un temps de travail conforme aux recommandations de l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) soit 45 heures avec le paiement des heures supplémentaires, des indemnités de transport et de logement, une prime de risque et des soins médicaux gratuits pour les professionnels et leurs familles. Cette dernière demande pourrait être surprenante, et pourtant selon le témoignage d'un médecin parlant de ses collègues, il explique : « Il y a eu des cas où ils n'avaient même pas les moyens de se faire soigner lorsqu'ils tombaient malades et étaient contraints de mendier ».
Le lancement de la grève a été précédé d'une intense mobilisation sur les réseaux sociaux autour des hashtags #HealthWorkersMatter (les travailleurs de la santé comptent) ou #PayHealthWorkersFairly (payer équitablement les travailleurs de la santé). A cette occasion les populations ont pu découvrir qu'un médecin spécialiste gagne 80 dollars par mois, un médecin généraliste 7600 birrs mensuel soit une cinquantaine d'euros, les autres personnels de santé, infirmiers ou aides-soignants, touchent des salaires encore bien moindres.
Un système de santé en lambeaux
Le seul moyen de s'en sortir est de cumuler plusieurs postes augmentant le nombre d'heures de travail comme l'indique un docteur de Black Lion Specialized Hospital : « Je viens de terminer mon service de nuit, j'ai travaillé la nuit précédente dans un hôpital privé et je suis de retour aujourd'hui. Nous sommes soumis à une pression intense. » avec un risque avéré de dégradation des qualités des soins prodigués aux patients. La situation est bien plus désastreuse dans les provinces du pays où les heures supplémentaires ne sont pas payées et les salaires arrivent avec retard, ce qui entraîne des vagues de démission aboutissant à des déserts médicaux.
La déclaration d'Abuja sur la santé fixe comme objectif un budget dédié à la santé équivalent à 15% du PIB. Pour l'Ethiopie on en est loin, la Banque Mondiale estimait en 2022 que ses dépenses représentaient 2,85% de son PIB.
La répression plutôt que la négociation
Au lieu de répondre aux revendications, les autorités ont eu un discours contradictoire. Affirmant que la grève a peu d'impact mais accusant les personnels de santé de tuer les patients. Elles ont emprisonné Mahlet Gush une anatomopathologiste renommée ainsi que huit autres collègues. La Dr Mahlet est accusée « d'incitation à l'émeute et aux troubles » et de « collaboration avec des forces hostiles à la paix pour fomenter une rébellion urbaine » puis d'autres accusations ont été portées à son encontre, notamment d'avoir « provoquer la mort de patients par la grève ». Sauf que depuis plus d'un an elle n'exerce plus d'activité clinique.
En fait, son incarcération est liée à l'interview qu'elle a donnée à la BBC critiquant l'état catastrophique de l'offre de soins dans le pays. Cette répression, habituelle pour le gouvernement qui n'hésite pas à étouffer les voix dissidentes, a conduit l'Ethiopian Human Rights Commission (Commission éthiopienne des droits de l'homme) organisme public, à marquer sa réprobation.
La répression s'est accentuée. Ainsi Amnesty International a reçu une liste de 121 salariés de la santé qui ont été arrêtés. D'autres subissent des intimidations et des menaces notamment le retrait de leur licence.
En dépit de ces pressions, la grève tient bon et les autorités ont commencé à négocier, mais le personnel met comme préalable à l'ouverture des pourparlers la libération des salariés emprisonnés et la levée de toutes les sanctions.
Une victoire des grévistes serait un encouragement pour d'autres secteurs notamment celui de l'enseignement, lui aussi fort mal traité.
Paul Martial
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Afrique : De l’OUA à la nécessité de la refondation souverainiste de l’UA !

Il y a 62 ans, 32 États indépendants d'Afrique se retrouvaient un 25 mai à Addis-Abeba pour fonder l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA). 1963, c'était trois ans après l'accession au droit d'avoir un drapeau, un hymne, un État des deux courants indépendantistes national révolutionnaire panafricain dont les figures de proues étaient Kwame Nkrumah, Modibo Keita, Sékou Touré et Gamal Abdel Nasser et national réformiste à sa tête L. S. Senghor, Houphouët Boigny et Bourguiba. L'OUA fut ainsi baptisée par les chefs d'Etats qui voulaient « accomplir » et par ceux qui voulaient « trahir » la « mission » libératrice que « chaque génération doit découvrir » selon la formule de Franz Fanon.
Tiré d'Afrique en lutte.
Née d'un tel compromis entre indépendantistes radicaux et néocoloniaux, l'OUA prolongeait le piège de la seconde balkanisation qu'a été la « loi cadre » qui préfigurait l'implosion des entités panafricaines coloniales AOF et AEF en entités territoriales émiettées qui vont chacune aller, divisée, à l'indépendance. La « loi cadre » était donc une stratégie de division pour saboter le projet panafricain du Rassemblement Démocratique Africain (RDA) de « l'indépendance dans l'unité ».
Ce compromis historique entre indépendantistes radicaux panafricains et néocoloniaux réformistes a été obtenu sur la base de « l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation » et la « coopération pour parachever la libération du continent du colonialisme ».
La petite bourgeoisie radicale indépendantiste progressiste a concédé à la bourgeoisie réformiste l'érection des frontières au sein de l'AOF/AEF de l'empire colonial français et au sein des territoires de l'empire colonial britannique en proclamant « intangibles les frontières Étatiques ». Pour parachever cette stratégie de division, les impérialistes et leurs laquais néo-coloniaux vont liquider les éphémères Fédération du Mali et l'Union Guinée Ghana Mali par les coups d'États contre Nkrumah et Modibo.
A l'actif de l'OUA, il faut signaler la reconnaissance de la République Saharouie et un soutien plutôt porté par les radicaux indépendantistes que les réformistes néocoloniaux aux luttes de libération nationale des colonies portugaises, de la Namibie, du Zimbabwe et anti-apartheid d'Afrique du Sud. Les unes après les autres les luttes armées anti-coloniales en Angola, Guinée Bissau-Cap-Vert, Mozambique, Zimbabwe, Namibie et Afrique du Sud avec l'apport de Cuba socialiste vont débarrasser l'Afrique du colonialisme direct.
L'OUA signe son arrêt d'inutilité politique et sa servilité néocoloniale par son silence face à l'appel de Thomas Sankara en 1987 de « refuser collectivement de payer la dette, car si je le fais tout seul je ne serai pas parmi vous au prochain sommet » et son laisser faire de l'assassinat de cet illustre président qui a fait un temps rêver d'une Afrique en voie de libération.
Au baptême de l'UA
Le cataclysme de la fin du monde bipolaire avec la fin de l'URSS et du camp socialiste d'Europe va assommer les courants révolutionnaires et progressistes souverainistes anti-impérialistes. L'impérialisme Euro-Atlantique/G7 et Israélien va se lancer dans le projet de « re-mondialisation » de son hégémonie séculaire sous l'égide de l'impérialisme Yankee. Cette « re-mondialisation » prend la forme du totalitarisme de la pensée unique libérale imposée au monde et à l'Afrique par le biais de la dette, des plans d'ajustement structurel du FMI/BM et le dévoiement des luttes populaires africaines vers la généralisation à travers « les conférences nationales de la démocratie multipartite » néocoloniale. Elle se manifeste aussi sous la forme du cycle des guerres d'agression de l'impérialisme contre l'Irak, la Yougoslavie, l'Afghanistan, la Côte d'Ivoire, la Libye, etc.
C'est dans ce contexte qu'est impulsée la mutation de l'OUA en UA par les États de la partie sud de l'Afrique et la Libye d'abord en 1999 au sommet de Syrte puis en 2002 à Durban en Afrique du Sud.
Se définissant comme « une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale », l'UA se dote d'institutions spécialisées et d'organes spécialisés dont « la création d'institutions financières continentales : (la Banque centrale africaine (BCA), le Fonds monétaire africain (FMA) et la Banque africaine d'investissement (BAI)) ».
Panique à bord chez les impérialistes voyant que l'axe Libye et Afrique du Sud/Namibie/Angola/Mozambique s'orientait vers une coopération économique rompant avec la dépendance verticale extravertie aux économies impérialistes, il fut décidé de s'attaquer à la Libye en instrumentalisant le prétendu « printemps arabe » pour y prolonger la politique de la canonnière Otanienne ainsi qu'en Syrie. Pourquoi la Libye ? Parce que comme nous l'écrivions en août 2011 dans notre article intitulé « Guerre coloniale de la Françafric, de l'Eurafric et de l'Usafric contre le peuple Libyen », les impérialistes reprochaient à Khadafi : « D'avoir empêché jusqu'ici la mise en place de « l'union Europe-Méditerranée » par laquelle le grand patronat Français veut rééquilibrer la construction européenne dominée par l'Allemagne ; D'être à l'initiative du Fond Monétaire Africain (FMA) qui est un fond africain qui rompt le monopole quasi - exclusif qu'impose jusqu'ici le FMI et la Banque Mondiale à l'Afrique ; D'être l'une des parties à l'origine du projet en cours de réalisation du satellite à 100% africain ; D'avoir investi dans les pays d'Afrique notamment dans des infrastructures à des taux d'intérêts bas ; D'avoir transformé la Libye en pays d'Afrique avec un niveau de vie proche de celui des pays développés avec l'éducation et la santé gratuites ; D'avoir diversifié les fonds souverains en dollars, euros et surtout en réserve d'or ; D'avoir nationalisé le pétrole, le raffinage et expulsé les bases militaires US ; D'avoir doté la Libye d'un réservoir en eau unique au monde ; D'avoir soutenu les luttes de libération nationale en Afrique et dans le monde contre les colonialistes ».
et à l'AES et le Sénégal
Une fois la Libye ramenée à l'âge de pierre et le meurtre sauvage de Khadafi obtenu, les djihado-terroristes armés jusqu'au dents ont essaimé dans le Sahel se mêlant aux séparatistes et ethnicistes pour planter leurs griffes dans les États des bourgeoisies bureaucratiques néocoloniales dont la faillite réside dans la généralisation de la corruption et du vol impuni de l'argent public. C'est là un processus d'embourgeoisement de la petite bourgeoisie intellectuelle néocoloniale. Les classes politiques, y compris les gauches révolutionnaires et communistes, ont été happées par les capitulations et l'intégration des principaux leaders à la tête des partis dans les systèmes néocoloniaux dont pourtant les militants ont été les meneurs et sacrifiés des luttes pour la démocratisation des dictatures néocoloniales civiles et militaires qui ont sévi entre 1960 et 1990.
Ces vingt années, 1990 et 2010, ont révélé aux yeux d'une partie de plus en plus importante de l'intelligentsia et de nos peuples la faillite totale des dictatures néocoloniales soumises au FMI/BM, des alternances démocratiques qui font se succéder des régimes politiques ayant tous la même politique libérale apatride dictée par les plans libéraux d'ajustement structurel et qui en plus dans le cas du Mali, Burkina, Niger se sont révélés complices de la duplicité des impérialistes françafricains, eurafricains et usafricains dans leur prétendue « guerre contre le terrorisme » dans le cadre de leur stratégie réactionnaire de dupe de « choc, guerre de religions, de cultures, de civilisations » et « d'occupation militaire du Sahel » comme nous l'écrivions dès 2010.
Si dans les pays de l'AES, la corruption généralisée par l'intégration de la quasi-totalité de la classe politique dans le système néocolonial a empêché l'existence d'une offre politique alternative, malgré l'effort de certains des résistants de la gauche communiste comme nos camarades de Sanfin du Mali, c'est au Sénégal qu'a émergé, en plus d'une minorité de résistants de gauche communistes, une offre politique alternative à l'intégration des ex-gauches, notamment communistes au néocolonialisme.
Dans l'AES, c'est donc la fraction souverainiste des armées nationales qui est venue parachever les révoltes populaires contre les États faillis et au Sénégal, la rébellion souverainiste s'est dotée d'un parti-front et de leaders qui ont chassé dans les urnes le régime néocolonial.
L'actuelle seconde phase souverainiste de libération africaine voit donc s'opérer le développement plus ou moins rapide des prises de consciences inégales souverainistes, mais tendanciellement historiquement en hausse constante.
La crise de la CEDEAO/UEMOA avec le départ de l'AES préfigure la crise qui va progressivement atteindre l'UA dont les chefs d'États néocoloniaux sont de plus en plus confrontés aux exigences de souveraineté des peuples.
L'AES, qui rappelle la mort-née Union Guinée/Ghana/Mali, est l'antithèse du piège attrape-nigaud de « l'unité par la coopération » qui fut le sceau de naissance de l'OUA et de sa mutation en UA. L'AES est vite passée à la « confédération » qui doit être une phase de transition vers la « fédération » des peuples et États qui se sont libérés du néocolonialisme.
Que le Sénégal souverainiste confronté à une phase de transition dans laquelle une sous-phase de redressement des finances publiques se révèle incontournable, œuvre, nous l'espérons avec le nouveau gouvernement du Ghana, à empêcher la poursuite de l'utilisation par les impérialistes de la CEDEAO/UEMOA contre l'AES est déjà très positif et doit être considéré comme une étape préparatoire à la convergence puis à l'unité avec l'AES confédérée le moment venu.
C'est ainsi que nous tirerons les leçons des échecs de l'OUA pour refonder à terme l'UA en une confédération puis une fédération des États souverains d'une Afrique débarrassée du néocolonialisme.
25/05/25
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le plan hasardeux de l’Église catholique pour "réparer" le catholicisme américain

Le catholicisme américain est devenu un champ de bataille. Le sédévacantisme — cette tendance opposée aux réformes libérales de l'Église issues du concile Vatican II dans les années 1960 (messe en langue vernaculaire, hiérarchisation moins marquée, implication accrue des laïcs, accent mis sur la justice sociale) — gagne en popularité.
22 mai 2025 | tiré de Canadian Dimension | Photo : Messe d'inauguration du pape Léon XIV sur la place Saint-Pierre, Cité du Vatican. Photo courtoisie de la Conférence des évêques catholiques d'Angleterre et du Pays de Galles / Flickr.
https://canadiandimension.com/articles/view/maga-and-the-pope
Il constitue aujourd'hui la base du mouvement du « catholicisme traditionnel » ou TradCath, un courant profondément réactionnaire et de droite au sein de l'Église, particulièrement prégnant aux États-Unis, notamment chez les convertis protestants en quête de rigueur et d'autorité dans un christianisme hiérarchique, ainsi que chez certains jeunes hipsters post-ironiques (voir : Dasha Nekrasova du balado Red Scare).
Depuis la démission de Benoît XVI — un homme allant jusqu'à attribuer les abus sexuels commis par le clergé à un excès de relativisme moral en théologie —, les conservateurs de l'Église, très présents aux États-Unis, ont souvent eu le sentiment que leur voix était marginalisée dans les affaires ecclésiastiques. Depuis peu, les tensions longtemps souterraines au sein du catholicisme américain explosent au grand jour. Le réseau américain Eternal Word Television Network (EWTN), par exemple, est désormais connu pour son attitude passivement agressive envers la mise en œuvre de Vatican II. Des figures comme le cardinal Raymond Burke adoptent une posture intransigeante de guerre culturelle « anti-libérale », Burke allant même jusqu'à défier publiquement le défunt pape François et remettre en question son autorité.
Si le mouvement TradCath existe aussi dans plusieurs pays — notamment en France et en Pologne —, c'est aux États-Unis que les braises sont les plus vives. On craint depuis plusieurs années qu'un tel mouvement réactionnaire ne débouche sur un schisme majeur, qui pourrait mener à une sécession d'une partie de l'Église américaine du Saint-Siège — un courant parfois désigné sous le nom de « catholicisme MAGA ».
Avec l'élection du pape Léon XIV — un Américain modéré, synodaliste progressiste mais conservateur sur la doctrine —, on espère manifestement qu'il puisse utiliser son influence locale pour adoucir les angles les plus durs du catholicisme américain, tout en poursuivant les orientations pastorales et tournées vers le Sud global initiées par François, dont il était proche. Si les catholiques américains peuvent s'identifier à un pape qui est l'un des leurs, un homme bien connecté dans leur univers et intimement familier des conflits internes au catholicisme américain, alors peut-être pourra-t-il recoller les morceaux. Mais si cela vous évoque les ambitions centristes désastreuses du Parti démocrate, c'est peut-être que vous êtes plus perspicace que les cardinaux.
Les mouvements alignés sur MAGA ne peuvent être apaisés par une modération bienveillante. L'Église catholique ne peut plus rien faire pour apaiser les catholiques MAGA — tout comme leurs homologues politiques, ils sont allés trop loin dans l'abîme de l'irrationnel. Steve Bannon, qui avait qualifié François de « marxiste », a déjà lancé la même accusation contre le plus modéré Léon, l'accusant d'être « anti-Trump, anti-MAGA et pro-frontières ouvertes ». Les influenceurs MAGA sont déjà montés au front, déclarant que Léon est encore plus radical que François, l'accusant d'être atteint du « virus mental woke » parce qu'il a un jour retweeté un message sur George Floyd. Ce nouveau chef d'un ordre religieux international a même été accusé de ne pas être suffisamment « America First ». Et comme si cela ne suffisait pas, certains tentent maintenant, par des raisonnements pseudo-scientifiques, de prouver que le nouveau pape serait transgenre.
Voilà les personnes que l'Église catholique pense, à tort, pouvoir apaiser. Le mouvement catholique MAGA est voué à son propre sort, car ses fidèles se complaisent dans leur haine du Saint-Siège et ne montrent aucun désir d'en dévier, ce qui correspond parfaitement à leurs obsessions complotistes et à leur rejet de toute autorité en dehors de QAnon et Donald Trump. Prolongement de la Nouvelle Droite, ils se méfient de toute influence « étrangère » ou « globale », ce qui inclut le Vatican, souverain et éloigné.
L'Église pourrait annuler Vatican II, excommunier tous les Latinos, et publier une bulle pontificale déclarant qu'il est péché de boire de la bière « woke » — elle ne pourrait toujours pas les satisfaire. Si l'Église veut éviter d'éventuels schismes à venir, une voie plus prometteuse serait de chercher à combler le fossé avec le mouvement réformateur moderniste croissant en Allemagne. Autrement, il serait plus judicieux pour elle de concentrer ses efforts sur le maintien de son influence dans le Sud global, là où son impact est le plus important et porteur de sens. C'est ce que le pontificat de François avait bien compris : il a méthodiquement remodelé l'épiscopat mondial, en promouvant systématiquement des évêques d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, désormais influents au sein du Collège des cardinaux, au détriment des anciens centres européens de pouvoir.
L'avenir de l'Église se joue dans le Sud global. Et alors que ces régions affrontent des défis majeurs liés à l'instabilité politique et aux bouleversements climatiques, elles auront besoin d'une Église réformée pour répondre à leurs besoins. À la place, l'Église s'apprête à s'enliser dans le bourbier américain, ce qui pourrait lui coûter bien plus d'énergie et de ressources qu'elle ne peut se le permettre.
Jack Daniel Christie est écrivain et artiste d'origine anishinaabe, partageant son temps entre Toronto et Montréal. Sa poésie et sa prose ont été publiées notamment dans Commo, Bad Nudes et Calliope. Finaliste du prix Irving Layton en fiction, il est rédacteur en chef du fanzine de poésie et série d'événements Discordia Review. Il a déjà écrit sur le phénomène TradCath sur le blogue de Discordia.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Budget de Trump : plus d’inégalités et de corruption

La semaine dernière, la Chambre des représentantEs, dominée par le Parti Républicain, a adopté par 215 voix contre 214 le « Big Beautiful Bill », comme l'appelle le président Donald Trump, qui accorde de nouvelles réductions d'impôts aux riches et plus d'argent à l'armée tout en réduisant toute une série de programmes sociaux destinés aux classes ouvrières et aux pauvres.
29 mai 2025 | Hebdo L'Anticapitaliste - 756
https://lanticapitaliste.org/actualite/international/budget-de-trump-plus-dinegalites-et-de-corruption
Le projet de loi, de plus de 1 000 pages, réduit Medicaid, qui fournit des soins de santé aux adultes et aux enfants à faible revenu, réduit le Supplemental Nutrition Assistance Program, qui fournit une aide alimentaire aux personnes ayant peu ou pas de revenus, et réduit le soutien à l'éducation à tous les niveaux, de l'école élémentaire à la recherche universitaire.
Une loi pour les riches qui augmente la dette
Selon les estimations de l'office budgétaire du Congrès, quelque 8,6 millions d'AméricainEs, hommes et femmes, risquent de perdre toute couverture de santé d'ici à 2034. Et Trump est en train de licencier 100 000 fonctionnaires fédéraux. Dans le même temps, le projet de loi prévoit plus d'argent pour l'armée et les autorités chargées de l'immigration.
Malgré les coupes dans les programmes sociaux, le projet de loi augmentera la dette nationale d'environ 3 300 milliards de dollars. Le projet de loi est maintenant transmis au Sénat, également à majorité républicaine, qui l'amendera ; les deux chambres devront ensuite concilier leurs divergences. Au bout du compte, la loi sera dévastatrice pour les pauvres et une aubaine pour les riches.
La monnaie de Trump et la corruption
Alors qu'il s'emparait de la nourriture et des soins médicaux des pauvres, Donald Trump organisait un dîner à son Trump National Golf Club, dans la banlieue de Washington, pour 250 milliardaires, les plus gros acheteurs de sa cryptomonnaie $TRUMP, une pièce numérique qui n'a d'autre fonction que la spéculation. Les convives présents ont acheté en moyenne 1,7 million de dollars de $TRUMP, les sept premiers achetant 10 millions de dollars et l'un d'entre eux, 40 millions de dollars. De nombreuses personnes présentes — dont un grand nombre sont originaires de pays asiatiques — ont déclaré avoir investi dans le $TRUMP afin de pouvoir influencer le président et la politique économique des États-Unis.
Depuis qu'il est devenu président, Donald Trump a ajouté des milliards à sa fortune personnelle, dont plus récemment 320 millions de dollars d'honoraires grâce à la vente de sa cryptomonnaie. Alors que les convives arrivaient, des dizaines de manifestantEs brandissaient des pancartes portant des slogans tels que « Crypto Corruption » et « Les États-Unis sont à vendre », et criaient : « Honte, honte, honte ».
Les démocrates ont critiqué l'utilisation par Donald Trump de sa fonction pour s'enrichir. « Le dîner de Donald Trump est une orgie de corruption », a déclaré la sénatrice Elizabeth Warren du Massachusetts lors d'une conférence de presse du parti démocrate organisée avant le dîner. « Donald Trump utilise la présidence des États-Unis pour s'enrichir grâce aux crypto-monnaies et il le fait au vu et au su de tous. »
Trump intouchable
Des gouvernements et des hommes d'affaires du monde entier passent des accords avec Trump pour tenter d'influencer les politiques américaines. Donald Trump veut imposer des droits de douane de 46 % sur les importations vietnamiennes ; le gouvernement vietnamien coopère avec la famille Trump, qui construit un complexe de golf de 1,5 milliard de dollars à l'extérieur de Hanoï, la capitale du pays, peut-être pour tenter de réduire les droits de douane qui touchent environ un tiers des exportations vietnamiennes. Mais il y a 20 propriétés avec la marque Trump dans des pays du monde entier : coopérer avec les entreprises privées du président devient un moyen d'essayer d'influencer les décisions politiques.
Trump fait tout cela en toute impunité. Le président américain n'est pas tenu par les lois relatives aux conflits d'intérêts. La Cour suprême lui a accordé l'immunité. Sa loyale Pam Bondi contrôle le ministère de la Justice. Il est intouchable.
Alors que la résistance aux attaques de Trump contre les travailleurEs et les pauvres se développe lentement, il n'y a que peu ou pas de résistance à la corruption de Trump. Pourquoi ?
Certains, bien sûr, admirent l'homme d'affaires qu'est Trump, d'autres se laissent embobiner par lui. Quoi qu'il en soit, il contrôle l'exécutif, le législatif et bénéficie du soutien de la Cour suprême, si bien qu'il semble tout-puissant. De plus, dans l'histoire des États-Unis, nous n'avons sans doute jamais vu une corruption d'une telle ampleur. La rapidité des actions de Trump nous laisse pantois. En réponse, nous avons des critiques des démocrates, mais la direction de ce parti est à la fois divisée et impopulaire. Et nous avons quelques dizaines de manifestantEs qui crient « Honte ! » Que faudrait-il faire ? C'est à nous de le déterminer.
Dan La Botz,
traduction Henri Wilno
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Sur le mythe de l’abandon de l’hypocrisie par Washington

La visite de Donald Trump dans les États arabes du Golfe a donné lieu à beaucoup de commentaires sur un changement radical que le nouvel-ancien président américain aurait introduit dans la politique étrangère américaine. L'hypocrisie reste cependant une constante de cette politique.
28 mai 2025
Gilbert Achcar
Professeur émérite, SOAS, Université de Londres
Abonné·e de Mediapart
https://blogs.mediapart.fr/gilbert-achcar/blog/280525/sur-le-mythe-de-l-abandon-de-l-hypocrisie-par-washington
Ce blog est personnel, la rédaction n'est pas à l'origine de ses contenus.
La visite de Donald Trump dans les États arabes du Golfe a donné lieu à beaucoup de commentaires sur un changement radical que le nouvel-ancien président américain aurait introduit dans la politique étrangère américaine, en particulier envers la région arabe. Les commentaires se sont fondés sur les déclarations de Trump lors de la visite, en particulier son éloge de ce qu'il a décrit comme les succès remarquables des régimes du Golfe exportateurs de pétrole et de gaz, insinuant que la principale source de leur richesse était leur habileté à gérer les affaires. Il a accompagné cet éloge de l'affirmation répétée qu'il avait opéré un changement radical dans la politique étrangère de Washington, de sorte que l'Amérique dorénavant ne fasse plus la leçon à d'autres États sur la démocratie, ou ne tente plus d'en reconstruire certains sur des bases démocratiques, en référence aux échecs américains en Irak et en Afghanistan.
En réalité, la seule période de l'histoire moderne qui a vu un changement réel, bien que limité, dans la politique arabe de Washington a été durant le premier mandat de George W. Bush (2001-2005) et la première moitié de son second mandat (2005-2009). L'orgueil démesuré des États-Unis à l'apogée de l'hégémonie mondiale unipolaire qu'ils ont connue au cours de la dernière décennie du siècle dernier, après l'effondrement du système soviétique, a abouti à l'accession des « néoconservateurs » au pouvoir dans la nouvelle administration. Ceux-ci ont promu une politique « idéaliste » naïve, fantasmant sur une reproduction du rôle joué par l'Amérique dans la reconstruction de l'Europe occidentale et du Japon sur des bases prétendument démocratiques, mais cette fois dans la région arabe. En fait, l'idéologie néoconservatrice a fourni à l'administration Bush, pour la poursuite de son occupation de l'Irak, un prétexte qui a pris de plus en plus d'importance lorsque le prétexte principal originel – le mensonge selon lequel Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive – s'est effondré.
Washington s'est alors lancé dans une tentative de construire un système « démocratique » en Irak répondant à ses intérêts et a tenté de l'imposer au peuple irakien par le biais de législateurs de son choix – jusqu'à ce que le mouvement populaire répondant à l'appel de l'autorité religieuse chiite l'oblige à accepter une assemblée constituante élue au lieu d'une assemblée nommée par l'occupant. À ce stade, dans un effort visant à confirmer la sincérité de ses intentions, l'administration Bush, en particulier par l'intermédiaire de Condoleezza Rice après sa promotion de conseillère à la sécurité nationale au poste de secrétaire d'État, a déclaré que l'époque où la stabilité autoritaire avait la priorité sur les exigences de la démocratie était révolue et que le moment était venu d'inverser l'équation. Cette prétention s'est accompagnée de pressions sur le royaume saoudien, le Koweït et l'Égypte pour qu'ils mettent en œuvre des réformes limitées. Elle s'est rapidement estompée en Égypte lorsque Hosni Moubarak, au second tour des élections législatives de 2005, ferma la parenthèse démocratique limitée qu'il avait ouverte au premier tour, sachant pertinemment que les Frères musulmans en seraient les principaux bénéficiaires. Les résultats du premier tour furent suffisants pour confirmer son point de vue auprès de Washington, qui cessa par la suite d'exercer des pressions sur lui.
La perspective « idéaliste » des néoconservateurs s'est entièrement effondrée à la suite du déclenchement de la guerre civile irakienne en 2006. L'administration Bush s'est alors débarrassée des néoconservateurs les plus en vue dans la seconde moitié du second mandat du président (2007-2008). Elle revint au cours que les États-Unis avaient suivi à l'échelle mondiale depuis le début de la Guerre froide. Dans les pays du Nord mondial, ce cours a développé un discours idéologique démocratique presque exclusivement dirigé vers la sphère soviétique (pour rappel : Washington a accueilli le régime portugais quasi-fasciste parmi les membres fondateurs de l'OTAN en 1949, et le coup d'État en Grèce en 1967 n'a pas empêché ce pays de rester membre de l'alliance tout au long du régime militaire qui a pris fin en 1974).
Dans les pays du Sud mondial, le cours « réaliste » constituait la norme. En effet, Washington a joué un rôle clé dans le renversement par la force de plusieurs régimes démocratiques progressistes et leur remplacement par des dictatures de droite (le plus célèbre de ces nombreux cas est probablement le coup d'État militaire de 1973 contre Salvador Allende au Chili). Barack Obama et Joe Biden ont tous deux suivi le même cours hypocrite, quelles que puissent être leur prétention au contraire. L'hypocrisie a même atteint son paroxysme sous Biden, qui, en 2021 et 2023, a convoqué un « Sommet pour la démocratie » incluant des personnalités éminentes de la galaxie néofasciste, telles que le brésilien Bolsonaro, le philippin Duterte et l'indien Modi, sans oublier, bien sûr, l'israélien Netanyahu.
Dans la région arabe, les prétentions démocratiques de Washington depuis l'époque de la Guerre froide ne l'ont pas empêché de parrainer l'établissement d'un régime imprégné d'extrémisme religieux dans le royaume saoudien tout en exploitant ses richesses pétrolières. Washington a même poussé à l'accentuation de cet extrémisme ou à son raffermissement face à la « révolution islamique » de 1979 en Iran. C'est ce qu'a souligné le prince héritier Mohammed ben Salmane lui-même dans une célèbre interview donnée après son entrée en fonction, en réponse à une question sur l'extrémisme religieux qu'il avait entrepris de démanteler dans le royaume. Le prétexte utilisé par les États-Unis et d'autres pays occidentaux ayant des intérêts dans la région arabe pour justifier leur silence sur le despotisme était le « respect des cultures locales ». C'est le même prétexte qu'utilise Donald Trump pour justifier la priorité qu'il donne aux intérêts étatsuniens et à ses intérêts personnels et familiaux sur toute autre considération.
Si Trump a introduit un changement quelconque dans le cours de la politique étrangère américaine, c'est en abandonnant le discours démocratique que cette politique avait pratiqué en combinaison hypocrite avec un « réalisme » qui privilégiait les valeurs matérialistes sur toutes autres valeurs. Trump a ainsi abandonné l'un des outils de la soft power que l'Amérique imaginait exercer sur le monde entier jusqu'à son arrivée à la Maison Blanche. Le cours néofasciste que Washington a adopté au cours du second mandat de Trump n'est cependant pas moins hypocrite qu'auparavant. Le vice-président J.D. Vance a fait la leçon aux gouvernements européens libéraux sur la « démocratie » en défense des forces néofascistes dans leurs propres pays, et nous avons vu Trump lui-même se targuer d'offrir l'asile à une poignée de fermiers blancs sud-africains sous prétexte qu'ils subissaient un génocide, pur fruit de l'imagination de ses amis suprémacistes blancs, tout en incitant à un véritable et terrible génocide à Gaza. La morale de tout cela est que l'hypocrisie a été la caractéristique constante la plus éminente de la politique étrangère de Washington depuis des décennies et jusqu'à ce jour.
Traduit de ma chronique hebdomadaire dans le quotidien de langue arabe, Al-Quds al-Arabi, basé à Londres. Cet article est d'abord paru en ligne le 27 mai. Vous pouvez librement le reproduire en indiquant la source avec le lien correspondant.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La famine comme arme de génocide : Gaza 2025 - Union Soviétique 1941

Les images des enfants de Gaza, que la plupart des médias occidentaux refusent de montrer, ne laissent aucun doute : elles rappellent celles des camps d'extermination nazis filmées par des cinéastes comme John Ford, Samuel Fuller ou George Stevens juste après leur libération par l'armée américaine : des squelettes vivants, la peau collée sur les os, les yeux enfoncés dans les orbites, le regard embrumé !
Alors, force est de constater que le présent recours de l'État d'Israël a la famine comme arme de guerre contre la population de Gaza ressemble comme deux gouttes d'eau au « * Hungerplan* » (Plan de la faim) mise en œuvre par les nazis en Union Soviétique en 1941-1942, afin d'éliminer 30 millions de citoyens soviétiques. Dans les deux cas, même déshumanisation préalable des victimes, même volonté de ceux qui se posent en « * Herrenrasse* » (race des maîtres) d'exterminer leurs « * Untermenschen* » (sous-hommes) slaves et juifs alors, et palestiniens aujourd'hui, et même projet de vider le territoire de ses populations indigènes afin de l'occuper et le coloniser.
Et à Goering qui déclare à Galeazzo Ciano, ministre des affaires étrangères de Mussolini, que *« de 20 à 30 millions de personnes mourront de faim cette année en Russie. Et c'est sans doute très bien ainsi, car certains peuples doivent être décimés » *fait écho le ministre israélien Bezalel Smotrich qui déclare sans ambages qu'il serait *"justifié et moral de faire
mourir de faim 2 millions de Palestiniens à Gaza »…*
Ceci dit, il y a eu finalement « seulement » environ 6 millions de soviétiques (militaires, civils, juifs) morts de la faim, non pas parce qu'il a manqué aux nazis la volonté ou la détermination d'aller au bout de leur *Hungerplan*, mais en raison de la mauvaise tournure qu'a pris pour eux leur guerre contre l'URSS. Alors, Ernest Mandel a manifestement raison quand il constate que *« ce n'est pas vrai que les projets d'extermination des nazis étaient exclusivement réservés aux Juifs. Les Tziganes ont connu une proportion d'extermination comparable à celle des Juifs. À plus long terme, les nazis voulaient exterminer cent millions de personnes en Europe centrale et orientale, avant tout des Slaves ». (1)*
En somme, la Shoah n'est pas l'unique holocauste de l'histoire. Mais, s'il n'est pas unique, s'il y a eu d'autres avant ou en même temps que la Shoah, alors le meme Ernest Mandel a de bouveau raison de tirer la conclusion suivante : »Nous disons à dessein que l'holocauste est jusqu'ici le sommet des crimes contre l'humanité. Mais il n'y a aucune garantie que ce sommet ne soit pas égalé, ou même dépassé, à l'avenir. Le nier a priori nous semble irrationnel et politiquement irresponsable. Comme le disait Bertolt Brecht : « II est toujours fécond le ventre qui a accouché de ce monstre. »
En quelques mots Ernest Mandel non seulement invalide les arguments de tous ceux qui ont fait leur fortune en répétant que la Shoah est unique, « indicible » et « irrépétible », mais il nous avertit et nous prépare à la possibilité de nouveaux holocaustes. Et ce faisant, il répond d'avance aux deux réactions trop bien connues, aussi infondées et stupides l'une que l'autre : celle qui traite de « sacrilège » et interdit toute comparaison de la Shoah (2) avec ce qui arrive actuellement aux Palestiniens de Gaza, et l'autre qui s'interroge « comment est-ce possible que les juifs fassent aux Palestiniens ce qu'eux-mêmes ont subi des Allemands ? ». Tant que reste « fécond le ventre qui a accouché de ce monstre », c'est-à-dire tant qu'existent et se réunissent ce que Mandel appelle les « prémisses matérielles, sociales et idéologiques du génocide nazi », des nouveaux holocaustes sont possibles et notre devoir est de nous préparer à les prévenir en mobilisant toutes nos forces contre leurs « prémisses » !
Alors, que dire et que faire de tous ces dirigeants des 153 pays, dont les nôtres, qui bien que signataires de la « Convention sur le génocide », refusent ostensiblement de l'appliquer ? Que dire et que faire d'eux qui refusent le « devoir de prévenir le génocide » que leur impose cette Convention, un devoir « qui naît dès qu'un État a connaissance, ou aurait normalement dû avoir connaissance, d'un risque grave de génocide », qui comprend le « recours a la famine comme arme de guerre »,… « des actes constitutifs de crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, notamment l'extermination, et d'actes de génocide » ? (3) Que dire et que faire de ces complices de génocidaires et d'autres coupables de crimes contre
l'humanité ? …
Et la gauche dans tout ça, gauche israélienne en tout premier lieu ? Vu ce qu'elle ne dit pas et ce qu'elle ne fait pas en plein génocide des Palestiniens de Gaza, on ne peut que s'exclamer : cette gauche israélienne n'a que le nom ! (4) Car il n'y a nul besoin même d'être de gauche pour se révolter contre ce genocide, pour faire tout son possible pour le faire cesser, tout en luttant bec et ongles contre les génocidaires à la tête de ton propre pays.
Et pourtant, cette « gauche » israélienne ne fait rien de tout ça. Bien sûr, elle dénonce Netanyahou, elle va même jusqu'à l'appeler fasciste, mais elle ne dit rien des Palestiniens qui sont méthodiquement affamés, et systématiquement bombardés et massacrés par dizaines des milliers par l'armée de leur pays. Elle leur refuse sa solidarité. Elle s'en fout d'eux.
Comme d'ailleurs s'en foutent éperdument d'eux ses pareils de « gauche » dans la Diaspora qui parlent « en général » de paix et de coexistence avec les Palestiniens, mais n'osent même pas se démarquer des génocidaires et de leurs exécutants (militaires et autres) en faisant ce qu'avaient fait jadis les antifascistes allemands sous le Troisième Reich, et font, fort heureusement, aujourd'hui des milliers d'autres juifs aux Etats-Unis et de par le monde : descendre dans la rue aux côtés des Palestiniens, en brandissant publiquement les quatre mots qui sauvent l'honneur à la fois des juifs et de l'humanité : « not in my name » !
Notes
1. *Ernest Mandel » Prémisses matérielles, sociales et idéologiques du
génocide nazi* » :
https://ernestmandel.org/spip.php?page=article&id_article=183&lang=fr
2. Voir notre article *"**Auschwitz, la faillite de l'idée du progrès et
la réhabilitation de la dimension utopique du socialisme*" :
https://ujfp.org/auschwitz-la-faillite-de-lidee-du-progres/
3.
https://www.hrw.org/fr/news/2025/05/15/gaza-le-nouveau-plan-israelien-se-rapproche-de-lextermination
4. *Ce qu'un « sommet pour la paix » nous révèle sur l'état de la gauche
israélienne :*
https://agencemediapalestine.fr/blog/2025/05/12/ce-quun-sommet-pour-la-paix-nous-revele-sur-letat-de-la-gauche-israelienne/
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Gaza : un terrorisme d’Etat

L'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 a été un acte terroriste et barbare. Mais la riposte du gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou, massacrant plus de soixante mille habitants de Gaza, en leur majorité des femmes, des enfants et des personnes agées, a été cent fois plus terroriste.
Tiré du blogue de l'auteur.
1) Qui gouverne Israël ?
Benjamin Netanyahou et sa clique sont les héritiers d'un mouvement qui n'a jamais occulté sa nature criminelle.
En décembre 1948, lors de la visite de Menahem Begin, un des principaux leaders du parti Hérout, aux États-Unis, une trentaine de Juifs américains, plutôt "sionistes de gauche", parmi lesquels Hannah Arendt et Albert Einstein, ont envoyé au New York Times une déclaration qui dénonce catégoriquement ce personnage et son mouvement :
"Aux éditeurs du New York Times"
Parmi les phénomènes politiques les plus inquiétants de notre époque, est l'émergence, à l'intérieur de l'État d'Israël nouvellement créé, du "Parti de la Liberté" (Tnuat Haherut), un parti politique qui ressemble beaucoup, dans son organisation, ses méthodes, sa philosophie politique et ses prétentions sociales, aux partis politiques nazis et fascistes. Il a été créé par des membres et sympathisants de l'ancien Irgun Zvai Leumi, une organisation chauvine, droitière et terroriste, en Palestine. (...)
Un exemple choquant a été donné par ce qu'ils ont fait contre le village arabe de Deir Yassin. Ce village, situé à l'écart des routes principales et entouré de terres juives, n'a pris aucune part à la guerre et a même combattu des groupes arabes qui avaient l'intention d'y établir une base. Le 9 avril, selon le New York Times, des groupes terroristes ont attaqué ce paisible village, qui n'était en rien un objectif militaire dans ce conflit, tué la plupart de ses habitants (240 personnes, hommes, femmes et enfants), et gardé quelques-uns en vie, afin de les faire parader, en tant que prisonniers, dans les rues de Jérusalem. (...)
L'incident de Deir Yassin illustre le caractère et les actions du Parti de la Liberté. À l'intérieur de la communauté juive, ils prêchent un mélange d'ultra-nationalisme, de mysticisme religieux et de supériorité raciale. (...)" [1]
Le gouvernement actuel d'Israël, hégémonisé par le Likoud (héritier direct du Hérout de Begin), a cependant dépassé, de loin, les crimes commis par ses ancêtres dénoncés comme "fascistes" par Albert Einstein. C'est un gouvernement qui comporte d'ailleurs des personnages comme Itamar Ben Gvir et Bezalel Smotrich, qui vont bien au-delà, dans leur ultra-nationalisme raciste, de leurs alliés fascistes du Likoud. Ce gouvernement était devenu assez impopulaire – notamment par sa tentative d'évincer la Cour suprême – et était au bord de l'écroulement, menacé par de larges manifestations dans toutes les villes du pays. Il a été sauvé par l'attaque du 7 octobre 2023.
2) Que s'est-il passé le 7 octobre 2023 ?
Le Hamas, mouvement fondamentaliste et réactionnaire qui gouvernait la bande de Gaza, avait été longtemps soutenu par Netanyahou pour diviser le mouvement national palestinien. Lors d'une réunion du Likoud en mars 2019, Benjamin Netanyahou déclarait : "Ceux qui veulent empêcher la création d'un État palestinien doivent soutenir le renforcement du Hamas (...)".
Que s'est-il donc passé le 7 octobre ? On a pu lire et entendre les propositions les plus contradictoires, dans la plus grande confusion. Enzo Traverso propose une analyse sobre et objective :
"L'attaque du 7 octobre, qui a tué des centaines de civils israéliens, peut évidemment être qualifiée d'acte terroriste. Il n'était pas nécessaire d'assassiner et de blesser des civils, et de tels actes ont de surcroît toujours nui à la cause palestinienne. C'est un crime que rien ne peut justifier et qui doit être condamné. La réprobation nécessaire de ces moyens d'action ne remet cependant pas en cause la légitimité – reconnue par le droit international – de la résistance à l'occupation, une résistance qui implique aussi le recours aux armes." [2]
Un des aspects les plus tragiques de cette attaque barbare a été le fait que beaucoup de victimes appartenaient à des kibbutzim de gauche, pacifistes, et étaient même parfois directement engagées dans des actes de solidarité avec les Palestiniens de Gaza. Si le Hamas avait attaqué seulement les bases militaires et pris deux cents soldats israéliens comme otages, cela aurait pu être une victoire politique. Mais le Hamas, depuis longtemps, avait choisi d'ignorer la distinction entre militaires et civils comme méthode de lutte.
3) La réponse d'Israël est un terrorisme d'État.
La riposte du gouvernement israélien a été cent fois plus terroriste que l'attaque du Hamas. Elle a résulté dans la destruction de Gaza, de ses maisons, écoles, hôpitaux, universités, et dans le massacre de plus de soixante mille Gazaouis (des milliers de corps ensevelis sous les décombres n'ont pas encore été pris en compte), dont la majorité étaient des femmes, des enfants et des personnes âgées. Parmi les civils ainsi assassinés, des médecins, des infirmières, des écrivains, des poètes, des musiciens, des journalistes, des cinéastes, des travailleurs des associations humanitaires, des employés des Nations Unies. On compte aussi plus de cent mille blessés, parmi lesquels de nombreux enfants mutilés. Netanyahou et sa clique ont aussi utilisé la faim comme arme de guerre, en bloquant l'entrée à Gaza des secours alimentaires et médicaux. Il s'agit, comme le constate dans son récent livre le politologue Gilbert Achcar, "du pire épisode du long calvaire du peuple palestinien". [3]
L'objectif maintenant déclaré de cette criminelle destruction est l'expulsion des deux millions de Palestiniens de la bande de Gaza, un nettoyage ethnique sans précédent. Malgré le soutien de Donald Trump, ce projet est irréalisable, aucun pays n'étant disposé à recevoir tout un peuple expulsé de sa terre.
Il s'agit d'un crime de terrorisme d'État, un véritable crime contre l'humanité. De nombreux universitaires israéliens, comme Raz Segal, parlent de génocide. Lee Mordechai, professeur à l'université de Jérusalem, après avoir rejeté ce terme, a changé d'avis : il s'agit de génocide.
4) L'opposition à la guerre se renforce, en Israël même.
La politique d'extermination du gouvernement israélien a rencontré une opposition croissante dans l'opinion publique internationale, y compris la diaspora juive. Des milliers de jeunes juifs ont participé aux protestations, notamment aux États-Unis. Il est ridicule de les accuser d'"antisémitisme". Les gouvernements européens, après deux années de complicité, commencent à prendre leurs distances.
Mais à l'intérieur même de l'État d'Israël, l'opposition à cette guerre s'étend. Les médias se réfèrent surtout aux familles des otages qui exigent un cessez-le-feu et des négociations avec le Hamas. Ces négociations ont permis la libération de plusieurs otages et un nombre important de prisonniers palestiniens, mais pas Marwan Barghouti, le "Nelson Mandela palestinien"...
Cependant, le refus de cette guerre barbare ne se limite pas à ces familles : il est beaucoup plus profond et ample. Il inclut des ONG comme B'Tselem, qui défendent les prisonniers palestiniens, Standing Together, qui réunit juifs et palestiniens dans l'opposition à la guerre, ou Breaking the Silence, qui publie des témoignages sur les crimes commis à Gaza ; les journalistes du quotidien Haaretz, comme Gideon Levy et Amira Hass ; des milliers d'officiers et soldats réservistes, notamment de l'aviation, qui ont publié des déclarations refusant de participer à la guerre (l'état-major de l'armée reconnaît que près de 40 % des réservistes ne répondent pas à l'appel) ; 3600 Israéliens qui ont signé un appel demandant des sanctions contre Israël. Les manifestations se multiplient, notamment sur les campus, où on a pu voir des pancartes proclamant : "Stop the Genocide", "Palestinian Lives Matter".
La principale force politique dans cette opposition est le Parti communiste israélien (Hadash), dont plusieurs députés, juifs comme Ofer Kassif, qui a appelé les soldats à refuser d'obéir aux ordres de participer au génocide, ou arabes, comme Ayman Odeh et Aida Touma-Souleiman, ont été suspendus de la Knesset (parlement) pour avoir dénoncé la guerre. Pour les communistes et pour les Israéliens les plus critiques, c'est toute l'entreprise colonialiste en Cisjordanie et à Gaza qu'il faut rejeter.
5) Quel avenir ?
Au-delà de la guerre et des massacres, peut-on imaginer un avenir commun pour Juifs israéliens et Arabes palestiniens ?
Pour le grand écrivain palestinien Elias Sanbar, ancien ambassadeur de la Palestine auprès de l'Unesco, le premier pas serait "une reconnaissance pleine et anticipée de la Palestine" (dans les frontières de la ligne verte de juin 1967) :
"Qu'est-ce qui interdirait à des nations souveraines de reconnaître pleinement un pays même si la souveraineté de ce dernier est captive d'un puissant occupant ?" [4]
La gauche en France et ailleurs est divisée entre partisans d'un État, de deux États, d'une fédération binationale, etc. J'aimerais ajouter une autre idée : une confédération démocratique, socialiste et multinationale des peuples du Moyen-Orient. Est-ce un rêve ? Certes, mais comme disait Lénine, "il faut rêver"...
Michael Löwy
Notes
[1] Le journaliste grec Giorgo Mitralias a re-découvert et publié dans son blog ce document.
[2] Enzo Traverso, Gaza devant l'histoire, Québec, Lux, 2025, p. 88.
[3] Gilbert Achcar, Gaza, génocide annoncé. Un tournant dans l'histoire mondiale, Paris, La Dispute, 2025.
[4] Elias Sanbar, "La dernière guerre ?". Palestine, 7 octobre 2023 - 2 avril 2024, Paris, Gallimard, "Tracts", n° 56, 2024
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

En l’espace d’une semaine, un avant-poste de colon efface toute une communauté palestinienne

Après avoir construit sur leurs terres, des colons israéliens ont attaqué et chassé les habitants de Maghayer Al-Dir, l'un des derniers villages du sud de la vallée du Jourdain.
Tiré d'Agence médias Palestine.
Le matin du 18 mai, des colons israéliens ont établi un avant-poste illégal au sein de la communauté palestinienne de bergers de Maghayer Al-Dir, dans la zone C de la Cisjordanie, à seulement 100 mètres des habitations des résidents.
En milieu de semaine, avant toute confrontation violente ou incident de vol de bétail, près de la moitié des villageois palestiniens avaient fait leurs bagages et pris la fuite, les autres se préparant à faire de même : sous le regard des colons, les familles ont commencé à charger leurs moutons, leurs meubles, la nourriture pour animaux et des réservoirs d'eau dans des camions.
Mais samedi après-midi, la « patrouille » habituelle des colons dans le village a dégénéré en une attaque organisée. Quatre colons ont commencé à bousculer de jeunes Palestiniens qui se tenaient sur les toits des bâtiments en cours de démantèlement. « [Les colons] cherchaient la bagarre », a déclaré Avishay Mohar, un militant et photographe qui se trouvait sur place.
Les colons et les Palestiniens ont commencé à se lancer des pierres. Alors que l'affrontement semblait avoir pris fin, les colons ont appelé des renforts : environ 25 colons supplémentaires, certains masqués, beaucoup armés de fusils d'assaut et de matraques, se sont joints à l'attaque contre les habitants et les militants internationaux, qui ont riposté.
Un colon a été touché à la tête par une grosse pierre, s'est effondré et a perdu connaissance. Un Palestinien a également été touché au visage par une pierre. Un deuxième colon, apparemment mineur, a saisi le pistolet dans le gilet de son ami inconscient et a commencé à tirer en l'air. « Un autre colon est arrivé avec un M16 et a commencé à tirer sur nous », se souvient Mohar. Alors que la panique se propageait, les habitants ont couru frénétiquement vers le village voisin de Wadi Al-Siq, dont la population avait été déplacée quelques mois plus tôt lors d'une vague de violence des colons soutenus par l'État en octobre 2023.
Les colons ont poursuivi les habitants en fuite dans la vallée, leur jetant des pierres et brisant leurs téléphones. Ils ont saisi les deux appareils photo, le téléphone, le portefeuille et la batterie externe de Mohar. Au sol, il a vu les colons frapper à coups de matraque un garçon palestinien de 15 ans à la tête. Mohar a commencé à avoir des vertiges à cause des coups et avait du mal à relever la tête. « J'ai dit aux colons : « Si vous continuez, vous allez me tuer ! » » Ils ont continué à le frapper violemment dans le dos.
Après l'arrivée tardive de l'armée et l'appel des ambulances, les recherches pour retrouver les 12 blessés— dont certains ont été retrouvés entre 500 et 600 mètres du village — se sont poursuivies jusque dans la nuit. Le lendemain matin, il ne restait plus un seul habitant à Maghayer Al-Dir. Les 23 familles, soit environ 150 personnes, avaient été contraintes de fuir.
« Cette attaque a envoyé un message aux communautés palestiniennes de toute la Cisjordanie », a déclaré Mohar. « Non seulement vous ne pouvez pas rester, mais vous ne pouvez même pas partir tranquillement. »
« Ici aussi, il y aura des Juifs »
Depuis octobre 2023, plus de 60 communautés de bergers palestiniens de Cisjordanie ont été déplacées, et au moins 14 nouveaux avant-postes ont été construits sur leurs ruines ou à proximité. Une communauté expulsée violemment, Wadi Al-Siq, a été victime d'abus, notamment d'agressions sexuelles, qui ont conduit à la dissolution de l'unité « Desert Frontier » de l'armée israélienne.
Comme dans le cas de Maghayer Al-Dir, la création d'avant-postes de colons éleveurs a été le principal facteur qui a poussé les Palestiniens à quitter leurs maisons dans la zone C. Selon un récent rapport des ONG Peace Now et Kerem Navot, les colons israéliens ont utilisé des avant-postes pastoraux pour s'emparer d'au moins 786 000 dunams de terres, soit environ 14 % de la superficie totale de la Cisjordanie. Au cours des deux dernières années et demie, sept communautés pastorales palestiniennes voisines de Maghayer Al-Dir ont été dépeuplées.
Maghayer Al-Dir était la dernière communauté palestinienne restante dans la périphérie de Ramallah, à l'est de la route Allon, une autoroute stratégique nord-sud construite par Israël dans les années 1970 pour relier les colonies et préparer l'annexion potentielle du territoire situé à l'est de la route, le long de la frontière jordanienne. Originaires du Naqab/Néguev, les familles de Maghayer Al-Dir ont été expulsées en 1948 vers une autre partie de la vallée du Jourdain, avant que l'État ne décide de construire une base militaire et de les déplacer une nouvelle fois vers leur site actuel.
Dans une vidéo tournée par le militant Itamar Greenberg le jour où les colons ont établi le nouvel avant-poste, on peut entendre un colon se vanter du nettoyage ethnique de Maghayer Al-Dir. « C'est le dernier endroit qui reste – Dieu merci, nous avons chassé tout le monde… Toute cette zone n'est plus que des Juifs », explique le colon en montrant du doigt l'étendue à sa gauche. La caméra se concentre ensuite sur le site où les jeunes du sommet de la colline s'affairent à construire l'avant-poste. « Ici aussi, il y aura des Juifs. »
Comme l'a rapporté +972 en août 2023, la plupart des communautés vivant dans le territoire situé entre Ramallah et Jéricho, une zone de 150 000 dunams, ont été contraintes de fuir au cours des mois précédents, lorsque les colons ont commencé à construire rapidement des avant-postes pour le bétail et à s'en prendre violemment aux habitants, avec le soutien de l'armée israélienne et des institutions de l'État. Aujourd'hui, seules deux communautés palestiniennes, M'arajat et Ras Al-Auja, subsistent dans toute la partie sud de la vallée du Jourdain.
Même avant la construction du dernier avant-poste, Maghayer Al-Dir était complètement encerclée par des colonies et des avant-postes israéliens. Au nord se trouve l'avant-poste semi-autorisé de Mitzpe Dani ; à l'est, Ruach Ha'aretz (« Esprit de la terre »), établi peu avant la guerre et agrandi par la suite ; et au sud, près du village désormais déserté de Wadi Al-Siq, se trouve l'un des avant-postes de Neria Ben Pazi. Bien que Ben Pazi ait été sanctionné par le gouvernement britannique la semaine dernière pour son rôle dans la construction d'avant-postes illégaux et l'expulsion de familles bédouines palestiniennes de leurs maisons, il a été vu en train de patrouiller dans le village dans les jours qui ont précédé le départ forcé de la communauté.
« Les colons sont venus préparés, avec un plan, pour s'emparer des terres et nous expulser », a déclaré un habitant du village qui a préféré rester anonyme par crainte de représailles de la part des colons.
Ces dernières années, les colons des avant-postes environnants ont commencé à ériger des clôtures qui isolent les maisons des habitants de la route principale menant à Maghayer Al-Dir. Ils volaient également de manière systématique l'eau du puits du village pour abreuver leurs moutons.
Un autre habitant, qui a également souhaité garder l'anonymat, explique qu'il n'y a aucune différence entre la violence des colons et celle de l'État. « Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de loi », déclare-t-il à +972. « [Les colons] disent ‘Nous sommes le gouvernement', et la police est avec eux. » Il envisage désormais de vendre son troupeau de moutons, car les colons s'emparent de plus en plus des terres sur lesquelles les Palestiniens faisaient paître leur bétail.
« L'année dernière, des colons sont entrés dans le village et ont attaqué mes proches », a-t-il poursuivi. « Nous avons essayé de nous défendre en filmant, et j'ai été arrêté. Heureusement, le juge d'Ofer [tribunal militaire] m'a libéré en demandant [ironiquement] au procureur si nous étions censés servir le café aux colons qui envahissaient nos maisons. »
Une tactique familière
Le jeudi 22 mai, la famille Malihaat a passé la journée à faire ses cartons. Les colons avaient érigé leur dernier avant-poste à l'intérieur d'une bergerie appartenant à Ahmad Malihaat, 58 ans, père de neuf enfants. Quelques heures après sa mise en place, a-t-il raconté, les colons « ont rapidement essayé de s'emparer de nos moutons, afin de pouvoir ensuite prétendre [aux autorités israéliennes] qu'ils leur appartenaient et les emmener ».
Il s'agit d'une tactique bien connue de la communauté : début mars, des dizaines de colons armés de fusils et de gourdins ont volé plus de 1 000 moutons à la communauté de bergers de Ras Ein Al-‘Auja. Craignant que cela ne se reproduise, les habitants de Maghayer Al-Dir ont concentré leurs efforts initiaux sur l'évacuation du bétail du village dans les jours qui ont suivi la construction de l'avant-poste.
Pourtant, la famille Malihaat a témoigné que mercredi soir, les colons ont réussi à leur voler un âne et 10 sacs de nourriture pour animaux. Malihaat se souvient que les colons lui ont dit d'aller en Jordanie ou en Irak. « Ils veulent nous expulser, nous et les autres communautés bédouines, et s'emparer des terres par tous les moyens. »
Malgré l'ordre de l'administration civile du 18 mai de cesser leurs activités de construction, les colons ont agrandi l'avant-poste de Maghayer Al-Dir jour après jour, installant une grande tente et raccordant le site à l'eau courante d'un avant-poste voisin érigé peu avant la guerre.
Alors qu'ils rassemblaient leurs biens et se préparaient à partir, Malihaat raconte qu'il n'avait pratiquement pas dormi ni mangé depuis la construction de l'avant-poste. Il ajoute que son régime alimentaire se composait « principalement de cigarettes et d'eau ». À ce moment-là, il avait presque prédit l'attaque imminente. « On ne sait jamais ce que [les colons] vont faire. Ils vont peut-être frapper votre fils, puis appeler la police et vous arrêter, vous ou votre fils, et vous devrez payer une caution de 20 000 shekels. »
Malihaat ne sait pas encore où sa famille va s'installer. Il a indiqué qu'une fois qu'une communauté de bergers est déplacée, elle obtient parfois l'autorisation temporaire de s'installer sur des terres appartenant à d'autres communautés palestiniennes dans la zone B de la Cisjordanie. Mais ce n'est pas une solution à long terme.
« Quand votre voisin est gentil, tout va bien, mais eux [les colons], ils ne veulent pas la paix », a conclu Malihaat. « Ils veulent vous expulser, vous tuer et détruire votre maison. »
En réponse à la demande de +972, un porte-parole de l'armée israélienne a déclaré que le nouvel avant-poste était situé sur un terrain appartenant à l'État et n'empiétait pas sur la zone où réside la communauté. L'administration civile a également confirmé qu'un ordre d'arrêt des travaux avait été émis pour l'avant-poste, « en raison de la présence d'éléments de construction illégaux dans la zone ».
Une version de cet article a été publiée pour la première fois en hébreu sur Local Call. Vous pouvez la lire ici.
Oren Ziv est photojournaliste, reporter pour Local Call et membre fondateur du collectif de photographes Activestills.
Traduction : JB pour l'Agence Média Palestine
Source : +972 Magazine
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Fondation Humanitaire de Gaza : le nouveau modèle israélien d’aide humanitaire militarisée

‘De tels programmes ne font guère plus que maintenir l'illusion d'une préoccupation humanitaire au milieu des violences génocidaires et du nettoyage ethnique qui se poursuivent.‘
Tiré d'Agence médias Palestine.
En mars 2024, la principale initiative mondiale de surveillance de la sécurité alimentaire, l'IPC (Integrated Food Security Phase Classification) a averti que la famine était imminente à Gaza.
Aujourd'hui, près d'un demi-million de Palestiniens sont confrontés à une famine catastrophique, le reste de la population du territoire se trouvant en état de crise ou d'urgence.Des enfants, des personnes âgées et des malades, mais aussi des personnes qui étaient autrefois en bonne santé, meurent chaque jour de malnutrition, de déshydratation et de maladies qui pourraient être évitées.
Les bébés naissent dans un monde de précarité et de famine.
Il ne s'agit pas d'une catastrophe naturelle. C'est le résultat brutal de la violence orchestrée et de l'apathie collective mondiale. La famine à Gaza n'est pas un dommage collatéral, mais plutôt la conséquence intentionnelle des politiques conçues par le gouvernement israélien pour maximiser la souffrance et la mort.
L'utilisation de la nourriture et de l'aide humanitaire comme arme est depuis longtemps un pilier de la stratégie militaire d'Israël à Gaza et dans toute la Palestine occupée.
Depuis qu'Israël a imposé son blocus sur Gaza il y a 17 ans, les Palestiniens vivent sous un régime de contrôle total qui étouffe leur économie, paralyse leurs infrastructures et restreint la circulation des personnes et des biens.
En 2012, le gouvernement israélien a dû rendre public un document rédigé en 2008, qui révélait que son ministère de la Défense avait calculé l'apport calorique minimum nécessaire pour éviter la malnutrition tout en continuant à restreindre autant que possible l'accès à la nourriture. Comme l'a déclaré un haut responsable israélien en 2006, Gaza devait être maintenue « au régime ».
Des restrictions opaques
Depuis plus d'une décennie, les organisations de défense des droits humains et les experts indépendants de l'ONU ont condamné à plusieurs reprises ce blocus, le qualifiant de punition collective. Mais en l'absence de répercussions concrètes, les gouvernements israéliens successifs ont continué à renforcer et à étendre cette pratique de privation orchestrée.
Le refus systématique, le retard et la destruction de l'eau, de la nourriture, des fournitures médicales et des abris sont devenus les caractéristiques déterminantes de cette politique ; même les équipements de purification de l'eau, les béquilles et l'insuline ont été bloqués en raison des restrictions injustifiables et opaques d'Israël en matière de « double usage ».
Les prestataires de services publics palestiniens, les réseaux de la société civile et les organisations humanitaires se trouvent dans l'incapacité de répondre aux besoins les plus élémentaires des Palestiniens vivant à Gaza. Ces derniers mois, alors qu'Israël intensifiait son offensive, ce blocus s'est transformé en un siège à part entière.
Les conséquences inévitables de cette stratégie délibérée ont été catastrophiques. Des experts indépendants de l'ONU ont déclaré à la mi-2024 que la famine s'était propagée dans toute la bande de Gaza.
Des enfants et des personnes âgées meurent de faim et de déshydratation, tandis que l'Organisation mondiale de la santé a averti que la famine à Gaza menace de freiner de manière permanente la croissance et le développement cognitif de toute une génération d'enfants.
Au milieu de cette crise qui s'aggrave, la manipulation de l'aide dite humanitaire s'accélère. Au printemps 2024, les États-Unis ont construit un « quai humanitaire » au large des côtes de Gaza. Les Palestiniens ont exprimé leur scepticisme, craignant que ce quai ne serve à masquer des opérations militaires, tandis que les organisations humanitaires ont fait valoir que sa construction ne faisait que détourner l'attention de l'obstruction délibérée par Israël de tous les points de passage terrestres existants.
Au mois de juin, la zone entourant ce quai a été utilisée lors d'un raid israélien contre le camp de réfugiés de Nuseirat, déguisé en mission humanitaire. Près de 300 Palestiniens ont été tués et près de 700 autres blessés.
Les experts des droits de l'homme de l'ONU ont qualifié cette attaque d'exemple de barbarie sans précédent. Pourtant, aucune répercussion significative n'a été dirigée contre Israël ou son allié américain.
Les acteurs humanitaires établis ont été maintes fois discrédités, notamment l'Office de secours et de travaux des Nations unies (UNRWA), ce qui constitue une autre tactique dans cette guerre d'usure.
L'UNRWA joue depuis longtemps un rôle central dans la distribution de l'aide et la fourniture de services essentiels dans toute la bande de Gaza. Mais ces derniers mois, elle a fait l'objet d'une campagne de désinformation intensifiée, qui a conduit à des attaques directes contre son personnel, au retrait de financements et à une interdiction imposée par la Knesset israélienne, une mesure à la fois illégale et sans précédent dans l'histoire de l'ONU.
« Affamer pour soumettre »
Cet affaiblissement des infrastructures civiles et humanitaires à un moment où les besoins sont extrêmement élevés a encore isolé la population palestinienne de Gaza, renforçant sa dépendance à l'égard de programmes d'aide contrôlés de l'extérieur et largement irresponsables.
Le dernier programme en date d'Israël est la Gaza Humanitarian Foundation (GHF), nouvellement créée et soutenue par Tel-Aviv et Washington. La GHF a été créée pour superviser la distribution de l'aide dans toute la bande de Gaza, dans le but de mettre à l'écart toutes les structures existantes, y compris l'ONU. Un ancien porte-parole de l'UNRWA a condamné cette initiative, la qualifiant d'« aide humanitaire de façade », une stratégie visant à masquer la réalité, à savoir « affamer la population pour la soumettre ».
Selon la proposition de la GHF, les plus de deux millions d'habitants de Gaza seraient contraints de se procurer de la nourriture dans l'un des quatre « sites de distribution sécurisés ». Aucun des sites proposés n'est situé dans le nord de Gaza, une région qu'Israël a attaquée et occupée dans le but de procéder à un nettoyage ethnique, ce qui signifie que les personnes qui y vivent encore seront contraintes de fuir vers le sud pour accéder à l'aide vitale. La privation de l'aide humanitaire comme moyen de transfert forcé d'une population est reconnue comme un crime contre l'humanité.
L'annonce officielle du GHF ne fait aucune mention des attaques répétées d'Israël contre des centres de distribution alimentaire, des boulangeries et des convois humanitaires, qui ont causé la mort de centaines de Palestiniens qui tentaient de nourrir leur famille, ni de l'obstruction délibérée par Israël du système humanitaire existant.
Cette forme de contrôle de l'aide renforce le siège plutôt que de l'alléger. Des solutions inhumaines et inadéquates, telles que les largages aériens de vivres ou les colis alimentaires conditionnés, ne font guère plus que maintenir l'illusion d'une préoccupation humanitaire, tandis que la violence génocidaire et le nettoyage ethnique se poursuivent. Les auteurs de ces privations se posent en sauveurs, tout en continuant à affamer une population pour la pousser au déplacement et à la soumission.
Il ne s'agit pas d'une critique marginale : le coordinateur des secours d'urgence de l'ONU, Tom Fletcher, a qualifié les plans présentés par le GHF de « feuille de vigne pour justifier davantage de violence et de déplacements ».
Malgré la décision rendue en janvier 2024 par la Cour internationale de justice, qui exigeait la protection immédiate des civils à Gaza et la fourniture généralisée d'une aide humanitaire, la situation a continué de se détériorer rapidement. Une enquête menée en janvier 2025 auprès de 35 organisations humanitaires travaillant à Gaza a révélé un consensus écrasant : 100 % d'entre elles ont déclaré que l'approche adoptée par Israël était inefficace, inadéquate ou avait systématiquement entravé l'acheminement de l'aide.
L'incapacité de la communauté internationale à agir de manière décisive a permis cette crise prévisible – non pas une crise humanitaire, mais une crise politique marquée par l'apathie, l'indifférence et l'impunité. Les avertissements concernant la malnutrition massive et l'effondrement des infrastructures sanitaires et sociales de Gaza ont été ignorés pendant des années. Que la famine frappe aujourd'hui une population qui a été systématiquement privée de nourriture ne devrait surprendre personne.
L'utilisation de l'aide et de la nourriture comme armes à Gaza n'est pas un accident tragique. C'est le résultat prévisible – et prévu – d'un siège destiné à contrôler et à déplacer la population. L'incapacité des États et des organismes multinationaux à mettre fin à ce processus n'est pas simplement le résultat d'un environnement politique complexe, c'est un échec de la volonté, de la responsabilité et de la gouvernance mondiale.
Les détracteurs du GHF et des derniers plans d'Israël visant à mener un nettoyage ethnique sous couvert d'aide humanitaire doivent reconnaître la longue histoire de l'occupant en matière d'instrumentalisation et de militarisation de l'aide. Nous pourrons ainsi nous détourner des efforts réformistes visant à garantir une apparence de conduite humanitaire prétendument éthique et dénoncer l'ensemble des moyens utilisés par Israël pour créer une dépendance à l'aide depuis des décennies, dans le seul but de manipuler le système humanitaire comme pilier central de ses ambitions coloniales plus larges.
Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement la politique éditoriale de Middle East Eye.
Amira Nimerawi est PDG de Health Workers 4 Palestine (HW4P) et spécialiste de l'impact des programmes au sein de la Palestinian Medical Relief Society (PMRS), spécialisée dans les programmes de soins d'urgence et de santé sexuelle en Palestine.
Sara el-Solh est médecin et anthropologue. Elle travaille à l'échelle nationale et internationale sur diverses questions de santé publique, notamment la migration, la justice climatique et l'accès aux soins de santé.
James Smith est maître de conférences en politique et pratique humanitaires à l'UCL et médecin urgentiste basé à Londres. Il a travaillé à Gaza entre décembre 2023 et janvier 2024, puis d'avril à juin 2024.
Mads Gilbert est un médecin urgentiste norvégien qui se rend régulièrement dans les camps de réfugiés palestiniens au Liban, en Cisjordanie occupée et à Gaza depuis 1982.
Traduction : JB pour l'Agence Média Palestine
Source : Middle East Eye
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’évolution du mouvement syndical en Ukraine

Oleksandr Skiba est membre du syndicat VPZU (Syndicat libre des cheminots d'Ukraine – KVPU) au dépôt ferroviaire de Darnytsa et président de la Fondation pour le développement de l'Union.
Tiré de Entre les lignes et les mots
1. Introduction
Le mouvement syndical ukrainien est né dans le cadre du système soviétique, où les syndicats jouaient principalement un rôle décoratif, se concentrant sur la distribution des avantages sociaux plutôt que sur la défense des droits des travailleurs. L'effondrement de l'Union soviétique a marqué le début d'un nouveau chapitre. Dès 1990, des organisations syndicales indépendantes ont commencé à émerger, remettant en cause les institutions de l'« ancien système ». Au fil du temps, un nombre important de ces organisations se sont regroupées au sein de la Confédération des syndicats libres d'Ukraine (KVPU).
Parallèlement, la Fédération des syndicats d'Ukraine (FPU) – la plus grande coalition de syndicats dits « traditionnels » ou « jaunes » – a poursuivi ses activités. Cette entité a hérité d'actifs et de positions institutionnelles considérables de l'ère soviétique. Bien qu'elle ait conservé une structure organisationnelle formelle, comprenant des rapports, des comités et des divisions de jeunes, ses opérations étaient largement symboliques et manquaient d'engagement substantiel. En particulier, la participation des jeunes au sein de ces organisations était nominale, sans véritable implication dans les processus de prise de décision ou de défense des droits du travail.
Au début de la guerre à grande échelle en 2022, le mouvement syndical s'est retrouvé dans une situation de crise profonde. Les principaux défis à relever ont été les suivants :
– Faiblesse institutionnelle : Les syndicats ont exercé une influence minimale sur les processus législatifs et l'élaboration de la politique économique ;
– Isolement politique : Les questions relatives au travail ont été marginalisées et les syndicats ne disposent pas d'une plate-forme politique spécifique ;
– Stagnation organisationnelle : La vision stratégique était absente, les cadres juridiques étaient sous-développés et les progrès en matière de transformation numérique restaient insuffisants.
2. Contexte juridique et politique en temps de guerre
Le déclenchement d'une invasion à grande échelle en Ukraine a entraîné des transformations radicales dans le cadre juridique des relations de travail. La loi n°2136, adoptée en 2022, a considérablement restreint les droits des employés : les grèves ont été interdites, les garanties sociales ont été réduites et des dispositions clés des conventions collectives ont été annulées. En conséquence, les syndicats ont été privés de leurs mécanismes d'influence légaux et publics.
Les centres de recrutement territoriaux (TCC) sont devenus un instrument de pression supplémentaire. Des cas ont été documentés où la mobilisation aurait été utilisée pour cibler des militants syndicaux et des employés ayant une position fermement pro-ouvrière. Les employeurs, quant à eux, ont acquis un nouveau pouvoir discrétionnaire, à savoir la capacité de déterminer quels employés seraient mobilisés et lesquels seraient exemptés de la mobilisation, souvent sur la base de la loyauté personnelle ou de l'implication dans des activités syndicales. Ces développements ont eu un impact significatif sur les représentants des syndicats indépendants, qui sont généralement plus virulents dans leurs critiques à l'égard des employeurs et des autorités de l'État.
En outre, un nombre important de personnes ayant une position civique active, y compris des dirigeants et des militants, se sont portées volontaires pour le service militaire au début de 2022. Cela a considérablement affaibli le capital humain et le leadership intellectuel du mouvement syndical, aggravant les crises existantes de gouvernance et de résilience institutionnelle.
Simultanément, la suspension effective des activités du Service national du travail – en particulier des inspections de protection du travail – a entraîné des violations impunies des normes de sécurité et des conditions de travail. La suspension des inspections programmées a créé un environnement propice aux abus, en particulier dans les secteurs dangereux et à bas salaires.
Ainsi, le mouvement syndical a été soumis à une double pression : celle de l'État, qui a imposé des mesures restrictives en temps de guerre, et celle des employeurs, qui ont exploité la guerre comme moyen de contrôle. Dans un tel contexte, la défense des droits des travailleurs exige non seulement une expertise juridique, mais aussi un courage personnel exceptionnel.
Les éléments clés de ce contexte sont les suivants
– La loi n°2136 et les restrictions qu'elle impose aux droits des travailleurs, notamment l'interdiction des grèves et la réduction des garanties sociales ;
– La loi martiale et la pression des centres de recrutement territoriaux (TCC) ;
– La mobilisation des militants syndicaux, qui a conduit à l'affaiblissement des structures organisationnelles ;
– La suspension de facto des inspections de la protection du travail, ce qui entraîne des violations sur le lieu de travail non contrôlées.
3. La réponse des syndicats aux défis de la guerre
En réponse aux défis sans précédent posés par l'invasion à grande échelle, les syndicats ukrainiens ont mobilisé un large éventail d'initiatives visant à soutenir les travailleurs et à défendre la cohésion sociale. Malgré les limites institutionnelles et les contraintes politiques, les syndicats ont fait preuve de résilience, d'adaptabilité et d'un engagement fort en faveur de la solidarité.
Activités bénévoles et aide humanitaire : Les organisations syndicales ont joué un rôle actif dans les efforts de volontariat, apportant un soutien essentiel aux personnes déplacées à l'intérieur du pays et aux populations vulnérables. Ces initiatives comprennent la distribution de nourriture, de vêtements, de médicaments et d'abris, ainsi que la coordination du soutien logistique en coopération avec les communautés locales et les partenaires internationaux.
– Soutien aux travailleurs des infrastructures essentielles et du secteur de la défense : Les syndicats ont apporté une aide ciblée aux employés travaillant dans les services essentiels, en particulier dans les secteurs de l'énergie, des transports, des soins de santé et de la défense.
– Protection des droits des travailleurs mobilisés
Engagement dans des initiatives syndicales internationale : Les syndicats ukrainiens ont participé activement aux réseaux mondiaux de solidarité et aux forums internationaux du travail. Ces engagements ont permis de faciliter l'échange de bonnes pratiques, d'obtenir une aide matérielle et de sensibiliser la communauté internationale aux luttes du mouvement syndical ukrainien.
4. L'impasse stratégique et la perte d'influence
Dans le contexte de la guerre, le mouvement syndical ukrainien s'est retrouvé non seulement dans une situation d'adversité extérieure, mais aussi dans une profonde crise stratégique interne. Nous avons été confrontés à l'absence d'une stratégie cohérente, tournée vers l'avenir et proactive, capable de relever les défis contemporains et de façonner l'avenir des relations de travail dans le pays. La crise s'est traduite de la manière la plus visible par la passivité organisationnelle, l'incapacité à influencer les processus législatifs, un éloignement du discours public national et, surtout, la perte de la voix politique des syndicats.
Un nombre important de syndicats ukrainiens ont, par inertie, préservé la tradition de comportement apolitique de l'ère soviétique. Toutefois, dans le contexte de la transformation profonde de l'État et de la société ukrainiens, cette position a cessé d'être neutre. Au contraire, elle est devenue destructrice. Rester apolitique lorsque des décisions fondamentales affectant les droits des travailleurs sont prises est en fait une forme de complicité dans la violation de ces droits. En conséquence, les syndicats ne sont pas seulement absents de la sphère politique, ils perdent l'influence limitée qu'ils détenaient auparavant.
Le contraste avec les pays européens est frappant. Sur tout le continent, les forces politiques de gauche se concentrent de plus en plus sur les questions liées au travail : répartition équitable des revenus, sécurité sociale, gestion des effets de l'automatisation et de la numérisation. Les syndicats européens s'engagent activement auprès des partis politiques progressistes, participent aux débats parlementaires et font pression pour défendre les intérêts des travailleurs aux niveaux national et supranational. En Ukraine, en revanche, cette synergie stratégique est pratiquement inexistante. Les syndicats et leurs alliés politiques potentiels opèrent de manière isolée, sans plateformes, stratégies ou alignement idéologique communs. Il en résulte une marginalisation – les syndicats sont aujourd'hui largement sans alliés et sans influence.
Les implications de l'automatisation et de l'essor de l'intelligence artificielle sont particulièrement cruciales. Dans d'autres pays, les syndicats sont en première ligne pour défendre la reconnaissance du travail numérique, lutter pour la préservation des emplois, assurer la protection des données et garantir l'accès à l'amélioration des compétences et à la reconversion. En Ukraine, cependant, ces domaines critiques restent presque entièrement négligés. Il existe un réel danger que le pays prenne du retard dans sa réponse à la quatrième révolution industrielle, donnant ainsi l'initiative aux sociétés transnationales et aux structures oligarchiques locales.
L'impasse stratégique dans laquelle se trouvent actuellement les syndicats ukrainiens se manifeste dans de multiples dimensions :
– L'absence de partenariats politiques et d'engagement significatif avec les mouvements de gauche ;
– L'incapacité à façonner des agendas législatifs en défense des droits des travailleurs ;
– Une méconnaissance de la transformation numérique de l'économie ;
– Le refus de constituer un socle idéologique cohérent et fondé sur des valeurs.
Cette impasse ne peut être surmontée que par une réévaluation fondamentale des principes et des pratiques. Les syndicats doivent retrouver leur rôle historique d'acteurs politiques, d'agents du changement sociétal et de participants actifs au dialogue public. Sans cette transformation, le mouvement restera inaudible, n'inspirera pas confiance et, en fin de compte, ne sera pas pertinent.
5. Le problème des syndicats jaunes et des faux syndicats
L'un des problèmes les plus urgents et les plus préjudiciables auxquels est confronté le mouvement syndical ukrainien est la persistance de ce que l'on appelle les « syndicats jaunes » ou faux syndicats. Il s'agit d'organisations qui ressemblent extérieurement à des syndicats légitimes mais qui, dans la pratique, servent les intérêts des employeurs, des fonctionnaires ou d'autres structures de pouvoir. Leur fonction première est de simuler un partenariat social et de remplacer la véritable défense des droits des travailleurs par des activités superficielles adaptées à l'avantage du capital et de l'autorité.
Les racines de ces formations remontent à l'ère soviétique, lorsque les syndicats étaient intégrés à l'appareil d'État et fonctionnaient davantage comme des organisateurs d'activités de loisirs et d'événements cérémoniels, des distributeurs de chèques vacances que comme des défenseurs des droits du travail. Aujourd'hui encore, pour de nombreux Ukrainiens, le concept de « syndicat » reste synonyme de « cadeaux et de célébrations » plutôt que de lutte, de solidarité et d'action collective.
Les employeurs utilisent activement de faux syndicats pour faire pression sur les travailleurs et discréditer le mouvement syndical indépendant. Dans plusieurs secteurs – notamment l'administration publique, les transports et l'énergie – les employés sont souvent contraints d'adhérer à de tels syndicats sous la menace d'un licenciement, d'une perte d'avantages sociaux ou comme condition d'emploi de facto. Cette pratique constitue une violation directe du droit fondamental à la liberté d'association. Pourtant, en raison de la capacité limitée des inspections du travail et de l'absence de contrôle public efficace, ces violations restent souvent impunies.
Ces pseudo-syndicats bénéficient souvent d'un accès privilégié au dialogue officiel avec l'État et les employeurs. Ils participent aux commissions tripartites, signent des conventions collectives et contribuent ainsi à légitimer la détérioration des conditions de travail. Pendant ce temps, les syndicats authentiques, indépendants et actifs sont relégués aux marges du paysage institutionnel.
La présence de syndicats « jaunes » constitue une menace plus profonde et plus insidieuse : elle sape la confiance du public dans le mouvement syndical dans son ensemble. Les travailleurs qui ont été confrontés à ces faux syndicats sont plus susceptibles d'être désillusionnés et de perdre confiance dans la possibilité d'une représentation collective efficace. Il en résulte une apathie généralisée et une réticence à s'engager dans l'auto-organisation ou la protestation. Sans confiance et sans croyance dans le pouvoir de l'action collective, l'essence même du syndicalisme est vidée de sa substance.
La question des faux syndicats nécessite une réponse globale et systémique, notamment :
– Reconnaissance officielle du problème au niveau de l'État et de la société ;
– Mise en place d'un registre national transparent des organisations syndicales, avec des critères d'authenticité clairement définis ;
– Campagnes de sensibilisation du public visant à informer les travailleurs des différences entre les syndicats authentiques et les syndicats « jaunes » ;
– L'inclusion institutionnelle directe de représentants de syndicats indépendants dans les processus de négociation et les commissions consultatives dirigés par l'État ;
– Des mécanismes stricts de responsabilisation pour sanctionner les employeurs qui contraignent les travailleurs à adhérer à des syndicats conformes ou contrôlés par l'employeur.
Il ne s'agit pas d'une question secondaire ou technique, mais d'un impératif stratégique. Sans affronter et résoudre cette question, le développement d'un mouvement syndical fort, démocratique et solidaire en Ukraine restera impossible.
Si nous aspirons à être des voix respectées au sein de la communauté mondiale du travail, si nous cherchons à participer sur un pied d'égalité au dialogue international de la gauche, nous devons d'abord déblayer le terrain institutionnel. Nous devons restaurer l'intégrité du concept de syndicat. Ce n'est qu'à cette condition qu'une nouvelle ère de solidarité sera possible.
6. L'avenir des syndicats dans l'Ukraine de l'après-guerre
Une croyance largement répandue, mais erronée, persiste au sein de la société ukrainienne : l'idée que tout recommencera « après la guerre ». Cependant, la réalité est beaucoup plus complexe. La période d'après-guerre exigera non seulement la reconstruction matérielle des infrastructures, mais aussi la résolution de déséquilibres socio-économiques profondément enracinés que la guerre a à la fois révélés et exacerbés.
L'Ukraine est déjà confrontée à un paradoxe : malgré la guerre en cours, les secteurs des services et du commerce continuent de dominer la production industrielle. Dans de nombreuses régions, il existe un déficit critique d'emplois manufacturiers, le capital et la main-d'œuvre étant largement concentrés dans le secteur des services et de la consommation. Un exemple frappant est que dans les grands centres urbains, les complexes commerciaux et de loisirs emploient plus de personnes que les grandes entreprises industrielles. Ce modèle économique n'est pas viable – surtout si l'on tient compte du retour prévu de centaines de milliers de vétérans et de la vague d'émigration en cours.
Le temps de guerre a partiellement atténué les effets du chômage en intégrant de larges segments de la population dans l'économie de la défense et du volontariat. Des activités telles que la fabrication de drones FPV, la réparation d'équipements militaires, le soutien logistique de l'armée et le développement de systèmes civils de guerre électronique ont créé des opportunités d'emploi à court terme. Pour de nombreux ménages, cet engagement constitue la principale source de revenus. Toutefois, ces solutions ne sont que temporaires et se transformeront ou nécessiteront une restructuration fondamentale une fois que la phase active de la guerre aura pris fin.
L'une des menaces les plus graves dans le contexte de l'après-guerre est la criminalisation potentielle des relations de travail. L'Ukraine d'après-guerre pourrait être confrontée à une augmentation de l'emploi non réglementé (travail « gris » et « noir »), à une économie souterraine croissante, au pillage des entreprises et à des programmes d'externalisation du travail forcé sans garanties sociales. Les groupes vulnérables – notamment les anciens combattants, les personnes handicapées, les jeunes et les résidents des territoires anciennement occupés – sont particulièrement exposés au risque d'exploitation et de marginalisation.
Si l'État et la société ne sont pas en mesure d'offrir des possibilités d'emplois sûrs, dignes et tournés vers l'avenir, une partie importante de la main-d'œuvre continuera à chercher des moyens de subsistance à l'étranger. L'émigration de la main-d'œuvre est déjà devenue l'une des principales stratégies de survie. Avec l'ouverture des frontières de l'UE et l'instabilité intérieure persistante, cette tendance est susceptible de s'intensifier.
La réponse appropriée à ces nouveaux défis n'est pas la préservation des structures syndicales existantes, mais leur transformation complète. Les syndicats doivent devenir des institutions modernes et dynamiques, capables de façonner l'ordre socio-économique de l'après-guerre. Les domaines clés de la réforme sont les suivants :
– Transformation numérique : Transition vers des moyens de communication modernes, des mécanismes numériques pour la transparence et la protection des droits ;
– Défense juridique : Expansion des fonctions de soutien juridique au sein des syndicats, y compris l'amélioration de la formation des militants et une plus grande implication des juristes syndicaux ;
– Réflexion stratégique : Planification à long terme basée sur les tendances démographiques, économiques et géopolitiques ;
– Subjectivité politique : Développement de la capacité institutionnelle à influencer la législation, à s'engager dans des négociations avec le gouvernement et à former des coalitions avec d'autres institutions sociales.
– Les syndicats de l'avenir ne doivent pas seulement jouer leur rôle traditionnel de défenseurs des salaires et des conditions de travail. Ils doivent devenir des institutions stratégiques capables d'articuler et de mettre en œuvre une vision nationale de la stratégie de développement du travail, empêchant ainsi la société ukrainienne de sombrer dans le chaos socio-économique et le désespoir de l'après-guerre.
7. Conclusion : Le choix entre extinction et modernisation
Le mouvement syndical ukrainien se trouve à un carrefour historique. Continuer à fonctionner avec des modèles et des méthodes dépassés, c'est s'engager sur la voie de l'insignifiance et du déclin. Face à la profonde transformation de la société et à la reconstruction d'après-guerre, les syndicats doivent choisir : l'extinction ou la modernisation.
La modernisation doit être comprise non pas comme un ajustement cosmétique, mais comme une transformation globale. Elle signifie la consolidation de toutes les actions de protestation et de grève dans le cadre d'une vision stratégique cohérente. Elle signifie la politisation des syndicats et leur représentation active au sein des organes législatifs à tous les niveaux de gouvernement.
Aujourd'hui, les syndicats ukrainiens reflètent en partie un modèle plus large d'infantilisme social et politique. Trop de dirigeants syndicaux restent enfermés dans une conception étroite de leur mission – isolés dans les limites techniques de la représentation des travailleurs et dédaigneux de l'engagement politique, qu'ils considèrent comme le domaine des opportunistes ou des adversaires.
Mais cette attitude a un coût. Dans les sociétés démocratiques modernes, s'abstenir de participer à la vie politique n'est pas une marque de vertu, mais un abandon de pouvoir. Ceux qui se désengagent de la politique abandonnent inévitablement leur avenir à ceux qui agissent sans se soucier du bien public. Le résultat n'est pas la neutralité, mais la vulnérabilité.
Le mouvement syndical doit retrouver sa voix et sa pertinence. Le slogan du 21e siècle doit être clair : de la défense à l'attaque !
25 mai 2025
Publié par le Réseau syndical international de solidarité et de luttes.
Traduction Patrick Le Tréhondat.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les « unionistes » cherchent la stratégie gagnante pour « éteindre » la candidature Mélenchon

Après « La meute », les partisans d'une candidature unique à gauche en 2027, sans le candidat de LFI, oscillent entre inquiétude et espoir avant le congrès du PS.
23 mai 2025 | tiré de Regards.fr
https://regards.fr/les-unionistes-cherchent-la-strategie-gagnante-pour-eteindre-la-candidature-melenchon/
Promis, juré, ils ne sont « pas obsédés » par Jean-Luc Mélenchon. Les « unionistes », cette petite bande d'élus qui a contribué à former la Nouvelle Union du Front Populaire (NFP) aux dernières élections législatives, n'ont pas renoncé à faire émerger une candidature commune en 2027… sans le candidat de LFI, faut-il le préciser. C'est pourtant le nom du tribun de la gauche qui est sur toutes les lèvres et dont l'ombre plane sur toutes les discussions. Avec les anciens insoumis comme Clémentine Autain, François Ruffin, Alexis Corbière, qui siègent désormais sur les bancs des écolos, mais aussi leur cheffe Marine Tondelier, la haute fonctionnaire Lucie Castet, la députée PCF Elsa Faucillon ou encore la maire socialiste de Nantes et numéro 2 du PS, Johanna Rolland, ils ne se parlent pas « tous les quatre matins » et toujours avec une « grande prudence », voire « un brin de parano », confie l'un d'eux. Échaudés par les sarcasmes de presse – Libérationavait révélé que certains d'entre eux se retrouvaient autour d'une salade de pommes de terre portugaises – et de leurs adversaires, le groupe réfléchit à une autre stratégie après la parution de « La Meute », ce livre choc qui accable Jean-Luc Mélenchon et la direction de LFI. Officiellement, ils n'ont plus de contact avec leurs anciens camarades. « C'est silence radio », soupire Clémentine Autain. Mais les ponts ne sont pas totalement rompus avec tous les insoumis, selon nos informations. « Il y en a, en dehors des trentenaires qui ont été promus suite à la dernière purge, qui gardent le sens de l'amitié », observe un rescapé sous le sceau de l'anonymat.
« Le sujet, ce n'est pas Jean-Luc mais de se demander comment on créé les conditions d'une candidature commune pour battre le RN »
Alexis Corbière, député ex-LFI
« Le sujet, ce n'est pas de se positionner par rapport à Jean-Luc mais de se demander comment on créé les conditions d'une candidature commune pour battre le Rassemblement national en 2027 », affirme à PolitisAlexis Corbière. Son discours semble pourtant empreint d'un soupçon de nostalgie : « Avant, Jean-Luc avait le verbe vif, mais ça l'empêchait pas d'entretenir une certaine souplesse avec le reste de la gauche et de bâtir des ponts », se remémore l'ancien compagnon de route de l'Insoumis en chef. La déferlante médiatique autour de l'ouvrage a laissé des traces. « J'ai passé ces deux dernières semaines loin des réseaux sociaux face au shitstorm provoqué par cette enquête », s'épanche l'un de ses camarades. Dit autrement, cela donne : « L'hypothèse d'une candidature de Jean-Luc Mélenchon en 2027 ne peut être éteinte qu'avec un candidat unitaire ». Même s'ils ne veulent pas hurler avec la meute, les anciens « purgés », comme ils se surnomment entre eux, ont conscience que ce livre donne de la résonance à leurs revendications. « Le réel, ce sont les élections et ce qui va peut-être faire bouger LFI, ce sera peut-être les municipales. Ils vont découvrir que c'est une élection avec une grammaire différente des législatives », ajoute Alexis Corbière. « Notre responsabilité ultime, c'est de tout faire pour que le RN ne gagne pas en France et donc que la gauche doit être au 2e tour de la présidentielle. C'est notre matrice », répète à son tour Johanna Rolland, comme un mantra.
C'est pour cette raison que Lucie Castet a lancé l'appel du 2 juillet. L'ancienne candidate du NFP au poste de première ministre invite les chefs de partis à se rassembler pour la « primaire des gauches la plus large qu'on n'ait jamais proposée ». Le tout après le congrès des écolos et des socialistes et la fin des élections municipales. Une nouvelle tentative après son initiative « Gagnons ensemble », lancée avec Marine Tondelieret peu appréciée par les Insoumis, jusqu'alors plutôt conciliants avec elle. Clémentine Autain plaide en tous cas pour « ne pas perdre de temps » face à « la menace de l'extrême-droite. Il faut sortir des conciliabules, on ne va pas y arriver en additionnant les petits partis. La condition pour gagner, c'est de créer une dynamique comme on l'avait fait pour le NFP », affirme la députée.
Contradictions et maladresse
Reste une inconnue, le congrès du Parti socialiste, qui aura lieu du 13 au 15 juin. L'actuel premier secrétaire Olivier Faure a réussi à bâtir des relations de confiance à l'Assemblée avec ses partenaires de la défunte Nupes. « Si Olivier n'est pas reconduit, ça va être compliqué », s'inquiète Clémentine Autain. « Si c'est Nicolas Mayer-Rossignol qui est désigné, c'est terminé, autant donner les clefs du camion à Raphaël Glucksmann », résume l'un de ses camarades. C'est pourquoi Olivier Faure porte l'idée d'une plate-forme commune, sans LFI, à ce stade. « Olivier dit une chose simple, c'est que Mélenchon sera coûte que coûte candidat à la présidentielle et il n'attendra personne. Donc, l'objectif, c'est de ramener autour de nous des électeurs insoumis et même des cadres LFI en créant une dynamique », assume l'un des lieutenants du patron du PS.« On a réussi deux fois à créer les conditions de l'union », rappelle fièrement Alexis Corbière. « Les électorats ont fusionné même s'il y a eu de l'irritation, il faut maintenir l'acquis du NFP », martèle l'élu de Seine-Saint-Denis.
Reste que les membres de ce groupe devront d'abord s'affranchir de leurs propres contradictions. En dehors d'Alexis Corbière, de François Ruffin et de Marine Tondelier, les autres ne semblent pas chauds pour s'allier avec LFI pour tenter de remporter l'Elysée en 2027. S'il répète que la gauche « est plus forte ensemble », le député de la Somme a, une fois de plus, crispé ses petits camarades en annonçant dans Libération le 20 mai qu'il voulait une primaire à gauche… pour la gagner. « Ça a été mal pris, François est souvent maladroit », s'agace l'un d'eux. « Il a voulu dire qu'il ne voulait pas d'une primaire pour se ranger derrière un social mou », démine l'un de ses soutiens. Le député de la Somme, réputé pour faire cavalier seul, avait pourtant donné des gages en acceptant le rassemblement du 2 juillet. Même tentation du côté de Marine Tondelier. « Perdu pour perdu, autant qu'on mette un troisième candidat écologiste entre Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann », mettait en garde la patronne des écolos en conférence de presse le 6 mai. Avant de reconstruire l'union à gauche, les « unionistes » devront la maintenir dans leurs propres rangs.
Nils Wilcke
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Une initiative législative populaire oblige le gouvernement espagnol à régulariser exceptionnellement les migrants

700 000 personnes ont signé le document qui a poussé le gouvernement espagnol à présenter une proposition. Les modalités précises qui permettront d'assurer son adoption sont encore en cours de négociation.
27 mai 2025 | tiré d'Inprecor.fr
https://inprecor.fr/node/4773
Le gouvernement espagnol négocie avec ses partenaires un processus de régularisation extraordinaire pour les immigrant·es. Les tenants et aboutissants de ce processus ont été révélés par El País, qui rapporte que la secrétaire d'État aux Migrations, Pilar Cancela, a rencontré mercredi différents groupes parlementaires pour leur présenter les grandes lignes de la proposition.
Selon cette source, la question à l'ordre du jour est de régulariser les immigré·es qui peuvent prouver qu'ils sont dans le pays depuis au moins un an, qui retirent leur demande s'ils sont demandeurs d'asile, qui n'ont pas de casier judiciaire, qui ne font pas l'objet d'une mesure d'expulsion et qui ne représentent pas un risque pour la sécurité nationale. Ils se verront attribuer un permis de séjour et de travail d'un an sans obligation de contrat préalable, à condition qu'ils puissent ensuite se mettre en conformité avec les règles de régularisation ordinaires en vigueur. Cela contraste, par exemple, avec la procedure de régularisation de 2005, lancée par José Luis Rodríguez Zapatero, qui exigeait dès le départ un contrat de travail.
Toutefois, toutes ces conditions devront encore être négociées afin d'obtenir une majorité parlementaire suffisante pour être approuvées. Le problème sera la position des Catalans de Junts et des Basques du PNV. Les premiers veulent en échange au moins la mise en œuvre de la délégation de compétence en matière d'immigration. Et les seconds ont jusqu'à présent défendu une régularisation subordonnée à l'existence de contrats de travail, conformément à la position du patronat basque.
La droite dans l'opposition, le Parti populaire, avait elle aussi déjà préconisé une procédure de régularisation des immigré.e.s, mais elle souhaite également la subordonner à l'existence de contrats de travail et raccourcir le délai proposé par le gouvernement. Selon El País, en dépit de ses déclarations défavorables, « le gouvernement compte sur une abstention sous la pression de l'Église et, surtout, des chefs d'entreprise (représentés par la Confédération espagnole des organisations patronales), principaux intéressés par la régularisation de travailleurs potentiels ».
Une nouvelle réglementation sur les étrangers est entrée en vigueur mardi
Cette mise en avant de la proposition de régularisation extraordinaire est considérée comme un contrepoids à l'entrée en vigueur, mardi, de la nouvelle réglementation sur les étrangers qui, selon le même journal, place « des milliers de travailleurs au bord de l'illégalité ».
Ce règlement réduit la durée nécessaire pour obtenir un permis de séjour de trois à deux ans, rendant celui-ci valable dans un premier temps pour un an, puis renouvelable pour quatre ans supplémentaires. Il instaure une « deuxième chance » pour les personnes qui ont déjà obtenu un permis de séjour mais l'ont perdu pour une raison quelconque, comme la perte de leur emploi, et ouvre de nouvelles possibilités de regroupement familial pour les proches de ressortissants espagnols.
D'autre part, les demandeurs d'asile qui souhaitent accéder à la régularisation par cette voie devront renoncer à leur demande d'asile ou avoir reçu une réponse négative, se retrouvant ainsi en situation irrégulière. Ils devront se trouver dans cette situation pendant les six mois précédant immédiatement la demande de régularisation et ne pourront recourir à cette option de légalisation que dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur du texte. Selon les experts, cela pourrait automatiquement mettre des milliers de personnes en situation irrégulière et affaiblir le statut de l'asile.
Sont également critiquées les restrictions du regroupement familial des ascendant.e.s (parents et beaux-parents) qui viennent d'entrer en vigueur. Ces personnes, si elles ont entre 65 et 80 ans, devront prouver qu'elles sont financièrement dépendantes du citoyen espagnol.
Les étudiant·e·s étranger·e·s pourront également travailler à temps partiel, jusqu'à 30 heures par semaine. Mais les emplois dans la recherche leurs sont interdits. Les mineur·e·s perdent également le droit d'obtenir un permis de séjour pour étudier.
Les aspects négatifs de la réglementation ont conduit les organisations Association pour les droits de l'homme en Espagne, la Coordination des quartiers et le réseau Extranjeristas en Red, une association d'avocats spécialisés dans le droit de l'immigration, à porter l'affaire devant la Cour suprême.
Elles souhaitent obtenir l'annulation des modifications concernant les demandeurs d'asile, la partie relative aux mineurs, et contestent la discrimination à l'égard des parents étrangers de ressortissants espagnols qui sont ressortissants de pays tiers.
Une deuxième procédure devant la même instance a été engagée par d'autres organisations, Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, Red Acoge et Servicio Jea, qui mettent l'accent sur l'incompatibilité entre la procédure de protection internationale et ce qui est désormais exigé des demandeurs d'asile.
L'Initiative législative populaire fait pression pour que des changements soient apportés
Une régularisation extraordinaire des immigrant·e·s ne figurait pas à l'ordre du jour des principaux partis espagnols, qui estimaient qu'elle n'était pas nécessaire, voire qu'elle violerait les règles en vigueur dans l'Union européenne. Ce qui a conduit à ce changement, c'est l'existence d'une Initiative législative populaire qui a recueilli près de 700 000 signatures et le soutien de 900 organisations et mouvements sociaux.
La force de la pétition à travers tout l'État espagnol a été telle que, à l'exception de Vox qui a maintenu son programme anti-immigration, tous les autres partis parlementaires l'ont acceptée. Sans grand enthousiasme dans la plupart des cas. La droite espagnole ne s'est pas laissée entraîner par l'extrême droite, non pas par mérite propre, mais parce que la Conférence épiscopale catholique s'est rangée du côté de l'ILP, affirmant que son adoption était un signe de « maturité démocratique » et soulignant que les immigrés « travaillent pour le bien commun ».
Les militants en première ligne pour l'ILP insistent désormais pour que la régularisation extraordinaire se concrétise immédiatement « afin de régler une fois pour toutes la situation des personnes qui vivent et travaillent dans ce pays », comme l'affirme à El Salto Edith Espínola, porte-parole de Regularización Ya, qui réclame également davantage de techniciens et d'infrastructures pour mener à bien ce processus.
Elle souligne toutefois : « Nous ne savons pas s'il s'agit d'une opération de marketing médiatique ou si le Congrès va réellement dans la bonne direction ».
La gauche face au processus
Pour sa part, la gauche extra-gouvernementale considère également avec prudence la proposition de régularisation extraordinaire du gouvernement. Le quotidien espagnol Público s'est entretenu avec des membres de la Gauche républicaine de Catalogne qui participent aux négociations et qui reconnaissent qu'il y a une « opportunité », mais qui restent « quelque peu sceptiques », indique le journal, ajoutant que le parti ne signera un accord que si les organisations promotrices de l'ILP sont d'accord.
Podemos est encore plus sceptique, rappelant que la forme choisie par l'exécutif implique que la loi passe devant le Parlement et risque d'être rejetée, alors qu'elle aurait pu être facilement adoptée par décret gouvernemental. C'est ce qu'a défendu la secrétaire générale de cette formation, Ione Belarra, lors d'une conférence de presse, où elle a exprimé sa crainte qu'il s'agisse davantage d'une mise en scène que d'une véritable volonté de changement, utilisant Junts et le PNV « comme excuse pour ne pas faire ce qu'ils ne veulent pas faire ». En effet, si le PSOE avait voulu changer la loi, a-t-elle insisté, il aurait pu le faire « dès le lendemain ».
Le parti a également précisé qu'il n'y avait aucune négociation en cours avec le gouvernement, mais qu'il était « grand temps » que celui-ci « réfléchisse à l'importance de ne pas maintenir dans cette situation d'exception démocratique des millions de personnes en Espagne, ce qui, en outre, constitue un terreau idéal pour l'exploitation du travail et toutes sortes de violations des droits humains ».
Publié le 23 mai 2025 par Esquerda.net (Portugal). Traduit pour ESSF par Pierre Vandevoorde avec l'aide de DeepLpro
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La normalisation du fascisme en Italie

Alors que le pays commémore chaque 25 avril la fin du fascisme, l'Italie navigue dans une ambiguïté. À la croisée des chemins entre mémoire et révisionnisme, le pays se confronte à un passé qu'il n'a jamais complètement refoulé après avoir marginalisé, voire effacé, les mouvements antifascistes.
23 mai 2025 | tiré du site Frustrations
https://frustrationmagazine.fr/la-normalisation-du-fascisme-en-italie
Aux abords de la Piazzale Gorini située dans l'est de Milan, loin du tumulte du centre-ville, trois femmes voilées marchent paisiblement. Leur pas ralentit lorsqu'elles aperçoivent, à une centaine de mètres, un groupe d'hommes aux crânes rasés. Regards appuyés, silence pesant : les femmes traversent la rue. Une heure plus tard près de 2000 militants néofascistes, essentiellement masculins, se réunissent pour commémorer la mémoire de Sergio Ramelli, militant fasciste tué en 1975 par des membres de l'Avant-garde ouvrière (une organisation d'inspiration maoïste-léniniste active dans les années 1970 en Italie). Le cortège silencieux s'achève sur trois “Presente !” – une formule rituelle héritée du fascisme italien, scandée bras tendu pour affirmer la présence symbolique des morts dans le combat politique – dans ce quartier pourtant cosmopolite. « Les groupes d'extrême droite, adorateurs de Mussolini, comme Veneto Skinhead Front, Forza Nuova, Casa Pound, Do.Ra ont toujours opéré dans les rues avec des actions violentes sans jamais provoquer de véritable indignation nationale, ou de la part de nos gouvernements. Aujourd'hui ils n'ont plus besoin d'agir avec autant de violence dans les rues. Ils ont pu répandre et normaliser leur idéologie. On retrouve désormais des politiques élus qui écoutent, défendent et/ou comprennent certaines de leurs revendications » indique Vincenzo Scalia, docteur en sociologie de la déviance du département des sciences politiques et sociales de l'université de Florence.

Photo : Rémi Guyot
Le fascisme dépénalisé, l'antifascisme étouffé par le droit
L'antifascisme du quotidien, tel que l'explique Mark Bray – historien américain, auteur de l'ouvrage de référence Antifa : The Anti-Fascist Handbook – repose sur la nécessité d'ériger des tabous sociaux qui rendent les idées fascistes et les comportements discriminatoires socialement inacceptables. Ce type de lutte nécessite une vigilance constante à l'échelle individuelle et collective, mais aussi un cadre légal robuste et ferme. En Italie, bien que la Constitution interdise explicitement la reconstitution de partis fascistes, les lois Scelba (1952) et Mancino (1993) n'ont pas permis son application en raison de formulations juridiques floues et de critères restrictifs pour qualifier un acte de reconstitution fasciste. Le Mouvement social italien (MSI) a donc pu être créé en 1946, reprenant largement l'idéologie fasciste, mais sans volonté officielle de rétablir son régime dictatorial, passant ainsi entre les mailles législatives. Sans grand procès national permettant une « défascisation », le pays a pu réintégrer d'anciens fonctionnaires fascistes à la vie politique nationale.
Dès lors, le fascisme est progressivement dissocié de son caractère illégal, ce qui a permis à des groupes d'extrême droite de s'immiscer dans la sphère politique et de normaliser leurs idées. Son idéologie a donc pu continuer d'infuser dans la société italienne, abaissant la garde morale de ses citoyens, faisant sauter les digues qui le protégeaient d'un retour des mouvances d'extrême droite. Désormais, le glissement à droite et à l'extrême droite de la société italienne renforce la création d'un « extrême centre » qui banalise l'agenda politique et médiatique néo-fasciste. « Les groupuscules d'extrême droite sont largement minoritaires. Au niveau des élections, ils ne représentent que très peu d'électeurs. Ils font du bruit, mais restent en marge de la société » déclare Federico Benini, élu du Parti Démocrate (PD) à la mairie de Vérone. Une analyse qui occulte des mécanismes politiques fondamentaux, comme la fenêtre d'Overton – un concept politique qui décrit les limites du discours acceptable dans l'espace public, et comment elles peuvent être déplacées pour normaliser des idées auparavant jugées extrêmes.
L'exemple du décret DDL 1660 et comment le centre gauche se droitise
« Le décret DDL 1660 est passé en avril 2025. Il vise à criminaliser les manifestants et les activistes. Une personne qui bloque une route avec son corps, comme cela peut être fait dans les mouvements écologistes et anticapitalistes, peut être soumise à des peines d'emprisonnement en fonction des « circonstances et de la gravité de l'infraction ». L'achat d'une carte SIM nécessitera un contrôle strict d'identité, excluant de facto les personnes en situation irrégulière. Ce décret vise à réduire les libertés fondamentales. C'est un virage autoritaire » déclare Chiara Pedrocchi, journaliste indépendante qui a couvert l'évolution de la loi pour Voice Over Foundation. Pour Federico Benini (PD), la perception est différente : « Il y a du positif dans cette loi, même si nous devons encore travailler dessus, car nous devons permettre la liberté de manifestation, sans qu'elle empiète sur les libertés des autres usagers de l'espace public. » « Cette rhétorique est typique. Elle relève des justifications données par les partis de droite et d'extrême droite », affirme Leonardo Bianchi, journaliste indépendant qui couvre l'extrême droite en Italie et en Europe. « Alors que l'antifascisme de rue est en crise, le cadre légal et médiatique restreint de plus en plus son expression » poursuit l'auteur de la newsletter « Complotti ! »
Une opposition radicale essoufflée
Dans le quartier ouvrier de Sant'Eustacchio à Brescia, le président du Parti communiste italien (PCI) en Lombardie, Lamberto Lombardi, et ses camarades tous âgés de plus de 60 ans se confient sur l'émiettement du parti communiste. « Avant les néofascistes se cachaient pour répandre leurs idées, désormais ils opèrent au grand jour sans être inquiétés. C'est une des conséquences de notre défaite. » Dans les dernières semaines, la tête « d'un nord-africain » a été mise à prix sur les murs de la gare de Varese par Casa Pound. A Padoue, les militants de la même organisation ont tracté devant un centre social de la ville en faveur de la « re-migration », nouveau terme à la mode dans les groupes d'extrême droite pour demander l'expulsion des « étrangers ». Les antifascistes sont intervenus violemment pour mettre fin à l'action. Une vingtaine d'entre eux ont été conduits au commissariat. « Les personnes sans papiers victimes de violences des groupuscules d'extrême droite ne sont pas crues, et craignent de se rendre au commissariat en raison de leur situation irrégulière. Elles se retrouvent sans défense. Depuis que Maroni (Ligue du Nord) a pris le rôle de ministre de l'Intérieur, la culture de la violence policière s'est accentuée et leur proximité avec les mouvances d'extrême droite s'est resserrée. Le mouvement antifasciste se retrouve à être considéré dans l'illégalité face à des groupes néo-fascistes » affirme Vincenzo Scalia.
La bourgeoisie aux manettes du système médiatique et de l'affaiblissement de l'Etat de droit
La situation actuelle est la conséquence d'une longue histoire qui a détruit la cause communiste et antifasciste, autrefois capable d'enrayer le retour du fascisme. Les « Arditi del popolo », premier groupe antifasciste d'Italie dans les années 1920, a échoué face au soutien matériel et financier des élites économiques envers les fascistes, à la destruction des infrastructures et l'unité de la gauche afin de coopérer face à un ennemi commun. Malheureusement, l'histoire semble de nouveau se répéter. Aujourd'hui, au niveau régional, du PD au PCI en passant par les mouvements antifascistes, les désaccords empêchent toute avancée. « Au sein de la gauche, nous restons en désaccord sur la stratégie à adopter, et sur la lecture des évènements » confie Ricardo, militant communiste. « Il est possible de travailler ensemble si on met l'européisme et la défense de la méritocratie au centre de notre stratégie. Sur la question des droits individuels, nous n'avons pas tant de désaccords » affirme Federico Benini du Parti démocrate. « Il y a une fracture entre l'ancienne et la nouvelle génération. Les plus vieux n'intègrent pas suffisamment les logiques d'intersectionnalités dans la lutte antifasciste » indique Chiara Pedrocchi. « Il y a eu une réécriture de l'histoire, qui permet de promouvoir l'idéologie d'extrême droite, et exclure la nôtre », assure Lamberto Lombardi. « Je participe aux manifestations et à la défense de centres sociaux, mais il est vrai que nous manquons d'initiatives et de représentants de la cause antifasciste au niveau national, en dehors d'Ilaria Salis au Parlement européen » reconnaît Antonello, militant antifasciste. « Au niveau médiatique, Silvio Berlusconi a été l'un des précurseurs du contrôle médiatique et de son articulation à des fins politiques. Désormais, même sur la Rai (ndlr : service public de radio-télévision en Italie), des intellectuels se font exclure pour leur position, comme Antonio Scurati par exemple » déclare Leonardo Bianchi. En effet, l'écrivain et essayiste italien célèbre pour sa trilogie sur Mussolini a été écarté en raison de ses critiques sur la ligne éditoriale de la chaîne et la normalisation croissante de l'extrême droite à laquelle elle contribue.
« La France vit ce que l'Italie a vécu ces dernières années »
Depuis 2022, l'Italie connaît un tournant politique majeur avec l'arrivée au pouvoir de Giorgia Meloni et de son parti Fratelli d'Italia, héritier idéologique des mouvements néo-fascistes. Ce gouvernement s'inscrit dans une coalition comprenant également la Lega, parti d'extrême droite aux positions populistes et souverainistes. Cette alliance a marqué un renforcement des discours nationalistes, conservateurs et identitaires au cœur de la politique italienne, faisant de l'Italie un terrain d'observation essentiel pour comprendre la montée des droites radicales en Europe.« Malgré ses spécificités et ses différences, il y a de nombreux points de convergence entre ce que vit la France actuellement et ce qu'a vécu l'Italie ces dernières années. Matteo Renzi (anciennement PD) a eu une approche très similaire à celle d'Emmanuel Macron de par ses mesures sociales et économiques, tout comme son rapprochement avec l'idéologie d'extrême droite. Cela a conduit deux ans plus tard à sa victoire » souligne Leonardo Bianchi. « En Italie comme en France, il y a un anticommunisme latent, et une disqualification du discours antifasciste, qui le rend de plus en plus inaudible et inaccessible pour de nombreuses personnes. Désormais quand on parle de marxisme ou d'anticapitalisme, les auditeurs manquent de repères pour juger de la proposition, tant ces discours sont devenus minoritaires dans l'espace médiatique, et dans les discours de gauche influencés par des décennies de domination néolibérale, de dépolitisation du réel et de diabolisation de la gauche radicale » déclare Chiara Pedrocchi. Alors que Bruno Retailleau a entrepris la dissolution des groupes de résistance comme la Jeune Garde et Urgence Palestine, en les mettant sur le même plan que Lyon Populaire, groupuscule d'extrême droite très violent, le ministre de l'Intérieur français démontre sa volonté de diaboliser les mouvements progressistes radicaux. Cette situation laisse donc libre court à un virage identitaire radical du centre et de la droite, inspiré des mouvements néo-fascistes, afin d'exploiter la désillusion créée par les promesses non-tenues du système capitaliste qui règne en Italie, en France et au-delà. Ce repli pourrait toutefois être interprété comme le symptôme d'une avancée des idées progressistes, désormais suffisamment menaçantes pour inquiéter les élites bourgeoises, soucieuses de préserver leurs privilèges. Pour que cette dynamique s'inverse, l'internationalisation de la lutte antifasciste pourrait bien être la clé face à celle des mouvements néo-fascistes libéraux.
Photos de Rémi Guyot
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Une perspective socialiste dans une Ukraine en guerre

On publie ci-dessous, l'article introduction au numéro spécial des Brigades éditoriales de solidarité avec Sotsialnyi Rukh. On peut télécharger ce numéro en cliquant sur ce lien. Patrick Le Tréhondat est membre des Brigades éditoriales de solidarité et du Comité français du Réseau européen de soutien à l'Ukraine. 1er mai 2025.
26 mai 2025 | Lettre des Brigades éditoriale de solidarité
Huit mois après le début de la guerre à grande échelle, Sotsialnyi Rukh (Mouvement social) réunissait ses militant·es en conférence nationale à Kyiv. Cet événement, qui s'est tenu le 17 septembre 2022, dans des conditions très difficiles, se devait de faire le point de la situation et fixer la feuille de route de l'organisation.
Tirant le bilan des mois passés depuis le 24 février 2022, Sotsialnyi Rukh soulignait que « la société civile avait été contrainte de remplir le rôle de l'État et, au lieu d'attendre une assistance de sa part, d'assumer presque toutes ses fonctions sociales ».
La guerre, poursuivait la déclaration, avait « conduit à de nou velles formes d'auto-organisation et de politique populaire » : La mobilisation du peuple sur la base de la guerre de libéra tion nationale a renforcé le sentiment d'implication populaire dans une cause commune et la conscience que c'est grâce aux gens ordinaires, et non aux oligarques ou aux entreprises, que ce pays existe. La guerre a radicalement changé la vie sociale et politique en Ukraine, et nous ne devons pas permettre la destruction de ces nouvelles formes d'organisation sociale, mais les développer.
Parmi les revendications mises en avant, Sotsialnyi Rukh insistait sur la nécessité de « la nationalisation des entreprises clés sous contrôle ouvrier » et de « l'ouverture des livres de compte dans toutes les entreprises, quelle que soit la forme de propriété et l'im plication des salariés dans leur gestion, création d'organes et de comités élus séparés pour la réalisation de ce droit ».
L'organisation fixait ainsi une orientation politique autogestion naire pour le contrôle et la gestion de la société par la population, une nécessité face à un pouvoir oligarchique déficient dans les tâches de la défense du pays. Ainsi, dans une interview donnée, lors de son passage à Paris en novembre 2022, Katya Gritseva, membre de cette organisation, observait que « beaucoup de gens étaient volontaires » :
Ils s'engagent dans l'aide mutuelle, créent des organisations extra-étatiques pour pallier les carences d'un État peu préparé à une telle situation. Cette dynamique d'auto-organisation est contradictoire avec le retour des conservateurs, voire de l'ex trême droite. Pour la gauche, il agit d'agir en faveur de cette dynamique, d'aider les travailleurs, les gens, sans prétendre leur donner des leçons à la manière des staliniens.
Depuis, contre vents et marées, Sotsialnyi Rukh a maintenu cette orientation socialiste tout en participant de toutes ses forces à la résistance anti-impérialiste contre l'agresseur russe. Nombre de ses militant·es se sont engagé·es dans les forces armées et l'orga nisation organise en permanence des collectes de fonds pour leur apporter un soutien matériel (notamment pour l'achat de drones). Sotsialnyi Rukh apporte également une aide aux soldat·es dans la défense de leurs droits sociaux, en particulier par l'animation d'une hot-line pour répondre à leurs questions et les aider à résoudre leurs problèmes face à une hiérarchie trop souvent autoritaire.
Sotsialnyi Rukh est une petite organisation, mais ce n'est pas un groupuscule. En son sein, sensibilités marxistes et libertaires, par exemple, se mélangent. Ses militant·es sont inséré·es dans le mou vement syndical, dans les deux confédérations FPU et KVPU, mais aussi dans les syndicats indépendants comme celui du personnel soignant Soyez comme nous, le syndicat étudiant Priama Diia ou encore le syndicat des locataires.
Sotsialnyi Rukh impulse partout où il le peut l'auto-organisation démocratique des exploité·es et des dominé·es face au pouvoir ukrainien qui, au service des classes dominantes, détruit pas à pas les acquis sociaux du prolétariat ukrainien et est par trop souvent inefficace. Il revendique le contrôle et la gestion des entreprises par les salarié·es mais aussi, par exemple, celui des abris antiaé riens par la population à la suite de graves dysfonctionnements qui ont mis en danger ceux et celles qui cherchaient un refuge lors de bombardements.
Sotsialnyi Rukh prête également une attention soutenue à la for mation de ses membres et aux débats d'idées. Malgré la guerre, il apporte sa part à une vie intellectuelle vivace et critique. Il orga nise régulièrement des conférences sur des sujets les plus divers, comme la défense des droits des travailleur·euses, l'histoire du mouvement ouvrier ukrainien ou encore celle du mouvement révolutionnaire en Amérique du Sud. Tous ces forums publics sont également diffusés en ligne. Les conférencier·es viennent parfois d'autres pays, car Sotsialnyi Rukh s'affirme comme une organisa tion internationaliste qui n'oublie pas, même en période de guerre, de commémorer le massacre de Tian'anmen par la bureaucratie chinoise, de saluer une grève des travailleur·euses britanniques, de publier des informations sur les luttes ouvrières ou anticolo niales dans le monde (Géorgie, Palestine, Argentine, États-Unis…).
Dans la douloureuse lutte de libération nationale que mène l'Ukraine, malgré les trahisons et les abandons occidentaux, Sotsialnyi Rukh défend une perspective socialiste qui combine à la lutte existentielle du pays l'émancipation sociale par l'autodétermi nation et l'auto-organisation des masses ukrainiennes.
Ce recueil illustre ce combat mais aussi cette démarche concrète (et ses voies transitoires) pour un socialisme démocratique d'auto gestion. Son expérience, ses pratiques sociales et écrits politiques constituent pour les gauches internationales un acquis inestimable dans leur entreprise d'élaboration d'un programme pour l'émanci pation au 21e siècle.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Ukraine : Escalade des attaques russes contre les civils

(Kiev, 22 mai 2025) – Les attaques menées par la Russie en Ukraine depuis janvier 2025 ont tué et blessé davantage de civils que durant la même période en 2024, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Les autres gouvernements, en particulier l'administration Trump, devraient user de leur influence lors de leurs discussions avec le Kremlin pour inciter la Russie à respecter le droit international humanitaire et à mettre fin aux attaques délibérées, indiscriminées et disproportionnées contre les civils et les biens civils.
26 mai 2025 | tiré du site Entre les lignes entre les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/05/26/ukraine-escalade-des-attaques-russes-contre-les-civils/
- Les attaques menées par les forces russes en Ukraine depuis janvier 2025 ont tué et blessé davantage de civils que durant la même période en 2024.
- Ces attaques ont violé l'interdiction des attaques indiscriminées et disproportionnées imposée par le droit international. De telles attaques, lorsqu'elles sont commises délibérément ou par imprudence, constituent des crimes de guerre au regard du droit international.
- Les efforts diplomatiques devraient privilégier la protection des civils et la justice pour les violations. Cela implique un soutien continu aux enquêtes et aux poursuites pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité.
« Les attaques russes tuent et blessent un plus grand nombre de civils, y compris des femmes et des enfants, qu'auparavant, alors même que les dirigeants mondiaux impliqués dans les négociations expriment leur horreur face au nombre croissant de victimes », a déclaré Belkis Wille, directrice adjointe de la division Crises, conflits et armes à Human Rights Watch. « Les négociateurs devraient exiger la fin immédiate des attaques contre les civils et les infrastructures civiles. »
Human Rights Watch a enquêté sur quatre attaques menées par les forces russes en Ukraine entre le 1er février et le 4 avril 2025, qui ont tué au moins 47 civils et blessé plus de 18 autres personnes. Human Rights Watch a conclu que ces attaques étaient illégales car elles ont violé, au minimum, l'interdiction des attaques indiscriminées et disproportionnées en vertu du droit international. Les forces russes n'ont pas fait la distinction entre objectifs civils et militaires, ni évité les pertes civiles disproportionnées que l'on pouvait attendre de ces attaques par rapport à l'avantage militaire attendu. De telles attaques, qu'elles soient commises délibérément ou imprudemment, constituent des crimes de guerre au regard du droit international.
Le 1er février à 7h44, un missile russe a détruit une aile d'un immeuble résidentiel dans la ville de Poltava, située à 240 kilomètres de la ligne de front ; cette attaque a tué 15 civils et blessé 20 autres personnes. Une base aérienne militaire dont l'entrée est située à une distance d'environ 700 mètres du lieu de l'explosion est la seule cible militaire identifiée par Human Rights Watch dans cette zone.
Le 4 février, les forces russes ont lancé un missile sur la ville d'Izioum, située dans l'est de l'Ukraine à une distance de 42 kilomètres de la ligne de front. La frappe a touché le bâtiment du Conseil municipal dans le quartier central d'Izioum, tuant 6 civils et en blessant 57 autres, dont trois enfants. La cible militaire la plus proche identifiée par Human Rights Watch est un bureau de recrutement militaire, situé à une distance d'environ un kilomètre du Conseil municipal.
Dans la nuit du 5 mars, une munition explosive a frappé le toit de l'Hôtel Tsentralnyi, à Kryvyï Rih, dans le sud-est du pays, à 70 kilomètres de la ligne de front ; cette frappe a tué 6 civils, et blessé 31 autres personnes. La munition a touché le centre de l'hôtel, et endommagé 14 immeubles résidentiels et plusieurs autres bâtiments. Les forces russes et des blogueurs russes ont confirmé l'attaque, affirmant qu'elle avait tué 28 combattants étrangers qui se trouvaient dans l'hôtel ; toutefois, Human Rights Watch n'a trouvé aucune preuve étayant cette assertion. La cible militaire la plus proche identifiée par Human Rights Watch est un bureau de recrutement militaire, situé à une distance de 5,7 kilomètres de l'hôtel.
Karol Swiacki, fondateur et président d'Ukraine Relief, une organisation non gouvernementale fournissant une aide humanitaire aux Ukrainiens, se trouvait dans le restaurant de l'hôtel au moment de l'attaque avec six personnes, dont une femme et son fils âgé de 6 ans.
« On discutait, on riait un peu, et puis, en une milliseconde, il y a eu un bruit énorme, des bruits de verre brisé, beaucoup de poussière », a relaté Karol Swiacki. « L'endroit où nous étions assis est devenu un enfer… On était sous le choc, on cherchait une sortie [de secours]… C'était un cauchemar. L'enfant hurlait… La poussière nous empêchait de voir quoi que ce soit. J'ai dû me couvrir la tête et la bouche avec mon manteau. »
Le soir du 4 avril, les forces russes ont lancé une autre attaque contre Kryvyï Rih. Une munition a explosé au-dessus d'un parc, endommageant son aire de jeux, de nombreux bâtiments à proximité et un restaurant. Cette attaque a tué 20 civils, y compris neuf enfants, dont la plupart se trouvaient dans l'aire de jeux. La frappe a aussi blessé 73 autres personnes, dont un bébé de 3 mois.
Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a déclaré qu'il s'agissait de « l'attaque la plus meurtrière contre des enfants » enregistrée par le HCDH depuis le début de l'invasion russe en Ukraine en février 2022. La cible militaire la plus proche identifiée par Human Rights Watch était le même bureau de recrutement militaire de Kryvyï Rih mentionné ci-dessus, situé à environ 2,5 kilomètres du parc.
Les forces russes n'ont émis aucun avertissement préalable aux civils qui se trouvaient sur ces sites ou à proximité, avant ces quatre attaques meurtrières.
Entre janvier et avril 2025, le nombre de civils tués et blessés par des attaques russes en Ukraine a augmenté de 57% par rapport à la même période en 2024 ; la hausse du nombre de blessés a été particulièrement importante. Le 24 avril, la Russie a mené une attaque dévastatrice contre Kiev ; les tirs de missiles et de drones ont tué au moins 12 civils, et blessé au moins 90 autres personnes.
Le droit international humanitaire, qui rassemble les lois de la guerre, oblige les parties à un conflit à faire en tout temps la distinction entre combattants et civils. Les civils ne peuvent jamais être la cible délibérée d'attaques. Les parties belligérantes sont tenues de prendre toutes les précautions possibles pour minimiser les dommages causés aux civils et aux biens civils. Les attaques ne peuvent viser que des objectifs militaires. Les attaques ciblant des civils, qui ne font pas de distinction entre combattants et civils, ou qui sont susceptibles de causer des dommages disproportionnés à la population civile par rapport au gain militaire attendu, sont interdites.
Les violations graves du droit de la guerre, y compris les attaques indiscriminées et disproportionnées, commises avec une intention criminelle – c'est-à-dire délibérément ou par imprudence – constituent des crimes de guerre. Les individus impliqués dans ces attaques peuvent être tenus pénalement responsables de la commission d'un crime de guerre, ainsi que de l'assistance, de la facilitation, de l'aide ou de l'incitation à un crime de guerre. Les commandants et les dirigeants civils peuvent être poursuivis pour crimes de guerre au titre de la responsabilité du commandement, s'ils avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance de la commission de crimes de guerre et ont pris des mesures insuffisantes pour les prévenir ou en punir les responsables.
« Les efforts diplomatiques visant à mettre fin à la guerre menée par la Russie en Ukraine devraient privilégier la protection des civils et la justice pour les abus », a conclu Belkis Wille. « Cela signifie qu'il ne faut pas accorder d'amnistie aux auteurs de violations graves du droit international humanitaire, et qu'il faut continuer à soutenir les enquêtes et les poursuites pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. »
Suite en anglais, comprenant des informations plus détaillées sur les quatre attaques illégales russes.
https://www.hrw.org/fr/news/2025/05/22/ukraine-escalade-des-attaques-russes-contre-les-civils
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Adoption du projet de loi 89 : « Il s’agit d’une journée sombre pour les travailleuses et les travailleurs »

Le projet de loi 89, adopté aujourd'hui, aura de lourdes conséquences pour l'ensemble de la main-d'œuvre du Québec, affirment les porte-paroles des principales organisations syndicales, dont la CSQ.
« Le premier ministre et son ministre du Travail n'ont vraisemblablement pas saisi l'ampleur des dégâts qu'occasionnera sa nouvelle législation. Il s'agit d'une journée sombre pour les travailleuses et les travailleurs », dénoncent les porte-paroles Robert Comeau de l'APTS, Luc Vachon de la CSD, Caroline Senneville de la CSN, Éric Gingras de la CSQ, Mélanie Hubert de la FAE, Julie Bouchard de la FIQ, Magali Picard de la FTQ, Christian Daigle du SFPQ et Guillaume Bouvrette du SPGQ.
Des conséquences pour toutes les personnes salariées du Québec
Il ne fait aucun doute pour les organisations syndicales que les impacts du projet de loi se feront sentir bien au-delà des personnes syndiquées. « Nous le répétons, les gains obtenus par la négociation exercent une pression positive sur les milieux non syndiqués, obligeant les employeurs à s'ajuster pour demeurer compétitifs. C'est à l'ensemble de la main-d'œuvre québécoise que le gouvernement s'attaque en limitant la capacité des travailleuses et des travailleurs à défendre et à améliorer leurs conditions de travail », déplorent les porte-paroles.
Une menace à la paix industrielle
Les règles entourant le recours et l'exercice de la grève permettaient jusqu'ici de maintenir l'équilibre fragile, mais essentiel entre les travailleuses, les travailleurs et les patrons. Les organisations syndicales ne s'expliquent pas pourquoi Jean Boulet a voulu tout bouleverser, si ce n'est pour assujettir l'ensemble des personnes salariées au bon vouloir des employeurs et pour faire plaisir au patronat ainsi qu'à un conseil des ministres aux tendances antisyndicales.
« L'encadrement entourant l'exercice du droit de grève, qui était somme toute limitatif, offrait aux travailleuses et aux travailleurs la possibilité d'améliorer leurs conditions à l'intérieur de balises claires. Le ministre semble s'être trouvé des prétextes pour bafouer leurs droits et, de ce fait, il menace la paix industrielle », évoquent les représentants syndicaux. « Il nous semble clair que les limitations au droit de grève contenues dans cette législation ne passeront pas le test des tribunaux. Les constitutions, tant canadienne que québécoise, ainsi que l'arrêt Saskatchewan sont sans équivoque à ce propos. Les droits syndicaux sont aussi des droits humains. »
Des gains obtenus grâce aux luttes
Au fil des décennies, de nombreuses avancées sociales bénéficiant à l'ensemble de la société ont été obtenues grâce aux luttes menées par les travailleuses et les travailleurs syndiqués. L'équité salariale, l'implantation du réseau des CPE, le salaire minimum, les congés parentaux sont quelques-uns des gains obtenus grâce à la mobilisation syndicale. « Ce sont nos moyens de pression et nos grèves qui ont permis à des millions de Québécoises et de Québécois de bénéficier de ces droits. Priver les travailleuses et les travailleurs de leur capacité à lutter, c'est freiner les progrès de toute la société québécoise », insistent les porte-paroles.
« Le lien de confiance est rompu »
Dès l'évocation par Jean Boulet de ses intentions, à la fin 2024, les organisations syndicales ont invité le ministre du Travail à la prudence. « Nous avons rapidement saisi que le ministre ne serait pas ouvert à la discussion afin de trouver des solutions satisfaisantes pour tous. D'ailleurs, nous nous expliquons mal cette volte-face complète de la part du ministre du Travail, qui a drastiquement changé de ton à partir de ce moment : il a choisi de rompre le dialogue avec les travailleuses et les travailleurs du Québec. Le lien de confiance est rompu », concluent les porte-paroles.

Le plan d’aide d’Israël à Gaza est un élément clé de sa stratégie d’expulsion des Palestiniens

Le projet d'Israël de confier la distribution de l'aide à Gaza à une entreprise privée américaine est un élément clé de son plan de nettoyage ethnique de la population. Voici comment.
Tiré de Agence médias palestine
27 mai 2025
Par Qassam Muaddi, le 22 mai 2025
Photo : Des Palestiniens font la queue pour recevoir des pots de nourriture distribués par des organisations caritatives, à Gaza, le 21 mai 2025. (Photo : Omar Ashtawy/APA Images)
L'expulsion forcée du peuple palestinien est désormais l'objectif explicite de la guerre menée par Israël contre Gaza. Mercredi soir, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu'Israël ne mettrait fin à la guerre que si « le Hamas se rendait, Gaza était démilitarisée et que nous mettions en œuvre le plan Trump ».
Trump est revenu sur son plan de février visant à « prendre possession » de Gaza, à expulser sa population et à la transformer en « Riviera du Moyen-Orient », mais Netanyahu l'a tout de même saisi et considéré comme un feu vert pour exterminer Gaza. La dernière phase de ce plan consiste à militariser l'aide humanitaire à des fins d'extermination finale de Gaza.
Le plan est simple : affamer la population de Gaza et créer une seule zone rase où elle pourra venir chercher des rations alimentaires, acheminées par l'armée israélienne et gérées par une entreprise privée américaine. La population de Gaza sera contrainte de se rendre dans ces points de collecte, où elle sera parquée dans ce qui sera en fait un camp de concentration, situé dans l'ancienne ville de Rafah, transformée aujourd'hui en un terrain vague.
Netanyahu a clairement exprimé tout cela dans sa dernière déclaration, publiée au lendemain de l'annonce par Israël de son intention d'autoriser l'entrée d'une aide humanitaire « minimale » à Gaza pour des « raisons diplomatiques », afin d'éviter des accusations de crimes de guerre et des images de famine.
Lundi, le cabinet de guerre israélien a finalement approuvé l'entrée de l'aide, après deux mois de blocus total du territoire assiégé. Cette famine forcée a entraîné la propagation de la faim et des maladies. Le bureau des médias du gouvernement de Gaza a indiqué qu' au moins 70 000 enfants palestiniens ont été hospitalisés pour malnutrition sévère.
La décision du cabinet fait suite à d'intenses négociations avec le Hamas au Qatar, avec la médiation de cet État du Golfe et la pression de l'envoyé américain au Moyen-Orient, Steve Witkoff. Les pourparlers ont débuté après la libération par le Hamas du soldat israélo-américainEdan Alexander au début de la semaine dernière.
Les États-Unis auraient fait pression sur Israël pour qu'il envoie une équipe de négociateurs, conduisant finalement à la décision d'autoriser l'entrée de denrées alimentaires.
Les pourparlers se poursuivent sur la possibilité d'un cessez-le-feu, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu insistant sur le fait qu'Israël ne s'engagera pas à mettre fin à la guerre et conservera le contrôle de Gaza. Le Hamas insiste sur des garanties américaineset une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU stipulant qu'Israël ne reprendra pas ses attaques sur Gaza après la libération des prisonniers israéliens. Toutefois, pour l'instant, les Palestiniens de Gaza devraient bénéficier d'un certain soulagement face à la famine, Israël ayant déjà commencé à autoriser l'entrée d'un petit nombre de camions de nourriture dans la bande de Gaza.
Mardi, l'ONU a déclaré que les neuf camions autorisés à entrer la veille par Israël ne représentaient qu'une « goutte d'eau dans l'océan » par rapport aux besoins de la population dévastée. Mais la quantité de l'aide autorisée à entrer à Gaza n'est pas la seule préoccupation qui plane autour de cette question. Une crainte supplémentaire grandit que l'aide puisse être utilisée comme un outil par Israël pour atteindre son objectif principal en temps de guerre : faciliter l'expulsion des Palestiniens de Gaza.
L'objectif d'Israël : le nettoyage ethnique
Lorsque Israël a annoncé sa dernière offensive visant à contrôler l'ensemble de Gaza, baptisée « opération Gédéon », le quotidien israélien Yediot Ahronot a rapportéque l'une des phases de l'opération consisterait à transférer la majorité de la population palestinienne vers le sud de la bande de Gaza, en particulier dans la région de Rafah. Ces informations ont été publiées simultanément avec les déclarations de Netanyahu aux réservistes israéliens la semaine dernière, selon lesquelles Israël vise à chasser les Palestiniens de Gaza et que le principal obstacle est de trouver des pays prêts à les accueillir. La concentration des Palestiniens dans le sud de Gaza est considérée par la plupart des analystes comme une étape préparatoire à leur expulsion. Ce nouveau plan d'aide humanitaire à Gaza pourrait être la dernière pièce de cette stratégie.
Cette utilisation tactique de la distribution de nourriture est envisagée par le cabinet de guerre israélien depuis l'année dernière, plusieurs mois avant la conclusion du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. En septembre 2024, Netanyahu discutait déjà du meilleur mécanisme pour permettre la distribution de l'aide dans le nord de Gaza, où l'armée israélienne prévoyait alors d'étendre ses opérations terrestres. Netanyahu a déclaré lors d'une réunion du cabinet que l'armée israélienne « se chargerait » de distribuer l'aide dans les zones où elle s'efforçait également de vaincre la résistance palestinienne.
Le journal israélien Makor Rishon a rapportéà l'époque que le Premier ministre israélien suivait les suggestions de ses alliés d'extrême droite au sein du cabinet, Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich et Orit Strock, qui auraient soutenu le contrôle de l'armée israélienne sur la distribution de l'aide, dans le cadre d'un plan plus large visant à étendre l'offensive terrestre dans le nord de la bande de Gaza. Le journal citait Smotrich qui qualifiait ce plan de « changement stratégique » visant à « maximiser l'effort militaire » afin de vaincre le Hamas.
Deux mois plus tard, l'armée israélienne a bouclé tout le nord de la bande de Gaza, provoquant une baisse immédiate de la quantité de nourriture disponible et poussant quelque 400 000 Palestiniens au bord de la famine dans le cadre de ce qui a été appelé « le plan des généraux », destiné à chasser les Palestiniens du nord de Gaza. Cette opération a fait chuter la population du nord de Gaza sous la barre des 100 000 habitants, atteignant même 75 000 selon certaines sources. Israël n'a jamais été en mesure de mettre en œuvre son projet de contrôle de la distribution de l'aide, car le blocus du nord a suffi à lui seul à chasser la majeure partie de la population de la région, et un cessez-le-feu a finalement été conclu à la mi-janvier.
Le nouveau plan d'aide
Même si le cabinet de guerre israélien a approuvé lundi l'entrée des camions d'aide, la mise en œuvre effective de cette décision a été progressive. Jeudi, le bureau des médias du gouvernement de Gaza a annoncé que certains camions étaient arrivés dans la bande de Gaza pour distribution trois jours après la date prévue.
Les organisations internationales, notamment les agences des Nations unies telles que l'UNRWA et le Programme alimentaire mondial (PAM), ont traditionnellement joué un rôle clé dans la distribution de l'aide à Gaza. Mais quelques minutes après la décision du cabinet cette semaine, le Times of Israel a rapporté qu'Israël allait adopter un nouveau mécanisme pour distribuer l'aide par l'intermédiaire de l'armée israélienne, contournant ainsi les organisations internationales.
L'élément le plus important de ce nouveau dispositif est que l'aide ne serait pas distribuée dans toute la bande de Gaza, mais dans des points de distribution spécifiques où les Palestiniens seraient tenus de se rendre pour la recevoir.
Ce plan israélien avait en fait déjà été annoncé comme un plan conjoint des États-Unis et d'Israël, qui prévoyait la distribution d'une aide sous forme de rations limitées aux ménages. Dans le nouveau plan israélien, plutôt que de travailler avec les organisations humanitaires traditionnelles, la distribution serait organisée par la Gaza Humanitarian Foundation, une fondation humanitaire récemment créée aux États-Unis. Le 4 mai, les organisations internationales présentes à Gaza ont unanimement rejeté ce plan dans une déclaration commune, affirmant qu'il « contrevient aux principes humanitaires fondamentaux et semble conçu pour renforcer le contrôle sur les produits de première nécessité comme moyen de pression dans le cadre d'une stratégie militaire ».
Cette déclaration a été suivie le 6 mai par une déclaration des équipes d'aide humanitaire de l'ONU, qui ont déclaré que ce plan « semble être une tentative délibérée d'instrumentaliser l'aide ».
Un mois plus tôt, le 8 avril, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, avait rejetéle contrôle israélien sur la distribution de l'aide à Gaza, affirmant qu'il risquait « de contrôler davantage et de limiter de manière cruelle l'aide jusqu'à la dernière calorie et au dernier grain de farine ». M. Guterres avait ajouté que l'ONU « ne participerait à aucun arrangement qui ne respecterait pas pleinement les principes humanitaires : humanité, impartialité, indépendance et neutralité ».
Pendant ce temps, Gaza meurt de faim
Alors qu'Israël poursuit officiellement les négociations de cessez-le-feu avec le Hamas au Qatar, sa décision d'autoriser l'entrée de l'aide a été présentée comme un pas en avant dans les efforts visant à mettre fin à la crise humanitaire à Gaza. Cependant, si elle est mise en œuvre conformément au plan d'Israël, la livraison de l'aide pourrait devenir une nouvelle étape dans la stratégie israélienne visant à atteindre son objectif désormais explicite d'expulser la population palestinienne de la bande de Gaza.
Dans le même temps, la famine s'accentue de minute en minute dans la bande de Gaza, faisant depuis octobre 2023 au moins 57 morts parmi les Palestiniens, principalement des enfants, selon le ministère palestinien de la Santé, et provoquant 300 fausses couches dues au manque de nutriments. Le bureau des médias du gouvernement de Gaza a également déclaré qu'un nombre indéterminé de personnes âgées étaient décédées en raison du manque de médicaments au cours de la même période.
Tout cela se poursuit alors que les forces israéliennes intensifient leurs frappes aériennes sur la bande de Gaza, tuant 82 Palestiniens au cours des dernières 24 heures (mardi à mercredi), selon le ministère palestinien de la Santé. Depuis octobre 2023, l'offensive israélienne sur Gaza a officiellement tué plus de 53 000 Palestiniens, la plupart des estimations du bilan total du génocide étant beaucoup plus élevées.
Traduction : JB pour l'Agence Média Palestine
Source : Mondoweiss
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

En 2025, les Démocrates ont le vent dans les voiles ; merci à D. Trump et à la nouvelle organisation de la base

Plus de 16,000 collaborateurs.trices sont déjà sur le terrain développant ce que le Président de Parti démocrate, Ken Martin, décrit comme une infrastructure d'organisation jamais vue en période d'élection non présidentielle.
John Nichols, The Nation 20 mai 2025
Traduction, Alexandra Cyr
2025 est déjà une bonne année électorale pour les Démocrates. Il ne fait pas de doutes que le chaos, la cruauté et l'incompétence de l'administration Trump y est pour quelque chose. Elle a aidé les Démocrates à se relever des pertes de 2024 à la Chambre des représentants et au Sénat. Pourtant ils ne peuvent pas simplement s'en remettre à d'autres mauvaises politiques pour gagner les élections. Il faut vous saisir vous-mêmes des chances du moment. Il est évident que le Président du Comité central du Parti démocrate, (DNC), Ken Martin, qui n'a jamais caché son enthousiasme pour l'organisation de la base, est engagé dans ce sens.
Comme il me l'a dit cette semaine, pour ce président nouvellement élu, la notion qui veut qu'il : « n'y ait pas d'années de congé » est centrale. Avec cela en tête, K. Martin et son adjointe Libby Schneider, ont mis en place, en ces temps d'intense vie politique aux États-Unis, une stratégie peu remarquée mais efficace : il y a déjà 16,000 bénévoles sur le terrain partout dans le pays. Cela annonce aussi une augmentation significative en cette année sans élections mais qui définit celle de mi-mandat en 2026.
Mme Schneider décrit cela comme « une nouvelle organisation qui vise à impliquer les militants.es démocrates de la base à entrer en action, à demander des comptes aux Républicains.es qui ont adopté une proposition de budget désastreuse qui volent les familles ouvrières et donnent aux ultra riches ».
La direction du Parti doit faire face à de plus en plus de pressions et de mécontentement envers la stratégie dite des 50 États. Depuis plus de 20 ans on la discute dans les cercles démocrates depuis que l'ancien président du comité central, Howard Dean, qui après avoir tenté de l'implanter, l'a abandonnée. L'approche actuelle est fortement soutenue par des stratèges comme Mme Schneider qui y réfère comme : « la structure d'organisation la plus forte que la direction nationale ait jamais eue durant une année sans élections présidentielles ».
C'est ce à quoi Ken Martin, qui a longtemps été le président du Minnesota Democratic-Farmer-Labor Party avant son élection à la présidence du DNC en février dernier, réfère comme son obsession devant toutes les autres. Il semble que ça porte fruit non seulement électoralement mais aussi quand on observe l'affluence aux 100 assemblées publiques démocrates partout dans le pays. On y défie les Républicains.es sur leurs attaques contre presque tout à partir de Medicaid jusqu'à la démocratie en tant que tel.
K. Martin m'a déclaré que nous allions continuer à voir des investissements et un effort d'organisation de la part du DNC « que nous n'avons encore jamais vu ». Avec son équipe il débutait une nouvelle organisation communautaire numérique qui vise à « centraliser les opportunités de formation en communication, les événements, et les campagnes de demandes de comptes ». Il y aura aussi des programmes de formation pour outiller les bénévoles de la base qui se mobilisent pour la campagne : « Fight to Save Medicaid ». Et il ajoute : « Les principes qui nous guident pour l'organisation vont permettre au Parti de travailler à l'année longue à l'organisation des communautés, au renforcement de la base, à l'élection de candidats.es qui vont se battre pour la classe ouvrière et pour améliorer la vie des Américains.es ».
« Pas d'années de congé » est une bonne direction. La nouvelle direction du Parti démocrate parle toujours de nouvelles approches, de nouvelle stratégies. Avec les Démocrates, les débats ne manquent pas. Au cours des récentes semaines, on a entendu parler de beaucoup de drames liés au DNC spécialement quand le sous-comité des créances a recommandé une reprise de l'élection à la vice-présidence électorale suite à des plaintes sur la manière dont le vote initial avait été conduit et à des discussions à propos de la manière d'aborder les luttes pour les primaires. Bien des débats sont légitimes et importants dans un parti où l'accord sur la nécessité de changements est fort mais on observe moins de consensus sur ce qui est exactement requis.
Mais en même temps que ces débats se tiennent le Parti doit s'occuper d'un bien plus grand enjeu à court terme : les campagnes électorales à mener cette année. Comme en aucune autre année sans élections programmées, 2025 se présente un peu comme un fourretout. Il y a des élections pour les postes de gouverneurs en Virginie et au New Jersey. Des élections partielles auront lieu dans ces États et ailleurs au pays. Et des élections de juristes et de maires sont aussi au programme. Celles de mi-mandat sont dans un peu plus d'un an mais ça ne veut pas dire que les précédentes ne sont pas sans enjeux majeurs. C'est pourquoi, depuis son élection à la présidence du DNC il y a trois mois, K. Martin et son équipe ont adopté une attitude qui n'admet aucune excuse par rapport à ce cycle électoral.
Pour Mme Scheinder, l'investissement dans cette organisation précoce donne déjà des résultats.
Elle a raison. Même si les Démocrates ont débattu de la manière de se repositionner après l'amer échec de l'élection présidentielle de 2024, ils ont commencé à encaisser des records de succès en 2025. La candidate soutenue par le Parti au poste de la Cour suprême du Wisconsin a battu son adversaire à plates coutures alors qu'il était soutenu par le Parti républicain et D. Trump, qu'E. Musk y ait dépensé des sommes records et que d'autres millionnaires républicains le soutenaient aussi. Au cours des quatre premiers mois de l'année, les Démocrates ont gagné cinq élections partielles qui ont conforté leur situation à la Chambre des représentants. Ils ont profité de gains en Iowa et dans des districts de Pennsylvanie que D. Trump avait gagné haut la main en 2024. Ils ont surpassé leurs résultats de 2024 dans des élections partielles partout dans le pays. La semaine dernière les Républicains.es ont été estomaqués.es lorsque qu'un de leurs membres, maires élu dans une grande ville, a été éconduit de son poste par un Démocrate par une marge de 57 voix contre 43.
Il n'y a pas de doutes que cela soit en lien avec la manière par laquelle D. Trump et son allié multimillionnaire E. Musk qui a été « l'employé spécial du gouvernement », ont agi depuis le début de cette nouvelle administration. Ils ont été soutenus par les Républicains.es au Congrès. Leurs actions ont affaibli Social Security et l'administration des services aux anciens.nes combattants.es. Leurs menaces de coupes dans le budget de Medicaid provoquent de réelles peurs. Et tout cela avec un activisme débridé.
« Pas congés ; pas de jours de congé, par d'année de congé », répète Mme Scheinder à la suite de K. Martin. Et elle ajoute : « Le DNC est le premier comité national démocrate qui organise des liens directs avec les électeurs-trices pour les élections en 2025 et en 2026. Nous sommes témoins en temps réel de ce qu'un modèle d'organisation soutenu et couvrant toute l'année peut signifier pour les résultats électoraux. Les Démocrates surpassent leurs résultats dans les élections partout dans le pays, explicitement dans 22 élections sur 24 au cours des seuls cinq premiers mois de 2025 ».
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Comme il me l'a dit cette semaine, pour ce président nouvellement élu la notion qui veut qu'il : « n'y ait pas d'années de congé » est centrale.
Les lockoutés de Heidelberg pensent que leur patron ne tiendra pas longtemps
La caricature d’actualité en affiche de l’artiste cubain Martirena dans notre nouvelle boutique !
Les travailleurs de la STM se sont fait enlever leur droit de grève
L’Étoile du Nord dénonce l’arrestation arbitraire d’une de ses journalistes
Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
Depuis la dernière décennie, nous observons une montée des extrêmes droites à travers le monde, qui s’articule par une multiplication en puissance des discours haineux et une augmentation des pratiques xénophobes face à l’immigration à l’échelle mondiale. Cette réalité provoque une crise de l’hospitalité telle que nous la connaissons actuellement, qui s’exprime notamment par le durcissement des politiques migratoires, le renforcement des contrôles frontaliers par les agences fédérales et policières, la restriction progressive du droit d’asile, ainsi qu’à l’accès aux soins de santé et au logement pour les personnes migrantes, notamment de l’Amérique latine. Celles et ceux qui sont forcé·es de migrer, dans l’espoir d’offrir une vie meilleure à leur famille ou d’échapper à la violence et aux changements climatiques dans leur pays d’origine, sont confronté·es à une exploitation capitaliste et au racisme systémique. D’un côté, les personnes migrantes sont vues comme une marchandise exploitable aux yeux des États et des entreprises, et de l’autre, elles deviennent les boucs émissaires de tous les maux de la société capitaliste pour détourner l’attention de la véritable source des problèmes structurels.
Devant cette fermeture des frontières et les déportations massives, des voix s’élèvent aux quatre coins du continent et se rejoignent pour former ce numéro de Caminando, ainsi que pour dénoncer les politiques migratoires inhospitalières. Cette édition comporte des analyses sur les migrations Sud-Nord et les conséquences des politiques d’hostilité, des récits de vie de personnes migrantes vivant avec un statut précaire ou sans statut, des réflexions sur la discrimination raciale et la criminalisation de la migration. Nous retrouvons également des histoires de résistances, où la solidarité et l’entraide se renforcent face à cette chasse aux personnes migrantes et leur invisibilisation historique.
De nombreux articles présentés dans ce numéro analysent les migrations du Sud vers l’Amérique du Nord. Le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis, en janvier 2025, a ravivé les inquiétudes concernant les politiques migratoires, en particulier à l’égard des personnes migrantes latino-américaines à la frontière du Mexique. L’histoire nous rappelle toutefois que le racisme et la vision de la personne immigrante comme criminelle existaient bien avant l’arrivée au pouvoir de Trump. Parallèlement au renforcement des frontières, les pays du Nord global ont aussi développé des techniques pour retarder l’arrivée des personnes migrantes, voire les décourager ou les inciter à l’immobilité, en offrant l’option de faire les démarches d’immigration et la demande d’asile sans mettre les pieds sur leur territoire. Les politiques de contention de la migration se retrouvent dans des programmes politiques comme l’application CBP One, mise en place par l’administration Biden, et l’initiative Quedate en México par l’administration Trump. Les casas de migrantes situées à la frontière mexicaine se transforment en lieu d’attente et d’hospitalité pour des milliers de personnes. La plupart de ces refuges ont été mis en place par des organisations de la société civile ou des congrégations religieuses en réponse à l’insécurité et la précarité vécues par les personnes migrantes et demandant l’asile qui attendent de pouvoir entrer légalement aux États-Unis. Dans ce numéro de Caminando, nous pouvons justement en apprendre davantage sur les défis affrontés par les organisations travaillant pour la reconnaissance des personnes migrantes et documenter les violations de droits humains.
Les poèmes sur la frontière Mexique–États-Unis qui accompagnent ce numéro sont à la fois porteurs d’espoir et d’incertitude. La poésie illustre de quelle manière une traversée périlleuse à la frontière transforme rapidement ce fameux « rêve états-unien » en un réel cauchemar.
Quelques articles portent plus particulièrement sur la situation au Québec. On peut lire notamment à propos du durcissement des politiques migratoires sous le gouvernement de François Legault, entre autres par sa tentative d’annuler 18 000 dossiers d’immigration, la fermeture du chemin Roxham ou encore le maintien des permis fermés pour les travailleur·eurs étrangers·ères temporaires. Selon le Regroupement des organismes en hébergement pour les personnes migrantes, les discours anti-immigration se reflètent notamment dans la discrimination en matière d’accès au logement ou au travail, vécue par les personnes nouvellement arrivées. Sur une note plus positive, le Projet accompagnement solidarité Colombie, un collectif anticolonial et féministe basé à Montréal, nous partage leur récente initiative d’éducation populaire qui porte sur la justice climatique afin de sensibiliser les jeunes personnes québécoises au lien entre le racisme environnemental et les injustices liées à la migration.
Quelques articles analysent comment les crises climatiques, politiques et économiques en Amérique latine, ainsi que le renforcement des dynamiques extractivistes impulsées par le Nord global, entraînent des millions de personnes à émigrer dans un pays voisin du Sud global. En Argentine, le président Javier Milei diabolise la migration et affirme que les personnes migrantes profitent du système afin de justifier la hausse des frais migratoires et des procédures pour la résidence temporaire et permanente dans un contexte de chômage et de réduction des politiques sociales. Au Brésil, des personnes migrantes vénézuéliennes sont relocalisées de force dans l’État de Roraima, dans des hébergements temporaires où ont été observées de graves violations de droits humains perpétrées par des autorités locales et internationales. En Colombie, le déplacement forcé du peuple Nasa-Paéz, dans le Département du Cauca, s’inscrit dans un processus colonial et de dépossession du territoire. Cette population autochtone nous offre toutefois un exemple de résistance et de reconstruction du tissu social autour de la préservation de la mémoire collective, de la lutte pour la récupération de leur territoire ancestral et la protection de la Terre-Mère.
Nous aimerions remercier la contribution de toute personne ayant rendu possible le développement, la promotion et la diffusion de la revue : auteur·trices, poètes, illustrateur·trices, traducteur·trices, réviseur·es, membres du comité éditorial, médias alliés québécois, libraires, ainsi que nos partenaires financiers. Enfin, la superbe couverture de ce numéro a été réalisée par Liana Perez Tello et nous la remercions pour sa créativité et son engagement solidaire.
Ce numéro représente une lecture essentielle pour comprendre les enjeux actuels dans les Amériques et la solidarité des organisations qui parviennent à cultiver l’hospitalité dans un environnement de plus en plus restrictif. Nous espérons qu’il générera une discussion sur les inégalités engendrées par la logique de sécurisation des frontières et mobilisera vers des actions concrètes. Le Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL) reste engagé envers les luttes sociales qui nous unissent depuis bientôt 50 ans. Les liens tissés continueront d’inspirer les générations futures et de renforcer les mouvements sociaux d’ici et d’ailleurs.
Bonne lecture!
The post Éditorial first appeared on Revue Caminando.
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.











