Derniers articles

Québec solidaire doit demander l’abrogation de la loi 69 assurant la gouvernance responsable des ressources énergétique et modifiant diverses dispositions législatives et exiger que soit lancé un large débat public sur l’avenir énergétique du Québec

Proposition d'urgence du Comité d'action politique Écologiste présentée au Conseil national au Conseil national du 7 et 8 juin 2025. Cette proposition d'urgence a été adoptée par le Conseil national de Québec solidaire tenu les 7 et 8 juin dernier.
1. CONSIDÉRANT que l'urgence climatique et la nécessité d'être carboneutre d'ici 2050 ne sont plus à démontrer ;
2. CONSIDÉRANT la déclaration du programme du parti sur la souveraineté des peuples autochtones et de son principe afférent des relations d'égal à égal et de nation à nation ;
3. CONSIDÉRANT que la Loi 69, qui vise à doubler la production énergétique du Québec d'ici 25 ans, comporte plusieurs risques importants pour le Québec, notamment :
a. Miser principalement sur la croissance énergétique pour attirer des multinationales en leur offrant des tarifs d'électricité concurrentiels ;
b. Négliger la décarbonation de notre économie et ignorer les entreprises locales concernées ;
c. Privatiser la production et la distribution de l'électricité ;
d. Augmenter significativement les tarifs d'électricité ;
e. Ignorer la sobriété énergétique et la protection de nos territoires agricoles et des écosystèmes ;
f. Soutenir et développer un extractivisme qui sert la filière batterie et l'électrification du parc automobile, tout en négligeant les transports collectifs publics ;
4. CONSIDÉRANT le consensus de plusieurs peuples autochtones et organisations de la société civile, notamment le syndicats et groupes écologistes qui exigent un débat public large sur l'avenir énergétique du Québec avant d'élaborer un Plan de gestion intégré des ressources énergétiques (PGIRE) ; 5. CONSIDÉRANT l'impact de la loi sur plusieurs régions du Québec par des projets comme le Projet TES Mauricie ;
6. CONSIDÉRANT, d'après ce qui précède, qu'il y a urgence d'agir, le Comité d'action politique écologiste propose :
1) Que Québec solidaire demande l'abrogation de la loi 69 ;
2) Que Québec solidaire, en collaboration avec les peuples autochtones et les organisations alliées, exige la tenue d'un large débat public de société sur l'avenir énergétique du Québec dans une perspective de transition socio- écologique juste et de repossession collective de nos ressources énergétiques ;
3) Que Québec solidaire appuie les revendications des opposant·es au projet de loi 69 et encourage la participation de ses membres aux mobilisations de 2025 et 2026 en faveur d'une transition énergétique juste, fondée sur la planification démocratique des besoins, la décentralisation régionale et la gestion collective de l'énergie sous contrôle public, de la production et la distribution.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La position de l’Afrique dans le nouvel ordre mondial

L'Afrique est aujourd'hui à la croisée des chemins, prise entre les crises internes, les dynamiques changeantes du pouvoir mondial et le lent déploiement de l'ordre politique postcolonial. D'un côté à l'autre du continent, les partis au pouvoir, autrefois légitimés en tant que libérateurs nationaux, perdent du terrain, mais l'opposition reste divisée et n'a pas grand-chose à offrir en termes de gouvernance alternative.
25 juin 2025 | tiré de Viento sur
https://vientosur.info/la-posicion-de-africa-en-el-nuevo-orden-mundial/
Le Soudan reste pris au piège d'une guerre dévastatrice entre les forces armées soudanaises et les forces paramilitaires de soutien rapide. C'est un conflit qui a déplacé des millions de personnes et qui s'est en même temps internationalisé, l'Égypte et les Émirats arabes unis soutenant des camps opposés.
Les élections de 2024 au Mozambique ont été l'un des exemples les plus clairs de ce déclin, lorsque le parti au pouvoir, le Frelimo, a été proclamé vainqueur d'un processus condamné par de nombreuses personnes comme étant frauduleux. Le chef de l'opposition Venâncio Mondlane, candidat du parti Podemos nouvellement créé, a accusé le gouvernement d'avoir orchestré une manipulation électorale massive, avec des décomptes parallèles des votes indiquant qu'il avait effectivement remporté les élections. Le parti au pouvoir a réagi aux manifestations de masse en déclenchant une violente répression. Ce faisant, il a poursuivi sa tendance à réprimer la dissidence politique et à maintenir son contrôle par des moyens de plus en plus autoritaires.
La perte de légitimité de ces gouvernements de l'ère de la libération ne se limite pas au Mozambique. En Afrique du Sud, le Congrès national africain (ANC) a perdu sa nette majorité pour la première fois depuis 1994, ne remportant qu'environ 40 % des voix aux élections de 2024. Après des décennies de domination politique, le parti fait maintenant partie d'une coalition difficile et extrêmement fragile avec l'Alliance démocratique (DA), un parti avec lequel il a longtemps rivalisé. Cela a forcé l'ANC à gouverner à partir d'une position plus centriste, limitant sa capacité à développer des politiques auxquelles sa base traditionnelle pourrait s'attendre.
Alors que certains secteurs de l'ANC considèrent cette coalition comme une concession nécessaire pour maintenir la stabilité, d'autres la qualifient de trahison de la mission historique du parti, notamment en raison de l'orientation politique néolibérale de la DA. Les conséquences de ces événements restent à voir : elles dépendront de la persistance du gouvernement de coalition, de la poursuite de la fracture de l'ANC ou de la force des mouvements d'opposition en dehors du processus électoral officiel.
Le déclin de l'ANC fait partie d'une tendance plus large en Afrique australe, où le Zanu-PF du Zimbabwe s'enracine au pouvoir par des moyens répressifs plutôt que par le soutien populaire, en utilisant le pouvoir judiciaire et la commission électorale pour bloquer toute contestation de l'opposition. Pendant ce temps, la Swapo en Namibie et le BDP au Botswana ont été confrontés à des revers électoraux sans précédent (le BDP a perdu une élection pour la première fois depuis l'indépendance), ce qui indique que même les partis au pouvoir autrefois stables ne sont plus assurés d'une victoire électorale facile. L'émergence de ces changements indique que leurs références autrefois puissantes en tant que partis libérateurs ne sont plus suffisantes pour obtenir un mandat gouvernemental suffisant.
Conflit
L'affaiblissement de ces gouvernements s'inscrit dans un contexte d'aggravation des conflits et d'instabilité dans d'autres parties du continent.
Le Soudan reste empêtré dans une guerre dévastatrice entre les forces armées soudanaises et les paramilitaires des Forces de soutien rapide. Ce conflit a déplacé des millions de personnes et est progressivement devenu international, l'Égypte et les Émirats arabes unis soutenant des camps opposés. La guerre a non seulement aggravé l'effondrement économique du Soudan, mais elle constitue également une menace pour la stabilité régionale, avec des retombées au Tchad, au Soudan du Sud et en Éthiopie.
La République démocratique du Congo (RDC) continue de lutter contre les insurrections armées, en particulier le M23 soutenu par le Rwanda, qui exacerbe les tensions régionales. Les accusations d'ingérence transfrontalière contribuent à la détérioration des relations diplomatiques.
Ces crises ne sont pas isolées, mais reflètent un échec plus profond de la gouvernance à travers l'Afrique, où, dans de nombreux cas, l'État est incapable de résoudre les griefs sociaux et économiques sans recourir à la violence.
L'effet Trump
Au milieu de toutes ces crises, l'Afrique doit aussi faire face au changement de l'ordre international. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche a déjà commencé à remodeler les relations de l'Afrique avec les États-Unis. Il y a eu un changement en faveur d'une relation plus transactionnelle et d'un accent renouvelé sur la sécurité plutôt que sur le développement. L'une des premières grandes mesures de politique étrangère de Trump a été l'élimination de l'aide au développement avec le démantèlement de l'USAID et le retrait du financement de programmes de santé cruciaux, y compris le Plan d'urgence du président américain pour la lutte contre le sida (PEPFAR). Des millions de personnes n'ont donc pas accès au traitement du VIH et à d'autres services essentiels.
Cela s'est fait sentir de manière plus aiguë dans les pays où les systèmes de santé sont déjà mis à extrêmement rude épreuve, ce qui exacerbe les crises de santé publique qui pourraient avoir des effets déstabilisateurs à long terme. Le gouvernement américain justifie ces coupes par des arguments typiques de son idéologie America First, qui considère l'aide étrangère comme une dépense inutile et non comme un investissement stratégique dans la stabilité.
Et cela a coïncidé avec un durcissement de la politique américaine en matière de migration. Le gouvernement envisage d'interdire l'octroi de visas d'entrée qui pourraient affecter des dizaines de pays africains en limitant l'accès des étudiants, des travailleurs et des touristes. Cette approche n'est pas sans rappeler la fermeture des frontières de la première présidence de Trump. Cela annonce un approfondissement de l'isolement des États-Unis par rapport à l'Afrique, traitant le continent davantage comme un risque pour la sécurité et une source non souhaitée d'immigrants que comme un partenaire diplomatique ou économique.
Trump et l'Afrique du Sud
L'hostilité manifestée par l'administration américaine à l'égard de l'Afrique du Sud a été particulièrement choquante. Trump a expulsé l'ambassadeur sud-africain et imposé des sanctions en réponse à la politique d'expropriation des terres et aux positions de politique étrangère de Pretoria, notamment sa volonté de tenir Israël responsable du génocide qu'il commet à Gaza. Le gouvernement américain maintient que cela implique de la sympathie pour le Hamas et l'Iran.
Ces mesures punitives reflètent le malaise général du trumpisme à l'égard des gouvernements qui remettent en question l'hégémonie américaine, en particulier ceux du groupe des BRICS. En qualifiant les positions politiques de l'Afrique du Sud d'« anti-américaines », Trump a effectivement rompu l'une des relations diplomatiques les plus importantes entre les États-Unis et une puissance africaine. Cela s'inscrit également dans la volonté générale de sa présidence de privilégier les États autoritaires de droite et d'isoler les gouvernements qu'il considère comme de gauche ou indépendants.
Les États-Unis, la Chine et les ressources africaines
En même temps, le gouvernement de Trump cherche à établir un type de relation différent avec certains pays africains, notamment en ce qui concerne les ressources. Il négocie actuellement un traité sur les minéraux stratégiques avec la République démocratique du Congo (RDC). Il propose une assistance militaire en échange d'un accès exclusif à des minéraux critiques, indispensables aux industries de pointe des États-Unis, en particulier le secteur technologique et l'industrie militaire. L'accord garantirait aux entreprises américaines un contrôle étendu sur l'extraction du cobalt et d'autres minéraux essentiels. Cela reflète un changement dans la stratégie des États-Unis, qui remplacent l'aide au développement par une extraction économique directe.
Le gouvernement américain affirme que cette collaboration contribuera à stabiliser la RDC en lui apportant une aide en matière de sécurité. Les critiques, quant à elles, estiment que cette démarche risque d'intensifier une dynamique néocoloniale en donnant la priorité à l'extraction des ressources plutôt qu'à un véritable développement économique.
La politique de la Chine à l'égard de l'Afrique est elle aussi en mutation. Pendant deux décennies, Pékin a été le principal partenaire économique du continent, finançant des infrastructures et commerçant à une échelle bien supérieure à celle de toute autre puissance étrangère. Cependant, avec le ralentissement de l'économie chinoise, sa disposition à accorder des prêts importants aux gouvernements africains s'est réduite. Des pays comme la Zambie et le Kenya, lourdement endettés envers la Chine, subissent déjà les pressions de cette nouvelle stratégie de crédit. Il semble que l'époque où la Chine offrait des facilités de financement pour de grands projets d'infrastructure touche à sa fin.
Cela place les pays africains dans une position précaire. De nombreux gouvernements, qui ont structuré leur économie autour d'investissements chinois continus, peinent désormais à s'adapter à cette nouvelle réalité. Ce changement réduit les options de financement extérieur pour l'Afrique, d'autant plus que les institutions financières occidentales imposent elles aussi des conditions de plus en plus strictes pour l'octroi de prêts, en particulier aux pays fortement endettés.
Une nouvelle politique est-elle possible ?
Pour les gouvernements africains, ces changements soulèvent des questions difficiles en matière de stratégie politique et économique. Le déclin des mouvements de libération nationale n'a pas encore conduit à l'émergence d'alternatives progressistes viables. Les partis d'opposition à travers la région défendent pour la plupart des modèles de gouvernance néolibéraux au lieu d'articuler de nouvelles approches de transformation économique. Plutôt qu'un tournant clair vers un renouveau démocratique, une grande partie du continent semble tiraillée entre la montée de la répression étatique et la fragmentation des oppositions. Beaucoup de partis d'opposition, bien qu'ils critiquent les gouvernements en place, n'ont pas été en mesure de proposer des programmes économiques rompant avec le paradigme néolibéral dominant. Cela signifie que, même dans les pays où les partis au pouvoir subissent un déclin électoral, il y a peu d'éléments laissant croire que leur remplacement transformerait réellement le paysage politique ou économique.
Bien que des mouvements impliqués dans des luttes syndicales ou communautaires continuent de revendiquer un changement, leur capacité à remettre en cause les structures de pouvoir établies demeure incertaine. La faiblesse actuelle des alternatives de gauche en Afrique reflète une tendance mondiale plus large, où les forces socialistes et social-démocrates peinent à se réaffirmer dans un monde dominé par le capital financier et le pouvoir des entreprises.
Cependant, il y a des signes que cela pourrait changer. D'un bout à l'autre du continent, les appels à la souveraineté économique se multiplient, à des programmes de renforcement de la protection sociale et aux résistances financières extérieures. Si ces luttes donnent naissance à des formations politiques cohérentes, elles pourraient jeter les bases d'un nouveau type de politique, une politique qui rompt avec les échecs des partis issus de la libération et les limites des forces d'opposition libérales.
L'ordre politique postcolonial en Afrique est en train de s'effondrer, mais on est loin d'être clair sur ce qui va suivre. L'érosion de la légitimité des partis au pouvoir ne s'est pas encore traduite par une transformation significative du système. Dans de nombreux cas, elle n'a fait qu'ouvrir la porte à de nouvelles formes de manœuvre des élites. En cette période de transition, la véritable bataille ne se limite pas au seul terrain électoral, mais concerne la nature même de l'État, la gouvernance économique et la place de l'Afrique dans un ordre mondial en mutation rapide. Jusqu'à ce que des alternatives émergent pour faire face aux dépendances du continent vis-à-vis de la finance mondiale, de l'extraction des ressources et de la croissance basée sur la dette, l'Afrique continuera d'être soumise à des cycles d'instabilité, avec ou sans les anciens mouvements de libération aux commandes.
02/04/2025
Will Shoki
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Québec solidaire doit s’opposer au projet de loi 97 visant principalement à moderniser le régime forestier et doit demander une large consultation publique sur la préservation et la gestion des forêts du Québec

Proposition d'urgence du CAP Écologiste présentée au Conseil national des 7-8 juin 2025. Cette proposition d'urgence a été adoptée par le Conseil national de Québec solidaire tenu les 7 et 8 juin dernier.
1. CONSIDÉRANT que l'urgence climatique et la nécessité de protéger et de restaurer la biodiversité ne sont plus à démontrer.
2. CONSIDÉRANT que le Québec adhère au Cadre mondial de la biodiversité de Kunming adopté à Montréal en 2022 par la 15e Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique.
3. CONSIDÉRANT que le projet de loi 97 néglige plusieurs mesures de protection de la biodiversité de l'accord Kunming, notamment, la protection des territoires, leur usage durable dans le respect des droits des communautés autochtones et locales ainsi que la protection de la biodiversité dans l'ensemble des politiques publiques.
4. CONSIDÉRANT que de nombreux acteurs s'opposent à l'adoption du projet de loi 97 [1] , notamment les peuples autochtones qui n'ont pas été parties prenantes de la consultation visant à réformer le régime forestier du Québec ainsi que la Fédération québécoise des municipalités (FQM) qui craignent de voir les ressources forestières de leurs territoires ne soient exploitées par l'industrie forestière à un rythme non viable et qui ne permet pas de préserver les emplois de ce secteur à plus long terme.
5. CONSIDÉRANT que les forêts jouent un rôle essentiel dans un contexte de crise climatique, puisqu'elles captent et séquestrent le carbone.
6. CONSIDÉRANT que les forêts sont déjà affectées par le réchauffement climatique et que Québec solidaire doit prévoir des mesures pour accompagner leur adaptation et favoriser leur résilience.
7. CONSIDÉRANT, d'après ce qui précède, qu'il y urgence d'agir, le Comité d'action politique écologiste propose :
1. Que Québec solidaire s'oppose à l'adoption du projet de loi 97 dans sa forme actuelle ;
2. Que Québec solidaire exige qu'une nouvelle mouture du projet de loi 97 protégeant adéquatement les milieu naturels soit déposée à l'automne ;
3. Que Québec solidaire exige la tenue d'une vaste consultation publique portant sur la modernisation du régime forestier ainsi que sur la préservation des forêts du Québec. Dans le cadre de ce processus démocratique, les divers acteurs seront invités à prendre part aux décisions, notamment les peuples autochtones, les municipalités et leurs regroupements, les syndicats, la société civile, l'industrie du tourisme et l'industrie forestière. Cette consultation devra prendre en compte les études les plus récentes qui concernent l'état de nos forêts au Québec et les meilleures pratiques pour les préserver.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« Les massacres en Palestine sont similaires à ceux de la colonisation en Afrique »

Entretien · Malgré une solidarité ancienne avec la cause palestinienne forgée dans les luttes anticoloniales, les États africains peinent à faire face à l'influence israélienne. L'ambassadeur de Palestine en Côte d'Ivoire, Abdal Karim Ewaida, décrypte ces relations, et il se félicite de ce qu'il analyse comme le réveil de l'engagement africain en faveur de son pays.
Tiré d'Afrique XXI.
Alors que Gaza subit depuis plus de dix-huit mois une guerre génocidaire, un basculement discret s'opère en Afrique : celui d'un réveil diplomatique sur la cause palestinienne. En janvier 2024, la Cour internationale de justice (CIJ) a reconnu la plausibilité d'un génocide à Gaza, à la suite de la plainte déposée par l'Afrique du Sud. Cet engagement est historique, même s'il n'a pas permis de mettre fin à la violence israélienne. Dans la foulée, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a adopté une résolution (1) condamnant l'« apartheid » israélien qui responsabilise les États africains.
Mais la solidarité avec la Palestine reste fragmentée. Elle est portée par certains pays comme l'Afrique du Sud, l'Algérie, la Namibie, le Sénégal. Le Cameroun ou l'Érythrée refusent encore de reconnaître l'État de Palestine. Le Rwanda, pourtant marqué par le génocide des Tutsis en 1994, demeure un allié de Tel-Aviv. Le Maroc, malgré des manifestations imposantes contre la normalisation de ses relations avec Israël, poursuit sa coopération sécuritaire et technologique.
Comment expliquer ces dissonances ? Quel rôle jouent les calculs diplomatiques, les partenariats sécuritaires ou encore l'influence grandissante des Églises évangéliques pro-israéliennes ? Que peut faire le continent pour la Palestine ? Ancien ministre des Affaires étrangères, ex-ambassadeur au Niger et au Burkina Faso, l'ambassadeur de Palestine en Côte d'Ivoire, Abdal Karim Ewaida, répond à ces questions dans un entretien accordé à Afrique XXI où il décrypte les batailles politiques au sein de l'Union africaine (UA) et appelle le continent africain à transformer sa mémoire historique en force diplomatique.
« Israël a une diplomatie patiente, méthodique et opaque »
Raouf Farrah : En 2020, Israël a tenté d'obtenir le statut d'observateur auprès de l'UA. Cela a déclenché une intense bataille diplomatique qui a conduit à son exclusion, en 2023. Ce n'était pas une première : Israël courtise l'UA depuis deux décennies. Que révèle, selon vous, cette séquence ?
Abdal Karim Ewaida : Cette tentative n'était pas anodine. Israël cherchait à redéfinir les équilibres diplomatiques du continent à son avantage, en misant sur les divisions internes à l'UA. Depuis 2002, il multiplie les démarches pour obtenir un statut officiel qui lui permettrait d'influencer de l'intérieur les décisions collectives africaines. Cette offensive a mis au jour une ligne de fracture entre les États qui privilégient des partenariats stratégiques immédiats – sécuritaires, agricoles, technologiques – et ceux qui restent fidèles aux principes fondateurs de l'UA : l'autodétermination, les droits humains et la solidarité avec les peuples opprimés.
Accorder ce statut à Israël aurait représenté une rupture symbolique majeure : cela aurait affaibli l'engagement collectif de l'Afrique en faveur de la Palestine et miné sa crédibilité sur la scène internationale. Fort heureusement, des pays comme l'Afrique du Sud, l'Algérie et la Namibie se sont mobilisés pour faire barrage.
Mais ce refus n'a pas mis fin à la stratégie israélienne. Elle se poursuit sous d'autres formes, plus discrètes : des relations bilatérales renforcées, notamment avec des pays influents comme l'Éthiopie – siège de l'UA – ou le Kenya. C'est une diplomatie patiente, méthodique et parfois opaque. Si elle n'est pas contrebalancée par une présence palestinienne plus active, elle risque d'éroder progressivement le soutien panafricain à notre cause.

Raouf Farrah : Diriez-vous qu'Israël instrumentalise les vulnérabilités africaines pour asseoir son influence et affaiblir le soutien africain à la Palestine ?
Abdal Karim Ewaida : L'expansion de la présence israélienne en Afrique s'inscrit dans une stratégie assumée : renforcer son influence diplomatique, construire des alliances stratégiques et redéfinir les équilibres régionaux à son avantage. Israël investit dans des secteurs clés – sécurité, agriculture, innovation –, et cela répond aux besoins immédiats de nombreux États africains, confrontés au terrorisme, à l'insécurité alimentaire ou aux défis climatiques. Plusieurs gouvernements perçoivent cette coopération comme un levier de modernisation.
En 2017, Benjamin Netanyahou est devenu le premier chef d'État non africain à s'adresser à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao). Depuis, les interactions entre dirigeants africains et responsables israéliens se sont intensifiées. Mais derrière cette coopération technique se cache une stratégie politique. En renforçant ses partenariats économiques et militaires, Israël cherche aussi à affaiblir le soutien africain à la Palestine dans les forums internationaux, notamment aux Nations unies. Des logiques de dépendance se créent, rendant certaines capitales frileuses à toute critique par crainte de perdre un appui ou un investissement.
« Des combattants de l'OLP ont été formés en Afrique »
Raouf Farrah : Il existe aussi des dynamiques idéologiques et religieuses derrière le soutien à Israël sur le continent. Comment la montée en puissance du sionisme chrétien (2) influence-t-elle la cause palestinienne en Afrique ?
Abdal Karim Ewaida : Le sionisme chrétien en Afrique puise ses racines dans l'héritage des missions chrétiennes occidentales, qui ont façonné de nombreuses communautés évangéliques à travers le continent. Aujourd'hui, bon nombre de ces Églises, influencées par des réseaux états-uniens, perçoivent le soutien à Israël comme un devoir religieux associé à l'accomplissement de prophéties bibliques. Cette vision contribue à une forte domination des récits pro-israéliens qui relèguent souvent la souffrance palestinienne à l'arrière-plan, voire la nient totalement.
Dans certains contextes, cette influence alimente même une rhétorique ouvertement hostile aux Palestiniens. Mais il est important de souligner que le sionisme chrétien ne représente pas l'ensemble des voix religieuses africaines. De nombreuses organisations, de nombreux intellectuels et chefs spirituels – notamment en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Sud – continuent de manifester un soutien actif à la cause palestinienne. Cela dit, faire face à l'impact grandissant du sionisme chrétien nécessite bien plus que des déclarations de principes. La sensibilisation est cruciale : intégrer des discours sur les droits humains, l'histoire coloniale et la réalité du terrain dans les cercles de foi peut aider à déconstruire des récits biaisés et à favoriser une compréhension plus équilibrée et plus empathique du combat palestinien.
Raouf Farrah : La quasi-totalité des pays africains, à l'exception du Cameroun et de l'Érythrée, reconnaissent officiellement l'État de Palestine. Cette reconnaissance politique s'est-elle traduite par un véritable appui ?
Abdal Karim Ewaida : Pour beaucoup de pays africains, la cause palestinienne n'est pas perçue comme une affaire étrangère mais comme le prolongement naturel de leurs propres luttes pour la liberté, l'émancipation et la dignité. Il faut rappeler que l'État de Palestine a été proclamé en 1988 à Alger, sur le sol africain : un symbole fort. Et bien avant cela, dès 1974, l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) obtenait le statut d'observateur auprès de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), l'ancêtre de l'UA. Ce sont des gestes politiques lourds de sens, qui ont confirmé un ancrage profond et commun aux deux histoires. Mais ce lien ne s'est pas joué uniquement dans les discours. Il a pris une forme très concrète sur le terrain. Des combattants de l'OLP ont été formés dans plusieurs pays d'Afrique, notamment en Algérie, en Angola, au Mozambique ou encore en Tanzanie. Il existait une solidarité militaire et révolutionnaire entre mouvements de libération.
Les liens entre l'OLP et l'African National Congress (ANC) en Afrique du Sud en sont un exemple emblématique : ils partageaient des réseaux, des soutiens et des stratégies de résistance. Pendant longtemps, la base arrière de l'OLP à Tunis était également un point de coordination politique et diplomatique majeur, qui accueillait régulièrement des délégations africaines et internationales.
Cette solidarité s'est également manifestée sur la scène internationale. Dans les années 1970 et 1980, l'Afrique a joué un rôle clé dans les grandes tribunes multilatérales – que ce soit aux Nations unies, à l'intérieur du Mouvement des non-alignés ou au sein de la défunte OUA – pour défendre les droits des Palestiniens à la souveraineté et à l'autodétermination. C'est une alliance historique, forgée dans les luttes communes contre le colonialisme, l'apartheid et l'oppression systémique.
Des pays comme l'Afrique du Sud, la Namibie, le Nigeria ou l'Algérie maintiennent un engagement ferme aux côtés de la Palestine aujourd'hui. Mais pour préserver cette solidarité, la Palestine doit intensifier sa présence sur le continent : diplomatique, mais aussi culturelle, économique et populaire. Le soutien des sociétés civiles africaines est essentiel pour contrebalancer l'influence israélienne et raviver un lien qui, historiquement, reposait sur des luttes communes de libération.
La reconnaissance diplomatique a été bien plus qu'un simple symbole. Elle s'est appuyée sur des liens historiques, politiques et humains profonds. La vraie question aujourd'hui est de savoir comment raviver cette solidarité dans un monde qui a profondément changé.
« Un engagement sur les droits humains plus concret »
Raouf Farrah : Un autre signal fort est venu de l'UA. Après plus de deux décennies de relatif silence, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a adopté en 2024 une résolution qui condamne l'« apartheid » israélien. Cette prise de position marque-t-elle une nouvelle étape ?
Abdal Karim Ewaida : Oui. L'adoption de la résolution 611 marque un tournant dans l'engagement de l'institution africaine envers la cause palestinienne, après une période de relative inaction, ponctuée seulement par des communiqués de solidarité.
Cette résolution relance l'implication africaine dans les débats sur les droits humains en Palestine, mais l'Afrique ne peut s'en contenter ; ce texte doit être le point de départ d'un engagement plus concret et mieux structuré. Par exemple, la mise en place d'un mécanisme permanent de suivi sur la situation en Palestine permettrait de documenter de manière systématique les violations, dont les expulsions forcées, les agressions militaires, les détentions arbitraires, les restrictions des libertés… Ces données seraient précieuses pour les actions diplomatiques et juridiques à venir.
La publication de rapports, intégrant témoignages et analyses juridiques, renforcerait la pression sur les États africains pour qu'ils adoptent des positions claires sur la Palestine et leurs liens avec Israël. La Commission peut également inciter les gouvernements africains à transformer les résolutions en actions dans le domaine de l'aide humanitaire ou de la coopération économique avec la Palestine.
En parallèle, une meilleure collaboration entre ONG africaines et palestiniennes impliquées dans les droits humains permettrait de consolider ces engagements. D'ailleurs, ces voix ont joué un rôle clé dans l'adoption de la résolution 611. Par conséquent, cette résolution est une avancée, mais elle doit déboucher sur un plaidoyer actif, des politiques concrètes et une mobilisation soutenue.
Raouf Farrah : L'action engagée par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice contre Israël n'a pas permis d'arrêter la guerre génocidaire menée à Gaza et en Cisjordanie. Au-delà de l'action judiciaire, quelle est sa portée pour les Palestiniens ?
Abdal Karim Ewaida : Cette action marque un tournant juridique et politique majeur dans l'histoire du Sud global, puisque c'est un pays africain qui réaffirme la validité de la Convention pour la prévention du génocide (1948) et mobilise le droit international comme outil contre l'impunité israélienne. Le 26 janvier 2024, suite à l'action de l'Afrique du Sud, la CIJ a rendu une ordonnance reconnaissant la plausibilité des accusations de génocide et a ordonné à Israël de prendre des mesures immédiates pour empêcher tout acte génocidaire et faciliter l'accès à l'aide humanitaire pour les Palestiniens de Gaza. Aucune de ces mesures n'a été appliquée.
En saisissant la CIJ, l'Afrique du Sud affirme au monde que les violences systématiques et à grande échelle infligées aux Palestiniens de Gaza ne peuvent rester impunies. D'autres pays, notamment africains, ainsi que l'UA, ont depuis rejoint cette initiative, renforçant la légitimité de la démarche et attestant d'un consensus international croissant sur la nécessité de rendre justice.
Au-delà de sa dimension juridique, cette procédure pèse considérablement politiquement. En contraignant la communauté internationale à examiner juridiquement les actions d'Israël, l'Afrique du Sud et ses alliés contribuent à élargir la prise de conscience mondiale face à la crise en cours à Gaza. Cette initiative pourrait accentuer la pression sur Israël et nourrir des débats plus larges sur les droits humains et l'application du droit international humanitaire. Le ralliement d'autres pays à cette action juridique témoigne d'une solidarité diplomatique qui dépasse les discours et se traduit par des actes concrets, comme la création du Groupe de La Haye (3), un groupe d'États du Sud global soutenant la plainte sud-africaine.
Si la CIJ donnait raison à l'Afrique du Sud, cela établirait un précédent majeur, réutilisable dans d'autres affaires de violations graves des droits humains et de crimes internationaux. Un tel jugement ne concernerait pas uniquement Israël, mais enverrait aussi un signal fort à tous les États qui s'adonnent à des pratiques d'oppression systématique.
« Des atrocités au nom de la mission civilisatrice »
Raouf Farrah : Vous avez évoqué l'importance de mobiliser la mémoire collective et les expériences historiques communes entre l'Afrique et la Palestine. En quoi ce que vivent les Palestiniens fait-il écho aux crimes coloniaux subis par les Africains ?
Abdal Karim Ewaida : Les massacres commis par les anciennes puissances coloniales en Afrique présentent de fortes similitudes avec la situation actuelle en Palestine. À travers le continent, des atrocités ont été commises en Namibie, en Algérie, au Congo et au Cameroun – pour ne citer que ces cas – au nom de la mission civilisatrice, justifiées par une idéologie raciste de déshumanisation des peuples colonisés.
Cette logique raciste visant à effacer l'identité de l'autochtone se retrouve dans les discours qui légitiment l'occupation israélienne, niant aux Palestiniens leur humanité et leurs aspirations. Les pratiques coloniales – déplacements forcés, massacres, destruction des moyens de subsistance – trouvent aujourd'hui un écho dans les territoires palestiniens, notamment à Gaza et en Cisjordanie.
Un autre parallèle frappant est l'inaction internationale. Comme dans les génocides africains (4), la communauté internationale est bloquée par les intérêts géopolitiques de pays entretenant un climat d'impunité totale.
Raouf Farrah : Malgré ces parallèles historiques, certains pays africains restent silencieux sur le génocide en Palestine. On pense notamment au Rwanda ou au Cameroun, le premier marqué par un génocide et l'autre par une guerre de libération sanglante. Comment expliquer ces prises de distance ?
Abdal Karim Ewaida : C'est une question complexe. La réticence de certains pays africains à soutenir la Palestine ne vient pas nécessairement d'un désaccord de fond, mais plutôt de priorités politiques internes : stabilité, développement économique, sécurité nationale.
Dans certains cas, c'est aussi une question de diplomatie stratégique. Ces États évitent de prendre des positions internationales jugées sensibles, notamment pour ne pas compromettre leurs relations avec Israël ou avec des partenaires occidentaux influents. Il faut aussi comprendre que certaines personnes au pouvoir adoptent une posture de prudence qu'elles justifient au nom du « pragmatisme ». On préfère parfois le silence à une prise de position pouvant être perçue comme risquée.
Cela dit, cette prudence institutionnelle contraste fortement avec une opinion publique africaine souvent beaucoup plus favorable à la cause palestinienne, une opinion marquée par des récits de colonisation, de résistance et par une forte identification à la souffrance du peuple palestinien. Ce décalage entre les gouvernements et les populations met en lumière les tensions qui traversent aujourd'hui la politique étrangère de plusieurs pays africains : d'un côté, les intérêts d'État et les équilibres géopolitiques, de l'autre, une attente morale et historique de cohérence. Et c'est dans cet espace-là que se joue aussi la crédibilité du continent sur la scène internationale.
« Il faut enrichir la solidarité entre la Palestine et l'Afrique »
Raouf Farrah : Le champ médiatique africain, à l'instar du champ religieux, est aujourd'hui traversé par des récits concurrents sur la Palestine. D'après vous, les médias africains permettent-ils encore à la voix palestinienne de se faire entendre ?
Abdal Karim Ewaida : Honnêtement, la couverture est très inégale. Dans certains pays, la question palestinienne revient régulièrement dans les journaux ou les débats télévisés. Mais dans d'autres, elle est absente. Ce décalage s'explique par plusieurs facteurs : d'abord, le poids des alliances politiques et les pressions gouvernementales. Là où les gouvernements entretiennent des liens étroits avec Israël ou ses alliés occidentaux, les médias tendent à s'autocensurer. Le simple fait d'aborder la question palestinienne peut devenir politiquement sensible, voire risqué.
Beaucoup de pays africains traversent des crises majeures – conflits internes, instabilité économique, tensions sociales. Dans ce contexte, les rédactions privilégient naturellement les urgences locales. Ce n'est pas toujours un choix politique. Parfois, il s'agit juste de couvrir ce qui capte l'attention du public.
Mais il y a aussi un autre angle qu'on oublie souvent : la propriété des médias et les influences idéologiques. Certains évitent de prendre position pour ne pas heurter des groupes politiques ou religieux influents. D'autres, souvent financés de l'étranger, adoptent des récits pro-israéliens, parfois de manière implicite.
Les médias ont un rôle essentiel à jouer. Il ne suffit pas de relayer les nouvelles de Gaza ou de Cisjordanie lors des flambées de violence. Il faut aller plus loin : produire du journalisme d'enquête, diffuser des témoignages directs, analyser les racines du conflit et les relier aux expériences africaines de colonialisme, de résistance, de lutte pour la dignité. Il ne s'agit pas seulement de contrer l'influence d'Israël ; il s'agit d'enrichir une solidarité politique, culturelle et humaine qui a toujours existé entre la Palestine et l'Afrique.
Notes
1- CADHP, Résolution sur la situation en Palestine et dans les territoires occupés, 2024, disponible ici.
2- la nouvelle administration Trump », The Conversation, 18 janvier 2025, à lire ici.
3- Le Groupe de la Haye, Déclaration conjointe du 31 janvier 2025, voir ici.
4- Aujourd'hui, deux génocides africains ont été reconnus : celui des Hereros et des Namas en Namibie, à partir de 1904, et celui des Tutsis au Rwanda, en 1994.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Que reste-t-il du projet progressiste du gouvernement Lula ?

Tant que le nouveau cadre budgétaire et la recherche d'un déficit zéro persisteront, le gouvernement s'enfoncera dans les contradictions et continuera à perdre en popularité
28 mai 2025 | tiré d'Europe solidaire sans frontières
https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article75216
Récemment, l'ancien président de la Banque centrale, Armínio Fraga, a réaffirmé la nécessité pour le gouvernement brésilien de geler le salaire minimum pendant six ans, afin qu'il n'y ait pas de réelles 'augmentations, mais seulement d'ajuster le montant en fonction de l'inflation de l'année précédente. Fraga a souligné que les dépenses liées à la masse salariale et à la sécurité sociale atteignent 80 % du budget, raison pour laquelle un ajustement drastique de cet ordre serait une nécessité absolue. L'ancien président a également affirmé que le pays avait besoin d'une réforme plus profonde de la sécurité sociale, sur le modèle de l'ajustement mis en œuvre par le président argentin, Javier Milei. Il est intéressant de noter qu'Armínio n'a pas mentionné le fait que la pauvreté en Argentine touche 57,4 % de la population, le niveau le plus élevé en 20 ans, et que l'indigence touche 15 % de la population argentine.
Au Brésil, le salaire minimum a une grande influence sur l'économie et la vie des travailleurs. Outre qu'il définit le salaire minimum légal pour les salariés, il sert de référence pour la rémunération des travailleurs indépendants et fixe le montant minimum des prestations de sécurité sociale, telles que les retraites, les allocations et les allocations de chômage. Son actualisation a donc un impact direct sur le pouvoir d'achat de la population, ce qui stimule la consommation et réduit les inégalités. Pour illustrer cela, sans les augmentations obtenues entre 2004 et 2019, le salaire minimum en 2019 serait de seulement 573,00 R$ au lieu de 998,00 R$, c'est-à-dire que les augmentations cumulées au cours de cette période ont représenté une hausse de 425,00 R$ au-dessus de l'inflation. Cette progression a non seulement augmenté la rémunération des travailleurs formels mais a également eu une incidence sur les salaires minimums de plusieurs catégories, tant dans les négociations entre les syndicats et les entreprises que dans des textes législatifs spécifiques, comme pour les salaires minimums dans l'éducation et la santé. Elle a en outre favorisé l'adoption de salaires minimums dans des régions telles que le Sud, São Paulo et Rio de Janeiro. Il en a résulté une concentration des travailleurs dans la tranche comprise entre un et deux salaires minimums, ce qui a réduit les inégalités dans la répartition des revenus du travail et augmenté la part des salaires dans l'économie.
Malgré ces progrès, le salaire minimum est encore loin de respecter les dispositions de la Constitution qui prévoit un montant susceptible de couvrir les besoins fondamentaux du travailleur et de sa famille, notamment le logement, l'alimentation, la santé et l'éducation. Ce défi devient encore plus urgent compte tenu des récentes modifications de la législation du travail, telles que les lois 13.429/2017 et 13.467/2017, qui ont affaibli les droits et accru les contrats précaires par exemple pour le travail en interim et la levée des restrictions à l'externalisation. Dans ce contexte, la revalorisation du salaire minimum apparaît comme un outil essentiel pour garantir un revenu décent, en particulier aux travailleurs les plus vulnérables.
Selon l'IBGE, en 2024, le revenu moyen des 40 % les plus pauvres atteignait 601 reais et les 1 % de la population brésilienne ayant les revenus les plus élevés percevaient l'équivalent de 36,2 fois le revenu des 40 % les plus pauvres. En outre, les données du rapport d'Oxfam montrent que 63 % de la richesse du Brésil est entre les mains de 1 % de la population. L'enquête souligne également que les 50 % les plus pauvres ne détiennent que 2 % du patrimoine du pays. L'étude fournit également des détails sur le groupe qui accumule le plus de richesse.
Selon ce document, 0,01 % de la population brésilienne possède 27 % des actifs financiers.
Mais sur cette question, le fondateur et associé de Gávea Investimentos, Armínio Fraga, n'a rien dit, et il a encore moins dit que lorsque la Banque centrale augmente les taux d'intérêt de 0,5 %, cela entraîne une augmentation de 2,9 milliards de reais par an des dépenses publiques, selon les estimations du Trésor national. Cette augmentation profite directement aux 0,01 % les plus riches de la population brésilienne. Il n'a pas non plus commenté les résultats de la perception de l'impôt foncier rural (ITR) entre 2019 et 2024, qui, malgré l'augmentation des recettes, atteignant 3 milliards de réaux, correspond au montant perçu uniquement grâce à l'impôt foncier (IPTU) du quartier de Pinheiros, dans la ville de São Paulo. Plus inquiétant encore, cependant, est le fait que, depuis 2008, le gouvernement a modifié les règles fiscales, transférant aux municipalités la responsabilité de l'enregistrement cadastral et du contrôle des propriétés rurales, ainsi que les recettes collectées, alors qu'à l'origine, conformément à la loi foncière, l'ITR était destiné à financer la réforme agraire. En conséquence, les grandes propriétés rurales contribuent à hauteur de montants dérisoires, recourant souvent à la fraude fiscale, tandis que les ressources collectées ne remplissent pas leur fonction sociale.
Manifester une préoccupation pour l'économie et la société brésiliennes et prescrire des remèdes qui ne font qu'accentuer les inégalités, qu'elles soient de revenus, de genre, de race ou d'éducation, est devenu une pratique courante parmi les grands noms de la politique brésilienne, comme c'est le cas d'Armínio Fraga, et même du gouvernement fédéral lui-même ; c'est le cas des coupes effectuées dans le Benefício de Prestação Continuada (BPC) et le Bolsa Família, des programmes de redistribution des revenus essentiels pour la population brésilienne.
Je ne peux pas non plus passer ici sous silence la récente restriction des dépenses dont la promulgation a fait l'objet du décret n° 12.448 qui établit le programme budgétaire de l'exécutif pour l'exercice 2025. Pour les universités fédérales, ce décret représente une réduction considérable de leurs ressources, qui ne sont déjà pas très importantes. La recherche incessante par le gouvernement de moyens pour réduire le déficit et satisfaire le marché produit ces prétendus remèdes au goût insupportable et nuisibles aux services publics comme à leurs utilisateurs.
Cette même semaine, le gouvernement a également signé le décret n° 12.456/2025, qui réglemente la nouvelle politique d'enseignement à distance (EaD), une mesure importante et nécessaire compte tenu du grand dispositif trompeur mis en place par les conglomérats éducatifs pour capter l'argent des enfants de la classe ouvrière qui souhaitent étudier, que sont devenus les cours EaD. Ce modèle d'enseignement (et d'affaires) a été présenté haut et fort par ses défenseurs comme un moyen de « démocratiser » l'éducation, ce qui est sans nul doute une affirmation fausse, puisque l'enseignement d'excellence, que ce soit dans l'éducation de base ou dans l'enseignement supérieur, trouve sa forme la plus efficace dans l'enseignement présentiel. Les institutions académiques les plus renommées, tant au niveau national qu'international, adoptent et valorisent ce modèle d'apprentissage.
Maintenant, réfléchissons à ceci : si, tout en limitant les cours à distance (ce qui est juste), le gouvernement fédéral réduit les dépenses des universités fédérales, qui voient leurs ressources diminuer d'année en année et leur capacité à offrir des bourses et des aides réduites en permanence, comment la population la plus pauvre va-t-elle pouvoir étudier ? N'est-il pas évident que cela a également un effet sur la façon dont les gens perçoivent les possibilités d'accès à l'éducation et la difficulté de faire des études ? Jusqu'à quand le président Lula va-t-il suivre les recettes d'Armínio Fraga et de ses acolytes, au détriment de la population qui l'a élu ? Le peuple veut pouvoir étudier, avoir un salaire décent, avoir accès à des soins et à une éducation de qualité, ce qui ne peut se concrétiser tant que le nouveau cadre budgétaire et la recherche du déficit zéro restent les objectifs du gouvernement. Et avec cela, la popularité de Lula ne fait que diminuer. Finalement, parmi toutes ses promesses de campagne, laquelle en fait tient-il réellement et intégralement ?
Bianca Valoski est doctorante au programme de troisième cycle en politiques publiques de l'Université fédérale du Paraná dans le domaine de la recherche en économie politique de l'État national et de la gouvernance mondiale. Elle est fonctionnaire à la mairie de São José dos Pinhais, où elle travaille dans les finances publiques.
P.-S.
Traduit pour ESSF par Pierre Vandevoorde avec l'aide de DeepLpro
https://movimentorevista.com.br/2025/05/o-que-restou-da-agenda-progressista-do-governo-lula/
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Panama est l’épicentre de la lutte en Amérique latine – Journée internationale de solidarité avec le peuple panaméen le 9 juin

Un petit pays de 4,2 millions d'habitant·es montre à l'Amérique latine et au monde qu'il est possible d'affronter les intérêts du capital financier et des fonds vautours dans la troisième décennie du 21e siècle.
3 juin 2025 | tiré d'Inprecor.org
https://inprecor.fr/node/4783
Il y a quelques jours, le sang d'un jeune indigène de douze ans, grièvement blessé par la répression gouvernementale, a montré que le conflit entrait dans une nouvelle phase. Peu avant, Saúl Méndez, le principal dirigeant du puissant syndicat de la construction, a dû demander l'asile à l'ambassade de Bolivie pour éviter d'être présenté comme un trophée et mis en prison, ce qui est déjà arrivé à deux autres de ses dirigeants, Genaro López et Jaime Caballero, qui ont été envoyés dans la pire prison pour criminels de droit commun de ce pays, un syndicat dont les cotisations avaient déjà été confisquées par le gouvernement précédent, une mesure que le nouveau président a continué à maintenir, malgré les récentes perquisitions au siège de son syndicat et la fermeture de sa coopérative. Des milliers d'enseignants en grève se sont vu retirer leur fiche de paie et beaucoup d'autres ont été illégalement placés en congé permanent sans solde.
Cela se produit au milieu d'un impressionnant siège médiatique mondial correspondant à celui du pays, qui crée un rideau d'information empêchant le mouvement social et la population du monde de savoir ce qui se passe dans le petit pays d'Amérique centrale.
L'origine
En 2023, après une période de montée des luttes du mouvement enseignant et des travailleurs dans leur ensemble au Panama, la rébellion écologique populaire la plus importante du monde à ce jour au XXIe siècle a eu lieu. Après des semaines de mobilisation et de paralysie du pays, menées par les enseignants, les ouvriers du bâtiment, les travailleurs de la banane, les communautés indigènes, les jeunes, les femmes, les écologistes, les communautés et une grande partie de la classe moyenne, une décision de la Cour suprême a été obtenue, ordonnant l'arrêt des opérations de la transnationale First Quantum et la fermeture de la mine qui avait déclenché la révolte populaire. Cette décision judiciaire a annulé l'accord fallacieux conclu au parlement panaméen, qui visait à prolonger la destruction de l'environnement.
Cette contre-marche des autorités publiques a été provoquée par la crainte de la bourgeoisie panaméenne face à la rébellion populaire écologique qui avait conduit à la fermeture des voies de transport les plus importantes du pays, affectant les profits des secteurs du capital. Il s'agit d'une victoire écologique sans précédent.
La réaction de la bourgeoisie panaméenne et du capital financier a été d'adopter en 2024 la candidature présidentielle de José Raúl Mulino, ancien ministre de l'Intérieur du gouvernement corrompu de Martinelli et choyé par M. Motta, le magnat de l'industrie aérienne panaméenne, des médias et d'autres opérations commerciales. Son programme, construire une nouvelle situation politique qui permettrait un retour à la domination de la rébellion pré-écologique, d'étendre les profits du capital financier dans ce pays et de réaliser l'agenda néocolonial d'une nouvelle administration Trump imminente à la Maison Blanche.
La nouveauté de l'élection du président Mulino fut l'arrivée au parlement d'un groupe important de députés indépendants, qui avaient profité de la vague de révolte populaire pour se faire une place. Ce renouvellement parlementaire, qui montrait l'intention de l'électorat de produire une nouvelle situation politique, a été rapidement trahi par la moitié de cette nouvelle faction parlementaire qui s'est rapidement mise d'accord avec le gouvernement réactionnaire de Mulino qui, élu avec seulement 34% des voix, n'avait pas de majorité parlementaire.
Cette nouvelle corrélation des forces lui permet d'aller de l'avant avec l'approbation de la loi 462, qui entraîne une nouvelle régression du système de retraite et de pension de la classe ouvrière panaméenne, qui passe d'une retraite représentant environ 60 % de son salaire à 30 % ou moins. Elle permet également aux familles riches du Panama de gérer les fonds de pension et de se lancer dans la spéculation sur les marchés financiers. En outre, le président Mulino annonce son intention de rouvrir l'exploitation minière et d'autoriser à nouveau First Quantum, en contournant la décision de la Cour suprême de justice. L'indignation s'est répandue dans tout le Panama.
Pour aggraver les choses, l'arrivée de Trump pour son deuxième mandat s'accompagne d'une intention claire de revenir à la situation de contrôle du canal de Panama, ce qui rencontre l'approbation du gouvernement Mulino, qui signe un accord pour permettre la réouverture de trois bases militaires américaines, malgré le fait que le Panama, par disposition constitutionnelle, n'a pas d'armée et qu'un traité en vigueur entre les deux pays avait établi la fin d'une telle présence militaire étrangère depuis la fin de l'année 1999. Une situation de vassalité du gouvernement américain a ainsi été créée, ce qui a conduit à un nouveau cycle de protestations.
Cinq semaines de grève nationale
Les premiers à se mettre en grève le 23 avril ont été les enseignants, qui ont annoncé qu'ils ne retourneraient pas en classe tant que la loi 462 (système de pensions et de retraites) ne serait pas abrogée, que la fermeture de l'industrie minière ne serait pas garantie et que le mémorandum d'entente militaire avec les États-Unis ne serait pas annulé. À cette occasion, des milliers de parents et de familles des écoles et des collèges décident en assemblée de soutenir la grève des enseignants de leurs enfants. Les associations scolaires ayant été supprimées par Noriega dans les années 1980, des mobilisations d'élèves du secondaire sont réapparues, tandis que l'université de Panama a été l'épicentre de réunions, de déclarations, de rassemblements et d'une méga-marche, malgré la tache inexplicable de l'expulsion par les autorités d'un étudiant pour des actions de lutte et les tentatives de transformer l'université en un "espace de négociation" et non d'action décisive en faveur de l'indignation patriotique.
Les mobilisations quotidiennes des enseignants et des professeurs, ainsi que l'entrée dans le conflit des travailleurs de la banane et du puissant syndicat de la construction, ont entraîné dans la lutte des populations entières dans les provinces de l'intérieur du pays. Cela a augmenté la qualité et le nombre des manifestants, ce qui a conduit le gouvernement de M. Mulino à déclencher une répression sans précédent au cours des dernières décennies à l'encontre du mouvement social. Les centaines de blessés et d'arrestations quotidiennes n'ont pas mis fin aux protestations, au contraire, elles les ont amplifiées.
Lorsque les comarcas indigènes sont entrées dans le conflit, la répression a été impitoyable, en particulier à l'encontre des femmes et des enfants des peuples d'origine. Le fait qu'un enfant de 12 ans et un étudiant universitaire aient été gravement blessés par les balles d'un gouvernement qui a déclaré publiquement qu'il ne se souciait pas de sa popularité (-50%), alors que les sondages publiés indiquaient que l'opinion publique approuvait son mandat à moins de 10%, montre que nous sommes face à un gouvernement à la poigne de fer qui cherche à infliger au mouvement social une défaite qui lui permettra de se débarrasser de ses principales organisations afin d'avancer dans ses plans néfastes.
Cette semaine, le conflit entre dans une phase décisive, tandis que le gouvernement joue la carte de la temporisation en espérant que les manifestations s'apaiseront dans les prochains jours. Cependant, tout indique que nous passerons des mobilisations à la paralysie du pays, ce qui nécessitera une multiplication des voix de la solidarité internationale.
La bonne méthode
L'Alianza Pueblo Unido por la Vida, la coalition de mouvements sociaux à l'origine des manifestations, a constitué un large front social pour faire face à l'offensive néo-conservatrice et néo-colonialiste de M. Mulino.
Les syndicats d'enseignants, les syndicats de travailleurs, les syndicats environnementaux et les syndicats communautaires montrent que la bonne voie consiste à aller au-delà des luttes sectorielles et à construire des alliances entre les forces nationalistes, patriotiques et de la classe ouvrière pour générer une large participation de la population afin de faire avancer les luttes et de vaincre le capital financier, les politiques extractivistes et le néo-colonialisme nord-américain.
La bourgeoisie panaméenne : entre la voracité de la financiarisation et la peur de l'explosion
Social. La contradiction à laquelle la bourgeoisie panaméenne est à nouveau confrontée, comme en 2023, est de choisir entre la voracité du capital financier qui s'en prend aux fonds de pension et aux investissements miniers et la stabilité du régime bourgeois lui-même. C'est pourquoi elle a parié sur l'écrasement de la révolte, via la manu policial, mais si elle n'y parvient pas, elle devra choisir entre reculer ou perdre le contrôle.
De plus en plus, l'association de ceux qui sont au sommet, les puissants et les riches, a de moins en moins de contacts avec le peuple et se concentre sur la propagande dans les médias qu'ils possèdent. La question est de savoir combien de temps cette situation va durer.
Révocation du mandat présidentiel
Une solution intermédiaire qui commence à résonner dans les rues est la possibilité de révoquer le mandat du président et de convoquer de nouvelles élections, mais elle se heurte à l'obstacle juridique que constitue le fait que cette action révocatoire n'a jamais été réglementée. Cependant, les initiatives légales pour y parvenir continuent d'avancer et de suivre leur cours, avec une sympathie croissante de la part des citoyens.
La destitution de Mulino a une autre voie légale, à savoir que l'Assemblée des députés devrait entendre l'accusation présentée par l'Alianza Pueblo Unido pour violation de la personnalité internationale de l'État, en raison du mémorandum de vente qui permet la réouverture des bases militaires américaines. Si les niveaux de participation communautaire en 2023 sont atteints, cela pourrait configurer une nouvelle corrélation des forces qui permettrait de juger le président actuel, sur la base des normes établies dans la Constitution panaméenne.
Cela permettrait de renverser la loi 462, de rouvrir l'exploitation minière et d'annuler le mémorandum qui a permis la réouverture des bases militaires américaines. Mais cela ne peut se faire que dans le cadre du maintien et de l'élargissement des mobilisations populaires. C'est pourquoi les prochaines heures seront déterminantes pour la suite des événements.
La nécessité de la solidarité internationale
Face à cette situation dramatique, une solidarité internationale large et plurielle des forces démocratiques et progressistes, du mouvement social et éducatif au niveau international est nécessaire. Nous ne pouvons pas laisser le peuple panaméen seul en cette heure.
C'est pourquoi le mouvement social a lancé, entre autres initiatives importantes, une campagne mondiale de protestation et de remise de déclarations de solidarité avec la lutte du peuple panaméen, devant les ambassades et consulats panaméens de chaque pays, le 9 juin 2025. Cela permettrait de commencer à briser le siège médiatique mis en place par les grandes agences de presse et d'établir un important réseau de communication alternative et de solidarité. La suite vous attend
L'événement aura lieu le 9 juin devant l'ambassade panaméenne de leurs pays.
Le 2 juin 2025
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La société civile, dernière frontière vers le totalitarisme au Salvador

La société civile organisée du Salvador constitue la dernière frontière du voyage que le gouvernement de Nayib Bukele a entamé vers l'État totalitaire en 2019. L'approbation récente de la loi sur les agents étrangers semble être l'outil utilisé pour surmonter cette dernière barrière. La communauté internationale, en particulier les institutions espagnoles présentes dans le pays, semble regarder ailleurs - quand elle n'est pas de connivence avec les intérêts corporatistes du gouvernement salvadorien - dans un contexte de stigmatisation, de criminalisation, de répression et de violence à l'encontre des organisations populaires et de ceux et celles qui défendent les droits humains.
https://www.elsaltodiario.com/revista-pueblos/sociedad-civil-ultima-frontera-totalitarismo-salvador
Omal
27 mai 2025
Comment nous en sommes arrivés là
Depuis que le président nouvellement élu Nayib Bukele a fait irruption à l'Assemblée nationale en 2020, accompagné de soldats armés, pour demander l'approbation d'un prêt destiné à lutter soi-disant contre les gangs, l'escalade du processus de concentration du pouvoir et de cooptation de toutes les institutions publiques ne s'est jamais démentie.
La première victime a été l'indépendance judiciaire. En un seul jour, en mai 2021, le procureur général - qui enquêtait sur des cas de corruption de l'exécutif - a été démis de ses fonctions et un nombre important de magistrats de la Cour suprême ont été révoqués, établissant ainsi un système judiciaire qui travaille dans l'intérêt du gouvernement. Depuis lors, le ministère public a persécuté les opposants et opposantes politiques et bloqué les enquêtes les concernant, tandis que la Cour suprême a entériné la réélection anticonstitutionnelle de Bukele pour un second mandat.
Avec un système judiciaire capturé, l'étape suivante consistait à coopter les autres organes du pouvoir politique du pays, le corps législatif et les municipalités, en changeant les règles du jeu quelques mois avant les élections de 2024. Le nombre de représentant-es à l'assemblée législative a été réduit de 84 à 60, et le nombre de municipalités a été réduit de 262 à 44. En conséquence, New Ideas - le parti de Bukele - avec d'autres groupes politiques, a réussi à gagner presque tous les sièges du pays, obtenant 57 député-es et 43 mairies, sans nier la popularité du président en raison du sentiment social d'amélioration en termes de sécurité.
Comme si cela ne suffisait pas, peu de temps après, le dernier instrument qui permettait de limiter, même temporairement, le pouvoir absolu du gouvernement est tombé : le processus de modification constitutionnelle en deux législatures. Deux jours avant la fin de son mandat, la législature précédente a approuvé un changement constitutionnel selon lequel toute modification de la Magna Carta pouvait être effectuée de manière expresse, sans devoir être ratifiée par une seconde législature. Suite à la ratification de ce changement par la nouvelle assemblée en janvier 2025, la constitution peut être réformée en deux jours sans aucun dialogue social ou débat parlementaire, à la demande d'une publication de Bukele sur les médias sociaux, comme c'est devenu la norme.
Ce processus de dégradation démocratique est sous-tendu par l'imposition d'un régime d'exception en vigueur depuis 38 mois, au cours duquel 400 personnes sont mortes sous la tutelle de l'État, tandis que 85 500 ont été capturées sans aucune garantie
Pour mesurer l'ampleur du pouvoir accumulé, le gouvernement pourrait aujourd'hui, en 48 heures seulement, s'il en avait la volonté, par exemple, introduire la peine de mort, révoquer les accords de paix ou rendre illégaux les partis politiques.
Enfin, nous ne pouvons pas oublier que ce processus de dégradation démocratique s'est accompagné de l'imposition d'un régime d'exception en vigueur depuis 38 mois, au cours duquel 400 personnes sont mortes sous la protection de l'État, tandis que 85 500 ont été capturées sans aucune garantie et sans qu'il ait été possible de prouver leur culpabilité.
C'est pourquoi la société civile salvadorienne, à travers ses diverses expressions (syndicats, mouvements populaires, ONG, médias, collectifs d'avocats, entre autres), constitue le seul et dernier contrepoids et rempart de dignité face au pouvoir absolu de Nayib Bukele.
Le récit officiel commence à se fissurer
La popularité de Bukele avait déjà commencé à baisser depuis le mois d'avril, en raison de la désapprobation par la majorité de la population salvadorienne de la réactivation des mines de métaux, ainsi que du rejet généralisé de la politique d'emprisonnement massif des migrants expulsés des Etats-Unis.
Cependant, les événements de ces dernières semaines ont été particulièrement éprouvants pour le dirigeant salvadorien. D'une part, l'incapacité des institutions publiques à gérer la crise de la mobilité provoquée par les glissements de terrain sur la route « Los Chorros » a entraîné l'arrestation de 16 transporteurs, dont l'un est décédé en garde à vue.
D'autre part, la récente révélation par le journal El Faro d'un prétendu pacte avec l'entourage de Bukele de la part de chefs de gangs pour favoriser sa victoire à la mairie de San Salvador, tremplin pour son arrivée à la présidence du pays, a généré une nouvelle réponse répressive qui a contraint plusieurs journalistes à quitter le pays face aux menaces officielles de mandats d'arrêt à leur encontre.
L'arrestation de leaders sociaux fait partie d'une stratégie : montrer au monde l'impunité avec laquelle Bukele exerce sa répression et rappeler au peuple salvadorien que personne n'est à l'abri
Cependant, les événements se sont précipités le 12 mai, lorsque des membres de la coopérative El Bosque ont été violemment réprimés, et certains d'entre eux capturés, par des membres de la police militaire alors qu'ils manifestaient pacifiquement contre l'expulsion imminente de 300 familles. Le lendemain, le conseiller juridique de la coopérative, Alejandro Henríquez, a été capturé ; aujourd'hui, avec le pasteur et président de la coopérative, José Ángel Pérez, ils sont tous deux en prison. Le même jour, face à l'indignation et au rejet de la société civile et du mouvement social, le président Bukele a publié sur le réseau social X son désormais célèbre message annonçant le projet de loi sur les agents étrangers.
Quoi qu'il en soit, la prise de conscience que le Salvador est entré dans une nouvelle dimension se fait avec l'arrestation de Ruth López le 18 mai. López est membre de l'organisation Cristosal et l'une des personnes les plus influentes du pays. Son arrestation fait partie d'une stratégie : montrer clairement au monde l'impunité avec laquelle Bukele exerce sa répression et rappeler au peuple salvadorien que personne n'est à l'abri. Les coutures du régime sont apparentes et il réagit en faisant la démonstration de sa force répressive.
Loi sur les agents étrangers
L'annonce sur les réseaux sociaux s'est rapidement concrétisée et la loi sur les agents étrangers a été formellement approuvée, de nuit et avec préméditation, le 20 mai. Alors que beaucoup d'entre nous avaient déjà fait une croix sur cette journée, le député des Nouvelles Idées Christian Guevara a présenté la loi en séance plénière à 16h40, et en moins de deux heures, elle était déjà approuvée. Sans discussion, sans étude, sans débat de fond et avec une renonciation aux formalités. Si, en 2021, la communauté internationale a réussi - comme elle s'en vante habituellement - à paralyser l'approbation d'un projet de loi similaire, cette fois-ci, les missions diplomatiques accréditées dans le pays n'ont même pas su, le jour même, qu'une loi encore plus néfaste était sur le point d'être approuvée. Elles l'ont appris en direct et, dans le meilleur des cas avec résignation, elles se sont rendu compte de leur propre inutilité.
Dans la logique de Bukele, c'est tout à fait logique : profiter de ce moment pour passer définitivement de l'autocratie au totalitarisme, avant que l'édifice ne s'écroule. La corrélation des forces au niveau international est différente aujourd'hui avec la montée de l'extrême droite et de l'administration Trump. Cependant, le récent précédent du FMI forçant un processus de non-officialisation du bitcoin démontre que, avec les bonnes incitations, la communauté internationale pourrait influencer le Petit Poucet d'Amérique centrale. Mais bien sûr, les incitations ont changé.
La loi sur les agents étrangers pourrait être le coup de grâce pour de nombreuses organisations qui, grâce à la solidarité internationale, effectuent un travail louable en tant que garants de la dignité et de l'accès aux droits
Comme cela a déjà été largement dénoncé, cette loi pourrait représenter le coup de grâce pour de nombreuses organisations qui, grâce à la solidarité internationale, effectuent un travail louable en tant que garants de la dignité et de l'accès à certains droits pour des groupes populaires historiquement abandonnés par l'État. En outre, elle aura également un impact sur d'autres groupes qui, ces dernières années, sont devenus des cibles directes des attaques et de la répression des institutions de l'État, sous la direction d'un gouvernement qui non seulement reconnaît ouvertement son mépris pour les droits humains, mais qui s'en vante également.
Désormais, toute action visant à promouvoir les droits humains peut être considérée comme une activité à motivation politique susceptible d'entraîner des amendes, la suppression du statut juridique ou l'engagement de la responsabilité pénale de ses membres. Tout cela dans un cadre de discrétion absolue et d'arbitraire de la part du gouvernement.
Les insinuations plus ou moins directes et le ton revanchard et provocateur du président de l'assemblée législative, Ernesto Castro, à l'égard d'une partie de la société civile salvadorienne lors de la séance de vote, suggèrent que la nouvelle réglementation sera utilisée de manière implacable contre toute voix critique à l'égard du gouvernement.
C'est pourquoi les mouvements qui regroupent les victimes du régime d'exception injustement emprisonnées, les organisations qui documentent et dénoncent les violations des droits humains, les avocats qui représentent les prisonniers et prisonnières politiques et accompagnent les familles des personnes disparues, les syndicalistes qui revendiquent les droits de la classe ouvrière face au démantèlement de l'État, les organisations féministes et de la diversité sexuelle, qui représentent aujourd'hui le seul soutien aux femmes victimes de violences et à la population LGTBQ+, sont particulièrement visés par cette mesure ; les journalistes, les communicateurs sociaux et les médias alternatifs qui dénoncent les cas de corruption, ou les organisations qui accompagnent les communautés menacées d'expulsion pour la construction de mégaprojets ou pour la défense de leurs terres, rivières ou forêts, courent actuellement un risque sérieux de disparition et/ou de criminalisation pour avoir représenté un échec dans l'équation du projet politique et économique du pays basé sur le culte de Bukele et l'enrichissement vorace de sa famille, de son entourage le plus proche et de l'oligarchie classique.
Il est inquiétant, parce que naïf ou mal intentionné, le discours officieux que certaines représentations diplomatiques ou agences de coopération ont tenu ces derniers jours, supposant - et par conséquent promouvant - l'inévitabilité de l'approbation de cette loi, relativisant ses impacts potentiels sous l'argument grossier que certaines agences de coopération opèrent encore au Nicaragua, en dépit de l'existence de réglementations similaires.
Cette position tente d'ignorer le fait qu'au Nicaragua, en vertu de sa propre loi sur les agents étrangers adoptée en 2020, qui est de facto moins répressive que celle de son homologue salvadorien - elle ne prévoit pas l'imposition d'une taxe sur les transactions reçues par les agents étrangers depuis l'étranger - a servi de cadre juridique à l'annulation de plus de 4 000 organisations à but non lucratif, ainsi qu'à la confiscation par l'État de leurs actifs et à la persécution de leurs dirigeants.
Réponse pusillanime ou collusion d'intérêts ?
Mais comme nous l'avons souligné au début, il ne s'agit peut-être pas seulement de réponses pusillanimes : peut-être cette nouvelle loi est-elle une réglementation qui sert les intérêts d'États tiers ? Y a-t-il une collusion d'intérêts ?
Il y a moins d'un an aujourd'hui, le roi d'Espagne Felipe VI se rendait au Salvador pour participer à l'inauguration du second mandat présidentiel de Bukele. Un jour avant la cérémonie officielle, des vétérans de guerre et des signataires des accords de paix ont été accusés de terrorisme et de subversion, sans que l'accusation ne fournisse de preuves, et aujourd'hui ils sont toujours en prison dans l'attente de leur procès. Au même moment, les organisations de défense des droits humains dénonçaient déjà la détention injuste et l'emprisonnement de milliers de Salvadoriens et Salvadoriennes dans des conditions inhumaines.
Cependant, malgré ce contexte, l'État espagnol n'a pas hésité à lancer une politique intensive pour encourager les entreprises espagnoles à investir au Salvador, en profitant de l'absence de normes environnementales et de la violation systématique des droits à la participation et à l'information des personnes et des communautés affectées par les mégaprojets. Selon le compte rendu officiel de l'ambassade d'Espagne au Salvador, il s'agirait de profiter de « la sécurité juridique qu'ils perçoivent dans le pays ».
Le Royaume d'Espagne a utilisé des fonds publics pour financer la construction d'un aéroport, laquelle a provoqué une catastrophe écologique, et a encouragé l'implantation de l'énergie nucléaire au Salvador
Sous cette prémisse, et au cours de la seule année dernière, le Royaume d'Espagne a eu le temps d'utiliser des fonds publics pour, premièrement, financer la construction d'un aéroport, ce qui a provoqué une catastrophe écologique dans l'est du pays, générant des pénuries d'eau et forçant le déplacement de douzaines de familles ; deuxièmement, promouvoir la mise en œuvre de l'énergie nucléaire au Salvador, malgré les avertissements du mouvement écologiste sur les risques qu'elle comporte dans un pays à forte activité sismique ; et troisièmement, ouvrir des glaciers dans le centre historique de San Salvador, un territoire qui fait l'objet d'innombrables plaintes de la part du voisinage concernant l'embourgeoisement par des entreprises prétendument liées à l'entourage du président.
Bien que l'exemple de l'Espagne soit le plus typique, un débarquement massif de mégaprojets d'infrastructure, de communication et d'énergie renouvelable, motivé par la stratégie de la porte d'entrée mondiale de l'UE, devrait également avoir lieu dans un avenir proche. De même, suite à la réactivation de l'exploitation des métaux dans le pays, on pourrait assister à moyen terme au retour des entreprises canadiennes, australiennes et américaines, profitant de la hausse du prix de l'or et n'excluant pas l'existence d'autres métaux directement liés à l'olivier et au capitalisme vert numérique.
En somme, la discrétion avec laquelle la solidarité internationale sera désormais canalisée, affectant directement ceux qui s'opposent au développement massif de mégaprojets touristiques, urbanistiques, agro-industriels, énergétiques et d'infrastructures en tout genre, met sérieusement en péril les minima démocratiques du pays. Tout cela, en outre, dans un contexte où le gouvernement encourage les investissements étrangers et la vente aux enchères des terres et des ressources naturelles du Salvador au plus offrant. La loi sur les agents étrangers promeut l'idée que « si nous ne les voyons pas et si nous ne les entendons pas, ils n'existent pas », un paradigme particulièrement favorable aux intérêts du pouvoir corporatif qui doit être combattu.
C'est pourquoi nous demandons à la communauté internationale de tout mettre en œuvre pour faire cesser ce scandale et de mettre toutes ses capacités politiques et diplomatiques au service de cette tâche. En même temps, nous voulons montrer notre soutien et notre engagement aux mouvements sociaux et populaires salvadoriens : quoi qu'il arrive, la solidarité internationaliste ne cessera pas, quels que soient les obstacles, et les liens déjà existants n'en seront que renforcés.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La Chine sous pression : mobilisations populaires et fractures systémiques

Les manifestations qui ont traversé la Chine entre mai et début juin 2025 mettent en lumière des tensions profondes et une dynamique d'instabilité croissante dans le tissu social du pays.
Tiré d'Europe solidaire sans frontière.
Une société sous pression : le tableau général des mobilisations
L'analyse des épisodes de mobilisation sociale enregistrés en Chine entre la fin du mois de mai et le début du mois de juin 2025 fait apparaître des tensions systémiques qui traversent l'ensemble du pays. Loin d'être des phénomènes isolés, ces événements mettent en évidence des fractures profondes dans la situation sociale actuelle du pays, où les difficultés économiques se mêlent à des problèmes structurels de nature politique et à des violations croissantes des droits fondamentaux.
La période considérée, qui culmine symboliquement avec le 36e anniversaire de la répression de Tiananmen le 4 juin 1989, présente une concentration extraordinaire de protestations qui, en un peu plus d'une semaine, ont investi avec intensité différents secteurs de la société : de l'industrie manufacturière à la construction, de l'éducation aux soins de santé, et même le système pénitentiaire. Cette succession rapide de mobilisations transversales montre que les causes des troubles ne peuvent être attribuées à des problèmes sectoriels spécifiques, mais plutôt à des dynamiques systémiques plus profondes évoluant simultanément.
Les huit journées « échantillons » analysées en détail - du 26 mai au 3 juin - révèlent également une répartition géographique couvrant l'ensemble du pays, de la province industrielle de Guangdong aux régions du nord-est, soulignant ainsi que le phénomène n'est pas limité à certaines zones économiques, mais représente une manifestation généralisée des fractures du tissu social chinois contemporain.
Le phénomène des arriérés de salaires : dimensions et caractéristiques
Les arriérés de salaires apparaissent comme le dénominateur commun de la grande majorité des protestations documentées. Selon les données du China Labour Bulletin, pas moins de 88 % des incidents de protestation collective en 2024 étaient liés au non-paiement, soulignant la façon dont ce problème est devenu endémique dans l'économie chinoise. L'organisation note que « les arriérés de salaires représentent 76 % des événements sur la carte des grèves depuis 2011 », ce qui indique une persistance du phénomène sur une décennie.
Le cas de la manifestation des travailleurs de Yunda Express à Chengdu illustre la complexité de ces dynamiques et la manière dont les conflits se développent et, parfois, sont résolus. Le conflit, qui a duré du 30 mai au 2 juin, est né non seulement de questions salariales, mais aussi de la décision unilatérale de l'entreprise de délocaliser le centre de distribution dans la ville de Ziyang, dans le comté de Lezhi, sans offrir de compensation ou d'alternatives de travail aux employés en échange de la délocalisation. Les travailleurs ont bloqué l'entrée du centre de distribution pour empêcher les véhicules d'entrer et de sortir, paralysant ainsi les activités de l'entreprise.
La chronique de la manifestation révèle l'escalade des tensions : dans la nuit du 31 mai, la police a tenté de disperser les manifestants par la force et, selon les témoignages des travailleurs, certains employés ont été battus au cours de l'intervention. Après des jours de résistance et de négociations serrées, l'entreprise a finalement accepté, le 2 juin, d'indemniser les employés selon une formule mathématique précise : salaire moyen plus 6 000 yuans multipliés par les années de service. Cette résolution montre qu'une pression collective soutenue peut encore obtenir, bien qu'en de rares occasions, des résultats concrets dans le contexte chinois, malgré l'environnement répressif.
Le secteur manufacturier a connu de nombreux troubles reflétant les difficultés économiques structurelles de l'économie chinoise. Par exemple, à Ningbo, dans le Zhejiang, les travailleurs de Rockmoway Clothing se sont mobilisés pendant deux jours consécutifs (les 2 et 3 juin) pour protester contre la décision de l'entreprise de retenir arbitrairement 40 % de leurs salaires. De même, plusieurs usines ont connu des grèves prolongées en raison d'arriérés de salaires, comme sur les chantiers de BASF à Donghai, dans le Guangdong, où les ouvriers du bâtiment se sont croisés les bras le 2 juin pour protester contre le non-paiement de leurs salaires.
La géographie des protestations dans l'industrie manufacturière montre une concentration particulière dans la province de Guangdong, le « moteur » de l'économie chinoise, qui avait enregistré 37 cas en avril 2025, de loin le nombre le plus élevé de toutes les régions. Cette concentration reflète la pression croissante exercée sur les industries orientées vers l'exportation dans une province qui représente le cœur manufacturier de la Chine.

L'impact de la guerre commerciale et les transformations du travail industriel
L'escalade des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine a eu des effets directs et mesurables sur la condition des travailleurs. L'expansion des droits de douane américains, qui visent également les biens produits par des entreprises chinoises dans des pays tiers, a amplifié les incertitudes et exacerbé la crise à laquelle sont confrontés les travailleurs. Les données montrent que le secteur manufacturier a connu une augmentation significative des troubles, passant de 25 cas en mars 2025 à 39 en avril suivant, ce qui reflète les pressions croissantes exercées sur les industries orientées vers l'exportation.
Les manifestations se sont étendues géographiquement « de la province de Guangdong, dans le sud-ouest de la Chine, où se trouvent de nombreuses entreprises manufacturières, à Tongliao, dans la province de Jilin, dans le nord-est », mettant en évidence une répartition nationale du phénomène. Comme le note Workers' Solidarity, « cela reflète également le fait que les problèmes du système économique chinois s'étendent aussi aux activités internationales », les travailleurs chinois employés dans des projets à l'étranger ayant fait grève en Arabie Saoudite et à Oman le 29 mai pour réclamer leurs salaires.
Les protestations dans les usines Foxconn, l'un des plus grands fabricants au monde qui fournit des iPhones à Apple, sont particulièrement significatives. À l'usine de Hengyang, les travailleurs se sont mis en grève pour protester contre la réduction des subventions et des heures supplémentaires, tandis qu'à l'usine de Taiyuan, ils ont protesté contre les projets de transfert des installations de production de Taiyuan à Jincheng, à trois heures de route. Lors des manifestations de rue, les travailleurs ont crié « Nous voulons que nos droits soient respectés ».
BYD, le principal constructeur chinois de voitures électriques, a également été confronté à d'importants troubles. Le 28 mars, plus de 1 000 travailleurs de l'usine de Wuxi se sont mis en grève pour protester contre les baisses de salaire, la fin des primes d'anniversaire et d'autres réductions d'avantages. Quelques jours plus tard, les travailleurs de l'usine de Chengdu ont également manifesté pour réclamer la sécurité de l'emploi, la transparence des délocalisations et des compensations équitables.
Parmi les différents secteurs, l'industrie de l'habillement et de la chaussure a été particulièrement touchée par la crise, ses travailleurs ayant souvent souffert du non-paiement des salaires. Ces industries sont souvent petites et concentrées dans la même région, de sorte que le non-paiement des salaires ou la suspension de l'activité en raison de la baisse de la rentabilité se produisent souvent dans des endroits proches au même moment. Parmi les grèves dans l'industrie manufacturière en 2024, le secteur de l'habillement arrive en deuxième position (90 cas) après le secteur de l'électricité et de l'électronique (109 cas).
L'affaire « Brother 800 » : symbole du désespoir systémique
Le 20 mai 2025, l'incendie de l'usine textile de la Sichuan Jinyu Textile Company dans le comté de Pingshan a acquis une résonance symbolique qui dépasse largement la dimension locale de l'événement. Wen, un ouvrier de 27 ans, a mis le feu à son lieu de travail après avoir été privé des salaires qui lui étaient dus pour un montant total de 5 370 yuans, contrairement aux 800 yuans initialement rapportés par les médias et plus tard démentis par la police.
La reconstitution des faits révèle la complexité de la dynamique qui a conduit à ce geste extrême. Wen avait présenté sa démission le 30 avril et, conformément à l'article 9 des dispositions provisoires sur le paiement des salaires, il était censé recevoir tous les arriérés de salaire immédiatement après la cessation d'emploi. Lorsqu'il a terminé les procédures de démission le 15 mai, l'usine lui devait 5 370 yuans (environ 760 dollars). Wen a demandé un paiement immédiat, mais le service financier a refusé, invoquant des procédures d'approbation internes. Après avoir à nouveau demandé le paiement à son supérieur, sans succès, Wen a développé ce que le rapport de police appelle des « pensées de vengeance ».
L'incendie a causé des dommages économiques estimés à des dizaines de millions de yuans et a conduit à l'arrestation de l'auteur, mais l'histoire est devenue virale sur les médias sociaux chinois avec le hashtag « Brother 800 ». L'écart entre les 800 yuans initialement déclarés et les 5 370 yuans réellement dus a alimenté les débats sur les médias sociaux, où de nombreux utilisateurs ont exprimé leur solidarité avec Wen, le considérant comme un « héros désespéré » plutôt que comme un criminel.
Ce cas met en évidence l'inefficacité structurelle des mécanismes de protection juridique. Comme l'observe ironiquement un témoin, « lorsque les personnes à qui l'on devait des salaires ont demandé une aide juridique, les juges ont disparu et le personnel du département du travail s'est également éclipsé. Mais lorsque Wen a mis le feu à l'usine, la police est immédiatement arrivée et les magistrats sont réapparus ». Cette critique souligne que le système réagit rapidement aux violations de l'ordre public, mais reste inerte face aux violations systématiques des droits des travailleurs.
La description de la situation familiale de Wen - pauvreté, mère malade, besoin urgent d'argent - illustre la façon dont les difficultés économiques individuelles sont liées à l'absence de filets de sécurité sociale adéquats. Le China Labour Bulletin souligne que l'incident représente « une rupture dans les systèmes juridiques et institutionnels conçus pour soutenir les travailleurs », mettant en évidence l'inadéquation des structures syndicales existantes qui sont « restées silencieuses » tout au long de l'affaire.
La réaction du public reflète une frustration généralisée à l'égard de ces failles systémiques. En ligne, un commentaire viral demandait : « Pourquoi un homme en serait-il réduit à incendier une usine pour 800 yuans ? Cela signifie qu'il était littéralement affamé ». D'autres ont dénoncé le double standard : les travailleurs qui protestent sont qualifiés de fauteurs de troubles, tandis que les employeurs qui retiennent les salaires sont tolérés par les autorités.
La crise de la construction et de l'immobilier : une spirale descendante
Le secteur de la construction représentait 54,48 % de toutes les protestations collectives en avril 2025, un chiffre qui reflète la crise persistante du marché immobilier chinois. Cette concentration dans le secteur de la construction montre que la crise immobilière, qui a commencé avec l'affaire Evergrande en 2021 et s'est propagée à l'ensemble du secteur ainsi qu'à l'économie en général, continue d'avoir des effets dévastateurs sur les conditions de travail.
Les projets inachevés sont une source particulière de tensions sociales, car ils concernent non seulement les travailleurs du secteur, mais aussi les citoyens qui ont investi leurs économies dans le logement. Par exemple, à Xianyang, Shaanxi, le 30 mai, des propriétaires de bâtiments inachevés du projet Sunac Shiguang Chenyue ont manifesté devant le centre de pétition local, accusant le gouvernement d'avoir détourné des fonds de construction, ce qui a entraîné plusieurs arrestations par la police. Toujours à Qingdao, Shandong, des centaines de propriétaires du projet immobilier inachevé Heda Xingfucheng ont organisé une manifestation collective dans le district de Chengyang le 31 mai, bloquant la circulation et forçant l'accès au site de construction, plusieurs propriétaires ayant subi des violences de la part de la police.
Ces épisodes montrent que la crise immobilière ne concerne pas seulement les opérateurs du secteur, mais s'étend aux citoyens de la classe dite moyenne qui ont investi leurs économies dans l'achat d'un logement, créant ainsi une base sociale plus large de mécontentement potentiel. La convergence de la crise économique et des attentes sociales déçues est un élément particulièrement déstabilisant pour la stabilité sociale.
L'extension des manifestations au secteur public : enseignants, médecins et travailleurs de la santé
Les autorités sont particulièrement préoccupées par l'extension des manifestations au secteur public, traditionnellement considéré comme plus stable et fidèle au système. Dans la province de Shandong, les enseignants contractuels n'ont pas reçu de salaire depuis six mois. Un enseignant d'école primaire a déclaré : « Notre salaire mensuel n'est que d'environ 3 000 yuans (un peu plus de 400 dollars) et, depuis six mois, nous vivons avec de l'argent emprunté ».
Un autre enseignant de Shanxi a signalé que son école exigeait la restitution des primes de fin d'année versées au personnel depuis 2021, ainsi qu'une partie de la rémunération perçue pour les activités extrascolaires. Ces mesures ont provoqué un mécontentement généralisé sur le site , comme en témoignent les messages publiés sur le réseau social Xiaohongshu (RedNote).
Les travailleurs de la santé sont confrontés à des problèmes similaires. Une infirmière d'un hôpital public de la province de Gansu, dans le nord-ouest du pays, a déclaré que son salaire mensuel n'était que de 1 300 yuans (moins de 200 USD) et que sa prime de rendement n'avait pas été versée depuis quatre mois. À Fuzhou, dans la province de Jiangxi, des médecins et des infirmières de l'hôpital Dongxin n° 6 se sont rassemblés devant le bâtiment du gouvernement municipal de Fuzhou le 7 avril, pour réclamer le paiement des salaires liés à la performance qui n'ont pas été versés depuis sept mois.
Comme l'observe Zhang, un enseignant retraité de l'université de Guizhou : « Dans le passé, ce sont les travailleurs migrants et les ouvriers qui réclamaient des salaires, mais aujourd'hui, les enseignants, les médecins et les éboueurs se joignent également à la lutte. Cela montre que la »structure stable« de la Chine commence à s'effilocher ». Cette observation rend compte d'un changement qualitatif fondamental : l'extension du mécontentement social à des catégories traditionnellement privilégiées du secteur public indique une crise de légitimité qui va au-delà des difficultés économiques conjoncturelles.
Violations des droits de l'homme dans le système pénitentiaire : témoignage de Liu Xijie
Le système judiciaire et pénitentiaire a fait l'objet de plaintes particulièrement sérieuses qui ont mis en lumière des abus systématiques. Liu Xijie, originaire de Bozhou dans l'Anhui et détenu de 2011 à 2024 à la prison n° 1 de Fushun dans le Liaoning, a trouvé le courage de dénoncer publiquement et nominalement les abus systématiques de la police pénitentiaire ces jours-ci, en donnant les noms précis des officiers accusés.
Selon son témoignage détaillé, aux alentours de février 2022, plus de 200 prisonniers ont été soumis à des sévices de degrés divers, notamment des tortures électriques à l'aide de matraques électriques, des insultes et des coups pour des infractions mineures telles que des réponses non conformes, des postures inappropriées ou un pliage incorrect des couvertures. Les témoignages décrivent de manière particulièrement effrayante comment certains agents pénitentiaires auraient trouvé du plaisir dans les mauvais traitements, piétinant des personnes âgées, introduisant des matraques dans la bouche des détenus, électrocutant des prisonniers au point de provoquer une incontinence fécale.
Le cas le plus grave concerne Fan Hongyu, un prisonnier décédé le 19 février 2022 à la suite de tortures répétées pour n'avoir pas mémorisé le règlement de la prison. Ce témoignage, rendu public à un moment de tension sociale particulière, met en lumière la façon dont le système répressif utilise des méthodes qui violent systématiquement les droits humains fondamentaux, contribuant au climat général d'oppression qui alimente le mécontentement social.
Episodes de protestation étudiante : le cas de Xuchang et la mémoire de Tiananmen
L'analyse des mouvements étudiants révèle des dynamiques particulièrement significatives. Le 3 juin à Changning, dans la province du Hunan, des centaines de lycéens de l'école Shangyu ont organisé une manifestation spontanée sur le campus pour évacuer le stress des examens d'entrée à l'université. L'événement, d'abord pacifique et caractérisé par des cris libérateurs, a rapidement pris une connotation politique lorsque l'école a alerté les autorités sur l'enthousiasme excessif manifesté par les jeunes.
Lorsque la police est intervenue et a arrêté trois organisateurs présumés, la situation a rapidement dégénéré : les étudiants ont formé un mur humain pour empêcher les voitures de police de partir, en criant des slogans tels que « retirons-nous de l'école, rendons l'argent » et en exigeant la libération des camarades arrêtés. Malgré la détermination affichée, les policiers ont réussi à briser le cordon d'étudiants par la force, emmenant les trois jeunes hommes sous le regard impuissant de leurs camarades.
Cet épisode est particulièrement sensible compte tenu de sa proximité temporelle avec l'anniversaire du 4 juin 1989, une date qui continue de représenter un moment extrêmement sensible pour les autorités chinoises. Dans le cas du collège n° 6 de Xuchang, dans le Henan, où une élève s'est suicidée prétendument à cause des brimades de son professeur, des milliers d'élèves et de citoyens ont manifesté devant l'école, pénétrant dans le campus et endommageant des bureaux avant que la police n'intervienne. Wu Jianzhong, secrétaire général de la Taiwan Strategy Association, note que l'incident s'étant produit à proximité d'une date sensible comme le 4 juin, les autorités ont réagi avec une extrême prudence, craignant qu'il ne déclenche des troubles sociaux et ne se propage rapidement, comme un incendie.
Contrôle social et répression : l'anniversaire de Tiananmen
Dans le cadre du 36e anniversaire de Tiananmen, les autorités ont mis en œuvre des mesures de contrôle sans précédent à l'encontre du groupe des « mères de Tiananmen ». Pour la première fois dans l'histoire du groupe, toute communication avec le monde extérieur a été coupée, les téléphones portables et les appareils photo étant interdits lors de la commémoration au cimetière de Wan'an à Haidian.
Le 31 mai, les Mères de Tiananmen ont publié une lettre ouverte signée par 108 parents de victimes, commémorant les membres décédés au cours de l'année écoulée et réitérant leurs demandes : enquête impartiale sur l'événement, publication des noms des morts, indemnisation des familles et punition des coupables. Zhang Xianling, 87 ans, s'est ému dans une vidéo il y a quelques jours : « Depuis 36 ans, nous n'avons cessé de chercher le dialogue avec les autorités, mais nous n'avons été que mis sous contrôle et réprimés ».
Cette escalade du contrôle met en évidence la sensibilité particulière des autorités à toute forme de mémoire collective liée aux événements de 1989, suggérant une vulnérabilité perçue du régime aux liens potentiels entre les protestations contemporaines et les précédents historiques de mobilisation sociale.
Censure numérique et contrôle de l'information
La gestion de l'information sur les incidents de protestation révèle des stratégies sophistiquées pour contrôler le discours public. Dans le cas de l'incident du collège Xuchang n° 6, les autorités ont rapidement supprimé tous les contenus publiés sur les médias sociaux, et le fil de discussion sur le collège Xuchang n° 6 sur le site Weibo a disparu. Lorsque les élèves ont réalisé que leurs messages n'étaient pas autorisés à circuler, ils n'ont eu d'autre choix que d'exprimer leur frustration contre l'école elle-même, ce qui a fini par dégénérer en une confrontation ouverte.
Dans le même temps, le cyberespace chinois a montré des réactions anormales. Début juin, dans le jeu de Tencent « Golden Spatula Wars », tous les avatars des utilisateurs de WeChat ont été uniformément remplacés par des pingouins verts et ne pouvaient être changés, ce qui a suscité une grande attention de la part des joueurs. Un internaute s'est plaint sur Platform X : « Les pingouins étaient à l'origine un symbole de divertissement, mais ils sont maintenant devenus un masque de censure. »
En outre, comme chaque année autour du 4 juin, les plateformes de médias sociaux chinoises bloquent des mots-clés tels que « square », « tank », « 8964 », et le contenu correspondant est immédiatement supprimé, tandis que les comptes qui les ont publiés risquent d'être interdits. Le 4 juin, l'avocat des droits de l'homme Pu Zhiqiang a été sommé par la police de supprimer son discours commémoratif sur la plateforme X.
Dynamique de la résistance effective : le cas de Dongguan
Malgré le contrôle autoritaire, plusieurs épisodes montrent que la mobilisation sociale conserve une capacité à influencer les décisions des autorités locales lorsqu'elle atteint des dimensions significatives et formule des demandes économiques concrètes. Le cas de Dongguan est un exemple emblématique de mobilisation spontanée et réussie des travailleurs.
Le 2 juin, des centaines de travailleurs migrants vivant dans le village de Yangyong, dans la ville de Dalang, se sont opposés à l'introduction d'un système de péage qu'ils considèrent comme économiquement insoutenable. Leur action collective, qui a débuté vers 18 heures par le blocage des barrières de péage, s'est étendue à plusieurs centaines de personnes criant des slogans tels que « enlevez les barrières ».
Sous la pression soutenue des manifestants, la police de stabilité sociale a dû céder vers 22 heures, envoyant des travailleurs pour retirer tous les équipements de péage. La politique fiscale, mise en œuvre la veille, a été déclarée nulle et non avenue, mettant en évidence le fait que les difficultés économiques poussent les classes populaires à des formes de résistance de plus en plus organisées et efficaces.
Évolution des stratégies de protestation et de l'organisation sociale
L'analyse révèle une évolution dans la manière dont les manifestations sont organisées, reflétant l'adaptation des mouvements sociaux à l'environnement technologique et répressif contemporain. Dans le cas des étudiants de Xuchang, l'utilisation des téléphones portables et de l'internet a permis une connexion et une agrégation rapides, soulignant comment les technologies numériques peuvent agir comme des multiplicateurs d'action collective en dépit des contrôles gouvernementaux.
Zeng Jianyuan, directeur exécutif de l'Association académique démocratique chinoise à Taïwan, note que « dans le climat actuel de gouvernance répressive et de purges politiques en Chine, seules les questions apolitiques peuvent légitimer des formes de rassemblement collectif à grande échelle ». Toutefois, il ajoute que « le Parti communiste chinois perçoit clairement que ce tumulte n'est pas seulement un geste de soutien à une école ou à un incident isolé, mais qu'il reflète également deux problèmes plus profonds ».
Le premier problème, selon Zeng, est que « sous l'administration de Xi Jinping, la société chinoise connaît une vague de détresse émotionnelle collective, et beaucoup cherchent un exutoire ». Le second, , est que « l'incident de Xuchang révèle un relâchement du contrôle social par les autorités locales : les étudiants ont pu se coordonner et se rassembler rapidement grâce aux téléphones portables et à l'internet, signe de l'échec des mécanismes locaux de maintien de la stabilité ».
Il est clair que les manifestations les plus récentes ne peuvent pas être interprétées comme de simples réactions spontanées à des injustices spécifiques, mais représentent plutôt des manifestations d'un « malaise émotionnel collectif » plus large qui cherche des canaux d'expression à travers des questions apparemment apolitiques.
Crise de légitimité des autorités locales
Les protestations documentées mettent en évidence une crise de légitimité croissante des autorités locales, incapables d'assurer une médiation efficace entre les pressions économiques centrales et les besoins sociaux locaux. L'imposition arbitraire de taxes au niveau local est un excellent exemple de cette dynamique.
Dans le cas du village de Pingtang, dans la ville de Gushan, province de Zhejiang, le comité du village a publié un avis annonçant qu'à partir du 10 mai, des « frais de gestion sanitaire » et des « frais de stationnement » seraient prélevés sur tous les résidents permanents et les travailleurs du village : 80 yuans par an pour les adultes, 40 yuans pour les enfants et 500 yuans pour les voitures et les tricycles. L'avis indiquait également que ceux qui ne paieraient pas à temps seraient « mis sous contrôle » à partir du 1er juin, et que chaque personne devrait payer un supplément de 200 à 100 yuans, que leurs véhicules seraient verrouillés et que ceux qui forceraient les serrures seraient « traités comme des auteurs d'actes de vandalisme contre des biens publics ».
Li, un locataire du village, a déclaré que « cette taxe n'a jamais été convenue avec les villageois et n'a jamais fait l'objet d'une réunion publique. Je suis un locataire extérieur et je n'ai jamais entendu parler d'une réunion du village approuvant cette taxe ». Certains villageois ont critiqué la décision du comité du village, la qualifiant d'« extorsion éhontée ». Un autre villageois, Zhang Shun (pseudonyme), a déclaré : « Ma famille compte cinq personnes et nous devons payer 400 yuans par an. Nous ne pouvons absolument pas nous le permettre. Est-ce encore un pays dirigé par le Parti communiste ? ». Jia Lingmin, une militante, a souligné que le comité du village est une organisation populaire autonome et que toutes les redevances doivent obtenir un « permis de redevance », faute de quoi elles sont illégales.
Cet épisode illustre la façon dont les gouvernements locaux, sous la pression des difficultés fiscales, ont recours à des mesures de plus en plus désespérées et illégales pour lever des fonds, ce qui érode encore plus leur légitimité aux yeux de la population. Comme l'observe Zhang, un enseignant retraité de l'université de Guizhou : « Le niveau élevé de la dette locale et le durcissement des politiques centrales ont fortement affecté la gestion fiscale locale. Les victimes les plus directes sont les travailleurs permanents et contractuels ».
Transformations du tissu social chinois
Tang Gang, un universitaire du Sichuan, propose une analyse particulièrement perspicace des transformations sociales en cours, notant que la société chinoise évolue « d'une société traditionnelle où il était possible de faire des compromis, de se tolérer mutuellement et de coexister, à une société marquée par de rudes conflits, où les positions sont irréconciliables et où la coexistence devient impossible ». Cette transformation, qu'il attribue aux changements survenus au cours des dix dernières années sous la direction de Xi Jinping, suggère une détérioration qualitative des relations sociales qui transcende les questions économiques spécifiques.
Xue, chercheur en relations du travail à Guizhou, identifie plusieurs facteurs qui contribuent à l'escalade des conflits entre travailleurs et patrons. « Tout d'abord, dans certaines entreprises, les dirigeants syndicaux sont directement nommés par les patrons, ce qui empêche le syndicat de représenter véritablement les intérêts des travailleurs. Cela entrave la défense des droits des salariés et alimente les tensions. Deuxièmement, la relation entre le capital et le travail est fortement orientée vers le marché, mais il n'y a pas de répartition équitable des revenus. De plus, dans de nombreuses usines, l'opacité prévaut dans la gestion des questions concernant les travailleurs, ce qui exacerbe encore les contradictions ».
L'analyse de M. Xue montre que les problèmes ne sont pas simplement économiques, mais qu'ils reflètent des déficiences structurelles dans le système de relations industrielles de la Chine. L'absence de syndicats indépendants et représentatifs prive les travailleurs de canaux efficaces de résolution des conflits, ce qui les oblige à recourir à des formes de protestation de plus en plus directes et parfois extrêmes.
Vers des scénarios d'instabilité croissante
L'accumulation des tensions documentées au cours de la période fin mai-début juin 2025 indique à elle seule que la Chine d'aujourd'hui est confrontée à des défis sociaux de nature systémique qui ne peuvent être résolus par les seuls mécanismes répressifs traditionnellement employés par le régime. La transversalité sectorielle des protestations, l'extension géographique nationale des phénomènes et l'implication de catégories traditionnellement stables telles que les enseignants et les travailleurs de la santé montrent que les difficultés actuelles ne sont pas des fluctuations conjoncturelles mais plutôt des manifestations de contradictions structurelles plus profondes.
La capacité limitée des autorités locales à répondre efficacement aux demandes populaires, combinée au désespoir économique croissant de larges pans de la population, crée des conditions potentiellement explosives. Comme l'a montré l'affaire « Brother 800 », lorsque les voies légales de résolution des conflits s'avèrent inefficaces, les citoyens peuvent recourir à des formes de protestation de plus en plus extrêmes et destructrices.
L'intensification des mesures répressives, visible dans l'isolement des Mères de Tiananmen et la censure rapide des épisodes de protestation, indique une perception de vulnérabilité de la part du régime qui pourrait paradoxalement alimenter de nouvelles tensions. La stratégie de contrôle de l'information, bien qu'efficace à court terme, risque d'alimenter la frustration et la radicalisation lorsque les citoyens découvriront l'impossibilité de communiquer leurs revendications par les canaux institutionnels.
Les autorités chinoises semblent se trouver dans une position de plus en plus difficile, obligées de trouver un équilibre entre les exigences du contrôle social et la nécessité de maintenir la stabilité économique. L'expérience de la courte période analysée suggère que cette tension atteint des seuils critiques, avec des implications qui pourraient s'étendre bien au-delà des frontières de l'épisode ou du secteur concerné.
Andrea Ferrario
Sources : Yesterday, Radio Free Asia, China Labour Bulletin, AsiaNews, Workers' Solidarity
• Traduction Pierre Vandevoorde et Pierre Rousset avec l'aide de DeepL.
Source - Andrea Ferrario 05 juin 2025
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’Arabie saoudite, nouveau pôle d’influence aux États-Unis

Sans parvenir à détrôner Israël, l'Arabie saoudite, mais aussi les Émirats arabes unis et le Qatar ont acquis un nouveau poids auprès de Donald Trump. Les motivations du président américain relèvent à la fois de la géo-économie et de ses intérêts personnels. Mais qui peut encore se fier à ses engagements ?
Tiré de orientxxi
3 juin 2025
Par Fatiha Dazi-Héni
Deux hommes souriants, l'un en costume, l'autre en tenue traditionnelle, posent ensemble.
Riyad, le 13 mai 2025. Le président états-uniens Donald Trump et le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman lors du forum d'investissement américano-saoudien au centre de conférences du Roi Abdel Aziz.
© Official White House Photo / Daniel Torok / Flickr
La première visite à l'étranger du président Donald Trump au cours de son deuxième mandat (hormis celle consacrée aux obsèques du pape François à Rome) s'est déroulée du 13 au 16 mai 2025 dans les trois pays les plus actifs diplomatiquement du monde arabe : l'Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis. Elle s'est accompagnée d'une moisson de contrats signés ou promis (acquisition d'armements et d'avions civils) et d'annonces d'investissements vertigineux liés à la technologie et notamment à l'intelligence artificielle (IA), qui sont évalués à plus de deux mille milliards de dollars via les fonds souverains du Golfe et les grandes compagnies publiques liées aux industries minières, d'hydrocarbures ou de défense.
Ces monarchies, et plus particulièrement l'Arabie saoudite, sont apparues comme un pôle d'influence capable d'infléchir en partie les orientations de la politique étatsunienne. Cependant, le caractère transactionnel de la diplomatie trumpienne et sa méthode erratique incitent à tempérer les premières déclarations enthousiastes sur le succès éclatant de cette visite pour les monarques du Golfe et notamment pour le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman (MBS).
Une chose est sûre, l'alchimie entre le président étatsunien et MBS fonctionne parfaitement. Le discours élogieux prononcé par Donald Trump sur le « miracle de la modernité selon une méthode arabe réalisé en huit ans en Arabie saoudite par MBS », avec les Émirats arabes unis comme modèle référent, se voulait un vibrant hommage à « l'avenir radieux qui s'offre aux pays du Golfe, car forgé sur le business et le commerce et non par le chaos », allusion transparente à l'Iran (1).
Les perspectives d'un accord avec Téhéran
Le slogan America First du MAGA (« Make America Great Again ») de Trump résonnait avec le Saudi First de la Vision 2030de MBS. Comme le souligne Yasmine Farouk, directrice Golfe Péninsule arabique à l'International Crisis Group (2), le président Trump a traité le royaume comme un partenaire stratégique en lui conférant le statut de leader régional du Proche-Orient et non plus seulement comme un État ami ou simplement client comme les États du Golfe avaient coutume d'être considérés.
Les annonces politiques du président Trump de poursuivre les négociations avec Téhéran pour parvenir à un nouvel accord nucléaire et celle, plus surprenante, de la levée des sanctions économiques contre la Syrie, ajoutée à sa rencontre avec le président syrien Ahmed Al-Charaa à Riyad, ont constitué un réel succès diplomatique pour Riyad, et un revers pour Israël. C'est le résultat d'un travail de lobbying de la diplomatie saoudienne en étroite concertation avec Ankara pour convaincre le président Trump d'œuvrer à la stabilisation de la région enfoncée dans le profond chaos engendré par la dévastation de Gaza depuis le 8 octobre 2023 (3). En coordination avec le président turc Recep Tayyip Erdoğan et l'émir du Qatar, le prince héritier saoudien engrange un succès diplomatique certain qui lui confère une légitimité de leader régional conduisant une diplomatie de détente au contraire du premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou.
Revirement saoudien
L'autre gain substantiel pour MBS est d'avoir convaincu Trump que ce contexte dramatique ne pouvait pas déboucher sur une normalisation avec Israël. Désormais, le président étatsunien ne conditionne plus, contrairement à son prédécesseur Joe Biden, le renforcement des relations bilatérales de défense et une coopération sur le nucléaire civil à la normalisation des relations entre Riyad et Tel-Aviv.
De même, en dépit des déclarations contradictoires, le président Trump a maintenu le cap des négociations avec Téhéran, prenant en compte les vives préoccupations de ses interlocuteurs du Golfe sur les risques de déflagration dans la région en cas de conflit ouvert entre Israël et l'Iran. Riyad a activement défendu l'idée de voir signé un nouvel accord sur le nucléaire, contrairement à sa position antérieure d'hostilité au Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)signé en 2015. Cette position avait contribué à encourager la politique de sanctions maximales à l'encontre de Téhéran, décidée lors du premier mandat Trump et à la dénonciation de l'accord en mai 2018.
Preuve du revirement saoudien radical sur la question nucléaire iranienne, Khaled Ben Salman, ministre de la défense saoudien et frère cadet de MBS, a remis en mains propres au Guide iranien une lettre, le 17 avril 2025, témoignant du soutien de Riyad pour la réalisation d'un accord permanent sur ce dossier. Cet entrain est aussi largement motivé pour des raisons intérieures. Riyad souhaite en effet développer son propre programme nucléaire et enrichir l'uranium, dont il dispose à foison, à des fins civiles.
De son côté, Téhéran reste très attentif à la décision du président Trump de lever les sanctions contre la Syrie, et en particulier à leur matérialisation concrète. Les Iraniens n'hésitent plus à faire miroiter aux négociateurs étatsuniens, via la médiation d'Oman, les opportunités d'investissements qui s'offriraient aux sociétés étatsuniennes en cas d'accord sur le nucléaire.
Un échec sur la Palestine
En revanche, sur la question palestinienne, la visite du président Trump n'a rien changé et a même constitué, en particulier pour Doha, un échec dans ses efforts constants pour obtenir du gouvernement Nétanyahou un cessez-le-feu à Gaza. De fait, l'insistance de Donald Trump à maintenir son idée de déportation des Palestiniens de Gaza afin de prendre le contrôle de ce territoire pour en faire une « riviera », montre les limites de l'influence politique des États de la région.
Si la relation de Trump avec le premier ministre israélien s'est détériorée, rien n'indique une inflexion majeure de la politique des États-Unis quant au projet du gouvernement israélien en Palestine. Ainsi, le redéploiement de la présence militaire étatsunienne dans la région depuis les attaques du 7 octobre 2023, qui est passée d'environ 34 000 à près de 50 000 hommes à la fin de 2024, semble moins motivé par une planification à long terme que par un soutien indéfectible à Israël et aux menaces perçues en provenance de l'Iran et à l'instabilité en mer Rouge (4).
Toutefois, Riyad tentera de capitaliser sur le plan diplomatique lors de la réunion des Nations unies consacrée à la solution à deux États que le prince héritier coprésidera à New York, le 17 juin, avec le président français Emmanuel Macron. Ce dernier pourrait y annoncer, aux côtés du Royaume-Uni et du Canada (voire de nouveaux pays membres de l'UE), la reconnaissance de l'État palestinien, isolant un peu plus Israël.
La Tech, véritable moteur de la visite
Plutôt que d'inscrire le discours de Trump à Riyad dans la lignée du discours du Caire de Barack Obama (5) prononcé le 4 juin 2009, celui du président Trump s'inscrit dans le sillage des propos et de la visite d'État de trois jours du président chinois Xi Jinping à Riyad (du 8 au 10 décembre 2022). Tout comme celle de Xi, la visite de Trump a d'abord eu vocation à consolider la relation bilatérale, en traitant le royaume comme un partenaire incontournable de la compétition géoéconomique qui oppose les deux puissances globales.
Contrer la présence technologique et commerciale chinoise au sein des monarchies du Golfe a constitué un axe majeur de cette visite présidentielle étatsunienne comme en témoigne la présence de tous les géants étatsuniens de la Tech à Riyad, Doha ou Abou Dhabi. Les EAU ont ainsi conclu un accord pour héberger le deuxième plus grand centre de données du monde, avec l'achat des semi-conducteurs ultra performants de la compagnie Nvidia. C'est dans le cadre de ce projet colossal d'investissements sur dix ans, d'un montant de mille milliards et 400 millions de dollars que cheikh Tahnoun, à la tête de la compagnie G42 et conseiller à la sécurité nationale auprès de son frère, Mohammed Ben Zayed (MBZ), président des EAU, a fait le choix d'opter pour la Tech étatsunienne. Sa compagnie avait été contrainte par le président Biden de restreindre sa coopération avec la Chine dans le domaine de l'IA.
Cependant, une partie des congressistes étatsuniens demeure sceptique sur la fiabilité émiratie concernant sa prise de distance avec Pékin ou concernant sa diplomatie militarisée et agressive au Soudan (6) que Washington réprouve. Elle pourrait peser sur le débat et exiger des mesures concrètes pour s'assurer que l'accès émirati à 500 000 puces de pointe conçues par la multinationale étatsunienne Nvidia dès 2026 ne profite pas à la Chine - ce qui est d'ailleurs un engagement de Donald Trump.
L'ombre de la Chine
Pour sa part, MBS a réitéré son objectif d'investir 600 milliards dans des partenariats avec les États-Unis. Outre l'industrie d'armements, c'est l'IA qui est le centre de son attention que cela soit dans les secteurs d'infrastructure, de la santé, la sécurité ou les coopérations scientifiques. Comme le fait remarquer Jonathan Fulton (7) bon connaisseur des relations Chine-Golfe et États-Unis-Golfe, même en ramenant cette somme au chiffre vérifié de 283 milliards, ce montant éclipse largement les contrats d'une valeur de 50 milliards obtenus lors de la visite triomphale d'État du président Xi Jinping à Riyad en 2022. L'annonce de mégacontrats d'armements estimés à 142 milliards de dollars contre le montant record de 121 milliards atteint sous les deux mandats Obama donne un aperçu de la volonté saoudienne de prioriser le partenariat sécuritaire avec les États-Unis.
Pour les monarchies du Golfe, et notamment les EAU et l'Arabie saoudite, qui se livrent une âpre concurrence pour devenir les hubs de l'inter connectivité et de la Tech au croisement des continents africain, européen et asiatique ; l'industrie de l'IA est la clé de voûte de l'ère post-énergie fossile. De fait, ces pays sont jusqu'à présent parvenus à ménager leur coopération avec Pékin, en refusant de faire un choix entre les deux puissances globales. Mais cette visite a été l'occasion pour ces trois monarchies du Golfe d'exprimer leur préférence pour la Tech et la sécurité que leur procure le partenaire étatsunien.
Cependant, avec l'avance prise par l'implantation des entreprises chinoises dans le secteur de l'IA et leurs chaines d'approvisionnement dans la région, la Chine continuera à être un partenaire important sur le long terme. La diplomatie active de Pékin œuvre à renforcer les relations commerciales Sud-Sud dans le cadre de divers sommets multilatéraux (BRICS (8), Organisation de coopération de Shanghai— OCS (9), ou ASEAN (Association des nations du Sud-Est asiatique en français (10) )—CCG— Chine (11) et de visites bilatérales en Asie du Sud et dans le Golfe, parallèlement au chaos suscité par la guerre des droits de douane lancée par le président Trump.
Durant la visite de Trump, un forum des investissements saoudo-étatsuniens s'est également tenu où il a été question d'édifier l'autre pierre angulaire du renforcement de la coopération bilatérale autour de l'industrie minière stratégique et des terres rares que le royaume possède en quantité. Cette coopération relève d'un impératif de sécurité nationale pour Washington et le royaume offre l'occasion aux États-Unis de réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine dans ce domaine stratégique.
Ainsi, l'Arabie saoudite, qui ambitionne dans le cadre de son programme Vision 2030 de devenir un hub mondial de traitement des minerais, offre aux États-Unis la possibilité de diversifier ses chaines d'approvisionnements. Elle a ainsi rehaussé sa cote en tant que partenaire stratégique clé. Riyad est même parvenu à s'inscrire d'ores et déjà comme partenaire économique de premier plan dans l'ère post pétrolière, alors même que durant le premier mandat Trump, âge d'or du pétrole de schiste, Riyad et Washington étaient devenus des concurrents.
Le second mandat ouvre la voie à une coopération dense, mais la pression du président Trump à maintenir bas les cours du prix du pétrole (autour de 65 dollars) alors que Riyad a construit son budget autour d'un prix moyen de 80 dollars, pourrait contrarier le rythme ambitieux des réformes économiques prévues dans le cadre de la Vision 2030.
Des difficultés à se fier à Donald Trump
Pourtant, il paraît difficile de conclure au lendemain de cette visite que l'influence régionale de Riyad puisse opérer de manière pérenne en raison du caractère transactionnel et personnel des relations qui lient le président Trump à ce jeune monarque et à ses deux homologues qatari et émirati. De même, il n'est pas certain que cette visite, présentée comme destinée à réparer et à renforcer une relation dégradée avec l'Arabie saoudite et le Golfe sous l'administration Biden, ne connaisse de revers, tant le président Trump s'est illustré par de nombreux revirements notamment sur les tarifs douaniers même avec ses alliés les plus proches (pays de l'UE, Grande-Bretagne, Canada où même le Japon).
Cependant, comme les dirigeants du Golfe l'avaient pressenti, le président Trump du fait de son imprévisibilité risque de s'avérer un interlocuteur beaucoup plus difficile à manœuvrer que son prédécesseur par le premier ministre israélien (12). Ce qui pourrait le contraindre à revoir à la baisse sa stratégie de guerre sans fin au Proche-Orient.
L'épisode de la négociation menée avec le Hamas et avec l'aide de Doha pour libérer l'otage israélo-étatsunien ou encore l'accord conclu avec les Houthis, avec la médiation omanaise, pour mettre fin aux frappes en mer Rouge sans concertation avec Tel-Aviv, conforte cette intuition des dirigeants du Golfe. C'est l'une des raisons pour lesquelles, outre les relations personnelles et d'affaires qui les lient, les dirigeants du Golfe, MBS en tête, ont affiché leur préférence de voir Donald Trump accéder à la présidence en dépit de son parti pris pro-israélien.
La montée en puissance des monarchies du Golfe dans l'économie mondialisée se combine avec une nouvelle géopolitique de la finance et de l'aide extérieure, au moment où précisément le président Trump retire les programmes de l'US Aid ce qui ouvre de nouvelles possibilités aux États du Golfe. Ces derniers ont donc intérêt à maintenir le cap de la diversification de leurs partenariats commerciaux et industriels dans un monde plus multipolaire où la compétition fait rage sur la meilleure façon de réguler l'économie mondiale.
Notes
1. « Trump et le tournant de Riyad », texte intégral du discours traduit en français, Le Grand continent, 15 mai 2025.
2. « Regional response : How Gulf monarchies leveraged Trump's visit », European Council on Foreign Relations, 21 mai 2025.
3. Anthony Samarani, « MBS-Erdoğan : la tentation d'un grand rapprochement face à Israël », L'Orient-Le-Jour, 18 mai 2025.
4. Safia Karasick Southey, « Deterrence or creep ? US forces quietly surge back to Middle East », Responsible Statecraft, 24 avril 2025.
5. Intitulé « un nouveau départ », il visait à refonder les relations de Washington avec le monde musulman, notamment après le désastre de l'intervention étatsunienne en Irak.
6. Jean-Pierre Filiu, « La stratégie séparatiste des Émirats arabes unis », Le Monde, 11 mai 2025.
7. « Trump in the Gulf, commentary on HK's Chief Executive Lee's Gulf trip, PRC delegation to Morocco, more US sanctions on Iranian oil to China », The China-MENA Newsletter, 16 mai 2025.
8. Les BRICS se composent des dix États suivants : Afrique du Sud, Brésil, Chine, Égypte, Émirats arabes unis, Éthiopie, Inde, Indonésie, Iran, Russie. L'Arabie saoudite préfère, quant à elle, maintenir son adhésion sans l'officialiser.
9. Ses membres sont la Chine, la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, l'Inde, le Pakistan, l'Iran et Bélarus.
10. Ses membres sont les Philippines, l'Indonésie, la Malaisie, Singapour, la Thaïlande, le Brunei, le Viêtnam, le Laos, le Myanmar et le Cambodge.
11. « The Inaugural ASEAN-GCC-China Summit : Economic Aspirations Amid Strategic Ambiguity », China Global South Project, 23 mai 2025.
12. Fatiha Dazi-Héni, « Riyad et l'administration Trump 2 », Institut de recherche stratégique de l'école militaire (IRSEM), 18 mars 2025.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Avec l’élection de Lee Jae-myung, la Corée du Sud espère tourner la page d’une crise majeure

Après six mois de crise politique et économique déclenchée par la tentative de coup de force du président destitué, la quatrième économie d'Asie a élu à sa tête le démocrate de centre-gauche Lee Jae-myung, avec un fort taux de participation.
Tiré d'Europe solidaire sans frontière.
Séoul (Corée du Sud).– À chaque score affiché sur l'immense écran installé devant l'Assemblée nationale sud-coréenne, les cris de joie des manifestant·es, drapé·es de bleu, la couleur du Parti démocrate (PD, progressiste), se font entendre. Alors que les pancartes s'agitent, les pourcentages défilent à la télévision, province par province, et les premiers résultats de cette élection anticipée désignent Lee Jae-myung comme président de la République de Corée.
Mercredi 4 juin, la commission électorale a confirmé la victoire du démocrate, qui, au vu de la crise politique en cours, a pris ses fonctions sans période de transition. En 2022, lors du précédent scrutin présidentiel, Lee Jae-myung avait perdu de justesse face à Yoon Suk-yeol, le président finalement destitué le 4 avril.
Cette fois, Lee Jae-myung l'a emporté avec 49,42 % des suffrages et une avance confortable de près de 10 points sur son nouveau rival conservateur, dans un scrutin qui se joue à un tour. Et ce, malgré une affaire judiciaire, certes moins retentissante que celle de Yoon Suk-yeol mais tout de même très suivie dans le pays : devant la Cour suprême, le démocrate fait en effet l'objet d'accusations pour avoir violé la loi électorale lors de la présidentielle de 2022.
Il aurait en effet menti à la télévision en déclarant ne pas connaître, alors qu'il était maire de la ville de Seongnam, un haut fonctionnaire impliqué dans un projet d'aménagement du territoire. Or, ils ont posé tous les deux sur une photo lors d'un voyage de golf à l'étranger. Après de nombreux rebondissements, le démocrate semble aujourd'hui intouchable pour cinq ans : selon la Constitution, le chef de l'État ne peut être poursuivi, excepté pour trahison ou rébellion.
Lee Jae-myung a grandi dans une famille modeste d'un village de montagne, à Andong, dans le sud-est du pays. Encore adolescent, il arrête ses études pour travailler à l'usine, un épisode de sa vie dont il a fait un argument de campagne. Finalement, Lee Jae-myung reprend ses études et exerce comme avocat des droits humains, avant d'entrer en politique puis de devenir en 2018 gouverneur de la province de Gyeonggi, la plus peuplée de Corée du Sud.
La sanction du camp conservateur
Sa victoire dans cette élection présidentielle n'a rien d'une surprise, malgré tous les efforts de Kim Moon-soo, candidat du Parti populaire du peuple (PPP, conservateur), pour renverser une dynamique défavorable.
Ces soutiens du président déchu Yoon Suk-yeol, ultraconservateurs chrétiens, pro-Trump et biberonnés aux théories complotistes qui circulent sur le YouTube d'extrême droite, affirment que Lee Jae-myung est un espion de la Corée du Nord et de la Chine et reprennent à leur compte des slogans trumpistes tel que « Stop the Steal » (« arrêtez de voler »), en référence au soi-disant « vol » de l'élection par Joe Biden en 2020.
Peu après la victoire de Donald Trump, la Maison-Blanche avait exprimé son inquiétude quant à « l'influence de la Chine dans les démocraties du monde entier », tout en soulignant que l'alliance Séoul-Washington resterait inébranlable.
Le candidat conservateur a obtenu 41,15 % des voix, tandis que celui du New Reform Party, formation mineure d'extrême droite populiste, n'a récolté que 7,7 % des suffrages, malgré le soutien important des jeunes hommes de 20 à 30 ans, séduits entre autres par son antiféminisme. Le pourcentage restant des voix exprimées correspond aux votes blancs et invalides, tandis que la participation, record, a atteint 79,4 %, le taux le plus élevé depuis vingt-huit ans.
« La plus grande erreur du PPP a été de ne pas se distancer assez des prises de position de Yoon Suk-yeol », analyse Bong Young-shik, professeur associé en sciences politiques à l'université Yonsei. Même son départ forcé du PPP n'a pas suffi. Et pour cause : Yoon Suk-yeol a plongé la Corée du Sud dans la pire crise politique depuis la fin de la dictature, en 1987.
Tard dans la nuit du 3 décembre 2024, il avait déclaré la loi martiale puis envoyé l'armée, accompagnée d'hélicoptères militaires, bloquer le Parlement alors que les député·es tentaient de s'y réunir en urgence pour voter le retrait du décret. C'est dans ce contexte que Lee Jae-myung s'est filmé dans son taxi en route pour l'Assemblée nationale, puis en train d'escalader une barrière pour entrer en douce. Ces images diffusées en direct ont été vues par de nombreux Sud-coréen·nes.
Les parlementaires avaient finalement réussi à procéder au vote grâce à l'aide de citoyen·nes qui ont tenu tête aux soldats, alors que certains avaient reçu l'ordre de tirer, d'après un rapport du parquet.
Défis institutionnels et économiques
C'est pourquoi les enjeux de cette élection étaient de taille : au lendemain de l'entrée en vigueur de la loi martiale, la monnaie nationale, le won, a fait une chute spectaculaire, inédite depuis quinze années. À la baisse de confiance des investisseurs se sont ajoutés les droits de douane imposés par l'administration Trump : + 25 % pour la Corée du Sud. Ce sont les semiconducteurs, fierté nationale, qui en pâtissent le plus.
Aussi, l'économie était au cœur de la campagne. Tandis que Lee Jae-myung proposait d'établir une task force pour faire face à la crise, et de soutenir les petits commerces, son rival Kim Moon-soo promettait d'assouplir certaines réglementations encadrant les entreprises, et de réviser la loi sur la sécurité industrielle afin d'empêcher les dirigeant·es de faire l'objet de poursuites pénales en cas d'accidents mortels sur le lieu de travail.
En quelques années, la qualité du régime démocratique s'est nettement dégradée.
Lee Jae-myung a fait du rétablissement de la démocratie sa priorité absolue, selon son premier discours le 3 juin au soir. Il faut dire que la tentative de coup de force de Yoon Suk-yeol est révélatrice d'un constat inquiétant : en quelques années, avant même cet événement spectaculaire, la qualité du régime démocratique en Corée du Sud s'est nettement dégradée.
Dans son rapport annuel, le Varieties of Democracy Institute (V-Dem) de l'université de Göteborg (Suède) classe la Corée du Sud au 47e rang sur 179 pays selon son indice de démocratie libérale, qui prend en compte la liberté et l'équité des élections, l'état des libertés civiles, d'association et d'expression, ainsi que la justice sociale. En 2019, avant l'élection de Yoon Suk-yeol, la Corée du Sud était encore 13e sur cette liste.
Lee Jae-myung appelle ainsi de ses vœux une loi martiale réformée, ainsi que la séparation des pouvoirs des procureurs qui, en Corée du Sud, peuvent à la fois inculper et enquêter. Le démocrate voudrait également changer l'unique mandat de cinq ans en possibilité de se représenter pour deux mandats de quatre ans : il assure que le bilan du chef de l'État pourrait être jugé, et celui-ci réélu ou bien désavoué.
Par le passé, beaucoup de responsables politiques ont fait des promesses similaires, mais aucun n'a amorcé de tels changements. Aussi, certains des opposants à Lee Jae-myung s'interrogent et considèrent sa volonté de réformer le mandat présidentiel comme une opportunité de s'en autoriser un deuxième, et pourquoi pas davantage, la presse d'extrême droite allant jusqu'à citer l'exemple de Vladimir Poutine.
Un alignement entre la présidence et le Parlement
Avec sa majorité acquise à l'Assemblée nationale, le président n'aura a priori pas de difficultés à mener son agenda. En effet, au Parlement, unicaméral, les démocrates ont obtenu une large victoire, avec plus de 170 sièges sur 300, aux élections d'avril 2024.
« Selon les affirmations du PPP,rapporte le docteur en sciences politiques Bong Young-shik, il n'y aura pas de pouvoirs qui se contrebalancent, et donc élire Lee Jae-myung mènerait le pays à la dictature. L'argument opposé soutient que c'est un processus nécessaire pour éliminer les vices et la corruption de l'ensemble du système. Et c'est un désir très fort exprimé par tous les Coréens, de gauche ou de droite, jeunes ou vieux. »
Mais dans cette campagne éclair de trois semaines, bien des sujets ont été mis de côté : ainsi, les questions de genre ont été quasi absentes des débats. Pourtant, la Corée du Sud abrite, et de loin, le pire écart de salaires de l'OCDE avec 29,3 % de différence entre femmes et hommes, en 2023. Le poste laissé vacant de la ministre de l'égalité, des genres et de la famille, qui a démissionné en février 2024, témoignait des desseins de l'ancien président.
Ouvertement antiféministe, Yoon Suk-yeol avait fait de l'abolition de ce ministère une promesse de campagne. Wooyeal Paik, professeur en sciences politiques de l'université Yonsei, compare les positions sur la question : « Lee Jae-myung a déclaré qu'il améliorerait les droits des deux genres, quoi que cela signifie, et se concentrerait sur la défense des droits des femmes. Mais les autres candidats, comme Kim Moon-soo, n'en ont pas touché mot, sûrement pour des raisons liées à leurs bases électorales. »
La tâche principale de Lee Jae-myung et de son gouvernement reste de restaurer la confiance populaire dans les institutions. Une gageure, dans un contexte où les affaires judiciaires minent l'image des responsables politiques depuis de longues années.
Camille Ruiz
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« Massacre des affamés » : les forces israéliennes tuent 31 Palestiniens dans un centre de distribution d’aide humanitaire

Un centre d'aide humanitaire géré par les États-Unis a été le théâtre d'un nouveau massacre dans le sud de Gaza après que les forces israéliennes ont ouvert le feu sur des civils. « Les Américains et les Israéliens nous ont tendu un énorme piège pour nous attirer ici et nous tuer », a déclaré un témoin oculaire à Mondoweiss.
Tiré de Agence Médias Palestine
2 juin 2025
Par Tareq S. Hajjaj
Point de distribution d'aide humanitaire géré par la Fondation humanitaire de Gaza à al-Bureij, dans le centre de Gaza, le 29 mai 2025. (Photo : Moiz Salhi/APA Images)
Dimanche matin à l'aube, des Palestiniens du sud de Gaza se sont rendus au point de distribution d'aide humanitaire de Rafah géré par le Fonds humanitaire pour Gaza (GHF), l'organisme américain chargé de fournir l'aide aux Palestiniens à la place de l'ONU. Selon des témoins oculaires qui se sont entretenus avec Mondoweiss, lorsque des milliers de personnes en quête d'aide sont arrivées dans le quartier d'al-Alam, dans le quartier de Tal al-Sultan à Rafah, l'armée israélienne a ouvert le feu sur la foule.
Alors que de nombreuses personnes patientaient devant le site d'aide humanitaire tôt le matin, attendant les instructions des employés américains, des témoins oculaires rapportent qu'un drone israélien survolait la zone et leur ordonnait via haut-parleur d'entrer dans le périmètre clôturé à 6 heures du matin.
Après que des centaines de personnes aient pénétré dans l'enceinte, les soldats ont ouvert le feu sur la foule, tuant 31 personnes et en blessant 200 autres avec des balles réelles, a déclaré dimanche le ministère de la Santé de Gaza dans un communiqué.
« Tous les martyrs arrivés à l'hôpital n'avaient qu'une seule blessure par balle à la tête ou à la poitrine », indique le ministère de la Santé. « Cela confirme l'intention de l'occupant de tuer des civils. »
Le directeur des hôpitaux de Gaza, Muhammad Zaqout, a déclaré lors d'une conférence de presse devant l'hôpital Nasser de Khan Younis que les blessés étaient arrivés au centre médical dans des charrettes tirées par des animaux ou portés sur les épaules des gens, l'armée israélienne ayant empêché les ambulances d'atteindre le site d'aide.
L'armée israélienne nie que des soldats aient tiré sur des civils dans le centre, qualifiant ces allégations de « fausses informations ». Le GHF a également niéces informations, les qualifiant de « complètement fausses et fabriquées », et a publié des images de vidéosurveillance de la distribution d'aide à Rafah comme preuve apparente que la journée s'était déroulée « sans incident ».
La semaine dernière, trois personnes ont été tuéesau centre de distribution d'aide géré par le GHF à al-Bureij, au nord de l'axe Netzarim, et sept autres ont été portées disparues à la suite des troubles qui ont éclaté la semaine dernière dans le site sud du GHF à Rafah. Aujourd'hui, 2 juin, l'armée israélienne a tué trois autres personnes sur le site du GHF à al-Bureij.
« Les Américains et les Israéliens nous ont tendu un piège »
Ahmed Abu Libdeh, 28 ans, est arrivé au centre de distribution d'aide à Rafah à 5 heures du matin en provenance de l'est de Khan Younis. Au lieu de recevoir de la nourriture, il a été témoin de ce qu'il décrit comme « l'un des massacres les plus horribles perpétrés par l'armée [israélienne] » à Rafah.
« Nous étions debout à l'extérieur du centre de distribution », a déclaré Abu Libdeh à Mondoweiss. « Vers 6 heures du matin, un quadricoptère a survolé le site et a annoncé par haut-parleur que l'endroit était sûr et que nous pouvions entrer pour récupérer la nourriture. »
« Le haut-parleur du quadricoptère disait : « Marchez, vous êtes en sécurité. Nous vous distribuerons l'aide dans quelques instants » », a ajouté Abu Libdeh, précisant qu'après l'arrivée de l'aide, « ils ont commencé à nous bombarder et à nous tuer ».
« Dès que nous sommes entrés dans le centre de distribution et avons commencé à transporter les vivres, l'armée israélienne a ouvert le feu », a-t-il expliqué. « La scène était horrible. Nous ne voyions rien à cause de la poussière, des bombardements et des tirs nourris dirigés contre nous. Des dizaines de personnes ont été tuées. »
Abu Libdeh précise que la première frappe a eu lieu vers 6 h 15, lorsqu'un premier bombardement a visé une voiture remplie de personnes qui avaient reçu de la nourriture et quittaient la zone. « Après le bombardement de la voiture, les chars ont ouvert le feu sur nous », a-t-il décrit.
Ahmad décrit les premières minutes comme « un choc pour tout le monde », rappellant qu'ils étaient entrés sur le site de distribution conformément aux instructions de l'armée israélienne. « Nous ne savions pas d'où venaient les bombardements ni qui les lançait. La poussière envahissait la zone et les gens couraient sans savoir ce qui se passait. Des gens tombaient dans la bousculade et j'ai vu des dizaines de personnes gisant sur le sol, en sang. Ils sont tous morts parce que personne ne pouvait les sauver. »
« Les Américains et les Israéliens nous ont tendu un énorme piège en nous attirant ici pour nous tuer par dizaines », a conclu Abu Libdeh. « Nous ne voulons pas de l'aide des États-Unis. Nous voulons que la guerre cesse et la fin de la famine. »
Le massacre de dimanche a conduit de nombreux Palestiniens de Gaza à conclure que l'objectif du GHF n'est pas de distribuer de la nourriture à la population, mais d'aider et de soutenir l'armée israélienne dans son objectif d'« exterminer » les Palestiniens.
Arafat, 49 ans, qui a préféré ne pas donner son nom de famille, apparaît assis à l'hôpital Nasser avec un petit enfant sur les genoux dans un témoignage vidéo pour Mondoweiss. Tous deux pleurent, tandis qu'Arafat sanglote pour son frère, qui, selon lui, a été tué par l'armée israélienne à Rafah alors qu'il cherchait de la nourriture pour sa famille.
« Pourquoi nous disent-ils d'aller chercher de la nourriture pour nous tuer une fois sur place ? », demande Arafat. « Ce sont des menteurs. Ils nous mentent et mentent au monde entier. Les Américains conspirent avec les Israéliens pour nous tuer. Ils ont tué mon frère parce qu'il était parti chercher de la nourriture pour sa famille. » Arafat explique que l'enfant assis sur ses genoux est son neveu.
« Ils ont créé un endroit où nous pouvons être tués de sang froid », a poursuivi Arafat. « Ils ne devraient pas dire que c'est une zone humanitaire. C'est un piège et un massacre des affamés. »
Arafat note que certaines personnes faisaient la queue près du point de distribution depuis 23 heures la veille. « Le résultat, c'est que nous recevons la mort au lieu de nourriture », dit-il. « Nous ne voulons pas de l'aide de l'Amérique. Nous ne voulons pas de la nourriture de l'Amérique. Si l'Amérique veut nous aider, comme elle le prétend, qu'elle arrête la guerre. Nous ne voulons rien d'autre d'elle. »
Traduction : JB pour l'Agence Média Palestine
Source : Mondoweiss
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Gaza. Ceux qui ont épaulé le génocide

Dans son dernier ouvrage, Pascal Boniface, fondateur et directeur de l'Institut des relations internationales et stratégiques (IRIS), démontre combien l'impuissance du droit international à arrêter la guerre contre Gaza tient à la complicité des pays et des politiques occidentaux et à la complaisance des médias mainstream, notamment en France.
Tiré de orientxxi
5 juin 2025
Par Jean-Michel Morel
Droit international Gaza 2023-2025 Bande de Gaza France Génocide Israël Liberté d'expression Médias Palestine
Des corps enveloppés de bleu sont placés dans une fosse, entourés de personnes en deuil.
Khan Younès, le 22 novembre 2023. Des Palestiniens enterrent des corps dans une fosse commune du cimetière de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza. Les dépouilles, qui ne portaient que des numéros, provenaient de l'hôpital indonésien et de l'hôpital Al-Shifa, dans le nord de la bande de Gaza, selon les membres du comité présents sur le lieu de l'enterrement.
Mahmud HAMS / AFP
Couverture de livre avec fond coloré et titre en gras sur le conflit à Gaza.
Permis de tuer Gaza : Génocide, négationnisme et Hasbara
Pascal Boniface
Éditions Max Milo, 2025
283 pages
21,90 euros
Premier rappel salutaire dans le livre de Pascal Boniface, Permis de tuer, le fait que tout n'a pas commencé le 7 octobre 2023. Depuis 1967, « la colonisation de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est est illégale. L'annexion de Jérusalem-Est est illégale. Le blocus de Gaza est illégal ». La guerre à Gaza est le dernier exemple en date de cette violation par Israël du droit international au prétexte récurrent que son existence est en jeu.
Même si la décision de la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale (CPI) de délivrer un mandat d'arrêt contre Benyamin Nétanyahou et Yoav Gallant, son ex-ministre de la Défense, a pu donner l'impression que la justice internationale s'emparait du dossier, depuis rien n'a changé. Les crimes de guerre comme les crimes contre l'humanité se sont poursuivis et intensifiés ; un génocide est en cours.
Cette incapacité à agir efficacement pour mettre un terme aux massacres se reflète à l'ONU où, avertit Boniface, « les choses sont simples. Dans la grande majorité des cas, les résolutions obligatoires qui exigent quelque chose d'Israël sont bloquées par un veto des États-Unis. »
« Amnesty International, Human Rights Watch… Quand l'humanitaire fait le jeu du Hamas »
Aux côtés des juridictions internationales, des ONG humanitaires se sont employées à dénoncer « un piège mortel » pour les Palestiniens (1). Un constat qui, très rapidement, après le déclenchement de la guerre par Israël, est devenu une évidence dès lors que les morts et blessés se sont accumulés et que, progressivement, la famine s'est installée. Une réalité que les médias ont mis des mois à accepter, et encore de manière timide et sans jamais remettre en cause le récit qu'ils avaient propagédepuis le 7 octobre 2023. Mais il y a encore Franc-Tireur qui, dans son édition du 24 janvier 2024, a débusqué les vrais coupables : « ONG au service du pire : Amnesty International, Human Rights Watch… Quand l'humanitaire fait le jeu du Hamas. »
Titre en haut, image d'une bougie sur fond noir, message sur ONG et humanitaire.
Cette partialité dans la prise en compte de la « destruction directe de la population palestinienne » (Amnesty International) s'examine au trébuchet de ce que pèse la guerre russo-ukrainienne dans les discours de la plupart des politiciens et des médias où l'agresseur est, à juste titre, vilipendé. A contrario, les massacres perpétrés par l'armée israélienne sont le plus souvent minorés ou justifiés en recourant à l'argument qui voudrait que dans chaque hôpital rasé, dans chaque école bombardée, dans chaque maison détruite, se sont réfugiés des « terroristes » du Hamas. Ce que, le 18 janvier 2024, s'est évertué à justifier Isaac Herzog, le président d'Israël, au Forum de Davos : « Sous chaque matelas de n'importe quelle maison à Gaza, il y a une roquette. »
Cette approche du conflit repose sur ce que Pascal Boniface appelle « un biais médiatique occidentaliste ». Il est illustré par le positionnement d'Israël, membre revendiqué de l'Occident depuis sa fondation en 1948, choix confirmé par les assertions sans ambiguïté de son actuel premier ministre : « Nous faisons partie de la culture européenne… L'Europe se termine en Israël (2) », ou bien encore, en décembre 2024, lors de ses vœux aux communautés chrétiennes en Israël : « Israël mène le monde dans le combat contre les forces du mal et de la tyrannie… ».
Un occidentalo-centrisme guerrier
Une phraséologie qui, en Occident, nourrit inévitablement l'islamophobie et le fameux « concept » d'islamo-gauchisme. Une façon, nous dit Pascal Boniface, d'assimiler l'islam à une menace terroriste, interdisant de critiquer Israël « comme un pays qui occupe une terre qui n'est pas la sienne et réprime dans le sang un peuple qui ne veut pas se soumettre, mais devient la pointe avancée de la guerre contre le terrorisme ».
Le 6 octobre 2024, Pascal Praud, le présentateur vedette de CNews, propriété du milliardaire catholique intégriste Vincent Bolloré, ce laboratoire de la désinformation, a relayé cette logique dans le JDD (propriété du même milliardaire) : « Le 7 octobre a changé ma vie. Je devinais depuis quelque temps : le monde arabo-musulman a déclaré la guerre à l'Occident. Israël est un rempart. » Un occidentalo-centrisme guerrier qui s'accompagne de l'inévitable rappel à l'Holocauste convoqué pour culpabiliser les opposants au conflit et clore toute discussion sur les agissements meurtriers d'Israël.
Pascal Boniface cite un expert de cette rhétorique en la personne d'Alain Finkielkraut, qui, le 24 octobre 2024, dans l'émission Le Club Idée du FigaroTV, lance :
Quoi qu'on pense de la riposte israélienne, le mot génocide est fou, ignoble. Il permet de nazifier les Juifs, de leur faire perdre leur crédit victimaire et ainsi de les faire basculer dans le camp des bourreaux.
Pas sûr que les 6 millions de juifs assassinés lors de la Seconde guerre mondiale envisageaient leur martyre sous forme de « crédit victimaire » dont pourrait se réclamer Israël.
Dans un chapitre bienvenu, l'essayiste s'attarde sur le rôle néfaste du lobby pro-israélien. Il dénonce son implication dans la politique intérieure française :
Le lobby pro-israélien s'est montré hyper efficace pour affaiblir le soutien diplomatique de la France à la cause palestinienne, influencer la classe politique française en faveur du gouvernement israélien, créer une solidarité entre des personnes ayant les mêmes appréciations du conflit, et limiter au maximum la capacité d'expression de ceux qui ne pensent pas comme eux.
Institution agissante du lobby, le Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF) mène le combat de l'assimilation entre antisionisme et antisémitisme. Il trouve des alliés dans la droite, parfois à gauche et dans la macronie à l'exemple d'Aurore Bergé, actuelle ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, qui, le 13 février 2025, lors des Assises contre l'antisémitisme a déclaré : « L'antisionisme, la haine décomplexée d'Israël sont les nouveaux visages de l'antisémitisme. »
Un maccarthysme rampant
Boniface donne à comprendre ce combat comme étant d'abord celui de Nétanyahou qui « a réussi à imposer ce slogan creux dans le débat français, qui sert d'arme de dissuasion massive à toute critique de la politique israélienne à l'égard des Palestiniens et des territoires occupés ».
Chercheur, il fait aussi état de ce maccarthysme rampant qui sévit dans les médias refusant de l'inviter ou de ces campagnes de dénigrement dont il est l'objet ou bien encore de son éviction de la manifestation — qu'il a créée — « Les Géopolitiques de Nantes » par la maire socialiste, Johanna Rolland. « La ville de Nantes, écrit-il, est l'une des rares grandes métropoles à n'avoir toujours pas entamé en 2024 d'action de coopération décentralisée avec une collectivité palestinienne. » Ceci expliquant sans doute cela.
L'auteur veut espérer que « l'histoire sera sévère pour ceux qui sont restés muets face à l'indicible ». Lui ne fait pas partie des adeptes de la cécité volontaire, ni des repentis de la 25e heure, ceux qui s'aperçoivent avec retard que leur « soutien inconditionnel à Israël » les a précipités dans un abîme d'insalubrité morale.
Note
1. Le 1er juin 2025, le chef de l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), Philippe Lazzarin, a indiqué sur X que la distribution d'aide humanitaire à Gaza était devenue un « piège mortel »
2. Pascal Boniface citant Sophie Bessis dans La civilisation judéo-chrétienne, anatomie d'une imposture, Les Liens qui libèrent, 2025.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Gaza, jour 606 : 102 Palestiniens assassinés dans les « pièges mortels » des nouveaux centres humanitaires

Point sur la situation à Gaza, où Israël assassine les Palestinien-nes jusque dans les centres de distributions alimentaires, tout en poursuivant ses opérations de déplacement forcé de la population.
Tiré de Agence Médias Palestine
3 juin 2025
Par l'Agence Média Palestine
Depuis une semaine, le Fonds Humanitaire pour Gaza (GHF), soutenu par les État-Unis, est mandaté par Israël pour contrôler les distributions d'aide alimentaire à la place des organisations locales et internationales (dont l'ONU) en place jusqu'ici, après plus de deux mois de blocage total des livraisons de ces dernières et la destruction systématique depuis 18 mois des infrastructures qui permettaient une forme d'autonomie alimentaire aux Gazaoui-es, assiégé-es depuis 17 ans par Israël.
Ces nouvelles« distributions alimentaires » sont le théâtre de scènes de chaos, de massacres et d'enlèvements. Selon un communiqué du bureau des médias de Gaza publié ce mardi 3 juin au matin, au moins 102 Palestinien-nes ont été assassiné-es dans ou à proximité de ces centres en une semaine, et plus de 500 autres ont été blessé-es. Le ministère dénonce ces centres qu'il décrit comme des « pièges » dans lesquels Israël attire les Gazaoui-es qu'il a précédemment affamé-espour les tuer.
« Ces soi-disant centres d'aide sont situés dans des zones exposées et à haut risque contrôlées par les forces d'occupation », a déclaré le bureau. « Ils sont devenus des pièges mortels. Les civils affamés sont attirés par la faim et le siège, puis froidement pris pour cible et abattus. » Qualifiant les tirs de calculés et s'inscrivant dans un plan plus large, le bureau a déclaré que ces scènes reflétaient « la cruauté derrière cette opération et révélaient ses véritables intentions ».
« Hunger Games dans la vie réelle »
« Un nouveau massacre commis par l'occupation israélienne, visant des points de distribution d'aide supervisés par les États-Unis à Gaza, faisant des martyrs et des dizaines de civils blessés #WitkoffMassacre », écrivait dimanche Ramy Abdul, responsable de l'organisation de surveillance des droits humains Euro-Med, dans un message publié sur X.
Des témoins oculaires interrogés par Euro-Med ont rapporté que des quadricoptères et des chars israéliens ont ouvert le feu sur les personnes qui attendaient de recevoir de la nourriture sur le site de Rafah vers 6 heures du matin dimanche. « Les forces d'occupation ont commencé à bombarder la zone sans discernement, transformant la scène en un horrible massacre. Au même moment, les forces de sécurité américaines ont tiré des gaz lacrymogènes sur les personnes à l'arrière pour les disperser et les tenir à distance », ont déclaré les survivant-es. Plus de 32 personnes ont été tuées dans ce massacre dimanche.
« Ces Hunger Games de la vie réelle doivent cesser, un nouveau cessez-le-feu doit être déclaré et Israël doit autoriser l'accès à tous les points de passage au système humanitaire mondial normal », a réagit Jan Egeland, directeur du Conseil norvégien pour les réfugiés, sur son compte X.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exigé qu'une enquête soit ouverte. Jeremy Konyndyk, président de Refugees International, a qualifié le détournement par Israël du système d'aide à Gaza d'« effroyable, indéfendable et criminel ». « Le gouvernement israélien utilise l'aide comme une arme et toutes les personnes impliquées dans le GHF se rendent complices de crimes de guerre », a-t-il écrit sur X. « Mettons fin à cela. »
Nettoyage ethnique
L'ONU et les organisations humanitaires affirment que le GHF ne respecte pas les principes humanitaires, l'accusant d'utiliser l'aide à des fins militaires et avertissant que cela pourrait servir à dépeupler le nord de Gaza, comme le prévoit l'armée israélienne. Car outre les atrocités qui s'y déroulent, les centres de distribution du GHF sont aussi stratégiquement situées afin de participer au déplacement des milliers de Palestinien-nes du Nord de Gaza.
Trois des sites de distribution du GHF se trouvent à Rafah, dans des zones où l'armée israélienne a émis des avertissements d'évacuation. Le quatrième site est situé dans la ville de Gaza, près de la frontière avec Deir el-Balah, où des centaines de milliers de Palestiniens déplacés ont trouvé refuge. Aucun des points de distribution n'est situé au nord du corridor de Netzarim. Tous sont situés dans des zones qui ont été entièrement rasées par l'armée israélienne au cours des 18 derniers mois.
Les Palestinien-nes, affamé-es depuis plus de trois mois par le blocus israélien, doivent parcourir à pied ou sur des chariots tirés par des animaux les distances conséquentes pour se rendre dans les centres, alors qu'il n'y a plus de carburant. L'emplacement des centres vise donc à servir d'incitatif au déplacement vers le sud.
Depuis la rupture par Israël du cessez-le-feu le 18 mars dernier, l'armée israélienne a émis des ordres d'évacuation et/ou placé sous contrôle militaire 81% de l'enclave palestinienne, selon le dernier relevé de l'OCHA. 2,3 millions d'habitants de Gaza sont entassés sur une bande de terre de plus en plus réduite dans le sud de Gaza, près de la frontière égyptienne.
Israël cache peu son objectif de déplacer définitivement la population de Gaza, les responsables promouvant ouvertement des plans de « migration volontaire ». Une enquête du Financial Times rapporte que les zones vers lesquelles les Palestiniens sont poussés ressemblent à un « désert aride, sans eau courante, sans électricité et sans hôpitaux ».
Des images satellites montrent les forces israéliennes en train de déblayer des terrains et d'installer des infrastructures militaires dans les zones évacuées. Examinant des dizaines d'ordres d'évacuation forcée récents, l'analyste politique Xavier Abu Eid déclare : « Le gouvernement israélien a été très clair quant à son plan pour Gaza. Il s'agit d'un nettoyage ethnique. »
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les 30 ans de la marche _Du pain et des roses _célébrés à Québec : un appel à continuer la lutte

Québec, le 8 juin 2025 – Près de 2000 personnes se sont rassemblées hier dans les rues de Québec pour souligner les luttes féministes, 30 ans après la marche Du pain et des roses.
Du Musée des Beaux-Arts du Québec, jusqu'à l'Assemblée nationale, à l'image de la marche s'y étant conclue le 4 juin 1995, les marcheuses et les marcheurs se sont ensuite dirigés à la Place George V. Sous le thème Marchons pour _Du pain et des roses, _encore et plus que jamais, les chants, les slogans et les diverses prises de paroles ont rappelé les revendications de 1995 et leur actualisation dans le contexte de 2025, permettant de faire le point sur les luttes féministes pour combattre la pauvreté [1] dont les femmes sont les premières victimes.
L'événement du 7 juin [2] concluait une série de marches locales débutées le 26 mai, [3] réalisées dans 12 régions du Québec, par 25 organismes du mouvement féministe, communautaire et syndical, avec la collaboration d'une trentaine d'autres organisations de leurs réseaux. Environ 1200 personnes ont participé à ces marches parcourant 5550 km au total, en hommage au trajet de 1995.
« Les actions organisées autour du 30e anniversaire de la marche « Du pain et des roses », et surtout, la ferveur avec laquelle les revendications féministes ont été porté aujourd'hui, sont de bon augure pour la suite du mouvement » souligne Sylvie St-Amand, présidente de la Fédération des femmes du Québec et co-porte-parole des actions de Marchons pour _Du pain et des roses, _encore et plus que jamais.
« La marche de 95 nous a appris que même, et peut être surtout dans des moments difficiles, il ne faut pas baisser les bras. C'est justement le moment de se mobiliser quelle que soit la manière ! » lance Françoise David, porte-parole de l'événement et présidente de la Fédération des femmes du Québec en 1995.
Un rosier symbolique a été remis à la présidente de l'Assemblée nationale, madame Nathalie Roy, laquelle a indiqué souhaiter le mettre en terre à proximité du monument soulignant la lutte des suffragettes, sur le terrain de l'Assemblée nationale. Mesdames Ariane Émond, Michèle Rouleau, Marie-José Turcotte et Marjorie Villefranche, marraines [4] de la marche en 1995, étaient présentes, en compagnie de mesdames Arcelle Appolon, Florence-Agathe Dubé-Moreau, Melissa Mollen-Dupuis et Adina Ungureanu, co-marraines [4]pour les actions de 2025.
La marche s'est conclue par une invitation à un grand rassemblement organisé par la Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes [5], à Québec le 18 octobre prochain, dans le cadre de la 6e édition de cette marche internationale, issue de celle de 1995.
À propos
À compter du 26 mai 2025, des marches locales et divers événements ont été réalisés par 25 organisations du mouvement féministe, communautaire et syndical ; environ 1200 personnes ont parcouru un total de 5550 km : Centrale des syndicats du Québec, [10] à Saint-Sauveur, le 28 mai ; Centre de femmes l'Essentielle [11] à Beloeil, le 3 juin ; Centre de femmes les Elles du Nord [12] à Chibougamau, le 5 juin ; Centre des femmes Centr'Elles [13] à Carleton, du 26 mai au 4 juin ; Centre des femmes de Longueuil [14], les 27 et 28 mai et les 3 et 4 juin ; Centre des femmes de Memphrémagog [15], le 29 mai ; Centre d'organisation mauricien de services et d'éducation populaire ( [16]COMSEP), le 26 mai ; Coalition montréalaise
de la Marche mondiale des femmes [17] (CMMMF) et ses groupes membres, le 29 mai ; Collective citoyenne Pas Une de Plus [18], le 4 juin ; Comité Action Féministe d'Unifor Québec [19], 7 juin – vers le rassemblement ; Comité régional Saguenay-Lac-Saint-Jean de la Marche mondiale des femmes [20] et ses groupes membres, le 5 juin ; Conseil central du Montréal métropolitain - CSN, [21] le 29 mai ; Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec [22] (FTQ), le 3 juin ; Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec [23] (FIQ), les 3 et 5 juin ; Groupes locataires de Maison pour la santé durable [24], du 26 mai au 4 juin ; L'R des centres de femmes du Québec [25] et ses groupes membres, du 26 mai au 4 juin ;
Regroupement des groupes de femmes de la Capitale nationale [26] (RGF-CN) et ses groupes membres, organisation du rassemblement du 7 juin. ; Réseau d'action pour l'égalité des femmes immigrées et racisées du Québec [27] (RAFIQ), le 5 juin ; Réseau des tables régionales de groupes de femmes du Québec [28] (RTRGFQ) et ses groupes membres, du 26 mai au 4 juin ; ROSE du Nord, [29] le 4 juin ; Syndicat des cols bleus Montréal [30] (SCFP301), du 26 au 30 mai ; Table de concertation de Laval en condition féminine [31] (TCLCF) et ses groupes membres, le 4 juin ; Table de concertation des groupes de femmes de Lanaudière [32] (TCGFL) et ses groupes membres, le 4 juin ; Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec (TCMFCQ) [33] et ses groupes membres, du 26 au 4 juin ; Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie [34] (TCMFM) et ses groupes membres, du 26 mai au 4 juin.
Personnes ayant pris la parole le 7 juin 2025 (ordre d'apparition)[1] : Françoise David, présidente de la FFQ en 1995 ; Chantal Locat, marcheuse en 1995 ; Michèle Rouleau, militante pour les droits des Premières Nations et marraine de 1995 ; Melissa Mollen-Dupuis, militante Innu et co-marraine des actions de 2025 ; Lise Fournier, marcheuse en 1995 et comité d'organisation de l'événement en 2025 ; Nathalie Roy, présidente de l'Assemblée nationales ; Diane Matte, coordonnatrice de la marche en
1995 ; Marjorie Villefranche, marraine de 1995, Maison d'Haïti ; Adina Ungureanu, Collectif des femmes immigrantes du Québec et co-marraine des actions de 2025 ; Marie Eve Brunet et Johanne Gagnon, Collectif pour un Québec sans pauvreté ; Sylvie St-Amand, présidente de la FFQ ; Mercédez Roberge, travailleuse pour la marche en 1995 et comité d'organisation de
l'événement en 2025 ; Émilia Castro, Pénélope Guay et Julie Antoine, porte-paroles de la Coordination du Québec pour la marche mondiale des femmes.
Des marraines et des co-marraines engagées : En prélude aux activités, une lettre ouverte est parue dans La Presse [35], sous la signature des marraines de la marche de 1995 et de courtes capsules vidéos [36], réunissant ces dernières et des co-marraines des événements de 2025, ont été diffusées par les médias sociaux [37].
Marraines de 1995, de nouveau présentes en 2025 : Aoura Bizzarri, fondatrice du Collectif des femmes immigrantes du Québec ; France Castel, chanteuse et comédienne ; Ariane Émond, journaliste indépendante et animatrice ; Ranee Lee, chanteuse, musicienne et professeure de jazz à l'Université McGill ; l'honorable Chantal Petitclerc, sénatrice,
médaillée paralympienne, Michèle Rouleau, militante pour les droits des Premières Nations ; Marie-Claire Séguin, autrice, compositrice, interprète, coach vocal et artiste peintre ; Marie-José Turcotte, communicatrice et guide de randonnée, ex journaliste-animatrice et cheffe d'antenne à Radio-Canada ; Marjorie Villefranche, ex directrice générale
de la Maison d'Haïti.
Leurs co-marraines pour les actions de 2025 : Arcelle Appolon, directrice de la Maison d'Haïti ; France Beaudoin, animatrice et productrice, Léa Clermont-Dion, autrice et réalisatrice, récipiendaire du prix Hélène Pedneault ; Marion Cousineau autrice, compositrice et interprète ; Florence-Agathe Dubé-Moreau, commissaire indépendante en art contemporain, autrice de « Hors jeu » et récipiendaire du prix littéraire de la Gouverneure-Générale ; Melissa Mollen-Dupuis, militante Innu ; Adina Ungureanu, directrice du Collectif des femmes immigrantes du Québec ; et Ariane Vaillancourt autrice compositrice et interprète.
« Marchons pour [38]_Du pain et des roses, encor [38]_e et plus que jamais » [38] est organisé par la Fédération des femmes du Québec [39], en collaboration avec la Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes [5]. Les marches locales du 26 mai au 4 juin 2025 sont réalisées par des organisations autonomes et celle du 7 juin à Québec est organisée grâce à la contribution du Regroupement des groupes de femmes de la Capitale-Nationale [26].
La Marche des femmes contre la pauvreté « Du pain et des roses » [40] a eu lieu du 26 mai au 4 juin 1995, à l'initiative de la Fédération des Femmes du Québec, avec la collaboration d'un grand nombre d'organisations. Plus de 850 femmes ont marché pendant 10 jours en direction de l'Assemblée nationale. Plus de 18 000 personnes les y attendaient, pour entendre le gouvernement de l'époque répondre à leurs revendications contre la pauvreté.
Liens
[1] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwszEuO6yAQheHVwAyLN1UDBpl4GxGmihhd5wW-WX8rrZ5-R-enbKF6HSVnkzw6jM55uWdM2mPbaqvGBEBoEBtY9mgZw0ZJ9hzBh7KFhuRQXw0lEzWYlFAHY4TXsxP_6291L_3gMVWErWIAIFT7OEJbvoM88n6eryncRdhV2LW19_KuSy3CroM__KBey9mfj6kMYlBW2yDsKu9MvajBB5fJqlP-hesfCHcx2ngT5ciDqdRvQXj9Gjwn38r_uvPyHDc5z8F8__4Doyebkiq1kPJQmwKyTelNg9HeO4tafrL9CQAA__9BwFvQ
[2] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwsy02yqyAQQOHVwAyrgeZvwCATt5FCuo28p0lEzfpv5dadfqcOZRMrgpecdcBkk7cW5ZKDJQgGESs5U0zRibwGzck6X8GDbNlHdGVycyKb4K4paA9Rh5DAaS0Qjkb8v-1qK23lfigfp5pcjJTU0lc3D98g17yc5_sQ9ibMKMw4z_uw16EWYcat9LqwoksF9e9qT2XAOLVfPHEVZvzIjakV1XnlcrBqlH_h_gfC3jRo1F723JlKPdvrKRDenY-DH-WqCw-v_pDH2Zm37-84IZkQVKmFFMY6q0hmVjBB1IBoTQL5yeYnAAD__2DVXPk
[3] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwszT2S3CAQxfHTQNZTfDQIAoJN5hpbPXSzwtasdkCawKd3yeX0_-rVj4tLFU3UUuyC2efoPeq1GB9zqxFDzJSic5Ux5wdFQWKkpeleYsJAj9Ay-2w-LS82mmSXJZtgrUIzO8vv_oIn9U3GhJgeNYeUOMM6ttBu16C3sh7Hz1T-Q7m7cvfWXrdXvVVS7s4y4UmjrjJh2yttMuFnyAQWqKv8gfd-TuATXLwUoBMQfp39G5xxQbm7fgp3giGb0BToXP6Fz_9B-Q9rLNqoRxnCVI--fys0lzHli866ym0fX3oeQ-R5_YNkZLcsQJUYMNUGiV0D8zDJGkTvstHv4v4GAAD__8vzaVY
[4] https://us.cisionone.cision.com/c/eJxMjTly3TAQBU8DZPML-xIgUPKvoRoCAxE2V4D0-V2UHSib6n5dU5IK2QjHKUlvoo5Oa8Pn5Jybqg82h5Ar6hC1MdpmL4uPshjNW3LBWJxsjUVH8SmLl04E6X0UVkpmxGiFfrcTVmwL9QEuTDnaEEqEuS-2vh7BlzRf1zGY_mDqzdS71vN15ldGpt4LDVixd2wbDSgEMkYLdMEj8v5TDcB8tX37nq3Y8_zcx353KDcc2Lane3Z9HzSAtrx3etix3APOm-AXrtgGU2--UmkInRbCQdBK-gaf_wHTH1JIIx3vqVP595cZcXQag77wzjO99v7Fx9WJ1qe3FE1R3gNmLGBCrhCKqiAmEaQwRqso-J-k_gYAAP__x-1-Rg
[5] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwszDFywyAQheHTQIdnFxYEBYUbX8OD2JXFRIptUOLrZ5yk_d98j7ONlSBoyThRcik4R3rNxJ4wWOIgYZ6DCJRKbmEU8XOVqlsOkXyZ_ZLYJbgiTxgg4jQl8IiKYDSWj_Y0e2mb9GFCnGvyMXIya9_8cnoPesvrcTyGcmdlL8peXq_XqT73fTnd-03ZSxBT6tHun8aC9XoXbsV02aQMMY3zb7j-B-XOCEgYdM9d-A8qgkeXMeRWvuoq7189ji6yv72XRGynyZRa2FCsi4lsFwMzRAQiZxPo72x_AgAA__8_5Vpy
[6] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwsy0tuwyAUheHVwAyL92PAIFLkBXQDEXCvYxQ7pOA0269cdfqd80OUvmhuKUbhdFDBKqXpGrOCggYl95glZo-2GC0l-MyFM0HSGq3XJmWzBFCB3wQ4YbkXzgVuhCCajwr4qN9sT3XDPpj1uQTjPQS29s0s0znQLa7H8RpEXYiciZw_n8-0pIK5tcdU2k7kfH2_Un3iATh6GzhECOY8q3lrJW1I1HXpt_mL7gg1sY4bpoGsQvyD2z8QdRFcaGFpjx0hlaO2J9H81XEMvKd3WXFq_U7H0RH3szcYNEjnWCoJmPZlYR7kwnjmXnCtlQyc_kT5GwAA__8EJWQo
[7] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwsy81u6yAQQOGnMTuiYRgMs2ARKdfr275AhGEcozo_BadS375K1e13dErEkAlGJdF4YsujtaTWmH1CZrN4YLQlk1kykJ8degyQCVWNYyCXZrdwsQxnU7wZIRjvGZwxA0GvRT7qp76muknregxzZhdCYb22zS2HV1BbXPf90Qd7HHAacJrrfti-B5xOz_-p3v7tJ-nv9y5dT9ObNsxOI6BTVyk16SabpC66lvgL5z8Y7NGAITOqFpuUlPd6vw0Ejya9yyU98yqHe7uovjeR6-t3wlTQe51yKppCXnQouGiYIRggssigviL-BAAA__-cXFsX
[8] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwsi02O6yAQBk8DO6ymaf4WLCJFvkaEoR1bsZ_zwDPR3H6UaHaf6quqCUMhcJKT9hRNdMaQXBLGinVCiox-9mTDpCMUx568t5MLck0ukM2TnWM1EW66eu0gaO8jWK0FQV8rP9b_as_rxq0rF6YSbQg1qqVtdh7eh9zScp7PLsxF4ChwfL1ew5wLT8fxGMqxCxx3rmsWOHY-3475DHPNgwHQjgDA-egtEAp058-Thbka-alU441zZ7XW9AG3PyDMRYMm7WRLjWsu53r8EwTPxr3zPX-VhYej3WU_G_P-7i1Hqui9yiVXRaHMKlScFUwQNBAZjCC_E_4GAAD__1iNZBM
[9] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwsy01uwyAQQOHTwI5oBjA_CxZpJavrXiDCzBCTOE0Cbs9fper2e3qUdCgWnOSE3kYTnTFWrskvupCpqGtkAl1LdYx5AS4eMGOVLblgp7xMNZKJcELy6CCg9xEmRGFhNOJre6pbbhv3oVxYSpxCoKjWvk318ApyS-u-P4YwR6Fnoee6tXK4dqHnIfScP96el_c1Xj7ljall1XnjPFg1Sn9w-gdhjgho0cmeOlMue7t_CQuPzmPwOX-XlQ_3fpZj78y31z9xtKS9V7lkUjaUqgLpqmCBgGCt0RHkT9K_AQAA___0XFgt
[10] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwszM2OKiEQxfGngR2GguJrwcKNr2GqqWqb3Paq0DO-_sTJbH8n58_V5YY2aqmQsPgSvUe91VQcyRqDUIi-hRUoRUmQFk8xoLDuNWYMtIS1sC_2Cpwg2gwpFRsAFNrZWf71l7lT32VME_PSSsiZi9nGHtbTZ9B73Y7jOZU_K3dR7vJ-v087tfk6PcZNuYu-C3cyQ3ahKaZz_YXrHyh_BgsIUY86hKkd_fFfoX0OmVNu9NU2-ZT0PIbI_fMPUpBdSoYascHcVpPZrcYuNoNF9K5Y_V3dTwAAAP__7ZNViQ
[11] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwszEuO6yAQheHVwAyreBcDBplkGxGmyjG65HHB3dl-y62efkfnp2ywOgiSs44u2RSsdXLPvqKpoNeVNDpPWChWRPA1bCsDsmw5oPNl9Vsim-CmKeoAqGNM4LUWDmYj_tf-q0dpncdUAdeaPCIltY_ut-UcZM_7cbynsBdhrsJcP5_PUjeek59H4955qUWYq3wwtaIGdy6TVaP8C7c_EPaiQTsd5MiDqdSjvZ7CwXucpXv5qjsvr3GX8xjMj_PvOTkyMapSCymHdVNIZlOwAmpwzpoE8jubnwAAAP__vKNYfg
[12] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwsyzGO6yAQgOHTQEc0wGCGgiJNrhFhZojRs5M88O75V1lt-_36OTuqCIuWbCMmnxbvUW95ZUfBk-UChMF5KwLom0ALxUcB3fNCGMoaWmKf4G452gXIxpggWKsQZmf51_-bo_RdxjQLrTUFIk5mG3tol0_Qe97O8z2Vvyp3U-5WmzwvtSh304dwL2bILmWK6Zx_4f4Hyl8tWLSLHnkIl3r211MhvIfMKY_yVTe5vMZDz3OIHJ8_SEJ2MZpSCxuk2gyxawZWIAuI3iXQ39n9BAAA__8vnFKC
[13] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwsy01uwyAQQOHTmB0WA8PfgkU2uUaEmSFGseMU3Ob6Vapuv6dHSYeCyglO4DGa6IxBsSZVXTVgoRqEGhf0aLIO5JxhQjBKtOQC2rzYGslEdQPy4FQA76OyABOq0Ygf7UvuuW3ch3RhKdGGQFGufbN1_gSxpfU8X2Myl0lfJ319v99zzYWX43jM5dgnfS38PDtvGw-xM7UsO2-cB8tG6Q9u_zCZCyhAcKKnzpTL2Y7nhOrVeQy-5--y8nz0uxhnZ94_v-WIpL2XuWSSGEqVgXSValEBFKLRUYmfpH8DAAD__yYuWgc
[14] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwszE2uKiEQxfHVNDMMBcXXgIETt2GQKmzyaPVBe3v7N5o7_Z2cPyUdCionOIHHaKIzBsWaagVybCoWG3U2xbCq1bGLPuhMFkRLLqDNN1sjmaiuQB6cCuB9VBZgQTUb8b_2X265dR5TunAr0YZAUa6j23r6DKKndd9fczHnRV8WfTmO41T4sQ8mrrxtPPvzcX_zu_XTc9zFxtSyHNw5T5aN0heuf7CYMyhAcGKkwZTL3p6PBdVr8Jx8z--y8jcz98G8ff6WI5L2XuaSSWIoVQbSVaqbCqAQjY5K_CT9GwAA__9n2lyk
[15] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwsy72O6yAQQOGnMR0WA8NfQZEmrxFhZmyja-Jc8G5ef5XVtt_RoaRDQeUEJ_AYTXTGoNgTksO8GKQ1KgieCDJri9oq8Fp7EjW5gDYvdo1konoAeXAqgPdRWYAJ1ajE_-p_2XI9uA_pwlKiDYGi3Pth1_kTxJH263qNydwmfZ_0_f1-z4WfV2fisXJrPBq319655e3c5nI20Zhqlp0PzoNlpfQLjz-YzA0UIDjRU2fK5arnc0L16jwGb_mr7DyffRPj6szt81uOSNp7mUsmiaGsMpBepVpUAIVodFTiO-mfAAAA__8k911d
[16] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwsy72O4yAUQOGngQ4LLv8FRYr1A0TaYqvoAtcxir3OgGfy-qOMpv2OTk0QipGOU1LeRB2d1oavqXrvgi-Ui5FZQkHUSBogG-8DLMBbcsFYzHaJVUd5U9UrJ4PyPkqrFDNytEqP9iF2bBv1IVzIJdoQahRr3-wyvQPf0nqez8H0hcHMYH69XtOChfJxPKZy7AzmsWInBrO6_P33x17355XBzHeqDUWnjXCQaDX9wO0XmL4oqYxyvKdOFcvZjv_MyGenMeiOn2Wl6eh3Ps5OtL9_S9FU8F5gwSpMKIsIFRYhswxKGqMhSv6V4DsAAP__Lulc-Q
[17] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwsy8Fu4yAQgOGngRsWM2ADBw6RIu8-wN6jMQwxir1OwW1ev0rV6_frzxF9snqSHMHZYMJkjJVrBEw4JkfICBgKUuCiadELcDHJkaxx8nakZSwhm6BvkB1M2oNzQY8AwupeMz_qh9qpbty6mvySwuh9Dmpt21iGd5BbXM_z2YW5CJwFzq_XayiUeDmOx5COXeDcV2oscIZrc9e___48QeAsd86VVOONqbOqOf7A7ReEuYAGC5NssXGmdNbjv7D62bh3vtNnWnk42l32szHv73_kYDM6pyhRVtanonzGovSiPWhrDQYtvyJ-BwAA__9fkl0W
[18] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwsy73u2yAUQPGngQ0LMF93YMjiOVLVOcLcS4xihxSc5vWrVP_1d3Qw6pCNdJyi8gZmcPNs-BZdoux9SBaNzCABsYC1UCw6AqcLr9EFY9NqC-AM8qbQKyeD8h6kVYoZOSrSo_4RR6o79SFcWDPYEBDE1ndbpm_ge9zO8zXYfGF6YXr5fD5TSZnW1h5TbgfTyzWN309Cuu7v8WujvvbWHsT0wg_CmkSnndIgUTH-h9sPsPmipDLK8R47YcpnbU9m5KvTGHRP77zR1Pqdj7MTHd_fEhjU3ouUEwoTchEBdRFylUFJY2YNkv-N-l8AAAD__7thYCc
[19] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwszLuOwyAQheGnMR3RAMOtoEiT14jwzDhG69zA2bz-KtG239H5udhECEFJMRGzy8E5VGuZScAaoWRnDNFHCjXBYpGiiDBl1UpI6Ovsl8wuw9lwNAGSiTGDN2ZCGI3lpz31tbZN-tAhzZR9Spz12je_HD6D2sq6748xueNkT5M9vd_vw-vWlnt_vmQWOtz7RV2FW9VdNqlDdOPyhfM_TO5owKAJqpcuXGlv99uE8Ogyhlzqi1b5ZsbeRa6fv5eMbGPUlSprTLToxHbRMEMygOhsBvVb7F8AAAD__yJVWDk
[20] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwsy01uwyAQQOHTwA5rgOFvwSKbXCMizBCj2k0Kbn39KlW339OjbGJF8JKzDphs8taiXLOjYotrhhhdxNiALFVisJiqQ2bZs4_oyt21RDbBTVPQHqIOIYHTWiDMTvzRv9Re-sZjKh_vNbkYKal1bK4t7yC3vB7Hawp7EeYqzPU8z2Vw7Q3MUp-7MFe5M_WiBm9cJqtO-Q9u_yDsRYNG7eXIg6nUoz8_BcJr8Jz8KN915eU5HnIeg3l__44TkglBlVpIYaxNRTJNwR2iBkRrEsifbH4DAAD__8J-Vi8
[21] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwsy0uu4yAQQNHVwAyr-MOAQSbZRgRV5Ri1nQ-4O9tv5elNz9WlYhI6CJKLji7bHKx1cist8upbAl51wxpaRmwEFHX1ubYAspeQnK_Nr5lshpumqAMkHWMGr7VwMDvxn_5WR-07j6lCaph9SpTVNna_Lt8g97Kd52sKexHmKsz18_ksiMehcD6WNy5YhbnKg6lXNXjnOll1Kj9w-wVhLxq000GOMpgqnv35EA5eg-fke_2LGy_PcZfzHMzH9_ecHZkYVcVKyiVcVSKzKmiQNDhnTQb5r5j_AQAA__9nNlfe
[22] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwsy72O6yAQQOGngQ5rgOFnCoo0eY0IwxCja9_E4N3nX2W17Xd0ajKxIHjJSQckS95alFvKhWxEJAdQnHHZhmbQrKSj5-ZakD35iC6vrlG1BA9dg_YQdQgETmuBMHvlf_1UR-47j6l8XAu5GCupbeyuLZ8g97Rd13sKexPmLsy9XedylqVkYe7y4NqzGrxznqx6Tb_w-ANhbxo0ai9HGlxzufrrv0B4D56Tn_mrbLy8xlPOazAfn98xYTUhqFxyVRhLU7GapmCFqAHRGgL5ncxPAAAA__-Y9lLs
[23] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwsyztuAyEQgOHTQMdqeA8FhRtfw2KZwYuyfsEmvn7kKO3366dssDoIkrOOLtkUrHVyy7hGJLIAFSMHbUuLreoWqaJNLRbZc0Dny-pbIpvgoinqAKhjTOC1Fg5mJ_7qL3UrfecxVcC1Jo9ISW1j9235BLnn7TieU9iTMGdhzu_3e2n9Ncv94OVVl1qEOcsbUy9q8M5lsuqU_-DyD8KeNGingxx5MJV69MddOHgOnpOv5btuvDzGVc5jMN8-v-fkyMSoSi2kHNamkExTsAJqcM6aBPInm98AAAD__-f7V4U
[24] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwszUuO6yAQheHVwIyIRxmoAYNMvI2oTJVjdO08wLnrb6XV0-_o6OficwUbtRSXAAPGEEBvhQJgmKxfgdnyIjHgyogVEtoYKelWYoaJlmlFDmhvjpOLNruU0E7OKbCjsfxrb3NQ26UPE_NSccqZ0Wx9n9bLd9B72c7zNVS4Kj8rP9N4vS_Pfld-PqiN58OwmJ3MoMcphj-dll2Un_Uh3Mh02YWGmMblF25_oMLVWQcu6l66MNWzPR8K7KvLGHKnT93km9Hj7CLH9z8JAvuUDFViA7muJrNfjV1sdhYgeLT6f_E_AQAA__9aHF2k
[25] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwsy7uO4yAUgOGngQ6LyzGXgiLalattdl8gAs4hRrHjLHgmrz_KaNrv149R-wLScorKQTDBGgN8jTlB9qBSqdV55RFdMFK7AkWTtbnyFq2HOeW5BjRBXhU6ZaVXzgU5K8VAjoZ0b__FntpGfQjrcwmz9xjE2re5Tu_At7ie53Mwc2F6YXp5vV5TTYXycdyncuxML3_-IY1f9Dg7jd-00L7T-Fv4TtiS6LRRGiQaxm-4_gAzFyUVKMt77ISpnO14MJDPTmPQLX2Ulaaj3_g4O9H-_mcKgNo5kUpCAb5U4VFXIbP0SgIYHST_jPorAAD__6g9Xzk
[26] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwszDuOKyEQheHVQIZVQPEKCJx4GxZQhRvd9uNCz6x_1KNJv6PzUzaxIXjJWQdMNnlrUW6ZbfC6UyVGdBA62ki1tF5bc7UUkiP7iK5U1xPZBHdNQXuIOoQETmuBsAbxv_FfPcvYeS7lY23JxUhJbXN3_XIOcs_bcXyWsFdhbsLc5qO31-U9H8Lc5JNpFDV557JYDcq_cP8DYa8aNGovZ55MpR3j_RIIn8lr8aN8tY3PklzHZH6ef8cJyYSgSiukMLauIpmuoELUgGhNAvmdzU8AAAD__2SlVP8
[27] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwsy01uwyAQQOHTwA5rBoa_BYtIla8RYRjHKHbtYre5fpWq2-_p1aRDIXCSE3qKJjpjSC6JPExeAxGidQVJ51nXGDlymXxwWbbkAtk82TlWE-GO1aODgN5HsIiC4GyVn-1Lbbmt3E_lwlSiDaFGtfTVzsM7yDUt13WcwtyEHoUeX6_XMOfC074_h7JvQo9H3-e28nAshzBjq8J8IAA4wmCJLFCUG9eWVeeV88mq1fQH938Q5oaAhE721LnmcrX9UxAcnc-TH_m7LDzs_SHPqzNv799ypKq9V7nkqiiUWYWqZwUTBAQioyPIn6R_AwAA___eBV99
[28] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwsy7GO4yAQgOGngQ6LgQFDQZHGV190fYSZcYxin7Pg3bz-Kqttv18_JRMKai85wYjRRm8tyjVZjDQDkMaIHDIj-rxkChwceOu1rMkHdHl2SyQb9Q1oBK8DjGPUDkCg7pX4UT_UnuvGrSsf5hJdCBTV2ja3DO8gt7Se57MLexFmEmZ6vV7DkgvPx_EYyrELM13_Xf9Mf-XOVLNqvHHurCqlH7j9grAX0IDgZUuNKZezHv8F6mfj3vmeP8vKw9Husp-NeX__jiOSGUeVSyaFoSwqkFmUnnUAjWhN1PIrme8AAAD__6J3WBQ
[29] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwsyzFv8yAQgOFfAxsWB2cDA0P0SZ4_qVuWCLhzbMWuU3Djv1-l6vq8eikaX1APkiM4DDYM1qKco0WPyVuEQE4ntAw6QyLKmcDZTHKJg8c-5X4KZIO-ATkYtAfngu4BBOq2ED-WL7WlZeXa1OBzCb33FNRc137q3kGucT6OZxP2IswozHieZzelwnnfH13ZN2HGNqfKwowwXF_nNf37-C83piWpyiunxmqh-Au3PxD2AhoQBlljZUrlWPZPgfpZuTW-p-8yc7fXu2xHZd7ef88ByTinUkmk0JdJeTKT0ll70IjWBC1f0fwEAAD__0LmXIQ
[30] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwsy0uO6yAQheHVwAyrgOI1YJBJthHhoojRdW4ScHe233KrdWbf0V-ziYTgJWcdMNnkrUW55cC-BcD1XGvFFIrsWrREsK7UQPbsI7qyupaqTXDTNWgPUYeQwGktEGav_K-_1aP0ncdUPq6UXIw1qW3sri3nIfe8HcdrCnsR5irM9fP5LJPay4Je3rRQEeYqH1x7UYN3LpNVr_kXbn8g7EWDRu3lyINroaM__wuE1-A5-V6-aOPlOe5yHoP5cfaOE1YTgipUqsJITcVqmoIVogZEaxLI72x-AgAA___Im1cR
[31] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwsyzGO6yAQgOHTQIc1A4OBgiJNrhFhZojRc14S8O75V1lt-_36OdtYCVYtGQMll1bnSO_ZUyQvuAFuPhKK97wlAiYOLrWadM9rJF823xK7BDfkgCtEDCGBR1QEs7P862_zKP2QMc0at5p8jJzMPg7flk_QR97P8zWVuyh7VfZ61qO25V2XWpS96odwL2bIIWWK6Zx_4fYHyl0QkHDVIw_hUs_-_K8IXkPmlHv5qrssz3HX8xwij8_vJRHbEEyphQ3F2kxk2wxsEBGInE2gv7P9CQAA__93AVPa
[32] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwszE2SwiAQxfHThB1W8xFoFizceA2rQzeGmkQdiHP-KWfc_l69P2eLxUNQkk30yaXgnFdrts6jrYvDIiAAATk6a8knpIAVSbUc0M-0zDWxS3A1HE0ANDEmmI2ZPIzG8tW-9U5tkz50wKWkGZGTXvs219N7UFtej-M5Jnee7GWylyr7LmOjO724SZfTo9_ULtxId9mEhujG-Q-uH5jc2YDxJqieuzCVoz3uk4dnlzHkRq-y_mfG0UX293-W5NnGqKkQa4-lamRbNSyABrx3NoH6yfY3AAD__zn5V0c
[33] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwsyzuOwyAQgOHTQIfFY3gVFGlyjQiYcYxixwk46-uvstr2-_Vj0qGCdJyS8hBNdMYAX5Imst5DkIZCDUGhButBqVhNLRkdb8kFsLnYOaKJ8qbQKyeD8j5KqxQDORrSo73FlttKfQgXSo02BIxi6audp2_ga1qO4zWYuTB9Zfp6nuc050pl3x9T3Temr0cuK820bTSmSs-j0_tDhSrfCFsWnVbKg0TD9Ae3f2DmoqQC5XhPnTDXo-1PBvLVaQy6509daNr7nY-jE23f31IE1N6LXDMKCHUWAfUsZJFBSQCjo-Q_Sf8GAAD__-vdX70
[34] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwsyz2O6yAUQOHVQIcFl8tfQZEm24gwXGIU85wHnvH2RxlN-x2dEsFnlJZTVA6DDlZr5FtcJWqfLVjw1dBqXDCUsnUKAaoBw1u0Hk1aTQ1FB_lQxSkrvXIuSKMUQzlboVf7L3pqO40prF9zMN6XILaxm7p8At_jdp7vyfSNwZ3B_bqupaZM63G8lnx0Bvcz99p5p9KSGLRTmiRaib_w-AOmb0oqVJaPOKikfLbjH0P5HjQnPdNX3mg5xpPPcxD1z28oYAHnRMqpCPS5Cl-gCrlKrySihiD5d4SfAAAA__84tVf6
[35] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwszkvS2yAQBODTwG5UMAIBCxbe6BquEYwsEr0MUnz9lJN_-3V3VeeIPhk1SI7amdCHoe-NXCIaR4Zxdi7pwVD2E2tSaQ40WcXayhIHbyxNdg65D-qps9OD8tq5oKzWwqhWMv8ub9iorFwbDH5KwXqfAyx1tXP3DeQal-s6m-gfAkeB4-fz6VY6K7fGXSKBYy60Hq-bBY7HWfZy7E3giAotKAuI38oNJ5Ud-ILMDerRuMG53g3eN8Mv2qi07lxOuXEuBJVXpsZQcvwHzx8Q_UMrbfQga6ycKV3l2IVR_9-86E4Ld0d9yXZV5u27txxMRueAEmUwPs3gM86gJuW1MqbHoOSfiH8DAAD__2PZb90
[36] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwsyz2vmzAUxvFPY29GfjkGn8FDpIouVdU7dUTGPlxMIRCbJMq3r9Le6ZF-j_7JaxdBtpy86gANtsYAn31HjuwUk0VIiGDBjBimkaLUE8YWePatAxtGO2EyKAeVOtVKp7oOpVWKgaw50Z98E1vIK5UqWjdGtM4lFHNZ7dS8D776-TyPysyF6Z7p_vl8Nq_9ft5HauK-Md0fa3ituZ7M9P_n268feBvK8rFcd_P4-fp96I9Qx8vyPTnKA27LwTdKOYhCK4VKIif_D4YvYOaipALV8uILpRDPvF8ZyKNQrfQZ7nGmZi-fvJ6FaHv3lhCS7joRYkgCXJyES3oScpROSQCjUfKH138DAAD__3_VaWY
[37] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwsjc3O2yAURJ8Gdlj8w12wiBT5NaJruMQodp2C26hvXzn6dqMzczQl6Zit9JySChYMeGMsXxMuzmpf1YIZnM9knCek4LEihVKJt-Sjdbi4CsWAfKgSlJdRhQDSKcWsHK3Qq_0WO7aN-hA-LhlcjAXE2jdXp6vgW1rP8z2YuTE9Mz1_Pp-pYqblOF5TPnam551KQ6bnQee1Md9g7jgBQFBOGZDWGjBM-_Pfm5i5G_51RKeNcJBoJX3B4wcwc1NSWeV5T50K5rMdv5iV705j0BP_5JWmoz_5ODvRfvmOwBYdgsCMRdiYq4hFVyEXGdX1r0Hyv0n_DwAA__-U_mVl
[38] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwsy01uwyAQQOHTwA6Lf4YFi0iVrxENMI5R7DgFp7l-larb7-nVpKFY6TklFWw00Rtj-ZrQOMjeRkQNuUBGG1wGJE1OgsuVt-TBOsxuidVEeVU1KC9BhRClU4pZOVqle_sWO7aN-hAecokOoEax9s0t0yfwLa3n-RzMXJiemZ7f7_e0YKF8HPepHDvT89frie1BZ6XRj0FDxeiYnvlOtaHotBEOEq2mP7j-AzMXJZVVnvfUqWI52_FgVj47jUE3fJWVpqPf-Dg70f75HUVbdQgCC1ZhoSwCql6EzBKUtNboKPlP0r8BAAD__7KkXuI
[39] https://us.cisionone.cision.com/c/eJxEzEmO3SAUheHVwOw-0TcDBqVE3kaJB5cyiW1swFl_5ChSTb-j_-QgXFLMUAzcKi-9kVLRNThWrMjaoWBRJusLaqu5QamSYooLWoNxSse3Lj5Lzz55ttwwx631THNOFBs14-96wR7rhn2Ace_ktXPZw9o3XV7PQLewznkOIj-IWIhYSrleV3qlSMRytj5L22qDOnEfRCx77Gltx4Cz3R3yDWesB-CEjAN6GzgAj9Q6PnZu94DrRvgV91ifnMjvzx9xDiJ_CkN3zDVCxw3jQKg5_IPP_0DkB2dccUN76JhjmrUdRLGz4xj4Fe-04qv1LzpmR9yfXqNXWVgLMcUMyqUCLosC7M0cZ0pJ4Rn9E8TfAAAA__9We3fx
[40] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwsjc1uwyAQhJ8GbkTLn4EDh0iVb30Ga82uYxQnccFpX79y1eN8M6OPsonFwSA56-CSTYO1Tq45BotAc5x1MgXnBAb94kuKbINnp2XNQ3QeZ78ksgkmTUEPEHUICbzWwkGvxPf6pR5YN25dDXEuycdISa1t88vlLOSW1-PYu7BXYUZhxqVdfuq97kwVL692E2Y8szDjJ7ay8vTxnnasz4mPibhP7dW5y8c5V403xs6qUv4D0z8Q9qpBOz3IlhsTlqO-nsLB3rh3vuG7rHy6ZD8a8-P8e06OTAgKC5JysSwqklkUzBA1OGdNAvmdzW8AAAD__yyWY4Q
[41] https://us.cisionone.cision.com/c/eJx8zruOHCEQheGnoTNGQBUUFXSw0qhfY8Sl2Eaem6Fnn98a28kmG_86Ol9dXSxowiKrJWTgAIDLvrZCQAQozUu2jYkrmpiJiTI2l5a-hog-Zd-4ApuLrWSDiZaIjbdWoZm9yq_-W99Sv8qYOsRc2MdYWe_j6tvpHZbruh_Hcyr4UG5TbkvPfip99sf99LiLctuXVW67Se3pMuQqacpUbnvd5yvPMnoWBd_zpVcFZ2ss2qBckPeNgvOQmsrRH3eF5jlkTvlMr7LL6TE-lQt7mruCM4JkIUQSSrUFR4BkGFkgM-QapJRcGhmPIXgOyDFjE59iDi1415a_FP2fontdv9kUfPyDLWP9CbTMY4jc3nsvjNUR6VRS1RhL07G6pk020RpEcGyWr9X9CQAA__8dZ40c
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

D’Haïfa à Tel-Aviv, reportage auprès de ces Israéliens qui veulent l’arrêt de la guerre à Gaza

Ces dernières semaines, les Israéliens ont défilé par milliers dans les rues du pays. Pas un jour ne passe sans manifestations contre la politique de Netanyahou, pour demander le retour des otages, pour un arrêt de la guerre à Gaza et plus récemment pour s'indigner de la souffrance des Gazaouis.
Tiré de l'Humanité
https://www.humanite.fr/monde/guerre-israel-hamas/dhaifa-a-tel-aviv-reportage-aupres-de-ces-israeliens-qui-veulent-larret-de-la-guerre-a-gaza
Léonor Varda
On les a d'abord aperçus à l'université d'Haïfa, devant l'école des beaux-arts Bezalel de Jérusalem ou encore sur le campus Ben Gourion de Beer-Sheva, au sud d'Israël. Puis ces drapeaux noirs ont pris place, épars, parmi les symboles brandis par les manifestants, aux côtés du ruban jaune de la campagne pour les otages encore détenus à Gaza, intitulée « Ramenez-les à la maison », et de banderoles anti-Netanyahou.
Le mouvement du black flag (« drapeau noir » en anglais) est né il y a tout juste deux semaines àl'initiative de groupes d'universitaires de Tel-Avivdésireux de délivrer un message : la guerre à Gaza doit prendre fin, et avec elle la dévastation qui frappe les civils gazaouis et leurs enfants – dont 1 309 ont été tués par Israëlaprès sa rupture unilatérale du cessez-le-feu le 18 mars, selon l'Unicef.
« Nous pensons qu'un drapeau noir flotte aujourd'hui sur la conduite du gouvernement et que les soldats et les pilotes qui bombardent Gaza sont complices d'actes criminels », assène Dana Olmert, chercheuse en littérature à l'université de Tel-Aviv et membre du conseil d'administration de l'ONG israélienne anti-occupation Breaking the silence. L'enseignante, par ailleurs fille de l'ancien premier ministre Ehud Olmert issu de la droite et proche d'Ariel Sharon, est l'une des figures actuelles d'un monde universitaire de gauche refusant de rester muet plus longtemps face aux décisions de son gouvernement.
« L'Israélien moyen ne connaît pas les images de Gaza »
« Il existe en Israël une gauche radicale, petite mais engagée, qui résiste à l'occupation depuis des décennies, expose Dana Olmert. Ces derniers mois, de plus en plus de voix se sont jointes à cet appel, exigeant la fin de la guerre et des dommages causés aux civils innocents à Gaza. » L'apparition dans les cortèges de portraits de civils tués dans l'enclave palestinienne est cependant bien récente en Israël. Elle existe aujourd'hui grâce à une prise de conscience tardive par la société israélienne des crimes perpétrés par son armée à Gaza, estime Liran Razinsky, un autre professeur issu de l'université de Bar-Ilan, à Ramat-Gan, dans la banlieue est de Tel-Aviv.
Les médias israéliens sont majoritairement responsables, selon lui, de ce retard : « L'Israélien moyen ne connaît pas les images de Gaza, car les médias locaux, surtout la télévision, ne les ont pas diffusées. Je pense que beaucoup de citoyens ont eu très mal moralement en les découvrant, juge-t-il. Les politiciens savent, les internationaux savent, mais ici tout le monde ne lit pas Haaretz. » Il serait pourtant hypocrite de résumer le problème à un manque d'information, ces universitaires en conviennent.
Comme nombre de citoyens, Liran Razinsky a vu lasociété se fracturer sur la question israélo-palestinienne. Parfois jusqu'à la rupture. « Au lendemain du 7 octobre 2023, un ami que je fréquentais depuis plus de trente ans m'a dit : « Il faut faire une deuxième Nakba » (exode des Palestiniens avant et pendant la guerre israélo-arabe et la proclamation de l'État d'Israël en 1948 – NDLR) », se souvient-il. « J'ai répondu qu'il s'agissait d'un crime contre l'humanité, et il m'a accusé d'être du côté de Staline, de Pol Pot, parce que je ne condamnais pas assez le Hamas. Puis il a refusé tout contact avec moi. »
Le bloc uni des colons
Cette polarisation de la société israélienne s'exprime dans la rue, foulée ces dernières semaines par des manifestants aux aspirations adverses. Les altercations entre ces groupes ne sont pas rares, alors que l'extrême droite au pouvoir répète sur les plateaux télévisés et lors de marches nationalistes qu'« il n'y a pas de civils innocents à Gaza ».
Le 7 octobre aura eu pour conséquence l'élargissement du fossé entre deux blocs distincts, selon Dana Olmert : « D'un côté, une partie croissante de l'opinion publique recherche une solution politique globale avec les Palestiniens, soutient un cessez-le-feu immédiat, la fin de la famine à Gaza et le renversement du gouvernement actuel. Pour ce groupe, ramener les otages chez eux le plus rapidement possible est la priorité absolue. De l'autre côté, on trouve un public de plus en plus influencé par des idéologies racistes et juives suprémacistes, qui appelle à la vengeance et à l'expansion des colonies dans les territoires occupés. » Les figures de proue de ce combat messianique et anti-Arabes ne sont autres que les influents ministres d'extrême droite Itamar Ben Gvir (Sécurité nationale) et Bezalel Smotrich (Finances), alliés de Benyamin Netanyahou depuis 2022 au sein de la coalition gouvernementale.
Ceux-là contribuent au défoulement d'un discours sioniste extrémiste : Bezalel Smotrich annonçait encore ce jeudi 29 mai la création de 22 nouvelles implantations juives enCisjordanie occupée, au mépris du droit international. De son côté, Itamar Ben Gvir s'affichait lundi dernier à Jérusalem aux côtés des colons les plus nationalistes et racistes du pays lors de la Marche des drapeaux, qui célèbre chaque année l'occupation et l'annexion par Israël de la partie orientale de la ville. Une preuve supplémentaire de la prise en otage du pouvoir par une frange nationaliste radicale, qui a poussé des dizaines de milliers d'Israéliens à manifester contre une dérive autocratique et pour le maintien d'un contre-pouvoir institutionnel en avril et mars.
Contestation bâillonnée
« Ce n'est pas que les gens n'ont pas envie de manifester, mais vous allez voir comment la police encadre les manifestations ces temps-ci… Des policiers par centaines, chaque mouvement est scruté et ils peuvent être agressifs. » Ce dimanche 1er juin, Nisreen Mourkus est stressée. Du coffre de sa voiture, elle sort pêle-mêle des affiches en hébreu et en arabe, des portraits d'enfants tués à Gaza et des autocollants et flyers portant le logo du Mouvement démocratique des femmes en Israël, un groupe de femmes juives et arabes créé en 1949 afin de militer pour la solution à deux États.
« D'habitude, je vais faire imprimer tout ça à Acre. Mais mon imprimeur refuse depuis quelque temps, il a peur que la police ne ferme son commerce… Donc j'ai dû en trouver un autre à Nazareth. Lui a accepté ! » raconte-t-elle, en route vers la manifestation prévue ce jour-là sur les hauteurs d'Haïfa, au nord d'Israël, pour l'arrêt des violences à Gaza. Cette Arabe d'Israël, Palestinienne dont la famille est restée sur place lors de la création d'Israël en 1948, ne touche pas terre ces derniers jours.
Elle se trouve prise entre l'organisation de marches contestataires dans le nord du pays, la rédaction de lettres à l'adresse de diplomates internationaux pour les inciterà faire pression sur Israël, et plusieurs visites dans les camps de réfugiés palestiniens de Cisjordanie, où l'armée entreprend des destructions massives depuis le mois de février. « Je milite avec plusieurs collectifs pour les droits humains, les droits des femmes et des enfants, les droits sociaux… Tout est connecté, en particulier en ces temps de guerre », souligne cette militante communiste, avant d'ajouter : « J'espère qu'un jour, les Israéliens comprendront qu'il n'est pas tenable de vivre ici en se préparant constamment à la prochaine guerre contre un de ses voisins. »
Ce jour-là, la manifestation est déplacée sur le mont Carmel. En contrebas, on aperçoit le port d'Haïfa. « Nous sommes bien moins visibles des habitants du centre-ville que lors des défilés précédents », souffle Nisreen Mourkus, ployant sous le poids de ses pancartes. Habituellement, les manifestants empruntent Allenby Street, l'artère fréquentée du centre. Sans cette concession sur le parcours, la manifestation aurait été interdite par le ministère de la Sécurité d'Itamar Ben Gvir, disent ses organisateurs.
C'est donc encadré par un imposant dispositif policier que le cortège s'élance à 17 heures. Des pancartes sur lesquelles on peut lire « Arrêtez la guerre », des slogans écrits en hébreu, en arabe et en anglais, sont brandies. Autour de la bannière de l'Action antifasciste flottent plusieurs drapeaux noirs.
Pour une information libre sur la Palestine
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Pitié pour le peuple de Gaza ! Une discussion de la stratégie du Hamas et des options auxquelles il est confronté

Ce à quoi nous avons assisté ces derniers jours dans les négociations entre le Hamas et l'État sioniste sous patronage américain et arabe, à la suite du rejet par le mouvement islamique de la trêve de soixante-dix jours, accompagnée de libérations mutuelles de prisonniers et de l'entrée de l'aide humanitaire, proposée par l'envoyé américain Steve Witkoff et acceptée par Benyamin Netanyahou, est en fait une répétition de ce à quoi nous assistons depuis le début de l'année dernière.
4 juin 2025
Gilbert Achcar
Professeur émérite, SOAS, Université de Londres
Tiré de Mediapart
https://blogs.mediapart.fr/gilbert-achcar/blog/040625/pitie-pour-le-peuple-de-gaza
Ce blog est personnel, la rédaction n'est pas à l'origine de ses contenus.
Photo Serge d'Ignazio
Après la propagation de la nouvelle d'un accord imminent, le Hamas a annoncé son rejet du plan parce qu'il ne stipule pas le retrait de l'armée israélienne de la bande de Gaza et la cessation permanente de la guerre. Ce sont les mêmes conditions que le Hamas a annoncé avoir obtenues au printemps de l'année dernière. Les habitants de Gaza avaient alors célébré la bonne nouvelle jusqu'à ce qu'il devienne clair qu'il s'agissait d'un fruit de l'imagination. J'ai commenté ce que le mouvement avait annoncé à l'époque, il y a plus d'un an, sous le titre « Poker menteur entre le Hamas et Netanyahou ».
Je dois m'excuser auprès des lecteurs et lectrices pour la longueur des deux extraits qui suivent, mais le but en est assez clair. Ils illustrent le fait que la situation est restée la même depuis le début de l'année dernière, avec cependant une différence importante : le nombre de victimes de l'assaut génocidaire contre le peuple de Gaza continue d'augmenter inexorablement, et la destruction sioniste de la bande de Gaza et son dépeuplement (« nettoyage ethnique ») se poursuivent à un rythme extrêmement dangereux, et ce dans le but de créer une situation irréversible. Le long extrait suivant de l'article mentionné ci-dessus se lit aujourd'hui comme s'il s'agissait d'un commentaire sur la situation actuelle, en remplaçant Joe Biden par Donald Trump et Anthony Blinken par Steve Witkoff :
« La déclaration de Khalil al-Hayya, le chef adjoint du Hamas à Gaza, expliquant ce que le mouvement avait accepté, n'a laissé aucune place à l'espoir qu'un accord serait trouvé, sauf en prenant ses désirs pour la réalité. Si l'État sioniste avait accepté l'interprétation officielle du mouvement, cela aurait simplement été un aveu de défaite écrasante. La proposition acceptée par le Hamas prévoyait trois étapes, qui, selon al-Hayya, comprenaient non seulement un cessez-le-feu temporaire et un échange de prisonniers entre les deux parties, mais aussi une cessation permanente des hostilités, un retrait complet de l'armée israélienne de la bande de Gaza, et même la fin du blocus imposé à l'enclave [...] Il est évident que l'État sioniste ne pourrait jamais accepter de telles conditions, et le Hamas n'est certainement pas naïf ou enclin à la pensée magique au point de croire que sa position déclarée conduirait à une trêve.
Cela suggère que l'annonce avait en fait deux objectifs : un objectif secondaire, qui était de soustraire le Hamas au reproche des habitants de Gaza, qui ont désespérément besoin d'une trêve accompagnée d'une accélération de l'entrée de l'aide afin qu'ils puissent reprendre leur souffle, se réunir, enterrer leurs morts et guérir leurs blessures. Ainsi, après une longue attente, le mouvement leur dit qu'il a accepté la trêve, mais que c'est Israël qui la rejette. L'autre objectif, principal, de l'annonce concerne le jeu de poker menteur en cours entre le Hamas et Benyamin Netanyahou.
On sait que ce dernier est pris entre deux feux dans la politique intérieure israélienne : ceux qui appellent à donner la priorité à la libération des Israéliens détenus à Gaza, les familles des détenus naturellement en premier lieu, et ceux qui rejettent toute trêve et insistent pour continuer la guerre sans interruption, menés par les ministres les plus extrémistes de l'extrême droite sioniste. Cependant, la plus grande pression sur Netanyahou vient de Washington, qui s'aligne sur les souhaits des familles des détenus israéliens dans sa poursuite d'une trêve “humanitaire” de quelques semaines, permettant à l'administration Biden de se dire avide de paix et préoccupée par le sort des civils, après avoir été et tout en restant un partenaire pleinement responsable de la guerre génocidaire d'Israël, une guerre qu'Israël n'aurait pas été en mesure de mener sans le soutien militaire des États-Unis.
Netanyahou a décidé d'échapper à l'embarras en acceptant tactiquement un cessez-le-feu de quelques semaines et les conditions d'un échange de prisonniers que Washington, selon les mots de son secrétaire d'État, a jugé “extrêmement généreuses”. C'était il y a quelques jours, et Antony Blinken a ajouté que la balle était maintenant dans le camp du Hamas et que celui-ci porterait seul la responsabilité de la poursuite de la guerre s'il rejetait la proposition. C'était embarrassant pour le mouvement islamique, à la fois aux yeux de la population de Gaza et aux yeux de l'opinion publique internationale, car il sait pertinemment que le gouvernement sioniste est déterminé à achever son occupation militaire de la bande de Gaza.
Ainsi, le Hamas a répondu à Netanyahou par une contre-manœuvre, annonçant en grande pompe médiatique son acceptation d'un cessez-le-feu basé sur une proposition très différente de celle que Netanyahou avait acceptée, renvoyant ainsi la balle dans son camp, sachant qu'il rejetterait sa proposition. Cependant, ce jeu est dangereux, car il n'a pas vraiment embarrassé Netanyahou, du fait que toutes les fractions de l'élite du pouvoir sioniste partagent son rejet d'une telle proposition. Au contraire, cela a renforcé le consensus sioniste pour achever l'occupation de Gaza... (Fin de la citation tirée de « Poker menteur entre le Hamas et Netanyahou », Al-Quds al-Arabi, 7 mai 2024 – en arabe.)
Mais la similitude entre la situation d'il y a un an et la situation actuelle ne cache pas le fait que les choses se sont sérieusement détériorées, ce que j'ai souligné il y a deux mois comme suit :
« La victoire de Donald Trump pour un second mandat présidentiel a permis à Netanyahou d'obtenir ce qu'il espérait, mais qu'il n'aurait pas pu faire sans le feu vert des États-Unis […] Avec le soutien de Trump, Netanyahou a maintenant changé la direction de la pression : au lieu que le Hamas utilise ses otages comme levier pour obtenir des concessions d'Israël en échange de leur libération graduelle, Netanyahou a réoccupé la bande de Gaza, prenant tous ses habitants en otages. Il menace maintenant le Hamas de continuer à tuer des milliers de Gazaouis et à déplacer la plupart d'entre eux si le mouvement ne se rend pas, ne libère pas tous ses captifs et ne quitte pas la bande de Gaza, de surcroît.
Le peuple de Gaza est maintenant confronté à deux possibilités, sans qu'une troisième ne se profile à l'horizon : soit le régime sioniste poursuit son projet d'achever la Nakba de 1948 en perpétrant un nouveau “nettoyage ethnique” accompagné de l'annexion de la bande de Gaza, comme le préconisent les alliés de Netanyahou à l'extrême droite sioniste ; ou l'accord négocié par les États arabes est conclu, qui stipule le départ des dirigeants et des combattants du Hamas et de leurs alliés de Gaza, à l'instar du départ des dirigeants et des combattants de l'OLP de Beyrouth en 1982, pour être remplacés par l'Autorité palestinienne de Ramallah, soutenue par des forces arabes. Le Hamas n'a pas son mot à dire dans le premier scénario, celui du nettoyage ethnique, bien entendu, mais il peut négocier le second et fixer ses propres conditions.
Au-delà de cela, quelle autre option le Hamas a-t-il à offrir ? La seule stratégie alternative que nous ayons entendue de la part du mouvement est celle articulée par l'un de ses porte-parole, Sami Abu Zouhri […] Il a appelé à faire face au projet de déplacement de la population de la manière suivante : “Face à ce plan diabolique qui combine massacres et famine, tous ceux qui peuvent porter des armes n'importe où dans le monde doivent agir. Faites usage de tout engin explosif, balle, couteau ou pierre. Que tout le monde brise son silence. Nous sommes tous des pécheurs si les intérêts de l'Amérique et de l'occupation sioniste restent en sécurité alors que Gaza est massacrée et affamée.” Cette vision de la bataille est une réitération de l'appel lancé par Mohammed Deif le matin de l'opération Déluge d'Al-Aqsa : “Aujourd'hui, aujourd'hui, tous ceux qui ont un fusil doivent le sortir, car c'est son heure. Et celui qui n'a pas de fusil doit sortir avec sa machette, sa hache ou son cocktail Molotov, avec son camion, son bulldozer ou sa voiture […] Voici venu le jour de la grande révolte qui mettra fin à la dernière occupation et au dernier système d'apartheid dans le monde.”
Il est rapidement devenu évident que parier sur un tel appel était un pur fantasme, car rien de notable ne s'est produit, même en Cisjordanie occupée, sans parler des territoires de 1948 et du monde arabe. Alors, quelles sont les chances de succès du même appel aujourd'hui, après tout le génocide et la dévastation que le peuple de Gaza a endurés ? Quant à ceux qui soutiennent cet appel depuis l'extérieur de la bande de Gaza et ne le mettent pas en œuvre avec tout « engin explosif, balle, couteau ou pierre » sur lesquels ils peuvent mettre la main, selon la recommandation d'Abou Zouhri, ils ne sont que des hypocrites qui incitent verbalement de loin à se battre jusqu'au dernier Gazaoui. La vérité est que le Hamas est aujourd'hui confronté à un choix entre renoncer à son contrôle de Gaza – dont il peut négocier les termes pour assurer la sécurité et la survie du peuple de la bande de Gaza – et poursuivre la stratégie de libération par les armes et les illusions. De ces dernières, c'est-à-dire des illusions, le mouvement islamique a certainement beaucoup plus que des premières. Il semble toutefois qu'un débat soit en cours parmi les dirigeants du mouvement quant à l'approche à suivre face au dilemme décrit ici. (Fin de la citation tirée de « Gaza et la sagesse de Salomon », Al-Quds al-Arabi, 1er avril 2025 – en arabe.)
Traduit de ma chronique hebdomadaire dans le quotidien de langue arabe, Al-Quds al-Arabi, basé à Londres. Cet article est d'abord paru en ligne le 3 juin. Vous pouvez librement le reproduire en indiquant la source avec le lien correspondant.
PS1 : Abou Zouhri (basé au Qatar) s'est plus récemment illustré en suscitant une vaste réprobation – à Gaza en premier lieu – pour avoir déclaré lors d'un entretien télévisé à la mi-mai : « Aujourd'hui, nous sommes plus certains de la justesse de la bataille après que nous et notre peuple ayons réussi à tenir pendant quinze mois », en expliquant que « les maisons qui ont été détruites seront reconstruites et les ventres de nos femmes donneront naissance à beaucoup plus d'enfants que ceux qui sont morts en martyrs ».
PS2 : Pour une discussion approfondie du génocide en cours et de la stratégie du Hamas, voir mon tout dernier ouvrage : Gaza, génocide annoncé. Un tournant dans l'histoire mondiale.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Lancement - discussion : Extrême-droitisation du monde des médias et de l’édition

Joignez-vous à nous mercredi prochain pour le lancement de l'ouvrage Déborder Bolloré, une collaboration exceptionnelle entre trois éditeurs québécois et 125 éditeurs français pour contrer les empires médiatiques et les idées d'extrême-droite qu'ils propagent.
La discussion portera sur la concentration et l'extrême-droitisation des médias et du monde de l'édition. Elle réunira l'essayiste Philippe de Grosbois, la rédactrice en chef (Pivot) Claire Ross, la journaliste Gabrielle Brassard-Lecours, ainsi que l'éditeur Claude Rioux.
À propos
L'empire du milliardaire Vincent Bolloré est devenu en quelques années un levier majeur de la conquête du pouvoir par l'extrême-droite en France. Au-delà du déluge xénophobe, la « bollosphère » fait chaque jour la promotion de discours sexistes et homophobes légitimant les violences contre les femmes et les personnes LGBTQIA2S+, en plus de promouvoir l'avènement d'une société inégalitaire.
Au Québec, l'empire de Pierre-Karl Péladeau peut faire penser à celui de Bolloré. Entretenant une panoplie de chroniqueurs aussi xénophobes que transphobes – dont un faisant la navette entre ses plateformes et celles de Bolloré (CNews) –, PKP possède les chaînes LCN et TVA et, via Québecor, des journaux, magazines et hebdomadaires parmi les plus lus de la province, en plus du « premier groupe d'édition, de diffusion et de distribution de langue française au Québec et au Canada », le Groupe Livres Québecor Média inc.
Ce recueil, édité collectivement par des éditeurices indépendant·es, alimente la réflexion générale sur la nécessité de s'opposer à l'empire Bolloré et par extension aux empires médiatiques. Chercheureuses, imprimeureuses, éditeurices et libraires y analysent ainsi les dynamiques de concentration et d'extrême-droitisation du marché. Chacun·e tente de formuler, depuis sa position respective, des réponses à cette question urgente : comment faire face au libéralisme autoritaire dans le monde du livre ?
Page Facebook de l'activité%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D].
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
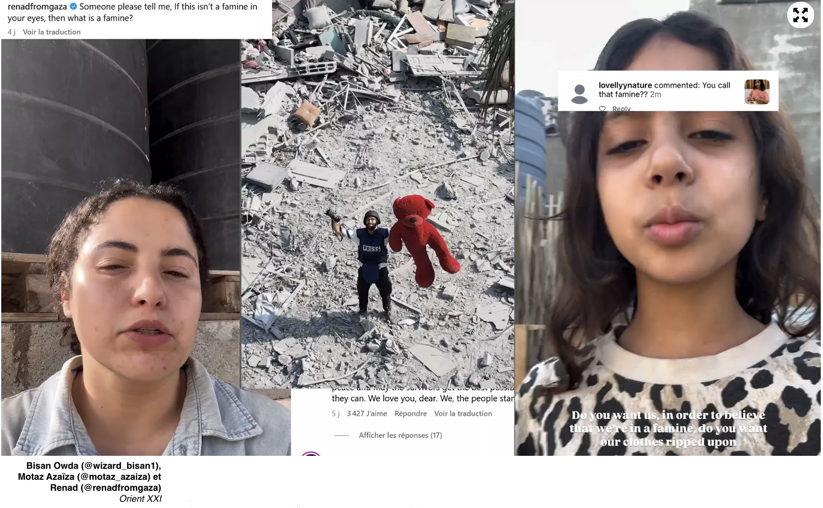
Gaza. Influenceurs par temps de génocide
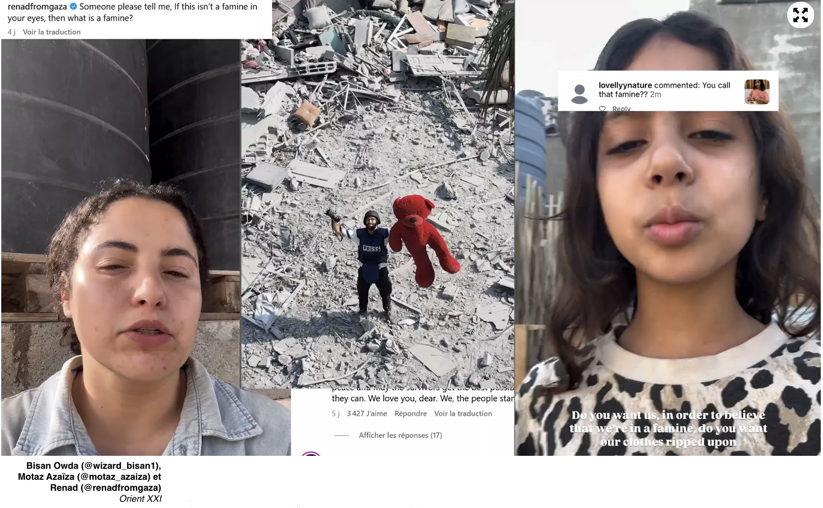
La guerre contre Gaza est le premier génocide retransmis en direct sur les petits écrans de nos téléphones. Malgré l'absence d'électricité, l'accès difficile à Internet et la famine, les Palestiniens de Gaza continuent à documenter sans relâche leur calvaire. Certains sont devenus des icônes suivies en ligne par des millions de personnes. Une présence en ligne, notamment en anglais, qui s'est construite depuis les mobilisations sur tout le territoire de la Palestine historique en 2021.
Tiré d'Orient XXI.
Il faut commencer par dire que la présence en ligne palestinienne s'était déjà construite bien avant 2023. Depuis quelques années déjà, on a pu remarquer une évolution notable du paysage des réseaux sociaux palestiniens. Ces derniers ont commencé à acquérir une plus grande visibilité au niveau mondial et une force de frappe digitale, avec les comptes de jeunes Palestiniens à l'anglais parfait et qui sont capables de mener des campagnes aux hashtags viraux.
C'est le cas de #SaveSheikhJarrah en 2021 sous l'impulsion notamment des jumeaux El Kurd (Muna @muna.elkurd15 et Mohammed @mohammedelkurd, respectivement 1,5 million et un million d'abonnés). Ce hashtag a été créé en référence au quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est occupé sous la menace d'expulsions massives d'habitants au profit de colons juifs. À ce jour, ce hashtag a été utilisé plus d'un million de fois en anglais sur Instagram sous ses différentes formes et plus de 970 000 fois en arabe.
De la même façon, le soulèvement palestinien de grande ampleur qui a éclaté en mai 2021 a été largement relayé sur les réseaux sociaux et sur les groupes WhatsApp et Telegram, par exemple lors de l'appel à la grève générale du 18 mai pendant les bombardements israéliens sur Gaza, sous des hashtags comme #GazaUnderAttack (#GazaSousAttaque) ou #the_strike_of_dignity (la_grève_de_la_dignité). Cela a contribué à connecter les Palestiniens entre eux (éclatés dans différents espaces géographiques, coupés par des checkpoints, le mur de séparation et le blocus de Gaza), et de rallier les Palestiniens d'Israël (qui se sont joints à un soulèvement de ce type pour la première fois depuis 1948) et, au-delà, de toucher une audience étrangère qui s'est sensibilisée à la cause palestinienne.
Une maîtrise des codes et de l'anglais
Cette visibilité en ligne a sans aucun doute aidé à amorcer un changement de perception de la part de l'opinion mondiale vis-à-vis des Palestiniens. Ceux-ci ne sont en effet plus seulement perçus à travers les images lointaines des médias traditionnels. Ils peuvent à présent être vus comme de jeunes influenceurs capables de prendre la parole, de s'adresser à un public international, de construire une audience, de peser dans le « game » des réseaux sociaux et d'en jouer le jeu, et à qui surtout on peut s'identifier. Cela a pu jouer un rôle dans l'infléchissement de l'opinion internationale en faveur de la cause palestinienne, en particulier auprès d'une jeunesse dite woke aux États-Unis et ailleurs, et en général sur les campus occidentaux.
Les influenceurs de Gaza sont encore plus impressionnants dans leur maîtrise des codes et de la langue dominante des réseaux sociaux. Pour la plupart ils n'ont jamais voyagé ni étudié à l'étranger en raison du blocus imposé sur l'enclave depuis 2007 (contrairement à un influenceur de Jérusalem comme Mohammed El Kurd qui a étudié aux États-Unis). De très jeunes journalistes se sont fait remarquer et sont devenus des figures publiques et populaires grâce à leurs comptes sur les réseaux sociaux, comme Motaz Azaïza (@motaz_azaiza, 16,9 millions d'abonnés), Bisan Owda (@wizard_bisan1, 4,8 millions d'abonnés), Plestia AlAqad (@plestia.alaqad, 4,2 millions d'abonnés), et bien d'autres.
Motaz Azaïza n'a que 26 ans, mais déjà quelques cheveux blancs et la maturité d'un trentenaire. Passionné de photographie, il avait acquis une petite popularité sur Instagram avant la guerre en cours en postant des portraits, des couchers de soleil et des scènes de plage à Gaza. Il rêvait de voyager et surtout de visiter le reste de la Palestine, mais, comme il le dit, ses photos voyageaient plus que lui. Il est devenu photojournaliste dès mai 2021 quand Israël a bombardé Gaza pendant 11 jours. Mais c'est après le 7 octobre 2023 que son compte a bondi de 25 000 abonnés à un million en, seulement, une dizaine de jours, et à 9 millions dès la fin du mois d'octobre 2023. Il a atteint ensuite un pic à 17,4 millions (avant de retomber à 16,9), ce qui fait de lui l'un des journalistes les plus suivis sur les réseaux sociaux au niveau mondial.

Il a su créer un lien direct et personnel avec le public via son compte Instagram en leur parlant directement en anglais et en arabe. Il a exposé non seulement son travail de journaliste, mais aussi l'humain derrière la caméra qui est pris dans la fureur des bombardements, ses états d'âme sans filtre, les amis qu'il a perdus, quelques rares moments de joie aussi, jusqu'à son départ de Gaza début 2024. Son compte a couvert la guerre de façon incarnée et c'est cela qui fonctionne sur les réseaux sociaux, même si son physique de gendre idéal a aussi possiblement joué un rôle. L'une de ses photos a été classée par Time Magazine dans le Top 10 des photos de l'année 2023 et vu sa notoriété en ligne, ce même magazine l'a sélectionné en 2024 parmi les 100 personnalités les plus influentes dans le monde.
- « Hi everyone, it's Bisan from Gaza and I'm still alive »
Sa consœur Bisan Owda, 27 ans, a, elle, été classée parmi les 25 femmes les plus influentes de 2024 par le Financial Times (aux côtés de Taylor Swift ou de Kamala Harris). Elle a reçu un certain nombre de prix de journalisme et de droits humains, dont un Emmy Award pour sa série documentaire AJ+ « It's Bisan from Gaza and I'm Still Alive » diffusée par la chaîne Al Jazeera, malgré des campagnes de lobbying pour contester sa nomination. Ses 4,8 millions d'abonnés sur Instagram connaissent bien son gimmick de début de vidéos « Hi everyone, it's Bisan from Gaza and I'm still alive » (« Bonjour tout le monde, c'est Bisan de Gaza et je suis toujours en vie. »). Une façon de souligner que non, ce n'est pas une évidence d'être toujours en vie quand on est dans la bande de Gaza sous les bombes et encore moins quand on est journaliste. Et en effet, on attend ses vidéos pour s'assurer qu'elle vit toujours, ce qui n'est plus le cas de tous les Instagrammeurs cités ici.

Bisan garde une approche journalistique, relayant les informations qu'elle peut collecter sur la situation en différents endroits de l'enclave et en documentant ce qui se passe dans les lieux de refuge où elle a pu se trouver, comme à l'hôpital Al-Shifa au début de la guerre, à Rafah, ou dans la zone d'Al-Mawasi. Mais elle n'hésite pas à partager aussi ses moments de désespoir, ses déplacements d'un refuge à l'autre, ses maladies de peau liées au manque d'hygiène, ses rencontres avec des enfants, sa joie de pouvoir croquer dans une carotte après en avoir été privé pendant des mois à Gaza…
C'est qu'elle reste une « conteuse », du nom du programme de vidéos Hakawatiya (Raconteur d'histoires) qu'elle produisait avant la guerre avec la chaîne de télévision Roya Palestine. Et de fait, à chaque publication, on écoute ce que Bisan a à nous dire. La plupart de ses posts sont des vidéos brutes face caméra, mais adressées directement au monde extérieur. Son visage, ses traits plus ou moins tirés et les mots qu'elle ne mâche pas, sont une source d'informations précieuse pour qui veut suivre ce que subissent les Gazaouis, et témoigner de leurs conditions de vie, leur santé mentale, leur survie.
Ce que l'on n'a pas pu montrer ni à Grozny ni dans le ghetto de Varsovie
Outre les journalistes, il y a toute une gamme de créateurs de contenus qui n'appartiennent pas à l'univers des médias, mais qui ont repris les codes des influenceurs du monde entier. À la différence que, dans leurs cas, le contexte est celui d'une guerre. Ils montrent la vie dans Gaza entièrement dévastée et la réalité de la guerre d'une façon jamais vue auparavant. C'est comme s'il y avait eu des Instagrammeurs dans le ghetto de Varsovie ou dans Grozny en train d'être rasée, montrant en direct tous les aspects de la survie.
Aussi étonnant que cela puisse paraître, il y a actuellement à Gaza des « influenceurs » cuisine, fitness, jardinage, lifestyle, etc. Bien sûr, ils ne peuvent pas bloguer comme partout ailleurs dans le monde, mais chacun apporte un angle de vue direct et précieux sur ce qui se passe à Gaza, avec toutes les difficultés quotidiennes, la dévastation, les aspects insoutenables, mais aussi des petits moments de bonheur et des touches d'humour. Bien souvent, le bourdonnement incessant des drones de surveillance israéliens accompagne leurs courtes vidéos. Une réalité inévitable de la bande de Gaza, avant même le 7 octobre 2023. Ils utilisent aussi toutes les astuces des réseaux, notamment les multi-publications d'un même contenu sur plusieurs comptes afin d'accroître leur portée et leur visibilité.
Ainsi Hamada Shaqoura (@hamadashoo, 582k abonnés), blogueur culinaire avant la guerre et qui est maintenant derrière les fourneaux d'une sorte de soupe populaire appelée Watermelon Relief (Secours Pastèque (1)), qui distribue de la nourriture aux enfants. Il nous montre en détail comment, sous un hangar en tôles et dans d'énormes marmites, il prépare de grandes quantités de riz au lait, de hamburgers ou d'autres délices prisés par les enfants.
Et pendant toute la durée de sa recette, au lieu de regarder ce qu'il fait quand il verse un ingrédient ou remue sa mixture, il fixe l'objectif avec un regard perçant. Il nous scrute, nous les spectateurs, au fond des yeux. C'est un style chez certains créateurs de contenus qui cultivent un degré de provocation et de détachement. Mais dans son cas, il semble plutôt nous mettre devant nos responsabilités chaque seconde de sa vidéo : « Voilà ce que je suis obligé de faire et dans quelles conditions ».

Et dans les faits, on ne peut pas détourner les yeux, car il est fascinant de voir comment il réalise des petits miracles, des plats et des friandises que les enfants adorent et qui ont l'air réellement appétissants. Et tout cela non pas avec des ingrédients raffinés, mais avec des produits de qualité aléatoire comme d'énormes boîtes de conserve bon marché issus de l'aide alimentaire. Le meilleur moment : la distribution à la fin aux enfants qui se bousculent, se délectent avec gourmandise et ne se font pas prier pour dire que c'est délicieux devant la caméra. On est là pour ces quelques sourires au milieu du désastre.
Des recettes pour se régaler, pour survivre
L'adorable petite Renad (@renadfromgaza), elle, cuisine devant un petit réchaud derrière la tente familiale. C'est son jeu préféré, une dînette « pour de vrai » et son moyen d'évasion d'un quotidien bouleversé. Elle a 11 ans et 1,2 million d'abonnés, et a posté depuis un an une soixantaine de recettes variées, toujours « à la façon gazaouie ». Les vidéos sont filmées et sous-titrées en anglais avec l'aide de sa grande sœur (@dr.nourhanattallah) qui est consciente de préserver ainsi la santé mentale de sa cadette.
- Renad, comme les pros des réseaux, ponctue toutes ses vidéos avec certains gimmicks qui sont devenus sa patte : « Yallah nbalesh » (« allez on commence ») et à la fin « wallah tejaaaanen » (« je vous jure ça déchiiire »).
Le plus réussi, c'est qu'elle arrive vraiment à nous intéresser à des recettes typiques de Gaza (avec l'indispensable piment qui les accompagne) qu'on peut reproduire chez soi. Mais l'on est surtout fasciné par la façon avec laquelle les Gazaouis parviennent à les préparer et à entretenir et sauvegarder leur patrimoine culinaire en utilisant des produits très limités en raison de l'entrée restreinte des denrées alimentaires et de la pénurie de produits frais, et tout cela cuisiné de façon rudimentaire derrière une tente…

Renad, comme les pros des réseaux, ponctue toutes ses vidéos avec certains gimmicks qui sont devenus sa patte : « Yallah nbalesh » (« allez on commence ») et à la fin « wallah tejaaaanen » (« je vous jure ça déchiiire »). Et l'on s'en régale à l'avance parce que finalement, au-delà de la recette, nous partageons l'enthousiasme brut et joyeux d'une enfant qui joue à l'influenceuse « cuisine » et a réussi à se créer sa propre échappatoire.
Dans un autre style, Basma Abu Shahla (@basma_shahla, 635k abonnés), créatrice d'une marque de vêtements à Gaza avant la guerre, est retournée vivre dans son logement partiellement détruit en avril 2024. Elle a alors commencé à poster des vidéos très lifestyle et cocooning (2), dans l'esprit d'une tendance actuelle des réseaux présentant de belles images de pâtisseries faites maison et de goûters réconfortants. Mais dans son cas, ce n'est pas un jardin riant ni une décoration cosy dans l'air du temps en arrière-plan, mais un champ de ruines.

Le côté soigné, doux et esthétisant de ses petites mises en scène tranche avec le décor alentour, créant alors une esthétique à part entière, incongrue, mais extrêmement puissante. Le 17 octobre 2024, elle a posté une vidéo déchirante, dans son style habituel de préparation, mais dans lequel toutes les casseroles étaient vides puisque l'aide humanitaire n'était pas rentrée depuis plusieurs semaines et que le nord de Gaza était soumis à une famine aiguë. Comme ces dernières semaines.
Bricolage et jardinage, envers et contre tout
Au rayon influenceurs « DIY et bricolage », on trouve Ibrahim Abu Karsh (@ibrahimkarsh), qui a « seulement » 40,2k abonnés, mais qui montre des astuces incroyables qu'il appelle camping tricks. On a vu depuis le début de la guerre les Gazaouis construire des fours à bois à base de terre séchée ou des réchauds improvisés dans des boîtes de conserve en l'absence d'électricité et de gaz, mais Ibrahim élève l'art de la récupération à un niveau de débrouillardise supérieur. Le voir prélever de la boue du sol et en extraire une eau presque pure à l'aide de filtres rudimentaires est bluffant. Il utilise du coton et de la gaze absorbante, qui retiennent l'eau avant de la faire passer goutte à goutte, un peu plus propre, d'un bocal à l'autre. Dans d'autres vidéos, il construit un petit chauffage d'appoint avec des boîtes de conserve vides, récupère le sel de l'eau de mer ou encore fabrique une bougie anti-moustiques. Ses vidéos sont sans paroles, mais il n'y en a pas besoin, ses DIY (Do it yourself, bricolage ou travail manuel amateur) sont simples et efficaces.

Aussi remarquable que les influenceurs « cuisine », l'influenceur fitness existe à Gaza. Un Tibo InShape (3) local est Mohamed Hatem du compte @gym_rat_in_gaza (221k abonnés). Il peut vous apprendre à faire de la musculation dans n'importe quel contexte, en utilisant un encadrement de porte, un bidon d'eau ou une bouteille de gaz. Sa motivation sans faille, sa routine parfaite et son humeur inaltérable en toute occasion sont le meilleur moyen de vous culpabiliser de ne pas être davantage en forme dans votre environnement privilégié et de ne pas faire plus d'exercice.

Élément perturbant, dans une pièce de sa maison à moitié détruite dans laquelle il présente des exercices entre deux fauteuils, une étoile de David et des inscriptions ont été taguées, dont le mot « revanche » en hébreu, et un « Allez l'OM » en français dans le texte. Des membres de l'armée israélienne ont en effet occupé sa maison quelque temps avant de se retirer en début d'année 2025.
Au rayon jardinage, un autre enfant des réseaux sociaux très à l'aise devant les caméras, Ahmed, 8 ans, a commencé à apparaître sur le compte Instagram de son père Aaed Abusweilem (@tasnemaaed, 1 million d'abonnés) et à planter un petit jardin en avril 2024. Du maïs et des oignons à côté de sa tente à Rafah. Il n'a pas manqué de transporter ses plants au cours des déplacements forcés de la famille. Il fait un tas d'autres choses sur son compte : principalement demander des dons via Paypal ou Gofundme, comme beaucoup d'autres Gazaouis en ligne, exposer sa vie quotidienne, ses joies, et aussi les moments sombres comme quand sa mère et ses sœurs ont été blessées par des éclats d'obus lors d'un bombardement près de leur tente en décembre 2024.

Mais ce sont ses vidéos de jardinage qui ont fait sa popularité, dont AJ+ a d'ailleurs fait un sujet. Sur ses vidéos il porte très souvent un chat dans ses bras, un capital sympathie assuré tant les félins sont populaires sur les réseaux sociaux. Son premier chaton, Suzy, est mort d'une hépatite, ce qui l'a beaucoup affecté. À présent, il est toujours avec celui qui ne le quitte plus, un beau matou noir du nom de Simba que son frère avait retrouvé tout petit sous les décombres. Le père d'Ahmed leur a récemment créé un compte dédié à leurs noms : @ahmed_and_simba.
- Il n'a pas pu aller au bout de son défi et sa « petite ferme », comme il l'appelait, est restée orpheline depuis qu'il a été tué le 26 août 2024 à l'âge de 19 ans
Un autre jardinier amateur des réseaux sociaux était Medo (@medo_halimy, 118k abonnés), un jeune homme attachant qui aimait se baigner et admirer le coucher du soleil pour oublier son quotidien. Il s'ennuyait dans cette vie de réfugié sous une tente et a eu l'idée de planter tous les jours jusqu'à la fin de la guerre. Ce jardinier amateur n'y connaissait absolument rien en jardinage. Il a appris les bases au fur et à mesure des conseils et commentaires des internautes. Il partageait en même temps au quotidien sa vie sous la tente, répondant régulièrement aux questions des abonnés sur la survie à Gaza : comment s'approvisionne-t-on en eau ou encore comment parvient-on à avoir du réseau internet. Il n'a pas pu aller au bout de son défi et sa « petite ferme », comme il l'appelait, est restée orpheline depuis qu'il a été tué le 26 août 2024 à l'âge de 19 ans par des éclats d'obus d'une frappe israélienne visant Khan Younès.

Un univers de débrouille
Medo était proche du duo Omar et Mohammed du compte @omarherzshow qui totalise 1,5 million d'abonnés. Il s'agit de deux amis qui avaient à peine commencé l'université à la rentrée 2023 quand leurs études ont été brutalement interrompues une semaine après, le 7 octobre. Dans le nom de leur compte Instagram il y a le mot « show » et c'est en effet un « show » fascinant : des vidéos rythmées, amusantes, avec les musiques et montages dans les tendances du moment. Ce sont deux jeunes amis qui mettent en scène leur vie sur les réseaux, font des vlogs comme il y en a plein en ligne, s'exprimant dans un anglais américanisé et reprenant les codes des influenceurs business et lifestyle. Sauf que leur vie n'a absolument rien de normal.
Ils ont commencé en créant un petit business : ils vendaient pour quelques dizaines de shekels des copies numériques d'applications, de jeux vidéo, de dessins animés ou de séries télé, qu'ils stockaient sur leurs disques durs, aux clients de passage dans un café. Un business de débrouille dans un univers où l'électricité, internet et les distractions sont devenus des denrées rares. Le fait qu'ils veuillent trouver de la joie dans la pire des situations et qu'ils documentent leur routine quotidienne de façon enjouée, sans toujours faire référence aux horreurs de la guerre, leur garantit d'être particulièrement visés par des commentaires pro-israéliens.

Mais c'est souvent leur communauté d'abonnés qui se charge de répondre de manière systématique, argumentée ou sarcastique. Par exemple, la vidéo du jour 52, où ils ont l'idée de se faire un chocolat chaud sur la plage, a déclenché des commentaires (en majorité effacés depuis) niant l'existence d'une famine à Gaza puisque le marché où ils se rendent est achalandé et qu'ils ont le « luxe » d'avoir du chocolat… Leurs abonnés ont répondu abondamment en rappelant les chiffres du génocide en cours et en arguant que le fait de se partager un petit sachet de chocolat en poudre et de chauffer son lait en brûlant du bois dans une vieille boîte de conserve n'avait précisément rien d'un luxe. Cela les blesse sans aucun doute, car plusieurs de leurs vidéos ont voulu se justifier de ce qui n'était pas montré directement dans leurs routines quotidiennes : les morts, les destructions et les difficultés pour trouver un logement temporaire ou simplement aller chercher de l'eau.
Et puis ils ne font pas toujours des vidéos. Ils disparaissent pendant plusieurs mois, ce qui en général sous-entend qu'ils n'ont alors pas la capacité de vloguer ; comme lors de déplacements forcés d'une « zone d'abri » à une autre ou encore à la mort de Medo. C'est de nouveau le cas depuis février 2025 et nous, derrière nos petits écrans, ne pouvons rien faire d'autre qu'espérer qu'ils sont sains et saufs.
Autres comptes à suivre
Journalistes
– @plestia.alaqad (4,2 millions d'abonnés)
– @hindkhoudary (1,1 million d'abonnés), journaliste d'Al Jazeera
– @bayanpalestine (245k abonnés)
– @nooh.xp (427k abonnés), photographe et secouriste
– @aboodgaza (68,7k abonnés), photographe
Créateurs de contenus
– @m7md_vo (2,4 millions d'abonnés) : Mohamed Al Khalidi souvent accompagné de son petit frère trisomique Kenan.
– @ashraf_almajaida (1,1 million d'abonnés) : Ashraf et son petit frère Aboud
– Les frères @reachabed (329k abonnés) et @reachyusuf (470k abonnés)
– @ahmedmateer (35,1k abonnés) DIY, bricolage
– @dr.mo5tar (68,5k abonnés), chef dans les camps de réfugiés
– @mahashome (396k abonnés), cuisine, lifestyle
– @nouur97 (342k abonnés), mode, lifestyle
– @shamsabdn (146k abonnés), lifestyle, coaching, photographie
– @aborjelaa (487k abonnés) de l'initiative de soutien humanitaire @shababgaza
– @shorouqalazbaki (89,2k abonnés), lifestyle, promotion d'initiatives caritatives comme « 4 sisters »,
– @shababgaza
Notes
1- NDLR. Les couleurs de la pastèque (rouge, vert, blanc, noir) rappellent celles du drapeau palestinien. Avec l'interdiction de brandir leur drapeau, les Palestiniens ont alors utilisé la pastèque comme un moyen détourné d'exprimer leur identité nationale et leur résistance. La pastèque est utilisée comme symbole de solidarité avec la Palestine à travers le monde.
2- NDLR. Le cocooning désigne le fait de rester chez soi dans un environnement chaleureux et protecteur, pour se détendre ou fuir le stress extérieur.
3- Influenceur fitness français, youtubeur francophone le plus suivi avec plus de 26 millions d'abonnés.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le trumpisme, stade suprême de l’anti-intellectualisme

« Misère de l'anti-intellectualisme. Du procès en wokisme au chantage à l'antisémitisme » est sorti le 2 octobre 2024. On était un an après le 7 octobre. Or en France il n'y a eu aucune recension. Reste que l'élection de Donald Trump en a confirmé l'actualité. Après six mois, il était épuisé. L'avant-propos de la réédition, aujourd'hui en librairie, revient sur le paradoxe de cette (non-)réception.
5 juin 2025 | tiré du blog d'Éric Fassin sur mediapart.fr
https://blogs.mediapart.fr/eric-fassin/blog/050625/le-trumpisme-stade-supreme-de-l-anti-intellectualisme
La première édition de cet ouvrage est arrivée en librairie le 2 octobre 2024. Il était parti à l'imprimerie le 19 août, jour où s'ouvrait aux États-Unis la convention démocrate : Kamala Harris pouvait encore espérer la victoire. Du côté français, on savait seulement qu'Emmanuel Macron, au mépris des résultats d'élections législatives qu'il avait pourtant convoquées, refusait de choisir un Premier ministre dans les rangs de la gauche. Mon introduction annonçait un programme : « penser l'actualité ». Il ne s'agissait pas seulement de récapituler des développements récents, des deux côtés de l'Atlantique. Cet essai sociologique avait l'ambition de donner des clés pour comprendre ce qui prenait forme sous nos yeux. Pendant la fin de campagne, le candidat républicain accusait les migrants, dans l'Ohio, de manger chiens et chats. Contre ces alternative facts, que valait alors le fact checking ? C'était l'apothéose du bullshit politique – le grand n'importe quoi.
Or, cinq semaines après la parution du livre, Donald Trump remportait l'élection aux États-Unis. Force est de le constater : mon titre, Misère de l'anti-intellectualisme, a bien été validé par les cent premiers jours de ce second mandat. Dès son investiture, le 20 janvier, le président prenait un décret pour « défendre les femmes contre l'extrémisme de l'idéologie du genre et restaurer la vérité biologique dans l'État fédéral », et un autre pour « mettre fin au gâchis et à la radicalité de programmes de diversité et de politiques préférentielles dans l'administration fédérale ». L'anti-intellectualisme s'attaque en premier lieu aux politiques minoritaires, taxées de wokisme. Comme lors des attaques républicaines contre les présidentes d'universités auditionnées à la Chambre des Représentants depuis décembre 2023, il se drape dans la lutte contre l'antisémitisme. Les manifestations pro-palestiniennes servent de prétexte pour expulser des étudiants étrangers, écarter des professeurs, et sous la pression d'enquêtes annuler des financements fédéraux pour obtenir la capitulation d'universités d'Ivy League placées sous le contrôle du régime. Le nouveau vice-président, J.D. Vance, l'avait déclaré sans ambages en 2021 : « Les universités, voilà l'ennemi. »
En France, Patrick Hetzel, ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche nommé en septembre 2024 par Michel Barnier, avait demandé quelques mois plus tôt à l'Assemblée nationale la création d'une commission d'enquête sur les « dérives islamo-gauchistes » dans l'enseignement supérieur. C'était reprendre le projet auquel l'ancienne ministre Frédérique Vidal avait dû renoncer. Quelques jours avant la date anniversaire du 7 octobre 2023, Patrick Hetzel inaugurait sa fonction nouvelle en condamnant « des manifestations et prises de position de nature politique, en lien avec le conflit au Proche-Orient », qui iraient, à l'en croire, « à l'encontre des principes de neutralité et de laïcité du service public de l'enseignement supérieur. » Les mobilisations ne parlent pourtant ni d'islam ni de judaïsme ; l'alibi républicain sert juste à neutraliser (au sens policier) le monde universitaire. C'est qu'à la différence des États-Unis, l'anti-intellectualisme avance souvent masqué. D'ailleurs, les mesures contre les universités s'y autorisent volontiers, non d'une idéologie, mais d'une rationalisation néolibérale : ce peut être au nom de l'évaluation des politiques publiques et de la rigueur budgétaire que sont visés, sans qu'il soit besoin de les nommer, les savoirs critiques.
Ainsi, début 2025, le Haut Conseil de l'Évaluation de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur (HCERES) a rendu des avis défavorables sur de multiples licences et masters, surtout en philosophie et sciences sociales (y compris dans ma propre université). Or on apprenait bientôt que beaucoup de ces avis, susceptibles d'entraîner la fermeture de diplômes, contredisaient ceux des évaluateurs sollicités par cette instance. Démentant son indépendance supposée, le HCERES s'était ainsi permis, à l'insu de tous, de rayer d'un trait de plume, avec leurs conclusions, le principe même du jugement des pairs qui est un des piliers des libertés académiques. La révélation de ce contrôle politique entraînait un vote de l'Assemblée nationale, le 10 avril, pour la suppression de cette instance. Pourtant, le nouveau ministre, Philippe Baptiste, n'hésitait pas à protester… au nom de « l'autonomie » et de la « liberté académique ». Ce n'est sans doute pas un hasard si des soutiens intellectuels de l'offensive anti-intellectuelle contre un prétendu islamogauchisme, dès l'annonce en 2021 par Frédérique Vidal d'une enquête, avaient justement proposé de confier celle-ci au HCERES, « institution indépendante du ministère », pour lutter « contre la contamination du savoir par le militantisme ». On retrouve la convergence des logiques néolibérales et néofascistes : pour les premières, les savoirs critiques sont inutiles ; pour les secondes, ils sont dangereux.
Toutefois, la France apparaît quelque peu en décalage, voire en retrait par comparaison avec la radicalisation trumpiste. Dans les recherches bénéficiant d'un financement fédéral, le président des États-Unis a établi une liste de centaines de mots suspects ; y figurent non seulement « diversité » ou « intersectionnalité », ou encore « antiracisme », « race et ethnicité », qui organisent pourtant le recensement, et certaines de ses catégories, comme « noir » ou « Native American » (mais pas « blanc ») ; non seulement « LGBT » ou « trans », et bien sûr « genre », ou encore « féminisme », et même « femmes » (mais pas « hommes »). La purge ne s'arrête plus au « wokisme ». Le soupçon pèse aussi sur « discrimination » et « privilège », « inégalité » et « injustice », ou encore « inclusion » et « exclusion », et même « handicap » ou « santé mentale ». Outre « Golfe du Mexique », c'est la « science du climat » qui passe à la trappe, sans oublier « biais » ou « à risque ». Bref, la cible est la vérité scientifique en tant que telle.
Quant à la justification de la répression anti-universitaire par la lutte contre l'antisémitisme, sa crédibilité est quelque peu entamée par le salut, pudiquement qualifié de « romain », affiché le jour de l'investiture du président par son favori, Elon Musk. Que Steve Bannon, son rival dans le camp trumpiste, l'imite un mois plus tard n'a fait qu'en confirmer la signification. L'hebdomadaire allemand Die Zeit a d'ailleurs tranché (en pastichant Gertrude Stein) : « un salut hitlérien est un salut hitlérien est un salut hitlérien ». Pourtant, le président de l'Anti-Defamation League, Jonathan Greenblatt, censé lutter contre l'antisémitisme, n'a voulu y voir qu'« un geste maladroit, dans un moment d'enthousiasme, pas un salut nazi. » Pourquoi s'en étonner ? Ce livre apporte un éclairage. D'un côté, Elon Musk a favorisé l'expression suprémaciste sur X, allant jusqu'à reprendre à son compte la version antisémite de la « théorie » du grand remplacement, et de l'autre, cela n'a pas empêché le même Jonathan Greenblatt d'applaudir son engagement après l'interdiction de slogans pro-palestiniens sur son réseau social. Bannir le mot « décolonisation » pour parler d'Israël est un gage d'antiwokisme qui dédouane des accusations d'antisémitisme. Au moment même où celles-ci pleuvent contre la gauche, le néofascisme qu'elles épargnent peut avancer à découvert.
La résonance de ce livre avec une actualité qu'il paraît anticiper explique probablement l'épuisement de son premier tirage, six mois seulement après sa sortie. Cet accueil d'un public désireux de mieux comprendre interroge d'autant plus sur le silence qui a prévalu jusqu'à présent dans les médias : une seule recension, dans Le Soir, en Belgique ; deux entretiens en vidéo, l'un pour Regards, revue de gauche, l'autre pour SQOOL TV, chaîne consacrée à l'éducation. Ni le premier anniversaire du 7 octobre, coïncidant avec sa sortie, ni le nouveau mandat de Donald Trump n'ont suffi à éveiller l'intérêt journalistique. Comment l'interpréter ? Les deux premières phrases du livre apportent une première réponse : « On ne peut plus rien dire » a cédé la place à : « Taisez-vous ! » Son annulation dans les médias privés ou publics qui vont de l'extrême droite au macronisme confirme donc l'argument de cet ouvrage. Face à des analyses qui invalident un discours dominant sur l'antisémitisme qui s'emploie à diaboliser la gauche pour mieux dédiaboliser l'extrême droite aux portes du pouvoir, la prudence journalistique le dispute à l'embarras.
On peut ajouter que ce silence est l'effet d'une logique médiatique qui amène à discuter surtout ce dont on parle déjà. Or, aujourd'hui, ce n'est plus la gauche qui donne le la : l'hégémonie idéologique est passée à droite. En conséquence, les pamphlets de droite accaparent l'attention, fût-ce pour les critiquer. De fait, la plupart des médias continuent de faire comme si l'on pouvait débattre de tout avec n'importe qui – y compris pour dire n'importe quoi. C'est croire que l'on vivrait encore dans un espace public libéral où les opinions pourraient s'affronter lors d'échanges argumentés. Mais s'il défend des valeurs, Misère de l'anti-intellectualisme n'est pas à proprement parler un livre d'opinion. C'est un travail sociologique qui mobilise des faits empiriques et des outils conceptuels pour appréhender la configuration politique renouvelée par le trumpisme. Sans doute un essai polémique eût-il été la cible d'attaques. Contrairement à mes craintes, ce n'a pas été le cas : ce livre n'a pas suscité d'écho médiatique, même négatif. Dans un contexte d'anti-intellectualisme, le savoir subit bien sûr des formes de silenciation. Le public rencontré par ce livre, malgré l'annulation par les médias, confirme néanmoins l'amoindrissement de leur pouvoir prescripteur, en particulier dans les jeunes générations qui sont au cœur de cet ouvrage. Reste à espérer que des médias suivent l'intérêt des lecteur∙ices, à défaut de le dicter.
Finalement, la non-réception médiatique du livre peut donc s'expliquer, non pas malgré son actualité, mais à cause d'elle. Le contexte nouveau, dans son incertitude, crée en effet un malaise dans l'antiwokisme. En France, le Rassemblement national, qui a tant œuvré pour gagner un certificat de dédiabolisation, peut-il emboîter le pas à la radicalisation trumpiste ? Certes, il n'est pas surprenant que Marion Maréchal, Sarah Knafo et Éric Zemmour aient bénéficié d'une invitation à Washington pour les cérémonies d'investiture présidentielle, et non Marine Le Pen. Encore la condamnation de celle-ci en justice pourrait-elle entraîner son revirement : Donald Trump ne lui a-t-il pas manifesté sa solidarité ? À l'entendre, « c'est le même scénario qui a été utilisé contre moi ». Le trumpisme triomphant pourrait-il donc enfoncer un coin, en France, entre la minorité au pouvoir et l'extrême droite dont le soutien tacite, depuis la parution de ce livre, a été la condition nécessaire de survie des gouvernements choisis par Emmanuel Macron ? Il est vrai qu'à l'instar de J.D. Vance, Washington ne cache pas son mépris pour l'Union européenne ; celle-ci ne menace-t-elle pas de sanctions des oligarques comme Mark Zuckerberg et Elon Musk lui-même ? Il serait pourtant prématuré d'en conclure que, face à la coalition d'autocrates qui se dessine entre Donald Trump, Vladimir Poutine, et tant d'autres, la France et l'Europe renoueront avec un modèle libéral mis à mal par le recul des libertés publiques et le durcissement des politiques xénophobes, mais aussi, sous de multiples formes, par la privatisation de la puissance publique.
En tout cas, face à l'antiwokisme de Trump, la France ne saurait sérieusement se prétendre woke. Lorsque l'ambassade américaine à Paris exige des entreprises françaises qu'elles renoncent à toute politique de diversité, beaucoup s'offusquent d'une telle ingérence. « Quel toupet ! ». Cela dit, comme le souligne un dessin de Colpacano (Le Monde, 6 avril 2025) : « on n'a jamais eu de politique inclusive ! » L'ironie redouble dans l'image : un technicien de surface noir et une secrétaire qui apporte le café aux patrons indignés encadrent silencieusement ces deux hommes blancs. Cependant, les pourfendeurs européens du « totalitarisme woke » sont actuellement confrontés à un dilemme : la haine de l'Europe professée par le trumpisme les condamne-t-elle à sacrifier l'antiwokisme ? Il en est pour le reconnaître, ce combat n'est plus une priorité ; et de préconiser la « nuance », plutôt qu'un antiwokisme primaire. Mais il leur serait coûteux de devoir renoncer aux séductions de la notoriété éditoriale et médiatique qui accompagne l'incessant ressassement de leurs opuscules et tribunes. Pour ne pas renoncer aux gratifications de cette prolifique polémique, ils n'hésitent pas à plaider que, si le wokisme sert de « repoussoir » commode au poutinisme et au trumpisme qui le répriment, les wokes seraient en même temps les « alliés objectifs » de Poutine et Trump, communiant dans la détestation de l'universalisme occidental. « Hitler a déshonoré l'antisémitisme », écrivait Georges Bernanos en 1944. Trump finira-t-il par discréditer l'antiwokisme, ou bien celui-ci sera-t-il sauvé, en Europe comme aux États-Unis, par le chantage à l'antisémitisme réservé à la gauche ?
Misère de l'anti-intellectualisme. Du procès en wokisme au chantage à l'antisémitisme, Textuel, 2e édition, 4 juin 2025

Ressources naturelles & extractivisme

Entre novembre 2023 et novembre 2024, la CQMMF a organisé une série de cinq (5) webinaires qui avait pour but de faire le tour du monde des résistances féministes. Chaque webinaire a été consacré à un thème spécifique et à une région du monde nous permettant de partager nos expériences et surtout de mieux comprendre comment s'organisent les résistances féminises.
Amériques
Le tour du monde des résistances féministes s'est poursuivi le 19 septembre sous le thème de l'extractivisme et les ressources naturelles. Les panélistes étaient Aurora Valentina du Pérou et Alejandra Laprea du Venezuela.
Qu'est-ce que l'extractivisme ?
Tout d'abord l'animatrice a rappelé que l'extractivisme est un mode d'accumulation de richesse qui implique d'extraire des ressources et de les vendre sur les marchés (souvent internationaux). L'extractivisme va jusqu'à avoir recours au pillage et à la dépossession des peuples.
les luttes et résistances
Pour Alejandra Laprea, les luttes menées sont ancrées dans la résistance aux grandes multinationales qui saccagent les terres et les territoires et qui tentent de contrôler les richesses du Venezuela. Le Venezuela est un pays avec une grande quantité d'or et de pétrole, de minéraux rares pour la technologie, avec une biodiversité incroyable et beaucoup d'eau douce. Les ressources de ce pays, qui est une porte d'accès à l'Amérique du Sud, sont convoitées. Le blocus subit depuis 10 ans a affecté l'économie du Venezuela, ce qui a mené selon Alejandra Laprea à un retard important dans le développement du pays et à une dépendance aux dollars américains. Le peuple vénézuélien réclame un commerce libre. Il y a quelques années, le peuple vénézuélien a décidé de mener sa propre révolution pour que les richesses naturelles soient au service du peuple. Le peuple doit résister constamment pour s'assurer que les ressources naturelles, tout comme les systèmes de santé et d'éducation, demeurent au service de la population.
Aurora Valentina nous a expliqué être très impliquée dans les luttes aux côtés de deux communautés autochtones qui sont menacées par une minière canadienne. Dans ce projet, pour lequel la population n'a jamais été consultée, les eaux sont à risque d'être contaminées. C'est déjà arrivé par le passé, de l'arsenic a été détecté. Les conséquences importantes sur la santé et sur la pénurie d'eau sont bien réelles. Des démarches sont faites pour sensibiliser les dirigeant-e-s des communautés et pour fortifier ce mouvement. Des jeunes soulignent l'importance des emplois fournis par cette minière qui est considérée comme « une vache à lait ». Malheureusement, ce lait est contaminé, et contamine les eaux. Il y a eu plusieurs marches pour empêcher la minière de déployer ses machines. On tente de faire taire le mouvement de mobilisation, notamment en accusant les communautés mobilisées d'avoir volé des équipements. La lutte se poursuivra !
Alejandra Laprea dénonce que l'embargo imposé au Venezuela vise à contrôler les ressources du pays et les mettre entre les mains des multinationales. Les conséquences sont importantes : rationnement de l'eau et de l'électricité, manque d'accès aux vaccins de la COVID, confiscation de traitements pour les diabètes. Les impacts de ces restrictions sur les femmes sont importants. Le système capitaliste est en crise, et cette crise se fait sur le dos des femmes. Leur charge de travail augmente, elles doivent régler les problèmes d'eau, combler les lacunes du système hospitalier et elles ont moins de possibilités économiques. Les femmes s'organisent et créent des propositions pour une économie nouvelle, telle qu'un projet de coopératives pour la gestion des résidus solides, pour le recyclage du plastique, du carton et du verre afin de les convertir en nouveaux objets. Aussi des centaines de femmes s'organisent autour des écoles afin de fournir du matériel et de la nourriture en élevant des animaux. Elles se forment sur l'économie féministe afin de faire avancer des circuits de production et de consommation.
Pour Aurora Valentina, la lutte contre les violences vécues par les femmes et l'accompagnement des organisations leur venant en aide sont centraux. Les entreprises minières ont amené beaucoup de violence au Pérou : abandon par les maris partis travailler à la mine, manque de protection des femmes, manque de nourriture pour les enfants, maltraitance. Un autre problème rencontré est la pénurie alimentaire. Les femmes ne savent plus comment nourrir leur famille, il n'a a pas assez de production agricole.Au Pérou, si on se bat pour défendre son territoire, on se fait persécuter, menacer, insulter par la police et par les minières. Le gouvernement et la police défendent les minières, donc une minière canadienne, qui détruisent les territoires autochtones. Des gens ont été condamnés et ont dû fuir pour éviter la prison et les persécutions. Dans toutes les régions, les femmes sont mobilisées et actives. Il y a des femmes qui font des activités artisanales leur permettant de gagner leur vie. Il faut chercher des stratégies, il faut continuer de se battre, pour faire reculer les entreprises minières.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Oui, trop tard pour qu’Israël et les israéliens se libèrent de leurs démons génocidaires !

Après vingt mois de massacres quotidiens de civils -surtout des femmes et des enfants- et des actes d'un indicible sadisme mortifère, dont la famine organisée contre les habitants de Gaza, l'État israélien, mais aussi la société israélienne, voient leur heure de la vérité approcher comme jamais auparavant
* Par Yorgos Mitralias*
Alors, l'État sioniste peut-il devenir « normal », un État plus ou moins pareil aux autres ? En somme, est-il « réformable » ou est-il condamné à s'enfoncer de plus en plus dans la barbarie raciste, obscurantiste et exterminatrice de ses voisins qu'il traite de sous-hommes ? Et la société israélienne, peut-elle se défaire de ses fascistes et aspirants dictateurs ou il est déjà trop tard pour qu'elle se libère de ses tentations totalitaires et de ses démons suprématistes ?*
La réponse à ces interrogations est donnée d'abord par les événements de ces vingt derniers mois. Évènements qui ont vu l'État israélien franchir l'une après l'autre toutes les « lignes rouges », non seulement en se transformant en une machine à tuer massivement et en commettant les pires crimes contre l'humanité, mais aussi en les revendiquant publiquement,
allant jusqu'à se déclarer systématiquement fier de ces « exploits » macabres ! Le constat est donc catégorique : *l'État israélien suit une évolution inexorable et pleinement assumée vers sa transformation en État criminel et hors la loi !*
Mais, ce qui rend cette évolution encore plus redoutable et sinistre c'est qu'elle est rendue possible par la complicité active et l'approbation enthousiaste de la très grande majorité des citoyens israéliens ! Cette amère, et si dangereuse, vérité qu'on avait pu constater jour après jour ces vingt derniers mois, est maintenant pleinement confirmée par les conclusions d'une enquête d'opinion publiée par Haaretz (1) et passée – « évidemment » - presque sous silence par les grands médias de nos pays : *82% des Israéliens veulent expulser les Palestiniens de Gaza, et 47% d'eux veulent les tuer tous, enfants inclus !*
Et aussi, 56% des Juifs israéliens veulent expulser d'Israël ses citoyens Palestiniens, et ce pourcentage monte a 66% pour les Israéliens de moins de 40 ans. Il est à noter que, selon la même enquête, 70% des Israéliens dits « libéraux » et laïcs soutiennent l'expulsion des Gazaouis de leur terre, ce qui nous éclaire déjà sur la vraie nature de leurs manifestations contre
Netanyahou et son gouvernement : oui, ils veulent très sincèrement renverser ce gouvernement, et une partie d'eux, surtout les familles des otages, veulent le cessez-le feu. Mais, tout ça ne veut pas dire qu'ils veulent une paix durable avec les Palestiniens, ni qu'ils sont contre leur expulsion de Gaza ou même contre leur extermination. D'ailleurs, il suffit de lire attentivement la plupart de leurs proclamations pour voir que, sauf rares et très louables exceptions, ils ne sont pas contre ou même soutiennent la reprise de la guerre d'extermination contre les Palestiniens après un cessez-le-feu qui permettrait la libération des otages détenus pas Hamas.
De même, l'énorme pourcentage (97% !) des Ultra-orthodoxes (*Haredim*) qui soutiennent l'expulsion de Gazaouis devraient rendre plus circonspects ceux qui dans nos pays, s'empresseraient de penser du bien du parti de ces mêmes Haredim vu qu'il prépare, ces jours-ci, la chute du gouvernement Netanyahou. *En Israël, on peut être contre Netanyahou et être aussi
mauvais ou même pire que lui…*
La réponse aux interrogations de l'heure de la vérité israélienne, que donnent tant les événements des derniers vingt mois, que l'enquête d'opinion déjà citée, ne laisse donc aucun doute : Non, ce monstrueux Etat sioniste n'est pas « réformable », comme d'ailleurs n'est pas « réformable » la societe israélienne qui soutient activement ses politiques génocidaires ! Ce qui a comme conséquence que *même si Netanyahou est éloignée du pouvoir, les politiques criminelles continueront parce qu'elles correspondent aux vœux de la très grande majorité de la population juive d'Israël*. Alors, inutile de parler des divers
« solutions » du problème moyen-oriental (un ou deux états) avant de répondre a la question primordiale : que faire de l'État sioniste et surtout que faire de cette société israélienne ?
Il y a 16 mois, en décembre 2023, on écrivait déjà que « *le massacre méthodique et le nettoyage ethnique des Palestiniens qui a commencé avec la liquidation de ce qui est ce véritable ghetto de Gaza, se font en toute conscience car ils correspondent aux objectifs historiques du projet sioniste : la création, par l'extermination, l'expulsion et la soumission des indigènes, d'un État exclusivement juif sur l'ensemble des terres du Grand Israël !* ». Et on continuait en tirant la conclusion suivante : *« un
tel État est par nature monstrueux, inhumain et... irréformable » …et « la solution qui s'impose crève les yeux : il faut changer cet État de fond en comble, afin de le rendre au moins « normal »,« comme les autres ». En somme, il faut le dé-sioniser* ».(2)
Arrivés à cette conclusion, on s'interrogeait comment faire pour de-sioniser Israël. Alors, on se tournait vers deux grandes expériences du passé qui pourraient nous aider : celle de l'Allemagne nazie, et celle de l'Afrique du Sud de l'Apartheid. Et voici ce qu'on écrivait : « *La dénazification de l'Allemagne à la fin de la Deuxième Guerre mondiale a été imposée par les puissances qui l'ont vaincu sur le champ de bataille. L'Apartheid sud-africain, la « purification » et la « normalisation » de
l'État s'est faite de l'intérieur, à l'initiative de deux populations jusqu'alors ennemies. Sur la base de ces précédents, on peut déjà exclure l'application à Israël du modèle de la dénazification allemande parce qu'il présupposerait la défaite militaire d'Israël, ce qui conduirait très probablement à un terrible bain de sang de sa population juive* ».
Ayant donc exclu la dénazification a l'allemande, notre article d'alors se déclarait en faveur de « *la variante sud-africaine qui suppose que la dé-sionisation d'Israël vienne de son intérieur, à l'initiative de ses propres citoyens* ». Aujourd'hui, tenant compte non seulement des massacres et autres crimes contre l'humanité, perpétrés, jour après jour, par l'État israélien à Gaza -mais aussi de plus en plus en Cisjordanie. Et tenant compte surtout des dispositions pogromistes et exterminatrices de la grande majorité des citoyens (juifs) d'Israël, nous ne pensons plus comme il y a 16 mois, en décembre 2023 : *Un scénario de dé-sionisation à la sud-africaine de la société israélienne nous paraît improbable sinon impossible*, d'autant plus que le temps court contre une éventuelle « pacification » de cet État et de cette société.
Malheureusement, ce qui apparait déjà, mais en filigrane, dans l'horizon israélien est la purge de cette société d'abord de ses (rares) éléments critiques du génocide palestinien, et ensuite de tout citoyen (juif) qui osera revendiquer des droits et libertés démocratiques. Alors, confrontés à une telle situation dominée par une extrême droite fascisante, obscurantiste, très agressive et violente, il est très probable qu'on assistera à l'exacerbation et la généralisation d'un phénomène qui pointe déjà le nez : l'exode massive d'Israël de ses citoyens tant soit peu libéraux et laïcs qui tiennent à leurs droits individuels les plus
élémentaires. Le résultat d'une telle évolution sera qu'il n'y aurait plus en Israël que des factions d'extrémistes plus ou moins délirantes et suprématistes, lesquelles tôt ou tard se battront entre elles, tout en inventant des nouveaux « ennemis » qu'il faudra bombarder sinon exterminer afin de perpétuer leur pouvoir fondé d'ailleurs sur le sentiment d'extrême insécurité qui résulte du mythe fondateur d'un Israël prétendument condamné à vivre encerclé par des ennemis soi-disant héréditaires.
Notre conclusion ne pourrait pas être optimiste, d'autant plus que nous ne voyons pas comment les Israéliens pourraient redevenir des êtres plus ou moins « normaux », arrêtant de favoriser, et de pratiquer, le nettoyage ethnique et l'extermination des Palestiniens, et demain peut-être d'autres de leurs voisins, au nom du mythe de ce Grand Israël biblique qu'il faut
reconstituer. Donc, pour l'instant nous ne sommes sûrs que d'une chose : quand Israël rencontrera ses premières vraiment grandes difficultés, et ses soutiens d'aujourd'hui, qui sont des antisémites patentés, se tourneront de nouveau contre les juifs, ceux qui prendront leur défense seront, de nouveau, les mêmes qui les ont toujours défendus bec et ongles et au péril
de leur vie. C'est-à-dire ces quelques gens de gauche, de préférence des révolutionnaires, qu'on ose qualifier aujourd'hui d'antisémites…
*Notes*
*1.*
https://geopoliticaleconomy.com/2025/05/30/poll-israelis-expel-palestinians-gaza-genocide/
*2.* Voir *Pour que les horreurs du carnage de Gaza soient les derniers Purger l'État d'Israël de ses fondements sionistes ! :
**https://www.pressegauche.org/Pour-que-les-horreurs-du-carnage-de-Gaza-soient-les-derniers-purger-l-Etat-d
<https://www.pressegauche.org/Pour-q...>
*
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Gaza à la lumière de Fanon

Dans le cadre du colloque scientifique international sur Frantz Fanon « Guerrier Silex », qui s'est tenu le 31 mai à l'Hôtel Karibea de Sainte-Luce, dans le sud de la Martinique, j'ai présenté une conférence sur l'héritage de Frantz Fanon. Organisé par l'association First Caraïbes, dirigé par le psychiatre et militant Aimé Charles-Nicolas, cet événement a rendu hommage à l'œuvre et à la pensée de Fanon.
Tiré du blogue de l'auteur.
Je voudrais commencer par remercier Aimé Charles-Nicolas et les organisateurs de cette conférence de m'avoir invité à participer à cet événement historique. Il est particulièrement exaltant pour moi de me trouver en Martinique, dans un lieu où Fanon a grandi et qui a eu une influence profonde sur son imagination et sur sa pensée – un lieu qui, comme vous le savez sans doute, l'a hanté jusqu'à la fin d'une existence tragiquement écourtée, ce d'autant plus qu'il n'a jamais pu y retourner une fois qu'il a rejoint la lutte pour la libération nationale de l'Algérie.
Lorsque j'ai commencé à travailler sur ma biographie de Fanon, je connaissais déjà ses racines martiniquaises, sa dette envers Aimé Césaire et son influence sur les écrits d'auteurs comme Edouard Glissant ou Patrick Chamoiseau. Mais ce n'est qu'à l'occasion de mes recherches que j'ai pris conscience de l'extraordinaire richesse et de la créativité de la tradition intellectuelle et poétique de la Martinique, qui imprègne tous les écrits de Fanon, et pas seulement Peau noire, masques blancs. Si Fanon a fini par s'identifier publiquement comme un Algérien, il est resté profondément attaché à la Martinique, et seul un Antillais aurait pu écrire Les Damnés de la terre, qui dépeint la société coloniale à travers le prisme des sociétés de plantation du Nouveau Monde.
Donc, encore une fois, un grand merci : je suis très reconnaissant d'être accueilli par vous ici.
On m'a demandé de parler de « Gaza à la lumière de Fanon ». Avant d'aborder ce sujet, j'aimerais inverser le titre proposé et parler de « Fanon à la lumière de Gaza », car la lecture qu'on peut faire aujourd'hui de cet auteur est forcément surdéterminée par les événements du 7 octobre et leurs conséquences.
Lorsque j'ai achevé la version anglaise de ce livre pendant l'hiver 2022, je m'attendais plutôt à ce qu'il soit lu à travers le prisme de la vague de manifestations contre l'assassinat de George Floyd par la police de Minneapolis un an et demi auparavant, ainsi que du débat que ce mouvement de protestation avait suscité autour des questions d'identité raciale et de l'expérience d'être noir sous la domination blanche. Mais ce contexte herméneutique a connu une métamorphose dramatique le 7 octobre 2023, lorsque des combattants du mouvement islamiste Hamas et d'autres factions palestiniennes ont franchi la frontière sud d'Israël, tuant près de 400 soldats et plus de 700 civils israéliens, et repartant avec 250 otages entre leurs mains. En quelques jours, Fanon a été tour à tour célébré et vilipendé sur les médias sociaux comme l'inspirateur intellectuel de l'attaque dite du « déluge d'Al-Aqsa », faisant ainsi l'objet d'un curieux consensus entre la gauche décoloniale et la droite sioniste. Dans un article intitulé « Vengeful Pathologies » paru dans la London Review of Books début novembre 2023 et traduit en français – sous le titre « Pathologies de la vengeance » – par le site Orient XXI, j'ai essayé de compliquer cette lecture, qui remonte à la célèbre préface de Sartre pour Les Damnés de la Terre. Lorsque mon livre est paru deux mois plus tard, j'ai été attaqué simultanément sur deux fronts : par les conservateurs pro-israéliens, qui m'accusaient de normaliser la croyance de Fanon en la violence, et par certains secteurs de la gauche radicale, qui me reprochaient de tenter de la neutraliser.
De l'avis de mes critiques, j'avais commis l'erreur impardonnable de vouloir injecter un peu de nuance dans le rapport de Fanon à la violence. Cette perception du révolutionnaire martiniquais comme incarnation d'une vision purificatrice et presque extatique de la violence anticoloniale évoque à mes yeux les observations de Fanon lui-même sur l'image de l'homme noir en Occident. Dans Peau noire, masques blancs, il écrit que le Noir est censé représenter tout ce qui relève de l'instinct biologique et des pulsions érotiques et violentes que les Blancs – et d'autres - préfèrent désavouer en eux-mêmes. Il n'est donc pas étonnant que Fanon continue d'être perçu comme un champion de la violence aveugle et absolue. Les écrits et la personnalité du psychiatre antillais ne sont dès lors qu'un écran sur lequel aussi bien les fanoniens que les anti-fanoniens projettent leurs peurs et leurs fantasmes. Or, fait remarquable en ce qui concerne le conflit israéolo-palestinien, Fanon a été symboliquement enrôlé comme combattant et guide idéologique d'une lutte sur laquelle il n'a jamais écrit un seul mot.
Certes, les passages de Fanon susceptibles d'être cités à l'appui de ce type d'arguments en faveur de la violence ne manquent pas. Il est exact que Fanon était partisan de la lutte armée : dans son esprit, la décolonisation était un processus intrinsèquement violent, et la violence était indispensable non seulement pour renverser le colonialisme, mais aussi pour surmonter la léthargie, l'impuissance et le fatalisme qu'il avait induits chez les colonisés. Il était hanté par l'idée que, si la Martinique et d'autres îles des Antilles n'avaient pas réussi à conquérir une liberté authentique, c'est parce qu'elles n'avaient jamais mené une véritable lutte contre leurs oppresseurs, contrairement au peuple haïtien. En réalité, la Martinique avait elle aussi connu ses révoltes d'esclaves, mais Fanon n'était pas familier de cette histoire, en partie à cause des lacunes et des silences de l'historiographie coloniale française. Ce sentiment obsédant d'un échec martiniquais a profondément marqué sa réflexion sur la révolution anticoloniale. Dans Les Damnés de la terre, comme l'a souligné Jean Khalfa, Fanon semble non seulement analyser la violence de la lutte anticoloniale, mais aussi en tirer une certaine jouissance, la présentant comme une sorte de nécessaire thérapie de choc. À mesure que la répression de la révolte algérienne par la France se faisait plus brutale et se traduisait par l'éradication de villages entiers, l'utilisation systématique de la torture et la disparition de milliers de personnes suspectes de sympathiser avec le FLN, Fanon manifestait de plus en plus son soutien aux attentats à la bombe et aux actions armées visant les civils. Il déclare même à un moment donné que tout Français présent sur le sol algérien est coupable, et constitue donc, apparemment, une cible légitime. Notons qu'il s'agit d'un raisonnement que certains de ses propres camarades au sein du FLN rejetaient.
En même temps, Fanon était manifestement perturbé par la violence, et pas seulement par celle du colonisateur. On perçoit son désarroi à ce sujet dans L'An V de la révolution algérienne, où il déplore la « brutalité presque physiologique » dont font preuve certains rebelles, et, surtout, dans le dernier chapitre des Damnés de la terre, intitulé « Guerre coloniale et troubles mentaux ». Il y évoque le meurtre d'un adolescent européen par deux de ses camarades algériens, ainsi que les troubles post-traumatiques dont souffrent les soldats rebelles ayant commis des crimes de guerre. Dans sa reconstitution poignante de la rencontre entre Fanon et Sartre à Rome en 1961, Simone de Beauvoir décrit un homme hanté par la violence dont il a été témoin et terrifié à l'idée de celle qu'il anticipait. Il se reprochait la mort de son mentor, le dirigeant nationaliste Abane Ramdane, assassiné par ses propres camarades au Maroc, et prédisait qu'au lendemain de l'indépendance, les règlements de compte et les accusations de trahison risquaient de provoquer un bain de sang. Par conséquent, pour pouvoir présenter Fanon comme un partisan inconditionnel de la violence, il faut en faire une lecture très sélective.
On ne peut que spéculer sur ce qu'il aurait pu dire au sujet de la Palestine. Il fait allusion dans Les Damnés de la terre aux réparations allemandes accordées à l'État juif après la guerre, mais ne mentionne jamais la Nakba, ni le sionisme, ni le colonialisme de peuplement qui est au fondement de l'existence d'Israël. S'il avait vécu assez longtemps pour voir la guerre des Six Jours en 1967 et assister à l'émergence de ce pays en tant que puissance occupante, il n'aurait sans doute pas manqué d'aborder la question. Dans le monde intellectuel francophone, ses contemporains ont réagi à la question palestinien de manière assez diverse. Claude Lanzmann, sioniste convaincu, n'a pas hésité à faire un usage assez pervers des thèmes fanoniens en célébrant le culte de la force prôné par Israël et en présentant Tsahal comme l'armée de libération nationale du peuple juif. Sartre, à qui sa visite de l'État juif à la veille de la guerre de 1967 avait laissé un goût plutôt amer, oscillait entre une défense embarrassée des Israéliens et des expressions sporadiques de soutien à la lutte armée des Palestiniens. Des historiens militants comme Pierre Vidal-Naquet et Mohammed Harbi se sont vigoureusement opposés à l'occupation et à l'expansionnisme brutal d'Israël et invoquaient une solution qui permettrait aux Arabes palestiniens et aux Juifs israéliens d'affirmer leur identité nationale tout en partageant équitablement la terre. Jacques Vergès, avocat du FLN pendant la guerre d'indépendance algérienne, s'alignait sur les positions du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) et d'autres groupes armés qui prônaient une décolonisation totale et violente, laissant planer l'incertitude sur l'existence des Juifs en Israël-Palestine. Par ailleurs, à la fin des années 1960, les organisations de la résistance palestinienne, du Fatah au FPLP en passant par le Front démocratique de libération de la Palestine (FDLP), ont de fait « palestinisé » Fanon en adoptant ses thèses et en distribuant des traductions des Damnés de la terre dans les camps d'entraînement de fedayines en Jordanie, au Liban et en Syrie.
Il est presque impossible d'imaginer Fanon se rangeant du côté de Lanzmann, mais aurait-il suivi les traces de Harbi et de Vidal-Naquet, ou bien celles de Vergès et du FPLP ? On peut défendre aussi bien l'une ou l'autre de ces hypothèses, car nous l'avons vu, les opinions de Fanon sur la violence étaient complexes et parfois contradictoires. En outre, nous ne savons pas ce qu'il aurait pensé de la version spécifique du colonialisme de peuplement propre au sionisme, compte tenu de la Shoah et des liens ancestraux des Juifs avec la Palestine. Tout comme Sartre, il soutenait les mouvements de libération nationale dans le monde arabe, mais avait de nombreux amis juifs et connaissait parfaitement l'histoire de l'antisémitisme en Europe. Aurait-il considéré le sionisme comme l'expression idéologique d'un simplement mouvement de conquête coloniale, et donc un phénomène à combattre avec les mêmes moyens qu'en Algérie, ou bien à la fois comme une forme de colonialisme et un projet national, exigeant dès lors des stratégies de résistance différentes ? Et ne devait-on pas considérer les Juifs israéliens comme différents des pieds noirs ?
Là encore, il est impossible de trancher, et l'œuvre de Fanon se prête à différentes lectures de ces questions. Dans L'An V de la révolution algérienne, il envisage un avenir dans lequel les Européens ayant embrassé la lutte pour l'indépendance seraient considérés comme des Algériens et vivraient aux côtés des musulmans sur un pied d'égalité ; mais à d'autres moments, il semble avoir une vision plus pessimiste des possibilités de coexistence. Autrement dit, invoquer le nom de Fanon à propos du 7 octobre et de Gaza, c'est ouvrir le débat, mais certainement pas le résoudre. Je ne pense pas qu'il faille s'en plaindre. Fanon ne demandait pas à ses aînés – ou aux auteurs qui l'ont précédé – de lui apporter des réponses toutes faites. Pourquoi nous comporter différemment ? C'est à nous qu'il revient de décider comment nous pouvons appliquer ses idées à la Palestine, en effectuant un véritable « saut » interprétatif – ou plutôt, un saut qui, je cite, « consiste à introduire l'invention dans l'existence ». Il ne s'agit donc pas de suivre servilement la lettre de ses écrits, mais d'être fidèle à l'esprit de son humanisme radical : comment mettre ses analyses au service des opprimés, de la liberté et de ce qu'il appelait la « désaliénation ».
Les parallèles entre le conflit israélo-palestinien aujourd'hui et l'Algérie du milieu des années 1950 n'auraient certainement pas échappé à Fanon. Tout comme l'Algérie française, Israël est fondé sur les ruines d'une autre société ; ses efforts incessants pour coloniser la terre et déposséder la population indigène se sont accélérés au cours des dernières années et ont été marqués par une brutalité croissante. Bien que les colonies israéliennes de Gaza ait été démantelées il y a près de 20 ans, le territoire est resté sous le contrôle et la surveillance étroite de l'État juif. Depuis 2007, la bande de Gaza est soumise à un blocus punitif dont on ne voit pas la fin. Jusqu'au 7 octobre, les Israéliens pensaient l'avoir neutralisée, instaurant même un partenariat tacite avec le Hamas, dont les dirigeants à Doha recevaient des millions de dollars transportés par les valises du gouvernement de Benjamin Netanyahou. Il y régnait un calme inquiétant, le calme de la « pacification », qu'Israël confondait avec la paix tout en cherchant à négocier des accords avec les dirigeants des États du Golfe.
Le 7 octobre, cette illusion de paix imposée par les conquérante a été brisée. Le « déluge d'Al-Aqsa » est une offensive traumatisante qui a brisé le sentiment d'invincibilité d'Israël et qui rappelle de manière frappante le soulèvement de Philippeville en 1955, « point de non-retour » de la guerre franco-algérienne, selon la formule de Fanon. Dans les deux cas, les actes de résistance légitime visant des soldats étaient mêlés à d'horribles crimes de guerre, dont des massacres sommaires de civils. On ne peut pas savoir si Fanon aurait établi de telles distinctions, mais ses écrits nous permettent de mieux comprendre pourquoi le 7 octobre s'est produit et pourquoi il a pris cette forme-là. L'auteur des Damnés de la terre n'a jamais manqué de le souligner : la violence anticoloniale est une contre-violence ; elle répond à la violence bien plus grande qui émane du système colonial et le définit. Et elle se manifeste partout où le système colonial a rendu le dialogue impossible. Fin 2023, ce n'était pas seulement le Hamas, mais le mouvement palestinien tout entier, qui se trouvait dans une impasse stratégique, incapable d'obtenir des concessions de la part d'Israël et courant le risque d'être complètement oublié par la communauté internationale. Le 7 octobre n'est pas sorti de nulle part.
L'œuvre de Fanon nous aide aussi à comprendre les pulsions les plus obscures qui ont animé le massacre de centaines d'habitants de kibboutz et de participants à une rave party. « Le colonisé, écrit-il, est un persécuté qui rêve en permanence de devenir persécuteur. » Le 7 octobre, ce rêve s'est réalisé pour ceux qui ont franchi la frontière sud d'Israël : les Israéliens allaient enfin éprouver le sentiment d'impuissance et de terreur que les Gazaouis avaient connu toute leur vie. En tant que psychiatre, Fanon n'aurait d'ailleurs eu aucun mal à comprendre pourquoi les Palestiniens ont pris les armes contre ceux qui les avaient dépossédé des terres de leurs ancêtres, imposé un blocus punitif à Gaza et bombardé leurs domiciles en faisant des dizaines de milliers de morts. Il était logique, expliquait-il, que « [celui] à qui on n'a jamais cessé de dire qu'il ne comprenait que le langage de la force, décide de s'exprimer par la force ». Il n'aurait pas non plus été étonné par le spectacle de la jubilation des Palestiniens face au 7 octobre, ni par les dénégations du Hamas quant au massacre intentionnel de civils perpetrés par ses miliciens - pas plus qu'il n'aurait été surpris par la machine de propagande israélienne qui, insatisfaite des crimes réels du Hamas, a diffusé des récits mêlant faits vérifiés et mensonges, comme la décapitation de bébés et le viol systématique de femmes. Dans une guerre coloniale, insistait-il, « le bien est tout simplement ce qui leur fait du mal ».
Après le 7 octobre, on a surtout invoqué Fanon en rapport avec la question de la lutte armée. Mais son œuvre apporte également un éclairage majeur sur l'impitoyable guerre de répression menée par Israël. Déterminée à surmonter son humiliation par le Hamas, l'armée israélienne a poursuivi une campagne de bombardements massifs, de nettoyage ethnique et d'organisation de la famine. Cette guerre contre les civils constitue clairement un génocide, selon les experts des droits humains et certains des plus éminents historiens de la Shoah, dont les Israéliens Omer Bartov et Amos Goldberg. Tsahal a tué plus de 54 000 Palestiniens à Gaza, déplacé la quasi-totalité de la population et détruit la plupart des bâtiments résidentiels, ainsi que toutes les universités et tous les hôpitaux. Elle a également étendu la guerre au Liban et occupé des régions de la Syrie. La violence d'Israël a revêtu en outre un caractère grotesquement exhibitionniste, à l'instar de la violence coloniale décrite par Fanon : elle vise à affirmer purement et simplement la domination tout autant qu'à atteindre un quelconque objectif politique. Et le langage des dirigeants israéliens est ouvertement raciste et génocidaire. « Nous combattons des animaux humains et nous agissons en conséquence », expliquait l'ancien ministre de la Défense israélien Yoav Gallant, confirmant ainsi l'observation de Fanon selon laquelle « le langage du colon, quand il parle du colonisé, est un langage zoologique [et] se réfère constamment au bestiaire ». Un membre de la Knesset a récemment suggéré qu'il fallait séparer les hommes de Gaza des femmes et des enfants et les tuer tous. Ce type de déclarations revient fréquemment en Israël, et sans aucune retenue.
Je ne pense pas que Fanon aurait été surpris de la rapidité avec laquelle l'offensive d'Israël s'est pratiquement transformée en guerre d'annihilation. Comme le mentor de ses années de jeunesse, Aimé Césaire, il avait compris que la violence fasciste avait un lien intime avec l'histoire de la conquête coloniale et que les guerres de répression coloniale acquéraient souvent le caractère d'un authentique génocide. Israël n'échappe pas à ce schéma. Si les milieux intellectuels et politiques des pays du Nord ont pour l'essentiel soutenu l'État juif, c'est aux pays du Sud – notamment l'Afrique du Sud post-apartheid –, forts de leur propre expérience de la domination raciale et coloniale, qu'a incombé la tâche de demander des comptes à Israël. Depuis la guerre de Gaza, le monde semble presque aussi « coupé en deux » qu'il l'était sous les yeux de Fanon à l'époque de la guerre d'Algérie.
Une dimension cruciale de la guerre de Gaza et du conflit dans lequel elle s'inscrit est le racisme – un thème auquel Fanon a consacré encore plus d'attention que la violence. Depuis le début de l'offensive israélienne, on assiste en Occident à une explosion de racisme contre les Palestiniens, et le soutien aux droits de ces derniers, faussement assimilé à de l'antisémitisme, y est de plus en plus souvent criminalisé. Aux États-Unis, s'exprimer au nom de la Palestine peut vous conduire en prison ou à l'expulsion du territoire, même si vous avez un permis de séjour permanent. Fanon connaissait la flexibilité et la créativité du racisme, qui ne cesse d'inventer de nouvelles cibles, Juifs, Noirs, Arabes ou autres. Dans l'imaginaire anti-palestinien, les Arabes de Palestie ne représentent pas seulement la barbarie, il ne sont pas simplement les ennemis existentiels de la civilisation « judéo-chrétienne », mais ils constituent une dangereuse cinquième colonne, comme l'étaient les Juifs en Europe. Apatrides, antagonistes des descendants des victimes de l'Europe, ils n'ont apparemment pas le « droit d'avoir des droits », ce qui est d'après Hannah Arendt la condition préalable pour être considéré comme un être humain à part entière. La déshumanisation des Palestiniens est allée de pair avec la guerre génocidaire contre Gaza, mais aussi avec l'offensive plus sournoise mais tout aussi conséquente menées en Occident contre les immigrés, en particulier les immigrés musulmans – et contre la démocratie elle-même.
Dans Les Damnés de la terre, Fanon prédisait que l'« héritage humain de la France en Algérie » serait « toute une génération d'Algériens, baignée dans l'homicide gratuit et collectif gratuit avec les conséquences psychoaffectives que cela entraîne ». On peut appliquer la même logique à l'héritage d'Israël en Palestine. Mais avec une différence essentielle : à l'époque où Fanon rédigeait son manifeste tiers-mondiste, la décolonisation et l'indépendance de l'Algérie étaient pratiquement inévitables. Les Algériens étaient en train de gagner. Si l'attaque du 7 octobre a obligé le reste le monde à porter de nouveau son regard sur la Palestine, il s'agit d'une victoire à la Pyrrhus. Les Gazaouis continuent à être harcelés et bombardés et leur agonie est tournée en dérision par des discours obscènes sur la transformation de la bande de Gaza en nouvelle Côte d'Azur débarrassée de ses habitants. De leur côté, les habitants de la Cisjordanie sont confrontés à une campagne brutale de « gazafication » menée par l'armée israélienne. Les menaces existentielles qui pèsent sur les Palestiniens ne concernent pas seulement leur survie en tant que peuple, mais aussi leur simple survie physique sur le sol qu'ils habitent.
Comment résister ? En dernière instance, c'est aux Palestiniens eux-mêmes qu'il convient de répondre à cette question. Ce n'est pas à nous d'en décider, et encore moins de les mettre sur la sellette en n'acceptant d'écouter que ceux qui condamnent le 7 octobre. À essayer de réduire au silence ceux d'entre eux qui estiment que le « déluge d'Al-Aqsa » était un acte de résistance nécessaire, on n'aboutira qu'à décourager le débat qui se développe actuellement au sein du peuple palestinien. C'est le cas en particulier à Gaza, où la colère de la population est générale face à la décision du Hamas de lancer une attaque qui a fourni à Israël le prétexte pour commettre un génocide et transformé son territoire en gigantesque chantier de démolition. Les Palestiniens n'ont pas besoin qu'on les sermonne, ce serait arrogant de notre part. Pour autant, ce n'est pas une raison pour renoncer à la lucidité intellectuelle et morale – ou pour chanter les louanges du Hamas, une organisation dont la conception de la lutte pour la libération laisse beaucoup à désirer, c'est le moins que l'on puisse dire. Dans le même esprit, on peut citer un passage souvent négligé des Damnés de la terre dans lequel Fanon explique que « le racisme, la haine, le ressentiment, “le désir légitime de vengeance” ne peuvent alimenter une guerre de libération. […] Il est vrai que les interminables exactions des forces colonialistes réintroduisent les éléments émotionnels dans la lutte, donnent au militant de nouveaux motifs de haine, de nouvelles raisons de partir à la recherche du “colon à abattre”. Mais le dirigeant se rend compte jour après jour que la haine ne saurait constituer un programme ».
Pour Fanon, la décolonisation concernait non seulement les musulmans, voués à s'émanciper du joug de l'oppression coloniale, mais aussi les membres de la minorité européenne et les Juifs (eux-mêmes issus d'une communauté indigène de l'Algérie précoloniale) qui se montraient prêts à se joindre à la lutte pour la libération. Dans L'An V de la révolution algérienne, il rendait hommage aux non-musulmans d'Algérie qui, aux côtés de leurs camarades musulmans, envisageaient un futur dans lequel l'identité et la citoyenneté algériennes seraient définies par des idéaux communs, et pas par la religion ou l'appartenance ethnique. Les identités respectives du « colon » et de l'« indigène » – tout comme celles du « Noir » et du « Blanc » – n'étaient pas pour lui des essences immuables mais des créations d'un système oppressif ; elles disparaitraient une fois que ce système serait démantelé. Au lendemain de l'indépendance, le colonisé découvrirait « l'homme derrière le colonisateur », et inversement.
Fanon était un homme d'idéaux, pas un homme de violence. Il imaginait un monde rebâti à neuf par la décolonisation et la révolution sociale, un monde dans lequel les hommes et les femmes opprimés, les sujets racialisés de l'empire occidental, pourraient déterminer leur propre existence dans la liberté et la souveraineté. Mais il nous rappelle constamment que la seule affirmation de beaux idéaux et l'exaltation de notre humanité commune ne suffiront pas à nous mener à la terre promise. La liberté exige la lutte, et la lutte se caractérise rarement par son décorum ou sa courtoisie – elle est même parfois « désordre absolu », selon ses propres termes. Cela ne signifie pas pour autant que la médecine choisie par le docteur Fanon, à savoir la thérapie de choc de la violence, soit toujours le principal remède à un ordre oppressif, et encore moins le seul. Comme l'illustre son propre parcours et celui de la révolution algérienne, un recours excessif à la violence peut avoir pour conséquence de mettre en péril les idéaux mêmes au nom desquels on combat, et conduire à de nouvelles formes d'oppression et de domination brutale. Il existe d'ailleurs des situations dans lesquelles d'autres formes de confrontation et de mobilisation populaire sont plus efficaces, pour des raisons pragmatiques autant que morales. Fanon lui-même défendait cette idée dans Peau noire, masques blancs, où il décrit avec admiration il décrit avec admiration les tactiques de la phase initiale du mouvement des droits civiques à la fin des années 1940 et au début des années 1950 aux États-Unis. Mais il n'existe pas de circonstance où le pouvoir, un pouvoir injuste, cède sans combattre, quel que soit le choix des armes.
Dans mon livre, je décris le sentiment d'exaltation éprouvé par Fanon face à l'attitude combative du peuple algérien. Mais ce que Fanon admirait chez les Algériens, ce n'était pas tant l'usage des mitrailleuses et des bombes que ce qui sous-tendait leur résistance : la dignité, l'esprit de sacrifice, le refus d'être déracinés, l'attachement à leur culture et la détermination à se constituer en nation – soit cela même que les Palestiniens désignent depuis des décennies du nom de « sumud », qui exprime la fermeté inébranlable dans la résilience. Dans les manifestations de solidarité organisées sur les campus étatsuniens, on a entendu scander le slogan « Nous sommes tous palestiniens », une expression de solidarité et d'identification imaginaire sans doute hyperbolique, mais que Fanon aurait certainement apprécié. Circulant à travers le campement de solidarité de Bard College, l'établissement où j'enseigne, j'ai croisé plus d'une étudiante ou d'un étudiant plongés dans les pages des Damnés de la terre. Qu'en aurait pensé Fanon ? Aurait-il été flatté de constater l'actualité de son livre, ou plutôt désemparé de constater qu'il était malheureusement toujours aussi pertinent ? « Je n'arrive point armé de vérité décisives », affirmait-il avec force dans Peau noire, masques blancs. Nul doute que son vœu le plus cher aurait été de voir son message de lutte et d'intransigeance rendu obsolète par l'avènement d'un monde plus juste et d'une nouvelle humanité.
Dans notre combat pour que ce monde advienne, et dans l'attente du jour où la Palestine sera libre, les idées stimulantes et souvent perturbantes de Fanon resteront pour nous une boussole irremplaçable.
**********************
Rédacteur de la London Review of Books pour les États-Unis, je suis l'auteur de Frantz Fanon, une vie en révolutions (La Découverte, 2024), qui est récemment apparu en poche.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’équipage de la flottille de la Liberté doit retrouver la liberté

Suite à un long périple dont le terminus aurait dû être le territoire de Gaza, le bateau de la flottille de la Liberté a été arrêté de manière manifestement illégale dans la nuit du dimanche 8 juin au lundi 9 juin. Cette attaque contre cette action civile, est une preuve de plus de la volonté destructrice du gouvernement de Benyamin Nétanyahou de faire cesser l'existence du peuple palestinien.
Tiré du blogue de l'auteur. Illustration : Trajectoire du Madleen, bateau humanitaire arrêté au large de l 'Égypte dans les eaux internationales
Chers gouvernements, vos citoyens ont été enlevés, agissez.
En dépit de tout respect du droit en haute-mer, et de manière générale, en dépit du respect du droit, le gouvernement Israélien a aujourd'hui franchi une étape supplémentaire en stoppant net le parcours du Madleen et en enlevant à son bord l'ensemble de son équipage.
Le choix de ces mots n'est pas pris à la légère, car dans ces eaux, Israël n'a aucun droit d'aucune nature à faire comme bon lui semble contre un bateau qui ne veut pas aller sur son territoire. Mais comme le petit gouvernement génocidaire de ce pays veut faire cesser tout contact extérieur avec l'enclave palestinienne, alors ce dernier harcèle, bafoue les règles communes et agit comme des barbares n'ayant que comme intention la violence et le sang de l'Autre.
Messieurs Macron, Bayrou, Barrot, si ces mots vous atteignent (ce que je pense est un bien maigre espoir), vos concitoyens ont été enlevés. Soyez enfin responsables politiquement comme le laisse entendre votre titre de responsable politique et agissez pour que tout l'équipage de ce bateau soit secouru et non retenu par cet état définitivement terroriste 1.
Cette action vous laisse aussi une grande marge de manœuvre pour faire cesser la violence et la barbarie qui se passe en territoire palestinien. Cet appel est le même pour tous les gouvernements dont au moins un citoyen se trouvait sur la Flottille de la Liberté.
Ce court texte n'est qu'une expression parmi d'autres d'un désarroi citoyen et d'une volonté que ceux qui ont le pouvoir d'agir le fassent.
Merci à ces femmes fortes et ces hommes forts qui ont embarqué sur ce navire et qui ravivent les flammes de l'espoir. Ne nous taisons pas et multiplions nos voix, que ce soit dans nos journaux ou sur les places de nos villes, pour que ces flammes de nouveau allumées puissent continuer de briller.
Clamons le haut et fort : La flottille de la liberté et le peuple palestinien doivent retrouver la liberté.

Rima Hassan et Greta Thunberg font voile vers Gaza : un courage qui met à nu l'inaction mondiale LA LETTRE DU 5 JUIN
5 juin 2025 | tiré de Regards.fr
par Loïc Le Clerc
Cette histoire va-t-elle finir en tragédie ou en épopée ? Le choix revient à Israël qui, par le passé, avait réagi par la force à ce genre de « provocation ».
Le 1er juin, le navire humanitaire Madleen a pris le large depuis la Sicile, direction Gaza. À son bord, douze personnes et pas des moindres : la militante écologiste suédoise Greta Thunberg, l'eurodéputée LFI Rima Hassan – on a même vu l'acteur Liam Cunningham de la série « Game of Thrones » venir les soutenir lors de leur départ.
Cette action, à l'initiative de la Coalition de la flottille pour la liberté, a pour objectif d'acheminer « des quantités limitées » d'aide humanitaire à Gaza, de « dénoncer le blocus et le génocide en cours ». Mais sa portée est 1000 fois plus symbolique.
Cette embarcation fait parler d'elle par les passagers qu'elle transporte. Les médias y projettent leur lumière… Enfin, les médias, c'est beaucoup dire : en France, c'est surtout grâce à leur propre force de frappe sur les réseaux sociaux que Rima Hassan et Greta Thunberg font exister leur voyage. Comme pour toute lutte, l'incarnation est un facteur qui fait la différence et, dans ce cas précis, l'impact est à la hauteur de la résonance internationale que l'équipage porte en lui.
Au fond, que nous dit le Madleen ? On peut y voir un acte héroïque, aussi courageux que romantique, tout comme on y perçoit un désespoir profond. Ce bateau en dit long sur l'inaction du monde, alors que tout Gaza se meurt.
La réaction d'Israël va elle aussi être porteuse de symboles. En mai dernier, un autre navire humanitaire de la même organisation était la cible de tirs de drones israéliens, provoquant un incendie et une brèche dans la coque. Plus loin dans le temps, en 2010, Israël avait pris d'assaut une autre « flottille de la liberté », tuant neuf personnes et causant 28 blessés, comme le rappelle Dominique Vidal dans #LaMidinale de Regards.
Et là, déjà, Israël a commencé l'intimidation, tout d'abord par une déclaration de la marine leur demandant de « se préparer » car elle est « prête à un large éventail de scénarios, qu'elle appliquera selon les instructions des dirigeants politiques ». Des mots suivis d'actes avec le survol du navire par deux drones. La démonstration humanitaire n'est pas sans risque, ce à quoi répond Rima Hassan : « Quel que soit le danger de cette mission, il est loin d'être aussi dangereux que le silence du monde entier face à un génocide retransmis en direct ».
Il va sans dire que si Israël devait agir avec la même furie qui est la sienne depuis plusieurs mois, un drame pourrait se jouer en direct à la télévision. Comme une sorte de petite allégorie du génocide des Gazaouis. L'impunité dénoncée est brandie comme un étendard, lorsque le sénateur républicain Lindsey Graham, proche de Donald Trump, ironise « J'espère que Greta et ses amis savent nager ».
Le reste du monde, l'Europe, la France, resteront-ils muets jusqu'à la fin des temps ? Quelle tuerie sera la ligne rouge de l'Histoire ? Le Madleen a pour objectif d'atteindre les côtes palestiniennes d'ici une dizaine de jours. Tout un horizon…
Notes
1 : Terrorisme Gouvernement par la terreur. ; Emploi systématique de la violence pour atteindre un but politique ; Attitude d'intolérance, d'intimidation. (Le Robert)
Image : Capture d'écran réalisée à partir du site https://freedomflotilla.org/ffc-tracker/

Photo : Jack Guez Agence France-Presse Le voilier humanitaire Madleen dans le port sud d'Ashdod après avoir été intercepté par les forces israéliennes le 9 juin 2025
Palestine Mettez fin au blocus de Gaza !
Déclaration du Bureau Exécutif de la Quatrième Internationale
Depuis trois mois, Israël bloque la quasi-totalité de l'aide humanitaire à Gaza, ce qui fait planer la menace d'une famine massive, de décès et d'épidémies dus à l'absence de soins médicaux.
Le Madleen était la dernière tentative en date de la coalition de la flottille de la liberté pour défier le blocus naval israélien et apporter une aide humanitaire symbolique à Gaza. Qualifiée par Netanyahou de « croisière selfie », les courageux militants des droits de l'homme à bord, dont l'eurodéputée franço-palestinienne Rima Hassan et la militante écologiste Greta Thunberg, se sont d'abord détournés pour recueillir et mettre en sécurité des réfugiés de guerre soudanais. Puis, alors qu'il se trouvait encore dans les eaux internationales, le Madleen a été accosté et envahi par les forces israéliennes qui ont arrêté l'ensemble de l'équipage.
Ce n'est pas la première fois qu'Israël bafoue de manière flagrante le droit international. Israël n'a pas le droit d'imposer un blocus à Gaza, ni d'empêcher les navires humanitaires d'accoster à Gaza. Israël n'a pas non plus le droit d'aborder ou d'attaquer ces bateaux dans les eaux internationales.
La Quatrième Internationale condamne la politique génocidaire du gouvernement israélien et appelle à :
- La libération immédiate des membres de l'équipage !
– L'imposition de sanctions contre Israël !
– La fin du commerce d'armes avec Israël !
– A une mobilisation mondiale massive pour mettre fin à ce génocide !
Le 9 juin 2025
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Lettre ouverte des médias et des organisations de défense de la liberté de la presse sur l’accès à Gaza

À l'initiative de Reporters sans frontières (RSF) et du Comité pour la protection des journalistes (CPJ), plus d'une centaine d'organisations de défense de la liberté de la presse et de rédactions internationales - dont l'AFP, France 24, Mediapart, Le Monde - lancent un appel public pour demander un accès immédiat et sans restriction des journalistes internationaux à la bande de Gaza et la protection des journalistes palestiniens.
Tiré du blogue de l'auteur.
Depuis plus de 20 mois, les autorités israéliennes empêchent l'entrée des journalistes étrangers dans la bande de Gaza. Dans le même temps, l'armée israélienne a tué près de 200 journalistes palestiniens dans l'enclave bloquée, dont au moins 45 dans l'exercice de leur profession. Les journalistes palestiniens qui continuent de travailler, seuls témoins présents sur le terrain, subissent des conditions intenables : déplacements forcés, famine, menaces permanentes.
Cet appel collectif, lancé avec RSF et CPJ, rassemble des médias emblématiques à l'international, de tous les continents, qui réclament leur droit d'envoyer leurs correspondants dans l'enclave pour travailler aux côtés de leurs confrères palestiniens.
« Le blocus médiatique imposé sur Gaza, avec le massacre de près de 200 journalistes par l'armée israélienne, facilite la destruction totale de l'enclave bloquée ainsi que son effacement. Les autorités israéliennes interdisent l'entrée aux journalistes étrangers et orchestrent un contrôle implacable de l'information. C'est une tentative méthodique d'étouffer les faits, de museler la vérité, d'isoler la presse palestinienne, et avec elle la population. Nous exigeons des gouvernements, des institutions internationales et des chefs d'État qu'ils mettent fin à leur silence coupable, qu'ils imposent l'ouverture immédiate de Gaza à la presse internationale, et qu'ils rappellent une évidence trop souvent piétinée : en droit international humanitaire, tuer un journaliste est un crime de guerre. Ce principe n'a été que trop bafoué : il doit être appliqué. » Thibaut Bruttin. Directeur général de RSF
Ce blocus médiatique sur Gaza continue en dépit des appels répétés de RSF à garantir un accès libre aux journalistes, et des recours judiciaires tels que la demande de l'Association de la presse étrangère (la Foreign Press Association ou FPA) devant la Cour suprême israélienne. Les journalistes palestiniens sont, quant à eux, enfermés, déplacés, affamés, diffamés et ciblés en raison de leur métier. Ceux qui ont survécu au massacre sans précédent des journalistes, se retrouvent sans abris, sans matériel, sans soins et même sans nourriture, selon un rapport du CPJ. Ils risquent d'être tués à tout moment.
Pour mettre fin à l'impunité qui permet à ces crimes de continuer, RSF a par ailleurs saisi à plusieurs reprises la Cour pénale internationale (CPI) pour lui demander d'enquêter sur des crimes de guerre présumés commis contre les journalistes à Gaza par l'armée israélienne. RSF soutient aussi les journalistes palestiniens sur le terrain, en particulier à Gaza, à travers des partenariats concrets avec des organisations locales comme ARIJ (Arab Reporters for Investigative Journalism).
Ce partenariat permet de fournir un appui matériel, psychologique et professionnel aux journalistes palestiniens, tout en garantissant la diffusion de reportages de qualité, malgré le blocus et les risques. RSF réaffirme, à travers cette coopération, son engagement à défendre un journalisme indépendant et rigoureux, même dans les conditions les plus extrêmes.
Lire l'appel en intégralité
L'appel a été signé par :
1. Actualite.cd, Patient Ligodi, fondateur (République démocratique du Congo)
2. Agence France-Presse, Phil Chetwynd, directeur de l'information internationale (France)
3. Agência Pública, Natália Viana, directrice exécutive (Brésil)
4. Al Araby Al Jadeed, Hussam Kanafani, directeur du secteur des médias
5. Al Jazeera Center of Public Liberties & Human Rights, Sami Alhaj, directeur (Qatar)
6. Al-Masdar Online, Ali al-Faqih, PDG (Yémen)
7. Alternative Press Syndicate (Liban)
8. Amazônia Real, Kátia Brasil, directrice (Brésil)
9. Arab Reporters for Investigative Journalism (ARIJ), Rawan Daman, directrice générale
10. ARTICLE 19
11. Asia Pacific Report, David Robie, rédacteur en chef (Nouvelle-Zélande)
12. Associated Press, Julie Pace, rédactrice en chef et vice-présidente senior (États-Unis)
13. Association of Foreign Press Correspondents, Nancy Prager-Kamel, présidente
14. Bahrain Press Association (Bahreïn)
15. Birama Konaré, directeur général, Joliba (Mali)
16. BirGun Daily, Yasar Aydin, coordinateur de l'information (Turquie)
17. Brecha, Betania Núñez, directrice journalistique (Uruguay)
18. British Broadcasting Corporation (BBC), Deborah Turness, PDGPDG, BBC News (Royaume-Uni)
19. Bulatlat, Ronalyn V. Olea, rédactrice en chef (Philippines)
20. CamboJA, Nop Vy, directeur exécutif (Cambodge)
21. Casbah Tribune, Khaled Drareni, directeur de la rédaction (Algérie)
22. Cedar Centre for Legal Studies (CCLS) (Liban)
23. Center for Investigative Journalism of Montenegro (CIN-CG), Milka Tadić Mijović, rédactrice en chef
24. Churchill Otieno, directeur exécutif, Eastern Africa Editors Society et président, Africa Editors Forum (Kenya)
25. Committee to Protect Journalists (CPJ), Jodie Ginsberg, PDG
26. Community Peacemaker Teams (CPT) (Kurdistan irakien)
27. Confidencial.digital, Carlos F. Chamorro, directeur (Nicaragua, en exil)
28. Connectas, Carlos Eduardo Huertas, directeur (Les Amériques)
29. Daraj Media, Hazem al Amin, rédacteur en chef, Alia Ibrahim, PDG et Diana Moukalled, directrice de la rédaction (Liban)
30. Journal Dawn, Zaffar Abbas, rédacteur en chef (Pakistan)
31. De Último Minuto, Hector Romero, directeur (République dominicaine)
32. Delfino.CR, Diego Delfino Machín, directeur (Costa Rica)
33. Deník Referendum, Jakub Patocka, rédacteur en chef et éditeur,
34. Digital Radio-télévision DRTV, William Mouko Zinika Toung-Hou, directeur adjoint de l'information (Congo-Brazzaville)
35. Droub, Murtada Ahmed Mahmoud Koko, directeur général (Soudan)
36. Efecto Cocuyo, Luz Mely Reyes, directrice (Venezuela)
37. Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) (Égypte)
38. El Ciudadano, Javier Pineda, directeur (Chili)
39. El Diario de Hoy, Óscar Picardo Joao, directeur de la rédaction (Salvador)
40. El Espectador, Fidel Cano Correa, directeur (Colombie)
41. El Faro, Carlos Dada, cofondateur et directeur,
42. El Mostrador, Héctor Cossio, directeur (Chili)
43. El Sol de México, Martha Citlali Ramos, directrice éditoriale nationale (Mexique)
44. El Universal, David Aponte, directeur général éditorial (Mexique)
45. elDiarioAR, Delfina Torres Cabreros, directrice journalistique (Argentine)
46. ENASS, Salaheddine Lemaizi, directeur (Maroc)
47. European Broadcasting Union, Noel Curran, directeur général
48. Équipe Média, Mohamed Mayara, coordinateur général (Sahara occidental)
49. Fédération européenne des journalistes (FEJ), Ricardo Gutiérrez, secrétaire général
50. Eyewitness Media Group, Patrick Mayoyo, directeur des innovations éditoriales
51. Financial Times, Roula Khalaf, rédactrice en chef (Royaume-Uni)
52. Forbidden Stories, Laurent Richard, fondateur (France)
53. Foreign Press Association, Deborah Bonetti, directrice (Londres)
54. Foreign Press Association, le conseil (Israël et les territoires palestiniens)
55. Fondation pour le journalisme d'investigation – FIJ, Fisayo Soyombo, fondateur et rédacteur en chef (Nigeria)
56. France 24, Vanessa Burggraf, directrice (France)
57. Free Press Unlimited, Ruth Kronenburg, directrice exécutive
58. Front Page Africa, Rodney Sieh, rédacteur en chef et éditeur (Libéria)
59. GabonClic.info, Randy Karl Louba, directeur (Gabon)
60. Geneva Health Files, Priti Patnaik, fondatrice
61. Geo News, Azhar Abbas, rédacteur en chef (Pakistan)
62. Global Investigative Journalism Network (GIJN), Emilia Diaz-Struck, directrice exécutive
63. Global Reporting Centre, Sharon Nadeem, productrice et responsable des partenariats
64. Guineematin.com, Nouhou Baldé, fondateur et administrateur (Guinée)
65. Haaretz, Aluf Benn, rédacteur en chef (Israël)
66. 7amleh - Le Centre arabe pour la promotion des médias sociaux, Nadim Nashif, Directeur exécutif (Palestine\Israël)
67. Hildebrandt en sus trece, César Hildebrandt, directeur (Pérou)
68. HuMENA pour les droits humains et l'engagement civique
69. Independent Television News, Rachel Corp, directrice générale (Royaume-Uni)
70. Inkyfada, Malek Khadhraoui, directeur de la publication (Tunisie)
71. International News Safety Institute (INSI), Elena Cosentino, directrice (Royaume-Uni)
72. International Press Institute (IPI), Scott Griffen, directeur exécutif
73. IWACU, Abbas Mbazumutima, rédacteur en chef (Burundi)
74. Klix.ba, Semir Hambo, rédacteur en chef (Bosnie-Herzégovine)
75. L'Alternative, Ferdinand Ayité, directeur de la publication (Togo)
76. L'Événement, Moussa Aksar, directeur de la publication (Niger)
77. La Voix de Djibouti, Mahamoud Djama, directeur de la publication (Djibouti)
78. Le Jour, Haman Mana, directeur de publication (Cameroun)
79. Le Monde, Jérôme Fenoglio, directeur (France)
80. Le Reporter, Aimé Kobo Nabaloum, directeur de publication (Burkina Faso)
81. Le Temps, Madeleine von Holzen, rédactrice en chef (Suisse)
82. Centre libanais des droits de l'homme (CLDH) (Liban)
83. Luat Khoa, Trinh Huu Long, rédacteur en chef (Vietnam)
84. Mada Masr, Lina Atallah, PDG (Égypte)
85. Mail & Guardian, Luke Feltham, rédacteur en chef par intérim (Afrique du Sud)
86. Malaysiakini, RK Anand, rédacteur en chef exécutif (Malaisie)
87. Mekong Review, Kirsten Han, rédactrice en chef (Singapour)
88. MediaTown, Ashraf Mashrawi, directeur (Palestine)
89. MENA Rights Group (Suisse)
90. Mizzima Media, Soe Myint, directeur général et rédacteur en chef (Myanmar)
91. Mullithivu Press Club - Kanapathipillai Kumanan, photojournaliste et coordinateur (Sri Lanka)
92. Muwatin Media Network, Mohammed Al-Fazari, PDG et rédacteur en chef (Royaume-Uni)
93. Monte Carlo Doualiya (MCD), Souad Al-Tayeb, Directrice (France)
94. National Public Radio (NPR) Edith Chapin, vice-présidente senior et rédactrice en chef (États-Unis)
95. New Bloom Magazine, Brian Hioe, rédacteur en chef fondateur (Taïwan)
96. Nord Sud Quotidien, Raoul Hounsounou, directeur de publication (Bénin)
97. OC Media, Mariam Nikuradze, cofondatrice et codirectrice (Géorgie)
98. Organización Editorial Mexicana, Martha C. Ramos Sosa, directrice générale de la rédaction (Mexique)
99. People Daily, Emeka Mayaka Gekara, rédacteur en chef (Kenya)
100. Photon Media, Shirley Ka Lai Leung, PDG (Hong Kong)
101. Plan V, Juan Carlos Calderón, directeur (Équateur)
102. Prachatai, Mutita Chuachang, rédactrice en chef (Thaïlande)
103. Premium Times, Musikilu Mojeed, rédacteur en chef - directeur des opérations (Nigeria)
104. Pressafrik, Ibrahima Lissa Faye, directeur de publication (Sénégal)
105. Prospect Magazine, Alan Rusbridger, rédacteur en chef
106. Pulitzer Center, Marina Walker Guevara, rédactrice en chef
107. Rádio Ecclesia, Gaudêncio Yakuleingue, directeur (Angola)
108. Radio Universidad de Chile, Patricio López, directeur (Chili)
109. Radio France Internationale (RFI), Jean-Marc Four, Directeur (France)
110. Reporters sans frontières (RSF), Thibaut Bruttin, directeur général
111. Rory Peck Trust, Jon Williams, directeur exécutif
112. SMEX (Liban)
113. SMN24MEDIA, Kamal Siriwardana, directeur de l'information (Sri Lanka)
114. Society of Professional Journalists, Caroline Hendrie, directrice exécutive (États-Unis)
115. Stabroek News, Anand Persaud, directeur (Guyana)
116. Syrian Center for Media and Freedom of Expression, SCM (Syrie)
117. Taz – die tageszeitung, Barbara Junge, rédactrice en chef (Allemagne)
118. Tempo Digital, Wahyu Dhyatmika, directeur général (Indonésie)
119. The Globe and Mail & président du Forum mondial des rédacteurs en chef (WAN-IFRA), David Walmsley, rédacteur en chef (Canada)
120. The Independent, Geordie Greig, rédacteur en chef (Royaume-Uni)
121. The Intercept Brasil, Andrew Fishman, président et cofondateur (Brésil)
122. The Legal Agenda (Liban)
123. The Magnet, Larry Moonze, rédacteur en chef (Zambie)
124. The Nairobi Law Monthly, Mbugua Ng'ang'a, rédacteur en chef (Kenya)
125. The New Arab, Hussam Kanafani, directeur du secteur des médias
126. The Point, Pap Saine, directeur de la publication (Gambie)
127. The Reckoning Project, Janine di Giovanni, PDG
128. The Shift, Caroline Muscat, fondatrice (Malte)
129. The Wire, Seema Chishti, rédactrice en chef (Inde)
130. Association mondiale des éditeurs de journaux (WAN-IFRA), Vincent Peyrègne, PDG, Andrew Heslop, directeur exécutif pour la liberté de la presse
131. TV Slovenia, Ksenija Horvat, directrice (Slovénie)
132. Twala.info, Lyas Hallas, directeur de publication (Algérie)
133. Unnu.news, Lkhagvatseren Batbayar, rédacteur en chef (Mongolie)
134. Vikalpa - Sampath Samarakoon, rédacteur (Sri Lanka)
135. Wattan Media Network, Muamar Orabi, directeur général (Palestine)
136. Woz – die Wochenzeitung, Florian Keller, Daniela Janser, Kaspar Surber, comité de rédaction (Suisse)
137. Bianet, Murat İnceoglu, rédacteur en chef (Turquie)
138. Mediapart, Carine Fouteau, Rédactrice en chef (France)
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Quatre journalistes assassinés dans un hôpital à Gaza

Une nouvelle attaque israélienne ciblant des journalistes palestiniens a fait quatre victimes, portant à 224 le nombre de journalistes assassiné-es par Israël à Gaza depuis le 7 octobre 2025.
Tiré d'Agence médias Palestine.
Un drone israélien, au matin du jeudi 5 juin 2025, a visé une tente de journalistes qui se trouvait dans la cour de l'hôpital Al Ahli, également connu sous le nom d'hôpital baptiste, dans la ville de Gaza. Au moins sept personnes ont été assassinées dans cette frappe, y compris des personnes qui accompagnaient des patient-es de l'hôpital, et de nombreuses autres ont été blessées dont des membres du personnel soignant.
Le syndicat des journalistes palestiniens (PJS) confirme que cette attaque a causé la mort de Suleiman Hajjaj, correspondant de Palestine Today, Ismail Badah, caméraman de Palestine Today, et Samir Al-Rifai, de l'agence de presse Shams. Le journaliste Ahmed Qaljah, caméraman indépendant pour Al-Arabiya, a été grièvement blessé lors de cette attaque, et a succombé à ses blessures quelques heures plus tard. L'attaque a blessé trois autres journalistes.
Cette attaque porte à 224 le nombre de journalistes tués par les forces israéliennes depuis le 7 octobre 2023, selon le Bureau des médias du gouvernement de Gaza. Parmi elles et eux, on compte 14 femmes journalistes et, selon Reporters sans frontières, 42 journalistes qui ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions. En outre, des dizaines de journalistes ont été tués lors d'attaques ciblées contre leurs domiciles. Le Syndicat des journalistes palestiniens a documenté le bombardement de 152 maisons qui a tué 665 membres de la famille et proches de journalistes. D'autres journalistes ont été tués lors de bombardements aveugles tout au long du génocide en cours. 415 journalistes ont été blessés dans diverses circonstances. De plus, un grand nombre de militants des réseaux sociaux ont été pris pour cible, l'armée israélienne incitant systématiquement à la haine et les menaçant de mort s'ils ne se taisent pas.
Le Centre palestinien pour les droits humains (PCHR) a dénoncé fermement cette attaque et toutes les précédentes, affirmant que le ciblage de la presse vise à empêcher la documentation des actes génocidaires commis par Israël contre les civils palestiniens dans la bande de Gaza. « Le PCHR estime que les attaques et les assassinats continus et croissants de journalistes au cours des 20 derniers mois prouvent sans équivoque qu'il s'agit d'assassinats délibérés et intentionnels, visant à intimider, terroriser et empêcher les journalistes de révéler la vérité au monde. Ces attaques ciblées font partie du crime de génocide commis par Israël dans la bande de Gaza. »
Le jour-même de cette attaque, 130 organisations mondiales de presse et de défense de la liberté de la presse, dont la BBC, l'AFP, Al Jazeera ou encore Le Monde, ont appelé à ce que les médias internationaux aient immédiatement accès à Gaza et à ce que les journalistes palestiniens bénéficient d'une protection totale. Dans une lettre coordonnée par Reporter Sans Frontières et le Comité de protection des journalistes, ces médias dénoncent « une attaque directe contre la liberté de la presse et le droit à l'information. »
« Les journalistes locaux, les mieux placés pour dire la vérité, sont confrontés au déplacement et à la famine. À ce jour, près de 200 journalistes ont été tués par l'armée israélienne. Beaucoup d'autres ont été blessés et voient leur vie constamment menacée parce qu'ils font leur travail : témoigner. »
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Cinq ans après l’assassinat de George Floyd

George Floyd a été assassiné le 25 mai 2020 lorsqu'un policier blanc de Minneapolis a appuyé son genou sur le cou de Floyd pendant 9 minutes et demie alors que ce dernier était menotté et implorait qu'on le laisse respirer.
Tiré de Inprecor
5 juin 2025
Par Malik Miah
La mort de Floyd a été filmée par une jeune personne, alors que d'autres personnes noires criaient à la police de relâcher Floyd.
Son meurtre a donné lieu à des manifestations nationales et internationales et à un réexamen du racisme sociétal et institutionnel, y compris le maintien de l'ordre. Cinq ans plus tard, quel est l'héritage de la mort de Floyd et du mouvement pour la justice et la responsabilisation de la police ?
De BLM à la contre-révolution
Pour faire simple : l'essor du mouvement Black Lives Matters (BLM), qui a obtenu quelques modestes avancées et un changement de conscience pour des millions de personnes, se trouve aujourd'hui dans le collimateur de la contre-révolution MAGA de Donald Trump.
Trump est un raciste de toujours qui affirme que la diversité, l'équité et l'inclusion sont des « discriminations de réversion » et un « génocide blanc ». Pourtant, c'est au cours de son premier mandat que Floyd a été assassiné. Il a soutenu les brutalités policières excessives, y compris contre les manifestants de BLM.
Le président Joe Biden et les démocrates, qui dépendaient du vote des Noirs, ont promu des réformes limitées de la police tout en vantant les mérites des flics qui « font leur travail ». Parmi ces changements modestes, le ministère de la Justice de Joe Biden a imposé un décret de consentement au département de police de Minneapolis.
Le policier qui a assassiné Floyd, Derek Chauvin, a été condamné à la fois dans un procès d'État et dans un procès fédéral. Cette décision est importante, car le président Trump ne peut pas accorder de grâce pour la condamnation prononcée dans le Minnesota.
Le nouveau ministère de la Justice de Trump a récemment mis fin aux décrets de consentement à Minneapolis et dans d'autres villes et avance des mensonges anti-Noirs en qualifiant de « raciste » l'enseignement de la vérité sur le racisme.
Cinq ans plus tard, une grande partie des progrès obtenus grâce aux manifestations de masse dans les rues ont été réduits à néant ou sont menacés. Les suprémacistes blancs dirigent ouvertement la Maison Blanche et le Congrès.
Une longue histoire de déni
Peu après son retour à la présidence, Donald Trump a contraint la municipalité de Washington à supprimer la place George Floyd.
Mais la volonté actuelle de défendre les privilèges des Blancs contre les droits des Noirs n'est pas une nouveauté, mais un retour à ce qui a existé pendant la plus grande partie de l'histoire des États-Unis. En 400 ans, les Noirs américains n'ont eu l'espoir d'être acceptés en tant que citoyens à part entière que pendant deux périodes : les 20 années qui ont suivi la guerre de Sécession et les 50 années qui ont suivi la révolution des droits civiques.
La communauté noire s'accorde largement sur les violences racistes commises par la police et sur la nécessité d'une véritable réforme, ce qui n'a guère été le cas au cours des cinq dernières années. Les démocrates et les libéraux se sont contentés de soutenir la réforme du bout des lèvres, sachant qu'elle n'aboutirait jamais.
Dans les années 1960, Malcolm X et Martin Luther King Jr. ont tous deux souligné que les ségrégationnistes blancs étaient au moins ouverts sur leur racisme, alors que la plupart des libéraux blancs faisaient la leçon aux dirigeants noirs pour qu'ils « ralentissent » la lutte en faveur d'un changement fondamental.
Minneapolis aujourd'hui
Le site de Minneapolis où Floyd a été assassiné fait l'objet d'un débat tendu sur la meilleure façon d'honorer son héritage, selon Melissa Hellmann du Guardian, qui s'est jointe à de nombreux journalistes étrangers le jour de l'anniversaire, le 25 mai.
Une fresque murale se trouve à l'angle de la 38e rue et de l'avenue Chicago à Minneapolis, dans la zone appelée George Floyd Square.
« En mai dernier, Roger Floyd et Thomas McLaurin ont parcouru la 38e rue et l'avenue Chicago à Minneapolis, passant devant un rond-point avec un jardin et une station-service inoccupée sur laquelle on pouvait lire : Where there's people there's power » (« Là où il y a des gens, il y a du pouvoir »).
« Aujourd'hui, cinq ans après le meurtre de George Floyd, l'avenir de la place où il est mort reste incertain, alors que le conseil municipal délibère sur des plans d'aménagement.
« McLaurin et Roger Floyd souhaitent que la place soit commémorée comme un site historique qui a lancé un mouvement mondial en faveur de la justice raciale et qui a servi d'appel au ralliement pour la responsabilisation de la police ».
Le journaliste du Guardian a ajouté : « Minneapolis abritait le plus ancien journal appartenant à des Noirs et géré par des Noirs, ainsi que plus de 20 entreprises appartenant à des Noirs entre les années 1930 et 1970. »
Michael McQuarrie, directeur du Centre pour le travail et la démocratie de l'université d'État de l'Arizona, qui a mené des recherches sur la place de Minneapolis lors des manifestations de 2020, a déclaré que la ville était divisée sur la manière de faire évoluer la zone au cours des cinq dernières années.
Il considère que la fermeture de la rue de 2020 à 2021 sera un facteur de transformation pour la communauté. Mais certains membres de la communauté, des membres du conseil municipal et des membres de la famille de Floyd affirment qu'il n'est pas possible de précipiter la guérison.
Jason Chavez, membre du conseil municipal du quartier 9, où se trouve une partie de la place, a déclaré qu'il fallait reconnaître qu'il s'agissait d'un « élément historique de l'histoire de notre ville qui ne sera jamais oublié ».
« Nous ne pouvons pas aseptiser ce qui s'est passé ici durant l'été 2020 », a déclaré M. Chavez.
Une remise en question fondamentale s'impose
Le 19 juin 2020 sur la place George Floyd. Fibonacci Blue CC by Sea
Keka Araujo, de Black Enterprisemagazine, a expliqué les sentiments de nombreux Afro-Américains :
« Cinq ans après le meurtre tragique et évitable de George Floyd, la lutte pour une responsabilité authentique et une justice équitable est loin d'être terminée ; en fait, à bien des égards, on a l'impression qu'elle reprend, avec des exigences plus pressantes que jamais...
« Le 25 mai 2020 reste une inscription brutale dans notre histoire commune honteuse, qui a déclenché une insurrection mondiale contre l'inégalité raciale et les méfaits des forces de l'ordre, que seule une remise en question fondamentale pourrait réparer.
« Pourtant, à l'approche de ce sombre anniversaire, la ferveur initiale de l'indignation et les appels urgents à une réforme systémique ont principalement cédé la place à une immobilité troublante, une marée de régression rampante qui laisse beaucoup se demander si les conditions mêmes qui ont conduit à la mort de Floyd ne sont pas tacitement autorisées à réapparaître. »
Araujo nous le rappelle avec éloquence :
« Comme l'histoire nous le rappelle constamment, le chemin vers la justice est rarement linéaire. L'élan naissant pour une réforme globale de la police au niveau fédéral s'est largement enlisé, les efforts législatifs n'ayant pas réussi à obtenir une adhésion bipartisane… et ayant rencontré une opposition persistante, un refoulement perceptible contre la compréhension même de l'existence du racisme systémique et les exigences de responsabilité ».
Ce que lui et beaucoup d'autres ne parviennent pas à identifier, c'est la racine du racisme, de la violence policière et de la suprématie blanche pratiquée par l'État : le système capitaliste. Il ne pourra jamais y avoir de fin au racisme, y compris à la violence policière, tant que ce système ne sera pas renversé.
Jusqu'à ce que ce système soit remis en cause, nous devons continuer à nous battre et à résister, et nous devons le faire les yeux grands ouverts. C'est la principale leçon à tirer de l'héritage du 25 mai 2020 à aujourd'hui. La communauté noire le sait mieux que toute autre population opprimée.
Publié par
Against The Current
le 5 juin 2025
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Lettre ouverte au premier ministre canadien, Mark Carney : Palestine, l’urgence absolue

Partout à travers le monde se multiplient les appels pour faire cesser les massacres à Gaza, pour un régime de sanctions effectif contre Israël, pour la reconnaissance de l'État de Palestine. Dernier en date, celui émanant de personnalités du Canada.
Tiré d'Orient XXI.
Ce matin du 29 mai 2025, au lever, nous apprenons que plus de 50 personnes ont déjà été tuées à Gaza et le jour n'est pas terminé. À quel niveau d'horreur faudra-t-il arriver pour que nos gouvernements bougent pour empêcher la poursuite de ce carnage ?
- La protection du peuple palestinien est devenue une urgence absolue. À Gaza, après quelques semaines de suspension, les massacres de masse ont repris, accompagnés d'un siège total, d'une famine généralisée et de déplacements forcés de populations.
C'est le constat dramatique que faisait « l'appel de Paris pour la protection du peuple de Palestine » le 25 mai 2025 : « plus de 53 000 Palestiniens ont été tués suite aux opérations militaires israéliennes. La bande de Gaza dévastée est devenue inhabitable et en ruines. »
Le jugement que l'Histoire portera sur notre silence
Au Québec, une pétition de plus de 800 personnes, endossée par de grands noms de notre histoire, exprime la même indignation et demande au premier ministre du Canada, Mark Carney, de « hausser le ton ». Ils disent : « Nous refusons d'être maintenus dans l'impuissance et la passivité. Nous refusons le jugement que l'Histoire portera sur notre silence (1). »
Il n'y a pas que les gens qui meurent à Gaza : moins de 5 % des terres agricoles sont aujourd'hui utilisables, selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Comment appelle-t-on une telle destruction ?
Gaza, c'est grand comme l'île de Montréal. Imaginez si tous nos hôpitaux étaient bombardés à répétition, détruits ou gravement endommagés. Et si notre centre-ville et nos quartiers résidentiels étaient réduits en poussière.
Nous avons vu, pratiquement en direct, des enfants brûler vifs à Gaza. Ils tendaient les bras. On voyait leurs petits corps bouger, mais on n'entendait pas leurs cris dans l'école bombardée où ces enfants vivaient avec leurs parents. L'ambassadrice américaine (sous la présidence Biden) a raconté la scène, comme nous le faisons ici, mais ça n'a pas empêché la diplomate d'opposer son veto, ce jour-là, à une résolution de cessez-le-feu, au conseil de sécurité de l'ONU.
Après Gaza, la Cisjordanie
Le 26 mai, on a encore vu des enfants palestiniens brûler vifs, dans une école de Gaza : 36 morts. À Gaza, des enfants sont amputés d'un bras, d'une jambe ou les deux, sans anesthésie ! Parce que les réserves des hôpitaux sont bombardées ou épuisées. Les enfants dont on parle sont si petits qu'ils demandent parfois si leur bras ou leur jambe coupée va « repousser ». Et plusieurs sont orphelins, à cause de la guerre.
Après Gaza, la Cisjordanie aussi devient un champ de bataille : en 18 mois, on y a compté plus de 1 500 attaques de l'armée israélienne. Les colons ont fait plus de 900 morts et plus de 7 000 blessés palestiniens, sans compter ceux qui ont été déplacés, par milliers. Les colons s'accaparent des terres, brûlent des oliveraies et des maisons !
Le 26 mai 2025, 800 juristes britanniques, dont deux anciens juges de la Cour suprême du Royaume-Uni, ont même affirmé que l'action des autorités israéliennes dans les territoires occupés pouvait constituer un génocide, en écho aux conclusions de la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967 (2).
Non moins importante que la protection de la population d'Israël face à toute agression, la protection du peuple palestinien et de ses enfants est devenue une urgence absolue. C'est notre devoir ! À tous.
« Tout être humain dont la vie est en danger a droit au secours » (article deux de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec). On retrouve le même esprit dans le droit international humanitaire. C'est ce droit qu'il faut absolument préserver.
Notre combat contre l'apartheid
Dans son histoire, le Canada a su relever des défis similaires. Qui a regretté notre combat contre l'apartheid en Afrique du Sud ? Et notre campagne courageuse contre les mines antipersonnel, avec le soutien inoubliable de Lady Di ? En 1956, on a dit non à la guerre de Suez et l'on a inventé les casques bleus, ce qui a valu au Canada un prix Nobel de la paix. Le Canada a plus que milité pour la création de la Cour pénale internationale : il en a été un architecte essentiel. La « responsabilité de protéger » porte aussi notre signature.
Avons-nous appris des leçons de notre histoire ?
Le 19 juillet 2024, la Cour internationale de justice de La Haye a confirmé que Gaza et la Cisjordanie sont des territoires « occupés ». La Cour a dit qu'Israël doit mettre fin à cette occupation de près de 60 ans et retirer ses colons de Cisjordanie. Pas dans dix ans ! Maintenant.
La Cour internationale dit aussi qu'Israël doit indemniser les Palestiniens pour les dommages découlant de cette colonisation. Plusieurs des juges dénoncent aussi l'existence d'un système d'apartheid en Cisjordanie, comme l'avait déjà observé Nelson Mandela, citoyen honoraire du Canada.
Le 17 septembre 2024, suivant l'avis de la Cour internationale, l'Assemblée générale de l'ONU a voté massivement « pour un démantèlement des colonies israéliennes avant le 18 septembre 2025 ». Le 18 septembre, c'est dans moins de quatre mois ! Le Canada s'est abstenu lors de ce vote. Nous lui demandons de reconsidérer sa position et de se ranger, comme la France, du côté de la grande majorité de l'Assemblée générale.
Le 29 mai 2025, Israël annonce la construction de 22 nouvelles colonies en Cisjordanie. Devant une telle provocation, le Canada peut-il continuer d'ignorer l'avis de la Cour et poursuivre comme si de rien n'était son commerce en libre-échange avec Israël, un libre-échange qui inclut les produits de Cisjordanie ?
On ne peut ignorer l'avis de la Cour internationale de justice
L'avis de la Cour internationale de justice est clair comme de l'eau de roche. La Cour dit le droit ! Le Canada ne peut ignorer cette décision. En partenariat avec un nombre croissant de pays européens — récemment l'Allemagne et la Norvège —, le Canada doit exiger le respect de la justice internationale, réclamer la paix, et annoncer une solide stratégie de pressions sur les autorités israéliennes, comprenant un régime de sanctions et la reconnaissance de l'État palestinien. Cette reconnaissance est présentée le 30 mai 2025 par le président Emmanuel Macron comme « pas simplement un devoir moral, mais une exigence politique (3) ».
Le Canada accueillera les pays du G7 à Kananaskis le 15 juin. Du 17 au 20 juin, se tiendra à New York une session spéciale de l'Assemblée générale de l'ONU, présidée par la France et l'Arabie saoudite, pour relancer une solution pacifique au conflit israélo-palestinien. La semaine suivante aura lieu un sommet de l'OTAN à La Haye. Le Canada devrait profiter de ces tribunes pour exercer du leadership et défendre les droits d'un peuple en péril !
************************
Liste des signataires
François Crépeau, professeur de droit international, université McGill, ancien rapporteur spécial des Nations unies pour les droits de l'homme des migrants
Aline Gobeil, ancienne journaliste à Radio-Canada
Avec le soutien de
Hon. Lloyd Axworthy, président du Conseil mondial pour les réfugiés et les migrations
Hon. René Dussault, ancien coprésident de la commission royale sur les peuples autochtones
Peter Leuprecht, ancien doyen de la faculté de droit de l'université McGill, ancien directeur des droits de l'homme et secrétaire général adjoint du Conseil de l'Europe
William A. Schabas, professeur de droit international, université du Middlesex, Londres, Royaume-Uni
Mark Antaki, université McGill
Rachad Antonius, professeur associé, université du Québec à Montréal (UQAM)
Robert Armstrong, consultant en télécommunications
Idil Atak, professeure, université métropolitaine de Toronto
Suzanne Aubry, écrivaine
Stéphane Beaulac, PhD (Cantab), professeur de droit international, université de Montréal
Gilles Bibeau, professeur émérite, université de Montréal
Megan Bradley, professeur et William Dawson Scholar, sciences politiques et développement international, université McGill
Bonnie Campbell, professeure émérite, UQAM
Christopher Campbell-Duruflé, professeur adjoint, faculté de droit, université métropolitaine de Toronto
Sonia Cancian, psychanalyste, historienne, centre de recherches interdisciplinaires en études montréalaises, université McGill
Janet Cleveland, chercheuse, institut universitaire Sherpa
Ellen Corin, professeure émérite, université McGill
Geneviève Dufour, professeure, université d'Ottawa
Gilles Duruflé, consultant en finance internationale
Samaa Elibyari, présidente du Conseil canadien des femmes musulmanes-Québec
Evan Fox-Decent, professeur de droit et président de la chaire en droit et justice cosmopolite, université McGill
Katsi'tsakwas Ellen Gabriel, artiste, documentariste, activiste autochtone en droits de la personne et en environnement, Kanehsatà:ke, Canada
Alain-G. Gagnon, professeur titulaire, département de science politique, UQAM
Ana Gómez-Carrillo, MD, psychiatre, hôpital pour enfants de Montréal, Centre médical de l'université McGill
Gaëtane Gascon, retraitée d'Oxfam Canada
Jill Hanley, professeure titulaire, école de travail social, université McGill
Simon Harel, professeur titulaire, département de littératures et de langues du monde, université de Montréal
Ghayda Hassan, UQAM
Denise Helly, institut national de la recherche scientifique, Montréal
Janique Johnson-Lafleur, institut universitaire Sherpa et université McGill
Niky Kamran, université McGill
Dr Laurence J. Kirmayer, professeur distingué James McGill, directeur, division de psychiatrie sociale et transculturelle, Université McGill
Myrna Lashley, université McGill
Isabelle Lasvergnas, psychanalyste
Karine Mac Allister, PhD
Abdelwahed Mekki-Berrada, professeur titulaire, université Laval
Donna Mergler, professeure émérite, UQAM
Lucie Nadeau, MD, professeure agrégée, divisions de psychiatrie sociale et culturelle et de pédopsychiatrie, université McGill
Vrinda Narain, professeure associée, faculté de droit, université McGill
Ndeye Dieynaba Ndiaye, professeure agrégée, département des sciences juridiques, UQAM
Alex Neve, chercheur principal, école supérieure d'affaires publiques et internationales de l'université d'Ottawa, ancien secrétaire général d'Amnesty International Canada
John Packer, centre d'études sur les droits humains et l'éducation, faculté de droit, université d'Ottawa
Michel Peterson, psychanalyste, école lacanienne de Montréal, Corpo Freudiano, Alfapsy
Johanne Poirier, professeure, faculté de droit, université McGill
Maryse Potvin, professeure titulaire, UQAM
Cécile Rousseau, professeure, Université McGill
Claude Savoie, avocate
Marina Sharpe, professeure associée, collège miliaire de Saint-Jean
Oussama Sidhom, université McGill
Louise Vandelac, professeure titulaire, sociologie, UQAM
Marie-Joëlle Zahar, directrice du réseau de recherche sur les opérations de paix, université de Montréal
Notes
1- « Des centaines de personnalités québécoises demandent à Mark Carney de lever le ton face à Israël », Le Devoir, 28 mai 2025.
2- « UK must impose sanctions on Israel to meet legal obligations, say more than 800 lawyers », The Guardian, 27 mai 2025.
3- Le Monde, 30 mai 2025.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Taxes de 50 % sur l’acier et l’aluminium : escalade dans la guerre commerciale ou nouveau bluff ?

Ce mercredi est entrée en vigueur une nouvelle hausse des droits de douane des États-Unis sur les importations d'acier et d'aluminium, de 25 % à 50 %. Une hausse considérable, qui, si elle se pérennise, provoquera de graves secousses dans un secteur déjà sous tension. Mais ce choix pourrait être un nouveau coup de la part de Trump destiné à le renforcer dans les négociations.
4 juin 2025 | tiré de Révolution permanente | Crédits photo : Flickr The White House
https://www.revolutionpermanente.fr/Taxes-de-50-sur-l-acier-et-l-aluminium-escalade-dans-la-guerre-commerciale-ou-nouveau-bluff
Ce mercredi 4 juin, Trump a de nouveau eu recours à l'un de ses leviers politiques préférés : les droits de douane. En augmentant de 25 % à 50 % les taxes sur l'acier et l'aluminium, Trump poursuit sa lancée protectionniste. Mais, depuis son investiture, le monde a assisté à un tel nombre de revirements dans sa politique commerciale que cette nouvelle annonce ne semble plus émouvoir grand monde : s'agit-il d'un simple nouveau coup de bluff, que Trump se hâtera de suspendre dans les prochains jours, ou avons-nous là affaire à une augmentation durable des droits de douane ?
La guerre commerciale ne s'est jamais interrompue
Le 2 avril, à l'occasion du « Liberation Day », Trump avait déclenché une panique mondiale en annonçant une offensive commerciale tous azimuts, avec des taxes ciblant l'ensemble des produits importés depuis l'ensemble des partenaires commerciaux des États-Unis. Cette offensive s'était suivie d'une escalade avec la Chine atteignant jusqu'à 145 % de droits de douane. Mais, face à la pression des marchés et des risques réels de récession et d'inflation, le président américain s'était vu contraint d'interrompre sa folle course, en accordant d'abord le 9 avril une pause de 90 joursà l'ensemble des pays, exceptée la Chine, et en parvenant par la suite à un accord décrétant une pause similaire avec la Chine le 14 mai.
L'annonce de ce mercredi concernant les importations d'acier et d'aluminium vient nous rappeler que ces pauses n'ont jamais interrompu la politique douanière de Trump et constituent davantage des trêves fragiles que la fin de son offensive. En effet, les taxes sur l'acier et l'aluminium n'ont pas cessé d'être en vigueur, Trump avait lancé des attaques sur ces deux importations dès février, portant le niveau des droits de douane à 25 % début mars.
Mais cette nouvelle hausse est aussi un rappel de la fragilité de la trêve de 90 jours, accordée par les États-Unis aux pays du monde entier dans l'idée de leur accorder la possibilité de signer des accords bilatéraux. Ne restent plus que cinq semaines à la fin de ce moratoire, et seul un pays est parvenu à conclure à ce jour un accord surtout symbolique avec l'administration Trump : le Royaume Uni. L'accord annoncé par Trump et Starmer le 8 mai dernier a certes permis au Royaume Uni d'être le seul pays à échapper aux nouvelles taxes de 50 % sur l'acier et l'aluminium. Mais ce deal reste très fragile, car il s'agit d'un arrangement informel ne disposant aucun cadre juridique déterminé : il ne met aucunement le gouvernement de Starmer à l'abri d'un revirement inopiné de Trump. Ce risque est d'autant plus grand que le décret instituant les nouvelles taxes précise que Trump se réserve le droit de les appliquer au Royaume Uni s'il estime que Starmer ne remplit pas entièrement ses engagements pris dans l'accord du 8 mai.
Ces nouveaux tarifs interviennent par ailleurs en pleines négociations entre les États-Unis et Union européenne. Ce mercredi a eu lieu une rencontre entre Maroš Šefčovič, commissaire européen au commerce, et Jamieson Greer, représentant étasunien pour le commerce extérieur. Si les deux hommes ont décrit leur rencontre comme ayant été « constructive », la hausse de taxes annoncée aujourd'hui par Trump ne va pas faciliter les négociations. Venant frapper un secteur métallurgique en crise dans le monde entier, et en Europe tout particulièrement, ces nouvelles taxes pourraient bien devenir un nouvel atout de Trump dans les négociations. Mais il serait illusoire de réduire la politique commerciale de Trump à des coups de bluff destinés à renforcer sa capacité à obtenir des accords favorables aux États-Unis. Le projet du président étasunien reste un projet protectionniste qui vise à renforcer la production industrielle américaine. En tant que « barrière » de protection pour la sidérurgie étasunienne, telles que les a nommées Trump lui-même, ces nouvelles taxes douanières pourraient bien se pérenniser.
Une menace sérieuse pour le secteur métallurgique, en crise dans le monde entier
Les droits de douane sur l'acier et l'aluminium interviennent dans une période de crise profonde pour ces secteurs, dans un contexte de surcapacité industrielle mondiale. Pour prendre l'exemple de l'acier, cette crise est le fruit d'une explosion de la production mondiale, celle-ci étant passée de 1148 millions de tonnes en 2005 à 1892 en 2023. Un accroissement stimulé par la Chine, qui est devenu de très loin le premier producteur mondial d'acier, avec 1019 millions de tonnes produites en 2023. L'inondation du marché par un acier souvent plus abordable que l'acier produit dans les pays occidentaux a fortement mis à mal cette industrie. Le tout dans un contexte de très faible croissance de l'économie mondiale, exerçant une pression à la baisse sur la demande. Si Trump compte protéger l'industrie étasunienne grâce à ces droits de douane, cette stratégie va avoir des conséquences catastrophiques sur ses partenaires commerciaux, mais elle va également affecter par ricochet l'économie étasunienne.
Les premières victimes seront les premiers exportateurs d'acier et d'aluminium vers les États-Unis, au premier chef d'entre eux le Canada. Alors que les importations canadiennes représentent 23 % de l'acier et 40 % de l'aluminium importés aux États-Unis, les industriels canadiens ont tiré le signal d'alarme ce mercredi. Si des droits de douane de 25 % mettaient déjà à mal les exportations vers les États-Unis, le passage à 50 % les rend quasi impossibles. Alors que le premier ministre canadien Mike Carney avait promis une politique intransigeante face aux provocations de Trump, cette nouvelle attaque le met face à un défi bien difficile à résoudre.
Ces droits affecteront également les autres grands exportateurs vers les États-Unis à l'instar du Mexique et le Brésil, mais également l'UE. Si les pays européens ne sont pas les plus grands exportateurs vers les États-Unis, ces nouvelles barrières font planer la menace d'une inondation du marché européen par l'acier et l'aluminium qui ne pourront plus entrer sur le marché américain. Or, le secteur sidérurgique est en net recul depuis une décennie en Europe : la production a baissé de 20 % de 2014 à 2023, avec une baisse de 8 % des emplois directs sur la même période. Mis profondément à mal par la hausse des prix de l'énergie provoqués par la guerre en Ukraine, la stagnation économique et la crise de secteurs qui sont des grands consommateurs d'acier comme le secteur automobile ont aggravé sa rentabilité économique.
Le 19 mars dernier, en réaction aux droits de douane de 25 %, la Commission européenne avait déjà volé au secours de cette industrie avec des mesures de sauvegarde, telles que des quotas d'importation, mais aussi d'autres instruments de défense commerciale. Il semble probable que la nouvelle hausse pousse la Commission à intensifier ces mesures. Mais ces taxes spécifiques à l'acier et l'aluminium pourraient également faire l'objet d'un accord diplomatique entre UE et États-Unis. La pression exercée par Trump sur l'Europe est multiple : aux droits de douanes s'ajoutent les velléités de se désengager militairement d'Ukraine, pouvant aller jusqu'aux menaces de se désengager de l'OTAN. Sa stratégie transactionnelle le conduit à multiplier ces points de pression afin de faire plier ses partenaires, sans distinguer les questions commerciales, militaires ou sécuritaires. Les nouvelles taxes sur l'acier et l'aluminium pourraient alors jouer un rôle stratégique dans le cadre de ces négociations, dont l'issue est toutefois toujours très incertaine.
La stratégie de la classe ouvrière face à la guerre commerciale
Quelle que soit l'issue de cette guerre commerciale, et la pérennité ou non de ces mesures tarifaires, les victimes de cette politique agressive et erratique seront toujours les travailleurs. Malgré les prétentions de Trump de défendre le secteur industriel étasunien, ces mesures vont directement affecter les travailleurs américains. Ces taxes vont en effet produire de fortes tensions inflationnistes, et vont mettre à mal l'ensemble des secteurs manufacturiers dont la production reposait sur l'importation d'acier et d'aluminium. Ainsi, alors que l'économie mondiale est dans une longue phase de stagnation depuis la crise des subprimes, ces taxes vont accroître les risques de récession, qui vont en premier lieu toucher les travailleurs, en attaquant leur pouvoir d'achat et leurs emplois.
Si cela vaut pour les États-Unis, c'est a fortiori le cas pour le monde entier. La crise touchant le secteur sidérurgique permet aux patrons de multiplier les plans sociaux et licenciements, allant jusqu'aux fermetures d'usines. Arcelor Mittal, deuxième producteur mondial d'acier, a annoncé le 23 avril la suppression de 636 emplois sur sept sites dans le Nord. Cette annonce intervient dans le contexte d'une large vague de licenciements, et alors que le géant avait déjà confirmé la fermeture des sites de Reims et de Denain en février. Le groupe justifie ces suppressions par les difficultés économiques et la concurrence chinoise. Des justifications hypocrites, alors qu'il est lui-même un des acteurs de la production et de l'importation d'acier chinois en France.
Face à ces attaques, qui vont s'aggraver avec l'escalade commerciale de Trump, les bureaucraties syndicales, à l'instar de Sophie Binet, nous proposent de riposter aux côtés du gouvernement Macron avec des mesures protectionnistes de rétorsion. Cette réponse chauvine, en plus d'alimenter un discours nationaliste, ne fera qu'aggraver la situation de la classe travailleuse en accentuant les tendances à la récession et à l'inflation produites par la guerre commerciale. Face aux nouvelles attaques de Trump et aux attaques patronales qui vont suivre, une seule réponse est possible. Une réponse par en bas, des travailleurs auto-organisés qui par leurs méthodes de lutte exigent le maintien de leurs emplois, en brandissant notamment une revendication essentielle du mouvement ouvrier : la nationalisation sans indemnités des usines.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Pour les universités, la répression de Trump, c’est « pire que le maccarthysme »

Les États-Unis ont déjà connu deux purges politiques de la gauche, la « Peur rouge » des années 1920 et le maccarthysme des années 1950, et nous sommes aujourd'hui en pleine purge Trump, qui est pire que les précédentes.
Hebdo L'Anticapitaliste - 757 (05/06/2025)
Par Dan La Botz
Crédit Photo
Wikimedia Commons
La « Peur rouge » des années 1920 a suivi la révolution russe d'octobre 1917. Elle a été immédiatement provoquée par des anarchistes autoproclamés qui ont envoyé des bombes au procureur général A. Mitchell Palmer et au juge de la Cour suprême Oliver Wendel Holmes. Le gouvernement américain a arrêté des milliers d'anarchistes, de socialistes et de communistes, dont plusieurs milliers d'immigrantEs originaires de Russie, d'Europe de l'Est et d'Europe du Sud qui ont été expulsés.
La guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique, qui a débuté à la fin des années 1940, a conduit à ce qu'on a appelé le maccarthysme. Le sénateur du Wisconsin Joseph McCarthy, président de la sous-commission d'enquête permanente du Sénat, a tenu des audiences sur la subversion communiste et ceux qu'il a appelés à témoigner ont souvent vu leur vie détruite par cela seul, perdant leur emploi et leur réputation. D'autres commissions législatives du Congrès et des États ont également tenu des audiences. En 1954, le Congrès a adopté et le président Dwight D. Eisenhower a signé la loi sur le contrôle des communistes, interdisant le Parti communiste. Au cours de cette période, des centaines de personnes ont été emprisonnées et des milliers ont perdu leur emploi.
Criminalisation de ses opposants
Aujourd'hui, Trump et les Républicains s'en prennent à ceux que Trump qualifie de « gauchistes lunatiques, socialistes et communistes » ou de « membres d'un réseau mondial de soutien au Hamas » ou encore d'« antisémites ». Des immigrantEs sont déclaréEs « criminels » sans procédure régulière, arrêtés et expulsés.
Trump expulse de plus en plus d'immigrantEs, parfois en invoquant la loi controversée de 1798 sur les ennemis étrangers (Enemy Aliens Act), parfois en violant le droit des immigrantEs à une procédure régulière. Les États-Unis ont notamment expulsé illégalement Kilmar Abrego García vers son pays d'origine, le Salvador, et ont refusé son retour malgré une décision de justice. Trump a mis fin au statut de protection temporaire de centaines de milliers de migrantEs vénézuéliens, cubains, haïtiens et nicaraguayens, et la Cour suprême a confirmé sa décision. Trump a également modifié le statut de plus de 1 800 étudiantEs internationaux et jeunes diplôméEs, les rendant plus vulnérables à l'expulsion.
On retrouve ici des échos de la guerre froide, aujourd'hui remplacée par une guerre froide avec la Chine communiste. L'administration Trump a déclaré qu'elle révoquerait « de manière agressive » les visas des étudiantEs chinois qui étudient aux États-Unis, soit 280 000 personnes. Sont menacés ceux qui ont des liens avec le Parti communiste chinois, qui étudient dans des domaines critiques tels que les sciences, l'ingénierie et la médecine ou qui « causent des problèmes », c'est-à-dire qui participent à des manifestations.
Une répression globale pour tout manifestant
Ellen Schrecker, historienne spécialiste du maccarthysme, affirme que « l'attaque actuelle contre l'université est infiniment pire que le maccarthysme ». Cette attaque est plus large, plus puissante et vise à discipliner et à contrôler l'ensemble de l'enseignement supérieur. En 2021, le vice-président J.D. Vance a prononcé un discours intitulé « Les universités sont l'ennemi », et sous Trump, c'est certainement devenu le cas. Dans le but de discipliner les universités, Trump a gelé environ 11 milliards de dollars de fonds destinés à la recherche.
Le maccarthysme ne menaçait que des professeurs individuellement, mais selon l'historienne Ellen Schrecker, la répression de Trump sur « les manifestations sur les campus contre la guerre d'Israël à Gaza et les menaces d'expulsion d'étudiants et de membres du corps enseignant, […] cela touche également les salles de classe, les laboratoires, les programmes d'études, les bibliothèques, les dortoirs, les programmes DEI, les bureaux d'admission, les décisions en matière de personnel, les sports, les agences d'accréditation ». Trump a même recomposé des institutions entières telles que le New College of Florida.
Contrairement à la période McCarthy, nous assistons à une résistance croissante. À l'université Columbia, qui a cédé aux exigences de Trump, les étudiantEs ont hué la présidente par intérim, Claire Shipman. Et au MIT, la présidente de la promotion 2025, Megha Vemuri, a prononcé un discours percutant attaquant les liens du MIT avec l'armée israélienne et la guerre génocidaire contre le peuple palestinien. Elle en a payé le prix en étant exclue de la cérémonie de remise des diplômes. Mais la lutte continue.
Dan La Botz, traduction Henri Wilno
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Marche mondiale vers Gaza ; plus de 80 organisations canadiennes se mobilisent au Canada

Montréal, Tiohtia ;ke, le 5 juin 2025 - La situation à Gaza a franchi le point de non-retour. Depuis le début de l'offensive israélienne, plus de 54 000 Palestiniens et Palestiniennes ont été tuées, dont plus de 16 000 enfants. Les bombardements incessants, le blocus et le siège total imposé à la population civile ne laissent aucun doute : il s'agit d'un génocide en cours.
Photo Serge d'Ignazio
Désormais la famine est utilisée comme une arme de guerre, une de plus dans l'arsenal de la stratégie israélienne visant à détruire la population de Gaza. Ce blocus mortifère, cette privation délibérée de nourriture, d'eau et de soins, s'ajoute aux bombardements incessants, plongeant près de 2 millions de personnes, soit 93 % de la population, dans une crise alimentaire extrême. Selon des organisations humanitaires, 470 000 personnes risquent de mourir des conséquences directes de cette famine provoquée. Malgré les pressions croissantes de la communauté internationale, Israël intensifie ses frappes, plongeant
les habitant·es de Gaza dans un cauchemar sans fin.
Face à cette réalité insoutenable et à l'inaction coupable des grandes institutions internationales et de nos gouvernements, un mouvement citoyen mondial sans précédent s'organise : la Marche Mondiale vers Gaza. Cette initiative appelle à une mobilisation pacifique et massive le 15 juin 2025, depuis l'Égypte, pour marcher vers Rafah en solidarité avec le peuple palestinien et exiger la fin immédiate des violences.
« La marche porte trois revendications claires et urgentes : la levée immédiate du blocus sur Gaza, l'ouverture des frontières et l'entrée massive de l'aide humanitaire, ainsi que la fin des complicités internationales qui rendent ce génocide possible. » souligne Baya El Hachemi, membre du collectif Palestine Vivra à l'origine de la mobilisation au Canada.
« Nous refusons de rester spectatrices et spectateurs. Nous marchons pour Gaza. » martèle-t-elle.
Une délégation canadienne rassemblant entre 75 et 120 personnes ; militant·e·s, syndicalistes, professionnel·les de la santé et membres de la société civile se joindra à cette marche historique aux côtés de milliers de citoyennes et citoyens du monde entier. Elle bénéficie d'un important soutien de la société civile au Canada, mobilisée autour de valeurs de justice, de dignité humaine et de solidarité internationale.
Plus de 80 organisations à travers le Canada ont officiellement endossé cette initiative, soulignant l'urgence d'agir face à la situation alarmante en cours à Gaza. « Le silence tue. Il faut agir, au-delà des mots, pour mettre fin au génocide à Gaza », affirme Safa Chebbi, de Désinvestir pour la Palestine et membre de la coordination canadienne nationale de la Marche. Elle rappelle que notre solidarité ne peut se limiter à des prises de position symboliques : elle doit se traduire par des actions concrètes, coordonnées et déterminées pour briser l'isolement de Gaza et soutenir la lutte du peuple palestinien pour sa liberté et sa dignité.
À propos
La marche mondiale vers Gaza est une mobilisation internationale qui rassemble des délégations de plus de 60 pays.
Des centaines d'organisations à travers le monde ont déjà répondu à l'appel : syndicats, ONG, collectifs féministes, associations de quartier, groupes antiracistes...
Palestine Vivra est une organisation citoyenne non partisane née à Montréal en août 2024, en réponse aux mobilisations contre le génocide en cours à Gaza. Elle œuvre pour renforcer la solidarité avec la Palestine par des actions de sensibilisation au Québec et des projets de coopération internationale. Elle constitue également la structure juridique de la campagne québécoise de la Flottille de la Liberté.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.













