Derniers articles

Solidarité féministe 101

PAS UNE de PLUS est une collective citoyenne de Sherbrooke qui rassemble des féministes en action contre les féminicides et les violences genrées. Nous nous organisons de façon autogérée, et travaillons avec une analyse féministe, intersectionnelle et transinclusive des luttes.
Tiré du Journal Entrée libre
Date : 1 juin 2025
Crédit image : Collective Pas une de plus
Nos actions sont politiquement orientées vers la déconstruction des systèmes de domination, comme le patriarcat et le capitalisme.
Nous ne sommes pas un organisme communautaire, une organisation financée, un groupe légalement constitué. On est une gang de féministes.
Nous rêvons d'un mouvement d'apprentissages collectifs, de partages d'Histoires de vie, de savoirs féministes et d'éducation populaire. Nous voulons un espace public militant et organisationnel porteur de justice sociale et surtout, d'espoir. Nous, citoyennes féministes en colère, vivant de l'impuissance et de la désolation, écoeurées du statuquo autour du continuum de violence genrée.
« Les conditions d'inégalité peuvent être reproduites au sein des mouvements et des organisations de défense des droits des femmes lorsque sont amplifiées les voix, les idées et les expériences des femmes blanches, riches, cisgenres, hétérosexuelles et les femmes non en situation de handicap, au détriment des voix, des idées et des expériences des femmes marginalisées. » (Un guide pour construire la solidarité féministe intersectionnelle, Institut canadien de recherches sur les femmes, 2021)
Reconnaitre le savoir expérientiel et l'engagement militant
On peut nous qualifier de militantes, d'activistes, de « féministes radicales qui prônent la désobéissance civile » et qui avancent le fait que le système est gangrené et que rien n'y changera si nous ne le changeons pas nous-mêmes. Ce qui est crucial dans le féminisme que nous portons, c'est de reconnaitre que notre engagement est fondé sur nos valeurs de justice sociale, d'équité et de respect de nos droits.
Traumavertissement : Ce qui suit est une liste d'enjeux multiples que peuvent vivre plusieurs femmes et qui laissent des marques permanentes. La force des féminismes portés par la Collective est bâtie à partir de nos réalités de ce qu'on vit ou ce qu'on a vécu : plusieurs types de violences (conjugale, familiale, sexuelle, économique, psychologique, judiciaire, systémique, médicale, policière, classiste, capacitiste), plusieurs types de discrimination (basée sur le genre, l'orientation sexuelle, l'identité ou l'expression de genre, l'âge, la classe sociale, les convictions politiques et/ou sur le handicap visible et invisible), décrédibilisation de nos savoirs, pauvreté, contrôle coercitif, limitation à l'accès aux transports, risque d'itinérance et itinérance cachée, certains troubles alimentaires, certaines dépendances, certains troubles de santé mentale, errance médicale, inaccessibilité de ressources en santé mentale et santé physique gratuites, inaccessibilité de produits menstruels ou de contraception gratuits, grossophobie ordinaire et médicale, absence de représentativité dans les études en santé, non-reconnaissance de la douleur, surmédicalisation et décrédibilisation de l'overdose d'effets secondaires sexisme ordinaire, harcèlement de rue, décrochage et raccrochage scolaire, arrestation et détention illégale, suicide d'une personne proche, proche-aidance, accompagnement et décès d'un parent d'un cancer du sein ou cancer des ovaires, sa propre tentative de suicide ou moments très noirs.
Pour nous, ces savoirs appelés « expérientiels », sont tous aussi – sinon plus – importants que ce qu'on peut apprendre à l'école. Nos pensées féministes se sont développées au contact des autres, avec des livres, des films, des BD, des cercles de parole, des collectifs autonomes, des participations à des recherches par et pour, des actions directes, des assemblées, des comités en non-mixité choisie. Juste en se parlant. Mais ça, on s'en torche la plupart du temps. On nous invisibilise. On nous gaslight. On nous invalide. Pourquoi faut-il toujours être une personne « experte » avec des diplômes ou représenter une organisation pour que notre parole ait de la valeur ? Pour qu'on nous écoute ? Pour vrai.
En ces moments troubles où la transmisogynie, la haine des femmes et la peur de l'Autre sont des discours réguliers, l'action citoyenne féministe devrait être encouragée. La désolidarisation d'une frange d'un mouvement vis-à-vis d'une partie jugée radicale se condamne lui-même à sa perte. Parce que si on ne travaille pas ensemble, on ne gagnera jamais la lutte.
Et si vous pensez que la désobéissance civile est le mal absolu, on vous invite respectueusement à quitter votre poste de directrice d'une table de concertation en défense de droits des femmes et à refaire vos devoirs.
Nos droits n'ont pas été gagnés avec le statuquo. C'est la multiplication des actions, dont la désobéissance civile, qui fait qu'on a les libertés et les droits d'aujourd'hui. Et c'est grâce à la multiplication des actions, dont la désobéissance civile, que nous les avons protégés, que nous les protégeons, que nous les protégerons.
Alors, où est la place des citoyennes dans la lutte féministe en Estrie ?
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Comptes rendus de lecture du mardi 17 juin 2025


Devenir fasciste
Mark Fortier
J'ai beaucoup aimé ce bouquin, très d'actualité, dont je ne saurais trop vous recommander la lecture. Devant la montée de l'extrême droite, qui a pris le pouvoir dans de nombreux pays et qui menace de triompher dans d'autres, le sociologue Mark Fortier envisage - non sans une certaine ironie - de se convertir au fascisme, histoire de se mettre à l'abri des conséquences du totalitarisme en marche. Il nous explique, à ce propos, la responsabilité de ceux qui ont laissé faire, de ceux qui ont laissé se dégrader nos institutions, nos droits et même notre pensée à travers les mots, au profit de la droite et de l'extrême droite, en nous rappelant, dans la solidarité propre à la gauche, le devoir de résistance et de changement.
Extrait :
Il était là, le souci des libertariens : comment allaient-ils pouvoir, une fois la planète détruite, éviter que leurs gardes ne tournent leurs armes contre eux pour les tuer ? Ils savaient bien que vivre en autarcie exigerait une force armée privée pour repousser les voleurs, la plèbe, la foule écumant des envieux. Un des participants à la rencontre avait déjà à son service une douzaine d'anciens soldats. Pour éviter cette violence, suggéra l'universitaire, vous pourriez traiter ces gardes en amis, ne pas simplement investir dans les armes et les munitions, mais vous investir personnellement dans votre relation à ces personnes. Rushkoff précisa tout de même que le mieux, vraiment, serait d'agir au présent et de s'engager dans la lutte contre la catastrophe écologique. Il se permit de suggérer qu'il serait judicieux de leur part de se soucier du monde. De prendre leurs responsabilités. Les libertariens ont levé les yeux, surpris d'avoir payé si cher pour se faire servir un discours de hippie. « Ne serait-il pas plus réaliste de miser sur la production de robots de combats ? » lança alors l'un d'entre eux, « Oui, mais seront-ils opérationnels à temps ? » de s'inquiéter un autre.

Quand les élèves se révoltaient
Emanuelle Dufour et Francis Dupuis-Déri
Ce très beau livre, qui ressemble à une bande dessinée, se veut un manuel scolaire de l'année 2047-2048. Il nous situe ainsi après l'effondrement de la civilisation industrielle provoqué par la crise climatique une douzaine d'années plus tôt. Il revient sur les nombreuses luttes et révoltes étudiantes pour plus de démocratie et de justice sociale au cours de l'histoire et plus récemment contre les changements climatiques. C'est un bouquin éclairant, facile d'accès, et fort bien illustré, qui nous parle de vraie démocratie, de justice sociale et des actuelles luttes des jeunes générations pour la défense de l'environnement. Je vous en recommande certainement la lecture !
Extrait :
Nous sommes en l'An 12 après l'Effondrement (ap. E.) des systèmes politiques, économiques et sociaux de la civilisation industrielle. Cet effondrement a été provoqué par une crise climatique globale qui avait été prédite de longue date par des milliers de scientifiques et, au tournant des années 2020, par des millions d'élèves du Mouvement des jeunes pour le climat. C'est une jeune Suédoise de 15 ans, Greta Thunberg, qui avait lancé ce mouvement en entamant une grève scolaire pour le climat dès 2018. Heureusement, en 2035 l'Effondrement a donné lieu à l'émergence d'une nouvelle génération plus démocratique, plus égalitaire et plus solidaire.
Pour en finir avec Octobre
Francis Simard
Francis Simard nous a quitté il y a une dizaine d'années. Si vous ne l'avez fait, je vous invite à lire son fameux bouquin « Pour en finir avec Octobre » sur l'enlèvement du ministre Pierre Laporte par la cellule Chénier du Front de libération du Québec. C'est un récit humain et honnête des événements d'octobre 1970.
Extrait :
Je ne crois pas aux choses immuables. Je ne crois pas que la vie ce soit un acte solitaire qu'on devrait assumer tout seul. J'ai comme l'impression de n'avoir jamais cru que j'étais né dans un monde où tout était décidé, que rien ne pouvait changer, qu'il fallait donc l'accepter en cherchant tout seul à s'en sortir. Il me semble que c'est comme la vie. On vient au monde, on grandit, on vieillit, on meurt. On change tout le temps. Si c'est vrai pour une vie humaine, ça doit être vrai pour une société. Toutes les sociétés.
Des bonobos et des hommes
Deni Béchard
Traduit de l'anglais
« Des bonobos et des hommes » relate le travail de l'ONG Bonobo Conservation Initiative (BCI), qui travaille étroitement avec des Congolais pauvres et démunis à la protection et à la conservation de ces importants grands singes, si près de nous génétiquement, que sont les bonobos. Ce récit d'une lecture fort agréable nous en apprend tant sur les bonobos que sur les hommes, tant sur la guerre et l'impact du capitalisme étranger que sur l'avenir de certaines espèces animales et de l'humanité elle-même. Vous prendrez assurément beaucoup de plaisir à le lire, vous aussi.
Extrait :
Bien que lents à se dévoiler, les bonobos ont commencé à faire des apparitions, jetant ici et là des regard à travers le feuillage, les yeux curieux, les lèvres d'un rouge vif sur leurs visages noirs. Ils avaient les bras tendus et musclés des athlètes, et leurs corps possédaient une grâce particulière. En nous étudiant, ils enroulaient leurs longs doigts autour des branches et des troncs d'arbres. Nous nous frayions un chemin dans la végétation en tentant de les apercevoir de plus près.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Changement de garde à la FTQ – Le secrétaire général Denis Bolduc annonce qu’il ne sollicitera pas de renouvellement de mandat

La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) annonce que son secrétaire général, Denis Bolduc, profitant de la rencontre mensuelle du Bureau de direction qui s'est tenue ce lundi, a fait part aux vice-présidents et vice-présidentes de la FTQ qu'il ne solliciterait pas de nouveau mandat au Congrès de novembre prochain à Québec. Dans un même temps, l'actuelle présidente, Magali Picard, a confirmé qu'elle sollicitera un deuxième mandat à la tête de la Fédération.
Denis Bolduc a été élu secrétaire général de la FTQ lors du 32e Congrès en novembre 2019, puis réélu au 33e Congrès en janvier 2023. Auparavant, il a été président du Syndicat canadien de la fonction publique pour le Québec (SCFP-Québec) de 2016 à 2019, secrétaire général du SCFP-Québec de 2011 à 2016 et membre du conseil exécutif du SCFP national de 2011 à 2020. Denis est aussi membre du conseil d'administration du Fonds de solidarité FTQ.
« C'est avec une grande fierté et humilité que j'ai servi tout au long de ma carrière les travailleurs et travailleuses du Québec, que ce soit à la FTQ ou auprès de mon syndicat d'origine, le SCFP-Québec, ou en tant que président du syndicat de la rédaction lors du malheureux lock-out de 16 mois au Journal de Québec imposé par Quebecor. Défendre les valeurs syndicales, de justice sociale, de solidarité et de respect fait partie de mon ADN. Est-il besoin de rappeler que les sociétés les plus justes, démocratiques et équitables sont les pays les plus syndicalisés ?
« C'est donc avec le sentiment du devoir accompli que je quitterai le poste de secrétaire général de la FTQ en novembre prochain. À tous les travailleurs et travailleuses, mes amis et collègues qui m'ont permis d'exercer mes fonctions en tant que leader syndical et secrétaire général de la plus grande et belle centrale syndicale qu'est la FTQ, MERCI », déclare le secrétaire général, Denis Bolduc.
« Denis est non seulement un proche collaborateur, mais aussi et surtout, un ami et fidèle allié dans tous les dossiers, pas toujours faciles, sur lesquels la FTQ a dû intervenir pendant toutes ces années. Denis a toujours su prendre la défense des travailleurs et travailleuses avec conviction et détermination sans jamais sacrifier les valeurs qui font de lui un homme de principe. Denis a fait grandir la FTQ et nous ne pouvons que le remercier. Je suis fière d'avoir eu comme coéquipier mon ami Denis », conclut la présidente de la FTQ, Magali Picard.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

13e congrès de la FIQ | Un moment important

Nous avons vécu un moment important, la semaine dernière, à Québec. Ce 13e congrès de la FIQ a été le terreau de nos luttes et de notre solidarité pour les années à venir. J'ai vu des professionnelles en soins audacieuses, brillantes et déterminées réfléchir, discuter et débattre sur les défis de demain. Vos déléguées syndicales sont animées par une volonté sincère de défendre vos droits, d'améliorer vos conditions de travail et de rendre le réseau de la santé plus humain.
C'est donc avec une immense fierté et beaucoup d'émotion que j'ai accepté le deuxième mandat de présidente qu'elles m'ont accordé à l'issue des élections.
Depuis 2021, j'ai le privilège de vous représenter, de porter nos luttes et nos espoirs. Ce rôle est exigeant, souvent confrontant, mais toujours profondément porteur de sens. Alors que s'amorce mon deuxième mandat, mes convictions et ma détermination sont plus vives que jamais. Je continuerai de porter votre voix haut et fort, sans compromis.
Mais mon travail ne serait pas possible sans l'apport inestimable de mes collègues. Je tiens à souligner tout le travail qu'ont accompli Isabelle Giroux, Patrick Guay et Laurier Ouellet au sein du comité exécutif dans les quatre dernières années. Leur dévouement a laissé une marque importante à la FIQ.
Une nouvelle équipe se met en place et je suis ravie d'accueillir Julie Daignault, Pascal Beaulieu et Sébastien Bouchard parmi nous. J'ai hâte de poursuivre le travail à leurs côtés, ainsi qu'à ceux des membres réélues du Comité exécutif, soit Nathalie Levesque, Françoise Ramel, Isabelle Trépanier, Roberto Bomba et Jérôme Rousseau !
Pour en savoir plus sur les décisions prises, les visages du nouveau Comité exécutif et des comités statutaires et les dossiers prioritaires qui guideront nos actions dans les prochaines années, je vous invite à lire cette édition du FIQ en action jusqu'au bout.
Merci de faire vivre notre fédération avec autant de force et de solidarité. Nous sommes et resterons inébranlables face aux défis de demain.
Julie Bouchard
Présidente de la FIQ
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Lettre ouverte : Grève à la STM : à la défense des transports publics pour tous et toutes

Depuis le 9 juin, les 2400 employé·es de l'entretien de la STM sont en grève. Les grévistes ont raison de refuser le bouleversement de leurs horaires de travail, qui menace de détériorer leur qualité de vie et la conciliation travail-famille. Ils contestent également le recours à la sous-traitance, qui risque de dégrader la qualité du service en nous privant du savoir-faire des travailleur·euses à l'interne et en soumettant un service public aux exigences de rentabilité du secteur privé. Cette privatisation tranquille risque par ailleurs d'augmenter les coûts plutôt que de les réduire.
La lutte des employé·es de la STM pour des conditions de travail décentes est intimement liée à la qualité d'une offre de métros et d'autobus propres et sécuritaires pour tous et toutes. En ce sens, leurs conditions de travail sont nos conditions de transport en tant qu'usagers et usagères.
Au Québec, les transports sont les principaux contributeurs aux bouleversements climatiques (43 % des émissions de GES). Or, il est impossible d'offrir une alternative écologique et attrayante à l'auto solo sans garantir l'accès à des transports publics fiables, fréquents, efficaces et abordables. Valoriser les conditions d'emploi des travailleur·euses de la STM, c'est donc faire un choix de société pour des transports collectifs accessibles et de qualité comme moyen d'affronter la crise écologique.
Nous refusons les analyses à courte vue et les analogies douteuses. La grève, ce n'est jamais une « prise d'otage » – c'est un droit constitutionnel qui permet la défense de nos conditions de travail et de nos services publics.
La grève actuelle révèle que le transport en commun est central pour notre société. En réalité, l'atteinte la plus grave aux usagères et usagers n'est pas causée par la grève mais par le sous-financement chronique et la sous-traitance. L'inconfort de nos déplacements découle de pannes de métro toujours plus fréquentes et de passages d'autobus souvent moins fréquents. Il est causé par des stations vétustes que l'on doit fermer pendant des jours et par des tarifs en hausse constante. Il l'est aussi par le tout à l'auto individuelle (même électrique) et les autoroutes qui s'allongent sans fin, en l'absence de plan d'infrastructures de transport public pour relier nos quartiers, nos villes et nos villages. Si l'impact temporaire de la grève sur notre quotidien est réel, l'impact chronique du sous-financement du transport collectif sur nos vies l'est bien davantage.
Cette grève nous rappelle aussi que nos transports publics dépendent de personnes dont le travail est trop souvent invisibilisé : préposé·es à l'entretien, briqueteur·ses, soudeur·ses, électricien·nes, plombier·ères, rembourreur·ses, cantonnier·ères, mécanicien·nes, parmi d'autres. Sans leur travail et leur expertise, nous ne pourrions pas prendre le métro ou l'autobus sans inquiétude pour notre santé et notre sécurité.
Les figures héroïques de notre époque ne portent pas de cape : elles font, entre autres, que nous pouvons nous déplacer collectivement tout en respectant les limites écologiques de notre habitat fragile. Les grévistes ne défendent pas autre chose. Ils méritent toute notre solidarité. D'autant plus que l'usagère d'aujourd'hui est la gréviste de demain, et que c'est de leur solidarité mutuelle que dépend notre avenir collectif.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Compressions de 151 M$ Plus de 40 postes professionnels abolis dans dix cégeps

Québec, le 10 juin 2025 — Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) dénonce l'abolition de plus de 40 postes professionnels dans les dix cégeps qu'il représente à la suite des compressions de 151 M$ imposées par la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Déry.
Parmi les postes abolis, on retrouve notamment des personnes conseillères pédagogiques, analystes en informatique, psychologues, sexologues, aides pédagogiques individuelles, chercheuses et conseillères aux ressources matérielles. « Il est inévitable que les services aux étudiants et aux entreprises soient réduits en raison de ces abolitions de postes. Avec cette décision, la ministre va nuire aux objectifs du gouvernement, tant en termes de diplomation que d'aide aux entreprises dans une période économique particulièrement incertaine », critique Guillaume Bouvrette, président du SPGQ.
Dans plusieurs milieux, l'épuisement guette aussi un nombre grandissant de professionnelles et professionnels. « Non, nos membres ne peuvent pas faire plus avec moins, ils sont au bout du rouleau. Ils sont déjà en surcharge et le gouvernement supprime des postes en plus d'interdire de faire des heures supplémentaires. Les attentes sont irréalistes, même les directions d'établissement dénoncent ces compressions », juge M. Bouvrette.
Il va sans dire que la nouvelle est accueillie difficilement dans les cégeps. « Ce sont des moments difficiles pour les personnes visées par ces annonces et pour leur équipe. Évidemment, nous allons continuer d'accompagner nos membres dans cette période pénible. Nous voulons aussi exprimer notre solidarité envers les autres personnes concernées, notamment le personnel de soutien qui est lui aussi durement touché par cette situation », indique M. Bouvrette.
Selon le SPGQ, d'autres moyens existent pour améliorer les finances du gouvernement comme de mettre fin à la sous-traitance abusive qui a notamment mené au scandale SAAQclic, arrêter les mauvais investissements comme dans le projet de NorthVolt et mettre en priorité la lutte à l'évasion fiscale.
À propos du SPGQ
Le SPGQ est le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec. Créé en 1968, il représente plus de 35 000 spécialistes, dont environ 26 000 dans la fonction publique, 6 000 à Revenu Québec et 3 000 répartis dans les secteurs de la santé, de l'enseignement supérieur et au sein de diverses sociétés d'État.
Source
Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Un succès de librairie révélateur d’un ras le bol ?

Dans la semaine suivant son lancement, le livre réquisitoire « L'exploitation de notre eau par Rio Tinto » écrit par deux anciens cadres d'Alcan et Rio Tinto se situait au sixième rang du palmarès de vente de livres en librairie au Québec. La maison d'édition Somme Toute qui le publie envisage déjà une réédition. Le Mouvement Onésime-Tremblay considère la popularité de ce livre comme un indicateur évident de la soif d'information de la population sur une multinationale qui, par-delà son image, recouvre d'opacité ses activités qualifiées par plusieurs de comportement anti-social alors qu'elle utilise les richesses naturelles du Québec comme une pompe à profit et ce, au détriment des besoins régionaux.
Déjà en octobre dernier, l'insatisfaction était manifeste lors du colloque « 1926-2026 : cent ans d'occupation par Alcan et Rio Tinto, un bilan s'impose » suivi dans la foulée par la création du Mouvement Onésime-Tremblay.
Le succès du livre de Jacques Dubuc et Myriam Potvin est un jalon important dans l'expression de ce ras le bol. Nous croyons que le fait saillant de ce livre est d'esquisser pour la population une voie de sortie au cul de sac dans lequel nous amène collectivement Rio Tinto. Les auteurs nous rappellent qu'il existe autre chose que la résignation. « Le levier du bail de location des forces hydrauliques de la rivière Péribonka et des conditions qui s'y rattachent se trouve toujours entre les mains du Gouvernement du Québec » (p. 62). L'utilisation du bassin hydrographique de la rivière Péribonka a été accordé à Alcan puis Rio Tinto en retour d'engagements concernant la construction d'usines générant des centaines d'emplois. Jacques Dubuc et Myriam Potvin le démontrent amplement : ces engagements ne sont pas respectés et ce, malgré les multiples délais accompagnés de généreux cadeaux. Ce de non-respect de contrat ouvre la porte à ce que le gouvernement, de plein droit, prenne possession des barrages et installations sur la rivière Péribonka. Cette entente prend fin le 31 décembre 2025. Il faut agir maintenant.
Les élections municipales se tiendront à l'automne et celles du Québec dans un peu plus d'un an. Le Mouvement Onésime-Tremblay souhaite que les partis politiques et les élus locaux se positionnent clairement sur cet enjeu que nous qualifions d'existentiel pour la population du Saguenay—Lac-Saint-Jean et de l'ensemble du Québec.
Le Mouvement Onésime Tremblay a pour objectifs de favoriser l'expression et la diffusion d'un point de vue citoyen axé sur le bien commun face à l'impact des actions passées, présentes et futures d'Alcan et Rio Tinto ainsi que de contribuer à la reprise en main de nos ressources dans l'intérêt de la collectivité.
L'exploitation de notre eau par Rio Tinto, Quel avenir pour le Québec ? Jacques Dubuc et Myriam Potvin, maison d'édition Somme Toute. Version PDF disponible à 16,99$ à https://www.leslibraires.ca/livres/l-exploitation-de-notre-eau-par-jacques-dubuc-9782897945541.html
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Attac Québec dévoile la puissante machine de lobbyisme de Glencore, qui reçoit son Prix du lobby de l’année 2025

Montréal, le 12 juin 2025 — Connue pour son implication controversée à la Fonderie Horne à Rouyn-Noranda et visée par une action collective toujours devant les tribunaux, la compagnie Glencore se distingue dans de nombreux dossiers pour ses pratiques soutenues d'influence politique. C'est pourquoi Attac Québec, l'Action citoyenne pour la justice fiscale, sociale et écologique, lui décerne son tout nouveau Prix du lobby de l'année 2025.
L'association altermondialiste a choisi d'accorder cette récompense satirique à une firme dont l'influence est excessive et dont la recherche de profit passe avant les intérêts d'une grande partie de la population. Son objectif est aussi de montrer, par l'exemple d'un cas particulier, comment s'exerce le lobbyisme des grandes entreprises au Québec.
« En ce sens, Glencore est tout à fait méritoire, affirme Claude Vaillancourt, président d'Attac Québec. Que ce soit à Limoilou, en Abitibi avec la Fonderie Horne, à Montréal-Est ou à Salaberry-de-Valleyfield avec CEZinc, la firme (ou ses filiales), par son action et son influence auprès des éluEs, porte atteinte aux droits à la santé et à un environnement sain des populations. »
Un lobbyisme tentaculaire
Derrière ses activités industrielles, Glencore déploie une stratégie de lobbying tentaculaire. Selon Attac Québec, l'entreprise exerce une pression soutenue sur les gouvernements du Canada et du Québec, ou des municipalités, en plus de chercher activement à façonner l'opinion publique à son avantage.
Attac Québec a constaté l'ampleur du réseau d'influence de Glencore. Parmi les lobbyistes recensés, on retrouve d'anciens élus, des chefs de cabinet, des journalistes reconvertis, ainsi qu'une centaine d'intervenants actifs représentant les intérêts de la firme. S'ajoutent à cela des organismes industriels financés par Glencore, qui agissent comme relais de ses revendications auprès des décideurs et décideuses politiques.
Au Québec, 17 lobbyistes enregistrés et cinq cabinets de conseil sont à son service. À Ottawa, elle emploie 1 employé et 19 cabinets-conseils. L'influence de la firme s'exerce aussi par les réseaux industriels telles les associations minières et les chambres de commerce. À elle seule, l'Association minière du Canada a tenu 1049 rencontres avec des responsables politiques ou des fonctionnaires fédéraux, allant du cabinet du premier ministre jusqu'à l'ambassadeur représentant le Canada auprès de l'ONU.
Glencore bénéficie, de plus, d'un soutien financier considérable de la part des gouvernements. Attac Québec attire l'attention sur plusieurs des formes d'appui public dont la firme bénéficie, incluant des subventions directes, des investissements via des fonds publics, ainsi que des avantages réglementaires.
Un cas d'exemple : CEZinc à Salaberry-de-Valleyfield
Grâce à des demandes d'accès à l'information, Attac Québec a pris connaissance d'un cas préoccupant à Salaberry-de-Valleyfield, où la Ville et le ministère de l'Environnement ont laissé passer un projet d'agrandissement d'un site d'enfouissement de déchets de zinc exploité par CEZinc, une filiale de Glencore. Le projet a été approuvé malgré ses impacts environnementaux sur les milieux humides, reconnus pour leur biodiversité et leur rôle écologique essentiel.
« J'ai été élue municipale pendant plus d'une décennie. Cette municipalité avait la possibilité — et la responsabilité — tout comme le ministère de l'environnement, d'imposer des limites à ce projet, mais visiblement elle ne l'a pas fait », déclare Sophie Thiébaut, coordonnatrice d'Attac Québec.
Un prix annuel
Le prix de cette année a été accordé à la suite d'une recherche rigoureuse résumée dans un document de vulgarisation de quatre pages disponible sur le site de l'association. Attac remercie de leur collaboration les groupes suivants, qui surveillent l'activité de Glencore depuis des années : Comité ARET, Regroupement vigilance mine Abitibi-Témiscamingue, Mining Watch Canada, RevolvAir, Mères au front.
Glencore se mérite ce prix après qu'Attac Québec se soit penchée sur d'autres compagnies qui ont des pratiques de lobbyisme intensives, telles Amazon, McKinsey, Devimco, Google et Pfizer. Notre Prix du lobby de l'année sera remis annuellement tant que l'influence des lobbys sera aussi démesurée. En parallèle, l'association élabore des recommandations afin que les lois québécoises encadrent mieux les lobbyistes des grandes entreprises.
Le prix à Glencore sera remis lors d'un Grand Gala du lobby de l'année, animé par l'humoriste Christian Vanasse, aura lieu le 19 juin au 3720, avenue du Parc.
Les détails de l'événement se trouvent ici : https://www.eventbrite.ca/e/gala-de-remise-du-prix-du-lobby-de-lannee-2025-tickets-1400217069949?aff=ebdssbdestsearch
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Pour un transport (vraiment) en commun

Cette année ne fera pas exception, les titres du transport en commun augmenteront à partir du 1er juillet. L'ARTM manque d'argent certes, mais ce n'est pas dans les poches des usagers qu'il faut aller le chercher. Tout comme Mme Plante, mairesse de Montréal, nous croyons fermement que le transport en commun DOIT être considéré comme un service public essentiel, au même titre que la santé et l'éducation.
Par :
TROVEP de Montréal
ACEF du Nord de Montréal
Centre communautaire Radisson
Ex Aequo
RUTA Montréal
Welfare Rights Committee
Les tarifs de transport en commun sont les mêmes pour tout le monde.
Qu'on gagne 150 000$ ou 15 000 $, une passe mensuelle coûtera désormais 104 $. Le Grand Montréal abrite la majorité (60%) des Québécois en situation de pauvreté. Est-ce qu'une personne à faible revenu a moins besoin de se déplacer, de faire son épicerie, d'aller chez le médecin, d'avoir accès au travail, de s'impliquer socialement, d'avoir des liens sociaux qu'une personne avec des revenus décents ? Bien sûr que non ! Alors pourquoi, encore aujourd'hui, des personnes doivent se priver ou limiter leur déplacement par manque d'argent ? Ce n'est pas normal, acceptable, viable dans une société comme la nôtre.
Pouvoir se déplacer est un droit et ne doit pas dépendre de la grosseur de son portefeuille !
Il est où le tarif social, il est où ?
Depuis 2013, on nous promet une tarification sociale basée sur le revenu (moins on gagne, moins on paie) qui pourrait coûter autour de 30M$. Valérie Plante et Denis Coderre s'étaient engagés à la mettre en place en 2017. Douze ans plus
tard, toujours pas de tarif social pour le transport en commun. Ultimement, c'est de gratuité dont on aurait besoin, principe avec lequel Mme Plante s'est dite en accord lors d'une audience d'un conseil de ville en février dernier.
Le coût de la vie étant tellement élevé, plusieurs personnes doivent couper dans des dépenses essentielles pour arriver à équilibrer leur budget. Le transport est souvent le poste budgétaire sacrifié, ce qui a plusieurs impacts négatifs dans la
vie des gens : isolement social, risque de maladies accru, cercle vicieux de la pauvreté.
La Ville a des moyens à sa disposition pour augmenter le financement du transport en commun. Prenons l'exemple du stationnement sur rue. Dans le livre blanc d'Alliance transit, on calcule qu'une case de stationnement sur rue coûte
1275 $ à la ville par année. Avec les 450 000 cases de stationnement qui sont actuellement gratuites, la ville pourrait aller chercher 500M$ par an.
Chacun doit faire sa part pour que le transport en commun puisse répondre adéquatement aux besoins de la population. La ville a des pouvoirs dont elle doit se saisir. On a besoin d'entendre et de voir des engagements clairs et concrets
du municipal.
Le gros joueur : le gouvernement provincial
L'État demeure bien évidemment le joueur clé dans l'équation. D'une part, il a le devoir de s'assurer que toute sa population puisse se déplacer. D'autre part, il a les moyens financiers et réglementaires nécessaires pour le faire.
Ce n'est pourtant pas la direction que l'État prend en se désengageant du financement du transport en commun et en mettant tous ses œufs dans le même… parc automobile. Qu'une auto soit électrique ou non, on fonce tout droit dans le fossé si on ne redonne pas sa juste place au transport en commun qui, soit dit en passant, est le meilleur moyen pour réduire les gaz à effet de serre (GES).
Des solutions pour trouver de l'argent, il y en a. On ne le répètera jamais assez, tout n'est qu'une question de choix ! Par exemple, l'IRIS calcule qu'en taxant le patrimoine des 10% des ménages québécois les plus fortunés, l'État pourrait
aller chercher 6 milliards de dollars en recette fiscale. Des solutions comme celle-là, il y en a des dizaines. Elles ne font peut-être pas le bonheur de certains, mais elles sont porteuses d'une vision qui englobe le bien-être commun et non
celui de quelques-uns.
Le gouvernement doit investir dans le transport en commun et donner les moyens aux villes de fournir ce service essentiel.
L'heure du rassemblement a sonné
Devant l'inaction de nos dirigeants, il est temps de se rassembler et de dire : “Non à la hausse des tarifs !”
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
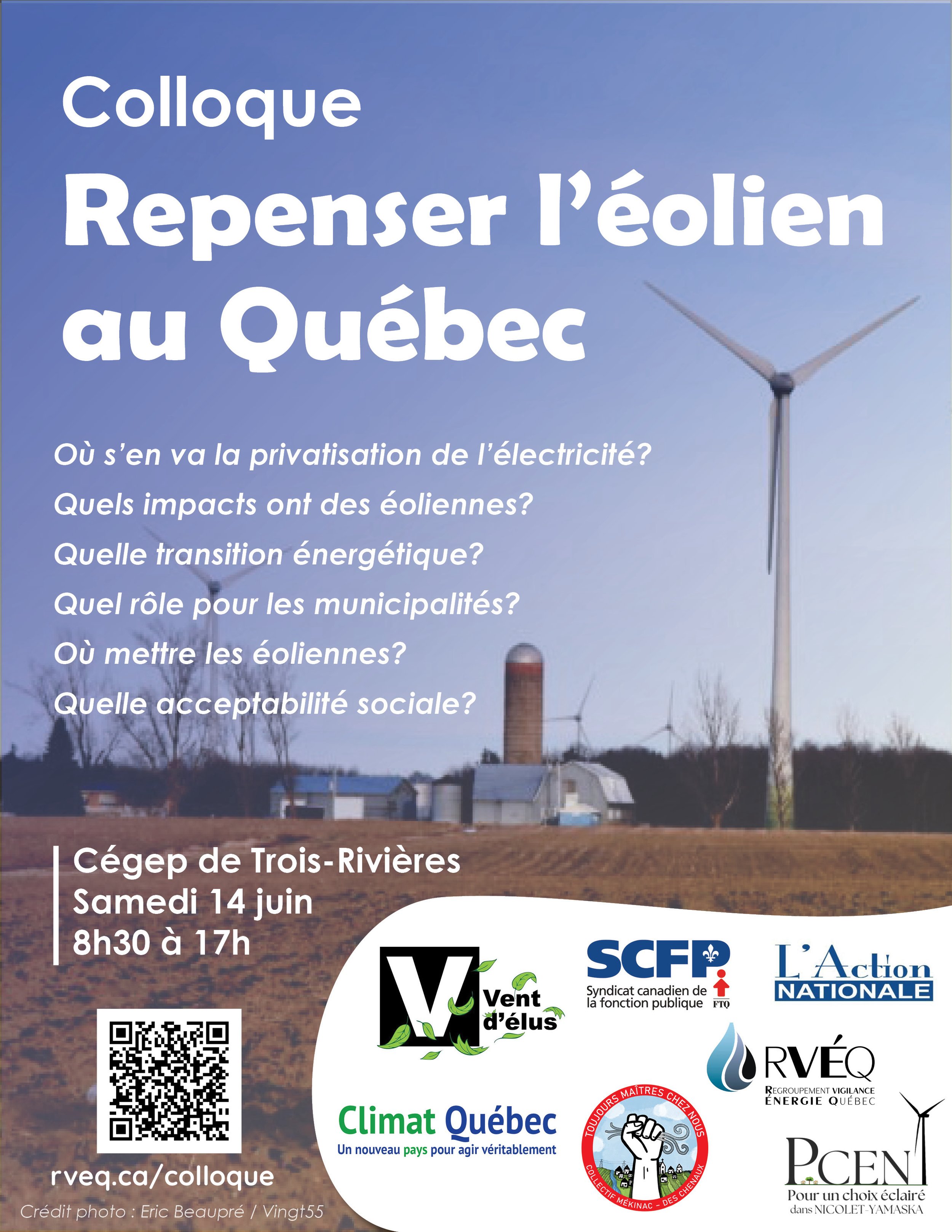
Un colloque révisant la stratégie éolienne du Québec
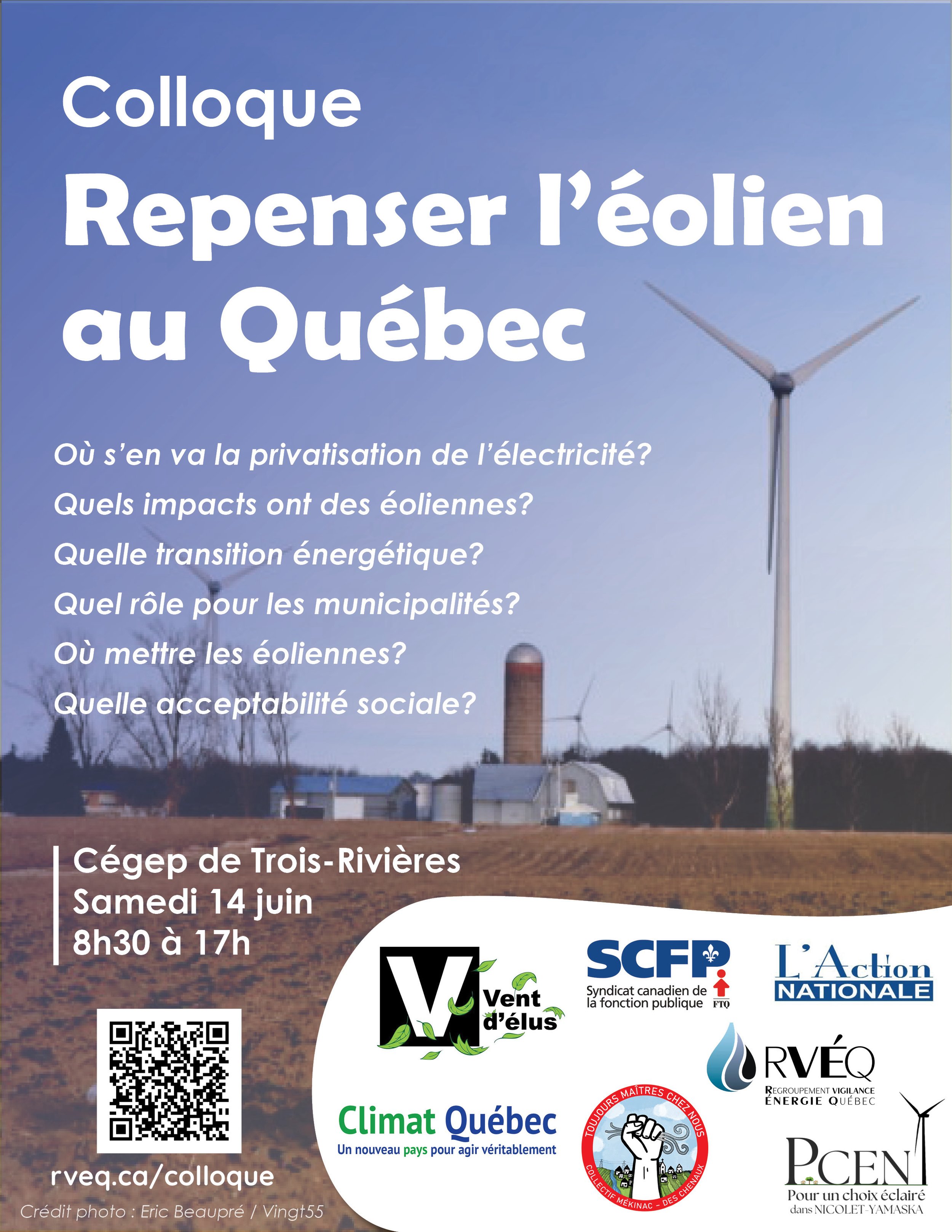
Trois-Rivières, mercredi le 11 juin juin 2025 – Alors que la pénurie d'électricité annoncée par Hydro-Québec s'effrite à vue d'œil, en grande partie à cause de l'abandon de projets industriels énormément énergivores, la direction d'Hydro-Québec s'obstine à foncer tête baissée dans la construction de parcs éoliens démesurés.
Des experts et citoyens réclament un développement démocratique et transparent
Rappelons que ces nouvelles éoliennes prévues en Mauricie comme dans plusieurs autres régions du Québec mesureront plus de 200 m de haut, soit deux fois la hauteur du pont Laviolette à Trois-Rivières, et pourraient atteindre jusqu'à 40 unités dans un seul village.
Un colloque d'envergure intitulé « Repenser l'éolien au Québec », réunira experts, élus et citoyens le 14 juin prochain au cégep de Trois-Rivières, visera justement à remettre en question la gouvernance énergétique actuelle et à proposer une vision lucide, ancrée dans l'intérêt public.
Les 10 000 MW prévus, soit environ 1 500 mégaéoliennes imposées aux communautés, n'ont plus aucune justification. La stratégie précipitée du gouvernement Legault et de Michael Sabia, fondée sur une pénurie désormais remise en question, est mise à nu. Puisque tout le développement éolien repose sur cette fausse prémisse, il est urgent d'instaurer un moratoire tant que la lumière n'aura pas été faite sur les besoins réels du Québec.
Ce moratoire, c'est ce que demandait déjà en conférence de presse, le 29 janvier 2025, une large coalition citoyenne : 25 comités citoyens éoliens, dans presque autant de MRC, en plus de groupes syndicaux, de chercheurs, et de deux partis politiques. Cette pause servirait à instaurer une démarche cohérente profitant au bien commun et non à des intérêts particuliers. Aux termes d'un débat public et d'un BAPE générique sur l'éolien, il serait alors possible d'orienter ce développement en fonction des recommandations d'experts, des populations visées et de différents groupes de la société civile, et non pas seulement pour servir un programme politique affairiste.
Il est urgent de rectifier le tir alors que l'approche actuelle laisse fuir des milliards de profits vers le secteur privé et les paradis fiscaux, qui va se traduire immanquablement en une augmentation importante du coût de l'électricité pour les consommateurs et les PME.
« Ce qu'on veut pour le Québec, c'est un développement éolien justifié, cohérent, démocratique, public, transparent et respectueux du territoire et de ses habitants », déclare Janie Vachon-Robillard, porte-parole du collectif Pour un choix éclairé dans Nicolet-Yamaska et co-organisatrice de l'événement.
« Nous assistons à l'accélération de la privatisation de l'énergie éolienne. Les citoyens ruraux subissent les impacts tandis que de précieuses forêts et terres agricoles sont sacrifiées. Les profits enrichissent seulement quelques actionnaires au lieu de bénéficier à toute la société québécoise à travers Hydro-Québec », souligne Louise Morand, coordonnatrice au Regroupement vigilance énergie Québec (RVEQ).
Trois tables rondes d'experts
L'événement réunira 12 panélistes répartis en trois tables rondes thématiques animées par des spécialistes reconnus :
Choix énergétiques – Justice et durabilité
Municipalités – Démocratie – Acceptabilité sociale
Agriculture – Forêt – Santé
Le colloque sera également marqué par le lancement d'un numéro spécial sur l'éolien de la prestigieuse revue L'Action Nationale.
« Les questions sont nombreuses et légitimes : combien d'hectares de terres agricoles seront sacrifiés ? Quels sont les impacts sur la santé animale et humaine ? Quelles sont les alternatives aux projets en cours ? », énumère Rachel Fahlman, conseillère municipale à Saint-Zéphirin-de-Courval et présidente de Vent d'élus.
« L'absence de consultation publique mine la cohésion sociale. Les Québécois méritent d'être consultés sur des décisions qui transformeront leur territoire pour les décennies à venir », affirme Carole Neill, porte-parole du collectif Toujours Maître chez nous.
Détails pratiques
Quoi : Colloque « Repenser l'éolien au Québec »
Quand : 14 juin 2025, 9h à 17h
Où : Cégep de Trois-Rivières, Pavillon des Humanités, local HC-1000
Inscription :https://rveq.ca/colloque
Organisé par le Regroupement vigilance énergie Québec
En collaboration avec : Vent d'élus, Toujours Maître chez Nous, Pour un choix éclairé dans Nicolet-Yamaska, Climat Québec, L'action Nationale et le Syndicat canadien de la fonction publique Québec
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Gaza : quand les mots occultent la réalité

Dans le conflit israélo-palestinien, il est des habitus rhétoriques médiatiques et politiques à déconstruire. Les mots qui occultent la réalité, comme le silence, sont un choix – et une arme qui tue aussi sûrement que les bombes.
Tiré du blogue de l'autrice.
Quand les mots occultent la réalité
Dans le conflit israélo-palestinien, il est des habitus rhétoriques médiatiques et politiques à déconstruire. Au-delà des sempiternels « Israéliens sauvagement assassinés par des terroristes » et des « Palestiniens morts dans des heurts avec l'armée », où la déshumanisation est flagrante, il y a une inversion lexicale tenace qui mérite d'être examinée.
En effet, à force de convoquer des termes aussi lourds de sens que « extermination », « combat existentiel », « isolement », ou encore « non-reconnaissance » au sujet d'Israël, il devient impératif de confronter ces mots à la réalité, non pas celle projetée dans les discours officiels ou les intentions supposées, mais celle qui s'impose dans les faits chaque jour sur le terrain, dans les chiffres, dans les corps.
L'extermination : du fantasme idéologique au fait concret
L'invocation d'une volonté d'extermination du peuple israélien, notamment attribuée au Hamas, appelle une mise au point. Le Hamas est une organisation autoritaire, radicale et classée terroriste par l'Union européenne, les États-Unis, le Canada et d'autres. L'attaque du 7 octobre 2023 en constitue une illustration tragique.
Il est nécessaire de rappeler que ces attaques ne ciblaient pas des Juifs parce que Juifs, mais des Israéliens à proximité de l'enclave sous blocus depuis 17 ans parce qu'Israéliens et donc considérés comme appartenant à la puissance occupante. D'ailleurs des victimes non juives ont été recensées. Il n'en reste pas moins que ces attaques relèvent d'un mode opératoire terroriste et qu'à ce titre elles doivent être condamnées. Pourtant, en dépit de sa violence, ce mouvement ne possède ni la puissance militaire, ni les capacités logistiques pour anéantir un État souverain doté de l'un des arsenaux les plus sophistiqués au monde.
À l'inverse, sous nos yeux, c'est bien le peuple palestinien qui subit aujourd'hui une dynamique d'effacement méthodique : physique, démographique, territorial. Selon les Nations Unies, plus de 52 000 Palestiniens ont été tués à Gaza depuis octobre 2023. The Lancet, publication scientifique de référence, dont la méthodologie et la rigueur sont internationalement reconnues, estime que ce chiffre est sous-évalué de 40%.
À l'échelle d'un territoire aussi exigu que la bande de Gaza, ce bilan constitue un fait historique d'une gravité exceptionnelle. S'y ajoutent des dizaines de milliers de blessés et une multitude de morts indirectes, causées par l'absence de soins, de médicaments, de nourriture ou d'eau potable. Le PAM, l'UNICEF et l'OCHA alertent sur une famine généralisée et une malnutrition aiguë frappant massivement les enfants. Cette hécatombe n'est pas un dommage collatéral.
Elle résulte d'une stratégie militaire ciblant délibérément les infrastructures civiles, les hôpitaux, les écoles, les camps de réfugiés. Le Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme parle ouvertement d'une punition collective, en violation flagrante des Conventions de Genève.
En Cisjordanie, les colons armés par des membres du gouvernement israélien et soutenus par l'armée israélienne sur le terrain orchestrent des expulsions violentes de camps et de villages. Ces forces d'occupation perpétuent une colonisation agressive, un harcèlement administratif, judiciaire et militaire incessant, au mépris du droit international et dans une impunité totale. Le quotidien des Palestiniens y devient invivable.
La bataille existentielle : qui disparaît vraiment ?
L'expression « combat existentiel » revient régulièrement dans les discours israéliens, mais à la lumière des faits, on peut se demander qui mène réellement une lutte pour sa survie ? Israël est une puissance régionale majeure, alliée stratégique des États-Unis, dotée de l'arme nucléaire et d'une armée des plus performantes au monde. Aucun acteur régional ne dispose aujourd'hui des moyens de remettre en cause son existence, pas même l'Iran dont les missiles balistiques n'ont causé aucun dommage en Israël.
À l'inverse, les Palestiniens, eux, sont littéralement menacés de disparition. Le peuple se disloque, le territoire est morcelé, l'économie est asphyxiée et l'avenir politique confisqué. À Gaza comme en Cisjordanie, c'est l'existence biologique collective des Palestiniens qui est en péril, et ce n'est pas une menace symbolique ni fantasmée.
L'isolement : un renversement trompeur
L'idée selon laquelle Israël serait isolé sur la scène internationale relève d'une inversion discursive majeure. En réalité, Israël bénéficie d'un appui stratégique, diplomatique et financier sans équivalent. Le pays reçoit chaque année plusieurs milliards de dollars d'aide militaire américaine, entretient des relations commerciales solides avec l'Union européenne, première zone économique mondiale, et multiplie les partenariats sécuritaires et énergétiques avec des puissances émergentes. Plusieurs Etats arabes se sont même déjà engagés dans une normalisation diplomatique.
Israël n'a d'ennemis que ses voisins menacés par ses velléités expansionnistes, pas ceux dont il ne menace pas l'intégrité territoriale. À l'inverse les Palestiniens vivent dans un isolement presqu'absolu : Gaza subit un blocus total depuis plus de dix-sept ans, sans accès libre à la mer, à l'espace aérien, à l'importation d'équipements essentiels.
La Cisjordanie est morcelée par le Mur, militairement occupée et économiquement dépendante. Dans les territoires palestiniens, l'Autorité palestinienne ne contrôle ni les frontières, ni l'état civil, ni la monnaie. La voix politique palestinienne, marginalisée, ne trouve d'écho que dans des rapports d'ONG ou les couloirs de l'ONU.
La reconnaissance d'Israël : une formule creuse
L'injonction à reconnaître Israël est devenue une formule politique sans substance, voire une arme rhétorique. L'existence d'un pays qui dispose d'un siège aux Nations Unies est-elle réellement questionnable ? Aucun pays d'envergure ne nie l'existence d'Israël. L'Initiative de paix arabe de 2002 proposait une reconnaissance diplomatique pleine et entière (donc de nouer des relations diplomatiques) en échange d'un retrait israélien dans les frontières de 1967, conformément aux résolutions de l'ONU.
Or Israël entretient sciemment un flou autour de ses frontières : Jérusalem-Est, la Cisjordanie, le Golan restent annexés ou colonisés, sans cadre légal reconnu. Dès lors, parler de « non-reconnaissance » est une diversion rhétorique masquant le refus israélien de se soumettre au droit international.
À l'inverse, l'OLP a reconnu Israël dès 1988 puis avec les Accords d'Oslo en 1993. Mais Israël n'a jamais reconnu d'Etat palestinien, tout en rendant sa viabilité impossible par la colonisation continue et le morcellement de son territoire. Conditionner aujourd'hui, comme le fait le Président français, la reconnaissance de l'Etat palestinien à des exigences irréalistes revient à ajouter à la punition collective militaire, une punition collective politique qui fait porter à la population palestinienne la responsabilité de se débarrasser d'une faction armée minoritaire qu'est le Hamas et conforte le gouvernement israélien extrémiste dans son objectif d'assimiler tous les Palestiniens à des terroristes pour ne jamais avoir à reconnaître la Palestine.
Terrorisme et extrémisme : un miroir déformant
Le Hamas est un mouvement dont l'idéologie islamiste radicale est avérée. Il est né en 1987 dans la bande de Gaza, en opposition au Fatah de Yasser Arafat, et avec le soutien d'Israël1 soucieux de diviser l'OLP puis d'affaiblir l'Autorité palestinienne. Ce parti a pris le pouvoir à Gaza en 2007 au lendemain des élections législatives de 2006, mais sa gestion brutale et sa corruption ouverte l'a rendu impopulaire et largement contesté (par ex. la Marche du retour en 2018-2019 et encore des manifestations jusqu'à très récemment).
Aucune élection n'a eu lieu dans les territoires palestiniens de Gaza ou de Cisjordanie depuis 2006 donc la majorité de la population n'a jamais voté (en 2006, 60% de la population de Gaza avait moins de 18 ans ; en 2023, plus de 50% des 2,1 millions de Gazaouis avaient moins de 20 ans) et le Hamas n'a jamais dirigé la Cisjordanie où vivent plus de 3 millions de Palestiniens. Ce mouvement est donc minoritaire dans l'architecture institutionnelle palestinienne. La dénonciation du Hamas et de ses actes terroristes est fondée en droit, d'ailleurs, il figure toujours sur les listes noires.
À l'inverse, en Israël, l'extrémisme n'est pas un danger marginal, il est institutionnalisé. Les extrémistes ne sont pas dans l'opposition, ils sont au pouvoir. Les figures messianiques, xénophobes, homophobes, suprémacistes, issues de la mouvance kahaniste – autrefois interdite en Israël –, comme Itamar Ben Gvir ou Bezalel Smotrich, siègent aujourd'hui au gouvernement et dirigent des ministères clés.
Ils ont été élus démocratiquement. Et ce vote populaire est assumé puisqu'encore 82% de la population juive israélienne soutient la politique suprémaciste et le projet de nettoyage ethnique des territoires palestiniens2. Ces ministres extrémistes israéliens sont reçus à Bruxelles, à Washington, à Londres, à Paris. Ils signent des accords, posent pour des photos officielles. Ils sont armés, financés par les plus grandes puissances du monde et bénéficient de l'impunité diplomatique que confère la puissance.
Dès lors, une question fondamentale se pose : lequel des deux régimes exprime le mieux l'état réel de son opinion publique ? Un mouvement extrémiste palestinien qui a confisqué le pouvoir par les armes depuis 2006, ou un gouvernement israélien qui incarne fidèlement le choix de la majorité des électeurs ?
Et que signifie ce basculement de la majorité israélienne vers des partis prônant ouvertement l'annexion, le transfert de population, et la supériorité ethnico-religieuse ? Cette radicalisation démocratiquement validée, mériterait une attention au moins équivalente à celle accordée au Hamas. A défaut, le double standard constitue une faute politique, mais aussi une compromission morale historique.
Sortir de la fiction symétrique
Il ne s'agit pas ici de relativiser les crimes de l'un par ceux de l'autre. Il s'agit de voir que l'asymétrie est totale : militaire, diplomatique, narrative, humaine. Ceux qui meurent ne sont pas ceux que l'on dit. Ceux qui disparaissent ne sont pas ceux que l'on craint. Ceux qui résistent sont criminalisés. Ceux qui dominent sont légitimés.
Cette inversion du réel devient ici l'arme la plus efficace de l'impunité. Elle anesthésie les consciences et dévoie les mots. Pourtant la responsabilité intellectuelle demeure : regarder en face, c'est déjà refuser la complicité. L'Histoire jugera. Mais en attendant, les mots qui occultent la réalité, comme le silence, sont un choix – et une arme qui tue aussi sûrement que les bombes.
Notes
1- Tal Schneider, “For years Netanyahu propped up Hamas…”, Times of Israel, 08.10.2023 ; Nitzan Horowitz, “Netanyahou a explicitement
renforcé le Hamas”, Le Grand Continent, 11.10.2023.
2 Shay Hazkani, Tamir Sorek, “Yes to Transfer : 82% of Jewish Israelis Back Expelling Gazans”, Haaretz, 28.05.2025.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Hydro-Québec attaqué !

La CAQ sombre de plus en plus dans une forme de duplessisme. Elle s'acoquine avec les classes dirigeantes économiques actuelles, nous tient des propos populistes et ce, au détriment
de la collectivité.
Chers citoyen(ne)s et représentant(e)s de notre belle démocratie.
Je vous interpelle du fond du cœur, face au récent bâillon du gouvernement, concernant Hydro-Québec et leur transition énergétique (PL69). Le geste posé est une attaque frontale à nos droits sociaux ; tant au niveau démocratique, économique, qu'écologique. À la suite du bâillon, j'ai ressenti une véritable claque identitaire et une désappropriation de notre joyau national qu'est Hydro-Québec. La CAQ sombre de plus en plus dans une forme de duplessisme. Elle s'acoquine avec les classes dirigeantes économiques actuelles, nous tient des propos populistes et ce, au détriment
de la collectivité. Je ne m'attends pas à des excuses de ce gouvernement, pas plus qu'il ne recule en fin de mandat… Mais *ce bâillon peut et doit être contesté considérant son **atteinte à la démocratie, à **l'absence de
justification et au risque de manipulation*.
Le « nationalisme économique » prôné par l'actuel gouvernement est plutôt une vieille recette régressive de capitalisme sauvage guidée par l'État. Je viens de Shawinigan et dans notre région, un énorme chantier d'éolienne privée est en cours. Je ne suis pas contre les éoliennes et je ne suis pas la famille Chrétien, l'obscure et puissante firme étatsunienne Halliburton et les stratégies d'insertion sociale, m'inquiètent au plus haut point. Le mégaprojet de TES Canada, au-delà des nombreux impacts socioécologiques, détourne notre attention sur les avantages de ces empires de devenir
d'importants distributeurs d'électricité privée. Avec ce projet de loi, ils ont le vent dans les voiles pour enfoncer le clou de la privatisation et contribuer au démantèlement de notre force collective qu'est Hydro-Québec.
La CAQ mène une attaque en règle contre le bien commun et nous musèle. J'ai le devoir de me battre avec amour et colère contre l'usurpation de Nos droits, le vol de nos ressources et la destruction de notre habitat. Je refuse d'être colonisé davantage. Je vous invite à joindre votre voix et vos actions pour faire reculer ce gouvernement. J'implore la majorité des acteurs de la société civile et les élu(e)s qui ne sont pas sous la domination caquiste ou impérialiste, à se défendre et à contester le bâillon.
*Sébastien Bois,*
*Citoyen de Shawinigan*
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Environnement : Les défis de la conscientisation

Notre principal espoir de changer la donne en matière d'environnement, chez nous et ailleurs dans le monde, passe par la conscientisation des populations. Et cette conscientisation passe à son tour par une presse libre, entièrement affranchie des intérêts privés, comme je l'ai déjà souligné, pour redonner aux questions environnementales et aux défis que posent les changements climatiques la priorité absolue dans le traitement et l'analyse de l'information.
(Ce texte a d'abord été publié dans l'édition de juin du journal Ski-se-Dit.)
Plusieurs intellectuels et militants relèvent ces temps-ci l'intérêt que l'on porte dans les médias à une foule de sujets secondaires au détriment du génocide en cours à Gaza. C'est bien sûr tout à fait déplorable ! Et il en est de même depuis des décennies pour ce qui est du réchauffement de la planète et de l'environnement en général auquel on accorde, somme toute, très peu de place dans les médias. Comme le soulignent pourtant depuis plus de vingt ans les plus éminents climatologues et scientifiques, « l'avenir de l'humanité est en jeu ».
Le principal obstacle
Nous vivons dans des sociétés où la presse écrite et électronique et les médias sociaux sont dominés par le monde des affaires et de vastes conglomérats qui en sont bien souvent d'ailleurs les propriétaires. Quand ces moyens de communication ne sont pas directement la propriété des forces de l'argent, ce qui n'est manifestement pas souvent le cas, ils sont alors soumis indirectement aux contraintes imposées par la publicité, les grands annonceurs ne permettant pas que l'on fasse la promotion de valeurs et de mesures qui puissent nuire au développement de leurs produits et services.
On peut bien sûr aborder les questions d'environnement et les questions sociales dans nos médias, mais alors de façon secondaire, dans les marges en quelque sorte, comme une quelconque soupape de sécurité, perdues dans le fouillis des communications de toutes sortes, à travers des petits et grands scandales, des questions d'argent, des accidents de la route, des faits divers, des potins et des sports. Quant aux médias sociaux, ils sont entre les mains d'intérêts financiers et de propriétaires très à droite sur le plan politique et ont en grande partie sombré dans le mensonge et la désinformation.
Nous avons évité le pire, lors des dernières élections fédérales, en ne portant pas au pouvoir le Parti conservateur du Canada, parti qui s'était engagé à démanteler progressivement notre diffuseur public Radio-Canada/CBC. Il n'est pas difficile de mesurer l'ampleur de ce qu'aurait été cette perte en matière d'indépendance journalistique et de qualité des informations et des analyses. Parce qu'il est essentiel que notre réseau public d'information radio et télévision qu'est Radio Canada/CBC continue d'exister et, plus encore, qu'il devienne véritablement – en changeant de cap – un réseau d'information totalement indépendant des intérêts privés et financiers.
Comme je l'ai mentionné dans ma précédente chronique sur l'environnement, nous devrons lui fournir ces moyens d'action en lui assurant un financement adéquat qui lui permette d'assurer cette pleine indépendance et donc, tant sur le plan journalistique que culturel, en interdisant toute forme de publicité privée et même partiellement privée sur son réseau de stations de radio et de télévision. Une information de grande qualité et indépendante des contraintes imposées par le secteur privé est fondamentale pour redonner aux questions sociales et environnementales l'importance qu'elles méritent. Nous pouvons le faire ! D'autres pays le font aussi !
Seule une presse indépendante devrait d'ailleurs pouvoir profiter directement et indirectement de l'aide gouvernementale si nous voulons bâtir une presse écrite et électronique libre et en mesure d'accorder aux questions environnementales et sociales la place primordiale qui leur revient. Je songe ici aux journaux communautaires et à tous les journaux d'idée sans buts lucratifs qui ne bénéficient pas du soutien financier - même sporadique - d'entreprises ou de mécénats. L'argent est disponible. Il suffirait entre autres, dans un premier temps, de taxer les géants du Web et de les bien réglementer. De faire de même, dans un deuxième temps, avec les grandes institutions financières et grandes entreprises qui engrangent chaque année d'indécents profits. Et dans le même ordre d'idée, de permettre et de soutenir la mise en place de médias sociaux entièrement publics, peut-être comme composante de Radio-Canada/CBC, réseaux qui appartiendraient à l'ensemble de la population, plutôt qu'à de riches entreprises américaines qui nous manipulent et nous désinforment plus qu'autre chose avec leurs détestables algorithmes.
Le politique suivra
« C'est énoncer une vérité désormais banale que de dire que ce sont les idées qui mènent le monde » écrivait Ernest Renan dans « L'avenir de la science » en 1848. Si banale qu'elle soit, cette vérité est cependant trop oubliée de nos jours, avec la mainmise graduelle des entreprises privées et conglomérats sur le monde des médias et de la culture au cours du dernier siècle. Parce que le capitalisme, appelons-le par son nom, ne détruit pas seulement notre environnement, la vie de foules et de foules d'individus sur terre, d'animaux et de plantes ; il pervertit et détruit aussi le monde des idées, des communications, des médias, qui nous permettraient de mener le monde… vers la justice sociale, l'égalité et un environnement sain pour l'avenir de l'humanité, et de la faune et de la flore.
Parce que ce dont tous les médias devraient parler, en priorité, à la une, en début de bulletins de nouvelles, quotidiennement, régulièrement, de façon encourageante dans la mesure du possible, c'est d'environnement, de décroissance, de justice sociale, d'égalités réelles. Le politique, dans une société représentative comme la nôtre et même dans d'autres formes d'organisation finirait par suivre la poussée populaire en faveur de réels changements.
L'information essentielle, celle qui porte sur la protection de notre environnement, la nécessaire décroissance, la justice sociale et l'égalité entre les êtres doit commencer à occuper toute la place, sinon presque toute la place, dans nos nouvelles, nos analyses et même nos loisirs et nos activités culturelles.
En matière de défense et de protection de l'environnement en particulier, il n'y a pas de demi-mesures. Un changement de cap s'impose ! Nous ne pouvons continuer à tergiverser avec des engagements de réduction des gaz à effet de serre jamais tenus de la part d'oligarchies uniquement soucieuses de la croissance sans fin du capital. Ni de mesures de substitutions, toujours ancrées dans un monde en perpétuelle croissance, elles aussi, comme le passage de formes d'énergie plus polluantes à des formes d'énergies moins polluantes ou supposées telles.
Pour finir
J'aimerais terminer cette chronique d'abord en soulignant l'importance de la présence de journaux communautaires ou indépendants comme le journal Ski-se-Dit pour contribuer à de tels changements, journaux dont la survie financière n'est jamais assurée, qui survivent contre vents et marées, en nous assurant chaque mois une présence médiatique proche de nos réalités quotidiennes. Je suis d'ailleurs très reconnaissant à la direction de ce journal de me permettre de m'y exprimer avec cette liberté de parole qui n'est pas toujours admise, quoi qu'on en pense, sans jamais tenter, à aucun moment, d'en réduire la portée.
J'aimerais aussi profiter de cette précieuse tribune pour vous suggérer quelques ouvrages sur l'environnement et des sujets qui y sont liés de près dans notre lutte pour un monde meilleur :
(Je tiens à commencer par l'essai le plus connu de Serge Mongeau, le père de la simplicité volontaire, qui nous a quittés au cours du dernier mois.)
– La simplicité volontaire – Serge Mongeau – Écosociété.
– Aux origines de la décroissance – Cédric Biagini, David Murray, Pierre Thiesset et plusieurs autres – Écosociété.
– Le plastique est mort, vive le bioplastique ! – Paul Lavallée – Écosociété.
– L'Entraide, l'autre loi de la jungle – Pablo Servigne et Gauthier Chapelle – Éditions Les liens qui libèrent.
– Tenir tête aux géants du web – Alain Sauliner – Écosociété.
– Sens dessus dessous - Eduardo Galeano (traduit de l'espagnol) – Lux Éditeur
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Monde arabe. Quelle culture dans un espace politique contraint ?

Comment mener une réflexion sur la production culturelle dans le monde arabe tout en tenant compte du contexte politique ? Car la culture n'est pas seulement le miroir du réel : elle agit dessus, tout en étant elle-même impactée par ses bouleversements. Au cours de la dernière décennie, le durcissement de la vie politique et le rétrécissement continu de l'espace public observés dans plusieurs pays du Maghreb et du Proche-Orient ont eu une incidence directe et indirecte sur le secteur culturel : restrictions budgétaires, fermeture des lieux dédiés, censure ouverte ou déguisée, coupure progressive avec le public…
Tiré d'Orient XXI.
Entre mémoire, témoignage et résistance
Pour autant, la situation diffère selon les pays. Ainsi, en Jordanie, l'affaiblissement de la scène théâtrale s'explique autant par la marginalisation de la culture dans les politiques publiques que par la répression politique. En Tunisie, certaines formes d'expression tentent d'investir un espace alternatif à la suite de la fermeture des espaces officiels. Tandis qu'en Égypte, la répression institutionnelle qui s'abat sur la culture indépendante n'a pas réussi à empêcher l'émergence de la littérature carcérale comme acte de mémoire et de résistance individuelle. Pour survivre à la guerre et à l'effondrement de leur pays, les écrivains yéménites se réfugient pour leur part dans la littérature, alors qu'en Algérie la culture prospecte de nouveaux espaces – numériques, mais aussi physiques, comme les cafés littéraires – pour permettre la circulation des idées, loin de la censure. Au Liban, le centralisme culturel vole en éclats, grâce à des initiatives qui s'attachent – notamment depuis l'agression israélienne de 2024 – à élargir l'identité collective en restaurant le lien entre le fait culturel et l'appartenance locale.
Et comment ne pas s'arrêter sur le cas de la Palestine, où le génocide en cours à Gaza nous place devant une question fondamentale : quelle signification peut encore avoir l'acte d'écrire, de peindre ou d'exposer alors que des villes sont dévastées et des familles entières, anéanties ? Dans une telle situation, l'œuvre artistique constitue à la fois un témoignage et un acte salvateur : ainsi des installations présentées lors de la dernière biennale de Charjah, aux Émirats arabes unis, qui ont donné à voir des fragments de corps, des décombres et une mémoire disloquée. Le moment n'est pas seulement celui d'une production culturelle, mais aussi celui de l'interrogation sur l'utilité de l'art et sa capacité à exprimer une résistance face à l'anéantissement.
Dans ce nouveau dossier du Réseau des médias indépendants sur le monde arabe, nous verrons comment la culture s'adapte au rétrécissement du champ politique et à son verrouillage en ouvrant un espace alternatif. Mais aussi comment les restrictions laissent de profondes empreintes, et comment la fiction peut devenir un moyen d'appréhender l'impasse. Seront également posées des questions fondamentales : comment maintenir vivante la culture là où la vie publique est vidée de son sens ? L'écriture, la chanson ou la peinture sont-elles des expressions à même de restituer aux populations ce dont elles ont été dépouillées ?
Diversité des expériences
Nous constaterons dans ce dossier la diversité des expériences. Ainsi, en Tunisie, les stades de football apparaissent comme le dernier espace public où la contestation collective est tolérée. Selon le blog Nawaat, constitué de dissidents tunisiens proposant un espace de débat, les groupes d'ultras y sont une force politique et culturelle qui relaie la colère sociale et livre une bataille quotidienne contre la censure et la répression par le biais des chants, des slogans et des tifos. Depuis les gradins des stades jusque sur les murs des villes, l'art du tag a explosé dans la foulée de la révolution tunisienne en 2011, avant de reculer avec le retour de la répression policière et du contrôle de l'espace public. Cette forme de contestation perdurera-t-elle face aux menaces de bâillonnement ?
En Jordanie, la situation est différente : si le théâtre n'y est pas directement en butte à la répression, il se retrouve de fait exclu des politiques culturelles qui ne l'inscrivent pas parmi leurs priorités, déplore le webmédia indépendant jordanien 7iber. On assiste ainsi à l'érosion continue d'un secteur qui perd à la fois ses subventions et son public, tandis que des grand-messes officielles viennent cacher la misère culturelle. Ici, la parole n'est pas étouffée, on la laisse simplement s'éteindre en silence.
Au Liban, Mashallah News nous emmène dans une Tripoli longtemps négligée, où le centre culturel Rumman tente de briser le centralisme beyrouthin. Ouvert dans la foulée du soulèvement d'octobre 2019, cet espace d'expression et de rassemblement a pris une nouvelle dimension après l'explosion du port de Beyrouth, le 4 août 2020. Durant l'agression israélienne contre Gaza et le Sud-Liban en 2024, le lieu a entrepris de faire le lien entre expression culturelle et colère politique. Rumman ne se présente plus uniquement comme une tribune artistique, mais comme un espace où est repensé le rapport de la culture à la société.
En Algérie, où sévit toujours une censure féroce, certains tentent d'instaurer des espaces indépendants de débat et de création. Le portail d'information algérien Maghreb émergent, ouvert en 2010, plusieurs fois censuré, nous explique comment le numérique permet de redéfinir la relation entre les artistes et le public et de promouvoir une culture critique libérée du discours officiel.
Malgré la répression institutionnelle qui frappe la culture égyptienne depuis 2013, l'écriture continue de sourdre des murs : littérature carcérale, tribunes numériques alternatives et projets cinématographiques, selon le média panarabe Assafir Al-Arabi, né en 2012 comme supplément au quotidien libanais de gauche As-Safir avant de continuer en version numérique à la disparition de celui-ci en 2016. Le site documente une réalité qui, à défaut d'être changée, sera du moins sauvée de l'oubli. De l'écriture comme acte de résistance à l'écriture comme tentative d'appréhender la perte : dans un Yémen ravagé par la guerre et son cortège de tragédies, les écrivains privilégient le roman à la poésie, comme si la fiction restait le seul langage possible, constate Orient XXI. En plein essor depuis quelques années, ce genre littéraire apparaît aujourd'hui comme un moyen de conjurer le chaos au sein d'une réalité devenue inintelligible.
Mais c'est en Palestine que la question se pose avec le plus d'acuité. Au moment où des villes sont rayées de la carte et des familles entières, massacrées, l'art se fait à la fois témoignage et cri de détresse, relève le site web d'information égyptien Mada Masr. À la biennale de Charjah, où les participants gazaouis exposent des œuvres porteuses de mémoire, d'affliction et de résistance, l'art se présente comme ultime acte de salut.
Depuis l'Italie, enfin, le site culturel Babelmed.net relaie la voix des artistes de hip-hop d'origine arabe, qui expriment leurs revendications identitaires à travers la musique. Refusant d'être réduits à un statut de migrants, c'est dans leur dialecte qu'ils chantent leurs épreuves afin de s'affirmer dans une société qui ne les reconnaît pas totalement. La culture est ici un instrument d'affirmation par-delà les frontières géographiques.
Ce dossier a été réalisé dans le cadre des activités du réseau Médias indépendants sur le monde arabe. Cette coopération régionale rassemble Assafir Al-Arabi, BabelMed, Mada Masr, Maghreb Émergent, Mashallah News, Nawaat, 7iber et Orient XXI.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
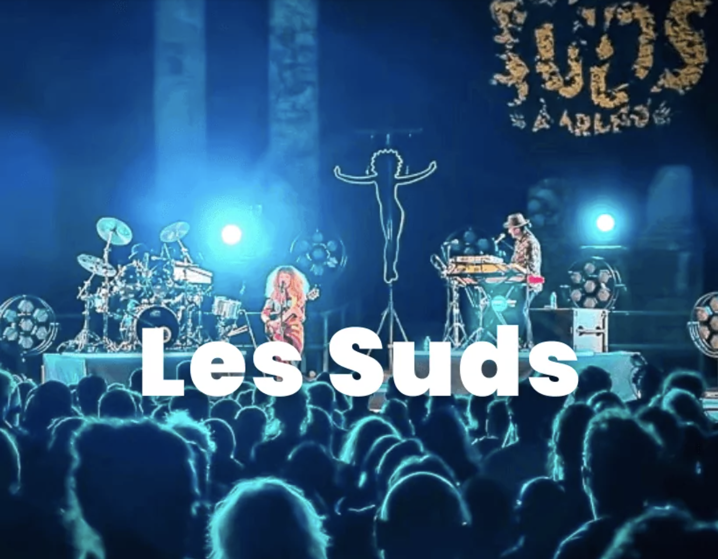
Résister par la musique : Les Suds à Arles célèbrent la culture palestinienne
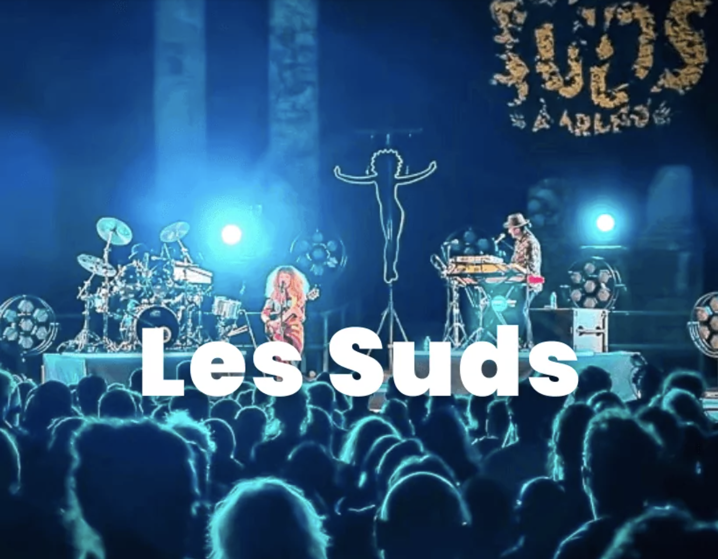
En 2025, alors que les images d'une Palestine meurtrie continuent de traverser les écrans du monde, le festival des Suds, à Arles fait le choix de célébrer, dans toute sa beauté et sa complexité, la culture palestinienne.
Tiré du blogue de l'auteur.
« Dans le tumulte d'un monde conquis par des démons dont nous nous espérions délivrés, célébrer la 30eédition d'un festival conçu comme une ode à la diversité offre l'occasion d'affirmer qu'un autre récit est possible. Celui qui oppose à la verticalité d'une vision exclusive et excluante, l'horizontalité des droits culturels, la fécondité de l'hybridation et du dialogue entre les cultures, la force des émotions partagées. »
– Stéphane Krasniewski
En 2025, alors que les images d'une Palestine meurtrie continuent de traverser les écrans du monde, le festival des Suds, à Arles fait le choix de célébrer, dans toute sa beauté et sa complexité, la culture palestinienne.
Ainsi, lundi 14 juillet, Elias Sanbar conversera avec Farouk Mardam-Bey et Edwy Plenel à l'occasion de la Rencontre Mediapart, et le festival projettera, vendredi 18 juillet, le film Mémoires de Palestine, avec Leïla Shahid comme figure centrale… avant d'applaudir le Trio Joubran venu fêter ses 20 ans sur la scène du Théâtre Antique. Ils rêvaient de n'être que des musiciens, les souffrances de leur peuple leur imposent d'en être plus que jamais les porte-drapeaux. Viscérale, leur musique témoigne, résiste, et alors que de nombreux artistes palestinien·nes sont empêché·es de se produire sur leur propre territoire, leur concert à Arles – accompagnés d'un quintet de cordes et percussions – a une résonance particulière. Leurs cordes entrelacées avaient déjà fait vibrer le cœur du public venu les écouter sur cette même scène en 2018… Et comment ne pas se souvenir du dernier récital du poète palestinien Mahmoud Darwich, le 14 juillet 2008, au Théâtre Antique, entouré de Samir et Wissam Joubran ?
Quelques heures plus tard, dans la Cour de l'Archevêché, un autre regard sur la culture palestinienne prendra vie à travers le live set d'Isam Elias, mêlant sonorités afro-orientales, beats électro et influences trap. Installé en France pour pouvoir faire entendre sa voix par la musique – « Là-bas [en Palestine], on accorde moins d'importance à l'art et à la culture. Je ne peux pas vivre de ça, ni me faire entendre si je reste » [interview Le Courrier de l'Atlas] –, il affirme l'urgence d'une expression artistique libre et politique. Sa musique reflète une jeunesse palestinienne multiple, urbaine et connectée au monde. Là où l'on parle de guerre, il insuffle la fête comme réponse. Là où l'on veut faire taire, il fait danser.
À travers ces propositions, SUDS choisit à nouveau de faire de la scène un lieu d'écoute, de mémoire, et de solidarité. Dans un paysage culturel qui a parfois tendance à l'apolitisme confortable, offrir une scène, un public, une écoute devient une responsabilité éthique pour les institutions culturelles.
Du 14 au 20 juillet 2025 à Arles, on ne viendra pas seulement écouter de la musique. On viendra honorer la force d'un peuple, la beauté d'une culture, et la puissance de l'art comme dernier bastion de liberté.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Océans : jusqu’où faut-il en arriver pour que la situation soit prise au sérieux ?

Alors que s'achève le sommet des océans de Nice, un ensemble de chercheurs en écologie marine et océanographes dresse un premier bilan et propose quelques principes fondamentaux pour susciter le sursaut collectif que la situation appelle. « La conférence UNOC3 aurait pu être l'occasion pour la France de prendre le leadership d'une transition écologique du secteur de la pêche et d'une réelle protection des écosystèmes marins. Mais les mesures annoncées lundi dernier par le Président sont très loin de cela ».
13 juin 2025 | tiré d'Europe solidaire sans frontières
Les écosystèmes marins subissent les impacts des activités humaines, en particulier dans les zones côtières où ils ont connu d'importantes pertes historiques d'habitat. Plus de la moitié de la surface des océans est soumise à la pêche industrielle et plus d'un tiers des stocks sont considérés comme surexploités[1],[2].
En Europe, la Politique Commune de la Pêche (PCP), malgré les moyens considérables qui lui sont alloués, échoue de manière systémique depuis des décennies à atteindre ses objectifs[3]. À peine la moitié des stocks pêchés dans l'Atlantique sont considérés en bon état, et des espèces emblématiques comme le maquereau et le hareng sont désormais hors de leurs limites de sécurité[4].
Face à ces constats alarmants, l'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) et la communauté scientifique recommandent la mise en place d'aires marines protégées dont la couverture spatiale et les niveaux de protection soient suffisamment ambitieux pour produire des effets significatifs (10% sans aucune activité extractive et 20% sans pêche/infrastructures industrielles).
À l'instar de nombreux autres pays, la France a jusqu'à présent mis en avant une ambition essentiellement axée sur l'étendue de ses AMP, au détriment de mesures de protection réellement contraignantes. Les restrictions imposées aux activités humaines y restent souvent limitées, et la pêche industrielle, notamment au chalut (pélagique ou de fond), y est fréquemment permise. L'autorisation dans la très grande majorité des AMP françaises de la pêche au chalut de fond, pourtant reconnue pour ses effets particulièrement destructeurs sur les écosystèmes benthiques, est un enjeu clé pour le gouvernement français.
Cette situation s'inscrit à rebours des travaux scientifiques qui indiquent sans ambiguïté l'inefficacité de demi-mesures de protection[5],[6],[7]. En qualifiant de « protégées » des aires marines qui ne le sont pas, elle traduit aussi un mépris de la sémantique et du débat public sur le sujet.
À l'inverse, des aires marines véritablement protégées apporteraient des bénéfices importants : effets de régénération accompagnés de débordements dans les zones adjacentes (accessibles aux pêcheries)[8],[9], et possibilité pour les scientifiques de démêler les effets de la pêche de ceux du changement climatique. L'usage des AMP comme zones témoin est notamment essentiel pour établir des états de référence, et fournir des informations indispensables à la gestion des milieux marins.
Des bénéfices importants peuvent donc être obtenus avec des aires marines sous protection stricte. Pour autant, les AMP ne sont pas la solution miracle à la surexploitation des ressources marines et à ses effets sur les écosystèmes. Tout d'abord parce qu'elles ne font pas à elles seules diminuer la pression de pêche si cette dernière est simplement reportée hors AMP. Et aussi parce que la définition des AMP ne s'est pas toujours faite sur des critères d'intérêt écologique. C'est particulièrement vrai pour la protection des écosystèmes benthiques, écosystèmes qui restent mal connus, mal cartographiés et mal protégés.
Les niveaux d'exploitation actuels ne sont pas soutenables. Ils menacent à la fois le devenir de nombreux écosystèmes marins et aussi celui des filières de pêche qui en dépendent. C'est d'autant plus vrai que celles-ci sont par ailleurs soumises à un renchérissement tendanciel de l'énergie qui va se raréfier et qu'elles doivent se décarboner. Il est donc indispensable d'engager une transformation profonde de nos modes d'exploitation des ressources marines. Trop rares sont les voix qui abordent le sujet, notamment du côté du gouvernement. Même les constats les plus simples ne sont pas posés.
Avec l'intérêt général en tête, nous proposons ici quelques principes fondamentaux, en espérant susciter le sursaut collectif que la situation appelle.
• Les perturbations écologiques et socio-économiques liées à l'exploitation des écosystèmes marins dans un contexte de changement climatique sont largement imprévisibles. Cette réalité nouvelle rend illusoire la poursuite du statu quo. En particulier, la grande pêche industrielle, et notamment celle pratiquée au chalut de fond par des navires de plus de 25 mètres, doit être considérée comme un mode d'exploitation obsolète.
• Des formes alternatives de pêche existent, notamment en favorisant les arts dormants[10],[11],[12]. Mais à l'heure actuelle ces métiers sont mal reconnus et mal représentés. Ils ont besoin d'être rendus visibles, pris au sérieux et aidés par les pouvoirs publics. Ceci passe notamment par une réorientation des subventions aujourd'hui accordées massivement aux engins de pêche ayant les plus forts impacts environnementaux.
• L'abandon progressif et accompagné de la grande pêche industrielle au profit de filières respectueuses des écosystèmes doit s'accompagner d'une réduction des prises et donc aussi de la consommation. Le poisson pêché dans la nature est un bien rare et doit être consommé comme une fête.
• L'État doit assumer ses responsabilités et permettre à l'ensemble des parties prenantes de définir en concertation les chemins d'une transformation écologique et sociale, compatible avec la nécessaire préservation des écosystèmes marins, la prise en compte du sort des personnes qui travaillent dans les filières et l'accès des classes populaires aux produits de la mer.
La conférence UNOC3 aurait pu être l'occasion pour la France de prendre le leadership d'une transition écologique du secteur de la pêche et d'une réelle protection des écosystèmes marins. Mais les mesures annoncées lundi dernier par le Président sont très loin de cela : les 4 % de zones de « protection forte » n'interdisent que le chalutage de fond, et concernent principalement des zones profondes dans lesquelles cette technique est déjà bannie.
Elles permettent encore le chalutage pélagique, y compris par des navires industriels, et ne répondent toujours pas aux critères de protection stricte de l'UICN. Enfin, aucune vision sur la transition du secteur de la pêche n'a été esquissée. En dépit du volontarisme affiché par E. Macron en faveur du traité sur la haute mer (dont la portée restera très limitée), l'UNOC3 n'a fondamentalement rien réglé des pressions humaines qui dégradent toujours plus l'état des océans et des écosystèmes qu'ils abritent.
Jusqu'où faut-il en arriver pour que la situation soit prise au sérieux ?
Signataires :
Olivier Aumont (chercheur océanographe, IRD),
Xavier Capet (chercheur océanographe, CNRS),
Didier Gascuel (chercheur en écologie marine, Agro Rennes),
Sara Labrousse (chercheure en écologie marine, CNRS)
Notes
[1]IPBES (2019) : Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. https://files.ipbes.net/ipbes-web-prod-public-files/inline/files/ipbes_global_assessment_report_summary_for_policymakers.pdf
[2]FAO. 2024. La Situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture 2024. Pour une transformation des systèmes agroalimentaires axée sur la valeur. Rome. https://doi.org/10.4060/cd2616fr
[3]Rainer Froese et al. Systemic failure of European fisheries management. Science 388,826828 (2025). DOI:10.1126/science.adv4341
[4] Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) – 76th Plenary report (STECF-PLEN-24-02), PRELLEZO, R., NORD, J. and DOERNER, H. editor(s), Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2025, https://data.europa.eu/doi/10.2760/1035959, JRC140570.
[5] Turnbull, J. W., Johnston, E. L., & Clark, G. F. (2021). Evaluating the social and ecological effectiveness of partially protected marine areas. Conservation Biology, 35(3), 921-932.
[6] Zupan, M., Fragkopoulou, E., Claudet, J., Erzini, K., Horta e Costa, B., & Gonçalves, E. J. (2018). Marine partially protected areas : drivers of ecological effectiveness. Frontiers in Ecology and the Environment, 16(7), 381-387.
[7] Sala, E., & Giakoumi, S. (2018). No-take marine reserves are the most effective protected areas in the ocean. ICES Journal of Marine Science, 75(3), 1166-1168.
[8] Halpern, B. S., Lester, S. E., & Kellner, J. B. (2009). Spillover from marine reserves and the replenishment of fished stocks. Environmental Conservation, 36(4), 268-276.
[9] Sala, E., Costello, C., Dougherty, D., Heal, G., Kelleher, K., Murray, J. H., ... & Sumaila, R. (2013). A general business model for marine reserves. PloS one, 8(4), e58799.
[10] Zeller, D., & Pauly, D. (2019). Back to the future for fisheries, where will we choose to go ?. Global Sustainability, 2, e11.
[11] McClenachan, L., Neal, B. P., Al-Abdulrazzak, D., Witkin, T., Fisher, K., & Kittinger, J. N. (2014). Do community supported fisheries (CSFs) improve sustainability ?. Fisheries Research, 157, 62-69.
[12] Charles, A. (2023). Sustainable fishery systems. John Wiley & Sons.
P.-S.
• Les invités de Mediapart. 13 juin 2025 :
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/130625/oceans-jusquou-faut-il-en-arriver-pour-que-la-situation-soit-prise-au-serieux
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Percer les mystères de l’océan, un défi crucial pour comprendre le climat

Malgré son rôle primordial dans la régulation du climat, l'océan reste sous-étudié par la science, faute de moyens. Dans les abysses, des phénomènes complexes risquent de s'avérer décisifs pour l'avenir, selon les océanographes.
13 juin 2025 | tiré de reporterre.net | Photo : P Ifremer / CC BY 4.0 / Treluyer Loic
https://reporterre.net/Percer-les-mysteres-de-l-ocean-un-defi-crucial-pour-affronter-la-crise-climatique
Une énorme éponge nous protège pour l'instant du chaos climatique : l'océan. Il absorbe 90 % de l'excédent de chaleur généré par nos émissions de gaz à effet de serre. Sans compter qu'il limite, en amont, l'ampleur du changement climatique en absorbant environ le quart de nos émissions de carbone.
Pour combien de temps encore ? L'éponge va-t-elle arriver à saturation ? À quelle vitesse ? Dans quelle proportion et avec quelles conséquences ? Ces questions obsèdent bon nombre de climatologues et océanographes, encore incapables d'y apporter des réponses satisfaisantes.
Acteur majeur du système climatique terrestre, l'océan est paradoxalement sous-étudié par la science. En 2020, les États n'y consacraient, en moyenne, que 1,7 % de leur budget de recherche, déplorait un rapport de l'Unesco.
En amont de l'Unoc 3 (la troisième Conférence des Nations unies sur l'océan qui se tient à Nice du 9 au 13 juin), un congrès scientifique mondial, porté par le CNRS et l'Ifremer, appelait les décideurs politiques à s'engager fortement pour l'océan, notamment en finançant davantage la recherche. Et en matière de relations climat-océan, les zones d'ombre à explorer sont légion.
Les mystérieuses turbulences de l'océan
« Contrairement à l'atmosphère qui est relativement transparente et qu'on observe bien par satellite, l'océan est complètement opaque à tout rayonnement, passé quelques mètres de profondeur », explique Sabrina Speich, océanographe et climatologue, professeure à l'École normale supérieure.
Il faut donc aller mesurer in situ ce qu'il se passe sous la surface. Mais les campagnes océanographiques coûtent cher et peinent à couvrir l'immensité des mers du globe. La tâche est d'autant plus ardue que l'océan est particulièrement turbulent. C'est-à-dire qu'il s'y forme une multitude de tourbillons, rendant la compréhension de la circulation océanique très difficile.
« On a dans l'océan l'équivalent des cyclones et anticyclones dans l'atmosphère sauf que c'est à beaucoup plus petite échelle, de l'ordre de 50 à 100 km de diamètre, là où les anticyclones sont de taille continentale. C'est inévitable puisque l'échelle de turbulence est en partie déterminée par la densité des fluides, et que l'eau est plus dense que l'air », souligne l'océanographe Marina Lévy, directrice de recherche au CNRS.
Les connaissances se sont affinées avec le déploiement, au début des années 2000, du réseau de 4 000 flotteurs automatiques du programme international Argo. Ces bouées dérivent au gré des courants, plongent jusqu'à 2 000 mètres de fond et renseignent la communauté scientifique sur la température et la salinité des eaux un peu partout sur la planète, complétant les nombreux autres réseaux de bouées, marégraphes et navires gérés notamment par le Système mondial d'observation de l'océan, programme appartenant à l'Unesco.
Les modèles numériques peinent à inclure les petits tourbillons
Évidemment, plus la science progresse, plus elle réalise la complexité colossale des phénomènes en jeu. « La topographie très complexe de la dorsale médio-atlantique, ces montagnes sous-marines au milieu de l'Atlantique qui remontent jusqu'à l'Islande, génère des mécanismes océaniques à très petite échelle. On a, pas exemple, des eaux qui vont cascader de 300 m à 2 000 m de profondeur, entre le Groenland et l'Islande », dit Virginie Thierry, physicienne océanographe et coordinatrice de la contribution française à Argo.
Créer des modèles numériques permettant de rendre compte et d'anticiper les évolutions possibles de l'océan s'apparente donc à une gageure. « Pour comprendre la réponse des océans aux évolutions climatiques futures, on a besoin d'un modèle global comprenant toute la surface de la Terre et de prendre en compte le plus de rétroactions possibles. Complexifier ainsi les modèles nécessite de la puissance de calcul, qui est mobilisée au détriment de la finesse de la résolution spatiale des simulations », expose Juliette Mignot, océanographe et directrice adjointe du laboratoire Locean.
La résolution des modèles du système Terre, l'équivalent de leurs pixels, est aujourd'hui de l'ordre de 100 km de large. Tous les phénomènes de plus petite échelle sont difficilement pris en compte et certains processus ne sont pour l'instant pas du tout intégrés.
« Ces modèles sont hydrostatiques, c'est-à-dire qu'ils considèrent la vitesse verticale des eaux comme négligeable. Ces mouvements verticaux sont mal connus », illustre Sabrina Speich. De même, certains petits tourbillons, plus petits que les pixels des modèles, parfois de moins de 15 km de rayon, sont mal pris en compte, « alors même qu'ils semblent avoir un rôle clé dans les échanges avec l'atmosphère », dit l'océanographe.
La circulation océanique détraquée par le réchauffement
Inévitablement imparfaits, les modèles sont tout de même cohérents, corrigés et affinés continuellement en étant confrontés aux observations. Si leur amélioration reste un enjeu crucial, c'est parce qu'ils visent à mieux comprendre la circulation océanique globale, qui constitue le cœur du thermostat planétaire. C'est elle qui fait de l'océan une éponge climatique.
Pour comprendre ce qui concentre les efforts des océanographes, il faut revenir un instant sur le fonctionnement de cette éponge. Le moteur de cette circulation, c'est la différence de densité entre les eaux. Plus une eau est froide et salée, plus elle est dense.
Schéma simplifié de la circulation océanique profonde engendrée par des écarts de température et de salinité des masses d'eau. Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0/Robert Simmon, Nasa/Miraceti
Or, l'océan se refroidit en approchant des pôles. Il y devient également plus salé, car lorsque l'eau se change en glace, elle rejette le sel dans l'eau de mer, où la concentration augmente donc au fur et à mesure de la formation de la banquise. Les masses océaniques aux hautes latitudes sont donc plus denses, et vont plonger en profondeur. Elles entraînent comme un tapis roulant les courants en surface depuis les zones chaudes des tropiques vers les pôles, tandis que les courants en profondeur font le chemin inverse.
Cette boucle gigantesque est appelée « circulation méridienne de retournement » ou Moc, et Amoc pour l'océan Atlantique (Atlantic Meridional Overturning Circulation). Ce mécanisme est essentiel pour les deux facettes de notre éponge planétaire.
D'une part, ce brassage avec les abysses permet de stocker en profondeur la chaleur emmagasinée par l'océan. D'autre part, il transporte le CO2 qui se dissout naturellement à la surface de l'océan jusqu'aux fonds marins, permettant aux couches océaniques de surface de ne pas saturer et de continuer à retirer du CO2 de l'atmosphère. Ce qu'on appelle la « pompe physique à carbone ».

L'Amoc est un ensemble complexe de courants océaniques qui traversent l'Atlantique, dont le fameux Gulf Stream, ici représenté. Il joue un rôle crucial pour redistribuer la chaleur sur le globe. Nasa/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio
Mais le changement climatique perturbe lui-même grandement cette mécanique. La fonte de la banquise et le réchauffement de l'océan vont très probablement ralentir l'Amoc dans les prochaines décennies, en modifiant sa température et sa salinité, d'après le consensus scientifique sur le sujet. Même si l'intensité et la vitesse de cet affaiblissement sont entourés de très vastes incertitudes.
La dangereuse stratification de l'océan
Au-delà de l'Amoc, le réchauffement de l'océan affaiblit dangereusement ce mélange vertical des eaux océaniques. On l'a vu : plus l'eau est chaude, moins elle est dense et moins elle peut plonger vers les profondeurs. Sous l'effet du réchauffement planétaire, la couche de surface de l'océan se réchauffe et il devient de plus en plus difficile de réunir les conditions pour qu'elle se mélange aux eaux très froides des abysses. Autrement dit, plus le contraste de température entre les couches de l'océan est important, plus l'océan est stratifié, plus cette différence de densité entre les eaux va constituer une barrière compliquée à franchir.

La couche de surface de l'océan est mélangée par les vents et absorbe de plus en plus de chaleur atmosphérique. Ajouté à d'autres phénomènes, cela intensifie la stratification et réduit le mélange avec l'océan profond, les couches devenant trop contrastées, comme de l'huile sur de l'eau. © Jean-Baptiste Sallée, Locean (CNRS/MNHN/IRD/Sorbonne Université)
En 2021, une étude, publiée dans la revue Nature et menée par des chercheurs du CNRS, de Sorbonne Université, et de l'Ifremer, s'inquiétait de ce phénomène. Le réchauffement de la couche de surface stabiliserait depuis cinquante ans l'océan à un rythme six fois supérieur aux estimations passées, entravant les capacités de mélange des eaux, donc cette absorption en profondeur de la chaleur et du CO2.
Énième illustration de la complexité et des interactions entre phénomènes océaniques : ce blocage du mélange des eaux limite également les échanges d'oxygène et de nutriments entre la surface et les abysses. Avec pour conséquence de menacer le développement du plancton, ces organismes extrêmement divers qui constituent le socle des écosystèmes marins.

Cette espèce phytoplactonique (Lepidodinium chlorophorum) est responsable de cette eau colorée verte en baie de Vilaine. Lesbats Stephane / CC BY 4.0 / Ifremer
Or, ce plancton absorbe aussi du carbone, qu'il contribue à pomper vers les abysses lorsque les organismes et les particules organiques chutent vers le fond. « Cette pompe biologique contribue à réduire le CO2 dans l'océan de surface et à activer la pompe physique du carbone. Mais on ne sait pas si cette pompe biologique diminue ni quelles en seraient les conséquences. La plupart des modèles intègrent quelques groupes de planctons mais la réalité est beaucoup plus complexe, on travaille à l'intégrer plus finement », dit Marina Lévy.
1 200 capteurs plongeant jusqu'à 6 000 mètres
« Tout l'enjeu de nos travaux, c'est de réduire les incertitudes, résume Virginie Thierry. On connaît très mal l'océan profond mais on sait qu'environ 10 % de la chaleur en excédent va sous les 2 000 m. On a besoin de mieux comprendre la contribution de l'océan pour boucler le bilan énergétique de la planète. »
Explorer l'océan sous les 2 000 m, c'est l'ambition du déploiement des nouveaux flotteurs Argo, baptisés OneArgo, bardés de nouveaux capteurs et dont quelque 1 200 devraient être capables de plonger jusqu'à 6 000 m.
« Un soutien financier durable et renforcé est urgent »
En amont de l'Unoc, Virginie Thierry et des dizaines de ses collègues internationaux signaient un article dans la revue Frontiers in Marine Science. Un appel collectif à investir « en urgence » dans le programme Argo, financé aujourd'hui pour moitié par les États-Unis, dont la politique antiscience fait craindre pour la pérennité du projet.
« Un soutien financier durable et renforcé est urgent pour permettre à OneArgo de se déployer pleinement et donner à nos sociétés les moyens de préserver les nombreux services que l'océan nous rend et de faire face aux défis climatiques et environnementaux majeurs actuels », résume l'Ifremer. La plupart des océanographes dans le monde pourraient en dire autant.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Un avant et un après l’UNOC 3 ?

Si la conférence sur les océans, tenue à Nice durant la deuxième semaine de juin, a été grandement médiatisée et a permis plusieurs développements prometteurs pour la protection des océans, beaucoup de ceux-ci ne sont que des étapes dans la réalisation de projets encore à venir et de nombreux espoirs y ont fait naufrage.
La Conférence des Nations unies sur l'océan (UNOC), a réunis du 9 au 13 juin à Nice sur la Côte d'Azur plus de 100 000 personnes, 12 000 délégations de 175 pays, 115 ministres, 64 chefs d'État et 28 responsables d'organisations onusiennes, représentant au total près de 85 % du volume des ressources de la planète et plus de 90 % des zones économiques exclusives mondiales.
Une conférence nécessaire
Michel Prieur, professeur de droit de l'environnement et président du centre international de droit comparé de l'environnement, participait à l'UNCO 3. Il explique que cette conférence est nécessaire pour avoir une vision globale des enjeux qui s'entremêlent quand il est question de la mer. « Il y a déjà de nombreux traités sur la mer », affirme-t-il en mentionnant le traité de portée générale sur les droits de la mer de 1982 et de nombreuses conventions spéciales sur des pollutions particulières qui ont été instituées il y a assez longtemps et n'intègrent pas les nouvelles données environnementales. « Donc, il était nécessaire de réactiver le droit lié aux océans. C'est depuis Rio 92 ou il a été démontré que la mer était un milieu fragile qui était victime de pollution. » C'est d'abord toutes les catastrophes des déversements d'hydrocarbures qui ont alerté l'opinion publique et les gouvernements. Il y a aussi eu les découvertes scientifiques sur les richesses de la mer, la biodiversité, la crise alimentaire et la surpêche. « Tout ça faisait un ensemble. On ne pouvait pas traiter séparément la pollution par les hydrocarbures, les poissons, les recherches sous-marines. Il fallait une réflexion intégrée horizontale et c'est l'objet des conférences sur les océans. » Celle à Nice en est la troisième.
Avancées
Les organisateurs sont satisfaits de l'événement. L'envoyé spécial de la France et organisateur de l'UNOC 3, Olivier Poivre d'Arvor, affirme à ce sujet que « Nice a gagné le pari de l'océan ». Les avancées sur le traité international de protection de la haute mer et de la diversité marine ont motivé le président Macron à annoncer sa mise en vigueur en janvier 2026, bien qu'il manque quelques voix promises. Pour Rym Benzina Bourguiba, présidente de la saison bleue (Tunisie), obtenir 55 ratifications fermes alors qu'auparavant il y en eût 22 ou 23, c'est un bon pas, considérant ceux qui seraient à venir. « Avec 15 autres ratifications qui vont venir d'ici septembre, ça va être annoncé à New York, ce moratoire sur la haute mer, c'est très important. » Enseignant-chercheur à Sciences Po Bordeaux et à Bordeaux Sciences Agro, Pierre Blanc, auteur de « Géopolitique et climat », considère que les avancées de l'UNOC 3 montrent une vivacité du fonctionnement multilatéral.
La résolution de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) d'interdire les subventions aux techniques destructrices, qui a été ratifiée par 103 États, serait une autre avancée. « Cela représente environ 3 000 bateaux, il en faudrait 3 600, soit 10 pays supplémentaires, pour que la résolution entre en vigueur », a affirmé le directeur des politiques internationales de la Fondation Tara, André Abreu.
En ce qui concerne la réduction de la production de plastique, 96 pays ont signé une déclaration d'intention en ce sens. Ils représentent plus de la moitié des 170 pays impliqués dans les négociations du « traité plastique » qui dure depuis 2022 et dont le cinquième round doit reprendre en août à Genève. La ministre française de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, est directe à ce sujet. « Ce que nous voulons, c'est un traité qui fixe un objectif de long terme avec une trajectoire de réduction à respecter ». Le ministre de l'Environnement des îles Salomon, Trevor Manemahaga affirme que « C'est la pollution de l'océan qui est en jeu, la santé de nos enfants qui est en jeu, l'avenir de la planète qui est en jeu. » Il y aurait environ 460 millions de tonnes de plastique qui auraient été produites en 2024, une quantité qui pourrait tripler d'ici à 2060.
Moins bon point
La conférence a cependant essuyé certaines critiques, notamment au sujet des engagements financiers jugés insuffisants et du manque de progrès concret obtenu. La chef de délégation de Greenpeace International à l'UNOC, Megan Randles, commente à ce sujet : « Nous avons entendu beaucoup de belles paroles ici à Nice, mais elles doivent se transformer en actions. »
Il y a aussi eu 100 milliards de dollars d'aide qui ne se sont pas matérialisés. Cet argent serait nécessaire. Selon le président de la Polynésie française (300 000 habitants sur 118 îles), Moetai Brotherson, les nations insulaires sont « des colosses avec des épaules gigantesques et des tout petits pieds », puisqu'ils représentent moins de 0,1 % du PIB mondial réparti sur un tiers de la surface du globe.
La présidente des îles Marshall (42 000 habitants sur 29 îles), Hilda C. Heine, a affirmé que « trop peu de choses sont faites et trop lentement. »
Le président des Palaos (21 000 habitants sur 340 îles), Surangel Whipps Jr. demande aux pays riches de mettre en pratique leurs discours sur la protection des océans, mettant au défi ces pays : « Si vous voulez vraiment protéger les océans, prouvez-le. »
Le ministre de l'Environnement du Vanuatu (320 000 habitants sur 83 îles), Ralph Regenvanu, a affirmé « Nous vivons votre avenir. Si vous pensez être en sécurité, vous ne l'êtes pas. » Son pays a d'ailleurs saisi la justice internationale pour obliger les États développés à réduire leurs émissions de CO2.
Principales responsables du réchauffement climatique, les énergies carbonées ont aussi été peu discutées à la conférence. Selon l'ancien émissaire américain pour le climat, John Kerry, présent à Nice, « il est impossible de protéger les océans sans s'attaquer à la principale cause de leur effondrement : la pollution due aux combustibles fossiles injectés sans relâche dans l'atmosphère. » Bruna Campos, de l'ONG Ciel commente à ce sujet que d'« ignorer l'impératif de sortir du pétrole et du gaz offshore n'est pas seulement une injustice : c'est inadmissible. »
Une conférence historique malgré ses faiblesses ?
Pour l'artiste fondateur du projet archipel de l'UNOC, Yacine Aït Kaci, cette conférence lui fait penser à la COP21 à Paris. « Il y a vraiment eu un avant et un après, en tout cas au niveau de la mobilisation de la société civile et de la prise de conscience collective. Je crois qu'il s'est vraiment passé quelque chose à Nice cette semaine, et donc, dans le monde. »
Dans une entrevue donnée à TV5 Monde diffusée le 14, juin, le docteur François Gemenne qui est un des auteurs du dernier rapport du GIEC, considère que la conférence sur l'océan à Nice est aussi une opération de communication qui permet de mettre le sujet dans l'actualité et de créer une certaine forme de dynamique politique, comme cela se serait produit avec le traité sur la haute mer. L'UNOC 3 serait donc aussi un exercice de communication. « Sincèrement, sur quel autre sujet peut-on aujourd'hui trouver autant de gouvernements avec un but commun ? Il ne reste quasiment plus que l'environnement, il faut bien le dire. »
Michel Gourd
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Cinéma expérimental et mépris de classe : une histoire critique (partie 2)
ANNÉES 45 À AUJOURD’HUI : LE MÉPRIS PAR LE CINÉMA SE DONNE DES MOYENS
Pour aider à vous souvenir où j’en étais la dernière fois, voici des extraits de la conclusion de mon premier article : La première génération expérimentale trouve son origine dans une partie de la classe petite-bourgeoise intellectuelle européenne, qui utilise le cinéma pour se distinguer à la fois par sa production et par sa cinéphilie, des classes supérieures, moyennes et travailleuses qui participent ensemble à la production sociale (au sens large) dominante du cinéma. La petite-bourgeoisie expérimentale de première génération se distingue de toutes ces classes : elle passe par des circuits de production (circulation, distribution, publicité, etc.) parallèles, dans les cas où elle se soucie d’être un minimum vue, ce qui empêche la consommation de masse de ses films ; elle rend aussi ses films incompréhensibles pour la cinéphilie dominante. Le cinéma parlant, en augmentant drastiquement le prix de la fabrication des films, causera des obstacles productifs à l’autonomie intellectuelle de cette classe, autonomie qu’elle ne laissera même pas tomber pour intégrer par exemple la production militante ouvrière des années 20-30. La première génération ne saura pas résoudre le problème du financement de son cinéma, véritable obstacle à son autonomie, et en conséquence le cinéma expérimental s’essoufflera, jusqu’à son relancement par la deuxième génération après la Deuxième Guerre mondiale. En effet, dans les années 30-45, en Europe, le développement des esthétiques précédemment associées au cinéma expérimental (souvent sous la forme des courants) diminue, et presque aucun film marquant rattaché aujourd’hui au cinéma expérimental n’est produit. Le projet de la création d’organisations de production (au sens plus strict) autonome, sous forme notamment de coopératives, est cependant déjà envisagé.
Raphaël Simard

Entre les deux générations : des problèmes de production et de transmission
Dans les années 30 et jusqu’à la fin de la Deuxième Guerre mondiale (donc 1930-1945), le cinéma expérimental est surtout constitué de courants mineurs et/ou plus isolés que dans la décennie 20[i]. Les faits décisifs de ces années dans le relancement ultérieur du cinéma expérimental sont l’émergence du cinéma expérimental états-unien (et non plus européen comme dans la première génération), dont la première avant-garde nationale de 1927 à 1934 est d’ailleurs composée de critiques et de cinéastes et non plus d’artistes d’autres disciplines (comme c’était le cas souvent dans la première génération) ; et le rôle joué par des passeurs « entre la première avant-garde européenne [que l’on a vu dans le précédent article] et l’avant-garde américaine d’après-guerre », comme le Tchécoslovaque Alexander Hackenschmied qui anticipait déjà le « cinéma de transe » des années 40 dans son film de 1930 :
Émigré aux États-Unis après avoir réalisé avec Herbert Kline et Hans Burger le long-métrage Crisis, pour Frontier Films [une structure de cinéma militant], sur la montée du fascisme dans son pays, [Hackenschmied] épouse Maya Deren et coréalise avec elle […] le film fondateur de la nouvelle avant-garde américaine : Meshes of the Afternoon (1943). Oskar Fischinger et Hans Richter […] quittent eux aussi l’Allemagne et deviennent de remarquables passeurs.[ii]
L’avant-garde américaine des années 30 reste donc « composée de cinéastes isolés[iii] ». Ce n’est pas surprenant : la distinction sociale par le capital culturel telle que la décrite Pierre Bourdieu ne se fait pas de manière mécanique, sans intervention des sujets collectifs — les classes dominantes doivent en effet transmettre le capital culturel à la prochaine génération, sans quoi leur position sociale ne persisterait pas :
[Le modèle bourdieusien de la distinction] octroie tout d’abord une place importante à la stratification temporelle des goûts et des pratiques, qui se manifeste en particulier, dans l’espace de la production comme dans celui de la consommation culturelle, à travers les cycles d’innovation et la succession des avant-gardes. Les productions culturelles sont soumises, comme l’ensemble des produits, à un phénomène de cycle de vie qui s’agrémente de mouvements inverses de banalisation et de réhabilitation culturelle déplaçant périodiquement la frontière qui sépare le domaine de la culture savante de celui de la culture populaire. Cette dynamique temporelle entre de ce fait en composition avec une série de clivages générationnels.[iv]
C’est exactement ce qu’il faudra attendre pour voir un relancement de la production de films expérimentaux. Nous verrons que la transmission se fera sur la base d’une nouvelle cinéphilie, et que la nouvelle génération aura la particularité par rapport à la première (les premières avant-gardes européennes) de se doter de moyens productifs plus grands pour assurer au long cours la transmission du capital culturel qui fait qu’encore aujourd’hui il y a du cinéma expérimental[v].
La deuxième cinéphilie dominante est une cinéphilie petite-bourgeoise intellectuelle
La seconde grande cinéphilie qui se développe au XXe siècle, appelée cinéphilie « moderne » ou « savante » par Laurent Jullier et Jean-Marc Leveratto, se construit dans une certaine mesure en opposition à la première cinéphilie dominante (la cinéphilie que j’appelais « de masse » ou « ordinaire » dans le premier article)[vi]. Le dédain et le silence sur la première cinéphilie dans la recherche universitaire en cinéma, et ce au moins encore en 2010, en rendent compte, comme le soulignent les deux auteurs, en accord avec le critique Philippe d’Hugues[vii]. Cette nouvelle cinéphilie peut être considérée comme la deuxième cinéphilie dominante selon moi, au sens qu’elle sera défendue par des moyens matériels qui en assureront la domination idéologique et la reproduction, qu’elle sera en accord avec les aspirations d’une classe plus dominante que dominée, et qu’elle servira d’outil idéologique participant au maintien des classes (antagonistes ou non). Je veux en effet défendre que cette deuxième cinéphilie dominante est portée par le sujet collectif de la petite-bourgeoisie intellectuelle en général et non en partie (tout comme la première génération). Cette seconde génération s’inscrira dans le cours de ce que Jullier et Leveratto appellent « l’institutionnalisation de l’expertise cinématographique » dans les décennies 40 et 50, en Europe et aux États-Unis[viii]. Le rôle joué conjointement par les universités et les États y est primordial : en France par exemple, cela passe par la « création par l’État d’un dispositif de contrôle économique de l’industrie cinématographique, le CNC, d’un dispositif de valorisation de la production française, le Festival de Cannes, mais aussi par la reconnaissance officielle de l’importance de son étude à l’Université. »[ix] Le rôle matériel fondamental que seront amenés à jouer les universités et les États dans le cinéma expérimental de deuxième génération se comprend à la lumière du coût plus grand des films avec le cinéma parlant, qui obligeait, comme nous l’avons déjà vu, à trouver une source de financement plus grande et plus stable pour le cinéma expérimental. Cette condition matérielle était selon moi un frein à l’aspiration d’autonomie intellectuelle de la classe petite-bourgeoise intellectuelle du cinéma expérimental, et explique qu’elle trouvera le relancement de sa production de films seulement dans des institutions lui promettant une relative autonomie productive. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que la deuxième génération sera surtout impulsée, sans s’y réduire du tout, par des États-Uniens. Les universités américaines ont commencé avant les universités des autres nations à s’intéresser au cinéma de manière scientifique : elles commencent à « intégrer, dans les années 20, [l’étude du cinéma] dans leurs cursus littéraires, économiques et sociologiques. Des cours d’enseignement apparaissent [aux États-Unis dès cette époque]. »[x] En un mot, la recherche cinématographique est progressivement intégrée à l’Université que ce soit en France vers 1940 ou aux États-Unis dans les années 20. Ce phénomène traduisait le fait que l’Université en général est un lieu particulièrement peu accessible pour les classes travailleuses. En France à l’époque : « [l’] Université […] ne connaît pas encore le phénomène de démocratisation des études supérieures que vont instaurer les années 60. »[xi] Jullier et Leveratto affirment qu’en France, la composition sociale de l’Université et l’autonomie obtenue grâce et face aux institutions publiques mènent au postulat fondamental de la conception du cinéma de la cinéphilie savante : l’autonomie revendiquée de l’art, dont le cinéma, par rapport à la société[xii]. Cependant, ce postulat de la cinéphilie savante donne lieu à deux attitudes, une socio-politique et une esthétique, qui se contredisent : cette cinéphilie présente d’un côté la volonté d’étudier le cinéma en montrant péjorativement le fait qu’il est assujetti aux grandes entreprises et aux idéologies « conservatrices » ; la même cinéphilie présente, de l’autre côté, l’affirmation d’une valeur intrinsèque et artistique du cinéma, par sa seule forme, donc qui devrait être étudié en dehors de son contexte social[xiii]. Le postulat de cette cinéphilie mène à des postures et des pratiques (comme nous le verrons), en apparence contradictoires, qui ne peuvent donc pas définir cette cinéphilie : je tenterai de trouver l’unité de celle-ci encore une fois dans la cohérence avec une même condition matérielle et un même usage du cinéma comme outil de distinction et de prise d’autonomie intellectuelle.
On peut considérer généralement la deuxième cinéphilie dominante comme une position permise par une autonomie matérielle partielle par rapport à l’État et au marché du film que n’avait pas (même si les critiques professionnels avaient une certaine indépendance vis-à-vis du marché du film) la petite-bourgeoisie intellectuelle intégrée au marché dans les années 20-30. En effet, aux États-Unis, selon Jullier et Leveratto (et on peut le supposer en Europe aussi), les nouvelles classes moyennes vont utiliser les universités comme moyen pour développer une cinéphilie qui leur permettra de se distinguer de la cinéphilie de masse d’alors :
Shyon Baumann [chercheur] rend compte […] du fondement sociologique de ce processus d’émergence d’une expertise cinéphile savante et de sa promotion d’une valeur artistique du cinéma. S’appuyant sur La distinction de Pierre Bourdieu, il y reconnaît un phénomène de revendication par les classes moyennes nouvelles, dont l’expansion a été favorisée par l’énorme développement du secteur des services à partir de la seconde guerre mondiale, d’une consommation culturelle commune jusqu’alors relativement méprisée. Aux États-Unis cette conversion du cinéma en instrument de distinction culturelle est alimentée, à partir des années 50, par l’importation de films européens [dont des films expérimentaux] et d’écrits de critiques étrangers […]. La consommation avide de ces films et de ces écrits, diffusés par les Art Houses (les [salles de cinéma] d’art et d’essai) et les Universités, a ainsi permis d’instituer la légitimité culturelle d’une certaine forme de consommation cinématographique qui est devenue un marqueur de supériorité culturelle de celui qui la maîtrise. On observe donc aux États-Unis comme en France, ce que Shyon Baumann caractérise comme la conversion d’un certain discours sur le cinéma en capital culturel […].[xiv]
Il y a un véritable mépris pour le cinéma de masse d’alors, tant dans plusieurs des facteurs ou critères de son goût qu’est la cinéphilie de masse que dans son mode de production au sens large des films, c’est-à-dire la valeur marchande établie par les grandes entreprises. Comme mentionné plus haut, le cinéma produit par le cinéma expérimental choquera parfois les goûts de la masse, par sa morale ou son propos politique, mais d’autres fois il se rendra incompréhensible pour le consommateur ordinaire, montrant à ce dernier ainsi l’invalidité ou l’incapacité de son jugement cinématographique :
Réservé aux individus capables de faire l’effort de personnaliser leur jugement, ce jugement [le jugement de la cinéphilie savante] n’est pas accessible à la masse des consommateurs attentifs uniquement au plaisir que leur procure le film [ceci est une tournure ironique qui fait référence notamment à l’importance des émotions dans la cinéphilie de masse]. La qualité cinématographique se définit du même coup par sa capacité à décevoir l’attente du consommateur ordinaire, incapable de vraiment juger les films.[xv]
Un lien étroit entre progressisme socio-politique et progressisme des formes esthétiques est évident dans cette cinéphilie : la « tradition » esthétique est associée au conservatisme au sens politique et social, l’innovation esthétique est associée au progressisme[xvi]. Les consommateurs ordinaires, typiquement les classes populaires, sont considérés comme pris dans la tradition et le conservatisme, et il convient de le leur montrer, en faisant des films qui leur rappelle leur incapacité : « on peut dire [de cette cinéphilie qu’elle est] “moderne” au sens où elle fait des cinéphiles qui ne se soumettent pas à son esthétique des “autres”, prisonniers de la tradition, victimes de leur sens [leurs émotions, par exemple], et dupés par la magie cinématographique des blockbusters. »[xvii] Or, cette disposition à la lutte politique, que n’avaient presque pas les cinéastes expérimentaux de la première avant-garde européenne, se verra dans le cinéma expérimental de deuxième génération, mais surtout dans les années 60 :
Les années 60 voient la contestation [dans la société en général] embraser tous les domaines : lutte contre la censure ([Jonas] Mekas ira en prison) pour avoir projeté Un chant d’amour, de Jean Genet), contre la guerre du Vietnam, pour les droits civiques des minorités, pour la reconnaissance de la culture gay [on pourrait ajouter : pour les droits reproducteurs féminins]. Le cinéma underground [appellation d’un courant plus précis de cette époque et dominant le cinéma expérimental] est en phase avec tous ces mouvements.[xviii]
Dès lors, on peut comprendre les films politiques choquants (pour le cinéphile de masse) de la seconde avant-garde du cinéma expérimental, avant-garde qui sera aussi intégrée à l’Université (nous le verrons plus bas), comme une rupture avec la première cinéphilie qui valorisait l’éthique dans le jugement cinématographique, rupture permise par l’autonomie partielle du sujet collectif qui les produit face à l’État et au marché : « L’irrévérence, la réhabilitation du corps, l’hédonisme fonctionnent comme autant de détonateurs au sein d’un cinéma encore marqué par les contraintes du code Hays, le code moral régissant la production américaine de 1930 à 1968. »[xix] Ainsi sont unifiées les deux postures contradictoires fondamentales de la deuxième cinéphilie dominante, l’une socio-politique et l’autre esthétique, par une même distinction de classe et par une revendication d’autonomie.
À la lumière de la base matérielle et du postulat fondamental de la deuxième cinéphilie dominante, nous pourrons désormais comprendre le rapport entre les deux cinéphilies dominantes du XXe siècle. Plus exactement, il faut expliquer pourquoi la cinéphilie savante reprend en général les présupposés de la cinéphilie de masse que j’ai identifiés bien plus haut : le rapport affectif/émotionnel au cinéma, le statut du cinéma comme art au-delà de la production capitaliste, l’intérêt pour la technique du cinéma, le respect d’une certaine éthique au cinéma, et la conception du cinéma comme création personnelle[xx]. Avant tout, il faut dire que la reprise des présupposés n’est pas surprenante, dans la mesure où la cinéphilie savante provient de classes moyennes nouvelles, donc en partie de transfuges venant des classes travailleuses accédant à l’Université, et en partie de la petite-bourgeoisie intellectuelle autrefois intégrée au marché (du cinéma) et qui entre désormais à l’Université ; en somme, toutes des classes qui partageaient la cinéphilie de masse. Selon la théorie bourdieusienne, « certains domaines culturels qui relèvent de la culture populaire d’une génération peuvent […] s’incorporer à la culture savante des générations suivantes » ; la reprise que je vais décrire n’est donc pas étrangère du tout au processus de transmission générationnelle du capital culturel[xxi]. La position elle-même de la petite-bourgeoisie intellectuelle qui développe la cinéphilie savante la met dans un rapport ambivalent à la société : bien que l’Université lui donne une autonomie certaine dans la recherche, elle dépend tout de même de l’État et du marché dans une grande mesure pour continuer son activité, ce qui la pousse selon moi à s’intéresser au cinéma de masse, au cinéma valorisé par la cinéphilie de masse. Ce qui change dans la cinéphilie savante et le cinéma expérimental de deuxième génération, par rapport à la précédente cinéphilie, c’est que l’usage de ces présupposés n’est plus accessible à la masse comme il l’était dans la critique professionnelle des années 30 ou dans les livres d’histoire du cinéma des années 20 ; seuls ceux ayant ce capital culturel, cette cinéphilie savante, ses codes précis, peuvent les utiliser, les maîtriser ; ces présupposés deviennent autant de manières de se distinguer de la masse, et ils le permettent d’autant plus qu’ils sont des présupposés communément partagés par la masse[xxii].
Je veux repasser les points que j’ai énoncés au début de ce dernier paragraphe qui formaient la première cinéphilie, pour voir leur redéploiement dans la seconde. Le rapport affectif/émotionnel au cinéma n’est plus une capacité de tous les spectateurs : il demande désormais de faire l’effort de se créer un jugement personnel, c’est-à-dire en réalité d’intégrer les codes du bon discours sur les œuvres, les références à connaître, le vocabulaire scientifique de la recherche, etc.[xxiii] Autrement dit, l’émotion et « le plaisir que […] procure le film » ne peuvent plus être simplement vécus et exprimés dans le langage courant, car ils sont vus comme opposés, antinomiques à l’analyse formelle du cinéma, anti-scientifiques[xxiv]. Elle doit être intégrée à un discours savant sur les qualités formelles du film, discours qui remplace l’écoute en tant que moment propice à l’émotion. Le statut du cinéma comme art ayant une valeur supplémentaire, supérieure à celle du profit fait par la grande production, conception qui était en germe dans la cinéphilie de masse, devient avec la cinéphilie savante une catégorisation entre les films d’art produits et défendus par les cinéphiles savants, et les films commerciaux aimés par la masse parce que cette dernière est jugée fondamentalement conservatrice (typiquement les blockbusters)[xxv]. L’intérêt pour la technique du cinéma passe désormais par le retour à un art abstrait et plastique déjà présent dans la cinéphilie de la première génération expérimentale (« agir sur la pellicule même, grattée, trouée, striée, maculée de peinture cellulosique, rayée ou brûlée, ou chez d’autres artistes, […] retravailler le film numériquement[xxvi] »), ou même sans image (comme dans le cinéma « structurel » de Tony Conrad où il n’y a parfois que des clignotements) ou sans histoire ressemblant de près ou de loin à la réalité du consommateur de masse (comme le « film de transe » qui montre une expérience subjective, dans un monde ressemblant au rêve sans que le film rende explicite qu’il s’agisse d’un rêve)[xxvii]. Le respect d’une certaine éthique au cinéma passe désormais parfois par un cinéma qui choque, car il s’attaque à la morale des films ou de la société (pensons au « cinéma du corps » et à ses scènes de violence et de sang, ou encore aux scènes érotiques mêlant violence et fluides corporels d’un Kenneth Anger), et ce, de manière souvent trop excessive pour être recevable pour le consommateur moyen habitué en plus à une éthique du cinéma fortement teintée par la religion chrétienne. En général aussi, la séparation entre le cinéma et la grande production capitaliste — qu’elle soit revendiquée dans la théorie et la critique, ou qu’elle soit actée par la production dans d’autres circuits — s’accompagne d’une prétention à une supériorité morale ou éthique selon Jullier et Leveratto[xxviii]. La conception du cinéma comme création personnelle du cinéaste passe désormais notamment par ceci que les cinéastes du cinéma underground « se veulent uniquement cinéastes et expriment [par leur film et leur activité de cinéaste] leur moi profond (ils jouent eux-mêmes dans leurs films) plutôt que les préceptes d’une école [comme c’était le cas dans l’avant-garde européenne][xxix] ». Aussi, il est intéressant de remarquer que, si la cinéphilie savante se distingue des cinéphiles de la masse, elle admet les mêmes présupposés que cette dernière. Pour faire cela, elle a besoin au surplus d’appliquer ces présupposés sur des objets culturels de masse, par exemple dans sa théorie ou sa critique. Autrement dit, elle a besoin de regarder et commenter les films regardés par la masse, au contraire de la cinéphilie expérimentale de la première génération qui rejetait le cinéma dominant d’un bloc[xxx]. Elle s’adresse à tout le monde comme le faisaient les critiques professionnels, mais pour dire à tout ce monde qu’il ne vaut pas la peine qu’elle lui parle, tant il est incompétent[xxxi].


En bref, la cinéphilie savante développe un postulat fondamental, socio-politique et esthétique, d’autonomie du cinéma, postulat conditionné par l’autonomie matérielle partielle que la petite-bourgeoisie intellectuelle acquiert face soit au marché pour la petite-bourgeoisie qui lui était intégrée dans les années 20-30, soit au milieu de l’art moderniste pour les expérimentaux des mêmes années, en intégrant l’Université et les institutions publiques. Les deux postures contradictoires fondamentales de la deuxième cinéphilie dominante, l’une socio-politique et l’autre esthétique, trouvent leur unité, leur cohérence dans une même distinction de classe et par une revendication d’autonomie. Cette autonomie partielle la place dans une situation de dépendance en même temps que d’indépendance matérielle face à toutes celles-ci, ce qui l’oblige à s’intéresser au cinéma de masse. Elle reprend donc les présupposés de la cinéphilie de masse, mais de manière à mépriser la capacité de jugement cinématographique des classes inférieures et moyennes qui partagent cette cinéphilie de masse. Du même souffle, elle veut critiquer la capacité de production cinématographique des classes supérieures qui produisent le cinéma de masse. Toutes ces classes seraient les prisonniers et/ou les défenseurs du « conservatisme » de la forme cinématographique (esthétique) et de la société (socio-politique).
La deuxième génération du cinéma expérimental : sa classe et sa cinéphilie
Le cinéma expérimental de deuxième génération, quant à lui, se développe selon moi à partir de la cinéphilie savante, si bien qu’on ne peut pas lui reconnaître de cinéphilie propre, distincte. Les théoriciens et pratiquants expérimentaux n’« adoptent » pas ni ne « créent » à eux seuls la cinéphilie savante : ils la développent en même temps que les cinéastes, théoriciens et chercheurs du cinéma intégrés au milieu universitaire, dans les deux décennies de l’après-guerre, à cause donc d’une même base matérielle d’existence. En effet, « l’institutionnalisation de l’expertise cinématographique », ou autrement dit le développement de la cinéphilie savante, se produit en même temps que l’institutionnalisation du cinéma expérimental. Comme mentionné précédemment, c’est bien aux États-Unis, pays particulièrement précoce à intégrer le cinéma dans la recherche universitaire, que le cinéma expérimental de deuxième génération naît. En fait, le passage par l’Université deviendra désormais au cours des deux décennies d’après-guerre chose de plus en plus fréquente, avant d’être un passage presque obligé, pour les individus et courants expérimentaux ; soit en début de carrière pour jouer le rôle d’innovation, soit en fin de carrière pour jouer le rôle de passeur aux nouvelles générations. En effet, le milieu universitaire avait été le lieu dans les années 20-30 de « vives réserves formulées par les cinéastes et théoriciens de gauche [particulièrement intéressés par le cinéma et y œuvrant en tant que critiques, historiens et cinéastes] ([Sergueï] Eisenstein, [Léon] Moussinac, [Béla] Balázs, Walter Benjamin) quant à l’existence d’un cinéma indépendant en régime capitaliste[xxxii] ». Désormais, entre nombreux autres, Hans Richter, passeur par excellence entre les avant-gardes européenne et américaine, enseigne au Film Institut du City College de New York, de 1942 à 1957[xxxiii]. De même, le théoricien P. Adams Sitney « met au point, au cours des années 1960 et 1970, toute une typologie [ici : étude des types de film] visant à créer un corpus linguistique spécifique au cinéma expérimental », et un de ses articles, Film Culture (1969), influencera grandement le courant dit « structurel » du cinéma expérimental[xxxiv].

À la place d’énumérer les individus et petits groupes intégrés à l’Université, une manière de révéler le rôle fondamental de l’institutionnalisation dans le cinéma expérimental de deuxième génération est d’expliquer le développement d’une unité cinéphilique dans ce cinéma. Les facteurs matériels suivants, provenant de l’intégration à l’Université et aux institutions publiques, détermineront leur unité cinéphilique : l’intégration à des lieux d’activité similaires entre les penseurs et pratiquants du cinéma expérimental, ainsi que les moyens matériels stables que leur donneront les organisations nommées. Dans la dimension intellectuelle, la cinéphilie dominante qui domine ces organisations sera adoptée par le cinéma expérimental. Par exemple, après 1969, dans l’underground, « un extraordinaire foisonnement d’écritures voit le jour » ; cette tendance à la théorisation de la pratique de cinéaste, laissant paraître une approche scientifique conditionnée par l’Université, dépasse largement celle de la première génération expérimentale (et ses quelques manifestes et « hypothèses esthétiques ») et sera typique désormais du cinéma expérimental (de ses théoriciens évidemment, mais aussi de ses pratiquants)[xxxv]. Plus généralement, Barbara Turquier affirme en effet que le cinéma expérimental de deuxième génération est conditionné par l’Université : à la fin des années 60, « la marge du cinéma expérimental [en résumé, ceux de l’underground, qui sera le premier terme de ralliement de la seconde génération expérimentale] s’est imposée au sein de structures institutionnelles telles le musée ou l’université, de sorte que la question des conventions liées aux attentes de ces structures [institutionnelles, le musée ou l’Université,] se pose avec acuité[xxxvi] ». Les théoriciens et cinéastes expérimentaux acceptent d’ailleurs si bien les conventions universitaires qu’à la dissolution de l’underground après le cinéma structurel, en fin 1970, les « principaux cinéastes du mouvement sont reconnus [au sens où ils sont reconnus dans l’Université] : ils enseignent et ont accès à des bourses pour réaliser quelques projets[xxxvii] ». Autrement dit, en s’intégrant à l’Université, la petite-bourgeoisie intellectuelle expérimentale s’approprie des pratiques universitaires qui lui serviront à assurer son unité et la continuité dans le temps de son objet culturel : l’enseignement aux prochaines générations, la théorie qui donne une compréhension commune au sujet collectif de l’objet culturel qu’il produit, la fabrication de films dans le cadre de l’Université avec tout ce que cela a pu impliquer de compromis (qu’on a vus à travers les changements entre la première cinéphilie expérimentale et la deuxième cinéphilie dominante à laquelle les expérimentaux adhèrent). Cette intégration générale des différentes générations du cinéma de l’avant-garde américaine (« les “anciens” comme Kenneth Anger, James Broughton, Gregory Markopoulos, Bruce Conner, Jonas Mekas, Stan Brakhage [, etc.] et des nouveaux venus, comme Hollis Frampton, Ernie Gehr, Ken Jacobs, George Landow, Michael Snow, Andy Warhol ») à l’Université et à d’autres institutions publiques (musée, etc.) en vient à son terme. Dans les années 60, le cinéma expérimental de deuxième génération trouve une forme d’unité qu’il a relativement conservée depuis[xxxviii]. Un processus semblable en Europe, bien que décalé dans le temps, s’est sans doute passé : les conditions matérielles (des expérimentaux et de la cinéphilie dominante) entre les deux régions étaient semblables (les conditions d’accès des classes sociales à l’Université et l’entrée du cinéma dans la recherche scientifique, par exemple) comme nous l’avons dit ; et la cinéphilie des expérimentaux qui en a découlé en Europe ressemble aujourd’hui à la cinéphilie des expérimentaux aux États-Unis.
L’unité expérimentale de deuxième génération, obtenue décidément vers la fin des années 1960 grâce à l’intégration des différentes générations aux institutions universitaire et publique,se fera dans un premier temps autour du terme underground qui ne doit cependant pas être considéré comme un courant cinématographique au sens propre : « [il] ne marque pas la naissance d’une nouvelle avant-garde, mais sa généralisation ; les pratiques artistiques y sont des plus disparates, et c’est plutôt cette hétérodoxie qui le caractérise, comme, d’ailleurs, tout le cinéma expérimental à venir.[xxxix] » Autrement dit, cette unité se fait sur la centralité de l’œuvre individuelle autonome du cinéaste, en accord avec la cinéphilie savante : le temps du développement collectif par courants artistiques ou cinématographiques est révolu. Cela s’explique selon moi par la nouvelle habitude de la petite-bourgeoisie expérimentale de passer par l’Université, habitude acquise en fin 70, Université qui permet sans doute aux cinéastes et théoriciens expérimentaux (et non expérimentaux) de gagner un certain contrôle sur leurs films et leur cinéphilie, sans passer par l’affiliation à un courant d’art moderniste comme le faisaient les avant-gardes européennes, ou encore à un des grands groupes expérimentaux des années 40 à 70 (films de transe, new American Cinema, underground, et film structurel, selon Bassan). En fait, ce n’est qu’après cette autonomisation que, selon Raphaël Bassan, la vision et la pratique dites « évolutives » du cinéma expérimental prennent fin, et que ce dernier prend un tournant de recherche esthétique individuelle qui est encore le sien aujourd’hui : « l’affiliation aux courants est remplacée au profit d’individualités et de groupes singuliers qui expérimentent toutes les pratiques[xl] ».
Nous avons vu que le cinéma expérimental est dans sa deuxième génération encore une fois produit socialement par la petite-bourgeoisie intellectuelle, classe qui entre à l’Université et dans les institutions publiques entre 45 et 65, sans épargner les expérimentaux. Or, cette intégration a offert des lieux d’activité similaires et des moyens matériels stables, et a poussé les expérimentaux à adopter des pratiques universitaires (enseignement, théorie, fabrication de films avec du financement obtenu par l’Université, etc.), toutes des conditions matériellesqui leur ont permis d’obtenir une unité de cinéphilie au bout du processus d’intégration vers 70. Cette cinéphilie est fondamentalement la même que la deuxième cinéphilie dominante, elle-même portée par la petite-bourgeoisie intellectuelle dans les organisations nommées. En effet, la cinéphilie du cinéma expérimental de deuxième génération trouve son unité cinéphilique dans la valorisation de la multiplicité des pratiques choisies par l’artiste autonome individuel, et non par des groupes ou familles esthétiques rigides. Et ce postulat fondamental est le même que celui de la cinéphilie dominante : l’autonomie socio-politique et esthétique du cinéma. On ne peut donc pas parler d’une cinéphilie propre au cinéma expérimental de deuxième génération.
Le cinéma expérimental est l’expression cohérente du cinéma de la petite-bourgeoisie intellectuelle
Un problème reste : si la cinéphilie de la deuxième génération du cinéma expérimental est essentiellement la même que la deuxième cinéphilie dominante, pourquoi la catégorie de cinéma expérimental reste-t-elle si importante, débattue, revendiquée encore aujourd’hui (repensons aux ouvrages récents de définition du cinéma expérimental) ? Pour comprendre, il faut selon moi tenter d’expliquer la ressemblance partielle, non pas des présupposés, mais bien du processus de distinction sociale et de l’aspiration à l’autonomie, entre la cinéphilie de la première avant-garde (européenne) et cette cinéphilie savante ou deuxième cinéphilie dominante. En général, il faut déterminer ce qui fait la particularité du cinéma expérimental dans l’expression cinématographique des aspirations de toute la petite-bourgeoisie intellectuelle.
D’une part, le processus de distinction sociale qui fut celui des petits-bourgeois intellectuels du cinéma expérimental de première génération, par rapport aux classes travailleuses et aux classes moyennes et supérieures intégrées au marché du cinéma, est de nature semblable à celui qu’opère la petite-bourgeoisie à l’Université. En effet, ces deux distinctions sociales ont été effectuées par la petite-bourgeoisie intellectuelle : dans le premier cas, la fraction non intégrée au marché et pratiquant dans les milieux de l’art moderniste, alors que les intellectuels des années 20 et la critique professionnelle ont été intégrés au marché et ont adopté la cinéphilie de masse ; dans le second cas, la fraction intégrée à l’Université et aux institutions publiques, ce qui ne représente évidemment pas toute la petite-bourgeoisie. Ces deux situations particulières — qui ont mené chacune à la formation d’une cinéphilie par la petite-bourgeoisie — expliquent le commun mépris pour la cinéphilie de masse entre ces cinéphilies, venant d’une même position intermédiaire entre la bourgeoisie et le prolétariat ; mais aussi la différence dans la manière de mépriser et d’autonomiser la cinéphilie petite-bourgeoise, qui provient de la différence entre les deux situations particulières que sont les milieux de l’art moderniste dépendant de mécènes, et l’Université et l’État. La cinéphilie savante, pour se distinguer de la cinéphilie de masse, utilise une stratégie de reprise des présupposés de la cinéphilie de masse. Cette stratégie répond à la situation concrète du sujet collectif qui produit cette cinéphilie : intégré dans l’État et l’Université et donc dépendant de ceux-ci, et provenant de classes qui partageaient la cinéphilie de masse, le lien de ce sujet collectif avec la société et donc sa cinéphilie dominante est plus solide que celui de la première génération, ce qui fait qu’il façonnera sa cinéphilie à partir de la dominante ; mais sa situation est aussi celle d’une certaine autonomie intellectuelle permise par sa position, donc sa cinéphilie sera un moyen pour elle d’exprimer et de renforcer son autonomie vis-à-vis des autres classes partageant la cinéphilie de masse. Quant à elle, la première génération, non intégrée au marché, à l’Université et à l’État, mais dépendante des milieux artistiques petits-bourgeois et de mécènes, donc beaucoup moins liée matériellement à la cinéphilie de masse, ne reprend pas ses présupposés, ne fait que s’y opposer, se rendre incompréhensible pour les classes qui la partagent. En même temps, elle développe sa cinéphilie en adéquation avec les présupposés de l’art moderniste, principalement en rejetant la fiction au profit de l’abstraction. Ceci l’amène à ne pas utiliser de personnages vivant des émotions et auxquels on peut s’identifier (dans une histoire ayant au moins une apparence de réalité)… bref à rejeter tous les présupposés de la cinéphilie de masse. Elle revendique le cinéma comme art et comme art moderne. La différence entre les situations matérielles des deux générations à partir desquelles chacune effectue son processus de distinction débouche donc sur deux différences cinéphiliques majeures : la propension de la cinéphilie savante à la politique et à la critique des films de masse (pour les critiquer évidemment et ainsi se distinguer, comme déjà dit). On a déjà compris que la première découlait du postulat fondamental d’autonomie socio-politique et esthétique du cinéma, qui était lui-même l’expression de l’autonomie et du contrôle pris sur sa cinéphilie par la petite-bourgeoisie intellectuelle ; alors que celle intégrée au marché dans les années 20-30 dépendait de ce marché, et que celle expérimentale de première génération dépendait des mécènes et des milieux de l’art moderniste. La seconde différence majeure, que j’ai déjà expliquée par la dépendance-autonomie de la petite-bourgeoisie intellectuelle intégrée aux institutions face au reste de la société, ne doit pas être négligée. En fait, tout un pan des expérimentaux de la deuxième génération d’avant-garde s’intéresse dans ses films et théorisations au cinéma de masse, jusqu’à aujourd’hui, souvent en utilisant ce matériau pour le détourner, ce qui relève de la distinction sociale à même le cinéma de masse. Ces pratiques se retrouvaient dans des cas isolés de la génération 20-30, par des surréalistes : « [Bruce] Conner [cinéaste de la deuxième génération] […] se réfère à la culture populaire, illégitime (comme jadis les surréalistes et plus tard Jack Smith, Andy Warhol et Kennet Anger [tous des cinéastes de la deuxième génération] avec Scorpio Rising, 1963)[xli] ». Par exemple, l’intérêt pour le cinéma de masse se voit dans l’insertion théorique du cinéma expérimental dans toute l’histoire du cinéma (dont le cinéma de masse donc) par le courant expérimental lettriste, notamment dans le texte de l’influent Isidore Isou ; et ce, toujours pour distinguer le cinéma expérimental (ici dans son courant lettriste), dans ce cas comme l’étape supérieure du cinéma[xlii]. On peut enfin percevoir cet intérêt pour le cinéma de masse dans la pratique du found footage du cinéma expérimental dans les années 70 puis 90, qui réutilise des images et plans d’autres films pour en faire de nouveaux[xliii] ; ou encore, dans les années 2010, la réutilisation de « films, d’actualités — guerres, cataclysmes, tragédies humaines, mises à mort — » piochés sur Internet (Youtube, Vimeo, les différents médias) pour en faire des dystopies critiquant les médias de masse[xliv].

D’autre part, la relative différence entre les deux processus de distinction sociale ne signifie pas que ce ne puisse pas être le même sujet collectif à la source des deux cinéphilies et des deux distinctions. Autrement dit, selon moi, la contradiction cinéphilique et productive entre les petits-bourgeois intellectuels intégrés au marché et ceux qui ne l’étaient pas, pendant la période de la première génération expérimentale, ne signifie pas que le cinéma expérimental ne puisse pas être l’objet culturel de l’ensemble de la classe et aux différentes époques. Prenons le cas de la première génération expérimentale. On a vu qu’il y avait eu une distinction de celle-ci par rapport aux classes participant à la cinéphilie de masse, dont la petite-bourgeoisie intégrée au marché. La cinéphilie de masse est celle de plusieurs classes, elle ne réalise pas de distinction sociale par le cinéma : si la petite-bourgeoisie intégrée au marché affirme que le cinéma a une valeur supplémentaire au profit de la classe capitaliste qui produit du cinéma, cette petite-bourgeoisie reste totalement dépendante de la vente des journaux et revues de cinéma (entre autres médias) aux consommateurs majoritairement travailleurs, et publicise les films produits par la grande entreprise capitaliste dont elle est donc dépendante. La place pour son autonomie est en somme faible. À ce moment, la cinéphilie expérimentale exprime une aspiration à l’autonomie intellectuelle et une distinction de classe intermédiaire, même si elle reste dépendante des milieux de l’art moderniste et de mécènes. L’autonomie des deux petites-bourgeoisies intellectuelles est partielle, mais on voit bien que celle du cinéma expérimental est plus grande par sa situation spécifique ; en conséquence, l’expression, par les films et les écrits, de son désir d’autonomie, est beaucoup plus manifeste, culminant à l’idée de coopératives au Congrès de 1929. Dès cette époque, la cinéphilie du cinéma expérimental est déjà celle de la couche la plus consciente de la classe petite-bourgeoise intellectuelle : elle effectue déjà une distinction sociale, et pense déjà une recherche d’autonomie, alors que la couche intégrée au marché doit s’y plier pour faire carrière. Prenons maintenant le cas de la deuxième génération. Depuis l’avènement de la cinéphilie savante, la différence de pratique au sens large du cinéma, entre ceux des individus de la petite-bourgeoisie intellectuelle (intégrée à l’Université et à l’État) qui sont non expérimentaux, et ceux qui sont expérimentaux, n’en est, comme nous l’avons vu, désormais plus fondamentalement une de cinéphilie (alors qu’il y avait une différence de cinéphilie entre les expérimentaux et la critique professionnelle des années 30), de conception idéelle du cinéma. Selon moi, elle en sera surtout une de production au sens de fabrication et de distribution du cinéma : les individus qui ont revendiqué le cinéma expérimental, ou alors ceux que l’histoire du cinéma a retenus comme en faisant partie, se démarqueront généralement par une certaine tension vers l’autonomie de leur production du cinéma par rapport non plus seulement au marché, mais à l’État et à l’Université, en ce qui a trait à la fabrication et à la distribution des films. En effet, il ne faut pas passer sous silence le rôle, conjoint à celui des universités et institutions étatiques, de l’organisation de la production sociale des films de manière autonome vis-à-vis du grand capital producteur de cinéma, dont se dotera la petite-bourgeoisie du cinéma expérimental dans la lignée des projets promulgués par les congressistes de 1929 en Europe. En fait, à la fin de la période d’intégration du cinéma expérimental à l’Université et à l’État, vers 1965-1970, une multitude de coopératives, de collectifs de distribution et/ou de production, de festivals (qui assurent la distribution des films) et de manifestations (au sens large de présentations ou rassemblements publics, lieux par exemple d’un spectacle ou de projection de films) sont fondés et organisés[xlv]. Ils suivent l’exemple fameux de la « révolution [qui] se produit dans l’arène cinématographique underground lorsque le 18 janvier 1962 est fondée, à New York, par Jonas Mekas et ses proches, la Film Makers’ Cooperative, association de diffusion à but non lucratif, qui permet aux cinéastes expérimentaux de projeter leurs œuvres en dehors des circuits commerciaux et des grandes manifestations d’arts plastiques.[xlvi] » Raphaël Bassan parle alors du début de la formation d’une véritable « microsociété de cinéastes, de critiques, de théoriciens, d’enseignants », tendance qui durera au-delà de la décennie 60, dans les décennies 70 et 80 et jusqu’à aujourd’hui :
Le modèle américain [de la coopérative] fait tache d’huile : la London Film-Makers’ Co-op est fondée en 1966, suivie par l’Austrian Filmmakers Cooperative à Vienne (1968), le Collectif Jeune Cinéma (CJC) à Paris (1971), le Canadian Filmmakers Distribution Centre à Toronto (1972). Le festival international de Knokke-le-Zoute (Belgique) popularise à travers toute l’Europe, dans ses éditions de 1963 et 1967, le cinéma underground. Sa tâche est facilitée par les tournées préfestivalières que Jonas Mekas et P. Adams Sitney font régulièrement sur le Vieux Continent, avec un large échantillon d’œuvres de leurs amis. La manifestation Avant-Garde pop et beatnik, conçue par Sitney, qui se tint à l’automne de 1967 à la Cinémathèque française, marque durablement les cinéastes et les critiques français, intrigués et séduits par le cinéma underground. En France, le festival d’Hyères devient, de 1971 à 1983, une importante vitrine du cinéma expérimental. Sa section « Cinéma différent », gérée par Marcel Mazé, cofondateur et premier président du Collectif Jeune Cinéma, accueille des cinéastes venus de tous les pays. Deux autres coopératives se créent en France : la Paris Films Coop., en 1974, et Light Cone, en 1982. Cette dernière, sous la responsabilité du cinéaste Yann Beauvais, son cofondateur, donne au cinéma expérimental français et international une visibilité qui en accroît sa reconnaissance.[xlvii]
On pourrait voir selon moi une autre expression de cette tension vers l’autonomie dans le mouvement des laboratoires, mouvement dont il faudrait faire une étude plus approfondie bien sûr pour en connaître les conditions précises d’émergence : « Au mouvement des coopératives des années 1970 et 1980 succède celui des laboratoires [dans les décennies 1990 et 2000 surtout] qui permet enfin aux cinéastes de contrôler toutes les étapes de la fabrication d’un film.[xlviii] » Cette organisation autonome de la production des films réalise des objectifs nés de la tension aussi présente chez l’avant-garde européenne, laquelle avait ses revues, mais n’avait pas les moyens autonomes de produire des films en grand nombre. Cette dernière dépendait surtout de ses mécènes, et ses films demandaient très peu de financement, entre autres en raison de leur abstraction. Quand elle commence à penser aux solutions à ce besoin d’autonomie, les nouveaux besoins du film parlant faisaient déjà ralentir sa production de films. Selon moi, on peut expliquer cette organisation autonome de la production de films par ceci que la relative autonomie qu’autorisent l’Université et les institutions publiques (musées, etc.) n’est pas toujours suffisante pour une partie, une couche de la petite

La voix des femmes : semons la résistance à l’agriculture industrielle

Bien qu'elles représentent près de la moitié de la main-d'œuvre agricole mondiale, les femmes possèdent moins de 15% des terres agricoles et sont rémunérées près de 20% de moins que leurs homologues masculins. Ces disparités ne sont pas de simples statistiques : elles reflètent des expériences vécues qui déterminent les luttes quotidiennes des femmes rurales. Partout dans le monde, les petites productrices alimentaires affrontent une réalité difficile. Qu'il s'agisse de l'accès à la terre, des politiques publiques, des conditions de travail ou du pouvoir décisionnel, les femmes se heurtent à des obstacles systémiques qui perpétuent les inégalités sociales.
Tiré de Entre les lignes et les mots
À mesure que l'agriculture dominée par les grandes entreprises s'étend, les pratiques agricoles traditionnelles sont de plus en plus évincées, exacerbant ainsi les vulnérabilités des communautés rurales. Les femmes, déjà marginalisées, subissent de plein fouet ces changements. Elles prennent soin de leurs familles et de leurs communautés, mais remplacent aussi leurs partenaires masculins quand ces derniers émigrent pour trouver du travail. Et ce sont également elles qui assurent la survie des personnes âgées et des enfants. Leur bien-être n'est pas qu'un enjeu personnel : c'est toute la résilience rurale qui en dépend.
Pourtant, les contributions et les luttes des femmes restent souvent invisibles, tout comme les préjudices spécifiques qu'elles subissent en raison de l'agriculture industrielle.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Aux indifférentes

Ce texte est destiné à interpeller toutes les femmes qui croient que mettre négligemment une croix dans un carré d'extrême-droite [au Portugal on a un seul bulletin de vote et on doit cocher le carré correspondant à la liste que l'on a choisie] n'a rien à voir avec leurs droits fondamentaux.
Tiré de Entre les lignes et les mots
Gramsci, dans un texte de 1917, proclamait sa haine de l'indifférence, « poids mort de l'histoire », de la passivité et de l'absentéisme qui, de toute façon, agissent sur le monde. Ce texte s'adresse aux indifférentes. Non pas avec haine, mais avec une profonde inquiétude, espérant obstinément qu'une part de cette indifférence individualiste puisse encore se transformer en empathie et en solidarité. Ce texte interpelle toutes les femmes qui pensent que tout cela ne les concerne pas et qui considèrent qu'une croix apposée négligemment sur un bulletin de vote n'a rien à voir avec leurs droits fondamentaux.
L'extrême droite commence par nos corps, nos droits, notre liberté. Cette affirmation peut paraître déplacée, étant donné que tant de mouvements d'extrême droite contemporains sont dirigés par des femmes ou comptent des femmes parmi ses dirigeants. Permettez-moi de commencer par dire ceci : aucun fasciste n'est féministe. Il n'y a rien de progressiste dans le triomphe électoral de quelqu'un qui aspire à un monde dont on pensait que la page était définitivement tournée. Derrière le visage d'une femme – que l'on pourrait même comparer à Jeanne d'Arc ou à la République française elle-même, comme c'est le cas de la tristement célèbre Marine Le Pen – se cachent parfois les plus sinistres machinations misogynes et vengeresses. Le vote en faveur d'une femme d'extrême droite, avec toutes les explications qui pourraient inciter différents types de femmes à voter, représente l'acceptation tacite de la vague de régression, presque comme un accord à la suppression de nos droits, à condition que ces mesures punissent davantage celles qui sont encore plus faibles que nous.
Voyons maintenant ce que l'extrême droite nous fait subir. Le Rassemblement national de Le Pen a systématiquement voté contre les avancées et les progrès en matière de droits des femmes : en matière d'égalité salariale, de lutte contre le harcèlement et les violences sexistes, et contre la parité. Giorgia Meloni, cette « girlboss » fasciste, s'oppose aux quotas de genre, renforce le rôle des mère des femmes dans ses discours publics, a voulu restreindre le droit à l'avortement et pénaliser celles qui y ont recours, et même empêcher les couples lesbiens d'avoir des enfants ensemble. En Allemagne, Alice Wiedel – peut-être l'incarnation même de cette dissonance cognitive des femmes au sein de l'extrême droite contemporaine – dirige un parti qui défend la « famille traditionnelle », attaque « l'idéologie du genre », s'oppose au mariage homosexuel et prône le retour des femmes à « l'ancien temps », loin de la corruption du féminisme. Toutes, tout en attaquant les droits des femmes, prétendent vouloir protéger les femmes européennes – autrement dit, les femmes blanches – des hommes racisés, des migrants qui viennent les harceler et les violer, malgré l'absence de corrélation statistique entre les deux réalités. Nous avons ici un parti qui leur ressemble beaucoup : contre « l'idéologie du genre », antiféministe et qui utilise nos corps comme justification à ses politiques xénophobes.
Est-ce que je dis quelque chose qui vous concerne ? Peut-être que cela vous laisse indifférente, que cela ne vous concerne pas, après tout. Votre vie va bien. Vous pensez peut-être que cela ne vous concerne pas parce que vous n'avez jamais avorté ? Parce que vous avez un bon salaire ? Parce que vous n'avez jamais été agressée par votre partenaire ? Parce que vous pouvez voter et participer à la vie politique ? Parce que vous n'avez jamais ressenti de discrimination ? Parce que votre mari vous aide même à la maison ? Peut-être même dites-vous que vous n'êtes pas féministes ? Vous vous trompez.
Si vous avez pu envisager de ne pas avorter, c'est parce que la contraception est devenue accessible à toutes et qu'elle vous permet de choisir d'être mère ou non. Si vous avez un bon salaire, c'est parce que des milliers de femmes se sont battues pour avoir simplement le droit d'avoir quelque chose à soi (c'était le bon temps quand nos économies appartenaient au mari, non ?), pour être admises à l'université et à des emplois qualifiés, et pour ne pas subir de discrimination salariale. Si vous n'avez jamais subi de violences psychologiques, sexuelles ou physiques de la part de votre partenaire, vous avez de la chance d'échapper au poids des statistiques sur la violence, mais vous savez certainement que si vous êtes agressée, votre agresseur aura commis un crime public et qu'il est du devoir de chacun de le signaler.
Si vous pouvez voter et être politiquement actives, c'est parce que des milliers de femmes dans le monde entier ont renoncé à une vie d'indifférence fataliste et se sont battues – parfois jusqu'à la mort – pour qu'aujourd'hui vous puissiez choisir qui vous voulez pour vous gouverner et même vous gouverner vous-même Si vous pensez n'avoir jamais été victime de discrimination, je peux vous dire que vous êtes l'exception à la règle : un tiers des femmes dans l'UE ont été victimes de harcèlement au travail, la moitié l'ont été à un moment de leur vie, vingt-cinq femmes ont été assassinées au Portugal par leur partenaire, 32% des femmes dans l'UE ont subi des violences conjugales, les viols ont augmenté de 10% au Portugal l'année dernière et, surtout, nous savons que tous ces chiffres sont largement sous-représentés car la plupart de ces crimes ne sont pas signalés. Si vous n'avez jamais été victime, demandez-vous si aucune de vos amies, membres de votre famille ou connaissances n'en a été victime. Si vous pensez qu'il suffit que Manuel aide à la maison, comme si cette tâche vous incombait et qu'il daigne gentiment mettre vos vêtements dans le panier à linge, détrompez-vous. Si vous ne vous sentez pas dépassée par les doubles, voire triples, tâches ménagères et familiales, sachez qu'en moyenne, les femmes effectuent 74% de ce travail au Portugal. Votre père changeait-il les couches ? Votre grand-père cuisinait-il ? Qu'est-ce que ta mère et tes grands-mères ont arrêté de faire pour que tu puisses grandir ?
Si tout cela vous dérange – j'imagine que ce lecteur a de l'empathie – vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas féministe. Tout ce qui a changé a été fait par des féministes. Avec le plus grand sérieux, sans crainte d'être qualifiées d'hystériques, de prostituées, de frigides, d'ennuyeuses. Elles ont fait ça pour nous. Ne donnez pas votre vote à ceux qui veulent tout défaire. Ne soyez pas indifférentes.
Je vis, je suis un militant – disait Gramsci à la fin du texte précité. Ne soyons ni dupes ni complaisants. J'ajoute : je vis, je suis féministe.
Léonor Rosas
Diplômée en sciences politiques et relations internationales de la NOVA-FCSH. Étudiante en master d'anthropologie sur le colonialisme, la mémoire et l'espace public à la FCSH. Députée du Bloc de gauche au Parlement de Lisbonne. Étudiante et militante féministe.
Article publié dans Gerador le 28 mai 2025
Communiqué par FP et JJM
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Contrôle de l’âge pour les sites pornos : quand le « business » passe avant la protection des enfants.

Alors que la France s'apprête enfin, le 6 juin 2025, à mettre en œuvre la loi SREN du 21 mai 2024 imposant un contrôle effectif de l'âge pour accéder aux sites pornographiques, le géant Aylo, propriétaire de Pornhub, RedTube et YouPorn, décide de rendre ses plateformes inaccessibles depuis le territoire français et d'afficher en page d'accueil un texte de lobbying s'opposant à cette loi. Un « coup de com » visant à devancer le blocage imminent que pourrait ordonner l'ARCOM.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/06/08/controle-de-lage-pour-les-sites-pornos-quand-le-business-passe-avant-la-protection-des-enfants/?jetpack_skip_subscription_popup
Depuis plus de quatre ans, l'industrie pornographique multiplie les recours dilatoires contre une loi aux visées pourtant claires : empêcher les enfants d'être exposés à des contenus violents, sexistes, racistes, dégradants et souvent illégaux. Pourquoi une telle résistance de la part de l'industrie ?
Tout simplement car le cœur du modèle économique de cette industrie repose sur l'exposition massive des mineur·es à la pornographie.
Une stratégie cynique : accrocher les enfants, fidéliser les clients
Durant l'enfance et l'adolescence, le cerveau est en pleine construction. Ainsi, l'exposition précoce à des contenus sexuels violents modifie durablement les repères affectifs, émotionnels, empathiques. Plus l'exposition est prématurée, plus la dépendance est profonde et durable. Comme l'a rappelé le Haut Conseil à l'Égalité dans son rapport Pornocriminalité (2023), l'exposition des enfants à la pornographie « développe le système limbique, responsable des pulsions, et inhibe le développement du cortex préfrontal, siège de l'empathie et du discernement ». Ce visionnage à un jeune âge constitue un véritable « viol psychique » selon la chercheuse en neurosciences Maria Hernandez. Il influence profondément la construction des sexualités, en les imprégnant de rapports de domination virilistes, de racisme et de misogynie, renforce l'adhésion à la culture du viol, accroit le risque de passages à l'acte violents.
Les mineur·es sont une cible stratégique pour l'industrie, car un enfant accro à la pornographie devient un adulte captif.
Protéger les mineur·es de la pornographie est aussi un enjeu de lutte contre l'inceste et la pédocriminalité. Outre le fait que ces plateformes abritent de la pédopornographie, très souvent des vidéos de violences diffusées par les pédocriminels, la pornographie est également utilisée dans la stratégie des agresseurs pour semer la confusion, inverser la honte et la culpabilité, et sidérer les victimes ciblées. Les survivant·es de pédocriminalité voient l'irruption dans leur psychisme de scripts pornographiques dans ce qu'ils ont de plus oppressifs, discriminants, chosifiants, et peuvent par le visionnage compulsif et anxieux de pornographie se retrouver dans un état d'anésthésie émotionnelle dissociative, qui profite aux agresseurs.
Assez d'hypocrisie : la loi est claire, les moyens existent
Depuis 2020, la loi française oblige les éditeurs de sites pornographiques à mettre en place un véritable contrôle de l'âge de leurs utilisateurs et utilisatrices. Le cadre juridique est complet : le décret d'application est en vigueur, un référentiel technique a été publié, et la CNIL a validé plusieurs solutions respectueuses du RGPD, notamment la vérification par un tiers de confiance, l'utilisation de la carte bancaire ou encore l'analyse faciale sans recours à la reconnaissance biométrique. Les moyens existent.
Alors comment expliquer qu'une industrie aux moyens colossaux, habituellement en tête des innovations majeures de la tech (paiement en ligne, streaming vidéo, VR, IA, robotique), serait incapable de développer un simple système de vérification d'âge ? La réponse est simple : elle ne veut pas.
Un tournant juridique historique
Le 6 juin, l'ARCOM pourra bloquer sans passer par un juge les sites qui refusent d'appliquer la loi. Le blocage volontaire des sites Pornhub, YouPorn et RedTube en France révèle ce que l'industrie pornographique tente depuis des années de dissimuler : son refus obstiné de toute régulation, même minimale, pour protéger les mineur·es. Cette industrie multimilliardaire préfère mobiliser ses ressources pour combattre toute tentative de régulation, à grand renfort d'avocats et de lobbyistes, plutôt que de renoncer à un accès inconditionnel et gratuit qui alimente son modèle économique fondé sur la violence et sur l'érotisation de toutes les oppressions. Face à cela, l'application stricte de la loi et la mobilisation collective sont essentielles. Le contrôle de l'âge sur les sites pornographiques est un impératif de santé publique, de protection de l'enfance et d'égalité entre les sexes, qui doit primer sur les profits de l'industrie pornocriminelle.
Osez le Féminisme appelle à :
– Appliquer sans délai les mesures de contrôle d'âge sur tous les sites pornographiques accessibles depuis la France.
– Renforcer la coopération européenne pour sortir la pornographie de la zone de non-droit numérique.
– Reconnaître les dommages causés aux enfants, aux femmes et à toute la société par la pornographie et agir en conséquence.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Pénalisation des agentes de la Fonction publique pendant la grossesse, une attaque inacceptable

La baisse de la rémunération dès le deuxième jour d'arrêt maladie rend coupable tous les agents et agentes d'être malades : elle est intrinsèquement injuste et nous continuons de la dénoncer. Mais, au XXIe siècle, rien ne peut justifier qu'un gouvernement, prétendument attaché à l'égalité entre les femmes et les hommes, puisse faire peser sur les agentes enceintes une sanction financière injuste sans tenir compte des réalités médicales, sociales ou professionnelles liées à leur grossesse.
Tiré du site de la CGT
Bagnolet, vendredi 6 juin 2025
Monsieur François Bayrou
Premier ministre
Madame Aurore Bergé
Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations
Monsieur Laurent Marcangeli
Ministre de l'Action publique, de la Fonction publique et de la Simplification
Objet : pénalisation des agentes de la fonction publique pendant la grossesse, une attaque inacceptable
Monsieur le Premier ministre,
Madame la Ministre,
Monsieur le Ministre,
Nos organisations syndicales dénoncent solennellement une mesure discriminatoire d'une gravité inacceptable à l'encontre des femmes en situation de grossesse exerçant dans la fonction publique. À compter du 1er mars 2025, vos choix politiques impliquent que les femmes en situation de grossesse placées en congé maladie ordinaire – hors congé pour grossesse pathologique ou congé maternité - subiront une perte de rémunération de 10 % dès le premier jour d'arrêt. Ainsi, une femme dont la grossesse est déclarée mais qui serait contrainte de s'arrêter quelques jours sur avis de son médecin verra sa rémunération amputée.
Ce choix politique constitue une discrimination sexiste manifeste et une attaque contre les droits des femmes et leurs conditions matérielles de vie. Il renvoie à une époque que nous pensions révolue où les droits des travailleuses étaient suspendus à leur capacité à rester « productives » malgré les difficultés physiques liées à la maternité.
Est-ce ainsi que votre gouvernement entend défendre les droits des femmes ?
La baisse de la rémunération dès le deuxième jour d'arrêt maladie rend coupable tous les agents et agentes d'être malades : elle est intrinsèquement injuste et nous continuons de la dénoncer. Mais, au XXIe siècle, rien ne peut justifier qu'un gouvernement, prétendument attaché à l'égalité entre les femmes et les hommes, puisse faire peser sur les agentes enceintes une sanction financière injuste sans tenir compte des réalités médicales, sociales ou professionnelles liées à leur grossesse. Cette décision est d'autant plus scandaleuse qu'elle touche un secteur, la fonction publique, où les inégalités salariales, les retards de promotion, les carrières hachées, les temps partiels imposés et la précarité contractuelle sont structurellement présentes. Vous ajoutez à ces inégalités une violence économique supplémentaire.
Et pour rappel, en 2018, le Parlement avait corrigé par amendement la dimension sexiste de l'instauration du jour de carence en le supprimant pour les femmes enceintes, montrant sa capacité à entendre les alertes et revendications, dont celles portées par nos organisations syndicales.
Nous exigeons :
– le retrait immédiat de la baisse de la rémunération des jours d'arrêt maladie, injuste pour l'ensemble des agent⋅es de la fonction publique ;
– la garantie pleine et entière du maintien de salaire pour toute femme enceinte placée en congé maladie ordinaire sur avis médical quelle qu'en soit la nature ;
– des politiques de santé au travail dans la fonction publique qui prennent réellement en compte la santé globale des femmes au travail mais aussi les parcours de maternité et le retour à l'emploi.
Pour nos organisations syndicales, sanctionner les femmes parce qu'elles sont enceintes ne relève pas d'une politique liée aux contraintes budgétaires : c'est une régression, c'est une attaque contre toutes les femmes et c'est une faute.
Nous attendons donc un retrait clair et assumé de cette mesure inégalitaire.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, en notre détermination collective.
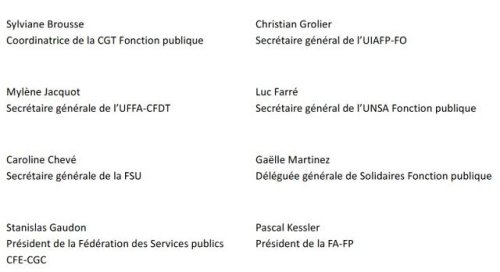
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Lettre ouverte intersyndicale Mayotte aux ministres des Outre-Mers et du travail

Mayotte, 101e département français, a été dévastée le 14 décembre dernier par le cyclone Chido. Les dégâts sont considérables, tant du fait de la force du vent, que de la fragilité voire de l'absence d'infrastructures. L'heure est à la reconstruction mais depuis 6 mois nos équipes constatent que passés les travaux d'urgence, les chantiers n'avancent plus.
Tiré de Entre les lignes et les mots
Lettre ouverte Mayotte
M. Le ministre des Outre-Mer,
Mme la Ministre du travail
Les dessertes de la barge, indispensables pour relier l' île de petite terre à celle de grande terre, sont toujours très limitées. Ceci, cumulé à l'absence totale de transports en commun organisés, engorge totalement le trafic et la population du territoire passe des heures en voiture chaque jour pour aller travailler. Le Centre Hospitalier de Mayotte n'a toujours pas été mis hors d'eau. Une part importante de sa surface est toujours inutilisable et le reste est protégé par des bâches donc inondé à la première pluie. La prise en charge sanitaire des habitant.e.s, et notamment des accouchements est indigne.
Par manque d'enseignant.e.s et de places dans les établissements, les élèves ne sont pris en charge qu'à mi-temps dans les écoles (et seulement trois heures par jour pour l'école élémentaire). Avant même la saison sèche, l'eau est déjà coupée plusieurs jours par semaine et le prix des bouteilles d'eau explose. Les travailleurs et les travailleuses n'en peuvent plus, une majorité n'ont toujours pas réussi à reconstruire leur maison, par manque de matériaux mais aussi de moyens, l'essentiel des habitations n'étant pas assurées. Nous demandons une aide d'urgence pour les ménages dont le toit ou l'habitat est abîmé par le cyclone. Alors qu'il s'agit d'une réserve de biodiversité au plan mondial, la situation environnementale, notamment en termes de traitement des déchets, est extrêmement inquiétante.
Le contexte est d'autant plus catastrophique que Mayotte est le territoire le plus pauvre de France. 77% des habitant.e.s vivent sous le seuil de pauvreté. L'économie informelle domine. Seuls 35% des plus de 65 ans ont une pension de 270€ en moyenne, le RSA et les allocations familiales sont à 50% de la métropole et les aides au logement n'existent pas. Chaque salarié fait donc vivre sa famille élargie, parfois 10 à 20 personnes, alors que le Smic mahorais est toujours inférieur de 25% au Smic du reste de la France, abattement répercuté sur la quasi-totalité des salaires. Pourtant, les prix sont en moyenne supérieurs de 30% à ceux de la métropole, mais beaucoup plus en réalité. Pourquoi ? Parce qu'à Mayotte comme dans les autres DROM COM subsiste une économie de comptoir avec des monopoles privés.
Le projet de loi de reconstruction de Mayotte doit faire avancer concrètement la situation pour l'ensemble de la population. Il est donc très attendu. Les mahoraises et les mahorais veulent une mise en place rapide de la convergence des droits sociaux prévue à ce stade seulement d'ici 2031. Pourtant, dans le même temps, le projet de loi prévoit que les entreprises bénéficieraient d'une exonération totale des cotisations sociales et des impôts dès 2026 pour 5 ans via la mise en place d'une zone franche sur le territoire mahorais et ce sans aucune contrepartie. Il ne faut pas créer un sentiment d'inégalité de traitement entre les aides aux entreprises et l'égalité réelle des droits à mettre en place pour la population.
Mme et M. les Ministres, nous vous alertons solennellement car la situation à Mayotte est explosive. Les habitant-es de l'île n'en peuvent plus d'être traité.e.s comme des citoyen.ne.s de seconde zone. Il faut prendre la mesure des besoins immenses de l'archipel notamment en matière de services publics, si on veut le sortir de la crise que le cyclone Chido n'a fait qu'amplifier. Nous nous associons aux conclusions du rapport que vient de publier le CESE et nous exigeons que les lois de la République s'appliquent pleinement à Mayotte en commençant par celles concernant l'immigration.
La revendication de nos syndicats à Mayotte n'est pas la remise en cause du droit du sol mais la fin du visa territorialisé, ce visa dérogatoire qui enferme ses détenteurs à Mayotte et les empêche de rejoindre la métropole. Nous le réaffirmons, la convergence sociale doit être mise en place au plus vite, en commençant par mettre fin à l'abattement du Smic mahorais dès 2026. Pour cela, nous demandons l'ouverture de concertations au plus vite, à Paris, avec des modalités permettant l'association directe de nos organisations locales pour enfin mettre en place l'égalité des droits.
Marylise Léon
Secrétaire générale de la CFDT
Sophie Binet
Secrétaire générale de la CGT
Laurent Escure
Secrétaire général de l'UNSA
Murielle Guilbert et Julie Ferua
Co-porte-paroles de Solidaires
Caroline Chevée
Secrétaire générale de la FSU
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Génocide à Gaza, menace sur l’information en France !

Le traitement médiatique général pour le moins biaisé de ce qui se passe à Gaza dans une grande partie des rédactions est en train de détruire la crédibilité de la presse française et de valider la thèse mortifère du « choc des civilisations ».
Tiré du blogue de l'auteur. Aussi disponible sur librinfos74
Ce vendredi 13 juin en fin d'après-midi, la chaleur étouffante, ayant allègrement dépassée les 30°c toute la journée, ne s'est pas encore estompée. Cela n'empêche pas les bénévoles de s'agiter tous azimuts dans les jardins de l'ECREVIS[1], le fameux tiers-lieu de Meythet, en périphérie d'Annecy, afin que tout soit prêt. Au menu ce soir, concerts de rap et d'électro engagés, entrecoupés de témoignages en provenance de Gaza, l'ensemble des fonds récoltés devant aller aux associations locales soutenant la cause palestinienne. Des membres des associations ITHAR 74[2] et AFPS Annecy[3] tiennent d'ailleurs des stands à proximité du bar, leur garantissant une certaine fréquentation tout au long de la soirée.
L'équipe de l'ECREVIS ouvre le bal sur une petite scène extérieure en bois, présentant la soirée comme une volonté de « laisser parler et danser nos corps face à l'horreur du génocide en cours ». Francesca, de l'AFPS d'Annecy, en témoigne ensuite : « La Palestine est une société où l'art a une fonction majeure, celle d'une forme de résistance ». Alors il s'agit de « célébrer la beauté ce soir, et la vie malgré tout ». Parmi les différents témoignages lus sur scène, les mots glaçants de Racha, fillette palestinienne de dix ans qui avait rédigé un… testament, avant d'être ensuite tuée avec toute sa famille dans un bombardement israélien : « je souhaite que mes vêtements aillent aux personnes dans le besoin », avait-elle écrit. L'émotion est alors palpable dans l'assemblée. Environ 200 personnes sont présentes ce soir dans les jardins de l'ECREVIS, et toutes les générations sont représentées.
Face à une opinion de plus en plus choquée, l'éditocratie en roue libre !
Ce vendredi soir à l'ECREVIS, à première vue que des gens ordinaires, choqués à juste titre par ce qui se passe à Gaza. Pas d'abayas et de voiles intégraux en vue, ni stand du Hamas, du Hezbollah ou encore des Frères Musulmans. Heureusement que Caroline Fourest n'est pas là, car elle risquerait de qualifier l'ensemble des personnes présentes d'« idiots utiles des islamistes ».

En effet, alors que l'évidence d'un génocide en cours à Gaza est de plus en plus difficile à nier et que les opinions publiques partout sur la planète, y compris en France, semblent de plus en plus choquées par ce qui se passe au Proche-Orient[4], une bonne partie de nos « journalistes », appelons-les plutôt « éditorialistes » ou « doxosophes », continuent de nous offrir un festival de mauvaise foi et d'indignation à géométrie variable, qui devrait ôter définitivement toute crédibilité à leurs propos. Le César de la malhonnêteté intellectuelle pourrait être décernée la semaine écoulée à Caroline Fourest, pour sa « couverture » de la « flottille de la liberté », renommée « la flottille s'amuse »[5] selon un jeu de mots pour le moins douteux, n'ayant pas hésité à faire dans l'insulte et l'outrancier[6]. Une éditorialiste d'autant plus dangereuse qu'elle pare toujours ses démonstrations d'un certain nombre d'informations tout à fait factuelles mais amplifiées à dessein, et jamais resituées dans leur contexte, comme dans le cas de Zaher Birawi, cofondateur de la « flottille de la liberté » et accusé d'être un « agent du Hamas »[7]. Et les liens entre le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou et le Hamas, on en parle ?[8] Et le traitement d'un journaliste français détenu illégalement par Israël[9], on en parle ?
Heureusement que de véritables journalistes, qui vont sur le terrain et se donnent la peine d'interroger les principaux concernés, sauvent l'honneur de la profession, comme cette semaine dans Envoyé Spécial[10]. Ils sont malheureusement trop souvent noyés par le bruit de fond permanent des éditorialistes des chaînes d'infos en continu, devenus un véritable cancer de l'information. L'absurde est que ces derniers continuent de pérorer sur les ondes sur le mode « le droit d'Israël à se défendre » alors que parmi les Israéliens eux-mêmes, de plus en plus de voix dissidentes commencent à émerger pour dénoncer le génocide en cours et exiger un cessez-le-feu immédiat et des sanctions à l'égard d'Israël[11]. Et alors que plus de 200 journalistes palestiniens sont morts eux pour avoir effectué le métier d'essayer d'informer[12].Alors pourquoi cet acharnement à refuser de voir l'évidence ? Et si la véritable raison n'était pas surtout leur vision raciste de la société française, à mille lieux de la géopolitique proche-orientale ?
Israël, bras armé des nouveaux croisés contre l'Islam
C'est en lisant notamment un des derniers ouvrages de Pascal Boniface, Permis de tuer, Gaza : génocide, négationnisme et Hasbara, que ce mystère de l'acharnement médiatique français à défendre inconditionnellement les exactions israéliennes s'éclaircit un peu. L'expert en géopolitique, auteur de nombreux ouvrages de relations internationales[13], part notamment du constat objectif de différence totale de traitement médiatique entre l'agression russe de l'Ukraine, qui a scandalisé à raison, et la destruction totale de Gaza par l'armée israélienne, qui continue de bénéficier d'une complaisance médiatique absolument indéfendable en droit international. Il explique ce « tropisme pro-israélien dans la plupart des médias français » par des raisons légitimes comme « la culpabilité par rapport à l'antisémitisme – concernant en particulier Vichy et la Shoah » et des motivations beaucoup moins « nobles ». Pascal Boniface écrit : « Israël est aussi soutenu pour être la pointe avancée du combat contre l'Islam. Pour ceux qui ont mal digéré la guerre d'Algérie, ou pour ceux qui, pour d'autres raisons éprouvent un racisme anti-arabe, qui assimilent islam et terrorisme, Israël « fait le boulot ». »

Benyamin Netanyahou joue d'ailleurs à fond cette carte, ayant déclaré sur TF1 en mai 2024[14] :
« Notre victoire c'est la victoire d'Israël contre l'antisémitisme, c'est la victoire de la civilisation judéo-chrétienne contre la barbarie. C'est la victoire de la France. »
On comprend tout de suite mieux cet amour inconditionnel d'Israël qui illustre surtout l'islamophobie ambiante dans une France gangrénée par la lepénisation des esprits et la bollorisation des médias[15]. Et cela rejoint les mots de la prix Nobel de littérature Annie Ernaux, tout récemment dans la Grande Librairie : « Cela suppose que soit nommé et interrogé l'imaginaire raciste à l'égard des Arabes qui est au cœur de l'acceptation du martyre de Gaza »[16].
Alors que la peur de l'Islam ne cesse d'être instrumentalisée par le gouvernement actuel, sous perfusion idéologique d'un Rassemblement national plus fort que jamais, entre hystérie autour du voile[17] et fabrication de toutes pièces d'une menace « frériste »[18], alors que des milliardaires d'extrême droite comme Vincent Bolloré ou Pierre-Edouard Stérin[19] tentent d'imposer leur agenda réactionnaire, le traitement médiatique dominant en France sur le génocide de Gaza vient parfaitement illustrer cette vision du monde antirépublicaine de « choc des civilisations », entre une civilisation judéo-chrétienne fantasmée dont Israël serait le premier bras armé en terre sarrasine et un Islam global perçu comme un bloc idéologique monolithique barbare par nos éditorialistes hémiplégiques, dont l'analyse du monde relève surtout des propos de bistrot racistes.
Bien plus que les Frères musulmans, ce sont ces nouveaux croisés des plateaux télé qui sont véritablement dangereux pour notre vivre ensemble et nos principes républicains de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité. A quand un rapport parlementaire sur le séparatisme de Pascal Praud ?
En attendant, l'horreur du génocide en cours à Gaza heurte à raison notre conscience universelle, comme elle fut heurtée le 7 octobre 2023, sans jamais avoir l'indignation à géométrie variable. Car pour la majorité des personnes sincères que l'on croise dans les rassemblements comme celui du 13 juin à l'ECREVIS, la vie d'un enfant palestinien vaut celle d'un enfant israélien. Mais même sans nous projeter jusqu'à Gaza, le traitement médiatique ici de la situation là-bas est très lourd de dangers pour notre propre liberté d'expression, notre droit à une information honnête et sourcée, notre vivre ensemble, nos principes républicains, et au final notre propre démocratie.
Alors indignons-nous sous toutes les formes possibles contre le génocide en cours, car si on ne le fait pas pour les Gazaouis, faisons-le au moins pour nous.
Comme l'écrit la jeune auteure gazaouie Nour Elassy : « Si les droits humains, la morale, ont un sens, Gaza est l'endroit où ces valeurs doivent subsister ou mourir. Car si le monde peut nous regarder disparaître sans rien faire, rien de ce qu'il prétend défendre n'est réel. »
Benjamin Joyeux
Notes
[1] Ecouter notre podcast : https://librinfo74.fr/radio-librinfo-episode-1-ebullition-a-lecrevis/
[2] https://www.instagram.com/ithar_74/
[3] https://www.instagram.com/afpsannecy/
[4] Voir le sondage Odoxa selon lequel 74% des personnes interrogées soutiennent la prise de sanction à l'égard d'Israël : https://www.publicsenat.fr/actualites/international/gaza-les-trois-quarts-des-francais-soutiennent-la-position-de-la-france-et-des-sanctions-contre-israel
[5] Voir https://www.franc-tireur.fr/la-flotille-samuse
[6] Lire https://www.acrimed.org/Flottille-pour-Gaza-la-hargne-de-l-editocratie
[8] Lire par exemple https://fr.timesofisrael.com/pendant-des-annees-netanyahu-a-soutenu-le-hamas-aujourdhui-on-en-paie-le-prix/
[12] Voir https://www.youtube.com/watch?v=FiREi0vtRM0
[13] Par ailleurs directeur de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, boycotté depuis plusieurs années par nos principaux médias audiovisuels, lire https://www.lecourrierdelatlas.com/le-nouveau-livre-de-pascal-boniface-sur-gaza-ignore-par-les-medias/
[15] Lire notamment https://www.humanite.fr/en-debat/arcom/quelle-riposte-a-la-bollorisation-des-medias
[18] Lire https://theconversation.com/les-freres-musulmans-menacent-ils-reellement-la-republique-257303
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Entre sursaut populaire et menace nucléaire

L'engrenage armé au Moyen-Orient a pour point d'orgue la destruction des capacités nucléaires de l'Iran et l'occupation de la Palestine. C'est le dessein affiché par Benjamin Netanyahu. Hier lundi, le Premier ministre déclarait que « tuer Khamenei mettra fin au conflit ». Annonce faite au moment où 40 Palestiniens (es) sont tués par son armée. A Paris, ce samedi, la colère était à son paroxysme !
De Paris, Omar HADDADOU
L'escalade armée au Moyen-Orient tombe à point nommé pour Trump et les Européens afin de finaliser des commandes civiles et militaires colossales. Ce lundi 16 juin, pendant qu'on enterrait à Gaza les 40 victimes des bombardements israéliens sur un site de distribution d'aide humanitaire, géré par la Fondation GHF, le Président américain avait la tête focalisée sur le choix d'agréer ou d'exclure la demande de Volodymyr Zelensky quant à l'achat de matériel militaire. C'est dire l'état d'esprit qui prédomine la Géopolitique.
Trump dont les bruits de couloir susurrent qu'il aspirerait à un Prix Nobel de la Paix, aura quand même réussi à se hisser au rang d'excellent Promoteur des Belligérances !
Ce climat de reconfiguration de la planète en un immense Souk d'Intérêts stratégiques des puissances occidentales, a ouvert le champ à toutes les conquêtes et les coups de boutoir à l'égard des dominés.
Comble de l'indignité à consigner, l'organisation du Salon du Bouget (Vitrine des Avionneurs européens) en France, au moment où le bilan à Gaza dépasse les 55 000 morts et 12 blessés. Syndicats et Journalistes de Gauche ont fustigé l'évènement, le qualifiant de honte !
La folie des Puissants nous passionne ! L'Humanité restera -t-elle sans défense face à l'empiètement du Droit International par Neatanyahu et Trump ? L'assentiment claironné du Président américain, a conforté l'empressement de son alter égo à détruire les capacités nucléaires de l'Iran, en passe d'atteindre le nombre requis de centrifugeuses pour l'enrichissement de l'uranium (à Natanz) et l'acquisition de l'arme nucléaire.
D'où l'entreprise d'éliminer les ténors de l'Etat-Major, les Eminences grises et la promesse d'abattre le Guide suprême iranien : « Tuer Khamenei, mettra fin au conflit » « Nous changerons la face du Moyen-Orient. Nous les éliminerons un par un ! » annonçait -il-hier, à la télé.
Quelques heures plus tard, avant minuit, l'Iran procédait à des frappes jusqu'à l'aube sur l'Etat hébreu. Le monde pourrait basculer dans un troisième conflit mondial par le triomphe de l'Injustice (Hogra !)
En France, comme partout en Europe, l'escalade mortifère a suscité une vague d'indignations et de rassemblements impressionnants pour dénoncer l'impunité et la politique génocidaire de Netanyahu.
Le retour de la « Flottille de la Liberté » impulsée par la franco-palestinienne, Rima Hassan et les membres d'équipage, a était un moment fort, donnant lieu, ce samedi 14 juin, à une mobilisation de grande ampleur contre le génocide à Gaza. Ils étaient plus de 150 000 manifestants (es) à battre le pavé entre République et Nation. Dans le cortège, les Syndicats poids lourds, tels que CFDT, CGT, FO, FSU, UNSA, etc, insufflaient une dynamique contestataire assourdissante.
La présence des étudiants (es) et la jeunesse militante, brandissant des slogans pour la Paix, est de loin la plus importante au cœur de la ferveur de la marche. Il serait évidemment indélicat de ne pas citer les familles avec leurs enfants à bas âge, les retraités, les travailleurs (es), les Magistrats, les Demandeurs d'Emploi, les Sans-Papiers, etc, qui criaient de toute leur force de « cesser le massacre des innocents et des bébés ! ».
Notons l'investissement fédérateur et puissant de la France-Insoumise, d'Urgence Palestine (menacée par l'épée de Damoclès), d'EuroPalestine, des Ecologistes, ainsi que d'autres collectifs, scandant d'une seule voix : « Rima, Rima, Paris est avec toi ! » Puis en arabe : « Tahya tahya Falestine (Vive, vive Palestine) », « Ertah ertah ya chahid ! Sa nouasal el Kifah ! (Repose-toi Martyr, nous poursuivrons le combat ! » « Sahyouni Bara ! Falestine Houra ! (Sioniste dehors ! Palestine, libre ! » « Cessez-le feu ! Cessez-le feu ! Nous sommes tous des Palestiniens ! ». Et la voix de Rima de galvaniser les milliers de manifestants (es) sous les yous yous des femmes : « Nous continuerons, jusqu'à la libération de la Palestine ! ».
O.H
*****
Grande manif à Paris après le retour de Rima Hassan et la "Flottille de la liberté" et en continuation à la mobilisation massive pour Gaza.
Impulsée par la France Insoumise et l'Intersyndicale, la dynamique va reprendre dès demain au Trocadéro.LE DEUXIEMME BATEAU EST DEJA PRET A PARTIR !C'est un point de non retour de la lutte du Peuple auquel nous assistons, ici comme partout dans le monde !









******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Quelques jours après un meurtre d’extrême-droite, Retailleau dissout la Jeune Garde : faisons front !

Ce jeudi 12 juin, Bruno Retailleau a annoncé avoir dissous la Jeune Garde en conseil des ministres. Alors que l'extrême droite se félicite de cette offensive, l'ensemble des organisations de la gauche syndicale et politique doit faire front en solidarité avec l'organisation antifasciste et contre le durcissement autoritaire.
12 juin 2025 | tiré de Révolution permanente
https://www.revolutionpermanente.fr/Quelques-jours-apres-un-meurtre-d-extreme-droite-Retailleau-dissout-la-Jeune-Garde-faisons-front
Crédits photo : Compte X de Raphaël Arnault
« Je me félicite que les organisations La Jeune Garde et Lyon Populaire aient été dissoutes ce matin ». C'est par ces mots que le ministre de l'Intérieur a publiquement annoncé ce jeudi la dissolution de l'organisation antifasciste la Jeune Garde, en parallèle de celle d'une organisation d'extrême-droite, qui sert de caution à la répression des antifascistes.
Bruno Retailleau avance ainsi dans la procédure administrative annoncée le 29 avril dernier contre la Jeune Garde, mais aussi Urgence Palestine, dont il n'a pour le moment pas annoncé la dissolution. Cette nouvelle dissolution constitue une offensive autoritaire d'ampleur du gouvernement, que l'extrême-droite n'a pas tardé à saluer. « Victoire du Rassemblement national, la Jeune Garde a été dissoute ! » a ainsi réagi Julien Odoul du RN sur X. De fait, avec la dissolution de la Jeune Garde, cofondée par le député LFI Raphaël Arnault, Bruno Retailleau accorde à l'extrême-droite une revendication de longue date.
L'annonce de l'attaque avait eu lieu quelques jours à peine après le meurtre islamophobe d'Aboubakar Cissé, assassiné dans la mosquée Khadidja à La Grand-Combe. Un moment symbolique choisi pour ré-affirmer son soutien à une extrême droite de plus en plus décomplexée et violente, contre laquelle la Jeune Garde lutte depuis sa création en 2018.
De la même façon, ce jeudi, la nouvelle annonce survient au lendemain des obsèques d'Hichem Miraoui, victime d'un meurtre raciste début juin. Ces dernières semaines, la Jeune Garde s'est mobilisée contre sa dissolution, notamment en manifestant en nombre le 1er mai, mais aussi contre la dissolution d'Urgence Palestine.
Cette dissolution n'est pas seulement celle d'une organisation antifasciste, mais aussi d'une organisation qui soutient la Palestine et dénonce le génocide à Gaza, et ce au moment où celui-ci s'accélère. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, la Jeune Garde dénonce le rôle du gouvernement dans le renforcement du racisme, note que « c'est la première fois depuis 1945 que l'organisation d'un député d'opposition est dissoute » et annonce porter un recours auprès du Conseil d'État
L'ensemble des organisations politiques et syndicales de gauche doivent apporter leur soutien à la Jeune Garde et opposer le front le plus large possible en défense des droits démocratiques. Contre les procédures bâillons qui visent à réprimer le mouvement social, du soutien à la Palestine, aux collectifs contre l'islamophobie comme le CCIF, jusqu'aux collectifs antifascistes, le mouvement ouvrier doit prendre l'initiative d'une large mobilisation contre la répression et l'offensive anti-démocratique. Face à la cabale de l'extrême droite et d'un ministre ultra-réactionnaire contre une organisation… antifasciste, il faut à nouveau faire front !
Podcast avec deux militant-es de la Jeune Garde - et Ugo Palheta - publié par Spectre

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Mouvement étudiant en Serbie : « soit on s’arrête, soit ce sera la guerre civile »

Depuis novembre 2024, les étudiants serbes mènent une révolte sans précédent contre le gouvernement corrompu de Vučić. Avec deux camarades belges de la Gauche Anticapitaliste, je suis allée à Belgrade à leur rencontre.
12 juin 2025 | tiré d'International View Point
https://internationalviewpoint.org/spip.php?article9039
Devant la Faculté de philosophie de Belgrade, une table et des chaises de camping sont installées. Une dizaine d'étudiants, emmitouflés dans des duvets, surveillent l'entrée. Sur la table, des sudokus et des paquets de cigarettes pour passer le temps. Les étudiants se relaient dès 8 h du matin pour garder la faculté, devenue à la fois dortoir et Assemblée populaire. Plusieurs fois par semaine, des cours y sont organisés, ouverts à toutes et tous. On y tient aussi des assemblées décisionnelles où se dessine l'avenir du mouvement. Les étudiants nous accueillent avec le sourire, prennent la parole tour à tour, puis tous en même temps. Ils nous disent être là depuis le jour 0, soit déjà six mois.
Petit rappel : le 29 novembre dernier, l'auvent de la gare de Novi Sad s'est effondré, causant la mort de 15 personnes (1). Les étudiants se sont rapidement mobilisés contre le régime autoritaire d'Aleksandar Vučić, accusé d'avoir attribué les travaux à des entreprises corrompues et incompétentes.(2) Dans un pays où il est difficile de critiquer le pouvoir en place, les étudiants ont réussi un tour de force : ils ont « dépolitisé » le mouvement, refusant d'en faire un combat partisan dans un pays profondément divisé. Cette stratégie leur a permis de rassembler au-delà des clivages idéologiques. Ils ont structuré leur mobilisation autour de quatre revendications simples :
– 1. Publication de tous les documents relatifs à la reconstruction de la gare de Novi Sad, actuellement inaccessibles au public.
– 2. Confirmation par les autorités compétentes de l'identité de toutes les personnes raisonnablement soupçonnées d'avoir agressé physiquement des étudiants et enseignants, et ouverture de poursuites pénales.
– 3. Abandon des charges contre les étudiants arrêtés pendant les manifestations, et suspension de toutes les procédures judiciaires.
– 4. Augmentation de 20 % du budget alloué à l'enseignement supérieur.
La réponse à ces revendications a été massive. Les étudiants ont réussi à rallier une large partie du pays, à l'aide de diverses techniques de mobilisation, comme les marches nationales pour contrer la propagande d'État. Le mouvement a atteint son apogée le 15 mars 2025, lorsque 400 000 personnes ont afflué vers la capitale.(3)
Mais que s'est-il passé depuis ? Pourquoi les médias ont-ils cessé de parler des Balkans ?
Le gouvernement joue la carte de l'usure face à une jeunesse épuisée
Face à cette contestation persistante, le gouvernement a rapidement réagi en jouant la montre et en utilisant le calendrier universitaire à son avantage. Fin mai, les examens approchent. Le gouvernement en profite pour exercer une pression supplémentaire sur les étudiants. Ces derniers ont pris leur décision : ils passeront les examens, en sachant qu'ils vont les rater. Ils ont choisi de sacrifier une année d'études pour l'avenir de leur pays.
En réponse à cet échec massif potentiel, le gouvernement serbe menace de privatiser les universités, sous prétexte que le secteur public ne garantit pas le succès des étudiants. Face à cette stratégie de l'échec, les rangs se clairsement : « au début, les gens venaient, maintenant on est à bout ». Bien qu'encore soutenu par une majorité de la population, le nombre d'activistes actifs diminue : « nous ne sommes pas assez nombreux, maintenant nos gardes vont de 8 h à 11 h ». De moins en moins d'entre eux viennent garder les barricades universitaires : « nous sommes les derniers soldats courageux », disent les irréductibles.
À la pression du gouvernement s'ajoute sa guerre psychologique : propagande, campagnes de discrédit, manœuvres déloyales. Les étudiants dénoncent le groupe « Studenti koji žele da studiraju » – littéralement « les étudiants qui veulent étudier » – mis en place par le pouvoir et installé devant le Parlement pour contrecarrer les manifestants.(4)
Malgré la fatigue et les stratégies politiques vicieuses, le mouvement résiste, notamment grâce à une structure horizontale bien rodée.
Un mouvement se revendiquant non hiérarchique, apolitique et non partisan
Les étudiants s'expriment à tour de rôle devant l'université, aucun ne se distingue particulièrement. Au début du mouvement, certains ont tenté de s'imposer, mais ont vite été écartés. Le mouvement ne reconnaît aucun leader. Dans les médias, on ne voit jamais les mêmes visages : « nous voulons mettre en avant les revendications, pas les personnes ». Il revendique une organisation totalement horizontale : « nous sommes contre la hiérarchie ». Ils se veulent également apolitiques et non partisans, afin de rassembler le plus largement possible et de déjouer les tentatives de récupération par l'opposition ou certains enseignants cherchant à obtenir des postes dans un éventuel gouvernement technocratique.
Mais en réalité, le mouvement est traversé de profondes divisions politiques
Derrière cette façade apolitique, une ligne idéologique plus affirmée se dessine. Des étudiants de la faculté de philosophie expliquent : « c'est un mouvement communiste par essence ». Ils défendent l'idée d'un Front social donnant le pouvoir au peuple : « que le peuple décide ». Le Front social n'existe pas encore formellement en Serbie, mais c'est une proposition politique issue du mouvement étudiant. Il vise à créer un large réseau horizontal rassemblant étudiants, travailleurs, agriculteurs et autres groupes sociaux, unis contre la corruption et l'autoritarisme du régime Vučić. Ce projet veut dépasser les clivages traditionnels, rejeter la manipulation partisane et promouvoir une démocratie directe et participative. (5)
La faculté de philosophie à laquelle appartiennent les étudiants rencontrés, ancrée à gauche, critique ouvertement d'autres établissements jugés trop conciliants avec les institutions libérales. Elle défend une ligne anti-européenne et souverainiste, convaincue que l'UE méprise la jeunesse serbe. À plusieurs reprises, l'UE est tenue pour responsable des bombardements de 1999 : « nous n'aimons pas l'UE »(6). À l'inverse, d'autres universités restent tournées vers Bruxelles et semblent attendre une réponse de l'Union européenne, souhaitant reproduire les sociétés libérales d'Europe occidentale. Mi-mai, une vingtaine d'étudiants ont couru 2000 km de Novi Sad à Bruxelles dans l'espoir d'une réponse des institutions européennes, qui soutiennent discrètement le gouvernement Vučić (7).
L'Europe et la France négocient-elles encore les droits humains et la démocratie ?
La France, ou la « grande démocratie européenne » qui vend des Rafale à un autocrate
Le 9 avril, Emmanuel Macron a reçu le président Vučić, sans un mot sur le mouvement étudiant ni sur la dérive autocratique du pays (8). Comment se fait-il que, face à un tel déni de démocratie, les pays européens détournent le regard ?
La complicité silencieuse de la France s'explique par des intérêts économiques et géopolitiques. Depuis sa réintégration dans les Balkans en 2019, la stratégie française privilégie la coopération sécuritaire et économique, au détriment des exigences démocratiques. Paris préfère ouvrir un marché à ses investisseurs plutôt que de lutter contre la corruption. En juillet 2023, Vučić a signé un contrat historique avec Macron : l'achat de 12 avions de chasse Rafale pour 3 milliards d'euros. Le président français a alors salué une « démonstration de l'esprit européen ».
Une somme colossale pour un pays où le salaire minimum ne dépasse pas 400 euros mensuels, mais qui renforce les liens militaro-industriels entre Paris et Belgrade. Et la France ne s'arrête pas là. Elle est impliquée dans plusieurs projets stratégiques en Serbie : Vinci exploite l'aéroport de Belgrade, Michelin a une usine de pneus à Pirot, et des discussions sont en cours pour construire des centrales nucléaires en partenariat avec EDF et Framatome.
Cette politique s'inscrit dans un cadre plus large appelé stabilocratie (9), c'est-à-dire le soutien tacite à des régimes autoritaires tant qu'ils garantissent une stabilité politique et un accès aux marchés. En privilégiant ses contrats à ses principes, la diplomatie française alimente un statu quo géopolitique qui renforce un régime autoritaire au détriment d'une société civile en lutte pour la démocratie.
L'Europe du marché, pas des peuples
Le silence français fait écho au silence européen. Le président serbe a même été publiquement félicité par Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, saluant son « sens des responsabilités » et le « potentiel économique » du pays, sans un mot sur les atteintes à la démocratie ou la corruption. En 2023, sous prétexte de « transition écologique »(10), l'UE a relancé le projet minier très controversé de Rio Tinto, suspendu en 2022 grâce aux mobilisations écologistes. Un projet d'extraction de lithium destiné à l'industrie européenne, sans égard pour les écosystèmes locaux ni les populations concernées. La jeunesse serbe est sacrifiée sur l'autel de la transition « verte » européenne.
La même année, la Serbie a reçu la plus importante subvention européenne de son histoire : plus d'un demi-milliard d'euros pour la rénovation du corridor ferroviaire Belgrade-Niš.
La Serbie est aussi un point stratégique pour Bruxelles. Elle se trouve sur la route des Balkans et permet de sous-traiter le contrôle migratoire. La Serbie agit comme tampon et se permet des refoulements illégaux, des violences policières et le non-respect des droits humains (11). Ainsi, l'Europe garde les mains propres et Vučić, en jouant le rôle de gardien de la « forteresse », s'achète l'indulgence politique de Bruxelles. L'UE redoute aussi un basculement vers la Russie, partenaire économique et marché potentiel. Bien qu'elle soit candidate à l'adhésion, la Serbie refuse d'aligner ses sanctions sur celles de l'UE contre Moscou. Vučić joue habilement de cette position « non alignée », oscillant entre promesses d'intégration européenne et proximité assumée avec le Kremlin. Ce double jeu inquiète Bruxelles, qui craint que Belgrade devienne un cheval de Troie russe au cœur du continent.
Tous ces intérêts économiques et géostratégiques justifient que les dirigeants européens ferment les yeux sur un gouvernement illibéral et des pratiques autoritaires. On peut alors se demander : à quoi sert l'Union européenne si elle sacrifie sa jeunesse au nom du libre-échange, de la sécurité et des relations géopolitiques (12) ?
Et maintenant ? « Soit on s'arrête, soit ce sera la guerre civile »
La mobilisation s'essouffle (13). Vučić assure à ses partisans que « l'histoire est finie ». Lucides, les étudiants de la faculté de philosophie n'envisagent plus que deux issues : « soit on s'arrête, soit ce sera la guerre civile ». Ils insistent encore : leur objectif est avant tout de mobiliser les Serbes : « nous voulons mobiliser notre peuple ». Il ne s'agit pas seulement de changer le gouvernement, mais de changer de système.
À l'heure où les étudiants serbes nous rappellent que l'émancipation ne viendra ni des gouvernements ni des institutions, mais des peuples en lutte, nous pouvons nous demander : quel est notre rôle dans cette solidarité internationaliste qu'il reste à construire ?
5 juin 2025 –
Notes
1] Euronews, 30 December 2024 “Serbian prosecutors indict 13 over deadly canopy collapse that sparked mass protests”.
[2] For more context see “Serbian students cycle to Strasbourg, Macron prefers to receive the autocrat Vučić”, “Chronology of the struggle in Serbia”, “Student protests in Serbia : "The movement cannot afford to stop now"”, “Serbia's Mass Protests Against a Crony-Capitalist Government”.
[3] BBC, 16 March 2025, “Serbia's largest-ever rally sees 325,000 protest against government”.
[4] See Ćaciland Protest Camp.
[5] Contretemps, 25 February 2025 “Mouvement étudiant en Serbie : « Un État-providence, c'est ce dont notre pays a besoin »”, Cerises la Coopérative, 4 April 2025, “Serbie : un nouveau front étudiants-travailleurs”.
[6] Modern Diplomacy, 18 March 2025, “Remembering 1999 : How the NATO Bombing Shaped Serbian National Identity”.
[7] Brussels TImes, 13 May 2025, ‘From my village to Brussels' : Serbian student protest reaches Belgium.
[8] Euronews, 10 April 2025 “President Vučić gets strategic support from France for Serbia's ‘European destiny'”.
[9] Fondation Jean-Jaurès, 2 June 2022, “Sortir de la ‘stabilocratie' : repenser l'approche française des Balkans occidentaux”.
[10] Reporterre, 13 May 2025, “En Serbie, la lutte contre le lithium alimente une révolte historique”.
[11] Amnesty International “Human rights in Serbia”.
[12] Fondation Jean-Jaurès, 20 January 2025 “En Serbie, une ultime bataille pour la démocratie fait rage dans l'indifférence de l'Europe”.
[13] RFI, 22 May 2025, “Serbie : malgré des résultats, les manifestations anti-Vucic perdent de leur ampleur”.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

En Pologne, victoire électorale de la droite dure

Au second tour de l'élection présidentielle polonaise, le 1er juin, Karol Nawrocki, soutenu par la droite extrême (PiS, parti Droit et Liberté) et l'extrême droite illibérale et fascisante a gagné avec 50,89 % contre 49,11 % à Rafal Trzaskowski, le candidat libéral soutenu par le gouvernement actuel de Donald Tusk (PO, Plateforme civique).
Tiré de Inprecor
11 juin 2025
Par Jan Malewski
© Karole Nawrocki sur Facebook
Le taux de participation a atteint 71,63 %, plus qu'à toutes les élections présidentielles précédentes. Au premier tour (18 mai) Trzaskowski (31,36%) était légèrement (31,36%) devant Nawrocki (29,54%), mais les candidats de la droite fascisante et pro-poutiniste ont obtenu 22,69 % alors que celles et celui se réclamant de la gauche seulement 10,18 %. Il s'agit donc d'une sérieuse défaite et la coalition gouvernementale pourrait se décomposer, laissant ainsi la place à un gouvernement ultra conservateur, voire à une coalition avec l'extrême droite.
Tusk incapable de répondre aux questions démocratiques et sociales
Si la République en Pologne est moins présidentialiste qu'en France et que le gouvernement n'est pas dirigé par le président, ce dernier peut bloquer le gouvernement en refusant de signer les lois adoptées par le Parlement. De plus, le gouvernement Tusk n'a toujours pas été capable de remettre sur pied la justice et le tribunal suprême que les gouvernements précédents du PiS ont déformé.
En octobre 2023, la mobilisation populaire contre l'autoritarisme gouvernemental du PiS et surtout pour les droits des femmes bafoués avait permis la victoire électorale de la coalition menée par Tusk. Plus d'un an après, le nouveau gouvernement s'est avéré incapable de réaliser ses promesses en matière des droits démocratiques, qui comprenaient l'abandon du néolibéralisme technocratique au profit d'une gouvernance plus humaine et démocratique, des réformes telles que la libéralisation de la loi sur l'avortement, une politique de logement social et un investissement plus important dans la culture et l'éducation.
Pire, il commencé à céder à des réflexes illibéraux en durcissant le discours contre l'immigration et en créant un Comité gouvernemental pour la déréglementation qui se donne pour but d'alléger la responsabilité des hommes d'affaires et, à terme, de réduire leurs impôts… Même la nouvelle radio-télévision publique, remplaçant la machine de propagande du PiS, s'est avérée incapable de réaliser un journalisme indépendant.
Deux choix, une seule option : le marché
En absence d'une forme stable d'auto-organisation des mouvements de protestation précédents la société polonaise et en particulier la classe ouvrière est restée atomisée, espérant de moins en moins du gouvernement libéral, voire se retournant contre lui. Ainsi, chez les électeurs n'ayant qu'un niveau d'éducation primaire, Nawrocki a obtenu 73,4 %, et dans le groupe des électeurs ayant suivi une formation professionnelle, 68,3 %. La répartition par profession révèle une situation similaire. Nawrocki a triomphé parmi les agriculteurs (84,6 %) et les travailleurs manuels (68,4 %). Il arrive même en tête parmi les chômeurs (64,7 %). Et si les femmes ont plus voté en faveur de Trzaskowski (52,8%), Nawrocki l'emporte parmi l'électorat le plus jeune (53,2 % chez les 18-29 ans et 54 % chez 30-39 ans). Les jeunes ont voté plus contre le gouvernement que pour lui.
Car le choix était entre deux candidats liés au dogme du marché libre et à l'austérité fiscale. La seule différence est que le libéralisme économique de Trzaskowski privilégie les déréglementations telles que la réduction des cotisations sociales des entreprises (sans toucher à celles des travailleurs), tandis que Nawrocki est pour un contrôle autoritaire de l'État au service des élites économiques.
C'est un nouvel épisode d'une lente décomposition du libéralisme post-stalinien, tel qu'il a été conçu depuis 1989. Cela laisse la porte ouverte à la droite radicale, qui peut ainsi s'emparer du ressentiment accumulé.
Publié par L'Anticapitaliste le 12 mai 2025
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Grèce : une offensive inquiétante contre le pluralisme médiatique

En Grèce, le gouvernement Mitsotakis met en œuvre une stratégie de contrôle sur l'information dans un contexte de mécontentement public et de scandales. Des actions récentes, comme la fermeture d'Attica TV, la révocation de licence pour Dimokratia FM et l'encadrement des créateurs YouTube, soulèvent des questions sur le pluralisme médiatique et la liberté d'expression déjà limités dans le pays.
Tiré du blogue de l'auteur.
La démocratie hellénique semble aujourd'hui prise au piège d'une stratégie gouvernementale insidieuse, orchestrée pour museler toute voix dissonante au sein de son paysage médiatique. Sous l'égide du gouvernement de droite de Kyriakos Mitsotakis, au pouvoir depuis 2019, la Grèce assiste, non sans inquiétude, à une succession d'événements qui dessinent un plan délibéré visant à asseoir un contrôle hégémonique sur l'information. Cette offensive survient dans un climat de colère populaire exacerbée, alimenté par des scandales à répétition et l'indignation face à l'inaction du pouvoir.
Colère populaire et scandales à répétition
Le peuple grec, déjà exaspéré, a exprimé son "ras-le-bol" lors de manifestations d'une ampleur inédite, notamment en février dernier, avec des rassemblements massifs en Grèce et à l'étranger. Au cœur de cette colère, la tragédie ferroviaire de Tempe, qui a coûté la vie à 57 personnes en février 2023, incarne la perception d'une gouvernance clientéliste et opaque. La dissimulation et le déni de responsabilité face à ces défaillances des systèmes de sécurité ferroviaire sont perçus comme une insulte par les familles des victimes et une grande partie de la population. Cette défiance s'est aggravée avec l'éclatement du scandale du logiciel espion "Predator". En 2022 il a été révélé que le téléphone du leader de l'opposition socialiste, avait été mis sur écoute par les services secrets grecs, en parallèle d'une tentative d'infection par "Predator qui a visé des centaines d'autres personnes.
Ces révélations ont déjà causé des dommages électoraux au parti de la Nouvelle Démocratie au pouvoir. La corruption est toujours endémique dans le pays et le gouvernement Mitsotakis a mis en place, depuis 2019, un système de pouvoir clientéliste et centralisé, marginalisant les institutions indépendantes et la voix de la société civile. Par ailleurs, le creusement des inégalités produit par les politiques en faveur de l'oligarchie, l'alignement atlantiste absolu au niveau de la politique étrangère et la proximité affiché avec Trump et Netanyahu ne fait que renforcer le ressentiment de la majorité de la population. C'est dans ce contexte de colère populaire exacerbée et de déliquescence institutionnelle que s'intensifie l'offensive du gouvernement contre la liberté de la presse. En l'espace de seulement quinze jours, trois événements majeurs illustrent cette manœuvre visant à étouffer toute voix qui n'a pas accepté d'être corrompue et qui continue de lui faire face.
La fermeture d'Attica TV
L'épisode le plus révélateur est sans conteste la fermeture abrupte d'Attica TV. Cette chaîne, connue pour sa proximité avec l'opposition de centre gauche, a annoncé l'arrêt immédiat de ses opérations à ses quelque soixante-dix employés. La fréquence d'Attica TV appartenait à la municipalité d'Aspropyrgos et était exploitée par la société Media Time, liée aux hommes d'affaires Dimitris Bakos, Giannis Kaimenakis et Alexandros Exarchou. Alors que leur contrat de location courait jusqu'en septembre 2025, la décision fut prise d'y mettre fin prématurément, sous le prétexte d'un désaccord sur le renouvellement du bail. Il a été révélé que la proposition des propriétaires de réduire drastiquement le loyer mensuel, de 20 000 à 5 000 euros, était manifestement une manœuvre destinée à provoquer l'échec des négociations. Il est crucial de souligner que Messieurs Bakos, Kaimenakis et Exarchou, bien que moins médiatisés, jouissent d'un portefeuille d'investissements colossaux, se chiffrant en milliards d'euros, couvrant des secteurs aussi lucratifs que la construction, la banque et l'énergie, avec 132 entreprises recensées sous leur influence. Dans ce contexte, des pertes annuelles de l'ordre de 3 à 3,5 millions d'euros pour Attica TV étaient parfaitement gérables pour des entités de cette envergure. La cessation d'activité est donc perçue, non comme une nécessité économique, mais comme un désengagement politique calculé de l'opposition de centre-gauche, annonçant un "mauvais présage" pour la pluralité des médias grecs.
Le retrait de la licence de Dimokratia FM
Parallèlement à cette liquidation, une tentative flagrante de museler la station de radio "Dimokratia FM" a été mise en œuvre. Le groupe Filippakis, propriétaire des journaux "Dimokratia" et "Estia", avait entrepris de lancer cette nouvelle entité radiophonique sur la fréquence 102.7 FM. Le journal "Dimokratia" est connu pour son opposition très forte au gouvernement de Kyriakos Mitsotakis, incarnant la voix d'une droite populaire radicalement opposé à Mitsotakis. Cette fréquence appartenait légalement au parti d'extreme droite LAOS depuis 2010, et son examen de licence aurait dû avoir lieu il y a treize ans, après le départ de LAOS du Parlement en 2012. Étonnamment, c'est précisément à l'annonce du projet de "Dimokratia FM" que le gouvernement, par l'intermédiaire du vice-ministre auprès du Premier ministre, Pavlos Marinakis, a déposé une disposition parlementaire, le 6 juin, visant à révoquer cette licence. Cette manœuvre est clairement interprétée par les observateurs comme une machination gouvernementale dont le but ultime est la censure, cherchant à empêcher qu'une opinion dissidente n'atteigne un public plus vaste par les ondes radiophoniques.
Le contrôle de YouTube
Le bras de fer gouvernemental ne s'arrête pas aux médias traditionnels ; il s'étend désormais à la sphère numérique, particulièrement YouTube. Des dizaines de créateurs de contenu sur cette plateforme ont reçu un courriel du Conseil National de la Radio et de la Télévision (ESR), les contraignant à s'inscrire à son registre. Une telle injonction les place de facto sous la supervision de l'ESR. Le gouvernement est parfaitement conscient que des millions d'internautes grecs se sont tournés vers YouTube pour une information alternative, délaissant les bulletins des chaînes conventionnelles. La décision 1/2022 de l'ESR, qui fonde cette exigence d'enregistrement, est volontairement vague quant aux critères précis (nombre d'abonnés, fréquence de publication), mais elle affirme explicitement que la radio et la télévision sont soumises au contrôle direct de l'État. Cette imprécision confère à l'ESR le pouvoir d'imposer des amendes exorbitantes aux YouTubers pour leur contenu, constituant ainsi un outil de pression redoutable contre les chaînes d'opposition.
Ces initiatives, survenues en l'espace d'une quinzaine de jours seulement, ne sauraient être considérées comme des coïncidences isolées. Elles révèlent un plan gouvernemental visant à étouffer l'opposition médiatique. Cette stratégie s'inscrit dans un contexte plus large de détérioration de la liberté de la presse et de la confiance dans les médias en Grèce, un pays qui dégringole d'ailleurs dans les classements internationaux. La manipulation médiatique est déjà omniprésente, avec des médias largement subventionnés par le gouvernement qui soutiennent sans réserve ses politiques. L'ensemble de ces manœuvres — la suppression d'un média d'opposition traditionnel, l'obstruction à l'établissement d'une nouvelle radio critique, et l'assujettissement des plateformes numériques — ne sont pas de simples ajustements réglementaires. Elles constituent une escalade alarmante dans la tentative du gouvernement Mitsotakis de façonner un récit unique et de neutraliser toute contestation significative. Si Attica TV et Dimokratia FM à eux seuls ne suffiraient pas à garantir un troisième mandat à Mitsotakis, l'extension de ce contrôle au paysage numérique marque une étape cruciale. Cette dérive autoritaire pose de graves questions sur la santé de la démocratie grecque et la survie de la pluralité médiatique, laissant présager un avenir incertain pour la liberté d'expression dans le pays.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.
















