Derniers articles

Grande-Bretagne : « Construire le parti »

Au cours des derniers mois, plusieurs groupes de la gauche organisée britannique ont discuté de la formation d'un nouveau vecteur national : soit un parti politique, soit une alliance électorale. Les arguments en faveur d'une telle institution ne pourraient être plus clairs. Le gouvernement travailliste au pouvoir se caractérise par sa soumission envers les intérêts des entreprises, sa complicité dans le génocide à Gaza et la répression de la dissidence. Alors que l'opposition conservatrice reste obsédée par les guerres culturelles et entachée par son long passé de mauvaise gestion, le parti d'extrême droite Reform UK [Nigel Farage] semble en passe de remporter la majorité des suffrages populaires, présentant sa vision powelliste [référence à Enoch Powell (1912-1998) qui disposa d'une grande influence dans le débat politique et qui avait les caractéristiques conservatrices et libertariennes] comme la seule alternative viable.
Tiré de Inprecor
4 août 2025
Par James Schneider
Les sondages suggèrent qu'un parti de gauche pourrait remporter autant de voix que le parti au pouvoir, avec 15% chacun. Ce chiffre pourrait encore augmenter s'il s'enracinait dans des circonscriptions clés et lançait une attaque énergique contre le consensus de Westminster : un événement qui marquerait une avancée majeure pour un bloc socialiste historiquement lié par les contraintes du travaillisme. Si les politiciens et les acteurs impliqués dans cette nouvelle organisation n'ont pas encore défini de ligne directrice claire, la députée socialiste de premier plan Zarah Sultana et l'ancien leader travailliste Jeremy Corbyn ont annoncé la tenue d'une conférence inaugurale cet automne, au cours de laquelle les politiques et les modèles de direction pourront être décidés démocratiquement. En moins de 24 heures, 200 000 personnes se sont inscrites, un chiffre stupéfiant.
James Schneider est l'un des organisateurs qui travaille sur ce projet. Né en 1987, il s'est radicalisé à la suite de la guerre en Irak et de la crise financière mondiale. Il a cofondé le groupe de campagne Momentum afin de rallier le soutien populaire à la direction de Corbyn en 2015, avant d'être recruté un an plus tard comme directeur de la communication stratégique du parti. À ce poste, il a défendu une forme de « populisme de gauche » sans concession, tentant – en vain – de résister à la pression exercée par l'aile droite du Parti travailliste pour qu'il capitule sur des questions clés telles que le Brexit. Depuis, il a publié Our Bloc (2022), son projet pour l'avenir de la gauche britannique, et travaille aujourd'hui comme directeur de la communication pour l'Alliance progressiste qui réunit la IIe Internationale, des syndicats et des ONG.
James Schneider s'est entretenu avec Oliver Eagleton sur certaines des questions cruciales qui se posent dans le processus de construction d'un parti : comment celui-ci peut servir de médiateur entre le pouvoir populaire et le pouvoir électoral, les structures organisationnelles qu'il doit mettre en place, les facteurs qui ont précédemment empêché son lancement et les exemples internationaux dont il peut s'inspirer. Cet entretien est le premier d'une série de réflexions sur les perspectives de la gauche post-Corbyn qui seront publiées sur Sidecar [site en lien avec la New Left Review].
Oliver Eagleton : Commençons par votre description générale de ce qu'un hypothétique parti de gauche devrait espérer accomplir dans le paysage politique des années 2020, en particulier dans des pays comme la Grande-Bretagne, où il serait confronté à un certain nombre d'obstacles majeurs, de l'emprise des médias traditionnels au système antidémocratique de Westminster, en passant par la division des forces à gauche du Parti travailliste.
La tâche de ce parti devrait être d'entreprendre différentes formes de « construction politique ». Il y a tout d'abord la construction de l'unité populaire : prendre les circonscriptions qui constituent actuellement une majorité sociologique et les traduire en une majorité politique. En Grande-Bretagne, il s'agit de la classe ouvrière pauvre, des diplômés en déclin social et des communautés racialisées. La plupart des gens envisagent les circonscriptions en termes purement électoraux : « Comment pouvons-nous gagner quelques sièges supplémentaires ? », etc. Mais peu importe que vous ayez cinquante, cent ou deux cents députés si votre stratégie électorale n'est pas liée à ce projet social plus large.
Vient ensuite la construction du pouvoir populaire : il s'agit de mettre en place des organisations structurées que les gens peuvent utiliser pour contrôler démocratiquement différents aspects de leur vie, soit en obtenant des concessions du capital et de l'État, soit en les transcendant partiellement – en décommodifiant [suppression du statut de marchandise] certaines ressources ou en créant des espaces autonomes. Cela permet aux gens de légiférer collectivement depuis la base tout en créant les conditions pour que leur parti légifère depuis le sommet. Le mouvement ouvrier et les coopératives britanniques ont traditionnellement servi cet objectif. D'autres pays ont des traditions plus variées en matière de création de pouvoir populaire, à travers des groupes de locataires, des collectifs agricoles, des syndicats d'endettés, des occupations de terres, pour n'en citer que quelques-unes.
Cela nous amène à la forme finale de la construction politique : celle d'une alternative populaire. L'unité populaire et le pouvoir populaire démontrent qu'il existe d'autres moyens d'organiser la société dans son ensemble, tout en élaborant un programme majoritaire pour le gouvernement capable de répondre aux besoins de la population à court et moyen terme. Si nous poursuivons cette stratégie tripartite, nous commencerons à voir émerger de nouvelles formes de protagonisme populaire qui diffuseront la lutte et le contrôle dans toute la société.
Permettez-moi de vous donner deux exemples tirés de la Colombie. Ce pays a été historiquement l'un des principaux avant-postes de l'impérialisme sur le continent, dominé par une élite compradore conservatrice. Pourtant, depuis plus de soixante-dix ans, le pétrole du pays est propriété publique, car les travailleurs du pétrole ont lancé une grève illimitée en 1948 qui a contraint l'État à créer une entreprise nationalisée, et la pression massive et persistante de la population a empêché tous les gouvernements qui se sont succédé depuis lors de revenir sur cette décision. Plus récemment, en 2010, une institution appelée le Congrès populaire a été créée pour rassembler divers mouvements sociaux et luttes territoriales : urbains, paysans, autochtones. L'une de leurs initiatives a été de mettre en place des territoires de production alimentaire contrôlés par les paysans, qui relient les petits agriculteurs aux pauvres des villes, et ils ont finalement contraint le gouvernement à reconnaître et à soutenir ces territoires en expansion, que le mouvement considère comme des « tranchées du pouvoir populaire ». Cette stratégie de légiférer par le bas a contribué à l'élection du tout premier gouvernement de gauche de Colombie en 2022, dirigé par Gustavo Petro.
En résumé, notre parti doit être un vecteur d'unité, un catalyseur de l'organisation populaire et un levier de mobilisation populaire vers une alternative sociale. Notre objectif à long terme, bien au-delà de ce qui peut être réalisé dans les années 2020, doit être d'établir une société qui reconnaît la dignité fondamentale de chaque personne. Si ce principe est évident pour beaucoup, les macrostructures de notre système mondial s'y opposent fermement. L'ordre actuel repose sur une triade composée du capital, de la nation et de l'État. Notre objectif doit être de le remplacer par un autre : le social, l'international et le démocratique – trois logiques interdépendantes qui ouvrent la voie à de nouvelles formes de vie au-delà de l'exploitation, de l'empire et du contrôle hiérarchique. Cela signifie socialiser l'économie, transformer notre position dans la chaîne des relations impériales et la division mondiale du travail, et démocratiser l'État. Il n'y a pas de voie vers un avenir écologique durable sans ces transformations. Dans ce pays, nous n'avons jamais eu de vecteur qui ait tenté d'opérer ce type de changement par le biais d'une politique de masse. Aucun des petits groupes de gauche ne l'a fait. Même sous la direction de Corbyn au sein du Parti travailliste, nous n'avons pas conçu notre objectif en ces termes. Ce qu'il faut, c'est un parti populaire, entouré d'un ensemble d'organisations, capable de conquérir le pouvoir dans tous les domaines : social, culturel, politique, industriel.
Pouvez-vous nous en dire plus sur la manière dont cette stratégie s'attaquerait aux réalités pratiques de la politique britannique actuelle ?
Les groupes sociaux que j'ai décrits plus haut – les travailleurs pauvres, les diplômés en déclin social et les personnes victimes de racisme – seraient les principaux bénéficiaires d'un mouvement visant à abolir l'état actuel des choses. Bien sûr, un parti de gauche doit également chercher à gagner le soutien d'autres groupes : il existe des éléments progressistes en dehors de ces groupes, tout comme il existe des éléments réactionnaires en leur sein, ce n'est donc pas un processus rigide ou mécanique. Mais ce sont les trois principaux acteurs à travers lesquels l'unité populaire peut être forgée. Certaines des raisons pour lesquelles ils constituent une majorité numérique sont liées à la position mondiale de la Grande-Bretagne en tant qu'économie avancée au cœur du capitalisme, mais d'autres sont plus spécifiques : par exemple, les politiques mises en œuvre par le New Labour [slogan utilisé dans la campagne électorale de 1996 et qui sera associée à Tony Blair] dans l'enseignement supérieur, le logement et l'industrie, qui ont créé la catégorie des diplômés en déclin social (ironiquement, puisque le New Labour était en partie le projet d'une classe de diplômés en ascension sociale). De plus en plus, les actions de l'establishment – en particulier du gouvernement travailliste actuel – renforcent un intérêt commun parmi ces groupes. Les partis de Westminster ont appauvri les personnes sans patrimoine ainsi que les jeunes diplômés, et ils ont tenté de rejeter la faute sur les personnes racialisées, y compris celles qui n'entrent pas dans ces deux autres catégories sociales, ce qui leur donne une base commune pour renverser le statu quo.
Le potentiel est donc là. Ce qui manque, c'est la capacité. En matière de pouvoir populaire, nous partons d'un niveau très bas. La vie civique en Grande-Bretagne, comme dans une grande partie du Nord global, a été réduite à néant. La vie associative de la classe ouvrière a été détruite, pas seulement les syndicats et les coopératives, mais aussi les bibliothèques, les pubs, les clubs, les groupes de musique, les équipes sportives. De moins en moins de gens se souviennent même de cette culture politique d'autrefois. Notre expression la plus forte du pouvoir populaire est le mouvement syndical, qui a surtout connu la défaite au cours des cinquante dernières années, ce qui a naturellement créé une posture défensive. Comment surmonter cela ? Eh bien, le pouvoir populaire repose toujours sur la concentration. Ce n'est pas un hasard si l'usine crée des ouvertures politiques à la gauche ; il en va de même pour les quartiers populaires, qui sont des lieux où les gens se rassemblent naturellement. En Grande-Bretagne, cela a des implications claires pour la stratégie électorale en raison du système électoral majoritaire à un tour. Je ne suis pas un défenseur de ce système, mais il existe et nous devons travailler avec pour l'instant. Il nous oblige notamment à poursuivre une stratégie de concentration : ancrer notre projet dans des zones spécifiques où ces trois groupes sociaux sont majoritaires.
Prenons l'exemple des élections de l'année dernière, où les cinq candidats indépendants de gauche ont remporté des sièges au Parlement : un gain relativement modeste, mais historique, car il n'y avait eu que trois indépendants de gauche depuis la Seconde Guerre mondiale. La situation à Islington North, où Corbyn a battu son adversaire travailliste avec une marge écrasante, était quelque peu sui generis dans la mesure où il était un candidat de renommée nationale et dont la notoriété était de 100 %. Elle a toutefois des implications plus larges, dans la mesure où tous les derniers éléments de pouvoir social ont été mobilisés pour soutenir la campagne, précisément parce que les gens y voyaient l'expression de leur propre vie civique. Tous les groupes de jardinage, toutes les églises, toutes les mosquées, toutes les sections syndicales de la région ont reconnu en Corbyn leur incarnation politique, et c'est pourquoi ils se sont mobilisés pour lui, presque indépendamment de leur opinion sur des politiques spécifiques.
Les quatre autres candidats indépendants ont également remporté une large victoire grâce au pouvoir social réel dont ils jouissent dans leurs communautés, qui repose en grande partie sur les mosquées – même si, bien sûr, de nombreux non-musulmans et musulmans non pratiquants ont également fait campagne et voté pour eux. Les gens vont à la mosquée chaque semaine. C'est un lieu de socialisation, un lieu de bien-être, un lieu d'orientation morale. Ainsi, même si ces candidats indépendants seraient les premiers à admettre qu'ils étaient inexpérimentés en politique, qu'ils n'avaient pas mené de campagne brillante, ni mis en place une communication innovante ou un programme politique complet, ils ont néanmoins été portés à la victoire grâce à cette identification avec le centre du pouvoir communautaire, qui a contribué à canaliser leur répulsion commune face au génocide à Gaza et à toute une série d'autres questions. C'est exactement la raison pour laquelle l'establishment a réagi avec une telle horreur. Il ne s'agissait pas seulement d'islamophobie, mais aussi de la prise de conscience paniquée que le pouvoir populaire peut contourner les structures censées le neutraliser.
Si votre ambition est de créer une sorte de lien contraignant entre un parti politique et des formes plus larges de vie associative, il y a peut-être une distinction à faire entre les mouvements et les institutions. Les premiers peuvent être éphémères et informels, incapables de créer des formes durables de pouvoir populaire en l'absence des seconds. On pourrait dire que, lorsqu'il s'agit de questions telles que le génocide à Gaza, c'est le mouvement qui mobilise les gens en tant que sujets politiques, l'institution qui traduit cette politisation en pouvoir populaire, et le parti qui exploite ce pouvoir pour influencer ou s'emparer de l'État. Ce qui m'amène à poser la question suivante : si la culture institutionnelle de la classe laborieuse britannique a été largement détruite au cours des cinquante dernières années, ne laissant derrière elle que des enclaves isolées, ne manque-t-il pas alors un maillon essentiel dans cette chaîne ? Comment un nouveau parti de gauche devrait-il aborder ce problème ?
Nous devons construire davantage d'institutions. C'est pour moi la tâche stratégique la plus importante pour le parti, mais aussi celle qui risque le plus d'être négligée. Tout en renforçant les manifestations du pouvoir populaire qui ont survécu aux ruines du néolibéralisme, nous devons en créer de nouvelles. Le nombre de ménages qui sont locataires au Royaume-Uni est de 8,6 millions. Le nombre de personnes syndiquées dans le secteur locatif est d'environ 20 000. Seuls 38% des locataires ont voté lors des dernières élections. Si, sous le Labour de Corbyn, nous avions décidé d'aller frapper aux portes et d'organiser les locataires, combien de dirigeants de ce secteur social aurions-nous aujourd'hui ? Comment aurions-nous pu faire évoluer la conscience de la gauche travailliste, afin qu'elle cesse de soutenir un parti parlementaire sur Twitter et qu'elle se concentre plutôt sur la construction de ses propres institutions solides ? On pourrait poser les mêmes questions sur toute une série d'autres thèmes. Avec alors 600 000 membres du Parti travailliste, dont 450 000 étaient de gauche, nous aurions pu décider que notre priorité politique était de nous organiser autour de la question X ou Y. Si nous avions mobilisé ne serait-ce que 10% de ces membres de gauche, nous aurions pu créer de nouvelles organisations populaires : coopératives alimentaires, syndicats de personnes endettées, groupes de soutien à la santé mentale. Nous aurions pu mener des campagnes pour organiser une grève pour le climat ou tenter de nationaliser les services publics par le biais de boycotts massifs. Les possibilités ne manquent pas, et ce n'est pas à moi de dire lesquelles nous devrions privilégier dans les années à venir. Ces choix doivent être faits démocratiquement par un parti politique national.
Si le nouveau parti passe tout son temps à élaborer la politique sociale parfaite pour notre futur techno-gouvernement de gauche imaginaire lorsque nous dirigerons l'État, il n'ira nulle part. S'il se considère comme un Parti travailliste 2.0, avec une meilleure politique que l'actuel mais sans moyen de participation populaire réelle, il sera détruit par les forces contraires. Pendant la période Corbyn, nous étions pris au piège dans une situation où les membres du Parti travailliste étaient souvent réduits à attendre que quelques personnes au sommet prennent des décisions, au lieu de devenir eux-mêmes des acteurs et des leaders. Nous ne pouvons pas répéter cette erreur. Je pense qu'il est important de se rappeler qu'en dehors de l'Europe et de l'Amérique du Nord, les réunions politiques ne sont pas ennuyeuses. Elles sont animées, participatives et ancrées dans la culture populaire, avec de la musique, de la nourriture et même de la danse. Les gens normaux y participent parce qu'ils s'y sentent chez eux. Il existe différentes façons de participer. Et c'est parce que leur objectif est de renforcer les liens de solidarité et d'unité afin que les gens puissent s'engager dans la construction du pouvoir populaire.
Comment le nouveau parti que vous envisagez devrait-il s'y prendre pour créer ce type de culture politique non traditionnelle en Grande-Bretagne ?
Dans la Grande-Bretagne contemporaine, l'establishment n'a rien à raconter : il dit que tout va bien et qu'il faut se taire sur ses problèmes. Le bloc réactionnaire, quant à lui, affirme que tout va mal : impossible d'obtenir un rendez-vous à l'hôpital, les prix des logements sont inabordables, les salaires ont baissé, et tout cela est la faute des musulmans, des migrants et des minorités. Lorsque ce sont les deux seuls discours proposés, c'est généralement le second qui l'emporte, car il répond au moins à certaines revendications réelles. Mais la vérité, c'est qu'attaquer les minorités est en soi une position minoritaire. Il existe peut-être une certaine forme de racisme omniprésent en Grande-Bretagne, mais la plupart des gens ne passent pas leur temps à penser à leur haine des étrangers, ce qui laisse clairement la place à un autre discours. Ce que nous devrions proposer à la place, c'est une « guerre des classes avec le sourire ». Nous devrions rejeter toutes les pieuses déclarations de la classe politico-médiatique, car elles sont détestées par le public, à juste titre. Nous devrions créer des controverses plutôt que de nous en éloigner. Ce style de communication est souvent appelé « populisme de gauche ». Il consiste à tracer une ligne d'antagonisme large et audacieuse, avec d'un côté l'unité et de l'autre la division. Cette ligne d'antagonisme est extrêmement simple : la cause de nos problèmes, ce sont les banquiers et les milliardaires. Ils sont en guerre contre nous, alors nous allons leur faire la guerre. Nous devons chercher à dérouter et à scandaliser les médias traditionnels avec un style politique combatif mais aussi joyeux. Nous devons organiser des réunions comme celles que je viens de décrire, avec de la musique, de la nourriture et des groupes de discussion, où les gens peuvent repartir avec des actions claires à mener. Cela signifie naturellement que le parti doit être basé principalement en dehors de Westminster ; il ne doit pas être associé à des types en costume qui passent leur temps à marmonner hypocritement devant les caméras.
Mon rêve est un parti qui ait le même impact que « Turn the Page », le premier titre de l'album Original Pirate Material, premier album du groupe The Streets. Quelque chose que vous n'avez jamais entendu auparavant, mais que vous reconnaissez instantanément ; indéniablement britannique et ancré dans la vie quotidienne, des pubs aux trottoirs. Un son – ou dans notre cas, une politique – qui mélange sans effort les cultures et les traditions, ancré dans la classe et la communauté, mais qui va de l'avant avec confiance et style. Nous devons nous approprier ce registre national-populaire. Pour le dire de manière plus théorique, l'efficacité de ce type de politique réside dans la libération du potentiel progressiste de la dimension « nationale » de la triade capital-nation-État. Sur Sidecar, vous avez publié la semaine dernière un court article stimulant de Dylan Riley intitulé « Lénine en Amérique », qui, suivant Gramsci, affirmait que Lénine poursuivrait aujourd'hui une « relation productive et créative avec la culture politique révolutionnaire nationale et démocratique spécifique dans laquelle on opère ». La gauche britannique doit réfléchir dans ce sens.
Vous avez mentionné la Colombie comme modèle, mais réfléchissons un instant aux différences historiques et contextuelles. Dans ce pays, vous aviez un État dominé par deux grands partis, les libéraux et les conservateurs, qui ont passé des décennies à collaborer avec les États-Unis pour maintenir le pays dans un état de dépendance périphérique tout en excluant les secteurs populaires du pouvoir. Beaucoup de ces secteurs étaient donc largement exclus des processus d'accumulation économique et de participation politique, ce qui a contribué à forger certaines traditions autonomes de lutte : mouvements de guérilla contrôlant de vastes zones rurales, campagnes contre l'extractivisme, groupes défendant les territoires autochtones. Petro a réussi à unifier bon nombre de ces forces dans son projet électoral, amenant les marginaux – les « nobodies », comme on les appelait affectueusement – au cœur du gouvernement. En Grande-Bretagne, en revanche, le problème de longue date est moins celui de l'exclusion populaire que celui de l'assimilation populaire. Le Parti travailliste a traditionnellement été un outil permettant d'intégrer la classe ouvrière dans l'État et de la réconcilier avec l'impérialisme, avec pour résultat que notre culture de lutte populaire est moins active, que nos réunions de gauche sont plus ennuyeuses et que la base organique de ce type de politique de masse est beaucoup plus faible.
La direction de Corbyn a fait une évaluation lucide de ces conditions. Votre objectif n'était pas nécessairement de donner du pouvoir à « la base » et d'espérer qu'elle vous mènerait à la victoire. Il s'agissait plutôt d'exploiter une situation de crise politique, de s'emparer du pouvoir étatique et de mettre en œuvre un programme de réformes non réformistes qui, à son tour, galvaniserait de larges couches de la population, en renforçant les travailleurs et travailleuses, les locataires, les migrant·es, etc. Cette approche, dans laquelle la politique d'en haut précède la politique d'en bas, n'était pas simplement une erreur stratégique. Elle reflétait notre situation historique particulière et les possibilités politiques qu'elle offrait. On pourrait soutenir que ces mêmes conditions ont également façonné la manière dont le projet d'un nouveau parti de gauche a été développé jusqu'à présent, les décisions étant prises par une couche relativement restreinte d'acteurs politiques qui espèrent – non sans raison – utiliser les victoires électorales pour stimuler des luttes plus larges.
L'explication que vous donnez est globalement correcte et aide à comprendre pourquoi la conscience dominante au sein de la gauche britannique est fortement électoraliste. Je ne suis pas contre le fait de gagner des élections ou d'entrer au gouvernement. Je pense que c'est essentiel. Mais il y a deux raisons pour lesquelles cela peut et doit être combiné dès le départ avec ces autres processus de construction politique. Premièrement, l'assimilation de la classe ouvrière britannique – non seulement par le Parti travailliste, mais aussi par les syndicats pendant la période corporatiste – n'a jamais été totale : il y a toujours eu des révoltes populaires et des lieux de résistance. Il existe donc des traditions radicales sur lesquelles s'appuyer. Deuxièmement, nous approchons aujourd'hui de la fin d'une offensive capitaliste qui a duré plusieurs décennies et qui visait à détruire cette résistance. Cela s'est fait en partie par l'assimilation, mais surtout par la force brute : l'exclusion violente des masses tant dans le Nord que dans le Sud, avec des mineurs britanniques qui se faisaient fracasser le crâne et des militants de gauche argentins jetés d'hélicoptères. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que cette offensive commence à s'essouffler, non pas à cause d'une opposition extérieure, mais à cause de ses propres limites internes : l'incapacité des États-Unis à freiner le développement souverain de la Chine, en particulier après 2008, et la pression croissante sur les ressources à mesure que la crise écologique s'accélère. Cela crée une opportunité cruciale pour un parti de gauche.
Mais nous ne pouvons pas simplement reproduire le corbynisme dans ce contexte. Nous ne sommes pas à la tête d'un parti gouvernemental et nous n'avons aucune chance d'y parvenir dans un avenir proche. Ce pari purement électoraliste, qui a déjà été battu en brèche, est donc encore moins viable aujourd'hui. Le nombre de personnes qui avaient même conscience de la stratégie 2015-2019 telle que vous la décrivez était également extrêmement limité : seule une poignée de membres du cabinet fantôme et de conseillers de haut rang l'auraient formulée de cette manière. La logique du socialisme parlementaire est restée très intacte. Je pense que nous avons besoin d'un changement fondamental dans notre vision stratégique afin de créer un consensus au sein de la gauche qui reconnaisse l'importance du pouvoir populaire.
Si vous voulez un exemple négatif, vous pouvez vous tourner vers le Parti vert. Son approche consiste à faire élire ses candidats à des fonctions publiques afin qu'ils puissent utiliser leur notoriété pour défendre des politiques progressistes. Selon leurs propres termes, ils ont remporté un certain succès, élisant un député pour la période 2019-2024, puis quatre autres depuis, ainsi que de nombreux conseillers municipaux. Mais quel impact ont-ils eu sur la conscience publique ? Pratiquement aucun. Extinction Rebellion et Fridays for the Future ont eu un effet beaucoup plus tangible sur la politique environnementale de masse. L'approche arithmétique des Verts – plus il y a d'élus, mieux c'est – est vieille de deux cents ans et remonte à l'époque des révolutions libérales, lorsque le débat public se déroulait dans des parlements et des assemblées nouvellement formés où le nombre comptait vraiment. Elle est totalement inadaptée aux années 2020. Le porte-parole le plus en vue du parti n'est même pas député. On entend récemment des propos tels que « Avec les Verts, un parti de gauche pourrait détenir la clé du pouvoir à Westminster ». C'est le même genre d'absurdités illusoires que certains membres du Socialist Campaign Group colportent depuis des années : « Si nous restons au sein du Parti travailliste et faisons profil bas, nous pourrons peut-être détenir la clé du pouvoir ». Quel a été le résultat ?
C'est un modèle libéral de front populaire qui engage implicitement la gauche à soutenir un gouvernement travailliste, ce qui serait un suicide moral et politique. Mais restons-en un instant aux leçons du corbynisme : la plupart des gens ont reconnu que l'une des principales raisons de sa défaite était son manque de base sociale solide, qui a rendu plus difficile la riposte aux campagnes de diffamation et au sabotage politique dont le projet a été victime. Mais après 2019, beaucoup de ces personnes se sont mises à « construire la base » d'une manière déconnectée de toute infrastructure nationale plus large, donnant naissance à un ensemble d'initiatives disparates – un syndicat communautaire ici, un groupe d'action directe là – que le gouvernement en place a pour l'essentiel ignorées ou réprimées.
Il est désormais largement admis qu'une synthèse entre organisation électorale et organisation populaire est nécessaire, comme vous le dites, mais il n'y a toujours pas de consensus sur la forme que cela devrait prendre. La question de savoir si cette nouvelle organisation doit être un parti dès le départ ou si elle doit commencer par une alliance électorale a fait l'objet de nombreux débats. Les partisans de cette dernière option font valoir que la fragmentation de la gauche britannique, et de la vie civique britannique dans son ensemble, nécessite une coalition capable d'englober les luttes locales et de soutenir les leaders communautaires qui ne s'identifient pas explicitement à « la gauche », même s'ils partagent globalement notre vision politique. Cependant, une coalition lâche risque de pérenniser la fragmentation de la gauche plutôt que de la réparer. Quelle est votre position sur ces questions ?
Je ne suis favorable à aucune de ces deux positions, du moins pas dans leur version extrême. D'un côté, on risque d'aboutir à un travaillisme réchauffé, avec une meilleure politique mais une forme de parti similaire, dont la priorité première est de trouver des candidats pour les élections locales. De l'autre, le danger est de se retrouver avec une coalition informelle d'indépendants qui n'offre aucune perspective gouvernementale pour un véritable changement. Aucune de ces deux options ne permettra de construire un véritable pouvoir dans la société.
Dans le livre que j'ai écrit après la défaite de 2019, j'ai plaidé en faveur d'une fédération des mouvements, des organisations structurées et des forces existantes de gauche qui pourrait servir de base à un projet plus ambitieux. Aujourd'hui, il est encore tout à fait plausible qu'une organisation fédérée puisse jouer ce rôle : jeter les bases de ces différents types de constructions politiques dont j'ai parlé précédemment. Mais, de plus, il faudrait toujours une structure décisionnelle unifiée pour pouvoir mettre en place une structure plus large, qu'elle soit fédérale, confédérale ou centrale. Opter pour une coalition plutôt que pour un parti ne changerait rien au fait que les gens doivent d'abord se rassembler et s'accorder sur les grandes lignes, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. Il n'y a pas non plus de raison pour qu'un parti ne puisse pas respecter des positions diverses, avec des tendances différentes et un pluralisme interne. Une marque politique locale existante devrait pouvoir continuer à fonctionner avec un haut degré d'autonomie, si tel est son souhait. Il s'agit là, franchement, de questions secondaires qui pourront être réglées lorsque nous aurons mis en place les canaux de délibération appropriés.
Mon modèle préféré serait une structure dans laquelle nous confierions la stratégie aux membres et la tactique à la direction. Les grandes questions stratégiques – quel type de construction du pouvoir social privilégier, comment répartir les ressources entre les militants à travers le pays, quel type d'éducation et de formation politiques fournir, quel devrait être le contenu du programme politique – seraient toutes décidées collectivement. Les tactiques, c'est-à-dire la manière dont ces objectifs stratégiques sont mis en œuvre, peuvent alors être déterminées en grande partie par les organisateurs ou les politiciens de premier plan. Pour que cela fonctionne, il faudrait un système de direction collective. Cela pourrait se passer comme suit. Une équipe de direction composée de douze ou quinze personnes se présenterait avec une proposition stratégique et peut-être aussi une proposition politique qu'elle soumettrait aux membres, qui voteraient par vote unique transférable pour leur stratégie préférée et les candidats associés. Cela donnerait lieu à la formation d'un comité national composé de dirigeant·es issus de différentes équipes, qui synthétiseraient ensuite les différentes propositions et les soumettraient à la conférence des membres, où elles pourraient être approuvées, modifiées ou rejetées. Le comité élirait également des personnes à différentes fonctions nationales : notre porte-parole principal, notre organisateur principal, notre chargé des relations avec les mouvements progressistes, notre directeur du parti, etc. De cette manière, vous auriez toujours des personnes occupant des postes de direction identifiables, mais cela ne serait pas simplement un concours de popularité. Cela créerait une couche de dirigeants capables de prendre des décisions rapides et tactiques, mais cela favoriserait également le protagonisme populaire en transformant la stratégie en une entreprise collective.
Si un vecteur de gauche avait été lancé plus tôt, il aurait pu saisir un certain nombre d'opportunités politiques. Au niveau de l'élite, il aurait pu exploiter la décision prise en juillet dernier par Starmer de suspendre sept députés, dont Sultana, du parti parlementaire, et peut-être convaincre davantage d'entre eux de quitter le navire.
Au niveau des masses, cela aurait pu permettre de monter une réponse unifiée de la gauche à la vague croissante de violence raciste incitée par Starmer et Farage. Pourquoi, selon vous, ce projet a-t-il mis si longtemps à être rendu public ?
Je travaille sur ce sujet depuis environ un an et je pense qu'il existe des facteurs structurels qui rendent difficile le lancement de quoi que ce soit : pas seulement le type spécifique de parti de gauche que je préconise, mais n'importe quel type de parti de gauche. Comme je l'ai déjà dit, il s'agit de la question de la prise de décision. Quelles sont les décisions légitimes ? Qui peut les prendre et qui peut les mettre en œuvre ? On se retrouve face au dilemme de la poule et de l'œuf : on ne peut pas prendre de décisions avant d'avoir une structure, mais pour avoir une structure, il faut prendre des décisions. Dans d'autres situations équivalentes, ce problème est contourné de l'une des trois manières suivantes.
La première est l'intervention d'un hyperleader. Jean-Luc Mélenchon dit : « Le Parti de Gauche ne fonctionne pas, je forme La France Insoumise », et c'est ce qui se passe. Les gens le suivent. En Grande-Bretagne, nous n'avons pas ce type de figure. Nous avons une sorte d'hyperleader en la personne de Jeremy Corbyn, une personne dont l'autorité morale et politique domine celle de tous les autres, mais il n'agit pas de cette manière. Ce n'est pas son style.
La deuxième solution est une organisation structurée préexistante, dotée d'une capacité de décision disciplinée. Il peut s'agir d'un syndicat ou d'une campagne politique. En Afrique du Sud, Abahlali baseMjondolo, un mouvement de personnes vivant dans des bidonvilles, compte 180 000 membres répartis dans 102 quartiers et mène des occupations de terres dans quatre provinces. Je me suis rendu à leur assemblée générale lorsque j'observais les élections en Afrique du Sud l'année dernière et j'ai assisté à leurs discussions sur la création de leur propre structure électorale. Ils peuvent utiliser leurs mécanismes démocratiques existants qui permettent de prendre des décisions, de les contester et de les renverser dans le cadre d'un processus ouvert où chacun connaît sa position. Cela aussi fait défaut en Grande-Bretagne.
La troisième solution consiste en un petit groupe de personnes politiquement avancées, étroitement liées, capables de prendre des décisions collectives. Au cours de l'histoire, de nombreux partis communistes ont été formés par une douzaine d'individus assis autour d'une table, qui sont rapidement devenus des mouvements de masse. Mais ici, les discussions ont lieu entre des personnes d'horizons et de priorités très différents, qui n'ont pas cette vision collective.
Ces trois facteurs structurels font apparaître un autre facteur contingent qui prend une importance considérable. Il s'agit en fait du facteur déterminant, même s'il se situe en amont des autres. Il s'agit de la question des personnalités. Dans des moments d'insuffisance collective comme celui-ci, les problèmes individuels passent au premier plan. Cela devient beaucoup plus décisif dans des conditions de paralysie objective. Mais aujourd'hui, heureusement, il semble que des progrès soient réalisés. Un nouveau parti est en train de se former malgré ces obstacles, car le besoin politique et la pression extérieure sont écrasants. On ne peut pas ne pas construire un nouveau parti lorsque votre parti, qui n'a pas encore de nom, est déjà à égalité avec le parti au pouvoir dans les sondages. Cela va se produire sous une forme ou une autre.
Quels sont vos projets pour le lancement officiel, maintenant que Corbyn et Sultana ont annoncé cette conférence ?
Malheureusement, le parti a déjà été lancé, même s'il n'existe pas encore. Nous avons été privés d'un lancement soigneusement planifié, mais nous pouvons nous en accommoder. Ce que nous devons faire maintenant, c'est minimiser l'importance du facteur humain contingent en créant un autre type d'autorité souveraine : un organe qui ait le pouvoir de faire avancer le processus. Concrètement, cela prend la forme de cette conférence démocratique. Elle pourrait être chargée de mettre en place un comité qui aurait alors une réelle légitimité dans ses décisions. Toute personne qui s'inscrit comme membre du parti devrait avoir le droit de participer pleinement. La conférence doit les réunir tous, avec des installations hybrides et un vote entièrement en ligne. Elle pourrait élire une équipe de direction collective qui serait chargée de développer l'organisation au cours de l'année suivante, et nous pourrions ensuite mettre en place des structures et une culture qui permettraient de prendre des décisions plus significatives. Rien de tout cela ne serait parfait. En fait, ce serait loin d'être optimal, car cela reviendrait à construire une voiture tout en conduisant. Toutes sortes d'erreurs pourraient être commises, qui pourraient avoir des répercussions plus tard. Mais cela permettrait au moins d'accélérer le processus. Cela offrirait un peu d'espoir à un moment politique où il fait cruellement défaut. Et cela serait très important.
Entretien publié sur le site Sidecar le 25 juillet 2025 ; traduction rédaction A l'Encontre.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La loi Duplomb partiellement censuré : un pied dans la porte ?

Jeudi 7 août, le Conseil constitutionnel a censuré la ré-autorisation de l'acétamipride, un néonicotinoïde dont la toxicité sanitaire et environnementale n'est plus à démontrer.
8 août 2025 tiré du site Les Soulèvements de la Terre
AH BON, IL Y A UNE « CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT » DANS LA CONSTITUTION ?
Jeudi 7 août, le Conseil constitutionnel a censuré la ré-autorisation de l'acétamipride, un néonicotinoïde dont la toxicité sanitaire et environnementale n'est plus à démontrer. La décision s'appuie sur la Charte de l'environnement, intégrée depuis plus de 20 ans à la Constitution et qui prétend que « les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ».
Cette charte n'a jamais réussi à empêcher la fuite en avant mortifère du complexe agro-industriel. La reculade très partielle de l'Etat est la conséquence directe d'une colère populaire montante face à une intoxication généralisée des corps et des milieux par l'industrie des pesticides. Cette colère s'est traduite ces derniers mois dans le combat de l'association Cancer colère et des autres associations de victimes, dans des actions directes telles que des blocages et intrusions dans des sites de production de pesticides, dans les 2 millions de signatures de la pétition réclamant l'abrogation de la loi Duplomb. Cette dynamique de résistance n'a en rien perdu sa pertinence, et nous devons continuer à œuvrer à son approfondissement : cette loi, même amputée, constitue toujours une offensive brutale d'un modèle agro-industriel délétère. Même sans acétamipride, le blanc-seing accordé à l'agrandissement des fermes-usines en particulier ne peut que contribuer à toujours plus intensifier le recours à la chimie de synthèse.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A AUSSI CENSURÉ LA VALIDATION AUTOMATIQUE DES MÉGA-BASSINES
La version du texte soumise au Conseil prévoyait également d'inscrire dans la loi que tout projet de méga-bassines devrait être considéré comme étant d'intérêt général. S'il n'a pas censuré cet article, le Conseil constitutionnel a toutefois émis une importante « réserve d'interprétation ». Comme l'explique Mediapart, « d'une part, les prélèvements d'eau pour ces stockages ne peuvent se faire dans les nappes dites ‘inertielles', c'est-à-dire les nappes souterraines longues à se recharger ou se vider ; d'autre part, la ‘raison impérative d'intérêt général majeur' inscrite dans le texte pour ces projets peut être contestée devant les tribunaux. Ce qui veut dire que la loi est préventivement vidée de son sens : l'intérêt général est présumé, mais un tribunal peut l'invalider.
On sait que les batailles juridiques ne suffisent pas à empêcher les projets mortifères de se faire – que la ‘victoire' arrive une fois les travaux terminés ou qu'elle ne soit tout simplement pas appliquée, par exemple. Il est d'ailleurs possible que des reprises de chantiers de bassines tentent de reprendre à l'automne, notamment dans la Vienne. Tenons-nous prêt-es à y réagir promptement si besoin.
MENER LE COMBAT CONTRE LE MONDE DES PESTICIDES
Comme l'a déclaré Fleur Breteau, porte-parole de Cancer Colère : « Cette décision nous apprend une chose, c'est que le rapport de force fonctionne. Et comme il reste 288 molécules nocives pour la santé et l'environnement utilisées en agriculture, on ne va pas s'arrêter là. Ce que nous voulons, c'est un moratoire sur les pesticides. » Nous n'arracherons pas l'interdiction immédiate de la production et de l'utilisation de ces produits les plus toxiques (cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques et perturbateurs endocriniens), sans une résistance populaire déterminée, sans un mouvement massif de lutte. Cette revendication doit par ailleurs être couplée à deux autres : un coup d'arrêt à la délocalisation coloniale des contaminations environnementales, par l'interdiction des exportations prédatrices par les firmes agrochimiques de pesticides interdits sur le territoire hexagonal ; la nécessaire interdiction aux frontières des produits importés traités avec les mêmes pesticides, provoquant une concurrence déloyale que dénoncent la majeure partie des actifs agricoles. La mobilisation citoyenne des 2 millions de pétionnaires contre la loi duplomb doit se prolonger, par des actions collectives à la hauteur des enjeux et par l'émergence d'une force d'opposition dans la rue.
PAS D'ALTERNATIVE A LA CHIMIE DANS UN MONDE OU LA PRODUCTION AGRICOLE EST DÉVOLUE À UNE MINORITÉ DE 400 000 EXPLOITANT-ES
La sortie généralisée des pesticides et la métamorphose de nos modes de production agro-alimentaires réclamera une réforme agraire plus profonde encore. Une transformation passera par la conquête de mesures protectrices à même de faire cesser la guerre commerciale, et permettre aux agriculteurs d'affronter en connaissance de cause les enjeux écologiques et climatiques. Mais aussi par des luttes foncières pour freiner l'agrandissement et la concentration capitalistique des exploitations. Enfin, par une reprise en main des filières pour se réapproprier la valeur prédatée par les firmes, et asseoir ainsi la garantie économique générale d'un revenu paysan. Ce n'est qu'en imposant politiquement, par la construction d'un rapport de force conséquent, le nécessaire réempaysannement de masse de nos territoires, que nous pourrons nous arracher à notre dépendance à l'endroit de la filière mortifère des pesticides.
Nous continuerons à nous opposer à la loi Duplomb : rendez-vous dans les champs, les usines et les rues !
P.-S.
• Les Soulèvements de la terre, 8 août 2025 :
https://lessoulevementsdelaterre.org/blog/duplomb-partiellement-censure-un-pied-dans-la-porte
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Protestations en temps de guerre à l’intérieur des frontières de la Fédération de Russie

Quels moyens légaux de protestation restent-ils aujourd'hui en Russie ? Où se recoupent les mouvements environnementaux, humanitaires et autochtones ? Kirill Medvedev présente ces nouvelles formes de lutte à l'intérieur des frontières de la Fédération de Russie.
6 août 2025 |tiré du site Entre les lignes entre les mots
Catastrophes environnementales, centralisation excessive, faiblesse des collectivités locales, manque d'autonomie régionale : même si la guerre en Ukraine tend à occulter les questions politiques intérieures russes dans les médias, celles-ci n'en restent pas moins importantes. Sur les quelque 300 campagnes de protestation qui ont eu lieu dans 40 régions de Russie en 2024, la majorité était consacrée à des questions environnementales et d'urbanisme, qu'il s'agisse de lutter contre la déforestation, les nouvelles colonies pénitentiaires ou les décharges.
Les campagnes les plus médiatisées et les plus explosives surviennent lorsque l'autodétermination des minorités ethniques entre en jeu parallèlement aux préoccupations environnementales. Cela s'explique non seulement par le fait que ces campagnes rassemblent des personnes et des groupes aux priorités très différentes, mais aussi parce que les divers groupes ethniques au sein de l'État russe sont un sujet extrêmement sensible pour le régime. D'une part, les autorités sont obsédées par la préservation de « l'intégrité » du pays. D'autre part, elles sapent lentement mais sûrement cette intégrité en démantelant l'autonomie locale et en renforçant la hiérarchie bureaucratico-militaire. De plus, elles promeuvent un discours nationaliste et impérialiste (selon lequel il existerait un « monde russe » transnational, que « les Russes et les Ukrainiens ne forment qu'un seul peuple » et que la langue russe a droit à l'hégémonie au niveau national parce que les Russes de souche ont « fondé » le pays). En conséquence, pour les écologistes et les autres militants sociaux, les questions relatives aux minorités ethniques constituent à la fois un facteur de risque et un moyen de négociation. Ils peuvent parier sur le fait que les autorités ne veulent pas aggraver la situation.
La campagne menée en 2018-2020 à la gare de Shies, dans la région d'Arkhangelsk, où la lutte environnementale contre une décharge que les autorités et les entreprises de Moscou tentaient d'imposer a rassemblé divers groupes, est un bon exemple. Pour certains, il s'agissait d'une question purement environnementale ; pour d'autres, il s'agissait de protéger le Nord russe en tant que région ethnoculturelle. Certains se sont battus pour défendre le patrimoine autochtone. D'autres ont donné la priorité à la justice sociale. D'où la diversité politique des manifestants et de leurs partisans, qui comprenaient des militants de gauche, des militants libéraux des droits de l'homme, des anarchistes, des nationalistes, ainsi que des représentants de partis parlementaires et de divers mouvements civils.
Cet article examine de plus près trois campagnes récentes afin de comprendre comment les problèmes environnementaux et les droits humains s'entrecroisent avec les questions d'autonomie régionale et de souveraineté autochtone.
Altaï : « Les citoyens ont le devoir de défendre leur patrie » contre les oligarques
La République de l'Altaï occupe un territoire petit mais stratégiquement important entre le Kazakhstan, la Mongolie et la Chine avec les régions adjacentes de Touva, Khakassie, Kemerovo et Altai Krai en Russie. (La République de l'Altaï est distincte de l'Altaï Krai.) En juin 2025, elle a été le théâtre de manifestations déclenchées par une réforme du gouvernement local qui a supprimé les conseils de village, qui constituaient la forme de gouvernement la plus locale et la plus immédiate.
Cette réforme remonte à 2020, lorsque, dans le cadre des tristement célèbres amendements présidentiels à la Constitution, l'autonomie locale a été intégrée à un « système unifié d'autorité publique ». Peu après, en 2021, le projet de loi dit « Klishas-Krasheninnikov » a été proposé (il a finalement été adopté en 2025), permettant aux autorités régionales de se débarrasser de l'autonomie locale dans les zones urbaines et rurales et de regrouper les petites municipalités en districts (l'équivalent approximatif des comtés aux États-Unis). Les opposants ont qualifié cette mesure de « coup de grâce » pour l'autonomie locale.
Le 24 juin 2025, le parlement de la République de l'Altaï a adopté un système d'autonomie locale à un seul niveau : les dix districts actuels, dont les dirigeants sont élus par le peuple, seront remplacés par un nombre identique de districts dirigés par des « fonctionnaires nommés », tandis qu'une centaine de conseils villageois seront supprimés.
En réponse, la population a organisé une série de manifestations et bloqué les routes avec des slogans tels que « Turchak doit démissionner », « Non à l'accaparement des terres par les oligarques », « L'Altaï est à nous » et « Oui à un gouvernement à deux niveaux ».
Les autorités ont riposté par la répression (les militants ont été condamnés à 13-14 jours de détention ou à des amendes). Andreï Turchak, fils d'un ami de Poutine et idéologue de Russie unie, nommé par Moscou à la tête de la République, a qualifié les manifestants de vandales sur sa chaîne Telegram. Il les a exhortés à « ne pas troubler les esprits », car « nous luttons ensemble pour la paix et la prospérité de la République de l'Altaï tandis que nos gars sur le front défendent les intérêts de la grande Russie ». Pendant ce temps, ces « gars sur le front » ont enregistré un message de soutien aux manifestants : « Notre patrie est déchirée par Turchak et [le chef du gouvernement par intérim] Prokopyev ».
Qu'est-ce qui préoccupe tant la République de l'Altaï ? Tout d'abord, sa vulnérabilité face aux entreprises basées à Moscou, exacerbée par la nouvelle réforme. Parmi ces entreprises, on trouve la Sberbank, qui construit des hôtels et des complexes touristiques pour l'élite moscovite et régionale, et la holding pharmaceutique Evalar, qui possède des plantations d'herbes médicinales dans les contreforts des montagnes de l'Altaï. Comme d'habitude, les entreprises sont étroitement liées à l'État : German Gref, le directeur de la Sberbank, est un éminent libéral pro-gouvernemental et ancien ministre du Développement économique. Larisa Prokopyeva, fondatrice d'Evalar, est la mère du chef du gouvernement par intérim de l'Altaï, Alexander Prokopyev. Certains prédisent qu'il finira par remplacer Turchak.
En juin 2024, une vidéo est devenue virale, montrant Gref réprimandant des chauffeurs de taxi à l'aéroport de Gorno-Altaysk pour avoir garé leurs voitures au mauvais endroit. (Les chauffeurs ont répondu en se plaignant du manque de parkings modernes.) Il s'en est également pris à leur apparence, menaçant de les faire licencier. « Regardez-vous, debout là, en sous-vêtements ! Garés les uns sur les autres. Qui êtes-vous pour… Comment vous appelez-vous ? Je suis [l'Allemand] Gref. Ouvre encore la bouche et tu ne travailleras plus jamais ici. Compris ? »
Les habitants de l'Altaï ont compris. « Gref est désormais le représentant de nombreuses personnes qui investissent de l'argent et tentent d'acheter des terres locales. Le message anti-oligarchique est au cœur du mouvement des manifestants », explique Vladimir, un habitant de la région avec qui je me suis entretenu.
Selon ses concitoyens de l'Altaï, les entreprises moscovites n'apportent aucun avantage ni aucune nouvelle opportunité à la République. La réforme permettra aux entreprises d'acheter, de manière volontaire ou obligatoire, des parcelles de terrain appartenant à des communautés rurales et gérées jusqu'à présent par les conseils villageois. Cela risque de créer « un apartheid social, qui entraînera le transfert massif de terres, en particulier le long des berges des rivières et des lacs, vers des complexes touristiques fermés et des communautés de maisons de vacances », explique Pavel Pastukhov, blogueur et manifestant actif. Il estime que les habitants seront privés d'eau, de forêts et de pâturages, ce qui créera un conflit social à long terme et un sentiment d'« occupation » de leur terre natale. De plus, le projet de vente des terres sans appel d'offres risque d'accroître la corruption et de nuire aux entreprises locales, déjà fragiles.
Le mot « terre » revient souvent dans les manifestations pour une autre raison : cette année, les législateurs de la République de l'Altaï ont supprimé de leur constitution la phrase garantissant « l'intégrité, l'inaliénabilité et l'indivisibilité du territoire [de la République] ». Certains spéculent que le gouvernement fédéral prévoit d'annexer la République à la région voisine de l'Altaï. Pour les peuples autochtones de l'Altaï, cela signifierait la perte de leur identité nationale. Le gouvernement fédéral avait déjà évoqué l'idée de fusionner les deux régions dans les années 2000, mais en 2006, une manifestation de masse s'était déroulée dans la capitale de la République, Gorno-Altaysk, pour s'opposer à cette mesure, et aujourd'hui, la politique de fusion des régions menée par Moscou fait l'objet d'un débat constant.
La réponse des autorités aux premières manifestations de cet été a déclenché une vague de protestations, et l'organisation Kurultai du peuple de l'Altaï a demandé l'autorisation d'organiser un rassemblement. Dans un premier temps, l'administration a autorisé un rassemblement de 102 participants dans un parc local, mais elle a ensuite cédé et accordé un lieu plus grand. Au total, environ 4 000 personnes se sont rassemblées, un nombre important pour une république qui ne compte que 220 000 habitants.
« Nous sommes venus ici aujourd'hui parce que nous comprenons que c'est le dernier combat de notre peuple. C'est le dernier combat non seulement du peuple de l'Altaï, mais aussi de tous les peuples qui vivent dans la République de l'Altaï, et de ceux qui vivent n'importe où en Russie », a déclaré la principale oratrice du rassemblement, Aruna Arna, la « leadeuse du peuple de l'Altaï ». Elle s'est fait connaître pour son opposition à l'ancien chef de la république, Khorokhordin, et a fait l'objet de perquisitions à son domicile, de détentions et de poursuites administratives. En avril 2023, Arna a été accusée de « discréditer l'armée russe » : elle avait critiqué la mobilisation et suggéré d'envoyer les enfants des fonctionnaires russes à la guerre. L'année dernière, elle a été condamnée à une amende pour un message sur les sosies de Poutine et la fraude électorale.
« Nous défendons notre opinion de manière légale et légitime, et tout ce qu'ils nous donnent, c'est une gifle », poursuit Aruna. « Un État est constitué d'un peuple et d'un territoire. S'il n'y a ni peuple ni territoire, il n'y a pas d'État. Si nous voyons que notre État, notre République de l'Altaï, est en train d'être détruit, alors, conformément à l'article 59 de la Constitution, les citoyens ont le devoir de défendre leur patrie : nous obéissons à la loi. […] On nous dit que la seule politique qui fonctionne, c'est l'investissement. Regardez autour de vous : qui s'est enrichi, à part les investisseurs milliardaires qui possèdent pratiquement tout ? […] Nous exigeons [d'élire] nos propres représentants. Il ne s'agit pas de détruire les administrations villageoises et les députés, mais au contraire de redonner vie aux villages. »
« On ne peut pas prendre la terre d'une nation. […] Comme l'a dit Vladimir Lénine, « La paix aux nations, la terre aux nations ! » Turchak devrait être ici [à notre manifestation]. Il est temps qu'il commence à respecter le peuple », fait écho Antonina Chaptynov, veuve de Valery Chaptynov, connu comme le premier leader post-soviétique de la République de l'Altaï.
Turchak, pour sa part, estime que le nouveau système permet d'économiser des ressources et évite aux habitants de l'Altaï de passer par les méandres bureaucratiques. « C'est facile d'être gentil, essayez donc de faire le bien », commente-t-il à propos de l'adoption de la loi qui a suscité tant d'indignation parmi les habitants. Cependant, les habitants de l'Altaï ont réussi à préserver l'élection directe des chefs de district. Et, comme c'est souvent le cas, les concessions partielles se sont accompagnées d'une répression accrue.
L'histoire de l'Altaï rassemble plusieurs éléments caractéristiques : la destruction de l'autonomie locale, l'expansion agressive des grandes entreprises moscovites et les solutions politiques et policières habituelles qui provoquent la résistance des habitants. Ceux-ci craignent de perdre leurs terres (par nécessité ou sous la pression), ils perdent l'élection des députés de leur village et, avec elle, la possibilité d'influencer les autorités et de résoudre simplement leurs problèmes quotidiens. (« Maintenant, il faut parcourir 50 à 60 kilomètres pour un simple bout de papier, en l'absence de transports réguliers », se plaint Vladimir. Enfin, ils ont le sentiment que leur République, garante de la préservation de la langue et de la culture altaïennes, est menacée.
Opposer l'intégrité du pays à celle de ses régions, le racisme, le mépris des pauvres et l'arrogance coloniale, laisser les oligarques agir à leur guise : clairement, rien de tout cela ne contribuera à maintenir une immense fédération multiethnique.
Défendre les Shikhans au Bachkortostan : le racisme russe se tire une balle dans le pied
Le Bachkortostan est un autre endroit où la protection de l'environnement, la résistance à l'emprise fédérale et la lutte contre les grandes entreprises vont de pair avec l'autodétermination des peuples autochtones. En 2020, des manifestations ont éclaté dans la République contre l'exploitation des gisements de calcaire du shikhan de Kushtau, un site naturel emblématique et une montagne sacrée.
Une campagne publique massive a réussi à bloquer le projet. En 2024, les tensions sont de nouveau apparues après la condamnation de l'activiste Fail Alsynov, qui s'était exprimé lors d'un rassemblement public contre l'exploitation aurifère dans la chaîne de montagnes Irendyk. Les manifestations se sont déroulées sous des bannières écologistes, mais Alsynov lui-même est connu comme l'ancien leader de l'organisation nationaliste Bashkort. Il a même osé mentionner l'éléphant dans la pièce : « Ce n'est pas notre guerre. Aucun étranger n'a attaqué notre terre ». La répression contre Alsynov (condamné à quatre ans de prison pour « incitation à la haine interethnique ») a fait de l'activiste un héros de la résistance : 10 000 personnes se sont rassemblées lors d'un rassemblement en sa défense.
En mai 2025, les manifestations ont repris au Bachkortostan. Cette fois, les habitants étaient mécontents des projets de développement du Kryktytau shikhan proposés par l'une des plus grandes entreprises privées du pays, la Russian Copper Company, représentée par sa filiale Salavatskoe. Kryktytau est un site de rituels et de rassemblements traditionnels bashkir mentionné dans le poème épique Ural-batyr. (La chanson « Homay » du groupe Ay Yola, basé à Oufa, qui a gagné en popularité dans le monde turc, fait référence à ce lieu et au personnage de l'épopée.)
Les manifestations contre la destruction du shikhan ont commencé en 2020. Les défenseurs de Kushtau ont gagné, obtenant le retrait des entreprises et du gouvernement. Mais pendant la guerre, la société minière a repris ses activités à Kryktytau. La population estime que l'usine minière menace les écosystèmes des rivières locales et du lac Yaktykul, un monument naturel.
Le 22 mai, des unités de police régulière et anti-émeute en tenue de combat sont arrivées au cıyın, un rassemblement traditionnel dans le district d'Abzelilovsky, où les participants avaient prévu de discuter de la question de Kryktytau. Craignant une manifestation de masse, les autorités de tout le district ont annulé le Sabantuy, le festival annuel marquant la fin des semailles de printemps. En juin, des militants ont été arrêtés et soumis à des « entretiens préventifs » avec la police. Comme dans l'Altaï, des soldats se sont joints aux manifestations : ils ont enregistré un message vidéo, mais quelques jours plus tard, ils ont retiré leur soutien, affirmant avoir été manipulés.
Les partisans d'Alsynov ont été chassés des places publiques, mais en mémoire de la victoire de Kushtau, des festivals folkloriques sont désormais organisés chaque année dans le village voisin de Shikhany, une nouvelle tradition issue de cette lutte. Mais les tensions persistent. « Le racisme russe se tire une balle dans le pied », déclare Rim Abdunasyrov, l'un des héros de la lutte pour Kushtau. « Nous, les Bachkirs, avons notre propre terre, et notre peuple la défendra. Au cœur de tout ce qui s'est passé à Kushtau se trouve le mot « patriotisme », aujourd'hui corrompu. Pas le patriotisme qui consiste à partir à l'étranger avec des armes, mais celui qui consiste à défendre sa terre et son peuple. »
« Où est Seda ? » : campagne contre la violence domestique de Saint-Pétersbourg à Grozny
Dans ces deux premiers cas, les conflits entre la politique nationale et les intérêts locaux se sont produits dans des régions qui ont souffert (ou plutôt refusé de souffrir) de l'expansionnisme du gouvernement fédéral et des grandes entreprises. Dans le cas de la campagne « Où est Seda ? », l'action s'est d'abord déroulée à Saint-Pétersbourg.
Seda Suleymanova avait quitté la Tchétchénie pour s'installer dans la métropole du nord de la Russie en 2022, fuyant la violence domestique. À Saint-Pétersbourg, Seda a trouvé un emploi dans un bar et a emménagé avec son petit ami Stas. Un jour, elle s'est retrouvée à fuir par une porte dérobée pour échapper à son frère, qui s'était présenté sur son lieu de travail pour exiger qu'elle retourne en Tchétchénie. Peu après, elle a été arrêtée par les forces de sécurité sous de fausses accusations de vol et remise à ses proches. Le 4 septembre, Mansur Soltayev, le médiateur pour les droits de l'homme de la République tchétchène, a publié une vidéo dans laquelle il marchait aux côtés de Suleymanova, silencieuse, confirmant qu'elle était en vie et « en sécurité ». Depuis, personne ne l'a revue.
Lena Patyaeva, une amie proche de Seda, pense qu'elle a très probablement été victime d'un « crime d'honneur ». Après la disparition de Suleymanova, Patyaeva a organisé la campagne « Où est Seda ? », qui, bien qu'elle n'ait pas encore obtenu de réponse à sa question, a réussi à faire ouvrir une enquête pénale sur sa disparition (avril 2024) et, plus récemment, à faire déclarer Suleymanova disparue.
Patyaeva raconte qu'elle a commencé par envoyer des courriels aux médias publics, mais n'ayant reçu aucune réponse, elle a décidé d'organiser un piquet de grève solo pour « attirer l'attention des médias ».
« J'ai organisé mon premier piquet le 1er février 2024. J'avais très peur. […] Mais après le piquet, je n'ai reçu aucune menace et personne ne m'attendait dans la cage d'escalier pour m'attaquer. J'ai réalisé que la peur fait naître des montagnes d'une taupinière. Cela m'a aidée à continuer. »
Patyaeva a organisé plusieurs autres piquets à Saint-Pétersbourg, mais a ensuite constaté que l'intérêt diminuait, ce qui signifiait qu'elle perdait toute possibilité de faire pression sur l'enquête. Elle a alors décidé d'organiser un piquet à Grozny. Elle a soigneusement réfléchi à sa stratégie afin de minimiser les risques et d'attirer l'attention sur le problème. Craignant que les forces de sécurité ne placent de la drogue sur elle, Lena a enregistré une vidéo à l'aéroport de Sheremetyevo pour prouver qu'elle avait passé les contrôles de sécurité et qu'elle n'avait pas d'objets ou de substances interdits en sa possession. Dès le début du piquet, un message a été publié sur la chaîne Telegram « Où est Seda ? », dans lequel la militante explique ses actions et appelle à la solidarité. Les forces de sécurité ont arrêté Lena une heure après le début du piquet de grève, mais son pari que « personne n'a intérêt à provoquer un scandale interethnique à propos d'une fille qui n'a pas brûlé le Coran ni commis d'acte illégal et qui se bat simplement pour son amie » s'est avéré juste : elle a été rapidement libérée sans inculpation. Elle a atteint son objectif, qui était « d'attirer l'attention des médias avant même son éventuelle arrestation ».
Une grande partie de la campagne consistait à impliquer différents groupes politiques, du Parti libertaire à l'Action socialiste de gauche, qui, selon Patyaeva, « se sont réunis et ont trouvé un terrain d'entente ». Les militants visaient à recueillir 2 000 signatures papier au cours des quatre semaines de la campagne, mais ils ont finalement obtenu plus de 5 500 signatures papier et plus de 2 000 signatures électroniques.
« Ce n'est pas une question de politique. […] Je souhaite bénéficier du soutien le plus large possible. Même de la part de personnes avec lesquelles je ne serais pas d'accord si nous nous asseyions pour discuter de toutes les autres questions », admet Lena. « Le cas de Seda est clair pour tout le monde : la gauche comme la droite, les libéraux comme les conservateurs, l'opposition comme les partisans du gouvernement. Les seuls qui détestent cette campagne sont ceux qui soutiennent les « crimes d'honneur », généralement des hommes tchétchènes. Ils nous envoient des menaces, tandis que certaines femmes tchétchènes, au contraire, me soutiennent et me remercient pour ce que je fais. »
La campagne « Où est Seda ? » touche un point sensible de la politique russe. Comme on le sait, la Tchétchénie a développé son propre système juridique, dans lequel les agents de l'État se livrent non seulement à des représailles extrajudiciaires internes, mais mènent parfois aussi des raids en dehors de la République (comme le meurtre de Boris Nemtsov ou l'enlèvement des militants de l'opposition Magamadov et Isaev à Nijni Novgorod). Ce fait est aussi évident qu'il est impossible pour les autorités tchétchènes de le reconnaître : elles affirment que la Tchétchénie respecte toujours les lois russes communes. Le gouvernement fédéral ferme également les yeux sur les « crimes d'honneur » et autres manifestations du statut particulier de la République.
La question de l'autonomie tchétchène est devenue un défi existentiel pour le nouvel État russe dans les années 1990 et, dans le même temps, l'un des principaux arguments en faveur de l'élection d'un président issu de la police secrète. Aujourd'hui, la Tchétchénie, avec ses anachronismes reconstruits et ses cultes militarisés, sert d'exemple effrayant pour le reste de la Russie, et « l'ordre public » dans la république du Caucase du Nord reste un symbole du transfert de pouvoir réussi il y a 25 ans, des réalisations politiques de Poutine et de la viabilité globale de la Fédération de Russie en tant qu'État post-soviétique. L'image sinistre de la Tchétchénie tient en grande partie à son caractère fermé : les habitants du reste de la Fédération de Russie ne sont pas censés connaître l'état d'esprit réel des Tchétchènes. Tout ce que le gouvernement veut qu'ils sachent (ou croient), c'est que le mécontentement public à l'égard du régime de Kadyrov leur coûterait cher et que sa chute entraînerait rapidement l'effondrement de la Russie.
La tactique de Lena Patyaeva consistant à franchir les frontières s'est donc avérée aussi risquée que justifiée, d'abord lorsqu'elle est arrivée à l'improviste à Grozny pour manifester, puis lorsqu'elle s'y est rendue pour être interrogée en tant que témoin. « L'enquêteur tchétchène m'a dit que je devais être interrogée en tant que témoin à mon domicile, mais j'ai immédiatement répondu : « Laissez-moi venir chez vous ». » Ce voyage en Tchétchénie lui a également permis d'entrer en contact direct avec la population locale, y compris des policiers. « L'un d'eux m'a demandé pourquoi je pensais que ses proches l'avaient tuée. Et quand il a appris que Seda vivait à Saint-Pétersbourg avec un Russe, il a admis : « Oh, eh bien, dans ce cas, ils auraient pu la tuer ». »
Le gouvernement tchétchène n'aime pas la publicité, c'était le principal argument de Lena. « La publicité est le seul moyen de pression dont nous disposons. Lorsque je me suis impliquée dans cette affaire, l'histoire était déjà publique et il était trop tard pour régler les choses en privé. À l'heure actuelle, la publicité est la seule chose qui leur met la pression et les met mal à l'aise […] Il faudra du temps aux forces de sécurité tchétchènes, assises dans leurs bureaux, pour décider qu'elles en ont assez de toute cette agitation et qu'elles doivent montrer Seda vivante ou mettre ses assassins en prison, si elle a été tuée. »
Il semble que la tactique de Lena, bien que lente, porte ses fruits : le fait que Seda ait été déclarée disparue en juin est une avancée majeure, qui donne une lueur d'espoir à tous ceux qui suivent cette histoire difficile.
Transcender les nouvelles frontières
Lorsque les moyens de protestation se font rares, que les anciennes structures de contestation ont disparu et que les traditions de résistance post-soviétiques sont brisées, ceux qui veulent s'exprimer n'ont plus que quelques outils à leur disposition. Ils peuvent s'adresser à Poutine, faire intervenir des soldats, recueillir des signatures, lancer des pétitions, organiser des piquets de grève individuels, rassembler des gens… Presque tout le monde essaie d'agir dans le cadre de plus en plus restreint de la loi et presque tout le monde insiste sur la nature « apolitique » de ses actions, ce qui lui permet de se défendre contre la répression tout en comptant sur le soutien de la majorité politiquement confuse sur des questions spécifiques, telles que la préservation du patrimoine naturel et culturel dans les républiques ethniques minoritaires ou le rejet de coutumes telles que les « crimes d'honneur ».
Cependant, quel que soit le degré de distanciation par rapport à la politique, la nécessité de créer un cadre plus large pour discuter des questions locales demeure. Au lieu d'une concurrence entre les grands programmes politiques, qui a été interdite, on assiste à la réinvention ou à la création de rituels collectifs (et parfois personnels), à une lutte pour l'interprétation des symboles officiels de la mémoire historique ou pour la formulation de la Constitution. On peut rappeler comment les femmes de conscrits (dans une autre campagne récente très médiatisée, The Way Home) se sont approprié des dates et des monuments pour leurs actions, rivalisant avec les autorités pour définir la mémoire publique de la Seconde Guerre mondiale.La déclaration de Turchak selon laquelle les défenseurs de l'autonomie de l'Altaï « dérangent les esprits » met en évidence un véritable désaccord : les divinités, les esprits locaux, les fantômes ancestraux et les figures des morts représentent-ils toujours la paix et l'ordre, c'est-à-dire l'administration actuelle, ou pourraient-ils se ranger du côté de ceux qui défient les riches et les puissants de ce monde ?
Dans une interview, Lena Patyaeva, figure de proue de la campagne « Où est Seda ? », raconte comment elle a pris le temps de se familiariser avec l'ensemble du paysage politique et comment elle a élaboré étape par étape sa stratégie de campagne et son cadre rituel unique. « J'ai pris la décision d'aller en Tchétchénie le soir du Nouvel An. Je ne voulais pas le faire n'importe quel jour, mais à la date anniversaire de l'enlèvement, le 25 mars. […] Grâce à mon voyage en Tchétchénie, les gens ont commencé à recueillir des signatures. Je suis certaine que sans ce voyage, les choses ne se seraient jamais passées à une telle échelle ». Rompant avec les conventions, les fêtes saisonnières telles que le réveillon du Nouvel An ne sont pas ici des moments de repos avant le retour à l'ordre ancien, mais des occasions de prendre une décision importante et de faire un pas en avant – un pas à la fois personnel et socialement significatif, comme pour briser le cycle de l'apathie politique généralisée.
Un nouveau rituel politique important consiste à défendre le territoire, dans différents sens du terme : alors que l'État salue la défense des nouvelles frontières de la Fédération de Russie, ses actions sont perçues par de nombreux habitants des régions russes comme une attaque contre leur territoire, qu'il s'agisse de leurs parcelles privées, de leurs zones forestières et montagneuses protégées ou des frontières administratives de leurs républiques minoritaires sur lesquelles les autorités fédérales ont des projets.
Le régime se soucie de l'« intégrité » du territoire sous son contrôle, il protège ses frontières – et il les viole également, privant les pays voisins de leur intégrité, supprimant les garanties d'intégrité des constitutions de ses républiques membres et divisant leurs territoires (rappelons les récentes manifestations en Ingouchie contre le transfert d'une partie de leur territoire à la Tchétchénie). Il crée une frontière informelle entre la Tchétchénie et le reste de la Fédération de Russie, et nous voyons que le franchissement de cette frontière par un militant s'est avéré être un geste politique fort qui a conduit à un succès partiel.
Plus on parle de frontières, plus il est important de trouver comment les franchir, et plus il est important de penser au-delà des frontières notre façon de voir les choses, nos actions et nos projets. Shies est devenu un centre de résistance en grande partie parce qu'il se trouvait à la jonction de deux régions : la région d'Arkhangelsk et la République des Komis. Ce qui se passe aujourd'hui au Bachkortostan est soutenu par les habitants de la région voisine de Tcheliabinsk, entre autres, ce qui est un bon signe que ce qui se passe ne se limite pas à un programme ethnique ou national bachkir. Le peuple de l'Altaï a été soutenu par les habitants d'autres régions et États : Tyva, Sakha, Bouriatie, Kraïe de l'Altaï et Kirghizistan. Les montagnes, les forêts, les rivières et les zones climatiques transcendent les frontières, tout comme les droits humains. En cette période d'obsession pour les frontières et la souveraineté, nous devrons tous donner un nouveau sens politique à cette vérité évidente.
Des citoyens engagés de différentes régions de Russie réapprennent à faire de la politique dans de nouvelles conditions. Ils sont contraints de forger de nouveaux liens au-delà des barrières érigées par les autorités et de recoder les rituels soutenus par l'État. Est-il possible de créer un espace politique dans lequel la lutte pour la terre contre les fonctionnaires fédéraux et les entreprises devient un front commun, et où les traditions patriarcales dépassées cessent d'être un moyen de terroriser, de diviser et de paralyser la société ? C'est peut-être possible, mais cela exigera non seulement que les militants locaux fassent preuve de courage et d'ingéniosité, mais aussi qu'ils bénéficient d'une attention, d'un soutien et d'une solidarité non dogmatiques, au-delà de toutes les frontières.
Kirill Medvedev
https://www.posle.media/article/wartime-protest-across-russias-internal-borders
Traduction Deepl revue ML
https://www.reseau-bastille.org/2025/08/01/protestations-en-temps-de-guerre-a-linterieur-des-frontieres-russes/
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le nouveau maccarthysme universitaire de la critique d’Israël aux États-Unis, en Allemagne et en Israël

À Jérusalem, aux États-Unis, en Allemagne des professeurs sont licenciés et des étudiants sanctionnés pour s'être exprimés sur la guerre à Gaza. La liberté académique n'est pas un luxe de tour d'ivoire ; elle est une pierre angulaire de la vie démocratique. Prenons la parole non seulement pour nous-mêmes, mais pour un espace public plus juste et honnête. Par Katharina Galor et Noga Wolff.
Tiré du blogue des autrices.
À Jérusalem, une professeure a été emmenée menottée pour avoir critiqué la guerre que son gouvernement mène à Gaza. Aux États-Unis, deux présidentes d'université ont dû démissionner sous la pression de donateurs opposés aux manifestations pro-palestiniennes. En Allemagne, une chaire de professeur invité a été annulée après qu'une universitaire juive américaine a signé une lettre appelant à un cessez-le-feu. Dans ces trois contextes nationaux — Israël, les États-Unis et l'Allemagne — un nouveau maccarthysme vise les universitaires critiques de la politique israélienne.
Depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 et la guerre menée par Israël à Gaza, les universitaires critiques d'Israël font face à une répression grandissante. Dans ces trois pays, le simple fait de réclamer un cessez-le-feu ou de témoigner de la compassion pour les civils palestiniens peut entraîner des représailles professionnelles, des menaces judiciaires, l'opprobre public, la censure, des menaces d'expulsion — voire l'emprisonnement.
Nous sommes deux universitaires israéliennes, l'une en Israël, l'autre aux États-Unis, cette dernière en lien étroit avec le monde académique allemand. Les États-Unis et l'Allemagne apportent un soutien politique et militaire constant à Israël, mais celles et ceux qui remettent en cause ce soutien paient un prix élevé. Les accusations d'antisémitisme, de haine ou de trahison ciblent aussi bien des chercheurs juifs qu'arabes, mais frappent plus durement encore les Palestiniens, les musulmans, les voix minoritaires.
À Harvard et à l'Université de Pennsylvanie, Claudine Gay et Liz Magill ont dû démissionner sous la pression politique et financière, accusées d'avoir été trop indulgentes envers des manifestations pro-palestiniennes. Des professeurs ont été licenciés, et des étudiants internationaux ainsi qu'un universitaire ont été menacés d'expulsion pour leurs prises de position pro-palestiniennes. De plus, la définition de l'IHRA de l'antisémitisme, adoptée dans nombre d'universités, confond critique d'Israël et antisémitisme, en particulier lorsqu'elle assimile l'antisionisme à de la haine et de la violence. Le climat sur les campus s'est glacé : des enseignants sont surveillés, réprimandés ou sanctionnés pour leurs recherches ou leurs enseignements critiques portant sur Israël ou la Palestine, des étudiants s'autocensurent – le silence s'installe.
En Allemagne, où la lutte contre l'antisémitisme est une priorité nationale, cet engagement est instrumentalisé pour étouffer la critique d'Israël. L'histoire de la Shoah, la culpabilité allemande et la notion de Staatsräson — qui fait du soutien à Israël un impératif moral et politique — sont invoquées pour délégitimer toute forme de solidarité avec les Palestiniens. En 2019, le Bundestag a qualifié le mouvement BDS d'« antisémite » ; depuis, des universitaires ont perdu des financements ou des invitations pour avoir défendu les droits des Palestiniens. Depuis le 7 octobre, on demande aux candidats à des postes académiques de renier le BDS ou d'approuver la définition IHRA comme condition d'embauche ou de financement. Le soutien inconditionnel à Israël est érigé en devoir moral ; les voix critiques sont perçues comme une atteinte au consensus moral et politique. L'universitaire juive américaine Amy Kaplan a ainsi vu son poste de professeur invité annulé à l'université de Hambourg après avoir signé une lettre appelant à un cessez-le-feu.
En Israël, toute voix critique est réprimée au nom de la sécurité nationale et de la loyauté envers l'État. Exprimer de la compassion pour les Palestiniens ou critiquer la guerre est perçu comme une trahison. Nadera Shalhoub-Kevorkian, universitaire palestinienne citoyenne d'Israël, a été arrêtée après avoir critiqué la guerre à Gaza – une première pour une universitaire israélienne. D'autres enseignants ont été suspendus ou licenciés pour avoir exprimé des positions pro-palestiniennes. De nouvelles ordonnances d'urgence promulguées après le 7 octobre restreignent encore la liberté d'expression, en assimilant la critique à l'incitation. La loi « Nakba » de 2011 autorise le gouvernement à réduire les subventions des institutions qui commémorent la catastrophe palestinienne de 1948. La frontière entre dissidence et criminalité s'efface.
La liberté académique n'est pas un luxe de tour d'ivoire ; elle est une pierre angulaire de la vie démocratique. Quand des professeurs sont licenciés et des étudiants sanctionnés pour s'être exprimés, ce n'est pas qu'un problème universitaire – c'est un problème démocratique. La répression de la critique d'Israël s'inscrit dans une érosion plus vaste de l'espace public. Message glaçant : certaines vérités doivent rester cachées.
Paradoxalement, l'acharnement de cette répression prouve l'importance de nos idées : si elles étaient insignifiantes, nul ne chercherait autant à les faire taire.
Universitaires, étudiants, artistes : faisons front commun et refusons l'intimidation. Exigeons le droit de questionner et de nous exprimer sans crainte. Le nouveau maccarthysme ne réussira que si nous laissons la peur l'emporter ; il échouera si nous répondons par une solidarité internationale.
Aujourd'hui, l'universitaire est visé — comme le sont journalistes, avocats, artistes et toutes celles et ceux qui osent penser, créer ou témoigner. Prenons la parole non seulement pour nous-mêmes, mais pour un espace public plus juste et honnête. Quand nous parlons d'une seule voix, nous faisons plus que résister – nous élargissons le champ du possible.
Katharina Galor enseigne les études juives et le Moyen-Orient à l'Université Brown, aux États-Unis. Elle a publié Out of Gaza : A Tale of Love, Exile, and Friendship (Potomac Books, 2025), et ses recherches portent sur la culture visuelle, le patrimoine et le conflit israélo-palestinien.
Noga Wolff enseigne au College of Management Academic Studies, en Israël. Elle a écrit sur les interprétations historiographiques de l'antisémitisme et s'intéresse aux questions d'identité, de pédagogie et de société dans l'Israël.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La loi européenne sur la liberté des médias - Protection ou contrôle ?

L'entrée en vigueur de la loi européenne sur la liberté des médias (European Media Freedom Act) en août 2025 soulève un paradoxe fondamental : comment une législation présentée comme protectrice de la liberté de la presse peut-elle simultanément autoriser l'arrestation de journalistes et leur surveillance ?
Tiré du blogue de l'auteur.
Cette analyse critique examine les tensions inhérentes à ce texte législatif qui révèle des difficultés "commodes" pour concilier sécurité, lutte contre la désinformation et liberté d'expression dans l'espace démocratique européen.
I. Les ambitions affichées : une protection renforcée du journalisme
A. Les garanties théoriques de la loi
La loi européenne sur la liberté des médias s'inscrit officiellement dans une démarche de protection du journalisme. L'article 4 établit le principe de protection des sources journalistiques, interdisant en théorie le recours aux logiciels espions ou aux arrestations pour contraindre les journalistes à révéler leurs informateurs. Cette disposition répond à une préoccupation légitime face aux pressions croissantes exercées sur les journalistes d'investigation dans plusieurs États membres.
La volonté de renforcer les médias de service public (article 5) témoigne également d'une reconnaissance de leur rôle dans le pluralisme démocratique. En exigeant des procédures transparentes pour la nomination des dirigeants et un financement adéquat, la loi semble vouloir prémunir ces organismes contre les instrumentalisations politiques.
B. Une réponse aux défis contemporains
Cette législation s'inscrit dans un contexte où les médias européens font face à des défis multiples : concentration capitalistique, influence des plateformes numériques, campagnes de désinformation et pressions politiques croissantes. La création d'un cadre juridique harmonisé répond à un besoin réel de coordination face à ces enjeux transnationaux.
II. Les contradictions fondamentales : liberté conditionnelle et contrôle renforcé
A. L'exception qui dévore la règle
La principale contradiction de cette loi réside dans ses exceptions. Si l'article 4 protège théoriquement les sources journalistiques, il autorise immédiatement des dérogations au nom de l'« intérêt général » et de la « proportionnalité ». Ces notions floues et subjectives ouvrent une brèche considérable dans la protection annoncée.
L'autorisation d'utiliser des « logiciels de surveillance intrusifs » pour des infractions punies de trois ans d'emprisonnement minimum élargit dangereusement le champ d'application. L'inclusion du « racisme et de la xénophobie » aux côtés du terrorisme révèle une approche extensive qui pourrait englober de nombreux sujets d'investigation journalistique sensibles.
B. La surveillance institutionnalisée
L'obligation de tenir des registres nationaux des propriétaires de médias (article 6) instaure un système de fichage qui, sous couvert de transparence, permet un contrôle administratif renforcé. Cette mesure, couplée aux possibilités de surveillance, dessine les contours d'un système de monitoring généralisé de la profession journalistique.
III. La lutte contre la désinformation : prétexte ou nécessité ?
A. Un enjeu démocratique réel
La préoccupation concernant la désinformation n'est pas feinte. Les campagnes de manipulation informationnelle, amplifiées par les algorithmes des plateformes numériques, constituent effectivement une menace pour le débat démocratique. La volonté de réguler les « modèles économiques qui tendent à amplifier les contenus polarisants » répond à une problématique avérée.
B. Les risques de l'arbitraire
Cependant, la définition de la désinformation reste problématique. Qui détermine ce qui constitue une information fiable ? Le « Comité européen pour les services de médias », malgré son indépendance formelle, reste largement influencé par la Commission européenne qui en fournit le secrétariat et y place un représentant. Cette configuration soulève des questions sur l'impartialité des décisions.
La promotion des « médias de confiance » implique nécessairement une labellisation qui pourrait créer une hiérarchie entre sources « approuvées » et « suspectes », remettant en cause le principe d'égalité d'accès à l'information.
IV. Les enjeux démocratiques : entre protection et paternalisme
A. Le paradoxe de la liberté contrôlée
Cette loi illustre un paradoxe contemporain : l'État démocratique, face aux défis de la désinformation et des menaces sécuritaires, tend à restreindre les libertés qu'il prétend protéger. La logique sécuritaire l'emporte progressivement sur les principes libéraux, créant un système de « liberté surveillée » pour les médias.
B. L'érosion du contre-pouvoir journalistique
En institutionnalisant le contrôle des médias par des organismes liés aux autorités publiques, cette loi risque d'affaiblir la fonction de contre-pouvoir traditionnellement dévolue à la presse. L'autocensure pourrait se développer face aux risques de sanctions ou de surveillance.
V. Perspectives critiques et alternatives
A. Une harmonisation par le bas ?
Plutôt que d'harmoniser vers le haut les standards de liberté de la presse, cette loi semble niveler par le bas en généralisant des pratiques restrictives. Elle risque de légitimer dans l'ensemble de l'UE des mesures de contrôle qui n'existaient que dans certains États membres.
B. Vers une solution alternative
Une approche plus respectueuse des libertés fondamentales pourrait privilégier : l'éducation aux médias, la transparence des algorithmes de recommandation, le soutien économique aux médias indépendants sans contrepartie éditoriale, et des mécanismes de fact-checking décentralisés plutôt qu'une régulation centralisée.
Conclusion
La loi européenne sur la liberté des médias révèle les tensions de nos démocraties contemporaines, prises entre la nécessité de lutter contre de nouvelles menaces informationnelles et la préservation des libertés fondamentales. En prétendant protéger la liberté de la presse tout en instaurant des mécanismes de contrôle étendus, elle illustre parfaitement la dérive sécuritaire qui caractérise de nombreuses législations actuelles.
Cette loi pose une question fondamentale : dans quelle mesure peut-on restreindre la liberté au nom de sa protection ? La réponse à cette interrogation déterminera l'avenir du journalisme européen et, plus largement, la sanité de nos démocraties. Car comme l'histoire l'enseigne, les atteintes à la liberté de la presse, même justifiées par de nobles intentions, constituent souvent les premiers pas vers l'autoritarisme.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Journalistes en danger : Nos yeux et nos oreilles à Gaza sont pris pour cibles

Un collectif de 52 journalistes, retraités, actifs et enseignants, lance un appel à la solidarité envers les journalistes de la bande de Gaza dont le travail est rendu impossible par les conditions de vie quand ils ne sont pas directement visés par des bombardements.
Nous sommes un groupe de journalistes québécois souhaitant exprimer toute notre solidarité envers nos collègues de la bande de Gaza, qui exercent leur métier dans des conditions effroyables.
Nous joignons ainsi notre voix à celle de nombreux autres associations et syndicats de journalistes internationaux, dont la Fédération internationale des journalistes, qui représente 600 000 professionnels des médias dans plus de 140 pays, ainsi que la Fédération européenne des journalistes, qui ont dénoncé ces conditions au cours des derniers mois.
Depuis 22 mois, plus de 200 journalistes et travailleurs médiatiques palestiniens sont tombés sous les bombes ou sous les balles israéliennes, « dont au moins 46 ciblés en raison de leur activité journalistique », selon Reporters sans frontières et le consortium d'enquête de médias Forbidden Stories.
Encore ce dimanche, le 10 août, cinq journalistes du réseau Al-Jazeera ont péri dans une frappe ciblée sur leur tente, dans la ville de Gaza. Reporters sans frontières dénonce l'« assassinat revendiqué » par l'armée israélienne d'une des victimes de cette frappe, Anas al-Sharif.
Ce conflit meurtrier a déjà tué plus de journalistes et de travailleurs de médias que toutes les guerres réunies depuis le début du XXe siècle, affirme l'Institut Watson de l'Université Brown, au Rhode Island (1).
Ceux qui continuent, malgré tout, à nous informer font preuve d'un immense courage. Ils sont nos yeux et nos oreilles sur le terrain, les seuls à pouvoir rendre compte de la terrible réalité à laquelle font face les habitants de la bande de Gaza. Leur travail est indispensable, particulièrement maintenant, alors que le cabinet de sécurité israélien vient de voter l'occupation militaire de la ville de Gaza, ce qui ne peut qu'exacerber la crise humanitaire actuelle.
Trop affaiblis pour informer
Avec l'étau du blocus imposé par Israël, nos collègues palestiniens souffrent aussi, comme leurs 2 millions de compatriotes, de la faim, à un point tel que certains sont trop affaiblis pour continuer à exercer leurs fonctions – comme le révélait récemment l'un des correspondants de l'Agence France-Presse.
Nous avons le devoir de dénoncer cette réalité sans précédent, qui entrave la liberté d'informer tout en mettant en péril la vie des journalistes.
Nous appelons le gouvernement canadien à faire pression auprès du gouvernement israélien afin qu'il mette tout en œuvre pour laisser les journalistes palestiniens effectuer leur travail en respectant minimalement leur sécurité.
Rappelons que les journalistes sont, en vertu de l'article 79 de la Convention de Genève (12 août 1949), « considérés comme des personnes civiles » et doivent donc bénéficier des mêmes mesures de protection lors des conflits armés.
Nous demandons également au gouvernement du Canada de faire pression sur les autorités israéliennes pour qu'elles ouvrent la bande de Gaza aux médias internationaux, dont ceux du Québec, afin qu'ils puissent rendre compte du conflit armé et de la catastrophe humanitaire en cours, comme c'est le cas dans toute autre guerre, notamment celle qui sévit en Ukraine. Cette ouverture devrait aussi permettre aux organismes de presse internationaux qui engagent des journalistes palestiniens à Gaza de se rendre sur place pour leur prêter main-forte et les aider à améliorer leur situation.
Enfin, nous réclamons l'évacuation de ceux parmi nos collègues palestiniens dont l'état de santé est précaire au point de mettre leur survie en péril.
Soutenir publiquement les journalistes de Gaza, c'est défendre la liberté de la presse et la libre circulation de l'information, toutes deux grandement menacées. Ces enjeux de la liberté d'information et de la protection des journalistes en zone de conflit devraient nous unir et nous mobiliser, en dehors de toute partisanerie politique.
* Consultez la liste complète des 52 signataires de la lettre
1. Consultez le rapport de l'Institut Watson de l'Université Brown

La forêt québécoise face aux spoliateurs et à ses alliés caquistes

Depuis avril dernier, le projet de loi 97 plane au-dessus de la tête du Québec comme une épée de Damoclès alors que le gouvernement caquiste s'apprête à donner littéralement une large partie de la forêt québécoise à l'industrie forestière sous prétexte de lui fournir de la prévisibilité. Or, le bulldozer de l'industrie est affamé suite aux incendies de forêts de l'année dernière et le gouvernement Legault lui offre le tiers de la forêt québécoise sur un plateau d'argent. Tous les intervenant-es se mobilisent pour freiner ce vol des ressources.
Le projet de loi 97 de la ministre Blanchette-Vézina divise le territoire forestier en trois parties : des zones d'aménagement forestier prioritaire, des zones multi-usages et des zones de conservation. La planification stratégique de cette répartition territoriale incomberait non plus aux fonctionnaires du ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF), mais plutôt à des aménagistes forestiers régionaux. Ces derniers devront au préalable mener des consultations avec les populations locales concernées, se prêtant ainsi aux menaces de pressions de l'industrie et de ses alliés au sein des élites locales.
Les critiques pleuvent : risques d'affaiblissement des zones de protection environnementales, absence de véritable consultation auprès des Premières nations, graves lacunes quant aux assises scientifiques de l'orientation de la politique, inquiétudes quant au sort des ZEC (zones d'exploitation contrôlée), ignorance quant aux conséquences des changements climatiques, consultations publiques alambiquées.
La forêt québécoise est mal en point. Conséquence des feux de forêt qui se multiplient, de l'arrivée d'insectes ravageurs, de l'érosion de la biodiversité, de la surexploitation commerciale ; plusieurs parlent d'une tempête parfaite. Le projet de loi caquiste est déposé dans ce contexte et rien ne vient corriger les orientations qui ont mené à cette situation, au contraire. Pour citer Nature Québec, « Le projet de loi 97 vient sacrifier les acquis environnementaux et sociaux hérités de la Commission Coulombe, au profit des intérêts à court terme des grands lobbys du bois, incluant des multinationales, le tout de manière antidémocratique ! On recule de 40 ans en arrière, alors qu'il faudrait regarder 40 ans en avant ! »
Les Premières nations mènent une lutte de tous les instants contre ce projet de loi. Selon APTN news, l'ingénieur forestier et chercheur Eric Alvarez affirme que 23,56 millions d'hectares de forêt sont identifiés comme potentiellement exploitables. « Cela réserverait quelque 8 millions d'hectares à la seule industrie forestière. Huit millions d'hectares où tous les autres intervenant-es et utilisateur-ices de la forêt publique n'auront qu'une chose à faire : se taire. » Selon APTN news, « les objections des Autochtones portent principalement sur le fait que le projet de loi ne reconnaît pas leurs droits inhérents. Cette question est étroitement liée à la proposition de privatiser un tiers des terres du Québec, dont près de la moitié n'ont pas été cédées et ne font pas l'objet de traités. »
Selon le chef Lucien Wabanonik, ces propositions font du projet de loi 97 « une insulte à notre intelligence » et « une provocation directe à nos membres en territoire » qui « constitue un acte de dépossession de nos terres ». Pendant ce temps, la CAQ jette de l'huile sur le feu des tensions entre les communautés autochtones et les travailleurs et travailleuses de la forêt dans une stratégie évidente du diviser pour régner. Elle mobilise les élites locales afin de faire front contre les oppositions. Des barrages et contre-barrages sont montés de part et d'autre. L'APNQL a quitté la table de concertation en guise de protestation face à l'immobilisme de la ministre. La formation du Front de Résistance Autochtone Populaire (FRAP) qui a organisé une manifestation en juillet dernier risque de rallier les peuples autochtones autour de la revendication du retrait du projet de loi.
Bref, la CAQ donne littéralement un tiers de la forêt québécoise à l'industrie qui serait désormais maître chez nous au détriment des intérêts de la population. Le projet de loi ne fait aucune mention des objectifs de protection de la ressource et l'industrie pourrait faire comme bon lui semble.
L'opposition s'est mobilisée rapidement dès le dépôt du projet de loi. Les Premières nations, les syndicats, les groupes écologistes ont émis des avis défavorables aux objectifs caquistes. On exige le retrait pur et simple du projet de loi. Les oppositions à l'assemblée nationale demeurent prudentes quant à la critique de l'orientation du gouvernement Legault. Québec solidaire demande de suspendre les travaux entourant le projet de loi 97 et de consulter les Premières nations. Le premier ministre Legault, face aux critiques, évite de parler de changements au projet de loi, mentionnant des « ajustements » qui pourraient être apportés mais qui ne remettent pas en question son orientation générale.
Le gouvernement caquiste veut nous enfoncer sa loi dans la gorge. La résistance populaire demeure la seule façon de faire entendre raison à ces spoliateurs.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
30 ans de YOGA DU RIRE
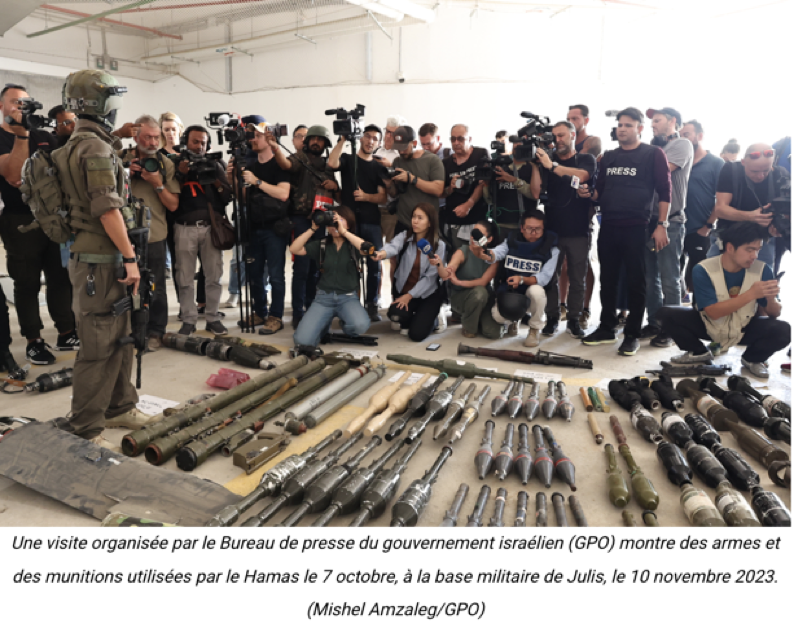
« Cellule de légitimation » : une unité israélienne chargée de relier les journalistes de Gaza au Hamas
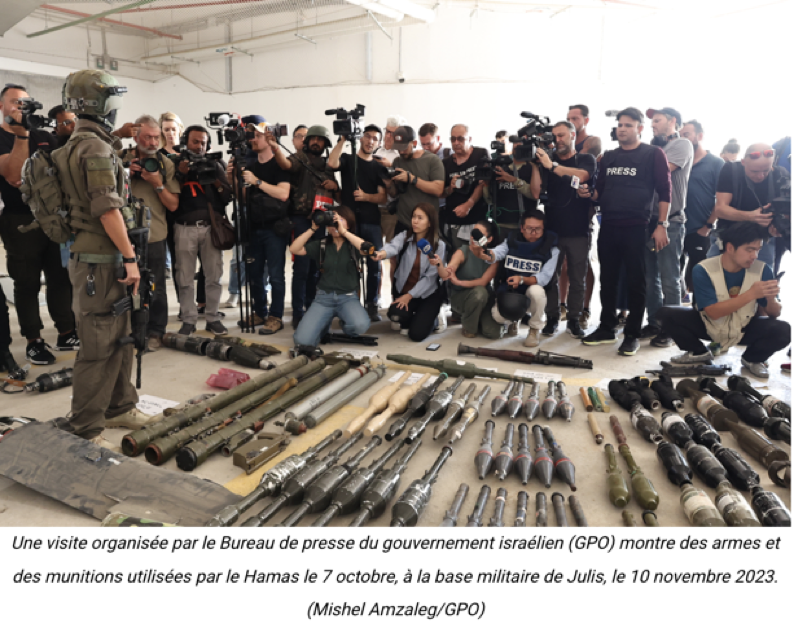
Considérant les médias comme un champ de bataille, une cellule secrète du renseignement militaire a fouillé Gaza à la recherche de matériel destiné à renforcer le hasbara israélien, y compris des affirmations douteuses visant à justifier le meurtre de journalistes palestiniens.
Tiré d'Agence médias Palestine.
L'armée israélienne a mis en place une unité spéciale appelée la « Cellule de légitimation », chargée de collecter du renseignement à Gaza afin de renforcer l'image d'Israël dans les médias internationaux, selon trois sources du renseignement qui se sont confiées à +972 Magazine et Local Call et ont confirmé l'existence de l'unité.
Créée après le 7 octobre, l'unité recherchait des informations sur l'utilisation par le Hamas des écoles et des hôpitaux à des fins militaires, ainsi que sur les tirs de roquettes ratés des groupes armés palestiniens qui ont causé des victimes civiles dans l'enclave. Elle avait aussi pour mission d'identifier des journalistes basés à Gaza qu'elle pourrait présenter comme des agents infiltrés du Hamas, afin de désamorcer l'indignation mondiale croissante suscitée par l'assassinat de reporters palestiniens, le dernier en date étant le journaliste d'Al Jazeera Anas Al-Sharif, tué cette semaine dans une frappe aérienne israélienne.
Selon ces sources, la motivation de la Cellule de légitimation n'était pas la sécurité, mais la communication. Animés par la colère que des reporters gazaouis « salissent [le] nom [d'Israël] aux yeux du monde », ses membres étaient impatients de trouver un journaliste qu'ils pourraient relier au Hamas et marquer comme cible, a affirmé l'une d'elles. Cette source a décrit un schéma récurrent dans le travail de l'unité : chaque fois que les critiques médiatiques contre Israël s'intensifiaient sur un sujet précis, la Cellule recevait pour ordre de trouver du renseignement déclassifiable et exploitable publiquement pour contrer le récit.
« Si les médias mondiaux parlent d'Israël qui tue des journalistes innocents, alors immédiatement il y a une pression pour trouver un journaliste qui ne serait pas si innocent, comme si cela rendait acceptable de tuer les 20 autres », a déclaré une source du renseignement.
Souvent, c'était l'échelon politique israélien qui dictait à l'armée les axes d'enquête de l'unité, a ajouté une autre source. Les informations recueillies par la Cellule de légitimation étaient également transmises régulièrement aux Américains par des canaux directs. Des officiers du renseignement ont indiqué qu'on leur avait dit que leur travail était essentiel pour permettre à Israël de prolonger la guerre.
« L'équipe collectait régulièrement du renseignement pouvant servir au hasbara, par exemple, une cache d'armes [du Hamas] découverte dans une école, tout ce qui pouvait renforcer la légitimité internationale d'Israël à poursuivre les combats », a expliqué une autre source. « L'idée était de permettre [à l'armée] d'opérer sans pression, afin que des pays comme les États-Unis ne cessent pas de fournir des armes. »
L'unité cherchait aussi des preuves reliant la police de Gaza à l'attaque du 7 octobre, pour justifier leur ciblage et démanteler la force de sécurité civile du Hamas, a ajouté une source familière de son travail.
Deux sources du renseignement ont raconté qu'au moins une fois depuis le début de la guerre, la Cellule de légitimation avait déformé du renseignement pour permettre de présenter faussement un journaliste comme membre de la branche militaire du Hamas. « Ils étaient impatients de l'étiqueter comme une cible, comme un terroriste, de dire qu'il était légitime de l'attaquer », se souvient une source. « Ils disaient : le jour, c'est un journaliste, la nuit, c'est un commandant de section. Tout le monde était enthousiaste. Mais il y a eu une chaîne d'erreurs et des raccourcis pris.
« À la fin, ils ont réalisé qu'il était réellement journaliste », poursuit la source, et le journaliste n'a pas été visé.
Un schéma similaire de manipulation apparaît dans les renseignements présentés sur Al-Sharif. Selon les documents publiés par l'armée, non vérifiés de manière indépendante, il aurait été recruté par le Hamas en 2013 et serait resté actif jusqu'à ce qu'il soit blessé en 2017, ce qui, même si les documents étaient exacts, prouverait qu'il ne jouait aucun rôle dans la guerre actuelle.
Il en va de même pour le cas du journaliste Ismail Al-Ghoul, tué en juillet 2024 dans une frappe aérienne israélienne à Gaza-Ville avec son caméraman. Un mois plus tard, l'armée a affirmé qu'il était un « opérateur de la branche militaire et un terroriste Nukhba », citant un document de 2021 prétendument extrait d'un « ordinateur du Hamas ». Or ce document indiquait qu'il avait reçu son grade militaire en 2007, alors qu'il n'avait que 10 ans, et sept ans avant sa supposée recrue dans le Hamas.
« Trouver le plus de matériel possible pour le hasbara »
L'un des premiers efforts médiatisés de la Cellule de légitimation a eu lieu le 17 octobre 2023, après l'explosion meurtrière de l'hôpital Al-Ahli à Gaza-Ville. Tandis que les médias internationaux, citant le ministère de la Santé de Gaza, rapportaient qu'une frappe israélienne avait tué 500 Palestiniens, les responsables israéliens affirmaient que l'explosion avait été causée par une roquette mal tirée du Jihad islamique et que le bilan était bien moindre.

Le lendemain, l'armée a diffusé un enregistrement que la Cellule avait retrouvé dans des interceptions de renseignements, présenté comme un appel téléphonique entre deux membres du Hamas accusant le Jihad islamique de la bavure. De nombreux médias mondiaux ont ensuite jugé l'hypothèse plausible, certains menant leurs propres enquêtes, et cette divulgation a porté un coup sévère à la crédibilité du ministère de la Santé de Gaza, saluée au sein de l'armée israélienne comme une victoire pour la Cellule.
En décembre 2023, un militant palestinien des droits humains a déclaré à +972 et Local Call qu'il avait été stupéfait d'entendre sa propre voix dans cet enregistrement, qu'il affirmait être simplement une conversation anodine avec un ami. Il a insisté n'avoir jamais été membre du Hamas.
Une source ayant travaillé avec la Cellule de légitimation a déclaré que la publication de matériel classifié comme un appel téléphonique était extrêmement controversée. « Ce n'est vraiment pas dans l'ADN de l'Unité 8200 d'exposer nos capacités pour quelque chose d'aussi vague que l'opinion publique », a-t-il expliqué.
Pourtant, les trois sources ont indiqué que l'armée traitait les médias comme une extension du champ de bataille, l'autorisant à déclassifier des renseignements sensibles pour diffusion publique. Même le personnel du renseignement extérieur à la Cellule devait signaler tout élément pouvant servir dans la guerre de l'information. « Il y avait cette phrase : “Ça, c'est bon pour la légitimité” », se rappelle une source. « Le but était simplement de trouver le plus de matériel possible au service du hasbara. »

Après la publication de l'article, des sources officielles de la sécurité ont confirmé à +972 et Local Call que diverses « équipes de recherche » avaient été mises en place au sein du renseignement militaire israélien au cours des deux dernières années dans le but « d'exposer les mensonges du Hamas ». Elles ont déclaré que l'objectif était de « discréditer » les journalistes couvrant la guerre dans les médias audiovisuels « de manière soi-disant fiable et précise », mais qui, selon elles, faisaient en réalité partie du Hamas. Selon ces sources, ces équipes de recherche ne jouent pas de rôle dans la sélection des cibles individuelles à attaquer.
« Je n'ai jamais hésité à dire la vérité »
Le 10 août, l'armée israélienne a tué six journalistes lors d'une frappe qu'elle a admis avoir dirigée contre le reporter d'Al Jazeera Anas Al-Sharif. Deux mois plus tôt, en juillet, le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) avait exprimé sa crainte pour la vie d'Al-Sharif, affirmant qu'il était « la cible d'une campagne de diffamation de l'armée israélienne, qu'il considérait comme un prélude à son assassinat ».
Après qu'Al-Sharif a publié en juillet une vidéo virale de lui en larmes en couvrant la crise de la faim à Gaza, le porte-parole arabophone de l'armée israélienne, Avichay Adraee, a diffusé trois vidéos l'attaquant, l'accusant de « propagande » et de participer à la « fausse campagne de famine du Hamas ».
Al-Sharif avait identifié le lien entre la guerre médiatique et la guerre militaire : « La campagne d'Adraee n'est pas seulement une menace médiatique ou une destruction d'image ; c'est une menace réelle pour ma vie », avait-il confié au CPJ. Moins d'un mois plus tard, il était tué, l'armée présentant ce qu'elle disait être du renseignement déclassifié prouvant son appartenance au Hamas pour justifier la frappe.
L'armée avait déjà affirmé en octobre 2024 que six journalistes d'Al Jazeera, dont Al-Sharif, étaient des opérateurs militaires, accusation qu'il avait vigoureusement niée. Il est devenu le deuxième de cette liste à être visé, après le reporter Hossam Shabat. Depuis l'accusation d'octobre, ses déplacements étaient bien connus, ce qui a amené de nombreux observateurs à se demander si le meurtre d'Al-Sharif, qui rapportait régulièrement depuis Gaza-Ville, ne faisait pas partie du plan d'Israël visant à imposer un black-out médiatique en prévision de la capture de la ville.
En réponse aux questions de +972 Magazine sur la mort d'Al-Sharif, le porte-parole de l'armée a réaffirmé que « Tsahal a attaqué un terroriste de l'organisation terroriste Hamas qui opérait sous couverture en tant que journaliste du réseau Al Jazeera dans le nord de la bande de Gaza », et a affirmé que l'armée « ne nuit pas intentionnellement aux personnes non impliquées et en particulier aux journalistes, tout en respectant le droit international ».
Avant la frappe, a-t-il ajouté, « des mesures ont été prises pour réduire les risques de victimes civiles, y compris l'utilisation d'armes de précision, d'observations aériennes et d'informations de renseignement supplémentaires ».
Âgé de seulement 28 ans, Al-Sharif était devenu l'un des journalistes les plus connus de Gaza. Il figure parmi les 186 reporters et travailleurs des médias tués dans l'enclave depuis le 7 octobre, selon le CPJ, la période la plus meurtrière pour les journalistes depuis que l'organisation a commencé à collecter des données en 1992. D'autres organismes avancent un bilan allant jusqu'à 270.
« Si ces mots vous parviennent, sachez qu'Israël a réussi à me tuer et à faire taire ma voix », avait écrit Al-Sharif dans son dernier message, publié à titre posthume sur ses réseaux sociaux. « J'ai vécu la douleur dans tous ses détails, goûté à la souffrance et à la perte à maintes reprises, et pourtant je n'ai jamais hésité à dire la vérité telle qu'elle est, sans la déformer ni la falsifier. »
Source : +972 Magazine
Traduction : ST pour Agence Media Palestine
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Gaza : après le meurtre de six professionnels des médias dans une frappe israélienne ciblée, RSF demande une réaction internationale forte

Ce dimanche 10 août, une frappe israélienne a tué six professionnels des médias, dont cinq travaillant ou ayant travaillé pour le média qatarien Al Jazeera et un journaliste indépendant, dans la bande de Gaza. Revendiquée par l'armée israélienne, elle visait le reporter d'Al-Jazeera Anas al-Sharif, qu'elle accuse, sans avancer de preuves solides, d'“appartenance terroriste”.
Tiré du site de RSF.
Reporters sans frontières (RSF) dénonce une technique indigne utilisée de manière récurrente contre les journalistes destinée à masquer des crimes de guerre, alors que l'armée a déjà tué plus de 200 professionnels des médias. L'organisation appelle à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU pour stopper ce massacre.
- “RSF dénonce avec force et colère le meurtre de six professionnels des médias par l'armée israélienne, perpétré sous couvert, une fois encore, d'accusations de terrorisme contre un journaliste. Pourtant l'un des journalistes les plus célèbres de la bande de Gaza, Anas al-Sharif. L'armée israélienne a tué plus de 200 journalistes depuis le début de la guerre. Il faut de toute urgence mettre un terme à ce massacre et à la stratégie de blackout médiatique d'Israël, destinée à masquer les crimes commis par son armée, depuis plus de 21 mois, dans l'enclave palestinienne assiégée et affamée. La communauté internationale ne peut plus fermer les yeux et doit réagir et faire cesser cette impunité. RSF appelle le Conseil de sécurité des Nations unies à se réunir d'urgence sur le fondement de la résolution 2222 de 2015 sur la protection des journalistes en période de conflit armé afin de stopper ce carnage.
- - Thibaut Bruttin
- Directeur général de RSF
Dans la soirée du 10 août, l'armée israélienne a tué le reporter d'Al Jazeera Anas al-Sharif dans une frappe ciblée sur une tente abritant un groupe de journalistes à proximité de l'hôpital al-Shifa, à Gaza. Cette frappe revendiquée par les autorités israéliennes a également tué cinq autres professionnels des médias, dont quatre travaillant ou ayant travaillé pour la chaîne qatarienne Al Jazeera – le correspondant Mohammed Qraiqea, le vidéoreporter Ibrahim al-Thaher, Mohamed Nofal, assistant caméraman et chauffeur ce jour-là, et Moamen Aliwa, journaliste indépendant qui a travaillé avec Al Jazeera – ainsi qu'un autre journaliste indépendant, créateur d'une chaîne YouTube d'information, Mohammed al-Khaldi. Cette attaque a également blessé les reporters indépendants Mohammed Sobh, Mohammed Qita et Ahmed al-Harazine.
Cette attaque, revendiquée par l'armée israélienne, reproduit un procédé déjà employé contre des journalistes d'Al Jazeera. Le 31 juillet 2024, l'armée israélienne avait tué les reporters Ismail al-Ghoul et Rami al-Rifi dans une frappe ciblée et revendiquée, à la suite d'une campagne de dénigrement visant le premier, accusé, comme Anas al-Sharif, d'“appartenance terroriste”. Hamza al-Dahdouh, Mustafa Thuraya ou encore Hossam Shabat, eux-aussi travaillant pour le média qatarien, comptent notamment parmi les victimes de cette méthode dénoncée par RSF.
Dès octobre 2024, RSF avait mis en garde contre l'imminence d'une attaque visant Anas al-Sharif à la suite des accusations de l'armée israélienne. La communauté internationale, l'Union européenne, le Royaume-Uni et les États-Unis en tête, est restée sourde à ces avertissements. En vertu de la résolution 2222 de 2015 sur la protection des journalistes en période de conflit armé, le Conseil de sécurité des Nations unies a le devoir de se réunir d'urgence à la suite de ce nouveau meurtre extrajudicaire commis par l'armée israélienne.
Depuis Octobre 2023, RSF a déposé quatre plaintes auprès de la Cour pénale internationale (CPI) pour demander des enquêtes sur ce qu'elle qualifie de crimes de guerre commis par l'armée israélienne contre les journalistes à gaza.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le mirage d’un État palestinien

La reconnaissance par un nombre croissant de pays d'une entité hypothétique appelée « État de Palestine » est positive en termes d'impact symbolique. Mais dans les conditions présentes, ce ne saurait être plus qu'une version renouvelée de la vaste prison dans laquelle l'État sioniste confine le peuple palestinien dans les territoires occupés en 1967.
30 juillet 2025
Gilbert Achcar
Professeur émérite, SOAS, Université de Londres
Abonné·e de Mediapart
https://blogs.mediapart.fr/gilbert-achcar/blog/300725/le-mirage-d-un-etat-palestinien
Ce blog est personnel, la rédaction n'est pas à l'origine de ses contenus.
La reconnaissance par un nombre croissant de pays d'une entité hypothétique appelée « État de Palestine » est positive en termes d'impact symbolique quant à la reconnaissance du droit du peuple palestinien à un État, un droit que nient la plupart des composantes de l'establishment sioniste, en particulier la gamme des partis sionistes d'extrême droite qui gouverne actuellement Israël. Cependant, les significations et les implications de cette reconnaissance varient considérablement avec le temps.
Les pays qui ont reconnu l'État de Palestine à la suite de sa proclamation par le Conseil national palestinien, réuni à Alger en 1988, dans la foulée de la grande Intifada populaire dans les territoires occupés en 1967, ont soutenu ce qui était considéré à l'époque comme un épisode majeur dans l'histoire de la lutte palestinienne. C'est ainsi que cela fut perçu, en effet, même si la proclamation était en fait une déviation de l'Intifada de son cours initial. Yasser Arafat et ses collaborateurs à la tête de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) cherchaient à poursuivre l'illusion d'un « État palestinien indépendant » en mettant la pression populaire au service d'un processus de négociation diplomatique parrainé par les États-Unis. C'est ainsi que la proclamation de 1988 fut immédiatement suivie par l'acquiescement honteux d'Arafat à la condition que Washington lui avait imposée pour négocier avec lui. Il déclara publiquement avec grand bruit : « Nous renonçons totalement et absolument à toutes les formes de terrorisme » (déclaration réitérée lors d'une conférence de presse à Genève le 14 décembre 1988).
La proclamation d'un État à l'époque avait néanmoins le caractère d'un geste de défi et fut appuyée par les pays qui soutenaient effectivement le droit du peuple palestinien dans les territoires de 1967 à se libérer de l'occupation sioniste. Au total, 88 pays reconnurent l'État de Palestine nouvellement proclamé, dont presque tous les pays arabes (à l'exception du régime syrien d'Assad, qui était un ennemi acharné de la direction palestinienne), la plupart des pays d'Afrique et d'Asie (avec quelques exceptions naturelles, comme le régime d'apartheid en Afrique du Sud, allié de longue date de l'État sioniste), et les pays du bloc de l'Est dominé par l'Union soviétique. Dans une scission planétaire notable, aucun pays du bloc occidental, dirigé par les États-Unis, ne reconnut l'État de Palestine à l'époque, à l'exception de la Turquie, ni aucun pays d'Amérique latine, à l'exception de Cuba et du Nicaragua, les deux pays rebelles contre l'hégémonie de Washington.
Les reconnaissances se poursuivirent après 1988, englobant progressivement les autres pays d'Asie et d'Afrique – à quelques exceptions près (Cameroun et Érythrée, pour des raisons opposées) – et d'Amérique latine. Les premiers États membres de l'OTAN à reconnaître l'État de Palestine – en plus de la Turquie et des pays d'Europe de l'Est qui se trouvaient auparavant dans l'orbite de l'Union soviétique et l'avaient donc reconnu avant de rejoindre l'alliance – ont été l'Islande en 2011 et la Suède en 2014. D'autres États membres de l'OTAN ne les suivirent dans cette voie que lorsque l'ampleur de la guerre génocidaire d'Israël dans la bande de Gaza devint évidente. La Norvège, l'Espagne et la Slovénie ont reconnu l'État de Palestine en 2024, suivis par le reste des pays d'Amérique latine (le plus récent étant le Mexique cette année).
Jusqu'à ce que le président français annonce son intention de reconnaître officiellement l'État de Palestine en septembre prochain, lorsque l'Assemblée générale de l'ONU se réunira, toutes les puissances de l'Occident géopolitique – en particulier les États-Unis, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Japon et l'Australie – avaient refusé de le faire et le refusent encore aujourd'hui, invoquant divers prétextes, en particulier l'argument très hypocrite selon lequel cette reconnaissance pourrait entraver les efforts de paix. [Cet article a été écrit avant l'annonce conditionnelle par Keir Starmer que le Royaume-Uni reconnaîtrait lui aussi l'État de Palestine en septembre, à moins qu'Israël n'accepte un cessez-le-feu et une amélioration de la situation à Gaza.] La pression publique s'accroît dans ces mêmes pays au sujet du génocide en cours à Gaza, à un moment où le caractère délibéré du crime a atteint son apogée avec la présente famine organisée de la population de Gaza. Cela pourrait conduire à de nouvelles reconnaissances et a déjà conduit à une pression accrue sur Israël pour qu'il autorise l'entrée de l'aide alimentaire dans la bande de Gaza.
En réalité, ceux qui ont attendu qu'Israël commette les atrocités en cours au vu et au su du monde entier avant de reconnaître l'État de Palestine tentent principalement de dissimuler leur complicité tacite avec l'occupation sioniste de la Cisjordanie et de la bande de Gaza durant près de soixante ans. Le réveil de dernière minute du premier ministre britannique et du chancelier allemand, et leur décision de participer au largage aérien d'aide dans la bande de Gaza, effectué par la Jordanie et les Émirats arabes unis – une décision condamnée par les organisations humanitaires comme un acte symbolique inutile – ne méritent que du mépris, d'autant plus que les deux pays de l'OTAN mentionnés sont parmi les plus importants collaborateurs militaires de l'État sioniste après les États-Unis.
Ce qui devrait être évident, c'est que les efforts actuels pour établir un État palestinien, à l'instar de la conférence réunie à New York sous parrainage français et saoudien, ont maintenant un sens très différent de la reconnaissance de 1988. Cette année-là avait connu les meilleures conditions politiques que le peuple palestinien ait jamais connues depuis la Nakba de 1948. L'Intifada a suscité la sympathie populaire internationale et a provoqué une grave crise morale au sein de la société et de l'armée israéliennes. Elle créa les conditions pour le retour au pouvoir du Parti travailliste sioniste et sa conclusion des accords d'Oslo avec la direction Arafat, ce qui était inimaginable avant cette époque, bien que lesdits accords aient compris des conditions profondément iniques que Yasser Arafat accepta par pure délusion.
Cependant, ce qui semblait être un État hypothétique mais réalisable en 1988, et même en 1993 (bien que le processus d'Oslo eût été voué à l'échec), est aujourd'hui moins réaliste qu'un mirage dans le désert. Il est probable qu'un dixième ou plus de la population de la bande de Gaza a été tué, et au moins 70 % des bâtiments de l'enclave ont été détruits, dont 84 % des bâtiments de la partie nord et 89 % des bâtiments de Rafah (selon une récente enquête géographique effectuée par l'Université hébraïque de Jérusalem). Alors, de quel type d'État palestinien parlent-ils ? Les plus généreux d'entre eux le voient comme régi par le cadre d'Oslo, qui a abouti à une Autorité palestinienne sous tutelle israélienne, dont la « souveraineté » nominale est limitée à moins d'un cinquième de la Cisjordanie, en plus de Gaza. D'autres envisagent une entité encore plus limitée, après la reconquête par Israël de la majeure partie de la bande de Gaza et l'expansion des colonies sionistes en Cisjordanie.
Les conditions définies par le consensus national palestinien en 2006 (le « document des prisonniers ») comme exigences minimales pour l'établissement d'un État palestinien indépendant – à savoir, le retrait de l'armée et des colons israéliens de tous les territoires palestiniens occupés en 1967, y compris Jérusalem-Est ; la libération de tous les prisonniers palestiniens détenus par Israël ; et la reconnaissance du droit au retour et à des réparations pour les réfugiés palestiniens – ont été reléguées aux oubliettes en tant que revendications « extrémistes », alors qu'elles étaient à l'origine conçues comme des conditions minimales, exprimant une volonté de compromis. En vérité, toute entité palestinienne qui ignore ces conditions de base ne sera rien de plus qu'une version renouvelée de la vaste prison à ciel ouvert dans laquelle l'État sioniste confine le peuple palestinien dans les territoires de 1967, sur une étendue géographique de plus en plus réduite et une population qui continue de diminuer par suite du génocide et du nettoyage ethnique.
Traduit de ma chronique hebdomadaire dans le quotidien de langue arabe, Al-Quds al-Arabi, basé à Londres. Cet article est d'abord paru en ligne le 29 juillet. Vous pouvez librement le reproduire en indiquant la source avec le lien correspondant.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le cabinet de sécurité israélien approuve le plan de Netanyahu visant à prendre le contrôle de Gaza, ignorant les avertissements de l’armée israélienne

Le cabinet de sécurité a également approuvé le plan de Netanyahu visant à ce que l'armée israélienne prenne le contrôle total de la ville de Gaza. Selon certaines sources, l'évacuation des habitants de la ville de Gaza vers d'autres zones devrait être terminée d'ici le 7 octobre, et ce n'est qu'après cela que la prise de contrôle militaire devrait commencer.
Tiré de Association France Palestine Solidarité
8 août 2025
Haaretz par Jonathan Lis, Noa Shpigel, Yael Freidson, Jack Khoury, Ben Samuels
Photo : Les Palestiniens déplacés rentrent chez eux au nord de Gaza après le cessez-le-feu, janvier 2025
Le cabinet de sécurité israélien a approuvé vendredi matin la proposition du Premier ministre Benjamin Netanyahu visant à instaurer le contrôle israélien sur la bande de Gaza, à l'issue d'une réunion marathon de 10 heures qui s'est tenue pendant la nuit.
La prise de contrôle israélienne devrait commencer par une invasion de la ville de Gaza. Le bureau de Netanyahu a déclaré que l'armée israélienne prendrait le contrôle de la ville « tout en distribuant une aide humanitaire à la population civile en dehors des zones de combat ».
Selon un haut responsable israélien qui s'est entretenu avec Haaretz, « lorsqu'une opération majeure débutera dans la ville de Gaza, la population civile se verra offrir la possibilité d'évacuer vers d'autres zones, pas nécessairement vers les camps centraux, afin d'assurer sa protection ».
C'était le cas, a-t-il dit, au début de la guerre, pendant l'offensive de Rafah et ailleurs.
Un haut responsable israélien a déclaré à Haaretz qu'il n'y avait actuellement aucun projet d'envahir et d'occuper les camps de réfugiés dans le centre de la bande de Gaza, ajoutant qu'Israël pouvait prendre le contrôle effectif de la ville de Gaza sans que les troupes israéliennes soient présentes sur tout son territoire.
Un autre responsable a déclaré à Haaretz que « les efforts visant à obtenir la libération des otages se poursuivront par tous les moyens ». Selon des sources proches du dossier, l'évacuation des habitants de la ville de Gaza vers d'autres zones devrait être achevée d'ici le 7 octobre, après quoi l'armée prendra le contrôle de la ville.
Les responsables militaires israéliens se sont opposés au plan approuvé par le gouvernement, préconisant plutôt de mener des raids ciblés et de prendre le contrôle des principales voies d'accès afin de diviser la bande de Gaza
Après l'approbation du plan de Netanyahu, son bureau a publié une déclaration indiquant qu'« une majorité décisive des ministres du cabinet de sécurité estimait que le plan alternatif qui avait été soumis au cabinet de sécurité ne permettrait ni de vaincre le Hamas ni d'obtenir la libération des otages ».
La déclaration énumérait également cinq principes pour mettre fin à la guerre, à commencer par le désarmement du Hamas, suivi du « retour de tous les otages, vivants ou décédés ».
Les autres principes comprennent « le contrôle sécuritaire israélien dans la bande de Gaza » et « la mise en place d'une administration civile alternative qui ne soit ni le Hamas ni l'Autorité palestinienne ».
La déclaration publiée par le bureau de Netanyahu ne mentionne pas le terme « occupation », qui a des implications juridiques en termes de protection de la population civile et de prévention de son transfert vers d'autres territoires, et se contente du concept vague de « prise de contrôle ».
En outre, les préparatifs nécessaires avant la mise en œuvre du plan offrent une occasion de modifier la décision.
Selon une source bien informée, le chef d'état-major de l'armée israélienne, Eyal Zamir, a mis en garde les ministres qui ont participé à la réunion du cabinet de sécurité contre les répercussions du plan.
« Il n'y a pas de réponse humanitaire pour le million de personnes que nous allons transférer », a déclaré Zamir. « Tout sera compliqué. Je vous suggère de retirer le "retour des otages" des objectifs opérationnels. »
Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a accusé le chef militaire d'avoir rendu publique la discussion.
« Cessez de parler aux médias », a-t-il déclaré. « Nous voulons une victoire. Nous nous inquiétons tous pour les otages, mais aussi pour les soldats et les combattants qui exigent la victoire. »
Ben-Gvir a poursuivi : « Il y a constamment des fuites provenant de sources militaires. Vous êtes subordonné à l'échelon politique. Apprenez de la police comment obéir aux décisions des politiciens. »
Le ministre des Finances Smotrich a également soutenu le plan de Netanyahu. « Nous devons parler de victoire. Si nous optons pour un accord temporaire, ce sera une défaite », a-t-il déclaré.
« Nous ne pouvons pas nous arrêter à mi-chemin. Nous devons faire payer le prix au Hamas. Le Hamas doit payer le prix de ses actes. »
Le ministre Zeev Elkin, qui dirige la Direction Tkuma (Renaissance) chargée de restaurer les communautés frontalières de Gaza endommagées lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, a déclaré que la proposition de Zamir transformerait effectivement Gaza en Cisjordanie.
« L'armée propose un plan pour mettre fin aux combats », a déclaré Elkin. « C'est le genre de mesures de sécurité routinières que nous prenons en Cisjordanie. Ce n'est pas une guerre. »
Jeudi, des milliers de personnes ont manifesté contre le plan de Netanyahu devant le bureau du Premier ministre à Jérusalem et dans plusieurs endroits à travers le pays.
Zamir, qui s'oppose à cette mesure, a été vivement critiqué ces derniers jours par l'entourage proche de Netanyahu. Un haut responsable du bureau du Premier ministre aurait déclaré : « Si cela ne convient pas au chef d'état-major, qu'il démissionne. »
Traduction : AFPS
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le « jour d’après » à Gaza

Il est ironique que les annonces de Netanyahou aient provoqué un tollé contre lui, alors qu'il les avait conçues comme une déclaration de son intention d'ouvrir la voie à un règlement.
Tiré du blogue de l'auteur.
Les récentes déclarations de Benyamin Netanyahou, faites dans une interview accordée à Fox News jeudi dernier et lors de deux conférences de presse dimanche, ont soulevé un tollé général. Il s'est trouvé condamné par la plupart des gouvernements occidentaux, y compris le gouvernement allemand (une rareté remarquable), qui lui reprochent tous d'avoir annoncé son intention de prendre le contrôle total de la bande de Gaza en occupant les zones bâties peuplées restantes, de la ville de Gaza à Deir al-Balah. Des cris hypocrites de condamnation se sont élevés, avertissant Netanyahou que ce projet conduira à des déplacements massifs et à un grand nombre de morts, comme si le génocide et les déplacements perpétrés par l'armée sioniste au cours des 22 derniers mois, et soutenus durant plusieurs mois par les mêmes gouvernements occidentaux qui aujourd'hui blâment Netanyahou, n'étaient pas déjà pires que ce qu'il promet à présent.
Le premier ministre israélien a certainement été surpris par la vaste condamnation de ses déclarations, ce qui l'a incité à faire de nombreuses apparitions dans les médias pour clarifier ce qu'il a perçu comme un malentendu. Il est ironique, en effet, que les annonces qu'il a faites dans l'intention de rassurer les gouvernements arabes et occidentaux ont provoqué un tollé contre lui, alors qu'il les avait conçues comme une déclaration de son intention d'ouvrir la voie à un règlement. Ses partenaires de l'ultradroite sioniste au gouvernement l'ont bien compris, qui ont dénoncé sa position, menaçant de dissoudre la coalition et de provoquer de nouvelles élections parlementaires. Cette fois-ci, Bezalel Smotrich lui-même – qui a refusé de suivre l'exemple de son ami Itamar Ben-Gvir lorsque ce dernier s'est retiré temporairement du gouvernement au début de cette année pour protester contre la trêve entrée en vigueur dans la bande de Gaza à la veille du retour de Donald Trump à la Maison Blanche – a déclaré dimanche dernier qu'il avait « cessé de croire que le premier ministre peut et veut conduire l'armée israélienne à une victoire décisive ». Il a ajouté : « De mon point de vue, nous pouvons tout arrêter et laisser le peuple décider ».
Qu'y a-t-il donc de nouveau dans les récentes annonces de Netanyahu ? Ce n'est certainement pas la déclaration de son intention d'achever l'occupation de la bande de Gaza et de déplacer sa population, un processus qui est en cours depuis plus de 22 mois au vu et au su de tous. Il s'agit plutôt de sa déclaration claire, pour la première fois depuis le début de la guerre génocidaire, qu'il n'a pas l'intention d'occuper la bande de Gaza en permanence et de l'annexer dans son intégralité à Israël. Au lieu de cela, il a souligné que son objectif est de compléter la prise de contrôle de la bande de Gaza en prélude à la fin de la guerre sur la base du désarmement du Hamas et de la transformation de Gaza en zone démilitarisée dans laquelle les Gazaouis seraient soumis à une autorité « civile » provisoire, non israélienne, prête à coexister en paix avec Israël, à condition qu'il ne s'agisse ni du Hamas ni de l'Autorité palestinienne (AP) dont le siège est à Ramallah. Cela s'accompagnerait du maintien par Israël du contrôle sécuritaire de la bande de Gaza, y compris le déploiement permanent de ses forces armées le long d'axes stratégiques et dans certaines zones, tandis que des « forces arabes » seraient chargées de maintenir la sécurité dans les zones peuplées sous l'autorité palestinienne intérimaire.
La vérité est que ce scénario est certainement plus conforme aux souhaits des États arabes et de la plupart des États occidentaux que le scénario préféré par l'ultradroite sioniste, qui consiste à déplacer la plupart des Gazaouis de la majeure partie de la bande de Gaza et à l'annexer, comme cela s'est produit lors de la Nakba de 1948 pour la plupart des territoires palestiniens entre le fleuve et la mer. Le scénario du « jour d'après », soutenu par les États arabes et la plupart des gouvernements occidentaux, a récemment été décrit dans la déclaration publiée par les pays qui se sont réunis au siège des Nations Unies à New York à la fin du mois dernier, à l'invitation de la France et du royaume saoudien. Cette déclaration, qui a été approuvée par la Ligue arabe et l'Union européenne, ainsi que par plusieurs États arabes et européens, dont l'Égypte, le Qatar, la Jordanie, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne et la Turquie, ainsi que par quelques pays d'autres parties du monde, a salué les efforts de « l'Égypte, du Qatar et des États-Unis » pour trouver un règlement qui mettrait fin à la guerre en cours, à des conditions qui incluent la stipulation que « le Hamas doit mettre fin à son gouvernement de Gaza et remettre ses armes à l'Autorité palestinienne ».
Le correspondant d'Al-Quds Al-Arabi a rapporté ce qui suit sur les pourparlers devant avoir lieu le jour de la rédaction de cet article : « La proposition [égypto-qatarie] que la délégation du Hamas est censée discuter au Caire comprend le gel des armes de la résistance, l'abandon complet par le Hamas du contrôle de la bande de Gaza et la libération de tous les détenus israéliens en un seul lot, en échange de la fin complète de la guerre et du début de la reconstruction dans la bande de Gaza. Elle comprend également la formation d'un comité arabo-palestinien devant prendre le contrôle de la bande de Gaza et la gouverner jusqu'à ce qu'une administration palestinienne au complet, avec du personnel de sécurité palestinien, soit qualifiée pour remplir ce rôle. » (Tamer Hendaoui, Al-Quds Al-Arabi, 12 août 2025).
La principale divergence entre le projet euro-arabe et ce que Netanyahu a annoncé est que le projet prévoit le retrait de l'armée israélienne de toute la bande de Gaza et le transfert de son contrôle à l'AP de Ramallah. Si la distance entre les deux approches – euro-arabe et israélienne – peut sembler grande, les récentes déclarations de Netanyahu l'ont en fait réduite. Ce faisant, il ouvre la voie à un compromis que Washington cherchera à imposer à tous, un compromis qui répondra certainement plus aux nouvelles conditions posées par Netanyahou qu'aux conditions énoncées dans la Déclaration de New York (voir « Trump, Netanyahou et la réorganisation du Moyen-Orient », Al-Quds Al-Arabi, 8 juillet 2025). Ce faisant, Netanyahu ouvre également la voie à l'imposition de sa vision à ses alliés d'ultradroite, invoquant une fois de plus la pression des États-Unis.
Gilbert Achcar
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Cisjordanie : De Sakhnin à Ramallah, une nouvelle vague de lutte populaire palestinienne prend racine

Face à l'indignation croissante suscitée par la situation à Gaza, les manifestations et les grèves de la faim marquent le renouveau d'un mouvement palestinien déterminé à surmonter les divisions et à maintenir la résistance.
Tiré d'Agence médias Palestine.
Ces dernières semaines, la mobilisation populaire palestinienne a connu un essor remarquable, en particulier dans les territoires de 1948 (Israël) et en Cisjordanie occupée. Cette dynamique reflète un effort croissant pour renouer avec une vague de solidarité mondiale revitalisée, qui perdure, et même s'étend, malgré les répressions sévères contre les mouvements pro-palestiniens aux États-Unis et dans une grande partie de l'Europe.
Tous les signes indiquent que cette dynamique continuera à croître, avec la possibilité d'aboutir à une insurrection populaire plus large, capable de faire reculer les politiques brutales d'Israël envers les Palestiniens sur l'ensemble du territoire.
Les images déchirantes en provenance de Gaza, enfants émaciés, familles sans cesse déplacées, civils abattus alors qu'ils attendent de la nourriture, deviennent impossibles à ignorer ou à justifier pour les alliés d'Israël. Ces images commencent à hanter les gouvernements occidentaux, longtemps complices de la campagne génocidaire israélienne, les exposant à la honte dans l'opinion publique et révélant la faillite morale de leur silence. Sous la pression croissante de leurs citoyens, plusieurs États occidentaux ont récemment durci leur ton face à la conduite d'Israël à Gaza : rythme effréné des tueries, obstruction délibérée à l'aide humanitaire, absence manifeste de plan pour mettre fin à la guerre.
Les reproches les plus visibles sont venus sous forme de reconnaissances officielles (ou de menaces de reconnaissance) de l'État de Palestine par quelques chefs d'État occidentaux, notamment Emmanuel Macron. Pourtant, ces déclarations, bien que spectaculaires sur le papier, restent largement symboliques. La « solution à deux États » qu'elles évoquent est largement perçue comme illusoire et insuffisante, elle préserve le régime colonial et d'apartheid d'Israël et nie à des millions de réfugiés palestiniens leur droit au retour.
Même si ces déclarations ne devraient pas avoir d'impacts concrets immédiats, elles restent néanmoins un geste de soutien important, et un encouragement moral nécessaire au mouvement populaire, ouvrant la voie à une nouvelle phase de réflexion et d'action.
Un paysage en mutation
Les manifestants palestiniens et leurs alliés suivent de près les évolutions de l'équilibre géopolitique régional. Avec le soutien indéfectible de Washington, Israël agit désormais en toute impunité sur l'ensemble du territoire de ce que l'on appelle « l'Axe de la Résistance » dirigé par l'Iran. Et malgré les coups sévères subis par l'Iran lors de sa récente guerre de 12 jours contre Israël, il est loin d'être vaincu. Les deux camps accélèrent leur réarmement en vue d'une phase encore plus sanglante du conflit.
Mais pour l'instant, face à une balance des forces fortement en faveur d'Israël, de nombreux militants palestiniens se tournent vers l'intérieur, vers la résistance populaire de base, en l'absence de force militaire extérieure capable de freiner l'agression israélienne. Et certains éléments laissent penser que cette stratégie peut porter ses fruits.
Malgré sa domination militaire, la position mondiale d'Israël, y compris parmi les communautés juives, est plus fragile que jamais. En juin, en tant que président de la campagne One Democratic State (ODSC), j'ai participé à un événement exceptionnel : la première conférence juive antisioniste, tenue dans la ville natale de Theodor Herzl, fondateur du mouvement sioniste. Les organisateurs y ont réuni environ 500 intellectuels et militants juifs du monde entier, avec pour but d'unir le nombre croissant de Juifs antisionistes et de les intégrer dans le mouvement progressiste mondial contre le régime génocidaire d'Israël.
Face aux horreurs infligées à Gaza et à la violence croissante en Cisjordanie, Israël ne parvient plus à redorer son image à l'étranger. Sa propagande ne peut plus masquer ses crimes. Certains estiment même qu'Israël n'a pas encore pris conscience de l'ampleur des dégâts, à la fois sur le plan stratégique et de sa réputation, qu'il est en train de s'infliger, des dommages qui pourraient devenir irréversibles. Dans ce contexte, une stratégie de résistance populaire soutenue et connectée à l'échelle mondiale n'est plus seulement envisageable ; elle devient une nécessité historique.
Ces dernières années, plusieurs tentatives ont été faites pour emprunter cette voie, notamment les grandes manifestations à la frontière de Gaza en 2018-2019, connues sous le nom de « Grande Marche du Retour ». Dès le départ, ces marches ont été violemment réprimées par l'armée israélienne, dans le but d'étouffer leur impact auprès de l'opinion publique mondiale.
Pourtant, cette dynamique n'a jamais atteint la Cisjordanie. Cela s'explique en partie par le climat politique fragile et par l'absence de vision cohérente de la résistance populaire au sein de l'Autorité palestinienne (AP). Liée à sa coordination sécuritaire avec Israël, l'AP a activement saboté les mobilisations indépendantes, collaborant étroitement avec le colonisateur pour empêcher leur émergence.
En mai 2021, un large soulèvement populaire avait balayé toute la Palestine, du fleuve à la mer. Un instant, on a cru à l'émergence d'une campagne nationale et durable de résistance civile. Mais l'introduction d'une dimension militaire, par les tirs de roquettes du Hamas, a rompu cet élan et affaibli le potentiel de cette voie civile. L'opportunité existait malgré la répression israélienne ; elle ne s'est simplement pas concrétisée.
Ces occasions manquées ont renforcé chez beaucoup la conviction que la résistance populaire, légale, culturelle, artistique, reste l'un des moyens les plus prometteurs de défier la domination israélienne, peut-être même plus que la force militaire. Même certains analystes israéliens admettent désormais que les événements du 7 octobre et la guerre qui s'en est suivie ont ébranlé le prestige de l'armée israélienne, un prestige qui, malgré des décennies de crimes, était resté étonnamment intact.
Une étincelle venue de Sakhnin
Un développement récent marque un possible tournant dans la mobilisation des citoyens palestiniens d'Israël. Dans la ville de Sakhnin, au nord, des milliers de personnes se sont réunies pour une grande manifestation contre le génocide à Gaza, tandis qu'à Jaffa, plusieurs figures de proue, y compris des députés palestiniens et des membres du Haut Comité de suivi des citoyens arabes d'Israël, ont lancé une grève de la faim de trois jours. La présence significative de Juifs israéliens anti-occupation fut particulièrement marquante, un signe encourageant pour l'avenir d'une véritable co-résistance.
De Sakhnin, les manifestations se sont rapidement étendues à d'autres villes palestiniennes des territoires de 1948, à travers la Galilée, le Triangle, le Naqab et la région côtière. Et désormais, fait crucial, l'écho de ce mouvement commence à résonner en Cisjordanie, bien que les Palestiniens y soient toujours pris entre la répression des forces d'occupation israéliennes et celle de leurs collaborateurs de l'Autorité palestinienne.
Inspirés par la grève de la faim des leaders palestiniens à l'intérieur d'Israël, des activistes et figures nationales de Cisjordanie ont entamé leur propre grève, non seulement en solidarité avec Gaza, mais aussi comme outil de réveil politique. Les grévistes de la faim à Ramallah, que j'ai rejoints un jour, parlaient ouvertement de leur inspiration directe tirée de la mobilisation des citoyens palestiniens d'Israël et de leurs dirigeants. Sommes-nous en train d'assister aux premiers pas d'un mouvement populaire unifié, capable d'imposer un véritable changement ? Il est encore trop tôt pour le dire. Mais une chose est certaine : les Palestiniens ne peuvent plus se permettre la paralysie de l'immobilisme politique. La suite dépendra des dynamiques internes, et de la capacité des leaders du mouvement à penser stratégiquement pour construire le moteur, la structure et le cadre nécessaires à cette transformation historique.
Awad Abdelfattah, le 6 Août 2025
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le Munich de l’Alaska : Le sommet Trump-Poutine a récompensé l’agression et trahi l’Ukraine

Christopher Ford affirme qu'il s'agit de l'effondrement du "pivot" vers l'Ukraine et de la consolidation de l'axe Trump-Poutine.
17 août 2025 | Ukraine Solidarity Campaign de Grande-Bretagne --- Christopher Ford
Traduction : Marc Bonhomme
Il y a deux semaines, Washington a amorcé un virage serré contre Moscou. L'indignation publique du président Trump face au massacre de civils ukrainiens par la Russie a été si intense qu'il a prétendu avoir ordonné à deux sous-marins nucléaires américains de s'approcher des eaux russes, tout en promettant de nouvelles sanctions sévères. Les commentateurs ont parlé d'un "pivot" vers l'Ukraine.
Ce pivot n'était qu'un leurre, il n'a jamais eu lieu.
M. Trump a décidé de remplacer l'aide directe à l'Ukraine par un accord commercial dans lequel les gouvernements européens paient l'intégralité du coût des armes, notamment de la défense aérienne. Un spectacle grotesque où Trump profite de la vulnérabilité de l'Ukraine, qu'il a contribué à créer. Il n'y a pas eu d'augmentation importante de l'aide militaire, même par le biais de ventes à l'Europe pour l'offrir à l'Ukraine.
La menace de Trump d'imposer des "tarifs douaniers sévères" à la Russie et à ses clients pétroliers ne s'est finalement concrétisée que par des droits de douane sur l'Inde, épargnant la Chine, la Turquie et d'autres pays - une décision largement perçue en Asie comme une question de relations commerciales plutôt que comme un soutien à l'Ukraine. En juillet, il a fixé au 2 septembre la date limite pour que la Russie progresse vers la paix, puis l'a reportée du 7 au 9 août, avant de remplacer brusquement le discours sur les conséquences graves par un discours sur les territoires ukrainiens qui devraient être cédés à la Russie. Le délai est passé sans conséquence ; au lieu de cela, Trump a envoyé l'envoyé spécial Steve Witkoff à Moscou le 6 août, où Poutine n'a fait aucune concession et a répété ses demandes d'annexion maximalistes - une réunion que Trump a saluée comme un "grand progrès". Le lendemain, le sommet de l'Alaska a été annoncé, et lors des préparatifs, M. Trump a affirmé à plusieurs reprises que l'Ukraine devrait céder des territoires pour parvenir à un accord.
À la veille du sommet de l'Alaska, la Russie a de nouveau frappé l'Ukraine avec 85 drones Shahed et un missile Iskander, tuant des civils et détruisant des infrastructures. Sur le front, ses forces ont poursuivi leurs offensives, sans nouvelles sanctions américaines, maintenant ainsi la machine de guerre en marche.
Dans ce contexte, le sommet a débouché sur quatre résultats clairs, tous à l'avantage de Moscou et tous au détriment de l'Ukraine :
1. Normalisation des relations avec la Russie
L'accueil sur tapis rouge, les échanges personnels chaleureux et les éloges publics de M. Trump ont marqué une nouvelle étape dans la réhabilitation internationale de Vladimir Poutine. Les deux hommes ont salué des entretiens "extrêmement productifs" et "très chaleureux". Poutine a invité Trump à Moscou pour le prochain round.
2. Les sanctions ne sont plus à l'ordre du jour
Les mesures annoncées comme inévitables ont disparu. Dans une interview accordée à Fox News après le sommet, M. Trump a confirmé qu'"en raison de ce qui s'est passé aujourd'hui", une action punitive n'était plus envisagée. L'influence des États-Unis s'est évaporée en un aprèsmidi.
3. Pression sur l'Ukraine pour qu'elle cède des territoires
Dans la même interview accordée à Sean Hannity (Fox News), Trump a admis que lui et Poutine s'étaient "largement mis d'accord" sur les conditions de l'échange de territoires, laissant à Kiev le soin d'accepter ou de refuser. Les exigences de l'agresseur sont ainsi présentées comme relevant de la responsabilité de l'Ukraine, ce qui a pour effet de rejeter sur l'Ukraine la responsabilité de l'échec de la pacification et de récompenser l'invasion de la Russie.
4. Le cessez-le-feu n'est plus nécessaire
Le cessez-le-feu immédiat que Trump a demandé à l'Ukraine d'accepter sous la contrainte, au prix de nombreuses vies, sans aucune pression réciproque sur Poutine, a été abandonné. Aujourd'hui, Trump a entièrement adopté la position russe en faveur d'un soi-disant accord de paix permanent.
En substance et symboliquement, l'Alaska n'a pas été un pas vers la limitation de l'agression russe, mais un pas vers l'accommodement. Le prétendu pivot vers l'Ukraine s'est dissous dans un rapprochement plus profond envers la Russie.
Toutes les nouvelles sanctions destinées à punir la guerre de conquête de la Russie ont disparu, la justice pour les crimes de guerre a disparu et la charge de mettre fin à la guerre a été transférée de l'auteur à la victime.
Malgré toute l'hypocrisie de Washington et son histoire mouvementée en matière d'adhésion à l'ordre juridique d'après-guerre qu'il a contribué à créer à Nuremberg, accueillir Poutine - un criminel de guerre recherché - marque un nouveau coup d'arrêt. Rappelons que Poutine est recherché pour l'enlèvement de milliers d'enfants dans les régions d'Ukraine occupées par la Russie et leur transfert dans la Fédération de Russie.
Le sommet a donné une victoire au Kremlin et a rejoué le scénario de l'apaisement des années 1930 qui a récompensé l'agression et enhardi les autoritaires en puissance. On peut soutenir que l'ordre international d'après-guerre est effectivement terminé, avec un effondrement de ses principes fondamentaux et un affaiblissement des institutions face à la montée de l'autoritarisme et à l'agression incontrôlée.
C'est l'axe de réaction Trump-Poutine en action : un réalignement stratégique qui normalise un criminel de guerre inculpé, démantèle la pression exercée sur son régime et exige que l'Ukraine paie le prix d'une "paix" qui consacre l'occupation russe.
Les dirigeants européens ont fait l'éloge de M. Trump et du sommet de l'Alaska, Keir Starmer (premier ministre de la Grande-Bretagne) déclarant que le "leadership de M. Trump dans la poursuite de la fin de la tuerie doit être salué". Cette réaction accommodante de Trump joue en sa faveur : elle renforce la fausse image qu'il veut projeter tout en camouflant l'aide qu'il apporte réellement aux objectifs du Kremlin. En le présentant comme un pacificateur crédible malgré sa volonté de normaliser les relations avec Poutine sans réelles concessions, Trump légitime l'atteinte à la souveraineté de l'Ukraine et enhardit la Russie. Il affaiblit également le mouvement syndical et ceux qui défendent la démocratie aux États-Unis.
Il existe une alternative à la trahison.
Pendant toute une année, on nous a dit que la ville de Pokrovsk, dans la région du Donbass, tomberait aux mains de la Russie. Un an plus tard, bien que privée d'aide, l'Ukraine tient toujours la ville, qui ne doit pas être livrée à l'occupation russe, comme d'autres villes. La résilience ukrainienne devrait prouver qu'il existe une alternative à la trahison si l'aide réelle dont l'Ukraine a besoin pour garantir une paix juste était fournie.
Il existe une alternative, que le mouvement syndical doit affirmer, comme l'indique la vision de la campagne de solidarité avec l'Ukraine "Une autre Ukraine est possible - libérée de l'occupation". Le mouvement syndical, la société civile et le gouvernement travailliste doivent rejeter tout règlement légitimant l'occupation russe et rallier un soutien militaire, financier et diplomatique. Cela signifie qu'il faut augmenter les livraisons d'armes, saisir les actifs russes, annuler la dette de l'Ukraine et appliquer des sanctions plus sévères. La justice internationale doit poursuivre les crimes de guerre et garantir le retour des enfants enlevés.
La voie à suivre ne doit pas consister à apaiser les nouveaux autoritaires, mais à soutenir une Ukraine démocratique et unie, débarrassée des oligarques et des occupants. Cela signifie qu'il faut résister à la conquête territoriale et se tenir aux côtés de ceux qui, en Ukraine, luttent pour la justice sociale, l'égalité et l'autodétermination - un avenir construit sur la solidarité, et non sur la capitulation face à de nouvelles formes de fascisme.

Pas d’accord avec les criminels de guerre sur le sol de l’Alaska

À lire ! Les organisations du Native Movement Alaska viennent d'adopter cette déclaration qui dénonce l'impérialisme russe et la rencontre des néofascistes Trump/Poutine à Anchorage, ce 15 août 2025 :
« Le Mouvement autochtone s'oppose à tout accord qui force l'Ukraine à céder des territoires, à récompenser l'agression ou à réduire au silence ceux dont la vie est en jeu. Nous nous opposons à la montée du fascisme et à l'occupation violente partout, que ce soit en Ukraine, en Palestine ou ici en Alaska. Aucun de nous ne sera libre tant que nous ne le serons pas tous. »
Internationaliste, cette déclaration rompt avec le discours actuellement porté par une partie de la gauche québécoise qui, dans les faits, défend un internationalisme à géométrie variable, selon qu'il s'agisse de la Palestine ou de l'Ukraine.
Elle devrait ainsi interpeller l'ensemble des organisations militantes qui, tout en se disant décoloniales, ne prennent pas clairement position en faveur du droit du peuple ukrainien à l'auto-détermination et à la résistance, y compris armée, contre le colonialisme.
Ce communiqué a été traduit en français par Aplutsoc.
Camille Popinot et Paco
Aucun accord avec les criminels de guerre sur le sol alaskien
Alors que le président Donald Trump s'apprête à rencontrer le président russe Vladimir Poutine en Alaska le 15 août pour discuter de la crise ukrainienne, le Mouvement autochtone se tient aux côtés des Alaskiens et de ceux qui, à travers le pays, condamnent toute tentative de légitimer les crimes de guerre russes sur le territoire alaskien.
L'Alaska connaît le coût de l'impérialisme russe. Pendant plus d'un siècle, les colonisateurs russes ont volé et exploité des terres, décimé les populations autochtones d'Alaska par la violence, les maladies et l'esclavage, et anéanti des cultures par la suprématie religieuse. Aujourd'hui, nous observons la même stratégie impérialiste en Ukraine : annexion de territoires, ciblage de civils et déportation forcée de plus de 20 000 enfants ukrainiens – un crime de guerre au regard du droit international.
L'histoire de l'Alaska sous la domination russe ne nous rend pas neutres, elle fait de nous des témoins. La décision d'accueillir Poutine, un criminel de guerre, sur le sol alaskien est une trahison de notre histoire et de la clarté morale qu'exigent les souffrances de l'Ukraine et des autres peuples occupés.
Le Mouvement autochtone s'oppose à tout accord qui force l'Ukraine à céder des territoires, à récompenser l'agression ou à réduire au silence ceux dont la vie est en jeu. Nous nous opposons à la montée du fascisme et à l'occupation violente partout, que ce soit en Ukraine, en Palestine ou ici en Alaska. Aucun de nous ne sera libre tant que nous ne le serons pas tous.
Native Movement Alaska : https://www.nativemovement.org/nm-blog/2025/8/14/no-deals-with-war-criminals-on-alaska-soil
Traduit par Aplutsoc : https://aplutsoc.org/2025/08/15/alaska-non-au-sommet-des-brigands/
PS : une vidéo du "comité d'accueil" à Anchorage : https://www.facebook.com/100001518997674/videos/pcb.24478548451779115/1931539270967762



Donald Trump jette à la poubelle le socle de la politique climatique des États-Unis

L'Agence étasunienne pour la protection de l'environnement s'est sabordée en annulant un texte juridiquement fondamental. Une étape de plus dans la lutte sans relâche de Donald Trump contre toute politique écologique.
Tiré de Reporterre
2 août 2025
Par Erwan Manac'h
La thérapie de choc orchestrée par Donald Trump contre les politiques environnementales et climatiques ne connaît aucun répit. Mardi 29 juillet, l'Agence pour la protection de l'environnement (EPA) a rayé d'un trait de plume un texte adopté sous Barack Obama servant de fondement juridique aux réglementations fédérales limitant les rejets de CO2 des voitures et des usines.
L'endangerment finding (« reconnaissance de dangerosité » en français) est un texte scientifique publié en 2009, à l'issue de décennies de débats et de controverses juridiques et à la suite d'un arrêt de la Cour suprême des États-Unis faisant jurisprudence, en 2007. Il reconnaît que le dioxyde de carbone et le méthane, comme causes du changement climatique et facteurs de pollution atmosphérique, nuisent à la santé. C'est sur le fondement de ce grand principe que l'EPA a pu réglementer les émissions maximales des pots d'échappement des véhicules ainsi que les rejets des usines et centrales à gaz ou à charbon.
Croisade contre « la religion du changement climatique »
« Si elle est finalisée, l'annonce d'aujourd'hui serait la plus grande mesure de dérégulation de l'histoire des États-Unis », a claironné Lee Zeldin, le patron climatodénialiste de l'EPA, nommé par Donald Trump le 29 janvier. En s'exprimant à l'occasion d'une visite chez un concessionnaire de camions à Indianapolis, il a fustigé « les personnes qui […] sont prêtes à ruiner le pays au nom de la justice environnementale ».
Dans sa croisade contre « la religion du changement climatique », il vise en particulier les normes édictées par l'administration de Joe Biden pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des voitures et camions, accusées d'augmenter le prix des véhicules neufs et de renchérir les factures énergétiques des ménages.
« En révoquant cette conclusion scientifique fondamentale, Trump fait passer la loyauté envers les grandes compagnies pétrolières avant la science et la santé des populations. Il s'agit purement et simplement d'une capitulation politique », dit Dan Becker, directeur de campagne pour l'ONG Center for Biological Diversity, dans un communiqué.
« Les fondements juridiques [de cette décision] sont très fragiles »
Pour motiver sa décision, qui se dessine depuis le mois de mars, le ministère étasunien de l'Énergie a publié le 29 juillet un rapport commandé à cinq scientifiques c connus pour nier les causes anthropiques et minimiser les conséquences du réchauffement climatique. Ils dénoncentdans ce texte les « stratégies d'atténuation agressives ».
De nombreux observateurs s'alarment des conséquences importantes d'une suppression de l'endangerment finding sur les réglementations passées et futures en termes d'émissions de gaz à effet de serre. La bataille ne fait toutefois que commencer : une période de consultation publique de quarante-cinq jours s'ouvre, ainsi qu'une guérilla juridique, avec des recours qui pourraient aboutir à l'annulation de la décision annoncée le 29 juillet.
« Les fondements juridiques sont très fragiles », dit Richard Revesz, expert en politique environnementale à la faculté de droit de l'université de New York, interrogé par le Guardian. Il estime notamment que les fondements théoriques sur lesquels s'appuie l'administration Trump pour motiver sa décision risquent de ne pas tenir, face à cinquante ans de travaux scientifiques démontrant la dangerosité des gaz à effet de serre.
Lire aussi : Climat : pourquoi la décision de la Cour internationale de justice est « historique »
Bien que fragile juridiquement, la décision annoncée le 29 juillet risque d'avoir des conséquences inaltérables, soulignent les ONG : « Ça va prendre des années » pour remonter jusqu'à la Cour suprême, estime Dena Adler, spécialiste du droit de l'environnement interrogée par l'Agence France-Presse. « Pendant ce temps, les entreprises polluantes auront infligé des dommages irréversibles », dit Lena Moffitt, directrice de l'ONG Evergreen Action, également citée par le Guardian.
Six mois d'attaques contre l'environnement
Cette décision est l'une des plus violentes attaques de Donald Trump contre les politiques climatiques, qu'il multiplie depuis son retour à la Maison Blanche en janvier.
Il a notamment pris plusieurs mesures pour favoriser les énergies fossiles : levée, dès son investiture, d'interdictions de forage décidées par son prédécesseur ; détricotage en juin de la réglementation sur les rejets des centrales au charbon, au pétrole et au gaz, incriminées dans une pollution massive de l'environnement au mercure ;attaque, devant les tribunaux, des États qui tentent de faire payer aux compagnies pétrolières et gazières les conséquences du changement climatique ; affaiblissement des procédures d'autorisation environnementale pour les projets extractivistes ; retrait des États-Unis de l'Accord de Paris sur le climat ; autorisationde l'exploitation minière des fonds marins…
En une seule journée, le 12 mars, il a démantelé 31 réglementations environnementales, dont beaucoup portaient sur l'extraction d'hydrocarbures.
Lire aussi : En 100 jours, Trump a plongé les États-Unis dans une dystopie climatique
Donald Trump a également baissé les garde-fous contre le déversement de polluants dans les zones navigables et l'EPA s'est illustrée, en mai, par un affaiblissement des mesures visant à lutter contre la présence de PFAS, ces « polluants éternels » dérivés du fluor, dans l'eau potable. Les seuils de concentration maximale de la plupart des polluants ont été supprimés, tandis qu'une loi est en préparation pour supprimer la quasi-totalité des protections d'habitat pour les espèces menacées.
Au total, 20 milliards de dollars (environ 18 milliards d'euros) de subventions destinées à la lutte contre la crise climatique ont été supprimés depuis son retour au pouvoir en janvier. L'Agence étasunienne d'observation océanique et atmosphérique a dû licencier 900 de ses employés(20 % de son effectif) et doit cesser de répertorier les grandes catastrophes climatiques. Des subventions aux universités Harvard et Columbia ont été gelées et les chercheurs ont été forcés, sous peine de perdre leurs financements, de bannir 120 mots de leurs travaux, dont « climat » et « femme ».
Les États-Unis sont le deuxième plus gros émetteur de gaz à effet de serre mondial après la Chine et le plus important de l'histoire. Ils représentaient à eux seuls 11 % des gaz à effet de serre mondiaux en 2021.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Trump, les Démocrates et nous : les trois blocs aux États-Unis

Après la victoire éclatante de Zohran Mamdani – candidat de la gauche socialiste (DSA) – aux primaires démocrates de la ville de New York, en vue de l'élection municipale qui aura lieu à l'automne, Mathieu Bonzom s'interroge sur les formes de résistance au pouvoir trumpiste, analyse la crise du Parti démocrate et donne à voir les perspectives possibles pour la gauche états-unienne.
Tiré de la revue Contretemps
21 juillet 2025
Par Mathieu Bonzom
Milliardaire recherche candidat. Après avoir soutenu Donald Trump à la dernière élection présidentielle, Bill Ackman fait la une des journaux en annonçant vouloir financer une grande campagne électorale centriste. Contre le trumpisme ? Non : contre la gauche, à New York, au lendemain de l'étonnante victoire de Zohran Mamdani à la primaire démocrate pour le siège de maire.
La presse s'interroge, notamment en France : que font donc les Démocrates face à Trump ? Et les interrogations sur cette apparente inaction démocrate sont compliquées par ce qui se joue entre ce parti et les socialistes qui entreprennent (surtout depuis Bernie Sanders à la présidentielle il y a une dizaine d'années) de s'inviter dans ses primaires [1].
Or, l'arène électorale, où certains contre-pouvoirs institutionnels potentiels au trumpisme sont en jeu (dès cette année au niveau local, l'année prochaine au niveau du Congrès fédéral) est très révélatrice de ce que les Démocrates sont en train de faire, et de ce qui est en train d'arriver à la vie politique étatsunienne en général.
Malgré tout ce qui sépare les dispositifs institutionnels et l'histoire politique des États-Unis et des autres pays du centre capitaliste, force est de constater qu'une même dynamique « à trois blocs » (extrême-droite, centre, gauche) est en train de s'affirmer un peu partout, et se présente comme une sorte de nouvel horizon politique général à la fin de ce premier quart du 21e siècle.
Les Démocrates, à la tête du deuxième parti capitaliste aux États-Unis (et même premier en dons de milliardaires s'agissant de la campagne Kamala Harris l'an dernier), en sont les premiers surpris. Dans « la plus vieille démocratie au monde », les aspects anti-démocratiques du système politique trahissent aussi bien son âge que la défaite historique de la gauche voici un siècle. Des milliards de dollars inondent l'arène politique avec de moins en moins de retenue. Pourtant il semblerait que tout cela ne suffise plus à garantir indéfiniment le verrouillage du champ politique autour des deux grands partis de la bourgeoisie. De façon pour le moins imprévue (au même titre qu'en France du reste), ce ne sont pas deux mais trois blocs qui se dessinent, de façon persistante, aux États-Unis.
Pour mieux comprendre comment s'organisent les conflits politiques entre ces trois blocs depuis le retour de Trump, commençons par quelques remarques sur les forces et les limites, à ce jour, de la résistance au trumpisme.
Mamdani et la résistance contrastée à Trump
L'élection municipale new-yorkaise revêt plus que jamais un enjeu national. Parce qu'un charismatique socialiste de 33 ans a gagné l'investiture du Parti démocrate, au grand dam de la direction de ce dernier. Parce qu'il a mené une campagne mobilisant 50 000 bénévoles et a fait remonter la participation électorale de façon spectaculaire [2].
Parce qu'il l'a fait au nom d'un programme à la fois combatif contre la vie chère [3], et solide sur l'antiracisme, face à l'offensive de Trump contre les immigré∙es comme à l'islamophobie exacerbée, et sur l'anti-impérialisme en particulier concernant la Palestine. Parce qu'il s'est imposé dans l'un des plus grands centres du pouvoir économique au monde, et dans un pays où la gauche a historiquement été marginalisée, ou encore parce qu'il est musulman. Mais aussi parce que Trump ne semble rencontrer aucune résistance significative depuis son retour à la tête de l'État.
Aucune résistance ? Il en a peu été question en France, mais les « No Kings » protests [4] contre sa présidence ont fait du 14 juin l'une des plus grandes journées de manifestations de l'histoire des États- Unis, avec 4 à 6 millions de personnes rassemblées à travers le pays, dans plus de 2 000 localités. Ce n'est peut-être qu'un début.
Certes, il en faudra plus pour arrêter un autoritarisme déterminé à détruire ce qu'il reste de libertés dans une société déjà malmenée par le passé. Dos au mur face à l'austérité de Trump [5], les franges combatives du mouvement syndical, par exemple, retrouveront peut-être leur dynamisme des années Biden. Des réseaux de solidarité s'organisent, notamment face au déchaînement de racisme, de violence et aux détentions arbitraires contre les immigré∙es et certain∙es opposant∙es politiques.
De leur côté, Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez sillonnent les régions républicaines à fort électorat populaire en dénonçant l'oligarchie devant des salles combles. Et la victoire de Mamdani déclenche une nouvelle vague d'adhésions à l'organisation phare de la nouvelle gauche socialiste, les Democratic Socialists of America (DSA).
Le retour d'un trumpisme déchaîné n'a pas encore rencontré d'obstacle décisif sur son passage. D'après le bilan ci-dessus cependant, on peut dire qu'une base politique existe pour une contre-offensive. De plus, Trump n'est pas sûr de remporter son pari de conserver son étroite majorité électorale grâce au racisme d'État et à son usage autoritaire des institutions alors que sa politique économique et sociale va causer des ravages dans les classes populaires, y compris dans les secteurs qui ont voté pour lui.
Certaines des structures organisationnelles existantes ou en train de se constituer (politiques, syndicales et inter-syndicales, associatives…) pourraient contribuer à lancer cette contre-offensive pour de bon. Jusqu'à présent celle-ci a été introuvable, le choc et la désorientation ont eu tendance à l'emporter, mais le coup d'éclat new-yorkais pourrait non seulement faire des émules mais résonner comme un appel à la mobilisation générale.
Si la victoire de Mamdani à la primaire démocrate pour la mairie de New-York a connu un tel retentissement national, c'est qu'elle apparaît comme la campagne la plus éclatante et crédible pour regrouper les forces qui s'opposent à Trump, sans comparaison possible avec tout ce qu'ont pu faire les Démocrates depuis six mois.
Entre Trump et la gauche : la crise du Parti démocrate
En ces temps de crise politique, les grands dirigeants démocrates se font bien plus discrets qu'en 2017. Beaucoup espèrent un retour de balancier aux élections de mi-mandat, qui sont encore bien loin. Compter sur Trump pour organiser des élections régulières relève déjà du pari. Mais surtout, abandonné par une part croissante des classes populaires, le parti vit une crise dans la crise.
Joe Biden, revenu en politique en 2020 pour bloquer Sanders, est devenu l'incarnation parfaite d'un parti dépassé, dans le déni du rejet massif de son bilan social et international. Kamala Harris a prôné la continuité, avec le résultat que l'on sait.
Si l'on revient à New York, il est significatif que les ténors et les sopranos du Parti démocrate, dans la primaire d'une élection test après le retour de Trump, n'aient rien trouvé de mieux que de se ranger derrière Andrew Cuomo. L'ancien gouverneur de l'État de New York a démissionné, il y a quatre ans, après avoir été accusé de corruption et de harcèlement sexuel, ainsi que d'une gestion désastreuse des soins aux personnes âgées pendant la pandémie du Covid-19.
Cela n'a pas empêché son parti de le soutenir à nouveau cette année (après tout, fils de gouverneur lui-même, il s'est associé personnellement et politiquement aux familles Kennedy et Clinton depuis de longues années). Les riches donateurs ont fait de même et les sondages le donnaient gagnant, mais il est finalement arrivé deuxième loin derrière Mamdani. Il a fini par confirmer son intention déjà annoncée de se présenter comme candidat indépendant, mais il s'est là encore fait voler la vedette par le candidat socialiste sur les réseaux sociaux : Cuomo n'a qu'à ouvrir la bouche pour faire affluer les dons de simples électeurs∙trices vers Mamdani, ironise ce dernier.
Et c'est peut-être encore la deuxième place qui attend Cuomo au concours d'imitateurs de Trump : le maire démocrate sortant, Eric Adams, se présente lui aussi en tant qu'indépendant. Inculpé pour corruption, il a vu son affaire classée alors qu'il se ralliait publiquement à la politique migratoire du président. Les « phénomènes morbides » de la crise ne portent pas seulement les noms de Trump, Vance, ou Musk, mais aussi Biden, Harris, Clinton, Schumer, Pelosi, Cuomo, Adams, etc.
Il y a tout juste un an, les dirigeants démocrates se réjouissaient d'avoir fait battre les élu∙es de gauche Jamaal Bowman (à New York) et Cori Bush (à Ferguson) dans les primaires au Congrès, en raison de leurs prises de position défendant la Palestine [6]. Tandis que Biden remportait la primaire présidentielle sans opposition, beaucoup croyaient refermer la parenthèse de dix années de poussée socialiste. Aujourd'hui, on voit bien que c'était illusoire, que les dix ans de renouveau socialiste n'étaient pas un épiphénomène en train de se terminer, et que l'un de ses facteurs est bien l'incapacité durable des Démocrates à incarner une politique crédible pour les classes populaires.
La question de la Palestine mérite que l'on s'y arrête un peu plus. Le New York d'Eric Adams a vu le déchaînement de la police contre les mobilisations de solidarité avec la Palestine (notamment à Columbia). Plus tard, lors de son rapprochement avec Trump impliquant de soutenir l'action de la police fédérale de l'immigration, celle-ci en a profité pour enlever et placer en rétention prolongée le militant étudiant Mahmoud Khalil loin de sa famille pendant trois mois, le laissant aujourd'hui menacé d'expulsion. Le moins qu'on puisse dire est que les Démocrates ne s'empressent pas de soutenir Khalil, naturellement.
La campagne Mamdani, tout en maintenant sa focalisation sur les questions socio-économiques, a courageusement tenu des positions justes sur ces questions, et démontré que ce n'était pas un suicide politique à New York, voire aux États-Unis. Au contraire : c'est un enjeu très important en soi (les États-Unis étant activement impliqués dans une colonisation qui dure depuis trois quarts de siècles et aboutissant à un génocide encore en cours) mais aussi pour rallier les classes populaires et marquer une rupture nette avec le consensus des deux grands partis des classes dirigeantes.
« Good policy and good politics », comme on dit parfois : c'est juste à la fois sur le fond, et en termes de stratégie politique, de construction d'un bloc à vocation majoritaire. Mamdani a été très bon dans la dimension socio-économique de sa campagne ; cela ne doit cependant pas faire oublier l'importance de son positionnement antiraciste et anti-impérialiste, qu'il n'a jamais renoncé à défendre (ce qui n'a pas été le cas de tous ses camarades socialistes ces dernières années).
La poussée à gauche se poursuit bel et bien. De son côté, Trump a mis son camp en ordre de bataille. Le centre néolibéral est pris entre la montée de l'extrême droite et la résurgence de la gauche, comme dans bien d'autres pays. Mais il semble plus pris de cours qu'ailleurs, un peu comme si des décennies de vie politique rendue si routinière par l'érosion extrême de la démocratie avaient endormi ses capacités d'analyse et d'initiative politique (dans un système où les partis sont des organisations notoirement décentralisées). Le Parti démocrate, qui faisait campagne « contre le fascisme » il y a quelques mois, trahit aujourd'hui que pour lui c'était un slogan de campagne comme un autre, car il ne sort pas vraiment de son mode de fonctionnement antérieur.
Du reste, on voit bien que le centre préférerait le face-à-face avec l'extrême-droite, comme en France là aussi. Si le but du centre est d'apparaître comme la seule opposition légitime, prête à bénéficier d'un déclin de la popularité de l'extrême-droite, alors la gauche ne doit même pas avoir le droit d'exister. D'où les attaques très virulentes contre Mamdani de la part de figures démocrates, après sa victoire. Des attaques choquantes pour la frange de centre-gauche du parti, qui sans être anticapitaliste, voit très nettement qu'une vieille garde corrompue tente de saborder une campagne jeune, dynamique et populaire, soit tout ce qui manque au parti. Du côté de la base du centrisme, il y a donc de bonnes raisons de penser que la crise s'approfondira encore.
Et du côté des classes dirigeantes ? C'est bien parce que le Parti démocrate ne s'impose plus autant dans le peuple, malgré tout le soutien dont il bénéficie de la part des riches, que l'on observe l'attrait de bon nombre d'entre eux pour l'ultra-autoritarisme. Les grands capitalistes peuvent en effet trouver leur compte, à court terme, dans le trumpisme – moyennant quelques rappels à l'ordre par Wall Street, comme sur le protectionnisme. Le brouillard de la guerre (militaire, économique, environnementale) se fait de plus en plus épais sur le long terme. « Après moi le déluge » prend son sens le plus littéral.
Alimenter le racisme permet aux riches trumpistes de cimenter une alliance avec une partie des classes populaires blanches issues de zones rurales surreprésentées en vertu de la Constitution, tout en bénéficiant de la crise du Parti démocrate dans d'autres secteurs de l'électorat. Il reviendra à la gauche et aux mouvements populaires de briser ce bloc d'extrême droite.
Quelles perspectives à gauche ?
On ne saurait assez insister sur la ligne politique qui a conduit à la victoire d'une campagne de masse à New York en plein retour du trumpisme. Cette ligne se caractérise, comme on l'a vu, par deux dimensions principales : un positionnement limpide et combatif pour les conditions de vie des classes populaires et contre les riches, et une intransigeance contre les principaux points de la politique raciste et impérialiste des États-Unis, en particulier dans la solidarité avec les immigré∙es et les musulman∙es dont il fait partie, ainsi qu'avec la Palestine – cette deuxième dimension, antiraciste et anti-impérialiste étant plus affirmée que dans la plupart des précédents en date aux États-Unis. Si cette ligne pourra sans doute connaître des ajustements dans le cadre d'une stratégie différenciée sur le plan local, il serait dommageable, sur le fond et en termes de stratégie, de revenir en arrière, et de ne pas porter cette ligne à l'échelle nationale.
Cependant les chances de lancer et réussir une contre-offensive à Trump ne reposent pas seulement sur la capacité des socialistes à trouver et tenir la bonne ligne politique : la lutte contre les classes dirigeantes repose sur le développement d'une dynamique entre le bloc de gauche qui se consolide peu à peu et les mobilisations de masse. La consolidation et l'extension progressive de ce bloc et le déploiement de fortes mobilisations sociales devront s'alimenter mutuellement, ou échouer séparément.
De ce point de vue la radicalité de la campagne Mamdani et du bloc de gauche en général dépend moins de la lettre de son programme que de sa capacité à servir de catalyseur au développement et l'activité d'une gauche de masse dans la population. Sans cela, même des mesures relativement modestes seront inapplicables et Trump continuera d'avoir largement le champ libre. Avec cela au contraire, des espoirs plus ambitieux seront permis car la démonstration sera faite qu'il est possible pour les classes populaires de remporter des victoires qui changent la société à condition de s'organiser et de se mobiliser. Car c'est bien cette conviction même, moteur fondamental de la politique anticapitaliste de masse, qui reste encore à reconstruire au 21e siècle. Les deux niveaux (construction au sein des masses de mobilisations sociales et d'un bloc politique) doivent fonctionner ensemble.
Prenons encore une fois le cas de Mamdani à New York. La situation est contrastée : la campagne elle-même a permis d'élargir, de mobiliser et d'organiser les forces militantes de la gauche dans la ville. DSA compte désormais plus de 10 000 militant∙es dans la ville de New York (et peut espérer des retombées dans le reste du pays, en termes d'adhésions et de stratégie). Ses résultats électoraux sont prometteurs dans les classes populaires. Cependant ces dernières restent largement extérieures aux organisations de la gauche comme DSA. Mamdani a reçu des soutiens importants de la part du mouvement syndical, qui reste lui aussi largement à reconstruire néanmoins.
En outre, les obstacles seront nombreux pour l'application du programme : il faudra non seulement affronter les initiatives directes des riches, de Trump, ou d'une police très puissante et autonome (le fameux NYPD), ce qui annonce de nouvelles batailles antiracistes et anti-impérialistes difficiles mais décisives. Il faudra également faire face aux Démocrates centristes qui contrôlent encore les institutions de l'État de New York.
Ceux-ci se disent ouverts à certaines propositions de politique sociale de Mamdani (pour ne pas déplaire à l'électorat populaire sur le logement ou les crèches par exemple) mais résolument opposés aux mesures de justice fiscale qui sont indispensables à leur réalisation [7]. Aux États-Unis, les villes sont très dépendantes de l'aval des États pour un certain nombre de mesures [8], notamment fiscales. L'État de New York exerce aussi un contrôle sur la régie des transports municipaux (la MTA). Le maire de centre-gauche Bill de Blasio s'était d'ailleurs heurté dans les mêmes domaines à l'opposition du gouverneur… Andrew Cuomo.
Il faudra donc mener une bataille politique pour que les centristes paient le prix de leurs positions politiques, mais cela ne pourra pas réussir seulement depuis la Mairie, il faudra une mobilisation populaire, d'une façon ou d'une autre (ainsi sans doute que de nouvelles campagnes électorales de gauche à l'échelon de l'État).
Zohran Mamdani ne vient pas des classes populaires, cependant c'est un militant socialiste plus chevronné que beaucoup des candidat∙es que DSA a été amené à soutenir. Il est sans doute très conscient de ces enjeux, ce qui est un bon début.
Ensuite, le problème de la reconstruction de mobilisations de masse et d'organisations politiques des classes populaires, dans leur diversité de genre et de race, se pose un peu partout. Là encore, la solution n'est pas une simple question de ligne politique. Des réponses organisationnelles sont à inventer, aux États-Unis comme ailleurs, à partir des conditions de vie et des activités autonomes des classes populaires d'aujourd'hui : activités syndicales et para-syndicales, comités de locataires, mais aussi multiples formes d'entraide dans le travail reproductif qu'il s'agirait de soutenir, de consolider, d'organiser et de politiser.
La situation politique est critique, et pour y faire face il sera indispensable de commencer à inventer de telles solutions. C'est parfois dans ce genre de situation que des avancées soudaines se produisent, ce qui justifiera d'examiner avec attention la ville et l'État de New York, ainsi que les États-Unis plus généralement, dans les prochains mois et années. La voie vers un parti de masse des classes populaires au 21e siècle reste à trouver, mais il faudra la trouver.
Après avoir beaucoup insisté sur la nécessité de mobilisations de masse pour que ce défi soit sérieux, il faut tout de même souligner que les mobilisations nécessitent tout autant une perspective politique aussi bien pour les déclencher que pour leur permettre de savoir ce qu'elles veulent et d'obtenir de réels succès.
Quelles que soient les incertitudes sur l'avenir, le retour confirmé de la politique de classe et de la polarisation gauche-droite, un siècle après sa défaite historique aux États-Unis ne saurait donc être considéré comme un détail. Les petits groupes d'extrême-gauche qui mettent en garde contre le réformisme ne mesurent pas le caractère vital de ces avancées dans la politique de masse (la politique de masse étant d'ailleurs vitale y compris précisément d'un point de vue révolutionnaire).
Alors que certains secteurs de DSA divergent de New York notamment sur la place des campagnes électorales en général et des primaires démocrates en particulier, on peut faire ici l'hypothèse que la poursuite dans cette voie est justifiée jusqu'à nouvel ordre. Parce qu'elle renforce la gauche en élargissant sa base électorale et en consolidant ses organisations comme DSA. Parce qu'elle contribue à la crise du Parti démocrate, crise qui devra être bien plus profonde encore avant qu'un parti de gauche de masse puisse émerger (sans que l'on puisse préjuger des délais que cela implique, en ces temps incertains).
Parce que les expériences concrètes et les débats qu'elles occasionnent sont aussi la source de propositions stratégiques distinctes tournées vers l'électorat populaire républicain, comme des campagnes électorales indépendantes sur de bases de gauche (le cas récent souvent cité est celui de Dan Osborne, qui tentera une deuxième fois sa chance pour devenir Sénateur du Nebraska l'année prochaine), l'objectif à terme étant d'affaiblir le bloc d'extrême-droite dans les classes populaires et de mettre en crise les deux partis.
Républicains et Démocrates agissent comme si rien n'allait leur faire payer le prix de leur incapacité à répondre réellement aux besoins et attentes des classes populaires. La gauche relève le défi de leur prouver le contraire.
Les dirigeants des deux partis et leurs riches soutiens pourront-ils acheter la défaite de Mamdani et de ses homologues à travers le pays ? Peut-être. Ils feront alors, au vu de tous, un pas de plus dans la voie de l'oligarchie, qui sème la misère, la destruction de la planète, la fascisation, et – aboutissement logique – la guerre et le génocide. À la primaire de New York, cependant, ils ont échoué.
Des deux côtés de l'Atlantique, du Nouveau Front populaire à Zohran Mamdani, la gauche esquisse un autre horizon politique en gagnant des batailles qui paraissaient perdues d'avance. Elle le fait en sachant s'unir sur des bases offensives. Car les compromis sociaux-libéraux avec les milliardaires, rejetés dans la rue et les urnes par les classes populaires, n'arrêteront pas l'argent ni la force brute de l'oligarchie fascisante. Trumpistes et centristes, macronistes et lepénistes, ne pourront éternellement voler la victoire.
*
Une première version de ce texte, nettement moins développée, a été publiée sous forme de tribune sur le site du journal Le Monde.
Notes
[1] Les règles des primaires sont définies par les États, qui disposent de listes électorales où les électeurs∙trices sont inscrit∙es comme étant affilié∙es à tel ou tel parti. En vertu de quoi on peut être membre d'une organisation socialiste, tout en étant inscrit démocrate et donc légalement autorisé à concourir aux primaires démocrates. Il ne peut donc y avoir d'exclusion des socialistes selon les mêmes modalités que dans d'autres contextes.
[2] Les résultats détaillés montrent de bonnes surprises dans des catégories sociales populaires votant rarement, dans des quartiers populaires ayant connu des percées pour Trump en 2024, etc. Voir les commentaires présentés ici : https://newleftreview.org/sidecar/posts/gilded-city?pc=1685
[3] Les principales propositions sont un gel des loyers assorti de projets de construction de logements sociaux, des transports publics gratuits et efficaces, la création de commerces alimentaires municipaux pour lutter contre l'inflation, ou encore l'accès universel à des crèches gratuites. Soit un ensemble de mesures d'urgence pour qu'il redevienne possible pour les classes populaires de vivre dignement dans la ville qui dépend de leur travail. Le tout financé par un ajustement fiscal en faveur des classes populaires, calqué sur ce qui existe dans des villes voisines.
[4] Cette journée organisée par une large coalition d'organisations sociales (syndicales, de défense des droits humains…) et politiques (structures soutenant des candidatures de centre-gauche ou de gauche) s'est focalisée sur la question démocratique, comme son nom l'indique (voir le site officiel : https://www.nokings.org/). La date a été choisie pour coïncider avec la grande parade militaire voulue par Trump pour marquer les 250 ans de l'armée des États-Unis, et son propre 79e anniversaire, et qui ne fut pas la démonstration de force espérée par la Maison Blanche. Ce type de mobilisation n'est donc pas survenu aussi vite qu'en 2017 mais a bien fini par entrer en scène de façon marquante, non seulement dans les bastions démocrates mais dans tout le pays : https://jacobin.com/2025/06/no-kings-protests-trump-popularity
[5] Avec le fameux « Big Beautiful Bill », celui qui fut un candidat pseudo-anti-système l'année dernière montre aujourd'hui son vrai visage de président des riches, avec une politique budgétaire de classe et de race d'ampleur historique : réductions d'impôts massives pour les riches et explosion du budget de la police de l'immigration, financées en particulier par des coupes monumentales dans le financement fédéral des prestations sociales de santé et alimentaires. Cela vient s'ajouter à de multiples autres mesures consistant à détruire des services publics déjà réduits à la portion congrue.
[6] Le niveau de solidarité avec la Palestine atteint des niveaux historiques aux États-Unis ces dernières années ; et le bilan des campagnes pro-Israël aux États-Unis est bien plus mitigé que leurs soutiens ne le prétendent, comme l'illustre la victoire de Mamdani et comme l'indiquait récemment Jacobin : https://jacobin.com/2025/07/israel-lobby-campaign-spending-nyc
[7] Un maire de gauche pourrait sans doute, cependant, avancer plus librement sur des mesures ayant de bonnes chances d'entretenir sa popularité. Pour une analyse poussée (et parfois technique) des enjeux, voir https://www.dissentmagazine.org/online_articles/what-can-zohran-accomplish/
[8] Le maire socialiste de Chicago, Brandon Johnson, en a fait l'amère expérience ces dernières années.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

25 ans de réductions d’impôts et de désastre budgétaire aux Etats-Unis

Le 3 juillet, le Congrès américain a adopté les réductions d'impôts de Trump. Les médias traditionnels et les économistes ont principalement rendu compte des détails de ces réductions, c'est-à-dire les impôts qui ont été réduits dans la loi de 2025, les gains qui en découlent pour les entreprises et les riches par rapport au reste de la population, l'impact sur le PIB et peut-être même sur les déficits et la dette publics.
12 août 2025 | tiré du site alencontre.org
https://alencontre.org/ameriques/americnord/usa/25-ans-de-reductions-dimpots-et-de-desastre-budgetaire-aux-etats-unis.html
Tout cela est intéressant, mais ce n'est pas le plus important. Ils ignorent délibérément la perspective historique de ces réductions d'impôts et la situation d'ensemble qu'elles révèlent.
Cette situation d'ensemble annonce la crise budgétaire qui se profile, alimentée par la convergence croissante entre les réductions effrénées d'impôts depuis 2001, l'escalade chronique des dépenses militaires et de guerre, les crises économiques de plus en plus fréquentes et profondes entrecoupées de périodes de croissance économique plus lente, et maintenant, depuis 2022, l'accélération des coûts annuels de la dette nationale des Etats-Unis, qui s'élèvent à des milliers de milliards de dollars.
La dette des Etats-Unis est en passe d'atteindre 38 000 milliards de dollars d'ici la fin de l'année 2025. Les paiements d'intérêts aux détenteurs d'obligations dépassent déjà 1000 milliards de dollars par an. Le Congressional Budget Office, l'organe de recherche du Congrès américain, estime que la dette nationale atteindra 56 000 milliards de dollars d'ici 2034, avec des paiements d'intérêts à hauteur de 1700 milliards de dollars, et tout cela était pronostiqué avant que Trump adopte des réductions d'impôts de 5000 milliards de dollars.
De plus, l'élite américaine » ne montre aujourd'hui aucun signe de vouloir remédier à la crise budgétaire qui s'annonce. Elle continue :
• à réduire de plusieurs milliers de milliards de dollars les impôts des entreprises, des investisseurs et des 1% des ménages les plus riches,
• à augmenter les dépenses du Pentagone, des guerres et autres « mesures de défense » [voir l'article de William D. Hartung publié sur le site alencontre.org le 29 juillet],
• à permettre aux assurances maladie et aux grandes entreprises pharmaceutiques de ponctionner le Trésor,
• à verser chaque année des milliers de milliards de dollars supplémentaires aux détenteurs de titres américains, qu'ils soient étrangers ou états-uniens.
De nombreuses études montrent que, historiquement, 60% des déficits budgétaires des Etats-Unis, et donc de la dette nationale, sont dus à l'insuffisance des recettes fiscales, résultant de réductions chroniques d'impôts, d'une croissance économique lente, de l'évasion fiscale légale et de la fraude. Voici quelques faits intéressants sur les réductions d'impôts cumulées opérées par les deux partis politiques depuis 2001.
Réductions d'impôts cumulées 2001-2025
Les réductions d'impôts de George W. Bush décidées en 2001-2003 se sont élevées à 3800 milliards de dollars sur la décennie 2001-2010. On estime qu'environ 80% de ces réductions ont profité aux entreprises, aux sociétés et aux particuliers fortunés, car elles ont été principalement axées sur les taux d'imposition des particuliers, les plus-values et les dividendes des entreprises, ainsi que sur l'impôt sur les successions touchant les 1% des ménages les plus riches. George W. Bush a ensuite réduit les impôts de 180 milliards de dollars au printemps 2008, alors que l'économie commençait à entrer en récession et que la grande crise de 2008-2009 se profilait.
Lorsque Barak Obama a pris le pouvoir en 2009, son plan de relance économique, l'American Rescue Plan, adopté en mars, prévoyait 325 milliards de dollars supplémentaires de réductions d'impôts. L'ensemble de son plan de relance s'élevait à 787 milliards de dollars, dont 280 milliards ont été alloués aux Etats, qui ont ensuite thésaurisé la majeure partie de cette somme.
Moins de 200 milliards de dollars ont donc été consacrés à la relance de la consommation, ce qui s'est immédiatement révélé insuffisant pour relancer l'économie des Etats-Unis. Il a dû ajouter 25 milliards de dollars supplémentaires pour le programme « cash for clunkers » ou Car Allowance Rebate System [prime à la casse devant faciliter l'achat de nouvelles voitures consommant moins d'essence] et 25 milliards de dollars supplémentaires pour les « first time home buyers » (acheteurs d'une première maison) plus tard dans l'année. La plupart de ces derniers n'ont d'ailleurs pas été versés aux acheteurs de maisons, mais aux prêteurs hypothécaires afin de les inciter à accorder davantage de prêts hypothécaires.
Lorsque les réductions d'impôts de Bush ont dû être renouvelées en 2010, Obama les a prolongées de deux ans, jusqu'en 2012. Cela représentait 803 milliards de dollars supplémentaires de réductions d'impôts, là encore principalement au profit des riches et des entreprises.
En août 2011, dans le cadre d'un accord avec le Congrès [les républicains sont majoritaires dans la Chambre des représentants], Obama a réduit les dépenses sociales de 1500 milliards de dollars dans le cadre d'un nouveau plan « d'austérité ». 1000 milliards ont été supprimés dans le seul domaine de l'éducation et d'autres programmes sociaux ; 500 milliards de dollars devaient être supprimés dans les dépenses de défense, mais cette mesure a été reportée et n'a jamais été appliquée.
Les plans d'austérité dans les programmes sociaux suivent toujours les plans de relance en cas de crise. Cela a été le cas en 2011 après les plans de relance de 2009-2010. C'est à nouveau le cas aujourd'hui, en 2025, après les plans de relance Covid de 2020-2021, que nous aborderons plus en détail ci-dessous.
Les réductions d'impôts d'Obama en 2012 ont rendu permanentes celles de Bush. Elles ont coûté 5000 milliards de dollars supplémentaires. Elles étaient censées éviter ce que les médias, les lobbyistes et les propagandistes appelaient le « mur budgétaire » imminent [pour s'opposer à des augmentations d'impôts – qui passeraient de 35% à 39,6% – entre autres sur les Américains gagnant plus de 400 000 dollars annuels]. Elles étaient censées relancer l'économie.
Ce ne fut pas le cas. La croissance économique en termes de PIB pour le reste du mandat d'Obama n'a atteint en moyenne que 60% de la moyenne historique des périodes de reprise qui ont suivi les dix récessions précédentes aux Etats-Unis depuis 1948.
Obama a donc réduit les impôts des riches et des entreprises plus que Bush. Pour rappel, Bush a réduit les impôts de 4000 milliards de dollars (3800 milliards + 180 milliards). Obama a réduit les impôts de 325 milliards de dollars (2009) + 803 milliards de dollars (2010-2011), puis de 5000 milliards de dollars (2012). Cela représente 4000 milliards de dollars (Bush) et 6100 milliards de dollars (Obama). Puis sont venus les 4500 milliards de dollars de Trump en 2018.
***
Trump avait promis pendant la campagne électorale de 2016 de réduire les impôts de 5000 milliards de dollars. Et c'est à peu près ce qu'il a fait. La réduction d'impôts de 2018 pour la décennie à venir a coûté 4500 milliards de dollars.
Son administration, soutenue par les médias et les économistes de profession, a estimé que ces 4500 milliards de dollars ne coûteraient que 1900 milliards. Le secrétaire au Trésor de Trump à l'époque, Steve Mnuchin, a même déclaré publiquement que les réductions d'impôts de Trump « se financeraient d'elles-mêmes ».
Il voulait dire par là que les réductions d'impôts stimuleraient tellement le PIB et l'économie des Etats-Unis que la croissance entraînerait une augmentation des recettes fiscales au cours de la décennie qui compenserait les 1900 milliards de dollars. Citons Steve Mnuchin à l'époque : « nous pensons que les réductions d'impôts s'autofinanceront sur une période de dix ans » (Reuters, 13 février 2020).
La preuve que les réductions d'impôts de Trump en 2018 s'élevaient à 4500 milliards de dollars, et non à 1900 milliards, se reflétait dans les prévisions budgétaires de l'administration Trump et dans la réduction du déficit fédéral américain de 4600 milliards de dollars sur la décennie 2018-2028. Une preuve encore plus convaincante a été fournie par le Congressional Budget Office (Bureau du budget du Congrès), l'organe de recherche du Congrès, qui a estimé en 2025 que le coût des réductions d'impôts de 2018 s'élevait à au moins 4000 milliards de dollars au total !
Pendant plusieurs années, lors de débats avec des économistes de profession de renom tels que Robert Reich et Paul Krugman, l'auteur de cet article n'a cessé de démontrer que les réductions d'impôts de Trump ne s'élevaient pas à 1900 milliards de dollars, mais à 4500 milliards de dollars. Voici pourquoi.
Tout d'abord, l'estimation officielle de 1900 milliards de dollars était basée sur l'hypothèse que l'économie américaine connaîtrait une croissance annuelle de 3 à 3,5% au cours des dix prochaines années, soit de 2018 à 2028. Une prévision qui s'est avérée totalement inexacte.
Après une croissance modeste en 2018-2019, l'économie des Etats-Unis s'est effondrée en 2020 lorsque le gouvernement a ordonné un arrêt partiel de l'activité économique en réponse au Covid. L'économie a redémarré timidement et s'est redressée par étapes en 2021. Elle n'a ensuite connu qu'une croissance modérée entre 2022 et 2024 [respectivement 2,5%, 2,9% et 2,8%].
Cette modeste reprise du PIB sur trois ans a fait suite à l'énorme plan de relance budgétaire et monétaire de 10 700 milliards de dollars mis en place par le Congrès et la Réserve fédérale (Fed, banque centrale) entre 2020 et 2022 : 6700 milliards de dollars de relance budgétaire et 4000 milliards de dollars supplémentaires de relance monétaire par la Réserve fédérale. En d'autres termes, une montagne de mesures de relance n'a produit qu'une goutte d'eau dans l'océan du PIB.
Ensuite, l'estimation des réductions d'impôts de 2018 a largement sous-estimé et n'a pas pris en compte l'ampleur des réductions d'impôts dont ont bénéficié les transnationales américaines offshore.
Les 108 plus grandes entreprises américaines du classement Fortune 500 ayant des filiales offshore avaient accumulé 2700 milliards de dollars sur leurs comptes offshore, qu'elles ne rapatriaient pas aux Etats-Unis afin d'éviter de payer le taux d'imposition des sociétés de 35% en vigueur à l'époque. Les estimations des bénéfices non rapatriés provenant des activités offshore des transnationales américaines s'élevaient à 4000 à 5000 milliards de dollars.
Les réductions d'impôts de Trump en 2018 leur ont permis de rapatrier ces bénéfices et de ne payer que 10%. Cela représente une économie d'impôt de 25% sur au moins 4000 milliards de dollars.
Le département américain du Commerce a estimé en 2020 que les transnationales américaines n'avaient rapatrié que 750 milliards de dollars en 2018 et 250 milliards supplémentaires en 2019. Elles ont donc payé 10%, soit 100 milliards de dollars, au lieu de 35%, soit 350 milliards. Elles ont empoché les 900 milliards restants sur les mille milliards rapatriés. Malheureusement, aucun registre gouvernemental à ce sujet n'a été tenu après 2019.
Qu'ont-elles fait des 900 milliards de dollars qu'elles ont rapatriés ? Comme l'a rapporté le Wall Street Journal le 28 janvier 2020 : « Une grande partie de ce que les entreprises ont récupéré a servi à des rachats d'actions ». Après avoir atteint en moyenne environ 125 milliards de dollars par trimestre en 2017, les rachats d'actions du S&P 500 ont bondi à 200 milliards de dollars par trimestre en 2018 et 2019.
Et qu'est-il advenu des quelque 3000 à 4000 milliards de dollars supplémentaires que les entreprises n'ont jamais rapatriés ? Elles ont thésaurisé les 3000 à 4000 milliards de dollars restants dans leurs filiales offshore afin d'échapper à l'impôt. Une autre faille leur a permis de convertir leurs bénéfices en espèces provenant de leurs activités à l'étranger en titres financiers à court terme détenus à l'étranger, sur lesquels ils n'avaient pas à payer d'impôts.
Et il y avait un autre moyen d'éviter les impôts : elles ont manipulé leurs prix internes, c'est-à-dire ce que les activités situées aux Etats-Unis facturaient ou payaient à leurs filiales étrangères. Elles ont payé à leurs filiales étrangères des prix plus élevés pour les composants ou les produits finis, transférant ainsi les bénéfices à l'étranger où ils étaient enregistrés à des taux d'imposition plus bas, ce qui a également augmenté leurs coûts aux Etats-Unis et donc réduit les bénéfices imposés à un taux plus élevé.
La loi fiscale Trump de 2018 a également augmenté le montant que les transnationales devaient verser aux pays étrangers, qu'elles pouvaient ensuite déduire de leurs impôts dus aux Etats-Unis.
Le fait est donc que ces règles et ces échappatoires offshore ont considérablement réduit le montant total des réductions d'impôts d'au moins 2000 milliards de dollars sur dix ans, entre 2018 et 2028, qui ont été largement sous-estimées ou n'ont pas été prises en compte dans les estimations officielles du Trump de 2018, qui évaluaient le coût de la réduction d'impôts à 1900 milliards de dollars.
En résumé, des hypothèses erronées concernant la croissance du PIB sur une décennie, la réduction de l'imposition des bénéfices rapatriés et les échappatoires permettant de réduire les impôts dus sur les activités de leurs filiales offshore ont fait que les réductions d'impôts des transnationales américaines ont été bien plus importantes que ce qui avait été annoncé. Ces hypothèses et ces échappatoires ont fait que les réductions de 2018 se sont élevées à 4500 milliards de dollars, et non à 1900 milliards de dollars comme annoncé « officiellement ».
Ainsi, le total des réductions d'impôts pour la période 2001-2019 s'élève à 14 600 milliards de dollars.
***
Puis est venu le plan de relance budgétaire Covid de 2020, pendant la dernière année du mandat de Trump, en 2020. Les impôts ont été réduits de 950 milliards de dollars supplémentaires dans le cadre du plan de relance budgétaire « CARES Act » adopté par le Congrès en mars 2020, puis de 260 milliards de dollars supplémentaires dans le cadre de la loi d'urgence « Consolidated Appropriations Act » adoptée en décembre de la même année, alors que l'économie américaine vacillait à nouveau.
Ces réductions d'impôts de 1200 milliards de dollars en 2020 ont été suivies en 2021 par le plan de relance budgétaire « AMERICAN RELIEF PLAN » de Biden, qui a réduit les impôts de 640 milliards de dollars supplémentaires.
En 2022, Biden a ensuite réaffecté une partie des aides non utilisées pour les programmes sociaux de son plan de relance à une nouvelle série de trois programmes de relance des investissements des entreprises, d'un coût total de 1700 milliards de dollars :
1. la loi sur les infrastructures,
2. la loi sur les puces électroniques et la modernisation,
3. la loi mal nommée « Inflation Reduction Act », qui consistait principalement en des réductions d'impôts et des subventions aux entreprises énergétiques, aux énergies alternatives et aux combustibles fossiles.
Ces trois lois de 2022 sur l'investissement des entreprises ont permis de réduire les impôts d'environ 500 milliards de dollars supplémentaires.
Si l'on additionne toutes les réductions d'impôts de 2001 à 2024, les deux partis – deux administrations républicaines et deux administrations démocrates ont réduit les impôts de près de 17 000 milliards de dollars !
Il n'est donc pas surprenant que Trump 2025 réduise à nouveau les impôts de 5000 milliards de dollars, une fois de plus principalement au profit des entreprises, des investisseurs et des ménages les plus riches. Une réduction massive des impôts est en cours depuis un quart de siècle, depuis 2001. (On peut affirmer que cette tendance remonte encore plus loin, aux réductions d'impôts de Reagan en 1981 et 1986 et à celles de Clinton en 1997-1998.)
***
Tout cela s'inscrit dans la politique budgétaire à long terme de l'ère néolibérale (de 1979 à actuellement) :
• réduire les impôts des riches et de leurs entreprises,
• compenser en partie le coût des réductions d'impôts par des coupes dans les programmes sociaux,
• augmenter les dépenses de défense et de guerre,
• ignorer les effets de tout cela sur les déficits budgétaires et la dette nationale, qui se traduisent par une augmentation des paiements d'intérêts aux détenteurs d'obligations américaines à 1000 milliards de dollars par an.
Des études historiques à long terme montrent de manière concluante que les réductions d'impôts et la baisse des recettes fiscales due à la lenteur de la croissance économique, à la fraude et à l'évasion fiscale sont responsables de 60% des déficits budgétaires.
Les autres facteurs importants qui ont contribué au déficit budgétaire et à la dette nationale des Etats-Unis depuis 2001 sont les suivants :
• les 9000 milliards de dollars dépensés pour les guerres à l'étranger au cours du premier quart du XXIe siècle ;
• les deux grands plans de sauvetage de 2008-2009 (787 milliards de dollars au total), 2020 (3,1 milliards de dollars) et 2021 (1,9 milliard de dollars) ;
• la hausse chronique des prix pratiqués par les entreprises de santé et d'assurance, qui fait grimper le coût des programmes publics d'aide à la santé (Medicare [pour les personnes âges dès 65 ans et les handicapés], Medicaid [personnes à faibles revenus], Schip-State Children's Health Insurance Program, rebaptisé Chip, pour enfants non assurés de familles à bas revenus, ACA [Obamacare adoptée suite à la hausse du coût des soins]) ;
• l'augmentation des intérêts versés aux investisseurs (américains et étrangers) qui achètent des titres du Trésor américain.
Ainsi, la perte de recettes fiscales due à 25 ans de réductions d'impôts et au ralentissement de la croissance économique à long terme (17 000 milliards de dollars), les 9000 milliards de dollars gaspillés dans des guerres sans fin depuis 2001, le coût des plans de sauvetage (5800 milliards de dollars) et la flambée des prix des soins de santé (environ 500 milliards de dollars) expliquent à eux seuls la majeure partie de la dette nationale actuelle, qui s'élève à 36 200 milliards de dollars.
En bref, un train budgétaire est en train de dérailler depuis au moins 25 ans et le « Big Beautiful Bill » (BBB) de Trump, d'un montant de 5000 milliards de dollars, ainsi que les milliers de milliards supplémentaires consacrés à la défense et aux guerres, font passer ce train à la vitesse supérieure.
Trump, les déficits budgétaires et la dette nationale
Les déficits budgétaires américains s'élèvent en moyenne à 2000 milliards de dollars par an et sont en hausse depuis 2016. Ils devraient augmenter de 2000 milliards supplémentaires en 025, avant même que les réductions d'impôts de Trump n'entrent en vigueur cette année.
La dette nationale n'est que l'accumulation des déficits budgétaires annuels. En 2000, la dette nationale américaine s'élevait à 5600 milliards de dollars. Huit ans plus tard, elle avait presque doublé pour atteindre 10 700 milliards de dollars. Elle a ensuite doublé sous Obama pour atteindre 20 000 milliards de dollars à la fin de 2016. Trump a ajouté 7800 milliards de dollars au cours des quatre années de son premier mandat et Biden a ajouté 850 milliards de dollars supplémentaires en seulement quatre ans. A la fin du mandat de Biden, en décembre 2024, la dette nationale avait atteint 36 200 milliards de dollars.
À titre indicatif, ce chiffre, qui devrait atteindre 38 000 milliards de dollars d'ici la fin de l'année 2025 et 56 000 milliards de dollars d'ici 2034, n'inclut pas la dette inscrite au bilan de la Réserve fédérale (qui s'élève actuellement à 8000 milliards de dollars) ni la dette des Etats et des collectivités locales, qui se chiffre à plusieurs milliers de milliards de dollars supplémentaires.
Conséquences futures
Il est ironique que Trump ait choisi d'appeler sa proposition de réduction des impôts et d'augmentation des dépenses de défense le « Big Beautiful Bill » (le grand beau projet de loi), ou BBB comme l'appelle le Congrès. En effet, dans le monde de la finance, BBB désigne les entreprises les plus mal gérées, surendettées et présentant un risque élevé (notation triple B). La notation triple B les rend financièrement très fragiles et les expose à un risque élevé de défaut de paiement et de faillite.
Il est toutefois peu probable que le gouvernement fédéral américain fasse faillite ou ne puisse honorer ses paiements annuels de 1000 à 1700 milliards de dollars aux détenteurs d'obligations de la dette nationale. Il lui suffit pour cela d'« imprimer » davantage de billets, soit en ajoutant électroniquement des comptes à la Réserve fédérale, soit, dans un avenir proche, en créant une monnaie numérique.
Mais si cela ne signifie pas nécessairement la faillite, cela pourrait très bien entraîner l'effondrement de la valeur du dollar américain à l'échelle mondiale. Cela pourrait à son tour entraîner l'abandon du dollar comme monnaie de réserve et d'échange mondiale. Et cela pourrait entraîner l'effondrement du recyclage des dollars américains vers les Etats-Unis par les détenteurs étrangers de dollars excédentaires. Dans ce cas, le budget annuel des Etats-Unis ne pourrait plus être financé, ce qui nécessiterait alors des réductions massives des dépenses et des hausses d'impôts. En d'autres termes, ce serait la fin de l'empire mondial états-unien.
Les réductions d'impôts et le projet de loi sur les dépenses de Trump ne sont qu'une nouvelle version de la politique budgétaire néolibérale, cette fois-ci sous stéroïdes. Mais la politique budgétaire néolibérale est défaillante. En effet, elle ne produit plus les mêmes effets de relance sur l'économie réelle, les investissements réels et la croissance du PIB qu'au cours des dernières décennies. Il faut augmenter l'ampleur des mesures de relance budgétaire pour générer une croissance du PIB réel identique, voire inférieure.
La politique budgétaire a plutôt pour effet de stimuler les marchés financiers, aux Etats-Unis et dans le monde, et donc de faire grimper les cours des actions, des obligations, des devises, des produits dérivés et autres instruments financiers. Ou bien les réductions d'impôts sont réorientées par les transnationales qui en bénéficient vers des investissements et des activités offshore.
En d'autres termes, elles servent à subventionner l'expansion du capital états-unien à l'étranger. La financiarisation et la mondialisation des investissements sont deux caractéristiques de l'économie capitaliste du XXIe siècle. Un effet similaire s'applique à la politique monétaire américaine : une part de plus en plus importante des injections de liquidités de la Réserve fédérale dans l'économie est détournée vers les marchés financiers et vers l'étranger.
La meilleure preuve en est peut-être les 10 700 milliards de dollars de mesures de relance budgétaire et monétaire injectés par le Congrès et la Réserve fédérale en 2020-2022. Cela aurait dû entraîner une expansion massive de la croissance du PIB en 2022-2024. Elle n'a produit qu'une croissance historique moyenne un peu supérieure à 2%.
Tous les médias, les économistes et les responsables gouvernementaux qui vantent les mérites des réductions d'impôts de Trump et de la loi BBB pour stimuler l'économie réelle (c'est-à-dire les salaires, l'emploi, l'investissement, etc.) ne font que du battage médiatique. Les réductions d'impôts de 2018 n'ont pas eu cet effet. Ni celles d'Obama et de Bush avant elles. La loi BBB actuelle de Trump n'aura pas d'effet différent.
La politique budgétaire et monétaire de la fin de l'ère néolibérale – dans le capitalisme américain et l'empire économique mondial du XXIe siècle – est en train d'échouer. Néanmoins, « l'élite américaine » redouble d'efforts pour réduire les impôts des riches et mener ses guerres pour défendre l'empire.
Jack Rasmus
Jack Rasmus est professeur au St. Mary's College en Californie et l'auteur du livre récemment publié The Scourge of Neoliberalism : US Economic Policy from Reagan to Trump (Le fléau du néolibéralisme : la politique économique américaine de Reagan à Trump), Clarity Press, 2020.
Article publié sur le site de Jack Rasmus le 11 juillet 2025 ; traduction rédaction A l'Encontre
https://alencontre.org/ameriques/americnord/usa/25-ans-de-reductions-dimpots-et-de-desastre-budgetaire-aux-etats-unis.html
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Trump, les Démocrates et nous : les trois blocs aux États-Unis

Après la victoire éclatante de Zohran Mamdani – candidat de la gauche socialiste (DSA) – aux primaires démocrates de la ville de New York, en vue de l'élection municipale qui aura lieu à l'automne, Mathieu Bonzom s'interroge sur les formes de résistance au pouvoir trumpiste, analyse la crise du Parti démocrate et donne à voir les perspectives possibles pour la gauche états-unienne.
21 juillet 2025 | tiré du site contretemps.eu
https://www.contretemps.eu/trump-democrates-mamdani-sanders-gauche-etats-unis/
***
Milliardaire recherche candidat. Après avoir soutenu Donald Trump à la dernière élection présidentielle, Bill Ackman fait la une des journaux en annonçant vouloir financer une grande campagne électorale centriste. Contre le trumpisme ? Non : contre la gauche, à New York, au lendemain de l'étonnante victoire de Zohran Mamdani à la primaire démocrate pour le siège de maire.
La presse s'interroge, notamment en France : que font donc les Démocrates face à Trump ? Et les interrogations sur cette apparente inaction démocrate sont compliquées par ce qui se joue entre ce parti et les socialistes qui entreprennent (surtout depuis Bernie Sanders à la présidentielle il y a une dizaine d'années) de s'inviter dans ses primaires[1].
Or, l'arène électorale, où certains contre-pouvoirs institutionnels potentiels au trumpisme sont en jeu (dès cette année au niveau local, l'année prochaine au niveau du Congrès fédéral) est très révélatrice de ce que les Démocrates sont en train de faire, et de ce qui est en train d'arriver à la vie politique étatsunienne en général.
Malgré tout ce qui sépare les dispositifs institutionnels et l'histoire politique des États-Unis et des autres pays du centre capitaliste, force est de constater qu'une même dynamique « à trois blocs » (extrême-droite, centre, gauche) est en train de s'affirmer un peu partout, et se présente comme une sorte de nouvel horizon politique général à la fin de ce premier quart du 21e siècle.
Les Démocrates, à la tête du deuxième parti capitaliste aux États-Unis (et même premier en dons de milliardaires s'agissant de la campagne Kamala Harris l'an dernier), en sont les premiers surpris. Dans « la plus vieille démocratie au monde », les aspects anti-démocratiques du système politique trahissent aussi bien son âge que la défaite historique de la gauche voici un siècle. Des milliards de dollars inondent l'arène politique avec de moins en moins de retenue. Pourtant il semblerait que tout cela ne suffise plus à garantir indéfiniment le verrouillage du champ politique autour des deux grands partis de la bourgeoisie. De façon pour le moins imprévue (au même titre qu'en France du reste), ce ne sont pas deux mais trois blocs qui se dessinent, de façon persistante, aux États-Unis.
Pour mieux comprendre comment s'organisent les conflits politiques entre ces trois blocs depuis le retour de Trump, commençons par quelques remarques sur les forces et les limites, à ce jour, de la résistance au trumpisme.
Mamdani et la résistance contrastée à Trump
L'élection municipale new-yorkaise revêt plus que jamais un enjeu national. Parce qu'un charismatique socialiste de 33 ans a gagné l'investiture du Parti démocrate, au grand dam de la direction de ce dernier. Parce qu'il a mené une campagne mobilisant 50 000 bénévoles et a fait remonter la participation électorale de façon spectaculaire[2].
Parce qu'il l'a fait au nom d'un programme à la fois combatif contre la vie chère[3], et solide sur l'antiracisme, face à l'offensive de Trump contre les immigré∙es comme à l'islamophobie exacerbée, et sur l'anti-impérialisme en particulier concernant la Palestine. Parce qu'il s'est imposé dans l'un des plus grands centres du pouvoir économique au monde, et dans un pays où la gauche a historiquement été marginalisée, ou encore parce qu'il est musulman. Mais aussi parce que Trump ne semble rencontrer aucune résistance significative depuis son retour à la tête de l'État.
Aucune résistance ? Il en a peu été question en France, mais les « No Kings » protests[4] contre sa présidence ont fait du 14 juin l'une des plus grandes journées de manifestations de l'histoire des États- Unis, avec 4 à 6 millions de personnes rassemblées à travers le pays, dans plus de 2 000 localités. Ce n'est peut-être qu'un début.
Certes, il en faudra plus pour arrêter un autoritarisme déterminé à détruire ce qu'il reste de libertés dans une société déjà malmenée par le passé. Dos au mur face à l'austérité de Trump[5], les franges combatives du mouvement syndical, par exemple, retrouveront peut-être leur dynamisme des années Biden. Des réseaux de solidarité s'organisent, notamment face au déchaînement de racisme, de violence et aux détentions arbitraires contre les immigré∙es et certain∙es opposant∙es politiques.
De leur côté, Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez sillonnent les régions républicaines à fort électorat populaire en dénonçant l'oligarchie devant des salles combles. Et la victoire de Mamdani déclenche une nouvelle vague d'adhésions à l'organisation phare de la nouvelle gauche socialiste, les Democratic Socialists of America (DSA).
Le retour d'un trumpisme déchaîné n'a pas encore rencontré d'obstacle décisif sur son passage. D'après le bilan ci-dessus cependant, on peut dire qu'une base politique existe pour une contre-offensive. De plus, Trump n'est pas sûr de remporter son pari de conserver son étroite majorité électorale grâce au racisme d'État et à son usage autoritaire des institutions alors que sa politique économique et sociale va causer des ravages dans les classes populaires, y compris dans les secteurs qui ont voté pour lui.
Certaines des structures organisationnelles existantes ou en train de se constituer (politiques, syndicales et inter-syndicales, associatives…) pourraient contribuer à lancer cette contre-offensive pour de bon. Jusqu'à présent celle-ci a été introuvable, le choc et la désorientation ont eu tendance à l'emporter, mais le coup d'éclat new-yorkais pourrait non seulement faire des émules mais résonner comme un appel à la mobilisation générale.
Si la victoire de Mamdani à la primaire démocrate pour la mairie de New-York a connu un tel retentissement national, c'est qu'elle apparaît comme la campagne la plus éclatante et crédible pour regrouper les forces qui s'opposent à Trump, sans comparaison possible avec tout ce qu'ont pu faire les Démocrates depuis six mois.
Entre Trump et la gauche : la crise du Parti démocrate
En ces temps de crise politique, les grands dirigeants démocrates se font bien plus discrets qu'en 2017. Beaucoup espèrent un retour de balancier aux élections de mi-mandat, qui sont encore bien loin. Compter sur Trump pour organiser des élections régulières relève déjà du pari. Mais surtout, abandonné par une part croissante des classes populaires, le parti vit une crise dans la crise.
Joe Biden, revenu en politique en 2020 pour bloquer Sanders, est devenu l'incarnation parfaite d'un parti dépassé, dans le déni du rejet massif de son bilan social et international. Kamala Harris a prôné la continuité, avec le résultat que l'on sait.
Si l'on revient à New York, il est significatif que les ténors et les sopranos du Parti démocrate, dans la primaire d'une élection test après le retour de Trump, n'aient rien trouvé de mieux que de se ranger derrière Andrew Cuomo. L'ancien gouverneur de l'État de New York a démissionné, il y a quatre ans, après avoir été accusé de corruption et de harcèlement sexuel, ainsi que d'une gestion désastreuse des soins aux personnes âgées pendant la pandémie du Covid-19.
Cela n'a pas empêché son parti de le soutenir à nouveau cette année (après tout, fils de gouverneur lui-même, il s'est associé personnellement et politiquement aux familles Kennedy et Clinton depuis de longues années). Les riches donateurs ont fait de même et les sondages le donnaient gagnant, mais il est finalement arrivé deuxième loin derrière Mamdani. Il a fini par confirmer son intention déjà annoncée de se présenter comme candidat indépendant, mais il s'est là encore fait voler la vedette par le candidat socialiste sur les réseaux sociaux : Cuomo n'a qu'à ouvrir la bouche pour faire affluer les dons de simples électeurs∙trices vers Mamdani, ironise ce dernier.
Et c'est peut-être encore la deuxième place qui attend Cuomo au concours d'imitateurs de Trump : le maire démocrate sortant, Eric Adams, se présente lui aussi en tant qu'indépendant. Inculpé pour corruption, il a vu son affaire classée alors qu'il se ralliait publiquement à la politique migratoire du président. Les « phénomènes morbides » de la crise ne portent pas seulement les noms de Trump, Vance, ou Musk, mais aussi Biden, Harris, Clinton, Schumer, Pelosi, Cuomo, Adams, etc.
Il y a tout juste un an, les dirigeants démocrates se réjouissaient d'avoir fait battre les élu∙es de gauche Jamaal Bowman (à New York) et Cori Bush (à Ferguson) dans les primaires au Congrès, en raison de leurs prises de position défendant la Palestine[6]. Tandis que Biden remportait la primaire présidentielle sans opposition, beaucoup croyaient refermer la parenthèse de dix années de poussée socialiste. Aujourd'hui, on voit bien que c'était illusoire, que les dix ans de renouveau socialiste n'étaient pas un épiphénomène en train de se terminer, et que l'un de ses facteurs est bien l'incapacité durable des Démocrates à incarner une politique crédible pour les classes populaires.
La question de la Palestine mérite que l'on s'y arrête un peu plus. Le New York d'Eric Adams a vu le déchaînement de la police contre les mobilisations de solidarité avec la Palestine (notamment à Columbia). Plus tard, lors de son rapprochement avec Trump impliquant de soutenir l'action de la police fédérale de l'immigration, celle-ci en a profité pour enlever et placer en rétention prolongée le militant étudiant Mahmoud Khalil loin de sa famille pendant trois mois, le laissant aujourd'hui menacé d'expulsion. Le moins qu'on puisse dire est que les Démocrates ne s'empressent pas de soutenir Khalil, naturellement.
La campagne Mamdani, tout en maintenant sa focalisation sur les questions socio-économiques, a courageusement tenu des positions justes sur ces questions, et démontré que ce n'était pas un suicide politique à New York, voire aux États-Unis. Au contraire : c'est un enjeu très important en soi (les États-Unis étant activement impliqués dans une colonisation qui dure depuis trois quarts de siècles et aboutissant à un génocide encore en cours) mais aussi pour rallier les classes populaires et marquer une rupture nette avec le consensus des deux grands partis des classes dirigeantes.
« Good policy and good politics », comme on dit parfois : c'est juste à la fois sur le fond, et en termes de stratégie politique, de construction d'un bloc à vocation majoritaire. Mamdani a été très bon dans la dimension socio-économique de sa campagne ; cela ne doit cependant pas faire oublier l'importance de son positionnement antiraciste et anti-impérialiste, qu'il n'a jamais renoncé à défendre (ce qui n'a pas été le cas de tous ses camarades socialistes ces dernières années).
La poussée à gauche se poursuit bel et bien. De son côté, Trump a mis son camp en ordre de bataille. Le centre néolibéral est pris entre la montée de l'extrême droite et la résurgence de la gauche, comme dans bien d'autres pays. Mais il semble plus pris de cours qu'ailleurs, un peu comme si des décennies de vie politique rendue si routinière par l'érosion extrême de la démocratie avaient endormi ses capacités d'analyse et d'initiative politique (dans un système où les partis sont des organisations notoirement décentralisées). Le Parti démocrate, qui faisait campagne « contre le fascisme » il y a quelques mois, trahit aujourd'hui que pour lui c'était un slogan de campagne comme un autre, car il ne sort pas vraiment de son mode de fonctionnement antérieur.
Du reste, on voit bien que le centre préférerait le face-à-face avec l'extrême-droite, comme en France là aussi. Si le but du centre est d'apparaître comme la seule opposition légitime, prête à bénéficier d'un déclin de la popularité de l'extrême-droite, alors la gauche ne doit même pas avoir le droit d'exister. D'où les attaques très virulentes contre Mamdani de la part de figures démocrates, après sa victoire. Des attaques choquantes pour la frange de centre-gauche du parti, qui sans être anticapitaliste, voit très nettement qu'une vieille garde corrompue tente de saborder une campagne jeune, dynamique et populaire, soit tout ce qui manque au parti. Du côté de la base du centrisme, il y a donc de bonnes raisons de penser que la crise s'approfondira encore.
Et du côté des classes dirigeantes ? C'est bien parce que le Parti démocrate ne s'impose plus autant dans le peuple, malgré tout le soutien dont il bénéficie de la part des riches, que l'on observe l'attrait de bon nombre d'entre eux pour l'ultra-autoritarisme. Les grands capitalistes peuvent en effet trouver leur compte, à court terme, dans le trumpisme – moyennant quelques rappels à l'ordre par Wall Street, comme sur le protectionnisme. Le brouillard de la guerre (militaire, économique, environnementale) se fait de plus en plus épais sur le long terme. « Après moi le déluge » prend son sens le plus littéral.
Alimenter le racisme permet aux riches trumpistes de cimenter une alliance avec une partie des classes populaires blanches issues de zones rurales surreprésentées en vertu de la Constitution, tout en bénéficiant de la crise du Parti démocrate dans d'autres secteurs de l'électorat. Il reviendra à la gauche et aux mouvements populaires de briser ce bloc d'extrême droite.
Quelles perspectives à gauche ?
On ne saurait assez insister sur la ligne politique qui a conduit à la victoire d'une campagne de masse à New York en plein retour du trumpisme. Cette ligne se caractérise, comme on l'a vu, par deux dimensions principales : un positionnement limpide et combatif pour les conditions de vie des classes populaires et contre les riches, et une intransigeance contre les principaux points de la politique raciste et impérialiste des États-Unis, en particulier dans la solidarité avec les immigré∙es et les musulman∙es dont il fait partie, ainsi qu'avec la Palestine – cette deuxième dimension, antiraciste et anti-impérialiste étant plus affirmée que dans la plupart des précédents en date aux États-Unis. Si cette ligne pourra sans doute connaître des ajustements dans le cadre d'une stratégie différenciée sur le plan local, il serait dommageable, sur le fond et en termes de stratégie, de revenir en arrière, et de ne pas porter cette ligne à l'échelle nationale.
Cependant les chances de lancer et réussir une contre-offensive à Trump ne reposent pas seulement sur la capacité des socialistes à trouver et tenir la bonne ligne politique : la lutte contre les classes dirigeantes repose sur le développement d'une dynamique entre le bloc de gauche qui se consolide peu à peu et les mobilisations de masse. La consolidation et l'extension progressive de ce bloc et le déploiement de fortes mobilisations sociales devront s'alimenter mutuellement, ou échouer séparément.
De ce point de vue la radicalité de la campagne Mamdani et du bloc de gauche en général dépend moins de la lettre de son programme que de sa capacité à servir de catalyseur au développement et l'activité d'une gauche de masse dans la population. Sans cela, même des mesures relativement modestes seront inapplicables et Trump continuera d'avoir largement le champ libre. Avec cela au contraire, des espoirs plus ambitieux seront permis car la démonstration sera faite qu'il est possible pour les classes populaires de remporter des victoires qui changent la société à condition de s'organiser et de se mobiliser. Car c'est bien cette conviction même, moteur fondamental de la politique anticapitaliste de masse, qui reste encore à reconstruire au 21e siècle. Les deux niveaux (construction au sein des masses de mobilisations sociales et d'un bloc politique) doivent fonctionner ensemble.
Prenons encore une fois le cas de Mamdani à New York. La situation est contrastée : la campagne elle-même a permis d'élargir, de mobiliser et d'organiser les forces militantes de la gauche dans la ville. DSA compte désormais plus de 10 000 militant∙es dans la ville de New York (et peut espérer des retombées dans le reste du pays, en termes d'adhésions et de stratégie). Ses résultats électoraux sont prometteurs dans les classes populaires. Cependant ces dernières restent largement extérieures aux organisations de la gauche comme DSA. Mamdani a reçu des soutiens importants de la part du mouvement syndical, qui reste lui aussi largement à reconstruire néanmoins.
En outre, les obstacles seront nombreux pour l'application du programme : il faudra non seulement affronter les initiatives directes des riches, de Trump, ou d'une police très puissante et autonome (le fameux NYPD), ce qui annonce de nouvelles batailles antiracistes et anti-impérialistes difficiles mais décisives. Il faudra également faire face aux Démocrates centristes qui contrôlent encore les institutions de l'État de New York.
Ceux-ci se disent ouverts à certaines propositions de politique sociale de Mamdani (pour ne pas déplaire à l'électorat populaire sur le logement ou les crèches par exemple) mais résolument opposés aux mesures de justice fiscale qui sont indispensables à leur réalisation[7]. Aux États-Unis, les villes sont très dépendantes de l'aval des États pour un certain nombre de mesures[8], notamment fiscales. L'État de New York exerce aussi un contrôle sur la régie des transports municipaux (la MTA). Le maire de centre-gauche Bill de Blasio s'était d'ailleurs heurté dans les mêmes domaines à l'opposition du gouverneur… Andrew Cuomo.
Il faudra donc mener une bataille politique pour que les centristes paient le prix de leurs positions politiques, mais cela ne pourra pas réussir seulement depuis la Mairie, il faudra une mobilisation populaire, d'une façon ou d'une autre (ainsi sans doute que de nouvelles campagnes électorales de gauche à l'échelon de l'État).
Zohran Mamdani ne vient pas des classes populaires, cependant c'est un militant socialiste plus chevronné que beaucoup des candidat∙es que DSA a été amené à soutenir. Il est sans doute très conscient de ces enjeux, ce qui est un bon début.
Ensuite, le problème de la reconstruction de mobilisations de masse et d'organisations politiques des classes populaires, dans leur diversité de genre et de race, se pose un peu partout. Là encore, la solution n'est pas une simple question de ligne politique. Des réponses organisationnelles sont à inventer, aux États-Unis comme ailleurs, à partir des conditions de vie et des activités autonomes des classes populaires d'aujourd'hui : activités syndicales et para-syndicales, comités de locataires, mais aussi multiples formes d'entraide dans le travail reproductif qu'il s'agirait de soutenir, de consolider, d'organiser et de politiser.
La situation politique est critique, et pour y faire face il sera indispensable de commencer à inventer de telles solutions. C'est parfois dans ce genre de situation que des avancées soudaines se produisent, ce qui justifiera d'examiner avec attention la ville et l'État de New York, ainsi que les États-Unis plus généralement, dans les prochains mois et années. La voie vers un parti de masse des classes populaires au 21e siècle reste à trouver, mais il faudra la trouver.
Après avoir beaucoup insisté sur la nécessité de mobilisations de masse pour que ce défi soit sérieux, il faut tout de même souligner que les mobilisations nécessitent tout autant une perspective politique aussi bien pour les déclencher que pour leur permettre de savoir ce qu'elles veulent et d'obtenir de réels succès.
Quelles que soient les incertitudes sur l'avenir, le retour confirmé de la politique de classe et de la polarisation gauche-droite, un siècle après sa défaite historique aux États-Unis ne saurait donc être considéré comme un détail. Les petits groupes d'extrême-gauche qui mettent en garde contre le réformisme ne mesurent pas le caractère vital de ces avancées dans la politique de masse (la politique de masse étant d'ailleurs vitale y compris précisément d'un point de vue révolutionnaire).
Alors que certains secteurs de DSA divergent de New York notamment sur la place des campagnes électorales en général et des primaires démocrates en particulier, on peut faire ici l'hypothèse que la poursuite dans cette voie est justifiée jusqu'à nouvel ordre. Parce qu'elle renforce la gauche en élargissant sa base électorale et en consolidant ses organisations comme DSA. Parce qu'elle contribue à la crise du Parti démocrate, crise qui devra être bien plus profonde encore avant qu'un parti de gauche de masse puisse émerger (sans que l'on puisse préjuger des délais que cela implique, en ces temps incertains).
Parce que les expériences concrètes et les débats qu'elles occasionnent sont aussi la source de propositions stratégiques distinctes tournées vers l'électorat populaire républicain, comme des campagnes électorales indépendantes sur de bases de gauche (le cas récent souvent cité est celui de Dan Osborne, qui tentera une deuxième fois sa chance pour devenir Sénateur du Nebraska l'année prochaine), l'objectif à terme étant d'affaiblir le bloc d'extrême-droite dans les classes populaires et de mettre en crise les deux partis.
Républicains et Démocrates agissent comme si rien n'allait leur faire payer le prix de leur incapacité à répondre réellement aux besoins et attentes des classes populaires. La gauche relève le défi de leur prouver le contraire.
Les dirigeants des deux partis et leurs riches soutiens pourront-ils acheter la défaite de Mamdani et de ses homologues à travers le pays ? Peut-être. Ils feront alors, au vu de tous, un pas de plus dans la voie de l'oligarchie, qui sème la misère, la destruction de la planète, la fascisation, et – aboutissement logique – la guerre et le génocide. À la primaire de New York, cependant, ils ont échoué.
Des deux côtés de l'Atlantique, du Nouveau Front populaire à Zohran Mamdani, la gauche esquisse un autre horizon politique en gagnant des batailles qui paraissaient perdues d'avance. Elle le fait en sachant s'unir sur des bases offensives. Car les compromis sociaux-libéraux avec les milliardaires, rejetés dans la rue et les urnes par les classes populaires, n'arrêteront pas l'argent ni la force brute de l'oligarchie fascisante. Trumpistes et centristes, macronistes et lepénistes, ne pourront éternellement voler la victoire.
*
Une première version de ce texte, nettement moins développée, a été publiée sous forme de tribune sur le site du journal Le Monde.
Notes
[1] Les règles des primaires sont définies par les États, qui disposent de listes électorales où les électeurs∙trices sont inscrit∙es comme étant affilié∙es à tel ou tel parti. En vertu de quoi on peut être membre d'une organisation socialiste, tout en étant inscrit démocrate et donc légalement autorisé à concourir aux primaires démocrates. Il ne peut donc y avoir d'exclusion des socialistes selon les mêmes modalités que dans d'autres contextes.
[2] Les résultats détaillés montrent de bonnes surprises dans des catégories sociales populaires votant rarement, dans des quartiers populaires ayant connu des percées pour Trump en 2024, etc. Voir les commentaires présentés ici : https://newleftreview.org/sidecar/posts/gilded-city?pc=1685
[3] Les principales propositions sont un gel des loyers assorti de projets de construction de logements sociaux, des transports publics gratuits et efficaces, la création de commerces alimentaires municipaux pour lutter contre l'inflation, ou encore l'accès universel à des crèches gratuites. Soit un ensemble de mesures d'urgence pour qu'il redevienne possible pour les classes populaires de vivre dignement dans la ville qui dépend de leur travail. Le tout financé par un ajustement fiscal en faveur des classes populaires, calqué sur ce qui existe dans des villes voisines.
[4] Cette journée organisée par une large coalition d'organisations sociales (syndicales, de défense des droits humains…) et politiques (structures soutenant des candidatures de centre-gauche ou de gauche) s'est focalisée sur la question démocratique, comme son nom l'indique (voir le site officiel : https://www.nokings.org/). La date a été choisie pour coïncider avec la grande parade militaire voulue par Trump pour marquer les 250 ans de l'armée des États-Unis, et son propre 79e anniversaire, et qui ne fut pas la démonstration de force espérée par la Maison Blanche. Ce type de mobilisation n'est donc pas survenu aussi vite qu'en 2017 mais a bien fini par entrer en scène de façon marquante, non seulement dans les bastions démocrates mais dans tout le pays : https://jacobin.com/2025/06/no-kings-protests-trump-popularity
[5] Avec le fameux « Big Beautiful Bill », celui qui fut un candidat pseudo-anti-système l'année dernière montre aujourd'hui son vrai visage de président des riches, avec une politique budgétaire de classe et de race d'ampleur historique : réductions d'impôts massives pour les riches et explosion du budget de la police de l'immigration, financées en particulier par des coupes monumentales dans le financement fédéral des prestations sociales de santé et alimentaires. Cela vient s'ajouter à de multiples autres mesures consistant à détruire des services publics déjà réduits à la portion congrue.
[6] Le niveau de solidarité avec la Palestine atteint des niveaux historiques aux États-Unis ces dernières années ; et le bilan des campagnes pro-Israël aux États-Unis est bien plus mitigé que leurs soutiens ne le prétendent, comme l'illustre la victoire de Mamdani et comme l'indiquait récemment Jacobin : https://jacobin.com/2025/07/israel-lobby-campaign-spending-nyc
[7] Un maire de gauche pourrait sans doute, cependant, avancer plus librement sur des mesures ayant de bonnes chances d'entretenir sa popularité. Pour une analyse poussée (et parfois technique) des enjeux, voir https://www.dissentmagazine.org/online_articles/what-can-zohran-accomplish/
[8] Le maire socialiste de Chicago, Brandon Johnson, en a fait l'amère expérience ces dernières années.

Amérique latine. Vers une « contre-révolution culturelle ? »

« Quand vous regardiez les chiffres du Chili, il semblait impossible que le système s'effondre […], mais soudain, il s'est effondré. Et il s'est effondré parce que, fondamentalement, ils n'ont pas livré la bataille culturelle. » Cette affirmation confuse de Javier Milei est curieuse, non pas tant parce qu'un président « libertarien » revendique la dictature d'Augusto Pinochet – plusieurs ultralibéraux de l'époque l'ont également appuyée –, mais parce que le pinochetisme a bel et bien mené une bataille culturelle qui a même transcendé son propre régime. Mais au-delà des précisions historiques, ce que révèle la phrase du président argentin, c'est son obsession – et celle des nouvelles droites radicales – pour la bataille culturelle ; une contre-révolution à la Viktor Orbán en Hongrie, aujourd'hui admirée pour son combat anti-woke.
24 juillet 2025 | tiré du site Europe solidaires sans frontières
https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article75835
Le terme « woke » (éveillé), dont l'origine remonte à l'histoire du mouvement afro-américain, a été détourné par la droite contre ses ennemis. Si, dans un premier temps, il servait à critiquer un certain progressisme excessivement « paternaliste », il est aujourd'hui devenu un cri de ralliement contre le progressisme dans son ensemble. Bien qu'il fût jusqu'à récemment inconnu dans le monde hispanophone, il a finalement fait son entrée dans le discours public grâce à la nouvelle droite, notamment Vox en Espagne.
« Peu importe que nous soyons bons gestionnaires ou bons politiciens, nous n'irons nulle part sans la bataille culturelle », a déclaré Milei en décembre 2024, lors d'une réunion [en Argentine] de la Conférence d'action politique conservatrice (CAPC), un réseau mondial très présent en Amérique latine, qui constitue l'un des porte-voix de la réaction internationale.
L'Amérique latine a connu ces dernières années la montée en puissance des nouvelles droites radicales, qui étaient déjà en train de transformer les champs politiques dans les démocraties occidentales. La victoire électorale de Jair Bolsonaro en 2018 avait ouvert la « fenêtre d'Overton » – c'es-à-dire la possibilité de tenir des discours extrémistes sans être socialement pénalisé –, mais c'est l'élection de Javier Milei qui a donné un élan sans précédent à ce phénomène qui a eu pour contrepartie la crise des droites libérales-conservatrices traditionnelles. En fin de compte, la région n'est pas étrangère à la « rébellion du public » – théorisée par l'ancien analyste des médias de la CIA Martin Gurri [dans son livre datant de 2014 The Revolt of the Public and the Crisis of Authority in the New Millennium] – , ni au ressentiment, à l'anxiété, à la dépression, à la colère et à la méfiance sociale abordés par Richard Seymour dans son livre Disaster Nationalism : The Downfall of Liberal Civilization (Verso, 2024).
La défaite de l'Argentin Mauricio Macri [en 2019 face à Alberto Fernandez, « péroniste »] et la crise du second mandat du Chilien Sebastián Piñera [qui s'est terminé en mars 2022] ne sont que deux expressions d'un phénomène plus large. Pour l'influenceur réactionnaire Agustín Laje [écrivain argentin, actif à la tête de la Fundacion Faro et de la Fundacion Libre], ce n'est que le résultat d'une « droite lâche » dont la pusillanimité a fini par ouvrir la voie au retour de la gauche ou du centre-gauche au pouvoir dans plusieurs pays de la région. Pour Agustin Laje – invité quotidiennement dans différents pays d'Amérique latine et dont l'influence idéologique ne cesse de croître au sein du gouvernement Milei –, ces droites ont capitulé face au mondialisme, voire face à l'agenda « woke ». Le mondialisme, a-t-il déclaré, est un système de domination mondiale et de contrôle total, « le projet de pouvoir politique le plus ambitieux jamais vu ». D'où la diabolisation de l'Agenda 2030 [en septembre 2025, à l'échelle internationale, les gouvernements ont adopté la résolution : « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l'horizon 2030 »].
Au cours des deux premières décennies de ce siècle, le centre-droit brandissait un discours contre le populisme de gauche, qui mettait l'accent sur les institutions républicaines, qui accusait les populistes d'autoritarisme et brandissait la défense de la démocratie libérale. Aujourd'hui, cependant, les droites radicales sont loin de ces véhémences. En Argentine, les partisans de Milei qualifient de « républicains ringards » les libéraux qui critiquent le mépris de l'exécutif pour les institutions et les insultes constantes de Milei visant quiconque ose le remettre en question. C'est pourquoi le président autoritaire salvadorien Nayib Bukele peut apparaître comme un modèle en matière de lutte contre la criminalité – même si, dans la pratique, son modèle est difficilement exportable –, ou que Milei peut continuer à dire qu'il « déteste l'Etat » alors qu'il est chef de l'Etat, et Bolsonaro a été séduit par l'idée d'organiser un coup d'Etat [en janvier 2023].
Les connexions mondiales d'un projet « antiglobaliste »
Budapest, autrefois éloignée géographiquement et culturellement de l'Amérique latine, est aujourd'hui une Mecque réactionnaire. Son influence n'a plus besoin d'être traduite en espagnol par Vox. De plus en plus de figures de proue de la droite latino-américaine se rendent dans la capitale hongroise en quête d'inspiration.
« L'immigration illégale n'est pas un accident. C'est une stratégie. C'est une décision politique. C'est une arme contre la liberté de nos peuples », a dénoncé le Chilien José Antonio Kast, qui est en lice pour les élections présidentielles de cette année [soit un des trois candidats de la droite, outre Evelyn Matthei et Johannes Kaiser, libertarien], reprenant ainsi la théorie complotiste du « grand remplacement » diffusée par le Français Renaud Camus [1re édition 2011].
Mais si, en Europe, le cœur de cette « théorie » est lié à la paranoïa civilisationnelle vis-à-vis de l'islam, en Amérique latine, la migration est intrarégionale (et dans le cas du Chili, elle vote en grande partie à droite, surtout les Vénézuéliens). Laje, dont la Fundacion Faro a été soutenue par le gouvernement Milei, a également trouvé dans la Hongrie d'Orbán un modèle pour son projet « antiglobaliste » (antimondialisation). Ces nouvelles droites ont également « acheté » l'occidentalisme façonné par les extrêmes droites du Nord. Les messages publiés sur les réseaux sociaux par les libertariens argentins contre les « dangers » de l'islam peuvent ignorer le fait qu'il n'y a pas d'immigration musulmane récente dans la région, reproduire des visions fantaisistes sur la « civilisation judéo-chrétienne » [voir à ce sujet l'ouvrage de Sophie Bessis, La civilisation judéo–chrétienne : anatomie d'une imposture, Liens qui libèrent, 2025] et surjouer leur soutien à Israël, à l'instar du « sionisme chrétien », des évangéliques pro-israéliens très influents dans des pays comme le Brésil ou le Guatemala. « L'Occident est en danger » à cause du socialisme, a averti Milei lors du Forum économique mondial de Davos en 2024.
« Ceux qui sont censés défendre les valeurs occidentales sont cooptés par une vision du monde qui conduit inexorablement au socialisme et, par conséquent, à la pauvreté. » Cet Occident se résume souvent aux Etats-Unis de Donald Trump et à l'Israël de Benyamin Netanyahou.
Une droite rebelle ?
Comme ailleurs, les nouvelles droites latino-américaines combinent de manière complexe des images de retour à l'ordre et de rébellion contre le statu quo. Si Milei incarnait davantage une droite rebelle, le Chilien José Antonio Kast incarne une droite de la loi et de l'ordre. Mais en réalité, les deux articulent les deux éléments. Milei s'est vanté de rétablir l'ordre dans les rues contre les protestations sociales et, malgré sa haine de l'Etat, il a augmenté les dépenses en matière de services de renseignement. De son côté, Kast appelle à « oser » voter pour lui, et son crypto-pinochetisme rime avec son appel à « être audacieux ».
Bien qu'elles fassent appel à des rétro-utopies, ces droites sont loin de représenter un retour linéaire au passé. Elles s'adaptent plutôt aux nouvelles circonstances. Par moments, la tragédie tourne à la farce : Milei, militant nataliste, n'a que des « enfants à quatre pattes » [des chiens clonés] (Elon Musk lui-même lui a déjà fait remarquer que cela ne comptait pas !). Ni Milei, ni sa puissante sœur Karina, ni sa vice-présidente Victoria Villarruel ne sont mariés. Ces droites peuvent même se revendiquer de « gays anti-queer » et compter parmi leurs leaders de nombreuses femmes « anti-idéologie du genre ».
Le progressisme régional est s'affronte donc à un paradoxe : si les forces de centre-gauche gouvernent un grand nombre de pays, dont le Brésil et le Mexique, elles se sentent affaiblies face à la bataille culturelle menée par des droites qui leur disputent la rue. Et aussi les réseaux sociaux, à partir desquels ces droites trollent, trompent leurs cibles et accablent leurs adversaires progressistes pour les mettre sur la défensive. Les droites ont également conquis un grand nombre de jeunes, surtout, mais pas uniquement, des hommes. Leurs discours, en particulier les discours libertariens, semblent mieux adaptés pour interpréter les changements socio-technologiques en cours. Tout cela laisse penser que de nombreux gouvernements progressistes pourraient être remplacés par des forces de droite entre 2025 et 2026.
Pourtant, les sociétés latino-américaines ont connu ces dernières années de profondes transformations, notamment l'adoption du mariage pour tous et du droit à l'avortement dans plusieurs pays, et ne semblent pas disposées à accepter passivement des restaurations conservatrices. Ce n'est pas un hasard si l'une des plus grandes manifestations contre Milei a été organisée par des collectifs LGBTI+ après ses déclarations au Forum de Davos, où son anti-wokisme l'a conduit à associer l'homosexualité à la pédophilie (une analogie qui, a-t-il précisé par la suite, ne s'appliquait qu'aux gays woke). Le slogan « Nous ne retournerons jamais dans le placard » a mobilisé des milliers de personnes, pas seulement des homosexuels, dans le centre de Buenos Aires.
Pour l'instant, aucune de ces extrêmes droites n'a réussi à imposer son projet politique (établir une hégémonie), à l'exception de Bukele, dont les positions idéologiques sont assez complexes et qui gouverne un petit pays (le Salvador). Bolsonaro n'a pas été réélu et est aujourd'hui inéligible. Milei jouera une partie de son avenir lors des élections de mi-mandat de cette année, et d'autres, comme Kast, tenteront de l'emporter lors des prochaines élections. Le progressisme représente encore – malgré l'érosion de sa « sécurité ontologique » [confiance dans la continuité de sa propre identité et de la constance de l'environnement social] – de larges secteurs sociaux et conserve une capacité de mobilisation considérable lorsqu'il trouve un étendard fédérateur. En fait, on pourrait dire qu'une partie de la radicalité des nouvelles droites naît de la crainte que les progressistes retrouvent leur confiance en eux et passent à l'offensive.
Pablo Stefanoni
P.S.
Opinion publiée dans El Pais le 22 juillet 2025 ; traduction rédaction A l'Encontre
https://alencontre.org/ameriques/amelat/debat-une-contre-revolution-culturelle-en-amerique-latine.html
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La portée de l’attaque de Trump contre le Brésil - La guerre tarifaire de Trump selon les pays et régions du monde

Trump ne veut pas seulement établir de nouvelles conditions commerciales avec le Brésil. Son véritable objectif est d'imposer son autorité sur un pays étranger. La guerre tarifaire menée par les États-Unis contre le monde entier, mise en œuvre selon une méthode que certains qualifient désormais de harcèlement et de chantage à l'échelle internationale, est l'expression ultime de l'interventionnisme impérialiste. Sous la présidence de Trump, les États-Unis affichent leur mépris pour la planète, en particulier pour les nations qu'ils considèrent comme subalternes et fragiles.
8 août 2025 | tiré d'Europe solidaires ans frontières
Il est difficile de dresser la carte des droits de douane. Ceux-ci fluctuent au gré des caprices de Trump, de ses élans autoritaires et de son immoralité sans limites.
Il est néanmoins possible d'identifier trois groupes de pays.
Le premier d'entre eux est la Chine, le pivot de la guerre tarifaire. Le retour des États-Unis à une politique protectionniste s'explique par la concurrence chinoise et le déclin relatif de la puissance économique américaine. Trump cherche ainsi à attaquer la Chine, directement ou indirectement, en visant ses alliés sur le plan économique. Mais comme le poids de l'économie chinoise est aujourd'hui incontournable, après une escalade tarifaire sans précédent en avril, Trump a dû conclure un accord, qui prévoit des droits de douane de 30 % sur les produits chinois contre 10 % dans le sens inverse.
La deuxième sphère est représentée par les pays considérés comme des alliés. Dans ces cas, Trump met un couteau sous la gorge de ses partenaires traditionnels afin d'obtenir des avantages économiques immédiats. C'est cette logique qui a présidé aux accords conclus avec l'Union européenne, le Japon et la Corée du Sud, par exemple. Ces accords prévoient des droits de douane asymétriques entre les États-Unis et les pays concernés ainsi que des achats et des investissements étrangers sur le territoire américain, en particulier dans le secteur énergétique.
Le troisième groupe est constitué des pays considérés comme fragiles par l'impérialisme. Il s'agit du Sud global. Dans leurs cas, Trump tente de piller les économies nationales, de générer une instabilité politique, d'intervenir et de piller les ressources. Le président souhaite également soustraire les pays du Sud global à l'influence chinoise, reconstituant ainsi, par l'intimidation, les « arrière-cours » des États-Unis dans le monde. Mais la réalisation complète de ce souhait est irréalisable.
Il est important de rappeler que même les économies les plus modestes sont soumises à des droits de douane plancher de 10 %. Un article récent du New York Times a montré que la simple perspective de ces droits de douane a provoqué une véritable catastrophe au Lesotho, en Afrique, où l'industrie textile s'effondre et où les licenciements sont massifs. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres.
Dans l'optique de Trump, le Brésil se trouve dans ce troisième groupe de nations. D'où la gravité des attaques perpétrées contre le Brésil, qui visent à la fois l'économie et la souveraineté du plus grand pays d'Amérique latine, désormais pénalisé par les droits de douane les plus élevés, en plus des sanctions dirigées contre sa Cour suprême.
Trump ne veut pas seulement établir de nouvelles relations commerciales avec le Brésil. Son véritable objectif est d'imposer son autorité sur un pays étranger. Ces menaces reflètent la convoitise impérialiste pour les ressources naturelles, les entreprises publiques, les minerais rares et même le fonctionnement du marché intérieur brésilien, y compris le contrôle du système Pix de paiements électroniques et les normes juridiques qui régissent l'environnement virtuel et les géants de la technologie.
S'il le pouvait, Trump soumettrait l'administration brésilienne au même type de contrôle déjà imposé au Panama et à l'Ukraine. Après les menaces contre le canal de Panama, José Raúl Mulino a retiré le pays d'Amérique centrale de la Route de la soie chinoise et a accordé des privilèges commerciaux et militaires aux États-Unis. Volodymyr Zelensky, sous la pression de la guerre, a quant à lui cédé à Trump l'exploitation des minerais ukrainiens. Et le président américain peut compter sur la collaboration enthousiaste de l'extrême droite brésilienne.
Nous sommes confrontés à la plus grande menace pour la souveraineté nationale de ce siècle, un fait politique qui inaugure une nouvelle ère dans les relations entre les deux pays et dans la situation brésilienne. Le Brésil n'est pourtant pas un acteur insignifiant. Outre le fait qu'il s'agit de la principale économie d'Amérique latine, le pays compte 210 millions d'habitants, est membre des BRICS, possède des richesses naturelles et, en ce moment même, mène à bien une enquête pour traduire en justice son extrême droite criminelle et putschiste.
Dans les semaines à venir, on peut espérer que le gouvernement brésilien maintiendra la fermeté dont il a fait preuve jusqu'à présent, car c'est la seule façon de préserver les intérêts nationaux. En outre, le moment semble opportun pour le pays d'adopter des mesures de rétorsion à l'égard des États-Unis et de renverser la logique de dépendance de son économie, y compris vis-à-vis de la Chine. Cela exigerait la décision de renforcer le marché intérieur, de rompre avec la politique économique néolibérale et de s'attaquer aux effets du retour à la primauté du modèle extraviste – un ensemble de mesures qui semblent difficiles à mettre en œuvre sans une forte pression sociale.
Quant à Trump, il faut espérer que les conflits internes aux États-Unis, ajoutés à la mobilisation anti-impérialiste mondiale, parviennent à enrayer la spirale de la démence. Après tout, ceux qui ressentent un tel besoin de montrer leur force ont généralement besoin de cacher leur faiblesse. Et au cas où une « tempête parfaite » viendrait à se former au-dessus de la tête du président américain, le sortilège pourrait bien se retourner contre le lanceur de sorts.
Samir Oliveira
P.-S.
• Traduit pour ESSF par Pierre Vandevoorde avec l'aide de DeepLpro
Le titre a été augmenté par ESSF.
Source - « La portée de l'attaque de Trump contre le Brésil ». FLCMF, 8 août 2025
https://flcmf.org.br/a-dimensao-do-ataque-de-trump-ao-brasil/
« Fondation Lauro Campos et Marielle Franco » Fondation du PSOL " dont l'objectif est de fournir aux militant.es. des outils qui leur permettent, de manière critique et ouverte, d'affronter les débats qui ont lieu dans la société et ainsi d'augmenter la portée des idées socialistes.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Un nouveau cycle pour la gauche brésilienne ?

30 juillet 202 | tiré d'Europe solidaire sans frontières
https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article75843
1. La recomposition de la gauche brésilienne est un processus qui a déjà commencé mais qui se développe très lentement. Sommes-nous à l'aube d'un cycle qui dépasse les limites du lulisme ? Il existe de nombreuses variables encore indéfinies. Les deux plus importantes sont indissociables et nous ramènent au cœur de l'énigme : la gauche sera-t-elle capable de vaincre l'extrême droite et, dans ce processus qui passera par les élections de 2026, assisterons-nous à une montée de la combativité des travailleurs et de la jeunesse ? Telles sont les deux questions centrales. L'histoire nous enseigne qu'il n'y a pas moyen d'ouvrir un cycle au-delà du lulisme sans victoire sur le bolsonarisme et sans une montée de la lutte des masses. Si c'est la défaite qui prévaut, nous continuerons à voir des divisions, des fractures et une dispersion au sein de la gauche. Ce sera une régression, et nous connaîtrons une pause historique comme celle qui a suivi 1964, espérons-le, moins longue. Les militants révolutionnaires doivent rester convaincus que, tôt ou tard, les travailleurs se soulèveront. Mais l'ouverture d'un nouveau cycle au-delà du lulisme ne peut reposer uniquement sur ce dénouement. L'improvisation créative, bien qu'elle ait sa place dans la lutte politique, est dangereuse. Il existe une marge pour L'imprévu, le soudain, le brusque, le surprenant, mais elle est mince. Nous avons appris lors des événements tumultueux de juin 2013 que des occasions se présentent et se perdent. L'« objectivisme », une forme simpliste de déterminisme sociologique qui prône le statu quo, n'est pas une bonne boussole. La force de la conscience se joue dans l'engagement, la volonté, le projet et le programme. Le marxisme est militant. Il faudra ouvrir la voie avec de nouveaux outils, tant dans la sphère des mouvements sociaux, en particulier féministe et noir, que dans la lutte politique, qui exige un instrument plus puissant que ceux dont nous disposons aujourd'hui.
2. Que nous enseigne l'histoire ? Quand on regarde en perspective, il y a eu, au cours des cent dernières années, cinq cycles de la gauche au Brésil : l'anarcho-syndicaliste, le getuliste [de Getulo Vargas, dictateur « social » puis président réformiste élu entre 1930 et 1954 ndt], le communiste, le guérillerisme et le petiste/luliste. Le passage de chacun de ces cycles au suivant a été déterminé par de grands changements des conditions objectivess au Brésil et dans le monde, mais aussi par d'intenses luttes politico-idéologiques. Les transitions ont été conditionnées par des phases intermédiaires plus ou moins complexes. Les conditions qui ont favorisé l'affirmation du getulisme sur l'anarcho-syndicalisme ont été, pour simplifier, la victoire de la révolution de 1930, le début de l'industrialisation et le rôle prépondérant de Vargas. Le cycle communiste s'est ouvert sous l'impact de la défaite du nazisme et du fascisme, du rôle de l'URSS et du leadership de Prestes. Le cycle de la guérilla s'est appuyée sur l'impact de la révolution cubaine, la vague de mobilisation étudiante et ouvrière de 1968 et le rôle de Mariguella. Le cycle du PT s'est appuyée sur les luttes de masse de la phase finale de la dictature et le rôle de Lula. Mais il faut garder le sens des proportions. Le cycle anarcho-syndicaliste a duré moins de vingt ans. Le getulisme a été hégémonique pendant une trentaine d'années. Les communistes ont co-dirigé pendant moins de quinze ans. Les organisations de lutte armée ont été influentes pendant environ cinq ans. Le lulisme domine la gauche depuis quarante ans. Tous ceux qui l'ont sous-estimé se sont trompés. Il n'est ni immortel ni insurmontable, mais il est résilient.
3. À l'échelle latino-américaine, les cinq forces les plus importantes de la gauche sont le chavisme, le lulisme, le kirchnérisme, le MAS bolivien et la Frente Amplio uruguayenne, héritière de Mujica. Le lulisme est un phénomène distinct tant du kirchnérisme – dernière incarnation du péronisme – que du chavisme. Comparativement, il est plus fort que le kirchnérisme et plus faible que le chavisme. Il est plus fort que le péronisme pour deux raisons principales : (a) parce qu'il repose sur la majorité des mouvements sociaux organisés, sur la majorité de l'intelligentsia de gauche et, surtout, sur le PT, qui reste l'un des plus grands partis de gauche au monde ; (b) parce que Lula est un leader de gauche qui jouit d'une légitimité populaire supérieure à celle de Cristina. Mais il est paradoxalement plus faible que le chavisme après la mort de Chávez pour deux raisons essentielles : (a) parce qu'il n'a pas mené un processus révolutionnaire comme l'a été la victoire sur la tentative de coup d'État de 2002 ; (b) parce qu'il ne s'appuie pas sur une implantation dans les forces armées. Le lulisme est également un phénomène différent, beaucoup plus enraciné dans la classe ouvrière que le parti Morena de Claudia Sheinbaum au Mexique, le Frente Amplio de Gabriel Boric au Chili ou la coalition Pacto Histórico de Gustavo Petro en Colombie. Mais le PT est beaucoup plus homogène que le Frente Amplio uruguayen. Le seul parti qui a réussi à s'implanter socialement de manière équivalente est le MAS d'Evo Morales, mais les divisions internes irréversibles de la gauche bolivienne l'ont condamné.
4. Le cycle du PT a été le plus fort et, de loin, le plus long de notre histoire. La gauche n'a jamais eu autant d'influence et n'a jamais été aussi solidement enracinée dans le passé. Comme on peut s'y attendre, il sera beaucoup plus difficile de le dépasser que lors des épisodes précédents. Cela nécessitera la conjonction d'une montée en puissance colossale, de ruptures au sein du PT et du PCdB, la présence d'acteurs politiques collectifs. Mais c'est possible. Entre autres raisons, parce que le petisme s'est transformé en lulisme, et si c'est là sa force, c'est aussi sa faiblesse. Les sondages dont on dispose sur une longue période indiquent une dynamique claire. Le lulisme a une date de péremption. Pourquoi ? (a) parce qu'il dépend d'une relation de confiance personnelle avec les plus pauvres ; (b) parce que le PT n'a pas réussi à préserver son influence majoritaire parmi les couches moyennes de travailleurs « modestement aisés » ; (c) parce que l'expérience des masses avec la stratégie luliste de « réformisme faible » n'est pas suffisante pour gagner la « guerre » idéologique pour la conscience. La dépendance du PT vis-à-vis de Lula est désormais absolue. Un lulisme sans Lula aura peu de chances de perdurer, car aucun leader de remplacement doté de la même autorité n'est apparu. Sans Lula, le PT n'est qu'un appareil électoral sans tête, et la tendance la plus probable est un déclin irréversible.
5. La recomposition de la gauche dépendra de l'issue de la lutte contre le bolsonarisme. À un autre niveau d'analyse, elle sera conditionnée par l'évolution de la situation internationale, en particulier par la résistance à l'extrême droite en Argentine contre Milei, et contre Trump dans le monde. La victoire pourrait être rapide, si d'ici 2026, on voyait surgir une vague ascendante, même strictement électorale. Si l'on envisage un scénario de victoire « à froid », on assisterait, dans les grandes lignes, à une prolongation indéfinie de la « durée de validité » du lulisme, car le PT trouve sa cohésion dans la gestion de l'État. Si l'on envisage un scénario de victoire « à chaud », tout s'accélère, car les limites du lulisme seront remises en question par un niveau d'attentes et d'exigences beaucoup plus élevé, mais les voies en seront « à découvrir » car les différenciations internes ne se sont pas encore « décantées ».
Ce qui semble certain, c'est que la possibilité d'une rupture au sein du PT favorisera la construction d'un nouvel instrument de lutte incluant l'unification avec des fractions de la gauche radicale.
Si l'on envisage un scénario de défaite électorale et de démoralisation inexorable, le plus probable est que la configuration de l'après-lulisme dépende de la « libération des forces » à la suite d'une crise explosive au sein du PT, un peu comme il en a été du dénouement de la crise du PCB après la défaite de 1964, qui sera probablement précédée d'un virage programmatique vers encore plus de modération de la part de l'appareil et de ruptures avec les ailes de gauche. L'avenir de la gauche sera un processus de médiation entre « l'ancien » et le « nouveau », dans une large mesure, malgré le lulisme, mais sans nécessairement renier l'héritage du lulisme.
6. Le résultat récent du processus d'élection directe (PED) au PT en 2025 a confirmé la montée en puissance de l'aile CNB (Construindo um Novo Brasil, « Construire un nouveau Brésil ») et le recul de l'influence des tendances de gauche, ainsi que la victoire incontestable d'Edinho. Le vote est décourageant pour ceux qui avaient misé sur le fait que le PT pourrait jouer un rôle plus important en poussant le gouvernement vers un virage à gauche au cours des douze prochains mois. Il a également laissé sans soutien les courants qui comprennent la nécessité de lutter pour un programme avec une inflexion anti-impérialiste plus forte face à l'offensive des États-Unis. Non pas que les attentes étaient très élevées, car personne mieux que la gauche du PT n'est conscient qu'elle occupe un espace de résistance. Mais le résultat modeste obténu par Rui Falcão et Valter Pomar, même additionné à celui de Romênio Pereira, signale un isolement à la limite de l'irréversible, presque irrattrapable.
7. La conclusion à tirer de ce PED est que, malgré les luttes internes épouvantables au sein de la CNB, avec des critiques féroces sur la concentration des pouvoirs dans la trésorerie, la menace exacerbée d'une dispute pour la présidence par le Nordeste, et même les accusations abusives de Quaquá, l'unité du courant luliste, déchiré par divers groupes d'intérêts parlementaires et régionaux, a été préservée. Aucune divergence n'était finalement insurmontable. Pourquoi ? Il y a trois hypothèses. Le dévoilement des scores montre clairement que ce n'était pas par crainte des résultats, si les listes de gauche s'étaient unies. La CNB conserve une emprise sur l'appareil bien supérieure à ce qu'est son hégémonie politique. Ce n'est pas non plus parce qu'il existe un accord stratégique sur un projet politique pour le Brésil. Il n'y a pas eu de discussion sur le programme. La troisième hypothèse est que l'unité a été maintenue et qu'Edinho a remporté une élection triomphale parce que Lula l'a demandé.
8. Le processus de confrontation interne et même externe au PT pour l'après-Lula est contenu jusqu'aux élections de 2026 pour trois raisons principales, bien qu'il existe d'autres facteurs : (a) la première est de nature objective – un facteur est défini comme objectif lorsqu'il s'impose de lui-même et qu'il n'y a rien à y faire – Lula sera candidat à sa réélection, et cela conditionne tout ; (b) la deuxième est de nature subjective et se résume au fait incontournable qu'il n'y a pas de consensus au sein de la CNB sur ce que doit être le programme et sur qui doit être le successeur ; (c) la troisième est que le successeur sera désigné par Lula, même si cela nécessitera de nombreuses négociations et consultations.
9. Il est impossible d'imaginer l'avenir de la recomposition sans le PSol. La simple existence du PSol, depuis vingt ans, dans les conditions terribles de la lutte politique au sein de la gauche brésilienne, est un exploit remarquable. Le PSol a été une tranchée défendue par des combattant.e.s dévoué.e.s à la cause sociale, un espace d'accueil pour les socialistes des traditions les plus diverses. La liberté interne garantit l'expression de toutes les tendances dans le respect de la proportionnalité. Le PSol attire la majorité des jeunes qui s'engagent, dont le militantisme sur les lieux de travail, dans les quartiers, dans les mouvements pour le logement populaire, dans le féminisme, dans la lutte pour les droits des Noirs et parmi les LGBT est reconnu pour leur enthousiasme et leur dévouement. Le PSol a été en première ligne des campagnes internationalistes au cours des deux dernières décennies. Le défi de construire un parti de gauche radicale avec une présence dans les institutions, légalement reconnu, de manière à ce que la visibilité d'un programme socialiste puisse s'exprimer, était un pari qui exigeait du courage, de la détermination et beaucoup d'espoir en l'avenir. Il a été prouvé qu'il était possible d'avoir une gauche en dehors du PT, même minoritaire. Dans les deux plus grandes villes du Brésil, le PSOL est arrivé au second tour des élections municipales, devant le PT. Il a perdu, mais il a perdu des élections que le PT aurait également perdues. Le PSol n'est pas immunisé contre les mêmes pressions que l'ensemble de la gauche. Il souffre de l'électoralisme, d'adaptation syndicaliste, du poids de son appareil et du bureaucratisme. Ce n'est pas le parti révolutionnaire imaginaire idéalisé par une partie de l'avant-garde. Oui, le PSol est très imparfait, mais il n'est pas pétrifié et stérile, c'est une organisation utile. Face au poids parfois écrasant du PT, il a été un point d'appui pour les militant·e.s les plus lucides qui résistent à l'idée que la seule façon de lutter pour la révolution brésilienne est de se replier sur un projet politique « de musée »
10. Tant le camp luliste que la gauche ultra-radicale partagent l'idée que le PSOL aurait tous les défauts du PT, mais pas sa principale qualité, qui est le soutien encore majoritaire du peuple de gauche. En d'autres termes, c'est le parti qui a le plus de poids électoral. Dans la version la plus « marxiste », le PT est le parti de gauche à qui la classe ouvrière fait le plus confiance. Quant aux défauts du PSol, ils peuvent être résumés en trois « péchés originels » : (a) ce serait un parti de parlementaires ; (b) ce serait un parti regroupant différentes courants sans capacité de centralisation ; (c) ce serait un parti réformiste. Ce sont trois demi-vérités. Une demi-vérité est un mensonge complet, une simplification. Le PSOL est très imparfait, évidemment. Mais cette évaluation hâtive n'est ni correcte ni juste. Le PSOL n'est pas seulement un appareil électoral : son rôle militant a été indispensable dans les récentes mobilisations de la campagne « Sem Anistia » (Pas d'amnistie) en mars, et dans l'organisation des manifestations de juillet pour la taxation des super-riches, par exemple. Il n'est pas honnête de minimiser le fait qu'une partie des militants les plus combatifs des mouvements de femmes et de Noirs, des mouvements populaires pour le logement et des LGBT, des mouvements environnementaux, indigènes et culturels soutiennent le PSOL. Le PSOL, bien qu'hétérogène et divisé en deux camps, majoritaire et minoritaire, a conservé une remarquable capacité d'intervention unifiée au cours des vingt dernières années, même s'il a connu des hauts et des bas. Enfin, il n'existe pas de « règle » pour définir qui est révolutionnaire et qui ne l'est pas. À strictement parler, il existe deux positions extrêmes, mais insatisfaisantes : (a) soit sont révolutionnaires toutes les personnes qui défendent la nécessité d'une révolution ; (b) soit seules sont révolutionnaires les personnes qui ont dirigé une révolution. Évidemment, la première position est très large et la seconde très restrictive. Bien qu'il s'agisse d'un parti qui a les élections pour horizon, le PSOL organise une partie très importante, sinon la majorité, des révolutionnaires de gauche.
Valerio Arcary
P.-S.
• Traduit pour ESSF par Pierre Vandevoorde avec l'aide de DeepLpro
Source - Esquerda online. 30 juillet 2025 :
https://esquerdaonline.com.br/2025/07/30/um-novo-ciclo-da-esquerda-brasileira/
• Valerio Arcary est professeur titulaire à la retraite de l'IFSP. Docteur en histoire de l'USP. Militant trotskiste depuis la Révolution des œufs. Auteur de plusieurs livres, dont Ninguém disse que seria fácil (Personne n'a dit que ce serait facile, 2022), publié aux éditions Boitempo.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Renaissance du projet sioniste de fragmentation de l’Orient arabe

Tandis que ce projet semble dérivé de l'imagination d'adeptes de la « théorie du complot », il est loin d'être une fiction et est plus proche de sa réalisation que jamais auparavant.
23 juillet 2025
Gilbert Achcar
Professeur émérite, SOAS, Université de Londres
Abonné·e de Mediapart
https://blogs.mediapart.fr/gilbert-achcar/blog/230725/renaissance-du-projet-sioniste-de-fragmentation-de-l-orient-arabe
Ce blog est personnel, la rédaction n'est pas à l'origine de ses contenus.
Dans l'article de la semaine dernière sur les affrontements sanglants dans la province syrienne de Soueïda, j'ai écrit qu'Israël « espère certainement une escalade de la violence afin d'en profiter pour renforcer l'influence de la minorité parmi les Druzes syriens qui aspire à établir un émirat druze sous protection israélienne » (« Syrie : le danger de jouer avec le feu », Al Quds Al-Arabi, 15 juillet 2025). À cet égard, il convient de rappeler une perspective caressée depuis longtemps au sein du mouvement sioniste, en particulier parmi ses « faucons », selon laquelle il est dans l'intérêt du projet sioniste de fragmenter l'Orient arabe en établissant des entités basées sur des minorités sectaires et ethniques, soumises à la protection israélienne. Cela permettrait à l'État sioniste de construire un empire régional qui lui serait inféodé en tant que plus grande puissance militaire de la région.
Tandis que ce projet semble dérivé de l'imagination d'adeptes de la « théorie du complot », le document le plus important qui le révèle est loin d'être une fiction. Il est constitué par les journaux intimes de Moshe Sharett (1894-1965), l'un des fondateurs de l'État d'Israël et son deuxième Premier ministre depuis la fin de 1953, à la suite de la démission de David Ben Gourion de ce poste qu'il allait récupérer deux ans plus tard. Les papiers de Sharett, considéré comme l'une des « colombes » de l'establishment israélien, sont des notes qu'il a écrites entre 1953 et 1957 pour son usage privé (elles n'étaient pas destinées à la publication). Ces notes ont été publiées en hébreu en 1979 en huit volumes. Livia Rokach, une journaliste israélienne qui a travaillé comme correspondante pour la radio israélienne dans les années 1960 avant de devenir une critique du régime sioniste (elle s'est suicidée en 1984) a méticuleusement lu ces volumes. Elle a fait connaître leurs révélations les plus graves à travers des extraits qu'elle a traduits en anglais et commentés dans un livre sorti au début des années 1980, publié par l'Association des diplômés universitaires arabo-américains (AAUG), dont Naseer Aruri (1934-2015), un intellectuel et militant politique palestinien de premier plan, était cofondateur et président. Aruri écrivit une préface au livre, faisant suite à un avant-propos de Noam Chomsky.
Les journaux de Sharett ont révélé de nombreuses questions qui ont fait l'objet de débats au sein de l'élite du pouvoir de l'État sioniste. Il s'agissait, entre autres, de plans visant à occuper le sud de la Syrie, à établir un État maronite au Liban, à soustraire la bande de Gaza au contrôle égyptien (sous lequel elle se trouvait jusqu'à son occupation par Israël en 1967) et à expulser les réfugiés palestiniens originaires des terres saisies par l'État sioniste en 1948, de tous les territoires situés entre le Jourdain et la mer Méditerranée, en commençant par l'expulsion des réfugiés palestiniens de la bande de Gaza vers le territoire égyptien.
En 1982, l'AAUG a publié un autre document sioniste, traduit en anglais et annoté par Israël Shahak (1933-2001), professeur de chimie à l'Université hébraïque de Jérusalem, un survivant du génocide nazi des Juifs d'Europe devenu l'un des plus éminents critiques juifs du sionisme, et le dirigeant de la Ligue israélienne pour les droits humains et civils. Le document, un article publié dans une revue sioniste en février 1982, a été connu plus tard sous le nom de « plan Yinon » d'après le nom de son auteur, Oded Yinon, haut fonctionnaire du ministère israélien des Affaires étrangères et ancien conseiller d'Ariel Sharon, un des principaux dirigeants de l'extrême droite sioniste à l'époque. Sharon supervisa l'occupation du Liban en 1982 en tant que ministre de la guerre dans le gouvernement de Menahem Begin, premier gouvernement dirigé par le parti d'extrême droite Likoud dans l'histoire de l'État d'Israël.
Intitulé « Une stratégie pour Israël dans les années 1980 », l'article de Yinon décrivait un plan qui comprenait l'établissement d'un État copte en Égypte, conduisant à la partition de l'Égypte, qui conduirait à son tour à la partition du Soudan et de la Libye voisins. Le plan comprenait également la division du Liban, de la Syrie et de l'Irak en entités basées sur des lignes sectaires et ethniques (y compris un État druze en Syrie, auquel le plateau du Golan pourrait être annexé, selon la vision de Yinon). Il s'agissait également d'accorder aux Palestiniens le contrôle de la Jordanie, de sorte à ouvrir la voie au déplacement de tous les autres Palestiniens de la rive occidentale à la rive orientale du fleuve.
La mention de ce vieux projet sioniste s'est estompée au cours des dernières décennies, car il s'est heurté à la décision des États-Unis de maintenir la division de la carte de la région telle qu'elle a résulté de la domination coloniale européenne qui a fait suite à l'effondrement de l'Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale. (Notons cependant qu'il n'a pas manqué aux États-Unis, durant leur occupation de l'Irak, de partisans de la partition de ce pays selon la perspective sioniste.) La dérive droitière de la société et de la politique israéliennes, qui a atteint son apogée sous le gouvernement actuel de Benjamin Netanyahou, a ressuscité le projet, en le stimulant considérablement.
Ce gouvernement a saisi l'occasion offerte par l'opération « Déluge d'al-Aqsa » lancée par le Hamas le 7 octobre 2023, pour attaquer non seulement les Gazaouis, mais toutes les composantes du peuple palestinien vivant entre le fleuve et la mer. Il a également attaqué le Liban, la Syrie et le Yémen, trois pays qui ont connu ou connaissent encore des guerres civiles fondées sur des divisions confessionnelles. Et ce, tandis que l'Irak, quatrième pays dans la même situation, a jusqu'à présent été épargné par l'agression directe d'Israël depuis que les États-Unis y ont détruit l'État depuis 1991 et ont cherché ensuite à le reconstruire depuis 2003 sur la base du « diviser pour régner ». Tout cela sans parler, bien sûr, de la partition de facto de la Libye, du Soudan et du Yémen.
Le résultat est que les conditions dans l'Orient arabe – et en particulier dans les trois pays géographiquement proches de l'État sioniste : le Liban, la Syrie et l'Irak – sont maintenant plus propices que jamais à la réalisation d'une partition de ces États selon la perspective sioniste. Le comportement actuel d'Israël à l'égard de la Syrie et du Liban s'inscrit clairement dans ce contexte. Cette ambition israélienne se heurte à l'intérêt des États arabes qui ont une influence sur Washington – autrement dit, les riches États du Golfe – ainsi qu'à celui de l'État turc, tous soucieux d'empêcher une telle partition hautement déstabilisatrice pour l'ensemble de la région. Cette contradiction a maintenant atteint son paroxysme et c'est la raison pour laquelle l'administration Trump a manifesté son mécontentement face au comportement de son allié israélien envers la Syrie en particulier.
Traduit de ma chronique hebdomadaire dans le quotidien de langue arabe,Al-Quds al-Arabi, basé à Londres. Cet article est d'abord paru en ligne le 22 juillet. Vous pouvez librement le reproduire en indiquant la source avec le lien correspondant.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Comment la Chine redessine l’Asie du Sud-Est

Des dettes du Laos aux équilibres fragiles de la Thaïlande : cinq exemples montrent comment Pékin tisse un réseau de dépendances économiques et politiques.
Tiré de Europe Solidaire Sans Frontières
23 juillet 2025
Par Andrea Ferrario
Depuis des années, la Chine tisse un réseau dense de relations en Asie du Sud-Est, combinant investissements, infrastructures, coopération technologique et pression diplomatique. Les pays de la région stratégiquement situés entre l'océan Indien et le Pacifique sont aujourd'hui au cœur d'une transformation silencieuse qui redéfinit leurs orientations économiques et, dans de nombreux cas, leurs structures décisionnelles elles-mêmes. La Chine a articulé sa stratégie autour d'une série d'initiatives qui vont bien au-delà du champ économique. La « sécurité nationale globale », concept désormais central dans la pensée stratégique chinoise, englobe des domaines tels que l'alimentation, la finance, la technologie, le cyberespace et même l'opinion publique. Dans cette optique, les initiatives promues au sud de la frontière ne sont pas isolées, mais s'inscrivent dans un projet global visant à consolider une zone d'influence stable, favorable aux intérêts de Pékin et moins perméable à la présence de rivaux.
L'Asie du Sud-Est est idéale pour ce projet. Ses économies, dynamiques mais encore vulnérables, ont besoin de capitaux, de technologies et d'infrastructures. La Chine est prête à les fournir, mais à des conditions qui ne se limitent pas aux taux d'intérêt. L'accès préférentiel aux ports, aux chemins de fer et aux centres logistiques, la promotion d'accords numériques bilatéraux, la construction de laboratoires partagés et de plates-formes industrielles communes ne sont que quelques-uns des instruments mis en œuvre. À cela s'ajoute un travail minutieux avec les élites politiques et entrepreneuriales, souvent mené loin des projecteurs. Tous les gouvernements ne réagissent pas de la même manière. Certains pays se sont laissés absorber presque entièrement, d'autres tentent de se débrouiller en conservant une marge de manœuvre. Tous évoluent toutefois dans un contexte où la Chine a su tirer parti des incertitudes mondiales et du retrait d'autres acteurs pour consolider sa position. Plus qu'une conquête fulgurante, il s'agit d'un lent rééquilibrage qui modifie les habitudes logistiques, les dépendances énergétiques et les liens institutionnels.
Dans la suite de cet article, nous analyserons cinq cas emblématiques, chacun représentatif à sa manière d'une forme différente d'influence : de la dépendance structurelle à la cooptation sélective, du compromis calculé à la résistance prudente. Il en ressortira une mosaïque hétérogène, mais tendant vers une convergence : l'adaptation, plus ou moins consciente, à une présence chinoise qui semble destinée à durer.
Le Laos : le prototype de la dépendance structurelle
Le Laos est aujourd'hui peut-être l'exemple le plus flagrant de la capacité de l'influence chinoise à remodeler profondément un pays, au point de compromettre son indépendance effective. En quelques années, le gouvernement de Vientiane a lié son destin économique, logistique et technologique à celui de la Chine, en acceptant un modèle de développement fortement dépendant du crédit et de la présence directe de la République populaire. La rhétorique officielle parle de partenariat stratégique et de modernisation accélérée, mais la réalité quotidienne montre une économie en difficulté, une population appauvrie et une administration de plus en plus perméable aux intérêts extérieurs.
La crise est évidente. Les salaires dans la fonction publique ont été réduits, les retraites sont versées avec retard, les denrées alimentaires subissent des hausses constantes et les ménages ont du mal à faire face aux dépenses de base. La dévaluation du kip, la monnaie nationale, a érodé en quelques années le pouvoir d'achat de la population urbaine et rurale, tandis que l'inflation se maintient à des niveaux élevés. Le pays, qui n'a pas les ressources nécessaires pour faire face à ses dettes, n'a évité le défaut de paiement que grâce à un soutien discret mais constant de la Chine. En échange, il a cédé le contrôle d'infrastructures essentielles, les droits d'exploitation des ressources naturelles et des parts importantes de son espace économique.
L'expansion chinoise ne s'est pas limitée aux chemins de fer et aux centrales électriques. Dans de nombreuses zones urbaines, les activités commerciales et les complexes résidentiels sont aujourd'hui entièrement gérés par des opérateurs chinois, souvent soumis à des réglementations distinctes de celles qui s'appliquent au reste du pays. Le réseau électrique a été transféré à une entreprise chinoise en garantie des prêts reçus. L'accès préférentiel à des zones économiques spéciales, la construction d'infrastructures clés et la diffusion du mandarin comme langue technique dans l'administration publique sont les signes d'un processus qui va bien au-delà de la coopération économique.
Malgré ce contexte, le gouvernement continue de tenir un discours optimiste. Chaque visite officielle chinoise s'accompagne de nouveaux protocoles d'accord et de projets communs, souvent présentés comme des succès inégalables. L'absence d'espace critique dans les médias, le contrôle de l'information et le consensus apparent contribuent à maintenir cette image figée. Cependant, les tensions sociales s'intensifient. Dans une école de la banlieue de la capitale, un enseignant commentait, résigné : « Les Chinois sont partout, ils parlent entre eux, ils construisent, ils achètent, mais nous ne comptons presque plus pour rien ». Ce témoignage, recueilli par Le Monde, reflète un sentiment qui peine à émerger mais qui est de plus en plus répandu.
Le cas du Laos montre clairement ce qui peut arriver lorsqu'un petit pays vulnérable adopte une stratégie de développement fondée sur la dépendance à un seul acteur dominant. Il n'y a pas eu d'occupation ni de mise sous tutelle formelle, mais le résultat n'est pas très différent de ce qu'aurait produit un contrôle direct, à savoir une souveraineté vidée de sa substance, une économie asservie et une société qui s'adapte en silence à un nouveau centre de commandement.
Le Cambodge : une alliance personnelle et structurelle
Au Cambodge, l'influence chinoise a trouvé un terrain fertile grâce à la convergence entre les intérêts stratégiques de Pékin et le projet dynastique de la famille Hun. Le long maintien au pouvoir de Hun Sen, suivi de l'ascension de son fils Hun Manet à la tête du gouvernement, a assuré la continuité d'une relation construite au fil du temps, consolidée par un réseau dense d'accords, d'investissements et de faveurs réciproques. Plus qu'une simple alliance politique, c'est une relation de symbiose qui s'est établie, dans laquelle la légitimité interne du régime repose en grande partie sur la protection et le soutien économique de la Chine.
À la différence du Laos, où la dépendance se manifeste sous la forme d'une dette, le Cambodge connaît plutôt une convergence stratégique. La Chine a massivement investi dans le pays, avec des projets allant des infrastructures à la sécurité. Le port de Ream, en cours d'agrandissement, est au centre des préoccupations en raison de ses potentialités militaires. Les manœuvres militaires conjointes, ainsi que la fourniture d'équipements à la police et à l'armée cambodgiennes, confirment une collaboration qui va au-delà du symbolique. Pékin a trouvé dans le gouvernement de Phnom Penh un allié fiable, prêt à défendre ses positions, y compris dans les forums multilatéraux.
Les effets de cette présence sont particulièrement visibles sur la côte. La ville de Sihanoukville, autrefois fréquentée par les touristes locaux et occidentaux, a été transformée en quelques années par une vague de capitaux chinois. Casinos, tours résidentielles, centres commerciaux et hôtels se sont multipliés, souvent sans plan d'urbanisme cohérent. La population locale a été en partie expulsée des quartiers centraux, les prix ont augmenté, le paysage urbain a été bouleversé. La croissance, concentrée dans quelques secteurs, a principalement profité aux entrepreneurs chinois et aux personnalités proches du pouvoir.
Dans le reste du pays également, la coopération s'étend à des secteurs clés : routes, ponts, barrages, réseaux numériques. Les entreprises chinoises participent à des projets de développement agricole, gèrent des zones industrielles et proposent des systèmes de surveillance urbaine. Le gouvernement cambodgien a accueilli cette pénétration comme une opportunité, favorisant l'enseignement du mandarin dans les écoles publiques et renforçant les échanges universitaires. La structure étatique s'adapte progressivement aux protocoles, aux modèles et aux priorités définis par Pékin.
Toutefois, cette centralité chinoise comporte également des vulnérabilités. L'économie cambodgienne, même si elle est en croissance, reste fragile et dépendante de quelques secteurs. Le risque qu'une crise en Chine ou un changement de ligne politique ait des répercussions immédiates sur le pays est réel. Mais pour les dirigeants de Phnom Penh, le lien avec Pékin est considéré comme une garantie de stabilité et de protection. Le système qui s'est consolidé n'a pas seulement accepté l'influence chinoise : il en a fait un élément essentiel de sa survie.
Thaïlande : un équilibre fragile
La Thaïlande se distingue des autres pays analysés par sa tradition indépendante, héritée d'une longue histoire d'équilibre entre puissances rivales. Cette attitude se reflète encore aujourd'hui dans la gestion des relations avec la Chine, perçue à la fois comme un partenaire indispensable et une source potentielle d'ingérence. Bangkok a cherché à tirer parti de la concurrence entre Pékin et Washington pour conserver une marge de manœuvre, mais les contradictions internes et les pressions extérieures rendent cette stratégie de plus en plus difficile à maintenir.
L'économie thaïlandaise est fortement intégrée à celle de la Chine. La Chine est le premier partenaire commercial du pays et a investi dans de nombreux projets d'équipements, notamment la ligne ferroviaire à grande vitesse qui devrait relier le nord du pays au réseau chinois en passant par le Laos. À cela s'ajoutent des accords dans les secteurs de l'automobile, du tourisme et de la logistique. Toutefois, l'adoption des technologies chinoises et la participation à des initiatives promues par Pékin n'ont jamais été automatiques. Les autorités thaïlandaises ont à plusieurs reprises ralenti ou renégocié les termes de projets jugés trop déséquilibrés tout en cherchant à renforcer la coopération avec d'autres acteurs régionaux et internationaux.
Sur le plan politique, les relations avec la Chine sont étroitement liées aux dynamiques internes du pouvoir. La monarchie, les dirigeants militaires et les élites entrepreneuriales partagent dans une certaine mesure la même conception d'une Thaïlande neutre, mais appelée à jouer un rôle central dans la région. Cependant, au sein même de ces cercles, des divergences d'orientation apparaissent. Certains secteurs prônent un rapprochement plus net avec Pékin, d'autres craignent qu'une dépendance excessive ne compromette l'autonomie stratégique du pays. La gestion de l'équilibre, plus qu'un art diplomatique, est devenue un exercice quotidien de compromis et d'adaptations.
Les tensions entre la Thaïlande et le Cambodge pour le contrôle des eaux entourant l'île de Ko Kut et ses ressources en gaz naturel offrent un exemple concret de la manière dont la Chine peut influencer les dynamiques régionales de façon opaque. Bien qu'elle ne soit pas directement impliquée dans le conflit, Pékin est liée aux deux pays par des intérêts convergents, et sa position ambiguë contribue à rendre le cadre des négociations plus incertain. Ce type de situation alimente en Thaïlande la crainte que la Chine, plutôt que de jouer le rôle de médiateur, agisse comme un acteur intéressé par le maintien d'une tension contrôlée qui renforce sa position centrale.
La Thaïlande n'est pas un pays passif et dispose de ressources institutionnelles, économiques et militaires suffisantes pour mener une politique étrangère autonome. Mais la pression croissante, combinée à l'érosion de la confiance dans d'autres interlocuteurs internationaux tels que les États-Unis, rend de plus en plus coûteux le maintien d'une position équilibrée. Le risque n'est pas tant celui d'une subordination formelle que celui d'une convergence progressive par inertie, dans laquelle la liberté de choix se réduirait sans être explicitement supprimée.
Vietnam et Malaisie : l'art difficile de l'équilibre
Le Vietnam et la Malaisie font face à la présence chinoise à partir de positions différentes, mais tous deux tentent, avec des résultats contrastés, de maintenir une position autonome dans une région où les pressions se multiplient. Les deux pays ne partagent ni la même histoire ni la même structure économique, mais ils sont unis par un besoin stratégique commun : éviter que l'influence de Pékin ne se transforme en une subordination structurelle, sans pour autant renoncer aux avantages économiques qu'elle comporte.
Le Vietnam est peut-être le plus prudent et le plus méfiant des pays de la région à l'égard de la Chine. Le souvenir de la guerre de 1979 est encore vif, tout comme les tensions entre les deux pays en mer de Chine méridionale, et malgré les discours sur la coopération, Hanoï se méfie des intentions chinoises. Dans le même temps, le pays est profondément intégré dans la chaîne de valeur asiatique et entretient avec la Chine l'une de ses relations commerciales les plus intenses. Les exportations vietnamiennes dépendent en grande partie des matières premières et des composants chinois, et toute tentative de diversification s'avère lente et coûteuse. Le découplage technologique entre les États-Unis et la Chine a offert au Vietnam une occasion rare. Les entreprises occidentales ont transféré une partie de leur production dans le pays, réduisant ainsi leur dépendance à l'égard de la fabrication chinoise. Mais ce transfert a également exposé Hanoï à de nouvelles pressions. Les autorités américaines ont commencé à surveiller le Vietnam pour des pratiques présumées de triangulation commerciale, l'accusant de servir de passerelle pour les marchandises chinoises destinées au marché américain. Le pays se trouve ainsi pris entre deux feux : il doit exploiter la rivalité sino-américaine pour renforcer son économie, sans toutefois devenir une cible ou un pion.
Le positionnement de la Malaisie est plus ambivalent, l'influence chinoise s'y manifestant sous des formes plus nuancées mais tout aussi pénétrantes. Ces dernières années, Pékin a renforcé sa coopération avec Kuala Lumpur dans des secteurs sensibles tels que l'intelligence artificielle, les technologies numériques et les transports. La visite du président chinois a abouti à une série de nouveaux accords qui renforcent le rôle de la Chine en tant que principal partenaire stratégique. Dans le même temps, la Malaisie exporte beaucoup vers les États-Unis et bénéficie encore d'une certaine ouverture aux capitaux occidentaux. Le gouvernement malaisien a déclaré à plusieurs reprises qu'il ne souhaitait pas s'engager en faveur d'un camp ou d'un autre, mais cette position est de plus en plus difficile à tenir. Les élites économiques et politiques sont divisées : certaines poussent à une convergence plus explicite avec la Chine, d'autres craignent que cela ne réduise la marge de manœuvre pour négocier avec d'autres acteurs internationaux. La diplomatie malaisienne continue d'invoquer l'équilibre et la neutralité, mais la structure économique du pays reflète une réalité plus complexe, où les choix formels ne coïncident pas toujours avec les choix effectifs.
Les deux pays montrent, chacun à leur manière, la difficulté d'une stratégie médiane. Le Vietnam résiste avec prudence mais dépend d'un réseau de production qui le lie étroitement à la Chine. La Malaisie tente de naviguer entre deux pôles mais risque de se retrouver dans une position de subordination dissimulée sous une apparence de souplesse. Dans les deux cas, la Chine n'impose pas mais dispose, en proposant des accords, des technologies, des capitaux et des alliances qui s'insèrent dans les espaces laissés vacants par d'autres. Le choix n'est pas toujours contraignant mais les conséquences le sont bel et bien.
Convergences et divergences dans la dépendance
La pénétration chinoise en Asie du Sud-Est n'est pas homogène mais contrastée. Elle va de modèles de dépendance structurelle, comme au Laos et au Cambodge à des configurations plus souples, comme en Thaïlande, au Vietnam et en Malaisie. Dans tous les cas, ce sont les mécanismes (prêts garantis, investissements directs, concessions stratégiques, formation d'élites locales) qui rendent l'influence chinoise efficace, et non seulement les idéologies ou la propagande. Il ne s'agit pas d'une domination explicite ou militaire, mais d'une hégémonie silencieuse qui s'exerce à plusieurs niveaux : économique, technologique et institutionnel. Dans certains cas, les gouvernements ont utilisé l'axe avec Pékin pour compenser des déficiences internes ou pour renforcer leurs régimes politiques, presque toujours au détriment de la transparence, de la neutralité administrative et, surtout, de la liberté de leurs populations. Là où la Chine a pris le rôle d'interlocuteur privilégié, la marge de manœuvre s'est réduite.
L'influence chinoise se consolide dans les contextes où les dirigeants politiques sont prêts à céder des pouvoirs de décision en échange d'un soutien économique, d'infrastructures clés en main ou d'une légitimation diplomatique. Cela vaut autant pour les pays aux institutions fragiles que pour ceux qui conservent une certaine autonomie. Ce qui change, c'est la vitesse à laquelle les règles locales s'adaptent à des logiques extérieures.
Andrea Ferrario
P.-S.
• Traduit pour ESSF par pierre Vandevoorde avec l'aide de Deeplpro
Source - Andrea Ferrario, 23 juillet 2025 :
https://andreaferrario1.substack.com/p/come-la-cina-ridisegna-lasia-sudorientale
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Moscou en Asie : alliance avec Pékin, flirt avec ses rivaux

Alors que Poutine et Xi consolident leur partenariat « sans limites », la Russie entretient des relations de plus en plus étroites avec les principaux rivaux régionaux de la Chine.
Tiré de Europe Solidaire Sans Frontières
21 juillet 2025
Par Andrea Ferrario
En février 2022, alors que Vladimir Poutine consolidait avec Xi Jinping un partenariat qualifié d'« illimité », peu auraient imaginé que trois ans plus tard, des avions militaires russes et chinois survoleraient ensemble le ciel de l'Alaska, ou que leurs garde-côtes mèneraient des patrouilles conjointes dans l'Arctique. Pourtant, derrière cette coopération militaire croissante se cache un paradoxe stratégique qui caractérise la présence russe en Asie. Moscou se range résolument aux côtés de Pékin contre l'Occident sur la scène internationale, mais cultive en même temps des relations de plus en plus étroites avec les principaux rivaux régionaux de la Chine.
Le cas le plus emblématique est celui du Vietnam. En juin 2024, alors que la guerre en Ukraine faisait rage depuis trois ans, Poutine a été reçu en grande pompe à Hanoï. Le président vietnamien To Lam a déclaré que le dirigeant russe « avait contribué à la paix, à la stabilité et au développement de la région Asie-Pacifique », annonçant son intention de renforcer la coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité. Les deux pays ont signé plus d'une douzaine d'accords bilatéraux, allant de l'énergie à la technologie nucléaire, tandis que la Russie continue d'avoir accès à la base navale de Cam Ranh Bay, essentielle pour projeter sa présence en mer de Chine méridionale.
Les relations avec l'Inde sont encore plus significatives. Lors du sommet Inde-Russie de juillet 2024, Modi a rencontré Poutine pour la deuxième fois en quelques mois, le qualifiant de « cher ami » et soulignant que leur lien « a été mis à l'épreuve à plusieurs reprises, et en est toujours sorti renforcé ». L'Inde a continué d'augmenter ses importations de pétrole russe, qui représentaient 40 % du total en 2023, et a mis en place des systèmes de paiement alternatifs pour contourner les sanctions occidentales. Dans le même temps, New Delhi reste fortement dépendante des livraisons militaires russes, qui représentent depuis plus de vingt ans plus de 65 % de ses importations d'armes, même si l'Inde diversifie actuellement ses sources d'approvisionnement.
Cette double approche, qualifiée par les analystes de « balancing-hedging » (c'est-à-dire un équilibre entre l'alignement stratégique avec une puissance et la prudence dans le maintien de relations avec ses rivaux), n'est pas le fruit du hasard. À l'échelle mondiale, la Russie s'appuie de plus en plus sur la Chine comme partenaire économique, militaire et politique pour contrebalancer l'influence des États-Unis. Au niveau régional, cependant, Moscou adopte une stratégie de diversification, évitant de prendre position en faveur de Pékin dans les différends territoriaux et maintenant des canaux de communication ouverts même avec les pays qui sont en concurrence avec elle. La position russe sur la question de la mer de Chine méridionale est particulièrement révélatrice. Moscou n'a jamais critiqué ouvertement la Chine ni remis en cause publiquement la « ligne des neuf traits », avec laquelle Pékin revendique la quasi-totalité de la zone maritime. Dans le même temps, elle ne soutient pas clairement et directement ses revendications. Lorsque, en 2016, le tribunal de La Haye s'est prononcé contre les prétentions chinoises, Poutine a défendu le choix de la Chine de ne pas reconnaître le verdict, mais uniquement parce que Pékin n'avait pas participé à la procédure, sans entrer dans le fond du litige.
La position de la Russie repose sur une logique stratégique bien calibrée. Bien que Pékin ait conscience des relations de Moscou avec ses rivaux régionaux, la Chine accepte tacitement cette ligne de conduite, reconnaissant qu'un éventuel désengagement russe pousserait des pays comme le Vietnam et l'Inde vers un rapprochement avec Washington. Comme l'a fait remarquer un expert des relations sino-russes, la Chine préfère que ses voisins s'appuient sur la Russie plutôt que sur les États-Unis. De plus, les tensions croissantes avec Washington rendent encore plus important pour Pékin de renforcer son entente avec Moscou, considérée comme son seul grand allié possible dans sa confrontation à long terme avec les États-Unis.
L'énergie nucléaire comme instrument d'influenceà longue échéance
L'énergie nucléaire est devenue l'élément le plus sophistiqué de la stratégie russe de pénétration en Asie, un domaine dans lequel Moscou parvient encore à rivaliser à armes presque égales avec les puissances occidentales, malgré les sanctions. Rosatom, la société nucléaire d'État russe, contrôle 88 % du marché mondial des centrales nucléaires et a enregistré en 2024 un chiffre d'affaires à l'étranger supérieur à 18 milliards de dollars. Mais derrière ces chiffres se profile une stratégie géopolitique à long terme, dans laquelle la coopération nucléaire, une fois mise en place, crée des dépendances structurelles durables en matière de maintenance des installations, d'approvisionnement en combustible et de gestion des déchets. Le cas du Vietnam est particulièrement révélateur. Le projet de centrale nucléaire de Ninh Thuận-1, suspendu en 2016, a été relancé en janvier 2025 avec la signature d'un nouveau protocole d'accord entre Rosatom et Vietnam Electricity. Pendant les neuf années où le projet a été suspendu, la Russie a continué à investir dans le pays. Selon le PDG de Rosatom, Alexeï Likhachev, entre 2019 et 2025, l'entreprise a formé environ 400 techniciens vietnamiens qui ont été employés dans ses programmes à l'étranger. Aujourd'hui, en plus de la reprise des travaux à Ninh Thuận-1, la Russie prévoit également la construction d'un nouveau réacteur de recherche dont le chantier devrait démarrer en 2027.
L'Indonésie apparaît comme le banc d'essai le plus ambitieux pour cette stratégie. Rosatom a présenté à Jakarta un modèle de développement modulable, conçu pour s'adapter à la configuration géographique de l'archipel. La première phase comprend des centrales nucléaires flottantes, qui seront suivies par des centrales à haute puissance construites sur la terre ferme. Le vice-PDG de Rosatom, Andrei Nikipelov, a souligné que les unités flottantes constituent un moyen rapide d'accéder à l'énergie nucléaire et entraînent des coûts minimes pour l'Indonésie puisque le remplacement du combustible serait géré par les installations russes. Cette proposition s'inscrit parfaitement dans les plans de développement énergétique du pays, qui prévoient la mise en service de 250 MW d'énergie nucléaire d'ici 2032, 7 GW d'ici 2040 et 35 GW d'ici 2060.
Outre le Vietnam et l'Indonésie, l'expansionnisme nucléaire russe concerne un nombre croissant de pays d'Asie du Sud-Est. Parmi ceux-ci, la Malaisie a manifesté un intérêt croissant pour les technologies proposées par Moscou. Lors d'une réunion qui s'est tenue en juin 2025 entre le PDG de Rosatom, Aleksey Likhachev, et le vice-Premier ministre malaisien Fadillah Yusuf, Kuala Lumpur a exprimé un intérêt particulier pour les centrales nucléaires flottantes de 100 mégawatts. Même des pays aux capacités technologiques plus limitées, comme le Cambodge et le Laos, explorent la possibilité d'une coopération avec la Russie dans ce domaine. Tous deux ont signé des accords préliminaires pour l'utilisation civile de l'énergie atomique et Moscou a propose des programmes de formation destinés au développement des compétences locales. L'objectif à long terme est de créer un réseau de dépendances technologiques qui rendrait beaucoup plus difficiles d'éventuelles sanctions occidentales contre Rosatom. Selon Rafael Grossi, directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, sanctionner l'entreprise pourrait avoir des répercussions négatives sur la sécurité mondiale, car Rosatom fournit du combustible et des services à de nombreux pays.
Le Myanmar, laboratoire de l'alliance russo-chinoise
Le Myanmar, gouverné par une junte militaire qui a pris le pouvoir lors d'un coup d'État et qui est aujourd'hui engagé dans une guerre civile, est devenu le laboratoire le plus avancé de la coopération russo-chinoise en Asie, un cadre dans lequel Moscou et Pékin expérimentent une division des rôles qui pourrait préfigurer les dynamiques régionales de demain. La Chine investit des milliards de dollars dans le Corridor économique Chine-Myanmar et dans de grands projets d'infrastructure, tandis que la Russie se concentre sur le transfert de technologies militaires avancées, la coopération spatiale et le nucléaire. Il en résulte une forme de partenariat complémentaire, développé dans un contexte d'isolement international total des forces rebelles.
La création de l'Agence spatiale du Myanmar en juin 2024 est un signe fort de cette stratégie. L'agence a été placée sous le contrôle direct du chef de la junte, Min Aung Hlaing, et a vu le jour trois mois après sa visite à Moscou, au cours de laquelle plusieurs protocoles d'accord ont été signés avec la Russie, dont un sur l'exploration et l'utilisation pacifique de l'espace. Poutine a confirmé qu'un centre de traitement des données satellitaires est déjà opérationnel en Birmanie avec le soutien de Moscou, tandis que Min Aung Hlaing a déclaré avoir beaucoup appris lors de sa visite à Samara, une région russe réputée pour la production de vaisseaux spatiaux et de satellites.
La coopération s'est également intensifiée sur le plan militaire. La Russie a achevé la livraison des six chasseurs Su-30SME commandés en 2018 pour un montant total de 400 millions de dollars. Les deux derniers appareils ont été livrés lors d'une cérémonie qui s'est tenue en décembre 2024 à la base aérienne de Meiktila, où Min Aung Hlaing a fait baptiser les avions avec de l'eau bénite, les qualifiant d'essentiels pour protéger l'intégrité territoriale du pays et faire face aux « menaces terroristes », c'est-à-dire la résistance démocratique armée. Malgré cette supériorité aérienne, la junte a toutefois perdu le contrôle de vastes zones dans les États ethniques et dans le centre du Myanmar, y compris deux centres de commandement régionaux dans le nord de l'État Shan et le quartier général du Commandement occidental dans l'État de Rakhine.
La coopération nucléaire ajoute une dimension stratégique supplémentaire. Rosatom est engagé dans le développement d'un projet de réacteur modulaire au Myanmar sur la base d'un accord intergouvernemental signé en 2023, tandis que des experts russes collaborent avec des institutions locales dans le cadre de programmes de formation et d'initiatives scientifiques visant à renforcer les compétences internes. Dans le même temps, la Chine continue de jouer le rôle de principal investisseur économique. Au cours de cette seule année, Myanmar China Harbour Engineering a signé des protocoles d'accord d'une valeur totale de 61 millions de dollars avec la Fédération du riz du Myanmar et quatre entreprises publiques en vue de construire des infrastructures portuaires destinées à développer les exportations agricoles du pays.
Le cas du Myanmar montre clairement que la Russie et la Chine mettent en œuvre une stratégie de complémentarité qui va au-delà de la simple coopération économique. D'un côté, Pékin garantit la survie du régime grâce à des investissements massifs et à son accès aux marchés. De l'autre, Moscou fournit des technologies à haute valeur stratégique, telles que des satellites, des avions de chasse et des réacteurs nucléaires. Cette répartition des rôles permet aux deux puissances d'étendre leur influence sans entrer en concurrence directe, dessinant ainsi un modèle de pénétration conjointe qui pourrait également être appliqué dans d'autres contextes marqués par des crises ou l'isolement international.
Les limites structurelles et les perspectives d'avenir
Malgré l'expansion apparente de l'influence russe en Asie, les données mettent en évidence des limites structurelles susceptibles de compromettre la viabilité de cette stratégie. Le secteur des ventes d'armes, historiquement le plus rentable pour Moscou dans la région, a connu un effondrement spectaculaire. Il est passé de 1,4 milliard de dollars en 2014 à moins de 100 millions en 2024. Les sanctions occidentales ont remis en question la fiabilité de la Russie en tant que fournisseur d'armement, poussant de nombreux pays d'Asie du Sud-Est à se tourner non seulement vers des approvisionneurs traditionnels tels que les États-Unis et l'Europe, mais aussi vers de nouveaux acteurs émergents tels que la Corée du Sud et la Turquie.
Les difficultés logistiques constituent un obstacle supplémentaire. La Russie rencontre des problèmes d'accès aux marchés de l'Asie du Sud-Est en raison de l'infrastructure portuaire encore peu développée dans ses régions d'Extrême-Orient et de sa forte dépendance à l'égard des routes commerciales chinoises. Le commerce bilatéral avec le Cambodge, par exemple, est passé de 239 millions de dollars en 2021 à environ 55 millions en 2024, tandis que celui avec le Laos a été réduit à seulement 5 millions. Les autorités russes elles-mêmes ont reconnu les difficultés à pénétrer de nouveaux marchés, comme le montre le cas du projet de recrutement d'un million de travailleurs indiens. Les responsables concernés ont reconnu leur manque d'expérience avec la main-d'œuvre indienne ou sri-lankaise, soulignant les barrières culturelles et linguistiques qui entravent l'expansion. La dépendance de nombreux partenaires asiatiques à l'égard des institutions financières occidentales impose également de fortes limites. Malgré des signes de rapprochement croissant avec Moscou et un volume d'échanges commerciaux qui a atteint 1,3 milliard de dollars en 2024, le Pakistan reste structurellement dépendant du Fonds monétaire international pour faire face à ses problèmes économiques. Cette situation a contraint Islamabad à condamner publiquement l'invasion russe de l'Ukraine. Le projet d'importation de pétrole russe a également été bloqué en raison de l'absence de modernisation des raffineries pakistanaises.
Le cas des Philippines sous la présidence de Ferdinand Marcos Jr. montre à quel point les changements politiques peuvent rapidement affecter les équilibres régionaux. Après une phase d'ouverture à l'égard de Moscou sous le mandat de Duterte, Manille a ramené sa politique étrangère vers des positions plus proches de Washington. En conséquence, le commerce bilatéral avec la Russie est passé de 1,16 milliard en 2021 à environ 600 ou 700 millions en 2024. Jusqu'en 2022, plus de 80 % des exportations philippines vers Moscou étaient constituées de produits électroniques. Cependant, les sanctions imposées par les États-Unis en 2023 aux entreprises impliquées dans la chaîne d'approvisionnement de l'industrie russe de la défense ont rendu ces échanges encore plus difficiles.
La Russie ne se limite plus à ses stratégies économiques et militaires traditionnelles mais s'essaie également à des opérations visant à infléchir l'opinion publique dans des contextes qui peuvent sembler peu perméables. Le cas du Japon est emblématique. En 2024, l'agence de presse gouvernementale Sputnik a plus que triplé la diffusion de ses contenus sur le compte japonais de la plateforme X, dépassant 1,04 million de partages contre 320 000 l'année précédente. À partir d'octobre 2023, la stratégie s'est affinée. Les heures de publication ont été avancées de la soirée au matin afin de favoriser une plus grande visibilité, et les contenus alternent entre des images apparemment inoffensives, telles que des crabes ou des loutres de mer, et de la propagande anti-ukrainienne et des thèses complotistes. L'objectif n'est pas tant de promouvoir un discours pro-russe que de déstabiliser la société japonaise. Cet objectif est devenu évident lorsque, en pleine campagne électorale pour le renouvellement de la chambre haute du Japon, la chaîne russe en langue locale a donné la parole à un représentant du parti d'extrême droite Sanseito, déjà en forte croissance à l'époque et qui est ensuite passé de 2 à 17 députés lors du scrutin.
Un événement particulièrement significatif a été la rencontre en mai 2024 entre Poutine et Akie Abe, veuve de l'ancien Premier ministre japonais et ancien chef du parti LDP au pouvoir, assassiné en 2022. Les douze articles publiés par Sputnik sur cet événement ont été partagés près de 10 000 fois, atteignant plus de 12 millions de vues. La tentative de légitimer la Russie à travers l'image publique d'une personnalité respectée comme Akie Abe démontre le niveau de sophistication atteint par ces campagnes, ainsi que, bien sûr, la disponibilité de la droite gouvernementale de Tokyo à s'y laisser impliquer. Contrairement à ce qui se passe en Europe et aux États-Unis, le Japon n'a imposé aucune restriction à Sputnik, qui reste en revanche interdit dans l'Union européenne depuis mars 2022.
La confrontation croissante entre les États-Unis et la Chine pourrait, paradoxalement, élargir ou bien restreindre la marge de manœuvre de la Russie. D'une part, l'incertitude causée par la politique de Trump à l'égard de ses alliés traditionnels pourrait inciter plusieurs pays asiatiques à diversifier leurs alliances, créant ainsi de nouvelles ouvertures pour Moscou. Le fait qu'un nombre croissant de membres de l'ASEAN se rapprochent des BRICS, l'Indonésie y étant désormais pleinement intégrée et la Malaisie, la Thaïlande et le Vietnam y étant associés en tant que partenaires, reflète la volonté d'explorer des alternatives aux canaux occidentaux traditionnels. Cependant, l'intensification de la polarisation mondiale risque de restreindre progressivement l'espace disponible pour la stratégie russe du « double niveau ». Plus la rivalité entre Washington et Pékin s'intensifie, plus les mécanismes d'alignement systématique ont tendance à prévaloir, réduisant ainsi la possibilité pour chaque pays de mener une politique étrangère autonome. Les gouvernements d'Asie du Sud-Est, bien que désireux de préserver leur indépendance stratégique, pourraient être contraints de faire des choix plus clairs. Dans ce scénario, la capacité de la Russie à cultiver des relations avec les rivaux régionaux de la Chine dépendrait non seulement de son habileté diplomatique, mais aussi de la volonté de Pékin de tolérer une certaine ambiguïté stratégique dans un contexte marqué par une confrontation de plus en plus directe avec les États-Unis.
Andrea Ferrario
P.-S.
• Traduit pour ESSF par Pierre Vandevorde avec l'aide de Deeplpro.
Source - Andrea Ferrario, 21 juillet 2025
https://andreaferrario1.substack.com/p/mosca-in-asia-alleanza-con-pechino
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Tensions frontalières en Asie du Sud-Est : Dynasties, Capital et guerre contre les peuples

Les récents affrontements armés entre le Cambodge et la Thaïlande ont fait des victimes, déplacé des communautés et détruit des moyens de subsistance. Présentés dans les médias comme un « différend frontalier », ils sont en réalité le symptôme violent de forces bien plus profondes : l'héritage du colonialisme, la cupidité d'élites bien établies, la domination géopolitique et les rivalités entre les superpuissances, ainsi que la logique militariste qui continue de dominer l'Asie du Sud-Est. Il ne s'agit pas simplement de lignes territoriales, mais de savoir qui détient le pouvoir, qui tire profit des conflits et qui saigne pour et à cause d'eux.
Tiré de Europe Solidaire Sans Frontières
13 août 2025
Par Raul Urbano
Frontières coloniales, héritage impérial
Les origines de ce conflit remontent à l'ère coloniale, lorsque les autorités impériales françaises ont unilatéralement découpé l'Asie du Sud-Est en territoires pour servir leurs propres intérêts stratégiques et économiques. Dans le cas du Cambodge, la France a délimité 817 kilomètres de territoire cambodgien, une décision qui a semé les graines d'un conflit à long terme, en particulier au sujet des temples anciens situés près de la frontière. Mais si la cartographie coloniale a tracé les lignes, la violence actuelle est entretenue par des classes dirigeantes qui manipulent les griefs historiques pour attiser le nationalisme et détourner l'attention de leurs propres échecs.
Corruption, capital et nuage de fumée
Au Cambodge, un énorme scandale a révélé les liens de la famille dirigeante avec le groupe Huione, un empire financier basé à Phnom Penh, accusé d'avoir blanchi des milliards de dollars par l'intermédiaire de filiales telles que Haowang Guarantee, Huione Pay PLC et Huione Crypto, souvent via la Thaïlande. Son principal dirigeant, Hun To, est directement lié à l'actuel président du Sénat et au Premier ministre.
Les avertissements de la banque centrale du Cambodge et les révélations des médias internationaux n'ont pas apporté de réforme ni de justice. Au contraire, l'éclatement du conflit frontalier a permis à la famille dirigeante de se refaire une image de défenseur nationaliste et de se mettre à l'abri de tout contrôle. Le moment de l'embrasement, qui coïncide avec le pic d'attention du public pour le scandale, révèle comment la guerre peut être déployée comme un nuage de fumée politique.
Dynasties et militarisme
La divulgation par les dirigeants cambodgiens d'un appel téléphonique impliquant la Première ministre thaïlandaise dans des conflits militaires internes a aggravé les tensions. En Thaïlande, la Première ministre Paetongtarn Shinawatra - fille de Thaksin et nièce de Yingluck - représente une autre dynastie bien ancrée. Le Cambodge et la Thaïlande sont tous deux pris dans des cycles où le pouvoir oscille entre les familles oligarchiques et les militaires, ce qui affaiblit les institutions démocratiques et les rend facilement inapplicables.
Le conflit du temple, bien qu'il ait été réglé par les tribunaux internationaux en faveur du Cambodge, a été instrumentalisé par l'État thaïlandais pour susciter un sentiment nationaliste, à l'instar du refus de la Chine de reconnaître les décisions internationales relatives à la mer des Philippines occidentales. Dans ce cas, le nationalisme n'est pas une défense de la souveraineté du peuple, mais un instrument de survie politique.
La guerre contre les marginaux
Le 24 juillet, le conflit s'est transformé en guerre ouverte. Des civils et des soldats sont morts. L'initiative de cessez-le-feu du président de l'ANASE (ASEAN) et Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a échoué lorsque la Thaïlande a rompu la trêve. Les Nations unies ont organisé une réunion, mais la violence a persisté.
Ce n'est pas l'élite dirigeante qui souffre le plus, mais les pauvres - agriculteurs, pêcheurs, communautés indigènes - contraints de fuir leurs maisons et d'abandonner leurs terres. Ces personnes n'ont pas eu leur mot à dire dans les décisions qui ont déclenché la guerre, et c'est pourtant sur elles que pèse le plus lourd fardeau.
Au Cambodge, la pauvreté se maintient à près de 18 %, avec des taux élevés de famine et de mauvaise santé. En Thaïlande, 2,3 millions de personnes - essentiellement des ruraux - vivent dans la pauvreté. Les Philippines connaissent des situations similaires, avec des dynasties politiques contrôlant la plupart des provinces et aggravant la pauvreté des paysans, des pêcheurs et des populations indigènes. Dans toute la région, la domination des élites - enracinée dans les structures coloniales et soutenue par les systèmes capitalistes - signifie que les besoins fondamentaux de la majorité sont systématiquement négligés.
L'impérialisme dans le processus de paix
Même le cessez-le-feu a été moins un triomphe de la diplomatie qu'une démonstration de marchandage géopolitique. Il n'a eu lieu que sous la pression de la Malaisie, de la Chine et des États-Unis, ces derniers utilisant les négociations commerciales comme moyen de pression. Cela révèle comment la « paix » dans de tels contextes est souvent traitée comme une monnaie d'échange pour des intérêts impériaux et économiques, et non comme un droit de l'homme ou un impératif moral.
La farce s'est aggravée lorsque le Cambodge a désigné Donald Trump pour le prix Nobel de la paix - un geste déjà soutenu par le Pakistan et Israël - mettant à nu le cynisme et la manipulation de l'image qui définissent la politique de l'élite mondiale.
La lutte à venir
Ce conflit n'est pas seulement une question de terres et de territoires. Il s'agit de systèmes - frontières coloniales maintenues par les dirigeants postcoloniaux, profits capitalistes qui enrichissent une minorité et militarisme qui considère les vies humaines comme sacrifiables à la poursuite du pouvoir. Le nationalisme n'est pas transformateur : c'est une arme utilisée par les élites dirigeantes pour faire taire les dissidents, justifier la militarisation et dresser les peuples les uns contre les autres au lieu de les opposer à leurs véritables oppresseurs.
Si nous voulons briser ces cycles, la voie à suivre doit être ancrée dans la solidarité anticoloniale, le démantèlement des régimes dynastiques et militaires, la résistance au pillage capitaliste de nos terres et de notre travail, et la défense des droits de l'homme de tous les peuples. Nous devons rejeter le faux choix entre les autocrates nationaux et les impérialistes étrangers. La véritable souveraineté que nous recherchons est le pouvoir des communautés de contrôler leurs terres, leurs ressources et leur avenir sans exploitation, militarisme et domination. La solidarité d'en bas doit être travaillée et renforcée par toutes les parties prenantes, en particulier les opprimés, les exploités et les marginalisés.
L'avenir de l'Asie du Sud-Est ne sera pas assuré par des dynasties, des armées ou des milliardaires. Il sera gagné par les luttes organisées et unies des peuples à travers les frontières, refusant d'être réduits au silence par le bruit des tirs ou trompés par l'agitation de drapeaux qui masquent l'avidité des puissants.
Raul Urbano
Mindanao, Philippines
P.-S.
• Traduit pour ESSF par Pierre Rousset avec l'aide de DeepLpro.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
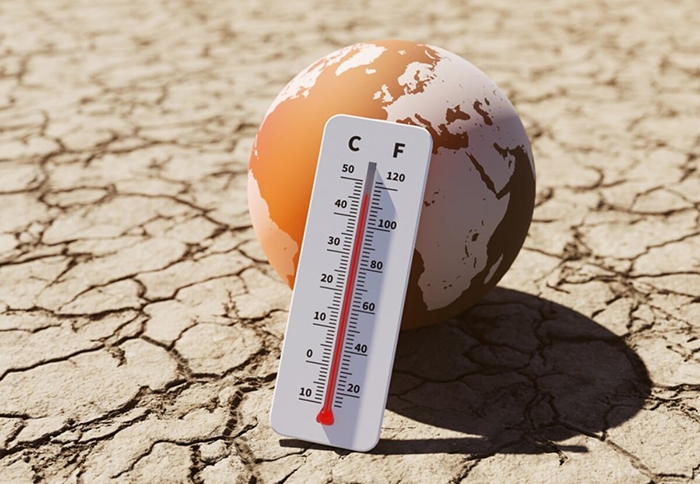
Débat. « Vers 3ºC de plus en 2100. Faire ce qu’il est possible de faire » (I)
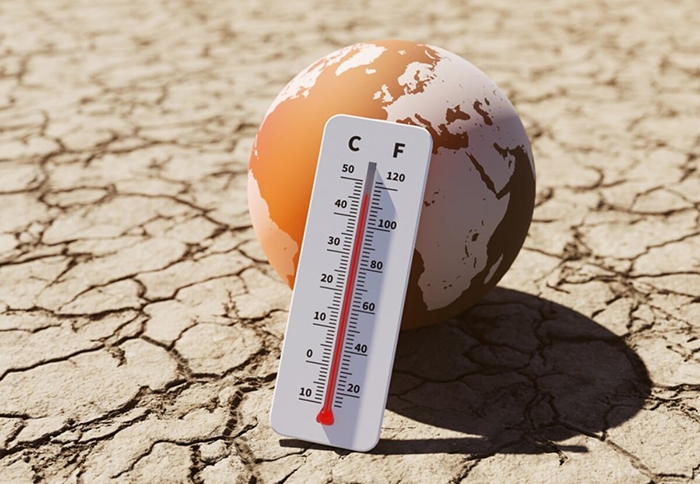
L'année 2024 a été la plus chaude depuis des milliers d'années. Auparavant, le record était détenu par l'année 2023 !
Tiré de A l'Encontre
15 juillet 2025
Par Robert Lochhead
Celeste Saulo, l'ancienne directrice du Service Météorologique National de l'Argentine, et actuelle secrétaire générale de l'Organisation Météorologique Mondiale, avertit que les évènements météorologiques extrêmes n'ont jamais été si nombreux et si intenses, et qu'ils vont augmenter encore. [1]
Le croira-t-on ? depuis 1990, quand on commençait à se préoccuper de l'effet de serre, jusqu'en 2019, plus de combustibles fossiles ont été brûlés que de 1750 à 1990, soit depuis le début de la Révolution industrielle ! [2] Depuis 1990, toute la politique du réchauffement climatique n'a-t-elle donc été qu'un théâtre hypocrite ? Quelle est la part des bonnes intentions impuissantes et de la mauvaise volonté ?
Le nouveau président du GIEC [3], l'écossais Jim Skea, remarquait en juillet 2023 : « Nous sommes dans une situation très difficile. Les actions entreprises par les États jusqu'ici ne permettent pas d'atteindre les objectifs de la COP 21 de Paris en 2015. Le fait que nous ayons fait aussi peu de progrès sur la réduction des émissions de CO2 renforce la nécessité d'accélérer le processus d'atténuation des effets du réchauffement. » [4] L'objectif de Paris en 2015, c'était de ne pas dépasser en 2100, 1,5ºC-2ºC de plus qu'en 1850. Or aujourd'hui, nous avons déjà atteint 1,5ºC de plus et le monde continue à brûler toujours plus de combustibles fossiles. À ce rythme, nous allons vers 3ºC voire 4ºC de plus en 2100. Soit un monde invivable pour les milliards d'êtres humains les plus vulnérables.
Le GIEC avait calculé que cela nécessitait de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici à 2030 pour les annuler complètement en 2050. Et que donc les usages du charbon, du pétrole et du gaz naturel devraient d'ici 2050 baisser respectivement de 95%, 60% et 45% (comparé à 2019). [5] On n'en prend pas le chemin !
Qui s'attendait à ce qu'un paladin du néo-libéralisme comme l'ex-premier ministre britannique Tony Blair déclare récemment : « La stratégie actuelle ne fonctionne pas » ? C'est le moins qu'on puisse dire. Tony Blair a fait sa déclaration en présentant le rapport de son Tony Blair Institute for Global Change : Le paradoxe climatique : pourquoi nous avons besoin de relancer (reset) l'action contre le changement climatique. » [6]
Mais les banquiers les plus influents, eux, signalent que le marché aura besoin de « générations » pour abandonner les combustibles fossiles, car les investissements dans les énergies renouvelables ne sont tout simplement pas rentables et seuls les combustibles fossiles rapportent des bénéfices à deux chiffres. [7]
Qui s'en préoccupe encore ?
Les trois dernières conférences internationales sur le climat se sont tenues dans des pays pétroliers, à Sharm El-Sheik en 2022, à Dubaï en 2023, à Bakou en 2024. Donald Trump a été réélu qui avait retiré les États-Unis du Traité conclu à Paris en 2015 à la COP 21. Trump qui encourage une consommation accrue du charbon et une croissance des forages pétroliers, et qui interdit aux fonctionnaires fédéraux toute allusion au réchauffement climatique. Les partis d'extrême-droite nient que le réchauffement climatique soit un vrai problème. Le mouvement international contre le réchauffement climatique semble ébranlé. L'ambiance est plombée par l'extermination des Palestiniens à Gaza, la récente guerre d'Israël et des États-Unis contre l'Iran, et la poursuite de l'offensive russe contre l'Ukraine, et les progrès partout de l'extrême-droite, qui est négationniste du réchauffement climatique.
Les 10-21 novembre prochains, aura lieu la COP 30 à Belem, au Brésil, en pleine forêt amazonienne.
La faim, la misère, les guerres, l'oppression, l'exploitation avec ses bas salaires et la précarité, ainsi que les distractions des médias, masquent le problème aux yeux des larges masses que les gouvernements ne se préoccupent d'ailleurs pas d'éclairer et alerter.
L'échec patent de trente années des politiques contre l'effet de serre illustre une réalité terrible : la masse immense sur la Terre de l'industrie des combustibles fossiles. Pas seulement la puissance financière et politique des grandes multinationales pétrolières mais l'omniprésence physique de cette industrie :
« L'ampleur physique de l'actuel système énergétique basé sur les combustibles fossiles est en effet énorme. Il y a des milliers de grandes mines de charbon et de centrales électriques au charbon, quelques 50'000 champs pétrolifères, un réseau mondial comptant au moins quelque 300'000 km d'oléoducs et 500'000 km de gazoducs et 300'000 km de lignes de transmission. Globalement, le coût de remplacement de l'infrastructure fossile et nucléaire existante est d'au moins 15 à 20 trillions de dollars. » [8] Remplacement par des énergies renouvelables, s'entend.
Le capitalisme s'est construit depuis le XVIIIe siècle sur les combustibles fossiles, charbon d'abord, pétrole ensuite. C'est la prospérité de millions d'entreprises, les profits de leurs actionnaires, et le gagne-pain de leurs salariés, qui en dépendent chaque jour. Leur abandon suscite donc des résistances puissantes. Que vont devenir les pays pétroliers dans une économie mondiale sans pétrole ? Mais ces pays et ces entreprises ont eu 30 ans pour se reconvertir.
Dans son rapport fameux publié en 2006, l'ex-économiste en chef de la Banque mondiale, le très néolibéral Nicholas Stern, décrivait le changement climatique comme « l'échec le plus grave de l'économie de marché ». [9]
Regarder en face le monde à 3ºC ou 4ºC plus chaud qu'en 1850
Dans ce monde en 2100 avec 3ºC de plus, le Sahara sera remonté jusqu'à Madrid, Rome et Athènes, le désert du Nouveau Mexique jusqu'à San Francisco, le désert du Namib s'étendra jusqu'à Johannesburg, et le désert de Gobi jusqu'à Beijing. Les Alpes seront aussi peu enneigées que l'Atlas marocain aujourd'hui, et pour un milliard d'habitants des pays tropicaux et équatoriaux, il y aura des conditions inhabitables avec des températures de plus de 42ºC au Soleil durant 145 jours par année, rendant dangereux de travailler dehors, et 200 nuits par année trop chaudes pour se rafraîchir de la chaleur du jour, et pour dormir. La plupart des villes portuaires du monde seront inondées régulièrement par la hausse du niveau des mers.
Le rétrécissement des glaciers de l'Himalaya, avec les massifs qui l'entourent, va diminuer le débit des grands fleuves qui irriguent l'Inde et le Pakistan (Indus, Gange, Brahmapoutre), l'Indochine (Mékong), la Chine (Yang Tsé Kiang et Fleuve jaune). C'est l'agriculture qui nourrit des milliards de personnes qui sera menacée.
Le GIEC a calculé que la hausse du niveau des océans, du fait de la fonte des glaces et de la dilatation de l'eau par sa température plus élevée, pourrait atteindre entre 0,4 et 1,4 m environ en moyenne. Daniel Tanuro, dans son livre de 2010, L'impossible capitalisme vert, fait remarquer qu'entre 1990 et 2006 le niveau moyen des océans s'est élevé de 3,3 mm par an alors que le GIEC avait prévu 2 mm par an. Soit 60% de plus. [10]
Une hausse de 1m, ou s'approchant de 1m, signifie que les côtes, et les estuaires, là où habite la majorité de la population humaine, connaîtront des inondations géantes plus fréquentes et plus catastrophiques. Les deltas seront submergés, les plages, les forêts riveraines, les estuaires, les embouchures des fleuves, les villes portuaires et les rives urbanisées aussi, et le dessin des côtes sera bouleversé. Un pays comme le Bangladesh, qui est le delta du Gange et du Brahmapoutre, et se situe tout entier au raz de la mer, sera annihilé, comme beaucoup des petits États insulaires du Pacifique et de l'Océan indien, des grandes parties de la Floride et de la Louisiane, pour ne rien dire des Pays-Bas.
Le monde à + 4ºC en 2100
Si la température moyenne au niveau des mers montait de 4ºC, l'Himalaya n'aura plus que la moitié de sa couverture de glace et les Alpes plus que 10%. La calotte de glace de l'Antarctique Ouest aura commencé à se fragmenter. Le niveau des mers sera monté de 2m ce qui déplacera des centaines de millions d'habitants des régions côtières. Soit autant de réfugiés désespérés de ne savoir où aller. Les régions méditerranéennes et subtropicales seront des déserts et l'Amazone, et les autres forêts équatoriales, envahies par la mer, seront desséchées et ravagées par des terribles incendies. Aux latitudes aujourd'hui dites tempérées de Tokyo, Shanghai, Rio de Janeiro, et New York, la longue saison à plus de 40ºC rendra le travail à l'extérieur impossible et tuera des milliers de personnes de coups de chaleur. Entre la montée du niveau des mers, la désertification et les terribles chaleur et humidité, l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, la Floride et la Louisiane, le delta du Mékong au Vietnam, tels que nous les connaissons, n'existeront plus.
À 40ºC, les céréales alimentaires ne pourront plus pousser. La production du maïs des États-Unis s'effondrera. Les trois quarts des cultures de blé du monde seront ravagées par la sécheresse. Dans les décennies antérieures, les cultures auront certes prospéré dans le Grand Nord, au Canada, en Sibérie, en Alaska. Mais dans le monde à 4ºC de plus, elles seront rattrapées par la sécheresse montant du Sud et par la fonte du permafrost au Nord et les inondations de boues que cette fonte engendre. [11]
L'humanité ne s'éteindra pas. Mais ce sera un basculement catastrophique de la civilisation humaine.
Cette prévision d'un monde à + 3ºC ou + 4ºC doit devenir une arme politique en étant expliquée et rappelée à la population par les gouvernements, et par les mouvements sociaux, pour justifier et définir les mesures radicales à prendre et servir de tableau de bord pour l'effort collectif.
Les dangers des aggravations en cascade ou rétroactions positives
La gravité d'un avenir plus chaud n'est pas linéaire sinon exponentielle car une Terre plus chaude accroît l'effet de serre. Plus de chaleur provoque plus de chaleur encore :
– La fonte du permafrost arctique et antarctique dégage du méthane qui dans l'atmosphère est un puissant gaz à effet de serre, en plus du gaz carbonique.
– La fonte des glaces diminue les surfaces blanches du globe qui réfléchissent les rayons du soleil. Une Terre plus sombre se chauffera plus vite.
– Les forêts absorbent massivement du CO2. Mais la sécheresse croissante diminuera la couverture des forêts équatoriales et tropicales. Une Terre moins verte se chauffera plus vite.
– En particulier, la chaleur et la sécheresse accroissent le nombre et les dimensions des incendies de forêts qui libèrent de grandes quantités de CO2 et peuvent diminuer la couverture forestière.
À pas de tortue
De 1990 à 2021, la part à la production mondiale primaire d'énergie des combustibles fossiles a, certes, baissé de 81,36% à 80,34% grâce au développement des énergies renouvelables. Mais leur quantité absolue a presque doublé, passant de 298 millions de térajoules à 496 millions de térajoules. Même la part du charbon a passé de 93 millions de térajoules en 1990 à 168 millions de térajoules en 2021. [12] La production d'électricité de l'Inde, nouveau géant économique, est principalement à base de charbon et son représentant à la COP26 à Glasgow en 2021 a mis son veto à ce que la résolution finale parle d'une élimination rapide du charbon.
La croissance économique depuis 1990 a été fossile et le reste. Les capitalistes des fossiles ne défendent pas seulement leurs profits mais surtout la rentabilité de leurs gigantesques capitaux fixes pas encore amortis et résultant d'investissements réalisés relativement récemment partout dans le monde.
La Commission de l'Union européenne annonce que l'UE s'approche d'une réduction de 55% des gaz à effet de serre depuis 1990 et d'une croissance à 42,5% de la part des énergies renouvelables. Ses objectifs pour 2030. Mais ce sont là les plans nationaux annoncés par les gouvernements, et non une réalité accomplie et vérifiée. [13]
Le gouvernement chinois a annoncé que les émissions de CO2 de la Chine ont baissé de 1% en 2024 et que les énergies renouvelables, dans lesquelles il inclut le nucléaire, constituent 57% de la production d'énergie et 89% des capacités installées dans la dernière année.[14]
Naomi Klein qui se bat pour un New Deal Vert, a porté un jugement averti sur Donald Trump : « On parle parfois de Donald Trump comme d'un négationniste du changement climatique. Je ne pense pas qu'il nie l'existence du changement climatique. Il sait très bien qu'il y a des changements climatiques. Mais il croit que tout ira bien. C'est pourquoi il se demande comment acheter le Groenland – pour profiter de la fonte des glaces pour s'approprier le pétrole et le gaz. Quelqu'un qui ne croit pas aux changements climatiques ne serait pas intéressé par le Groenland. Le Groenland ne l'intéresse que parce que la glace fond, ouvre des routes commerciales et libère des réserves de combustibles fossiles. Il n'y a que l'indifférence et la croyance que les riches pourront s'isoler. » [15]
Pour Donald Trump, le réchauffement et la montée du niveau des mers sont des perspectives de promotion immobilière sur les nouveaux bords de mer pour des plages et des hôtels de luxe. Il a retiré les États-Unis du Traité de Paris de 2015, parce qu'il n'accepte aucune limitation ni restriction aux entreprises et à la rentabilité des capitaux. De par « l'égoïsme sacré » de son nationalisme, il n'accepte aucune contrainte sur son gouvernement par des accords multilatéraux qui instituent des engagements qu'il devrait respecter. C'est ainsi qu'il a retiré les États-Unis de l'Organisation Mondiale de la Santé. Les politiques promues contre le réchauffement climatique et contre les pandémies sont pour lui « l'extrémisme du socialisme européen. » [16]
Isabel Díaz Ayuso, la présidente d'extrême-droite de la communauté de Madrid, déclare qu'elle reconnaît dans les solutions proposées contre le réchauffement climatique, un communisme qui ne dit pas son nom. Il y a là un grain de vérité car les solutions imposent d'aller à contre-courant du business as usual.
Probablement que beaucoup de décideurs du monde se rassurent en pensant que le progrès scientifique va apporter dans dix ou vingt ans des solutions insoupçonnées aujourd'hui qui ne perturberont pas la marche du business et permettront même de faire des bonnes affaires.
Les alternatives aux combustibles fossiles ne sont pas rentables
De COP en COP, les gouvernements et les décideurs du monde ont postulé que l'abandon progressif des combustibles fossiles devait être financé par les investisseurs privés. Mais leurs promesses de financement ne se sont pas concrétisées.
Et, si possible, faire payer la facture aux salariés-consommateurs, par le jeu des prix protégeant les profits, ce qui ne cesse de discréditer la lutte contre le changement climatique aux yeux des couches les plus pauvres de la population, ce que l'extrême-droite exploite malicieusement.
Michael Roberts l'a expliqué récemment en se basant sur le livre de Brett Christophers, The Price is Wrong-Why Capitalism won't save the Planet, Verso, 2023 : Premièrement, la rentabilité est structurellement faible sur le marché mondial capitaliste depuis des décennies, anémiant l'investissement. Mais, deuxièmement, la baisse des prix des énergies renouvelables diminue la rentabilité des capitaux qui s'y placent pour les vendre. Une fois que les panneaux solaires sont vendus et installés, le soleil est gratuit alors que les combustibles fossiles doivent être achetés tous les jours. Seuls les combustibles fossiles offrent des bénéfices à deux chiffres. « Pour ces raisons, les économistes de la banque JPMorgan concluent que “le monde a besoin d'un contrôle de réalité” dans son mouvement des combustibles fossiles vers l'énergie renouvelable, et ils affirment que cela pourrait prendre “des générations” pour atteindre les cibles net-zéro. JPMorgan considère que changer le système énergétique du monde « est un processus qui devrait être mesuré en décennies, ou en générations, et pas en années”. Parce que l'investissement dans l'énergie renouvelable “n'offre actuellement que des retours médiocres”. »
C'est pourquoi Brett Christophers conclut que le sauvetage du réchauffement climatique nécessitera l'action de la puissance publique, c'est-à-dire des investissements massifs par les États. [17]
(Dans la deuxième partie de l'article, nous proposons cinq mesures possibles de politiques publiques pour diminuer l'émission de CO2.)
Capturer le CO2 émis au lieu d'arrêter d'en émettre
Le nouveau président du GIEC depuis 2023, le britannique Jim Skea déclarait en entrant en fonctions : « Même avec une neutralité carbone, nous devrons sans doute extraire du CO2 de l'atmosphère. » [18] C'était reconnaître l'échec des politiques de diminution de l'effet de serre jusqu'à maintenant.
La COP 29 à Bakou l'année dernière a vu la consécration des techniques expérimentales pour extraire le CO2déjà émis et pour refroidir l'atmosphère et la Terre. C'est-à-dire les promesses futuristes hasardeuses pour n'avoir pas besoin de renoncer aux combustibles fossiles. Cela s'est introduit dans la résolution finale de la conférence avec le nouveau terme de combustibles fossiles non-atténués (unabated fossil fuels), soit ceux dont le CO2 émis n'est pas recapturé. Les « bons » combustibles fossiles seront donc ceux qui bénéficieront de la recapture du CO2 qu'ils émettent. [19]
Toute une armada de start-ups et expérimentations, financées par Bill Gates et autres oligarques super-riches, travaillent sur ces idées.
La technologie existe, certes, pour retirer le CO2 des gaz émis, par exemple par une usine. Par exemple, une aciérie ou une usine de ciment qui en dégagent beaucoup. Mais appliquer cela à l'air ambiant, à l'atmosphère entière, paraît de la science-fiction. Il existe des moyens d'intégrer le CO2 à un matériau, par exemple une roche carbonée, ou de le transformer en un carburant, ce qui repousse le problème plus loin. Mais ce qui est envisagé couramment, et déjà pratiqué à petite échelle, c'est de simplement enfermer le CO2 dans un réservoir, dans une cavité souterraine, ou dans une roche perméable mais étanche, des mines de sel souterraines, des lacs souterrains, …C'est possible mais hautement dangereux. Car si le réservoir fuit, ou que le CO2 s'échappe à nouveau dans l'atmosphère, tout est perdu. Ce sont les NET, les technologies à émissions négatives.
Le climatologue de l'Université de Manchester, Kevin Anderson, a fait scandale en 2016 en révélant que, en cachette, les NET avaient fait partie des calculs optimistes de la COP21 de Paris en 2015. [20]
Les NET, technologies à émissions négatives
– La NET qui est disponible techniquement et qui a les faveurs de l'industrie des combustibles fossiles, c'est la BECCS, bioénergie avec capture et séquestration du carbone : cultiver sur des surfaces immenses des herbes ou des arbres à croissance rapide, par exemple des Eucalyptus, pour les brûler à la place des combustibles fossiles. En croissant, ils auront absorbé du CO2 de l'air. Comme combustibles, ils permettent d'employer les technologies que maîtrise l'industrie pétrolière. Le CO2 qu'émet leur combustion est conservé, enfermé, comprimé, conduit par des réseaux de pipelines jusqu'à ces « puits » où on prétend l'enfermer pour des milliers d'années. Outre le pari hasardeux de cet enfermement, cette BECSS, de par les surfaces immenses de plantations, concurrencera l'agriculture pour l'alimentation. On se souvient que le président de Nestlé en 2009 avait publiquement dénoncé les cultures de céréales pour la production d'alcool comme combustible, parce que cela aggravait la crise alimentaire.
– La capture du CO2 de l'air par une résine adsorbante. Le principe est bien connu par ces petites billes de résine jaune qui servent à désioniser l'eau en retirant son calcaire. Des surfaces immenses seraient couvertes d'une telle résine qui adsorberait le CO2. Périodiquement, il faudrait laver cette résine puis extraire le CO2 de l'eau de rinçage, l'enfermer, le comprimer, le conduire par des tuyauteries jusqu'à l'enfermer sous terre.
– La fixation par la soude caustique. Comme on sait, le CO2 réagit avec la soude caustique pour donner du carbonate de sodium. Le CO2 de l'air serait fixé par la soude caustique dans des tours de lavage. Le carbonate de sodium pourra être jeté à la mer ou calciné pour retrouver la soude caustique à réutiliser et le CO2 à enfermer. La soude caustique est produite par électrolyse de l'eau salée ce qui consomme de l'électricité.
– Augmenter l'absorption du CO2 atmosphérique par les océans en y dispersant de la chaux. Cela produit du carbonate de calcium, du calcaire, qui précipite au fond de la mer. Pour disperser cette chaux, il faut une immense flotte de bateaux qu'il faut propulser. La chaux est produite par calcination du calcaire, ce qui consomme de l'énergie et dégage du CO2 qu'on pense enfermer. [21]
Tout cela est à un stade expérimental ou de petites installations-pilotes. De là à traiter tout le CO2 de l'atmosphère pour en diminuer la quantité, il y a un saut pour le moins incertain. Tout cela est absurde mais envisagé pour continuer à brûler pétrole, gaz naturel et charbon.
Refroidir l'atmosphère pour continuer à brûler du pétrole
Les grandes éruptions volcaniques refroidissent l'atmosphère durant plusieurs mois en injectant dans la stratosphère des aérosols, entre autres soufrés, et des particules, qui filtrent les rayons du soleil. Jusqu'aux années 1970, les pétroles consommés contenaient une haute teneur en soufre qui, une fois brûlé, produisait du dioxyde de soufre (SO2) puis avec l'eau de pluie des gouttelettes d'acide sulfurique. Ces gouttelettes filtraient les rayons du soleil et freinèrent l'effet de serre de 1940 à 1975. Mais ces « pluies acides » nuisaient à la végétation et provoquaient des maladies pulmonaires chez des millions de personnes. On a donc préféré des pétroles pauvres en soufre et désulfuré préalablement le pétrole. C'est ainsi que dès 1975, le réchauffement climatique a pu prendre son envol. [22]
– L'idée sur laquelle travaillent plusieurs équipes bien financées, c'est trouver à injecter dans la haute atmosphère des aérosols chimiques qui miment cet effet refroidissant du soufre et des volcans. Mais sans nuire ni à la santé des humains ni à celle de la végétation. Or l'atténuation de l'ensoleillement nuit déjà à la végétation.
– Autre solution : Le méthane ou gaz naturel est présent dans l'air en quantités beaucoup plus faibles que le CO2. Il s'échappe naturellement lentement dans l'espace hors de l'atmosphère alors que le CO2 y reste pour des milliers d'années. Mais c'est un gaz à effet de serre 84x plus puissant que le CO2. L'idée de certains, c'est éliminer au moins ce méthane atmosphérique en provoquant à hautes altitudes une réaction chimique qui le transforme en CO2.
– Ou encore, compenser le rétrécissement de la surface de neige et de glace qui réfléchissait les rayons du soleil en blanchissant les nuages ou des grandes surfaces du sol par de la poudre d'oxyde de titane, le blanc de la peinture blanche, ou des gigantesques toiles blanches.
Tout cela est appelé géo-ingénierie. C'est étudié en recevant des financements intéressés. Ou encore, mettre en orbite des parasols titanesques. L'industrie pétrolière est prête à financer tout cela pour préserver la poule aux œufs d'or du pétrole.
Que de temps perdu
Que de temps perdu depuis la Conférence de Rio de 1992 qui a fait officiellement de l'effet de serre une préoccupation des Nations Unies en votant à l'unanimité la Convention-cadre sur les changements climatiques.
Que de temps perdu depuis la déposition devant le Congrès à Washington en 1988 du climatologue James Hansen de la NASA.
Que de temps perdu depuis la fondation en 1988 par l'Assemblée des Nations Unies du GIEC, le Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat dont les rapports font autorité depuis lors.
Que de temps perdu depuis son rapport de 1990 qui établissait que pour stabiliser le taux de CO2 dans l'atmosphère au double de sa valeur préindustrielle, c'est-à-dire environ 580 ppm, il faudrait réduire les émissions annuelles de CO2 de 60%. [23] Aujourd'hui en 2025, c'est encore 420 ppm mais ça monte chaque année.
Que de temps perdu depuis 1982 quand les ingénieurs de la compagnie pétrolière EXXON, dans un rapport secret, calculaient que la croissance de la consommation de pétrole allait augmenter le taux de CO2 dans l'atmosphère et par son effet de serre réchauffer le climat de la planète.
Que de temps perdu depuis 1959 quand le physicien nucléaire Edward Teller (1908-2003) exposait à l'Université de Columbia à New York que la combustion des carburants fossiles allait, par l'effet de serre, faire fondre les glaces après l'an 2000 et monter le niveau des mers. [24]
Que de temps perdu depuis 1954, quand une Air Pollution Foundation créée par les compagnies pétrolières et automobiles des États-Unis finançait les mesures du taux de CO2 dans l'air de Charles Keeling et envisageait les « conséquences planétaires » de son accroissement. [25]
Le marché contre le climat
De la COP1 à Berlin en 1995 à la COP3 en 1997 à Kyoto puis la COP 21 en 2015 à Paris, les puissances du monde ont cherché des moyens de lutter contre l'effet de serre qui ne dérangent pas les affaires ni les profits, et si possible des astuces pour atteler les lois mêmes du marché capitaliste à la tâche. Cela s'est révélé un mirage :
– Le commerce des droits d'émission de carbone s'est révélé un casino de spéculations financières. Ces marchés artificiels de droits et crédits d'émissions commercialisables ont produit peu de diminution des émissions de gaz à effet de serre. [26]
– Les fonds d'investissements verts et durables sont un leurre parce que les produits pétroliers sont bien plus rentables.
– La neutralité carbone est un faux-semblant car elle postule que les émissions de CO2 soient contrebalancées par son absorption par l'activité humaine, par les eaux et par la végétation. Mais cette absorption est difficile à mesurer exactement et elle est systématiquement exagérée pour éviter de couper dans les émissions. La neutralité carbone est actuellement une véritable arnaque qui permet aux entreprises de s'en réclamer en finançant des prétendus projets de fixation du CO2 par des parcelles de forêt qu'elles financent bon marché dans des pays pauvres. C'est ainsi que Air France, par exemple, s'engage à compenser depuis 2020 les émissions de ses vols en France métropolitaine grâce à des projets au Brésil, au Pérou, au Kenya, en Inde et au Cambodge. [27] En février 2019, le gouvernement français, dans sa nouvelle loi sur l'énergie, a remplacé l'objectif de diviser par 4 les émissions de CO2 de la France d'ici 2050, décidé en 2005 sous la présidence de Jacques Chirac, par l'objectif d'atteindre en 2050 la neutralité carbone, ce qui n'est pas du tout la même chose et implique la poursuite des émissions inchangées. [28]
Tous les instruments envisagés par les vingt-quatre conférences des Nations Unies sur le climat depuis 1992 restent à l'intérieur, pas seulement du capitalisme, mais plus précisément du néo-libéralisme qui est l'orthodoxie impérieuse depuis cinquante ans :
Enno Schröder et Servaas Storm de l'Institute for New Economic Thinking le jugent ainsi : « Nous serons capables de mettre fin progressivement aux émissions de gaz à effet de serre avant le milieu du siècle seulement si nous mettons nos sociétés et nos économies “sur un pied de guerre” (…) Notre analyse statistique montre que pour éviter une catastrophe climatique, le futur doit être radicalement différent du passé. La stabilisation du climat requiert un bouleversement fondamental des infrastructures des énergies fossiles, de la production et des transports, un bouleversement massif des intérêts privés dans les énergies fossiles et leur production, et des investissements publics à grande échelle – et tout cela devrait être fait au plus vite. L'analogie de Steffen d'une mobilisation massive face à une menace existentielle est fondamentalement correcte. Le problème pour la plupart des économistes, c'est que cela suggère une poussée directionnelle par des acteurs étatiques, cela a un goût de planification, de coordination et d'interventionnisme public, et cela va à l'encontre du système de croyances orienté vers le marché de la plupart des économistes. »[29] Et à l'encontre des intérêts économiques dominants.
Kevin Anderson et ses collègues jugent ainsi le temps perdu dans leur grand article de 2021 : « Pourquoi n'avons-nous pas infléchi la courbe des émissions ? » : « Les comptes rendus historiques suggèrent qu'il y avait à la fin des années 1980 déjà une compréhension partagée parmi des industriels influents, des scientifiques et des politiciens que le changement climatique d'origine humaine était une préoccupation réelle qui rendait l'action nécessaire. Ainsi le sujet fut traité par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1988, et le GIEC fut créé la même année. La prise de conscience publique de la question a commencé à se diffuser à travers le monde dans les années 1990, même si la compréhension était limitée. Si une action concertée et décisive avait été entreprise alors, des réductions modestes des émissions et une transition cumulative progressive d'abandon des combustibles fossiles aurait pu éviter une grande partie du changement climatique qui aujourd'hui a été inscrit irrémédiablement dans la Nature. Au lieu de cela, et en trente années seulement, plus de CO2fossile a été émis qu'auparavant dans l'histoire entière : 804 Gigatonnes durant les 240 années de 1750 à 1990 et 872 Gigatonnes durant les trente années de 1990 à 2019. » [30]
La courbe décisive
La courbe décisive à considérer, c'est celle de la croissance du taux de CO2 dans l'atmosphère. C'est la courbe de Keeling du nom de Charles Keeling (1928-2005) qui a mesuré heure par heure la concentration de CO2 depuis 1958 au sommet du Mauna Loa à Hawaï. En 1960, c'étaient 320 parties par million (0,32‰) ; en 1978 : 330 ppm. C'est aujourd'hui 420 ppm. La Conférence de Paris en 2015 prévoyait qu'en atteignant 1,5ºC de réchauffement en 2040, la courbe s'infléchirait enfin et le taux de CO2 cesserait d'augmenter et commencerait à baisser ou, tout au moins, à se stabiliser à 440 ppm (voir le graphique).
Pour redescendre à 400 ppm de CO2 dans l'atmosphère en 2050, ce qui correspondait à limiter la hausse de la température moyenne du globe à 2°C d'ici 2100, le GIEC a calculé qu'il faudrait diminuer pour cela d'ici 2050 le total des rejets dans l'atmosphère de gaz à effet de serre de 50% à 85%.
Si aucun infléchissement de la courbe n'a lieu avant 2100, la température planétaire aura alors augmenté de 3ºC depuis 1850. L'infléchissement de la courbe, vers 2050-2060 enfin, espérons-le, serait le début de la diminution du taux de CO2 dans l'air et donc d'une diminution de l'effet de serre qui réchauffe l'atmosphère. Mais on est loin.
Le site Carbon Brief vient de publier la courbe de la Chine qui montre un infléchissement depuis mars 2024 et une légère descente depuis lors. (cité par Adam Tooze, Chartbook 5 juin 2025). Mais c'est peut-être causé par des réductions de la production d'électricité qui brûle des combustibles fossiles, plus que par la réduction de ses émissions de CO2.
Graphique : Taux de CO2 dans l'atmosphère (courbe de Keeling). Graphique de 2023 du Meteorological Office du Royaume-Uni. Nous sommes en 2025 et aucun infléchissement de la courbe n'a eu lieu, la courbe continue de monter. Le zig-zag de la courbe est dû à l'alternance des saisons dans l'hémisphère Nord, qui a plus de masses continentales : en été la végétation est abondante et absorbe beaucoup de CO2, en hiver beaucoup moins. [31]
La catastrophe imminente
Dans le meilleur des cas, ce qui a été fait depuis 1992, ce sont des progrès dispersés, par exemple la génération de l'électricité par le soleil et le vent en Europe et les progrès de l'automobile électrique. Red Eléctrica, la gestionnaire du réseau électrique espagnol, rapporte que la production d'électricité par les renouvelables, hydroélectrique, photovoltaïque et éolienne, a atteint un maximum historique et continue de croître : en 2024, 56, 8% de la demande totale, 10% de plus que l'année précédente avec en 2024 un minimum historique d'émissions de CO2 par l'Espagne. [32] Le GIEC estime que dans le monde entier, le solaire et l'éolien représentent aujourd'hui 10% de la génération d'électricité. [33]
Mais les petits progrès sont sans cesse noyés par la croissance économique et la croissance de la consommation des combustibles fossiles ailleurs dans le monde. Et cela se fait en ordre dispersé, pays par pays, parfois ville par ville, les uns plus avancés, les autres plus en arrière. Il a été calculé qu'à ce rythme, il faudra un siècle et demi pour atteindre l'objectif de réduction des émissions de CO2 que la COP de Paris en 2015 fixait pour 2050.
La perspective effrayante et la terrible inaction des pouvoirs en place suscitent chez les jeunes conscients de l'enjeu, un désespoir, voire des suicides, et, surtout, un refus de faire des enfants qui devient fréquent et que les démographes commentent de plus en plus souvent. Mais le pire n'est pas certain et il est encore temps si les mesures efficaces sont mises en œuvre sans attendre, pour infléchir cette courbe de Keeling. Ma petite-fille a 5 ans, c'est pour elle que j'écris. Elle aura 40 ans en 2060. Quel avenir vais-je lui laisser ? Pendant combien de temps est-il encore temps ?
Daniel Tanuro a mis en exergue de son livre de 2020 les vers de François Villon de 1489 : « Frères humains qui après nous vivrez, N'ayez les cœurs contre nous endurcis. » [34]
Sans pression sociale rien ne se fera
Il est évident malheureusement qu'il n'existe aujourd'hui pas de rapport des forces social qui pousse les gouvernements à agir efficacement. Sans des mouvements populaires politisés qui exigent des mesures efficaces, les gouvernements et les capitalistes ne feront rien.
Un modèle, ce sont les manifestations massives contre les centrales nucléaires dans les années 1970 dans plusieurs pays. Un mouvement qui fut massif, insistant, inventif, avec des comités de base organisant beaucoup de gens et accumulant un savoir pour surveiller l'industrie nucléaire et les services étatiques compétents et polémiquer de façon informée contre eux.
C'est pour un tel mouvement que nous allons formuler plus loin des ébauches d'un programme de mesures de politiques publiques possibles. (2e partie à suivre le 16 juillet)
Notes
[1] Interview de Celeste Saulo, El Pais, 11 mars 2025.
[2] Isak Stoddard, Kevin Anderson, Stuart Capstick, Wim Carton, Joanna Depledge, Keri Facer, Clair Gough, Frederic Hache,Claire Hoolohan, Martin Hultman, Niclas Hällström, Sivan Kartha, Sonja Klinsky, Magdalena Kuchler, Eva Lövbrand,Naghmeh Nasiritousi, Peter Newell, Glen P. Peters, Youba Sokona, Andy Stirling, Matthew Stilwell, Clive L. Spash, and Mariama Williams,
“Three Decades of Climate Mitigation : Why Haven't We Bent the Global Emissions Curve ?”(Trois décennies d'atténuation du climat : Pourquoi nous n'avons pas infléchi la courbe des émissions globales ?),
Annual Review of Environment and Resources, www.environ.annualreviews.org, 29 june 2021.
[3] Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat / Intergovernmental Panel on Climate Change.
[4] Le Temps, Genève, 25 juillet 2023.
[5] Daniel Tanuro, « OPA fossile sur les COP », alencontre.org, 8 décembre 2023.
[6] El Pais, 30 avril 2025.
[7] Michael Roberts, « Fixing the climate – it just ain't profitable », thenextrecession.wordpress.com, 23 juin 2024.
[8] Nations-Unies, World Economic and Social Survey 2011 : The Great Green Technological Transformation, Genève, 5 juillet 2011, cité par Daniel Tanuro, Trop tard pour être pessimistes ! Écosocialisme ou effondrement, éditions Textuel, Paris, 2020, page 105.
[9] Daniel Tanuro, « COP 28, Ahmed al-Jaber inscrit son nom dans l'histoire de l'enfumage capitaliste », alencontre.org, 15 décembre 2023.
[10] Daniel Tanuro, L'impossible capitalisme vert, La Découverte, Paris, 2010
[11] Mark Lynas, Our Final Warning, Six Degrees of Climate Emergency, HarperCollins, Dublin, 2020, pp. 167-211.
[12] Agence Internationale de l'Énergie/AIE, cité par Alain Bihr, “Le mirage des énergies « renouvelables »”, alencontre.org, 15 octobre 2024.
[13] El Pais, 29 mai 2025.
[14] El Pais, 26 mai 2025.
[15] The Nation, 10 septembre 2019. Naomi Klein est l'autrice de nombreux ouvrages dont :Tout peut changer : Capitalisme et changement climatique, Toronto, Alfred A.Knopf, 2014.
[16] Gilbert Achcar, « Néofascisme et changement climatique », Mediapart, 7 juillet 2025.
[17] Michael Roberts, « Fixing the climate – it just ain't profitable », thenextrecession.wordpress.com, 23 juin 2024.
[18] Le Temps, Genève, 25 juillet 2023.
[19] Pascaline Minet, “ La capture du carbone au cœur des débats à la COP28”, Le Temps, Genève, 9 décembre 2023.
[20] Kevin Anderson, The Hiddden Agenda : How Veiled Techno-Utopias shore up the Paris Agreement, (Le plan caché : Comment des utopies technologiques cachées soutiennent l'accord de Paris), https://www.geoengineeringmonitor.org
[21] Daniel Tanuro, Trop tard pour être pessimistes, op. cit., p.148.
[22] Robert Lochhead, « Effet de serre, Pour quelques degrés de plus », page*2. no. 8/9, janvier -février 1997.
[23] Robert Lochhead, art. cit.
[24] Benjamin Franta, « Ce que le Big Oil savait sur le changement climatique, selon ses propres termes », The Conversation, 28 octobre 2021, traduction alencontre, 7 novembre 2021.
[25] Oliver Milman, « L'industrie des combustibles fossiles était au courant du danger climatique dès 1954 », alencontre.org, 31 janvier 2024, traduction de The Guardian, 30 janvier 2024.
[26] Daniel Tanuro, L'impossible capitalisme vert, La Découverte, Paris, 2010, page 290.
[27] Coralie Schaub et Aurore Coulaud, « La “neutralité carbone” : la grande arnaque.“Le seul zéro qui compte, c'est à la source” », Libération, 4 novembre 2021, alencontre.org.
[28] Arjuna Andrade, « France/Climat. Macron ordonne “ne changez rien” », Les nouvelles de l'éco, France Culture, 11 février 2019, alencontre.org.
[29]https://braveneweurope.com/enno-schroder-and-servaas-storm-why-green-growth-is-an-illusion
[30] Isak Stoddard, Kevin Anderson, et al. art.cit.
[31] Martina Igini, “Atmopsheric CO2 Jump in 2024 off Track With Trajectory Needed to Meet 1,5C Goal, Met Office Says”, Earth Org, Jan 19th 2024.
[32] El Pais, 30 avril 2025.
[33] Le Temps, Genève, 3 septembre 2023.
[34] Daniel Tanuro, Trop tard pour être pessimistes ! Écosocialisme ou effondrement, éditions Textuel, Paris, 2020.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Débat. « Vers 3ºC de plus en 2100. Faire ce qu’il est possible de faire » (II)

Tiré de A l'encontre
16 juillet 2025
Par Robert Lochhead
La merveilleuse Greta Thunberg a eu cent fois raison de qualifier ces conférences annuelles COP des cirques. Elles sont d'ailleurs aussi des foires commerciales et les lieux de tous les lobbyings. Elles noient les gouvernements disposés à agir au milieu de ceux qui freinent et de ceux dont on ne peut rien espérer comme les pays pétroliers. L'unanimisme de ces conférences a pour fonction d'éviter ce que les capitalistes appellent la distorsion de la concurrence : il faut universaliser les politiques afin d'éviter que, sur le marché mondial, les pays qui agissent soient concurrencés avec succès par ceux qui n'agissent pas mais s'économisent le coût des mesures efficaces. Cela repose donc sur l'idée que la lutte contre le réchauffement climatique est défavorable aux affaires.
Pour des conférences des gouvernements disposés à agir
Le croira-t-on ? La résolution adoptée par la COP 28 à Dubaï fut la première de l'histoire des COP à inclure les mots « fossil fuels/ combustibles fossiles »[1]
Car la Convention-cadre adoptée à l'unanimité par la Conférence de Rio en 1992 ne parlait, elle, que « d'éviter une perturbation anthropique dangereuse du système climatique. »
Il faudrait exiger des conférences internationales des pays disposés à agir efficacement et qui constituent une masse suffisante pour avoir un effet notable sur la planète, ce qui est appelé diplomatiquement « union of the willing. »Par exemple, l'Union européenne plus le Canada, l'Australie et la Nouvelle Zélande, soit des pays où une pression populaire, une force démocratique, peut s'exercer sur les gouvernements. Plus la Chine, si elle réalise ses promesses de mesures efficaces contre le réchauffement climatique. Étant entendu que d'autres pays pourraient rejoindre plus tard.
Mais redisons-le : Sans pression sociale, rien ne se fera !
Pour un New Deal Vert ou un Projet Manhattan pour le climat
Il n'existe aujourd'hui aucun rapport de forces social pour un écosocialisme même si c'est la solution véritable. Cela imposerait rien moins qu'abolir le capitalisme. Mais il faut proposer à un mouvement social des objectifs prioritaires, à court et moyen terme, qui soient le ferment d'une lutte à long terme plus globale. Des objectifs qui soient repris par un mouvement social comme un pont entre la situation actuelle et la nécessaire transition ces prochaines années vers des objectifs de transformation à grande échelle plus vastes si le mouvement social se renforce. [2]
Il doit être possible de proposer des mesures fortes d'action gouvernementale et d'intervention étatique dans l'économie, comme évoquées dans la première partie de l'article, et pousser pour les imposer aux gouvernements. L'urgence d'éviter un monde à + 3ºC en 2100 n'est-elle pas suffisante pour des mesures comparables aux politiques de guerre des deux guerres mondiales, c'est-à-dire des injections massives d'argent public ?
Naomi Klein et beaucoup d'autres auteurs proposent un New Deal Vert parce que le New Deal de 1933 du président Franklin Roosevelt est un précédent d'un capitalisme corrigé par des grandes entreprises publiques. Avant 1990 et les privatisations néolibérales, il y avait encore des entreprises publiques, des banques publiques et des industries publiques, et des politiques économiques publiques, qui seraient aujourd'hui des points d'appui pour une action publique ambitieuse contre le réchauffement climatique.
Le New Deal de 1933-1938 a créé cette grande entreprise publique hydroélectrique, et de mise en valeur de la vallée du fleuve Tennessee, la Tennessee Valley Authority, qui a employé jusqu'à 30'000 salariés, et le Projet Manhattande 1941-1945 qui a construit la bombe atomique avec des usines publiques gigantesques employant 130'000 employés fédéraux.
Le projet Manhattan a coûté au budget fédéral deux milliards de dollars. Deux milliards de dollars d'alors équivalent aujourd'hui à un pouvoir d'achat de 40 milliards de dollars. C'est l'ordre de grandeur des investissements récents dans l'Intelligence Artificielle.
En 2019, le sénateur Bernie Sanders et la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, les deux animateurs des Democratic Socialists of America, ont proposé un programme de Green New Deal qui prévoit d'injecter en 10 ans 16'000 milliards de dollars d'argent public pour la transition énergétique. Daniel Tanuro juge ce projet très réjouissant mais lui reproche d´être bien vague quant aux sources de financement, n'envisageant même pas une ponction fiscale sur les riches.[3]
Brian Deese du MIT, qui fut un haut fonctionnaire de la Maison Blanche sous Joe Biden, propose un Plan Marshall contre le réchauffement climatique en offrant au monde un grand financement public US pour exporter les bonnes technologies d'énergie propre des États-Unis, comme par hasard celles qui intéressent les compagnies pétrolières : la capture du CO2, l'hydrogène vert, produit à partir du pétrole ou du gaz naturel, l'énergie géothermique, plus le nucléaire. Ben voyons !
Mais l'idée d'un plan Marshall et, surtout, sa dimension sont intéressantes. Le Plan Marshall de 1947 pour reconstruire l'Europe eut un financement de 13 milliards $ jusqu'en 1952, ce qui correspond à 200 milliards $ d'aujourd'hui. Cela fut alors 5% du PIB des Etats-Unis, ce qui serait aujourd'hui 1000 milliards $. [4]
Des mesures concrètes quantifiées et popularisées
Jusqu'ici, on a compté sur des petites améliorations progressives, chaque année un peu moins de charbon, un peu plus d'électricité solaire, un peu plus de voitures électriques, un peu plus d'investissements dans des entreprises « vertes ». Ce qu'il faut, c'est des grosses tranches de mesures efficaces d'un coup, pour marquer une dynamique, pour mobiliser le grand public, pour démontrer que c'est possible.
Des mesures efficaces sont possibles qui ne soient pas d'avance choisies pour leur ajustement aux préférences du marché capitaliste mais qui n'y sont pas forcément contraires. Une liste doit être élaborée pour constituer un plan discuté publiquement.
Je commence par en citer seulement 5 exemples en attendant que la liste s'allonge par une réflexion collective. Chaque exemple mériterait, bien sûr, d'être développé car c'est plus facile à dire qu'à faire. Encore faut-il vouloir faire !
A-Remplacer tout le chauffage des bâtiments au mazout et au gaz naturel par du chauffage électrique, par une campagne volontariste sur 10 ans dans toute l'Europe.
Le chauffage des bâtiments, tant d'habitation qu'administratifs, commerciaux et industriels, consomme environ 35% de l'énergie totale consommée en Suisse. Principalement sous la forme de mazout et de gaz naturel. [5] Par conséquent, ce remplacement en Europe -en plus d'autres pays volontaires comme le Canada et l'Australie-, devrait permettre d'infléchir enfin un peu cette terrible courbe de Keeling.
Cela veut dire imposer aux propriétaires des immeubles des délais, subventionner massivement la production, l'achat et l'installation de nouveaux chauffages électriques, accroître en proportion la production d'électricité, par des moyens autres que les combustibles fossiles s'entend, et le réseau qui la distribue.
Bill McKibben nous signale cette mesure d'électrification du chauffage en présentant sous le titre The Future Is Electric dans la New York Review of Books du 4 novembre 2021 le livre de l'ingénieur Saul Griffith pour le remplacement des combustibles fossiles par l'électrification :
« Si nous devons couper en deux les émissions dans la présente décennie – un impératif – nous devons tailler dans l'usage des combustibles fossiles en grosses tranches, pas des petites. (…) Nos maisons consomment environ un cinquième de toute l'énergie, la moitié pour le chauffage et la climatisation, et un autre quart pour chauffer l'eau. “Le joyau des banlieues, la villa unifamiliale, domine la consommation d'énergie, loin devant les grands appartements au deuxième rang”, avertit Griffith. Le secteur de l'industrie consomme plus d'énergie – environ 30 quadrillons de BTUs – mais un grand pourcentage surprenant en est dépensé pour “trouver, extraire et raffiner les combustibles fossiles”. »[6] Bill McKibben est l'éminent militant écologiste, ami du sénateur Bernie Sanders, régulièrement menacé de mort depuis 1990.
B-Moteurs électriques pour tous les camions et bus
Il est énormément question de l'augmentation des voitures électriques. Mais cela bute sur les faibles revenus et le scepticisme des millions de salariés automobilistes dont beaucoup roulent avec des voitures anciennes.
Dans les pays industrialisés, les transports consomment 32% de l'énergie finale, fournie à 90% par les carburants fossiles. Les transports routiers 74%, les avions 11,4% et les bateaux 13%, le rail 1,4%. L'Agence Internationale de l'Énergie calcule que bien qu'ils ne constituent que 8% des véhicules, les camions et les bus consomment 35% des carburants du transport routier et dégagent donc autant du CO2 émis. 35% de 74% de 32% sont 8,3% : camions et bus émettent donc 8,3% du CO2 total émis contre 15,4% les véhicules légers.[7]
Il serait plus facile d'électrifier rapidement camions et bus qui sont relativement moins nombreux et appartiennent pour la plupart à des entreprises importantes qui en ont les moyens. Il faut donc obliger les propriétaires de tous les camions et tous les bus à passer en cinq, ou dix ans, à des moteurs électriques, moyennant des subventions étatiques pour faciliter une telle transition.
L'Union européenne a édicté qu'en 2035 plus aucune automobile à moteur thermique ne pourra être mise en service. Pour les camions et bus, tiens donc ?, l'objectif est moins strict, seulement des émissions plus basses. Ce que je propose, c'est d'inverser cela et électrifier d'abord à marche forcée les camions et bus.
Dans son excellent article récent sur la voiture électrique, Alain Bihr expose que l'avantage des voitures électriques sur les voitures à moteur à explosion n'est vraiment substantiel que si leur fabrication et l'extraction de leurs matériaux, en particulier les métaux des piles, soient réalisés en consommant le moins de combustibles fossiles possible, c'est-à-dire essentiellement à base d'énergies renouvelables. Mais heureusement, les faits qu'il expose démentent le titre négatif de son article : « La voiture électrique, une alternative illusoire. » Mais par ailleurs, il a raison qu'il est indispensable de diminuer parallèlement le trafic automobile : [8]
– Diminuer le transport des marchandises par camions au profit du rail. Le transport des marchandises par le rail, c'est 29,7% en Suède, 22% en Italie, 20,6% en Allemagne, 38% en Suisse, mais seulement 9,2% en France et 4,2% en Espagne. [9]
– Dissuader les automobiles transportant une seule personne et imposer un minimum de deux personnes sur les trajets particulièrement chargés du domicile au lieu de travail. Sur le Golden Gate Bridge de San Francisco, le péage est fortement réduit si trois ou plus d'occupants par véhicule. En Suisse, le trajet Lausanne-Genève, 70 km, est l'autoroute la plus chargée de Suisse. C'est un va et vient de pendulaires entre ces deux pôles économiques du Léman. On pourrait y décourager catégoriquement d'un coup la présence d'une seule personne dans chaque voiture.
C-Remplacer tous les vols de moins de 1000 km par le train. Il faut chiffrer leur contribution aux émissions de CO2 et donc la contribution de leur abandon à leur diminution.
Dans toutes l'Europe, sauf curieusement en Espagne, les trains de nuit ont été récemment redéveloppés et connaissent un grand succès. C'est réjouissant.
Certains proposent un rationnement des vols en avions. C'est impossible à tous égards. Pour la complexité de l'application et parce que cela va nuire avant tout à la population la moins aisée pour qui les voyages et les vacances en avions sont devenus une consommation courante de vacances.
C+–Les mouvements écologistes réclament l'interdiction des avions privés. Dans le triomphalisme actuel des super-riches, c'est probablement impossible. Mais l'État pourrait exiger que leurs avions soient à la pointe de la motorisation sans rejets de CO2. Ils peuvent se le payer : Moteurs électriques avec grandes piles au lithium, moteurs à hydrogène. Et qu'ils servent de démonstration pour les nouveaux avions de ligne.
D-Stimuler l'économie des pays d'Afrique noire pour lui permettre de supporter le réchauffement climatique.
L'Afrique noire est particulièrement menacée par le réchauffement climatique de par sa latitude et, surtout, de par sa pauvreté et son marasme économique. Son réchauffement va produire des migrations massives vers le Nord, le Maghreb et la Méditerranée et l'Europe, et vers le Sud, vers l'Afrique du Sud.
Deux mesures efficaces peuvent être prises immédiatement et produire leurs effets salutaires rapidement :
-Remettre la dette astronomique des pays d'Afrique noire, ce qui est revendiqué, et parfois promis, depuis longtemps. Afin de permettre à ces pays les dépenses publiques dont ils ont besoin. Et qui leur permettront de prendre des mesures contre le réchauffement climatique.
En l'an 2020, l'Afrique subsaharienne devait 702 milliards de dollars aux institutions financières du Nord, et leur servait chaque année 44 milliards d'intérêts. Pour certains de ces pays, ce sont 60% de leurs revenus annuels. Ainsi les pays les plus pauvres du monde financent les banques du Nord, et cela depuis des décennies. [10]
-Abolir le Franc CFA des anciennes colonies françaises. C'est un carcan déflationniste, et néo-colonialiste, piloté depuis Paris qui empêche ces quinze pays de moduler une monnaie nationale pour stimuler leurs exportations.[11]
De façon cruelle, on rétorquera que cela augmentera leur consommation de produits pétroliers et leurs émissions de CO2. Dans un premier temps assurément, mais des mesures correctrices peuvent plus facilement être prises par des pays à l'aise financièrement que sans cesse étranglés par leur dette. Et la diminution des émissions des pays riches peut compenser cet effet négatif provisoire chez les pays pauvres.
E-Subventionner partout dans le monde la reforestation pour augmenter fortement la surface boisée et pas seulement la maintenir.
Planter des arbres n'est pas cette panacée pour ceux qui la financent pour ne pas avoir à diminuer leur consommation de combustibles fossiles. Couvrir d'arbres les continents ne peut pas remplacer la diminution des combustibles fossiles.
Mais les forêts sont réellement des puissants puits de CO2 qui en diminuent le taux dans l'atmosphère. Il faut en accroître la surface dans tous les pays au-delà des limites traditionnelles. Certes, cela va être en partie un travail de Sisyphe car une course de vitesse contre le desséchement et les incendies, accrus par le réchauffement du climat. Mais la reforestation est un travail peu coûteux de faible technologie, de forte intensité de main-d'œuvre, et qui a l'avantage de permettre la mobilisation de nombreux volontaires, et même des milliers d'enfants, pour planter des petits arbres.
Il faut planter des forêts dans tous les pays, même un pays qui se croit modèle comme la Suisse parce qu'elle a bloqué sa surface de forêts par sa Loi de 1902, renouvelée par le nouveau texte de 1991. Donc pour la Suisse, planter activement au-delà de la limite de 1902.
Il s'agit ici, bien sûr, de planter des forêts durables, pour toujours, avec des espèces d'arbres spécifiques, adaptées à l'écosystème local, et non ces monocultures d'espèces intruses destinées à servir de combustible dans les BECCS. En outre, il n'y a pas à planter d'arbres dans les savanes et les tourbières qui absorbent beaucoup de CO2. [12]
– Dans la dernière période, l'Espagne et l'Écosse ont réalisé des campagnes volontaristes de reboisement, pour citer ces deux pays comme exemples. Depuis 1990, la surface de forêts en Espagne a augmenté de 33,6%. Depuis la création du parlement et du gouvernement écossais en 1999, la Forestry Commission Scotland a planté 84% des surfaces reforestées au Royaume-Uni. Jusqu'en 2018, le gouvernement écossais avait fait planter 11'200 nouveaux hectares de forêts et il prévoit de planter 15'000 ha par année dorénavant. La nouvelle autonomie écossaise veut réparer le déboisement massif des siècles passés pour la construction des bateaux et l'élevage extensif, quand l'Écosse était dominée par l'Angleterre.
– L'Amazone et toutes les forêts tropicales humides sont en recul et doivent être préservées et agrandies. Cela implique un subventionnement massif de la part des pays riches, de la reforestation d'une part mais surtout pour dédommager tous les humbles gens qui défrichent et endommagent la forêt à la recherche d'un gagne-pain.
Il faut proposer une agence de l'ONU qui regroupe tous les pays qui portent la forêt tropicale humide : Brésil, Pérou, Bolivie, Colombie, Venezuela, les Guyanes, Panama, Costa Rica, Guatemala, Bélize, Gabon, Cameroun, Congo, Angola, Indonésie, Malaisie, Timor, Birmanie, Thaïlande, Laos, Cambodge, Vietnam, ma liste n'est pas exhaustive !
Depuis 2023, les huit pays de la forêt amazonienne sont réunis par une association pour le moment assez vague.
Une telle agence doit stimuler protection et reforestation, et études, recevoir et distribuer les subventions internationales, sanctionner gouvernements et entreprises, organiser collectivement la lutte contre les incendies.
– Depuis 2002, l'Union africaine encourage la plantation de la Grande Muraille Verte de Dakar à Djibouti pour verdir le Sahel et faire barrage au désert du Sahara : 7500 km sur 15 km de large. Cette Grande Muraille Verte doit être largement subventionnée par les pays riches et accélérée pour aller à l'encontre de la désertification. Vingt pays ont constitué l'Agence panafricaine de la grande muraille verte. À ce jour, seulement 15% ont été plantés, principalement au Sénégal et en Éthiopie. Mais entre deux, c'est malheureusement le Sahel des pires guerres civiles et massacres.
Le modèle, c'est la grande muraille verte de Chine parallèle à la Grande Muraille pour faire barrage au désert de Gobi. Dans le Sahel africain, la grande muraille verte pose, bien sûr, des problèmes complexes d'interaction avec les populations et de développement rural, pour ne pas parler des guerres civiles.
Le projet est soutenu par toutes les agences de l'ONU et par la Banque mondiale et l'Union européenne.
– Les campagnes de reforestation doivent également boiser l'intérieur des villes, pour créer des forêts urbaines qui rafraîchissent l'air et l'ambiance pendant les grandes chaleurs. Cela permet, par exemple, de mobiliser les enfants des écoles pour planter les plantons.
Une levée sur la fortune des super-riches
Pour déployer les énergies renouvelables sur dix ans, l'Union européenne calcule qu'il faudra 600 milliards d'investissements. [13]
L'ancien directeur général de l'OMC, Pascal Lamy, estime que la lutte contre le changement climatique coûtera 1700 milliards de dollars par année pour la Terre entière. [14]
L'économiste Cédric Durand, de l'Université de Genève, chiffrait cela ainsi en 2021 : « L'autre aspect de la transition est une forte poussée d'investissement pour faire face au choc de l'offre causé par la décroissance du secteur du carbone (…) Dans son dernier rapport sur l'énergie, Bloomberg (New Energy Outlook 2021) estime qu'une économie mondiale en croissance nécessitera un niveau d'investissement dans l'approvisionnement et les infrastructures énergétiques compris entre 92'000 et 173'000 milliards de dollars au cours des trente prochaines années. L'investissement annuel devra plus que doubler, passant d'environ 1700 milliards de dollars par an aujourd'hui à une moyenne comprise entre 3100 et 5800 milliards de dollars par année. » [15]
En particulier, beaucoup d'argent sera nécessaire pour aider, dédommager, subventionner, toutes celles et tous ceux, entreprises et particuliers, qui seront lésés par l'abandon des combustibles fossiles.
De COP en COP, ce sont 1300 milliards $ qui ont été promis aux pays dits en développement pour chaque année dès 2035. Une grande partie seront des prêts, qui vont augmenter leur dette, et le reste devrait être des investissements privés. Cela reste vague. [16] Ce sont des promesses. Pour le moment, même les 100 milliards par année promis pour le Fonds vert pour le Climat, destiné à être géré par la Banque mondiale, n'ont pas été versés par les pays riches. Entretemps, durant l'année 2021-2022, les compagnies pétrolières et gazières ont fait 4000 milliards $ de bénéfices. [17]
Plusieurs auteurs ont proposé de financer la lutte contre le réchauffement climatique par l'impôt sur les super-riches.
Pour sortir de la grande récession de 2008, la Fed a injecté dans l'économie mondiale 4500 milliards de dollars entre 2008 et 2010.[18]
Pour se réarmer, l'UE prévoit aujourd'hui de dépenser 650 milliards d'Euros.
La Première Guerre mondiale et la défaite ont coûté à l'Allemagne 73 milliards de marks-or. [19] Adaptés au coût de la vie, ce sont 250 milliards € d'aujourd'hui. Elle a financé cela par l'impôt et des emprunts parmi sa population.
– Le 31 décembre 1919, Matthias Erzberger (1875-1921), le ministre des finances de l'Allemagne, vaincue, accablée de dettes, faisait voter une levée sur la fortune (Reichsnotopfer) qui a été en vigueur durant trois ans. Le taux en était progressif, débutant à 10% et montant jusqu'à 65% pour les fortunes de plus de 2 millions de marks. [20]
– Ces dernières années, les Jeunesses socialistes suisses ont par deux fois réussi à faire soumettre à votation populaire un impôt sur la richesse :
En 2019, les JS déposaient avec 109'332 signatures de citoyens suisses leur initiative fédérale « Alléger les impôts sur les salaires, imposer équitablement le capital » dite initiative 99%. Le texte prévoyait que les revenus du capital du 1% des contribuables les plus riches, supérieurs à 100'000 francs, seraient taxés comme 1,5 fois plus grands, ce qui augmenterait de 5 à 10 milliards de francs les rentrées fiscales, afin d'alléger les impôts des petites fortunes. L'initiative fut soumise à votation populaire en 2021 et rejetée, mais en remportant 35,12% des voix.
En février 2024, les JS déposaient avec 140'000 signatures leur initiative dite « pour l'avenir » qui prévoit de taxer à un taux de 50% les successions et donations de plus de 50 millions de francs « pour financer la politique climatique ». L'initiative vient d'être rejetée par les deux chambres du Parlement, approuvée par la Parti socialiste en minorité, et sera soumise à votation populaire le 30 novembre 2025 prochain.
Le patronat et les partis bourgeois, majoritaires au parlement suisse, ont combattu férocement les deux initiatives en les qualifiant de « confiscatoires » et nuisibles à l'investissement et à la prospérité.
– Lors du World Economic Forum de janvier 2023 à Davos, Oxfam a présenté sa proposition d'un impôt sur les super-riches, de 2% pour les millionnaires, 3% pour ceux qui possèdent plus de 50 millions de dollars, et 5% pour les milliardaires, qui rapporterait 37 milliards de dollars par an rien qu'en Suisse. Cela afin de lutter contre la pauvreté. [20]
Selon la revue Bilan de décembre 2024, les 25 plus grandes fortunes de Suisse étaient :
– Gérard Wertheimer, 37 milliards
– Famille Hoffmann Oeri, 28 milliards
– Famille Duschmalé, 28 milliards
– Klaus-Michael Kühne, 27 milliards
– Famille Joseph Safra, 22 milliards
– Famille Aponte, 20 milliards
– Jorge Lehmann, 17 milliards
– Andrey Melnichenko, 17 milliards
– Famille Bertarelli, 15 milliards
– Famille Blocher, 15 milliards
– Famille Firmenich, 14 milliards
– Guillaume Pousaz, 14 milliards
– Famille Bonnard et Schindler, 13 milliards
– Famille Brenninkmeijer, 13 milliards
– Famille Castel, 13 milliards
– De Carvalho-Heineken, 12 milliards
– Famille Charlen, 12 milliards
– Famille Khan, 12 milliards
– Famille Mortimer Sackler, 11 milliards
– Nicolas Puech, 11 milliards
– Johann Rupert, 11 milliards,
– Prince Hans-Adam de Liechtenstein, 10 milliards
– Famille Liebherr, 9 milliards
– Marcel Telles, 9 milliards
– Famille Landolt, 8 milliards Total : 398 milliards CHF
Disons 7%. Une levée de 7% sur ces 25 contribuables produirait 27,8 milliards de francs suisses, approximativement autant d'Euros. Et ce ne sont que les 25 plus riches. Et 7%, ce n'est pas beaucoup. Ce taux pourrait être progressif, par exemple de 7% à 15%. Ce numéro de Bilan recense 313 contribuables en descendant jusqu'à 200 millions de francs de fortune dont 53 qui possèdent un milliard et plus. En Suisse seulement. Ces 313 contribuables totalisent une fortune de 910,85 milliards. Une levée de 7% produirait donc 63,75 milliards de francs suisses. Le « moins riche » avec 200 millions de francs de fortune devrait payer 14 millions.
Le même calcul pourra être fait pour d'autres pays. Prenons encore l'exemple de l'Espagne où j'habite maintenant :
Selon la revue Forbes de novembre 2023, les 25 plus fortunés d'Espagne étaient :
– Amancio Ortega, 81,8 milliards €
– Sandra Ortega, 7,1 milliards €
– Rafael del Pino, 5,9 milliards €
– Juan Carlos Escotet, 4 milliards €
– Juan Roig, 3,9 milliards €
– Tomás Olivo, 3,5 milliards €
– Daniel Maté, 2,9 milliards €
– Juan Abelló, 2,9 milliards €
– Leopoldo Del Pino Calvo-Sotelo, 2,7 milliards €
– Famille Andic, 2,7 milliards €
– Miguel Fluxá Roselló, 2,5 milliards €
– María Del Pino Calvo-Sotelo, 2,5 milliards €
– Alicia Koplowitz, 2,4 milliards €
– Victor Grifols Roura y familia, 2,4 milliards €
– Hortensia Herrero, 2,2 milliards €
– Sol Daurella Comadrán, 2 milliards €
– Florentino Pérez, 1,9 milliards €
– Guillermo Fierro Eleta, 1,9 milliards €
– Juan María Riberas Mera, 1,6 milliards €
– Simon Pedro Barceló Vadell y familia, 1,6 milliards €
– Francisco Riberas Mera, 1,5 milliards €
– Alberto Palatchi, 1,5 milliards €
– José María Serra Farré y familia, 1,5 milliards €
– Carmen Thyssen, 1,4 milliards €
– Albert Cortina, 1,4 milliards €
Cela fait un total de 145,7 milliards €. Une levée de 7% produirait donc 10,2 milliards €.
Cette liste Forbes énumère les 100 personnes plus riches d'Espagne, en descendant jusqu'à 349 millions €, totalisant une fortune de 196,2 milliards €. 7% de 196,2 milliards € sont 13,73 milliards €.
On peut donc estimer que si on répète ces calculs pour les 47 pays d'Europe, on arriverait avec ces 7% de levée sur les fortunes des quelques centaines de super-riches de chaque pays d'Europe, à un produit total d'environ 1000 milliards €.
– Un groupe international d'économistes emmenés par Thomas Piketty du Laboratoire de l'Inégalité Mondialeproposait en 2023 pour lutter contre le réchauffement climatique, une taxe sur la fortune des 65'130 personnes du monde qui possèdent plus de 100 millions de dollars (0,001% de la population), avec un taux de 1,5% jusqu'à 3%, qui permettrait de lever chaque année 300 milliards de dollars. [22]
– Plus modestement, l'économiste Gabriel Zucman, qui avait été en 2013 le doctorant de Thomas Piketty, a réussi à faire voter par la Chambre des députés française le 20 février 2025 dernier, sur proposition de la NUPES, une taxe plancher de 2% sur les patrimoines de plus de 100 millions €, soit 4000 personnes en France, contre la volonté du président Macron qui accepterait cette taxe si elle était mondiale. Ce taux plancher veut dire que l'impôt sur le revenu de ces riches contribuables ne pourrait pas être inférieur à 2% de leur patrimoine. La loi est devant le Sénat. Cette taxe pourrait rapporter quelque chose de l'ordre de grandeur de 10 milliards €. Gabriel Zucman a rédigé un rapport sur une telle taxe, mais mondiale, à la demande de la présidence brésilienne du G20. [23]
Les moyens financiers existent donc, en abondance, facilement accessibles pour les autorités fiscales des États, pour financer le sauvetage de l'humanité des terribles + 3ºC en l'an 2100.
Toutes et tous ces super-riches, qui sont les puissants actionnaires des entreprises capitalistes, voient depuis des années leur fortune augmenter chaque année et réussissent à échapper largement à l'impôt. Il est important de les nommer toutes et tous, pour créer une pression sociale sur elles et eux.
Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils se désolidarisent du sort des milliards d'habitants de cette planète. (Juin 2025)
Notes
[1] Daniel Tanuro, « COP 28, Ahmed al-Jaber inscrit son nom dans l'histoire de l'enfumage capitaliste », alencontre.org, 15 décembre 2023.
[2] Je paraphrase le Programme de Transition de Léon Trotsky de 1938. Je n'ai vraiment pas la prétention de proposer un « programme de transition » pour la lutte contre le réchauffement climatique. Si tant est que cela puisse avoir un sens dans les circonstances si différentes. Mais c'est une inspiration pour combler l'écart entre la politique quotidienne et le « programme maximum », le but humaniste qu'il faut viser : l'écosocialisme.
[3] Daniel Tanuro, Trop tard pour être pessimistes ! Écosocialisme ou effondrement, éditions Textuel, Paris, 2020, pp. 303-306.
[4] Brian Deese, « The Case for a Clean Energy Marshall Plan, How the Fight Against Climate Change Can Renew American Leadership », Foreign Affairs, foreignaffairs.com, september 2024. Adam Tooze, Chartbook 319, adamtooze@substack.com, sept. 2024
[5] Statistique globale de l'énergie 2023, Office fédéral suisse de l'énergie.
[6] Bill McKibben, « The Future is Electric », The New York Review of Books, November 4th 2021. Saul Griffith, Electrify : An Optimist's Playbook for Our Clean Energy Futur, MIT Press, Cambridge MA, 2021. Une British Thermal Unit/BTU = 1055 kilojoules. De Bill McKibben en français : La Nature assassinée, Fixot, 1994 (1re éd. 1989).
[7] eurostat/statistics et iea trucks and buses
[8] Alain Bihr, “La voiture électrique, une alternative illusoire”, alencontre.org, 11 novembre 2024.
[9] El Pais, 22 juin 2025.
[10] CADTM, décembre 2022.
[11] Ndongo Samba Sylla, « The Franc Zone, A Tool of French Neocolonialism in Africa », Jacobin.com, 1er juin 2020. CFA= Communauté financière en Afrique
[12] Élise Buisson, Marie Ange Ngo Bieng, Thierry Gauquelin, « Pour un reforestation raisonnée », Pour la Science, novembre 2021.
[13] El Pais, 4 mai 2025.
[14] Le Temps, Genève, 28 juillet 2023.
[15] Cédric Durand, « Le dilemme énergétique. (Et la voie d'une transition écologique démocratique », NLR-Sidecar, alencontre.org, 5 novembre 2021.
[16] Bernardo Jurema, « Will COP 30 Deliver for the Amazon – and the Planet ? », jacobin.com. 23 décembre 2024.
[17] Daniel Tanuro, « COP 28, Ahmed al-Jaber inscrit son nom dans l'histoire de l'enfumage capitaliste », alencontre.org, 15 décembre 2023.
[18] Adam Tooze, « The Forgotten History of the Financial Crisis », Foreign Affairs, September/October 2018.
[19] Isaac Johsua, La crise de 1929 et l'émergence américaine, Presses Universitaires de France, Paris, 1999, p.184.
[20]- Feuille des Lois du Reich/ReichsgesetzBlatt Nr.252, S. 2188.
[21] Le Temps, Genève, 16 janvier 2023.
[22] El Pais, 31 janvier 2023.
[23] Libération, 21 février 2025.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Sahel : sortir de l’impasse militariste

Que se passe-t-il actuellement au Sahel ? Paul Martial nous décrit l'évolution des rapports de force militaires en les réinsérant dans les contextes politiques et sociaux propres aux différents pays de la région.
Tiré du site web de la revue Contretemps.
Vendredi 13 juin. À peine arrivés au Mali, des mercenaires de la nouvelle structure militaire russe Africa Corps remplaçant Wagner, la milice d'Evgueni Prigojine décédé, sont tombés dans une embuscade entre Anefis et Aguelhoc dans la région de Kidal. Le bilan est lourd. Plusieurs dizaines de morts sont évoquées. L'opération est revendiquée par le Front de libération de l'Azawad (FLA) regroupant majoritairement les indépendantistes touarègues.
Ce traquenard met à mal le narratif présentant les mercenaires russes, qu'ils soient de Wagner ou d'Africa corps (et bien souvent appartenant successivement aux deux entités), comme de redoutables combattants qui, sur le terrain militaire, étaient censés faire la différence. Il relativise aussi le seul succès dont peut se prévaloir Wagner, à savoir la récupération de Kidal, place forte des mouvements indépendantistes touarègues et présentée par les autorités maliennes comme la reconquête de la souveraineté nationale qui se révèle pour le moins précaire.
Le remplacement de Wagner par Africa Corps ne va pas modifier en profondeur la relation entre les autorités maliennes et les supplétifs russes. L'essentiel des combattants de Wagner a été intégré à Africa Corps. Ce qui pourrait évoluer est une plus grande mainmise des autorités russes sur la politique malienne car la nouvelle entité dépend du ministère de la défense, ce qui n'était pas le cas pour Wagner. D'autres changements pourraient apparaître notamment sur le volet économique. Le gouvernement malien payait mensuellement 10 millions de dollars à l'officine de mercenaires.
Avec Africa Corps on assiste plus à une formalisation de l'intervention russe considérée plus comme une relation d'État à État ouvrant éventuellement la voie à une exonération de ce paiement pour le gouvernement malien. Pour l'essentiel, rien ne devrait changer y compris sur le terrain militaire tant au Mali que pour les deux autres pays, le Niger et le Burkina Faso qui forment l'Alliance des États du Sahel (AES) confrontés eux aussi aux attaques des djihadistes.
La situation humanitaire dégradée
Depuis la prise du pouvoir par les juntes militaires des pays de l'AES, les djihadistes du JNIM, l'acronyme de Jamāʿat nuṣrat al-islām wal-muslimīn (Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans) affilié à Al-Qaïda et les troupes de l'État Islamique au Grand Sahara (EIGS) ne cessent de progresser. Sur les 135 entités administratives que comptent ces trois pays sahéliens, la plupart des experts considèrent que les deux tiers sont sous le contrôle plus ou moins lâche des groupes islamistes.
Cette progression s'accompagne d'une augmentation importante des décès, près de 11 200 comptabilisés fin juin 2024. Soit un triplement par rapport à 2021. Et encore il faut apprécier cette évolution avec prudence, car le contrôle des juntes sur l'information avec une répression contre les journalistes laisse à penser que cette évolution reste sous-estimée.
Sur le versant humanitaire, la situation elle aussi a empiré, près de cinq millions et demi de personnes sont déplacées. Dans la plupart des zones où la guerre fait rage entre forces islamistes et armées, les écoles et centres de santé sont fermés laissant les populations sans éducation et soins. A titre d'exemple au Burkina Faso, 20 % des établissements sanitaires et environ 5 300 structures scolaires sont laissés à l'abandon. Le résultat est que 40 % des enfants n'ont pas accès à l'école.
L'insécurité alimentaire est considérée comme un risque majeur. Au Mali, 12 % de la population est victime de malnutrition, au Niger la moitié des enfants souffre de carences nutritives modérées ou sévères, et au Burkina Faso plus de 2,3 millions de personnes souffrent de la faim.
L'avancée djihadiste
Les groupes islamistes gagnent du terrain en tirant profit de l'affaiblissement des armées nationales lié à l'incurie et la corruption de la plupart des officiers supérieurs. Ils détournent les soldes, utilisent une partie des financements conséquents que consacrent les pays à leur défense pour construire des villas ou acheter des sociétés. À cela s'ajoute le trafic des armes parfois vendues aux groupes armés.
Les experts du Conflict Armament Research estiment que l'essentiel de l'armement et des munitions des assaillants proviennent des armées nationales dont une grande partie est récupérée à la suite d'attaques contre les convois militaires ou les casernes.
De plus les djihadistes ont largement investi dans les technologies notamment dans les communications grâce aux réseaux Starlink permettant une circulation de l'information entre les combattants donnant un avantage décisif lors des batailles. Ce renforcement des capacités opérationnelles s'accompagne, avec le réseau satellitaire de Musk, d'une présence sur les principaux réseaux sociaux où des courtes vidéos mettent en avant les succès de leurs opérations militaires démentant les communications officielles des autorités.
De plus l'avantage qu'avaient les forces armées des pays sahéliens dans les airs tend à s'estomper avec l'utilisation des drones par les groupes armés. Ils s'en servent pour la collecte de renseignements, pour des bombardements mais aussi pour la conduite des batailles. La première utilisation de drone a eu lieu au Mali en avril 2024 où les combattants ont utilisé un quadrirotor, équipé de grenades et d'obus de mortier pour attaquer une milice Dozo alliée à l'armée nationale.
Au Burkina Faso l'attaque du camp militaire de Diapaga qui a causé la mort d'une cinquantaine de personnes et permis la prise d'un important arsenal, notamment des automitrailleuses, a été dirigée avec l'aide de drones. Cela permettait aux dirigeants des insurgés d'avoir une vision globale du champ de bataille. Il est probable que l'utilisation des drones par les groupes armés va s'intensifier, augmentant leur force de frappe.
Dans ce contexte, les armées nationales sont dans l'incapacité de tenir les territoires, les casernes deviennent des cibles et chaque attaque accroît le nombre de soldats tués ou fait prisonniers, provoquant la démoralisation parmi les troupes. L'exemple du camp de Boulikessi considéré comme hautement stratégique pour son contrôle des routes dans le centre du Mali est tout à fait révélateur. Attaquée deux fois en un mois, l'armée malienne n'a eu d'autres solutions que l'abandon de cette emprise sous l'euphémisme d'un retrait stratégique.
Les juntes au pouvoir
Tant au niveau social que sécuritaire la situation est des plus préoccupante et ne cesse de se dégrader. C'était pourtant pour mettre fin au déficit sécuritaire que les militaires dans les trois pays, avaient décidé de renverser le régime civil, comme si l'armée n'avait pas de responsabilité dans cet état de fait. La prise du pouvoir par les militaires s'est déroulée dans un contexte de forte combativité populaire bien que différenciée dans les trois pays.
Au Mali, des mobilisations importantes notamment conduites par le Mouvement du 5 Juin – Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP) se sont déroulées contre le gouvernement du président Ibrahim Boubacar Keïta qui ne s'est pas contenté de cumuler les échecs économiques et militaires mais a aussi été éclaboussé par les différents scandales de corruption. Particulièrement dans le viseur les frasques « bling bling » du fils du président, Karim. Sur les réseaux sociaux, on le voit se prenant en selfie en croisière sur un yacht de luxe où le champagne coule à flot en train de danser avec des jeunes filles.
Les militaires ont dévoyé la mobilisation populaire en usurpant le pouvoir avec la complicité d'une minorité du M5-RFP conduite par Choguel Maïga qui deviendra Premier ministre sans avoir de réel pouvoir.
Au Burkina Faso en 2014 une révolution renverse la dictature de Blaise Compaoré qui débouchera sur des élections dont les deux principaux candidats étaient des libéraux proches de la France. Le bilan du gouvernement de Roch Marc Christian Kaboré comme leur coreligionnaire civil malien a été incapable de redresser un tant soit peu la barre. L'attaque de la caserne de gendarmerie d'Inata va déclencher une indignation de la population car malgré plusieurs appels, ces gendarmes resteront isolés réduits à chasser pour se nourrir. Lors de l'attaque conduite par les djihadistes, une soixantaine de militaires périront.
Si la responsabilité de cet évènement est largement partagée entre le gouvernement Kaboré et l'armée, cela n'empêchera nullement les militaires de prendre le pouvoir par un premier coup d'État mené par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba suivi par un second. L'armée burkinabée avait le champ totalement libre, contrairement au Mali, avec l'absence d'une quelconque opposition politique. La volonté du mouvement du Balai Citoyen bien implanté parmi la jeunesse à se cantonner uniquement dans un rôle de vigie de la scène politique, à enlever la possibilité d'apparaître comme une alternative aux politiciens dont l'allégeance à la France était évidente.
Une autre voie aurait pu être empruntée à l'image des Comités de Résistance au Soudan. Ils apparaissent au début comme un mouvement civil d'aide et de solidarité, puis comme un outil de mobilisation, pour à la fin juste avant la guerre des généraux, être capable de proposer une « charte révolutionnaire du pouvoir populaire » présentée comme une alternative aux militaires mais aussi aux partis politiques intégrés au système.
Le Niger présente une différence notable, Le président Mohamed Bazoum a été élu lors d'un processus électoral globalement satisfaisant. Il avait commencé à suivre une voie intéressante pour tenter de mettre fin à la guerre menée par les djihadistes en tentant à la fois une réponse militaire et une politique d'ouverture pour des pourparlers de paix. Cependant il est apparu comme l'homme des Français en acceptant d'héberger les troupes françaises dans son pays qui avaient été précédemment expulsées du Mali puis du Burkina. De plus avant de briguer la présidence Bazoum était ministre de l'intérieur et de la sécurité et avait laissé de forts mauvais souvenirs aux activistes du pays.
Un incident qui est relativement passé sous silence mais qui reflète les tensions et les mobilisations contre l'impérialisme de la France est la manifestation à Téra dans la région de Tillabéri contre le convoi de l'opération Barkhane dont la répression a fait deux morts, certainement provoqués par les tirs des soldats français.
On le voit peu ou prou, l'accession au pouvoir des militaires dans les pays de l'AES reste une conséquence des mobilisations populaires contre les gouvernements civils corrompus. Elle s'est également nourrie de l'incompréhension des populations sur l'absence tangible de résultats contre les djihadistes par l'armée française se targuant de connaître le terrain, incapable de juguler les attaques ennemies.
Pour nombre de jeunes, cette incompréhension s'est transformée en doute, puis en conviction celle d'une complicité de la France avec les groupes armés. Une opinion qui a été en vogue sur les réseaux sociaux. Elle doit aussi son succès à la politique de l'armée française tissant une alliance bien qu'informelle mais réelle avec les indépendantistes touarègues, regroupés à l'époque dans le Mouvement national de libération de l'Azawad (MNLA). Le travail en commun entre le MNLA et l'armée française contre les djihadistes a été vu comme une atteinte à la souveraineté nationale parce qu'elle impliquait une sanctuarisation de la région de Kidal pour les touarègues indépendantistes.
Au niveau économique la junte malienne a engagé un bras de fer avec des sociétés minières occidentales pour un partage des profits plus équitables. Si cet objectif a conduit à des mesures coercitives pour les dirigeants des filiales des multinationales, elle n'est pas en soi une rupture avec l'ordre économique. Beaucoup de gouvernements africains ont revu leur droit minier, les ont amendés afin d'obtenir une meilleure répartition des richesses. Dans le passé des gouvernements parfaitement réactionnaires et totalement alignés sur les gouvernements occidentaux ont parfois pris des mesures bien plus radicales, c'est le cas par exemple de la politique de la zaïrianisation au Congo, comportant un versant économique lancé par Mobutu.
Cela a débouché sur le changement de monnaie, sur la nationalisation du foncier et des biens commerciaux appartenant aux étrangers. Cette campagne s'est déroulée avec une volonté affichée de rompre avec tout ce qui pouvait représenter l'occident dans le pays, ainsi les prénoms, les noms des villes et des rues ont été changés y compris celui du pays. Le Congo deviendra la république du Zaïre. Cette politique violente, bureaucratique et imposée par le haut a été un moyen d'affermir une politique clientéliste pour la pérennité du pouvoir. C'est ce qui se passe avec les juntes de l'AES qui profitent largement de la rente sécuritaire avec l'explosion des budgets de défense.
Les méthodes de corruption restent classiques, des contrats opaques sans appel d'offres, des attributions de marchés publics à des membres de la famille ou des proches de la junte et la répression contre les journalistes et les ONG pour éviter que les informations sur ces détournements circulent. Cependant, il est difficile de cacher les villas luxueuses récemment construites par les membres des juntes.
Concernant les narratifs souverainistes abondamment utilisés par les putschistes, elles font difficilement illusion. Rappelons que les caciques de la Françafrique n'hésitent pas eux aussi à utiliser le vocabulaire anti-colonialiste ou des organisations « panafricaines » pour vilipender les ONG qui pointent la corruption de ces satrapes. Ainsi « l'ONG » Dignité et conscience africaine organisait une conférence de presse pour faire « face aux attaques des ONG occidentales contre les dirigeants africains » avec la question : « Comment accepter que des chefs d'État de pays indépendants soient l'objet de telles intrusions dans les affaires intérieures de leurs pays respectifs ? »
Les dirigeants maliens ont bien compris que la question de la reconquête de Kidal pourrait renforcer leur popularité et donner un peu de crédit à leurs déclarations souverainistes même si à moyen terme cette politique s'est révélée catastrophique comme nous le verrons un peu plus tard. Certes les déclarations contre la politique de la France sont toujours accueillies avec enthousiasme, que cela soit celle du Premier ministre Choguel Maïga à la tribune des Nations-Unies déclarant que la France avait abandonné le Mali en plein vol ou celle du dirigeant Burkinabé Ibrahim Traoré critiquant les politiques néo-colonialistes de l'occident, sous l'œil bienveillant de son hôte Poutine, rejouant ainsi une pâle copie frelatée de Thomas Sankara.
D'autant que le comportement des autorités françaises ne fait qu'alimenter cette rhétorique. Avec Barkhane, la hiérarchie militaire française dirige les opérations et s'affranchit des avis des pays sahéliens concernés. Les soldats français ont travaillé en collaboration avec des milices qui se sont rendues coupables de crimes de guerre comme le GATIA (le Groupe autodéfense touareg Imghad et alliés). Les forces tricolores ont été responsables de bombardement sur des civils notamment à Bounti tuant 19 personnes tout en refusant systématiquement la création d'une commission d'enquête indépendante. Les autorités françaises voulaient intervenir militairement pour rétablir Bazoum suite au coup d'État. Sans parler évidemment de l'arrogance continue du Président Macron qui indispose autant les Africains que les Français.
Les juntes contre la population
La question centrale pour les trois juntes pourrait se résumer à comment rester au pouvoir avec un bilan bien éloigné des promesses faites pour justifier leur coup de force. Pendant de longs mois, les discours sur la souveraineté et la seconde indépendance des pays de l'AES ont rencontré une approbation.
Elle tend maintenant à se déliter au vu des attaques quasi quotidiennes des groupes armés avec leur lot de morts, de prisonniers, de témoignages de soldats attaqués ne recevant aucune aide en dépit de leurs appels désespérés, des villages encerclés et abandonnés à leur triste sort par les autorités. Les politiques adoptées par juntes restent d'abord de limiter les informations au profit d'une propagande basée, comme dirait Trump, sur la vérité alternative. Ainsi, les radios et chaines de télévision indépendantes sont fermées, les journaux menacés et les journalistes sont bâillonnés.
Les voix dissidentes doivent être aussi étouffées même les partisans de la première heure des coups d'Etat qui se montrent critiques sont emprisonnés au Mali ou envoyés au front au Burkina Faso. Au Niger des militants anti-impérialistes comme Moussa Tchangari sont emprisonnés sur ordre du président Abdourahamane Tiani ancien chef de la garde présidentielle. Il se veut désormais le héraut de la souveraineté du pays, pourtant lors de sa longue carrière il ne s'est pas particulièrement distingué dans la lutte contre le néocolonialisme de la France.
Au Burkina Faso, les syndicalistes, comme Moussa Diallo Secrétaire général de la CGT-B, sont obligés de rentrer dans la clandestinité. Au Mali, les partis sont désormais interdits et les militants comme Oumar Mariko dirigeant du parti de la gauche radicale Solidarité Africaine pour la Démocratie et l'indépendance (SADI) sont contraints à l'exil. Dans le même temps les structures ad hoc créées et assujetties aux juntes adoubent les présidents ainsi Asimi Goita qui est passé directement de colonel à général cinq étoiles pourra rester à la présidence du Mali aussi longtemps que le pays encoure des risques terroristes.
Leur gestion de la guerre a véritablement fait empirer la situation. Au Mali la junte a dénoncé unilatéralement les accords d'Alger signés par une série de groupes armés, pour la plupart indépendantistes. Puis elle les a considérés comme des terroristes et lancé l'opération de reconquête de Kidal. Non seulement la junte malienne s'est mise à dos l'Algérie, la principale force régionale l'accusant de déstabiliser le Mali, mais elle a ouvert un nouveau front en interne avec le risque qui tend à se concrétiser d'une alliance entre JNIM et FLA.
Au Burkina Faso la fuite en avant est de mise avec la mise en place des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP). Ces civils qui sont recrutés reçoivent pendant une ou deux semaines une formation militaire des plus sommaires. Ils sont censés être une aide dans le renseignement pour l'armée. Eparpillés dans les villages, ils deviennent rapidement des cibles pour les djihadistes. La plupart des VDP sont issus des Koglweogo qui dans les campagnes jouaient le rôle à la fois de police et de juge. Ils ont été souvent épinglés par les organisations de défense des droits humains pour des actes de torture contre des personnes soupçonnées d'être des bandits. Actuellement les VDP sont accusés de massacres contre la communauté peule soupçonnée de soutenir le JNIM. Les forces armées nigériennes dans une moindre mesure s'appuient aussi sur des milices communautaires, notamment les Zankaï issues de la communauté zarma qui visent les Peuls accusés de soutenir l'Etat Islamique en particulier dans la région de Tillabéri.
Les armées de l'AES accompagnées de leurs mercenaires russes ou communautaires ont tué plus de civils que de djihadistes. Les dernières révélations du journal « Le Monde » et de l'hebdomadaire « Jeune Afrique » sur les actes de tortures des mercenaires de Wagner, le tout accompagné d'insultes racistes, en sont une illustration glaçante de ce que peuvent subir les populations de ces trois pays. L'isolement et les violations à grande échelle des droits humains ne font que renforcer les positions des groupes armés islamistes ou indépendantistes.
L'ironie est que la stratégie de la fuite en avant militariste adoptée par les forces armées nationales est la même que celle suivie par les militaires français avec à la clef, le même résultat, un échec cuisant s'expliquant par la nature de la crise au Sahel.
La stratégie des djihadistes
Au Sahel, les raisons de l'engagement dans le combat djihadiste sont multiples. Elles sont souvent liées au souci de protection de soi, de sa famille ou de sa communauté. Il peut s'agir aussi de vengeance contre les exactions des autorités ou de milices se réclamant d'une autre communauté. La question économique c'est-à-dire la possibilité d'avoir une activité lucrative est aussi évoquée par les prisonniers djihadistes ou les repentis interrogés par des universitaires. Un constat se dégage, très peu mettent en avant la religion.
Certes, il existe des débats sur l'importance que prend la religion dans cette radicalisation. Il semble illusoire d'écarter complètement cette donnée. D'autant que la plupart des dirigeants ont une approche différente et plus religieuse qu'ils transmettent quotidiennement aux combattants. Cela permet de donner un cadre à l'action mais aussi une justification à la guerre menée avec son cortège de souffrance et de mort.
La force des groupes djihadiste est de s'insérer dans les communautés par différentes façons, et d'être partie prenante dans des conflits très locaux. Autrement dit les combats politiques et parfois armés sont le plus souvent bien antérieurs à l'apparition des groupes djihadistes. Si on prend le cas des rébellions touarègues, elles datent depuis le début de l'indépendance du Mali. Le Niger également a connu des révoltes armées de ces communautés. À cet égard le parcours de Iyad Ag Ghali, le dirigeant du JNIM, est tout à fait édifiant et caractéristique de l'histoire de la lutte des touarègues dans les régions du Mali. À la fin des années 1980, il fonde le Mouvement populaire de libération de l'Azawad (MPLA) qui n'a rien de religieux et défend les revendications de Touarègues. Ce n'est qu'au début des années 2000 que la question religieuse deviendra centrale.
Dans le centre du Mali la katiba de Macina du prédicateur Amadou Koufa s'est construite en défendant les populations les plus pauvres, il dénonce les abus, l'obligation de verser de l'argent pour accéder aux pâturages, critique les grands propriétaires de troupeaux, les religieux corrompus. On retrouve cette même rhétorique dans le groupe Ansarul Islam du Burkina Faso qui a intégré le JNIM, son dirigeant Ibrahim Malam Dicko défend l'égalité entre les classes sociales, défends les personnes d'origine serviles et critique les chefferies traditionnelles. Ces discours ont un grand retentissement parmi les nombreux jeunes déclassés et sans avenir.
Les djihadistes assurent au moins à la population une justice qui apparait juste et rapide. Cette dimension est souvent sous-estimée mais importante voire même vitale quand il s'agit de régler des questions foncières ou liées au cheptel. Cette lutte armée est mue par les profondes inégalités sociales, la violence des forces armées et l'absence de justice et n'est pas surdéterminée par les questions religieuses même si globalement les populations ont une forte attache à l'islam. Gagner cette guerre implique des profondes réformes sociales.
Aussi surprenant que cela puisse paraître, l'armée française avait intégré cette dimension et a tenté d'y répondre en lançant le projet « Alliance Sahel » puis « Coalition pour le Sahel » en sollicitant la participation de l'Union Européenne, et des institutions financières internationales. Cette action est restée vaine car elle rentrait en contradiction avec la trajectoire affichée de l'intervention, à savoir l'éradication des terroristes et non la mise en place d'une politique de développement et d'amélioration de la gouvernance. Une telle politique se serait heurtée aux élites en place et in fine aurait donné du crédit aux combattants islamistes critiquant la corruption et l'inefficience des autorités.
Les milliards dépensés et qui continuent à l'être le sont en pure perte et auraient pu être investis dans des programmes améliorant réellement le sort des populations.
Quel avenir ?
Indépendamment des spécificités de chaque pays composant l'AES, certains éléments communs peuvent être soulignés car susceptibles de jouer un rôle dans l'avenir.
En premier lieu, il y a d'abord une volonté manifestée depuis des années des populations d'ouvrir un dialogue avec les djihadistes et plus généralement les groupes armés pour aller vers la paix. Si on prend le cas du Mali cette demande a été réitérée à plusieurs reprises. En 2017 lors de la Conférence d'entente nationale, la société civile a lancé des appels à la discussion. En 2019 à nouveau, lors du dialogue national inclusif, sur les 3 000 délégués un bon nombre s'est prononcé pour l'ouverture des pourparlers avec Amadou Koufa et Iyad Ag Ghali pour instaurer la paix.
Au Niger des négociations ont été initiées dès 2022 par le gouvernement Bazoum avant qu'il ne soit renversé. Au Burkina Faso sous la présidence de Kaboré puis ensuite lors du premier coup d'État mené par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, la volonté de négociation de paix s'est heurtée à l'intransigeance des autorités françaises qui s'étaient tracées comme ligne rouge le refus de discuter et a fortiori de négocier avec ce qu'elles appelaient les terroristes. Une règle systématiquement bafouée quand il s'est agi de négocier la libération des otages occidentaux.
Cette recherche de dialogue, on la retrouve au plus profond des trois pays. Des villages ou des villes négocient avec les djihadistes la fin du blocus ou la fin des attaques et souvent il s'agit de notables et religieux qui mènent ces discussions. Ces accords passés entre villageois et groupes armés sont considérés comme un soutien aux djihadistes et entraînent des massacres de nombreux civils par les militaires. La junte au Burkina Faso considère les partisans du dialogue comme des traîtres. Récemment encore Traoré déclarait : « Le Burkinabè ne négociera pas avec son ennemi. On va se battre et nous allons vaincre. Nous ne lâcherons rien, absolument rien. »
Deuxièmement la situation internationale a des répercussions sur les groupes armés ou du moins certains. L'évolution du groupe Hayat Tahrir al-Cham dirigé par Ahmed al-Charaa en Syrie pourrait être une voie empruntée par le JNIM. À savoir une désaffiliation d'Al-Qaeda, des exigences religieuses moindres qui permettraient des alliances avec d'autres groupes comme les indépendantistes de l'Azawad.
Les discussions existent déjà entre ces deux forces avec deux points de divergence, la question religieuse et la question de l'indépendance. Si chaque entité, on n'ose pas dire « met de l'eau dans son vin », alors une alliance pourait se former. Si des escarmouches entre FLA et JNIM se sont produites au moment de la fin de l'accord de paix, rapidement un modus vivendi a été trouvé ouvrant la voie à des coopérations militaires ponctuelles contre les forces armées maliennes et les mercenaires de Wagner. Ce fut le cas à Tin-Zouatin près de la frontière algérienne où 82 Russes ont trouvé la mort.
Troisième donnée, l'isolement grandissant des juntes à l'extérieur. Le Niger refuse de coopérer avec son voisin le Bénin, facilitant les attaques de plus en plus nombreuses des djihadistes dans ce pays. Le Burkina Faso a des relations exécrables avec la Côte d'Ivoire, l'accusant de vouloir déstabiliser le pays sans que des preuves formelles puissent étayer cette accusation. Le Mali s'est brouillé avec l'Algérie qui a joué un rôle décisif dans les accords de paix dénoncés depuis par la junte. Ces pays frontaliers à ceux de l'AES sont de plus en plus inquiets de la dégradation sécuritaire qui fragilise leur régime et qui voient peu à peu des incidents violents se produire sur leurs sols. C'est le cas par exemple du parc naturel W-Arly-Pendjari (WAP) se situant sur les trois frontières du Bénin du Burkina et du Niger, véritable base arrière pour les islamistes armés.
Quatrième point, la fragilité des juntes. En effet on ne peut exclure des mouvements à l'intérieur de l'armée. Au Burkina Faso Traoré dénonce des tentatives de coups d'État réelles ou imaginaires déjouées. Cela montre qu'il ne peut compter sur la totalité des forces armées. Récemment, le Niger en l'espace de deux jours, a connu deux mutineries l'une à Filingué l'autre à Téra. Les troupes ont refusé de monter au front ce qui en dit long sur l'état des forces nigériennes. Au Mali à l'intérieur de l'armée des voix dissidentes se font entendre.
Pour l'avenir de nombreuses options existent, on peut en citer trois qui se sont produites dans d'autres pays. Un scénario à la somalienne où les groupes islamistes parviennent à contrôler la plupart des territoires encerclant des capitales, restant sous la domination des juntes, en tentant d'imposer un blocus et continuant leurs guerres vers les pays côtiers. Un second scénario qui ressemblerait à ce qui s'est produit en Syrie. La rupture du JNIM avec Al-Qaeda et une relative déconfessionnalisation permettant des alliances avec des fractions de l'armée dans un des trois pays de l'AES autour de l'expulsion des troupes russes, et d'une gouvernance sans corruption. Enfin on ne peut écarter un écroulement, sous les coups de boutoir des djihadistes, d'un des trois régimes qui aurait un effet de domino sur les deux autres pays. Un épisode qui rappellerait celui de l'Afghanistan avec toutes les conséquences catastrophiques particulièrement pour les femmes.
*
2 juillet 2025.
Illustration : Wikimedia Commons.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.












