Derniers articles

Gérard Depardieu, condamné pour agressions sexuelles

Le tribunal judiciaire de Paris a condamné Gérard Depardieu pour agression sexuelle à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à deux ans de privation de son droit d'éligibilité. Il est également inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS).
Tiré de Entre les lignes et les mots
Il devra en outre verser des dommages et intérêts aux deux victimes directes, Amélie et Sarah* et à l'AVFT – Libres et Egales qui s'était constituée partie civile à leurs côtés. Enfin, il devra réparer le préjudice né du comportement de son avocat à l'audience et constituant une victimisation secondaire. G. Depardieu a interjeté appel de cette décision de condamnation.
Ce procès a jeté une autre lumière sur l'acteur Gérard Depardieu, ce « monstre sacré du cinéma français » ou, selon les termes du président de la République, cet homme qui « rend fière la France ». Un comédien qui a profité de sa notoriété pour agresser sexuellement des femmes pendant des années sans être arrêté, voire en sachant qu'il pouvait compter sur l'omerta de la « grande famille » du cinéma qui a permis son impunité.
Une stratégie d'agresseur rodée
Lors de son intervention à l'audience, l'AVFT a présenté ses analyses de cette stratégie.
G. Depardieu est un homme de pouvoir. Pouvoir économique tout d'abord car le nom de Depardieu attire les financements et promet le succès d'un film. « On ne va pas arrêter le tournage pour une costumière » avait dit l'une des témoins pendant le procès. Elle aussi dénonçait des violences sexuelles aujourd'hui prescrites.
Pouvoir de faire embaucher qui il veut, acteurs et actrices mais aussi logeman, garde du corps, habilleuse, maquilleuse… qui lui sont redevables. Ces allié·es seront prompt·es à banaliser ses comportements (« il n'est pas méchant », « il est comme un enfant, il cherche à faire des bêtises ») et à le protéger en mettant en cause les victimes.
G. Depardieu choisit ses victimes, des femmes intermittentes du spectacle précaires, qui savent qu'il ne faut pas « faire de vague » si l'on veut conserver son travail ou signer d'autres contrats par la suite dans un secteur compétitif ou le recrutement se fait souvent par cooptation. Des jeunes travailleuses sans réseau de soutien, dont les marges de manœuvre pour s'opposer à G. Depardieu sans risquer des représailles sont très restreintes.
G. Depardieu isole la victime dans le collectif de travail. Celle qui ose dénoncer ses agissements est traitée de « balance ». Le collectif de travail est soit passif, soit complice : c'est la plaignante qui a un problème, qui est « coincée » ou manque d'humour. C'est elle qui n'a pas su réagir, « elle n'avait qu'à… ». Rares sont celles qui ont reçu le soutien de membres de ce collectif.
G. Depardieu, par la voix de son avocat, se fait passer pour la victime. Victime d'un complot, qui serait ici ourdi par Médiapart, victime de manipulation, victime « d'une société dans laquelle on ne peut plus rien dire ». Rappelons que les luttes des travailleuses pour le droit de travailler dignement datent du 19ème siècle.
Un procès qui invite les membres de la « grande famille » à s'interroger sur leur responsabilité dans la perpétuation des agressions sexuelles
Sans la complicité active ou passive des équipes de tournage, des producteurs, des réalisateurs, des autres acteurs et actrices, sans leur aveuglement volontaire, sans leur justification parce que … « c'est Gérard », Gérard Depardieu n'aurait pas pu agresser en toute impunité.
La solitude change de camp
Ce procès s'est tenu grâce à une réaction en chaine de solidarité entre femmes rompant la solitude dans laquelle chacune des victimes était ou avait été enfermée, parfois pendant des décennies. De l'appel lancé par l'actrice Anouk Grinberg, au soutien de Charlotte Arnould qui dénonce les viols de G. Depardieu, lequel a déterminé Amélie à témoigner, puis Sarah, aux quatre femmes qui sont venues exposer ce que l'acteur leur avait imposé et à celles qui ont rapporté ce dont elles avaient été les témoins oculaires lors des tournages. Nous avons entendu des femmes courageuses et solidaires.
La victimisation secondaire reconnue
Lors des 4 jours d'audience, les parties civiles ont été maltraitées par Jérémie Assous, l'avocat de G. Depardieu. Ce dernier n'a cessé d'insulter, de crier, d'humilier, recourant le plus souvent à ce stratagème pour faire diversion lorsque son client était en difficulté face aux questions du tribunal ou des avocates des parties civiles, Mes Carine Durrieu-Diebolt et Claude Vincent.
Dans sa décision, le tribunal rapporte ses propos et attitudes : « Ainsi, le conseil de Gérard DEPARDIEU a pu s'adresser aux conseils de parties civiles en ces termes : « C'est honteux. Arrêter de le cuisiner comme ça. Vous êtes abjecte et stupide. » Ou encore « C'est insupportable de vous entendre, déjà votre voix, c'est dur alors… » (…) Il a également pu déclarer à Amélie (…), partie civile : « Je n'ai jamais vu une vraie victime s'opposer à des actes aussi élémentaires. On ne vous croit pas » ou à : « Je ne vous crois pas du tout. Pour moi, vous êtes bel et bien quelqu'un qui ment ». » Le tribunal considère que les parties civiles « ont été exposées à une dureté excessive des débats à leur encontre, allant au-delà des contraintes et des désagréments strictement nécessaires à la manifestation de la vérité, au respect du principe du contradictoire et à l'exercice légitime des droits de la défense. » Il précise que « Si les droits de la défense et la liberté de parole de l'avocat à l'audience sont des principes fondamentaux du procès pénal, il n'en demeure pas moins qu'ils ne sauraient légitimer des propos outranciers ou humiliants portant atteinte à la dignité des personnes ou visant à les intimider. En l'espèce, il résulte des débats que les parties civiles ont été confrontées à une défense des plus offensive fondée sur l'utilisation répétée de propos visant à les heurter et qui n'était manifestement pas nécessaire à l'exercice des droits de la défense. »
Ajoutons que non seulement G. Depardieu ne s'est pas désolidarisé de ce comportement d'agression. Il a au contraire, à la fin de l'audience, exprimé ses remerciements à son avocat pour sa défense, qu'il a donc explicitement entérinée.
Si l'on peut saluer la reconnaissance de cette maltraitance, il demeure regrettable que le président, responsable de la tenue de l'audience et garant de la sérénité des débats, ne soit, à aucun moment, intervenu lors du procès pour recadrer Jérémie Assous et lui rappeler ses obligations en tant qu'auxiliaire de justice.
De même que l'on ne peut que s'étonner de l'inaction des représentant·es du bâtonnier présent·es certains jours, face à la violation des obligations déontologiques de l'avocat (manquements aux obligations de confraternité, de délicatesse et de courtoisie).
Une condamnation légère
L'on peut également regretter la nature de la peine prononcée. Le tribunal n'a pas suivi les réquisitions du procureur de la République : aucune peine d'amende, la peine de 18 mois est assortie d'un sursis simple (sans obligations particulières) et l'exécution provisoire, qui contraint au versement immédiat des dommages et intérêts, n'a pas été prononcée.
Ces dommages et intérêts sont par ailleurs faibles au regard du patrimoine de G. Depardieu qui est millionnaire et aux demandes des parties civiles. Ils ne couvrent en outre pas la totalité des frais engagés par les victimes dans cette procédure, en violation du principe de la réparation intégrale du préjudice causé.
Il n'en demeure pas moins que cette condamnation est une victoire pour toutes celles qui ont été victimes de Gérard Depardieu.
Catherine Le Magueresse, pour l'AVFT Libres et Egales
* Sarah est un prénom d'emprunt.
https://www.avft.org/2025/05/15/gerard-depardieu-condamne-pour-agressions-sexuelles/
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Kurdistan accueille un congrès de femmes du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord

KURDISTAN – La ville kurde de Souleimaniye a accueilli un congrès de femmes du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord.
Le premier Congrès de la Coalition régionale des femmes démocratiques du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord a permis le partage les expériences des femmes en matière de lutte commune et de solutions régionales.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/05/19/kurdistan-accueille-un-congres-de-femmes-du-moyen-orient-et-de-lafrique-du-nord/
Le premier congrès de la Coalition régionale des femmes démocratiques du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (en kurde : Kongreya Koordînasyona Jinên Herêmî ya Demokratîk a Rojhilata Navîn û Bakurê Afrîkayê, NADA) s'est poursuivi aujourd'hui à Souleimaniye, au Kurdistan du Sud. Environ 200 femmes de 19 pays, principalement du Moyen-Orient et d'Afrique, y ont participé.
Le congrès, organisé pour partager les expériences de lutte commune des femmes et pour discuter de solutions régionales, a débuté avec beaucoup d'enthousiasme le jeudi 15 mai.
Les discussions théoriques ont dominé les séances de la première journée, avec des présentations de représentantes de divers pays sur le patriarcat, les politiques de guerre et les expériences de résistance. Les séances se sont poursuivies par des échanges animés entre les participantes.
Aujourd'hui, deuxième journée du congrès, l'accent a été mis sur les ateliers et les propositions de solutions. La première séance a été consacrée aux défis rencontrés par les luttes des femmes et aux opportunités qui en ont découlé.
Les résultats des ateliers, qui ont abordé des sujets tels que le rôle des organisations de femmes, l'importance des alliances de femmes contre les alliances néolibérales et patriarcales et les systèmes d'autodéfense des femmes, ont été partagés avec les participants.
La séance de l'après-midi a abordé des sujets tels que l'émergence politique des femmes dans le contexte de la Troisième Guerre mondiale, le leadership des femmes dans la construction de la paix et des sociétés démocratiques, la révolution des femmes et la place de la NADA dans le confédéralisme démocratique des femmes.
Après les présentations des panels, des discussions seront menées pour renforcer la lutte commune.
Le congrès s'est poursuivi en soirée avec un événement artistique réunissant des femmes des quatre régions du Kurdistan qui ont chanté notamment l'hymne national kurde « Ey Reqib ». (ANF et JINNEWS)
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Appel urgent à la paix lancé par les féministes indiennes et pakistanaises

Nous, féministes de l'Inde et du Pakistan, saluons sans équivoque le cessez-le-feu déclaré par nos deux nations aujourd'hui. La tension et l'escalade des quinze derniers jours nous rappellent à quel point la paix est fragile. Le cessez-le-feu donne également raison aux appels à la désescalade et à la paix lancés par des milliers de personnes ordinaires de part et d'autre de la frontière. Même si nous espérons qu'il s'agit d'une cessation absolue des hostilités, nous nous souvenons des événements récents.
Tiré de Entre les lignes et les mots
Le cessez-le-feu n'est que le premier pas dans la longue marche vers la justice et la paix
Nous condamnons l'attentat terroriste de Pahalgam qui a tué 25 touristes venus de différentes régions de l'Inde et un du Népal pour visiter le Cachemire. Une personne locale a également perdu la vie dans l'attaque de Pahalgam. Ces attaques ciblées ont creusé le fossé communautaire entre musulman·es et hindou·es en Inde et ont été exploitées pour inciter à la haine, à la peur et à la punition collective.
Au lendemain de l'attentat de Pahalgam, ce sont les femmes – y compris les mères, les filles, les sœurs et les épouses – qui portent le poids insupportable du chagrin. Au lieu de le respecter et de le partager, il a été transformé en arme et fait l'objet d'une militarisation ou d'une surveillance policière — surtout quand les personnes refusent de suivre le scénario de la haine. Himanshi Narwal, la jeune veuve de l'une des victimes tuées, fait partie des survivant·es qui, malgré une douleur inimaginable, ont trouvé la force de lancer un appel à la paix. Elle a demandé aux personnes de ne pas diriger leur rage contre les Cachemiri·es et les musulman·nes qui, comme elle, sont pris·es au piège dans un cycle de violence qu'elles et ils n'ont pas créé. Pour ce simple acte d'humanité, elle a été trollée, vilipendée et attaquée par des nationalistes à l'affut, plus attachés à la soif de sang qu'à la vérité.
Liant l'attaque terroriste au Pakistan, l'Inde a immédiatement suspendu le traité sur les eaux de l'Indus et relancé les projets hydroélectriques et la construction de barrages qui étaient auparavant limités par le traité. Les deux parties ont annulé les visas de courte durée pour les visiteurs et les visiteuses. Nous avons assisté à des scènes déchirantes à la frontière Attari-Wagah, où des femmes indiennes et pakistanaises munies des « mauvais » passeports ont été contraintes de remettre leurs enfants à leurs maris avant de passer dans « leurs pays », ce qui a provoqué une détresse insondable pour les femmes elles-mêmes, leurs enfants et leurs familles. Quatorze jours plus tard, l'Inde a mené des frappes aériennes et le Pakistan a riposté, puis les deux pays ont procédé à des frappes de drones.
Les campagnes de désinformation menées de part et d'autre ont rendu la vérité difficile à établir. Une chose est sûre : la perte de vies humaines, la peur généralisée et l'escalade de la violence s'ajoutent à la terreur possible des suites graves et irréversibles que les tensions entre les deux puissances nucléaires pourraient entraîner pour les populations de l'ensemble de l'Asie du Sud.
En tant que féministes, nous sommes fondamentalement contre la guerre et le militarisme. Nous dénonçons l'économie de guerre qui se nourrit de la violence et de la destruction, ainsi que les structures profondément patriarcales qui l'alimentent et la soutiennent. Le fait que l'opération indienne ait été baptisée Sindoor, un geste profondément patriarcal, est un rappel brutal de la propagande misogyne employée par les deux camps. Entre les êtres cher·es, il existe également de nombreux autres symboles privés et spécifiques, dont le Sindoor, pour certaines femmes, pourrait être l'un d'entre eux. Mais lorsque le Sindoor devient un cri de guerre, il efface et arme la douleur, et réduit les femmes à des corps sur lesquels sont construits les fantasmes nationalistes masculinistes de conquête, de violence et de viol.
L'année écoulée a été marquée par une flambée de la violence dans le monde, les images dévastatrices de Gaza et d'autres zones de conflit étant devenues quotidiennes, ce qui a tragiquement désensibilisé de nombreuses personnes aux véritables horreurs des conflits armés. Les gouvernements indien et pakistanais et les faiseurs d'opinion ne semblent pas se soucier des conséquences catastrophiques de la guerre et de l'immense dévastation qu'elle causerait. Seuls ceux qui fabriquent et vendent des systèmes d'armes à nos gouvernements tireront profit de la guerre. La guerre renforce, exacerbe et perpétue les inégalités existantes, affectant de manière disproportionnée les femmes, les minorités sexuelles et religieuses ainsi que les enfants. Ces hostilités détournent l'attention de ce dont les personnes ont réellement besoin : l'éducation, la santé, l'emploi, la protection sociale, la sécurité et le bien-être.
Nous, féministes de l'Inde et du Pakistan, sommes fermement convaincues que la guerre n'est jamais une solution. Nous appelons au démantèlement des structures de pouvoir qui entretiennent la violence. La logique de guerre – enracinée dans le nationalisme, la masculinité toxique et les frontières de l'ère coloniale – doit être rejetée. Dans les deux pays, les femmes activistes, les journalistes et les bâtisseurs et les bâtisseuses de paix plaident depuis longtemps en faveur du dialogue, de la désescalade et de la diplomatie. Pourtant, nos voix sont constamment mises de côté et écrasées par la rhétorique incendiaire et le militarisme affirmé qui dominent la sphère publique.
Nous appelons les gouvernements de l'Inde et du Pakistan à :
* Consolider le cessez-le-feu du 10 mai, renoncer aux violations transfrontalières et désamorcer les tensions croissantes en maintenant les canaux de communication ouverts ;
* Lancer conjointement une enquête, avec des représentant·es internationaux, sur l'attentat de Pahalgam afin de traduire les auteurs en justice.
* S'abstenir d'actions unilatérales telles que l'interruption du traité sur les eaux de l'Indus ;
* Donner la priorité au dialogue et à la diplomatie et s'y engager afin de résoudre les différends.
D'œuvrer à la résolution de la question politique centrale du Cachemire, qui est au cœur du conflit.
Nous demandons instamment aux féministes du monde entier d'élever la voix en signe de solidarité et de se joindre à nous pour résister à la guerre et construire la paix. Il n'y a ni temps ni espace pour la complaisance.
Saheli Women's Resource Centre, New Delhi, Inde ; Women's Action Forum (WAF), All Chapters, Pakistan ; Aurat March, Lahore, Pakistan ; All India Democratic Women's Association, Inde.
Appuis individuels (par ordre alphabétique) : Abha Bhaiyya, Aisha Gazdar, Amar Sindhu, Amrita Chhachi, Anita Pinjani, Anuradha Banerji, Arfana Mallah, Avantika Tewari, Ayesha Kidwai, Beena Sarwar, Chayanika Shah, Devangana Kalita, Elaine Alam, Farrah Taufiq, Farida Shaheed, Gulbadan Javed , Haseen Musarat, Huma Ahmed-Ghosh, Humaira Rahman, Iram Hashmi, Kalyani Menon Sen, Kavita Krishnan, Kausar Khan, Khawar Mumtaz, Lalita Ramdas, Madhu Bhushan, Maimoona Mollah, Malka Khan, Maria Rasheed, Mariam Dhawale, Meera Sanghamitra, Nageen Hyat, Naheed Aziz, Najam Panhwar, Natasha Narwal, Naseem Jalbani, Nasim Jalbani, Nasreen Azhar, Neelam Hussain , Nighat Said Khan, Nivedita Menon, Nuscie Jamil, Nuzhat Shirin, Pamela Philipose, Pratiksha Baxi, Raheema Panhwar, Rashida Dohad, Riffat Aziz, Rita Manchanda, Ritu Menon, Roshmi Goswami, Rozina Junejo, Rukhsana Rashid, Saba Gul Khattak, Safia Noor, Salima Hashmi, Samina Jabbar, Samina Omar Asghar Khan, Shabnam Hashmi, Shad Begum, Sheeba Chhachi, Shahnaz Rouse, Simi Kamal, Smita Gupta, Soonha Abro, Sumaira Ishfaq, Syeda Hamid, Tahira Abdullah, Tasneem Ahmar, Uma Chakravarti, Urvashi Butalia, Uzma Noorani, Vani Subramanian, Vanita Mukherjee.
11 mai 2025
http://www.sacw.net/article15335.html
Traduit avec DeepL.com (version gratuite)
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les mouvements féministes africains face au colonialisme vert

La prise de conscience écologique des mouvements féministes africains est en hausse. Premières victimes des dérèglements climatiques induits par le capitalisme transnational, les femmes africaines sont aussi aux premières loges des effets des politiques « vertes » menées par le Nord global, dont l'extraction de minerais pour technologies « propres ». L'écoféminisme promeut dès lors des alternatives endogènes, justes et égalitaires.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/05/02/les-mouvements-feministes-africains-face-au-colonialisme-vert/?jetpack_skip_subscription_popup
Avec l'aimable autorisation des Editions Syllepse
Les écoféminismes africains mènent une réflexion critique sur les liens entre le modèle de développement dominant, la crise écologique et les questions de paix et de non-violence, ce qui leur permet de s'interroger de façon radicale et novatrice tant sur ce qu'est le féminisme que sur le rapport à la nature. Tandis que le mouvement mondial semble parfois se diviser sur la question de savoir si l'association genre-nature n'est pas réductrice pour les femmes, la plupart des mouvements engagés dans l'activisme féministe et environnemental en Afrique ont simplement cherché à créer des alliances stratégiques entre les femmes et la protection de l'environnement.
La Kenyane Wangari Maathai (1940-2011) et son Mouvement de la ceinture verte (GBM) représentent bien l'activisme collectif centré sur l'écologie qui définit l'essence même de l'écoféminisme africain. Première écologiste à recevoir le Prix Nobel de la paix en 2004, Wangari Maathai a mis en évidence la relation étroite entre le féminisme et l'environnementalisme africains, qui remettent en cause à la fois le patriarcat et les structures néocoloniales qui minent le continent. Comme l'écrivait Janet Muthuki (2006), spécialiste sud-africaine des questions de genre, « le GBM de Maathai est un activisme écoféministe africain qui, par le biais d'enjeux environnementaux, met en lumière les rapports de genre et défie le patriarcat au sein des structures idéologiques nationales et globales ».L'écoféminisme intersectionnel souligne l'importance du genre, de la race et de la classe, et établit un lien organique entre les préoccupations féministes, l'oppression du patriarcat et l'exploitation de l'environnement dont elles sont considérées comme les gardiennes dans différentes cultures. Parce que les femmes subissent les multiples crises auxquelles l'Afrique est confrontée, il est essentiel d'adopter une approche intersectionnelle pour créer des mouvements radicaux en faveur du changement.
Comme l'a déclaré une autre figure de l'écoféminisme africain, Ruth Nyambura, « ce dont nous avons besoin, c'est de mouvements transnationaux véritablement révolutionnaires et non de petits cocons. Bien sûr il est important de prêter attention aux réalités locales, mais un mouvement écoféministe se doit de transformer la manière dont les femmes accèdent aux ressources économiques, intellectuelles et écologiques, en particulier les plus vulnérables, souvent en première ligne de la dévastation écologique et climatique. Il s'agit d'œuvrer pour revendiquer et réimaginer des façons plus justes et égalitaires d'être les un·es avec les autres. Fondamentalement, cela signifie détruire le patriarcat et se réapproprier les “biens communs” » (Merino, 2017).
Écoféminisme, anti-extractivisme et justice climatique
En cela, la dimension anti-extractiviste est un élément du cadre conceptuel qui caractérise les luttes des mouvements écoféministes africains contemporains, au cœur des débats sur la justice environnementale. Elle s'incarne notamment dans le travail politique de la WoMin African Alliance. « De nombreuses régions du Sud font l'objet d'une nouvelle vague de colonisation, les multinationales et leurs gouvernements respectifs reculant sans cesse les frontières très rentables des richesses minières et naturelles. La WoMin Alliance qualifie d'extractiviste ce modèle de développement, qui n'est qu'un nouveau maillon de la chaîne d'exploitation de l'Afrique et de ses peuples. L'extractivisme est patriarcal et raciste, car il s'appuie sur le travail bon marché d'ouvriers noirs, exploités dans des conditions extrêmes au profit d'entreprises transnationales et de leurs chaînes d'approvisionnement. Le travail non rémunéré des femmes sert l'accumulation de ces profits, en assurant la subsistance des travailleurs et de leurs familles, l'approvisionnement en eau, en soins, etc. » (Mapondera et col., 2020).
Avec l'enjeu climatique et la transition vers les énergies renouvelables, les militantes écoféministes africaines sont de facto de plus en plus impliquées dans les luttes contre les mégaprojets extractivistes dit « verts », qu'ils soient solaires, éoliens, géothermiques ou producteurs d'hydrogène. L'extraction des terres rares pour la fabrication des technologies « propres » en est un bon exemple. Elle crée des dommages considérables : accaparement des terres, pollution des écosystèmes, perte des moyens de subsistance et effets dévastateurs sur la santé des personnes vivant en aval des opérations d'extraction et de traitement des minerais, tels que cancers, malformations, dégénérescences musculosquelettiques, etc.
À Madagascar par exemple, les militantes écoféministes soutiennent activement la résistance de communautés locales à un mégaprojet d'exploitation de terres rares, le site minier de cette vaste opération d'extraction risquant fort de devenir une zone de sacrifice social, économique et écologique… destinée au verdissement de la consommation du Nord global.
Le mouvement écoféministe africain se situe à la confluence de trois courants qui luttent contre les idéologies hégémoniques qui ont vulnérabilisé les cultures indigènes : le mouvement anti-néolibéral, principalement soutenu par les activistes pour la justice climatique ; le mouvement anti-impérialiste, porté par les décoloniaux ; et le mouvement antipatriarcal, mené par les féministes. Ainsi les afro-écoféministes se battent-elles pour démanteler les structures de pouvoir qui exploitent à la fois les femmes et la nature.
Au niveau communautaire, on assiste à une prise de conscience croissante des menaces qui pèsent sur la biodiversité et le climat, du fait des projets agro-industriels et extractifs à grande échelle, mis en œuvre sur le continent africain par les grandes entreprises et le pouvoir d'État. L'écoféminisme est indissociable des luttes concrètes menées sur le terrain pour préserver, développer ou réparer les espaces habitables et les liens sociaux, grâce à des dynamiques matérielles et culturelles qui permettent à une société de se reproduire sans détruire d'autres sociétés ou espèces vivantes.
Ainsi, les mouvements pour la justice climatique qui se concentrent sur la crise écologique et ses causes profondes, suivant une perspective féministe, s'appuient sur la prise de conscience croissante par les populations concernées que le modèle de développement néolibéral dominant n'est pas viable. Ces mouvements écoféministes se concentrent sur les crises climatique et écologique en Afrique, sur leurs liens avec le développement extractiviste et ses répercussions différenciées selon le genre, et exigent « que le système capitaliste injuste soit démantelé afin de prendre soin de la planète et de réparer les violations historiques des droits des peuples et de la nature » (Mapondera et col., 2020).
Vu leur caractère transnational, aussi bien le mouvement pour la justice climatique que le projet de décolonisation ne peuvent se limiter à une approche fragmentaire, mais requièrent un plan d'action panafricain. La fragmentation du continent et ses divisions idéologiques ont contribué à perpétuer les différentes formes de colonialisme. Le panafricanisme est dès lors une étape essentielle du projet poursuivi par les afro-écoféministes.
Colonialisme, écoféminismes et cultures autochtones
Pour Wangari Maathai (2009), « le colonialisme a marqué le début de la détérioration de la nature, en raison de l'extraction des ressources naturelles. L'exploitation des forêts, les plantations d'arbres importés, la chasse aux animaux sauvages et l'agrobusiness sont des activités coloniales qui ont détruit les écosystèmes africains ». En cela, l'afro-écoféminisme est un pilier important de l'approche féministe décoloniale visant à promouvoir un changement systémique en Afrique.
Les tenants d'un écoféminisme africain s'appuient d'ailleurs sur le riche héritage des cultures autochtones, pour remettre en question le pouvoir patriarcal et le néocolonialisme. Alors que certaines figures du féminisme africain, comme Fainos Mangena, rappellent que la tradition culturelle et la philosophie communautaire africaines ne sont pas compatibles avec le féminisme parce qu'elles sont profondément patriarcales, d'autres écoféministes, comme Sylvia Tamale et Munamato Chemhuru, estiment que les philosophies traditionnelles africaines comme l'« Ubuntu » peuvent être utilisées pour viser la justice de genre, ainsi que les autres objectifs de l'afroféminisme.
Comme l'écrit l'universitaire et militante des droits humains ougandaise Sylvia Tamale (2020), « les traits sous-jacents de l'écoféminisme évoquent beaucoup les pratiques traditionnelles des cultures autochtones ». En effet, les pratiques écoféministes puisent largement dans « la relation épistémique entre les peuples autochtones et la nature, qui se manifeste à travers leur spiritualité, leurs totems, tabous, mythes, rituels, etc. Notamment, les effets de la violation d'un tabou social n'étaient pas individualisés et la responsabilité de s'y plier était communautaire ».
Un exemple typique de cette relation épistémique réside dans les déclarations de femmes malgaches, gardiennes du patrimoine biologique et culturel de la communauté autochtone de l'île de Sakatia, dans le nord-ouest du pays. Elles expliquent la raison d'être des rituels et des coutumes, et leur importance vitale pour le bien commun, la coopération et le respect entre les vivants et les morts. « Nos ancêtres observaient strictement les tabous fonciers, et la plupart des habitants de Sakatia les observent encore. […] Pour préserver le poisson, on ne pêche que la quantité dont on a besoin ; le surplus doit être distribué à la communauté ; il ne peut être ni jeté ni vendu, […] sous peine de nuire à l'environnement. Il est interdit de détruire les forêts qui fournissent la pluie et l'air frais dont nous avons besoin pour vivre. […] Nous avons une convention dotée d'un système de sanctions à respecter, […] sinon tout le village sera maudit » (CRAAD-OI, 2021).
Les communautés malgaches de Sakatia respectent la même « éthique du rapport à la nature » que de nombreux autres groupes autochtones d'Afrique subsaharienne qui se méfient des interventions anthropiques qui portent atteinte à la biodiversité de manière telle qu'elles menacent l'humanité. Comme l'a souligné Sylvia Tamale (2020), « les femmes des pays du Sud global ne s'auto-identifient sans doute pas comme “écoféministes”, mais elles nourrissent une longue histoire de conscience écologique et d'obligation morale à l'égard des générations futures ».
Alternatives écoféministes africaines
Dans une perspective décoloniale et écoféministe, il existe déjà, aux niveaux micro et méso, de fécondes alternatives. Nombre d'entre elles ont été empruntées à l'Afrique, comme l'économie solidaire et les solutions collectives pour gérer le travail et les ressources telles que les semences ou l'argent, et doivent être reconnues et développées. Comme en Amérique latine avec des propositions inspirées des cosmovisions indigènes, en ce compris les droits de la nature et le « Buen Vivir » fondé sur une vision sociale et écologique intégrée, il existe un important fonds africain d'idées, de pratiques et de concepts politiques endogènes qui reposent sur la tradition, ainsi que sur les luttes anticoloniales et les transformations postcoloniales.
Il s'agit notamment des systèmes autochtones de connaissances, de la propriété communautaire, des droits territoriaux et de la coopération au travail. Parmi ces alternatives, les principales sont des voies critiques fondées sur ce qui est connu en Afrique australe comme l'Ubuntu, une vision du monde répandue dans toute l'Afrique subsaharienne et qui « tente de réduire les visions patriarcales, dualistes et anthropocentriques de l'existence » (Chemhuru, 2018). Grâce à l'Ubuntu, les Africain·es célèbrent depuis des siècles les valeurs qui relient le passé et le présent, ainsi que les êtres humains et la nature.
En tant que paradigme éthique, l'Ubuntu n'est pas compatible avec les relations capitalistes, la propriété privée et les inégalités généralisées. Il exige au contraire un activisme pour la solidarité et la décolonisation, face à ce que Vishwas Satgar appelle l'« écocide impérial ». L'éthique écologique de l'Ubuntu est à l'origine de « la notion radicale de post-extractivisme, qui consiste à abandonner, pour les générations futures, les combustibles fossiles et les minerais qui alimentent l'accumulation capitaliste destructrice et ses crises, notamment le changement climatique » (Terreblanche, 2018).
D'un point de vue écoféministe africain, « l'éthique de l'Ubuntu souligne la nécessité de traiter avec soin des composants de la nature souvent considérés comme moralement insignifiants, tels que les êtres animés non humains. Cela implique que des vertus tels l'attention, la bonté et le respect puissent aussi être accordées à ces éléments non animés de l'environnement que sont la nature physique, les plantes et les plans d'eau qui ne sont pas nécessairement dotés de sentience » (Chemhuru, 2018).
Des alternatives tangibles sont déjà proposées par les femmes africaines rurales autochtones pour défendre, contre le modèle extractiviste prédateur, leurs territoires, leur autonomie, leurs modes de production, leurs communautés et leur relation d'interdépendance avec la nature, sans lesquels elles ne pourraient pas survivre. Ces alternatives apparaissent dans la manière dont ces femmes traitent nos ressources naturelles, les échangent, en prennent soin et les régénèrent, dans la manière dont elles nourrissent nos familles, coopèrent au sein de nos communautés, etc. Comme le dit WoMin, « la majorité des femmes en Afrique, qui portent le fardeau climatique et écologique tout en ayant, paradoxalement, le moins contribué à ces crises, pratiquent, à travers leur résistance écoféministe au patriarcat extractiviste, une alternative de développement que l'humanité doit respecter si nous voulons survivre, nous et la planète » (Mapondera et col., 2020).
Concrètement, les alternatives justes et durables, axées sur l'Ubuntu et un fondement solidaire, ainsi que sur des modes de vie en harmonie avec la nature, contiennent une série d'éléments proposés par les écoféministes africaines. Il s'agit d'abord de renforcer la souveraineté alimentaire, grâce à un modèle agroécologique à faible consommation d'intrants. Et parallèlement, de viser la souveraineté énergétique par des formes décentralisées de production renouvelable, sous le contrôle des communautés et en particulier des femmes, en mettant fin à l'extraction des combustibles fossiles. Des modes d'extraction à petite échelle et à faible impact resteront autorisés, dans des formes de propriété collective et selon les priorités locales. Quant au modèle de gouvernance, il requiert une démocratie participative à tous les niveaux de prise de décision, qui reconnaît le rôle central des femmes dans la société, leurs besoins spécifiques et la nécessité du consentement.
Ces alternatives permettront de remettre en question la primauté de la propriété privée, en soutenant les systèmes dans lesquels les ressources naturelles sont « possédées » et gérées par des collectifs, ainsi que l'expansion des biens communs en tant qu'élément essentiel de la lutte contre la privatisation et la financiarisation. Parallèlement, pour les classes riches et moyennes du Nord et du Sud, une transition vers une consommation décroissante s'impose.
Zo Randriamaro
Chercheuse en sciences sociales, féministe panafricaniste et activiste des droits humains, fondatrice et coordinatrice du Centre de recherche et d'appui pour les alternatives de développement-Océan Indien (CRAAD-OI), Antananarivo, Madagascar.
Version réduite d'un article paru dans The Geopolitics of Green Colonialism, Pluto Press, 2024, sous le titre : « Eco-feminist Perspectives from Africa ».
Article paru dans Alternatives sud : Business verte et pays pauvre
https://www.syllepse.net/business-vert-en-pays-pauvres-_r_22_i_1114.html
https://www.cetri.be/Business-vert-en-pays-pauvres
Bibliographie
Chemhuru M. (2018), « Interpreting Ecofeminist Environmentalism in African Communitarian Philosophy and Ubuntu : An Alternative to Anthropocentrism », Philosophical Papers, 48 (2).
CRAAD-OI (2021), Women's Dialogues to Dream and Imagine Development Alternatives, Sakatia, Madagascar.
Mapondera M. et col. (2020), « Building an Ecofeminist Development Alternative in a Time of Deep Systemic Crisis », African Feminist Reflections on Future Economies, Accra.
Muthuki J. (2006), Rethinking Ecofeminism : Wangari Maathai and the Green Belt Movement In Kenya, University of Kwazulu-Natal.
Merino J. (2017), « Women Speak : Ruth Nyambura Insists On A Feminist Political Ecology », MS Magazine.
Tamale S. (2020), Decolonization and Afro-Feminism, Ottawa, Daraja Press.
Terreblanche Ch. (2018), « Ubuntu and the struggle for an African eco-socialist Alternative », dans Satgar V. (dir.), The Climate Crisis : South African and Global Democratic Eco-socialist Alternatives, South Africa, Wits University Press.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« Le projet de canal interocéanique est un échec »

Le canal du Nicaragua était un projet de canal interocéanique, une voie navigable censée relier la mer des Caraïbes à l'océan Pacifique en traversant le Nicaragua, en Amérique centrale. Une sorte d'alternative au canal de Panama qui aurait offert à ses investisseurs chinois une porte commerciale stratégique entre l'Atlantique et le Pacifique. Un chantier pharaonique d'ingénierie qui aurait traversé le lac Cocibolca, le plus grand réservoir d'eau douce d'Amérique centrale, avec un impact environnemental énorme, la destruction d'au moins 300 communautés et le déplacement de plus de cent mille paysans et paysannes.
13 mai 2025 | Tiré de Viento sur
Un peu plus de dix ans et des centaines de manifestations plus tard, en mai 2024, le Congrès du Nicaragua a annulé la concession accordée à l'entreprise chinoise responsable du projet, enterrant définitivement le projet initial. Mais en novembre 2024, dans un contexte marqué par les premières menaces de Donald Trump concernant le canal de Panama, Daniel Ortega a présenté un nouveau projet de canal à des investisseurs chinois, avec un nouveau tracé.
En quoi consiste le canal interocéanique ? Quelle est son importance aujourd'hui avec les menaces de Trump sur le canal de Panama ? Quelle est la situation actuelle des droits humains au Nicaragua ?
Nous avons discuté de tout cela, et de bien d'autres choses, dans un nouvel entretien de Claves Internacionales avec Francisca Ramírez Torres, connue sous le nom de Doña Chica, une dirigeante paysanne nicaraguayenne, connue pour avoir coordonné le Conseil pour la défense de la terre, du lac et de la souveraineté, un mouvement opposé à la construction du canal interocéanique. Elle a été l'une des cinq finalistes du prix Front Line Defenders en 2017, destiné aux défenseur·es des droits humains en danger. Elle vit actuellement en exil au Costa Rica, dans le Campement paysan de Upala. Une initiative née d'un groupe de paysan·nes demandeur·ses d'asile, provenant de différentes communes du Nicaragua, qui se sont rencontrés dans la lutte contre le canal et qui s'organisent pour faire face ensemble aux défis de la survie en exil et de la résistance communautaire.
Miguel Urbán : Nous aimerions commencer, Doña Chica, si vous le permettez, en vous demandant en quoi consistait le projet de construction du canal interocéanique, connu sous le nom de Canal du Nicaragua.
Doña Chica : Eh bien, c'était un projet lancé par la dictature d'Ortega-Murillo en 2013. Une concession a été accordée sans que nous soyons consultés ou même informés. Nous n'avons jamais donné notre consentement concernant ce fameux canal interocéanique. Ce qu'il y a eu, c'est une vague de violence contre les paysan·nes : l'armée et le Parquet général de la République sont venus mesurer nos terres.
Miguel Urbán : Quel impact ce projet initial aurait-il eu sur le territoire et l'environnement ?
Doña Chica : Une destruction totale de l'environnement et une violence intense contre les communautés paysannes. Mais nous avons résisté. Nous avons organisé plus de cent marches contre le projet, et nous n'avons pas permis qu'une seule pierre soit posée. Je crois que c'était l'un des mouvements les plus farouches contre les intérêts de la dictature. Aujourd'hui, nous en payons le prix : beaucoup de leaders sont déplacés, ont dû quitter leurs terres au Nicaragua et partir en exil les mains vides. Nous avons été déchus de notre nationalité, nos biens confisqués, mais nous pensons que cela en valait la peine. Dans un pays où les droits humains sont violés, où il n'y a pas de justice économique, où seuls les puissants décident de l'avenir du peuple, on ne peut pas se taire. Le mouvement paysan a mené une lutte juste pour défendre les droits des paysan·nes et empêcher l'imposition d'un projet destructeur, autant pour l'environnement que pour notre culture de vie et de travail de la terre.
Miguel Urbán : Théoriquement, ce projet est enterré. Le Congrès nicaraguayen l'a déclaré clos en mai dernier. Mais il semble qu'en novembre, au moment où Donald Trump a remporté les élections et commencé à menacer de reprendre le contrôle du canal de Panama, Daniel Ortega a relancé le projet, en le proposant à nouveau à des investisseurs chinois, comme alternative au canal de Panama. En quoi consisterait ce nouveau projet ?
Doña Chica : C'est un projet voué à l'échec. Nous pensons qu'aucun investisseur digne de ce nom ne peut investir dans un pays où les droits humains sont violés, où il n'y a ni liberté d'expression, ni liberté religieuse, où le peuple est persécuté. Cela n'a aucun sens. Mais avec les intérêts d'Ortega et du grand capital, qui piétinent toujours les droits et la vie des gens, on peut s'attendre à tout.
Mais nous croyons que l'histoire du Nicaragua est marquée par la lutte paysanne, et s'il y a une cause pour laquelle il faut se battre, quitte à risquer sa vie, c'est la terre. Aucun paysan n'acceptera qu'on lui prenne ses terres. Le paysan est généralement attaché à son autonomie — un bon exemple, c'est la lutte de Sandino contre une dictature. Et voilà qu'Ortega cherche à marginaliser à nouveau les paysan·nes, comme en 2013 quand il a imposé une loi pour ce canal interocéanique qui confisquait nos terres. Les paysan·nes se sont à nouveau levé·es, ont participé à la rébellion d'avril, ce qui a poussé beaucoup d'entre nous à l'exil. Mais de l'étranger, nous continuons à résister, parce que nous luttons pour une patrie libre et pour obtenir réparation pour les paysan·nes.
Miguel Urbán : Avez-vous pu analyser ce nouveau projet de canal interocéanique et le regain d'intérêt potentiel qu'il pourrait susciter avec la présidence de Trump ? Que savons-nous de ce projet et de son impact ?
Doña Chica : Oui. Ils ont choisi une nouvelle route, la route numéro quatre, qui avait déjà été envisagée à l'époque. Pour l'instant, nous restons dans l'expectative, même si nous pensons que c'est une menace réelle, vu les intérêts économiques en jeu. Mais cela nous a aussi aidés à nous réorganiser, à rester actifs, à avoir plus d'impact au Nicaragua, étant donné les inquiétudes suscitées chez la population par cette nouvelle proposition. Et même si aucune action concrète n'a été entreprise pour l'instant, les populations concernées par ce nouveau tracé sont elles aussi en alerte et se réorganisent.
Miguel Urbán : Les dernières nouvelles internationales sur le Nicaragua, dans la presse grand public, montraient Rosario Murillo prenant davantage de pouvoir au sein du régime, en assumant la direction de l'armée. Quelle est la situation actuelle ?
Doña Chica : Ils restent au pouvoir parce qu'ils sont armés, mais ils n'ont plus aucun soutien populaire. Aujourd'hui, ils sont rejetés par 90 % de la population. Et ils le savent très bien, c'est pour cela qu'ils interdisent les réunions, qu'ils empêchent toute forme d'organisation, toute articulation sociale. Ils savent qu'ils n'ont plus de soutien. Cette situation les pousse à multiplier les annonces publiques pour vendre une image à l'international. Mais à l'intérieur, ils savent qu'ils ont tout perdu. Peu importe les projets qu'ils inventent, cela ne leur permettra pas de regagner l'appui populaire. Ils ne se maintiennent que par la répression, en réduisant les gens au silence, mais cela ne durera pas éternellement.
Miguel Urbán : Vous êtes actuellement en exil au Costa Rica, Doña Chica. Et si je ne me trompe pas, vous travaillez à un projet appelé Campement paysan de Upala. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ?
Doña Chica : En 2019, à la suite d'une crise humanitaire, nous avons dû quitter nos terres. Et comme les paysan·nes savent cultiver la terre et en vivent, nous avons décidé de louer un terrain à des Costariciens. Nous y avons recommencé à produire, à nous réorganiser, à chercher des moyens de stabilité pour résister. Le campement paysan est né de cette nécessité d'avoir un lieu pour cultiver, assurer notre sécurité alimentaire et notre travail, dans un pays où le statut de réfugié comporte des limites. On a une protection contre le renvoi vers le pays qui nous réprime, mais les moyens de subsistance — la nourriture, le logement, la santé — doivent être assurés par chacun·e. Nous pensons que nous devons continuer à lutter où que nous soyons, et que la stabilité est essentielle pour poursuivre notre combat. Il s'agit de réorganiser le mouvement paysan et les déplacé·es que nous rencontrons, qui partagent les mêmes convictions de lutte. Nous réinventer pour résister.
Vidéo : Mobilisation populaire au Panama contre le bradage du Canal de Panama au profit des États-Unis
https://youtube.com/shorts/yjGNcfaI09w?si=KSIsyTNunXmCY-YA
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Mines, bétail, soja : comment les multinationales saignent le Brésil

Chaque jour, la pression mortifère des multinationales se renforce, y compris sur des espaces encore préservés. Au Brésil, le bassin amazonien et ses régions périphériques sont en proie à une déforestation massive. Place à la culture de soja, à l'élevage de bovins et aux pollutions récurrentes générées par l'extraction minière, aux dépens de la biodiversité et de la survie des communautés locales.
10 mai 2025 | tiré du site de Terrestres
https://www.terrestres.org/2025/05/10/mines-betail-soja-comment-les-multinationales-saignent-le-bresil/
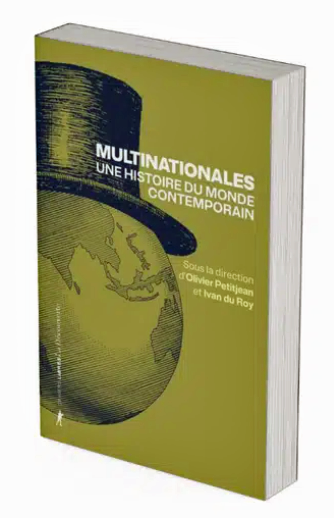
Ce texte constitue le dernier chapitre du livreMultinationales : une histoire du monde contemporain, dirigé par Olivier Petitjean et Ivan du Roy, sorti en février 2025 aux éditions La Découverte.
Le 5 juin 2022, aux confins de l'Amazonie brésilienne, Dom Phillips, journaliste britannique, et Bruno Pereira, anthropologue et expert brésilien des peuples autochtones, sont assassinés alors qu'ils naviguent sur la rivière Itacoaí (État d'Amazonas), un affluent indirect de l'Amazone. Les deux hommes étaient en train de documenter les abus perpétrés contre les communautés autochtones et l'environnement dans le Val do Javari, l'une des plus grandes réserves autochtones du pays, d'une superficie équivalente à celle de l'Autriche et frontalière avec le Pérou. Les organisations de défense de la liberté de la presse déplorent régulièrement les lenteurs de l'enquête de la justice brésilienne. Celle‑ci a cependant permis l'arrestation de plusieurs suspects faisant partie d'un réseau criminel plus vaste, impliqué dans des activités économiques illégales dans cet écrin de biodiversité protégé, telles que la pêche, l'extraction minière et l'abattage de bois, avec des ramifications bien au‑delà des simples acteurs locaux.
Les noms de Dom Phillips et Bruno Pereira s'ajoutent à la longue liste des défenseurs de l'environnement — représentants de communautés locales, militants écologistes, chercheurs… — assassinés au Brésil. Entre 2012 et 2021, 342 des 1 733 meurtres de défenseurs de l'environnement recensés dans le monde par l'organisation Global Witness ont eu lieu au Brésil. Ces défenseurs, qu'ils soient membres de communautés locales, militants écologistes ou simples citoyens, mènent une lutte inégale pour protéger leur terre et leurs droits face à des menaces constantes. Elizeu Berçacola Alves est l'un d'entre eux. Ancien fonctionnaire du secrétariat d'État à l'environnement dans l'État amazonien de Rondônia (frontalier avec la Bolivie), il vit sous la protection du Programme fédéral de protection des défenseurs des droits humains depuis 2016 et a réchappé à plusieurs tentatives d'assassinat. En cause, ses enquêtes sur un homme d'affaires local, Chaules Volban Pozzebon — propriétaire de plusieurs entreprises dans l'industrie du bois, de holdings de gestion d'actifs, et relié à plusieurs sociétés de transport et de construction — impliqué dans la déforestation et le commerce illégal de bois, l'accaparement de terres protégées, la corruption d'élus locaux et le recours au travail forcé. Cet entrepreneur a depuis été condamné et purge une peine de soixante‑dix ans de prison.
Ces assassinats et menaces constituent la manifestation la plus brutale de l'intense pression économique qui s'exerce sur la forêt amazonienne et les communautés qui y vivent, pour y extraire les ressources naturelles ou transformer ces espaces en terres exploitables. En arrière‑plan de ces petites et moyennes entreprises qui opèrent dans l'illégalité, ou se rendent directement coupables d'activités criminelles se dessine l'ombre du puissant secteur brésilien de l'agrobusiness, très présent sur les marchés mondiaux, et dont ces sociétés sont souvent les fournisseurs.
En validant ce formulaire, j'accepte de recevoir des informations sur la revue Terrestres sous la forme d'une infolettre éditoriale bimensuelle et de quelques messages par an sur l'actualité de la revue. Je pourrai me désinscrire facilement et à tout moment en cliquant sur le lien de désabonnement présent en bas de chaque email reçu, conformément à la RGPD.
Viandes et soja
L'agrobusiness brésilien est l'un des principaux moteurs de la déforestation. Parmi les géants de ce secteur, on trouve la multinationale brésilienne JBS, le plus grand producteur de viande au monde, ainsi que les groupes étatsuniens Cargill et Bunge, des acteurs majeurs de la production de soja. JBS, qui porte le nom de son fondateur, José Batista Sobrinho, est créée en 1953 dans l'État de Goiás, au centre‑ouest du Brésil, avant d'installer son siège à São Paulo (la famille Batista possède 49 % des actions). Elle s'est spécialisée dans l'élevage, l'abattage et la vente de viandes bovine, porcine, ovine, de volaille ou de poisson. JBS emploie environ 250 000 personnes sur 500 sites dans plus de vingt pays, et fournit en viande de grands groupes de restauration rapide (McDonald's, Burger King, KFC) ou des enseignes de la grande distribution (Carrefour, Lidl, Walmart). Les millions de têtes de bétail abattues par JBS chaque année nécessitent d'immenses pâturages, entrant en conflit avec la nécessité de préserver les zones protégées, notamment forestières. La multinationale est régulièrement accusée — par des enquêtes journalistiques (notamment le média indépendant Repórter Brasil) ou des rapports d'organisations non gouvernementales — de « blanchiment de bovins », une pratique consistant à acheter des milliers de bovins à des fermes illégales, participant à la déforestation, puis à « légaliser » ce bétail pour l'exporter, notamment dans l'Union européenne.

Des vaches au bord de la route dans le sud du Brésil, dans la région du Pantanal — Julie Daniel CC
Le gouvernement (centre gauche) du président Luiz Inácio Lula da Silva se félicite d'une réduction de 31 % de la déforestation en Amazonie entre janvier et mai 2023 comparée aux années précédentes, quand le pays était encore gouverné par le président d'extrême droite Jair Bolsonaro, qui avait largement affaibli les législations environnementales et encouragé la déforestation. La tendance est cependant tout autre pour le Cerrado, où la destruction des écosystèmes atteint des niveaux records. Contrairement à la forêt amazonienne, la zone du Cerrado n'a pas été incluse dans les territoires concernés par la directive européenne interdisant l'importation de produits issus de la déforestation. Les géants agro‑industriels y ont donc intensifié leurs activités.
Travail esclave
En plus de constituer une menace pour les écosystèmes, l'agriculture intensive recourt au travail forcé. Celui‑ci s'appuie le plus souvent sur une forme de servitude par la dette, plaçant des travailleurs pauvres ou migrants (y compris pour des migrations internes au Brésil) à la merci de recruteurs travaillant pour des propriétaires terriens ou des fournisseurs de grandes marques. Recrutés dans les régions périphériques du bassin amazonien, ils sont envoyés à des centaines de kilomètres de leurs villes ou villages d'origine contre la promesse d'un emploi, sont sous‑payés, travaillent dans des conditions indignes et doivent s'endetter auprès de leur employeur pour leur logement et leur nourriture, ce qui les maintient sous leur emprise. Ces pratiques sont qualifiées de « conditions analogues à l'esclavage » et sont souvent désignées au Brésil par le terme « travail esclave », quand le travailleur est soumis à des conditions dégradantes, à un travail épuisant, à la servitude pour dettes, au travail forcé ou à la restriction de sa liberté de déplacement (l'esclavage a été aboli tardivement au Brésil, par une loi de 1888). Ces pratiques se retrouvent dans l'élevage, la déforestation ou l'extraction minière en Amazonie, mais concernent aussi d'autres secteurs comme la construction ou l'industrie du textile.
De même, le soja brésilien exporté vers l'Asie ou l'Europe — où il sert essentiellement à l'alimentation animale dans les élevages intensifs — constitue l'une des causes majeures de déforestation et d'appauvrissement des communautés locales. Cargill et Bunge, qui figurent parmi les géants mondiaux du négoce de matières premières, en particulier alimentaires, sont des acteurs incontournables de la culture et de l'exportation du soja brésilien. Bunge joue ainsi un rôle majeur dans la destruction du Cerrado, selon une étude menée par la fondation environnementale Mighty Earth (basée à Washington) publiée en juin 2023. Le Cerrado est une vaste savane tropicale, en périphérie de la forêt amazonienne, qui couvre près de 20 % du territoire brésilien. Reconnu comme l'un des écosystèmes les plus riches en biodiversité au monde, il abrite des milliers d'espèces végétales et animales, dont beaucoup sont endémiques. Le Cerrado contribue de manière cruciale à l'équilibre écologique continental, notamment en régulant le cycle de l'eau, et en stockant du carbone pour atténuer le changement climatique. Selon Mighty Earth, les fournisseurs de Bunge ont causé la déforestation de dizaines de milliers d'hectares dans la région de Matopiba, au centre du Brésil, entre 2021 et 2023, malgré l'engagement « zéro déforestation » de la multinationale de négoce.
Un travailleur brésilien dans un champ de cannes à sucre — Cícero R. C. Omena, 2005, CC
Pour lutter contre ce fléau, le Brésil a mis en place en 2003 la « lista suja » (liste noire), un registre public des employeurs reconnus coupables de travail esclave destiné aux entreprises qui s'approvisionnent en soja, sucre ou café et qui veulent éviter des fournisseurs recourant au travail esclave. La constitutionnalité de cette liste a été confirmée par la Cour suprême en 2020 malgré les tentatives de suppression par les lobbyistes de l'agrobusiness et de l'immobilier. L'inclusion d'une entreprise ou d'une marque sur cette liste peut entraîner la suspension de financements publics et de contrats commerciaux. « L'esclavage moderne persiste parce qu'il y a une logique économique derrière : générer plus de profit avec le moindre coût possible, sans aucun respect pour la dignité humaine », estime Leonardo Sakamoto, journaliste brésilien et activiste engagé dans la lutte contre le travail esclave, fondateur du média indépendant Repórter Brasil. Plusieurs grandes multinationales ont été accusées d'implication directe ou indirecte dans des pratiques de travail esclave : la découverte d'ateliers clandestins dans l'État de São Paulo qui confectionnait des vêtements pour Zara (groupe Inditex) fait scandale en 2011. En 2019 et 2020, des ranchs où est pratiqué le travail forcé vendent leur bétail à JBS. Des révélations régulières concernent des usines de bioéthanol ou de sucre (approvisionnant notamment la coopérative agricole française Tereos et sa marque Beghin‑Say).
Pollution minière
L'exploitation minière représente un autre vecteur de destruction en Amazonie, et dans d'autres régions du pays, comme l'État du Minas Gerais. Des multinationales telles que Vale et Anglo American dominent ce secteur, extrayant principalement du fer, de l'or et du cuivre. Les projets miniers nécessitent souvent la construction de barrages, de routes et d'infrastructures qui fragmentent l'habitat naturel et perturbent les modes de vie des communautés locales.
Vale est fondée au Brésil en 1942 sous le nom de Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) par le régime de Getúlio Vargas pour exploiter les mines de fer d'Itabira (Minas Gerais). Elle devient ensuite l'une des plus grandes entreprises minières au monde et le premier producteur de minerai de fer ou de nickel. Elle est privatisée en 1997 puis simplifie son nom en 2009, pour « Vale ». Basée à Rio de Janeiro, la société opère dans quatorze États brésiliens et sur les cinq continents, et possède neuf terminaux portuaires. En 2006, elle acquiert le canadien Inco, plus grand producteur mondial de nickel. Derrière ce succès économique, ses pratiques environnementales et sociales sont très critiquées. Vale a été nommée « pire entreprise du monde » en 2012 par les ONG Greenpeace et Déclaration de Berne (Public Eye aujourd'hui).
Un homme marche dans les décombres après la rupture du barrage de Bento Rodrigues dans le Minas Gerais — Romerito Pontes CC
La compagnie minière est tristement célèbre au Brésil pour deux catastrophes industrielles dans l'État du Minas Gerais, en 2015 puis en 2019, dans une zone où Vale possède de multiples concessions minières. À Mariana, la rupture d'un barrage minier du groupe Samarco (détenu par Vale avec le groupe australien BHP Billiton) provoque la mort de dix‑neuf personnes et le déversement de boues toxiques sur plusieurs centaines de kilomètres en aval, dans la rivière Rio Doce, celle‑là même qui a donné son nom à la multinationale. Trois ans plus tard, à Brumadinho, l'effondrement des bassins de rétention de boues toxiques cause la mort de plus de 300 personnes et une dévastation environnementale massive en aval sur plus de 500 km jusqu'à l'océan Atlantique. En mars 2024, le leader autochtone Merong Kamakã Mongoió est retrouvé mort à Brumadinho. Il aurait été victime de persécutions de la part de policiers militaires et de gardes de sécurité au service de la multinationale, selon des témoignages d'amis et de membres de sa famille. Bien que ces désastres écologiques et humains soient survenus en dehors de l'Amazonie, ils illustrent les risques que posent toujours les activités minières à grande échelle, tant pour l'environnement que pour les populations humaines. D'autant que Vale et d'autres compagnies possèdent plusieurs vastes concessions minières en Amazonie. Barcarena, un district industriel à proximité de Belém, en Amazonie brésilienne, abrite ainsi des installations industrielles telles que la plus grande fonderie d'aluminium au monde, opérée par Hydro Alunorte (filiale de la norvégienne Norsk Hydro), et une usine de kaolin appartenant à l'entreprise française Imerys. Ces installations provoquent des pollutions répétées depuis deux décennies, menaçant la santé des habitants, polluant les rivières et les nappes phréatiques, et altérant les écosystèmes locaux. En deux décennies, au moins vingt‑six accidents industriels et fuites de polluants ont été recensés, principalement liés aux bassins de décantation, contaminant les eaux locales, et rendant la pêche et l'accès à l'eau potable difficiles, voire impossibles.
Mariana (Minas Geraris) – Le barrage de Fundão, exploité par la compagnie minière Samarco, deux ans après la tragédie de l'effondrement de la structure de confinement des résidus – José Cruz/Agência Brasil CC
Norsk Hydro, avec sa fonderie d'aluminium Hydro Alunorte, est une source majeure de pollution. Les « boues rouges » issues de la transformation de bauxite en alumine contiennent des métaux lourds. En février 2018, après des pluies intenses, l'entreprise est accusée de déverser illégalement des effluents contaminés dans la forêt et les rivières. Les conséquences sont graves : acidification des eaux, mortalité des poissons, et risques sanitaires pour les habitants. Les actions juridiques menées par l'autorité fédérale contre les multinationales sont compliquées par un manque de moyens, les enquêtes en cas d'accidents ne sont pas systématiques. Les communautés affectées, principalement les quilombolas (descendants d'esclaves) et les caboclos (métis d'Amérindiens et d'Européens), résistent aux pressions pour quitter leurs terres. Elles revendiquent le droit de rester et demandent la dépollution des eaux et une compensation juste pour les dommages subis. En réponse, l'État du Pará envisage de les délocaliser pour « les protéger des pollutions chroniques », ce qui permettrait d'étendre la zone industrielle de ces deux multinationales. Ce projet de délocalisations forcées s'accompagne de menaces et d'intimidations, exacerbant les tensions locales.
« De la multitude de matières premières qui transitent par leur territoire, les habitants n'en supportent que les retombées négatives », constate au moment de ces pollutions Marcel Hazeu, professeur en sciences environnementales à l'université fédérale du Pará, dans un reportage réalisé par le média Basta !. En plus de supporter les destructions de leur environnement et les pollutions générées par les activités agricoles ou minières, les communautés locales ne bénéficient que très rarement des infrastructures mises en place pour les multinationales (réseau d'électricité, accès à l'eau courante…). Et ne profitent pas forcément des emplois directs ou indirects créés. Les 100 000 employés de JBS au Brésil, qui travaillent dans les abattoirs ou les usines de transformation, perçoivent un salaire moyen de 1 700 Réais (environ 300 euros), très légèrement au‑dessus du salaire minimum, qui demeure très faible au regard du coût de la vie. Dans onze des douze municipalités brésiliennes où JBS possède d'importants sites de production, une recherche menée par l'anthropologue Raísa Pina (université de Brasilia) montre que la pauvreté a progressé de 50 %. La chercheuse précise que son étude ne démontre pas une causalité directe entre les implantations de JBS et l'augmentation de la pauvreté mais met en lumière le paradoxe d'une « nation qui abrite la plus grande entreprise agroalimentaire au monde, avec un slogan “ nourrir le monde ”, tout en connaissant une augmentation de la faim ».
De l'Amazonie à Brasilia
Cette pression physique continue sur l'Amazonie et les communautés qui y vivent se double d'un important lobbying à Brasilia, au parlement fédéral, pour affaiblir ou entraver la moindre politique de protection de l'environnement ou de sanctuarisation de territoires au profit des populations autochtones. Des coalitions ad hoc rassemblant des députés ou des sénateurs de plusieurs partis y défendent spécifiquement les intérêts des groupes agro‑industriels et des grands propriétaires terriens. Ainsi, le FPA (Front parlementaire pour l'agriculture) rassemble en 2024 environ 300 députés (sur 513), issus des partis centristes, de droite libérale, conservateurs ou de droite extrême — également appelé la bancada ruralista (le banc rural) à l'Assemblée nationale — et une cinquantaine de sénateurs (sur 81). Les députés membres du FPA entretiennent un lien privilégié avec un think tank, l'Instituto Pensar Agro (IPA). Celui‑ci ébauche des projets d'amendements et des rapports à destination de ces députés lors de projets de loi, comme celui réautorisant plusieurs pesticides ou celui sur l'exploitation minière des terres indigènes. Or l'IPA est financé par les organisations professionnelles de l'agrobusiness, qui regroupent producteurs, entreprises et géants des secteurs agro‑industriels, comme JBS, Cargill, Bunge, Nestlé, ou de la chimie, tels BASF et Bayer.

Tereza Cristina, alors ministre de l'Agriculture du Brésil, au World Cotton Day organisé par l'OMC le 7 October 2019 — WTO/ Roxana Paraschiv
Lors du mandat du président Jair Bolsonaro (2019‑2023), les députés du FPA ont tenu pas moins de 160 rencontres officielles avec les délégués de l'IPA et des représentants du ministère de l'Agriculture, dont vingt réunions en présence de la ministre Tereza Cristina, elle‑même porte‑voix des intérêts agro‑industriels quand elle était députée. Cet intense lobbying a été documenté par l'Observatoire de l'agrobusiness au Brésil (De Olho nos Ruralistas), un média indépendant. À ces réunions s'ajoutent les rendez‑vous bilatéraux entre multinationales et membres du gouvernement. Syngenta, multinationale suisse désormais propriété de ChemChina, se distingue avec quatre‑vingt‑une réunions avec le ministère de l'Agriculture, suivie de JBS avec soixante‑quinze rencontres, puis Bayer, leader du marché brésilien des pesticides, avec soixante entrevues. Bayer a également tenu seize réunions en dehors des registres officiels, incluant une audience directe avec le président Bolsonaro et la participation de la ministre Tereza Cristina à une vidéo institutionnelle de la multinationale.
Pendant la présidence Bolsonaro, les députés membres de la bancada ruralista ont joué un rôle majeur dans le démantèlement des lois protégéant l'environnement. Le code forestier de 2012 a ainsi été modifié sous la pression des lobbyistes de l'agrobusiness pour faciliter la déforestation légale au profit de l'expansion des cultures de soja et des pâturages pour le bétail. La bancada ruralista a également soumis des projets de loi comme celui visant à reclasser des zones protégées en « zones d'occupation anthropique » en vue de les ouvrir à l'exploitation agricole, ou permettre l'extraction minière et la construction de barrages hydroélectriques au sein des territoires sanctuarisés pour les populations autochtones. La corruption et les soupçons d'implication dans des activités économiques criminelles, constatées au cœur de l'Amazonie, remontent aussi au plus haut niveau du pouvoir brésilien. Le ministre de l'Environnement du gouvernement Bolsonaro, Ricardo Salles, a dû démissionner de son poste en 2021 alors qu'il est ciblé par deux enquêtes de la Cour suprême fédérale pour commerce illégal de bois et… violation de la législation environnementale dans des espaces protégés. Ces enquêtes ne l'ont pas empêché d'être réélu député fédéral en 2023.
Le réseau d'influence tissé par la FPA et l'IPA met en lumière comment les intérêts économiques des multinationales pèsent lourdement sur les décisions politiques au Brésil, au détriment des régulations environnementales et des droits des peuples autochtones et communautés locales. Le cas brésilien illustre l'énorme pression économique qu'exercent de nombreux acteurs économiques, en premier lieu les multinationales de l'agroalimentaire et de l'extraction minière, sur de vastes zones naturelles comme l'Amazonie et le Cerrado. Les diverses formes que prend cette pression — des menaces qui pèsent sur les défenseurs de l'environnement et les communautés locales jusqu'à la déforestation massive, en passant par les pollutions industrielles, des conditions de travail indignes, ou la destruction de précieuses zones de biodiversité — se manifestent bien au‑delà du Brésil, que ce soit dans d'autres États amazoniens d'Amérique du Sud, dans les forêts tropicales d'Afrique équatoriale ou d'Asie du Sud‑Est, dans le vaste territoire canadien ou les steppes de Sibérie, et parfois même au nom de la transition écologique. Mettre en place et faire respecter de véritables politiques de préservation et de lutte contre le réchauffement climatique, quitte à contraindre l'appétit des multinationales, constitue l'un des défis majeurs du nouveau siècle.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Équateur : Qu’est-il arrivé à la gauche ?

Il y a un peu plus d'un mois, le 13 avril 2025, Daniel Noboa Azín du parti Action Nationale Démocratique (ADN) a été réélu à la présidence de l'Équateur. En revanche, la droite sociale-démocrate, représentée par Luisa Gonzáles du parti Revolución Ciudadana (RC) - liée à l'ancien président Rafael Correa - a perdu pour la troisième fois la course au siège présidentiel. L'axe discursif corréisme/anti-corréisme est réapparu comme stratégie électorale, mais cette dichotomie n'explique pas la crise structurelle du capitalisme et ne reflète pas non plus les antagonismes de classe, comme certains secteurs ont essayé de le positionner. La logique électorale, transformée en cage de fer, a capturé les masses séduites par des promesses immédiates. Plus de 1,2 million de voix ont ratifié Noboa, une figure associée aux intérêts du capital transnational et de l'impérialisme américain.
https://vientosur.info/ecuador-que-le-paso-a-la-izquierda/
15 mars 2025
Cette analyse se démarque des interprétations simplistes qui attribuent son triomphe à l'utilisation de l'État, au marketing politique, aux erreurs de son adversaire, aux campagnes de désinformation ou aux théories de la méga-fraude. Elle examine plutôt trois facteurs clés :
• La mise en place de réponses matérielles et punitives aux revendications sociales, ainsi que la capitalisation du mécontentement populaire, notamment le rejet du corréisme.
• Les convergences économiques et politiques entre la droite néolibérale (ADN) et la social-démocratie (RC), qui ont limité la différenciation programmatique.
• La crise de la gauche institutionnelle et l'absence d'un projet anticapitaliste cohérent.
1. Les données ne tuent pas la narration
Dans certains milieux universitaires et médiatiques, il existe un mythe selon lequel les données objectives déterminent le succès politique. Or, la politique se définit par la capacité à imposer des récits et à exercer le pouvoir, et pas seulement par des statistiques. Noboa, élu en novembre 2023, a dû faire face à un mandat intérimaire marqué par des scandales et des chiffres défavorables :
• Fin 2023 : le ministère de l'Environnement accorde à l'entreprise Vinazin S.A., dont Lavinia Valbonesi - l'épouse du président - est actionnaire majoritaire, un enregistrement environnemental pour un projet immobilier privé à Olón, au sein d'une zone de forêt et de végétation protégées.
• Juin 2024 : Des contrats de petits-déjeuners scolaires d'une valeur de plus de 150 millions de dollars ont été attribués à la Corporación de Alimentos y Bebidas (CORPABE S.A.), liée à Isabel Noboa Pontón, la tante du président.
• Février 2025 : Le ministère de l'énergie et des mines attribue le champ Sacha (77 000 barils par jour) au consortium SINOPETROL, lié aux proches de Noboa. Sous la pression électorale, la décision est annulée le 12 mars.
• NARPOTEC : Port contrôlé par la famille Noboa à Guayaquil, où 151 paquets de cocaïne ont été saisis en 2025. Un entrepreneur de la société est arrêté mais relâché grâce à un avocat lié au gouvernement (Revista Raya, 2025).
• Crise énergétique (2023-2024) : Des pannes récurrentes ont causé des pertes de 7,5 milliards de dollars US dans le secteur commercial et industriel. Il est fort probable que le phénomène se répète cette année (Chambre de commerce de Quito, 2025).
• Violence : l'Équateur a l'un des taux d'homicide les plus élevés au monde. Rien qu'au cours des 50 premiers jours de l'année 2025, plus de 1 300 meurtres ont été enregistrés, ce qui équivaut à une moyenne d'un homicide par heure. Cette tendance s'est intensifiée au cours du premier trimestre de l'année, lorsque le chiffre a presque doublé pour atteindre 2361 cas, une étape qui a été décrite comme l'une des périodes les plus violentes de l'histoire du pays. Malgré les 85 000 opérations militaires menées au cours de l'année par ce que l'on appelle le bloc de sécurité - composé des forces armées et de la police nationale - ces actions n'ont eu que peu ou pas d'impact sur la réduction de la criminalité.
• Affaire Les 4 enfants des Malvinas : en décembre 2024, quatre enfants d'origine africaine ont été arrêtés dans le sud de Guayaquil par des militaires au cours d'une patrouille nocturne. Le gouvernement a délibérément manipulé l'affaire jusqu'après les élections, lorsque le témoignage du personnel en uniforme impliqué a révélé que les victimes avaient été enlevées, torturées et ensuite tuées.
• Ingérence américaine : le 29 mars 2025, Daniel Noboa a rencontré Donald Trump et a demandé la collaboration d'Erik Prince, fondateur de l'entreprise militaire privée Blackwater, qui s'est rendu dans le pays au cours de la première semaine d'avril. Ces actions s'inscrivent dans une série de politiques controversées : déclarations récurrentes de l'état d'urgence - la dernière datant du 12 avril, moins de 24 heures avant le second tour des élections -, militarisation de la société civile et impunité légale pour les membres des forces de sécurité, entre autres mesures.
En plus de ces facteurs, le limogeage de sa vice-présidente Verónica Abad, les allégations de violence par procuration de la part de son ex-femme Gabriela Goldbaum, la hausse des prix du carburant et la fraude aux licences de campagne n'ont pas empêché sa victoire. Pourquoi la population l'approuve-t-elle alors qu'il s'agit d'un régime ploutocratique ? Pourquoi les analyses de la gauche institutionnelle et de la social-démocratie étaient-elles si erratiques ?
2. La conquête des esprits et des cœurs
Le triomphe électoral de Daniel Noboa a suscité trois interprétations prédominantes. La première – articulée par des analystes tels que Durán Barba, García et Ricaurte – tourne autour du marketing politique. Selon cette vision, Noboa a réussi à se différencier de l'archétype de l'homme politique traditionnel – y compris le corréisme – en capitalisant sur les erreurs de son adversaire, Luisa González. Parmi celles-ci figurent des propositions ambiguës telles que la « dollarisation à l'équatorienne », les « gestionnaires de la paix », la proximité controversée avec Maduro, la réactivation de la Loi de Communication et les scandales révélés dans les discussions d'Augusto Verduga, ancien conseiller du Conseil de participation citoyenne et de contrôle social (CPCCS).
Une seconde approche —défendue par des auteurs comme Andino et Santiago— rend responsable la machine d'État. Ici, on soutient que l'utilisation systématique des ressources publiques, des fonctionnaires et des appareils institutionnels à des fins de prosélytisme aurait été décisive. Cette pratique, cependant, n'est pas nouvelle : depuis le début du XXIe siècle, les gouvernements équatoriens ont normalisé l'instrumentalisation de l'État pendant les campagnes, ce qui remet en question leur rôle en tant que facteur exclusif dans ce processus.
La troisième lecture, conduite par Rafael Correa, vise un mégafraude au moyen de stylos à encre effaçable qui auraient altéré les voix. Cette thèse, néanmoins, se heurte à un fait gênant : la Révolution citoyenne a déployé une armée d'observateurs formés aux processus électoraux, ce qui affaiblit la narration d'une manipulation généralisée.
Les critiques transversales révèlent les limites de ces explications. L'obsession pour le marketing, par exemple, réduit l'électeur à ce que Durán Barba (2011) a appelé "des singes avec des rêves rationnels", une métaphore qui déshumanise et simplifie le lien entre les stratégies communicatives et les préférences citoyennes. De plus, bien que l'utilisation de l'État à des fins électorales soit réelle, sa récurrence historique en fait un élément structurel plutôt qu'une variable décisive unique. Enfin, la théorie de la fraude ignore tant la capacité de surveillance de Rafael Correa qu'un fait indiscutable : Noboa a su se connecter à l'immédiateté de la population.
Au-delà des récits en conflit, le triomphe s'explique par l'efficacité de Noboa à offrir des réponses symboliques - bien qu'éphémères - à des demandes urgentes. Les états d'urgence contre la violence, le déploiement militaire dans les rues ou les bons économiques de 500 millions de dollars pendant la campagne ont fonctionné comme des mirages de solution dans un contexte où le structurel est relégué au profit de l'urgence électorale.
Pour illustrer ces assertions, prenons d'abord le cas des enfants assassinés aux Malvinas. Le récit de la gauche institutionnelle se concentre sur la thèse selon laquelle "l'État n'a pas respecté les droits de l'homme". Bien que cela soit vrai, sa limite réside dans le fait de ne pas offrir de réponses concrètes au problème structurel de la violence dans les populations. Il existe une asphyxie dans les conditions matérielles de vie des secteurs populaires — aggravée par l'insécurité et le narcotrafic — qui oblige les propres communautés, et non l'État, à rejeter le discours des droits de l'homme pour rechercher la justice par leurs propres moyens. Le cas des 4 enfants des Malvinas, une exécution extrajudiciaire et un crime d'État, révèle cette contradiction : le récit dominant de la gauche institutionnelle et de la social-démocratie ne se connecte pas avec les besoins immédiats de la population.
La posture de Noboa, en revanche, l'a fait. En recourant à la militarisation, aux états d'exception, à la cession de souveraineté et aux complexes pénitentiaires sous le discours de la main de fer, son discours a nié l'État de droit dans sa conception libérale, mais a résonné auprès des secteurs qui privilégient la survie. La population soutient ces mesures dans la logique de faire face aux gangs, valorisant davantage la présence militaire dans les rues que les récits abstraits sur les droits humains, en particulier dans les zones où la violence les a effacés de facto.
Cela ne cache pas que la violence s'exprime, avant tout, comme un manque d'emploi, de services de base, de transports dignes, de soins médicaux et d'aliments. Noboa ne cherche pas à résoudre ces problèmes de fond ; cependant, sur le marché des votes - la mal nommée démocratie - son image s'est mieux vendue que celle de ses rivaux. Pourquoi ? Parce qu'en contexte actuel de guerre ouverte contre le peuple et de besoins urgents, la dimension des droits — humains, ethniques, de genre — a cessé de fonctionner comme élément mobilisateur pour de larges secteurs populaires. L'efficacité de Noboa résidait dans sa capacité à capitaliser ce vide : il a offert des mirages d'ordre immédiat dans un scénario où le structurel reste une promesse non tenue.
Un deuxième thème évident est la demande de travail et d'emploi. La majorité de la population manque de ressources pour couvrir ses besoins immédiats tels que l'alimentation, la santé, les services de base ou les dettes. Les bons remis par Noboa — qualifiés par certains d'immoraux ou d'antiéthiques —, malgré leur caractère momentané et limité, ont matériellement soulagé des familles en crise. Bien qu'ils ne résolvent pas les problèmes structurels, la différence entre manger ou ne pas manger dans les secteurs les plus vulnérables constitue une base de soutien social que Noboa a su capitaliser. Contrairement aux récits publics, sa victoire s'explique par le fait que l'élite qu'il représente a réussi à hégémoniser les esprits et les coeurs, en partant de réponses concrètes qui ont consolidé son pouvoir.
Cette pratique, en outre, n'est pas nouvelle. Lors d'élections précédentes, le parti qui est aujourd'hui dans l'opposition (Révolution Citoyenne) a doublé la valeur du Bon de Développement Humain pendant les campagnes, lorsqu'il était au gouvernement. Son candidat-président de l'époque, Rafael Correa, tout comme Noboa, n'a pas demandé de licence pour faire de la propagande, un acte qui était alors légal mais contesté. La différence réside dans le fait qu'après la réforme du Code de la démocratie poussée par le corréisme dans son rôle d'opposant, de telles actions sont aujourd'hui illégales. Cependant, la logique sous-jacente persiste : utiliser des ressources d'État pour gagner des adhésions immédiates.
Face à cela, la social-démocratie et la gauche institutionnelle pourraient recourir à Paulo Freire et diagnostiquer un syndrome de l'opprimé : l'internalisation de la logique de l'oppresseur par les victimes, qui finissent par dupliquer sa domination (Freire, 2005). Ou, dans sa version la plus simpliste, traiter le peuple de fasciste, de fleur bleue, d'âne, avec des phrases comme « après, ne vous plaignez pas ». Mais la réflexion de fond, dans une clé gramscienne, est qu'il n'y a pas d'hégémonie — conquête d'adhésions authentiques — sans une intervention matérielle minimale dans la réalité (Thwaites Rey, 2007). Alors que Noboa a offert, au moins symboliquement, des palliatifs concrets, ses rivaux se sont enfermés dans des discours abstraits ou dans la dénonciation éthique, sans proposer d'alternatives tangibles dans un contexte où la survie prime sur l'idéologie.
3. Droite radicale et ‹gauche› modérée
Au-delà des nuances théoriques du libéralisme économique — comme la synthèse néoclassique —, le capitalisme opère avec deux styles définis de politique économique : le libre marché et le keynésianisme. En Équateur, ces visions se sont confrontées il y a un mois lors des élections : le projet néolibéral-oligarchique de Noboa contre le projet keynesien-social-démocrate de González. Ce scénario reflète une lutte inter-bourgeoise, où deux factions de la classe dominante — avec des intérêts non antagonistes — disputent le modèle d'accumulation et la gestion du social. Les deux groupes, malgré des rhétoriques opposées, partagent des pratiques étatiques depuis 2014, comme l'attestent les politiques de la droite social-démocrate (RC) et la néolibérale (ADN).
Les coïncidences sont palpables. À l'Assemblée nationale, le RC et l'ADN ont voté ensemble en faveur de la Loi sur l'efficacité économique et la génération d'emplois (2023) et du projet de réforme constitutionnelle pour l'assistance militaire étrangère (2025). Pendant la campagne, González a renforcé son alignement avec le pouvoir économique : il a rencontré Mónica Heller, une figure pro-israélienne liée aux chambres de commerce, et a proposé de rapatrier les migrants vénézuéliens, rejoignant le discours sécuritaire de Jean Tópic, un mercenaire proche de Nayib Bukele.
De plus, la social-démocratie a montré des ambiguïtés qui ont approfondi sa déconnexion. Dans des territoires affectés par l'exploitation minière, son offre de respecter les consultations populaires — sans proposer de moratoire ou de révocation des concessions — s'est avérée insuffisante. Il n'y a également pas eu d'autocritique concernant les violations des droits des indigènes — depuis l'éducation interculturelle jusqu'aux exécutions extrajudiciaires — commises sous leurs gouvernements. Dans le discours de Tixán, espace où des alliances ont été scellées avant le second tour, des slogans vides comme espoir ou patrie ont prédominé, éludant des réponses concrètes aux demandes urgentes.
Alors que la droite avance avec pragmatisme - contrôlant le gouvernement, l'État et l'économie élargie - la social-démocratie et la gauche institutionnelle fantasment, s'enfermant dans des rhétoriques. La première, influencée par des figures telles que Milei, Trump ou Bukele, radicalise sa défense de la propriété privée et sa guerre existentielle contre le communisme. Les secondes, en revanche, appellent à la désescalade, sans réaliser que leur modération consolide leur plafond de verre. La bourgeoisie, ainsi, hégémonise à la fois les moyens matériels (pouvoir économique, monopole de la violence, domination institutionnelle) et les immatériels (idéologie, médias, bon sens), configurant ce qui est défini comme pouvoir-réellement-existant : la trilogie de la propriété privée (Marx), l'État en tant qu'appareil de domination de classe (Lénine) et l'hégémonie comme conquête des esprits et des cœurs (Gramsci) (Iza, Tapia et Madrid, 2024, p. 27).
Après les résultats électoraux, le corréisme fait face à un dilemme. Malgré sa présence législative et au sein des gouvernements locaux, les défections internes et la haine semée par les élites — qui associent RC au communisme malgré sa distance idéologique — érodent sa base. Le rejet, fonctionnel aux intérêts de l'oligarchie, se nourrit d'un mécontentement populaire que la gauche institutionnelle n'a pas su canaliser. Dans ce jeu, la droite ne se contente pas de gagner des élections : elle redéfinit les règles du pouvoir.
4. Paradoxes de la gauche
Deux paradoxes résument le carrefour équatorien. Le premier : Noboa a triomphé en canalisant le mécontentement populaire, tout comme Correa en 2006 a capitalisé sur le ras-le-bol néolibéral. Azín a même absorbé le mécontentement exprimé lors des grèves de 2019 et 2022. C'est lui — et non la gauche — qui a incarné la rupture, défiant des cadres normatifs et se connectant avec la désespérance des majorités par le biais d'une action séparée de la politique traditionnelle.
La seconde est plus aigüe : tandis que la social-démocratie et la gauche institutionnelle exigent le respect de la Constitution et de l'État de droit, la droite oligarchique les viole systématiquement. Cela contredit la tradition critique de la gauche historique, qui postulait la transformation radicale de l'ordre. La droite pousse les limites du permis, tandis que ses rivaux renforcent un statu quo qu'ils prétendent combattre.
Les dernières années montrent un schéma clair : les conquêtes de la gauche anticapitaliste et du champ populaire les plus significatives — comme les soulèvements d'octobre 2019 et de juin 2022, dirigés par la CONAIE — ont émergé en dehors des voies institutionnelles. Ici, une autre tension émerge : le droit à la résistance entre en conflit avec la souveraineté de l'État, un dilemme juridique qui reflète un conflit matériel. Des mouvements comme Black Lives Matter (États-Unis), les gilets jaunes (France), ou l'expérience panafricaine d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso et dans d'autres pays du Sahel confirment que la légitimité populaire se gagne souvent en marge de la légalité bourgeoise. Cependant, la gauche institutionnelle, piégée dans son conservatisme —plus papiste que le Pape—, défend le contrat social qui l'étouffe, tandis que la droite estompe les frontières normatives pour recueillir un soutien populaire et faire des affaires.
Ce cynisme se reproduit dans des alliances comme celle de Pachakutik avec le gouvernement de Noboa le 7 mai 2025, continuant de manière honteuse une politique de conciliation des classes. Des personnages comme Ricardo Vanegas, Guadalupe Llori ou Salvador Quishpe —qui en 2021 ont conclu un accord avec le gouvernement de Guillermo Lasso— ne sont pas des exceptions : ils sont des symptômes d'un système de partis où prédominent les intérêts de classe et les mirages de mobilité sociale. Parler de trahison est naïf ; le problème est structurel. La soi-disant discipline organique s'efface devant les calculs pragmatiques dans des espaces de pouvoir comme l'Assemblée.
Enfin, la gauche anticapitaliste n'a pas non plus renouvelé ses stratégies après les soulèvements d'octobre et de juin. Son atomisation et son manque de ressources matérielles et intellectuelles l'empêchent de construire un projet de pouvoir avec une identité propre. Ce vide a ouvert la voie au clan Noboa pour capitaliser sur le mécontentement.
Le défi est clair : le fascisme n'est pas un monstre à venir, mais une menace larvée dans les couloirs des partis néolibéraux et sociaux-démocrates, dans des ONG élitistes, chez plusieurs journalistes influents, dans la répression officielle et parmi une intelligentsia de droite radicalisée. Noboa frappera économiquement les secteurs populaires, mais la montée du fascisme se mijote dans les entrailles du pouvoir-réellement-existant. Surmonter cette cécité théorique et pratique exige que la gauche anticapitaliste se réinvente, transcendant ses jalons historiques.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Mort de José Mujica : le repos du guerrier

"Mon cycle est terminé. Sincèrement, je meurs et le guerrier a droit à son repos". Le 9 janvier, José Alberto Mujica Cordano (Montevideo, 1935-2025), Pepe Mujica, ancien guérillero de Tupamaro, ancien député, ancien président de l'Uruguay, fait ses adieux publiquement après avoir annoncé que les métastases de son cancer de l'œsophage découvert en 2024 avaient « colonisé » son foie et qu'il ne donnerait plus d'interviews et n'accepterait plus de soins palliatifs. Le mardi 13 mai, sa vie s'est définitivement arrêtée.
https://vientosur.info/muere-jose-mujica-el-descanso-del-guerrero/
13 mai 2025
À l'âge de 89 ans, le vétéran de la politique a laissé des instructions pour être enterré avec sa chienne Manuela dans sa maison, la ferme Rincón del Cerro, à la périphérie de Montevideo.
Issu d'une famille modeste, cultivateur de fleurs ayant abandonné ses études secondaires pour travailler dans les champs, d'origine basque et italienne, Mujica a rejoint le Mouvement national des Tupamaros (MLN-T), une organisation armée de gauche née dans le feu de la révolution cubaine au début des années 1960. Il a été touché par balle six fois lors d'affrontements avec la police. Il a passé 15 ans de sa vie en prison et s'est évadé de deux d'entre elles.
En 1971, avec le chef suprême et fondateur des Tupamaros, Raúl Sendic, et d'autres dirigeants historiques -Eleuterio Fernández Huidobro, Jorge Manera Lluberas et de nombreux militants-, il a mené une évasion spectaculaire de la prison de Punta Carretas, recréée dans le film La noche de 12 años, de l'Uruguayen Álvaro Brechner.
Sans tirer un coup de feu, en silence, en rampant dans un tunnel de 40 mètres depuis leurs cellules, dans une opération complexe qui a duré 20 minutes, 106 militants des Tupamaros, de l'OPR-33, des FARO et cinq prisonniers de droit commun, répartis sur trois étages différents de la prison, ont réussi à s'échapper par la sortie d'une maison privée située à l'extérieur, précédemment occupée par un commando de soutien aux Tupamaros.
Mujica a été à nouveau emprisonné en 1972 et a retrouvé la liberté en 1985, avec le retour de la démocratie en Uruguay. Avec d'autres anciens dirigeants tupa et d'autres groupes de la gauche radicale, Mujica crée quatre ans plus tard le Mouvement pour la participation populaire (MPP), qui fait partie de la coalition de centre-gauche Frente Amplio, née au début des années 1970.
Le Frente Amplio remporte les élections présidentielles pour la quatrième fois en novembre 2024 avec Yamandú Orsi, le dauphin de Mujica, comme candidat à la présidence, et Carolina Cosse comme vice-présidente, soutenu-es par plusieurs forces de la gauche radicale de la coalition.
Le Frente Amplio regroupe une trentaine de partis, mouvements et courants de gauche, socialistes, communistes, trotskistes et démocrates-chrétiens. Dans leur programme commun, ils se définissent comme progressistes, anti-impérialistes, antiracistes et anti-patriarcaux.
Pepe Mujica a été député du Frente Amplio, sénateur, ministre de l'agriculture de Tabaré Vázquez et est devenu président de l'Uruguay en 2010 après avoir remporté les primaires de cette coalition hétéroclite.
Les gouvernements du Frente Amplio, ceux du socialiste Tabaré Vázquez (2005-2010 et 2015-2020) et de Pepe Mujica (2010-2015) ont définitivement brisé le bipartisme, l'alternance existant depuis des décennies entre le Parti national et le Parti Colorado.
Malgré la promotion d'un programme de mesures sociales progressistes dès le premier gouvernement du Frente Amplio, les divisions en son sein sont rapidement apparues.
Tabaré Vázquez a opposé son veto à une proposition de la majorité de la coalition, approuvée par le Parlement, visant à légaliser l'interruption de grossesse. Il a également opposé son veto à une proposition législative du Frente Amplio visant à abolir la Ley de Caducidad, qui avait laissé impunis les crimes commis par les militaires, les policiers et les civils pendant la dictature militaire.
Tabaré Vázquez a accepté seulement que certains responsables de ces crimes ne soient pas couverts par cette amnistie.
Mujica a remplacé Vázquez en 2010 après le second triomphe électoral du Frente Amplio et a apporté une tendance plus progressiste au gouvernement. Pendant son mandat, l'avortement et le mariage homosexuel ont été légalisés, et l'Uruguay est devenu le premier pays au monde à légaliser la vente et la consommation contrôlées de marijuana, réglementées par l'État.
« Nous appliquons un principe très simple , disait Mujica, reconnaître les faits. L'avortement est vieux comme le monde. Aujourd'hui, les femmes ne se rendent pas directement à la clinique pour avorter. C'était le cas lorsque c'était clandestin. Ici, elle va voir un psychologue et elle est bien soignée ».
Quant au mariage homosexuel, il a déclaré : « On dit que c'est moderne, mais c'est plus ancien que nous tous. C'est une réalité objective. Il existe et ne pas le légaliser reviendrait à torturer les gens inutilement ». « Laissons chacun faire ce qu'il veut de son cul », a-t-il déclaré lors d'une entrevue.
Et il dirait la même chose de la consommation de marijuana : « C'est un outil pour lutter contre le trafic de drogue, qui est un crime grave, et pour protéger la société ». Mujica a apporté une précision : « Mais attention, les étrangers ne pourront pas venir en Uruguay pour acheter de la marijuana ; il n'y aura pas de tourisme de la marijuana ».
Bien qu'étant un petit pays de 3,5 millions d'habitants sans importance particulière au niveau international, l'Uruguay a joué un rôle actif dans les nouvelles organisations régionales d'Amérique latine et des Caraïbes au cours des premières décennies du 21e siècle, lorsque des gouvernements plus progressistes que jamais dans l'histoire de la région sont arrivés au pouvoir, sous les gouvernements du Frente Amplio et en particulier sous le mandat de Mujica.
Des forces progressistes aux caractéristiques différentes sont arrivées au pouvoir en Argentine, en Uruguay, au Chili, au Brésil, au Paraguay, en Bolivie, en Équateur, au Salvador, au Venezuela et au Nicaragua, et contrairement aux turbulences, aux divisions internes et aux graves déviations idéologiques qu'ont connues plusieurs de ces processus, le Frente Amplio est parvenu à maintenir une relative stabilité interne malgré les différences entre les groupes qui le composent.
Mujica a attribué ces déviations dans d'autres pays au culte de la personnalité et à l'éloignement de nombreux dirigeants des mouvements sociaux et des majorités qui les ont portés au pouvoir.
Ces dernières années, il a fini par se montrer très critique non seulement à l'égard de Daniel Ortega, qui suivait la dérive dictatoriale de l'ancien dirigeant du FSLN, ou de Nicolás Maduro, qu'il considérait comme ayant trahi l'idéologie chaviste, mais aussi à l'égard de Cristina Kirchner ou d'Evo Morales, qui n'avaient pas accepté que « leur temps soit révolu » et à qui il recommandait de s'effacer et de passer le relais aux nouvelles générations.
« Dans la vie, il y a un temps pour arriver et un temps pour partir , a déclaré M. Mujica. Un bon dirigeant est celui qui non seulement fait de bonnes choses, mais qui a aussi la capacité de créer une bonne équipe capable de les poursuivre ».
Même lorsqu'il était président, Mujica n'a jamais cessé de vivre avec sa compagne Lucía dans leur modeste ferme de 20 hectares à Rincón del Cerro, une zone rurale proche de la capitale uruguayenne.
Il travaillait personnellement la terre avec son tracteur et vendait sa production, car pendant des années, il a donné 90 % de son salaire à des œuvres sociales et 5 % au Movimiento de Participación Popular (MPP). Il affirmait qu'avec les pesos qui lui restaient, le salaire de sénateur de sa compagne et les produits qu'il vendait, ils avaient de quoi vivre ensemble.
À la mort de sa compagne de toujours, Lucía Topolansky, ancienne Tupamara et ancienne sénatrice, la ferme passera aux mains du MPP, a décidé le couple.
La vie austère de l'ancien guérillero, sa simplicité, sa façon de parler simple et directe, sa lutte contre la corruption et le gaspillage, son engagement social, sa capacité à parler et à dialoguer avec le peuple comme avec les dirigeants des grandes puissances, sa tolérance et sa recherche constante du consensus avec ceux qui défendaient d'autres positions idéologiques, lui ont valu le respect même de nombreux hommes politiques et de personnes aux positions diamétralement opposées aux siennes.
Malgré cela, sa vie politique publique n'a pas été exempte de critiques sévères de la part des secteurs qui partageaient son militantisme au sein des Tupamaros, ainsi que de la part de militants d'autres groupes de gauche. Nombreux étaient ceux qui affirmaient que Mujica était absorbé par le système même qu'il avait combattu depuis sa jeunesse.
En mai 2007, il avait fait une déclaration dans laquelle il faisait l'autocritique de son passé de guérillero : « Je regrette profondément d'avoir pris les armes avec peu d'habileté et de ne pas avoir évité une dictature en Uruguay ».
L'adaptation de l'ancien guérillero aux temps nouveaux, sa façon particulière de faire de la politique depuis le parlement, d'abord comme député, puis comme sénateur et enfin comme président, a souvent été perçue par les secteurs les plus radicaux de la gauche comme un abandon des valeurs idéologiques des Tupamaros.
Les critiques qu'il a reçues de la part des secteurs de gauche, parfois très dures, portaient sur divers aspects de ses positions politiques : l'absence d'avancées significatives en matière de redistribution des richesses au cours de son mandat, ses changements de position à l'égard des militaires, ou encore ses divergences avec le mouvement féministe.
En 2019, après avoir été élu sénateur, il fait des déclarations controversées et agressives à l'hebdomadaire uruguayen Voces. Il va jusqu'à dire que « Le mouvement féministe est tout à fait inutile ». Mujica reconnaît le machisme, dénonce la société patriarcale, mais affirme que le féminisme ne peut pas remplacer la lutte des classes. « Je vois aussi des classes sociales au sein même du mouvement féministe », a-t-il affirmé.
La déclaration qui a peut-être suscité le plus de critiques au sein du mouvement féministe uruguayen est celle qu'il a faite dans la même entrevue à propos du rôle des femmes à la maison : « Les femmes ont une responsabilité envers leurs enfants qui n'est pas celle des hommes. Elles font tout pour les nourrir et les protéger. Une femme est toujours une mère, et nous parcourons le monde en ayant toujours besoin d'une mère, parce que sinon vous ne savez même pas où se trouve votre chemise ».
La gauche a également critiqué Mujica et Topolansky en raison de leur opinion sur l'armée et des relations qu'ils ont entretenues avec les forces armées au cours de leur mandat.
L'une des controverses qui dure depuis des années au sein du Frente Amplio concerne la position à adopter par rapport à la loi 15.848 sur l'extinction des créances punitives de l'État, adoptée en 1986 sous le gouvernement de Julio María Sanguinetti, chef du parti conservateur traditionnel Colorado, qui a remporté les premières élections après le retour de la démocratie en 1984.
Cette loi amnistie les crimes commis par la dictature militaire entre 1973 et le 1er mars 1985, date de l'entrée en fonction de Sanguinetti.
Face aux critiques du Frente Amplio et de certains secteurs de la société, Sanguinetti a soumis le maintien ou l'annulation de cette loi d'impunité à un plébiscite populaire en 1989. Selon certains analystes, la crainte d'une révolte des militaires et de leur retour au pouvoir pourrait avoir été la raison pour laquelle le plébiscite a abouti au maintien de la loi.
Mujica a dénoncé le président Sanguinetti à l'époque pour avoir utilisé la loi controversée afin d'entraver l'enquête sur les cas de prisonniers disparus. Pendant sa présidence, Sanguinetti a décidé de protéger en vertu de cette loi des cas tels que la détention du militant communiste Álvaro Balbi, arrêté en 1975, emmené au bataillon d'infanterie 13, où il a été retrouvé mort le lendemain.
Lorsque Mujica est arrivé au pouvoir, il a annulé la décision de Sanguinetti, qui avait également été critiquée par la Cour interaméricaine des droits de l'homme.
En 2009, avec Tabaré Vázquez au pouvoir, le Frente Amplio a de nouveau fait pression pour obtenir un nouveau plébiscite, et le même résultat s'est répété. La majorité des Uruguayens a décidé de maintenir la loi en place.
Mujica a toujours critiqué le fait que, lors de ce plébiscite, la question de la Ley de Caducidad n'a pas été posée comme un vote indépendant, mais a été incluse comme un vote secondaire le même jour que les élections générales ; une simple case à remplir que de nombreux électeurs ont laissée vide. « Il ne faut pas en conclure que la majorité des Uruguayens sont avec les répresseurs, dira Mujica, mais ce qu'ils veulent, c'est tourner la page, regarder vers l'avant et non vers l'arrière ».
En 2011, alors que Pepe Mujica est déjà président, le Frente Amplio soumet au vote du Congrès la proposition d'organiser un troisième plébiscite sur la loi pour tenter de l'abolir.
Mujica a été critiqué par une grande partie du Frente Amplio lui-même pour avoir rejeté cette proposition qu'il avait défendue auparavant. Sa position était similaire à celle adoptée par un autre ancien dirigeant historique des Tupamaros, Eleuterio Fernández Huidobro : « Même si nous ne sommes pas d'accord, nous devons respecter ce que nos citoyens ont déjà dit lors d'un plébiscite à deux reprises, la volonté du peuple doit être respectée ».
Toutefois, M. Mujica a déclaré qu'il n'utiliserait en aucun cas sa prérogative présidentielle pour opposer son veto à l'initiative présentée par son parti politique et qu'il respecterait la discipline du vote. Tous deux ont voté en faveur de l'annulation de la Ley de Caducidad. Leurs votes ont été décisifs ; on savait que le vote serait très serré.
Cependant, la proposition législative n'a pas été adoptée. Le vote s'est soldé par une égalité de 49 voix parce qu'un député du Frente Amplio, Víctor Semproni, ancien dirigeant syndical de premier plan et ancien guérillero de Tupamaro, dont le vote était attendu, s'est absenté du vote, de sorte que l'initiative n'a pas eu lieu et que la Ley de Caducidad est restée en vigueur. Semproni a ensuite été sanctionné par le tribunal de conduite politique du Frente Amplio.
Fernández Huidobro, quant à lui, a démissionné de son siège de sénateur du Frente Amplio pour marquer son opposition, mais ne l'a pas partagé avec la coalition. Il est ensuite devenu ministre de la défense dans le second gouvernement de Tabaré Vázquez et a critiqué nombre de ses anciens collègues et d'organisations de défense des droits de l'homme pour avoir « stigmatisé » les militaires. « Ce sont des malades qui parlent en permanence des forces armées et des militaires ».
Ses déclarations, faites lors d'un discours pour la Journée de l'armée le 18 mai 2015, ont incité le Bureau politique du Frente Amplio à publier une déclaration sévère et trois des organisations membres de la coalition, La Vertiente Artiguista, Casa Grande et le Partido por la Victoria, à demander sa démission en tant que ministre. Elles ont dénoncé la position de l'ancien dirigeant de Tupamaro comme une atteinte à l'ensemble de la lutte pour la mémoire historique.
Pepe Mujica a évité d'entrer dans cette controverse, mais sa position sur la question était déjà connue, au moins depuis 2008, lorsqu'il a déclaré qu'il ne se consacrait pas à « cultiver l'oubli ou à cultiver la mémoire ». « J'ai décidé de m'engager dans ce qui me semble être le monde de mes petits-enfants, dans lequel je ne serai pas ».
Et en 2014, il fait une déclaration à La República à propos des officiers militaires de la dictature emprisonnés qui relance le débat au sein du Frente Amplio : « Je ne me suis pas battu pour avoir des vieux en prison. Je préférerais qu'ils meurent chez eux (...) Pourquoi devrions-nous avoir un type de 85 ans en prison ? Que la mort les trouve dans un coin quelque part et qu'ils soient assignés à résidence ! »
La question est restée latente pendant toutes ces années, depuis le moment où la démocratie est revenue en Uruguay, il y a 40 ans. La parution en 2024 du livre Los Indomables, de Pablo Cohen, avec des entrevues de Mujica et Topolansky, a relancé la polémique.
L'ancien sénateur et partenaire de Mujica y affirme que « les témoins de crimes contre l'humanité commis pendant la dernière dictature ont menti dans leurs déclarations à la justice afin d'obtenir la condamnation d'anciens officiers militaires ». Mujica a approuvé cette grave accusation : « Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu, et ils l'ont fait par dépit, par vengeance ».
Une telle accusation a été un véritable coup dur pour les survivants de la dictature, pour les parents des 192 disparus au moins, pour les milliers de victimes de représailles et les exilés, et a représenté un coup de semonce pour les répresseurs qui sont accusés d'avoir systématiquement menti à la justice au sujet des crimes de la dictature, et d'avoir fait obstruction aux enquêtes.
Peu après, le couple Mujica-Topolansky a reçu Guido Manini Ríos, un homme entré au Liceo Militar en 1973, l'année même du coup d'État des forces armées, et qui deviendra au fil des ans le controversé commandant en chef de l'armée sous le gouvernement de Tabaré Vázquez en 2015.
Ses critiques constantes des enquêtes de la justice sur les crimes de la dictature ont conduit le Frente Amplio à exiger sa démission et Vázquez s'en est finalement débarrassé en 2019.
Manini entre alors en politique et fonde le parti de droite Cabildo Abierto, dont il est sénateur, devenant de facto le porte-parole des revendications des officiers militaires emprisonnés de la dictature.
En 2020, il répète depuis son siège au Sénat des propos similaires à ceux tenus par Mujica en 2014 : « Jusqu'à quand des militaires octogénaires continueront-ils à être poursuivis pour des faits qui se sont produits il y a 50 ans ? »
Manini a demandé à Mujica à plusieurs reprises d'intercéder pour améliorer les conditions des prisonniers militaires afin qu'ils puissent finir de purger leur peine dans leur pays.
À son tour, l'ancien dirigeant de Tupamaro l'a prié de demander à son propre peuple de collaborer immédiatement en fournissant des informations sur les lieux où se trouvent les prisonniers de l'opposition ayant disparu.
Le fait que le Frente Amplio ait obtenu la majorité au Sénat mais pas à la Chambre des députés a conduit certains secteurs de la gauche uruguayenne à craindre que les relations cordiales que Mujica et son vice-président élu, Yatmandú Orsi, entretenaient avec l'entourage des militaires ne conduisent le Frente Amplio à rechercher le soutien des deux sénateurs du Cabildo Abierto afin de faire passer ses budgets et ses lois au sein de l'assemblée législative. Si cela s'était produit, cela aurait provoqué une crise majeure au sein du Frente Amplio.
Mujica n'est pas le seul des nombreux anciens chefs de guérilla devenus présidents avec l'arrivée de la démocratie en Amérique latine et en Afrique à s'être vu reprocher sa métamorphose par ses anciens camarades militants.
Nelson Mandela, leader du Congrès national africain (ANC) et de l'organisation de guérilla Umkhonti we Sizwe (MK) (Lance de la nation), qui, après 27 ans d'emprisonnement, allait devenir président de l'Afrique du Sud, en a fait personnellement l'expérience. Nombre de ses anciens collègues lui ont reproché de faire trop de concessions à ceux qui avaient été complices de l'apartheid, de l'oppression, de la répression brutale et des crimes dont la population noire majoritaire, dont Mandela faisait lui-même partie, avait été victime pendant des décennies.
C'est aussi le cas de Dilma Rousseff, marxiste comme Mandela et Mujica, militante de la guérilla du Grupo Política Operária (Polop), elle aussi torturée et emprisonnée pendant deux ans, et qui finira par devenir présidente du Brésil. La gauche radicale a remis en cause sa politique de coexistence au pouvoir avec des secteurs de la droite, qui sont précisément ceux qui finiront par la trahir et par organiser un coup d'État en douceur pour la renverser.
Comme la plupart des pays d'Amérique latine et des Caraïbes qui ont subi des dictatures militaires sanglantes financées et armées par l'empire américain, l'Uruguay n'a pas encore réglé ses comptes avec les répresseurs, et parmi ceux qui les ont combattus à l'époque, comme Pepe Mujica, ils sont nombreux ceux qui comprennent qu'« il y a des dettes qui ne peuvent jamais être payées ; elles se portent dans le sac à dos ».
Avec son humour mordant et son ironie, le vieux guérillero a déclaré dans un discours à son peuple en novembre 2018, après lui avoir demandé de lutter pour l'unité de la gauche et alors que l'ombre de la Faucheuse semblait se profiler au loin : « Je veux vous dire, camarades, de tout mon cœur, que lorsque le dernier voyage arrivera, et parce que j'aime la vie malgré toute la douleur, je voudrais dire à celui qui nous emmène de l'autre côté : S'il vous plaît, servez une nouvelle tournée ».
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Pendant que le calvaire du peuple s’intensifie, les privilèges et les richesses des membres du Conseil Présidentiel de transition (CPT) s’améliorent, après un (1) an à la tête du pays, le cri d’alarme de l’ECCREDHH

L'Organisme de Défense des Droits Humains ECCREDHH se dit consterné encore une fois par la montée sanglante des actes de criminalité partout dans le pays. Pourtant, celles et ceux qui ont la pleine responsabilité pour rétablir l'ordre et la sérénité, se mettent à s'occuper sur comment se procurer plus de privilèges et de richesses pendant qu'ils ont relativement une feuille de route.
Port-au-Prince, Haïti le 13 Mai 2025
Qui sont les principaux responsables de la situation dans laquelle le pays est plongé ?
Une crise alimentaire alarmante
Actuellement, Haïti compte plus d'un million de déplacés internes, près de la moitié est constituée d'enfants selon l'Organisation internationale de la Migration OIM. Parallèlement, une Insécurité Alimentaire galopante met à nue l'irresponsabilité des dirigeants haïtiens qui, à aucun moment de la durée n'ont montré aucune volonté pour agir en conséquence.
Plus de 5.7 millions de personnes sont face à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë pour la période de mars à juin 2025, représentant 51% de la population haïtienne, soit un niveau d'insécurité alimentaire jamais atteint, selon le dernier rapport d'un organisme de l'ONU (OCHA).
C'est encore un signe de progression de cette crise alimentaire en Haïti.
Les enfants sont exclus de l'école, le MENFP reste muet.
Le système éducatif haïtien fait face depuis des décennies à de nombreux défis. Avec un accès extrêmement limité à l'éducation pour la population, frappé déjà par l'instabilité politique qui règne dans le pays. Et maintenant, est sur le point de disparaître dans des zones où la violence des groupes armés viennent engraver la plaie.
Une situation qui était déjà complexe et compliquée sur plan éducatif avec un système discriminatoire qui favorise l'intégration d'un groupe spécifique et exclut la majorité. Combien d'enfants en Haïti qui ne peuvent pas aller à l'école aujourd'hui pendant que l'État a l'impérieuse obligation de garantir leur droit ?
Près de 3 000 écoles dans le département de l'Ouest et du bas-Artibonite, situées dans des zones contrôlées par des groupes armés, sont fermées. Le Ministère de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle reste muet à ce sujet. Donc à tous les niveaux, les droits humains sont violés systématiquement de manière volontaire par les dirigeants de l'Etat Haïtien.
Une crise de chômage qui renforce les groupes armés
En raison de l'irresponsabilité des dirigeants haïtiens et à défaut de la mise en place des politiques publiques adéquates relatives à la création d'emplois et d'opportunités pour la jeunesse, ils sont voués à des activités subversives et au service des groupes armés et des politiques.
En Haïti, le taux de chômage mesure le nombre de personnes activement à la recherche d'un emploi en pourcentage de la population active. Donc selon les prévisions de Trading Économique, le taux de chômage en Haïti devrait se situer autour de 14,80 pour cent en 2025 et 15,00 pour cent en 2026, selon nos modèles économétriques.
Cette crise de chômage croissante provoquant l'intégration des jeunes au sein des groupes armés et les filles dans des actes de prostitution. Aucune décision pragmatique n'est jamais prise pour appliquer même des règles et principes de droit.
Que veut le principe de l'état de droit ?
Pourtant, le principe veut que : L'Etat est obligé de prendre les précautions nécessaires pour prévenir un risque avéré d'atteinte aux violations des droits humains. Et si un droit devait être finalement violé, l'Etat doit veiller à ce qu'une réparation soit obtenue.
L'état de droit permet de promouvoir et de protéger ce cadre normatif commun. Ce qui fait qu'il est une obligation pour l'État de protéger la vie, la santé et la dignité de la personne etc. Donc si le Conseil Présidentiel de Transition (CPT) et le gouvernement après plus d'un (1) an, n'offrent aucun espoir et n'inspirent aucune confiance, ils doivent tout simplement se retirer et se mettre à la disposition de la justice.
En effet, Il n'existe pas d'état de droit dans les sociétés où les droits de l'homme ne sont pas protégés ; à l'inverse, les droits de l'homme ne peuvent pas être protégés dans des sociétés où n'existe pas un véritable état de droit. D'où le principe de l'égalité devant la loi, la responsabilité au regard de la loi et l'équité dans la protection et la défense des droits ne sont pas figurés avant dans les axes d'intervention de l'Etat en termes de politique publique.
Le vagabondage d'État affaiblit les institutions publiques et doit rapidement cesser L'Organisme de Défense des Droits Humains ECCREDHH signale que ce que nous sommes en train de vivre en Haïti, c'est du bagage d'État. Ce sont des hommes et des femmes qui s'enrichissent illicitement.
Des hommes et femmes qui se donnent des privilèges sans rendre le moindre service à la communauté. Ces comportements rendent le dysfonctionnement purement et simplement des institutions publiques qui avaient pour mission de servir la république.
En fait, des exemples sont clairs avec le scandale la Banque Nationale de Crédit (BNC), de la Caisse d'Assistance Sociale, (CAS), de l'immigration, de l'Office de Protection des Citoyens (OPC), de l'Office d'Assurance Vieillesse (ONA) etc.
Est-ce qu'Haïti fait face à une crise d'homme ou de femmes d'État ?
A ce stade de dégénérescence totale et du refus de la morale, l'Organisme de Défense des Droits Humains ECCREDHH appelle le CPT et le gouvernement à adopter la voie de la sagesse. Car ils ont échoué dans la mission pour laquelle ils ont été confiés.
L'Organisme de Défense des Droits Humains ECCREDHH croit que l'état de droit permet l'exercice concret des droits de l'homme. Il favorise l'indépendance des pouvoirs de l'Etat et harmonise les actions des institutions républicaines à travers l'application des règles de droits relatives.
Par conséquent, tout pouvoir qui agit à l'encontre des règles et principes de l'État de droit, tout pouvoir qui agit à l'encontre des intérêts généraux de la nation doit être limogé.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le général Hemedti, l’architecte en chef du chaos soudanais

Chef de guerre redouté, le général Mohamed Hamdan Dagolo, dit « Hemedti », est un personnage central du conflit qui ravage le Soudan depuis 2023. Parti de rien, ce militaire sans foi ni loi a réussi à s'imposer politiquement et à devenir un des hommes les plus riches du pays. Une ascension qu'il doit avant tout à sa brutalité et à son alliance avec les puissances régionales.
Tiré de MondAfrique.
Né en 1974 dans une famille de la tribu arabe Mahariya des Rizeigat, originaire du Darfour et du Tchad, Mohamed Hamdan Dagolo est le fils d'une famille de bergers nomades. Il a grandi dans un contexte de conflits communautaires où son clan a connu l'exclusion. Cette enfance lui a permis de se construire une image de défenseur des pauvres et des laissés-pour-compte face aux élites de Khartoum. En réalité, tout son parcours s'inscrira dans la violence ethnique.
En 2003, lors de la première guerre du Darfour, il rejoint les Janjawid, un groupe pro-gouvernemental chargé d'attaquer les populations non-arabes de la région. Cette milice se rend tristement célèbre par ses massacres, viols déplacements forcés. Hemedti s'y distingue par sa brutalité, une efficacité sans pitié, gravissant les rangs jusqu'à devenir commandant, puis chef. Devant ses « excellents » résultats, il est dans la foulée promu général d'armée. En 2013, pour tenter de blanchir l'image des Janjawid, le régime d'Omar el-Béchir les rebaptise Forces de soutien rapide (FSR). À la tête de ces troupes, Hemedti contrôle non seulement les territoires du Darfour, mais aussi ses richesses : mines d'or, gomme arabique, bétail.
L'ascension par la terreur
Lorsqu'en 2015 la coalition menée par l'Arabie Saoudite et les Emirats arabes unis déclare la guerre aux Houthis du Yémen, il engage des milliers de combattants soudanais, principalement issus des FSR, pour combattre aux côtés des monarchies du Golfe. Cette intervention lui apporte un soutien politique et financier massif, tout en consolidant ses alliances avec Riyad et Abu Dhabi, l'or noir des pétromonarchies coule abondamment dans ses caisses.
Ce rôle de patron d'une entreprise de mercenaires lui donne en outre une stature internationale. Il parade dans les capitales africaines et arabes, négocie les questions migratoires et le contrôle des frontières avec les diplomates occidentaux. Ainsi, il se construit une légitimité de chef d'Etat en puissance. Malgré les milliers de combattants et les moyens colossaux mis à la disposition des FSR par la coalition, les Houthis finiront par gagner la guerre après avoir subi des pertes, des destructions et enduré la famine pendant huit ans. Mais le mal est fait, Hemedti est aux portes du pouvoir à Khartoum.
Frankenstein à Khartoum
Après un grand mouvement populaire qui a déstabilisé le régime soudanais, l'armée renverse Omar el-Béchir en avril 2019. Le général al-Burhan à la tête de l'armée régulière prend la direction du Conseil de transition, Hemedti patron d'une armée privée en devient le numéro 2. Le ver est dans le fruit. En juin 2019, la population manifeste pacifiquement afin que le pouvoir soit rendu aux civils. Les FSR passent à l'action, ils font ce qu'ils ont toujours fait. Ils sèment la terreur et la désolation en dispersant le sit-in à coups de gaz lacrymogène et de balles réelles.
Les rapports d'ONG qui suivront feront état également de viols, de corps jetés dans le fleuve, a minima 130 personnes sont décédées ce jour-là. Quelques jours plutôt devant les exigences des militants pro-démocratie, le patron des mercenaires, qui s'exprime très rarement, avait lancé cette phrase prémonitoire : « Ma patience avec la politique a des limites. »
Après ce massacre, la politiste Sarra Majdoub écrit un article publié dans Orient XXI intitulé « Frankenstein à Khartoum ». En conclusion, l'analyste imaginait la suite : « Dans tous les cas ,Hemetti est une menace, même si les militaires se maintiennent au pouvoir. Il pourrait se transformer en Frankenstein qui non seulement anéantirait les espoirs d'un Soudan nouveau, mais se retournerait contre ceux qui l'ont créé et accaparerait le pouvoir. »
L'appui décisif des Émiratis
Et c'est précisément ce qu'il advint. Le 15 avril 2023, les deux généraux au pouvoir se déclarent la guerre. Si l'armée régulière dirigée par al-Burhan n'est pas exempte de reproches, les combattants d'Hemedti se lancent dans une entreprise de destruction à grande échelle. Khartoum est ravagée par les flammes et les destructions volontaires, les populations qui le peuvent fuient principalement en Egypte, les autres subissent les exactions de la milice. Puis la guerre s'étend à l'ensemble du pays avec toujours le même scénario tragique : massacres, viols, déplacements de populations. Bien entendu, l'ancien berger devenu milliardaire ne pourrait combattre les forces régulières soudanaises sans de puissants appuis.
Si l'Arabie saoudite s'est rangée du côté du gouvernement soudanais, les Emirats arabes unis apportent aux FSR un soutien diplomatique, financier, militaire, logistique, de grande ampleur. Mais une nouvelle fois, malgré tous les moyens mis à sa disposition, Hemedti a perdu de nombreuses positions, notamment toute la région de Khartoum. Depuis plusieurs mois, il prépare un repli stratégique sur le Darfour qu'il contrôle encore en grande partie, excepté la capitale régionale El-Fasher. Il mise désormais tout sur son bastion ouest devenu le nouvel épicentre du conflit soudanais avec les attaques massives contre les civils et les camps de déplacés, notamment celui de Zamzam. Cette stratégie n'est pas sans rappeler les logiques de partition qui ont déjà déchiré le pays par le passé, comme lors de la sécession du Soudan du Sud. Le patron des FSR agit-il ainsi pour garantir sa survie politique et militaire ou est-il encore le mercenaire des Emirats arabes unis ? Quelle que soit la réponse, son nom restera associé à l'histoire tragique du Soudan.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Mali : Une dictature décomplexée

L'interdiction des partis politique est une nouvelle étape dans l'affermissement d'une dictature incapable de juguler les attaques djihadistes.
Désormais au Mali l'ensemble des partis politiques sont dissous. C'était une préconisation du Conseil National de Transition (CNT) l'organisme législatif mis en place par la junte qui s'est emparée du pouvoir en 2021. A cette époque le colonel Assimi Goïta s'était engagé à organiser des élections et à rendre le pouvoir aux civils. Depuis, les élections n'ont eu de cesse d'être reportées, le colonel est devenu général des armées et le CNT préconise qu'il reste au pouvoir jusqu'en 2030.
Une longue succession
L'interdiction des partis est l'aboutissement d'une politique de restriction de l'espace démocratique. Au début la junte avait déjà tenté d'interdire le parti SADI (Solidarité Africaine pour la Démocratie et l'Indépendance) car son dirigeant Oumar Mariko avait critiqué les agissements des forces armées maliennes contre les civils. Peu à peu toutes les voix discordantes ont été pourchassées. Les youtubeurs comme Ras Bath, ou Rose-Vie Chère sont derrière les barreaux, des dignitaires religieux subissent également le même sort. Ainsi l'imam Bandiougou Traoré a été arrêté pour avoir simplement critiqué un financement conséquent pour l'organisation d'un festival dans la ville de Kayes « alors que l'état des routes dans la région se dégrade chaque jour ».
La junte tente de terroriser les populations avec les disparitions d'activistes. Suite à la décision d'interdiction des partis politiques, un rassemblement de quelques centaines de personnes a eu lieu pour exiger le retour au pouvoir des civils. Depuis, nombre de manifestants sont enlevés. C'est le cas de deux dirigeants de l'opposition politique, Abba Alhassane et El Bachir Thiam, mais aussi de Abdoul Karim Traoré, dirigeant d'une organisation de jeunesse. Par contre sur les réseaux sociaux, les partisans des putschistes peuvent appeler à la violence contre les opposants en toute impunité.
Les populations dans le viseur
Cette répression n'a pas qu'un caractère politique. Elle se situe également sur le terrain ethnique. Sous prétexte de lutte contre les djihadistes, qui d'ailleurs se renforcent et gagnent du terrain, les forces armées maliennes avec leurs supplétifs russes de Wagner se rendent coupables de massacres de membres de la communauté peule. Récemment lors d'une opération de l'armée dans la ville de Diafarabé dans le centre du pays, une vingtaine d'hommes ont été interpellés et égorgés comme ce fut le cas en avril pour les 60 hommes arrêtés et exécutés à Sébabougou.
La guerre extrême entre d'un côté les djihadistes et de l'autre les forces maliennes, place les populations dans un étau où elles subissent successivement les représailles des uns puis des autres.
Les putschistes lors de leur prise de pouvoir, parlaient d'une seconde indépendance du Mali, il n'en est rien. S'il y a une similitude à trouver, c'est la période des années 70/80, celle de la dictature de Moussa Traoré renversée par une révolution populaire.
Paul Martial
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Éthiopie. Au Tigray, « personne ne veut renouer avec la guerre »

Deux ans et demi après la fin du conflit qui a endeuillé cette région septentrionale d'Éthiopie, la menace de nouveaux affrontements plane aux niveaux local, national et même international avec l'Érythrée voisine. Les riverains, les populations déplacées, les responsables politiques et les anciens combattants redoutent et rejettent cet obscur scénario.
Tiré d'Afrique XXI.
Étalé le long d'étroites allées sinueuses et poussiéreuses, un enchevêtrement de tentes estampillées du logo bleu des Nations unies sert de refuge à quelque 28 000 personnes depuis plus de quatre ans. Le camp d'Adi Mehameday est situé à 82 kilomètres de la ville de Shire, dans la région du Tigray, au nord de l'Éthiopie. Il abrite une fraction du million de déplacés qui n'ont pas pu rentrer chez eux, malgré la fin de la guerre entre les Forces de libération du peuple du Tigray (FLPT) et les Forces de défense nationale éthiopiennes, le 2 novembre 2022.
« Nous avions de l'espoir mais nous n'avons toujours pas reçu d'informations concrètes de nos dirigeants. Ils ont parfois annoncé notre retour, mais cela n'a jamais eu lieu », résume Medhin Yalem, les traits tirés. Le manque de nourriture est en train d'avoir raison de son père, trop faible pour marcher depuis un an, tandis que son fils de 20 ans souffre d'anémie. Le foyer fait rarement plus d'un repas quotidien. Comme la plupart des rescapés du camp d'Adi Mehameday, Medhin Yalem est originaire du Wolkait, une zone administrative de l'ouest du Tigray. « Certains de nos voisins ont tenté de retourner à Tselemti [district proche du Wolkait, NDLR], avant de revenir. La zone n'est pas sécurisée », poursuit la quinquagénaire qui se retrouve sans revenus après avoir abandonné ses troupeaux et sa parcelle.
Malgré l'accord de paix, la région du Tigray, actuellement gouvernée par une administration intérimaire liée au FLPT, mais avec le contrôle d'Addis-Abeba comme le prévoient les accords de Pretoria, reste sous la pression de plusieurs factions armées : le Wolkait est toujours occupé par les forces Amhara, une région voisine qui a combattu aux côtés de l'État fédéral et qui revendique ce bout de territoire ; tandis qu'au nord-est du Tigray, les troupes de l'Érythrée, également alliées d'Addis-Abeba pendant la guerre, occupent aussi une partie de la région située à leur frontière.
Depuis, les victimes d'une des guerres les plus meurtrières d'Afrique, qui a tué environ 400 000 militaires et 300 000 civils, selon un rapport publié en juin 2024 par le New Lines Institute, survivent dans un état de « ni guerre ni paix ».
Luttes de pouvoir internes et répression
En mars, des tensions internes au FLPT ont par ailleurs failli ajouter un peu plus de confusion à la situation actuelle. Debretsion Gebremichael, le chef du FLPT, et Getachew Reda, alors président de l'administration intérimaire du Tigray, se sont mutuellement accusés de ralentir la mise en œuvre de l'accord de paix. Le traité prévoyait le retour des déplacés, la libération des zones occupées ou encore le désarmement et la réintégration de 274 000 militaires ayant rejoint les Forces de défense du Tigray (FDT), le bras armé du FLPT. Seuls 17 000 d'entre eux ont participé au programme de démobilisation, a déclaré fin avril la Commission nationale de réhabilitation.
Les désaccords croissants entre Debretsion Gebremichael et Getachew Reda ont conduit, le 15 septembre 2024, à l'exclusion de ce dernier du FLPT. Six mois plus tard, le 10 mars, Getachew Reda a suspendu trois généraux des FDT, fort de son poste de président de l'administration intérimaire. En réaction, Debretsion Gebremichael a imposé ses hommes à la tête de villes où Getachew Reda avait placé ses proches soutiens, incluant la capitale régionale Mekele. « Getachew parlait de réformer les conseils administratifs locaux alors que sa priorité aurait dû être de libérer son peuple. Beaucoup de Tigréens ont trouvé cela prématuré quand ils habitent toujours dans des abris de fortune et n'ont ni nourriture, ni eau, ni vêtements », justifie Debretsion Gebremichael, rencontré le 18 mars à l'hôtel Axoum de Mekele.
Des violences sporadiques, des arrestations arbitraires et au moins une exécution extrajudiciaire se sont ensuivies, d'après les témoignages recueillis par Afrique XXI à Mekele et dans la petite ville d'Adi Gudom, à 40 km au sud. Hadera Kiros, le président de l'Association des jeunes d'Adi Gudom, a passé trois jours en détention au moment du changement de maire que certains qualifient de « coup d'État ». « Les jeunes s'enfuient vers Mekele ou Addis-Abeba car ils ont peur du FLPT et de leurs soldats », témoigne ce père de deux enfants.

Le 11 mars, Alemu Haile, un travailleur du bâtiment de 37 ans, se tenait parmi la centaine de riverains d'Adi Gudom qui protestaient contre le remplacement du maire d'Adi Gudum pro-Getachew par un édile envoyé par Debretsion. Un bandage sur la tête, la voix affaiblie, ce père de deux enfants affirme avoir été touché à la tête par trois balles tirées par des miliciens proches des FDT. « La force ne peut être une solution, déplore son frère aîné, Gebrehiwet Haile. Il est essentiel que les dirigeants dialoguent avec les citoyens. Autrement, ils risquent de déclencher un nouveau conflit entre les soutiens de Getachew et ceux de Debretsion », redoute le fonctionnaire.

Getachew Reda a finalement été éjecté de la tête de l'administration intérimaire au profit du général Tadesse Werede, le 8 avril, avec l'aval d'Addis-Abeba. Pour autant, cette situation n'a pas rassuré les Tigréens. « Je n'ai vu aucun changement, ni aucune solution concrète aux problèmes qui nous affectent. L'instabilité continue. Nous nous sentons en danger et nous vivons dans la peur », détaille Mitslal Abraha, depuis Shire. Le chaos politique et sécuritaire contraint cette pharmacienne sans emploi à repousser, depuis des mois, l'ouverture de sa propre officine. « J'ai besoin de garanties et de stabilité », insiste celle qui a participé à l'effort de guerre en soignant les blessés dans une clinique publique où les salaires n'ont jamais été payés.
Abiy Ahmed et le spectre d'un conflit avec l'Érythrée
La nomination de Tadesse Werede laisse également perplexe Meressa Dessu, chercheur à l'Institut d'études de sécurité basé à Addis-Abeba. « Tadesse a systématiquement minimisé l'échec de l'administration intérimaire. En le nommant, [le Premier ministre] Abiy Ahmed tente de créer davantage de divisions au sein du FLPT et des FDT, », craint Meressa Dessu.
À Addis-Abeba, les bisbilles internes au FLPT ne sont guère commentées. Le Premier ministre, Abiy Ahmed, est occupé par les autres conflits sur son sol, notamment dans les régions Amhara et Oromia. En avril 2023, en Amhara, les milices fanno ont organisé de violentes manifestations contre l'intégration des forces régionales au sein de l'armée et de la police nationales. Ces tensions ont dégénéré quatre mois plus tard en une rébellion armée contre les troupes fédérales avec lesquelles les fanno et les forces régionales avaient pourtant combattu pendant le conflit au Tigray.
Le chef du gouvernement fait en outre planer le spectre d'une résurgence des hostilités avec l'Érythrée à travers une rhétorique belliciste. « La mobilisation militaire se poursuit en Érythrée. De son côté, Abiy Ahmed n'a pas renoncé à son accès à la mer Rouge. Les intérêts incompatibles de ces deux nations, unies jusqu'à l'indépendance de l'Érythrée en 1993, et leur refus de toute négociation mèneront inévitablement à la guerre », avertit Meressa Dessu. Le chercheur précise que les scissions au sein de la population tigréenne bénéficient à la fois à Abiy Ahmed et au dictateur érythréen, Isaias Afwerki.
« Je ne veux pas perdre de temps avec la guerre »
Ces tensions inquiètent les Tigréens. « Nous redoutons que la situation ne s'embrase entre l'Éthiopie et l'Érythrée, assurait Debretsion Gebremichael mi-mars. Nous espérons que les différends seront réglés diplomatiquement. Car même si nous n'y participons pas, les combats auront forcément lieu ici, sur nos terres, compte tenu de notre position géographique. » En février, le média spécialisé Africa Intelligence révélait « une réunion confidentielle inédite, fin janvier, à Asmara » au cours de laquelle Isaias Afwerki aurait « assuré les officiers des FDT de sa protection en cas de conflit avec l'Éthiopie ». Interrogé, le chef du FLPT nie tout contact avec les autorités érythréennes.
En revanche, les relations restent exécrables entre les hommes de Debretsion Gebremichael et Addis-Abeba. « Plutôt que de se concentrer sur la réhabilitation de la population du Tigray, qui a subi une guerre génocidaire, le gouvernement éthiopien a eu recours à des actes malveillants tels que le blocage de l'entrée de produits essentiels dans la région du Tigray, comme le carburant, et l'arrêt des activités qui permettent de sauver des vies. Ces actions mettent en jeu la vie et les moyens de subsistance de la population du Tigray », dénonce le FLPT dans un communiqué daté du 26 mars.
Et la plupart des anciens combattants des FDT sont formels : ils ne reprendront pas les armes. « La guerre n'aide personne. Vous perdez beaucoup de vies et vous vous retrouvez avec un accord qui ne change rien », tranche Kaleab, qui témoigne sous pseudonyme. En 2021, ce peintre de 25 ans s'était engagé après le décès d'un proche. Exaspéré par les querelles de pouvoir entre les dirigeants tigréens, l'artiste se réjouit d'avoir obtenu un visa pour les États-Unis : « Je suis jeune, je peux accomplir beaucoup de choses. Ma famille attend beaucoup de moi. Je ne veux pas perdre davantage de temps avec la guerre. »
La malnutrition fait déjà des victimes
Dans une ruelle de Mekele, à l'abri des oreilles indiscrètes, Abebe (un prénom d'emprunt) confie qu'il préférerait lui aussi quitter l'Éthiopie plutôt que de remettre l'uniforme. « Nous connaissons désormais les conséquences de la guerre, souligne le trentenaire. J'ai perdu mes deux petits frères et des amis. Les responsables politiques doivent ramener la paix et cesser de travailler pour leurs propres intérêts. » Faisant partie de la majorité des ex-membres des FDT qui n'ont pas été démobilisés, ce médecin qui officie dans un hôpital militaire de Mekele craint d'être forcé de se battre en cas de nouveaux affrontements. Sa ville natale est toujours occupée par les troupes érythréennes, empêchant ses parents de quitter le camp de déplacés qui les héberge. « Les Tigréens se sont sacrifiés et ont relevé tellement de défis que personne ne veut renouer avec la guerre », conclut-il.
Retour à Adi Mehameday. L'agricultrice au chômage Medhin Yalem citée plus haut décrit la manière dont la communauté qui accueille les déplacés a fini par leur tourner le dos. « Les habitants en ont assez de nous. Ils n'ont plus suffisamment de nourriture à partager car ils subissent eux-mêmes les effets du conflit », regrette la mère de famille. Or la malnutrition progresse au Tigray. Début mars, la faim a emporté Abeba Teklu, mère de trois fillettes. « Cela faisait deux à trois ans qu'elle souffrait de malnutrition. Son état s'est dégradé et elle a développé une insuffisance rénale », raconte son veuf, Tesheger Tagegne.

L'Institut de recherche en santé publique de Mekele enregistre une hausse de 43 à 48 % d'enfants et d'adolescents de moins de 18 ans malnutris entre juillet 2024 et janvier 2025. « Les tensions aux différents échelons et la crainte d'une nouvelle guerre contribuent à la malnutrition et à l'instabilité alimentaire », indique Hayelom Kahsay, le directeur de cet institut. Le gel des financements de l'Agence des États-Unis pour le développement international (Usaid), décrété par le président états-unien Donald Trump le 20 janvier, a encore aggravé une situation humanitaire qui deviendrait catastrophique en cas de reprise de la guerre.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Signes d’alerte en Ouganda

Alors que l'Ouganda se prépare aux élections générales de 2026, les fantômes de son passé font un retour malvenu, annonçant un cycle électoral difficile. Certes, la situation politique n'a jamais été aussi équilibrée en Ouganda depuis le retour du multipartisme en 2005. Ceux qui ont osé défier le président Museveni et le Mouvement de résistance nationale (NRM) ont été arrêtés et agressés à maintes reprises.
Tiré d'Afrique en lutte. Photo : Le général Muhoozi Kainerugaba, le fils du président ougandais Yoweri Museveni, assiste à sa fête d'anniversaire à Entebbe, en Ouganda, le 7 mai 2022. Abubaker Lubowa/REUTERS
Mais à mesure que Museveni vieillit et que la jeune population réclame le changement, l'État devient de plus en plus répressif. Pendant des années, de hauts responsables du NRM ont insisté sur le fait que le multipartisme serait trop polarisant pour une société diversifiée sur les plans tribal, linguistique, culturel et religieux comme l'Ouganda. Aujourd'hui, les pouvoirs en place attisent cette polarisation.
Au cœur des derniers développements se trouve le fils du président et successeur potentiel, le général Muhoozi Kainerugaba. Connu pour ses publications imprécises sur les réseaux sociaux et son autoglorification excessive, Muhoozi a franchi les limites les unes après les autres, montrant clairement à la société ougandaise que les règles ne s'appliquent pas à lui. Il a joué un rôle important dans la campagne militaire visant à réprimer violemment, souvent mortellement, les partisans de l'opposition lors du dernier cycle électoral. En janvier, il a affirmé que seul son père l'empêchait de décapiter le populaire leader de l'opposition Robert Kyagulanyi, dit Bobi Wine.
Fin avril, Eddie Mutwe, garde du corps de Wine, a été enlevé. On ignorait où il se trouvait jusqu'à ce que Muhuoozi commence à publier des articles à son sujet quatre jours plus tard sur X, affirmant que Mutwe était « dans mon sous-sol ». Il a partagé une photo sur laquelle Mutwe avait été déshabillé et la barbe rasée. Muhoozi écrivit que son prisonnier avait été capturé comme une nsenene (sauterelle) et suggéra qu'il suivait des cours de runyankore, la langue parlée par les habitants du sud-ouest de l'Ouganda (comme le président Museveni). Lorsque Mutwe fut finalement traduit en justice pour vol, des preuves indiquèrent qu'il avait été torturé pendant sa détention.
La volonté de créer un spectacle violent destiné à la consommation de masse, la comparaison déshumanisante avec la sauterelle, la référence linguistique spécifique, l'escalade constante des menaces – rien de tout cela n'est de bon augure dans un pays au passé sanglant de violence politique à caractère ethnique. Sortir de cette période chaotique était censé être la marque de fabrique du Mouvement de résistance nationale du président Yoweri Museveni.
Mais c'est le fils et successeur potentiel de Museveni qui savoure ce retour à la violence gratuite et anarchique, allié à un sens du spectacle, comme message politique. Depuis plusieurs années, les analystes mettent en garde contre le risque d'atrocités de masse en Ouganda. L'année dernière, le Centre Simon-Skjodt du Musée mémorial de l'Holocauste des États-Unis a publié un rapport d'alerte précoce axé sur l'Ouganda, soulignant comment « l'incertitude entourant ce qui pourrait être la première transition politique du pays depuis près de quatre décennies nourrit les divisions et les craintes de violences potentielles ». Ces derniers développements ajoutent un peu de poudre aux yeux à une situation déjà dangereuse.
Michelle Gavin
Source : https://www.cfr.org/blog/africa-transition
Traduction automatique de l'anglais
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Éliminer l’identité ukrainienne dans les territoires occupés

Dans toutes les zones qu'elle occupe, la Russie impose de manière brutale à la population locale de prendre la citoyenneté russe. Un des moyens utilisés a été la menace de la priver de ses biens. Désormais, ceux qui ont accepté de prendre la nationalité russe risquent de se retrouver sans domicile.
7 mai 2025 | tiré du site Entre les lignes entre les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/05/07/eliminer-lidentite-ukrainienne-dans-les-territoires-occupes/
Directeur du Centre de recherche sur l'occupation et ancien conseiller du maire de Marioupol, Petro Andriuchtchenko évoque le « pillage total des habitants de Marioupol » et affirme que le nombre d'appartements placés sous séquestre au prétexte d'une prétendue absence de « propriétaire » ne cesse d'augmenter.
La situation est « surréaliste ». Aux milliers de gens qui avaient pris la nationalité russe pour conserver leur appartement et qui avaient fait la queue des jours entiers pour « réenregistrer » leur bien conformément à la législation russe, il est répondu qu'ils n'avaient plus de domicile.
Andriuchtchenko diffuse une vidéo où l'on voit une femme debout devant le logement où elle a vécu pendant trente ans et à laquelle l'administration chargée du logement refuse de lui remettre les clés. Elle n'est pas la seule victime.
Le site ukrainien 0629.com.ua a examiné la dernière liste d'appartements dits « sans propriétaire » publiée le 4 avril par les autorités d'occupation de Marioupol. […] Elle comporte plus de 300 appartements. Des listes similaires sont en cours d'élaboration dans toutes les régions occupées, à l'exception de la Crimée. En effet, bien que la Russie ait rendu tout aussi impossible la vie en Crimée si on n'a pas la citoyenneté russe, le Kremlin a été plus lent à introduire des mesures empêchant les propriétaires ukrainiens de conserver leurs biens sans passeport russe.
Par contre, depuis 2022, tous les faux-semblants ont été abandonnés et les mesures de pillage sont plus rapides et plus agressives.
À Marioupol, les propriétaires ont trente jours pour se présenter en personne et pour contester la classification de leur bien comme « sans propriétaire ». Si le propriétaire en titre est contesté par les autorités ou absent – un grand nombre d'Ukrainiens ont été contraints de fuir –, cela permet le pillage encore plus librement. Les organisations de défense des droits humains conseillent cependant aux Ukrainiens se trouvant dans cette situation de ne pas retourner dans les territoires occupés pour faire valoir leurs droits. Ils risquent d'être arrêtés et condamnés à de lourdes peines d'emprisonnement sur la base de fausses accusations. […]
Au cours de l'été 2024, RIA-Melitopol s'est entretenu avec des Ukrainiens de Melitopol (dans la partie de la région de Zaporijjia occupée) qui avaient tenté de retourner à Melitopol via Moscou et l'aéroport de Cheremetievo. Ils ont rapporté que le formulaire qu'ils devaient remplir contenait des questions sur leurs biens immobiliers auxquelles il fallait répondre de manière exhaustive, allant jusqu'à mentionner les parts détenues dans les appartements de leurs proches. « En règle générale, les propriétaires de biens particulièrement prisés, tels que les magasins ou les beaux appartements, sont renvoyés là d'où ils sont venus. » Le FSB vérifiait les réponses concernant leurs biens à l'aide de données informatiques et toute omission servait de prétexte pour une « expulsion » immédiate.
Selon RIA-Melitopol, il est légitime de penser que le FSB dispose d'une liste des biens convoités par les envahisseurs.
« Nationalisation », extorsion et substitution de population
Le 7 avril, Ivan Fedorov, chef de l'administration régionale de Zaporijjia, a rapporté que si les envahisseurs pillaient le territoire occupé depuis trois ans, ils utilisaient désormais une nouvelle méthode la « vente aux enchères » de terres illégalement confisquées et « nationalisées ».
Selon lui, cela permet de se débarrasser des Ukrainiens jugés « déloyaux [à la Russie] » et de les remplacer par des mercenaires ayant combattu contre l'Ukraine, ou par des « spécialistes » venus de Russie.
Tout cela n'est pas nouveau. En mai 2024, le groupe East Human Rights Group signalait que des terrains étaient attribués à l'armée d'occupation après avoir été inscrits au registre russe des « terres confisquées ». À l'époque, quelque 2 000 terrains avaient été illégalement attribués. Ce chiffre est sans doute beaucoup plus élevé aujourd'hui.
Si les chiffres cités précédemment ne concernaient que l'installation de quelque 10 000 « spécialistes » russes avec leurs familles dans la région occupée de Zaporijjia, Petro Andriuchtchenko citent d'autres sources indiquant que la Russie est déterminée à modifier totalement la composition démographique des territoires occupés : cinq millions de ressortissants de la Fédération de Russie pourraient être déplacés sur le territoire ukrainien occupé d'ici 2030. Cette estimation découle des plans annoncés lors d'un forum à Rostov, intitulé « Intégration 25 », qui évoquait une population de dix millions d'habitants dans tous les territoires occupés, à l'exception de la Crimée. […]
Cela s'inscrit dans le cadre des tentatives claires et extrêmement agressives de la Russie pour éradiquer l'identité ukrainienne sur le territoire occupé et pour emprisonner ou se débarrasser des Ukrainiens considérés comme « trop ukrainiens ». Le 25 mars 2025, Vladimir Poutine a publié un décret selon lequel les citoyens ukrainiens seront expulsés s'ils n'ont pas pris la nationalité russe. À en juger par le nombre considérable d'arrestations d'Ukrainiens dans les territoires occupés, y compris ceux qui ont pris la nationalité russe, sous des accusations absurdes d'« espionnage » ou de « trahison », il semblerait que tous les Ukrainiens soient considérés, dans une certaine mesure, comme « peu fiables » […].
Halya Koynach
Halya Koynach est membre du Groupe de défense des droits humains de Kharkiv. Article publié sur le site Human Rights in Ukraine, 18 avril 2025.
Publié dans Soutien à l'Ukraine résistante (Volume 38)
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/05/03/1er-mai-2025-solidarite-internationaliste-avec-les-travailleureuses-dukraine-pour-une-paix-juste-et-durable/
https://www.syllepse.net/syllepse_images/soutien-a—lukraine-re–sistante–n-deg-38.pdf
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Pour une paix juste et durable en Ukraine plus que jamais renforcer le soutien à la résistance du peuple ukrainien

UNE GUERRE IMPÉRIALISTE RUSSE
C'est Poutine qui a déclenché la guerre en envahissant l'Ukraine dans une logique im périaliste de conquête d'un pays indépendant. Poutine a toujours exposé clairement les buts de la guerre d'agression qu'il mène depuis 2014 :
- Mettre fin à l'indépendance de l'Ukraine, qui, pour lui, fait partie de la Russie.
- Annexer un maximum de territoires ukrai niens considérés comme « russes ».
- Une victoire impérialiste pour consolider le régime en Russie – et en particulier, conti nuer son œuvre de liquidation des oppositions démocratiques.
- Éliminer Zelenski par une destitution forcée, voire par une élimination physique.
Mai 2025 | tiré du site Arguments pour la lutte sociale
https://aplutsoc.org/wp-content/uploads/2025/05/resu_4-pages-ukraine_mai-2025.pdf
Pour lire le dépliant, cliquez sur l'icône
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Ukraine : comment mettre plus de pression sur Poutine ?

Les alliés de l'Ukraine cherchent actuellement une manière de faire pression sur la Russie pour qu'elle accepte une pause dans les combats, ce qui pourrait passer par des actions et menaces plus crédibles.
Vendredi dernier, les délégations ukrainiennes et russes tenaient des pourparlers de paix à Istanbul sous médiation turque. La réunion, de deux heures, a abouti à un échange de prisonniers, mais non à une trêve. La Russie veut que l'Ukraine abandonne quatre de ses régions qu'elle contrôle partiellement et la Crimée annexée en 2014. Le pays envahi devrait aussi renoncer à rejoindre l'OTAN et ne plus accepter de livraisons d'armes occidentales. Pour sa part, l'Ukraine a exigé des garanties de sécurité solides et a fermement rejeté ces demandes.
Pour forcer la Russie a être sérieuse dans ses négociations, qui sont actuellement plus un exercice de relation publique qu'autre chose, le professeur associé au département de science politique de l'université de Pittsburgh, William Spaniel, qui tient le site « Lines on map » sur YouTube ou il analyse de manière détaillée la guerre en Ukraine, a publié le 17 mai une vidéo d'une trentaine de minutes exposant la manière dont pourrait se résoudre ce conflit en forçant la Russie à négocier un arrêt des combats.
Le scientiste qui a un PhD de L'université Rochester en 2015, considère que la proposition d'arrêt des combats de l'envoyé spécial des États-Unis chargé de la résolution du conflit en Ukraine, l'ex-général Keith Kellogg, était raisonnable, mais qu'il n'y avait pas eu de suivi à ce sujet. Les États-Unis y menaçaient la Russie d'augmenter leur aide à l'Ukraine si Poutine faisait la sourde oreille à une demande d'arrêt des combats. William Spaniel considère que la Russie est de plus en plus convaincue que les États-Unis n'ont aucun intérêt de continuer leur implication en Ukraine, quel que soit le déroulement des événements.
Même si Trump menace publiquement d'augmenter l'aide militaire américaine à l'Ukraine si la Russie ne déclare pas d'arrêt des combats, le chercheur ne croit pas qu'actuellement que cela convaincra Poutine qu'il le ferait réellement. Il affirme que Trump ne gère pas les relations internationales au jour le jour en fonction de ses humeurs, comme beaucoup d'analystes le croient, mais suit plutôt une doctrine tirée du document « Une stratégie pour défendre les intérêts américains dans un monde plus dangereux » sur lequel il avait fait en fin avril une vidéo d'une quarantaine de minutes intitulée la « doctrine Trump », détaillant les impératifs pour prioriser les actions américaines. Cette doctrine prioriserait Taiwan sur l'Ukraine.
L'Europe doit aussi devenir plus crédible
William Spaniel considère aussi que les pays européens qui font actuellement des menaces doivent les faire suivre d'actions réelles. « Cessez de le dire et faites-le ! » affirme le scientiste, « Si les pays européens payaient un prix réel pour mettre en application leurs menaces, cela les rendrait crédibles. » Il serait important que l'aide militaire à l'Ukraine augmente actuellement substantiellement sur le terrain pour permettre à son armée d'arrêter l'avancée incrémentale des Russes. Les alliés de l'Ukraine pourraient après confronter Poutine, montrant qu'ils sont sérieux et qu'il devrait négocier. La menace toucherait aussi la production de matériel militaire qui continuerait en Occident, mais qu'il serait accumulé et non envoyé en Ukraine tant que les combats seraient arrêtés. Il y serait cependant envoyé dès qu'ils reprendraient.
Il y a beaucoup à faire pour que les actions prises par l'Occident contre la Russie soient crédibles. Le meilleur exemple de cette situation s'est produit le 17 mai dernier alors que la marine estonienne a tenté d'aborder dans les eaux neutres du golfe de Finlande un pétrolier de la flotte fantôme russe en mer baltique. Depuis 2022 le brut russe est placé sous sanction par le G7 et l'Union européenne (UE), mais ces sanctions sont contournées par la Russie qui utilise des « navires-fantômes ». Alors que les navires de patrouille, des avions de l'OTAN et des hélicoptères se sont approchés du pétrolier, tentant à deux reprises de l'arraisonner, un chasseur russe Sukhoi 35 aurait violé l'espace aérien estonien, soit le ciel de l'OTAN, pour défendre et libérer le navire-fantôme bien qu'il battait pavillon du Gabon.
La guerre hybride russe contre les pays occidentaux continue d'ailleurs à bafouer leur souveraineté. Une vidéo produite par le journal Le Figaro mise sur son site internet le 17 mai montre que la DGSI française doit toujours faire face à plusieurs opérations d'espionnage russe sur son territoire. Une note du renseignement français récemment publiée fait aussi état de menaces et actions russes contre la France. La consultante en relation internationale Franco-Ukrainienne, Alla Poedie disait le 15 mai sur les ondes de LCI au sujet de l'infiltration des agents d'influence russe sur le territoire français : « Ça fait 30 ans que je suis en France et ça fait 30 ans que j'observe les agents russes fonctionner en toute impunité, ouvertement, en approchant les hommes politiques, les femmes politiques, différents leaders d'opinion. » Elle considère d'ailleurs que ces actions deviennent plus agressives.
Le ministère français des Armées publiait à ce sujet sur son site internet à la mi-mai la vidéo « Matriochka : la campagne pro-russe de désinformation » qui fait état de plusieurs actions belliqueuses russes visant l'occident. Différentes manœuvres de désinformation reliées au dispositif informationnel pro-russe auraient été détectées depuis septembre 2023. Un phénomène qui existe depuis longtemps, mais qui se serait massivement amplifié depuis le début de la guerre en Ukraine. Ces attaques s'intensifieraient lors de grands événements.
.
Le temps presse
« La pression sur la Russie doit se poursuivre jusqu'à ce qu'elle soit prête à mettre fin à la guerre », affirme Zelensky sur tous les tons et dans tous les médias. Plusieurs croient encore que Trump mettra à exécution des restrictions bancaires à Moscou et les menaces d'imposer des sanctions dites secondaires. Ce dernier pourrait aussi approuver le projet de loi du sénateur américain Lindsey Graham qui bénéficie d'un soutien bipartisan au Congrès. Il impose aux pays qui achètent à Moscou du gaz et du pétrole des droits de douane punitifs.
Considérant que l'Ukraine a encore beaucoup de soutien aux États-Unis et même chez les républicains, William Spaniel croit que la large minorité démocrate pourrait aider à marginaliser les extrémistes MAGA s'y opposant et faire passer cette loi. Toujours selon le scientiste, l'Union européenne devrait s'attacher dès maintenant à développer de nouveaux systèmes d'armes capables de protéger ses pays des menaces militaires.
Des actions pourraient aussi diminuer l'instrumentalisation par la Russie de « l'internationale réactionnaire ». L'essayiste et journaliste qui a publié « La Gratitude » aux éditions de L'Observatoire, Laetitia Strauch-Bonart, considère que la droite française doit soutenir sans ambiguïté l'Ukraine.
Malgré le manque de prévisibilité qu'offre la diplomatie américaine, l'Union européenne continue cependant à avancer et a adopté de nouvelles sanctions visant la flotte de pétroliers fantômes. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, affirme que le plafond du prix du pétrole russe fixé par le G7 pourrait être abaissé. L'UE travaille aussi à de nouvelles mesures s'attaquant au secteur financier de Moscou et aux gazoducs Nord Stream.
Les récents mouvements économiques au niveau mondial pourraient aussi être favorables à une cessation des hostilités en Ukraine. Avec un baril sous la barre des 70 dollars, la Russie est prise avec une diminution de ses revenus. Ana Maria Jaller-Makarewicz, de l'Institute for Energy Economics and Financial Analysis, croit que la chute des prix pétroliers pourrait pousser le pays à conclure un accord de paix.
Michel Gourd
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« Le spectre du fascisme hante l’Europe alors qu’elle célèbre le jour de la Victoire en Europe »

[Il y a 80 ans aujourd'hui 8 mai, l'Europe célébrait la défaite du fascisme après une lutte colossale. Pourtant, comme le souligne l'historien Enzo Traverso, ce nouvel anniversaire de la Victoire en Europe (Victory in Europe Day) intervient à un moment où l'extrême droite est plus forte qu'elle ne l'a jamais été depuis 1945.]
Tiré de A l'Encontre
12 mai 2025
Par Enzo Traverso
Viktor Orban et Giorgia Meloni, 24 juin 2024.
Les commémorations sont des miroirs intéressants pour les récits hégémoniques du passé, qui ne correspondent pas nécessairement à la conscience populaire de l'histoire. Cela est particulièrement vrai pour les anniversaires mondiaux comme le 8 mai 1945.
Pendant des décennies, l'Occident a célébré le jour de la Victoire en Europe (V-E-Day) pour afficher sa puissance et affirmer ses valeurs. Dans cet état d'esprit, l'Occident était non seulement puissant, mais aussi vertueux. Cette liturgie de la démocratie libérale s'est déroulée sans heurts et de manière consensuelle, tous les participants se rassemblant autour de souvenirs, de symboles et de valeurs qui ont forgé leur alliance.
En 1985, quarante ans après la fin du conflit, la République fédérale d'Allemagne (RFA) s'est jointe à ces commémorations. Dans un discours célèbre prononcé devant le Bundestag, le président de la RFA, Richard von Weizsäcker, a solennellement déclaré que l'Allemagne ne devait pas considérer cette date comme un jour de défaite, mais plutôt comme un jour de libération.
Après la fin de la guerre froide, le jour de la Victoire symbolisait le triomphe de l'Occident : capitalisme, puissance militaire, institutions solides, prospérité économique et mode de vie plaisant. Certains chercheurs ont parlé d'une sorte de fin de l'histoire à la Hegel, tandis que d'autres ont évoqué une fin heureuse à la Hollywood.
Des repères instables
Aujourd'hui, ce rituel rassurant semble anachronique, réminiscence d'une époque révolue. Quatre-vingts ans après la chute du Troisième Reich, le fascisme refait surface en Europe. Six pays de l'Union européenne – l'Italie, la Finlande, la Slovaquie, la Hongrie, la Croatie et la République tchèque – ont des partis d'extrême droite au pouvoir. Des partis similaires sont devenus des acteurs majeurs dans toute l'Union européenne, de l'Allemagne à la France et de la Pologne à l'Espagne.
Dans ce contexte, il peut sembler préférable d'éviter les commémorations internationales. Après tout, J. D. Vance, l'omniprésent vice-président des Etats-Unis, pays libérateur de 1945, pourrait célébrer la liberté en faisant l'éloge de l'Alternative für Deutschland (AfD), ou le tout aussi omniprésent Elon Musk pourrait le faire en faisant le salut hitlérien.
A l'est du continent, Vladimir Poutine commémorera le sacrifice du peuple soviétique dans la lutte contre le fascisme – vingt millions de morts – en louant l'héroïsme de l'armée russe qui a envahi ce qu'il appelle l'Ukraine « nazie » il y a trois ans. Nos repères historiques sont bouleversés ; la mémoire conventionnelle ne correspond pas au terrible chaos de notre présent.
Malgré son caractère officiel, le jour de la Victoire en Europe a également été une date mémorable pour la gauche. Comme l'avait souligné Eric Hobsbawm [1917-2012], ce jour symbolisait la victoire des Lumières sur la barbarie. Une coalition entre le libéralisme et le communisme, héritiers antagonistes du legs des Lumières, avait vaincu le Troisième Reich. Cette vision était hégémonique dans la culture de la Résistance, selon laquelle l'antifascisme luttait contre les ennemis de la civilisation. Si elle était vraie à bien des égards, cette perspective était néanmoins trop simpliste.
Au lieu de nous livrer à une commémoration rituelle et cooptée, cet anniversaire devrait peut-être nous inciter à procéder à une réévaluation critique. Le jour de la Victoire en Europe célèbre la victoire d'une alliance militaire dans une guerre mondiale qui comportait de nombreuses dimensions, notamment l'établissement d'un nouvel ordre mondial dans lequel cette coalition « des Lumières » ne pouvait survivre.
En Occident, les Etats-Unis sont devenus la superpuissance dominante ; dans le bloc soviétique, la guerre d'autodéfense de l'URSS contre l'agression nazie s'est transformée en occupation militaire et en une nouvelle forme de colonialisme en Europe de l'Est. Les idées du libéralisme et du communisme se sont institutionnalisées sous la forme de l'impérialisme et du stalinisme.
Pour la gauche, la fin de la Seconde Guerre mondiale a été une victoire des mouvements de résistance, qui a donné une légitimité démocratique aux nouveaux régimes nés de l'effondrement du Troisième Reich. Dans la plupart des pays d'Europe occidentale, la démocratie n'a pas été imposée par les vainqueurs, elle a été conquise par la résistance.
Comme l'a souligné Claudio Pavone [1920-2016], le concept de résistance avait toutefois plusieurs dimensions. Il englobait à la fois l'ensemble des mouvements de libération nationale contre l'occupation allemande, une guerre civile entre les forces antifascistes et de nombreux régimes qui avaient collaboré avec les occupants nazis, et une guerre de classes visant à changer la société, car les élites dirigeantes et la plupart des composantes du capitalisme européen avaient été impliquées dans le fascisme et la collaboration.
Cette guerre des classes a été remportée en Yougoslavie, qui est devenue un pays socialiste, et a créé les conditions d'une gauche puissante dans de nombreux autres pays, de l'Italie à la France. Elle a également renforcé la résistance contre le franquisme en Espagne et le salazarisme au Portugal.
Les ambiguïtés de la libération
Toutefois, si l'on regarde au-delà des frontières européennes, le paysage apparaît beaucoup plus diversifié. En tant qu'anniversaire mondial, le 8 mai 1945 revêt différentes significations. Alors que le jour de la Victoire en Europe a été célébré et mythifié comme un symbole de libération en Occident, il n'en a pas été de même ailleurs.
En Europe centrale et orientale, ce moment de libération s'est avéré éphémère, car le régime nazi a rapidement cédé la place à un bloc de régimes autoritaires mis en place par l'URSS. Dans de nombreux pays, cela a signifié la russification et l'oppression nationale.
Le jour de la Victoire en Europe n'est pas non plus un événement commémoratif marquant la libération en Afrique et en Asie. En Algérie, cette même date est l'anniversaire des massacres coloniaux de Sétif et Guelma, lorsque l'armée française a violemment réprimé les premières manifestations pour l'indépendance nationale. Ce fut le début d'une vague de violence impériale qui balaya toute l'Afrique française et atteignit son paroxysme deux ans plus tard à Madagascar [la répression par l'armée française contre l'insurrection malgache initiée en mars 1947 fera entre 1947 et 1949 des dizaines de milliers de morts].
C'est un gouvernement de coalition à Paris, composé de partis de la résistance, qui a été responsable de cette explosion de violence coloniale – une coalition qui comprenait les principaux partis de gauche, les socialistes et les communistes. Les mémoires antifascistes et anticoloniales ne sont pas toujours harmonieuses et fraternelles. L'anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale mérite un souvenir critique plutôt que des célébrations apologétiques. (Article publié sur le site Jacobin le 8 mai 2025 ; traduction rédaction A l'Encontre)
Enzo Traverso enseigne à l'université Cornell. Ses deux derniers ouvrages en français : Gaza devant l'histoire (Ed. Lux, 2024) et Révolution : une histoire culturelle (La Découverte, 2022).
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
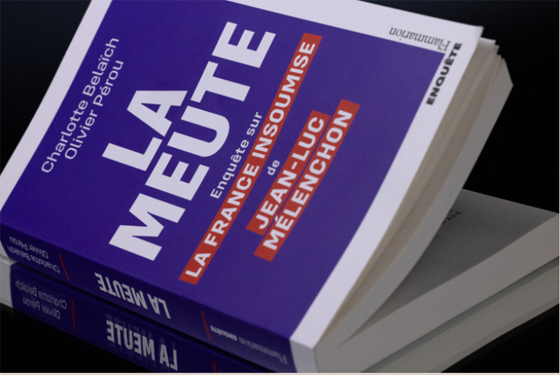
Contre la V° République : ni Chef ni Meute !
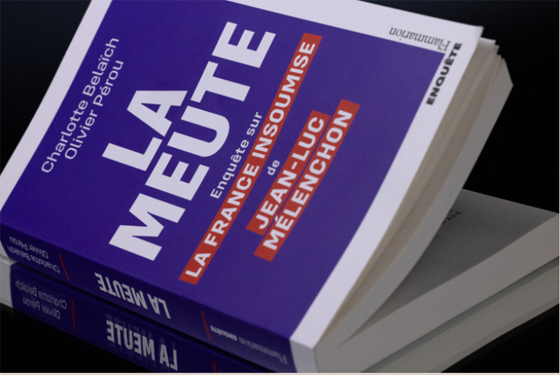
On parle beaucoup ces jours-ci du livre La meute, de Charlotte Belaïch et Olivier Pérou – Flammarion, 22 euros, mais pas toujours disponible car manifestement un succès de librairie – sorti quelques jours après l'émission Envoyé Spécial sur le même sujet : LFI.
12 Mai 2025 | tiré du site Arguments pour la lutte sociale
Les uns disent que les « révélations » qu'il contient les consternent. Bon, quand Fabien Roussel prend un air contrit pour dire qu'en somme, on dirait une secte, on peut sans doute parler d'hypocrisie …
Les autres, du côté de LFI, ou mieux encore de sa garde prétorienne et police politique interne, le POI, sont en mode « complot médiatique de ceux qui ont peur de nous, car nous sommes la vraie menace contre leur domination ». On peut sans doute parler là de fantasmes de gens cherchant à se rassurer …
Ce livre est une addition de faits et de témoignages établis d'une manière journalistique tout à fait professionnelle, et dont quiconque connait un peu l'objet dont il traite ne doutera pas un seul instant, d'autant (comme dans mon cas, mais je n'ai rien d'original à cet égard) qu'il savait déjà tout ou presque (1).
Le sujet est à vrai dire plus restreint que LFI. Si certains de ses membres, notamment sur les réseaux sociaux, se comportent en meutes, la meute dont il est ici question est plus restreinte que la masse militante : c'est une faide (suite féodale), où, comme on dit en langue allemande, une Gefolgschaft, à savoir la troupe ou la « truste », l'équipe de jeunes fidèles au Chef et l'escortant (« jeunes » en ce sens qu'ils sont tous et toutes plus jeunes que lui).
Ce livre nous présente plein d'anecdotes et de récits de vie concernant Jean-Luc Mélenchon et environ vingt à trente personnes formant ce premier cercle ou tournant autour, cette cour ou quelque nom qu'on lui donne, centrée sur lui. Même s'il y a ça et là des formulations heureuses (ex. : à la fin de l'avant-dernier chapitre, la mise en opposition abyssale entre le désir de « faire la révolution » et l'ambition d'être président de la V° République), il ne faut pas y chercher des explications historico-politiques ou l'analyse sociologique d'un tel phénomène pour laquelle je me permets de renvoyer à mes propres articles. Le tout reste très factuel tout en donnant une impression d'ensemble désastreuse, mais conforme à la réalité. L'intérêt est souvent psychologique, et il est réel.
Ledit phénomène est ancien. Dans les années 1990, j'ai participé à je ne sais combien d'« universités d'été », « rencontre-débats » et autres « assises » dont J.L. Mélenchon était l'un des acteurs principaux. J'ai pu noter tout de suite ses talents oratoires, et, peu après, leurs limites : les ficelles étaient toujours les mêmes. Mais elles faisaient vibrer un parterre d'admirateurs où se détachait une phalange d'élus, presqu'exclusivement masculine, qui le suivait, effectivement, en meute. Phénomène pas propre à Mélenchon mais qui était le plus prononcé, dans les milieux socialistes critiques, avec lui. Si l'on parvenait à passer par-dessus ce corps des officiers, chose pas toujours évidente car, déjà, la meute entendait garder pour elle le lien privilégié au Chef, on pouvait encore discuter avec lui à égalité, de façon normale, mais cela s'est fait de plus en plus difficile au fil du temps.
Un jour, au bar, entouré d'une dizaine d'admirateurs lui collant aux baskets, il m'avait toisé ostensiblement en s'écriant : « Je sais reconnaître un périscope ! ». Je dois dire que je n'ai compris cette histoire de périscope que quelques minutes plus tard : il venait de me désigner à sa faide comme un « sous-marin » ! Ce que je n'étais pas, mais comme j'intervenais, à tort ou à raison, en exprimant ce que je pensais au lieu de l'imiter, je devais constituer un danger.
Dans La Meute, on apprend d'ailleurs que lors de sa première rencontre avec Clémentine Autain, à la même époque, il lui avait dit qu'elle faisait de « l'entrisme » : une sorte de test pour casser un peu l'interlocuteur afin, ensuite, de mieux passer alliance et rechercher l'allégeance. Ce type de relations m'ayant toujours, non seulement répugné, mais surtout complément échappé, à l'instar par exemple des hiérarchies de l'Education nationale, j'ai d'autant plus résolument continué à vouloir être un « sous-marin » … de moi-même, comme nous devrions tous l'être !
La lecture de La Meute ne comporte qu'un seul membre de la truste féodale des années 1990, Jérome Guedj. Car l'autre caractéristique de ce type de groupement est le renouvellement de leurs membres, chaque tournant du Chef entrainant soit des départs, soit des exils, toujours sanctionnés par une rupture ostensible et volontairement blessante du côté du Chef : le Chef se définit justement comme Chef par ce pouvoir de blesser.
C'est ce qui permet, plus tard, d'écrire des livres, car les blessés, pieds écrasés et autres exilés veulent bien témoigner, parfois pudiquement, voire anonymement. L'une de leur motivation provient d'ailleurs de la schadenfreude qu'ils éprouvent à dénigrer, plaindre ou prédire la chute de ceux qui leur ont succédé. Ils observent que la recherche de la docilité conduit à la sélection privilégiée des imbéciles. Observation qu'il faut d'ailleurs amender : les Bompart et même les Panot ne sont pas des imbéciles, mais ils se réduisent eux-mêmes, dans leur servitude volontaire dépeinte par ce La Boétie dont le Chef a fait le nom de leur Institut, à l'état d'Imbéciles du Chef, qui définit bien leur statut très honorable et très précaire …
Le plus intéressant de ce livre est la dégradation qu'il donne à voir et à penser dans ce qu'il appelle la meute et que j'appellerai donc plutôt la cour, qui en interne est parfois désignée du surnom de l'Imperium. Non seulement Ruffin et Autain, qui ont toujours été à une certaine distance, mais Corbière, Garrido, Simonnet, qui n'ont jamais totalement renoncé, sans doute, à parler et donc à penser par eux-mêmes, n'en sont plus, cependant que deux vieux compagnons du Chef décédaient, François Delapierre (dont l'épouse, Charlotte Girard, sera excommuniée par le Chef) puis Bernard Pignerol, mais on note l'ascension de personnages douteux, et on se prend d'une certaine pitié pour le Chef vieillissant, qui tombe dans les rets d'une médiocrité arriviste, avide, vulgaire et réactionnaire aussi évidente que Sophia Chikirou : quelle honte !
Les dénonciateurs du livre auront beau jeu de dire que les chapitres tournant autour de celle-ci tiennent de Gala, ou d'un mauvais roman-photo sur les amours ancillaires du patriarche en son automne. Mais on leur rétorquera que c'est criant de vérité et que les auteurs sont bien obligés d'en parler puisque c'est cela qui fait maintenant la politique du Chef et donc de LFI !
Et c'est, certes, plus grotesque que gaulois …
Il y a d'ailleurs pire : le « Bénalla de Mélenchon » – les connaisseurs d'un autre passé se diront aussi : « le Malapa de Mélenchon (2) » ! – Sébastien Delogu, le gars qui ne sait pas qui était Pétain, propulsé chauffeur et garde du corps mais aussi député (quelle image du peuple transparait-elle dans de tels choix ?) : « A qui veut l'entendre, il se vante de collectionner les femmes. « Il reçoit des messages privés de tous les côtés, des meufs de la téléréalité, des Russes … çà rend dingue », raconte un ancien proche. » Ouais …
Et observons que l'ascension du POI comme garde rapprochée, amorcée en 2022 mais vraiment scellée dans la défense d'Adrien Quatennens, l'homme à claques, à la fin de cette même année 2022, est concomitante de la place prise par une Chikirou voire par un Delogu. Les fins de règne sont les plus ravageuses. Pauvre Chef …
Voilà donc pour cet ouvrage. Maintenant, la vraie question, c'est : est-ce bien ce livre (et l'émission d'Envoyé spécial) qui suscite une interrogation générale sur LFI ? Indépendamment de leur intérêt propre (à cet égard Envoyé spécial met plus en exergue le rôle, devenu central, du POI, que La Meute), le livre et l'émission ne sont pas des causes, mais des symptômes, des révélateurs, au plus des facteurs d'accélération. Ni plus, ni moins. Et vu la posture de repli défensif, « en tortue », prise par LFI en jouant les persécutés envers « les médias », même pas sûr que ça accélère quoi que ce soit.
Voici l'essentiel : le moment où livre et émission arrivent, et qui a précédé leur arrivée, est le moment où le désir d'unité contre le risque RN et contre la politique antisociale et les dénis de démocratie de Macron est en train de se tourner contre Mélenchon, perçu, au niveau des gens ordinaires, comme un obstacle qui pourrait faire élire Le Pen ou Bardella, ou l'héritier de Macron.
Sans donner trop d'importance anticipée aux sondages, on évoquera bien sûr ici le sondage de Regards indiquant la possibilité qu'une candidature de gauche unie, voire d'une candidature de gauche unie hormis LFI, pourrait accéder au second tour d'une présidentielle, ce qui n'apparaît plus être le cas pour une candidature LFI, c'est-à-dire Mélenchon, même s'il avait le soutien de toute la gauche.
Ce sont les mêmes couches sociales et électorales qui ont fait la poussée de Mélenchon au premier tour de 2022, car elles voulaient barrer la route à Le Pen et tenter d'éviter un nouveau second tour Macron/Le Pen, dont le réflexe défensif et le désir d'unité se tournent de plus en plus contre Mélenchon, et par sa faute.
Ceci avait commencé avant la formation du NFP les 9 et 10 juin 2024 et l'a conditionnée. Ce qui, au passage, nous indique la différence entre la NUPES, accord de sommets dans lequel J.L. Mélenchon était le plus fort, et le NFP, où l'accord des sommets, précaire et contesté, est imposé par la volonté majoritaire montant d'en bas.
La situation internationale, surtout depuis ce qu'il est convenu d'appeler « la scène du Bureau ovale » (Vance et Trump aboyant sur Zelensky), en faisant prendre conscience de l'Axe Trump/Poutine surplombant le risque d'extrême droite en Europe et celui du RN en France, accentue fortement cette évolution car si Mélenchon pouvait apparaître, en 2017 et déjà plus difficilement en 2022, comme susceptible de battre le RN au second tour, ce n'est à présent plus du tout le cas, et son attitude envers l'Axe Trump/Poutine est évidemment perçue par les larges masses, qui ont du flair, comme problématique.
La question de l'unité pour gagner, de plus en plus, pose la question du retrait de Mélenchon, qui ne sera pas président de la V° République et c'est tant mieux, car, depuis 2016, son orientation politique conduirait à une super-V° République intégrative et répressive, et non une VI°.
La base de LFI, elle aussi, veut l'unité pour gagner. Il faut miser là-dessus, inutile de demander à Mélenchon de renier Chikirou, Delogu et le POI, il n'y a qu'une seule chose à lui demander et s'il le faut à lui imposer : l'unité et donc son retrait, ou sa minorisation.
Au passage, LFI explosera ? Très bien, que cent fleurs s'épanouissent !
Mais cette demande n'aura de crédibilité que si elle-même ne roule pas pour un autre Chef et n'est pas arrimée à l'horizon présidentiel !
Il s'agit d'en finir avec la V° République, d'aller vers ce processus constituant que tous les grands mouvements sociaux récents, Gilets jaunes, retraites, ont commencé à dessiner !
Voila le défi, voila le sujet à discuter vraiment.
VP, le 12/05/25.
Notes
(1) Je n'ai relevé qu'une erreur, p. 326, où le russe Sergueï Oudaltsov est dit « emprisonné en Russie depuis 2011 ». En fait, cet « opposant de gauche », qui se réclame de Staline et considérait Navalny comme son ennemi principal, devant Poutine, a fait trois ans de prison et a été parfois victime d'acharnement pénal des services de sécurité depuis, écopant de plusieurs courtes peines de prison, tout en développant son orientation politique favorable aux guerres de Poutine qui devraient selon lui aider à remettre en place une économie à la soviétique. En tant qu'opposant russe ayant la faveur de J.L. Mélenchon, Alexeï Sakhnin l'a remplacé en 2022 car celui-ci, pour qui Crimée et Donbass sont russes, a toutefois condamné l'agression du 24 février, ce qui le rendait plus présentable, puis a quitté la Russie.
(2) Lionel Malapa avait été le garde du corps de Pierre Lambert et responsable du SO central de l'OCI.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Reform Party – Le Parti travailliste nourrit le monstre

Une remarque a retenu l'attention dès les premières heures de la soirée électorale jeudi dernier : « Reform les dévore au petit déjeuner. » Ce parti, qui n'avait obtenu qu'un seul député avant les élections générales de juillet – où il en a décroché cinq –, vient de :
• remporter la plus grande part des voix de la soirée ;
• gagner une élection partielle parlementaire avec un déplacement de vote de 17 % ;
• faire élire 650 nouveaux conseillers municipaux ;
• prendre le contrôle de dix conseils de comté pour la première fois ;
• remporter deux mairies ;
• et se voit attribuer une part des voix nationale projetée à 30 %, ce qui lui donne une chance de former ou de participer à un gouvernement de coalition de droite.
6 mai 2025 | tiré d'International View Point | Photo : Reform Party, parti europhobe et anti-immigrant
https://internationalviewpoint.org/
Tous les sondages des derniers mois plaçant le Reform Party à égalité, voire devant les travaillistes et les conservateurs, se trouvent ainsi validés – voire surpassés. Avec plus de 120 000 membres, ce parti a déjà dépassé les conservateurs. De riches donateurs, notamment venus de la sphère trumpienne, ont renfloué ses caisses. Avoir des centaines de conseillers municipaux confère non seulement de la visibilité et des ressources matérielles, mais permet également d'implanter le parti localement, facilitant ainsi les campagnes futures.
Des journalistes ont noté une professionnalisation de l'organisation du Reform Party. Plus de 80 représentants et membres du personnel conservateurs ont fait défection. Cela se reflète aussi dans l'instauration d'un cordon sanitaire vis-à-vis des partisans de Tommy Robinson, malgré l'affinité idéologique de certains membres. Les voix les plus extrêmes ont été largement tenues à l'écart des médias pendant la campagne. Farage vise maintenant les élections des assemblées galloise et écossaise.
Conservateurs et travaillistes frappés durement
Comme ces sièges avaient été remportés au plus fort de la popularité de Boris Johnson, les conservateurs en ont perdu davantage que les travaillistes – 676 sièges au total. Leur direction, tout comme celle du Labour, est prise en étau entre la droite et la gauche. Par exemple, les Libéraux-démocrates les ont battus dans le sud-ouest et le Shropshire, et ont pris le contrôle de l'Oxfordshire et du Gloucestershire.
Beaucoup d'électeurs conservateurs, notamment pro-européens, n'ont pas apprécié que la direction penche vers les politiques du Reform Party. D'un autre côté, des figures comme Robert Jenrick, candidat malheureux à la direction, prônent un rapprochement avec le Reform Party.
Jacob Rees-Mogg (ancien député tory) a même déclaré que c'était une bonne soirée pour « la droite ». Pour ces gens, une recomposition de la droite avec le Reform Party comme partenaire égal, voire dominant, est une option envisageable. En Italie, la droite traditionnelle a fusionné avec les post-fascistes des Frères d'Italie dans une coalition dirigée avec succès par Giorgia Meloni.
Un Labour désorienté
Les porte-parole travaillistes semblaient abasourdis par les résultats. Ils affirment que la réticence de leur base traditionnelle à voter ou même à se déplacer provient du chaos laissé par les conservateurs après 14 années de pouvoir. Le Labour doit prendre des « décisions difficiles » à cause des Tories, donc ce n'est pas vraiment de leur faute…
Mais les électeurs ont évoqué, sur le pas de leur porte, des sujets tels que la suppression des aides au chauffage hivernal ou les coupes dans les allocations pour personnes handicapées. D'autres choix politiques étaient possibles : revenir sur le plafond de deux enfants pour les allocations, ne pas toucher aux aides hivernales, maintenir les prestations d'invalidité ou respecter les engagements écologiques.
Une fois qu'on exclut de taxer les riches, de modifier les règles fiscales arbitraires ou de collectiviser certaines ressources, on s'enferme soi-même. Surtout si l'on veut appliquer, ne serait-ce que partiellement, un programme social-démocrate.
La direction travailliste semble aussi croire que ses positions indéfendables sur la Palestine, l'aide internationale, les femmes WASPI ou les droits des personnes trans n'auront aucun effet négatif sur les électeurs. Normalement, un nouveau gouvernement bénéficie d'un état de grâce. Mais les règles fiscales strictes imposées par Rachel Reeves limitent considérablement la possibilité de mesures populaires.
La chute massive du nombre d'adhérents, conséquence de la purge contre la gauche, a visiblement affaibli la machine militante. Le Reform Party a réussi à concurrencer le Labour sur ce terrain lors de l'élection partielle de Runcorn – une tendance probablement répliquée dans plusieurs batailles locales.
Et maintenant ?
Deux orientations se dessinent au sein du Labour. Avant même la perte de Runcorn, la droite du parti – y compris dans ses organes centraux – y voyait une opportunité de se rapprocher davantage des politiques anti-migrants du Reform Party et d'imiter son programme « anti-woke ». Jonathan Hinder, député de Pendle et Clitheroe, déclarait récemment :« Trop de personnes de la classe ouvrière perçoivent Labour comme le parti des immigrés, des minorités, des allocataires. » « Le pays doit réduire drastiquement l'immigration, très rapidement, quitte à faire passer la souveraineté démocratique avant les obligations juridiques internationales. » À propos de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), il a ajouté : « Il est évident qu'elle ne fonctionne pas. »
D'autres au sein de la direction pensent qu'il n'est pas nécessaire de modifier la ligne, misant sur un réflexe progressiste « paniqué » qui pousserait l'électorat vers Labour pour contrer la menace « néofasciste » d'un gouvernement du Reform Party ou Reform Party/conservateurs. C'est le coup à la Macron : se faire élire en ralliant la gauche pour barrer la route à l'extrême droite. Problème : le système britannique uninominal à un tour ne génère pas ce type de panique avant qu'il ne soit trop tard.
Comme on l'a vu jeudi, le système majoritaire est profondément antidémocratique : il pénalise les petits partis jusqu'à ce qu'ils franchissent un certain seuil. Le Reform Party remporte des sièges avec bien moins de 50 % des voix, tout comme le Labour l'a fait lors de sa victoire historique avec seulement 34 % des suffrages. Reform pourrait très bien répéter l'exploit, surtout avec un accord avec les Tories.
Vers un tournant à gauche ?
Certain·es, même en dehors du Socialist Campaign Group, comme Rachael Maskell (députée de York Central), appellent Starmer à revenir sur des mesures comme la suppression des aides au chauffage ou les coupes dans les allocations handicap. Des pressions internes pourraient pousser à des ajustements symboliques pour répondre à ces critiques.
Diane Abbott est plus directe : le slogan de Starmer après les résultats, prônant « plus de rapidité et de fermeté » dans le Plan pour le changement, doit être abandonné. L'une des rares gagnantes, la mairesse de Doncaster Ros Jones, a rompu avec la ligne du parti en dénonçant ses politiques envers les retraité·es et les personnes handicapées. Elle a même fait campagne contre ces mesures, et mis en place des politiques locales pour en atténuer les effets. Cette indépendance a sans doute sauvé sa réélection face à l'assaut du Reform Party.
Pourquoi copier le Reform Party ne fonctionne pas
Pour la gauche, il est évident que des ajustements cosmétiques ne vaincront pas le Reform Party. Le dénoncer de manière abstraite comme raciste – ou pire, comme nazi – ne suffit pas. Face à la colère et à la désillusion des électeurs sur la vie chère et la politique, il faut proposer des solutions concrètes, pas couper les aides ou se contenter du statu quo.
Il faut expliquer où l'on prend l'argent pour améliorer la vie des gens. Tout le monde sait que la société regorge de richesses. Il faut être honnête : prévoir une taxe sur la richesse, taxer davantage les profits des grandes entreprises. Si la réponse de Starmer se résume à bricoler autour de la croissance, alors il continuera à nourrir ce monstre du Reform Party.
Lors des élections générales, le Labour a ménagé le Reform Party. Ils ont même retiré un·e candidat·e crédible face à Farage à Clacton. Très peu de matériel de campagne ciblait le Reform Party. Les stratèges comme Morgan McSweeney pensaient que le Reform Party nuirait aux Tories, ouvrant la voie à un raz-de-marée. Ce fut vrai… mais de courte durée. À peine neuf mois après cette victoire sans enthousiasme, les conséquences sont déjà visibles. Depuis que le Reform Party monte dans les sondages, le Labour est passé de l'ignorance à l'imitation de ses politiques.
Ainsi Yvette Cooper ne cesse de vanter le nombre de déportations effectuées et de pointer l'origine ethnique ou migrante des délinquants. À Runcorn, la candidate a été poussée à lancer une pétition contre un hôtel d'accueil pour demandeurs d'asile, malgré ses propos antérieurs favorables. Elle-même a fini par admettre que ce discours s'était retourné contre elle. Et lorsque Labour a perdu Runcorn, la déclaration officielle minimisait la défaite en parlant de « quelques voix » manquantes – quid des 15 000 autres ?
Un espace à gauche du Labour
Dans un contexte où le Labour perd 186 conseillers et un siège parlementaire ultra-sûr, les Verts ont bien résisté et gagné des sièges. Jessica Elgot, pourtant proche de Starmer, rapporte que le Labour perd plus de voix à sa gauche qu'au profit du Reform Party. Il existe un espace progressiste à gauche de Labour.
À Preston, Michael Lavalette et deux autres indépendant·es défendant une ligne pro-palestinienne et anti-austérité ont été élu·es. Dans les circonscriptions où la communauté musulmane est significative, le vote ne revient pas vers le Labour.
Les stratèges du parti pensent que la question palestinienne n'est qu'une vague pétition éphémère sur internet, et que ces électeurs « n'ont nulle part où aller ». Ils ne comprennent pas que le silence complice du gouvernement face au génocide, au blocage de l'aide humanitaire et à l'envoi d'armes britanniques entraînera une rupture durable.
L'expérience de Preston montre aussi le potentiel perdu d'une alternative politique à gauche du Labour. Le débat en cours sur la création d'un nouveau parti large de gauche – d'abord localement, avant une annonce nationale – a empêché une intervention électorale coordonnée. Pourtant, un tel développement est essentiel, y compris pour construire un mouvement de masse contre le Reform Party et son racisme anti-migrant.
Un système politique défaillant
Andrea Jenkins (du Reform Party), nouvelle mairessse du Lincolnshire, n'a pas perdu de temps pour afficher un discours violemment anti-migrant. Dans son discours de victoire, elle a déclaré qu'il ne devrait plus y avoir d'hôtels pour demandeurs d'asile : « Qu'ils vivent sous des tentes, comme en France. »
Le professeur John Curtice a raison : le système bipartisan ne fonctionne plus. Dans certaines circonscriptions, on se retrouve avec cinq partis majeurs, et des sièges sont gagnés avec des scores très éloignés de la majorité absolue. Un retour au bipartisme n'est pas à exclure – surtout si les Tories disparaissent ou fusionnent avec le Reform Paty – mais pour l'instant, l'instabilité politique est là pour durer.
Cette nouvelle réalité crée une opportunité favorable pour une nouvelle alternative électorale de masse à gauche. Une fois qu'un·e électeur·rice change de vote, il/elle peut le faire de nouveau, pour un parti plus progressiste. La gauche doit continuer à défendre un système de représentation proportionnelle – comme le congrès du Labour l'a lui-même approuvé. C'est plus démocratique, et cela pourrait atténuer la frustration massive (voire majoritaire, selon les résultats locaux) vis-à-vis du système politique. Cela donnerait une place équitable aux Verts et à toute nouvelle gauche alternative.
Résister au Reform Party : une responsabilité pour la gauche
Le Labour ne s'opposera pas vraiment au Reform Party. C'est à la gauche qu'incombe la tâche d'organiser la résistance dans la rue, dans les campagnes et sur le terrain électoral face à Farage et à son parti. Nous devons démonter les mensonges et les contradictions de leurs politiques. Cela commencera dès maintenant dans les conseils locaux qu'ils ont remportés jeudi. Farage promet déjà des coupes « façon Doge » et des attaques contre l'égalité des chances et les politiques de diversité.
Des campagnes locales, en lien avec les syndicats des travailleurs municipaux, seront nécessaires.
Bien que la réponse principale au Reform Party doive venir de militant·es hors du Labour, il faudra aussi s'appuyer sur tout·e député·e de gauche – ou même de gauche modérée – prêt·e à s'opposer à Farage et à aux politiques du gouvernement qui nourrissent sa popularité. Le succès du Reform Party rend la discussion sur un nouveau parti de gauche d'autant plus urgente.
Anticapitalist Resistance – 5 mai 2025
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

De la « Nakba » au génocide perenne !

Sous le prisme de domination et de nettoyage ethnique, Netanyahou annonce la prise de contrôle de toute la bande de Gaza ! Les bombardements s'intensifient sur l'enclave, avec près de 54.000 victimes. La France de Macron et Retailleau, a les yeux rivés sur le sommet « Choose » et la dissolution des mouvements associatifs français en soutien à la Palestine. La rue refuse l'omerta !
De Paris, Omar HADDADOU
Tournant le dos à Gaza et ses enfants calcinés, Paris fait la part belle au festival de Cannes et à Tom Cruise et sa « Mission impossible ».
Fléau des temps modernes, la colonisation se standardise dans les mœurs sociétales.
Les institutions internationales plient devant le diktat étasunien qui appuie iniquement le siège opéré par Netanyahou. Fort de ce funeste soutien, le chef du gouvernement israélien déclarait, hier lundi 19 mai 2025 : « Israël va prendre le contrôle de tout le territoire de la bande de Gaza. Les combats sont intenses et nous progressons. Nous ne cédons pas ! Mais pour réussir, il faut agir de manière à ce qu'on ne nous arrête pas ! ».
Aussi, fait-il de l'invincibilité un outil de fierté et un paradigme de légitimation du carnage à imprimer dans l'esprit collectif. Pour un plébiscite, ça vaut la boucherie !
Ce lundi encore, la défense palestinienne a fait état de 52 morts et 18 000 blessés dont la plupart des enfants. Les 2 millions de personnes affamées, selon le chef de l'OMS, n'ont pas suscité la moindre réaction chez Macron, accaparé par le sommet « Choose », ses 37 milliards d'investissements, et les tables rondes, bien pourvues, avec le Patronat. A cela s'ajoute la ponction de 40 milliards pour « l'effort de guerre » au détriment des services publics et des retraites.
La déportation massive des Palestiniens en 1948 (es) a ouvert la voie à un processus génocidaire de colonisation innommable dont le continuum se cristallisera épouvantablement dans la bande de Gaza. Soixante-dix-sept (77) ans se sont écoulés, actant une injustice déshumanisante, signée de la main du Secrétaire d'Etat britannique Arthur Balfour, se déclarant en faveur de l'établissement « d'un foyer national pour le peuple juif ».
La suite ? Une colonisation greffée de crimes contre l'Humanité qui s'inscrit dans la durée !
L'extermination systématique des Palestiniens, le déplacement de la population, la famine, la situation sanitaire catastrophique et l'impunité à vomir - que cautionnent ignoblement les Occidentaux - constituent la trame macabre d'un impérialisme institutionnalisé.
La commémoration de la Nakba (catastrophe) s'articule dans un contexte de praticabilité et de durabilité de l'ordre colonial où la prédation des puissants reste l'alpha et l'oméga.
L'hécatombe n'émeut plus ! Trump module la fréquence du mal, accordant à Netanyahou le quitus de la sale besogne. Capitulards, Macron et l'Europe accommodent leur reptation au gré des rapports de force.
Ce week-end, sur les ondes d'une radio publique française, le Premier ministre Netanyahou, à propos de l'arrêt de l'offensive, déclarait avec désinvolture : « Pas de cessez-le feu avant d'atteindre tous les objectifs ! ». Relayée par un chroniqueur, spécialiste du Moyen Orient, une autre annonce défraie la chronique : Dans son agenda, Netanyahou aurait comme option de « proposer à la diaspora juive des quatre coins de la planète, de venir peupler Gaza, une fois vidée de sa population ! » « De lancer, selon un Analyste, des conquêtes et non des opérations limitées ».
Une entreprise déjà ébauchée, dès octobre 2023, par les ultra-orthodoxes, jurant sur des supports vidéo de « retourner dans le Gush Katif et de réinstaller Gaza ».
A Paris, la tragédie palestinienne est éclipsée par les coups de boutoir du tristement notoire, Bruno Retailleau. Ragaillardi par son intronisation, ce dimanche, à la tête des Républicains, après avoir réussi à faire fléchir le chef de l'Etat par le spectre de l'insécurité et la parade de démission, le Ministre xénophobe de l'Intérieur nourrit des ambitions qui pourraient sceller sa politique négationniste envers les Immigrés et les Musulmans (es) : « Notre famille politique est à même aujourd'hui de porter un projet pour la présidentielle 2027 ! ».
Vous l'aurez saisi, le projet de l'abus et de l'acharnement !
Ce fait d'armes « républicain », se cristallise après signature, ce vendredi 16 mai en Conseil des Ministres, de la dissolution des trois groupes : Urgence Palestine, Jeune Garde et Lyon Populaire, leur reprochant des « provocations à des agissements violents ». Larcher et Ciotti s'en délectent !
Menacée de disparaitre, Urgence Palestine qui prenait part à la mobilisation, contre le génocide et en mémoire à la Nakba de 1948, ce samedi à Paris gare du Nord, a fait savoir qu'elle saisirait le Conseil d'Etat et de faire signer une pétition lui permettant de continuer à manifester, nonobstant les ukases des lobbies de la Droite et Extrême Droite. Cette velléité de mise à mort de la lutte pour la cause palestinienne, a donné lieu à une grande marche ce 17 mai, entre Gare du nord et Place Saint-Augustin, rassemblant tous les Collectifs de la Gauche : Ecolos, La France Insoumise, Syndicats, Travailleurs de divers secteurs, Associations, Etudiants (es), Militants Antifa, et les Sans-Papiers.
Un cortège de milliers de personnes, ayant pour mot d'ordre « Stop au génocide ! Non à une 2ème Nakba ! », étoffé par des mises en scène macabres, illustrant l'atrocité de l'occupant.
L'inarrêtable et irréductible Olivia Zémor, Présidente d'EuroPalestine, a conduit, comme à l'accoutumée et avec le brio qu'on lui connait, la procession, dictant à chaque fois des slogans poignants : « Génocide à Gaza, on ne se taira pas ! », « Honte à vous ! A vos institutions et vos intimidations, on répond mobilisation ! Avions de la mort ! A bas les Collabos ! Macron, qu'est-ce que t'attends pour prendre des sanctions ? Pas de génocidaires dans nos salles de concert ! Pas de haine sur nos scènes ! et de clore son indignation par :
« Il faut leur faire sentir le vent du boulet ! »
O.H
PS : Des touristes irlandais se sont joints à nous en applaudissaient à tout rompre. Faute d'espace, nous ne pouvons publier l'échange avec ces Profs retraités de l'Université de Dublin et un fonctionnaire de l'industrie pharmaceutique. Tous s'identifient à la cause Palestinienne et glorifient les Indépendances du Vietnam, de l'Algérie, de l'Afrique du Sud et celles à venir… Fait marquant : Un chef d'entreprise français criant dans le mégaphone : Free, Free Palestine !



******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Etats-Unis. L’administration Trump, le Parti démocrate et les oppositions

L'évaluation médiatique habituelle des 100 premiers jours d'un nouveau président n'a apporté que de mauvaises nouvelles pour Donald Trump. Les sondages ont montré que le soutien à Trump était le plus bas de tous les présidents à l'échéance de 100 jours de mandat depuis près de 80 ans, avec plus de personnes désapprouvant qu'approuvant la position de Trump sur presque toutes les questions importantes.
Tiré de A l'Encontre
16 mai 2025
Par Lance Selfa
Mais l'opposition croissante à la politique désastreuse de Trump n'a pas apporté beaucoup de bonnes nouvelles à la prétendue « opposition », soit le Parti démocrate. Selon un sondage CNN, seuls 29% des adultes ont une opinion favorable du Parti démocrate, son plus bas niveau depuis 1992. Seules 63% des personnes se déclarant démocrates ou indépendantes proches des démocrates ont une opinion favorable de « leur » parti. Les partisans soutiennent généralement leur « équipe » à un taux de 80% ou plus.
Le même sondage CNN a révélé que la plupart des démocrates souhaitaient que leur parti lutte plus fermement contre Trump et les républicains. Les analystes ont suggéré que les Démocrates pourraient être confrontés à une révolte de type « Tea Party » de leur base électorale, comme les Républicains l'ont connu en 2009-2010. A l'époque, la combinaison de l'ardeur de la droite populaire et le soutien de donateurs de droite tels que les frères Koch avait canalisé le ressentiment conservateur à l'égard de l'administration Obama en direction d'une radicalisation du Parti républicain. A bien des égards, le « Tea Party » des années 2010 a préparé le terrain pour la prise de contrôle du Parti républicain par Trump et son mouvement MAGA.
La possibilité d'un « Tea Party » démocrate reflète l'incapacité totale des dirigeants démocrates au Congrès et des autres opportunistes qui se positionnent comme conseillers du parti. Certains veulent s'aligner sur les thèmes trumpiens tels que les messages anti-trans ou « anti-woke ». D'autres affirment que les démocrates devraient se concentrer uniquement sur les questions économiques fondamentales telles que l'impact des droits de douane imposés par Trump et minimiser les attaques de ce dernier contre les immigrant·e·s.
Les politiciens et les dirigeants « normies » [conventionnels] du Parti démocrate pensent que l'impopularité historique de Trump se traduira par des gains pour les démocrates (et pour une majorité à la Chambre des représentants) lors des élections de mi-mandat de 2026. Ils supposent ensuite que les démocrates auront alors un pied à l'étrier pour commencer à réparer les dégâts causés par Trump et la bande de démolisseurs de Musk.
Il s'agit de la pensée optimiste du « tout ira bien » qui était censée avoir permis de battre Trump en 2020. Pourtant, il ne faut pas supposer que Trump annulera les élections de mi-mandat ou déclarera la loi martiale pour éviter ce règlement de comptes. Comme ils l'ont montré entre 2021 et 2024, les démocrates sont parfaitement capables de ne pas demander des comptes à Trump et à ses sbires. « L'échec du ministère de la Justice de Biden à poursuivre Trump pour son instigation à l'émeute du Capitole du 6 janvier 2021 est le dernier exemple de l'histoire du procureur général Merrick Garland, qui s'est toujours montré indulgent envers les crimes des puissants », affirme l'auteure Sarah Kendzior dans sa newsletter du 16 novembre 2023 (« Servants of the Mafia State »).
C'est dans ce contexte qu'il faut replacer la tournée « Fighting Oligarchy » menée par le sénateur du Vermont Bernie Sanders et la députée new-yorkaise Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), qui a attiré des foules immenses dans des régions favorables aux démocrates comme Denver et Los Angeles, mais aussi dans des salles combles dans des endroits plus conservateurs comme Nampa, dans l'Idaho. Cette tournée a également pris soin de passer par des régions où les démocrates pensent avoir de bonnes chances de battre les républicains sortants à la Chambre des représentants.
Au début de l'administration Trump, alors que la plupart des démocrates de l'establishment traitaient Trump comme un colosse politique et disaient à leurs partisans qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose pour l'arrêter, la tournée de Sanders et AOC a aidé les membres de la base du camp libéral (progressiste) de la politique américaine à sortir de leur sentiment d'isolement et de désespoir. Mais Sanders et AOC sont engagés dans un projet que le révérend Jesse Jackson [militant des droits civiques et candidat aux primaires démocrates en 1984 et 1988] appelait « garder l'espoir vivant » au sein du Parti démocrate.
« Non, nous n'essayons pas de créer un troisième parti », a déclaré Sanders à l'émission Meet the Press de NBC. « Ce que nous essayons de faire, c'est de renforcer la démocratie américaine, où la confiance dans les partis démocrate et républicain est actuellement extrêmement faible. […] Ce qui manque aux démocrates aujourd'hui, c'est une vision pour l'avenir. Comment allons-nous offrir un niveau de vie décent à une jeune génération qui, toutes choses égales par ailleurs, sera plus pauvre que ses parents ? »
Ocasio-Cortez est également très claire quant à ses efforts pour réformer le Parti démocrate, approche qu'elle incorpore dans ses discours de campagne lors de ses déplacements : « Nous avons besoin d'un Parti démocrate qui se batte aussi plus fermement pour nous. Cela signifie que les communautés doivent choisir et voter pour des démocrates et des élus qui savent défendre la classe ouvrière […] Nous devons nous unir et consacrer chaque jour de l'année à sensibiliser nos voisins, à aller à leur rencontre afin de chasser ces républicains et de les remplacer par des démocrates combatifs. » (Left Voice, 13 avril 2025)
En théorie, les démocrates pourraient défendre des politiques plus progressistes sans perdre le soutien des entreprises. Des partis similaires dans d'autres pays, comme les libéraux au Canada, soutiennent par exemple l'assurance maladie publique pour tous. Mais l'establishment libéral aux Etats-Unis est soumis à des limites que l'establishment conservateur ne connaît pas.
Sanders et AOC, et leurs porte-parole idéologiques comme le magazine socialiste réformiste Jacobin, pensent pouvoir convaincre les démocrates – ou une partie importante d'entre eux – de soutenir des politiques, des politiciens et une orientation sociaux-démocrates. Mais le Parti démocrate états-unien moderne est une entreprise multimilliardaire dont les grands donateurs soutiennent le capitalisme entrepreneurial.
Ainsi, même lorsque les politiciens démocrates parviennent à rassembler suffisamment de voix au parlement pour soutenir, par exemple, un système de santé à payeur unique [le gouvernement et non les assurances privés doivent assurer les coûts des soins], le courant dominant du parti veille à ce que ces réformes ne soient pas adoptées. Voir les exemples de Californie (2022) ou du Vermont, par exemple. Le fait de maintenir le système d'assurance maladie le complexe hospitalier sous le « grand chapiteau » des démocrates limite ce que ceux-ci peuvent accomplir.
La politique de droite, en revanche, n'est pas soumise aux mêmes contraintes. Même si les dirigeants du monde des affaires et la plupart des riches trouvent Trump et les partisans de MAGA – comme la députée Marjorie Taylor Greene (républicaine de Géorgie – peu recommandables, ils savent qu'en se pliant à leur politique d'extrême droite, ils ont la possibilité d'obtenir les mesures qui leur tiennent vraiment à cœur : réductions d'impôts, déréglementation [entre autres du système bancaire et financer], affaiblissement du contrôle des entreprises et subventions à l'industrie.
Imaginons le scénario suivant. Les démocrates remportent une victoire historique et le Congrès américain en 2026. Ils contrôlent désormais une branche clé du gouvernement. Que feront-ils ?
Abrogeront-ils les réductions d'impôts accordées par Trump aux riches, financeront-ils la réembauche des fonctionnaires fédéraux [écartés par le DOGE de Musk] et le rétablissement de programmes essentiels, ou encore supprimeront-ils les budgets liés aux initiatives de Trump ? Vont-ils destituer Trump et les membres de son cabinet qui ont enfreint la loi ? Vont-ils adopter des réformes du droit de vote et des droits civils et civiques ? Compte tenu de leur tendance à vouloir rétablir le statu quo, la réponse à toutes ces questions est « non ». On peut déjà presque entendre les excuses. Pas étonnant que même les partisans du Parti démocrate déclarent aux sondeurs qu'ils ne savent pas vraiment ce que défend leur propre parti.
Ceux et celles d'entre nous (de la gauche dite radicale) doivent tenir compte de la faiblesse historique des forces d'opposition de notre camp. Il est positif que la grande majorité s'oppose à l'action de Trump et que des centaines de milliers de personnes aient manifesté contre les mesures prises par son administration. Mais les organisations telles que les syndicats sont au plus bas depuis des décennies et les organisations non gouvernementales proches du Parti démocrate, comme Indivisible [créée en 2016 et dont le mot d'ordre est « We fight on, together »], captent une grande partie de la « résistance » à Trump.
***
Les quatre vecteurs d'opposition à Trump peuvent être résumés ainsi :
. Les manifestations « Tesla Takedown » contre Elon Musk, l'homme de main de Trump ;
. Les manifestations « de masse » organisées par des organisations telles que Indivisible et 50501 (50 protests, 50 states, 1 movement, initié en janvier 2025) ;
. La défense locale des droits des immigré·e·s sous le slogan « Connaissez vos droits » ;
. La résistance des syndicats et de la classe ouvrière ;
L'examen de chacun d'entre eux nous permet de dresser un bilan de la résistance à Trump 2.0 jusqu'à présent.
Tesla Takedown. Il s'agit d'une véritable initiative populaire lancée par quelques individus qui se sont rassemblés avec des pancartes contre Musk dans une station de recharge Tesla à Waterville, dans le Maine, début février. La militante en ligne Joan Donovan a amplifié leurs efforts avec le hashtag #TeslaTakedown sur la plateforme Bluesky, et quelques jours plus tard, le documentariste Alex Winter a créé un site web où les groupes locaux pouvaient annoncer leurs propres manifestations anti-Tesla. Depuis, des centaines de manifestations ont eu lieu devant les concessionnaires Tesla, les stations de recharge et les garages.
Tesla Takedown a la particularité d'être la première initiative majeure visant à rassembler l'opposition à la politique destructrice de Trump et Musk. Et son travail pour dénoncer le faux populisme de l'administration Trump en mettant en avant un « tech bro » (terme d'argot désignant un programmeur stéréotypé masculin) et un oligarque fasciné par le nazisme est indéniable. Tesla Takedown pourrait revendiquer une partie du mérite pour le retrait de Musk de la scène publique et les indications selon lesquelles le conseil d'administration de Tesla envisageait de le licencier. Mais à part produire une pression médiatique, on ne voit pas très bien quelle pression supplémentaire le mouvement Tesla Takedown pourrait exercer sur Trump et Musk.
Les ventes de Tesla étaient déjà en baisse avant que le DOGE (Department of Government Efficiency, département de l'efficacité gouvernementale) de Musk ne commence son raid au sein du gouvernement fédéral. Les ventes de Tesla à l'étranger s'effondrent et le cours de son action, source d'une grande partie de la fortune de Musk, devait être corrigé à la baisse car il s'agit de l'une des actions les plus surévaluées cotées en bourse. Il est possible que les protestations contre Tesla s'apaisent à mesure que Musk exercera son influence loin des projecteurs médiatiques. Avec ses activités dans le domaine des satellites Starlink et des fusées SpaceX, soutenues par des contrats de plusieurs milliards de dollars avec le gouvernement américain, Musk continue d'exercer une influence supérieure à celle de certains États souverains.
Journées d'action. Selon certaines estimations, le nombre de manifestations anti-Trump et le nombre de personnes mobilisées dépassent ceux des premiers jours de 2017, lorsque de grandes mobilisations telles que les marches des femmes avaient marqué l'imagination du public. Ces manifestations ont été organisées par un large éventail de groupes, mais les principaux organisateurs sont des organisations non gouvernementales (ONG) telles que Indivisible et 50501, un projet du groupe de lobbying libéral MoveOn. La participation aux rassemblements « Hands Off » (Ne touchez pas) organisés le 5 avril dans les mairies et les Capitols [bâtiments des législatifs] des Etats d'un bout à l'autre des Etats-Unis a été impressionnante. Les organisateurs cherchent à reproduire (ou à dépasser) les rassemblements « Hands Off » le 14 juin, date à laquelle ils se mobilisent sur le thème « No Kings ».
Deux anciens membres du personnel du Congrès démocrate ont fondé Indivisible en 2016 avec l'intention de mobiliser la pression populaire sur le Congrès contre les initiatives de Trump, en particulier sa tentative ratée d'abroger l'Affordable Care Act [Obamacare]. 50501 est né d'un forum Reddit [site web communautaire] au début de l'année 2025. Bien qu'il compte de nombreuses filiales locales, Indivisible est davantage ancré dans le monde des ONG professionnelles de Washington, avec une équipe d'experts des médias et de la recherche, et un comité d'action politique qui « canalise l'énergie populaire pour faire élire des candidats progressistes ».
50501 est une organisation plus décentralisée qui organise des manifestations par le biais d'appels à l'action en ligne. Sa culture politique reflète la dernière décennie d'organisation de la « génération Z » (les personnes nées après 1996), qui met l'accent sur « l'entraide » et l'organisation « sans leader ». L'un de ses principaux constituants est Political Revolution, un comité d'action politique formé par d'anciens organisateurs de la campagne de Bernie Sanders en 2016 pour soutenir des candidats progressistes, principalement au sein et autour du Parti démocrate. Indivisible s'inscrit plus naturellement dans la politique libérale conventionnelle. Par exemple, l'un de ses slogans du 5 avril était « Hands Off NATO ! » (Ne touchez pas à l'OTAN !), mais il n'y avait pas de « Hands Off Palestine ! » (Ne touchez pas à la Palestine !). 50501 affiche un profil plus radical, qualifiant Trump de « criminel » et de « traître » et dénonçant les ploutocrates milliardaires et le « fascisme ». Néanmoins, 50501 collabore avec Indivisible et a invité les dirigeants d'Indivisible à ses conférences Zoom nationales.
« Connaissez vos droits ». Certaines des formes d'opposition les plus efficaces au programme de Trump sont venues de groupes locaux de défense des droits des immigré·e·s et de groupes communautaires qui ont empêché les rafles organisées par le Department of Homeland Security (DHS) et mises en œuvre par l'Immigration and Customs Enforcement (ICE) contre les immigrés. Ces groupes ont été si efficaces pour informer les immigrés de leurs droits que le « tsar des frontières » de Trump, Tom Homan, les a dénoncés. Dans certaines circonstances, des groupes communautaires se sont organisés pour faire pression sur l'ICE, les tribunaux et les forces de l'ordre locales afin d'obtenir la libération de personnes arrêtées par le DHS, comme Mohsen Mahdawi [militant palestinien, étudiant à la Columbia University] et Rühmeysa Oztürk. [de nationalité turque, étudiante à Tufts University, un juge du Vermont a ordonné sa libération]. Une manifestation dans une petite ville de l'Etat de New York où Homan possède une maison de vacances a permis de libérer une famille victime d'une rafle de l'ICE. Il existe des dizaines d'histoires comme celle-ci qui montrent que la protestation peut fonctionner et que ni les immigrés ni leurs défenseurs n'ont à se soumettre à la police d'immigration brutale de Trump.
Cependant, il ne faut pas oublier que l'administration Trump a déjà commis des actes odieux, notamment l'expulsion de centaines d'immigrés vers des goulags au Salvador et à Guantanamo Bay, à Cuba. Et le budget qu'elle fait passer au Congrès prévoit une augmentation de plusieurs milliards de dollars pour « intensifier » à l'échelle industrielle les arrestations et les expulsions d'immigrants.
Résistance des syndicats et des travailleurs. Il n'est pas surprenant qu'une administration remplie de milliardaires de droite et anti-syndicats s'en prenne aux droits des travailleurs et des syndicats. Les actions de l'administration montrent à quel point il est superficiel de prétendre que le Parti républicain est devenu un parti de la « classe ouvrière ». L'attaque de l'administration Trump contre les fonctionnaires fédéraux, avec des licenciements massifs illégaux et la résiliation des contrats de près d'un million de travailleurs, est plus grave que la répression de la grève des contrôleurs aériens de la PATCO par Ronald Reagan en 1981.
Le mieux que l'on puisse dire de la réponse des syndicats, c'est qu'il y en a une. Des syndicats de premier plan comme le Service Employees (SEIU) et les syndicats nationaux d'enseignants, ainsi que l'AFL-CIO, ont approuvé des manifestations telles que « Hands Off ». Sean McGarvey, président du North American Building Trades Union, habituellement conservateur, a appelé au rapatriement depuis le Salvador de Kilmar Abrego Garcia, un apprenti dans le bâtiment dans le Maryland, qui a été kidnappé illégalement.
Mais des décennies de compromissions et de faiblesse politique au sein du mouvement syndical reviennent aujourd'hui le hanter. Pendant des décennies, les syndicats fédéraux qui sont actuellement démantelés sont restés inactifs et dépendants du lobbying à Washington. Les efforts d'organisations relativement nouvelles comme le Federal Unionists Network sont importants, mais ils partent d'une position extrêmement faible. La plupart des responsables syndicaux espèrent que leurs poursuites judiciaires contre les mesures antisyndicales de Trump aboutiront. Mais ils n'ont aucune stratégie fondée sur une quelconque organisation sur le lieu de travail si les tribunaux ne se prononcent pas en leur faveur.
Si l'on se tourne vers le secteur privé, où les syndicats ne représentent qu'environ 6% des travailleurs et travailleuses, on peut voir les fruits amers de plusieurs années de recul politique. Le président pro-Trump du syndicat des Teamsters (IBT), Sean O'Brien, a légitimé une alliance syndicale avec l'extrême droite. En conséquence, O'Brien et l'IBT n'ont pas fait grand-chose depuis qu'UPS [société de logistique] a annoncé 20 000 licenciements en réponse aux droits de douane prévus par Trump. Le syndicat United Autoworkers (UAW), dont la grève « stand-up » de 2023 a inspiré des millions de personnes, a soutenu les droits de douane prévus par Trump, même s'il n'y a aucune preuve que le commerce déloyal soit la cause du déclin du syndicat. Le président de l'UAW, Shawn Fain, a aligné le syndicat sur les droits de douane de Trump, sans voir « les véritables menaces qui pèsent sur les travailleurs de l'automobile et le rôle que le syndicat peut jouer pour y résister », comme l'a récemment écrit Andy Sernatinger. [militant syndical du Wisconsin, article publié sur le site Tempest le 30 avril].
Toute résistance authentique au programme de Trump doit être saluée et renforcée. Mais nous devons également « ne pas mentir » et « ne pas revendiquer de victoires faciles », comme l'a déclaré le révolutionnaire guinéen-bissau Amilcar Cabral dans les années 1960. L'opposition à Trump est actuellement faible.
Les organisations de protestation de masse fonctionnent encore largement selon la perspective qu'elles avaient mise en œuvre en 2017-2018. C'est-à-dire protester maintenant et faire pression pour obtenir une Chambre des représentants ou un Congrès dirigé par le Parti démocrate en 2026. Nous avons plus haut souligné les lacunes de cette perspective, qui n'a pas empêché le retour de Trump à la Maison Blanche. Cette orientation a également mis en sommeil – sous le mandat de Biden – de nombreuses organisations de « résistance » surgie lors du premier mandat Trump 1.0.
L'organisation populaire sur les lieux de travail et dans les communautés a été efficace dans certaines circonstances limitées. Mais les syndicats et les organisations communautaires sont-ils prêts à faire face à une augmentation quantitative ou qualitative des déchaînements et de la répression trumpiens ? Pour l'instant, cela ne semble pas être le cas.
Cependant, au printemps 2025, la société états-unienne s'oppose à ce que fait Trump. Et, si l'histoire peut nous donner une indication, les gens ordinaires sont capables de se mobiliser à tout moment. Personne n'avait prédit, et encore moins prévu, l'énorme vague d'actions antiracistes qui a eu lieu au plus fort de la pandémie de Covid après le meurtre de George Floyd en 2020. Nous aurons besoin de cela, et bien plus encore, pour vaincre Trump et la menace autoritaire qu'il représente. (Article reçu le 15 mai, traduction rédaction A l'Encontre)
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

En 100 jours, Trump a lancé une « attaque tous azimuts » contre l’environnement

Comparée à son premier mandat, la menace que représente une seconde administration Trump atteint un « nouveau niveau », selon des groupes environnementaux et des experts juridiques. Cent jours après le début du second mandat de Donald Trump, les pires craintes des environnementalistes se sont réalisées — et même dépassées.
5 mai 2025 | tiré d'Inside Climate News | Photo : Des militant·e·s pour la justice environnementale brandissent des pancartes lors d'une manifestation après que le sénateur Edward Markey (démocrate du Massachusetts) se soit vu refuser l'entrée au siège de l'EPA, le 6 février à Washington, D.C. Crédit : Al Drago/Getty Images
Auteurs et autrices : Kiley Bense, Bob Berwyn, Dennis Pillion, Georgina Gustin, Jake Bolster, Marianne Lavelle et Wyatt Myskow
Face à une avalanche de décrets, d'annonces et de mesures visant les ressources naturelles les plus précieuses du pays et ses communautés les plus vulnérables, les défenseurs de l'environnement redoutent que l'agenda Trump, s'il n'est pas freiné, ne fasse régresser les États-Unis de plusieurs décennies.
« Ce n'est pas une exagération de dire que l'administration Trump a lancé l'attaque la plus grave de l'histoire de la Maison-Blanche contre l'environnement et la santé publique. Jour après jour, heure après heure, elle détruit l'un des acquis majeurs de notre époque », a déclaré Manish Bapna, président-directeur général du Natural Resources Defense Council (NRDC), une ONG environnementale. « Si cette offensive réussit, il faudra une génération, voire plus, pour réparer les dégâts. »
Le sénateur démocrate Sheldon Whitehouse, membre de la commission sénatoriale de l'environnement et des travaux publics, a déclaré à Inside Climate News que l'« offensive corrompue » du président contre l'air pur, l'eau potable et l'énergie propre abordable faisait de lui « le président le plus impopulaire de l'histoire après 100 jours de mandat ». Un sondage Washington Post-ABC News-Ipsos indique que Trump n'obtient que 39 % d'approbation, un score inférieur à celui de n'importe quel autre président à ce stade depuis que de tels sondages existent.
« Le gouvernement mafieux de Trump, financé par les énergies fossiles, privilégie l'illégalité et le mépris de la Constitution plutôt que la baisse des coûts de l'énergie pour les ménages, la croissance économique ou la réduction de la pollution », a ajouté Whitehouse. « Les Américains le savent : leur situation s'est empirée, et cela ne fera qu'empirer. »
Deux visions opposées : la communication officielle versus la réalité
Un communiqué de presse publié par la Maison-Blanche pour le Jour de la Terre peignait pourtant un tableau radicalement différent. Intitulé « En ce Jour de la Terre, nous avons enfin un président qui suit la science », le texte vantait les actions de Trump sur l'environnement, comme « promouvoir l'innovation énergétique pour un avenir plus sain » (capture carbone et nucléaire), « réduire les réglementations inutiles » (notamment sur les émissions des centrales à charbon), « protéger la faune » (en suspendant l'éolien en mer), ou encore « protéger les terres publiques » (en les ouvrant à l'exploitation pétrolière, gazière et minière tout en assurant une gestion responsable).
Interrogée, la Maison-Blanche n'a pas répondu directement aux critiques sur son bilan environnemental, mais a réaffirmé sa volonté de « protection » en reprenant les slogans de campagne du président.
« Comme le président l'a dit, les Américains méritent un air pur et une eau propre », a déclaré la porte-parole Taylor Rogers. « En moins de 100 jours, le directeur de l'EPA, [Lee] Zeldin, a déjà pris des mesures pour éliminer les toxines, fournir des terres saines aux Américains et utiliser des politiques de bon sens pour alimenter le grand retour américain. »
Pour les experts, ce discours officiel est révélateur d'une stratégie de désinformation. « C'est une véritable masterclass de double langage », a commenté Hannah Perls, avocate au Harvard Environmental and Energy Law Program.
Loin de promouvoir « un avenir plus sain », l'administration a supprimé des agences et abrogé des règles destinées à réduire la pollution et améliorer la santé publique. Au lieu d'« innover », Trump a soutenu le charbon et annulé des projets d'énergie renouvelable. Plutôt que de « protéger les terres publiques », il a licencié des milliers d'agents des parcs et forêts, menacé la Loi sur les espèces menacées et favorisé l'exploitation minière et forestière. Et au lieu de « suivre la science », il a coupé des financements cruciaux et ignoré les experts du climat.
Son administration nie à nouveau le changement climatique, se retire de l'Accord de Paris et a écarté les scientifiques du principal rapport national sur le climat.
Une attaque d'une ampleur inédite
« On s'attend toujours à des revirements politiques d'une administration à l'autre, qu'elle soit démocrate ou républicaine », explique Perls. Mais traditionnellement, ces changements se faisaient au scalpel, au cas par cas.
« Cette fois, ils utilisent de la dynamite », dit-elle.
Un feu vert pour polluer
« Les moins de 50 ans n'ont pas connu à quel point l'air était sale avant la Loi sur l'air pur de 1970 », rappelle David Hawkins, avocat au NRDC. Il décrit le New York des années 1960, ses appuis de fenêtre couverts de suie, la fumée noire des incinérateurs et le plomb dégagé par les véhicules.
Il a vu les réglementations améliorer la qualité de l'air, réduire les maladies respiratoires et les morts prématurées, tout en apportant d'énormes bénéfices économiques.
« Mais rien n'est acquis », dit-il. L'administration Trump veut abroger ces protections, via une disposition de "péremption automatique" des règlements, qui pourrait dispenser les pollueurs d'obligations légales.
Les avocats spécialisés jugent cette disposition illégale, mais elle n'est qu'un exemple parmi d'autres. Le plan de Trump pour l'EPA prévoit une réduction de 65 % du budget, ramenant l'agence à ses niveaux les plus bas depuis sa création, en 1970.
Perls craint la perte d'expertise à l'EPA et le message envoyé aux industries : « Elles vont voir ça comme un feu vert pour polluer sans retenue. »
Justice environnementale attaquée
« L'administration a clairement indiqué pour qui elle travaille : les grandes industries polluantes. Et elle impose aux communautés le fardeau de cette pollution », résume Geoff Gisler, du Southern Environmental Law Center (SELC), qui poursuit le gouvernement fédéral pour avoir gelé illégalement des subventions.
« On assiste à un mépris total des processus légaux », dit-il. « Déjà présent lors du premier mandat, mais cette fois, on change d'échelle. »
Les coupes à l'EPA, combinées à une note de service de mars excluant la race et le statut socio-économique dans les enquêtes, auront des effets graves. « Des gens mourront », affirme Perls. « Peut-être pas demain, ni dans six mois, mais cela arrivera. »
Les groupes de justice environnementale sont paralysés : subventions gelées pour des projets locaux, suppression d'outils comme EJ Screen, fermeture de bureaux dédiés.
« Créer le chaos, c'était le but », selon Patrick Drupp (Sierra Club). « Les petites associations ou les projets solaires communautaires ne peuvent pas attendre huit mois un jugement. »
Un sabotage général
Les attaques ne visent pas seulement l'EPA. Le Département de la sécurité intérieure a mis fin à toute activité liée au climat. La FEMA a supprimé les programmes de résilience aux catastrophes.
Le Département de la santé (HHS) a licencié les équipes gérant les aides au chauffage pour les familles pauvres, les logements énergétiques, ou la prévention de maladies environnementales comme l'asthme.
En février, la ministre de la Justice Pam Bondi a fermé tous les bureaux liés à la justice environnementale.
« S'en prendre à la justice environnementale, c'est s'en prendre à des millions d'Américains qui dépendent d'un air pur et d'une eau potable », a dénoncé le sénateur Ron Wyden.
Détruire l'État administratif
Trump prétend revenir à une approche « de base » : l'air et l'eau plutôt que le climat. Mais ses exemples — comme le nettoyage de déchets toxiques en Californie ou la lutte contre les produits chimiques PFAS — sont sujets à caution. Il est resté silencieux sur l'opposition aux réglementations PFAS et a précipité l'approbation de plans étatiques douteux.
Même les opérations saluées, comme la réponse aux incendies en Californie, ont suscité des protestations, car des zones humides protégées ont été utilisées comme dépôt de déchets toxiques.
Sous couvert d'éliminer le gaspillage, la Department of Government Efficiency (DOGE), dirigée par le donateur Elon Musk, orchestre cette offensive. Mais pour les experts, l'objectif est clair : saboter l'État administratif lui-même.
« Si vous voulez soigner un cancer, vous enlevez la tumeur, pas le patient », conclut Perls. « Ici, ils ne cherchent pas à guérir. Ils veulent tuer. »
Licenciements massifs, lieux protégés désanctuarisés et Musk
Depuis son retour à la présidence, Trump a profondément restructuré les agences fédérales chargées de gérer les terres publiques de l'Ouest américain, au détriment potentiel de ces paysages, de la faune et des communautés qui en dépendent.
En février, le Service des parcs nationaux a licencié 1 000 employés, avant que deux juges de district fédéraux n'ordonnent leur réintégration, déstabilisant les parcs à travers le pays alors qu'ils se préparent à la saison la plus chargée de l'année. Trump a également réduit de 10 % les effectifs du Service forestier des États-Unis, et des milliers d'autres employés auraient accepté des offres de départ volontaire. Le gel des financements a bloqué des travaux de conservation essentiels.
Désormais, les employés de DOGE, supervisés par le milliardaire Elon Musk, ont pris les rênes du Département de l'Intérieur, où le secrétaire Doug Burgum a vanté l'idée de vendre des terres publiques pour répondre à la crise du logement. L'administration Trump a également émis des décrets visant à simplifier les procédures minières et à accélérer des projets hautement controversés.
« Les terres publiques fédérales appartiennent à tous les Américains, » a déclaré Mike Quigley, directeur de l'Arizona pour la Wilderness Society. « Elles sont gérées par le gouvernement fédéral en notre nom. Donc, si vous voulez ouvrir une mine sur des terres publiques, la période de commentaires et le processus NEPA (National Environmental Policy Act) existent pour que les propriétaires — vous, moi, votre voisin — puissent donner leur avis. Et quand j'entends parler de ‘simplification', je crains que cela ne soit un euphémisme pour dire ‘approbation automatique'. »
L'accélération des projets miniers et de forage pétrolier ou gazier pourrait menacer certaines des espèces et des paysages les plus emblématiques des États-Unis. « Nous avons certains des derniers habitats fauniques de qualité dans les 48 États contigus, » a déclaré Alec Underwood, directeur des programmes du Wyoming Outdoor Council, une ONG environnementale basée à Lander. « Ils sont irremplaçables. »
Les bouleversements en matière de personnel et de réglementation ont déjà des effets concrets. Les licenciements ont touché « des personnes réelles qui vivent dans nos communautés et travaillent sur les terres publiques, » selon Underwood. « Beaucoup d'entre eux sont désormais sans emploi. »
L'industrie pétrolière et gazière a salué les actions de Trump au cours des cent premiers jours. La Western Energy Alliance, une association de l'industrie basée au Colorado, a applaudi les « mesures décisives du président pour promouvoir le développement du pétrole et du gaz naturel. »
« Nous avons assisté à un changement radical, passant d'une administration qui imposait des politiques restrictives, limitait les autorisations et menaçait les projets énergétiques, à une autre qui soutient activement le développement, » a déclaré Kathleen Sgamma, présidente de l'alliance, dans un communiqué. Sgamma, qui s'était retirée de la course pour diriger le Bureau of Land Management après des questions sur sa loyauté envers Trump, a également salué les « actions agressives de déréglementation » de l'EPA.
Ailleurs dans l'Ouest, les communautés et les environnementalistes se préparent à la réduction ou à la suppression de monuments nationaux. En mars, l'administration Trump a annoncé l'élimination des monuments nationaux de Chuckwalla et des Highlands de Sáttítla en Californie, avant de supprimer cette annonce d'un document de la Maison Blanche. La semaine dernière, le Washington Post a rapporté que l'administration envisageait de réduire les monuments nationaux Baaj Nwaavjo I'tah Kukveni - Empreintes ancestrales du Grand Canyon, Ironwood Forest, Chuckwalla, Organ Mountains-Desert Peaks, Bears Ears et Grand Staircase-Escalante — et ce, malgré leur popularité quasi universelle auprès des électeurs.
Erik Schlenker-Goodrich, directeur exécutif du Western Environmental Law Center, estime que l'approche désordonnée de l'administration met le pays en danger.
« On se sent comme Bip Bip et Coyote, » dit-il. « On a couru au-delà du bord de la falaise proverbiale et on flotte dans le vide, sans rien en dessous de nous. Et c'est profondément périlleux. »
Il ajoute : « La gravité finira par agir, et beaucoup d'organisations comme la nôtre réfléchissent à la manière d'atténuer les effets de cette chute sur ce qui nous tient à cœur : les terres publiques, la faune de l'Ouest, les rivières sauvages. »
L'administration s'en est également prise aux programmes de conservation et de lutte contre le changement climatique du Département de l'Agriculture (USDA), laissant des dizaines de milliers d'agriculteurs sans l'aide financière et technique qu'ils attendaient.
Le décret « Unleashing American Energy » de Trump a immédiatement gelé des milliards de dollars destinés aux agriculteurs pour la mise en œuvre de pratiques climatiques ou de mesures d'efficacité énergétique sur leurs fermes, dans le cadre de la loi phare de Biden sur le climat, l'Inflation Reduction Act. Une partie de ces fonds a été débloquée depuis par la secrétaire à l'Agriculture Brooke Rollins, mais leur distribution reste incertaine.
Des poursuites judiciaires ont été engagées par des groupes de défense au nom des agriculteurs pour exiger la restitution de ces fonds. Une analyse d'anciens employés de l'USDA estime que près de 2 milliards de dollars sont dus à plus de 22 000 agriculteurs pour des programmes de conservation et d'efficacité énergétique.
Début mai, l'agence a annulé un programme de 3 milliards de dollars lancé sous Biden — le Partnership for Climate-Smart Commodities — en le rebaptisant Advancing Markets for Producers. Elle a précisé que seuls les projets répondant à de nouveaux critères seraient désormais financés.
De même, l'agence a annoncé qu'elle ne financerait les projets du Rural Energy for America Program que si les demandeurs modifiaient leur dossier de subvention pour « supprimer les éléments néfastes liés à la DEIA et au climat d'extrême gauche ». DEIA signifie Diversité, Équité, Inclusion et Accessibilité — un terme regroupant les efforts d'égalité des chances au travail et ailleurs.
L'agence, qui supervise également le Service forestier, a publié une « déclaration de situation d'urgence » pour ouvrir 110 millions d'acres aux intérêts de l'industrie forestière — une décision que les groupes écologistes estiment susceptible d'accélérer la destruction des forêts anciennes et d'accentuer leur vulnérabilité à la sécheresse et aux incendies. Ce mémo a été publié peu après un décret de Trump visant à augmenter la production de bois de 25 % à l'échelle nationale.
« Trump a montré son indifférence aux besoins des agriculteurs, notamment avec sa politique tarifaire erratique et dévastatrice, mais son administration les abandonne aussi sur la question du climat, » a déclaré Karen Perry Stillerman, responsable des programmes agroalimentaires à l'Union of Concerned Scientists.
PS : pour voir les liens de l'article voir l'article original :
https://insideclimatenews.org/news/30042025/trump-second-administration-first-100-days-assault-on-the-environment/
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Que signifie un pape américain pour l’Amérique ?

Le conclave des cardinaux a élu pour la première fois un pape américain, un homme qui a critiqué la politique du président Donald Trump et du vice-président J.D. Vance. Que signifie pour l'Amérique le choix de cet Américain à la tête de l'Église catholique ?
Hebdo L'Anticapitaliste - 754 (15/05/2025)
https://lanticapitaliste.org/actualite/international/que-signifie-un-pape-americain-pour-lamerique
L'Église catholique est une organisation énorme et influente. Il y a 1,4 milliard de catholiques dans le monde. Vingt pour cent des Américains sont catholiques, soit 73,2 millions d'entre eux. Les protestants sont plus nombreux en Amérique, mais ils sont divisés en de nombreuses églises, alors que l'Église catholique est la plus grande organisation religieuse des États-Unis. Alors qu'elle était majoritairement blanche, les immigrantEs du Mexique, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud ont modifié la composition ethnique de l'église. Aujourd'hui, 36 % des catholiques américains sont hispaniques, 54 % sont blancs, 4 % sont asiatiques et 2 % sont noirs. Et en 2024, Trump a remporté les suffrages de 54 % de tous les catholiques et de 61 % des catholiques blancs.
Sur les traces de François
Oui, l'Église catholique est une institution fondamentalement conservatrice, voire réactionnaire, patriarcale et sexiste, qui refuse aux femmes des rôles de direction ou même une voix dans les délibérations, et qui leur refuse le droit au divorce et à l'avortement. Il est vrai qu'elle n'a pas réussi à protéger les enfants des abus sexuels commis par des prêtres. Oui, historiquement, elle a été liée en de nombreux endroits, et en particulier en Amérique latine, à la classe dirigeante des propriétaires terriens et des capitalistes, ainsi qu'à l'État. Oui, pendant des siècles, elle a eu le caractère de « l'opium du peuple », une drogue pour les oppriméEs.
Pourtant, même cette institution conservatrice a produit des courants progressistes et même proches du socialisme, comme la théologie de la libération qui a été influente en Amérique latine dans les années 1960 et 1970. Théologie quasiment marxiste, elle a incité des millions de personnes en Amérique latine à la résistance, à la rébellion voire à la révolution. Horrifié, le pape réactionnaire Benoît XVI (2005-2013) a tenté de l'éradiquer, renvoyant des prêtres et des professeurs.
Le pape François, récemment décédé, était partisan d'une théologie du peuple mettant l'accent sur les travailleurEs et les pauvres, les migrantEs, mais aussi les marginaux et les oppriméEs tels que les LGBT. Il semblerait que le nouveau pape Léon XIV suivra les traces de François.
Un pape anti-Trump ?
Robert Francis Prevost, né à Chicago en 1955, est diplômé de l'université catholique de Villanova en Pennsylvanie, de la Catholic Theological Union à Chicago et de l'université pontificale Saint-Thomas d'Aquin à Rome. De 1985 à 1999, il a été missionnaire au Pérou, et de 2014 à 2023, il est retourné au Pérou et est devenu citoyen péruvien. Il a été chef de l'ordre des Augustins et a occupé des postes importants dans la hiérarchie catholique.
Prévost a choisi le nom de Léon XIV, se plaçant ainsi dans la tradition de Léon XIII, pape de 1878 à 1903, qui, dans son encyclique Rerum Novarum (des choses nouvelles), s'est penché sur « la misère et le malheur qui pèsent si injustement sur la majorité de la classe ouvrière ». Léon XIII, tout en s'opposant au socialisme et en défendant le capitalisme, a reconnu la nécessité et le droit des travailleurEs à organiser des syndicats, faisant ainsi passer l'Église du Moyen Âge au monde moderne.
Trump et Vance ont tous deux félicité Léon XIV d'être devenu pape et ont félicité l'Amérique de l'avoir produit. Mais qu'arrivera-t-il aux électeurs de Trump si le pape s'oppose aux politiques racistes et xénophobes du président ? Le nouveau pape sera-t-il en mesure de faire changer certains esprits ? Les partisans de Trump sont critiques. Laura Loomer, une activiste d'extrême droite qui influence Trump, a déclaré que le nouveau pape était « anti-Trump, anti-Maga, pro-ouverture des frontières et un marxiste total comme le pape François ». Et elle n'a pas vraiment tort. Bien qu'il ne soit évidemment pas marxiste, les messages de Prevost sur les médias sociaux avant son élection indiquent qu'il est pour la protection des immigréEs, pour la réduction de la violence armée et pour la lutte contre le changement climatique.
Donald Trump va maintenant devoir partager la scène mondiale avec un autre dirigeant américain puissant : le pape Léon XIV qui sera un opposant sur de nombreux sujets.
Dan La Botz, traduction Henri Wilno
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le conflit entre l’Inde et le Pakistan autour de l’eau illustre la vulnérabilité croissante de région face au changement climatique

Dans une décision sans précédent, l'Inde a récemment suspendu le traité sur les eaux de l'Indus de 1960 avec le Pakistan, invoquant le terrorisme transfrontalier. Cette décision s'inscrit dans une série d'escalades entre les deux pays, qui se trouvent désormais au bord de la guerre. [Voir sur l'escalade et la désescalade le dossier publié sur ce site le 10 mai. Le cessez-le-feu est loin d'avoir supprimé les tensions. Modi indique que le dispositif militaire mis en place le 7 mai est encore en place.]
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/05/14/appel-urgent-a-la-paix-lance-par-les-feministes-indiennes-et-pakistanaises-et-autre-texte/?jetpack_skip_subscription_popup
La suspension du traité sur les eaux de l'Indus reflète une tendance régionale grandissante : les pays d'Asie du Sud considèrent de plus en plus l'eau comme un atout stratégique plutôt que comme une ressource commune, dans un contexte de méfiance croissante, de stress climatique et de concurrence géopolitique.
La région abrite près d'un quart de la population mondiale et dépend d'énormes fleuves transfrontaliers alimentés par les glaciers de l'Himalaya. Cela constitue le « troisième pôle » (Hindu Kush-Karakoram-Himalayan system) de réserves d'eau douce. Une rupture de la diplomatie de l'eau pourrait entraîner un effondrement environnemental, des crises humanitaires et une instabilité géopolitique. L'utilisation de l'eau comme arme doit être traitée de toute urgence comme une question de justice climatique mondiale.
Un point de tension a été atteint en août 2024, lorsque des inondations dévastatrices ont touché près de 5,8 millions de personnes au Bangladesh. Certains responsables bangladais ont accusé l'Inde d'avoir libéré sans avertissement un excédent d'eau provenant d'un grand barrage en amont. L'Inde a nié toute responsabilité, invoquant des précipitations extrêmes et le fonctionnement normal du barrage. Néanmoins, cet incident a ravivé les tensions de longue date entre les deux pays.
Pour compliquer encore la situation, la Chine a récemment approuvé la construction du plus grand projet hydroélectrique au monde sur le fleuve Yarlung Tsangpo au Tibet, qui devient le Brahmaputra en Inde. Ce projet gigantesque a suscité l'inquiétude quant à la capacité de la Chine à exercer un contrôle en amont et aux risques écologiques pour l'Inde et le Bangladesh en aval.
La Chine n'a pas signé d'accords officiels de partage de l'eau avec ses voisins, mais sa présence croissante dans les infrastructures hydrauliques régionales annonce un changement radical dans la politique hydraulique de l'Asie du Sud et de l'Est.
Le changement climatique aggrave la situation
Les évolutions climatiques récentes font des fleuves transfrontaliers un sujet de friction géopolitique de plus en plus important. Ces évolutions incluent l'accélération de la fonte des glaciers, l'irrégularité des moussons et l'intensification des phénomènes météorologiques extrêmes.
Si la fonte des glaciers va temporairement augmenter le débit des fleuves, les prévisions à long terme sont sombres. Si les émissions [entre autres de CO2] et le réchauffement se poursuivent, de nombreux fleuves alimentés par des glaciers, notamment l'Indus, le Gange et le Brahmapoutre, pourraient voir leur débit considérablement réduit d'ici la fin du siècle. Cela affectera directement des centaines de millions de personnes qui en dépendent.
La crise est exacerbée par les changements qui touchent l'Himalaya. La région se réchauffe plus rapidement que la moyenne mondiale, avec un glissement des chutes de neige vers les précipitations qui perturbe le calendrier et le volume des eaux qui s'écoulent des montagnes vers les champs et les villes en contrebas.
Dans le même temps, l'extraction non durable des eaux souterraines a poussé les réserves d'eau phréatiques de l'Asie du Sud vers l'épuisement, menaçant à la fois la sécurité alimentaire et la sécurité hydrique.
Un dangereux précédent
L'effondrement ou la suspension du Traité des eaux de l'Indus pourrait créer un dangereux précédent. Il est important de noter que la menace ne réside pas tant dans le fait que l'Inde coupe l'approvisionnement en eau – une mesure peu probable et techniquement difficile à mettre en œuvre – que dans l'érosion de la confiance, de la transparence et du partage des données.
L'une des caractéristiques les plus précieuses du traité est le partage régulier de données sur des éléments tels que les niveaux d'eau, le débit des fleuves et le fonctionnement des barrages. Le Pakistan a besoin de ces données pour prévoir les inondations et les sécheresses, planifier son irrigation, produire efficacement de l'énergie hydroélectrique et gérer son eau potable, mais l'Inde indique qu'elle ne respectera plus ces obligations.
Cependant, les relations tendues de l'Inde en matière d'eau ne se limitent pas au Pakistan. Le Bangladesh et le Népal se sont souvent sentis mis à l'écart ou soumis à des pressions lors des négociations, et l'intention de l'Inde de reconsidérer des traités de longue date suscite des inquiétudes dans ces deux pays.
C'est particulièrement le cas à l'approche de l'expiration du traité sur les eaux du Gange en 2026 : le fleuve Gange, qui traverse l'Inde, irrigue une grande partie du Bangladesh, et le traité garantit à ce dernier un débit minimal.
D'autres accords clés, tels que le traité Mahakali [1996, entre l'Inde et le Népal] et l'accord sur le fleuve Kosi entre l'Inde et le Népal, ainsi que l'accord sur le partage des eaux de la Teesta entre l'Inde et le Bangladesh, restent largement non appliqués, ce qui alimente la méfiance. Ces échecs sapent la confiance dans la diplomatie régionale en matière d'eau et jettent le doute sur l'engagement de l'Inde en faveur d'une coopération équitable.
Cette situation n'est pas améliorée par le fait que l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh continuent tous à utiliser des méthodes d'irrigation obsolètes qui entraînent une consommation d'eau supérieure à leurs besoins. Alors que le changement climatique intensifie les inondations, les sécheresses et la fonte des glaciers, il est urgent de réformer les traités existants sur l'eau afin de les adapter aux réalités climatiques, hydrologiques et géopolitiques actuelles.
Le traité sur les eaux de l'Indus, négocié dans les années 1960, avant l'émergence de la science climatique moderne, ne tient pas compte de ces transformations. En effet, la plupart des traités sur l'eau dans la région restent ancrés dans des cadres technocratiques et centrés sur l'ingénierie, qui ne tiennent pas compte de l'extrême variabilité du climat et de ses effets en cascade.
L'expiration prochaine du traité sur les eaux du Gange et la négociation en cours d'autres accords sur les bassins constituent une occasion cruciale de repenser la gestion de l'eau en Asie du Sud.
Bien que l'Indus traverse l'Inde avant le Pakistan, dans d'autres bassins, l'Inde est en aval. C'est le cas du Brahmaputra, où elle exige une coopération en amont de la Chine.
Le fait de saper le traité de l'Indus pourrait affaiblir la position de l'Inde dans les négociations futures et tendre ses relations avec le Népal et le Bangladesh, tout en donnant à la Chine plus d'influence dans la politique hydrique de l'Asie du Sud. La Chine étend déjà son influence en accordant des milliards de dollars de prêts au Bangladesh et en renforçant ses liens avec le Népal, en particulier dans le domaine des infrastructures hydrauliques.
Utiliser l'eau comme arme est une stratégie périlleuse qui pourrait se retourner contre ses auteurs. L'affaiblissement de la diplomatie de l'eau en Asie du Sud n'est pas seulement une menace régionale ; il met en danger la sécurité climatique mondiale.
Face à l'aggravation des effets du changement climatique et à la répétition des catastrophes, la mise à jour des accords transfrontaliers tels que le traité sur les eaux de l'Indus, le traité sur les eaux du Gange et les accords sur le Kosi et la Teesta n'est plus une option, mais une nécessité urgente aux conséquences considérables.
Mehebub Sahana
Mehebub Sahana est chercheur en géographie auprès de l'Université de Manchester
Article publié sur le site The Conversation le 9 mai 2025 ; traduction rédaction A l'Encontre (cartes non reproduites)
https://alencontre.org/asie/bangladesh/le-conflit-entre-linde-et-le-pakistan-autour-de-leau-illustre-la-vulnerabilite-croissante-de-region-face-au-changement-climatique.html
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La Chine : une nouvelle puissance capitaliste impérialiste

China in Global Capitalism (d'Eli Friedman, Kevin Lin, Rosa Liu et Ashley Smith, chez Haymarket Books, 2024) est une excellente introduction à la Chine d'aujourd'hui. Il examine la nature de la société chinoise et les raisons du conflit grandissant entre la Chine et les Etats-Unis.
Tiré d'À l'encontre.
Le livre commence par affirmer (de manière convaincante, à mon avis) que « la Chine du XXIe siècle est capitaliste » [p. 11]. Les auteurs montrent que la poursuite du profit domine l'économie :
« Dans un large éventail de secteurs, il est clair que c'est la production de marchandises à des fins lucratives qui régit l'économie, et non la production pour les besoins humains…
»Les biens tels que la nourriture, le logement, l'éducation, les soins de santé, les transports et le temps libre et social ne sont pas fournis par le gouvernement. Au contraire, la grande majorité de la population chinoise doit vendre sa force de travail, c'est-à-dire sa capacité à travailler, à des entreprises privées ou publiques en échange d'un salaire afin de subvenir à ses besoins essentiels. » [p. 14]
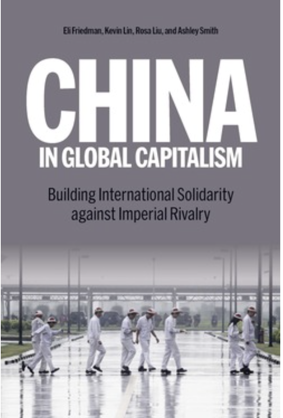
Il s'agit d'un changement majeur par rapport au système précédent :
« L'apparition d'un marché du travail capitaliste a été politiquement controversée à la fin des années 1970, car de nombreux membres du PCC [Parti communiste chinois] soutenaient encore le système maoïste de l'« emploi à vie » [sécurité de l'emploi], appelé « bol de riz en fer ». Bien que les salaires fussent dérisoires dans ce système, les travailleurs urbains de la plupart des entreprises avaient accès gratuitement ou presque gratuitement au logement, à l'éducation et aux soins de santé. Plus important encore, il était pratiquement impossible de licencier quelqu'un… Mais dans les années 1990, l'Etat avait clairement décidé que l'avenir appartenait aux marchés du travail capitalistes, comme l'a clairement indiqué la loi sur le travail de 1994, qui a établi un cadre juridique pour le travail salarié… Cependant, plutôt que d'instaurer un marché du travail hautement réglementé sur le modèle social-démocrate (comme le souhaitaient de nombreux réformateurs), le travail a été marchandisé et reste très informel. » [p. 15]
Les auteurs affirment que l'Etat chinois :
« gouverne dans l'intérêt général du capital… La nature capitaliste de l'Etat est très évidente dans la politique menée dans les entreprises. La Chine a connu une explosion de la contestation ouvrière au cours des trois dernières décennies ; le pays est le leader mondial des grèves sauvages. Comment l'Etat réagit-il lorsque les travailleurs recourent à la tradition ancestrale consistant à refuser de travailler pour le capital ? Sa police intervient presque exclusivement au nom des patrons contre les travailleurs et travailleuses, un service qu'elle rend aussi bien aux entreprises privées nationales qu'étrangères et publiques. Il existe d'innombrables exemples où la police ou des hommes de main à la solde de l'Etat ont recouru à la coercition pour briser une grève. » [p. 17]
Ils expliquent qu'il n'existe pas de véritables syndicats :
« Le seul syndicat légal est la Fédération des syndicats de toute la Chine (ACFTU-All-China Federation of Trade Unions), une organisation contrôlée par le PCC. Plutôt que de représenter les travailleurs et travailleuses et de défendre leurs intérêts, l'ACFTU assure la paix sociale pour les entreprises. Il n'est donc pas surprenant que les responsables des ressources humaines des entreprises soient systématiquement nommés à la tête du syndicat de leur entreprise. » [p. 18]
Les capitalistes ont été autorisés à adhérer au PCC et aux organes gouvernementaux :
« Lors de la session 1998-2003 de l'Assemblée populaire nationale (APN), les travailleurs ne représentaient que 1% des représentants, tandis que les entrepreneurs en constituaient 20,5%, un renversement complet par rapport aux années 1970. Aujourd'hui, l'APN et le Conseil consultatif politique du peuple chinois présentent une concentration étonnante de ploutocrates. En 2018, les 153 membres les plus riches de ces deux organes du gouvernement central disposaient d'une fortune combinée estimée à 650 milliards de dollars. » [p. 19]
Comme aux Etats-Unis, il existe un « pantouflage » entre les entreprises et les institutions publiques. [p. 19]
Le secteur public relativement fort de l'économie chinoise est parfois cité comme preuve que la Chine n'est pas capitaliste. Cependant, les auteurs soulignent qu'avant l'ère néolibérale, les entreprises publiques étaient courantes dans les pays capitalistes. De plus, le secteur public chinois a été considérablement réduit :
« Des dizaines de millions de travailleurs du secteur public ont été licenciés dans les années 1990 et au début des années 2000 dans le cadre de la campagne menée par l'Etat pour « briser le bol de riz en fer ». En projetant les travailleurs sur un marché du travail pour lequel ils n'étaient absolument pas préparés, cette campagne de privatisation a engendré des crises de subsistance et une lutte des classes massive. A la suite de cette vague de ventes et de détournements des retraites des travailleurs, les entreprises publiques restantes ont été soumises aux contraintes du marché, y compris dans leurs régimes de travail. » [p. 21]
Cela inclut le recours généralisé aux travailleurs temporaires.
Une « puissance impériale »
Les auteurs affirment que la Chine est devenue « une nouvelle puissance impériale » :
« Elle se bat pour sa part du marché mondial, conforte le sous-développement du Sud et conclut des accords pour s'assurer des ressources partout dans le monde. L'intégration de la Chine dans le capitalisme mondial a généré à la fois une collaboration et une concurrence entre elle et les Etats-Unis ainsi que les autres puissances impérialistes. » [p. 27]
L'économie chinoise a connu une croissance rapide :
« L'économie chinoise est passée de seulement 6% du PIB états-unien en 1990 à 80% de ce PIB en 2012. Les transnationales ont stimulé cet essor. Mais la Chine a exigé des entreprises étrangères de haute technologie et à forte intensité capitalistique qu'elles transfèrent leur technologie aux entreprises publiques et privées locales. Ainsi, l'Etat chinois a soutenu le développement du capital indigène et lui a permis d'être compétitif au sein du système mondial. » [p. 32]
Les auteurs affirment que la Chine a contribué au sous-développement persistant des pays du Sud :
« En Amérique latine, ses exportations bon marché ont sapé les industries de la région et réduit les pays à exporter des matières premières vers la Chine, ce qui constitue le piège classique de la dépendance. » [p. 34]
La Chine a également augmenté ses dépenses militaires à hauteur de 293,35 milliards de dollars en 2021, ce qui la place au deuxième rang mondial derrière les Etats-Unis. [p. 41]
« Elle a également mené un programme agressif d'établissement de bases militaires sur les îles qu'elle revendique en mer de Chine méridionale et a revendiqué des territoires à divers Etats en mer de Chine orientale…
»Cette projection de puissance en mer de Chine méridionale et orientale a mis la Chine en conflit avec plusieurs Etats asiatiques, tels que le Japon, les Philippines, Brunei, Taïwan, le Vietnam, l'Indonésie et la Malaisie. » [p. 42]
Les auteurs notent que,
« malgré son essor, la Chine reste dépendante des pays capitalistes avancés, en particulier des Etats-Unis. Elle a besoin d'eux pour ses marchés et ses intrants, en particulier les microprocesseurs avancés qu'elle n'est pas encore en mesure de fabriquer elle-même. » [p. 43]
Je suis d'accord pour dire que la Chine agit de plus en plus comme une puissance impérialiste. Mais la situation est complexe : la classe ouvrière chinoise est toujours surexploitée par le capital étranger, ce qui est généralement le signe d'un pays semi-colonial.
Résistance
La croissance économique rapide de la Chine est parfois qualifiée de « miracle ». Mais les auteurs affirment que
« la croissance de la Chine repose sur l'exploitation de la classe ouvrière, le travail reproductif non rémunéré, en particulier celui des femmes, et la spoliation des terres, des ressources naturelles et des biens collectifs. Ces formes d'exploitation et de spoliation profitent non seulement aux élites chinoises, mais ont également contribué à assurer la rentabilité du capitalisme au niveau international, enrichissant ainsi les entreprises et les investisseurs des pays riches d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie. » [p. 47]
Il y a également eu une résistance à l'oppression et à l'exploitation :
« Les paysans ont toujours lutté contre les pratiques corrompues et antidémocratiques de confiscation des terres et de marchandisation. Leurs homologues urbains ont fait de même. Les populations se sont organisées contre la destruction de quartiers entiers à la demande de promoteurs immobiliers avides de terrains et de leurs alliés au sein des municipalités. Dans les années 1990, les travailleurs se sont mobilisés contre le vol des biens publics lors de la privatisation des entreprises publiques… Les travailleurs migrants issus des campagnes ont pris le relais de la résistance dans les usines et dans le secteur des services en pleine expansion…
»Les troubles sociaux se sont considérablement amplifiés au cours des années 1990 et 2000. Les « incidents de masse », comme le gouvernement appelle les actions collectives de plus de vingt-cinq travailleurs et paysans, ont atteint le nombre de 87 000 en 2005, année où le gouvernement a cessé de communiquer ces données… [Voir à ce sujet le site China Labour Bulletin – réd.]
»Même sans organisation formelle, ces luttes ont arraché des victoires symboliques, juridiques et matérielles importantes à l'Etat et au capital. » [p. 47-48]
De nombreuses grèves ont obtenu des augmentations de salaire ou de meilleures conditions de travail. Mais les troubles ont également contraint le gouvernement à modifier certaines de ses politiques.
La résistance à la privatisation des entreprises publiques en est un exemple :
« Les travailleurs ont résisté à ces réformes du marché par une vague de luttes. De la fin des années 1990 à la fin des années 2000, ils ont organisé des manifestations et des grèves contre les licenciements, le vol des retraites et la privatisation. L'exemple le plus célèbre est peut-être le mouvement de Liaoyang en 2002, où des dizaines de milliers de travailleurs et travailleuses des entreprises publiques se sont soulevés contre la fermeture d'usines, menaçant la stabilité sociale. De nombreuses autres manifestations ont eu recours à des tactiques radicales telles que le blocage des routes et des voies ferrées. En 2009, les travailleurs du groupe Tonghua Iron and Steel, dans la province de Jilin [nord-est], ont capturé et battu à mort un dirigeant d'une entreprise privée qui menait une campagne de privatisation. L'Etat a réagi par la répression, arrêtant et condamnant les leaders à de longues peines de prison. Les travailleurs qui ont perdu leur emploi se sont retrouvés sur le marché du travail privé sans grand espoir de trouver un travail décent. Néanmoins, leur résistance farouche a contribué à la décision de Hu Jintao [président de 2003 à 2013] de renoncer à la poursuite de la privatisation de l'industrie d'Etat. » [p. 55]
Un autre exemple est la lutte des travailleurs migrants :
« Les travailleurs et travailleuses migrants issus des campagnes sont des travailleurs de seconde classe dans le régime de citoyenneté interne stratifié. Ils sont exclus des services sociaux dans leurs villes d'adoption parce que leur enregistrement officiel, leur hukou, est lié à leur village d'origine. D'un côté, leur accès aux prestations sociales dans leur village leur offre une certaine protection en période de chômage. Mais d'un autre côté, leur statut précaire dans les villes en fait une main-d'œuvre extrêmement exploitable pour les industries chinoises et transnationales…
»Ces travailleurs ont répondu à leur exploitation par des luttes syndicales militantes, à l'instar des classes ouvrières d'autres pays qui ont connu des processus d'industrialisation similaires. Leurs revendications portaient principalement sur les salaires, les conditions de travail et les protections juridiques…
»Afin de tenter d'étouffer cette vague de militantisme, le gouvernement chinois a adopté des réformes du travail qui ont codifié les droits fondamentaux des travailleurs et travailleuses… Mais cela n'a pas réussi à mettre fin aux grèves et aux manifestations et a peut-être même inspiré les travailleurs en récompensant leurs actions et en leur donnant une légitimité juridique…
»Les travailleurs sont passés à l'offensive, exigeant des augmentations de salaire supérieures aux exigences légales. Une grève à l'usine de transmission Honda Nanhai – province du Guangdong [voir China Labour Bulletin 20 mai 2015 – réd.] a déclenché une vague de grèves massives dans l'industrie automobile au cours de l'été 2010. » [p. 55-57]
Le livre aborde l'oppression des femmes et la résistance féministe. La privatisation a aggravé l'oppression des femmes. Dans le passé, les entreprises publiques fournissaient à leurs employés un logement, des soins de santé, des services de garde d'enfants et des soins aux personnes âgées. La privatisation a entraîné la perte de ces services.
Les parents doivent payer des services de garde privés, s'occuper de leurs enfants à la maison ou, dans le cas de nombreux travailleurs et travailleuses migrants, demander à leurs grands-parents dans leur village d'origine de s'en occuper.
« Aujourd'hui, la Chine est l'un des rares pays au monde où les dépenses publiques pour les services de garde d'enfants de moins de trois ans sont nulles. » [p. 64]
Cette situation alourdit la charge qui pèse sur les femmes et a contribué à creuser l'écart salarial entre les hommes et les femmes.
Certaines femmes se sont organisées pour tenter d'améliorer la situation. Un groupe appelé « Youth Feminist Activism » (Activisme féministe des jeunes) a
« mené des campagnes, organisé des manifestations, intenté des procès, créé des plateformes sur les réseaux sociaux, monté des pièces de théâtre et organisé des marches, tout en appelant à des réformes pour lutter contre la discrimination et la violence à l'égard des femmes dans toute la société. » [p. 71-72]
Cinq leaders du groupe ont été arrêtées en 2015.
Les questions nationales en Chine
La Chine compte 56 ethnies officiellement reconnues, mais 92% de la population appartient à la majorité Han. Les minorités vivent principalement dans les régions périphériques de la Chine.
Ces régions ont connu des soulèvements :
« De 2008 à 2020, la périphérie de la Chine a été le théâtre d'une intense résistance sociale. Cette période de douze ans a été marquée par des bouleversements massifs au Tibet, au Xinjiang et à Taïwan. Hong Kong a connu deux épisodes spectaculaires d'insurrection massive, le premier en 2014, puis à nouveau en 2019. » [p. 77]
Ces événements ont eu différentes causes immédiates, mais
« contrairement au caractère des protestations dans les régions centrales de la Chine, elles ont toutes été marquées par une hostilité ouverte envers l'Etat chinois ». [p. 77]
Concernant le Tibet, les auteurs affirment :
« Bien que la croissance du PIB de la région ait été impressionnante, la plupart des bons emplois et des possibilités entrepreneuriales sont revenus aux colons Han… La discrimination anti-tibétaine sur le marché du travail est bien documentée…
»Les colons Han dans les régions tibétaines ont été les principaux bénéficiaires de l'augmentation des dépenses publiques dans les infrastructures, ces projets entraînant souvent le déplacement et la dépossession des populations tibétaines. » [p. 81]
Outre la répression de la culture tibétaine, la discrimination économique a conduit à « un ressentiment latent à l'égard de la domination coloniale han ». [p. 82] Les auteurs affirment que :
« Face à une telle oppression nationale, les Tibétains affirment leur droit à l'autodétermination nationale et le droit de façonner leur propre avenir comme ils l'entendent. » [p. 83]
La situation est similaire au Xinjiang [nord-ouest] :
« Le gouvernement central a financé de grands projets d'infrastructure et encouragé les investissements privés dans la région…
»Les Ouïghours ont toutefois peu bénéficié de l'impressionnante croissance économique du Xinjiang, dont les fruits ont largement profité aux colons Han. Cette inégalité raciale est le résultat d'une discrimination dans l'enseignement et sur le marché du travail. Pour progresser dans le système d'enseignement supérieur chinois, il est nécessaire de maîtriser le mandarin, ce qui place les locuteurs natifs ouïghours (ainsi que les locuteurs tibétains, kazakhs et d'autres langues minoritaires) dans une situation nettement défavorable. » [p. 84]
Cette situation a conduit à des émeutes raciales en 2009, suivies d'
« une insurrection de faible intensité et parfois violente [qui] a couvé pendant des années. Les Ouïghours ont mené de nombreuses attaques au couteau contre des commissariats de police au Xinjiang. » [p. 85]
L'Etat chinois a lancé une « guerre populaire contre le terrorisme » afin d'éradiquer « l'extrémisme islamique ». Les auteurs décrivent cette « guerre » comme suit :
« En 2017, l'Etat avait construit d'immenses camps, appelés par euphémisme « centres de rééducation », où il a emprisonné des centaines de milliers de musulmans. Alors que le prétexte était qu'il s'agissait simplement de sites de formation professionnelle, de nombreuses fuites ainsi que des documents gouvernementaux accessibles au public ont révélé que ces camps avaient pour but de promouvoir la « déradicalisation » et un sentiment d'« unité ethnique », ainsi que la soumission au régime du PCC. » [p. 85]
La langue et la culture ouïghoures ont été attaquées et un « système de surveillance dystopique » a été mis en place dans tout le Xinjiang. [p. 85]
Les entreprises occidentales ont profité de la répression des Ouïghours en fournissant une partie de la technologie de surveillance et en utilisant le travail forcé dans les camps pour produire des marchandises destinées à être vendues sur le marché mondial.
Les manifestations à Hong Kong ont principalement porté sur des questions de droits démocratiques : opposition aux lois répressives et revendications pour des élections libres. Les auteurs affirment que l'absence de démocratie est liée au niveau très élevé d'inégalité économique à Hong Kong, où une oligarchie riche contrôle le gouvernement tandis que les logements sociaux sont insuffisants et que les pauvres sont « contraints de s'entasser dans de minuscules appartements aux loyers exorbitants ». [p. 90] La discrimination à l'égard de ceux qui ne parlent pas le mandarin est également source de mécontentement.
Taïwan n'a jamais été contrôlée par le PCC, mais ce dernier prétend qu'elle fait partie de la Chine parce qu'elle a autrefois fait partie de l'empire Qing. Taïwan a été gouvernée par le Japon entre 1895 et 1945, puis reprise par le Kuomintang (KMT), le parti soutenu par les Etats-Unis qui a gouverné la Chine jusqu'à sa défaite par le PCC en 1949.
Les auteurs affirment que le peuple taïwanais considérait le KMT comme une « force d'occupation brutale ». Lorsqu'il s'est rebellé, le KMT « a répondu par une répression brutale, tuant plusieurs milliers de personnes et en arrêtant et torturant des milliers d'autres ». [p. 94]
Dans les années 1980, le mouvement pro-démocratique taïwanais a réussi à obtenir la libéralisation politique et la démocratie parlementaire. Parallèlement, les réformes économiques de Deng Xiaoping [président de 1983 à 1990] ont créé des opportunités en Chine continentale pour les capitalistes taïwanais :
« Les entreprises taïwanaises ont investi des sommes colossales dans les zones franches industrielles en pleine expansion de la Chine. L'exemple le plus célèbre est celui de Foxconn [qui produit entre autres pour Apple], qui a trouvé en Chine un environnement sans syndicats, où les autorités locales étaient en mesure de lui garantir d'immenses terrains et une main-d'œuvre gigantesque à bas prix… Ironiquement, c'est le KMT, l'ancien ennemi juré du PCC, qui a plaidé en faveur d'une intégration plus profonde des deux économies au nom de l'élite fortunée de Taïwan. » [p. 96]
Cependant, en 2014,
« des centaines de milliers de personnes ont envahi les rues pour exprimer leur opposition à un accord commercial néolibéral qui renforcerait l'influence économique de la Chine. Des centaines de manifestant·e·s ont occupé le bâtiment du Yuan législatif pendant des semaines, mobilisant un soutien massif de la population et réussissant à faire échouer l'accord commercial. » [p. 97]
En résumé, les auteurs affirment :
« Ainsi, l'adhésion ouverte du PCC au chauvinisme Han et à l'ethnonationalisme a déclenché des luttes pour l'autodétermination nationale sur son territoire et dans sa périphérie. » [p. 99]
Tout en reconnaissant que les responsables politiques occidentaux tentent de tirer profit de ces mouvements, ils affirment que la gauche devrait soutenir les luttes pour la démocratie et l'autodétermination.
Etats-Unis et Chine
La rivalité entre les Etats-Unis et la Chine s'intensifie :
« Comme le montre clairement le conflit autour de Taïwan, l'émergence de la Chine en tant que nouvelle puissance capitaliste l'a amenée à une opposition croissante avec les Etats-Unis. » [p. 103]
Jusqu'à la première administration Trump, la politique états-unien à l'égard de la Chine était « une combinaison de confinement et d'engagement ». [p. 108] Les Etats-Unis ont tenté d'intégrer la Chine dans leur ordre mondial néolibéral.
« Dans le même temps, Washington restait méfiant en raison de la réticence de Pékin à se plier entièrement à ses diktats et a donc pris des précautions en conservant certains éléments d'une politique d'endiguement à l'égard de la Chine. Par exemple, il a maintenu son vaste archipel de bases militaires dans la région Asie-Pacifique et a régulièrement patrouillé ses eaux, y compris le détroit de Taïwan, avec des porte-avions et des cuirassés. » [p. 109]
Trump a adopté une approche plus ouvertement hostile, lançant une guerre tarifaire et tentant de mettre fin aux transferts de technologie entre les entreprises états-uniennes et chinoises. Biden a largement poursuivi cette politique. Les auteurs commentent :
« Ce conflit a déclenché une logique de restructuration de la mondialisation, fragmentant le système en blocs de sécurité nationale rivaux dans certains domaines économiques stratégiques tout en maintenant les chaînes d'approvisionnement mondiales dans d'autres. » [p. 121]
Il existe également une « course aux armements dans la région », les Etats-Unis, la Chine et d'autres Etats augmentant leurs dépenses militaires. [p. 122]
Environnement
La Chine est devenue le plus grand émetteur mondial de dioxyde de carbone en 2006. En 2019, les émissions annuelles de dioxyde de carbone de la Chine étaient deux fois plus élevées que celles des Etats-Unis. L'industrialisation a également entraîné la pollution des sols, de l'eau et de l'air.
Ces problèmes résultent du développement capitaliste de la Chine :
« Les multinationales… ont délocalisé une grande partie de leurs « industries polluantes » en Chine, où la réglementation environnementale était et reste laxiste. » [p. 127]
La pollution a donné lieu à des manifestations de masse :
« En fait, le mécontentement et la résistance populaires ont contraint l'Etat à adopter des mesures qui remédient au moins en partie à la dégradation de l'environnement. Par exemple, les critiques populaires des habitants des grandes villes comme Pékin contre la pollution atmosphérique ont poussé le gouvernement à fermer ou à délocaliser les industries très polluantes. » [p. 130-131] [Un bilan devrait être établi des initiatives prises par le gouvernement dans le domaine des « énergies renouvelables » et de leurs « villes modèles » – réd.]
Solidarité internationale
Dans le contexte de l'intensification de la rivalité entre les Etats-Unis et la Chine, les auteurs plaident en faveur de la solidarité internationale :
« Les dirigeants des deux Etats ont recours au nationalisme pour détourner la colère populaire vers les peuples opprimés et leurs rivaux impérialistes. Dans le même temps, l'exploitation et l'oppression accrues ont provoqué et continueront de provoquer d'intenses luttes parmi les travailleurs et les opprimés aux Etats-Unis et en Chine. Dans ce contexte, la gauche doit adopter une approche claire visant à construire une solidarité internationale à partir de la base contre les deux Etats impérialistes et leurs classes dirigeantes. » [p. 163]
Ils ajoutent :
« Notre travail consiste à tisser des réseaux, aussi rudimentaires soient-ils, entre les militants aux Etats-Unis, en Chine et ailleurs, qui pourront à l'avenir faire de la solidarité réciproque par la base une force capable de s'opposer au capitalisme mondial, au nationalisme des grandes puissances et aux rivalités interimpérialistes qu'ils attisent. » [p. 175]
Article publié sur le site Links.org le 8 mai 2025 ; traduction rédaction A l'Encontre.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’Iran doit renoncer à la bombe et Israël démanteler la sienne

C'est bien connu, les medias chassent en meute et bien souvent avec la complaisance de la classe politique qui participe ainsi à la fabrication de l'opinion publique.
Le spectre de la bombe iranienne fait ainsi la une de tous les plateaux médiatiques sans que soit abordée la question de l'autre bombe, l'israélienne.
Tiré de La chronique de Recherches internationales
Site : http://www.recherches-internationales.fr/
Michel Rogalski
Directeur de la revue Recherches internationales
Comme si celle-ci était naturelle, allait de soi et ne pouvait faire l'objet d'aucune interrogation. Ainsi l'une serait admissible et l'autre désignée comme le mal absolu. La seconde ferait l'objet de toutes les critiques, la première serait un tabou qu'il serait indécent d'évoquer, au risque pour le journaliste qui en serait tenté de sentir son oreillette grésiller, le rappeler à l'ordre et lui faire sentir que sa carrière n'est plus assurée. Ainsi, il y aurait une bombe de la guerre et une bombe de la paix.
C'est ainsi que medias et classe politique organisent de concert le débat en évoquant de façon récurrente la menace iranienne d'accéder à l'arme nucléaire. On remarquera la fausse symétrie, l'une n'étant que virtuelle, l'autre bien réelle, mais tous deux se réfugiant, pour l'un dans l'absence d'assumer en entretenant un flou total et pour l'autre en jurant que telle n'est pas son intention et qu'on lui fait un mauvais procès. Dissimulation chez l'un et déni chez l'autre.
L'affaire remonte à loin et reste régie par l'ombre tutélaire du Traité de non-prolifération nucléaire signé en 1968, peu à peu rejoint par une majorité de pays – aujourd'hui 192. D'emblée, refuser d'adhérer à l'Accord signifiait une intention non-dissimulée d'accéder au statut de puissance dotée de l'arme nucléaire. Peu de pays en prirent le risque. On en connaît la liste : Afrique du sud, Inde, Pakistan, Israël. Tous ces pays, avec des complicités diverses, accédèrent à l'arme nucléaire. Deux y renoncèrent, l'Afrique du sud et l'Ukraine, pour des raisons différentes. On peut donc affirmer que le Traité, même si tous ses termes ne sont pas intégralement appliqués, a rempli l'essentiel de son rôle, celui d'éviter la prolifération nucléaire.
Ainsi l'Afrique est devenu un continent dénucléarisé et l'Amérique latine a évité de l'être malgré les ambitions symétriques de l'Argentine et du Brésil. La situation du continent asiatique étendu au Moyen-Orient est fort différente et beaucoup plus complexe car des situations spécifiques y coexistent permettant à chacun de s'affirmer comme un cas particulier. Après l'avoir signé, la Corée du nord s'en est retirée et possède aujourd'hui l'arme et les missiles pouvant la porter. La Chine était déjà dotée au moment de l'Accord. L'Inde, le Pakistan et Israël non-signataires du Traité se sont chacun doté de l'arme et l'Iran signataire de l'Accord est suspecté par la communauté internationale de ne pas le respecter et de refuser de se soumettre aux inspections de l'AIEA (Agence Internationale de l'Énergie Atomique) censée en contrôler l'application et à procéder à une aide technique pour accéder à l'usage pacifique du nucléaire. Il lui est reproché d'enrichir l'uranium à des taux qui se rapprochent de la capacité d'accéder à la bombe. L'Iran réfute ces accusations et affirme qu'il n'a pas une telle intention.
C'est dans ce contexte que, sous la mandature de Barack Obama, un Accord fut signé à Vienne en 2015, le Joint Comprehensive Plan of Action (JPCoA) associant les 5 membres du Conseil de sécurité, l'Allemagne et l'Iran. Cet Accord fut dénoncé unilatéralement par D. Trump en 2018. Depuis lors, malgré les sanctions, Téhéran augmente le nombre et le rythme de ses centrifugeuses enrichissant l'uranium à des teneurs qui approchent un possible usage militaire.
Aujourd'hui, Donald Trump, devant l'inefficacité de son retrait de l'Accord, semble désireux de renouer le contact avec l'Iran, sans se concerter avec l'Europe, et entame une série de négociations bilatérales auxquelles les Iraniens, lassés de l'entrave des embargos, acceptent de participer. Trump tente aujourd'hui de revenir sur sa posture, mais en écartant les Européens. Ces négociations se déroulent sous l'égide du Sultanat d'Oman alors qu'États-Unis et Iran n'ont plus de relations diplomatiques. Le contexte a bien changé. Israël s'est imposée comme puissance militaire régionale incontestée et accumule les victoires par les armes contre le Hamas à Gaza, contre le Hezbollah au Liban, bénéficie de la chute du régime syrien et a détruit une large partie des défenses antimissiles iraniennes. Téhéran a perdu beaucoup d'alliés au Moyen-Orient, peine sous les sanctions et redoute une attaque israélienne sur son potentiel nucléaire. Bref, Israël a fait le « sale boulot » pour le compte de l'Occident sous la protection des bâtiments de guerre américains patrouillant en Méditerranée orientale.
En réalité il est fort probable que l'Iran souhaite accéder au statut d'un État du « seuil nucléaire », c'est-à-dire d'être en capacité rapidement (entre un et deux ans) de devenir, si nécessaire, une puissance nucléaire. D'autres pays comme la Corée du sud ou le Japon, pourraient partager une telle ambition. Cela ferait tâche d'huile au Moyen-Orient et demain l'Arabie saoudite ou la Turquie participeraient à une telle prolifération. Rien ne serait plus dangereux. Tout doit être fait, par des moyens diplomatiques et coopératifs pour rechercher une issue non-militaire.
Le paradoxe c'est qu'au Moyen-Orient le seul État doté – Israël - est le plus véhément dans l'opposition farouche à une éventuelle bombe iranienne, adoptant ainsi comme seule logique celle de vouloir être la seule puissance nucléaire de la région, au point de menacer de frappes préemptives le dispositif iranien, comme il le fit à l'égard de l'Irak en détruisant en 1981 son réacteur nucléaire en cours de construction. Cette posture n'a aucune légitimité dès lors que sa sécurité est garantie par l'allié américain qui n'hésite pas à déplacer ses bâtiments de guerre en Méditerranée pour signifier sa totale solidarité avec Tel-Aviv et par le soutien acquis d'avance des pays occidentaux. Car en cas de danger existentiel tout le monde sait qu'Israël sera défendu de façon inconditionnelle par tous ses alliés qui ne manquent jamais de le répéter.
Cette bombe israélienne qui fut construite avec la complicité dissimulée d'États dotés et signataires du Traité de non-prolifération – notamment de la France et des États-Unis - est une incitation à pousser d'autres pays de la région à s'engager dans la même voie. Longtemps cachée, niée et dissimulée son existence est maintenant admise mais, au contraire d'arsenaux d'autres pays pour lesquels la communication est d'usage dès lors que les expérimentations sont réussies, elle reste entourée d'un flou discret. Envisagée très tôt par Ben Gourion le programme israélien démarre dès la fin des années 1950 et sera effectivement considéré comme opérationnel dès le début des années 1970. Depuis lors, il est entouré d'une opacité entretenue et fait figure d' « exception » acceptée y compris par l'AIEA qui n'a jamais pris le sujet à bras-le-corps et a ainsi contribué à en « normaliser » l'existence. Ainsi le pays peut prétendre bénéficier du prestige de la possession de l'arme nucléaire sans avoir à en payer le moindre coût diplomatique ou moral et peut continuer à jouir du monopole de l'arme nucléaire dans la région. Partant de ce principe d'exception, Tel-Aviv peut s'exonérer de toute recherche politico-diplomatique en vue d'une zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient. Cette discrétion fut accompagnée et partagée par la quasi-totalité du monde occidental. Dans le pays, les critiques et les discussions fusent de toutes parts sur les options sécuritaires choisies par les dirigeants et visent tout à la fois l'armée, le Mossad et le Shin Bet, mais la question nucléaire reste taboue et n'est jamais débattue.
Aujourd'hui, poser, à raison, la question de l'accession de l'Iran à l'arme nucléaire est légitime, et il faut se réjouir de la reprise des négociations avec les États-Unis à Oman, mais peut-on aborder ce sujet en entretenant délibérément le silence sur l'autre bombe du Moyen-Orient ? Autre forme de deux poids et deux mesures ?
Cette chronique est réalisée en partenariat rédactionnel avec la revue Recherches internationales à laquelle collaborent de nombreux universitaires ou chercheurs et qui a pour champ d'analyse les grandes questions qui bouleversent le monde aujourd'hui, les enjeux de la mondialisation, les luttes de solidarité qui se nouent et apparaissent de plus en plus indissociables de ce qui se passe dans chaque pays.
https://shs.cairn.info/revue-recherches-internationales?lang=fr
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Rapport Addameer : « plus de 10 100 prisonniers politiques identifiés dans les prisons israéliennes en mai 2025 »

Nous publions ci-dessous notre traduction du dernier rapport porté par la Commission des affaires des détenus, la Société des prisonniers palestiniens (PPS) l'association Addameer, association palestinienne de soutien aux prisonniers et d défense des droits humains.
Tiré d'Agence médias Palestine.
Les forces d'occupation israéliennes continuent de procéder à des arrestations massives lors de raids violents et incessants dans les maisons et les lieux publics palestiniens dans les villes, les villages et les hameaux de toute la Cisjordanie. Le nombre total d'arrestations en avril 2025 a atteint 530, dont 60 enfants (moins de 18 ans) et 18 femmes. Ce chiffre comprend les personnes qui sont toujours en détention et celles qui ont été libérées par la suite.
Dans ce rapport mensuel spécial, la Commission des affaires des détenus, la Société des prisonniers palestiniens (PPS) et l'Association Addameer pour le soutien aux prisonniers et les droits de l'homme présentent les faits et chiffres clés relatifs aux milliers de prisonniers politiques palestiniens détenus par l'occupation israélienne.
Ces campagnes d'arrestations massives se poursuivent dans le contexte du génocide en cours à Gaza et de l'escalade de l'agression en Cisjordanie, en particulier dans les villes du nord de Jénine et de Tulkarem, qui sont confrontées à des arrestations massives, des exécutions sommaires, des déplacements forcés et des destructions généralisées. Ces chiffres n'incluent pas les centaines de personnes soumises à des interrogatoires violents sur le terrain en Cisjordanie, en particulier dans les camps de réfugiés et les villes. Ces interrogatoires s'accompagnent souvent de passages à tabac, d'abus et d'intimidations, visant même les enfants et les femmes. L'occupation a également continué à utiliser des civils comme otages et boucliers humains, et a poursuivi et arrêté à nouveau d'anciens prisonniers, dont certains avaient été libérés lors des accords d'échange récents.
Avec les données recueillies en avril 2025, le nombre total d'arrestations effectuées par les forces d'occupation israéliennes en Cisjordanie depuis le début du génocide en octobre 2023 s'élève à environ 17 000 cas, incluant les personnes actuellement détenues et celles qui ont été libérées par la suite. Ce chiffre ne tient pas compte des milliers d'arrestations qui auraient eu lieu à Gaza.
En avril, les autorités d'occupation israéliennes ont annoncé la mort de deux prisonniers palestiniens détenus par leurs soins : Musab Odeili, originaire de Naplouse, assassiné le 16 avril 2025 (sa mort a été confirmée le lendemain), et Nasser Khalil Radaydeh, originaire de la ville d'Al-Ubeidiya, près de Bethléem, assassiné le 20 avril 2025. Il convient de noter qu'un certain nombre de détenus enlevés à Gaza ont été informés de manière informelle par leurs familles que leurs proches avaient été assassinés pendant leur détention par l'occupant. Les groupes de prisonniers n'ont pas encore reçu de réponse claire de l'armée israélienne concernant le sort de ces détenus.
Toujours en avril, les résultats de l'autopsie du jeune détenu palestinien de 17 ans assassiné en mars ont été rendus publics. Les médecins ont conclu que la cause principale du décès de Walid Ahmad, originaire du village de Silwad, près de Ramallah, était la privation de nourriture.
Les groupes de défense des prisonniers signalent également une forte augmentation du nombre d'ordres de « détention administrative » émis par l'armée en avril, ce qui a entraîné une augmentation significative du nombre de personnes arrêtées en Cisjordanie et détenues en vertu de ces ordres. Début mai, on comptait 3 577 « détenus administratifs », dont plus de 100 enfants, soit plus que le nombre de prisonniers condamnés et de personnes en attente de jugement dans les prisons israéliennes. Les détenus administratifs sont des personnes détenues sans procès ni inculpation sur la base d'un « dossier secret » auquel ni le détenu ni son avocat n'ont accès, ce qui signifie qu'ils n'ont aucun moyen de se défendre devant les tribunaux militaires israéliens, structurellement oppressifs.
Chiffres clés au début du mois de mai 2025
Le nombre de Palestiniens identifiés détenus dans les prisons centrales, les camps militaires, les centres d'interrogatoire et de détention de l'occupation dépasse les 10 100 personnes au début du mois de mai 2025. Ce chiffre n'inclut pas tous les Palestiniens enlevés à Gaza, en particulier ceux détenus dans les camps militaires de l'occupation.
Ce chiffre comprend :
– 3 577 Palestiniens arrêtés en Cisjordanie occupée et détenus sans procès ni inculpation en vertu de l'ordre de « détention administrative » israélien
– Au moins 400 enfants, dont au moins 100 en « détention administrative ».
– 35 femmes, dont deux enceintes de cinq mois et une malade du cancer.
– 1 846 Palestiniens arrêtés dans la bande de Gaza occupée et détenus sans procès ni inculpation en vertu de la loi israélienne sur les « combattants illégaux ».
Avant le génocide, il y avait au total 5 250 prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes, dont 40 femmes, 170 enfants et environ 1 320 « détenus administratifs ».
À noter : le nombre total de Palestiniens identifiés détenus sans procès ni accusation sous différents prétextes juridiques – en Cisjordanie et à Gaza – s'élève à 5 423 personnes, ce qui signifie que plus de la moitié des 10 100 Palestiniens identifiés comme détenus sont emprisonnés arbitrairement et sans procédure judiciaire régulière.
Depuis le 7 octobre 2023, au moins 66 prisonniers politiques palestiniens identifiés ont été tués directement ou indirectement par des gardiens de prison de l'occupation israélienne. Ce chiffre n'inclut pas les dizaines de détenus non identifiés qui ont été arrêtés à Gaza et tués dans des circonstances inconnues des avocats et des institutions palestiniennes de défense des prisonniers. L'occupation israélienne continue de refuser toute information sur leur sort, leur identité et leur lieu de détention, laissant leurs proches dans l'ignorance.
Le nombre total de détenus palestiniens identifiés comme martyrs depuis 1967 s'élève désormais à 303 personnes.
Violations systématiques des droits humains des détenus
Sur la base de dizaines de visites effectuées par nos équipes juridiques auprès de détenus tout au long du mois d'avril 2025, il est évident que le système pénitentiaire de l'occupation israélienne continue de se livrer à des abus systématiques et brutaux à l'encontre des prisonniers. Il s'agit notamment de torture, de privation délibérée de nourriture et de soins médicaux. Les témoignages des prisonniers révèlent la propagation continue de maladies, notamment la gale, qui est devenue un moyen de torture physique et d'exécution lente, en particulier dans les prisons de Naqab (Néguev) et de Megiddo. Face à l'aggravation de cette crise sanitaire, les organisations de prisonniers ont appelé l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à intervenir et à faire pression sur l'occupant pour qu'il mette fin aux politiques à l'origine de ces épidémies, en particulier le refus d'accorder aux prisonniers l'accès aux produits d'hygiène et d'assainissement les plus élémentaires.
En termes d'abus systématiques, les conditions des Palestiniens enlevés à Gaza et détenus par l'armée israélienne sont les pires. Les témoignages des prisonniers sont parmi les plus choquants, révélant des niveaux extrêmes de torture, d'abus et d'humiliation. Les témoignages d'agressions sexuelles, qui occupent une place importante dans les récits recueillis, notamment ceux documentés en avril lors de visites au camp militaire d'Ofer et dans d'autres installations, sont particulièrement alarmants. L'occupant israélien continue également de pratiquer des disparitions forcées, refusant de communiquer l'identité de nombreux détenus enlevés à Gaza, y compris ceux qui sont morts ou ont été tués en détention.
La répression exercée par les forces armées pénitentiaires s'est également intensifiée, avec des raids et des agressions systématiques contre les détenus dans toutes les prisons et tous les camps de détention. Des dizaines de détenus ont été victimes de violents passages à tabac, dont beaucoup ont subi des blessures plus ou moins graves. Ces attaques ont particulièrement visé les leaders du mouvement des prisonniers, qui continuent d'être soumis à un isolement carcéral prolongé depuis le début du génocide.
La répression violente s'étend aux femmes détenues dans la prison israélienne de Damon, où se trouvent actuellement 35 Palestiniennes, dont deux femmes enceintes de cinq mois et une malade du cancer. Outre les agressions physiques continues, ces femmes sont soumises à un isolement collectif, au déni de leurs besoins fondamentaux et à la négligence médicale, notamment le refus de soins ou d'un suivi médical adéquat.
La situation des enfants détenus s'est également considérablement détériorée depuis le début du génocide, marquée par une augmentation alarmante de l'ampleur et de la brutalité des crimes commis à leur encontre. Cela inclut l'intensification des campagnes d'arrestations et l'augmentation du nombre d'enfants détenus, ainsi que leur exposition aux mêmes abus que les prisonniers adultes, hommes et femmes.
L'administration pénitentiaire israélienne continue de restreindre systématiquement les visites des équipes juridiques aux prisonniers et tente d'entraver le travail des avocats par tous les moyens possibles. Cela inclut une surveillance étroite pendant les visites et leur programmation à des intervalles irréguliers. Les organisations de défense et de soutien des prisonniers sont également confrontées à de graves difficultés pour obtenir l'accès aux prisons de Nafha et Ramon (désormais appelée prison de Ganot), en raison d'un retard délibéré dans l'attribution des dates de visite. Ce problème s'est récemment aggravé, de nombreux avocats se voyant totalement interdits de visite.
Le système pénitentiaire persiste également à intensifier les mauvais traitements infligés aux détenus lors de leur transfert vers les lieux de visite, ce qui conduit de nombreux prisonniers à ne pas divulguer certaines informations par crainte de représailles après leur visite, comme cela a été le cas pour des dizaines de détenus au cours des derniers mois.
Les groupes de prisonniers soulignent que le temps est le facteur clé qui détermine le sort et la vie des prisonniers. Plus ils restent longtemps sous la garde de l'occupation israélienne, plus leur sort et leur vie sont menacés.
Traduction : JB pour l'Agence Média Palestine
Source : Addameer
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« Le rendre inhabitable » : la stratégie israélienne de destruction totale des infrastructures urbaines

Début avril, quelques semaines seulement après avoir repris leur offensive sur Gaza, les forces armées israéliennes ont annoncé qu'elles avaient pris le contrôle de la ville de Rafah située à l'extrême sud de Gaza afin de créer le « corridor de Morag » (l'Axe Morag), un nouveau corridor militaire qui divise encore davantage la bande de Gaza. Selon le Bureau des médias du gouvernement de Gaza, l'armée aurait détruit plus de 50 000 logements à Rafah, soit 90% de ses quartiers résidentiels au cours de la guerre. Aujourd'hui, l'armée a entrepris de raser les dernières structures de Rafah, transformant toute la ville en zone tampon et coupant le seul point de passage entre Gaza et l'Egypte.
Tiré d'À l'encontre.
Y., un soldat récemment revenu de son service de réserve à Rafah, a décrit les méthodes de démolition de l'armée au magazine +972 et à Local Call. « J'ai obtenu quatre ou cinq bulldozers [d'une autre unité], et ils ont démoli 60 maisons par jour. Une maison d'un ou deux étages est détruite en une heure ; une maison de trois ou quatre étages prend un peu plus de temps », a-t-il déclaré. « La mission officielle était d'ouvrir une voie logistique pour les manœuvres, mais dans la pratique, les bulldozers détruisaient simplement les maisons. La partie sud-est de Rafah est complètement détruite. L'horizon est plat. Il n'y a plus de ville. »
Le témoignage de Y. concorde avec ceux de dix autres soldats qui ont servi à différents moments dans la bande de Gaza et dans le sud du Liban depuis le 7 octobre, et qui se sont entretenus avec +972 et Local Call. Il correspond également aux vidéos publiées par d'autres soldats, aux déclarations officielles et officieuses d'officiers supérieurs actuels et anciens, à l'analyse d'images satellites et aux rapports d'organisations internationales.
Ensemble, ces sources brossent un tableau clair : la destruction systématique des bâtiments résidentiels et des infrastructures publiques est devenue un élément central des opérations de l'armée israélienne et, dans de nombreux cas, son objectif principal.
Une partie de ces destructions est le résultat de bombardements aériens, de combats au sol et d'engins explosifs improvisés placés par des militants palestiniens à l'intérieur de bâtiments à Gaza. Cependant, bien qu'il soit difficile d'obtenir des chiffres précis, il semble que la plupart des destructions à Gaza et dans le sud du Liban n'aient pas été causées par des frappes aériennes ou pendant les combats, mais plutôt par des bulldozers ou des explosifs israéliens, dans le cadre d'actes prémédités et intentionnels.
Selon l'enquête de +972 et Local Call, cette décision a été motivée par une stratégie délibérée visant à « raser la zone » afin de garantir que « le retour des populations dans ces espaces ne soit pas possible », comme l'a déclaré Yotam, qui a servi comme commandant adjoint d'une brigade blindée à Gaza.
Les destructions « non opérationnelles », dépourvues de justification militaire directe, ont commencé dès les premiers mois de la guerre. Dès janvier 2024, le site d'investigation israélien The Hottest Place in Hell [Le lieu le plus brûlant dans l'enfer] a rapporté que l'armée avait procédé à la « destruction systématique et complète de tous les bâtiments situés à moins d'un kilomètre de la barrière [de séparation entourant Gaza] toutefois à l'intérieur de la bande de Gaza, sans qu'ils aient été identifiés comme des infrastructures terroristes, ni par les services de renseignement ni par les soldats sur le terrain », dans le but de créer une « zone tampon de sécurité ».
Le rapport citait des soldats qui affirmaient que dans les zones proches de la barrière frontalière, telles que Beit Hanoun et Beit Lahia, le quartier de Shuja'iyya dans le nord de la bande de Gaza, ainsi qu'à Khirbet Khuza'a, à la périphérie de Khan Younès, entre 75% et 100% des bâtiments avaient été détruits à cette date, de manière quasi indiscriminée. Mais ce qui a commencé dans la périphérie de Gaza est rapidement devenu une méthode largement déployée dans toute la bande de Gaza, liée au plan plus large d'Israël visant à rendre une grande partie de Gaza invivable pour les Palestiniens.
Ces actions constituent des violations flagrantes du droit de la guerre, selon Michael Sfard, avocat israélien et expert en droits de l'homme. « La destruction de biens [individuels] qui n'est pas impérativement requise par les nécessités de la guerre constitue un crime de guerre », a-t-il expliqué, « et il existe également un crime de guerre spécifique et plus grave, à savoir la destruction [gratuite et] généralisée de biens non justifiée par des nécessités militaires. Parmi les experts juridiques, les militants des droits humains et les universitaires, il existe un débat important sur la nécessité d'établir un crime contre l'humanité appelé “domicide”, c'est-à-dire la destruction d'une zone utilisée pour l'habitation humaine. »

« Nulle part où retourner »
Depuis qu'Israël a violé le cessez-le-feu en mars 2025, environ 2800 Palestiniens ont été tués à Gaza [jusqu'en date du 15 mai], et près de 53 000 ont été tués et 120 000 blessés au cours de la guerre. Comme +972 l'a déjà signalé le 3 avril, les frappes aériennes sont responsables de la grande majorité des victimes civiles. Mais c'est la destruction systématique de l'espace urbain de Gaza qui prépare le terrain pour le nettoyage ethnique de la bande de Gaza, appelé « mise en œuvre du plan Trump » dans le discours politique israélien.
Le Premier ministre Benyamin Netanyahou a ouvertement approuvé cette vision fin mars, peu après la reprise de la guerre par Israël. « Le Hamas déposera les armes. Ses dirigeants seront autorisés à partir. Nous veillerons à la sécurité générale de la bande de Gaza et permettrons la mise en œuvre du plan Trump pour une migration volontaire », a affirmé Netanyahou. « Tel est le plan. Nous ne le cachons pas et sommes prêts à en discuter à tout moment. »
Cette semaine encore, Netanyahou a établi plus explicitement le lien entre la destruction de bâtiments civils et le déplacement forcé. « Nous détruisons de plus en plus de maisons – ils n'ont nulle part où retourner », aurait-il déclaré lors d'une réunion de la commission des affaires étrangères et de la sécurité [de la Knesset]. « Le seul résultat attendu sera le désir des Gazaouis d'émigrer hors de la bande de Gaza. »
En décembre 2024, l'ONU estimait que 69% de tous les bâtiments de la bande de Gaza, dont 245 000 logements, avaient été endommagés, et que plus de 60 000 bâtiments avaient été complètement détruits. Fin février 2025, ce chiffre était passé à 70 000, selon Adi Ben Nun, spécialiste en GIS (Geographical Information Systems) à l'Université hébraïque de Jérusalem, qui a réalisé une analyse satellite pour +972 et Local Call. Au moins 2000 structures supplémentaires ont été détruites en mars, dont plus de 1000 à Rafah.
Aujourd'hui, selon une analyse visuelle réalisée par le chercheur Ariel Caine pour Local Call et +972, plus de 73% des bâtiments de Rafah et de ses environs ont été complètement détruits, moins de 4% ne présentant aucun dommage visible. La zone comptait environ 28 332 bâtiments, s'étendant du corridor de Philadelphie au corridor de Morag.
Certains des bâtiments de Gaza qui ont été complètement rasés par des bulldozers ou des explosifs lors de démolitions planifiées avaient déjà été endommagés, soit par des frappes aériennes, soit lors de combats au sol. Cependant, les données de l'ONU fournissent une indication du grand nombre de structures détruites sans nécessité opérationnelle : entre septembre et décembre 2024, période durant laquelle il n'y a pas eu de combats intenses à Gaza, plus de 3000 bâtiments supplémentaires ont été endommagés à Rafah et environ 3100 nouveaux bâtiments dans le nord de la bande de Gaza.
L'arme principale de l'arsenal de destruction de l'armée est le bulldozer blindé D9 de Caterpillar, utilisé depuis longtemps pour commettre des violations des droits humains dans les territoires palestiniens occupés. Mais les soldats qui se sont entretenus avec +972 et Local Call ont également décrit une autre méthode privilégiée pour détruire des quartiers résidentiels entiers : remplir des conteneurs ou des véhicules militaires hors d'usage avec des explosifs, puis les faire exploser à distance.
« Au final, le D9 [bulldozer blindé] a façonné le visage de la guerre », a tweeté le journaliste israélien de droite Yinon Magal début février. « C'est ce qui a poussé les Gazaouis à retourner dans le sud, après [être venus dans le nord pour rejoindre leurs maisons pendant le cessez-le-feu] et avoir réalisé qu'ils n'avaient nulle part où aller… Et ce n'était pas une directive du chef d'état-major ou de l'état-major général, c'était une politique du “terrain”, des commandants de division, des commandants de brigade, des commandants de bataillon et même des équipes du génie militaire qui ont changé la réalité. »
Un ancien haut responsable de la sécurité dans l'armée israélienne, qui a maintenu des contacts avec de nombreux commandants, a confirmé que certains commandants sur le terrain ont pris l'initiative d'ordonner la destruction d'autant de bâtiments que possible à Gaza, même en l'absence de directives militaires officielles de la part des officiers supérieurs. « J'ai reçu des rapports d'officiers sur le terrain indiquant que des mesures inutiles du point de vue opérationnel étaient prises : démolition de maisons, expulsion de dizaines et de centaines de milliers d'habitants, destruction systématique de Beit Hanoun et Beit Lahia. Ils m'ont dit que les unités D9 opéraient hors de leur contrôle », a-t-il déclaré à +972 et Local Call. « Je ne sais pas quel pourcentage correspondait à des destructions non opérationnelles, mais c'était beaucoup. »
Les commandants à Gaza disposent d'un large pouvoir discrétionnaire en matière de démolition de bâtiments, a admis une source militaire officielle, tout en niant l'existence d'une directive à Gaza visant à « détruire pour le plaisir de détruire ». « Un commandant peut démolir un bâtiment qui pourrait constituer une menace », a-t-il déclaré, soulignant que les commandants de rang inférieur étaient peut-être responsables des destructions les plus importantes.
Par ailleurs, plusieurs réservistes ont témoigné que la méthode de rasage systématique et délibéré des infrastructures civiles par l'armée avait également été employée dans le sud du Liban, lors de l'invasion terrestre d'octobre-novembre 2024. Selon un réserviste, les préparatifs de l'invasion comprenaient un entraînement à la démolition, dont l'objectif explicite était de détruire les villages chiites, presque tous considérés comme des bastions du Hezbollah, afin d'empêcher les habitants de revenir.
« Si les soldats prenaient leur temps, vérifiant sur quel mur fixer les explosifs, puis sortaient du bâtiment et filmaient l'explosion, cela prouve qu'il n'y avait aucune justification [opérationnelle] à cela », a expliqué Muhammad Shehada, chercheur invité au Conseil européen des relations internationales et originaire de Gaza. Un de ses amis, qui possède un passeport étranger et est entré dans la bande de Gaza pendant le cessez-le-feu, lui a décrit à quel point la destruction était méthodique. « Il a dit qu'on pouvait voir que [les soldats avaient] démoli une maison, nettoyé les décombres et passé à la suivante. »
Avant la guerre, Muhammad Shehadeh vivait lui-même à Tel Al-Hawa, un quartier de Gaza connu pour ses immeubles de grande hauteur et où vivent des fonctionnaires et des universitaires, non loin du corridor de Netzarim. « Lorsque les habitants de Gaza apprennent que l'armée va ouvrir un corridor, ils savent qu'il ne restera plus un seul bâtiment. Nous savions que Tel Al-Hawa allait disparaître. »
« Le message est clair : nous allons tout détruire »
Lorsque le cessez-le-feu est entré en vigueur fin janvier 2025, des milliers de Palestiniens se sont précipités pour retourner à Jabalia, dans le nord de Gaza, pour découvrir que le camp de réfugiés tel qu'ils le connaissaient n'existait plus, des quartiers entiers avaient été réduits en ruines. Leurs récits de la destruction concordent avec les témoignages des soldats qui ont servi à Jabalia entre octobre 2024 – date à laquelle l'armée israélienne est revenue dans le camp – et le cessez-le-feu.
Avraham Zarviv, un opérateur D9 surnommé « le niveleur de Jabalia » en raison des vidéos de destruction qu'il a publiées sur les réseaux sociaux, a expliqué ses méthodes dans une interview accordée à Channel 14.
« Je n'avais jamais vu un tracteur de ma vie, seulement en photo », a déclaré Avraham Zarviv, qui est juge au tribunal rabbinique dans la vie civile. La brigade Givati, dans laquelle il a servi, a décidé quelques mois après le début de la guerre de créer une unité d'ingénierie spécialisée dans les opérations de démolition. « Nous sommes montés sur des tracteurs, des D9, des excavatrices… nous avons appris le métier, nous sommes devenus très professionnels. Vous ne comprenez pas ce que c'est que de démolir un immeuble – sept, six, cinq étages – les uns après les autres. »
Entre octobre 2024 et janvier 2025, Avraham Zarviv a déclaré avoir détruit en moyenne « 50 bâtiments – pas des logements, des bâtiments… A Rafah, ils n'ont nulle part où aller, à Jabalia, ils n'ont nulle part où retourner. » Avraham Zarviv est récemment retourné servir à Rafah. Avant le seder de Pâque en avril dernier, il a mis en ligne une vidéo de Rafah le montrant devant une rue où certains bâtiments étaient encore debout. Avraham Zarviv n'a pas précisé dans la vidéo ce qu'il faisait exactement à Rafah, mais a déclaré qu'il était revenu « pour se battre jusqu'à la victoire, jusqu'à la colonisation… Nous sommes ici pour toujours. »
Alors que certains opérateurs D9 comme Zarviv ont fièrement vanté leurs crimes de guerre, d'autres soldats ne parlent pas publiquement de la destruction. Selon Y., « il y a une certaine indifférence : les gens en sont à leur quatrième ou cinquième déploiement, ils s'y sont habitués ». Mais quel que soit leur niveau de zèle, affirme Y., les soldats comprenaient à quoi servaient les bulldozers. « Il n'y a pas eu d'ordre officiel [de détruire Rafah], mais le message est clair : nous allons tout détruire. »
L'armée a procédé à l'anéantissement complet de Rafah malgré le fait, comme l'a souligné Y., qu'« il n'y a eu aucune confrontation [avec des combattants du Hamas], nous n'avons croisé que des ambulanciers », en référence à l'incident au cours duquel des soldats israéliens ont tué 15 ambulanciers et pompiers dans le quartier de Tel Al-Sultan [voir sur ce site l'article publié le 5 avril 2025].
Comme Y., les autres soldats interrogés par +972 et Local Call ont déclaré n'avoir vu aucun ordre écrit de l'état-major de l'armée pour procéder aux démolitions, et que ces ordres provenaient généralement de la brigade ou de la division.
L'ancien haut responsable de la sécurité a déclaré avoir contacté l'état-major après avoir appris la destruction systématique dans le nord de la bande de Gaza, et il est « convaincu que cela ne venait pas du chef d'état-major [Herzi Halevi], mais qu'il a perdu le contrôle de la situation. La destruction qui n'est pas liée à des objectifs militaires est un crime de guerre. Cela venait d'en bas [des officiers de niveau intermédiaire, notamment les commandants de brigade et de bataillon]. La vengeance n'est pas un objectif militaire [officiel], mais on a laissé faire. »
« Quand tu entres dans une maison, tu la fais sauter »
H. a servi deux fois dans la réserve à Gaza, la première fois au début de 2024, et la seconde entre mai et août en tant que commandant de la salle des opérations d'un bataillon stationné dans le corridor de Netzarim. « Lors de ma première période de réserve, j'étais à Khirbet Khuza'a [un village près de Khan Younès]. Nous avons tout détruit, mais il y avait une logique : élargir la ligne de contact [zone tampon] parce qu'elle était proche de la frontière. [La deuxième fois], la zone où nous nous trouvions était le long du corridor de Netzarim, près de la mer. Il n'y avait aucune justification opérationnelle pour démolir les bâtiments. Ils ne représentaient aucune menace pour Israël. C'était devenu une routine : l'armée s'était habituée à l'idée que lorsqu'on entre dans une maison, on la fait exploser. Ce n'était pas une initiative locale, cela venait du commandant du bataillon ».
H. a poursuivi : « Les cibles à démolir [les bâtiments marqués pour destruction] étaient transmises à la brigade. Je suppose que cela remontait jusqu'à la division. Le commandant du bataillon marquait les bâtiments d'un X et vérifiait la quantité d'explosifs disponible. Il envoyait un commandant de compagnie vérifier qu'il n'y avait pas de prisonniers de guerre ou de personnes disparues [otages] à l'intérieur. Dans les cas où des Palestiniens se trouvaient encore dans les maisons, on leur disait de partir, mais c'était rare. »
Selon H., les destructions étaient quotidiennes. « Certains jours, nous démolissions huit à dix bâtiments, d'autres jours aucun. Mais au total, pendant les 90 jours où nous étions là-bas, mon bataillon a détruit entre 300 et 400 bâtiments. Nous nous éloignions de 300 mètres [du bâtiment] et nous le faisions exploser. »
Lorsque H. est arrivé dans le corridor de Netzarim en mai 2024, celui-ci ne s'étendait que sur quelques dizaines de mètres de large au nord et au sud. A la fin de son service, trois mois plus tard, les démolitions avaient élargi le corridor à sept kilomètres de chaque côté. « Nous avons pris trois kilomètres à Zaytoun [au nord de Netzarim] et également à Al-Bureij et Nuseirat [au sud]. Il ne reste plus rien, pas un seul mur de plus d'un mètre de haut », a-t-il déclaré. « L'ampleur et l'intensité de la destruction sont tellement gigantesques que c'est indescriptible. »
Yotam, le commandant adjoint de la compagnie, a rejoint les réserves le 7 octobre et a servi pendant 207 jours à Gaza, participant à la première incursion terrestre dans la ville de Gaza et le long du corridor de Netzarim. Il a ensuite été renvoyé de l'armée après avoir signé une lettre appelant les soldats à cesser de servir jusqu'à la libération des otages.
« Nous nous réveillions et le bataillon se voyait attribuer une compagnie du génie pour la journée, ainsi qu'une quantité spécifique d'explosifs », a expliqué Yotam, décrivant comment les missions de démolition commençaient. « Cela signifiait démolir entre un et cinq bâtiments [par jour]. »
En tant que commandant adjoint de la compagnie, Yotam était chargé de diriger les missions. « Je suis allé voir le commandant du bataillon qui m'a dit : “Trouvez quelque chose d'important sur le terrain et démolissez-le.” Je lui ai répondu : “Je ne ferai pas une mission comme ça.” Je suis donc allé voir le commandant de la compagnie du génie, nous avons ouvert une carte et sélectionné cinq bâtiments. Si nous ne l'avions pas fait, ils auraient simplement choisi des bâtiments au hasard – de toute façon, ils voulaient démolir tout le quartier. Le sentiment général était : “Nous avons une compagnie du génie aujourd'hui, allons détruire quelque chose.” »
Comme d'autres soldats qui se sont entretenus avec +972 et Local Call, Yotam a affirmé que l'objectif militaire principal de la deuxième phase de la guerre, en mars et avril 2024, était la destruction pour la destruction. Il a ajouté qu'un commandant de division avait déclaré qu'il s'agissait d'un « moyen de pression sur le Hamas » pour parvenir à un accord sur les otages, mais qu'au niveau pratique « ce n'est pas une mission opérationnelle. Elle ne sert aucun objectif concret. Il n'y a pas de protocole établi. »
Yotam a déclaré que dans la région de Netzarim, les unités sur le terrain avaient une grande liberté pour décider de ce qu'elles voulaient détruire. « La logique opérationnelle était que ce territoire était détenu par l'armée israélienne et ne serait pas rendu de sitôt, et que personne ne se souciait de la vie des Palestiniens qui s'y trouvaient. Ce n'est pas une zone qui va redevenir un quartier palestinien. J'ai vu de mes propres yeux des centaines de bâtiments rasés. Des quartiers entiers au nord de l'hôpital de l'amitié turco-palestinienne [dans le centre de la bande de Gaza] ont été détruits. On ne peut rester indifférent à une destruction d'une telle ampleur. »
« Un spectacle tous les soirs »
Plusieurs soldats interrogés ont décrit les rituels cérémoniels qui accompagnaient les démolitions à Gaza. Un caporal réserviste de la brigade 55 qui a servi près de Khan Younès a raconté son expérience lors de missions : « Nous passions dans les maisons, nous vérifiions qu'il n'y avait pas d'informations intéressantes ni de militants présents, puis l'unité du génie entrait dans chaque bâtiment avec des charges de 10 kg qu'elle fixait aux piliers. C'était comme un spectacle tous les soirs : un officier supérieur, généralement un commandant de compagnie ou plus haut gradé, communiquait par radio avec l'unité de déminage et le corps du génie, prononçait un discours expliquant pourquoi nous étions là, comptait à rebours, puis boum. Nous regardions derrière nous et il ne restait plus rien. »
Yotam a également évoqué ces rituels pendant son service de réserve à Gaza. « Quand une rangée de bâtiments était détruite, le commandant du bataillon prenait la radio, prononçait un discours héroïque sur quelqu'un qui était mort et sur la nécessité de poursuivre la mission, puis ils faisaient exploser toute une rangée de bâtiments. »
Une autre pratique courante consistait à incendier les maisons que les forces israéliennes avaient utilisées comme installations militaires temporaires, marquant ainsi la fin d'une mission, comme l'a déjà documenté +972 le 8 juillet 2024. « C'était une routine, ils le faisaient tout le temps », a déclaré Yotam. « Plus tard, ils ont arrêté et n'ont brûlé que les maisons qui avaient servi de centres de commandement. »
Les soldats comprenaient également la signification plus large de ces démolitions ritualisées. En l'absence de tout objectif opérationnel, elles servaient un objectif politique et idéologique : rendre Gaza invivable pour les générations à venir.
« En fin de compte, nous ne combattons pas une armée, nous combattons une idée », a déclaré le commandant du bataillon 74 au journal israélien Makor Rishon [quotidien ultranationaliste et conservateur qui prône l'annexion des territoires palestiniens] en décembre 2024. « Si je tue les combattants, l'idée peut subsister. Mais je veux rendre cette idée irréalisable. Quand ils regardent Shuja'iyya et voient qu'il n'y a plus rien, juste du sable, c'est ça le but. Je ne pense pas qu'ils pourront revenir ici avant au moins 100 ans. »
« Personne ne sait mieux que nous que les Gazaouis n'ont nulle part où retourner », a expliqué un commandant dont le bataillon a participé à la destruction d'environ un millier de bâtiments en deux mois en 2025. Un soldat qui a servi dans le même bataillon a ajouté : « L'idée était de tout détruire. Juste créer des zones de destruction. »

« Vous détruisez toute une rue en un seul coup »
En avril 2025, le journaliste israélien Yaniv Kubovich est entré dans « le corridor de Morag » – la bande de terre que l'armée a nettoyée entre Khan Younès et Rafah – et a rapporté avoir vu les restes d'un ancien véhicule blindé de transport de troupes (APC) près d'un des bâtiments détruits.
Les soldats lui ont expliqué qu'il s'agissait d'une autre méthode utilisée pour faire s'effondrer les bâtiments, qui cause d'importants dégâts à l'environnement. « L'armée israélienne charge [le véhicule blindé] d'explosifs et l'envoie de manière autonome dans une rue ou un bâtiment préalablement bombardé par l'armée de l'air. Mais après un an et demi de guerre, les véhicules blindés remplis d'explosifs sont devenus une alternative moins coûteuse. »
Selon Yaniv Kubovich, les restes de ces véhicules blindés explosifs sont désormais visibles partout dans la bande de Gaza, et leur utilisation semble s'être considérablement développée depuis le début de la guerre.
A., qui a effectué plusieurs missions à Gaza, a déclaré à +972 et Local Call que cette méthode ne se limite pas aux anciens APC. « Vous prenez deux conteneurs géants, vous utilisez des dizaines, voire des centaines de litres d'explosifs, et à l'aide d'un D9 ou d'un Bobcat [petit bulldozer] télécommandé, vous les placez à un endroit prédéterminé, puis vous les faites exploser. En un seul coup, vous détruisez toute une rue. Une fois, nous sommes entrés dans un complexe qui servait autrefois de centre éducatif pour les jeunes. Nous y avons passé une nuit, puis ils l'ont fait sauter. Nous étions à un kilomètre et demi [de l'explosion] et nous avons quand même senti le souffle passer au-dessus de nous, comme une forte rafale de vent. J'ai cru que le bâtiment s'était effondré sur moi. »
A. a déclaré que cette méthode était parfois utilisée à des fins relativement opérationnelles : faire exploser une zone soupçonnée de contenir un engin explosif, par exemple, ou dégager le passage pour les troupes.
Mais Yotam l'a décrite comme un autre outil principalement utilisé pour détruire des bâtiments. « La mission est définie une fois que vous recevez la quantité [d'explosifs] qui vous est allouée, puis c'est : “OK, allez-y”. Une partie de la mission politico-militaire consiste à raser des bâtiments ou à rendre une zone inutilisable. » Y., qui a récemment servi à Rafah, a également témoigné : « Chaque nuit, ils font exploser un ou deux [de ces véhicules blindés]. La force est incroyable, ça rasera tout autour. »
Alors que les forces israéliennes rasent Rafah, les dizaines de milliers de Palestiniens contraints d'évacuer en avril peuvent entendre de loin la destruction de leurs maisons. Le Dr Ahmed al-Sufi, maire de Rafah, a déclaré à +972 et Local Call que lorsqu'il est retourné dans la ville en janvier, au début du cessez-le-feu, il a été choqué par l'ampleur des destructions. Aujourd'hui, à nouveau déplacé à l'extérieur de Rafah, il entend les bombardements aériens et les explosions incessantes au sol, et il craint que la situation ne soit bien pire. « Personne ne sait à quoi ressemble la ville aujourd'hui, mais nous nous attendons à ce qu'elle soit complètement détruite. Il sera très difficile pour les habitants de revenir. »
« L'armée israélienne utilise diverses méthodes pour détruire la ville, soit par des bombardements aériens incessants, soit en faisant exploser des bâtiments piégés », a expliqué Mohammed Al-Mughair, directeur de l'approvisionnement de la défense civile à Gaza. « Il y a également des robots piégés qui sont envoyés dans des maisons et des quartiers entiers et qui explosent à l'intérieur. Il y avait plusieurs zones où des bâtiments étaient encore intacts et habitables [pendant le cessez-le-feu], mais avec ces bombardements incessants, nous ne savons pas ce qui s'est passé, en particulier dans les zones entourant le corridor de Morag. »
« Notre objectif était de détruire les villages chiites »
Cette politique de destruction systématique – une tactique visant à empêcher les civils de retourner chez eux – a également été mise en œuvre lors de l'invasion terrestre de deux mois menée par Israël dans le sud du Liban. Une analyse des images satellites réalisée fin novembre 2024, peu après la conclusion du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, a révélé que 6,6% de tous les bâtiments situés dans les districts au sud du fleuve Litani avaient été complètement ou fortement détruits.
G., réserviste dans le bataillon du génie 7064, s'est présenté à l'entraînement à l'été 2024, avant l'invasion prévue. Il a déclaré à +972 et Local Call que le briefing indiquait explicitement que l'objectif du bataillon était de détruire les villages chiites. « Lors de l'entraînement à la démolition avant l'invasion [terrestre], un major du bataillon nous a expliqué que notre objectif en entrant au Liban serait de détruire les villages chiites. Il n'a pas parlé de “terroristes”, d'“ennemis” ou de “menaces”. Il n'a utilisé aucun terme militaire, juste « villages chiites ». Il s'agit d'une destruction sans objectif militaire, uniquement politique. L'objectif était d'empêcher les habitants de revenir. Cela a été clairement énoncé. L'idée était qu'il n'y aurait aucune possibilité de reconstruction après la guerre. Rétrospectivement, nous avons vu qu'ils avaient détruit des écoles, des mosquées et des installations de purification de l'eau. » Il a refusé de se présenter pour d'autres missions de réserve, mais n'a pas été puni.
Pendant la formation de G., aucune distance spécifique par rapport à la frontière n'a été fixée comme limite pour la destruction, mais « la brigade 769, dont nous dépendions, a décidé d'un rayon de 3 kilomètres. D'après ce que j'ai vu [du côté israélien de la frontière], ils ont réussi. » Dans une interview accordée à Srugim [journal en ligne], le commandant de la Brigade 769 a confirmé ces propos : « Partout où il y a du terrorisme, des soupçons de terrorisme ou même un parfum de terrorisme, je détruis, démolis et élimine. »
L., un réserviste qui a servi à Gaza et sur le front oriental du Liban, a déclaré que l'armée avait fait venir « un nombre considérable de forces du génie, tant régulières que de réserve ». Son unité au Liban « n'a rencontré que peu ou pas de résistance, bien moins que prévu », et l'un des objectifs était « de détruire toutes les infrastructures des villages, car presque tous étaient considérés comme des bastions du Hezbollah. Ils ont commencé à détruire les villages de manière assez complète et intense – presque toutes les maisons, pas seulement celles marquées comme étant celles des commandants du Hezbollah. Mines, explosifs, pelleteuses, D9 – [ils ont utilisé] tous les outils pour démolir les bâtiments. Ils ont également détruit les infrastructures électriques, hydrauliques et de communication, afin de les rendre inutilisables à court terme, et même si [les habitants] reviennent, il faudra beaucoup de temps pour les reconstruire. »
Selon L., les maisons épargnées étaient souvent celles appartenant à des familles chrétiennes. « J'ai remarqué que les bâtiments avec des croix à l'intérieur restaient souvent debout », a-t-il expliqué.
G., comme indiqué, a refusé d'entrer au Liban afin de ne pas participer à la destruction des villages, mais depuis le côté israélien de la frontière, il a vu et entendu ce que son bataillon faisait là-bas. « Une partie des destructions a eu lieu après que tout avait déjà été conquis et qu'il n'y avait plus de résistance… J'ai vu des preuves de destructions intentionnelles sur le WhatsApp du bataillon. Des soldats du bataillon se sont filmés en train de faire sauter des bâtiments. Mon bataillon n'est entré qu'après qu'il n'y avait plus de Hezbollah, plus d'armes, plus de bâtiments utilisés à des fins militaires secondaires [contre Israël] – rien qui [puisse être pris pour cible] en vertu du droit de la guerre. »
Cette logique de destruction massive a également été appliquée en Cisjordanie, bien qu'à une échelle moindre. En fait, une source militaire a déclaré à +972 et Local Call que la nature des destructions à Gaza découle des tactiques développées par l'armée lors de l'opération « Bouclier défensif » en Cisjordanie pendant la deuxième Intifada –« mettre à nu le terrain » dans le jargon militaire.
Selon un rapport de l'OCHA (Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU) datant de mars 2025, depuis le début de l'année 2024, Israël a démoli 463 bâtiments en Cisjordanie dans le cadre d'activités militaires, déplaçant près de 40 000 Palestiniens des camps de Jénine, Nur Shams et Tulkarem dans le cadre de l'« opération Mur de fer ». Dans le camp de réfugiés de Jénine, comme l'a déjà rapporté +972, l'armée a fait exploser des quartiers résidentiels entiers et rasé des rues dans le cadre d'une campagne visant à remodeler le camp afin de réprimer la résistance palestinienne et de saper le droit au retour. L'armée a récemment annoncé son intention de démolir 116 autres maisons dans les camps de réfugiés de Tulkarem et Nur Shams.
D'après les chiffres fournis par des soldats ayant servi à Gaza, un seul bataillon dans la bande de Gaza pourrait détruire autant de bâtiments en une semaine. Mais l'idée sous-jacente est la même. La destruction n'est plus simplement le résultat des activités militaires d'Israël, ni une partie d'une stratégie militaire plus large : elle semble être l'objectif même.
Le porte-parole de l'armée israélienne a répondu à notre demande de commentaires par la déclaration suivante : « L'armée israélienne n'a pas pour politique de détruire des bâtiments en tant que tels, et toute démolition d'une structure doit respecter les conditions établies par le droit international. Les allégations concernant les déclarations de soldats au sujet de démolitions sans rapport avec des objectifs opérationnels ne sont pas suffisamment détaillées et ne correspondent pas aux politiques et aux ordres de l'armée israélienne. Les incidents exceptionnels font l'objet d'un examen par les mécanismes d'enquête et de contrôle de l'armée israélienne.
»L'armée israélienne opère sur tous les fronts dans le but de contrecarrer le terrorisme dans un contexte sécuritaire complexe, où les organisations terroristes établissent délibérément des infrastructures terroristes au sein des populations et des structures civiles. Les affirmations contenues dans l'article reflètent une incompréhension des tactiques militaires du Hamas dans la bande de Gaza et de la mesure dans laquelle ces tactiques impliquent des bâtiments civils.
»En Cisjordanie (Judée-Samarie) également, les organisations terroristes opèrent et exploitent la population civile comme boucliers humains, la mettant ainsi en danger. Elles plantent des explosifs et cachent des armes dans la région. Dans le cadre de la campagne contre le terrorisme dans le nord de la Samarie, les routes de la région sont parfois détruites, ce qui nécessite la démolition de bâtiments conformément à la loi. Cette décision a été prise pour des raisons opérationnelles et après examen des alternatives.
»L'armée israélienne continuera d'agir conformément à la loi [israélienne] et au droit international, de neutraliser les bastions terroristes et de prendre toutes les précautions possibles pour minimiser les dommages causés aux civils. »
Article publié par le site +972, une version en hébreu a été publiée sur le site Local Call, le 15 mai 2025 ; traduction rédaction A l'Encontre.
Meron Rapoport est rédacteur à Local Call. Oren Ziv est photojournaliste, reporter pour Local Call et membre fondateur du collectif de photographes Activestills.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

SOS Palestine. Levons-nous contre l’extermination et la barbarie !

Israël affame Gaza jusqu'à la mort dans le cadre de sa stratégie d'« offensive finale ». Les mouvements humanitaires et des travailleur·ses du monde entier doivent se mobiliser pour mettre fin au génocide !
Tiré de Inprecor
16 mai 2025
Par Bureau exécutif de la IVe Internationale
Jaber Jehad Badwan, CC BY-SA 4.0
La barbarie perpétrée par l'État sioniste d'Israël contre le peuple palestinien est sans limite. Au-delà les 120 000 blessé·es et 52 000 civil·es tué·es (selon les chiffres officiels), dont des milliers d'enfants et de femmes, les 1,9 million de personnes déplacées à l'intérieur du pays (80 % des habitants de Gaza), les attaques contre les convois de solidarité, l'exécution de médecins et de journalistes, ces dernières semaines, le génocide qui dure depuis 19 mois a pris des contours encore plus terrifiants.
Depuis la fin du cessez-le-feu en mars, Netanyahou, son cabinet d'extrême droite et les faucons de l'armée, avec le soutien direct des États-Unis et le soutien indirect des pays européens, torturent la population de Gaza par la faim et le manque de médicaments, en raison du siège du territoire et de l'interdiction de toute aide humanitaire, des frappes aériennes sur les hôpitaux et les infrastructures alimentaires.
L'ONU, Oxfam, Amnesty International et d'autres observateurs des droits humains rapportent que la famine à Gaza est « pire qu'avant le cessez-le-feu ». Les infrastructures du territoire sont au bord de l'effondrement total, 93 % de la population est confrontée à une insécurité alimentaire aiguë, au niveau de l'extermination par la famine. Les décès dus à la malnutrition aiguë, à la déshydratation, aux maladies et aux blessures non soignées sont très nombreux, tandis que le carburant, l'eau, l'électricité et les fournitures médicales font défaut.
La torture collective actuellement infligée est un instrument délibéré du gouvernement qui est la pointe avancée de l'extrême droite mondiale : le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a annoncé sans ambages que, comme au cours des deux derniers mois, Israël continuera d'empêcher toute entrée de nourriture, d'eau, de médicaments et de carburant à Gaza. Il a également défendu le bombardement d'entrepôts alimentaires et de générateurs électriques. Et la torture collective des Gazaoui·es n'est qu'un moyen opportun pour préparer une offensive « finale » visant à « libérer Gaza du Hamas », comme l'a annoncé Netanyahou début mai.
Comme l'a fait remarquer un militant palestinien dans un grand journal britannique, les génocidaires utilisent des moyens bon marché, silencieux et brutaux pour commettre des meurtres de masse.
Briser le silence qui tue
Les gouvernements impérialistes et les médias complices tentent de faire taire les voix de la protestation, soit en effaçant l'information, soit par la répression. La stratégie dans ce cas est de faire passer la barbarie qui se déroule en Palestine comme « naturelle » et acceptable.
Nous devons de toute urgence briser ce mur de silence et d'inaction !
La Quatrième Internationale se joint à l'appel lancé par La Via Campesina et 17 autres organisations pour la mobilisation des États et des agences internationales, qui ont l'obligation légale d'intervenir lorsqu'il y a obstruction à l'aide humanitaire d'une manière qui contribue au génocide, aux crimes de guerre ou aux crimes contre l'humanité.
Il est nécessaire et urgent d'intensifier la pression sur les gouvernements, principalement ceux de gauche, de centre-gauche et démocrates, afin qu'ils acceptent de collaborer à la création de couloirs humanitaires et à la mise en place de forces de protection pour les civils de Gaza, comme le propose La Via Campesina. Les mouvements sociaux et les partis de gauche ont un rôle fondamental à jouer dans cet effort, à travers des rassemblements, des pétitions, des manifestations, des campagnes téléphoniques et des journées mondiales d'action coordonnées. Les parlementaires et les dirigeants de masse du monde entier sont appelés à lancer une offensive concentrée pour dénoncer cette nouvelle phase du génocide.
En ce terrible anniversaire de la Nakba, la Quatrième Internationale appelle à une mobilisation internationale de masse, sur le long terme, en solidarité avec le peuple palestinien. Nous exigeons que les gouvernements complices rompent toutes leurs relations économiques, diplomatiques et universitaires avec l'État génocidaire. Occupons les rues, les universités et les lycées ! Luttons pour empêcher les bateaux transportant les instruments de mort d'atteindre Israel ! Interdisons la répression contre les voix et les organisations qui défendent la Palestine,
• Mettons fin au siège et au blocus humanitaire meurtrier imposé par Israël, avec le silence complice des gouvernements de droite et d'extrême droite !
• Dans les rues et dans les parlements, faisons pression sur les gouvernements et les agences internationales officielles pour qu'ils prennent immédiatement position et agissent contre le blocus de Gaza.
• Soutien total à la Flottille pour la liberté, qui tente de rejoindre les côtes de Gaza avec de l'aide humanitaire !
• Pour une large coalition d'organisations sociales et humanitaires nationales et internationales afin de coordonner les initiatives mondiales contre le génocide !
Le 15 mai 2025
Déclaration du Bureau exécutif de la Quatrième Internationale
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Action surprise à Montréal, la poste pourrait être en grève vendredi
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.















