Derniers articles

« Nettoyage ethnique » aux Etats-Unis

Les pratiques antimigratoires en vigueur dans ce qui était une grande démocratie sont en train de transformer le territoire étatsunien en une vaste zone frontalière. La peur s'installe dans le pays qui protégeait jadis ceux qui cherchaient la sécurité.
Manouk BORZAKIAN (Neuchâtel, Suisse), Gilles FUMEY (Sorbonne Univ./CNRS). Renaud DUTERME (Arlon, Belgique), Nashidil ROUIAI (U. Bordeaux), Marie DOUGNAC (U. La Rochelle)
15 août 2025 | tiré d'un blog de mediapart.fr | Illustration : Le camp d'Alcatraz Alligator en Floride
https://blogs.mediapart.fr/geographies-en-mouvement/blog/150825/nettoyage-ethnique-aux-etats-unis
Dans l'histoire et la géographie de l'enfermement, donc de la privation d'espace, on atteint aux États-Unis trumpiens un niveau rarement égalé de violence et de sadisme à l'égard des humains. Olivier Milhaud avait ouvert la thématique d'une géographie des prisons. Espérons qu'il sera suivi par une jeune génération sur celle des camps de migrants.
Les États-Unis ont ouvert en juillet 2025 un centre de détention pour les personnes migrantes. Un « centre de concentration » au cœur d'un marécage infesté d'au moins 200 000 alligators dont la taille des adultes atteint quatre mètres. Situé dans les Everglades de la Floride, un nouveau bâtiment est sorti de terre en moins de dix jours. Des tôles, des grillages derrière lesquels on entasse neuf exilés par cellule, sans soins, sans nourriture propre à la consommation et de la lumière par des néons 24h/24.
Pour l'Observatoire sur les 'Etats-Unis et le consortium pancanadien de recherches Borders in Globalization, Elizabeth Vallet n'a pas peur des mots : c'est un « centre de concentration ». Donald Trump s'est permis des blagues sur ceux qui risqueraient leur vie en s'enfuyant, comme les bagnards sur l'île du Diable en Guyane au temps de Dreyfus : « Les serpents sont rapides, mais les alligators… » a-t-il plaisanté. Trump feignant de craindre qu'on apprenne aux prisonniers à échapper aux reptiles, a voulu qu'on appelle ce centre l'« Alcatraz des alligators », en allusion au fort de la baie de San Francisco où se trouve le fameux pénitencier.
La journaliste Elie Hervé rapporte les propos d'Elizabeth Vallet : « Ce qui définit la politique migratoire de Trump, c'est la mise en place d'une politique répressive et de la cruauté dont il fait preuve à l'encontre des personnes exilées. » Même pour certains détenteurs de carte verte qui sont aussi enfermés. Ces pratiques s'ajoutent à des renvois de migrants vers une prison du Salvador, voire le sinistre camp militaire de Guantanamo à Cuba, ouvert à la suite des attentats du 11-Septembre. Une politique surprenante, visant à contourner les refus de certains États à récupérer leurs citoyens. En juillet, certains exilés ont été renvoyés au Soudan du Sud, pays en guerre, alors qu'ils n'en sont pas originaires.
Tout comme le ministre Bruno Retailleau a mobilisé 4000 forces de l'ordre les 18 et 19 juin 2025 pour interpeller illégalement plusieurs dizaines de milliers de migrants dans les gares et les bus à Paris, Trump a demandé à la police fédérale de l'immigration (ICE) aidée par des Marines d'arrêter des hispaniques dans les hôpitaux, les tribunaux, les magasins de bricolage et jusque dans les écoles. Pour Elizabeth Vallet, s'installe un climat de peur dans la société étatsunienne. « Les coupes dans le domaine de la santé, de l'éducation, des services sociaux, de l'aide au développement, dans des services administratifs bénéficiant de l'ICE sont en train de faire de cet office un État dans l'État. »
Trump n'a pas la primeur de cette politique. L'histoire rappelle que dans les années 1920, il ne faisait pas bon migrer aux États-Unis et que le Ku Klux Klan, organisation terroriste suprémaciste des années 1860 agissait ainsi. Mais la nouveauté est qu'aujourd'hui, la traque aux migrants est décidée d'en haut. Les gardes-frontières, les policiers, les membres de l'ICE agissent partout sur le territoire : « L'ensemble du pays est devenu une zone frontalière, un espace où l'arbitraire est maître ». Les centres de détention prospèrent, gérés par des sociétés privées qui font des profits, en faisant travailler les détenus, les migrants « pour un salaire dérisoire qui s'apparente à du travail forcé » selon Elizabeth Vallet. Une situation dont il sera difficile de suivre l'évolution, en évitant les mensonges du président : certaines personnes arrêtées ne sont pas enregistrées. Et donc, ne peuvent pas faire valoir leurs droits.
L'indécence et le cynisme atteignent-ils leur somment lorsque l'influenceuse d'extrême-droite, Laura Loomer, osait déclarer que « les alligators auraient au moins 65 millions de repas ». 65 millions, c'est le nombre d'Hispaniques dans le pays. « Ce que Trump met en place, c'est un nettoyage ethnique, pour le chercheur José Angel Maldonado, né au Honduras. Il veut façonner une Amérique blanche et, pour cela, il n'a plus aucune limite. »
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Washington : la contestation grandit face à la prise de pouvoir de Trump

Six États dirigés par des Républicains se sont désormais engagés à envoyer des troupes de la Garde nationale pour appuyer la prise de contrôle de Washington, D.C., par l'administration Trump, laquelle a assumé le commandement des forces de police au nom de la lutte contre le crime. En y ajoutant la Garde nationale de D.C., que Trump contrôlait déjà, cela porte à plus de 2 000 le nombre de soldats déployés dans les rues de la capitale. Cette mise sous tutelle fédérale intervient alors même que la criminalité violente dans la capitale est à son plus bas niveau depuis 30 ans — des chiffres que l'administration Trump conteste, le ministère de la Justice ayant ouvert une enquête pour déterminer si les responsables municipaux avaient manipulé les statistiques.
« Ce que nous voyons, c'est l'illégalité, mais elle vient entièrement de la Maison-Blanche », déclare l'activiste communautaire Keya Chatterjee, directrice du groupe Free DC.
20 août 2025 | tiré de democracy.now
AMY GOODMAN : Le Tennessee est devenu le sixième État républicain à accepter d'envoyer des troupes de la Garde nationale à Washington, D.C., afin d'appuyer la mainmise grandissante du président Trump sur la capitale nationale. Les gouverneurs républicains de Louisiane, de l'Ohio, de la Caroline du Sud, de la Virginie-Occidentale et du Mississippi font de même. Une partie des troupes est arrivée mardi. Ces gouverneurs ont mobilisé leur Garde nationale même si plusieurs de leurs villes connaissent des taux de criminalité pires que ceux de D.C. Selon le média The Handbasket, des membres de la Garde nationale de D.C. ont commencé à s'entraîner à porter des armes de poing dans les rues de la capitale.
Trump a envoyé la Garde nationale la semaine dernière en déclarant que D.C. faisait face à une « urgence criminelle », alors que les archives montrent que la criminalité violente y est au plus bas depuis 30 ans. En janvier, le bureau du procureur fédéral du district avait publié un communiqué intitulé « La criminalité violente à D.C. atteint son plus bas niveau depuis 30 ans ». Mais Trump a mis en doute ces chiffres, et les procureurs fédéraux ont lancé une enquête criminelle pour savoir si la police locale avait manipulé les données. Cette enquête est supervisée par l'avocate par intérim nommée par Trump pour le district de Columbia : l'ancienne animatrice de Fox News, Jeanine Pirro.
Pendant ce temps, The Washington Post rapporte qu'un nouveau sondage indique que 80 % des habitants de D.C. s'opposent au décret fédéralisant les forces de l'ordre. La mairesse Muriel Bowser a accusé Trump de mener une offensive autoritaire. Voici ses propos :
MURIEL BOWSER : « Les chiffres dans le district ne justifient pas l'arrivée de mille personnes d'autres États. Vous le savez… Ce n'est pas logique. Si vous voulez comprendre ce qui se passe, la question n'est pas pour nous, mais pour savoir pourquoi l'armée est déployée dans une ville américaine pour y surveiller des Américains. »
AMY GOODMAN : Des organisateurs communautaires se sont mobilisés contre le déploiement de la Garde nationale. Voici Samantha Davis, fondatrice de la Black Swan Academy, qui œuvre pour l'autonomisation des jeunes noirs :
SAMANTHA DAVIS : « Ce n'est pas une question de criminalité, c'est une question de contrôle. Ce n'est pas une question de sécurité publique, c'est une question de pouvoir. La semaine dernière, Donald Trump a proposé que nos enfants à D.C., dès 14 ans, soient jugés comme des adultes. Voulez-vous ça ? »
PUBLIC : « Non ! »
SAMANTHA DAVIS : « Et la procureure de Trump a dit qu'elle voulait poursuivre nos jeunes, mais qu'elle était frustrée parce qu'elle “ne pouvait pas mettre la main sur eux”. Voulez-vous ça ? »
PUBLIC : « Non ! »
SAMANTHA DAVIS : « Trump a menacé que si D.C. ne punissait pas plus sévèrement nos enfants, il fédéraliserait notre ville. Voulez-vous ça ? »
PUBLIC : « Non ! »
SAMANTHA DAVIS : « Nous ne sacrifierons pas nos enfants à un tyran. »
AMY GOODMAN : Nous allons maintenant à D.C., avec Keya Chatterjee, directrice de Free DC. Pouvez-vous nous faire un point sur les troupes déployées ?
KEYA CHATTERJEE : « Ce que nous voyons ici, c'est une situation qui, si D.C. était un État, serait considérée comme un acte de guerre civile. Des Gardes nationaux envoyés d'un État vers un autre, contre la volonté des élus locaux et des habitants. C'est le manuel classique d'un dictateur : prendre le contrôle de la capitale pour faire taire la dissidence.
Nous sommes vulnérables car D.C. n'est pas un État. Nos élus ne contrôlent même pas notre propre Garde nationale. Cette prise de pouvoir armée met en danger non seulement les habitants de D.C., mais aussi la démocratie américaine et, par extension, le monde entier. Nous voyons déjà des postes de contrôle illégaux, des fouilles humiliantes, des arrestations arbitraires. Tout cela, c'est l'illégalité organisée, mais elle vient de la Maison-Blanche. »
Vie quotidienne et résistance
Chatterjee décrit la peur quotidienne : habitants enlevés dans la rue par des agents fédéraux masqués, familles sans nouvelles de leurs proches. Mais aussi la résistance :
- solidarité de voisinage,
- musique go-go dans les rues,
- casserolades tous les soirs à 20 h, symbolisant les huit quartiers de la ville.
- « C'est une méthode éprouvée contre les dictateurs : répondre par la joie, la communauté, la fierté culturelle », dit-elle.
- Sur les financements bloqués
- Le Congrès a gelé 1,1 milliard de dollars de fonds locaux de D.C. :
- « Si le gouvernement voulait la sécurité, il permettrait d'investir dans le logement, l'éducation, la santé et l'alimentation, ce qui réduit la criminalité. Au lieu de cela, il bloque nos ressources. C'est du vol pur et simple. Et rappelons-le : l'absence d'égalité juridique pour D.C. est un héritage direct de l'esclavage et du racisme. Aujourd'hui, on doit choisir : être du côté de D.C. et de l'égalité, ou être du côté de la tyrannie. »
Les sans-abri visés
JESSE RABINOWITZ, du National Homelessness Law Center :
« Enfermer les gens qu'on ne veut pas voir, c'est du pur autoritarisme. Trump commence par cibler les sans-abris, les personnes trans et les migrants, parce qu'il pense qu'ils n'ont pas de soutien populaire. Mais bientôt, ce sera tous ceux qui ne sont pas des hommes blancs, riches, cisgenres, chrétiens et héérosexuels. »
KEYA CHATTERJEE ajoute :
« Ils détruisent les campements, jettent les affaires des gens à la poubelle. Ils veulent criminaliser la pauvreté, criminaliser l'existence même de ceux qui dorment dehors. Mais ce sont nos voisins, une partie intégrante de notre communauté. Nous exigeons que cette brutalité cesse immédiatement. »
Conclusion :
Les habitants de D.C. restent unis pour exiger le départ immédiat des troupes fédérales et de la Garde nationale déployées par Trump.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Tunisie : après la démocratie, les libertés syndicales dans le viseur

Depuis début août 2025, l'Union générale tunisienne du travail (UGTT) est la cible d'attaques frontales par le président tunisien Kaïs Saïed et ses partisans. Le 7 août, des manifestants ont attaqué le siège de la Centrale tunisienne. Cette tentative d'assaut de son siège a été suivie par une déclaration du président tunisien en soutien aux manifestants, avec une menace à peine voilée, visant à criminaliser l'action syndicale et à affaiblir l'UGTT. Ces attaques interviennent dans un contexte où le dialogue social est très dégradé, marqué par une rupture quasi totale et une confrontation ouverte.
Tiré d'Europe solidaire sans frontière.
Les organisations syndicales françaises CFDT, CGT, Unsa, Solidaires et FSU dénoncent ces attaques, condamnent la campagne d'intimidation menée par les autorités tunisiennes et expriment leur solidarité avec leurs homologues de l'UGTT.
Depuis son « coup de force constitutionnel » le 25 juillet 2021, qui s'apparente de plus en plus à un coup d'État au fur et à mesure que Kaïs Saïed s'arroge les pleins pouvoirs, ce dernier a progressivement mis en place une présidence autoritaire, affaiblissant les piliers de la démocratie tunisienne. Kaïs Saïed, qui ne cache pas son hostilité aux corps intermédiaires, gouverne par décrets présidentiels, sans contre-pouvoirs institutionnels. Après le démantèlement du pluralisme politique avec l'arrestation d'opposants sous prétexte de « complot contre la sûreté de l'État », l'intimidation et la criminalisation des voix dissidentes et l'attaque contre la liberté d'expression avec le harcèlement et même l'emprisonnement de journalistes pour leurs critiques du régime, Kais Saïed s'attaque désormais au syndicalisme.
Les organisations syndicales françaises CFDT, CGT, Unsa, Solidaires et FSU appellent le gouvernement français, et plus largement les décideurs européens, à condamner les dérives autocratiques du régime de Kaïs Saïed et à dénoncer le mémorandum UE-Tunisie.
L'UGTT, fondée en 1946, est un acteur historique majeur en Tunisie, ayant joué un rôle central pour l'indépendance de la Tunisie. L'UGTT est co-lauréate, en 2015, du Prix Nobel de la Paix pour son rôle dans le processus de transition démocratique en Tunisie, après la révolution de 2011. La CFDT, la CGT, l'Unsa, Solidaires et FSU réaffirment leur soutien à l'UGTT et au rassemblement organisé par le syndicat ce jeudi 21 août. Les organisations syndicales françaises joignent leur voix à l'appel du mouvement syndical mondial aux autorités tunisiennes 1 pour garantir la sécurité des membres des syndicats et respecter leurs obligations internationales en vertu des Conventions 87 « Liberté syndicale et protection du droit syndical » et 98 « Droit d'organisation et de négociation collective » de l'OIT.
CFDT, CGT, Unsa, Solidaires, FSU
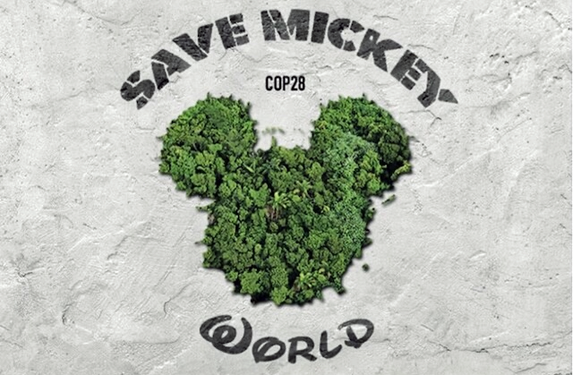
Depuis des décennies, le Nord accumule une dette environnementale envers les peuples du Sud
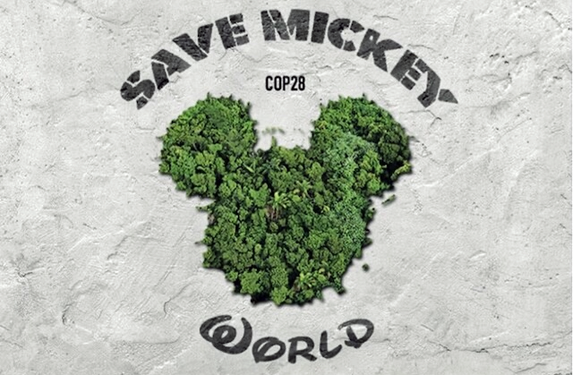
Éric Toussaint est interviewé par le journaliste argentin Jorge Muracciole. Depuis la Belgique, l'historien et économiste met en garde contre la crise écologique mondiale. Il affirme qu'elle a atteint un niveau extrême et insiste sur la nécessité de « lutter pour changer le mode de production et les relations de propriété ». Comprendre la dette climatique et écologique est essentiel pour parvenir à la bifurcation écologique. Cela devient indispensable pour trouver une solution juste et durable. La dette écologique, celle que doivent notamment les États du Nord, doit être reconnue : cela donnerait lieu à des réparations correspondantes. Afin de démêler ce défi, dans l'impasse de la mondialisation capitaliste, nous reprenons le dialogue, cette fois depuis Bruxelles, avec Éric Toussaint est le porte-parole du Comité pour l'abolition des dettes illégitimes (CADTM), historien, docteur en sciences politiques de l'université de Liège et de Paris VIII, membre du Conseil scientifique d'ATTAC France, cofondateur du Conseil international du Forum social mondial en 2001.
2 juillet 20225 | tiré du site du CADTM | Illustration : Jorge Alaminos
https://www.cadtm.org/Depuis-des-decennies-le-Nord-accumule-une-dette-environnementale-envers-les
Jorge Muracciole – Quelle est la situation actuelle de ce qu'on appelle la dette écologique ?
Éric Toussaint – Elle a atteint un niveau extrême. Les températures et le niveau des océans augmentent progressivement et le nombre de personnes touchées, tant au Sud qu'au Nord, est impressionnant. Toutes les données nous montrent que la situation va continuer à s'aggraver car le système capitaliste international n'a pas la volonté d'agir et les gouvernements n'ont donc pas la capacité de trouver des solutions. De nombreux gouvernements négationnistes, comme ceux de Trump ou de Milei, ne donnent pas d'importance à l'ampleur de la crise. Les États du Nord ont accumulé des dettes envers les peuples du Sud : ils devraient reconnaître la dette écologique mondiale historique qu'ils ont contractée et accepter le fait qu'ils doivent payer des compensations financières.
Jorge Muracciole –Est-ce faisable ?
Éric Toussaint –Si l'on tient compte de la chronologie, la dette contractée par les États du Nord, au niveau de ce qui peut être mesuré en termes de changement climatique, de crise écologique et d'effet de serre à grande échelle, a commencé avec l'avènement de la révolution industrielle en Europe à partir de 1820/30 et s'est poursuivie aux États-Unis. Il s'agit d'un processus de deux siècles d'accumulation de gaz à effet de serre propres au développement industriel capitaliste. Au cours des XXe et XXIe siècles, d'autres pays de la périphérie capitaliste se sont ajoutés à ces émissions. Il est évident que les ouvriers qui ont travaillé tout au long du XIXe siècle, soumis à une exploitation extrême, avec des journées de plus de 12 heures et dans des conditions de travail insalubres, ainsi que le travail infantile inhumain, ne sont pas responsables des dommages écologiques causés par leurs gouvernements et les entreprises privées, soutenues par des méthodes policières. La réponse du mouvement ouvrier a été très variée. On ne peut en aucun cas tenir les prolétaires européens pour responsables du projet civilisateur polluant de leurs bourgeoisies. Les paysans ne sont pas non plus responsables du développement du modèle capitaliste dans la production agricole. Ils sont plutôt victimes de ce modèle. Les coupables sont les gouvernements au service de la classe capitaliste et de ses grandes entreprises privées.
Jorge Muracciole -Dans un texte datant du début de l'année 2025, vous affirmez que les groupes capitalistes dominants ont épuisé les réserves et pollué la planète par l'utilisation excessive des énergies fossiles et la surproduction : l'imposition d'une mondialisation néolibérale absurde selon les intérêts des peuples du Sud.
Éric Toussaint –On peut identifier de grandes sociétés industrielles qui existaient déjà il y a plus d'un siècle et qui exploitaient frénétiquement les ressources naturelles en Europe et en Amérique du Nord, puis dans le Sud global.
Il est essentiel de souligner la responsabilité des grandes entreprises qui ont vu le jour au XIXe siècle ou au début du XXe siècle, telles que Coca-Cola (fondée en 1886), Pepsi-Cola (1898), Monsanto (1901), Cargill (1865) dans le secteur agroalimentaire, BP (1909), Shell (1907), Exxon Mobil (1870), Chevron (1879), Total (1924), dans le secteur pétrolier, ThyssenKrupp (1811), Arcelor Mittal (une union de différents groupes nés dans la première moitié du XXe siècle) dans le secteur de l'acier et des métaux, Volkswagen (1937), General Motors (1908), Ford (1903), Renault-Nissan-Mitsubishi (groupe de trois entreprises créées entre 1870 et 1932) dans le secteur automobile, Rio Tinto (1873), BHP Billiton (1895) dans le secteur minier, ont eu et ont encore une énorme responsabilité dans les émissions de GES. Si l'on calculait la quantité de GES générée par leurs activités depuis leur création, on se rendrait compte que cela représente une part très importante de ce qui s'est accumulé dans l'atmosphère comme une véritable bombe à retardement, qui a fini par exploser. Plus récemment, il convient d'ajouter à la liste incomplète mentionnée ci-dessus l'impact néfaste sur l'environnement des GAFAM (Google, Apple, Facebook-Meta, Amazon et Microsoft), X,… avec leurs énormes centre de data qui prennent encore plus d'ampleur avec l'exploitation de l'Intelligence Articifielle. Enfin, il faut ajouter aujourd'hui à cette liste une série d'entreprises privées, ou dans certains cas publiques, originaires de pays capitalistes dits émergents qui jouent également un rôle néfaste pour l'environnement : Gasprom et Rosneff en Russie ; Sinopec et Petrochina en Chine, Petrobras et Vale do Rio Doce au Brésil, Coal India et Tata en Inde,… pour ne donner que quelques exemples.
Fondamentalement, que ce soit au Nord ou au Sud, le mode de production capitaliste est responsable de la destruction de la planète. Au lieu de rendre l'humanité responsable de la crise écologique en parlant d'anthropocène, il serait plus approprié de rendre le mode de production capitaliste responsable de la crise et d'utiliser l'expression capitalocène, comme le fait le CADTM et d'autres.
Jorge Muracciole –Et aujourd'hui ?
Éric Toussaint –Cet impact de l'industrie extractive se produit en pleine mondialisation, avec la recherche de terres rares ou de lithium pour l'industrie de la téléphonie numérique et des batteries, dans des régions telles que le triangle entre le sud de la Bolivie, le nord-ouest de l'Argentine et le nord du Chili. On pourrait dresser une longue liste d'exemples de l'impact environnemental et humain.
Jorge Muracciole –Ce sont des faits occultés par la presse dominante.
Éric Toussaint – La solution au problème n'est pas compatible avec le mode de production capitaliste. Il n'existe pas de solution de « capitalisme vert ». Il faut une politique de rupture avec le mode de production capitaliste.
Jorge Muracciole – Ce ne sera pas facile.
Éric Toussaint –Cette année, différents peuples autochtones de différentes régions de la planète auront l'occasion de débattre de cette question, notamment lors de la COP 30 qui se tiendra à Belém, au Brésil, du 10 au 21 novembre. Les peuples autochtones des Amériques, avec des délégations du monde entier, s'opposeront au sommet officiel, qui n'offrira aucune solution réelle. Ils s'opposeront même à l'orientation productiviste et extractiviste du gouvernement Lula, qui souhaite exploiter davantage de pétrole, y compris dans des zones très sensibles sur le plan environnemental.
Jorge Muracciole –En ce qui concerne ce sommet, quelle est la situation des régions les plus touchées par les effets du productivisme extractiviste ?
Éric Toussaint –L'Asie, et en particulier l'Asie du Sud, avec des pays comme le Pakistan et le Bangladesh, qui comptent au total 400 millions d'habitants. Au Pakistan, en 2022, des inondations ont provoqué le déplacement de près de 30 % de la population. Il en va de même en Afrique de l'Est : des inondations combinées à l'intervention de groupes paramilitaires payés par des sociétés transnationales, comme en République démocratique du Congo, au Kenya, en Tanzanie et au Mozambique, pour extraire du coltan, du cuivre, de l'uranium, du pétrole...
Jorge Muracciole –En Amérique du Nord également.
Éric Toussaint –Oui, des pluies incontrôlables avec de grandes inondations ou des sécheresses prolongées et des incendies en Californie, à Hollywood, ou encore à São Paulo et Quito. Tout cela est le résultat d'un projet civilisationnel qui génère des changements climatiques dans le Nord global et affecte toute la planète. Il est nécessaire de mettre en œuvre un projet de décroissance dans les pays du Nord afin de réduire considérablement les effets de cette croissance incontrôlée. Et de modifier le mode de vie des populations du Nord... Par exemple, en réduisant l'utilisation des voitures individuelles. D'autre part, dans les pays du Sud, nombreux sont ceux qui ont besoin de croissance, de réorganiser et d'articuler la production avec des éléments de décroissance dans certains secteurs de production et de croissance dans d'autres. Par exemple, une production accrue pour améliorer les conditions de logement, l'accès à l'électricité, aux égouts, à l'eau courante, à faible coût pour la population, l'investissement dans l'éducation...
Jorge Muracciole –Pour le mettre en œuvre, un véritable changement de conscience est nécessaire.
Éric Toussaint –Un changement de culture ne suffit pas, il faut également mettre fin ou réduire fortement les activités des entreprises extractives et limiter l'utilisation des ressources naturelles du sous-sol. Il faut lutter pour changer le mode de production et les relations de propriété. Les entreprises énergétiques et extractives doivent être sous contrôle public. L'obligation de rembourser la dette est ce qui instaure l'idée forte d'exporter davantage de matières premières pour les pays périphériques. Il faut l'annuler.
La version originale publiée dans Tiempo Argentino a été révisée et modifiée par Éric Toussaint.
Traduction de l'espagnol par CADTM.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« L’agriculture pastorale extensive est le seul rempart pour reprendre la terre aux feux »

Cet été, les terres du département de l'Aude ont été ravagées par une série de cinq incendies. Pour le vigneron Nicolas Mirouze, des mutations de la vie paysanne s'imposent après la catastrophe.
22 août 2025 | tiré de Reportere.net
https://reporterre.net/L-agriculture-pastorale-extensive-est-le-seul-rempart-pour-reprendre-la-terre-aux-feux
Nicolas Mirouze est vigneron dans les Corbières (Aude) et membre de la coopérative l'Atelier paysan. Il milite pour une agriculture paysanne et biologique. Son exploitation est située juste à proximité de la zone où des incendies ont ravagé le département cet été.
Nicolas Mirouze est vigneron dans les Corbières (Aude) et membre de la coopérative l'Atelier paysan. Il milite pour une agriculture paysanne et biologique. Son exploitation est située juste à proximité de la zone où des incendies ont ravagé le département cet été.
Reporterre — Comment avez-vous réagi face à l'énorme feu qui a sévi du 5 au 9 août ?
Nicolas Mirouze — On ne parle pas juste d'un grand feu, mais d'une série d'incendies. On en a vécu cinq dans les Corbières cet été. Le premier a commencé sur notre commune, le 29 juin, juste devant notre ferme. Le vent l'a poussé de l'autre côté de la route départementale, on n'a pas eu de dégât immédiat. Mais cinq jours plus tard, ça recommençait.
Dans le massif, 400 hectares ont disparu. Le 10 juillet, un autre incendie frappait les alentours de Narbonne : 2 500 hectares ont été ravagés à 3 kilomètres de chez nous. On espérait alors que ce soit fini, on se disait que c'était le plus gros feu... Mais cela ne faisait que commencer. Début août, ça a été apocalyptique, on n'avait jamais vu ça. On vivait entre les flammes et les canadairs, dans un état de stress terrible.
Au total, en deux mois, 20 000 hectares ont brûlé près de chez nous. Voilà la réalité : on est dévastés. Tout est en train de cramer, on ne voit pas d'autres perspectives. On vit comme en sursis, en se disant que c'est une question de temps avant que ce qui n'a pas été brûlé se consume.
À l'évidence, la végétation n'est plus adaptée au climat. Les arbres meurent. Cela fait quatre ans que l'on subit une sécheresse incroyable : nos cumuls de pluie sont inférieurs à la moitié de ce que l'on avait l'habitude de recevoir. On change de monde. Nous ne sommes plus juste dans le climat sec méditerranéen, on est passé à autre chose, un chaos aride.
Comment ce phénomène vient-il percuter votre vie paysanne ?
On attend la pluie et on redoute l'été. La destruction par le feu est d'une radicalité effrayante. Après le passage de l'incendie, il n'y a plus rien, c'est une dévastation totale. Il va falloir reconstruire et repenser beaucoup de choses pour qu'habiter ici redevienne désirable. En tant que paysans et paysannes, nous sommes ancrés dans le sol, nous ne pouvons pas et ne voulons pas fuir. Notre vie est sur place. On a un attachement physique, presque viscéral à cette terre, même si elle est rude.
« Le feu prolonge les conséquences de l'industrialisation de l'agriculture »
Surtout, je crois que le feu vient raviver une crise plus profonde que nous traversons depuis des décennies. Il prolonge les conséquences de l'industrialisation de l'agriculture, prend appui sur la déprise agricole et la disparition de la paysannerie.
Entre 900 et 2 000 hectares de vignobles ont brûlé cet été. Mais la destruction des vignes n'a pas commencé avec les incendies. L'arrachage des vignes a été poussé par les politiques productivistes, pour privilégier les grosses structures et restructurer la filière. En une génération de travailleurs, soit en moins de quarante ans, on a supprimé la moitié de la surface en vigne du département. Les friches ont gagné du terrain sur les zones les plus déshéritées et les moins arrosées, qui sont aussi les plus à risque en matière d'incendie.
Vous voulez dire que les feux sont aussi l'occasion de faire le bilan de l'agriculture industrielle ?
Tout à fait, il faut questionner ces politiques d'arrachage qui ont conforté le modèle de l'agriculture intensive. Elles ont décimé les communautés paysannes, dans des zones où on aurait pu faire du bon vin et d'autres formes de production. L'incendie vient se greffer à cette situation et fragilise encore davantage l'agriculture paysanne.
Aujourd'hui, il est urgent d'imaginer un autre scénario, de replanter des vignes, d'installer des éleveurs, de remettre au goût du jour les transhumances hivernales - celles qui vont des montagnes au littoral - pour repeupler ce territoire.
« L'agriculture paysanne doit retrouver sa place »
Cette catastrophe doit au minimum permettre de prendre des décisions stratégiques à la hauteur du danger : l'agriculture paysanne doit retrouver sa place dans les friches abandonnées et les terres livrées au feu. C'est pourquoi nous plaidons pour la structuration d'une filière d'élevage extensif dans notre département.
En quoi le retour de la petite paysannerie et de l'élevage extensif pourrait limiter les feux ?
Le projet d'installation pastorale extensive est le seul rempart crédible pour reprendre la terre aux grands feux. Par l'élevage, on va avoir une occupation de surface sans commune mesure avec ce que l'on pourrait imaginer avec une monoculture de vignes. C'est aussi une bonne réponse à la protection des zones naturelles. Cela permet de diversifier la production agricole, de transformer des friches viticoles par des surfaces fourragères. Les troupeaux régénèrent les sols épuisés par la monoculture intensive de la vigne et débroussaillent les friches. Ce sont de bons pare-feux contre les incendies.
Chez nous, on a installé un éleveur avec un cheptel de 120 brebis. Cela protège aussi nos champs et nos bâtiments. Mais cette démarche individuelle et sa duplication ne suffira pas, il faut imaginer la mise en place de toute une nouvelle filière à l'échelle du département, créer des prairies, nourrir la terre pour faire pousser des vergers et de la production maraîchère. L'élevage extensif est un levier de transformation plus général du modèle agricole. C'est une première étape.
Quels sont justement les freins et les difficultés qui bloquent son apparition ?
Ce sont des problèmes systémiques que l'on retrouve ailleurs : la difficulté à promouvoir l'installation agricole. Les conditions de production ici sont dures, donc ce n'est pas très désirable : les moyens alloués par les politiques publiques doivent être plus importants. Notre territoire et la zone méditerranéenne, de manière générale, devraient être reconnus comme étant des espaces en « situation de handicap naturel majeur » lié au réchauffement climatique.
Lire aussi :« Du jamais-vu » : pourquoi l'incendie dans l'Aude s'est propagé si vite
Cela permettrait d'aider davantage financièrement les futurs éleveurs, comme dans les zones de montagne. Au fond, il faudrait requestionner la PAC [politique agricole commune] et flécher l'argent autrement. Faut-il massivement soutenir la viticulture intensive productiviste ou d'autres modèles d'installation dans les Corbières ?
Le second frein, immense, est la valorisation de la production locale. Tant que notre viande sera peu valorisée, il n'y aura pas d'installation massive. L'importation de viande ovine venue de l'autre bout de la planète, qui inonde le marché avec des prix imbattables, devrait être interrogée. Il faut des mesures protectionnistes pour que la valorisation aille aux producteurs, avec des prix minimum d'entrée sur le territoire.
Ce feu peut-il servir de prise de conscience ?
J'espère évidemment un sursaut. C'est dans les moments de crise que l'on évolue. Le plus important reste surtout de ne pas rester passifs, de ne pas attendre tout des pouvoirs publics. Il faut se structurer, sortir collectivement de l'impuissance et de la dépossession, repenser les choses démocratiquement, comme citoyens, habitantes et habitants.
On n'est pas naïfs. On voit que le modèle agricole intensif va chercher à se maintenir, qu'il n'est pas fondamentalement remis en question. Des offensives médiatiques utilisent aussi les tragédies qui nous frappent pour polariser encore davantage notre société, en incriminant les écologistes et les consommateurs de viande. Nous refusons ces clivages : pour panser nos blessures et penser un avenir en commun, le moment est à la solidarité plutôt qu'à la division. On va mener notre reconstruction par le bas, à l'échelle locale. Et ce sera révolutionnaire.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Plastique : un échec temporaire du multilatéralisme ?

Quelques pays seulement ont réussi à faire échouer une entente mondiale voulue par la majorité des 184 à Genève du 4 au 14 août pour créer un traité international contraignant contre la pollution plastique, qui semble de plus en plus être un danger pour la planète et la santé de la population.
L'environnement mondial est actuellement en crise. En 1950, la production de plastique était de 2 millions de tonnes. Elle a régulièrement augmenté et en 20 ans, soit de 2000 à 2020, sa production est passée de 230 millions de tonnes par ans à 460 millions. Si rien n'est fait, elle devrait tripler d'ici 2060 et atteindre 1,2 milliard de tonnes annuellement. Un tiers du pétrole extrait aujourd'hui de la terre est transformé en plastique. Comme mondialement, il y aurait seulement 9 % des déchets de cette production qui seraient recyclés, il y aurait actuellement 8 milliards de tonnes de plastiques qui pollueraient la planète.
Un échec
Après dix jours de pourparlers, les 184 pays réunis à Genève pour créer un traité international contraignant contre la pollution plastique (CNI5-2) ne sont pas parvenus à l'adopter. Les négociations portaient sur toute la durée de vie du plastique depuis la substance dérivée du pétrole jusqu'à son état de déchets. Les pays avaient échoué une première fois à avoir un accord lors de la dernière séquence de négociation à Busan en Corée du Sud en 2024.
L'Arabie saoudite, le Qatar, les États-Unis, la Russie et la Chine se sont opposés de plusieurs manières à l'arrivée d'un accord contraignant. Selon le ministre fédéral belge du Climat et de la Transition environnementale, Jean-Luc Crucke, c'est un échec du multilatéralisme parce que malgré 120 pays qui se sont réunis derrière l'Europe, les pays producteurs de pétrole ont refusé un accord. « Une poignée de pays, guidés par des intérêts financiers de court terme et non par la santé de leurs populations et la durabilité de leur économie, ont bloqué l'adoption d'un traité ambitieux contre la pollution plastique », a affirmé la ministre française de la Transition énergétique, Agnès Pannier Runacher.
Selon le chef de la délégation de Greenpeace, Graham Forbes, ces négociations ont été inondées de lobbyistes de l'industrie des carburants fossiles. « L'industrie pétrochimique est déterminée à nous sacrifier au profit de ses intérêts à court terme », affirme Greenpeace.
Des conséquences sur la santé ?
Le plastique ne disparaît pas, mais s'effrite et devient de plus en plus petit. Il devient microplastique quand il a une taille inférieure à 5 millimètres, puis nanoplastique quand il est inférieur à un micromètre. Il est alors facile à inhaler et ingérer. Selon la chercheuse spécialisée sur les microplastiques de l'université de Lille, Mathilde Body-Malapel, « on sait qu'une fois qu'ils sont dans l'organisme, selon leur taille, ils vont se diffuser de manière plus ou moins importante ». Plus ils sont petits, moins les barrières de l'organisme vont pouvoir les retenir. Les plus petits réussissent à pénétrer dans le sang. Ils peuvent alors se diffuser dans l'ensemble des organes.
Les scientifiques cherchent encore à déterminer les effets de ces plastiques sur les humains. Plusieurs tests ont déjà été menés sur des souris. Ils ont constaté des maladies neurologiques comme le Parkinson ou l'Alzheimer, des problèmes cardiovasculaires avec des AVC, des problèmes pulmonaires, intestinaux ou de fertilité.
Mathilde Body-Malapel affirme de plus qu'il y a 16000 additifs différents qui sont ajoutés aux polymères de plastique pour réaliser les produits que nous consommons dans notre vie quotidienne. Il y aurait 4000 de ceux-ci qui seraient jugés préoccupants pour la santé ou l'environnement.
Nathalie Gontard directrice de recherche en science de l'alimentation et de l'emballage à l'INRAE a écrit un livre sur le plastique et considère qu'il est une drogue dans nos sociétés. « On à une mauvaise compréhension de la pollution plastique parce que l'on croit que c'est uniquement une question de déchets or ce n'est pas le cas ». Le plastique émet des micros et des nanoplastiques dès le début de sa production.
Un traité mondial nécessaire
La Directrice du Programme des Nations unies pour l'environnement, Inger Andersen, affirme qu' « il faut garder à l'esprit que le monde veut et a besoin d'un traité conventionnel sur le plastique, car la crise devient incontrôlable et les citoyens sont franchement indignés. »
Le ministre danois de l'environnement, Magnus Heunicke, a précisé que bien que les négociations soient suspendues, l'Union européenne n'abandonnera pas. « Ces négociations suspendues veulent dire que nous allons travailler plus efficacement avec les pays qui sont prêts à aller de l'avant. »
L'Union européenne a pour sa part mis de l'avant la nécessité de réfléchir à la manière dont les pays peuvent mieux travailler ensemble à l'avenir. « Quelque chose doit changer. Les méthodes de travail et les règles actuelles ont atteint leurs limites » a affirmé la négociatrice principale du Panamá, Debbra Cisneros, lors de la dernière plénière.
Ce n'est donc que partie remise. « Le secrétariat va travailler pour trouver une date et un endroit, où CNI5-3 aura lieu », a déclaré le président du comité des négociations (CNI5-2), l'Équatorien Luis Vayas Valdivieso. L'utilisation du vote à la majorité des participants a été proposée pour la prochaine rencontre. Cet échec du multilatéralisme pourra-t-il être surmonté suffisamment rapidement pour éviter que cette problématique ne s'aggrave ?
Michel Gourd
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Canulars et négationnisme climatique

Cette année nous avons peut-être l'un des étés les plus horribles dont je me souvienne, avec des épidémies toujours actives dans la moitié du pays : on estime qu'environ 24 000 personnes ont dû être expulsées de leurs maisons, plus de 140 000 hectares ont été brûlés [au 22 août, le chiffre de 400 000 hectares a été dépassé] et au moins quatre personnes sont mortes dans différents incendies. Une tragédie aux conséquences incalculables, qui met une fois de plus en lumière, sur le territoire et sur nos propres vies, l'impact mortifère de la crise écologique que nous vivons : « Une classe de maître en matière de destruction climatique ».
20 août 2025 | tiré de Viento sur
Un hélicoptère-bombardier travaille à éteindre l'incendie, le 17 août 2025, à Quiroga, Lugo, Galice (Espagne). Europa Press -Publico.es
Parce que la succession des incendies et leur plus grand potentiel destructeur ne sont pas le fruit du hasard ou d'un été « exceptionnellement » chaud, mais la conjonction de la crise climatique, de la dégradation permanente du territoire et de la vie de ceux qui l'habitent sous le maelström de l'exploitation capitaliste.
Malgré le fait que la barbarie climatique est déjà là, l'avancée des formations d'extrême droite continue de nier l'évidence de l'urgence écologique dans une défense du statu quo néolibéral extractiviste et prédateur des ressources. Elles agissent ainsi comme un frein à la mise en œuvre de politiques ambitieuses de transition énergétique et d'adaptation au changement climatique. Mais la vérité est qu'il est difficile de déchiffrer dans quelle mesure les positions négationnistes défendues par la vague réactionnaire mondiale répondent à une croyance idéologique ou s'inscrivent dans une stratégie de défense des intérêts du pouvoir des entreprises et d'un modèle économique ancré dans l'énergie fossile. En fait, il est tout à fait possible qu'ils répondent à ces deux raisons, et même à d'autres. Mais ce qui, à mon avis, ne fait aucun doute, c'est que le négationnisme climatique a évolué d'un arrière-plan discret pour atteindre une place de premier plan dans les guerres culturelles de l'extrême droite, devenant une caractéristique presque unanime dans les formations d'extrême droite à l'échelle mondiale.
Ainsi, comme pour le Dana ou le black-out, aujourd'hui, avec les incendies et les canicules, les canulars et les complots de l'extrême droite sont de retour pour inonder les réseaux sociaux et enivrer le débat public. Ils réaffirment leur négationnisme climatique, répandent leur haine, attaquent le gouvernement et, ce faisant, tentent de sauver de leur responsabilité dans la tragédie tous ces politiciens négationnistes ou retardataires qui investissent plus d'argent dans la promotion de la corrida que dans la prévention des incendies de forêt. N'importe quelle explication, aussi folle qu'elle puisse paraître, tant qu'elle nie la crise climatique. Nous ne pouvons pas oublier que beaucoup de ces distributeurs professionnels de canulars sont dopés jusqu'aux sourcils avec de l'argent public par le biais des institutions contrôlées par le Parti populaire (PP).
Dans le cas de la Dana de Valence, Abascal lui-même (leader de Vox) est allé jusqu'à pointer, sur le réseau social X, la Commission européenne et sa présidente Ursula von der Leyen comme faisant partie des coupables de la tragédie de Valence. Tous, sauf son partenaire Mazón. Ainsi, il accuse Von der Leyen de favoriser la suppression des barrages en raison du « fanatisme climatique » du Green Deal européen : « S'il y a des coupables... vous êtes la première avec votre droit pénal à faire sauter des barrages. Vous êtes une ennemie des Espagnols ». Le canular sur la démolition des barrages franquistes par le gouvernement a eu un tel écho sur les réseaux, atteignant même certaines émissions de télévision, que le ministère de la Transition écologique et du Défi démographique (MITECO) a dû nier qu'un réservoir de Valence ait été détruit. Malgré les dénégations de MITECO, l'extrême droite a fait la sourde oreille et a continué à répandre le même canular, parce que l'examen de la raison n'a aucune valeur pour eux, pour qui ne compte que la capacité à mobiliser de tristes passions.
En ce sens, dans le cadre de la fête de la colombe à Madrid, le vice-président de Vox, Javier Ortega Smith, a assuré à la presse que « le fanatisme climatique ne permet pas de nettoyer les montagnes », attisant le fantôme conspirationniste sur l'Agenda 2030 que l'extrême droite aime tant. Un nouveau canular profitant d'un moment de crise et d'agitation publique pour diffuser son programme négationniste.
Non seulement la législation n'interdit pas le défrichement des forêts, mais dans de nombreuses régions, c'est obligatoire. Par exemple, en Galice, il s'agit d'une obligation de prévention des incendies ; en Castille-et-León, une obligation ; en Catalogne, une obligation ; et dans le Pays valencien, une obligation établie qui, si elle n'est pas respectée, entraîne également une sanction.
Un canular auquel s'est également jointe la présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en pointant du doigt ces « agendas idéologiques » (Agenda 2030) déjà évoqués par Ortega Smith et qui empêcheraient soi-disant de « nettoyer les montagnes » ou les « berges des fleuves ». Bien que Díaz Ayuso puisse sembler être une ultra-exception, il s'agit plutôt d'un exemple de la façon dont la droite conservatrice européenne adhère à l'agenda du déni climatique, y compris les canulars.
Lors de la tragédie de Valence, l'un des canulars les plus fortement répétés de la fachosphère a été l'incroyable théorie de l'attaque météorologique marocaine utilisant une arme expérimentale américaine, le High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP). N'importe quelle explication, aussi folle soit-elle, tant qu'elle nie la crise climatique. Ces jours-ci, nous voyons comment un canular qui présente des similitudes avec l'attaque présumée de HAARP à Valence se propage comme de la poudre à canon : un prétendu terrorisme incendiaire provoquerait des incendies de manière coordonnée dans différentes parties du pays. En fait, le président du PP, Alberto Núñez Feijóo, a utilisé le concept de « terrorisme » dans ses déclarations publiques pour faire référence à cette vague d'incendies.
La prétendue mafia terroriste pyromane qui attaque notre pays est un canular qui vise à dédaigner, une fois de plus, l'influence du changement climatique sur les incendies, ou à nier directement son existence. Parce que, quelle que soit l'origine de l'incendie, les scientifiques ont documenté comment le réchauffement climatique et la modification de certaines conditions environnementales non seulement favorisent, mais intensifient également le pouvoir destructeur des incendies. Les vagues de chaleur de plus en plus fréquentes et les sécheresses soudaines (une chaleur sévère et soudaine qui assèche la végétation et le sol à une vitesse inhabituelle) sont des épisodes qui ont une relation directe et causale avec les incendies de cette année.
En ce sens, l'un des canulars les plus courants pour nier l'intensité et la fréquence anormales des vagues de chaleur, un produit du changement climatique, est d'accuser la communauté scientifique et les médias de faux alarmisme pour justifier les politiques d'action climatique. Ainsi, il a été affirmé que les chaînes de télévision peignent des cartes météorologiques avec des couleurs de plus en plus intenses pour effrayer la population. Tout cela au milieu de l'une des pires vagues de chaleur de mémoire d'homme, non seulement à cause des températures élevées, mais aussi à cause de sa prolongation temporaire, un exemple de plus de la façon dont les canulars négationnistes attaquent même le principe empirique le plus élémentaire.
Le « grand black-out » d'avril 2025 a poussé la droite dans sa guerre culturelle particulière en faveur du nucléaire, à charger contre le gouvernement et, bien sûr, à s'attaquer aux énergies renouvelables, dans le but de délégitimer les politiques d'action contre la crise climatique, en amplifiant les discours négationnistes. Dans le cas des incendies de cet été, une fois de plus, les réseaux sociaux ont été inondés de faux messages combinant l'attaque contre le gouvernement avec la criminalisation de l'énergie photovoltaïque et éolienne.
De cette façon, ils ont diffusé un prétendu plan machiavélique du gouvernement lui-même par lequel il aurait provoqué les incendies pour « s'emparer du terrain et construire des moulins et des panneaux solaires ». Des canulars qui se sont répandus comme de l'écume à travers les réseaux de la fachosphère, malgré le fait que la loi forestière interdit l'utilisation d'une terre brûlée pour autre chose que la régénération du couvert végétal.
Il est paradigmatique qu'à mesure que le climat se détériore et que la moitié de l'Espagne brûle, le négationnisme par canular augmente. L'avancée des positions négationnistes d'extrême droite contre toute politique d'atténuation de la crise climatique montre que les preuves scientifiques et empiriques de la crise écologique, en elles-mêmes, sont inutiles. Car, face aux peurs et aux incertitudes générées par la crise écologique – qui, à son tour, est une variante de la crise systémique du capitalisme – les pactes étatiques ou les pactes de greenwashing ne sont pas valables. Avec notre territoire en flammes, il est plus nécessaire que jamais d'élever une alternative écosocialiste qui nous permette d'abriter un principe d'espoir pour l'avenir. En attendant, jusqu'à ce que nous nous attaquions à cette tâche de manière décisive, le déni de l'autoritarisme réactionnaire continuera de croître.
19/08/25
Miguel Urban. Ancien député européen d'Anticapitalistas et membre du Conseil consultatif de Viento Sur
https://www.publico.es/opinion/columnas/fuego-dana-apagon-bulos-negacionismo-climatico.html
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Comment travaillent les enseignant·es ukrainien·nes à 60 kilomètres du front ?

Malgré le danger permanent et le manque d'enseignant·es, les éducateurs et les éducatrices de la ville frontalière de Kryvyi Rih continuent d'instruire les enfants et de veiller à leur avenir. Snizhana Oleksun, enseignante, parle de la vie entre les sirènes, des écoles souterraines.
En Ukraine, le nombre d'enseignant·es diminue : d'ici 2030, il manquera 108 000 enseignant·es, soit un tiers. Les professeur·es de langues étrangères et de sciences naturelles sont les plus recherchés, et la pénurie est particulièrement criante dans les communautés proches du front. Les écoles qui manquent d'enseignant·es affichent, comme on pouvait s'y attendre, un niveau de préparation des élèves moins bon, ce qui s'ajoute au stress causé par la guerre, les difficultés quotidiennes et la formation en ligne prolongée. Dans l'ensemble, l'invasion russe à grande échelle a entraîné des pertes éducatives équivalentes à deux années d'études scolaires.
Olena Tkalich s'est entretenu avec Snizhana Oleksun, professeure d'anglais et de sciences sociales à Kryvyi Rih, la petite ville natale du président Volodymyr Zelensky et grande ville industrielle de la région de Dnipropetrovsk, dont les frontières sont actuellement disputées par les envahisseurs russes. Elle a parlé des écoles souterraines, des perspectives pour les jeunes dans cette ville minière et de la vie des enseignant·es dans un contexte de guerre.
Comme le salaire des enseignant·es est faible, environ 15 000 hryvnias [310 euros] en moyenne, et qu'il y a une pénurie d'enseignant·es, Snizhana travaille à la fois à l'école, au collège et donnant des cours particuliers d'anglais.
« Ma journée de travail commence à 8 heures du matin et se termine généralement à 20 heures, parfois même à 21 heures. Mais j'exagère un peu. Ce ne sont que des cours jusqu'à 20 heures. En plus, quand tu rentres à la maison, tu dois remplir tout un tas de documents. Il y a les méthodes pédagogiques, les dossiers électroniques dans lesquels tu dois impérativement enregistrer des informations, et la vérification des cahiers. La charge de travail est énorme. En plus, les parents t'appellent sans arrêt, tu dois être constamment joignable. En ce moment, il faut savoir tout le temps où en est chaque enfant. Sans compter les nuits blanches avec les sirènes et les bombardements. Et chaque enseignant·e a ses propres problèmes, vous comprenez » explique Snizhana.
Son mari et son fils servent dans l'armée ukrainienne, et parmi ses anciens élèves, il y a des jeunes qui se sont engagés volontairement dans l'armée.
« C'est très difficile pour moi d'en parler, car ce sont mes meilleurs élèves. Ils ont obtenu leur diplôme en 2019. Dania Kozlov était dans une compagnie de reconnaissance et a été tué. Il était la fierté de notre groupe », dit-elle.
Quand on lui demande ce qui la motive à continuer à travailler dans l'éducation, Snizhana répond qu'elle vient d'une famille de profs et qu'elle n'a jamais pensé à faire autre chose.
« Je suis tout simplement passionnée par ce métier. Je l'aime beaucoup et c'est clairement ma vocation, ce que je ressens au plus profond de moi. Vous comprenez, il faut travailler. Et ce sont sans doute les yeux des enfants, qui brillent lorsqu'ils acquièrent de nouvelles connaissances, qui vous motivent » souligne Snizhana.
Comment fonctionne l'éducation « en sous-sol »
D'ici fin 2025, 180 écoles souterraines devraient voir le jour en Ukraine. Trois d'entre elles sont en cours de construction à Kryvyi Rih. Cependant, dans l'école où travaille Snizhana, tout le processus éducatif a déjà été transféré « sous terre ».
« À l'école, nous travaillons tout le temps dans un abri. Mes cours commencent dans l'abri et nous ne nous déplaçons pas (en cas d'alerte aérienne, les enseignant·es sont tenu·es d'emmener les enfants dans l'abri, ndlr). D'un côté, c'est pratique, mais de l'autre, c'est gênant car il n'y a pas de portes entre les classes et on entend constamment les autres enseignant·es et les autres enfants, on est en permanence dans le bruit. Cela déconcentre les enfants, il faut retenir leur attention pendant toute la leçon et imaginer différentes formes et méthodes pour les intéresser et les empêcher de se disperser. On nous a livré de nouveaux meubles cette année, on nous a donné de nouveaux tableaux interactifs. Mais tout cela se trouve sous terre. Les enfants tombent très souvent malades, car ces conditions ne conviennent pas à tout le monde. En réalité, elles ne conviennent à personne. Même avec une super ventilation, quand tu arrives le matin, tu ne peux pas respirer » explique Snizhana.
Au collège, en revanche, les enfants étudient dans leurs classes habituelles et en partie en ligne. De plus, l'établissement scolaire compte de nombreux bâtiments, entre lesquels les élèves doivent constamment se déplacer dans la ville. Il est très difficile de s'assurer que tout le monde se rende à l'abri en cas d'alerte. Pour des raisons de sécurité, mais aussi parce qu'elles et ils ne peuvent pas quitter le pays après 18 ans, de nombreux enfants partent à l'étranger.
« Cette année, après le dernier bombardement du terrain de jeux de Yuvileiny (qui a fait 18 mort·es, dont 9 enfants, ndlr), beaucoup ont quitté l'école. Les parent·es viennent chercher leurs enfants parce qu'elles et ils s'inquiètent. La sécurité passe avant tout, l'éducation est secondaire. Elles et ils partent [à l'étranger] pratiquement tous les jours. Ce sont surtout les enfants qui étudient au collège après leur première année qui partent. Elles et ils sont assez nombreux. Quand elles ou ils atteignent l'âge de 16 ans, elles ou ils partent même seuls. Et elles et ils commencent à s'adapter à la vie, à travailler. Souvent, elles ou ils poursuivent leurs études au collège en ligne. Tant que c'est possible, mais on ne sait pas ce qu'il en sera avec les nouvelles lois » raconte Snizhana.
Cet été, un débat a eu lieu sur la réduction de l'enseignement en ligne, car il aurait un impact négatif sur la qualité. Cependant, le ministère de l'Éducation et de la Recherche a finalement accepté que chaque établissement scolaire décide lui-même de la forme d'enseignement à dispenser.
« Pour passer complètement à l'enseignement hors ligne, il faudrait une sécurité totale. Or, celle-ci n'existe pas. Et les bombardements sont constants. La nuit dernière, une école de sport pour enfants a été touchée, elle est complètement détruite » déplore Snizhana.
Selon elle, de nombreux enseignant·es quittent également le pays en raison de la combinaison des risques et des bas salaires.
« En particulier celles et ceux qui enseignent l'anglais. Même si elles et ils terminent leurs études universitaires, elles et ils ne veulent pas aller travailler dans une école pour un salaire dérisoire. Elles ou ils ouvrent donc leurs propres établissements privés » note-t-elle.
En même temps, il y a beaucoup de personnes déplacées à l'intérieur du pays. La proximité de l'est et le mode de vie similaire à celui d'une grande ville industrielle ont fait de Kryvyi Rih un centre d'accueil important pour les personnes déplacées. « Au collège, j'ai des garçons qui ont même quitté la région lorsque la guerre a éclaté dans le Donbass en 2014. Ils vivent dans une ville située presque à l'extérieur de la ville. Les transports y sont très mauvais. Mais cela ne les empêche pas de bien étudier » explique l'enseignante.
De plus, dans le contexte de la guerre, des cours spéciaux sur la sécurité ont été mis en place dans les écoles et les collèges. « Il y a des moments consacrés à la sécurité au travail, où nous parlons constamment aux enfants des dangers des mines. Nous avons tous et toutes suivi des formations appropriées lorsque la guerre a éclaté et avons obtenu des certificats. De plus, nous organisons obligatoirement des cours sur la sécurité de l'information sur Internet, afin d'apprendre aux élèves à prendre toutes les informations avec un esprit critique et à ne pas se laisser provoquer » ajoute Snizhana.
L'Ukraine reste l'un des pays les plus minés au monde. En trois ans d'invasion russe, 336 personnes ont été tuées par des engins explosifs en Ukraine, dont 18 enfants, et 825 personnes ont été blessées. Au cours de l'année dernière, les cas où les services spéciaux russes ont recruté des adolescents et les ont forcés à incendier des voitures militaires ou à apporter des explosifs dans des installations militaires se sont multipliés. Plusieurs mineurs ont été tués ou gravement blessés. Parallèlement, il y a quelques mois, le SBU a annoncé que deux garçons de 14 et 17 ans originaires de Kryvyi Rih avaient refusé de travailler pour le FSB [service de renseignement russe] et avaient informé les forces de l'ordre de tentatives de recrutement. Ils ont été récompensés pour leur geste.
Pourquoi la pénurie de main-d'œuvre ne favorise pas l'augmentation des salaires
Au cours des dernières années, en particulier dans le contexte de la guerre, des discussions se poursuivent sur le manque criant de main-d'œuvre qualifiée dans le pays. Il s'agit notamment de personnes capables de travailler dans des industries complexes, y compris dans le domaine militaire. Après la désindustrialisation rapide des années 1990, l'économie du pays s'est réorientée vers le secteur des services, et le prestige des professions ouvrières et, par conséquent, de l'enseignement professionnel a considérablement diminué. Cependant, Kryvyi Rih reste une ville de métallurgistes dotée d'une infrastructure éducative appropriée.
« Nous sommes une ville industrielle, avec des mines, des carrières, des usines. C'est pourquoi le collège se concentre sur les professions qui seront demandées dans notre ville. Soudeurs, électricien·nes, informaticiens·ne, spécialistes en informatique et en logiciels » explique Snizhana. Selon elle, ici, les étudiant·es des collèges ne sont pas considéré·es comme des outsiders et, pour la plupart, elles et ils poursuivent ensuite des études supérieures, en se concentrant déjà clairement sur une spécialité et une expérience spécifiques. Aujourd'hui, ellks et ils acquièrent cette expérience plus tôt que d'habitude, car les géants métallurgiques de Kryvyi Rih manquent de main-d'œuvre. Au début de l'invasion, lorsque les occupants ont coupé les voies logistiques vers la mer d'Azov, de nombreuses entreprises ont cessé leur activité et mis leurs employé·es au chômage technique. La plupart d'entre eux ont fini par s'engager dans l'armée. Mais aujourd'hui, de nouvelles voies ont été trouvées pour le transport du minerai de fer et d'autres produits. Les étudiant·es des collèges sont donc activement impliqués dans ce processus.
« À l'usine ArcelorMittal (anciennement Kryvorizhstal, qui fait désormais partie de la plus grande entreprise métallurgique au monde – ndlr), les enfants sont passés à un enseignement individuel et ont commencé à travailler dès leur deuxième année. Vous comprenez donc à quel point la main-d'œuvre manque » souligne Snizhana.
Et pourtant, selon elle, il existe un paradoxe : les jeunes spécialistes se voient proposer un salaire minimum qu'elles et ils refusent. Ainsi, une partie des diplômé·es qui pourraient acquérir de l'expérience, une qualification supérieure et, à terme, un meilleur salaire, sont perdu·es.
« Parmi les diplômés de l'année dernière, il y avait une jeune fille dont toute la famille sont des électriciens. Elle est allée travailler à l'usine, mais le salaire y est de 7 000 hryvnias [144 euros]. Pour des jeunes qui veulent vivre indépendamment de leurs parents et louer un logement, c'est trop peu. C'est pourquoi, bien sûr, elles ou ils vont travailler comme baristas ou dans des magasins d'alimentation, où les salaires sont deux fois plus élevés. Beaucoup partent également à Kyiv pour gagner leur vie où elles et ils ne sont pas déclarés officiellement, mais travaillent au noir dans le bâtiment » note l'enseignante.
À la question de savoir quel sera le rôle des diplômé·es des collèges dans la reconstruction du pays, Snizhana répond qu'il est trop tôt pour en parler.
« Pour l'instant, tout le monde pense avant tout à sa sécurité. Les enfants sont évacués en masse. Et celles et ceux qui restent, seront-ils capables de s'en sortir émotionnellement, physiquement et psychologiquement La reconstruction est une question secondaire pour l'instant, à mon avis » dit-elle.
Presque tous les élèves et enseignant·es de son collège et de son école ont des proches dans l'armée. Mais l'année dernière, certains avaient choisi d'étudier au collège pour échapper à la conscription.
« Comment puis-je réagir à cela ? C'est une question provocante. J'ai deux fils qui font la guerre… » soupire Snizhana.
Fin juillet, lors des manifestations contre la corruption, elle a rejoint le mouvement à Kryvyi Rih, brandissant une pancarte sur laquelle on pouvait lire : « Pour des conditions de vie dignes ».
Actuellement, les autorités reconnaissent le problème de la pénurie d'enseignant·es, principalement en raison des bas salaires. Selon les lois « Sur l'éducation » et « Sur l'enseignement secondaire général complet », le salaire minimum d'un·e enseignant·e en Ukraine doit être au moins égal à trois salaires minimums. En 2025, cela représentera 24 000 hryvnias [496 euros] par mois. Cependant, dans la pratique, cette norme est reportée chaque année lors de l'adoption du budget de l'État. Le ministre de l'Éducation, Oksen Lisovyi, a déclaré qu'en 2026, la « prime aux enseignant·es » devrait être augmentée de 1 000 hryvnias [22 euros] à partir de janvier, puis de 2 000 hryvnias supplémentaires à partir de septembre. Toutefois, cela nécessite un financement de 40 milliards hryvnias, ce qui, dans un contexte budgétaire restreint, reste incertain.
7 aout 2025
Traduction par Patrick Le Tréhondat}

Venez me parler

Katya Gritseva, co-fondatrice et militante du syndicat étudiant ukrainien Priama Diia était à l'Université d'Eté des Mouvements Sociaux et des Solidarités de Bordeaux, en août 2025. Nous publions ici son intervention.
Comment aborder des sujets difficiles. Comment parler de choses graves. Chaque jour, quelqu'un meurt. Des roquettes volent, nous sommes privés de sommeil.
Nous sommes des militants. Nous nous jetons dans la lutte sociale parce que nous pensons que c'est important. Mais aussi parce que nous ne voulons pas penser uniquement à la guerre. Pourtant, il est impossible de ne pas y penser. Parce que chaque jour, quelqu'un meurt : des amis, d'anciens camarades de classe, des proches. Chaque jour, quelqu'un part à la guerre, quelqu'un perd sa maison, sa ville, sa région. La mer, les champs, la forêt. Qui sera le prochain et que va-t-il se passer ensuite ? Des camarades partent à la guerre, ils changent, on a du mal à les reconnaître. Quelqu'un passe à côté de vous et le bruit de ses pas vous irrite. Le moindre bruit retentissant vous oblige à vous cacher.
Chaque jour, tout change : combien de temps pouvons-nous encore tenir ? Certains sont déjà brisés, d'autres le seront demain. Quand atteindrez-vous votre limite personnelle ? J'ai besoin et envie de parler de la lutte sociale des mouvements progressistes en Ukraine. Mais le fait est que je ne peux pas en parler sans évoquer la guerre, et j'aimerais un jour pouvoir avoir cette perspective, mais tant que l'impérialisme russe existera, le traumatisme ne pourra pas disparaître. Je ne serais pas libre de m'exprimer complètement.
Trois ans de guerre. Et chacun a accumulé de nombreuses histoires. Lorsque je raconte la mienne, les gens ont tendance à me plaindre et à me dire que je suis forte. Lorsque j'écoute les histoires des autres, j'ai envie de les plaindre et de leur dire qu'ils sont forts. Il y a toujours quelqu'un dont l'histoire est plus effrayante et plus terrible. En écoutant mes camarades palestiniens, j'ai été choquée d'apprendre que ce qui n'a duré que quelques mois à Marioupol – le blocus, la faim, les bombardements constants – dure déjà depuis un an en Cisjordanie. Ma ville, Marioupol, est actuellement occupée, soumise à une propagande russe constante et à l'exploitation. La ville a été détruite, mais au moins, elle n'est plus bombardée. Les soldats russes violent les femmes qui y résident, les hommes d'affaires russes bafouent les droits des travailleurs, parler sa propre langue est un crime. Mais au moins, ma mère a de l'électricité et de l'eau. Quel sens a la pitié et qu'est-ce qu'un véritable soutien ? Comment mettre fin à toutes les guerres ? Ce sont des questions trop complexes qui, en tant que militant social en Ukraine, ne m'aident pas vraiment à agir. Il y a une frustration totale et l'impossibilité de se souvenir de ce que signifie la stabilité. Mais il est nécessaire de continuer à avancer et d'apporter notre petite contribution à la cause commune.
Nous devons rester humanistes, mais pour cela, nous devons toujours rester curieux et garder foi en l'être humain. Être progressiste, c'est cultiver la compréhension des autres ou prouver que nous sommes meilleurs qu'eux, que nous savons mieux qu'eux ? Je suis souvent déçue par les gens de mon pays, mais je veux les comprendre, je veux les soutenir lorsqu'ils font des pas vers la démocratie et la justice sociale.
En juillet dernier, nous avons été témoins de manifestations spontanées massives contre une loi interdisant les institutions anticorruption. Nous avons eu le sentiment qu'un événement important, inattendu et passionnant était en train de se produire. En France, nous sommes habitués à de tels bouleversements, mais en Ukraine, même avant que la population et les rues ne soient épuisées par la guerre, les manifestations de masse étaient rares. Et pourtant, dans plusieurs grandes villes, les citoyens sont descendus dans la rue, unis contre cette loi controversée.
Nous n'avions aucune illusion sur cette manifestation, qui était en fait assez libérale, mais pour mes camarades, il était essentiel de s'y joindre et d'y injecter un programme social. Nous avons été agréablement surpris de voir que les gens étaient capables de se mobiliser même en temps de guerre. Nous apprenons seulement à redonner le contrôle des processus qui se déroulent dans le pays au peuple, aux exploités et aux opprimés. La guerre a créé la nécessité d'agir différemment, d'être inventifs et attentifs. Nous ne cherchons pas à attirer toute l'attention sur nous, mais nous sommes devenus plus attentifs à nos sœurs dans le malheur, aux pays qui souffrent également des ambitions impérialistes.
Dans différentes régions du monde, des personnes continuent de s'entre-tuer pour des ressources. Nous n'avons pas beaucoup évolué depuis le Moyen Âge, si ce n'est que les armes sont désormais plus terrifiantes et invisibles. Le concept de décolonialisme est devenu naturel pour beaucoup, même s'ils ne connaissent pas encore ce mot ou n'ont pas lu Fanon. Cependant, comment élargir et approfondir les revendications sociales ? La grande majorité des citoyens ukrainiens ont un besoin urgent de soutien social. Beaucoup ont appris à se soutenir mutuellement, à partager leurs ressources, à organiser des activités publiques. En 2024, le premier syndicat de locataires a été fondé ; en 2023, nous avons relancé le syndicat étudiant Priama Diia, ce qui a en fait signifié la création d'un mouvement étudiant de gauche à partir de zéro ; en 2022, des « collectifs de solidarité » ont commencé à se former, un réseau de soutien aux soldats anti-autoritaires.
La médecine, l'éducation, les transports publics et d'autres infrastructures sont constamment soumis à la double frappe des missiles russes et des réformes néolibérales. Un recteur d'université, un propriétaire d'usine, un ministre, un directeur : tous justifient leurs actions antisociales par la guerre. « Nous n'avons pas d'argent, nous sommes en guerre, taisez-vous, nous sommes en guerre. » Les conflits de classe s'intensifient, et la chose la plus stupide dans notre situation serait de rester les bras croisés à attendre une révolution, de donner des leçons de morale. Notre avenir et notre capacité à survivre dépendent directement de notre capacité à unir les gens malgré leur atomisation pathologique, de notre capacité à développer des initiatives citoyennes.
Nous n'avons pas besoin de pitié, mais de compréhension et de respect. Nous avons besoin d'un dialogue direct. Nous avons besoin d'être entendus. Cependant, nous avons également beaucoup à apprendre : mieux écouter les autres peuples opprimés, cultiver notre curiosité. La catastrophe provoquée par la Russie est horrible et doit être stoppée, mais en même temps, quelque chose de véritablement nouveau est en train de naître et de se développer dans les vides qu'elle a créés, dans les blessures qu'elle a exacerbées.
En tant que mouvement de jeunesse, nous recherchons de nouvelles formes d'organisation des masses. Nous devons comprendre comment développer un mouvement libre de toute tendance capitaliste, patriarcale, autoritaire et exploiteuse, et l'utiliser pour avancer vers une société libre et égalitaire.
L'activisme étudiant n'est que l'une des premières étapes vers la création d'une culture de l'engagement. En deux ans et demi d'existence, nous avons uni et rallié de nombreux jeunes à des idées progressistes ; nous sommes devenus l'un des mouvements les plus visibles et les plus importants d'Ukraine. Nous acquérons de plus en plus d'expérience, nous apprenons de nos erreurs et de nos victoires, mais ce qui est également important, c'est que nous essayons d'établir des liens solides avec des mouvements similaires en Pologne, en Géorgie, en Serbie, en France et dans d'autres pays, car nous savons que notre lutte est mondiale.
Je suis heureuse d'avoir été invitée dans cette université. Chacun d'entre vous peut discuter avec moi, débattre, argumenter. Vous pouvez être en désaccord et garder votre propre opinion, vous n'êtes pas obligé d'adopter ma position. Mais je vous invite à trouver en vous l'intérêt et la curiosité sincère pour ce qui se passe dans mon pays. Venez me parler.
Bordeaux, 23 août 2025.
Katya Gritseva
co-fondatrice et militante du syndicat étudiant ukrainien Priama Diia
Source : Patrick Le Trehondat, RESU-France.
Titre choisi par Camille Popinot

Une rentrée sociale hautement frondeuse en France

Outragée ! « Rançonnée » dans les urnes, la Gauche, menée par son chef charismatique Jean-Luc Mélenchon (LFI-NFP), a promis de revenir à la charge dès la rentrée sociale, en septembre 2025. Pour empêcher le plan Bayrou, elle s'offre l'alliance du nouveau mouvement « Bloquons tout le 10 septembre ! ».
Voilà une résolution cogitée sous un parasol, que le Premier ministre peut s'enorgueillir de dérouler aux Français (es) en quête d'un pouvoir d'achat : « Suppression de 2 jours fériés. Comme disait ma mère : « La ration est moindre et les mouches à foison ! ».
François Bayrou, le Sisyphe de la Macronie que la combinarde Marine le Pen (RN) et le déserteur renégat, Olivier Faure (PS), pouponnent obséquieusement à des fins politiciennes, s'échine à redorer son blason et redresser sa cote de popularité en chute libre (18 % indice de confiance) par des mesures hautement préjudiciables au citoyen (e).
Sa formule visant à combler le déficit budgétaire à hauteur de 4,5 milliards d'euros, a suscité un tollé au sein de la Gauche. Une opportunité pour Jean-Luc Mélenchon (LFI-NFP) de réinvestir l'arène de la contestation, et, soit dit en passant, se faire justice. En effet, ce lundi, le chef des Insoumis a fait part « d'une prochaine mobilisation sur le terrain comme à l'Assemblée nationale, et une session extraordinaire dans la perspective de faire tomber le gouvernement, conformément aux vœux des Français ».
L'ancien Député européen semble engagé dans une dynamique de reconquête et de lutte digne de la pugnacité de Gisèle Halimi, ralliant le nouveau mouvement « Bloquons tout » le 10 septembre (très actif sur les réseaux sociaux).
Un collectif rassemblant des adhérents (es) de divers horizons qui a déjà esquissé ses premières actions. A savoir la chute du gouvernement actuel, le pouvoir d'achat et les retraites.
Emboitant le pas à Jean-Luc Mélenchon, le porte-parole de La France Insoumise, Manuel Bompart, ne mâchait pas ses mots quant à l'initiative de faire tomber le locataire de Matignon, exhortant de vive voix, ce lundi 18 août, tout le monde à prendre le même engagement : « Je demande aux militants de LFI et de tous ceux qui partagent nos idées de se mettre au service de ce mouvement », s'étrangle le député.
L'heure est à la concertation entre syndicats pour décider d'une riposte unitaire, au plus tôt ! Aussi, les formations poids lourds, telles la CFDT, CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, s'attèlent-elles à apporter les dernières mises au point avant le passage à l'offensive sur le bitume. Et le roussi émane déjà de quelques déclarations virulentes à l'instar de celle débitée par le Président de CFE-CGC, François Hommeril : « Un premier ministre qui ne connait rien au travail et à la productivité ! ».
Plus acerbe, l'ancien Secrétaire général de Force ouvrière (FO), Jean-Claude Mailly, martèle : « Politiquement, Bayrou va droit au mur volontairement. Il veut s'arrêter ! ». Si certains syndicats sont déjà montés au créneau contre le chef du gouvernement et l'exécutif, la circonspection et l'attentisme restent de mise pour nombre de formations. Les Écologistes, porteurs du slogan « À la rigueur budgétaire, mobilisation unitaire » le scénario catastrophe n'est pas à exclure, à la rentrée sociale. Ils dénoncent une politique d'austérité délétère : « l'État prépare 43,8 milliards d'économie en cinq ans », pointent-ils. Le passage au laminoir des acquis sociaux sous un gouvernement de Droite implacable, fait craindre une implosion sociale dure à contenir.
La Gauche, pourrait, dans les prochaines échéances, voir les usurpateurs de sa légitimé électorale, aller droit dans le mur !
O.H
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le Parti travailliste est mort" : Zarah Sultana trace la voie d’une alternative socialiste en Grande-Bretagne

À 31 ans, Zarah Sultana incarne une nouvelle génération de dirigeantes socialistes britanniques qui refuse les compromissions. Son opposition intransigeante au soutien du gouvernement Starmer au génocide de Gaza lui a valu d'être exclue du groupe parlementaire travailliste en 2024.
17 août 2025 | tiré d'Europe solidaire sans frontières
https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article75931
Loin de s'en lamenter, Sultana a choisi de quitter définitivement un parti qu'elle juge « mort » pour co-fonder avec Jeremy Corbyn une nouvelle formation de gauche. Dans cet entretien, elle détaille sa vision d'un parti démocratique et de masse, ancré dans les mouvements sociaux, capable de défier à la fois l'establishment travailliste et la montée de l'extrême droite. Un projet qui pourrait redéfinir le paysage politique britannique.
Zarah Sultana fait partie des dirigeantes socialistes les plus en vue de Grande-Bretagne. Née à Birmingham en 1993, elle s'est politisée dans le mouvement étudiant puis lors de la montée du corbynisme : siégeant au bureau national des Young Labour [1], travaillant comme organisatrice communautaire pour le parti et finalement se présentant au parlement, où elle représente maintenant Coventry South [2]. Son élection a coïncidé avec le début de la direction travailliste de Keir Starmer, qu'elle a longtemps fustigée pour ses perspectives réactionnaires et son autoritarisme mesquin. Au cours de l'année écoulée, son profil s'est considérablement accru grâce à son opposition tranchante à la complicité du gouvernement Starmer dans le génocide de Gaza. Sa dissidence a conduit à sa suspension du groupe parlementaire, et depuis lors elle est devenue l'étendard de l'alternative de gauche naissante : l'une des figures les plus jeunes et les plus populaires impliquées dans sa formation. Sultana a proposé de co-diriger le nouveau parti aux côtés de Corbyn, et fait partie d'un groupe travaillant sur la conférence de fondation cet automne.
Pour le troisième volet de cette série Sidecar, Oliver Eagleton s'est entretenu avec Sultana sur le nouveau parti de gauche : pourquoi il est nécessaire, quel type de structures démocratiques il devrait avoir, ses objectifs parlementaires et extra-parlementaires, sa réponse à l'extrême droite, l'argument en faveur de la co-direction, et comment la conférence devrait être organisée.
Oliver Eagleton : Commençons par votre trajectoire politique et votre relation avec le Parti travailliste. Comment a-t-elle évolué dans le temps ? Qu'est-ce qui vous a amenée à la décision de partir plus tôt cette année ? Pensez-vous que d'autres de la soi-disant « gauche travailliste » vous suivront ?
Zarah Sultana : J'ai été formée politiquement par la Guerre contre le terrorisme et les conséquences de la crise financière. La première fois que je me suis engagée dans la politique parlementaire, c'était quand le gouvernement de coalition [3] a lancé une attaque directe contre ma génération en triplant les frais de scolarité ; j'ai fait partie de la première cohorte qui a dû payer 9 000 livres par an [environ 10 500 euros] pour l'enseignement supérieur. J'ai décidé d'adhérer au Parti travailliste à l'âge de dix-sept ans, parce qu'à cette époque il semblait qu'il n'y avait pas d'autre parti qui pouvait servir de véhicule pour le changement. Je n'ai jamais pensé qu'il était parfait. Ma section locale dans les West Midlands [4] était contrôlée par des hommes âgés qui ne voulaient pas que les jeunes – surtout pas les jeunes femmes de gauche – soient impliqués. Quand je suis allée étudier à Birmingham en 2012, les clubs et sociétés travaillistes ne faisaient rien d'autre qu'organiser des conférences de députés de droite, alors j'ai dû trouver d'autres débouchés politiques.
Dans ma première semaine d'université, mon père et moi avons rejoint une délégation de conseillers et militants travaillistes qui sont partis en voyage en Cisjordanie occupée, et cela a changé ma façon de me voir. Je n'avais jamais pensé auparavant que j'étais privilégiée, mais j'ai réalisé qu'à cause du pur hasard de l'endroit où j'étais née et du passeport que je détenais, j'étais traitée différemment par les autorités israéliennes. J'ai vu comment elles harcelaient et maltraitaient les Palestiniens puis se comportaient avec moi comme avec un être humain normal. Je suis allée à Hébron [5] et j'ai vu les routes réservées aux Juifs, les communautés qui subissaient des attaques quotidiennes de la part des colons et des soldats. Tout cela était difficile à comprendre. Mais c'était encore plus déconcertant que nous – notre pays, notre société – permettions que cela arrive. Alors cela a allumé un internationalisme en moi : une opposition profonde au pouvoir impérial, à l'apartheid, au colonialisme de peuplement et à l'occupation militaire.
Puis quand je me suis impliquée dans le National Union of Students [6], j'ai réalisé que je n'étais pas la seule à ressentir cela. C'est un moment vraiment magique, quand vous découvrez que vous n'êtes pas seule dans votre politique. J'ai commencé à faire campagne sur des questions comme l'éducation gratuite, les bourses d'entretien, l'antiracisme, le logement, Boycott, Désinvestissement et Sanctions [7]. Ce n'est qu'après avoir obtenu mon diplôme, cependant, que j'ai appris à quel point notre contrat social était brisé. J'ai vraiment eu du mal à trouver du travail. J'allais au Jobcentre [8], regardais mon CV et me demandais pourquoi, malgré mon diplôme et mon expérience, je n'avais pas de place dans cette économie. Et bien sûr j'étais aussi accablée par 50 000 livres [environ 58 000 euros] de dettes.
Quand Jeremy a remporté l'élection à la direction travailliste en 2015, ma pensée immédiate a été : « Oh mon dieu, voici une opération politique nationale qui ne déteste pas les jeunes ! » Alors j'ai mis toute mon énergie dans l'aile jeunesse du parti. J'avais déjà vu Jeremy s'exprimer sur les questions qui étaient les plus importantes pour moi – lors de manifestations, d'événements, de piquets de grève – ce qui rendait naturellement le Parti travailliste comme un endroit où j'appartenais. Il a mis en place une Unité d'Organisation Communautaire, dans le but de développer un type différent de politique enracinée dans les préoccupations matérielles des gens, et je suis allée y travailler, ce qui m'a permis d'organiser dans ma région d'origine : des zones comme Halesowen, Wolverhampton et Stourbridge [9], qui avaient toutes voté pour le Brexit. Nous avons fait campagne sur des questions locales, organisé des formations, identifié des dirigeants et construit le pouvoir communautaire. De là, j'ai eu l'opportunité de me présenter aux élections européennes puis aux élections générales de 2019, c'est ainsi que je suis devenue députée.
Mais aujourd'hui nous avons un type très différent de Parti travailliste : un qui poursuit l'austérité, dilue les projets de loi sur les droits des travailleurs, et soutient activement le génocide. J'ai passé des mois à pousser le gouvernement Starmer à considérer des politiques populaires comme les taxes sur les super-riches, la nationalisation des services publics et les repas scolaires gratuits universels. J'ai aussi lutté contre certains de ses pires excès, comme le maintien du plafond des allocations pour deux enfants [10], la suppression des paiements de combustible d'hiver et des allocations d'invalidité, et la vente d'armes à la machine de guerre israélienne. En conséquence, j'étais parmi le groupe de députés qui ont eu le whip retiré [11] l'année dernière. Quand j'ai parlé pour la dernière fois au Chief Whip du parti [12], il a insinué que je n'allais jamais être réadmise parce que j'avais critiqué leur complicité dans les crimes de guerre d'Israël. Mais, contrairement à certains faux rapports, ils n'allaient jamais m'expulser du groupe parlementaire ; ils prévoyaient de me maintenir dans un limbe permanent. J'ai tenu bon. J'ai dit au Chief Whip que le génocide en Palestine était un test décisif – non seulement pour moi, mais pour des millions de personnes à travers le pays – et que c'était bien plus important pour moi que ma carrière politique.
Alors quitter le parti a longtemps été une question de quand, pas de si. Mais il était important pour moi de partir selon mes propres termes, sinon vous donnez à la direction la capacité de contrôler le narratif. J'ai choisi de le faire lors d'une semaine saillante, quand le gouvernement a décidé de cibler les allocations d'invalidité et de proscrire Palestine Action [13]. Il ne pouvait y avoir de reflet plus clair de là où le Parti travailliste a fini. Voici un parti qui veut imposer des coupes à certaines des personnes les plus marginalisées de notre société pour plaire aux investisseurs. Voici un parti qui, pour la première fois dans l'histoire britannique, criminalise un groupe d'activistes non-violents, utilisant les parties les plus répressives de l'État pour protéger les marges bénéficiaires des fabricants d'armes. Si ce ne sont pas des lignes rouges pour vous, alors franchement vous n'en avez aucune.
Le Parti travailliste est mort. Il a détruit ses principes et sa popularité. Certains députés travaillistes qui se considèrent de gauche s'accrochent encore à son cadavre. Ils disent qu'en restant ils pourront conserver leur influence politique. Ma réponse est simple : vous n'avez pas pu arrêter les coupes d'invalidité, vous n'avez pas pu arrêter le flux d'armes vers un État d'apartheid génocidaire, alors où est cette influence dont vous parlez ? Il n'y a aucun intérêt à rester à attendre un changement de direction pendant que les gens meurent – pas seulement à Gaza, mais aussi de la pauvreté dans ce pays. Il est temps de sortir, de construire quelque chose de nouveau, et d'inviter tout le monde à nous rejoindre.
OE : Pour beaucoup de gens de notre génération, le corbynisme a établi un paradigme pour la politique radicale. Considérant le gouffre historique entre 2015 et 2025, cependant, comment devrions-nous l'adapter au présent ?
ZS : Je pense que nous sommes dans un moment politique très différent. Nous devons nous appuyer sur les forces du corbynisme – son énergie, son attrait de masse et sa plateforme politique audacieuse – et nous devons aussi reconnaître ses limites. Il a capitulé devant la définition IHRA de l'antisémitisme [14], qui l'assimile notoirement à l'antisionisme, et que même son auteur principal Kenneth Stern a maintenant publiquement critiquée. Il a trianguló sur le Brexit [15], ce qui a aliéné un énorme nombre d'électeurs. Il a abandonné la resélection obligatoire des députés pour le compromis du scrutin de déclenchement [16], gardant en place beaucoup des structures antidémocratiques du parti. Il n'a pas fait d'effort réel pour canaliser ses adhérents de masse vers le mouvement ouvrier ou les syndicats de locataires, ce qui aurait enrichi la base sociale du parti. Quand il a été attaqué par l'État et les médias, il aurait dû riposter, reconnaissant que ce sont nos ennemis de classe. Mais au lieu de cela il était effrayé et beaucoup trop conciliant. C'était une erreur grave. Si nous contestons le pouvoir d'État, nous allons faire face à une réaction majeure, et nous devons avoir la résilience institutionnelle pour y résister. Vous ne pouvez pas donner un pouce à ces gens.
Entre 2015 et 2019 j'avais des amis et collègues qui travaillaient au sommet du Parti travailliste, et ils peuvent vous dire qu'en partie c'était un environnement de travail hautement dysfonctionnel avec de la toxicité et du harcèlement – pas de Jeremy, mais de certaines personnes autour de lui. Le pouvoir était trop centralisé. Ce n'est pas ce dont nous avons besoin pour ce projet émergent. Nous avons maintenant une génération plus jeune qui est hautement politisée à cause des politiques désastreuses de l'establishment sur le logement, l'éducation, l'emploi et la guerre. Ils vont exiger une place à la table et la capacité d'exercer un pouvoir réel, et à juste titre. Ma vision pour le nouveau parti concerne ce type de participation active, parce que c'est ainsi que je suis entrée en politique moi-même : pas par la voie traditionnelle de me présenter comme conseillère, mais à travers les mouvements sociaux. Tout le monde doit sentir qu'il est impliqué et l'organisation doit être représentative de la société au sens large. Cela signifie aussi que nous ne pouvons pas minimiser notre antiracisme. Certaines personnes veulent que nous nous concentrions uniquement sur les « questions économiques ». Mais si la politique de classe est détachée de la politique de race alors elle est vouée à l'échec – parce que quand nos voisins sont simultanément ciblés pour l'expulsion et la déportation, cette lutte est une seule et même chose.
OE : Vous avez raison qu'un projet de gauche qui trace une ligne de division illusoire entre race et classe finira par diviser sa base, tout en dégénérant politiquement. Mais je veux aussi demander comment le parti devrait se positionner vis-à-vis de Reform [17]. Une partie de ses messages jusqu'à présent a mis l'accent sur l'arrêt de l'extrême droite et la défaite de Farage. Je pense que nous pouvons tous être d'accord sur la nécessité de cela. Mais y a-t-il un danger qu'en se présentant principalement comme un parti antifasciste, cela puisse détourner l'attention du gouvernement comme notre adversaire principal, ou même légitimer le Parti travailliste comme partie d'une sorte de front populaire ?
ZS : Je ne pense pas que vous devez choisir si vous concentrer sur Reform ou le Parti travailliste. Vous pouvez vous opposer à Farage et expliquer ce qu'il ferait au pays, et vous pouvez aussi attaquer le gouvernement pour agir comme Reform-lite. Rappelez-vous cette citation de Sivanandan [18], « Ce qu'Enoch Powell dit aujourd'hui, le Parti conservateur dit demain, et le Parti travailliste légifère le jour d'après. » [19] À moins que nous défions cette politique powelliste partout où elle lève la tête, nous rendons un mauvais service aux gens que nous voulons représenter. Il est vrai que nous ne pouvons pas traiter la montée du nationalisme raciste comme simplement une question morale ; nous devons aborder ses causes structurelles : la façon dont il se nourrit de la colère et du désespoir dans des zones qui ont été dévastées par le consensus de Westminster [20]. Mais la droite n'a pas le monopole de cette colère. Je suis en colère aussi. Nous devrions tous être en colère quand nous pensons à ce qui est arrivé à ces communautés de la classe ouvrière, et nous devrions canaliser ces sentiments pour faire un argument très clair – que le problème n'est pas le travail migrant mais les propriétaires exploiteurs, les compagnies d'énergie cupides, les services privatisés. Nous n'avons pas à traiter les gens avec condescendance et leur dire que leurs frustrations sont fausses, nous n'avons pas non plus à céder à aucune sorte de nativisme. Nous pouvons être confiants dans notre politique et la communiquer à travers des campagnes locales et des conversations persuasives.
C'est un long processus ; cela prend des mois et même des années, surtout dans des endroits où ces arguments ne sont pas familiers à la plupart des gens. Mais il y a des façons de les faire passer. L'une est de parler du type de société que nous voulons réellement, et de la décrire en détail plutôt que de simplement faire des slogans. Quels sont nos objectifs à long terme ? Plus de temps avec nos proches, plus d'espaces verts, garde d'enfants universelle, transport public gratuit, ne pas s'inquiéter des factures. Ce sont des choses dont Farage et Starmer ne parlent pas, alors cela nous permet de contraster notre vision positive avec leur vision entièrement négative. Et puis il y a toujours la question : comment allons-nous payer pour cela ? Eh bien, nous pouvons mettre fin aux dépenses militaires massives ; nous pouvons taxer les compagnies de pétrole et de gaz ; nous pouvons inverser la redistribution de richesse du public vers le privé qui s'est accélérée depuis le Covid. Nous devrions nous engager à financer le transport public gratuit au lieu de financer des guerres éternelles. Ce sont des politiques qui ont du sens pour les gens. Nous devons argumenter pour elles aussi agressivement que la droite argumente pour les siennes.
OE : C'est une bonne description de l'horizon à long terme. Quels sont les objectifs à plus court terme du projet ?
ZS : Nous en sommes encore à un stade embryonnaire, mais d'un autre côté nous avons déjà plus de 700 000 personnes qui ont montré de l'intérêt, alors notre travail en ce moment devrait être de nous concentrer sur l'activation de notre base et d'articuler qui nous sommes – ce qui, incidemment, est pourquoi je crois que nous devrions nous appeler « La Gauche », parce que c'est une expression sans excuses de ce que nous défendons. En même temps nous devons recruter à travers le pays, dans des zones qui n'ont pas les mêmes niveaux d'activité politique que Londres. Nous avons vu un énorme intérêt dans le Nord-Ouest et le Nord-Est [21], ce qui est très excitant, et bien sûr j'aimerais voir plus de gens impliqués dans les West Midlands. Mon point de vue est qu'il devrait aussi y avoir un haut degré d'autonomie pour l'Écosse et le Pays de Galles. Beaucoup de groupes locaux officieux ont aussi surgi depuis que nous avons annoncé le parti, mais nous formaliserons nos structures lors de la conférence à venir. La structure globale du parti doit être unitaire, sinon ce ne sera pas un projet cohésif qui unit le spectre existant de mouvements et de luttes. Une fédération ne sera pas aussi capable de galvaniser les gens ou de passer à l'offensive ; elle pourrait finir par être peu plus qu'une collection lâche de différents groupes plutôt qu'un bloc puissant et uni.
Pour établir tout cela nous devons avoir une conférence pleinement démocratique. Cela repose sur quelques choses différentes. D'abord, elle ne peut pas être dirigée juste par des députés. En ce moment il y a six d'entre nous députés dans l'Alliance Indépendante [22], cinq desquels sont des hommes. Ce ne devrait pas être à quoi notre parti ressemble en avançant, alors le comité qui organise la conférence devrait être équilibré en genre ainsi que racialement et régionalement diversifié, tous avec un enjeu égal et des droits de vote. Tout ce qui est moindre serait un club de garçons. Deuxièmement, ceux qui participent à notre conférence inaugurale doivent participer de manière significative, et cela ne peut signifier qu'Un Membre Un Vote. Il devrait y avoir un lieu accessible, ainsi qu'un aspect hybride avec de faibles barrières à l'entrée. Nous devrions viser la participation de masse, par opposition à une structure de délégués étroite qui pourrait être non représentative de notre base. Et finalement, nous devrions avoir un véritable forum pour le débat et la discussion, pas une situation où les décisions sont prises par une équipe exécutive et approuvées par tout le monde d'autre.
Tout cela est vital, parce qu'à moins que nous ayons les bons processus démocratiques internes dès le départ il sera beaucoup plus difficile pour le parti d'agir comme un catalyseur pour toute forme plus large de démocratisation ; alors que si nous organisons une conférence ouverte et pluraliste, nous aurons déjà brisé les conventions de la politique britannique, ce qui est un premier pas sur la route pour les remodeler. Nous pouvons alors établir non seulement une plateforme qui parle aux préoccupations quotidiennes des gens, mais aussi une présence de campagne majeure à travers le pays. Nous ne voulons pas juste de l'électoralisme – nous voulons un projet qui est lié aux syndicats de locataires, à l'organisation ouvrière, à la lutte pour défendre le NHS [23] de la privatisation et au mouvement de solidarité avec la Palestine.
Pour faire campagne efficacement sur tous ces fronts nous devons faire un ensemble clair de demandes. Pensez à Zohran Mamdani à New York [24] ; même beaucoup d'entre nous ici en Grande-Bretagne savons quels sont ses principaux engagements. Il les a exprimés de sorte que tout le monde puisse les comprendre, et ils résonnent à un niveau bien plus profond que la plupart du discours politique. Si nous commençons à faire cela alors nous réaliserons que nous n'avons pas à être redevables aux traditions archaïques de Westminster, qui sont conçues pour rendre la politique exclusive.
OE : Une des questions que nous avons discutées dans cette série jusqu'à présent est l'équilibre entre pouvoir populaire et parlementaire. Certains ont argumenté que le nouveau parti devrait être un levier pour la mobilisation populaire, dont le rôle principal est de renforcer ou créer des institutions de la classe ouvrière comme prérequis pour de futures campagnes électorales. D'autres disent que la priorité est de créer un bloc parlementaire proéminent qui peut faire des interventions efficaces et gagner des élections – ce qui, en retour, aura un effet spontanément énergisant sur la vie civique de la classe ouvrière. Où vous situez-vous dans ce débat ?
ZS : C'est un faux binaire. Je vois mon travail à Westminster comme un pont entre les mouvements sociaux, les syndicats et le parlement. Les lois progressistes que nous prenons maintenant pour acquises – protections des travailleurs, congé de maternité, le week-end, même le droit de vote – ne sont venues que parce que les députés ont été forcés de répondre à des pressions plus larges. Les luttes qui ont forcé ces concessions sont souvent effacées de l'histoire. Aujourd'hui nous voyons des députés travaillistes montrer leur soutien aux « droits des femmes » en portant des écharpes de suffragettes tout en votant en même temps pour proscrire Palestine Action. Nous ne devrions pas suivre leur exemple en agissant comme s'il y avait un gouffre nécessaire entre les royaumes du pouvoir populaire et parlementaire. Un parti qui ne se soucie que des élections sera irrelevant en dehors d'un cycle électoral. Et un parti qui ignore le parlement créera un vide qui sera inévitablement occupé par l'extrême droite.
Ce que je veux – et j'ai du mal à voir comment un parti de gauche réussi pourrait être établi d'une autre façon – est une orientation de campagne, de mouvement social combinée avec une présence parlementaire robuste : une situation où nos députés sont en première ligne des actions de grève et des mobilisations antifascistes. Si vous vous concentrez entièrement sur le parlement plutôt que de construire une capacité plus large, c'est une approche très à court terme, parce que qu'est-ce qui arrive quand ces députés sont attaqués par l'establishment ? Qu'est-ce qui arrive s'ils perdent leurs sièges ou s'ils prennent leur retraite ? Vous devez construire l'infrastructure sociale qui les soutiendra en fonction et identifiera de nouveaux dirigeants pour les remplacer. C'est ce type de pouvoir communautaire qui soutient les politiciens socialistes et les tient responsables. Sans cela, vous obtenez soit la capitulation, soit vous obtenez une gauche qui est dominée par quelques figures de proue au sommet, ce qui la rend formellement indistinguable de tout autre parti.
Le fait est que les gens reconnaissent quand les politiciens sont inauthentiques, quand ils n'ont aucune connexion à une base populaire. Ils le voient à travers immédiatement. Alors que quand vous êtes le type de politicien comme Jeremy ou John McDonnell [25] ou Diane Abbott [26], dont l'autorité est profondément enracinée dans les luttes communautaires, vous avez un profil très distinct, et vous pouvez faire des gains beaucoup plus significatifs.
OE : Quand il s'agit de certaines décisions stratégiques, cependant, il pourrait y avoir quelques choix binaires. Par exemple, le parti devrait-il mettre en place sa propre unité d'organisation communautaire, comme celle pour laquelle vous aviez l'habitude de travailler, ou devrait-il laisser l'organisation communautaire aux communautés ?
ZS : En théorie, j'adore l'idée d'avoir l'organisation communautaire de masse comme partie de l'ADN du parti. Il y a des gens qui font déjà le travail quotidien de s'assurer que personne dans leur communauté n'ait faim, ou que l'extrême droite ne puisse pas attaquer les hôtels d'asile [27]. Le nouveau parti devrait trouver ces gens – qui ne correspondent pas nécessairement aux notions traditionnelles d'un dirigeant politique – et les faire participer, leur demander de façonner l'organisation, les cultiver pour des positions d'autorité. Mais cela devrait-il prendre la forme d'une unité d'organisation communautaire telle que nous en avions dans le Parti travailliste ? Ici je pense qu'il y a certaines limitations. Dans mon expérience, la COU n'obtenait pas toujours les victoires qu'elle méritait, en partie parce que quand ce type de travail communautaire est attaché à un parti il vient immédiatement avec certaines connotations, qui pourraient rebuter ceux qui sont compréhensiblement lassés de la politique de parti. Nous avons aussi eu des situations où la COU est entrée en conflit avec d'autres parties du Parti travailliste, par exemple quand les conseils ne payaient pas leurs travailleurs un salaire équitable. Je ne dis pas que cela arriverait avec le nouveau projet, mais il y a toujours le danger que quand un parti national fait une gamme d'activités d'organisation différentes elles peuvent ne pas s'imbriquer parfaitement et des tensions peuvent survenir.
L'organisation communautaire serait plus efficace si, plutôt que d'être dirigée par une unité spécifique, elle devient une pratique ancrée à travers le parti – dans comment nous dirigeons les réunions, les sessions de formation, le démarchage et les campagnes. Le rôle du parti pourrait être de développer ce type de culture politique de masse : rendre naturel pour les gens de s'engager en politique au niveau de base, pour qu'ils aillent créer des syndicats de locataires, des clubs de lecture, des groupes anti-raids [28], ou quoi que ce soit d'autre qui répondrait à leurs besoins locaux. De cette façon, le parti jouerait un rôle en stimulant les luttes populaires sans avoir à les gérer et les contrôler. L'éducation politique serait une partie vitale de cela : traduire le sens instinctif des gens de ce qui ne va pas avec la société en une perspective radicale. Si nous obtenions la moitié des gens qui se sont inscrits comme sympathisants dans l'éducation politique, les effets seraient transformateurs. Il est impossible de prédire où cela mènerait.
OE : C'est intéressant. Alors le parti ne serait pas nécessairement chargé de former ces institutions, mais il ne présumerait pas non plus qu'elles vont simplement surgir spontanément. Il utiliserait plutôt ses structures démocratiques locales et ses initiatives d'éducation pour créer la culture politique qui pousserait les gens à devenir actifs. Une chose qui va certainement militer contre tout cela est le factionnalisme inutile. Qu'en est-il des divisions qui ont assailli le projet jusqu'à présent ?
ZS : Après que j'ai annoncé ma démission et mon intention de co-diriger la fondation d'un nouveau parti de gauche avec Jeremy, les fuites contre moi ont été presque instantanées. Un petit nombre de personnes qui sont impliquées dans le parti se sont engagées dans des briefings anonymes, faisant des commentaires hostiles et implicitement islamophobes sur moi au Sunday Times et Sky News. Ce comportement est absolument inacceptable dans n'importe quel contexte, mais surtout un dans lequel nous essayons de créer une nouvelle culture politique. Des gens qui sont supposément de gauche pensant qu'il est approprié d'utiliser la presse Murdoch [29] pour diffuser des calomnies est stupéfiant. C'est la même classe médiatique qui a essayé de détruire la réputation de Jeremy et la politique qu'il représente. Il n'y a pas de place pour cela dans ce que nous construisons. Nous comprenons tous le désaccord camarade, mais c'est différent quand vous franchissez les lignes de classe pour le bien du factionnalisme et du psychodrame. Les membres ne veulent pas cela ; c'est un repoussoir majeur pour eux. Personnellement je n'ai pas de temps pour ce type d'intimidation et d'harcèlement, et je ne vais pas laisser cela saboter un projet qui est beaucoup plus grand que nous tous. Nous avons le fascisme qui grogne à la porte ; les égos n'ont pas de place dans ce combat.
OE : Un argument d'avocat du diable contre un modèle de parti entièrement dirigé par les membres pourrait aller quelque chose comme suit. Parce que nous n'avons pas encore une culture politique de masse, beaucoup de gens qui veulent être politiquement actifs ne savent pas vraiment ce que cela impliquerait. Ils pourraient donc vouloir que leurs énergies soient dirigées, plutôt que de faire toute la direction eux-mêmes. L'absence de politique de masse signifie aussi que la gauche organisée consiste en divers groupes relativement petits avec leurs propres priorités distinctes, qui seront difficiles à rassembler dans une structure unifiée sans intervention d'en haut. Et il y a aussi le risque connexe que certaines de ces priorités pourraient ne pas être particulièrement représentatives de la société au sens large. Que diriez-vous à cela ?
ZS : Si nous suivons cet argument nous allons juste reproduire les problèmes avec chaque autre parti politique : contrôle de haut en bas, prise de décision non responsable, querelles internes, emplois distribués aux copains. Je trouve l'argument contre la démocratie dirigée par les membres bizarre étant donné que notre objectif entier est d'autonomiser les gens. Vous ne pouvez simplement pas faire cela sans faire participer les gens et leur donner la propriété sur les politiques, la stratégie et la direction. Cela résultera inévitablement en quelques situations difficiles, avec diverses positions et perspectives s'affrontant, mais c'est à prévoir. S'il y a certaines questions où nous ne pouvons pas convaincre une majorité, alors nous ne pouvons pas simplement les contourner ou les ignorer ; ce serait une abdication de responsabilité politique. Au lieu de cela nous devons travailler plus dur. Je n'ai aucune réticence, par exemple, à défendre un programme socialiste résolument antiraciste et pro-trans, même si des parties de cela sonnent controversées pour certaines personnes. Ce n'est qu'en ayant ces discussions au grand jour et à travers les canaux appropriés que nous pouvons créer quelque chose qui semble fondamentalement différent, se sent fondamentalement différent, des autres partis de Westminster. Si ce n'est pas l'objectif, que faisons-nous ici ?
OE : Tant que nous sommes sur le sujet des autres partis, quelle est votre vue sur les alliances électorales ?
ZS : Je suis ouverte aux alliances électorales, avec la réserve que cela devrait être soutenu par les membres. En général, je pense que nous devrions être disposés à travailler avec quiconque nous aidera à battre la droite et l'establishment. Nous devons être pragmatiques, surtout tant que nous travaillons dans le système du scrutin uninominal à un tour [30], bien que gagner la réforme électorale devrait aussi être un objectif. Mais à ce point il serait prématuré de commencer à découper les circonscriptions – décider où nous devrions nous présenter, où nous pourrions nous effacer – quand nous n'avons pas encore compris l'étendue complète de ce que nous construisons. Jusqu'à ce que nous ayons réellement créé le parti, et obtenu un sens de ses capacités et de ses limites, nous ne pouvons pas faire cela en détail. Il va y avoir quatre ans jusqu'aux prochaines élections générales. Nous devons d'abord développer les structures du parti, et alors les négociations sur ce type de stratégie viendront plus tard si les membres les approuvent.
OE : Quels sont les bénéfices d'un modèle de co-direction, avec vous et Corbyn à la barre ?
ZS : Si nous avons plus de voix au sommet, si nous évitons de concentrer le pouvoir dans une paire de mains, alors nous serons plus représentatifs de notre mouvement et plus responsables envers lui. Ce n'est pas une petite chose de commencer un nouveau parti, il y a beaucoup à faire et nous devons partager le travail. Alors il semble naturel que deux personnes avec les mêmes valeurs et principes, et la même croyance dans le projet, le fassent ensemble. Nous avons beaucoup à apprendre l'un de l'autre ; j'apprends toujours de Jeremy et j'aimerais penser qu'il y a des perspectives que je peux lui offrir aussi. Une co-direction avec des pouvoirs égaux signifierait qu'aucun de nous n'est une figure symbolique. Cela nous permettrait aussi de prendre ce qui est souvent juste un slogan libéral sur « plus de femmes dans des rôles de direction » et d'en faire une réalité, sapant les préjugés qui retiennent habituellement les jeunes femmes : pas assez sérieuses, trop inexpérimentées, et ainsi de suite. Les gens sont déjà énormément excités par cette idée et ils ont pris contact en nombres vastes. Il ne s'agit pas d'éviter une direction forte, mais de doubler sa force.
OE : Que peuvent faire les sympathisants avant la conférence ? Comment peuvent-ils être le plus utiles ?
ZS : Le recrutement de masse est crucial. Nous devrons organiser des événements dans la période qui précède la conférence pour enthousiasmer les sympathisants et recruter plus de gens. Une des meilleures parties du corbynisme était les rassemblements et la musique et les performances. Nous devons récupérer cela. Ce dont nous avons besoin est une politique d'amusement et de joie. Nous ne sommes pas intéressés par des réunions où tout le monde a un point d'ordre et ils parlent pendant vingt minutes chacun. Pensez-vous que les jeunes de seize ans qui vont bientôt avoir le droit de vote [31] voudront s'asseoir à travers cela ? Le nouveau projet devrait engager cette génération en s'imbriquant dans la culture de masse. Nous avons déjà vu des musiciens, artistes, acteurs s'aligner pour s'impliquer. Jade Thirlwall [32] a été favorable, ainsi qu'Aimee Lou Wood [33] et Ambika Mod [34] – des gens dans cette tranche d'âge plus jeune qui sont en contact avec le sentiment populaire et qui savent à quel point il est éloigné de la politique en décomposition de l'establishment. Nous devons faire de la politique différemment et ce n'est pas un cliché, mais un prérequis pour ce parti.
L'objectif est de changer la politique pour toujours. Quand nous avons un gouvernement qui aide au génocide et mène la guerre contre ses propres citoyens, et une extrême droite qui se prépare à entrer à Downing Street [35], nous ne pouvons pas nier l'urgence. Alors je suis prête à tout donner à ce combat. C'est ce que je dois à ma communauté et à ma classe. C'est le moment.
is among Britain's most prominent socialist leaders. Born in Birmingham in 1993, she became politically active in the student movement and later in the upsurge of Corbynism : serving on the national executive of Young Labour, working as a community organiser for the party and eventually running for parliament, where she now represents Coventry South. Her election coincided with the beginning of Keir Starmer's Labour leadership, which she has long excoriated for its reactionary outlook and petty authoritarianism. Over the past year her profile has increased significantly thanks to her trenchant opposition to the Starmer government's complicity in the Gaza genocide. Her dissent led to her suspension from the parliamentary party, and since then she has become a standard-bearer for the nascent left alternative : one of the youngest and most popular figures involved in its formation. Sultana has proposed co-leading the new party alongside Corbyn, and is part of a group working on the founding conference this autumn.
Zarah Sultana interviewée par Oliver Eagleton
P.-S.
https://newleftreview.org/sidecar/posts/the-alternative
Traduit pour ESSF par Adam Novak
Notes
[1] Young Labour est l'aile jeunesse du Parti travailliste, pour les membres âgés de 14 à 26 ans
[2] Coventry South est une circonscription parlementaire dans les Midlands de l'Ouest, région industrielle du centre de l'Angleterre
[3] Le gouvernement de coalition entre conservateurs et libéraux-démocrates de 2010-2015, dirigé par David Cameron
[4] Les West Midlands sont une région métropolitaine du centre de l'Angleterre, incluant Birmingham et Coventry
[5] Hébron est une ville de Cisjordanie sous occupation israélienne, théâtre de tensions constantes entre colons juifs et population palestinienne
[6] Le NUS est le syndicat national des étudiants britanniques
[7] BDS est un mouvement international de boycott d'Israël inspiré de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud
[8] Le Jobcentre Plus est l'agence gouvernementale britannique pour l'emploi et les allocations
[9] Ces villes des West Midlands sont d'anciennes zones industrielles touchées par la désindustrialisation
[10] Cette mesure limite les allocations familiales aux deux premiers enfants
[11] Le « whip » est la discipline de parti ; perdre le whip signifie être exclu du groupe parlementaire
[12] Le Chief Whip est responsable de la discipline parlementaire
[13] Palestine Action est un groupe d'activistes britanniques qui mène des actions directes contre l'industrie de l'armement israélienne
[14] La définition de l'antisémitisme de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste (IHRA), controversée car elle assimile souvent antisionisme et antisémitisme
[15] Triangulation politique : stratégie consistant à adopter des positions modérées entre la gauche et la droite
[16] Système où les députés sortants peuvent être défié par leur section locale sous certaines conditions
[17] Reform UK est le parti d'extrême droite de Nigel Farage
[18] A. Sivanandan était un intellectuel et activiste antiraciste sri-lankais-britannique
[19] Enoch Powell était un politicien conservateur britannique connu pour ses positions anti-immigration
[20] Le « consensus de Westminster » fait référence aux politiques néolibérales partagées par les partis principaux
[21] Régions industrielles du nord de l'Angleterre
[22] L'Alliance Indépendante regroupe les députés ayant quitté ou été exclus du groupe parlementaire travailliste
[23] National Health Service, le système de santé publique britannique
[24] Zohran Mamdani est un député socialiste démocrate de l'État de New York
[25] John McDonnell était le ministre fantôme des Finances sous Corbyn
[26] Diane Abbott est une députée travailliste de gauche, première femme noire élue au Parlement britannique
[27] Les hôtels d'asile hébergent temporairement les demandeurs d'asile en Grande-Bretagne
[28] Les « raids » font référence aux opérations d'arrestation d'immigrés sans papiers
[29] Empire médiatique de Rupert Murdoch, incluant The Sun et The Times
[30] First-past-the-post : système électoral britannique où le candidat avec le plus de voix gagne
[31] L'âge de vote au Royaume-Uni pourrait être abaissé à 16 ans
[32] Membre du groupe pop Little Mix
[33] Actrice britannique connue pour « Sex Education »
[34] Actrice britannique
[35] Résidence officielle du Premier ministre britannique
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Après la grande panne d’électricité : quel modèle énergétique pour la transition écologique ?

La panne d'électricité du 28 avril dernier a bouleversé pendant quelques heures la péninsule ibérique et le sud de la France. Toutes celles et ceux qui y vivent ont été touchés d'une manière ou d'une autre. Cela a fait l'objet de nombreuses discussions qui, pour ne pas rester au stade de l'anecdote, compte tenu des risques systémiques qu'une telle situation se reproduise, exigent une analyse et une réflexion approfondies. Il faut en tirer des leçons pour l'avenir.
19 août 2025 | Tiré d'Inprecor->https://inprecor.fr/node/4949 | Photo : Rue Rosalia de Castro, Vigo le 28 avril 2025. /Seoane Pardo CC BY-SA 4.0
En ce sens, on peut dire que le système énergétique se trouve à un tournant historique. L'urgence climatique, la fragilité géopolitique et la raréfaction des ressources nous obligent à repenser la manière dont nous produisons, distribuons et consommons l'énergie. Dans ce contexte, l'augmentation de la capacité énergétique basée sur les énergies renouvelables apparaît comme un enjeu crucial.
Mais tout développement n'est pas bon à prendre : il reproduit en effet bon nombre des logiques du système fossile qu'il est censé remplacer, car le modèle de transition énergétique actuel est mené par de grandes entreprises privées, dont l'objectif est la rentabilité. Un oligopole privé a pénétré et accaparé toutes les sources et technologies, y compris les énergies renouvelables, et est protégé par l'État et par un système de prix qui lui garantit des marges et un marché, dans le secteur le plus rentable de l'économie espagnole. Face à cette situation, il est urgent de défendre une transition écosocialiste juste, démocratique et planifiée qui place au centre la vie et le bien-être collectif.
Comment fonctionne le système électrique ?
Le système électrique n'est pas la forme principale sous laquelle l'énergie nous parvient et ne représente que 24 % du total de l'énergie utilisée, le reste provenant de sources fossiles utilisées pour le transport ou le chauffage. Le réseau électrique nécessite une infrastructure complexe qui permet à l'électricité produite d'atteindre les points de consommation de manière instantanée, continue et sûre. Pour comprendre les défis actuels et les décisions que suppose sa transformation, il est important de connaître ses éléments clés et leurs interactions.
Le système électrique comprend quatre grandes phases :
• Production d'électricité dans des centrales (thermiques, nucléaires, hydroélectriques, solaires, éoliennes, etc.).
• Acheminement de l'électricité à haute tension sur de longues distances via un réseau de lignes de transport.
• Distribution de l'électricité en moyenne et basse tension aux foyers, aux entreprises et aux services.
• Consommation : utilisation finale de l'énergie électrique par les utilisateurs domestiques, industriels ou publics.
Le système électrique centralisé exige que la production et la consommation soient équilibrées à tout moment. Cela nécessite un contrôle technique continu, généralement automatisé, afin d'ajuster l'offre à la demande réelle, la production à la consommation, seconde par seconde. Pour répondre à cette exigence, il faut non seulement une surveillance et une coordination adéquates, mais aussi combiner des technologies présentant des caractéristiques très différentes, certaines plus difficiles à gérer que d'autres – c'est le cas des énergies renouvelables – dans la production qui contribue au système électrique.
Les caractéristiques des technologies de production d'électricité
En résumé, les principales technologies actuelles présentent les caractéristiques suivantes.
Centrales thermiques fossiles (gaz, charbon, fioul)
Elles contribuent à la gestion du système électrique centralisé actuel en ayant l'avantage de pouvoir être mises en marche ou arrêtées en fonction de la demande. Elles ont également une puissance installée et une inertie élevées qui assurent la stabilité au système.
Cependant, elles sont très polluantes, émettent de grandes quantités de CO₂ et d'autres gaz, sans oublier la dépendance extérieure qu'entraîne le recours à l'importation de ces sources, l'incertitude causée par les troubles géopolitiques et d'autres risques environnementaux et sanitaires graves.
Centrales nucléaires
On attribue souvent à cette technologie le mérite d'une production continue et contribuant à la stabilité du réseau, en raison de son inertie. Mais il faut savoir que cette continuité n'est pas un avantage, mais un élément de rigidité, car si les centrales peuvent être arrêtées, leur remise en service est très lente et très coûteuse. Le fait de devoir produire en permanence est exactement le contraire de ce dont le système de réseau centralisé a besoin. Les lobbies nucléaires essaient de promouvoir leur technologie, avec le mantra de sa stabilité, mais elle implique d'adapter le système et le reste des sources d'énergie.
Il est également vrai qu'elles n'émettent pas directement de CO₂, mais différents éléments rendent totalement inenvisageables leur utilisation dans le cadre de la transition écologique à moyen et long terme : même si leurs coûts d'exploitation sont faibles, leurs coûts d'investissement sont élevés, ce qui les rend peu rentables ; leur durée de vie est limitée à quelques décennies et il en découle des coûts de démantèlement et de réinvestissement très élevés ; la gestion des déchets radioactifs s'étend à l'échelle géologique et il n'existe pas de conteneurs capables de résister à la corrosion pendant plus d'un siècle ; et malgré les améliorations en matière de sécurité, les risques à long terme font de l'improbable un danger certain, comme pourrait l'affirmer Ulrich Beck1, sans oublier la consommation d'eau nécessaire au refroidissement des centrales.
Les énergies renouvelables
Les énergies renouvelables représentent l'alternative, mais elles ne sont pas exemptes de contraintes. Tout d'abord, le système de réseau électrique centralisé est mal adapté aux énergies renouvelables.
L'énergie éolienne est propre, ainsi que l'énergie solaire photovoltaïque, et celle-ci est en outre modulaire et facile à installer. Toutes deux ont de faibles coûts d'exploitation. Mais elles sont intermittentes, plus difficiles à gérer, nécessitent de grandes surfaces disponibles et le modèle technologique actuel ne génère pas d'inertie. Pour accroître leur compatibilité dans un environnement stable, avec le système actuel, elles nécessitent des solutions de stockage ou de secours, qui sont aujourd'hui insuffisantes. Dans les pays où l'eau est abondante, comme les pays scandinaves, les centrales hydroélectriques fonctionnent bien, mais dans les pays touchés par des sécheresses récurrentes, comme le nôtre, les batteries constituent une alternative. Celles-ci sont également coûteuses, tant en termes économiques qu'en termes de matériaux critiques (lithium, cobalt, nickel), avec l'empreinte écologique qui en découle, tandis que l'hydrogène est peu efficace comme accumulateur et que ses utilisations seront limitées.
Plus on intègre d'énergies renouvelables intermittentes, plus le réseau électrique devient techniquement complexe. C'est pourquoi, parallèlement à la production renouvelable, il est indispensable de promouvoir un modèle décentralisé et distribué de manière à ce que l'autoconsommation dans des communautés énergétiques, qui réduit la pression sur le réseau central, soit privilégiée. Il faut aussi appliquer des politiques de gestion de la demande qui encourage la consommation aux heures où la production est la plus élevée. À cet égard, certaines mesures peuvent déjà être prises. Dans la mesure où le système électrique nécessite une synchronisation entre la production et la consommation, quel sens cela-t-il qu'au printemps et en été, la tranche de consommation la plus chère corresponde aux heures les plus ensoleillées ? Il faudrait au contraire que l'électricité soit moins chère pendant les heures les plus ensoleillées de la journée à cette période de l'année.
Ce qui ne fonctionne pas dans le développement actuel des énergies renouvelables
Loin de constituer une véritable alternative au système fossile, le déploiement actuel des énergies renouvelables est guidé par la logique du marché et non par les besoins sociaux ou écologiques. Les entreprises privées investissent de manière désordonnée, en privilégiant les zones où le raccordement au réseau électrique est le plus accessible et rentable, et celles où la consommation est plus importante, sans tenir compte des conséquences sur les territoires et des conflits avec les besoins des communautés rurales, qui sont souvent situées à proximité de ces mêmes points de raccordement.
Cette logique extractiviste des renouvelables ne réduit pas vraiment le recours aux sources non renouvelables : dans de nombreux cas, elle s'y ajoute simplement, tandis que les systèmes fossiles et nucléaires se maintiennent tant qu'ils continuent à générer des profits. En outre, la centralisation du système – qui reproduit le modèle fossile – à travers des méga-installations solaires et éoliennes et un réseau électrique centralisé qui nécessite une part importante d'énergies polluantes pour être stable, entre souvent en conflit avec les populations rurales, les usages agricoles traditionnels et la biodiversité.
Au lieu d'avancer vers une réduction de la consommation et une réorganisation du modèle énergétique, on reproduit un modèle productiviste qui se heurte de front aux limites écologiques de la planète.
Vers un modèle énergétique juste et durable
L'énergie est un bien commun essentiel. Elle doit donc être gérée par une planification publique, avec une participation démocratique communautaire, et non comme un domaine lucratif. Il est indispensable que les pouvoirs publics reprennent l'initiative dans la conception du système énergétique, en s'orientant vers un modèle qui combine :
• Les énergies renouvelables comme source principale, en réduisant et en remplaçant progressivement les énergies fossiles et nucléaires.
• Une distribution décentralisée et communautaire, avec des systèmes d'autoconsommation, des réseaux locaux et un stockage de l'énergie adapté à chaque territoire.
• Une collaboration avec les communautés rurales et urbaines, en intégrant des critères sociaux, environnementaux et paysagers dans le choix des sites et des modèles de gestion.
• Une participation démocratique aux décisions énergétiques, en reconnaissant l'énergie comme un droit et non comme une marchandise.
Ce modèle nécessite un investissement public soutenu, non seulement dans les infrastructures de production, mais aussi dans les réseaux de distribution intelligents, le stockage, l'efficacité énergétique et l'éducation technique et citoyenne. Un investissement public ne peut se limiter au financement des infrastructures dont les entreprises privées tirent profit ; il doit profiter à l'ensemble de la société. Par exemple, la location massive de batteries et de systèmes de stockage, bien qu'elle puisse contribuer à stabiliser le réseau électrique, revient également à réduire les coûts d'investissement que les entreprises privées auraient dû assumer. Si le secteur public loue des batteries à grande échelle, alors il serait logique que l'ensemble du système soit public, par une socialisation de ce secteur stratégique. Le coût, bien qu'élevé, sera toujours inférieur aux 5 % de dépenses prévues pour la Défense d'ici à 2030. Il s'agirait sans aucun doute d'une bien meilleure option.
Mettre en œuvre la socialisation n'est toutefois pas suffisant. Cela doit s'accompagner d'une planification du redéploiement des infrastructures et de modifications technologiques. Fondé sur les énergies renouvelables – et de manière marginale, sur le gaz pour les situations d'urgence – ce modèle doit remplacer les autres technologies et sources d'énergie, déployer un modèle décentralisé, et adapter les sources aux spécificités des territoires, par les décisions démocratiques de chaque communauté concernant l'emplacement des installations. De même, il semble indispensable que la réorganisation et le redéploiement des infrastructures s'effectuent dans le cadre d'une transition appuyée sur la recherche et l'innovation. Ainsi, elle pourra reposer de plus en plus sur des technologies low tech – appelées également « modestes » ou « légères » – indépendantes de l'industrie fossile et capables de minimiser l'utilisation des matériaux et de l'énergie, et s'inscrivant dans une « économie en spirale », dans laquelle on réintègre autant que possible les matériaux dans le cycle de la nature – en gardant à l'esprit que la thermodynamique est têtue à cet égard, comme le souligne souvent le professeur José Manuel Naredo 2. Tout en fournissant un service suffisant à l'ensemble de la population.
Souveraineté énergétique et territoire
Dans un monde de plus en plus marqué par les tensions autour du contrôle des ressources, l'autosuffisance énergétique devient un élément clé de la souveraineté. La péninsule ibérique, et en particulier le sud, dispose d'un potentiel énorme, suffisamment important pour satisfaire une grande partie de sa demande avec des énergies renouvelables. Mais cela exige un changement de modèle : il ne suffit pas de changer les sources énergétiques, il faut également transformer les rapports de forces qui structurent le système.
Une véritable souveraineté énergétique implique de décider collectivement quelle énergie doit être produite, comment, où, pour qui et avec quels impacts. Cela suppose de reconnaître que l'énergie n'est pas neutre, que son accès inégal conditionne tous les aspects de la vie et que toute transformation doit s'accompagner d'une justice territoriale et sociale, dont le premier pas est l'éradication de la précarité énergétique, en garantissant l'approvisionnement de base à toute la population, et en tenant compte des limites de notre biosphère.
Cette justice implique également, comme nous l'avons indiqué, de convenir de l'emplacement des installations selon des critères qui ne compromettent pas les possibilités et les besoins de la production agricole, ni les besoins des communes rurales, et qui incluent l'adaptation technique des infrastructures nécessaires. Par exemple, développer des éoliennes sans pales, qui transfèrent l'énergie par le biais de vibrations induites par des vortex – car les oiseaux suivent le même chemin que le vent exploité par ces dispositifs –, ou installer les fermes solaires sur des parkings, sur les toits des bâtiments et des industries et dans les zones rurales, de façon à avoir un impact moindre sur les populations, l'agriculture et la biodiversité.
Gardons également à l'esprit que nous devons multiplier ces infrastructures basées sur les énergies renouvelables – non pas pour les additionner aux technologies fossiles et nucléaires, mais pour les remplacer dans leur immense majorité.
Les limites biophysiques : la face cachée de la transition
On ne peut pas parler de transition énergétique sans reconnaître les limites matérielles de la planète. L'électrification de l'économie, nécessaire à bien des égards, ne doit pas être conçue dans le cadre d'une croissance illimitée de la production d'énergie renouvelable. Il semble nécessaire d'augmenter radicalement la capacité actuelle, à condition que cela ne se fasse pas de manière désordonnée et selon des critères de marché, mais en tenant compte des besoins et des conditions sociales, environnementales et techniques. Mais nous devons être conscients que cela implique de disposer de matériaux en quantités énormes, tels que le cuivre, le lithium et les terres rares, dont la disponibilité est limitée et dont le cycle de vie pose d'énormes défis écologiques. Cela impliquera également de poursuivre la recherche scientifique et de développer des infrastructures pouvant utiliser d'autres matériaux abondants, tels que l'aluminium qui, bien que moins bon conducteur que le cuivre, pourrait convenir à certaines activités.
Les infrastructures renouvelables actuelles dépendent indirectement des énergies fossiles pour leur extraction, leur fabrication, leur transport ou leur maintenance. Leur durée de vie est limitée – généralement pas plus de 30 ans –, ce qui implique de les reconstruire, et elles génèrent des déchets. Il ne suffit donc pas de changer les sources d'énergie, il est indispensable de transformer le modèle économique pour une économie sobre et juste, opérant des choix dans les besoins énergétiques à satisfaire, en évitant les consommations excessives et superflues, au lieu d'essayer de maintenir le même niveau de consommation.
Cela implique :
• De promouvoir des modes de vie et de consommation sobres, efficaces et partagés, sans renoncer à satisfaire les besoins liés au bien-être et à un mode de vie digne.
• De parier sur la mobilité publique, collective et électrifiée, en donnant la priorité au transport par rail et tramway, mais aussi par bus ou métro, et de réserver l'usage des voitures électriques en milieu urbain pour les services essentiels (taxi, ambulance, pompiers). Il s'agit aussi de développer des systèmes municipaux de transport partagés permettant de desservir les zones rurales non desservies.
• Donner la priorité à l'utilisation de l'énergie pour couvrir les besoins fondamentaux et les activités à forte utilité sociale.
Quelle politique économique pour quel modèle énergétique ?
Une transition énergétique écologique exige une politique économique au service du bien commun. Il ne s'agit pas seulement de changer la matrice énergétique, mais de construire un autre modèle de développement. Un modèle qui ne recherche pas une croissance illimitée, mais l'équilibre avec les limites naturelles et la justice sociale.
Cela nécessite :
• Une planification publique à long terme, avec des critères techniques, sociaux et écologiques ;
• Une négociation et une participation démocratique des communautés aux décisions stratégiques ;
• Une reconversion de l'emploi et de la formation professionnelle vers des secteurs écologiques ;
• Une décentralisation des systèmes de production et de distribution, en maintenant une articulation, voire une synergie, entre les différents systèmes.
Les élites économiques et politiques mondiales semblent avoir choisi une voie opposée : une transition autoritaire et antisociale, fondée sur le contrôle des ressources stratégiques, l'extractivisme, le recours croissant à la force, les inégalités et l'exclusion. Il s'agit d'un modèle où les combustibles fossiles, l'énergie nucléaire et les énergies renouvelables extrêmement centralisées coexistent dans un système de plus en plus instable, extractif et militarisé. Un modèle qui se barricade pour faire face aux protestations, restreint les droits et consolide les privilèges d'une minorité.
Cette voie est non seulement socialement injuste, elle est aussi anti-écologique et politiquement insupportable. Elle va à l'encontre des intérêts de la majorité, en particulier des classes populaires et des peuples du Sud, et bloque toute possibilité de transition réelle vers un avenir viable.
Le modèle énergétique n'est pas une simple question technique : c'est une question profondément politique. Il détermine quelle vie est possible et pour qui. C'est pourquoi la lutte pour un nouveau système énergétique est aussi une lutte pour la démocratie, la justice et la dignité. De même, le système électrique n'est pas seulement un réseau technique : c'est aussi un champ de décisions politiques, sociales et écologiques. Chaque technologie a ses conditions, ses avantages et ses limites, et aucune, pas même les énergies renouvelables, n'est exempte d'impacts. C'est pourquoi une transition énergétique juste nécessite non seulement davantage d'énergies renouvelables, mais aussi une planification démocratique consciente, à partir du secteur public et des communautés, qui donne la priorité aux usages socialement nécessaires, minimise les impacts et distribue l'énergie de manière plus démocratique.
Éviter les coupures d'électricité à l'avenir ne dépend pas seulement de l'installation de plus de panneaux solaires ou d'éoliennes, mais d'une profonde refonte de notre mode de vie, de production et d'organisation. Nous avons besoin d'un modèle public, démocratique, à la hauteur des besoins, écologique et juste. Et nous devons le développer dès maintenant, car le modèle actuel est de plus en plus incertain et dangereux.
Le 6 juin 2025
1. Ulrich Beck (1944-2015), est un sociologue allemand, enseignant-chercheur à la London School of Economics, auteur de la Société du risque (1986), et de nombreux ouvrages et réflexions sur la gestion et la mitigation politique et économique des risques dans les sociétés occidentales contemporaines.
2. José Manuel Naredo Pérez (1942-…) est un économiste et statisticien espagnol, pionnier, chercheur et vulgarisateur de l'économie écologique en Espagne, domaine dans lequel il a apporté d'importantes contributions en tant qu'auteur et éditeur.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
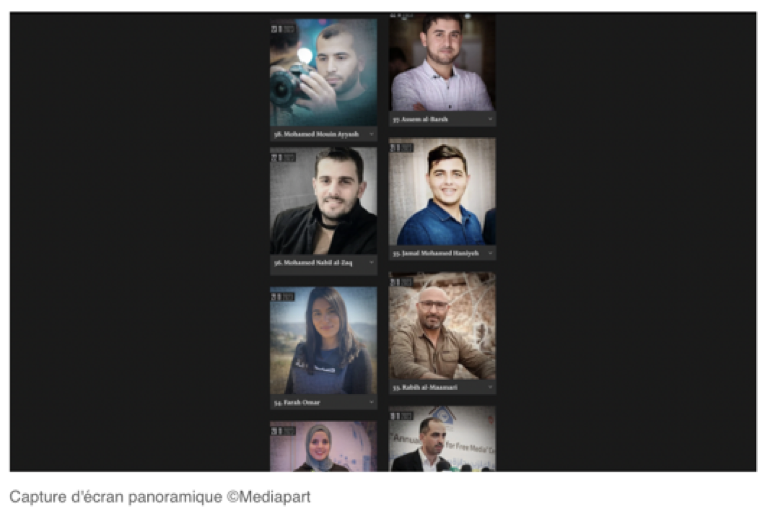
Israël et l’extermination des journalistes à Gaza
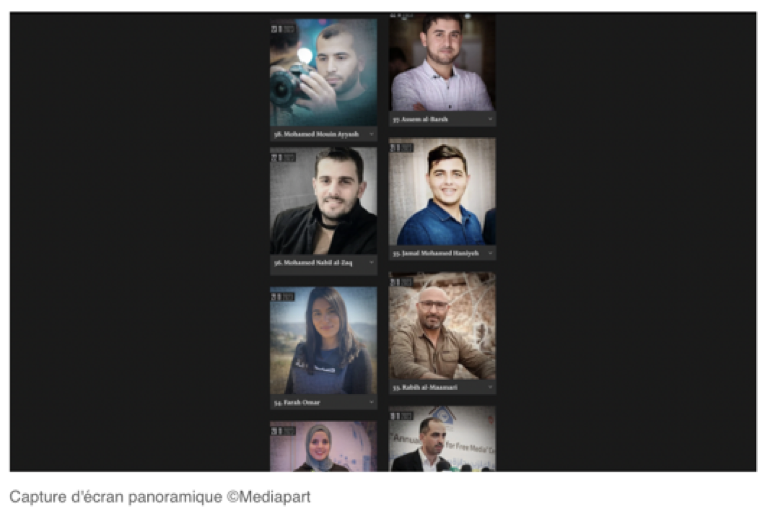
Jamais un conflit ni un champ de brutalité n'ont atteint le degré de sauvagerie qu'Israël inflige depuis près de deux ans aux journalistes de Gaza. L'exécution de plus de 230 reporters et correspondants en 680 jours, constitue une entreprise d'extermination dirigée contre celles et ceux qui portent caméras, micros et ordinateurs pour consigner, jour après jour, les récits et témoignages de leur peuple.
Tiré du blogue de l'auteur.
Jamais, dans l'histoire documentée des guerres et des violences collectives, un conflit ni un champ de brutalité n'ont atteint le degré de sauvagerie qu'Israël inflige depuis près de deux ans aux journalistes de Gaza.
L'exécution de plus de 230 reporters et correspondants en 680 jours, presque tous délibérément ciblés par des bombardements aériens, des tirs de snipers ou la traque incessante de drones, constitue une entreprise d'extermination dirigée contre celles et ceux qui portent caméras, micros et ordinateurs pour consigner, jour après jour, les récits et témoignages de leur peuple.
Cette politique d'élimination s'inscrit dans un projet plus vaste d'anéantissement méthodique qui a déjà frappé médecins, personnels soignants et secouristes — plus de 400 tués —, ainsi que professeurs et enseignants palestiniens — plus de 450 assassinés. Par leur effacement, c'est l'avenir même de la société palestinienne qui est visé, dans ce que l'on nomme désormais « le futuricide » : la destruction des conditions d'un devenir collectif, aggravée par la dévastation de plus de 85 % des infrastructures hospitalières, scolaires et universitaires de l'enclave.
Le meurtre des journalistes revêt toutefois une signification singulière, intrinsèquement liée à l'entreprise génocidaire, et peut-être encore plus redoutable sur le plan politique. Il vise à instiller la terreur absolue, à exhiber une impunité totale et, surtout, à contrôler intégralement la production de l'information et du langage, à prescrire la description du réel et à imposer une narration unique avec ses interprétations. Autrement dit, il s'agit de liquider la fonction journalistique elle-même, dans ce qu'elle incarne de rôle social, politique, documentaire et critique, afin d'empêcher l'émergence de récits indépendants, dotés de leur propre vocabulaire et de leurs concepts, capables de contester ou de déconstruire la rhétorique officielle de la « guerre contre le terrorisme ».
Le meurtre comme norme suprême de la censure
Israël, en tant que puissance d'occupation et de guerre, tire une part essentielle de sa domination de sa capacité à maintenir la fiction de la « légitimité » de sa violence et à imposer ses justifications dans les grands médias occidentaux. Cela suppose un discours unique, soigneusement calibré, qu'aucune voix ne doit troubler. Israël agit également comme s'il détenait le monopole absolu de la production du sens. En façonnant mots et images, il décide de ce qui peut être dit ou tu, substitue à la réalité une version artificielle et l'impose comme vérité exclusive, réputée inattaquable.
Une telle politique exige aussi un contrôle physique et territorial, imperméable à toute imprévisibilité. Si les journalistes étrangers sont interdits d'accès à Gaza afin d'éviter les versions divergentes, il faut surtout empêcher les reporters palestiniens de combler ce vide en les éliminant. L'attitude israélienne à leur égard dépasse toute comparaison avec les systèmes coloniaux lors de leurs guerres de fin d'empire ou avec les régimes totalitaires — y compris fascistes — qui considéraient le meurtre comme la sanction ultime de la censure. Ces derniers recouraient encore à des mesures « intermédiaires » : suspension, emprisonnement, mutilation ou exécution ponctuelle destinée à semer la peur. Israël, lui, a fait du meurtre la règle, le seuil ordinaire en deçà duquel rien n'est jugé suffisant, et au-delà duquel ne subsistent que l'escalade des atrocités, les raffinements macabres de la mise à mort et le sort infligé aux corps.
Ce comportement sans précédent dans l'histoire de la violence d'État, relève davantage des logiques de réseaux criminels « professionnels » qui assurent leur survie en exécutant quiconque menace leurs secrets ou leur capital symbolique et matériel. C'est précisément ce que fait l'armée israélienne depuis octobre 2023 : tous les deux ou trois jours, elle liquide un.e journaliste palestinien.ne dont les récits et les images révèlent ses crimes. À cette logique s'ajoute enfin une dimension de vengeance : ayant échoué à imposer le silence, Israël pourchasse ceux et celles qui ont brisé son mur de propagande et ruiné son monopole sur l'information, l'image et le sens.
L'honneur du métier et le refus de sa disparition
Cette approche criminelle et vindicative mène à une équation implacable : à une violence israélienne d'une intensité inédite répond une résistance palestinienne exceptionnelle par sa forme et par la détermination de ses acteurs à préserver la fonction journalistique et son rôle politique. Chaque massacre voit surgir de nouvelles et nouveaux reporters reprenant le flambeau de leurs collègues tombés. Le combat contre l'anéantissement devient constitutif du métier, exercé quotidiennement au milieu des ruines, dans les quartiers dévastés, sous les tentes des déplacés, jusque dans la proximité des centres de distribution d'aide humanitaire, où l'armée d'occupation frappe ceux qui ne cherchent qu'à survivre.
Depuis près de deux ans, les journalistes palestiniens protègent donc, au péril de leur vie, les nouvelles de leur peuple. Mais ils défendent pareillement le journalisme lui-même. Leur cause est devenue l'une des lignes de fracture culturelle, politique et éthique les plus marquantes du monde aujourd'hui.
C'est la raison pour laquelle ils paient un prix double : celui d'une guerre génocidaire et celui d'une guerre de diffamation visant à justifier l'horreur. Leur survie, ainsi que celle des jeunes journalistes appelés à leur succéder, représente bien plus que la protection d'êtres humains et de leurs récits : elle incarne la sauvegarde d'une profession et d'une fonction critique dont l'impact dépasse les frontières de Gaza, tout en y demeurant tragiquement enraciné.
Une première version de ce texte a été publié en arabe dans le quotidien Al-Quds Al-‘Arabi, basé à Londres, le 16 août 2025.

« Cellule de légitimation » : une unité israélienne chargée de relier les journalistes de Gaza au Hamas

Considérant les médias comme un champ de bataille, une unité secrète des services de renseignement de l'armée a fouillé Gaza à la recherche d'éléments susceptibles de renforcer la hasbara israélienne, y compris des affirmations douteuses qui justifieraient le meurtre de journalistes palestiniens.
Tiré de France Palestine Solidarité. Photo : Les bombardements israéliens ont tué les journalistes d'Al Jazeera Anas Al-Sharif et Mohammed Qreiqeh © Motasem A Dalloul.
L'armée israélienne a mis en place une unité spéciale appelée « Legitimization Cell » (Cellule de légitimation), chargée de recueillir des renseignements à Gaza susceptibles de renforcer l'image d'Israël dans les médias internationaux, selon trois sources des services de renseignement qui se sont entretenues avec +972 Magazine et Local Call et ont confirmé l'existence de cette unité.
Créée après le 7 octobre, cette unité recherchait des informations sur l'utilisation par le Hamas d'écoles et d'hôpitaux à des fins militaires, ainsi que sur les tirs de roquettes ratés par des groupes armés palestiniens qui ont causé des dommages aux civils dans l'enclave. Elle a également été chargée d'identifier les journalistes basés à Gaza qu'elle pourrait présenter comme des agents secrets du Hamas, afin d'atténuer l'indignation mondiale croissante suscitée par le meurtre de reporters par Israël, dont le dernier en date est le journaliste d'Al Jazeera Anas Al-Sharif, tué lors d'une frappe aérienne israélienne la semaine dernière.
Selon les sources, la motivation de la cellule de légitimation n'était pas la sécurité, mais les relations publiques. Poussés par la colère que les journalistes basés à Gaza « salissent le nom [d'Israël] devant le monde entier », ses membres étaient impatients de trouver un journaliste qu'ils pourraient associer au Hamas et désigner comme cible, a déclaré une source.
La source a décrit un schéma récurrent dans le travail de l'unité : chaque fois que les critiques à l'égard d'Israël s'intensifiaient dans les médias sur une question particulière, la cellule de légitimation recevait pour instruction de trouver des renseignements pouvant être déclassifiés et utilisés publiquement pour contrer le discours.
« Si les médias internationaux parlent d'Israël tuant des journalistes innocents, alors on cherche immédiatement un journaliste qui ne serait pas si innocent, comme si cela rendait acceptable le meurtre des 20 autres », a déclaré la source du renseignement.
Souvent, c'était l'élite politique israélienne qui dictait à l'armée les domaines du renseignement sur lesquels l'unité devait se concentrer, a ajouté une autre source. Les informations recueillies par la cellule de légitimation étaient également transmises régulièrement aux Américains par des canaux directs. Les agents du renseignement ont déclaré qu'on leur avait dit que leur travail était essentiel pour permettre à Israël de prolonger la guerre.
« L'équipe recueillait régulièrement des renseignements pouvant être utilisés à des fins de hasbara — par exemple, un stock d'armes [du Hamas] [trouvé] dans une école — tout ce qui pouvait renforcer la légitimité internationale d'Israël pour continuer à se battre », a expliqué une autre source. « L'idée était de [permettre à l'armée] d'opérer sans pression, afin que des pays comme les États-Unis ne cessent pas de fournir des armes. »
L'unité a également cherché des preuves reliant la police de Gaza à l'attaque du 7 octobre, afin de justifier de la prendre pour cible et de démanteler les forces de sécurité civiles du Hamas, a déclaré une source proche du travail de la cellule de légitimation.
Deux des sources du renseignement ont raconté qu'au moins une fois depuis le début de la guerre, la cellule de légitimation avait déformé des informations afin de présenter à tort un journaliste comme un membre de la branche militaire du Hamas. « Ils étaient impatients de le désigner comme une cible, comme un terroriste, afin de pouvoir l'attaquer en toute légitimité », se souvient une source. « Ils ont déclaré : Pendant la journée, c'est un journaliste, mais la nuit, c'est un commandant de peloton. Tout le monde était enthousiaste. Mais il y a eu une série d'erreurs et de raccourcis. »
« Finalement, ils ont réalisé qu'il était vraiment journaliste », a poursuivi la source, et le journaliste n'a pas été pris pour cible.
Un schéma similaire de manipulation est évident dans les renseignements présentés sur Al-Sharif. Selon les documents publiés par l'armée, qui n'ont pas été vérifiés de manière indépendante, il a été recruté par le Hamas en 2013 et est resté actif jusqu'à ce qu'il soit blessé en 2017 — ce qui signifie que, même si les documents étaient exacts, ils suggèrent qu'il n'a joué aucun rôle dans la guerre actuelle.
Il en va de même pour le cas du journaliste Ismail Al-Ghoul, tué lors d'une frappe aérienne israélienne en juillet 2024 avec son caméraman à Gaza. Un mois plus tard, l'armée a affirmé qu'il était un « membre de la branche militaire et un terroriste de Nukhba », citant un document de 2021 qui aurait été récupéré sur un « ordinateur du Hamas ». Or, ce document indiquait qu'il avait obtenu son grade militaire en 2007, alors qu'il n'avait que 10 ans, soit sept ans avant d'avoir été prétendument recruté par le Hamas.
« Trouver autant de matériel que possible pour la hasbara »
L'une des premières actions très médiatisées de la cellule de légitimation a eu lieu le 17 octobre 2023, après l'explosion meurtrière à l'hôpital Al-Ahli de Gaza. Alors que les médias internationaux, citant le ministère de la Santé de Gaza, rapportaient qu'une frappe israélienne avait tué 500 Palestiniens, les responsables israéliens affirmaient que l'explosion avait été causée par une roquette du Jihad islamique qui avait mal fonctionné et que le nombre de morts était bien inférieur.
Le lendemain de l'explosion, l'armée a diffusé un enregistrement que la cellule de légitimation avait trouvé dans des interceptions de renseignements, présenté comme un appel téléphonique entre deux agents du Hamas attribuant l'incident à un tir raté du Jihad islamique. De nombreux médias internationaux ont ensuite jugé cette affirmation plausible, y compris certains qui ont mené leurs propres enquêtes, et cette divulgation a porté un coup sévère à la crédibilité du ministère de la Santé de Gaza — saluée au sein de l'armée israélienne comme une victoire pour la cellule.
Un militant palestinien des droits humains a déclaré à +972 et Local Call en décembre 2023 qu'il avait été stupéfait d'entendre sa propre voix dans l'enregistrement, qui, selon lui, n'était qu'une conversation anodine avec un autre ami palestinien. Il a insisté sur le fait qu'il n'avait jamais été membre du Hamas.
Une source ayant travaillé avec la cellule de légitimation a déclaré que la publication de documents classifiés tels qu'un appel téléphonique était très controversée. « Cela ne correspond pas du tout à l'ADN de l'unité 8200 d'exposer nos capacités pour quelque chose d'aussi vague que l'opinion publique », a-t-il expliqué.
Néanmoins, les trois sources du renseignement ont déclaré que l'armée considérait les médias comme une extension du champ de bataille, ce qui lui permettait de déclassifier des informations sensibles pour les rendre publiques. Même les membres du personnel du renseignement n'appartenant pas à la cellule de légitimation ont reçu pour instruction de signaler tout document susceptible d'aider Israël dans la guerre de l'information. « Il y avait cette phrase : « C'est bon pour la légitimité » », se souvient une source. « L'objectif était simplement de trouver autant de documents que possible pour servir les efforts de hasbara. »
Après la publication de cet article, des sources officielles du secteur de la sécurité ont confirmé à +972 et Local Call que diverses « équipes de recherche » avaient été mises en place au sein des services de renseignement militaires israéliens au cours des deux dernières années dans le but de « dénoncer les mensonges du Hamas ». Ils ont déclaré que l'objectif était de « discréditer » les journalistes qui couvraient la guerre sur les chaînes de télévision « d'une manière prétendument fiable et précise », mais qui, selon eux, faisaient en réalité partie du Hamas. Selon ces sources, ces équipes de recherche ne jouent aucun rôle dans la sélection des cibles individuelles à attaquer.
« Je n'ai jamais hésité à transmettre la vérité »
Le 10 août, l'armée israélienne a tué six journalistes lors d'une frappe qu'elle a ouvertement reconnue comme visant le reporter d'Al Jazeera Anas Al-Sharif. Deux mois plus tôt, en juillet, le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) avait fait part de ses craintes pour la vie d'Al-Sharif, affirmant qu'il était « la cible d'une campagne de dénigrement de l'armée israélienne, qu'il considère comme un prélude à son assassinat ».
Après qu'Al-Sharif ait publié en juillet une vidéo virale dans laquelle il apparaissait en larmes alors qu'il couvrait la crise alimentaire à Gaza, le porte-parole arabophone de l'armée israélienne, Avichay Adraee, a publié trois vidéos différentes l'attaquant, l'accusant de « propagande » et de participer à la « fausse campagne de famine du Hamas ».
Al-Sharif a établi un lien entre la guerre médiatique menée par Israël et la guerre militaire. « La campagne d'Adraee n'est pas seulement une menace médiatique ou une destruction d'image ; c'est une menace réelle », a-t-il déclaré au CPJ. Moins d'un mois plus tard, il a été tué, l'armée présentant ce qu'elle a qualifié d'informations déclassifiées sur son appartenance au Hamas pour justifier l'attaque.
L'armée avait déjà affirmé en octobre 2024 que six journalistes d'Al Jazeera, dont Al-Sharif, étaient des agents militaires, une accusation qu'il avait vigoureusement niée. Il est devenu le deuxième de cette liste à être pris pour cible, après le reporter Hossam Shabat. Depuis l'accusation d'octobre, sa localisation était bien connue, ce qui a conduit de nombreux observateurs à se demander si le meurtre d'Al-Sharif, qui rendait régulièrement compte de la situation à Gaza, faisait partie du plan israélien visant à imposer un black-out médiatique avant ses préparatifs militaires pour s'emparer de la ville.
En réponse aux questions du magazine +972 sur le meurtre d'Al-Sharif, le porte-parole de l'armée israélienne a réitéré que « l'armée israélienne avait attaqué un terroriste de l'organisation terroriste Hamas qui opérait sous le couvert d'un journaliste du réseau Al Jazeera dans le nord de la bande de Gaza », et a affirmé que l'armée « ne blesse pas intentionnellement des personnes non impliquées, et en particulier des journalistes, conformément au droit international ».
Avant l'attaque, a ajouté le porte-parole, « des mesures ont été prises pour réduire le risque de blesser des civils, notamment l'utilisation d'armes de précision, des observations aériennes et des informations supplémentaires provenant des services de renseignement ».
À seulement 28 ans, Al-Sharif était devenu l'un des journalistes les plus reconnus de Gaza. Il fait partie des 186 reporters et professionnels des médias tués dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre, selon le CPJ — la période la plus meurtrière pour les journalistes depuis que le groupe a commencé à collecter des données en 1992. D'autres organisations ont estimé le nombre de morts à 270.
« Si ces mots vous parviennent, sachez qu'Israël a réussi à me tuer et à faire taire ma voix », a écrit Al-Sharif dans son dernier message, publié à titre posthume sur ses comptes de réseaux sociaux. « J'ai vécu la douleur dans tous ses détails, j'ai goûté à la souffrance et à la perte à maintes reprises, mais je n'ai jamais hésité à transmettre la vérité telle qu'elle est, sans déformation ni falsification. »
Traduction : AFPS

« Ill y a des époques qui appellent les médiocres » (Karl Marx) - A propos des billettistes du Journal de Montréal

Cette formule me vient à l'esprit quand je parcours le Journal de Montréal. En effet, une bonne partie de ses billettistes (à quelques exceptions près) doivent leur renommée aux chroniques qu'ils y tiennent bien plus qu'à la pertinence ou à la profondeur de leurs analyses. Ils s'abandonnent le plus souvent à la démagogie la plus grossière.
Je pense à Richard Martineau, Joseph Facal, Mario Dumont, Sophie Durocher, Mathieu Bock-Côté et Yasmine Abdelfaddel. S'ils n'écrivaient pas dans ce journal à grand tirage, certains seraient inconnus du grand public ou encore, pour la plupart d'entre eux, des commentateurs dans des médias de droite peu lus par le public. Mais même ceux d'entre eux qui bénéficient d'une certaine notoriété, la médiocrité leur colle à la peau, y compris Bock-Côté, en dépit des ouvrages qu'il a déjà publiés et Dumont qui a déjà été député. La notoriété de ce dernier ne le sauve pas de la relative médiocrité intellectuelle qui semble sa marque de commerce. Les prétentions intellectuelles de Bock-Côté, le « penseur de service » de Québecor ressemblent à un bel habit qui dissimule ses très moyennes performances intellectuelles et sa démagogie prétentieuse.
Deux grands axes guident tout ce monde à divers degrés : l'anti gauchisme, (en fait la gauche en général) et le « wokisme » en particulier celui-ci étant censé incarner un danger majeur pour la liberté de pensée ; Joseph Facal surtout s'est fait une spécialité de le dénoncer, car il sévirait dans les universités d'une part. Leur autre obsession est la défense acharnée d'Israël ; en effet, Richard Martineau s'emploie à confondre antisionisme et « antisémitisme » ; il se fait aussi une spécialité de dénigrer les sociétés arabes en reprenant à son compte tous les préjugés les plus éculés à leur endroit. Bien entendu, de son point de vue, la gauche propalestinienne s'enferre dans des contradictions insoutenables en ne mentionnant pas certaines positions du Hamas palestinien et en donnant priorité à la critique d'Israël. Je ne m'étendrai pas sur les arguments souvent spécieux utilisés par ces deux bouffons puisqu'ils les étalent sans complexe dans leurs chroniques. Il suffit d'ouvrir le Journal de Montréal pour que leur démagogie apparaisse au premier coup d'oeil.
Mais celle-ci dépasse la personne de ces petites vedettes qui ont renoncé à toute subtilité dans l'étalage de leurs positions. En effet, qu'ils se laissent prendre ou non à leur propre démagogie importe peu puisqu'ils ne forment que la courroie de transmission de l'orientation politique de Québecor. Ils se livrent à une entreprise d'intoxication idéologique auprès du grand public, traduisant en terme simples (pour ne pas dire simplistes dans le cas de Martineau) ce qui paraît bien constituer la position de Québecor, leur employeur, sur certaines questions délicates.
Par exemple, s'ils défendent la souveraineté, ils appuient du même souffle un certain conservatisme dans la gestion des finances publiques. Ils sont donc partisans d'une indépendance mâtinée de néoconservatisme.
De leur point de vue, la lutte armée des Palestiniens est qualifiée de « terrorisme » mais ils évitent d'exposer les motifs qui poussent ce peuple opprimé à résistance. Mais Israël, lui, bien sûr, ne fait qu'utiliser son droit à l'autodéfense...
Poutine est un tyran et les Ukrainiens ont le droit et même le devoir de lutter pour sauvegarder leur liberté nationale, ça va de soi. Ils ne qualifient jamais la résistance ukrainienne de « terroriste ».
Les six billettistes ci-dessus nommés se prononcent sur une foule de sujets un une sorte de bavardage aussi bruyant que superficiel, comme des commères. Facal et Bock-Côté eux, s'efforcent de donner une certaine sophistication à leurs propos, ce qui ne confère pas pour autant à ceux-ci de réelle profondeur analytique. Ils s'en tiennent à la surface des choses. Ils participent donc à la médiocrité politique ambiante autant qu'ils en sont le résultat.
Le Journal compte aussi quelques chroniqueurs progressistes, à la critique sociale plus pertinente, comme Josée Legault, Émilise Lessard-Therrien (une ancienne députée de Québec solidaire) ou centristes comme Antoine Robitaille et un analyste international comme Loïc Tassé. Pierre-Karl Péladeau, le grand patron du Journal, essaie sans doute de maintenir une apparence d'équilibre entre la droite et la « gauche » dans sa feuille de chou, mais la tonalité dominante relève tout de même en faveur de la première.
Pour s'amuser des propos de Richard Martineau, Joseph Facal¸Mathieu Bock-Côté et Mario Dumont, il faut posséder un certain sens de l'humour. En effet, selon Chris Marker, « l'humour est la politesse du désespoir ».
Jean-François Delisle
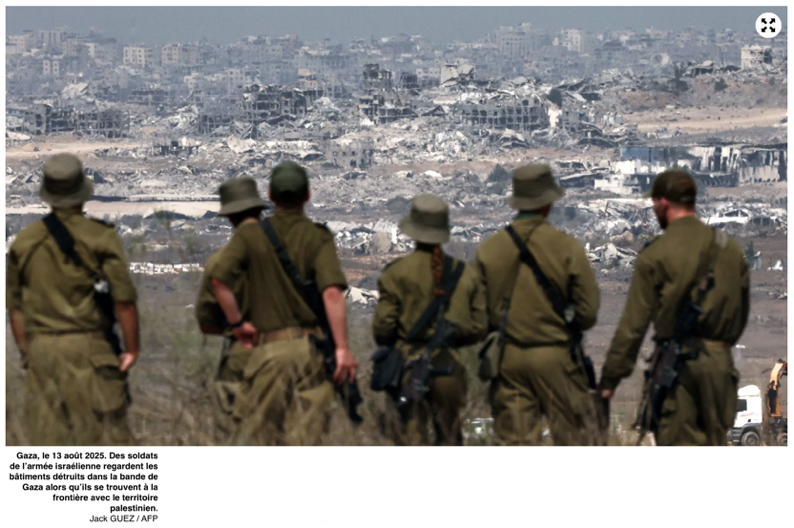
De l’Iran à Gaza, la guerre sans fin d’Israël
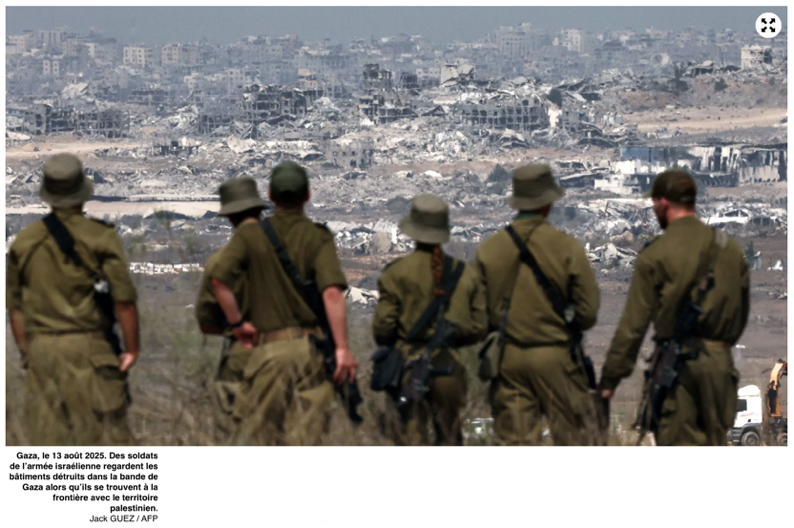
C'est une nouvelle étape qui s'est ouverte au Proche-Orient, avec l'attaque israélo-étatsunienne contre l'Iran. Même si les hostilités ont cessé, le plan du premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou se confirme : anéantir Gaza, étendre le théâtre des conflits, engager son pays dans une guerre sans fin pour l'hégémonie régionale.
Tiré d'Orient XXI.
Le 18 juin 2025, sixième jour de l'attaque israélienne contre l'Iran, dans une interview accordée au New York Times, le général David Petraeus prodigua au président étatsunien Donald Trump une série de conseils que celui-ci ne lui avait pas demandés : le président devait lancer un ultimatum à l'ayatollah Ali Khamenei et lui ordonner de démanteler le programme d'enrichissement d'uranium de Téhéran sous peine d'encourir « la destruction totale de son pays, de son régime et de son peuple ». Si Khamenei refusait « cela renforcerait notre légitimité, et nous serions en quelque sorte “obligés” de les réduire en cendres » (1). On n'a guère entendu de commentaires sur ces propos de Petraeus, l'ancien commandant en chef des troupes étatsuniennes en Irak et en Afghanistan, qui recommandait en substance de faire subir à un pays de 90 millions d'habitants le même traitement que Gaza : les menaces d'hécatombe proférées par des responsables étatsuniens contre des dirigeants étrangers et leurs peuples ne choquent plus personne et ne suscitent aucune condamnation ; elles font désormais simplement partie du « débat » sur les modalités de la gestion de l'empire.
Comme l'arme atomique à Hiroshima
Le 22 juin, l'armée de l'air étatsunienne a largué des bombes anti-bunker GBU-57 sur les sites d'enrichissement d'uranium de Fordow et de Natanz et lancé des missiles Tomahawk sur un centre de recherche nucléaire proche d'Ispahan. On aurait pu croire que Trump suivait les conseils de Petraeus, mais il s'est bientôt empressé de crier victoire, alléguant que les frappes étatsuniennes avaient détruit les capacités nucléaires de l'Iran — selon un rapport préliminaire classifié des services de renseignement, le programme nucléaire iranien n'aurait été retardé que de quelques mois —, avant de convaincre les belligérants d'accepter un cessez-le-feu.
- Dans le style surréaliste qui caractérise la politique étrangère de Trump, les trois parties en conflit pouvaient chacune revendiquer la victoire.
Les frappes israéliennes ont causé d'importants dégâts dans des quartiers résidentiels et près d'un millier d'Iraniens auraient été tués. Mais malgré les menaces de Benyamin Nétanyahou, Khamenei n'a pas été assassiné, et Washington n'a pas réduit l'Iran en cendres. Ce qui n'a pas empêché Trump, lors de la visite du premier ministre israélien à la Maison Blanche le 6 juillet, de comparer son action à l'utilisation de l'arme atomique par le président Harry Truman à Hiroshima (« elle a évité beaucoup de combats inutiles, et mon action a aussi évité beaucoup de combats inutiles ». (2) Pendant ce temps, à Gaza, famine et massacres continuaient de plus belle, mais tant qu'Israël et l'Iran étaient en guerre, les souffrances des Palestiniens ne faisaient plus la une.
Dans le style surréaliste qui caractérise la politique étrangère de Trump, les trois parties en conflit pouvaient chacune revendiquer la victoire. Nétanyahou vantait les succès de l'armée de l'air israélienne, qui avait éliminé les principaux dirigeants des Gardiens de la révolution par des frappes éclair aussi dévastatrices que la destruction de l'aviation égyptienne dès les premières heures de la guerre de juin 1967. Khamenei se félicitait du fait que son régime ait survécu et que les missiles balistiques iraniens aient pénétré jusqu'au cœur du territoire israélien, frappant cinq bases militaires, causant des dégâts considérables à Haïfa et à Tel-Aviv et se soldant par la mort de 28 civils, dont les membres d'une famille palestinienne qui habitait l'un des nombreux villages arabes dépourvus d'abri anti-aériens. Trump, enfin, pouvait se présenter à la fois comme un grand chef militaire et un artisan de paix, ralliant à sa cause des néoconservateurs hostiles à son administration tels que William Kristol, tout en rassurant sa base sur le fait qu'il n'était pas en train de fomenter une nouvelle guerre coûteuse au Proche-Orient.
Lors de sa rencontre avec Trump, Nétanyahou révéla qu'il avait proposé la candidature du président étatsunien au prix Nobel de la paix. De son côté, le président iranien Massoud Pezechkian, dans une interview avec Tucker Carlson, fit preuve d'une curieuse mansuétude (visiblement très calculée) envers l'homme qui venait de bombarder son pays : « Trump est tout à fait capable de guider le Proche-Orient vers un avenir de paix et de prospérité », a-t-il déclaré sans la moindre trace d'amertume (3). L'important était que l'occupant de la Maison Blanche empêche Israël d'entraîner toute la région dans un « abîme » de guerres sans fin.
Tout cela aurait pu être évité
Depuis le cessez-le-feu, le régime de Téhéran a lancé une purge contre les traîtres présumés, dont quelques-uns ont été pendus, et expulsé des centaines de milliers de réfugiés afghans. Israël contrôle l'espace aérien iranien et peut y déployer à volonté ses avions de combat et ses drones, comme il le fait régulièrement au-dessus du Liban et de la Syrie. Tout cela aurait pu être évité. Il y a dix ans, le Conseil de sécurité des Nations unies, l'Union européenne et l'Iran avaient conclu un accord, le Plan d'action global commun (JCPOA), visant à garantir que le programme nucléaire iranien serait destiné à des fins pacifiques. Mais trois ans plus tard, l'administration Trump a dénoncé cet accord, alors même qu'il semblait bien fonctionner et qu'il n'y avait aucune preuve que l'Iran l'ait violé — une décision vivement applaudie par Israël et ses partisans. Dans la foulée, Téhéran a aussitôt commencé à enrichir de plus grandes quantités d'uranium à Fordow et dans ses autres installations nucléaires.
Pourtant, au moment où Israël a lancé son attaque-surprise le 13 juin, l'Iran était toujours en pourparlers avec les États-Unis, et la directrice du renseignement national de Trump, Tulsi Gabbard, avait elle-même déclaré devant le Congrès en mars 2025 que l'Iran n'était pas en train de construire une arme nucléaire. (Démentie publiquement par son chef, qui l'accusa carrément de ne pas savoir de quoi elle parlait, elle a changé son discours après l'entrée en guerre des États-Unis.)
- Pourtant, jusqu'à présent, la Maison Blanche n'avait jamais laissé aucune force militaire étatsunienne participer à une offensive israélienne.
Il est tentant d'interpréter la décision de Trump de bombarder l'Iran en termes psychologiques, une explication qu'il a lui-même encouragée. « Peut-être que j'attaquerai, peut-être que je n'attaquerai pas, déclarait-il le 18 juin à des journalistes qui l'interrogeaient à ce sujet. En fait, personne ne sait ce que je vais faire. » Il est possible qu'il ait souhaité avant tout éviter de donner une impression de faiblesse, même si cela l'amenait à un conflit frontal avec ceux de ses partisans qui sont très hostiles aux interventions militaires outre-mer, comme Tucker Carlson et Steve Bannon. Peut-être aussi ne voulait-il pas laisser Israël pilonner l'Iran sans en tirer lui-même le moindre profit symbolique.
Un blanc-seing à Tel-Aviv
Mais les motivations personnelles de Trump importent moins que ce fait incontournable : Washington a donné son plein aval à l'hégémonie régionale d'Israël. Depuis la guerre de 1967, les États-Unis ont régulièrement joué le rôle de protecteur de cet État en lui apportant une aide financière et militaire considérable et un soutien inébranlable au Conseil de sécurité de l'ONU, y bloquant toute résolution condamnant les crimes de guerre israéliens. En 2003, Washington a envahi l'Irak sans aucune justification militaire raisonnable, mais sous les applaudissements des faucons israéliens, dont Nétanyahou.
Pourtant, jusqu'à présent, la Maison Blanche n'avait jamais laissé aucune force militaire étatsunienne participer à une offensive israélienne.
Notes
1- Elisabeth Bumiller, « Iran and the Specter of Iraq : ‘We Bought All the Happy Talk' », The New York Times, 18 juin 2025.
2- Larissa Howie, « Trump compares himself to Truman after Iran attack », MSN, juin 2025.
3- « Tucker Carlson interviewe le président iranien Mosoud Pezeshkian », YouTube, 8 juillet 2025.

De l’anti-impérialisme au compromis : la politique de classe de l’indépendance indienne

Alors que le pays célèbre le 78ᵉ anniversaire de son indépendance, nous présentons une série d'articles retraçant la naissance de la nation et sa situation actuelle. Cet article, le premier de la série, examine l'indépendance de l'Inde, en situant 1947 dans le contexte plus large des crises de l'impérialisme mondial, de l'évolution de l'équilibre des forces de classe et des calculs stratégiques de l'État britannique. Au-delà de l'hagiographie nationaliste, il interroge les compromis économiques et politiques qui ont façonné le transfert du pouvoir, le rôle de la bourgeoisie indigène dans la limitation de la portée de la décolonisation et les possibilités révolutionnaires manquées, en particulier en ce qui concerne la position du Parti communiste indien pendant la guerre. En reliant les luttes internes aux développements géopolitiques, cet article cherche à présenter l'indépendance indienne comme un processus historique controversé plutôt que comme un moment unique de libération. -éd
Tiré d'Europe solidaire sans frontière.
L'indépendance de l'Inde en 1947 a marqué un tournant majeur dans l'histoire contemporaine, car elle a signifié la fin de près de deux siècles de domination coloniale britannique, la plus importante de la planète. Cet événement ne peut être réduit à une simple victoire politique pour une nation, mais doit être considéré comme s'inscrivant dans le cadre plus large du conflit mondial entre les puissances impérialistes et les nations opprimées, façonné par la relation entre la lutte des classes et le développement des forces productives. Le mouvement d'indépendance a suscité de grands espoirs d'émancipation sociale, mais ce rêve est resté largement insaisissable.
L'Inde britannique était une colonie dépendante de l'économie capitaliste mondiale. Vers la fin du XVIIIᵉ siècle, l'économie du sous-continent a été transformée pour répondre aux besoins des entreprises britanniques. Elle constituait un vaste marché pour les produits manufacturés britanniques et une source de matières premières et de produits agricoles, notamment le coton, le jute et le thé. La politique coloniale a systématiquement affaibli les industries locales. Selon Karl Marx, « l'Angleterre commença par évincer les cotonnades indiennes du marché européen, puis elle se mit à exporter en Hindoustan le filé et enfin inonda de cotonnades la patrie des cotonnades », ce qui a nui à l'autosuffisance de l'économie locale, la rendant dépendante du capitalisme britannique. Bien sûr, il ne s'agissait pas d'une conséquence involontaire de la gouvernance britannique, mais d'une reconfiguration délibérée de la dynamique économique de l'Inde afin de l'aligner sur les objectifs capitalistes métropolitains.
Les forces de classe au sein du mouvement nationaliste indien
La lutte interminable pour l'indépendance de l'Inde n'était pas un mouvement unique, mais une coalition de personnes de différentes classes et origines ayant des objectifs différents. Le Congrès national indien a été fondé en 1885, et la plupart de ses dirigeants étaient issus de la bourgeoisie indigène et de la classe terrienne. Leur objectif principal était de créer un État indépendant qui conserve des droits de propriété capitalistes solides et un marché national qui ne soit pas contrôlé par les Britanniques.
Dans les années 1920, la classe capitaliste indienne, un groupe restreint mais influent composé d'industriels, de commerçants, de banquiers et de propriétaires d'usines, avait accumulé un pouvoir économique considérable au sein de l'économie coloniale. Cette consolidation était le résultat de trois développements historiques clés : les changements dans la politique coloniale, l'émergence d'intérêts capitalistes organisés et la montée du capitalisme nationaliste.
La Première Guerre mondiale (1914-1918) a offert deux opportunités majeures à la classe capitaliste indienne. Elle a perturbé les importations britanniques en Inde, créant ainsi un espace pour la croissance industrielle locale, en particulier dans les secteurs du textile, du jute, du fer et de l'acier. La guerre a également stimulé la demande en fournitures militaires, permettant aux capitalistes indiens d'accumuler des profits sans précédent. Selon l'historien Bipan Chandra, « la perturbation des échanges commerciaux normaux pendant la guerre a augmenté les exportations indiennes de matières premières et de denrées alimentaires ». Les Britanniques, bien que réticents, ont dû s'appuyer davantage sur les entreprises indiennes en raison des pénuries liées à la guerre.
Dans le même temps, la bourgeoisie indienne s'est organisée de diverses manières, notamment par le biais de la Chambre des marchands indiens (1907) et, plus tard, de la Fédération des chambres de commerce et d'industrie indiennes (FICCI) (1927). Cela a donné à la bourgeoisie une voix institutionnelle pour faire pression en faveur de droits de douane, d'une politique industrielle et d'une participation accrue à la gouvernance. De colossaux industriels indiens tels que G. D. Birla, Jamnalal Bajaj et Purshottamdas Thakurdas devinrent des personnalités influentes tant sur le plan économique que politique.
La bourgeoisie indienne s'est alignée sur le Congrès national indien (INC), en particulier pendant le mouvement de renom de non-coopération (1920-1922), soutenant le swadeshi (utilisation de produits indiens) en même temps comme politique nationaliste et comme politique axée sur le profit. Bien que la bourgeoisie indigène fût politiquement soumise aux Britanniques, elle a établi une domination manifeste dans certains secteurs. Vers les années 1920, les usines indiennes dominaient le secteur du coton à Bombay et Ahmedabad et se développaient dans le domaine du jute au Bengale, auparavant dominé par le capital britannique. L'aciérie créée par les Tata à Jamshedpur (Tata Iron and Steel Company) en 1907 est devenue un symbole de l'autosuffisance industrielle et était la plus imposante aciérie de l'Empire britannique au milieu des années 1920. Tous ces développements ont facilité leur influence sur les politiques commerciales, la bourgeoisie indienne ayant réussi à faire adopter des droits de douane protecteurs (par exemple, les droits sur le coton en 1923) afin de protéger l'industrie nationale des importations britanniques.
Leur alliance avec la politique nationaliste et leur soutien au Congrès leur ont donné un poids politique leur permettant d'influencer l'orientation du mouvement d'indépendance vers des objectifs servant les intérêts capitalistes plutôt que la révolution socialiste. L'hégémonie de la bourgeoisie indienne était un projet de classe, et cela ne se reflétait nulle part mieux que dans le programme économique du Congrès, qui visait l'indépendance nationale sous le capitalisme. Ainsi, la puissance économique de la bourgeoisie indienne a créé son hégémonie politique, lui permettant de devenir la classe dirigeante du mouvement national et de marginaliser les revendications plus radicales des ouvriers et des paysans. Son leadership a permis de garantir que les luttes anti-impérialistes ne dépassent pas les limites et ne menacent pas les relations de propriété capitalistes. Il est également avéré qu'elle a parfois coopéré avec certaines sections de l'État colonial lorsque cela servait ses intérêts, par exemple en acceptant des capitaux britanniques dans des coentreprises et en réprimant les mouvements sociaux militants.
Malgré sa domination économique croissante, la bourgeoisie indigène avait encore du chemin à parcourir. Elle était toujours soumise à des contraintes structurelles, car le capital britannique conservait le contrôle des finances, du transport maritime, des plantations et de nombreux secteurs très rentables, notamment les assurances et les banques. De plus, l'État colonial était fondamentalement conçu pour protéger les intérêts impériaux, et les concessions accordées aux capitalistes indiens n'étaient que tactiques et n'ont jamais été transformatrices.
En résumé, dans les années 1920, la bourgeoisie indienne avait atteint une domination sectorielle dans des industries clés (textile, acier). Sa puissance économique lui a permis d'exercer une hégémonie sur la politique nationaliste, qu'elle a habilement utilisée pour faire avancer ses intérêts de classe, orientant ainsi le programme économique du mouvement indépendantiste vers le développement capitaliste. En raison de leur position hégémonique au sein du bloc anticolonial, les alternatives socialistes et ouvrières ont été explicitement mises à l'écart.
La situation créée autour de la Première Guerre mondiale a été une précieuse leçon pour la bourgeoisie indienne. Elle a compris qu'elle pouvait équitablement rivaliser avec le capital britannique lorsqu'elle bénéficiait d'une protection, et que le pouvoir politique était la clé pour garantir cette protection de manière permanente.
Au-delà du discours bourgeois
Les récits officiels nous rappellent que le Congrès national indien a mené la lutte pour la liberté et l'a remportée en 1947. Cependant, ils ne précisent pas pour qui cette liberté a été obtenue. Qu'est-il advenu des ouvriers des usines, des paysans écrasés par les loyers et les dettes, ou des masses laborieuses qui ont versé leur sang dans les rues ?
Pendant ce temps, la révolution russe a changé le cours de l'histoire humaine. Elle a prouvé que même un pays vaste et arriéré pouvait vaincre sa classe dirigeante et ses chaînes impérialistes grâce à la puissance unie des ouvriers et des paysans. Elle a inspiré des millions de personnes à travers le monde et, en Inde, quelques années plus tard, les communistes et les socialistes ont pris leur rôle d'aile consciente de la lutte pour la liberté. Ils ont lié la lutte anti-impérialiste à la lutte pour renverser le capitalisme et le féodalisme. Cependant, bien avant l'existence du Parti communiste, les révolutionnaires indiens à l'étranger – les Ghadarites – ont brandi la bannière de la rébellion armée contre les Britanniques. Bien qu'ils ne fussent pas encore marxistes, ils partageaient avec les communistes une haine de l'exploitation coloniale et une croyance en la solidarité internationale de la classe ouvrière.
Le Parti communiste indien (CPI) a été officiellement créé en 1925 à Kanpur. Dès le début, il s'est enraciné dans les luttes des ouvriers et des paysans. Il a mené des grèves dans les usines textiles de Bombay et les usines de jute du Bengale, organisé les cheminots en syndicats militants et diffusé la littérature marxiste malgré la répression coloniale brutale. Dès le début, les communistes ont explicitement indiqué que l'indépendance sous le capitalisme ne mettrait pas fin à l'exploitation. Leur objectif était une république ouvrière et paysanne.
En 1934, le Parti socialiste du Congrès (CSP) a été fondé par Jayaprakash Narayan, Acharya Narendra Deva et d'autres. Ils ont tenté de pousser le Congrès vers des réformes agraires radicales, une industrialisation dirigée par l'État et également une action directe contre l'impérialisme. Si le CSP a souvent collaboré avec les communistes dans le cadre de grèves et de luttes paysannes, sa position au sein du Congrès lui a souvent lié les mains lorsque la direction a fait des compromis avec les Britanniques ou la bourgeoisie.
Les communistes et les socialistes ont créé des organisations de masse qui ont donné à la lutte pour la liberté une dimension militante et ouvrière. Les grèves menées par l'All India Trade Union Congress (AITUC) ont secoué Bombay, Calcutta et les lignes ferroviaires à travers le pays. Sous la direction de l'All India Kisan Sabha (AIKS), des millions de paysans se sont soulevés contre le système foncier, déclenchant des mouvements tels que Tebhaga au Bengale, la lutte armée au Telangana et d'autres. Il ne s'agissait pas de protestations symboliques, mais de défis directs au pouvoir colonial et capitaliste foncier.
Les communistes indiens ont en effet été parmi les premiers à réclamer ouvertement et sans relâche l'indépendance totale (purna swaraj) vis-à-vis de la domination britannique. Ce faisant, ils ont marqué leur temps, à une époque où les dirigeants bourgeois indiens du Congrès hésitaient encore entre une réforme constitutionnelle modérée et le statut de dominion au sein de l'Empire britannique. Jusqu'à la fin des années 1920, la direction dominante du Congrès (dominée par les modérés, puis par l'aile du « programme constructif » de Gandhi) n'exigeait pas la séparation complète de l'Empire britannique. Ses revendications portaient généralement sur une plus vaste représentation de l'Inde au sein du pouvoir législatif et sur le statut de dominion, c'est-à-dire l'autonomie gouvernementale au sein de l'Empire, à l'instar du Canada ou de l'Australie. La bourgeoisie craignait qu'une rupture totale ne provoque des soulèvements de masse incontrôlables qui pourraient également menacer ses propres relations de propriété. Même dans le rapport Nehru de 1928, le statut de dominion était l'objectif officiel, malgré l'agitation croissante des jeunes et de la gauche en faveur d'une indépendance totale.
Les années de guerre et les contradictions de classe
Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata, les communistes s'y opposèrent initialement en tant que guerre interimpérialiste, c'est-à-dire un conflit entre puissances coloniales rivales pour des marchés et des territoires. Ils s'opposèrent aux efforts de guerre britanniques en Inde, appelèrent à des luttes militantes et s'alignèrent avec d'autres forces anticolonialistes dans des grèves, des soulèvements paysans et des manifestations. Cela créa des communistes une partie de la coalition antibritannique plus large, malgré leur taille encore limitée.
Cependant, la situation a changé après l'invasion de l'Union soviétique par Hitler en 1941. La ligne du Komintern s'est orientée vers une guerre populaire, soutenant les Alliés contre le fascisme. Cela a conduit le CPI à s'abstenir du mouvement Quit India en 1942. Cette action a créé des divisions entre les communistes et les autres forces anti-impérialistes.
Pour les communistes du monde entier, la défaite du fascisme devint la tâche principale ; les luttes anticoloniales devaient désormais être subordonnées à l'effort de guerre des Alliés. Ce fut la « capitulation » du PCI dans le contexte indien. Dans la pratique, il soutint l'effort de guerre des Alliés (britanniques) en Inde, exhortant les travailleurs à éviter les grèves qui pourraient entraver la production pour la guerre. Il œuvra même au maintien de la paix industrielle, une position qui aida objectivement l'impérialisme britannique. Lors du mouvement Quit India d'août 1942, le plus vaste soulèvement populaire contre la domination britannique depuis 1857, le CPI s'y opposa, le qualifiant de perturbateur pour la lutte contre le fascisme.
Quit India était principalement dirigée par le Congrès et par une action spontanée des masses populaires. En refusant d'y participer — et dans certains cas en décourageant activement les grèves et les manifestations —, le CPI s'est aliéné une portion considérable des masses anti-impérialistes. Cette décision a été considérée par de nombreux nationalistes comme une « trahison » ou une « collaboration » avec les Britanniques.
Avant 1941, les communistes gagnaient en influence grâce à des grèves militantes et des actions paysannes. La nouvelle ligne a refroidi cette militance, rompant le lien entre le CPI et les courants anti-britanniques les plus militants pendant près de trois ans. Ce changement a signifié que le CPI a cédé le leadership du mouvement de masse au Congrès nationaliste bourgeois. La chance de positionner la classe ouvrière comme l'avant-garde de la lutte pour l'indépendance a été perdue, du moins temporairement.
Du point de vue du PCI, cette politique était une question de loyauté internationaliste envers l'Union soviétique, qui était menacée dans son existence même. Mais en Inde, elle signifiait donner la priorité aux besoins de guerre de l'Empire britannique plutôt qu'à la libération immédiate. Si cela pouvait se défendre d'un point de vue antifasciste mondial, cela affaiblit la crédibilité anti-impérialiste du PCI au niveau national et sa capacité à contester le leadership bourgeois après 1945.
Après la guerre, le CPI a tenté de retrouver son élan révolutionnaire avec la lutte armée du Telangana, le mouvement Tebhaga et des grèves militantes, mais à ce moment-là, le Congrès s'était déjà réaffirmé comme la principale force nationaliste. La « capitulation » communiste de 1941-1945 a sans doute compromis la possibilité d'une indépendance menée par la gauche en Inde. Les marxistes comme R. Palme Dutt défendent la décision du PCI comme étant historiquement nécessaire pour vaincre le fascisme, tandis que d'autres – y compris certains membres de la gauche indienne – affirment qu'il s'agissait d'une subordination sectaire aux ordres du Komintern qui a rompu le lien organique entre les communistes et le soulèvement anticolonialiste de masse en Inde.
Il est crucial de reconnaître que les organisations populaires de gauche, en particulier les syndicats, ont contribué de manière significative au mouvement Quit India. Les factions de gauche issues de traditions non communistes, telles que le RSP, le RCPI, le BLPI, entre autres, se sont engagées dans le mouvement avec un enthousiasme considérable. De plus, les socialistes du CSP sont entrés dans la clandestinité pour lutter, et après 1945, les communistes sont revenus à l'action militante de masse, menant des grèves, des mutineries (révolte de la Royal Indian Navy, 1946) et des soulèvements paysans armés.
L'occasion manquée et ses conséquences
Le refus du CPI de rejoindre Quit India a empêché la classe ouvrière et la paysannerie de devenir les leaders organisés et conscients du mouvement d'indépendance à un moment décisif. En conséquence, le nationalisme bourgeois a pu présenter 1947 comme sa victoire, façonnant le nouvel État pour servir l'accumulation capitaliste et préserver le pouvoir des propriétaires terriens.
Le retrait du PCI du front anti-britannique en 1942 a laissé le champ politique ouvert à l'expansion des forces communautaires, même si ce n'était pas la seule cause. Le lien est subtil mais très réel en termes de politique de classe et de vide politique.
Le retrait du PCI n'a pas créé le communautarisme. La politique impériale britannique et les contradictions de classe en Inde l'avaient déjà nourri, mais avec le départ des communistes du front anti-impérialiste, un pôle d'attraction séculaire majeur de la classe ouvrière a été retiré du front. Sans ce pôle, le fossé entre la bourgeoisie et les communautés s'est creusé, et la lutte pour l'indépendance s'est de plus en plus jouée en termes communautaires plutôt qu'en termes de classe. Le sous-continent souffre encore aujourd'hui de cet héritage dévastateur.
En résumé, subordonner une lutte de libération coloniale aux besoins de politique étrangère d'un autre État (même « socialiste ») peut rompre le lien organique entre les révolutionnaires et les masses et rendre l'initiative politique à la bourgeoisie.
La révolution inachevée
En fin de compte, la direction bourgeoise du Congrès a négocié un accord avec l'impérialisme britannique qui a laissé intact le système féodal et protégé la propriété capitaliste. Les communistes et les socialistes, malgré leur héroïsme, n'étaient pas en mesure de prendre le pouvoir national en 1947. La répression, les débats internes et la force politique de la bourgeoisie ont fait que la révolution s'est arrêtée à mi-chemin.
1947 montre que la souveraineté politique peut coexister avec l'exploitation capitaliste.
Soumya Sahin
• Traduit pour ESSF par Sushovan Dhar.
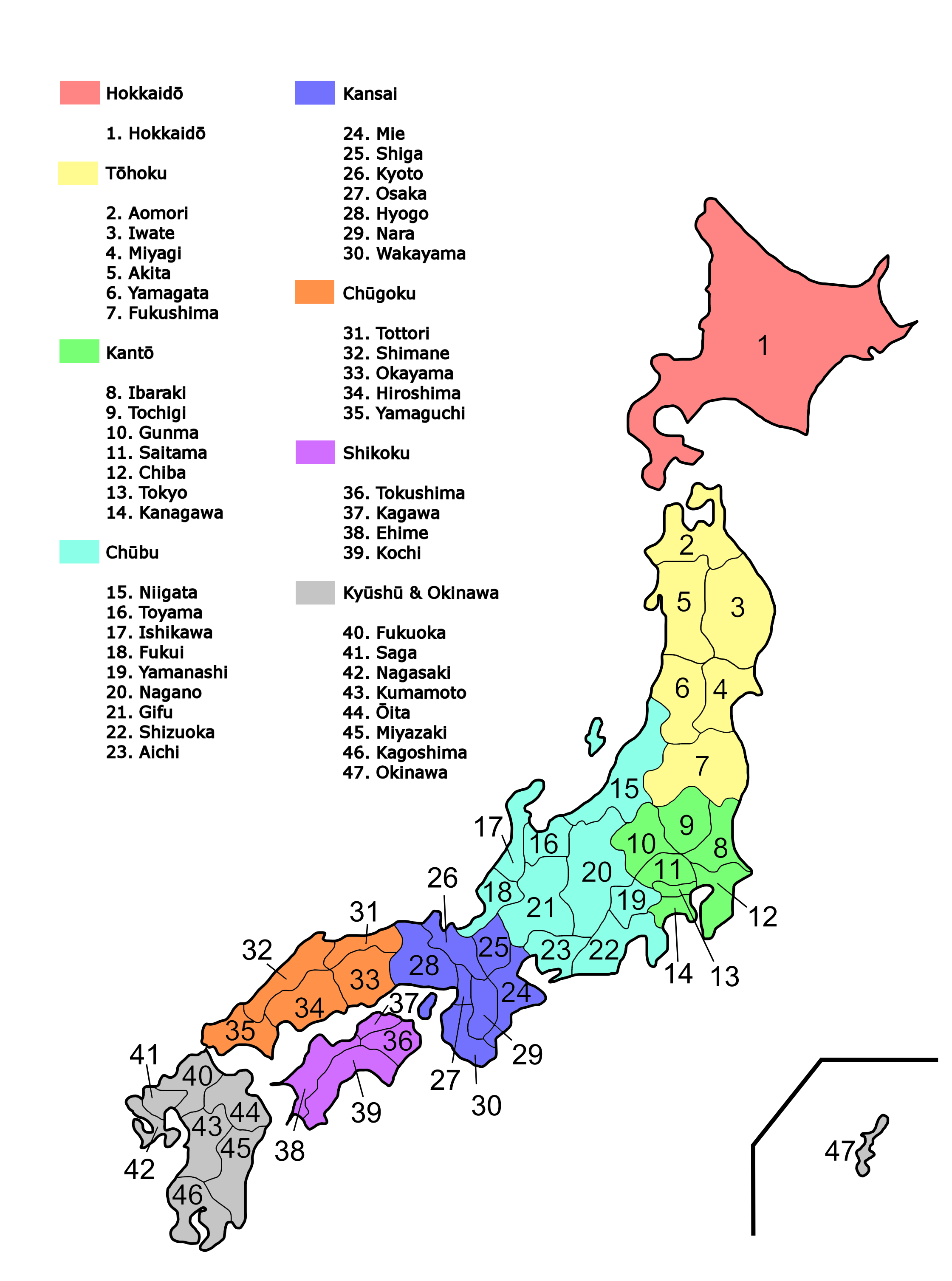
Au Japon, l’Orient extrême
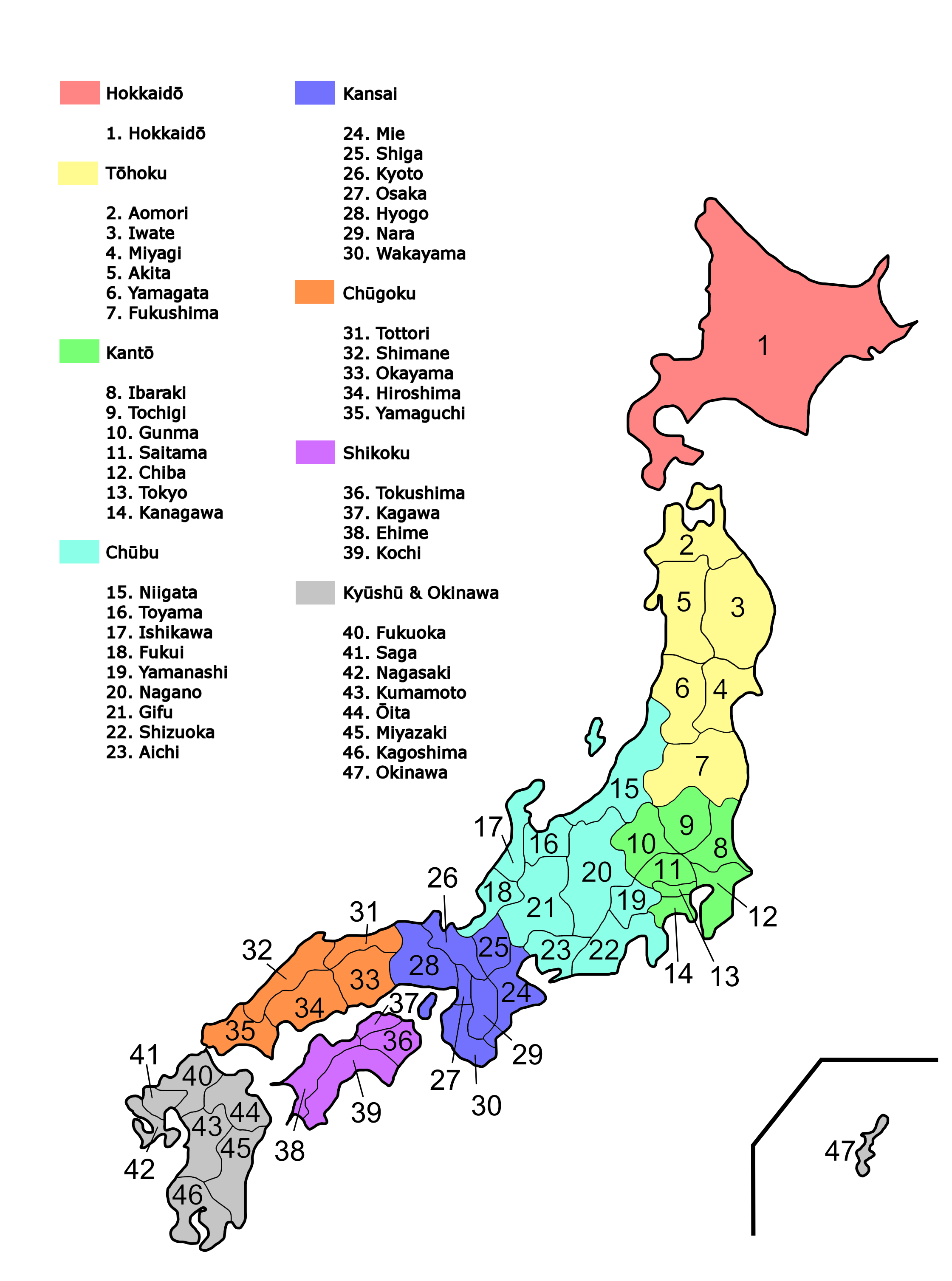
Imaginez votre stupeur quand, flânant dans les rues d'une grande ville allemande, vous découvririez une église où l'on vient prier pour les soldats nazis morts au combat. Cette folie révisionniste existe bel et bien en plein centre de Tokyo, à deux pas du Kokyo, le palais de la famille impériale.
Tiré de : La chronique de Recherches internationales
Axel Nodiot
Journaliste, spécialiste de l'Asie-Pacifique
Au sanctuaire shinto de Yasukuni, entre de grandes allées, des cerisiers et d'anciennes maisons de thé, les Japonais honorent les deux millions de "divinités" tombées lors des invasions coloniales de l'empire (1868-1945) et pendant la "Grande guerre d'Asie de l'est" – la Seconde guerre mondiale. Au détour d'un sentier, un monument est même dressé à la gloire de la Kempeitai, surnommée la "Gestapo japonaise", qui tortura, massacra, viola et réduit au travail forcé des Coréens, Chinois, Taïwanais et d'autres peuples de la région.
Cette époque sombre, qui a vu le Japon rejoindre les puissances de l'Axe et se conclure par l'horreur des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, a toujours ses nostalgiques. Preuve en est du scrutin du 20 juillet dernier, qui a renouvelé la moitié des sièges de la Chambre des conseillers, la chambre haute de la Diète japonaise. La conclusion principale de cette élection est la perte de majorité du Parti libéral-démocrate (PLD, droite). Cette dernière était prévisible, tant ses dirigeants, empêtrés dans des scandales de fraude financière et électorale, ont entraîné le peuple dans un ultralibéralisme intenable. Mais ce nouveau revers est éclipsé par la percée des mouvements d'extrême droite, jusqu'ici anecdotiques ou tentant de prendre les rênes du PLD.
Le Sanseito, parti populiste et xénophobe, n'avait jusqu'ici qu'un conseiller – Sohei Kamiya, son leader. Il en a fait élire 14 de plus, recueillant 7,4 millions de voix sur l'archipel, soit 12,55 %. Créé en 2020 pendant la crise du Covid-19, le mouvement est très présent sur les réseaux sociaux, où ses dirigeants déversent des discours antisémites, antivax, homophobes et favorables à la réécriture de la Constitution pacifique du Japon. Il a surtout réussi à capter la faction nationaliste des électeurs du PLD. Ces derniers sont issus des classes aisées, et les plus zélés d'entre eux suivaient jusqu'à présent la très droitière Sanae Takaichi. Elle a failli devenir premier ministre en septembre 2024, lors des élections internes au parti convoquées après la démission de Fumio Kishida (2021-2024), devancée de seulement quelques voix par Shigeru Ishiba, l'actuel dirigeant. Également révisionniste, elle se rend régulièrement au sanctuaire de Yasukuni, les mains chargées d'offrandes. Takaichi est enfin affiliée au Nippon Kaigi, une organisation ultranationaliste qui a pour symbole l'ancien drapeau du Japon impérial, sur lequel le soleil levant irradie ses rayons rouges.
Mais le Sanseito a réussi à mobiliser l'électorat populaire. À 47 ans, Sohei Kamiya a mené une campagne à la Donald Trump (dont il loue le "style politique audacieux") centrée sur l'immigration et "Les Japonais d'abord", en détournant les préoccupations principales de la classe travailleuse : la sécurité sociale, la hausse des prix du riz et la baisse alarmante de la natalité. Comme leurs voisins Sud-coréens, les Japonais sont déprimés par l'inflation et une culture du travail très prenante, qui les fait rechigner à se marier et à fonder une famille. En 2024, seules 700 000 naissances environ ont été enregistrées dans l'archipel, le plus bas chiffre depuis l'établissement du recensement, à la fin du XIXe siècle. Le capitalisme à outrance et les inégalités creusées dans son sillage mènent certains hommes japonais à l'isolement – symbolisé par l'inquiétant phénomène des hikikomori, ces hommes plus ou moins jeunes qui ne sortent plus de leur chambre quitte à y mourir – et constitue un terreau fertile à l'antiféminisme et à la xénophobie.
C'est aussi à ces masculinistes que s'est adressé le Sanseito, à l'instar d'autres dirigeants de droite nationaliste tels que l'États-unien Donald Trump, l'Argentin Javier Milei ou le Sud-coréen Yoon Suk-yeol, déchu après avoir déclaré la loi martiale en décembre 2024. Sohei Kamiya a par exemple qualifié l'égalité des genres "d'erreur qui pousse les femmes à travailler et les empêche d'avoir des enfants". Résolument antisyndicaliste et favorable à des baisses d'impôt pour les entreprises et à "des coupes" dans l'administration et les services publics, il est enfin partisan d'une remilitarisation de l'archipel. Le sujet est brûlant depuis quelques années : l'article 9 de la Constitution interdit certes au Japon de disposer d'une armée autre que défensive. Mais le texte hérité de 1945 est sans cesse détricoté par les gouvernements du PLD depuis Shinzo Abe (2006-2007 et 2012-2020) : les jietai (Forces japonaises d'autodéfense) sont désormais déployées à l'étranger, et le pays a récemment mis à l'eau son premier porte-avions depuis la fin de la Seconde guerre mondiale. Il s'agit du "Kaga", du nom d'un ancien porte-avions qui avait servi lors de la seconde guerre sino-japonaise et de la bataille de Pearl Harbor.
Cette remilitarisation est largement encouragée par l'allié états-unien, qui fournit des armes à Tokyo, Séoul, Manille ou encore Taipei pour encercler la Chine dans le Pacifique. La "stratégie des chaînes d'îles", comme formulée par Washington, fait du Japon un maillon essentiel de l'impérialisme américain en Asie. Quelque 50 000 GI stationnent en permanence sur l'archipel, notamment sur les bases militaires d'Okinawa, au sud, ce qui irrite les habitants, confrontés de longue date à des agressions de jeunes Japonaises par les soldats. Et le gouvernement japonais ambitionne d'établir un commandement unifié des jieitai, dirigé par un général états-unien. Pour réarmer leur pays en dépit de la "paix éternelle" inscrite dans la Constitution, les dirigeants ont commandé ces dix dernières années la bagatelle de 147 avions bombardiers F-35 au Pentagone, ainsi que plusieurs centaines de missiles Tomahawk. En 2023, le premier ministre Fumio Kishida, lui aussi issu des rangs du PLD, a fait voter par la Diète une loi de programmation militaire qui doterait le Japon du troisième budget de la Défense au monde.
Récemment, les menaces de droits de douane de l'administration Trump ont de nouveau fait ployer le genou à Shigeru Ishiba. Parmi les gages du premier ministre au président états-unien, outre les 15 % de taxes sur les produits japonais, des investissements de 550 milliards de dollars dans l'industrie américaine, notamment de l'armement, alors que " le ministère de la Défense achète déjà environ 1 000 milliards de yens (5,8 milliards d'euros, ndlr) d'armes aux Etats-Unis ", déplore le journal communiste Akahata. Pour ne rien arranger, Ishiba est partisan d'un " OTAN asiatique " qui assiérait encore plus confortablement Washington en Asie-Pacifique, au risque de faire enrager Pékin et de mettre le feu à la poudrière régionale. Le premier ministre évoque même le " parapluie nucléaire américain ", impensable pour le seul pays atomisé de l'Histoire, à quelques jours des commémorations des 80 ans de Hiroshima et Nagasaki.
Cette escalade mortifère provoque l'ire des hibakusha, les survivants de la bombe nucléaire et leurs descendants. Ils voient déjà leur gouvernement boycotter le dernier comité préparatoire à la conférence d'examen du Traité de non-prolifération nucléaire cette année. Ils redoutent désormais de voir bientôt abrogé l'article 9, ce que désire ardemment le Sanseito et les factions nationalistes du PLD. Un temps avancée, la démission de Shigeru Ishiba après le scrutin du 20 juillet est finalement abandonnée. Mais pour gouverner, le premier ministre devra nouer de nouvelles alliances avec les partis d'opposition. Il s'agit de savoir s'il privilégiera les besoins de son peuple, comme le veulent les progressistes pacifistes, ou s'il préfèrera séduire les nationalistes bellicistes. Malheureusement, de premiers éléments de réponse existent. Durant la campagne, les libéraux se sont alignés sur l'agenda xénophobe de l'extrême droite et de la "paix par la force" états-unienne. Au risque de revoir un jour les rayons de l'empire japonais brûler l'Asie de l'Est.
Cette chronique est réalisée en partenariat rédactionnel avec la revue Recherches internationales à laquelle collaborent de nombreux universitaires ou chercheurs et qui a pour champ d'analyse les grandes questions qui bouleversent le monde aujourd'hui, les enjeux de la mondialisation, les luttes de solidarité qui se nouent et apparaissent de plus en plus indissociables de ce qui se passe dans chaque pays.
Site : http://www.recherches-internationales.fr/
https://shs.cairn.info/revue-recherches-internationales?lang=fr
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

31 organisations de la diaspora indienne et de la société civile internationale condamnent la disparition forcée et la torture en détention d’étudiants et de jeunes militants par une cellule spéciale de la police à Delhi, en Inde.

22 juillet 2025, Montréal, New Delhi, Londres, RU. 31 organisations de la diaspora indienne et de la société civile internationale ont publié une déclaration commune condamnant la disparition forcée et la torture d'étudiants et de jeunes militants dans la ville de New Delhi et ses environs. Cette déclaration souligne la gravité de cet incident et la négligence flagrante des autorités de l'État à l'égard des obligations internationales de l'Inde en matière de droits de
l'homme.
Cette action de la Cellule spéciale de la police de Delhi contre des étudiants et des jeunes militants dénonçant les excès de l'État en Inde n'est pas un incident survenu dans le vide, mais met en évidence la suspension de la démocratie en Inde et la manière dont les autorités de l'État ignorent de manière flagrante les obligations internationales de l'Inde en matière de droits de la personne.
Elle rappelle des incidents précédents en la matière et fait référence à la volonté générale et systémique du gouvernement indien de démanteler la société civile indienne. La déclaration souligne le lien existant entre l'état d'exception qui s'impose dans certaines régions telles que le Cachemire, le Bastar et le Manipur et la façon dont le mépris de l'état de droit se normalise de plus en plus dans l'ensemble du pays.
Le texte intégral est ci-bas.
Cette déclaration commune souligne les enjeux que soulèvent la prise en otage et la torture d'étudiants et de jeunes militants dans la ville de New Delhi, la capitale nationale de l'Inde, et dans ses environs.
Une précédente déclaration commune sur la répression dans deux universités de Delhi, publiée le 5 mars 2025, notait que les étudiants et étudiantes critiquant la violence d'État en cours dans la région Adivasi du Bastar dans l'État du Chhattisgarh, situé dans le centre de l'Inde, ainsi que l'exclusion toujours plus systématique des musulmans en tant que citoyens de l'Inde, étaient « arbitrairement enlevés puis portés “disparus” alors qu'il était su qu'ils étaient détenus dans des postes de police, certains d'entre eux étant soumis à des interrogatoires illégaux par des agences de renseignement dont les attributions relèvent de la sécurité nationale de haut niveau ». Toutes ces actions des autorités de l'État sont justifiées par « un récit qui délégitime l'activisme étudiant et citoyen en le qualifiant de “naxalisme urbain” ou de perturbations menées par des musulmans à l'encontre d'un “État hindou pacifique” ».
Les 17 et 18 juillet 2025, des rapports de terrain ont signalé que de nombreux étudiants et jeunes militants, incluant certains de ceux qui avaient été visés par les incidents mentionnés dans notre déclaration précédente, étaient portés disparus depuis plusieurs jours et que d'autres continuaient à disparaître.
Il est ressorti que le 9 juillet 2025, les activistes Gurkirat, Gaurav et Gauraang du Bhagat Singh Chhatra Ekta Manch (bsCEM) ont été portés disparus à Delhi. Le 11 juillet 2025, Ehtmam et Baadal du Forum Against Corporatization and Militarization, qui fait campagne contre les excès de l'État dans le Bastar, ont également été portés disparus à Delhi. À peuprès à la même époque, Samrat Singh a également été porté disparu à Yamunanagar, dans l'Haryana, « à l'insu
des autorités locales et en dehors du mandat juridictionnel de la police de Delhi ». Nous insistons sur l'utilisation du terme « disparu » car aucun mandat d'arrêt n'a été produit, ces personnes ont simplement été enlevées de force par les autorités de l'État et détenues dans un poste de police local en plein Delhi. Pendant plusieurs jours, personne n'a su où elles étaient et elles n'ont pas eu accès à leur famille ou à un avocat. Ils n'ont pas été présentés à un magistrat
dans les 24 heures suivant leur arrestation comme l'exige la loi. La déclaration de la Campaign Against State Repression's (CASR) souligne que pendant leur garde à vue, les militants ont été « déshabillés, battus, électrocutés et soumis à des traitements dégradants, notamment en se faisant plonger la tête dans des cuvettes de toilettes. La police a également proféré à leur endroit d'horribles menaces de violences sexuelles, en particulier à l'encontre des militantes, à qui l'on a dit qu'elles seraient violées à l'aide de bâtons ». On leur a demandé de signer des documents vierges et nous pouvons supposer que ceux-ci pourraient éventuellement être utilisés contre eux ou pour incriminer d'autres militants. Ils ont ensuite été libérés les uns après les autres vers le 18 juillet 2025, mais le 19 juillet, on a appris une nouvelle disparition, celle de Rudra, étudiant au Zakir Hussain College de l'université de Delhi.
Ces disparitions forcées, autrefois caractéristiques de régions fortement militarisées telles que le Cachemire, le Bastar et le Manipur, sont aujourd'hui observées dans toute l'Inde, dans les zones rurales comme dans les zones urbaines. Si l'ampleur de ces attaques est sans précédent, elle n'est pas inattendue, car les prémices de cette évolution sont en cours depuis un certain temps. En 2021, le conseiller à la sécurité nationale Ajit Doval avait ouvertement déclaré que
lasociété civile était le « nouveau front de bataille ». La surveillance, l'intimidation et l'incarcération d'acteurs civils clés, d'organisateur-ices et de mobilisateur-ices travaillant avec des communautés marginalisées, ainsi que le resserrement des sources de financement leur étant destinées, ont contribué audémentellement systématiquede la société civile de diverses manières depuis déjà plusieurs années. À l'automne del'année suivante, le ministre de l'intérieur Amit Shah a « présidé » un « Chintan Shivir » - traduit par « camp de réflexion » - réunissant les ministres de l'intérieur, les lieutenants-gouverneurs et les administrateurs des territoires de l'Union, les ministres de l'intérieur des États, les directeurs généraux de la police et les directeurs généraux des forces centrales de police armée et des organisations centrales de police de tout le pays pour « réfléchir à des améliorations » à apporter aux stratégies et tactiques
de sécurité nationale. Cette grande assemblée de l'« appareil de sécurité » de l'Inde s'est tenue à Surajkund, dans l'Haryana. Le 28 octobre 2022, Narendra Modi s'est adressé à celle-ci par liaison vidéo. Au travers d'autres « suggestions », il a offert cette « perle de sagesse » : « Toute forme de naxalisme, qu'il s'agisse de celui qui utilise des armes ou celui qui utilise des stylos, doit être déracinée ». Cela faisait écho àl'ordre de deux juges qui avaient suspendu le premier acquittement du professeur G.N. Saibaba, lors d'une audience extraordinaire de la Cour suprême de l'Inde, et qui avaient estimé que cela était justifié car le « cerveau était plus dangereux » que « l'implication directe ». Une autre stratégie utile « suggérée » par Narendra Modi à Surajkund consistait à réorienter les ressources policières en matière d'investigations sur les délits mineurs - en déréglementant le commerce - vers le renforcement des lois
antiterroristes et des mécanismes de surveillance numérique. En d'autres termes, il était temps d'étendre la suspension de la Constitution, qui avait déjà cours au Cachemire, au Manipur et dans le Bastar.
Les disparitions forcées et les tortures perpétrées aujourd'hui derrière les murs d'un commissariat de police ne peuvent être comprises que comme une manifestation de l'enracinement et de la normalisation de la violence d'État ainsi que du mépris de l'État de droit en tant que mode de gouvernance, qui s'étend désormais des forêts du Bastar et du Cachemire
jusqu'au cœur de la capitale. C'était voulu. Le poste de police qui a été le théâtre des derniers épisodes de torture visant les étudiants et des jeunes les plus brillants de l'Inde est situé dans l'un des quartiers les plus choyés de New Delhi - New Friends Colony, une localité où se côtoient différentes classes sociales, notamment d'anciens officiers de la marine et de l'armée, des hommes d'affaires et des résidents plus modestes. Le fait que ces tortures se déroulent sous
leur nez, dans la capitale nationale dirigée par le BJP, illustre une fois de plus la normalisation de la violence d'État en Inde.
Passons en revue les violations commises dans le cadre de la présente affaire, qui ne fait l'objet d'aucune forme de procédure régulière, d'aucune documentation juridique et d'aucune garantie procédurale, comme l'exigent généralement le droit constitutionnel indien et les procédures pénales établies. Nous ne disposons d'aucune information concernant la reconnaissance officielle des arrestations par aucune autorité compétente, ni aucune indication de contrôle judiciaire ou documentation démontrant que les personnes détenues ont été présentées à une autorité judiciaire dans les délais légaux prescrits par la loi indienne. Il s'agit donc de disparitions forcées avec violation du droit à être informé des motifs de l'arrestation (aucune note d'arrestation ni aucun mandat n'ont été présentés), du droit à pouvoir disposer d'un avocat, du droit des familles d'être informées et du droit à la vie et à la dignité. Les menaces de violence sexuelle sont constitutives de torture sexuelle au regard des lois et conventions contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Toutes ces suspensions de droits constituent une multitude de violations des lois, statuts et conventions nationales et internationales qui protègent nos droits civils et politiques, dont le droit de protester contre les excès de l'État. L'Inde est tenue, en vertu du droit international relatif aux droits de l'homme, et en particulier du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), auquel elle est partie, de défendre les droits de toutes les personnes privées de liberté, y compris la protection contre les arrestations arbitraires et l'accès rapide à un avocat et au contrôle judiciaire (article 9, paragraphes 1 à 4). Les normes internationales, telles que reflétées dans la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées - que l'Inde a signée mais n'a malheureusement pas encore ratifiée - interdisent la détention secrète (article 17(1)) et exigent que tous les détenus soient placés dans
des installations officiellement reconnues, avec des registres régulièrement mis à jour, accessibles et centralisés (article 17(2)-(3)).
Nous, groupes de la diaspora indienne et de la société civile du monde entier, demandons une enquête complète et indépendante sur les circonstances des détentions illégales, de la torture et de l'intimidation par la police à Delhi. Nous condamnons sans équivoque l'inversion complète de l'État de droit par l'État indien, son utilisation abusive des lois relatives à « l'ordre public », ainsi que son recours normalisé et généralisé à la surveillance, aux disparitions forcées et à la violence en détention à l'encontre de ses propres citoyens.
Signataires :
International Solidarity for Academic Freedom in India (InSAF India)
India Labour Solidarity (UK)
South Asia Solidarity Group
Students' Federation of India - United Kingdom
Anti-Imperialist Front (Britain)
International Council of Indian Muslims (ICIM)
12ummah.com
Prof Saibaba Study Circle
Sofia Karim, Turbine Bagh, London
SOAS Ambedkar Society
Hounslow Friends of Palestine
Indian Workers Association (GB)
Indian Scheduled Caste Association UK
Hindus for Human Rights UK
Oxford South Asian Ambedkar Forum (OxSAAF)
Justice For All Canada, (Toronto, ON)
Canadian Forum for Human Rights and Democracy in India
Hindus for Human Rights USA
Brighton Ambedkar Reading Circle
other indias collective (The Netherlands)
Alliance Against Islamophobia
Telangana Vidyavanthula Vedika - North America
Indian American Muslim Council (IAMC)
The Humanism Project (Australia)
Indian Alliance Paris (IAP)
South Asian Diaspora Action Collective (SADAC)
Institute for Policy Studies Climate Policy Program, USA
Boston South Asian Coalition (BSAC)
CERAS - Centre sur l'Asie du Sud/South Asia Forum
Progressive Students' Group – South Asian University
ROT Collective (UK)
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Jubilé de la Cedeao. Un anniversaire dans la tempête

Le 28 mai, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a fêté son cinquantième anniversaire dans un contexte régional et international profondément instable, marqué par des mutations géopolitiques et des recompositions d'alliances. Pour l'organisation, qui a souvent été pionnière en matière d'intégration, ce jubilé est synonyme de remise en question aussi urgente que profonde.
Tiré d'Afrique XXI.
La crise de confiance à l'égard de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao), comme à l'égard d'autres institutions régionales, n'est pas un phénomène isolé. Elle s'inscrit dans un paysage de reconfiguration plus large de l'ordre international, qui voit les partenariats extérieurs se multiplier et se diversifier sur le continent africain. La Chine, la Russie, la Turquie, l'Union européenne (UE) ou encore les États-Unis proposent des modèles d'engagement aux logiques concurrentes et au service de leurs intérêts qui ont progressivement fragmenté l'espace ouest-africain. L'intensification des violences liées aux groupes armés djihadistes, la résurgence des coups d'État militaires, la montée du sentiment anti-interventionniste et les pressions économiques ont également contribué à fragiliser la capacité de la Cedeao à promouvoir un modèle de cohésion régionale.
Dans un contexte de réaffirmation de la souveraineté nationale et d'une quête de reconnaissance internationale, la diversification des partenariats est, certes, source d'opportunités. Elle rend cependant plus complexe encore la construction d'un projet régional commun dans la durée. Déjà fragilisée par des tensions internes et des difficultés à faire respecter ses normes, l'organisation a été prise de court. Elle n'a pas su répondre efficacement aux frustrations des citoyens ouest-africains que les juntes militaires au pouvoir au Mali, au Niger et au Burkina Faso ont su, elles, exploiter.
Le retrait coordonné de la Cedeao de ces trois pays, effectif depuis le 29 janvier, constitue pour l'institution un tournant historique. Pour la première fois, trois États membres fondateurs se retirent en même temps, dénonçant publiquement une organisation déconnectée des aspirations populaires et de leurs priorités sécuritaires. Ce départ retentissant met en lumière les tensions qui traversent la Cedeao depuis plusieurs années. Conçue autour d'un ambitieux projet d'intégration économique et politique, l'organisation peine aujourd'hui à faire l'unanimité parmi ses membres. Les critiques récurrentes sur son fonctionnement – jugé trop intergouvernemental, peu inclusif et instrumentalisé par certains chefs d'État – vont jusqu'à menacer sa légitimité.
Plus d'une décennie de débats
Cinquante ans après sa création, cette crise politique peut aussi devenir une chance. Le temps du bilan est arrivé : que reste-t-il du projet fondateur d'intégration ? Quels acquis préserver ? Et, surtout, quelles orientations nouvelles impulser pour restaurer la confiance, redéfinir les priorités et adapter les outils institutionnels aux nouvelles réalités ? Ce tournant historique exige des choix ambitieux et difficiles. La capacité de l'organisation à se réinventer sera déterminante tant pour sa propre survie que pour l'avenir du modèle de coopération régionale qu'elle incarnait en Afrique de l'Ouest.
L'émergence de la Cedeao n'a pas été le fruit d'une inspiration soudaine, ni l'œuvre d'un individu, d'un État ou d'un groupe d'États. Elle est plutôt le produit de plus d'une décennie de débats patients et de discussions continues, dans lesquels chaque État et chaque dirigeant de la région ont été, à un moment ou à un autre, plus ou moins étroitement impliqués.
Après une première tentative avortée, pilotée par le président libérien William Tubman en 1965, il faut attendre la fin de la guerre du Biafra, en 1970, pour que les chefs d'État du Nigeria (le général Yakubu Gowon), du Togo (le général Gnassingbé Eyadéma) et du Bénin (le général Mathieu Kérékou) relancent activement l'idée d'une communauté économique sous-régionale, en avril 1972. Le Togo y voit un intérêt stratégique : tirer parti de sa position géographique entre le Ghana et le Nigeria et promouvoir la stabilité régionale comme condition préalable à un commerce entre États. L'exemple du Togo rappelle que la personnalité des dirigeants ouest-africains a toujours été un facteur déterminant dans la transformation de l'organisation.
Le fruit d'un contexte régional et international
La Cedeao voit le jour le 28 mai 1975 à Lagos, au Nigeria, avec pour objectif de « promouvoir la coopération et le développement dans tous les domaines de l'activité économique […] dans le but d'élever le niveau de vie de ses peuples, d'accroître et de maintenir la stabilité économique, de renforcer les relations entre ses membres et de contribuer au progrès et au développement du continent africain ». Ce qui ressort clairement de la liste des seize États membres, c'est que la Cedeao réunit une grande diversité de pays, tant en termes de puissance économique et militaire que de régimes politiques. Cette hétérogénéité a toujours façonné les dynamiques internes de l'organisation.
Ses valeurs fondatrices sont le panafricanisme et le non-alignement, qui reflètent la volonté des États ouest-africains de s'autodéterminer régionalement et de se préserver de l'emprise des grandes puissances extérieures. À l'époque, l'influence de la Communauté économique européenne (CEE) sur la Cedeao est indirecte et elle se manifeste principalement par la reconnaissance de la pertinence du modèle et de l'expérience européens.
La région ouest-africaine possède une longue tradition de coopération, sous des formes variées, dont certaines remontent à la période coloniale. Les premiers modèles d'institutions régionales africaines orientées vers le développement économique ont vu le jour à la fin des années 1950. C'est le cas de plusieurs organisations regroupant d'anciens territoires colonisés par la France comme le Conseil de l'entente, créé en 1959 et toujours en activité sous la direction de la Côte d'Ivoire, la Fédération du Mali, née la même année et rapidement dissoute, en 1960, ou encore l'Union douanière de l'Afrique de l'Ouest, remplacée par l'Union douanière et économique de l'Afrique de l'Ouest en 1966, puis par la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest en 1972.
Un foisonnement propice au « Forum shopping »
En 2006, la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique1 répertoriait près de trente organisations régionales coexistantes en Afrique de l'Ouest. Face à cette galaxie d'institutions aux mandats parfois redondants, elle appelle à une rationalisation, c'est-à-dire à une meilleure coordination, voire à la fusion de certaines structures pour gagner en efficacité et en lisibilité. En 2013, un premier pas est franchi avec la signature de l'accord établissant le Cadre de consultation, de coopération et de partenariat entre les organisations intergouvernementales d'Afrique de l'Ouest. Mais il est insuffisant. La rationalisation institutionnelle reste un chantier inachevé reflétant les contradictions persistantes entre ambitions d'intégration régionale et opportunisme national.
Cette multi-appartenance, bien que témoignant d'un fort intérêt des acteurs politiques pour la coopération régionale, a surtout donné lieu à une pratique dite de « Forum shopping » permettant aux États de s'investir, parmi une multitude d'organisations dont ils sont membres, dans celles qui répond le mieux à leurs intérêts du moment. C'est ce qu'a démontré, par exemple, le recours à la Commission du bassin du lac Tchad pour déployer la Force multinationale mixte de lutte contre Boko Haram. De même, le Burkina Faso et le Niger, deux des trois pays ayant quitté la Cedeao, sont membres de plus de huit organisations intergouvernementales en Afrique de l'Ouest2.
Cette pluralité d'appartenances offre aux États une marge de manœuvre diplomatique non négligeable : elle leur permet de réorienter leur coopération régionale vers d'autres cadres institutionnels plus flexibles, moins contraignants politiquement ou davantage alignés sur leurs intérêts stratégiques du moment, tout en maintenant une présence dans les dynamiques régionales. Cependant, ce foisonnement a surtout engendré un imbroglio institutionnel, caractérisé par des chevauchements de mandats, une dispersion et un gaspillage des ressources humaines et financières aboutissant à une inefficacité opérationnelle encore observable aujourd'hui.
Un cadre de référence en Afrique
Dans ses premières années, jusqu'en 1990, la Cedeao se concentre principalement sur l'intégration économique. Elle est la première organisation du continent à mettre en œuvre la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux, avec la signature du Protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement en 1979. En pleine guerre froide, le Protocole de non-agression de 1978 et le Protocole relatif à l'assistance en matière de défense de 1981 sont les deux premiers instruments sans lien avec le développement économique. Ils visent à protéger les États membres contre toute déstabilisation émanant d'un autre État. Le Protocole de 1981 prévoit d'ailleurs la mise en place des Forces armées alliées de la Communauté, avant-goût de l'actuelle Force en attente (FAC). Mais ces deux protocoles n'ont jamais été mis en œuvre, et il faut attendre les années 1990 pour qu'un virage vers la coopération sécuritaire s'opère.
Dans ces années-là, les réformes politiques de l'organisation sont influencées par l'évolution du contexte international marqué par l'essor de l'ordre libéral démocratique. Alors même que la plupart de ses États membres sont encore gouvernés par des régimes militaires, la Cedeao s'aligne progressivement sur les nouvelles exigences de gouvernance démocratique. En 1991, les chefs d'État et de gouvernement adoptent la Déclaration de principes politiques, qui affirme leur adhésion aux principes de la démocratie, des droits de l'homme et de l'État de droit. Cette reconnaissance au plus haut niveau institutionnel permet d'inscrire ces principes à l'agenda de l'organisation.
Cette période est aussi marquée par le glissement progressif d'un agenda purement économique vers un rôle accru dans les domaines politique et sécuritaire. L'idée sous-jacente est que la promotion de la bonne gouvernance et des principes démocratiques dans les États membres favorisera un environnement politique stable et prévisible permettant d'attirer les investissements directs étrangers et de stimuler la croissance économique régionale. Le lien sécurité-développement est énoncé pour la première fois en 1993 dans le traité révisé. L'inclusion des conflits intraétatiques dans le champ d'action de la Cedeao accroît significativement son autorité supranationale.
Premières immixtions dans des conflits armés
Durant cette période, l'organisation joue un rôle central dans la gestion des conflits armés au Liberia (1990-1997), en Sierra Leone (1997-2000) et en Guinée-Bissau (1998-2008). Les interventions de l'Ecowas3 Monitoring Group (Ecomog) constituent un moment charnière dans la gestion du maintien de la paix par les organisations régionales africaines. Ces opérations relancent un débat ancien, porté dès 1963 par Kwame Nkrumah, sur la nécessité d'une capacité continentale de réponse aux crises. Si l'Ecomog a permis de limiter l'ampleur de certaines catastrophes humanitaires, le bilan de ses interventions reste cependant contrasté, en raison d'un manque d'expérience militaire, de lacunes logistiques, d'une coordination insuffisante entre les États contributeurs et entre les structures de commandement ainsi que d'une volonté politique limitée4. S'y ajoutent des faiblesses institutionnelles, un flou sur le rôle même de l'Ecomog et des accusations de corruption ou d'ingérence.
Tirant les leçons, la Cedeao abandonne progressivement le principe de non-ingérence tant débattu au moment de l'intervention au Liberia5. Cette orientation est consolidée en 1999 par l'adoption du Mécanisme pour la prévention, la gestion, la résolution des conflits, le maintien de la paix et la sécurité. Il confère notamment au président de la Commission le pouvoir d'intervenir rapidement en cas de crise, sans attendre l'approbation préalable des chefs d'État. Mais l'exercice de ce pouvoir reste limité par un processus complexe qui implique l'adoption d'un mandat juridique, des manœuvres diplomatiques et le soutien (ou l'absence de soutien) des États membres.
Ces évolutions montrent comment la Commission de la Cedeao s'est progressivement engagée dans la promotion de la démocratie et dans la lutte contre des menaces sécuritaires de plus en plus diverses. Elle a ainsi tenté de faire évoluer une vision centrée sur la réponse militaire vers un horizon plus large, dit de sécurité humaine, prenant en compte les vulnérabilités politiques, économiques, sociales, sanitaires, agricoles et environnementales des populations. Toutefois, cette ambition s'est heurtée à la persistance d'une visée centrée sur la sécurité des États, dominante depuis les années 1990. La montée de l'insécurité en Afrique de l'Ouest, notamment dans les pays du Sahel, démontre les limites d'une approche principalement militaire6 et constitue un tournant dans l'histoire récente de la Cedeao.
Approfondir l'intégration pour affronter les nouveaux défis
Depuis les années 2000, l'organisation a continué d'approfondir l'intégration régionale tout en répondant à des défis contemporains de plus en plus complexes. La création de l'Architecture africaine de paix et de sécurité (APSA) en 2002 par l'Union africaine (UA), dont la Cedeao est l'un des piliers, a renforcé la priorité accordée aux questions de sécurité, parfois au détriment du projet d'intégration économique initial.
Consciente du lien étroit entre gouvernance et instabilité, l'organisation adopte en 2001 le Protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance réaffirmant que les carences en matière démocratique figurent parmi les causes profondes des conflits dans la région. Elle est une nouvelle fois pionnière en matière de prévention des conflits avec la création du mécanisme d'alerte précoce plus connu sous l'acronyme anglais Ecowarn (Ecowas Early Warning and Response Network). Ce dispositif permet à l'organisation de surveiller en permanence l'état de la sécurité humaine dans la région grâce à 77 points focaux issus de la société civile, répartis dans les quinze pays (cinq par pays et sept pour le Nigeria). Le réseau est coordonné par un représentant national du Réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, ou Wanep (West Africa Network for Peacebuilding). Les observateurs nationaux collectent chaque semaine des données locales et les soumettent à la direction de l'alerte précoce, située au siège de la Cedeao, à Abuja. Cette direction surveille, collecte, contrôle et analyse ces données afin de fournir des recommandations aux différentes parties prenantes de la Commission.
En 2014, la Cedeao décide de décentraliser ce dispositif. L'objectif est de privilégier les actions aux niveaux national, départemental et communautaire et de faire en sorte que l'organisation n'intervienne qu'en dernier ressort. En 2017, la décentralisation démarre avec l'ouverture à Bamako du premier centre national de coordination du mécanisme d'alerte précoce et de réponse. Le processus s'est poursuivi, et, en juin 2025, tous les États membres disposaient d'un centre, à l'exception du Bénin, du Cap-Vert, du Sénégal et du Togo.
Les États membres maîtres de l'agenda
À ce jour, la Cedeao repose sur une architecture institutionnelle complexe combinant des organes politiques et techniques. Cette configuration peu lisible de l'extérieur rend son fonctionnement difficile à appréhender, notamment pour les partenaires internationaux, les observateurs et les citoyens ouest-africains eux-mêmes. En 2007, le Secrétariat exécutif de la Cedeao est transformé en Commission afin de lui donner plus de moyens pour agir. La Commission joue un rôle central de coordination entre cinq institutions régionales (Parlement, Cour de justice, Groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest-Giaba, Organisation ouest-africaine de la santé, Banque d'investissement et de développement de la Cedeao) et quatorze agences spécialisées traitant de domaines aussi variés que la monnaie, l'agriculture, l'énergie, le genre ou la jeunesse.
Si la coopération économique et sécuritaire est son activité la plus connue et la plus visible, la Cedeao ne s'y réduit pas. Malgré des avancées majeures dans les interventions régionales, à l'image de la Gambie en 2017 sous le leadership du Sénégal7, elle reste critiquée pour les irrégularités et le caractère ad hoc de ses processus de prise de décision. L'opportunisme à court terme de ses États membres s'est traduit par la formation de coalitions ad hoc, comme le G5 Sahel en 2014 ou l'Initiative d'Accra en 2017. Ces initiatives militaires portées par des États ont relégué au second plan les efforts au profit d'une planification stratégique engagés en 2004 avec le projet de force en attente.
La Commission est un acteur majeur dans l'élaboration des politiques dans les divers domaines qu'elle tente de coordonner8. Toutefois, malgré son étroite collaboration avec les États membres, ces derniers restent les principaux responsables de l'élaboration de l'agenda. Ce phénomène est particulièrement perceptible dans le domaine de la prévention des conflits. Bien que la Commission ait développé un arsenal d'outils dédiés, dont Ecowarn, les dirigeants ouest-africains privilégient généralement une approche réactive face aux crises ouvertes plutôt que proactive en négligeant les signaux et les indicateurs d'alerte.
Autonomie financière et dépendance externe
Afin de se donner les moyens de l'autonomie financière, les États membres lancent le prélèvement communautaire, mécanisme unique en Afrique. Mis en place sous la forme d'une taxe de 0,5 % appliquée sur les importations en provenance de pays non membres, ce prélèvement constitue une source importante de revenus qui permet de financer entre 70 et 90 % du budget opérationnel annuel de l'organisation9. Mais malgré l'instauration de ce prélèvement communautaire, présenté comme un instrument de souveraineté financière, les appels répétés à la régularisation des contributions des États membres laissent entrevoir des manquements fréquents et des retards de paiement qui fragilisent la stabilité budgétaire de l'institution.
Dans les faits, de nombreux projets stratégiques, notamment dans les domaines de la paix et de la sécurité, des infrastructures ou du développement sectoriel (agriculture, climat, santé), restent fortement dépendants de financements extérieurs. L'Union européenne, la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, ainsi que des partenaires bilatéraux comme la France ou l'Allemagne jouent un rôle central en matière de financement, d'appui technique et de coordination des projets de la Cedeao. Le Fonds pour la paix, destiné à financer les opérations de soutien à la paix régulières ou exceptionnelles, illustre bien cette hybridation. Alimenté par le prélèvement communautaire, il bénéficie également de contributions volontaires des États membres et du soutien d'une multitude de bailleurs de fonds internationaux tels que les Nations unies, le Japon ou la Chine.
Cette configuration soulève des tensions structurelles. D'un côté, l'organisation peut se prévaloir, mieux que d'autres sur le continent, d'une relative autonomie budgétaire dans le financement de ses coûts de fonctionnement grâce à son système communautaire, mais, de l'autre, elle reste fortement tributaire de l'aide internationale, notamment pour ses missions les plus visibles et politiquement sensibles.
Les défis des conflits transfrontaliers
Tout comme les guerres civiles dans l'Union du fleuve Mano dans les années 1990, la crise du Sahel, qui éclate au Mali en 2012, et ses effets de débordement dans les États côtiers ont constitué un test pour la capacité de la Cedeao à prévenir et à gérer les conflits.
Les opérations de la force Ecomog, dès le début des années 1990, ont démontré sa capacité à s'engager rapidement. Dans un contexte de fin de guerre froide, la force s'inscrit dans une tendance croissante vers une « appropriation » locale de la gestion des conflits permettant une réponse plus contextualisée et plus légitime. La Cedeao est en mesure de déployer des contingents de ses pays membres dans les zones de conflits plus rapidement et à moindre coût que les missions de maintien de la paix qui prennent le relais. À partir de 2004, le projet de Force en attente accélère l'interopérabilité entre les forces de sécurité nationales.
Mais malgré ces avancées, l'organisation fait face à des capacités opérationnelles et expéditionnaires limitées qui la rendent fortement dépendante du soutien logistique et financier de bailleurs de fonds extérieurs. Les niveaux de formation et d'équipement varient considérablement d'un État membre à l'autre, ce qui nuit à l'efficacité et à l'harmonisation des interventions. Par ailleurs, une forme de concurrence institutionnelle entre l'UA et la Cedeao dans le déploiement des troupes complique parfois la coordination des efforts. Enfin, le modèle d'opérations de paix dirigées par des acteurs africains reste inadapté pour répondre pleinement aux menaces terroristes croissantes dans la région, du fait de moyens logistiques limités, d'un manque de coordination opérationnelle et de mandats souvent trop restrictifs.
La lutte contre le terrorisme, une rupture dans l'agenda
À partir des années 2010, et plus précisément après la crise sécuritaire au Mali et ses développements, la Cedeao se voit reléguée à un rôle secondaire dans la lutte contre le terrorisme. Le sentiment général est que ses outils ne sont ni pleinement fonctionnels ni effectivement mis en œuvre. En 2013, les États membres définissent une politique commune et adoptent une stratégie en matière de lutte contre le terrorisme. En 2014, une stratégie Sahel voit le jour, intitulée Programme de cohérence et d'actions régionales pour la stabilité et le développement des zones sahariennes-sahéliennes (PCAR). Mais aucune de ces deux stratégies ne sera réellement opérationnalisée.
Le PCAR, en particulier, ne verra pas le jour, faute d'adéquation entre les ambitions affichées et les moyens financiers mobilisés. Son intérêt résidait pourtant dans la volonté de proposer un cadre d'action ouest-africain cohérent, capable de coordonner des organisations jusque-là actives de manière fragmentée ou dans des formats ad hoc. À l'inverse, les stratégies développées par d'autres acteurs, tels que l'Union européenne, les Nations unies ou la Banque africaine de développement, mieux dotés en ressources humaines, financières et politiques, se révèlent plus attractives10.
En 2019, les chefs d'état-major des armées de la Cedeao, les chefs des services de sécurité et les chefs des services de renseignements identifient plusieurs obstacles majeurs à la mise en œuvre de la Stratégie de lutte contre le terrorisme de l'organisation : un faible engagement des États membres, des retards dans l'adoption et la mise en œuvre des mesures de prévention imaginées, un faible niveau de partage du renseignement entre les États ainsi qu'une implication insuffisante des acteurs de la société civile dans les efforts de prévention.
Un manque de moyens et de souveraineté
Un autre argument voit dans l'intergouvernementalisme excessif de la Cedeao, son talon d'Achille depuis sa création, l'un des principaux freins à son fonctionnement efficace. Ce caractère intergouvernemental transparaît dans le pouvoir exercé avant tout par la Conférence des chefs d'État, organe politique où prime la défense des intérêts nationaux sur les objectifs d'intégration régionale. La réputation de la Commission de la Cedeao en matière de défense de la démocratie a ainsi été mise à mal lorsque certains dirigeants se sont opposés à la révision du Protocole de 2001 visant à limiter les mandats présidentiels ou lorsque l'organisation a adopté une position ambivalente face aux modifications constitutionnelles en Côte d'Ivoire ou au Togo11
En outre, la force en attente a été délaissée au profit d'une coopération militaire régionale qui apparaît de plus en plus comme un sous-produit de la sécurité des régimes. Paradoxe de l'histoire, l'Ecomog a toujours été citée comme un exemple de première coalition ad hoc ayant permis à la Cedeao de construire sa crédibilité et sa légitimité en matière sécuritaire. Deux décennies plus tard, la crise au Sahel a remis à l'ordre du jour les coalitions ad hoc : le G5 Sahel, l'Initiative d'Accra et la Force multinationale mixte ont réuni des États confrontés à un problème de sécurité commun, notamment à leurs frontières. Ces formats souples permettent un déploiement rapide dans un cadre qui respecte davantage la souveraineté nationale tout en offrant des ressources ciblées et une forme de légitimité politique. Si ces coalitions ont parfois montré leurs limites en matière de durabilité et d'efficacité, leur montée en puissance témoigne néanmoins d'une perte de confiance dans les mécanismes classiques de la Cedeao, perçus comme trop rigides ou obsolètes, notamment sa Force en attente, rarement mobilisée.
Enfin, la dépendance financière de la Commission et des États membres pour la mise en œuvre des projets et des déploiements régionaux s'est accompagnée d'une influence politique extérieure qui a progressivement affecté la souveraineté régionale, voire brouillé les priorités stratégiques au profit des agendas des bailleurs de fonds. Cette même dépendance a fait l'objet de critiques récurrentes sur l'interférence extérieure dans les affaires économiques et politiques des États membres, notamment dans des contextes de fragilité ou de transition. La création du G5 Sahel continue d'être perçue comme une initiative portée à bout de bras par les pays européens tout en étant concurrente – ou du moins parallèle – des efforts de sécurité de la Cedeao. Bien que les partenaires extérieurs affirment laisser la direction politique et stratégique aux acteurs de la région, l'impression demeure que leurs décisions orientent l'agenda au détriment du rôle africain.
Et les peuples dans tout ça ?
Adoptée en 2007, la « Vision 2020 » de la Cedeao marque une volonté claire de transformation : passer d'une « Cedeao des États » à une « Cedeao des peuples ». La « Vision 2050 » de la Cedeao réaffirme cette ambition avec pour objectif de renforcer l'intégration régionale tout en répondant aux défis émergents, en misant sur un développement durable, inclusif et participatif. Or, malgré un cadre normatif ambitieux et une visée progressiste, la construction d'une véritable Cedeao des peuples se heurte à des résistances étatiques, à une faiblesse des leviers institutionnels et à une distance encore marquée entre l'organisation et ses citoyens.
Certes, la Commission peut se prévaloir de sa proximité avec les organisations de la société civile ouest-africaine. En 2004, elle a signé un partenariat avec le West Africa Network for Peacebuilding (Wanep), qui fait partie intégrante de son dispositif d'alerte précoce. Cependant, l'implication active des citoyens et des organisations de la société civile dans les processus décisionnels demeure marginale, et les espaces de dialogue restent réduits, à l'image de la liberté d'expression dans certains États membres.
Pour renforcer sa légitimité, la Cedeao doit prioriser une communication concrète et une gouvernance participative. Actuellement, de nombreux citoyens ouest-africains ignorent les missions et les bénéfices tangibles de l'organisation, ce qui suscite indifférence et méfiance. Par exemple, peu de commerçants comprennent que la libre circulation des biens permise par la Cedeao influe directement sur leurs revenus ou que la carte d'identité biométrique facilite leurs déplacements transfrontaliers. La Cedeao est souvent perçue comme une entité technocratique ou un « club de chefs d'État » éloignés des réalités quotidiennes. Une transformation est donc cruciale pour replacer les populations au cœur du projet d'intégration.
Les reproches des citoyens
Au-delà des discours, la Cedeao manque encore de ressources humaines et financières pour assurer un suivi rigoureux dans la mise en application des décisions, y compris lorsqu'il s'agit de rappeler à l'ordre les États membres qui ne les respectent pas. Les nombreux protocoles sur la libre circulation, la gouvernance ou l'intégration économique restent d'application inégale, et leurs manquements ont rarement été sanctionnés. Cette lacune se traduit concrètement sur le terrain. Par exemple, les citoyens se heurtent encore fréquemment à des tracasseries administratives ou à des contrôles abusifs aux frontières, même lorsqu'ils possèdent la carte d'identité biométrique de la Cedeao. Ce décalage entre les engagements régionaux et la réalité nationale affaiblit la crédibilité de l'organisation et nourrit la frustration. Dans les années à venir, l'une des priorités devrait être de recentrer les efforts sur un bilan honnête des actions entreprises et de renforcer les mécanismes de suivi et de redevabilité, afin que les décisions soient réellement adaptées et appliquées.
Enfin, la Commission et ses agences spécialisées doivent impérativement corriger l'inégalité dans la répartition des bénéfices de l'intégration régionale. Les populations de plusieurs pays riches en ressources naturelles, comme le Mali (or) ou le Nigeria (pétrole), dénoncent leur exclusion des retombées économiques, voyant souvent la richesse se concentrer entre les mains de quelques élites. Le désenchantement et le rejet de la gouvernance se sont manifestés à travers des mouvements citoyens comme Y'en a marre au Sénégal ou Le Balai citoyen au Burkina Faso. Cette frustration a nourri un scepticisme croissant à l'égard de la Cedeao et de son action au service des peuples. Pour renforcer un sentiment d'appartenance régionale, l'organisation doit concentrer ses efforts sur la visibilité des politiques de redistribution et développer la communication sur les bénéfices concrets de l'intégration, notamment dans les zones transfrontalières.
La crise actuelle de la Cedeao intervient dans un contexte mondial marqué par une remise en question du multilatéralisme, fragilisé tant par le repli souverainiste de certains États que par les limites de la coopération internationale face à des crises complexes (pandémies, guerres, reconfiguration des alliances stratégiques, etc.). Dans cet environnement incertain, les organisations régionales devraient jouer un rôle crucial de stabilisation et de projection collective. Or la paralysie partielle de la Cedeao fragilise cette posture, alors même que l'Afrique de l'Ouest fait face à des défis multiples : insécurité, inégalités croissantes, transitions politiques contestées, pression démographique et vulnérabilité aux chocs extérieurs.
Ne pas « casser la calebasse »
Pour les pays membres, les enjeux d'intégration vont bien au-delà du seul cadre institutionnel, la Cedeao offrant des leviers essentiels pour faciliter les échanges, harmoniser les politiques économiques, attirer les investissements et promouvoir des projets structurants à l'échelle régionale. Dans un espace où la majorité des pays sont enclavés et dépendants de corridors transfrontaliers, en particulier les trois pays qui viennent d'en claquer la porte, l'absence de coordination régionale freinera encore davantage la croissance et l'inclusion économique. La désintégration partielle de la Cedeao pourrait ainsi compromettre les objectifs de réduction de la pauvreté et d'émergence économique en ralentissant les dynamiques de marché commun, de mobilité et de mutualisation des ressources.
Consciente de ces risques, l'organisation a récemment adopté une posture plus conciliante à l'égard des membres de l'Alliance des États du Sahel en laissant ouverte la porte du dialogue. Le maintien de la libre circulation des personnes est vital, et les deux organisations n'ignorent pas leur interdépendance économique et sociale profonde. Malgré les tensions politiques actuelles, la Cedeao souhaite montrer l'importance de préserver l'esprit de solidarité communautaire.
Il en va donc de l'avenir collectif des sociétés ouest-africaines de repenser leur intégration en conjuguant souveraineté nationale et coopération régionale au service du développement humain. La survie et la pertinence de la Cedeao dépendront de sa capacité à se réformer, à entendre les voix discordantes et à faire évoluer ses instruments vers plus de flexibilité, de légitimité et d'impact pour les populations.

Une vaste purge militaire au Mali

La situation au Mali est particulièrement tendue, marquée par une série d'arrestations qui secouent l'armée et le pouvoir en place. Sur fond d'une situation économique catastrophique et d'accusations contre les services français dont un agent aurait été arrèté.
Tiré d'Afrique en lutte.
Des arrestations massives ont eu lieu à Bamako : Entre 36 et 40 militaires et hauts gradés ont été arrêtés ces derniers jours, dont des figures respectées comme le général Abass Dembélé et la générale Nema Sagara. Les motifs officiels sont flous. Un communiqué officiel a confirmé les arrestations « pour tentative de déstabilisation ». En coulisse, il s'agirait de neutraliser toute contestation interne à la junte.
Une certitude, l'atmosphère est tendue au Mali. Des témoignages évoquent des cris dans les sous-sols de la DGSE malienne, assimilée à une police politique au service du régime.
La France visée
Lors d'une précédente purge en mai 2022, le gouvernement malien avait évoqué le soutien d'un “État occidental” aux putschistes, sans le nommer. Beaucoup ont vu une allusion à la France. La DGSE française est visée par le pouvoir malien. Un agent nommé “Yann” est cité. La junte semble plutôt mener une opération de consolidation du pouvoir, sous couvert de sécurité nationale.
Depuis le coup d'État militaire du 18 août 2020, la République du Mali semble avoir substitué à la quête de justice et de démocratie un dogme du développement vitrifié : construire des routes, ériger des ponts, découper des rubans — tout en muselant la société civile et en détournant les règles les plus élémentaires de la commande publique.
Dans une tribune incisive publiée en juillet 2025, explique le chroniqueur et expert Mohamed AG Ahmedou, l'analyste malien Sambou Sissoko dresse un tableau implacable d'un État devenu le théâtre d'un “hold-up infrastructurel” orchestré au profit d'un cartel d'entreprises aux accointances opaques. COVEC, EGK, EGMK, ATTM : ces noms reviennent avec une régularité métronomique dans les décrets ministériels, les annonces du gouvernement de transition, et les rares contrats consultables. Des noms que l'on croirait sortis d'un roman dystopique, et pourtant, ce sont les véritables bénéficiaires d'un Mali livré à une économie politique de la prédation.
Les propos de Sissoko, que certains dans la capitale accusent d'« exagération idéologique », trouvent pourtant un écho bien réel dans les rues de Kayes, dans les cercles de Tombouctou, et jusque dans les villages délaissés du Gourma. À Gossi, Issa AG Alhassane, enseignant à la retraite, soupire : « Ils parlent de routes, mais moi je vois des promesses. Des chantiers qui commencent et ne finissent jamais. Et quand c'est fini, la saison des pluies emporte tout. »
Même constat à Sévaré, où Aïcha, commerçante, rit jaune en évoquant les 32,6 milliards de francs CFA alloués à la route Sévaré-Mopti :
« Ils ont goudronné le centre-ville pour les caméras, mais les camions dégradent le peu de route praticable dès la sortie. On sait tous que c'est du théâtre. »
La fabrique du consentement autoritaire
« Les chantiers d'infrastructures, note Mohamed AG Ahmedou sur son site, sont devenus les piliers d'une gouvernance autoritaire, qui instrumentalise le développement pour consolider le pouvoir. L'autoritarisme malien ne se contente plus de menacer les journalistes ou de dissoudre les partis politiques. Il s'habille désormais d'enrobé bitumineux ».
La procédure dite « d'entente directe », mentionnée à de multiples reprises dans les décisions gouvernementales, est systématiquement utilisée pour contourner les appels d'offres ouverts. La législation de l'UEMOA est pourtant claire : sauf urgence avérée, la concurrence est la règle. Mais depuis 2020, aucun audit de la Cour des comptes n'a été publié. Le silence administratif est devenu l'allié le plus fidèle de la captation. Ces projets, sans exception , ont été confiés à des entreprises proches du pouvoir, souvent sans publication des résultats d'attribution, sans justification technique, sans contrôle parlementaire.
« La commande publique est devenue une affaire privée. » Sissoko
Dans les régions nord du pays, cette centralisation économique attise une frustration croissante. Un conseiller municipal d'Anefis confie, sous anonymat : « Le Nord est exclu des décisions économiques, sauf quand il s'agit de sécuriser les convois d'approvisionnement. Aucune route ne sort de chez nous, sauf pour aller vers les mines. »
Une diplomatie du béton
Le COVEC, bras armé économique de Pékin, est emblématique de cette diplomatie du bitume. Là où la Banque mondiale ou la BAD exigent des contreparties en matière de gouvernance et de traçabilité, la Chine se contente de résultats visibles — peu importe la manière.
À Bamako, le nouveau contournement RR9 trône comme un symbole de modernité. Mais aucun rapport n'en détaille les surcoûts, ni l'état d'avancement réel.
« La route n'est pas un bien neutre. C'est un choix politique », commente Youssouf Ag Rhissa, chercheur en développement basé à Niamey.

Deux ans après le coup d’Etat, le Niger à la dérive

Le 26 juillet 2023, le Niger basculait brutalement dans l'incertitude politique. Le président élu Mohamed Bazoum était évincé par un coup d'État militaire, dont les zones d'ombre demeurent, deux ans plus tard, toujours aussi épaisses. Derrière ce putsch, certains voient la main de l'ancien président Mahamadou Issoufou, évoquant un jeu d'alliances et de rivalités internes mal maîtrisé. Une hypothèse qui alimente les tensions au sein même du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), tiraillé entre courants divergents et ambitions contradictoires.
Tiré de MondAfrique.
Deux années se sont écoulées. Et pourtant, la promesse d'une transition structurée, capable d'ouvrir une nouvelle ère politique, semble aujourd'hui dissoute dans un discours souverainiste souvent excessif et parfois contreproductif. Loin d'un processus ordonné de refondation, le pays évolue dans une zone grise institutionnelle, sans cap clair, sans échéancier crédible, sans projet cohérent.
Une transition sous tension
Le CNSP, organe militaire s'étant emparé du pouvoir, est rapidement passé du langage de la rupture à celui de la rente politique. Le discours patriotique, teinté d'une rhétorique de rupture avec l'ordre ancien et les puissances étrangères, a servi de paravent à une gestion du pouvoir marquée par le repli, l'improvisation, et la personnalisation de la décision. Le pays s'est progressivement isolé de ses voisins et de ses partenaires traditionnels, rompant des alliances sans en bâtir de nouvelles réellement viables.
À l'interne, la machine de la refondation tourne à vide. Les institutions transitoires attendues, garantes d'un retour à l'ordre constitutionnel, tardent à voir le jour. Le Conseil consultatif de transition (CCR), présenté comme l'organe de dialogue et de représentation nationale, s'est avéré n'être qu'un cénacle de partisans du régime, récompensés pour leur loyauté plus que pour leur légitimité. Sans réel pouvoir, son rôle reste flou, sa mission obscure, et sa pertinence contestée. L'utilité de ce Conseil est en effet loin d'être une évidence et se présente au contraire comme une anomalie institutionnelle budgétivore en décalage total avec les attentes d'un peuple en proie à de graves incertitudes.
Le projet AES : entre précipitation et opacité
L'adhésion hâtive du Niger à l'Alliance des États du Sahel (AES), aux côtés du Mali et du Burkina Faso, illustre les errements d'une diplomatie devenue trop idéologique. Ce projet d'intégration régionale, aussi ambitieux que mal préparé, aurait mérité un débat national, une concertation élargie, et une planification rigoureuse. Au lieu de cela, slogans et décisions à l'emporte-pièce ont pris le pas sur le pragmatisme nécessaire à une véritable refondation géopolitique. La mise en place d'une confédération, présentée comme un horizon stratégique, ne peut se faire sans l'adhésion explicite et informée de l'ensemble des populations concernées.
Par ailleurs, la création de cette alliance, autour de réalités propres aux trois pays membres, ne devrait pas se concevoir comme alternative à l'actuelle Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) qui devrait demeurer, à une autre échelle, le cadre sous régional d'intégration économique en cohérence avec les autres parties du continent.
Isolement régional, tensions internes
Sur la scène régionale, le Niger paie aujourd'hui le prix fort de ses ruptures intempestives. Les relations avec ses deux géants frontaliers, le Nigeria et l'Algérie, sont au plus bas. La fermeture prolongée de la frontière avec le Bénin constitue un contresens diplomatique et économique, dont les conséquences pèsent lourdement sur les circuits d'approvisionnement et les conditions de vie des Nigériens.
Le populisme qui entoure ces décisions masque difficilement l'absence de vision stratégique. Revendiquer la souveraineté ne saurait se faire au détriment de l'intérêt national. Or, le Niger semble évoluer dans une logique d'affrontement plutôt que de coopération, se coupant de leviers essentiels à sa stabilité et à son développement.
Le Niger devrait conserver son rôle de pôle de référence en matière de stabilité dans la sous-région. Ce marqueur de sagesse et de pragmatisme doit être préservé en dépit des vicissitudes politiques internes actuelles.
Une impasse politique et sécuritaire
Deux ans après le putsch, les Nigériens sont toujours dans l'attente d'un véritable projet politique. Les espoirs nés de la promesse d'une gouvernance vertueuse, débarrassée des travers du passé, clientélisme, corruption, exclusion, s'étiolent. Le pays donne l'image d'un pouvoir replié sur lui-même, sourd aux aspirations populaires, et prisonnier d'une logique de survie.
Malgré des promesses de lutte renforcée, le CNSP peine à inverser la tendance sécuritaire. Les régions comme Tillabéri, Tahoua ou Dosso échappent de plus en plus au contrôle de l'Etat, laissant la population à la merci d'exactions de toutes sortes.
La situation de Mohamed Bazoum, maintenu en détention depuis son renversement, cristallise cette impasse. Au-delà de la dimension humaine, c'est le respect du droit et des principes républicains qui est en jeu. Une sortie apaisée, respectueuse des fonctions qu'il a occupées, s'impose comme une nécessité politique et morale.
L'appel au sursaut
Le Niger est à la croisée des chemins. Dans un contexte régional et international de plus en plus instable, l'heure exige lucidité et à laresponsabilité. Le pays ne peut se permettre un naufrage politique prolongé, au risque d'aggraver les souffrances d'une population déjà éprouvée par l'insécurité et la crise économique. Un sursaut national s'impose, porté par les élites politiques, intellectuelles et sociales, pour remettre le Niger sur les rails d'un avenir possible.
Il est encore temps de sauver l'essentiel : la stabilité, la cohésion nationale, et la dignité d'un peuple en quête de justice, de sécurité et d'un État enfin au service du bien commun.

Comptes rendus de lecture du mardi 26 août 2025

Le mythe de la bonne guerre
Jacques R. Pauwels
Version originale en néerlandais
Il s'agit probablement du meilleur livre qu'il m'ait été donné de lire sur la Deuxième Guerre mondiale et ses suites. C'est un ouvrage fouillé qui déconstruit les nombreux mythes véhiculés depuis 1945 à travers le cinéma et la littérature états-uniennes sur les réalités de cette guerre contre l'Allemagne nazie. Comme le montre l'auteur, les États-Unis sont entrés en guerre sous la contrainte et leurs riches industriels ont fait des affaires avec le IIIe Reich le plus longtemps possible en prolongeant ainsi la guerre sans grande conscience morale. Ce sont en fait les Soviétiques qui ont affronté l'essentiel des troupes hitlériennes tout au long de la guerre, qui en ont le plus souffert avec environ 27 millions de morts, et qui nous ont finalement libérés des nazis. Vous en apprendrez même beaucoup plus. Un livre à lire absolument !
Extrait :
En ce qui concerne l'élite du pouvoir aux États-Unis, la Guerre Froide s'apparentait, ou du moins s'approchait, de la perfection, mais pas uniquement parce qu'elle était centrée sur l'ennemi « parfait ». La Guerre Froide se révéla merveilleuse, quelle que fut l'identité ou la nature de l'ennemi, tout simplement parce qu'il s'agissait d'une guerre et non de la paix. N'importe quel conflit contre n'importe quel ennemi se révélait être un cadeau du ciel car il permettait de maintenir les dépenses militaires à des niveaux élevés, soutenant ainsi le boom économique produit par la Deuxième Guerre mondiale. Grâce à ce nouveau conflit, l'industrie de l'armement pouvait continuer à fonctionner comme la dynamo keynésienne de l'économie américaine. De surcroît, la principale caractéristique de la Guerre Froide ― l'escalade sans fin de la « course aux armements » ― fournira une abondante source de profits aux grandes entreprises américaines. Et, comme le nouvel ennemi, l'Union soviétique, patrie du communisme, était le vrai ennemi idéologique ― ce que l'ancien ennemi nazi n'avait jamais été ―, la Guerre Froide offrit encore un avantage supplémentaire. Avec un tel ennemi, c'étaient non seulement les communistes américains, mais tous les partisans de changements radicaux, qui pouvaient être discrédités en tant que subversifs « non américains », en tant qu'agents de l'Union soviétique. La Guerre Froide servit à supprimer toute dissidence.
Peut-on voyager encore ?
Rodolphe Christin
J'avais beaucoup aimé le « Manuel de l'antitourisme » de Rodolphe Christin il y a plusieurs années. « Peut-on voyager encore ? » est d'une lecture moins agréable, plus difficile. C'est malheureux, parce qu'il traite de façon recherchée des effets délétères des grands voyages touristiques, mais aussi de bien d'autres incidences négatives du capitalisme sur l'environnement. Il gagnerait à être écrit avec plus de fluidité, mais il vaut tout de même grandement la peine d'être lu.
Extrait :
Face aux enjeux climatiques et sociaux, le système touristique ne devrait pas avoir d'avenir si l'on veut être conséquent et considérer les désastres en cours à la mesure de leur importance.
L'argent
Émile Zola
« L'argent » est le dix-huitième roman de la série des Rougon-Macquart dans l'ordre de rédaction, mais le quatrième dans l'ordre chronologique. On y retrouve de nouveau Aristide Saccard, sans scrupules, lui qui avait amassé une importante fortune dans le précédent roman « La curée ». Brouillé avec son frère, le ministre Eugène Rougon, il conserve toujours ses rêves de gloire. Il met ainsi sur pied une entité nébuleuse, la Banque Universelle, destinée à financer des travaux de grande envergure au Moyen-Orient. Il y attire dans ses filets en les trompant des petits épargnants en quête de profits faciles et rapides. Tout semble se dérouler sans obstacle, de mieux en mieux, alors qu'il gonfle artificiellement la valeur des actions… Le roman s'inspire des événements de l'époque. Des idées en cours aussi. J'ai bien aimé encore une fois.
Extrait :
Ah ! l'argent, cet argent pourrisseur, empoisonneur, qui desséchait les âmes, en chassait la bonté, la tendresse, l'amour des autres ! Lui seul était le grand coupable, l'entremetteur de toutes les cruautés et de toutes les saletés humaines. A cette minute, elle le maudissait, l'exécrait, dans la révolte indignée de sa noblesse et de sa droiture de femme. D'un geste, si elle en avait eu le pouvoir, elle aurait anéanti tout l'argent du monde comme on écraserait le mal d'un coup de talon, pour sauver la santé de la terre.
Du contrat social
Jean-Jacques Rousseau
Je viens de lire cet important essai qui repose dans ma bibliothèque depuis plusieurs dizaines d'années. C'est le texte le plus important sur le sujet qui nous provienne du siècle des Lumières. Selon Rousseau, la justice ne peut se définir comme le droit du plus fort ; s'il en était ainsi, les individus les plus puissants seraient donc toujours les plus justes. La justice consiste plutôt en l'harmonie entre les actes individuels et l'autorité civile. Et les individus ne sont d'ailleurs contraints à agir que si l'autorité est légitime... Pour se protéger, les personnes s'accordent sur une relation contractuelle par laquelle elles s'engagent à accepter diverses fonctions et obligations en échange des avantages de la coopération sociale. Un petit livre de moins de deux cents pages, mais une œuvre monumentale !
Extrait :
Je veux chercher si, dans l'ordre civil, il peut y avoir quelque règle d'administration légitime et sûre, en prenant les hommes tels qu'ils sont, et les lois telles qu'elles peuvent être. Je tâcherai d'allier toujours dans cette recherche ce que le droit permet avec ce que l'intérêt prescrit, afin que la justice et l'utilité ne se trouvent point divisées.

Sol Zanetti, candidat au porte-parolat de Québec solidaire

Le lien pour rejoindre sa campagne :
Sol Zanetti, candidat au porte-parolat de Québec solidaire
https://solzanetti.quebec/
QUI SUIS-JE ?
Né à Sainte-Foy d'un père venu d'Italie et d'une mère de Shawinigan, j'ai sillonné les rues de ma banlieue-bungalow classique et occupé les sous-sols style années 1970 du quartier jusqu'à mes 17 ans.
À 15 ans, j'ai lu le livre d'Albert Jacquard J'accuse l'économie triomphante ! et ma vision du monde a changé irréversiblement. Alimenté par un mythique prof d'histoire en secondaire 5, je me suis mis dans la tête qu'il fallait changer le monde au plus vite et que c'était possible. « Soyons réalistes, exigeons l'impossible », disait le Che ; la citation se trouvait sur le mur de ma chambre.
Entre 15 et 20 ans, je deviens indépendantiste. La lutte pour la liberté de notre peuple me touche au plus profond du cœur. Je me rends compte que cette quête de souveraineté est un enjeu universel. Je ne cesse depuis de prendre conscience de son importance, non seulement pour le peuple québécois, mais pour toutes les nations autochtones d'ici et d'ailleurs. Ensemble, dans la paix et l'amitié véritables, nous vaincrons, j'en suis convaincu.
« Il faut rester fidèle à ses rêves de jeunesse, car ils sont les seuls », disait Pierre Bourgault. Cette maxime est gravée en moi à jamais. Un jour, peut-être, je me la tatouerai quelque part, mais pas tout de suite.
Je pars ensuite étudier au Cégep de Lévis-Lauzon en sciences humaines et langues. J'ai pu constater dès les années 2000 que le problème de la mobilité interrives était vraiment dû au manque de transport collectif plutôt qu'à un manque de troisième lien à l'est.
J'ai voulu être journaliste, historien, sociologue, économiste ; je me suis retrouvé en philo.
Pendant mes études, je travaille comme préposé aux bénéficiaires dans un hôpital, principalement en géronto-psychiatrie. Pas facile. Je découvre que les préposées d'expérience ont souvent le même superpouvoir : ensoleiller les vies des personnes vulnérables, rester positives lorsque le crépuscule de la vie approche et que l'esprit s'étiole. Mon admiration envers elles est infinie.
Je travaille ensuite comme intervenant en santé mentale dans une clinique de traitement pour jeunes adultes aux prises avec la psychose. J'ai appris à écouter l'humain pour vrai. Merci infiniment à la communauté du 388.
Et là, je deviens prof de philosophie au Campus Notre-Dame-de-Foy. J'adore ça. J'enseigne à des futures pompières, policiers ou musiciennes, à des étudiants en mode, etc. J'apprends à vulgariser, à susciter le désir d'apprendre et de philosopher.
En 2012, j'ai 29 ans, bientôt 30, et c'est le soulèvement étudiant. Je m'implique dans les Profs contre la hausse et je commence mon implication politique. Je deviens candidat pour Option nationale, un parti indépendantiste de gauche naissant. Un an et demi plus tard, j'en deviens le chef jusqu'à sa fusion avec Québec solidaire en 2017.
Bien que je me sois toujours considéré féministe, c'est en militant dans un parti politique constitué majoritairement d'hommes, comme la plupart des milieux politiques encore aujourd'hui, que ma compréhension du féminisme et du patriarcat s'est approfondie. Merci aux militantes d'Option nationale, de QS et aux vidéos des Brutes de m'avoir fait cheminer grandement dans ma formation continue d'allié.
Élu en 2018 comme député solidaire de Jean-Lesage, je milite pour ma ville et mon pays en construction.
Le militantisme indépendantiste est la colonne vertébrale de mon engagement. Depuis 2015, j'ai participé à plusieurs ouvrages collectifs de promotion de l'indépendance : Le livre qui fait dire oui, Ce qui nous lie ; l'indépendance pour l'environnement et nos cultures. Depuis 2016, j'ai donné 89 conférences sur l'indépendance et je compte franchir le cap du 100 avant les élections 2026. Les appuis à l'indépendance et à la gauche, nous pouvons les faire augmenter. Je le sais maintenant et je veux qu'on y contribue tout le monde ensemble.
Aujourd'hui, papa d'une fille formidable de 4 ans (et demi !), je me présente pour devenir le prochain co-porte-parole de Québec solidaire. C'est un peu fou, cette histoire, mais bon. C'est ce qui arrive quand on écoute son cœur, j'imagine.
Rêver, mobiliser, changer le monde
Cette lettre ouverte signée par Sol Zanetti a été publiée dans Le Soleil le 3 mai 2025
Il ne se serait pas passé grand-chose dans l'histoire de l'humanité sans les rêveuses et les rêveurs. Rêver, imaginer un avenir libre, affranchir nos ambitions collectives des préjugés sur ce qui est possible et impossible, oser se projeter dans le monde dont nous avons besoin pour être heureux : c'est le superpouvoir humain à l'origine de toutes les grandes créations scientifiques et sociales.
La joute politique tue souvent les rêves collectifs. Rapidement, celles et ceux qui osent rêver se font dénigrer par les corbeaux du prétendu « réalisme ». Leurs adversaires tentent de les dévaluer en faisant croire que leurs propositions sont impossibles. Il ne faut jamais céder devant ces oiseaux de malheur.
En effet, il n'y a rien qui change aussi souvent que les limites du possible dans l'opinion majoritaire d'une société. Le droit de vote des femmes et l'abolition de l'esclavage, pour ne nommer que ces exemples frappants, ont été longtemps considérés comme impossibles avant de devenir des acquis sociaux évidents.
Il est parfaitement possible de faire du Québec un pays libre et démocratique, une société qui vit en équilibre avec son environnement, et où l'égalité et la solidarité rendent possible l'épanouissement de tout le monde.
Nos rêves à nous, Québécoises et Québécois, sont beaucoup trop grands et précieux pour les laisser pourrir dans l'espace confiné d'une province du pétro-État canadien. Donnons à nos rêves les coudées franches et à notre désir l'espace d'exister. Ce qui est impossible, c'est de penser que le monde pourra poursuivre sur la même voie encore 25 ans en continuant de surproduire, de détruire la planète et de laisser se creuser les inégalités partout. Tôt ou tard, ça va péter solide. En 2025, il vaut mieux rêver que dormir au gaz.
Pour que nos rêves politiques soient féconds, nous devons passer à l'action et mobiliser nos communautés. Une fois rassemblés, tout devient possible.
Nous devons investir le Parlement, mais aussi les rues, les ruelles et les rangs. Le pouvoir des partis de gauche au Québec est ancré dans les luttes sociales menées sur tout le territoire davantage qu'au sein du système politique englué que nous a légué notre histoire coloniale.
Lorsque je vois les idées conservatrices et rétrogrades gagner en popularité ici comme ailleurs, un sentiment d'urgence me traverse.
Les solutions de l'avenir ne peuvent pas être de « continuer comme ça », de nous désolidariser les uns des autres et de nous diviser en nous contentant de protéger la richesse des riches.
Le monde a besoin d'amour, de rencontres, d'écoute, d'empathie, de remises en question, de générosité, de partage, d'entraide, d'espoir, de créativité, de liberté, de joie, de temps pour penser et vivre dignement. Ce sont les politiques de gauche qui donnent tout ça. Ce sont les politiques de gauche que je veux pour le Québec, notre véritable pays. C'est pour ça que je suis engagé à Québec solidaire : pour transformer mon inquiétude personnelle en espoir partagé et contribuer à changer le monde.
Je voulais, par cette lettre, vous annoncer que je réfléchis sérieusement à me porter candidat pour devenir le porte-parole masculin du parti en novembre prochain. Je veux épauler Ruba de mon mieux pour qu'elle nous représente au débat des chefs de la prochaine campagne électorale si c'est le souhait des membres et le sien.
Je veux que nos députées et députés sortent encore plus de l'Assemblée nationale pour épauler les mouvements citoyens sur l'ensemble du territoire, je veux qu'on prenne plus de risques pour défendre nos valeurs même quand ça fait fâcher des chroniqueurs, je veux qu'on remette la lutte aux changements climatiques au centre de la politique québécoise et qu'on contribue à nous faire penser en pays toute la gang.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Je suis candidat au co-porte-parolat de Québec solidaire, pour une gauche unie et assumée

Lien pour rejoindre la campagne :
Ma vision
Les dernières années ont été marquées par une montée de la droite, et surtout de l'extrême-droite intolérante, partout dans le monde. Plus que jamais, nous avons besoin d'une gauche forte et rassembleuse.
Je crois profondément que Québec solidaire doit jouer un rôle fort en tant que parti progressiste, féministe, écologiste et indépendantiste.
Environnement et lutte aux changements climatiques
Alors que la crise climatique continue de prendre de l'ampleur, il est inconcevable que ce sujet ne soit pas plus pris au sérieux. Par exemple, l'environnement n'a pas été au coeur des débats lors de la dernière élection fédérale, ce qui s'avère particulièrement inquiétant.
Au Québec, depuis 2018, la CAQ nous fait reculer en environnement : elle abandonne les transports collectifs, tout en s'entêtant à défendre de mauvais projets autoroutiers comme le troisième lien. Elle sacrifie nos milieux naturels pour des projets comme Stablex ou Northvolt. Elle met en péril la qualité de l'air et la santé de la population en cédant devant des entreprises comme Glencore, qui polluent de Limoilou à Rouyn-Noranda. Même le PQ renonce à faire la lutte aux changements climatiques en proposant d'abolir la taxe sur l'essence.
C'est la responsabilité de Québec solidaire de rappeler que la crise climatique est bien réelle et que l'environnement n'est pas un sujet accessoire. Alors que François Legault est prêt à raviver les projets de pipeline pour exporter le pétrole albertain et à sacrifier notre territoire, nous avons besoin de la voix forte de Québec solidaire pour rappeler à quel point les Québécoises et les Québécois n'adhèrent pas à cette vision passéiste.
Justice sociale et logement
Québec solidaire se distingue depuis sa création par l'attention portée aux plus vulnérables de notre société et par son profond désir de justice sociale. Plus que jamais, la lutte aux inégalités sociales doit être au cœur de notre projet politique.
Depuis sept ans, l'écart entre les riches et les pauvres se creuse au Québec, les loyers augmentent de manière vertigineuse et l'itinérance explose dans toutes les villes du Québec.
L'inaction de la CAQ est particulièrement inquiétante : les villes sonnent l'alarme sur l'absence d'implication du gouvernement du Québec en matière de lutte à l'itinérance et la ministre de l'Habitation, plutôt que de considérer le logement comme droit et d'agir en conséquence, suggère plutôt aux locataires d'investir en immobilier !
Depuis sept ans, les services publics se dégradent, les hôpitaux tombent en ruines, les salaires des éducatrices en CPE sont de moins en moins attractifs et les droits syndicaux disparaissent.
Démocratie
Québec solidaire porte depuis sa création les idéaux de démocratie et de représentativité : ça se traduit à travers ses engagements de longue date en faveur de la réforme du mode de scrutin ou en faveur de l'assemblée constituante comme chemin vers la souveraineté du Québec.
Ça se traduit également par nos principes féministes incarnés par les pratiques de parité et de représentation, qui assurent une plus grande pertinence à notre vision de la société.
Mais, notre parti ne porte pas seulement ces idéaux uniquement dans les débats publics : il s'est toujours démarqué des autres par la force de sa démocratie interne, de l'implication de ses membres et de la richesse de ses débats politiques. L'importance qu'accorde notre parti au partage du pouvoir et aux décisions collectives fait peut-être sourciller certains chroniqueurs, mais elle constitue le fondement de ce qui nous distingue et rend notre proposition politique aussi solide.
S'impliquer dans les relations avec les instances, être à l'écoute et présent sur le terrain : voilà selon moi un rôle essentiel du porte-parole. Ce rôle doit s'incarner partout au Québec, avec une sensibilité particulière pour la diversité des régions, des réalités et des enjeux.
Course au porte-parolat de Québec solidaire : Etienne Grandmont reçoit l'appui de Christine Labrie
Québec, le 25 août 2025 – Le député de Taschereau, Etienne Grandmont, poursuit sa tournée des régions du Québec dans le cadre de sa course au porte-parolat de Québec solidaire.
Alors qu'il sera à Sherbrooke ce mercredi 27 août en soirée pour rencontrer les membres de Québec solidaire, il a reçu ce matin l'appui de sa collègue députée de la circonscription de l'Estrie, Christine Labrie, qui a publié sur ses réseaux sociaux un message dans lequel elle vante les qualités de son collègue, notamment son écoute et son leadership rassembleur, ainsi que son engagement sincère envers l'environnement et la justice sociale.
Voir la publication : https://www.facebook.com/photo/?fbid=1299876104839367&set=a.406331327527187
Il s'agit du deuxième appui qu'Etienne Grandmont reçoit d'un-e membre du caucus des député-es de Québec solidaire après celui d'Andrés Fontecilla, député de Laurier-Dorion, lors de son lancement de campagne au printemps dernier.
Un engagement envers l'environnement et la justice sociale et une qualité d'écoute rassembleuse
Avec tout le travail qu'il y a à faire au Québec pour réduire les inégalités, Christine Labrie se dit rassurée par l'engagement profond de son collègue envers la lutte aux changements climatiques et envers la justice sociale.
Celle qui a été co-porte-parole par intérim reconnaît en son collègue les qualités nécessaires pour agir en tant que co-porte-parole pour la suite. Elle cite notamment ses grandes capacités d'écoute, sa présence sur le terrain et dans les instances du parti, ainsi que son désir de travailler pour unir les forces.
« Etienne, c'est quelqu'un qui aborde ses dossiers l'esprit ouvert : il écoute, il est capable de prendre acte des points de vue différents pour trouver la meilleure solution, et il est toujours constructif. C'est de politiciens comme ça dont on a besoin au Québec, et Québec solidaire a besoin de lui pour grandir », explique Christine Labrie, députée solidaire de Sherbrooke.
« C'est un immense honneur pour moi de recevoir l'appui de Christine, une femme intègre et rigoureuse qui a beaucoup donné à la gauche québécoise au cours des 7 dernières années. Sa capacité à rassembler autour d'objectifs communs et son excellent travail sur le terrain m'ont toujours beaucoup inspiré. Christine incarne à cet égard le travail que je veux faire pour coaliser les forces progressistes du Québec si je deviens co-porte-parole. », conclut Etienne Grandmont.
-30-
Renseignements :
Marc-Olivier Gingras-Tremblay
Attaché de presse
514 210-3993 etienne2025qs@gmail.com
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Sous Mark Carney, le principal groupe de pression du capital reprend le volant

Le gouvernement libéral du Canada est devenu l'instrument docile du pouvoir des grandes entreprises, ressuscitant la gouvernance en coulisses du Business Council.
31 juillet 2025 / Canadian Dimension | Photo : Sous Mark Carney, le gouvernement libéral du Canada est devenu l'instrument docile du pouvoir des grandes entreprises, ressuscitant la gouvernance en coulisses du Business Council et marginalisant la démocratie au passage. Photo : Mark Carney/Facebook)
La plupart des Canadien-nes n'ont aucune idée de ce qu'est le Business Council of Canada ni de qui il représente. Mais à Ottawa, l'organisation et ses lobbyistes sont reconnus comme des acteurs de poids, bénéficiant de plus d'influence et d'accès que jamais. Le PDG du Business Council, Goldy Hyder, a obtenu une rencontre en face à face avec le premier ministre Mark Carney quelques jours à peine après son élection et depuis, les lobbyistes du groupe sont en contact constant avec Carney et ses plus hauts responsables.
Par l'intermédiaire du Business Council, le Canada des grandes entreprises a formulé son cahier de doléances sans détour : accélérer l'extraction des ressources, réduire les impôts pour les géants du numérique et les riches, démanteler les services publics et injecter des fonds massifs dans l'industrie de l'armement.
Peut-être plus controversé encore : après une élection présentée comme un bras de fer face aux États-Unis, le Business Council a poussé en faveur d'un rapprochement avec le régime Trump — malgré les preuves accablantes de son caractère erratique et peu fiable.
Sur tous les dossiers majeurs, Carney a livré. Son gouvernement libéral s'est rapidement aligné sur les priorités du Council, laissant de nombreux partisans libéraux désorientés. Pourtant, à bien des égards, cela marque un retour à la normale dans l'alliance de longue date entre la classe politique canadienne et son élite corporative.
L'élection de Carney a déclenché une sorte de renaissance pour le Business Council, qui s'était senti marginalisé ces dernières années. Jadis force dominante dans la définition des politiques économiques des années 1980 et 1990, le Council — connu un temps sous le nom de Conseil canadien des chefs d'entreprise — avait vu son influence décliner sous le gouvernement Trudeau.
Aujourd'hui, avec Carney à la barre, Ottawa a connu ce que Politico décrit comme un profond « changement d'ambiance ». Finies les excuses larmoyantes et les consultations interminables de Trudeau. À la place, les libéraux de Carney, de concert avec les conservateurs, ont fait passer à toute vitesse des projets de loi controversés comme C-2 (Loi sur des frontières solides) et C-5 (Loi sur la construction du Canada), tout en réorientant rapidement les priorités fédérales vers les intérêts corporatifs et l'expansion militaire.
Ottawa : ouverte aux affaires
Alors que les Premières Nations, les groupes environnementaux et les défenseur-euses des droits des migrant-es sont exclu-es des lieux de pouvoir, les dirigeant-es d'entreprise profitent d'une politique de la porte ouverte, rencontrant régulièrement les principaux et principales ministres et conseillers-ères de Carney. Comme le rapporte Politico, « les pontes du monde des affaires veulent entrer — et obtiennent du temps face à face » alors que Carney pousse ses ambitieux projets « de construction nationale » prêts à l'emploi.
Aucun groupe n'a plus profité de cet accès que le Business Council of Canada. Selon Taylor-Vaisey et Djuric, Goldy Hyder affirme que le groupe peine à répondre à l'avalanche d'invitations de la part du nouveau gouvernement Carney, qui s'est montré « très ouvert… à tous les niveaux ».
Ces démarches portent leurs fruits. En quelques mois à peine, le gouvernement libéral de Carney a rayé un à un les points de la liste de souhaits du lobby patronal : suppression de la taxe carbone (que le Business Council soutenait autrefois comme un prix à payer pour obtenir des pipelines) et de la hausse de l'impôt sur les gains en capital ; accélération des projets d'extraction de ressources et affaiblissement des droits autochtones ainsi que des réglementations environnementales ; expansion massive des dépenses militaires, tout en annonçant les coupes budgétaires les plus profondes d'une génération.
Le Business Council n'est pas un lobby ordinaire. Il représente les PDG de plus de 170 des plus grandes entreprises du Canada, et son conseil d'administration réunit certain-es des dirigeant-es les plus puissant-es du pays. Le milliardaire de l'alimentation Galen Weston, incarnation de l'avidité corporative au Canada, y siège, aux côtés de PDG de compagnies pipelinières (TC Energy, Keyera), de grandes banques (CIBC, Banque Nationale) et d'autres institutions financières majeures (Blackrock, Power Corporation), y compris Brookfield Asset Management, où Carney était vice-président jusqu'à l'an dernier.
Le Business Council a depuis longtemps défendu un programme d'extractivisme, de déréglementation et d'austérité, programme que les gouvernements canadiens successifs ont progressivement fait leur. « Si vous voulez savoir ce que le gouvernement fédéral prépare pour demain, écrit le journaliste Donald Gutstein dans son livre The Big Stall, il suffit de regarder ce que [le Business Council of Canada] réclame aujourd'hui. »
Les coudes baissés
Alors, que réclament aujourd'hui le Business Council of Canada et son omniprésent PDG ? L'item numéro un de leur agenda est que le gouvernement fédéral adopte une politique de rapprochement avec le président américain Donald Trump. Selon le Globe and Mail, le puissant lobby corporatif a « poussé agressivement le gouvernement Carney en coulisses » sur la bonne approche à adopter vis-à-vis de Trump. La campagne de pression a commencé presque aussitôt après la réélection de Carney et des libéraux.
Lorsque Carney s'est rendu à Washington pour sa première rencontre avec Trump, Hyder était sur place pour le voir (« une coïncidence, mais aussi une occasion fortuite », selon ses mots). Alors que Carney affirmait poliment mais fermement à Trump et aux médias que le Canada « n'était pas à vendre », les PDG représenté-es par Hyder ont clairement estimé que l'époque des « coudes levés » était terminée. « Nous devons nous rappeler que, sous certains aspects, nous voulons effectivement être davantage intégrés aux États-Unis », a écrit Hyder en revenant de sa visite.
Hyder avait rencontré des responsables de l'administration Trump, dont le secrétaire au Trésor Scott Bessent, et a fait rapport au premier ministre sur ce qu'il faudrait pour « réaffirmer » la relation économique du Canada avec l'Amérique de Trump :
« On nous a beaucoup parlé à la fois de sécurité nationale et de sécurité économique. L'expression Forteresse Amérique du Nord a été répétée de nombreuses fois par plusieurs responsables. On nous a parlé de l'importance de l'Arctique et de la nécessité d'un “dôme doré” pour protéger nos deux pays. Et on nous a parlé de l'importance des ressources naturelles du Canada. Dans chacun de ces domaines, il existe beaucoup de terrains d'entente et de partenariats à développer. »
Dans un pays supposément démocratique comme le Canada, on pourrait croire naïvement que la construction d'une Forteresse Amérique du Nord serait politiquement inacceptable — surtout après une élection polarisante centrée sur l'opposition à Trump. Les sondages montrent de façon constante qu'une écrasante majorité de Canadiens rejette toute concession et favorise une ligne dure face aux États-Unis, se disant prête à assumer le coût de la résistance. Peu de Canadiens souhaitent rejoindre le projet de défense antimissile Golden Dome. Et rares sont ceux et celles qui accepteraient que l'eau, les minéraux critiques ou d'autres ressources naturelles servent de monnaie d'échange dans l'espoir (de plus en plus vain) que Trump renonce à ses tarifs.
Pour les PDG du Canada, cependant, il ne s'agit que d'un problème de communication à gérer. Équilibrer les attentes des Canadien-nes — qui pensaient que le gouvernement Carney prendrait ses distances avec une intégration accrue aux États-Unis — tout en se rapprochant dans les faits de l'Amérique de Trump est « un exercice d'équilibrisme » nécessaire, selon Hyder.
Lier toujours plus le Canada aux États-Unis
Faire en sorte que le Canada se lie toujours plus étroitement aux États-Unis est au cœur de la raison d'être du Business Council. Fondé en 1976 sous le nom de Business Council on National Issues, le groupe de pression a mené la charge pour un accord commercial avec les États-Unis dans les années 1980, a soutenu des ententes similaires verrouillant les politiques pro-entreprises comme l'ALÉNA, l'Accord multilatéral sur l'investissement (AMI) et la Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA) dans les années 1990, et a exigé dans les années 2000 une intégration économique plus profonde, des liens militaires plus étroits et des politiques d'immigration harmonisées avec les États-Unis au moment où ceux-ci menaient une série de guerres désastreuses au Moyen-Orient.
En fin de compte, être en décalage avec l'opinion publique ne gêne en rien le Council. Celui-ci « se fiche de ce que pense le public, car son audience est le gouvernement »,expliquait Gutstein au National Observer en 2020. « Ils ciblent le premier ministre. Les premiers ministres provinciaux. Les hauts fonctionnaires. »
Hyder et le Business Council ont en effet su cibler Carney et ses principaux et principales conseiller-ères avec efficacité. La rencontre « fortuite » du 6 mai à Washington entre Carney et Hyder n'a pas été un coup isolé. Depuis l'élection de Carney, le Business Council a fait pression sur des responsables gouvernementaux à 22 reprises. La plupart de ces rencontres ont eu lieu avec le chef de cabinet du premier ministre et ses principaux et principales conseiller-ères, ou avec la ministre des Affaires étrangères Anita Anand et l'ambassadrice du Canada aux États-Unis Kristen Hillman — les personnes clés dans la définition de la stratégie de Carney vis-à-vis de Trump. D'après le registre des lobbyistes, ces démarches ont porté massivement sur les relations canado-américaines et la renégociation imminente de l'Accord Canada–É.-U.–Mexique (ACEUM).
Carney cède, nous en payons le prix
Les principaux conseiller-ères de Carney semblent avoir été particulièrement réceptifs à l'influence du Conseil canadien des affaires. Bien que le premier ministre ait fait campagne sur la réduction de la dépendance du Canada envers les États-Unis, son gouvernement a gardé secrètes les premières négociations avec le régime Trump après l'élection du 28 avril. Dès juin, des rapports ont commencé à circuler sur un passage rapide de la défiance à l'accommodement.
Malgré les attaques répétées de Trump, qualifiant le Canada de « 51e État », et ses lourds tarifs sur l'acier, l'automobile et l'aluminium canadiens, le Canada a assoupli ses mesures de représailles. Carney, pour sa part, s'est efforcé de bâtir une relation plus étroite avec Trump. Lors de pourparlers en coulisses sur un projet « d'accord global de commerce et de sécurité », il a multiplié concession sur concession face aux exigences erratiques et changeantes du président américain.
Le revirement de Carney laisse perplexes de nombreux analystes. « Rien dans la stratégie américaine de M. Carney, en particulier sa quête d'un accord “global” de commerce et de sécurité, n'a le moindre sens », écrivait Blayne Haggart dans le Globe and Mail du 9 juillet, après l'abrogation par Carney de la taxe sur les services numériques — un cadeau de 7 milliards de dollarsaux géants technologiques américains comme Google et Meta :
« L'abandon de la TSN, qui annulait une loi votée au Parlement, n'a rien rapporté au Canada. En échange de cette abdication si servile de notre souveraineté, M. Carney a obtenu la promesse d'un menteur en série de poursuivre les négociations sur un accord qui, n'étant pas un traité, dépendra entièrement des caprices de l'autocrate de la Maison-Blanche…
La recherche même d'un tel traité pose le même problème. Vu le caractère éphémère de tout accord potentiel, pourquoi pense-t-il qu'un accord global est possible, même sans tout céder d'avance ? »
Cette confusion se dissipe pourtant si l'on comprend que chacune de ces concessions à Trump — de l'abolition de la taxe numérique à l'affaiblissement des réglementations environnementales pour les industries extractives, en passant par l'augmentation massive des dépenses militaires — constitue aussi une concession à l'agenda corporatif du Conseil canadien des affaires et de ses membres, qui réclament précisément ces changements depuis des années (et, sans surprise, les directeurs générauxde Google et de Meta sont membres du Conseil).
Hyder, le Conseil et la classe dirigeante des affaires dans son ensemble adoptent une stratégie « pile je gagne, face tu perds » dans leurs négociations avec Trump. Si un accord de commerce et de sécurité est conclu, les concessions à Trump seront présentées comme le prix nécessaire à payer pour faire lever les tarifs — en passant sous silence le levier considérable que le Canada pourrait exercer contre les États-Unis s'il le voulait.
Si l'accord échoue, ces mêmes politiques pourront immédiatement être rebrandées comme des « mesures fermes » pour tenir tête à Trump et rebâtir notre souveraineté économique. Dans les deux cas, ce sont les travailleur-euses, les migrant-es, les Premières Nations et l'environnement qui en paient le coût. À cet égard, Carney s'avère un vendeur idéal de l'agenda corporatif.
La stratégie du Conseil canadien des affaires pourrait toutefois exploser au visage de Carney. Le chef libéral bénéficie encore d'une lune de miel politique, mais son agenda radicalisé en faveur des grandes entreprises suscite rapidement de l'opposition.
Les Premières Nations, les groupes de défense des droits des migrant-es, les défenseur-euses des droits civiques et les organisations environnementales commencent déjà à exprimer leur frustration d'être exclu-es des cercles du pouvoir, dénonçant les initiatives de Carney comme dangereusement antidémocratiques — voire ouvertement trumpistes. Un chef autochtone a décritle récent sommet des Premières Nations sur le projet de loi C-5, convoqué à la hâte après son adoption, comme une « séance de subjugation — pas de consultation ».
Les travailleur-euses du secteur public, les défenseur-euses des services publics, ainsi que les groupes de solidarité avec la Palestine et les mouvements anti-guerre risquent de se joindre bientôt à elleux, en posant la question suivante : pourquoi y a-t-il tant d'argent pour les joujoux militaires fabriqués et contrôlés aux États-Unis comme le F-35 ou le grotesque Golden Dome de Trump, mais si peu pour la santé et l'éducation ?
Le président Trump, flairant la désespérance, a multiplié ses exigences envers le Canada. Les espoirs de suppression totale des tarifs s'amenuisent, tandis que les responsables de l'administration Trump réclament des concessions allant de la gestion de l'offre laitière à la relance de l'oléoduc Keystone XL en passant par l'abolition des lois linguistiques du Québec.
Mais si Carney doit s'inquiéter des contrecoups politiques, ce n'est pas le problème du Conseil canadien des affaires.
Un « gouvernement parallèle »
À bien des égards, il s'agit d'un retour aux sources pour ce puissant groupe de pression. Durant les années 1980 et 1990, les premiers ministres sollicitaient régulièrement les avis et l'approbation du Conseil canadien des affaires sur les budgets, et les innombrables groupes de travail et comités sectoriels de ce lobby d'affaires œuvraient en coulisses pour transformer les rêves politiques du 1 % en réalité législative — souvent avec grand succès. Sans surprise, l'hystérie autour des déficits, les baisses d'impôt aux entreprises et une austérité écrasante étaient alors à l'ordre du jour.
À son apogée, le Conseil ne se contentait pas d'influencer la législation : il la rédigeait souvent. Ce fut notamment le cas de la Loi sur la concurrence, profondément défaillante, qui a permis aux monopoles corporatifs de prospérer sans grand contrôle. Durant cette période, le Conseil fonctionnait comme un véritable « gouvernement parallèle », son PDG de l'époque, Thomas d'Aquino, faisant office de « premier ministre de facto », comme le constatait le regretté Murray Dobbin dans un portrait publié en 2007.
Sous Stephen Harper, toutefois, l'influence du Conseil à Ottawa a commencé à décliner. Le chroniqueur conservateur Terrence Corcoran le décrivait alors comme « un leader beaucoup plus timide en matière de politique qu'il ne l'avait été sous d'Aquino ». Mais ce relatif effacement traduisait moins un recul qu'un reflet de ses succès antérieurs : les premiers ministres Jean Chrétien et Paul Martin avaient déjà livré l'essentiel du programme économique de Bay Street, ne laissant que peu de choses à ajouter pour Harper.
De plus, John Manley, avocat d'affaires de Bay Street et ministre de l'Industrie sous Paul Martin, incarnait précisément ces « élites laurentiennes » que les néoconservateurs de l'Ouest comme Harper adoraient détester. Harper était davantage à l'écoute d'un cercle restreint — et idéologiquement plus rigide — d'élites économiques et de think tanks, dont plusieurs issus du secteur pétrolier albertain.
Les frustrations du Conseil ont persisté sous Justin Trudeau, surtout dans ses gouvernements minoritaires après 2019. Si Trudeau s'est montré remarquablement conciliant durant la pandémie — offrant au Canada corporatif des renflouements massifs sans conditions réelles —, l'accord de mars 2022 avec le NPD a été jugé inacceptable par le Conseil.
Le vice-président principal du Conseil, Robert Asselin, a dénoncé l'entente comme preuve que Trudeau se concentrait « de plus en plus sur sa survie plutôt que sur une gouvernance de principe ». En mettant de l'avant l'assurance-médicaments, les soins dentaires et une loi anti-briseurs de grève malgré l'opposition des milieux d'affaires, le gouvernement Trudeau avait « signalé un virage marqué à gauche » et « outrepassé son rôle ». Des priorités clés des entreprises — comme le financement de l'armée, la baisse des impôts et l'expansion des infrastructures fossiles — étaient négligées.
Lorsque Trudeau a démissionné, Hyder a déploré que « la relation entre le gouvernement fédéral et le secteur privé ait souvent été conflictuelle ». Mais le Conseil n'était pas pour autant impuissant durant ces années. Comme l'a documenté Gutstein, le lobby des PDG a exercé une influence décisive sur le « grand compromis » climatique de Trudeau, qui associait tarification carbone et construction de pipelines.
La pression du Conseil et d'autres groupes de lobbying patronal poussait déjà les libéraux vers la droite, même avant la démission de Justin Trudeau. Mais avec l'arrivée providentielle à la tête du gouvernement d'un ancien banquier central et ex-Goldman Sachs, la réconciliation avec le Canada corporatif a atteint un nouveau sommet.
Nikolas Barry-Shaw est responsable de campagne sur le commerce et la privatisation au sein du Conseil des Canadiens.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
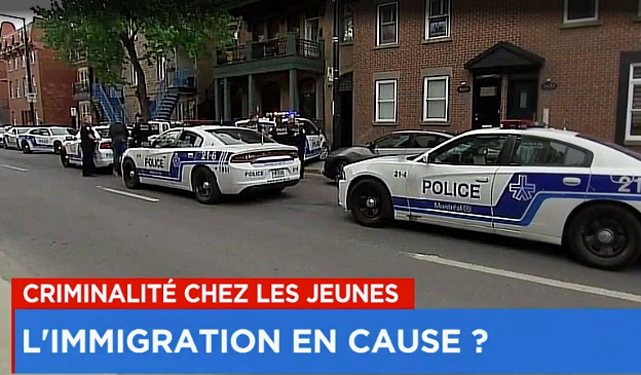
La popularité montante du PQ se conjugue avec celle de son discours raciste
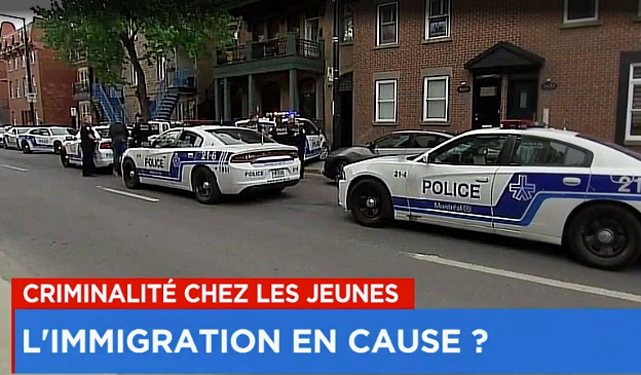
Plusieurs ont eu vent de cet article du Journal de Montréal où le chef péquiste remarquait une « flambée de violence observée chez les jeunes [qui] est liée en partie à des groupes criminels issus de l'immigration ». Il en déduisait que « Québec devrait […] embaucher 800 policiers supplémentaires et 100 nouveaux travailleurs de rue. » Il semble que la montée en popularité du PQ se conjugue avec l'intensification de son « dog whistling » raciste.
22 août 2025
Heureusement que l'IRIS est aux aguets : « Il est pour le moins surréel d'entendre le chef péquiste parler de l'époque, « il y a 20-30 ans », où le crime organisé avait soi-disant des méthodes plus douces, considérant que sévissait au Québec au début des années 1990 une guerre des motards qui a fait de nombreuses victimes, dont certaines parfaitement innocentes. Au-delà de cette première impression, il importe d'aller voir ce que disent les données et la recherche au sujet de la criminalité et des jeunes. On constatera alors que la situation est très différente de l'interprétation qu'en propose M. St-Pierre Plamondon » ce que démontre avec maintes statistiques à l'appui la note de recherche de Julia Posca de l'IRIS.
Règle générale, la criminalité québécoise et montréalaise est en baisse depuis le début du siècle, en particulier pour les homicides. Chez les jeunes la criminalité non violente l'est aussi mais non celle violente. Avant de pointer du doigt la jeunesse (racisée), il faudrait prendre le temps de jauger les enjeux sociaux de constater la recherchiste :
En faisant malgré tout ce rapprochement [entre criminalité et immigration], Paul St-Pierre Plamondon reprend à son compte un discours aux relents xénophobes sur la jeunesse racisée et sur les personnes immigrantes qui n'est malheureusement pas nouveau.
En déformant la réalité de l'évolution de la criminalité à Montréal, le chef du PQ emprunte une vieille stratégie rhétorique qui lui donne les moyens de justifier des solutions répressives dont l'efficacité a pourtant maintes fois été démentie. Depuis les années 1980, on dépeint les jeunes issus de l'immigration (ou perçus comme tel) comme représentant une menace pour la sécurité des autres citoyen·ne·s. Ce discours a permis de légitimer des mesures qui ont accentué la criminalisation de ces jeunes, et ce faisant, leur marginalisation. Ce cercle vicieux, qui est encore à l'œuvre aujourd'hui, explique en partie les tendances que l'on observe depuis quelques années en matière de criminalité juvénile.
L'expérience des intervenant·e·s sur le terrain et les travaux de plusieurs chercheurs et chercheuses ont bien montré que ce n'est pas à cause de leur origine ethnique ou de leur statut d'immigration que certains jeunes commettent des crimes, mais plutôt à cause de facteurs psychologiques et sociaux sur lesquels il importe d'intervenir. La précarité économique et le manque d'opportunités, l'insécurité liée au profilage et à la répression qui sévit dans les quartiers où résident ces jeunes ainsi que le besoin d'appartenance et de valorisation comptent parmi les facteurs en cause.
Le racisme montant du PQ élargit le vide à gauche de l'échiquier politique, tout comme en symbiose avec celui de la CAQ il cristallise le nationalisme québécois comme un nationalisme raciste ce qui entache l'indépendantisme et corrompt la lutte pour la langue française. En ce moment, il n'y a que Québec solidaire qui puisse donner un coup de Jarnac pour corriger cette débandade politique. Celle-ci entraîne le peuple québécois vers l'abîme trumpiste y compris la complicité génocidaire et la marginalisation de l'existentielle crise climatique. Le gouvernement fédéral de l'alliance de facto Libéral-Conservateur, par sa politique fossile (loi C-5), militariste (2% du PIB cette année, 5% en 2035) et répressive (loi C-5 et projet de loi C-2), masquée par le fauxsemblant du nationalisme canadien, a ouvert tout grand les portes à cette plongée dans le gouffre.
Il ne suffit pas de s'afficher comme le parti des travailleuses et travailleurs y compris racisé-e-s comme le fait le Manifeste de Québec solidaire définissant la nouvelle orientation du parti. Même si les politiques du logement, du pouvoir d'achat, des services publics, des droits des travailleurs-travailleuses s'adressent aussi à celles et ceux racisé-e-s, elles ignorent la spécificité d'une visible lutte contre le racisme. Abandonner les « woke » pour les travailleurs-travailleuses, comme avoir honte du député Haroun Bouazzi dénudant l'hypocrisie de l'Assemblée nationale, est se précipiter de Charybde en Scylla tout en sombrant, en vain, dans l'opportunisme électoraliste. Comme l'a mis en évidence la sympathie du peuple-travailleur québécois envers les agent-e-s de bord d'Air Canada, l'électorat est majoritairement prêt à appuyer les travailleuses et les travailleurs mais sur une base wokiste, cette fois-ci, c'était les femmes et les LGBTQ+.
Marc Bonhomme, 22 août 2025
www.marcbonhomme.com ; bonmarc@videotron.ca
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Qu’est-ce que l’impérialisme MAGA ?

John Bellamy Foster explique que, malgré certaines allusions à un isolationnisme pseudo anti-impérialiste, la politique étrangère de Donald Trump s'est cristallisée en une forme de populisme « hypernationaliste » qui rompt avec l'internationalisme libéral adopté par les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Elle promeut la domination sur les autres pays par la puissance militaire plutôt que par la mondialisation économique.
Foster précise que cette « doctrine Trump s'oppose aux empires multiethniques et aux nations multiethniques », en opérant sur une « définition raciale de la politique étrangère, avec l'idée que les États-Unis sont un pays blanc et que les autres ethnies n'y ont pas leur place ».
Alors que certaines analyses situent la base de la coalition trumpiste dans la « classe ouvrière blanche », cette idéologie plonge en réalité ses racines dans la petite bourgeoisie, propriétaire de biens et moins hostile à la grande bourgeoisie capitaliste. « Si vous remontez aux années 1930, en Italie et en Allemagne, c'est la même base sociale qui a nourri le mouvement fasciste, mais comme résultat d'une alliance entre le grand capital… et la petite bourgeoisie. »
8 juillet 2025 | tiré de Democracy now !
Lien :
« The Trump Doctrine and the New MAGA Imperialism »
AMY GOODMAN : Bienvenue à Democracy Now !, democracynow.org, The War and Peace Report. Je suis Amy Goodman, avec Juan González. Le président Trump a annoncé lundi sur les réseaux sociaux une nouvelle série de tarifs douaniers menaçants, allant de 25 à 40 % sur les importations de 14 pays, dont le Bangladesh, l'Indonésie, le Japon, la Corée du Sud et la Thaïlande. Ils devraient entrer en vigueur le 1er août, sauf nouvel accord. Parallèlement, Trump a menacé d'imposer un tarif additionnel de 10 % aux pays qui s'aligneraient sur le groupe des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), invoquant leurs « politiques anti-américaines ». La menace est survenue alors que le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva ouvrait un sommet de deux jours des BRICS à Rio de Janeiro.
PRÉSIDENT LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA : [traduit] Nous ne voulons pas d'un empereur. Nos pays sont souverains. Si Trump impose des tarifs, les autres ont le droit de faire de même. Il existe une loi de réciprocité. Je pense qu'il n'est pas responsable pour le président d'un pays comme les États-Unis de menacer le monde avec des tarifs douaniers sur les réseaux sociaux. Honnêtement, il existe d'autres forums pour qu'un président d'un pays de cette taille s'adresse aux autres nations.
AMY GOODMAN : Cela intervient alors que le vice-président JD Vance promeut la nouvelle orientation de politique étrangère de Trump. Le mois dernier, il s'est adressé au Parti républicain de l'Ohio.
VICE-PRÉSIDENT JD VANCE : Ce que j'appelle la doctrine Trump est assez simple. Premièrement, vous définissez clairement l'intérêt américain : dans ce cas, que l'Iran ne peut pas posséder l'arme nucléaire. Deuxièmement, vous tentez d'abord de résoudre agressivement ce problème par la diplomatie. Et troisièmement, si cela échoue, vous employez une puissance militaire écrasante pour régler la question, puis vous vous retirez rapidement, avant que cela ne devienne un conflit prolongé.
AMY GOODMAN : Pour en parler, nous sommes rejoints par John Bellamy Foster, professeur de sociologie à l'Université de l'Oregon, rédacteur en chef du Monthly Review, où son nouvel article s'intitule « The Trump Doctrine and the New MAGA Imperialism ». Eh bien, professeur Foster, pouvez-vous exposer votre thèse pour nous ?
JOHN BELLAMY FOSTER : Merci. La doctrine Trump a été formulée durant la première administration Trump. Normalement, ce sont les médias qui définissent les « doctrines présidentielles », en observant comment une présidence agit selon un principe particulier. Avec Trump, la situation était confuse : était-il isolationniste ? anti-impérialiste ?
Durant son premier mandat, Michael Anton, un des principaux idéologues MAGA, issu du Claremont Institute (un centre intellectuel MAGA), siégeait au Conseil de sécurité nationale. On l'a écarté de ce poste pour qu'il puisse formuler officiellement une doctrine Trump crédible pour les experts en politique étrangère. Il a donné une conférence, nommé ensuite à Hillsdale College (institution MAGA), puis à Princeton, et son exposé a été publié dans Foreign Policy, la principale revue américaine de politique étrangère. Aujourd'hui, Anton est directeur de la planification politique au Département d'État, en pratique le principal « idéologue » de la diplomatie américaine.
Il a défini une doctrine en quatre piliers :
- Le populisme national — manière dont le mouvement MAGA se désigne lui-même, écho au national-socialisme nazi.
- Chaque nation doit être avant tout nationaliste dans son orientation.
- Opposition à l'internationalisme libéral et à l'hégémonie américaine libérale d'après-guerre. À la place : un impérialisme hypernationaliste « America First », où les États-Unis dominent seuls le monde.
- Opposition aux empires et nations multiethniques. En s'inspirant d'Aristote (tribu, cité, empire), Anton soutient que la politique étrangère doit se fonder sur l'ethnicité, en pratique sur une définition raciale : les États-Unis comme pays blanc, excluant les autres ethnies, et organisant la politique étrangère comme intérieure sur cette base.
Voilà pourquoi cette doctrine est cruciale : Anton est désormais le principal stratège de la politique étrangère américaine.
JUAN GONZÁLEZ : Professeur, dans votre analyse, que je trouve parmi les plus claires sur ce nouveau mouvement fasciste, vous contredisez ceux qui affirment que le néofascisme trumpiste repose sur la classe ouvrière. Vous dites plutôt que trois secteurs du capital monopoliste — la tech, le pétrole et gaz, et le capital-investissement — se sont alliés avec la petite bourgeoisie et des travailleurs privilégiés pour constituer la base du mouvement MAGA. Pouvez-vous développer ?
JOHN BELLAMY FOSTER : Sociologiquement, la petite bourgeoisie est une catégorie bien définie aux États-Unis : petits propriétaires, exploitants agricoles, cadres intermédiaires, populations rurales, souvent liée à l'évangélisme. Elle est majoritairement blanche, plus aisée que la classe ouvrière (les 60 % inférieurs), et vote beaucoup plus. C'est la base du trumpisme : nationaliste, revancharde (« rendre sa grandeur à l'Amérique »), raciste, anti-immigrés, misogyne, patriarcale. On la retrouve dans les zones périurbaines.
Dès l'émergence de Trump, The New York Times, qui ne parlait plus de la classe ouvrière depuis des décennies, a commencé à évoquer la « classe ouvrière blanche ». Mais en réalité, il s'agit de la petite bourgeoisie, historiquement appelée la petite-bourgeoisie, base traditionnelle des mouvements fascistes. Dans les années 1930, en Italie et en Allemagne, c'était la même assise sociale, alliée au grand capital.
Cette couche n'est pas anticapitaliste : elle s'oppose surtout à ce que l'idéologie MAGA appelle la « classe dirigeante » (les cadres et technocrates vus comme contrôlant l'État), ainsi qu'à la classe ouvrière, perçue comme multiethnique, diverse et pauvre — condition qu'ils redoutent. Elle joue donc un rôle d'« arrière-garde » mobilisée par les milliardaires, depuis le Tea Party jusqu'à Trump, pour pousser le système politique vers la droite dure et développer un mouvement néofasciste, malgré ses contradictions internes.
AMY GOODMAN : John Bellamy Foster, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Professeur de sociologie à l'Université de l'Oregon, rédacteur en chef du Monthly Review, il s'exprimait depuis l'État de Washington. Son article le plus récents'intitule « The Trump Doctrine and the New MAGA Imperialism », disponible sur democracynow.org.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Révolution en Serbie : lettre ouverte à M. Sandro Gozi

Sandro Gozi, député européen Renaissance, se dit très inquiet de la situation politique en Serbie, où le régime au pouvoir a repris les méthodes utilisées en son temps par Slobodan Milošević. Pourtant, en même temps, Emmanuel Macron soutient fermement Aleksandar Vucic, au nom de la stabilité... et des investissements français en Serbie.
Tiré du blogue de l'auteur.
M. Gozi, dans un entretien que vous venez d'accorder au media serbe N1, vous partagez votre grande inquiétude quant au scenario biélorusse qui se produit actuellement en Serbie, orchestré par le parti au pouvoir et par le président de la République, Aleksandar Vučić.
Vous indiquez clairement que la rhétorique utilisée par le pouvoir est une menace explicite de guerre civile, dans un pays candidat à l'Union Européenne. Vous évoquez les revendications légitimes de justice, d'indépendance des médias et des institutions publiques dans le pays. Le Parlement Européen a bien eu plusieurs débats sur la situation, et ce depuis plusieurs années déjà. La Commission Européenne pointe régulièrement dans son rapport annuel sur la Serbie les entraves à la justice, à l'État de Droit, les menaces contre des journalistes et les scrutins électoraux frauduleux.
Les revendications portées dans la rue n'ont pas commencé avec l'effondrement de l'auvent devant la gare de Novi Sad le 1er novembre dernier, où 16 personnes ont perdu la vie. Elles étaient présentes bien avant. De nombreux étudiant-es serbes présent-es à l'étranger, ont manifesté à Paris, Berlin, Vienne, Rome, et même sous les fenêtres de vos bureaux du Parlement Européen.
Aujourd'hui, M. Gozi, exprimer votre inquiétude ne suffit plus. En tant que secrétaire général du groupe Renew Europe, vous avez un pouvoir non négligeable. Votre rôle est d'autant plus important que vous siégez au Parlement Européen en tant que député Renaissance, parti du président Emmanuel Macron.
Ce même M. Macron tient pourtant à démontrer son amitié avec le président Vučić. Pas plus tard que début août, le président de la République française a échangé avec son homologue serbe, répétant ce qu'il avait dit en février, ou en août 2024, que la Serbie avait un destin européen. Pourtant, dans les faits, la France demeure aujourd'hui un allié indéfectible du président serbe. Les entreprises françaises n'ont jamais autant obtenu de contrats publics. On y compte notamment Dassault et ses Rafale, Vinci et la gestion de l'aéroport de Belgrade, mais aussi Egis qui se targue de ses travaux de reconstruction de la gare de Novi Sad. Ce groupe, malgré sa participation au consortium et les opacités sur le contrat, n'a pas daigné répondre aux questions soulevées après la chute mortelle de l'auvent, ni aux médias ni à une justice serbe entre les mains du pouvoir.
M. Gozi, si vous tenez aujourd'hui réellement au destin européen de la Serbie et à la vie des citoyennes et citoyens serbes, s'inquiéter gravement n'est plus une ligne politique tenable. Vos collègues du groupe Renew Irena Joveva et Helmut Brandstätter ont soutenu la nomination des étudiants serbes au prix Sakharov du Parlement Européen. C'est un premier pas vers la reconnaissance de la légitimité de leurs demandes. En tant que député Renaissance, il est aussi de votre devoir de demander publiquement à l'ensemble de votre parti, mais aussi et surtout à M. Macron de cesser de soutenir le régime dictatorial – n'ayons pas peur d'utiliser les mots puisque c'est vous qui comparez la Serbie à la Biélorussie – de M. Vučić et du parti progressiste serbe (SNS).
Celui-ci se comporte non pas en garant de la stabilité, mais en agitateur permanent de haine. Est-on vraiment surpris quand on sait que ce même président fut un temps Ministre de la Propagande sous le régime de Slobodan Milošević ? Allez-vous continuer à vous indigner depuis Bruxelles, tout en tolérant que vos collègues et amis de Paris soutiennent coûte que coûte le président serbe au motif d'une stabilité érodée depuis bien longtemps ? Allez-vous fermer les yeux sur les connivences des groupes industriels français, allemands et italiens avec le régime au pouvoir ?
Le destin européen de la Serbie se joue maintenant, et bien que ses citoyens n'attendent pas nécessairement un changement venu d'ailleurs, vous avez aussi votre importance dans les demandes citoyennes en cours et l'orientation future de la Serbie. Les personnes qui sont actuellement réprimées, arrêtées, frappées, menacées de viols et de mutilations par la police sauront s'en souvenir dans les mois à venir.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Une base de données de l’armée israélienne suggère qu’au moins 83 % des morts à Gaza étaient des civils

Des informations classifiées datant du mois de mai révèlent qu'Israël estimait avoir tué quelque 8 900 militants lors de ses attaques contre Gaza, ce qui indique un pourcentage de victimes civiles sans précédent dans l'histoire moderne, selon une enquête conjointe.
Tiré d'Agence médias Palestine.
Les données issues d'une base de données interne des services de renseignement israéliens indiquent qu'au moins 83 % des Palestiniens tués lors de l'offensive israélienne sur Gaza étaient des civils, selon une enquête menée par le magazine +972, Local Call et The Guardian.
Les chiffres obtenus à partir de cette base de données classifiée, qui recense les décès de militants du Hamas et du Jihad islamique palestinien (JIP), contredisent largement les déclarations publiques faites tout au long de la guerre par l'armée israélienne et les responsables gouvernementaux, qui ont généralement affirmé que le ratio entre civils et militants tués était de 1 pour 1 ou 2 pour 1. Au contraire, ces données classifiées corroborent les conclusions de plusieurs études suggérant que les bombardements israéliens sur Gaza ont tué des civils à un rythme sans précédent dans l'histoire moderne.
L'armée israélienne a confirmé l'existence de cette base de données, qui est gérée par la Direction du renseignement militaire (connue sous l'acronyme hébreu « Aman »). Plusieurs sources proches des services de renseignement et familiarisées avec cette base de données ont déclaré que l'armée la considérait comme le seul décompte officiel des victimes parmi les militants. Une source affirme : « Il n'y a aucun autre endroit où vérifier ».
La base de données comprend une liste de 47 653 noms de Palestiniens de Gaza qu'Aman considère comme actifs dans les branches armées du Hamas et du JIP ; selon les sources, cette liste est basée sur les documents internes des groupes obtenus par l'armée (que +972, Local Call et The Guardian n'ont pas pu vérifier). La base de données désigne 34 973 de ces noms comme étant des membres du Hamas et 12 702 comme étant des membres du Jihad islamique (un petit nombre d'entre eux sont répertoriés comme actifs dans les deux groupes, mais ils ne sont comptés qu'une seule fois dans le total général).
Selon les données obtenues en mai de cette année, l'armée israélienne estimait avoir tué environ 8 900 membres depuis le 7 octobre, dont 7 330 considérés comme morts avec certitude et 1 570 enregistrés comme « probablement morts ». La grande majorité d'entre eux étaient des membres subalternes, l'armée estimant avoir tué entre 100 et 300 membres haut placés du Hamas sur les 750 nommés dans la base de données.
Une source proche de la base de données a expliqué qu'une information spécifique était jointe au nom de chaque membre de la liste dont l'armée était certaine d'avoir tué, justifiant ainsi cette désignation. +972, Local Call et The Guardian ont obtenu les données chiffrées de la base de données sans les noms ni les rapports de renseignement supplémentaires.
Le bilan global publié quotidiennement par le ministère de la Santé de Gaza ( dont l'organisation Local Call a révélé l'année dernière qu'il était considéré comme fiable, y compris par l'armée israélienne) ne fait pas la distinction entre civils et militants. Mais en comparant les chiffres des victimes militantes obtenus à partir de la base de données interne de l'armée israélienne en mai et en les comparant au bilan total du ministère de la Santé, il est possible de calculer une proportion approximative de victimes civiles pour la guerre jusqu'à il y a trois mois, lorsque le bilan s'élevait à 53 000 morts.
En supposant que tous les décès certains et probables de militants aient été pris en compte dans le bilan, cela signifierait que plus de 83 % des morts à Gaza étaient des civils. Si l'on exclut les décès probables et que l'on ne retient que les décès certains, la proportion de morts civils passe à plus de 86 %.
Les sources des services de renseignement ont expliqué que le nombre total de militants tués est probablement plus élevé que celui enregistré dans la base de données interne, car il n'inclut pas les membres du Hamas ou du JIP qui ont été tués mais n'ont pas pu être identifiés par leur nom, les Gazaouis qui ont pris part aux combats mais n'étaient pas officiellement membres du Hamas ou du JIP, ni les personnalités politiques du Hamas telles que les maires et les ministres du gouvernement, que Israël considère également comme des cibles légitimes (en violation du droit international).
Toutefois, cela ne signifie pas nécessairement que le pourcentage de victimes civiles est inférieur à celui calculé ci-dessus ; en fait, il pourrait même être plus élevé. Des études récentes ont suggéré que le bilan du ministère de la Santé, qui s'élève actuellement à environ 62 000 morts, est également susceptible d'être largement inférieur au nombre total de victimes de l'offensive israélienne, peut-être de plusieurs dizaines de milliers.
Falsification des chiffres
Depuis le début de la guerre, les responsables israéliens ont cherché à rejeter les accusations de meurtres gratuits à Gaza alors que le nombre de morts palestiniens s'accumulait rapidement. En décembre 2023, alors que le nombre de morts s'élevait déjà à 16 000, le porte-parole international de l'armée israélienne, Jonathan Conricus, a déclaré à CNN qu'Israël avait tué deux civils pour chaque militant, un ratio qu'il a qualifié de « extrêmement positif ». En mai 2024, alors que le nombre de morts s'élevait à 35 000, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a affirmé que le ratio était en fait plus proche de 1:1, une affirmation qu'il a répétée en septembre de la même année.
Le nombre précis de militants qu'Israël affirme avoir tués depuis le 7 octobre a fluctué de manière apparemment illogique. En novembre 2023, un haut responsable de la sécurité a laissé entendre au site d'information israélien Ynet qu'Israël avait déjà tué plus de 10 000 militants. Dans une évaluation militaire officielle présentée au gouvernement le mois suivant, ce chiffre est tombé à 7 860.
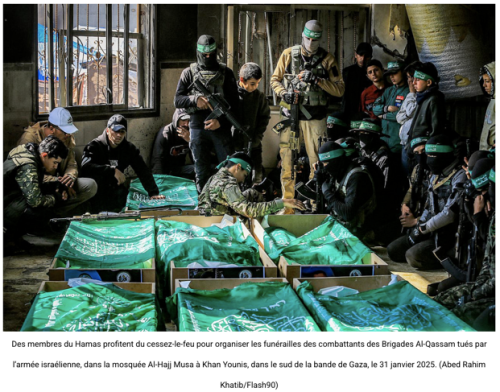
Les fluctuations mystérieuses du nombre de victimes parmi les militants se sont poursuivies en 2024. En février de cette année-là, le porte-parole de l'armée israélienne a affirmé qu'Israël avait tué 13 000 membres du Hamas, mais une semaine plus tard, l'armée a annoncé un chiffre inférieur, soit 12 000. En août 2024, l'armée a déclaré avoir tué 17 000 membres du Hamas et du JIP, un chiffre qui a de nouveau diminué deux mois plus tard pour atteindre 14 000 morts « avec une forte probabilité ». En novembre 2024, Netanyahu a estimé ce nombre « proche de 20 000 ».
Dans son discours de départ à la retraite en janvier de cette année, le chef d'état-major sortant Herzi Halevi a réaffirmé qu'Israël avait tué 20 000 militants à Gaza depuis le 7 octobre. Et en juin, le Centre Begin-Sadat pour les études stratégiques, un centre de recherche de droite de l'université Bar-Ilan, a cité des sources militaires affirmant que le nombre de militants tués à Gaza s'élevait à 23 000.
Des sources des services de renseignement ont déclaré à +972, Local Call et The Guardian que certaines de ces affirmations provenaient probablement d'une base de données ancienne et inexacte tenue par le commandement sud de l'armée, qui estimait à la fin de l'année dernière, sans fournir de liste de noms, qu'environ 17 000 militants avaient été tués. « Ces chiffres sont des affabulations du commandement sud », a déclaré une source des services de renseignement.
Les rapports exagérés du commandement sud reposaient probablement sur les déclarations de commandants sur le terrain dont les subordonnés signalaient régulièrement à tort des victimes civiles comme étant des militants.
Par exemple, +972 et Local Call ont récemment révélé un cas dans lequel un bataillon stationné à Rafah a tué environ 100 Palestiniens et les a tous enregistrés comme « terroristes », alors qu'un officier du bataillon a témoigné que, sauf dans deux cas, les victimes étaient toutes non armées. Une enquête menée l'année dernière par Haaretz a également révélé que seuls 10 des 200 « terroristes » que le porte-parole de l'armée israélienne avait déclaré avoir été tués par la 252e division dans le corridor de Netzarim pouvaient être identifiés comme des membres du Hamas.
En avril 2024, le quotidien de droite Israel Hayom a rapporté que plusieurs membres de la commission des affaires étrangères et de la défense de la Knesset avaient remis en question la fiabilité des chiffres sur les pertes militantes qui leur avaient été présentés par l'armée. Après avoir examiné les données de l'armée, les membres de la commission ont constaté que le nombre réel était beaucoup plus faible et que l'armée avait gonflé le nombre de victimes parmi les militants « afin de créer un ratio de 2 pour 1 » entre les morts civils et les morts parmi les militants.
« « Nous signalons la mort de nombreux membres du Hamas, mais je pense que la plupart des personnes que nous déclarons mortes ne sont pas vraiment des membres du Hamas », a déclaré à +972, Local Call et The Guardian une source des services de renseignement qui accompagnait les forces sur le terrain. « Les gens sont promus au rang de terroriste après leur mort. Si j'avais écouté la brigade, j'aurais conclu que nous avions tué 200 % des membres du Hamas dans la région. »
Une source officielle chargée de la sécurité a confirmé qu'avant la mise en place de la base de données du renseignement, les chiffres avancés par l'armée concernant les pertes parmi les militants, tels que le chiffre de 17 000, n'étaient qu'une « estimation » largement basée sur les témoignages des officiers. « La méthode de comptage a changé », a déclaré la source. « Au début de la guerre, [nous nous basions] sur les déclarations des commandants qui disaient « J'ai tué cinq terroristes ».
La base de données du renseignement, en revanche, repose sur une analyse individuelle et constitue le seul chiffre auquel l'armée peut « s'engager » avec un haut degré de certitude, a expliqué la source, tout en admettant qu'il pourrait s'agir d'une sous-estimation. La source a ajouté que les chiffres avancés publiquement par les dirigeants politiques ne sont pas coordonnés avec les données du renseignement disponibles.
L'analyste palestinien Muhammad Shehada a déclaré à +972, Local Call et The Guardian que les chiffres de la base de données des services de renseignement correspondent étroitement à ceux qui lui ont été communiqués par des responsables du Hamas et du JIP : en décembre 2024, ils estimaient qu'Israël avait tué environ 6 500 de leurs membres, y compris des membres de la branche politique.
« Ils mentent sans arrêt »
Peu après le 7 octobre, Yossi Sariel, alors commandant de l'unité d'élite de renseignement militaire Unit 8200, a commencé à partager quotidiennement avec ses subordonnés le nombre de membres du Hamas et du JIP tués à Gaza. Selon trois sources proches du dossier, ce graphique, appelé « tableau de bord de la guerre », était présenté par Sariel comme une mesure du succès de l'armée.
« Il mettait beaucoup l'accent sur les données, les données, les données », a expliqué l'un des subordonnés de Yossi Sariel. « Il fallait tout mesurer en termes quantitatifs. Pour montrer l'efficacité. Pour essayer de rendre tout plus intelligent et plus technologique. »
Une autre source a déclaré que cela ressemblait à « un match de football, avec des officiers assis autour d'un tableau de bord qui regardaient les chiffres grimper ». (Yossi Sariel a décliné notre demande de commentaires, nous renvoyant vers le porte-parole de l'armée israélienne.) Le général de division (à la retraite) Itzhak Brik, qui a servi pendant de nombreuses années comme commandant dans l'armée israélienne, puis comme médiateur pour les plaintes des soldats, a expliqué comment cette vision des choses avait alimenté une culture du mensonge.
« Ils ont créé un système [selon lequel] plus vous tuiez, plus vous réussissiez, et par conséquent, ils ont menti sur le nombre de personnes tuées », a-t-il déclaré, qualifiant les chiffres présentés par le porte-parole de l'armée israélienne de « l'un des bluffs les plus dangereux » de l'histoire d'Israël.
« Ils mentent sans arrêt, tant les militaires que les responsables politiques », a ajouté Brik. « À chaque raid, le porte-parole de l'armée israélienne déclarait : « Des centaines de terroristes ont été tués » », a-t-il poursuivi. « Il est vrai que des centaines de personnes ont été tuées, mais ce n'étaient pas des terroristes. Il n'y a absolument aucun lien entre les chiffres qu'ils annoncent et ce qui se passe réellement. »
Lorsqu'il s'est entretenu avec des soldats chargés d'examiner et d'identifier les corps des personnes tuées par l'armée à Gaza, ceux-ci lui ont déclaré : « Parmi toutes les personnes que l'armée dit avoir tuées, la plupart sont des [civils]. Point final. »
Le Hamas et le JIP ont tous deux été gravement affaiblis par l'offensive israélienne de ces deux dernières années, qui a tué la plupart des hauts responsables des deux groupes et considérablement endommagé leurs infrastructures militaires. Néanmoins, les données obtenues à partir de la base de données des services de renseignement montrent qu'Israël n'a tué qu'un cinquième des personnes qu'il considère comme des militants. Les estimations des services de renseignement américains suggèrent que le Hamas a recruté 15 000 agents pendant la guerre, soit deux fois plus que le nombre de personnes tuées par Israël.
Mais les discours génocidaires largement répandus par les dirigeants israéliens et les hauts responsables militaires depuis le début de la guerre suggèrent une intention de nuire à tous les Palestiniens de Gaza, et pas seulement aux militants. Le matin du 7 octobre, l'ancien chef d'état-major Herzi Halevi a déclaré à sa femme : « Gaza sera détruite », a-t-elle révélé dans un podcast récent. Et dans un enregistrement divulgué ces derniers mois et diffusé la semaine dernière sur la chaîne israélienne Channel 12, le directeur de l'Aman de l'époque, Aharon Haliva, a déclaré que « 50 Palestiniens doivent mourir » pour chaque Israélien tué le 7 octobre, ajoutant « peu importe même si ce sont des enfants ».
Le droit international ne définit pas ce qui constitue un taux « acceptable » de victimes civiles, mais examine plutôt chaque attaque selon le principe de « proportionnalité ». À cet égard, dès novembre 2023, +972 et Local Call ont révélé que l'armée israélienne avait considérablement assoupli les restrictions sur les pertes civiles après le 7 octobre, autorisant le meurtre de plus de 100 civils palestiniens lors d'une tentative d'assassinat d'un haut commandant du Hamas, et jusqu'à 20 pour des agents subalternes.
Selon les experts, cette politique de tir et la culture de vengeance qui s'est développée après le 7 octobre ont entraîné un taux de victimes civiles à Gaza extrêmement élevé pour une guerre moderne, même comparé à des conflits connus pour leurs tueries aveugles, tels que les guerres civiles en Syrie et au Soudan.
« Ils mentent sans arrêt, tant les militaires que les responsables politiques », a ajouté Brik. « À chaque raid, le porte-parole de l'armée israélienne déclarait : « Des centaines de terroristes ont été tués » », a-t-il poursuivi. « Il est vrai que des centaines de personnes ont été tuées, mais ce n'étaient pas des terroristes. Il n'y a absolument aucun lien entre les chiffres qu'ils annoncent et ce qui se passe réellement. »
Lorsqu'il s'est entretenu avec des soldats chargés d'examiner et d'identifier les corps des personnes tuées par l'armée à Gaza, ceux-ci lui ont déclaré : « Parmi toutes les personnes que l'armée dit avoir tuées, la plupart sont des [civils]. Point final. »
Le Hamas et le JIP ont tous deux été gravement affaiblis par l'offensive israélienne de ces deux dernières années, qui a tué la plupart des hauts responsables des deux groupes et considérablement endommagé leurs infrastructures militaires. Néanmoins, les données obtenues à partir de la base de données des services de renseignement montrent qu'Israël n'a tué qu'un cinquième des personnes qu'il considère comme des militants. Les estimations des services de renseignement américains suggèrent que le Hamas a recruté 15 000 agents pendant la guerre, soit deux fois plus que le nombre de personnes tuées par Israël.
Mais les discours génocidaires largement répandus par les dirigeants israéliens et les hauts responsables militaires depuis le début de la guerre suggèrent une intention de nuire à tous les Palestiniens de Gaza, et pas seulement aux militants. Le matin du 7 octobre, l'ancien chef d'état-major Herzi Halevi a déclaré à sa femme : « Gaza sera détruite », a-t-elle révélé dans un podcast récent. Et dans un enregistrement divulgué ces derniers mois et diffusé la semaine dernière sur la chaîne israélienne Channel 12, le directeur de l'Aman de l'époque, Aharon Haliva, a déclaré que « 50 Palestiniens doivent mourir » pour chaque Israélien tué le 7 octobre, ajoutant « peu importe même si ce sont des enfants ».
Le droit international ne définit pas ce qui constitue un taux « acceptable » de victimes civiles, mais examine plutôt chaque attaque selon le principe de « proportionnalité ». À cet égard, dès novembre 2023, +972 et Local Call ont révélé que l'armée israélienne avait considérablement assoupli les restrictions sur les pertes civiles après le 7 octobre, autorisant le meurtre de plus de 100 civils palestiniens lors d'une tentative d'assassinat d'un haut commandant du Hamas, et jusqu'à 20 pour des agents subalternes.
Selon les experts, cette politique de tir et la culture de vengeance qui s'est développée après le 7 octobre ont entraîné un taux de victimes civiles à Gaza extrêmement élevé pour une guerre moderne, même comparé à des conflits connus pour leurs tueries aveugles, tels que les guerres civiles en Syrie et au Soudan.
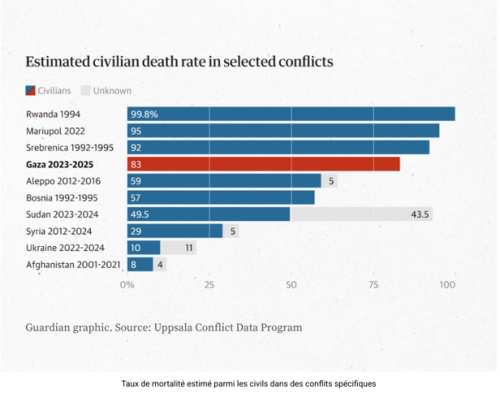
« La proportion de civils parmi les personnes tuées serait exceptionnellement élevée, d'autant plus que cela dure depuis si longtemps », a déclaré Therese Pettersson, du Programme de données sur les conflits d'Uppsala (UCDP), qui recueille des données sur les victimes civiles dans le monde entier. Elle a ajouté qu'il est possible de trouver des taux de victimes civiles similaires en isolant une ville ou une bataille particulière dans le cadre d'un conflit plus large, mais « très rarement » lorsqu'on examine une guerre dans son ensemble.
Dans les conflits mondiaux suivis par l'UCDP depuis 1989, les civils n'ont représenté une proportion plus importante des morts que lors des génocides de Srebrenica (1992-95) et du Rwanda (1994) et pendant le siège de Marioupol par la Russie, qui a duré trois mois (2022), a déclaré Mme Pettersson.
Ce n'est qu'après un cessez-le-feu qu'il sera possible de calculer avec précision le nombre de victimes civiles et militantes à Gaza. Mais la base de données du renseignement indique que le ratio de victimes civiles est nettement supérieur aux chiffres présentés par Israël au monde depuis près de deux ans.
+972 et Local Call ont initialement contacté le porte-parole de l'armée israélienne à la fin du mois de juillet pour obtenir des commentaires et ont reçu une déclaration qui ne contredisait pas nos conclusions : « Tout au long de la guerre, des évaluations complètes des renseignements ont été menées sur le nombre de terroristes éliminés dans la bande de Gaza. Le décompte est un processus complexe qui repose sur la situation des forces sur le terrain et sur des informations provenant de divers services de renseignement, tout en recoupant un large éventail de sources. »
Trois semaines plus tard, après que le Guardian eut demandé des commentaires sur les mêmes données, l'armée a déclaré qu'elle souhaitait « reformuler » sa réponse et a rejeté nos conclusions sans autre explication : « Les chiffres présentés dans l'article sont incorrects et ne reflètent pas les données disponibles dans les systèmes de l'armée israélienne. Tout au long de la guerre, des évaluations du renseignement sont effectuées en continu concernant le nombre de terroristes éliminés dans la bande de Gaza, sur la base de méthodologies d'évaluation des dommages causés par les bombes (BDA) et de vérifications croisées provenant de diverses sources […] [y compris] des documents provenant d'organisations terroristes dans la bande de Gaza. »
Un porte-parole n'a pas immédiatement répondu lorsqu'on lui a demandé pourquoi l'armée avait donné des réponses différentes à des questions portant sur un seul ensemble de données.
Emma Graham-Harrison, du Guardian, a contribué à cet article.
Traduction : JB pour l'Agence Média Palestine
Source : +972 Magazine
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.











