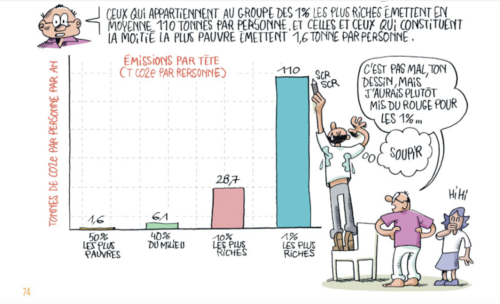Derniers articles

« Nous devons vaincre le fascisme » : un conseiller municipal de Chicago face à la menace de Trump de déployer des troupes dans la ville

Le président Donald Trump a signé lundi un décret exécutif établissant des unités « spécialisées » de la Garde nationale, prêtes à être rapidement déployées à Washington D.C. et dans les 50 États, et a de nouveau menacé d'envoyer des troupes dans des villes dirigées par des démocrates, comme Chicago. Responsables et organisateurs de terrain ont promis de riposter.
« Nous sommes une ville ouvrière forte », déclare Byron Sigcho-Lopez, conseiller municipal socialiste démocrate du 25ᵉ district de Chicago. « Nous n'allons pas normaliser le fascisme, et nous sommes prêts à affronter le dictateur de face. » Sigcho-Lopez affirme que la ville prépare une mobilisation de masse qui aura lieu le jour de la Fête du travail.
26 août 2025 | tiré de democray now !
https://www.democracynow.org/2025/8/26/byron_sigcho_lopez_chicago_trump_takeover
AMY GOODMAN : Bienvenue à Democracy Now ! Je suis Amy Goodman à New York. Juan González est à Chicago. Le président Trump a signé lundi un décret exécutif créant des unités « spécialisées » de la Garde nationale pouvant être rapidement déployées à Washington et dans tous les États. Selon ce décret, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth supervisera la Garde nationale pour aider les forces de l'ordre locales à, je cite, « réprimer les troubles civils ». Cette décision survient quelques semaines après que Trump a déjà déployé la Garde nationale à Washington, où le taux de criminalité était pourtant à son plus bas niveau depuis des décennies. Trump a également menacé d'envoyer des troupes à New York, Baltimore, Chicago et dans d'autres villes. Voici ses propos :
DONALD TRUMP : J'ai dit que la prochaine devrait être Chicago, parce que, comme vous le savez, Chicago est actuellement un champ de bataille meurtrier. Ils refusent de l'admettre. Ils disent : « Nous n'avons pas besoin de lui. Liberté, liberté. C'est un dictateur, c'est un dictateur. » Beaucoup de gens disent : « Peut-être qu'un dictateur, ça nous plairait. » Moi, je n'aime pas les dictateurs. Je ne suis pas un dictateur.
AMY GOODMAN : De son côté, le gouverneur démocrate de l'Illinois, JB Pritzker, a répondu lundi à Trump lors d'une conférence de presse, entouré d'élu-es, de responsables économiques et de leaders communautaires.
GOUVERNEUR JB PRITZKER : Plus tôt aujourd'hui, dans le Bureau ovale, Donald Trump a regardé les caméras et a demandé que je dise personnellement : « Monsieur le Président, pouvez-vous avoir l'honneur de protéger notre ville ? » À la place, je lui dis : Monsieur le Président, ne venez pas à Chicago. Vous n'y êtes ni désiré, ni nécessaire. Vos propos de ces dernières semaines révèlent une dégradation inquiétante de vos facultés mentales et sont indignes de la haute fonction que vous occupez. Plus inquiétant encore, vous semblez dépourvu de toute préoccupation pour les membres de l'armée que vous déployez sans scrupule comme de simples pions dans votre quête toujours plus alarmante de pouvoir.
AMY GOODMAN : C'était le gouverneur JB Pritzker. Pour en parler, nous rejoignons Chicago avec le conseiller municipal Byron Sigcho-Lopez, élu pour représenter le 25ᵉ district. Immigré d'Équateur, il a été élu en 2019 comme socialiste démocrate, avec l'appui des Democratic Socialists of America (DSA).
AMY GOODMAN : Nous vous souhaitons la bienvenue, conseiller municipal, à Democracy Now ! Vous avez tenu une réunion ce week-end, rassemblant des gens de partout. Vous êtes président du comité du logement et de l'immobilier. Pouvez-vous nous parler de votre réaction à la menace du président Trump ?
BYRON SIGCHO-LOPEZ : Merci, c'est un honneur d'être avec vous en ce moment critique.
Quand Trump parle comme un dictateur, beaucoup de gens réagissent : personne n'aime un dictateur. Et personne ne veut voir la normalisation de la présence de troupes militaires dans les villes américaines. Nous avons rejoint les nombreux appels de nos communautés pour défendre notre ville. Nous ne pouvons pas normaliser la militarisation, la disparition de nos voisin-es, l'enlèvement de nos voisin-es, comme nous l'avons vu le 4 juin ici dans notre ville, lorsque des hommes masqués ont tendu un véritable piège humain et kidnappé principalement des femmes de notre communauté.
Nous ne normalisons pas ; nous organisons. Nous ne désespérons pas. Nous n'avons pas peur. Nous ne nous soumettons pas aux dictateurs. Et ici, à Chicago, nous avons fait ce que nous avons toujours fait, dès que furent annoncées les déportations massives : nous nous organisons, à la grande frustration de l'administration Trump, qui a vu une communauté informée, bien organisée, et c'est ce qu'elle continuera de voir. Nous avons appris — en tant qu'ancien organisateur syndical — que le patron est souvent notre meilleur organisateur. Il est en train d'unifier notre ville. Il a uni notre communauté immigrante. Il est en train d'organiser et d'unifier notre ville plus que jamais. Désormais, nous avons des dirigeants syndicaux et religieux prêts à s'assurer que nos écoles, nos églises, nos hôpitaux soient des refuges sûrs, comme ils devraient l'être.
Et nous voulons qu'il sache que, pour la fête du Travail, alors que Trump se prépare à faire de cette fête du Travail la dernière dans notre ville, nous voulons qu'il sache que ce sera une fête du Travail historique, avec des leaders religieux et des habitant-es de toute la ville qui se rassembleront pour défendre chaque voisin-e. Non seulement des parlementaires texans fuient actuellement la violence politique de l'administration Trump, mais nous avons aussi de nombreux voisin-es qui ont été kidnappé-es, des familles entières. Nous avons encore des milliers d'enfants séparés de leurs familles depuis la première administration Trump, qui ne sont toujours pas retrouvés. Alors, ici à Chicago, nous nous organisons. Nous mobilisons des syndicalistes, des leaders religieux et communautaires pour défendre notre ville. Nous n'allons pas normaliser un dictateur. Nous n'allons pas normaliser des zones militarisées. En un temps comme celui-ci, nous nous levons et nous organisons.
JUAN GONZÁLEZ : Et, conseiller municipal, je voulais vous demander : vous représentez le 25e district, où se trouve le quartier de Pilsen, avec sa communauté mexicaine et latino historique. Quelle est la situation sur le terrain en ce moment en ce qui concerne les descentes à Chicago ? En juin, au moins une douzaine de personnes ont été arrêtées par les services fédéraux d'immigration après s'être présentées à un rendez-vous administratif de routine dans un bureau du South Loop. Quelle est la situation actuelle concernant ces descentes ?
BYRON SIGCHO-LOPEZ : Eh bien, nous avons été l'une des premières communautés ciblées par l'administration Trump. Nous avons eu, très tôt, un père arrêté après avoir déposé ses enfants à l'école. À la fin de la dernière année scolaire, l'ICE s'était installée juste à côté de l'une de nos écoles primaires, dans une laverie automatique, attendant les parents à la sortie des classes. Tout cela vise à créer la terreur, à effrayer les gens, à semer la peur, à pousser les gens à se déporter eux-mêmes. Nous voyons bien que maintenant, non seulement ils ne respectent pas les droits, mais ils utilisent la violence comme outil du fascisme. Ils n'ont pas respecté les droits constitutionnels lorsqu'ils sont entrés dans une de nos entreprises il y a quelques mois et ont arrêté deux travailleurs.
Dans notre communauté, il y a actuellement une profonde inquiétude et une peur réelle que l'administration Trump vienne arracher des familles. Ils rôdent autour des écoles, des hôpitaux, des églises. Alors, dans notre communauté, nous nous organisons. Nous dénonçons l'administration Trump qui s'attaque aux églises, aux hôpitaux, aux écoles. Nous nous préparons. Nous travaillons main dans la main avec tous les leaders communautaires, comme nous l'avons fait quand l'administration avait menacé de déportations massives. Nous nous sommes organisés.
Et maintenant, nous nous organisons avec les syndicats pour que nos leaders syndicaux, nos élus, nos leaders religieux et notre communauté en première ligne, protègent les quartiers populaires et les transforment en espaces sûrs. Et nous préparons une mobilisation massive pour le 1er septembre, jour de la fête du Travail, dirigée par le Chicago Teachers Union et bien d'autres organisations, afin que l'administration Trump voie notre dignité, notre solidarité avec Los Angeles, notre solidarité avec Washington. Nous voyons ce qui se passe. Nous devons nous assurer que cela reçoive plus de couverture médiatique. Nous invitons tous les médias à venir à Chicago.
Nous nous organisons pour protéger nos communautés. Nous sommes prêts à nous mobiliser, pas seulement à informer les gens de leurs droits. Il est clair que l'administration Trump ne respecte pas nos droits constitutionnels. Alors nous allons nous organiser pour protéger notre peuple et passer à l'offensive. Nous devons les tenir responsables des morts dans les centres de détention de l'ICE, des camps de concentration construits illégalement, et aussi des enfants séparés, des multiples atrocités. Nous sommes prêts ici à Chicago. Nous sommes une ville ouvrière forte. Nous n'allons pas normaliser le fascisme, et nous sommes prêts à affronter le dictateur de front. Et nous savons que nous pouvons vaincre le Project 2025 et le dictateur qui veut consolider son pouvoir.
JUAN GONZÁLEZ : Et, conseiller municipal, je voulais aussi vous demander : vous êtes un proche allié du maire Brandon Johnson. Quelles discussions avez-vous eues avec lui sur la manière dont il compte réagir si Trump envoie la Garde nationale, notamment concernant la réaction de la police de Chicago ?
BYRON SIGCHO-LOPEZ : Oui, nous avons été en communication étroite avec le maire Johnson, comme nous l'avions fait quand nous avons lancé une grande campagne « Connaissez vos droits », pour nous assurer que le maire sache qu'il est crucial que la ville de Chicago reste ferme. Et aujourd'hui, il se joindra à nous pour annoncer une mobilisation majeure pour la fête du Travail.
Nous avons aussi parlé de l'importance de garantir qu'il n'y ait aucune collaboration entre le département de police de Chicago et l'administration Trump. Nous avons vu ce qui s'est passé le 4 juin. Une enquête a été ouverte, de nombreux dirigeants et élus ont condamné les actions de l'ICE et toute forme de collaboration ce jour-là. Et le maire a montré son soutien à notre communauté. Il reste ferme. Il est allé à Washington défendre notre Constitution, nos lois de l'État et de la ville. Et nous sommes prêt-es à nous mobiliser pour la fête du Travail, avec le maire Johnson à nos côtés. Il n'y aura pas de collaboration entre la police de Chicago et les agents de l'ICE. Et c'est bien pour cela, selon nous, que l'administration Trump veut déployer l'armée : parce qu'elle sait qu'elle ne peut plus mener de telles opérations sans la collaboration de la police de Chicago. Cette fois-ci, il veut envoyer l'armée. Nous allons continuer à résister. Nous allons continuer à faire en sorte qu'il n'y ait aucune collaboration avec la police de Chicago.
Mais plus que tout, nous voulons assurer une mobilisation massive dans notre ville pour nous protéger mutuellement, protéger nos voisin-es. Je me réjouis que le maire Johnson se joigne aujourd'hui au lancement du mouvement de la fête du Travail pour défendre notre ville. Chicago est une ville ouvrière, une ville syndicale. Et nous allons rejoindre Los Angeles et Washington dans la lutte contre le fascisme. Et nous savons que nous allons vaincre le Project 2025 ici à Chicago. Nous sommes prêt-es, comme l'a dit ma sœur, Stacy Davis Gates, à un véritable effort pour reconstruire notre pays. Les Américain-es sont courageux. Les Américain-es ne se laisseront pas gouverner par des rois ou des dictateurs. Et ici, à Chicago, nous montrons et nous allons montrer la force du mouvement ouvrier, aux côtés des leaders religieux et de nos communautés immigrantes. Le dictateur a uni notre ville, et nous sommes prêt-es à relever le défi, car nous devons vaincre le fascisme. Le président Fred Hampton l'a dit clairement : si nous ne vainquons pas le fascisme, le fascisme finira par nous écraser tous et toutes. Alors, ici à Chicago, la terre de Fred Hampton, la terre du mouvement ouvrier, nous disons à Trump : nous n'avons pas peur. Nous ne serons pas intimidé-es. Et nous ne nous soumettrons pas à un dictateur.
AMY GOODMAN : Nous parlons avec Byron Sigcho-Lopez, conseiller municipal de Chicago.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

En Cisjordanie, le processus de colonisation s’intensifie dans l’ombre du génocide

3000 oliviers ont été déracinés par des militaires israéliens la semaine dernière dans un village près de Ramallah. Une mesure symbolique qui accompagne une augmentation des violences coloniales sur les territoires occupés depuis le 7 octobre 2023. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a publié vendredi son rapport mensuel d'information sur l'état de la colonisation en Cisjordanie.
Par l'Agence Média Palestine
Le 25 août 2025
La plantation d'oliviers détruite se trouvait à proximité d'Al-Mughayyir, un village de 4000 habitants situé au nord-est de Ramallah, dans le centre de la Cisjordanie. L'ordre de déracinement des oliviers a été donné par l'armée. Le fondement ? Les oliviers poseraient “une menace pour la sécurité” d'une route menant à une colonie israélienne qui traverse les terres du village.
Déraciner des oliviers, une destruction symbolique
Peu après leur déracinement, les habitants du village ont commencé à replanter des oliviers sur la terre encore empreinte des stigmates des bulldozers israéliens. Pendant la destruction de ces champs d'oliviers, une des militaires à bord d'un bulldozer s'est filmée en train de ravager le champ. Elle a posté la vidéo sur les réseaux, accompagnée d'une légende menaçant de détruire les habitations la fois suivante.
Une illustration de plus de la volonté des militaires israéliens de détruire et d'occuper les terres palestiniennes situées en Cisjordanie. Le chef du village Marzouq Abu Naim a d'ailleurs annoncé à l'agence de presse palestinienne Wafa que les soldats israéliens avaient “pris d'assaut plus de 30 maisons, détruisant les biens et les véhicules des habitants”.
Les oliviers sont un marqueur symbolique car ils ont une importance dans la culture palestinienne, à la fois par leur caractère ancien et leur longévité, et aussi pour leur importance dans l'économie locale. En 2011, la production d'huile d'olive représentait 57% des territoires cultivés dans les territoires palestiniens. Qui dit symbole pour le peuple palestinien, dit aussi cible privilégiée des colons israéliens. Les oliviers sont donc régulièrement déracinés, devenant un symbole du vol et de l'accaparement des terres palestiniennes par les Israéliens.
Les violences coloniales en Cisjordanie s'intensifient
Ces dégradations des biens produits sur les terres agricoles palestiniennes s'accompagnent régulièrement de violences contre les Palestiniens de Cisjordanie, allant du harcèlement jusqu'au meurtre. D'après le rapport mensuel d'OCHA publié vendredi dernier, 25 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie au mois de juillet 2025.
Entre le 1er janvier 2024 et le 31 juillet 2025, près de 40.000 Palestiniens de Cisjordanie ont été victimes de déplacement forcé, dû à la destruction de leurs terres, habitations ou cultures. Cette destruction de 3000 oliviers s'inscrit dans la même logique d'après le chercheur palestinien Hamza Zubeidat, interrogé par Al-Jazeera : “Il faut être clair : depuis 1967, Israël continue de mettre en œuvre le même plan visant à expulser la population palestinienne des campagnes et des villes de Cisjordanie. Ce qui se passe actuellement n'est que la poursuite de ce processus d'expulsion des Palestiniens. Il ne s'agit pas d'un nouveau processus israélien.”
Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les terres agricoles détruites par l'armée israélienne près du village d'Al-Mughayyir sont la principale source de revenus des habitants de cette zone. C'est plutôt la raison même qui a poussé au déracinement des oliviers, pour rendre invivable le quotidien des habitants palestiniens : “« L'arrachage des arbres, la confiscation des sources d'eau, le blocage et l'interdiction d'accès des Palestiniens à leurs fermes et à leurs sources d'eau entraînent une insécurité alimentaire et hydrique accrue”, conclut Zubeidat.
Les violences de l'armée israélienne et des colons sur les territoires palestiniens occupés peuvent aller jusqu'au meurtre, comme celui de l'activiste palestinien Awdah Hathaleen, que nous avions documenté plus tôt au mois d'août. D'après le dernier rapport d'OCHA, 671 Palestiniens ont été tués par des Israéliens entre le 1er janvier 2024 et le 31 juillet 2025, dont 113 enfants.
Il y a une dizaine de jours, la validation finale a été apportée au plan de colonisation E1, un projet massif de création de plus de 3400 logements en Cisjordanie, qui pourrait couper en deux les territoires palestiniens occupés. Ce projet est vivement critiqué par l'ONU et illégal au regard du droit international. Mais qu'importe, le régime colonisateur israélien ne s'en est jamais soucié.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Jean-Marie Brohm, "Sociologie politique du sport" Une vision totalitaire du monde

Sociologie politique du sport est une analyse freudo-marxiste du système sportif, de sa bureaucratie institutionnelle et de son idéologie élitiste. L'idolâtrie du champion, la logique aliénante du dépassement, la démultiplication permanente des spectacles sportifs relayés par les médias, les agences de publicité et les sponsors ont totalement envahi l'espace public et les loisirs.
Colonisé par les multinationales capitalistes et l'affairisme des groupes financiers, le système sportif, devenu de plus en plus opaque (dopage, corruption, violences sexuelles, racisme), fonctionne comme un appareil idéologique d'État au service des pouvoirs en place, aussi bien dans les oligarchies libérales que dans les régimes totalitaires, les dictatures militaires ou les théocraties islamiques.
Avec ses effets de diversion massive, de conformisme culturel, de mimétisme de foule et d'identification nationaliste, le sport est l'exemple type d'un opium du peuple.
– L'auteur : Jean-Marie Brohm est sociologue, professeur émérite des Universités, directeur de publication de la revue Prétentaine et membre de l'Association Internationale Interactions de la Psychanalyse (A2IP). Il est l'auteur de plusieurs ouvrages fondateurs de la Théorie critique du sport et de l'olympisme.
– Date de parution : mars 2025
– Format : 14 x 20,5 cm, 422 pages
– ISBN : 9782490070305
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Jean-Marie Brohm, "Interprétation des oeuvres musicales"

La grande diversité des interprétations d'une même oeuvre renvoie à l'énigme des compétences ou expériences des chefs d'orchestres, chanteurs et solistes dans la restitution musicale des partitions. Il existe donc un horizon imaginaire de l'oeuvre, associé aux circonstances de sa composition et aux conceptions esthétiques du compositeur, qui rend complexe l'évaluation de toute interprétation.
Sommaire :
Paradoxes de l'écoute musicale et difficultés de la critique
Hector Berlioz : La tempête romantique
Albert Roussel : L'ivresse rythmique
Charles Munch : Molto appassionato
Arnold Schoenberg, Alban Berg, Anton Webern : La rupture du dodécaphonisme
Jean Sibelius : Grand Nord et épopée de la nature
Dimitri Chostakovitch : Entre déchirements, peurs et solitude
Evgeny Svetlanov : Un chef de légende
Paul Hindemith : Motorisme et harmonie du monde
Edgard Varèse : Le son organisé
Charles Ives : Le transcendantalisme américain
Leonard Bernstein : La passion de la liberté
Arthur Honegger : Cris du monde et espérance liturgique
Bohuslav Martinů : Fantaisies et paraboles
– L'auteur : Jean-Marie Brohm est sociologue, professeur émérite des Universités, directeur de publication de la revue Prétentaine et membre de l'Association Internationale Interactions de la Psychanalyse (A2IP). Il a été membre du comité de rédaction de la revue Répertoire des disques compacts.
– Date de parution : septembre 2025
– Format : 14 x 20,5 cm, 336 pages illustrées en noir et blanc
– ISBN : 9782490070312
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Comment les riches ravagent la planète (et comment les en empêcher)

En adaptant et en mettant à jour son ouvrage de 2007, le journaliste Hervé Kempf acte l'échec de la stratégie du rapport et la sécession des ultra-riches. Décrivant la polycrise du capitalisme, il annonce le besoin d'une résistance insurrectionnelle et d'un avenir désirable.
Tiré du blogue de l'auteur.
Hervé Kempf est une figure majeure du journalisme critique en France. Suivant les pas d'un Edwy Plenel, faisant ses classes au Monde où il a assumé un engagement syndical vis à vis d'une orientation d'accompagnement du système, il co-fonde le journal écologiste Reporterre avant de s'y consacrer pleinement lorsqu'il quitte Le Monde. Auteur d'une quinzaine de livres, il adapte et mets à jour dans cet album BD son ouvrage de 2007 "Comment les riches détruisent la planète".
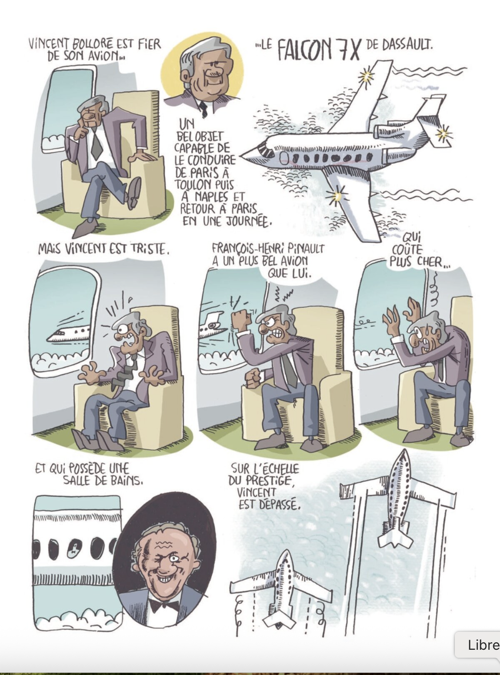
Le dispositif BD est connu et très proche du best-seller de Jean-Marc Jancovici Le monde sans fin : en mettant en scène les auteurs au milieu de figures historiques, de graphiques et de scènes humoristiques, il s'agit d'illustrer visuellement un propos parfois technique et très chiffré. Contrairement à Jancovici (auquel il s'oppose jusqu'à l'intégrer dans l'album) en revanche, Kempf assume une position radicale qui dépasse allègrement l'exposition des faits en montrant une évolution croissante de nombre d'écologistes qui clament la fin de l'information pour la lutte citoyenne face à un système capitaliste suicidaire qui se radicalise dans son refus de tout aménagement. Or l'auteur est très clair : il ne s'agit pas d'un aménagement mais d'une bascule historique qui serait nécessaire (où il rejoint Le monde sans fin sur ce point).
L'originalité du propos est de rappeler le poids pas du tout statistique mais tout à fait quantifiable du mode de vie des ultra-riches sur la crise climatique et la crise sociale et politique qui l'accompagne. Hervé Kempf dépasse alors le seul champ de l'écologie et de la justice sociale pour nous montrer l'alliance de fait du Capital (et de ses dirigeants) avec le populisme d'extrême-droite pour la préservation d'un ordre mis en danger par le choc climatique. Les évolutions sécuritaires et politiques constatées depuis plusieurs années sont une conséquence directe du risque encouru par l'ordre capitaliste. Actant comme nombre d'écologistes raisonnables l'échec de la stratégie des rapports scientifiques, il cite Nelson Mandela qui proclamait (dans les pas des Constituants de 1793 et des Pères fondateurs américains) la nécessité de la résistance violente lorsque les autres méthodes ne fonctionnent pas et que le pouvoir nous y force.
L'attaque sur les 0.01% peut paraître facile et défouloir, il demeure que la mise en cohérence de l'ensemble des éléments de la crise que nous visons (crise politique, autoritarisme et répression des contestations populaires, crise climatique, crise budgétaire, montée du fascisme, sécessionnisme,...) est très bien faite et convaincante.
Intriquant les enjeux écologiques, démocratiques et économiques, Kempf propose une vision d'ensemble et nomme les choses, comme ce "capitalisme despotique" que nombre de penseurs ont annoncé depuis le XIX° siècle. En sourcant largement ses chiffres et en concluant son propos par la nécessité d'une perspective positive pour sortir d'une résistance mortifère, l'auteur fait une démonstration courageuse et impliquante. Aux rêves citoyens !
Comment les riches ravagent la planète, et comment les en empêcher.
de Hervé Kempf et Juan Mendez
Nombre de pages : 128p.
Date de sortie (en France) : 27 septembre 2024.
Éditeur : Seuil
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le projet de loi sur le régime forestier est un important recul pour les droits des Autochtones

Déposé en avril par Québec, le projet de loi 97 visant à réformer le régime forestier fait l'objet d'une forte opposition des environnementalistes, d'experts en foresterie et des peuples autochtones.
Tiré de The conversation. Photo : Des travailleurs empilent et trient le bois d'œuvre résineux fraîchement coupé dans une usine de sciage à Mont-Blanc, au Québec. Le projet de loi 97 a été vivement critiqué par des communautés autochtones et des groupes environnementaux. La Presse Canadienne/Christinne Muschi
Les Premières Nations soulignent que le régime forestier ouvre la porte à une exploitation du territoire rappelant les débuts de la colonisation et qu'il viole leurs droits. Elles demandent à Québec que la politique soit repensée en co-construction avec les peuples autochtones concernés.
Ces nations ont-elles de tels droits ? Tout à fait. Voici pourquoi.
Professeure adjointe à l'Université de Montréal en droit constitutionnel, droits et libertés et droit autochtone, je suis une fière Wendat.
Vers un retour à l'exploitation intensive de la forêt ?
N'ayant de « moderne » que le nom, la Loi visant principalement à moderniser le régime forestier, portée par la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, propose plutôt un retour en arrière. Elle rappelle les images du tristement célèbre film documentaire L'erreur boréale de Richard Desjardins. Ses conclusions de surexploitation de la forêt avaient été essentiellement confirmées en 2004 par la Commission Coulombe sur les forêts publiques.
Le régime proposé diviserait le territoire forestier public en trois zones dédiées à l'aménagement forestier prioritaire, à la conservation et au multi-usage. L'aménagement « prioritaire » représenterait le tiers du territoire et permettrait son exploitation intensive. Dans cette zone comme dans la zone multi-usage, c'est l'industrie elle-même qui gouvernerait les activités d'aménagement, incluant la sélection des secteurs de coupe.
Pire, l'article 17.5 prévoit que « toute activité ayant pour effet de restreindre la réalisation des activités d'aménagement forestier aux fins d'approvisionner une usine de transformation du bois dans une zone d'aménagement forestier prioritaire est interdite ». Autrement dit, même si les communautés locales ont des droits légitimes sur ces territoires, toute activité de conservation ou visant l'exploitation à des fins économiques des ressources par les peuples autochtones eux-mêmes seraient interdites.
L'interdiction est si générale qu'elle permet aussi de se demander si Québec entend respecter son obligation constitutionnelle de consulter les nations visées avant que ne soit émise chaque autorisation d'exploitation du territoire.
Une violation claire des droits des peuples autochtones
Même si cela n'a pas toujours été le cas, le droit constitutionnel canadien reconnaît aujourd'hui de façon claire les droits ancestraux et issus de traités des peuples autochtones. Selon la Cour suprême du Canada, ces droits incluent notamment le pouvoir de participer à la gouvernance de leurs territoires. Les gouvernements ont donc l'obligation, avant toute décision pouvant nuire à ces droits, qu'ils soient déjà établis ou simplement revendiqués de manière crédible, de consulter les peuples autochtones, de chercher à les accommoder et, dans certains cas, de les indemniser.
Cette obligation découle du principe juridique de l'honneur de la Couronne, un principe selon lequel l'État doit agir de manière honorable envers les peuples autochtones, dans un esprit de réconciliation.
L'idée d'interdire « toute activité » restreignant l'exploitation intensive de la forêt dans la zone d'aménagement prioritaire apparaît donc à sa face même ignorer les droits autochtones bien reconnus.
Le projet de loi 97 viole également la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, adoptée en 2007, que le Canada s'est engagé à mettre en œuvre. Dans ses articles 10 et 28, la Déclaration interdit de retirer ces peuples de leurs territoires sans consentement et réparation. Ailleurs, elle protège notamment le droit d'utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les territoires et ressources occupés traditionnellement selon leurs propres modes de gouvernance. La Déclaration garantit aussi le droit des peuples autochtones à la préservation de leur environnement.
En particulier, les articles 18 et 19 de la Déclaration obligent les États à inclure les peuples autochtones dans tout processus décisionnel pouvant affecter leurs droits. De telles politiques ne peuvent être adoptées sans leur consentement préalable, libre et éclairé.
La Cour suprême du Canada a récemment confirmé que la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones a une portée juridique réelle : elle constitue un instrument international permettant d'interpréter le droit canadien, notamment depuis son intégration à la loi fédérale adoptée en 2021. Cette loi « impose au gouvernement du Canada l'obligation de prendre, en consultation et en collaboration avec les peuples autochtones, « toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les lois fédérales soient compatibles avec la Déclaration ».
D'autres tribunaux commencent aussi à s'y référer pour préciser les obligations des gouvernements en matière de droits ancestraux et de consentement.
Le Québec fait bande à part en refusant toujours de reconnaître la Déclaration. Or, de la même manière qu'il aurait été intenable, après les atrocités de la Seconde Guerre mondiale, de refuser la Déclaration universelle des droits de la personne adoptée en 1948, il est aujourd'hui impensable de nier les droits fondamentaux des peuples autochtones. Ces droits, ancrés dans leur histoire, leur territoire et leur souveraineté, ne peuvent plus être ignorés en 2025 comme ils l'ont été au début de la colonisation.
D'autres modèles existent pourtant, comme celui de la forêt communautaire pour lequel la Colombie-Britannique fait figure d'exemple. Les ententes qui en découlent permettent notamment une distribution plus équitables des profits et des investissements en éducation, en infrastructures et en loisirs. Elles peuvent également inclure des avantages sociaux, culturels et écologiques pour les communautés, en plus d'assurer une adaptation aux changements climatiques et de réduire les risques de feux de forêt.
Coconstruire un régime forestier avec les peuples autochtones
La tendance juridique est claire. La mise en œuvre de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones est amorcée. Les tribunaux interprètent désormais le droit canadien à sa lumière. Cette évolution va au-delà du simple droit d'être consultés : c'est le principe du consentement qui s'impose progressivement pour respecter les droits inhérents des peuples autochtones, fondés sur leur « souveraineté préexistante », c'est-à-dire leur statut de nations autonomes qui exerçaient déjà leurs propres formes de gouvernance bien avant la colonisation.
Moderniser le régime forestier québécois exige d'aller en sens inverse de l'approche de Québec. Revenir vers une exploitation intensive des forêts nie les droits des peuples autochtones déjà bien reconnus et mènera inévitablement à des contestations judiciaires.
Une approche moderne reconnaîtrait les droits fondamentaux des nations touchées et les considérerait d'égal à égal pour développer une politique équitable. Pour reprendre les mots de la Cour suprême, une telle démarche participerait d'une véritable « justice réconciliatrice ».
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Privatisation de la production d’électricité : investissements publics opaques et coûteux

L'Alliance de l'énergie de l'Est, sa société en commandite privée et sa société par actions, de connivence avec la CAQ, viennent de flouer une fois de plus les Québécoises et les Québécois. Le secteur Énergie du SCFP rappelle que les 6 000 MW d'éoliennes signifient qu'on ajoutera des milliers de poteaux et de pales dans les territoires du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, pour une énergie intermittente qui aurait plutôt dû être située là où c'est le plus efficace, c'est-à dire dans la région de la Baie-James. De plus, l'ajout de cette capacité pourrait impacter la stabilité du réseau d'Hydro-Québec.
On a appris hier que 18 milliards de dollars sont investis alors que le modèle privé de l'Alliance de l'énergie de l'Est, qui s'appuie sur des municipalités et des régies intermunicipales de l'électricité, ne tient pas la route.
« Fait inusité, la Commission municipale du Québec n'a jamais voulu enquêter sur des faits troublants : la Régie intermunicipale de l'énergie du Bas-Saint-Laurent est lourdement déficitaire depuis deux ans, avec plus de 25 millions de dollars de pertes. En effet, dans le Rapport financier consolidé 2024, disponible sur le site du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation[1], on rapporte un déficit accumulé, lié aux activités, à la fin de l'exercice, de 25,2 millions de dollars en 2024 et de 24,9 millions de dollars en 2023 », d'expliquer le président du secteur énergie du SCFP-Québec, Frédéric Savard.
« Nous avons toujours su que le premier ministre voulait donner au privé la production d'électricité. Il y a déjà 4 000 MW d'éoliennes privées au Québec, on en aura 10 000 MW. C'est plus que 25 % du total en privé ce qui constitue un retour en arrière considérable. Il faut se demander où ira l'argent public et comment il sera dépensé », s'interroge, à juste titre, le président du secteur Énergie.
Oui à plus d'énergie propre, mais au public !
Produire plus d'électricité pour favoriser l'électrification des transports ou pour diminuer les émissions de carbone de l'industrie est une nécessité, à l'heure de l'urgence climatique. Toutefois, il n'y a aucun plan viable en ce sens au gouvernement actuel ! La véritable intention de François Legault est de faire croire aux régions dévitalisées du Québec, qui ont cruellement besoin de projets structurants pour leur économie régionale, que la structure bancale et opaque de l'Alliance de l'énergie de l'Est et consorts sera une bonne chose pour leur développement, en échange de votes stratégiques en vue de la prochaine élection !
« Nous allons continuer à nous battre contre ce gouvernement qui, malgré les preuves récurrentes d'incompétence et d'irresponsabilité, continue de forcer des investissements publics pour générer des profits privés ! », de conclure Frédéric Savard.
Notes
[1] https://www.mamh.gouv.qc.ca/documentsfinanciersweb/Rapport-financier-2024-et-autres-R7010.pdf
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les cent pires citations sionistes

Jean-Pierre Bouché
Michel Collon
En donnant la parole uniquement aux dirigeants d'Israël, Jean-Pierre Bouché et Michel Collon révèlent la différence entre le discours officiel et la pensée réelle de ses fondateurs, présidents, ministres et militaires.
De 1895 à aujourd'hui, ils y exposent sans filtre leur stratégie. Et cela pourrait vous surprendre... Indispensable pour comprendre et convaincre !
Extrait de l'introduction :
De quoi avez-vous besoin ? Quels problèmes rencontrez-vous lorsque vous discutez d'Israël ? Voici les réponses que l'on reçoit en général quand on pose cette question :
1. « L'émotion. La discussion est vite tendue, cela empêche le dialogue. »
2. « Le manque de connaissances. Les gens ignorent l'Histoire. »
Ces deux problèmes, notre livre va vous aider à les résoudre. Certes les émotions face aux guerres sont légitimes. Mais l'émotion, ça se manipule. À chaque guerre, une propagande organisée par des professionnels avec de gros moyens, s'efforce de nous faire basculer dans « le bon camp ». Les armes de destruction massive en Irak ne furent qu'un exemple parmi d'autres fake news souvent passées inaperçues du public. L'émotion court-circuitant la raison, on ne cherche plus les faits manquants, ni les causes profondes du conflit.
En ce qui concerne le manque de connaissances, ce livre vous propose une solution toute simple : écouter les sionistes. Écoutez les précurseurs du projet d'État juif depuis 1895 ! Écoutez les fondateurs de l'État d'Israël en 1948 ! Écoutez les présidents, ministres et militaires qui ont géré les nombreuses guerres et l'expansion constante du territoire : 1967, 1973, 2000, 2006, 2009, 2014… À chaque fois, quand ils parlent entre Israéliens, ils tiennent un discours complètement opposé à leur com officielle destinée à l'opinion publique internationale.
Vous serez étonnés de constater qu'en fait, ils ont tout écrit noir sur blanc. Nos 100 pires citations exposent leurs plans, la violence jugée « nécessaire » et la façon aussi de tromper l'opinion internationale. « On peut mentir, dans l'intérêt de la Terre d'Israël », déclarait le Premier ministre Shamir en 1992.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le mouvement syndical doit être repensé pour la nouvelle ère politique canadienne

Le mouvement syndical canadien a évité de justesse la catastrophe lors des élections fédérales d'avril. La balle tirée par la droite a été légèrement déviée grâce à la décision collective des électeurs de regrouper le vote du centre-gauche derrière les libéraux de Marc Carney. Mais l'affaire a été très serrée, après une succession de vagues politiques qui ont vu, à la toute fin, un retour de l'électorat ouvrier vers les conservateurs – les présumés vainqueurs – jusqu'à ce que le nouvel impérialisme américain menace la souveraineté canadienne et change fondamentalement la dynamique et la direction de la politique fédérale.
12 août 2025 | tiré de Canadian dimension | Photo : Des membres d'Unifor défilent lors de la parade de la Fête du travail à Toronto. Photo : Mary Crandall.
https://canadiandimension.com/articles/view/labour-needs-an-overhaul-for-the-new-era-of-canadian-politics
Les syndicats ont accueilli ce résultat avec soulagement et cherchent désormais des points d'influence et de collaboration avec le gouvernement Carney afin de protéger les acquis passés et défendre les intérêts des travailleurs dans la guerre commerciale en cours et dans le programme de « construction nationale » à venir. Le mouvement syndical dispose de quelques sièges aux tables de concertation du nouveau gouvernement, mais il n'est qu'un groupe d'intérêt parmi d'autres dans le vaste camp « Équipe Canada ». De plus, le mouvement ouvrier aborde cette nouvelle ère politique avec une liste considérable de problèmes. Le plus important est que sa campagne de 2025 n'a eu qu'un impact limité sur les travailleurs, et l'absence de stratégie politique cohérente et unificatrice a laissé le mouvement syndical vulnérable.
Ni le mouvement syndical ni le NPD n'ont réussi à freiner ou inverser la tendance mondiale au « désalignement » (dont j'ai récemment parlé dans Canadian Dimension), qui voit les électeurs ouvriers abandonner les partis traditionnels de la classe laborieuse pour se tourner vers le populisme de droite. Le dépouillement a montré que le désalignement de la classe ouvrière était encore plus marqué au Canada. Si seuls les votes ouvriers avaient compté, le populisme de droite de Poilievre et son faux « conservatisme ouvrier » auraient probablement triomphé. Selon une analyse post-électorale d'EKOS, la poussée conservatrice a été « largement alimentée par des populistes de droite… plus jeunes, massivement masculins, diplômés du collégial, plus présents dans la classe ouvrière que dans la classe moyenne ».
Alors que le gouvernement Carney approche de ses 100 jours au pouvoir, il bénéficie encore d'un taux d'approbation majoritaire, et la vague conservatrice de la fin de campagne a reculé. Mais les profondes divisions au sein de la classe ouvrière, accumulées au fil de la dernière décennie, demeurent. Les résultats de 2025 envoient un puissant message : un dialogue non partisan avec des millions de travailleurs ne peut plus attendre.
Or, alors que certains syndicats s'apprêtent à se lancer dans le processus de révision électorale et de renouvellement du leadership du NPD qui commencera en septembre, rien n'indique pour l'instant que le mouvement syndical lui-même entreprendra un examen critique de ses propres performances et stratégies politiques.
Il ne sert à rien de minimiser la montée du conservatisme dans une large partie de la classe ouvrière, y compris dans les rangs syndicaux. En 2025, plusieurs circonscriptions à forte densité syndicale ont basculé vers le Parti conservateur, renversant des sièges cruciaux comme Windsor-Ouest, où le vote conservateur a bondi de 23 %.
D'autres basculements en Ontario (Brampton-Ouest, London–Fanshawe, Kitchener-Sud) et en Colombie-Britannique (Skeena–Bulkley Valley, Nanaimo–Ladysmith, Cowichan–Malahat–Langford), souvent d'anciens bastions néo-démocrates, ont attiré l'attention médiatique. Mais comparé à 2015, quand le vote syndical avait joué un rôle décisif pour battre Harper en réduisant le soutien conservateur chez les syndiqués à 24 %, la progression conservatrice a été continue dans la plupart des circonscriptions ouvrières. Dans 50 circonscriptions fortement ouvrières en anglais canadien, définies par le revenu salarial, le travail manuel, l'emploi manufacturier et de services, ainsi que le niveau d'éducation, le soutien aux conservateurs a augmenté à chaque scrutin : une hausse de 6 % entre 2015 et 2025.
Depuis 2015, cette poussée conservatrice avait été en partie masquée par dix années de gouvernements libéraux qui ont abrogé des lois antisyndicales, élargi les programmes sociaux et soutenu les droits syndicaux. L'opinion publique envers les syndicats s'était améliorée, et les conditions post-COVID du marché du travail avaient permis de fortes avancées à la table de négociation, dont une hausse historique des grèves. Mais sous la surface, des tensions politiques et culturelles se développaient, accompagnées d'un déclin continu de la syndicalisation dans le secteur privé. En 2025, ce désalignement a brisé les barrières et s'est imposé comme une force visible et puissante dans le mouvement syndical.
- Seule une poignée de syndicats a rompu avec la tradition en appuyant officiellement des candidats conservateurs, mais ces gestes ont marqué une élection où les appuis officiels au NPD et aux libéraux ont aussi été rares. Outre les syndicats policiers, les conservateurs ont reçu le soutien officiel de la Fraternité internationale des chaudronniers, de la Fraternité des charpentiers du Nouveau-Brunswick, des Plombiers et tuyauteurs, section locale 67 de Hamilton, de sections locales de la FIOE à Windsor, Regina et Québec, ainsi que des Métallos, section locale 2251 à Sault Ste. Marie. Le syndicat des travailleurs du bâtiment (Labourers International Union) n'a pas officiellement endossé les conservateurs, mais a soutenu leur campagne « Boots Not Suits » visant les travailleurs de la construction, et a accueilli un des grands rassemblements de Poilievre en fin de campagne.
« Ces appuis ont suivi l'élection provinciale en Ontario, où huit organisations des métiers de la construction ont appuyé le Parti progressiste-conservateur de l'Ontario, tout comme une section locale des téléphonis d'Unifor et une section locale des travailleurs de l'automobile d'Unifor. »
À l'inverse, trois syndicats nationaux – le SCFP, les Métallos (USW) et l'ATU – ont officiellement soutenu le NPD, tandis que les Ingénieurs d'Ontario et les Charpentiers de l'Ontario appuyaient les libéraux. La grande majorité des syndicats ont toutefois évité tout endossement formel, préférant se concentrer sur les enjeux et les campagnes de mobilisation électorale.
Les campagnes syndicales de 2025 ont opposé au populisme conservateur un populisme centré sur les travailleurs, mettant en garde contre le bilan antisyndical de Poilievre et des conservateurs. Le Congrès du travail du Canada a rapporté le 1er mai que plus de 40 000 personnes avaient signé sa campagne « Workers Together ». Lancée en début d'année avec une conférence d'action politique, elle produisit un programme détaillé, une offensive sur les réseaux sociaux et des porte-à-porte en avril.
Les plus grands syndicats ont mené leurs propres campagnes d'information et de mobilisation. La plus importante, Unifor Votes, comptait 78 organisateurs et a mené des opérations dans 25 circonscriptions clés. USW Votes a mobilisé ses membres dans quatre circonscriptions, CUPE Votes a produit du matériel électoral et fait du porte-à-porte, tandis que UFCW Votes a organisé des groupes de discussion. Malgré tout, moins de syndicats se sont inscrits comme tiers participants qu'aux élections précédentes.
« Malgré ces campagnes, moins d'organisations syndicales canadiennes se sont inscrites pour participer directement à l'élection de 2025 que lors des scrutins précédents. Cela inclut 13 syndicats nationaux (Canada's Building Trades, CAPE, CFNU, Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants, STTP, SCFP, FTQ, NUPGE, AFPC, TUAC, IPFPC, Métallos et Unifor), quatre syndicats provinciaux (BCGEU, HEU, EFTO et ONA), deux sections locales (SCFP 4400 et Vancouver IFF) ainsi que le Toronto and York Labour Council (les données complètes sur les dépenses syndicales de tiers ne seront disponibles qu'en septembre). »
Globalement, les campagnes syndicales ont eu un impact modeste, sans égaler l'urgence ressentie par la population qui a propulsé la coalition anti-conservatrice et le plus haut taux de participation électorale depuis 1993.
La stratégie politique du mouvement syndical a subi un test de résistance en 2025, et n'a pas bien résisté. Pour la majorité des syndicats dont l'objectif principal était d'empêcher un gouvernement hostile, l'élection a été beaucoup trop serrée. Pour ceux qui voient le NPD comme le bras politique du mouvement ouvrier, 2025 fut dévastateur. Aucun camp ne peut se dire satisfait.
Les lourdes pertes du NPD l'ont repoussé aux marges de la politique fédérale, déclenchant une année de remise en question et de renouvellement de la direction. Le mouvement syndical s'est retrouvé avec beaucoup moins d'alliés au Parlement. Attribuer cette défaite uniquement au « vote stratégique » occulte des mutations plus profondes de l'opinion ouvrière, qui ont fracturé les loyautés partisanes et partagé le vote entre libéraux et conservateurs. Selon Abacus, 21 % des électeurs NPD de 2021 ont voté conservateur en 2025, et sur 17 sièges perdus, 10 sont allés aux conservateurs.
Une partie importante du mouvement syndical demeure fidèle au NPD et misera sur son renouvellement. Un NPD revitalisé, renouant avec ses racines ouvrières, pourrait redynamiser la politique de classe. Mais sans un engagement plus large du mouvement syndical et une volonté claire de transformer le parti, ce virage reste peu probable.
D'autres syndicats, eux, chercheront à forger des relations institutionnelles à divers niveaux de gouvernement. Mais cette approche manque aussi de souffle pour placer la politique ouvrière au cœur de l'agenda national.
Les revendications syndicales envers le gouvernement Carney portent surtout sur la sécurité de l'emploi et des revenus. « Nous avons besoin de plus que de simples solutions temporaires, écrivait la présidente du CTC, Bea Bruske, deux semaines après l'élection. Il faut une stratégie globale qui ne laisse aucun travailleur derrière. »
Unifor a été plus loin en réclamant un programme économique national immédiat, incluant des pénalités contre les entreprises délocalisant aux États-Unis, une expansion du réseau ferroviaire national, un pacte de défense avec l'Europe, un resserrement des règles sur les minéraux critiques, ainsi qu'un programme national de logement visant à protéger et développer l'emploi forestier.
« Pourtant, à de rares exceptions près, le mouvement syndical est resté largement spectateur lorsque le gouvernement Carney a fait adopter sa loi phare, le projet de loi C-5, la Loi sur la construction du Canada. Cette loi déréglemente de façon spectaculaire les processus d'approbation des grands projets, qui devraient provenir en grande partie de promoteurs du secteur privé. Le gouvernement n'adoptera pas une “approche descendante… disant nous voulons ceci, nous voulons cela”, a déclaré Carney au début de juillet. »
Le lobby patronal, comprenant le Business Council, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, la Chambre de commerce et les think tanks de droite allant du Fraser Institute au C.D. Howe Institute, a pour sa part inondé le gouvernement de demandes. Celles-ci réclament d'amples réductions et crédits d'impôt pour les entreprises, des mesures d'austérité gouvernementale dans l'ensemble des ministères et un soutien inconditionnel aux oléoducs et gazoducs, entre autres. Le Fraser Institute et le Macdonald-Laurier Institute ont également été à l'avant-garde des appels à démanteler la gestion de l'offre dans l'agriculture canadienne.
Comme lors de la campagne électorale, la présence et l'action politiques du mouvement syndical devront être considérablement renforcées s'il veut avoir la moindre chance d'influencer les choix et l'orientation du gouvernement Carney. Il faut plus qu'une politique industrielle nationale : des protestations politiques, des actions directes et même des grèves seront nécessaires pour montrer aux décideurs que les travailleurs ne resteront pas passifs dans l'attente d'investissements du secteur privé censés garantir la sécurité d'emploi et protéger leurs droits face aux guerres commerciales et à l'agression des États-Unis contre les travailleurs canadiens.
Cela a déjà été fait. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les syndicats canadiens ont relié les revendications des travailleurs à l'intérêt national. Entre 1941 et 1943, les grèves dans les industries clés de guerre — bien qu'illégales au regard des règlements d'exception — ont obtenu l'appui de la population et ont mené à l'Arrêté en conseil 1003 en 1944, qui établissait la reconnaissance et l'accréditation syndicales. La grève de Ford à Windsor en 1945 a ensuite assuré l'adoption de la formule Rand sur la sécurité syndicale — une percée majeure qui a nourri la croissance du syndicalisme. Deux ans plus tard, dans l'immédiat après-guerre, des grèves coordonnées de travailleurs forestiers de la côte Ouest, de marins des Grands Lacs et de travailleurs du textile au Québec ont consolidé la formule Rand et gagné la semaine de travail de 40 heures à l'échelle nationale.
Comme l'a écrit Charles Lipton dans son ouvrage de référence The Trade Union Movement of Canada :
« Il a été nécessaire que le mouvement syndical mène ce type de lutte pour les conditions de travail et l'organisation, afin de consolider les travailleurs et de combiner leurs besoins économiques élémentaires avec la cause générale de la victoire sur le fascisme. Le renforcement du mouvement est devenu décisif. C'est ce qui s'est produit : pour les syndicats, ces années furent celles de progrès sans précédent, avec des bonds gigantesques en matière de membership, d'unité et de conscience. »
Rien ne résonnera davantage auprès de la classe ouvrière élargie — syndiquée ou non syndiquée — qu'une action politique et économique de masse. Tout aussi urgent, toutefois, est le besoin de confronter le conservatisme ouvrier, à la fois dans la société en général et à l'intérieur des syndicats, par le dialogue et l'éducation. Un engagement significatif nécessitera une mobilisation sectorielle et communautaire d'envergure, ainsi que des liens plus solides avec les mouvements sociaux enracinés dans les communautés ouvrières. À l'heure actuelle, ces objectifs ne constituent ni des priorités centrales de l'organisation et de l'action politiques syndicales, ni des thèmes communs de discussion parmi les dirigeants et stratèges syndicaux.
Il existe des points de départ clairs pour un nouveau dialogue de classe. Les programmes d'éducation syndicale doivent disposer de plus de ressources, avec des contenus et des méthodes mis à jour, conçus pour relever le défi générationnel du conservatisme ouvrier. Les organisateurs et formateurs devront aussi dépasser leur focalisation traditionnelle sur les salaires et les enjeux liés au lieu de travail.
L'accessibilité n'était pas le seul, ni même le principal facteur qui a poussé des électeurs ouvriers vers les conservateurs en 2025. L'analyse d'EKOS sur la polarisation a révélé de fortes divisions à l'intérieur de segments spécifiques de la classe ouvrière : les jeunes hommes manifestaient des niveaux élevés de méfiance envers les institutions et étaient fortement exposés à la désinformation, tandis que des enjeux sociaux et de santé, comme la vaccination, se sont avérés de puissants prédicteurs du comportement électoral.Un écart entre les sexes sans précédent — les femmes ayant montré une forte résistance aux appels conservateurs — souligne la nécessité d'une approche intégrée qui prenne en compte à la fois les préoccupations économiques et culturelles.
Le cœur du conservatisme ouvrier est également tout proche pour les syndicats canadiens. Les métiers spécialisés constituent une circonscription clé de la classe ouvrière, et ils ont été à l'avant-garde du basculement vers le conservatisme et le populisme. Dans 25 circonscriptions fédérales de la classe ouvrière en anglais canadien, où la concentration des métiers spécialisés est la plus forte, les conservateurs en ont remporté 23 lors de chacune des quatre élections depuis 2015. D'autres facteurs régionaux expliquent aussi ces résultats, mais la corrélation entre les métiers et les stratégies politiques conservatrices fait des travailleurs spécialisés la première ligne dans la lutte pour la conscience de classe ouvrière.
Il existe cependant des tendances encourageantes dans la classe ouvrière canadienne, qui peuvent et doivent être mises à profit. De façon générale, les travailleurs à faible revenu n'ont pas adhéré au populisme conservateur. Dans les 50 circonscriptions fédérales de l'anglais canadien ayant les revenus médians les plus bas, seulement 16 ont élu des conservateurs et moins de 10 ont montré une croissance substantielle du soutien conservateur entre 2015 et 2025. Dans 12 cas, le soutien conservateur a même reculé.
Le désalignement peut être global, mais il n'est pas universel. Il existe des majorités démographiques et des communautés résilientes et combatives sur lesquelles on peut compter pour répondre positivement à un appel large et de classe de la part des syndicats canadiens. Mais si la politique syndicale reste de faible intensité, avec des stratégies fragmentaires, et que le glissement supplémentaire de la classe ouvrière vers le populisme de droite n'est pas freiné, il pourrait ne pas être possible d'éviter la prochaine balle. Pour élever la sécurité d'emploi et les droits des travailleurs au rang d'enjeux centraux et déterminants de la vie politique canadienne, il faudra une refonte du programme et des stratégies politiques du mouvement syndical.
Fred Wilson écrit sur les enjeux syndicaux et sociaux. Il est retraité d'Unifor et auteur de A New Kind of Union (Lorimer, 2019). Il est également bénévole comme conseiller pour le projet Mexico Worker Rights Action (CALIS). Suivez ses publications sur Bluesky et Medium.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Déclaration de Bea Bruske sur le plan de Carney de supprimer les contre-droits de douane américains

Les syndicats du Canada refusent d'accepter que les sanctions douanières imposées à nos industries d'exportation critiques soient devenues la « nouvelle norme ». Ces droits de douane s'en prennent aux travailleuses et travailleurs canadiens et à notre économie, et notre gouvernement doit tenir bon. Nous ne pouvons pas nous soumettre aux exigences de Donald Trump.
Soyons clairs : la capitulation n'a rien permis d'obtenir de plus pour le Canada de la part de Trump. Qu'il s'agisse de supprimer la taxe sur les services numériques ou de faire des concessions sur la sécurité des frontières, céder n'a fait qu'affaiblir nos industries et nuire aux travailleuses et travailleurs. Supprimer les contre-droits maintenant ne ferait que donner une fois de plus à Trump une victoire facile tout en faisant subir les conséquences aux travailleurs et aux collectivités du Canada.
Les contre-droits de douane n'ont rien de symbolique. Ils constituent la ligne de défense du Canada dans cette guerre commerciale qui s'intensifie. Abolir les contre-droits de manière unilatérale maintenant serait trahir le mandat clair confié au premier ministre par la population canadienne : lutter contre la guerre commerciale de Trump et défendre les bons emplois canadiens.
Se plier aux pressions de Trump n'est pas une option. Il est temps de répliquer avec force, de défendre les travailleuses et travailleurs et de déployer tous les outils disponibles pour protéger nos industries et nos collectivités. Le premier ministre Carney doit se servir du grand pouvoir de négociation du Canada pour empêcher la décimation d'industries indispensables et la perte de milliers de bons emplois.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Course contre la montre : le projet de maison d’hébergement Marie-Claire Kirkland-Casgrain est à quelques jours d’être compromis faute d’engagement du gouvernement du Québec

Sans réponse de la Société d'habitation du Québec d'ici une semaine, l'offre d'achat pour la future Maison Marie-Claire Kirkland-Casgrain tombera. « Nous sommes littéralement suspendus à une décision du gouvernement du Québec, et chaque jour de silence nous rapproche d'une annulation pure et simple du projet », déplore Myriam Lafrance, directrice du projet. « Le financement de l'exploitation est confirmé, mais sans engagement pour l'immeuble, nous ne pouvons pas aller de l'avant. »
En février dernier, une offre d'achat a été déposée pour l'acquisition d'un lieu avec l'objectif d'y accueillir jusqu'à 20 femmes et enfants fuyant la violence conjugale.
Plus de deux mois après avoir déposé son dossier à la Société d'habitation du Québec (SHQ), ce silence prolongé, malgré des échanges antérieurs encourageants, place le projet d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale dans une situation critique, à quelques jours seulement de l'échéance de son offre d'achat.
Depuis le dépôt du dossier complet à la SHQ, qui a exigé à l'organisme un engagement de fonds, l'équipe du projet s'attendait à une réponse rapide compte tenu de l'engagement du gouvernement à ouvrir cette nouvelle ressource rapidement. À ce jour, aucune confirmation n'a été émise, bien que toutes les analyses techniques du projet soient, à notre connaissance, complétées. Cette absence de réponse empêche également le dépôt du dossier à la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), qui exige l'aval préalable de la SHQ.
Un projet promis, mais toujours bloqué
En 2021, le gouvernement Legault annonçait l'ajout de quatre nouvelles maisons d'hébergement pour répondre à la hausse inquiétante des demandes d'hébergement par les victimes de violence conjugale. Le projet Marie-Claire Kirkland-Casgrain fait partie de ces initiatives saluées par la communauté et soutenues par les autorités locales. Bien que le financement pour les services ait été octroyé par le ministère de la Santé et des Services sociaux, aucun financement n'a été prévu pour la construction de la nouvelle maison. Comment est-ce possible d'offrir de l'hébergement sans toit ?
« Les déclarations ne suffisent plus. Il faut maintenant des actes. Il est inacceptable qu'un projet jugé prioritaire par l'ensemble du gouvernement soit bloqué par un simple manque de réponse administrative », insiste Louise Riendeau, du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale.
Le temps presse
Le projet est maintenant dans une course contre la montre : si aucun engagement ferme n'est reçu dans les prochains jours, l'offre d'achat tombera à l'eau. Cela signifierait la perte d'un lieu déjà identifié, évalué et validé, et possiblement la fin du projet dans sa forme actuelle.
« Comme OBNL, nous avons déjà engagé des sommes importantes pour faire avancer ce projet. Nous ne pouvons pas porter seuls le risque d'un silence gouvernemental », rappelle Myriam Lafrance.
Une situation symptomatique
Ce retard s'inscrit dans un contexte plus large de lourdeur administrative et de flou entre les responsabilités provinciales et fédérales. D'autres projets de maisons d'hébergement pour femmes sont également ralentis au Québec, pris dans les dédales bureaucratiques.
Nous demandons officiellement à la ministre de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, de sortir de ce silence et de confirmer l'engagement de la SHQ dans ce projet. Il est encore temps d'agir — mais le temps presse.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La CSD invite ses membres à participer à la Marche mondiale des femmes 2025

La Marche mondiale des femmes revient à Québec le 18 octobre 2025 ! Cet événement d'envergure, qui n'a lieu qu'aux cinq ans, est une occasion unique de se rassembler et de faire entendre nos voix pour l'égalité, la justice sociale et le respect des droits des femmes.

Une histoire de luttes et de victoires
La Marche Du pain et des roses de 1995 a donné l'élan aux Marches mondiales des femmes, organisées aux cinq ans depuis l'an 2000. Ensemble, ces grandes mobilisations ont permis des avancées majeures au Québec, notamment :
– L'adoption de la Loi sur l'équité salariale
– La création des Centres de la petite enfance (CPE)
– La mise en place du Régime québécois d'assurance parentale
– L'introduction du harcèlement psychologique et sexuel dans la Loi sur les normes du travail
– L'ajout de congés pour obligation familiale dans la Loi sur les normes du travail
– L'enquête nationale sur les femmes et filles autochtones disparues et assassinées
Ces gains nous rappellent que marcher et se mobiliser, ça donne des résultats concrets.
Revendications 2025
En 2025, nous marcherons encore, car les droits des femmes demeurent fragilisés. Nos revendications :
– Vivre en paix et en sécurité
– Pouvoir faire ses propres choix libres et éclairés
– Avoir accès à un revenu décent pour assurer une autonomie économique et vivre dans la dignité
– Bénéficier de services publics gratuits et universels de qualité (santé, services sociaux, éducation)
– Protéger l'environnement et vivre dans un milieu sain et respectueux des communautés et de la biodiversité
Un rendez-vous historique
La CSD a toujours été présente à ces grandes mobilisations. Chaque marche est un moment fort de solidarité, de fierté et de mémoire collective. En 2025, soyons encore nombreuses et nombreux à marcher ensemble pour faire avancer les droits des femmes.
👉 On vous attend à Québec le 18 octobre 2025 !
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Lettre ouverte | Le réseau d’éducation a besoin de prévisibilité, pas de surprises

L'éducation est une forme de contrat social, celui qui fait de l'égalité des chances un socle commun. C'est un pilier fondamental de notre société, une promesse faite à chaque enfant, à chaque famille, à chaque génération. Pourtant, année après année, notre réseau d'éducation est contraint de fonctionner dans un climat d'incertitude budgétaire qui varie selon les aléas et les choix politiques et qui fragilise tout le système. C'est ce que nous dénonçons aujourd'hui d'une voix commune. Il faut faire les choses autrement. Pour nos jeunes, leurs parents ; pour l'avenir du Québec.
En cette rentrée scolaire 2025, un moment central dans la vie de nos jeunes, de centaines de milliers de familles et du personnel à pied d'œuvre dans le réseau, tout le monde travaille avec ardeur pour que tout se déroule bien. Mais à quel prix ? Nous posons sérieusement la question.
Impossible d'entamer cette nouvelle année scolaire sans revenir sur la saga des coupes budgétaires du début de l'été.
D'une part, la marche arrière du gouvernement demeure partielle et ne règle en rien les problèmes déjà présents dans le réseau. Plus encore, les conditions imposées avec ce retour d'investissements budgétaires – telles que la reddition de comptes accrue et le resserrement administratif – accentuent le manque de prévisibilité dans le financement du réseau et constituent un écueil pour une planification stratégique. C'est vrai pour l'année qui débute, alors inutile de parler à moyen et long terme.
Une chose est claire pour nous : il faut garantir plus de prévisibilité au réseau d'éducation.
À quand des investissements cohérents et prévisibles en éducation qui ne se retrouvent pas, année après année, à la merci des budgets et des agendas politiques ?
La prévisibilité budgétaire n'est pas un caprice administratif : c'est une condition de base pour garantir la cohérence, la continuité et la qualité des services éducatifs. On demande beaucoup de choses à l'école, mais on ne lui donne pas les moyens d'y arriver.
Cette incertitude génère également un stress inutile sur les différentes équipes et mobilise des énergies précieuses. Elle mine la confiance et l'efficacité du réseau. Le personnel en subit les contrecoups et les élèves en paient le prix, alors qu'ils devraient être au cœur de toutes les décisions.
En juin dernier, les réactions aux coupes ont été vives et promptes. Les voix se sont multipliées pour dénoncer ces décisions insensées. La pression était forte, le gouvernement a senti l'opposition de la population et c'est ce qui l'a fait reculer. Mais comment en est-on arrivé là ?
Pour un gouvernement qui a dit, à maintes reprises, que l'éducation est une priorité, comment se fait-il qu'il ne ressente pas toute l'importance que revêt l'éducation pour les Québécoises et les Québécois ?
Non seulement les compressions et les coupes en éducation sont inacceptables, mais les investissements actuels restent insuffisants pour couvrir les coûts réels engendrés par la hausse du nombre de jeunes dans nos écoles et nos centres, par les besoins des élèves en situation de handicap ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (HDAA), par l'état de vétusté de nombreux établissements, et par les dépenses de fonctionnement qui continuent de peser lourdement sur le financement et le fonctionnement de nos écoles et centres. Après des années de compressions par les gouvernements précédents, les dommages sont tangibles et préoccupants, ce qui souligne l'urgence de maintenir des investissements à la hauteur des besoins, de façon constante, année après année.
Cessons de jouer sur les mots et avec les chiffres : diminuer les investissements, c'est couper. L'éducation mérite mieux.
Nous demandons donc aujourd'hui au gouvernement qu'il réaffirme clairement la place centrale qu'elle occupe dans notre société. C'est une chose de le dire, ce que nous demandons, ce sont des décisions cohérentes, cesser la gestion au jour le jour et un engagement à offrir plus de prévisibilité pour le réseau.
*La Coalition des partenaires en éducation est composée de :
Éric Gingras, Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
Richard Bergevin, Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ)
Éric Pronovost, Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ)
Carolane Desmarais, Fédération du personnel professionnel de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ)
Magali Picard, Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec (FTQ)
Caroline Senneville, Confédération des Syndicats Nationaux (CSN)
Heidi Yetman, Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ)
Francis Côté, Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement (FQDE)
André Bernier, Association québécoise du personnel de direction des écoles (AQPDE)
Sylvain Martel, Regroupement des comités de parents autonomes du Québec (RCPAQ)
David Meloche, Association des commissions scolaires anglophones du Québec (ACSAQ)
Amélie Duranleau, Société québécoise de la déficience intellectuelle (SQDI)
Kathleen Legault, Association montréalaise des directions d'établissement scolaire (Amdes)
Bianca Nugent, Coalition de parents d'enfants à besoins particuliers du Québec (CPEBPQ)
Lili Plourde, Fédération québécoise de l'autisme (FQA)
Evelyne Alfonsi, Association des administrateurs des écoles anglophones du Québec (AAEAQ)
Mélanie Laviolette, Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)
Katherine Korakakis, Association des comités de parent anglophone du Québec (ACPA)
Jean Trudelle, Debout pour l'écolePatrick Gloutney, SCFP-Québec
Michelle Poulin, secteur de l'éducation du SCFP-Québec
Manon Cholette, Conseil national du soutien scolaire (CNSS-SEPB)
Marie Deschênes, Union des employés et employées de service, section locale 800 (UES800–FTQ)
Frédéric Brun, Fédération des employées et employés de la Fédération des services publics – CSN (FEESP-CSN)
Benoit Lacoursière, Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Semaine pour l’école publique du 29 septembre au 5 octobre

Cette année, comme chaque automne, la Semaine pour l'école publique (SPEP) revient, dans une formule améliorée ! Du 29 septembre au 5 octobre, ce sera l'occasion pour la FAE, mais aussi pour toutes les personnes travaillant au sein des écoles publiques du Québec, pour les élèves et leurs parents ainsi que pour toutes celles et tous ceux qui l'ont à cœur comme notre porte-parole, l'auteur Simon Boulerice, de souligner leur attachement à cette institution, d'en faire la promotion et surtout de mettre en valeur son importance cruciale pour la société québécoise.
Notre porte-parole
Pourquoi avoir choisi Simon Boulerice comme porte-parole de la Semaine pour l'école publique ? Cet artiste multidisciplinaire voue une admiration sans borne à l'école publique et à ce qu'elle a de plus beau ; il en est d'ailleurs le fruit. S'il n'avait pas été auteur, il aurait sans doute été un (épatant) enseignant. Simon personnifie la polyvalence, la persévérance et la créativité. Il maîtrise à merveille la langue française et il accorde une grande importance à la littérature et au pouvoir transformateur de celle-ci. L'école publique, pour lui, c'est une richesse collective, qui permet à tous les élèves, jeunes et adultes, d'avoir accès à la culture. Simon, c'est non seulement un modèle pour les jeunes de 4 à 99 ans, mais c'est un aussi un être d'une admirable générosité, d'une authenticité sans faille. En somme, le porte-parole incarne profondément les valeurs de la SPEP !
Le concours Simon dans ma classe est de retour !
Vous pouvez participer dès maintenant au concours Simon dans ma classe ! Ainsi, vous courrez la chance de recevoir la visite de Simon Boulerice dans votre classe cet automne.
Formulaire d'inscription
Utilisez ce formulaire pour vous inscrire au concours « Simon dans ma classe ! » et courez la chance de gagner, pour vous et votre groupe-classe, une visite de notre porte-parole Simon Boulerice dans le cadre de la Semaine pour l'école publique.
Inscription : jusqu'au 19 septembre.
Pourquoi célébrer l'école publique ?
Il y a un demi-siècle, les bâtisseurs du Québec moderne ont voulu nous léguer une démocratie vivante et dynamique, ouverte à la participation citoyenne, grâce à une éducation accessible, gratuite et universelle qui ne pouvait reposer que sur une école publique forte. Fille de la Révolution tranquille, l'école porte donc depuis cinquante ans les espoirs de ce projet de société.
Grâce à l'école publique, la société québécoise s'est développée. Elle est devenue plus alphabétisée, plus instruite, plus conscientisée. Grâce à l'école publique, la société québécoise peut être fière de la richesse de sa culture et de ses talents.
Depuis un demi-siècle, l'école publique québécoise a fait ses preuves :
– Elle inspire les rêves de la société, en incarne les idéaux de justice et d'égalité, en porte les aspirations et en transmet l'héritage.
– Elle accueille et appartient à toute la population. En ce sens, elle est la gardienne et la promotrice des valeurs et des aspirations de la société.
– Elle découle d'une responsabilité collective à laquelle chacun peut prendre une part active.
– Elle est une porte ouverte sur le patrimoine culturel du Québec et du monde.
– Elle constitue un passage privilégié vers la citoyenneté et la vie en société.
– Elle continue de vous convaincre qu'une société démocratique et développée ne saurait se passer d'un système d'éducation qui a les moyens de ses ambitions et qui est pleinement accessible à toutes et à tous.
C'est pourquoi, nous, qui avons collectivement et historiquement la responsabilité de bâtir une société meilleure, en appelons à :
– la reconnaissance et au soutien inconditionnel de la juste valeur de l'école publique ;
– une éducation assumée politiquement et financièrement par l'État à titre de priorité nationale ;
– l'amélioration des conditions de celles et ceux qui vivent, font et apprennent à l'école publique ;
– l'amélioration de l'accessibilité et des services offerts à toutes celles et à tous ceux qui désirent s'instruire ;
– la fin, dans le système d'éducation, de la concurrence déloyale et inappropriée soutenue par le financement public des écoles privées.
Nous faisons appel à toutes celles et à tous ceux qui, comme nous, ont à cœur un système d'éducation public de qualité, universel, gratuit, accessible, égalitaire, riche en services et en encadrement.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Réforme du régime forestier : Un engagement clair et formel attendu du gouvernement

À la suite d'une rencontre politique tenue hier avec les ministres Ian Lafrenière (Relations avec les Premières Nations et les Inuit),Maïté Blanchette-Vézina (Ressources naturelles et Forêts) et un membre du cabinet du premier ministre, relativement au projet de réforme du régime forestier (projet de loi 97), l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) réaffirme que le gouvernement a tous les éléments nécessaires pour poser des gestes politiques et législatifs concrets afin d'assurer la vitalité des forêts. La balle est donc dans leur camp.
Le Chef de l'APNQL, Francis Verreault-Paul, accompagné d'une délégation élargie de représentants des Premières Nations, composée notamment de Jonathan Germain (Chef, Mashteuiatsh) et de Jérôme Bacon St-Onge (Vice-Chef, Pessamit), a réaffirmé les trois éléments fondamentaux comme éléments de fondation du projet de loi :
• Le respect des droits ancestraux et issus de traités ;
• La mise en place d'une cogestion de gouvernements à gouvernement ;
• Le retrait du zonage d'aménagement forestier prioritaire.
Demeurant ouverte à continuer les discussions et à trouver des solutions législatives, l'APNQL s'attend à un engagement politique fort et concret de la part du gouvernement du Québec.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Pétition pour le retrait du PL97

Ce projet de loi
⚖ Ne respecte pas les droits ancestraux et la gouvernance des premiers peuples
🗯 A exacerbé un racisme et des violences envers les autochtones
💰Donne des chèques en blanc à des multinationales forestières
🪓Ouvre la porte à des coupes abusives
🌲🌳Ne protège pas les poumons du continent
🦌🐾 Ne tient pas compte de la biodiversité
Signons, partageons, soyons légions !
Retrait et réécriture du projet de loi no 97, Loi visant principalement à moderniser le régime forestier.
Pour signer cette pétition, vous devez compléter 3 étapes :
Étape 1 : remplissez le formulaire sous le texte de la pétition et envoyez-le (vous devez accepter les conditions à respecter pour pouvoir signer la pétition avant d'envoyer le formulaire).
Étape 2 : consultez votre boîte de courriels et ouvrez le message envoyé par l'Assemblée.
Étape 3 : dans ce message, cliquez sur le lien vous permettant d'enregistrer votre signature.
Vous ne pouvez signer la même pétition qu'une seule fois.
Texte de la pétition
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi no 97 ne garantit ni la résilience des forêts publiques du Québec face aux changements climatiques, ni le respect des engagements du Québec en matière de protection des espèces menacées ;
CONSIDÉRANT QUE ce projet de loi menace la stabilité à long terme des emplois dans le secteur forestier ;
CONSIDÉRANT QUE le processus d'élaboration du projet de loi no 97 n'a jamais reçu le consentement libre, préalable et éclairé des Premières Nations, ce qui constitue une violation flagrante de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, à laquelle le Québec adhère ;
CONSIDÉRANT QUE cette violation des droits ancestraux alimente des tensions sociales, exacerbe le racisme dont sont victimes les communautés autochtones, met en péril les emplois des travailleurs de la filière forestière et retarde le travail de réparation des relations entre l'industrie et les Premières Nations ;
CONSIDÉRANT QUE le texte ne reflète ni les propositions des peuples autochtones ni celles des organisations environnementales et syndicales ;
Nous, signataires, demandons au gouvernement du Québec :
de retirer son projet de loi visant la réforme du régime forestier ;
de procéder à sa réécriture en suivant un processus démocratique, transparent, mené en co-construction avec les Premières Nations et en intégrant les recommandations des acteurs du milieu forestier.
Date limite pour signer : 29 septembre 2025
Pour signer la pétition.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« Le marxisme du XXIe siècle ne peut être qu’un écomarxisme »

Depuis une quinzaine d'années, nous assistons à une réactualisation de Marx dans le débat écologique. À quoi doit-on ce regain d'intérêt ? Quelles ressources théoriques cet auteur propose-t-il pour penser la crise climatique et environnementale ? Un entretien mené par Germana Berlatini, Davide Gallo Lassere.
22 août 2025 | tiré du blogue de Michael Löwy
GB/DGL : Depuis une quinzaine d'années, nous assistons à une réactualisation de Marx dans le débat écologique. À quoi doit-on ce regain d'intérêt ? Quelles ressources théoriques cet auteur propose-t-il pour penser la crise climatique et environnementale ?
ML : La question serait plutôt pourquoi il a fallu tellement de temps pour retrouver l'apport de Marx à l'écologie… Certes, il s'agit d'une problématique relativement marginale dans ses écrits, pour la bonne raison que la question commençait seulement à se poser au 19ᵉècle.
Quelles sont alors ses principales contributions dans ce domaine ?
Personne n'a autant dénoncé que Marx la logique capitaliste de production pour la production, l'accumulation du capital, des richesses et des marchandises comme but en soi. L'idée même de socialisme – au contraire de ses misérables contrefaçons bureaucratiques – est celle d'une production de valeurs d'usage, de biens nécessaires à la satisfaction de nécessités humaines. L'objectif suprême du progrès technique pour Marx n'est pas l'accroissement infini de biens (« l'avoir ») mais la réduction de la journée de travail, et l'accroissement du temps libre (« l'être »).
Par ailleurs, on trouve dans le Capital des passages où il est explicitement question des ravages provoqués par le capitalisme sur l'environnement naturel ; par exemple, la conclusion du chapitre sur la grande industrie et l'agriculture du livre I, qui esquisse une remarquable vision dialectique des contradictions du « progrès » induit par les forces productives :
« Chaqueprogrès de l'agriculture capitaliste est un progrès non seulement dans l'art d'exploiter le travailleur, mais encore dans l'art de dépouiller le sol ;caque progrès dans l'art d'accroître sa fertilité pour un tempest un progrès dans la ruine de ses sources durables de fertilité. Plus un pays, les États-Unis du Nord de l'Amérique par exemple, se développe sur la base de la grande industrie, plus ce processus de destruction s'accomplit rapidement. La production capitaliste ne développe donc la technique et la combinaison du procès de production sociale qu'en sapant en même temps les deux sources d'où jaillit toute richesse : la terre et le travailleur.. »
On trouve ici l'idée que le progrès peut être destructif, un « progrès » dans la dégradation et la détérioration de l'environnement naturel. L'exemple choisi apparaît trop limité – la perte de fertilité du sol –,, mais il ne pose pas moins la question plus générale des atteintes, par la production capitaliste, au milieu naturel, à ce qu'il appelle, dans un autre passage, les« conditions naturelles éternelles ».
GB/DGL : eestce que vous pourriez expliquer brièvement qu'est-ce qu'il entend par cette expression ? Marx n'a-t-il pas toujours eu une conception très historicisée de la nature ?
ML : e ne pense pas que Marx "historicise" la nnature... nalyse, ien sûr, omme historiques, e rapport des humains à la nature et les transformations de celle-ci par l'activité humaine. Mais il pense, ar exemple, ue la terre en tant que telle est une ""ndition naturelle éternelle" pour l'activité humaine. Il revient sur cet argument à plusieurs rreprisesdans Le Capital :
"Tout l'esprit de la production capitaliste,oientée vers le profit monétaire immédiatement proche, est en contradiction avec l'agriculture, ui doit prendre en compte l'ensemble permanent ((ändigen) des conditions de vie de la chaîne des générations humaines."
Cette production apitaliste provoque une "rupture irréparable du métabolisme" entre les sociétés humaines et la nature, n "métabolisme prescrit par les lois naturelles de la vie".
On ourrait ajouter, notre époque, ue le climat fait partie de ces "conditions naturelles de la vie", n train d'être détruites par le productivisme et la hybris capitaliste. Certes, on pourrait aussi rgumenter que le climat a une histoire, ui est même en train de s'aaccélérerà notre époque. Mais cela n'est pas contradictoire avec la constatation qu'une certaine température, isons inférieure à 50 ou 60 degrés Celsius, ait partie des "cconditions naturelles de la vie" pour les humains.
GB/DGL : Comme vous l'avez souligné tout à l'heure, d'après Marx le développement des forces productives est aussi, à la fois, un développement des forces destructives. Cela remet radicalement en cause la philosophie de l'histoire déterministe et téléologique qui caractérise des passages de son œuvre et, encore plus, la lecture dogmatique fournie auXXᵉsiècle par certains auteurs marxistes et par de nombreuses institutions du mouvement ouvrier. Quelles sont les principales implications théoriques et politiques d'un tel renversement ?
ML : Certes, ne lecture « ddéterministe » et même « productiviste » de Marx dominé chez les marxistes dogmatiques du 220ᵉècle, que ce soit dans la social-démocratie (quand elle se réclamait encore du marxisme !) ou dans le « socialisme réel » de facture soviétique. On a privilégié les écrits de Marx, comme lalaréface à la Critique de l'économie politique (1859),qi se prêtent à des lectures de ce type. On a ainsi ignoré tout ce qui, chez Marx (ou Engels), met en question une vision linéaire de l'histoire comme « progrès », ddéterminéar le développement des forces productives. Par exemple, ses derniers écrits sur la commune rurale russe comme point de départ d'un processus révolutionnaire pouvant épargner à la Russie les affres du capitalisme. Ou encore les textes de critique du productivisme capitaliste comme « rupture métabolique » entre les sociétés humaines et la nature, recensés par les éécomarxistesohn Bellamy Foster et Kohei Saïto.
Cela dit, le marxisme est une pensée en mouvement, qui ne peut pas se limiter aux écrits de Marx et Engels. Le mot d'ordre de Rosa Luxemburg, « socialisme ou barbarie » (1915), était déjà un dépassement de la philosophie de l'histoire comme progrès inévitable. Et Walter BBenjamin, dans ses écrits des années1930,0, critiquait l'idéologie du progrès et « l'idée meurtrière d'exploitation de la nature » propre à la modernité capitaliste.
Le marxisme du21ᵉsiècle ne peut être qu'un écomarxism, qui met la question du rapport à la nature au centre de la réflexion et au cœur de la définition même du socialisme. La crise écologique et le changement climatique étaient peu visibles au 19ᵉᵉsiècle, mais sont devenus à notre époque l'enjeu économique, social, politique et humain décisif de notre époque. L'éco-marxisme du 21ᵉᵉsiècle ne peut que rompre avec l'idéologie du Progrès fondé sur le développement des forces productives, tout en reprenant la critique de Marx à la réification marchande, au fétichisme de la marchandise et à la logique du capitalisme qui consiste, selon le vol. 1 du Capital, à « accumuler pour accumuler, produire pour produire ».
L'écomarxisme exige aussi une reformulation du programme socialiste, qui devra se donner comme horizon révolutionnaire, comme le propose Saïto, « un communisme de la décroissance ».
GB/DGL : Vous avez d'abord parlé de Marx et puis vous avez fait allusion à Luxemburg et à Benjamin. Est-ce que vous pouvez expliciter davantage quelles sont les principales sources philosophiques de l'écosocialisme ?
ML : Cela dépend des auteurs. Pour certains, ce sont les écrits de critiques de la technique comme ceux publiés par Jacques Ellul, ou des institutions modernes (l'école, l'hôpital) comme les textes de Ivan Illich. Je ne nie pas l'intérêt de ces auteurs, mais pour moi, les principales sources de l'écosocialisme sont : Marx, relu d'un point de vue anti-productiviste (comme je l'ai esquissé dans la réponse antérieure), le romantisme anticapitaliste et Walter Benjamin.
Le romantisme est beaucoup plus qu'une école littéraire du début du XIXᵉiècle : 'est une vision du monde, qui commence avec Jean-Jacques Rousseau mais se poursuit jusqu'à nos jours. Le cœurde cette philosophie romantique est une critique de la civilisation capitaliste industrielle moderne, au nom de certaines valeurs prémodernes.Elle prend différentes formes, régressives rêvant d'un (impossible) retour au passé, ou révolutionnaires, prônant un détour par le passé vers l'avenir utopique. La critique romantique dénonce le désenchantement du monde, la quantification et la mercantilisation universelles, mais aussi la destruction de l'environnement par la civilisation moderne.
Jean-Jacques Rousseau, dans son célèbre Discours sur les origines de l'inégalité entre les hommes (1755) – véritable manifeste inaugural du romantisme –,, célèbre le « sauvage » qui, crit-il, « vit en paix avec toute la nature et avec ses semblables », et regrette que la civilisation ait fait de l'être humain « un tyran de lui-même et de la nature ». Passionné par la nature vierge, il parle avec nostalgie des « forêts immenses que la cognée ne mutila jamais ».
Dans notre livre Romantisme anticapitaliste et nature (Paris, Payot, 022), on ami Robert Sayre et moi-même discutons de cette critique romantique dans les écrits de voyageurs du XVIIIᵉiècle comme William Bartram, dans les œuvresdu peintre du XIXᵉhomas Cole, ns l'utopie communiste écologique de William Morris et dans les écrits du critique culturel anglais Raymond Williams. On trouve des échos contemporains de cette tradition dans l'indigénisme écologique de Naomi Klein.
Dans cette tradition, un des principaux auteurs que nous discutons est précisément Walter Benjamin, par sa critique impitoyable – d'inspiration romantique anticapitaliste– de l'idéologie du progrès inévitable et de « l'idée meurtrière d'exploitation de la nature », prônée par la civilisation bourgeoise. À ces tendances destructrices de la modernité capitaliste, enjamin oppose la conception de la nature comme mère généreuse, propre aux sociétés matriarcales du passé et le rêve utopique d'une harmonie future avec le monde naturel suggérée par Fourier et Marx.
Un nombre croissant d'écosocialistess'intéresse aux écrits de Walter Benjamin comme source philosophique d'une conception de l'histoire sensible aux aspects destructeurs du « progrès » technique et économique promu par la civilisation capitaliste.
GB/DGL : dans quelle mesure une telle référence à la pensée romantique et utopique est-elle compatible avecvec un dialogue avec les sciences de la nature ?
ML : Il existe sans doute des romantiques rétrogrades, asséistes ou même obscurantistes qui s'opposent aux sciences de la nature. Mais, omme Robert Sayre et moi-même e rappelonsdans notre livre sur romantisme et nature, n des pionniers des sciences naturelles modernes, lexandre von Humboldt (fin du 18ᵉ siècle) était un penseur romantique et un critique des estructions – raves déforestations, ppauvrissement de la terre, pollution, etc. – rovoquées par la civilisation moderne.
Les romantiques utopiques ou révolutionnaires ne rejettent pas science en tant que telle : e qu'ils mettent en question,, c'est son usage par la société capitaliste industrielle. Walter Benjamin, ans ses Thèses de 1940 "Sur le concept d'histoire", e critique pas la science moderne, ais le culte du progrès technique, ui "n'envisage que les progrès de la maîtrise sur la nature, on les régressions de la société" : on expression la plus sinistre,, c'est, ses yeux, a technocratie fasciste.
Cette attitude est aussi celle des écosocialistes qui s'inspirent de la critique romantique de la civilisation. Loin de rejeter lascience de la nature, s s'appuient, ar exemple, ur les documents du GIEC, e Groupe international d'étude du climat, omposé de scientifiques du monde entier, our attirer l'attention sur la montée de la température et l'inefficacité des mesures de réduction des émissions de CO₂ prises jusqu'ici. Ce qu'ils dénoncent,, c'est l'instrumentalisation e la science par le système capitaliste t sa dynamique destructrice. Ils ne mettent pas en question les découvertes d'Einstein et la physique nucléaire ! Mais ils s'opposent à l'énergie nucléaire, ilitaire ou civile, romue par le capitalisme (t sa copie conforme par le "socialisme réel"). Albert Einstein lui-même était un socialiste avec une sensibilité écologique…Voici ce qu'il disait de notre rapport à l'environnement :
"Un être humain est une partie d'un tout que nous appelons Univers,une partie limitée dans le temps et l'espace. Il s'expérimente lui-même, ses pensées et ses émotions comme quelque chose qui est séparé du reste, une sorte d'illusion d'optique de la conscience. Cette illusion est une sorte de prison pour nous, nous restreignant à nos désirs personnels et à l'affection de quelques personnes proches de nous. Notre tâche doit être de nous libérer nous-mêmes de cette prison en étendant notre cercle de compassion pour embrasser toutes créatures vivantes et la nature entière dans sa beauté."
N'est-ce pas romantique ?
GB/DGL : Après ce tour d'horizon des sources philosophiques de l'éco-socialisme, et avant de revenir sur les points saillants de l'éco-socialisme au XXIᵉiècle, nous aimerions nous attarder d'abord sur un autre nœudauquel vous avez fait allusion. Vous avez parlé de la commune agraire russe et – par extension – de la paysannerie non occidentale. Tout au long du XXᵉiècle, les expériences paysannes provenantde l'Amérique latine, de l'Afrique, de l'Asie, etc. ont renouvelé le marxisme. Pourquoi cela a-t-ilil été important ? Quel est le bilan de ces histoires multiples et variées ? Et quels sont les horizons politiques qu'elles peuvent ouvrir aujourd'hui ?
ML : Dans toutes les grandes révolutions sociales du 20ᵉiècle, les paysans ont joué un rôle déterminant. Tout d'abord, dans la Révolution mexicaine de 1911-17, où l'Armée du Sud d'Emiliano Zapata a été la pointe la plus avancée et la plus radicale du mouvement insurgent. Comme l'a montré le grand historien marxiste latino-américain Adolfo Gilly, les zapatistes ont formé, dans l'État de Morelos, une véritable commune socialiste. Dans la Révolution russe elle-même, le prolétariat a été le principal acteur sociopolitique mais sans le soutien de la paysannerie, jamais l'Armée rouge n'aurait gagné la guerre civile. Il faut aussi prendre en compte que les ouvriers étaient souvent d'origine paysanne et le même vaut pour les soviets de soldats qui ont joué un rôle décisif dans la Révolution d'octobre 1917 à Petrograd. Dans les révolutions chinoise et indochinoise, des années 1930 jusqu'à la victoire des Vietnamiens dans les années 1970, ontrouve à nouveau les paysans comme principal sujet du mouvement révolutionnaire dirigé par les communistes. Enfin, en Amérique latine, aussi bien la Révolution cubaine de 1959 que celle du Nicaragua en 1979 ont été menées par des mouvements de guérilla dont la principale base sociale étaient les paysans. Dernier épisode : e soulèvement de l'EZLN (EjércitoZapatista de Liberación Nacional) en 1994, ui a conduit à une expérience communautaire qui dure encore aujourd'hui, vait été menée par des paysans indigènes d'origine maya.
Ce rôle révolutionnaire des paysans n'avait pas été prévu par les grandspenseurs marxistes, depuis Marx lui-même jusqu'à Rosa Luxemburg, Lénine ou Trotsky. Certes, ils avaient compris qu'une révolution prolétarienne n'aurait pas pu vaincre sans le soutien des paysans, mais ils n'avaient pas imaginé que la paysannerie puisse être la principale force sociale du mouvement révolutionnaire. Victor Serge, dans ses écrits des années 1920 sur le mouvement révolutionnaire en Chine, est une exception. C'est donc des dirigeants communistes comme Mao Tse-Toung et Hô Chiinh qui vont prendre en compte, dans leurs écrits, et surtout dans leur pratique, ce rôle des masses paysannes. Certes, le bilan de ces révolutions, une fois au pouvoir, est contrasté : sans doute des mesures sociales radicales ont été prises, mais le pouvoir a été monopolisé par des régimes bureaucratiques et autoritaires, ur lesquels les paysans ou les ouvriers n'avaient aucun contrôle.
En Amérique latine,, le grand penseur marxiste José Carlos Mariátegui avait proposé dès 1927-29 une stratégie révolutionnaire basée sur les traditions collectivistes ancestrales – « le « communisme inca » » » – des paysans indigènes. La similitudeentre ses écrits et ceux de Marx sur la commune rurale russe – qu'il ne connaissait pas – est frappante. Ses propositions furent rejetées lors de la Conférence des Partis communistes d'Amérique latine, hegemonisée par le stalinisme. Aussi le rand mouvement de résistance contre les Marines américains mené en 1927 par l'Armée des Hommes Libres d'Augusto Sandino était une lutte paysanne. Quand n 1932 éclate à El Salvador une insurrection contre la dictature militaire, elle est menée par la paysannerie : ce fut le seul soulèvement de masse dirigé par unParti communiste (fondé par Farabundo Marti) dans l'histoire de l'Amérique latine. Il fut désavoué par l'Internationale communiste.
Il faudra attendre la Révolution cubaine et les écrits de Che Guevara pour qu'une réflexion marxiste sur le rôle révolutionnaire des paysans soit à nouveau développée. Ses écrits sur la guerre de guérilla assignent une place centralee à la paysannerie. Cela vaut aussi pour le dirigeant révolutionnaire péruvien (trotskiste) Hugo Blanco, qui mena, au début des années 1960, un grand mouvement de luttes paysan/indigène, non sous la forme de guérillamais de groupes d'autodéfensearmée. Au cours des dernières décennies,, Hugo Blanco a écrit des textes importants en défense de l'indigénisme paysan et de l'écosocialisme : selon lui, les communautés indigènes pratiquaient déjà l'écosocialisme il y a plusieurs siècles…
En Afrique, es paysans ont pris une place essentielle dans les grands mouvements anticolonialistesen Afrique du Nord et dans les colonies portugaises (Angola, Mozambique, Guinée-Bissau). Ces expériences ont nourri la réflexion de penseurs révolutionnaires, arxistes ou proches du marxisme, comme Franz Fanon ou Amilcar Cabral. Hélas, après une période initiale d'inspiration socialiste ou autogestionnaire les régimes issus de la lutte anticolonialeont sombré dans l'autoritarisme et la corruption.
Aujourd'hui encore on trouve nombre de mouvements paysans à tendance anticapitalistedans le monde. La plupart sont fédérés dans le réseau international Via Campesina. Une de ses composantes les plus importantes est le MST, le e Mouvement des paysans sans terre Brésil, qui organise des centaines de milliers de paysans, et dont les militants et les cadres se réclament du marxisme.
Les indigènes et les paysans en général sont actuellement une force sociopolitiquequi se trouve en première ligne dans le combat contre la destruction capitaliste de l'environnement, n défense des forêts et de l'eau. Cela vaut notamment pour les pays du Sud global, ais aussi pour les États-Unis et le Canada, où les indigènes résistent aux oléoducs ou à l'exploitationdes sables bitumineux.
Aussi bien l'histoire des révolutions du siècle dernier que le combat écologique actuel exigent un renouveau de la pensée marxiste sur la paysannerie et les communautés indigènes.
GB/DGL : Après cet aperçu historico-politique sur la paysannerie dans les révolutions socialistes au XXᵉconcentrons-nous maintenant sur le présent et l'avenir. Vous avez mentionné la décroissance tout à l'heure, et vous avez parlé des questions agraires et paysannes ensuite : quels sont les principes fondamentaux de l'écosocialismeau XXIᵉiècle ? Autour de quels piliers théoriques et politiques construire une alternative aux ravages sociaux et écologiques en cours ?
ML : Pour beaucoup de marxistes, le socialisme c'est la transformation des rapports de production – par l'appropriation collective des moyens de production – pour permettre le libre développement des forces productives. L'écosocialisme du 21ᵉiècle se réclame de Marx, mais rompt de façon explicite avec ce modèle productiviste. Certes, l'appropriation collective est indispensable, mais il faudrait aussi transformer radicalement les forces productives elles-mêmes :
a) en changeant leurs sources d'énergie (renouvelables, à la place des énergies fossiles) ;
b) en réduisant la consommation globale d'énergie ;
c) en réduisant (« décroissance ») la production des biens, et en supprimant les activités inutiles (publicité) et les nuisibles (pesticides, armes de guerre) ;
d) en mettant un terme à l'obsolescence programmée.
L'écosocialisme implique aussi la transformation des modèles de consommation, des moyens de transport, de l'urbanisme, du « mode de vie ». Bref, c'est beaucoup plus qu'une modification des formes de propriété : il s'agit d'un changement de civilisation, fondé sur des valeurs de solidarité, égalité, liberté et respect pour la nature. La civilisation écosocialiste rompt avec le productivisme et le consumérisme, pour privilégier la réduction du temps de travail et donc l'extension du temps libre dédié à des activités sociales, politiques, ludiques, artistiques, érotiques, etc. Marx désignait cet objectif par l'expression « règne de la liberté ».
Pour accomplir la transition vers l'écosocialisme, il faut une planification démocratique, orientée par deux critères : la satisfaction des véritables besoins et le respect des équilibres écologiques de la planète. C'est la population elle-même – une fois débarrassée du matraquage publicitaire et de l'obsession consommatrice fabriquée par le marché capitaliste – qui décidera, démocratiquement, quels sont les véritables besoins. L'écosocialisme est un pari sur la rationalité démocratique des classes populaires.
Pour accomplir le projet écosocialiste, des réformes partielles ne suffisent pas. Une véritable révolution sociale est nécessaire. Comment définir cette révolution ? On pourrait se référer à une note de Walter Benjamin, en marge de ses thèses.. Sur le concept d'histoire (1940) : « Marx a dit que les révolutions sont la locomotive de l'histoire mondiale. Peut-être que les choses se présentent autrement. Il se peut que les révolutions soient l'acte par lequel l'humanité qui voyage dans le train tire les freins d'urgence ». Traduction en termes du XXIᵉ siècle : nous sommes tous des passagers d'un train suicide, qui s'appelle civilisation capitaliste industrielle moderne. Ce train se rapproche, à une vitesse croissante, d'un abîme catastrophique : le changement climatique. L'action révolutionnaire vise à l'arrêter – avant que ce ne soit trop tard.
L'écosocialisme est à la fois un projet d'avenir et une stratégie pour le combat ici et maintenant. Il n'est pas question d'attendre que « les conditions soient mûres » : il faut susciter la convergence entre luttes sociales et luttes écologiques et se battre contre les initiatives les plus destructrices des pouvoirs au service du capital. C'est ce que Naomi Klein appelle Blockadia. C'est avec des mobilisations de ce type que pourra émerger, dans les luttes, la conscience anticapitaliste et l'intérêt pour l'écosocialisme. Des propositions comme le Green New Deal font partie de ce combat, dans leurs formes radicales, qui exigent l'abandon effectif des énergies fossiles – au contraire de celles qui se limitent à recycler le « capitalisme vert ».
Quel est le sujet de ce combat ? Le dogmatisme ouvriériste/industrialiste du siècle passé n'est plus actuel. Les forces qui aujourd'hui se trouvent en première ligne de l'affrontement sont les jeunes, les femmes, les indigènes, les paysans. Les femmes sont très présentes dans le formidable soulèvement de la jeunesse lancé par l'appel de Greta Thunberg – une des grandes sources d'espoir pour l'avenir. Comme nous l'expliquent les écoféministes, cette participation massive des femmes aux mobilisations résulte du fait qu'elles sont les premières victimes des dégâts écologiques du système. Les syndicats commencent, ici ou là, à s'engager aussi. C'est important, car, en dernière analyse, on ne pourra pas battre le système sans la participation active des travailleurs des villes et des campagnes, qui constituent la majorité de la population. La première condition, c'est, dans chaque mouvement, d'associer les objectifs écologiques (fermeture de mines de charbon, de puits de pétrole ou de centrales thermiques, etc.) avec la garantie de l'emploi des travailleurs concernés.
Avons-nous des chances de gagner cette bataille, avant qu'il ne soit trop tard ? Contrairement aux prétendus « collapsologues », qui proclament, à cor et à cri, que la catastrophe est inévitable et que toute résistance est inutile, nous croyons que l'avenir reste ouvert. Il n'y a aucune garantie que cet avenir sera écosocialiste : c'est l'objet d'un pari au sens pascalien, dans lequel on engage toute son existence, dans un « travail pour l'incertain ». Mais, comme le disait, avec une grande et simple sagesse, Bertolt Brecht : « Celui qui lutte peut perdre. Celui qui ne lutte pas a déjà perdu.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« Jeju 4.3 » : histoire d’un massacre oublié, au cœur des enjeux de mémoire

Le Centre culturel coréen de Paris a proposé l'exposition « Jeju 4.3 Archives — Sur la vérité et la réconciliation », qui met en lumière un épisode méconnu et longtemps occulté de l'histoire sud-coréenne : le massacre de Jeju (1948).
Lettre du Centre culturel coéen de Paris
À travers des documents d'archives, l'exposition retrace le long travail de mémoire initié par les familles de victimes et une Commission vérité et réconciliation créée en 2005.
Son rapport, publié en 2009, conclut à l'exécution de 15 000 à 30 000 civils (communistes ou supposés tels) par l'armée sud-coréenne.
Dans une unique salle plongée dans la pénombre, l'exposition retrace le combat des familles de victimes pour obtenir la vérité et la reconnaissance des faits survenus à Jeju entre avril et mai 1948. L'événement peut très bien servir d'exemple en HGGSP dans le cadre du chapitre sur Histoire et mémoire, et mis en relation avec d'autres faits similaires s'étant produits dans des lieux et à des époques différents : on pense bien sûr aux charniers du franquisme ou au rapport Rettig au Chili, entre autres.
Comme l'Europe qui a connu ses années « barbares » durant l'après-guerre (Keith Lowe), l'Asie a aussi subi son lot de vengeances et de violences extra-légales, tantôt le fait de sursauts populaires, tantôt instrumentalisées par les pouvoirs de l'État naissant ou renaissant. Les logiques de la guerre froide se sont solidifiées aussi rapidement en Extrême-Orient qu'elles l'ont fait en Europe. Le vide politique engendré par l'effondrement de l'Empire japonais et l'intérêt stratégique porté par Staline et Truman sur l'Asie-Pacifique ont conduit à l'émergence de figures politiques fortes et clivantes de part et d'autre du spectre politique.
À ce titre, la Corée est le pays où la scission fut la plus tangible et durable. Dès la capitulation du Japon, la péninsule coréenne est divisée (à titre temporaire) le long du 38e parallèle. Le nord devient une zone soviétique, le sud une zone américaine, dans l'attente, particulièrement espérée chez la population rurale, pressurée socialement, d'une réunification (Pascal Dayez-Burgeon).
En 1948, l'échec des négociations entre les deux Grands entraîne la proclamation successive de la République de Corée (Corée du Sud) et de la République populaire démocratique de Corée (Corée du Nord). De part et d'autre, la crainte des ennemis de l'intérieur entraîne des arrestations politiques, des emprisonnements et des exécutions sommaires.
Au Sud, Yi Sungman, président pro-américain nouvellement élu, est confronté à une série de soulèvements provoquée par l'annonce de la partition de la péninsule. Des insurrections sur fond de contestation sociale et de rhétorique anti-japonaise, menées par le Parti du travail de Corée du Sud, branche méridionale du PC nord-coréen. La répression qui débute sur l'île méridionale de Jeju le 3 avril 1948 est féroce. Le pouvoir sud-coréen, avec l'accord tacite du gouvernement américain, traque les manifestants insulaires, estimés à un peu plus de 1 000 hommes. La lutte anti-guérilla menée par les soldats du Sud dure un an et se solde par la mort d'entre 15 000 et 30 000 civils, accompagnée de son lot de destructions et d'exactions (viols, tortures, massacres…).
Ce pan sombre de l'histoire coréenne est aussi au cœur du roman Impossibles adieux de Han Kang (prix Nobel de littérature 2024), paru en français en 2023.
Il fait écho à l'autre exposition présentée au Centre culturel coréen jusqu'au 6 septembre 2025, « Île de Jeju, vivre avec la mer », consacrée aux haenyeo, ces femmes plongeuses qui incarnent un tout autre visage de la mémoire insulaire.
Centre culturel coréen de Paris, 20 rue la Boétie, Paris 75008. Entrée libre.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
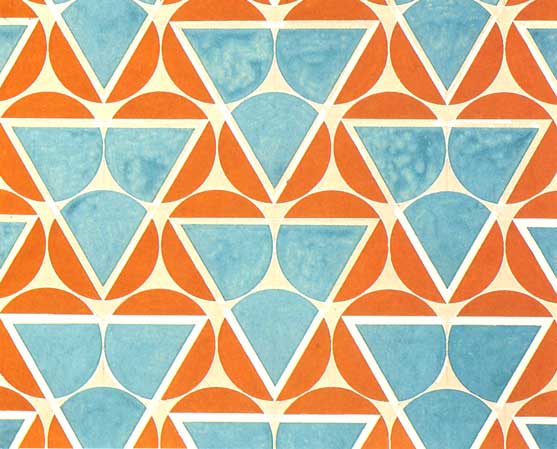
Le style de Marx : entretien avec Vincent Berthelier
Au printemps 2025, le professeur Vincent Berthelier faisait paraître un livre intitulé Le style de Marx. Dans celui-ci, il étudie les stratégies langagières mobilisées par Karl Marx (1818-1883) et leurs effets politiques. Nous nous sommes entretenus avec l’auteur pour mieux comprendre son projet, ses principaux résultats de recherche et leur intérêt pour la pensée contemporaine. Entrevue réalisée par Antoine Deslauriers.
Vincent Berthelier, Le style de Marx, Paris, Éditions sociales, 2025, 200 pages.
Vous partez d’une hypothèse de lecture simple, mais décisive : considérer Marx comme un écrivain, et non pas seulement comme un théoricien ou un militant révolutionnaire. En quoi cette approche modifie-t-elle la manière dont vous envisagez son œuvre ?
En prenant en compte la dimension écrite, voire littéraire, de l’œuvre de Marx, je me mets en fait dans la même position que la plupart de ses lectrices et lecteurs, qui ne sont spécialistes ni d’économie, ni de philosophie, ni de sociologie. Au-delà des commentaires savants sur Marx, il s’agissait de revenir au texte, à son mode d’argumentation, et à ce qu’on voudrait en tirer pour notre monde et notre vie militante quand on commence à le lire – ce que j’ai commencé à faire à l’âge de vingt ans.
Quand on intègre cette dimension écrite et littéraire, on s’aperçoit que Marx, comme tout le monde, raisonne sur un mode qui s’efforce d’être scientifique et rigoureux, mais qui passe nécessairement par des intuitions sensibles. Sa façon de rendre compte des rapports sociaux et politiques, façonnés par le capital et les intérêts de classe, s’appuie sur un réseau de mots et d’images déterminant dans la constitution de ses concepts. Toute connaissance passe par le langage, et donc par tout ce qui traverse le langage – puisqu’il n’existe pas de langage pur, strictement rationnel, univoque et transparent, comme celui dont rêvent parfois les philosophes analytiques.
Je reviens aussi par endroit sur ce qui me semble être des limites de la pensée de Marx, qui sont autant de problèmes pour une analyse critique contemporaine du capital (sa conception de la classe moyenne, de la paysannerie, de la valeur économique, etc.). Toutefois, sa manière d’écrire et de formuler sa pensée n’est pas invalidée par le fait qu’elle soit imprégnée de littérature et de strates de langue préexistantes, au contraire. Sa démarche critique est inscrite dans la langue qu’il emploie.
Prenons par exemple le début du 18 Brumaire : « Hegel remarque quelque part que tous les grands faits et les grands personnages de l’histoire universelle adviennent pour ainsi dire deux fois. Il a oublié d’ajouter : la première fois comme tragédie, la seconde fois comme farce. »
On peut lire ce début comme une simple boutade, introduisant une métaphore banale (politique = théâtre). C’est oublier que la question de la représentation politique est le problème central de l’essai de Marx, et ce qui lui donne toute sa pertinence (quand bien même son analyse de la paysannerie parcellaire est fausse). En pensant un phénomène politique (le coup d’État du neveu de Napoléon Ier) sur le mode théâtral, Marx ne minimise pas son caractère historique. Toute la métaphore théâtrale dans le 18 Brumaire consiste à tenir les deux bouts : d’un côté le spectacle grotesque de la politique, de l’autre les véritables intérêts qui sous-tendent ce spectacle, mais n’en sont pas distincts.
Pour faire un parallèle contemporain assez simple : il est évident que les articles de la presse bourgeoise déplorant la bouffonnerie de Donald Trump ne nous apprennent rien. Mais ce serait une erreur de mettre de côté le poids des représentations, sous prétexte de matérialisme : les représentations (et les représentants) ont une pesanteur historique, et les individus de telle ou telle classe agissent à travers elles.
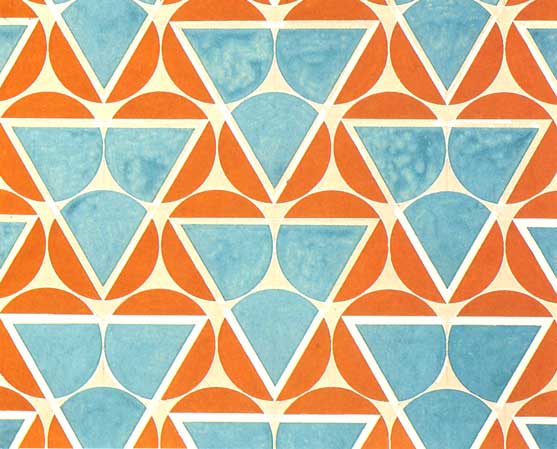
En étant formulé au singulier, le titre de votre ouvrage suggère une cohérence stylistique chez Marx. Peut-on réellement parler d’un style unifié entre les Manuscrits de 1844, Le 18 Brumaire, Le Capital ou encore la correspondance ? Quelles continuités, mais aussi quelles ruptures, avez-vous identifiées dans cette diversité de textes ?
Les textes que vous mentionnez ne sont évidemment pas écrits de la même manière, ne serait-ce que parce qu’ils sont de nature très différente, et qu’ils ne s’adressent pas aux mêmes destinataires. Ils ne sont même pas toujours écrits dans la même langue. Mais ils présentent des éléments de continuité. Certains sont propres à la formation intellectuelle de Marx : les citations et allusions littéraires qui parcourent toute son œuvre sont caractéristiques de l’intellectuel ayant reçu une éducation bourgeoise libérale. Les nombreuses références bibliques, quant à elles, sont à la fois le patrimoine commun de l’Europe chrétienne, mais plus spécifiquement celui d’un ancien étudiant en philosophie (discipline qui n’est alors pas strictement séparée de la théologie en Prusse).
Une figure comme l’antimétabole (ces « renversements du génitif », Philosophie de la misère changé en Misère de la philosophie) inscrit d’abord Marx dans la filiation de Hegel et Feuerbach. C’est globalement une constante de son style, mais elle n’est pas employée avec la même fréquence dans les Annales franco-allemandes (pendant la phase jeune-hégélienne de Marx) ou dans Le Capital (où il en fait un emploi beaucoup plus restreint, mais toujours significatif).
De manière générale, le principe de l’approche stylistique, c’est qu’on ne peut pas traiter tous les faits de style d’une œuvre (ils sont pour ainsi dire infinis). On sélectionne ceux qui nous paraissent significatifs, à commencer par les plus visibles. On en fait l’inventaire, de la façon la plus objective possible (car les faits de langue sont tendanciellement objectivables). Enfin on les interprète, selon leur fréquence et leur répartition. Il m’arrive de m’attarder sur des traits de style qui n’apparaissent qu’à certains endroits du Capital, parce qu’ils produisent beaucoup de sens (par exemple la façon qu’a Marx d’y décrire le communisme), et d’en mettre de côté certains qu’il pratique tout au long de sa vie (les calembours par exemple) parce qu’ils sont à mes yeux d’un moindre intérêt critique. Cela dit, je ne prétends pas à l’exhaustivité : j’ai cherché à faire la synthèse des travaux existants en anglais, allemand, espagnol et français, et cette synthèse peut encore être enrichie.
Vous soulevez à quelques reprises la question de la traduction, notamment lorsque vous discutez de la glossolalie de Marx. Le style marxien se maintient-il d’une langue à l’autre ? Que perd-on – ou que gagne-t-on – dans ce déplacement linguistique ?
Dans la traduction, certains traits de langue et de style se perdent : des jeux de mots intraduisibles, des tournures de phrase propres à l’allemand ou à l’anglais, les connotations de tel mot dans sa langue. Les déperditions ne sont d’ailleurs pas tout à fait les mêmes si on passe d’une langue indo-européenne à l’autre, ou si l’on traduit vers le chinois ou le japonais par exemple. D’autres traits se transmettent plus ou moins intacts : les répétitions, les figures de renversement, les métaphores, les effets de voix, l’ironie. Marx étant un penseur internationaliste, je me suis bien sûr focalisé sur ceux-ci. C’est un travail assez différent de ce que j’ai pu faire auparavant, sur la littérature de langue française (où l’analyse grammaticale est fondamentale). Mais l’essentiel est de savoir sélectionner.
Je lis l’allemand, mais j’avais lu l’essentiel des œuvres de Marx en français. Quand un trait me semblait intéressant, je comparais la traduction au texte original. Il ne faut pas exagérer l’écart : la traduction nous fait tout de même accéder à quelque chose du texte original. Avec l’expérience, je me suis mis à sentir intuitivement quand les traducteurs oubliaient de rendre en français certaines figures de style du texte original. Il arrive aussi qu’ils surtraduisent quand le style de Marx leur semble trop plat – alors même que ce style plat est lui aussi porteur de sens !
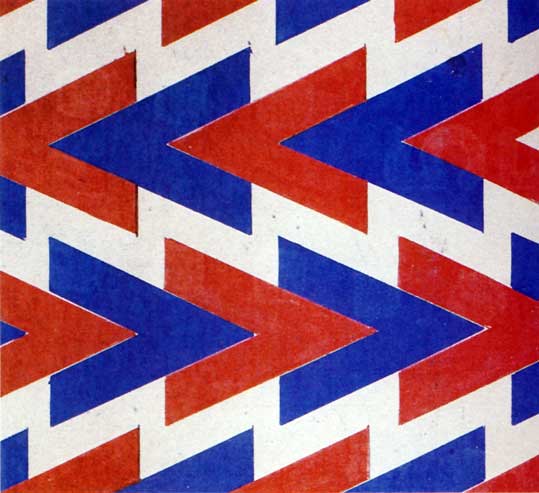
Dans la biographie qu’il lui consacre, Jonathan Sperber décrit Marx comme un « homme du XIXe siècle » (2013). Sans contester cette lecture, vous montrez que l’œuvre marxienne puise à des sources plus anciennes – la littérature gréco-latine, le théâtre de Shakespeare, la satire romantique, la prose de Goethe, parmi bien d’autres. Dans quelle mesure cette culture classique informe-t-elle son écriture et sa pensée ?
Cette question requiert une réponse générale et des réponses spécifiques. La réponse générale est la suivante : Marx a reçu de son entourage (son père et son beau-père) une éducation bourgeoise libérale, avec une culture humaniste dont les branches les plus tardives sont la pensée des Lumières et le libéralisme romantique. C’est le socle de la pensée de Marx, dont le premier combat fut pour la liberté de la presse en Prusse. La prétendue critique des droits de l’homme dans l’article Sur la question juive vise bien à rendre concrets des droits humains abstraits, et à poursuivre le combat des Lumières européennes.
Il est donc important de rappeler l’ancrage universaliste et républicain de Marx, à une époque où la montée électorale de l’extrême droite fragilise les convictions démocratiques de la gauche radicale, et où l’on fait un mauvais procès à l’universalisme, sous prétexte de déconstruire l’eurocentrisme. En ce sens aussi, je m’éloigne de Sperber, qui voudrait faire de Marx un homme de son temps, qui ne serait plus du nôtre. Marx nous offre au contraire des ressources pour un universalisme mis à jour (et qu’il faut continuer à mettre à jour), certainement pas limité au XIXe siècle.
Pour les réponses spécifiques, sans entrer dans le détail : c’est en partie à travers des références littéraires que Marx pense certains objets, notamment certaines classes sociales. Pour le coup, ce n’est pas toujours pour le mieux, et je montre en quoi sa conception du lumpenprolétariat ou des petits-bourgeois est largement livresque – ce qui risque de nous poser des problèmes pour penser les classes moyennes et les formes impures d’exploitation (qui sont en fait la norme en Occident, où tout le monde, y compris les exploité·es, profite de l’exploitation du reste du monde).
Le style de Marx emprunte parfois une veine prophétique, voire messianique. Comment interprétez-vous cette tonalité chez un auteur qui revendiquait une approche scientifique, y compris dans ses écrits les plus militants ou polémiques ?
Comme dit plus haut, les allusions religieuses sont d’une part le socle culturel commun de tou·tes les Européen·nes de l’époque. La première lecture des ouvrier·es dans les pays protestants, c’est la Bible – y compris chez les radicaux. En outre, tout le mouvement social est pétri de messianisme. Mais la culture biblique est aussi enracinée chez les philosophes de langue allemande. Quand il évoque la Bible, Marx est donc traversé à la fois par le langage révolutionnaire et par le langage philosophique de son temps. Mais ici, il ne faut pas s’en tenir à un trait de langue sans le mettre en contexte. Le rôle militant de Marx a été de laïciser le mouvement ouvrier, de le défaire de sa gangue chrétienne messianique (celle d’un Weitling par exemple).
Ensuite, Marx ironisait beaucoup sur son rôle de « monsieur le prophète », quand bien même certaines de ses pages sont en effet portées par un souffle prophétique.
Enfin, il faut rappeler que du vivant de Marx, on a connu trois révolutions en France : 1830, 1848, 1871, sans parler du reste de l’Europe ou de la Guerre de Sécession états-unienne. Il n’y a rien de messianique à prophétiser des révolutions : elles rythment l’histoire du XIXe siècle, il s’agit surtout de savoir quand et pourquoi elles adviennent. En revanche il faut faire une distinction importante : Marx prophétise des révolutions à venir dans une société de classe foncièrement contradictoire, mais ne vaticine pas sur la nature du communisme. Là aussi, tout son effort a été de défaire le socialisme de sa dimension utopique et religieuse. C’est pourquoi les critiques du communisme comme religion laïque sont extrêmement faibles – à peu près aussi faibles que les critiques indignées de la « religion du marché ».
Dans le prolongement des travaux de Benoît Denis (2006), Jean-François Hamel propose de penser les rapports entre littérature et politique à partir de la notion de « politique de la littérature », qu’il définit comme « un système de représentations, plus ou moins largement partagé », permettant à la fois d’« identifier l’être de la littérature » et de « mesurer […] sa présence et sa puissance dans l’espace public[1] ». Même si Marx n’est pas un auteur littéraire au sens étroit du terme, pensez-vous que l’on puisse parler d’une politique de la littérature marxienne ? Si oui, quels en seraient les traits constitutifs ?
Comme nous tou⋅tes, Jean-François Hamel est partagé entre deux constats. D’une part, l’impuissance de la littérature à transformer le monde, a fortiori depuis qu’elle est devenue un média secondaire, concurrencé par la bande dessinée, le cinéma, internet, les podcasts, etc. D’autre part, l’évidence que la littérature est un terrain fortement politisé, et qu’elle a pu charrier des enjeux politiques majeurs selon les contextes (c’est particulièrement vrai dans des contextes politiques répressifs, où la littérature a pu prendre le relais du discours politique pour la critique ou la formation intellectuelle). Cela étant posé, les écrits de Marx ne peuvent être envisagés comme de la littérature que dans un sens très large (comme on parle de « littérature scientifique »). Mais à cet égard, on ne saurait mieux dire qu’Éric Vuillard, dans sa préface du Manifeste du parti communiste : dans l’histoire de l’art d’écrire, Marx est le premier à retourner complètement et explicitement la pratique littéraire contre ceux qui l’ont instituée et en ont été les propriétaires à des fins de domination.
L’autre politique de la littérature de Marx, c’est son internationalisme. Le Manifeste propose une théorie de la Weltliteratur, d’une littérature devenue mondiale parce que le marché unifie le monde. Et en même temps, le communisme marxiste au XXe siècle a ouvert un espace de circulation des idées et des textes, dont les livres de Marx font partie, un espace mondial mais qui n’était pas mondialisé par le marché (et qui ne se limitait pas à la sphère d’influence stalinienne). Le communisme a créé cette Weltliteratur annoncée par le Manifeste en 1848. Toute la question est de savoir si une telle politique internationale de la littérature est encore possible au XXIe siècle, et quelle forme elle prendra ou est en train de prendre.

Les Éditions La Fabrique ont publié en janvier 2024 Lénine et l’arme du langage, un très bel ouvrage dans lequel le philosophe Jean-Jacques Lecercle étudie les formes et les fonctions du mot d’ordre léninien. Diriez-vous que l’on retrouve des dispositifs langagiers similaires chez Marx ?
Le mot d’ordre, selon la formule célèbre, résulte de l’analyse concrète d’une situation concrète. Il propose un scénario révolutionnaire immédiat, valable ici et maintenant, au sein d’un rapport de force. En cela, il est confronté à d’autres mots d’ordre. Un mot d’ordre, en tant que tel, n’a donc rien à voir avec les bons mots et les « formules » qu’on peut trouver sur les pancartes de manif, qui connotent plutôt un style, un esprit, une esthétique, et construisent une connivence politique tout en permettant à son créateur de se distinguer (sur tout cela, voir le Que faire de Lénine ? de Guillaume Fondu). En 1917, « Tout le pouvoir aux soviets » est un scénario d’action qui s’oppose à « Gagnons les élections à la Douma », c’est bien un mot d’ordre. Quand ces mêmes mots se retrouvent sur une pancarte de manif actuelle (dans une conjoncture où il n’y a pas de soviet de soldats ou de travailleurs), ça devient une formule, un clin d’œil.
Le mot d’ordre, susceptible de varier en fonction des nécessités du moment, appartient au jeu de langage de l’agitateur politique. L’ouvrage de Jean-Jacques Lecercle reconstitue justement, avec la clarté qui lui est coutumière, la philosophie du langage implicite de Lénine. Il distingue les différents jeux de langages qui se côtoient dans une formation sociale, et les différents rôles qui peuvent correspondre à ces jeux de langage. Ainsi, un Lénine a pu jouer, selon la temporalité dans laquelle il se place, les rôles de théoricien, de propagandiste / organisateur et d’agitateur / activiste.
Quid de Marx ? Comme le montre Lecercle, celui-ci est pris entre deux fonctions du langage, rappelées par la phrase de Lénine : « La théorie de Marx est toute puissante parce qu’elle est juste » – et par la même phrase, modifiée par les maoïstes : « La théorie de Marx est toute puissante parce qu’elle est vraie ». Dire le juste, rôle du politique, de l’organisateur; dire le vrai, rôle du théoricien.
Il faut bien sûr rappeler (avec les travaux de Jean Quétier) quelle fut l’activité politique de Marx en tant que militant. Il s’est trouvé en position d’agitateur, d’activiste, notamment en 1848-1849. Et il a abondamment rappelé que ses analyses politiques et stratégiques étaient soumises à des situations historiques concrètes. Dans le Manifeste, on voit alterner une analyse théorique de l’histoire, qui cherche à dire le vrai ; des « mesures » qui énoncent un programme général, fixent un cap concret pour les politiques révolutionnaires ; enfin, dans les dernières pages, quelque chose qui se rapproche du mot d’ordre, en précisant quelles sont les factions politiques avec lesquelles les communistes doivent s’allier dans chaque pays d’Europe. Or ces dernières pages n’ont plus qu’une valeur documentaire.
Et de manière plus générale, quand bien même on trouverait des mots d’ordre chez Marx, ils n’auraient plus grand intérêt pour nous (et les mots d’ordre de Lénine n’ont pas d’intérêt en soi, sinon qu’ils sont liés à une réflexion sur leur fonction tactique). En revanche des slogans tels que « À chacun selon ses besoins, de chacun selon ses moyens » ne constituent pas des mots d’ordre. Ces formules, qui souvent sont reprises par Marx à d’autres militant⋅es et théoricien⋅nes, et qu’on trouve par exemple dans la Critique du programme de Gotha, se situent entre le vrai et le juste (le vrai sur ce que serait un mode de production authentiquement non capitaliste mais communiste, le juste sur le cap à fixer pour construire le communisme). Au fond, la Critique du programme de Gotha vient après un mot d’ordre (« Unité du mouvement ouvrier ») qui a été concrétisé tactiquement.
Ce qui est frappant dans tout le parcours de Marx, c’est plutôt l’effort pour se débarrasser d’un jeu de langage inadéquat (celui du millénarisme révolutionnaire et de l’utopie). Si je devais accentuer la différence entre Lénine et Marx, j’emprunterais donc plutôt l’idée d’Alain Badiou, selon laquelle Marx, comme Freud avec la psychanalyse ou Saussure avec la linguistique, a institué un jeu de langage scientifique, contre ses adversaires. Et sa tactique irait plutôt dans le sens d’une victoire de cette exigence scientifique au sein du mouvement social, que d’une victoire révolutionnaire directe.
Notes
[1] Jean-François Hamel, « Qu’est-ce qu’une politique de la littérature ? Éléments pour une histoire culturelle des théories de l’engagement », dans Laurence Côté-Fournier, Élyse Guay et Jean-François Hamel (dir.), Cahiers Figura, vol. 35, 2014, p. 14-15.
Témoignages et contestation suivent la rentrée au Québec

Le débat est amorcé : deux rencontres dans le cadre de la course au porte-parolat de Québec solidaire

Pour assurer un suivi de la course au porte-parolat de Québec solidaire, nous publions :
1. La vidéo de la rencontre du 9 octobre dernier à Sherbrooke
2. L'audio de la rencontre des trois candidats avec les commissions nationales de Québec solidaire
1. La vidéo de la rencontre de Sherbooke :
2. L'audio de la rencontre des 3 candidats avec les commissions nationales de Québec solidaire
Pour visiter le site dédié à la course au porte-parolat, voici l'adresse
https://course.quebecsolidaire.net
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
L’irrigation du pouvoir
La CAQ : Désastres et déceptions
Un syndicaliste ontarien déclaré coupable pour son support à la Palestine

Les employées de soutien scolaire : invisibles, essentielles… et oubliées par l’État

Depuis longtemps, les médias et beaucoup de politiciennes et politiciens parlent des enseignantes quand vient le temps de parler du personnel scolaire. Ce raccourci médiatique contribue à augmenter l’invisibilité du personnel de soutien scolaire. Pourtant, son rôle est essentiel dans la vie quotidienne des élèves. Ces personnes accueillent les élèves à leur arrivée à l’école le matin, elles sont présentes et aident au bon déroulement du dîner. La secrétaire répond aux appels des parents, les ouvriers s’assurent que l’école est en bon état. On ne peut plus se permettre de mettre ces employées[2] à l’écart.
Les employées de soutien scolaire, ce sont 43 classes d’emploi en Outaouais. On peut regrouper ces classes d’emploi en trois grandes familles : le service direct à l’élève, le soutien administratif et le soutien manuel. Mis à part les postes relevant du soutien manuel, ces emplois sont généralement occupés par des femmes. Ce sont souvent des emplois précaires, à salaire peu élevé et à temps partiel. Le salaire moyen des employées de soutien ne permet pas de vivre hors de la pauvreté, selon les chiffres de l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS)[3].
Le présent texte veut faire connaitre les employées de soutien scolaire de l’Outaouais, qui elles sont, ce qu’elles font et dans quelles conditions elles doivent exercer leurs fonctions. Nous ferons également une présentation des principaux enjeux syndicaux et des luttes à mener pour les employées de soutien scolaire en Outaouais.
Les employées de soutien scolaire en Outaouais
En Outaouais, les employées de soutien scolaire ont un profil varié. Ce sont majoritairement des femmes, à 78 %. Cette prédominance souligne l’importance de la contribution des femmes au milieu scolaire. Il est difficile de brosser un portrait médian de l’employée de soutien scolaire. En ce qui concerne l’âge, le spectre va de la jeune femme en début de carrière à la femme retraitée qui fait quelques heures en service de garde ou comme surveillante d’élèves, en passant par la maman à la maison qui travaille quelques heures pendant que les enfants sont à l’école. Les origines culturelles sont diversifiées également : on voit de plus en plus de personnes issues de l’immigration dans les milieux scolaires, comme partout ailleurs en Outaouais, mais c’est inégal selon le lieu où est situé l’établissement. Leur scolarité est hétérogène parce que les exigences d’emploi sont très variées : diplôme d’études secondaires ou d’études professionnelles, attestation d’études collégiales, diplôme d’études collégiales techniques ou d’études universitaires. Différents parcours de vie peuvent également amener des femmes à joindre le personnel des écoles et des centres de services scolaires à titre de personnel de soutien.
Les employées de soutien scolaire font face à des réalités professionnelles spécifiques : leurs postes sont précaires, à temps partiel, peu valorisés et dont le salaire moyen est insuffisant pour répondre aux besoins de base[4]. Ce sont plus de 50 % des employées de soutien qui ont un statut précaire ; ces femmes travaillent à temps partiel et ont des horaires irréguliers. De plus, la majorité d’entre elles sont mises à pied pendant l’été et doivent recourir à l’assurance-emploi.
Le manque de reconnaissance constitue un problème majeur. Bien que leur travail soit essentiel, les employées de soutien scolaire sont souvent perçues comme moins importantes que les enseignantes, ce qui fait en sorte qu’elles se sentent moins valorisées. Comme leur salaire moyen annuel en 2023-2024 est de 24 704,78 $[5], leur situation financière précaire contribue à un sentiment de dévalorisation pour beaucoup d’entre elles. Enfin, l’environnement de travail est stressant; elles doivent gérer des situations difficiles, comme un comportement incorrect des élèves, leur violence et celle des parents, et ce, sans avoir les ressources nécessaires pour effectuer leur travail en profondeur, pour faire de la prévention et travailler en amont. Le rapport 2023 du Secrétariat à la condition féminine constate que « le fait d’occuper un emploi à prédominance féminine s’associe à un niveau plus faible de bien-être, de reconnaissance […] ainsi qu’à un niveau plus élevé de détresse psychologique, d’insomnie et de demandes émotionnelles en moyenne[6] ». Cela décrit bien la réalité des employées de soutien scolaire.
Les fonctions des employées de soutien dans les écoles
Les employées de soutien scolaire assurent plusieurs rôles dans les écoles. Elles s’occupent, entre autres, de l’accueil, du secrétariat, de la surveillance lors des récréations et lors de la période du diner. Elles peuvent soutenir l’enseignante dans ses enseignements, adapter du travail pour des élèves à besoins particuliers ou accompagner et aider ces élèves à réaliser leurs travaux scolaires. Elles veillent au bien-être des élèves handicapé·e·s ainsi qu’à leur hygiène et à leur sécurité. Les employées de soutien scolaire peuvent aussi accompagner des élèves dans une démarche de modification de leur comportement, elles peuvent planifier, organiser et animer des ateliers ou des activités visant à développer des habiletés sociales, cognitives et de communication des élèves. Elles peuvent intervenir auprès d’un élève en situation de crise et favoriser son retour au calme. Les employées de soutien scolaire peuvent aussi être responsables de la création d’activités qui aident le développement global de l’élève dans le cadre du programme du service de garde[7]. Ce ne sont ici que quelques exemples des fonctions des employées de soutien scolaire.
Ces tâches relèvent de différentes classes d’emploi. En Outaouais, comme on l’a déjà dit, on compte quarante-trois classes d’emploi différentes. Il est plus simple de définir le personnel de soutien scolaire par la négative : n’est pas une employée de soutien scolaire, toute personne qui n’est, dans l’école, ni cadre, ni enseignante, ni professionnelle.
Une grande variété d’emploi, une grande variété d’employées qui ont toutes, de près ou de loin, une incidence sur la réussite scolaire des élèves. Si certaines employées ne sont que rarement en contact direct avec les élèves, leur travail reste indispensable au bon fonctionnement des centres de services scolaires. On oublie souvent que le support administratif est à la base même des activités quotidiennes des écoles. La technicienne en organisation scolaire participe activement à fabriquer les horaires de l’école, la technicienne en transport scolaire détermine les circuits, la programmation des horaires, la rédaction des contrats et des règlements ainsi que le contrôle de leur application. Ces employées qui travaillent souvent dans l’ombre sont véritablement les maitres d’œuvre de la présence des élèves à l’école. Cependant, c’est la triste réalité, ces personnes sont souvent mises de côté quand on parle du milieu scolaire. En effet, on préfère simplifier le message dans les médias, mettre de l’avant la profession enseignante et passer outre toutes les autres professions.
Les conditions de travail des employées de soutien
On l’a déjà mentionné, les employées de soutien scolaire ont un statut précaire. Les emplois sont peu rémunérés et comptent souvent des heures fragmentées. Beaucoup sont également des emplois cycliques qui comportent une mise à pied pendant la période estivale. Selon les données du Conseil du trésor, les employées de soutien scolaire avaient, en 2023-2024, un salaire annuel brut moyen de 24 704,78 $. À titre de comparaison, Statistiques Canada évaluait, en 2022, à 25 303 $ le seuil de faible revenu avant impôt pour une personne vivant seule dans une ville comme Gatineau[8]. Selon la publication de l’IRIS de 2024[9], le revenu viable à Gatineau, soit l’équivalent du revenu après impôt nécessaire pour mener une vie hors de la pauvreté, est de 38 146 $ pour une personne seule, de 50 052 $ pour une famille monoparentale dont l’enfant fréquente un centre de la petite enfance (CPE) et de 78 145 $ pour une famille de deux parents dont les deux enfants fréquentent un CPE. Ces données démontrent bien la précarité financière dans laquelle se retrouve une bonne proportion des employées de soutien scolaire.
Les conditions de travail des employées de soutien scolaire sont de plus en plus difficiles. Ces dernières années, la violence a augmenté dans le milieu scolaire. En Outaouais, environ 25 % des employées de soutien disent avoir été victimes de violence au courant de l’année scolaire 2023-2024, selon un sondage effectué par la Fédération du personnel de soutien scolaire CSQ (FPSS-CSQ)[10]. Il faut souligner que 50 % des personnes sondées disent ne pas remplir de déclaration quand elles sont victimes d’un geste violent. De plus en plus de parents font, comme les élèves, preuve d’incivilité, et ces comportements sont également en augmentation. De plus en plus de secrétaires ont affaire à des parents qui manquent de respect, crient ou insultent.
Par ailleurs, le personnel de soutien scolaire n’échappe pas à la pénurie actuelle de main-d’œuvre. La main-d’œuvre qualifiée est rare, ce qui alourdit la tâche des employées de soutien qualifiées en poste étant donné qu’elles doivent effectuer elles-mêmes un travail autre que le leur ou accompagner des personnes non qualifiées. Ces tâches supplémentaires ne sont pas reconnues, non plus que le temps nécessaire pour les accomplir. Personne ne revoit les demandes à la baisse. Bref, l’employée doit effectuer ses tâches normales, en plus de devoir compenser pour l’absence d’une personne qu’on aurait dû embaucher ou le manque de formation d’une autre, et ce, dans le même temps. Enfin, l’organisation du travail dans les écoles est souvent modifiée sans que les personnes principalement touchées par les modifications ne soient consultées. Certaines employées doivent travailler sept heures par jour, sans avoir de pause pour diner, car on attend d’elles qu’elles soient constamment avec les élèves. Aller aux toilettes pendant sa journée de travail peut parfois devenir problématique.
Il faut aussi prendre en compte la faible valorisation sociale et professionnelle des employées de soutien scolaire. En effet, quand on parle des écoles au Québec, on parle des enseignantes et on néglige les autres employées. Cette habitude contribue largement au sentiment d’invisibilité qui habite les employées de soutien scolaire. On oublie qu’une école ne peut pas fonctionner si les employées de soutien ne sont pas présentes. Pensons à la secrétaire d’école qui s’occupe d’orienter les suppléants et suppléantes de la journée, d’accueillir les élèves en retard, de contacter les parents des élèves absents, de répondre aux appels, de gérer les petits bobos des élèves, pour ne nommer que quelques-unes de ses tâches. Une école, c’est beaucoup plus que des enseignantes. L’équipe école au complet doit être mise en valeur. Par leurs rôles différents et complémentaires, les employées de soutien scolaire sont toutes indispensables au succès des élèves.
Dans son rapport de 2023, le Secrétariat à la condition féminine considère la non-reconnaissance de toutes les tâches effectuées comme un des principaux problèmes des emplois à prédominance féminine. De nombreux emplois d’employées de soutien scolaire sont de l’ordre du « prendre soin ». Des études démontrent que plusieurs tâches sont invisibles et informelles. Il y a également un manque de reconnaissance des compétences généralement attribuées au genre féminin, telles que les compétences relationnelles, humaines, cognitives, émotives, etc.[11] Il va sans dire que la présence historiquement moins importante des femmes dans la sphère politique a un lien avec ce manque de reconnaissance. Si plus de décideurs et de personnes en position de pouvoir avaient vécu la réalité des employées de soutien scolaire ou celle d’un emploi à prédominance féminine, fort est à parier que cela aurait eu un effet sur leur vision et leurs propositions politiques. Il faut sans doute faire des changements et travailler à rendre les rôles politiques plus accessibles aux femmes et plus attrayants.
Enjeux syndicaux et politiques publiques
L’action syndicale en Outaouais est forte et dynamique. Les syndicats militent pour de meilleures conditions de travail, des salaires équitables et la reconnaissance des métiers et fonctions. Considérant les nombreux enjeux syndicaux et leur complexité, le Syndicat du soutien scolaire de l’Outaouais (SSSO-CSQ) effectue un travail d’envergure. La précarité de l’emploi, le bas niveau des échelles salariales au regard de celles des professions comparables, la difficulté des conditions de travail et l’ampleur de la charge de travail constituent les principaux défis à relever. Le syndicat revendique des postes à temps plein et un horaire non fractionné pour garantir aux employées de soutien sécurité et stabilité financière ainsi que la possibilité de concilier famille et travail. Il revendique aussi une meilleure échelle salariale afin de rendre plus faciles le recrutement et la rétention du personnel qualifié. La pénurie est de plus en plus marquée et le personnel non légalement qualifié ou sans formation plus nombreux. Il est donc important d’attirer les jeunes diplômées et de garder le personnel qualifié. Le syndicat revendique des conditions de travail décentes, entre autres un milieu de travail sécuritaire, exempt de violence. Il réclame aussi une charge de travail raisonnable qui tienne compte de l’augmentation des besoins des élèves et de l’insuffisance des ressources nécessaires pour accomplir efficacement les tâches. Nombre d’employées de soutien n’ont même pas le temps de prendre une pause dans la journée. Ces conditions de travail difficiles mènent plusieurs d’entre elles vers l’épuisement professionnel, ou encore vers une réorientation de carrière.
Le rôle des employées de soutien est essentiel, et malgré cela, le gouvernement refuse de les soutenir en effectuant des coupes budgétaires et en demandant un gel d’embauche. Ces décisions gouvernementales ont un impact direct sur les conditions de travail des employées de soutien parce qu’elles réduisent les ressources et demandent de faire plus avec moins. En Outaouais, le gouvernement du Québec impose une réduction budgétaire de 5,5 millions de dollars dans le réseau de l’éducation[12].
Lors des dernières négociations, les employées de soutien en Outaouais ont pu voir des progrès sur le plan du salaire et des assurances. Malgré ces avancées, nous militons toujours pour l’augmentation du taux horaire afin que la paye des employées soit réellement améliorée. Quant aux assurances, il y a encore beaucoup de travail à faire pour que la protection soit comparable à celle offerte ailleurs, malgré l’augmentation de la part de l’employeur obtenue lors des dernières négociations. Les employées de soutien ont besoin d’une nette amélioration de leurs conditions de travail et d’un salaire décent. Le Syndicat du soutien scolaire de l’Outaouais continuera assurément d’intervenir, de mobiliser et de lutter en ce sens.
On l’a déjà dit, les femmes constituent 78 % des employées de soutien. Ces emplois méritent d’être pleinement reconnus pour leur importance et leur contribution essentielle. Sans employées de soutien, pas d’école ! Il faut continuer à se mobiliser et à mettre de l’avant les travailleuses dans la lutte pour leurs droits. Leur travail, invisible mais indispensable, mérite une reconnaissance. La solidarité est donc déterminante pour faire face aux défis liés à l’équité salariale et à la sous-valorisation des emplois à prédominance féminine. Lorsque les femmes s’unissent et se soutiennent mutuellement, elles renforcent leur voix collective, une voix incontournable face aux injustices persistantes dans le monde du travail. La mobilisation collective permet de faire davantage de sensibilisation à l’égard de la nécessité de rémunérer les femmes à la hauteur de leur contribution, et met en lumière les inégalités systémiques, en particulier dans les métiers du prendre soin où l’immense majorité des personnes qui y travaillent sont des femmes. Cette mobilisation est également cruciale pour la défense des droits des femmes, afin de garantir qu’elles aient un accès équitable à toutes les possibilités d’avancement professionnel, sans être freinées par des discriminations salariales ou des stéréotypes de genre. Il est donc indispensable que la solidarité féminine ne soit pas seulement un principe, mais un moteur de changement vers l’égalité entre les sexes.
Un appel à la reconnaissance
Les travailleuses du soutien scolaire font donc face à plusieurs défis, notamment le fait d’occuper des emplois peu rémunérés, qui comptent un nombre d’heures insuffisant, des horaires irréguliers et une mise à pied cyclique l’été. Cela contribue à maintenir ces femmes dans la précarité et à entretenir un sentiment d’insatisfaction. Ce dernier peut à son tour amener les gens à quitter le milieu de l’éducation. En Outaouais, on assiste à un exode des employées de soutien scolaire au profit d’emplois dans la fonction publique fédérale. Ces emplois sont souvent mieux rémunérés et les conditions de travail meilleures. Par ailleurs, la violence de plus en plus importante dans nos milieux constitue un autre défi : les paroles comme les gestes violents font maintenant partie du quotidien des travailleuses.
Il n’y a pas de solution parfaite aux problèmes des employées de soutien scolaire de l’Outaouais. Cependant, il est essentiel que leur contribution au milieu scolaire et à la société québécoise soit reconnue à sa juste valeur. Il ne s’agit pas seulement de souligner la journée ou la semaine du personnel de soutien. Il faut aller au-delà, il faut en faire plus. Avec les années, les employées de soutien se sont appauvries et ont été dévalorisées par le gouvernement. La juste reconnaissance de leur implication à tous les moments de la vie des élèves constitue une exigence minimale pour rendre leur valeur à ces professions qui passent souvent inaperçues aux yeux du public québécois. Difficile de parler de reconnaissance et de valorisation sans parler de salaires. Il est évident que les salaires doivent être augmentés. Il est complètement ridicule et injuste que des gens employés par l’État ne soient pas capables de se sortir de la pauvreté. Les employées de soutien scolaire méritent mieux. Ce n’est pas normal qu’elles quittent un emploi qu’elles aiment, en milieu scolaire, pour aller vers un emploi de la fonction publique fédérale pour une question de salaire.
Bien que le portrait qui a été fait de la situation des employées de soutien scolaire peut sembler un peu sombre, un vent de changement politique pourrait apporter bien des améliorations. Sur le plan local, un travail énorme s’effectue pour faire connaitre le personnel de soutien scolaire. Le Syndicat du soutien scolaire de l’Outaouais ne manque pas une occasion de faire valoir son point de vue et celle de ses membres sur différentes situations difficiles. Il faut absolument dénoncer les coupes et le gel des embauches et des dépenses qui mettent une pression sur les employées de soutien scolaire. La Fédération du personnel de soutien scolaire de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) est également très présente dans les médias et réagit aux événements qui surviennent dans le milieu scolaire. Cette présence médiatique contribue à faire valoir l’importance du personnel de soutien scolaire. Cependant, ce combat ne peut pas être mené seul. Il faut que les politiciennes et politiciens modifient leur discours pour que la société amorce un changement dans sa perception de l’importance des employées de soutien scolaire. Il va sans dire que les autres acteurs du milieu scolaire pourraient également contribuer à améliorer cette situation et à favoriser une prise de conscience plus grande au sein de la société. Une école sans personnel de soutien scolaire, ça ne peut pas fonctionner. Il est temps que la société le reconnaisse, que les femmes et les hommes politiques le reconnaissent et que cela transparaisse dans les négociations, tant sur le plan salarial que sur celui des conditions de travail.
Par Maude Sioui-Daoust, vice-présidente secteur Draveurs du Syndicat du soutien scolaire de l’Outaouais et Mélanie Déziel-Proulx, vice-présidente aux dossiers spéciaux du même syndicat.
- Dans le texte, le féminin désigne les femmes et les hommes étant donné que la majorité des employées de soutien scolaire sont des femmes. ↑
- Eve-Lyne Couturier et Guillaume Tremblay-Boily, Le revenu viable en 2024 : sortir de la pauvreté dans un contexte de crise du logement, Montréal, Institut de recherche et d’informations socioéconomiques, 2024. ↑
- Couturier et Tremblay-Boily, ibid. ; Statistique Canada. Tableau 11-10-0241-01. Seuils de faible revenu (SFR) avant et après impôt selon la taille de la communauté et la taille de la famille, en dollars courants, 26 avril 2024. ↑
- Secrétariat du Conseil du trésor, L’effectif de la fonction publique du Québec 2021-2022 – Équivalents temps complets (ETC). ↑
- Secrétariat à la condition féminine, Pour la valorisation des emplois à prédominance féminine. Analyse de la sous-valorisation des emplois à prédominance féminine et recommandations visant à leur assurer une meilleure reconnaissance, rapport 2023, gouvernement du Québec, septembre 2023. ↑
- Comité patronal de négociation pour les centres de services scolaires francophones, Plan de classification. Personnel de soutien, édition du 8 février 2024. ↑
- Statistique Canada, 26 avril 2024, op. cit. ↑
- Couturier et Tremblay-Boily, 2024, op. cit. ↑
- Fédération du personnel de soutien scolaire (CSQ), Sondage sur la violence auprès du personnel de soutien scolaire de la FPSS-CSQ, avril 2024. ↑
- Secrétariat à la condition féminine, 2023, op. cit. ↑
- Fatoumata Traoré, « Compressions en éducation : “C’est de l’austérité”, dit un syndicat en Outaouais », Radio-Canada, 18 décembre 2024. ↑

Les dynamiques et particularités de l’Outaouais syndical

On dit souvent de l’Outaouais qu’elle est l’oubliée des régions québécoises. Sa position frontalière et la proximité de sa plus grande ville, Gatineau, avec Ottawa, font qu’on la considère régulièrement comme une dépendance de l’Ontario ou du fédéral, à l’écart des dynamiques sociales et politiques du Québec. Ce cliché tenace ne résiste pourtant pas à l’épreuve des faits, et si sa position frontalière donne évidemment une couleur particulière à l’Outaouais, elle reste profondément québécoise tant dans sa culture que dans les enjeux qu’elle rencontre et dans la façon dont s’y structure la société civile. À cet égard, l’histoire et la situation actuelle du syndicalisme dans la région montrent bien comment elle contribue à ce mouvement essentiel de la société québécoise tout en rencontrant des défis qui lui sont propres. Sans prétendre à l’exhaustivité, nous proposons ici un aperçu de l’Outaouais syndical passé et présent, tout en nous concentrant sur une organisation en particulier, la Confédération des syndicats nationaux (CSN), dont l’histoire est intrinsèquement liée à celle de la région.
Portrait de l’Outaouais syndical
La plupart des grandes organisations syndicales québécoises sont représentées en Outaouais. La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) y dispose d’un conseil régional comme la CSN qui y compte un conseil central, chaque conseil rassemblant les syndicats de leur centrale dans la région. Dans le domaine de l’éducation, les enseignantes et enseignants des centres de services scolaires francophones sont représentés par le Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais (SEO), membre fondateur de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) lorsque ses syndicats membres se sont séparés de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) en 2006. Ironiquement, c’est une ancienne présidente du SEO, Suzanne Tremblay, qui représente aujourd’hui la circonscription de Hull à l’Assemblée nationale sous la bannière de la Coalition avenir Québec (CAQ). Sa présence au sein du caucus caquiste ne semble toutefois pas avoir freiné les ambitions antisyndicales du parti au pouvoir, comme le montre le dépôt récent du projet de loi 89 visant à restreindre considérablement l’exercice du droit de grève. Dans le domaine de la santé et des services sociaux, le portrait syndical de l’Outaouais correspond à celui de bien d’autres régions du Québec, comme l’illustre la représentation syndicale au sein du Centre intégré en santé et services sociaux de l’Outaouais (CISSSO). À la suite notamment des réorganisations et des maraudages imposés par le gouvernement du Québec dans les dernières décennies, la CSN y conserve la représentation des personnels paratechniques, auxiliaires et de métiers, ainsi que des personnels de bureau et administratifs, tandis que les professionnel·le·s, techniciennes et techniciens sont représentés par l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) et les infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes par la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ). Le reste du secteur public et parapublic compte sur les joueurs habituels au Québec, notamment la CSN (par exemple à la Société des alcools du Québec, mais aussi, fait plutôt inusité, au sein des cols bleus de la Ville de Gatineau), le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) (notamment dans les grandes sociétés d’État telle Hydro-Québec ainsi que dans le secteur municipal et paramunicipal) et les deux syndicats indépendants, le Syndicat de la fonction publique du Québec (SFPQ) et le Syndicat des professionnelles et professionnels du Gouvernement du Québec (SPGQ).
Une particularité de la région tient bien entendu à l’importance de la fonction publique fédérale. La centralité de cet employeur tant à Ottawa qu’à Gatineau a des répercussions importantes sur les dynamiques syndicales dans la région. D’une part, il est fréquent que des travailleuses et travailleurs vivent dans une ville/province et travaillent dans l’autre. Cela a des incidences sur les structures syndicales qui cherchent à les représenter tant dans leur milieu de travail que dans leur milieu de vie. Comment, en effet, mobiliser des membres travaillant au Québec, mais payant des impôts et utilisant des services publics situés en Ontario, et vice-versa ?
Ce paradoxe est renforcé par le fait que le syndicat représentant la vaste majorité de ces travailleuses et travailleurs, l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC), dispose de sa propre structure régionale couvrant tant la rive québécoise que la rive ontarienne de la région de la capitale fédérale. Les membres de l’AFPC en Outaouais ne sont ainsi pas rattachés à l’AFPC-Québec, mais bien à l’AFPC-Région de la capitale nationale (RCN). Cela n’a pas été sans poser problème au Conseil régional de la FTQ en Outaouais qui s’est parfois retrouvé à partager les mêmes plates-bandes que la structure régionale d’un de ses principaux affiliés; de récentes discussions visent toutefois à permettre une meilleure coordination entre les deux structures. La centralité de la fonction publique fédérale dans la région, et en son sein des membres de l’AFPC, fait aussi en sorte de donner un statut particulièrement important à la vice-présidence régionale de l’AFPC, qui est régulièrement sollicitée dans les médias pour parler des réalités de ses membres, mais aussi pour jouer, à l’occasion, le rôle de porte-parole informel des syndicats de la région. Le fait que deux de ces anciens vice-présidents occupent aujourd’hui des fonctions syndicales de premier plan à l’échelle nationale – Larry Rousseau, devenu vice-président exécutif du Congrès du travail du Canada, et Alex Silas, devenu vice-président exécutif national de l’AFPC – confirment l’importance de ce poste et son rôle prééminent au sein du mouvement syndical de la région.
Dans le secteur privé, on retrouve des syndicats majoritairement affiliés à la FTQ, notamment des sections locales UNIFOR dans l’industrie forestière et de la transformation du bois, historiquement importante dans la région, mais aussi dans le commerce et la distribution (par exemple les Travailleurs et Travailleuses unis de l’alimentation et du commerce – TUAC), dans les télécommunications (on pense en particulier aux membres du SCFP chez Vidéotron qui ont récemment vu se terminer un lockout extrêmement long) ou encore dans la construction avec les syndicats de métiers. La CSN a quant à elle une présence assez faible dans le secteur privé en Outaouais, à quelques exceptions près, comme le syndicat de la scierie Louisiana Pacific à Maniwaki.
Une riche histoire syndicale
Les racines syndicales sont profondes en Outaouais; celles de la famille des syndicats catholiques ont été particulièrement documentées à l’occasion du 100e anniversaire du Conseil central des syndicats nationaux de l’Outaouais (CCSNO) qui rassemble aujourd’hui les syndicats CSN de la région, mais dont les origines remontent, au même titre que sa centrale, au syndicalisme confessionnel[2]. Curieusement, l’Association ouvrière de Hull, fondée en 1912 et qui sera le prélude au CCSNO actuel, était à ses débuts affiliée aux Chevaliers du travail, une organisation syndicale nord-américaine sans lien avec l’Église, mais également distincte des grands syndicats étatsuniens qui s’établissaient alors au Canada et au Québec. Sa conversion au catholicisme est étroitement liée à la grande influence de l’Église dans la région d’Ottawa-Hull, notamment auprès des francophones, pour qui elle représentait un marqueur identitaire, jusque dans leurs organisations syndicales. Outre l’évêché d’Ottawa, dont relève l’Outaouais québécois jusque dans les années 1960, la Congrégation des oblats joue un rôle central, notamment en fondant plusieurs institutions francophones dans la région, dont l’Université d’Ottawa et le journal Le Droit. Il n’est donc pas surprenant que, dès 1919, le Conseil central national des ouvriers de Hull (ancêtre direct du CCSNO) voie le jour et que, deux ans plus tard, ce soit dans ses locaux que sera fondée la Confédération des travailleurs catholiques du Canada (CTCC), prédécesseur de la CSN.
Difficile d’ignorer dans ces prémices historiques du syndicalisme catholique en Outaouais les luttes épiques des allumettières en 1919 et 1924[3]. Hull produisait à l’époque 99 % des allumettes consommées au Canada non seulement grâce aux abondantes forêts de l’Outaouais, mais aussi du fait des usines de transformation installées très tôt dans la région.
La propriété de ces entreprises était concentrée dans les mains de quelques grands propriétaires, dont E.B. Eddy, d’origine étatsunienne. Il employait dans ses usines d’allumettes une main-d’œuvre essentiellement féminine et soumise à des risques importants, notamment la nécrose maxillaire causée par l’exposition au phosphore blanc. Les conditions de travail sont en outre misérables, et les travailleuses encadrées exclusivement par des contremaitres masculins. Elles s’organisent donc au sein d’un syndicat catholique et réussissent, grâce à leur solidarité et à leur mobilisation, à faire reconnaitre leur syndicat et à améliorer leurs conditions de travail. Elles sont pour l’occasion largement soutenues par l’opinion publique et par les institutions contrôlées par les Oblats. Les allumettières de Hull deviendront un symbole important pour le mouvement ouvrier de l’Outaouais et au-delà. Fondatrices de l’un des premiers syndicats féminins au Canada, elles seront reconnues en 2007 dans une toponymie notoirement dominée par les hommes, alors que la Ville de Gatineau nommera un important nouveau boulevard en leur honneur, et que la plus récente bibliothèque municipale de la ville se verra baptisée du nom de leur porte-parole, Donalda Charron, en 2020.
Cet épisode ne doit pas pour autant faire oublier les tendances très conservatrices qui marquent également le syndicalisme catholique de l’époque. Si les femmes connaissent à Hull un remarquable taux de syndicalisation de 50 % en 1922, contre à peine 2 % dans le reste du Québec, elles n’ont pas le droit de participer aux assemblées de leur propre conseil central, et encore moins d’y occuper un poste électif. L’aumônier y garde une influence considérable et assure le respect d’orientations anticommunistes féroces, dans la lignée de celles adoptées par la CTCC à l’échelle nationale.
Il est par ailleurs important de noter que plusieurs syndicats d’établissements industriels se joignent aux « syndicats internationaux », sans lien avec l’Église, au prix de luttes de haut vol telle la lutte à la Maclaren à Buckingham où deux travailleurs, dont le président du syndicat, sont assassinés par les briseurs de grève, les scabs, embauchés par l’employeur en 1906. Plusieurs de ces sections syndicales sont les précurseurs de celles aujourd’hui affiliées à UNIFOR.
Le syndicalisme catholique en Outaouais évoluera ensuite à l’image du reste du Québec. L’Église y perdra progressivement son influence et les syndicats gagneront en combativité. Leur laïcisation se fera dans les années 1960. C’est aussi à cette époque que le gouvernement mené par Pierre E. Trudeau – dont ironiquement fait partie un ancien président de la CTCC-CSN, Jean Marchand – impose une restructuration draconienne du centre-ville de Hull avec la construction du complexe Portage visant notamment à assurer la mise sous tutelle, tant politique qu’administrative, de la rive québécoise par le pouvoir fédéral. De ce traumatisme collectif marqué par un grand nombre d’évictions et une crise du logement sans précédent naitront par ailleurs une vaste mobilisation et un dense mouvement social, notamment dans le domaine de la lutte pour le logement et des coopératives d’habitation. Celle-ci marquera durablement le tissu social de la région, où des organismes comme Logemen’occupe et d’importants réseaux de coopératives constituent aujourd’hui des alliés importants pour le mouvement syndical.
Les années 1960 sont aussi celles où l’on voit le portrait économique de la région changer brusquement. D’un mouvement dominé par les industries privées, en particulier celles liées à l’exploitation forestière et à la transformation du bois, le syndicalisme voit le secteur public prendre une place centrale en quelques années à peine, non seulement avec le développement de la fonction publique fédérale, mais aussi avec la mise en place des grands réseaux publics et des entreprises d’État par le gouvernement du Québec. C’est à ces transformations que l’on doit le paysage syndical que nous connaissons aujourd’hui et que nous avons exposé précédemment.
Région négligée, région mobilisée
L’histoire plus récente du CCSNO, sans résumer à elle seule l’ensemble des dynamiques syndicales dans la région, nous donne toutefois un aperçu des grands enjeux qui se posent aujourd’hui au mouvement ouvrier en Outaouais. Nous nous appuyons ici sur une enquête réalisée entre 2018 et 2021 sur les organisations syndicales régionales au Québec, comprenant notamment la distribution d’un questionnaire aux délégué·es du congrès triennal du CCSNO en 2019, des entrevues avec plusieurs membres de son exécutif et une analyse des résolutions adoptées par ses congrès dans la décennie 2010.
Un premier constat s’impose : la place prépondérante occupée par les syndicats du secteur public. À cet égard, la composition du CCSNO illustre bien la transition vécue par la région vers une économie de services et le statut de pôle de services publics qu’y occupe en particulier la ville de Gatineau. Ainsi, l’important Syndicat des travailleurs et travailleuses de la santé et des services sociaux de l’Outaouais, fruit des fusions et des consolidations forcées par le gouvernement du Québec dans ce secteur, est de loin le principal affilié du conseil central. À l’image d’autres structures au sein de la CSN, le CCSNO a d’ailleurs dû revoir ses statuts afin de garantir une représentation adéquate de ce mégasyndicat de la santé sans pour autant lui permettre de pouvoir contrôler à lui seul le conseil. Les observations réalisées pendant les instances du CCSNO permettent toutefois de noter la présence et la participation active d’autres syndicats du secteur public, mais en provenance de différentes fédérations sectorielles, notamment les syndicats des cols bleus de la ville de Gatineau, des employé·es de magasin et de bureau de la SAQ et des professeur·es du Cégep de l’Outaouais.
Cette centralité des services publics s’observe aussi dans les résolutions adoptées au courant des années 2010. La préservation et la protection de ces services y occupent une place très importante. En cela, le CCSNO est en phase avec les orientations de sa centrale, dictées par un contexte politique d’austérité et des coupes régulières faites dans les grands réseaux publics par le gouvernement du Québec. Cependant, on note que plusieurs préoccupations environnementales reviennent régulièrement dans les revendications du Conseil. Il s’oppose notamment très tôt à l’instauration d’un dépotoir de déchets nucléaires à Chalk River, en Ontario, en amont de la rivière des Outaouais, dont une défaillance pourrait avoir des conséquences environnementales catastrophiques sur la région. On voit aussi apparaitre des demandes pour améliorer la qualité du transport en commun à Gatineau, une ville marquée par l’étalement urbain et dont le réseau de transport collectif est notoirement connu pour les importants défis qu’il rencontre.
Là où le CCSNO se distingue des conseils centraux des autres régions, c’est lorsque l’on se penche sur les affinités partisanes de ses délégué·es. Dans les trois régions où nous avons mené notre enquête, l’Outaouais, l’Abitibi-Témiscamingue et le Montréal métropolitain, nous avons demandé aux délégué·es aux congrès des conseils centraux de la CSN de quel parti ils et elles se sentaient les plus proches sur la scène politique québécoise. L’Outaouais est la seule région où la majorité des délégué·es ont répondu « aucun » (52 %)[4]. Ce résultat était également élevé en Abitibi-Témiscamingue, mais pas majoritaire (43 %)[5] tandis que Québec solidaire (QS) arrivait largement en tête des choix dans le Montréal métropolitain (47 %)[6]. Souvenons-nous que ce coup de sonde suivait de seulement quelques mois l’élection générale de 2018 au cours de laquelle la scène politique québécoise s’était vue considérablement chamboulée, notamment par l’émergence de deux organisations, la CAQ et QS, au détriment des « vieux partis », le Parti libéral et le Parti québécois[7]. Bien que ce réalignement partisan se veuille une réponse au cynisme et au désengagement politique, les délégué·es que nous avons sondés semblaient encore bien déconnectés des organisations censées les représenter à Québec.
Il semble raisonnable d’émettre l’hypothèse que ce sentiment d’aliénation exprimé de façon particulièrement forte par les militantes et militants syndicaux de l’Outaouais soit en lien avec la position de la région elle-même vis-à-vis du pouvoir politique québécois, de son sentiment d’être « prise pour acquise » et ainsi négligée par l’État provincial. Historiquement considérée comme acquise aux « rouges[8] » en raison de sa proximité avec Ottawa et du rapport de dépendance avec cette dernière qui lui a été imposé, l’Outaouais a pourtant envoyé un coup de semonce en élisant trois, puis quatre député·es caquistes sur ses cinq circonscriptions en 2018, puis en 2022, incluant dans le « château fort » libéral de Hull. Malgré cela, le « statut particulier » qui lui a été reconnu par l’Assemblée nationale en 2019 ne semble toujours pas porter ses fruits, même sous un gouvernement « bleu ».
Cela se reflète également dans le design des coalitions populaires régionales auxquelles ont participé les organisations syndicales, au premier rang desquelles le CCSNO, dans les dernières années. Comme dans bien d’autres régions du Québec, les années des gouvernements libéraux Charest et Couillard avaient vu se former un Réseau de vigilance en Outaouais qui rassemblait largement les acteurs des milieux syndicaux, militants et communautaires. Bien qu’il ait servi de solide base de mobilisation en opposition aux politiques néolibérales et austéritaires, il n’a pas survécu, notamment aux tensions intersyndicales créées par les maraudages forcés en santé et services sociaux, ainsi qu’à d’autres divergences existant au sein des groupes citoyens. À cet égard, notre enquête montre que la solidarité intersyndicale et plus largement les coalitions populaires sont plus difficiles à faire vivre en région que dans le Montréal métropolitain. Toutefois, ce réseau a récemment été réactivé sous le nom de Coalition Solidarité Outaouais, semblant indiquer une nouvelle volonté de création d’un espace à la fois intersyndical et ouvert aux organisations populaires afin notamment de résister aux coupures budgétaires et aux tentatives de privatisation larvée du réseau de la santé.
Il n’est pas anodin de constater que les coalitions populaires importantes qui se sont refondées en Outaouais et auxquelles les syndicats ont activement participé, se sont toutes axées sur le sentiment d’abandon et d’iniquité ressenti par la population de la région. La coalition Équité Outaouais, lancée en 2018, insiste ainsi sur le traitement injuste fait à la région en matière de santé et services sociaux, d’éducation et de justice sociale. Sans que les syndicats n’y participent directement, la coalition SOS Outaouais, lancée en 2024 par la Fondation Santé Outaouais, se centre quant à elle plus spécifiquement sur le déficit de services en santé en se basant notamment sur les études de l’Observatoire du développement de l’Outaouais qui a fait la démonstration des retards vécus dans plusieurs secteurs de la région[9]. Il semble donc que ce sentiment d’aliénation vis-à-vis de Québec, cette impression d’être oublié dans son propre pays et d’en vivre les conséquences concrètes au quotidien soit aussi un ressort important de mobilisation, voire de fierté. L’histoire a montré que même face à des adversaires féroces et dans un contexte hostile, qu’il s’agisse de l’antisyndicalisme d’un E.B. Eddy ou des velléités assimilatrices d’un Pierre E. Trudeau, l’Outaouais sait se tenir debout et résister. Son mouvement syndical en témoigne et les luttes d’hier continueront d’inspirer celles d’aujourd’hui et de demain, quoi qu’en pensent les pouvoirs politiques, à Ottawa comme à Québec.
Par Thomas Collombat, professeur titulaire de science politique à l’Université du Québec en Outaouais et directeur du Département des sciences sociales de l’Université du Québec en Outaouais. Certaines des données utilisées dans cet article sont tirées d’une recherche financée par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH).
- Soulignons ici l’excellent travail de l’historien Roger Blanchette, principal auteur de la brochure 1919-2019. Conseil central des syndicats nationaux de l’Outaouais. Pionnier du mouvement syndical québécois, publiée en février 2019 par le Conseil central des syndicats nationaux de l’Outaouais à l’occasion de son centenaire et dont sont tirées plusieurs des données utilisées dans cette partie. ↑
- Voir à ce propos l’ouvrage de Kathleen Durocher, Pour sortir les allumettières de l’ombre. Les ouvrières de la manufacture d’allumettes E.B. Eddy de Hull (1854-1928), Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, 2022. ↑
- Le taux de réponse à nos questionnaires distribués en Outaouais était de 62,5 %. ↑
- Taux de réponse de 78,5 %. ↑
- Taux de réponse de 57 %. ↑
- Voir Thomas Collombat et Xavier Lafrance, « Recomposition de la gauche québécoise et rôle politique du syndicalisme », Recherches sociographiques, vol. 63, n° 1-2, 2022, p. 131-155. ↑
- NDLR. Les « rouges » étant le Parti libéral. ↑
- Voir notamment le rapport L’Outaouais en mode rattrapage. Suivi des progrès pour combler le retard historique de la région en santé, éducation et culture rédigé par Alexandre Bégin et Iacob Gagné-Montcalm et publié en avril 2022 par l’Observatoire du développement de l’Outaouais. ↑
Blockades and Solidarity | Emma Goldman Collective (Quebec, 2025)

Pour rebâtir une Gauche populaire

📅 Vendredi 29 août 2025
🕑 Dès 18h
📍La Korrigane - 380 rue Dorchester, Québec
Événement Facebook : https://www.facebook.com/events/4135489120042694
Sur la plate-forme Mouvement : https://mouvement.quebecsolidaire.net/carte/6461
Dans le cadre de la course au co-porte-parolat de Québec solidaire, Geru Schneider vous invite à une rencontre privilégiée avec lui ce vendredi soir. Cette soirée conviviale vous permettra de découvrir la vision de Geru pour l'avenir de notre mouvement et d'échanger avec lui sur les grands enjeux de cette course au co-porte-parolat. Tout cela dans une ambiance détendue qui met de l'avant la démocratie participative qui nous unit toustes commes membres de Québec solidaire.
Venez poser vos questions, vos idées et vos préoccupations à cette soirée, que vous soyez militant·e de longue date ou simplement curieux·se des orientations futures de QS que propose Geru.
Blocages et solidarité | Collectif Emma Goldman (Québec, 2025)
Où est notre Top Gun ?
gauche.media
Gauche.media est un fil en continu des publications paraissant sur les sites des médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG). Le Regroupement rassemble des publications écrites, imprimées ou numériques, qui partagent une même sensibilité politique progressiste. Il vise à encourager les contacts entre les médias de gauche en offrant un lieu de discussion, de partage et de mise en commun de nos pratiques.