Revue Droits et libertés
Publiée deux fois par année, la revue Droits et libertés permet d’approfondir la réflexion sur différents enjeux de droits humains. Réalisée en partenariat avec la Fondation Léo-Cormier, la revue poursuit un objectif d’éducation aux droits.
Chaque numéro comporte un éditorial, les chroniques Un monde sous surveillance, Ailleurs dans le monde, Un monde de lecture, Le monde de l’environnement, Le monde de Québec, un dossier portant sur un thème spécifique (droits et handicaps, droits des personnes aînées, police, culture, droit à l’eau, profilage, mutations du travail, laïcité, etc.) ainsi qu’un ou plusieurs articles hors-dossiers qui permettent de creuser des questions d’actualité. Les articles sont rédigés principalement par des militant-e-s, des représentant-e-s de groupes sociaux ou des chercheuses ou chercheurs.
Créée il y a 40 ans, la revue était d’abord diffusée aux membres de la Ligue des droits et libertés. Depuis, son public s’est considérablement élargi et elle est distribuée dans plusieurs librairies et disponible dans certaines bibliothèques publiques.
Bonne lecture !

Bâtir nos solidarités contre les violences islamophobes

Retour à la table des matières Droits et libertés, printemps / été 2025
Chronique Le monde de Québec
Bâtir nos solidarités contre les violences islamophobes
Maryam Bessiri, Hassina Bourihane, Mélina Chasles, Sophie Marois, membres du conseil d’administration de la Ligue des droits et libertés - section de Québec [caption id="attachment_21653" align="alignright" width="304"] credit Youth Coalition Combating Islamophobia London[/caption]
Le 6 juin 2021, la famille Afzaal a été fauchée par une attaque à la voiture bélier à London, en Ontario. Quatre de ses membres ont été tué-e-s dans ce que la Cour supérieure de l’Ontario a désigné comme un acte terroriste motivé par le nationalisme blanc et la haine des personnes musulmanes. Le seul survivant, un garçon de 9 ans, a perdu ce soir-là sa sœur de 15 ans, ses deux parents et sa grand-mère paternelle. Quatre ans plus tard, cet attentat islamophobe ne doit pas être réduit à un drame isolé. Il s’inscrit dans une chaîne de violences interconnectées, dont l’attentat contre la Grande mosquée de Québec a constitué un sinistre précédent.
Le 29 janvier 2017, notre ville, Québec, a été plongée dans l’horreur et le deuil alors qu’un homme a ouvert le feu sur des fidèles rassemblés pour prier à la Grande mosquée, tuant six de nos concitoyens de confession musulmane. Cet attentat a laissé une cicatrice profonde dans le tissu social et révélé au grand jour les dangers d’une islamophobie trop souvent banalisée.
Depuis, la section de Québec de la Ligue des droits et libertés appuie les mobilisations citoyennes qui ont émergé pour honorer les victimes, lutter contre l’islamophobie et défendre une société fondée sur la dignité de toutes et tous. Aujourd’hui, nous réaffirmons qu’il est essentiel de comprendre les racines de cette haine pour mieux la combattre, et de renforcer nos solidarités face à la montée inquiétante des idéologies réactionnaires et suprémacistes.
credit Youth Coalition Combating Islamophobia London[/caption]
Le 6 juin 2021, la famille Afzaal a été fauchée par une attaque à la voiture bélier à London, en Ontario. Quatre de ses membres ont été tué-e-s dans ce que la Cour supérieure de l’Ontario a désigné comme un acte terroriste motivé par le nationalisme blanc et la haine des personnes musulmanes. Le seul survivant, un garçon de 9 ans, a perdu ce soir-là sa sœur de 15 ans, ses deux parents et sa grand-mère paternelle. Quatre ans plus tard, cet attentat islamophobe ne doit pas être réduit à un drame isolé. Il s’inscrit dans une chaîne de violences interconnectées, dont l’attentat contre la Grande mosquée de Québec a constitué un sinistre précédent.
Le 29 janvier 2017, notre ville, Québec, a été plongée dans l’horreur et le deuil alors qu’un homme a ouvert le feu sur des fidèles rassemblés pour prier à la Grande mosquée, tuant six de nos concitoyens de confession musulmane. Cet attentat a laissé une cicatrice profonde dans le tissu social et révélé au grand jour les dangers d’une islamophobie trop souvent banalisée.
Depuis, la section de Québec de la Ligue des droits et libertés appuie les mobilisations citoyennes qui ont émergé pour honorer les victimes, lutter contre l’islamophobie et défendre une société fondée sur la dignité de toutes et tous. Aujourd’hui, nous réaffirmons qu’il est essentiel de comprendre les racines de cette haine pour mieux la combattre, et de renforcer nos solidarités face à la montée inquiétante des idéologies réactionnaires et suprémacistes.
Des violences interreliées, nourries par des idéologies communes
Ces attaques ont souvent été qualifiées d’« actes isolés » commis par des « loups solitaires », et même qui ne relèveraient d’aucune idéologie particulière. Or, les assaillants revendiquent eux- mêmes des filiations. L’auteur de l’attentat de London citait celui qui s’est attaqué en 2019 à deux mosquées de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, comme principale « source d’inspiration ». Ce dernier avait à son tour glorifié l’assaillant de la Grande mosquée de Québec, allant jusqu’à écrire son nom, avec ceux d’autres tueurs de masse, sur l’une des armes utilisées pour commettre l’attentat1 . Ces liens, fièrement assumés, ne sont pas anecdotiques : ils relèvent d’une vision du monde2 et d’un réseau numérique transnational3 fondés sur le suprémacisme blanc, l’islamophobie et les conspirations du « grand remplacement ». Ces idéologies conçoivent l’immigration, la diversité ethnoculturelle et le féminisme comme des menaces existentielles à l’établissement d’une « nation pure », désignée comme la « nation blanche ». Les procès des attentats de London et de Québec ont d’ailleurs révélé que leurs auteurs avaient envisagé d’autres cibles, notamment des cliniques d’avortement et des groupes féministes. Ces faits témoignent d’un noyau idéologique, bien documenté par la recherche, selon lequel contrôler qui « appartient » à la nation implique aussi de contrôler les corps, les rapports de genre et les sexualités4.Des fractures profondes
Les témoignages des proches des victimes nous rappellent que la violence islamophobe ne surgit pas au hasard, mais s’enracine dans des inégalités profondes. Comme l’a exprimé Tabinda Bukhari — mère, belle-mère et grand-mère des victimes de London — au terme du procès :« La désignation de terrorisme reconnaît la haine qui a alimenté le feu, la laideur qui a coûté la vie à Talat, Salman, Madiha et Yumnah. Mais cette haine n’existait pas dans le vide. Elle a prospéré dans les chuchotements, les préjugés, la peur normalisée de l’autre… Cette haine cachée sous nos yeux [hidden in plain sight] a été normalisée par la croyance non contestée qu’il existerait une hiérarchie raciale au Canada. Ce procès ne concernait pas qu’un seul acte. C’était un rappel brutal des lignes de fracture profondément ancrées dans notre société5».
Affronter cette haine implique de reconnaître que le racisme est systémique et ancré dans les histoires coloniales québécoise et canadienne, et qu’il persiste aujourd’hui dans les discours publics, les politiques migratoires, les lois discriminatoires et les violences du quotidien. La banalisation des expériences d’islamophobie, ou encore la législation interdisant les signes religieux dans l’exercice de certaines professions — affectant frontalement les femmes musulmanes — participent de cette dynamique et l’institutionnalisent.La force des solidarités
Nos solidarités constituent un rempart essentiel contre ces exclusions et ces violences. Dès le lendemain du 29 janvier 2017, des milliers de résident-e-s de la Ville de Québec ont encerclé la Grande mosquée dans un élan de solidarité avec les victimes et la communauté musulmane. Des rassemblements semblables se sont tenus dans de nombreuses autres villes à travers le pays, et le monde. Depuis, le comité citoyen 29 janvier, je me souviens organise des commémorations annuelles de l’attentat avec le Centre culturel islamique de Québec.Affronter cette haine implique de reconnaître que le racisme est systémique et ancré dans les histoires coloniales québécoise et canadienne, et qu’il persiste aujourd’hui dans les discours publics, les politiques migratoires, les lois discriminatoires et les violences du quotidien.À London, des ami-e-s de la plus jeune victime, Yumnah Afzaal, ont fondé la Youth Coalition Combating Islamophobia (YCCI). Cette association menée par des jeunes crée des ressources éducatives, organise des vigiles et développe des projets artistiques sous la bannière Take Initiative, End Islamophobia6. [caption id="attachment_21657" align="alignleft" width="339"]
 Nusaiba Al-Azem devant la Grande mosquée de Québec le 29 janvier 2022 pour représenter la London Muslim Mosque Crédit : Muriel Leclerc, 2022[/caption]
Au niveau institutionnel, la Ville de London a déployé un plan de lutte contre l’islamophobie, une première pour une municipalité en Amérique du Nord. Ce plan mobilise une vingtaine de partenaires dans les secteurs de l’éducation, de la santé et des services sociaux, de l’immigration, des arts et de la jeunesse pour agir collectivement contre l’islamophobie7. Certaines commissions scolaires de la région ont aussi développé des programmes pour soutenir le personnel enseignant à se former au sujet du racisme et des approches anti-oppressives8. Autant d’initiatives qui pourraient nous inspirer à Québec et dont nous avons grand besoin.
Ces mobilisations se montrent plus essentielles que jamais dans un contexte où les idéologies racistes, suprémacistes et d’extrême droite desquelles se sont abreuvés les assaillants de Québec et de London continuent de circuler avec une virulence alarmante. Toute forme de banalisation ou d’invisibilisation des violences issues de ces idéologies doit être activement combattue.
Nusaiba Al-Azem devant la Grande mosquée de Québec le 29 janvier 2022 pour représenter la London Muslim Mosque Crédit : Muriel Leclerc, 2022[/caption]
Au niveau institutionnel, la Ville de London a déployé un plan de lutte contre l’islamophobie, une première pour une municipalité en Amérique du Nord. Ce plan mobilise une vingtaine de partenaires dans les secteurs de l’éducation, de la santé et des services sociaux, de l’immigration, des arts et de la jeunesse pour agir collectivement contre l’islamophobie7. Certaines commissions scolaires de la région ont aussi développé des programmes pour soutenir le personnel enseignant à se former au sujet du racisme et des approches anti-oppressives8. Autant d’initiatives qui pourraient nous inspirer à Québec et dont nous avons grand besoin.
Ces mobilisations se montrent plus essentielles que jamais dans un contexte où les idéologies racistes, suprémacistes et d’extrême droite desquelles se sont abreuvés les assaillants de Québec et de London continuent de circuler avec une virulence alarmante. Toute forme de banalisation ou d’invisibilisation des violences issues de ces idéologies doit être activement combattue.
- Documentaire Attentat à la mosquée, un devoir de mémoire, réalisé par Catherine En ligne : https://ici.tou.tv/attentat-a-la-mosquee-un-devoir-de-memoire
- Mark Davis, Violence as method : the “white replacement”, “white genocide”, and “Eurabia” conspiracy theories and the biopolitics of networked Ethnic and Racial Studies, 2024.
- Voir, par exemple: https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1766695/twitter-neonazi-alexandre-bissonnette-attaque-mosquee-quebec
- Voir, par exemple: https://lemonde.fr/idees/article/2025/03/27/entre-racisme-et-masculinisme-des-liaisons-ordinaires_6586717_3232.html
- En ligne : https://ici.radio-canada.ca/rci/en/news/2051263/nathaniel-veltman-afzal-family-ruling-terrorism-islamophobia
- En ligne : https://ycci.ca
- En ligne : https://london.ca/living-london/anti-racism-anti-oppression
- En ligne : https://lfpress.com/news/local-news/on-afzaal-attack-anniversary-school-board-set-to-unveil-anti-islamophobia-plan
L’article Bâtir nos solidarités contre les violences islamophobes est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

Le tournant identitaire : « nos valeurs priment sur vos droits »

Retour à la table des matières Droits et libertés, printemps / été 2025
Le tournant identitaire : nos valeurs priment sur vos droits
Louise Pelletier, membre du comité exécutif et du CA de la Ligue des droits et libertés Maryève Boyer, membre du comité exécutif et du CA de la Ligue des droits et libertés Déposés à l’hiver 2025, deux projets de loi s’attaquent directement à la Charte et aux droits humains au Québec, au nom de « nos valeurs québécoises ». Récemment, le premier ministre Legault, en parlant de prières dans l’espace public, statuait que selon lui ce n’est pas quelque chose « qu’on devrait voir au Québec ». Un cadre de référence bien arbitraire et malléable qu’emploie le gouvernement, alors que des obligations claires lui incombent en matière de respect des droits humains de tout-e-s. Il nous parait important de replacer les débats actuels sur la laïcité de l’État dans leur contexte historique : la crispation identitaire dont nous sommes témoins actuellement doit être prise fort au sérieux.
En assimilant le hijab au voile des religieuses enseignantes, le gouvernement Legault nous a présenté comme progressiste une posture d’arrière-garde : comme si être laïc, c’est rejeter le hijab, c’est affirmer sa laïcité, qui serait une valeur collective des Québécois-e-s. Pourtant, la société québécoise est loin d’être consensuelle! Tel que dans une opération de propagande classique, le gouvernement Legault s’appuie sur des mythes pour faire de la Loi sur la laïcité de l'État la pièce maîtresse de sa législation. Au fondement de cette loi, un mythe selon lequel les Québécois-e-s auraient chassé la religion de leurs écoles lors de la Révolution tranquille, conquête historique qu’il faut préserver par fidélité à notre glorieux passé. Tout est faux dans ce récit : la Révolution tranquille n’a pas sorti la religion de l’école, la population était loin d’être unanime sur cet enjeu, ce n’est qu’après de longues négociations, tant avec des groupes sociaux qu’avec le clergé, que le gouvernement Lesage a fait adopter en 1964 la loi qui crée le ministère de l’Éducation enlevant aux Églises le contrôle du système scolaire. Les écoles restent confessionnelles, exigence de l’Assemblée des évêques qui a cédé sur un point : les écoles catholiques seront désormais ouvertes aux enfants des non croyants. Il s’agit d’une bien petite ouverture : pendant les cours de religion, ces enfants ont le droit d’attendre dans le corridor.
Même quand la Charte des droits et libertés de la personne du Québec adoptée en 1975, oblige les écoles à offrir le choix de l’enseignement moral, 90 % des parents continuent d’inscrire leurs enfants aux cours de religion. La plupart des Québécois-e-s, devenus majoritairement non pratiquant-e-s, associent encore la religion à l’identité nationale. En 1995, un rapport gouvernemental propose une conception de l’école basée sur l’égalité et liberté de conscience et de religion pour toutes et tous : fin des commissions scolaires catholiques et protestantes. Il faudra attendre la loi 118, en 2000, pour que finalement les commissions scolaires confessionnelles soient abolies pour être remplacées par des commissions scolaires basées sur la langue et que les écoles soient déconfessionnalisées. Près de 45 ans après la création du ministère de l’Éducation, l’enseignement religieux est retiré des programmes.
Avec l’école neutre, des enfants de toutes les religions se retrouvent sur les bancs des écoles francophones, ce qui réveille de vieilles peurs. En 2001, dans la cour de son école, un jeune sikh nommé Gurbaj Singh Multani échappe accidentellement son kirpan, poignard rituel que les sikhs portent sous leurs vêtements. L’école lui interdit de le porter. Les parents protestent au nom de la liberté de religion. En 2006, la Cour suprême leur donne raison soulevant un tollé dans une partie de la population, qui y voit une mise en péril du droit de la majorité à exister : les religions des autres sont désormais suspectes. Les médias dénoncent la prière musulmane dans une cabane à sucre, le menu halal à l’école et les accommodements raisonnables.
« Nos valeurs collectives, tout autant que les droits individuels, doivent être reconnues. » Ainsi s’exprime Guy Rocher, dans un manifeste signé par 3 000 « Intellectuels pour la laïcité ». Le gouvernement Marois y trouve son mantra - les valeurs collectives – et propose en 2013 le projet de loi sur la laïcité, nommée « Charte des valeurs québécoises », qui prétend rendre les droits conditionnels au respect de valeurs qui sont issus des peurs et préjugés ambiants. Peur de l’Islam et du sort qu’il réserve aux femmes ? La laïcité de l’État, une valeur collective, garantit l’égalité à toutes. Peur du hijab et autres signes religieux? La loi les interdit. Peur des accommodements raisonnables? La loi les restreint. Une partie de la société, incluant des organisations de droits humains, résiste et parvient à renverser la vapeur : la loi ne sera pas adoptée. Mais l’idée de rogner les droits des minorités au nom des valeurs gagne des adeptes. L’islamophobie aussi.
En 2019, deux ans après l’attentat de la Grande Mosquée de Québec, le gouvernement Legault fait adopter sous bâillon la Loi sur la laïcité de l’État, où le respect des droits est conditionnel au respect des valeurs de la majorité. Une loi qui déroge de façon préemptive aux deux Chartes, canadienne et québécoise, tout en mettant de l’avant une conception erronée et instrumentalisée de la laïcité qui, plutôt que de garantir la neutralité de l’État face aux différentes religions, viole les droits humains de plusieurs groupes de Québécois-e-s. La véritable laïcité était-elle en danger? La réponse du professeur Louis-Philippe Lampron est claire : « Si l’on abrogeait, demain matin, la Loi sur la laïcité de l’État, le Québec serait toujours un État où le principe de la séparation du religieux et de l’État s’applique ».
Plus de cinq ans après son application, il est avéré que la loi 21 discrimine les femmes portant le hijab, contredisant la soi-disant valeur collective de l’égalité femmes-hommes, et viole les libertés de conscience, d’expression et de religion de nombreuses personnes. Contrairement aux droits, les valeurs n’ont jamais protégé personne. Pourtant, elles apparaissent maintenant dans plusieurs textes de loi du gouvernement. En flattant l’ego national, elles ont pour rôle de faire accepter par la population des mesures discriminatoires envers les minorités.
En 2024, on apprend qu'à l’école Bedford, des enseignant-e-s musulman-e-s sont soupçonné-e-s de faire du prosélytisme. Pour répondre à ce type de situations, le ministre Bernard Drainville dépose en mars 2025, le projet de loi no 94 qui interdit les signes religieux à tout le personnel des centres de services scolaires et des services de garde foulant aux pieds les droits de centaines de femmes, en plus d’autres mesures qui risquent de faire obstacle à la participation de tou-te-s et à l’exercice du droit à l’éducation… alors que les mis en cause de l’école Bedford ne portaient pas de signes religieux. Le projet de loi no 84 sur l’intégration nationale (PL84) fait reposer le fardeau de l’intégration sur les immigrant-e-s et insiste pour leur adhésion, et pour l’intégration des minorités culturelles, aux valeurs québécoises, suggérant à nouveau que ces valeurs soient en péril. Ce PL84 prétend même assujettir la Charte québécoise au modèle d’intégration nationale, plutôt que d’adopter un modèle d’intégration qui y serait conforme !
En donnant l’impression de valoriser Notre histoire, Notre culture, Notre nation, les lois du gouvernement dirigent la colère du peuple vers les autres : ceux qui ne parlent pas la langue nationale, qui portent des signes religieux, qui n’adhèreraient pas assez à notre culture, à nos valeurs, le tout en ignorant délibérément les nations autochtones présentes sur le territoire québécois. Partout en Occident les démolisseurs de la démocratie procèdent de la même manière.
Ils sont à nos portes.
Déposés à l’hiver 2025, deux projets de loi s’attaquent directement à la Charte et aux droits humains au Québec, au nom de « nos valeurs québécoises ». Récemment, le premier ministre Legault, en parlant de prières dans l’espace public, statuait que selon lui ce n’est pas quelque chose « qu’on devrait voir au Québec ». Un cadre de référence bien arbitraire et malléable qu’emploie le gouvernement, alors que des obligations claires lui incombent en matière de respect des droits humains de tout-e-s. Il nous parait important de replacer les débats actuels sur la laïcité de l’État dans leur contexte historique : la crispation identitaire dont nous sommes témoins actuellement doit être prise fort au sérieux.
En assimilant le hijab au voile des religieuses enseignantes, le gouvernement Legault nous a présenté comme progressiste une posture d’arrière-garde : comme si être laïc, c’est rejeter le hijab, c’est affirmer sa laïcité, qui serait une valeur collective des Québécois-e-s. Pourtant, la société québécoise est loin d’être consensuelle! Tel que dans une opération de propagande classique, le gouvernement Legault s’appuie sur des mythes pour faire de la Loi sur la laïcité de l'État la pièce maîtresse de sa législation. Au fondement de cette loi, un mythe selon lequel les Québécois-e-s auraient chassé la religion de leurs écoles lors de la Révolution tranquille, conquête historique qu’il faut préserver par fidélité à notre glorieux passé. Tout est faux dans ce récit : la Révolution tranquille n’a pas sorti la religion de l’école, la population était loin d’être unanime sur cet enjeu, ce n’est qu’après de longues négociations, tant avec des groupes sociaux qu’avec le clergé, que le gouvernement Lesage a fait adopter en 1964 la loi qui crée le ministère de l’Éducation enlevant aux Églises le contrôle du système scolaire. Les écoles restent confessionnelles, exigence de l’Assemblée des évêques qui a cédé sur un point : les écoles catholiques seront désormais ouvertes aux enfants des non croyants. Il s’agit d’une bien petite ouverture : pendant les cours de religion, ces enfants ont le droit d’attendre dans le corridor.
Même quand la Charte des droits et libertés de la personne du Québec adoptée en 1975, oblige les écoles à offrir le choix de l’enseignement moral, 90 % des parents continuent d’inscrire leurs enfants aux cours de religion. La plupart des Québécois-e-s, devenus majoritairement non pratiquant-e-s, associent encore la religion à l’identité nationale. En 1995, un rapport gouvernemental propose une conception de l’école basée sur l’égalité et liberté de conscience et de religion pour toutes et tous : fin des commissions scolaires catholiques et protestantes. Il faudra attendre la loi 118, en 2000, pour que finalement les commissions scolaires confessionnelles soient abolies pour être remplacées par des commissions scolaires basées sur la langue et que les écoles soient déconfessionnalisées. Près de 45 ans après la création du ministère de l’Éducation, l’enseignement religieux est retiré des programmes.
Avec l’école neutre, des enfants de toutes les religions se retrouvent sur les bancs des écoles francophones, ce qui réveille de vieilles peurs. En 2001, dans la cour de son école, un jeune sikh nommé Gurbaj Singh Multani échappe accidentellement son kirpan, poignard rituel que les sikhs portent sous leurs vêtements. L’école lui interdit de le porter. Les parents protestent au nom de la liberté de religion. En 2006, la Cour suprême leur donne raison soulevant un tollé dans une partie de la population, qui y voit une mise en péril du droit de la majorité à exister : les religions des autres sont désormais suspectes. Les médias dénoncent la prière musulmane dans une cabane à sucre, le menu halal à l’école et les accommodements raisonnables.
« Nos valeurs collectives, tout autant que les droits individuels, doivent être reconnues. » Ainsi s’exprime Guy Rocher, dans un manifeste signé par 3 000 « Intellectuels pour la laïcité ». Le gouvernement Marois y trouve son mantra - les valeurs collectives – et propose en 2013 le projet de loi sur la laïcité, nommée « Charte des valeurs québécoises », qui prétend rendre les droits conditionnels au respect de valeurs qui sont issus des peurs et préjugés ambiants. Peur de l’Islam et du sort qu’il réserve aux femmes ? La laïcité de l’État, une valeur collective, garantit l’égalité à toutes. Peur du hijab et autres signes religieux? La loi les interdit. Peur des accommodements raisonnables? La loi les restreint. Une partie de la société, incluant des organisations de droits humains, résiste et parvient à renverser la vapeur : la loi ne sera pas adoptée. Mais l’idée de rogner les droits des minorités au nom des valeurs gagne des adeptes. L’islamophobie aussi.
En 2019, deux ans après l’attentat de la Grande Mosquée de Québec, le gouvernement Legault fait adopter sous bâillon la Loi sur la laïcité de l’État, où le respect des droits est conditionnel au respect des valeurs de la majorité. Une loi qui déroge de façon préemptive aux deux Chartes, canadienne et québécoise, tout en mettant de l’avant une conception erronée et instrumentalisée de la laïcité qui, plutôt que de garantir la neutralité de l’État face aux différentes religions, viole les droits humains de plusieurs groupes de Québécois-e-s. La véritable laïcité était-elle en danger? La réponse du professeur Louis-Philippe Lampron est claire : « Si l’on abrogeait, demain matin, la Loi sur la laïcité de l’État, le Québec serait toujours un État où le principe de la séparation du religieux et de l’État s’applique ».
Plus de cinq ans après son application, il est avéré que la loi 21 discrimine les femmes portant le hijab, contredisant la soi-disant valeur collective de l’égalité femmes-hommes, et viole les libertés de conscience, d’expression et de religion de nombreuses personnes. Contrairement aux droits, les valeurs n’ont jamais protégé personne. Pourtant, elles apparaissent maintenant dans plusieurs textes de loi du gouvernement. En flattant l’ego national, elles ont pour rôle de faire accepter par la population des mesures discriminatoires envers les minorités.
En 2024, on apprend qu'à l’école Bedford, des enseignant-e-s musulman-e-s sont soupçonné-e-s de faire du prosélytisme. Pour répondre à ce type de situations, le ministre Bernard Drainville dépose en mars 2025, le projet de loi no 94 qui interdit les signes religieux à tout le personnel des centres de services scolaires et des services de garde foulant aux pieds les droits de centaines de femmes, en plus d’autres mesures qui risquent de faire obstacle à la participation de tou-te-s et à l’exercice du droit à l’éducation… alors que les mis en cause de l’école Bedford ne portaient pas de signes religieux. Le projet de loi no 84 sur l’intégration nationale (PL84) fait reposer le fardeau de l’intégration sur les immigrant-e-s et insiste pour leur adhésion, et pour l’intégration des minorités culturelles, aux valeurs québécoises, suggérant à nouveau que ces valeurs soient en péril. Ce PL84 prétend même assujettir la Charte québécoise au modèle d’intégration nationale, plutôt que d’adopter un modèle d’intégration qui y serait conforme !
En donnant l’impression de valoriser Notre histoire, Notre culture, Notre nation, les lois du gouvernement dirigent la colère du peuple vers les autres : ceux qui ne parlent pas la langue nationale, qui portent des signes religieux, qui n’adhèreraient pas assez à notre culture, à nos valeurs, le tout en ignorant délibérément les nations autochtones présentes sur le territoire québécois. Partout en Occident les démolisseurs de la démocratie procèdent de la même manière.
Ils sont à nos portes.L’article Le tournant identitaire : « nos valeurs priment sur vos droits » est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

Nos luttes garantissent nos droits

Une version courte a été publiée dans dans la rubrique Idées en revue dans Le Devoir, le 20 mai 2025.
Retour à la table des matières Droits et libertés, printemps / été 2025
Nos luttes garantissent nos droits
Diane Lamoureux, professeure émérite, Université Laval, membre du comité de rédaction et membre du CA de la Ligue des droits et libertés À la Ligue des droits et libertés (LDL), nous le répétons depuis des années, les droits humains ne sont pas que des éléments codifiés dans des chartes, mais plutôt la sédimentation des luttes sociales du passé et des ancrages pour les luttes à venir afin de généraliser la liberté, l’égalité et la solidarité dans des sociétés, y compris celles qui se qualifient de démocratiques. Car celles-ci tentent soient de les mettre au rancart, soit de privilégier l’un ou l’autre de ces principes au détriment des autres. Pour illustrer mon propos, je prendrai l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec qui traite des discriminations. Dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH)[1], adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies en 1948, l’article 2 énonçait que « Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation ». Au sortir d’un génocide, la Shoah, et dans un contexte de mouvements de décolonisation en Afrique et en Asie, un tel énoncé recelait une puissance symbolique importante. On en retrouve des traces dans la version originelle de la Charte québécoise. Celle-ci énonçait que : « Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’état civil, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale »[2] et elle précisait que : « Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit ».[L'Association des droits des gai(e)s du Québec] allait mobiliser les communautés homosexuelles et entreprendre une action de pression auprès des pouvoirs publics pour inclure l’orientation sexuelle dans la Charte.Cet énoncé ne faisait pas que s’inspirer de la DUDH, mais faisait suite à des luttes menées précédemment par des militantes et des militants des droits humains actifs depuis l’entre-deux-guerres contre le racisme et l’antisémitisme, en faveur des droits des femmes, contre la censure, etc. Cet article a, depuis, été enrichi explicitement d’autres motifs sur la base desquels il est interdit de discriminer : l’orientation sexuelle, le handicap, la grossesse, l’âge et l’identité ou l’expression de genre. Ces ajouts ne relèvent pas de l’évolution naturelle de notre société, mais plutôt des mobilisations qu’ont menées les organisations LGTBQ+, les mouvements de personnes vivant avec un handicap ou les syndicats ou les groupes féministes. La première modification, pour ajouter l’orientation sexuelle à la liste des motifs illicites de discrimination, résulte des luttes menées par les organisations homosexuelles contre les descentes policières dans les bars gais, mais aussi d’une volonté politique du parti nouvellement arrivé au pouvoir, le Parti québécois. En effet, dans les débats entourant l’adoption de la Charte en 1975, ce parti avait présenté un amendement (battu) pour inclure l’orientation sexuelle et l’avait inscrit à son programme pour les élections de 1976. Même si le Code criminel avait été modifié en 1969 pour décriminaliser les actes homosexuels en privé et entre adultes consentants, les lieux de rassemblement publics des personnes homosexuelles comme les bars et les saunas continuaient à faire l’objet de descentes policières sous prétexte d’être des maisons de débauche. Ces descentes policières se sont accentuées à l’approche des Jeux olympiques de Montréal en 1976 donnant lieu à la formation du Comité homosexuel anti-répression puis sa transformation en Association des droits des gai(e)s du Québec. Cette dernière association allait mobiliser les communautés homosexuelles et entreprendre une action de pression auprès des pouvoirs publics pour inclure l’orientation sexuelle dans la Charte. Une descente policière particulièrement musclée au bar Le Truxx en octobre 1977 lui permet de mobiliser dans la communauté en plus de recueillir des appuis au sein de la Commission des droits de la personne, du Conseil du statut de la femme, de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), de la LDL et du Barreau du Québec. En 2016, pour tenir compte de la situation des personnes trans et non-binaires, l’article 10 de la Charte a été à nouveau modifié pour inclure l’identité ou l’expression de genre. Cela faisait suite à des mobilisations antérieures concernant le mariage et l’homoparentalité. C’est un travail de mobilisation et de pression similaire qui allait permettre d’inclure le handicap et les moyens pour y pallier l’année suivante. Alors que les personnes vivant avec un handicap ont longtemps été perçues comme des personnes à protéger, elles commencent à s’organiser, entre autres dans le Comité de liaison des handicapés physiques (CLHP) fédérant plus de 100 organismes. Elles insistent sur le fait qu’au lieu de s’orienter vers une législation spécifique il faut plutôt viser l’intégration sociale des personnes vivant avec un handicap. Pour ce faire, elles revendiquent que le handicap soit inscrit à la Charte comme motif illicite de discrimination. Soulignons que cela fait suite à un long processus d’auto-organisation de personnes vivant avec un handicap et à une réflexion importante sur le fait que le handicap ne doit ni définir entièrement une personne, ni lui interdire de vivre dans la dignité. C’est ce qui a permis ensuite de développer toute une série de politiques (encore insuffisantes) pour permettre l’accessibilité et l’adaptation en emploi, dans le logement, dans le transport ou dans les lieux publics. Quant à la grossesse, mentionnée explicitement dans la Charte à partir de 1982, elle constituait souvent un motif de congédiement pour les femmes. Ce sont essentiellement les groupes de femmes et les comités de condition des femmes dans les syndicats qui ont conduit les mobilisations pour que cesse cette forme de discrimination à l’encontre des femmes. À l’heure où non seulement nous célébrons les 50 ans de la Charte québécoise mais que nous cherchons également à la bonifier, ces exemples de mobilisations montrent bien que celle-ci peut servir d’ancrage pour des mobilisations futures. Car, si les droits ne s’appliquent pas à toutes et tous, ce ne sont plus des droits, mais des privilèges, pour paraphraser Condorcet. L’égale dignité des personnes exige que nous soyons à même d’identifier les discriminations qui perdurent et d’y pallier dans la Charte, mais aussi dans nos lois, règlements et politiques publiques.
[1] En ligne : https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/ [2] Charte des droits et libertés de la personne (LQ 1975, c. 6).
L’article Nos luttes garantissent nos droits est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

(Re)construire l’édifice des droits humains – 50 ans de la Charte québécoise

 Adoptée en 1975, la Charte des droits et libertés de la personne du Québec est une loi fondamentale qui a profondément marqué l'histoire des luttes pour l'égalité, la justice sociale et les droits humains au Québec. Ce dossier de la revue Droits et libertés explore une diversité de thématiques liées à l'histoire de la Charte et à son rôle dans les luttes pour les droits humains.
Adoptée en 1975, la Charte des droits et libertés de la personne du Québec est une loi fondamentale qui a profondément marqué l'histoire des luttes pour l'égalité, la justice sociale et les droits humains au Québec. Ce dossier de la revue Droits et libertés explore une diversité de thématiques liées à l'histoire de la Charte et à son rôle dans les luttes pour les droits humains.
Plusieurs personnes et organisations de différents milieux nous ont partagé leurs perspectives sur le rôle, les impacts et les limites de la Charte québécoise ainsi que sur la manière dont elle pourrait être renforcée pour répondre aux défis et enjeux du Québec d'aujourd'hui et de demain.
Inspirée des grands textes du droit international des droits humains, la Charte québécoise exige d'être promue et reconsidérée tant par les parlementaires que par la population.
Bonne lecture !
Procurez-vous la revue Droits et libertés!
- Devenez membre de la LDL pour recevoir deux numéros de Droits et libertés par année!
- Numérique (PDF) : 8 $
- Imprimée incluant livraison* : 11 $ incluant les frais de poste
- Abonnez-vous à deux numéros : 15 $ pour un abonnement individu ou 30 $ pour un abonnement organisation.
* Les articles sont mis en ligne de façon régulière. *
Dans ce numéro
Éditorial
Le tournant identitaire : nos valeurs priment sur vos droitsMaryève Boyer et Louise Pelletier
Chroniques
Un monde sous surveillance
Génocide à Gaza, IA et complicité de Microsoft, Google et AmazonDominique Peschard
Un monde de lecture
Les fictions du racismeCatherine Guindon
Ailleurs dans le monde
Le retour du fascisme allemand?Édouard de Guise
Le monde de Québec
Bâtir nos solidarités contre les violences islamophobesMaryam Bessiri, Hassina Bourihane, Mélina Chasles et Sophie Marois
Dossier principal
(Re)construire l'édifice des droits humains
Présentation
(Re)construire l'édifice des droits humainsPaul-Etienne Rainville
La Charte et ses institutions
Pour que la Charte québécoise brille de tous ses feuxMe Louis-Philippe Lampron Nos luttes garantissent nos droits
Diane Lamoureux La Charte québécoise, un texte vivant en perpétuelle évolution
Me Philippe-André Tessier Le Tribunal des droits de la personne
Michèle Rivet
Perspectives militantes
Enfin reconnaître le droit au logementStéphanie Barahona La Charte québécoise et les droits environnementaux
Entrevue avec Geneviève Paul et Me David Robitaille
Propos recueillis par Paul-Etienne Rainville La Charte québécoise et les droits des peuples autochtones
Entrevue avec Katsi'tsakwas Ellen Gabriel Ellen
Propos recueillis par Paul-Etienne Rainville Travailler sous permis de travail fermé?
Meritxell Abellan Almenara et Amel Zaazaa Le pouvoir relatif des Chartes en contexte social hostile
Sheba Akpokli, Etienne Dufour et Fred Catherine Lavarenne Regards croisés sur les droits humains
Témoignages d'organisations de la société civile Quel droit de manifester à Québec ?
Josyanne Proteau et Linda Forgues Droits humains et prisons : un défi pour la justice
Me Amélie Morin La nouvelle gestion publique : une menace aux droits humains
Christian Djoko Kamgain Les droits culturels, pour donner du sens à la vie
Entrevue avec Vincent Greason
Propos recueillis par Elisabeth Dupuis
Reproduction de la revue
L'objectif premier de la revue Droits et libertés est d'alimenter la réflexion sur différents enjeux de droits humains. Ainsi, la reproduction totale ou partielle de la revue est non seulement permise, mais encouragée, à condition de mentionner la source.
L’article (Re)construire l’édifice des droits humains – 50 ans de la Charte québécoise est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

Embarquez avec nous !

Retour à la table des matières Droits et libertés, automne 2024 / hiver 2025
Embarquez avec nous !
COMITÉ MOBILITÉ DE LA TABLE DES GROUPES DE FEMMES DE MONTRÉAL
Au Québec, les femmes en situation de handicap dépendent plus des transports collectifs que les autres femmes ou encore, les hommes en situation de handicap1. Pourtant, leurs expériences sont souvent ignorées lors des réflexions sur ces services. Face à ce constat, les membres de la Table des groupes de femmes de Montréal (TGFM) ont lancé une recherche-action en 2023 pour inclure ces femmes dans les décisions sur la mobilité durable. Ce projet a engagé 10 expertes du vécu, qui ont tenu des journaux de bord, participé à des balades exploratoires et contribué à l’analyse. Plus de 150 femmes y ont aussi participé via un sondage et des groupes de discussion. La mobilité est un droit essentiel à la participation sociale des mères, travailleuses, étudiantes, proches aidantes et militantes en situation de handicap. L’article 15 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec garantit l’accès aux transports et aux lieux publics sans discrimination. Les témoignages recueillis dans le cadre de notre recherche-action soulignent que ces droits sont encore souvent bafoués, compromettant la capacité de ces femmes à se déplacer de façon autonome et sécuritaire à bord des transports collectifs. Cet article dévoile quelques enjeux clés qui sont présentés plus en détail dans notre rapport de recherche2. [caption id="attachment_20889" align="alignnone" width="458"] Crédit : Bérénice Lemarié[/caption]
Crédit : Bérénice Lemarié[/caption]
Les transports collectifs
D’abord, le service de transport adapté complique considérablement la conciliation entre travail, famille et vie sociale des personnes qui en dépendent.
À Montréal, les transports collectifs comprennent d’abord le transport en commun régulier (autobus, métros, trains) qui fonctionne selon des horaires fixes et est, en principe, accessible à tout le monde. Il y a ensuite le transport adapté qui pallie les obstacles du réseau régulier en offrant, sur réservation, des véhicules, itinéraires et accompagnements adaptés aux besoins individuels des personnes ayant une incapacité qui affecte grandement leur mobilité. L’offre est complétée par les navettes qui offrent des trajets pour faciliter des déplacements ciblés (par exemple, aéroport ou traverse du fleuve). Parmi les répondant-e-s de notre sondage, 67 % jugent que le transport adapté est accessible et sécuritaire, contre seulement 28 % pour les autobus, métros et trains et 16 % pour les navettes fluviales. Dans le même ordre d’idées, 2 répondant-e-s sur 3 considèrent le transport adapté sécuritaire, et le personnel et les client-e-s bienveillant-e-s, alors que moins de la moitié évalue positivement le personnel et les client-e-s du transport en commun. Malgré cette meilleure perception du transport adapté, ce service ne parvient pas à offrir des déplacements équitables et sécuritaires.Mirages du transport adapté
D’abord, le service de transport adapté complique considérablement la conciliation entre travail, famille et vie sociale des personnes qui en dépendent. Pour ne nommer que quelques irritants logistiques, les réservations ne peuvent pas se faire à la dernière minute. L’accompagnement, crucial pour le sentiment de sécurité, est contraignant tout comme le nombre de sacs permis, ce qui complique la possibilité de faire son épicerie. En raison des retards et des jumelages, un trajet peut prendre plus de deux heures pour parcourir quelques kilomètres. L’insécurité est un problème. Les espaces d’attente sont souvent hostiles : peu de bancs, d’éclairage et d’accès à des toilettes. En hiver, la neige et le froid aggravent ces conditions. En été, les travaux et les piétonnisations compliquent l’embarquement et le débarquement. Les témoignages révèlent des comportements dangereux du personnel ou des gestes non consentis, notamment lors de l’attache de la ceinture de sécurité, ainsi que des remarques intrusives et sexistes. Des cas d’agressions physiques, sexuelles et psychologiques ont été vécus à bord des véhicules. Surtout, les expertes du vécu expriment une faible confiance envers le système de plainte en raison de l’absence de suivi et de changements constatés. Le transport adapté est précaire. Dans les dernières années, en plus des réductions de service dues aux conditions météorologiques, d’autres ont été établies en raison de la pandémie et en raison de problèmes de main-d’œuvre et de financement en août 2022. Les réductions incluent la limitation des trajets hors de l’île de Montréal, la permission exclusive des déplacements liés aux études, au travail et à la santé et la suspension des accompagnements. Ces restrictions portent atteinte au droit à la mobilité notamment de celles qui n’ont pas d’alternatives de transport.Inaccessible et non sécuritaire
[caption id="attachment_20890" align="alignright" width="237"] Crédit : Bérénice Lemarié[/caption]
Conformément à la loi, les autorités de transport ont l’obligation d’assurer l’accessibilité des transports en commun pour les personnes en situation de handicap3. Les plans de développement en accessibilité universelle conduisent à l’ajout d’ascenseurs, de loges et de tourniquets accessibles et de portes automatiques dans certaines stations de métro. De plus, de nombreux véhicules du réseau d’autobus sont équipés de signaux sonores et de rampes d’accès. Cependant, ces avancées dépendent du financement gouvernemental. Vraisemblablement, la Société de transport de Montréal (STM) ne pourra atteindre sa cible de 41 stations de métro universellement accessibles d’ici 2025, puisque le gouvernement de la CAQ a rejeté la demande d’aide financière pour la mise en accessibilité de 6 stations4.
Crédit : Bérénice Lemarié[/caption]
Conformément à la loi, les autorités de transport ont l’obligation d’assurer l’accessibilité des transports en commun pour les personnes en situation de handicap3. Les plans de développement en accessibilité universelle conduisent à l’ajout d’ascenseurs, de loges et de tourniquets accessibles et de portes automatiques dans certaines stations de métro. De plus, de nombreux véhicules du réseau d’autobus sont équipés de signaux sonores et de rampes d’accès. Cependant, ces avancées dépendent du financement gouvernemental. Vraisemblablement, la Société de transport de Montréal (STM) ne pourra atteindre sa cible de 41 stations de métro universellement accessibles d’ici 2025, puisque le gouvernement de la CAQ a rejeté la demande d’aide financière pour la mise en accessibilité de 6 stations4.
Environ 1 répondant-e sur 3 considère qu’il est impossible de se déplacer de manière sécuritaire pour être parent, proche aidant-e, étudiant-e, occuper un emploi ou s’impliquer dans sa communauté.
Les expertes du vécu soulignent les retombées positives de ces aménagements et équipements qui les incitent à utiliser le réseau régulier lorsque possible. Toutefois, les ascenseurs, escaliers mécaniques et rampes d’accès sont souvent hors service, rendant certains trajets impraticables. Les mesures d’urgence ne sont pas universellement accessibles. En effet, les messages d’urgence sont communiqués uniquement à l’oral, il faut parfois évacuer à une station de métro sans ascenseur et les navettes sont rarement accessibles. Enfin, des obstacles saisonniers compliquent l’accès au réseau : des itinéraires détournés en raison de travaux ou de piétonnisation, ainsi que des risques de chute dus à une mauvaise gestion du déneigement ou des chantiers de construction. L’accessibilité ne dépend pas uniquement des infrastructures. De nombreux témoignages révèlent des manques de civisme, comme le fait de s’asseoir sur des sièges réservés ou de ne pas offrir d’aide ou de le faire de façon inadéquate (par ex., sans demander le consentement). Plusieurs ont également subi du harcèlement de rue (par ex., regards, commentaires, attouchements ou menaces envers elles, iels ou leur chien d’assistance). C’est pourquoi il est essentiel de mener des actions de sensibilisation et de formation pour changer les attitudes et comportements du personnel et de la clientèle dans les transports en commun.Des impacts profonds
[caption id="attachment_20891" align="alignright" width="228"]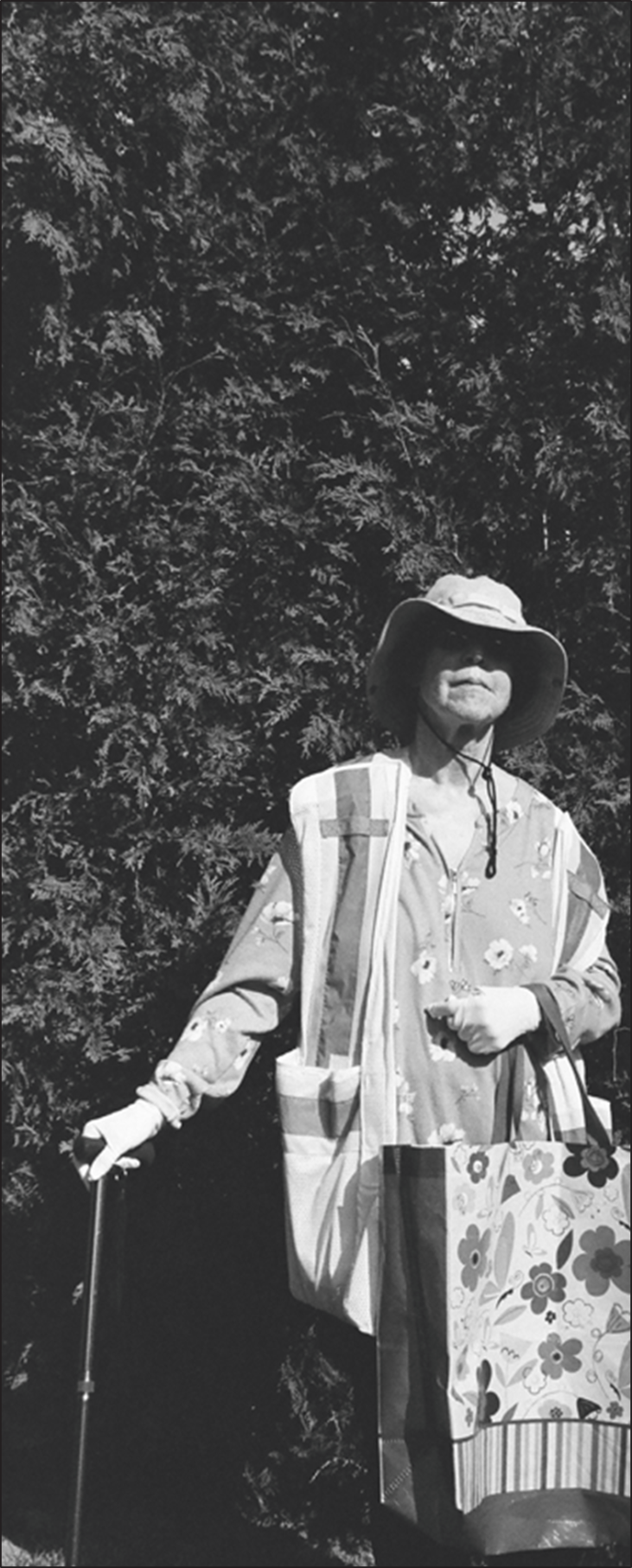 Crédit : Bérénice Lemarié[/caption]
Plus de 3 répondant-e-s sur 4 affirment vivre du stress et limiter leurs déplacements en raison des problèmes quotidiens de mobilité. Ces obstacles affectent leur autonomie et leur participation sociale. Environ 1 répondant-e sur 3 considère qu’il est impossible de se déplacer de manière sécuritaire pour être parent, proche aidant-e, étudiant-e, occuper un emploi ou s’impliquer dans sa communauté. Cette perception fait écho aux études qui mettent en évidence le rôle clé des transports collectifs dans l’accès et le maintien à l’emploi des personnes en situation de handicap5.
Les femmes en situation de handicap ne restent pas passives devant un système de transport capacitiste. Elles et iels utilisent diverses stratégies selon leur tolérance au risque, leurs obligations et leurs ressources : elles recourent au transport adapté, au taxi ou demandent de l’accompagnement pour se déplacer.
Crédit : Bérénice Lemarié[/caption]
Plus de 3 répondant-e-s sur 4 affirment vivre du stress et limiter leurs déplacements en raison des problèmes quotidiens de mobilité. Ces obstacles affectent leur autonomie et leur participation sociale. Environ 1 répondant-e sur 3 considère qu’il est impossible de se déplacer de manière sécuritaire pour être parent, proche aidant-e, étudiant-e, occuper un emploi ou s’impliquer dans sa communauté. Cette perception fait écho aux études qui mettent en évidence le rôle clé des transports collectifs dans l’accès et le maintien à l’emploi des personnes en situation de handicap5.
Les femmes en situation de handicap ne restent pas passives devant un système de transport capacitiste. Elles et iels utilisent diverses stratégies selon leur tolérance au risque, leurs obligations et leurs ressources : elles recourent au transport adapté, au taxi ou demandent de l’accompagnement pour se déplacer.
Pour une mobilité durable, inclusive et sécuritaire
Pour la TGFM, cette recherche-action est un outil de défense collective des droits. Parmi les initiatives visant à faire connaître les résultats, la TGFM a conçu une exposition qui présente une série de photos évocatrices des expertes du vécu accompagnées de textes exprimant leurs revendications pour la mobilité à Montréal. Ces témoignages démontrent que les enjeux de mobilité touchent profondément le quotidien de personnes réelles. Il est urgent de repenser les pratiques, les comportements et la planification des services publics pour garantir une mobilité durable, inclusive et sécuritaire à Montréal et partout au Québec. L’exposition photo se déplacera, selon la demande, dans différents milieux et événements pour susciter ces réflexions.1 Office des personnes handicapées du Québec, Les femmes avec incapacité au Québec, un portrait statistique de leurs conditions de vie et de leur participation sociale, 2021. En ligne : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/org/ophq/Statistiques/femmes-incapacite.pdf 2 En ligne : https://www.tgfm.org/fr/nos-publications/143 3 Article 67 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale. 4 S. Baillargeon, Le programme pour l’accessibilité du métro à l’arrêt, Le Devoir, 11 mai 2024. En ligne : https://www.ledevoir.com/societe/transports-urbanisme/812712/transport-commun-programme-accessibilite-metro-arret 5 A. Tessier et coll., The impact of transportation on the employment of people with disabilities: a scoping review, Transport Reviews, 2023. En ligne : https://doi.org/10.1080/01441647.2023.2229031
L’article Embarquez avec nous ! est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

Participation citoyenne et villes, quel avenir ?

Retour à la table des matières Droits et libertés, automne 2024 / hiver 2025
Participation citoyenne et villes, quel avenir ?
Elsa Mondésir Villefort, Conseillère en participation citoyenne et membre du CA de la Ligue des droits et libertés
Depuis les dernières élections de 2021, on assiste à une situation exceptionnelle alors qu’un nombre record d’élu-e-s ont pris la décision de quitter la scène municipale. En réaction à cette situation alarmante, un projet de loi a été déposé le 10 avril 2024 par la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest. Adoptée en juin 2024, la loi 24 (projet de loi 57), qui vise essentiellement à protéger les élu-e-s et à favoriser l’exercice sans entraves de leurs fonctions ne pourra pourtant pas, à elle seule, mettre un frein aux démissions dont nous sommes témoins. La démocratie municipale, déjà en crise et fragilisée, fait l’objet de plusieurs débats soulevant des questions importantes concernant la participation des citoyen-ne-s aux affaires politiques et publiques, participation qui est inévitablement affectée par l’arrivée de cette loi. Bien que les actrices et acteurs du milieu municipal soient confrontés à un climat particulièrement difficile, les élu-e-s détiennent toujours les clefs du pouvoir. Hocine Ouendi, un jeune Montréalais résidant de l’arrondissement d’Anjou, en est l’exemple parfait. Le 4 octobre 2022, il s’est présenté au conseil d’arrondissement pour exercer son droit de prendre part aux débats relatifs aux décisions qui le concernent. Le maire d’arrondissement lui a fait comprendre qu’un jeune de son âge n’avait pas la légitimité de prendre la parole et qu’il aurait plutôt dû être représenté par un adulte1. L’incident a conduit la Ville de Montréal à émettre une déclaration rappelant l’obligation de répondre, dans le respect, aux questions soumises par la population2. Hocine Ouendi n’est pas seulement venu avec une question, mais aussi avec des pistes de solution pour pallier une problématique vécue par plusieurs jeunes, soit l’accès aux installations publiques de l’arrondissement. C’est pourtant à un déni de son droit de participer à la vie politique qu’il s’est heurté, laissant l’enjeu qui lui tenait à cœur sombrer dans l’oubli. Cet événement est représentatif des nombreux obstacles auxquels plusieurs groupes marginalisés font face. En donnant des leviers supplémentaires aux villes et aux municipalités pour encadrer le débat public à travers la loi 24, on met en danger le droit des citoyen-ne-s d’accéder à des espaces sécuritaires favorisant leur participation. La responsabilité de préserver et de soutenir la capacité d’agir des populations doit être au cœur des stratégies à mettre en place. Sans l’établissement de processus de participation qui informent adéquatement les citoyen-ne-s, les accompagnent et encouragent une prise de parole et d’actions, il ne sera pas possible pour les villes de prendre des décisions éclairées, durables et représentatives des nombreuses réalités vécues. Dans ce cas spécifique, la déclaration de la Ville de Montréal conserve un caractère symbolique qui n’a, dans les faits, redonné aucun pouvoir à Hocine Ouendi. Au contraire, une plainte portée par sa famille à la Commission municipale du Québec a été rejetée alors qu’elle dénonçait les manquements graves de l’élu3. Même si ce n’est pas son objectif annoncé, la nouvelle loi n’est pas à l’abri d’une instrumentalisation ayant pour conséquence de limiter l’engagement citoyen.Ces personnes, qui ne sont pas majoritairement en position d’autorité dans la société, peuvent faire face à différents obstacles qui entravent leur participation, et elles n’ont pas les mécanismes nécessaires pour protéger leur droit de participer aux affaires publiques.
Pour une saine démocratie dans les villes
Si les probabilités de croiser Justin Trudeau ou François Legault un samedi matin en faisant son épicerie sont pratiquement nulles pour le commun des mortels, la situation n’est pas la même au niveau municipal. Certaines municipalités au Québec ne comptent qu’une poignée d’habitant-e-s (moins de 1000), ce qui peut rendre les dynamiques dans les espaces de participation citoyenne plus difficiles comme les membres de la communauté côtoient les élu-e-s quotidiennement. En 2017, la loi 13 (projet de loi 122) visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs a été adoptée. Cette nouvelle reconnaissance est venue contribuer à la réflexion sur la participation publique des citoyen-ne-s en mentionnant, notamment, le besoin que toutes et tous soient « consultés en amont des prises de décision » ainsi que la nécessité d’avoir une « présence active des élus dans le processus de consultation » (article 80.3). Cette proximité fait la force du monde municipal qui bénéficie d’un contact privilégié avec la population, ce qui rend le milieu plus aligné sur les réels besoins des gens qui y vivent. Le revers de la médaille fait toutefois en sorte que les mésententes entre les acteurs et les actrices d’une communauté peuvent prendre une place prépondérante dans l’espace public. Entre 2021 et 2024, un élu sur dix a démissionné de son rôle avec un taux de départ record dans les plus petites communautés4. L’importance de mettre en place des outils pour contrer l’intimidation et le harcèlement dans le milieu municipal n’est pas contestée, mais on peut questionner si la cible est réellement la bonne lorsqu’on consulte certains éléments de la loi 24. La Ligue des droits et libertés (LDL), le Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec (MÉPACQ) et le Regroupement des organismes en défense collective des droits (RODCD) se sont prononcés à maintes reprises sur le dossier : certaines mesures de la loi ouvrent la porte aux dérives et menacent plusieurs libertés constitutionnelles (libertés d’expression, d’opinion et d’association). Les cas de citoyen-ne-s se sentant muselés dans l’exercice de leur droit de participer sont nombreux à travers le Québec. Joan Hamel, citoyenne de Trois-Rivières, a reçu une lettre d’un huissier en 2023 après avoir fait un commentaire sur Facebook, alors que la Ville vivait une situation particulièrement tendue en lien avec l’expansion d’un parc industriel. La Ville prétendait que son commentaire contrevenait à la Politique sur la prévention de la violence dans les interactions avec le personnel de la Ville de Trois-Rivières. La lettre stipulait qu’une récidive pouvait entraîner une amende. Le justificatif derrière cette intervention a été critiqué, d’autant plus que cela s’est produit alors qu’un dialogue important avait été entamé autour de la situation de l’expansion du parc5. En mettant l’accent sur le besoin d’encadrer les interventions des citoyen-ne-s, la nécessité de naviguer dans des zones de tension et de débattre d’enjeux polarisants est gravement menacée. La solution ne se trouve pas dans un passe-droit offert aux citoyen-ne-s qui ne seraient jamais imputables de leurs actions, mais elle ne peut pas non plus se retrouver sur un terrain où les règles du jeu sont redéfinies pour protéger un acteur au détriment de ceux et celles auxquels il est redevable et qu’il est censé représenter. D’ailleurs, restreindre la prise de parole affecte nécessairement les personnes aux intersections de plusieurs oppressions et dont l’existence même suscite le débat. Ces personnes, qui ne sont pas majoritairement en position d’autorité dans la société, peuvent faire face à différents obstacles qui entravent leur participation, et elles n’ont pas les mécanismes nécessaires pour protéger leur droit de participer aux affaires publiques.Mieux protéger les droits humains
La ville appartient à celles et ceux qui l’habitent. Pour protéger toutes les personnes concernées, une réflexion s’impose sur les faiblesses et les défis qui rendent difficile la participation au Québec, peu importe de quel côté du pouvoir nous nous retrouvons. Il est impératif de s’interroger sur ce qui menace notre démocratie ainsi que sur les réels maux de société dont le climat actuel est le symptôme : opacité des institutions et des prises de décision, discriminations, sentiment d’impuissance des citoyen-ne-s, désinformation, manque d’éducation à la démocratie et bien plus. Il existe un fossé majeur entre la personne citoyenne et le monde politique. En tant que gouvernement de proximité, le palier municipal est un espace de choix pour expérimenter, innover et redéfinir les espaces de participation citoyenne tels qu’on les connaît. Les villes sont plus que jamais concernées par les enjeux de l’heure qu’il s’agisse d’immigration, de culture, de changements climatiques, de transformation du tissu social, etc. Nous aurons besoin d’avoir beaucoup plus de voix au chapitre pour faire face aux défis émergents. Il faut rester vigilant-e-s face à la situation actuelle et s’accorder sur le fait que les reculs au droit de participer aux affaires publiques et politiques ne peuvent pas faire partie de la solution.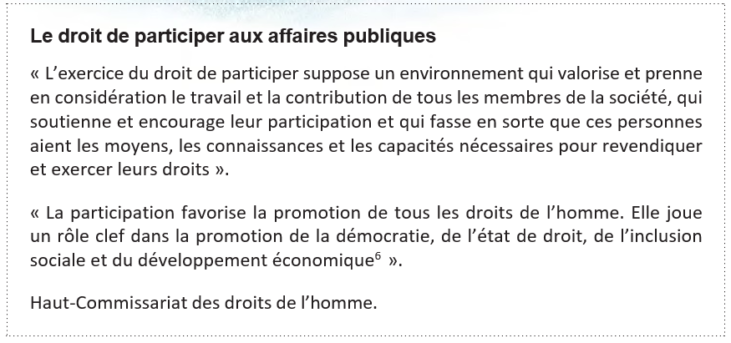
1 Arrondissement Anjou. Séance du conseil d’arrondissement et séance liée au Budget et au PDI 4 octobre 2022. [vidéo] (à partir de 23 h). En ligne : https://www.youtube.com/live/EUcnRe_parU 2 En ligne : https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/2022-10-24/propos-discriminatoires-envers-un-adolescent/le-maire-d-anjou-blame-par-le-conseil-municipal-de-montreal.php 3 En ligne : https://www.lapresse.ca/actualites/2023-08-18/propos-cassants-envers-un-adolescent/la-plainte-contre-le-maire-d-anjou-rejetee.php 4 En ligne : https://www.lesoleil.com/actualites/politique/2024/01/23/pres-dun-elu-municipal-sur-dix-a-demissionne-depuis-les-elections-de-2021-WPG3WACNKJFJVJNAPL5JNAHUDE/ 5 En ligne ; https://www.lapresse.ca/contexte/le-prix-de-nos-incivilites/2023-09-10/proteger-les-employes-museler-les-citoyens.php 6 Haut-Commissariat des droits de l’homme. Directives à l’intention des États sur la mise en œuvre effective du droit de participer aux affaires publiques : 4, 2018. En ligne :https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/PublicAffairs/GuidelinesRightParticipatePublicAffairs_web_FR.pdf
L’article Participation citoyenne et villes, quel avenir ? est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

Défis de collaboration entre villes et organismes communautaires

Retour à la table des matières Droits et libertés, automne 2024 / hiver 2025
Défis de collaboration entre villes et organismes communautaires
Caroline Toupin, Coordonnatrice, Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA)
Que l’on pense aux pratiques policières visant à encadrer le droit de manifester, au contrôle de l’espace public régissant le droit de cité des personnes en situation d’itinérance, aux îlots de chaleur qui compromettent le droit à la santé et à un environnement sain, au transport en commun et au droit à la mobilité, ou encore à la construction de logements sociaux et au droit au logement, les villes et les municipalités jouent un rôle majeur en matière de droits humains. Dans un contexte politique prétendant à une décentralisation des interventions étatiques en matière de services de santé, sociaux et communautaires, ce rôle est appelé à augmenter. C’est le cas pour les villes et les municipalités, mais également pour les organismes communautaires. En effet, à mesure que les inégalités se creusent et que les besoins non-répondus de la population débordent des fissures béantes du réseau public (causé par des années d’austérité et des réformes néolibérales), l’action communautaire autonome (ACA) est amenée malgré elle à combler les lacunes des services publics. Positionné aux premières lignes du rapport entre l’appareil étatique et la population, le rôle joué par les gouvernements de proximité et les organismes communautaires dans la gestion des crises (sociale, sanitaire, climatique) sera tout autant décuplé. [caption id="attachment_20837" align="alignnone" width="470"] Crédit : Meaghan Johnston[/caption]
Crédit : Meaghan Johnston[/caption]
Collaboration nécessaire
Pour y faire face, la collaboration entre le milieu municipal et communautaire s’impose comme une nécessité dans les années à venir, pour garantir le respect des droits de tou-te-s. Cette relation, bien que prometteuse, présente des défis que nous devons surmonter. Nous nous trouvons à l’intersection de deux milieux aux nombreux points communs, mais où des préjugés tenaces subsistent de part et d’autre. Encore aujourd’hui, les organismes d’ACA sont souvent perçus, particulièrement lorsque la municipalité offre du soutien financier ou des ressources, comme de simples extensions des services municipaux. Cette perception erronée engendre des attentes inappropriées concernant le développement de services et conduit à des tentatives d’ingérence dans leurs orientations et approches. Cette vision compromet dangereusement l’autonomie des organismes, un ingrédient vital à leur agilité en temps de crise. Elle nuit également à la mission de transformation sociale des organismes et à leur capacité à défendre les droits des membres de leur communauté.Trois exemples
L’exemple de Saint-Constant illustre parfaitement ces défis et les conséquences graves d’une incompréhension du rôle des organismes communautaires et de leur autonomie. En 2018, la Ville a pris la décision drastique de retirer son soutien financier à la Maison des Jeunes et de l’expulser de ses locaux après 25 ans de collaboration, créant ainsi un précédent alarmant. La Ville a tenté d’imposer des changements majeurs dans les services offerts par l’organisme et dans les clientèles desservies, allant jusqu’à essayer d’imposer une direction générale. Cette action a provoqué une vague d’indignation au sein du conseil d’administration, qui a cependant résisté à toutes tentatives d’ingérence, préférant perdre gros plutôt que son autonomie. Au lieu de laisser la communauté décider des services de sa Maison des Jeunes, le maire a créé un service similaire sous contrôle municipal. Cette décision a non seulement menacé l’existence de l’organisme, mais a également privé la communauté de St-Constant et ses jeunes de la créativité et de la vitalité essentielles qu’ils apportent à leur ville. Or, c’est le besoin qui crée un organisme d’ACA : dans ce cas-ci, le besoin des jeunes de se rassembler et de se doter d’un milieu de vie et d’un réseau de soutien à leur image. Et ce sont les personnes directement concernées qui exercent leur droit d’association en fondant un nouvel organisme. Avec l’exemple de Saint-Constant, l’intervention acharnée de la Ville pour le contrôle de la ressource a eu comme conséquence de saboter l’exercice du droit d’association des membres de l’organisme. Un autre exemple récent est celui de la maison Benoît Labre à Montréal, qui aide les personnes sans-abri depuis 70 ans. La ville veut déplacer son centre de jour à cause de plaintes du voisinage. On dit que la maison est trop près d’une école et qu’elle cause des problèmes de cohabitation avec les gens du quartier. Dans ce cas précis, la Ville s’approprie un pouvoir qu’elle n’a pas et s’ingère dans l’autonomie de l’organisme car la Maison Benoît Labre est propriétaire de son édifice. La maison Benoit Labre a été créée pour répondre aux besoins de sa communauté, par, pour et avec les personnes. Les interventions étatiques s’avèrent inappropriées pour garantir leur dignité et leur droit à la santé et à un logement. Le tollé soulevé par la Ville et les médias dans l’affaire fait craindre le pire pour les droits des personnes en situation d’itinérance et utilisatrices de drogues, alors que l’intolérance face à la détresse et la souffrance sociale alimentent le syndrome du pas dans ma cour, le déracinement des organismes communautaires et le déplacement des populations marginalisées. Même situation du côté de Lévis où l’achalandage trop élevé de l’organisme Le 55, un refuge pour personnes en situation d’itinérance, créé des enjeux de cohabitation avec les commerces. C’est pourquoi le maire de Lévis a négocié une entente avec le refuge pour une relocalisation et qu’il a ensuite fait voter un règlement interdisant aux ressources communautaires de s’installer dans le Vieux-Lévis. Le droit d’association des citoyennes et citoyens soucieux de répondre aux besoins de leur communauté par la création d’organismes communautaires est compromis de plein fouet.Malgré ces défis, il existe des points communs significatifs entre le milieu municipal et le milieu communautaire, qui font de nous des alliés naturels. La proximité avec les citoyennes et les citoyens est l’un de ces atouts majeurs, favorisant la démocratie et une participation citoyenne active.
Défis et points communs
L’insuffisance chronique du financement public à la mission fragilise les organismes et exacerbe ces problématiques. Les organismes sont placés dans des rapports de force défavorables où ils sont trop souvent forcés d’accepter des conditions et des pressions indues qui compromettent leur indépendance, par crainte de se mettre à dos les élu-e-s municipaux et leurs équipes. Malgré ces défis, il existe des points communs significatifs entre le milieu municipal et le milieu communautaire, qui font de nous des alliés naturels. La proximité avec les citoyennes et les citoyens est l’un de ces atouts majeurs, favorisant la démocratie et une participation citoyenne active. L’exercice de la citoyenneté passe en grande partie par les rouages du filet communautaire, que la communauté a tissé pour faire face aux défis et aux crises. Les deux parties partagent un objectif commun fondamental : d’un côté, on parle de développement social, de l’autre, de transformation sociale. Bien que leurs approches puissent différer, leur engagement envers le bien-être de la communauté constitue un socle solide sur lequel nous devons construire les bases d’une collaboration plus forte et plus efficace. Le respect de l’autonomie des organismes communautaires et du droit d’association des citoyen-ne-s désireux d’en fonder de nouveaux, sont des éléments majeurs et centraux dans cette collaboration à construire. Cette autonomie et cette impulsion citoyenne garantissant la participation pleine et entière de la communauté dans la résolution des problèmes sociaux sont des catalyseurs d’innovations et d’agilité, deux éléments essentiels en temps de crises. Les municipalités, quant à elles, doivent faire face à la multiplication et l’intensification des effets de la crise socio écologique sur leurs communautés, souvent sans disposer des moyens nécessaires pour y répondre adéquatement. La collaboration entre le milieu municipal et le milieu communautaire n’est pas seulement souhaitable, elle est impérative. Elle nécessite un dialogue ouvert, honnête et un respect des autonomies respectives qui doivent cesser de s’opposer. Il s’agit là d’une des pièces maîtresses pour préserver un filet social robuste et démocratique, permettant à chaque partie de répondre aux besoins changeants de leurs communautés et en garantissant le respect des droits humains pour tou-te-s.L’article Défis de collaboration entre villes et organismes communautaires est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

La transition écologique, ça concerne tout le monde !

Retour à la table des matières Droits et libertés, automne 2024 / hiver 2025
La transition écologique, ça concerne tout le monde !
Entretien avec Nadia Lemieux, Chargée de projet, Collectivité ZéN Québec Propos recueillis par Elisabeth Dupuis, Responsable des communications, Ligue des droits et libertés Les changements climatiques touchent directement les municipalités, des plus petites aux plus populeuses, qui font de plus en plus face à des événements extrêmes causant des dommages considérables aux infrastructures et mettant en danger les populations. Les effets visibles des changements climatiques étant souvent d’ordre matériel, plusieurs municipalités se concentrent davantage sur des transformations d’ordre technique comme les mesures d’adaptation aux changements climatiques. Un aspect rarement abordé par les municipalités est celui de la justice sociale en tant que pilier d’une transition écologique réussie, qui « suppose que l’on revoie en profondeur plusieurs pans de l’activité humaine, particulièrement le modèle économique, les modes de production et de consommation1 ». Cette proposition représente une voie déterminante à saisir par les collectivités et par les municipalités. Les mobilisations citoyennes sont au cœur de ce mouvement pour une transition écologique porteuse de justice sociale. Elles s’incarnent à travers différents groupes et coalitions de la société civile et développent des initiatives porteuses d’avenir. [caption id="attachment_20841" align="alignright" width="339"] Crédit : Engrenage Saint-Roch[/caption]
Crédit : Engrenage Saint-Roch[/caption]
Des mobilisations citoyennes
Le Front commun pour la transition énergétique (FCTÉ), composé de plus de 90 membres à l’échelle du Québec, incluant la Ligue des droits et libertés, a lancé le projet Collectivités Zéro Émission Nette (ZéN) dans la foulée de l’élaboration d’une feuille de route pour la transition du Québec vers la carboneutralité appelant à la création de communautés résilientes. Depuis 2021, huit Collectivités ZéN se sont implantées à travers le Québec à des échelles locale ou régionale (Québec, Lachine, Laval, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Outaouais, Ahuntsic-Cartierville, Gaspésie, Rimouski), s’appuyant sur une démarche de coconstruction et d’innovation sociale. Ces projets collectifs sont accompagnés par le FCTÉ, mais portés par des organisations locales, dont des organismes communautaires, des groupes citoyens et parfois des institutions. « Le but du projet est de rassembler, mailler et accompagner le maximum d’organisations d’un territoire, pour mettre en œuvre, de façon concertée, une transition menant à la justice sociale et au respect des limites planétaires, incluant la carboneutralité2 ». Il s’agit d’une réelle transformation systémique touchant tous les aspects de la vie sociale qui est visée.En complémentarité
L’action des Collectivités ZéN est à la fois différente et complémentaire d’une planification de la transition par une ville ou par une municipalité régionale de comté (MRC). Elle s’appuie sur une démarche ascendante de coconstruction qui implique que plusieurs membres de la collectivité travaillent activement à la planification au lieu d’être uniquement consultés dans un processus piloté par un acteur municipal ou encore, gouvernemental. Dans une optique d’innovation sociale, les Collectivités ZéN contribuent à créer ensemble un imaginaire positif du futur qui soit rassembleur et engageant. Pour ce faire, elles sont soutenues par le milieu de la recherche, à travers l’accompagnement du projet Chemins de transition de l’Université de Montréal. Une méthodologie éprouvée permet de coconstruire, avec des citoyen-ne-s rassemblé-e-s lors d’ateliers, une vision citoyenne du futur. À Québec, par exemple, une vingtaine d’ateliers d’exploration du futur a permis de rejoindre près de 200 personnes pour élaborer une vision du futur de la ville. Cette vision, qui sert de phare à la transition, aborde des thématiques aussi variées que le pouvoir d’agir collectif, les milieux de vie, le modèle économique et le tissu social. Lorsque la vision est coconstruite, elle s’ancre davantage dans la communauté et suscite une forte mobilisation citoyenne autour de projets communs. Les municipalités peuvent ensuite intégrer ces visions dans leur propre planification en matière d’action climatique ou de transition.Si plusieurs municipalités ou MRC sont proactives sur le plan de l’adaptation aux changements climatiques, les aspects de justice sociale sont encore trop peu pris en compte dans le contexte de leur transition écologique.[caption id="attachment_20842" align="alignnone" width="731"]
 Crédit : Peggy Henry[/caption]
Crédit : Peggy Henry[/caption]
Des décisions de la base
Pour lutter efficacement contre les changements climatiques, Nadia de la Collectivité ZéN de Québec considère que le leadership se doit d’être partagé entre les municipalités et les populations. La ville est évidemment un acteur majeur, car elle dispose de leviers et de compétences pouvant avoir un impact direct sur l’atteinte de la résilience d’une collectivité ; pensons notamment au transport, à l’aménagement du territoire ou à l’habitation. Ainsi, la ville possède des pouvoirs, une force de frappe importante et des fonds qui pourraient servir à soutenir et encourager plus adéquatement les initiatives et les projets qui émergent de l’action citoyenne, par exemple pour protéger les milieux naturels ou renforcer l’autonomie locale dans les quartiers. Les décisions concernant les changements à mener doivent naître des populations directement concernées par les transformations de leurs milieux de vie. Dès le début, elles doivent participer à la planification de la transition socioécologique et faire partie de toutes les étapes de sa mise en œuvre. En ce sens, Nadia relève un manque de pouvoir d’agir des citoyen-ne-s en général, qui disposent de peu d’accès aux sphères décisionnelles les concernant. Les Collectivités ZéN sont des exemples de nouveaux espaces de dialogue et de travail collectif visant à renforcer le pouvoir d’agir des citoyen-ne-s et des différents acteurs locaux concernés par les transformations à venir. Il arrive souvent que les villes préconisent une logique de sensibilisation, d’éducation ou de communication cherchant à changer le comportement des citoyen-ne-s. Cette approche nuit à l’obtention d’une réelle adhésion aux actions en faveur de la transition écologique, car elle n’est pas en adéquation avec le renforcement du pouvoir d’agir des citoyen-ne-s. Une participation concrète aux transformations exige que les citoyen-ne-s fassent valoir leurs réalités et besoins et mettent de l’avant leur propre vision pour leur quartier. Le soutien des villes est nécessaire pour permettre aux diverses initiatives de se déployer pleinement. Des niches de transition socioécologiques, par exemple des espaces collectifs ou des tiers lieux, sont des lieux d’expérimentation, de solidarité, d’inclusion, où de nouvelles façons d’être ensemble se dessinent. D’autres projets porteurs peuvent avoir une approche entrepreneuriale qui veut le bien-être collectif plutôt que l’enrichissement. À travers le Québec, de telles initiatives se créent et s’inspirent mutuellement, ce qui fait émerger un mouvement plus large et renforce la résilience des communautés.Plus qu’un défi technique
Les villes doivent s’extirper du discours expert, purement technique de la lutte aux changements climatiques et de l’adaptation, car la transition n’est pas un simple défi technique. Ce sont des changements structurants, à tous les niveaux, nécessaires pour appréhender la transition écologique. Prenons l’exemple d’un plan de verdissement d’un quartier proposé par une municipalité qui se limiterait au nombre d’arbres à planter. Les Collectivités ZéN considèrent que l’apport de la population aux solutions de ce type permet d’aller au-delà des considérations sur un nombre d’arbres optimal. En impliquant les citoyen-ne-s dans des espaces de dialogue pour qu’ils et elles expriment leurs besoins concrets, une politique de verdissement a le potentiel d’améliorer concrètement les conditions de vie et l’équité au sein des quartiers. L’exemple du projet en verdissement de L’Engrenage Saint-Roch est éloquent. Le quartier Saint-Roch est l’un des quartiers de Québec avec le taux de canopée le plus faible et où se trouvent plusieurs îlots de chaleur. L’organisme, travaillant auprès des personnes à faible revenu et des personnes en situation d’itinérance, pilote le projet Verdir Saint-Roch, financé par la ville, pour favoriser « la création de lieux communs et d’initiatives d’aménagement durable3 ». Ce projet a impliqué les personnes de la communauté dans tout le processus, de la plantation à l’entretien. Ce projet est une alternative aux habituelles plantations dans des bacs de la ville, parfois laissés à l’abandon après quelque temps, car il renforce l’autonomie des participant-e-s.Leadership de la ville
Si de nombreux groupes sur le terrain et citoyen-ne-s sont déjà engagés et convaincus de l’importance d’agir, ils peuvent aussi vivre un certain découragement. Un climat d’impuissance peut s’installer face à d’autres acteurs du territoire, comme les grandes entreprises, pour qui le business as usual se poursuit. Dès lors, les citoyen-ne-s ont des attentes par rapport à la ville : elle doit mettre à profit ses leviers politiques et réglementaires pour amener les entreprises et la grande industrie à réduire leurs impacts environnementaux et à s’impliquer davantage dans la transition socioécologique. Bien souvent, la ville se trouve en porte-à-faux avec, d’un côté, le développement économique et la recherche de nouvelles recettes fiscales et, de l’autre, les impératifs de la transformation socioécologique. Le pouvoir d’agir de la base, malgré les efforts qui visent à le renforcer, continue de se buter au pouvoir et aux actions des acteurs très influents. Dans une optique de justice environnementale, la ville doit reconnaître que certains groupes sont plus affectés que d’autres par les impacts des crises environnementales, d’autant plus que ces groupes sont ceux qui y contribuent le moins. Pour Nadia, dans le but de renforcer le pouvoir d’agir, il est nécessaire que la ville accorde une place importante à ces groupes traditionnellement exclus des espaces décisionnels. La ville peut travailler plus étroitement avec les organismes communautaires intervenant auprès des personnes marginalisées afin de prendre en considération leur réalité dès la planification. Dans le cadre des plans d’adaptation aux changements climatiques, les Directions de santé publique s’impliquent proactivement pour identifier les bulles de vulnérabilité de différentes populations, et pour éviter de renforcer certaines inégalités sociales.[la ville] doit mettre à profit ses leviers politiques et réglementaires pour amener les entreprises et la grande industrie à réduire leurs impacts environnementaux et à s’impliquer davantage dans la transition socioécologique.
Réelle participation citoyenne
Il arrive que des villes s’étonnent de l’opposition citoyenne à des projets dits positifs sur le plan de l’adaptation aux changements climatiques ; elles oublient que les citoyen-ne-s sont mis, souvent, devant le fait accompli. Il arrive que l’information soit publiée dans les médias plutôt qu’à travers des séances d’information ou de consultation à la ville. Il faut se rappeler que les villes axent leurs démarches sur l’atteinte de l’acceptabilité sociale, un concept qui, selon la Ligue des droits et libertés et le Regroupement québécois des groupes écologistes, est du ressort du « marketing enrobé dans un langage qui lui donne un vernis social progressiste4 ». La participation citoyenne à la prise de décisions est l’un des trois piliers du droit à un environnement sain, avec l’accès à l’information et l’accès à la justice. Il faut comprendre que « le droit à un environnement sain est un droit humain, universel, inaliénable, interdépendant et indissociable des autres droits humains. Pour qu’il soit respecté, plusieurs conditions démocratiques5 » doivent être réunies en plus des éléments environnementaux comme la qualité de l’eau ou de l’air, par exemple. Cela dit, une réelle participation citoyenne requiert que les personnes fassent partie des transformations, avec un réel pouvoir d’agir. Pour y arriver, une décentralisation du pouvoir doit être envisagée. À Québec, les conseils de quartier pourraient être renforcés en ce sens. Pour le moment, leur rôle réside dans la consultation citoyenne, mais ultimement ces instances pourraient détenir plus de pouvoir. En revanche, cette restriction de pouvoir n’a pas empêché un conseil de quartier de se mobiliser, de défendre les droits des populations locales et de s’exprimer dans l’espace public sur les enjeux de la qualité de l’air à Québec. Les Collectivités ZéN espèrent que les villes prennent acte de leurs travaux, comme leurs visions du futur, qui illustrent des consensus grandissants en matière de transformations systémiques à opérer. La légitimité de la démarche vient de la coconstruction avec des groupes citoyens et des organismes locaux. Les villes ont tout intérêt à tenir compte des perspectives qui émergent de la société civile et des initiatives citoyennes, qui défrichent déjà le chemin vers le monde de demain.1 En ligne : https://www.pourlatransitionenergetique.org/les-criteres-dune-transition-energetique-porteuse-de-justice-sociale/ 2 En ligne : https://www.pourlatransitionenergetique.org/le-projet-collectivite-zen/ 3 En ligne : https://www.engrenagestroch.org/projets/verdir-saint-roch/ 4 Ligue des droits et libertés, Le droit à un environnement sain : trois piliers démocratiques à défendre, Montréal, Québec, 2024. 5 Ibid.
L’article La transition écologique, ça concerne tout le monde ! est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

Municipalités et droits humains : une rencontre qui se densifie

Retour à la table des matières Droits et libertés, automne 2024 / hiver 2025
Municipalités et droits humains: une rencontre qui se densifie
Me Benoît Frate, Professeur agrégé, Département d’études urbaines et touristiques, ESG UQAM
Me David Robitaille, Vice-doyen aux études et professeur titulaire, Section de droit civil, Faculté de droit, Université d’Ottawa Il est clair depuis longtemps, en droit interne canadien, que les municipalités sont imputables de la mise en œuvre et du respect des droits humains, en vertu, notamment, des Chartes canadienne et québécoise des droits. Comme le texte de la Pr Lucie Lamarche dans ce numéro l’a démontré, les institutions internationales, comme les organes de traités des Nations unies, voient quant à elles de façon croissante les municipalités d’ici et d’ailleurs sur leur radar, et ce, même si elles n’ont pas de statut formel en droit international public. Ce rapprochement, entre droits humains et municipalités, va de soi quand on y pense. Les municipalités du 21e siècle, gouvernements de proximité, créatrices et gardiennes des milieux de vie, jouent un rôle important bien au-delà des champs de compétence qu’on leur associe traditionnellement, comme la voirie, l’aqueduc ou la collecte des déchets ! Cette rencontre entre municipalités et droits humains s’est densifiée au même moment où le rôle des municipalités se transformait et que celles-ci gagnaient en autonomie. Le droit n’est pas étranger à cette transformation, bien au contraire. En effet, les trente dernières années ont vu les municipalités canadiennes traverser d’importantes réformes législatives provinciales visant à leur accorder davantage de pouvoirs et d’autonomie, malgré les paramètres constitutionnels en place, des réformes dont les tribunaux semblent jusqu’à maintenant bien avoir saisi la teneur. L’autonomisation croissante des municipalités sur les plans législatif et jurisprudentiel fait d’elles, plus que jamais, des interlocutrices incontournables en matière de droits humains. Cela est presque mathématique : avec plus de pouvoirs, viennent plus de responsabilités. Les prochaines lignes exposeront les grandes lignes de cette dynamique.Vers l’autonomie locale
Comme le rappelait récemment la Cour suprême du Canada1, les municipalités, constituant un champ de compétence provincial en droit constitutionnel, sont juridiquement sous le contrôle absolu des provinces. La Cour confirma dans cette affaire que le gouvernement ontarien avait parfaitement le droit de recomposer le conseil de ville de Toronto durant la campagne électorale municipale de 2013, le faisant passer de 47 à 25 conseillers, et que cela ne constituait pas une violation de la liberté d’expression des candidats. Les provinces, via une législation abondante, encadrent ainsi dans les moindres détails l’existence, les finances et les pouvoirs des municipalités. Malgré ce contrôle, des réformes législatives provinciales majeures ont eu lieu. L’aspect le plus frappant de ces dernières réside dans la façon dont l’attribution des compétences et pouvoirs aux municipalités a changé. La traditionnelle délégation spécifique, détaillée et restrictive de pouvoirs (sous forme de « liste d’épicerie ») a été transformée en approche plus globale par la création de « sphères de compétence », c’est-à-dire l’énonciation de domaines de compétence où les municipalités sont titulaires de pouvoirs larges. Au Québec, la Loi sur les compétences municipales2, entrée en vigueur en 2006, s’inscrit dans cette tendance. Celle-ci vise les pouvoirs dans neuf domaines de compétence, dont plusieurs ont des liens évidents avec les droits humains (culture, loisirs, activités communautaires et les parcs; développement économique local; production d’énergie et systèmes communautaires de télécommunication; environnement; salubrité; nuisances; sécurité; transport; et, depuis 2023, habitation). La différence entre les deux méthodes de délégation des pouvoirs est majeure. Par exemple, au Québec, alors que les conseils municipaux étaient auparavant habilités à adopter des règlements pour « défendre de jeter ou déposer des cendres, du papier, des déchets, des immondices, des ordures, des détritus et autres matières ou obstructions nuisibles dans les rues, allées, cours, terrains publics, places publiques, eaux ou cours d’eau municipaux », elles sont aujourd’hui habilitées à régir les « nuisances », la « sécurité » et l’« environnement ».
À sa face même, ce virage donne plus de flexibilité, de marge de manœuvre et de pouvoirs aux municipalités.
L’autonomie des municipalités canadiennes dépend aussi largement de la vision que les tribunaux ont du contrôle judiciaire des règlements municipaux. À ce titre, l’arrêt Shell de 19943, rendu par la Cour suprême, marque un tournant majeur. L’opposition nette entre les motifs majoritaires et dissidents dans cette affaire sur le rôle des autorités locales témoigne des deux approches entre lesquelles oscillaient alors les tribunaux : stricte et interventionniste, d’une part, et libérale et déférente, de l’autre. Or, cette seconde approche, favorisée par la juge McLachlin en dissidence, a aujourd’hui percolé dans l’ensemble de la jurisprudence canadienne. Le respect des municipalités comme espaces de vie démocratique, de libre expression citoyenne et de bien-être collectif, fut un élément déterminant de cette évolution.
La différence entre les deux méthodes de délégation des pouvoirs est majeure. Par exemple, au Québec, alors que les conseils municipaux étaient auparavant habilités à adopter des règlements pour « défendre de jeter ou déposer des cendres, du papier, des déchets, des immondices, des ordures, des détritus et autres matières ou obstructions nuisibles dans les rues, allées, cours, terrains publics, places publiques, eaux ou cours d’eau municipaux », elles sont aujourd’hui habilitées à régir les « nuisances », la « sécurité » et l’« environnement ».
À sa face même, ce virage donne plus de flexibilité, de marge de manœuvre et de pouvoirs aux municipalités.
L’autonomie des municipalités canadiennes dépend aussi largement de la vision que les tribunaux ont du contrôle judiciaire des règlements municipaux. À ce titre, l’arrêt Shell de 19943, rendu par la Cour suprême, marque un tournant majeur. L’opposition nette entre les motifs majoritaires et dissidents dans cette affaire sur le rôle des autorités locales témoigne des deux approches entre lesquelles oscillaient alors les tribunaux : stricte et interventionniste, d’une part, et libérale et déférente, de l’autre. Or, cette seconde approche, favorisée par la juge McLachlin en dissidence, a aujourd’hui percolé dans l’ensemble de la jurisprudence canadienne. Le respect des municipalités comme espaces de vie démocratique, de libre expression citoyenne et de bien-être collectif, fut un élément déterminant de cette évolution.
Des effets concrets en pratique
S’il est incontestable que les développements législatifs et jurisprudentiels décrits ci-dessus ont contribué, au moins en partie, à l’émancipation des municipalités canadiennes, celles-ci demeurent bien sûr assujetties à de nombreuses limites en raison des paramètres constitutionnels actuels. Pensons, par exemple, au fait que de nombreuses lois habilitantes sont encore rédigées sous le modèle de la « liste d’épicerie » ou encore que les lois et règlements de la province priment sur la réglementation municipale. Cela dit, dans l’histoire du droit municipal au pays, les avancées précitées sont non négligeables et ont des effets bien concrets. Elles sont prometteuses sur le plan de l’autonomie, de l’adaptabilité et de l’innovation réglementaire des municipalités, n’enfermant plus ces dernières dans un carcan aussi rigide qu’auparavant. Les municipalités agissent ainsi de façon croissante dans un ensemble de domaines, souvent de façon innovante. De l’interdiction des pesticides à l’encadrement de l’hébergement touristique de courte durée en passant par la lutte aux déserts alimentaires, les municipalités contribuent à la mise en œuvre locale des droits humains à un environnement sain, au logement, à la santé ou à l’alimentation, par exemple. Bien sûr, cette médaille a deux facettes : des actions municipales sont aussi susceptibles d’aller à l’encontre des droits humains. Bref, l’augmentation des pouvoirs municipaux entraînent des répercussions pour les titulaires de droits humains, ces derniers étant plus que jamais susceptibles d’être touchés par une action municipale.Bref, l’augmentation des pouvoirs municipaux entraînent des répercussions pour les titulaires de droits humains, ces derniers étant plus que jamais susceptibles d’être touchés par une action municipale.Les municipalités sont aussi souvent au centre de tensions et d’arbitrages entre des droits humains qui en apparence s’opposent, comme dans le dossier Transcontinental4 où la liberté d’expression a été plaidée à l’encontre d’un règlement interdisant la distribution d’imprimés publicitaires et ayant pour effet, notamment, de contribuer à la protection de l’environnement. Soulignons enfin que, fortes de cette autonomisation et des nombreux domaines dans lesquelles elles agissent désormais, nombreuses sont aussi les municipalités qui se déclarent villes des droits humains, villes inclusives ou villes durables, entre autres, quoique la contribution de ces étiquettes à la réalisation effective des droits humains dépende ultimement des actions concrètes qui en découlent. La rencontre entre droits humains et municipalités se densifie et rien n’indique un essoufflement de la dynamique, bien au contraire. Cette édition de Droits et libertés contribue à en prendre la pleine mesure.
Les auteurs sont respectivement Professeur agrégé, Département d’études urbaines et touristiques, ESG UQAM et Vice-doyen aux études et professeur titulaire, Section de droit civil, Faculté de droit, Université d’Ottawa. Tous deux sont membres du Barreau du Québec. Ils sont auteurs d’un récent texte qui fait le bilan de l’adoption de la Loi sur les compétences municipales; voir Benoît Frate et David Robitaille, Quinze ans de Loi sur les compétences municipales : contexte, avancées et limites pour l’autonomie locale, Service de la qualité de la profession, Barreau du Québec, Développements récents en droit municipal (2022), vol. 509, 2022, 203. 1 Toronto (Cité) Ontario (Procureur général), [2021] 2 RCS 845. 2 Loi sur les compétences municipales, RLRQ, C-47.1. 3 Produits Shell Canada ltée Vancouver (Ville), [1994] 1 RCS 231. 4 Médias Transcontinental Ville de Mirabel, 2023 QCCA 863.
L’article Municipalités et droits humains: une rencontre qui se densifie est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

Emplois municipaux, pour qui ?

Retour à la table des matières Droits et libertés, automne 2024 / hiver 2025
Emplois municipaux, pour qui?
Elisabeth Dupuis, Responsable des communications, Ligue des droits et libertés Le Québec, le Canada et les municipalités, ont des devoirs et obligations inscrits dans des lois, des Chartes et des Conventions, qui devraient toujours les guider dans l’élaboration de politiques ou de législations. Ces dispositions sont nécessaires afin d’assurer le respect des droits humains aux personnes en situation de handicap (PSH) dans des conditions d’égalité avec les autres1 et assurer leur pleine participation sociale. Dès 2001, le Québec s’est doté d’une loi pour corriger la situation des personnes faisant partie de certains groupes victimes de discrimination en emploi2. La Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans les organismes publics (LAÉE) s’applique notamment à toutes les municipalités qui emploient 100 personnes et plus. Après des années de mise en œuvre progressive de la LAÉE – le groupe des personnes handicapées a été ajouté en 2007 —, les avancées en matière d’emploi dans les municipalités auraient pu être significatives pour les PSH. Le 7e Rapport triennal 2019-20223, qui fait état de la situation en matière d’accès à l’égalité en emploi des organismes publics, explique que les 388 organismes assujettis incluant 71 municipalités sont très loin d’atteindre les indicateurs-cibles. En effet, l’écart est grand entre la représentation totale (0,9 %) des PSH et l’indicateur cible à atteindre (10,5 %) de leurs effectifs, et ce, malgré les augmentations des embauches entre 2019 et 2022. Les 71 municipalités embauchent 633 PSH sur un total de 74 288 employé-e-s. Malgré l’existence de nombreuses ressources et services en intégration et maintien en emploi disponibles à Montréal et sa région, la métropole a un faible taux de représentation soit 1 %. En 2019-2022, seules deux municipalités atteignent et dépassent leur indicateurcibles : Chambly (5 %) et Magog (6 %). Assujettie récemment à la LAÉE, la Ville de La Tuque atteint un taux de 5%! La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) énonce des préoccupations dans un contexte d’emploi favorable : « leur taux de représentation tarde à augmenter, et ce, malgré les efforts investis par les organismes publics […] » et ce taux, qui se situe toujours aux alentours de 1 % [depuis 2007], met en évidence « que les stratégies de recrutement et d’embauche des membres de ce groupe ne donnent pas réellement de résultats4 ».Tant de choses restent à faire pour que les PSH puissent exercer pleinement leurs droits et participer à la société. Les obstacles physiques, organisationnels et comportementaux5 sont identifiés au stade de l’embauche, de l’intégration et du maintien en emploi.Parmi ces obstacles, on retrouve en premier lieu le capacitisme ; la représentation du travailleur idéal ; les offres d’emploi ; l’accessibilité et l’adaptation des lieux de travail ; la compréhension et l’application des accommodements et des adaptations ; l’adéquation du transport adapté et des horaires de travail ; l’absence de culture d’inclusion ; l’application des conventions collectives ; le questionnaire médical préembauche, etc. L’interdépendance des droits est de toute évidence au cœur de la réalité des personnes en situation de handicap. Nous pouvons exiger des municipalités qu’elles en fassent davantage pour s’acquitter de leurs obligations légales et accélérer l’accès à l’égalité en emploi des PSH. Car il s’agit bien d’obligations qui leur incombent, et non de gestes charitables, pour permettre aux personnes en situation de handicap de participer pleinement à la société et d’exercer l’ensemble de leurs droits.
1 Mona Paré, La CDPH : des efforts du Canada depuis près de 20 ans, revue Droits et libertés, vol. 40, no 1, 2021. 2 Gouvernement du Québec, Rapport sur la mise en œuvre de la LAÉE, 2020. 3 CDPDJ, Rapport triennal, 2023. 4 Ibid. 5 CDPDJ, Rapport annuel du groupe visé des personnes handicapées, 2021.
L’article Emplois municipaux, pour qui? est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.












