Presse-toi à gauche !
Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Des climatosceptiques étasuniens ont infiltré le Parlement européen

Venu des États-Unis, un groupe de réflexion d'extrême droite et climatosceptique œuvre à démanteler les lois environnementales de l'Europe. Et ce, avec l'aide de députés européens.
Tiré de Reporterre. Légende de la photo : Le Heartland Institute transmet ses idées climatosceptiques au parlement européen. Wikimedia commons/ CC BY-SA 3.0/Diliff
La vague climatosceptique étasunienne est-elle en train de déferler sur l'Union européenne ? C'est la question que soulève une enquête du journal britannique The Guardian. Celui-ci a révélé le 22 janvier qu'un groupe de réflexion climatosceptique étasunien œuvrait, avec l'aide d'eurodéputés d'extrême droite, à démanteler les réglementations environnementales européennes.
Nommé le Heartland Institute, ce groupe d'influence a eu de nombreuses positions climatosceptiques. « [Il] a des liens avec l'administration Trump et a bénéficié de financements de la part d'entreprises comme ExxonMobil et de riches donateurs républicains américains », indique The Guardian. D'après le journal, les relations ont été établies il y a deux ans avec deux eurodéputés autrichiens du Parti de la liberté d'Autriche (FPÖ), groupe d'extrême droite et antimigration.
Ils ont permis au président du Heartland Institute, James Taylor, d'être accueilli au Parlement européen. Là, il a notamment pu rencontrer « des hommes politiques hongrois pour discuter de la politique climatique et de la loi sur la restauration de la nature [visant à stopper l'effondrement de la biodiversité] », poursuit l'article. Cela a pu avoir des conséquences sur la position de la Hongrie : « Plus tard dans le mois, le vote de la loi a été retardé lorsque la Hongrie a retiré son soutien, mais le projet de loi a finalement été adopté. »
« Un négationnisme climatique décomplexé »
Cette ingérence « n'est pas une surprise », réagit auprès de Reporterre l'eurodéputée La France insoumise Manon Aubry. « On observe déjà des groupes d'influence d'extrême droite œuvrer par exemple sur la question de l'avortement. Cela s'étend à l'écologie. »
Ce cas est révélateur de la rapidité avec laquelle l'extrême droite climatosceptique est arrivée à percer au sein des institutions européennes. L'Institut Heartland profite « d'une période où le sentiment anticlimat de la droite augmente fortement », estime The Guardian. « Nous craignons de voir renaître un négationnisme climatique décomplexé », a réagi Kenneth Haar, du Corporate Europe Observatory, auprès du quotidien.
Depuis les élections de juin dernier, ayant abouti à un nouveau Parlement européen plus à droite, le terrain de jeu est encore plus favorable. « Au fur et à mesure que le nombre de députés d'extrême droite grandit, que la quantité d'États d'extrême droite augmente, le nombre de leurs relais aussi, constate Manon Aubry. Et leur impact sera plus grand du fait de la victoire de Trump. Ils pourront mettre la pression en disant : “Dérégulez ou l'on vous met des droits de douane.” »
Des effets déjà visibles
Pour l'eurodéputée, l'effet de cette offensive de dérégulation est déjà visible au niveau de la Commission européenne : « Les premiers textes qu'elle a proposés — le paquet dit “Omnibus” — visent à déréguler les normes écologiques et sociales sur les entreprises [1]. Elles venaient pourtant d'être adoptées sous le mandat précédent. Cette influence sur la Commission européenne et le Conseil européen, c'est nouveau. Avant, elle se limitait à quelques députés. »
Au niveau du Parlement européen, tout dépendra de l'attitude de la droite. « L'Institut Heartland est susceptible de devenir l'un de ceux qui aideront à créer une alliance politique étroite entre les conservateurs et l'extrême droite qui sera très destructrice » pour le climat, s'inquiétait auprès du Guardian Kenneth Haar, du Corporate Europe Observatory.
« Ensemble, droite et extrême droite ont la majorité, confirme Manon Aubry. Et le cordon sanitaire se défait à vitesse grand V. L'extrême droite a de plus en plus de responsabilités, la charge de plus en plus de rapports. Ils ont compris qu'ils pouvaient gagner. »
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’agence de Musk le nomme chef du gouvernement

Je pense depuis longtemps que les médias américains seraient plus lucides sur l'ascension et le retour de Donald Trump si cela se passait à l'étranger, dans un pays étranger, où nous sommes habitués à ce que les correspondants étrangers écrivent avec une autorité plus incisive. Ayant suivi avec une inquiétude croissante les développements des dernières 24 et 36 heures à Washington, j'ai pensé tenter une telle dépêche. Voici une histoire qui devrait être écrite ce week-end :
La junte de Musk saisit des bureaux gouvernementaux clés
WASHINGTON, D.C. - Ce qui a commencé jeudi comme une purge politique des services de sécurité intérieure s'est transformé vendredi en un véritable coup d'État. Les unités techniques d'élite alignées sur l'oligarque des médias Elon Musk se sont emparées des systèmes clés du Trésor national bloquant l'accès extérieur aux dossiers du personnel fédéral et mettant hors ligne les réseaux de communication du gouvernement.
1 février 2025 | tiré de Doomsday Scenario
https://www.doomsdayscenario.co/p/musk-s-junta-establishes-him-as-head-of-government?fbclid=IwY2xjawIN-ylleHRuA2FlbQIxMQABHaS3YaDqfWqR-4kpGdSBep4riPlDT37lpGE0rq6ahq2YmR5RHkUVD1OtPA_aem_El8ovcsvVVzd1yQNPFZIQQ
Avec une rapidité qui a stupéfié même les observateurs politiques de longue date, les forces loyales à la junte de Musk l'ont installé au poste de chef du gouvernement non élu et pratiquement incontesté en quelques jours seulement, mettant à mal le système constitutionnel de cette démocratie de longue date et sa fière tradition d'État de droit vieille de près de 250 ans. Après s'être installées dans des ministères clés ainsi que dans un bâtiment adjacent au complexe présidentiel, les forces de M. Musk ont commencé à émettre des directives à l'intention des fonctionnaires et à forcer la démission d'agents jugés insuffisamment loyaux, comme le chef de l'autorité aéronautique du pays.
Le nouveau président de ce pays du G7, un oligarque de niveau intermédiaire nommé Donald Trump, est apparu, au milieu des mesures prises par Musk, comme étant de plus en plus un simple chef d'État en figure de proue. Trump est un criminel condamné qui a un long passé de corruption. Il est revenu au pouvoir à la fin du mois de janvier après un intermède de quatre ans au cours duquel il a promis des châtiments et des représailles contre les opposants étrangers et l'« État profond » national. Il a été accusé d'avoir tenté de renverser la transition pacifique du pouvoir qui l'avait destitué en 2021, mais des éléments loyalistes du système judiciaire ont réussi à bloquer ses poursuites et son incarcération, facilitant ainsi son retour au pouvoir.
Au cours des deux dernières semaines, les factions présidentielles loyalistes et les équipes soutenues par Musk ont lancé de vastes purges illégales, dignes de Staline, au sein des forces de police nationales et des procureurs, ainsi que des bureaux connus sous le nom d'inspecteurs généraux, qui sont généralement chargés d'enquêter sur la corruption du gouvernement. Alors que les chiffres officiels de ces évictions sans précédent ont été tenus secrets, des rumeurs ont circulé dans la capitale selon lesquelles le nombre de fonctionnaires de carrière touchés par les premières purges pourrait s'élever à plusieurs milliers, les commissaires politiques continuant d'évaluer les antécédents des membres des forces de police.
Le président vieillissant et mentalement affaibli, qui adhère depuis longtemps à la pensée conspirationniste, a passé une grande partie de la semaine à tenir des propos étranges sur les minorités raciales et ethniques opprimées du pays, qu'il a accusées sans preuve d'être à l'origine d'un accident d'avion mortel survenu de l'autre côté de la rivière, en face de la résidence présidentielle. Les attaques infondées et racistes contre ces minorités ont été l'un des principaux fondements de l'ascension imprévue de Trump dans le monde politique, après une carrière de magnat de l'immobilier et d'animateur de télé-réalité. Elles remontent à sa première annonce de candidature à la présidence en 2015, lorsqu'il a exprimé son indignation face à l'envoi de « violeurs » dans le pays par son voisin du sud.
Dès son retour à la présidence, il a mobilisé les forces de sécurité paramilitaires d'extrême droite pour mener des descentes dans les églises, les écoles et les lieux de travail, afin d'identifier et d'expulser les minorités raciales, y compris celles qui vivaient depuis longtemps en harmonie avec la majorité chrétienne blanche du pays. Il a également immédiatement fait libérer de prison quelque 1 500 partisans qui avaient participé à son insurrection ratée de 2021, dont des membres de milices violentes d'extrême droite lui ayant juré allégeance dès leur libération, en cas de troubles civils futurs. Par ailleurs, alors même qu'il relâchait des criminels violents dans les rues, M. Trump a retiré par décret la protection de sécurité gouvernementale accordée depuis longtemps à d'anciens militaires et responsables de la santé qu'il accuse de l'avoir trahi.
Soulignant son apparente déconnexion de la réalité, des informations ont fait surface selon lesquelles le président avait ordonné aux forces militaires de provoquer une catastrophe environnementale et d'inonder des régions d'une province séparatiste connue sous le nom de Californie et dirigée par un opposant politique très en vue. Cette décision met en lumière la façon dont l'armée, qui avait résisté aux prises de pouvoir inconstitutionnelles de Trump lors de sa première administration, est maintenant dirigée par un ministre de la Défense soumis, une personnalité favorisée de la télévision, inexpérimenté et confronté à une série d'allégations embarrassantes concernant son comportement en état d'ébriété sur le lieu de travail.
Les alliés étrangers, qui se sont longtemps alignés sur les États-Unis sur la scène internationale, ont été déstabilisés par la rhétorique nationaliste et impérialiste de plus en plus inquiétante provenant des comptes de médias sociaux du président, en grande partie postés sur un réseau détenu et géré par Trump lui-même, et se sont inquiétés. Lors de conversations privées dans les ambassades de la capitale, ils ont exprimé leur inquiétude quant à la possibilité que le président mobilise l'armée pour réaliser des ambitions territoriales jusqu'ici inimaginables, notamment s'emparer de leur voisin du nord, qui partage la plus longue frontière non défendue du monde, et potentiellement coloniser le Panama et le Groenland.
Le ministre de la Défense du pays, qui a déjà déclaré qu'il ne pensait pas que les femmes devraient être autorisées à servir dans des rôles de combat, et le nouveau ministre de l'Intérieur de Trump, qui est apparu à la télévision nationale portant l'uniforme paramilitaire de la force de sécurité frontalière au cœur de l'ascension politique de Trump, ont passé une grande partie de leurs premiers jours à faire écho et à amplifier l'hystérie du président au sujet des minorités raciales et ethniques. Ces fonctionnaires et d'autres représentants du gouvernement ont également annulé immédiatement toutes les célébrations officielles des fêtes religieuses et des fêtes des minorités ethniques, et ont cherché à effacer les sites web officiels, ainsi que tout enseignement de la longue histoire de ces minorités dont le pays peut être fier, aux travailleurs comme aux écoliers. Dans la nuit de vendredi à samedi, quelques heures après le départ des journalistes, le cabinet du ministre de la Défense a annoncé qu'il interdirait aux médias indépendants de l'establishment de travailler dans les quartiers généraux militaires du pays et qu'il les remplacerait par des organes de presse proches de la droite.
Le ministre de la Propagande de l'administration a également annoncé vendredi, apparemment sans grande préparation, qu'il allait déclencher une guerre commerciale immédiate, inattendue et apparemment irréfléchie avec les deux principaux partenaires économiques du pays. Une mesure qui, si elle était mise en œuvre, bouleverserait l'économie nationale, perturberait les chaînes d'approvisionnement et accélérerait le retour d'une crise inflationniste qui a ébranlé la politique intérieure au cours des cinq dernières années et qui semblait tout juste revenir à la normale. Ironiquement, c'est cette même crise inflationniste et les promesses de Trump de baisser le prix des œufs lors de sa campagne électorale qui ont ouvert la voie à sa victoire électorale imprévue en novembre.
Les autres oligarques du pays ont observé avec inquiétude l'ascension inattendue et rapide de Musk au pouvoir, ainsi que la concurrence entre les grandes entreprises de médias et de technologie qui sont en lien avec l'empire commercial de Musk (comme Meta, Amazon, Disney, Paramount, Apple et OpenAI). Ces entreprises ont rapidement négocié et payé des pots-de-vin au président pour permettre la poursuite de leurs activités sans entrave. Les conditions initiales de paiement allaient de cadeaux d'un million de dollars pour l'inauguration présidentielle à des paiements de 15 et 25 millions de dollars de la part de Disney et Meta pour financer la construction d'un sanctuaire présidentiel. Le paiement le plus élevé jamais enregistré est celui de 40 millions de dollars effectué par Amazon, qui a été organisé comme un cadeau pour l'épouse du président en échange de la possibilité pour l'entreprise de médias de tourner un biopic hagiographique.
On ignore également les termes précis de l'accord qui ont permis ces pots-de-vin et paiements, ainsi que la date à laquelle les paiements ultérieurs sont attendus. Cependant, Trump a décidé de licencier et d'affaiblir les organismes de surveillance du gouvernement qui ont longtemps gêné l'élite financière du pays, ce samedi.
Tout au long de la semaine de prise de pouvoir, qui s'est déroulée à un rythme effréné et semble de plus en plus irréversible d'heure en heure, ni les leaders parlementaires loyalistes ni ceux de l'opposition n'ont soulevé d'objection significative à l'encontre du nouveau régime ou du démantèlement du système constitutionnel d'équilibre des pouvoirs du pays. Quelques membres du corps législatif gériatrique ont publié des messages épars sur les réseaux sociaux pour condamner la décision, mais le Parlement, dont les deux chambres sont contrôlées par des membres dits « MAGA » triés sur le volet pour leur loyauté envers le président, est rentré chez lui plus tôt que prévu pour le week-end, alors que les forces de Musk se répandaient dans les rues de la capitale.
Le rôle éventuel que les forces de Musk permettraient au Parlement de jouer dans la nouvelle structure gouvernementale n'était pas clair au moment de son retour à l'Assemblée nationale, connue sous le nom de Capitole.
Notes
1. Églises écoles et lieux de travail : Les agents chargés de l'application des lois sur l'immigration pourront désormais arrêter des migrants dans des lieux sensibles comme les écoles et les églises, après que l'administration Trump a rejeté les politiques limitant les endroits où ces arrestations pourraient avoir lieu, alors que le nouveau président cherche à tenir ses promesses de campagne de procéder à des expulsions massives. La mesure annoncée mardi annule les directives qui, depuis plus d'une décennie, empêchent deux agences fédérales clés de l'immigration - l'Immigration and Customs Enforcement et le Customs and Border Protection - de mener des opérations de contrôle de l'immigration dans des endroits sensibles.
2. La vengeance de Trump contre Milley envoie un signal inquiétant aux hauts gradés de l'armée. Le général Mark A. Milley a été chef d'état-major des armées des États-Unis de 2019 à 2023.
Cette semaine, le président Trump a révoqué le dispositif de sécurité du général à la retraite Mark Milley et a annoncé une enquête sur la conduite de l'ancien chef d'état-major interarmées, mettant en œuvre les représailles promises tout en envoyant un message effrayant aux hauts gradés de l'armée.
Trump, qui a également révoqué l'habilitation de sécurité de Milley dans des ordres adressés au secrétaire à la Défense Pete Hegseth, est depuis longtemps en conflit avec Milley, qui s'est exprimé ouvertement contre le président dans des livres et des commentaires publics.
Richard Kohn, professeur émérite à l'Université de Caroline du Nord et expert des relations civilo-militaires, a déclaré que la décision de Trump découragerait les officiers supérieurs de faire leur travail et de conseiller honnêtement le président, notant qu'un ancien chef d'état-major interarmées n'a jamais vu ses détails de sécurité révoqués auparavant.
3. Amazon. Quelques jours avant l'élection de novembre, Bezos est intervenu pour empêcher le Washington Post, dont il avait fait l'acquisition en 2013, de soutenir la vice-présidente Kamala Harris. « Les soutiens présidentiels ne font rien pour faire pencher la balance d'une élection », a écrit Bezos dans un éditorial expliquant sa décision. « En réalité, les soutiens présidentiels créent une impression de partialité. Une impression de non-indépendance. Y mettre fin est une décision de principe, et c'est la bonne. »
Le milliardaire a également insisté sur le fait qu'il n'y avait aucune contrepartie dans sa décision.
Les employés du journal étaient furieux et des dizaines de lecteurs ont annulé leur abonnement en signe de protestation. Au cours des mois qui ont suivi, une série de rédacteurs et d'écrivains de renom ont quitté le Post ou ont démissionné de son comité de rédaction. Plus tôt cette semaine, la dessinatrice Ann Telnaes, lauréate du prix Pulitzer, a démissionné du journal après que le Post a supprimé son dessin représentant Bezos et d'autres personnalités de la Silicon Valley rendant hommage à une statue de Trump.
Traduction avec le logiciel DeepL
et André Frappier
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Merci Trump !

Dans le drame du triangle Groenland-Danemark-États-Unis, Trump devrait être remercié. D'une part, parce que ce drame montre à quel point la relation entre le Danemark et le Groenland sous la forme du royaume danois est dépassée et offre une chance de changer cette relation, et d'autre part, parce qu'une perception réaliste du rôle du Danemark dans le monde en tant que petit État doit enfin se matérialiser.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/01/29/groenland-des-inuits-a-dedommager/
L'illustration est tirée de l'article de Wikipédia intituléExercice Strikeback.
Le problème en tant qu'équation de pouvoir
La raison ?
La crainte que l'indépendance du Groenland ne crée un vide de pouvoir dans l'Arctique que la Russie et la Chine combleront militairement et en termes d'accès aux minerais stratégiques.
Qui ?
Les déclarations de Trump sont avant tout un message adressé à Moscou et à Pékin, puis à Copenhague et à Nuuk.
Résultats attendus :
Expansion de la présence militaire et civile américaine au Groenland et augmentation des contacts directs en dehors de Copenhague entre les deux pays.
Résultats souhaitables :
Construction d'une véritable communauté d'égaux, le Groenland et les îles Féroé ayant nettement plus d'influence sur la défense, la sécurité et les affaires étrangères qui concernent les deux pays.
Les récentes déclarations de Trump sur la possibilité d'utiliser des moyens militaires ou économiques pour prendre le contrôle du Groenland parce que la propriété du pays est cruciale pour la sécurité militaire et économique des États-Unis ont déclenché l'une des plus grandes tempêtes politiques de ces derniers temps au Danemark et au Groenland, un véritable choc pour un petit État qui a presque toujours fait volontiers ce que disait le grand frère. Bien que l'on ne sache jamais ce que Trump veut dire – l'une de ses principales astuces politiques, qu'il partage ironiquement avec Poutine, consiste à créer de l'incertitude – cet événement représente l'une des crises les plus graves dans les relations entre le Danemark et les États-Unis au niveau gouvernemental, malgré la tentative de Lars Løkke de lutter contre les incendies : « Je n'ai pas l'impression que nous soyons dans une crise de politique étrangère ». Mais il faut y voir une réaction traditionnelle du ministère des affaires étrangères lorsque les choses s'échauffent vraiment. Et après l'investiture de Trump, le sifflet a pris une autre tournure.
Le vice-président J.D. Vance, dans une interview accordéeà Fox News Sunday avant son investiture, n'a rien fait pour minimiser le conflit : « Nous n'avons pas besoin d'utiliser la force militaire. Ce que les gens oublient toujours, c'est que nous avons déjà des troupes au Groenland. Le Groenland est stratégiquement très important pour l'Amérique », soulignant que les États-Unis pourraient utiliser la force militaire s'ils le souhaitaient. Le fait qu'il n'y ait pas de crise est directement contredit par le fait que, en réponse à la question explicitede Mette Frederiksen, Trump ne rejettera pas les droits de douane sur les exportations danoises vers les États-Unis. Elle ne dira pas non plus après sa conversation avec Trump et la réunion au sein de la commission de la politique étrangère :
« Il a été suggéré par les États-Unis qu'il pourrait malheureusement se produire une situation dans laquelle nous travaillerions moins ensemble qu'aujourd'hui dans le domaine économique. »
La raison, bien sûr, est qu'en tant que Première ministre, elle veut avertir la population et les milieux d'affaires qu'une crise se profile, qui pourrait avoir des conséquences économiques désagréables pour le Danemark.
Et lorsque Trump a répété son désir de prendre le contrôle du Groenland lors d'une conférence de presse après son investiture, le Premier ministre a dû une fois de plus convoquer les chefs de parti pour un briefing confidentiel – mais cette fois-ci, pas les « ailes extrêmes », comme l'opposition de gauche et de droite est si joliment appelée.
La déclaration de Trump intervient à un moment où les relations entre le gouvernement autonome groenlandais et le gouvernement danois sont déjà au plus bas, alors que les héritages coloniaux continuent de faire surface, plus récemment sous la forme du scandale de la spirale (pose obligatoire de stérilet), de l'utilisation par les municipalités danoises de tests de parentalité qui ne s'appliquent qu'aux Européens blancs et du racisme latent dont sont victimes de nombreux Groenlandais au Danemark. Et même si le président et le présidium du Parlement danois, sous la pression de Mette F, ont dû introduire l'interprétation simultanée au Parlement danois, ont rejeté le piétinement du ministère des Affaires étrangères concernant la nomination d'un Groenlandais comme ambassadeur du Royaume au Conseil de l'Arctique, et ont récemment annoncé qu'ils allaient désormais allouer une somme non spécifiée à deux chiffres d'un milliard d'euros pour la modernisation de la défense dans l'Arctique. Et maintenant, après le début de la crise Trump, il est soudain possible d'examiner l'utilité des tests de parentalité. Dans l'ensemble, ces revirements doivent laisser une étrange sonnerie dans les oreilles groenlandaises : – Pourquoi quelque chose ne se produit-il que lorsqu'il y a une pression extérieure ?
L'importance de la sécurité du Groenland pour les États-Unis
Mais pourquoi Trump, le premier président debout des États-Unis, fait-il aujourd'hui ces déclarations inédites dans les relations internationales des États ? Si tu fais bouillir les déclarations et que tu essaies d'en trouver la substance, il le fait à cause de la perspective de l'indépendance du Groenland, entendue comme une sécession complète du Danemark. Quelque chose qui, aux yeux de Trump, risque de créer un vide de pouvoir dans une région vitale pour la défense du continent nord-américain – auquel le Groenland appartient géographiquement – et qui contiendrait d'importants gisements de minéraux et de métaux stratégiques, cruciaux pour le maintien de la supériorité technologique et militaire américaine. Jusqu'à présent, la Chine est le seul arbitre du raffinage de ces matériaux critiques et a récemment imposé un embargo sur l'exportation de certains des matériaux les plus importants pour la fabrication de la microélectronique. Et n'oublions pas qu'il pourrait y avoir beaucoup d'argent dans le processus d'extraction, ce qui pourrait profiter au futur pouvoir oligarchique des États-Unis.
Ce qui est surprenant lorsque Trump fait une déclaration aussi forte sur les matières premières essentielles, c'est que les États-Unis eux-mêmes possèdent de grandes quantités de ce que l'on appelle les éléments de terres rares. Le fait est que les États-Unis sont contraints d'envoyer des matières premières concentrées pour être raffinées en Chine : le plus grand producteur de terres rares du monde occidental, American Mountain Pass, envoie toute sa production en Chine, écrit Information. Ni les États-Unis ni l'Union européenne ne disposent de la technologie nécessaire pour le traitement, mais la Chine, oui – les terres rares en question se trouvent dans de nombreux endroits, ce n'est donc pas l'extraction qui pose un problème. Ils s'appuient donc sur des chaînes de valeur mondiale hautement spécialisées. En outre – toujours selon Information – la composition géologique des gisements de terres rares au Groenland n'est pas optimale et elles se trouvent en même temps que l'uranium, dont le gouvernement groenlandais a interdit l'exploitation.
Les conditions géographiques, climatiques et de transport rendent également difficile une exploitation minière rentable – ce que le rapport « Pour le bien du Groenland » de 2014 soulignait déjà. L'un des pères du rapport était le professeur de géologie Minik Rossing, qui a également exprimé son scepticisme sur la Deadline de DR récemment. À cela s'ajoute la nécessité de faire venir de la main-d'œuvre étrangère. En outre, le Groenland n'a pas de droits de propriété privée sur les terres, ce qui, avec la nouvelle loi sur les projets à grande échelle, serait perçu aux yeux des Américains comme une contrainte sévère pour une industrie extractive. Le Groenland n'est pas étranger au pillage des ressources de la terre qui a lieu ailleurs dans le monde, où les sociétés minières frappent comme des oiseaux de proie, mettant la terre à sec et laissant aux habitants les déchets toxiques et le nettoyage.
Mais les États-Unis – et l'UE aussi – construisent d'autres chaînes de valeur selon des lignes plus nationales dans le cadre de leurs tentatives de rompre leur dépendance à l'égard de la Chine, alors peut-être que les considérations stratégiques finiront par l'emporter sur les considérations commerciales.
Mais surtout, Trump ne veut tout simplement pas risquer que l'influence russe ou chinoise s'accroisse à mesure que l'influence danoise se réduit dans un pays qui s'étend sur plus de 2 millions de kilomètres carrés mais qui ne compte qu'environ 56 000 habitants. Les grandes puissances ne tolèrent pas le vide de pouvoir.
Et il n'y a rien de nouveau là-dedans. Car faut-il que Trump s'inquiète, les outils du contrôle américain n'existent-ils pas déjà ? Avec la doctrine Monroe de 1823, les États-Unis ont déjà affirmé qu'ils ne laisseraient pas des puissances extérieures s'établir sur les continents américains. Cette déclaration a été systématiquement suivie de la guerre hispano-américaine, qui a donné aux États-Unis Porto Rico et le contrôle de Cuba dans les Caraïbes, ainsi que l'achat des Antilles danoises en 1917. De la même manière, jusqu'à aujourd'hui – et plus récemment avec l'invasion du Panama en 1989 – les États-Unis n'hésitent pas à envahir directement ou à subvertir secrètement des pays américains s'ils estiment qu'ils sont confrontés à une prise de pouvoir « communiste », c'est-à-dire à un changement des relations de pouvoir en faveur des pauvres dans les pays en question – ou qu'ils se sont simplement mis en travers des intérêts et de la politique des États-Unis.
Dans le cas du Groenland, la vente des Indes occidentales signifiait que les États-Unis reconnaissaient en même temps la souveraineté du Danemark, bien que la doctrine Monroe s'appliquât toujours. Avec la Seconde Guerre mondiale, l'importance stratégique du Groenland est devenue évidente – d'abord parce que les États-Unis avaient besoin d'une station d'escale pour les avions qu'ils fournissaient à l'Angleterre, et plus tard, lorsque les États-Unis sont entrés en guerre eux-mêmes après l'attaque de Pearl Harbor, ils devaient également empêcher que le pays soit utilisé par les nazis pour menacer l'Amérique du Nord. L'ambassadeur danois à Washington, Kauffmann, est donc confronté à un ultimatum : soit les États-Unis occupent le Groenland sans autre forme de procès, soit un accord est conclu en vertu duquel le Danemark peut influencer les conditions de l'occupation et les États-Unis garantissent l'approvisionnement du pays. Kaufmann a sagement opté pour cette dernière solution.
En 1946, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont étudié la possibilité d'acheter le Groenland au Danemark – la guerre froide avait commencé. En 1951, la relation a été cimentée lorsque le Danemark et les États-Unis ont conclu un accord de défense, qui est de facto irrévocable car il faut que les deux parties y mettent fin. Par cet accord, les États-Unis se sont engagés à défendre le Groenland contre toute attaque. L'accord a également allégé la charge financière du Danemark.
Le développement des fusées en tant qu'armes de guerre que l'Allemagne nazie avait commencé a été poursuivi par les superpuissances afin que les fusées aient une portée beaucoup plus grande et puissent délivrer des têtes nucléaires. Et comme le nord du Groenland se trouve sur la trajectoire directe des fusées russes vers l'Amérique du Nord, les États-Unis ont construit une énorme base à Thulé – l'actuelle base spatiale de Pittufik – pour leurs bombardiers stratégiques, le stockage des armes nucléaires et un radar à très longue portée qui peut avertir les États-Unis et le Canada d'une attaque de fusées russes. En outre, le Groenland joue également un rôle dans la surveillance de ce que l'on appelle le GIUK gap, par lequel les sous-marins russes équipés d'armes nucléaires peuvent passer pour aller et revenir de la grande base libre de glace de la flotte russe du Nord sur la péninsule de Kola, à l'est de la Norvège.
Le traité de défense donne effectivement aux États-Unis les coudées franches pour faire ce qu'ils veulent dans le domaine de la défense. Le scandale de la lettre secrète du premier ministre social-démocrate H.C. Hansen, datant de 1957, montre bien que le Danemark en était parfaitement conscient. Lalettre secrète de Hansen de 1957, qui selon la devise « don't hear, don't see », permettait aux États-Unis de stocker des armes nucléaires sur la base de Thulé. La publication de cette lettre en 1995 a constitué une rupture de confiance cruciale dans les relations entre le Danemark et le Groenland. Mais elle n'a pas modifié la liberté de mouvement des États-Unis au Groenland. Même si les États-Unis, le Danemark et le Groenland ont signé un addendum à l'accord de défense à Igaliku en 2004, par lequel le Groenland a rejoint l'accord de défense et les États-Unis ont été tenus de notifier aux deux autres pays les changements majeurs dans la présence militaire américaine.
Le changement climatique, qui ouvre des voies de navigation beaucoup plus courtes entre l'Europe et l'Asie et donne potentiellement accès à de vastes ressources, et les tensions géopolitiques croissantes sous la forme d'un antagonisme grandissant entre les États-Unis et leurs alliés d'une part, et la Russie et la Chine d'autre part, ont remis l'Arctique sous les feux de la rampe (voir « L'Arctique, l'Atlantique Nord et la politique de sécurité » dans « L'OTAN est-elle sûre ? », Éditions Solidarité). Sur le plan militaire, la Russie a rouvert et modernisé un certain nombre de bases de l'Arctique, par ailleurs fermées. Il s'agit en premier lieu de la base aérienne de Nagurskoye, dans l'archipel de la Terre François-Joseph. En outre, le changement climatique permet d'utiliser toute l'année la route maritime du Nord, c'est-à-dire la route au nord de la Sibérie, ce dans quoi la Russie et la Chine investissent massivement. Principalement à des fins civiles et commerciales, mais bien sûr aussi à des fins militaires. Les États-Unis et les pays de l'OTAN la perçoivent comme une menace potentielle pour la route d'approvisionnement vulnérable entre l'Amérique et l'Europe à travers l'Atlantique Nord.
Dans un commentaire paru le 8 janvier dans le média de défense OLFI, le rédacteur en chef Peter Ernstved Rasmussen décrit avec justesse la relation entre le Danemark et le Groenland comme suit :
« Le gouvernement danois a fait son propre lit. Au lieu d'équilibrer les relations avec le Groenland, les gouvernements successifs ont poursuivi la mentalité de race maîtresse. Les Groenlandais se sentent provoqués à juste titre. Les États-Unis aussi, car nous n'avons jamais voulu prendre la sécurité au sérieux. Maintenant, la facture arrive, et elle sera coûteuse. »
Il est clair pour tout le monde que le Danemark est incapable de faire respecter sa souveraineté – quels que soient les efforts et la volonté de sacrifice de l'équipage militaire. Une patrouille en traîneau à chiens – Sirius – et quatre frégates qui peuvent à peine naviguer ne suffisent pas pour cette zone si étendue. Une véritable application de la souveraineté nécessitera des ressources que le Danemark, même s'il est l'un des pays les plus prospères du monde, ne pourra jamais mobiliser. Et ce, malgré la décision politique prise ces dernières années de déverser des milliards dans la défense de l'Arctique. Pour compenser l'insuffisance de la défense aérienne du Danemark au Groenland, il a également été envisagé aux États-Unis d'intégrer le Groenland au NORAD, le Commandement de l'aérospatiale et de la défense de l'Amérique du Nord.
Mais rien n'a été fait. Et pourquoi ? Parce que les politiciens, les officiers et les fonctionnaires du ministère de la Défense préfèrent dépenser l'argent pour quelque chose qui compte dans le calcul des objectifs de force de l'OTAN. L'Arctique ne compte pas, et l'OTAN n'a même pas de stratégie pour l'Arctique. Il s'agit là d'un nouveau scandale parmi tant d'autres au sein de l'armée, qui jette un doute légitime sur la sagesse de déverser d'innombrables milliards dans une défense avant qu'elle n'ait été dotée des compétences financières et managériales nécessaires.
Et qu'en est-il de l'indépendance ?
On pourrait commencer par faire le tri dans la langue, car il y a beaucoup de confusion sur ce que l'on entend réellement au Groenland et en groenlandais par ce que l'on traduit en danois par « autodétermination », « autonomie », « indépendance » et « détachement ».
Le mécontentement des Groenlandais à l'égard des relations entre le Danemark et le Groenland n'est pas nouveau. Il n'a cessé de croître depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, une guerre qui a rompu l'isolement du Groenland ; grâce au stationnement de troupes américaines dans des bases réparties dans tout le pays et au fait que les États-Unis étaient responsables de l'ensemble de l'approvisionnement du pays, la population groenlandaise s'est vu montrer un monde extérieur au pays. Lorsque le démantèlement des empires coloniaux européens s'est accéléré après la guerre mondiale, avec notamment la création du Comité de décolonisation de l'ONU, le Danemark a anticipé cette évolution en faisant du Groenland un comté danois en 1953 – en suivant le modèle portugais. En 1946-1951, le Portugal a transformé son Império Colonial Português en « provinces d'outre-mer » qui faisaient partie intégrante de la mère patrie. Cela a empêché les décolonisateurs trop zélés de s'immiscer dans les affaires des colonies et d'exiger leur indépendance.
L'intégration du Groenland au Danemark, soutenue par la plupart des Groenlandais, a également accéléré le développement qui allait conduire plus tard à l'autonomie locale (1979) puis à l'autonomie gouvernementale (2009). La tentative de danification du Groenland a bien sûr échoué, mais le reste de la modernisation de l'ensemble de la société groenlandaise a à la fois jeté les bases de l'État-providence – par exemple, les plus grands fléaux du Groenland que sont la tuberculose et la rougeole ont été éradiqués – et créé ses propres contradictions.
Contradictions parce que les Groenlandais étaient les spectateurs d'un développement auquel ils ne se sentaient pas associés et qu'ils se sentaient encore, à bien des égards, comme des citoyens de seconde zone dans leur propre pays. Par exemple, les salaires au Groenland étaient fixés en fonction d'un critère de lieu de naissance. Dans le même temps, de nombreux jeunes Groenlandais ont commencé à faire des études au Danemark, ont appris le danois et l'anglais, et sont devenus de plus en plus difficiles à refuser lorsqu'il s'agissait de déterminer leur propre situation. Les jeunes Groenlandais ont été influencés par des mouvements tels que la rébellion de la jeunesse et la lutte anti-impérialiste, et cette évolution a conduit à une organisation et à des revendications politiques, allant de l'autonomie locale et de l'auto-gouvernement à un désir généralisé d'une certaine forme d'indépendance.
Toutefois, il convient de noter qu'un sondage réalisé par l'Université du Groenland en 2024 montre que les Groenlandais interrogés considèrent la situation économique, le chômage et l'augmentation du coût de la vie comme les problèmes les plus urgents. Les questions de sécurité et de défense sont bien moins importantes sur la liste.
« Indépendance », « Autodétermination », « Sécession » ?
Les options politiques futures du Groenland peuvent être résumées comme suit :
– Indépendance totale
– Indépendance au sein d'un Commonwealth calqué sur le Commonwealth britannique avec des États égaux.
– Libre association, où le Groenland est indépendant mais a des accords avec d'autres pays dans des domaines politiques sélectionnés (par exemple, la sécurité et la défense).
La veille du Nouvel An, Múte Egede, le président du gouvernement autonome du Groenland, a prononcé son discours du Nouvel An, dans lequel il a notamment déclaré, dans la traduction danoise de Naalakkersuisut [le gouvernement autonome] :
«
Il est temps pour nous de faire un pas nous-mêmes et de façonner notre avenir, également en ce qui concerne les personnes avec lesquelles nous devrions coopérer étroitement et aussi celles qui devraient être nos partenaires commerciaux. Car notre coopération avec d'autres pays et nos relations commerciales ne peuvent pas continuer à se faire uniquement par l'intermédiaire du Danemark.
Ces dernières années, Inatsisartut [le parlement du Groenland] et Naalakkersuisutont travaillé ensemble pour prendre des mesures afin de rédiger notre constitution, qui est la base de notre sécession d'avec le Danemark.
»
Le mot « sécession » n'apparaît qu'une seule fois, tandis que le mot « indépendance » apparaît quatre fois. Une grande partie de la confusion sur ce qu'ils veulent réellement est probablement due à des traductions imprécises du groenlandais au danois. Pour le parti Naleraq et Pele Broberg, cependant, le langage est clair : l'indépendance signifie un détachement complet du Danemark. Pour IA – le parti frère de SF et EL, actuellement le plus grand parti du Groenland et qui forme avec Siumut la coalition gouvernementale actuelle et Siumut, l'« indépendance » signifie probablement quelque chose comme une construction politique dans le voisinage des deux dernières options.
Et il est judicieux que le Groenland profite de la crise créée par les déclarations de Trump pour obtenir de meilleures conditions selon ses propres termes. Il doit être difficile pour le gouvernement groenlandais d'attendre constamment que des pressions extérieures tirent le gouvernement danois vers l'auge.
Le royaume danois est-il uni ?
Au cours du débat du Parlement danois sur l'introduction de l'interprétation simultanée, il s'est passé quelque chose d'étrange que peut-être peu de gens ont remarqué. Mette Frederiksen a infligé à Inger Støjberg un violent remaniement qui, à première vue, semblait disproportionné car le remaniement portait notamment sur l'importance du Groenland pour l'OTAN et sur la politique de défense et de sécurité du Danemark. Mais ce que Mette Frederiksen a fait, c'est envoyer à Nuuk les premiers signaux indiquant qu'ils étaient – enfin – prêts à discuter de l'organisation et de la fonction du royaume danois.
Elle avait flairé quelque temps auparavant que la relation avec le Groenland était essentiellement une question de sécurité.
Après tout, le Groenland fait partie de l'étrange entité connue sous le nom de « royaume danois ». On pense que ce terme est apparu pour la première fois dans la thèse de doctorat « Rigsfællesskabet » de l'avocat Frederik Harhoff en 1993 (Frederik Harhoff, Rigsfællesskabet, Klim 1993).
Superficiellement, le mot donne l'impression que les participants sont égaux, quelque chose comme le Commonwealth britannique. Mais ce n'est pas le cas. Le royaume danois est une construction informelle qui n'est décrite dans aucune loi, qui n'a donc aucune signification juridique et qui, en tant que telle, n'est pas une coopération entre des entités politiques égales. Le Groenland et les îles Féroé font partie du royaume danois et sont soumis à la Constitution danoise. Cependant, le Parlement danois a délégué des responsabilités aux gouvernements autonomes des deux pays. Par conséquent, la loi de 2009 sur l'autonomie du Groenland stipule également que « la décision sur l'indépendance du Groenland est prise par le peuple groenlandais ». Le gouvernement groenlandais doit ensuite entamer des négociations avec le gouvernement danois, après quoi un accord doit être approuvé par un référendum au Groenland et enfin par le Parlement danois. Cette situation est similaire à la soi-disant « union » entre l'Angleterre et l'Écosse, où le parlement de Westminster a également le dernier mot, indépendamment de ce que le peuple écossais pourrait décider lors d'un référendum.
Sans minimiser les liens étroits qui existent entre les habitants du Groenland et du Danemark – environ 17 000 Groenlandais vivent au Danemark et 6 à 7 000 Danois au Groenland – le Groenland joue un rôle pour le Danemark avant tout dans ses relations avec les États-Unis, où, comme le dit le premier ministre, il ne devrait pas y avoir plus qu'une feuille de papier A4 entre les deux pays. Quelque chose qui cadre bien avec le fait que si Mette F a qualifié d'« absurde » le désir de Trump d'acheter le Groenland la dernière fois, cette fois-ci, le Premier ministre est resté silencieux. Jusqu'au jour où, alors que le fils de Trump effectuait un voyage éclair à Nuuk et que le premier ministre avait annulé au pied levé une visite à Copenhague, elle a pris la parole pour dire que « toute discussion [sur l'avenir du Groenland] doit commencer à Nuuk » et pas ailleurs, que le Danemark était une ancienne puissance coloniale qui avait commis des erreurs assez grossières en cours de route, que le désir d'indépendance du Groenland était légitime, mais aussi que les États-Unis étaient l'allié le plus important du Danemark.
Le petit État du Danemark a pu jusqu'à présent jouer la « carte du Groenland », précisément parce que dans la structure non légalisée actuelle, il n'est pas question de pays égaux. Même si le terme « communauté » est censé impliquer l'égalité. En réalité, le royaume danois est une invention danoise dont le but réel est de maintenir pour le Danemark une importance que sa taille ne justifie pas vraiment – si le Groenland était retiré du Danemark, la superficie du royaume diminuerait de 98%.
Le Danemark en tant que petit État
La dissolution du Danemark-Norvège en un seul royaume après les guerres napoléoniennes en 1814, puis la dissolution de l'État tout entier après la guerre perdue contre la Prusse et l'Autriche en 1864, ont réduit le Danemark à un petit État. Sa survie en tant qu'État indépendant dépendait d'un équilibre entre une bonne relation avec son voisin le plus proche, l'Allemagne, et la protection d'une autre grande puissance ou d'une alliance d'États.
Après la Seconde Guerre mondiale, le Danemark a dû réorganiser ses relations d'alliance. Une alliance de défense nordique a d'abord été tentée, mais les différences entre les intérêts de la Norvège et de la Suède étaient trop importantes, et finalement, le gouvernement social-démocrate, influencé par le coup d'État communiste de Prague en 1948, a accepté de rejoindre le Pacte atlantique – plus tard l'OTAN, dont la puissance dominante était les États-Unis. Les États-Unis étaient désormais le principal garant de la sécurité du Danemark dans le monde occidental, un rôle qu'ils ont conservé depuis, malgré quelques accrocs sur la route, comme la critique de la guerre américaine au Vietnam et la politique de la note de bas de page. C'est dans ce contexte qu'il faut voir le long silence puis les déclarations très prudentes de Mette Frederiksen, dont le but principal est de ne pas irriter le président américain Trump.
L'alliance avec les États-Unis a été construite à tel point que les déclarations de Trump sur le Groenland ont fait l'effet d'une véritable « bombe au ministère d'État » (Hans Engell dans le P1Genstartde DR, 15 janvier). Dans le même temps, la crise a montré au Danemark et aux Danois que le Danemark est en fait un petit État – malgré les tentatives des premiers ministres successifs de s'affirmer et de manger des cerises avec les grands en se joignant, par exemple, presque automatiquement aux aventures américaines en Afghanistan et en Irak. Mais quand on mange des cerises avec les grands, on se retrouve souvent avec des cailloux dans la tête.
Le fait qu'il ne faut rien avoir à dire aux États-Unis ressort de la manière très prudente dont le gouvernement s'exprime, même s'il est désormais clair que la conversation de 45 minutes de Mette Frederiksen avec Trump a été extrêmement franche, du moins de la part de ce dernier.
Et bien que plusieurs dirigeants de l'UE aient pris leurs distances avec les déclarations de Trump, il n'y a pas eu de réaction unifiée, ce qui aurait pu être bienvenu par ailleurs. Car les autres pays européens de l'OTAN n'auraient pas dû conclure quoi que ce soit non plus.
La réaction du Danemark est apparemment de travailler à huis clos pour ne pas contrarier l'homme de Washington. Mais cela ne peut qu'exercer une forte influence sur la politique du gouvernement lorsque la personne en qui vous aviez le plus confiance vous attaque soudainement. Une réponse possible pourrait être de mettre en attente le prochain accord de base bilatéral avec les États-Unis pour le moment.
Une nouvelle communauté
Dès 2018, l'un des meilleurs diplomates du service extérieur, Taksøe-Jensen, a suggéré de dissoudre le royaume danois dans son livre « Hvis Grønland river sig løs – en rejse i kongerigets sprækker ». Et un autre diplomate de haut rang, Zilmer-Johns, a fait une remarque similaire un peu plus tard. Lorsqu'il a pris sa retraite, il s'est exprimé et a déclaré àWeekendavisenen avril 2023 qu'au lieu de rafistoler le royaume danois, dont aucune des parties n'est satisfaite, le Danemark devrait entamer une discussion sur – ce à quoi une autre communauté pourrait ressembler.
Zilmer-Johns avait remarqué que parmi les politiciens groenlandais et féroïens, il y avait un manque fondamental de confiance dans le fait que le Danemark sauvegarderait pleinement les intérêts des deux autres royaumes. Enfin, Zilmer-Johns déclare :
« C'est aussi pour cela que je pose la question : Devrions-nous plutôt créer une communauté moderne où nous ne sommes pas préoccupés par ce que nous ne voulons pas ensemble, mais où nous nous concentrons sur ce que nous voulons ensemble ? Je suis sûr qu'il y aura un fort intérêt dans les trois parties du royaume, également dans le domaine de la défense et de la sécurité. »
Alors que le parti Naleraq souhaite une sécession complète, le parti IA au pouvoir estime que l'indépendance qu'ils souhaitent relève du domaine danois, sous peine d'être avalés par les États-Unis. L'une des figures clés de la politique groenlandaise, Aqqaluk Lynge – cofondateur du parti IA et dirigeant de longue date de la Conférence circumpolaire inuit (CCI) – a décrit le royaume danois dans une interview à P1 Morgen comme quelque chose qui a donné au Groenland la prospérité, la sécurité et la sûreté. Par conséquent, l'idée que se fait l'IA de l'avenir du Groenland n'est pas celle d'un État, mais d'une communauté d'égaux avec les autres parties du royaume. Auparavant, Aja Chemnitz (IA), qui est l'un des deux députés groenlandais, avait déclaré : « IA pense que nous ne pouvons plus attendre que le Groenland ait sa propre politique étrangère, de sécurité et de défense. Le Groenland doit avoir un droit de veto sur les affaires étrangères et la sécurité de notre pays. » « Rien sur nous, sans nous ».
Enfin, Aqqaluk Lynge déclare sans ambages dans un article d'opinion sur Altinget de 2023 que
« … il [est] assez peu probable que les grandes puissances reconnaissent une nouvelle formation étatique dans l'Arctique.Par conséquent, nous ne nous approcherons pas d'un Groenland indépendant reconnu par la communauté internationale dans un avenir proche. »
Et il réitère sa position dans un article surKNR :
« Nous n'avons notre liberté qu'au sein du royaume danois, il faut en tenir compte. Nous avons fait de gros efforts pour l'obtenir au sein du Commonwealth, et cela peut changer très rapidement, comme le menace Trump ».
Naturellement, les États-Unis tenteront de contourner Copenhague s'ils estiment qu'il est dans leur intérêt de le faire. Au cours de la première administration Trump, les États-Unis ont rouvert le consulat à Nuuk, ce qui a provoqué une telle nervosité au sein du département d'État qu'ils se sont empressés d'envoyer un représentant à Nuuk pour un séjour permanent. Dans la nouvelle ère Trump, nous assisterons probablement à d'autres contacts, prêts, accords de coopération, etc. visant à rapprocher le Groenland des États-Unis. Parallèlement, l'UE redoublera également d'efforts – Ursula von der Leyen et Múte Egede ont ouvert un bureau de l'UE à Nuuk peu avant Noël. Le nouvel aéroport de Nuuk, qui peut accueillir des vols long-courriers, est un autre élément du relâchement des liens entre le Groenland et le Danemark et une porte d'entrée vers une plus grande influence américaine.
Quel que soit l'avenir politique choisi par le Groenland – et les îles Féroé – il est temps que le Danemark prenne le taureau par les cornes et se rende compte que le temps est compté pour l'actuel royaume danois, nettoie les derniers vestiges du paternalisme danois et entame des négociations sérieuses avec le Groenland et les îles Féroé sur le type de communauté que les deux pays souhaitent. Sans une diligence raisonnable, le danger est que la prédiction diplomatique de Zilmer-John : « Si nous ne le faisons pas, nous courons le risque que cela déraille », devienne réalité, et cela ne profite qu'aux États-Unis.
Lynge exprime l'opinion de nombreux Groenlandais lorsqu'il déclare dans une interview vidéoà Berlingske le 21 janvier.
« Nous ne supporterons pas que les gens de MAGA courent ici en jouant au fandango ».
Donc merci à Trump, mais non merci.
Niels Frølich
Membre de l'équipe éditoriale de Critical Review En savoir plus
https://solidaritet.dk/tak-trump/
Communiqué par ML
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Grève générale en Serbie

De nombreux acteurs sociaux ont appelé à une grève générale le vendredi 24 janvier (appelée officiellement par les étudiant·es et lycéen·enes) qui a été marquée par des rassemblements de masse, qui se sont poursuivis samedi et dimanche, portant le nombre de manifestations à plus de 150. Au moins 22 000 personnes ont manifesté à Novi Sad, 15 000 à Niš dimanche, 6 000 à Kragujevac. Pour la ville de Belgrade, on estime qu'environ 35 000 personnes se sont rassemblées près du bâtiment du gouvernement, tandis que 20 000 autres personnes se sont rassemblées au rond-point près de la municipalité. Belgrade compte 1,3 million d'habitant·es et la Serbie 6,60 millions.
Tiré d'Europe solidaire sans frontière.
Les manifestations, qui ont débuté en novembre et réclament que les autorités rendent des comptes et que justice soit rendue pour l'effondrement de l'auvent de la gare de Novi Sad, le 1er novembre dernier, qui a fait 15 victimes. Cette contestation est devenue le plus grand défi auquel les autorités ont été confrontées depuis que le Parti progressiste serbe a pris le pouvoir en 2012. Le président Aleksandar Vucic a appelé à « punir sévèrement » les responsables de la tragédie qui s'est produite dans la gare, mais rien n'a été fait.
Mais pour beaucoup les dirigeants corrompus, par l'intermédiaire desquels des proches de fonctionnaires ont passé les commandes de construction de cet auvent, sont les symboles d'un régime qu'ils et elles ne supportent plus. Ils et elles demandent également que Vucic lui-même soit tenu pour responsable.
Les étudiant·es sont mobilisé·es en permanence depuis novembre 2024. Ils et elles expliquaient en décembre dernier « Nous avons suspendu nos études, organisé des assemblées générales et voté des revendications, créé des groupes de travail. Nous avons occupé les locaux des facultés et les avons adaptés à notre vie quotidienne. Nous avons installé des cuisines, des dortoirs, des pharmacies, des ateliers, des cinémas et des salles de classe qui dispensent des cours pendant la grève. En trois semaines, presque tous les bâtiments universitaires de Serbie sont devenus des centres d'auto-organisation politique 24 heures sur 24. Nous recevons le soutien de nos concitoye·nes, dont les dons nous permettent de vivre. Chaque jour, d'autres groupes vulnérables de la société se joignent à notre lutte... Nous mettons en pratique le principe de la démocratie directe. Lors de ces réunions, tout le monde a une voix égale et le droit de décider de toutes les questions ».
De son côté, le syndicat indépendant des éducateur·trice, de nombreuses écoles et personnes employées dans l'éducation se sont opposé·es à la décision des syndicats « représentatifs » de poursuivre les négociations avec le ministère de l'Éducation. Des troupes de théâtre de Belgrade, ainsi que le Théâtre national serbe de Novi Sad, puis le Théâtre national de Sombor, ont annulé leurs représentations et ont lu une déclaration de protestation contre la tentative d'assassinat d'une étudiante en référence à la voiture qui a foncé le 16 janvier sur un rassemblement étudiant.
Plus tôt le 15 janvier, le syndicat TENT a décidé de se mettre en grève et demande « la satisfaction des revendications des étudiant·es, la détermination des responsabilités dans la situation catastrophique de l'industrie électrique - mais aussi la destitution du directeur général de l'EPS AD, de l'ensemble du directoire, du conseil de surveillance, de l'Assemblée de EPS, et le Ministre des Mines et de l'Énergie. » Trois jours plus tard entre 53 000 et 55 000 personnes ont participé à une manifestation devant la Télévision Rodio de Serbie (RTS), sous le mot d'ordre « Notre droit à tout savoir » ce qui constituait selon un quotidien serbe l'un des plus grands rassemblements de l'histoire de la Serbie. À la suite du mouvement étudiant, d'autres secteurs de la société serbe se mettent en mouvement qui vient de culminer avec ce week-end de grève générale.
A la suite de ces manifestations, le premier ministre serbe, Milos Vucevic a démissionné le 25 janvier. « Afin d'éviter de ne pas augmenter davantage les tensions dans la société, j'ai pris cette décision », a-t-il déclaré. Une première victoire du mouvement des étudiants.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« Submersion migratoire » : Bayrou reprend la rhétorique du RN et prépare une offensive anti-immigrés

Lundi soir sur LCI et mardi à l'Assemblée, François Bayrou s'est fait le porte-parole du programme raciste du RN en évoquant un risque de « submersion migratoire ». Le PS a donc été obligé d'agiter la censure. Toute forme de stabilité offerte à ce gouvernement se paiera par une offensive raciste
28 janvie4 2025 | tiré de Révolution permanente
https://www.revolutionpermanente.fr/Submersion-migratoire-Bayrou-reprend-la-rhetorique-du-RN-et-prepare-une-offensive-anti-immigres
Macron avait déjà repris et popularisé des poncifs racistes de l'extrême droite : « ensauvagement », « décivilisation ». Son bras-droit, Gérald Darmanin alors ministre de l'Intérieur avait en 2020 déploré l'« ensauvagement de la société ». Le Premier Ministre François Bayrou, soutien de la première heure du Président, s'essaye désormais à la théorie conspirationniste et suprémaciste du « grand remplacement » en évoquant lundi soir sur LCI une « submersion migratoire » à Mayotte et en France. À l'Assemblée ce mardi, le chef du gouvernement a persisté en précisant qu'il parlait de submersion migratoire à Mayotte, où les Comoriens sont traités en étrangers sur leur archipel, avant d'ajouter « et ce n'est pas le seul endroit en France ». Un discours réitéré qui ne laisse pas le doute quant à la volonté d'assumer cette rhétorique empruntée à l'extrême-droite, que Jean Marie Le Pen avait popularisé en 1989 : « Nous sommes menacés par une vague, une submersion », affirmait-il.
Ces déclarations de Bayrou ont cependant reçu des réponses contradictoires. D'un côté, un secteur de la macronie avait déjà préparé le terrain. Lundi, Le Figaro publie une interview de Maud Bregeon, députée macroniste et ancienne porte-parole du gouvernement Barnier, dans laquelle celle-ci plaide pour remettre sur la table les mesures les plus dures de la loi Immigration. Mardi sur France Info, la députée de la Marne, Laure Miller, a soutenu les propos de Bayrou : « Si vous discutez avec n'importe qui dans la rue, vous verrez qu'il y a ce sentiment de submersion migratoire ». Mais il a également causé quelques remous chez les députés macronistes, du moins sur la forme. « Je n'aurais jamais tenu ces propos et ils me gênent » a ainsi affirmé Yaël Braun-Pivet qui n'a pourtant pas hésité à voter il y a un an la Loi Immigration. « Ce n'était pas le meilleur mot à utiliser », concède un ministre aux journal Les Echos. Bruno Retailleau (Intérieur) et Gérald Darmanin (Justice) se sont sans surprise félicités qu'ils reprennent leurs rhétoriques racistes.
Une offensive qui ouvre une crise avec le PS
Le Parti Socialiste, qui a jusque-là très bien plié pour refuser de censurer le gouvernement Bayrou-Retailleau, a été obligé de réagir à des propos d'un racisme aussi décomplexé, mais qui affleuraient déjà dans la déclaration de politique générale de Bayrou : « L'installation d'une famille étrangère dans un village pyrénéen ou cévenol, c'est un mouvement de générosité qui se déploie […]. Mais que trente familles s'installent et le village se sent menacé. » Les dirigeants du Parti Socialiste ont donc claqué la porte des négociations en cours visant à trouver un accord en vue de la CMP ce jeudi autour du budget 2025.
Désormais, le Parti Socialiste veut faire monter les enchères et parle plus volontiers de censure.Cette sortie aura des « conséquences déflagratoires » a réagi le député PS Laurent Baumel. La menace est plus prégnante encore au sein de de l'entourage d'Olivier Faure : « Le secrétaire général du PS, Pierre Jouvet, la sénatrice socialiste Corinne Narassiguin, son collègue député Arthur Delaporte, ou encore l'eurodéputée Chloé Ridel… Désormais, les menaces des cadres socialistes sont à prendre au pied de la lettre », pointe L'Opinion. Mais si rien n'est gravé dans le marbre, comme l'ont illustré le cirque autour des menaces de censure lors du discours de politique générale, il reste que la tension est remontée d'un cran suite aux propos de Bayrou.
Un accord précaire : la crise politique de retour au premier plan
Cette crise ouverte avec le PS illustre la très relative stabilité de l'accord obtenue par Bayrou. Un coup à « gauche » sur la question du budget et le « conclave » sur les retraites, un coup à droite pour contenter l'aile droite de son gouvernement, Retailleau et les LR. Une stratégie à très haut risque qui vise à tenter d'élargir son socle et de résoudre la quadrature du cercle d'une Assemblée structurellement divisée et instable.
Or cette fois, en voulant consolider son bloc sur la droite et tester le RN qui reste une clé pour une non-censure avec un PS polarisé, Bayrou risque de ruiner le tour de dressage qu'il avait réussi avec les socialistes et se met à la portée d'une censure du RN, comme Barnier. Et l'extrême droite est gourmande et n'a pas tardé à réagir. « Ce que l'on attend de lui, ce sont des actes qui suivent les constats et pour l'instant on a beaucoup de constats et très peu d'actes », a réagi Marine Le Pen au Palais-Bourbon. Pour l'heure, pas d'accord ni avec le PS ni avec le RN.
Une offensive qui présage de l'offensive autoritaire et raciste à venir
Mais la précipitation des macronistes à passer à l'après-budget témoigne de leurs ambitions racistes et sécuritaires. Sentiment d'insécurité, sentiment de « submersion » disent-ils, alors que Retailleau, Darmanin et les médias capitalistes saturent l'espace de discussions plus écœurantes les unes que les autres : violence de mineurs, guerre contre la drogue, restriction de droits délirants pour les prisonniers…
En menant une campagne permanente contre les réfugiés avec ou sans titres de séjour, comme avec la circulaire Retailleau qui veut rendre quasi-impossible la régularisation, les capitalistes préparent des offensives racistes contre toutes les personnes d'origine étrangère. Le « sentiment de submersion » de Bayrou s'arrête au prénom, à la couleur de peau ou à la manière de s'habiller ou de manger, il ne regarde pas la situation administrative.
Dans le monde entier, les partis de l'extrême centre néolibéral, se convertissent ouvertement aux thèses de l'extrême droite. En Allemagne, la démocratie-chrétienne (CDU) est prête à voter avec l'AfD, un parti nostalgique du nazisme, pour déporter des étrangers. En temps de crise, la démocratie capitaliste montre son vrai visage : raciste, policière et profondément anti-ouvrière.
Dans ces conditions, maintenir la « stabilité » d'un tel régime comme s'y engage le Parti Socialiste ou les directions syndicales en trouvant des accords avec le gouvernement pour ne pas le censurer, ou en participant au dialogue social, c'est permettre à ce gouvernement de mener des attaques racistes violentes qui vont s'abattre contre la population d'origine immigrée.
Toutes les oppositions en parole des directions syndicales à la loi immigration de 2024 ne valent rien si celles-ci s'acharnent à sauver le gouvernement qui ne rêve que de pourrir toujours plus la vie des travailleurs immigrés. La lutte contre l'extrême droite, si elle est sincère, doit passer par une lutte décidée contre ce gouvernement, son budget austéritaire et ses lois racistes !
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Le malaise andalou. Une approche de la question nationale andalouse
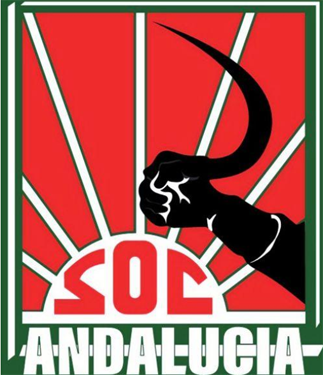
Nous avons voulu compléter notre dossier sur la question nationale par une contribution sur les nations qu'on associe généralement au « régionalisme », dont l'Andalousie est un exemple.
18 janvier 2025 | tiré du site inprecor.fr | Illustration : Le syndicat des ouvriers agricoles, Sinidicato Obrero del Campo, aujourd'hui SAT, a joué un rôle très important dans les mobilisations paysannes depuis la fin des années 1970.
Malaise. État de malaise physique ou spirituel. [Ou particulièrement, sentiment indéfini de ne pas être bien physiquement.]
Dictionnaire de María Moliner. Le sud, un jour, se lèvera
Une nation se lèvera
Fatiguée et blessée
République d'Andalousie
Tino Tovar, pasodoble de comparsa du Carnaval de Cadix « Tic Tac », année 2018.
Le présent texte se veut une approche de la question nationale andalouse en essayant d'analyser comment elle opère dans le panorama politique actuel et comment elle constitue un fait fondamental pour la libération sociale en Andalousie, quelle relation elle entretient avec la construction de l'État espagnol pour conclure par une proposition sur la façon dont nous devrions y faire face dans le but d'avancer vers une révolution écosocialiste en Andalousie et à partir de l'Andalousie.
Le malaise andalou
En Andalousie, nous avons un malaise : l'étrange sensation de vivre dans une crise permanente. Il ne s'agit pas d'une exagération, mais d'un malaise collectif face au rôle social et économique qui nous incombe. En d'autres termes, et pour faire simple, tout le monde en Andalousie sent, d'une manière ou d'une autre, que nous sommes plus pauvres que le reste de l'Espagne. Que nous pourrions être obligés de partir pour avoir un avenir, que l'on se moque de notre façon de parler ou que les choses sont plus difficiles ici.
Les facteurs sont multiples et les visions différentes, certaines contradictoires et d'autres complémentaires. Il ne s'agit pas d'un problème temporaire, ni d'un phénomène imputable aux derniers gouvernements ou aux crises économiques de la dernière décennie. Le malaise andalou est vieux de plusieurs siècles et s'inscrit dans l'identité de notre peuple. L'Andalousie ne peut être comprise sans le malaise andalou.
Mais comme je l'ai dit, le malaise andalou n'est pas seulement un sentiment, c'est un fait matériel. Ce malaise a une base réelle. Regardons quelques données.
En 2024, le nombre de personnes en risque de pauvreté en Andalousie est le plus élevé d'Espagne 1, le taux AROPE qui mesure le pourcentage de personnes en risque de pauvreté (idem) ou d'exclusion sociale est également le plus élevé d'Espagne (idem) et le nombre de personnes ayant des difficultés à joindre les deux bouts est supérieur de 7 points à la moyenne nationale (idem).
Le taux de chômage est beaucoup plus élevé que la moyenne de l'État, les salaires sont nettement inférieurs à la moyenne de l'État, six des dix municipalités aux revenus les plus faibles de l'État sont andalouses et même l'espérance de vie est plus faible.
C'est donc un fait qu'il existe en Andalousie une situation spécifique d'appauvrissement et d'inégalité dont souffrent directement les classes populaires et que l'Andalousie a joué un rôle de périphérie politique, sociale, économique et culturelle au sein de l'État espagnol.
La question est maintenant de savoir comment ce malaise andalou fonctionne politiquement, quelle est sa signification, comment il est canalisé et à qui il profite.
Les mauvaises réponses
Au cours des dernières décennies, différentes réponses politiques au malaise séculaire de l'Andalousie et à la situation spécifique d'oppression vécue par les classes populaires andalouses sont apparues.
À l'heure actuelle, nous pouvons distinguer trois catégories principales de réponses au malaise andalou, qui sont terriblement erronées et qui nous mènent dans des voies sans issue, comme je le décrirai ci-dessous.
Le premier de ces groupes pourrait être appelé le chauvinisme identitaire. Il s'agit de la tendance à placer la culture et l'identité au centre de la question andalouse comme une cause et non comme une conséquence de l'évolution matérielle et historique de notre peuple. Dans ce type de réponse, la cause de notre oppression est notre culture et notre façon d'être.
Cette réponse se décline en deux versions. L'une, profondément réactionnaire et classiste, affirme plus ou moins explicitement que la responsabilité de la situation socio-économique de l'Andalousie réside dans les prétendues caractéristiques culturelles des classes populaires andalouses. L'autre version, prétendument plus progressiste, est une forme d'autosatisfaction de la situation de l'Andalousie –se rattachant au mythe de l'Andalousie exotique ou orientale si typique du 19e siècle –, nie le malaise andalou et présente l'Andalousie comme un paradis de vertus où il fait bon vivre, précisément en raison de notre culture et de notre identité.
Ces deux visions du chauvinisme identitaire sont profondément ancrées dans la population andalouse et dans le reste de l'Espagne et nous conduisent à la même impasse et à la même paralysie.
Sur la scène politique andalouse, ces éléments ont été particulièrement utilisés dans leur version la plus prétendument progressiste par des positions politiques qui suggèrent une sorte de régionalisme andalou interclassiste qui présente la libération andalouse comme une conséquence directe d'un développement culturel et identitaire particulier, en ignorant la question des classes, de la libération sociale et de la construction même du régime espagnol, comme je l'expliquerai plus loin.
Un deuxième groupe de réponses erronées au malaise andalou est ce que nous pourrions appeler l'anti-catalanisme. Cette idée est profondément ancrée dans la société andalouse et c'est l'élément le plus utilisé par l'État espagnol pour canaliser l'agitation andalouse.
Ces réponses sont basées sur l'idée que l'origine de la situation d'oppression économique de l'Andalousie se trouve dans le développement d'autres territoires en Espagne. Elles partent d'un fondement réel – celui des rôles différents joués par les territoires et les nations dans la construction de la notion même d'Espagne et du sacrifice de certains d'entre eux – pour désigner le peuple catalan (ou basque) dans son ensemble comme l'ennemi d'une Espagne dont l'Andalousie serait le fer de lance, la zone la plus lésée par toute revendication nationale de l'une ou l'autre des nations sans État.
Mais l'idée qui sous-tend cette réponse erronée est un fort interclassisme. La conception des nations, des peuples ou des territoires comme un tout univoque et homogène avec des intérêts égaux, comme s'ils n'étaient pas liés à la classe sociale. Un territoire prétendument privilégié est présenté dans la construction territoriale de l'État comme s'il s'agissait de son peuple, et non d'une classe sociale qui dirige à la fois ici et dans l'État, et qui est responsable du rôle joué par l'Andalousie.
Le plus curieux est que l'État qui « répartit » n'est pas pointé du doigt. Cette théorie est toujours dirigée contre la Catalogne (ou Euskadi) mais jamais contre l'État. Pourquoi ? Parce qu'au cœur de cette vision, il n'y a pas une défense de l'Andalousie en soi, mais de l'Andalousie comme fer de lance de l'Espagne, comme la plus espagnole des « Espagnes ».
C'est actuellement l'axe fondamental du discours de la droite et de l'extrême droite en Andalousie, incluant la création d'un nouveau régionalisme andalou conservateur qui tente de redéfinir les symboles, l'histoire et l'identité andalouses.
Nous trouvons un troisième groupe de mauvaises réponses : ce n'est qu'une question de classes sociales. Ses partisans en viennent à proposer une résolution plus simple de la question : la nier. Ils affirment simplement qu'il n'y a pas de problème territorial en ce qui concerne l'Andalousie et que tous les indices socio-économiques de l'Andalousie répondent exclusivement à la question des classes, niant ainsi l'oppression spécifique de l'Andalousie. Tant sur le plan matériel que sur le plan culturel.
Cette réponse a généralement été défendue par la gauche centraliste, à la fois les plus socio-libéraux et ceux historiquement regroupés autour du Parti communiste espagnol, ou maintenant Sumar/Izquierda Unida ou Podemos. Bien qu'ils se réfèrent généralement aux luttes andalouses des années 1970 et 1980, ils y font toujours allusion comme à une lutte du passé, appréhendée avec nostalgie et dans le contexte particulier de la transition espagnole et de sa défense. Elles ne sont jamais évoquées comme un problème actuel ou comme une oppression majeure qui croise la question de la classe ou du patriarcat.
En somme, ils nient l'existence d'un malaise andalou endémique, il n'y a donc pas pour eux de question nationale andalouse mais simplement la question de la classe ouvrière en Espagne.
Cette réponse refuse de comprendre la composition des classes populaires andalouses, leur situation socio-économique et donc leurs expressions culturelles, identitaires, politiques et combatives. C'est un refus de comprendre la situation en Andalousie.
Face à ces trois réponses erronées, il convient de s'interroger sur l'origine et le développement du malaise andalou et sur son maintien.
L'origine du malaise andalou
Il est courant, lorsqu'on parle de l'Andalousie, de dire qu'il s'agit d'une terre « arriérée », de souligner que la clé pour comprendre la situation socio-économique de l'Andalousie est qu'elle est « sous-développée ». Ainsi s'insinue l'idée largement répandue selon laquelle le développement économique est une échelle univoque, à sens unique, dans laquelle l'Andalousie se trouve simplement à quelques échelons du reste de l'État espagnol.
Cette idée, qui est largement utilisée dans l'analyse de nombreuses régions du monde, est très utile pour maintenir le statu quo, ce qui est bénéfique pour les classes dirigeantes qui profitent de la façon dont l'État espagnol a été construit, en termes de classes et de territoire.
Elle leur est très utile pour deux raisons principales : premièrement, parce qu'elle nous place, nous les victimes du malaise andalou, dans une position purement passive, puisque nous ne pouvons qu'attendre que l'évolution naturelle nous fasse gravir l'échelle du développement ; deuxièmement, parce qu'elle ne nous montre qu'une seule voie possible : le développement le long de cette échelle à sens unique, le long de laquelle d'autres territoires ont déjà progressé avant nous.
C'est essentiellement faux. Et ce, pour une raison fondamentale : l'Andalousie n'est pas sous-développée. L'idée que l'origine de la situation de l'Andalousie est qu'elle est arrivée tardivement au développement capitaliste parce que les structures sociales, économiques et politiques d'une période précapitaliste s'y sont prolongées, est fausse.
Comme le soulignent des auteurs tels que Delgado Cabeza, Arenas Posadas et García Jurado, non seulement l'Andalousie n'est pas arrivée tardivement au développement du capitalisme, mais elle a joué un rôle de pionnier dans le développement du capitalisme dans la péninsule ibérique.
La conquête et la colonisation castillane de l'Andalousie entre le 11e et le 15e siècle et la colonisation ultérieure de l'Amérique à partir des côtes andalouses ont jeté les bases de la construction, entre le 15e et le 18e siècle, d'un développement particulier du capitalisme que des auteurs comme García Jurado appellent le « capitalisme seigneurial andalou », dans lequel un processus de prolétarisation précoce de la main-d'œuvre, la privatisation et la clôture des terres et l'importance du marché 2 sont apparues très tôt.
À cela s'ajoutent les institutions politiques issues de la conquête d'Al-Andalus, qui jouent le rôle de garant de la propriété privée des moyens de production, notamment de la terre, et d'une répression brutale au bénéfice des élites.
Très tôt est apparu le « problème de la terre », qui était déjà utilisée comme marchandise, avec des ouvriers sans terre prolétarisés par la spoliation des terres et qui a atteint son apogée au début du 19e siècle avec le désamortissement 3.
À partir du 17e siècle, le chômage est apparu comme un problème structurel et majeur en Andalousie4, où il existait une énorme classe de journaliers totalement dépossédés des moyens de production et obligés de vendre leur force de travail pour survivre.
Ce développement précoce du capitalisme en Andalousie, en lien avec les institutions héritées de la conquête d'Al-Andalus, la formation d'une classe sociale mêlant la seigneurie castillane et le problème de la terre et du commerce avec la colonisation de l'Amérique, ont eu un effet sur tous les aspects de la société andalouse.
C'est précisément ce développement particulier du capitalisme andalou qui façonne les structures sociales, la démographie, la culture, les secteurs économiques et l'identité de l'Andalousie.
Et à son tour, c'est ce qui façonne l'Andalousie en tant que nation. En ce sens, il est intéressant d'observer l'Andalousie à la lumière de ce que Gramsci a écrit sur la question méridionale. Il a compris que l'Italie du Sud fonctionnait, sur le plan politique et économique, comme une « immense campagne, par opposition à l'Italie du Nord, qui fonctionne comme une immense ville » 5. Et c'est précisément ces caractéristiques économiques et politiques et le rôle joué par le Sud qui ont formé et développé une question nationale pour le Sud. Il en va de même en Andalousie, où un fait national s'est constitué sur la base d'éléments matériels, sur un développement particulier du capitalisme qui a façonné toutes les structures sociales et l'identité nationale.
Ainsi, l'État espagnol moderne repose sur deux questions étroitement liées : la classe et le territoire. L'État espagnol, et la notion même d'Espagne, se sont constitués comme un artefact au bénéfice d'une classe sociale qui s'est formée au fur et à mesure que le capitalisme se développait, et qui tirerait profit de ce processus. Et qui, en même temps, il se construisait sur la base d'une distribution territoriale des secteurs économiques, des bénéfices et des politiques, qui généraient directement des territoires sacrifiés. L'Andalousie était l'un de ces territoires.
La clé de cette construction territoriale de l'État espagnol a été et continue d'être l'extractivisme. C'est la relation constituée avec certains territoires, transformés en zones sacrifiée par le biais d'un capitalisme purement extractif.
L'Andalousie sert de lieu d'extraction de matières premières manufacturées dans d'autres lieux, elle sert de zone d'implantation pour les industries les plus polluantes, de décharges dangereuses ou de stockage de déchets nucléaires (le seul cimetière nucléaire de l'État se trouve en Andalousie). Nous sommes également un territoire d'où l'on extrait une main-d'œuvre bon marché grâce à l'émigration de millions de personnes ou dans lequel on place certains secteurs productifs qui génèrent peu de valeur ajoutée, ont un impact environnemental énorme et répartissent très mal la richesse, comme le tourisme ou la construction. Le même processus peut être observé dans l'extraction de revenus par le biais du logement, le territoire étant le plus touristique d'Europe, ou au niveau culturel avec l'appropriation de la culture andalouse en tant que culture espagnole, avec l'exemple flagrant du flamenco.
Par conséquent, l'Andalousie n'est pas arrivée tardivement au capitalisme, et elle n'est pas non plus en retard. L'Andalousie joue un rôle pionnier et fondamental dans le capitalisme espagnol, elle joue un rôle de périphérie en expropriation permanente. L'Andalousie a été et est sacrifiée quotidiennement au profit de la classe sociale qui dirige l'État. Pour reprendre l'idée de Manuel Delgado Cabeza, l'Andalousie n'est pas arriérée, mais elle est l'arrière-cour du développement des autres.
Comme nous l'avons souligné, les bénéficiaires du rôle de l'Andalousie ne sont pas les classes populaires du nord de l'État, de la Catalogne, du Pays basque ou de Madrid. Les bénéficiaires de tout ce processus de construction territoriale de l'État espagnol sont l'oligarchie et les élites qui profitent de cette expropriation permanente de la richesse. Les élites andalouses aussi, ne l'oublions pas.
C'est pourquoi, en Andalousie, le malaise andalou a une explication qui rend inséparables la question nationale et la question sociale. On ne peut comprendre l'une sans l'autre, car la configuration nationale même de l'Andalousie repose sur les intérêts de la classe privilégiée. En d'autres termes, l'intérêt des classes laborieuses andalouses passe par une transformation, subversive, du rôle de zone sacrifiée que l'État espagnol a donné à l'Andalousie, c'est-à-dire qu'il passe aussi par la libération nationale de l'Andalousie.
Ainsi, nous bannissons du chemin de la libération de l'Andalousie toute hypothèse qui indiquerait la nécessité d'une approche interclassiste de la question andalouse ou d'une alliance avec les élites andalouses ou l'oligarchie andalouse.
Il n'est pas possible, même avec une vision étapiste telle que proposée par certains courants nationalistes à d'autres moments de l'histoire, de promouvoir une sorte de « révolution nationale » en alliance avec une bourgeoisie progressiste, car celle-ci a pleinement intérêt au maintien du statu quo, puisque la situation d'oppression en Andalousie correspond pleinement à ses intérêts matériels.
Une souveraineté andalouse pour construire l'écosocialisme
Par conséquent, une fois que nous avons vu l'origine du malaise andalou et comment l'État espagnol a été configuré sur l'imbrication des privilèges de classe et de l'inégalité territoriale, dont les classes ouvrières andalouses sont les perdantes, il ne nous reste qu'une seule réponse.
Une réponse qui aurait pour objectifs simultanés la libération sociale de la classe ouvrière et le dépassement du rôle de périphérie extractive dont souffre l'Andalousie. De plus, elle incorporerait de manière intersectionnelle la lutte contre l'oppression hétéropatriarcale subie par les femmes et les personnes LGTBIQ+, l'antiracisme, tout cela dans le cadre de la crise écologique d'une planète aux ressources limitées.
C'est là que le concept de souveraineté entre en jeu. Pour l'expliquer, je cite Nancy Fraser lorsqu'elle explique que la clé est de savoir comment et qui décide de l'utilisation de ce qui reste une fois qu'on a reproduit la vie et reconstitué ce qui a été dépensé. Fraser souligne que « la manière dont une société utilise ses capacités excédentaires est centrale : elle soulève des questions fondamentales sur la manière dont les gens veulent vivre – où ils choisissent d'investir leurs énergies collectives, comment ils entendent équilibrer le “travail productif” avec la vie de famille, les loisirs et d'autres activités – ainsi que sur la manière dont ils aspirent à se comporter avec la nature non humaine et sur ce qu'ils entendent léguer aux générations futures. Les sociétés capitalistes ont tendance à laisser ces décisions aux “forces du marché” » 6.
C'est précisément en Andalousie que nous subissons une double usurpation de la capacité à décider, de la souveraineté, sur tout ce qui est important dans la société. D'une part, en subissant un modèle économique, le capitalisme, qui accorde cette souveraineté aux « forces du marché » ; et d'autre part, en subissant un type de capitalisme, extractif et périphérique, qui nous place dans une situation de dépendance totale et d'infériorité. En tant qu'hommes et femmes de la classe ouvrière et de l'Andalousie, la subalternité est double.
Carlos Arenas Posadas a dit (et j'ai lu Oscar García Jurado) que « les peuples pauvres sont ceux qui n'ont pas la liberté de gérer leurs ressources, ceux qui n'ont pas les moyens de développer pleinement leur potentiel ».
Par conséquent, l'idée de souveraineté que nous devons défendre est précisément cela. La capacité des sujets politiques à décider démocratiquement comment, quoi, combien et quand produire, comment distribuer démocratiquement, comment utiliser notre temps, nos corps et comment nous relier les uns aux autres, aux autres sujets politiques, aux animaux non humains et à la planète.
Celles et ceux qui souffrent de ces oppressions croisées entre classe, nation andalouse, hétéropatriarcat et race sont les classes populaires andalouses et, à ce titre, sont constitué·es en tant que sujet politique pour lequel nous revendiquons la souveraineté.
La seule réponse utile pour les classes populaires andalouses est donc cette idée de souveraineté comme projet politique qui mise sur la capacité à décider de nos vies dans le but de renverser l'oppression de classe et le rôle de périphérie extractive, c'est-à-dire l'oppression nationale, que nous subissons en Andalousie.
Une telle souveraineté impliquerait de décider de notre propre voie, qui ne consiste pas à continuer à gravir l'échelle du développement capitaliste. Il ne s'agit pas de promouvoir un développement avec les mêmes valeurs et paramètres que ceux suivis par d'autres territoires, mais plutôt de le renverser.
De promouvoir un développement endogène écosocialiste, en partageant les richesses, selon les clés indiquées par l'économie écoféministe et en affrontant la crise climatique et énergétique de manière équitable, dans une relation saine avec la planète.
Seule cette proposition, qui comprend que l'oppression de classe en Andalousie ne peut être envisagée qu'en recoupant le fait national andalou et la construction territoriale de l'État espagnol qui condamne l'Andalousie à l'extractivisme, a le potentiel de comprendre l'identité même du peuple andalou.
Le peuple andalou a été façonné par des processus historiques et par le développement économique et social. C'est précisément ce processus qui a généré ses caractéristiques, ses éléments culturels, ses institutions sociales, ses expressions de toutes sortes, ses traditions et son identité. Tout ce processus constitue un fait complexe, contradictoire et différencié, avec ses propres expressions et une réalité différenciée.
La seule façon d'essayer de l'organiser et d'avancer vers une rupture avec le capitalisme pour façonner une Andalousie écosocialiste sera de comprendre ce fait national et de formuler une proposition pour résoudre ses contradictions : la souveraineté andalouse pour l'écosocialisme.
Si, par contre, la gauche de transformation sociale continue à ne pas comprendre la question nationale andalouse, il sera impossible non seulement que l'Andalousie cesse de souffrir des douleurs, silencieuses et séculaires, qui provoquent ce malaise andalou, mais il ne sera jamais possible non plus de se connecter réellement avec le seul peuple capable de surmonter ce malaise : la classe ouvrière andalouse.
Il ne sera jamais possible de transformer un peuple qui ne se comprend pas. En tant que révolutionnaires, notre obligation est de faire la révolution écosocialiste dans le lieu et le moment historique où nous vivons. Notre lieu s'appelle l'Andalousie.
Le 16 décembre 2024
Notes
1. « L'état de la pauvreté en 2024 ». Réseau européen de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale en Espagne.
2. Approximación al capitalismo andaluz, Oscar García Jurado.
3. Le désamortissement ou désamortisation (desamortización en espagnol) est un processus économique entamé en Espagne à la fin du 18e siècle par Manuel Godoy et qui s'est prolongé jusqu'au 20e siècle, consistant à mettre aux enchères publiques des terres et des biens improductifs détenus dans l'immense majorité des cas l'Église catholique ou les ordres religieux, qui les avaient accumulés par le biais de nombreux legs ou donations, ainsi que des propriétés foncières appartenant à la noblesse.
4. Oscar García Jurado, idem.
5. Gramsci, Antonio. « Rapport sur le troisième congrès du parti communiste italien », publié dans l'Unitá, 24 février 1926. Dans « La question méridionale », Antonio Gramsci.
6. Nancy Fraser, Le capitalisme est un cannibalisme, 2025.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Autriche : Un gouvernement d’extrême droite en vue

Le chancelier conservateur Karl Nehammer, qui s'était engagé lors des élections législatives autrichiennes du 29 septembre à ne pas être le marchepied de Kickl pour la chancellerie, vient de démissionner de ses postes de chancelier et de chef de parti le 4 janvier en lui laissant la voie libre.
19 janvier 2025 | tiré du site de la gauche anticapitaliste
https://www.gaucheanticapitaliste.org/autriche-un-gouvernement-dextreme-droite-en-vue/
En septembre, le Parti autrichien de la liberté (FPÖ), d'extrême droite, dirigé par Herbert Kickl, devenait le premier parti avec 28,85 %, juste devant le Parti populaire autrichien (ÖVP), conservateur de droite, avec 26,27 %. Les sociaux-démocrates, 21,1 %, avaient exclu d'emblée toute coalition avec le FPÖ à un niveau national. Les conservateurs ont pu choisir s'ils préféraient gouverner avec Kickl ou avec les sociaux-démocrates.
Les négociations avec les sociaux-démocrates et les libéraux de « Neos » en vue d'une coalition gouvernementale ont été interrompues par « Neos » et les conservateurs. Les deux n'étaient pas du tout disposés à négocier ne serait-ce qu'une participation des riches et des super-riches à l'assainissement nécessaire du budget (réintroduction d'un impôt sur les successions ou sur la fortune), tant la pression exercée par le capital était forte. Les sociaux-démocrates avaient également proposé des alternatives telles qu'une taxe sur les banques — tout a été balayé d'un revers de main.
Depuis, les conservateurs se sont déclarés prêts à former un gouvernement avec l'extrême droite. Kickl a fait du lobbying avec succès en promettant de mettre en œuvre le programme économique des conservateurs s'il pouvait en échange occuper la chancellerie et des ministères importants.
Une politique contre la classe ouvrière
Le FPÖ et l'ÖVP savent que la mise en œuvre du programme économique de l'ÖVP entraînera un changement d'humeur de la population.
Il est prévu de détruire, ou du moins d'affaiblir considérablement, le système de santé ; de s'attaquer aux travailleurEs du secteur public (gel des salaires des enseignantEs et des infirmières…) et aux retraitéEs (gel des pensions et relèvement de l'âge légal de départ à la retraite) ; de mettre en place une « réforme du marché du travail », c'est-à-dire de réduire les prestations et de durcir les conditions d'emploi ; d'augmenter les impôts de masse.
En raison des procédures en cours contre des représentants de premier plan de l'ÖVP et du FPÖ, les deux partis voient d'un bon œil l'affaiblissement des contrôles démocratiques et de l'État de droit. Ils prévoient aussi de s'attaquer à l'indépendance de la télévision et de la radio publiques et d'exercer une influence massive sur la presse papier.
L'affaiblissement de la « chambre des travailleurs » (Arbeiterkammer ou AK, dont l'origine remonte à la révolution de 1918-1919), voire sa destruction par la réduction ou la suppression des cotisations à cette chambre, est un autre point de départ. Il en va de même pour l'indépendance de la justice (suspension des procédures, empêchement des enquêtes et de l'ouverture de nouvelles procédures), de la Cour des comptes, de l'Institut de statistique publique d'Autriche ou encore de l'administration publique.
Racisme et réaction au cœur du programme
En renforçant encore les mesures xénophobes et anti-minorités, le mécontentement doit être détourné vers des boucs émissaires présumés (réfugiéEs, migrantEs, chômeurEs, bénéficiaires de l'aide sociale, LGBTIQ+ ou encore artistes critiques envers la société). En outre, le FPÖ et l'ÖVP soutiennent tout ce qui alimente la crise climatique et prônent l'abandon des objectifs climatiques.
De larges alliances pour la défense des droits démocratiques et sociaux et contre l'« orbanisation » sont désormais une nécessité. Leur succès dépendra de l'engagement total de la social-démocratie et des syndicats (les organisations à gauche de la social-démocratie ne jouent qu'un rôle très limité en Autriche). C'est un très grand défi compte tenu des décennies paralysantes du partenariat social, durant lesquelles les temps de grève moyens se mesuraient en minutes, voire en secondes par personne et par an !
Parallèlement, nous devons développer un programme de gauche offensif et démystifier non seulement le populisme de droite du FPÖ, mais aussi l'idéologie néolibérale des « Neos ».
Article initialement publié sur l'Anticapitaliste, le 16 janvier 2025
Crédit Photo : DR
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

La russification forcée des enfants ukrainiens

Ce dossier se place dans la continuité d'une précédente enquête qui a servi de base à une communication envoyée en décembre 2022 au bureau du procureur de la Cour pénale interna- tionale (CPI). Celle-ci a contribué au dépôt, en mars 2023, de mandats d'arrêt contre Poutine et sa commissaire aux droits de l'enfant Maria Lvova-Belova. Ce nouveau volet de notre en- quête révèle que Russie-Unie (R-U, voir enca- dré Russie-Unie), le parti politique de Poutine, a contribué à planifier, coordonner et exécu- ter la déportation, la russification et l'adoption des enfants ukrainiens. L'enquête souligne la dimension génocidaire de cette entreprise qui vise à incorporer les enfants ukrainiens à la na- tion russe. L'intention génocidaire se traduit dans les propos des membres de Russie-Unie qui répètent que l'Ukraine n'existe pas, que les terres et le peuple ukrainiens sont russes, et qui témoignent d'une volonté fanatique de russifier les enfants ukrainiens. La nouvelle communica- tion appelle donc la CPI à étendre ses mandats à d'autres hauts responsables et à requalifier ces crimes afin d'accroître la pression judiciaire sur le pouvoir russe.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Trois ans de guerre en Ukraine : manifestons les 23 et 24 février

Le Comité français du Réseau européen de solidarité avec l'Ukraine (RESU), en ce début d'année 2025, appelle à participer massivement aux manifestations, actions, débats publics et autres initiatives qui seront organisés par les défenseurs·euses du peuple ukrainien à l'occasion du 3e anniversaire de l'invasion généralisée déclenchée par Poutine le 24 février 2022, et notamment à la manifestation prévue à Paris le dimanche 23 février.
7 janvier 2025 | tiré d'inprecor.fr
https://inprecor.fr/node/4526
Les actions menées autour de cette date auront une importance particulière en raison de l'avènement de Donald Trump à la présidence américaine, et des diverses pressions diplomatiques et économiques qui vont s'ajouter à l'agression meurtrière des armées russes et nord-coréennes et à l'occupation, pour imposer à l'Ukraine l'acceptation de celle-ci. La majorité des forces d'extrême droite en Europe pèsent en ce sens.
Nous rejetons les pressions menées au nom de « la paix » alors qu'elles ne contestent pas l'occupation, la russification des régions occupées, les déportations de populations et notamment d'enfants, et alors que pour l'impérialisme russe, l'Ukraine ne doit pas exister. Cette « paix »-là, c'est la légitimation d'annexions et c'est la poursuite de la guerre et de l'oppression.
Le Comité français du RESU réaffirme qu'il n'y aura pas de paix sans la justice que revendique la résistance populaire ukrainienne, armée et non armée. C'est pourquoi nous œuvrons à sa victoire pour une paix durable parce que juste contre les armés d'invasion de l'impérialisme russe. Et c'est aussi pourquoi nous nous insérons dans la solidarité internationaliste avec les luttes des mouvements sociaux, syndicaux, féministes et démocratiques en Ukraine.
Le Comité français du RESU soutient parallèlement la résistance antiguerre en Russie et au Bélarus.
Le Comité français du RESU appelle les gouvernements et États européens à fournir les moyens militaires et la protection aérienne que l'Ukraine demande – et aussi à annuler sa dette extérieure.
Le Comité français du RESU continuera de porter, dans la gauche et les mouvements sociaux français et dans les actions de solidarité avec l'Ukraine, la voix des Ukrainiennes et des Ukrainiens qui luttent à la fois contre le démantèlement des services publics, de la santé et de l'éducation, et contre l'invasion et l'occupation. En effet les politiques néolibérales du pouvoir portent atteinte aux droits des travailleuses et des travailleurs, à la résistance et à la lutte contre l'invasion russe.
Publié le 5 janvier 2024 par le RESU
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Géorgie : soulèvement pour la démocratie dans le Caucase – Le peuple géorgien face au gouvernement

Ashley Smith, de Tempest, et Ilya Budraitskis, de Posle Media, ont interrogé les activistes et universitaires géorgiens Ia Eradze, Luka Nakhutsrishvili et Lela Rekhviashvili sur les racines du soulèvement, sa trajectoire et la place de la Géorgie dans le capitalisme mondial et l'ordre impérialiste.
17 janvier 2025 | tiré du site inprecor.fr
La Géorgie, petite nation caucasienne de 3,8 millions d'habitant·es, est entrée dans une crise profonde. Son peuple s'est soulevé contre le parti au pouvoir, le Rêve géorgien, à la suite de l'adoption de sa « loi sur l'influence étrangère » d'inspiration russe, de sa loi homophobe sur la propagande anti-LGBTQ, du truquage des récentes élections et de la suspension des négociations d'adhésion à l'UE.
C'est le milliardaire Bidzina Ivanishvili qui tire les ficelles du Rêve géorgien. Il est l'oligarque le plus riche du pays et possède une fortune de 6,4 milliards de dollars, ce qui représente presque le budget total du gouvernement et un cinquième du PIB du pays. Lui et son parti, malgré leurs accrochages avec l'Occident et leur inclinaison vers la Russie, collaborent avec toutes les puissances impérialistes et les multinationales pour piller et exploiter le peuple, les richesses et les ressources du pays.
Excédé par cet autoritarisme et cette exploitation, le peuple géorgien est entré dans une phase de protestation massive contre son gouvernement, en faveur de la démocratie et de l'égalité. Le Rêve géorgien a réagi avec la plus grande brutalité, en réprimant les manifestations et en arrêtant les protestataires. Mais le mouvement ne montre aucun signe de recul et, à l'heure où nous publions, les manifestations de masse se poursuivent, pour le vingt-quatrième jour consécutif. Le pays est sur le fil du rasoir.
Ashley Smith, de Tempest , et Ilya Budraitskis , de Posle Media, se sont entretenus avec des militants et des universitaires géorgiens, Ia Eradze, Luka Nakhutsrishvili et Lela Rekhviashvili, à propos des racines du soulèvement, de sa trajectoire et de la place de la Géorgie dans le capitalisme mondial et dans l'ordre impérialiste.
Ilya Budraitskis Ashley Smith : Le peuple géorgien s'est soulevé, dans le cadre d'un nouveau mouvement de protestation de masse, contre le gouvernement. Les racines de ce mouvement sont, en partie, une réaction aux résultats des récentes élections qui ont ramené le Rêve géorgien au pouvoir. Quels étaient les thèmes de la campagne électorale ?Qui étaient les partis d'opposition et quels étaient leurs programmes ? La population s'est-elle montrée satisfaite de ces propositions ? Quels ont été les résultats officiels ? Les élections ont-elles été truquées ?
Luka Nakhutsrishvili : Nous sommes au cœur d'un soulèvement démocratique de masse contre le gouvernement du Rêve géorgien. Des centaines de milliers de personnes manifestent pacifiquement sur la place principale de Tbilissi et dans les villes et villages du pays. Au cours des deux dernières semaines, des marches de protestation ont été organisées à travers tout Tbilissi, en permanence. Des groupes professionnels et de quartiers de plus en plus nombreux ont commencé à s'auto-organiser. C'est un phénomène sans précédent dans notre histoire récente.
L'origine immédiate des protestations est la profonde crise de légitimité provoquée par le parti au pouvoir, qui suit le modèle adopté par Viktor Orban en Hongrie pour transformer son gouvernement en un régime autoritaire. Mais le Rêve géorgien est allé plus loin que la démocratie illibérale à la Orban en truquant les élections et en réprimant les manifestant.e.s d'une manière qui rappelle davantage le Belarus et la Russie. La suspension des négociations d'adhésion avec l'Union européenne n'a été que la dernière goutte d'eau.
Au cours des deux dernières années, le Rêve géorgien a pris un virage d'extrême droite spectaculaire. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2012, il se disait social-démocrate et était intégré au groupe socialiste du Parlement européen. Alors que beaucoup craignaient qu'il ne penche vers la Russie, il est resté favorable à l'intégration de l'UE et à l'adhésion à l'OTAN.
Mais depuis l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, il a fait volte-face en optant pour l'euroscepticisme, en se ralliant au nationalisme de droite, en prônant une politique réactionnaire vis-à-vis des questions de genre, en faisant entrer les théories conspirationnistes dans le débat politique et en exprimant ouvertement sa sympathie à l'égard de la Russie.
Le Rêve géorgien a fait campagne sur la base d'un discours de peur, en arborant le slogan « choisissez la paix, pas la guerre », accompagné d'images montrant d'un côté une Géorgie florissante et de l'autre une Ukraine détruite. Le message était clair : si vous votez pour l'opposition, la Géorgie finira par être envahie et occupée par la Russie.
En ce qui concerne le socle du Rêve géorgien, s'il a perdu beaucoup d'électeurs favorables à l'intégration dans l'UE, il a gagné le soutien des électeurs nationalistes d'extrême droite qui approuvent leur loi anti-LGBT, s'opposent au projet supposé de Washington d'entraîner la Géorgie dans une guerre mondiale et expriment leur hostilité à l'égard des bureaucrates de l'UE qui, selon eux, violent la souveraineté de la Géorgie. Le reste de leurs électeurs les a soutenus par peur de la guerre, cyniquement exploitée par le Rêve géorgien.
Lors des élections, les quatre principaux partis d'opposition se sont regroupés en coalitions pour s'opposer à Rêve géorgien. Ce sont des partis issus des milieux technocratiques, la plupart d'entre eux étant rattachés au gouvernement précédent, et ils se sont révélés incapables de répondre aux préoccupations de la grande majorité des électeurs. La plupart ne les aiment pas et ont voté pour eux de manière tactique pour battre Rêve Georgien ou au moins les empêcher d'obtenir une majorité absolue et de gouverner seuls.
IB & AS : En fin de compte, le Rêve géorgien a obtenu la majorité malgré des accusations largement répandues selon lesquelles il aurait truqué les résultats. Est-ce vrai ?
LN : Oui. Les sondages indiquaient qu'il resterait le parti le plus important mais qu'il n'aurait pas assez de voix pour former un gouvernement seul (comme le parti d'extrême droite de Kaczynski après les élections de l'année dernière en Pologne). Personne n'avait prévu qu'il gagnerait avec 54 % des voix. Pour parvenir à ce résultat, il a eu recours à toutes les combines que l'autoritarisme permet d'imaginer, en convertissant en outil au service de son pouvoir la précarité des conditions de vie de la majeure partie de la population, dont il avait préalablement tout fait pour qu'elle perdure.
Le parti a organisé ce que nous appelons un « carrousel de vote » pour que ses partisans puissent voter à plusieurs endroits et obtenir ainsi des résultats plus élevés. Rêve géorgien a également fait pression sur les gens pour qu'ils votent pour lui en menaçant de leur couper l'accès à notre système minimal de protection sociale, y compris les soins médicaux. Ils ont intimidé les travailleurs du secteur public, comme les enseignants, avec la menace de leur faire perdre leur emploi.
Les forces de sécurité ont dit à des personnes dont des proches étaient en prison que si elles ne votaient pas Rêve géorgien, elles ne bénéficieraient pas d'un procès équitable. Elles ont confisqué les cartes d'identité de ceux dont elles savaient qu'ils soutenaient les partis d'opposition afin de les empêcher de voter.
Ils ont entravé le vote des centaines de milliers d'émigré.e.s. Pourquoi ? Parce que ces personnes avaient quitté le pays en raison de leur exaspération à l'égard des responsables politiques et de la pauvreté, et qu'elles sont plus enclines à voter pour l'opposition.
Rêve géorgien a ensuite invalidé la plainte déposée par le président pour que les élections soient déclarées inconstitutionnelles en raison de violations massives des lois électorales. Ils n'ont même pas attendu la décision du tribunal qu'ils contrôlent pour convoquer le parlement, ce qui est clairement contraire à la Constitution. Le Rêve géorgien a donc tout fait pour amplifier la crise de légitimité provoquée par la façon dont il a ouvertement et gravement truqué les élections.
IB & AS : L'élément déclencheur du soulèvement est la décision de Rêve géorgien de suspendre le processus d'adhésion à l'Union européenne. Pourquoi a-t-il pris cette décision, d'autant plus qu'une majorité de Géorgien.ne.s est favorable à l'intégration ?
Ia Eradze : Rêve géorgien a probablement suspendu les négociations d'adhésion parce que la fraude électorale n'a suscité que peu de protestations. Il ne veut pas non plus accepter les conditions de l'UE en matière de réformes démocratiques, qui menaceraient son maintien au pouvoir. Enfin, la Russie a sans doute exercé des pressions en coulisses.
La suspension des pourparlers a transformé la situation et réveillé les personnes qui, comme moi, étaient sous le choc des résultats de l'élection. Je me suis senti paralysé pendant environ deux semaines. Je ne pouvais rien faire. Il y a bien eu des manifestations après les élections, organisées par les partis d'opposition, mais elles n'ont pas été très suivies.
La faible participation était le fruit d'une paralysie collective. Il a fallu des semaines pour que les gens comprennent l'énormité du trucage qui a permis à Rêve géorgien de remporter une telle victoire. La colère a commencé à s'accumuler sous la surface. L'annonce par Rêve géorgien de la suspension des négociations d'adhésion, qui viole notre Constitution, a fait sauter le bouchon de cette colère accumulée qui a jailli dans tout le pays.
À bien des égards, cette annonce a été une chance. Je craignais vraiment qu'ils ne fassent semblant de participer aux négociations de l'UE, en simulant des accords, tout en instaurant un régime autoritaire. Cela aurait été bien pire. Heureusement pour nous, ils sont allés trop loin et nous nous trouvons maintenant au beau milieu d'un mouvement de masse contre le gouvernement.
La plupart des gens ne protestent pas seulement à cause de la question de l'adhésion à l'UE. Nous sommes dans la rue pour empêcher un gouvernement autoritaire de continuer à fouler aux pieds notre Constitution, nos droits et nos conditions de vie. Nous manifestons pour défendre notre démocratie contre la transformation par le Rêve géorgien de toutes les institutions de l'État, des écoles aux tribunaux, en outils au service de ses intérêts et de ceux des oligarques qui le contrôlent.
Le gouvernement a réagi à notre soulèvement avec une brutalité extrême. Il a commencé à faire des descentes chez les gens pour trouver les personnes qui, selon lui, préparent une révolution. Ils ont arrêté certains dirigeants de l'opposition. Le régime devient chaque jour plus autocratique. Près de 500 personnes ont été arrêtées et la plupart d'entre elles ont été passées à tabac ; certaines ont été torturées ( le représentant du ministère public lui-même a jugé que le traitement de nombreuses personnes détenues relevait de la torture). Ces derniers jours, nous avons vu des personnes être enlevées dans la rue par la police. Parmi les prisonniers, il y a des professeurs, des étudiant.e.s et des lycéen.e.e ;s, des artistes et des médecins.
IB & AS : À quoi ressemblent les manifestations ? Quels sont les groupes et les catégories de personnes concernés et pour quelles raisons l'adhésion à l'UE est-elle importante pour eux ? S'agit-il des mêmes que ceux qui ont protesté contre la loi spéciale ? Quelles sont les principales revendications des manifestants ?
Ia E : Elles sont énormes. Un fort pourcentage des 3,8 millions d'habitant.e.s du pays se sont joint.e.s aux manifestations. À Tbilissi, qui compte environ un million d'habitant.e.s, chaque jour, tout au long de la journée et de la nuit, au moins 100 000 personnes manifestent et, certains jours, plus de 150 000.
Ces manifestations sont bien plus importantes que celles qui ont eu lieu au printemps contre la loi sur les agents de l'étranger, et elles n'ont pas lieu qu'à Tbilissi. Elles se produisent dans tout le pays, pas uniquement dans les grands centres mais aussi dans les petites villes de la campagne.
Elles sont bien plus diverses que les manifestations du printemps. Des personnes de tous âges ont rejoint le mouvement. Les jeunes sont présents en force, mais aussi tous les autres. Il y a diverses catégories de personnes, depuis les professions libérales jusqu'aux ouvriers, qui y participent. C'est vraiment beau à voir.
Tout le monde se rend compte du danger qui nous guette. Je fais moi-même partie d'une association qui organise des actions pour la défense de l'éducation. D'innombrables autres groupes dans différents secteurs de la société font de même. Rien de tout cela n'est très coordonné. C'est comme si des flux d'initiatives organisées séparément convergeaient pour former des manifestations massives.
Lorsque je me réveille le matin, je regarde le programme des manifestations pour savoir à laquelle je souhaiterais participer. Un jour, je me suis retrouvée à quatre manifestations différentes. Si elles sont si nombreuses, c'est parce qu'elles sont toutes auto-organisées.
C'est une réalité qui va à l'encontre de ce qu'en disent les médias gouvernementaux qui tentent de présenter la contestation comme une conspiration, un « Maïdan » fomenté par des puissances étrangères et leurs agents locaux. Ce n'est absolument pas le cas. Elle est spontanée et décentralisée. S'il y avait une planification aussi centralisée, vous iriez aux rassemblements et vous verriez une tribune avec des prises de parole organisées. Il n'en est rien. En fait, sur la place principale de Tbilissi où se déroulent les manifestations, il n'y a pas d'estrade, il n'y a pas de discours et les partis d'opposition ne dirigent pas les manifestations.
Il n'y a même pas de slogans scandés au cours de la journée. La plupart des manifestations consistent simplement en une contestation silencieuse du gouvernement. Cependant, l'énergie qui s'en dégage est étonnante. Mais le mouvement trouve progressivement sa voix collective ; il a déjà formulé deux exigences fondamentales : de nouvelles élections et la libération immédiate de tous les protestataires et activistes emprisonnés.
LN : Au vu du degré de décentralisation de ce mouvement de protestation, il est intéressant de se pencher sur son mode d'expression. Les manifestant.e.s tirent des feux d'artifice pour le Nouvel An et réalisent des spectacles laser sur le bâtiment du Parlement, devenu le symbole de tout ce qui ne va pas dans ce pays. Ils organisent des concerts et tapent sur les barrières métalliques que les forces de sécurité installent pour contenir les manifestations et les empêcher d'accéder au Parlement.
Plus tard dans la nuit, les manifestations se transforment en affrontements de rue entre « partisans » et forces spéciales. Preuve de sa peur et de son choix de la répression, le gouvernement a interdit les feux d'artifice, les lasers et les masques de protection du visage.
Ia E : Je tiens à souligner qu'au milieu de cette spontanéité, les gens commencent à s'organiser en petites initiatives qui se rejoignent dans les manifestations. Aussi décentralisée soit-elle, la planification existe, les objectifs sont déterminés et un mouvement est en train de s'organiser.
Par exemple, les manifestations ont ciblé une série d'institutions publiques pour dénoncer leurs calomnies à l'encontre du mouvement ou leur indifférence face à la brutalité du régime. Parmi ces institutions, citons le Service public de radiodiffusion, le Théâtre national le Ministère de l'éducation, la Maison des écrivains, le Centre national du cinéma, le Palais de justice et le Centre national pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement.
Dans certains cas, des fonctionnaires ont rejoint les manifestants à l'extérieur, et ce fut très émouvant de voir cela. Les fonctionnaires ont également commencé à signer des pétitions et à organiser des défilés, en dépit des pressions exercées par un gouvernement qui cherche à effacer la frontière entre la loyauté vis-à-vis d'un parti et les institutions de l'État.
Les partis d'opposition ne jouent pratiquement aucun rôle dans le mouvement. Ils ont été mis à l'écart, malgré ce qu'en disent les médias occidentaux. Les gens disent en plaisantant que ces partis devraient au moins faire quelque chose comme de proposer du thé chaud lors des manifestations.
LN : Les médias de l'opposition surreprésentent leur présence pour des raisons évidentes. Ils veulent améliorer leur image. Il en va de même pour la propagande du Rêve géorgien dans les médias, qui cherche à faire croire que ces manifestations sont organisées par l'« opposition radicale ». Mais lorsqu'on se trouve sur les lieux des manifestations, on s'aperçoit que cette dernière ne représente qu'une force négligeable et qu'elle ne fait pas grand-chose.
Certains de ces responsables politiques sont tellement conscients de leur rôle insignifiant qu'ils refusent désormais d'être interrogés lors des manifestations. Par conséquent, les personnes qui répondent aux questions sont des jeunes, dont beaucoup portent des masques à gaz, et ce qu'ils disent a beaucoup plus de sens que tout ce qu'on peut entendre de la part des politiciens.
IB & AS : Ces manifestations semblent très similaires à la révolte de Maidan en Ukraine.Celui-ci a débuté parmi les étudiant.e.s, puis, face à la répression brutale, le mouvement s'est rapidement étendu au reste de la société, se transformant en un soulèvement de masse très actif qui a fait chuter le gouvernement. Avec les divisions au sein du gouvernement, les démissions et le personnel politique de l'opposition qui a rejoint les manifestations, pensez-vous que le soulèvement géorgien pourrait suivre la même trajectoire ?
Ia E : Il est désormais inimaginable que cette crise puisse être résolue de manière institutionnelle, pacifique et légale. Notre pays est le théâtre d'une confrontation à grande échelle entre le peuple et le gouvernement...
LN : L'escalade est évidente. Le gouvernement est entré dans une logique de surveillance, de descentes de police et de répression brutale. Mais cela n'a dissuadé personne de descendre dans la rue. Le mouvement exige maintenant, non pas de nouvelles élections, mais le départ du gouvernement lui-même, et ce dès maintenant. Le sentiment général est que c'est nous ou eux. Le mouvement a atteint un point de bascule et nous verrons s'il s'intensifie au point de remettre en question la capacité du Rêve géorgien à gouverner.
En ce qui concerne les similitudes avec le Maïdan ukrainien, paradoxalement, c'est le Rêve géorgien qui reprend le scénario du Maïdan, qu'il s'agisse d'annuler les négociations avec l'UE comme l'avait fait Ianoukovitch, d'interdire les masques ou de mobiliser les voyous dans les rues. Ils semblent incapables de comprendre que le soulèvement actuel n'est rien d'autre qu'une tentative de « Maïdanisation » de la Géorgie par ses ennemis internes et externes. Cette obsession de Maïdan pourrait être l'une des raisons pour lesquelles le gouvernement a lamentablement échoué à comprendre - et à réprimer - ces protestations.
Lela Rekhviashvili : Le Rêve géorgien a également usé et abusé de l'insurrection de Maïdan pour effrayer les gens et les dissuader de protester. Ils ont dit que si l'on défie l'État de cette manière, la Russie interviendra et nous nous retrouverons envahis, occupés et en guerre comme l'Ukraine. Ils ont fait cela tout au long de la campagne électorale.
Mais le Rêve géorgien, dans son arrogance et peut-être sa bêtise, a suscité précisément cette opposition de masse qu'il avait présentée comme la pire des choses possibles. Leur autoritarisme est la principale cause de cette énorme vague de manifestations. Nous sommes maintenant sur le fil du rasoir, entre un gouvernement de plus en plus autocratique et un mouvement de masse qui ne montre aucun signe de recul.
IB & AS : Le scénario que vous décrivez ressemble à celui de nombreux autres soulèvements dans le monde, dans lesquels le fonctionnement normal d'un gouvernement ne permet pas de résoudre une crise. Souvent, dans de telles situations, la population met en place des mécanismes de substitution au gouvernement, des assemblées populaires, qui peuvent constituer un substitut à l'État. Y a-t-il des éléments indiquant que tous ces mouvements d'auto-organisation que vous décrivez se rassemblent pour former des niveaux plus élevés d'unité et de prise de décision démocratique ?
LN : Pas encore. Pour l'instant, les gens se mobilisent et trouvent de nouveaux moyens de résister aux gaz lacrymogènes, d'échapper à la répression et d'éviter les rafles et les arrestations auxquelles se livrent les autorités.
Ia E : Les gens commencent à s'organiser. Différents groupes et mouvements convergent vers des projets communs. Le meilleur exemple en est la façon dont de nombreuses forces se sont rassemblées pour protester contre le traitement partial de cette question par la chaîne de télévision publique et exiger qu'elle retransmette en direct la manifestations et qu'elle interroge des participant.e.s, ce qui a finalement contraint la chaîne à céder. Il y a des exemples, mais les gens ne se sont pas encore réunis en assemblées populaires pour discuter du mouvement et planifier collectivement des initiatives.
LN : Même ceux d'entre nous qui analysent et écrivent commencent à peine à y voir clair dans ce qui s'est passé au cours du mois dernier. Tout cela nous a pris par surprise. Comme le mécontentement suscité par les élections truquées n'a pas pu déboucher sur une protestation durable, nous avions commencé à nous préparer à une résistance lente organisée au sein de communautés plus restreintes. Mais voilà que les manifestations ont éclaté et se sont transformées en un véritable mouvement de lutte contre le gouvernement.
IB & AS : La Géorgie semble coincée entre plusieurs grandes puissances impériales - les États-Unis, l'Union européenne, la Russie et la Chine - en raison de son rôle de point de transit pour le commerce mondial. Expliquez-nous le rôle de la Géorgie dans le capitalisme mondial. Est-ce que la suspension de l'adhésion à l'UE qu'imposerait le Rêve géorgien changerait sa position dans le capitalisme mondial ? Serait-t-elle alors davantage intégrée au capitalisme russe ?
LR : La Géorgie est un pays périphérique typique, dans lequel les puissances impériales ont, sous couvert de développement, favorisé la constitution d'un système économique prédateur. L'UE et les États-Unis ont largement orienté la politique économique du pays depuis le début des années 1990, concourant ainsi à la naissance de contradictions insoutenables. D'une part, ils veulent que la Géorgie soit démocratique, mais d'autre part, eux et les capitalistes locaux, en particulier l'oligarque le plus puissant, Ivanishvili, veulent piller le pays pour leur profit.
Leur programme de développement est impossible à mettre en œuvre et à appliquer dans le cadre d'une démocratie. Pourquoi ? Parce que le pillage et la paupérisation suscitent une opposition qui remet en cause cette stratégie de développement. Pour juguler cette résistance, il faut recourir à la répression et, ce faisant, basculer dans l'autoritarisme.
Le secteur de l'énergie est un bon exemple de cette contradiction, d'autant plus que l'objectif commun de l'UE et du gouvernement géorgien est de faire de la Géorgie une « plaque tournante de l'énergie » et un maillon d'un corridor énergétique « vert ». Dans les années 1990, mais surtout depuis la Révolution des Roses de 2003, les gouvernements occidentaux, les agences d'aide ( comme l'USAID) et les banques de développement (comme la Banque mondiale et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement) ont joué un rôle majeur dans la création d'institutions publiques destinées à faciliter la privatisation et la déréglementation du secteur de l'énergie.
En 2008, la Géorgie avait privatisé toutes les centrales hydroélectriques héritées de l'ère soviétique à l'exception de deux d'entre elles. Alors que les institutions occidentales appuyaient la privatisation et la création d'une économie dépendante des investissements directs étrangers (IDE), ce sont des capitaux essentiellement russes qui ont racheté les centrales électriques et les installations de distribution d'énergie.
Lorsque les possibilités d'attirer des IDE par le biais de privatisations se sont taries, le gouvernement - toujours en coopération avec des intervenants occidentaux - a commencé à soutenir la construction de nouvelles centrales hydroélectriques dans le cadre du programme de transition écologique de l'Union européenne. En 2024, le gouvernement avait signé des contrats pour 214 nouvelles centrales hydroélectriques dans tout le pays, même si les capacités existantes couvrent presque la demande d'électricité domestique. Pour attirer les capitaux, il a proposé des terrains et des ressources en eau à des prix minimaux et a promis que l'État protégerait les investisseurs contre toute une série de risques financiers, juridiques et politiques.
En raison de la nature extractiviviste des nouveaux projets hydroélectriques, des mouvements populaires à l'échelon local ont réussi à s'opposer à ces projets et parfois à les annuler ou à les entraver, en particulier les grands projets tels que Namakhvani, Nenskra et Khudoni.
Le gouvernement a reçu un nouvel encouragement à relancer tous ces projets de centrales hydroélectriques contestés et à en proposer de nouveaux en 2022, lorsque l'UE a commencé à créer un « corridor d'énergie verte » traversant l'Azerbaïdjan, la Géorgie, la Roumanie et la Hongrie, et qu'elle s'est engagée à financer la pose d'un câble électrique sous-marin traversant la mer Noire. Les institutions européennes, et tout particulièrement la Communauté européenne de l'énergie, ont collaboré à l'élaboration des projets qui ont permis au gouvernement géorgien de présenter les exportations d'électricité comme un élément clé de son programme de développement et de prendre l'engagement que toutes les grandes centrales hydroélectriques précédemment contestées seraient construites.
Au cours des 15 années qui se sont écoulées depuis que cette nouvelle énergie hydroélectrique a été présentée comme un programme de « transition verte » et une panacée pour le développement, une série de capitalistes locaux ont appris de quelle manière il leur était possible de tirer profit de ce programme, certains rattachant de nouvelles centrales à la cryptomonnaie, ce qui a permis de créer un puissant lobby local favorable à la poursuite de l'expansion de ce secteur.
Le Rêve géorgien déclare que les mouvements d'opposition à l'hydroélectricité sont l'un de ses principaux ennemis. Il déclare ouvertement que la consolidation de son pouvoir, au travers notamment de l'adoption de la Loi sur les agents étrangers, est essentielle pour éliminer cette opposition au développement économique de la Géorgie.
C'est ce que je veux dire lorsque j'affirme que le programme de développement que le gouvernement géorgien a élaboré en collaboration avec les puissances occidentales, mais aussi au profit d'autres acteurs, notamment les capitaux russes et chinois (qui ne sont pas présents dans le secteur de l'énergie, mais qui sont importants dans les infrastructures de transport), est difficile, voire impossible, à mettre en œuvre démocratiquement. C'est pourquoi le Rêve géorgien, à l'instar de ses prédécesseurs politiques, évolue vers l'autoritarisme afin de mieux servir les intérêts du capital local et international.
Lorsque nous insistons sur le fait que la rupture du processus d'intégration à l'UE est dangereuse, ce n'est pas parce que nous en méconnaissons les conséquences problématiques ou que nous ignorons comment le populisme de droite ébranle les économies centrales et périphériques de l'Europe, ni comment de nombreux pays européens foulent aux pieds leur adhésion aux droits de l'homme, au droit international, à l'ONU, à la CPI et à la CIJ en poursuivant leur guerre conjointe, leur génocide, en Palestine.
Au contraire, il est parfaitement clair pour nous que la tendance actuelle à la consolidation autoritaire permet de dérouler le même programme de développement économique problématique sous un jour encore plus brutal, en supprimant même toute possibilité de s'y opposer. Cela signifie que nous sommes à la périphérie de l'Europe sans être protégés des pires effets de cette position périphérique par les mécanismes les plus élémentaires de protection des droits sociaux et politiques.
Et maintenant, qu'en est-il de la Russie et de la Chine ? Nous ne pouvons pas vraiment dire grand-chose sur la Russie, car tous les accords qu'elle a conclus l'ont été en coulisses, et non en public. La Russie a-t-elle exercé des pressions sur la Géorgie ? C'est probable, mais nous n'avons pas de précisions sur la nature de ces pressions. Toutefois, nous pouvons clairement observer que les responsables russes se déclarent satisfaits de la désagrégation des relations entre l'UE et la Géorgie.
La Chine est également restée discrète, mais ses intérêts économiques sont clairs. Elle considère la Géorgie comme un pays de transit qui lui permet d'accéder au marché européen. La Géorgie est particulièrement importante depuis que l'invasion impérialiste de l'Ukraine par la Russie a coupé la route nord de la Chine vers l'Europe.
L'un des itinéraires de substitution, appelé corridor médian des Nouvelles routes de la soie (Belt and Road Initiative, BRI), qui passe par la Géorgie, est devenu beaucoup plus important. La dernière chose que la Chine souhaite, c'est toute forme d'instabilité qui perturberait ses échanges commerciaux. Elle se désintéresse de la question de l'adhésion comme de l'autoritarisme, du moment que la route reste ouverte.
LN : La façon dont Lela présente le Rêve géorgien est bien meilleure que celle des campistes, qui laissent entendre qu'il s'agit d'une sorte de parti anti-impérialiste. La réalité, cependant, est beaucoup plus banale : La Géorgie est un régime oligarchique, dans lequel Ivanichvili s'assure de la loyauté de l'élite en accordant des avantages aux hommes d'affaires et aux responsables politiques moins fortunés, tandis que toutes les institutions publiques significatives, en particulier le système judiciaire, sont mises sous tutelle pour protéger leurs intérêts. Il existe donc une dynamique interne autonome qui reproduit le système oligarchique en Géorgie. Elle n'est en aucun cas réductible à une simple interaction avec le capital mondial ou occidental.
Les campistes ne le comprennent pas et finissent par excuser tout ce que fait le Rêve géorgien, depuis l'adoption de la Loi sur les agents étrangers jusqu'au trucage des élections, en passant par la répression du mouvement actuel. Mais, contrairement à la lecture qu'en font de nombreux campistes, la façon dont Rêve géorgien gère la situation n'est en aucun cas une simple réaction à « l'impérialisme occidental », ce qui justifierait indirectement leurs mesures autoritaires comme étant de l'autodéfense.
Les campistes se contentent de dénoncer l'Europe en raison de son histoire coloniale, de son présent néocolonial et de sa complicité avec le génocide, comme si c'était la fin de l'affaire. Bien que cela soit en grande partie vrai, ils présentent souvent la Chine comme une alternative en dépit de sa nature autocratique et de sa complicité avec notre exploitation et l'oppression dont nous sommes victimes. Ce n'est pas une solution de rechange.
Je pense qu'il est catastrophique pour la gauche d'abandonner ses principes démocratiques et de se faire le chantre du virage autoritaire du Rêve géorgien au nom de la souveraineté. Ce n'est pas seulement une erreur, c'est aussi un désastre politique. Toute personne engagée dans une politique d'émancipation devrait refuser cette approche.
Si la gauche s'y rallie, elle est assurée de rester isolée et sans influence dans le plus grand mouvement de lutte pour la démocratie et l'égalité que nous ayons connu depuis des générations. Elle placera la gauche de l'autre côté des barricades qui se dressent devant ce mouvement.
LR : Cette gauche campiste singe le dévoiement par le gouvernement de concepts tels que la souveraineté et le discours décolonial. Ce faisant, elle s'aligne sur un gouvernement qui sert nos oligarques et le capital international et qui réprime violemment son propre peuple.
Les États autoritaires, de la Russie à la Hongrie en passant par la Chine, se servent cyniquement du terrible bilan de l'Occident en matière d'impérialisme et de colonialisme pour justifier leur propre domination prédatrice. Les partisans de la gauche qui acceptent cela sont dangereusement attirés par une alliance rouge/brune, comme Sara Wagenecht en Allemagne.
IB & AS : Compte tenu de cette situation de plaque tournante, comment toutes ces puissances qui ont des intérêts en Géorgie, pour différentes raisons, ont-elles réagi au soulèvement et à la crise que traverse actuellement la Géorgie, la Chine, la Russie, les Etats-Unis, l'Union européenne ?
LN : A ce stade, seules les puissances occidentales ont condamné la répression et la violence perpétrées par le gouvernement. Elles n'ont pas non plus reconnu les résultats des élections, alors que la Chine, la Turquie, l'Iran et la Russie ont félicité Rêve géorgien pour sa victoire. La Russie a également déclaré que si Rêve géorgien avait besoin d'aide, elle serait prête à envoyer des troupes.
Ia E : Si les gouvernements de l'UE ont condamné la brutalité de Rêve géorgien, ce n'est pas le cas des banques de développement occidentales. Pourquoi ? Parce que le Rêve géorgien montre qu'il a bien l'intention de continuer à rembourser ses emprunts et à mener à bien les projets de développement auxquels il a souscrit. Il semblerait que les banques fassent passer leurs intérêts économiques avant la démocratie. En même temps, il est clair que le Rêve géorgien et les élites économiques qui le soutiennent ont énormément profité des projets de développement financés par ces banques. Cela me permet de souligner, une fois de plus, que la trajectoire de développement économique suivie par la Géorgie n'a été ni imposée au gouvernement par l'Occident, ni inévitable, mais qu'il s'agit plutôt du choix conscient et plutôt lucratif du gouvernement du Rêve géorgien d'accepter les règles du système de développement dominant à l'échelle mondiale.
LN : Dans le pire des cas, l'UE cessera d'exercer une pression réglementaire et politique sur la Géorgie en faveur de la démocratisation et continuera à faire des affaires avec elle, même avec ce gouvernement lamentable, comme elle le fait avec l'Azerbaïdjan, la Serbie et d'autres pays d'Europe centrale et d'Asie centrale. La Serbie pourrait être un cas particulièrement intéressant en tant que pays qui semble bloqué de façon durable dans sa procédure d'adhésion. Tout en dénonçant l'autoritarisme de la Serbie, l'UE conclut des contrats très impopulaires relatifs à l'extraction du lithium sur son sol.
Les campistes à l'étranger ou nos souverainistes locaux pourraient interpréter cela comme le fait que l'Occident laisse enfin un pays souverain tranquille. Mais en réalité, ce sera un problème pour nous, car l'horizon des normes démocratiques, rattaché au cadre européen, est un outil indispensable pour exercer une pression populaire sur un gouvernement qui, par ailleurs, entend réduire la démocratie à néant. En ce sens, l'UE est, pour les manifestant.e.s, le symbole de la primauté du droit, des droits civiques et de l'égalité.
À ce stade, au niveau des masses, l'aspiration à l'Europe et le discours sur la « défense de l'avenir brillant et européen de la Géorgie » semblent être le seul langage disponible pour exprimer les exigences en matière de démocratie et de justice sociale. La question qui se pose alors est de savoir comment le peuple reformulera ces exigences au cas où l'horizon européen viendrait à s'effondrer. Comment pouvons-nous lutter pour la démocratie politique et l'égalité économique en étant coupés des normes démocratiques et des droits de l'homme établies par l'« Occident collectif » ?
IB & AS : Dans cette situation évolutive, que devraient préconiser, selon vous, la gauche géorgienne, les mouvements sociaux et les syndicats ? Est-il possible de construire une alternative politique à gauche pour défier le Rêve géorgien et les partis d'opposition pro-capitalistes ?
Ia E : C'est très difficile à dire parce que dans le passé, il y a eu des tentatives qui n'ont rien donné. Je suis très optimiste aujourd'hui, car le tournant autoritaire de Rêve géorgien a poussé les gens à une sorte de réveil politique.
Nous devons commencer à discuter de la création d'un parti. Pour l'instant, les gens commencent à parler de l'organisation d'un mouvement sur la base d'une plate-forme qui réunirait certaines des forces auto-organisées afin de présenter des revendications communes. Cela pourrait enclencher un processus.
LN : Dans le même temps, de plus en plus de gens ressentent le besoin de se syndiquer dans des syndicats pour la plupart nouveaux, qui ne seront pas soumis aux intérêts du parti Rêve géorgien. Il s'agit d'une réponse immédiate à deux phénomènes : beaucoup ont découvert que la grève était l'outil pacifique de protestation et de résistance le plus efficace, mais comme, d'un point de vue purement juridique, il n'est pas facile de faire une grève en Géorgie, l'organiser à travers un syndicat apparaît comme le moyen le plus pratique de s'y essayer. Plus important encore, de nombreux fonctionnaires ont commencé à chercher des moyens de se syndiquer en réaction aux récentes modifications très sévères de la législation sur la fonction publique adoptés à la hâte par Rêve géorgien, qui permettront bientôt aux dirigeants des différentes institutions publiques fidèles au parti de licencier plus facilement ou de faire pression sur les fonctionnaires critiques du gouvernement. Tout d'un coup, les grèves et les syndicats, qui auraient été considérés comme des anachronismes « gauchistes » ou « soviétiques » il y a quelques semaines, se retrouvent maintenant au centre de l'attention comme une nécessité organique qui surgit du milieu des protestations.
Notre première tâche est donc de développer la lutte et de la maintenir. La réponse autoritaire du gouvernement à notre mouvement pousse les gens à réfléchir à des stratégies et des tactiques que l'opposition libérale a tenté de discréditer, comme la grève générale pour préserver notre démocratie.
IB & AS : Quelle position la gauche internationale doit-elle adopter dans cette situation ?Et que pouvons-nous faire pour aider la lutte de la Géorgie pour l'autodétermination, la démocratie et l'égalité ?
LR : La gauche internationale est en fait confrontée à la même question que la gauche géorgienne : comment sortir du cadre opaque d'un conflit entre l'UE et la Russie ? La clé est de comprendre et d'expliquer comment les rivalités géopolitiques écrasent les pays périphériques.
Aucune personne qui se réclame de la gauche ne devrait s'attendre à ce que les puissances impériales - les États-Unis, l'UE, la Russie et la Chine - servent nos intérêts. Quelles que soient leurs rivalités, elles ont en commun des visées prédatrices et soutiendront un régime autoritaire pour s'assurer qu'elles pourront les mettre en œuvre. Il est important de noter que la concurrence inter-impérialiste et la lutte pour l'hégémonie créent de nouveaux risques et de nouvelles vulnérabilités pour les États périphériques, qui doivent être pris au sérieux.
Il serait souhaitable que la gauche internationale entre davantage en contact avec les militant.e.s et les activistes géorgien.ne.s. À ce stade, il existe un fort sentiment d'appartenance à la gauche géorgienne. À ce stade, il existe une forte tendance pour une grande partie de la gauche à rechercher des personnes qui confirment son schéma erroné et trompeur selon lequel l'impérialisme occidental est le seul coupable, qui accusent un mouvement populaire de masse d'être sa proie et qui disculpent le régime oligarchique local.
Si la gauche internationale suit l'exemple de ces personnes, elle finira par apporter son soutien à la mainmise du Rêve géorgien sur le capitalisme périphérique. Certains dans la gauche occidentale gagneraient à cesser d'être tellement autocentrés qu'ils limitent leur critique à l'impérialisme occidental exclusivement. Je ne leur demande pas de ne pas critiquer l'Occident, mais de le faire plus sérieusement et de critiquer également les acteurs non occidentaux. C'est la seule façon de maintenir une position cohérente qui s'oppose non seulement à l'Occident mais aussi au capitalisme et à l'impérialisme où qu'ils soient.
LN : Ce que je demande fondamentalement à la gauche internationale, c'est de reconnaître nos préocupations locales, l'autonomie du peuple géorgien dans le choix de ses priorité dans sa lutte pour la démocratie et contre ce régime autoritaire. Arrêtez de ressasser les discours sur un « second Maïdan » et une « révolution de couleur ». Cela peut vous donner un sentiment de rectitude, mais cela vous amène aussi à nous trahir et à excuser le régime qui nous opprime.
Ia E : Je trouve étonnant qu'à gauche, on puisse oublier qu'à la périphérie aussi, il y a des gens et des peuples qui peuvent prendre leurs affaires en main. Cette attitude politique est fondée sur le désespoir. C'est notre capacité d'action collective qui est est au cœur de la solidarité dans notre pays et avec d'autres partout dans le monde. Je vous le demande, soutenez notre lutte contre Rêve géorgien.
Traduit pour ESSF par Pierre Vandevoorde avec l'aide de DeepLpro, Source - Tempest, 1 janvier 2025.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.












