Presse-toi à gauche !
Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Qui y-a-t-il à attendre de Pierre Poilievre ?

Sous P. Poilievre, les Conservateurs pourraient bien nous donner le plus réactionnaire et dangereux gouvernement de l'histoire du Canada
John Clarke, Canadian Dimension, 14 janvier 2025
Traduction, Alexandra Cyr
Ce serait à peine faire preuve d'un pessimisme sans fondement que de conclure que l'accablante possibilité de l'élection d'un gouvernement conservateur sous la direction de Pierre Poilievre lors de la prochaine élection fédérale soit réelle. Les sondages le confirment clairement et sans relâche. Ipsos leur accorde maintenant une avance de 25 points devant les Libéraux. Ce qui reflète le fait que la démission fracassante de Chrystia Freeland a encore empiré la situation.
La décision inévitable mais toujours reportée de Justin Trudeau de quitter à regret la direction de son parti ne peut être considérée que comme une opération salvatrice. Il fallait le remplacer mais comme c'est un tant soit peu improvisé de sélectionner un.e remplaçant.e le processus donne un semblant de justification pour la prorogation du Parlement jusqu'en mars. Mais rien de tout cela ne va tirer les Libéraux d'affaire. Cela ne permettra que la reprise des travaux du Parlement pour quelques mois. Il est très peu probable que le nouveau chef ou la nouvelle cheffe, choisi.e parmi un groupe discrédité, puisse arriver à renverser l'avance déterminante des Conservateurs, même de proche. Se débarrasser de Justin Trudeau pourra assurer aux Libéraux le rôle d'opposition officielle, mais même cela est loin d'être certain.
Depuis le début, les reportages montrent que P. Poilievre n'a aucune intention d'être accommodant et qu'il se saisira de toutes les occasions pour s'assurer que l'impopularité de J. Trudeau soit reportée sur la personne qui le remplacera. Après une décennie de gouvernements libéraux de plus en plus discrédités, ce ne sera peut-être pas une tâche difficile. J. Trudeau est parti mais le Parti conservateur a toujours le vent dans les voiles.
Les Libéraux ont fait leur temps comme gouvernement mais leur déclin se situe dans une tendance internationale : les Partis centristes ont de plus en plus de mal à se maintenir au pouvoir devant les défis que leur apporte la droite populiste. L'incapacité de l'administration Biden-Harris à offrir une alternative à D. Trump en est un exemple manifeste. Les Conservateurs canadiens vont pouvoir bénéficier de la victoire de D. Trump.
À l'attaque !
Un régime dirigé par P.Poilievre sera sûrement déterminé à imposer des politiques d'extrême droite. Durant la course à la chefferie conservatrice en 2022, j'ai écrit un article pour Counterfire au Royaume Uni. J'y soutenait que le « couronnement de P. Poilievre à la tête du Parti est l'accumulation de luttes pour son contrôle entre une aile modérée qui voulait préserver le rôle du capitalisme canadien comme organisateur politique calme et fiable et un autre courant de droite prêt à accommoder la colère réactionnaire qui grandit à la base et la périphérie du Parti ». Aujourd'hui, au bord du pouvoir, les Conservateurs se préparent à leur rôle longuement anticipé, celui de l'attaque. P. Poilievre voudra à tous prix prouver qu'il est décidé à agir fortement. Il voudra agir vite défiant les oppositions et mettant en place des mesures solides comme D. Trump le fait au sud de la frontière.
Récemment, la presse canadienne rapportait l'entrevue qu'un bien connu de la droite « intellectuelle publique », Jordan Peterson a tenu avec P. Poilievre. Immédiatement, E. Musk, ce riche et obscène entrepreneur de l'extrême droite internationale, s'est empressé de les féliciter. Par ailleurs il a publié une annonce depuis : « une base chrétienne luttant contre l'avortement en Indiana et qui cherche à protéger « les enfants non encore nés.es ».
Au cours de cette longue entrevue, P. Poilievre a démontré comment son conservatisme est différent de celui relativement contenu et prudent de sa période antérieure. Aucun vocabulaire conciliant eut égard au changements climatiques et à l'environnement. Au contraire, il a critiqué les grandes compagnies qui ont cédé devant les soit disant environnementalistes libéraux débridés. Il s'est engagé à donner aux compagnies du secteur des énergies fossiles toute liberté et ainsi : « provoquer un énorme boom de ressources dans notre pays ».
Il a accusé J. Trudeau de se servir d'une « idéologie extrêmement radicale » et d'imposer au Canada « un socialisme autoritaire ». Une telle rhétorique échevelée où le libéralisme est présenté comme une forme de radicalisme extrême est la marque de commerce de D. Trump et ces ressemblances dans leurs approches ne sont pas une coïncidence.
Note, ici le texte rapporte une intervention de Paris Marx sur X je ne traduis pas. N.d.t.
Pointant des coupes importantes, des reculs dans les politiques sociales et des dérégulations tout azimut, il promet de « couper dans la bureaucratie, les contrats de consultation, l'aide étrangère et des avantages des grandes corporations. Nous allons utiliser les sommes ainsi épargnées pour diminuer le déficit et les taxes et libérer le système de libre entreprise ». Il a aussi assuré que son programme d'austérité serait accompagné « de la plus grande répression du crime de l'histoire canadienne, une répression massive ».
Durant cette entrevue, P. Poilievre a présenté un programme dit « Canada First qui mettrait de côté la race, cette obsession que le wokisme a remis à l'ordre du jour ». Il est clair que comme d'autres gouvernements autoritaires d'extrême droite cette approche a pour objectif d'intensifier les injustices et les inégalités qui sont générées par le racisme tout en niant les problèmes existants.
Au plan international, nous pouvons nous attendre à ce qu'un programme de droite soit en vigueur et exécuté avec zèle sous sa direction. Ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne Israël. Rien des atrocités pratiquées contre les Palestiniens.nes ne fera tergiverser P. Poilievre et nous pouvons nous attendre à une remontée importante de l'intimidation et de la lutte contre le mouvement de solidarité avec la Palestine.
Nous devrions aussi nous intéresser à l'influence que l'administration Trump va avoir sur les politiques canadiennes durant la période à venir. Le gouvernement Trudeau a déjà renforcé les « mesures de sécurité à la frontière, renforcé notre système d'immigration qui contribuent à assurer un futur prospère au Canada ». Sans aucun doute, P. Poilievre est disposé à poursuivre dans cette direction. Parmi une vaste quantité d'enjeux politiques, les initiatives que prendra l'administration Trump feront ressortir le pire d'un gouvernement Poilievre. Et on peut ajouter que le fédéralisme fera ressortir le pire pour les provinces.
Résister
Il y aura sans aucun doute des tentatives d'arrêter les Conservateurs en chemin ou tout au moins de minimiser l'étendue de leur victoire. Mais il n'est pas risqué de penser qu'une fois la poussière retombée le nombre de leurs députés.es sera plus élevé que celui de tous leurs rivaux réunis. Donc, devant la venue de ce probable gouvernement extrêmement destructeur et dangereux, il faut que nous nous intéressions à la manière dont nos syndicats et notre mouvement social doivent y répondre. Le manque apparent de préparation actuel est profondément inquiétant.
Je me souviens de la sidération qui a marqué les premiers mois du dur gouvernement conservateur Harris en 1990, en Ontario. Certaines des mesures les plus nuisibles ont été adoptées sans opposition pour ainsi dire. Il y a quelques leçons à tirer de cette expérience particulièrement parce que les Conservateurs vont pavoiser en prenant des directions dans la lignée de D. Trump, au cours de leurs premiers jours au pouvoir. P. Poilievre proclame qu'il ne fera aucune concession ni compromis. C'est la meilleure raison pour le priver de toute période de grâce où il pourrait affecter négativement les travailleurs.euses et les communautés. Pour que la résistance soit efficace, nous devons avoir une classe ouvrière forte et unie, capable de développer et mobiliser une puissante coalition de forces opposées aux Conservateurs.
Mais, alors que nous ne sommes pas du tout préparés.es à contrer P. Poilievre comme nous le devrions, ce n'est pas une raison pour nous résigner. Il est très possible de convenir d'un plan de rencontres nationales, provinciales et locales pour développer un plan d'action afin de confronter ce qui sera un des gouvernements les plus réactionnaires et dangereux de notre histoire.
Avec le retour de D. Trump à la Maison blanche et P. Poilievre qui attend dans son ombre ici au Canada, les travailleurs.euses et les communautés vulnérables des deux côtés de la frontière ont à affronter des attaques majeures. À défaut de s'équiper d'une contre-offensive très solide, nous ferons face à des défaites douloureuses. La capacité de riposter sera primordiale. Dans la perspective de cette lutte de classe ouverte et immodérée, la question vitale est de savoir si nous pouvons lancer un mouvement capable de vider les lieux de travail et de remplir les rues.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

La meilleure réponse du Canada à l’agression de Donald Trump ? Le socialisme

Après 40 ans de néolibéralisme, nous devons inverser le mouvement en tablant sur une économie planifiée et une reprise en main de l'économie par l'État.
Tiré de The Breach
Traduction Johan Wallengren
Le président qui arrive au pouvoir aux États-Unis, Donald Trump, a ces derniers temps réfléchi à voix haute à l'idée d'utiliser la « force économique » aux fins d'annexion du Canada. Cette menace est brandie avec une telle outrecuidance que bien de gens n'y voient que fanfaronnade, incapables qu'ils sont d'accepter qu'un président des États-Unis fasse planer une telle menace sur le sort de notre économie.
On aurait cependant tort de prendre ces propos à la légère, et Trump doit être traité comme un acteur hostile à la sécurité économique du Canada. Au niveau fédéral, le chef du NPD, Jagmeet Singh, a eu le mérite de chercher à rallier des partisans derrière son plan contre Trump, qui consiste à préparer des représailles à tous tarifs douaniers que Trump pourrait imposer et à veiller à restreindre l'accès des sociétés américaines aux richesses minières du Canada.
Mais ces mesures de rétorsion, aussi nécessaires soient-elles, éludent un problème majeur. Ce n'est pas avec des tarifs douaniers et des messages sur Twitter que nous parviendrons à nous tirer de ce bourbier. Nous devons plutôt nous débattre avec la dure réalité que ce sont 40 ans de capitalisme néolibéral au Canada qui nous ont placé dans une telle position de faiblesse qu'un président peut à lui seul ternir notre avenir économique.
Pour résister véritablement à l'agression américaine, nous avons besoin d'une solution axée notamment sur des nationalisations, une planification économique et une participation des travailleurs, solution qui passe en d'autres mots par le socialisme.
Le passé du Canada offre quelques leçons et idées pour nous rapprocher de cet objectif. Les gens de gauche au pays ont jadis promu la vision d'un État robuste et de syndicats forts, gages de la construction d'une société socialiste démocratique indépendante. Il est temps de redonner vie à cette vision.
La réappropriation, rempart contre l'empire américain
Une partie du problème réside dans la profonde intégration de l'économie canadienne à l'économie américaine.
Lorsque des capitaux américains et étrangers sont investis dans une part aussi importante de l'économie canadienne que maintenant, en particulier dans des secteurs stratégiques tels que l'énergie, l'exploitation minière et l'industrie lourde, il ne faut pas s'étonner qu'un président américain s'en serve comme d'un levier.
Il y a un peu moins de 60 ans, il a pu sembler que le Canada était sur la bonne voie pour construire une économie plus autonome. Sous l'impulsion d'intellectuels de gauche et de militants syndicaux au sein du NPD et à l'extérieur du parti, des efforts ont été déployés non seulement pour se pencher sur l'étendue et les effets de la mainmise économique américaine sur le Canada, mais aussi pour s'y opposer.
Dans le contexte de la publication du rapport Watkins, qui détaillait pour le gouvernement fédéral les implications de l'engagement étranger dans notre économie – révélant pour la première fois à quel point le Canada était contrôlé par l'étranger sur le plan économique – il y a eu un grand sursaut de la part d'organisations nationales de gauche.
Des voix se sont élevées dans le champ gauche pour faire pression sur le gouvernement libéral de Pierre Trudeau afin qu'il s'engage à exercer un contrôle accru sur l'économie canadienne, notamment par la nationalisation d'industries clés, au premier rang desquelles l'énergie. (Il faut reconnaître que ces nationalistes de gauche ont souvent, mais pas toujours, négligé l'importance des droits des autochtones et de l'autodétermination). Ils ont fini par remporter des succès, parmi lesquels la création de la société publique Petro-Canada, obtenue uniquement parce que le leader du NPD David Lewis en avait fait une condition dans une entente intervenue du temps du gouvernement minoritaire de Trudeau en 1972.
Mais ces progrès initiaux se sont rapidement estompés lorsque le Canada et la plupart des pays occidentaux ont adopté des politiques de privatisation et ont adhéré au capitalisme néolibéral. Les gouvernements Mulroney et Chrétien ont ouvert les bras aux capitaux américains et à l'entreprise privée ; et ce qui a joué un rôle encore plus déterminant est que l'approche initiale de Trudeau père était trop motivée par le souci de permettre aux capitalistes canadiens d'avoir les coudées franches.
Nous devons tirer les leçons de ces échecs historiques : Le Canada doit défier la domination américaine en veillant à donner à l'État un certain contrôle sur l'ensemble des ressources stratégiques et des moyens de production.
Pendant 40 ans, le Canada a joué la carte de la privatisation et de l'intégration dans l'économie américaine. Cela n'a pas permis d'assurer la sécurité économique de notre pays, comme le montrent avec limpidité les menaces de Trump.
C'est dans cet esprit que le NPD doit faire preuve de courage et commencer à dire clairement que le capitalisme nous a desservi. Le socialisme peut nous mettre sur une autre voie.
Relancer la planification économique
Il est clair que le Canada a besoin que l'État reprenne un certain contrôle sur l'économie et se dote d'une vision à long terme pour être en mesure d'écarter des menaces telles que celles que Trump s'est mis à diffuser.
Mais ce n'est pas en un claquement de doigts que ces objectifs pourront être atteints. Il faut une planification économique réfléchie pour remettre en cause la mainmise américaine sur notre économie.
En effet, c'est le NPD, à ses débuts dans les années 1960, qui a soutenu, aux côtés des syndicats, que faute de planifier notre avenir économique, nous serions incapables de tenir tête aux États-Unis le moment venu. Eh bien, le moment est venu, et nous sommes pris au dépourvu.
À l'époque, le NPD et les syndicats réclamaient non seulement des sociétés d'État comme Petro-Canada, mais aussi une société d'État centrale qui investirait dans des projets en échange d'une participation au capital et d'un contrôle par les Canadiens, qui pourraient faire valoir des objectifs économiques d'une manière que les capitalistes ne permettraient jamais.
Ceux-ci ont aussi mis de l'avant que cette planification permettrait de mieux construire une économie est-ouest afin de réduire la dépendance à l'égard du commerce avec les États-Unis. L'objectif n'a jamais été, bien sûr, d'éliminer le commerce avec nos voisins du sud, mais bien d'éviter le calvaire actuel.
Malheureusement, tout cela a été soit rejeté par les gouvernements libéraux et conservateurs, soit rapidement démantelé lors de la vague de vente d'actifs des gouvernements dans les années 1980.
Trump a menacé, par exemple, de couper l'accès du Canada au marché américain de la construction automobile. De nombreux composants du secteur sont fabriqués au Canada, puis expédiés au sud pour entrer dans le processus de fabrication. Si la production de bout en bout pouvait s'enraciner au Canada, cela réduirait la portée des menaces de Trump.
Des pays comme la Norvège ont été beaucoup plus prévoyants en créant des industries énergétiques nationalisées qui ont rendu leurs citoyens plus riches que les Canadiens tout en constituant des fonds pour mieux planifier leur avenir économique. Ici, en revanche, nous avons de façon répétée « laissé aller à vau-l'eau » les booms pétroliers*.
Reste que la solution n'est pas de céder aux capitalistes à saveur de sirop d'érable plutôt qu'aux Américains. Galen Weston ne protégera pas plus la classe ouvrière canadienne que le ferait un magnat du Texas.
Le NPD a pris des initiatives qui ont requinqué un peu la flamme en demandant des comptes à classe des milliardaires, traînant certains d'entre eux devant des commissions parlementaires pour les interroger sur les prix abusifs. Pour ce qui a été de sévir contre les capitalistes du milieu de l'épicerie canadienne, une récente enquête de la CBC qui a révélé que ceux-ci lésaient les Canadiens en pratiquant des prix excessifs dans le commerce de la viande a montré qu'il y avait lieu de prendre des mesures.
Mais les auditions des commissions parlementaires ne suffisent pas. Oui, nous devons nous attaquer aux entreprises qui vivent aux crochets de l'état en obtenant toutes sortes d'avantages**, mais nous devons aussi nous attaquer de front à la question des participations étrangères et de la planification économique.
Une vision socialiste audacieuse pour l'avenir
Une des idées fausses sur le socialisme est que sa doctrine est focalisée uniquement sur le contrôle de l'État.
Une plateforme socialiste doit comprendre le contrôle de l'industrie par les travailleurs, ce qui peut aller de la syndicalisation universelle à la propriété directe des moyens de production sur le lieu de travail et mener à la démocratie économique au sens le plus large possible. Cela recouvre la propriété collective des entreprises, un plus grand pouvoir des travailleurs et une participation réelle des citoyens aux décisions relatives au fonctionnement de notre économie.
Une démocratie solide qui ne se réduit pas à l'acte de voter lors d'échéances qui se succèdent à quelques années d'intervalle mais permet d'exercer un contrôle collectif au jour le jour est essentielle pour dresser des barrages susceptibles d'endiguer la domination américaine.
De nos jours, les gens de la classe ouvrière n'ont pas leur mot à dire sur les décisions prises relativement à leur travail ni concernant les produits et les bénéfices généré par celui-ci. De ce fait, les travailleurs canadiens ont peu de contrôle direct sur leur destin, que ce soit au plan national ou dans nos relations avec les États-Unis.
Ce n'est qu'en restructurant notre société de manière que les Canadiens puissent dans une certaine mesure s'approprier leur lieu de travail, leur économie et leur pays que nous pourrons construire un rempart contre les attaques de Trump.
Il est toutefois essentiel de ne pas perdre de vue que la résistance à la domination américaine via le nationalisme économique ne doit pas occulter la recherche de la justice pour les peuples des premières nations, qui doivent être des partenaires de premier plan dans la construction d'une société et d'une économie démocratiques, notamment en mettant fin à notre propre agression coloniale en tant que pays et en procédant à une véritable restitution des terres.
Le moment est venu pour le socialisme démocratique de briller à nouveau, ce qui pourrait donner une occasion au NPD de s'illustrer. Des sondages récents montrent qu'une majorité écrasante de Canadiens rejettent les projets de Trump, et les néo-démocrates s'y opposent presque unanimement.
Nombreux sont les partisans faisant partie de la base du parti conservateur qui souhaitent prendre la nationalité américaine et l'engagement du parti libéral en faveur du capitalisme néolibéral ne lui permet pas de réagir en proposant quelque plan cohérent au-delà de la perspective d'attendre qu'un président démocrate retourne à la Maison Blanche.
Dans l'immédiat, le NPD se trouve devant une opportunité inestimable, alors qu'un mouvement anti-Trump se dessine, une occasion de se porter à la défense des travailleurs et des emplois. Mais cela est loin d'être suffisant : le parti doit procéder à des changements structurels fondamentaux pour réellement et significativement embrasser une vision de gauche.
Le NPD doit devenir le champion d'un avenir socialiste audacieux.
* L'auteur fait allusion ici à des autocollants qui sont apparus sur des voitures dans l'ouest du pays, avec la formule (en anglais) suivante : « PLEASE GOD LET THERE BE ANOTHER OIL BOOM.I WILL NOT PISS IT AWAY THE SECOND TIME ».
** L'auteur parle en anglais de « corporate welfare bums » une expression dont l'histoire est retracée dans une vidéo et un article (en anglais) disponibles sur le même site que l'article, à l'adresse Web : https://breachmedia.ca/corporate-welfare-bums-its-payback-time/
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Trump : la fin du libre-échange, le retour du colonialisme

Alors qu'il n'est pas encore entré en fonction, Donald Trump répète les « coups de menton », réitérant notamment sa volonté de faire du Canada le 51e État de la confédération américaine. Si ces velléités font d'abord sourire par leur démesure, leur répétition nous force à les prendre aujourd'hui au sérieux. Que signifient ces discours ? Doit-on craindre qu'ils se concrétisent ? Pour Alain Deneault, professeur de philosophie à l'Université canadienne de Moncton (Shippagan), ces déclarations du président des États-Unis montrent que le protectionnisme dont se revendique Donald Trump marque une régression : la protection de ses propres frontières n'empêchera pas Washington de franchir allègrement toutes celles qui le séparent des richesses convoitées par le milieu des affaires.
16 janvier 2025 | tiré du site d'Élucid
https://elucid.media/politique/trump-la-fin-du-libre-echange-le-retour-du-colonialisme-alain-deneault
Les coups de menton du président des États-Unis, Donald Trump, ne s'apparentent plus à de seuls coups de tête lorsqu'ils se répètent à l'identique. Une déclaration sur l'annexion du Groenland aux États-Unis apparaît insolite lorsqu'elle est faite une première fois en août 2019. Elle devient un projet lorsqu'elle est réitérée le 7 janvier 2025. On se met soudainement à rationaliser. Le réchauffement climatique et la fonte des glaciers restent synonymes pour M. Trump d'occasions d'affaires, un Eldorado même : les terres rares et autres éléments stratégiques pour l'industrie de pointe deviendront accessibles dans cette région nordique à la faveur du processus de dégel. Le phénomène climatique facilite aussi le transport maritime, à un carrefour que Washington entend régir.
Ici, rationaliser, c'est prendre la mesure de la déraison de la nouvelle administration américaine. « Beaucoup fantasment sur les ressources de l'île en minerais, en hydrocarbures ou en potentiel hydroélectrique. Ils minorent généralement la rudesse des conditions d'exploitation et les lourds investissements requis », a déjà écrit le journaliste Philippe Descamps dans Le Monde Diplomatique au terme d'un voyage sur l'île.
Il en va de même pour l'expression, répétée à l'envi en janvier 2025 par Donald Trump alors président désigné, voulant que le Canada soit le 51e État de la confédération américaine. Longtemps une métaphore pour dénoncer à gauche l'intégration du Canada aux dynamiques industrielles et commerciales états-uniennes, la voilà devenir subitement une lubie, voire un programme. Tout comme la dystopie voulant que l'armée des États-Unis prenne le contrôle de l'eau douce du Canada dans des années de sécheresse devient un plan. À l'image de l'immeuble de l'ambassade des États-Unis dans la capitale fédérale d'Ottawa, presque aussi grand que le parlement lui-même, voilà que cette représentation mentale prend un tour concret.
Le président Trump n'entend rien à l'humour. Mais c'est parce que d'ordinaire on n'entend rien à ceux qui n'entendent rien à l'humour que ces derniers parviennent, sous couvert d'humour, à avancer des revendications aux apparences invraisemblables. Ils profitent ainsi du temps gagné.
Ils le font d'autant mieux que, parfois, leurs sujets de prédilection se révèlent pathétiques. Que faire, sinon les parodier, lorsque Donald Trump, par exemple, suggère en 2017 que son visage figure à son tour sur la falaise du mont Rushmore ? Mais lorsque d'autres enjeux revêtent un caractère beaucoup plus grave, on le comprend trop tard. Dans un contexte mondial où le Président Trump voit d'un bon œil l'invasion de l'Ukraine par la Russie et trouve normal que l'État israélien se déchaîne cruellement en territoire palestinien, au Liban ou dans la Syrie dévastée, réduire ces déclarations à un simple jeu de bluff donne seulement l'illusion de reprendre la main. Force est de se rendre à l'évidence : avec Donald Trump, une meute de personnages intransigeants arrive en force à Washington et ne conçoit rien qui puisse résister à sa volonté.
Sans se perdre dans des débats sémantiques à savoir si le trumpisme est véritablement ou non un fascisme, bien des analogies s'imposent à l'esprit avec les précédents de l'Histoire lorsqu'on observe à Washington le déni des règles établies, l'arrogance de l'équipe ministérielle érigée en méthode, l'ignorance crasse de l'Histoire et le mépris de la culture retournés en valeur…
On écarquille les yeux en constatant par quelle rhétorique ordurière le futur secrétaire d'État, Elon Musk, répond au Premier ministre du Canada, lorsque celui-ci rappelle le statut politique souverain du Canada : « Ma nana, t'es plus le gouverneur du Canada. Ce que tu dis n'a aucune importance ».
Les analogies se vérifient aussi dans la façon qu'a l'environnement proche ou distant de plaire aux puissants. Il fallait voir en janvier 2025 les représentants des différents paliers de gouvernement du Canada s'empresser de se mettre en bouche des éléments de langage sur l'immigration, le commerce ou la souveraineté en Arctique, qu'on ne les avait jamais entendus partager, et ce, dans une tentative vaine de tempérer les ardeurs du président patibulaire.
C'est dans cet effet de cascades qu'on voit des acteurs sociaux influents de toute catégorie accepter l'augure du tyran huppé d'Amérique. On ne parle pas seulement des cadres et élus sceptiques du Parti républicain qui le suivent à tombeau ouvert dans ses dévalaisons, toute honte bue, après s'être opposés à lui, au premier chef le catholique James David Vance, maintenant vice-président, mais d'autres figures publiques, le dernier en lice étant le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg. Se découvrant soudainement viriliste, ce dernier a viré sa veste sans subtilité aucune en attribuant explicitement aux « récentes élections » sa décision de surseoir à toute velléité d'édition des contenus qui circulent sur les réseaux de son empire Meta.
Nous nous retrouvons dans l'ère des « rhinocéros », du nom de la pièce de théâtre qu'Eugène Ionesco avait écrite pour témoigner des basculements successifs de ses camarades antifascistes dans la rhétorique complotiste, suprémaciste et guerrière des nazis. Rare production historiquement significative de l'auteur d'un théâtre absurde, il s'en prenait aux « demi-intellectuels » des années 1920 et 1930, seulement capables de « succomber à des slogans supérieurs ».
La pièce Rhinocéros porte clairement sur la « nazification progressive » de cette engeance, déjà observée par l'auteur en Roumanie : « Nous étions un tas de gens qui étions contre le nazisme. Et puis, petit à petit, nous étions de moins en moins nombreux. Un moment donné, un de nos amis disait : “Certainement, les fascistes n'ont pas raison. Cependant, sur ce point…”, alors on savait tout de suite que, dès qu'ils disaient cela, ils étaient dans la machine, dans l'engrenage, et que c'était fini ». On ne les voyait plus aux réunions.
Ce dont la fin du libre-échange marque le début
La franchise avec laquelle cette volonté se déclare déroute ceux qui se sont formés dans les années obliques, rhétoriques et insidieuses de l'économie de marché néolibérale. La domination s'y exerçait selon des méthodes indirectes. Les politiques dites de développement suivant la Seconde Guerre mondiale, les plans d'ajustement structurels du Fonds monétaire international de la fin du XXe siècle ou la théorie de la « bonne gouvernance » les relevant ces dernières décennies, ont permis à une oligarchie principalement occidentale d'asseoir son hégémonie par le biais de mécanismes aux apparences autonomes. Le régime concurrentiel mondialisé qu'il s'est agi de promouvoir consistait à faire participer les différents acteurs sociaux à un jeu dans lequel les puissants maîtrisaient les règles.
Contrairement à un commerce malien, une coopérative malaisienne ou une société d'État brésilienne, une entreprise multinationale soutenue fiscalement, politiquement, voire militairement, par des États puissants, disposait de leviers infinis afin de s'adapter à toute conjoncture. Par le lobbyisme, sa force de négociation, ses capitaux financiers et aussi son pouvoir de corruption, elle pouvait obtenir d'une majorité d'États des droits de douane, des politiques fiscales, un aménagement du territoire, des subventions publiques et un encadrement sécuritaire valant pour règles communes, au détriment d'acteurs sociaux incapables de faire le poids.
Le syntagme de « libre-échange » a accompagné cette histoire moderne. Il a désigné plusieurs régimes différents de l'organisation commerciale mondiale, dont tous avaient pour finalité de consacrer un rapport de domination à travers des structures d'échange qui les normalisaient et les naturalisaient.
C'est aussi au nom de ce libre-échange qu'à la Conférence de Berlin de 1884-85, le souverain belge Léopold II convainc ses partenaires européens de lui accorder l'immense territoire congolais. Le Roi belge exercera d'abord à titre privé, plutôt qu'au nom de son État, une souveraineté politique sur le territoire. Il convaincra Allemands, Britanniques et Français de la lui reconnaître à la condition de créer un vaste espace de « libre-échange ». Il s'agissait de garantir un accès aux puissances industrielles dans cette très grande part du « gâteau africain ».
L'historien Henri Wessiling rappelle que le roi Léopold II avait pour livre de chevet l'ouvrage du bien nommé J. M. B. Money, Java. Or, How to Manage a Colony (1). C'est le grimoire utopiste de la colonisation à l'anglaise : des sociétés privées qui exploitent les richesses, un personnel administratif européen respecté, des colonisés admiratifs de l'autorité des Blancs, des chefs de clans incorporés ou neutralisés. On sait aujourd'hui qu'il n'en fut rien, et que le Congo belge fut sa souveraineté privée exerçant une cruelle domination sur des peuples asservis, notamment en ce qui concerne la filière du caoutchouc.
C'est aussi l'approche libre-échangiste que les États-Unis d'Amérique chercheront à faire triompher au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, au titre du « développement ». Les États européens seront amenés à abandonner leur tutelle politique et institutionnelle sur nombre de contrées du Sud et de l'Est, au profit d'une ouverture de ces régions aux entités privées convoitant leurs richesses naturelles (2). Cela aboutira à la fin du siècle à la mondialisation libérale, sous les auspices de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) favorisant l'abattement des tarifs douaniers dans le monde et la libre circulation des marchandises et des services.
Un regard superficiel sur le retour en force de l'État, que Donald Trump promeut, peut tromper ceux qui auraient été prompts à se dire de gauche il y a un demi-siècle. M. Trump parvient à les séduire en replaçant l'autorité publique au centre du jeu, prétend à la réindustrialisation et compte mettre fin à d'astreignantes guerres d'occupation en territoires lointains. Mais ce serait oublier que Washington ne compte faire respecter les frontières que lorsqu'il s'agit des siennes, et franchir allègrement toutes celles qui le séparent de richesses convoitées par le milieu des affaires dont il continue de faire partie, avec son gouvernement comprenant notamment 13 milliardaires.
Cette contestation du libre-échange mondial marque une régression. L'empire qui se veut « à nouveau grand » suppose, à l'ancienne, l'asservissement tutélaire d'espaces géopolitiques étrangers sur un monde conquérant et colonial. Se dire de nouveau « grand » ne s'est jamais résumé à la simple intendance des affaires intérieures. Les États-Unis d'Amérique ont longtemps eu leur chasse gardée en Amérique centrale et en Amérique du Sud, tout comme l'Europe ponctionnait les richesses de l'Afrique. Ils ont poursuivi sur un plan financier et industriel l'exploitation coloniale de ce vaste garde-manger agricole et réservoir de richesses énergétiques que le Canada constitue.
On est loin de la lutte populaire engagée contre le libre-échange qu'a provoquée le mouvement altermondialiste dans les années 1990, et qui a culminé à Seattle en novembre 1999 dans une neutralisation du sommet de l'OMC. À l'époque, l'autre mondialisation préconisée par la mouvance internationale visait à garantir des échanges justes entre les populations, sur la base du respect de normes sociales et écologiques. Le protectionnisme dont fait preuve désormais le pouvoir états-unien n'est le fait d'un repli que dans un premier temps.
Un Canada vulnérable
Les États-Unis n'ont pas attendu Donald Trump pour commettre de l'ingérence au Canada. On peut dire de celle-ci qu'elle est totalement intériorisée dans les affaires des deux États. Le dernier exemple en date concerne l'Outaouais rural, dans l'ouest du Québec. La multinationale Lomiko Metals entend saccager les terres aux abords du Lac-Simon pour y exploiter un minerai stratégique dans l'industrie de pointe, le graphite. Elle le fait, soutenue par les autorités fédérales canadiennes ainsi que par… le ministère de la Défense des États-Unis d'Amérique. Comme souvent, les Démocrates et le pouvoir politique canadien procèdent en douce pour effectuer ce que l'autoritarisme trumpiste se propose de mener frontalement.
À l'appui de sa déclaration de guerre commerciale, le redresseur de torts autoproclamé réitère qu'il imposera des tarifs douaniers de l'ordre de 25 % sur les produits d'importation canadiens, las de voir les États-Unis « subventionner » l'économie canadienne. Dans la novlangue trumpiste, une « subvention » américaine faite à un État est un coût qu'on doit payer lorsqu'on achète une marchandise plutôt que de se l'approprier par la force.
Le Canada est vulnérable à ce changement de paradigme étant donné que son fonctionnement industriel et financier dépend majoritairement de ces rapports commerciaux avec son voisin du sud. Selon l'agence de statistique du Canada, les biens et services qui font l'objet de relations commerciales de part et d'autre de la frontière séparant les deux pays représentaient quotidiennement 3,6 milliards de dollars canadiens en 2023. Près de 80 % des exportations canadiennes sont destinées aux États-Unis. Le pétrole sale des sables bitumineux en Alberta est raffiné au sud et Hydro-Québec fournit à la ville de New York l'électricité dont elle a besoin. Inversement, au Canada, près de la moitié des investissements directs de l'extérieur proviennent des États-Unis. Selon l'American Petroleum Institute, jusqu'à 90 % du pétrole raffiné dans l'est du Canada transite ou est produit par les États-Unis bon an mal an, tandis que « plus de 50 % du pétrole brut importé aux États-Unis provient du Canada, comparativement à 33 % en 2013 ».
Mais le Canada est d'autant plus fragile qu'il constitue lui-même dans son essence un avatar de l'idéologie libre-échangiste que l'administration Trump conteste. Il s'agit de la meilleure incarnation de l'utopie de J. W. Money. Le Canada moderne s'est déployé comme une colonie libérale moderne lorsqu'il a mis fin à l'apanage de la Compagnie de la Baie d'Hudson et autres sociétés à charte britanniques suivant la conquête anglaise de la Nouvelle-France. Ses bourses ultra-spéculatives et son gouvernement à la solde des investisseurs et banquiers en ont fait une colonie (officiellement un « Dominion ») essentiellement dédiée au soutien des multinationales et banques tournées vers l'exploitation de ses fourrures, céréales, minerais et énergies fossiles. Il n'a rien d'autre sur quoi s'appuyer pour exister.
Enfin, le Canada est un pays informe. Deux tiers de la population vit à moins de 100 kilomètres de la frontière américaine ; les Canadiens constituent une bande démographique le long d'un axe continental. D'un point de vue culturel, l'anglophonie canadienne, largement majoritaire, est depuis longtemps absolument absorbée par la production culturelle et médiatique américaine. C'est à la marge seulement que les « Canadians » fréquentent les artistes et intellectuels de leur pays. Le tsunami de propositions venant du sud s'exprimant dans leur langue, rien n'y résiste. Cela le prive de toute unité. Son histoire constitue un tout guère plus grand que la somme de ses annales. Ce n'est pas tant la carte du pays qui confère une unité à son territoire que le territoire qui injecte du sens dans la carte. La contrée se résume à une distribution de travailleurs dédiés à l'exploitation de sites étrangers sis le long de la frontière états-unienne.
Le Canada n'a jamais eu à cultiver d'attitude pugnace. Rarement distant de son voisin du sud sur un plan idéologique – un peu quant à Cuba à l'époque du père Trudeau, Pierre-Elliott, ou encore sur le conflit en Irak en 2003 –, le Canada s'est contenté depuis sa refondation de 1867 de marcher dans les plates-bandes de la plus grande puissance mondiale avec qui il partage un vaste espace continental, et d'en calquer les politiques. Son modèle social lui a longtemps permis de se distinguer des États-Unis, comme n'a pas manqué de le souligner à maintes reprises le sénateur « socialiste » Bernie Sanders ou encore le réalisateur progressiste Michael Moore (3).
Mais celui-ci périclite du fait de la pression que lui fait justement subir l'impératif de concurrence avec le modèle états-unien, notamment en raison de l'Accord de libre-échange nord-américain, au point où le modèle social canadien, quoique toujours meilleur, tend à ressembler aujourd'hui à celui en vigueur dans les États progressistes des États-Unis. Il est aussi sous-financé du fait des politiques fiscales canadiennes, qui ont favorisé l'intégration du pays aux paradis fiscaux de la Caraïbe britannique, qu'il a lui-même concouru à créer dans les années 1960 et 1970.
Non seulement cet ensemble de facteurs place le Canada en situation de vulnérabilité devant le voisin du Sud, mais il le laisse complètement pantois. Que faire ? Bomber le torse et rappeler l'ambassadrice, tout en boudant la cérémonie d'assermentation du nouveau Président ? C'est risible. S'essayer à un improbable sursaut national en réunissant dans une cellule de crise les Premiers ministres fédéral et provinciaux ainsi que leurs chefs de l'opposition respectifs ? La joute partisane et l'antagonisme parlementaire le rendent difficilement probable. Répliquer sur l'énergie puisque l'intendance énergétique est inextricable entre les deux pays ? Et ni l'Alberta en ce qui concerne le pétrole ni le Québec en ce qui regarde l'électricité n'ont intérêt à ce que des tarifs gênent leurs exportations. Alors, fédérer le peuple autour des droits culturels, en tous les cas en ce qui concerne les francophones ? La propagande fédérale a tout fait pour étouffer cet enjeu au fil des décennies.
Que se passera-t-il ?
Dans la conjoncture actuelle, depuis Israël, l'Europe de l'Est ou maintenant les États-Unis, seuls les stricts rapports de force semblent prévaloir. Aucun allié dans le monde n'est à même de soutenir le Canada de quelque façon dans quelque volonté de résistance.
Les pires scénarii continuent de dépasser l'entendement, comme une invasion pure et simple du Canada par les États-Unis dans le cadre d'une opération où l'armée américaine dirigerait ses blindés vers Ottawa et où l'aviation bombarderait la base militaire de Kingston. Mais on mesure déjà les effets tangibles d'un tel revirement du discours états-unien. Il devient soudainement probable que des représentants politiques, officines et médias fassent cas positivement de l'option du rattachement du Canada à la fédération américaine dans le débat public.
Le débat tournera autour de cette option. On fera l'inventaire des avantages d'une intégration, de sorte que ce faux débat devienne un enjeu central de la vie publique. On cherchera à traduit Anschluß en anglais (du français, il ne sera déjà plus question). Le représentant du Parti conservateur, Pierre Poilievre, proche de la mouvance trumpiste et pressenti pour devenir le prochain Premier ministre canadien, ne serait pas le plus à même de lui résister.
Moins une conquête, il se profilera un scénario plus attendu d'annexion, qui ne serait pas, lui non plus, sans rappeler quelques analogies. Avec son lot de résistants qui chercheront à être déterminants dans l'Histoire, au point peut-être de générer une autre forme politique au Canada, qui rompe positivement avec son fondement colonial.
Notes
(1) Henri Wesseling, Le Partage de l'Afrique. 1880-1914, Paris, Denoël, 1996, rééd. Gallimard, coll. Folio Histoire (1991), à propos de James William Bayley Money, Java : or, How to Manage a Colony, vol. 1, Londres, Hurst and Blackett, 1861.
(2) Gilbert Rist, Le Développement. Histoire d'une croyance occidentale, quatrième édition, Paris, Les Presses de Science Po, 2023.
(3) Michael Moore, Sicko, essai cinématographique, États-Unis d'Amérique, 2007.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Le rapport Hogue contredit la majorité de nos journalistes

En ce 28 janvier 2025, les Artistes pour la Paix remercient l'Honorable Marie-Josée Hogue d'avoir démenti les rumeurs affolées des réseaux sociaux, des médias et… de Pierre Poilievre.
Tiré de Artistes pour la paix
28 janvier 2025
Par Pierre Jasmin, secrétaire général des Artistes pour la Paix
Le Rapport sur l'ingérence étrangère de la Commissaire Marie-Josée Hogue a déclaré nos élections au caractère démocratique à l'abri de l'ingérence étrangère russe et chinoise. Ce rapport va aussi loin que la position politique de la commissaire lui permet d'aller et nous la remercions, par conséquent, d'avoir en quelque sorte endossé nos propres conclusions allant à l'encontre de celles de nos journalistes, ceux qu'on n'hésite pas à qualifier d'« embedded » soumis à l'influence des réseaux sociaux dont la Commissaire exprime le danger immensément plus grand pour notre indépendance politique.
(...)
N'ayant jamais été appelés à témoigner, les Artistes pour la Paix envoient notre conclusion à M. Michael Tansey, Sr. Communications Advisor – Public Inquiry into Foreign Interference in Federal Electoral Processes and Democratic Institutions (traduction en français ???)
www.ForeignInterferenceCommission.ca Follow us on X (formerly Twitter).
PS Combien de temps encore avant que le gouvernement canadien réalise que X d'Elon Musk nourrit le problème aigu de l'ingérence étrangère qui met en péril nos mœurs démocratiques ? Il est urgent qu'il trouve un autre mode de communication.
(...) Pendant des mois, toute la classe politique et médiatique regardait dans la mauvaise direction. Son attention était focalisée sur les soupçons à l'endroit d'élus qui auraient « sciemment » collaboré avec des États hostiles. Or, pendant ce temps, une menace bien plus « existentielle » à notre démocratie prenait de l'ampleur : celle de la désinformation. Et paradoxalement, elle ne faisait pas, à proprement parler, partie du cœur du mandat de la commission Hogue. Et même si la désinformation ne faisait pas partie des cinq volets formels du mandat de la commissaire, Marie-Josée Hogue a pris soin de faire un détour pour tirer la sonnette d'alarme.
« À mon avis, il n'est pas exagéré de dire qu'à l'heure actuelle, la manipulation de l'information (qu'elle soit d'origine étrangère ou non), représente le plus grand risque pour notre démocratie. Il s'agit d'une menace existentielle. » Citation extraite du rapport final de Marie-Josée Hogue, commissaire à l'Enquête sur l'ingérence étrangère.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2136012/ingerence-etrangere-commission-hogue-rapport
(...)
Dans un nouveau rapport, un groupe de réflexion issu du ministère fédéral de l'Emploi et du Développement social a déterminé quelles sont les « perturbations » les plus plausibles auxquelles le Canada, voire le monde entier, fait face. Intitulé Perturbations à l'horizon - Rapport 2024, le document, signé Horizons de politiques Canada, a recensé 35 perturbations mondiales, qu'ils ont partagées avec quelque 500 parties prenantes, collègues et expert.e.s en prospective au sein du gouvernement du Canada et au-delà.
En récoltant leurs commentaires – principalement sur la probabilité, l'impact et l'horizon temporel de ces perturbations –, le groupe de réflexion a pu circonscrire les menaces les plus criantes.
(...)
Le rapport Hogue contredit la majorité de nos journalistes, 28.01.2025,
Artistes pour la paix
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Quand l’argent pèse plus lourd que la santé : au tour du fédéral d’abandonner la population de Rouyn-Noranda
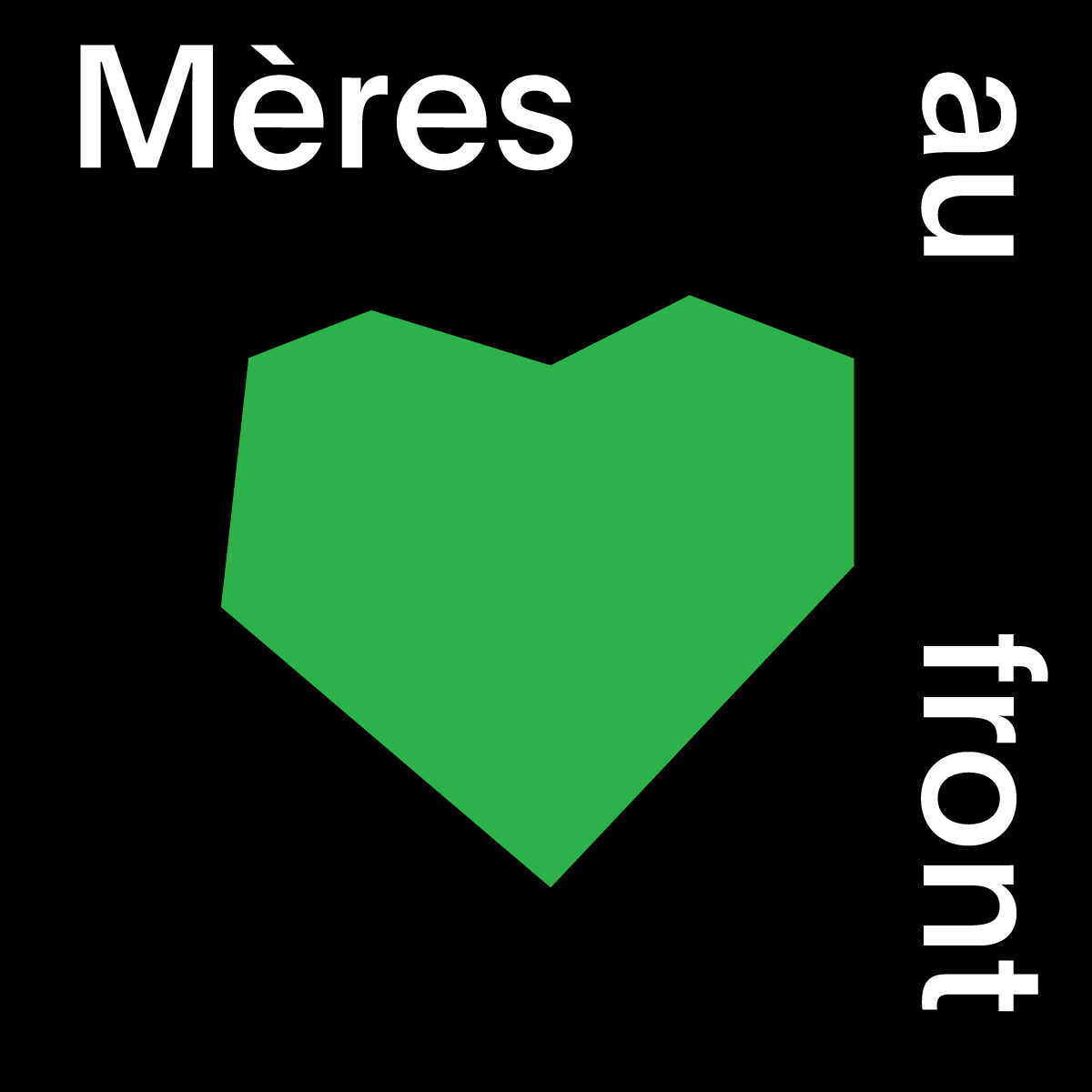
Rouyn-Noranda (Québec), le 31 janvier 2025 - Les Mères au front de Rouyn-Noranda et de tout le Québec dénoncent la soumission du ministre de l'Environnement et du gouvernement fédéral qui ont rompu leur engagement envers l'ONU. Elles déplorent que le lobbyisme exercé dans les coulisses ait eu préséance sur la santé de la population.
L'article publié par Radio-Canada révèle que le ministre Steven Guilbeault a cédé aux pressions de la fonderie Horne malgré avoir reconnu les risques plus élevés que le niveau acceptable pour la santé. Conséquemment, le gouvernement a choisi de ne pas signer les amendements de la Convention de Bâle qui auraient renforcé le contrôle et la traçabilité des déchets dangereux, et protégé la santé humaine.
« La responsabilité du ministre de l'Environnement est de protéger l'environnement, pas les profits d'une entreprise multimilliardaire coupable de corruption, de violation de droits de l'environnement et de droits humains partout sur la planète ! » dénonce Laure Waridel, écosociologue et co-instigatrice de Mères au front.
Rappelons que les déchets électroniques traités à la fonderie Horne contribuent à l'émission de contaminants atmosphériques qu'on retrouve à Rouyn-Noranda à des concentrations qui outrepassent les normes québécoises. « Tous les gouvernements nous ont abandonnées ! N'y a-t-il aucune limite à l'indécence quand il s'agit de l'industrie minière au Canada ? " s'indigne Jennifer Ricard Turcotte, Mères au front de Rouyn-Noranda.
Le livre Zones sacrifiées, en librairie le 4 février, est né de cette lutte qui dure depuis près de 3 ans et dans laquelle de nombreuses personnes préoccupées font tout en leur pouvoir pour que la qualité de l'air à Rouyn-Noranda s'améliore. Zones sacrifiées porte les voix multiples de ces citoyen·nes qui vivent l'innommable.
Plusieurs événements se tiendront prochainement à Gatineau, Montréal, Sherbrooke, Rouyn-Noranda, dont une performance devant l'Assemblée nationale le 20 février (présent·e·s : Anaïs Barbeau-Lavalette, Véronique Côté, Steve Gagnon, Jennifer Ricard Turcotte et Isabelle Fortin-Rondeau).
Source et à propos de Mères au front | meresaufront.org
Avec plus de 30 groupes locaux principalement à travers le Québec, Mères au front est un mouvement décentralisé qui regroupe des milliers de mères, grand-mères et allié·e·s de tous les horizons qui s'unissent pour protéger l'environnement dont dépend la santé, le bien-être et le futur de nos enfants.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Le mirage de TES Canada : une illusion coûteuse pour la Mauricie

En cet hiver, où le froid saisit autant qu'il émerveille, une menace plane toujours sur nos régions rurales : le projet TES Canada. Sous des airs de modernité et de transition énergétique, cette initiative s'apprête à transformer nos paysages en zones industrielles, bouleversant la qualité de vie, l'économie locale et l'équilibre environnemental.
Il est fascinant de constater avec quelle ferveur Michel Angers, maire de Shawinigan, compare le projet TES Canada aux grandes réalisations qui ont façonné le Québec moderne. Mais que reste-t-il de ces beaux discours lorsqu'on gratte la surface ? Un projet ancré dans des promesses illusoires, qui menace de transformer la Mauricie en une zone industrielle défigurée, sous prétexte de transition énergétique.
D'abord, rappelons que le projet TES Canada ne se limite pas à l'érection de quelque 140 méga éoliennes industrielles. Il s'agit d'une vaste entreprise de production d'hydrogène vert et de gaz naturel synthétique. Une industrie lourde qui s'implanterait en plein cœur de nos territoires et dans le parc industriel Alice-Asselin, à Shawinigan, avec un impact environnemental et social dont les promoteurs taisent l'ampleur réelle.
Les chiffres : un écran de fumée
Éric Gauthier et Jean-Benoît Courchesne, figures de proue de TES Canada, brandissent des chiffres mirobolants : 5,6 milliards de retombées économiques sur 23 ans, des milliers d'emplois, et des millions en redevances annuelles. Mais d'où viennent ces données ? Elles émanent directement des promoteurs eux-mêmes, sans audit indépendant. La firme Mallette, qui a produit l'analyse économique, l'a admis : si les données changent, les conclusions changent aussi. En d'autres termes, on demande à la population d'avaler ces chiffres sans poser de questions.
Et pendant ce temps, le maire Angers qualifie l'opposition de « minorité bruyante », balayant du revers de la main les préoccupations des citoyens et des municipalités voisines. Où est le débat démocratique lorsque les interventions citoyennes lors des conseils sont réduites à 30 minutes ?
Un coût social et environnemental inacceptable
Le véritable prix de TES Canada ne se mesure pas seulement en milliards de dollars, mais en hectares de terres agricoles sacrifiées, en écosystèmes détruits et en communautés déstabilisées. Avec 140 éoliennes géantes, des lignes de transport d'énergie, un parc solaire et une usine industrielle, la Mauricie sera méconnaissable.
Ce projet illustre parfaitement le « greenwashing » : un vernis écologique appliqué sur une entreprise qui repose en réalité sur des technologies énergivores et polluantes. Produire de l'hydrogène vert et du gaz synthétique à une échelle industrielle exige une quantité astronomique d'énergie et d'eau. Où est la durabilité dans cette équation ?
Les dangers pour nos terres et nos citoyens
En plus des impacts écologiques, TES Canada représente un risque concret pour les propriétaires et usagers des territoires avoisinants. Les projections de glace des éoliennes en hiver constituent un danger majeur pour les sentiers, les chemins de terre et les zones de circulation agricole. Ces blocs de glace projetés à grande vitesse menacent la sécurité des travailleurs, des résidents et des visiteurs des centres récréotouristiques et agrotouristiques.
De plus, la réciprocité joue en défaveur des citoyens : les propriétaires de terrains voisins aux installations éoliennes voient leur droit de jouissance de leur propriété considérablement réduit en plus du bruit, de l'ombre portée et de la nuisance visuelle. Bien qu'ils reçoivent une compensation monétaire, celle-ci est minime et sans commune mesure avec la perte d'usage réelle de leur bien ni avec l'occupation du territoire qui leur est imposée. Ils subissent ainsi les méfaits de ces infrastructures sans en retirer aucun bénéfice réel. TES Canada impose un sacrifice à plusieurs familles et exploitants, sans leur offrir de véritable contrepartie et sans qu'ils aient leur mot à dire.
Michel Angers : visionnaire ou opportuniste ?
Le maire Angers voit dans TES Canada une chance de redorer le blason d'un parc industriel qui peine à attirer des projets depuis sa création. Mais à quel prix ? Faire de la Mauricie un laboratoire d'expérimentation pour des multinationales avides de profits n'a rien d'une « pertinence sociale ».
En réalité, TES Canada n'est qu'un mirage. Derrière ses promesses attrayantes se cache une vérité bien plus sombre : l'exploitation de nos ressources naturelles au profit de quelques-uns, au détriment de notre qualité de vie, de notre territoire, de nos agriculteurs et des générations futures.
Michel Angers oublie que les grands projets qu'il évoque sont nés de la nationalisation de l'électricité, un pilier fondamental du Québec moderne. Or, TES Canada menace de plein front cet héritage en mettant nos ressources énergétiques entre les mains d'intérêts privés. René Lévesque et Adélard Godbout doivent se retourner dans leur tombe, car ce projet représente une attaque directe contre notre trésor public.
Une alternative est possible
Nous devons refuser cette vision réductrice de l'avenir de la Mauricie. Plutôt que de vendre nos terres aux multinationales, investissons dans des projets qui respectent nos écosystèmes, soutiennent nos communautés locales et favorisent une véritable transition énergétique.
Le débat sur TES Canada ne doit pas se limiter aux chiffres, mais inclure une réflexion sur ce que nous voulons pour notre région et notre planète. La Mauricie mérite mieux qu'un avenir fait de béton et de pales d'éoliennes. Elle mérite un avenir ancré dans le respect, la résilience et la durabilité.
Dany Janvier, citoyen de St-Adelphe
Contre la privatisation du vent et du soleil dans Mékinac Des Chenaux(CPVSMDC),
Toujours Maîtres Chez Nous(TMCN), RVÉQ
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Une grosse épine au pied pour Rio Tinto

En 1928, 2 ans après la fermeture des vannes du barrage d'îles Malignes à l'embouchure du Lac St-Jean qui avait élevé le niveau moyen d'une dizaine de pieds, la région connaît un printemps tardif suivi soudainement de chaleurs. Résultat, le Lac monte à un niveau jamais vu de mémoire d'humain.
À la demande de secours du maire de St-Méthode dont le village est entièrement inondé, le représentant d'Alcan répond : « Si voulez des secours, payez-vous en ! ». Pour Alcan, cette catastrophe est un « act of god". Bien sûr, il s'agissait d'un phénomène naturel mais est-ce que ce coup d'eau aurait eu le même effet sur un lac dix pieds plus bas ?
Poser la question, c'est y répondre.Quatre-vingt neuf ans plus tard au printemps 2017, la petite rivière Péribonka connaît une crue exceptionnelle. Depuis plusieurs années, les propriétaires de la Pointe Langevin a son embouchure constatent une érosion accélérée. Deux maisons ont été détruites, c'est bientôt le tour d'une autre et le reste (une vingtaine) voient une après l'autre leur valeur diminuée à 2 000$. Comme en 1928, Rio Tinto utilise le prétexte de « l'act of god" pour se déresponsabiliser de ce qui se passe.
Indépendamment de la crue exceptionnelle, comment ne pas voir que les problèmes à la Pointe Langevin sont directement liés au niveau élevé du lac (environ 10 pieds plus haut qu'avant 1926) ainsi qu'à la gestion du débit de la rivière Péribonka, particulièrement en hiver où il est environ le double d'avant la construction des barrages dans les années 60
Les problèmes autour de la Pointe sont en train de prendre des allures de gouffre sans fond, au sens propre comme au figuré. Au bout de la Pointe, la petite rivière Péribonka et la grande se rencontrent presque de plein fouet ce qui est en train de créer un gouffre au large qui, à terme va gruger l'ensemble de la Pointe. Le problème est même en train de s'étendre au village de Péribonka dont le quai a commencé à s'affaisser ainsi qu'une rue. Devant l'ampleur du problème, Rio Tinto a pris les jambes à son cou. Les autorités politiques quant à elles, regardent leurs souliers lorsque les propriétaires de la Pointe s'adressent à elles. Désespérés, ils en sont même venus à débourser 20 000$ de leurs poches pour financer une étude qui a confirmé leurs pires appréhensions.
L'ensemble du problème est éminemment politique. On a affaire à une multinationale qui jouit de la complicité active des autorités politiques et une population un peu trop habituée à se faire dire n'importe quoi.
Le monde a changé depuis 1926

Si Rio Tinto recycle les mêmes excuses imbuvables d'Alcan il y a cent ans, la conjoncture globale, elle, s'est considérablement transformée :
1- De générateur de richesse, la « puissance régnante » (entendre Alcan puis Rio Tinto) est passée au statut d'accro à l'aide publique. Les chiffres sont implacables : 12 000 emplois dans les années 60 et 2 700 aujourd'hui. Si on cumule l'avantage comparatif lié à la possession de leurs barrages, les exemptions d'impôt et le fait qu'ils sont exemptés d'amendes pour les GES, on arrive à une subvention publique de 1,2 milliard$ par année. Abusant de son pouvoir, Rio Tinto s'est même permis au cours des dernières décennies des congés de cotisation à la caisse de retraite de ses employé(e)s qui ont conduit à un manque à gagner de 2 milliards$ pour cette caisse. Aujourd'hui, les retraité(e)s syndiqué(e)s (plus de deux fois plus nombreux que les actifs) évaluent à plus de 30% leur perte de pouvoir d'achat. Plus pingre que jamais, Rio Tinto refuse de leur garantir le maintien de leur pouvoir d'achat… Accro à l'argent facile vous dites ? Rio Tinto a réalisé des profits de 11,8 milliards$ en 2023.
2- En 1926, lorsque le barrage d'îles Malignes a été inauguré, il y avait une certaine logique à utiliser le lac comme réservoir compte tenu du fait que l'électricité produite visait à alimenter des cuves d'électrolyse d'aluminium fonctionnant 24 heures sur 24 et ne souffrant aucun arrêt d'alimentation électrique. Aujourd'hui, avec 2 autres barrages sur le Saguenay et trois sur la rivière Péribonka, il n'y plus aucune raison de garder le lac à un tel niveau. Surtout que, contrairement à 1926, il ne manque pas d'alimentation électrique au Québec pouvant suppléer à un manque temporaire de production, ce qui n'était pas le cas en 1926. Et puis, comme rien ne se perd et rien ne se crée, un lac dix pieds plus bas fournira la même quantité d'eau au Saguenay.
3- C'est peu dire que le monde d'aujourd'hui est radicalement différent de celui d'autrefois. Au début du siècle passé, nous étions au début du développement industriel au Québec. Les gens voyaient la nature comme une ressource à exploiter sans limite. Au cours des dernières décennies, nous avons tou(te)s collectivement pris conscience que tout cela n'était qu'illusion et que nous devons radicalement changer notre façon de voir la nature. Plutôt que d'être une ressource qu'on exploite à l'infini, elle doit au contraire devenir une alliée qu'on respecte et conserve jalousement. Dans une telle optique, quel est le sens de maintenir un lac, de surcroît densément habité sur l'ensemble de ses rives, environ dix pieds plus haut que son niveau naturel alors que ses rives d'origine sont le résultat stable d'environ 10 000 ans d'histoire ? Là aussi, poser la question, c'est y répondre !
L'érosion accélérée de la Pointe Langevin est peut-être en train de devenir le Waterloo de Rio Tinto. Sa position est intenable parce que tout le monde sait que cette érosion est principalement liée au niveau élevé du lac et au débit élevé de la rivière Péribonka en hiver.
La base du problème est là. En se déresponsabilisant, Rio Tinto dit à la population de s'arranger avec le problème. Dans un certain sens, Rio Tinto a raison dans la mesure où la population était là avant Alcan et sera là après Rio Tinto. La souveraineté appartient au peuple ! À la population du Saguenay Lac Saint-Jean d'en tirer la conclusion en se prenant en main et en exerçant sa souveraineté.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Opposition autochtone et écologiste contre un projet de gazoduc en Colombie-Britannique

Le pipeline PRGT, autorisé il y a dix ans mais toujours pas construit, fait aujourd'hui face à des poursuites intentées par plusieurs communautés autochtones.
Plusieurs Premières Nations en Colombie-Britannique contestent le projet de gazoduc PRGT, estimant que le certificat d'évaluation environnementale et les accords qui datent de dix ans ne reflètent plus les engagements du gouvernement en matière de climat et de droits autochtones. Elles ont intenté des recours judiciaires contre le projet, ainsi que contre la Régie de l'énergie de la Colombie-Britannique, accusée d'avoir contourné ses propres exigences légales en autorisant le début des travaux.
23 janvier 2025 | tiré du site de Pivot | Illlustration : Arrière plan : Carte du tracé original du pipeline PRGT. Image : BCER et TC Energy. Montage : Pivot.
https://pivot.quebec/2025/01/23/opposition-autochtone-et-ecologiste-contre-un-projet-de-gazoduc-en-colombie-britannique/?vgo_ee=aIn3g6EcMQtgDxKewmhbPaLFZTco4tbjGl7Mpb1%2FY%2F4x%3AgwaRLNF7hWnA%2BbE60k9CgkF7vF8VUAtf
Depuis des mois, des membres de plusieurs Premières Nations dans le nord de la Colombie-Britannique, notamment les Gitanyow et les Gitxsans, ainsi que des groupes écologistes protestent fermement contre le gazoduc Prince Rupert Gas Transmission (PRGT), un pipeline de gaz naturel liquéfié de 900 kilomètres censé traverser leurs territoires, entre le nord-est de la province, lieu d'extraction du gaz, et un terminal d'exportation au nord-ouest, sur la côte.
Les communautés autochtones et les groupes écologistes soutiennent que le certificat d'évaluation environnementale du pipeline, approuvé il y a maintenant dix ans et qui arrive à échéance, ne doit pas être renouvelé. Ils ont déposé une poursuite contre PRGT et la Régie de l'énergie de la province, qui a autorisé le début des travaux de construction du gazoduc, ainsi qu'une autre poursuite contre le projet de terminal maritime qui doit accompagner le pipeline.
Ils estiment notamment que la production d'énergie fossile sous-tendue par ce projet mènerait la province à dépasser ses objectifs d'émissions de gaz à effet de serre (GES) et que le terminal pose un risque pour les saumons qui migrent dans le secteur.
Les Premières Nations rappellent aussi que les obligations des gouvernements en matière de consultations des peuples autochtones se sont accrues au cours de la dernière décennie et jugent donc que les consentements obtenus autrefois ne sont plus valables.
Gazoduc caduc ?
Ce projet de pipeline a été initié par TC Energy, la même compagnie qui a construit le pipeline controversé Coastal GasLink traversant le territoire Wet'suwet'en. Au printemps 2024, le projet PRGT a été vendu au gouvernement de la Première Nation Nisga'a et à Western LNG, une compagnie basée aux États-Unis.
En 2014, le gouvernement de la Colombie-Britannique avait accordé le certificat environnemental malgré la conclusion du Bureau d'évaluation environnementale selon laquelle le projet aurait des effets négatifs significatifs sur les caribous et les émissions de GES. Le certificat a ensuite été prolongé jusqu'au 25 novembre 2024.
Selon la Loi sur l'évaluation environnementale de la province, si la construction est « substantiellement démarrée » avant la date d'expiration du certificat, celui-ci peut être renouvelé indéfiniment sans nécessiter de nouvelles évaluations environnementales. Sinon, le certificat expire à la date prévue et le projet doit passer une nouvelle évaluation environnementale avant que toute activité de construction puisse reprendre.
« C'est une énorme faille qui permet de conserver le certificat indéfiniment sans jamais avoir à le mettre à jour. »
Tara Marsden, conseil des chefs héréditaires Gitanyow
En août 2024, des travaux de défrichage de l'emprise du pipeline ont débuté.
Les Gitanyow ont manifesté leur opposition en brûlant les accords qu'ils avaient signés il y a dix ans avec TC Energy et le gouvernement provincial et en installant des blocus le long de l'itinéraire prévu pour le pipeline.
Peu avant l'expiration du certificat, PRGT a soumis une demande au gouvernement de la Colombie-Britannique afin de déterminer si un « démarrage substantiel » de la construction avait eu lieu. Une décision de la ministre de l'Environnement de la province est attendue pour mars prochain.
En entrevue avec Pivot, Tara Marsden, directrice en durabilité du conseil des chefs héréditaires Gitanyow, indique qu'au cours des dix dernières années, PRGT n'a effectué que des travaux de défrichage, sur moins de 5 % de l'emprise du pipeline, pendant seulement deux mois et juste avant l'expiration du certificat d'évaluation environnementale.
Tara Marsden souligne que la détermination de démarrage substantiel « n'est pas un processus rigoureux ». En effet, « la législation à ce sujet ne précise pas la quantité de travail spécifique devant être accomplie pour qu'un démarrage soit considéré comme substantiel », explique-t-elle. « C'est très subjectif et considéré au cas par cas. Cela signifie qu'il s'agit d'une décision politique de ceux qui sont au pouvoir. »
« C'est une énorme faille qui permet de conserver le certificat indéfiniment sans jamais avoir à le mettre à jour », critique Tara Marsden.
Nouveaux défis environnementaux
« C'est très préoccupant, car nous avons un climat complètement différent en 2024 par rapport à 2014 », poursuit Tara Marsden.
« On a vu, très proches de notre communauté, des incendies de forêt majeurs », illustre-t-elle. « On a connu des sécheresses au moins quatre des dix dernières années, qui ont affecté la migration des saumons. On observe également davantage de maladies forestières causées par le changement du climat », énumère-t-elle.
De plus, PRGT a également demandé au Bureau d'évaluation environnementale de modifier le point d'aboutissement du pipeline pour qu'il débouche au terminal de Ksi Lisims. Ce projet de terminal flottant devant permettre de liquéfier et d'exporter douze millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par année est lui aussi porté par la Première Nation Nisga'a, Western LNG ainsi que Rockies LNG, et il est lui aussi contesté par plusieurs communautés.
En effet, les chefs héréditaires Gitanyow ont intenté, en octobre dernier, une action judiciaire contre Ksi Lisims devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique, dénonçant les menaces aux populations de saumons dans la rivière Nass, vitales pour les Gitanyow, et affirmant que leur peuple n'a pas été consulté de manière adéquate.
À cause d'une méfiance envers le processus d'évaluation environnementale mené par le gouvernement, les chefs héréditaires Gitanyow ont créé leur propre processus d'évaluation.
Les chefs ont évalué le projet de terminal en incluant des références aux émissions globales de GES du pipeline PRGT. « Nous avons constaté que l'ensemble des développements associés au pipeline, au terminal, à l'extraction de gaz et à l'hydroélectricité nécessaire pour alimenter le terminal va vraiment empêcher le gouvernement provincial d'atteindre ses objectifs de réduction des GES », affirme Tara Marsden.
Accords obsolètes
Les accords sur le pipeline PRGT ont été signés, il y a dix ans, par un mélange de conseils de bande et de chefs héréditaires des Premières Nations concernées.
Or, à l'époque, avant que la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones entre en vigueur en 2021, il n'y avait pas de reconnaissance officielle de la nécessité que les Autochtones offrent leur consentement libre, préalable et éclairé.
« Ces accords obsolètes ne reflètent pas le consentement libre, préalable et éclairé », affirme Tara Marsden. « On a dû se charger d'examiner les nouvelles informations, puis se demander si ce projet répond toujours à nos intérêts en 2024. »
« La nature de ces accords est si restrictive qu'on a dû attendre qu'ils expirent avec le certificat [d'évaluation environnementale en novembre dernier] et maintenant on est davantage en mesure de contester le projet légalement et publiquement. »
Tara Marsden déplore que l'adoption de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies n'a donné qu'une « impression de changement ».
« On ne devrait pas avoir à aller en cour ni à installer des blocus sur nos territoires pour que les gouvernements nous écoutent », dit-elle au sujet des luttes contre les pipelines PRGT et Coastal GasLink.
« C'est malheureusement ce qui se passe actuellement dans notre coin du monde. »
Le gouvernement donne le feu vert
Il ne serait pas possible pour PRGT de demander une détermination de « démarrage substantiel » des travaux si la Régie de l'énergie de la Colombie-Britannique (BCER) n'avait pas d'abord autorisé le début des travaux de défrichage.
Or, la BCER fait face, conjointement avec PRGT, à une poursuite intentée par la Skeena Watershed Conservation Coalition, Kispiox Valley Community Centre Association et la Bande de Kispiox (une communauté Gitxsan), qui l'accusent d'avoir contourné ses propres exigences légales à ce sujet.
« On ne devrait pas avoir à aller en cour ni à installer des blocus sur nos territoires pour que les gouvernements nous écoutent. »
Tara Marsden
En 2023, les permis émis par la BCER stipulaient que le titulaire ne devait pas commencer les travaux avant de recevoir une évaluation des effets cumulatifs du projet – c'est-à-dire non seulement des impacts directs du pipeline, mais aussi de la manière dont ils s'ajoutent aux impacts passés et futurs sur le territoire – réalisée par la Régie en consultation avec les nations autochtones concernées.
Le pipeline est divisé en sept sections. Cette condition était inscrite dans les permis pour chaque section.
Cependant, la BCER et PRGT ont scindé la section 5 en sections 5A et 5B. La section 5B traverse le territoire de la Première Nation Nisga'a, dont le gouvernement co-détient le pipeline. Par courriel, la BCER affirme que « cet amendement visait à répondre aux préoccupations des Nisga'as selon lesquelles certaines conditions du permis restreignaient leur droit d'utiliser leur territoire ».
Puis, la BCER a autorisé le début des travaux sur la section 5B en août 2024.
Au lieu d'effectuer sa propre évaluation des effets cumulatifs de l'ensemble du projet, en consultation avec d'autres Premières Nations situées sur l'itinéraire du pipeline, la BCER a compté sur les seules indications du gouvernement Nisga'a, qui a affirmé que l'évaluation des effets cumulatifs pour la section 5B avait déjà été réalisée à sa satisfaction dans le cadre des demandes de certificat d'évaluation environnementale pour le pipeline PRGT et pour le terminal de Ksi Lisims.
Par courriel, la BCER explique que « la condition relative aux effets cumulatifs s'applique au permis auquel elle est incluse et liée, comme toutes les autres conditions ». Autrement dit, selon la Régie, pour commencer les travaux sur la section 5B, il suffit de compléter l'évaluation pour cette section, plutôt que pour l'ensemble du projet.
La BCER ajoute que « les conditions pour les autres permis (sections), y compris l'exigence d'une évaluation des effets cumulatifs, n'ont pas été complétées pour le reste des sections ».
« Ils ont divisé le permis pour ne pas avoir à consulter les autres Premières Nations avant de commencer la construction », commente Tara Marsden. « Il s'agit d'une manœuvre très sournoise pour essayer de poursuivre leurs activités de construction, tout en étant conscients qu'il y a beaucoup d'opposition. »
Le Bureau d'évaluation environnementale de la Colombie-Britannique et la Première Nation Nisga'a n'ont pas répondu à nos demandes de commentaire au moment de publier.
Auteur·e
BIFAN SUN
Bifan Sun est journaliste spécialisée dans les enjeux de racisme et d'anti-racisme pour Pivot. Dans le cadre du projet « Différends : sur le terrain des luttes anti-racistes », soutenu par la Fondation canadienne des relations raciales, elle s'engage à faire entendre une pluralité de voix issues des communautés racisées sous-représentées dans la sphère médiatique francophone. Elle est titulaire d'une maîtrise en communication, pour laquelle elle a étudié la construction des récits de migration par un groupe de femmes migrantes marginalisées.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

La FIQ plaide pour un moratoire sur la coupe de 1,5 milliard $ dans le réseau de la santé

Québec, le 30 janvier 2025 — La Fédération Interprofessionnelle de la santé du Québec—FIQ accueille avec soulagement le changement de position du gouvernement du Québec, reconnaissant enfin l'impact réel des compressions sur l'offre et la qualité des soins.
Cependant, la FIQ considère que cette nouvelle approche ne va pas assez loin. La Fédération appelle le gouvernement à reporter immédiatement les coupes de 1,5 milliard $ prévues dans le budget de la santé, jusqu'à ce qu'une évaluation rigoureuse et approfondie des besoins réels du réseau de la santé et des services sociaux soit réalisée.
«
Le gouvernement doit reconnaître que les compressions budgétaires actuelles sont déjà en train de miner la qualité des services directs à la population. La situation devient critique : les équipes de soins sont insuffisantes, les patient-e-s souffrent des retards d'intervention et les établissements de santé sont à bout de souffle. Il est plus que jamais nécessaire de stopper les coupes et de permettre aux professionnelles en soins de travailler dans des conditions décentes
», indique Julie Bouchard, présidente de la FIQ.
Enfin le gouvernement réalise l'impact des compressions sur les services de soins. Toutefois, il est impératif de prendre des mesures concrètes pour soutenir les équipes de santé. La FIQ recommande que le réseau annule la directive de réduction du temps supplémentaire et permette à nouveau l'ouverture de lits additionnels, afin de maintenir une prise en charge adéquate des patient-e-s en fonction de la capacité des équipes de soins. La réalité des urgences et des listes d'attente en chirurgie ne peut plus être ignorée. L'ampleur de la crise nécessite que Santé Québec assure une couverture complète des équipes, qu'il s'agisse des soins à domicile, des soins hospitaliers, ou des services d'urgence.
Par ailleurs, la FIQ estime que l'une des pistes les plus urgentes pour améliorer la situation réside dans le renforcement de la première ligne de soins. Cela comprend un soutien accru aux soins à domicile, dont la réduction continue est inacceptable. « Nos aîné-e-s, personnes en situation de handicap et citoyen-ne-s vulnérables méritent un service de qualité. Une approche sérieuse en matière de soins à domicile permettrait de désengorger les urgences et d'offrir des alternatives aux hospitalisations évitables. En réinvestissant dans ces services publics, le gouvernement pourra non seulement améliorer la qualité de vie des citoyen-ne-s, mais également alléger la pression sur nos hôpitaux et améliorer le parcours de soins des patient-e-s », ajoute Mme Bouchard.
«
Nous ne devons pas céder à l'improvisation. Santé Québec doit prendre le temps de bien évaluer les besoins en ressources humaines et matérielles avant d'appliquer des coupes. Il est impératif de garantir que la trajectoire de soins ne soit pas affectée négativement. Chaque décision doit être prise en tenant compte de son impact sur la population, en particulier les plus vulnérables. Le gouvernement a un rôle crucial à jouer pour protéger le système de santé québécois. La FIQ en appelle à la responsabilité collective, notamment des décideur-euse-s politiques, afin de garantir que la santé des Québécois-e-s ne soit pas sacrifiée au nom de l'austérité. La FIQ demeure disponible pour collaborer avec Santé Québec dès maintenant
», conclut Julie Bouchard.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Le gouvernement doit retirer ses exigences de compressions et protéger le financement du réseau public

Alors que les témoignages d'usager·ère·s et de personnes salariées affecté·e·s par les compressions budgétaires se multiplient, le ministre de la Santé, Christian Dubé, commençait à lever le pied aujourd'hui sur les exigences imposées à Santé Québec. Pour l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), ce revirement partiel ne suffit pas. Le gouvernement doit retirer complètement ses demandes de compressions et garantir un financement stable et prévisible pour répondre aux besoins de la population.
« Le ministre Dubé prend acte des conséquences bien réelles de ces compressions, mais il continue d'exiger des réductions budgétaires qui mettent en péril les soins et services essentiels, dénonce Robert Comeau, président de l'APTS. Si le gouvernement veut réellement protéger le réseau public, il doit cesser d'imposer des choix financiers qui nuisent aux usager·ère·s et au personnel. Un budget, ça a deux colonnes : d'un côté, les dépenses, de l'autre, les revenus. Et si on réduit sans assurer un financement adéquat, c'est la population qui en paie le prix. »
Les effets des compressions sont déjà visibles, notamment en soins à domicile, où des usager·ère·s vulnérables voient leurs services réduits, mais également en santé mentale ou encore en imagerie médicale. L'APTS craint également des impacts majeurs sur d'autres secteurs du réseau, où le personnel espérait des renforts et non de nouvelles restrictions budgétaires.
« Nous devons briser ce cercle vicieux où les compressions affaiblissent le réseau, forcent le recours au privé et justifient ensuite d'autres réductions, ajoute Robert Comeau. C'est pourquoi l'APTS propose la mise en place d'un bouclier budgétaire qui assurerait un financement minimal du réseau public, à la hauteur des besoins réels de la population, et garantirait ainsi un réseau public de santé et de services sociaux sain et efficace. »
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :












