Presse-toi à gauche !
Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Jordanie – Égypte. Quand la chaîne Al-Jazira allume le feu

La couverture ambiguë faite par la chaîne qatarie Al-Jazira de la rencontre, le 11 février 2025, entre le roi Abdallah II de Jordanie et le président étatsunien Donald Trump, a provoqué de nombreuses réactions de colère dans le royaume hachémite et une montée de tensions avec une partie de l'opinion publique égyptienne, révélant la permanence de vieilles rancœurs passées.
Tiré d'Orient XXI.
Si le contexte de la guerre génocidaire à Gaza a creusé un fossé entre les populations des pays arabes et les gouvernements occidentaux, il a également réactivé des rancœurs passées entre pays arabes. La couverture pour le moins maladroite par Al-Jazira de la rencontre entre le roi Abdallah II de Jordanie et le président étatsunien Donald Trump l'a bien montré. Moins de dix jours après son investiture pour un second mandat, ce dernier a présenté son projet de nettoyage ethnique par la déportation des habitants de Gaza vers l'Égypte et la Jordanie. Les ministres des affaires étrangères de l'Égypte, de la Jordanie, des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite, du Qatar, un représentant de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) et le secrétaire général de la Ligue arabe y ont réagi dans un communiqué en date du 1er février 2025. Ils y refusaient catégoriquement « l'idée de déporter les Palestiniens de leur terre sous quelque circonstance que ce soit. »
Le Caire et Amman étant concernés en première ligne, une coordination égypto-jordanienne s'est traduite par la visite du prince héritier jordanien Hussein chez le président égyptien Abdelfattah Al-Sissi, le 16 février 2025. Le communiqué du palais royal jordanien qui s'en est suivi a souligné la nécessité de reconstruire la bande de Gaza « sans déporter le peuple palestinien frère ».
Suite au communiqué conjoint du 1er février, la Maison Blanche a invité le roi jordanien ainsi que le président égyptien à Washington. Si le palais royal a répondu présent, l'Égypte a fini par refuser l'invitation après la rencontre du président étatsunien et du roi Abdallah II, le 11 février.
Des « alertes » décontextualisées
Durant la rencontre avec le président étatsunien, en présence de la presse, le souverain jordanien a exprimé sa confiance en la capacité de Trump d'« instaurer la paix au Proche-Orient ». Cependant, il a évité de répondre aux attentes des États-Unis concernant l'accueil d'une partie des Palestiniens déportés. Lorsque Trump a fini par poser lui-même la question au roi, celui-ci a rappelé que toute décision s'appuiera sur un plan arabe commun avec l'Égypte et l'Arabie saoudite.
La chaîne qatarie Al-Jazira n'a pas retransmis cette rencontre en direct, mais en a rendu compte au fur et à mesure, à travers des bandeaux signalant les titres urgents. Voici la liste des alertes dans l'ordre où elles ont été diffusées :
- Trump : « Ce qui sera proposé sera extraordinaire pour les Palestiniens. Je connais bien le domaine immobilier et je pense que les Palestiniens apprécieront ce qu'on leur proposera. »
- Le roi de Jordanie : « Nous discuterons en Arabie saoudite comment travailler avec les États-Unis sur Gaza. Il y aura des réactions internationales. »
- Le roi de Jordanie : « Ce que nous pouvons faire immédiatement, c'est accueillir 2 000 enfants malades de Gaza. Nous attendons que l'Égypte présente de son côté un plan. »
- Le roi de Jordanie concernant l'accueil de Palestiniens : « Il faut prendre en compte la manière de faire cela de sorte à servir les intérêts de tous. »
- Le roi de Jordanie concernant la disponibilité d'une terre où les Palestiniens pourraient s'installer : « Je dois faire ce qui est dans l'intérêt de mon pays. »
Sorties de leur contexte, ces citations, émanant de dépêches de l'agence Reuters, ont donné l'impression que le roi Abdallah II acceptait le plan de Trump, et qu'il comptait accueillir les Palestiniens en Jordanie.
Or, à aucun moment, le roi n'a émis le moindre consentement quant à ce plan. Il a seulement déclaré que tout ce que son pays pouvait faire dans l'immédiat, c'était d'accueillir 2 000 enfants gazaouis atteints de cancer ou dont l'état de santé était particulièrement dégradé. Une initiative que le président étatsunien a qualifiée de « belle » en affirmant qu'il venait d'en apprendre l'existence. Ensuite, Abdallah II n'a pas parlé de la troisième minute de la conférence de presse à la huitième minute. Il n'a repris la parole que lorsqu'un journaliste lui a demandé son avis sur le souhait des États-Unis de contrôler Gaza. Évitant de répondre directement à la question, il a plutôt réaffirmé qu'il fallait attendre que l'Égypte présente son plan et ne pas précipiter les choses.
Lorsque le journaliste a de nouveau demandé au roi si des terres jordaniennes seraient allouées pour accueillir les Gazaouis, celui-ci a répondu qu'il devait penser en priorité à l'intérêt de son pays. Il a ajouté que le président étatsunien appréciait la décision jordanienne d'accueillir les 2 000 enfants. Cette dernière proposition s'est avérée bien pratique pour permettre au souverain jordanien de ne pas se prononcer sur des plans futurs ni de consentir au projet des États-Unis.
Vague de colère à Amman et au Caire
Comme dans le reste du monde arabe, la chaîne Al-Jazira est l'une des chaînes d'information continue les plus suivies en Jordanie. Elle l'est d'autant plus depuis le 7 octobre, grâce à sa couverture de la guerre génocidaire à Gaza rendue possible par un large réseau de correspondants dans la bande de Gaza et en Cisjordanie.
Mais la manière dont elle a rendu compte de la rencontre entre les dirigeants jordanien et étatsunien a mis le feu aux poudres en Jordanie. Certains étaient en colère, pensant que le roi avait consenti à « vendre Gaza » et « trahir la cause [palestinienne] ». D'autres en voulaient à la chaîne qatarie, l'accusant de « ternir l'image de la Jordanie » et de son roi en « diffusant de fausses informations ». Enfin, les soutiens du gouvernement jordanien ont rappelé que les intérêts de la Jordanie passaient avant tout.
Dans la même soirée, le ministre jordanien des affaires étrangères Ahmed Safadi est intervenu sur plusieurs chaînes de la télévision pour clarifier les déclarations du roi et lever le quiproquo. Il a souligné que le roi n'a, à aucun moment, émis d'accord sur le plan de Trump de déporter les habitants de Gaza.
Mais les réactions ne se sont pas limitées à la Jordanie. Les réseaux sociaux égyptiens se sont enflammés à leur tour, accusant le roi d'avoir « vendu » Gaza. Ils reprochaient aussi à la Jordanie de se mettre en retrait pour laisser l'Égypte assumer toute la responsabilité, jugeant par ailleurs la présence et les déclarations d'Abdallah II « plutôt faibles ». Des internautes ont même mobilisé l'histoire, rappelant comment la famille royale hachémite s'est retrouvée à la tête du royaume, ou encore les critiques acerbes du président Gamal Abdel Nasser à l'encontre du défunt roi Hussein, père de Abdallah II (1). Une bataille s'est enclenchée sur les réseaux sociaux entre Égyptiens et Jordaniens. Ces derniers défendaient la position du roi, arguant que ce dernier avait su éviter les pièges qui lui avaient été tendus par Washington. Ils sont allés jusqu'à accuser les Frères musulmans, qui jouissent depuis septembre 2024 d'une majorité relative au Parlement, d'alimenter ces critiques.
Intervention de la Maison Blanche
Voulant calmer le jeu, la porte-parole de la Maison Blanche Karoline Leavitt a tenu une conférence de presse le lendemain. Elle a confirmé que le roi Abdallah II a formellement refusé la proposition de président Trump, ce qui a mis fin à tout débat autour de la déportation des Palestiniens. Quelques heures après ces déclarations, la Maison Blanche a publié un message d'une quarantaine de secondes remerciant le roi Abdallah II et son peuple, suite à sa visite.
Le secrétaire d'État aux affaires étrangères Marco Rubio a déclaré deux jours plus tard que « pour le moment, le seul plan — bien qu'il ne plaise pas [aux pays arabes] — est celui proposé par Trump. S'ils ont une meilleure proposition, il est temps de la présenter. » Une proposition jordano-égyptienne, ainsi que la visite de Sissi à Washington, est prévue dans la foulée du sommet urgent de la Ligue arabe, qui se tiendra le 4 mars, convoqué par le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salmane.
Rubio a également déclaré : « Tous ces pays accordent une grande attention aux Palestiniens, mais aucun d'entre eux ne veut les accueillir, et, historiquement, aucun d'eux n'a rien fait pour Gaza. » Ainsi, le responsable de la politique étrangère étatsunien ne semble pas au courant qu'une grande partie du peuple jordanien est d'origine palestinienne ni que la Syrie et le Liban accueillent déjà, depuis plusieurs décennies, des réfugiés palestiniens.
À cause de cette polémique, des voix ont appelé sur les réseaux sociaux en Jordanie à boycotter Al-Jazira. Ce n'est pas la première fois que la chaîne qatarie fait l'objet de tels appels. Au-delà de l'actualité extrêmement tendue, les conséquences de sa couverture décontextualisée montrent la permanence de vieilles rancœurs arabes, que seul peut contrebalancer l'attachement des populations arabes à la question palestinienne.
Notes
1- NDLR. Les deux dirigeants entretenaient des relations assez exécrables, Nasser accusant le roi jordanien d'être l'allié de l'impérialisme britannique, tandis que Hussein se sentait menacé par le panarabisme prôné par Nasser. Il arrivait alors souvent à ce dernier de traiter le monarque de tous les noms d'oiseaux lors de ses discours.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Palestine, la censure frappe fort

Sur Instagram, chaque publication est une arme de mobilisation ou une cible de censure. Une image, un mot, un hashtag peuvent éveiller des millions de consciences ou disparaître en un instant. Pour les militant.es pro-Palestine, la plateforme est un terrain de lutte où chaque publication est un acte de résistance, chaque bannissement une tentative de les faire taire. Samar Alkhdour, en première ligne de cette bataille numérique, raconte comment son combat solitaire est devenu un mouvement collectif, malgré la répression orchestrée par les géants du web.
Tiré d'alter.quebec
Militantisme digital
À l'ère du numérique, le militantisme s'impose sur les réseaux sociaux, redéfinissant la défense des causes sociales. Publications virales, mots-dièse percutants, pétitions en ligne, chaque action peut exploser en un instant. Portée par une génération de « webmilitantisme » engagé et réactif, cette dynamique fait des plateformes numériques des leviers essentiels de sensibilisation et de mobilisation. Néanmoins, leur combat n'est pas sans contraintes.
Dans le contexte du génocide palestinien, ces activistes sont à la fois des armes de résistance, mais peuvent aussi être manipulé.es à des fins de désinformation. Les entreprises technologiques jouent désormais un rôle actif dans l'exclusion des voix palestiniennes, amplifiant ainsi l'effort systématique pour les réduire au silence. Utilisée pour détourner l'attention, semer la confusion et atténuer l'indignation publique, l'action de résistance numérique est devenue une cible et un terrain propre à la propagation de fausses informations.
L'exemple le plus marquant reste la rumeur des « 40 bébés décapités ». Relayée sans la moindre preuve par des médias influents comme CNN, des responsables politiques et même par le président Biden, elle fut discrètement démentie.
De plus, cette désinformation a des conséquences par ses incitations à la haine. Wadea Al-Fayoume, un enfant palestino-américain de six ans, a été poignardé à 26 reprises. Il fut reconnu que ce crime fut nourri par un climat d'hostilités, attisé par la couverture médiatique occidentale depuis le 7 octobre, en particulier par les discours incendiaires relayés sur les ondes des radios conservatrices.
Le combat de Samar Alkhdour : à armes inégales et à géométrie variable
Face au révisionnisme historique qui tente de déformer les faits, les mouvements pro-Palestine redoublent de créativité pour faire entendre la vérité. Samar Alkhdour en est une. Mère montréalaise d'origine palestinienne, elle mène ce combat avec une intensité particulière. Sa fille, Jana, s'est éteinte à Gaza, affaiblie par une grave malnutrition, et ce dans l'attente d'une décision d'Ottawa. Un drame qui renforce encore sa détermination.

Militante passionnée, elle allie activisme numérique et action sur le terrain, pour dénoncer la censure systématique et la désinformation qui entourent la cause palestinienne, déterminée à briser le silence imposé par les grandes plateformes et les médias dominants.
Elle témoigne des restrictions croissantes qu'elle subit sur Instagram, où elle a été bannie des directs et empêchée de collaborer avec d'autres comptes. Meta supprime aussi certaines de ses publications éphémères (Stories) sans avertissement, une censure accentuée par des biais algorithmiques qui ciblent disproportionnellement les contenus pro-Palestine. Comme l'a illustré l'erreur de traduction de Meta en octobre 2023, où le mot « terroriste » a été ajouté à des profils mentionnant « Palestinien » et « Alhamdulillah ».
Ces entraves illustrent les difficultés grandissantes auxquelles sont confrontés les mouvements militants sur les réseaux sociaux, où l'usage de certains mots jugés « sensibles » ou « antisémites » entraîne une censure automatique. « Plus je publie sur la Palestine, plus le bannissement furtif s'intensifie », déplore-t-elle, soulignant l'impact direct de ces restrictions sur la diffusion de l'information. Imposant alors une asymétrie entre le discours dominant et les voix dissidentes.
Cette potentielle censure pousse les militantes et militants à s'adapter pour poursuivre leur engagement dans la lutte numérique contre Israël. S'efforçant de trouver des failles aux interdictions répétées de diffusion directe sur Instagram, Samar mise désormais sur d'autres formats, comme les Reels et les publications classiques.
Elle sollicite également des pages et des proches disposant d'une large audience pour relayer son contenu. Récemment, elle a découvert qu'en « remixant » un Reel, elle pouvait le publier sur son compte sans qu'il soit bloqué, une astuce qui lui permet de contourner l'interdiction de collaboration imposée par la plateforme.
Le virtuel rallume la flamme de l'action
Malgré ces obstacles, Samar affirme que les réseaux sociaux restent tout de même un outil incontournable. Offrant une audience sans limites, Instagram joue un rôle essentiel dans la diffusion d'informations en temps réel. Son sit-in (pour dénoncer l'inaction du gouvernement canadien concernant l'accueil des personnes réfugiées palestiniennes) n'aurait jamais été entendu sans les réseaux sociaux, confie-t-elle. « Ce qui était un acte solitaire est devenu un mouvement collectif. »
Cette influence grandissante est la raison même de ce muselage et elle a un prix : la désensibilisation du public. C'est pour cette raison que les deux formes de militantisme, numérique et physique, sont essentielles et complémentaires. L'un nourrit l'autre et les maintient en mouvement.
Le défi actuel réside dans le fait que l'engagement militant cesse dès qu'on quitte le réseau social. À elles seules, les campagnes en ligne peinent à influencer les décisions politiques ou économiques, mais lorsqu'elles s'articulent avec des actions sur le terrain, leur portée s'amplifie. Pour celles et ceux qui ne peuvent pas manifester physiquement, les réseaux sociaux restent souvent le seul moyen de soutenir la cause palestinienne et de faire entendre leur voix.
Soutenez Samar et sa famille : contribuez à sa campagne de socio-financement sur GoFundMe
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les antinomies de la guerre russo-ukrainienne et ses défis pour la théorie féministe

Lorsque l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie a commencé le 24 février 2022, les féministes de différentes parties du monde n'ont pas gardé le silence : elles ont immédiatement condamné l'agression russe et déclaré leur solidarité avec l'Ukraine.
Tiré de Entre les lignes et les mots
Il y a eu à la fois des déclarations individuelles et des manifestes collectifs signés par des centaines de militantes et de chercheuses féministes. Ces déclarations ont été suivies par de nombreuses actions collectives anti-guerre, des piquets de grève et des conférences internationales en soutien à l'Ukraine et aux féministes ukrainiennes, auxquelles ont participé des féministes du monde entier. Les féministes transnationales sont devenues une partie importante du mouvement de bénévoles en soutien aux émigrants des régions menacées d'Ukraine. Et en regardant rétrospectivement les événements du printemps 2022, nous pouvons dire qu'une mobilisation féministe anti-militariste véritablement massive a eu lieu.
Pourtant, au sein de cette mobilisation féministe internationale, des désaccords considérables sont rapidement apparus entre les féministes de différentes parties du monde, et surtout entre les féministes ukrainiennes et d'Europe de l'Est d'une part, et un certain nombre de féministes d'Europe occidentale et d'autres pays occidentaux d'autre part. Ces désaccords portaient sur la manière d'arrêter la guerre russo-ukrainienne et sur les stratégies de résistance au militarisme appropriées et efficaces pour les féministes aujourd'hui.
Les questions les plus contestées dans la communauté féministe internationale étaient (a) les stratégies féministes de résistance non-violente à la violence militariste et (b) les critiques féministes du complexe militaro-industriel occidental et des politiques militaristes correspondantes de l'OTAN. Lorsque le « Manifeste de la Résistance Féministe Contre la Guerre » a été publié en mars 2022, les auteures ont déclaré qu'elles « condamnent profondément l'invasion militaire menée par le régime de Poutine en Ukraine », mais ont en même temps condamné le rôle de l'OTAN dans le conflit, qui, selon les auteures, « est co-responsable de la situation créée par son expansionnisme mondial et son discours sécuritaire militariste » et donc elles « rejettent les décisions qui impliquent d'ajouter plus d'armes au conflit et d'augmenter les budgets de guerre » [1].
Peu après, un groupe de féministes ukrainiennes associées à la ressource socialiste ukrainienne Commons a vu dans cette position une manifestation de pacifisme abstrait et une ignorance du contexte politique et culturel ukrainien, accusant les auteures et les signataires du « Manifeste de la Résistance Féministe Contre la Guerre » de « nier aux femmes ukrainiennes ce droit à la résistance, qui constitue un acte fondamental d'autodéfense des opprimés » et de montrer une attention insuffisante « aux voix de celles directement touchées par l'agression impérialiste »[2].
Comme l'a écrit Tamara Zlobina, l'organisatrice de la ressource féministe ukrainienne « Gender in Detail » à propos du manifeste susmentionné et de déclarations similaires : « Aucune des 'sœurs' n'a pensé à consulter les féministes ukrainiennes lors de la rédaction de ces appels (et là où les Ukrainiennes ont accidentellement lu ces textes avant leur publication et les ont critiqués, leurs voix ont été simplement ignorées) » [3].
Certaines féministes occidentales qui ont adopté une position pacifiste concernant la guerre russo-ukrainienne ont exigé l'arrêt de la fourniture d'armes à l'Ukraine. Cette position a été condamnée par plusieurs chercheuses féministes d'Ukraine et d'Europe de l'Est comme « occidentalisée » ou une sorte de « westplaining » analogiquement au mansplaining [4]. En fait, certaines féministes ukrainiennes et d'Europe de l'Est caractérisent même ce « westplaining » comme colonial et une forme d'impérialisme épistémique, c'est-à-dire « l'hubris de croire que ce que l'on sait ou étudie d'un point de vue privilégié, comme au sein de l'académie anglophone, peut être exporté en bloc vers des contextes dont on ne sait peu ou rien » [5].
La plupart des féministes ukrainiennes sont également en profond désaccord avec la critique féministe occidentale de l'idéologie et de la politique du nationalisme comme patriarcal, misogyne et militariste. Plus précisément, les féministes ukrainiennes soutiennent qu'une telle évaluation critique de l'idéologie et du nationalisme n'est vraie que pour l'idéologie et le nationalisme des pays colonialistes et leur « nationalisme impérial », mais qu'elle ne convient pas au nationalisme des peuples colonisés qui s'appuient sur la politique du nationalisme dans leur juste lutte pour leur indépendance nationale et qui ont donc le droit d'affirmer leur « nationalisme émancipateur » [6].
Comme l'a écrit Anna Dovgopol, militante féministe ukrainienne et coordinatrice du programme Genre au Bureau de Kiev de la Fondation Heinrich Boell, en réponse aux appels à une solidarité féministe non pas nationaliste mais transnationale avec les féministes ukrainiennes : « Il est temps pour l'Occident d'enlever sa blouse blanche et d'écouter le 'monde en développement'. Et de prendre le temps de réfléchir pourquoi eux, en tant qu'Occidentaux, ont le privilège de dénoncer le nationalisme » [7].
Cela dit, les féministes ukrainiennes, y compris celles qui se positionnaient comme pacifistes, ont conclu qu'il est nécessaire de repenser le concept de militarisme dans le contexte du besoin de l'Ukraine d'une résistance armée contre l'agression russe [8]. Le féminisme ukrainien aujourd'hui, avec sa réévaluation du militarisme, est défini comme ce que « les femmes font dans l'armée ukrainienne » [9] lorsque votre pays est confronté à une guerre comprise dans le sens d'une guerre existentielle ou totale.
La notion de guerre totale signifie que le conflit s'étend également à la sphère de la culture. C'est pourquoi les féministes ukrainiennes refusent en règle générale de coopérer avec les féministes et les représentants culturels des « pays agresseurs » (Russie et Biélorussie) et refusent de participer aux réunions et actions communes, même si elles sont organisées pour soutenir l'Ukraine et que tous leurs participants sont des dissidents de leurs régimes autoritaires [10]. En fait, de nombreuses féministes ukrainiennes considèrent toute déclaration publique des féministes russes sur la situation en Ukraine, même celles condamnant l'agression russe en Ukraine et exprimant leur soutien aux opprimés, comme inacceptable, car leur discours est le discours des oppresseurs et « dilue les voix ukrainiennes, les rendant vagues et incompréhensibles » [11].
Comme il s'est avéré, de nombreuses féministes occidentales n'avaient pas anticipé une critique aussi acerbe et une compréhension aussi nationalement marquée de l'anti-militarisme et de la solidarité féministe. En fait, une réunion en ligne « Solidarité Féministe Transnationale avec les Féministes Ukrainiennes » organisée par Judith Butler, Sabine Hark et moi-même le 9 mai 2022 a mis en lumière un certain nombre de désaccords significatifs entre les féministes transnationales dans le contexte de la guerre russo-ukrainienne, notamment : (a) des désaccords dus à la division Est-Ouest, menés par des participantes représentant l'Europe centrale et orientale ; (b) des désaccords entre une éthique féministe de non-violence et des arguments féministes en défense des discours et pratiques de violence et de vengeance des femmes ; et (c) des désaccords entre transnationalisme et nationalisme [12]. Comme le déclare Hark, cette guerre « remet en question les certitudes féministes, pacifistes et de gauche » et exige de se reposer la question « qu'est-ce que la solidarité transnationale, féministe et réparatrice en temps de guerre ? » Et elle demande ensuite, « si le pacifisme a manifestement échoué, cela signifie-t-il que la solidarité devrait maintenant être militariste ? Et orientée nationalement ? » [13].
La Philosophie Occidentale sur les Antinomies de la Guerre Russo-Ukrainienne
Les désaccords au sein des études féministes esquissés ci-dessus ressemblent à ce que le regretté Jacques Derrida appelait une situation d'indécidabilité, où aucun choix rationnel et éthique n'est possible ou où le choix n'est possible que sous la forme d'un choix forcé paradoxal. L'indécidabilité dans le contexte de la guerre russo-ukrainienne ne se limitait pas aux seules chercheuses féministes. Certains philosophes politiques contemporains qui réfléchissaient à l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie ont également formulé leurs déclarations sur la guerre en termes d'antinomies indécidables, que l'on peut appeler les antinomies de la guerre.
Jürgen Habermas, par exemple, a formulé ainsi la situation d'antinomies indécidables à laquelle la civilisation occidentale était confrontée à la lumière de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie :
L'Ukraine ne doit pas perdre. Cela est dû au fait que « si les alliés abandonnaient simplement l'Ukraine à son sort, ce ne serait pas seulement un scandale d'un point de vue politico-moral, ce serait aussi contraire aux intérêts de l'Occident » [14].
Poutine ne doit pas perdre. Poutine ne peut pas être acculé, car alors il pourra lancer une frappe nucléaire non seulement sur l'Ukraine mais aussi sur les pays de l'OTAN. Par conséquent, la défaite de Poutine signifie une guerre nucléaire mondiale et la mort de toute l'humanité [15].
De même, et de manière quelque peu surprenante, le critique constant d'Habermas, Slavoj Zizek, croyait que la guerre russo-ukrainienne impliquait la terreur de l'indécidabilité ou un choix forcé :
Nous sommes confrontés à un choix impossible : si nous faisons des compromis pour maintenir la paix, nous alimentons l'expansionnisme russe, que seule une « démilitarisation » de toute l'Europe satisfera. Mais si nous approuvons une confrontation totale, nous courons le risque élevé de précipiter une nouvelle guerre mondiale [16].
Ainsi, selon Habermas et Zizek, la situation politique de la guerre russo-ukrainienne s'apparente à une impasse indécidable, comme les antinomies de Kant. Mais les philosophes contemporains, contrairement à Kant, n'ont pas abandonné face à ces antinomies et ont continué à proposer diverses options pour surmonter les indécidabilités de la guerre russo-ukrainienne.
Parmi eux se trouve le célèbre critique du militarisme et pacifiste Noam Chomsky, qui pense que les Ukrainiens et le reste du monde devraient accepter les exigences de Poutine, puisque « nous avons stupidement manqué l'occasion d'influencer Poutine en temps de paix » et, en réprimant leurs sentiments d'indignation envers le criminel de guerre Poutine, se résigner à la triste réalité que c'est le seul moyen d'éviter la Troisième Guerre mondiale [17]. Bien que cette évaluation puisse sembler extrême, la position de Chomsky est en fait proche de celle d'Habermas, qui propose une stratégie plus sophistiquée pour confronter le régime de Poutine, qu'il appelle une « approche équilibrée éclairée et [qui implique] une pesée des risques » [18].
Selon Habermas, c'est précisément la stratégie que poursuit le chancelier allemand Olaf Scholz lorsqu'il insiste sur un exercice d'équilibre politiquement justifié entre la défaite de l'Ukraine et l'escalade d'un conflit limité en Troisième Guerre mondiale : l'Ukraine ne doit pas perdre, mais nous devons soigneusement peser chaque étape du soutien militaire, pour empêcher Poutine d'agir comme si l'Allemagne et d'autres pays de l'OTAN étaient officiellement entrés en guerre [19]. Dans ses publications ultérieures, Habermas continue de développer cette idée, proposant de chercher une solution à l'antinomie de la guerre en Ukraine via des négociations qui permettraient de trouver un compromis qui sauvera la face des deux côtés malgré leurs exigences diamétralement opposées [20]. Est-ce cette stratégie de négociation et de règlement que les féministes préconisant les stratégies de non-violence devraient rechercher ?
Les féministes ukrainiennes de gauche associées à la ressource socialiste Commons sont plus attirées par la position d'Etienne Balibar qui, contrairement à la position prudente et compromettante d'Habermas, choisit une stratégie plus ouverte et courageuse. Balibar n'a aucune illusion sur la perspective de pacifier Poutine par la négociation. « On peut être plus pessimiste sur les perspectives futures : on peut dire que les chances d'éviter une catastrophe sont minces » [21]. Ainsi, le devoir de l'intellectuel, selon Balibar, est de prendre une position sans équivoque dans cette situation tragique d'indécidabilité, qui porte la menace d'une guerre nucléaire mondiale et de la destruction de l'humanité. Et Balibar fait effectivement un choix politique sans équivoque : « Je dirai que la guerre des Ukrainiens contre l'invasion russe est juste, au sens le plus fort de ce mot. … Je ne me sens pas enthousiaste, mais je fais mon choix : contre Poutine » [22]
Comme Balibar, Žižek estime que le devoir de tout intellectuel aujourd'hui est de soutenir inconditionnellement la résistance du peuple ukrainien à l'invasion de Poutine et d'abandonner toute politique de « compréhension » et d'« apaisement » de l'agresseur [23]. Cet apaisement, pour Žižek, prend même une forme financière dans la mesure où l'Occident continue de vivre selon les lois du marché capitaliste, apportant chaque jour des revenus colossaux à l'État russe par la vente de pétrole et de gaz [24].
Afin de ralentir la catastrophe mondiale imminente tout en soutenant simultanément l'Ukraine, Žižek estime que les gouvernements occidentaux doivent : (a) abandonner les politiques de « dialogue équilibré » avec Poutine proposées par Habermas, car une prudence excessive ne peut qu'encourager l'agresseur (il ne faut pas avoir peur de franchir la ligne où Poutine « se mettrait en colère » et plutôt montrer à Poutine ses propres lignes rouges claires) ; (b) cesser immédiatement de faire des affaires avec la Russie de Poutine et arrêter de s'appuyer sur les mécanismes du marché pour s'engager directement dans l'organisation de ses propres approvisionnements énergétiques ; et (c) renforcer l'alliance de l'OTAN [25].
Ainsi, on peut affirmer que les positions des philosophes radicaux de gauche, tels que Balibar et Žižek, dans l'évaluation de la situation en Ukraine coïncident avec la position des féministes ukrainiennes qui estiment que la seule façon juste et efficace de résister à l'agression russe est de soutenir la guerre défensive de l'Ukraine avec des armes occidentales. Pourtant, Balibar et Žižek semblent plus proches des féministes transnationales dans la mesure où ils ne sont pas enclins à identifier tous les citoyens russes au régime de Poutine et où ils estiment qu'une véritable victoire ukrainienne n'est possible que sur la base de la construction de larges alliances anti-Poutine, y compris des alliances avec les représentants de toutes les forces opposées à Poutine en Russie et en Biélorussie.
Le fait qu'en Ukraine les politiciens aient abandonné la stratégie des larges alliances anti-Poutine, s'appuyant exclusivement sur leurs alliés occidentaux et réprimant la gauche dans leur pays, est, selon Žižek, fondamentalement erroné et devient le facteur décisif qui fait qu'aujourd'hui, plus de deux ans après le début de l'invasion russe, la résistance ukrainienne à la dictature de Poutine est plus éloignée d'une conclusion victorieuse [26]. De plus, selon Žižek, le pari sur le nationalisme et le rejet de la solidarité avec tous les opposants à la dictature de Poutine, y compris les dissidents russes, peut conduire au fait qu'après la fin de la guerre, l'Ukraine pourrait se retrouver dans une dépendance coloniale encore plus grande vis-à-vis des sociétés occidentales, et, par conséquent, même si l'Ukraine gagne la guerre, ce ne serait pas le peuple ukrainien, mais la clique nationale des oligarques qui pourrait être victorieuse [27].
Leçons féministes de la guerre russo-ukrainienne
Malgré les divisions entre les théoriciennes féministes et les antinomies de la guerre discutées ci-dessus, le point de vue dominant de la théorie et de la pratique féministes concernant la guerre a été et reste l'anti-militarisme. Cynthia Enloe, dans son livre Feminist Lessons of War (2023) [28], dédié aux féministes ukrainiennes, conclut que l'expérience de la guerre ukrainienne réaffirme cette conviction, même si cette conviction soulève des questions sur la compatibilité de la position anti-militariste féministe avec les demandes des féministes ukrainiennes pour la fourniture d'artillerie occidentale [29].
Contrairement au pacifisme, qui insiste sur l'inadmissibilité de la guerre comme moyen de solutions politiques, l'anti-militarisme féministe met l'accent sur la critique du postulat militariste clausewitzien ascendant de l'omnipotence et de l'irrésistibilité des forces de la violence en politique. La position clausewitzienne est contestée par les théoriciennes féministes de l'éthique de la non-violence, en particulier par Judith Butler, qui, dans sa critique féministe de la violence, soutient que les forces de la non-violence peuvent être plus efficaces et efficientes dans la résolution des questions politiques que les forces de la violence et de la guerre.
Concernant la guerre russo-ukrainienne, Butler déclare que face à l'agression de Poutine contre l'Ukraine, la communauté féministe internationale doit soutenir inconditionnellement l'autodéfense ukrainienne et espérer qu'elle réussisse [30]. Mais l'acceptation totale de la logique de la violence comme logique du développement historique est, selon Butler, une impasse pour la civilisation humaine, puisque la force motrice de toute guerre est la pulsion de mort freudienne, dont le but est la destruction des liens sociaux et de la coopération, que recherche le masculinisme militariste. Étant donné ce « but » non déclaré de la guerre, argumente Butler, « [m]ême la soi-disant 'guerre juste' court le risque d'une destructivité qui dépasse ses objectifs déclarés, son but délibéré » [31].
L'idée de la guerre comme expression de notre pulsion de mort se révèle le plus clairement dans le phénomène de la guerre d'extermination, c'est-à-dire des conflits de haute intensité, dont l'effet principal est l'élimination massive de la population de son adversaire, mais aussi de la sienne propre, tant militaire/mobilisée que civile. Selon Balibar [32], les guerres russo-ukrainienne et israélo-palestinienne ont aujourd'hui atteint le niveau des guerres d'extermination, et elles se qualifient d'ethnocide (en Ukraine) et de génocide (à Gaza) [33]. Lorsque les adversaires sont identifiés comme des « ennemis absolus » qui ne peuvent être que combattus et détruits, les guerres russo-ukrainienne et israélo-palestinienne se transforment, comme l'affirme Balibar, en « conflits sans solution diplomatique dans un avenir prévisible laissant la porte ouverte à diverses formes d'escalade » [34], où le désir passionné de détruire son ennemi ne peut être réalisé que par la capacité de tous les participants au conflit à accepter la décimation de leur jeunesse [35]. Par conséquent, dans la condition de la guerre d'extermination en cours, les dirigeants ukrainiens doivent prendre des décisions politiques dans une situation d'indécidabilité radicale lorsque (a) il est impossible d'arrêter de se battre en raison d'un désir très passionné d'accomplir un acte juste de représailles contre l'ennemi, qui menace d'ethnocide de la nation ukrainienne et lorsque (b) il est simultanément impossible de continuer à se battre, puisque la poursuite de la guerre menace la décimation des futures générations d'Ukrainiens.
Cependant, si au niveau des relations diplomatiques la guerre d'extermination est vue comme un conflit sans solution, comme l'affirme Balibar, alors au niveau de l'idéologie il semble qu'une telle solution existe, et qu'elle est la seule possible, celle qui est désirée par toutes les parties belligérantes, et qui est présentée comme complète, finale et salutaire. Cette décision est la Victoire, un événement qui, dès qu'il se produira – et, comme les peuples en guerre se le font dire par leurs dirigeants, il arrivera assez tôt – mettra immédiatement fin à l'état d'indécidabilité, qui devient de plus en plus insupportable pour tous les participants au conflit. Mais cette Victoire rédemptrice à venir ne nous est pas donnée en cadeau. Tout comme la Paix tant attendue, elle ne doit pas seulement être méritée, mais acquise, conquise. La Victoire est le signifiant maître vide dans lequel nos désirs collectifs, nos passions et nos espoirs sont investis aujourd'hui. Dans la situation de guerre en cours, elle est devenue l'objet d'une lutte hégémonique intense et sans compromis entre diverses parties et idéologies qui cherchent à la remplir de leur propre contenu politique.
Quelle image de la Victoire gagne l'hégémonie au milieu de la guerre russo-ukrainienne en cours ?
Si nous restons au niveau du discours des médias de masse, il semble évident que la version nationaliste de la Victoire gagne l'hégémonie, ce qui assure une mobilisation de masse et une longue chaîne d'équivalences qui surmontent les différences de classe, de race, de genre, d'âge et autres. Un élément clé de la version nationaliste de la Victoire est l'identification de la subjectivité victorieuse avec l'État-nation : la nation est au-dessus de tout, et tout individu ou groupe social qui ne contribue pas à l'affirmation de soi de la nation est défini comme un « agent étranger », « collaborateur », « organisation indésirable », et ainsi de suite. La victoire dans la guerre des nationalismes signifie : (a) l'humiliation totale et la désintégration de l'ennemi de l'État-nation ; et (b) la montée et le renforcement sans fin du pouvoir de son propre État-nation, qui doit être revivifié et renouvelé à la suite de la guerre [36]. Ici, les nationalistes de tous les pays en guerre sont en accord complet et en solidarité internationale complète. Aussi, dans l'image nationaliste universelle du monde, la Victoire est décrite comme l'achèvement du temps historique profane et la transition vers un temps messianique de nouveaux commencements et la naissance d'une super-nation complètement nouvelle.
Cette version de la Victoire est contestée principalement par les opposants traditionnels des nationalistes : les marxistes et les anarchistes. Ils estiment que dans une guerre de nationalismes concurrents, la victoire, comme triomphe d'une force politique sur une autre, est en principe impossible. Leur argument est basé sur une thèse concernant la relation symbiotique entre l'État et la guerre, qui forme l'une des forces ontologiques constitutives du capitalisme. Comme l'affirment Eric Alliez et Maurizio Lazzarato dans leur étude Wars and Capital : « La guerre fait partie intégrante de la machine Capital-État au même titre que la production, le travail, le racisme et le sexisme » [37].
Du point de vue marxiste, tant que l'État capitaliste existe, la guerre est permanente – y compris sous forme de « paix » – comme une guerre civile mondiale menée parmi les populations et contre la population. Lorsque la guerre capitaliste permanente passe de non sanglante à sanglante, elle change simplement de forme ; dans ce cas, il ne peut être question d'autre victoire que de la victoire du capital mondial. Et l'État assure cette victoire du capital à l'aide d'appareils idéologiques.
Dans la guerre totale moderne, les deux côtés se battent du côté du capital. Par conséquent, l'opposition démocratie-autocratie est fausse, selon Lazzarato : « La confrontation entre les États-Unis et la Russie qui est la toile de fond de cette guerre n'est pas entre une démocratie et une autocratie mais entre des oligarchies économiques qui se ressemblent sous de nombreux aspects, en particulier en tant qu'oligarchies rentières » [38].
Les guerres qui ne font pas partie de la guerre totale du capital contre la population – c'est-à-dire les guerres anti-capitalistes – incluent, selon Alliez et Lazzarato, les guerres révolutionnaires menées contre l'impérialisme occidental (par exemple, la guerre révolutionnaire en Haïti au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, et aujourd'hui les mouvements de guérilla anti-coloniaux en Afrique et en Amérique latine). Par conséquent, l'opposition politique correcte, du point de vue marxiste, est entre révolution et contre-révolution. Chaque guerre en cours doit être évaluée selon les critères suivants : Contre qui la guerre est-elle menée ? Quelle subjugation/domination renforce-t-elle ?
Quant aux féministes, elles sont souvent critiques et méfiantes vis-à-vis des théories et des stratégies politiques des marxistes et des anarchistes. Mais quand il s'agit de la question de la guerre, la position féministe est plus proche de la position des marxistes que des nationalistes. La version nationaliste de la victoire comme résolution de l'impasse d'une guerre d'extermination est rejetée par les féministes, premièrement, parce que le nationalisme est systématiquement associé dans la théorie féministe au patriarcat et à la misogynie, qui sont incarnés dans les pratiques de double exploitation des femmes : à la fois dans la réalité socio-politique et comme figures symboliques [39]. Comme le note Gayatri Spivak, « la femme est l'instrument le plus primitif du nationalisme », qu'il s'agisse du nationalisme du colonisateur ou de la nation colonisée, des oppresseurs ou des subalternes, coïncidant dans l'attitude envers l'instrumentalisation des sujets féminins [40].
Deuxièmement, le nationalisme, du point de vue de la théorie féministe, n'est pas une politique émancipatrice, mais anti-émancipatrice, appartenant au registre de la régression comme mécanisme inadéquat de gestion de crise, tel que défini par Rahel Jaegi, qui ne résout pas les contradictions sociales, mais ne fait que les exacerber et les intensifier, comme dans le cas d'un tel mode de régression qu'est le ressentiment, qui ne satisfait pas le désir de vengeance, mais ne fait que renforcer le sentiment de rester non vengé et donc dépendant d'un autre [41]. Le nationalisme, comme l'écrit Nacira Guenif, agissant sous les slogans de la libération nationale établit en fait « [l]a prééminence des puissants sur le peuple, … dirigée par un pouvoir militaire qui n'a jamais hésité à écraser son peuple, en particulier sa jeunesse. Le nationalisme était une plaie, c'était la raison même pour laquelle ce pays [son Algérie natale] et son peuple ne pourraient jamais être libres et souverains » [42].
Suivre la voie du nationalisme signifie, du point de vue de la critique féministe, accepter les politiques de régression et de ressentiment, qui sont activement utilisées par les dirigeants de la Fédération de Russie aujourd'hui, soulignant leurs « griefs » et « revendications » envers les pays occidentaux, et auxquelles s'oppose l'idée d'une guerre émancipatrice pour la démocratie contre la dictature de l'autoritarisme, que l'Ukraine mène aujourd'hui, selon les politiciens et philosophes politiques libéraux démocrates. Contrer efficacement le nationalisme de ressentiment russe signifie, d'un point de vue féministe, choisir des stratégies non pas nationalistes, mais de solidarité transnationale ou selon la formule créée par Helene Petrovsky « la solidarité comme pratique de l'être-en-commun » [43] : comme (a) une solidarité non hiérarchique et inclusive de type démocratique et (b) émancipatrice, fondée sur l'idée d'une résistance sans ressentiment à l'agression et à la violence militaire.
Cette stratégie féministe antimilitariste de résistance aux atrocités de l'agression russe, en tant que stratégie de résistance sans ressentiment et fidèle aux idées de la démocratie, peut sembler irréaliste et utopique dans le contexte de la guerre d'extermination en cours en Ukraine, comme l'admettent les partisans de l'éthique féministe de la non-violence [44]. Mais seule une stratégie de ce type permettra, selon eux, la préservation de la démocratie en Ukraine, qui serait la principale victoire ukrainienne dans cette guerre. Une stratégie féministe antimilitariste de résistance permettrait également une mobilisation populaire véritablement massive contre l'agression de Poutine, contrairement à la mobilisation nationaliste actuelle, qui est une mobilisation limitée, qui permet seulement d'intensifier le conflit en une guerre d'extermination mais ne fournit pas la mobilisation politique de masse nécessaire pour protéger la démocratie et résister à une agression autoritaire militaire à grande échelle.
Irina Zherebkina
The Philosophical Salon
https://thephilosophicalsalon.com/the-antinomies-of-the-russia-ukraine-war-and-its-challenges-to-feminist-theory/
Traduit par AN pour ESSF.
https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article73691
[1] ‘Feminist Resistance Against War. A Manifesto', in Spectre, March 17, 2022. Retrieved from
https://spectrejournal.com/feminist-resistance-against-war/
[2] ‘Right to Resist. A Feminist Manifesto', in Commons, July 7, 2022. Retrieved from
https://commons.com.ua/en/right-resist-feminist-manifesto/
[3] Tamara Zlobina, ‘The problem of feminist international politics. A view from Ukraine', in Global Dialogue, May 9, 2022. Retrieved from
https://globaldialogue.online/ally-en/2022/fas-voices_ukkrain_ok-the-problem-of-feminist-international-politics-a-view-from-ukraine/
[4] Janet E. Johnson, ‘How Russia's war in Ukraine can change gender studies', in Frontiers in Sociology. November 30, 2023.
[5] Olga Burlyuk, ‘On Russia's war against Ukraine and epistemic imperialism', IPW Lecture, The University of Vienna, Austria, October 7, 2022.
https://politikwissenschaft.univie.ac.at/details/news/ipw-lecture-on-russias-war-against-ukraine-and-epistemic-imperialism/
[6] Teresa Hendl, ‘Towards accounting for Russian imperialism and building meaningful transnational feminist solidarity with Ukraine', in Gender Studies, 26, 2022, p. 79.
[7] Anna Dovgopol Facebook, June 19, 2022. Retrieved from
https://www.facebook.com/anna.dovgopol.5/
[8] Olga Sasunkevich, ‘Affective Dialogue : Building Transnational Feminist Solidarity in Times of War', in Signs (49), 2024, p. 371.
[9] Oksana Zabuzhko, ‘Pro feminism, rusistiky, stosunky z Pol'sheu ta imperialism', in Ukraїner Q YouTube channel, February 17, 2024, 1:59:12
https://www.youtube.com/watch?v=S–4oklQiQE
[10] ‘Feminism, War, Solidarity', Editorial, Gender Studies, 26, 2022, p. 6.
[11] Olena Huseinova, ‘Why I'm Not Attending Prima Vista', in Prima Vista, 2023.
https://kirjandusfestival.tartu.ee/en/unfortunately-the-writer-in-residence-of-tartu-city-of-literature-residency-programme-olena-huseinova-will-not-be-performing-at-prima-vista/
[12] ‘Feminism, War, Solidarity', Editorial, in Gender Studies, 26, 2022, p. 5-6.
[13] Sabine Hark, ‘Wars as Commons. Scattered Notes on Solidarity', in Gender Studies, 26 (2022), p. 16.
[14] Jurgen Habermas, ‘War and Indignation. The West's Red Line Dilemma', in Reset Dialogues on Civilizations, May 6. 2022. Retrieved from
https://www.resetdoc.org/story/jurgen-habermas-war-indignation-west-red-line-dilemma/
[15] Ibid.
[16] Slavoj Žižek, ‘From Cold War to Hot Peace', in Project Syndicate, March 25, 2022. Retrieved from
https://www.project-syndicate.org/onpoint/hot-peace-putins-war-as-clash-of-civilization-by-slavoj-zizek-2022-03
[17] Noam Chomsky, ‘US Military Escalation Against Russia Would Have No Victors', in Truthout, March 1, 2022. Retrieved from
https://truthout.org/articles/noam-chomsky-us-military-escalation-against-russia-would-have-no-victors/
[18] Jurgen Habermas, ‘War and Indignation. The West's Red Line Dilemma', in Reset Dialogues on Civilizations, May 62022. Retrieved from
[19] Ibid.
[20]Jurgen Habermas, ‘A Plea for Negotiations', in Süddeutsche Zeitung, February 14, 2023
https://www.sueddeutsche.de/projekte/artikel/kultur/juergen-habermas-ukraine-sz-negotiations-e480179/?reduced=true
[21] Etienne Balibar, ‘In the War : Nationalism, Imperialism, Cosmopolitics', in Commons, June 29, 2022. Retrieved from
https://commons.com.ua/en/etienne-balibar-on-russo-ukrainian-war/
[22] Ibid.
[23] Slavoj Žižek, ‘From Cold War to Hot Peace', in Project Syndicate, March 25, 2022.
[24] Ibid.
[25] Ibid.
[26] Slavoj Žižek, ‘What the left gets wrong about Gaza and “decolonisation”', in The New Statesmen, December 20, 2023
https://www.newstatesman.com/world/middle-east/2023/12/israel-gaza-palestine-peace
[27] Slavoj Žižek, ‘The Axis of Denial', in Project Syndicate, June 29, 2023. Retrieved from
https://www.project-syndicate.org/commentary/left-right-populist-alliance-against-ukraine-by-slavoj-zizek-2023-06
[28] Cynthia Enloe, Twelve Feminist Lessons of War (London : Footnote, 2023).
[29] Ibid, p. 160.
[30] Judith Butler, ‘We fight against social domination, not against men and their anatomy', April, 30, 2022. Retrieved from
https://newsrnd.com/news/2022-04-30-judith-butler–%22we-fight-against-social-domination–not-against-men-and-their-anatomy%22.ByL4VV5rc.html
[31] Judith Butler. The Force of Nonviolence : an Ethico-Political Bind (London, New York : Verso, 2020), p. 78.
[32] Etienne Balibar, ‘Palestine, Ukraine and other wars of extermination : the local and the global', in Bisan Lectures Series, December 13, 2023. Retrieved from
https://aurdip.org/en/bisan-lecture-series-etienne-balibar-palestine-ukraine-and-other-wars-of-extermination-the-local-and-the-global/
[33] Ibid.
[34] Ibid.
[35] Ibid.
[36] Zillah Eisenstein, Hatreds : Racialized and Sexualized Conflicts in the 21st Century (New York, London : Routledge 1996), p. 27-29.
[37] Éric Alliez and Maurizio Lazzarato, Wars and Capital, trans. Ames Hodges, Semiotext(e), 2016, p. 15-16.
[38] Maurizio Lazzarato, ‘The War in Ukraine', in The Invisible Armada., July 8, 2022. Retrieved from
https://invisiblearmada.ncku.edu.tw/articles/the-war-in-ukraine
[39] Nira Yuval-Davis, Gender and Nation, London : Sage, 1997, p. 19.
[40] Gayatri Chakravorty Spivak, ‘Nationalism and the Imagination', Lectora, 15, 2009, p. 35-36.
[41] Rahel Jaeggi, ‘Modes of Regression. The Case of Ressentiment', in Critical Times, 5 (3) 2022, p. 35.
[42] Nacira Guenif, ‘Building Feminist Coalitions beyond Nationalism : A “Minority Report” from France', in Gender Studies, 26, 2022, p. 116.
[43] Helene Petrovsky, “Expressing and Conceptualizing Solidarity”, in Gender Studies, 26, 2022, p. 97.
[44]Judith Butler, ‘I am hopeful that the Russian army will lay down its arms', in Culture, April 24, 2022
https://en.ara.cat/culture/am-hopeful-that-the-russian-army-will-lay-down-its-arms_128_4353851.html
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« Guerre en Ukraine : trois ans après »

L'économiste Michael Roberts analyse le futur des économies russes et ukrainiennes, trois ans après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et alors que Zelensky se prépare à signer un accord avec Trump.
26 février 2025 | tiré de Révolution permanente
https://www.revolutionpermanente.fr/Guerre-en-Ukraine-trois-ans-apre%CC%80s-par-Michael-Roberts
Ukraine : une catastrophe humaine
Aujourd'hui marque la fin de la troisième année de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Après trois ans de conflit, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a causé des pertes considérables au peuple et à l'économie ukrainiens. Il existe différentes estimations du nombre de victimes civiles et militaires ukrainiennes (décès et blessures) : 46 000 civils et peut-être 500 000 soldats. Les pertes militaires russes sont à peu près les mêmes. Des millions de personnes ont fui à l'étranger et des millions d'autres ont dû fuir leurs foyers. Une évaluation confidentielle ukrainienne réalisée plus tôt en 2024, et rapportée par le Wall Street Journal (WSJ), a estimé les pertes des troupes ukrainiennes à 80 000 tués et 400 000 blessés. Selon les chiffres du gouvernement, au cours du premier semestre 2024, le nombre de personnes décédées en Ukraine a été trois fois supérieur à celui des naissances, a rapporté le WSJ. L'année dernière, les pertes ukrainiennes ont été cinq fois plus élevées que celles de la Russie, Kiev perdant au moins 50 000 militaires par mois.
Le PIB de l'Ukraine a baissé de 25 % et 7,1 millions d'Ukrainiens supplémentaires vivent désormais dans la pauvreté.

Par ailleurs, les retards scolaires des enfants ukrainiens sont particulièrement préoccupants : l'Ukraine se retrouvera avec une main-d'œuvre de moins bonne qualité en raison des perturbations du processus d'apprentissage causées par la guerre (et auparavant par le Covid). Ces pertes sont estimées à environ 90 milliards de dollars, soit presque autant que les pertes en capital fixe [1] à ce jour. Des études ont montré que vivre une guerre durant les cinq premières années de la vie d'une personne équivaut à une baisse d'environ 10 % des scores de sa santé mentale à l'âge de 60-70 ans. Le problème ne se limite pas aux victimes de guerre et à l'économie, mais aussi aux dommages à long terme causés aux Ukrainiens qui n'ont pas pu fuir.
Malgré la guerre, une légère reprise économique a été observée l'année dernière. Les exportations d'énergie ont bondi. Les ports ukrainiens de la mer Noire sont toujours en activité. Les échanges commerciaux se font vers l'ouest le long du Danube et, dans une moindre mesure, par train. Parallèlement, l'agriculture a amorcé une reprise. En revanche, la production de fer et d'acier reste encore très en-dessous de son niveau d'avant-guerre, passant de 1,5 million de tonnes par mois à seulement 0,6 million de tonnes par mois.

L'Ukraine manque cruellement de personnes valides pour produire ou pour aller à la guerre. Si le taux de chômage de l'Ukraine est redescendu à 16,8 % en janvier 2025 après un pic de 24,53% en 2022 [2], cela ne résout pas le problème de la pénurie de main d'œuvre. En effet, les personnes qualifiées ont quitté le pays et d'autres ont été mobilisés dans les forces armées. La situation est si mauvaise qu'il a été question de mobiliser les 18-25 ans [3] – actuellement exemptés – mais cette mesure est très impopulaire et réduirait encore davantage l'emploi civil.
L'Ukraine est encore totalement dépendante du soutien de l'Occident. Elle a besoin d'au moins 40 milliards de dollars par an pour maintenir ses services publics, subvenir aux besoins de sa population et maintenir la production. D'un côté, elle compte sur l'UE pour toutes ses dépenses publiques, et de l'autre, elle dépend des États-Unis pour son financement militaire - une « division du travail » pure et simple. En outre, le FMI et la Banque mondiale ont proposé une aide monétaire, mais pour l'obtenir, l'Ukraine doit démontrer sa « viabilité », c'est-à-dire qu'elle doit être capable à un moment donné de rembourser ses emprunts. Ainsi, si les prêts bilatéraux des États-Unis et des pays de l'UE (il s'agit principalement de prêts et non d'une aide directe) ne se concrétisent pas, le FMI ne pourra pas prolonger son programme de prêt.
Ce qui nous ramène à cette question : qu'adviendra-t-il de l'économie ukrainienne, si et quand la guerre avec la Russie prendra fin ? Selon les dernières estimations de la Banque mondiale, l'Ukraine aura besoin de 486 milliards de dollars au cours des dix prochaines années pour se redresser et se reconstruire, en supposant que la guerre prenne fin cette année. C'est près de trois fois son PIB actuel. Les dommages directs causés par la guerre ont actuellement atteint près de 152 milliards de dollars, avec environ 2 millions de logements - soit environ 10 % du parc immobilier total de l'Ukraine - endommagés ou détruits, ainsi que 8 400 km d'autoroutes, de routes nationales et autres routes, et près de 300 ponts. Environ 5,9 millions d'Ukrainiens sont demeurés à l'extérieur du pays, et les personnes déplacées à l'intérieur du pays étaient environ 3,7 millions.
Ce qui reste des ressources de l'Ukraine (celles qui n'ont pas été annexées par la Russie) a été vendu à des entreprises occidentales. Au total, 28 % des terres arables de l'Ukraine appartiennent désormais à un mélange d'oligarques ukrainiens, de sociétés européennes et nord-américaines, ainsi qu'au fonds souverain d'Arabie saoudite. Nestlé a investi 46 millions de dollars dans une nouvelle usine, dans la région de Volhynie, tandis que le géant allemand des médicaments et des pesticides, Bayer, prévoit d'investir 60 millions d'euros dans la production de semences de maïs dans la région centrale de Jitomir. MHP, la plus grande entreprise avicole d'Ukraine, appartient à un ancien conseiller du président ukrainien Porochenko. MHP a été le bénéficiaire de plus d'un cinquième de tous les prêts de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) au cours des deux dernières années. MHP emploie 28 000 personnes et contrôle environ 360 000 hectares de terres en Ukraine, une superficie plus grande que le Luxembourg.
Le gouvernement ukrainien s'est engagé à mettre en place une économie de « libre marché » pour l'après-guerre, qui inclurait de nouvelles vagues de déréglementation du marché du travail, en deçà même des normes minimales de l'UE en matière de travail (c'est-à-dire des conditions de travail proches de l'esclavage), ainsi que des réductions drastiques des impôts sur les sociétés et sur le revenu, parallèlement à la privatisation complète des actifs restants de l'État. Cependant, les pressions d'une économie de guerre ont contraint le gouvernement à mettre ces politiques de côté (pour le moment), les impératifs militaires étant prioritaires.
L'objectif du gouvernement ukrainien, de l'UE, du gouvernement américain, des agences multilatérales et des institutions financières américaines, désormais chargées de lever des fonds et de les allouer à la reconstruction, est de restaurer l'économie ukrainienne sous la forme d'une zone économique spéciale, avec des fonds publics pour couvrir les pertes potentielles du capital privé. L'Ukraine sera également libérée des syndicats, des régimes fiscaux et des réglementations sévères pour les entreprises et de tout autre obstacle majeur aux investissements rentables du capital occidental, en alliance avec les anciens oligarques ukrainiens.
Selon des sources ukrainiennes, le coût de la restauration des infrastructures (financement de l'effort de guerre : munitions, armes, etc. ; pertes de logements, d'immeubles commerciaux, indemnités pour décès et blessures, coûts de réinstallation, aides au revenu, etc.) et des pertes de revenus actuels et futurs atteindra 1 000 milliards de dollars, soit six années du PIB annuel précédent de l'Ukraine. Cela représente environ 2,0 % du PIB annuel de l'UE ou 1,5 % du PIB du G7 pendant six ans. D'ici la fin de cette décennie, même si la reconstruction se déroule bien, et en supposant que toutes les ressources de l'Ukraine d'avant-guerre soient restaurées (c'est-à-dire que l'industrie et les minéraux de l'est de l'Ukraine soient entre les mains de la Russie), l'économie serait encore inférieure de 15 % à son niveau d'avant-guerre. Dans le cas contraire, la reprise sera encore plus longue.
Russie : l'économie de guerre
L'invasion de l'Ukraine par la Russie au début de l'année 2022 pour prendre le contrôle des quatre provinces russophones du Donbass, dans l'est de l'Ukraine, a ironiquement donné un coup de fouet à l'économie russe. En 2023, la croissance du PIB réel était de 3,6 % et de plus de 3 % en 2024. L'économie de guerre de la Russie tient bon.

Au cours des trois dernières années de guerre, la Russie a réussi à échapper aux sanctions, tout en investissant près d'un tiers de son budget dans la défense. Elle a également pu accroître ses échanges commerciaux avec la Chine et vendre son pétrole à de nouveaux marchés, en utilisant en grande partie une flotte fantôme de pétroliers pour contourner le plafonnement des prix. Les pays occidentaux espéraient voir réduire les réserves de guerre du pays. La moitié de son pétrole et de ses produits pétroliers ont été exportés vers la Chine en 2023. Elle est devenue le premier fournisseur de pétrole de la Chine. Les importations chinoises en Russie ont bondi de plus de 60 % depuis le début de la guerre, car le pays a été en mesure de fournir à la Russie un flux constant de marchandises, notamment des voitures et des appareils électroniques, comblant ainsi le manque des importations de marchandises occidentales perdues. Le commerce entre la Russie et la Chine a atteint 240 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation de plus de 64 % depuis 2021, avant la guerre.
Cependant, la guerre a intensifié une grave pénurie de main-d'œuvre. Comme l'Ukraine, la Russie manque désormais cruellement de personnel, mais pour des raisons différentes. Même avant la guerre, la main-d'œuvre russe diminuait pour des raisons démographiques naturelles. Puis, au début de la guerre en 2022, environ trois quarts de million de travailleurs russes et étrangers, dont une partie de la classe moyenne des secteurs de l'informatique, de la finance et de la gestion, ont quitté le pays. Pendant ce temps, l'armée russe recrute des dizaines de milliers d'hommes en âge de travailler. Entre 10 000 et 30 000 travailleurs rejoignent l'armée chaque mois, soit environ 0,5 % de l'offre totale. Cela a profité aux travailleurs russes qui ne font pas partie des forces armées, car les cadres sont réticents à licencier qui que ce soit.
Les salaires ont connu une hausse à deux chiffres, tandis que la pauvreté et le chômage ont atteint des niveaux historiquement bas. Pour les personnes les moins bien rémunérées du pays, les salaires ont augmenté plus rapidement au cours des trois derniers trimestres que pour tout autre segment de la société, avec un taux de croissance annuel d'environ 20 %. Le gouvernement a dépensé massivement dans l'aide sociale aux familles, l'augmentation des retraites, les subventions hypothécaires et l'indemnisation des proches des militaires.

Mais l'inflation s'est emballée et le rouble s'est fortement déprécié par rapport au dollar, ce qui a contraint la Banque centrale russe à relever son taux d'intérêt à plus de 20 %.

Une économie de guerre signifie que l'État intervient et même outrepasse la prise de décision du secteur capitaliste pour l'effort de guerre national. L'investissement public remplace l'investissement privé. Ironiquement, dans le cas de la Russie, cela a été accéléré par le retrait des entreprises occidentales des marchés russes et par les sanctions. L'État russe a repris des entités étrangères et/ou les a revendues à des capitalistes russes engagés dans l'effort de guerre.
Les dépenses en nouvelles constructions, en équipements de haute technologie et en nouveaux kits ont atteint leur plus haut niveau en 12 ans, soit 14 400 milliards de roubles (136,4 milliards de dollars), soit une augmentation de 10 % par rapport à l'année précédente. Selon le Centre d'analyse macroéconomique et de prévision à court terme basé à Moscou, le taux de croissance des investissements a dépassé le taux de croissance du PIB avec une marge plus importante qu'au cours des 15 dernières années.
Les principales destinations de ces investissements vont dans la « substitution des importations », les infrastructures vers l'est et la production militaire. L'ingénierie mécanique, qui comprend la fabrication de produits métalliques finis (armes), d'ordinateurs, d'optique et d'électronique, ainsi que d'équipements électriques, est l'un des secteurs d'investissement qui connaît la croissance la plus rapide.
De nombreux économistes occidentaux prévoient un effondrement de l'économie russe, comme ils le disent depuis trois ans. La pénurie aiguë de main-d'œuvre, l'inflation persistante et croissante causée par la flambée des dépenses militaires et le durcissement constant des sanctions entraîneront, selon eux, une crise économique qui forcera Moscou à abandonner ses objectifs en Ukraine et mettra fin à la guerre, avec des conditions plus acceptables pour Kiev et ses alliés.
De nombreux analystes ont attribué ces signes de surchauffe à l'augmentation des dépenses liées à la guerre en Ukraine, en soulignant que les dépenses militaires ont atteint un niveau record, qui devrait dépasser 7 % du PIB en 2024. Alors que les dépenses de défense devraient augmenter de près de 25 % cette année, représentant environ 40 % des dépenses du gouvernement fédéral, certains ont évoqué la possibilité que la Russie sombre dans la « stagflation », combinant une inflation élevée avec une croissance faible, voire nulle.
Mais malgré la guerre la plus intense en Europe depuis 1945, Moscou a réussi à la financer avec des déficits budgétaires modestes, compris entre 1,5 et 2,9 % du PIB depuis 2022. Par conséquent, le Kremlin n'a pratiquement pas eu besoin d'emprunter pour financer la guerre. Les recettes fiscales générées par l'activité intérieure ont grimpé en flèche depuis le début de la guerre. Avec environ 15 % du PIB, la Russie a le plus faible ratio dette publique/PIB des économies du G20. Ainsi, bien qu'elle soit coupée de la plupart des sources de capitaux extérieures, la Russie reste plus que capable de financer les investissements intérieurs et les dépenses publiques avec ses propres ressources.
Au cours des deux dernières années, la Russie a enregistré un excédent de sa balance courante d'environ 2,5 % du PIB. Tant que la Russie pourra continuer à exporter de grandes quantités de pétrole, cela ne devrait pas changer. Les recettes pétrolières et gazières de la Russie ont bondi de 26 % l'année dernière pour atteindre 108 milliards de dollars, alors même que la production quotidienne de pétrole et de condensats de gaz a diminué de 2,8 % en 2024, selon des responsables du gouvernement russe cités par Reuters. Bien qu'elle soit restée le pays le plus sanctionné au monde en 2024, la Russie a exporté cette année-là un volume record de 33,6 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL), soit une augmentation de 4 % par rapport à l'année précédente.
L'Institute of International Finance (IIF) prévoit une baisse de rentabilité budgétaire du prix du pétrole russe (le montant nécessaire pour équilibrer les dépenses budgétaires) à 77 dollars le baril d'ici 2025, soutenue par une reprise des recettes pétrolières et gazières. Dans le même temps, le prix du pétrole extérieur d'équilibre (le prix nécessaire pour équilibrer le compte courant extérieur), à 41 dollars le baril, est le deuxième plus bas parmi les principaux exportateurs d'hydrocarbures. Cela signifie que le prix actuel du pétrole de l'Oural dépasse largement ces seuils d'équilibre.

Mais aucun de ces investissements dans l'économie de guerre ne soutiendra la croissance de la productivité à long terme de la Russie. L'économie de guerre de la Russie reviendra à l'accumulation capitaliste lorsque la guerre prendra fin. L'économie russe reste fondamentalement liée aux ressources naturelles. Elle repose sur l'extraction plutôt que sur la fabrication. La production de guerre est fondamentalement improductive pour l'accumulation de capital à long terme. La Russie reste technologiquement arriérée et dépendante des importations de haute technologie. Même avec des mesures de relance budgétaire massives, elle ne peut pas encore produire de technologies adaptées à un marché d'exportation compétitif au-delà des armes et de l'énergie nucléaire, les premières étant déjà autorisées et les secondes sur le point de l'être. La Russie n'est pas un acteur important, dans aucune des technologies de pointe, de l'intelligence artificielle à la biotechnologie.
Le creux démographique, la baisse de la qualité de l'enseignement universitaire et la rupture des liens avec les écoles internationales, ainsi que la « fuite des cerveaux », exacerbent ces problèmes. Le fossé technologique va probablement se creuser, la Russie comptant de plus en plus sur les importations chinoises et la rétro-ingénierie (copie). La croissance potentielle du PIB réel de la Russie ne dépasse probablement pas 1,5 % par an, car la croissance est limitée par le vieillissement et la diminution de la population, ainsi que par la faiblesse des taux d'investissement et de productivité.
L'économie de guerre russe est bien placée pour poursuivre la guerre pendant plusieurs années encore si nécessaire. En revanche, lorsque la guerre sera terminée, Poutine pourrait être confronté à un effondrement important de la production et de l'emploi. Le message sous-jacent est que la faiblesse de l'investissement, de la productivité et de la rentabilité du capital russe, même en excluant les sanctions, signifie que la Russie restera faible économiquement pendant le reste de cette décennie.
La paix
Le président Trump a déclaré qu'il cherchait un accord de paix par le biais de négociations directes avec la Russie. Cela signifierait la fin du soutien financier et militaire des États-Unis à l'Ukraine. Les dirigeants ukrainiens actuels s'opposent à tout accord qui impliquerait la perte de territoire et à tout veto sur une future adhésion à l'OTAN. Les dirigeants européens ont déclaré qu'ils soutiendraient l'Ukraine et continueraient à financer la guerre et à fournir un soutien militaire.
Trump veut récupérer ce que le gouvernement américain a dépensé jusqu'à présent pour l'Ukraine, ainsi que des garanties pour les dépenses futures destinées à reconstruire l'économie. Il s'est plaint des énormes transferts de fonds vers l'Ukraine, et accuse le gouvernement ukrainien d'avoir dissimulé la manière dont ils ont été dépensés. Mais c'est de la désinformation : la majorité des fonds que les États-Unis ont alloués à l'Ukraine sont restés chez eux pour financer la base industrielle de défense nationale et reconstituer les stocks américains. Les fabricants d'armes américains font d'énormes profits grâce à cette guerre.

Aujourd'hui, Trump exige que l'Ukraine cède plus de 50 % de ses droits miniers sur les terres rares aux États-Unis en échange de la livraison des 500 milliards de dollars nécessaires à la reconstruction d'après-guerre. Trump : « Je veux qu'ils nous donnent quelque chose en échange de tout l'argent que nous avons investi et je vais essayer de faire en sorte que la guerre se termine et que toutes ces morts cessent. Nous demanderons des terres rares et du pétrole, tout ce que nous pourrons obtenir. » Comme l'a déclaré le sénateur américain Lindsey Graham : « Cette guerre est une question d'argent... Le pays le plus riche de toute l'Europe en minéraux de terres rares est l'Ukraine, pour une valeur de deux à sept mille milliards de dollars... Donald Trump va chercher à conclure un accord pour récupérer notre argent, pour nous enrichir avec des minéraux rares... » Le problème est qu'environ la moitié de ces gisements (d'une valeur de quelque 10 à 12 000 milliards de dollars) se trouvent dans des zones contrôlées par la Russie.
Toutcela n'est autre qu'un indice supplémentaire que les actifs ukrainiens risquent d'être morcelés par les puissances occidentales. Le mois dernier, le président ukrainien Zelensky a signé une nouvelle loi élargissant la privatisation des banques publiques du pays. Elle fait suite à l'annonce par le gouvernement ukrainien, en juillet, de son programme de « privatisation à grande échelle 2024 » qui vise à attirer les investissements étrangers dans le pays et à lever des fonds pour le budget national ukrainien en difficulté. Parmi les actifs importants figurent actuellement le plus grand producteur de minerai de titane du pays, un important producteur de produits en béton et une usine d'extraction et de traitement. L'Ukraine envisageait de privatiser les quelque 3 500 entreprises publiques du pays dans le cadre d'une loi de 2018, qui stipulait que les citoyens et les entreprises étrangers pouvaient en devenir propriétaires. Des centaines d'entreprises de plus petite taille sont actuellement en cours de privatisation, ce qui a permis de générer des revenus de 9,6 milliards d'UAH (181 millions de livres sterling) au cours des deux dernières années.
Cela implique un sous-programme de sept ans appelé SOERA (State-owned enterprises reform activity in Ukraine), financé par l'USAID avec le ministère britannique des Affaires étrangères comme partenaire secondaire. SOERA vise à « faire progresser la privatisation de certaines entreprises publiques et à développer un modèle de gestion stratégique pour les entreprises publiques qui restent la propriété de l'État ».
Les capitaux britanniques se frottent également les mains. Des documents récemment publiés par le ministère britannique des Affaires étrangères ont indiqué que la guerre offrait « des opportunités » à l'Ukraine pour mettre en œuvre « des réformes extrêmement importantes ». « Le Royaume-Uni espère que la reconstruction de l'Ukraine profitera aux entreprises britanniques », observe un rapport sur l'aide britannique à l'Ukraine publié en début d'année par l'organisme de surveillance de l'aide, l'ICAI.
L'invasion de Poutine a poussé le peuple ukrainien dans les bras d'un gouvernement pro-libre marché et anti-travail, ce qui permettra aux capitaux occidentaux de s'emparer des actifs ukrainiens, et à exploiter les travailleurs de ce pays. C'était peut-être inévitable : des oligarques pro-russes et pro-occidentaux avant la guerre, aux capitaux occidentaux après.
La guerre n'a pas seulement détruit l'Ukraine ; elle a aussi sérieusement affaibli l'économie européenne, les coûts de production ayant explosé avec la perte des importations d'énergie bon marché en provenance de Russie. Mais il semble que les dirigeants européens veulent poursuivre la guerre même si Trump se retire. Ils se démènent désespérément pour trouver des fonds à cette fin et pour fournir une aide militaire accrue au gouvernement ukrainien assiégé. Certains dirigeants proposent d'envoyer des troupes en Ukraine. Donc « la guerre et non la paix ».
Tout aussi mauvaise est la décision de l'OTAN et des principaux dirigeants européens de doubler les dépenses de défense d'environ 1,9 % du PIB en moyenne d'ici la fin de la décennie, soi-disant pour résister aux attaques russes imminentes si Poutine obtient une paix gagnante cette année. Cette mesure est ridiculement justifiée par le fait que les dépenses de « défense » « seraient pour le plus grand bénéfice de tous » (Bronwen Maddox, directrice de Chatham House, le « think-tank » des relations internationales, qui présente principalement les points de vue de l'État militaire britannique). Maddox a conclu que : « le Royaume-Uni pourrait devoir emprunter davantage pour financer les dépenses de défense dont il a si urgemment besoin. Au cours de l'année prochaine et au-delà, les politiciens devront se préparer à récupérer de l'argent en réduisant les prestations de maladie, les retraites et les soins de santé... En fin de compte, les politiciens devront persuader les électeurs de renoncer à certains de leurs avantages pour financer la défense. » Le chef du parti vainqueur aux élections allemandes nous adresse le même message.
Cela entraînera un détournement massif des investissements des services publics et des prestations sociales, qui font cruellement défaut, ainsi que des investissements technologiques vers la production d'armes improductive et destructrice.
Notes
[1] Notion qui n'est pas utilisé dans la version originale = renvoie à du capital « perdu » qui sert à faire à faire fructifier le capital entrant.
[2] Etude de Statista, « Taux de chômage en Ukraine de 2012 à 2028 », 23/01/2025
[3] Blog DDT21 : L'Ukraine et ses déserteurs. Partie II : Guerre et révolution ? https://dndf.org/?p=21701
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Pour la liberté de l’Ukraine, pour une internationale antifasciste !

Le 24 février 2025, l'Ukraine est entrée dans sa quatrième année de résistance face à l'agression à grande échelle de la Russie.
Hebdo L'Anticapitaliste - 743 (27/02/2025)
https://lanticapitaliste.org/actualite/international/pour-la-liberte-de-lukraine-pour-une-internationale-antifasciste
Au cours des trois années écoulées, l'aide provenant des États-Unis et de l'UE a permis de bloquer l'offensive du Kremlin, mais a été insuffisante pour faire reculer l'armée russe.
On dénombre plus d'un million de victimes militaires (pour les forces russes, il s'agit principalement des populations racisées des régions périphériques) et civiles (ces dernières presque exclusivement du côté ukrainien). Auxquelles s'ajoute le déplacement forcé d'un quart de la population ukrainienne.
Poutine a entièrement remodelé l'économie autour de son objectif expansionniste : le budget militaire russe augmente sans cesse (43 % des dépenses publiques en 2025) au détriment des services publics. Dans l'économie de guerre, le capital des oligarques s'est concentré dans l'industrie militaire et l'extraction fossile, qui sont au cœur de la croissance économique du pays. Dès lors, rien ne laisse envisager que les négociations « pour la paix » que veut imposer Washington entraînent la fin de l'expansionnisme militaire russe, car « la Russie est devenue dépendante de la dépense militaire » 1.
Trump allié de Poutine face à la Chine
L'action de Trump accélère la redéfinition des alliances inter-impérialistes au détriment du droit à l'autodétermination du peuple ukrainien. Car aux yeux de Trump, la Russie est un potentiel point d'appui dans sa guerre d'hégémonie avec la Chine. Après avoir ouvert les négociations avec l'agresseur en excluant l'agressé, Trump a entièrement épousé la propagande poutinienne, en attribuant à l'Ukraine la responsabilité de la guerre et en déniant la volonté de la majorité de la population de préserver un pays indépendant et libre de l'impérialisme russe. La violence du chantage de Trump est manifeste : il demande à l'Ukraine de rembourser 500 milliards de dollars pour l'aide étatsunienne et de céder aux États-Unis le droit d'exploitation des ressources minières et des terres rares, et menace de restreindre l'accès de l'armée ukrainienne au système de communication Starlink, nécessaire pour se défendre des drones et de l'artillerie russes. Alors que le gouvernement ukrainien refuse de céder sans obtenir en contrepartie des garanties de sécurité, Poutine n'a pas tardé à proposer à Trump un accord pour l'exploitation des terres rares russes et des territoires ukrainiens occupés…
Les impérialismes russe, israélien et étatsunien s'unissent
N'en déplaise aux campistes qui ne voient dans l'agression de l'Ukraine qu'une guerre inter-impérialiste par procuration, l'alliance inter-impérialiste USA-Russie s'est renforcée lors du vote le 24 février 2025 d'une motion de l'ONU pour une paix juste et durable : les États-Unis s'y sont opposés aux côtés de la Russie, du Bélarus, de la Hongrie, du Nicaragua et d'Israël, en affichant explicitement une convergence d'intérêts. Les impérialismes russe, israélien et étatsunien ne se combattent pas : ils s'unissent contre le droit international et le droit d'autodétermination des peuples.
Réaffirmer le droit à l'autodétermination des peuples
Tandis que les gouvernements européens — et le capital dopé aux matières premières russes —peinent à résoudre leurs intérêts contradictoires vis-à-vis de la Russie poutinienne, la solidarité populaire avec la résistance ukrainienne ne doit pas fléchir : le 24 février, les manifestations ont été nombreuses contre l'axe Trump-Poutine, pour le droit des peuples à choisir leur présent et leur avenir, et pour défendre les espaces d'action et de contestation contre les impérialismes néofascistes — en Ukraine et au-delà.
La lutte de résistance ukrainienne est une lutte pour le droit d'existence et d'autodétermination du peuple ukrainien et de tous les peuples attaqués par les impérialismes meurtriers : aux côtés des UkrainienNEs comme des PalestinienNEs, soutenons la résistance contre l'offensive néofasciste internationale. Vive la résistance ukrainienne, vive l'antifascisme !
Gin et Elias Vola
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Gauches : l’union ou les défaites

Le Parti socialiste a pris une décision lourde de conséquences en choisissant de ne pas censurer le gouvernement dirigé par François Bayrou. Cette position permet la poursuite et l'aggravation des politiques anti-écologiques, antisociales et liberticides, des politiques qui étouffent les collectivités locales et les services publics.
22 février 2025 | tiré du site de la gauche écosocialiste
La « non censure » n'a pas affaibli les macronistes, la droite et l'extrême-droite. Elle a attisé les divergences au sein du Nouveau Front Populaire fragilisant l'unité nécessaire pour proposer une alternative crédible.
Cependant, les réactions exprimées par les dirigeants de la France insoumise, par Manuel Bompard évoquant une « rupture durable » du NFP ou Jean-Luc Mélenchon appelant à « tourner la page d'une relation toxique avec le PS », nous semblent disproportionnées et irresponsables.
L'escalade dans la confrontation au sein du NFP est pain béni pour la droite et l'extrême droite. La division de la gauche rend en effet par exemple plus aisée la conservation de villes comme Toulouse ou la conquête de villes comme Marseille par la droite lors des prochaines municipales. L'affaiblissement de la gauche est une opportunité pour ceux qui veulent en profiter : des rumeurs de dissolution de l'Assemblée nationale pour le mois de juillet refont évidemment surface, rendant envisageable la formation d'une majorité réactionnaire, voire pire. En effet, combien de députés de gauche seraient en capacité de conserver leur siège en cas d'effacement définitif du NFP ? Sans compter que cette situation ouvre également un boulevard vers l'Élysée pour Marine Le Pen.
Il est temps de dire stop. Si elles ne veulent pas disparaître, les forces de gauche doivent reconstruire leur union autour d'un programme de rupture, un programme mobilisateur, porteur d'espoir. Un programme du type de celui du NFP, adapté à chaque échéance de lutte sociale ou lors d'échéances électorales. Un programme visant une amélioration concrète de la vie quotidienne des gens. Pour y parvenir, il est essentiel de renouer le dialogue, de renoncer aux invectives et aux excommunications.
Alors que l'ombre menaçante de l'extrême droite s'étend, s'abandonner aux divisions constituerait une faute historique. Comme le disait Aragon : « Quand les blés sont sous la grêle, Fou qui fait le délicat, Fou qui songe à ses querelles, Au cœur du commun combat. »
Nous appelons les dirigeant·es de tous les partis de gauche à se ressaisir et invitons les millions de partisans du Nouveau Front Populaire, qui se sont massivement mobilisés lors des élections législatives, à faire entendre leur aspiration à l'unité et leur volonté de barrer la route aux fascistes.
Hendrik Davi, Myriam Martin
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Les émirats rejettent enfin le plan de Trump pour Ghaza : Mohammed Ben Zayed désavoue son ambassadeur à Washington

Le sommet consacré à l'avenir de la bande de Ghaza qui devait s'ouvrir ce jeudi à Riyad, en Arabie Saoudite, a été reporté à demain, selon l'AFP.
Tiré de El Watan-dz
20 février 2025
Par Mustapha Benfodil
Ce sommet qui avait pour principal ordre du jour de répondre au plan du président américain, Donald Trump, pour Ghaza, devait ne réunir initialement que l'Arabie Saoudite, l'Egypte, la Jordanie, les Emirats arabes unis (EAU) et l'Autorité palestinienne. Finalement, il va être « élargi aux six pays du Golfe », affirme l'AFP qui dit tenir l'information de deux diplomates arabes. « Un responsable saoudien a indiqué sous le couvert de l'anonymat que "le mini-sommet arabe" aurait lieu le "21 février" et non le 20 comme prévu initialement, précisant qu'il "réunira les dirigeants des six Etats du Conseil de coopération du Golfe (CCG), ainsi que l'Egypte et la Jordanie, pour examiner les alternatives arabes aux projets de Trump pour Ghaza », indique l'agence française. Un autre diplomate arabe a soufflé à l'AFP qu'« un pays du Golfe influent a exprimé son mécontentement après avoir été exclu du sommet de Riyad, ce qui a poussé les organisateurs à inclure l'ensemble des pays du Golfe ». Cette source n'a pas précisé de quel pays il s'agissait.
Fin de la tournée de Marco Rubio
A retenir, par ailleurs, la position exprimée par les Emirats arabes unis qui ont officiellement informé, hier, le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, de leur rejet du plan de Trump. Le président des Etats-Unis avait proposé, rappelle-t-on, de placer la bande de Ghaza sous contrôle américain et de la vider de ses habitants en transférant 2,4 millions de Palestiniens vers l'Egypte et la Jordanie principalement. Selon l'agence de presse émiratie (WAM), « Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, président des Emirats arabes unis, a reçu hier le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio ».
Les discussions ont porté, entre autres, sur « l'évolution de la situation au Moyen-Orient, en particulier dans les territoires palestiniens occupés, et sur les efforts déployés pour résoudre la crise dans la bande de Ghaza et ses répercussions sur la paix, la stabilité et la sécurité régionales », explique l'agence émiratie. Et de préciser dans la foulée que Mohammed Ben Zayed « a souligné la position ferme des Emirats arabes unis, qui rejettent toute tentative de déplacer le peuple palestinien de sa terre ». MBZ a fait savoir, en outre, à son hôte que « la reconstruction de Ghaza doit être liée à une voie menant à une paix globale et durable fondée sur la "solution des deux Etats" qui est la clé de la stabilité dans la région ».
La position officielle formulée par le chef de l'Etat émirati vient ainsi contredire celle énoncée par l'ambassadeur des Emirats à Washington, Youssef Al Otaïba il y a quelques jours, où il disait qu'il ne voyait pas d'alternative à la solution douteuse proposée par Trump, synonyme de deuxième Nakba. Il avait fait cette déclaration lors du Sommet mondial des gouvernements qui s'est tenu le 12 février à Dubaï. « Lorsqu'on lui a demandé si les Émirats arabes unis (EAU) travaillaient sur un plan alternatif à la proposition de M. Trump, M. Al Otaiba a répondu : "Je ne vois pas d'alternative à ce qui est proposé. Je n'en vois vraiment pas. Donc si quelqu'un en a une, nous sommes heureux d'en discuter, nous sommes heureux de l'explorer. Mais elle n'a pas encore fait surface », rapporte l'agence Anadolu.
Al Sissi et Pédro Sanchez contre le plan de Trump
Abou Dhabi constituait la dernière étape de la tournée du secrétaire d'Etat américain au Moyen-Orient. M. Rubio est arrivé, hier matin, aux Emirats en provenance de l'Arabie Saoudite où il avait pris part à la réunion entre les délégations américaine et russe pour préparer un prochain sommet entre Trump
et Poutine.
Lors de son séjour à Riyad, Marco Rubio a rencontré lundi le prince héritier Mohammed Ben Salmane. Au cours de cet entretien, il a souligné « l'importance d'un accord pour Ghaza qui contribue à la sécurité régionale », relève un communiqué du département d'Etat. A l'entame de sa visite dimanche, M. Rubio s'était rendu à Jérusalem où il avait réitéré le soutien inconditionnel des Etats-Unis à Israël. A noter par ailleurs que le président égyptien, Abdel Fattah Al Sissi, en visite officielle en Espagne, a réaffirmé hier, avec le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, leur rejet total du plan souhaité par Donald Trump. Al Sissi a lu une déclaration où il insisté sur « la nécessité de la reconstruction de Ghaza sans déplacement forcé – je le répète : sans déplacement forcé – du peuple palestinien de sa terre, à laquelle il s'accroche, et de sa patrie, qu'il ne consent pas à abandonner », rapporte l'AFP.
Fervent défenseur de la cause palestinienne, Pedro Sánchez a exprimé à son tour « le refus catégorique de l'Espagne et de son gouvernement (de donner leur approbation) au projet de transférer la population palestinienne en dehors de la bande de Ghaza ». Le Premier ministre espagnol a dit « soutenir, bien évidemment », la proposition égyptienne de reconstruction de la bande de Ghaza sans expulser sa population. Cette proposition fera l'objet d'un sommet extraordinaire de la Ligue arabe qui devait initialement se tenir le 27 février, au Caire, et qui a été reporté au 4 mars. Mustapha Benfodil

Ghaza : La Palestine appelle à protéger l'UNRWA
Le ministère palestinien des Affaires étrangères a vivement condamné l'invasion, mardi, par les forces d'occupation sionistes des écoles de l'Office des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) à El Qods-Est occupée, appelant la communauté internationale à prendre des mesures « dissuasives » à l'encontre de l'occupant, afin d'assurer la protection de l'agence onusienne. « Les agressions de l'armée d'occupation sioniste contre les étudiants et le personnel éducatif, et la fermeture des écoles affiliées à l'UNRWA constituent une violation flagrante de l'immunité et des privilèges dont jouissent les Nations unies et ses institutions, et une grave atteinte au droit international et aux résolutions onusiennes, qui affirment clairement qu'El Qods fait partie intégrante du territoire palestinien occupé depuis 1967 et est la capitale de l'Etat de Palestine », a souligné la diplomatie palestinienne dans un communiqué repris hier par des médias palestiniens. « Ces actes faisant partie des tentatives de l'occupation visant à effacer la question palestinienne, annuler le droit au retour des réfugiés et éliminer la condition de réfugié, conformément à ses objectifs coloniaux et expansionnistes, doivent être sévèrement sanctionnés par la communauté internationale », a insisté le ministère. Il a affirmé, à ce sujet, que « l'Etat palestinien ne lâchera jamais prise et continuera à se battre par tous les moyens diplomatiques, afin de contraindre l'occupant sioniste à mettre un terme à sa folie et à sa défiance à la légitimité internationale ». Le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a, pour rappel, fustigé l'attaque menée par les forces d'occupation sionistes contre des écoles de l'UNRWA, notant que les installations onusiennes « sont inviolables, et cette spécificité doit être prise en compte en permanence ».
Plus de 1100 mosquées détruites ou endommagées
L'entité sioniste a détruit ou endommagé 1109 mosquées dans la bande de Ghaza lors du génocide commis par son armée entre le 7 octobre 2023 et le 19 janvier dernier, a indiqué le ministère palestinien des Affaires religieuses. Le ministère a détaillé, dans un rapport, que « 275 mosquées avaient été partiellement ou gravement endommagées et 834 autres complètement détruites, en plus de la destruction de trois églises de la ville de Ghaza ». Le département a ajouté qu'« au moins 315 responsables et employés de mosquées avaient été tués et 27 autres arrêtés par les forces d'occupation ». Le rapport indique également que les soldats sionistes « ont détruit 643 biens appartenant à des institutions religieuses, pris pour cible 30 institutions juridiques et 30 bâtiments administratifs, dont le siège principal du ministère et le siège de la Radio du Saint Coran ». Le ministère a annoncé, à l'occasion de la publication du rapport, le lancement d'une « Coalition des minarets » pour la reconstruction des mosquées et des institutions religieuses dans la bande de Ghaza. Cette coalition regroupe des chefs d'institutions religieuses et caritatives et d'autres personnalités religieuses de plus de 30 pays.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Sous prétexte de vouloir protéger les Druzes : Netanyahu menace d’une intervention militaire en Syrie

Le Premier ministre israélien se sert de récents incidents qui se sont produits dans une ville druze appelée Jaramana, située aux portes de Damas, pour menacer d'intervenir en Syrie pour soi-disant « protéger les druzes ». Depuis l'effondrement du régime alaouite le 8 décembre 2024, Israël n'a de cesse de multiplier les agressions militaires contre la Syrie, au mépris du droit international.
Tiré d'El Watan.
Ces derniers jours, l'armée israélienne a mené de nombreuses frappes au sud de Damas suivies d'incursions terrestres, près de Deraa, Quneitra et Al Soueida. Dans un article recensant les dernières opérations militaires israéliennes en Syrie, aljazeera.net relève : « Depuis la chute du président Bachar Al Assad, les forces d'occupation israéliennes ont effectué plusieurs incursions dans le sud de la Syrie, atteignant de nombreux points importants, notamment Jabal Al Sheikh, Jabatha Al Khashab et Tallul Al Hamar dans le gouvernorat de Quneitra, en plus du bataillon de mortiers près de la ville d'Abdeen, dans la campagne occidentale de Deraa, où les forces israéliennes ont établi des postes militaires et y sont toujours stationnées. »
L'article poursuit : « Des postes avancés ont également été le théâtre d'incursions des forces d'occupation pendant des heures avant de se retirer, comme la zone du bassin du Yarmouk à l'ouest de Deraa, où les troupes israéliennes ont atteint les villes de Koya, Jamlah, Ma'ariyah et Abdeen. »
Le 25 février, au soir, quatre frappes israéliennes ont touché un site militaire à Kisweh, dans la province de Damas. Ces raids aériens ont fait deux morts, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). La même source a fait état en outre d'une autre série de frappes sionistes contre un site militaire dans la campagne de Deraa, au sud du pays. « Des avions israéliens ont mené quatre frappes sur le quartier général d'une unité militaire au sud-ouest de Damas.
Simultanément, une autre frappe israélienne a touché une position militaire dans la province de Deraa », précise l'OSDH. L'offensive aérienne menée dans la campagne de Deraa a touché plusieurs positions, spécialement au niveau des collines de Tell Al Hara qui surplombent le Golan occupé et le nord d'Israël.
Israël veut « démilitariser le sud de la Syrie »
Selon aljazeera.net, l'armée israélienne a effectué de nouvelles incursions terrestres suite à ses frappes aériennes contre des cibles militaires à Kisweh. « Mercredi soir (le 26 février, ndlr), les forces d'occupation israéliennes ont fait une incursion en territoire syrien. Elles sont arrivées par voie terrestre, à bord de dizaines de véhicules militaires, dans la ville d'Al Bakkar, dans la campagne occidentale de Deraa, et sont entrées dans une caserne militaire appartenant à l'ancienne armée syrienne, connue sous le nom de caserne Al Majahid, dont les bâtiments ont été dynamités.
Dans le même temps, des véhicules blindés ont pénétré dans la ville de Jaba, dans la campagne centrale de la province de Quneitra, et ont atteint la ville d'Ain Al Bayda, dans le nord de la province, où ils ont détruit au bulldozer des arbres dans les environs avant de se retirer en direction du Golan occupé. »
Pour justifier ses agissements belliqueux, l'entité sioniste a prétexté avoir « attaqué des cibles militaires dans le sud de la Syrie, y compris des quartiers généraux et des installations contenant des armes », indique la BBC. Un communiqué du bureau de Netanyahu a justifié cette offensive en disant que « la présence de forces militaires dans la partie sud de la Syrie constitue une menace pour Israël ».
Le dimanche 23 février, le Premier ministre israélien a mis le feu aux poudres en déclarant que « le sud de la Syrie devait être complètement démilitarisé ». « Nous n'autoriserons pas les forces de l'organisation HTS (Hayat Tahrir Al Sham) ou de la nouvelle armée syrienne à entrer dans la zone au sud de Damas », a-t-il affirmé. « Nous exigeons la démilitarisation complète du sud de la Syrie, y compris les provinces de Quneitra, Deraa et Soueida », a insisté le boucher de Ghaza.
Par ailleurs, Netanyahu s'est servi de récents incidents qui se sont produits dans une ville druze appelée Jaramana, située aux portes de Damas, pour menacer d'une intervention militaire en Syrie pour soi-disant « protéger les druzes ».
Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ce samedi 1er mars et premier jour de Ramadhan, il y a eu des affrontements armés dans cette ville à majorité druze et chrétienne (gouvernorat de Rif Dimashq). Ces incidents ont fait un mort. « Au moins une personne a été tuée et environ 9 autres ont été blessées dans la ville de Jaramana après que des affrontements aient éclaté entre des habitants de la ville et des membres de la Sécurité intérieure », explique l'OSDH.
« Si le régime s'en prend aux druzes, il en subira les conséquences »
Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a aussitôt réagi, dans un communiqué diffusé samedi soir, en s'attaquant avec véhémence au nouveau régime syrien qu'il qualifie d'« islamiste radical » et de « terroriste ». « Si le régime s'en prend aux druzes, il en subira les conséquences de notre part. Nous avons ordonné à Tsahal de se préparer et de transmettre un avertissement ferme et clair : si le régime porte atteinte aux druzes, nous lui porteront atteinte. » Ce sont les termes du communiqué officiel cité par l'AFP. Netanyahu et Israël Katz soutiennent que la ville de Jaramana « est actuellement attaquée par les forces du régime syrien ».
Sur le terrain, la situation est autrement plus complexe, et plusieurs personnalités druzes ont appelé au calme en soulignant leur attachement à la Syrie et en insistant sur les bonnes relations que les druzes entretiennent avec les nouvelles autorités. Hier, la situation semblait apaisée. « La ville de Jaramana est revenue au calme après les événements d'hier et d'aujourd'hui (samedi et dimanche, ndlr) », assure l'OSDH. L'ONG fait état d'un « retrait de toutes les factions locales de Jaramana après que les sages de la région aient appelé à l'arrêt des affrontements ».
A noter par ailleurs que plusieurs manifestations populaires ont eu lieu en Syrie ces derniers jours, notamment dans les provinces du Sud, dénonçant les violations israéliennes répétées de l'intégrité territoriale syrienne. Il convient de rappeler aussi que la Conférence de dialogue national, qui s'est tenue le 25 février à Damas, a vivement condamné les incursions sionistes ainsi que les velléités d'invasion israéliennes ciblant le territoire syrien.
Abdallah II : « Reconstruire Ghaza sans déplacer la population »
Le roi de Jordanie, Abdallah II, a réitéré la nécessité de reconstruire la bande de Ghaza sans déplacer sa population, mettant l'accent sur l'urgence de consolider le cessez-le-feu en vigueur. Au cours d'un appel téléphonique samedi soir avec le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, le roi Abdallah II « a souligné la nécessité de reconstruire la bande de Ghaza sans déplacer ses habitants, de consolider le cessez-le-feu en vigueur et d'intensifier les efforts internationaux en matière de réponse humanitaire », a indiqué la Cour royale jordanienne dans un communiqué.
Le roi Abdallah II a réitéré, à la même occasion, l'impératif de mettre un terme à l'escalade dangereuse des agressions sionistes en Cisjordanie occupée, soulignant « l'importance d'un travail sérieux et efficace, pour trouver un horizon politique permettant de parvenir à une paix juste et globale ». Samedi, le porte-parole du SG de l'ONU, Stéphane Dujarric, a mis en garde contre une éventuelle reprise de l'agression sioniste dans la bande de Ghaza, affirmant que cela serait « catastrophique ».
Ghaza : Obligations de l'entité sioniste L'OCI présente des observations écrites à la CIJ
Le secrétariat général de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) a présenté des observations écrites à la Cour internationale de justice (CIJ) concernant l'avis consultatif de l'ONU sur les obligations de l'entité sioniste vis-à-vis des activités des Nations unies, d'autres organisations internationales et d'Etats tiers dans les territoires palestiniens occupés.
Dans un communiqué repris samedi par l'agence de presse Wafa, l'OCI « a souligné l'importance de ces efforts juridiques pour faire face aux mesures de l'entité sioniste, la puissance occupante, et à ses lois empêchant l'Agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens(UNRWA) de mener ses activités dans les territoires palestiniens occupés depuis le 30 janvier dernier ». L'organisation islamique a, à ce sujet, renouvelé son « soutien indéfectible à l'UNRWA qui a été créée sur décision de l'Assemblée générale des Nations unies, pour servir les réfugiés palestiniens jusqu'à ce qu'une solution juste et permanente soit trouvée à leur cause ».
A rappeler que la CIJ avait fait savoir, début février, qu'elle avait autorisé l'OCI à émettre des remarques quant au respect de l'entité sioniste de ses obligations dans les territoires palestiniens. Le 19 décembre 2023, l'AG de l'ONU avait adopté une résolution demandant un avis consultatif à la CIJ sur les obligations de l'entité sioniste, en tant que puissance occupante, concernant la présence et les activités de l'ONU, y compris de ses agences et organes, d'autres organisations internationales et Etats tiers."
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le chef de la milice kurde du PKK en Turquie demande à ses partisans de déposer les armes
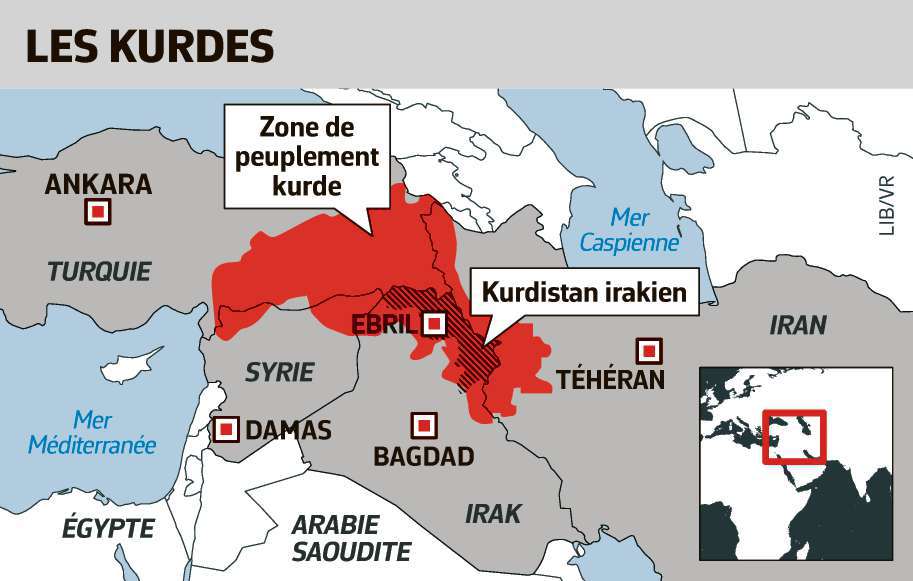
Les combats entre la Turquie et le Parti des travailleurs du Kurdistan, considéré comme une organisation terroriste par les États-Unis et l'UE, ont commencé en 1984 et ont fait environ 40 000 morts. La Turquie, en suspens sur une éventuelle fin du conflit avec le PKK après quatre décennies de combats.
Photo et article tirées de NPA 29
Abdullah Öcalan, leader du Parti des travailleurs du Kurdistan – déclaré organisation terroriste par l'UE, les États-Unis et la Turquie – a appelé à déposer les armes depuis la prison où il est emprisonné depuis 26 ans.
Dans une lettre adressée au parti politique pro-kurde DEM (Parti de l'égalité et de la démocratie), Öcalan a déclaré qu'il assumait la « responsabilité historique » de cet appel et a demandé à tous les groupes de faire de même et au PKK de se dissoudre.
Le DEM a rendu visite au leader en prison ce jeudi et lui a ensuite transmis son message. Le parti pro-kurde a formé un groupe de contact connu sous le nom de Délégation Imrali (du nom de l'île où Öcalan est emprisonné) et a rendu visite à trois reprises au fondateur du PKK, un événement rare en 26 ans d'isolement.
La dernière visite à Imrali remonte à presque quatre ans. Öcalan a fondé le PKK en 1978 avec une base séparatiste marxiste-léniniste et en 1984, le groupe a commencé une lutte armée contre le gouvernement turc pour créer un État kurde.
Öcalan est en prison depuis 1999 et le conflit entre les forces de sécurité turques et le PKK a fait environ 40 000 morts en quatre décennies. Dans les années 1990, le PKK a modifié son objectif en faveur d'une plus grande autonomie du peuple kurde au sein de la Turquie et a défini son idéologie comme un « confédéralisme démocratique ».
Les négociations entre Öcalan et la Turquie ont débuté l'année dernière et l'un des premiers signes publics a été la déclaration du leader ultranationaliste Devlet Bahceli. Le président du Parti du mouvement nationaliste (MHP), dans un virage à 180 degrés, a invité le fondateur du PKK à s'adresser au Parlement turc pour annoncer le démantèlement de l'organisation et ouvrir la possibilité de sa libération après plus de 25 ans de prison. .
« L'appel lancé par M. Devlet Bahceli, ainsi que la volonté exprimée par le président [Recep Tayyip Erdogan] et les réponses positives d'autres partis politiques, ont créé un environnement dans lequel j'appelle à déposer les armes », a expliqué Öcalan dans sa lettre. .
De même, il salue tous ceux qui « croient à la coexistence » et qui attendent cet appel, sur lequel des spéculations circulent depuis des semaines. « Les deux précédents dialogues d'Ankara avec le PKK (2009-2011 et 2013-2015) ont lamentablement échoué, entraînant de nouvelles violences et érodant la popularité du président. Cette fois, Erdogan s'est montré plus calculateur lorsqu'il s'agit de publier des mises à jour sur la diplomatie du PKK », a récemment noté l'analyste Soner Cagaptay, chercheur sur la Turquie au groupe de réflexion du Washington Institute et auteur de plusieurs livres sur Erdogan. .
Öcalan n'a pas officiellement dirigé le PKK depuis des décennies, mais il est considéré comme le principal dirigeant de l'organisation et ses dirigeants ont déclaré publiquement qu'ils écouteraient les messages d'Öcalan et agiraient en conséquence. .
La Turquie, en suspens sur une éventuelle fin du conflit avec le PKK après quatre décennies de combats Pourtant, les experts ont exprimé des doutes quant à la concrétisation de son message. « Certains anciens dirigeants soupçonnent peut-être que la Turquie ne fera pas de concessions similaires à l'assignation à résidence proposée à Öcalan. .
En fait, certains craignent probablement d'être tués par l'Organisation nationale de renseignement turque (MIT), même si on leur promet une amnistie à court terme en exil. « Des commandants plus âgés pourraient également s'opposer à la dissolution complète ou immédiate du PKK sans atteindre aucun de leurs objectifs initiaux, un résultat qui pourrait suggérer qu'ils ont gâché leur vie en vain », affirme Cagaptay.
Javier Biosca Azcoiti 27 février 2025
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Gaza. Le Hamas à la croisée des chemins

Malgré ses divers courants, le Hamas a réussi à traverser près de quatre décennies sans connaître de divisions dans ses rangs. Mais la destruction de Gaza après le 7 octobre et les pertes importantes qu'il a subies rebattent les cartes, que ce soit entre le courant religieux et militaire, ou bien entre l'aile basée dans Gaza et celles des dirigeants de l'extérieur.
Tiré d'Orient XXI.
L'évolution de la situation sur la scène palestinienne rend l'analyse de l'actualité et des perspectives particulièrement difficile. Ce constat est partagé par le Hamas, qui se trouve aujourd'hui tiraillé entre deux aspirations : celle du retour des Frères musulmans et du projet turc dans la région, au vu de l'évolution de la situation en Syrie ; ou la poursuite — non sans difficulté — du projet de « l'axe de résistance » — que le mouvement a rejoint à nouveau après une période de froid avec l'Iran (1) Si cet axe s'effondre complètement, le Hamas perdra alors sa capacité à poursuivre la lutte armée… s'il n'envisage pas déjà d'abandonner cette option.
Ce conflit interne rappelle le débat entre la branche palestinienne des Frères musulmans et Fethi Chikaki, fondateur de l'Organisation du Jihad islamique palestinien au début et au milieu des années 1980. Craignant la concurrence de ce dernier, le Hamas voit le jour avec le choix de la lutte armée dès sa création en 1987, pour devenir ainsi la dernière faction palestinienne à prendre les armes face à Israël. En moins d'un quart de siècle, il est devenu l'organisation la plus puissante à affronter Israël, jusqu'à mener une opération sans précédent dans l'histoire du conflit israélo-palestinien, voire israélo-arabe.
Deux courants internes concurrents
Plusieurs obstacles se dressent devant le choix d'abandonner la lutte armée, dont l'expérience du Fatah n'est pas la moindre, celui-ci s'étant beaucoup affaibli en optant pour cette voie. L'Autorité palestinienne (AP) — dont il est la composante principale — s'est alors transformée en une sorte d'agent de sécurité d'Israël et des États-Unis, voire en agent militaire aujourd'hui, comme le montre la double opération menée depuis le 5 décembre 2024 contre les différents groupes de résistance, dans le nord de la Cisjordanie occupée.
Le courant de Yahya Sinouar, cerveau de l'opération du 7 octobre, au sein du Hamas, essentiellement présent dans la bande de Gaza, représente également un obstacle à l'idée d'abandonner les armes. Ses idéologues et ses partisans se trouvent dans les nombreux rouages contrôlant les activités du Hamas dans les territoires palestiniens, à l'étranger, ainsi que dans les prisons. Ils sont toutefois moins présents en Cisjordanie, où les membres de l'organisation sont plus enclins à suivre le courant de Khaled Mechaal, chef du bureau politique entre 1996 et 2017.
Or, pour comprendre le Hamas, il faut sortir du narratif classique qui oppose le courant turco-qatari au courant Iran-Hezbollah, car la réalité interne est bien plus complexe. Et le 7 octobre ainsi que la guerre destructrice menée par Israël sur Gaza n'ont fait qu'ajouter à la complexité de la situation, après les changements majeurs, survenus au sein du mouvement après 2017.
Un des changements essentiels a vu le jour à la suite du conflit entre le courant de prédication (da'wa), dont les partisans sont aujourd'hui désignés au sein du mouvement comme des « pragmatiques », et le courant militaire, que ses adhérents appellent le « courant radical ». Les anciennes figures de la da'wa ont durement concurrencé Yahya Sinouar lors des élections internes de 2021. Ce dernier ne l'a emporté qu'avec grande difficulté.
Les partisans de la da'wa se trouvent principalement dans le travail institutionnel. Suivant l'exemple des Frères musulmans, ils mettent l'accent sur l'étude théologique et l'éducation religieuse. Quant au courant militaire, il peut être décrit comme une version palestinienne et actualisée des Frères musulmans. Imprégné par la littérature de la gauche palestinienne et de celle de l'« Axe de résistance », il place la Palestine et sa libération au centre de ses luttes.
Si l'aile militaire a fini par l'emporter ces dernières années, la destruction de Gaza après le 7 octobre et les pertes importantes au sein de la structure du Hamas ont tout remis en question. Dès lors, le courant de la da'wa a demandé qu'un bilan soit fait de l'expérience du mouvement jusque-là, et que des voies de survie soient envisagées pour le futur proche. Or, les idées émises par le président étatsunien Donald Trump ne leur laissent aucune marge de manœuvre. Une plaisanterie circulant chez certains cadres du Hamas dit que même si Khaled Mechaal, Moussa Abou Marzouk (numéro 2 du Hamas et son chef du bureau des relations internationales) et Izzat Al-Richek (chef du bureau des relations arabes et islamiques du Hamas) faisaient leur pèlerinage à la Maison Blanche en en faisant 700 fois le tour (2), Washington ne leur ferait aucune place dans les solutions politiques, encore moins depuis que le Hamas est taxé de « daéchien » et de « nazi ». Une boutade, certes, mais qui dit quelque chose de la réalité.
Le poids géographique
L'autre changement essentiel qu'a connu le Hamas après 2017 est celui relatif aux origines géographiques et régionales de son commandement. Celles-ci restent, pour les Palestiniens, déterminantes dans le choix des partenaires de vie ou d'affaires, et jusqu'à la direction politique. L'importance des origines n'est d'ailleurs pas spécifique au Hamas, mais touche toutes les factions palestiniennes. Ces dernières années, le conflit interne s'est intensifié autour du transfert du pouvoir des mains des dirigeants originaires de Cisjordanie ou de la diaspora vers celles des Gazaouis, après qu'Ismaïl Haniyeh est devenu le chef du bureau politique du Hamas et Yahya Sinouar, chef du mouvement à Gaza.
Or, selon des sources internes au Hamas basées à Gaza, Yahya Sinouar a œuvré, durant les trois dernières années précédant le 7 octobre, à faire sortir de la bande un grand nombre de cadres du mouvement, afin de briser le monopole décisionnel détenu par les anciens cadres. Ces Gazaouis représentent encore à ce jour un bloc parallèle qui empêche le Hamas de céder aux volontés d'un certain nombre de partenaires arabes. À la tête de ce groupe figure le dirigeant Khalil Al-Hayya, désigné dans le dernier communiqué du mouvement comme « le chef du Hamas à Gaza », après avoir été chargé d'affaires et adjoint du dirigeant de Gaza. Ces cadres gazaouis sont également présents dans des secteurs stratégiques, comme la sécurité, l'informatique et les finances.
Ces dernières années, la discussion a porté dans l'entourage de Sinouar sur la prise de décision centrale, qui devrait émaner depuis le bureau de Gaza au vu de son poids numérique. Il est aussi celui qui paie le plus lourd tribut en termes de combats et de siège. L'on pourrait souligner alors que Moussa Abou Marzouk, bien que gazaoui, est un partisan de Khaled Mechaal et ne fait pas partie du courant Sinouar. C'est vrai, à ceci près qu'Abou Marzouk a quitté Gaza depuis des décennies. Mais, en regardant de près les nominations et les changements de porte-paroles et de représentants du Hamas à l'étranger depuis 2017, l'enjeu des origines géographiques et régionales des uns et des autres apparaît comme évident. L'on constate alors le nombre de dirigeants gazaouis qui ont remplacé, au sein des comités de travail extérieurs, ceux issus de Cisjordanie et de la diaspora.
Lorsqu'en 2004, Israël assassine le cheikh Ahmed Yassin, et ensuite Abdelaziz al-Rantissi, la décision est prise de déplacer le bureau politique à l'étranger afin d'en protéger les dirigeants. Depuis, et jusqu'à l'élection de Haniyeh et Sinouar à la tête du bureau politique (2021), la prise de décision et le financement sont restés aux mains de Mechaal, jusqu'à l'avènement de la révolution syrienne, soutenue par le Hamas. Ce positionnement a mis de l'eau dans le gaz dans les relations du Hamas avec l'« axe de résistance », et a forcé Mechaal à quitter Damas.
Qui prend les décisions aujourd'hui ?
Selon des sources au sein du Hamas et basées à l'étranger, le mouvement est dirigé aujourd'hui par un comité de cinq membres qui sont le président du Conseil consultatif du Hamas, Mohamed Darwich Ismaël, également président du comité ; Khalil al-Hayya du bureau de Gaza, qui est l'ancien adjoint de Yahya Sinouar ; Zaher Jabarine du bureau de Cisjordanie, et ancien adjoint de Saleh al-Arouri (3) ; de Khaled Mechaal du bureau extérieur et vice-président du Hamas ; et enfin Moussa Abou Marzouk, responsable des relations internationales.
Cette nouvelle composition reste toutefois très fragile à cause des divergences de ses membres : le président du Conseil, Mohamed Darwich Ismaël, reste pour sa part à équidistance de l'Iran et de la Turquie ; Abou Marzouk s'aligne quant à lui sur le courant turco-qatari représenté par Mechaal, dont il devient le bras droit en Turquie. Quant à Al-Hayya et Jabarine, ils représentent l'ancien courant Sinouar-Arouri.
Pour l'heure, le Hamas se concentre davantage sur la question des otages et sur l'idée d'une sortie de guerre. Il repousse à plus tard les questions liées à son commandement, que ce soit au niveau interne palestinien (sous l'égide de Houssam Badrane), au niveau arabe (sous la direction d'Oussama Hamdane) ou au niveau des relations internationales, avec Moussa Abou Marzouk.
La période d'après-guerre devrait connaître une polarisation entre deux lignes. La première est celle de l'« axe de résistance », que Sinouar représentait, en adéquation avec les attentes du conseil militaire et la vision du bureau politique. Cette ligne s'étend à tous les pays de l'« Axe de résistance » ainsi qu'à tous ceux qui peuvent fournir le Hamas en armes.
La deuxième ligne est celle du courant turco-qatari, représenté par Mechaal et par Abou Marzouk, et qui s'aligne avec celle du Quartet pour le Moyen-Orient (4). Suivant les trois principes-cadres posés par le Quartet — le rejet de l'usage de la violence, la reconnaissance de l'État d'Israël et l'acceptation des précédents accords — pour aboutir à la création d'un État palestinien sur la base des frontières de 1967, le Hamas parachèvera son intégration au sein du système posé à la fois par la Ligue arabe et les États-Unis. Mais Mechaal et son courant concèdent ignorer encore les conséquences des changements régionaux ou internationaux avec la présidence de Trump et la prise du pouvoir d'Ahmed Al-Charaa en Syrie.
Quel rôle pour la Turquie ?
Les Turcs travaillent également de leur côté à l'institutionnalisation du mouvement et à la naturalisation ou l'octroi de permis de résidence permanente à ses cadres non militaires. Ankara tente également de convaincre le Hamas de la nécessité de cette étape pour ériger un État palestinien, ou du moins, pour que le mouvement ne disparaisse pas. Pour ce faire, ils l'intégreront de manière à ce qu'il soit sous leur contrôle, pour ensuite l'exploiter comme moyen de pression dans divers dossiers régionaux. Certains dirigeants du Hamas s'attendent même à ce que l'Iran accepte cette démarche, car Téhéran souhaite réduire la pression considérable qui pèse sur elle tout en assurant la survie du mouvement. Cependant, une partie importante du mouvement reste sceptique quant au programme turc et pourrait se tourner vers Téhéran, particulièrement ceux qui croient que la question palestinienne ne peut être résolue politiquement et que la solution réside dans le maintien de la résistance.
Mais que se passerait-il si le régime venait à changer en Turquie ? Et d'ailleurs, que pourrait obtenir Ankara pour les Palestiniens ? Un État ? Et sous quelle forme ? La guerre sur Gaza a été un exemple parfait des limites de la marge de manœuvre réelle des Turcs : ils n'ont réussi ni à mettre fin à la guerre ni à obtenir un accord de trêve. Pire, Ankara n'a même pas complètement suspendu les canaux commerciaux et les lignes d'approvisionnement maritime avec Israël, en raison de la présence sur son territoire de plusieurs entreprises privées israéliennes spécialisées dans la production et l'extraction de l'eau et dans le transport de nourriture et de gaz. De même qu'il existe une coopération turque avec des entreprises internationales d'exploitation minière et de gaz, dont les propriétaires ont des partenaires israéliens.
En réalité, une grande partie du Hamas de l'intérieur de Gaza, particulièrement ceux qui se méfient des Turcs, refuse l'adoption d'un nouveau programme politique et l'abandon des armes. Pour eux, cela va à l'encontre de la raison d'être de l'organisation en tant que mouvement de résistance. Les partisans de ce courant considèrent que la survie du Hamas repose sur le choix des armes, et qu'il ne faut pas trop compter sur ce qu'offrent les pays du Golfe ou même les États-Unis. Certes, il y a un certain ressentiment à l'encontre de l'« axe de résistance », mais ces partisans ne voient aucun avenir pour la résistance palestinienne sans les États qui la soutiennent militairement.
Cependant, avec la mort de Sinouar, ces voix commencent à s'estomper, laissant place à une volonté de préserver ce qu'il reste du mouvement et de sa base populaire. L'autre partie de ce courant envisage de se tourner plutôt vers l'Iran et le Yémen pour renforcer leurs positions, tout en maintenant une présence du Hamas en Turquie ainsi qu'au Qatar, sous couvert politique. Cette stratégie vise également à poursuivre les activités dans des « terrains prometteurs » comme l'Indonésie et la Malaisie.
Globalement, le Hamas se considère comme étant dans une phase extrêmement difficile qui pourrait le pousser à d'énormes concessions, qu'il ne souhaite pas accorder au Fatah, à l'heure où la question de l'intégration de l'arsenal du Hamas au sein de l'appareil sécuritaire de l'AP se pose dans certains cercles. Cependant, il pourrait être contraint d'en faire quelques-unes en fonction de l'évolution des événements, et de ce que Trump pourrait faire ou imposer aux pays arabes, y compris ceux qui ont normalisé leurs relations avec Israël, ou qui sont sur le point de le faire.
Les chances de survie
Entre-temps, on ne se bouscule pas pour la présidence du bureau politique. Après l'assassinat de Haniyeh, les rumeurs plaçaient Mechaal en favori, mais le poste est finalement allé à Sinouar. Depuis l'assassinat de celui-ci, plus personne dans le Hamas ne parle de la présidence. Selon une source de l'intérieur de l'organisation :
- Chacun sait que ce n'est pas tant un siège de présidence qu'un siège d'exécution. L'assassinat peut survenir à tout moment. Les tensions internes empêchent également la nomination d'un président, car l'ouverture d'un tel dossier risquerait de diviser le mouvement en deux parties ou plus.
Ce qui nous amène à un réel questionnement : comment le Hamas a-t-il pu être le seul organisme palestinien à ne pas avoir connu de scissions de toute son histoire, à l'inverse de toutes les autres organisations, qu'elles soient laïques, de gauche ou même islamistes ? Certaines figures ont quitté le mouvement pour se réfugier chez d'autres organisations, d'autres sont restées inactives ; aucune n'a formé un autre mouvement.
Réponse : à cause des élections, qui tombent d'ailleurs cette année, et qui ne pourront probablement pas se tenir au vu de la situation à Gaza comme en Cisjordanie. Ce scrutin à deux tours qui a lieu tous les quatre ans a toujours été le meilleur moyen d'apaiser les tensions internes au sein de l'organisation, tout en prévenant la dissidence. Il permet également à chaque courant de mettre en avant sa force et la justesse de sa lecture politique. Raison pour laquelle tout le monde cherche à éviter tout conflit autour de la présidence du bureau avant la date prévue des élections, afin que les voix et, ensuite, les parrainages soient les éléments décisifs.
Un dirigeant du Hamas commente :
- L'« axe de résistance » traverse sa période la plus difficile, et il y a un fort mécontentement quant à la gestion de la guerre contre Israël. Mais cette option reste moins risquée que celle de s'orienter complètement vers l'autre voie, celle du compromis. La Turquie agira selon ses intérêts sous protection américano-israélienne… Ce que nous craignons le plus, c'est la guerre interne au sein du Hamas et le conflit entre ses deux courants.
Il conclut :
- Il faut donner la liberté à l'action politique et aux espaces dans lesquels Mechaal, les Turcs et d'autres évolueront, mais sans toucher à une seule balle de notre arsenal, car cela signifierait notre mort à tous.
Notes
1- NDLR. Ce froid était dû au choix fait par le Hamas de s'opposer au régime de Bachar Al-Assad au moment de la révolution syrienne.
2- NDLR. Référence au pèlerinage de la Mecque durant lequel les fidèles font sept fois le tour de la Kaaba.
3- NDLR. Un des fondateurs des Brigades Al-Qassam et ancien vice-président du bureau politique de Hamas. Assassiné à Beyrouth le 2 janvier 2024.
4- NDLR. Comité international fondé à Madrid en 2002, dans le sillage de la seconde intifada, et formé par les États-Unis, la Russie, l'Union européenne et l'ONU, censé œuvrer comme médiateurs dans le « processus de paix » israélo-palestinien.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :












