Presse-toi à gauche !
Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

« Les femmes kurdes transforment la société, elles ne se contentent pas de lutter »

Écrivaine libanaise, Nelly Jazra a déclaré au micro de l'ANF que le mouvement des femmes kurdes allait au-delà de la lutte armée en confrontant les normes de genre et en transformant la société.
Tiré de Entre les lignes et les mots
Au Moyen-Orient, les femmes mènent une lutte à plusieurs niveaux. Elles résistent non seulement aux inégalités entre les sexes, mais aussi à la répression politique, à la domination culturelle et aux politiques coloniales.
À travers un vaste territoire s'étendant de l'Algérie à la Palestine, de l'Iran au Kurdistan, les femmes continuent de lutter pour leurs droits dans de nombreux domaines, notamment l'éducation, la représentation politique, la liberté vestimentaire et la résistance armée. Elles sont devenues porteuses d'un profond désir de liberté, exprimé dans le slogan « Jin, jiyan, azadî » (Femme, vie, liberté). Nelly Jazra, chercheuse, étudie ces luttes au niveau universitaire.
Nelly Jazra, universitaire libanaise travaillant à la Commission européenne, examine de près les mouvements de résistance des femmes au Moyen-Orient dans son livre récemment publié « La Lutte des Femmes », en s'intéressant plus particulièrement au rôle des femmes kurdes au Rojava. Elle s'est entretenue avec ANF sur le passé, le présent et l'avenir de ce combat.
Votre récent livre, « La Lutte des Femmes », vient de paraître. Vous y explorez les mouvements de femmes dans différents pays. Comment ce travail a-t-il débuté ?
Je suis originaire du Liban. Je suis née à Beyrouth et j'ai passé la majeure partie de ma vie au Moyen-Orient. Je connais donc très bien les enjeux de la région. Plus tard, j'ai déménagé en Europe pour travailler à la Commission européenne.
Mais j'ai continué à suivre l'évolution politique au Moyen-Orient, en particulier les luttes des femmes dans ces pays. Avec l'émergence de l'État islamique et les changements qui en ont résulté, je me suis montrée de plus en plus curieuse de l'impact de ces transformations politiques sur la vie des femmes.
Avant d'aborder les récents mouvements féministes, j'aimerais aborder le combat historique des femmes au Moyen-Orient. Ce combat est souvent resté dans l'ombre, et on a souvent l'impression qu'il n'a jamais existé. Est-ce vrai ?
Absolument pas. Bien sûr, on ne peut pas dire que toutes les femmes aient participé à ce combat. Mais dans de nombreux cas, lorsque leurs droits sont menacés ou qu'elles sont exclues de la vie publique, elles agissent. Cela est devenu particulièrement visible avec la montée des mouvements extrémistes, notamment de Daech, dans des pays comme la Syrie et l'Irak. Cela a également affecté d'autres pays où des forces extrémistes similaires étaient présentes.
Ces mouvements tentaient d'imposer aux femmes des règles qu'elles refusaient. En conséquence, les femmes se sont soulevées et ont commencé à résister. Bien sûr, on ne peut pas dire que toutes les femmes s'y soient opposées, car certaines se sont ralliées à ces groupes et ont adhéré à leur idéologie, mais elles constituaient une petite minorité.
La majorité des femmes s'opposent à la réduction de leurs droits.
On sait que les femmes ont joué un rôle actif durant la période anticoloniale au Moyen-Orient. Quel rôle ont-elles joué à cette époque ? Y a-t-il eu des mouvements féministes ?
Oui, il y en a eu. Les premiers mouvements de femmes remontent à l'époque du mandat français, au début du XXe siècle. À cette époque, les femmes d'Égypte, du Liban et de Syrie ont commencé à se mobiliser. L'une des premières mesures symboliques qu'elles ont prises pour affirmer leur présence dans la vie publique a été de retirer leur foulard.
Plus tard, elles ont commencé à formuler des revendications, à s'organiser en groupes et à appeler à la participation à différents niveaux. Dans les années 1950, les femmes de nombreux pays du Moyen-Orient ont obtenu le droit de vote. Dans certains cas, cela s'est même produit plus tôt que dans certains pays occidentaux. Elles ont également revendiqué des droits essentiels tels que le droit au travail, le droit à l'éducation, les droits relatifs à leurs enfants et l'accès à certaines professions.
Bien sûr, cela n'a pas été facile. Après l'indépendance, certains pays ont facilité l'accès des femmes à ces droits. Par exemple, au Liban, il existait une certaine liberté dans l'éducation et la vie professionnelle. Mais dans d'autres pays, c'est beaucoup plus difficile.
Dans votre livre, vous mentionnez que les femmes kurdes ont pris les armes pendant la guerre civile pour défendre leurs droits. Pourriez-vous développer ce point ?
Oui. La lutte des femmes kurdes n'est pas récente. Elle remonte bien plus loin, car le peuple kurde dans son ensemble n'a jamais été officiellement reconnu. Lors de la division administrative du Moyen-Orient, les Kurdes ont été répartis entre plusieurs pays, comme la Turquie, l'Irak, l'Iran et la Syrie.
En conséquence, ils n'ont jamais pu s'unir en tant que peuple et établir un État indépendant. Par exemple, après le génocide, les Arméniens ont fondé l'Arménie et obtenu un État. En revanche, les Kurdes n'ont pas été reconnus. Cela est dû en grande partie aux événements survenus en Turquie après la Première Guerre mondiale.
C'est pourquoi la lutte kurde a été longue et continue, et les femmes y ont toujours pris part. Elles ont été reconnues sur un pied d'égalité avec les hommes, ce qui leur a permis d'accéder à l'éducation, de porter les armes et de combattre dans les mêmes conditions que les hommes. La lutte s'est intensifiée lorsque des groupes religieux radicaux sont apparus dans les régions kurdes et ont tenté d'imposer leurs propres lois.
Cette période fut bien plus mouvementée et dure. C'est sur ce point que je me concentre le plus dans mon livre. Les femmes se sont organisées et ont lutté pour leurs droits.
Comment cette forme de résistance des femmes kurdes s'inscrit-elle dans le contexte plus large des luttes féministes au Moyen-Orient ?
Les femmes kurdes ont donné un exemple marquant. Leur lutte ne consistait pas seulement à prendre les armes pour défendre leur peuple, mais aussi à affirmer leur existence en tant que femmes. Bien sûr, je ne peux pas dire que cela s'applique à toutes les femmes. Nous vivons encore dans des systèmes patriarcaux et la domination masculine reste très forte. Cependant, à travers ces soulèvements, les femmes ont voulu être reconnues non seulement comme des combattantes, mais aussi comme des femmes. Elles voulaient participer à la société et partager le pouvoir.
Dans votre livre, vous soulignez que les outils de résistance des femmes varient selon les pays du Moyen-Orient. Quelles formes de résistance avez-vous observées dans les pays étudiés ?
Oui, la situation dans ces pays est très différente. Au Liban, par exemple, les mouvements sont principalement organisés par des structures civiles.
Hormis les périodes de guerre civile, les mouvements de femmes ont rarement pris la forme d'une résistance armée. Les structures qui revendiquent des droits sont principalement des organisations de la société civile. Ces organisations œuvrent sur des questions telles que la lutte contre les violences faites aux femmes, la promotion de leur participation politique et la lutte pour le droit de garde des enfants. En effet, au Liban, le statut personnel des femmes et des hommes n'est pas régi par le droit civil, mais par le droit confessionnel. Chaque secte ou groupe confessionnel possède son propre cadre juridique. Ces cadres étant généralement façonnés par les autorités religieuses, les femmes sont souvent désavantagées. Telle est la situation au Liban.
En Syrie, les femmes ont obtenu des droits au début du régime Baas. Ces droits ont ensuite été quelque peu négligés, mais ils étaient déjà établis dès le début.
Une situation similaire s'est produite en Irak. Cependant, avec l'évolution de la structure sociale et l'instauration de régimes autoritaires ou dictatoriaux, les droits des femmes ont commencé à reculer. Cela les a poussées à s'organiser. Mais s'organiser n'était pas chose aisée, car la liberté d'expression y était extrêmement limitée et l'espace de liberté très restreint. Les femmes ont donc peiné à former des organisations. Elles y sont néanmoins parvenues. La représentation politique, en revanche, était beaucoup plus difficile.
Parmi les Kurdes, je crois que les femmes sont davantage reconnues. Leur présence est plus forte, tant au niveau de la gouvernance que de la direction de la société.
Le mouvement des femmes kurdes, notamment au Rojava, prône une démocratie radicale. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour les femmes dans leur vie quotidienne ?
Comme je l'ai mentionné précédemment, cela ne s'applique pas à la majorité des femmes, car beaucoup vivent encore dans des sociétés rurales fortement patriarcales. Cependant, des mouvements féministes pionniers au sein de la société aspirent au changement, cherchent à instaurer de nouvelles règles, revendiquent plus de liberté et d'autonomie et souhaitent organiser leur propre vie de femme. Ces femmes ne veulent pas rester uniquement dépendantes des structures familiales ou communautaires. Dans nombre de ces régions, les systèmes tribaux sont encore très forts, ce qui rend la situation encore plus difficile pour les femmes. La famille élargie et les réseaux tribaux jouent un rôle central dans la vie quotidienne. Malgré cela, au fil du temps, les femmes ont réussi à revendiquer leur propre espace.
Comment les idées du leader du peuple kurde Abdullah Öcalan ont-elles influencé la position des femmes dans les projets politiques kurdes ?
Je crois que certaines orientations politiques ont grandement bénéficié aux femmes. Lorsque leurs droits et leur rôle dans la société sont reconnus, il leur devient beaucoup plus facile de progresser dans leurs luttes.
Il ne s'agit pas seulement de résistance armée. La résistance civile joue également un rôle important, et il est essentiel de reconnaître la présence des femmes à tous les niveaux de la société, tant au niveau local que régional. En particulier, il reste encore beaucoup à faire au niveau local pour améliorer la situation des femmes en milieu rural.
Je m'intéresse principalement à la manière dont les femmes ont rejoint les luttes armées, et comment elles l'ont fait en réponse à une menace spécifique : les mouvements extrémistes qui cherchaient à les refouler dans les ténèbres du Moyen Âge. Ces idéologies et structures fondamentalistes cherchaient à confiner les femmes au foyer et à les réduire à un rôle défini uniquement par la reproduction, les excluant ainsi de la vie sociale.
Les femmes kurdes ont rejeté cette idéologie réactionnaire. Elles ont riposté non seulement par les armes, mais aussi en prônant une transformation sociale, tentant de changer les mentalités par leur résistance.
Le slogan « Jin, jiyan, azadî » est devenu très populaire ces dernières années. Il a trouvé un écho mondial, notamment après l'assassinat de Jina Amini en Iran. Que souhaiteriez-vous dire sur la résistance des femmes en Iran ?
Certes, la situation des femmes en Iran est extrêmement difficile, mais elles font preuve d'un courage incroyable. Elles sont descendues dans la rue en pleine répression.
L'assassinat de Jina Amini a déclenché un puissant mouvement qui a bénéficié d'un large soutien de la part d'une grande partie de la société. Ce soulèvement est également le résultat d'un régime qui réprime les femmes, les empêche de s'exprimer librement et les contraint à porter le foulard. En Iran, le foulard est un symbole. Il représente l'obéissance et la répression.
Lorsque les femmes retirent leur foulard, cela devient une forme de rébellion. C'était également le cas au début du XXe siècle au Moyen-Orient, notamment en Syrie, en Irak et en Égypte, ou même à l'époque ottomane. Retirer le foulard a longtemps été un symbole de résistance à la soumission et à la domination.
Aujourd'hui, bien que le port du foulard reste obligatoire, les femmes l'ont enlevé et ont dû faire face à une répression sévère. Cette répression brutale a affaibli les manifestations, mais ne les a pas arrêtées. Les femmes continuent de se battre et tentent de faire changer les choses. Mais ce n'est pas facile, car le régime actuel s'est construit sur de nombreuses années et repose sur des fondations très solides. Leur combat est extrêmement difficile, et je leur souhaite beaucoup de courage.
Peut-on dire que les liens entre les mouvements de femmes du Moyen-Orient et ceux d'Occident se sont renforcés ? Existe-t-il vraiment un tel lien ?
Absolument. La lutte des femmes est universelle. La lutte des femmes au Moyen-Orient n'est pas fondamentalement différente de celle des femmes occidentales. Les objectifs sont communs. Même si les problèmes ne sont pas exactement les mêmes, le combat pour les droits est le même.
Partout, les femmes réclament la reconnaissance de leur existence, l'acceptation de leur place dans la société et l'assurance de leur participation sur un pied d'égalité, que ce soit dans la vie professionnelle, politique ou ailleurs. C'est pourquoi je crois que le combat est le même. Il a fallu beaucoup de temps aux femmes pour obtenir des droits en Occident. Au Moyen-Orient, cela prendra peut-être plus longtemps, mais on peut dire que le mouvement se poursuit et progresse, même lentement. On ne peut pas dire qu'il progresse toujours, car les situations peuvent varier. Mais d'un point de vue historique, on peut dire qu'il y a eu des progrès.
Sur le champ de bataille, on constate souvent que les forces d'occupation ciblent délibérément les femmes en priorité, comme au Kurdistan, en Palestine ou en Syrie. Ce ciblage des femmes est-il une stratégie consciente ?
Oui, car affaiblir une société, c'est affaiblir ses femmes et leurs droits. Que font les groupes fondamentalistes radicaux lorsqu'ils arrivent au pouvoir ? Prenons l'exemple des talibans. Ils interdisent aux filles d'aller à l'école, empêchent les femmes de travailler, imposent le port du voile, forcent les mariages d'enfants et empêchent les femmes de quitter leur domicile.
S'attaquer aux femmes revient à faire reculer la société tout entière. Lorsqu'elles sont prises pour cible, le visage de la société change radicalement. Elle cesse de progresser et commence à régresser. Une société équilibrée et progressiste, où chacun peut s'épanouir, n'est possible que si les femmes occupent la place qu'elles méritent. Les femmes jouent un rôle majeur dans l'éducation des enfants et dans la formation des nouvelles générations. Les hommes aussi, bien sûr, mais la contribution des femmes est essentielle. C'est pourquoi la reconnaissance des droits des femmes est vitale pour l'avenir de toute société.
Comme vous le savez, après la chute du régime d'Assad, le groupe djihadiste Hay'at Tahrir al-Sham (HTS/HTC) a pris le contrôle de certaines régions de Syrie. Quelle menace cela représente-t-il pour les femmes syriennes ?
En Syrie, les politiques envers les femmes restent floues et l'incertitude générale persiste dans le pays. Je crois qu'il n'existe toujours pas d'approche claire et cohérente en matière de droits des femmes.
Le pouvoir en place semble disposé à reconnaître les droits des femmes, mais la pression exercée par l'idéologie djihadiste est toujours très présente, et nous ne pouvons l'ignorer. Cette pression persiste. Des contradictions existent également au sein même du pouvoir. Certaines personnes ont exprimé des opinions défavorables aux droits des femmes, tandis que le leader, Ahmed Al-Sharaa (Al-Jolani), semble promouvoir l'idée de construire une société plus progressiste où les femmes pourront jouir de leurs droits. J'espère que des progrès significatifs seront réalisés dans ce sens à l'avenir.
Les droits acquis par les femmes au Rojava peuvent-ils servir d'exemple pour l'avenir des femmes syriennes ?
Oui, je le crois, notamment en ce qui concerne la façon dont les femmes kurdes ont obtenu des droits grâce à la lutte civile, en résistant à l'oppression et en imposant l'obéissance. À cet égard, leurs efforts peuvent servir d'exemple.
Qui est Nelly Jazra ?
Nelly Jazra est une chercheuse et auteure libanaise spécialisée dans les droits des femmes et les dynamiques politiques au Moyen-Orient et dans les pays méditerranéens. Titulaire d'un doctorat en économie, elle travaille comme experte sur divers projets de la Commission européenne.
Nelly Jazra s'intéresse particulièrement aux droits civiques et au rôle des femmes dans la vie politique dans les pays arabes. Elle examine également de manière critique les politiques européennes en matière de genre au Moyen-Orient.
Les œuvres sélectionnées du Dr Nelly Jazra comprennent :
Combats des Femmes
Les Mouvements Sociaux : Liban-Irak-Algérie
Femmes dans les printemps arabes
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Droits et liberté : Les femmes sous les talibans

« Je les ai suppliés, ma fille était en train de mourir » : les règles des talibans en matière d'escorte masculine tuent les mères et les bébés.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/04/08/droits-et-liberte-les-femmes-sous-les-talibans-autre-texte/?jetpack_skip_subscription_popup
Selon des expert·es, l'obligation pour les femmes d'être accompagnées d'un homme en public bloque l'accès aux soins de santé et contribue à l'augmentation des taux de mortalité.
C'est au milieu de la nuit que Zarin Gul a réalisé que sa fille Nasrin devait se rendre à l'hôpital le plus rapidement possible. Le mari de sa fille était parti travailler en Iran et les deux femmes étaient seules avec les sept enfants de Nasrin lorsque celle-ci, très enceinte de son huitième enfant, a commencé à ressentir de fortes douleurs.
Gul a aidé Nasrin à monter dans un pousse-pousse et elles sont parties dans la nuit. Tenant la main de sa fille tandis que le pousse-pousse cahotait sur le chemin de terre, Gul dit avoir prié pour qu'elles ne rencontrent pas de poste de contrôle taliban.
« Je n'arrêtais pas de penser : si seulement le mari de Nasrin était là. Si seulement je pouvais soulager la douleur de ma fille », dit-elle. Ses prières n'ont pas été exaucées. La petite lampe du pousse-pousse a été repérée par des combattants talibans qui leur ont fait signe de s'arrêter et ont exigé de savoir où elles allaient.
Alors que Gul, effrayée, expliquait que sa fille était malade et avait besoin de soins médicaux urgents, ils ont demandé pourquoi les femmes voyageaient sans escorte masculine, ou mahram. Bien que Gul ait expliqué que le mari de Nasrin travaillait à l'étranger, les combattants ont refusé de les laisser passer et de poursuivre leur voyage jusqu'à l'hôpital.
« Je les ai suppliés, leur disant que ma fille était mourante. Je les ai suppliés de me laisser passer », raconte Gul. « Mais ils ont continué à refuser. En désespoir de cause, j'ai menti et j'ai dit que le conducteur du pousse-pousse était mon neveu et notre tuteur. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils nous ont laissé passer ».
Lorsqu'ils sont arrivés à l'hôpital, il était trop tard. Le bébé de Nasrin était déjà mort dans son ventre et son utérus s'était édchiér. Les médecins ont dit que Nasrin devait être transférée dans un autre hôpital. Gul a donc aidé sa fille à monter dans un autre rickshaw et elles sont reparties en direction d'un hôpital public situé à une heure de route. En chemin, elles ont été arrêtées à deux autres points de contrôle talibans, et à chaque fois détenues pendant de longues périodes parce qu'elles voyageaient seules.
Elles ont finalement atteint l'hôpital, mais Nasrin n'avait pas survécue au voyage. « Les médecins nous ont dit qu'en raison des saignements excessifs et de la déchirure de l'utérus, le bébé et la mère étaient mort·es », raconte Gul. « Nous les avons enterré·es côte à côte.
The Guardian et Zan Times, une agence de presse afghane, ont interrogé des dizaines de femmes et de professionnel·les de la santé dans plusieurs provinces afghanes. Leurs témoignages dressent le tableau d'un système de santé maternelle et infantile dangereusement compromis et érodé par les politiques draconiennes des talibans à l'égard des femmes.
Leur refus de laisser les femmes se rendre à l'hôpital sans être accompagnées, combiné à l'augmentation du nombre de mariages précoces, à un accès insuffisant aux soins de santé, à des routes peu sûres et à une négligence culturelle de la santé des femmes, contribuera inévitablement à l'augmentation du nombre de décès maternels en Afghanistan, selon les agences de l'ONU.
Même avant l'arrivée au pouvoir des talibans, l'Afghanistan affichait un taux de mortalité maternelle trois fois supérieur à la moyenne mondiale, selon les derniers chiffres officiels de la Banque mondiale datant de 2020.
Les expert·es préviennent que la santé maternelle risque de se détériorer davantage, ce qui est aggravé par la décision des talibans, en décembre 2024, de fermer toutes les formations médicales aux femmes, y compris aux futures sages-femmes.
Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), 24 mères et 167 nourrissons meurent déjà chaque jour en Afghanistan de causes évitables. On estime que plus de 20 000 villages du pays sont dépourvus de services de santé de base, ce qui affecte 14 millions de personnes.
Un récent rapport d'ONU Femmes estime que d'ici 2026, le risque pour une femme de mourir en couches aura augmenté de 50%.
Le personnel hospitalier des provinces afghanes a rapporté que des femmes ont toujours été empêchées d'accéder aux soins de santé maternelle parce qu'elles n'étaient pas accompagnées d'un homme.
La plupart arrivent dans un état critique, et certaines meurent simplement parce qu'elles ont été amenées trop tard
Un professionnel de la santé de l'hôpital régional Mirwais à Kandahar explique que l'hôpital reçoit des patientes de toute la province de Kandahar, mais aussi des provinces voisines.
« La plupart d'entre elles arrivent dans un état critique et certaines meurent simplement parce qu'elles ont été amenées trop tard. « Certains bébés meurent dans le ventre de leur mère, tandis que d'autres décèdent quelques minutes après leur naissance. Selon le personnel, l'hôpital a enregistré au moins 800 décès maternels et plus de 1 000 décès de nouveau-nés l'année dernière.
« Une jeune femme est arrivée à l'hôpital après avoir accouché dans un taxi », raconte Samina, une sage-femme travaillant dans un hôpital public de Kandahar. « Son bébé était mort en chemin par manque d'oxygène ». Lorsque je lui ai demandé pourquoi elle n'était pas venue plus tôt à l'hôpital, elle m'a répondu : « J'ai dû attendre que mon mari revienne du travail. Je n'avais pas d'autre tuteur masculin ».
Deux femmes ont déclaré au Guardian qu'elles avaient fait une fausse couche parce qu'elles n'avaient pas eu accès aux soins. Une personne interrogée a signalé le décès d'un membre de sa famille pendant l'accouchement.
« Ma sœur est morte hier pendant l'accouchement », raconte Pashtana*, 35 ans, de la province de Kandahar. « Son mari n'était pas à la maison lorsqu'elle a commencé le travail, et elle ne pouvait pas aller seule chez le médecin. »
Pashtana a déclaré que si sa sœur s'était rendue seule à la clinique, « elle n'aurait pas été soignée parce qu'elle n'avait pas de mahram ».
Plusieurs femmes ont déclaré au Guardian qu'elles s'étaient vu refuser des traitements et des ordonnances en l'absence d'un tuteur masculin ou parce qu'elles n'avaient pas la permission d'en avoir un.
« Je ne peux pas voir les médecins ou obtenir des médicaments si je ne suis pas accompagnée de mon fils ou de mon petit-fils », explique Qandi Gul*, une femme de 50 ans qui s'est rendue dans une clinique pour un examen ophtalmologique.
Une femme médecin de la province orientale de Nangarhar déclare : « Depuis la prise du pouvoir par les talibans, les femmes ne vont pas chez le médecin, sauf si la maladie se développe au point d'être insupportable ».
« L'une des raisons est liée aux difficultés financières, mais parfois aussi au fait que les hommes de la famille sont négligents et n'amènent pas la femme chez le médecin plus tôt. Et comme elles ne peuvent pas se déplacer seules, leur état s'aggrave », explique-t-elle.
D'ores et déjà, la pénurie croissante de professionnel·les de la santé et de sages-femmes qualifiées met gravement en danger la vie des femmes et des enfants, en particulier dans les zones rurales où l'on trouve peu de médecin·es qualifié·es.
Les médecin·es interrogés·e par le Guardian ont estimé que « plus de la moitié » de leurs collègues féminines avaient quitté leur emploi, en particulier dans les petites villes et les villages.
« La plupart de mes collègues ont quitté l'Afghanistan, ce qui a gravement affecté le secteur des soins de santé dans le pays », a déclaré le Dr Sima*, qui a choisi de rester avec son mari, également médecin. « Nous sommes toustes deux spécialistes et nous avons réalisé que nous ne pourrions pas faire ce travail à l'étranger ; nous sommes donc resté·es pour servir le pays ».
Une sage-femme de la province de Takhar affirme que les fonctionnaires du ministère taliban chargé de la propagation de la vertu et de la prévention du vice harcèlent et humilient constamment le personnel médical féminin. « Nous faisons de notre mieux pour faire notre travail, mais la pression est insupportable. Beaucoup d'entre nous ont envie de démissionner. Parfois, ils nous insultent en prétendant que nos vêtements sont ‘non islamiques'. »
« Un jour, notre service des urgences a été submergé de patientes. Cette section est réservée aux femmes et les hommes n'y sont pas admis. Mais les talibans ont fait irruption et ont emmené trois infirmières, sous prétexte que leur uniforme n'était pas approprié. Ils leur ont fait signer un engagement à porter des vêtements plus longs avant de les laisser partir. Même dans des situations d'urgence vitale, au lieu de nous laisser soigner les patient·es, ils nous arrêtent à cause de nos vêtements ».
* Les noms ont été modifiés pour protéger l'identité des personnes interrogées et de certains rédacteurs et rédactrices. Une version de cet article a été publiée par Zan Times.
Sana Atif, Freshta Ghani, Ruchi Kumar and Zuhal Ahad
https://www.theguardian.com/global-development/2025/apr/03/i-begged-them-my-daughter-was-dying-how-taliban-male-escort-rules-are-killing-mothers-and-babies
Traduit avec DeepL.com (version gratuite)
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
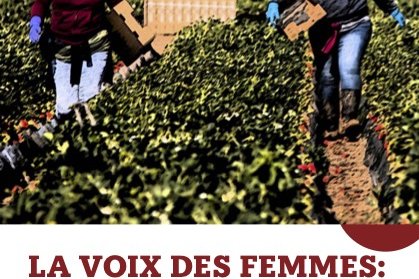
Drone Didi : autonomisation des femmes ou renforcement des inégalités ?
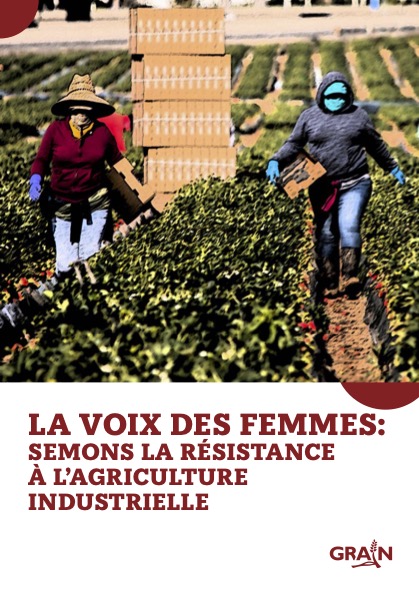
En Inde rurale, où les femmes représentent plus d'un tiers de la main-d'œuvre agricole, une nouvelle initiative est en train de prendre son envol. Le programme Namo Drone Didi, lancé par le gouvernement indien, vise à former 15 000 femmes issues de groupes d'entraide pour qu'elles deviennent pilotes de drones dans le cadre de tâches agricoles telles que la surveillance des cultures, l'épandage de produits agrochimiques et les semailles.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/04/04/larticulation-des-femmes-decvc-envoie-une-lettre-ouverte-a-hansen-sur-la-position-des-femmes-dans-la-vision-pour-lagriculture-et-lalimentation-autre-texte/?jetpack_skip_subscription_popup
Ce programme, qui s'inscrit dans un effort plus large visant à renforcer l'autonomie économique des femmes rurales, a été salué comme une initiative prometteuse. Mais pour des femmes comme Anita Patel, petite agricultrice de Varanasi, dans l'Uttar Pradesh, la réalité est plus complexe.
« Je suis une petite agricultrice qui doit subvenir aux besoins de sa famille », explique Anita. « Lorsque mon mari est tombé malade, j'ai dû trouver un travail qui me permettait de m'occuper de lui et de nos enfants tout en continuant à gérer notre ferme. Devenir Drone Didi m'a semblé être une bonne opportunité. »
Anita est l'une des premières femmes à participer à ce programme, soutenu par le groupe Mahindra, Garuda Aerospace et l'IFFCO (Coopérative indienne d'engrais agricoles). Grâce à une formation de 10 jours dispensée à l'Institut national de formation professionnelle d'Hyderabad, Anita a appris à piloter des drones, une compétence qu'elle utilise désormais pour pulvériser des biopesticides dans sa propre ferme biologique et des produits agrochimiques dans les fermes voisines.
« Utiliser le drone, c'est mieux que de porter chaque jour 10 litres de pesticides sur mon dos », explique-t-elle. « Mais ce n'est pas facile. La batterie ne dure que 30 minutes et je n'ai pas reçu les batteries supplémentaires promises par le gouvernement. »
Un programme plein de promesses et d'embûches
Le programme Namo Drone Didi s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus vaste visant à moderniser le secteur agricole indien, qui emploie près de la moitié de la population active du pays. Les femmes, souvent payées 25% de moins que leurs homologues masculins, assument une part disproportionnée des travaux agricoles. Le programme vise à remédier à ce déséquilibre en offrant aux femmes de nouvelles compétences et de nouvelles possibilités de revenus.
« L'idée est de réduire la charge physique pesant sur les femmes tout en augmentant leurs revenus », explique Gargie Mangulkar, représentante de MAKAAM, un forum national pour les droits des agricultrices. « Mais il y a d'importants défis à relever, qui vont des limites technologiques au risque accru d'endettement. »
Le programme offre une subvention de 80% sur le coût des drones, avec la possibilité de contracter des prêts via le Fonds d'infrastructure agricole pour couvrir les 20% restants. Cependant, l'accès à l'électricité, nécessaire pour recharger les batteries des drones, reste un obstacle majeur dans les zones rurales.
« Dans l'Inde rurale, l'approvisionnement électrique n'est pas fiable », explique Gargie. « En l'absence d'infrastructures adéquates, ces drones pourraient devenir un fardeau plutôt qu'un avantage. »
Les liens troubles avec les multinationales
Le programme Namo Drone Didi est étroitement lié aux intérêts des grandes entreprises. Garuda Aerospace, une startup basée à Chennai, fabrique le Kisan Drone, le principal outil utilisé dans le cadre du programme. De son côté, l'IFFCO et d'autres producteurs d'engrais proposent des formations et des incitations, notamment des scooters électriques gratuits pour les « Drone Didis » enregistrées.
« Ce programme est une contradiction en soi », explique Gargie. « D'un côté, le gouvernement promeut l'agriculture naturelle. De l'autre, il s'associe à des géants de l'agrochimie pour diffuser des pesticides. »
Anita, qui pratique l'agriculture biologique sur ses propres terres, voit bien les deux aspects. « J'utilise des biopesticides dans ma ferme, mais lorsque je suis engagée pour pulvériser dans d'autres fermes, j'utilise les produits chimiques qu'ils me fournissent », explique-t-elle. « C'est un travail et j'ai besoin de ce revenu. »
Si le programme Namo Drone Didi a peut potentiellement autonomiser les femmes rurales, les opposants mettent en garde contre le fait qu'il pourrait également renforcer les inégalités existantes. La transition vers une agriculture numérique, facilitée par des initiatives comme celle-ci, pourrait affaiblir les pratiques agricoles traditionnelles et accroître le contrôle des entreprises sur les petits producteurs et productrices.
« Les drones collectent des données détaillées sur l'utilisation et la productivité des terres », explique Gargie. « Ces données pourraient être exploitées par les entreprises pour dicter les pratiques agricoles, donner la priorité aux profits, voire identifier et acheter les terres les plus productives. »
Pour Anita, le programme lui a offert une bouée de sauvetage, mais il n'est pas sans poser de problèmes. « Je gagne environ 600 roupies (7 dollars des États-Unis) par jour, mais je dois encore faire deux ou trois autres petits boulots pour subvenir aux besoins de ma famille », confie-t-elle. « J'espère que le gouvernement tiendra ses promesses, notamment en ce qui concerne les batteries supplémentaires. Sans elles, il est difficile de joindre les deux bouts. »
Un appel à des alternatives durables
Tandis que le programme Namo Drone Didi s'étend, des organisations comme MAKAAM plaident pour des solutions plus durables. « Les femmes rurales ont besoin de meilleures alternatives », affirme Gargie. « Nous formons les femmes à l'agroécologie, en relançant des pratiques traditionnelles à la fois durables et émancipatrices. Nous avons commencé avec 50 femmes, et, aujourd'hui, environ 300 femmes rurales pratiquent l'agroécologie. »
Pour l'instant, Anita garde espoir. « Ce programme m'a permis de subvenir aux besoins de ma famille tout en restant près de chez moi », dit-elle. « Mais nous avons besoin de plus de soutien : des salaires plus équitables et un meilleur accès aux ressources. Ce n'est qu'à ces conditions que nous pourrons vraiment nous en sortir. »
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Quand des adolescentes résistent

Dans des situations extrêmes, la résistance surgit là où l'attend le moins, dans les pays où la condition des femmes est particulièrement oppressante et le soutien des hommes fait défaut. Et pourtant, un bon nombre d'adolescentes en Afghanistan et en RDC ont trouvé des façons de lutter, certes à une échelle modeste, mais significative.
Tiré de Entre les lignes et les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/04/29/quand-des-adolescentes-resistent/?jetpack_skip_subscription_popup
S'il fallait cartographier l'enfer, deux de ses pôles se trouveraient en Afghanistan et en République démocratique du Congo (RDC) respectivement et occuperaient la place centrale de la Géhenne réservée aux êtres humains nés de sexe féminin.
A prime abord, les deux pays, montagnes et désert d'un côté, tropiques et forêt vierge de l'autre, n'ont rien en commun. Si ce n'est l'extrême pauvreté des populations gouvernées de part et d'autre par une kleptocratie corrompue, les uns au nom d'une religion dévoyée, les autres, derrière un simulacre de démocratie. Et, à l'est de la RDC et en Afghanistan entier, on retrouve la plus abjecte chosification des femmes.
Dans cette partie du Congo qui regorge des minéraux les plus précieux, le viol sert à la captation des richesses, au pillage organisé des villages et des mines. Le corps des femmes est le champ de bataille suprême où s'affrontent toutes les convoitises- peu importe l'âge, du bébé de quelques mois à l'aïeule, pourvu qu'il y ait un vagin à déchirer, à taillader, à brûler. Comme si le principe de la féminité physique était à anéantir.
Les commanditaires rwandais de ces massacres à échelle gigantesque ont donné carte blanche à ces miliciens les M.23 abrutis par le sang, ivres de violence. C'est à partir de Kigali que tout s'organise avec la connivence cachée d'alliés à Kinshasa, sans la moindre entrave, sans la moindre réaction de la part des instances internationales pourtant habilitées à juger les crimes contre l'humanité. Et cela pour deux raisons principales. Les mines congolaises fournissent la planète en matières premières nécessaires pour notre technologie au quotidien, ordinateurs, téléphones dits intelligents- mais totalement dépourvus de réflexion morale. Repenser la technologie en fonction des conséquences humaines ? Impensable, d'autant que les victimes ne sont, majoritairement « que » des femmes.
Idem pour l'Afghanistan où s'est mis en place un apartheid de genre unique au monde : la moitié de la population, celle née de sexe féminin, est interdite de toute forme d'éducation au-delà d'un niveau primaire rudimentaire, interdite d'accéder à des services de santé, quitte à accoucher dans la rue devant une maternité où on leur refuse l'entrée si elles ne sont pas accompagnées d'un mahram, un proche parent masculin.
Certes quelques groupes occidentaux , s'en émeuvent ça et là, signent des pétitions, font montre de leur indignation. Ce sont souvent des soixantehuitardes plutôt que des jeunes militantes encartées qui se murent dans un silence politiquement correct, comme si mettre en cause le plus féroce des régimes islamistes (et tous les autres qui s'en inspirent) pouvait être taxé d'islamophobie. Et les gouvernements occidentaux (Russie comprise) Turquie et leurs sympathisants européens, eux, se montrent de plus en plus prêts à négocier avec les Talibans, comme si la montée partout des droites extrêmes et de la religion politisée suscitait une sorte de fatalisme qui acquiescerait le pire.
Mais en dépit du silence assourdissant de l'Occident, les adolescentes de l'Afghanistan et de la RDC se rebiffent. Voici deux exemples des plus parlants. A Bukavu dans un quartier pauvre, tous les samedis quand il n'y a pas école, depuis plus de dix ans, on range les tables et les bancs d'une salle de classe pour des cours de self-défense hebdomadaires destinés à des filles scolarisées de 6 à 18 ans. Quand les M23 sont venus occuper la villeen février dernier, les habitants étaient terrorisés par les agressions, les batailles en pleine rue, les vols à main armée. Mais au bout de 10 jours, ces petites guerrières en herbe, Pépé Macumu, leur vénérable prof et karateka chevronné, sans oublier l'infatigable Semy [1] qui les encadre ont décidé vaillamment de reprendre les cours – même si des cadavres jonchent les rues.
Bien entendu, leurs efforts peuvent paraître dérisoires en face de la brutalité des miliciens armés jusqu'aux dents, mais ces très jeunes filles auront toujours la dignité pour elles, le sentiment de leur propre valeur en tant que femmes. Dans ce microcosme urbain, la priorité a été donnée à la volonté de résister, de dire ‘non'. C'est le « no pasarán » des adolescentes congolaises.
Leur exemple inspire, puisque leDr Mukwege , prix Nobel de la Paix a voulu que de pareils cours aient lieu dans sa clinique, la fameuse clinique Panzi située également à Bukavu, où sont opérées les victimes de viols les plus brutaux.
A des milliers de kilomètres, en Afghanistan, leurs contemporaines résistent d'une autre façon : en étudiant. Emmurées chez elles par les Talibans, interdites de sortir, de chanter, de parler tout haut, elles ont été gommées, comme leurs aînées, de l'espace public, de la rue, des transports, en bref de la vie. Un pays sans femmes visibles où la moitié de la population est réduite à sa faculté domestique comme du bétail, labeur et reproduction.
Il existe des zones tribales pachtounes où les propriétaires tatouaient de la même façon « leurs » femmes et leurs vaches. La différence, c'est que cette pratique a été élevée au stade de dogme religieux par le régime taliban et s'exerce non pas directement sur le corps, mais par l'abolition de toute forme de droit et d'autonomie. Le corps féminin, voilé, entravé, naît marqué.
Mais ces jeunes filles se rebiffent. Des écoles secrètes se sont ouvertes partout dans le pays, gérées le plus souvent par des étudiantes qui avaient été en fin de cursus universitaire avant que toutes les facultés ne leur soient fermées. L'offre est variable, ce sont souvent des cours de tout genre, en fonction de que les enseignantes peuvent offrir. Pour celles qui peuvent se le permettre, des cours en ligne, parfois donnés à partir de l'étranger : encore faut-il pouvoir s'assurer d'une connexion internet et des moyens pour la payer, ainsi qu'une tablette et un téléphone.
Plus rarement, à l'instar de la scolarité mise en place par deux associations en France [2] qui travaillent ensemble, le programme scolaire entier, collège et lycée est proposé. Ici des adolescentes se rendent dans des classes secrètes, prenant des risques inouïs, pour apprendre, pour étudier, pour imaginer un avenir qui leur appartiendrait. Leurs jeunes enseignantes partagent ces risques dans une lutte certes inégale, contre le monolithe islamiste bien armé, bardé de technologie de surveillance. Mais ce que les Talibans ignorent, c'est que c'est ici que se forme la génération des femmes instruites qui les remplacera un jour si elles reçoivent le soutien qu'elles méritent
Au Congo, en Afghanistan, ces adolescentes luttent pour demeurer le sujet de leur propre histoire et non l'objet de celles de volontés (masculines hélas) arbitraires. Sans même se rendre compte de leur héroïsme, elles font partie des rarissimes résistantes de notre époque. A nous qui observons aussi mollement la montée de régimes autoritaires, voire totalitaires d'en tirer une leçon.
Pour tout renseignement sur le self-défense en RDC ou la scolarité secrète en Afghanistan, contacter : info@femaid.org
[1] Femaid (www.femaid.org)et Nayestane (www.nayestane.org)
[2] Association Afia-Fev, Bukavu
Carol Mann
Sociologue spécialisée dans la problématique du genre et conflits armés, activiste, chercheuse associée au LEGS (Paris 8), directrice de ‘FemAid'et ‘Women in War'.
https://blogs.mediapart.fr/carol-mann/blog/210425/quand-des-adolescentes-resistent-0
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
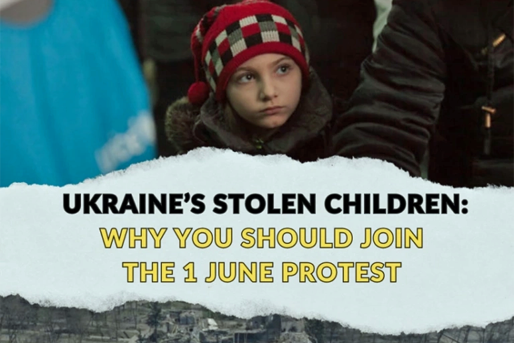
Les enfants volés de l’Ukraine : Un appel à l’action

Dans l'ombre de la guerre, une crise humanitaire dévastatrice se déroule en Ukraine, ciblant les plus vulnérables de la nation. Depuis l'invasion russe, les enfants ukrainiens sont au centre d'une stratégie génocidaire calculée visant à détruire l'avenir de l'Ukraine en tant que nation.
25 avril 2025 | tiré du site entre les lignes entre les mots
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/04/25/les-enfants-voles-de-lukraine-un-appel-a-laction/#more-93270
L'enlèvement et le déplacement forcés d'enfants ukrainiens appellent à une solidarité mondiale urgente pour identifier, localiser et sauver de la captivité russe les enfants ukrainiens qui ont été volés.
L'ampleur de la crise
Les chiffres racontent une histoire effrayante. Depuis le début de la guerre en 2014 et son escalade avec l'invasion totale de la Russie en 2022, on estime que 1,6 million d'enfants ukrainiens ont été touchés. Ce chiffre stupéfiant représente environ 20% de la population enfantine du pays. Ces enfants se sont vu voler leur vie, arrachés à leur foyer et à leur famille, dépouillés de leur identité et soumis à des traumatismes inimaginables.
Au cours des premiers mois de l'invasion, les autorités ukrainiennes ont recensé 19 546 cas d'enfants enlevés de force. Toutefois, l'ampleur réelle de la crise pourrait être bien plus importante. Le strict black-out de la Russie sur l'information dans les territoires occupés a rendu presque impossible la vérification du nombre exact d'enfants qui ont été transférés de force ou de leur situation actuelle.
Les responsables russes ont donné des indications troublantes sur l'ampleur des enlèvements. Selon les déclarations, plus de 700 000 enfants ukrainiens ont été transférés en Russie, ce qui dépasse de loin les estimations précédentes. Nombre de ces enfants sont désormais confrontés à une sombre réalité : endoctrinement, abus et même entraînement militaire forcé.
Privés d'identité et de citoyenneté
Beaucoup de ces enfants ont perdu leurs parents à cause de la guerre, ce qui les rend vulnérables et les prive de tout soutien. N'ayant pas accès aux recours juridiques prévus par le droit ukrainien ou international, ils sont pris au piège dans des circonstances désastreuses. Leur citoyenneté, leur identité et leurs liens familiaux sont systématiquement effacés, ce qui les laisse isolés et sans défense.
Les méthodes d'exploitation
Les crimes commis à l'encontre de ces enfants sont délibérés et multiformes. Ils visent à les dépouiller de leur héritage ukrainien et à les assimiler à la société russe. Ces atrocités se manifestent de plusieurs manières :
– L'endoctrinement et le nettoyage ethnique : Le régime russe a remanié le système éducatif dans les territoires occupés afin de rééduquer les enfants ukrainiens par la peur et la pression. En réécrivant l'histoire, en remplaçant les livres ukrainiens par des ouvrages russes et en niant l'existence de l'Ukraine, il vise à effacer l'identité nationale des enfants. Cette destruction culturelle systématique est la pierre angulaire de leur stratégie.
– Militarisation : Les garçons ukrainiens, dès l'âge de 12 ans, sont envoyés de force dans des académies militaires russes. Même dans les écoles des territoires occupés, des cours spécialisés les endoctrinent dans le système militaire russe. Contre leur gré, ces enfants sont formés pour devenir de futurs soldats, prêts à se battre contre leur propre patrie.
– Adoption forcée : De nombreux enfants sont placés dans des orphelinats russes ou adoptés de force par des familles russes. Cette coupure avec leurs racines ukrainiennes garantit que leur lien avec leur héritage est définitivement rompu.
– Traite et exploitation des êtres humains : Lorsque les noms et les dates de naissance des enfants sont modifiés, il devient pratiquement impossible de les retrouver. Cela les rend vulnérables à la traite des êtres humains en Russie, où des preuves indiquent des cas d'exploitation sexuelle, d'abus et de travail forcé.
Une violation manifeste du droit international
Les actions de la Russie ne sont pas seulement moralement répréhensibles, elles constituent également une violation flagrante du droit humanitaire international. Les conventions de Genève interdisent explicitement le transfert forcé ou la déportation de civils des territoires occupés. Des articles spécifiques traitent des droits des enfants, soulignant le besoin de soins appropriés, d'éducation et de réunification familiale, autant d'éléments qui sont systématiquement refusés.
Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) qualifie ces actes de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. La déportation forcée, en particulier lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une attaque systématique contre une population civile, répond aux critères de ces crimes graves. En ciblant les enfants, l'avenir même de l'Ukraine, la campagne russe témoigne d'une intention génocidaire, visant à effacer l'identité culturelle d'une nation et à saper sa souveraineté.

La stratégie cruelle derrière les enlèvements
L'enlèvement et l'assimilation forcée des enfants ukrainiens font partie d'une stratégie délibérée et sinistre. L'objectif de la Russie est d'effacer la culture ukrainienne en coupant les liens des enfants avec leur héritage, leur langue et leur famille. Pour ce faire, elle recourt à l'endoctrinement, à la militarisation et même à l'adoption forcée.
Le coût humain
Derrière ces chiffres stupéfiants se cachent des histoires individuelles de déchirement et de résilience. Beaucoup de ces enfants ont perdu leurs parents à cause de la guerre, ce qui les prive de tout recours légal et de tout moyen de s'échapper. Ils subissent des violences physiques et psychologiques, et certains risquent d'être victimes de la traite ou de l'exploitation.
Les conséquences psychologiques sont incommensurables. Les enfants qui sont endoctrinés dans la société russe sont confrontés à une crise d'identité qui peut prendre des années, voire des générations, à guérir. Ils sont non seulement privés de leur famille et de leur culture, mais aussi du sentiment de sécurité et d'appartenance que tout enfant mérite.
Pourquoi il faut y mettre un terme
L'enlèvement d'enfants ukrainiens par la Russie n'est pas seulement une crise humanitaire, c'est une stratégie aux implications considérables. En ciblant la prochaine génération d'Ukrainien·nes, la Russie cherche à affaiblir la résistance du pays et à compromettre son avenir en tant que nation souveraine.
Les motivations démographiques qui sous-tendent cette campagne ne peuvent être ignorées. La baisse du taux de natalité en Russie et le vieillissement de la population ont créé un besoin désespéré de jeunes. En déplaçant de force les enfants ukrainiens, la Russie tente de résoudre sa propre crise démographique aux dépens de l'avenir de l'Ukraine.
Cette stratégie rappelle étrangement les pratiques coloniales, où les enfants étaient arrachés à leur culture d'origine et assimilés aux sociétés dominantes. L'histoire nous a montré l'impact dévastateur à long terme de telles actions sur les individus et les communautés.
Se mobiliser pour la solidarité
Une action décisive est nécessaire pour ramener les enfants ukrainiens volés chez eux et garantir leur sécurité et leur bien-être.
Réunir les enfants ukrainiens volés avec leurs familles est plus qu'une mission humanitaire : c'est un combat pour la justice, la préservation de la culture et l'avenir de l'Ukraine en tant que nation.
Les enfants ukrainiens ne peuvent pas attendre. Il est temps d'agir.
À l'occasion de la Journée internationale de l'enfance, une marche pour les enfants d'Ukraine a été organisée à Londres pour réclamer la liberté des enfants enlevés par la Russie et la liberté de l'Ukraine face à l'occupation.
Lancée par Ukraine Solidarity Campaign, Campaign for Ukraine, Vsesvit et d'autres organisations ukrainiennes, conjointement avec les syndicats nationaux GMB, ASLEF, NUM et PCS, cette marche est un appel à l'action lancé au mouvement syndical et à l'ensemble de la société civile pour qu'ils prennent clairement position en faveur de la justice pour les enfants victimes de l'impérialisme et du fascisme russes.
Christopher Ford, secrétaire de la campagne de solidarité avec l'Ukraine
https://ukrainesolidaritycampaign.org/2025/04/21/ukraines-stolen-children-a-call-to-action/
Traduit avec DeepL.com (version gratuite)
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Une Ukraine démocratique et socialiste, et le droit à l’autodétermination pour toutes les nationalités opprimées

L'impérialisme russe est l'agresseur. Nous condamnons sans équivoque l'agression russe contre l'Ukraine.
26 avril 2025 | tiré du site entre les ligne entre les mots.
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/04/26/une-ukraine-democratique-et-socialiste-et-le-droit-a-lautodetermination-pour-toutes-les-nationalites-opprimees/#more-92909
Au-delà de toutes les discussions sur le caractère d'extrême droite du régime ukrainien, sur ses relations avec les néo-nazis ou avec l'OTAN, il existe certaines vérités fondamentales. L'Ukraine a été une nation opprimée sous la Russie tsariste, qui niait la spécificité de la langue et de la culture ukrainiennes. Même après la Révolution de février, les démocrates bourgeois ukrainiens avaient trouvé peu de soutien à Petrograd de la part du gouvernement provisoire russe. C'est le Parti bolchevique qui a inscrit le slogan du droit de toutes les nations opprimées à l'autodétermination. Ils ont accepté ce principe pour la Finlande, ainsi que pour l'Ukraine. Même lors des discussions de Brest-Litovsk, la délégation bolchevique de la Russie soviétique a reconnu le droit de l'Ukraine à l'autodétermination, tout en insistant sur le fait que les régimes fantoches mis en place par une puissance impérialiste n'étaient pas l'expression d'une véritable autodétermination.
En ce sens, Vladimir Poutine, qui cherche à étendre le pouvoir et l'autorité de l'impérialisme russe, a absolument raison de souligner que l'Ukraine moderne a été créée par Lénine et les bolcheviks. Cela a toutefois été nié par les répressions de l'ère stalinienne, la violence exercée contre les Tatars de Crimée, la terrible famine et les politiques assimilationnistes staliniennes en général.
Comme l'a clairement indiqué Poutine dans son discours, « Il est logique que la Terreur rouge et un glissement rapide vers la dictature de Staline, la domination de l'idéologie communiste et le monopole du Parti communiste sur le pouvoir, la nationalisation et l'économie planifiée – tout cela a transformé les principes de gouvernement formellement déclarés mais inefficaces en une simple déclaration. En réalité, les Républiques de l'Union n'avaient aucun droit souverain, aucun. » Il a toutefois regretté que « C'est vraiment dommage que les fondements fondamentaux et formellement juridiques de notre État n'aient pas été rapidement nettoyés [par Staline] des fantasmes odieux et utopiques [de Lénine] inspirés par la révolution, qui sont absolument destructeurs pour tout État normal. »
Poutine ne considère pas le conflit avec l'Ukraine comme un conflit international. Il veut faire revivre les ambitions impériales de la Russie, et l'Ukraine y occupe une place majeure. En tant que deuxième plus grande république de l'ex-URSS, elle occupait un espace considérable. L'impérialisme russe a été créé à partir de l'ancienne bureaucratie stalinienne. Vladimir Poutine, avec ses références d'ex-KGB, résume parfaitement cette transition. La Russie a connu une transition douloureuse vers le capitalisme et a donc émergé comme un impérialisme plus faible que celui des États-Unis. Mais c'est néanmoins un impérialisme.
L'ancienne Union soviétique s'est désintégrée et, bien que Moscou veuille affirmer son hégémonie partout, elle a été contrainte de procéder par petites étapes, car d'autres puissances impérialistes, ainsi que les ambitions nationales des nations autrefois dominées, constituent des obstacles. Néanmoins, Poutine a été implacable dans sa marche, tant sur le plan intérieur qu'international.
En Russie, les voix de l'opposition ont été étouffées, les médias sont contrôlés par l'État, et Poutine et ses acolytes exercent une autorité présidentielle ininterrompue depuis une génération. Sur le plan international, en 2008, pour empêcher la Géorgie d'adhérer à l'OTAN, Poutine (qui dirigeait alors depuis le bureau du Premier ministre derrière Dmitri Medvedev) a envahi son territoire. Une justification ténue a été invoquée en citant le soutien à la sécession des provinces d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, que Poutine a encouragées à revendiquer leur indépendance. En 2014, craignant que la Russie ne se retrouve encerclée si l'Ukraine rejoignait l'OTAN, Poutine a envahi et pris le contrôle de la Crimée. Ce faisant, il a violé l'accord de Budapest de 1994, dans lequel l'Ukraine renonçait au troisième plus grand arsenal nucléaire en échange d'assurances de sécurité inscrites dans un traité garantissant que son intégrité territoriale et sa souveraineté seraient pleinement respectées par les puissances étrangères, notamment la Russie. L'Ukraine espérait expressément prévenir les interventions militaires illégales.
Poutine est également intervenu militairement la même année dans les régions de Donetsk et de Louhansk, dans l'est de l'Ukraine, encourageant les groupes séparatistes à déclarer leur indépendance. Contrairement à la Crimée, où les Russes ethniques sont légèrement majoritaires, dans la région orientale du Donbass, la majorité est constituée d'Ukrainiens russophones, tandis que les Russes ethniques représentent environ 40% de la population de la région. Dans les deux cas, la Géorgie et l'Ukraine, Poutine pensait que les États-Unis étaient trop faibles pour l'affronter. En 2008, les États-Unis étaient enlisés dans la crise irakienne qu'ils avaient eux-mêmes brutalement provoquée, et en 2014, après avoir reconnu leur échec à atteindre tous leurs objectifs, ils ont retiré presque toutes leurs troupes d'Irak, se retrouvant avec une résurgence partielle de la paralysie militaire de l'après-guerre du Vietnam. Le fait que les États-Unis se soient finalement retirés d'Afghanistan en abandonnant leur gouvernement fantoche et n'aient guère fait plus que d'exprimer leur mécontentement face à l'envoi de troupes russes au Kazakhstan en janvier de cette année pour soutenir le régime autoritaire a bien pu figurer dans les calculs de Poutine.
L'Ukraine post-soviétique : un régime oligarchique
Compte tenu de la récente agression de la Russie, pourquoi en sommes-nous arrivés au point de cette nouvelle invasion à grande échelle ? Après tout, la guerre de 2014-15 sur le Donbass a entraîné la mort de milliers de personnes. Plus de 150 000 personnes ont été chassées de leur foyer. Pour commencer une analyse des développements récents, nous devons revenir aux manifestations de Maïdan en 2014. À leur tour, pour les comprendre, nous devons remonter aux fondements de l'Ukraine indépendante, à la montée de l'oligarchie, ainsi qu'à la faiblesse de l'économie ukrainienne malgré son extraordinaire richesse en ressources, qui agit comme un aimant pour les intérêts impérialistes concurrents.
La constitution ukrainienne de 1996, approuvée sous la présidence de Koutchma, a donné au président plus de pouvoirs qu'au parlement, mais pas dans la même mesure qu'en Russie : il s'agissait d'une république présidentielle-parlementaire, plutôt que d'une république purement présidentielle. Cela a également été un facteur très important dans l'évolution du système politique. Les élections présidentielles n'étaient pas des concours où le gagnant prenait tout, comme dans de nombreux autres pays ex-soviétiques.
Avec l'aide de l'État, des personnalités comme Rinat Akhmetov, Ihor Kolomoïsky, Viktor Pintchouk et Viktor Ianoukovitch ont acquis d'anciennes industries soviétiques à des prix bradés, puis ont réalisé d'énormes fortunes, non pas tant en investissant ou en modernisant, mais en les utilisant pour faire de l'argent rapidement, en transférant leurs capitaux à Chypre ou dans d'autres paradis fiscaux. Pendant de nombreuses années, Leonid Koutchma et son Premier ministre, Viktor Ianoukovitch, ont également réussi à maintenir un équilibre sur la question de l'intégration dans la sphère économique européenne ou russe, sans se tourner de manière décisive ni vers l'Ouest ni vers l'Est. Cela a protégé les oligarques ukrainiens, les empêchant d'être engloutis par des concurrents russes ou européens plus puissants. Il convient également de souligner que les oligarques ont pu jouer un rôle différent dans le système politique de celui de leurs homologues russes : ici, l'État a été incapable de les dominer et de les exclure de la participation comme l'a fait Poutine.
Le résultat final des manifestations à grande échelle de 2004, baptisées « Révolution orange », n'a vu aucun changement structurel, mais seulement un simple changement d'élites oligarchiques. Les troubles ont éclaté en raison de manipulations illégales, de corruption et de fraudes électorales (auxquelles la Commission électorale centrale a participé) en faveur de Ianoukovitch contre l'autre principal candidat, Viktor Iouchtchenko, lors du second tour de l'élection présidentielle de cette année-là. La Cour suprême ukrainienne a statué en faveur d'un nouveau vote, remporté par Iouchtchenko, ancien Premier ministre entre 1999 et 2001. Le président Koutchma ne pouvait légalement pas se représenter au-delà des deux mandats qu'il avait déjà effectués. De toute façon, sa réputation et sa crédibilité avaient été fatalement entachées par un scandale majeur antérieur, lorsque des preuves irréfutables ont révélé qu'il avait ordonné l'enlèvement d'un journaliste. En 2004, des amendements constitutionnels ont été adoptés par le Parlement pour équilibrer le système vers une présidence plus parlementaire. Comme la fonction de président avait désormais moins d'importance, Koutchma a accepté de cesser de soutenir Ianoukovitch.
Après sa victoire, le discours nationaliste anticommuniste de Iouchtchenko n'a pas pu empêcher sa popularité de s'effondrer, enlisé comme il l'était dans la corruption avec des oligarques favorisés. Il était également uniquement préoccupé par des manipulations politiques – dissolution du Parlement, révocation des membres de la Cour constitutionnelle pour imposer sa volonté – plutôt que par les difficultés d'une économie profondément instable. Celle-ci dépendait des fluctuations des recettes d'exportation et des investissements, les prix des métaux baissant, les niveaux d'inflation augmentant et le taux de croissance chutant de 12% en 2004 à 3% en 2005. Avec l'avènement de la Grande Récession et la chute de la croissance à 0,1% en 2008 et à -2,9% en 2009. Iouchtchenko a été évincé lors des élections de 2010, arrivant en cinquième position avec seulement 5,45% des voix. Aujourd'hui encore, le revenu par habitant de l'Ukraine est inférieur à ce qu'il était en 1991, tandis que sa population est passée de 50 millions à l'époque à 41 millions aujourd'hui.
Élu président en 2010, Ianoukovitch a tenté de revenir à la constitution de 1996. Cela signifiait également que la moitié des députés de la Rada (le parlement ukrainien) seraient élus dans des circonscriptions au scrutin uninominal à un tour, et l'autre moitié à partir de listes de partis. En plus de tenter de monopoliser le pouvoir politique, Ianoukovitch a essayé de concentrer le pouvoir financier et économique autour de sa propre équipe, en particulier sa famille. Le résultat a été une énorme corruption personnalisée ainsi que l'aliénation et la dissidence d'une multitude d'autres oligarques.
L'annonce faite par Ianoukovitch le 21 novembre 2013 qu'il suspendrait les négociations sur l'accord d'association avec l'UE a été le déclencheur initial des manifestations qui ont finalement conduit à sa chute. Pourtant, ce destin n'était pas préétabli. L'Ukraine était assez également divisée, environ 40% étant en faveur de la signature de l'accord d'association et 40% soutenant un accord avec l'Union douanière eurasienne dirigée par la Russie. Ainsi, lorsque les manifestations ont commencé, il ne s'agissait définitivement pas d'une révolte populaire à l'échelle nationale.
Pourquoi cela importerait-il tant, que ce soit pour l'UE ou pour la Russie ? Cela peut s'expliquer lorsque nous examinons l'économie ukrainienne. C'est le deuxième plus grand pays d'Europe par sa superficie et il compte plus de 40 millions d'habitants, soit 6 millions de plus que la Pologne.
* L'Ukraine se classe comme :
1re en Europe pour les réserves prouvées récupérables de minerais d'uranium ; 2e en Europe et 10e au monde en termes de réserves de minerai de titane ; 2e au monde en termes de réserves explorées de minerais de manganèse (2,3 milliards de tonnes, soit 12% des réserves mondiales) ; 2es plus grandes réserves de minerai de fer au monde (30 milliards de tonnes) ; 2e en Europe en termes de réserves de minerai de mercure ; 3e en Europe (13e au monde) pour les réserves de gaz de schiste (22 billions de mètres cubes) 4e au monde par la valeur totale des ressources naturelles ; 7e au monde pour les réserves de charbon (33,9 milliards de tonnes)
* L'Ukraine est un important pays agricole. Elle se classe comme :
1re en Europe en termes de superficie de terres arables ; 3e au monde par la superficie de terre noire (25 % du volume mondial) ; 1re au monde pour les exportations de tournesol et d'huile de tournesol ; 2e au monde dans la production d'orge et 4e pour les exportations d'orge ; 3e plus grand producteur et 4e plus grand exportateur de maïs au monde ; 4e plus grand producteur de pommes de terre au monde ; 5e plus grand producteur de seigle au monde ; 5e au monde dans la production apicole (75 000 tonnes) ; 8e au monde pour les exportations de blé ; 9e au monde dans la production d'œufs de poule ; 16e au monde pour les exportations de fromage.
* L'Ukraine est un important pays industrialisé
:
1re en Europe dans la production d'ammoniac ; 2e système de gazoducs d'Europe et 4e au monde ; 3e plus grande en Europe et 8e au monde en termes de capacité installée de centrales nucléaires ; 3e en Europe et 11e au monde en termes de longueur du réseau ferroviaire (21 700 km) ; 3e au monde (après les États-Unis et la France) dans la production de localisateurs et d'équipements de localisation ; 3e plus grand exportateur de fer au monde 4e plus grand exportateur de turbines pour centrales nucléaires au monde ; 4e fabricant mondial de lance-roquettes ; 4e place au monde dans les exportations d'argile 4e au monde pour les exportations de titane 8e au monde pour les exportations de minerais et de concentrés ; 9e au monde pour les exportations de produits de l'industrie de la défense ; 10e plus grand producteur d'acier au monde (32,4 millions de tonnes).
Au-delà de toute revendication d'autodétermination ou d'État tampon, il devrait maintenant être clair pourquoi les deux blocs impérialistes voulaient l'Ukraine. Et l'UE, avec son offre « simplement » économique, était dangereuse pour une Russie encore incapable de rivaliser industriellement avec l'Occident et qui considère l'expansion de son économie d'exportation déjà basée sur l'extraction comme sa meilleure voie à suivre.
L'Euromaïdan et après
Au début, le mouvement Euromaïdan de novembre 2013 à février 2014 était principalement composé de Kiéviens de la classe moyenne et d'étudiants, qui étaient principalement motivés par une idéologie européenne. Il y avait également une forte composante nationaliste anti-russe. En fait, toute idée d'une Ukraine construite sur une base nationaliste plutôt que démocratique devrait intégrer un certain degré d'anti-russisme. Les manifestations de Maïdan ont posé le choix entre l'accord d'association avec l'UE et l'Union douanière dirigée par la Russie en des termes très tranchés, presque civilisationnels : l'Ukraine est-elle avec l'Europe ou avec la Russie ? Va-t-elle s'aligner sur Poutine, Loukachenko (Biélorussie) et Nazarbaïev (Kazakhstan) ou n'avoir rien à voir avec eux ?
Cependant, indépendamment de cela, les manifestations de Maïdan étaient dès le début des mouvements de grande ampleur. Les toutes premières manifestations ont rassemblé 50 000 personnes ou plus à Kiev. Le 30 novembre, il y a eu une répression du mouvement. Les chaînes de télévision, appartenant aux oligarques qui soutenaient Ianoukovitch, ont soudainement montré la répression sous un mauvais jour. La manifestation tenue à Kiev le 1er décembre a été énorme, avec jusqu'à 200 000 personnes présentes. Le mouvement s'est également étendu géographiquement : il y avait des Maïdans dans presque toutes les villes. Il y avait une présence considérable d'extrême droite, qui comprenait des néo-fascistes, mais les manifestations étaient loin d'être uniquement néo-fascistes. En réalité, seule une infime minorité des manifestants présents aux rassemblements étaient d'extrême droite. Cependant, ils ont agi de manière unie et ont réussi à intégrer leurs slogans.
Après cette explosion initiale, il y a eu une intensification et une propagation. À partir de la mi-janvier, les manifestations semblaient entrer dans une troisième phase. Les négociations entre le gouvernement et l'opposition se sont poursuivies alors même que la violence s'intensifiait, jusqu'à l'éviction de Ianoukovitch le 22 février 2014. Le tournant majeur a peut-être été les tirs de tireurs d'élite sur les manifestants dans le centre de Kiev les 18, 19 et 20 février. Il y a eu un autre développement important le 18 février dans l'ouest de l'Ukraine, où les manifestants ont commencé à attaquer des postes de police et à piller leurs arsenaux, s'emparant d'armes en grande quantité. Cela s'est produit à Lviv, à Ternopil, à Ivano-Frankivsk et dans de nombreuses autres régions.
Cette évolution a radicalement changé la situation. La police anti-émeute était prête à disperser les manifestants lorsque ces derniers étaient armés de bâtons, de pierres et de cocktails Molotov, mais ils n'étaient pas prêts à mourir pour Ianoukovitch. Après le 18 février, les parties occidentales de l'Ukraine étaient sous le contrôle des manifestants, qui occupaient les bâtiments administratifs, les postes de police et les sièges des services de sécurité. Dans certains endroits, la police a tiré sur les manifestants, mais dans de nombreuses régions, elle est partie sans offrir beaucoup de résistance.
Le gouvernement Ianoukovitch est tombé fin février. Poutine, et une partie de la gauche qui voit en Poutine son rêve de résistance continue à « l'impérialisme » (identifié uniquement avec les États-Unis ou l'Occident), ont affirmé à plusieurs reprises que ce qui s'est passé était un coup d'État fasciste. Un « coup d'État » suggère une conspiration planifiée et organisée pour prendre le pouvoir, ce qui était loin d'être le cas. De plus, l'extrême droite n'était qu'une composante du gouvernement qui est arrivé au pouvoir. Enfin, l'hypothèse selon laquelle l'extrême droite était un outil de l'impérialisme américain ignore les dynamiques internes et traite tous les conflits nationaux dans une version de gauche des théories géostratégiques qui se concentrent, à un degré déraisonnable, uniquement sur les rivalités des grandes puissances.
Quoi qu'il en soit, l'annexion russe de la Crimée a donné d'énormes avantages au nouveau gouvernement, puisqu'il a gagné beaucoup de légitimité et a pu reléguer les questions sociales au second plan, en mettant l'accent sur « l'unité nationale » contre l'agression étrangère.
Craignant un mouvement social et politique russe comme Maïdan, Poutine a décrit le régime post-Ianoukovitch à Kiev comme dominé par des fascistes anti-russes, déformant la réalité afin de légitimer son annexion de la Crimée et le soi-disant besoin de « protéger » les populations russophones. Alors que les « Ukrainiens » étaient souvent identifiés aux « fascistes », la « guerre hybride » instrumentalisée par Moscou dans l'est de l'Ukraine pour déstabiliser le virage du pays vers les institutions occidentales a transformé la vie politique en Ukraine. Elle a eu pour effet d'accroître la haine et la rhétorique hystérique de vengeance qui a été utilisée par les élites dirigeantes dans tout le pays comme excuse pour leur politique antisociale. Les secteurs de la gauche qui voient dans Maïdan une conspiration américaine/OTAN étiquettent ainsi effectivement tous les Ukrainiens comme fascistes et les russophones comme progressistes. En fait, ce qui s'est passé depuis 2015 est très différent. Certes, Volodymyr Zelensky n'est pas un radical et n'avait pas de programme positif. Mais le triomphe électoral de ce comédien de télévision reflétait un moment où les Ukrainiens tentaient de rejeter l'oligarchie. Avec 73% des voix, il a remporté une victoire écrasante. En fait, cependant, il y a eu simplement une reconfiguration des oligarques.
Le rétablissement du statut de la culture et de la langue ukrainiennes fait inévitablement partie du projet de souveraineté et d'identité nationale pour des raisons historiques et géopolitiques actuelles. D'une certaine manière, l'agression de la Russie et les fréquentes remarques du Kremlin sur l'Ukraine en tant que non-pays et non-culture ont également contribué à promouvoir une dangereuse binarité d'opposition supposément inéluctable entre le nationalisme ukrainien et le nationalisme russe dans un pays où presque tout le monde peut lire et comprendre le russe, où 70% de la population, y compris un grand nombre d'Ukrainiens, peuvent également le parler, et où l'ukrainien est la langue de l'État tandis que le russe domine le marché des biens et produits culturels. Leur séparation complète est impossible en raison de leur entrelacement historique intime, et l'avenir de la langue ukrainienne et de la culture qui lui est liée doit être construit sur ses propres termes, en embrassant la multi-ethnicité et le multiculturalisme de la nation.
Nous devons également considérer que la République populaire de Donetsk et la République populaire de Lougansk, les régimes soutenus par la Russie, ont montré une hostilité claire envers tout multiculturalisme. L'un des premiers actes des Russes en Crimée et dans le Donbass a été de remplacer les panneaux multilingues par des panneaux uniquement en russe. L'Ukraine, au moins, dispose d'un système où la langue minoritaire doit être officiellement soutenue dans une municipalité si le nombre de locuteurs dépasse un certain niveau (10%) ; et il y a d'autres langues comme le hongrois, le roumain, le polonais, le tatar.
Rétablir une langue et une culture qui ont été historiquement réprimées est important et nécessaire, mais cela exige également un équilibre vis-à-vis du russe et des expressions culturelles connexes. Mais Porochenko, le président avant Zelensky, voulait aller au-delà en poussant une ligne anti-russe plus agressive. Cependant, l'inverse est également vrai. Ceux qui veulent blâmer les Ukrainiens pour l'invasion de Poutine doivent se rappeler à nouveau sa propre position. Dans son discours présidentiel aux citoyens russes le 21 février, les préparant à l'invasion, il a déclaré : « Je tiens à souligner à nouveau que l'Ukraine n'est pas seulement un pays voisin pour nous. C'est une partie inaliénable de notre propre histoire, culture et espace spirituel. »
De telles diatribes ont été typiques. Selon Poutine, Lénine, avec son principe du « droit à l'autodétermination », est le véritable coupable.
Ou comme le dit Poutine : « Du point de vue du destin historique de la Russie et de ses peuples, les principes léninistes de construction de l'État se sont avérés être non seulement une erreur, c'était, comme on dit, bien pire qu'une erreur. »
Encore une fois, ce sont « les directives sévères de Lénine sur le Donbass qui a littéralement été contraint à entrer en Ukraine », mais l'histoire a maintenant pris sa revanche car « 'les descendants reconnaissants' ont démoli les monuments à Lénine en Ukraine. C'est ce qu'ils appellent la décommunisation. »
Poutine promet de terminer le travail : « Vous voulez la décommunisation ? Eh bien, cela nous convient parfaitement. Mais il n'est pas nécessaire, comme on dit, de s'arrêter à mi-chemin. Nous sommes prêts à vous montrer ce que signifie une véritable décommunisation pour l'Ukraine. »
Même s'ils dénoncent l'invasion de Poutine, les idéologues occidentaux antisocialistes ont toutes les raisons de se réjouir de cette diatribe anticommuniste et de cette mise en accusation de Lénine et de ce qu'il représentait. Mais ceux de la gauche qui soutiennent Poutine vont-ils repenser leur position ?
Les États-Unis, l'UE et l'OTAN : rivalité inter-impérialiste
Il ne fait aucun doute que les États-Unis sont l'impérialisme le plus important et le plus puissant au niveau mondial. Ils détiennent le pire bilan en matière de soutien aux dictatures brutales à l'étranger et d'interventions militaires inacceptables dans d'autres pays. Ils détiennent le record d'être directement et indirectement responsables de la mort de civils, un bilan global depuis la Seconde Guerre mondiale qui dépasse facilement plusieurs millions.
Mais cela n'excuse pas le comportement d'autres pays, grands, moyens ou petits, qui cherchent à établir et à étendre leur hégémonie et leur domination régionales ou mondiales. Ces autres puissances comprennent plusieurs alliés occidentaux des États-Unis et des organismes comme l'OTAN, mais aussi des pays comme Israël, la Turquie, l'Inde, le Pakistan et, bien sûr, la Russie et la Chine. Il ne fait aucun doute qu'il y a et qu'il peut y avoir d'autres entrées dans ce large club de puissances impérialistes et aspirantes impérialistes. Les justifications avancées pour un tel expansionnisme consistent invariablement à citer les exigences de la « sécurité nationale » et la nécessité de « réagir » contre d'autres coupables désignés. La gauche internationale doit veiller à ne pas tomber dans la politique de défense du « moindre mal » présumé ou même à nier ou à diminuer son caractère impérialiste. Nous devons éviter de succomber à « l'anti-impérialisme des imbéciles ». Dans le cas de la Russie, il ne devrait y avoir aucune raison de confusion.
Explorons cette question de la relation de la Russie avec les États-Unis et l'OTAN depuis l'éclatement de l'Union soviétique. L'OTAN n'a, à nos yeux, jamais eu de justification, c'est pourquoi nous nous opposons à son existence, point final. Cependant, même selon la logique de la guerre froide qu'elle avait avancée, elle aurait dû être supprimée une fois le Pacte de Varsovie terminé.
En fait, bien sûr, l'OTAN dirigée par les États-Unis non seulement ne s'est pas dissoute. Non seulement elle a rompu ses promesses de ne pas s'étendre davantage, mais elle l'a délibérément fait pour étendre sa portée aussi près que possible des frontières de la Russie. Bien sûr, nous nous y opposons et nous condamnons cela parce que cela signifie saper la recherche mondiale d'une plus grande paix et justice, subordonner les pays plus petits et plus faibles, approfondir les alliances de classe dirigeante et permettre une plus grande exploitation des masses laborieuses ordinaires de leurs propres pays et d'autres pays. Nous ne devrions pas non plus être surpris que les membres de ce club impérialiste cherchent partout à intimider leurs voisins et à étendre leur puissance et leur domination autant que possible.
De Eltsine à Poutine, les dirigeants russes ont constamment parlé de leurs « besoins légitimes de sécurité ». « Besoins » est toujours un mot plus efficace à utiliser que « ambitions », qui ne s'accorderait pas si bien avec le terme « légitime ». Après l'éclatement de l'Union soviétique, la Russie est devenue, militairement et nucléairement, la deuxième puissance mondiale. Est-ce que quelqu'un dans son bon sens pense que les États-Unis ou l'OTAN vont ou veulent risquer de l'envahir territorialement ? Mais comme tous les impérialistes et aspirants impérialistes, la Russie veut également établir et consolider sa propre « sphère d'influence », un euphémisme pour déguiser le projet réel. Comme toute puissance impériale, ce projet équivaut à dominer autant que possible cette région désignée dont les frontières sont toujours ouvertes à l'expansion.
Malgré l'expansion des États-Unis et de l'OTAN, il est absurde de penser que les actions de la Russie dans son « étranger proche » ou plus loin sont sérieusement motivées par la crainte que « sa sécurité soit profondément menacée ». Ses actions ne sont pas une simple « réaction » ou autodéfense. En effet, le résultat le plus probable de ce que la Russie a fait sera le renforcement de l'engagement envers l'OTAN et l'expansion possible (certains diraient maintenant probable) de l'adhésion à l'OTAN en Europe, ainsi qu'un stimulus plus fort pour les pays de la région Asie-Pacifique à s'aligner et à se rapprocher des États-Unis et de ses structures d'alliance.
Nous devons catégoriquement nous opposer à tous les impérialismes. Lorsqu'il s'agit de répartir le blâme mondial et historique pour les iniquités de l'impérialisme, la part du lion revient évidemment aux États-Unis et à leurs alliés. Mais cette vérité ne doit pas être utilisée pour rationaliser les iniquités et le comportement d'autres impérialistes. Poutine n'a pas simplement envoyé des troupes sous l'Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) dominée par la Russie au Kazakhstan en tant que « réaction » à l'Occident ou comme une « contrainte » découlant de ses « besoins légitimes de sécurité ». Il l'a fait pour stabiliser un régime autoritaire brutal pro-russe réprimant son propre peuple.
Deux autres brefs commentaires doivent être faits ici. Nous avons vu l'hypocrisie à un niveau sans précédent, à la fois concernant la résistance ukrainienne et concernant les réfugiés, par l'UE et les médias occidentaux. Ce sont des pays et des médias qui ont toujours condamné la résistance palestinienne comme du terrorisme, mais ils sont aujourd'hui tous favorables à la résistance civile contre les Russes. Nous considérons leur « soutien » aux Ukrainiens comme hypocrite, lié aux intérêts des classes dirigeantes des puissances occidentales, et pas le moins du monde motivé par une préoccupation sincère pour les droits démocratiques. Il en va de même pour l'hypocrisie des médias et des États concernant l'accueil des réfugiés ukrainiens, car elle provient de pays qui ont été brutaux envers les réfugiés d'Afrique du Nord dans un passé récent. Twitter, qui a bloqué des comptes pour le financement participatif de Cuba (sur des questions non militaires), autorise le financement participatif pour l'aide militaire aux Ukrainiens. Cela montre les liens clairs entre des agences apparemment indépendantes et les puissances impérialistes occidentales.
Réactions indiennes – le régime et la grande gauche parlementaire
Quelle a été la réponse à l'invasion de l'Ukraine en Inde ? Honteusement mais comme on pouvait s'y attendre, le gouvernement Hindutva de Modi exprime son inquiétude mais pas de condamnation même s'il a une relation stratégique de facto avec les États-Unis. Contrairement à la Hongrie, dirigée par le leader d'extrême droite Orban, qui a accepté opportunément les sanctions de l'UE, la position de l'Inde est plus proche de celle du Brésil en ce qu'elle préfère suivre une ligne « neutre » en marchant sur la pointe des pieds. Modi veut maintenir la Russie satisfaite en raison de supposées exigences diplomatiques et militaires. Une plus grande sécurité pour l'Inde ne signifie pas que les régimes indiens devraient réduire significativement les dépenses militaires pour aider à éradiquer la pauvreté, ou résoudre le différend frontalier avec la Chine par des concessions mutuelles, ou chercher à promouvoir la paix en Asie du Sud. Il faut plutôt l'interpréter comme signifiant que nous devons acquérir de plus en plus de puissance militaire, non seulement pour protéger les frontières, mais pour projeter la puissance en Asie du Sud et au-delà, comme tout aspirant hégémon régional devrait le faire.
New Delhi affirme que sa priorité est maintenant d'évacuer les citoyens indiens d'Ukraine. Nous soutenons pleinement cette démarche. Mais le refus du gouvernement de condamner l'invasion rend plus difficile l'obtention du soutien moral et politique vital de la part du peuple et du gouvernement ukrainiens, affectant négativement la rapidité et l'efficacité de l'évacuation et mettant davantage en danger la vie des citoyens indiens. En ce qui concerne l'invasion, les partis d'opposition bourgeois sont soit silencieux, soit, dans le cas du parti du Congrès, sa position officielle n'est pas différente de celle du gouvernement. Pas de surprises ici.
Quant aux principaux partis de gauche, le Parti communiste indien (marxiste) ou PCM ne va pas au-delà de qualifier l'action russe de « regrettable » et, avec le Parti communiste indien (PCI), joue sur l'air que le véritable coupable est les États-Unis et l'OTAN, auxquels la Russie a réagi. Il en était de même, du moins initialement, pour le Parti des travailleurs au Brésil. Il n'y a pas une once d'analyse de classe dans les déclarations de ces partis qui prétendent être marxistes. Mais en Inde, aucun de ces partis n'a encore déclaré publiquement que la Russie (ou la Chine) sont des pays capitalistes, et encore moins qu'ils sont des puissances impérialistes. Ils refusent cette analyse même si Poutine, la classe dirigeante là-bas et le public russe n'ont aucune illusion sur le fait que le leur est autre chose qu'un pays capitaliste, et qui a manifestement tort sur le plan économique et politique. Combien de temps les partis de la gauche traditionnelle indienne continueront-ils à se mettre la tête dans le sable ?
Kunal Chattopadhyay
Achin Vanaik
The Radical
SPECIAL UKRAINE VOLUME
MARCH 2025
Réimpression de Spectre, USA, mars 2022
Traduit pour l'ESSF par Adam Novak
https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article74535
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Belgique : Vers la chute de l’Arizona, construire l’alternative dans et par les luttes

Nous sommes entrés dans une phase extrêmement dangereuse du capitalisme mondial : face à des perspectives de vie qui se dégradent de jour en jour pour une grande partie de la population mondiale, le mécontentement grandit, mais ne se traduit pas (encore) en une mobilisation large et organisée pour un projet de société alternative. Alors que les classes dominantes recourent à des méthodes de plus en plus violentes pour sauvegarder leur pouvoir et leurs privilèges, des forces d'extrême-droite prolifèrent en jouant sur l'incertitude, la peur, et les divisions renforcées par les politiques et l'idéologie néolibérales des dernières décennies. En Belgique, les nouveaux gouvernements organisent une attaque générale qui vise non seulement à se débarrasser des grandes conquêtes sociales, mais aussi et surtout à faire basculer durablement le rapport de force entre les classes sociales. Il s'agit d'une tentative de casser les outils de solidarité et de résistance de la classe travailleuse dans son ensemble.
Belgique : Vers la chute de l'Arizona, construire l'alternative dans et par les luttes
29 avril 2025 | tiré du site Inprecor.org |Photo : grève de l'enseignement à Bruxelles le mardi 8 avril. Crédit : Gauche anticapitaliste / CC BY-NC-SA 4.0
https://inprecor.fr/node/4707
Note : Le « plan Arizona » (ou « majorité Arizona ») est un terme utilisé en Belgique pour désigner une coalition gouvernementale spécifique, rassemblant les partis suivants : de droite et de centre droite. L'expression est apparue il y a cinq ans dans le débat médiatique et fait référence aux couleurs du drapeau de l'État américain : bleu, rouge, orange.
Pour autant, rien n'est encore inscrit dans le marbre. L'issue de cette nouvelle période dépendra avant tout de la capacité des mouvements sociaux et syndicaux à se mobiliser avec force et dans la durée, avec un objectif clair : la chute du gouvernement, seul moyen de stopper la casse sociale et de commencer le combat pour des alternatives sociales et solidaires. Pour y arriver, la résistance doit être la plus large et unitaire possible, s'appuyant sur une démocratie de la base au sommet.
Offensive globale et violente du capital
Ce nouveau gouvernement et les attaques à venir s'inscrivent dans une tendance mondiale à l'extrême-droitisation, intimement liée à la crise multidimensionnelle du capitalisme : une instabilité socio-économique profonde et une crise écologique sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Depuis la crise financière et économique de 2008, ni les politiques néolibérales, ni les politiques keynésiennes de relance, ni un amalgame des deux, n'ont réussi à stabiliser la situation économique et sociale. Bien au contraire : la pandémie du Covid, les effets du dérèglement climatique, la sous-performance des plus grandes économies, les inégalités croissantes de revenus et de richesses, l'aggravation de l'endettement public et privé, et les poussées d'inflation mettent en péril les conditions de vie -voire la vie même- d'une part toujours plus grande de la population mondiale. En même temps, malgré les nouveaux débouchés créés par le capitalisme vert et les multiples cadeaux fournis au grand capital dans le cadre des « politiques industrielles », ces différentes crises tendent à miner les sources stables de profits et d'accumulation.
Outre les délires de la spéculation et des bulles financières, les classes dominantes ne savent trouver d'autre réponse à ces contradictions qu'une offensive générale contre les droits démocratiques et sociaux : à la fois comme tentative d'accroître le taux d'exploitation et ainsi le taux de profit, et comme moyen de supprimer tout germe de révolte contre un système en perte de légitimité. Face au rejet de la démocratie libérale (marquée par une absence de démocratie économique, et démocratie politique limitée aux élections, laissant les gouvernements libres d'agir sans rendre de compte entre les scrutins) par une grande partie de l'électorat, le néolibéralisme se réinvente sous une nouvelle forme : fusionnée avec une idéologie et des politiques d'extrême-droite, en s'appuyant sur tout ce qui peut semer la division au sein de la classe travailleuse. Dans la même lignée, on observe un glissement généralisé vers des régimes autoritaires, une concurrence internationale et des tensions géopolitiques qui s'aiguisent, et l'accroissement des affrontements violents. Si la mondialisation néolibérale s'est accompagnée de la multiplication de foyers de « guerres pour les ressources » (les mal nommées « nouvelle guerres », résultats des offensives antisociales et austéritaires pilotées notamment par le FMI à l'encontre des ex-colonies) nous assistons en effet ces dernières années à une accélération de la violence armée à travers l'accroissement de l'échelle des conflits. L'invasion russe de l'Ukraine en 2022 a ainsi marqué un tournant, avec le retour de la guerre de haute intensité sur le territoire européen, qui faisait elle-même suite à l'annexion de la Crimée et la guerre de « basse intensité » menée par Poutine dans le Donbass depuis 2014. Avec le génocide à Gaza, soutenu ouvertement par les États soi-disant défenseurs des droits humains, le niveau de barbarie a atteint un autre sommet. Il s'agit d'un point de bascule : fini le récit de l'État de droit et son corollaire le droit international ; place à l'arbitraire politique à la Trump, au service d'un projet de société du chacun pour soi, où tout ce qui ne rapporte pas au capital – qu'il s'agisse de la nature ou de vies humaines – ne vaut plus rien.
Les classes dominantes ne savent trouver d'autre réponse à ces contradictions qu'une offensive générale contre les droits démocratiques et sociaux : à la fois comme tentative d'accroître le taux d'exploitation et ainsi le taux de profit, et comme moyen de supprimer tout germe de révolte contre un système en perte de légitimité.
« Il n'y a pas d'alternative »
En Belgique, cette tendance se traduit de façon limpide dans le programme du nouveau gouvernement : l'Arizona prévoit une vague de mesures antisociales, sexistes et racistes d'une ampleur inégalée depuis des décennies. 22 milliards d'économies sur les travailleur·euses avec ou sans emploi, avec ou sans papiers, et une minable petite taxe sur les plus-values pour tenter de faire passer la pilule1.
L'austérité se fera donc avant tout sous forme d'une réduction des dépenses sociales : autour de 9 milliards d'économies dans la sécurité sociale à elle seule. Avec des possibilités d'économies supplémentaires comme gage au cas où les hypothétiques « effets de retour » de plusieurs milliards ne seraient pas atteints2). Au niveau écologique tout reste très vague : il s'agit de poursuivre les politiques du capitalisme vert sans trop se soucier du « vert » dans les engagements, si ce n'est que pour justifier des choix politiques dangereux tels que la continuation et le développement du nucléaire.
Par ailleurs, ce discours s'appuie sur une logique technocratique, qui projette les questions économiques et budgétaires en dehors du champ de la discussion démocratique. Qu'il s'agisse de la « nécessité de rendre notre économie compétitive » ou des règles budgétaires européennes qui sont à nouveau imposées après une « pause » de trois ans, l'argument de la « contrainte extérieure » est habilement manipulé pour justifier la casse sociale. Tout comme d'autres discours dans le même style : « avec le vieillissement, on ne pourra plus financer notre sécurité sociale si on ne serre pas la vis maintenant » ; « il faut réduire la différence de revenu entre “ceux qui travaillent” et les “assistés” » ; « l'Arizona ou le chaos » ; ou encore « ça va faire mal » mais « il n'y a pas d'alternative », selon le mot d'ordre néolibéral depuis Thatcher. Un argument repris volontiers par les dirigeants des Engagés et de Vooruit, qui tentent de faire accepter le programme réactionnaire de l'Arizona en prétendant, notamment auprès des dirigeant·es des syndicats et des mutualités, que « sans eux, c'eut été (encore) pire ».
L'hypocrisie de ce dogmatisme austéritaire apparaît au grand jour avec le grand plan européen de 800 milliards d'investissement pour le réarmement de l'Union. Ne nous y trompons pas : il ne s'agit pas pour nous d'opposer dépenses de défense et investissement dans les besoins sociaux et environnementaux, opposition qui ne vaut qu'au sein du logiciel néolibéral et qui aveugle malheureusement une large partie de la gauche. Au contraire, nous avons plaidé pour une politique de sécurité indépendante et anticapitaliste, qui articule la nécessité d'une défense (y compris militaire) face au danger (néo)fasciste avec des investissements dans les services sociaux, une politique qui soit au service de la solidarité politique et matérielle avec le peuple ukrainien, et de la défense des intérêts de notre classe face à l'extrême droite. Le plan ReArm Europe est une mauvaise et dangereuse réponse à un vrai problème. Il a néanmoins le mérite d'illustrer que des moyens existent et que leur utilisation est un choix politique.
Le but de telles menaces mensongères est toujours le même : démotiver au maximum la résistance sociale qui gronde. La Fédération des entreprises de Belgique (FEB) accuse déjà les syndicats de provoquer avec leurs actions des dégâts économiques qui « ne feront qu'alimenter les vagues de restructurations et de faillites », quand celles-ci sont en réalité la conséquence de l'essoufflement du régime d'accumulation néolibéral. Bouchez pour sa part, le représentant le plus direct de la bourgeoisie radicalisée, s'est dit prêt à l'affrontement et même à devoir en payer l'addition électorale en 2029, du moment que l'offensive antisociale soit menée.
Briser la résistance : de la concertation les mains liées à la répression généralisée
La veille de la première grande action syndicale après la formation du gouvernement, le 13 février, Bart De Wever a rencontré le Groupe des Dix – instance suprême de concertation entre représentants des syndicats et des fédérations patronales. Selon le journal l'Écho, il voulait les écouter et les assurer « de sa volonté de soutenir le dialogue social ». Si on creuse un peu le programme de l'Arizona, toutefois, l'objectif réel saute aux yeux : mettre les syndicats et toute autre organisation du mouvement social hors-jeu, en les privant de budgets, en réprimant leurs militant·es, en les exposant à des sanctions graves, en leur faisant donc avaler pieds et poings liés les politiques antisociales. Le dernier exemple en date de cette inflexibilité est le recalage par la N-VA du premier accord conclu entre syndicats et patronat sur les prépensions au sein du G10 : un accord très minime, qui consistait seulement à maintenir le système des RCC jusqu'au 30 juin prochain, avec un impact budgétaire limité (10 millions d'euros), mais qui était insupportable pour le parti du Premier ministre. La rigidité des nationalistes flamands a surpris au point que même le patron de la FEB a invité la N-VA à faire preuve de davantage de souplesse, sous peine d'illustrer l'absence de marge de négociation entre les partenaires sociaux et de souffler sur les braises de la contestation3.
Ainsi, les mesures de « flexibilisation » du travail (travail de nuit et le dimanche, heures supplémentaires sans sursalaire ou récupération, flexi-jobs…) seront introduites sans besoin de consulter les syndicats. On tente de revenir aux négociations' individuelles entre travailleur·euse et patron, où le rapport de force est évidemment biaisé à cent pour cent en faveur du dernier. Le projet de loi sur la possible interdiction aux « casseurs » de manifester est remis sur la table. Les syndicats pourront en outre être tenus responsables des grèves qui se feraient sans respecter les règles de préavis. En même temps, le financement fédéral d'Unia, institution qui lutte contre les discriminations et pour l'égalité des chances, sera réduit d'un quart. Et ce ne sont que quelques exemples. La politique migratoire, basée sur la criminalisation des migrant·es, l'enfermement, l'expulsion et l'externalisation, piétine les droits humains et exacerbe toutes les formes de racisme. Pour mettre de telles politiques en pratique le plus « efficacement » possible, le gouvernement compte déployer des technologies avancées sans égards pour la protection de la vie privée, telles que la « reconnaissance faciale pour la détection des condamnés et des suspects ».
Si on creuse un peu le programme de l'Arizona, toutefois, l'objectif réel saute aux yeux : mettre les syndicats et toute autre organisation du mouvement social hors-jeu, en les privant de budgets, en réprimant leurs militant·es, en les exposant à des sanctions graves, en leur faisant donc avaler pieds et poings liés les politiques antisociales
En somme, pas besoin d'un gouvernement fasciste pour préparer le terrain d'un État autoritaire et répressif. On ne peut sous-estimer les risques d'une telle tendance : si le recours systématique à la répression par un appareil d'État montre en même temps sa fragilité, il peut aussi briser durablement les possibilités de s'organiser collectivement. Et entretemps, de nombreuses vies humaines sont en jeu.
L'urgence immédiate : résistance unitaire jusqu'à la chute du gouvernement
En Belgique, comme en Europe et ailleurs, la gauche au sens large est sur la défensive. Des coalitions de droite conservatrice qui intègrent ou s'appuient sur des forces d'extrême-droite sont formées et peuvent avoir du succès auprès de la classe travailleuse. Dans certains cas (Italie, Hongrie, Pays-Bas…) l'extrême-droite est déjà la première force au pouvoir. Il s'agit d'une situation plus qu'inquiétante, avec des enjeux énormes pour les sociétés humaines et notre planète. Dans ce contexte, les priorités de la Gauche anticapitaliste sont claires : combattre la résignation de la classe travailleuse et la convaincre qu'il faut se révolter contre l'Arizona et qu'une victoire est possible ; s'impliquer dans la construction d'un mouvement large, un front commun social articulé autour des syndicats qui regroupe toutes les organisations de gauche et progressistes, les syndicats, les organisations féministes, anti-racistes, LGBTI, anti-impérialistes, antifascistes, les collectifs militants et le monde associatif, pour mener la bataille contre ces forces réactionnaires4 ; et articuler ces deux tâches à la mise en avant d'un projet de société écosocialiste alternatif, élément de réponse déterminant face à la question du pouvoir politique qui se posera tôt au tard.
Des partis comme Vooruit ou les Engagés, en rentrant dans le gouvernement Arizona, ont choisi leur camp. On ne peut compter sur eux pour empêcher la casse sociale ; tout au plus pourront-ils obtenir des miettes pour adoucir ou ralentir quelque peu le processus douloureux. S'il reste important de maintenir un dialogue avec des militant·es de base de ces partis qui se désillusionneraient petit à petit, la stratégie de « mettre la pression » sur leurs directions pour grappiller quelques miettes n'est qu'une perte de temps, même si ces partis seront vraisemblablement les premiers maillons à céder dans une situation de plus grande conflictualité sociale, et donc dans cette perspective une pression maximale doit être maintenue à leur égard. De même, on ne peut s'appuyer sur l'opposition parlementaire de PS et Écolo qui ont participé activement au précédent gouvernement avec ses attaques contre les travailleur·euses et les migrant·es, même si ces partis ne sont pas la cible principale et peuvent être des alliés contre l'extrême-droite à certaines occasions. Le PTB est désormais un parti incontournable de la gauche parlementaire, le seul qui garde une certaine crédibilité dans une perspective de rupture. Pourtant, il continue de faire obstacle aux conditions nécessaires à la concrétisation d'une telle dynamique. Malgré une position globalement renforcée et le bulldozer qui se dresse en face, le parti continue à surfer sur des mots d'ordre opportunistes et insuffisants pour opérer une réelle rupture avec les politiques néolibérales. De plus, le parti continue de se poser comme l'unique prolongement politique possible pour les mouvements sociaux et syndicaux, appelant par exemple à se ranger derrière son programme en marchant le 27 avril « contre la casse sociale et pour la paix ». Les mandats parlementaires du PTB seraient bien plus utiles s'ils étaient mis au service de la construction d'un large front de résistance qui dépasse les intérêts du parti.
Le PTB est désormais un parti incontournable de la gauche parlementaire, le seul qui garde une certaine crédibilité dans une perspective de rupture. Pourtant, il continue de faire obstacle aux conditions nécessaires à la concrétisation d'une dynamique de front large de résistance.
Le seul moyen d'arrêter ces politiques régressives, c'est de mener le combat pour la chute du gouvernement. Pour y arriver, des manifestations annuelles ou des actions de désobéissance civile ponctuelles, aussi radicales et importantes soient-elles, ne suffiront pas. Une contre-offensive générale pour stopper le gouvernement implique de se mobiliser massivement, sur les lieux de travail et d'étude et dans la rue, autour d'un véritable plan d'actions combatif au finish.
Les syndicats, en tant que plus grand mouvement social organisé de la classe travailleuse en Belgique, ont un rôle central à jouer dans ce processus. Pour le moment, ils se veulent malheureusement rassurants envers le patronat et n'assument pas la nécessité de renverser le gouvernement. Pourtant, syndicats et mutualités sont eux-mêmes directement attaqué·es : les syndicats vont perdre des affilié·es sans emploi et seront visés par la répression, les mutualités se retrouvent contraintes d'appliquer les exigences du gouvernement fédéral en accélérant le retour des malades au travail sous peine de sanctions financières. Plus que jamais, l'alternative pour ces « corps intermédiaires », c'est soit de se faire balayer par une bourgeoisie radicalisée, soit la rébellion ! Le temps des illusions sur la « concertation sociale » doit prendre fin. Les syndicats ont la capacité d'organiser une grande campagne d'explication vers l'ensemble de la classe travailleuse du programme de démolition sociale de l'Arizona, et d'élaborer en parallèle un plan d'actions radical pour stopper la coalition. A condition que leurs directions rompent clairement avec la logique des « amis politiques » (social-démocratie et démocratie chrétienne) et les liens organiques avec des partis comme Vooruit ou le CD&V. Et à condition que les militant·es et délégué·es arrivent à instaurer une dynamique partant de la base qui permettra de dépasser les réticences et obstructions au sommet : des assemblées de travailleur·euses et des comités de grève, pour pouvoir débattre et décider ensemble des actions menées, et reconduire les grèves quand la dynamique est bonne. La nécessité de mobiliser largement et de dépasser l'inertie des grandes structures est l'occasion de développer des formes d'auto-organisation et d'autogestion, un pouvoir démocratique alternatif.
Un gouvernement de rupture anti-néolibéral est indispensable pour arrêter le carnage social et écologique. Pour défaire la stratégie des droites, nous aurons besoin de coaliser très largement les secteurs de la classe travailleuse et de ne laisser personne de côté. Seul un front commun social centré sur les syndicats pourra élaborer et imposer par l'action un réel programme de rupture qui unit et mobilise : un programme radicalement solidaire, écologique, démocratique qui inclut la défense des droits des femmes, des personnes racisées et exilées, et des personnes LGBTI+.
Les organisations de gauche et progressistes, dont la Gauche anticapitaliste, doivent mobiliser tou·te·s leurs membres et sympathisant·es en ce sens et participer au travail de terrain d'information et de ralliement.
Seul un front commun social centré sur les syndicats pourra élaborer et imposer par l'action un réel programme de rupture qui unit et mobilise : un programme radicalement solidaire, écologique, démocratique qui inclut la défense des droits des femmes, des personnes racisées et exilées, et des personnes LGBTI+.
Des lueurs d'espoir pour un autre horizon
Si la lutte actuelle est avant tout défensive, on ne peut découpler le combat contre ce gouvernement de la question de l'alternative programmatique.
L'extrême droite et les éléments néolibéraux radicalisés qui ont aujourd'hui l'initiative prospèrent sur une crise de l'alternative. Malgré un capitalisme de plus en plus agressif et destructeur, l'horizon de son dépassement semble lointain. Face à cette désillusion et dans le cadre d'une désintégration progressive des espaces de solidarité par le néolibéralisme, les réflexes immédiats pour la majorité de la population peuvent être le repli sur soi ou la tentative de sauvegarde d'une position sociale au détriment d'autres plus précarisés, autant de dispositions qui alimentent le ressentiment et les divisions au sein de notre classe, nourrissant le projet de l'extrême droite. Pour s'assurer de la victoire contre les forces (néo)fascistes et les néolibéraux qui leur pavent la voie, c'est avec les conditions de leur émergence qu'il faut rompre.
Les défis comme les dangers sont immenses, et rien ne garantit que la lutte sera victorieuse dans les années à venir. Mais des signes d'espoir sont là. Il s'agit de chercher les brèches qui se dessinent et d'aider à les ouvrir. 100 000 personnes ont manifesté à Bruxelles ce 13 février avant même que l'Arizona n'ait commencé à mettre en place ses politiques. L'inquiétude est largement partagée, et la colère gronde partout. Des initiatives radicales et unitaires telles que Commune Colère se mettent en place dans différentes villes. Sous pression de leurs bases, les deux principaux syndicats (FGTB et CSC) ont organisé une grève interprofessionnelle de 24 heures le 31 mars, qui a été correctement suivie, mais qui a aussi mis en lumière les limites actuelles du rapport de force en termes de mobilisation et de perspectives. Outre les multiples mobilisations du mois d'avril (grèves tournantes des cheminot·es, des enseignant·es, luttes paysannes, manifestation contre le centre fermé de Vottem), la ligne de mire du mouvement contre l'Arizona est désormais la journée d'actions nationales le 29 avril, également couverte par un préavis intersectoriel. Si la dynamique combative se maintient, ces actions ne seront que le début. Plus on est nombreux·se à participer, à s'organiser, à discuter de stratégie et d'alternatives, plus on a des chances de radicaliser et de structurer le mouvement, vers la grève générale prolongée et une pression sociale et économique maximale. Une victoire contre ce gouvernement est indispensable non seulement pour redonner l'espoir à tous·tes les exploité·es et opprimé·es qui résistent, mais aussi pour poser les jalons d'une offensive plus radicale.
La lutte qu'il faut mener aujourd'hui ne peut faire l'économie d'un programme positif qui assume la nécessité de rompre avec le capitalisme : il ne s'agit pas seulement de faire reculer la droite et l'extrême droite, de conserver les conquis sociaux ou encore de revenir à une période fantasmée où le partage de la valeur entre capital et travail aurait été plus équitable, mais bien de poser la question du dépassement du capitalisme au profit d'une autre société. Une question d'autant plus importante que la catastrophe écologique nous oblige aujourd'hui à l'urgence si on veut conserver l'habitabilité de la planète pour tous et toutes.
Pour ne pas être un horizon lointain et utopique, cette société doit se nourrir des revendications présentes : les grèves des cheminot·es, aujourd'hui, qui posent la question de l'importance des transports publics dans le cadre d'une transition écosocialiste, les mobilisations des travailleur·euses du non-marchand (la santé, la culture, les écoles, le monde associatif, les CPAS, la petite enfance, …) qui se battent pour de meilleures conditions de travail et mettent en lumière l'importance du travail du soin, sont autant de pistes qui contredisent la logique prédatrice du capital et posent les bases d'un autre rapport au monde et aux autres. De telles revendications, pour gagner en force, doivent cependant pouvoir s'articuler autour d'un projet de société alternative, un projet auquel doivent pouvoir contribuer les mouvements sociaux, les associations, les collectifs de quartier, etc.
Surtout, un tel programme doit assumer la traduction politique de ces aspirations. Cela ne signifie pas se limiter à une extension parlementaire aux revendications selon une logique de plaidoyer, mais au contraire rompre la division artificielle entre social et politique. Si un tel programme de rupture veut voir le jour, il faudra outrepasser le carcan étriqué du seul champ institutionnel, en poussant le mouvement social à assumer le rapport de force, par l'amplification des mobilisations, des luttes, des grèves, qui déplacent les lieux de décisions. En creux, cela signifie en effet poser la question du pouvoir. Sur les lieux de travail, d'étude, dans la rue : il s'agit de reprendre le contrôle de nos vies, d'agir collectivement en faveur d'une autre société, seule manière de travailler à la mise en œuvre d'une société écosocialiste et radicalement démocratique.
Si un tel programme de rupture veut voir le jour, il faudra outrepasser le carcan étriqué du seul champ institutionnel, en poussant le mouvement social à assumer le rapport de force, par l'amplification des mobilisations, des luttes, des grèves, qui déplacent les lieux de décisions. En creux, cela signifie en effet poser la question du pouvoir.
Publié le 17 avril 2025 par la Gauche anticapitaliste.
1Ajoutons que cette taxe est l'objet de débats au sein même de la coalition, avec un MR qui cherche à tout pris à en réduire la portée, pourtant déjà très minime (500 millions dans un budget de 22 milliards). Un nouvel exemple que même les mesures les moins injustes de l'accord de gouvernement (le “trophée” de Vooruit) sont insupportables pour la droite en position de force au sein de la majorité.
2« L'accord de ne pas augmenter la pression fiscale lors de contrôles budgétaires implique qu'on se retournera à chaque fois vers de nouvelles économies. Même si côté gauche, on remarque que la nuance que la pression fiscale ne peut pas augmenter en proportion du PIB laisse néanmoins une marge pour de nouveaux revenus. »Source : TIJD (traduction propre).
3Depuis l'accord a finalement été validé par le gouvernement. Voir L'Écho.
4On peut penser de façon non exhaustive aux syndicats (FGTB & CSC), la Gauche anticapitaliste, le PTB, le PSL, le réseau Ades, la Coordination antifasciste de Belgique, Commune Colère, les Collectifs 8 mars et toutes les organisations progressistes, féministes, anti-racistes, LGBTI+…
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« Il n’y a pas eu d’attaque extérieure, la panne est le produit de la cupidité des grandes compagnies d’électricité »

« Le problème, ce ne sont pas les énergies renouvelables, celui qui dit cela ne dit pas la vérité », souligne Antonio Turiel au début de l'interview accordée à NAIZ, au lendemain de la plus grande panne mondiale de l'histoire de l'État espagnol et du Portugal.
Le docteur en physique et expert en énergie, chercheur au CSIC, souligne que la clé est de stabiliser le système dans lequel convergent aujourd'hui de grandes quantités d'énergie photovoltaïque et éolienne. Il rappelle que c'est un problème que l'Allemagne connaît également et que l'année dernière, elle a failli provoquer une panne d'électricité massive en Espagne à cinq reprises.
Sans craindre d'être un verset lâche dans le discours public, il pointe du doigt les grandes entreprises énergétiques, leur « cupidité » et le manque d'investissements et de mécanismes de prévention.
30 avril 2025 | tiré de Viento sur
« Il n'y a pas eu d'attaque extérieure, la panne est le produit de la cupidité des grandes compagnies d'électricité »
Vous avez dit dans une autre interview que la coupure est le produit d'une production d'énergie photovoltaïque trop importante qui réagit mal à l'évolution de la demande. Qu'est-ce que cela signifie ?
C'est un problème de technologie. Les systèmes énergétiques classiques sont basés sur un système de tours de turbines lourdes pesant des milliers de tonnes, qui ont l'avantage d'être régulées par les changements de la demande, car la force à laquelle la turbine tourne peut augmenter ou diminuer la quantité d'électricité. C'est un mécanisme automatique, mais cela ne se produit pas avec le photovoltaïque car il ne produit pas de courant alternatif, il ne produit pas d'onde, mais une source continue. Vous avez besoin d'un appareil appelé onduleur, qui génère du courant synthétique, mais il a un problème, c'est qu'il répond très mal aux changements de la demande. Il lui est donc très difficile de suivre l'évolution de la demande sur le réseau.
Dans des conditions normales, le photovoltaïque est minoritaire et les systèmes inertiels sont responsables de la gestion des variations de la demande, mais dans ce cas précis, 60 % de la production à l'époque était photovoltaïque et 14 % éolienne. Et il n'y a pas eu de systèmes de stabilisation parce qu'il n'y a pas eu d'investissement.
Ce problème peut-il être résolu avec un plus grand nombre de ces investisseurs ?
Voyons, les investisseurs doivent toujours être là, même si ce n'est pas obligatoire. Si le réseau est en charge de la stabilisation, eh bien, quand le photovoltaïque est minoritaire, c'est le cas. Mais si c'est la source majoritaire, il faut qu'elle soit en charge [de stabiliser] une autre, l'investisseur ne suffit pas. Vous avez besoin d'un stabilisateur, qui est une sorte de batterie, qui, lorsqu'il reste de l'énergie, l'accumule et quand elle ne le fait pas, elle l'enlève. Normalement, les stabilisateurs doivent être mis dans une certaine quantité de puissance, par plante d'environ 50 mégawatts.
Donc, d'après ce que j'entends de vous, ce problème n'est pas nouveau.
Ce problème dure depuis des années, ce n'est pas nouveau ! Ce problème de stabilisation dure depuis des années maintenant et en fait, il existe un rapport très intéressant de l'organisme de régulation de l'énergie de l'UE, un super-régulateur qui coordonne tout le monde, qui explique le cas de ce qui s'est passé le 8 janvier 2021, lorsqu'il y a eu un problème similaire à celui du 28 avril et qui a presque détruit tout le réseau européen. C'est un incident qui a été analysé en détail et il a été constaté que le problème était l'inflexibilité pour changer la demande. Depuis lors, la nouvelle réglementation a forcé de nouveaux systèmes à proposer des caractéristiques de stabilisation plus exigeantes. Il s'agit d'une réglementation européenne.
Pourquoi est-il si certain que c'est ce qui s'est passé et non, comme certains le croient, une possible attaque extérieure ?
J'ai discuté avec des ingénieurs espagnols et nous pensons tous qu'il y a clairement un problème de stabilité. À partir de 12 heures [lundi midi], le problème de l'instabilité commence, il commence à y avoir des problèmes de changement de fréquence dans le signal actuel. Je vais vous donner un exemple : imaginez que vous avez un poteau que le vent pousse et va l'arracher, c'est une indication qu'il va aller au sol. Eh bien, c'est la même chose, les oscillations devenaient de plus en plus grandes et à la fin c'est ce qui s'est passé.
Alors, aurait-il pu être évité ?
Bien sûr ! L'année dernière, l'Espagne a été contrainte d'arrêter l'industrie à cinq reprises pour éviter que quelque chose comme celui d'hier ne se produise, par le biais du système de réponse active à la demande (SRAD), qui, avec un préavis de 15 minutes, peut informer les grandes industries qu'elles vont arrêter leur approvisionnement. Et ils acceptent en échange de recevoir de l'énergie moins chère. C'était une nouvelle, c'était publié. En fait, je me souviens que l'un des titres était « L'Espagne a failli faire le black-out ».
Certains blâmeront le photovoltaïque et les énergies renouvelables.
Le problème avec le photovoltaïque, c'est que ceux qui le produisent ont toujours intérêt à le vendre. Ils ont des contrats qui leur garantissent un prix garanti de 40 euros ou peu importe par mégawatt, et on a produit trop pour cela. Cela vient du fait de ne pas savoir s'arrêter, de voir qu'il y a tellement de demande et ainsi générer une stabilité croissante. Il y a eu un excès de cupidité et cela génère des instabilités et les systèmes commencent à échouer. Les câbles sont surchargés, déconnectés et une déconnexion en cascade se produit.
Pourquoi la disparition de 15 gigawatts en cinq secondes a-t-elle été mentionnée par Sánchez ?
Lorsque les 15 gigawatts disparaissent, c'est que les systèmes de protection sont activés. Sinon, tous les câbles auraient commencé à fondre. Imaginez une étincelle avec des puissances de gigawatt, ce seraient des puissances de foudre. Et les centrales nucléaires ont été automatiquement fermées, à cause de la situation très dangereuse qui existait. En fait, il devait y avoir des câbles dénudés et carbonisés, j'en suis sûr.
Comment ça ?
Il est sûrement arrivé qu'un câble à haute tension ait été transformé en phosphatine, mais ils ne voudront pas que cela soit connu car l'image n'est pas très bonne, cela donnerait une très mauvaise image. Mais je suis sûr que c'est arrivé.
Si vous étiez ministre de l'Énergie, que recommanderiez-vous à Sánchez pour que cela ne se reproduise plus ?
Eh bien, il faut prier [rires] et forcer les entreprises à mettre en place des systèmes de stabilisation. Ce que Sánchez a dit ce mardi, c'est à ce sujet, il met l'accent là où il devrait l'être. Il y a un enjeu qui n'a pas été investi mais aussi si l'usine à cycle combiné gaz avait été prête à prendre le relais, les problèmes auraient été moins importants. Ils les ont fait arrêter, et c'est une responsabilité criminelle.
Qui ?
Iberdrola, Endesa, Naturgy... Les grandes entreprises énergétiques sont celles qui contrôlent les centrales à gaz à cycle combiné. Une centrale thermique conventionnelle brûle du combustible pour produire de la chaleur, mais dans une centrale à cycle combiné, le système est différent ; C'est le gaz de combustion lui-même qui est utilisé, que vous réinjectez dans le système pour déplacer les pales. Cette force supplémentaire du gaz donne une puissance supplémentaire et de meilleures performances. Les centrales à gaz à cycle combiné ont environ deux fois les performances des autres, et en plus des meilleures performances, elles sont plus rapides, car c'est le gaz lui-même que vous déplacez et vous le faites réagir beaucoup plus rapidement. Ils sont utilisés pour stabiliser le système.
Cela dit, au moment de la panne, les centrales à cycle combiné ne représentaient que 8 % de l'ensemble du système et le lendemain, elles en représentent 40 %.
Et pourquoi ?
Parce que le gaz est plus cher, et que le système de tarification vous oblige à choisir d'abord les technologies les moins chères. Cela mettait le système lui-même en danger. Je comprends que vous utilisiez de l'énergie renouvelable, mais ce qui est logique, c'est que vous avez des centrales à cycle combiné en réserve. Mais leur entretien coûte beaucoup d'argent.
Pensez-vous que Sánchez sait tout cela ?
Je pense. Je sais que Teresa Ribera le sait.
Le dis-le-t-elle parce qu'elle connaît ou a des gens en commun avec elle ?
Pour une raison quelconque... Je sais que Ribera le sait. Et si elle le sait, la troisième vice-présidente (et ministre de la Transition écologique) le sait. Les déclarations de Sánchez indiquent qu'il comprend la nature du problème et que ce sont les grandes entreprises énergétiques qui nous ont conduits au black-out. Mais ils ont beaucoup de pouvoir. Et vous pouvez le voir dans les médias... Il y a de l'intérêt à ce que cette question ne soit pas très bien comprise.
Excluez-vous alors que ce soit le produit d'un sabotage ?
Oui. La réalité est beaucoup plus prosaïque, elle est plus minable, elle est plus misérable ; C'est la cupidité. Il est illusoire de penser à une attaque. De manière réaliste, à court terme, nous devons parier sur le fait qu'il y aura des centres de secours toujours prêts. Après ce qui s'est passé, je ne pense pas que cela puisse se reproduire à court terme parce qu'ils vont tirer le gaz, ce qu'ils font déjà. Les batteries sont très chères, extraordinairement chères, ce ne sont pas celles d'un téléphone portable, ce sont des monstres, des tonnes de lithium. Et tout attendre des centrales à cycle combiné, parce que c'est difficile parce qu'elles émettent du CO2 et que nous sommes censés l'éliminer. C'est difficile.
29/4/2025
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Soulèvement planétaire

On vit une situation assez paradoxale. Les dangers sont planétaires, les indicateurs sont au rouge et pourtant on ne parvient pas à rompre avec des logiques mortifères.
L'article propose de rappeler cette urgence écologique et climatique, et de mettre en relation la dégradation de la vie sur terre, l'érosion des droits et de la démocratie avec la nouvelle phase du capitalisme algorithmique. Les effets sont multiples et plutôt que de mener des luttes chacun dans son couloir on a besoin de mettre en relation nos expériences et nos combats. D'ouvrir notre pensée critique et notre sensibilité car l'une et l'autre sont menacées. Le combat, c'est déjà d'avoir ses sens ouverts, et d'être prêt à bâtir avec les autres une réalité partagée. Tandis que les milliardaires disent le réel, le défont et refont l'histoire, on doit depuis notre classe contester ce monde et ouvrir avec nos luttes et nos discours d'autres manières de nous lire et de faire l'histoire. Tandis qu'on constate un repli national dans bien des pays et des social-démocraties toujours plus frileuses pour proposer un récit alternatif et des perspectives émancipatrices, et donc anticapitaliste, l'article invite à renouer avec les dynamiques révolutionnaires ouvertes dans le passé, mais restées inabouties.
Malheureusement, les choix se restreignent. On l'on continue dans la barbarie, avec ces cinquante nuances de violence, ou l'on parvient à renverser la tendance.
Si d'un côté quelques Etats confirment et assument leur tournant autoritaire ou néofasciste avec en vue la guerre aux pauvres, aux étrangers, et l'accélération de l'écocide, on doit être plus nombreux à défendre la voie de la rupture. Elle implique de se solidariser avec les travailleurs, les étrangers, les incarcérés, les peuples opprimés. L'heure n'est plus aux compromissions mais à l'affirmation de la révolution. Plus que jamais, et dans tous les sens du terme, d'un point de vue affectif, intellectuel, on a besoin de semer un soulèvement écosocialiste planétaire.
Pour lire l'article au complet cliquer ici
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

À l’échelle mondiale, la rémunération des PDG a augmenté de 50 % depuis 2019, soit 56 fois plus que les salaires des employé.es

En amont de la Journée internationale des travailleurs (1er mai), une nouvelle analyse d'Oxfam révèle que la rémunération moyenne des PDG au niveau mondial a atteint 4,3 millions de dollars en 2024. Cela représente une hausse de 50 % en termes réels par rapport au salaire moyen de 2,9 millions de dollars comptabilisé en 2019 (corrigé de l'inflation). Cette hausse dépasse largement l'augmentation des salaires moyens réels des employé.es qui a été d'à peine 0,9 % durant la même période dans les pays où les données relatives aux rémunérations des PDG sont disponibles.
– La rémunération moyenne des PDG s'est accrue de 50 % en termes réels depuis 2019, tandis que le salaire moyen des employé.es n'a augmenté que de 0,9 %.
– En une heure, les milliardaires empochent l'équivalent de ce que les salarié.es gagnent en moyenne en une année entière.
– L'écart salarial moyen entre les femmes et les hommes au sein de 11 366 entreprises à travers le monde a légèrement diminué, passant de 27 % en 2022 à 22 % en 2023. Pourtant, en moyenne, les employées de ces entreprises continuent de « travailler gratuitement » le vendredi, tandis que leurs homologues masculins sont rémunérés pour la semaine entière.
– Oxfam et la Confédération syndicale internationale (CSI) appellent à augmenter les impôts sur les super-riches pour investir dans les populations et la planète.
Ces chiffres représentent les moyennes médianes basées sur la rémunération totale des cadres. Ils incluent les primes et les options d'achat d'actions et portent sur près de 2 000 entreprises implantées dans 35 pays où la rémunération des PDG a dépassé un million de dollars en 2024. Les données analysées par Oxfam proviennent de la base de données S&P Capital IQ qui compile les informations financières publiées par les entreprises.
– L'Irlande et l'Allemagne font partie des pays où les rémunérations des PDG sont parmi les plus élevées, avec une rémunération annuelle moyenne de respectivement 6,7 millions de dollars et 4,7 millions de dollars en 2024.
– La rémunération moyenne des PDG en Afrique du Sud était de 1,6 million de dollars en 2024, tandis qu'elle atteignait 2 millions de dollars en Inde.
« Année après année, nous assistons au même spectacle grotesque : la rémunération des PDG explose tandis que le salaire des employé.es stagne quasiment. Il ne s'agit pas d'une faille du système, le système marche parfaitement comme prévu. Il concentre toujours plus les richesses entre les mains des plus fortuné.es tandis que des millions de travailleurs et travailleuses peinent à payer leur loyer, à se nourrir et à se soigner », dénonce Amitabh Behar, directeur général d'Oxfam International.
Cette hausse de la rémunération des PDG intervient au moment où de plus en plus de voix mettent en garde contre le fait que les salaires ne suivent pas l'augmentation du coût de la vie. D'après l'Organisation internationale du travail (OIT), les salaires réels ont augmenté de 2,7 % en 2024. Toutefois, le salaire de nombre de travailleurs et travailleuses stagne. Ainsi, en France, en Afrique du Sud et en Espagne, les salaires réels ont augmenté d'à peine 0,6 % l'année dernière. Si les inégalités salariales ont diminué au niveau mondial, elles restent très élevées, notamment dans les pays à faible revenu où la part des revenus des 10 % les plus riches est 3,4 fois plus importante que celle des 40 % les plus pauvres.
Les milliardaires, souvent actionnaires ou propriétaires de multinationales, ont engrangé en moyenne 206 milliards de dollars de nouvelles richesses l'année dernière. Cela représente 23 500 dollars par heure, soit plus que le revenu moyen au niveau mondial en 2023, qui s'élevait à 21 000 dollars.
Par ailleurs, en plus de la flambée des rémunérations des PDG, les salarié.es à travers le monde sont maintenant confronté·es à une nouvelle menace : les nouveaux tarifs douaniers états-uniens. Ces politiques présentent des risques considérables pour les classes populaires du monde entier, notamment des pertes d'emplois et une hausse des prix des produits de première nécessité, ce qui pourraient exacerber encore davantage les inégalités déjà extrêmes.
« Avec la politique douanière irresponsable du président Trump, les choses vont de mal en pis pour nombre de travailleurs et travailleuses : on passe des politiques commerciales néolibérales destructrices aux tarifs douaniers utilisés comme une arme économique. Ces politiques nuiront non seulement aux classes populaires états-uniennes, mais surtout aux personnes qui tentent de sortir de la pauvreté dans certains des pays les plus pauvres du monde », déplore Amitabh Behar.
De plus en plus, la loi contraint les entreprises à publier les données relatives aux inégalités salariales entre femmes et hommes. D'après l'analyse d'Oxfam, qui s'appuie sur la base de données S&P Capital IQ, parmi les 11 366 entreprises implantées dans 82 pays qui ont publié leurs données relatives à l'écart de salaire femmes-hommes, l'écart moyen s'est légèrement réduit, passant d'environ 27 % en 2022 à 22 % en 2023. Pourtant, en moyenne, les femmes de ces entreprises continuent de « travailler gratuitement » le vendredi, alors que leurs homologues masculins sont rémunérés pour la semaine entière.
Les entreprises japonaises et sud-coréennes ont enregistré des écarts de salaire femmes-hommes moyens parmi les plus importants en 2023 : près de 40 %. L'écart salarial moyen en Amérique latine a légèrement augmenté, passant de 34 % en 2022 à 36 % en 2023. Les entreprises canadiennes, danoises, irlandaises et britanniques ont affiché un écart moyen de 16 %.
L'analyse d'Oxfam souligne que, sur 45 501 entreprises situées dans 168 pays ayant déclaré une rémunération de plus de 10 millions de dollars pour leur PDG, et précisé leur genre, moins de 7 % sont dirigées par des femmes.
« Les inégalités salariales scandaleuses entre les PDG et leurs salarié.es montrent que la démocratie fait cruellement défaut là où elle est la plus nécessaire : sur le lieu de travail. Des salarié.es du monde entier sont privé·es de leurs besoins les plus élémentaires tandis que les entreprises engrangent des profits sans précédent et se dérobent à leurs responsabilités grâce à l'évasion fiscale et au lobbying, » dénonce Luc Triangle, secrétaire général de la CSI.
« Les travailleurs et travailleuses exigent un nouveau contrat social fondé sur leurs intérêts et non sur ceux des milliardaires qui entravent la démocratie. Ce n'est pas radical de demander une fiscalité équitable, des services publics performants, des salaires décents et une transition écologique juste. C'est le fondement même d'une société juste. Il est temps de mettre fin au coup d'État des milliardaires contre la démocratie et de donner la priorité aux populations et à la planète. »
Oxfam et la CSI appellent les gouvernements à relayer et à soutenir les appels en faveur de l'imposition des super-riches, aussi bien à l'échelle nationale qu'au niveau mondial. Cela passe, notamment, par l'instauration de taux marginaux d'au moins 75 % sur les plus hauts revenus afin de décourager les rémunérations astronomiques pour les dirigeant.es d'entreprise. Les gouvernements doivent aussi veiller à indexer les salaires minimums sur l'inflation, et à ce que chaque personne ait le droit de rejoindre un syndicat, de se mettre en grève et de participer à des négociations collectives.
Notes aux rédactions
La note méthodologique d'Oxfam est disponible sur demande.
D'après les données de l'Organisation internationale du travail (OIT), dans les pays à faible revenu, la part des revenus perçue par les 10 % les plus riches est 3,4 fois plus élevée que celle perçue par les 40 % les plus pauvres. Le rapport mondial sur les salaires 2024-25 ainsi que les données sont disponibles en ligne.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :












