Presse-toi à gauche !
Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Des artistes demandent un cessez-le-feu à Gaza à la 96ème Cérémonie des Oscars

Lors de la Cérémonie des Oscars 2024, la demande pour un cessez-le-feu à Gaza a fait l'objet de plusieurs prises de parole et de position. Le 10 mars 2024 se déroulait la 96ème Cérémonie des Oscars, à Los Angeles. Dans la rue et du côté des lauréats, la demande pour un cessez-le-feu à Gaza a été au coeur des prises de parole et de position.
Par l'Agence Média Palestine, le 14 mars 2024
photo Manifestation sur Sunset Boulevard à Los Angeles, le soir des Oscars 2024.
Des centaines de manifestants, coordonnés notamment par ‘Workers For Palestine' et ‘SAG-AFTRA for a ceasefire', ont bloqué une grande partie d'Hollywood pendant la cérémonie de tapis rouge des Oscars. À quelques minutes du début de la cérémonie, la salle de bal est inhabituellement vide alors que les invités d'honneur se voient forcés d'accéder à pied à la cérémonie, se retrouvant ainsi en retard et nez-à-nez avec les manifestants.
Les manifestants ont fermé le Sunset Boulevard entre Vine Street et La Brea Avenue. Ils ont défilé dans la rue avec des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Pas de récompense pour le génocide » et ont conduit des bus scolaires couverts de drapeaux palestiniens.
Le prix du meilleur film étranger a été décerné à « La zone d'intérêt », de Jonathan Glazer, un film plongé dans l'Holocauste qui suit le quotidien du commandant du camp d'Auschwitz Rudolf Höss, et de sa famille dans leur maison situé en bordure du camp de concentration où plus d'un million de personnes sont mortes durant la Seconde Guerre Mondiale. Le film de Glazer, élaboré en collaboration avec le Mémorial et Musée d'Auschwitz-Birkenau, s'intéresse aux manières dont on peut lutter contre la déshumanisation, tant à l'époque qu'aujourd'hui. Lors de son discours, le réalisateur a adressé ce message concernant la situation à Gaza :
« Les choix de ce film ont été faits pour nous faire réfléchir et réagir dans le présent, pas pour qu'on se dise dans quelques années 'regardez ce qu'ils ont fait', mais pour qu'on se dise maintenant 'regardez ce qu'on fait'. Notre film montre là où a pu mener la déshumanisation la plus terrible. Et cela a forgé notre passé et notre présent. Aujourd'hui, nous nous tenons devant vous comme des hommes qui refusons que notre judéité et l'Holocauste soient instrumentalisés par une occupation qui a mené à une guerre impliquant tant d'innocents. Qu'il s'agisse des victimes du 7 octobre en Israël ou de celles des attaques incessantes qui se déroulent à Gaza, elles sont toutes des victimes de cette déshumanisation. »
Le film de Glazer avait d'ailleurs été programmé dans le cadre d'un ciné-club du collectif juif décolonial Tsedek, qui avaient ensuite été annulés suite à des pressions externes. Le réalisateur du film a tenu a adresser un message de soutien au collectif : « Au nom de la liberté de pensée et d'expression, nous soutenons le droit du collectif juif Tsedek ! de diffuser et discuter le film ‘La Zone d'intérêt'. Comme nous, ils condamnent les meurtres et l'oppression en cours des civil-es innocent-es à Gaza et dans les territoires occupés, comme celui des civil-es innocent-es tué-es et pris-es en otage le 7 octobre en Israël. Leur position n'est pas antisémite ». Une nouvelle programmation du film dans le cadre du ciné-club Tsedek sera bientôt prévue.
Sur le tapis rouge, plusieurs célébrités portaient également le pin's rouge d'« Artists for a Ceasefire », notamment les acteurs du film multi-nominé ‘Pauvres Créatures' Ramy Youssef et Mark Ruffalo, ou encore la chanteuse Billie Eilish. Le pin's symbolise un soutien au peuple palestinien et un appel au cessez-le-feu immédiat et permanent. Quand Ramy Youssef a été interviewé sur la raison pour laquelle il a choisi de porter ce pins lors de la cérémonie, il a répondu :
« Nous demandons un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza. Nous appelons à la paix et à une justice durable pour le peuple de Palestine. C'est un message universel : Arrêtons de tuer des enfants. Cessons de tuer des enfants. Ne participons pas à d'autres guerres. Personne n'a jamais regardé la guerre en arrière et pensé qu'une campagne de bombardements était une bonne idée. Le fait d'être entouré de tant d'artistes qui sont prêts à prêter leur voix, la liste ne cesse de s'allonger. Beaucoup de gens vont porter ces pin's ce soir. Il y a beaucoup de têtes parlantes dans les journaux télévisés, ici c'est un espace de cœurs parlants. Nous essayons d'envoyer un grand message à l'humanité. »
Les acteurs du film de Justine Triet primé à la catégorie du meilleur scénario ‘Anatomie d'une chute', Swann Arlaud et Milo Machado-Graner, ont eux porté un pin's arborant le drapeau palestinien.
Après près de 160 jours de bombardements israéliens sur la bande de Gaza, Israël a assassiné plus de 31 341 Palestiniens depuis le 7 octobre, dont au moins 12 300 enfants, et a blessé plus de 73 134 personnes.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« Le domaine des artistes, c’est l’art, pas la politique ! »

Justine Triet a reçu l'Oscar du meilleur scénario original pour Anatomie d'une chute après de nombreuses péripéties, marquées par un discours mémorable à Cannes l'an dernier contre la retraite à 64 ans. On lui reproche, comme à d'autres avant elle, d'être trop politique. Puisque ça ne semble pas évident pour tout le monde, retour sur quelques bases.
Tiré du blogue de l'auteur.
« Son discours n' avait rien à faire dans ce contexte de cinéma », « Qu'elle reste dans son rôle » ou « Qu'elle fasse de la politique alors, pas du cinéma ! » sont des commentaires récurrents de la prise de parole de Justine Triet l'an dernier lors du festival de Cannes. Et ce n'est ni la première ni la dernière fois que cela arrive.
Judith Godrèche a eu le même type de réactions aux Césars de cette année, souvenons-nous de celles à l'encontre du documentariste aujourd'hui député François Ruffin à ceux de 2017. C'est une rengaine : le cinéma et la politique seraient deux choses séparées.
Plus généralement, l'art et la politique seraient séparés. En tant qu'auteur, j'avoue avoir du mal à envisager par quel chemin on peut arriver à penser ainsi.
Créer, c'est militer
Quand on crée, on prend la parole. Par principe, cela signifie qu'on considère qu'elle vaut quelque chose. C'est politique. On refuse la position du sujet, de l'objet, on revendique au minimum celle de l'observateur. Parfois même celle de l'acteur.
Dans notre France actuelle, les hiérarchies sont bien présentes et de nombreuses personnes considèrent que leur parole est illégitime, inintéressante et inutile. Et quand ce n'est pas cela qui nous limite, ce sont directement des affirmations partagées massivement. Comme celles d'un Président de la République qui déclarait dans une gare qu'il y a ceux qui réussissent et « ceux qui ne sont rien ». Se mettre en avant, s'affirmer et s'exprimer, c'est donc déjà un acte militant.
Mais créer, c'est aussi agir dans un contexte de production. Dans l'émission Soft Power de Lex Tutor, on apprend chaque vendredi à quel point ce contexte est important pour la culture et ceux qui la font. Doit-on accepter ou refuser les subventions ? Et pour les publicités et les sponsors ? Quel rôle donne-t-on à celles et ceux qui travaillent avec nous ? Aux plateformes ? Aux intelligences artificielles ? Sur quel média s'exprime-t-on ? Sous quelle forme ? Si on choisit d'avoir une communauté, quel pouvoir doit-elle avoir sur notre travail ?
Chaque artiste doit se placer sur toutes ces questions dans l'intervalle confortable entre une rémunération suffisante et les valeurs et messages qu'il ou elle porte. Les compromis sont souvent nécessaires et aucune œuvre n'échappe au monde qui vit autour d'elle.
Cela signifie aussi que quand on devient créateur, on a une vie professionnelle de créateur. Des expériences, des aventures et des combats d'artistes. On aurait tort de s'en priver pour inspirer nos propres travaux. À ce degré là, on milite pour conserver ou changer notre environnement et nos conditions de travail. Notamment au sein de nos créations. Toute œuvre parle de l'art en général, de ce qu'il est au moment où il est décrit ou dénoncé, de comment il se fait ou ne se fait pas, de ses limites et de ses permissions.
J'irai même plus loin.
Créer, c'est répondre
J'ai commencé mon aventure d'auteur dans le monde de la fanfiction quand j'étais adolescent. J'ai lu des récits alternatifs des mondes d'Harry Potter, de Star Wars, de Digimon ou de Death Note et me suis parfois risqué à écrire dedans moi-même.
La première question que je me pose alors est : qu'est-ce que je souhaite écrire ? La première réponse, la plus simple, est d'essayer de reproduire et de développer une partie de ces univers qui me plaisent. De faire dans ce style. Dans cet esprit.
Le choix de l'œuvre de départ est déjà politique. Les grandes sagas sont privilégiées dans mon esprit car elles ne dévoilent qu'une partie assez minime de leur univers, laissant ainsi un champ libre à mon imagination. Mais dans ma jeunesse, il y avait aussi Matrix, Le Seigneur des Anneaux ou le Monde de Narnia. J'ai eu beau lire, regarder et aimer ces sagas, jamais je ne m'y suis aventuré dans mes écrits. Le champ des possibles m'y paraissait plus restreint, moins accueillant aussi. Question d'affinités. Parce que la création, même dans ces cadres de dérivés de fiction, doit permettre de se déployer soi et ses problématiques.
Le développement de l'univers que je choisis est donc une réponse. Une réponse à l'œuvre, à ses manques, à ses oublis, à ses aveuglements. Ce qui signifie en fait une relecture de cette œuvre par mes obsessions, qui ne sont pas celles de l'autrice ou de l'auteur originel. Ces oublis, ce sont des oublis selon moi. Des manques dans ce qui, moi, m'intéresse. C'est donc infiniment personnel. Et partager le travail qui en résulte s'en retrouve infiniment politique.
Depuis, j'écris de la fiction en général et tout un tas d'autres choses. Pourtant, j'ai tendance à me dire que tous mes travaux sont des fanfictions : les codes choisis sont bien plus larges, les inspirations plus nombreuses, mais tout ce que j'écris est une réponse. Créer est une critique, une réponse à d'autres créations et au monde.
Quand j'écris une romance pour le recueil de nouvelles Qui Sème l'Été, je réponds à toutes les romances que j'ai pu lire et à certains présupposés qui ne me conviennent pas. Quand j'écris Mauvais Élève qui raconte mon parcours dans l'éducation nationale, je décris évidemment l'application de certaines politiques, mais j'y raconte mes émotions en réponse à un militantisme que je trouve trop méfiant envers celles-ci. Quand j'écris une vidéo sur l'état déplorable des logements en France, je réponds à un silence médiatique tout en rendant hommage au travail de la fondation Abbé Pierre.
Et je ne suis pas le seul. Star Wars est une réponse à la guerre du Vietnam. Digimon remplace les créatures animales et végétales de Pokémon par des programmes dans un monde virtuel. Harry Potter à l'école des sorciers propose une manière de briser la barrière entre les genres fantasy et fantastique. Toutes ces œuvres sont des réponses à des créations préexistantes dans lesquelles on déploie ensuite ses propres obsessions.
Ironiquement, commenter, c'est déjà créer
Je ne connais pas d'étape dans la création qui ne soit pas le résultat d'un choix, et qui n'ait donc pas d'implication politique.
À mon avis, qui est plutôt un doigt mouillé qu'un baromètre, ce discours de séparation absolue entre cérémonie artistique et discours politique est d'abord dû à une société qui met des barrières partout : entre les scientifiques et les littéraires, entre les jeux d'enfants et les loisirs adultes, entre le spectacle et le monde (qu'il décrit ou dénonce pourtant). Nous gagnerions tous à davantage de transversalité et à moins d'exclusions automatiques.
Mais l'inconcevabilité d'un art apolitique me rend tout de même très perplexe. Est-ce possible de voir, de lire, d'écouter sans rien déceler qui gratte un peu ? Est-ce possible même de vouloir créer quelque chose qui ne suscite aucune discussion ?
Face à cet embarras, j'ai trouvé une réponse. Une histoire insuffisante mais confortable. Je crois que ces commentaires ne sont pas sincères.
Je pense et je me convainc de plus en plus que les personnes qui prétendent vouloir séparer l'art de la politique sont en réalité très imbus de leur pouvoir sur les réseaux sociaux. Un pouvoir précisément très politique.
Elles sont d'ailleurs contredites par toutes celles et tous ceux qui commentent sous les mêmes vidéos des « Bravo ! », « une prise de parole courageuse ! » ou des « enfin du bon sens ! ».
Tout se passe comme si on ne souhaitait séparer de la politique que l'art qui nous déplaît ou les prises de parole en désaccord avec nos engagements. Les deux positions antagonistes coexistent dans une forme de lutte pour un surcroît d'approbations, pour être repris ailleurs, pour engager une polémique qui va dépasser les seuls espaces d'expression libre. Finalement, en disant ne pas vouloir faire de politique, ces gens en font quotidiennement. Et je peine à croire qu'ils ne s'en aperçoivent pas.
La spécialité du « deux poids, deux mesures » que le monde politique pratique en permanence semble maintenant reprise par des internautes anonymes sinon conscients de leur positionnement politique, du moins bien au courant de leur potentiel pouvoir de nuisance.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Aya Nakamura et les JO : quand la France exporte son racisme

Aya Nakamura est l'artiste française la plus connue à l'étranger. Ces tubes viraux on pu faire le tour du monde notamment « Djadja », « Copine »... Ce choix n'est pas le fruit du hasard, cette artiste connaît un succès à l'international et fait le show. C'est ce que l'on attend lors d'un événement de cette envergure.
Tiré du blogue de l'autrice.

Aya Nakamura aux JO : un choix questionné
Les internautes sont conscients du choix stratégique fait pour “redorer” le blason de la France après les nombreuses polémiques racistes et islamophobes. Une femme noire pour l'ouverture des JO en France, quel pays progressiste ! Mais rapidement cette nouvelle ouvrira un spectacle raciste et misogyne. Pour illustrer cette annonce, un média a utilisé une photo de… Naomi Campbell au côté de Brigitte Macron ou des internautes français utilisent une photo de Megan Thee Stallion, artiste américain, pour dénoncer le manque de classe de la chanteuse française.
Confondre deux personnes racisés n'est pas une simple erreur : les personnes racisées ici les femmes noires n'ont pas le droit à leur individualité. Cela est aussi constaté par la psychologue Racky KA-SY :
- “Refuser de reconnaître l'autre comme un être unique et distinct des autres [...], nier son identité et ne pas le considérer comme l'humain qu'il est, c'est de la déshumanisation.”
Nous parlons également de l'homogéneisation exo-groupe c'est-à-dire que nous voyons les groupes différents de nous comme homogène d'où le fait de les confondre, ce regard reste fondé sur des idées reçues et stéréotypes. À contrario, l'hétérogéneisation endo-groupe permet de distinguer les personnes du groupe auquel nous appartenons. Il y a tout de même un certain rapport de domination qui s'instaure à travers ce regard porté sur l'autre.
Ce choix est remis en cause car il est considéré que la chanteuse n'est pas légitime pour représenter la France. Femme noire, issue d'un quartier populaire avec un style entre la pop, le R&B, le hip-hop et l'afrobeat… Au final un style très en vogue, un mélange et un renouvellement qui enflamment les pistes du monde entier. Certain.e.s se questionnent, peut-on ne pas aimer ce choix et ne pas être raciste ?
L'identité française : le mépris de classe et le racisme ?
Pour ses réfractaires, Aya Nakamura ne représente pas la France, ses chansons, son image ne collent pas. Nous avons pu avoir des propositions comme Michel Sardou, Patrick Bruel, Jean-Jacques Goldman ou encore Véronique Sanson… Si ce sont des grands noms de la chanson française, est ce qu'en 2024 ils ont la visibilité d'Aya Nakamura ? Et surtout est-ce vraiment pertinent dans le cadre des JO ? Il y a tout de même une volonté à parler au monde entier donc mettre une artiste internationale reste un choix cohérent. Le problème reste le racisme qui découle de cette annonce.
“ Y a pas moyen Aya, ici c'est Paris pas le marché de Bamako” voici ce que l'on peut lire sur la bannière d'un crépuscule d'extrême droite pour contester cette décision. À partir de là, est-ce que les débats parallèles comme ses tenues ou ses paroles ont de l'importance ?
La chanteuse subit de la misogynoir depuis le début de sa carrière. La misogynoir est un concept de la chercheuse Moya Bailey voulant mettre en lumière l'expérience particulière du racisme et de la misogynie que vivent les femmes noires. Comme le fait d'être les comparer à des hommes noirs quand leur physique ne répond à certaines injonctions (comme le fait de ne pas porter de maquillage ou d'avoir un corps musclé), les considérer comme des femmes colériques et agressives. À cela s'ajoute du mépris de classe car elle joue une musique qui n'est pas légitime si nous reprenons les théories bourdieusiennes du champ musical.
Les commentaires revenant assez souvent sont : “elle ne représente pas la France”, “elle est vulgaire”, “des textes qui ne sont pas écrit en français”... La musique peut avoir plusieurs formes. Nous avons des musiques à textes avec un message profond comme nous avons des musiques plus légères qui conviennent aux espaces festifs. Chanter du Edith Piaf n'est en rien un sacrilège, nombreux sont les artistes reprenons des titres de la variété française dans des genres tout à fait différents, c'est aussi ça la magie de l'art.
Racisme, misogynie, mépris de classe, les éditorialistes français se surpassent afin de contester ce choix qui n'a pas été acté. D'autres se voit surpris du manque de réaction du président qui n'avait pas hésité à prendre la parole pour défendre Gérard Depardieu. Même reproche à Rachida Dati qui avait pu promouvoir la musique dite urbaine argumentant sur le mépris de classe et la dimension artistique et politique du rap
“Mais je vous dois quoi en vrai ? Que dalle !”
La réponse de l'artiste a pu faire parler. Afin de répondre à la banderole raciste la chanteuse a pu tweeter :
- “Vous pouvez être racistes mais pas sourds. C'est ça qui vous fait mal ! Je deviens un sujet d'État numéro 1 [..] mais je vous dois quoi en vrai ? Que dalle !”
Forcément nous avons eu le droit à la fameuse gratitude que nous devons avoir surtout en tant que personne racisées, j'ai pu aborder cette question suite à la polémique autour d'Omar SY l'an dernier. Par son travail et son parcours, la chanteuse a pu se faire une place avec un succès international tout en subissant tous les jours des attaques sur son physique, sa couleur de peau, sa vie privée…. mais comme j'avais pu le préciser les personnes racisées devraient être plus reconnaissantes que le reste de la population. "Grâce à la France vous avez pu avoir du succès", il y a clairement une dimension raciste derrière cela et pour illustrer cette vision nous pouvons reprendre des propos tenus sur Sud Radio au sujet de la journaliste Rokhaya Diallo :
« Sans la France madame Diallo serait en Afrique avec 30kgs de plus, 15 gosses, en train de piller le mil par terre et d'attendre que Monsieur lui donne son tour entre les 4 autres épouses.
Des propos violents au niveau de la banderole de l'extrême droite. Pouvons-nous commencer à questionner l'aisance avec laquelle il est permis de tenir des propos d'une telle violence sous prétexte de la liberté d'expression ?
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Appel pour la VIème Rencontre écosocialiste internationale

Les 9, 10 et 11 mai 2024, la VIème Rencontre écosocialiste internationale et la Ière Rencontre écosocialiste Latino-Américaine et Caribéenne se tiendront à Buenos Aires.
Tiré de Gauche anticapitaliste
13 mars 2024
Par Collectif
Appel pour la VIème Rencontre écosocialiste internationale
La VIème Rencontre écosocialiste est la première à se tenir en Amérique Latine et dans les Caraïbes (Abya Yala), et s'inscrit dans la lignée des précédentes Rencontres organisées en Europe. Elle cherche à alimenter les débats sur la base de l'accumulation des constructions antérieures. L'objectif est de passer des dénonciations et des luttes défensives à la construction d'une stratégie globale pour affronter les causes structurelles générées par la marchandisation et la déprédation capitaliste et pour avancer vers un modèle de société qui n'est pas gouverné par les profits des entreprises et d'autres groupes d'intérêt, mais plutôt en termes de besoins sociaux en équilibre avec la nature et dans une perspective éco-féministe et anti-raciste.
La réunion comprendra des panels, des ateliers, des plénières et des espaces d'échange entre les collectifs, les activistes et les organisations en lutte afin d'avancer collectivement vers un agenda et un programme de lutte pour l'écosocialisme. Afin d'arriver à la réunion avec des contributions et des lignes de travail définies, nous organisons des activités en ligne qui peuvent être suivies via notre chaîneYouTube.
Nous comprenons que la diversité qui nous caractérise en tant qu'organisations de défense des biens communs et de lutte pour un monde sans exploitation est notre plus grande force, c'est pourquoi nous invitons tout le monde à participer aux groupes de travail et surtout à la construction de notre programme, qui sera l'axe organisateur des débats que nous voulons avoir dans ce moment historique. La construction est ouverte aux collaborations et nous vous encourageons à participer organiquement à cette instance afin d'avancer dans les discussions qui nous semblent indispensables.
La Rencontre aura une instance hybride, au moins pour les débats principaux, afin de faciliter la participation de celleux qui ne peuvent pas être présent·e·s en présentiel. Toutes les informations seront diffusées par le biais de nos réseaux et de notre liste de diffusion, et toute personne intéressée peut demander l'accès à la liste en cliquant sur le lien suivant :https://groups.google.com/g/6encuen...
Afin d'encourager et de donner de l'espace à tous les points de vue intéressés par la construction d'un horizon écosocialiste, nous recevons des contributions telles que des textes et/ou d'autres matériaux qui seraient intéressants pour socialiser avec le collectif qui participera à la Rencontre. Vous pouvez envoyer votre contribution par email : 6encuentroecosocialista@gmail.com ou par les réseaux de messagerie au numéro +541135648839.
Nous commençons à élaborer le programme de la Rencontre. Nous souhaitons que ce programme reflète les propositions des différents collectifs qui seront présents. Nous vous invitons à nous envoyer vos propositions et à participer aux réunions du groupe de travail programmeà travers ce lien. Nous avons déjà plusieurs axes thématiques, tels que l'écoféminisme, le militarisme, le syndicalisme, l'extractivisme et la stratégie et la construction écosocialiste.
L'objectif de la 1ère Rencontre Ecosociale d'Amérique Latine et des Caraïbes est de donner une continuité aux débats écosociaux à partir des territoires et des enjeux de la région, et il est proposé de poursuivre avec une seconde Rencontre qui se tiendra à l'occasion de la COP 30, qui aura lieu au Brésil l'année prochaine. Afin de construire le processus de la 2ème Rencontre, le Réseau Brésilien des Ecosocialistes a proposé de faciliter et de promouvoir les échanges nécessaires à la formation d'une coordination large et diversifiée de collectifs et d'activistes en vue de l'organisation de la 2ème Rencontre à Bethléem.
Dans cet Appel pour les VIèmes Rencontres, nous aimerions compter sur la signature d'organisations et/ou d'individus qui souhaitent contribuer à la diffusion et à la construction de l'initiative, pour lesquelles nous partageons notre Appel. Nous sommes en train d'organiser la logistique pour recevoir tout le monde de la meilleure façon possible, nous demandons donc à celleux qui souhaitent participer aux activités de remplir notre formulaire d'inscription.
Le contexte dans lequel nous devons organiser cet événement depuis l'Argentine est celui de l'avancée d'une extrême droite qui vise à détruire les droits gagnés par les syndicats, les féminismes et les organisations qui ont lutté – et continuent de lutter – pour plus de démocratie et une meilleure démocratie, en affrontant les dictatures et les projets néolibéraux.
Cependant, tout ce scénario nous appelle également à construire des horizons possibles à partir des luttes sociopolitiques et écologiques d'en bas et de gauche. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Argentine et l'Amérique latine ont besoin du soutien et de la solidarité internationalistes. C'est pourquoi nous comptons sur la présence de nombreux·euses camarades pour un débat fraternel.
Afin de rendre la Rencontre possible, nous demandons aux organisations, collectifs et individus qui peuvent et/ou veulent collaborer financièrement de le faire à travers le compte suivant. Nous pourrons ainsi commencer à préparer les espaces et garantir le transport, l'hébergement et la nourriture des camarades, ainsi que l'équipement nécessaire pour les transmissions en ligne.
IBAN ES25 1491 0001 2221 7799 8321
BIC TRIOESMMXXX
Titre : ASOCIACIÓN ANTICAPITALISTAS MOVIMIENTO POR EL PODER POPULAR (ASSOCIATION ANTICAPITALISTE POUR LE POUVOIR POPULAIRE)
Concept : Contribution VI Rencontres écosocialistes
Nous vous attendons à Buenos Aires !
Toutes les infos sur le site alterecosoc.org
Premières signatures
Anticapitalist Resistance / Anticapitalistas – España / Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade – Brasil / ATTAC Argentina / CADTM – AYNA/ Centelhas (PSOL) – Brasil / CLATE – Argentina / Climaximo – Portugal / Corriente Política de Izquierda (CPI) – Argentina / EcosBrasil / Ekologistak Martxan – País Vasco / ESK sindikatua- País Vasco / Extinction Rebellion South Africa / Gauche anticapitaliste – Belgique / Groupe écosocialiste de solidaritéS – Suiza / Grupo Iniciativa Ecosocialista en Chile / Gune Ekosozialista – País Vasco / Heñói – Paraguay / Huerquen Comunicación – Argentina / Insurgência (PSOL) – Brasil / Internacional de Servicios Públicos (ISP) / Jauzi Ekosoziala – País Vasco / La Cultural de la Costa – Argentina / LAB – País Vasco / Marabunta – Argentina / Marcha Plurinacional de los Barbijos – Argentina / Movimento Pela Soberania Popular na Mineração (MAM) – Brasil / Multisectorial Paren de Fumigarnos – Santa Fe – Argentina / Museo del Hambre – Argentina / Nouveau Parti Anticapitaliste – Francia / Nuestramérica – Argentina / Observatorio Petrolero Sur – Argentina / Plataforma América Latina y el Caribe Mejor Sin TLC / Poder Popular – Argentina / Propuesta Sur – Argentina / Rebelião Ecossocialista – Brasil / Rede Brasileira de Ecossocialistas – Brasil / Setorial ecossocialista del PSOL – Brasil / SolidaritéS – Suiza / Steilas sindikatua – País Vasco / Subversión – Argentina / Subverta (PSOL) – Brasil / Transnational Institute (TNI) / Yasunidxs – Ecuador
Adrian Ruiz / Alejandro Horowicz / Alfonso Caño Reyero / Andoni Louzao Bustamente / Andrea Leonett / Arlindo Rodrigues / Aude Martenot / Beatriz Rajland / Cecília Feitosa / Cecilia Piérola / Christine Poupin / David Fajardo / Eduardo Giesen / Endika Perez Gomez / Evelyn Vallejos / Fernando E. Tecuatl / Fernando Gonzaléz Cantero / Flavio Serafine / Francisca Fernández Droguett / Gabriel Casnati / Gabriel E. Videla / Hugo Milito / Iñaki Bárcena / Iñaki Uribarri / Iñigo Antepara / Iratxe Álvarez Reoyo / Iratxe Delgado Arribas / Ivan Moraes / Janilce Magalhães / Javier Aguayo / Javier Echaide / Jeanne Planche / Joana Bregolat / João Camargo / Joaquin Vega Padial / José Manuel Gutiérrez Bastida / José Seoane / José Seoane / Juan Tortosa / Julio Gambina / Licia Garcia / Listado de personas / Luciana Ghiotto / Lucien Durand / Manuel Gari / Marcos Filardi / María Elena Saludas / Mariana Souza / Marije Etxebarria Ezpeleta / Mario Bortolotto / Marisa Castro Delgado / Martin Lallana / Martín Mosquera / Mauricio Cornaglia / Mauricio Laxe / Michel Loẅy / Moira Millan / Natalia Chaves / Nathalie Delbrouck / Ollivier de Marcellus / Professor Túlio / Renan Dias Oliveira / Renato Roseno / Ritxi Hernández Abaitua / Rodrigo Andrade / Sabrina Fernandes / Sara Ibáñez Ortega / Sébastien Beltrand / Sébastien Brulez / Sergio Abraham Esparza / Sergio Esparza / Steven Tamburin / Talíria Petrone / Tamara Perelmuter / Tárzia Medeiros / Teo Frei / Tom Kucharz / Tomi Etxeandia Egidazu / Vanessa Dourado / Yayo Herrero
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Leila Alaoui, made in India

Paris. Quartier du Marais. Jeudi, 7 mars 2024. La Galeria Continua expose une série d'oeuvres inédites de Leila Alaoui. L'artiste, en résidence à Chennai, ancienne Madras, en Inde, témoigne de la condition ouvrière dans les usines de textile.
PAR MUSTAPHA SAHA.
Elle installe durant l'été 2014 un studio mobile avec projecteurs, déflecteurs, toile de fond noire Le cadre se décontextualise. Les trois cents travailleuses, revêtues de saris magnifiques, défilent devant son objectif. Aucune sélection préalable. Se nouent spontanément des liens d'empathie. Chaque séance est un moment d'amitié. Les gestes, les postures, les allures se ritualisent. Des silhouettes fines, droites, impassibles. Des peaux hâlées par le soleil et le vent. Des regards profonds. Un immense panneau décline trente gros plans de mains, des mains indélébilement marquées par le dur labeur, striées de cicatrices, rugueuses, noueuses. Des mains parfois effilées de jeunes filles. Des mains quelquefois veineuses, trahissant un âge avancé. Des mains nues découvrant leur innocence. La communauté féminine d'une obscure région tamoule acquiert, par la magie de l'art, une impressionnante visibilité.
En cette année 2014 où Leila Alaoui réalise son reportage photographique, une étude du Centre de recherche sur les entreprises multinationales (SOMO) et du Comité néerlandais pour l'Inde (ICN) souligne les conditions inhumaines de travail dans les filatures du Tamil Nadu. Des employées de tous âges travaillent six jours par semaine, du matin au soir, pour des salaires dérisoires. Les femmes sont incitées à quitter leur village par des promesses alléchantes. Elles se retrouvent esclavagisées. Les cadences infernales ne laissent aucun répit. Beaucoup des travailleuses sont hébergées dans des résidences misérables appartenant aux entreprises. Les gérants et les superviseurs, exclusivement des hommes, intimident, menacent, apeurent, profèrent des insultes et des injures. Les contrôles systématiques, les pressions permanentes, les chantages au licenciement au moindre retard entraînent une lourde pathologie professionnelle, maladies respiratoires, affections vésicales et rénales, problèmes cardiaques, lombalgies, fatigues chroniques, crises d'angoisse, dépressions.
Les usines d'habillement sous-traitent au profit des marques occidentales. La mondialisation est synonyme de délocalisation. Les enseignes de confection ne se soucient guère du fonctionnement interne de leurs fournisseurs, des violations des droits humains. Les carences de sécurité sont partout criantes. Les drames se succèdent. Les fabriques sont des cimetières de la mode jetable, du surconsumérisme effréné. Les vêtements et les chaussures usagés s'évacuent dans les pays du sud. Les marques d'ultra fast fashion rabaissent sans limites les petits prix. Les produits bon marché s'acculement dans des décharges monstrueuses. Selon le rapport 2020 de Climate Chance, l'industrie du textile est responsable d'un tiers des rejets de microplastiques dans l‘océan.
L'exposition est aussi une invitation à découvrir la culture tamoule. Les grands formats de Leila Alaoui suggèrent les architectures domestiques où certaines ouvrières évoluent au quotidien, les vérandas sur la rue avec des tuiles sur poteaux de bois, les cours intérieures, les arrière-cours, les thalvarams surnommés « les rues qui parlent ». Les façades offrent des extensions publiques, des passages toiturés au service des piétons, des bancs maçonnés pour les visiteurs et les pèlerins. La rue s'homogénéise avec juxtaposition d'appentis, de corniches, de pilastres, de colonnes ornées, de parapets sculptés. Une atmosphère retrouvée dans la scénographie de l'exposition, salles désenclavées, vétustés esthétiquement exploitées.
Les Tamouls, vivant majoritairement dans l'Etat du Tamil Nadu, principalement des indous, comptent également des minorités chrétiennes et musulmanes. Une culture millénaire, diversitaire. Une langue ancienne, riche d'un formidable patrimoine littéraire. Une musique antique, dite carnatique, codifiée quatre siècles avant l'ère chrétienne, essentiellement basée sur l'improvisation. Les architectures dravidiennes, les temples rocheux, les grottes sacrées, les stupas, les mosquées, les palais, les bas-reliefs, les arches monumentales, toranas. La vallée de l'Indus est la plus immémoriale des civilisations urbaines, avec la Mésopotamie et l'Egypte pharaonique. Les styles accompagnent l'évolution du bouddhisme. Révolution iconographique il y a deux mille ans, le Bouddha est représenté, pour la première fois au Gandhara, sous forme humaine. Les techniques de construction se perfectionnent avec les royaumes hindouistes du sud à partir du huitième siècle. Les temples en pierre se substituent aux édifices excavés. Plus tard, les architectures indo-musulmanes et mogholes.
Les dynasties tamoules antiques, protectrices des lettres et des arts, archivistes, édificatrices d'architectures somptueuses, entretiennent des relations diplomatiques avec Athènes et Rome. Une relation grecque anonyme du premier siècle, Periplus Maris Erytraei, Le Périple de la mer Erythrée, énumère les exportations indiennes, poivre, cannelle, nard, perles, ivoire, soie, diamants, saphirs, écaille de tortue. Au sixième siècle, les Pallava érigent le premier empire. La construction de vastes temples, fastueusement décorés, s'accélère. Des sages tamouls fondent le mouvement bhakti, composante essentielle de l'indouisme, préconisant l'amour pur et l'oubli de soi. Cinq voies balisent sa pratique, le jnâna yoga, yoga de la connaissance, le karma yoga, voie de l'action consacrée, le raja yoga, exercices physiques et spirituels, le tantra yoga, rites magiques et la discipline personnelle. Les Chola renversent les Pallava au neuvième siècle. Les invasions musulmanes prennent la relève à partir du quinzième siècle. Deux siècles plus tard, les puissances européennes établissent des colonies. Français, britanniques, portugais, néerlandais introduisent des styles européens, des dômes gothiques, des tours d'horloge victoriens. New Delhi s'enorgueillit de ses monuments Art déco. La Grande-Bretagne domine tout le sous-continent jusqu'à l'indépendance de 1947.
L'art tamoul est surtout un art religieux. La peinture de Tanjore apparaît au neuvième siècle. Le support est une pièce d'étoffe recouverte d'oxyde de zinc. L'image est polychrome. Elle peut être ornée de pierres semi-précieuses, brodée de fils d'or et d'argent. Le style d'origine est repris avec des techniques adaptées dans les fresques religieuses. Les sculptures de pierre et les icônes de bronze, de l'époque Chola notamment, sont des contributions majeures au patrimoine de l'humanité. Cet art se caractérise par des lignes douces et fluides, des détails traités avec une infinie minutie. Ni préoccupation d'exactitude ni souci de réalisme dans l'éxécution des portraits. Un art archétypal.
Flotte dans l'air de l'exposition une empreinte d'indigo, couleur apaisante, relaxante, envoûtante. Chromatique de la méditation, de l'intuition, de l'inspiration, de la création, de la conscience profonde. La haute résolution accentue l'effet hypnotique. L'indigo, pigment végétal issu des feuilles et des tiges de l'indigotier, était, dans les temps anciens, un produit de luxe. Les grecs et les romains l'appelaient l'or bleu. L'indigo, réintroduit dans les pays occidentaux au quinzième siècle par des marchands arabes, est prisé par les hippies pacificistes et la contre-culture californienne. Il imprègne de sa légende jusqu'aux Bleu jeans. Nous baignons toute l'après-midi dans un espace hors-temps, une ambiance hiératique peuplée de déesses.
Octobre 2014. Je fais la connaissance de Leila Alaoui à l'occasion de l'événement Le Maroc contemporain à l'Institut du Monde Arabe où nous sommes tous les deux exposants. Je présente des peintures sur toile, des portraits de figures de proue de la littérature marocaine, Driss Chraïbi, Edmond Amran El Maleh, Mohamed Leftah. Leila Alaoui montre Cossings, Traversées, une installation vidéo immersive, en triptyque, sur des migrants subsahariens clandestins, plongés dans un environnement hostile, collectivement traumatisés. Le pseudo-paradis européen se révèle une utopie problématique. Elle évite judicieusement la corde sensible. Portraits statiques, paysages abstraits, voix-off. La démarche anthropologique rejoint mon travail sociologique en recherche-action. Nous avons quelques conversations philosophiques. Elle me pose des questions sur Mai 68, sur le cinéma de Jean Rouch, sur la théorie rhizomique de Gilles Deleuze et Félix Guattari, sur des événements historiques qu'elle aurait voulu avoir vécus, sur des intellectuels qu'elle aurait voulu avoir connus. Elle me paraît assurer une relève crédible. Elle élabore des méthodologies originales, des techniques novatrices. Elle me tient informé de ses projets artistiques, toujours motivés par des raisons solidaires. J'apprécie sa soif intellectuelle, son énergie créative. Je lui consacre une chronique, après sa disparition tragique en juin 2016, intitulée Leila Alaoui ou l'ombre de l'absente. Dans l'édifice prestigieux de la Maison Européenne de la photographie de Paris, une photographie en noir et blanc de Leila Alaoui en guise d'hommage. Terrible contraste avec le rayonnement de son sourire. Remonte des tréfonds de l'être l'insurmontable sentiment d'impuissance. Que dire face à la perte irremplaçable d'un joyau de la terre ?
Mustapha Saha
Sociologue, artiste peintre.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
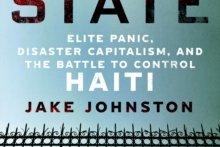
« Aid state : elite panic, disaster capitalism, and the battle to control Haiti »

L'État d'Haïti est au bord de l'effondrement : des groupes armés ont envahi le pays, de nombreux responsables gouvernementaux ont fui après l'assassinat du président Moïse en 2021, des réfugiés ont désespérément embarqué sur des bateaux pour rejoindre les États-Unis et l'Amérique latine, et l'économie est sous le choc des séquelles, de catastrophes, tant d'origine humaine que naturelle, qui ont détruit une grande partie des infrastructures d'Haïti.
« Aid state : elite panic, disaster capitalism, and the battle to control Haiti » by Jake Johnston, St Martin's Press. Published 18/03/2024. 384 pages. ISBN/Ean 1250284678 / 9781250284679. £18.74 £24.99
Tiré de Browns Books.
Traduction Google+a.c.
Comment une nation fondée sur la libération - un peuple qui s'est révolté avec succès contre ses colonisateurs et ses esclavagistes - est-elle arrivée à un tel précipice ? Dans « Aid State », Jake Johnston, chercheur et écrivain au Center for Economic and Policy Research, révèle comment les objectifs des capitalistes américains et européens ont réasservi Haïti sous prétexte de l'aider.
Pour l'Occident, Haïti a toujours été un endroit où la main d'œuvre est bon marché, où les politiciens sont dociles et où les profits peuvent être réalisés.
Au cours de près de 100 ans, les États-Unis ont cherché à contrôler Haïti avec une police d'occupation, des militaires et des forces de maintien de la paix, ainsi qu'avec des dirigeants triés sur le volet, censés réprimer les soulèvements et protéger les intérêts des entreprises.
Les tremblements de terre et les ouragans n'ont fait que nuire davantage à un État déjà décimé par le complexe industriel "humanitaire". Basé sur des années de reportages sur le terrain en Haïti et d'entretiens avec des hommes politiques aux États-Unis et en Haïti, des responsables de l'ONU et des Haïtiens qui luttent pour leur vie, leur foyer et leur famille, « Aid State » est un livre de témoignage qui bouleverse les consciences.
Image for Aid state : elite panic, disaster capitalism, and the battle to control Haiti
Une suggestion de lecture de : André Cloutier, Montréal, Québec, 17 mars 2024*
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
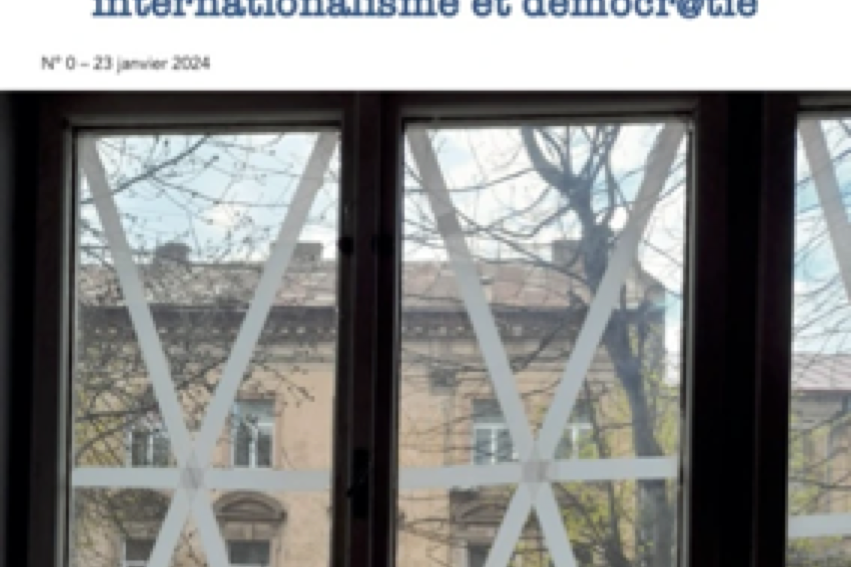
Adresse inaugur@le pour une revue
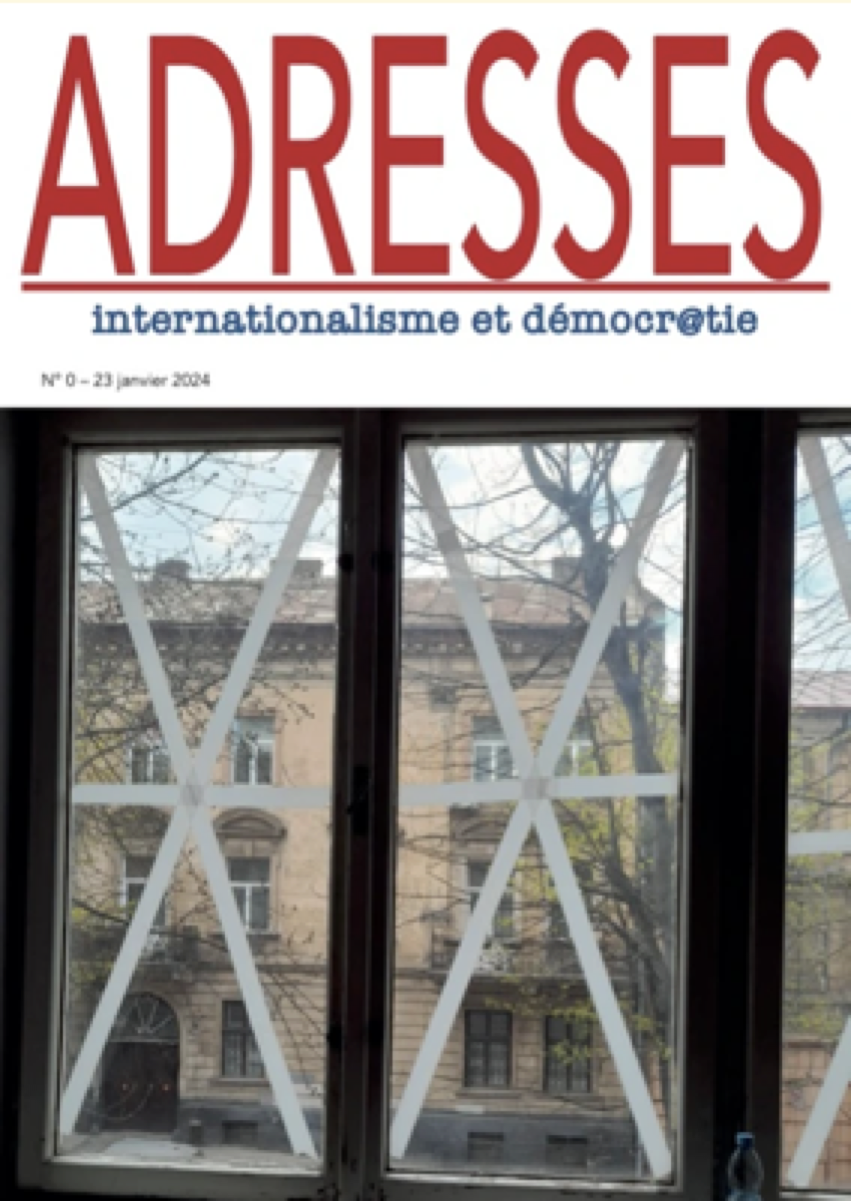
Les tambours de guerre du FNL vietnamien annonçaient une incroyable nouvelle : les envahisseurs n'étaient pas invincibles. Partout, ou presque, les campus s'enflammaient, l'insubordination ouvrière se répandait comme une traînée de poudre, le vieux monde était bousculé, Paris, Mexico, Berlin, Berkeley, Turin et Prague ne faisaient plus qu'un.
Tiré d'Entre les lignes entre les mots.
C'était il y a longtemps
La jeunesse, celle des facs et celle des usines, secouait la vieille société, les hiérarchies, les pouvoirs de droit divin, la propriété inaliénable, le patriarcat, les bureaucraties prédatrices et liberticides. Les murs prenaient la parole et les barricades ouvraient des voies insoupçonnées.
Désordre climatique dans le monde de Yalta, le cycle des saisons en fut perturbé. Le printemps fut tchécoslovaque et, en France, Mai dura jusqu'en juin. En Italie, Mai fut rampant et l'automne chaud. Dans les années qui suivirent, tout avait semblé possible à Santiago et à Lisbonne qui s'était couvert d'œillets.
Le fond de l'air était rouge et le souffle long de la révolution mit à mal la propriété privée des moyens de production, la morale établie, les rapports sociaux sexués, les divisions ethniques et les partis uniques. Il y eut de la contestation et de la subversion, des grèves et des conseils ouvriers, des expropriations et de l'autogestion, des livrets militaires brûlés, des batailles pour les droits civiques, des combats pour l'égalité et la libération des femmes, l'émergence nouvelle de l'écologie et, à une échelle inconnue jusque-là, d'un raz-de-marée féministe. Les libertés inabouties ou trahies étaient à portée de main et la chienlit éclaboussait les pères fouettards et les gardes-chiourmes.
Le monde pouvait changer de base : il apparaissait désormais possible de se réapproprier le contrôle des mécanismes de la vie en société. La démocratie pouvait être sans bornes et ne plus s'arrêter ni à la porte des entreprises ni aux frontières pas plus que dans les quartiers et les relations entre les peuples.
C'est aujourd'hui
Le monde a changé. Le printemps fut brisé à Prague et à Santiago, étouffé à Lisbonne. Un silence de mort est retombé sur la place Tienanmen. Mais le Mur de la prison « soviétique » s'est effondré libérant à la fois un espace pour la liberté et un continent entier aux prédateurs. L'emprise des multinationales sur le monde ne connaît plus guère de limites. Les impérialismes ont désormais de nombreux visages. De même que la barbarie. La planète brûle des prédations que la civilisation capitaliste lui inflige. Le monde est lourd du péril de la guerre de tous contre tous. Le fond de l'air est sombre, parfois même brun. Les fascismes du 21e siècle ne portent pas que des chemises noires.
Demain est pourtant déjà commencé
Cela fait plus d'un demi-siècle que d'aucuns avaient annoncé que la « civilisation était à un carrefour ». Il fallait choisir un itinéraire qui passait par des politiques démocratiques qui mettent au service du plus grand nombre ce que permettaient les progrès sociaux, culturels, scientifiques, technologiques et humains. Les chars russes, ceux qui pensaient que le bilan était « globalement positif », ceux qui se sont adaptés et accommodés et bien sûr ceux qui étaient partisans de la liberté du renard dans le poulailler en ont décidé autrement.
La civilisation est désormais au bord du gouffre : les forces du capital, celles des impérialismes et des sous-impérialismes, celles des barbaries et celles des fascismes sont à l'offensive sur la planète. Une planète qui brûle.
Quant aux forces émancipatrices, elles ont souvent fait, en partie, ce qu'elles ont pu mais elles se sont également souvent égarées dans diverses impasses dont les noms figurent sur les cartes comme autant d'obstacles à éviter : « campisme », « avant-gardisme », « substitutisme », « étatisme », « sectarisme » , « autoritarisme », « relativisme » et bien d'autres encore.
Alors oui, il faut en sortir. D'où l'idée d'une revue
Une de plus, direz-vous. C'est vrai. Cependant son titre se veut un clin d'œil à l'Association internationale des travailleurs de Marx et Bakounine et un appel à la mise en place d'un outil international et internationaliste de réflexion, de partage et d'échanges.
Le projet que vous avez sous les yeux paressait dans divers tiroirs. Il attendait un déclic. Celui-ci est venu d'outre-Atlantique avec le texte « Pour une gauche démocratique et internationaliste » rédigé par Ben Gidley, Daniel Mang et Daniel Randall, que nous avons été plusieurs à signer en répondant ainsi à leur appel et que nous publions en page 5 de ce numéro 00. C'est un texte qui met les pieds dans le plat et qui appelle au renouvellement des pratiques et des idées afin de rester fidèles à ce pour quoi nous combattons depuis des décennies : nous sommes attaché·es à une vision et à une pratique révolutionnaire où la démocratie, l'auto-organisation, l'autogouvernement – sous toutes leurs formes – sont au cœur du projet. Non la démocratie comme abstraction mais la démocratie comme objectif. Non l'internationalisme comme abstraction mais l'internationalisme comme pratique.
L'ambition est claire : faire renaître la capacité à discuter et à élaborer ensemble pour que s'ouvre – à la lumière de nos expériences multiples qui se sont souvent frottées les unes aux autres – une large discussion pour faire de la révolution une utopie concrète, pour permettre des synthèses, pour conserver et transmettre la mémoire des luttes, des expériences, des révolutions, pour contribuer à la socialisation des opprimé·es et des exploité·es.
Alors oui, une revue mondiale qui mette en place les conditions d'un échange mondial et qui donne accès « au plus grand nombre » à l'archipel des articles et des textes participant de cette recherche d'une issue à la crise du projet émancipateur.
Une revue pour explorer l'internationalisme et la démocratie
Sa « base politique » sera articulée autour des thématiques suivantes : émancipation du travail, autogouvernement, autodétermination, autogestion, auto-organisation, féminisme et genre, révolution, renversement/dépassement du capitalisme, alternatives, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, démocratie socialiste, reconversion industrielle pour une production socialement utile et écologiquement soutenable, refus du campisme et lutte contre tous les impérialismes et sous-impérialismes…
Une revue singulière composée de « cahiers » comportant des textes et articles piochés sur les sites et revues du monde, une sorte de plateforme, de hub où se croiseront les réflexions, selon un dispositif à construire et sans autres lignes directrices que de permettre l'échange et la lecture.
Une revue qui ne fera volontairement aucune concurrence aux publications papier ou internet existantes, bien au contraire, qui agira pour les mettre en synergie.
Une revue qui évitera les polémiques de seconde zone ou les textes étroitement politiciens.
Un projet ouvert en construction permanente.
Télécharger le n°0 au format PdF : Adresses inaugurales n°0
***
Vous trouverez ci-joint le numéro 00 de notre revue.
Nous écrivons dans l'éditorial : « L'ambition est claire, faire renaître la capacité à discuter et à élaborer ensemble pour que s'ouvre, à la lumière de nos expériences multiples qui se sont souvent frottées les unes aux autres, une large discussion pour faire de la révolution une utopie concrète, pour permettre des synthèses, pour conserver et transmettre la mémoire des luttes, des expériences, des révolutions, pour contribuer à̀ la socialisation des opprimé·es et des exploité·es. »
Certes, le projet formulé est ambitieux, mais il nous oblige. Nous pensons qu'il faut prendre des initiatives simples et rapides si nous ne voulons pas que l'« Appel pour une gauche démocratique et internationaliste » ne se transforme en une simple pétition.
Nous pourrions nous rencontrer pour faire connaissance, échanger sur les conditions d'un possible débat et jeter les bases d'une discussion organisée autour de nos objectifs communs.
Aussi, nous prenons l'initiative d'inviter les signataires qui le peuvent à se réunir à Paris courant mai. Un prochain courrier précisera le rendez-vous.
Bien sûr, cette réunion ne s'oppose pas aux réunions mondiales zoom envisagées autour de thèmes définis. Au contraire. Elle s'inscrit dans la perspective de faciliter les échanges entre nous.
Merci de faire parvenir à l'adresse de la revue vous remarques et votre avis concernant cette rencontre en mai à Paris.
Pour nous écrire : Adresses.la.revue@gmail.com
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
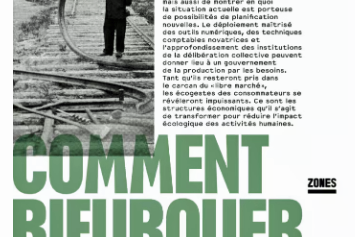
Pourquoi la bifurcation écologique est incontournable

L'économiste Cédric Durand et le sociologue Razmig Keucheyan ont joint leurs réflexions pour imaginer les voies possibles vers une planification écologique afin d'arrêter la destruction des écosystèmes.
13 mars 2024 | tiré de politis.fr | Illustration : Comment bifurquer. Les principes de la planification écologique, Cédric Durand et Razmig Keucheyan, La Découverte/Zones, 256 pages, 20,50 euros.
https://www.politis.fr/articles/2024/03/cedric-durand-ramzig-keuchian-comment-bifurquer-pourquoi-la-bifurcation-ecologique-est-incontournable/
Bien que toutes les personnes raisonnables sachent parfaitement que la crise environnementale menace et mène à la possible destruction de tous les êtres vivants, humains compris, les décisions prises par nos dirigeants politiques, industriels ou technocrates supposés travailler sur le sujet ne sont toujours pas à la hauteur de « l'impasse dans laquelle nous nous trouvons ». Et si la question environnementale est paradoxalement omniprésente dans le débat public, les indicateurs écologiques sont aujourd'hui tous au rouge.
Devant cette impuissance, ou plutôt cette non-volonté de changer de voie pour sauvegarder notre environnement, les deux auteurs de cet essai novateur, l'économiste Cédric Durand (université de Genève) et le sociologue Razmig Keucheyan (université Paris-Cité), se sont d'abord penchés sur les raisons de cette absence de réactions et de modifications du développement économique planétaire, en dépit de l'évidence des destructions en cours. Mais leur livre est surtout une analyse du chemin qu'il est impératif de suivre pour « bifurquer ».
« Limite fondamentale »
Bifurquer vers un autre monde s'impose en effet sans traîner, soulignent les deux chercheurs, puisqu'il est certain que « le monde du capitalisme industriel, productiviste et consumériste n'est pas compatible avec la préservation des écosystèmes vivables pour les humains ». Depuis 2008 et la dernière grande crise du système capitaliste, les États ont dû « dissiper cette illusion – pour ceux qui étaient encore sous son emprise – de la vertu régulatrice des marchés ». Et donc intervenir, les économies étant depuis largement sous perfusion publique.
La crise du covid-19 n'a fait que confirmer ce processus, celui d'une « 'étatisation' des mécanismes de marché », en phase avec un projet néolibéral qui, loin de réduire le pouvoir des États, s'emploie à s'en servir pour mieux protéger et développer les intérêts des marchés et des grandes entreprises productivistes, extractivistes, consuméristes, voire spéculatrices. Pourtant, « le cœur du problème actuel réside dans la crise environnementale » et « les solutions de marché à cette crise ne fonctionnent pas ».
Le capitalisme n'a d'autre boussole que le profit, et il n'investira que s'il en escompte un.
Cette crise, insiste les auteurs, se heurte à une « limite fondamentale », quand bien même le marché s'emploierait à « limiter » les destructions de l'écosystème : « Le capitalisme n'a d'autre boussole que le profit, et il n'investira que s'il en escompte un. » Et de souligner que « 'l'anarchie de la production' – la concurrence entre capitaux privés – empêche que les investissements nécessaires à la bifurcation écologique soient collectivement hiérarchisés et réalisés ».
Ce système, datant de plus de deux siècles, voire trois, n'a que trop duré, car on sait désormais qu'il nous mène à une impasse, empêchant la perpétuation même de nos existences. [1] « Nous n'avons pas le temps d'attendre. » Il y a urgence et « il nous faut un plan », s'exclament les auteurs. Leur livre se veut donc « une enquête sur les mondes possibles : ceux que l'on pourra conserver et ceux auxquels il faudra renoncer ».
Puisque le modèle de la croissance illimitée et de la centralité du PIB est clairement celui qui nous conduit à l'extinction prochaine de notre planète. Cette planification à laquelle appellent les auteurs est double : d'un côté, un « calcul écologique » inéluctable pour stopper les destructions des écosystèmes et assurer notre survie ; de l'autre, l'organisation d'un « espace démocratique » ou « processus de discussion » sur le devenir économique de nos sociétés, l'un et l'autre irrémédiablement liés.
L'importance de gagner le soutien des classes populaires.
Les difficultés politiques seront immenses, ne serait-ce qu'entre centralisation des impératifs écologiques et économiques et décentralisation politique capable de promouvoir une expérimentation institutionnelle de prise de décision au plus près des besoins humains et de la nature. Car « la planification écologique joue sur deux tableaux : côté pile, le calcul écologique ; côté face, la politique des besoins ».
Une planification indissociable de l'exigence d'un renouveau démocratique et donc de la constitution politique d'un « bloc social-écologique » soutenant un tel changement institutionnel et programmatique. Cela ne se fera pas sans mal puisque « travail et capital sont fracturés selon des lignes transclasses en fonction de l'intensité carbone des secteurs dans lesquels ils s'inscrivent ». Et de souligner l'importance de gagner le soutien des classes populaires à la planification écologique. Qui « sera sociale ou ne sera pas ».
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
[1] On ne saurait trop recommander, sur cette question vitale, la lecture du magistral essai écoféministe de la philosophe Émilie Hache, De la génération. Enquête sur sa disparition et son remplacement par la production, La Découverte.
Trump : La voie/voix du hors-État
Il peut s'avérer surprenant de constater à quel point la justice étasunienne semble être hypnotisée par les cas de déviance de l'ex-président, monsieur Donald Trump, qui pourtant cumule les mises en accusation pour des méfaits dont la culpabilité entraînerait normalement une sanction, en songeant surtout à l'attaque contre la démocratie et son symbole par le biais de son influence1.
Cette situation troublante mérite certes une attention et impose une réflexion qui doit aller au-delà d'une critique voulant que la justice utilise la règle du deux poids, deux mesures en fonction de la personne à l'endroit de qui des accusations pèsent. Car, il faut l'avouer, la logique veut qu'une personne qui a commis une faute reçoive une punition conséquente, bien sûr à condition d'avoir démontré hors de tout doute la faute en cause, ce qui engage forcément plusieurs nuances. Attardons-nous alors à l'une d'entre elles.
La loi du plus fort
À un certain moment de l'humanité, la hiérarchie humaine au sein d'un groupe ignorait les préceptes de la morale afin de suivre une loi fort simple : celle du plus fort. Nous pouvons présumer que la force physique et la ruse (ou force de l'esprit) régnaient donc en roi et maître. Or, la conscience et divers désirs contribuèrent à des modifications, voire à moderniser cette loi originelle de façon à garantir une meilleure cohésion de groupe. En instaurant une morale, il est alors devenu possible d'établir des règles ou des lois du vivre ensemble, supposant à la rigueur des obligations et des interdits à respecter, mais aussi des privilèges en tant que droits et libertés en vue d'un certain équilibre.
Cependant, à ces règles – subalternes – s'impose toujours la loi du plus fort qui échappe à ce registre ou plutôt réaffirme son hégémonie dans la mesure où elle ne fait pas la distinction entre un défenseur des lois et un hors-la-loi. Lorsque deux groupes se rencontrent, les plus forts d'entre eux – en puissance, en richesse ou en capital social et symbolique, non plus obligatoirement en termes de force physique – s'offrent un respect mutuel avant de s'affronter, s'il y a lieu. Plus souvent qu'autrement, des ententes tacites ou formelles assurent la coexistence des groupes sur des terrains spécifiques, voire même communs, jusqu'au moment où un déséquilibre survient et exige à l'un des plus forts de s'imposer.
Dans un contexte de loi, tout en sachant que la loi du plus fort a préséance, la coexistence d'hommes et de femmes qui respectent les lois et d'autres dits et dites hors-la-loi est assurée dans une forme de conclusion binaire dépassant la seule idée de la dichotomie du fort et du faible, puisque, tout compte fait, la vraie moralité qui découle de la loi du plus fort provient du besoin de trêve ou de compromis entre les plus forts eux-mêmes dans le but d'éviter leur anéantissement.
Des hors-États
En songeant au monde dans lequel nous évoluons, la notion d'État apparaît dans une connotation politique, juridique, géographique/territoriale, économique et sociale (incluant les communautés, les cultures et les religions) à travers laquelle les lois participent au maintien de son équilibre et mode de fonctionnement ; autrement dit, à l'ordre aspiré. Si à l'intérieur de ses frontières cette dynamique s'exerce, force est de considérer également quelques règles venant régir les relations avec d'autres États. Ces lois internationales lorsque brisées entraînent des sanctions contre le ou les États fautifs, mais le tout peut dégénérer en guerre dans un retour inéluctable à la loi du plus fort avec toute la splendeur de la barbarie qu'elle peut occasionner.
En revanche, il existe un pendant, voire l'envers de la médaille, qui suggère la présence d'un hors-État, toujours actif avec ses adeptes, à savoir une sorte de monde à la fois parallèle et interdépendant à celui de l'État, et ce, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières nationales. Or, cette réalité binaire s'exprime dans des extrêmes dont la zone médiane s'élargit en de multiples nuances, dans la mesure où le citoyen ou la citoyenne ordinaire peut aussi bien fréquenter l'un que l'autre, consommant les produits des deux mondes qui n'en forment qu'un seul. Néanmoins, la personne qui respecte les lois et celle qui se veut hors-la-loi connaissent la ligne ou cette frontière à franchir pour passer d'un côté à l'autre, à savoir cette zone intermédiaire remplie de permissions sous-entendues. Cette forme de limite assure un équilibre des instances (ou un ordre pour éviter trop de désordre), toujours dans une certaine mesure. Imaginons un instant la possibilité d'une équivoque par laquelle une limite ou frontière différente serait établie avec des vérités alternatives davantage appréciées par la population d'ensemble, forçant ainsi la main des plus forts à redéfinir leur entente.
Pour un autre registre
Ces précédentes réflexions nous amènent vers le registre employé par l'ex-président étasunien, monsieur Donald Trump, qui a compris le pouvoir d'une idée capable de se transformer en une idéologie grâce à laquelle une vision inédite du sens de l'existence devient réalisable, ce qui signifie également une autre façon de désigner la vérité. Chose certaine, les insatisfactions de la population étasunienne, voire plutôt d'une frange visiblement réfractaire au respect des lois, servent de mobile à l'apparition d'une voie de sortie vers le hors-État qui stimule d'ailleurs l'imaginaire dans une recherche de la liberté maximale, une valeur étasunienne fondamentale. Par conséquent, les attaques contre monsieur Donald Trump par les lois accentuent automatiquement un plus grand appui envers lui par ce mouvement qui le supporte, alors que ce dernier incarne le nouvel État espéré : le hors-État.
Par un étrange paradoxe, les États-Unis, fiers de leur État, ont engendré des êtres profitant de leurs valeurs et de leurs richesses, mais provoquant en même temps leur déséquilibre graduel vers le hors-État, dont un représentant continue d'animer une volonté dont plusieurs personnes et groupes se sentent interpellés. Pour rétablir l'ordre dans le désordre, alors que les lois ne suffisent plus, la solution consiste à un éventuel combat entre les plus forts de la nation.
Conclusion
Même au sein de notre civilisation, la loi ancestrale du plus fort continue de dominer et aide à comprendre plusieurs incohérences à nos systèmes jugés moralement bons. La justice étasunienne tergiverse sur le cas de monsieur Donald Trump, parce qu'elle le reconnaît comme un fort et qu'il incarne une voie comptant de nombreux et nombreuses adeptes. Par contre, le hors-État ne signifie pas l'absence de lois, mais plutôt une façon différente de les considérer, sinon de nouvelles ou semblables avec d'autres nuances. N'oublions toutefois pas que pour résoudre un problème, comme le dirait monsieur Albert Einstein, il importe d'utiliser des idées différentes de celles qui l'ont créé.
Guylain Bernier
Note 1 : Par définition, l'influence équivaut à dire « A – intentionnellement ou non – “fait voir” à B son intérêt là où il ne l'aurait pas placé dans cette relation. De sorte que B va, de lui-même, adopter une attitude ou un comportement appropriés (sic), c'est-à-dire, négativement, sans obligation […] » (Braud, 1985, p. 352). Ainsi, l'influence aurait un pouvoir de séduction, de manière à ce que l'individu influencé perçoive un avantage à la subir. Dans le coffre à outils de l'influence se trouvent donc la persuasion, la manipulation et l'autorité.
Référence
Braud, P. (1985). Du pouvoir général au pouvoir politique. Dans M. Grawitz & J. Leca (Dir.), Traité de sciences politique. La science politique, science sociale. L'ordre politique (Tome I) (pp. 335-394). Paris, France : Presses Universitaires de France.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
Le Nouveau Parti Démocratique du Québec : l’inconnu dans la maison
Dans le précédent numéro de Presse toi à gauche (édition du 12 au 18 mars), j'abordais sommairement et trop partiellement les raisons de l'insuccès persistant du parti au Québec. J'y confondais plus ou moins le NPD fédéral et son "petit frère" provincial. Il importe de bien les distinguer l'un de l'autre et de relater plus précisément l'évolution du parti au Québec.
Le Nouveau Parti démocratique du Québec a été fondé en 1963 par des syndicalistes, ceux de la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) et par des militants francophones du Parti social démocratique du Québec, une petite formation de gauche. Il formait donc à ses débuts la section québécoise du NPD fédéral et le demeurera jusqu'en 1988. À ce titre, il a participé aux scrutins fédéraux et provinciaux. À celui, fédéral de 1965 par exemple, il est allé chercher 12% des voix au Québec ; en 1968, 7%. Il exerçait ses activité exclusivement comme antenne du parti frère fédéral dans la "Belle province". Le Parti socialiste du Québec (PSQ) lui, proche du NPD, se chargeait de défendre la social-démocratie dans le cadre provincial, conformément à l'entente conclue avec le NPD d'Ottawa en 1963. Mais le PSQ "s'évapora" vers 1968.
Il faut dire qu'en cette époque farouchement nationaliste qui voyait la montée en puissance du mouvement souverainiste (fondation du Rassemblement pour l'indépendance nationale en 1960 et surtout celle du Parti québécois en 1968), la conjoncture n'était guère favorable pour un parti de centre-gauche fédéraliste.
Le Nouveau Parti démocratique du Québec consacra donc l'essentiel de ses énergies à la politique fédérale au cours des années 1970 et au début de la suivante. Il négligea la question nationale québécoise et insista plutôt sur une meilleure répartition de la richesse produite. Mais une bonne partie de la gauche se rallia au Parti québécois qui offrait le double avantage de promouvoir l'émancipation nationale du Québec et une forme de social-démocratie, du moins en théorie. La personnalité charismatique de René Lévesque y était pour quelque chose.
S'en rendant compte et pour ne pas abandonner tout le terrain de la politique provinciale "de gauche" au Parti québécois, le NPDQ y a fit quelques timides incursions, par exemple un petit nombre de candidats aux élections de 1970. Par la suite, il ne présenta plus de candidats aux scrutins provinciaux.
Les néodémocrates n'avaient rien d'inspirant pour l'électorat, en particulier les jeunes. Quelques chefs furent élus (comme Raymond Laliberté, ancien syndicaliste et président de la Corporation des enseignants du Québec de 1971 à 1973, Henri-François Gautrin de 1973 à 1979) mais non seulement leur personnalité était plutôt terne, mais ils ne comprenaient pas l'attrait de l'idéal souverainiste auprès d'une importante fraction de la jeunesse. Le parti tenta une nouvelle expérience électorale en 1976 mais subit un nouvel échec.
Toutefois, malgré tout influencée par l'ambiance très nationaliste de cette époque, le parti milita pour la reconnaissance du droit à l'autodétermination du Québec, ce qui influença à son tour une partie des membres du grand frère fédéral, mais que le congrès fédéral rejeta en 1977. Cependant. le congrès revint sur sa décision en 1983 et affirma le droit du Québec à l'autodétermination. Il devint ainsi le premier parti fédéral à affirmer cette reconnaissance.
Au milieu des années 1980, la direction du parti provincial jugea qu'il existait un vide au Québec. À l'époque, le gouvernement péquiste de René Lévesque se trouvait discrédité par l'échec du référendum de mai 1980 et surtout par les politiques budgétaires très restrictives imposées sans préavis par le cabinet Lévesque de 1981 à 1985. On estima donc au sein des cercles néodémocrates que le temps était peut-être propice pour détrôner le Parti québécois. Le NPDQ résolut donc de dédoubler sa mission : tout en demeurant une section provinciale du NPD fédéral, il s'investit sur la scène politique provinciale.
À partir de 1984, on procéda donc à une tentative de relance, non sans un certain succès : un nouveau chef, Jean-Paul Harney, ex député du NPD à la Chambre des Communes de 1972 à 1974 et surtout en 1985, la mise sur pied officielle de la nouvelle version du NPDQ qui occupa dès lors tout le champ politique, tant provincial que fédéral. Ce parti "relooké" présenta des candidats aux scrutins provinciaux de 1985, 1989, 1994 et 1998 avec divers succès mais dans tous les cas très modestes.
Au plan constitutionnel, pour se mettre en phase avec l'importante frange nationaliste et profiter de la mise en veilleuse de l'option souverainiste par le successeur de René Lévesque, Pierre-Marc Johnson, il affirma aussi son rejet de la Loi constitutionnelle de 1982. Il défendit cette position lors du scrutin de 1985. Il bénéficia aussi de la croissance du nombre de ses membres, ce qui n'en n'a pas fait pour autant un parti de masse comme l'avait déjà été le Parti québécois dans les années 1970.
Lors des élections fédérales de 1988, il recueillit 14% des votes au Québec. Dans les sondages, il grapillait de 10% à 17% des intentions de vote en 1987-1988. Il connut même une pointe de 22% en octobre 1987 à égalité avec le Parti québécois, quelques semaines avant le décès de René Lévesque.
En avril 1989, lors d'un congrès d'orientation, il adopta le principe d'une rupture des liens structurels avec les NPD fédéral. Par la même occasion, le parti y réaffirma sa position de 1985 sur le droit à l'autodétermination du peuple québécois Assortie d'une nouvelle association politique avec le Canada. Il concentra donc désormais tous ses efforts sur la scène politique provinciale. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette rupture ne scandalisa pas la direction du parti à Ottawa, vu que les divergences de vues entre les deux ailes créaient souvent des frictions entre elles. L'année suivante, le retour au pouvoir de péquistes sous Jacques Parizeau diminua encore sa marge de manoeuvre.
"À quoi bon appuyer un petit parti indépendantiste alors qu'un grand parti souverainiste vient de conquérir une majorité parlementaire ?" durent se dire bon nombre d'électeurs et d'électrices péquistes. En tout cas, le NPDQ ne recueillit à cette occasion que 1% des votes.
En 1995, le NPDQ devint (ou redevint) le Parti de la démocratie socialiste ; retour en un sens à la période 1963-1968. Il appuya bien sûr le OUI à la souveraineté en octobre 1995, mais on peut douter de son influence sur le résultat de ce nouveau référendum.
Le 7 septembre 2002, il intégra la coalition de l'Union des forces progressistes (UFP) pour se fondre ensuite dans Option citoyenne en 2006. (Précisons qu'il ne se fonde pas dans Option citoyenne mais fusionne avec pour devenir QUébec Solidaire : Presse toi à gauche) Il n'exista plus de 2006 à 2014.
À la suite du succès inattendu du NPD en 2011, des militants et militantes envisagèrent de relancer de relancer le parti sur la scène politique provinciale, mais sans la souveraineté.
Il fut donc "refondé" le 30 janvier 2014 et son chef intérimaire était Pierre Ducasse, ancien bras droit de Jack Layton au Québec. À l'élection partielle de Louis-Hébert du 2 octobre 2017, il n'alla chercher que 1.3% des voix. Le 21 janvier 2018, Raphaël Fortin fut élu chef de la formation, poste qu'il conserve encore. Au scrutin de 2018, le parti présenta 59 candidats sur 125 comtés mais il ne recueillit que 0.5% des suffrages. En 2022, il n'aligna aucun candidat. Il est totalement absent de la scène publique.
Voilà dans les grandes lignes l'histoire du NPD au Québec. S'il a fait acte de présence depuis 1963, celle-ci ne se révéla guère significative. Il n'a jamais réussi à s'imposer. La conjoncture a souvent joué contre lui, mais même cet élément défavorable ne peut tout expliquer. Il n'a même pas su profiter des rares périodes positives qui se sont présentées à lui, comme ce fut le cas durant la décennie 1980. Au plan fédéral, il a du affronter la concurrence des libéraux fédéraux, et au provincial, celle du Parti québécois. Le retour au pouvoir du parti souverainiste en 1994 lui a porté un coup fatal. Même la tentative de relance de 2014 ne lui a pas permis de se relever.
L'explication fondamentale à tous ces échecs ne réside-t-elle pas en définitive dans l'incapacité persistante de ce parti à se brancher sur une idéologie nationale franchement québécoise ?
Jean-François Delisle
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :












