Presse-toi à gauche !
Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Lancement du no. 31 des Nouveaux Cahiers du Socialisme sur l’intelligence artificielle (IA)

Librairie Zone Libre
mercredi 3 avril à 18 h
à la librairie Zone libre, près de l'UQAM.
Les NCS vous invitent au lancement de leur dernier numéro (dossier principal sur l'intelligence artificielle)
Quatre personnes prendront la parole pour discuter des différentes mythes et dangers de l'intelligence artificielle : Jonathan Martineau (« Le capital algorithmique »), Eric Martin (« Bienvenue dans la machine »), Dominique Perschard (de la Ligue des droits et libertés) et Pierre Mouterde (du comité du dossier des NCS).
L'IA est dotée d'une aura si séduisante qu'on fait l'impasse sur les dangers qu'elle véhicule.
Aux mains des tout puissants monopoles que sont les GAFAM, au sein d'un marché capitaliste néolibéralisé, elle est en train de faire son chemin dans nos vies au travers d'une surveillance généralisée et d'une utilisation dérégulée de nos données numériques. Elle risque de parachever le mouvement de « désappropriation » que le mode de production capitaliste faisait déjà peser sur la vie des travailleurs et des travailleuses.
L'IA constitue l'expression d'un saut qualitatif effectué dans le nouvel ordonnancement d'un monde globalisé. Avec une nuance de taille cependant : cet ordonnancement tend, par la course aux profits et aux logiques concurrentielles qui l'animent, par l'opacité et le peu de régulation dont il est l'objet, à court-circuiter les démarches démocratiques et citoyennes pensées par le bas et toute perspective émancipatrice.
Événement Facebook : https://www.facebook.com/events/438367492082430?ref=newsfeed

La Conférence syndicale internationale de solidarité avec l’Ukraine et ses syndicats du 22 février 2024 : un bilan

Bilan et conclusions politiques de la Conférence syndicale internationale de solidarité avec l'Ukraine et ses syndicats qui s'est tenue le 22 février à Kiev (online). Par Alfons Bech, membre du Réseau Européen de Solidarité avec l'Ukraine (ENSU/RESU)
1- La conférence syndicale internationale a été un succès. Organisée par la Fédération des syndicats d'Ukraine (FPU), la Confédération des syndicats libres d'Ukraine (KVPU) et avec le soutien de la Confédération syndicale internationale (CSI), de la Confédération européenne des syndicats (CES), d'ACTRAV et de la Fondation Friedrich Ebert, la conférence internationale de solidarité "Syndicats ukrainiens : Deux ans de guerre totale : défis, priorités et soutien supplémentaire", avec la participation de 191 personnes.
2- Comme publié sur leurs sites web, les syndicats ukrainiens présents à la conférence sont intervenus : "Luc Triangle, secrétaire général de la CSI ; Esther Lynch, secrétaire générale de la CES ; Ludovic Voet, secrétaire confédéral de la CES ; Maria Helena Andre, directrice du Bureau des activités pour les travailleurs de l'OIT (ACTRAV) ; Cathy Feingold, vice-présidente de la CSI, directrice du département international de l'AFL-CIO ; Kemal Özkan, secrétaire général adjoint de GU IndustriAll ; Britta Lejon, présidente de l'Union suédoise des fonctionnaires (ST) ; Jan Willem Goudriaan, président de l'Internationale des services publics ; Bea Bruske, secrétaire générale de la FSESP, présidente du Congrès du travail du Canada ; Lone Ilum Christiansen, directrice du syndicat danois ; Hélène Debore, secrétaire internationale de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ; Pierre Coutaz, du comité international de la CGT, qui a conclu son discours en ukrainien, promettant, comme tous les orateurs précédents, une aide et un soutien complets pour remporter la victoire sur l'ennemi, a été particulièrement bien accueilli par les syndicalistes ukrainiens. Les Ukrainiens ont également accueilli avec gratitude l'intervention de la coordinatrice internationale de l'UGT Catalunya, Catalina Llibre".
3- Le moment choisi pour la conférence était particulièrement difficile pour l'Ukraine sur le plan militaire. Avec beaucoup moins d'armes et de munitions que ne l'avaient promis les gouvernements qui la soutenaient, l'armée a dû se retirer des grandes villes. Les interventions de syndicalistes, hommes et femmes, devenus soldats, ont souligné l'émotion et le drame du moment, tout comme les interventions des dirigeants de la FPU et de la KVPU. Le message véhiculé est que la défense des droits du travail, des droits démocratiques et des droits humains est indissociable de la victoire dans la guerre contre la Russie. Honnêtement, nous ne pouvons pas isoler l'amélioration des conditions de vie et de travail de la classe ouvrière ukrainienne de l'aspect militaire. Nous devons "gagner la guerre et la révolution" en même temps.
4- C'est précisément parce que le moment est clé pour l'existence souveraine de l'Ukraine que cette conférence a été obligée de se confronter à cette question, l'une des plus difficiles dont l'ensemble du syndicalisme international a débattu depuis le début de la guerre à grande échelle. Le temps du changement est venu de passer à une position de soutien plus actif à l'Ukraine et donc plus exigeante vis-à-vis des gouvernements respectifs afin qu'elle puisse gagner la guerre et pas seulement "se défendre". Ce débat n'a pas encore été abordé, mais il a été soulevé lorsque la FPU et la KVPU ont adopté une déclaration commune disant : "À ce stade critique de la guerre, nous appelons nos amis internationaux à intensifier leur soutien global et indispensable à l'Ukraine afin d'accélérer la paix après la défaite de l'agresseur. Ce n'est qu'en vainquant l'agresseur russe que nous pourrons garantir une paix juste et durable en Ukraine et en Europe, et empêcher une telle agression à l'avenir. L'Ukraine continuera à progresser vers la victoire sur l'agression russe, ainsi que sur la voie de sa pleine intégration dans l'UE et l'OTAN".
5- L'intervention du représentant de l'UGT de Catalogne a commencé à entrer dans ce débat nécessaire, en déclarant : "Nous sommes convaincus que le droit des peuples à se défendre contre les agressions extérieures est un droit naturel inaliénable et que nous tous ici présents devons travailler pour aider nos camarades syndicalistes qui souffrent. Nous devons discuter de la manière dont nous pouvons les aider et travailler ensemble pour lever les barrières qui limitent cette aide et nous lient les mains. Même s'il faut pour cela revoir des positions des syndicats internationaux qui ont pu sembler valables en temps de paix, mais que les événements de ces dernières années ont obligé à revoir. Si les agresseurs ne respectent pas les traités internationaux et que, dans le même temps, nous imposons des limites à l'aide que nous pouvons apporter, nous laissons le champ libre à l'impérialisme, à la barbarie et au fascisme pour se répandre dans le monde entier".
6- Le rôle de l'ENSU dans cette conférence a été limité mais essentiel. Dès le début, nous avons encouragé les syndicats ukrainiens FPU et KVPU à approcher conjointement la CES et la CEI afin que ces deux organismes internationaux appellent à la participation de tous les syndicats européens. Nous avons été en contact avec les dirigeants internationaux de la FPU et de la KVPU, écoutant et faisant des propositions qui pourraient être utiles pour une large participation internationale. Nous avons adapté notre rythme et nos propositions à ceux acceptés par les syndicats, même si nous savions que les retards dans la prise de la décision finale de tenir la conférence ne facilitaient pas la participation en personne. Nous avons toujours, et à tout moment, essayé de suivre l'idée de "tout avec les syndicats ukrainiens, rien sans eux" et de consultation transparente et permanente sur tous les problèmes et difficultés. Le résultat montre que cette méthode de travail porte ses fruits et aide réellement les syndicats ukrainiens. Elle a également contribué à l'incorporation de l'UGT, syndicat historique de l'Etat espagnol. Savoir prendre notre place d'aide, d'auxiliaire des syndicats, sans chercher à les remplacer, est donc la clé de la poursuite de notre travail. Cela a ouvert une voie de solidarité et de confiance mutuelle entre les responsables syndicaux et l'ENSU, ce qui est un grand atout pour l'avenir.
7- Sur les débats politiques de fond qui doivent être discutés dans chaque syndicat et dans l'ensemble du syndicalisme international, l'ENSU défendra sa position contre les blocs militaires et l'escalade des armes, dans le cadre d'une politique indépendante des différents impérialismes.
Mais cela implique d'exiger des gouvernements qu'ils soutiennent l'envoi gratuit d'armes et de munitions à l'Ukraine, qu'elles soient suffisantes et les plus utiles. L'ENSU doit favoriser la compréhension et l'accord entre les syndicats ukrainiens qui demandent l'adhésion à l'OTAN comme "parapluie de sécurité" et les syndicats d'Europe occidentale qui sont contre l'OTAN, dans le cadre de réalités différentes et contradictoires. En tout état de cause, l'accord commun doit être de soutenir tout ce qui est utile à la victoire de la résistance ukrainienne dans cette guerre de libération nationale et à la défaite de l'impérialisme russe.
8- Une des prochaines étapes du travail syndical international peut être de soutenir les syndicats FPU et KVPU lors de la conférence de reconstruction à Berlin en juin prochain.
A notre avis, une des clés de la victoire et du soutien international est de lutter pour que l'Ukraine devienne dans un avenir proche une république des droits sociaux et humains, loin des politiques oligarchiques et corrompues.
Cela dépend également de la cohésion sociale interne et du retour de la majorité de la population déplacée ou réfugiée dans d'autres pays.Les syndicats ont une place de choix pour faire entendre leur voix lors de cette conférence. Nous leur avons déjà parlé à Kiv après la conférence et ils ont accepté d'en discuter en interne.Comme pour la conférence internationale, tout dépend si les syndicats ukrainiens jugent utile de participer, s'ils le font d'un commun accord et s'ils formulent leurs revendications.S'ils le font, l'ENSU est prête à les aider et à collaborer sur les questions qu'ils souhaitent.En fonction de leur réponse, nous réunirons à nouveau le groupe de travail syndical.
Alfons Bech, 19 mars 2024 (version originale en anglais)
Traduction Deepl.
Illustration : Logo CSI.

Féminicides en Algérie. Rapport sur les meurtres de femmes et de filles 2019-2022
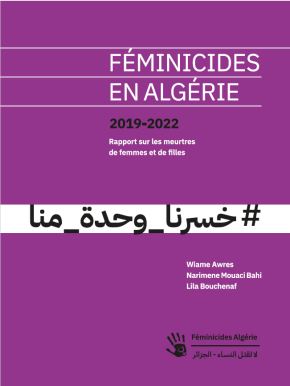
Féminicides en Algérie. Rapport sur les meurtres de femmes et de filles 2019-2022
Par Wiame Awres, Narimene Mouaci Bahi et Lila Bouchenaf
Au moins une femme est assassinée chaque semaine en Algérie.
Elles sont 228, depuis 2019, à avoir succombé à des mauvais traitements récurrents infligés, parfois depuis des décennies, par leur compagnon, ou à une agression du fait d'un inconnu. Leur point commun est d'être ciblées parce que femmes, ou filles. C'est ce mécanisme, et le contexte dans lequel il s'inscrit, que Féminicides Algérie s'est donné pour mission de comprendre, pour mieux le déconstruire. Données statistiques montées en tableaux et graphiques, analyses de cas, pour savoir et inventorier ; propositions et recommandations pour défaire les mailles de ce qui a tout l'air d'un système.
Rapport édité aux Editions Motifs
Liste des féminicides 2023
https://feminicides-dz.com/feminicides/liste-des-feminicides-2023/
Liste des féminicides 2024
https://feminicides-dz.com/feminicides/liste-des-feminicides-2024/
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

L’écoféminisme et ses rapport avec l’écosocialisme

Dans le cadre de la rencontre organisée par Révolution écosocialiste sur le thème "L'ÉCOFÉMINISME NÉCESSAIRE À L'ÉCOSOCIALISME, Élisabeth Germain et Lucie Mayer nous entretiennent de la réalité de l'écoféminisme et de ses rapports avec l'écosocialisme.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Pour l’arrêt des rejets et émissions toxiques de la Fonderie Horne à Rouyn-Noranda

Dans le cadre de la rencontre organisée par Révolution écosocialiste le 16 mars dernier sous le thème "L'ÉCOFÉMINSIME NÉCESSAIRE À L'ÉCOSOCIALISME, Nicole Desgagnés nous a exposé-e-s les luttes que des femmes mènent contre les rejets toxiques de la Fonderie Horne à Rouyn-Noranda.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Ça aurait été si simple

La fin de semaine dernière, veille de la Saint-Patrick, je me suis permis, avec la « bénédiction » de quelques amies grévistes, de franchir la porte de la nouvelle bibliothèque Gabrielle-Roy, à Québec, histoire de saisir l'ambiance, prendre quelques photos et l'occasion faisant le larron, emprunter quelques bd, pourquoi pas !
Ainsi donc, j'ai fait quelques étages et oui, c'est joli, ça sent bon, ça brille à pleins feux et l'œuvre magistrale la « Pluie d'or » de Micheline Beauchemin sur fond d'atrium en spirale géante est plus étincelante que jamais. Mais était-ce le fait de revenir après plusieurs longues années d'absence, de devoir gober et digérer un tout nouveau design architectural ou encore de croiser autant de visages inconnus sur les étages, toujours est-il que j'étais plutôt mal à l'aise dans cette atmosphère du samedi un peu surréaliste et fébrile, surtout avec la chorale des commis en grève qui chantaient et dansaient sur un tempo endiablé au dehors.
En réalité, j'étais comme dans un état second et j'errais ici et là avec l'étrange sentiment d'être un étranger dans une bâtisse que je connaissais pourtant depuis sa toute première inauguration en 1983. Et le décor avait beau s'avérer clinquant et ultra moderne, je trouvais que ça manquait de chaleur et d'humanité. Il manquait, notamment derrière les comptoirs, cet accueil si chaleureux des Cléo, Robert et Stéphanie alors que dans les autres secteurs, c'était la présence à la fois rassurante et constante des Marie-Josée, Joanne et Nathalie qui faisait défaut. Des employées celles-là, très professionnelles et toujours prêtes à se déplacer pour dépanner un itinérant à l'ordi, une immigrante perdue, un habitué en mal de jaser ou une maman dépassée.
Qui plus est, il manquait cruellement aussi de cette connexion si spéciale usagers-ères/personnel qui fait que c'est si bon, « normalement », de fréquenter Gabrielle-Roy et les autres succursales de la ville de Québec. Un aspect « grande famille élargie » d'ailleurs qui faisait dire à l'humoriste Michel Mpambara, au temps de ses premières années à Québec, que la bibliothèque Gabrielle-Roy avait été et de de loin son lieu d'apprentissage préféré comme immigrant nouvellement arrivé du Rwanda dans les années 90.
Plus tard, en regardant des gamines évoluer devant les rayonnages pour enfants avec l'aisance et la gravité qui leur est propre, je me suis dit qu'il y avait finalement quelque chose de profondément absurde dans cette situation de grève forcée. Ainsi, après avoir dépensé autant d'argent pour la réfection de l'établissement (quelque 45 M $), comment avait-on pu oublier d'offrir l'argent nécessaire pour renouveler de façon décente une convention collective échue depuis 2022 ? Ça aurait été si simple, me semble, de prévoir l'argent nécessaire pour offrir un taux horaire d'entrée plus convenable, des conditions de travail moins précaires, un rattrapage salarial décent. Si simple, oui.
Cela dit, l'argent ne pousse pas dans les arbres, on le sait, mais j'espère seulement qu'on va allumer à temps du côté de l'Institut Canadien de Québec (organisme gérant) parce que ce serait tellement dommage de perdre à jamais l'inestimable capital humain représenté par les 240 employés-es des bibliothèques en grève.
Tellement dommage … et inutile.
Gilles Simard, bédéphile et usager depuis 1983.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Libérez Boris Kagarlitsky et les autres prisonniers politiques russes opposés à la guerre

Pourquoi cette pétition est importante
Lancée par Boris Kagarlitsky International Solidarity Campaign
Nous, soussignés, avons été profondément choqués d' apprendre que le 13 février, Boris Kagarlitsky (65 ans), intellectuel socialiste russe de premier plan et militant anti-guerre, a été condamné à cinq ans de prison.
Kagarlitsky a été arrêté en juillet de l'année dernière sous l'accusation absurde de « justifier le terrorisme ». Après une campagne mondiale reflétant sa réputation internationale d'écrivain et de critique du capitalisme et de l'impérialisme, son procès s'est achevé le 12 décembre par un verdict de culpabilité et une amende de 609 000 roubles ($EU 6550.
L'accusation a alors fait appel de l'amende, la jugeant « injuste en raison de sa clémence excessive » et affirmant faussement que Kagarlitsky n'était pas en mesure de payer l'amende et qu'il n'avait pas coopéré avec le tribunal. En réalité, il avait payé l'intégralité de l'amende et fourni au tribunal tout ce qu'il demandait. Le 13 février, une cour d'appel militaire l'a condamné à cinq ans de prison et lui a interdit de gérer un site web pendant les deux années suivant sa libération.
L'annulation de la décision initiale du tribunal est une insulte délibérée aux milliers de militants, d'universitaires et d'artistes du monde entier qui respectent Boris Kagarlitsky et ont participé à la campagne mondiale pour sa libération. L'article de la loi russe utilisé contre Kagarlitsky interdit effectivement la liberté d'expression. La décision de remplacer l'amende par une peine d'emprisonnement a été prise sous un prétexte tout à fait fallacieux. Il ne fait aucun doute que l'action du tribunal représente une tentative de faire taire les critiques dans la Fédération de Russie concernant la guerre menée par le gouvernement en Ukraine, qui transforme le pays en prison.
Le simulacre de procès de Kagarlitsky est le dernier acte d'une vague de répression brutale contre les mouvements de gauche en Russie. Les organisations qui ont toujours critiqué l'impérialisme, occidental ou autre, sont désormais directement attaquées et nombre d'entre elles sont interdites. Des dizaines de militant.es purgent déjà de longues peines simplement parce qu'ils ou elles sont en désaccord avec les politiques du gouvernement russe et ont le courage de s'exprimer.
Beaucoup sont torturés et soumis à des conditions mettant leur vie en danger dans les colonies pénitentiaires russes, privés de soins médicaux de base. Des personnes politiques de gauche sont contraints de fuir la Russie, en étant l'objet d'accusations criminelles. Les syndicats internationaux tels que IndustriALL et la Fédération internationale des transports sont interdits et tout contact avec eux est passible de longues peines de prison.
Il y a une raison claire à cette répression contre la gauche russe. Le lourd tribut payé à cause de la guerre suscite un mécontentement croissant parmi les masses laborieuses. Les pauvres paient ce massacre de leur vie et de leur bien-être, et l'opposition à la guerre est toujours la plus forte parmi les plus pauvres. La gauche a porté le message et la volonté de dénoncer le lien entre la guerre impérialiste et la souffrance humaine.
Boris Kagarlitsky a réagi à la décision scandaleuse du tribunal avec calme et dignité : "Nous devons juste vivre un peu plus longtemps et survivre à cette période sombre pour notre pays", a-t-il déclaré. La Russie s'approche d'une période de changements et de bouleversements radicaux, et la liberté de Kagarlitsky et d'autres militant.es est une condition pour que ces changements prennent une tournure progressiste.
Nous demandons que Boris Kagarlitsky et l'ensemble des autres prisonnier.es anti- guerre soient libérés immédiatement et sans condition.
Nous appelons également les autorités de la Fédération de Russie à mettre fin à leur répression croissante de la dissidence et à respecter la liberté d'expression et le droit de manifester de leurs citoyen.nes.
Pétition · Change.org Également publié sur https://freeboris.info/ Les signataires qui souhaitent être contactés par la campagne doivent s'inscrire sur ce site.
Principaux signataires (liste restreinte - liste complète disponible ici)
Naomi Klein, writer (Canada)
Jeremy Corbyn MP (UK)
Jean-Luc Mélenchon, political leader (France)
Slavoj Žižek, Birkbeck and Ljubljana Universities (Slovenia)
Tariq Ali, writer (UK)
Yanis Varoufakis, writer and political leader (Greece)
Judy Rebick, feminist writer and activist (Canada)
Mikhail Lobanov, Politician and trade union activist (Russia)
Myriam Bregman, National Deputy (Argentina)
Nicolás del Caño, National Deputy (Argentina)
Christian Castillo, National Deputy (Argentina)
Alejandro Vilca, National Deputy (Argentina)
Fernanda Melchionna, Federal Deputy (Brazil)
Sâmia Bomfim, Federal Deputy (Brazil)
Walden Bello, Focus on the Global South (The Philippines)
Luciana Genro, State Deputy, Rio Grande do Sul (Brazil)
Kavita Krishnan, women's rights activist (India)
Piotr Ostrowski, President of All-Poland Alliance of Trade Unions (Poland)
Bernd Riexinger, Member of the Bundestag (Germany).
Janine Wissler, Member of the Bundestag (Germany).
Gregor Gysi, Member of the Bundestag (Germany).
Dietmar Bartsch, Member of the Bundestag (Germany).
Martin Schirdewan, Member of the European Parliament (Germany).
Richard Boyd-Barrett, TD (Ireland).
Gabriel Nadeau-Dubois, parliamentary leader, Québec Solidaire (Canada)
John McDonnell MP (UK)
Fredric Jameson, Duke University (USA)
Étienne Balibar, Université Paris-Nanterre (France)
Lin Chun, London School of Economics (UK/China)
Kohei Saito, University of Tokyo (Japan)
Claudio Katz, University of Buenos Aires (Argentina)
Luis Bonilla-Molina, Otras Voces en Educación (Venezuela)
Reinaldo Iturriza López, sociologist (Venezuela)
Patrick Bond (University of Johannesburg)
Lindsey German, Stop the War Coalition (UK)
Alex Callinicos, King's College London (UK)
Andrej Hunko, Member of the Bundestag (Germany)
Jodi Dean, Hobart-William Smith (USA)
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Manif à McGill : Solidarité avec Gaza

Plus d'un millier d'ancien.ne.s étudiant.e.s, de professeur.e.s, de membres du personnel et d'autres personnes de McGill signent une lettre ouverte de solidarité avec les étudiant.e.s en grève de la faim et exigent que l'Université coupe ses liens avec les institutions complices du génocide en cours à Gaza et retire ses investissements en soutien à l'apartheid israélien.
*Des ancien.ne.s étudiant.e.s, des professeur.e.s et des membres du personnel exigent que McGill se désengage de l'apartheid israélienne.
*Montréal, 11 mars 2024 -* Alors qu'Israël poursuit ses attaques incessantes contre la population de Gaza, un groupe d'étudiant.e.s de l'Université McGill en est au 22ème jour d'une grève de la faim pour exiger que l'Université coupe ses liens avec les institutions académiques israéliennes et se départisse de ses avoirs auprès des entreprises complices du génocide à Gaza et de l'apartheid israélienne. Jusqu'à présent, les membres de l'administration de l'Université McGill ont refusé de rencontrer les grévistes de la faim ou de prendre au sérieux leurs demandes. Aujourd'hui, plus d'un millier <http://docs.google.com/forms/d/1Hjx...> d'ancien.e.s étudiant.e.s, de professeur.e.s, de membres du personnel et de personnes affiliées à l'Université McGill se sont uni.e.s pour exprimer leur soutien aux grévistes de la faim et à leurs revendications.
« Nous sommes profondément déçu.e.s et dénonçons la réponse dédaigneuse de McGill aux demandes sincères des grévistes de la faim et de l'ensemble de la communauté universitaire », a déclaré Arnold Aberman, un ancien étudiant
en médecine de 1974 qui a signé la lettre.
« McGill doit maintenant faire preuve de la même force morale que celle dont elle a fait preuve contre l'apartheid en Afrique du Sud. Nous exhortons notre université à défendre la justice, à soutenir le mouvement BDS et à couper les liens avec les institutions israéliennes impliquées dans des violations des droits de l'homme. McGill doit faire preuve d'intégrité et agir immédiatement en fonction des valeurs qu'elle professe. »
En 1985, McGill a été la première université canadienne à se désengager de l'apartheid sud-africain, sous la pression des étudiant.e.s.
Le mouvement Boycott, désinvestissement et sanctions (« BDS ») est un mouvement non violent mené par la société civile palestinienne, qui appelle à la fin du régime d'apartheid oppressif d'Israël. Le mouvement BDS est guidé par le principe selon lequel les Palestinien.ne.s ont les mêmes droits que tous les autres peuples. Trois universités, en Norvège et au Brésil, ont déjà rompu leurs liens avec des établissements universitaires israéliens complices de violations des droits de l'homme à l'encontre des Palestiniens.
La lettre et les demandes des grévistes de la faim s'inscrivent dans un contexte pénible d'escalade de la violence et de violations des droits de l'homme à Gaza, qui a atteint une ampleur sans précédent au cours des cinq derniers mois. « Chaque jour, nous voyons les horreurs infligées à Gaza par Israël », ajoute une autre signataire, Amelia Philpott, diplômée de la Faculté de droit en 2018. « 250 Palestinien.n.es sont tué.e.s chaque jour. Il y a plus de 30 000 personnes mortes et 13 000 d'entre elles sont des enfants. Soyons clair.e.s : c'est un génocide et l'Université McGill en est complice. »
« Nous voyons des hôpitaux, des universités, des travailleurs et travailleuses de la santé et des universitaires décimé.e.s à Gaza", se désole Amy Darwish, un autre signataire diplômée en Counselling Psychology à McGill en 2005. « Tout cela est aggravé par un siège qui affame la population et que la Cour internationale de justice a jugé illégal. Si McGill se soucie de l'éducation, de la santé mondiale et de l'humanité, il est temps d'agir. Répondez aux demandes des grévistes de la faim. »
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Nos choix énergétiques seront déterminants

Il en coûtera en moyenne au minimum 13,39$ à chaque ménage québécois (qu'il soit riche ou pauvre), année après année, pour subventionner l'électricité que consommera Northvolt. Si on prend en compte les coûts associés à la puissance, ce sera beaucoup plus. Et ce, tous les ans. À perpétuité. Cette subvention récurrente de Monsieur Madame tout le monde s'ajoute aux subventions gouvernementales qui pourraient dépasser 7 milliards de dollars.
Émilie Laurin-Dansereau, conseillère budgétaire à l'Association coopérative d'économie familiale (ACEF) du Nord de Montréal
Jean-Pierre Finet, analyste et porte-parole, Regroupement des organismes environnementaux en énergie
À elle seule, Northvolt occasionnera un effet à la hausse de près de 1% (0.96%) sur la facture de la clientèle d'Hydro-Québec selon les données provisoires de la société d'État recueillies et colligées par l'analyste indépendant en énergie Jean-François Blain. En effet, l'usine de batteries devra s'alimenter à partir d'énergie post patrimoniale. En présumant un coût d'approvisionnement à 10 cents par kilowattheure (kWh) et un prix de vente à 5 cents par kWh au tarif L pour la grande industrie, il en résulte un déficit de 5 cents par kWh qui devra être épongé par l'ensemble de la clientèle, incluant les clients à faible revenus. Considérant une consommation annuelle de près de 3 milliards de kWh à elle seule, Northvolt nous coûtera donc très cher. Les 127 premiers millions de dollars de profits annuels de Northvolt proviendront donc de la clientèle d'Hydro-Québec. C'est d'ailleurs le genre d'information qui serait publique s'il y avait une évaluation environnementale indépendante et des audiences publiques par le BAPE telle que l'ont demandé plus de 180 groupes et signataires.
Qui doit payer pour la transition énergétique et le développement de l'économie ?
La question se pose. Pour le ministre Fitzgibbon, l'usine de batteries Northvolt est un projet phare pour la transition énergétique et pour le développement de l'économie. Pour lui, investir dans Northvolt et la filière batterie équivaut à créer de la richesse collective et à assurer la décarbonation de l'économie. Pourtant, rien n'est moins sûr. Nous n'avons aucune idée de la mesure dans laquelle cette usine de batteries réduira la consommation de pétrole au Québec. De même, nous ne savons toujours pas comment les retombées économiques hypothétiques futures de cette industrie compenseront les subventions initiales du gouvernement et les subventions tarifaires perpétuelles que nous lui accorderons collectivement. Pour l'instant, en l'absence d'études et de comparatifs, la seule chose que l'on puisse conclure, c'est que ce sont, en bonne partie, les ménages qui financent et créent la richesse pour l'industrie.
Décarboner l'économie et promouvoir le développement économique, ce n'est pas la responsabilité des clients d'Hydro-Québec. Le gouvernement s'est déjà trop souvent servi des tarifs d'électricité pour financer ses programmes de développement économique et ses projets environnementaux. Pensons à l'installation de bornes électriques, à l'achat d'électricité provenant d'éoliennes privées ou à l'entente sur la biénergie électricité-gaz signée avec Énergir. Il ne faudrait pas ajouter les coûts de la filière batterie en plus. La réduction des émissions de gaz à effet de serre bénéficie à la société en général et pas seulement aux clients d'Hydro-Québec. La transition énergétique doit donc être financée par l'ensemble de la société et par les grands pollueurs en raison desquels la décarbonation est aujourd'hui nécessaire.
Le premier ministre demande aux Québécois de « changer d'attitude » envers des projets comme Northvolt. Alors qu'un nombre effarant de ménages québécois (1 personne sur 7) peine déjà à payer leurs factures, financer des projets politiques à partir des factures d'électricité est sans contredit régressif. Il serait donc plus judicieux d'effectuer une planification intégrée des ressources énergétiques avant d'octroyer une quantité aussi importante de capacité électrique à l'industrie, de sorte à s'assurer que leur consommation ne se répercute pas sur la facture des consommateurs résidentiels d'électricité. L'utilisation des tarifs d'électricité pour financer la transition fait porter une proportion injuste des coûts de la transition sur les ménages les plus pauvres.
Les choix que nous allons faire dans le domaine de l'énergie seront déterminants pour notre avenir commun. C'est pourquoi ils doivent impliquer toute la population. C'est ensemble que nous devons déterminer ce qu'il convient de faire de nos ressources énergétiques. La justice sociale et climatique doit être au cœur de la lutte contre les changements climatiques. Le moment est maintenant venu de mettre l'économie au service de l'amélioration des conditions de vie de tous et toutes.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le budget menteur de la CAQ préparant des lendemains qui déchantent

Au fond du désespoir luitle phare du projet de société tissé de sobriété La lutte du secteur public s'est invitée pour le budget de la CAQ en sorcière maléfique au cœur d'un déficit monté en épingle qui n'a pourtant rien ni de terrible, dixit avec raison le Premier ministre. Celui-ci ne veut pas passer à l'histoire comme le cancre des comptables mais surtout il veut justifier une nouvelle baisse d'impôt avant les prochaines élections comme promis.
Ce déficit n'a non plus rien d'« historique » comme l'a montré un commentateur de droite mais futé de La Presse. Il faudrait en déduire la provision de 1,5 milliard pour les imprévus et ensuite le versement au Fonds des générations de 2,2 milliards. Ce déficit réel de 1.5 % du PIB est bien banal par rapport à ceux de la zone euro et des ÉU. Si ceux canadien et provinciaux sont moindres aujourd'hui, ils ne l'ont pas toujours été depuis le début de ce siècle.
Notre commentateur de La Presse pense que la CAQ a fait une erreur en sousestimant le règlement salarial du secteur public. Je dirais plutôt que telle était sa réelle intention de régler à bon marché pour ne pas dire de briser les reins syndicaux afin de dérouler le tapis rouge aux privatisations sur la base d'une crise incurable de démissions sans recrutement. Le rapport de forces tellement favorable économiquement et politiquement aux mouvement syndical, qui n'a pas su en profiter, a quand même empêché la CAQ de dévaster le secteur public. La CAQ se dit que le match revanche sera préparé par la nouvelle Agence de la santé lentement mise en place et par la continuelle désaffectation de l'école publique par les parents suite à son délitement sans fin mis en évidence par la lutte syndicale du secteur éducation.
Oh ! Philippe Couillard, sors de ce pingre budget au déficit gonflé à bloc
En attendant, la CAQ n'a pas l'intention de perdre son temps. Comme maints mouvements sociaux l'ont souligné, à commencer par l'IRIS et la FTQ, et n'en déplaise à notre commentateur de La Presse qui confond le saupoudrage de bonbons avec « [s]outien additionnel aux personnes démunies, aux logements sociaux, aux services de garde, aux aînés souffrant d'invalidité, aux soins à domicile, aux DPJ », il n'y a rien de significatif pour atténuer les graves crises des services publics, du logement populaire et du transport collectif. Comme le dit l'IRIS, « [é]tant donné l'état actuel des services publics, autant dire que le gouvernement ne fait qu'assurer le minimum requis pour maintenir les services qui sont déjà en très mauvais état. »
Tout suggère que le coup de massue viendra l'an prochain quand la CAQ préparera la prochaine baisse d'impôt. Les agences de cotation y verront qui attendront un plan rigoureux de retour à l'équilibre tel que prescrit par la loi… qui gonfle artificiellement le déficit. De prédire avec justesse l'analyste politique de RadioCanada qui y voit le retour de la rigueur des Libéraux de Philippe Couillard :
Pour résorber le déficit, Eric Girard a entre autres annoncé une hausse de la taxe sur le tabac et une réduction des crédits d'impôt dans le secteur des technologies de l'information. Ces mesures ne représentent toutefois que quelques centaines de millions de dollars, alors qu'on estime la portion structurelle du déficit à 4 milliards. Le plus dur reste donc à faire. Le gouvernement requerra pour 1 milliard de dollars d'"efforts d'optimisation" aux grandes sociétés d'État, mais les modalités de ces efforts restent encore à définir. Hydro-Québec fait partie des entités ciblées, même si l'entreprise est déjà engagée dans un vaste plan de croissance.
On s'en remet pour le reste à un classique de la politique, soit un « examen des dépenses gouvernementales ». L'exercice s'attardera à la fois aux dépenses fiscales pour les particuliers et les entreprises, mais aussi à l'ensemble des dépenses des ministères et des organismes. Aucune cible précise n'a toutefois été annoncée. Pour un gouvernement normalement féru d'indicateurs et de tableaux de bord, cela a de quoi étonner.
C'est précisément au même genre d'exercice que le gouvernement de Philippe Couillard avait convié les Québécois peu après être arrivé au pouvoir en 2014.
Ce retour de l'austérité — pardon de « l'optimisation » — est annoncé noir sur blanc quand est affirmé dans le discours du budget, selon le chroniqueur du Devoir, que « [p]our l'ensemble des dépenses gouvernementales, la hausse moyenne au cours des cinq prochaines années sera de 2,9 %. » ce qui est en-deçà de la hausse nécessaire pour maintenir le niveau actuel de services publics. Y contribuera la baisse des « transferts fédéraux [qui] chuteront de 6 %, soit près de 2 milliards, notamment en raison des changements qu'Ottawa a apportés l'an dernier à la péréquation » en plus d'un refus du fédéral de garantir une pleine compensation pour ses nouveaux programmes de soins dentaires et de médicaments sans compter de ne pas vouloir hausser sa contribution pour la santé. Finalement, l'attrape-mouche médiatique du déficit « record » de 11 milliard $ ne sert que d'« écran de fumée » pour annoncer des lendemains qui déchantent afin que la CAQ, avant même les prochaines élections, puisse renouer avec son populisme distributif, mais non redistributif, mêlant baisse des impôts et chèque-cadeau.
Un déficit mué en surplus à l'ombre du spectre ontarien illusionnant la foule
N'eut été de des baisses passées d'impôt, ce « super-déficit » super boosté se serait mué en super surplus réel dès 2026-2027. Selon une étude de la CSQ, les baisses de taux d'imposition du gouvernement du Québec, depuis 2018, soustraient chaque année plus de 6 milliards $ au revenu fiscal québécois. Or d'analyser l'expert économique de Radio-Canada, le « …déficit structurel [sera] de 4 milliards de dollars à compter de 2026. Une fois de plus, avant le versement au Fonds des générations, le déficit, à partir de 2026-2027, se situe entre 1 et 2 milliards. Et si on exclut la provision pour éventualités, on est à l'équilibre budgétaire. » Que dire de l'évitement fiscal et encore plus de l'évasion fiscale vers les paradis fiscaux. Même la CAQ les prend au sérieux en investissant 76 millions $ pour récupérer 405 M$ sur cinq ans. Ça me semble peu mais mieux que rien pour faire cracher le 1%.
La rengaine caquiste justifiant une telle baisse d'impôt est que le contribuable québécois est plus imposé que celui ontarien. Cette même étude de la CSQ a clairement démontré qu'au net c'est faux une fois pris en compte « les transferts et les aides financières offertes par les gouvernements (soutien et allocations aux enfants, prime au travail, crédit de solidarité et allocations pour travailleurs, etc.) » et plusieurs tarifs moins élevés (transport en commun, électricité, frais de scolarité universitaire, frais de garde). En plus, ces baisses avantagent d'abord les contribuables les plus fortunés par effet inverse de la progressivité.
Par rapport aux provinces canadiennes, en est ainsi amoindrie la « charge fiscale nette » de la fiscalité québécoise en faveur de la contribuable moins fortunée et ayant des enfants à charge. En 2022, la distribution des revenus après impôt et transferts faisait du Québec la moins inégalitaire parmi les provinces canadiennes à l'exception de l'Île-du-Prince-Édouard. Par contre, toujours selon le « Bilan de la fiscalité 2024 » de la Chaire en fiscalité de l'Université de Sherbrooke, au niveau de la structure fiscale par rapport à l'ensemble des provinces canadiennes, le gouvernement du Québec ménage les entreprises et le patrimoine et taxent relativement davantage les particuliers tant pour le revenu, mais avec une échelle plus progressiste comme on l'a constaté, la masse salariale, les cotisations sociales et la consommation, ces trois dernières étant des taxes indirectes régressives. Malgré un poids fiscal québécois global plus lourd que la moyenne canadienne, ce poids est légèrement moindre pour les bénéfices des entreprises et sensiblement moindre pour le patrimoine (la richesse).
Il y a un espace si l'on voit au bout de l'impasse la rupture indépendantiste
Il y a donc un espace pour hausser les deux types d'imposition au Québec. L'éléphant dans la pièce est les ÉU dont les poids fiscaux pour ces deux types d'impôt sont plus bas, surtout pour les bénéfices des entreprises. En est posé le dilemme de l'appartenance canadienne à l'ACEUM (ex-ALÉNA) imposant la fluidité des mouvements de capitaux dans cette zone. La crise de la productivité canadienne, en étonnante baisse depuis 5 ans ce qui angoisse la gent affairiste, provoque et entretient une fuite très marquée de capitaux directs depuis 2014 (voir graphique ci-bas). C'est particulièrement dans la zone ACEUM où il y a eu une inversion des courbes. En résulte que l'enjeu clef est moins une réforme fiscale, pourtant indispensable, dans le cadre d'un libre-échange qui vide le Canada de sa substantifique moelle capitaliste qu'un dégagement de la matrice extractiviste gazière-pétrolière canadienne désertée par les capitaux d'ici et d'ailleurs. Le défi est de le faire sans tomber dans le piège du nouvel extractivisme tout-électrique perpétuant à la moderne la tradition scieur de bois et charrieur d'eau.

Cette rupture indépendantiste libérerait en même temps le peuple québécois du carcan du libre-échange lui permettant de reprendre le contrôle de son épargne nationale en socialisant banques, quasi-banques et banques de l'ombre sous contrôle du 1%. Comme l'histoire du Québec des années 60-70 l'a démontré, la montée indépendantiste rime avec fierté nationale contre l'humiliation nationale, tant fédéraliste qu'autonomiste, ce qui donne au peuple québécois la confiance en soi et l'élan pour accomplir de grandes réformes véhiculées par sa langue nationale. Tel serait le grand chantier de la sobriété énergétique révolutionnant transport, habitat, agriculture, urbanisme, industrie, envers du Projet de la Baie James d'il y a un demi-siècle, rendu possible par la délivrance du carcan financierpétrolier fédéraliste et par le contrôle national et social des flux de capitaux générés par l'économie québécoise lesquels en ce moment prennent le large.
Dans le fouillis de contradictions, la sobriété énergétique fournit le fil d'Ariane
Au lieu de cette perspective, exigeante mais emballante, revivifiant l'espoir vacillant du peuple québécois dans un projet de société, la pingrerie populiste de la CAQ l'enlise dans des contradictions incompréhensibles où une chatte ne saurait retrouver ses petits. Nos infrastructures de toutes sortes tombant en ruines, la CAQ donne la priorité, pour le Programme québécois des infrastructures (PQI), à la rénovation (et prolongement-élargissement) du réseau routier aux dépens du transport en commun. Beau croc-en-jambe aux gouvernements régionaux et aux écologistes. Mais en même temps qu'elle donne la priorité au réseau routier, la CAQ annonce la disparition par étapes des subventions aux véhicules électriques tout en se faisant le chantre de la filière batterie grassement subventionnée comme socle du développement économique du Québec.
Comprenne qui pourra jusqu'à ce qu'on réalise que la baisse continuelle de prix des véhicules électriques et la réglementation gouvernementale des ÉU comme du Canada, sans oublier le bon marché de l'hydro-électricité québécoise comparé à l'essence, feront le travail de la mue électrique de la flotte routière au rythme de la CAQ sans qu'elle se ruine pour un soutien certes populaire mais dont l'efficacité est contestable. Dans une perspective de sobriété, les véhicules à batteries, que ne sont pas ou peu les équipements de transport en commun électrifiés, n'ont une place que marginale comme parc communautaire d'appoint mais nullement comme véhicules privés individuels ou familiaux.
Marc Bonhomme, 17 mars 2024
www.marcbonhomme.com ; bonmarc@videotron.ca
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :












