Presse-toi à gauche !
Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Biden et Trump s’accusent mutuellement de mettre fin à la démocratie américaine
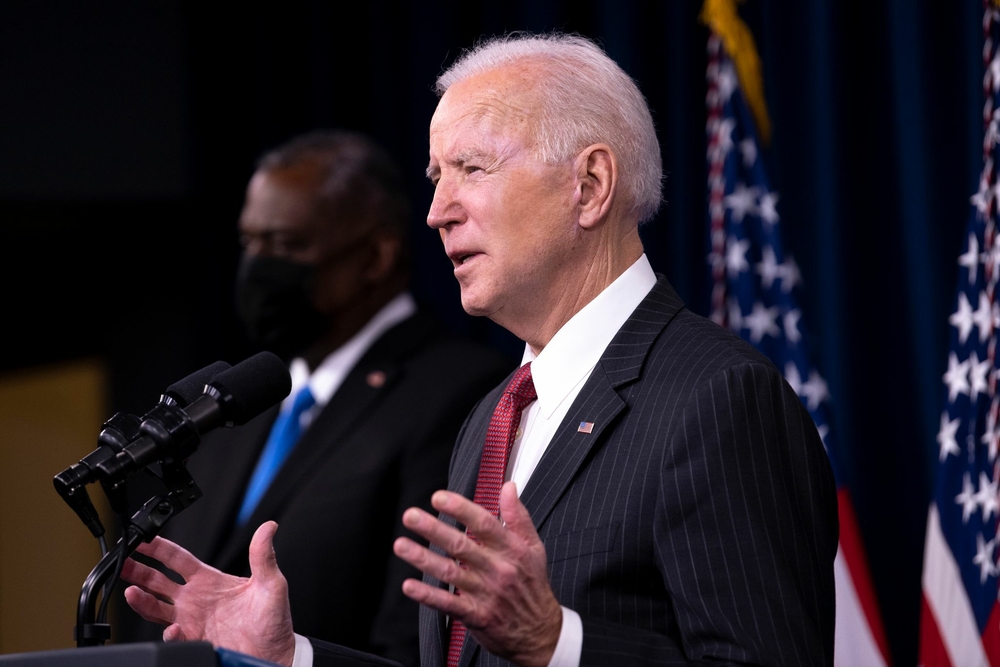
La nouvelle année a été marquée par les premières salves dans la bataille pour la présidence des États-Unis lors des élections de novembre 2024 : le président Biden et l'ancien président Trump se sont mutuellement accusés d'être des dangers pour la démocratie américaine.
Hebdo L'Anticapitaliste - 690 (11/01/2023)
Par Dan La Botz
Crédit Photo
Commons
Les deux candidats affirment qu'il s'agit d'une élection qui ne porte pas tant sur les politiques que sur le sens même du gouvernement et de la société. Dans le même temps, la Cour suprême fédérale vient d'annoncer qu'elle se pencherait sur la question du Colorado et du Maine, qui ont rayé la candidature de Trump du futur scrutin pour avoir encouragé et fomenté une insurrection contre les institutions. Et les premières primaires ne sont plus qu'à quelques jours, l'Iowa le 15 janvier et le New Hampshire le 28 janvier.
L'insurrection du Capitole
Profitant du troisième anniversaire de l'insurrection du 6 janvier 2021 et de la tentative de coup d'État au Capitole de Washington, Biden a prononcé un discours cinglant dans lequel il a accusé Trump de tenter de détruire les institutions fondamentales de la démocratie américaine, et ce, à Valley Forge en Pennsylvanie, le bivouac de l'armée de George Washington pendant la guerre d'indépendance américaine.
« Aujourd'hui, nous sommes ici pour répondre à la plus importante des questions : la démocratie est-elle toujours la cause sacrée de l'Amérique ? Il ne s'agit pas d'une question rhétorique, académique ou hypothétique. La question de savoir si la démocratie est toujours la cause sacrée de l'Amérique est la question la plus urgente de notre époque », a déclaré Biden. « C'est l'enjeu de l'élection de 2024 ». « Nous devons être clairs », a affirmé Biden. « La démocratie est sur le bulletin de vote. Votre liberté est en jeu ».
Trump a répondu en accusant Biden d'être « alarmiste ». Il affirme que Biden est le « véritable danger pour la démocratie ». Trump accuse Biden d'utiliser le ministère de la Justice pour le persécuter, l'ancien président étant désormais accusé de délits dans plusieurs affaires fédérales et au niveau des États. Trump prévient que si les Démocrates peuvent lui faire cela, ils peuvent le faire à n'importe qui. Il défend l'insurrection du 6 janvier comme une protestation légitime, faisant l'éloge des personnes condamnées et emprisonnées comme si elles étaient des héros, et continue d'affirmer que l'élection de 2020 lui a été volée par Biden et l'« État profond ».
Nécessité d'un troisième parti
Trump continue de devancer les autres candidats à la primaire républicaine de 30 points et les derniers sondages montrent que Trump et Biden sont au coude à coude. Le principal argument de Trump est que Biden est « corrompu et incompétent », notamment parce qu'il n'a pas réussi à contrôler l'immigration à la frontière sud. Avec des mots qui rappellent ceux d'Adolf Hitler dans Mein Kampf, il déclare : « L'immigration clandestine empoisonne le sang de notre nation. Ils viennent de prisons et d'institutions psychiatriques, du monde entier ». Dans ses discours, il fait l'éloge de dirigeants autoritaires comme Kim Jong-un, qu'il qualifie de « très gentil ». Et il cite Vladimir Poutine en disant que Biden le persécute.
Jusqu'à présent, les candidats des autres partis ou ceux qui se présentent en tant qu'indépendants, de Jill Stein du Parti vert aux indépendants, Cornel West et Robert F. Kennedy Jr., n'ont pas bénéficié d'une grande couverture médiatique ni du soutien du public. Pourtant, selon un récent sondage Gallup, 63 % des AméricainEs affirment qu'un nouveau troisième parti serait nécessaire. Mais les dirigeantEs des syndicats, les principales organisations noires et latinos et les groupes de femmes restent fidèles aux Démocrates, et il n'y a pour l'instant aucun signe de fissure. Avec les congés derrière nous, la compétition Biden-Trump dominera l'actualité tout au long de l'année 2024.
Bien que formulé en termes de lutte pour la démocratie, il s'agit en réalité d'un combat entre Biden, leader du parti de la ploutocratie des grandes entreprises et néolibérale, et Trump, qui représente un mouvement à tendance autoritaire et quasi fasciste.
Traduction Henri Wilno
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Le « Grand remplacement » aux États-Unis : racisme, antisémitisme et antisionisme

Pour comprendre pourquoi Claudine Gay, la présidente de l'université Harvard s'est vue contrainte de démissionner le 2 janvier, il faut analyser en détail les polémiques et fake news qui agitent les réseaux sociaux depuis quelques mois, et notamment X, propriété du trumpiste Elon Musk, et le rôle désormais central qu'y occupe la théorie du « Grand remplacement » imaginée par l'écrivain français Renaud Camus.
8 janvier 2024 | tiré de aoc.media
https://aoc.media/analyse/2024/01/07/le-grand-remplacement-aux-etats-unis-racisme-antisemitisme-et-antisionisme/
De l'antisémitisme…
« L'oiseau est libéré. » Le 28 octobre 2022, Elon Musk annonçait son rachat de Twitter en célébrant la libération de la parole. Depuis lors, les discours de haine se sont donné libre cours sur le réseau social rebaptisé X, avec les encouragements de l'homme le plus riche du monde.
Le 15 novembre 2023, à un « juif conservateur de Floride » qui dénonce la lâcheté des antisémites s'abritant dans l'anonymat d'internet, un compte sous pseudonyme répond : « Les communautés juives ont encouragé exactement la même forme de haine dialectique contre les Blancs qu'elles veulent faire cesser contre elles. Je n'en ai vraiment rien à foutre des populations juives occidentales troublées par la prise de conscience que ces hordes de minorités qu'elles soutiennent pour inonder leur pays ne les aiment vraiment pas beaucoup. Vous voulez la vérité en face ? La voici. » Elon Musk approuve ce message : « C'est la vérité vraie ». Il garantit ainsi des millions de vues à un post qui n'en sera pas moins supprimé pour avoir enfreint les règles du réseau X.
L'Anti-Defamation League (ADL), fondée en 1913 pour combattre l'antisémitisme, réagit le lendemain. Pour son président, Jonathan Greenblatt, qui est un ancien de la Maison Blanche sous Barack Obama, « dans un moment où l'antisémitisme explose en Amérique et fait une poussée à travers le monde, il est indéniablement dangereux d'utiliser son influence pour valider et promouvoir des théories antisémites. » Comme l'ADL dénonce la progression des discours de haine depuis qu'il a pris le contrôle de Twitter, Elon Musk l'accuse régulièrement de… diffamation. Pour expliquer son soutien au post antisémite, il a d'ailleurs enfoncé le clou : « L'ADL attaque injustement la majorité en Occident, bien que celle-ci soutienne le peuple juif et Israël. C'est à défaut de pouvoir, en vertu de ses principes, critiquer les groupes minoritaires qui constituent leur menace principale. » Il a toutefois tenu à élargir sa cible : « Il est vrai qu'il ne s'agit pas de toutes les communautés juives ; mais pas seulement de l'ADL. » Bref, il vise, non pas tous les juifs, mais des catégories de juifs, en tant que tels.
Il n'empêche : des suprémacistes blancs l'applaudissent. « C'est ce que nous disions à Charlottesville », en 2017, se félicite Nick Fuentes, « quand les manifestants criaient : “les juifs ne nous remplaceront pas !” ». Il s'agit de la version antisémite du « Grand remplacement », qui oppose les « remplacés » (blancs), non seulement aux « remplaçants » (de couleur), mais aussi aux « remplaceurs » (juifs). Le journaliste Yair Rosenberg le rappelle dans The Atlantic, au moment de perpétrer en 2018 un massacre dans une synagogue de Pittsburgh, le terroriste écrivait que, si les juifs prônent l'accueil des réfugiés, c'est pour « faire venir des envahisseurs qui tuent notre peuple. » Bref, les mots d'Elon Musk confirment alors, sans ambiguïté, son antisémitisme. C'est d'autant plus clair que le site Media Matters révèle le 17 novembre que des annonces de grandes entreprises apparaissent sur X à côté de comptes qui font l'apologie d'Hitler. Apple, IBM, Disney et d'autres renoncent alors à confier leurs publicités à ce réseau. Elon Musk riposte avec une « plainte thermonucléaire » contre cette association critique des médias ; pour lui, « le mal », ce n'est pas le retour du nazisme ; c'est sa dénonciation.
… à l'antisionisme
Pourtant, quelques heures plus tard, le même Jonathan Greenblatt congratule Elon Musk sur le réseau social : « Voici un geste important et bienvenu d'Elon Musk. J'apprécie qu'il mène ainsi le combat contre la haine. » Qu'est-ce qui explique ce revirement ? C'est qu'il répond à un autre post du propriétaire du réseau social, en référence au conflit du Proche-Orient : « “décolonisation”, “du fleuve à la mer,” et autres euphémismes, impliquent inévitablement le génocide. Les appels ouverts à la violence extrême sont contraires à nos principes, et entraîneront la suspension de comptes. » Autrement dit, tout se passe comme si la défense d'Israël annulait le grief d'antisémitisme.
Ce n'est pas un hasard. Le président de l'ADL avait en effet déclaré l'année précédente : « permettez-moi de clarifier ce point aussi clairement que possible : l'antisionisme, c'est de l'antisémitisme. » Sans doute avait-il bientôt nuancé, pour être « d'une clarté cristalline », cette affirmation dans un entretien accordé au New Yorker. Reste que l'ADL, en incluant les manifestations pacifiques en soutien aux Palestiniens, double les chiffres de la poussée d'antisémitisme depuis le 7 octobre. Le 19 octobre 2023, c'est la réaffirmation de cette logique qui l'autorise à renvoyer dos à dos les suprémacistes blancs et les organisations juives de gauche Jewish Voice For Peace et If Not Now, qui manifestent avec des rabbins contre « un génocide potentiel » à Gaza. Cette actualité prolonge une histoire. Dès 1974, dans un livre d'Arnold Forster et Benjamin Epstein, l'ADL dénonçait un « nouvel antisémitisme » (notion qui connaîtra une importante postérité en France) : à côté des traditionnels discours de haine de la droite, la Guerre du Kippour était selon eux le révélateur d'une indulgence condamnable, dans la gauche pro-arabe (y compris chez des juifs), pour les discours hostiles à l'État d'Israël.
Mais il y a plus. L'équivalence posée entre l'antisionisme et l'antisémitisme finit par réduire l'antisémitisme au seul antisionisme. Effet pervers de l'attaque du Hamas : à Elon Musk, l'ADL peut ainsi pardonner son complotisme, alors même qu'il vise les juifs, dès lors qu'il rejoint les positions sionistes. C'est précisément ce que dénonce Michelle Goldberg, le 20 novembre 2023, dans le New York Times : « Musk semble avoir appris sa leçon : un sionisme ardent peut servir d'alibi pour l'antisémitisme », car il est des dirigeants de la communauté juive pour « le rendre kasher ». Dans The Guardian, Sam Wolfson s'inquiète une semaine plus tard de cette même aberration : « des associations censées protéger les droits des juifs détournent le regard de l'hostilité aux juifs tant qu'elle est portée par des soutiens d'Israël. »
Benyamin Nétanyahou ne s'y trompe pas. Le 18 septembre, lors de sa visite en Californie, il avait déjà affiché son soutien enthousiaste à Elon Musk. Lors de leur échange sur X, il le proclamait non seulement « l'Edison de notre temps », mais aussi « le président officieux des États-Unis ». Il est vrai que le Premier ministre israélien, en difficulté dans son propre pays pour sa remise en cause anti-démocratique de la séparation des pouvoirs, était alors en froid avec Joe Biden, le président officiel. Sans doute pour Benyamin Nétanyahou, Elon Musk était-il un allié puissant. Mais celui-ci n'était-il pas engagé dans une virulente campagne antisémite, non seulement contre l'ADL, mais aussi contre George Soros ?
La rencontre donnait ainsi à Elon Musk l'occasion de se justifier : « Évidemment, je suis contre l'antisémitisme. Je suis contre “anti-quoi que ce soit”. » Il est vrai qu'il s'oppose à l'antisionisme comme à l'antiracisme. Deux mois plus tard, le 27 novembre, c'est au tour du Premier ministre israélien d'accueillir Elon Musk dans un kibboutz, l'une des scènes des massacres du 7 octobre ; cette fois, malgré la controverse récente, il n'est même plus question d'antisémitisme. Le quotidien de la gauche israélienne Ha'aretz s'indigne : « La répugnante accolade d'Israël à Elon Musk est une trahison cynique des juifs, les morts comme les vivants. » Tout se passe comme si l'antisémitisme n'existait plus que sous la forme de l'antisionisme.
Deux camps dans l'extrême droite
Aux États-Unis, Elon Musk est le révélateur d'un clivage au sein de la droite radicale. D'un côté, le polémiste Ben Shapiro, dont le Daily Wire est diffusé depuis mai 2023 en streaming sur X, prend la défense d'Elon Musk – et il le fait en tant que juif orthodoxe. Déjà le 28 septembre, dans la foulée de l'adoubement du patron de X par Benyamin Nétanyahou, il convoquait des personnalités juives, y compris des rabbins, pour défendre son diffuseur. Celui-ci en profitait pour détourner l'accusation d'antisémitisme vers « l'extrême gauche, y compris dans les meilleures universités où on leur enseigne qu'Israël, c'est l'apartheid, un État qui ne devrait pas exister. »
En novembre, Ben Shapiro le reconnaît, Elon Musk a d'abord fait « une grosse boulette » (“a major boo-boo”) : le post qu'il a cité aurait dû dire « des », et non « les communautés juives », puisque « la plupart des communautés orthodoxes », à commencer par la sienne, s'opposent (comme Elon Musk) aux politiques de diversité (Diversity Equity and Inclusion, ou DEI) et à « l'ouverture des frontières sur une base intersectionnelle » (sic). Il aurait donc dû préciser qu'il visait les juifs « de gauche » (liberal). Mais, selon Ben Shapiro, c'est ce qu'il a bientôt fait en nommant l'ADL. Or les médias qui dénoncent la proximité d'Elon Musk avec la « droite radicale » (alt right) seraient justement ceux qui appellent à un cessez-le-feu à Gaza. Leur antisionisme s'abriterait ainsi derrière l'imputation d'antisémitisme, également brandie contre Donald Trump. Reconnaissant, Elon Musk cite sa vidéo, ainsi qu'un post se félicitant que Jonathan Greenblatt et Ben Shapiro se retrouvent, malgré leurs divergences, pour le soutenir. Leur point commun ? Se ranger dans le camp d'Israël.
Or c'est sur ce point que la droite radicale se divise aux États-Unis. D'un autre côté, en effet, des stars du trumpisme prennent leurs distances avec Israël. Dans cet autre camp, on trouve Candace Owens, qui sur son compte, suivi par 4,5 millions de personnes, écrit le 3 novembre : « Aucun État, nulle part, n'a le droit de commettre un génocide. Rien ne justifie un génocide. Je n'arrive pas à croire qu'il soit besoin de le dire, ou qu'il soit le moins du monde jugé polémique de l'énoncer. » Une semaine après le déclenchement de l'offensive contre Gaza, ce post est évidemment lu comme une critique d'Israël. Ben Shapiro, pour qui elle travaille au Daily Wire, le juge « honteux ». Mais un compte de « Républicains contre Trump » s'indigne : « Où était-il lorsqu'elle a fait l'éloge d'Hitler ? Ou défendu l'antisémitisme de Kanye West ? »
Certes, cette femme noire, égérie de la droite évangélique, joue contre Ben Shapiro, en réponse à ses attaques, une carte antisémite : « Christ est roi. » Mais lui-même n'a-t-il pas justifié l'antisémitisme d'Elon Musk ? L'extrême droite se déchire aux États-Unis sur l'antisionisme, et pas sur l'antisémitisme. Candace Owens s'accorde sans peine avec Ben Shapiro pour dénoncer les juifs « de gauche », responsables, en soutenant les minorités, de favoriser le Grand remplacement. Car l'enjeu de leur conflit, c'est Israël. Et c'est ce qui vaut à Candace Owens le soutien de Tucker Carlson. FoxNews a fini par licencier ce tribun raciste en avril 2023. Il n'empêche : le 8 novembre, Donald Trump n'exclut pas de lui proposer la vice-présidence : « il a un bon sens remarquable ».
Or Tucker Carlson critique le soutien des États-Unis à Israël, comme à l'Ukraine d'ailleurs : à l'instar de Candace Owens, c'est un isolationniste, dans une tradition qui va de Charles Lindbergh à Pat Buchanan. Le 15 novembre, il invite donc celle-ci dans son émission : « Tucker on X ». On le voit, Elon Musk héberge les deux camps de la droite radicale. Si Tucker Carlson compatit avec les victimes du Hamas, il compare les réactions d'empathie qu'elles suscitent dans ce que Candace Owens appelle « le lobby pro-Israël » avec l'absence d'émotion face à une « tragédie » qu'il estime de plus grande ampleur : « Notre pays est envahi, en ce moment-même, par des millions de jeunes hommes dont nous ne connaissons pas les identités. Ils n'aiment probablement pas l'Amérique, et maintenant, ils vivent ici. »
Tucker Carlson reprend alors à son compte l'interpellation de Candace Owens. Les généreux donateurs qui financent les campus de l'Ivy League veulent leur couper les vivres quand y résonnent des discours anti-israéliens. Mais « où étiez-vous ces dix dernières années lorsqu'ils appelaient de leurs vœux un génocide anti-blanc ? » Il se prend à « détester ces gens » : « On taxait mes enfants d'immoralité du seul fait de leur couleur de peau, et c'est votre argent qui finançait cela. » En plein accord avec Candace Owens, Tucker Carlson reprend, comme à son habitude, tous les éléments de la théorie conspirationniste du Grand remplacement, y compris le racisme anti-blanc. En matière d'antisémitisme, c'est donc le même discours que Ben Shapiro, contre les juifs de gauche. Mais la ligne de partage, c'est l'antisionisme. À l'inverse du camp isolationniste de Tucker Carlson et Candace Owens, l'autre droite radicale, celle de Ben Shapiro et Elon Musk, est définie par le soutien à Israël. Reste à savoir quel camp Donald Trump pourrait finalement favoriser.
Le racisme escamoté
Pour sa part, dès le 17 novembre, la Maison Blanche a formellement condamné le post d'Elon Musk. Andrew Bates, un de ses porte-paroles, cite le post du journaliste Yair Rosenberg : « C'est littéralement la théorie embrassée par le suprémaciste blanc pour son massacre de la synagogue de l'Arbre de vie. Et Musk approuve. » Et de commenter qu'il est « inacceptable de répéter le mensonge odieux à l'origine de l'acte d'antisémitisme le plus mortel de l'histoire des États-Unis, surtout un mois après la journée la plus meurtrière pour le peuple juif depuis la Shoah. » Le lien est fait, d'emblée, avec l'attaque du Hamas. Le post qui est à l'origine de la polémique s'en prenait aux « juifs occidentaux » ; désormais, il s'agit tout autant d'Israël et de l'actualité politique de la guerre à Gaza, donc de l'antisionisme en même temps que de l'antisémitisme.
Sans doute ce communiqué dénonce-t-il « la promotion de la haine antisémite et raciste » ; mais, bien qu'il s'agisse de Grand remplacement, le deuxième terme passe aussitôt à la trappe. C'est le cas dès le titre de la dépêche qu'y consacre l'AFP : « La Maison Blanche accuse Elon Musk de faire une « promotion abjecte de l'antisémitisme. » D'ailleurs, comme son post, l'article de Yair Rosenberg dans The Atlantic répond uniquement à la théorie du complot, sans évoquer le Grand remplacement lui-même. Comme le résume le 17 novembre dans son titre un article de Media Matters : « C'est l'antisémitisme, imbécile ! »
Dans la polémique, il ne sera plus question des « hordes de minorités » venues « inonder le pays », selon le post qui est à l'origine de la polémique, soit un mélange de xénophobie (contre les immigrés) et de racisme (contre les minorités). Pourtant, c'est bien ce qui indignait Elon Musk le même jour, en réponse à un post du compte @EndWokeness montrant « des centaines de clandestins forçant notre frontière » à travers le Rio Grande. Et d'applaudir un autre post : seuls les Blancs se verraient interdire, par l'histoire dominante, d'être « fiers de leur race » ; il serait donc temps d'en finir avec « ces mensonges ». À l'évidence, le suprémacisme blanc ne se limite pas à l'antisémitisme.
Le Grand remplacement, dans la version originale de Renaud Camus, c'est un slogan démographique. Comme dans la version états-unienne, il efface la distinction entre immigrés et minorités. C'est pour mieux défendre les Français de souche : un peuple de couleur serait en voie de remplacer un peuple blanc, entraînant un changement de civilisation. Mais ce qu'on appelle la théorie du Grand remplacement correspondrait plutôt à une version conspirationniste, davantage répandue dans le monde anglophone, qui en impute la responsabilité aux juifs : George Soros serait la figure paradigmatique de ces « remplaceurs ».
Or l'écrivain français prétend se démarquer de cette théorie conspirationniste : pour lui, le « remplacisme » ne résulte pas d'un complot, mais d'un processus social caractéristique de la modernité. Du reste, interrogé en 2017 sur Charlottesville, Renaud Camus applaudissait le « nationalisme blanc », mais répudiait l'antisémitisme et le nazisme. Sans doute avait-il été échaudé par la polémique suscitée en 2000 par son Journal : il y déplorait la surreprésentation des « collaborateurs juifs » sur France Culture. Radio France annonçait porter plainte. Quant à Alain Finkielkraut, loin de se sentir visé, il prenait la défense, contre « la France grégaire », de cette « mélancolie barrésienne » : « depuis qu'il s'enchante de penser si bien, ce pays fait peur. » En 2017, quand ce producteur de France Culture invite l'écrivain une nième fois dans son émission, c'est pour débattre avec un démographe du « Grand remplacement ». Le médiateur de la radio publique défend ce choix contre la « censure », et à ceux qui rapprochent l'islamophobie d'aujourd'hui de l'antisémitisme d'hier, Alain Finkielkraut rétorque que c'est « faire l'impasse sur le nouvel antisémitisme », celui des musulmans.
Toutefois, on peut penser que la position actuelle de Renaud Camus ne relève pas seulement de la prudence. Peut-être, comme son ami Alain Finkielkraut, est-il guidé par la logique de l'ennemi principal. En tout cas, comme beaucoup à l'extrême droite, le voici devenu sioniste. En réaction à l'attaque du Hamas le 7 octobre, il s'engage « avec Israël », identifiant son propre combat à la vision qu'en exalte l'extrême droite israélienne : « Israël, l'une des plus vieilles nations sur la face de la Terre, est le modèle de toutes les appartenances. Si Israël n'est pas aux juifs, il n'y a plus de raison profonde pour que la France reste aux Français et l'Europe aux Européens. » Renaud Camus, comme ses épigones français d'extrême droite, n'a pas besoin de la théorie complotiste, si répandue aux États-Unis parmi les suprémacistes blancs, pour s'en prendre au « Grand remplacement ».
Il est d'autant plus problématique de restreindre l'idéologie du Grand remplacement à sa seule dimension antisémite, en oubliant son fondement xénophobe et raciste, que si la synagogue de Pittsburgh a été prise pour cible en 2018, c'est précisément en raison de son engagement en faveur des réfugiés. À Christchurch, en Nouvelle-Zélande, l'auteur de l'attentat de 2019 contre deux mosquées, Brenton Tarrant, au moment d'annoncer sa diffusion en direct sur Facebook, promet de « mener une attaque contre les envahisseurs ». De fait, son manifeste est intitulé « Le Grand remplacement », et c'est de lui que se réclament, la même année, le terroriste de Poway, Californie, qui s'en prend et à une synagogue et à une mosquée, et celui d'El Paso, Texas, contre des Mexicains, puis en 2022 celui de Buffalo, New York, contre des Noirs. Oblitérer ces autres événements, pourtant explicitement placés sous le signe du Grand remplacement, c'est donc s'empêcher de penser ensemble le racisme démographique et l'antisémitisme conspirationniste, soit l'idéologie du Grand remplacement et la théorie du complot qui en est un prolongement.
Pour une part, cela tient au contexte. Après le 7 octobre, rompant avec le traditionnel soutien conditionnel de son pays à l'État d'Israël, le président des États-Unis lui manifeste un appui inconditionnel. Il ne saisit donc pas l'occasion du post d'Elon Musk pour réunir la critique du racisme et de l'antisémitisme. Appeler à un cessez-le-feu, explique le 10 octobre sa porte-parole Karine Jean-Pierre, serait « répugnant » et « honteux ». Malgré ses différends avec Benyamin Nétanyahou, Joe Biden choisit son camp. C'est d'autant plus remarquable que ce choix pourrait lui coûter sa réélection : il s'aliène, non seulement les Arabes, ralliés au parti démocrate depuis 2001, qui pourraient cette fois faire basculer le scrutin dans un État-clé, le Michigan, mais aussi les jeunes générations qui lui étaient également acquises : si l'opinion continue de pencher nettement pour Israël, les 18-29 ans ont davantage de sympathie pour les Palestiniens, et ce, avec un écart comparable. Dès lors, ce sont les jeunes qui vont se retrouver mis en cause.
La campagne contre l'Ivy League
En effet, c'est dans ce contexte d'écart générationnel, en même temps que d'anti-intellectualisme, qu'on peut mieux comprendre les attaques répétées contre les campus états-uniens, et en particulier contre les élites de l'Ivy League, soupçonnées de laisser libre cours à l'antisémitisme, c'est-à-dire à l'antisionisme. Pour ses positions pro-palestiniennes, la gauche universitaire états-unienne a été durement tournée en dérision dans un sketch en anglais de l'émission satirique israélienne Eretz Nehederet (« Un pays merveilleux », rebaptisée « Un pays en lutte »), reposté sur X le 6 novembre par le compte de l'État d'Israël. Sur le campus de Columbia Antisemity (sic), on y voit de jeunes queers, caricatures de « wokisme », scander : « Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre. » Et de proposer leur aide, avec déférence, à un terroriste du Hamas qui leur promet pourtant la mort, avant de conclure : « Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre de juifs » (« From the river to the sea, Palestine will be Jews-free. »)
Le lendemain même, 7 novembre, l'usage de cette phrase (sans le mot « juifs », bien sûr) vaut à l'unique élue palestinienne du Congrès états-unien, Rashida Tlaib, un vote de rappel à l'ordre : ce serait un « appel génocidaire à la violence pour détruire l'État d'Israël et son peuple et le remplacer par un État palestinien. » Le Hamas ne l'a-t-il pas repris à l'OLP ? Certes, le Likoud l'utilise aussi : « entre la mer et le Jourdain, il n'y aura que la souveraineté israélienne. » Mais ce point n'est jamais abordé. Cette représentante du Michigan avait elle-même fait grief à Joe Biden de soutenir un génocide à Gaza (un premier rappel à l'ordre, la semaine précédente, avait échoué à réunir une majorité). Dénoncer « un système d'apartheid qui crée des conditions étouffantes et déshumanisantes pouvant mener à la résistance », ce serait défendre le terrorisme. Soutenue par des élues de couleur, Rashida Tlaib se défend en revendiquant une « coexistence pacifique » : « pour moi, les cris des enfants palestiniens et israéliens ne sont pas différents. »
Tout cela aura préparé le terrain pour les auditions de trois présidentes d'universités, le 5 décembre, par une commission de la Chambre des Représentants. L'investigation porte sur l'antisémitisme ; du racisme, il ne sera pas question. Dès l'ouverture, ces présidentes sont mises en accusation par Virginia Foxx, représentante républicaine de Caroline du Nord, qui préside la séance : « Aujourd'hui, chacune d'entre vous pourra répondre des nombreux cas d'antisémitisme haineux et vitriolique sur vos campus pour donner réparation ». Une vidéo intitulée « antisémitisme sur les campus » illustre alors son propos : dans des manifestations étudiantes pacifiques, on entend des slogans de solidarité avec Gaza et des appels à l'intifada, mais aucune référence aux Israéliens ni aux juifs. Robert Scott, représentant démocrate de Virginie, rappelle ensuite que « mes collègues républicains ont refusé les auditions sur les discriminations dans les universités demandées par les Démocrates de ce comité en 2017 alors que des suprémacistes blancs défilaient dans l'Université de Virginie en criant : ‘les juifs ne nous remplaceront pas.' »
Les trois présidentes à qui la parole est donnée commencent par condamner sans réserve « les attaques terroristes du Hamas le 7 octobre ». Chacune reconnaît la poussée de l'antisémitisme, non seulement dans la société, mais aussi sur les campus. Chacune ajoute que les incidents islamophobes aussi se sont multipliés. Chacune affirme que les discours qui incitent à la violence contreviennent aux règlements universitaires sur le harcèlement. Ces clarifications liminaires ne suffisent pas. Virginia Foxx leur demande : « Croyez-vous que l'État d'Israël a le droit d'exister en tant que nation juive ? » Les trois affirment en réponse le droit d'exister de l'État d'Israël – mais sans reprendre les derniers mots. Quant à Joe Wilson, républicain de Caroline du Sud, il somme chacune d'indiquer le pourcentage de conservateurs dans le corps professoral. Les présidentes ne pouvant répondre, puisqu'aucune université ne recueille ces données, il déduit qu'il n'y en a pas, ce qui serait la preuve d'un « illibéralisme », conclut-il, « dont le résultat est l'antisémitisme. »
Leur interrogatoire par Elise Stefanik, élue républicaine de New York, est aussitôt devenu viral. La nouvelle présidente du M.I.T., Sally Kornbluth, s'est présentée « en tant qu'Américaine et que juive » pour affirmer sa détestation de l'antisémitisme, et son engagement pour le combattre. Mais c'est dans les limites de la liberté d'expression : elle a souligné la différence profonde entre « ce que l'on a le droit de dire », et « ce que l'on devrait dire ». Elise Stefanik lui demande : « Appeler au génocide des juifs est-il en violation des codes de conduite du M.I.T. sur le harcèlement ? » « Je n'ai pas entendu d'appels au génocide sur notre campus. » « Mais vous avez entendu scander “intifada” ? » C'est du harcèlement « si des individus sont visés », répond la présidente du M.I.T., « de manière intrusive et persistante ». Même question pour Liz Magill : « oui ou non ? » La présidente de Penn (University of Pennsylvania) donne la même réponse, et ajoute : « si les mots deviennent un comportement, c'est du harcèlement. » La représentante s'emporte : « Le comportement, ça veut dire commettre un génocide ? » Même question pour Claudine Gay, présidente de Harvard, et même réponse. Comme ses collègues, au lieu d'un simple « oui » ou « non », cette politiste précise : « Cela dépend du contexte. » Elise Stefanik tranche alors : « Cela ne dépend pas du contexte. La réponse est oui, et voilà pourquoi vous devriez démissionner. »
Les trois présidentes ont donné, en substance, la même réponse : les codes de conduite respectent la liberté d'expression (garantie par le Premier amendement de la Constitution), et ils concernent le harcèlement (viser des individus avec insistance). Mais le compte-rendu officiel de la séance juge accablant leur consensus : « étant donné la réputation qu'ont les universités de promouvoir une complète convergence idéologique, ces témoignages sonnaient faux dès lors que c'étaient les mêmes mots que prononçaient les témoins. » Leur rappel des règles et des faits est donc inaudible : on y voit la confirmation d'une tolérance inexcusable pour l'antisémitisme. Comme naguère contre Elon Musk, la Maison Blanche met son poids dans la balance. Son porte-parole Andrew Bates réagit à nouveau : « C'est incroyable qu'il faille le dire : les appels au génocide sont monstrueux ; c'est l'antithèse de tout ce que notre pays représente. » Le président de l'ADL, Jonathan Greenblatt, l'en félicite.
L'émission satirique états-unienne Saturday Night Live se contente de moquer le jargon juridique des présidentes. La parodie d'Elise Stefanik s'en émerveille : « Suis-je en train de gagner ? » Mais c'est bien elle la cible principale : « Les discours de haine n'ont pas leur place sur les campus », continue son personnage, « seulement au Congrès, sur le Twitter d'Elon Musk », et bien sûr chez ses collègues et donateurs trumpistes. En revanche, son équivalent israélien, Eretz Nehederet, qui bénéficie désormais d'une audience internationale, poursuit sa campagne : après le sketch sur Columbia et avant celui sur Berkeley, un autre, non moins féroce, est consacré aux auditions, reconstituées dans l'univers d'Harry Potter. Les universitaires finissent par l'avouer, l'argent des Qataris serait la cause de leur tolérance pour les appels au génocide. C'est reprendre la nouvelle accusation des représentants républicains.
L'entretien que publie Ha'aretz avec un professeur de Harvard, Eric Maskin, prix Nobel d'économie, apporte dès son titre un tout autre éclairage : « Il n'y a guère d'antisémitisme à Harvard ». En revanche, « de l'antisionisme, sans aucun doute. » Tout est bien dans la définition. Et de confirmer : à sa connaissance, les étudiants pro-Palestiniens d'Harvard « n'ont jamais lancé d'appel au génocide ». De fait, « les juifs de Harvard ne sont pas leurs ennemis ; c'est de l'État d'Israël qu'ils ont à se plaindre. » Il est certes en désaccord avec eux ; mais il respecte leur engagement en faveur de ceux qu'ils estiment dominés. Selon lui, ils se trompent ; mais c'est par générosité. Ce juif new-yorkais est d'autant plus intéressant que, s'il apporte son soutien à Claudine Gay, en même temps, critique de Benyamin Nétanyahou, il approuve entièrement la politique pro-israélienne de Joe Biden. Non sans naïveté, la présidente s'est contentée de répondre à la question posée. Or « la plupart des universités ont une conception très libérale de ce que l'on peut dire. Si, pour la Constitution, ce n'est pas illégal, alors, on a le droit de le dire. »
Seule Sally Kornbluth échappe à ce jour à la tourmente. Liz Magill est aussitôt amenée à démissionner. « Et d'une, encore deux », jubile Elise Stefanik, citée et félicitée par Donald Trump. Quant à Claudine Gay, elle commence par s'excuser, mais l'offensive de la droite radicale ne s'arrête pas là. Christopher Rufo, un polémiste de la droite radicale qui s'est fait connaître par ses attaques contre les Études critiques sur la race à l'université puis contre les questions LGBT à l'école, fait pencher la balance avec des accusations de plagiat dans la thèse de Claudine Gay en 1997, qui porte justement sur l'impact positif de la diversité en politique. Si certains universitaires considèrent qu'il s'agit bien de plagiat, même mineur (reprendre verbatim des phrases d'auteurs que l'on nomme et discute, mais en omettant les guillemets), cette qualification a été récusée par les supposés plagiés eux-mêmes, à commencer par… son directeur de thèse. Cela n'y change rien. Le 2 janvier 2024, la première présidente noire de Harvard est acculée à la démission ; son mandat aura été le plus bref de l'histoire de cette université.
« Et de deux », claironne Elise Stefanik, qui s'engage à continuer la chasse aux sorcières. « Scalpée », jubile Christopher Rufo. Il lance un fonds de « chasse au plagiat » dans l'Ivy League et pavoise : « C'est le début de la fin pour la diversité (DEI) dans les institutions américaines. » En même temps, Bill Ackman, un investisseur milliardaire, lance un appel pour enquêter sur le corps professoral. Il veut investir dans l'Intelligence Artificielle pour faire tomber des têtes : « cela pourrait mener à des licenciements en masse d'universitaires, à des donateurs qui cessent de donner et à l'annulation de financements fédéraux. »
Claudine Gay l'a bien compris : au lendemain de sa démission, elle explique dans le New York Times : « ce qui vient d'arriver à Harvard est plus grand que moi. » À l'heure du trumpisme, « des campagnes de ce genre commencent souvent par des attaques contre l'éducation et l'expertise, car ce sont les meilleurs outils pour percer à jour la propagande. » La droite de la droite a bien raison de triompher : son récit s'impose comme une vérité – jusqu'en France : pour expliquer la démission de la présidente de Harvard, Le Monde répète qu'elle « n'avait pas clairement condamné des appels au génocide des juifs lancés sur le campus depuis le 7 octobre. » Et tant pis s'il n'y a pas eu de tels appels, si elle en a condamné le principe, et si elle a simplement rappelé les règles existantes en matière de harcèlement, conformément à la question qui lui était posée.
Le retour de la race
Il se trouve que ces mêmes universités étaient depuis quelques années accusées par cette même droite d'entraver la liberté d'expression : c'est la polémique contre la (supposée) « cancel culture ». Cette fois, qu'importe la liberté d'expression : sur de nombreux campus, des associations pro-palestiniennes, soupçonnées de soutenir le Hamas, sont bannies, d'autres réduites au silence ; des manifestations sont interdites, et des conférences annulées. Mais, dans ces situations, nul ne parle de « culture de l'annulation ». Désormais, la gauche universitaire est taxée, non plus de « maccarthysme », mais de laxisme. Ce serait justement la preuve qu'elle est partisane – intolérante avec les uns, tolérante pour les autres. Ainsi, pour le représentant républicain de l'Indiana Jim Banks, « Penn impose des règles aux discours qui lui déplaisent. » C'est donc une nouvelle attaque contre le (présumé) « wokisme ». D'ailleurs, un représentant républicain de l'Utah, Burgess Owens, interpelle aussi Claudine Gay (comme elle, il est noir) sur la « ségrégation raciale » à Harvard (c'est-à-dire sur des événements non-mixtes, réservés aux minorités). Au motif de s'attaquer à l'antisémitisme, l'antiracisme devient la cible – paradoxalement, comme pour les idéologues antisémites du Grand remplacement.
Ce retour de la race joue un rôle crucial dans la polémique sur l'antisémitisme. Revenons à Bill Ackman, l'un des plus virulents critiques de Harvard dont il est un ancien étudiant, comme Elise Stefanik. Il ne se contente pas de faire campagne sur les réseaux sociaux contre la présidente, qui n'aurait pas assez tenu compte de ses préconisations. Appelant à sa démission, il va jusqu'à remettre en cause sa nomination : « réduire le nombre de candidatures sur un critère de race, de sexe ou de sexualité, ce n'est pas la bonne manière de recruter les meilleurs pour diriger nos universités les plus prestigieuses. » Autrement dit, Claudine Gay devrait son poste à sa couleur. Et de reprendre un argument classique contre les politiques de discrimination positive que les juges conservateurs de la Cour suprême ont récemment bannie : « Il n'est pas bon, quand on se voit décerner la charge de président, de se retrouver à une place qu'on n'aurait pas eue sans un sacré coup de pouce dans la balance. » Bref, avec l'extrême droite, Bill Ackman s'en prend aux politiques de diversité (DEI) qui seraient la cause profonde de l'antisémitisme.
C'est la réduction du Grand remplacement à sa dimension antisémite qui a rendu possible ce retournement. La preuve ? Il est un contexte qui disparaît dans la charge menée contre les universités censément coupables de « wokisme », et donc d'antisémitisme. Républicaine modérée, Elise Stefanik s'est convertie au trumpisme jusqu'à se proclamer « ultra-MAGA » (Make America Great Again). Après l'insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole, Harvard l'a exclue d'un comité consultatif pour avoir refusé de reconnaître le résultat des élections et voté contre l'investiture du nouveau président. Quelques mois plus tard, elle a affirmé que les Démocrates s'apprêtaient à fomenter « une insurrection électorale permanente ». Comment ? « Leur plan, accorder une amnistie aux onze millions d'immigrés illégaux, renversera notre corps électoral actuel pour créer une majorité libérale permanente à Washington. » C'était reprendre à son compte la théorie complotiste du Grand remplacement.
Pour les Démocrates, en 2022, l'attentat de Buffalo, dans l'État de New York dont elle est représentante, qui visait des Noirs en considérant le Grand remplacement comme un « génocide blanc », a été l'occasion de dénoncer les conséquences de tels discours. Mais les Républicains se sont refusés à toute remise en cause – à l'exception de Liz Cheney : elle a pointé du doigt la responsabilité des dirigeants républicains pour avoir « encouragé le nationalisme blanc, le suprémacisme blanc et l'antisémitisme » de ceux qui n'hésitent pas à parler de « génocide blanc. » Cette vigoureuse critique de la dérive trumpiste a été écartée pour faire place à Elise Stefanik. Alors que celle-ci fait aujourd'hui la leçon à des présidentes d'universités, les commentateurs s'abstiennent de rappeler, du moins aux États-Unis, cet épisode récent, qui éclaire pourtant son usage du mot « génocide ».
On peut d'ailleurs s'interroger sur la sincérité de l'engagement d'Elise Stefanik contre l'antisémitisme : jamais elle n'a dit un mot contre Donald Trump lorsqu'il a estimé en 2017 qu'à Charlottesville, malgré les violences pendant les manifestations des néo-nazis, « il y avait aussi des gens très bien des deux côtés », ni en 2022 quand il dînait avec des antisémites notoires comme Kanye West et Nick Fuentes dans sa propriété de Mar-a-Lago. On comprend pourquoi elle rejette le mot « contexte » (utilisé par les trois présidentes) : aux États-Unis comme en France et ailleurs, les réactionnaires s'en prennent aux sciences sociales dont la vocation est précisément de contextualiser. C'est ainsi qu'ils imposent leur version des faits en même temps que leur vision du monde. En l'occurrence, faire abstraction des contextes dans cette controverse lancée par la droite républicaine ne permet pas de comprendre la manœuvre politique derrière leur rhétorique de lutte contre l'antisémitisme. Tout se passe en réalité comme si l'invocation de l'antisémitisme redéfini comme antisionisme permettait surtout de ne plus rien dire du racisme, sauf celui attribué à l'antiracisme.
À son insu, la Maison Blanche aura contribué à légitimer ce discours de la droite radicale en condamnant la théorie complotiste du Grand remplacement sans référence à son fondement xénophobe et raciste. En même temps, au Congrès, on fait le procès des universités, et non pas d'Elon Musk. C'est à ces institutions qu'on fait grief de la liberté d'expression qu'elles défendent, pas à celui qui, au nom de cette même liberté, a transformé son réseau social en chambre d'écho du racisme et de l'antisémitisme. Elon Musk peut continuer tranquillement ses posts sur le Grand remplacement ; il se contente de ne pas le nommer. Désormais, il s'en prend, non plus aux juifs, mais seulement aux politiques de diversité dont la présidente de Harvard serait l'incarnation : « DEI discrimine en raison de la race, du sexe, etc. : ce n'est pas seulement immoral, c'est aussi illégal ». Et de reposter Bill Ackman, pour qui « la racine de l'antisémitisme », c'est « une idéologie diffusée sur les campus en termes d'oppresseurs et d'opprimés », bref, Diversity, Equity, and Inclusion.
Tel est le sens commun de la droite républicaine. Le problème, ce n'est plus le racisme ; comme en France, c'est l'antiracisme, qui en serait le nouveau visage. Aujourd'hui, les partisans de la diversité ne sont-ils pas réputés complices de l'antisionisme ? Autrement dit, à l'heure du retour en force d'un antisémitisme d'extrême droite qui va jusqu'à se réclamer ouvertement du nazisme, on s'en prend, en même temps qu'aux juifs libéraux lorsqu'ils financent les universités, à la gauche intellectuelle. « On ne peut plus rien dire » : telle était hier encore la plainte opposée au « wokisme ». Aujourd'hui, sous prétexte de lutter contre un « nouvel antisémitisme », c'est plutôt l'injonction : « Taisez-vous ! »
Éric Fassin
SOCIOLOGUE, PROFESSEUR DE SOCIOLOGIE ET D'ÉTUDES DE GENRE À L'UNIVERSITÉ PARIS 8, MEMBRE DE L'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FRANCE ET CHERCHEUR AU LABORATOIRE SOPHIAPOL
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

« Le fascisme haut et fort » : D. Trump amplifie son discours raciste et l’extrême droite fais des plans pour une lente guerre civile

Nous allons maintenant examiner le langage de plus en plus autoritaire de Donald Trump dans ses discours de campagne.
Democracy Now, 21 décembre 2023
Traduction, Alexandra Cyr
Nermeen Shaikh : Nous allons maintenant examiner le langage de plus en plus autoritaire de Donald Trump dans ses discours de campagne. Durant la dernière fin de semaine, il a déclaré que les immigrants.es « empoisonnent le sang » de la nation.
Donald Trump : « Quand ils laissent…..je pense que le nombre exact de gens (entrés) dans notre pays est de 15 ou 16 millions. Quand ils font cela, nous avons beaucoup à faire. Ils empoisonnent le sang de notre pays. C'est ce qu'ils ont fait. Ils nous ont empoisonnés.es ».
N.S. : Ces remarques ont suscité un très grand nombre de critiques. La Vice-présidente, Kamala Harris a déclaré que ces termes étaient « semblables à ceux d'A. Hitler » Mais, mardi, D. Trump en a rajouté en Iowa durant un discours de campagne.
D.T. : Ce qui se passe est fou. Ils ruinent notre pays. Et c'est vrai : ils détruisent le sang du pays. C'est ce qu'ils font. Ils détruisent notre pays. Ils n'aiment que je dise cela. Je n'ai jamais lu Mein Kampf. Ils disent « Oh, Hitler a dit cela » de manière très différente ».
Amy Goodman : Donald Trump se tenait entre deux arbres de Noël.
Jeffe Sharlet nous rejoint maintenant. Il est un journaliste primé, auteur et professeur d'Anglais et d'écriture créative au Collège Dartmouth. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont The Undertow : Scenes from a Slow Civil War. Les caucus de l'Iowa et les primaires du New Hampshire sont les premiers et les premières du parti Républicain. Les Démocrates ont changé leur calendrier.
Jeff, d'abord pouvez-vous réagir à ces mots de « empoisonnement du sang » et la comparaison avec A. Hitler ? L'épouse de D. Trump, la mère du premier de ses trois fils, Ivana Trump, qui est décédée suite à une chute dans un escalier il y a quelques temps, a déclaré qu'il avait des extraits d'un livre d'A. Hitler sur sa table de chevet. (…)
Jeff Sharlet : C'est assez fascinant d'entendre D. Trump affirmer « Je n'ai jamais lu Mein Kampf ». Il semble que le livre qu'il est censé avoir eu récemment, est un livre différent d'Hitler. Mais ce qui m'interpelle c'est qu'il sorte de sa piste quand il parle ainsi alors que les comparaisons sont déjà faites. Il invoque cela parce que c'est une forme de chaos et que c'est dramatique. Je pense aussi qu'il compte sur le fait qu'il tirera plus profit auprès de sa base par le grand drame hitlérien de la deuxième guerre mondiale que par les comparaisons avec le pire dictateur fasciste de l'histoire. Je ne pense pas qu'il creuse cela, je crois plutôt qu'il va vers ça.
N.S. : Donc, que pensez-vous que seront les conséquences si on prend au sérieux ce langage ? Aussi, est-ce que cela pourrait faire diminuer ses appuis ou plutôt les augmenter ?
J.S. : Nous ne pouvons…tout ce que nous avons à faire, c'est d'examiner ce qui se passe. Cela augmente ses appuis. Et encore une fois, il comprend que la dramatisation et le spectacle sont ses atouts.
Mais, quant à la prise au sérieux de ces propos, je suis très content que la presse suive cette course comme si c'en était une de chevaux plutôt qu'au dernier soupir que nous pourrions….accrochons-nous à ce que nous à ce que la démocratie américaine possède encore. Commençons par examiner quelque chose qui se nomme Projet 2025. C'est un document de 900 pages réalisé par des alliés de D. Trump, la Fondation Héritage financée par l'argent des Koch. La presse a fait grand cas des Koch quand ils ont endossé la candidate Nikki Haley pour cacher leur mise (ailleurs). Un document de 900 pages pour le premier jour (suivant l'élection de 2024). Rappelez-vous que D. Trump a déclaré : « Le premier jour je serai un dictateur ». C'est une autre miette de langage pour mettre la presse sur le fil. « C'est une farce. Non non, le premier jour je serai un dictateur ; ce n'est qu'une farce. Qu'est-ce que je disais ? Dictateur ». Encore une fois, plus important que la substance (des mots), c'est le spectacle, la dramatisation qui le rend excitant dans le sens fasciste du mot, un homme d'action. Et vous avez ce document diffusé agence de presse par agence de presse qui contient les vues de tous les groupes de droite, avec un personnel de 20,000 individus et qui prévoit déjà recruter 5,000 avocats.es qui mèneront la bataille en parlant de camps de concentration, de surveillance interne, donc toutes les facettes d'un véritable gouvernement fasciste. Il n'a pas besoin de lire tout ça comme il n'a pas besoin d'avoir lu Mein Kampf pour mettre de l'avant ce contenu.
A.G. : Ce que les gens doivent comprendre c'est que ce document de 920 pages comme vous avez dit, écrit par la Fondation Héritage et financé par les frères Koch parle de réduire le financement du Département de la justice, de démanteler le FBI, de disloquer le Département de la sécurité intérieure (Homeland Security), celui de l'éducation et du commerce. Le sous-titre de votre prochain livre est : The Undertow, Scenes From a Slow Civil War. Nous allons bientôt entrer en 2024, pouvez-vous nous donner un avant-goût de ce que veut dire : « slow civil war » ?
J.S. : Il faut d'abord voir les conséquences qui sont déjà là : les femmes enceintes qui sont forcées d'avoir leur enfant ou souffrir physiquement et même mourir ; l'épidémie de suicides chez les personnes trans et queers ; toutes ces facettes sont celles d'une concentration de politiques fascistes. La lente guerre civile se met aussi en place par des lois qui empêchent les gens d'obtenir ce dont ils ont besoin. Ce sont les retombées de cette lente guerre civile.
Ce que ce document nous apprend, c'est qu'il y aura une accélération de tout ça. Le plan est conçu pour une période de 180 jours environ. La Fondation Héritage a fait sa réputation avec un document du genre qu'elle a élaboré pour Ronald Reagan en 1980. 60% en avait été installé au cours de premiers six mois de son administration. Ils s'y réfèrent et ajoutent : « OK mais c'était pour Reagan. Maintenant nous sommes dans l'ère Trump. Nous devons aller beaucoup plus loin ». C'est le terme qu'ils emploient : « beaucoup plus loin ».
N.S. : Jeff, à quel point diriez-vous que ce document est représentatif du mouvement conservateur d'extrême droite ? Et pensez-vous qu'avec ou sans l'élection de D. Trump, certaines de ces politiques seront mises en place ou qu'au moins on tentera de les faire adopter ?
J.S. : Je pense que c'est l'autre aspect dont il faut se souvenir. Si par un coup de chance, Nikki Haley en fin de compte (gagne, je ne prends pas cette possibilité au sérieux), mais si ça arrivait, c'est tout prêt pour elle aussi. Mais c'est aussi tout prêt pour le militantisme de droite. Il porte le signe du trumpisme. Et ça ne vient pas de n'importe quel groupe mais de la Fondation Héritage, de l'Alliance for Defending Freedom qui, en passant est le groupe responsable du retrait de l'arrêt Roe contre Wade. On y trouve aussi des organisations chrétiennes de droite, des intellectuels.les du Claremont Institute et du Hillsdale College comme s'ils et elles étaient de droite. Nous sommes face à une convergence. Le document compte 400 contributeurs.rices beaucoup, vraiment beaucoup sont d'anciens représentants.es de l'administration Trump et des entreprises à contrat dans le domaine de la défense. Je pense que ce document est aussi conçu pour mettre de l'avant une fois pour toute, tout ce que les compétences des bourreaux de travail peuvent employer pour concrétiser la furie du fascisme à la Trump. Comme si le mot d'ordre était : « OK Tout le monde au travail ! C'est le cadre, c'est le projet ». C'est un projet de trumpisme peu importe où cet homme se retrouve.
A.G. : Finalement, Jeff, vous êtes au New Hampshire. Nikki Haley y a reçu l'appui officiel du gouverneur de l'État, M. Sununu. Qu'est-ce que cela signifie ? Et elle a répondu au discours de D. Trump à propos de la pollution du sang du pays, que cela n'aidait en rien. Pouvez-vous, en finissant, nous parler des effets de ce type de langage, comment il façonne tout le discours et comment pensez-vous que les médias devraient traiter ce fait ?
J.S. : J'ai été impressionné de voir qu'ils ont pris un petit peu de hauteur récemment non seulement avec cette partie des termes mais aussi en rappelant celui de « vermine », un mot lié à l'extermination. Il est important de se rappeler que l'expression « empoisonnement du sang », n'appartient pas qu'à Mein Kampf, mais représente un courant sous-jacent qui traverse le discours de la droite américaine. J'ai examiné un document titré The American Mercury daté de 1957. Il s'agit d'une publication de droite pour les procès civiques. On croirait que ça a été écrit hier et l'expression « empoisonnement du sang » s'y trouve. C'est ce genre de procédé qui a toujours été là en douce et que D. Trump porte maintenant sur la scène nationale lui donnant une plateforme que l'extrême droite a toujours voulue et qu'elle avait un tout petit peur de proclamer, je pense. Ils avaient peur : « si nous disons cela tout haut, il se peut que nous perdions des gens ». Maintenant ils découvrent que les gens qu'ils attendaient viennent vers eux parce que le mot en F, fascisme, est prononcé haut et fort.
A.G. : Merci, Jeff Sharlet.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Condamner la chasse publique aux sorcières

Source médias : la présidente et directrice générale de la table ronde des femmes noires (black women's roundtable) condamne la chasse aux sorcières publique contre la présidente de l'université de Harvard qui a dû démissionner
Traduction Johan Wallengren
Washington - Melanie L. Campbell, présidente et directrice générale de la National Coalition on Black Civic Participation (Coalition nationale pour la participation civique des Noirs) et organisatrice de la Black Women's Roundtable, exprime ses vives préoccupations en rapport avec la démission de Claudine Gay, présidente de l'université de Harvard. La campagne menée par le milliardaire Bill Ackman, qui a fait fortune dans les fonds spéculatifs (hedge funds), a grandement contribué à ce dénouement. Cette tournure des événements est perçue non seulement comme un incident individuel, mais comme le résultat d'une attaque de plus grande envergure contre les valeurs de la diversité, de l'équité et de l'inclusion (DEI) non seulement dans la sphère de l'enseignement, mais aussi dans d'autres secteurs de la société.
Melanie Campbell est une source largement reconnue lorsqu'il s'agit de traiter des droits civils et de la justice sociale. Elle est disponible pour commenter dans les médias les implications de la démission forcée de la présidente Gay, qu'elle décrit comme une illustration inquiétante de la chasse aux sorcières en cours visant le leadership des femmes noires et les initiatives DEI pour lesquelles elles militent. Ce qui est arrivé à Claudine Gay va au-delà de sa seule personne ; c'est un message clair adressé à toutes les femmes noires qui cherchent à atteindre l'excellence dans leurs domaines d'activité respectifs. De tels actes sapent les progrès durement acquis dans notre lutte pour l'égalité et la représentativité.
La NCBCP, Coalition nationale sur la participation civique des Noirs [1], est l'une des organisations de défense des droits civiques et de la justice sociale les plus actives aux États-Unis. Elle œuvre pour un engagement accru des Noirs américains à l'égard de leurs droits civiques, économiques et électoraux.
La BWR, Table ronde des femmes noires [2], est la branche de la NCBCP qui aide les femmes et les jeunes filles à faire valoir leurs droits.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Guerre à Gaza : « Israël semble décidé à en découdre avec le Hezbollah et l’Iran à la faveur du soutien américain »

Le chercheur Gilbert Achcar analyse les conséquences pour le Moyen-Orient de l'attaque perpétrée le 7 octobre par le Hamas et de la guerre menée par Israël. Il revient sur le comportement du Hezbollah libanais, des Houthis yéménites mais aussi sur celui de l'Iran, « qui n'était pas partie prenante ».
Tiré de Europe Solidaire Sans Frontières
2 janvier 2024
Par Gilbert Achcar et Pierre Barbancey
Gilbert Achcar est professeur en relations internationales et études du développement à l'École des études orientales et africaines (Soas) de l'université de Londres. Observateur attentif des évolutions du Moyen-Orient, il constate que l'Iran et ses alliés régionaux ont reproché au Hamas de ne pas les avoir consultés avant l'attaque du 7 octobre. Pour lui, le mouvement islamiste s'est trompé en surestimant son impact régional et ses alliances.
Quel impact a eu l'attaque du 7 octobre au Moyen-Orient ?
Ce n'est pas tant le 7 octobre qui a des répercussions sur le plan régional que la guerre qui a suivi. Celle-ci va bien au-delà de toutes celles menées précédemment par Israël dans la bande de Gaza. Elle constitue déjà l'épisode le plus terrible, le plus sanglant de l'histoire palestinienne.
Jamais un massacre de cette nature et de cette intensité n'a été commis par Israël depuis sa création en 1948, depuis la Nakba, la catastrophe, c'est-à-dire l'expulsion de la grande majorité des Palestiniens du territoire sur lequel s'est établi le nouvel État. Nous sommes devant une seconde Nakba qui dépasse en intensité la précédente. Cela a un impact considérable sur la situation régionale.
Évidemment, le processus qu'on appelle la « normalisation » entre Israël et un certain nombre d'États arabes s'en trouve bloqué. Le dernier en cours concernait le royaume d'Arabie saoudite, sur lequel l'administration américaine se concentrait. La colère est forte au sein des opinions publiques de la région [1] , tout comme le ressentiment qui s'installe face à l'État d'Israël.
C'est d'autant plus important que, pour l'instant, il n'y a aucune clarté sur ce qui adviendra de la bande de Gaza une fois que les opérations militaires cesseront. Tout cela a ravivé la question palestinienne dans les opinions publiques locales, régionales et même mondiale, en lui donnant une ampleur sans précédent.
Le risque de déflagration régionale existe-t-il ?
Il semblerait que l'Iran et ses alliés aient reproché au Hamas de ne pas les avoir consultés. On sait que l'opération du 7 octobre a été conçue par un très petit noyau d'au plus cinq personnes. Selon une enquête récente, le Hamas aurait prévenu le Hezbollah libanais une demi-heure seulement avant le déclenchement de l'attaque.
L'Iran ne se considère pas tenu de s'associer à cet acte de guerre parce qu'il n'y a pas eu de préparation commune. C'est une façon de s'excuser de ne pas se lancer dans ce que souhaitait le Hamas, c'est-à-dire une guerre régionale. Le Hezbollah a pris soin de limiter les échanges de tirs, sans recours aux missiles de longue portée.
Il y a eu quelques actes ici ou là de milices en Irak, mais rien d'important. Et puis, il y a aussi les Houthis au Yémen. Mais ces derniers ont une relation encore plus distante avec l'Iran que celle du Hezbollah ou des milices irakiennes.
Quand on lit la déclaration du chef militaire du Hamas, Mohammed Deif, le matin du 7 octobre, on comprend mieux l'esprit qui a animé les instigateurs de l'attaque. On trouve d'abord un discours religieux. Le Hamas est une organisation intégriste islamique. Il a une vision religieuse qui invoque une intervention divine auprès des combattants engagés dans l'opération.
Il appelle ensuite les Palestiniens, où qu'ils se trouvent, puis les Arabes, puis les musulmans et, en particulier, l'Iran et ses auxiliaires régionaux. Il y avait donc cette illusion que l'opération allait déclencher un embrasement régional et qu'Israël serait mis en mauvaise posture, à devoir se battre sur plusieurs fronts à la fois. Mais cela n'a pas eu lieu. Le contraste entre l'attente de ceux qui ont fait l'opération et ce qui s'est passé en réalité montre bien que l'Iran n'était pas partie prenante.
Cela dit, Israël semble décidé à en découdre avec le Hezbollah et peut-être même avec l'Iran à la faveur du soutien américain à la guerre en cours. Le Hezbollah risque de voir son appui limité, quasi symbolique, au Hamas se retourner contre lui en fournissant un prétexte à Israël d'une agression de grande envergure.
Comment analysez-vous l'implication des Houthis du Yémen ?
Ils interviennent d'une manière plus spectaculaire que le Hezbollah. Ils s'en prennent aux bateaux qui desservent Israël en passant par le détroit de Bab el-Mandeb. Les États-Unis ripostent directement et mettent sur pied une coalition pour la protection de la navigation en mer Rouge.
Mais ce qu'on oublie à propos du rôle des Houthis, c'est le conflit yéménite lui-même. Ils relèvent d'une branche du chiisme au sens large et pratiquent une surenchère anti-israélienne vis-à-vis de l'autre camp au Yémen qui, de surcroît, est sunnite comme le Hamas. Pour eux, l'enjeu est de politique locale. Les Houthis s'érigent ainsi en représentants de l'ensemble du peuple yéménite, ainsi qu'en musulmans au-delà des différences confessionnelles. Mais je crois qu'ils freineront dès qu'il y aura une menace sérieuse à leur égard. Ils ont fait un grand coup médiatique qui ne leur a pas coûté grand-chose jusqu'ici. Je doute qu'ils aillent plus loin.
Cela signifie-t-il que le Hamas a décidé de tenir un rôle régional beaucoup plus important que celui qu'il jouait jusqu'à présent ?
Le Hamas a compté sur ses alliances et son impact régional pour que tout cela explose en même temps à la faveur de ce détonateur qu'aurait été l'opération du 7 octobre. C'était un mauvais calcul, même en invoquant l'intervention divine. Il a sous-estimé l'impact qu'aurait son opération sur Israël même, tout en surestimant son impact sur l'environnement arabe et régional, Iran inclus.
En Israël, l'extrême droite est au pouvoir. Une bonne partie de celle-ci considère que le retrait israélien de Gaza en 2005 était une erreur, et souhaite réoccuper ce territoire, et même l'annexer, puisque ce sont des partisans du Grand Israël, d'un État d'Israël qui engloberait les territoires occupés en 1967, Gaza et la Cisjordanie. Dès lors, il était évident que ce qui allait résulter de l'opération serait une catastrophe d'une ampleur inouïe.
On le voit avec le plan élaboré par le ministère israélien du Renseignement évaluant les scénarios de fin de guerre, la coïncidence de la publication de ces scénarios avec l'appel à la population palestinienne à se déplacer en masse vers le Sud. Près de 90 % de la population de Gaza ont été ainsi déplacés. Il était impensable qu'Israël puisse, à froid, se lancer dans la reconquête de Gaza souhaitée par l'extrême droite. Et d'ailleurs, il a fallu trois semaines, après le 7 octobre, pour que l'opération terrestre commence, ce qui montre bien qu'Israël n'était pas prêt.
Où tout cela peut-il mener ?
Je suis malheureusement pessimiste en ce qui concerne le sort des Palestiniens, parce que l'on assiste depuis longtemps à un glissement continu de l'État d'Israël vers l'extrême droite. De l'autre côté, il y a le pourrissement de l'Autorité palestinienne en Cisjordanie, rejetée par l'écrasante majorité de la population, et il y a les actions du Hamas. La situation a maintenant atteint un paroxysme avec cette guerre effroyable que mène Israël.
On est entré dans un nouveau cycle de radicalisation extrémiste en réaction à la barbarie de l'invasion israélienne de la bande de Gaza. Cette radicalisation ne se limitera pas à la région : comme d'habitude, elle débordera sur l'Europe, voire sur les États-Unis. De ce point de vue, les gouvernements occidentaux ont fait preuve de myopie extrême dans leur soutien inconditionnel à l'État d'Israël.
À l'échelle régionale, la situation est très assombrie, surtout si on y ajoute le fait que ce qui restait des dynamiques révolutionnaires enclenchées avec ce qu'on a appelé le Printemps arabe en 2011 a été liquidé…
Il reste quand même des raisons d'espérer, cependant. Ce qui a causé les deux vagues de soulèvements régionaux en 2011 et 2019, c'est la crise structurelle, socio-économique, profonde de la région. Une crise qui est loin d'être résolue. On devrait donc assister à de nouveaux épisodes de luttes sociales comme on l'a vu au Maroc ces derniers mois. C'est sur le plan social, sur le plan des luttes de classe, qu'il faut s'attendre à ce que de nouvelles perspectives s'ouvrent pour la région.
Abonnez-vous à la Lettre de nouveautés du site ESSF et recevez par
courriel la liste des articles parus, en français ou en anglais.
P.-S.
l'Humanité
Notes
[1] Gilles Achcar est l'auteur de La Poudrière du Moyen-Orient (2007), avec Noam Chomsky. Il vient de publier La Nouvelle Guerre froide : États-Unis Russie et Chine, du Kosovo à l'Ukraine aux Éditions du Croquant
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Hamas, son histoire, son développement. Une perspective critique

Dans cet article, le chercheur et militant internationaliste Joseph Daher revient sur les origines, le développement, l'orientation politique et la stratégie du Hamas, dans une perspective marxiste critique, tout en soulignant que « toute critique sérieuse du Hamas ne peut être formulée sans une opposition claire à l'État d'apartheid raciste et colonial d'Israël« .
Tiré de Contretemps
2 janvier 2024
Par Joseph Daher
L'armée d'occupation israélienne mène une guerre génocidaire contre la population palestinienne dans la bande de Gaza. Les 2,4 millions d'habitants de la bande de Gaza vivent sous des bombardements israéliens constants d'une violence sans précédent. Plus de 20 000 personnes ont été tuées par les frappes israéliennes. Plus de 1,9 million de Palestiniens sont déplacés dans la bande de Gaza, représentant plus de 85 % de la population totale du territoire. Il s'agit à bien des égards d'une nouvelle Nakba, après celle de 1948, au cours de laquelle plus de 700 000 Palestiniens ont été chassés de force de leurs foyers et sont devenus des réfugiés. Ce processus de nettoyage ethnique, qui ne s'est jamais arrêté, se poursuit aujourd'hui.
Le Hamas est diabolisé depuis ses attentats du 7 octobre 2023, qui ont entraîné la mort de plus de 1 139 individus, y compris 695 civils israéliens, 373 membres des forces de sécurité et 71 étrangers[1]. Quelles sont les origines de ce parti et comment s'est-il développé ? Quelle est l'orientation politique et la stratégie du Hamas, ainsi que ses alliances régionales ?
Avant de discuter de la nature politique du Hamas et de développer une perspective critique sur le parti islamique palestinien, il est nécessaire de clarifier certaines positions politiques. Premièrement, Israël a toujours été un projet colonial de peuplement visant à établir, maintenir et étendre son territoire, cherchant à déplacer continuellement par la violence les Palestiniens de leurs territoires. Des groupes comme Human Rights Watch (HRW) et Amnesty International ont également qualifié l'État israélien de régime d'apartheid. Deuxièmement, tout au long de son histoire, le mouvement sioniste, puis l'État israélien, se sont alliés aux puissances impérialistes occidentales et ont obtenu leurs soutiens, d'abord celui de l'empire britannique, puis celui des États-Unis. Le génocide actuel dans la bande de Gaza se déroule avec le soutien actif de toutes les puissances impérialistes occidentales, des États-Unis à l'Union européenne. La très grande majorité des classes dirigeantes occidentales soutiennent la propagande meurtrière de l'Etat d'Israël sur le « droit d'Israël à se défendre ». Cela signifie que les Palestiniens ne luttent pas seulement contre l'État israélien, mais aussi contre l'ensemble du système impérial occidental.
Dans ce contexte, les partisans de la lutte palestinienne pour la libération et l'émancipation doivent réaffirmer le droit à la résistance des opprimé.es face à un régime d'apartheid, raciste et colonial. En effet, comme toute autre population confrontée aux mêmes défis et menaces, les Palestinien.nes jouissent de ces droits, y compris par des moyens militaires. Certes, il ne faut pas confondre cela avec le soutien aux perspectives politiques des différents partis politiques palestiniens, ni avec toutes sortes d'actions militaires menées par ces acteurs, conduisant notamment au meurtre aveugle de nombreux civils comme le 7 octobre[2].
Pour l'État israélien, la question n'est en effet pas la nature de l'acte de résistance des Palestinien.ne.s, qu'il soit pacifique ou armé, ni même son idéologie, mais le fait que toute contestation des structures d'occupation et de colonisation doit être criminalisée et réprimée. Avant le Hamas et jusqu'à aujourd'hui, les factions de l'OLP, des organisations à la gauche du Fatah, les progressistes et démocrates palestinien.ne.s, ainsi que les civils sans idéologie affirmée, ont tous subi la répression israélienne. Tout comme les manifestations très largement pacifiques vers la barrière de séparation israélienne organisés par de jeunes manifestants au cours des derniers mois, et avant cela en 2018-19, également connues sous le nom de « Grande marche du retour », ont toutes été violemment réprimées par l'armée d'occupation israélienne, notamment par des tirs à balles réelles, des gaz lacrymogènes, et même des frappes aériennes. De nombreuses personnes ont été tuées, et des blessés parmi les manifestants désignés comme « terroristes ».
Plus généralement, la violence utilisée par l'oppresseur pour maintenir ses structures de domination et d'assujettissement ne devrait jamais être comparée ou mise sur le même plan que la violence de l'opprimé qui tente de restaurer sa propre dignité et qui cherche à faire reconnaître son existence.
La nature de l'État israélien et ses politiques ont créé les conditions pour le type d'actions qui se sont produites le 7 octobre, tout comme n'importe quel acteur colonial et occupant à travers l'histoire. Il est donc très important de situer l'attaque du Hamas dans le contexte colonial historique de la Palestine.
Dans cette perspective, toute critique sérieuse et honnête du Hamas ne peut être formulée sans une opposition claire à l'État d'apartheid raciste et colonial d'Israël, visant à son démantèlement, et à un soutien à l'autodétermination des Palestiniens, à leur droit à la résistance, et à leurs droits fondamentaux contre l'occupation, comprenant la fin de la colonisation, l'égalité pour les Palestiniens et un droit au retour garanti pour les réfugiés palestiniens.
Ce n'est qu'à partir de là que nous pouvons développer une critique du mouvement palestinien Hamas, son orientation politique et sa stratégie.
Origines et évolutions du Hamas
Le Hamas, acronyme arabe de « Mouvement de résistance islamique », a été officiellement créé en décembre 1987, au début de la première Intifada palestinienne. Ses racines remontent cependant à l'organisation égyptienne des Frères musulmans (FM), active dans la bande de Gaza depuis les années 1940, et à l'association al-Mujamma al-Islami fondée par Cheikh Ahmad Yassin[3] en 1973 à Gaza et légalisée par l'armée d'occupation israélienne en 1979. Al-Mujamma al-Islami a été créé et a agi comme une organisation de façade pour les activités des FM à Gaza.
Les autorités d'occupation israéliennes ont initialement encouragé le développement des structures d'al-Mujamma al-Islami dans toute la bande de Gaza, en particulier les institutions sociales et les activités politiques. Pour les forces d'occupation israéliennes, il s'agissait naturellement d'affaiblir le camp nationaliste et de gauche, en encourageant l'alternative islamique. En effet, les FM avaient décidé d'adopter un comportement de non-confrontation envers les forces d'occupation israéliennes et se sont d'abord concentrés sur l'islamisation de la société. Le choix de la confrontation non armée avec l'occupant israélien a été contesté au sein des FM au début des années 1980 et une nouvelle entité politique, le Jihad islamique, dirigé à Gaza par Fathi Shikaki, a été créée sur cette division. Shikaki a également été inspiré par la révolution islamique en Iran et par l'idéologie de l'ayatollah Ruhollah Khomeini.
La confrontation non armée avec Israël a pris fin avec la création du Hamas en 1987, notamment sous la pression d'une partie de la base du parti, particulièrement de jeunes militants, qui critiquaient l'absence de résistance à l'occupation israélienne. Ils plaidaient pour une politique plus conflictuelle contre l'occupant israélien, contrairement à la pensée traditionnelle axée d'abord sur l'islamisation de la société. Le déclenchement de l'Intifada en 1987 a permis aux partisans d'une ligne de résistance contre l'occupation de gagner une position plus forte au sein du mouvement. Ils ont convaincu les plus récalcitrants, en arguant notamment que le mouvement des FM et al-Mujamma al-Islami dans les territoires occupés subiraient une grande perte de popularité s'ils refusaient de s'impliquer dans l'Intifada[4]. En même temps, la popularité croissante du Jihad islamique dans sa résistance militaire contre les autorités d'occupation israéliennes constituait de plus en plus une menace directe pour les FM en termes de base populaire.
Un accord a finalement été trouvé entre la vieille garde conservatrice, favorable à une approche non conflictuelle avec Israël et composée principalement de commerçants urbains et de membres issus de la classe moyenne supérieure, et une jeune génération de nouveaux cadres militants, favorables à la résistance et composée pour la plupart d'étudiants issus de la classe moyenne inférieure et des camps de réfugiés, par la création du Hamas en tant qu'organisation affiliée distincte. Les membres des FM qui n'étaient pas d'accord avec sa création pouvaient rester au sein de l'organisation sans rejoindre le Hamas. La création du Hamas était un moyen de rejoindre l'Intifada sans mettre directement en péril l'avenir des institutions du mouvement et de l'association al-Mujamma al-Islami. Avec cette formule, en cas d'échec de l'Intifada, c'est la responsabilité du Hamas qui serait engagée et non celle des FM. C'est exactement le contraire qui s'est produit puisque la participation de la nouvelle organisation Hamas à l'Intifada a été un grand succès. Ce dernier a intégré presque tous les membres du mouvement des FM en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, et a surtout commencé à attirer des adeptes et des sympathisants qui n'étaient pas membres des FM.
Le développement du Hamas a également été stimulé par les événements régionaux tels que le boom pétrolier d'après 1973, permettant aux monarchies du Golfe d'augmenter leurs investissements dans les mouvements fondamentalistes islamiques, y compris à l'époque al-Mujamma al-Islami dans la bande de Gaza, et la création de la République Islamique d'Iran (RII). Les dirigeants de la RII ont en effet soutenu l'orientation politique fondamentaliste islamique à travers la région, y compris le Hamas à partir du début des années 1990. La consolidation des relations et futures alliances entre l'Iran et le Hamas se noue au moment de l'expulsion de centaines de membres du Hamas et du Jihad Islamique au Liban Sud à Marj al-Zouhour en 1992, y compris de l'actuel chef du bureau politique de l'organisation palestinienne Ismael Haniyeh. A cette période, le Hamas renforce également ses liens avec le Hezbollah au Liban.
D'un autre côté, les mouvements fondamentalistes islamiques dans les territoires palestiniens occupés (TPO) ont également bénéficié des revers majeurs de l'OLP, à commencer par la Jordanie en 1970 avec « Septembre noir » et la violente répression du régime jordanien contre les forces palestiniennes, qui a conduit à son transfert au Liban. Suite à la nouvelle expulsion des forces de l'OLP de Beyrouth vers Tunis en 1982, le mouvement national palestinien fut encore affaibli. Son leadership, sa stratégie et son programme politique étaient de plus en plus remis en question. Cela s'ajoutait à la concentration croissante de l'OLP, dirigée par le Fatah, sur la recherche d'une solution politique et diplomatique plutôt que sur la résistance armée. Cela était conforme à la dynamique politique de la guerre d'après octobre 1973, qui avait ouvert la porte à un règlement politique avec Israël, comme avec l'accord de paix avec l'Égypte.
En revanche, les dirigeants du Hamas ont refusé l'orientation de l'OLP et ont soutenu la résistance armée. Le Hamas a joué un rôle significatif dans la première (1987-1993) et la deuxième Intifada (2000-2005), tout en maintenant une position rhétorique forte contre l'accord de paix d'Oslo entre l'OLP et Israël. Après sa conclusion, l'accord d'Oslo a été de plus en plus largement perçu comme une capitulation totale de l'OLP face aux exigences d'Israël. Dans ce cadre, le Hamas a gagné en popularité au sein des TPO. Dans le même temps, l'Autorité Palestinienne (AP) a été de plus en plus critiquée en raison de son incapacité à atteindre les objectifs nationaux palestiniens face à l'occupation et à la colonisation israélienne continue, tandis que Ramallah était de plus en plus accusée de forte corruption et de pratiques clientélistes. De plus, la collaboration sécuritaire de l'AP avec Israël a également été vivement dénoncée au sein de la population et de la société palestinienne.
En même temps, le Hamas s'est lentement transformé d'un parti initialement refusant toute participation institutionnelle dans les années 1990 aux institutions héritées de l'accord d'Oslo à un accommodement politique avec ce dernier. Les responsables et dirigeants du Hamas ont expliqué leur changement de position par le fait que les accords d'Oslo avaient échoué, à la suite de la deuxième Intifada, alors qu'en 1996, participer à de telles élections aurait signifié les reconnaître et les soutenir.
Lors des élections législatives palestiniennes de janvier 2006, sous la forme de « Liste du changement et de la réforme », le Hamas a remporté la majorité des sièges, obtenant 42,9 % des voix et 74 des 132 sièges. Les puissances occidentales et Israël ont réagi en boycottant et en imposant un embargo sur le gouvernement dirigé par le Hamas, et en suspendant toute aide étrangère aux TPO[5]. Les tensions entre le Hamas et le Fatah se sont intensifiées et ont mené à un conflit entre les deux acteurs, le Hamas chassant le Fatah de Gaza en juin 2007, tandis que l'AP prenait le contrôle total de la Cisjordanie. La Cisjordanie et la bande de Gaza restent respectivement sous l'autorité de l'AP et du Hamas.
Parallèlement, le Hamas s'est considérablement renforcé militairement depuis la première incursion terrestre d'Israël lors de la guerre de 2008-2009, en partie grâce à ses liens croissants avec les Gardiens de la révolution iraniens et le Hezbollah, et au partage de l'expertise militaire de ses acteurs au mouvement palestinien. Les estimations des Brigades Ezzedine al-Qassam, la branche militaire du Hamas, concernant le nombre de combattants prêts au combat sont difficiles à estimer, avec des fourchettes allant de 15 000 à environ 40 000. L'aile militaire dispose de roquettes fabriquées localement, mais les roquettes à longue portée proviennent de l'étranger, d'Iran, de Syrie et d'autres pays, en passant par l'Égypte. Le Hamas utilise également de nombreux pièges armés, tels que les engins explosifs improvisés (IED), un type d'arme non conventionnelle qui peuvent être activés de diverses manières et sous diverses formes. La faction utilise des obus et des mines. Le Hamas fabrique une grande partie de ses propres armes, développe des drones et des véhicules sous-marins sans pilote et se lance dans la cyberguerre.
Programme et orientation politiques
Le Hamas a adopté sa première Charte le 18 août 1988, dans laquelle il reconnait son affiliation aux FM. Le mouvement islamique palestinien « considère la terre de Palestine comme un waqf islamique pour toutes les générations de musulmans jusqu'au jour de la résurrection ». Le Hamas a déclaré dans la première charte concernant l'OLP que : « Notre patrie est une, notre malheur est un, notre destin est un et notre ennemi est commun ». L'opposition du Hamas à l'OLP a toujours été essentiellement politique et non religieuse. Le texte de la 1ère Charte avait cependant des connotations antisémites, avec une référence au Protocole des Sages de Sion (un faux créé par la police tsariste au début du XXe siècle), ainsi qu'une dénonciation des « complots » des loges maçonniques, des clubs du Rotary et de Lyon.
La dernière charte du Hamas publiée en 2017 a connu des modifications majeures et représente une véritable tentative par le leadership du parti d'exprimer ses orientations politiques principales, par rapport à la première charte de 1988 considérée comme caduque depuis de nombreuses années par les principaux dirigeants du parti palestinien. Le mouvement se décrit dans cette nouvelle charte de la manière suivante :
« Le mouvement déclare que le Mouvement de résistance islamique “Hamas” est un mouvement islamique palestinien de libération et de résistance nationale. Son objectif est de libérer la Palestine et de faire face au projet sioniste. Son cadre de référence est l'Islam, qui en détermine les principes, les objectifs et les moyens. »
Dans la nouvelle charte, le contenu antisémite a été supprimé et la lutte du parti se tourne contre le sionisme[6]. Le nouveau document ne mentionne plus aucun lien avec les FM, alors que l'Islam reste évoqué comme son cadre de référence. Dans le même temps, le parti islamique palestinien propose un programme politique implicitement en accord avec une solution temporaire à deux États, conforme à de nombreuses déclarations faites par les responsables du Hamas au cours des dernières décennies concernant l'approbation du parti pour une telle solution, et au droit international.
Dans ce contexte, la comparaison entre Daesh et Hamas telle que préconisée par certains acteurs israéliens et occidentaux doit être totalement rejetée. Alors que le Hamas est ancré dans l'histoire palestinienne et s'oppose à la colonisation et à l'occupation israélienne, Daesh est né de l'occupation américaine de l'Irak. Il est né d'Al-Qaïda en Irak, qui a combattu à la fois l'occupation américaine et le régime fondamentaliste chiite installé par les États-Unis et soutenu par l'Iran. Il s'est ensuite étendu à la Syrie alors qu'il tentait d'établir un califat islamique sunnite. Le développement de Daesh est le résultat de l'impérialisme et de la contre-révolution au Moyen-Orient.
Les tentatives d'Israël et des gouvernements occidentaux de présenter le Hamas, et plus généralement les Palestiniens, comme des terroristes similaires aux organisations djihadistes ne sont pas nouvelles[7]. Après le 11 septembre 2001, la classe dirigeante israélienne a déjà décrit sa guerre contre les Palestiniens pendant la Seconde Intifada comme sa propre « guerre contre le terrorisme ». Et ce, même si l'AP sous la direction d'Arafat et le Hamas ont condamné les actions d'Al-Qaïda. Les actions suicides du Hamas à Jérusalem et ailleurs dans la Palestine historique ont été présentées comme « étant un symptôme du terrorisme islamique mondial », comme l'explique Tareq Baconi[8]. La présidence Bush a défendu au début des années 2000 le droit d'Israël à se défendre contre le « terrorisme islamique », tout comme l'actuelle administration américaine et les États occidentaux. Indépendamment de ce que nous pensons des attentats suicides, les opérations du Hamas s'inscrivaient dans le cadre d'une opposition à l'occupation et à la colonisation israéliennes, et non dans le cadre d'une lutte islamique mondiale. Le Hamas a justifié le recours aux attentats suicides pour saper les discussions d'Oslo et empêcher toute sécurité de la population israélienne. De plus, elle cherchait à alimenter les contradictions au sein de la société israélienne, mais ces actions ont plutôt favorisé son unité et renforcé l'extrémisme politique israélien[9].
Des organisations telles que Daesh ou Al-Qaïda présentent des différences dans leur formation, leur développement, leur composition et leur stratégie avec des partis politiques tels que le Hamas ou le Hezbollah au Liban[10]. Le Hamas a par exemple participé aux élections et aux institutions héritées des accords d'Oslo, tout en acceptant la diversité religieuse de la société palestinienne. En revanche, les djihadistes comme al-Qaïda et Daesh considèrent généralement la participation aux élections des institutions étatiques comme non islamique et se tournent plutôt vers des tactiques de guérilla ou de terrorisme dans l'espoir de s'emparer à terme de l'État, tout en s'attaquant aux minorités religieuses[11]. De plus, des affrontements ont eu lieu entre le Hamas et des groupes jihadistes salafistes dans la bande de Gaza depuis qu'il en a pris le contrôle. Les forces militaires du Hamas ont combattu ces groupes et ont lancé des campagnes d'arrestation contre leurs membres[12], perçus comme des menaces pour la sécurité et, dans une moindre mesure, comme des rivaux politiques pour leurs bases populaires.
Plus généralement, les tentatives d'Israël et des impérialistes occidentaux de comparer le Hamas et les groupes djihadistes tels que Daesh, ou avant Al-Qaïda, font partie d'une stratégie plus vaste consistant à s'appuyer de plus en plus sur l'islamophobie depuis le 11 septembre pour justifier leur soi-disant guerre contre le terrorisme.
Cela dit, l'orientation politique du Hamas ne doit pas être présentée ou qualifiée de progressiste. Le mouvement islamique palestinien promeut un programme politique et une vision de la société réactionnaires et autoritaires, et son règne à Gaza est loin d'être démocratique.
Classe et économie politique
À l'instar d'autres partis fondamentalistes islamiques, la base populaire du Hamas n'est pas ancrée dans une seule classe. La base électorale du Hamas s'est considérablement développée en deux vagues, d'abord lorsqu'il a rejoint la lutte contre Israël en 1987 et a mené une résistance militaire dans les années 1990 et 2000, et ensuite lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2006 et a pris le contrôle de la bande de Gaza en 2007. La résistance militaire du Hamas et son opposition aux accords d'Oslo et, plus généralement, aux politiques oppressives israéliennes, aux côtés de ses réseaux d'organisations caritatives, basés sur les anciens réseaux des FM et d'al-Mujamma al-Islami, et du mécanisme d'islamisation de la société, a permis au mouvement islamique palestinien de constituer une large base populaire, issue principalement des couches populaires défavorisées de la population palestinienne des territoires occupés, tout en étant capable de maintenir des liens avec les forces traditionnelles bourgeoises comme les commerçants aisés et autres. Le mouvement islamique palestinien a en effet historiquement et généralement bénéficié du soutien et de la sympathie des hommes d'affaires, des propriétaires fonciers, et des commerçants[13].
Le milieu social des dirigeants de la bande de Gaza, initialement composé majoritairement de petits-bourgeois et de classes moyennes inférieures, était historiquement plus propice à son expansion que les dirigeants de Cisjordanie issus d'un milieu social plus aisé, majoritairement bourgeois et d'élites traditionnelles, et liés à la monarchie jordanienne en raison de ses liens initiaux avec les FM jordaniens qui ont constitué un soutien fidèle aux dirigeants jordaniens pendant de nombreuses décennies. Le mouvement des FM dans les TPO, comprenait généralement des commerçants, des hommes d'affaires et des sections de la classe aisée palestinienne, qui ont généralement continué à soutenir le Hamas par la suite[14].
Au niveau de ses dirigeants et cadres, l'une des caractéristiques majeures de l'organisation palestinienne est qu'une grande majorité d'entre eux a un niveau d'éducation élevé et tend à occuper des professions libérales. Il peut également exister chez un grand nombre d'employés du Hamas, en particulier ceux qui occupent des postes de direction au sein de l'administration gouvernée par le parti dans la bande de Gaza, une certaine mentalité « petite-bourgeoise » (même si la très grande majorité d'entre eux sont d'origine prolétarienne), par le fait de devenir des cadres salariés, signifiant une certaine revalorisation sociale. Cette dynamique est cependant réduite fortement par la réalité politique et sociale de Gaza, caractérisée par un siège mortifère et des guerres continues menées par l'armée d'occupation israélienne, maintenant un lien relativement important entre les cadres locaux du Hamas et les classes populaires palestiniennes.
Plus généralement, et contrairement à d'autres mouvements fondamentalistes islamiques de la région, il est important de noter que le processus « d'embourgeoisement » de la direction du Hamas a été limité. Ceci est lié aux limites d'un développement capitaliste significatif et d'un processus d'accumulation de capital important dans les TPO, et plus particulièrement dans la bande de Gaza depuis l'imposition du siège en 2005, résultant de l'occupation israélienne et des politiques de de-développement imposées par l'État d'Israël. Ce dernier a mené une politique visant à limiter toute forme de développement économique et institutionnel autochtone susceptible de contribuer à la réforme structurelle et à l'accumulation de capital, en particulier dans le domaine industriel. Israël a empêché les Palestinien.nes de développer des industries locales susceptibles de concurrencer les industries israéliennes, augmentant et maintenant la dépendance de l'économie palestinienne vis-à-vis des importations israéliennes[15]. Les grands conglomérats palestiniens qui dominent l'économie en Cisjordanie sont en réalité principalement basés dans le Golfe. La stratégie économique de l'AP a d'ailleurs consisté à renforcer ces grands conglomérats palestiniens, tout en creusant les inégalités dans la société palestinienne[16].
Le Hamas a également pu construire une nouvelle classe marchande liée au parti, à partir de la fin des années 2000 et du début des années 2010, grâce à l'expansion massive des activités des tunnels avec l'Egypte. La bande de Gaza a même connu un « boom économique » selon un rapport de la Banque mondiale de 2011, la croissance du PIB atteignant 28 % au cours des six premiers mois de cette année-là[17]. Le marché du travail au premier semestre 2011 avait été caractérisé par une croissance relativement significative de l'emploi. Le taux de chômage au sens large était tombé à 32,9 % à la mi-2011, contre 45,2 % au second semestre 2010, selon le rapport sur la bande de Gaza pour les six premiers mois de 2011 réalisé par l'UNRWA[18]. L'emploi total avait augmenté de 21 % par rapport à l'année précédente, avec environ 41 270 personnes supplémentaires travaillant, les réfugié.es représentant environ la moitié de cette croissance. L'industrie des tunnels et les activités qui y étaient liées ou qui en bénéficiaient ont été le principal facteur de la hausse de l'emploi privé, notamment l'importation croissante de matériaux de construction. En termes géographiques, cette nouvelle prospérité a suivi les nouvelles opportunités d'emploi : le nord a décliné, tandis que le sud était en plein essor. Bayt Hanun, autrefois porte d'entrée de Gaza vers Israël, sombrait dans la dépression, tandis que Rafah, jusqu'ici la ville la plus pauvre de l'enclave, était en plein essor. L'économie des tunnels a été la principale raison de ce boom, estimé par les hommes d'affaires gazaouis à plus de 700 millions de dollars par an[19], et a renforcé le pouvoir du Hamas dans la bande de Gaza. La plupart des tunnels ont été financés par des investisseurs privés, pour la plupart des membres du Hamas, qui se sont associés à des familles se trouvant des deux côtés de la frontière[20]. Un rapport de l'Organisation internationale du travail a cité l'émergence de 600 « millionnaires des tunnels », qui ont particulièrement investi dans l'achat de terrains et dans l'immobilier[21]. Les brigades al-Qassam ont établi une surveillance sur une grande partie du réseau de tunnels qui était auparavant sous l'autorité de clans disparates et d'autres partis politiques. Cependant, à partir de la mi-2012, mais surtout après l'arrivée au pouvoir du dictateur égyptien Sissi suite au coup d'État militaire contre la présidence de Morsi en juillet 2013, l'activité des tunnels a été durement touchée et a considérablement diminué. Le régime militaire égyptien a fermé de nombreux passages de contrebande reliant le Sinaï à Gaza et les a inondés d'eaux usées.
Le Hamas, à l'instar des FM, soutient une économie basée sur le capitalisme et le libre marché[22]. Le Hamas souscrit à la croyance générale au sein des cercles des mouvements fondamentalistes islamiques selon laquelle la religion islamique promeut la libre entreprise et consacre le droit à la propriété privée[23]. Dans une interview que j'ai réalisée en 2012 avec Ali Baraka, représentant du Hamas au Liban, il a déclaré que le Hamas était contre une économie socialiste parce qu'elle allait à l'encontre des droits individuels et d'entrepreneur du peuple et qu'il soutenait plutôt l'initiative privée[24]. Le modèle économique islamique évoqué par les membres du Hamas n'est en aucun cas en contradiction avec le système capitaliste. Les sources de financement du Hamas expliquent également l'absence d'opposition au système capitaliste et son programme économique plutôt conservateur. Le mouvement islamique palestinien est financé par la République islamique d'Iran, le Qatar, les dons d'hommes d'affaires palestiniens de la diaspora[25] et les collectes de fonds effectuées principalement dans les monarchies du Golfe, mais aussi dans d'autres pays comme la Turquie et la Malaisie, qui sont reversés au parti et/ou à des œuvres caritatives, institutions et projets de bienfaisance affiliées au Hamas au sein des TPO[26]. Le Trésor américain a accusé le Hamas d'avoir établi un réseau secret de sociétés gérant environ 500 millions de dollars d'investissements dans des entreprises de divers pays de la région, notamment des sociétés opérant au Soudan, en Turquie, en Arabie Saoudite, en Algérie et aux Émirats arabes unis (EAU)[27].
Autoritarisme et Hala Islamya
Comme déjà souligné plus haut, le règne du Hamas dans la bande de Gaza depuis 2007 a été marqué par le siège mortifère imposé par l'armée d'occupation israélienne, avec l'assistance du régime égyptien, ainsi que par les politiques répressives de l'AP en Cisjordanie, particulièrement contre les membres, organisations et institutions du parti ou liés à ce dernier, mais pas seulement[28]. Ces éléments ont bien sûr influencé la politique du mouvement, caractérisée par un certain degré d'autoritarisme et de répression.
Dans le rapport 2022 d'Amnesty International, l'organisation de défense des droits humains a déclaré que « dans la bande de Gaza, un climat général de répression, suite à une répression brutale des manifestations pacifiques contre la hausse du coût de la vie en 2019, a effectivement dissuadé la dissidence, conduisant souvent à des formes d'auto-censure »[29]. D'autres organisations palestiniennes ont également condamné les violations des droits humains commises par le Hamas, notamment les détentions arbitraires, la torture et les coups punitifs[30]. Le parti islamique est également accusé de menacer les journalistes qui critiquent son gouvernement. De nombreuses protestations politiques publiques ont souvent été réprimées, comme les manifestations contre la division palestinienne du 15 mars 2011[31] jusqu'à plus récemment en juillet 2023, lorsque les forces de sécurité du Hamas ont une nouvelle fois réprimé dans plusieurs villes de la bande de Gaza, un mouvement de protestation contre les coupures d'électricité chroniques et des conditions de vies difficiles, mais aussi contre la gouvernance lacunaire, la corruption et l'autoritarisme[32].
Cet environnement autoritaire est reflété par différents sondages réalisés par le Centre palestinien de recherche politique et d'enquête (PSR), dans lesquels des larges secteurs de la population palestinienne basée à Gaza ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas critiquer les autorités du Hamas sans crainte, avec des taux atteignant 67,9 % en 2014 et 59% en 2023[33].
En même temps, le mouvement a poursuivi une politique renforçant un environnement islamique conservateur accompagné d'une plus grande politique d'islamisation de la société gazaouie, à travers son contrôle de l'administration publique, des organisations liées au mouvement et également par des mesures répressives. La diffusion de l'idéologie du Hamas à travers ses institutions et son réseau d'organisations est également un moyen pour consolider et reproduire son pouvoir sur de larges secteurs de la population palestinienne dans la bande de Gaza. Déjà à la fin des années 1980 et 1990, al-Mujamma al-Islami et le Hamas ont joué un rôle important dans une large mesure dans l'imposition par diverses formes de coercition des normes sociales conservatrices à Gaza[34]. Dans ce cadre, certains cybercafés ont été fermés pour protéger les « valeurs morales » et empêcher le mélange des hommes et des femmes. Le ministère de l'Intérieur a lancé des campagnes d'intimidation pour interdire aux coiffeurs masculins de coiffer une femme ou de travailler chez des coiffeuses féminines, tandis que les coiffeurs ne respectant pas cette règle étaient la cible d'attaques[35]. Les mesures répressives du gouvernement du Hamas et les attaques de groupes armés « inconnus » ont également visé des institutions ou individus ne respectant pas la hala islamyya, ou « sphère islamique ».
L'attitude du Hamas envers les femmes a évolué depuis sa création en leur octroyant davantage de place au sein du parti, mais toujours dans une perspective conservatrice islamique. Le parti encourage par exemple les femmes à poursuivre des études supérieures et à participer davantage à la vie publique, notamment au sein des activités du parti et des institutions à Gaza[36], mais dans le respect des « normes islamiques » telles que la ségrégation sexuelle et en favorisant principalement les emplois considérés comme une extension des rôles reproductifs des femmes, tels que l'enseignement, les soins infirmiers, etc.[37] Le mouvement islamique palestinien définit en effet la fonction première des femmes comme étant la « maternité » et, en particulier, l'inculcation des principes islamiques à la prochaine génération[38]. Il est certain que le Hamas n'est pas le seul acteur dans la région à promouvoir une vision patriarcale de la société, renforçant la domination masculine et une restriction des femmes à des rôles subalternes dans la société ; l'organisation palestinienne islamique a cependant renforcé et approfondi ces dynamiques à Gaza. Le Hamas a, notamment, encouragé et appliqué de plus en plus un code moral conservateur, œuvrant à la ségrégation sexuelle et la division du travail sexuée. Le gouvernement a mis par exemple en œuvre depuis avril 2013 la ségrégation sexuée dans toutes les écoles de Gaza pour les élèves de plus de neuf ans, sous prétexte de protéger « l'identité islamique » de Gaza[39]. Les autorités du Hamas ont, dans plusieurs cas, imposé des vêtements et des comportements particuliers censés préserver l'honneur des femmes[40] et celui de la famille, tandis qu'un tribunal islamique de la bande de Gaza a statué que les femmes avaient besoin de l'autorisation d'un tuteur masculin pour voyager[41]. Cela a provoqué des résistances au sein de la société palestinienne, mais pour le Hamas, comme d'autres mouvements fondamentalistes islamiques régionaux, le « modèle » islamique est considéré comme la seule « voie correcte » pour les femmes, sinon elles sont considérées comme étrangères à leur propre société et sous l'influence de l'impérialisme culturel occidental.
Stratégie et alliances régionales
En termes d'alliances politiques régionales, les dirigeants du Hamas ont cultivé ces dernières années des alliances avec le Qatar et la Turquie[42], ainsi qu'avec la République islamique d'Iran qui est son principal soutien politique, financier et militaire. L'aide annuelle de l'Iran au parti est estimée à environ 75 millions de dollars[43].
Dans le même temps, le Hamas a tenté d'améliorer ses relations avec d'autres monarchies du Golfe, notamment le Royaume saoudien, depuis plusieurs années, mais avec plus de difficultés. Au début de l'année 2021, à la suite de la réconciliation entre le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, a salué les efforts du roi saoudien Salman bin Abdul-Aziz al-Saud et du prince héritier Mohammed bin Salman pour résoudre la crise du Golfe et parvenir à la réconciliation. En octobre 2022, le Royaume saoudien a libéré l'ancien représentant du mouvement palestinien Hamas, Mohammed al-Khudari, ainsi que son fils Hani al-Khudari, et les a expulsés vers la Jordanie, après plus de trois ans de détention.
Plus généralement, le Hamas a assisté avec une inquiétude croissante à la conclusion des accords d'Abraham négociés par les États-Unis à l'été 2020 et à la poursuite de la normalisation des relations entre Israël et les États arabes. Sans oublier le rapprochement entre la Turquie et Israël. En mars 2022, le président israélien Isaac Herzog a été le premier haut responsable israélien à se rendre en Turquie depuis 2008. Ce contexte n'a donc fait que renforcer l'alliance cruciale du Hamas avec l'Iran – et donc le Hezbollah. Ses relations avec Téhéran ont continué à fournir au Hamas une assistance militaire, notamment des armes et une formation, en plus d'un financement important[44]. L'un des principaux objectifs de l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre était d'ailleurs de saper le processus de normalisation initié par Donald Trump et poursuivi par Joe Biden, entre Israël et certains pays arabes. Peu après le déclenchement de la guerre israélienne contre la bande de Gaza, le Royaume d'Arabie Saoudite a réagi en stoppant tout progrès sur les accords bilatéraux entre Riyad et Tel Aviv.
Les changements de direction au sein du mouvement politique du Hamas ont également eu un impact. Si les relations ont certainement été maintenues sur le plan politique et militaire au cours de la dernière décennie – malgré les désaccords sur le soulèvement syrien, notamment le refus des dirigeants de soutenir la répression du régime despotique de Damas contre le mouvement de protestation populaire – le remplacement de Khaled Meshaal par Ismael Haniyeh à la tête du Hamas en 2017 a ouvert la porte à des relations plus étroites entre le Hamas, le Hezbollah et l'Iran. De plus, la nomination de Cheikh Saleh al-Arouri – l'un des fondateurs de la branche armée du Hamas, les Brigades al-Qassam – au poste de chef adjoint du bureau politique du groupe, a également facilité cette évolution. Tout comme l'élection de Yahya Sinwar, autre membre fondateur des brigades al-Qassam, à la tête du mouvement à Gaza. En effet, la branche militaire a toujours entretenu des liens étroits avec l'Iran, contrairement au bureau politique du mouvement dirigé par Meshaal. En fait, les dirigeants des Brigades al-Qassam se sont opposés aux tentatives de Meshaal pendant son mandat d'éloigner le Hamas de l'Iran et du Hezbollah, en faveur d'une amélioration des relations avec la Turquie, le Qatar et même l'Arabie saoudite à un moment donné.
Les responsables du Hamas ont depuis multiplié leurs visites à Téhéran pour rencontrer le commandant des Gardiens de la révolution, Qassem Soleimani, tout en saluant à plusieurs reprises l'aide de l'Iran dans les médias. Ils ont déclaré à plusieurs reprises que le groupe avait réussi à développer de manière significative ses capacités militaires grâce à l'Iran qui leur avait fourni beaucoup d'argent, d'équipement et de savoir-faire.
Les relations renouvelées et approfondies avec l'Iran ne se sont toutefois pas faites sans critiques dans la bande de Gaza et même parmi les bases populaires du Hamas. Une photo du défunt commandant de la Force iranienne Quds, le général Qassem Soleimani, affichée sur un panneau publicitaire dans la ville de Gaza, a été vandalisée et démolie quelques jours seulement avant le premier anniversaire de sa mort. L'assassinat de Soleimani par une frappe américaine à Bagdad en 2020 a été fermement condamné par le Hamas, et Haniyeh s'est même rendu à Téhéran pour assister à ses funérailles. L'instigateur de l'action, Majdi al-Maghribi, a accusé Soleimani d'être un criminel. Plusieurs autres banderoles de Soleimani ont également été démontées et vandalisées, une vidéo montrant un individu le décrivant comme le « tueur des Syriens et des Irakiens ».
De même, le rétablissement des liens entre le régime syrien et le Hamas à la mi-2022 doit être vu comme une tentative de Téhéran de consolider son influence dans la région et de réhabiliter ses relations avec ses deux alliés. Cela dit, toute évolution dans les relations entre la Syrie et le mouvement palestinien ne signifiera pas un retour à la situation d'avant 2011, lorsque les dirigeants du Hamas bénéficiaient du privilège d'un soutien majeur de la part du régime syrien. Les responsables syriens réduiront très probablement leurs critiques publiques à l'égard du Hamas dans le cadre de leur alliance avec l'Iran, mais ne rétabliront aucune forme de soutien stratégique, militaire et politique, du moins à court terme. Les relations futures entre le régime syrien et le Hamas sont donc largement régies par des intérêts structurés et liés à l'Iran et au Hezbollah. De plus, la « réconciliation » reflète un problème plus général dans la stratégie politique de la lutte de libération du peuple palestinien.
Le Hamas n'est cependant pas une simple marionnette de l'Iran. Il dispose d'une autonomie propre par rapport à Téhéran, comme les désaccords sur la question syrienne ou le Bahrain[45] l'ont démontré dans le passé.
Conclusion
Après le 7 octobre, le Hamas a réussi à se positionner, une nouvelle fois, comme l'acteur principal sur la scène politique palestinienne, marginalisant encore davantage une AP toujours plus affaiblie. Les derniers sondages menés dans les TPO démontrent une popularité croissante du Hamas et un affaiblissement continu de l'AP[46]. Dans le même temps, la question palestinienne est désormais de retour à l'agenda israélien et régional.
Cependant, le parti islamique, tout comme le reste des partis politiques palestiniens, du Fatah à la gauche palestinienne, ne considère pas les masses palestiniennes, les classes ouvrières régionales et les peuples opprimés comme des forces pour gagner leur libération[47]. Au lieu de cela, ils recherchent des alliances politiques avec les classes dirigeantes de la région et leurs régimes pour soutenir leurs batailles politiques et militaires contre Israël. Les dirigeants du Hamas poursuivent une stratégie similaire ; ses dirigeants ont cultivé des alliances avec les monarchies des États du Golfe, notamment le Qatar récemment, et la Turquie, ainsi qu'avec le régime iranien. Plutôt que de faire avancer la lutte, ces régimes limitent leur soutien à la cause aux domaines où il fait progresser leurs intérêts régionaux et la trahissent lorsque ce n'est pas le cas. La réticence de l'Iran et du Hezbollah à réagir et à lancer une réaction militaire plus intense à la guerre israélienne contre les Palestinien.nes afin de préserver leurs propres intérêts politiques et géopolitiques le démontre. L'objectif de l'Iran en soutenant le Hamas, ou le Jihad islamique, n'est pas de libérer les Palestinien.nes, mais d'utiliser ces groupes comme levier politique, en particulier dans ses relations avec les États-Unis et les puissances occidentales.
Un positionnement clair critiquant les orientations politiques, sociales et économiques du Hamas ne devrait, cependant, pas empêcher la gauche, localement et internationalement, de soutenir la lutte palestinienne contre un régime d'apartheid, colonial et raciste soutenu par l'impérialisme occidental. Pour celles et ceux qui disent que nous devrions soutenir uniquement la résistance communiste ou dirigée par la gauche, c'est une grave erreur et un manque de soutien internationaliste. Il s'agit en fait d'une vieille position d'ultra-gauche sur la question nationale que Lénine avait déjà vivement critiquée. Le soutien à une lutte légitime contre l'occupation étrangère doit être apporté quelle que soit la nature de sa direction. De même, nous ne condamnons pas les envois d'armes à la résistance palestinienne par des États autoritaires.
En conclusion, il est important de réitérer notre soutien au droit à la résistance du peuple palestinien, y compris à la résistance armée, sans confondre cette position de principe avec le soutien aux perspectives politiques des dirigeants ou des groupes politiques qui les dirigent, y compris le Hamas.
Illustration : Tarciso
Notes
[1] https://www.newarab.com/news/israels-7-oct-toll-revised-down-social-security-data.
[2] Il est à noter que de nombreux civils israélien.nes le 7 octobre 2023 ont également été tués par les forces d'occupation israéliennes, notamment en tirant des obus de char sur des maisons où des Israéliens étaient détenus. Par exemple voir https://www.ynetnews.com/article/rkjqoobip.
[3] D'autres dirigeants éminents étaient le pharmacien Ibrahim al-Yazuri, le Dr Abd al-Aziz al Rantissi et le Dr Mahmud Zahar.
[4] Khaled Hroub (2010), Hamas, Pluto Press, p. 12.
[5] Un haut responsable de l'administration Bush de l'époque, Eliot Abrahams, a déclaré après la victoire du Hamas aux élections : « Légalement, nous devions traiter le Hamas comme nous avons traité Al-Qaïda ». Mentionné dans Tareq Baconi, Hamas Contained, The Rise and Pacification of Palestinian Resistance, 2018, Stanford University Press, p. 97.
[6] Il ne s'agit pas de contester l'existence chez certains dirigeants du Hamas, et d'autres, de discours ou paroles antisémites. Il faut néanmoins comprendre, pour mieux combattre ces discours antisémites, les sources et les conditions de la création de cet antisémitisme, pourquoi il a une audience et est reproduit : c'est avant tout la politique d'Israël, prétendument menée « au nom des Juifs » qui est le principal producteur de discours antisémites chez les Palestiniens. Il s'agit d'une réaction face à un oppresseur s'identifiant et prétendant parler au nom « des Juifs du monde entier ». Il ne s'agit pas de justifier mais de comprendre pour mieux lutter contre cette forme d'antisémitisme, très différent et qu'on ne peut pas comparer à l'antisémitisme des organisations d'extrême droite et fascistes occidentales.
[7] Déjà dans les années 1970, les actions des différents groupes palestiniens de l'OLP étaient souvent décrites comme terroristes.
[8] Tareq Baconi, Hamas Contained, The Rise and Pacification of Palestinian Resistance, p. 47.
[9] Il est important de noter que la majorité de la population palestinienne s'est opposée à ces attentats-suicides, menant d'ailleurs le Hamas à cesser ce genre d'opérations.
[10] Pour en savoir plus sur la différence entre les groupes djihadistes et les mouvements fondamentalistes islamiques, voir https://isreview.org/issue/106/marxism-arab-spring-and-islamic-fundamentalism/index.html.
[11] Parmi les djihadistes, il existe également des débats et des divisions sur les tactiques et stratégies permettant d'atteindre leur objectif d'un État islamique.
[13] Voir Ziad Abu Amr Z. Islamic fundamentalism in the West Bank and Gaza ; Khaled Hroub, Hamas, Pluto Press, 2010.
[14] L'analyste palestinien Khaled Hroub affirme que ces derniers ont toujours été considérés avec respect et admiration en raison de leurs dons continus au mouvement ; Khaled Hroub, Hamas, p.66-67.
[15] Sara Roy, The Gaza Strip : The Political Economy of De-development, Institute Palestine for Studies, 1995.
[16] Voir Adam Hanieh, Lineages of Revolt : Issues of Contemporary Capitalism in the Middle East, Haymarket, 2013.
[17] Word Bank (2012, March), Stagnation or Revival ? Palestinian Economic Prospects : http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/WorldBankAHLCreportMarch2012.pdf.
[18] UNRWA (2011) Labour Market in the Gaza Strip A Briefing on First-Half 2011. http://www.unrwa.org/userfiles/20111207970.pdf.
[19] Pelham. N (2011) ; Gaza's Tunnel Complex, http://www.merip.org/mer/mer261/gazas-tunnel-complex. Des interviews effectuées avec un certain nombre de Palestinien.nes à Gaza, en février 2012, m'ont confirmé ces informations.
[20] Les autorités du Hamas ont également imposé que les autorisations de tunnel soient conditionnées à la nomination de ses membres aux conseils d'administration des coopératives de tunnels, souvent à des conditions préférentielles. Pelham N. (Summer 2012), Gaza's Tunnel Phenomenon : The Unintended Dynamics of Israel's Siege, Journal of Palestine Studies, Vol 41, no. 4, http://palestinestudies.org/journals.aspx?id=11424&jid=1&href=fulltext.
[21] Pelham N. (October 26 2012) Gaza : A Way Out ?, http://www.nybooks.com/blogs/nyrblog/2012/oct/26/gaza-isolation-way-out/ ; des interviews effectuées avec un certain nombre de palestiniens à Gaza en février 2012 m'ont confirmé ces informations.
[22] Interview Dr. Ahmed Youssef , ancien conseiller politique d'Ismael Hanieh, membre du Hamas, Février 2012, Gaza city.
[23] Khaled Hroub, Hamas, pp. 66.
[24] Interview Ali Baraka, représentant du Hamas au Liban, Janvier 2012, Beyrouth.
[25] Un indicateur de ce soutien est le ciblage par les États-Unis de personnalités d'affaires palestiniennes dans divers pays de la région qui financent ou facilitent le financement du Hamas. Voir https://home.treasury.gov/news/press-releases/jl0159.
[26] Le Hamas a notamment utilisé un réseau financier mondial pour canaliser le soutien d'organisations caritatives et de différents pays, en faisant passer de l'argent via les tunnels de Gaza ou en utilisant des crypto-monnaies pour contourner les sanctions internationales.
[27] https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0798.
[28] Voir le rapport d'Amnesty International sur les violations de droits humains en Cisjordanie par l'AP
[31] https://content.time.com/time/world/article/0,8599,2061661,00.html ; Discussion à Gaza en Février 2012 avec des militants ayant participé à ces manifestations.
[33] http://www.pcpsr.org/sites/default/files/p52e.pdf.
[34] Le Hamas a par exemple mené des campagnes dans les années 1980 et 1990 pour imposer le voile islamique aux femmes, à la fois par des mesures propagandistes et violentes, particulièrement dans la bande de Gaza. Contre les tentatives violentes visant à imposer le hijab aux femmes, ces dernières ont eu peu, pour ne pas dire aucun, de soutien de la part des dirigeants nationaux de l'Intifada, y compris des groupes nationalistes et de gauche, qui n'ont pas réussi à affronter la campagne du port du voile à cette période et dans une certaine mesure y ont participé, comme le Fatah, pour tenter de démontrer qu'ils n'étaient pas moins « moraux » que le Hamas. Le Hamas a également lancé des campagnes de fermeture des cinémas et des restaurants vendant de l'alcool. Voir Islah Jad, Les Femmes islamistes de Hamas : entre le Féminisme et le Nationalisme, Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 2010, http://remmm.revues.org/6971 ; Sarah Roy, Hamas and civil society in Gaza, Princeton University Press 2011.
[35] Interview avec un journaliste indépendant dans la bande de Gaza, Janvier 2012, Gaza city.
[36] Voir Giorgia Baldi, « Re-Thinking Islam and Islamism : Hamas Women between Religion, Secularism and Neo-Liberalism », Middle East Critique 33, pp.241-261 24 Jun 2022 ; https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19436149.2022.2087950.
[37] https://www.7iber.com/politics-economics/the-palestinian-women-movement-versus-hamas/.
[38] Le Hamas a par exemple salué à l'occasion de la Journée internationale des femmes en mars 2021, le rôle des femmes palestiniennes en tant que mères et épouses dans le maintien de la cohésion sociale en protégeant la famille, élément de base de la société et garant de sa stabilité : https://english.palinfo.com/o_post/Hamas-praises-Palestinian-women-s-role-in-freedom-struggle/.
[40] En 2006, le programme politique du Hamas pour les élections législatives affirmait que les femmes devraient bénéficier d'une éducation islamique, afin de garantir que leur « personnalité indépendante » soit fondée sur « la chasteté, la décence et l'observance ». Manifeste électoral du Hamas pour les élections législatives tenues en janvier 2006, mentionné dans Azzam Tamimi, Hamas a history from within, Olive Branch Press, 2007, p. 297.
[42] Dans le cadre de cette alliance avec la Turquie, le dirigeant du Hamas Khaled Mashal n'avait pas hésité en avril 2018 de faire l'éloge de l'invasion et de l'occupation d'Afrin en Syrie par la Turquie lors d'une visite à Ankara. Il a déclaré que « le succès de la Turquie à Afrin sert d'exemple solide », en espérant qu'il sera suivi par des « victoires similaires de l'oumma islamique dans de nombreux endroits du monde. » L'occupation d'Afrin par les forces armées turques et ses mandataires syriens réactionnaires a chassé 200 000 personnes, principalement kurdes, et réprimé celles qui sont restées.
[43] Selon le département d'État américain, la République islamique d'Iran fournit jusqu'à 100 millions de dollars par an au Hamas et à d'autres groupes militants palestiniens : https://www.state.gov/wp-content/uploads/2023/02/Country_Reports_2021_Complete_MASTER.no_maps-011323-Accessible.pdf.
[44] L'Iran a réduit son aide au Hamas après l'éclatement du soulèvement en Syrie et le refus du mouvement palestinien de soutenir la répression meurtrière du régime syrien contre les manifestants syriens. La chercheuse Leila Seurat estime que l'Iran a réduit de moitié son aide économique au Hamas en 2013, passant de 150 millions de dollars à moins de 75 millions de dollars par an : https://www.foreignaffairs.com/israel/hamass-goal-gaza.
[45] En 2012, Ismail Haniyeh, premier ministre du gouvernement du Hamas à Gaza à l'époque, a fait l'éloge des « réformes » de Bahreïn alors que le régime, avec le soutien de ses alliés du Golfe, a écrasé le soulèvement démocratique du pays. De nombreux dirigeants du Hamas l'ont considéré comme un coup d'État « confessionnel » perpétré par les chiites de Bahreïn soutenus par l'Iran.
[46] https://pcpsr.org/en/node/961.
[47] Pour aller plus loin sur cette orientation : https://www.contretemps.eu/palestine-revolution-moyen-orient-strategie/.
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Iran : Vers une solidarité et une organisation conséquentes des mobilisations des salarié.es du secteur pétrolier

Faisant suite à leurs mobilisations éparses contre les conditions de vie et le faible niveau des salaires, ainsi qu'aux atteintes du gouvernement à leurs droits et avantages acquis, les travailleurs/euses permanent.es du secteur pétrolier ont annoncé, lors d'un de leurs rassemblements il y a environ deux mois, qu'ils organiseraient des rassemblements tous les lundis pour faire aboutir leurs revendications.
Tiré d'Europe solidaire sans frontière.
Cela fait plus d'un an que des retraité.es de la sécurité sociale, des enseignant.es, des employé.es des télécommunications, etc. ont décrété que des journées de mobilisation auront lieu certains jours de la semaine, et que des rassemblements simultanés seraient organisés dans différentes villes d'Iran.
Cette façon de lutter et de protester a joué un rôle dans le développement de l'unité entre retraité.es, ainsi que dans le renforcement du mouvement des retraité.es, qui est devenu habituel.
Aujourd'hui, les travailleurs/euses titulaires du secteur pétrolier ont pris comme modèle cette tradition progressiste et moderne, pour coordonner et organiser leurs mobilisations. Il ne fait aucun doute que l'utilisation de cette méthode renforcera leurs luttes.
Elle aura également un impact important sur le renforcement de la mobilisation et de l'unité des travailleurs/euses de tous les secteurs, face à leurs employeurs et au système étatique qui les soutient.
Le secteur pétrolier constitue la source principale des finances de l'Etat. Ce dernier est simultanément le patron de cette industrie, et est donc directement confronté aux salarié.es qui y travaillent.
Le pouvoir a un besoin vital que le secteur de la production pétrolière soit en activité afin de couvrir les coûts exorbitants de son propre système, ainsi que de la gouvernance en général.
Pour ces raisons, les salarié.es titulaires et de la sous-traitance du secteur pétrolier occupent une place particulière dans l'ensemble du mouvement ouvrier d'Iran.
Le développement de leurs mobilisations exercera une pression fondamentale et décisive sur le gouvernement et le contraindra à réagir.
Le résultat de chaque victoire et de chaque succès des travailleurs/euses du pétrole constituera un tremplin pour les victoires et les succès des salarié.es de tous les autres secteurs.
Il est du devoir de toutes et tous les travailleurs/euses, enseignant.es, retraité.s, chômeurs/euses, ainsi que de toute personne voulant une amélioration des conditions de travail et de vie, de soutenir les luttes des salarié.es du secteur pétrolier.
Signataires
1- Syndicat des retraité.es ;
2- Syndicat des travailleurs/euses de l'électricité et de la métallurgie de Kermanshah ;
3- Syndicat des peintres d'Alborz ;
4- Conseil des retraité.es d'Iran ;
5- Comité pour la création d'organisations ouvrières ;
6- Appel des femmes d'Iran ;
7- Voix indépendante des salarié.es du groupe sidérurgique « National Steel Group ».
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Entre l’OLP et le Hamas, les chaises musicales de la troisième voie palestinienne

Cette réflexion m'a été inspirée par la lecture du texte d'Adam Shatz publié le 31 octobre par Orient XXI et intitulé « Gaza, Les pathologies de la violence [1] » et de la réponse que lui a faite le 8 novembre Abdaljawad Omar sous le titre « Les pathologies de l'espoir dans la guerre pour la Palestine [2] ». Elle prend surtout pour point de départ la réplique de A. Omar qui, se saisissant de l'approche faite par Shatz de la violence anticoloniale, tente de la dépasser en dessinant à grands traits les objectifs stratégiques qu'elle sert. A. Omar conteste une approche de la violence exercée par la résistance palestinienne le 7 octobre en tant que phénomène épuisant tout son sens dans ses seules modalités, supposées d'ailleurs sans aucune certitude, et relevant de ce fait d'un simple jugement fondé sur les critères de la « normalité » et de la « pathologie ».
Tiré d'Algeria-Watch.
Il relève que Shatz propose « trois grands énoncés polémiques : « les pathologies vengeresses » des Israéliens et des Palestiniens « reflétant les mêmes instincts primordiaux » ; une critique de « la « gauche décoloniale », qu'il accuse de fermer les yeux sur les « crimes » commis par les colonisés et de se réjouir de manière puérile de la mort des civils » ; « l'utilisation d'analogies historiques » rapprochant les événements du 7 octobre avec « un épisode oublié de la guerre de libération algérienne : la bataille de Philippeville ».
Une négation de la rationalité de la violence révolutionnaire
A propos des événements de Skikda (ex. Philippeville) du 20 août 1955, Shatz écrit :
« Encerclé par l'armée française, craignant de perdre du terrain au profit des politiciens musulmans réformistes favorables à un règlement négocié, le Front de libération nationale (FLN) lança alors une attaque féroce dans la ville portuaire de Philippeville et ses environs. Des paysans armés de grenades, de couteaux, de gourdins, de haches et de fourches massacrèrent — parfois en les éventrant – 123 personnes, principalement des Européens, mais aussi un certain nombre de musulmans. Pour les Français, ces violences étaient purement gratuites, mais dans l'esprit des auteurs de ces actes, il s'agissait de venger les massacres à Sétif, Guelma et Kherrata de dizaines de milliers de musulmans par l'armée française, appuyée par des milices de colons, après les émeutes indépendantistes de mai 1945 ».
Réfutant la comparaison du 7 octobre avec le 20 août 1955, A. Omar réplique que « l'objectif principal de la bataille de Philippeville était de cibler les civils, et supposer que c'était l'objectif principal du 7 octobre revient à ignorer les faits ».
Dans cet échange d'interprétations, il est clair que Shatz n'invoque le 20 août algérien que pour appuyer la thèse de la vengeance qu'il développe à propos du 7 octobre, alors que A. Omar ne réfute la comparaison que pour écarter l'idée de vengeance à propos du 7 octobre. Moyennant quoi, tous les deux font une appréciation erronée des motifs et des enjeux du 20 octobre 1955 et retiennent en substance que l'insurrection visait les civils européens.
Or, cet accord sur le récit du 20 août constitue en lui-même une adhésion objective à la lecture coloniale de la violence révolutionnaire pendant la guerre d'Algérie mais aussi, potentiellement, une caution apportée par les deux auteurs à la lecture stigmatisante de la violence des colonisés que l'on applique actuellement selon les mêmes standards aux événements du 7 octobre. C'est dire que, en acceptant l'idée de Shatz selon laquelle l'ALN avait visé les civils, A. Omar, malgré ses dénégations, concède en creux que la grille de lecture vaut pour le 7 octobre.
On peut en effet observer que la surenchère actuelle focalisant sur un 7 octobre voué par le Hamas à des « atrocités contre les civils » est en train d'être gravée en temps réel dans le marbre de l'histoire et que cette version risque de n'en être plus jamais effacée, exactement de la même manière que l'histoire du 20 août 1955 demeure à jamais dans la mémoire sélective et révisionniste des Français celle du massacre de 123 civils européens.
C'est donc une erreur aux conséquences théoriques et pratiques graves que A. Omar commet, préoccupé qu'il est de disculper les combattants palestiniens, en concédant que l'insurrection du 20 août était une attaque contre les civils.
Il est en effet contraire à la réalité et nuisible à la représentation des luttes de libération nationale de considérer que la violence mise en œuvre puisse être stratégiquement plus ou moins rationnelle dans un cas que dans l'autre.
L'instinct de vengeance primaire est absent de l'insurrection du 20 août autant que de l'attaque du 7 octobre. Mais, comme il n'existe un semblant d'accord entre les deux auteurs que sur les motivations du 20 août, A. Omar s'opposant à Shatz sur les motivations du 7 octobre, il nous faut d'abord examiner les éléments qui réfutent leur lecture sinon identique du moins convergente du 20 août.
La dimension stratégique de l'insurrection du 20 août 1955
La seule part de vérité que l'on peut déceler dans l'affirmation de Shatz selon laquelle l'insurrection du 20 août avait pour moteur la volonté populaire de venger les massacres du 8 mai 1945, réside au mieux en ceci que c'était là un argument de mobilisation tout trouvé parmi d'autres pour le chef de la zone 2 de l'ALN, Zighout Youssef. On aurait pu supposer qu'il en fût autrement si les masses paysannes s'étaient révoltées de manière spontanée et anarchique. Tous les rapports de l'époque indiquent le contraire : l'initiative avait été prise par l'ALN et la population, sommairement armée, était rigoureusement encadrée par des djounouds dans les assauts qu'elle a lancés dans plusieurs villes de la région. Zighout poursuivait de ce fait un objectif stratégique lié à l'actualité de la lutte lancée le 1er novembre 1954 et non pas un dessein associé au passif sanglant de mai 1945. Sans qu'il soit nécessaire de s'attarder sur ce point qui a été suffisamment exploré par les historiens, il suffit de rappeler que, d'une part, il voulait remédier à l'isolement dans lequel se trouvaient les combattants de la zone 2 dans un contexte où l'armée de libération n'était pas encore structurée au niveau national, que, d'autre part, l'armée d'occupation s'efforçait d'empêcher toute jonction que l'ALN tenterait avec des milieux influents de la population algérienne et que, enfin, les couches paysannes, dépossédées par la colonisation et potentiellement favorables à la lutte, échappaient encore à son encadrement. C'est ce statu quo, que le 1er novembre n'avait pas ébranlé, qu'il fallait faire évoluer. L'objectif de Zighout était en définitive foncièrement rationnel, à la fois militaire et politique.
Et cela devait se confirmer, dans l'exécution, par le fait que l'attaque contre les civils ne constituait pas l'essentiel de l'action qui ne les a visés qu'en tant que composante des centres de colonisation, agricoles et industriels (notamment la mine de pyrite d'El Hallia), alors qu'étaient visés simultanément les bases et cantonnements des forces de la répression : le camp militaire d'El Khroub et les locaux de la police de Skikda furent entre autres lieux le théâtre de combats acharnés.
C'est une insurrection contre la colonisation, civile et militaire, c'est-à-dire contre le système colonialiste dans son essence et dans sa logistique militaro-policière, qu'a connue le 20 août 1955. Les attaques ont été planifiées pour donner tout son sens à l'objectif de lutte armée de libération nationale. Et, si des civils européens en ont été victimes, ce fut au prix du sacrifice consenti au centuple par les masses algériennes. L'implication des deux populations civiles devait d'ailleurs porter le message que la guerre de libération ne pouvait être qu'une guerre totale, avec la certitude déjà acquise que l'ALN et le peuple n'avaient pas d'autre choix que d'être dans le même camp pour faire pièce à la solidarité organique existant entre les colons et l'armée française qu'avait illustrée la coordination entre les militaires et les milices civiles dans les exactions de mai 1945. S'il y a bien un lien entre les événements de 1945 et ceux d'août 1955, comme le soutient Shatz, il ne tient nullement du désir de vengeance mais de l'expérience tirée par la société et les combattants algériens.
Cette expérience ne laissait d'ailleurs aucun doute sur le fait que la répression colonialiste serait terrible et elle le fut (12.000 personnes massacrées, des villages et des douars entièrement rasés). Mais les historiens s'accordent à considérer que les objectifs de l'insurrection furent atteints. Comme le relève Gilbert Meynier, « désormais le peuple était solidaire d'une ALN qui avait gagné en prestige. Le FLN représentait légitimement le peuple ; et le mythe de l'intégration avait volé en éclat [3] ».
Telle est la juste appréciation des objectifs et des acquis de l'insurrection du 20 août qui nous permet de réfuter l'appréciation qui en est faite par Shatz et par A. Omar, l'un, par assimilation, dans sa volonté d'étayer sa thèse du mobile irrationnel de l'attaque du 7 octobre, et l'autre, par différentiation, dans son intention de soutenir le contraire.
Un déficit de sens historique
Tous deux pêchent ainsi par simplification et par un déficit commun de sens historique que dénote le fait qu'ils semblent s'accorder à dire que « la bataille de Philippeville » est « un épisode oublié de la guerre de libération algérienne ».
Pour en revenir à notre propos sur l'opération Déluge d'Al Aqsa, il convient de relever toute la différence qui existe entre les deux approches. Alors que celle de Shatz épuise son propos dans l'examen des mobiles, celle d'A. Omar tente de s'approfondir par l'exploration des aspects tactique et stratégique.
L'auteur est beaucoup plus affirmatif dans l'interprétation qu'il propose du dispositif tactique et ce, après avoir mis en doute la version israélienne de l'attaque qui la représente comme une expédition barbare dirigée contre les civils et qui est reprise sans recul critique par Shatz :
« Les informations disponibles, écrit-il, permettent de supposer que l'opération du 7 Octobre avait trois objectifs tactiques principaux : capturer des soldats israéliens en échange de prisonniers, obtenir des informations ou des armes à partir des nombreuses bases militaires israéliennes et faire en sorte qu'aucune force policière ou militaire ne puisse facilement nettoyer et reprendre l'enveloppe de Gaza (ce qu'elle ferait probablement en négociant les otages qu'elle détient dans les colonies situées à l'intérieur de l'enveloppe de Gaza) ».
S'agissant de l'aspect stratégique de l'opération, il s'inscrit en faux contre l'analyse résolument nihiliste de Shatz mais sans en tirer des perspectives suffisamment affirmées. Il écrit :
« Pourquoi une attaque contre le nerf principal d'Israël – sa dissuasion et sa puissance militaire – ne conduirait-elle pas à une leçon d'humilité qui pourrait ouvrir d'autres voies pour une nouvelle solution politique ? Si de telles perspectives semblent lointaines dans le feu de l'action et des intentions génocidaires d'Israël, c'est la bataille réelle sur le terrain qui décidera de l'avenir ».
Ainsi suggéré sur le mode interrogatif, l'enjeu stratégique évoqué est par ailleurs formulé d'une façon qui trahit l'hésitation de l'auteur entre le plan militaire et le plan politique. Et il est évident que le seul test d'évaluation qui vaille se situe au niveau politique : quel profit attendre de l'attaque qui soit suffisamment important pour que se justifient tant soit peu les sacrifices qu'elle ne pouvait manquer d'exiger de la population de Gaza ?
• Omar effleure la réponse à cette question sans paraître vraiment s'en aviser dans un paragraphe précédent sa formulation : ayant exprimé le jugement sommaire qu'il porte sur l'insurrection du 20 août pour contester toute similitude qu'elle aurait avec le 7 octobre, il nuance son propos en écrivant plus loin que « l'une des conséquences les plus importantes de la bataille de Philippeville a été de mettre fin aux perspectives d'un mouvement de « troisième voie » qui liait les Arabes algériens aux colons français ». Ce faisant, il restitue en partie à l'événement une dimension stratégique qu'il avait d'abord niée, même s'il laisse ainsi entendre que cette « conséquence » a été obtenue sans avoir été préalablement pensée, c'est-à-dire comme une prime fortuitement ajoutée à l'objectif recherché qui était selon lui de « viser les civils ». Mais, de toutes façons, il ne concède à l'insurrection du 20 août ce résultat stratégique que pour mieux opposer la conjoncture politique algérienne à la situation actuelle en Palestine puisqu'il ajoute : « En Palestine, cette troisième voie a pris fin il y a deux décennies, devenant une coalition très faible soutenue par quelques organisations de défense des droits de l'homme et des voix minoritaires en Israël ».
• Et je crois que c'est là qu'il commet une erreur conséquente sur la situation palestinienne actuelle qui l'empêche d'apercevoir les enjeux politiques de l'opération du 7 octobre [4].
La 3e voie palestinienne : une menace en cours de réalisation avancée
Il existe en effet bel et bien en Palestine la menace, en cours de réalisation avancée, que le mouvement national succombe à une captation opérée par une troisième voie. Ce qui distingue cette problématique en Palestine par rapport aux précédents historiques des luttes de libération nationale, et notamment le précédent algérien, c'est que, d'une part, la résistance a semblé avoir conjuré ce risque relativement tôt lorsque le Fatah avait dégagé la cause palestinienne de la gangue stérile du conflit israélo-arabe en 1968, mais que, d'autre part, la trajectoire de la résistance qu'il a menée par la suite sous l'enseigne de l'OLP l'a conduit à partir de 1988 [5] et surtout des accords d'Oslo de 1993 à un terrible reniement.
Les accords de paix, précédés de la concession à Israël de 78% du territoire historique, ont en effet fourvoyé la résistance palestinienne dans un arrangement combinant à la fois le renoncement à la résistance et le retour sous la tutelle arabe, notamment celle de l'Égypte et de la Jordanie, dont les mobiles étaient de faire d'une Palestine pacifiée le prétexte et le point d'appui d'une stratégie de coopération économique régionale ayant Israël, avec sa technologie et sa puissance industrielle, pour pivot central.
Les accords d'Oslo ont doublement affaibli l'OLP :
– D'une part, en la reconnaissant comme l'unique représentant du peuple palestinien, Israël l'a isolée à la fois de la résistance intérieure qui avait été l'âme de la première intifada et des Palestiniens de la diaspora. Alors que cette même reconnaissance de l'OLP par l'ONU et la Ligue arabe en 1974 avait achevé de fermer la porte à toute troisième voie, sa confirmation par Tel Aviv allait au contraire entraîner dans une telle voie alternative l'organisation présidée par Arafat elle-même, débordée peu à peu par une résistance qui lui était extérieure. Israël a pu d'ailleurs compter sur les penchants monopolistiques de la direction de l'OLP rentrée de l'exil pour atteindre cet objectif. Après avoir offert aux Israéliens un désarmement du mouvement national empêchant tout retour à la résistance (en tournant la page de l'action violente et en s'engageant à sanctionner tout contrevenant), Yasser Arafat n'a pas hésité à abroger la charte palestinienne au prix d'un noyautage autoritaire du conseil national palestinien qui en a adopté les amendements en avril 1996. L'isolement du Fatah au sein de la résistance à laquelle il appartenait encore formellement fut consommé en 2005 lorsque Mahmoud Abbas conclut un cessez-le-feu avec Israël pour mettre fin à la seconde intifada. Le Hamas, le jihad Islamique ainsi que des factions de l'OLP ont alors résolu de poursuivre la lutte.
– D'autre part, les accords d'Oslo ont été conçus par les Israéliens, qui ont largement imposé leurs vues, comme un instrument de neutralisation de la cause palestinienne en la dissolvant dans une perspective de coopération régionale avec les États arabes. A cet égard, alors qu'ils occultaient les questions politiques épineuses de la reconnaissance de l'État palestinien et de l'arrêt de la colonisation des territoires occupés, ces accords ont détaillé dans deux des protocoles économiques annexes qui les accompagnaient une vision d'un nouveau Moyen-Orient économique et financier qui semblait mieux faite pour appâter les oligarchies arabes de la région que pour satisfaire les revendications palestiniennes.
Oslo, prélude à la normalisation israélo-arabe
George Corm a parfaitement analysé cette duperie à laquelle les États les plus industrialisés du G7, la Ligue arabe et les pays islamiques étaient conviés à prendre part. Prenant pour prétexte le projet d'investir dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, l'initiative avait pour dessein d'articuler une coopération israélo-arabe qui servirait les intérêts des Etats et rendrait irréversible la présence israélienne dans les territoires de 1967. De sorte que les accords d'Oslo furent le cheval de Troie d'une tentative de remodelage de la région qui anticipait, sur le plan économique, les plans que George W. Bush tenterait la décennie suivante d'imposer par la force des armes et dans une approche globale incluant le politique.
La frénésie qui s'était saisie à l'époque des milieux d'affaires est aujourd'hui oubliée. Mais il est bon de rappeler que toute une série de rencontres avaient été alors organisées dans une euphorie qui ne devait pas tarder à faire long feu : à la Banque mondiale à Washington, dans plusieurs capitales européennes ; mais aussi à Jérusalem où s'est tenue une « business conference » avec une forte participation arabe, au Maroc. Le célèbre forum de Davos lui-même devait accueillir Shimon Perez et Yasser Arafat, venus discuter business [6].
Ainsi, les accords d'Oslo n'ont pas seulement fait renier à l'OLP son engagement originel d'être le pôle dynamique de la résistance, ils ont converti ses instances dirigeantes en structures bureaucratiques chargées de garantir la « paix » nécessaire à la marche des affaires et de gérer la manne financière qu'elles recevaient en contrepartie de ses parrains arabes et occidentaux.
Parallèlement, le Hamas, issu des rangs des frères Musulmans, amorçait une trajectoire inverse qui devait le conduire de ses positions piétistes et attentistes initiales, qui lui avaient valu les faveurs d'Israël, à un engagement dans l'action armée amorcé à la faveur de la seconde intifada. Cédant à la suprématie de l'OLP, il devait ensuite accepter de s'intégrer dans le processus d'Oslo et de participer pour la première fois aux élections de 2006. Mais la victoire qu'il y a remportée devait paradoxalement le marginaliser définitivement, du fait du désaveu et du boycott des puissances occidentales qu'elle lui a valus en même temps que de la guerre civile dans laquelle elle l'a entraînée contre le Fatah [7].
Depuis lors, le nouveau paysage palestinien n'a fait que s'enraciner avec une division à la fois géographique et politique des deux principaux acteurs de la scène palestinienne : Gaza insurgée sous la férule du Hamas et la Cisjordanie livrée à la colonisation massive sous la supervision du gouvernement israélien et sous les yeux d'une Autorité palestinienne impuissante sinon complice.
La boussole qui indique habituellement dans des conflits analogues la position respective des deux protagonistes principaux et de la troisième voie alternative qui viendrait se mêler au jeu s'en est trouvée déréglée dans la mesure où c'est un véritable jeu de chaises musicales qui a fini par assigner aux deux organisations palestiniennes leurs places effectives.
Dans le même temps, la géopolitique régionale était elle-même profondément remaniée sous l'effet combinée de l'invasion de l'Irak et de la guerre syrienne qui ont redessiné les alliances nouées autour de la question palestinienne. Alors que les accords d'Oslo n'en finissaient pas d'étendre leurs effets « normalisateurs » aux États arabes qui appuyaient l'Autorité de Ramallah, notamment à la faveur des ralliements suscités par les accords d'Abraham, l'Iran s'affirmait dans son rôle de soutien au Hamas à Gaza en coordination avec l' « axe de la résistance » animé essentiellement par le Hezbollah.
C'est à partir de cette géographie locale et régionale qu'on peut décrypter les intentions stratégiques de l'opération du 7 octobre. L'adhésion annoncée de l'Arabie Saoudite au processus de normalisation allait rompre l'équilibre existant entre les factions palestiniennes, favorisant d'une manière qui pouvait s'avérer décisive la troisième voie que l'OLP, à travers le Fatah qui y prédomine, avait fini par incarner, à rebours de son histoire militante. La cause palestinienne était sur le point de disparaître sur le terrain et dans une reconfiguration régionale défaitiste. En Cisjordanie, l'autonomie était appelée à se limiter à une auto-administration subordonnée à Israël sur un micro-territoire constamment rogné par la colonisation, alors qu'à Gaza une résistance résiduelle était contenue par des raids récurrents de l'armée israélienne en attendant l'éradication du Hamas et le nettoyage ethnique qui ne pouvait manquer de l'accompagner.
Le 7 octobre et la position intenable de l'Autorité palestinienne
Il n'est donc pas douteux que l'opération « Déluge d'al Aqsa » a été pensée pour aboutir à une redistribution générale des cartes aux différents niveaux où elles se répartissaient :
1°- Frapper Israël au cœur de son territoire par une action militaire qui constitue une première depuis 1948 afin d'attester que son invulnérabilité n'était qu'un mythe auquel avait souscrit le défaitisme arabe. Et, à cet égard, l'acharnement d'Israël à affirmer que l'attaque ne fut qu'une action terroriste visant à massacrer, violer et mutiler la population civile s'avère de moins en moins payant, en dépit de la propagande qui le soutient ;
2° – Provoquer par contagion, et devant l'ampleur de la répression, un sursaut de la résistance en Cisjordanie avec pour objectif primordial de susciter une dissidence au sein des appareils de l'Autorité palestinienne et une remise en cause des accords d'Oslo ;
3° – Entraver le processus de normalisation dans la région dont la source et la justification se trouvent précisément dans ces accords ;
4° – Last but not least, mettre en échec l'offensive terrestre de l'armée israélienne à Gaza pour réhabiliter les vertus de la résistance par les armes.
L'attaque du 7 octobre est de ce fait bel et bien, quoi qu'en pense A. Omar (pour ne rien dire de l'interprétation erronée de Shatz), une opération destinée à faire barrage à une troisième voie, telle que sa menace doit être comprise dans le contexte spécifique palestinien. Il s'agit de contrer le retour de l'OLP dans le giron de régimes arabes convertis à la normalisation tel qu'il s'est amorcé à la fin des années 1980, dans un mouvement qui a annulé le chemin parcouru par l'organisation de Yasser Arafat depuis 1968 quand elle s'était arrachée à la tutelle de régimes bravaches et velléitaires.
Le pari n'est pas gagné d'avance. Les critères définissant les intérêts stratégiques des États arabes semblent avoir été durablement modifiés par la multiplication des conflits et des enjeux des deux dernières décennies au cours desquelles la question palestinienne a perdu la place prépondérante qu'elle y occupait. Le Hamas n'arrive pas à faire oublier aux Égyptiens qu'il est issu des Frères Musulmans ni aux Syriens qu'il s'est opposé à eux pendant la guerre civile de la dernière décennie. La tiédeur des positions exprimées au sommet de Ryad le 11 novembre dernier, la tacite confiance maintenue à Israël par les États normalisateurs, en dépit des massacres qui se poursuivent à Gaza, et même la réserve d'un pays comme l'Algérie à l'égard du Hamas [8] sont autant d'indices que celui-ci a du mal à mobiliser autour de lui. Les États arabes semblent attendre que l'éviction de Netanyahu et de ses soutiens d'extrême-droite ramène au pouvoir des partis qui approuvent le projet américain de remettre en selle les accords d'Oslo et l'Autorité palestinienne. Ils ont définitivement décidé que leur intérêt était là et certainement pas dans une relance de la résistance à l'occupation.
Dans un tel contexte, le Hamas ne peut incarner à lui seul la résurrection de la résistance. Voilà pourquoi la partie se joue essentiellement en Palestine où l'OLP et surtout le Fatah qui la domine ne peuvent désormais continuer aussi facilement à enfoncer la tête dans le sable.
Khaled Satour, décembre 8, 2023
Notes
[1] https://orientxxi.info/lu-vu-entendu/gaza-pathologies-de-la-vengeance,6829
[2] Publié d'abord en anglais sur mondoweis sous le titre Hopeful pathologies in the war for Palestine : a reply to Adam Shatz. La traduction française est accessible sur le site d'Algeria Watch : https://algeria-watch.org/?p=89687
[3] Gilbert Meynier, Histoire intérieure du FLN, 1954-1962, Paris, Fayard, 2002, p. 281.
[4] Il convient de préciser à ce stade de la réflexion que j'entends ici le concept polysémique de troisième voie par référence à l'option prise depuis 1968 par l'OLP de mener une résistance armée contre Israël mais aussi à partir de la conviction que la cause palestinienne n'a pas d'autre choix si elle veut se réaliser en État indépendant. Dès lors, la 3e voie est celle qui fournirait à Israël le partenaire palestinien susceptible de faire échec à cet objectif. Sur un plan plus global, se pose la question de la forme de réalisation de cet objectif (solution à deux États ou État démocratique sur l'ensemble de la Palestine historique) que je n'aborderai pas. Aussi bien, ne discuterai-je pas l'approche faite par Edward W. Said sous le titre Israël-Palestine, une troisième voie. Voir le Monde diplomatique d'août 1998 : https://www.monde-diplomatique.fr/1998/08/SAID/3925
[5] Le 15 novembre 1988 à Alger, Yasser Arafat annonçait la création de l'État palestinien sur 18% du territoire historique, avec Jérusalem pour capitale, ce qui constituait une reconnaissance d'Israël. Ce fut le préliminaire aux accords d'Oslo.
[6] Georges Corm, Le Proche-Orient éclaté, T. 2, 1956-2012, Gallimard, 2012, pp. 762 et s.
[7] Sur la trajectoire du Hamas, lire l'entretien avec Tareq Baconi publié par le site contretemps le 23 novembre 2023 sous le titre Le Hamas dans le mouvement national palestinien : une mise en perspective historique.
https://www.contretemps.eu/hamas-mouvement-national-palestinien-historique/?fbclid=IwAR0JAZyicFkkkbdWPjX4362vdknzCU9VQFJDy2pE843UDS2BsSR0sBKlIOg
[8] L'interdiction signifiée le 28 novembre à Abderrazak Makri, ancien leader du MSP, parti algérien de la mouvance Frères Musulmans, de quitter le territoire algérien pour se rendre auprès des chefs politiques du Hamas à Doha, en est un indice très significatif. https://www.jeuneafrique.com/1510461/politique/en-algerie-interdiction-de-sortie-du-territoire-pour-abderrazak-makri/
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Yémen, des centaines de milliers de manifestants

Ce vendredi 12 janvier des dizianes de milliers de Yéménites ont pris les rues dans nombreuses villes du pays pour manifester contre les attaques anglo-américaines sur leurs terres et en soutien à la Palestine, après que les États-Unis et le Royaume-Uni aient fait pleuvoir une centaine de missiles sur des infrastructures militaires et aériennes au Yémen la nuit même.
Tiré de MondAfrique.
La colère règne au Yémen, et vendredi des chants pro-palestiniens et anti-américains ont retenti dans les rues du pays, et particulièrement dans la capitale Sanaa, où des dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés. Les attaques anglo-américaines, qui avaient pour objectif d'éliminer des dirigeants Houthis, sont survenues après que le groupe rebelle religieux ait attaqué des navires de fret en mer rouge, point de passage d'un grand nombre de vaisseaux commerciaux, et donc d'une suprême importance. Ces attaques houthies, qui ont fortement perturbé le commerce mondial, ont été conduites au nom du soutien aux Palestiniens, qui subissent les bombardements israéliens. Les houthis sont soutenus par l'Iran, ennemi juré d'Israël et des États-Unis.
Vendredi, les Yéménites ont réagi au quart de tour. Le déluge de missiles avait eu lieu à l'aube, et en l'espace de quelques heures la masse avait investi les rues. Au menu, des drapeaux palestiniens et yéménites géants, des chants en soutien à la Palestine, et la défiance envers les États-Unis, exemplifiée par le classique moyen-oriental qui consiste à brûler des drapeaux états-uniens.
Des promesses de représailles
Le porte-parole Houthi a annoncé, dans une déclaration, que “l'agression criminelle” des américains et britanniques “ne sera pas sans réponse et sans punition”. Il continue, “Cette agression brutale ne découragera pas le Yemen dans sa position de support envers le peuple palestinien.”Dans la rue, la détermination régnait aussi. D'après les dires d'un manifestant, « Nous n'avons pas peur de l'aviation américaine ou britannique. Cela fait neuf ans que nous sommes bombardés et une nouvelle attaque n'est pas nouvelle pour nous ».
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Gaza. ces journalistes qu’on assassine.

Paris. Mercredi, 10 janvier 2024. Ils sont surarmés de caméras, d'appareils photo, de micros, de stylos, de blocs notes. Ils sont journalistes, reporteurs, correspondants, envoyés spéciaux. Les derniers témoins du génocide sioniste à Gaza. Ils sont les cibles prioritaires de l'armée israélienne.
Samedi, 6 janvier 2024. Deux roquettes provoquent la mort, dans leur voiture à Khan Younes, dans le sud de Gaza, de deux journalistes, Hamza al-Dahdouh, fils de Waël al Dahdouh, chef du bureau d'Al Jazeera, et Moustafa Thuraya, vidéaste pigiste à l'Agence France-Presse. Une éradication systématique du journalisme. Un crime de guerre à grande échelle. Un massacre sans fin. Une extermination totale. La chaîne internationale Al-Jazira demeure le dernier témoin. La famille de Waël al-Dahdouh, journaliste palestinien et chef du bureau de la télévision qatarie à Gaza, est décimée. Il est la voix des damnés de la terre sainte. Il n'a quitté l'antenne ni après l'assassinat, 25 octobre 2023, de son épouse, de sa fille de sept ans, de son fils de quinze ans, de son petit-fils d'un an et demi, ni après avoir été blessé le 15 décembre 2023 aux côtés de son collègue Samer Abou Daqqa tué sur le coup, ni après le meurtre de son fils aîné, Hamza al-Dahdouh, journaliste, vingt-sept ans. Il déclare : « Hamza était tout pour moi. Alors que nous, les palestiniens, nous sommes pleins d'humanité, les sionistes sont emplis de haine meurtrière ». Il couvre jusqu'où bout les événements dans sa ville natale, Gaza, réduite en cendres, avant de transférer ses bureaux et ses équipes à Rafah. Il compense la conscience absente d'un monde livré aux manipulations politiques et médiatiques.
Dimanche, 17 décembre 2023. Une tribune signée par deux cents journalistes sonne désespérément l'alarme. « Chaque jour, nos consœurs et confrères palestiniens se mettent en danger pour documenter la situation et informer le monde sur la situation à Gaza. Le Comité pour la protection des journalistes, qui tient des statistiques depuis 1992, signale que les derniers mois représentent la période la plus meurtrière pour les journalistes dans un conflit. C'est la plus grande atteinte à la liberté de la presse et d'expression jamais observée. Dans l'horreur qui étreint Gaza, les journalistes palestiniens sont en première ligne. Les violations contre la liberté́ de la presse commises par la machine de guerre israélienne ne sont pas nouvelles, à l'exemple de l'exécution de Shireen Abu Akleh le 11 mai 2022 à Jénine en plein reportage. Nous dénonçons, par ailleurs, l'asymétrie de la compassion à l'œuvre dans les médias français, justifiant l'injustifiable, et la partialité́ de la couverture médiatique, qui occulte la réalité́ de la guerre coloniale en cours. Nous dénonçons le fait que des journalistes soient sanctionnés et censurés dans leurs rédactions lorsqu'ils ne font pas preuve de complaisance par rapport à la version de l'armée israélienne. Nous apportons tout notre soutien au journaliste Mohammed Kaci, désavoué par la chaîne TV5 Monde pour une interview jugée trop critique. Le relai biaisé des événements, la minimisation de la colonisation, la dédramatisation des carnages israéliens sont une faillite journalistique et morale. La stratégie israélienne réduit au silence les populations civiles, détruit les infrastructures des médias. Notre rôle n'est pas de relayer la propagande militaire. Notre rôle est d'informer, de rapporter les faits réels ».
A Gaza, les écoles se transforment en charniers d'enfants, les maternités en cimentières de nouveaux nés. Des corps écrasés par les chars gisent dans les décombres. L'apocalypse dans toute son horreur. Les puissances occidentales apportent leur aide militaire inconditionnelle à l'armée sioniste. Elles garantissent son impunité dans le Conseil de Sécurité de l'Onu. Les journalistes palestiniens ne meurent pas de balles perdues et de dommage collatéraux. Ils sont expressément frappés pour empêcher toute documentation écrite, photographique, audiovisuelle. Ils ne sont plus visés individuellement par un sniper. Des missiles téléguidés exterminent plusieurs reporters à la fois. Selon le Syndicat des journalistes palestiniens, soixante maisons de journalistes, vingt-quatre stations de radio, soixante trois bureaux de médias ont été détruits. Le 9 octobre 2023, un raid de l'aviation anéantit le district de Rimal abritant le bâtiment Hiji et plusieurs médias. Le rédacteur en chef Saeed al-Taweel du site Al-Khamsa News, les correspondants Mohammed Sobboh et Hisham Alnwajha de l'agence de presse Khabar, sont tués.
Audrey Azoulay, directrice générale de l'Unesco publie un communiqué de protestation : « Je déplore la mort des journalistes Saeed Al-Taweel, Mohammed Sobboh et Hisham Alnwajha. Je demande une enquête indépendante pour déterminer les circonstances de cette tragédie. Les journalistes couvrant des situations de conflit doivent être protégés en tant que civils, conformément au droit international humanitaire et à la résolution 2222/2015 du Conseil de sécurité des Nations unies sur la protection des journalistes, des professionnels des médias et du personnel associé dans les situations de conflit ». Toujours en octobre 2023, le journaliste Assaad Shamlakh est liquidé avec neuf membres de sa famille par une frappe aérienne de leur demeure à Sheikh Ijlin. En novembre 2023, la journaliste Alaa Taher Al-Hassanat et le photojournaliste Mohammed Moin Ayyash sont éliminés de la même manière avec plusieurs de leurs proches. La terrorisation sioniste atteint parfois son objectif. Le dimanche 7 janvier 2024, Anas El Najar, correspondant du China Media Group annonce l'abandon de sa mission : « Ma couverture journalistique s'arrête là. Inutile de transmettre des informations de terrain à une planète qui n'a aucune humanité, aucun empathie ».
L'Organisation danoise International Media Support pointe ce conflit comme le plus funeste des conflits depuis un siècle, 83 journalistes morts à Gaza en deux mois, 71 morts pendant la guerre d'Irak en trois ans, 69 journalistes morts pendant la Seconde Guerre mondiale en six ans, 63 journalistes morts pendant la guerre du Vietnam en vingt ans. Le Syndicat des journalistes palestiniens dénombre 109 reporters délibérément abattus en trois mois. Le Comité de protection des journalistes, basé à New York, confirme globalement ces chiffres, 72 palestiniens, 4 israéliens, 3 libanais. Les journalistes étrangers sont interdits d'accès sur le territoire palestinien ou soumis au contrôle permanent de l'armée israélienne. Quand un journaliste gazaoui meurt, il n'y a personne pour le remplacer. Personne ne peut s'exposer à une mort certaine. La journaliste Ayat al-Khadour dénonce l'utilisation de bombes au phosphore blanc et de bombes thermobariques : « Les occupants israéliens larguent des bombes au phosphore blanc sur la zone de Beit Lahia, des bombes sonores effrayantes. La situation est terrifiante ». Elle ajoute : « Cela pourrait être ma dernière vidéo ». Peu de temps après, le lundi 20 novembre 2023, elle tombe sous un bombardement. L'utilisation de bombes au phosphore blanc, fournies par les Etats Unis, est confirmée par le Washington Post daté du 11 décembre 2023. L'origine américaine des obus est vérifiée par Human Rights Watch. Les mêmes codes de fabrication apparaissent sur des obus au phosphore blanc alignés à côté de pièces d'artillerie israéliennes dans la ville de Sderot, près de la bande de Gaza, sur une photo prise le 9 octobre 2023. L'armée sioniste veut, à tout prix, rendre sa guerre invisible au prix d'une monstrueuse boucherie. Les fake-news, l'intelligence artificielle, la peste internétique brouillent les pistes.
Mustapha Saha
Sociologue
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :












