Presse-toi à gauche !
Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Opération Craie-Mazie

Québec, le 9 mai 2025. Le 13 mai 2025, à partir de 7h et jusqu'à 8h30 du matin, le Conseil de quartier Montcalm organise l'Opération Craie-Mazie.
Conseil de quartier Montcalm
Par cette action, il désire manifester le souhait de la communauté de voir l'intersection Crémazie / Des Érables être sécurisée. Afin de rendre visible le passage fugace des piétons et cyclistes, le Conseil de quartier Montcalm tracera à la craie les empreintes de pas des gens qui traversent l'intersection. La somme des empreintes devrait parler d'elle-même en offrant un visuel coloré.
Si le Conseil a décidé d'organiser cette action citoyenne, c'est qu'il y a tout près d'un an, le 28 mai 2024, trois enfants ont failli être frappés par un autobus du RTC au coin de l'avenue des Érables et de la rue Crémazie Ouest, intersection qui n'a ni arrêt obligatoire, ni mesure d'apaisement, malgré les demandes répétées des parents et des citoyens depuis plusieurs années. À la suite de cet événement, une résolution du Conseil de quartier réclamait que l'intersection des Érables et Crémazie Ouest soit sécurisée, que ce soit par l'ajout d'une intersection surélevée, par un arrêt, par une traversée avec affichage, des saillies de trottoirs et un îlot refuge, ou un autre type d'aménagement. La Ville a refusé sous prétexte que « [l]es analyses de justification pour implanter des feux, des arrêts ou un passage pour piétons ont toutes été effectuées récemment, et aucun aménagement ne répond aux critères des normes du ministère du Transport et de la Mobilité durable (MTMD, anciennement MTQ). » Or, des arrêts ont été ajoutés à deux endroits récemment dans le quartier à des intersections similaires pour favoriser la mobilité active et améliorer la sécurité des piétons et cyclistes (Fraser et Bougainville ; Crémazie Ouest et Salaberry1). Ces normes du MTMD sont donc suffisamment flexibles pour que l'intersection Crémazie et des Érables soit sécurisée aussi..
La Ville a certes affirmé qu'« une problématique de visibilité réciproque a été constatée, et [qu'elle allait] demander l'interdiction de stationnement à proximité de l'intersection ». Cette dernière mesure semble bien mince compte tenu qu'un grand nombre d'élèves de l'école Anne-Hébert circulent à cet endroit matin et soir, mais aussi sur l'heure du dîner. Il y en aurait 34 uniquement au Projet Bourlamaque adjacent.
Plus encore, des citoyens ont observé que les automobilistes s'arrêtent naturellement à cette intersection et invitent les piétons à traverser d'un signe de la main, ce qui est parfois très dangereux, surtout pour les enfants, parce qu'un automobiliste qui arrive en sens inverse ne s'arrêtera pas forcément aussi.
Par l'Opération Craie-Mazie, le Conseil de quartier Montcalm souhaite que la Ville apporte des améliorations avec diligence ; n'attendons pas qu'un accident survienne pour agir.
Hélène Paradis, responsable du Comité Transport
Jonathan Tedeschi, co-président
Ann-Julie Rhéaume, citoyenne, responsable de Pas une mort de plus
Note
1. Ville de Québec, Sommaire décisionnel numéro TM2024-185 [en ligne]
https://gpddocs.ville.quebec.qc.ca/gpdblob/TM2024-185.pdf (site consulté le 18 juin 2024).
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Grande manifestation pour le logement social

Dans le cadre de la semaine nationale d'actions et d'occupations du FRAPRU, une grande manifestation pour le logement social s'organise à Québec afin de revendiquer un parc de logement locatif composé à 20% de logement social d'ici 15 ans. Le logement social, c'est à dire les coopératives et les OSBL d'habitation de même que les HLM, est le seul moyen viable à long terme pour lutter contre la spéculation immobilière et offrir des logements réellement abordables et de qualité !
Au Québec, le loyer moyen a presque doublé (augmentation de 47%) en 6 ans. Pour la ville de Québec, c'est une augmentation de 11,7% que nous avons enregistré cette année par rapport à l'an dernier. Avec un taux d'innocupation des logements historiquement bas (0,9% à Québec), la crise du logement fait rage et qu'est-ce qu'on nous propose ? Des projets dit « abordables », c'est à dire « des lofts de 435 pi² en deçà des 1 000$ par mois » ! La Table citoyenne et ses alliés en logement de la région de Québec ripostent et se mettent en marche pour le logement social !
Pour des quartiers solidaires et inclusifs, marchons ensemble pour le logement social !
Où : Place de l'Université du Québec
Quand : Samedi 24 mai à 13h
Dans le cadre cette semaine d'actions et d'occupations, la Table organise une action d'éclat locale et une occupation s'organise à l'échelle régionale.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Monsieur Lionel Carmant, à quoi servent les règles du PSOC si vous transformez le rehaussement en fond discrétionnaire ?

Montréal, le 6 mai 2025._ La Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles maintient sa vive opposition à la décision du ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant de répéter la façon de faire de l'an passé, soit de retenir une part du rehaussement des subventions à la mission globale du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) [1].
Montréal, le 6 mai 2025. La...
En effet le ministre a décidé de distribuer comme bon lui semble 1 des 10 millions de dollars annoncés au Budget. Non seulement il contourne les règles du PSOC, mais il s'apprête à décupler la tâche de fonctionnaires, contrevenant aux objectifs de son propre gouvernement.
Tout d'abord, rappelons que le Budget du Québec 2025, déposé le 25 mars dernier, n'annonçait que 10M$ pour le PSOC [2], soit la seule enveloppe qui s'adresse à l'ensemble des organismes communautaires autonomes du domaine de la santé et des services sociaux (OCASSS). « Le 30 avril, lors de l'Étude des crédits, le Ministre a convenu qu'il ne s'agissait « pas de sommes extraordinaires » [3] et c'est peu dire. Comment ose-t-il, du même souffle, dire qu'il est « au rendez-vous,
encore cette année » avec un rehaussement qui équivaut à peine à 1% du total des subventions distribuées pour la mission globale. Il dit qu'il reconnaît que les besoins sont immenses, mais ses gestes démontrent le contraire », dénonce Stéphanie Vallée, présidente de la TRPOCB.
Questionné par Guillaume Cliche-Rivard, porte-parole du 2e groupe d'opposition en matière de services sociaux durant l'Étude des crédits, le Ministre a répondu [4] « L'an dernier, on a quand même mis 9M sur 10M en mission globale, je m'engage à en mettre au moins autant cette année. (…) En fait, c'est pour des urgences, pour des organismes à risque de fermeture. (…) On va analyser toutes les demandes ».
En plus de diminuer la maigre somme à partager aux 3000 OCASSS, le Ministre transforme donc en financement discrétionnaire un montant qui n'a pas été conçu pour cet usage. « Cela contrevient aux principes en vigueur quant à l'administration du PSOC, notamment ceux prévus au Cadre normatif du PSOC 2023-2027 [5], issu de son ministère. « C'est
clair : ce seront évidemment des fonctionnaires de Santé Québec qui devront traiter les demandes des groupes. Or, à la lumière de plusieurs échéanciers reportés, on est en mesure d'affirmer que cette nouvelle instance est dysfonctionnelle. On ne peut que s'inquiéter de la création d'une administration parallèle des subventions », soulève Mercédez Roberge, coordonnatrice de la TRPOCB.
« Le plus ironique, c'est qu'au moment où M. Carmant annonçait qu'il étudierait toutes les demandes, la Présidente du Conseil du trésor, madame Sonia LeBel, cherchait de son côté à réduire la bureaucratie de l'État [3]. Ce n'est pas en laissant contourner les règles du PSOC qu'elle y arrivera, considérant que l'annonce du ministre Carmant pourrait susciter 3000 appels directs à son aide discrétionnaire », insiste Stéphanie Vallée.
Alors que le ministre de la Santé Christian Dubé est reçu aujourd'hui en Étude des crédits, la Table espère l'entendre sur cette façon de faire. Étant le grand patron de Santé Québec, que pense-t-il de l'utilisation de ses ressources humaines prévue par le Ministre Carmant ?
Le 14 mai prochain, la Table rencontrera les plus hautes responsables de Santé Québec pour la gestion du PSOC, suivi le 26 mai d'une rencontre avec le ministre Lionel Carmant. Elle y réitérera l'insuffisance de l'investissement et son impact négatif sur les groupes. Surtout, elle répétera la nécessité de respecter les règles et de verser l'entièreté des 10M$ à l'enveloppe du PSOC pour la mission globale, au bénéfice de l'ensemble des OCASSS. Elle l'a revendiqué en 2024 et
elle continuera de le faire.
SOURCE :
La Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et
bénévoles (TRPOCB), Mercédez Roberge, coordonnatrice,
coordination@trpocb.org ; 514-690-7826
● Stéphanie Vallée est présidente de la Table des regroupements
provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles. Elle est
également co-coordonnatrice de L'R des centres de femmes du Québec [6].
● Mercédez Roberge est coordonnatrice de la Table des regroupements
provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles [7].
Pour consulter la documentation soutenant l'analyse de la TRPOCB, un
dossier Drive est mis à disposition [8]
Pour visionner le montage d'extraits de l'Étude des crédits 2025, cliquer
ici (Youtube). [9]
Pour visionner la vidéo complète de l'Étude des crédits 2025 des
Services sociaux, cliquez ici (assnat.qc.ca) [10]
trpocb.org/communique-etudes-des-credits-2025/ [4]
À propos
Fondée en 1995, la Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles [11] (TRPOCB) est formée de 49 regroupements nationaux [12], rejoignant plus de 3 000 groupes communautaires autonomes à travers le Québec. Ce sont, par exemple, des maisons de jeunes, des centres de femmes, des cuisines collectives, des maisons d'hébergement, des groupes d'entraide, des centres communautaires, des groupes qui luttent contre des injustices ayant des répercussions sur la santé. Ceux-ci représentent les ¾ des organismes communautaires autonomes du Québec. Ceux-ci abordent la santé et les services sociaux sous différentes perspectives : femmes, jeunes, hébergement, famille,
personnes handicapées, communautés ethnoculturelles, sécurité alimentaire, santé mentale, violence, périnatalité, toxicomanie, etc.
La Table coordonne la campagne [13]_CA$$$H [13]_ (Communautaire autonome en santé et services sociaux – Haussez le financement [13]). Lancée le 17 octobre 2017, cette campagne vise l'amélioration substantielle du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), au bénéfice de plus de 3 000
organismes communautaires autonomes subventionnés par le MSSS. Depuis 2024, les revendications de la campagne _CA$$$H_ sont : L'ajout de 1,7 G$ à l'enveloppe annuelle du PSOC [14] (mission globale), l'indexation annuelle des subventions en fonction de l'Indice des coûts de fonctionnement du communautaire (ICFC [15]) et l'atteinte de l'équité
de financement et de traitement partout au Québec [16].
Vous recevez ce courriel car vous figuriez dans le communiqué de presse de Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles (TRPOCB). Pour vous désinscrire et ne plus recevoir de courriels de cette organisation cliquez ici [17].
Links :
[1] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwszLGu4yAQheGngY5oGAOGgiKNXyMamHGCYsdZ8K7y-Ktc3fY7Oj9njNVB0JLt7IJHtAn1I6PDGAgckRdYU6WZRVaeXA1lTbPolkO0icFBTcBws5xWC9Yj4CzKwWgsz_bH7NQ26cP4WpnnUstqnp_PK16-g97y4zzfQ01XhYvC5ezvo5bL0e8Kl0F3MizDWNjbtrXjNRQuehduZLpsQkNM4_wDt19Q0zXOk4u65y5M9WzHSzl4dxlD7vS3PuSb1-PsIvv3zjZVER-Mx8DGFVpNpBLM5Av4kEpJFvS_jP8DAAD__yzXXXM
[2] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwszkuO6yAQheHVwKxagAHjAYOeZButoig7qONHeERZ_lWuevodHenP0QSyykuOerbeGaMXI--R0HvySNO8hmCnYA0GRz6vSs_k2coSfdBLVlbRorL60XlZtdLOKDOzsKqVzL_lCTuWB9cGjijnOVFa4ff9PsLXZ5CPeO_9amL6FuYmzK3X66T0ddZNmFsaeeMORhkH42CgBz4HAw54lYYbQ-YGWz3HxQ3o3Pdx4OhYKjfgAxoenYE7NK6vQtygnVRwvIW5yZ1zQaj8YGwMJcf_8PMHYvoO82SDrLFyRurlPIRVV-XWeMNBd_40ytYr8_65Z70Qs_PgjM9gE64QMHmYXFLOLyktWslXNP8CAAD__668dro
[3] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwsy71uKyEQQOGngQ5rZhZYKCh8C_dXKVJawMzayL-BdeK8feQo7Xd0OFGoFryWhLP1jggj6WOyIXqSBdHPYS7guLiKwDRBnnLAoFvyASODhRqBYY8cFwR0BDSLsjAay6l9mEtuZ-nDuFqZ51LLYk7P5zVsXkGf03Fd70NNW0U7Rbvv22N9bIoo2v37f7g_39_2Ur_0Rbhl0-UseYhpnH5h_wdq2oZ5skH31IVzXdvtqizcu4whh_yoR9nc-kGPtYtcXjtjrCLOG0eejS15MSEXbyZXwPlYSkTQn4l-AgAA__9EfVfm
[4] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwszT0O4yAUBODTQEcEj_-CIo2vEQHvOUGJ4wTwKsdfebXFNN9oNJggVCMdp6S8cRZAReCP5FZdqyl-ddrmgKtGn8FltEZ5hKh4Sy6oiNLIGiXKm8K4KqksSPDEjBwN6dm-YsvtRX0IWyuiL7Ws4vn7vcPlLPgrPeb8DKavDBYGy-yfvZbL3u8Mlrpv2_Fu34MEzQNpiDO1E7Y5BEiwDBa-EbYsOr0oDxIN0z-4_Qemr8FrE3hPnTDX2fY3M_LTaQy656M-6HzjY3ai7ZyjipXIOmHBoTAlryLk4oS2RVoXS4lK8j8J_gYAAP__prdiXQ
[5] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwszMFyrCAQheGngR1W0wLCgkU2vkYKutsZKjpORFN5_FveyvY7dX7OGMlB0JLt5IJHtAn1M1taGH3AMUIR7xnJj34RBkeSZELdcog2MTigBAyfltNiwXoEnEQ56I3lq32brbRVjm48EfNUqS7m6_f3FYd70Gt-nue7q_FD4axwfl91bVTOtr_6sPXeh8d-_QzfNFBRON-icOadrk1epwEYfUSFs96EWzGHrFK6mMb5P3z-gRo_4jS6qI98CBe6-8rB-5De5VEuesqwHw_dz0Nku-9sE4n4YDwGNq6WxcRSgxl9BR9SrcmC_sn4LwAA___D2WPo
[6] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwsy02uKiEQQOHVwIxO8Q8DBk7choGqaiXarUK_F5d_482dfieHiknoIEguOrrgjdHZyFuxNkdKyWeIZLlhRGiZkrc6Qlh9kL2EpDOBA8xAcNGUVw3aGzCRhYPZie_9rbbaHzym8ohEsWFb1f3z2dPyDfJRbsfxmsKehDkLcx7I-zF4Lm9csApzlhtTr2rwg-tk1an8wuUPhD2laF2Sowymikd_7sLBa_CcfK3_8MbLc1zlPAbz9t1JZ2T2QXkTSLlWV5VqC8r6Bj7k1rIG-b-YnwAAAP__fmBV-A
[7] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwszE1uwyAQxfHTwI5oGPO5YJFNrhEBM05Q7NgFt8rxK1fd_p7enxKGasBJTtobZxF1RPlM1VqkeXYcMVjmaHSM2TkI7Gly7GVLLuhIYKBGILhrirMGbRHQszAwGvGrfak1t4X7ULZWIl9qmdXr83mHyznIJT2PYx9iugq8Cbwdfd9quWz9IfAmV6aWVeeF82DVKP3B_R_EdA1-MkH21JlyPdr2Fgb2zmPwI3_XJ58hOY7OvJ530rEyW6csOlKm5FmFXJyabAHrYilRg_xJ-BsAAP__irpVDA
[8] https://us.cisionone.cision.com/c/eJw0y7uu0zAcgPGnsTdHvscePJxSBcQCCwV1qXz5O7WSNMFOqz4-asVZf5--5LiJkmoMjvVSK86Z5fjqrBBK5mwyY8YHJWQAoUMPMfeQVPS4OG2YTVTSaGmiF5ZsZpQpTnkPSNJWEkzlL1l8maE2omJMqQ8xZDI9nzfTvQKe3XXft4bEB-ID4kOq5QHduK7jDF1cl09CfMjrnKA2xAf25wf7-U0efpvH19Ovw5l_385fTtPofT6N9LgQJIZ725A4vt_LXG4TXiAVTyrM4BuQktwbLv8BiQ_TC2lwdRWSj3tZb0jSrUJrMPp7vEK31hG3vQIsrz0xGwGUJorrRGTwmRgfNBEqUKVtCJZR_HD8XwAAAP__rHVvLQ
[9] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwsyz1vwyAQgOFfAxvRcXwYDwypKu9Vh44RcOcY5bNgt-m_r1J1fV69FDEUC15y1IP1DlGPKJeYbHIzGNKoc_A-QzCJrJtNRhuItKzRBz0SWCgjEBw0jbMG7RBwYGGhV-JT_VSXVM_cunKlEA255FmdHo9r2D2DPMdlXe9dmL3ASeD0c9vWbZdZ4PTydrw_Pt4PXL6FmWZO69ZYmNe-pMYkL0w1qcZnTp1VpfgHh38QZh8GY4NssTGlstbbVVi4N-6dj2krC-9u7Sj72pgvz530WJidVw49KZvTrELKXhmXwfkx51GD_Ir4GwAA___FUV8H
[10] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwszUuO5CAMxvHTkB0ROA9gwaKkUY4w25ZjOx3UeTVQj-OPqjTbn_X3xxE89WZsJFrXjwOADdCscRGLngQtge1h4cWBdCiODDk7Ejcpjt4GNr2hYNh8WQ6LNXYAA05Ub0pi-Um_ese0SS56IGJ2M82L_nm9Dt--D80W11qvorqbgknB9Hw-WyzlwNr-UkuoYFqygumRWE6Nd06nggkzrekhRV-YN9nlqJiyFAVTzfjA-0vTue-plHQeb729u7-fF9Z4F7p2rfumuqncr-vMVXV_PgPNLpxQZ9kEi-jE8QNf_0F1N--63jc5ZmGkms5D9ebKUop8451Wac_83ZSaRfZ3zjaQyDDqAUbW_YyL9jiPuhtmM4xhnoM1zSPCvwAAAP__RRl-mg
[11] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwszE1uwyAQxfHTwI4Ihu8Fi2x8jQiYcYxixy64VY5fuer29_T-mCBUIx2npLxxFkBF4EvyAdBnE10x3oYIUYdi0FpXQ4CokbfkgooojaxRonwojLOSyoIET8zI0ZBe7Utsua3Uh7C1IvpSyyxen8873K6Br2k5z4PpO4OJwXT2Y6_ltvcng4lvhC2LTivlQaJh-oPHPzB9D16bwHvqhLmebX8zI49OY9Azf9eFrhAfZyfarjuqWImsExYcClPyLEIuTmhbpHWxlKgk_0nwGwAA__9vvlPb
[12] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwszE2OAiEQxfHTwA5TVPO5YOGmr2GAqlZitzrATDz-xMlsfy_vTwlDNeAkJ-2Ns4g6orylAk4TQ7RYw2YceUu5AmqvAxqsXrbkgo4EBmoEgoumuGnQFgE9CwOjEd_blzpy27kPZWsl8qWWTd3f70c4fQa5p9ucL7GcBa4C19lfz1pOz34VuB58lM5D4Lq3MVngKg-mllXnnfNg1Sj9weUfxHIOfjFB9tSZcp3t-RAGXp3H4Gv-rjf-pOWYnfn43EnHymydsuhImZI3FXJxarEFrIulRA3yJ-FvAAAA__8rz1qD
[13] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwszE1uwyAQxfHTwI4IxoBhwSIbXyMamHGMEn8U3CrHr1x1-3t6f0oQitVecjKj9Q7ARJBLomwGNGX2IbpoM1uLxrBlYIsciWRNPphI2uoSNemHoTgbbRxoGFlY3Svxq36pFeubW1euFKIxlzyr1-ezhds1yHdazvMQw13AJGA627GXfNvbU8BUcD3wuXHB3vsiYJIrU0XV-M3YWVVKf_D4BzHcwzjYIFtqTFjOum_C6qNx7_zE77LwVZb9bMzrdScTC7PzyoEnZTPOKmD2anBZOx9zjkbLnwS_AQAA___ztVuR
[14] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwszUGO6yAQBNDTwI4I2oBhwSIbXyOC7iZGSRx_8I9y_JFHs32lqqIEAa32kpOZrXcAJoJck6UClg1W1sVQsDDlaXax5kjF-oKyJR9MJG01Rk36ZihWo40DDTMLq0cjfrR_6pXbk_tQDpFoLliqeny_W7icgXym9Tj2IaargEXAcvT9jeXy7ncBS-cPb9QwH-29qdq2vGHjzgrzGGMVsMgXU8uq85PzYNUo_cLtD8R0DfNkg-ypM2U8d4TVe-cx-J7_48rnlRxHZ36ddTIRmZ1XDjwpW3JVIRevJle087GUaLT8JPgJAAD__0HbYps
[15] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwszDtuQyEQheHVQIc1vKGgcHO3YcHMYCM_AzeRlx85SvsdnZ-KSeggSC46uuCN0dnIS-mhWd0ReubYGkcbKEAE1jlDtNXLUULSmcABZiA4acpdg_YGTGThYA3i6_hS9zpuPJfyiESxYevq-n4_0uEzyFu57PtrCXsUZhNm2-frie3wnGdhtoEdhdnknWlUNfnGdbEaVP7g9A_CHlO0LslZJlPFfTwfwsFr8lp8rt944U9Prn0y3z930hmZfVDeBFKu1a5SbUFZ38CH3FrWIH-K-Q0AAP__86xXUA
[16] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwszU2O6yAQBODTwI4IML8LFtn4GhF0NzGK7fiB85Tjjzya7VeqKkw6gJGOU1LeOKu1ipovCUxUzlP1QWWwBio6VWuuFl31xQTekgsqojQSokT5UBirkspqqT0xI0dDerV_YsttpT6EBUD0BUoVr-93D7cr4GtazvMYbLozPTM9n_14Q7m9-5PpedCnrUMca95huTYgb0d-7iQgjzEWpme-EbYsOq2UB4mG6Rcef8Cme_CTCbynTpjhbO-dGXl0GoOe-QMLXV98nJ1ou-qoIhBZJ6x2KEzJVYRcnJhskdbFUqKS_H_SPwEAAP__tHpi9w
[17] https://us.cisionone.cision.com/c/eJx8zsFu4yAQxvGnwTdHMAwDHHyoVPk1IpgZatTEyZqk6uOvUu2llz3_9en7yQKJ0dKki4tIAcBlmLbFIaeGihm4WW4UNIhlSYKSOFGZ-kLJZbFoOVuxZye5OesCWIhq0I4u-tn_zNfSL3qMOTCLxMq1zZ_f33s6vcJ0WbbH4z6MfzOwGljLvZ-4j37bT7ddDaxfzsB6VenlfOhFy9BhYH3u41kHH72q8b_zuYvx7yl6TAZIXy_Gvx8qhR_9thu090PH0I_y5E1Pt-PDAG1lbMa_o9eqETFqLNIIosdoM2b1NfsqpMyVW7QBiUImzKli01BSpUYB2vQjmf9J5i7LL5rxbz-u6Vj-55nG41C9vubiMqsGmgOQzFhLm1OpNPtQbaBca3Z2-lrgbwAAAP__rcSOYw
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

De quel côté penche Danielle Smith ?

L'Alberta a besoin d'idées percutantes pour savoir comment l'économie de la province croîtra dans l'avenir, pas de plus de soumission au pétrole.
D.T. Cochrane, Canadian Dimension, 25 avril 2025
side-is-danielle-smith-really-on
Traduction, Alexandra Cyr
La Première ministre de l'Alberta, Mme Danielle Smith, est devenue une figure centrale de l'élection fédérale de 2025. Elle est apparue à une rencontre de financement de l'extrême droite organisée par un supporter en vue du Président des États-Unis, Donald Trump qui a souligné sa présence sur un site d'extrême droite où elle semblait dire que le chef du Parti conservateur, M. Pierre Poilievre, est en phase avec l'administration Trump. On peut dire qu'elle a révélé sa propre position, alignée sur le programme Trump. Elle se met ainsi à dos une grande majorité des Canadiens.nes dont ceux et celles des Prairies. Mais elle admet qu'elle parle au nom des Albertains.es et de l'industrie la plus importante de la province, celle du pétrole et du gaz.
Pourtant les exportations de ces ressources sont devenues un élément de division que D. Trump n'a pas cessé d'utiliser dans ses attaques contre l'économie canadienne. Pendant que le Premier ministre de l'Ontario, M. D. Ford, déclarait qu'il imposerait une taxe à l'exportation de l'énergie de sa province comme réponse aux droits de douane imposés par l'administration Trump, Mme Smith refusait d'en faire autant avec les exportations de gaz et de pétrole de l'Alberta. Des droits de douane à l'exportation feraient pression sur les États-Unis en augmentant le coût de leurs importations d'énergie canadienne. Cela générerait aussi des revenus qui pourraient effacer les effets négatifs des droits de douane (imposés par l'administration Trump). Et plus important, cela pourrait aussi servir à éliminer la division que cette administration a tenté d'insérer en imposant des droits plus faibles sur l'exportation de l'énergie par rapport aux autres biens.
Les économistes débattent de cette stratégie d'imposition de droits de douane à l'exportation en réponse à cette guerre commerciale. Les dommages faits aux industries canadiennes et aux travailleurs.euses seraient, selon ces experts.es amplifiés par cette stratégie. Tout comme les droits de douane, ces taxes à l'exportation diminueraient la demande pour les produits canadiens. D'autres invoquent que ces taxes auraient un impact plus important sur les populations américaines modestes plutôt que sur ceux et celles qui promeuvent et bénéficient de cette guerre commerciale. Mais il faut clairement dire que le refus de Mme Smith de considérer des droits à l'exportation repose sur les propriétaires de compagnies, pas sur leurs employés.es ni sur le public albertain en général.
Les dirigeants.es de l'industrie pétrolière et gazière tentent de profiter de la guerre commerciale
Les exportations de gaz et de pétrole sont très importantes pour l'économie albertaine. Elles représentent environ 20% de son PIB. Selon Statistiques Canada, 40,000 emplois y sont directement reliés et 100,000 indirectement. Et ceci ne comprends pas les emplois que génèrent les dépenses faites par ces personnes.
Mais, les Albetains.es ordinaires n'ont jamais été les principaux.ales bénéficiaires de cette industrie depuis 2017.
Depuis 2017, les entreprises canadiennes de l'extraction et du transport des hydrocarbures ont versé 41 milliards de dollars de plus aux propriétaires qu'aux travailleurs.euses. En 2023, les propriétaires ont reçu 29 milliards, un record, alors que les travailleurs.euses ont reçu moins qu'en 2022 qui était déjà en dessous de 2014.
Ces compagnies utilisent la guerre commerciale et le soutien populaire important pour plus d'indépendance économique, pour mousser leurs propres intérêts. Elles prennent toujours la précaution de présenter leurs demandes comme profitables pour le Canada. Les P.D.Gs des 14 plus grandes compagnies de l'industrie fossile canadienne ont publié une lettre ouverte dédiée aux dirigeants.es des quatre grands Partis politiques fédéraux pour faire connaître ce qu'ils attendent du gouvernement dans ces rapports avec les menaces américaines. Sans surprise, on y trouve une demande pour plus d'investissements (publics) dans leur industrie. Le chef du Parti conservateur a incorporé toute la liste de ces demandes dans sa plateforme électorale.
Une analyse des données publiques de 12 de ces 14 entreprises, montre qu'elles ont atteint des profits records au cours des quatre dernières années, particulièrement en 2022 et 2023 où elles ont profité des hausses de prix du pétrole et du gaz ce qui a causé en même temps une inflation sur plusieurs décennies. Mais elles n'investissent pas l'équivalent pour autant ; elles payent des dividendes records à leurs actionnaires.
La totalité des profits de ces 12 compagnies excédaient de 111% en 2022-2023 ceux des quatre années précédant la pandémie, soit 2016-2019. Les dividendes étaient 60% plus élevés et les rachats de leurs actions étaient 235% plus élevés. Par contre les investissements nets, dépenses en capital après dépréciation, ont baissé de 92%.
Il est particulièrement frustrant de voir Imperial Oil afficher un drapeau canadien alors que le propriétaire majoritaire de l'entreprise est le géant Américain Exxon Mobil. Depuis 2020, elle a versé à Exxon 11,200 milliards de dollars en dividendes et rachats d'actions. Durant cette période, elle a investi un pauvre 5,300 milliards avant dépréciation à partir de 9,100 milliards de dollars. Donc, son investissement était négatif. Autrement dit, malgré des profits records, Imperial Oil gaspille ses actifs productifs pour enrichir la majorité de ses propriétaires américains.es.
Comment soutenir les employés.es de ces entreprises ?
Les dirigeants.es de l'industrie du pétrole et du gaz et les politiciens.nes qui répètent leurs arguments, visent les propriétaires corporatifs en se servant des travailleurs.euses comme paravent. Pourtant ces personnes ont besoin en ce moment d'un plan bien pourvu financièrement pour les aider dans la transition vers (les énergies renouvelables) ce que veulent aussi les Albertains.nes. S'il est fait correctement, ce plan soutiendrait les travailleurs.euses, et permettrait à l'Alberta d'être moins dépendante d'un seul secteur (économique) qui est entré dans un long déclin de toutes façons.
Les dirigeants.es de ces entreprises ne font que leur travail c'est-à-dire d'enrichir autant que possible leurs propriétaires. Mais les politiciens.nes n'ont pas à capituler devant leurs demandes ; pas besoin de reprendre leurs arguments corporatifs. Au contraire, il faut agressivement chercher de nouvelles possibilités de développement de leurs économies.
Il existe un potentiel caché dans toutes les régions canadiennes dépendantes des énergies fossiles. Mais cela doit être exploré activement par des programmes publics financés avec des fonds publics. Le secteur privé a donné des preuves qu'il ne prendrait pas la tête de ce vers quoi les régions doivent aller. En plus, dans la conjoncture économique mondiale incertaine actuelle souvent invoquée, le secteur privé est réticent à faire des investissements risqués. Mais les Albertains.es ne peuvent attendre. Le secteur public doit prendre le leadership.
En 2022 la Fédération du travail de l'Alberta a publié un rapport intitulé Skate to Where the Puck is Going. Il est plein d'idées créatives, avancées, sur la manière de développer l'économie de la province pour l'avenir. Ce plan contraste spectaculairement avec l'approche de D. Smith qui pense que la seule chose que les Albertains.es puissent faire, c'est l'extraction des fossiles et leur exportation. Cette attente si minimale est irrespectueuse de la population d'ici mais elle est en phase avec les élites auxquelles Mme Smith est attachée. Ce sont les dirigeants.es ultra riches et les propriétaires des compagnies gazières et pétrolières.
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Des coupes catastrophiques dans l’aide internationale

Lors de la dernière campagne électorale fédérale, le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, a proposé un plan pour assurer la défense de l'Arctique face aux visées expansionnistes de la Russie et de la Chine. Il promettait de faire construire deux nouveaux brise-glaces, de doubler les effectifs militaires et d'établir une base militaire permanente à Iqaluit.
7 mai 2025 | tiré de l'Aut'journal
Le tout serait réalisé très rapidement, promettait-il, et financé à partir des milliards $ que le Canada verse chaque année en aide étrangère. Reprenant la rhétorique de Donald Trump, il a déclaré : « Toutes ces améliorations vont être financées par une réduction importante de l'aide étrangère dont une grande partie va aux dictateurs, aux terroristes et aux bureaucraties mondiales. »
Heureusement, Pierre Poilievre a été battu.
De son côté, le Parti libéral s'est engagé à soutenir les plus pauvres et les plus vulnérables en temps de crise en maintenant le budget d'aide humanitaire internationale du Canada à au moins 800 millions de dollars par année. Ce qui est bien peu, étant donné que le Canada a consacré 6,88 milliards de dollars à l'aide internationale en 2023-2024, comparativement à 8,1 milliards en 2022-2023.
De leur côté, le Bloc québécois et le NPD s'engageaient à porter le financement de l'aide internationale à 0,7 % du revenu national brut du Canada, ce qui doublerait approximativement l'enveloppe actuelle de l'aide internationale. En effet, le Canada consacre actuellement 0,38 % de son revenu national brut (RNB) à l'aide internationale, ce qui est bien en deçà de ses engagements internationaux.
Les conséquences dévastatrices des coupes à USAID
L'un des premiers gestes de Donald Trump, quand il est arrivé au pouvoir, a été de geler le financement de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID). Comme les États-Unis contribuaient pour près de 30 % de toute l'aide internationale, « cette décision a eu des conséquences immédiates et considérables à travers le monde, mettant en péril des millions de vies et compromettant leur santé et leur économie », a dénoncé l'Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI).
« Les impacts sont dévastateurs, en particulier pour les populations les plus vulnérables, notamment en Afrique, l'aide alimentaire pour des milliers de personnes en situation d'urgence humanitaire a été interrompue, des personnes déplacées par les conflits voient leur accès à l'eau menacé et d'autres, atteintes du VIH, ne reçoivent plus de traitement et de médicaments. En Amérique latine, des refuges pour les personnes migrantes, ainsi que pour les victimes de violence sexuelle et de trafic humain, ont dû fermer leurs portes. »
Partout dans le monde, les pays coupent l'aide internationale
En France, le budget de l'aide publique au développement (APD) de 2025 a connu une chute brutale et inédite. L'APD a subi une coupe supérieure à 2,1 milliards d'euros, ce qui représente une diminution de 37 %.
Les moyens du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères sont encore plus affectés et chutent de 41 % par rapport à 2024.
« Cette décision drastique est difficile à accepter face aux besoins massifs de financements pour le développement et alors que la France avait réalisé plusieurs efforts ces dernières années : hausse de l'aide publique au développement et adoption d'une loi de programmation fixant la cible de consacrer 0,7 % du revenu national brut à l'APD… cible initialement projetée pour 2025 », a dénoncé Coordination SUD, une organisation de coordination nationale des ONG françaises de solidarité internationale.
Des coupes même en Suède
Même la Suède a décidé de réduire considérablement son budget d'aide au développement. Le gouvernement actuel, élu en 2022, est le gouvernement le plus conservateur que la Suède ait connu en 100 ans de démocratie. Pour accéder au pouvoir, les trois partis bourgeois traditionnels ont dû signer un protocole avec le parti d'extrême droite, Démocrates suédois (SD).
Ce gouvernement a adopté les politiques typiques de droite : coupes dans les services sociaux, réduction du fardeau fiscal pour les riches, réduction des droits des immigrants et du droit d'asile, et réduction de l'aide internationale. De plus, le ministre de l'Aide internationale est aussi ministre du Commerce extérieur, ce qui a entrainé une restructuration complète de l'architecture de l'octroi des fonds de l'aide internationale.
Les organisations syndicales suédoises ont ainsi perdu le financement public qu'elles recevaient auparavant. Ce qui a eu des conséquences désastreuses pour les organisations syndicales africaines, notamment, qui bénéficiaient d'un appui important des syndicats suédois.
Vers des États généraux québécois de la solidarité internationale
C'est dans ce contexte mondial difficile que l'AQOCI a décidé d'organiser des États généraux québécois de la solidarité internationale, qui se tiendront du 4 au 6 juin 2025 à l'Université de Montréal.
Cet évènement majeur vise à rassembler les actrices et acteurs des organismes de coopération et de solidarité internationales, leurs partenaires et leurs alliés des mouvements sociaux québécois : groupes de défense des droits de la personne, des droits des femmes et de l'égalité des genres, pour la protection de l'environnement, la promotion de la paix, groupes autochtones, le réseau communautaire, les organisations syndicales, les centres de recherche, etc.
L'AQOCI proposera alors une grande réflexion collective sur les enjeux, actuels et futurs, de la solidarité internationale afin de développer une vision commune et proposer des pistes d'action.
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

La bonne, la brute et l’affreuse vérité sur le rôle du Canada dans la Seconde Guerre mondiale.

La Seconde Guerre mondiale est la seule guerre moralement justifiable à laquelle a participé le Canada. Cela ne signifie pas pour autant que la couverture médiatique de sa conclusion européenne doive ignorer les aspects peu recommandables du rôle du Canada dans ce conflit.
Par Yves Engler, Montréal, 8 mai 2025
https://yvesengler.com/2025/05/08/the-good-bad-and-ugly-truth-about-canadas-role-in-wwii/
Traduction : André Cloutier, 11 mai 2025
La une du Globe and Mail de jeudi célébrait « Victoire et courage : le Canada et le monde soulignent les 80 ans de la fin de la guerre en Europe ». CBC, le Toronto Star et d'autres médias ont également publié récemment des articles simplistes et élogieux sur le rôle du Canada dans ce terrible conflit.
Contrairement aux sept autres grandes guerres du Canada, la Seconde Guerre mondiale était finalement justifiable. Mais c'est la menace que représentait l'expansionnisme nazi pour les intérêts britanniques, et non l'opposition au fascisme ou à l'antisémitisme, qui a poussé Ottawa à la bataille.
Pendant la période précédant la Seconde Guerre mondiale, l'Italie de Mussolini a envahi l'Abyssinie (Éthiopie), le seul pays africain indépendant. La position générale d'Ottawa s'est opposée à une action collective de la Société des Nations contre l'Italie et a finalement reconnu la souveraineté italienne sur l'Éthiopie.
Un autre contexte important de la Seconde Guerre mondiale fut la lutte entre le fascisme et la démocratie libérale en Espagne. Lors des élections de 1936, un gouvernement de coalition de gauche fut élu. L'Église catholique, la petite noblesse terrienne et le grand patronat cherchèrent immédiatement à renverser le gouvernement avec l'aide du général Francisco Franco, commandant des forces armées espagnoles d'outre-mer. Dans cette lutte armée, Franco fut soutenu par l'Allemagne hitlérienne, le Portugal fasciste et l'Italie de Mussolini. En avril 1937, Ottawa adopta la Loi sur l'enrôlement à l'étranger afin d'empêcher les Canadiens de combattre aux côtés du gouvernement républicain espagnol.
Pendant cette période, le Canada ne trouva aucun reproche à faire à l'armée fasciste japonaise qui occupa la Corée et massacra les Chinois en Mandchourie en fournissant du matériel de guerre. Dans les années précédant le début du front européen de la Seconde Guerre mondiale, le Japon était le troisième importateur de métaux non ferreux canadiens. Du milieu à la fin des années 1930, des organisations de gauche, des groupes pacifistes et des gens qui s'identifiaient comme amis de la Chine ont appelé à un boycott économique et militaire du Japon afin de mettre fin à la complicité du Canada avec l'expansionnisme japonais. Or, les entreprises canadiennes « ont encouragé le commerce avec la Mandchourie et le reste de l'empire japonais ».
Le soutien du Canada au fascisme au Japon et en Espagne dans les années précédant la Seconde Guerre mondiale devrait contredire l'idée que le Canada ait participé à la guerre pour combattre ce système politique et cette idéologie pervers. Le premier ministre Mackenzie King était en effet favorable au fascisme européen. Les responsables canadiens et britanniques sympathisaient avec l'antagonisme d'Hitler envers l'Union soviétique et la gauche européenne.
La menace que représentait l'expansionnisme nazi pour les intérêts britanniques a conduit Ottawa à la guerre. Comme l'expliquent Desmond Morton et Jack Granatstein, « le Canada est entré en guerre en septembre 1939 pour la même raison qu'en 1914 : parce que la Grande-Bretagne était entrée en guerre. » Et la guerre aura considérablement stimulé l'économie canadienne en difficulté.
Les Forces canadiennes ont commis des crimes humanitaires majeurs pendant la guerre. Plus inquiétant encore, les bombardiers canadiens ont contribué à la destruction de villes et d'infrastructures civiles allemandes. Un grand nombre de pilotes canadiens ont participé à une opération visant à détruire trois barrages dans la vallée de la Ruhr. Dans « Dam Busters : Canadian Airmen and the Secret Raid Against Nazi Germany », Ted Barris décrit une tentative d'inondation de la région et de destruction de l'économie civile.
L'objectif de l'offensive de bombardement stratégique était de saper le moral des civils. Selon le général britannique responsable du commandement des bombardiers, Arthur Harris, « la destruction de villes allemandes ; le massacre de travailleurs allemands et la destruction de la vie civilisée dans toute l'Allemagne… la destruction de maisons, de services publics, de transports et de vies ; la création d'un problème de réfugiés d'une ampleur sans précédent ; et l'effondrement du moral… [ Tels sont ] les objectifs attendus et prévus de notre politique de bombardement. Ils ne sont pas le résultat de tentatives visant à frapper des usines. ». Les bombardements ont fait 600 000 morts et plus de cinq millions de sans-abri en Allemagne. Mais les raids n'ont eu qu'un impact minime sur la production de guerre allemande jusqu'à la fin de la campagne.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, la zone de défense du Canada comprenait les Antilles et la Guyane britannique. Soutenant le système colonial, les troupes canadiennes ont remplacé les forces britanniques en Jamaïque de 1940 à 1946, ainsi qu'aux Bermudes et aux Bahamas pendant certaines périodes. Les perceptions raciales sous-tendaient le déploiement des troupes canadiennes. Selon le ministre de la Défense, Norman Rogers, le gouverneur de la Jamaïque « avait laissé entendre qu'il serait risqué de retirer toutes les troupes blanches ». La situation aux Bahamas était encore plus délicate. En juin 1942, des émeutes éclatèrent en raison des bas salaires des travailleurs noirs. Les troupes canadiennes arrivèrent aux Bahamas juste après les émeutes et leur principale mission consistait à protéger un gouverneur paranoïaque, le duc de Windsor.
Les Canadiens ont combattu sur terre, sur mer et dans les airs en Afrique coloniale. Décrivant une mission de soutien en 1943, un titre du « Hamilton Spectator » titrait : « Le Canada a fourni 29 navires et 3 000 marins pour l'action en Afrique du Nord ». De nombreux pilotes de chasse canadiens ont également opéré au-dessus du continent. Plus d'une demi-douzaine de pilotes canadiens ont défendu l'importante base de la RAF à Takoradi, au Ghana, et d'autres s'y sont rendus pour suivre la route de renforts d'Afrique de l'Ouest, qui acheminait des milliers d'avions de chasse vers le Moyen-Orient et le théâtre de la guerre en Afrique du Nord. Une équipe de Canadiens francophones experts en radiodiffusion, regroupée à Accra, au Ghana, a soutenu l'invasion alliée de l'Afrique du Nord française.
Les troupes canadiennes ont également combattu pour protéger la domination britannique en Asie. Ottawa a envoyé 1 975 soldats pour défendre Hong Kong à l'automne 1941. « Hong Kong constituait un avant-poste que le Commonwealth entendait conserver », pouvait-on lire dans un message des Affaires extérieures adressé à Londres en réponse à une demande de troupes. En partie pour aider la Grande-Bretagne à reconquérir Hong Kong, plusieurs Canadiens d'origine chinoise furent déployés secrètement en Chine. Selon Roy MacLaren dans « Canadiens derrière les lignes ennemies, 1939-1945 », ils furent envoyés parce que « si les Japonais capitulaient, il serait utile d'avoir une équipe sur place pour entrer rapidement à Hong Kong afin d'y rétablir l'autorité britannique ».
Les Canadiens contribuèrent également à rétablir l'autorité britannique dans une autre cité-État insulaire d'Asie. L'une des premières tâches du lieutenant-colonel Arthur R. Stewart de Vancouver à Singapour fut de hisser l'Union Jack au-dessus des bâtiments municipaux pour accueillir les premières troupes alliées à leur retour. Quelques centaines de Canadiens combattirent aux côtés des forces spéciales britanniques, australiennes et américaines qui menèrent des opérations secrètes en Malaisie, dans certaines régions de Chine et sur certaines îles du Pacifique. Le Groupe spécial canadien de radiocommunication numéro un fut dépêché en Australie pendant la guerre. Ses 330 membres surveillaient principalement les signaux japonais dans les Indes orientales néerlandaises (Indonésie). Les Canadiens participèrent également à des opérations de guerre psychologique en Birmanie, au Siam, en Indochine, en Malaisie et dans les Indes orientales néerlandaises. Début 1945, plus de 3 000 aviateurs canadiens ont servi dans la Royal Air Force (RAF) ou l'Aviation royale canadienne (ARC) en Asie du Sud-Est. Des unités de l'Aviation canadienne ont attaqué les positions japonaises en Inde et en Birmanie, et ont également fourni un soutien au transport.
Des dizaines d'officiers de l'armée canadienne ont contribué à la reconquête de la Birmanie, colonie britannique depuis un siècle. Les Canadiens ont également aidé la Grande-Bretagne à reconquérir la Malaisie. Au moins 16 Canadiens d'origine chinoise ont été envoyés derrière les lignes ennemies pour effectuer des missions de sabotage, organiser la résistance locale et préparer l'effondrement du contrôle japonais. Après la défaite japonaise, ils ont aidé les Britanniques à réprimer le mouvement d'indépendance. Les Canadiens ont contribué au désarmement de l'Armée populaire antijaponaise de Malaisie. Le major CD Munro et le sergent Charlie Chung ont été envoyés dans le nord de l'État de Kedah, « où des troubles s'étaient développés avec les forces de guérilla locales ». Début 1946, quelques dizaines d'officiers du renseignement canadiens ont servi à la station radio de Kuala Lumpur et ont participé à des opérations de guerre psychologique.
Plutôt que de la propagande édulcorée, le public mérite un compte rendu complet du rôle du Canada dans la Seconde Guerre mondiale. La bonne, la brute et l'horrible vérité sur notre soutien à l'impérialisme.
Yves Engler, Montréal, 8 mai 2025
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Un nouveau souffle pour le NPD ?

Les reculs politiques ou électoraux comportent un côté positif : ils peuvent donner l'occasion à un parti de se renouveler et de rebondir. Encore faut-il qu'il sache saisir l'occasion qui se présente à lui. C'est le cas du Nouveau Parti démocratique en ce moment.
On parle de le "reconstruire", comme s'il s'agissait d'un jeu de blocs. Bien sûr, le NPD a vu au dernier scrutin plusieurs de ses partisans filer chez les libéraux pour contrer la montée des conservateurs de Pierre Poilievre et élire un candidat capable d'affronter Donald Trump, en l'occurrence le libéral Mark Carney. Ce mouvement de bon nombre de néodémocrates vers les libéraux révèle que le parti n'est pas vu comme une formation à vocation de pouvoir mais plutôt d'opposition vouée à défendre les principes de la social-démocratie ; au fond, beaucoup de néodémocrates sont des libéraux de gauche. Il existe en effet une certaine parenté idéologique entre le Parti libéral et le Nouveau parti démocratique.
Il faut donc en premier lieu, ramener ces gens dans le giron du parti. Mais à plus long terme, il importerait que le NPD sorte de son ghetto électoral et essaie de ratisser plus large afin de se rapprocher enfin du pouvoir, seul moyen de changer véritablement les choses. Il reviendra à la nouvelle direction de se pencher sur ce problème et par conséquent de trouver le moyen de convaincre des groupes plus larges d'électeurs de l'appuyer. Ce sera un processus qui nécessitera une analyse froide et réaliste de l'état politique et électoral du Canada ; il impliquera aussi d'éviter de prendre ses désirs pour des réalités. Le NPD devra donc se faire plus rassembleur qu'il ne l'est actuellement.
Dans cette optique, il devra accorder une attention particulière à la question du Québec. Il faudra tout d'abord que le parti abandonne son approche centralisatrice et qu'il reconnaisse sans ambiguïté la spécificité du Québec, tout comme l'autonomie des provinces en général. En ce qui regarde plus spécifiquement le Québec, la nouvelle direction sera bien inspirée d'en accepter le nationalisme et d'agir en conséquence, comme Jack Layton avait commencé à le faire en son temps. Elle devra mette sur pied une équipe vouée à la tâche suivante : faire en sorte que le plus possible d'électeurs et d'électrices québécois se reconnaissent en lui. C'est une mission difficile dans la conjoncture présente mais faisable si on y met le temps et l'énergie nécessaires.
Unir progressiste "canadians" et québécois pourrait mener le parti aux portes du pouvoir. Le NPD est-il prêt à assumer cette mission ? Son avenir en dépend ; question de sens politique élémentaire.
Jean-François Delisle
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre
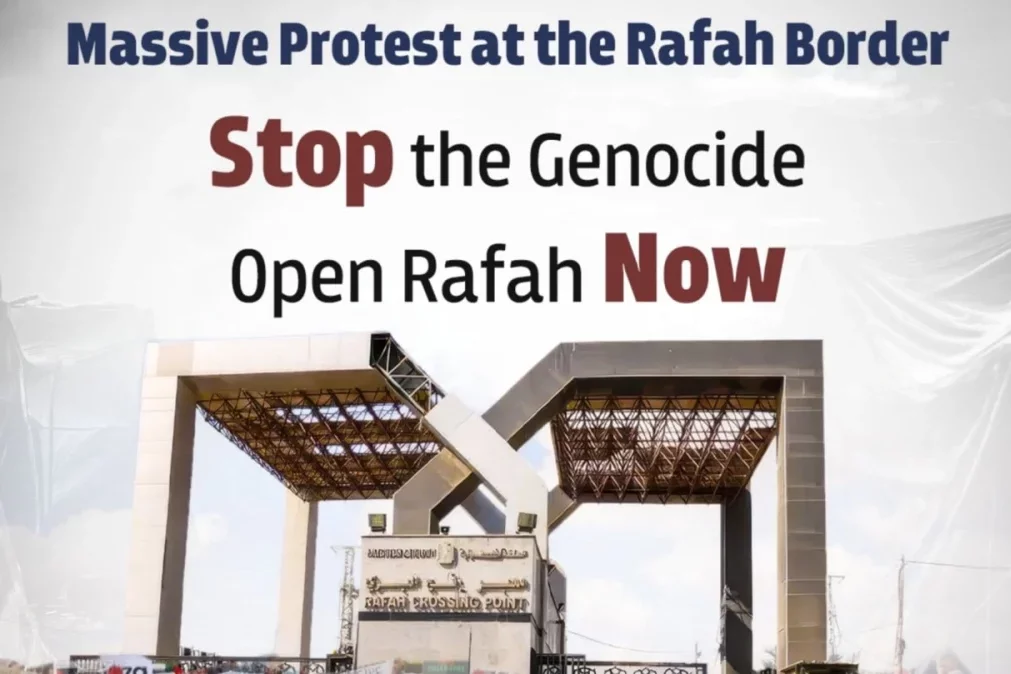
Marche mondiale pour Gaza

Depuis un peu plus de trois semaines, nous travaillons sans relâche sur la campagne Marche mondiale pour Gaza, dont vous avez probablement déjà entendu parler.
Chères amies, chers amis,
Nous nous concentrons actuellement sur la logistique, au Canada et en Égypte, en anticipant deux scénarios possibles :
Que l'Égypte accepte notre demande officielle de permettre la marche jusqu'à la frontière de Rafah, afin de lancer un appel urgent aux dirigeants mondiaux pour faire pression sur Israël afin d'ouvrir le passage et permettre l'entrée de plus de 3000 camions d'aide humanitaire actuellement bloqués.
Que l'Égypte refuse notre marche pacifique. Dans ce cas, nous comptons rassembler des milliers de personnes du monde entier au Caire pour mener des actions coordonnées sur le terrain, créant ainsi une pression médiatique équivalente sur nos gouvernements, y compris les autorités égyptiennes.
Comme nous le savons toutes et tous, la situation à Gaza est catastrophique. Des centaines de milliers de personnes souffrent de la faim, du manque de soins médicaux, de violences continues de la part des forces d'occupation et d'un abandon sans précédent de la part de la communauté internationale.
Nous avons décidé de dire stop, de mettre nos corps en jeu, et d'assumer le rôle que nos gouvernements ont délaissé : défendre les droits humains et dénoncer le génocide.
Nous avons déjà reçu des dizaines de soutiens à travers le monde, notamment un appui significatif depuis le Canada.
Un groupe de personnes issues de tout le pays se prépare à rejoindre la délégation canadienne, qui partira à la mi-juinpour participer à cette mission. Si vous souhaitez vous joindre à nous, veuillez remplir le formulaire ci-joint et l'envoyer à l'adresse électronique indiquée.
Nous vous encourageons à demander dès maintenant votre visa électronique et à réserver entre 7 et 12 jours autour du 15 juin pour pouvoir participer pleinement à cette mission.
Les candidat·e·s seront informé·e·s de leur acceptation dans un délai de 48 heures. Les personnes acceptées recevront un Guide du Participant contenant toutes les informations nécessaires, ainsi qu'un document à signer avant le départ en tant que membre officiel de la délégation. La sélection sera assurée par le Comité de Coordination du Canada, composé de membres de différentes provinces.
Vous trouverez des réponses à vos questions fréquentes, les pays et délégations impliqués, nos objectifs en tant que mouvement social international, ainsi que des interviews sur notre site :
👉 www.marchtogaza.net <http://www.marchtogaza.net/>
Cette mission a besoin non seulement d'un soutien organisationnel large, mais aussi d'un appui financier crucial <https://www.zeffy.com/donation-form...> pour couvrir les frais des participant·e·s. Nous vous invitons à contribuer selon vos moyens et à faire circuler cet appel.
Que vous vous rendiez en Égypte ou que vous souteniez depuis le Canada, votre rôle est essentiel pour faire pression sur le gouvernement canadien et changer sa politique envers Israël.
Organisations ayant jusqu'à présent adhéré à la Marche pour Gaza :
Montreal For a World BEYOND War (Canada)
Palestine Vivra (Canada)
Religions pour la Paix – Québec (Canada)
Parti Vert du Québec (Canada)
HELEM (Canada)
Le Journal des Alternatives – Plateforme altermondialiste (Canada)
Ottawa Healthcare Professionals for Palestine (Canada)
NPD – Section Québec (Canada)
Conseil Canadien des Femmes Musulmanes – Québec (Canada)
Just Peace Advocates / Mouvement Pour Une Paix Juste (Canada)
******
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Washington a tenté de s’immiscer dans les soins trans du Canada

Le Canada a été inclus dans un formulaire de lanceur d'alerte du gouvernement américain permettant de dénoncer des médecins offrant des soins trans aux mineurs, ce qui a fait craindre une répression par-delà la frontière. Lorsque Pivot et The Breach ont insisté pour avoir des explications auprès du département de la Santé, le Canada a été retiré du formulaire.
Cet article est publié en collaboration avec le média indépendant The Breach. Pour lire la version anglaise, cliquez ici.
5 mai 2025 | tiré de pivot.quebec | Illustration : Version originale du formulaire « Témoignages et plaintes concernant la mutilation chimique et chirurgicale des enfants » mis en ligne par le département américain de la Santé. Montage : Pivot
https://pivot.quebec/2025/05/05/washington-a-tente-de-simmiscer-dans-les-soins-trans-du-canada/
Le 14 avril, alors que l'élection fédérale canadienne battait son plein, le Department of Health and Human Services (HHS) du gouvernement des États-Unis a discrètement mis en ligne sur son site Web (archivé ici) un formulaire de lanceur d'alerte permettant de dénoncer les fournisseurs qui offrent des soins d'affirmation de genre aux enfants, qualifiant ces soins de « mutilation chimique et chirurgicale » et disant vouloir mener des enquêtes à ce sujet.
Or, un menu déroulant contenu dans ce formulaire listait les provinces et territoires du Canada, de même que les Forces armées du pays, permettant ainsi de dénoncer des soignant·es situé·es de ce côté-ci de la frontière.

Capture d'écran : HHS
Ce n'est qu'onze jours plus tard, après de multiples demandes médiatiques de Pivot et The Breach, qu'une employée de HHS nous a finalement informées avoir retiré le Canada du formulaire, sans pourtant mentionner qu'il s'agissait d'une erreur. La page Web affiche toujours avoir été mise à jour pour la dernière fois en date de la mi-avril.
HHS avait initialement ignoré de manière répétée nos questions visant à clarifier si le choix d'inviter à dénoncer des médecins œuvrant dans le système de santé canadien était intentionnel et, si c'était le cas, dans quels objectifs le Canada était ciblé. HHS s'est d'abord contenté de nous référer à un communiqué de presse ne contenant aucune information sur le sujet.
« Les actions du gouvernement des États-Unis en matière de soins d'affirmation de genre aux enfants n'influencent pas la ligne directrice que s'est donnée le Québec pour ces soins. »
Ministère de la Santé du Québec
L'inclusion du Canada dans ce formulaire a provoqué des peurs à l'effet que les dénonciations compilées par HHS puissent être utilisées pour établir des listes de surveillance, pour détenir les prestataires de soins canadiens à la frontière, ou même pour entreprendre des démarches judiciaires contre des professionnel·les de la santé d'ici.
Tout cela aurait pu limiter la possibilité des citoyen·nes américain·es d'obtenir des soins au Canada, notamment pour contourner les interdictions imposées aux États-Unis concernant les soins d'affirmation de genre.
On ignore si les États-Unis mènent actuellement des enquêtes sur des médecins canadien·nes. HHS a fait la sourde oreille face à nos questions à ce sujet. Une demande d'accès à l'information a été déposée auprès de HHS pour tenter d'y voir plus clair.
Les soins d'affirmations de genre offerts aux mineur·es sont légaux et disponibles au Canada et les États-Unis n'ont « aucun pouvoir législatif » au Canada, souligne Florence Ashley, juriste et bioéthicienne.
Le site Web du gouvernement du Canada indique que les chirurgies génitales ne sont jamais offertes aux personnes de moins de 18 ans, en adéquation avec les standards de soins de l'Association professionnelle mondiale pour la santé des personnes transgenres (WPATH).
Sur le site Web de GrS Montréal, une clinique offrant des chirurgies d'affirmation de genre, il est indiqué que l'âge minimum pour la mastectomie (masculinisation du torse) est de seize ans, toujours en conformité avec les standards de la WPATH.
Chez les enfants, les soins médicaux d'affirmation de genre se limitent typiquement aux bloqueurs de puberté et aux hormones.
Souveraineté canadienne défiée ?
Celeste Trianon, militante pour les droits trans, fait valoir que la version initiale du formulaire constituait une violation de la souveraineté internationalement reconnue du Canada. « Je crois que c'est la première fois que les États-Unis enfreignent la souveraineté des médecins canadien·nes, en tout cas par l'entremise d'un formulaire de lanceur d'alerte », dit-elle.
« HHS essaie d'utiliser son influence dans le but d'attaquer les prestataires de soins, pas seulement aux États-Unis, mais aussi ici au Canada. Ce n'est pas seulement absurde : c'est une menace dissimulée envers les personnes trans au Canada, incluant les personnes qui ont fui les États-Unis à cause des politiques anti-trans de Trump, et nous sommes les prochain·es », s'indigne Celeste Trianon.
« Si c'était n'importe quel autre groupe visé, on serait présentement en moment de scandale national. Mais vu que les personnes trans, dont les jeunes trans, sont vues comme jetables, notre société décide d'ignorer le tout. Quand est-ce qu'on va agir ? Se lever pour défendre les droits des personnes trans, c'est défendre nos valeurs canadiennes. »
Celeste Trianon fait remarquer que les attaques contre les droits trans aux États-Unis ne s'arrêtent pas aux enfants, et qu'« attaquer les soins trans des enfants, ça peut aussi engendrer des dommages collatéraux dans l'accès des adultes ».
« HHS essaie d'utiliser son influence dans le but d'attaquer les prestataires de soins, pas seulement aux États-Unis, mais aussi ici au Canada. »
Celeste Trianon
En réponse à nos questions, le ministère de la Santé du Québec affirme que « les actions du gouvernement des États-Unis en matière de soins d'affirmation de genre aux enfants n'influencent pas la ligne directrice que s'est donnée le Québec pour ces soins ». Québec a aussi souligné qu'aucune chirurgie génitale n'a été offerte à une personne mineure, malgré la mise en place d'un comité d'exception.
Un porte-parole des Forces armées canadiennes a affirmé de manière préliminaire, lors d'une conversation téléphonique le 17 avril, que « cette manœuvre ne fait pas de sens et [que] les États-Unis n'ont pas de pouvoir législatif ici. Ce que les autres pays font et disent ne nous influence pas », a-t-il ajouté.
« Fournir à tous les membres de l'équipe de la Défense un milieu de travail sain, respectueux et inclusif, exempt de harcèlement, de discrimination et de préjugés, est une priorité pour notre institution. La diversité des points de vue et des expériences vécues contribue à notre succès en tant qu'organisation », ont poursuivi les Forces par courriel, le 24 avril.
Un porte-parole de Santé Canada nous a dit que le gouvernement canadien examinait la situation plus en détail suite à notre demande médiatique.
Attaques anti-trans aux États-Unis
La mise en place du formulaire de HHS fait suite au décret (archivé ici) de l'administration Trump intitulé « Protecting Children from Chemical and Surgical Mutilation » daté du 28 janvier 2025, visant à mettre fin à l'accès aux soins d'affirmation de genre pour les enfants, un point focal de sa deuxième campagne présidentielle. Ce décret est actuellement bloqué dans certains États.
La plupart des associations médicales majeures aux États-Unis, comme l'American Medical Association, l'American Academy of Pediatrics et l'American Psychological Association, sont en faveur de l'accès à ces soins pour les mineurs et s'opposent à leur restriction, a rapporté NBC News.
Un exode d'états-unien·nes trans et non-binaires vers le Canada commence à prendre forme depuis l'investiture du président Trump, certain·es allant parfois même jusqu'à demander l'asile, selon Newsweek et le Globe And Mail.
La clinique McLean, à Mississauga, en Ontario, offre de faciliter des mastectomies par-delà la frontière pour les citoyen·nes américain·es. Dans un article de blogue publié le 14 avril 2025, la clinique écrit : « Il y a une tendance naissante qui montre que plusieurs Américain·es traversent la frontière pour se faire opérer au Canada. La vérité est qu'il ne s'agit plus d'une nouvelle surprenante. Année après année, le gouvernement des États-Unis révèle qu'un nombre croissant de ses citoyen·nes voyagent hors du pays pour des traitements médicaux, incluant les procédures de réassignation de genre. »
La clinique McLean n'a pas souhaité commenter.
La récente manœuvre anti-trans outrepassant la frontière canado-américaine évoque le contexte des interdictions sur l'avortement entre les États américains, alors que des personnes cherchant à recevoir une procédure d'interruption de grossesse doivent parfois voyager vers des États où elle est restée légale. Certains États voudraient aller jusqu'à rendre illégal l'acte de voyager entre les États pour un avortement, selon The Conversation et The Atlantic, qui décrivent respectivement cette situation comme un « champ de mines » et un « champ de bataille » législatif.
En ce sens, les États-Unis pourraient vouloir criminaliser le fait pour des mineurs d'accéder à des soins d'affirmation de genre par-delà la frontière canadienne.
L'administration Trump serait également en train de mettre de la pression sur le Royaume-Uni pour mettre fin à certaines lois protégeant les personnes LGBTQ+, soutenant qu'elles limiteraient la liberté d'expression, en échange d'un accord commercial, a rapporté The Advocate. Le Canada pourrait ainsi faire face à des moyens de pression semblables, étant aussi en guerre tarifaire avec Washington, bien que le premier ministre Mark Carney se soit prononcé en faveur des droits trans.
Correction : Le formulaire de lanceur d'alerte a bien été mis en ligne le 14 avril, et non le 15 avril. (05-05-2025)
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :
Abonnez-vous à la lettre

Perte du poste de ministre des Femmes, de l’Égalité des genres et de la Jeunesse au fédéral

Dès son arrivée au pouvoir, le nouveau chef du Parti libéral du Canada, Mark Carney a fait disparaître le poste de ministre des Femmes, de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, une situation qui inquiète les membres du G13. Cette disparition n'a rien d'anodin : elle prive les femmes et les minorités de genre d'une voix forte au sein du gouvernement, à un moment où les reculs sont déjà tangibles. Ce réajustement ministériel, s'il est permanent, n'est pas un geste isolé, mais fait partie d'un démantèlement plus large des institutions de justice sociale. (Extrait d'une infographie du G13)
Dès son arrivée au pouvoir, le nouveau chef du Parti libéral du Canada, Mark Carney a fait disparaître le poste de ministre des Femmes, de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, une situation qui inquiète les membres du G13.
Cette disparition n'a rien d'anodin : elle prive les femmes et les minorités de genre d'une voix forte au sein du gouvernement, à un moment où les reculs sont déjà tangibles. Ce réajustement ministériel, s'il est permanent, n'est pas un geste isolé, mais fait partie d'un démantèlement plus large des institutions de justice sociale.
Pourtant, lors de la création du ministère, le gouvernement libéral affirmait dans son propre communiqué « Devenir un ministère à part entière signifie que l'organisation disposera de la structure, du personnel, des ressources et de la plateforme nécessaires pour s'acquitter plus efficacement de son mandat. Ce changement rend l'organisation plus solide et la positionne sur le même pied que d'autres ministères. Il permet aussi de protéger et améliorer son travail, puisqu'il lui assure l'accès au personnel et aux ressources qu'ont les autres ministères pour produire les meilleurs résultats possible ».
Pourquoi il est essentiel de rétablir le poste de ministre des femmes, de l'égalité des genres et de la jeunesse au fédéral
Promotion de l'égalité des genres : Une ministre dédiée permet de coordonner les efforts pour promouvoir l'égalité des genres, en s'assurant que les politiques publiques tiennent compte des besoins spécifiques des femmes. Une ministre dédiée permet de coordonner les efforts pour promouvoir l'égalité des genres, en s'assurant que les politiques publiques tiennent compte des besoins spécifiques des femmes. Une ministre dédiée permet de coordonner les efforts pour promouvoir l'égalité des genres, en s'assurant que les politiques publiques tiennent compte des besoins spécifiques des femmes.
Représentation et pouvoir : Une personne ministre des Femmes, de l'Égalité des genres Une personne ministre des Femmes, de l'Égalité des genres Une personne ministre des Femmes, de l'Égalité des genres donne aux femmes plus de pouvoir au sein du gouvernement, donne aux femmes plus de pouvoir au sein du gouvernement, donne aux femmes plus de pouvoir au sein du gouvernement, leur permettant de mieux influencer les décisions politiques et leur permettant de mieux influencer les décisions politiques et leur permettant de mieux influencer les décisions politiques et de garantir que leurs voix soient entendues. de garantir que leurs voix soient entendues. de garantir que leurs voix soient entendues.
Soutien aux jeunes : En incluant la jeunesse dans son mandat, la ministre peut développer des programmes pour soutenir les jeunes femmes et hommes, favorisant leur participation active à la vie économique, sociale et politique du pays. En incluant la jeunesse dans son mandat, la ministre peut développer des programmes pour soutenir les jeunes femmes et hommes, favorisant leur participation active à la vie économique, sociale et politique du pays. En incluant la jeunesse dans son mandat, la ministre peut développer des programmes pour soutenir les jeunes femmes et hommes, favorisant leur participation active à la vie économique, sociale et politique du pays.
Pour un ministère des droits des femmes et de l'égalité au provincial
Depuis 2010, le G13 revendique la mise sur pied d'un ministère des Droits des femmes et de l'Égalité. L'objectif : se doter enfin des moyens pour atteindre une réelle égalité entre les femmes et les hommes et entre les femmes elles-mêmes.
Pourquoi un ministère des droits des femmes et de l'égalité ?
Vision d'ensemble : Un ministère des Droits des femmes et de l'Égalité permettrait de rapatrier les sommes attribuées aux différents ministères en un seul ministère et offrirait une vision d'ensemble des politiques touchant les femmes, assurant une approche intégrée et cohérente pour traiter les divers enjeux auxquels elles sont confrontées :
Égalité des sexes : Un ministère dédié aux enjeux et besoins des femmes permettrait de mieux coordonner les efforts pour atteindre une réelle égalité entre les sexes, en s'assurant que les politiques publiques tiennent compte des besoins spécifiques des femmes.
Lutte contre les violences faîtes aux femmes : Un ministère des droits des femmes pourrait centraliser les initiatives pour combattre les violences domestiques et sexuelles, offrant ainsi une réponse plus efficace et cohérente à ces problèmes.
Réduction de la pauvreté : Les femmes sont souvent plus touchées par la pauvreté. Un ministère des droits des femmes pourrait mettre en place des programmes ciblés pour améliorer leur situation économique et sociale.
Représentation et pouvoir : Un ministère des droits des femmes, dont le mandat serait de conseiller les autres ministères concernant les enjeux touchant les femmes, donnerait aux femmes plus de pouvoir au sein du gouvernement.














